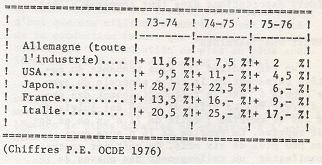Revue Int. 1977 - 8 à 11
- 3628 reads
Revue Internationale no 8 - 1e trimestre 1977
- 2656 reads
Textes du second congrès de RI
- 2575 reads
- La situation politique internationale.
- L'accélération de la crise économique.
- Etat et dictature du prolétariat.
Un choix parmi les rapports présentés au Congrès de 76. Dans le contexte de la fin des espoirs sur la "reprise économique", ils développent une analyse du jeu des différents facteurs qui déterminent la situation actuelle : l'affrontement entre les blocs impérialistes, les conflits entre différents secteurs de la classe dominante et la lutte de classe.
Dans le cadre de nos discussions sur la période de transition, nous présentons aussi une résolution sur l'Etat après la révolution.
La première partie d'une étude sur le surgissement des fractions de Gauche dans la Russie d'après Octobre : Ossinsky, le Centralisme Démocratique, l'Opposition Ouvrière, le Groupe Ouvrier jusqu'à 1921. Cet article cherche à montrer les difficultés de la prise de conscience dans la période de dégénérescence de la révolution, et les jalons de l'avenir qu'ont posé les Communistes de Gauche avant même que l'Opposition Unifiée (Trotski-Zinoviev) ne se constitue.
Cet échange de lettres entre le CCI et Battag1ia Comunista (l'un des groupes issus du PC Internationaliste d'Italie fondé en 43) vise à mettre en évidence le danger de l'antifascisme dont les germes ont pu pénétrer jusque dans les rangs de la Gauche Italienne malgré sa position contre la guerre impérialiste. Ce rappel de l'histoire de la Gauche Communiste des années 40 peut être considéré comme la continuation de notre polémique contre le PCI (Programme Communiste) actuel en dégénérescence et constitue une suite aux textes de BILAN (organe de 1a fraction Italienne en exil des années 30) sur l'Espagne 36, que nous avons republiés dans les n°4, 6 et 7 de la Revue Internationale.
Une mise au point du CCI à propos du refus des librairies "Contra a Corrente" de diffuser les publications du CCI.
TEXTES DU SECOND CONGRES DE REVOLUTION INTERNATIONALE
Les textes sur la "situation internationale" et sur la "période de transition" que nous publions dans le présent numéro de la Revue Internationale sont des rapports du Second Congrès de RI, section du CCI en France. Ces deux thèmes constituaient la toile de fond sur laquelle se sont inscrits les travaux du Congrès, l'axe de ses débats. S'ils étaient inscrits à l'ordre du jour du Congrès, ce n'est pas selon un choix de sujets théoriques généraux mais bel et bien en réponse au développement de la situation générale. En effet, l'évolution actuelle de la crise du système - qui n'est qu'une continuation de sa décadence - pose par son acuité, de plus en plus ouvertement, la perspective révolutionnaire comme seule issue possible. Aujourd'hui, son développement inéluctable et dont plus personne ne cherche à prédire une fin prochaine, va contraindre le prolétariat à reprendre les armes de sa lutte historique. Et au même moment où le capital ne cherche même plus à faire miroiter les reflets illusoires de "beaux jours" encore possibles mais ne peut que demander aux prolétaires du monde entier de "se serrer la ceinture", la révolution n'apparaît plus comme une possibilité lointaine mais comme une nécessité vitale. Le contenu du socialisme, les premiers problèmes que posera la victoire deviennent une préoccupation de plus en plus ressentie par les révolutionnaires. Ce sont ces problèmes, l'analyse de la situation qui conduit à la révolution et les premières questions que sa victoire posera au prolétariat, auxquels le Congrès a tenté de répondre. Et de plus en plus, ces deux aspects de l'avenir, la situation avant et après la révolution, seront intimement liés car c'est le développement présent de la crise qui, faisant de la révolution une perspective de plus en plus concrète, amène à se poser comme un problème réel le contenu de celle-ci.
Ceci est tellement vrai qu'aujourd'hui plusieurs groupes sont amenés à se pencher sur les problèmes de la période de transition et à en concevoir l'importance. Des groupes comme le PIC, la CWO, la revue Spartacus ont consacré dans leurs publications des articles sur cette question qui, il y a quelques années encore, était pratiquement méconnue au sein du mouvement ouvrier renaissant. C'est fondamentalement l'évolution de la réalité elle-même qui fait naître un tel besoin. Il a fallu que la crise apparaisse dans toute sa réalité pour que les éléments de la classe qui, comme ICO, le GLAT, Alarma ou les situationnistes en 68-69, ironisaient sur les "prophéties" de RI, soient obligés de la reconnaître et d'en parler. De la même façon, c'est bel et bien l'évolution présente de la situation qui pousse aujourd'hui différents groupes à se pencher sur les problèmes de la révolution et à les reconnaître comme tels. "L'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre". C'est la réalité qui suscite le développement de la conscience du prolétariat de ses intérêts et de ses tâches ; c'est elle qui met les révolutionnaires face à leurs responsabilités dans le développement de cette conscience.
De plus en plus, donc, le développement de la situation va poser le problème du contenu de la révolution qui deviendra une préoccupation croissante dans le mouvement ouvrier. Qui prend le pouvoir, comment est ce pouvoir, comment il s'organise, quelles sont les premières mesures à prendre ? Toutes ces questions vont être soulevées et largement débattues. C'est seulement sur la base des expériences passées de la classe que les premiers éléments de réponse peuvent être apportés. Ils nécessitent une réflexion approfondie et la responsabilité des révolutionnaires à cet égard est d'autant plus grande que la rupture de la continuité organique avec le mouvement ouvrier du passé, la méconnaissance par le mouvement ouvrier actuel des acquis de son propre passé en augmentent la difficulté. Depuis plusieurs années déjà RI a engagé des discussions sur la période de transition ; celles-ci viennent d'aboutir dans un premier temps à la résolution publiée dans la revue et qui est versée comme contribution au débat qui se déroule au sein du CCI et à la classe ouvrière dans son ensemble.
Quant aux textes sur la "situation internationale", le premier, tout en faisant un tableau de la situation politique mondiale, cherche à faire la synthèse des discussions sur l'actualité qui ont eu lieu au sein du CCI cette année et à mettre en évidence les différents facteurs qui interviennent dans toute situation ; en ce sens, il se conçoit aussi comme un texte de méthode cherchant à développer les armes pour la compréhension de toute situation politique. Le second s'attache à donner un aperçu de la situation économique du système à l'heure actuelle.
Ainsi le Second Congrès de RI ne s'est pas penché seulement sur des problèmes spécifiques à la section en France ; c'est véritablement comme une partie intégrante du CCI qu'il a conçu son travail. Nous avons publié les textes relevant plus directement de la section française dans RI n°32 mais les textes qui suivent relevant d'un intérêt général et international, nous les versons comme contributions dans notre presse internationale, à tout le mouvement ouvrier.
CN.
LA SITUATION POLITIQUE INTERNATIONALE
Pendant des années, les porte-parole appointés de la bourgeoisie ont essayé d'exorciser par des incantations à prétention scientifique les démons de la crise. En couvrant de prix Nobel et d'honneurs ses économistes les plus stupidement béats, cette classe espérait que les faits se plieraient à ses aspirations. Aujourd'hui la crise du capitalisme est devenue d'une telle évidence que même les secteurs les plus "confiants" et "optimistes" de la classe dominante ont admis non seulement son existence mais aussi sa gravité. De ce fait, la tâche des révolutionnaires n'est plus d'en annoncer l'inévitabilité mais de souligner la faillite des théories qui avaient surgi comme champignons après la pluie lors de la période de fallacieuse "prospérité" accompagnant la reconstruction des ruines de la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les théories les plus en vogue dans le monde bourgeois, celle de l'Ecole néo-keynésienne faisait figure de favorite. N'avait-elle pas annoncé une ère de prospérité illimitée grâce à une intervention judicieuse de l'Etat dans l'économie à travers les outils budgétaires ? Depuis 1945 une telle intervention a été la règle dans tous les pays : la catastrophe économique présente vient sonner le glas des illusions des disciples de celui que la bourgeoisie considère comme "le plus grand économiste du XXème siècle".
Plus généralement, la situation actuelle illustre la faillite de toutes les théories qui ont fait de l'Etat un possible sauveur du système capitaliste contre la menace de ses propres contradictions internes. Le capitalisme d'Etat qu'on a pu présenter comme la simple prolongation du processus de concentration engagé dans la période ascendante du capitalisme ou comme "dépassement de la loi de la valeur", se révèle de plus en plus pour ce qu'il a toujours été depuis son apparition au cours de la Première Guerre mondiale : la manifestation, essentiellement sur le plan politique, des efforts désespérés d'un système économique aux abois pour préserver un minimum de cohésion et pour assurer, non son expansion, mais sa survie.
La violence avec laquelle la crise mondiale frappe aujourd'hui les pays où le capitalisme d'Etat s'est développé le plus, anéantit de façon croissante les illusions sur leur nature "socialiste" et sur la prétendue capacité de la "planification" ou du "monopole du commerce extérieur" de venir à bout de l'anarchie capitaliste. Dans ces pays, le chômage est de plus en plus difficilement masqué par la sous-utilisassions de la main d'œuvre. C'est maintenant ouvertement et officiellement que les autorités reconnaissent l'existence de ce fléau typiquement capitaliste. De même, la hausse des prix, qui jusqu'à ces derniers temps ne touchait que le marché parallèle, s'étend de façon spectaculaire au marché officiel. L'économie de ces pays qui était censée tenir tête aux convulsions du capitalisme mondial se révèle fragile et mal armée pour affronter l'exacerbation actuelle de la concurrence commerciale. Loin d'être en mesure, comme l'annonçaient certains de leurs dirigeants, de "dépasser le capitalisme occidental", ces économies ont, au cours des dernières années, contracté d'énormes dettes à l'égard de celui-ci, ce qui aujourd'hui les place pratiquement dans une situation de banqueroute. Cet endettement considérable vient apporter un démenti cinglant à toutes les théories qui, oubliant, quelquefois même au nom du "marxisme", que la saturation générale des marchés n'est pas un phénomène spécifique à telle ou telle région du monde mais touche l'ensemble du capitalisme, ont cru trouver dans les pays soi-disant socialistes des débouchés miraculeux qui allaient résoudre les problèmes qui assaillent le capital.
Depuis la fin des années 60 où la bourgeoisie a commencé à prendre conscience des difficultés de son économie elle n'a eu de cesse de répéter que la situation actuelle est fondamentalement différente de celle de 1929. Terrifiée à l'idée qu'elle pourrait connaître une autre "dépression" de ce type, elle a essayé de se consoler en mettant en relief toutes les différences qui distinguent la crise actuelle de celle de l'entre-deux guerres. Elle a ainsi détaché de l'ensemble les différents aspects et les différentes étapes de la crise pour ne parler que de "la crise du système monétaire" à laquelle devait succéder la "crise du pétrole" rendue responsable à la fois de l'inflation galopante et de la récession.
Contrairement à ce que pensent la majorité des "spécialistes" de la classe dominante, la crise de 1929 et la crise actuelle ont la même nature fondamentale : les deux s'inscrivent dans le cycle infernal de la décadence du mode de production capitaliste : crise - guerre inter impérialiste –reconstruction - nouvelle crise, etc. Elles sont l'expression du fait qu'après une période de reconstitution de l'appareil productif détruit par la guerre impérialiste, le capitalisme se retrouve incapable d'écouler sa production sur un marché mondial saturé. Ce qui distingue les deux crises est du domaine du circonstanciel. En 1929, la saturation des marchés se traduit par un effondrement du crédit privé exprimé par l'effondrement de la Bourse. Après une première période de débandade on assiste, à travers les politiques d'armement et de grands travaux, comme dans l'Allemagne hitlérienne et le "New Deal" américain, à une intervention massive de l'Etat dans les mécanismes économiques qui permet une relance momentanée. Mais une telle politique trouve ses propres limites dans le fait que les réserves financières de l'Etat ne sont pas inépuisables : en 1938, les caisses sont vides et l'économie mondiale plonge dans une nouvelle dépression dont elle n'est sortie que par la guerre.
Dans la période qui suit la Seconde guerre l'intervention étatique ne se relâche pas comme dans celle qui suit la Première. En particulier les dépenses d'armement conservent une place majeure dans l'économie. Ceci explique le maintien depuis 1945 d'une inflation structurelle qui exprime la pression croissante des dépenses improductives nécessaires à la survie du système et qui conduit à un endettement de plus en plus généralisé particulièrement de la part des Etats. Avec la fin de la reconstruction et la saturation des marchés, le système ne trouve d'échappatoire que dans une fuite en avant de l'endettement qui transforme l'inflation structurelle en inflation galopante. Dès lors, le capitalisme n'a d'autre issue que d'osciller entre cette inflation et la récession dès que les gouvernements essayent de la combattre : c'est pour cela que plans de relance et plans d'austérité se succèdent dans un rythme dont l'accélération traduit en fait l'aggravation catastrophique des convulsions du système. Au stade actuel de la crise, c'est de façon de plus en plus simultanée et non alternée que l'inflation et la récession s'abattent sur les économies nationales.
L'intervention systématique de l'Etat a évité au système un effondrement du crédit privé comme celui de 1929. Obnubilée par les épiphénomènes et incapable de comprendre les lois fondamentales de sa propre économie, la bourgeoisie ne voit toujours pas venir devant elle son nouveau 29... pour la bonne raison qu'elle se trouve déjà dans la situation de 1938!
La situation présente de l'économie mondiale signe également la faillite de l'idée, défendue jusque dans les rangs des révolutionnaires, que la crise actuelle est une "crise de restructuration" comprise, non dans le sens qu'elle n'a d'issue que dans une transformation de la structure de la société, mais comme résultat d'un réaménagement des structures économiques existantes. En particulier, dans une telle conception les mesures de capitalisme d'Etat sont souvent présentées comme un moyen pour le système de surmonter ses contradictions.
Si, vers la fin des années 60, de telles théories pouvaient avoir un semblant de crédibilité, elles apparaissent aujourd'hui comme des élucubrations d'intellectuel original. Les dirigeants de l'économie bourgeoise seraient de bien piètres apprentis sorciers s'ils l'avaient plongée dans le chaos actuel uniquement dans le but de la "restructurer".
En fait, dans tous les domaines, la situation est aujourd'hui bien pire que celle qui existait il y a cinq ans, laquelle s'était déjà notablement dégradée par rapport à celle d'il y a dix ans. Si les conditions de départ d'il y a dix ans ont conduit au résultat d'il y a cinq ans et si celles de cette époque ont conduit au résultat actuel, on ne voit pas comment les conditions présentes - où la récession l'endettement et l'inflation n'ont jamais été pires - pourraient déboucher sur une quelconque amélioration de la situation de l'économie capitaliste.
Les prix Nobel d'économie comme les "révolutionnaires" qui ont jeté aux orties un marxisme prétendument "dépassé" devront se résigner : la crise actuelle est sans issue et ne peut aller qu'en s'aggravant.
Si la crise actuelle ne peut que s'approfondir de façon inéluctable, si aucune mesure prise par la classe dominante n'est capable d'en enrayer le cours, celle-ci est cependant conduite à adopter toute une série de dispositions afin de tenter, dans la débandade générale, d'assurer un minimum de défense de son capital national et d'en ralentir la dégradation.
Du fait que la crise est le résultat du caractère limité du marché mondial auquel se heurte l'expansion de la production capitaliste, une quelconque défense des intérêts d'un capital national passe nécessairement par un renforcement de ses capacités concurrentielles à l'égard des autres capitaux nationaux et corollairement le report sur eux d'une partie de ses difficultés. Outre les mesures à caractère extérieur aptes à améliorer ses positions sur la scène internationale, chaque capital national doit, sur le plan interne, mettre en place une politique tendant à diminuer le prix de revient de ses marchandises par rapport à celles des autres pays, ce qui suppose donc une baisse de des dépenses entrant dans la fabrication de chaque produit. Une telle baisse passe par une rentabilisation maximale du capital et une diminution de la consommation globale du pays, ce qui implique une attaque, d'une part contre les secteurs les plus arriérés de la production et contre l'ensemble des couches moyennes et, d'autre part contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
C'est donc une politique à trois volets - report de ses difficultés sur les autres pays, sur les couches intermédiaires et sur les travailleurs - et qui ont pour dénominateur commun le renforcement de la tendance au capitalisme d'Etat, que tente partout la bourgeoisie de mettre en place. C'est dans les résistances auxquelles s'oppose cette mise en place, dans les contradictions qu'elle fait surgir, qu'il faut rechercher les mécanismes à travers lesquels la crise économique débouche sur la crise politique qui, aujourd'hui, tend à son tour à se généraliser.
Le premier volet de la politique de la bourgeoisie de chaque pays, face à la crise, la tentative de report des difficultés sur les autres pays, se heurte à la limite immédiate et évidente d'entrer en contradiction avec la même tentative de la part de chaque autre bourgeoisie nationale. Elle ne peut que conduire à une aggravation des rivalités économiques entre pays qui se reportent nécessairement sur le plan militaire. Mais que ce soit sur le terrain économique ou, encore plus, sur le terrain militaire, aucune nation ne peut seule s'opposer à toutes les autres nations du monde. C'est ce qui explique l'existence de blocs impérialistes qui tendent nécessairement à se renforcer au fur et à mesure que la crise s'approfondit.
La division en de tels blocs ne recouvre pas nécessairement les rivalités commerciales majeures (ainsi l'Europe occidentale, les USA, le Japon, principaux concurrents sur le plan économique, se retrouvent au sein du même bloc impérialiste), qui n'en continuent pas moins de s'aggraver. Mais, même si des affrontements militaires ne sont jamais exclus entre pays d'un même bloc (cf. l'Israël et la Jordanie en 67, la Grèce et la Turquie en 74), ces tensions économiques ne sauraient remettre en cause la "solidarité" militaire des principaux pays qui le constituent face à l'autre bloc. Ne pouvant s'exprimer sur le plan militaire, au sein d'un même bloc, sous peine de favoriser l'autre, l'intensification des rivalités économiques entre pays débouche sur l'intensification des rivalités militaires entre blocs. Dans une telle situation, la défense du capital national de chaque pays tend à entrer de plus en plus en conflit avec la défense des intérêts du bloc de tutelle, par laquelle elle passe de façon inévitable. Outre la première contradiction déjà relevée, c'est donc là une difficulté supplémentaire à laquelle se heurte la bourgeoisie de chaque pays dans la mise en œuvre du premier volet de sa politique contre la crise et qui ne peut déboucher que sur la soumission des intérêts nationaux à ceux du bloc de tutelle.
La capacité de mise en œuvre par chaque bourgeoisie de ce volet de sa politique est conditionnée essentiellement par la puissance de son économie. Ce fait s'est traduit en premier lieu par un report des premières atteintes de la crise sur les pays de la périphérie du système : ceux du Tiers-monde. Mais, au fur et à mesure que la crise s'aggrave, ses effets viennent frapper de plus en plus brutalement les métropoles industrielles parmi lesquelles celles qui disposent du potentiel économique le plus solide sont aussi celles qui y résistent le mieux. Ainsi la "reprise" de 1975-76 dont ont bénéficié surtout les USA et l'Allemagne a été payée par une détérioration catastrophique des économies européennes les plus faibles comme celles du Portugal de l'Espagne et de l'Italie, ce qui a accru d'autant leur dépendance à l'égard des pays les plus puissants, essentiellement des USA. Cette suprématie économique se répercute sur le plan militaire où, non seulement les pays les plus faibles doivent, au sein de chaque bloc, se soumettre de façon croissante au plus puissant, mais où, également, le bloc ayant l'assise économique la plus solide, celui dirigé par les USA, progresse et se renforce au détriment de l'autre. Il est aujourd'hui devenu clair, par exemple, que la fameuse "défaite" américaine au Vietnam constituait un repli tactique d’une zone sans grand intérêt militaire et économique afin de venir renforcer la puissance américaine dans les zones beaucoup plus importantes d'Afrique australe et surtout du Moyen Orient. L'aggravation de la crise vient donc annuler les velléités "d'indépendance nationale" qui s'étaient développées à la faveur de la reconstruction dans certains pays comme la France, de même qu'elle apporte un démenti cinglant à toutes les mystifications entretenues par l'extrême gauche du capital sur la "libération nationale" et la "victoire contre l'impérialisme américain".
Le deuxième volet de la politique bourgeoise face à la crise consiste dans une meilleure rentabilisation de l'appareil productif s'exerçant contre les couches sociales autres que prolétariennes. Il consiste d'une part, en une attaque contre le niveau de vie de l'ensemble des couches moyennes liées aux secteurs non productifs ou à la petite production, d'autre part, dans une élimination des secteurs économiques les plus anachroniques, les moins concentrés ou travaillant suivant des techniques les plus archaïques. Les couches sociales en général assez hétéroclites touchées par ces mesures, sont composées essentiellement de la petite paysannerie, de l'artisanat, de la petite industrie et du petit commerce dont le revenu est souvent réduit de façon drastique à travers une aggravation de la pression fiscale et de 1a concurrence de la part d'unités productives ou de distribution plus concentrées et qui sont conduits bien souvent à la ruine et à l'abandon de leur activité. Cette politique peut également frapper, à travers des mesures de capitalisme d'Etat, les professions libérales, les cadres, certains secteurs de l'administration ou du secteur tertiaire particulièrement parasitaires comme également des fractions de la classe dominante elle-même, sous sa forme la plus classique liée à la propriété individuelle.
Cette politique du capital national se heurte nécessairement à la résistance, quelquefois très vive, de l'ensemble de ces couches qui, bien qu'incapables de s'unifier et historiquement condamnées, peuvent peser de façon notable sur la vie politique. En particulier, ces couches peuvent avoir un poids électoral important et quelquefois décisif dans certains pays, dans la mesure où elles constituent l'appui essentiel des gouvernements de droite liés au capitalisme classique - qui ont dominé dans beaucoup de pays durant la période de reconstruction - ou même une force d'appoint des gouvernements de gauche, particulièrement en Europe du Nord. De ce fait, la résistance de ces couches sociales peut constituer une entrave très puissante contre les mesures de capitalisme d'Etat que ces gouvernements sont conduits à prendre de façon impérative. Cette entrave peut, dans certains cas, aboutir à une véritable paralysie des capacités de ces gouvernements à prendre ce type de mesures, ce qui est un facteur venant aggraver encore la crise politique de la classe dominante.
Le troisième volet de la politique capitaliste face à la crise, l'attaque du niveau de vie de la classe ouvrière, est celui qui est destiné à devenir le plus important dans la mesure où cette classe est la principale productrice de richesse sociale. Cette politique, qui a pour but essentiel de réduire les salaires réels et d'augmenter l'exploitation, se manifeste principalement à travers l'inflation qui touche plus particulièrement les prix des biens de consommation, importants dans les milieux ouvriers comme l'alimentation, l'augmentation massive du chômage, la suppression d'un certain nombre "d'avantages sociaux", qui, en fait, font partie des moyens de reproduction de la force de travail, donc du salaire, et enfin d'une intensification, quelquefois violente, des cadences de travail.
Cette agression contre le niveau de vie de la classe ouvrière est devenue une réalité évidente reconnue par la classe capitaliste elle-même qui en fait la pierre angulaire de ses "plans d'austérité". Elle est en fait bien plus violente que les chiffres officiels n'osent le dire, dans la mesure où ceux-ci ne prennent pas en compte cette atteinte aux "avantages sociaux" (médecine, sécurité sociale, cadre de vie, etc.), non plus que le chômage qui ne frappe pas seulement les travailleurs sans travail mais pèse sur l'ensemble de la classe ouvrière puisqu'il se traduit lui aussi par une baisse globale du capital variable destiné à l'entretien de la force de travail.
Cette situation vient détruire une autre théorie qui a eu son heure de gloire durant la période de reconstruction : celle de la faillite des prévisions marxistes sur la paupérisation absolue du prolétariat. Aujourd'hui ce n'est plus de façon relative mais bien de façon absolue que diminue la consommation des travailleurs et qu'augmente l'exploitation.
L'agression capitaliste contre la classe ouvrière s'est heurtée, depuis ses tous débuts en 1968-69, à une réponse très vive de celle-ci. Cet affrontement entre bourgeoisie et prolétariat est celui qui aujourd'hui détermine le cours général de l'évolution historique par rapport à la crise : non pas guerre impérialiste comme à la suite de la crise de 1929, mais guerre de classe. En ce sens, des trois volets de la politique bourgeoise, c'est celui qui s'adresse directement à la classe ouvrière qui va tendre à primer de plus en plus quant à l'évolution politique générale. En particulier dans les zones où le prolétariat est le plus important, le capital va mettre de plus en plus en avant ses fractions politiques "de gauche" qui sont les plus aptes à mystifier et encadrer la classe ouvrière et lui faire accepter les "sacrifices" exigés par la situation économique. Ce besoin de faire appel à la gauche se fait d'autant plus sentir, parmi les pays industrialisés, que la situation de l'économie elle-même est incapable de constituer un facteur de "consensus social" et de confiance dans la capacité du capitalisme à surmonter la crise. Contrairement aux plus prospères et résistant le mieux aux assauts de la crise, dans lesquels il n'est pas besoin de propagande "anticapitaliste" pour attacher les travailleurs au char de leur capital national, ces pays sont donc à la veille de remaniements importants de leur appareil politique. Cependant, et c'est là une contradiction supplémentaire qui assaille la classe dominante, ces remaniements se heurtent à une résistance souvent très décidée de la part des équipes encore au pouvoir et qui, même au détriment des intérêts globaux du capital national, font tout leur possible pour y rester ou y conserver une place importante.
Dans la mise en place de chacun de ces trois axes de sa politique, la bourgeoisie se heurte donc à toute une série de résistances et de contradictions mais, de plus en plus, ces axes de la politique capitaliste peuvent également entrer en contradiction entre eux. Dans certains cas il y a convergence entre certains de ces axes : par exemple les nécessaires mesures de capitalisme d'Etat qui doivent frapper les secteurs les plus anachroniques du capitalisme constituent en même temps un bon moyen pour les fractions de gauche du capital de mystifier les travailleurs en les faisant passer comme mesures "anticapitalistes" ou "socialistes". De même, il est possible que la lutte contre les secteurs les plus anachroniques de la société soit menée par des forces politiques qui ont la confiance et l'appui du bloc de tutelle, comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne où le processus de "démocratisation" se fait en liaison et accord direct avec la bourgeoisie européenne et américaine. Cependant, on assiste très souvent à un conflit entre les mesures de capitalisme d'Etat, rendues indispensables par l'aggravation de la crise, et le resserrement des liens de soumission du capital national à l'égard de son bloc de tutelle, conflit qui peut résulter d'une atteinte aux intérêts économiques de la puissance dominante ou encore du fait que les forces politiques les plus appropriées pour les prendre ont, en politique internationale, des options non conformes à celles du bloc. Il peut, dans le même sens, surgir un conflit entre les nécessités du capital national en politique internationale et les mystifications nationalistes qu'il mettra partout en œuvre pour mieux encadrer le prolétariat.
A mesure que la crise s'approfondit, ces différentes contradictions tendent à s'aiguiser et à rendre encore plus inextricables les problèmes posés à la bourgeoisie, laquelle est de plus en plus conduite à faire face à ces problèmes, non pas avec un plan à long ou même à moyen terme, mais au coup par coup, au jour le jour, en fonction des urgences du moment. Cet aspect empirique de la politique de la bourgeoisie est encore accentué par le fait que cette classe est incapable de se donner une vision à long terme de ses propres perspectives historiques. Certes, elle a profité de ses expériences passées que ses hommes politiques et universitaires, économistes ou historiens, lui rappellent quand nécessaire pour lui éviter de commettre les mêmes erreurs : par exemple, sur le plan économique, elle a su éviter l'affolement de 1929, de même que sur le plan politique, elle a su prendre en 1945 les dispositions pour éviter une vague révolutionnaire d'après guerre comme celle de 1917-23. Cependant cette utilisation de ses propres expériences par la bourgeoisie ne va jamais bien plus loin que l'apprentissage d'un certain nombre de réponses précises face à des situations répertoriées. Ses propres préjugés de classe interdisent à la bourgeoisie de se donner une compréhension correcte des lois historiques, incapacité qui est encore aggravée par le fait qu'elle est aujourd'hui une classe réactionnaire dont la société qu'elle dirige est en pleine décomposition et décadence. Cette incapacité se manifeste avec d'autant plus d'ampleur que la situation économique lui échappe et avec elle l'intelligence des mécanismes de plus en plus complexes et contradictoires qui animent cette situation.
La compréhension des différentes politiques que la bourgeoisie de tel ou tel pays est amenée à adopter à tel ou tel moment, ainsi que de l'évolution des rapports de force et des affrontements entre les différentes fractions de cette classe, doit donc tenir compte de l'ensemble des données contradictoires des différents problèmes qu'elle doit résoudre et de l'importance relative que ces données acquièrent dans les différents pays, compte tenu de leur situation géographique, historique, économique et sociale respectives. Elle doit tenir compte, en particulier, du fait que la bourgeoisie n'agit pas nécessairement à chaque moment de la façon la plus appropriée à la défense de ses intérêts immédiats ou historiques et que c'est souvent à long terme et à travers des conflits quelquefois violents que ses fractions les plus aptes à faire face à une situation s'imposent à celles qui le sont le moins.
C'est dans les pays sous-développés que les contradictions rencontrées dans la mise en œuvre des tentatives de la bourgeoisie, sont les plus violentes. L'impasse totale sur le plan économique condamne à l'échec les différentes mesures que peut prendre la classe dominante : loin d'être en mesure de reporter sur les autres pays les difficultés du sien, celle-ci, au contraire, subit le poids de ce même type de politique de la part de la bourgeoisie des pays les plus développés. Cette impuissance sur le plan économique se répercute sur le plan politique par une instabilité chronique et des convulsions brutales. L'affrontement des différentes fractions du capital national, loin d'être en mesure de se résoudre sur le terrain institutionnel des rouages "démocratiques", débouche souvent sur des heurts armés. Ces heurts sont particulièrement violents entre d'une part, les fractions les plus liées au capitalisme d'Etat dont le besoin se fait sentir d'autant plus que l'économie est délabrée et d'autre part, les secteurs les plus anachroniques de la production particulièrement importants du fait du faible niveau de l'industrialisation.
Ces affrontements entre différents secteurs du capital national sont en général amplifiés par le poids des rivalités inter impérialistes quand ils ne sont pas purement et simplement mis au service de celles-ci comme c'est aujourd'hui le cas au Liban et en Afrique australe.
Pour toutes ces raisons, les pays sous-développés constituent le terrain de prédilection des luttes de "libération nationale"- surtout quand ils se trouvent dans les zones en dispute entre grands brigands impérialistes - ainsi que des coups d'Etat militaires dans la mesure où l'armée est en général la seule force de la société ayant un minimum de cohésion et où elle dispose de cet élément essentiel dans les conflits entre secteurs de la classe dominante de ce pays : la force physique. C'est elle en particulier qui, dans ces pays, se fait souvent l'agent le plus décidé du capitalisme d'Etat contre les secteurs "démocratiques" liés à des intérêts privés. Dans ces pays, cette prédominance des affrontements entre différentes fractions de la classe dominante est d'autant plus forte que la classe ouvrière, malgré les réactions quelquefois violentes qu'elle oppose à une exploitation féroce, est relativement faible de par le faible niveau d'industrialisation.
C'est dans les pays économiquement les plus puissants que la classe dominante contrôle encore le mieux l'ensemble des problèmes mis à nu par l'aggravation de la crise, qu'elle maintient la plus grande stabilité et maîtrise du jeu politique. Cela est lié au fait que c'est dans ces pays que les différents axes de la réponse bourgeoise à la crise provoquent le moins de contradictions, dans la mesure où la situation économique, moins délabrée qu'ailleurs, fait appel à des mesures moins extrêmes et où la classe dominante dispose encore d'énormes moyens politiques, résultat de son assise économique.
Concrètement, cela se manifeste par le fait que le capital national dispose d'une plus grande aptitude à concurrencer ses adversaires sur le plan économique et militaire, ce qui les place en moindre dépendance à l'égard des blocs impérialistes auxquels il impose un grand nombre de ses objectifs:
- par le poids très faible des points de vue numérique économique et, partant, politique des secteurs anachroniques de la production ;
- par la grande capacité de mystification de la classe ouvrière par le simple poids de la "prospérité" économique.
Ce dernier aspect de la puissance de la bourgeoisie est particulièrement sensible dans des pays comme les USA et l'Allemagne de l'Ouest où cette classe a pu se livrer à une attaque officiellement reconnue contre le niveau de vie du prolétariat (baisse sensible du salaire réel et augmentation massive du chômage) sans que celui-ci, pourtant le plus puissant du monde, n'ait réagi de façon majeure. Par ailleurs, dans ce type de pays, la tendance générale au capitalisme d'Etat que la crise vient accentuer de façon très puissante ne se traduit pas, comme dans les pays plus arriérés, par un choc violent entre secteur étatique et secteur privé de l'économie, mais par une fusion progressive de ces deux secteurs.
Dans ces conditions, la bourgeoisie dispose d'un marge de manœuvre relativement importante qui limite les affrontements entre ses différents secteurs (cf. la similitude des programmes entre les candidats Ford et Carter aux USA) ou les répercussions de ces affrontements (cf. la facilité avec laquelle la bourgeoisie américaine a surmonté et exploité l'affaire "Watergate"). Le faible niveau actuel des contradictions engendrées par la mise en place des premier et troisième volets de la politique capitaliste, pourtant les plus importants historiquement, peut, dans certains de ces pays, conduire à une prééminence circonstancielle de contradictions engendrées par la mise en place du deuxième. C'est ainsi qu'on peut s'expliquer la défaite social-démocrate en Suède et le recul du SPD en Allemagne dont le maintien au pouvoir, grâce au concours des libéraux, traduit cependant les besoins présents de la bourgeoisie allemande de moyens pour prendre des mesures de capitalisme d'Etat et mystifier la classe ouvrière.
Dans le cas des pays développés mais au capitalisme plus faible que les précédents, en particulier les pays d'Europe occidentale, les différentes contradictions auxquelles se heurtent les différents axes de la politique bourgeoise, tendent à l'heure actuelle à équilibrer leurs poids respectifs et à interagir jusqu'à aboutir à des situations à première vue paradoxales et précaires. Ce phénomène est particulièrement net en ce qui concerne la détermination de la place des PC dans la vie politique dans un certain nombre de pays européens. Ces partis constituent, dans ces pays, les fractions de l'appareil politique bourgeois les plus aptes à la fois de prendre les mesures résolues dans le sens du capitalisme d'Etat que la situation requiert et de faire accepter à la classe ouvrière le maximum de sacrifices. En ce sens, leur participation au pouvoir s'impose de plus en plus. Cependant, de par leurs options en politique internationale et la crainte qu'ils inspirent à des secteurs importants des classes possédantes, leur accession à des responsabilités gouvernementales se heurte à une résistance décidée du bloc américain qui trouve un appui important auprès des secteurs les plus anachroniques de la société. Ces dernières années, les PC ont tenté de donner au reste de la bourgeoisie un maximum de gages de leur attachement au capital national, de leur indépendance à l'égard de l'URSS et de leur volonté de respecter les règles démocratiques en vigueur dans leurs pays, volonté qui s'est exprimée en particulier par le rejet de la notion de "dictature du prolétariat". Cependant, toutes ces concessions n'ont pas suffi, pour le moment, à surmonter ces résistances alors que l'entrée des PC au gouvernement est devenue des plus urgentes dans certains de ces pays. Ceci constitue une illustration du fait, déjà signalé que, ballottée par ses contractions à l'échelle nationale et internationale, la bourgeoisie ne se donne pas nécessairement les instruments les plus appropriés aux moments les plus opportuns. Il est significatif du caractère éminemment temporaire et instable des situations et des rapports de force qui prévalent pour le moment dans un nombre important des pays d'Europe et plus particulièrement au Portugal, en Espagne, Italie et en France.
Le Portugal est des pays européens celui qui a, ces dernières années, illustré avec le plus d'évidence la crise politique de la bourgeoisie. Ses caractéristiques de pays sous-développé et qui expliquent le rôle fondamental joué par l'armée, jointe à ses caractéristiques de pays développé, en particulier une forte concentration prolétarienne animée d'une forte combativité à partir de la fin 73, sont à l'origine des soubresauts de ce pays en 1974 et 1975. La poussée initiale des forces de gauche : gauche militaire, gauche et gauchistes, qui s'expliquait à la fois par l'urgence des mesures de capitalisme d'Etat dans une économie particulièrement déliquescente et par le besoin de dévoyer et encadrer la classe ouvrière a laissé la place à un retour du balancier vers la droite à la faveur de la conjonction d'une retombée de la lutte de classe, d'une très forte résistance des secteurs liés à la petite propriété contre le capitalisme d'Etat et d'une énorme pression politique et économique du bloc américain. L'actuelle orientation de la politique portugaise vers la droite (remise en cause d'aspects de la réforme agraire, retour de Spinola, libération des agents de la PIDE), si elle exprime le reflux de la classe ouvrière et renforce sa démoralisation, est cependant peu armée pour faire face à la prochaine remontée et, de ce fait, est grosse d'instabilité future.
L'Espagne est un des pays européens appelés, dans les prochaines années, à connaître des convulsions majeures. La rigueur de la crise en même temps que la sénilité et l'impopularité de l'ancien régime franquiste y ont mis à l'ordre du jour des transformations politiques importantes dans le sens de la "démocratie" et que la disparition de Franco a permis de mettre en chantier. Ces transformations sont d'autant plus urgentes pour la bourgeoisie en Espagne qu'elle affronte un des prolétariats les plus combatifs du monde et que la simple répression est de moins en moins capable de contenir. Elles constituent "l'objectif" fondamental en direction duquel le capitalisme peut aujourd'hui, en Espagne, dévoyer la combativité ouvrière. Cependant, malgré l'urgence de la rupture ou de la "transition" démocratique, ce processus se heurte à une très forte résistance des secteurs les plus arriérés de la classe dominante ayant pour appuis essentiels la bureaucratie étatique, l'armée et surtout la police. De plus, la bourgeoisie espagnole, de même que l'ensemble de la bourgeoisie occidentale, reste extrêmement méfiante à l'égard d'un PCE, pourtant parmi les plus "eurocommunistes". Alarmée par l'expérience portugaise, elle tient en particulier à éviter qu'un passage trop rapide du pouvoir aux mains de l'opposition ne favorise trop le PCE qui en constitue la force majeure. En ce sens, elle met tout en œuvre pour qu'avant cette passation de responsabilités se constitue un grand parti du centre, défenseur de la bourgeoisie classique, capable de lui faire contrepoids.
C'est donc, par l'extrême fragilité de l'équilibre - traduction des faiblesses du capital national - entre la poussée de la lutte de classe, la résistance des vestiges du franquisme et les impératifs de la politique du bloc occidental que se traduit aujourd'hui en Espagne la crise politique de la bourgeoisie.
La situation du capital italien se caractérise elle aussi par l'extrême précarité des solutions politiques qu'il a pu jusqu'ici se donner. Face à une situation économique parmi les plus chaotiques d'Europe, sa fraction politique dominante, la Démocratie Chrétienne, se trouve dans l'incapacité de prendre des mesures d"'assainissement économique" et de renforcement effectif de l'Etat qui sont de plus en plus urgentes. Si, de l'avis même d'une partie croissante de la bourgeoisie, la venue au pouvoir du PCI est indispensable, cette solution se heurte pour l'heure à des résistances décisives. C'est la même alliance entre les intérêts de la bourgeoisie américaine et ceux des secteurs arriérés de l'économie nationale particulièrement visés par le capitalisme d'Etat qui avait, au Portugal, chassé le PC du pouvoir qui empêche son accession directe à ce même pouvoir en Italie. C'est pour le moment de façon indirecte que, face aux urgences de l'heure, le PCI assure ses responsabilités à la tête du capital italien. Cependant, son "soutien critique" à l'action du gouvernement minoritaire Andreotti ne peut constituer qu'un pis-aller qui ne saurait se prolonger très longtemps sans dangers majeurs pour ce capital.
En effet, cette solution bâtarde comporte le double inconvénient de ne pas permettre l'adoption de mesures énergiques de capitalisme d'Etat et de ne pas pouvoir être présentée comme une "victoire" pour les travailleurs comme le serait une participation directe du PCI au pouvoir alors qu'elle fait en même temps retomber sur lui une part de l'impopularité des mesures d"'austérité". Comme en Espagne, le capital est en Italie sur la corde raide.
En France, une longue période de stabilité politique touche à sa fin. Frappé, à la suite des autres pays latins, de plein fouet par la crise, ce pays est à la veille de bouleversements politiques importants. Les forces politiques au pouvoir depuis près de vingt ans sont de plus en plus usées et impuissantes pour prendre des mesures énergiques d"'assainissement" de l'économie. Très dépendantes des secteurs les plus retardataires de la société comme l'ont montré les affrontements parlementaires sur les "plus-values", ces forces ne sont capables que d'attaques relativement timides contre le niveau de vie de la classe ouvrière comme le fait apparaître la modération du plan Barre. Dans ces circonstances, "la gauche unie" pose avec assurance sa candidature à la succession de la droite qui interviendra probablement à la suite des élections législatives de 1978. De ce fait, celles-ci constituent de plus en plus le centre de polarisation de la vie politique en France, d'autant plus qu'elles doivent permettre, avec le relai opportun des municipales de 1977, de faire patienter jusqu'à cette "grande victoire" la classe ouvrière dont le mécontentement et l'inquiétude vont grandissants.
Dans l'attente de ce dénouement, la droite va se contenter d"'expédier les affaires courantes". Cependant, si la situation en France se rapproche de celles du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie par son caractère transitoire, le capital de ce pays dispose, comme traduction d'une plus grande force structurelle, d'une plus grande marge de manœuvre et de moyens plus importants pour parer dans l'immédiat à ses difficultés politiques.
Du point de vue de la précarité de son équilibre, la situation en Grande-Bretagne ne se distingue pas fondamentalement de celle des autres pays d'Europe considérés. Cependant, ce qu'il faut souligner concernant ce pays, c'est le paradoxe existant entre la profondeur avec laquelle il est frappé par la crise et la capacité de la bourgeoisie à continuer à maîtriser la situation sur le plan politique. En effet, si on prend en considération les différents axes de la politique bourgeoise, la classe dominante ne rencontre pas de problèmes majeurs avec les couches moyennes et en particulier avec la paysannerie proportionnellement la plus faible du monde. De même, sa fraction de gauche dominante, le parti travailliste, jouit de la parfaite confiance du bloc américain ; enfin, le capital a manifesté une grande capacité politique par la reprise en main d'un des prolétariats les plus combatifs du monde à travers un appareil syndical éprouvé dans lequel TUC et shop-stewards se partagent efficacement le travail.
Cependant, si la bourgeoisie la plus vieille du monde a momentanément surpris par l'ampleur de ses ressources, tout son "savoir faire" sera impuissant en fin de compte devant la gravité de la situation d'une économie qui depuis 1967 est une des moins épargnées par la crise mondiale.
Dans les pays dits "socialistes" la situation n'est pas fondamentalement différente de celle des pays du bloc occidental. C'est à travers les contradictions que soulèvent les divergences entre l'intérêt du bloc de tutelle et l'intérêt national, la nécessité de renforcer la cohésion d'un appareil productif peu efficace, les résistances sourdes mais quelquefois décisives de secteurs comme la paysannerie, les réactions limitées en nombre mais violentes de la classe ouvrière, que la crise se transmet de la sphère économique à la sphère politique. Cependant, la grande fragilité de ces régimes liée à leur faiblesse économique et à leur très grande impopularité leur laisse une marge de manœuvre très réduite, contrairement aux pays "démocratiques". En particulier, l'absence de forces politique de rechange du capital liée à son étatisation presque complète interdit une "relève démocratique" du type espagnol, capable de canaliser le mécontentement ouvrier. Les seuls changements que soit capable de se donner l'appareil politique de ces pays consiste dans la modification des cliques dirigeantes au sein du parti unique, ce qui limite de façon importante leur capacité de mystification. De ce fait, à part la récupération et l'institutionnalisation des organes que la classe peut se donner au cours de ses luttes et la mise en avant des thèmes "démocratiques" agités par des forces limitées destinées à rester dans l'opposition, le capital de ces pays dispose de peu de moyens d'encadrement de la classe ouvrière autre qu'une répression systématique et féroce. Sur chacun de ces points, la situation en Pologne est particulièrement significative : elle met en relief la grande faiblesse du capital de ces pays, la grande rigidité et les convulsions de son appareil politique qui sont liées à cette faiblesse ainsi que son impuissance à mener une attaque en règle contre le niveau de vie de la paysannerie et une classe ouvrière particulièrement combative.
Parmi les pays "socialistes", la Chine constitue un cas significatif. Son évolution - particulièrement mise en relief avec l'aggravation de la crise - tant en politique intérieure qu'en politique internationale, vient confirmer un certain nombre d'analyses déjà définies pour d'autres pays.
En premier lieu, son rapprochement à la fin des années 60 avec les USA apporte un démenti à la thèse qui veut qu'il y ait un "bloc du capitalisme d'Etat" aux intérêts fondamentalement "solidaires" face au "bloc du capitalisme privé". Ce rapprochement illustre également l'impossibilité d'une indépendance véritable de tout pays, aussi puissant soit-il, à l'égard des deux grands blocs impérialistes qui se partagent la planète, la seule "indépendance nationale" consistant en fin de compte dans une possibilité de passage de l'orbite de l'un à celle de l'autre.
En second lieu, les convulsions qui ont suivi la mort de Mao mettent en évidence la grande instabilité de ce type de régimes : l'affrontement entre les forces politiques plus ou moins favorables au bloc russe ou américain se combinent comme ailleurs avec les oppositions entre différentes orientations économiques et politiques et entre différents secteurs de la bureaucratie étatique pour aboutir à des règlements de compte violents et même sanglants entre les différentes cliques qui constituent l'Etat et le parti.
En troisième lieu, l'émergence à la tête de l'Etat de l'ancien chef de la police Hua Kuo-Feng s'appuyant en bonne partie sur 1'armée illustre à la fois que la répression la plus systématique et ouverte constitue le moyen privilégié pour contenir la lutte de classe et que, malgré ses caractéristiques particulières, la Chine n'échappe pas à la règle qui assigne à l'armée une place déterminante dans la politique intérieure des pays sous-développés.
Si c'est en prenant en considération, non pas un seul, mais les trois axes de la politique bourgeoise face à la crise et l'ensemble des contradictions qu'ils provoquent dans différents domaines qu'on a pu comprendre les conditions de l'actuelle crise politique de la classe dominante, cela ne signifie pas cependant que chacun de ces trois axes ait un impact égal dans l'évolution de celle-ci. On a déjà mis en relief le fait que certains d'entre eux peuvent à certains moments et de façon circonstancielle constituer l'élément déterminant d'une situation, mais il est également vrai que, sur le plan historique, certains de ces axes tendront de façon plus définitive à prendre le pas sur d'autres. On peut ainsi établir que l'importance des problèmes liés à l'attaque capitaliste contre les couches moyennes est appelée à diminuer en faveur des problèmes liés à ce qui touche les intérêts fondamentaux du capital et qui sont à la base de l'alternative ouverte par la crise : guerre de classe généralisée ou guerre impérialiste. Dans la période qui vient on verra donc s'accroître le poids des questions liées à la concurrence entre capitaux nationaux, ce qui se traduira par une aggravation des tensions inter impérialistes et un renforcement de la cohésion au sein des blocs, et d'autre part l'importance du facteur lutte de classe. Et dans la mesure où ce dernier est celui qui commande la survie du système, il devrait progressivement prendre le pas sur le précédent à mesure qu'augmentera la remise en cause de cette survie : l'histoire nous a montré, particulièrement en 1918, que le seul moment où la bourgeoisie peut oublier ses déchirements entre nations est celui où sa vie même est en jeu mais, qu'alors, elle est parfaitement capable de le faire.
Une fois posées ces perspectives globales, l'examen de la situation politique de la plupart des pays (à l'exception peut-être de l'Espagne et de la Pologne) conduit à la constatation que, cette dernière année, le facteur lutte de classe a été relativement effacé par rapport aux autres facteurs dans la détermination de la conduite des affaires bourgeoises. Et en fait, si contrairement aux années 30 la perspective générale n'est pas guerre impérialiste mais guerre de classe, il faut justement constater que la situation présente se distingue par l'existence d'un grand décalage entre le niveau de la crise économique et politique et le niveau de la lutte de classe. Ce décalage est particulièrement frappant quand on examine le pays qui, depuis 1969, a connu le plus grand nombre de mouvements sociaux : l'Italie. Si, dans ce pays, les premières atteintes de la crise avaient provoqué des réactions ouvrières aussi puissantes que celle du "mai rampant" de 1969, la véritable agression actuelle contre la classe ouvrière comme produit de la déliquescence de la situation économique ainsi que le chaos politique résultant également de cette situation, ne trouvent en face d'eux qu'une réponse prolétarienne très limitée, sans commune mesure avec celle du passé. Ce n'est donc pas seulement de stagnation de la lutte de classe dont il faut parler mais bien d'un repli de celle-ci et qui affecte aussi bien la combativité du prolétariat que son niveau de conscience puisque aujourd'hui, et particulièrement en Italie, l'appareil syndical -passablement bousculé et dénoncé par un nombre important de travailleurs dans le passé - a rétabli un contrôle assez efficace sur ceux-ci.
Indépendamment des explications qu'on peut donner au creux présent de la lutte de classe, ce phénomène vient donner un coup de grâce à toutes les théories qui voyaient dans la lutte de classe la cause du développement de la crise. Qu'elles soient le fait d'économistes bourgeois, en général les plus stupides et réactionnaires, ou qu'elles tentent de s'abriter derrière le "marxisme", ces conceptions sont aujourd'hui bien incapables d'expliquer par quel mécanisme un repli de la lutte de classe peut provoquer une telle aggravation de la crise économique. Le "marxisme" des situationnistes, qui voyaient dans mai 1968 la cause des difficultés économiques qu'ils n'ont découvert qu'avec plusieurs années de retard, comme celui du GLAT qui passe son temps à faire dire n'importe quoi à des cargaisons de chiffres a bien besoin d'aller se refaire une cure de santé.
Par contre, la situation actuelle semble apporter de l'eau au moulin des théories qui considèrent que la crise est l'ennemie des luttes ouvrières et que le prolétariat ne peut faire sa révolution que contre un système fonctionnant "normalement". Cette conception, qui trouve des arguments historique avec le cours suivi par la lutte de classe après 1929, est une des expressions, quand elle est développée par des révolutionnaires, de la démoralisation engendrée par la terrible contre-révolution qui a marqué la moitié du XXème siècle. Elle tourne le dos à l'ensemble de l'expérience historique et a été toujours combattue par le marxisme. De même, aujourd'hui, ce n'est pas en examinant d'une façon statique et immédiate la situation - ce qui peut effectivement conduire à la conclusion que le recul relatif des luttes est la conséquence de l'aggravation de la crise -, mais en prenant en compte l'ensemble des conditions et des caractéristiques du développement du mouvement prolétarien qu'on peut comprendre les causes de ce repli et, de ce fait, dégager les perspectives sur lesquelles débouche cette situation. Et de tous les facteurs qui déterminent la situation actuelle il faut en prendre en compte particulièrement trois :
- les caractéristiques du développement historique des mouvements révolutionnaires de la classe ;
- la nature et le rythme de la crise présente ;
- la situation créée par un demi-siècle de contre-révolution.
C'est depuis plus d'un siècle que les révolutionnaires ont mis en évidence que, contrairement aux révolutions bourgeoises qui "se précipitent de succès en succès", les révolutions prolétariennes "interrompent à chaque instant leur propre cours, (...) paraissent n'abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et se redresser à nouveau formidable en face d'elles" (K. Marx, Le 18 Brumaire). Ce cours en dents de scie de la lutte de classe qui se manifeste aussi bien par de grands cycles historiques de flux et de reflux que par des fluctuations à l'intérieur de ces grands cycles est lié au fait que, contrairement aux autres classes révolutionnaires du passé, la classe ouvrière ne dispose d'aucune assise économique dans la société. Ses seules forces étant sa conscience et son organisation constamment menacées par la pression de la société bourgeoise, chacun de ses faux pas ne se traduit pas par un simple coup d'arrêt de son mouvement mais par un reflux qui vient terrasser l'une et l'autre et la plonge dans la démoralisation et l'atomisation.
Ce phénomène est encore accentué par l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence dans laquelle la classe ouvrière ne peut plus se donner d'organisation permanente basée sur la défense de ses intérêts comme classe exploitée, comme pouvaient l'être les syndicats au siècle dernier. Aujourd'hui, au lendemain de la plus terrible contre-révolution de son histoire, ce caractère en dents de scie du développement des luttes de la classe est encore plus renforcé du fait de la rupture profonde entre les nouvelles générations ouvrières et les expériences passées du prolétariat. Celui-ci doit donc refaire toute une série d'expériences répétées avant d'être en mesure de pouvoir en tirer valablement les leçons, renouer avec son passé et tirer des expériences de ce1ui-ci les enseignements qu'il devra intégrer dans ses luttes futures.
Ce long chemin de la lutte de classe d'aujourd'hui est encore allongé par les conditions dans lesquelles s'opère la reprise : le développement lent d'une crise économique du système. Les mouvements révolutionnaires passés du prolétariat se sont tous développés à la suite de guerres, ce qui les plaçait d'emblée en face des convulsions les plus violentes que la société capitaliste puisse connaître et les confrontait rapidement aux problèmes politiques, en particulier à celui de la prise du pouvoir. Dans les conditions présentes, la prise de conscience de la faillite totale du système - particulièrement là où le prolétariat est le plus concentré, c'est-à-dire dans les pays les plus développés - est nécessairement un processus lent qui suit le rythme de la crise elle-même. Cela permet le maintien, pendant une longue période, de toute une série d'illusions sur la capacité de ce système à surmonter sa crise à travers différentes formules mises en avant par les équipes de rechange de la bourgeoisie.
C'est l'ensemble de cette situation qui a permis au capital de refaire une partie du terrain perdu au début de la crise face aux réactions brusques de la classe que celle-ci avait provoquées et qui avaient surpris la classe dominante dans un premier temps. En particulier, les fractions de gauche du capital et leur appareil syndical ont systématiquement saboté les luttes soit, quand elles étaient au pouvoir, en agitant la menace d'un "retour de la droite ou de la réaction", soit, plus souvent encore, en présentant la venue de la gauche - rendue de toutes façons de plus en plus nécessaire pour imposer des mesures de capitalisme d'Etat aux secteurs liés à la propriété individuelle comme un moyen de surmonter la crise et de préserver les intérêts prolétariens. Dans cette tâche, les gauchistes ont joué un rôle très important à travers leurs politiques de "soutien critique", racolant vers le terrain électoral et syndical les éléments de la classe qui commençaient à ruer dans les brancards de la gauche classique.
Cette perspective de victoire de la gauche a été facilitée par la déception qu'a pu faire peser sur la classe une série de défaites dans ses luttes économiques : ressentant le besoin d'une "politisation" de son action, mais ne disposant pas encore d'une expérience suffisante, elle a été conduite sur le terrain d'une "politisation" bourgeoise. Cette déception a également eu pour conséquence le développement d'un certain fatalisme parmi les travailleurs qui ne les incite à réagir de nouveau que face à une aggravation beaucoup plus violente de la crise.
L'ensemble de ces conditions permet d'expliquer les causes du désarroi actuel du prolétariat et du creux relatif de ses luttes. Mais avec l'aggravation irrémédiable de la crise économique et du fait que, contrairement à 1929, la classe d'aujourd'hui n'a pas été battue, ces conditions qui ont permis momentanément à la classe dominante de rétablir son emprise sur la classe ouvrière vont tendre à s'épuiser.
En effet, avec l'approfondissement de la crise et l'aggravation violente qu'elle suppose contre les conditions de vie du prolétariat, celui-ci sera contraint de nouveau à réagir quelles que soient les mystifications qui peuvent aujourd'hui encombrer sa conscience. Cette réaction va contraindre la gauche et ses rabatteurs gauchistes à se démasquer un peu plus là où ce n'est pas encore le cas.
Son accession à la tête de l'Etat rendue de plus en plus indispensable va probablement constituer, dans un premier temps, un facteur supplémentaire de temporisation. Mais en même temps, vont se mettre en place les conditions permettant au prolétariat de comprendre la seule issue de sa lutte : l'affrontement direct avec l'Etat capitaliste. Enfin, l'accumulation des expériences de la classe lui permettra de se doter des moyens de tirer les leçons de celles-ci, la démoralisation et les mystifications antérieurement subies se transformant dès lors en éléments supplémentaires de combativité et de prise de conscience.
Pour l'heure, les manœuvres mystificatrices déployées par la bourgeoisie portent encore leurs fruits et le rôle des révolutionnaires est de continuer à les dénoncer avec la plus grande énergie, plus particulièrement celles promues par les courants "gauchistes". Mais l'existence même du décalage présent entre le niveau de la crise et celui de la classe met à l'ordre du jour des resurgissements importants de cette dernière et qui tendront à combler ce décalage. Le calme relatif de la classe alors que la crise portait des coups de plus en plus violents, particulièrement en 1974-75, et qui l'ont comme étourdie dans un premier temps, ne saurait être interprété comme une inversion de la tendance générale de la reprise des luttes apparue à la fin des années 60. Le calme actuel est comme celui qui précède les tempêtes. Après un premier assaut à la fin des années 60 et au début des années 70, la classe ouvrière est en train, de façon souvent encore inconsciente, de préparer et concentrer ses forces pour un deuxième assaut. Les révolutionnaires doivent miser sur ce prochain assaut afin de ne pas être surpris par lui et être en mesure d'assumer pleinement leur fonction au sein des combats qui se préparent.
31/10/76
L'ACCELERATION DE LA CRISE ECONOMIQUE
"Il semble heureusement que, cette fois, le danger sera évité. La reprise a pris corps et s'est généralisée au premier semestre de 1976, et le chômage, qui avait atteint l'un de ses maxima d'après-guerre, a amorcé une baisse dans certains pays..." (Perspectives de l'OCDE, juin 76)
Quelques mois auront suffi pour balayer les prédictions optimistes de l'OCDE. Pour la première fois depuis la récession de 1974-75, les bourses de New York, Londres et Paris ont connu leurs cours les plus bas. Traduisant le profond scepticisme de la bourgeoisie quant à la profondeur de la "reprise", celle de Paris connaissait son "mardi noir" le 12 octobre avec une baisse moyenne de 3 % le même jour sur toutes les valeurs. Ce même mois, et le même jour, l'Espagne, le Portugal, l'Italie prenaient les mesures les plus draconiennes de leur histoire : hausse des produits courants, blocage des prix et des salaires, mesures protectionnistes de blocage des importations. Il est vrai que la France les avait déjà précédés dans cette voie, à un niveau plus faible, avec le "plan Barre". Simultanément, et le même mois, le franc, la livre, la lire continuaient leur lente descente aux enfers. "La reprise s'essouffle", pouvait conclure laconiquement le Monde du 5 octobre.
L'ESSOUFFLEMENT DE LA "REPRISE"
Avant d'examiner les phénomènes et la nature de la "reprise", il faut tout d'abord rappeler la situation de l'économie mondiale en 1975. Selon la Banque des Règlements Internationaux, l'expansion du commerce mondial a représenté cette année 35 milliards de dollars, c'est-à-dire le huitième du chiffre de 1974, la contraction du marché mondial la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale.
La paralysie des échanges qui traduit celle de l'appareil de production trop développé pour un marché mondial saturé de marchandises non réalisées se concrétise par un déclin de 10 % du volume du commerce international.
En août 75, et sur une année, la chute de la production industrielle était la suivante : USA : -12,5% ; Japon : - 14 % ; RFA : - 12 % ; France : - 9% ; Grande-Bretagne : - 6% ; Italie: - 12,2 %. Corrélativement, l'indice du cours mondial des métaux (base 100 en 1970) passait de 245,8 en mai 74 à 111,5 en juillet 75. Traduisant la contradiction irréductible entre les rapports de production et les forces productives, le chômage atteignait le chiffre record de 23 millions de chômeurs pour l'ensemble des pays de l'OCDE au milieu de l'année 75.
LES PHENOMENES DE LA "REPRISE"
Commencée au dernier trimestre 1975, la "reprise" trouve essentiellement sa cause dans le mouvement purement conjoncturel de restockage pendant 1975. Cet aspect artificiel de la "reprise" est souligné par le fait que "la constitution des stocks aura sans doute contribué cette année pour 1,75 % environ à l'expansion de la production en termes réels, alors que son rôle avait été négligeable à cet égard pendant les reprises de 1968 et 1972" ("Perspectives économiques" de l'OCDE).
Quels sont les résultats de cette opération "technique" ?
Toujours selon l'OCDE, dont les ministres se sont réunis en juin dernier à Paris : "l'expansion rapide que connaissent les Etats-Unis depuis le milieu de 1975 a donné une forte impulsion à la reprise dans d'autres pays, notamment au Japon. Le niveau de la production industrielle de la zone de l'OCDE est maintenant proche de son maximum des derniers mois de 1973. Le taux de chômage qui avait atteint quelque 5,50 % de la population active vers la fin de 1975 est maintenant descendu aux environs de 5 % de la population active, cette baisse reflétant essentiellement l'amélioration de la situation aux Etats-Unis. Au Japon et en Europe, le chômage partiel a nettement reculé mais le nombre de chômeurs est resté élevé".
Là aussi, ces optimistes prédictions devaient se trouver démenties par la réalité un mois plus tard
"L'infléchissement déjà observé en mai et juin se transforme maintenant en ralentissement et fait même craindre une chute précoce de l'activité économique. Les courbes de la croissance industrielle de la France et de l'Allemagne déclinent beaucoup plus qu'on aurait pu le prévoir il y a quelques mois. 5% par an de croissance, c'est peu pour un régime de croisière qui devrait normalement se situer à 7 ou 8%. L'Italie où la reprise est plus récente voit elle aussi sa courbe redescendre, bien que le rythme y reste encore élevé (18 %). Ne parlons pas de la Grande-Bretagne où l'essoufflement a suivi presque immédiatement le premier effort sérieux."
Quant aux deux géants économiques (USA et Japon), ils ont connu depuis le troisième trimestre 76 - moins marqué en raison de leur puissance économique - le même rythme de ... décroissance :
"Au Japon, le redémarrage a été tardif mais foudroyant : de 2 % à peine en novembre, le rythme est passé à près de 30 % en avril... En juin-juillet, le rythme n'y est plus que de 9 %. Seule, la courbe de croissance industrielle des Etats-Unis présente une forme différente, moins abrupte et plus rassurante : après un sommet de 18 % en septembre-octobre, le rythme a diminué pour atteindre 6 % au début de 76, puis il s'est stabilisé à 7 % en juin-juillet". (Le Monde, 5 octobre 1976)
Quant à la diminution du chômage présentée comme la grande victoire de la "reprise", elle est essentiellement le fait des USA où les effectifs de travail ont augmenté de 1.8 millions depuis le début de 1976 ([1] [1]). Au contraire, en Europe, non seulement le chiffre de chômeurs est resté identique en France. Italie et même RFA, mais il a crû en Grande-Bretagne au point d'atteindre le chiffre record de 6,4% de la population active.
C'est cette extrême modération de la reprise qui explique le recul de l'inflation pour les prix de gros et des matières premières (à l'exception des prix de détail toujours en hausse) : comme en 75, a commencé un mouvement de baisse des cours des métaux depuis juillet-août, qui s'explique par l'arrêt des achats (particulièrement ceux du Japon). De fait, le recul de l'inflation présenté par les économistes du capital comme l'amorce de la "reprise" traduit en réalité la rechute dans la crise.
LES MECANISMES DE LA "REPRISE"
Contrairement aux "reprises" qui avaient suivi les récessions de 67-68 et 71, celle du premier semestre 76 se caractérise par sa nature sectorielle et non généralisée. La relance de la production, loin de se manifester par l'essor des investissements en capital fixe (comme cela avait été le cas dans les précédentes "reprises" par une politique d'hyper inflation) émane avant tout des achats en biens durables (automobiles, électroménager, etc.), à quoi il faut ajouter les dépenses en services (Sécurité Sociale, travaux publics, logements). Il s'agit, en fait, purement et simplement de dépenses de rattrapage (usure des biens durables et d'équipements publics). Comme le constate l'OCDE, à propos de la France :
"La demande émanant du secteur public et la consommation privée ont constitué les éléments moteurs de cette reprise. Elles ont été ensuite relayées par la demande extérieure et le retournement du cycle des stocks. La progression extrêmement vive de la demande des ménages a été stimulée par les mesures de relance de l'automne dernier, et a pris essentiellement la forme d'un rattrapage dans les achats de biens durables qui avaient été différés depuis le milieu de 1974."
Contrairement à ce que prétendent les descendants du professeur Dühring en la personne de la gauche et des gauchistes, la relance de la production par la consommation est plus que jamais un pur mensonge, non seulement parce que la survie même du capital implique une croissance plus rapide du secteur l (production) sur le secteur II des biens de consommation mais parce que la croissance du premier secteur implique la nécessaire décroissance relative ou absolue du second, contradiction qui est la base même du système capitaliste. De fait, il ne peut y avoir d'essor de la consommation qu'en fonction d'une croissance massive et durable de la production répondant à l'existence de marchés solvables ; cet essor étant purement relatif et conjoncturel. De fait, les crises du capital décadent s'accompagnent non seulement d'une diminution de la consommation relative mais d'une diminution absolue de celle-ci. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui que des millions d'ouvriers sont rejetés de la production tandis que la masse du prolétariat subit une diminution de plus en plus accélérée de son salaire et nominal, et réel.
C'est pourquoi la demande en biens de consommation qui s'est manifestée est essentiellement une demande de "rattrapage" correspondant à l'usure de biens durables nécessaires à l'entretien de la force de travail.
De fait, on voit toute la faillite du maintien du niveau de consommation pour une fraction de plus en plus restreinte de la population en ce que même cette politique dite de "relance", non seulement n'a pas empêché la décroissance de la production pour l'ensemble des pays capitalistes, mais s'est accompagnée d'une relance réelle et exacerbée de l'inflation, par une politique systématique d'endettements et de déficits budgétaires. Ainsi, l'augmentation du volume des échanges au cours du premier semestre 76 a entraîné une accélération du déficit courant de l'OCDE qui est passé d'environ 6 milliards de dollars en 75 à quelque 20 milliards de dollars (taux annuel) au cours de ce premier semestre.
Face au pessimisme grandissant de la bourgeoisie, les gouvernements ont pris toutes sortes de mesures en vue d'encourager les investissements à la production : depuis les crédits d'impôts, les subventions pour l'investissement, jusqu'aux amortissements accélérés. Ainsi, le gouvernement français a institué fin 75 des a11ègements fiscaux en faveur des entreprises représentant 10 % de la valeur des commandes de biens d'équipement passées entre le 1er mai 75 et le 7 janvier 76. Quand les gouvernements se trouvent dans une situation de semi-banqueroute sur le plan financier, ils font appel massivement à l'endettement extérieur : 1 milliard de dollars, prêt de l'OCDE à l'Italie ; il en a été de même en Grande-Bretagne et au Portugal où les banques centrales ont soutenu à bout de bras l'économie défaillante de ces pays. Mais, comme le notait The Economist, récemment : "Les banquiers sont maintenant inquiets sur "le sort de ces prêts, mais ils ont permis que "le commerce continue à fonctionner". On ne peut être plus clair : la survie à crédit, ou la mort subite du système !
Cette survie "à crédit" est encore plus nette dans les soi-disant pays "socialistes", où la dette de l'ensemble des pays du bloc russe à l'égard de l'occident se chiffre maintenant à 35 milliards de dollars. Pour certains, la situation est si grave qu'ils demandent déjà un moratoire ; la Corée du Nord a même cessé de payer le service de sa dette qui s'élève à quelque 1,5 milliard de dollars. La situation est identique dans les pays arriérés non pétroliers où le déficit de la balance courante atteint maintenant le chiffre tout aussi vertigineux de 37 milliards de dollars. Face à une telle situation, les banquiers et les Etats occidentaux ont alors décidé de restreindre leurs prêts aux pays de l'est ; dans les pays de leur bloc, ceux-ci, comme en Italie ou en Grande-Bretagne, sont assortis de toutes sortes de conditions qui brisent toute velléité "d'indépendance nationale" et ne seront plus accordés qu'en fonction de la nécessité de sauvegarder la cohésion de leur bloc. L'URSS n'a accordé de nouveaux crédits que sous la condition d'un contrôle plus strict de sa politique extérieure.
A travers la croissance des déficits budgétaires et de la dette extérieure, on assiste à une intervention de plus en plus accélérée de l'Etat. C'est lui qui est le véritable moteur de la "relance", faute d'une relance véritable par des marchés, lesquels ont continué à stagner et même à décroître (l'évo1ution des parts de marché des sept grands pays de l'OCDE a encore décru en 76, à la seule exception du Japon et de la RFA). Devant cette situation, les Etats ont mis au point un système d'encouragement à l'exportation par un jeu de primes ou de dégrèvement des impôts sur les bénéfices, ce qui a notablement encouragé les pays exportateurs comme le Japon ou la RFA à accroître notablement la part de leurs exportations dans leur commerce global.
BRIEVETE DES "REPRISES"
L'un des indices les plus probants du caractère permanent de la crise générale du système depuis 67 est le raccourcissement des phases de reprise. La crise de 67-68 est suivie de deux ans de reprise ; celle de 71 d'un an et demi de reprise. La reprise de 76 n'aura duré qu'un peu plus de six mois. On voit par contre se manifester un rallongement des phases de récession : un an en 67 et 71 ; presque deux ans en 74-75. On a donc des phases de reprise de plus en plus brèves jusqu'au point où elles deviennent inexistantes tandis que les phases de récession, en devenant de plus en plus longues, tendent à devenir permanentes.
On voit ici toute la vanité de prétendues explications marxistes (telle celle de "Programme Communiste" n° 67) qui croient déceler encore des cycles de croissance et de récession dans le capitalisme décadent. L'existence de cycles qui se vérifiait au XIXème siècle parce que les récessions ouvraient la voie à une expansion élargie sur un marché mondial encore en friche pour le capital ne peut plus être observée sous le capitalisme en déclin.
Dans cette période d'ascension continue du mode de production capitaliste, où il prend sa forme moderne de capital industriel, la constitution des cycles est la manifestation de la croissance organique du système. Les cycles d'expansion et de récession expriment alors de façon matérielle le développement contradictoire d'un système se heurtant aux limitations du marché national dans son cadre de vie déjà mondial. Non limité encore par l'achèvement de la conquête du marché mondial, le capital connaît des crises qui sont essentiellement d'adaptation, quand la croissance de la production tend à être plus rapide que celle du marché, ou quand la révolution technique incessante impose des déplacements de plus en plus rapides des capitaux dans les nouvelles branches de la production. Les crises étaient donc le moteur de nouveaux cycles de la production, toujours plus élargis à l'échelle du marché mondial. L'observation de phases périodiques de récession ou de stagnation aussi régulières que les marées, et généralement courtes, trouvait sa cause de moins en moins dans le poids des déterminismes agricoles et climatiques (crise de 1847, par exemple) que dans la faiblesse momentanée du secteur universel de la croissance de la production : le capital sous sa forme de monnaie (or et crédit). Les phases longues de dépression, toutes relatives, telle celle de 1873 à 1896, trouvaient leur origine dans le surgissement de capitaux plus modernes (Etats-Unis, Allemagne) venant concurrencer les vieux pays capitalistes (Grande-Bretagne, France) et étaient donc plus locales qu'internationales. Il s'agissait de paliers dans la phase générale d'expansion internationale du système. Quant aux crises qui éclataient à la charnière de ces cycles, elles devenaient de moins en moins fréquentes mais de plus en plus fortes (1873), à la mesure de l'extension colossale du système lui-même.
Ce qui était des cycles naturels de vie d'un système en pleine croissance n'est plus aujourd’hui que de simples convulsions, des spasmes de plus en plus rapides et rapprochés. Seuls, les mécanismes mis en place par la bourgeoisie depuis 29 sont en mesure - et de plus en plus faiblement, exactement comme un frein qui perd sa force d'avoir été trop utilisé - d'adoucir la violence croissante des convulsions. Estimer malgré cela que la bourgeoisie serait à même déclencher à volonté "reprises" et booms avant de retomber dans une nouvelle crise, c'est croire que la bourgeoisie est à même de surmonter ses contradictions aujourd'hui mortelles indéfiniment dans le temps :
"Le cycle mondial que nous avons observé de 1971 à 1975 a une période moyenne d'environ 4 à 5 ans... Dans cette hypothèse, la reprise lente au début devrait s'accélérer vers 1977 par le jeu de simultanéité du cycle économique et de l'entraînement mutuel des économies ; cette reprise devrait être d'autant plus forte que la baisse a été plus profonde et faire place vers 1978 à un nouveau boom productif". ("Programme Communiste", n° 67)
La reprise de la crise actuelle et la banqueroute dans laquelle glisse lentement l'ensemble de l'Europe après les pays du Tiers monde se sont chargées de balayer de telles jongleries pseudo-dia1ectiques sur les cyc1es "naturels" du capitalisme en décadence. On peut mettre en parallèle la vision trotskiste - et cette convergence n'est pas le fait du hasard - d'un E. Mandel : celui-ci croit déceler dans la crise de 1967-68 une "nouvelle onde longue à tonalité stagnante", voire le "résultat d'un mouvement cyclique traditionnel (septennal, décennal ou quinquennal)". Bref, les augures bordiguistes et trotskistes sont des oiseaux de bon augure pour le capitalisme agonisant, auquel ils donnent les vertus de l'immortalité.
LA "REPRISE" EST INEGALE
Les récessions dans la période de reconstruction des années 50 avaient une origine purement conjoncturelle (inégalité de la reconstruction selon les pays, poids des guerres coloniales, etc.) ; c'est pourquoi la reprise était générale et se poursuivait avec autant de régularité que de force.
Depuis l'ouverture de la phase de crise générale du capitalisme en 67, l'inverse s'est produit. La récession est devenue la règle, la reprise l'exception. De générale au niveau du monde, la reprise de 69-70 ne touche plus aujourd’hui que les pays les plus puissants économiquement, essentiellement les impérialismes dominants qui rejettent les effets de la crise sur leur zone d'influence, comme les USA ou l'URSS, qui ont bénéficié momentanément de la reprise par leur emprise renforcée sur leur propre bloc. En réalité, seuls trois pays ont connu une réelle reprise de leur production et de leur commerce extérieur : les Etats-Unis, l'Allemagne Fédérale et surtout le Japon. La fameuse "reprise" a vu en effet la chute de trois des plus grandes puissances capitalistes : l'Italie, la Grande-Bretagne, la France.
Au bout du compte, seuls les Etats-Unis sont plus à même par leur puissance à résister à la concurrence exacerbée de la RFA et du Japon, par tout un jeu de changes flottants du dollar et une série de mesures protectionnistes accompagnés de pressions politiques sur ses alliés. La faiblesse du Japon et de la RFA, dont la production dépend du maintien et même de l'accélération de leurs exportations, laisse voir, alors que les USA voient déjà leur production industrielle décliner au dernier trimestre 76 et leur chômage reprendre, qu'après avoir été internationaux en 69-70 et 72-73, les mouvements de "reprise" deviennent inégaux et purement locaux. On peut dire que, lorsqu'ils se manifestent localement, de plus en plus dans deux ou trois nations, ils prennent une forme négative, puisque la "reprise" de la production est une chute plus ralentie dans la récession, et relative, puisque la condition de cette reprise locale est l'accélération de la décomposition des économies concurrentes les plus faibles. Et, dans cette décomposition générale, ce que la bourgeoisie nomme "reprise" n'est plus qu'une capacité plus forte de freiner la chute libre de l'économie des pays les plus forts économiquement et ne correspond plus à un essor de la production industrielle et du commerce mondiaux. Dans cette nouvelle crise mortelle du capitalisme mondial, il ne peut plus y avoir d'alternance des cycles comme en phase ascendante : il n'existe qu'un seul cycle, celui de la crise permanente qui mène soit à la guerre, soit à la révolution.
Examinons plus en détail quelles mesures essayent de mettre en place le capital au niveau national et international pour freiner la décomposition rapide de l'économie.
LES "SOLUTIONS" DE LA BOURGEOISIE : EXPORTER PLUS
De l'est à l'ouest, c'est la solution miracle. En particulier, c'est la seule qui s'offre aux capitaux les plus faibles, en raison de la médiocrité de leur marché intérieur. Par exemple, en Pologne les exportations ont progressé de 30% en 1975, assurant l'essentiel du maintien du PNB. Pour l'ensemble des pays de l'est, les exportations vers la zone OCDE ont progressé de 22 % en 1970 à 30 % en 1975. Il en est de même pour l'Italie et la Grande-Bretagne où des dévaluations successives leur ont permis d'accroître le volume et la valeur de leurs exportations.
Malgré toute l'aide apportée par les différents Etats aux entreprises exportatrices, un nombre infiniment plus restreint de pays a profité de quelques mois de "reprise" par rapport à 72. Il s'agit essentiellement des pays où la productivité du travail s'est élevée notablement ou maintenu au niveau antérieur, tandis que diminuait le salaire réel des ouvriers. Cela est particulièrement vrai pour les trois grandes puissances commerciales mondiales : Japon. RFA et USA. On peut le constater au travers de l'évolution des coûts unitaires de main d'œuvre dans les industries manufacturières :
C'est grâce à sa plus grande compétitivité que le capital japonais a pu notablement améliorer ses positions au détriment des USA en devenant le premier exportateur d'acier, en s’implantant solidement en Amérique latine et en Europe dans le domaine de l'automobile et de l'électronique. Il en a été de même dans une moindre mesure pour la RFA et les USA. Néanmoins, le fait que ce maintien des exportations des capitaux les plus forts s'est opéré aux dépens des autres capitaux qui deviennent ainsi des marchés de moins en moins solvables pour les premiers entraîne en fait une diminution des marchés globaux.
La première contradiction de cette "solution" du capital se révèle aujourd'hui sous son jour le plus cru, dans l'exportation massive de capitaux. Celle-ci a pris des proportions inconnues : les investissements de la RFA et du Japon hors de leur cadre national se sont multipliés par sept depuis 1967. Ce qu'on a appelé les "multinationales" qui investissent de plus en plus hors de leurs pays d'origine, exprime en réalité le besoin du capital à réduire ses coûts de production : par une diminution de la part du capital variable incluse dans le prix de la marchandise. Cela ne peut se faire que là où le coût de la force de travail se situe en dessous de la moyenne des pays développés et où la production de marchandises ne nécessite qu'un travail simple. L'installation d'unités de production déversant les marchandises à coût inférieur sur le marché mondial ne fait que renforcer la concurrence qu'elle essayait de surmonter : selon la Far Eastern Review (15/10/76) l'implantation d'usines de montage électronique japonaises à Singapour, en Corée du Sud, a entraîné en retour une concurrence accrue sur le marché national japonais des appareils à transistors. Il en est de même jusque dans la plus grande puissance capitaliste où, en raison depuis trois ans du moindre coût salarial des ouvriers américains ([2] [2]), les succursales des multinationales européennes et japonaises prennent déjà le 1/4 des exportations américaines avec un coût d'investissement moitié moindre qu'en 1970 (Neue Zürcher Zeitung, 29 juin 76).
Cette recherche de la diminution du coût des investissements sur le marché extérieur s'est accompagnée en retour de la chute des investissements dans les grands pays industriels.
C'est pourquoi la deuxième contradiction, symétrique de la première, qui se manifeste de plus en plus au sein des pays industrialisés est la nécessité de continuer à investir productivement afin de conserver un minimum de modernisation des installations, condition même du maintien de la compétitivité des marchandises exportées. De fait les mesures de restrictions budgétaires prises et la diminution massive des profits pour le capital entraînent une diminution croissante des investissements productifs et de la recherche technique au fur et à mesure même que les marchés se réduisent :
"La faible propension à investir que l'on observe depuis des années aux USA a eu pour résultat un phénomène de vieillissement de l'appareil de production beaucoup plus rapide qu'au Japon et en RFA. Alors qu'en RFA en 1975 moins de 50% du potentiel industriel avait onze ans d'âge et plus, aux USA cette proportion était de 85% ; dans des secteurs importants tels que l'acier, le papier, l'automobile, on ne trouve plus la moindre trace d'innovation". (Der Spiegel, 29 mars 1976)
Ce qui est déjà vrai aux USA (et encore plus en Grande-Bretagne) ne fait que se répéter à une plus grande échelle dans les pays les plus faibles. Les pays qui, comme l'URSS ou la Pologne, malgré la faiblesse de leur accumulation, ou plutôt en raison de celle-ci, tentent de moderniser leur appareil de production par des investissements opérés aux prix d'un endettement extérieur systématique ne font à long terme que grever leurs marchandises du poids de plus en plus lourd de la dette extérieure. Faute de positions sur le marché mondial, ils ne font qu'accélérer leur banqueroute (et aussi celle des Etats emprunteurs qui seront à la longue dans l'incapacité de recouvrir leurs prêts).
C'est pourquoi les seuls investissements possibles sont ceux que les capitalistes appellent cyniquement de "rationalité". Nous verrons plus loin comment ceux-ci se sont manifestés sous forme d'extension du chômage et d'une exploitation accrue de la classe ouvrière.
Ainsi donc, ce que la bourgeoisie se plaît à nommer "pénurie des capitaux" ne fait que traduire l'impuissance croissante du capital, à l'est comme à l'ouest, à trouver de nouveaux débouchés. Développer l'appareil productif pour une réalisation du capital de plus en plus restreinte devient de plus en plus absurde dans le cadre du système.
Aujourd'hui, seuls les capitalismes les plus développés sont à même de freiner la chute de leurs investissements pour maintenir leurs positions antérieures et cela au prix de la destruction des capitaux les plus faibles entraînant un nouveau rétrécissement des marchés solvables.
RETOUR AUX MESURES PROTECTIONNISTES
La fin de la "reprise" remet à l'ordre du jour les vieilles recettes de la bourgeoisie en crise. Compte tenu de la situation de banqueroute qui se manifeste par une balance négative de l'ensemble des pays de l'est, des pays du Tiers-monde comme de l'OCDE (à l'exception pour le moment de la RFA et du Japon), chaque Etat essaie de protéger son marché intérieur de la concurrence par des restrictions des importations de marchandises.
Ces derniers mois, la libre circulation des produits au sein de la CEE a vécu. Récemment, la France a décidé le blocage des prix de revente des importateurs jusqu'au 31 décembre, pour lutter contre la concurrence allemande. Depuis le printemps dernier, l'Italie a institué un dépôt obligatoire de 50 % sur les importations. Pour lutter contre la concurrence japonaise, la Grande-Bretagne parle d'instituer des contingentements supplémentaires. De façon générale, tous les plans anti-inflation adopté ces dernières semaines en Europe auront pour effet de restreindre les échanges extérieurs. La CEE envisage que les échanges au sein de la Communauté passeront en valeur de 13 à 10% d'ici un an.
Dans les pays de l'est, on commence à observer la même tendance puisque par exemple, le plan quinquennal hongrois 76-80 prévoit une diminution des importations, tant du Comecon que de l'OCDE : respectivement de 9,9% par an à 6,5% et de 8,3% à 6,5% (Courrier des Pays de l'est, mai 76).
Aux USA, le paradis du "libre échange", le gouvernement a décidé en juin d'imposer un contingentement sur les importations d'acier (aciers spéciaux et aciers inoxydables). La récente imposition de quotas à l'importation d'acier, ainsi que les nombreuses enquêtes antidumping touchant les télévisions japonaises, les chaussures et l'automobile, s'inscrivent dans cette même tendance au retour à une certaine autarcie.
Néanmoins de telles mesures extrêmes ne peuvent être prises que dans des limites bien définies, compte tenu :
- d'une division internationale du travail et d'une interpénétration ou plutôt interdépendance des capitaux plus grandes que par le passé ;
- du renforcement des blocs qui exige un minimum de stabilité économique, la banqueroute d'un pays donné sous les coups de mesures protectionnistes trop brutales pouvant entraîner la banqueroute des autres économies par un effet de réaction en chaîne ;
- des leçons qu'a tirées la bourgeoisie à la suite de la crise de 29 de l'effet catastrophique d'un retour brutal des économies nationales à l'autarcie ;
- du développement de la lutte de classe depuis 68 qui impose à la bourgeoisie une certaine prudence dans la limitation des importations de biens de consommation courante (cf., par exemple, les leçons qu'a tirées la bourgeoisie polonaise à la suite des émeutes des ouvriers polonais en 70).
Il est donc à prévoir que pendant une période encore on va voir ces mesures protectionnistes s'accompagner de marchandages sur les quotas d'exportation et de "compensations mutuelles" ([3] [3]). Cependant, la limitation graduelle des échanges ne peut que reporter le krach inévitable de l'économie mondiale à une échelle beaucoup plus élargie. D'autre part les "aides" massives accordées par les banques centrales aux économies défaillantes, en déclenchant de nouvelles vagues d'hyperinflation risquent à plus ou moins long terme de déclencher une banqueroute financière généralisée à mesure que la permanence de la crise entraîne des mouvements de panique au sein de la bourgeoisie de plus en plus incontrôlables.
CAPITALISME D'ETAT ET AUSTERITE
Toutes les mesures de "re1ance" prises par les différents Etats nationaux, ainsi que la part de plus en plus importante prise par l'Etat pour favoriser les exportations et freiner les importations sur le marché déclinant national, s'inscrivent tout naturellement dans la prise en charge de l'ensemble de l'économie par l'appareil étatique, ultime béquille du système.
La tendance au capitalisme d'Etat qui a abouti dans les pays de l'est et dans la plupart des pays du tiers monde à un contrôle total de l'économie (Pérou, Algérie, Chine, etc.), dans tous les pays où le capitalisme se trouve dans un état de débilité et de stagnation endémiques, s'est considérablement accrue ces dernières années dans les pays où l'économie se trouvait en situation de force sur le marché mondial. La venue de la gauche au pouvoir en Europe, afin de prendre des mesures de nationalisations permettant de contrôler l'ensemble de l'économie par un appareil centralisé se montre de plus en plus inévitable dans les mois à venir. L'apparition répétée de "scandales" dans l'ensemble des pays d'Occident peut être interprétée comme des pressions de plus en plus intenses d'une fraction croissante de la bourgeoisie sur les secteurs les plus rétrogrades ou les plus développés du capital afin de se plier à la nécessité d'un contrôle de plus en plus énergique des grandes sociétés capitalistes par l'Etat. Là où le capital est traditionnellement le plus puissant (Japon, USA), cette tendance s'exerce essentiellement par des mouvements de plus en plus rapides de concentration, largement favorisés par l'Etat au moyen "d'aides" diverses. Ainsi, aux USA même, rien qu'entre janvier et avril 76, le nombre des fusions est monté à 264, soit 40% de plus que durant la même période en 1975. Aux USA encore, une fraction croissante de la classe capitaliste n'hésite plus à envisager comme une très forte probabilité la planification de l'économie. En avril 76, le président de la Commission des voies et des moyens de la Chambre des représentants devait déclarer :
"L'expression "planification économique" est considérée dans certains milieux comme un drapeau rouge que l'on déploie face à l'entreprise privée et évoque l'image de commissaires soviétiques ; il serait absurde qu'un gouvernement puisse planifier dans tous ses détails le système complexe de l'offre et de la demande, mais il le serait encore plus de prétendre que le gouvernement n'a aucune responsabilité dans la prévision et qu'il n'a pas à prendre de mesures intelligentes pour éviter les dangers et même le désastre." (Cité par Hiscox : "Analyse de la crise aux Etats-Unis", Critique de l'économie politique, n°24-25)
Même dans les pays de capitalisme d'Etat, cette tendance se poursuit par la mise en route de plans tendant, comme en Russie, à liquider la petite propriété paysanne et à regrouper les terres dans des complexes agro-industriels, après les catastrophes agricoles successives. C'est ainsi que le CC du PCUS a fait paraître un arrêté en date du 2 juin 76 sur le "développement de la spécialisation et de la concentration agricoles sur la base de la coopération interentreprises et de l'intégration agro-industrielle" qui va dans ce sens (cf. Courrier des pays de l'est, juillet-août 76). De même, ces dernières années la fusion du capital par des concentrations horizontales et verticales s'est particulièrement accélérée : cette fusion du capital avec l'Etat rendue plus étroite par ces mesures a permis en 1976 le développement des unions industrielles regroupant des entreprises jadis autonomes (leur nombre monte maintenant à 2300, d'après le discours de Kossyguine au XXVème congrès du PCUS).
Ces mesures de "rationalisation" de l'économie face à la crise s'accompagnent de mesures d'austérité sans précédent tendant à rendre "bon marché" pour l'accumulation un Etat lourdement paralysé par des déficits budgétaires de plus en plus vertigineux. En 1975, conséquences des mesures de relance après la récession, ils atteignaient des sommets jusqu'ici inconnus : 70 milliards de dollars aux USA ; 35 milliards de dollars en RFA ; 10 milliards au Japon, etc.
Avec la fin de la reprise, l'OCDE prévoit et conseille (!) à ses membres de réduire les déficits budgétaires, qui selon elle devait régulièrement se réduire dès 1977. Cela vise plus particulièrement "les services" (sécurité sociale dont les cotisations sont partout relevées) faisant partie des salaires des ouvriers. A New York, les mesures de "rationalisation" des services municipaux se sont soldées le 1er juillet 76 par la suppression de 36.000 emplois, tandis que dans d'autres grandes villes étaient décidés des licenciements massifs, un accroissement des impôts et une réduction draconienne de l'aide sociale. De même, de la France à l'Italie en passant par la Pologne, sont prises des mesures de blocages de salaires accompagnées d'augmentations d'impôts ; en Pologne, le gouvernement a décidé d'office de prélever une part des dépôts des caisses d'épargne pour subventionner la construction de logements.
PAUPERISATION CROISSANTE DU PROLETARIAT
Ces dernières années ont vu croître notablement le taux d'exploitation du prolétariat par un développement convulsif de la productivité, pour les ouvriers conservant leur poste de travail. A cette augmentation du taux d'exploitation par l'extraction de la plus-value relative s'est ajoutée l'exploitation absolue par l'augmentation des heures travaillées supplémentaires.
A cette paupérisation relative du prolétariat, permanente à chaque instant de l'existence du système capitaliste, s'est cumulée l'extension croissante de la paupérisation absolue. Niée hier par les réformistes quand les crises cycliques s'abattaient sur la grande masse du prolétariat et aujourd'hui par la gauche du capital alors que la crise est devenue permanente, elle a fini par toucher l'ensemble de la classe. Limitée pendant la période de reconstruction aux pays du Tiers-monde et de l'est européen, elle englobe aujourd'hui l'immense masse du prolétariat mondial :
- sous la forme d'un chômage constant depuis plusieurs années qui touche maintenant pour l'OCDE 20 millions d'ouvriers, pour les pays du Tiers-monde au moins 20 % de la population active et pour les pays de l'est, où il est souvent dissimulé par les camps de travail, quand il n'est pas officiellement reconnu (il y avait 600.000 chômeurs en Pologne avant les évènements de 1970, selon Contemporary Po1and, septembre 71). De plus en plus, cette masse immense de chômeurs tend à atteindre le seuil de misère physiologique à mesure que les gouvernements diminuent leurs aides (déjà misérables) aux sans-travail. Si ce seuil de misère physiologique varie en fonction des pays (salaire historique des différentes classes ouvrières) quantitativement, qualitativement il tend à être atteint ou même franchi (comme le montre d'ailleurs les enquêtes de l'OCDE sur la "pauvreté") dans l'ensemble du monde capitaliste touché par la crise. 80 % des chômeurs frappés par la crise n'ont pu retrouver un travail fixe pendant la "reprise", essayant plus ou moins de vivre par le travail "au noir". Ceci devient déjà de moins en moins possible. La classe capitaliste parle non seulement de diminuer son "aide sociale" mais de créer des chantiers de travail. En Belgique, par exemple, le ministre du travail a projeté de contraindre les chômeurs à trois journées de travail gratuit par semaine sous peine de suppression immédiate de ces "aides".
- sous la forme de la diminution du salaire réel qui se manifeste tant dans la diminution des prestations de services (allocations familiales, sécurité sociale, etc.) que dans la décroissance du pouvoir d'achat atteint de plus en plus lourdement par l'inflation galopante. Les statistiques officielles du Département of Commerce révèle que le salaire réel moyen des salariés ayant du travail a baissé de plus de 10 % entre 1972 et 1975 aux USA mêmes. Toujours selon les statistiques officielles des ministères du travail ou patronales, on peut calculer qu'en France, au Japon, en Grande-Bretagne, en moins d'un an, de 1974 à 1975, le salaire réel a chuté en moyenne de plus de 6%. Cette chute s'est montrée plus ou moins forte dans les différents pays touchés par la crise en fonction de la résistance plus ou moins forte de la classe ouvrière aux attaques massives du capital ; par exemple, en Pologne, c'est tout récemment que les ouvriers viennent de subir des réductions massives de leur salaire réel, alors que l'insurrection de 1970 avait contraint le gouvernement polonais à s'endetter massivement auprès des USA et de l'URSS afin de mouiller la poudre par une hausse nominale de 40% des salaires en cinq ans ( Le Monde Diplomatique, octobre 1976), ce qui explique en grande partie la situation de banqueroute du capital polonais aujourd'hui qui comprend que "produire plus" signifie "consommer moins".
Cette situation d'aggravation des conditions de vie de la classe ouvrière n'a fait d'ailleurs que s'aggraver avec la "reprise" qui s'est accompagnée de blocages de salaires, alors que l'inflation se faisait toujours plus convulsive avec les techniques de "relance" mises en œuvre. Tout le mensonge de la "reprise" tient là.
Le retour de la paupérisation absolue qu'on croyait définitivement bannie "des sociétés industrielles" donne aujourd'hui tout son sens à l'analyse de Rosa Luxembourg faite il y a presque 70 ans :
"Les couches les plus basses de miséreux et de réprouvés qui ne sont que faiblement ou pas du tout employées ne sont pas un rebut qui ne compterait pas dans la société "officielle", comme bien entendu la bourgeoisie les présente ; elles sont liées par des liens intimes à la couche supérieure des ouvriers d'industrie les mieux situés, au travers de tous les membres intermédiaires de l'armée de réserve. L'existence des couches les plus basses du prolétariat est régie par les mêmes lois de la production capitaliste qui la gonflent ou la réduisent et le prolétariat ne forme un tout organique, une classe sociale dont les degrés de misère et d'oppression permettent de saisir la loi capitaliste des salaires dans son ensemble que si on englobe les ouvriers ruraux et l'armée de réserve de chômeurs avec toutes ses couches, depuis la plus haute jusqu'aux plus basses."
(Rosa Luxembourg, "Introduction à l'économie politique")
La paupérisation de la classe n'implique donc nullement son écrasement ou son atomisation ; la paupérisation absolue, loin de se traduire par la décomposition organique de la classe exploitée, comme ce fut le cas dans les périodes de déclin des systèmes esclavagistes et féodal, est l'affirmation organique de toute une classe, la classe historique contrainte de s'affirmer révolutionnairement ou de disparaître par la guerre dans la destruction de l'ensemble de l'humanité.
PERSPECTIVES
Dans un récent rapport établi à l'issue d'un conseil des principaux ministres de l'O.C.D.E. en juin 1976, la bourgeoisie mondiale a imaginé des "scénarii" (la bourgeoisie ne parle plus de prévisions étant donné la faillite de plus en plus grandissante du capitalisme d'Etat)... de croissance. Elle estime :
- que la croissance jusqu'à 1980 devra être modérée (pas plus de 5 % annuel) afin d'éviter une nouvelle vague d'inflation qui pourrait faire sombrer le système monétaire et financier international dans la banqueroute après une "reprise" trop forte. Ainsi la bourgeoisie qui avait développé historiquement les forces productives et en avait tiré tout son orgueil de classe conquérante avoue aujourd'hui que sa condition de survie consiste maintenant à "contenir le risque d'une croissance excessive des profits" et à éviter "le risque que la vigueur des forces expansionnistes à l’œuvre soit sous estimée" (OCDE, juin 1976) ;
- que "la croissance entre 1975 et 1980 ne pourra se produire que si la progression des salaires n'atteint pas un rythme tel qu'elle compromette la progression de la productivité et décourage l'investissement". Autrement dit le ralentissement de la décroissance dépend maintenant de la limitation de la lutte de classe. La bourgeoisie commence à comprendre que la survie de son système tient maintenant dans les mains de la classe prolétarienne.
Néanmoins la crise actuelle se développe encore lentement. A la différence de 1929, le krach de l'économie ne s'étend pas des nations les plus puissantes aux plus fragiles (des USA à l'Allemagne de 1929 à 1932) mais inversement des centres les moins développés aujourd'hui (Italie, Grande-Bretagne, France) vers le cœur du capitalisme (USA, Japon, Allemagne, URSS), selon un processus lent dû au fait que la chute des économies faibles s'accompagne momentanément du relatif renforcement de leurs rivaux les plus forts. Compte tenu de la disparition graduelle de phases de reprise et du soutien par le capital mondial de ses fractions en état de banqueroute, par une croissance de plus en plus rapide du capital fictif, la moindre résistance de la bourgeoisie aux mouvements de panique qui se font de plus en plus jour en son sein (et ce malgré tous les organismes internationaux dont elle s'est dotée depuis 1945 pour assurer une cohésion dans les rangs des différents capitaux nationaux) laissent planer la menace d'une banqueroute générale du système sur la tête d'une classe bourgeoise de plus en plus apeurée.
Ce sont ces deux facteurs (lutte de classe, panique croissante de la bourgeoisie) qui parallèlement déterminent la survie du système.
ETAT ET DICTATURE DU PROLETARIAT
Présentation sur la période de transition
Dans la plate-forme du CCI, adoptée au premier congrès du CCI de janvier 1976, le point concernant les rapports entre prolétariat et Etat dans la période de transition est resté "ouvert" :
"L'expérience de la révolution russe a fait apparaître la complexité et la gravité du problème posé par les rapports entre la classe et l'Etat de la période de transition. Dans la période qui vient, les révolutionnaires ne pourront pas esquiver ce problème mais devront y consacrer tous les efforts nécessaires pour le résoudre". (Plate-forme du CCI, point XV sur la dictature du prolétariat)
C'est dans le cadre de cet effort que s'inscrit la décision du deuxième congrès de RI d'aborder cette question et de tenter de parvenir à une résolution faisant le point de l'état de ces discussions sur ce problème.
Mais la question abordée est d'ordre programmatique. La plate-forme du CCI étant depuis le premier congrès la seule base programmatique pour toutes les sections du Courant, il va de soi que seul le congrès général du CCI a compétence pour décider de l'opportunité et du contenu d'un éventuel changement de la plate-forme.
En se prononçant sur une résolution sur la période de transition, le deuxième congrès de RI ne modifie donc pas les bases programmatiques de RI (pas plus que n'importe quelle section du CCI, RI n'a pas da bases programmatiques distinctes de celles du CCI).
Le congrès ne fait que faire le point sur l'effort réalisé au sein de RI dans la tâche de l'approfondissement de cette question afin de mieux l'inscrire dans l'effort global de l'ensemble du Courant.
LES LIMITES DE L'APPORT POSSIBLE
Afin de mieux pouvoir se repérer dans la complexité des problèmes de la période de transition, on peut regrouper ces derniers autour de trois sujets de préoccupation, distingués ici uniquement pour tenter de rendre plus commode la présentation de l'analyse :
- les spécificités générales qui distinguent globalement les fondements de la période de transition du capitalisme au communisme de ces deux genèses des autres systèmes qui l'ont précédée dans l'histoire;
- les rapports entre la classe révolutionnaire et le reste de la société au cours de la période de transition, c'est-à-dire les problèmes posés par la compréhension de ce qu'est la "dictature du prolétariat" et, par conséquent, ce que doit être le rapport entre la classe révolutionnaire et l'Etat dans la période de transition ;
- enfin, les questions concernant l'ensemble des mesures "économiques" concrètes de transformation de la production sociale.
Le travail d'analyse des révolutionnaires ne saurait manquer à la tâche d'apporter des réponses à l'ensemble de ces problèmes. Cependant, depuis que Marx et Engels jetèrent les bases du "matérialisme scientifique", les révolutionnaires savent que, sous peine de se perdre dans des spéculations à la recherche de ce que Marx appelait avec mépris "des recettes pour les marmites de l'avenir", ils doivent être conscients des limites immenses que leur imposent les limites mêmes de l'expérience prolétarienne dans ce domaine.
C'est l'ampleur de ces limites que Marx soulignait en 1875 dans sa critique du programme de Gotha en écrivant:
"Quelle transformation subira l'Etat dans une société communiste ? Quelles fonctions sociales s'y maintiendront qui soient analogues aux fonctions actuelles de l'Etat ? Cette question ne peut être résolue que par la science et ce n'est pas en accouplant de mille façons le mot peuple avec le mot Etat qu'on fera avancer le problème d'un seul saut de puce".
C'est la même conscience que R. Luxembourg exprimait en 1918 dans sa brochure sur la révolution russe :
"Bien loin d'être une somme de prescriptions toutes faites, qu'on n'aurait qu'à mettre en application, la réalisation pratique du socialisme comme système économique, social et juridique est une chose qui réside dans le brouillard de l'avenir. Ce que nous possédons dans notre programme, ce ne sont que quelques grands poteaux indicateurs montrant la direction dans laquelle les mesures à prendre doivent être recherchées, indications d'ailleurs surtout de caractère négatif. (…) (Le socialisme) a pour condition préalable une série de mesures violentes contre la propriété, etc. Ce qui est négatif, la destruction, on peut le décréter ; ce qui est positif, la construction, non. Terre vierge. Problèmes par milliers. Seule l'expérience est capable de faire les corrections et d'ouvrir des chemins nouveaux".
Outre cette limite d'ordre général, la résolution est consciemment limitée par l'objet qu'elle se donne. Elle ne prétend pas faire une synthèse de tout ce qui a pu être dégagé par les révolutionnaires sur la période de transition. En particulier, la résolution n'aborde pas la question des mesures économiques de transformation de la production sociale. Elle regroupe d'une part des positions acquises de longue date par le mouvement ouvrier (avant l'expérience de la révolution russe) et qui se sont confirmées comme de véritables frontières de classe ; d'autre part, des positions concernant les rapports entre la dictature du prolétariat et l'Etat de la période transition, dégagées principalement de la révolution russe et qui, si elles ne constituent pas par elles-mêmes des frontières de classe, n'en reposent pas moins sur une base historique suffisamment développée pour être partie intégrante des bases programmatiques d'une organisation révolutionnaire.
Les positions de classe fondamentales : inéluctabilité de la période de transition ; primauté du caractère politique de l'action du prolétariat comme condition et garantie de la transition vers la société sans classes ; caractère mondial de cette transformation ; spécificité du pouvoir de la classe ouvrière, en particulier le fait que le prolétariat, contrairement aux autres classes révolutionnaires de l'histoire, au lieu d'affirmer son pouvoir politique afin de consolider une position de classe dominante économiquement, position qu'il ne possèdera jamais, agit pour l'élimination de toute domination économique de classe par l'abolition des classes elles-mêmes ; impossibilité pour le prolétariat de se servir de l'appareil d'Etat bourgeois et nécessité de la destruction de ce dernier comme condition première du pouvoir politique prolétarien ; inéluctabilité de l'existence d'un Etat pendant la période transition, bien que profondément différent des Etats qui ont précédemment existé dans l'histoire.
Toutes ces positions constituent déjà par elles-mêmes un rejet catégorique de toutes les conceptions social-démocrates, anarchistes, autogestionnaires et modernistes qui, si elles ont sévi dans le mouvement ouvrier depuis ses premiers temps, ne servent pas moins aujourd'hui de piliers idéologiques de la contre révolution.
c'est sur la base de ces positions de classe fondamentales que la résolution dégage, principalement à partir de l'expérience de la révolution russe, des indications sur le problème du rapport entre prolétariat et Etat dans la période de transition au cours de la dictature du prolétariat : il en est ainsi de la compréhension du caractère inévitablement conservateur de l'Etat de transition ; de l'impossibilité d'identification du prolétariat ou de son parti avec cet Etat ; de la nécessité pour la classe ouvrière de concevoir ses rapports avec cet Etat auquel elle participe en tant que classe politiquement dominante, comme des rapports de force : "la domination de la société, c'est aussi sa domination sur l'Etat" ; nécessité de l'existence et du renforcement (armé) des organisations propres et spécifiques à la classe ouvrière (seule classe organisée comme telle dans la société), organisations sur lesquelles l'Etat ne peut avoir aucun pouvoir de coercition.
Ces indications affirment un rejet des conceptions qui ont pu servir de base mystificatrice à la "contre révolution qui se développe en Russie sous la direction du parti bolchevik dégénérant" et sont reprises aujourd'hui par l'ensemble des courants staliniens et trotskistes comme fondement théorique de la présentation du capitalisme d'Etat comme synonyme de socialisme.
Elles constituent donc un véritable garde-fou contre un ensemble de conceptions erronées que devra rencontrer demain le prolétariat dans son assaut mondial contre le capitalisme.
Cependant, aussi importantes que puissent être demain les conséquences de ces positions dans la lutte prolétarienne, il est nécessaire de comprendre aujourd'hui les limites réelles de cet apport :
Les expériences historiques sur lesquelles sont fondées ces positions, concernant les rapports classe-Etat de transition, demeurent encore trop peu nombreuses, trop spécifiques, pour que les conclusions qui en sont tirées puissent être considérées aujourd'hui par les révolutionnaires comme des frontières de classe, c'est-à-dire des positions qui constituent des parties clairement définies de la ligne de démarcation qui sépare le camp bourgeois du camp prolétarien. Les frontières de classe ne peuvent être appréhendées et définies par les révolutionnaires en fonction d'une expérience historique insuffisante ou de leur appréciation de l'avenir, mais sur une base expérimentale, fournie par l'histoire même des luttes prolétariennes, qui soit suffisamment nette et claire pour permettre d'en dégager des enseignements indiscutables.([4] [4])
Il faut donc souligner ici le caractère expressément limité des points que nous pouvons considérer acquis sur cette question : le rejet de l'identification du prolétariat ou de son parti avec l'Etat de transition ; la définition de la dictature du prolétariat par rapport à l'Etat comme une dictature de classe sur l'Etat et en aucun cas de l'Etat sur la classe ; la mise en avant de l'autonomie des organisations propres du prolétariat par rapport à l'Etat comme condition première d'une véritable autonomie et d'un véritable épanouissement de la dictature du prolétariat.
Ces points restent abstraits et généraux. Ils ne constituent que "quelques grands poteaux indicateurs montrant la direction dans laquelle les mesures à prendre doivent être recherchées, indicateurs d'un caractère souvent négatif". Les formes précises dans lesquelles ils pourront se concrétiser restent encore "terre vierge" que seule l'expérience permettra de défricher.
C'est une condition d'efficacité de l'organisation révolutionnaire que de savoir appréhender non seulement ce qu'elle sait et peut savoir, mais aussi ce qu'elle sait ni ne peut encore savoir. Il y va de sa capacité à savoir élaborer une véritable rigueur programmatique ainsi qu'à savoir faire siens à temps, dans l'action de la classe, les apports fondamentaux que seule la pratique vivante de la classe ouvrière peut fournir.
LE PROBLEME DU RAPPORT CLASSE-ETAT DE LA PERIODE DE TRANSITION DANS L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER
La méconnaissance généralisée de l'histoire du mouvement ouvrier, aggravée par la rupture organique qui sépare les révolutionnaires aujourd'hui des anciennes organisations politiques de la classe, ont pu faire paraître, dans certains cas, l'analyse sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui comme une "trouvaille", une "originalité" du CCI. Un rappel, même extrêmement bref et sommaire de la façon dont le problème a été abordé (il faudrait presque dire "découvert") par les révolutionnaires depuis Marx et Engels suffira à démontrer la fausseté d'une telle vision.
Dans le "Manifeste communiste" de Marx et Engels, qui n'emploie pas encore la formule de "dictature du prolétariat", "le premier pas dans la révolution ouvrière" est défini comme "la montée du prolétariat au rang de classe dominante, la conquête de la démocratie". Cette conquête n'est autre, en fait, que celle de l'appareil d'Etat bourgeois que le prolétariat devrait utiliser pour "arracher peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de la production dans les mains de l'Etat - du prolétariat organisé en classe dominante - et pour accroître le plus rapidement possible la masse des forces productives". Même si l'idée de l'inévitable disparition de tout Etat est déjà établie depuis "Misère de la Philosophie", même si l'inévitabilité de l'existence d'un Etat pendant les "premiers pas de la révolution ouvrière" est présente, le problème même du rapport entre classe ouvrière et Etat de la période de transition n'est qu'à peine entrevu.
C'est avec la Commune de Paris et son expérience que le problème commence réellement à être perçu au travers des leçons que Marx et Engels en dégagent : nécessité de la destruction de l'appareil d'Etat bourgeois par le prolétariat, mise en place d'un appareil tout différent qui "n'est plus un Etat au sens propre du mot" (Engels), dans la mesure où il n'est plus un organe d'oppression de la majorité par la minorité. Un appareil dont le caractère de poids hérité du passé est clairement souligné par Engels qui en parle comme d'un fléau, un fléau dont le prolétariat hérite dans sa lutte pour arriver à sa domination de classe mais dont il devra, comme l'a fait la Commune et dans la mesure du possible, atténuer les effets, jusqu'au jour où une génération élevée dans une société d'hommes libres et égaux pourra se débarrasser de tout ce fatras gouvernemental. (Préface de "la Guerre civile en France")
Cependant, malgré l'intuition de la nécessité pour le prolétariat de développer toute sa méfiance envers cet appareil hérité du passé (le prolétariat, écrivait Engels, "avait à prendre des précautions contre ses propres subordonnés et ses propres fonctionnaires en les déclarant sans exception et en tout temps amovibles") et du fait que la très courte et circonscrite expérience de la Commune de Paris ne pouvait pas poser le problème des rapports entre le prolétariat, l'Etat et les autres classes non exploiteuses de la société, une des idées majeures qui fut dégagée de la Commune, fut celle de l'identification de la dictature du prolétariat avec l'Etat de la période de transition. Ainsi, trois ans après la Commune de Paris, Marx écrivait dans sa "Critique du _programme de Gotha" :
"Entre la société capitaliste et la société communiste, se situe la période de transformation révolutionnaire de l'une en l'autre. A cette période correspond également une phase de transition politique, où l'Etat ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat."
C'est cette base théorique que Lénine reformula dans le concept de "l'Etat prolétarien" dans "l'Etat et la Révolution", c'est sur elle que les bolcheviks et le prolétariat russe instaurèrent la dictature du prolétariat en 1917.
Les conditions dans lesquelles dut se dérouler cette tentative prolétarienne, par le fait même qu'elles cumulaient les plus grandes difficultés pour le maintien d'un pouvoir prolétarien (écrasante majorité de paysans dans la société, nécessité de soutenir immédiatement une guerre civile impitoyable, isolement international de la Russie, faiblesse extrême de l'appareil productif détruit par la Première Guerre mondiale puis par la guerre civile), toutes ces conditions eurent pour résultat de faire éclater dans toute son ampleur le problème du rapport entre dictature du prolétariat et Etat.
La dure réalité des faits devait démontrer qu'il ne suffisait pas de baptiser l'Etat "prolétarien" pour que celui-ci agisse en fonction des intérêts révolutionnaires du prolétariat ; qu'il ne suffisait pas de placer le parti prolétarien à la tête de l'Etat (au point de s'identifier complètement avec lui) pour que la machine étatique suivit le cours que les révolutionnaires les plus dévoués voulaient lui imprimer.
L'appareil d'Etat, la bureaucratie d'Etat ne pouvait pas être l'expression des seuls intérêts de la classe prolétarienne. Appareil chargé de la survie de la société, il ne pouvait exprimer que les intérêts de la survie de l'économie moribonde russe. Ce que les marxistes répètent depuis les premiers temps se vérifiait dans toute sa puissance : les impératifs de la survie économique s'imposaient impitoyablement à la politique de l'Etat. Et l'économie était loin de pouvoir être influencée en quoi que ce soit en un sens prolétarien.
Lénine devait constater cette impuissance clairement lors du XXIème congrès du Parti, un an après le début de la NEP :
"Apprenez donc, communistes, ouvriers, partie consciente du prolétariat qui s'est chargée de diriger l'Etat, apprenez à faire en sorte que l'Etat que vous avez entre vos mains agisse selon votre gré... l'Etat reste entre vos mains mais est-ce qu'en fait de politique économique il a marché selon vos désirs ? NON ! ... Comment a-t-il donc marché ? La machine vous glisse sous la main : on dirait qu'un autre homme la dirige, la machine court dans une autre direction que celle qu'on lui a tracée".
L'identification du parti prolétarien avec l'Etat n'aboutit pas à la soumission de l'Etat aux intérêts révolutionnaires du prolétariat, mais au contraire à la soumission du parti aux intérêts de l'Etat russe. C'est ainsi que sous la pression des impératifs de la survie de l'Etat russe (dans lequel les bolcheviks voyaient l'incarnation même de la dictature du prolétariat - il s'agissait de la sauvegarde du "bastion prolétarien"), le parti bolchevik finit par soumettre la tactique de l'IC aux intérêts de la Russie (alliances avec les grands partis social-chauvins européens en vue de tenter de faire relâcher le "cordon sanitaire" qui étouffait la Russie) ; c'est sous cette pression que fut signé le traité de Rapallo avec l'impérialisme allemand ; c'est aussi pour éviter l'affaiblissement du pouvoir de l'appareil d'Etat "prolétarien" (et en son nom) que furent écrasés les insurgés de Kronstadt par l'Armée rouge.
Quant aux masses ouvrières, si l'identification de leur parti avec l'Etat avait abouti à les amputer de leur avant-garde, au moment même où elles en avaient le plus besoin, l'idée de l'identification de leur pouvoir avec l'Etat ne servit qu'à les rendre impuissantes et confuses devant l'oppression croissante de la bureaucratie étatique. ([5] [5])
La contre-révolution qui réduisait en cendres la dictature du prolétariat avait surgi de l'organe même que les révolutionnaires avaient pendant des décennies cru pouvoir identifier avec la dictature du prolétariat.
Le long processus de dégagement des leçons de l'expérience russe commença dès les débuts de la révolution elle-même.
Dans une confusion inévitable, en s'attaquant à des aspects parcellaires, sans pouvoir toujours saisir le fond même des problèmes au milieu des tourbillons d'une révolution dont les traits de dégénérescence se développaient à ses tous débuts, surgirent les premières réactions théoriques. Les critiques de Rosa Luxembourg dès 1918 dans sa brochure sur la révolution russe contre l'identification de la dictature du prolétariat avec celle du parti, tout comme sa critique de toute limitation par l'Etat de la vie politique de la classe ouvrière, portaient en elles déjà des bases de la critique de l'identification du prolétariat avec l'Etat de la période de transition. Rosa Luxembourg, malgré le fait de considérer toujours l'Etat de transition comme un "Etat prolétarien", malgré la subsistance de l'idée de "la conquête du pouvoir par le parti socialiste", dégage ce qui constitue le seul moyen réel d'atténuer les fâcheux effets du "fléau Etat" dont parlait Engels :
"L'unique moyen efficace que puisse avoir en main la révolution prolétarienne, ce sont, ici comme toujours, des mesures radicales de nature sociale et politique, une transformation aussi rapide que possible, les garanties sociales d'existence chez la masse et le déploiement de l'idéalisme révolutionnaire, qui ne saurait se maintenir durablement que par une vie immensément active des masses dans une liberté politique illimitée".
En Russie et au sein même du parti bolchevik, le développement de la bureaucratisation de l'Etat et donc de l'antagonisme entre prolétariat et pouvoir étatique provoqua dès les premières années la naissance de réactions telles celle du groupe d'Ossinsky ou plus tard du "groupe ouvrier" de Miasnikov qui, en mettant en question la bureaucratie soulevait déjà, même de façon confuse, le problème de la nature de l'Etat et des rapports entre classe et Etat de la période de transition.
Mais c'est probablement dans la polémique qui opposa Lénine et Trotski au Xème congrès du Parti, sur la question des syndicats, que la question de la nature de l'Etat fut posée de la façon la plus aiguë. En effet, contre Trotski qui défendait l'idée d'une plus grande intégration des syndicats ouvriers dans l'appareil d'Etat afin de mieux affronter les difficultés économiques, Lénine opposa la nécessité de sauvegarder l'autonomie de ces organisations de classe afin que les ouvriers puissent se défendre "des abus néfastes de la bureaucratie étatique". Lénine en arriva jusqu'à affirmer que l'Etat n'était pas "ouvrier, mais ouvrier et paysan avec de nombreuses déformations bureaucratiques". Même s'il est certain que ces débats étaient menés au milieu d'une confusion généralisée (pour Lénine, les divergences avec Trotski ne portaient pas sur des questions de principe mais résultaient de considérations contingentes), ils n'en étaient pas moins d'authentiques expressions de la recherche dans le prolétariat de réponses au problème des rapports entre sa dictature et l'Etat.
Les Gauches hollandaise et allemande, après avoir réagi dans le prolongement de Rosa Luxembourg au développement de la bureaucratie d'Etat contre le prolétariat en Russie et ayant eu à affronter les problèmes de la dégénérescence de la politique internationale de l'IC, furent aussi amenées à développer la critique de ce qu'elles appelèrent : le socialisme d'Etat. Cependant, le travail d'Appel fait en collaboration avec la gauche hollandaise sur les "Principes de base de la distribution communiste" aborda surtout la question de la période de transition du point de vue économique, les développements sur l'aspect politique demeurant essentiellement une réaffirmation des idées fondamentales de R. Luxembourg.
C'est surtout avec les travaux de la gauche italienne en Belgique et en particulier les articles de Mitchell publiés à partir du n°28 de mars-avril 1936 de la revue Bilan que les bases théoriques pour une compréhension plus profonde du problème ont été posées : tout en restant sur la base théorique "léniniste" de la quasi identité entre parti et classe, Bilan fut le premier à affirmer nettement le caractère néfaste de toute identification de la dictature du prolétariat avec l'Etat de la période de transition et à souligner parallèlement l'importance de l'autonomie de la classe et de son parti par rapport à cet Etat :
"Mais l'Etat soviétique ne fut pas considéré par les bolcheviks, au travers des terribles difficultés contingentes, essentiellement comme un "fléau dont le prolétariat hérite et dont il devra atténuer les plus fâcheux effets", mais comme un organisme pouvant s'identifier complètement avec la dictature prolétarienne, c'est-à-dire le Parti.
D'où résulta cette altération principale que le fondement de la dictature du prolétariat, ce n'était pas le parti, mais l'Etat qui, par le renversement des rapports qui s'ensuivit, se trouva placé dans des conditions d'évolution aboutissant non à son dépérissement mais au renforcement de son pouvoir coercitif et répressif. D'instrument de la révolution mondiale, l'Etat prolétarien était inévitablement appelé à devenir une arme de la contre-révolution mondiale.
Bien que Marx, Engels et surtout Lénine eussent maintes fois souligné la nécessité d'opposer à l'Etat son antidote prolétarien, capable d'empêcher sa dégénérescence, la Révolution Russe, loin de d'assurer le maintien et la vitalité des organisations de classe du prolétariat, les stérilisa en les incorporant à l'appareil d'Etat et ainsi dévora sa propre substance ".
L'analyse de Bilan porte encore des hésitations et des faiblesses, en particulier en ce qui concerne l'analyse de la nature de classe de l'Etat de la période de transition, considéré comme "Etat prolétarien".
Ces hésitations et ces insuffisances, normales, seront dépassées par les analyses d'Internationalisme en 1945 (voir article "la nature de l'Etat et la révolution prolétarienne" republié dans le n°1 du "Bulletin d'étude et de discussion" de RI, janvier 1973). Internationalisme affirme déjà de façon nette et se fondant sur des critères d'analyse objective de la nature économique et politique de la période de transition, la nature non prolétarienne et antisocialiste de l'Etat de la période de transition:
"L'Etat, dans la mesure où il est reconstitué après la révolution, exprime l'immaturité des conditions de la société communiste. Il est la superstructure politique d'une structure économique non encore socialiste. Sa nature reste étrangère et opposée au socialisme. De même que la phase transitoire est une inévitabilité historique objective par laquelle passe le prolétariat, de même l'Etat est un instrument de violence inévitable pour le prolétariat dont il se sert contre les classes dépossédées mais avec lequel il ne peut s'identifier. (...)
L'expérience russe a mis particulièrement en évidence l'erreur théorique de la notion d'Etat ouvrier, de la nature de classe prolétarienne de l'Etat et de l'identification de la dictature du prolétariat avec l'utilisation, par le prolétariat, de l'instrument de coercition qu'est l'Etat."
Internationalisme dégage de l'expérience de la révolution russe la nécessité vitale pour le prolétariat de savoir exercer un contrôle strict et permanent sur cet appareil d'Etat toujours prêt à devenir au moindre recul la force principale de la contre-révolution :
"L'histoire et l'expérience russe ont démontré qu'il n'existe pas d'Etat prolétarien proprement dit, mais un Etat entre les mains du prolétariat, dont la nature reste antisocialiste et qui, dès que la vigilance politique du prolétariat s'affaiblit, devient la place forte, le centre de ralliement et l'expression des classes dépossédées du capitalisme renaissant."
Encore imprégné de certaines des conceptions de la gauche italienne, dont il est issu, notamment en ce qui concerne la question du parti et des syndicats, mais se plaçant déjà dans la vision claire de la classe ouvrière comme véritable sujet de la révolution, Internationalisme affirme enfin la nécessité de la plus totale liberté politique de la classe et de ses organes unitaires (qu'il considère encore comme pouvant être les syndicats) par rapport à l'Etat, soulignant la condamnation de toute violence de ce dernier sur les premiers. Il est le premier aussi à établir une véritable cohérence entre les problèmes politiques et les problèmes économiques qui se posent pendant cette période :
"Cette phase transitoire du capitalisme au socialisme, sous la dictature politique du prolétariat, se traduit sur le terrain des rapports économiques par une politique énergique tendant à diminuer l'exploitation de la classe, d'augmenter constamment la part du prolétariat dans le revenu national, du capital variable par rapport au capital constant.
Cette politique ne peut être donnée par une affirmation programmatique du parti et encore moins être dévolue à l'Etat, organe de gestion et de coercition. Cette politique trouve sa condition, sa garantie et son expression dans la. classe elle-même et exclusivement en elle, dans la pression qu'exerce la classe dans la vie sociale, dans son opposition et sa lutte contre les autres classes.(...)
Toute tendance à diminuer le rôle des syndicats après la révolution, qui sous prétexte de l'existence de "l'Etat ouvrier", interdirait la liberté d'action syndicale et la grève, qui favoriserait l'immixtion de l'Etat dans les syndicats, qui, au travers de la théorie en apparence révolutionnaire de remettre la gestion aux syndicats, incorporerait en fait ces derniers dans la machine étatique, qui préconiserait la violence au sein du prolétariat et de son organisation, sous le couvert de et avec la meilleure intention révolutionnaire du but final, qui empêcherait l'existence de la plus large démocratie par le simple jeu de la lutte politique et des fractions au sein du syndicat, exprimerait une politique anti ouvrière faussant les l'apports du parti et de la classe, affaiblissant la position du prolétariat dans la phase transitoire. Le devoir communiste serait de dénoncer et de combattre avec la plus grande énergie toutes ces tendances et d'œuvrer au plein développement et à l'indépendance du mouvement syndical, indispensable pour la victoire de l'économie socialiste. "
Il revient à Internationalisme d'avoir su définir le cadre théorique général dans lequel la question des rapports entre la dictature du prolétariat et l'Etat dans la période de transition pouvait enfin être posée sur des bases solides et cohérentes.
C'est en s'inscrivant entièrement dans ce processus que la résolution présentée au congrès se conçoit comme une tentative de réappropriation des principaux acquis du mouvement ouvrier sur cette question et un effort pour continuer l'œuvre permanente d'approfondissement des bases programmatiques de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
C'est dire à quel point cette résolution n'a rien à voir avec une quelconque "trouvaille du CCI". Mais c'est dire aussi le poids de la responsabilité historique que fait peser sur les épaules de l'organisation révolutionnaire le fait d'assumer cet héritage.
CONTRIBUTION DU CONGRES DE R.I.
1) Entre le capitalisme et le socialisme existe inévitablement une période plus ou moins longue de transition de l'un à l'autre. Elle est transitoire dans le fait qu'elle ne connaît pas un mode de production propre ni stable. Sa caractéristique spécifique consiste dans le bouleversement ininterrompu et systématique qu'elle porte dans le mode de production. Par des mesures politiques et économiques, elle sape jusqu'aux fondements de l'ancien système et dégage les bases de nouveaux rapports sociaux : le communisme.
2) Le communisme est une société sans classes. La période de transition, qui ne se développe réellement qu'après le triomphe de la révolution l'échelle mondiale, est une période dynamique qui tend vers la disparition des classes, mais qui connaît encore la division en classes et la persistance d'intérêts divergents et antagoniques dans la société.
4) A la différence des révolutions bourgeoises qui eurent la région ou la nation pour cadre, le socialisme ne peut se réaliser qu'à l'échelle mondiale. L'extension de la révolution et de la guerre civile est donc l'acte primordial qui conditionne les possibilités et le rythme de la transformation économique et sociale dans le ou les pays où le prolétariat s’est déjà emparé du pouvoir politique.
3) A l'encontre des autres périodes de transition dans l'histoire, qui toutes se déroulaient au sein de l'ancienne société et culminaient dans la révolution, la période de transition du capitalisme au communisme ne peut débuter qu'après la destruction de la domination politique du capitalisme et en premier lieu de son Etat. La prise du pouvoir politique générale dans la société par la classe ouvrière, la dictature du prolétariat, précède.
5) Produit de la division de la société en classes, la dictature du prolétariat se distingue cependant du pouvoir des classes dominantes par le passé, essentiellement par les caractéristiques suivantes :
a) n’étant pas classe économiquement dominante, la classe ouvrière n'exerce pas son pouvoir pour défendre des privilèges économiques (qu'elle ne possède pas et ne possèdera jamais), mais pour détruire tous les privilèges ;
b) en conséquence, le prolétariat n'a nullement besoin, comme les autres classes, de cacher ses buts, de mystifier les autres classes en présentant sa dictature comme le règne de ²la liberté, l'égalité et la fraternité" ;
c) cette dictature n'a pas pour fonction de perpétuer l'état de choses existant, mais au contraire de le révolutionner, afin d'assurer l'avènement de la société véritablement humaine, sans exploitation ni oppression.
6) Dans toute société divisée en classes, afin d'empêcher que les antagonismes qui la travaillent n'explosent en luttes permanentes qui en menacent l'équilibre et mettent en péril jusqu'à son existence même, surgissent des superstructures, des institutions dont le couronnement est l'Etat, dont la fonction consiste essentiellement à maintenir ces luttes dans un cadre approprié, s'adaptant et conservant l'infrastructure existante.
7) La période de transition au socialisme est, comme nous l'avons vu, encore une société où subsiste la division en classes. C'est la raison pour laquelle surgit nécessairement cet organisme superstructurel, ce mal inévitable qu'est l'Etat. Mais des différences substantielles distinguent ce dernier de l'Etat des anciennes sociétés divisées en classes. L'expérience de la Commune de Paris a mis en évidence :
a) en premier lieu, le fait que pour la première fois dans l'histoire il est l'Etat de la majorité des classes exploitées et non exploiteuses contre la minorité (les anciennes classes dominantes déchues) et non d'une minorité exploiteuse pour l'oppression de la majorité ;
b) le fait qu'il ne se constitue pas sur une couche spécialisée, les partis politiques, mais sur la base de délégués élus par les organisations territoriales, les Conseils locaux, et révocables par elles ;
c) que toute cette organisation étatique exclut catégoriquement toute participation des couches et classes exploiteuses qui sont privées de tout droit politique ou civique ;
d) que la rémunération de ses membres ne peut jamais être supérieure à celle des ouvriers.
C'est dans ce sens que les marxistes pouvaient, avec raison, parler d'un semi-Etat, d'un Etat altéré, d'un Etat en voie d'extinction.
8) L'expérience de la révolution russe victorieuse devait apporter des enseignements précis, encore que négatifs, sur le rapport entre la dictature du prolétariat et l'institution étatique dans la période de transition :
a)la fonction des partis politiques du prolétariat se distingue fondamentalement de celle des partis bourgeois, tout particulièrement par le fait qu'ils ne sont pas et ne peuvent pas être des organismes d'Etat. Autant les partis de la bourgeoisie ne peuvent exister qu'en tendant à s'intégrer à l'appareil d'Etat, autant l'intégration des partis ouvriers à l'Etat après la révolution, les dénature et leur fait perdre complètement leur fonction spécifique dans la classe;
b) s'il est vrai que parce que la fonction de l'Etat se confond avec la conservation de l'état social existant, l'Etat dans les sociétés d'exploitation ne peut que s'identifier avec la classe économiquement dominante dans ce système et devenir l'expression principale de ses intérêts généraux et de son unité, à l'intérieur même de cette classe et face aux autres classes de la société, il n'est rien de tel pour le prolétariat qui, n'étant pas dominant économiquement, ne tend pas à conserver l'état de choses existant mais à le bouleverser et le transformer. Sa dictature ne peut trouver, dans une constitution conservatrice par excellence, comme est l'Etat, son expression authentique et totale. Il n'y a pas et il ne peut y avoir d'Etat socialiste. Etat et socialisme s'excluent par définition. Le socialisme étant l'intérêt historique du prolétariat, sa substance en développement, il y a identité et identification entre l'un et l'autre. En conséquence, dans la mesure même où on doit parler de prolétariat socialiste, on ne peut pas parler "d'Etat ouvrier", d'Etat du prolétariat. Aussi pensons nous que, sur la base de l'expérience de la révolution russe, une distinction très nette doit être faite entre l'Etat de la période de transition, que le prolétariat ne peut pas ne pas utiliser et soumettre à tout instant à sa dictature et cette dictature elle-même. Politiquement, l'identification entre les institutions étatiques de la période de transition et la dictature du prolétariat a apporté le plus grand mal à la dictature révolutionnaire du prolétariat et a parfaitement servi comme moyen de mystification à la contre révolution en Russie, sous la direction du parti bolchevik dégénérant ;
c) l'Etat de la période de transition, avec toutes ses altérations et limites, porte encore tous les stigmates d'une société divisée en classes. Il ne saurait jamais être l'organe concentrant et symbolisant le socialisme. Seule la classe prolétarienne est la classe porteuse du socialisme. Sa domination sur la société, c'est aussi sa domination sur l'Etat et elle ne peut l'assurer que par sa dictature de classe.
9) La dictature du prolétariat doit se définir par:
a) la nécessité de maintenir l'unité et l'autonomie de la classe dans ses organisations propres : les conseils ouvriers, en même temps qu'elle se prononce pour la dissolution de toute organisation propre aux autres classes en tant que classes ;
b) elle dicte comme règle générale son hégémonie au sein de la société, ce qui se traduit par sa participation hégémonique au sein de l'organisation d'où émane l'Etat mais interdit aux autres classes tout droit d'intervention au sein de sa propre organisation de classe ;
c) elle s'impose comme seule classe armée indépendamment de toute immixtion du reste de la société et tout particulièrement de l'Etat.
[1] [6] Cette "augmentation" des effectifs de travail, saluée par la bourgeoisie américaine comme la grande réussite de la "reprise" n'exprime en fait qu'une certaine diminution du nombre des chômeurs, ridicule à l'échelle des 9 millions de chômeurs en 1975.
[2] [7] Le salaire horaire est passé de 70 à 75 de 4,20 à 6,22 dollars aux USA alors qu'il grimpait de 2,08 à 6,46 dollars pour la Belgique ; et même 2,93 à 7,12 dollars en Suède (City Money International, mai 1976).
[3] [8] C'est ce qui s'est effectivement fait au cours de ce dernier trimestre : le Japon, dont la compétitivité menaçait d'inonder de ses marchandises les pays de la CEE, a dû s'incliner. Il devra se plier aux décisions de la CEE contingentant ses exportations d'acier, limiter sa politique de dumping et ouvrir plus largement son marché aux produits européens.
[4] [9] Les "bases programmatiques" d'une organisation révolutionnaire sont constituées par l'ensemble des positions principales et des analyses qui définissent le cadre général de son action. Les positions "frontières de classe" en font partie et en représentent inévitablement le squelette de base. Mais l'action d'une organisation révolutionnaire ne peut être définie par les seules frontières de classe. La nécessité de la plus grande cohérence de son intervention la contraint à chercher la plus grande cohérence dans ses conceptions et donc à définir le plus profondément possible le cadre général qui relie entre elles les différentes positions de classe en les plaçant dans une vision cohérente et globale des buts et des moyens de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
[5] [10] Ces deux éléments expliquent en partie la confusion, parfois extrême, qui caractérise les soubresauts prolétariens contre la contre révolution étatique (Kronstadt).
Conscience et organisation:
La gauche communiste en Russie : 1918 – 1930 (1ere partie)
- 6207 reads
Quand on parle de l'opposition révolutionnaire à la dégénérescence de la Révolution en Russie ou à celle de l'Internationale Communiste, il est entendu en général qu'on se réfère à l'Opposition de Gauche dirigée par Trotski et d'autres leaders bolcheviks. Les critiques tardives et inadéquates de la dégénérescence qui ont été faites par ceux qui ont joué un rôle actif dans cette dégénérescence sont prises pour l'Alpha et l'Omega de l'opposition communiste à l'intérieur de la Russie et de l'Internationale. La critique beaucoup plus profonde et plus sérieuse élaborée par les "Communistes de Gauche" bien avant que l'Opposition de Gauche n'apparaisse en 1923 est soit ignorée, soit considérée avec mépris comme des divagations de fous sectaires coupés du "monde réel". Cette déformation du passé est tout simplement une expression de la longue influence de la contre-révolution depuis la fin de la période de luttes révolutionnaires dans les années 20. C'est toujours l'intérêt de la contre-révolution capitaliste que de cacher ou de déformer l'histoire et les traditions véritablement révolutionnaires de la classe ouvrière et de ses minorités communistes, parce que ce n'est que de cette manière que la bourgeoisie peut espérer dissimuler la nature historique du prolétariat comme classe destinée à conduire l'humanité vers le règne de la liberté.
Contre cette déformation du passé, les révolutionnaires doivent réaffirmer et réexaminer les luttes historiques du prolétariat non par un intérêt d'archivistes pour l'histoire en tant que telle, mais parce que l'expérience passée de la classe forme avec ses activités présentes et futures une chaîne inséparable et parce que ce n'est qu'en comprenant le passé que le présent et le futur peuvent être mieux compris et abordés. Nous espérons que ce travail sur la Gauche Communiste en Russie contribuera à rétablir un chapitre important du mouvement communiste, contre les déformations de l'histoire bourgeoise, qu'elles soient académiques ou gauchistes. Mais avant tout, nous espérons qu'il servira à clarifier certaines leçons qui peuvent être tirées des luttes, les erreurs et les pas positifs de la Gauche Russe, leçons qui auront un rôle essentiel à jouer dans la reconstitution du mouvement communiste aujourd'hui.
"En Russie, la question ne pouvait être que posée. Elle ne pouvait être résolue en Russie."
Rosa Luxembourg, la Révolution Russe.
Dans le cours de la contre-révolution qui, dans le monde entier, a suivi la grande vague révolutionnaire de 17-23, un mythe s'est développé autour du bolchevisme, qui était décrit comme un produit spécifique de "l'arriération" russe et de la barbarie asiatique. Des survivants des communistes de la Gauche allemande et hollandaise, profondément démoralisés par la dégénérescence et la mort de la révolution en Russie, revenaient à des positions semi-mencheviks selon lesquelles le développement bourgeois en Russie dans les années 20 et 30 était inévitable parce que la Russie n'était pas mûre pour le communisme ; le bolchevisme était défini comme une idéologie de "l'intelligentsia" qui n'avait cherché que la modernisation capitaliste de la Russie et par conséquent l'avait réalisée à la place d'une bourgeoisie impuissante, en faisant une révolution "bourgeoise" ou "capitaliste d'Etat" et en s'appuyant sur un prolétariat qui n'était pas mûr.
Toute cette théorie était une révision totale du caractère véritablement prolétarien de la révolution russe et du bolchevisme et un dénie de la part de beaucoup de communistes de Gauche de leur propre participation au drame héroïque qui avait commencé en octobre 17. Mais comme tous les mythes, il contenait une part de vérité. Alors qu'il est fondamentalement le produit de conditions internationales, le mouvement ouvrier présente aussi certains caractères spécifiques issus de conditions historiques et nationales particulières. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas par hasard que le mouvement communiste qui resurgit est plus fort dans les pays d'Europe occidentale, et de loin plus faible, pour ainsi dire presque inexistant dans le bloc de l'Est. C'est un produit de la manière spécifique dont les événements historiques se sont déroulés dans les 50 dernières années, en particulier de la façon dont la contre-révolution capitaliste s'est organisée dans les différents pays. De même, quand on examine le mouvement révolutionnaire en Russie avant et après l'insurrection d'Octobre, si on ne peut en saisir l'essence qu'en la considérant dans le contexte du mouvement ouvrier international, certains aspects de ses forces et de ses faiblesses peuvent être liés aux conditions particulières qui prévalaient alors en Russie.
Sous beaucoup d'aspects, les faiblesses du mouvement révolutionnaire russe n'étaient que le revers de ce qui faisait sa force. La capacité du prolétariat russe à s'orienter très rapidement vers une solution révolutionnaire à ses problèmes a été grandement déterminée par la nature du régime tsariste. Autoritaire, en pleine décrépitude, incapable de mettre en place aucun système "tampon" stable entre lui et la menace prolétarienne, le système tsariste faisait que tout effort du prolétariat pour se défendre ne pouvait que l'amener immédiatement à s'affronter aux forces répressives de l'Etat. Le prolétariat russe, jeune mais très combatif et très concentré, n'a jamais eu le temps ni la place politique pour que se développe en son sein une mentalité réformiste qui aurait pu l'amener à identifier la défense de ses intérêts matériels immédiats à la survie de sa "patrie". Il était alors beaucoup plus facile pour le prolétariat russe de refuser toute identification avec l'effort de guerre tsariste après 1914 et de voir dans la destruction de l'appareil politique tsariste une condition préalable à sa marche en avant en 19l7. Très généralement et sans vouloir établir un lien trop mécanique entre le prolétariat russe et ses minorités révolutionnaires, ces aspects forts de la classe russe ont constitué l'un des facteurs qui ont permis aux bolcheviks d'être à la pointe du mouvement révolutionnaire mondial tant en 1914 qu'en 1917, par la dénonciation retentissante de la guerre et l'affirmation sans compromis de la nécessité de détruire la machine de l'Etat bourgeois.
Mais, comme nous l'avons dit, ces forces étaient aussi des faiblesses : l'immaturité du prolétariat russe, son manque de traditions organisationnelles, la brutalité avec laquelle il a été projeté dans une situation révolutionnaire, ont eu tendance à laisser d'importantes lacunes dans l'arsenal théorique de ses minorités révolutionnaires. Il est significatif, par exemple, que les critiques les plus pertinentes des pratiques réformistes de la social-démocratie et des syndicats aient commencé à être élaborées dans les pays où précisément ces pratiques étaient le plus solidement établies, en particulier en Hollande et en Allemagne. C'était là, plutôt qu'en Russie où le prolétariat se battait encore pour des droits parlementaires et syndicaux que les dangers pernicieux des habitudes réformistes ont été en premier lieu compris par les révolutionnaires. Par exemple, le travail de Anton Pannekoek et du groupe hollandais Tribune, dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, a contribué à préparer le terrain à la rupture radicale que les révolutionnaires allemands et hollandais ont fait avec les vieilles tactiques réformistes après la guerre. Il en est de même pour ce qui est de la Fraction Abstentionniste de Bordiga en Italie. Au contraire, les bolcheviks n'ont jamais vraiment compris que la période des "tactiques" réformistes étaient terminées une fois pour toutes avec l'entrée du capitalisme dans sa période d'agonie en 1914 ; ou tout au moins, ils n'ont jamais compris pleinement toutes les implications de la nouvelle période en ce qui concerne la stratégie révolutionnaire. Les conflits à partir des tactiques parlementaires et syndicales qui ont déchiré l'IC après 1920 étaient en grande partie le résultat de l'incapacité du parti russe à saisir pleinement la nécessité de la nouvelle période ; et cette incapacité n'était pas totalement le fait de la seule direction bolchevik : elle se reflète aussi dans le fait que la critique du syndicalisme, du parlementarisme et du substitutionnisme et des autres reliquats sociale-démocrates que faisaient les communistes de Gauche russes, n'ont jamais atteint le même niveau de clarté que celles des fractions de Gauche hollandaise, allemande et italienne.
Mais, là encore, il faut nuancer cette observation par une compréhension du contexte international de la révolution. Les faiblesses du parti bolchevik n'étaient pas définitives et cela précisément parce que c'était un parti véritablement prolétarien et, partant, ouvert à tous les développements et à la compréhension nouvelle qui proviennent de la lutte prolétarienne quand elle est dans une phase ascendante. Si la révolution d'Octobre s'était étendue internationalement, ces faiblesses auraient pu être surmontées ; les déformations social-démocrates qui existaient au sein du bolchevisme ne se sont cristallisées en un obstacle fondamental au mouvement révolutionnaire que lorsque la révolution mondiale est entrée dans une phase de reflux et que le bastion prolétarien en Russie s'est trouvé paralysé par son isolement. Le glissement rapide de l'IC vers l'opportunisme, en grande partie sous l'influence du parti russe dominant, était entre autres choses le résultat de l'effort des bolcheviks à chercher un équilibre entre les besoins de la survie de l'Etat-Soviet et les besoins internationaux de la révolution d'autre part ; un effort qui s'enferrait de plus en plus dans la contradiction au fur et à mesure que la vague révolutionnaire refluait. Cet effort a été finalement abandonné avec le triomphe "du socialisme dans un seul pays", ce qui signifiait la mort de l'IC et couronnait la victoire de la contre révolution en Russie.
Si l'isolement extrême du bastion russe devait empêcher en définitive le parti bolchevik de dépasser ses erreurs initiales, il a aussi entravé le développement théorique des fractions de la Gauche Communiste qui s'étaient détachées du parti russe en dégénérescence. Coupée des discussions et des débats qui se poursuivaient toujours dans les fractions de Gauche en Europe, soumise à la répression sans pitié d'un Etat de plus en plus totalitaire, la Gauche russe tendait à se restreindre à une critique formelle de la contre révolution russe et ne discernait que rarement les racine mêmes de la dégénérescence. La nouveauté absolue et la rapidité de l'expérience russe devaient laisser une génération tout entière de révolutionnaires dans une confusion complète au sujet de ce qui s'était passé. Ce n'est que vers les années 30 et 40 qu'une approche cohérente a commencé à apparaître parmi les fractions communistes qui avaient survécu. Mais cette compréhension a surtout été le fait des révolutionnaires en Europe et en Amérique ; la Gauche russe était trop proche, trop empêtrée dans toute cette expérience pour élaborer une analyse globale du phénomène. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'acquiescer à l'appréciation de la Gauche communiste faite par les camarades d'Internationalism :
"La contribution durable de ces petits groupes qui essayaient d'appréhender la nouvelle situation, ne pouvait être d'avoir compris l'ensemble du processus du capitalisme d'Etat à ses débuts pas plus que d'exprimer un programme cohérent pour relancer la révolution, mais dans le fait qu'ils an tiré la sonnette d'alarme et qu'ils ont dénoncé, pratiquement, pour la première fois dans l'histoire l'établissement d'un régime capitaliste d'Etat ; leur contribution dans le mouvement ouvrier a été d'avoir fourni la preuve politique que le prolétariat russe n'est pas allé à la défaite dans le silence".
("Une contribution sur le capitalisme d'Etat", J.A, Bul1etin d'étude et de discussion de RI n°10.11/Internationalism n°6).
Qu’est-ce que la gauche communiste ?
Un aspect du mythe du bolchevisme "arriéré" ou "bourgeois" réside dans l'idée selon laquelle il existe un abîme infranchissable entre les bolcheviks d'une part, qui sont représentés comme des partisans du capitalisme d'Etat et de la dictature du parti et les communistes de gauche d'autre part, qui sont dépeints comme les véritables défenseurs du pouvoir ouvrier et de la transformation communiste de la société. Cette idée est particulièrement séduisante pour les conseillistes et les libertaires qui ne veulent s'identifier qu'avec ce qui leur plaît dans le mouvement ouvrier passé et qui rejettent l'expérience réelle de la classe dès qu'ils découvrent ses imperfections. Dans le monde réel, il y a cependant une continuité directe et inéluctable entre ce qu'était le bolchevisme au début et ce qu'étaient les communistes de gauche dans les années 20 et après. Les bolcheviks étaient eux-mêmes à l'extrême gauche du mouvement social-démocrate d'avant guerre, surtout par leur défense acharnée de la cohérence organisationnelle et de la nécessité d'un parti révolutionnaire indépendant de toutes les tendances réformistes et confusionnistes dans le mouvement ouvrier ([1] [12]). Leur position sur la guerre de 14-18 (ou plutôt la position de Lénine et de ceux qu'il ralliait au sein du parti) était encore la plus radicale de toutes les déclarations contre la guerre dans le mouvement socialiste : "transformer la guerre impérialiste en guerre civile" et leur appel à la liquidation de l'Etat bourgeois a fait d'eux le point de ralliement de toutes les minorités révolutionnaires les plus intransigeantes du monde. Les "Radicaux de Gauche" en Allemagne autour desque1s se constitua le noyau du KAPD en 1920 s'inspiraient directement de l'exemple des bolcheviks, surtout lorsqu’ils commencèrent à réclamer la constitution d'un nouveau parti révolutionnaire en opposition totale avec les sociaux-patriotes du SPD ([2] [13]). Ainsi jusqu'à un certain point, les bolcheviks et l'IC, fondée en grande partie sur leur initiative, représentaient la "Gauche" : ils sont devenus le mouvement communiste. Le communisme de gauche n'a de signification que comme réaction contre la dégénérescence de cette avant-garde communiste à l'origine, et l'abandon par cette même avant-garde de ce qu'elle défendait au début. Le communisme de gauche est ainsi issu organiquement du mouvement communiste impulsé par les bolcheviks et l'IC.
Tout ceci devient clair lorsqu'on regarde les origines de la Gauche communiste en Russie même où toutes les fractions de gauche avaient leurs origines dans le parti bolchevik. C'est en soi une preuve du caractère prolétarien du bolchevisme. Parce qu'il était une expression vivante de la classe ouvrière, la seule classe qui peut faire une critique radicale et continuelle de sa propre pratique, le parti bolchevik a engendré sans cesse des fractions révolutionnaires. A chaque étape de sa dégénérescence, se sont élevées à l'intérieur même du parti des voix qui protestaient, se sont formés des groupes à l'intérieur du parti ou qui s'en séparaient pour dénoncer l'abandon du programme initial du bolchevisme. Ce n'est que quand le parti a finalement été enterré par ses fossoyeurs staliniens que ces fractions n'ont plus surgi de lui. Les communistes de gauche russes étaient tous des bolcheviks ; c'étaient eux qui défendaient une continuité avec le bolchevisme des années héroïques de la révolution, alors que ceux qui les ont calomniés, persécutés et exécutés, aussi célèbres qu'aient été leurs noms, étaient ceux qui rompaient avec l'essence du bolchevisme.
La Gauche Communiste pendant les années héroïques de la révolution : 1918 - 21
a) Les premiers mois
Le parti bolchevik fut en fait le premier parti du mouvement ouvrier reconstitué après la guerre à donner naissance à une gauche. C'était précisément parce que c'était le premier parti à mener une insurrection victorieuse contre l'Etat bourgeois. Dans la conception du mouvement ouvrier de l'époque, le rôle du parti était d'organiser la prise du pouvoir et d'assurer le rôle gouvernemental dans le nouvel "Etat prolétarien". En effet, le caractère prolétarien de l'Etat, selon cette conception, était garanti par le fait qu'il était entre les mains d'un parti prolétarien qui visait à conduire la classe ouvrière vers le socialisme. Le caractère fondamentalement erroné de cette double ou triple substitution (Parti-Etat, Etat-classe, Parti-classe) devait être dévoilé pendant les années qui ont suivi la révolution ; mais ce fut le destin tragique du parti bolchevik de mettre en pratique les erreurs théoriques du mouvement ouvrier tout entier et par là de démontrer par leur expérience négative la fausseté totale de cette conception. Toute la honte et les trahisons associées au bolchevisme découlent du fait que la révolution est née et morte en Russie et que le parti bolchevik, en s'identifiant avec l'Etat qui devait devenir l'agent interne de la contre révolution, s'est transformé en organisateur de la mort de la révolution.
Si la révolution avait éclaté et dégénéré en Allemagne et non en Russie, les noms de Luxembourg et de Liebknecht pourraient provoquer aujourd'hui les mêmes réactions ambiguës ou équivoques que ceux de Lénine, Trotski, Boukharine et Zinoviev. Ce n'est qu'à cause de la grande expérience que les bolcheviks ont entreprise que les révolutionnaires peuvent affirmer sans ambiguïté aujourd'hui : le rôle du parti n'est pas de prendre le pouvoir à la place de la classe et les intérêts de la classe ne s'identifient pas aux intérêts de l'Etat révolutionnaire. Mais il a fallu aux révolutionnaires de nombreuses années de dure réflexion et d'autocritique pour qu'ils soient capables d'énoncer ces leçons si simples en apparence.
Dès qu'il est devenu un parti qui avait la charge de l'Etat soviétique en Octobre 17, le parti bolchevik a commencé à dégénérer, non d'un seul coup, non dans un cours descendant totalement linéaire et non tant que la révolution mondiale était à l'ordre du jour, de manière irréversible. Mais, néanmoins, le processus général de dégénérescence a commencé immédiatement. Alors qu'auparavant, le parti avait été capable d'agir librement comme la fraction de la classe la plus résolue, montrant toujours la voie vers l'approfondissement et l'extension de la lutte de classe, le fait d'assumer le pouvoir d'Etat de la part des bolcheviks a mis un frein de plus en plus grand à leur capacité à s'identifier et à participer à la lutte de classe prolétarienne. A partir de là les besoins de l'Etat devaient prendre de plus en plus le pas sur les besoins de la classe ; et bien que cette dichotomie ait été obscurcie au début par l'intensité même de la lutte révolutionnaire, elle était néanmoins l'expression d'une contradiction intrinsèque et fondamentale entre la nature de l'Etat et la nature du prolétariat : les besoins d'un Etat sont essentiellement déterminés par le fait de maintenir une cohésion dans la société, de maintenir la lutte de classe dans un cadre correspondant au statu quo social ; les besoins du prolétariat et donc de son avant-garde communiste, par contre, ne peuvent être que l'extension et l'approfondissement de sa lutte de classe jusqu'au renversement de toutes les conditions existantes. Aussi longtemps que le mouvement révolutionnaire de la classe se trouvait dans une phase de montée de la lutte tant en Russie qu'internationa1ement, l'Etat soviétique pouvait être utilisé pour défendre les conquêtes de la révolution, il pouvait être un instrument dans les mains de la classe ouvrière. Mais dès que le mouvement réel de la classe eut disparu, le statu quo garanti par l'Etat ne pouvait être que le statu quo du capital. Telle était la tendance générale ; mais en fait les contradictions entre le prolétariat et le nouvel Etat ont commencé à apparaître immédiatement du fait de l'immaturité de la classe et des bolcheviks dans leur attitude vis-à-vis de l'Etat et par dessus tout du fait des conséquences de l'isolement de la révolution en Russie qui a pesé sur le nouveau bastion prolétarien dès le début. Confrontés à de nombreux problèmes qui ne pouvaient être résolus qu'au niveau international - l'organisation de l'économie ravagée par la guerre, les relations avec les immenses masses paysannes en Russie et avec un monde capitaliste hostile à l'extérieur - les bolcheviks manquaient d'expérience pour prendre des mesures qui auraient pu au moins atténuer les conséquences les plus néfastes de cette situation.
Dans les faits, les mesures qui furent prises ont tendu plutôt à aggraver les problèmes qu'à les résoudre. Et la majorité écrasante des erreurs commises sont provenues du fait que les bolcheviks se trouvaient à la tête de l'Etat et avaient ainsi le sentiment d'être dans le vrai en identifiant les intérêts du prolétariat aux besoins de l'Etat soviétique, en fait en subordonnant ces premiers à ces derniers.
Bien qu'aucune fraction communiste en Russie à cette époque n'ait réussi à faire une critique de fond de ces erreurs substitutionnistes - ce qui devait rester une carence de la part de toute la gauche russe -, une opposition révolutionnaire aux pratiques du jeune Etat bolchevik se cristallisa quelques mois après la prise du pouvoir. Cette opposition prit la forme d'un groupe communiste de gauche autour d'Ossinsky, Boukharine, Radek, Smirnov et d'autres, organisé principalement dans le Bureau régional du Parti à Moscou et s'exprimant dans le journal fractionnel "Kommunist". Cette opposition du début 18 fut la première fraction bolchevik organisée à critiquer les efforts du parti pour discipliner la classe ouvrière. Mais, en fait, la raison d'être originelle du groupe de la Gauche Communiste était l'opposition à la signature du traité de Brest-Litovsk avec l'impérialisme allemand. Il ne s'agit pas ici d'entreprendre une étude détaillée de toute la question de Brest-Litovsk. En résumé, le principal débat était entre Lénine et les communistes de gauche (avec Boukharine à leur tête) qui préconisaient une guerre révolutionnaire contre l'Allemagne et dénonçaient le traité de paix comme une "trahison" de la révolution mondiale. Lénine défendait la signature du traité comme étant un moyen d'obtenir une "marge de manœuvre" pour réorganiser le potentiel militaire de l'Etat soviétique. Les Gauches insistaient sur un fait :
"L'adoption des conditions dictées par les impérialistes allemands serait un acte qui irait contre toute notre politique du socialisme révolutionnaire. Cela conduirait à l’abandon de la ligne juste du socialisme international, en politique intérieure aussi bien qu’en politique étrangère et pourrait conduire à une des pires espèces d’opportunisme. ² (R. Daniels, The Conscience of the Revolution, p.73).
Tout en admettant l'incapacité technique de l'Etat soviétique à soutenir une guerre conventionnelle contre l'impérialisme allemand, ils préconisaient une stratégie d'épuisement de l'armée allemande par des attaques de guérilla, par des détachements mobiles de partisans rouges. Le fait de mener cette "guerre sainte" contre l'impérialisme allemand, espéraient-ils, servirait d'exemple au prolétariat mondial et l'inciterait à rejoindre la lutte.
Nous ne voulons pas entrer ici dans un débat a posteriori sur les possibilités stratégiques ouvertes au pouvoir soviétique en 1918. Nous soulignerons qu'aussi bien Lénine que les communistes de Gauche reconnaissaient que le seul espoir du prolétariat reposait sur l'extension mondiale de la révolution ; tous situaient leurs préoccupations et leurs actions dans un cadre internationaliste et tous présentaient leurs arguments ouvertement devant le prolétariat russe organisé dans les conseils. C'est pourquoi nous considérons qu'il est inadmissible de définir la signature du traité comme une "trahison" de l'internationalisme. Pas plus que, tel que c'est arrivé, il n'a signifié l'écroulement de la révolution en Russie ou en Allemagne, comme Boukharine le craignait. En tout cas, ces considérations stratégiques sont dans une certaine mesure des impondérables. La question politique la plus importante qui a surgi dans la discussion sur Brest-Litovsk est la suivante : est-ce que la "guerre révolutionnaire" est le principal moyen d'étendre la révolution? Est-ce que le prolétariat au pouvoir dans une région a la tâche d'exporter la révolution vers le prolétariat mondial à la pointe des baïonnettes? Les commentaires de la Gauche Italienne sur la question de Brest-Litovsk sont significatifs à cet égard :
²Des deux tendances dans le parti bolchevik qui se sont opposées à l'époque de Brest-Litovsk, de celle de Lénine et de celle de Boukharine, nous pensons que c'était la première qui était la plus adaptée aux nécessités de la révolution mondiale. La position de la fraction menée par Boukharine, selon laquelle la fonction de l'Etat prolétarien était de libérer les travailleurs des autres pays par une "guerre révolutionnaire" est en contradiction avec la nature même de la révolution prolétarienne et le rôle historique du prolétariat." (²Parti, Etat, Internationale. L'Etat prolétarien.² Bilan 18, Avril-Mai l935).
Contrairement à la révo1ution bourgeoise qui pouvait bien être exportée par les conquêtes militaires, la révolution prolétarienne dépend de la lutte consciente du prolétariat de chaque pays contre sa propre bourgeoisie : "la victoire d’un Etat prolétarien contre un Etat capitaliste (dans le sens territorial du terme) ne signifie en aucune manière la victoire de la révolution mondiale" (Ibid.) : le fait que l'entrée de l'Armée Rouge en Pologne en 1920 n'a réussi qu’à jeter les ouvriers polonais dans les bras de leur propre bourgeoisie est la preuve que les victoires militaires emportées par un bastion prolétarien ne peuvent se substituer à l'action politique consciente du prolétariat mondial et c'est pourquoi l'extension de la révolution est d'abord et avant tout une tâche politique. La fondation de l'IC en 1919 était ainsi une contribution de loin plus importante à la révolution mondiale qu'aurait pu l'être n'importe quelle "guerre révolutionnaire".
La signature du traité de Brest-Litovsk, sa ratification par le parti et les conseils et le vif désir de la Gauche d'éviter une scission dans le parti sur la question, marquèrent la fin de la première phase de l'activité des Communistes de gauche, Une fois que l'Etat soviétique avait acquis "le temps de souffler", les problèmes immédiats auxquels avait à faire face le parti étaient ceux de l'organisation de l'économie russe ravagée par la guerre. Et c'est sur cette question des dangers qui guettaient le bastion révolutionnaire que le groupe des Communistes de gauche a le plus contribué. Boukharine, le partisan fervent de la guerre révolutionnaire, était moins intéressé à critiquer la politique de la majorité bolchevik en matière d'organisation interne du régime et, à partir de ce moment là, la plupart des critiques les plus pertinentes de la politique intérieure devaient venir de la plume d'Ossinsky, qui devait se révéler être une figure de l'opposition bien plus cohérente que Boukharine.
Dans les premiers mois de 18, la direction bolchevik avait essayé de résoudre le désordre économique de la Russie d'une manière superficiellement "pragmatique".
Dans un discours fait au comité central bolchevik et publié sous le titre "les tâches immédiates du régime soviétique", Lénine préconisait la formation de trusts d'Etat dans lesquels les experts bourgeois et les propriétaires resteraient, mais sous la surveillance de l'Etat "prolétarien". Les travailleurs, en échange, auraient à accepter le système de Taylor du "management scientifique" (dénoncé autrefois par Lénine lui-même comme esclavage de l’homme par la machine) et de la "direction unique" dans les usines :
"La révolution requiert précisément dans l’intérêt du socialisme que les masses obéissent inconditionnellement à la seule volonté des dirigeants du procès de production".
Tout ceci signifiait que le mouvement des conseils d'usine, qui s'était propagé comme une traînée de poudre depuis février 1917, devait être refréné ; les expropriations réalisées par ces conseils ne devaient pas être encouragées, leur autorité croissante dans les usines devait être restreinte à une simple fonction de "contrôle" et ils devaient être transformés en appendices des syndicats qui étaient des institutions beaucoup plus malléables, déjà incorporées dans le nouvel appareil d'Etat. La direction bolchevik présentait cette politique comme la meilleure façon pour le régime révolutionnaire d'échapper à la menace du chaos économique et de rationaliser l'économie en vue de la construction définitive du socialisme quand la révolution mondiale se serait étendue. Lénine appelait carrément ce système "capitalisme d'Etat", terme sous lequel il entendait : contrôle par l'Etat prolétarien de l'économie capitaliste dans l'intérêt de la révolution.
Dans une polémique contre les communistes de gauche (Infantilisme et la mentalité petite bourgeoise du gauchisme), Lénine soutenait qu'un tel système de capitalisme d'Etat serait indiscutablement un pas en avant dans un pays arriéré comme la Russie où le principal danger de contre révolution venait de la masse petite bourgeoise, archaïque et atomisée, de la paysannerie. Cette conception est restée un "credo" des bolcheviks et les a aveuglés sur le fait que la contre révolution internationale s'exprimait d'abord et avant tout à travers l'Etat et non pas par les paysans. Les communistes de gauche aussi craignaient la possibilité de la dégénérescence de la révolution en un système de "rapports économiques petit-bourgeois". (²Thèses sur la situation présente². Kommunist, n°1, Avril 1918, et disponible en anglais dans : Daniels, Une Histoire documentaire de la Révolution). Ils partageaient aussi la conviction de la direction que la nationalisation par l'Etat "prolétarien" était bien une mesure socialiste. En fait, ils demandaient son extension à toute l'économie. Ils ne pouvaient pas être clairement conscients de ce que signifiait réellement le danger du "capitalisme d'Etat", mais, en se fondant sur un fort instinct de classe, ils ont vu rapidement les dangers inhérents à un système qui prétendait organiser l'exploitation des travailleurs dans l'intérêt du socialisme. L'avertissement prophétique d'Ossinsky est maintenant bien connu.
"Nous ne soutenons pas le point de vue de la construction du socialisme sous la direction des trusts. Nous soutenons le point de vue de la construction de la société prolétarienne par la créativité des travailleurs eux-mêmes, pas par les diktats des capitaines d'industrie. Nous faisons confiance à l'instinct de classe, à l'active initiative du prolétariat. Il ne peut en être autrement. Si le prolétariat ne sait pas comment créer les conditions nécessaires à l'organisation socialiste du travail, personne ne peut le faire à sa place et personne ne peut l'obliger à le faire. Le bâton, s’il est levé contre les travailleurs , se trouvera dans les mains d’une force sociale qui est, soit sous l’influence d’une autre classe sociale, soit dans les mains du pouvoir soviétique ; le pouvoir des soviets sera alors obligé de chercher du renfort contre le prolétariat chez une autre classe (par exemple, la paysannerie) et par là même il se détruira lui-même en tant que dictature du prolétariat. Le socialisme et l’organisation socialiste doivent être mis en place par le prolétariat lui-même ou ils ne seront pas mis en place du tout ; quelque chose sera installé, ²le capitalisme d’Etat².
(²Sur la construction du socialisme", Kommunist, n°2, Avril 1918. Daniels, ibid., p.85)
Contre cette menace, les communistes de gauche préconisaient le contrôle ouvrier de l'industrie par un système de comités d'usines et de "conseils économiques". Ils définissaient leur propre rôle comme étant celui "opposition prolétarienne responsable" constituée au sein du parti pour empêcher le Parti et le régime soviétique de "dévier" vers "le chemin désastreux de la politique petite bourgeoise". (²Thèses sur la situation présente²)
Les avertissements des gauches contre les dangers n'étaient pas restreints au plan économique, mais avaient de profondes ramifications politiques, ce qui peut être démontré par cet autre avertissement contre les efforts d'imposer la discipline du travail d'en haut :
²A la politique de gérer les entreprises sur la base d'une large participation des capitalistes et d'une centralisation semi bureaucratique, il devient normal d'ajouter une politique du travail qui vise à l'instauration parmi les travailleurs d'une discipline, sous les couleurs de "l’autodiscipline", à l'introduction du travail obligatoire (un tel programme avait été proposé par les bolcheviks de droite), au paiement aux pièces, à l'allongement de la journée de travail, etc."
"La forme de l'administration gouvernementale viendra à se développer dans le sens de la centralisation bureaucratique, vers le règne des "commissaires", vers la suppression de l'indépendance des conseils locaux et en pratique vers le rejet de "l'Etat-commune" administré par la base". (Thèses sur la situation présente)
La défense de la part des communistes des comités d'usines, des conseils, et de l'activité autonome de la classe ouvrière était importante non parce qu'elle aurait fourni une solution aux problèmes économiques rencontrés par la Russie, ou encore moins une recette pour la construction immédiate du "communisme" en Russie ; la Gauche déclarait explicitement que le "socialisme ne peut pas être réalisé dans un seul pays et surtout pas dans un pays "arriéré". (L.Schapiro, "L'Origine de l'autocratie communiste (p.137). Le fait que ce soit l’Etat qui imposait une discipline du travail, l'incorporation des organes autonomes du prolétariat dans l'appareil d'Etat, étaient surtout des coups portés à la domination politique de la classe ouvrière russe. Comme le CCI l'a souvent souligné ([3] [14]), le pouvoir politique de la classe est la seule garantie véritable de l'issue victorieuse de la révolution. Et le pouvoir politique ne peut être exercé que par les organes de masse de la classe, par ses comités, ses assemblées d'usines, ses conseils, ses milices. En affaiblissant l'autorité de ces organes, la politique de la direction bolchevik faisait peser une grave menace sur la révolution elle-même. Les signes de ce danger, que les communistes de gauche avaient si clairement vus dans les premiers mois de la révolution, devaient devenir encore plus sérieux pendant la période qui suivit la guerre civile. En fait, cette période allait déterminer sous beaucoup d'aspects la destinée finale de la révolution en Russie.
b) La guerre civile
La période de guerre civile en Russie, à partir de 18-20, montre surtout les dangers immenses que rencontre un bastion prolétarien, s'il n'est pas renforcé immédiatement par les armées de la révolution mondiale. Parce que la révolution n'a pas pris racine en dehors de la Russie, le prolétariat russe a du lutter à peu près seul contre les attaques de la contre révolution blanche et ses alliés impérialistes. Sur le plan militaire, la résistance des ouvriers russes était victorieuse. Mais politiquement, le prolétariat russe est sorti décimé de la guerre civile, épuisé, atomisé et plus ou moins privé de tout contrôle effectif sur l'Etat soviétique, Dans leur ardeur à gagner la lutte militaire, les bolcheviks avaient accéléré le déclin du pouvoir politique de la classe ouvrière en militarisant de plus en plus la vie sociale et économique. La concentration de tout le pouvoir effectif aux plus hauts niveaux de la machine d'Etat, permettait de poursuivre la lutte militaire de façon efficace et sans merci, mais elle sapait encore plus les véritables centres de la révolution : les organes unitaires de masse de la classe. La bureaucratisation du régime soviétique, qui s'est produite pendant cette période, devait devenir irréversible avec le reflux de la révolution mondiale après 1921.
Avec le début des hostilités en 1918, il y eut un resserrement général des rangs dans le parti bolchevik car chacun reconnaissait la nécessité de l'unité d'action contre le danger extérieur. Le groupe Kommunist, dont les publications avaient cessé de paraître après avoir été sévèrement critiquées par la direction du parti, n'existaient plus et son noyau du début se dispersa dans deux directions en réponse à la guerre civile.
Une tendance, représentée par Radek et Boukharine, saluait les mesures économiques imposées par la guerre civile avec enthousiasme. Pour eux, les nationalisations, la suppression des formes commerciales et monétaires et les réquisitions chez les paysans, les mesures dites de "communisme de guerre" représentaient une véritable rupture avec la phase ²capitaliste d'Etat" antérieure et constituaient un pas en avant majeur vers des rapports de production véritablement communistes. Boukharine a même écrit un livre – Les Problèmes économiques pendant la Période de Transition - qui explique comment la désintégration économique et même le travail forcé étaient des étapes préliminaires inévitables dans la transition au communisme. Il essayait manifestement de démontrer théoriquement que la Russie sous le communisme de guerre, qui avait été adopté simplement comme un ensemble de mesures d'urgence pour faire face à une situation désespérée, était une société de transition vers le communisme. Les ex-communistes de gauche, comme Boukharine, étaient tout à fait prêts à abandonner leurs critiques antérieures "de la direction unique" et de la discipline du travail, parce que, pour eux, l'Etat soviétique n'essayait plus de faire un compromis avec le capital à l'intérieur du pays, mais agissait résolument comme un organe de transformation communiste. Dans ses Problèmes de la Période de Transition, Boukharine soutenait que le renforcement de l'Etat soviétique et l'absorption croissante par cet Etat de la vie sociale et économique représentaient un pas décisif vers le communisme :
²L'intégration des syndicats au gouvernement, l’intégration de toutes les organisations de masse de prolétariat, sont le résultat de la logique interne du processus de transformation lui-même. La plus petite cellule de l’appareil de production doit devenir un support pour le processus général d’organisation qui est dirigé de façon planifiée et conduit par la volonté collective de la classe ouvrière qui se matérialise dans l’organisation qui couronne la société, celle qui embrasse tout : son pouvoir d’Etat. c’est ainsi que le système capitaliste d’Etat est transformé dialectiquement en son antithèse propre, dans la forme gouvernementale du socialisme des travailleurs.² (²Les Problèmes économiques², cité dans une Histoire documentaire du communisme, R. Daniels, éd. 1960, p. 180).
Avec des idées pareilles, Boukharine renversait "dialectiquement" le raisonnement marxiste selon lequel le mouvement vers la société communiste serait caractérisé par un affaiblissement progressif, un "dépérissement" de l'appareil d'Etat. Boukharine était encore un révolutionnaire quand il a écrit "Les problèmes économiques", mais entre sa théorie d'un "communisme" étatique, entièrement enfermé dans une seule nation et la théorie stalinienne du "socialisme dans un seul pays", il y a une continuité certaine.
Alors que Boukharine faisait la paix avec le communisme de guerre, ceux de la gauche qui avaient été le plus cohérents dans leur défense de la démocratie ouvrière, continuaient à défendre ce principe devant la militarisation croissante du régime. En 1919 le groupe du Centralisme Démocratique se formait autour d'Ossinsky, Sapronov et d'autres. Ils continuaient à protester contre le principe de "la direction unique" dans l'industrie et à défendre le principe collectif ou collégial comme étant "l'arme la plus efficace contre la départementalisation et l'étouffement bureaucratique de l'appareil d'Etat" (Thèses sur le principe collégial et l'autorité individuelle). Alors qu'ils reconnaissaient la nécessité d'utiliser des spécialistes bourgeois dans l'industrie et dans l'armée, ils mettaient aussi l'accent sur la nécessité de mettre ces spécialistes sous le contrôle de la base : "Personne ne discute la nécessité d'employer des spécialistes - la discussion, c'est : comment les emploie-t-on ?" (Sapronov, cité par Daniels, The Conscience of the Revolution, p.109) En même temps, les Centralistes démocratiques, ou "Décistes" comme on les appelait, protestaient contre la perte d'initiative des soviets locaux et ils suggéraient une série de réformes ayant pour but de les rétablir comme organes effectifs de la démocratie ouvrière. De telles politiques ont amené leurs critiques à remarquer que les Décistes s'intéressaient plus à la démocratie qu'au centralisme. Les Décistes réclamaient le rétablissement des pratiques démocratiques dans le parti. Au IXème congrès du PCR en septembre 1920, ils attaquèrent la bureaucratisation du parti, la concentration croissante du pouvoir dans les mains d'une petite minorité. Le fait que le congrès se soit terminé par le vote d'un manifeste qui appelait énergiquement à des "critiques plus générales des institutions du parti tant centrales que locales" et que soit rejetée "toute sorte de répression contre les camarades parce qu'ils ont des idées différentes" montre l'influence que ces critiques pouvaient encore avoir dans le parti. (Résolution du IXème congrès du Parti sur les nouvelles tâches de la construction du Parti).
En général, l'attitude des Décistes vis-à-vis des tâches du régime soviétique en période de guerre civile peut être résumée dans les phrases d'Ossinsky prononcées à ce même congrès :
"Le mot d'ordre fondamental que nous devons mettre en avant dans la période actuelle est celui de l'unification des tâches militaires, des formes militaires d'organisation et de méthode d'administration, avec l'initiative créative des ouvriers conscients. Si, sous la couverture des tâches militaires, vous commencez en fait à implanter le bureaucratisme, nous disperserons nos forces et n'arriverons pas à remplir nos tâches" (Cité par Daniels, Histoire documentaire, p.186).
Quelques années plus tard, le communiste de gauche Miasnikov devait dire ceci à propos du groupe du Centralisme Démocratique :
"Ce groupe n'avait pas une plate-forme qui ait une quelconque valeur théorique réelle. Le seul point qui attirait l'attention de tous les groupes et du Parti était sa lutte contre la centralisation excessive. Ce n'est que maintenant qu'on peut voir dans cette lutte, un effort encore confus du prolétariat pour déloger la bureaucratie des positions qu'elle venait de conquérir dans l'économie. Le groupe est mort de mort naturelle sans qu'aucune violence ne soit exercée contre lui." (L'ouvrier communiste,1929 - Un journal français proche du KAPD).
Les critiques des Décistes étaient inévitablement imprécises parce qu'ils représentaient une tendance née à une époque où le Parti Bolchevik et la révolution étaient encore très vivants, si bien que toute critique du Parti était vouée à prendre la forme d'appels à plus de démocratie dans le étaient voués à restreindre les critiques au niveau de la pratique organisationnelle plutôt qu'aux positions politiques fondamentales.
Beaucoup de ceux du Centralisme démocratique étaient ainsi engagés dans l'opposition militaire, qui s'était formée pendant une brève période en mars 1919. Les besoins de la guerre civile avaient forcé les bolcheviks à mettre en place une force combattante centralisée, l'Armée Rouge, composée non seulement de travailleurs mais aussi de recrues faites dans la paysannerie et d'autres couches. Très rapidement, cette armée commença à se conformer au schéma hiérarchique établi dans le reste de l'appareil d'Etat. L'élection des officiers était bientôt abandonnée parce que "politiquement inutile et techniquement inefficace" (Trotski, "Travail, discipline et ordre", 1920). La peine de mort pour désobéissance au feu, le salut et les formes spéciales pour s'adresser aux officiers avaient été rétablies et les distinctions hiérarchiques renforcées, surtout avec la mise à des postes de haut commandement dans l'armée des officiers antérieurement tsaristes.
L'opposition militaire, dont le porte-parole principal était Vladimir Smirnov, s'était constituée pour lutter contre la tendance à modeler l'Armée rouge sur les canons d'une armée bourgeoise typique. Elle ne s'opposait pas à la mise en place de l'Armée rouge en tant que telle, ni à l'emploi de "spécialistes" militaires, mais était contre une discipline et une hiérarchie excessives et voulait assurer à l'armée une orientation politique générale qui ne se sépare pas des principes bolcheviks. La direction du Parti accusait à tort ceux de l'opposition militaire de vouloir démanteler l'armée au profit d'un système de détachements de partisans plus adaptés aux guerres paysannes ; comme en beaucoup d'autres occasions, la seule alternative que la direction bolchevik pouvait voir à ce qu'ils appelaient "l'organisation étatique prolétarienne" était la décentralisation petite bourgeoise, anarchiste. En fait, les bolcheviks confondaient très souvent les formes bourgeoises de centralisation hiérarchique avec la centralisation et l'autodiscipline à partir de la base qui est une marque distinctive du prolétariat. En tout cas, ce que réclamait l'opposition militaire fut rejeté et le groupe se dispersa aussitôt. Mais la structure hiérarchique de l'Armée rouge - en conjonction avec le démantèlement des milices d'usines - devait faire d'elle un instrument plus efficace comme force répressive contre le prolétariat à partir de 1921.
En dépit de la persistance de tendances oppositionnelles à l'intérieur du Parti, tout au long de la période de guerre civile, la nécessité de l'unité contre les attaques de la contre révolution, agit comme force de cohésion tant dans le Parti que dans toute la classe et dans les couches sociales qui défendaient le régime soviétique contre les Blancs. Les tensions internes au sein du régime ont mûri pendant cette période pour n'apparaître au grand jour que lorsque les hostilités cessèrent, quand le régime eut à faire face aux tâches de reconstruire un pays dévasté. Les dissensions à propos de la nouvelle étape pour le régime soviétique s'exprimèrent en 1920-21 dans les révoltes des paysans, le mécontentement dans la marine, les grèves ouvrières à Moscou et Petrograd et culminèrent dans le soulèvement ouvrier de Cronstadt en mars 1921. Ces antagonismes s'exprimèrent inévitablement dans le Parti lui-même et dans les années déchirantes de 1920-21, il revient au groupe de l'Opposition Ouvrière d'avoir été le principal foyer de dissension politique au sein du Parti Bolchevik.
c) L'Opposition Ouvrière
Au Xème congrès du Parti, en mars 1921, éclata au sein du Parti Bolchevik une controverse qui était devenue de plus en plus aiguë depuis la fin de la guerre civile : la question syndicale. En apparence, c'était un débat sur le rôle des syndicats pendant la dictature du prolétariat, mais, en fait, c'était l'expression de problèmes beaucoup plus profonds sur l'avenir général du régime soviétique et de ses relations avec la classe ouvrière.
En résumé, il y avait trois positions dans le Parti : celle de Trotski, pour l'intégration totale des syndicats à "l'Etat ouvrier", où ils auraient pour tâche de stimuler la productivité du travail ; celle de Lénine pour qui les syndicats auraient toujours à agir en tant qu'organes de défense de la classe, même contre "l'Etat ouvrier", qui, soulignait-il, souffrait de "déformations bureaucratiques" et enfin la position de l'Opposition Ouvrière, pour la gestion de la production par les syndicats industriels, indépendants de l'Etat soviétique. Bien que tout le cadre de ce débat ait été profondément inadéquat, l'Opposition Ouvrière exprimait de façon confuse et hésitante l'antipathie du prolétariat pour les méthodes bureaucratiques et militaires devenues de plus en plus la marque du régime et l'espérance de la classe que les choses allaient changer maintenant que les rigueurs de la guerre avaient pris fin.
Les dirigeants de l'Opposition Ouvrière provenaient en grande partie de l'appareil syndical, mais le groupe semble avoir eu un soutien considérable de la classe ouvrière dans le sud-est de la Russie d'Europe et à Moscou, surtout chez les ouvriers de la métallurgie. Chliapnikov et Medvedev, deux des membres de la direction du groupe, étaient tous deux ouvriers métallurgistes. Mais le plus célèbre de ses dirigeants était Alexandra Kollontaï, qui avait écrit le texte programmatique de l'Opposition Ouvrière, comme un projet de "Thèses sur la question syndicale" soumis par le groupe au Xème congrès. Toutes les forces et les faiblesses du groupe peuvent être dégagées de ce texte, comme on peut en juger. Le texte commence en affirmant :
"L'Opposition Ouvrière est née du plus profond du prolétariat industriel de la Russie soviétique et a puisé sa force non seulement dans d'effroyables conditions de vie et de travail de sept millions de prolétaires industriels, mais encore dans les multiples écarts, oscillations et contradictions de notre politique gouvernementale et même dans ses franches déviations de la ligne de classe nette et conséquente du programme communiste". (Kollontaï, L'Opposition Ouvrière, Ed. du Seuil)
Kollontaï continue alors en soulignant les conditions économiques effroyables qu'a affrontées le régime soviétique après la guerre civile et en attirant l'attention sur la croissance d'une couche bureaucratique dont les origines se situent en dehors de la classe ouvrière - dans l'Intelligentsia, la paysannerie, les restes de la vieille bourgeoisie, etc. Cette couche est venue de plus en plus dominer l'appareil soviétique et le Parti lui-même, engendrant tant le carriérisme qu'un dédain aveugle pour les intérêts du prolétariat. Pour l'Opposition Ouvrière, l'Etat soviétique lui-même n'était pas un pur organe prolétarien mais une institution hétérogène obligée de tenir un équilibre entre les différentes classes et couches dans la société russe. Elle insistait sur le fait que la façon d'assurer que la révolution reste fidèle à ses buts initiaux, n'était pas de confier sa direction à des technocrates non prolétaires et aux organes socialement ambigus de l'Etat, mais à s'en remettre à l'auto activité et au pouvoir créatif des masses ouvrières elles-mêmes :
"Cette vérité qui est simple et claire pour n'importe quel ouvrier est perdue de vue par les sommets de notre Parti : le communisme ne peut pas être décrété. Il doit être créé par la recherche des hommes vivants, au prix d'erreurs parfois, mais par l'élan créateur de la classe ouvrière elle-même". (Kollontaï, p.80)
Cette vision générale de l'Opposition Ouvrière était très profonde sur beaucoup d'aspects mais le groupe fut incapable d'apporter une contribution dépassant ces généralités. Les propositions concrètes qu'il mettait en avant comme solution à la crise que traversait la révolution, se fondaient sur une série d'incompréhensions fondamentales, qui exprimaient toute l'ampleur de l'impasse dans laquelle se trouvait le prolétariat russe à cette époque.
Pour l'Opposition Ouvrière, les organes qui exprimaient les véritables intérêts du prolétariat n'étaient rien d'autre que les syndicats ou plutôt les syndicats industriels. La tâche de créer le communisme devait donc être confiée aux syndicats:
"L'Opposition Ouvrière reconnaît les syndicats comme les créateurs et les directeurs de l' économie communiste..." (Kollontaï, p.74)
C'est pourquoi, alors que les communistes de Gauche en Allemagne, Hollande et ailleurs dénonçaient les syndicats comme étant un des principaux obstacles à la révolution prolétarienne, la Gauche en Russie les exaltait comme des organes potentiels de transformation communiste ! Les révolutionnaires en Russie semblent avoir eu de grandes difficultés à comprendre que les syndicats ne pouvaient plus désormais jouer aucun rôle pour le prolétariat à l'époque de la décadence du capitalisme. Bien que l'apparition des comités d'usine et des conseils en 17 ait signifié la mort des syndicats en tant qu'organes de lutte de la classe ouvrière, aucun des groupes de Gauche en Russie ne l'avait vraiment compris, soit avant, soit après l'Opposition Ouvrière en 1921, alors que l'Opposition Ouvrière dépeignait les syndicats comme le squelette de la révolution, les véritables organes de la lutte révolutionnaire - les comités d'usine et les conseils - avaient déjà été émasculés. Dans le cas des comités d'usine, c'était leur intégration même dans les syndicats après 1918 qui les avait effectivement tués comme organes de la classe. Le transfert du pouvoir de décision dans les mains des syndicats, malgré la bonne intention de leurs partisans, n'aurait en aucune façon redonné le pouvoir au prolétariat en Russie. Même si un tel projet avait été possible, il n'aurait été qu'un simple transfert de pouvoir d'une branche de l'Etat à une autre.
Le programme de l'Opposition Ouvrière pour la régénérescence du Parti était également vicié à la base. Ils n'expliquaient l'opportunisme croissant du Parti qu'en termes d'afflux de membres non prolétariens. Pour eux, le Parti pouvait être remis dans le chemin prolétarien si une purge ouvriériste était effectuée contre les membres non ouvriers. Si le Parti était composé de manière écrasante de "purs" prolétaires aux mains calleuses, tout irait bien. Cette réponse à la dégénérescence du Parti manquait complètement son but. L'opportunisme du Parti n'était pas une question de personnes, mais une réponse aux pressions et aux tensions créées par l'exercice du pouvoir d'Etat et une situation de plus en plus défavorable. Recevoir les "rênes" du pouvoir en période ferait devenir n'importe qui "opportuniste", si pure que soit son origine prolétarienne. Bordiga remarquait, une fois, que les ex-ouvriers devenaient les pires de tous les bureaucrates. Mais l'Opposition Ouvrière n'a jamais mis en question la notion selon laquelle le Parti devait diriger l'Etat pour garantir qu'il reste un instrument du prolétariat :
"Le comité central de notre Parti doit devenir le centre supérieur de la politique de classe, l'organe de la pensée communiste et le contrôle permanent de la politique réelle des soviets et l'incarnation morale des principes de notre programme". (Kollontaï, p.88)
L'incapacité de l'Opposition Ouvrière à concevoir la dictature du prolétariat comme autre chose que la dictature du Parti les a conduits à faire frénétiquement acte de fidélité envers le Parti, quand, au milieu du Xème congrès, la révolte de Cronstadt a éclaté. Des leaders éminents de l'Opposition Ouvrière ont même donné des gages en se mettant eux-mêmes sur le front de l'assaut contre la garnison de Cronstadt. Comme toutes les autres fractions de gauche en Russie, ils n'ont pas du tout compris l'importance du soulèvement de Cronstadt en tant que dernière lutte de masse des ouvriers russes pour le rétablissement du pouvoir des soviets. Mais aider à la répression de la révolte n'a pas sauvé l'Opposition Ouvrière de la condamnation en tant que "déviation anarchiste, petite-bourgeoise", en tant "qu'élément objectivement contre-révolutionnaire" à la fin du congrès.
L'exclusion des "fractions" du Parti au Xème congrès porta un coup accablant à l'Opposition Ouvrière. Confrontée à la perspective d'un travail illégal, clandestin, elle s'avéra incapable de maintenir son opposition au régime. Quelques-uns de ses membres continuaient à lutter pendant les années 20, en association avec d'autres fractions illégales ; d'autres capitulèrent simplement. Kollontaï elle-même finit comme serviteur loyal du régime stalinien. En 1922, le journal communiste anglais le "Workers Dreadnought" faisait référence aux "dirigeants sans principe et sans épine dorsale" de la soi-disant "Opposition Ouvrière" (Workers Dreadnought, 20 juillet 22) et il y avait certainement un véritable manque de résolution dans le programme du groupe. Ce n'était pas une question de courage ou de manque de courage des membres individuels du groupe, mais le résultat des difficultés énormes qu'avaient à affronter les révolutionnaires russes pour essayer de s'opposer ou de rompre avec un parti qui avait été l'âme de la révolution. Pour beaucoup de communistes sincères, discuter les bases mêmes du Parti était pure folie. Il n'y avait rien en dehors du parti sinon le néant. L'attachement au Parti, si profond qu'il est devenu un obstacle à la défense des principes révolutionnaires, devait être encore plus prononcé dans l'Opposition de Gauche plus tard.
Une autre raison de la faiblesse des critiques de l'Opposition Ouvrière au régime était leur manque quasi total de perspectives internationales. Alors que les fractions de gauche les plus déterminées en Russie tiraient leur force de la compréhension du fait que le seul véritable allié du prolétariat russe et de sa minorité révolutionnaire était la classe ouvrière mondiale, l'Opposition Ouvrière avait un programme basé sur la recherche de solutions entièrement contenues dans le cadre de l'Etat russe.
La préoccupation centrale de l'Opposition Ouvrière était celle-ci : "Qui doit réaliser la créativité de la dictature du prolétariat dans la sphère de la construction économique ?" (Kollontaï, p.50). La tâche primordiale qu'ils fixaient à la classe ouvrière russe était la construction d'une "économie communiste" en Russie. Leurs préoccupations des problèmes de gestion de la production en créant des soi disant "rapports communistes" de production en Russie, manifestaient une incompréhension totale d'un point fondamental: le communisme ne peut pas être construit dans un bastion isolé. Le principal problème qui se dressait devant la classe ouvrière russe était l'extension de la révolution mondiale, non la "reconstruction économique" de la Russie.
Bien que le texte de Kollontaï critique "les relations commerciales actuellement engagées avec les puissances capitalistes, relations qui passent par dessus la tête du prolétariat organisé" (Kollontaï, p.56), l'Opposition Ouvrière était d'accord avec une attitude qui allait en se renforçant au sein même de la direction bolchevik, à savoir une tendance à mettre en avant les problèmes de l'économie russe au détriment de l'extension de la révolution au niveau international. Que ces groupes du parti aient défendu des positions divergentes sur le plan de la reconstruction économique est moins important que le fait qu'ils aient tous deux tendance à croire que la Russie pouvait se replier sur elle-même sans trahir les intérêts de la révolution mondiale.
La perspective exclusivement "russe" de l'Opposition Ouvrière se reflétait également dans son incapacité à développer des liens effectifs avec l'opposition communiste en dehors de la Russie. Bien que le texte de Kollontaï ait été sorti de Russie par un membre du KAPD et publié par le KAPD et le Workers dreadnought, Kollontaï changea d'avis par la suite et, regrettant sa décision, tenta de récupérer son texte ! L'Opposition Ouvrière ne fit aucune critique réelle de la politique opportuniste adoptée par l'IC ; elle approuva les 21 conditions et n'a pas cherché à se joindre à l'opposition de "l'étranger" malgré la solidarité que le KAPD et d'autres lui ont manifesté. En 1922, les membres de l'Opposition Ouvrière firent un dernier appel au IVème congrès de l'IC mais leur intervention se bornait à protester contre la bureaucratisation du régime et contre l'absence de liberté d'expression pour les groupes communistes dissidents en Russie. De toute façon, ils n'eurent que peu d'écho dans une Internationale qui avait déjà expulsé ses meilleurs éléments et qui allait approuver la politique du "front unique". Peu après leur dernier appel, une commission bolchevik spéciale fut formée pour examiner les activités de l'Opposition Ouvrière. La commission tira la conclusion que le groupe constituait une "organisation fractionnelle illégale" et la répression qui suivit mit fin à la plupart des activités de ce groupe ([4] [15]). L'Opposition Ouvrière eut le malheur d'être poussée sur le devant de la scène à une époque où le Parti subissait des bouleversements profonds qui allaient peu de temps après rendre toute activité oppositionnelle légale impossible en Russie. En voulant faire un compromis entre les deux extrêmes : le travail fractionnel au sein du Parti, d'une part, et une opposition clandestine au régime d'autre part, l'Opposition Ouvrière finit dans le vide ; dorénavant, le flambeau de la résistance prolétarienne trouverait des porteurs plus résolus et intransigeants.
C.D.
Ward
[1] [16] Les bolcheviks eux-mêmes ont produit des tendances d'extrême gauche pendant la période d'avant la Première guerre, notamment les maximalistes qui critiquaient la tactique parlementaire de l'organisation bolchevik après la révolution de 1905. Mais puisque ce débat avait lieu à l'époque marquant la fin de la phase ascendante du capitalisme, nous n'entrerons pas dans une discussion approfondie de ces positions dans cette étude. La Gauche Communiste, par contre, est un produit spécifique du mouvement ouvrier dans l'époque de décadence ; la Gauche Communiste a son origine dans la critique de la stratégie communiste "officielle" de l'IC à ses débuts, critique qui cherchait à définir les tâches révolutionnaires du prolétariat dans la nouvelle période.
[2] [17] cf. "Leçons de la Révolution Allemande" (Revue Internationale, n°2).
[3] [18] cf. "La dégénérescence de la Révolution Russe" et les "Leçons de Cronstadt" (Revue Internationale, n°3).
[4] [19] Bien que l'Opposition Ouvrière ait cessé d'exister après 1922, son nom comme celui du Centralisme Démocratique revient continuellement par rapport à l'activité clandestine jusqu'au début des années 30, ce qui semble démontrer que des éléments de ces deux groupes ont combattu jusqu'au dernier souffle.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [20]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [21]
Les ambiguïtés sur les «partisans» dans la constitution du parti communiste internationaliste en Italie
- 3100 reads
LETTRE DE BATTAGLIA COMUNISTA
Chers camarades,
Nous avons lu dans le numéro de septembre de votre journal le passage suivant ([1] [22]) :
"A vrai dire, les révolutionnaires alias les "métaphysiciens impuissants" ne seront qu'à demi surpris des offres de service discipliné des bordiguistes au front unique. C'est avec un précédent bagage antifasciste que l'actuel PCI s'est formé. Les premiers à rejoindre les rangs viennent des groupes de "partisans' italiens", ensuite ceux du Comité antifasciste de Bruxelles, puis des éléments de l'ancienne minorité de la Gauche favorables à ce qu'ils estimaient pouvoir être une "véritable lutte de classe" face à Franco. Par contre, la Gauche Communiste en France et en Belgique est restée de façon intransigeante sur les bases affirmées par la Gauche Communiste Internationale. Pendant la Seconde guerre, ses appels ne sont pas allés vers les antifascistes "sincères" ou "ouvriers", mais ils se sont adressés au prolétariat mondial, l'appelant à transformer la guerre impérialiste en guerre civile, excluant par avance tout geste pouvant être interprété comme un appui critique à la démocratie."
Ce passage est extrait de l'article "Honnêtes propositions d'hymen frontiste du PCI, polémique contre une des habituelles escapades frontiste de Programma Comunista (Le Prolétaire) en France".
Nous n'entendons pas entrer ici dans le cœur d'une polémique qui ne nous concerne pas et sur laquelle nous avons déjà clairement défini notre position. Nous entendons plutôt demander une profonde rectification des graves affirmations contenues dans le passage cité, affirmations que nous n'hésitons pas à qualifier d'entièrement et complètement fausses, sans que nous sachions si elles ont été dictées par le manque de connaissance ou par le laisser-aller politique. Il est vrai que Programma Comunista (les bordiguistes) s'est mis en dehors du Partito Comunista Internazionalista qui à Turin "en 1943 a tenu sa première convention et où s'étaient rassemblés à ce moment-là ces mêmes camarades qui aujourd'hui ruminent de nouveau ce frontisme (antifasciste et syndical) depuis longtemps digéré par la Gauche révolutionnaire". Mais il est tout aussi vrai que le P. C. Internazionalista a continué d'être en Italie la seule force qui défende avec sérieux et de façon conséquente tout ce que la gauche avait fait de mieux dans sa tâche de tirer les leçons et les conclusions de la première vague révolutionnaire ouverte par la révolution en Russie et close au sein de la Troisième Internationale. Que par ailleurs les "programmistes" se réclament par commodité de ce même patrimoine d'élaboration et de lutte pour le renier dans la pratique politique, c'est une affaire qui nous concerne seulement à cause de la confusion que cela engendre même dans les avant-gardes ouvrières.
Et ce Partito Comunista Internazionalista fondé en 43 qui connut la convention de Turin, le congrès de Florence de 1948 et celui de Milan en 1952 n'a pas tout à fait un bagage simplement "antifasciste". Les camarades qui l'ont constitué provenaient de cette Gauche qui avait la première dénoncé, aussi bien en Italie qu'à l'étranger, la politique contre révolutionnaire du bloc démocratique (comprenant les partis staliniens et trotskistes) et avait été la première et la seule à agir au sein des luttes ouvrières dans les rangs mêmes des Partisans, appelant le prolétariat contre le capitalisme quel que soit le régime dont il se recouvre.
Les camarades, que RI voudrait faire passer pour des "résistants", étaient ces militants révolutionnaires qui faisaient un travail de pénétration dans les rangs des Partisans pour y diffuser les principes et la tactique du mouvement révolutionnaire et qui, pour cet engagement, sont même allés jusqu'à payer de leur vie. Devons-nous rappeler aux camarades de Révolution Internationale les figures d'Acquaviva et d'Atti? Et bien, ces deux camarades vilement assassinés sur ordre des chefs staliniens (les mêmes démocrates d'aujourd'hui), étaient des cadres du Partito Comunista Internazionalista et c'est aussi au fait de leur héroïque conduite révolutionnaire que le Partito Comunista Internazionalista a pu et peut se présenter avec toutes ses cartes en règle.
En ce qui concerne les camarades qui pendant la période de la guerre d'Espagne décidèrent d'abandonner la fraction de la Gauche Italienne pour se lancer dans une aventure en dehors de toute position de classe, rappelons que les événements d'Espagne qui ne faisaient que confirmer les positions de la Gauche, leur ont servi de leçon pour les faire rentrer de nouveau dans le sillon de la gauche révo1utionnaire. Le Comité antifasciste de Bruxelles dans la personne de Vercesi, qui au moment de la constitution du P.C.Int., pense devoir y adhérer, maintient ses propres positions bâtardes jusqu'au moment où le parti rendant le tribut nécessaire à la clarté se sépare des branches mortes du bordiguisme.
Ce que nous affirmons est confirmé par des documents qui existent et que les camarades de Révolution Internationale ont à leur disposition mais semblent ne pas avoir lu. Le premier cahier internationaliste avec tous les documents "d'époque" montre quelle fut la politique du P.C.Int. et de quel "frontisme" il se réclamait (unité des travailleurs contre la guerre et contre ses agents fascistes et démocrates), chose tout à fait différente du frontisme d'organisations qui est aujourd'hui défendu par les programmistes.
En demandant que soit faite cette nécessaire rectification, au moment même où RI se place sur le terrain de la discussion avec les forces révolutionnaires et se déclare disponible pour l'initiative internationale de notre Parti, nous souhaitons que tous les révolutionnaires sachent mener un sérieux examen critique des positions sur les principaux problèmes politiques de la classe ouvrière aujourd’hui, en se documentant avec le sérieux propre précisément aux révolutionnaires, lorsqu’il s'agit de revenir (et c'est là quelque chose qui est toujours nécessaire) sur les erreurs du passé.
Saluts communistes
Pour l'exécutif du P.C.Int., Damen
REPONSE DU C. C. I.
Nous n'étions pas peu surpris de recevoir et de lire votre lettre imprégnée d'une sainte indignation, c'est le moins qu'on puisse dire. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un article publié dans le numéro 29 de Révolution Internationale du mois de septembre, article dirigé contre le PCI bordiguiste dans lequel nous mettions en relief l'opportunisme profond qui ronge cette organisation notamment pour ce qui concerne sa tendance de plus en plus accentuée vers le "frontisme". Le bordiguisme reconstitué en Parti à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous offre une image frappante d'une dégénérescence d'un courant autrefois communiste de gauche, sur toutes les questions qui se sont posées au mouvement ouvrier depuis la faillite de la 3eme Internationale : fonction du Parti, moment historique de sa constitution ; nature et fonction des syndicats aujourd’hui, programme de revendications transitoires ; électoralisme ; question de la libération nationale ; frontisme. Sur toutes ces questions, le bordiguisme converti en Parti, n'a fait qu'emprunter une voie qui l'éloigne de plus en plus des positions communistes et le rapproche chaque jour plus du trotskisme. Cette régression politique semble être la seule "invariance" dans l'évolution du bordiguisme et tout groupe vraiment révolutionnaire ne peut manquer de se heurter à lui et de le combattre implacablement. C'est ce qu'avait fait Révolution Internationale dans l'article incriminé.
Comment se fait-il alors que les attaques dirigées contre le bordiguisme aient atteint Battaglia Comunista qui s'en plaint et proteste, ce qui nous a valu cette lettre ? A croire que les balles ont malencontreusement ricoché. Mais ricoché sur quoi?
En premier lieu, cela vient du fait qu'il existe en Italie au moins quatre groupes qui se nomment PCI, tous les quatre provenant du même Parti initial, se réclamant de la même continuité, de la même "invariance", de la même tradition et de la même plate-forme initiale dont chacun se revendique comme le seul, le vrai et légitime, l'unique héritier. Il est certainement dommage que, par un excès d'amour propre et souci d'authenticité, ces groupes, en maintenant le même nom, ne font qu'entretenir une confusion. Nous n'y sommes pour rien et ne pouvons que le regretter. A cela, il faut ajouter que, hors d'Italie, et surtout en France, c'est le groupe bordiguiste (Progranna Comunista) qui est connu comme le PCI et, quoi qu'en pense Battaglia, cela ne semble pas complètement illogique. S'il ne nous appartient pas de donner des attestations de légitimité, il nous semble cependant que c'est aller vite en besogne que de considérer le bordiguisme comme un courant qui n'a fait que "traverser" la Gauche Italienne, comme veut le faire accroire la lettre. Quelle que soit sa régression aujourd'hui, personne ne peut ignorer ou nier que, durant 25 années, le bordiguisme se confond complètement avec ce qu'on connaît comme la Gauche Italienne. Cela est non seulement vrai pour la fraction abstentionniste de Bordiga, et son journal Il Soviet dans les années 20, mais est encore attesté par le fait que la Plate-forme, présentée par la gauche au Congrès de Lyon en 1926 et qui servira de base à son exclusion du PC, porte expressément le titre : "Plate-forme de la Gauche (Bordiguiste)".
Quoi qu'il en soit, personne ne pouvait se tromper sur l'adresse à qui notre article était destiné. Aucune équivoque ne peut subsister car nous avions de plus pris la précaution de souligner en toutes lettres dans le sous-titre : "Un PCI (Programme Communiste) frontiste". Quant au passage que vous citez et qui semble tellement vous irriter, remarquons qu'il était non seulement de notre droit mais politiquement tout à fait logique de nous demander si cette dégénérescence du bordiguisme n'est qu'un fait du hasard, ou s'il ne faut pas en chercher les germes et les trouver déjà dans le passé, dans les conditions politiques mêmes dans lesquelles s'est constitué ce Parti. Ce qui vous gêne est que l'histoire de la constitution de ce Parti se trouve être également votre propre histoire. Aussi, vous essayez de minimiser cette unité de responsabilité, cette unité tout court existant à l'origine de ce Parti, en marquant une distinction à faire selon vous dès le début, entre les uns et les autres, en écrivant :
"Il est vrai que Programma Comunista (les bordiguistes) s'est mis en dehors du Partito Comunista Internazionalista qui à Turin "en 1943 a tenu sa première convention et où s'étaient rassemblés à ce moment-là ces mêmes camarades (…)".
"… jusqu'au moment où le parti rendant le tribut nécessaire à la clarté se sépare des branches mortes du bordiguisme".
En d'autres termes : à la constitution du PCI, il y avait nous et eux ; ce qui était bon, c'était nous, le mauvais, c'était eux. En admettant qu'il en fut ainsi, cela ne change rien au fait que ce "mauvais" y était, qu'il constituait un élément fondamental et unitaire dans le moment de la constitution du Parti et que personne n'a rien trouvé à y redire ni n'a élevé la moindre critique, parce que lancés tous ensemble dans une course précipitée de construction d'un Parti, on ne prit pas le temps (sans parler déjà d'un examen sérieux du moment de la constitution du Parti) de regarder de plus près avec qui on entreprenait cette construction et de quelles positions et activités ceux-ci se réclamaient.
De ne l'avoir pas vu et compris au moment même peut à la rigueur être une explication, en aucun cas une justification, et encore moins a posteriori. C'est pourquoi nous ne comprenons pas vos protestations quand nous ne faisons que rappeler tout simplement les faits et leur signification à nos yeux.
Battaglia Comunista nous demande une "profonde rectification des graves affirmations contenues dans le passage cité", en ajoutant, "affirmations que nous n'hésitons pas à qualifier d'entièrement et complètement fausses". En fait de rectification, nous nous voyons plutôt obligés de nous expliquer et d'apporter des précisions qui fondent nos affirmations et qui sont, quoiqu'en pense Battaglia Comunista loin d'être "entièrement et complètement fausses". Tout d'abord, une chose doit être claire : nous n'avons jamais dit que le PCI -fondé en 1943 - avait "tout à fait un bagage simplement 'antifasciste'". Si telle avait été notre appréciation, nous l'aurions dit et nous aurions eu à son égard une attitude politique en conséquence, c'est-à-dire de dénonciation pure et simple comme envers les trotskistes, et non celle de la confrontation, ce qui est tout à fait différent, même si cette confrontation est parfois violente. Nous ne disons pas que les positions du PCI étaient "simplement" antifascistes, mais que dans le Parti, on avait laissé droit de cité (et cela jusque dans la direction) à des éléments qui se réclamaient ouvertement d'expériences (les leurs) frontistes et antifascistes. Ce que nous voulons mettre en évidence, c'est qu'à côté des affirmations de positions de classe, le PCI laissait subsister des ambiguïtés, tant du point de vue du regroupement des éléments que de celui des formulations. Tout se passait comme si en fermant la porte, on laissait à tout hasard la fenêtre entrouverte. Il ne faut pas nous faire dire ce que nous ne disons pas, mais nous entendons défendre tout ce que nous disons. Aussi nous souscrivons pleinement à ce qu'écrivait Internationalisme n°36 en juillet 1948 :
'Tout comme après la Conférence de 1945, nous estimons qu'en son sein (le PCI) sont rassemblés un grand nombre de militants révolutionnaires sains, et de ce fait, cette organisation ne peut être considérée comme perdue d'avance pour le prolétariat".
Internationalisme n'aurait certainement pas parlé ainsi d'un groupe simplement antifasciste, mais cela ne diminue en rien les "graves affirmations" critiques qu'il portait contre les "ambiguïtés" et les erreurs du PCI que les vicissitudes ultérieures de ce Parti, ses crises, et ses scissions, ont depuis amplement justifiées.
Ces ambiguïtés et erreurs, nous les trouvons dans le fait même de la constitution du Parti. Le Parti ne se constitue pas à n'importe quel moment. La Gauche Communiste de France avait raison en s'appuyant sur les critiques pertinentes portées par "Bilan" contre la proclamation de la 4eme Internationale de Trotski, de critiquer énergiquement la constitution du P.C.I. Un tel Parti constitué dans une période de réaction et de défaite de la classe porte non seulement des marques de volontarisme et d'artificiel mais doit nécessairement contenir des "flous" et des ambiguïtés politiques. Jamais, à notre connaissance, le P.C.I. (que vous soyez les seuls ou non à continuer) n'a répondu à cette critique, préférant, dans son enthousiasme de la constitution, l'ignorer dans un silence dédaigneux, en même temps qu'il ouvrait les portes à des éléments politiquement douteux.
Nous trouvons ces ambiguïtés dans la Plate-forme Politique du P.C.I. publiée en français en mai 1946. Faut-il insister sur le fait que durant la guerre et surtout vers la fin de celle-ci, les questions sur l'attitude des révolutionnaires face à la guerre, la Résistance partisane, la mystification antifasciste et autres "libérations" prenaient une acuité particulière, exigeant la plus grande clarté et intransigeance ? Parlant de ces activités et tout en condamnant la Résistance dans son ensemble, la Plate-forme écrit :
"Les éléments effectifs de l'action clandestine qui a été développée contre le régime fasciste ont été et sont des réactions spontanées et informes de groupements prolétariens et de rares intellectuels désintéressés ainsi que l'action et l'organisation que tout Etat et toute armée créent et alimentent aux arrières de l'ennemi." (Plate-forme, p. 19, § 7).
Tout le paragraphe 7, où est traitée la question des Partisans, s'efforce d'habiliter l'idée que ce mouvement a un double fondement : l'un d'origine prolétarienne, l'autre émanant des Etats et armées adversaires. Et pour mieux faire valoir encore le caractère de "réactions spontanées et informes de groupements prolétariens" on ira jusqu'à minimiser le poids de l'autre : "Ces chefaillons politiques qui sont apparus comme des mouches du coche n'ayant eu qu'une influence minime dans cette action" (ibid.). Comment ne pas sentir toute l'ambiguïté de cet autre passage de ce même paragraphe :
"En réalité le réseau que les partis bourgeois et pseudo-prolétariens ont constitué dans la période clandestine, n'avait pas du tout comme but l'insurrection partisane nationale et démocratique, mais seulement la création d'un appareil destiné à immobiliser tout mouvement révolutionnaire, qui aurait pu se déterminer au moment de l'effondrement de la défense fasciste et allemande." (Ibid.)
Cette insistance à vouloir distinguer et opposer "l'insurrection partisane nationale et démocratique" à la recherche d'"d'immobiliser tout mouvement révolutionnaire" recouvre nettement la première distinction faite sur l'origine et caractère doubles du mouvement Partisan et mène logiquement à la reconnaissance d'un possible mouvement "antifasciste prolétarien" sincère, démocratique et tout, en opposition à un faux antifascisme bourgeois.
C'est voiler à peine le lien "naturel" qu'on établit ainsi entre le prolétariat et les Partisans, et ce léger voile disparaîtra complètement quand on écrira:
"Ces mouvements (des Partisans) qui n'ont pas une orientation politique suffisante (sic !) expriment tout au plus la tendance de groupes prolétariens locaux à s'organiser et à s'armer pour conquérir et conserver le contrôle des situations locales et donc du pouvoir." (p. 2, § 18)
Le mouvement de Partisans n'est plus dénoncé pour ce qu'il est, la mobilisation des ouvriers pour la guerre impérialiste, mais devient une tendance de groupes prolétariens pour conquérir le pouvoir local, mais, malheureusement... "avec une orientation politique insuffisante"… !
Quand on pense que ce sont là des textes extraits de la Plate-forme, c'est-à-dire, le document de fondement, écrit avec la plus grande attention et par les membres les plus autorisés, on peut s'imaginer aisément quelles diatribes antifascistes se trouvaient dans la presse locale du P.C.I., dans le Sud surtout, qui se trouvait isolé et coupé du centre qui était dans le Nord ([2] [23]).
Avec une telle définition, on ne peut s'étonner qu'on en soit arrivé à prendre la défense de ces luttes :
"En ce qui concerne la lutte partisane et patriotique contre les Allemands et les fascistes, le Parti dénonce la manœuvre de la bourgeoisie internationale et nationale qui, avec sa propagande pour la renaissance d'un militarisme d'Etat officiel (propagande vide de sens) (sic) vise à dissoudre et à liquider les organisations volontaires de cette lutte, qui, dans beaucoup de pays ont déjà été attaquées par la répression armée."
On nous demandait une "rectification profonde de graves affirmations". Nous sommes absolument d'accord et convaincus que ces rectifications sont nécessaires et s'imposent. La seule question est de savoir qui doit rectifier quoi ? Est-ce à nous de rectifier de fausses accusations d'antifascisme ? Ou est-ce à Battaglia de rectifier des postulats et des formulations plus qu'ambiguës de la Plate-forme, base de constitution du P.C.I. ?
Comment le P.C.I. pouvait-il prendre la défense de l'organisation Partisane contre la menace de leur dissolution par l'Etat ? Les Partisans étaient l'organisation armée dans laquelle la bourgeoisie mobilisait les ouvriers de l'arrière pour la guerre impérialiste au nom de l'antifascisme et de la libération nationale. Cela ne semble pas tellement évident pour le P.C.I. qui voit dans cette organisation de Partisans patriotique et antifasciste quelque chose d'autre, "une réaction spontanée de groupements prolétariens" - d'où sa politique pleine de sollicitudes à son égard :
"Face à ces tendances qui constituent un fait historique de premier ordre... le Parti met en évidence que la tactique prolétarienne exige en premier lieu que les éléments les plus combatifs et les plus résolus trouvent finalement (!) la position politique et l'organisation qui leur permettra - après avoir longtemps donné leur sang pour la cause des autres - de se battre enfin et seulement pour leur propre cause." (Ibid.).
Qu'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit pas pour le P.C.I. d'éléments ouvriers égarés et entraînés dans une organisation capitaliste que le prolétariat en premier ordre doit détruire, mais donc d'une organisation ouvrière, "un fait historique de premier ordre", ayant une "orientation politique insuffisante", qu'on doit défendre contre la manœuvre de la bourgeoisie qui veut la dissoudre, avec qui il peut y avoir un dialogue, un terrain fertile pour la révolution et dans les rangs de laquelle on va pénétrer pour porter les positions communistes.
On pense nous confondre en nous disant que les militants du P.C.I. dans les rangs des Partisans n'allaient pas pour faire œuvre de "résistants" mais pour "diffuser les principes et la tactique du mouvement révolutionnaire". Soit. Mais pour faire la propagande orale ou écrite, on ne demande pas aux révolutionnaires l'adhésion dans une organisation contre révolutionnaire. Ce genre de pénétration est la tactique de ceux qui vont faire du "noyautage tactique" que nous n'apprécions pas outre mesure et que nous préférons laisser aux trotskistes. Mais cela n'explique pas encore pourquoi, précisément, dans les rangs des Partisans... et non pas dans les Partis P.S. ou P.C., par exemple ? Cela ressemble bien plus à la tactique d"'entrisme" des trotskistes et n'a rien de commun avec les positions révolutionnaires de la Fraction Italienne de la Gauche Communiste. Que ce soit de leur propre chef (ou sur décision du Parti) que le Parti ait accepté que "des cadres du Parti" adhèrent à l'organisation de Partisans, c'est là une "tactique" plus qu'étrange et que nous ne pouvons qualifier que de collaboration politique. Les Partisans, ne l'oublions pas, est une organisation contre révolutionnaire de la pire espèce, créée pendant la guerre en vue de perpétuer le massacre des ouvriers; c'est une organisation militaire, basée sur le "volontariat" (tout comme les S.S.) et, à ce titre, n'offre aucun terrain propice de diffusion de principes et tactiques révolutionnaires, ce qui la distingue de l'armée, dans laquelle les ouvriers sont mobilisés de force ([3] [24]). Le fait que cette organisation de guerre avait des allures "populaires" et sur sa façade "l'antifascisme", ne justifiait nullement la politique de pénétration et l'envoi de cadres de la part d'un Parti révolutionnaire. Si le P.C.I. l'a fait, c'est que lui-même était dans la confusion et, en plus, pris dans son "activisme", il a commis une terrible légèreté en laissant aller, ou, pire encore, en envoyant des militants dans ce repaire contre révolutionnaire militaire où ils ne pouvaient que se faire assassiner. D'une telle erreur, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter ([4] [25]).
Nous ne connaissons pas le détail des circonstances dans lesquelles furent assassinés, sur ordre des staliniens, les camarades Acquaviva et Atti. Mais leur fin tragique, loin d'apporter la preuve de la justesse de votre politique de participation, ne fait que nous renforcer dans notre conviction. Beaucoup de trotskistes en France et ailleurs ont perdu leur vie dans des circonstances analogues ; cela ne prouve nullement que la politique de participation qu'ils pratiquaient était révolutionnaire
Après tout ce que nous venons de voir, aucun doute n'est possible sur l'ambiguïté de la position du P.C.I. au moment de sa constitution concernant la question de la Résistance antifasciste et Partisane - et ceci devra peser sur l'évolution ultérieure de l'organisation. Pour confirmer nos dires, il suffit de citer l'intervention de Danielis ([5] [26]) au Congrès du P.C.I. à Florence (6-9 mai 1948) :
"Une chose doit être claire pour tout le monde : le Parti a subi l'expérience grave d'un facile élargissement de son influence politique - due à un non moins facile activisme - non en profondeur (car difficile) mais en surface. Je dois faire part d'une expérience personnelle qui servira de mise en garde face au danger d'une facile influence du Parti sur certaines couches, de masses, conséquence automatique d'une non moins facile formation théorique des cadres. Je me trouvais comme représentant du Parti à Turin, dans les derniers mois de la guerre. La Fédération était numériquement forte, avec des éléments très activistes, des tas de jeunes, de nombreuses réunions, des tracts, le journal, un Bulletin, des contacts avec les usines ; des discussions internes qui prenaient toujours un ton extrémiste dans les divergences sur la guerre en général ou la guerre de Partisans en particulier ; des contacts avec des éléments déserteurs. La position face à la guerre était claire : aucune participation à la guerre, refus de la discipline militaire de la part d'éléments qui se proclamaient internationalistes. On devait donc penser qu'aucun inscrit au Parti n'aurait accepté les directives du "Comité de Libération Nationale". Or, le 25 avril au matin (date de la "libération" de Turin), toute la Fédération de Turin était en armes pour participer au couronnement d'un massacre de 6 années, et quelques camarades de la province -encadrés militairement et disciplinés entraient à Turin pour participer à la classe à l'homme. Moi-même, qui aurais dû déclarer dissoute l'organisation, je trouvais un moyen de compromis et fis voter un ordre du jour dans lequel les camarades s'engageaient à participer au mouvement individuellement. Le Parti n'existait pas ; il s'était volatilisé."
Ce témoignage public d'un vieux militant responsable et formé par une longue expérience de la Fraction Italienne à l'étranger est éloquent et dramatique à la fois. Ainsi, ce n'est pas le Parti qui pénétrait dans les rangs de Partisans pour diffuser les principes et la tactique révolutionnaires, mais c'était bel et bien l'esprit de Partisans qui pénétrait dans le parti et gangrenait ces militants. Le fait que le P.C.I. ne se soit jamais livré à un débat critique approfondi sur ce sujet, que pour des raisons de prestige prévalant, le Parti ait préféré se réfugier dans le silence, entraînant, comme nous le verrons, d'autres "silences", explique bien des incidences le long de son histoire, la survivance de ces ambiguïtés et leur développement même, dans l'ensemble des groupes dans lesquels il s'est divisé.
Cette ambiguïté concernant la question de Partisans, nous la retrouverons à chaque pas dans les groupes issus du PCI originel, et cela non seulement chez les bordiguistes (Programma) avec leur soutien des mouvements de libération nationale dans les pays sous-développés. Nous la retrouvons dans le Bulletin International publié en français au début des années 60, fait en commun par News and Letters, Munis et Battaglia Comunista, où, dans un article d'un camarade italien, on essaie de montrer à l'aide de la théorie du "cas particulier" que les Partisans en Italie avaient quelque chose de différent des autres résistances dans les autres pays, et donc justifiait un traitement particulier. Les traces de cette position ambiguë, nous les retrouvons encore jusque dans la lettre présente de Battaglia Comunista quand elle parle "d'agir au sein des luttes ouvrières et dans les rangs mêmes des Partisans".
Selon la lettre de Battaglia, les camarades de la minorité de la fraction italienne allèrent en Espagne "en dehors de toute position de classe", à l'encontre des militants du PCI qui, eux, "faisaient un travail de pénétration dans les rangs des Partisans pour y diffuser les principes et la tactique du mouvement révolutionnaire". Mais est-ce que les camarades de Battaglia Comunista pensent que les militants de la minorité sont allés en Espagne pour "défendre la démocratie républicaine contre le fascisme" ? Eux aussi, en allant en Espagne, tout comme ceux du P.C.I. dans les rangs des Partisans, voulaient aller pour diffuser dans les files des principes et la tactique du mouvement révolutionnaire", pour la Dictature du Prolétariat, pour le Communisme. Pourquoi celle de la minorité a été une "aventure" et celle du P.C.I. un acte d'héroïsme ? Une simple question, et qui ne trouve certes pas sa réponse dans l'affirmation toute gratuite que les évènements "leur ont servi (à la minorité) de leçon pour les faire rentrer dans le sillon de la gauche révolutionnaire". Cette minorité exclue de la fraction, en 36 va se regrouper dans l'Union Communiste, qui défend les mêmes positions, et va y rester jusqu'à la dispersion de ce groupe pendant la guerre. Il n'a jamais plus été question de retour de ces militants à la Gauche Communiste, jusqu'au moment de la dissolution de la fraction et l'intégration de ses militants dans le P.C.I. (fin 45). Il n'a jamais été question de "leçon", ni de rejet de position, ni de condamnation de leur participation à la guerre antifasciste d'Espagne de la part de ces camarades. C'est tout simplement l'euphorie et la confusion de la constitution du parti "avec Bordiga" qui ont incité ces camarades, y compris les quelques camarades français survivants de l'ancienne Union Communiste, à le rejoindre, et cela sous l'instigation directe de Vercesi, devenu entre temps dirigeant du parti et son représentant en dehors d'Italie. Le Parti en Italie ne leur a pas demandé de comptes, non pas par ignorance – de vieux camarades de la fraction comme Danielis, Lecce, Luciano, Butta, Vercesi et tant d'autres ne pouvaient pas ignorer cette minorité que neuf ans avant ils ont eux-mêmes exclue - mais parce que le moment n'était pas à "de vieilles querelles" ; la reconstitution du Parti effaçait tout. Ce parti qui n'était pas trop regardant sur l'agissement des Partisans présents dans ses propres militants ne pouvait se montrer rigoureux envers cette minorité pour son activité dans un passé déjà lointain et lui ouvrait "naturellement" ses portes, faisant d'elle, dans le silence, l'assise de la section française du nouveau Parti.
Les choses ne vont pas mieux pour ce qui concerne les explications sur le Comité Antifasciste de Bruxelles et son promoteur Vercesi. A ce sujet la lettre dit :"Le Comité antifasciste de Bruxelles dans la personne de Vercesi, qui au moment de la constitution du PCI pense devoir y adhérer, maintient ses propres positions bâtardes jusqu'au moment où le Parti, rendant le tribut nécessaire à la clarté, se sépare des branches mortes du bordiguisme". Qu'en termes galants ces choses là sont dites ! Il - Vercesi - pense devoir y adhérer !!?? Et le Parti, qu'en pense-t-il ? Ou est-ce que le Parti est une société de bridge où adhère qui veut bien y penser ? Vercesi n'était pas le premier venu. C'est un vieux militant de la Gauche Italienne des années 20 -et principal porte-parole de la Gauche Italienne dans l'émigration. Il est l'âme de la Fraction, et principal rédacteur de Bilan. Son œuvre militante et ses mérites révolutionnaires sont énormes, de même que son influence. C'est pourquoi la lutte au sein de la Fraction à la veille de la guerre comme durant celle-ci contre les positions de plus en plus aberrantes de Vercesi avait une grande importance.
L'annonce de la constitution d'un Comité Antifasciste italien à Bruxelles les derniers mois de la guerre, avec Vercesi - au nom de la Fraction - à sa tête devait provoquer une violente réprobation parmi les éléments et groupes révolutionnaires en France. La fraction regroupée en France - avec l'accord du Groupe Français de la Gauche Communiste - a réagi en excluant Vercesi de la Fraction, quelques mois avant de connaître la constitution du Parti en Italie et qu'elle ne proclame sa propre dissolution. Ce qui rendait plus grave le comportement politique de Vercesi, c'est qu'il entraînait derrière lui les camarades italiens de Bruxelles et la majorité de la Fraction Belge. C'est dans cette situation que quelques mois après, Vercesi se rend en Italie où il obtient ces nouvelles investitures de dirigeant du nouveau Parti et sa représentation à l'étranger. Le Parti ne pouvait pas ne pas connaître ces évènements parce que, non seulement une bonne partie des camarades responsables de la Fraction dissoute venaient de retourner en Italie, mais surtout parce que le Groupe Français de la Gauche Communiste posait ces débats publiquement dans sa revue Internationalisme et multipliait ses lettres directes et lettres ouvertes au P.C.I. et aux autres fractions de la Gauche Communiste, dans lesquelles il critiquait et condamnait tous ces agissements. Mise à part la Fraction Belge, le P.C.I. s'enfermait dans un épais silence pour finalement, pour toute réponse, ne reconnaître en France que la Fraction nouvellement constituée par le même Vercesi sur la base et le concours de l'ancienne minorité, écartant ainsi le groupe Internationalisme et ses questions gênantes. Il fallait attendre pas moins que 1948 pour que le Parti se décide à rompre le silence, et dans une brève et laconique résolution se prononce contre le Comité Antifasciste de Bruxelles sans même mentionner nominalement celui qui reste un de ses dirigeants : Vercesi. La politique du silence, c'est la politique du maintien de l'ambiguïté. Et il fallait encore 5 années supplémentaires pour que, comme dit la lettre, "le Parti, rendant le tribut nécessaire à la clarté, se sépare des branches mortes du bordiguisme".
Il n'est pas dans notre intention de faire un historique du P.C.Int. Si nous nous sommes arrêtés longuement sur la Plate-forme et la question des Partisans, c'est parce que c'était à l'époque la question clé. Nous nous sommes peu arrêtés sur l'intégration de la minorité de la Fraction qui a participé à la guerre d'Espagne, ainsi que celle des tenants du Comité Antifasciste de Bruxelles, quoique les implications politiques de ces derniers soient de la plus haute importance, car ce que nous voulions n'était pas une condamnation ad hoc, mais simplement corroborer nos dires qu'à la base de la constitution du P.C.Int. se trouvent de graves ambiguïtés qui font de celui-ci une régression politique par rapport aux positions de la Fraction d'avant-guerre et de Bilan. Tout en se maintenant globalement sur un terrain de classe, le P.C.Int. n'est pas parvenu à se dégager des vieilles positions erronées de l'Internationale Communiste comme sur la question des syndicats et de la participation aux campagnes électorales. L'évolution ultérieure du P.C.Int. et la dislocation en plusieurs groupes qui s'en est suivie prouvent son échec. L'apport de la Gauche Italienne est considérable et ses travaux théoriques politiques appartiennent au patrimoine de l'histoire du mouvement révolutionnaire du prolétariat. Mais, comme pour la Gauche Allemande ou la Gauche Hollandaise, tout indique l'épuisement depuis longtemps de ce que fut la Gauche Italienne traditionnelle. C'est là une constatation d'une rupture de la continuité organique. Le terrible cours de la contre révolution, sa profondeur et sa longue durée, ont eu raison physiquement et organiquement de l'I.C. en faillite. La Fraction se voulait comme un pont entre le Parti d'hier et celui de demain. Cela ne s'est pas réalisé. La constitution du P.C.Int. se voulait être le pôle du nouveau mouvement révolutionnaire. Et la période, et ses propres insuffisances et ambiguïtés ne l'ont pas permis. Il a échoué et apparaît plus comme une survivance du passé que comme un nouveau point de départ. ([6] [27])
Avec la réapparition de la crise historique qui ébranle les fondements du système capitaliste, avec la reprise de la lutte des ouvriers dans tous les pays, ne pouvait manquer le resurgissement de nouveaux groupes révolutionnaires, exprimant la nécessité et la possibilité d'un regroupement des révolutionnaires. Il faut cesser de se réclamer d'une vague et douteuse continuité organique et de vouloir la ressusciter artificiellement. Il importe de s'atteler sérieusement a la tâche de regroupement, de créer un pôle de regroupement des révolutionnaires. C'est la tâche de l'heure.
Mais ce regroupement, pour remplir vraiment sa fonction et être apte à l'assumer pleinement, ne peut se réaliser qu'à partir et sur les bases de critères politiques précis, d'une cohérence et d'orientations claires, fruit des expériences du mouvement ouvrier et de ses principes théoriques. C'est là un effort à poursuivre méthodiquement avec le plus grand sérieux. Il faut se garder de la facilité comme disait Danielis, en convoquant des conférences sur la base vague d'une dénonciation de tel ou tel tournant des Partis "Communistes" d'Europe. Cela serait mettre en avant le souci du plus grand nombre aux dépens de critères politiques seuls aptes à constituer un fondement solide et donner une vraie signification à un regroupement révolutionnaire. Sur ce point encore, l'expérience de la constitution du P.C.Int. peut nous servir de leçon édifiante.
Fermement attaché à l'idée de la nécessité de contact et de regroupement des révolutionnaires, le C.C.I. encouragera et participera activement à toute tentative dans ce sens. C'est pourquoi il a répondu positivement à l'initiative de Battaglia d'une Conférence Internationale de groupes révolutionnaires, tout en mettant en garde contre l'absence de critères politiques, ce qui permet l'invitation de groupes tels que les trotskistes, modernistes de l'Union Ouvrière, ou mao-trotskistes du Combat Communiste, dont nous ne voyons pas la place dans une conférence de communistes.
On nous a demandé une "rectification". Nous venons de la faire, un peu longue peut-être, mais assez claire espérons-nous. C'est justement parce que nous restons plus que jamais convaincus de la nécessité de discussion entre les groupes qui se réclament du communisme que nous pensons que ces discussions ne seront vraiment fécondes que dans la plus grande clarté sur les positions politiques, dans le présent comme dans le passé.
Dans l'attente de vos nouvelles, et avec nos salutations communistes.
Le COURANT
COMMUNISTE INTERNATIONAL - 30/11/76
[1] [28] RI n°29.
[2] [29] Nous avons pu prendre connaissance de ces journaux, mais nous ne pouvons malheureusement pas en citer des passages, ne les ayant pas à notre disposition. Le Parti certainement pourrait les republier... ?
[3] [30] Les Partisans se sont constitués directement sous le contrôle des Alliés et, sur place, sous le contrôle du Parti Communiste et du Parti Socialiste.
[4] [31] De façon générale, nous n'aimons pas beaucoup le ton vantard concernant les camarades qui ont constitué le P.C.I., et qui provenaient de cette Gauche qui "avait été la première et la seule à agir au sein de luttes ouvrières et dans les rangs mêmes des Partisans appelant le prolétariat à la lutte contre le capitalisme, quel que soit le régime dont il se recouvre." Premièrement, il et difficile de ne pas être la "première" quand on est la "seule". Deuxièmement, cette Gauche n'était pas la "seule". D'autres groupes existaient comme les Conseillistes hollandais et américains, le R.K.D., les C.R., etc., qui défendaient les positions de classe contre le capitalisme et contre la guerre. Troisièmement, si on veut parler de participation jusque dans les rangs des Partisans, cette partie de la Gauche italienne qui s'est laissée entraîner n'aura sûrement pas trop souffert d'isolement, étant en bonne compagnie avec toutes sortes de groupes, des trotskistes aux anarchistes.
[5] [32] Danielis était un militant actif de la Fraction Italienne en France et est retourné en Italie à la veille de la guerre.
[6] [33] Il suffit de rappeler l'absence totale de différents groupes se réclamant du P.C.Int. lors des luttes de la FIAT et de Pirelli de l'automne chaud en 1969 en Italie, complètement surpris par les évènements, pour s'en convaincre. Ne parlons pas du ridicule appel des bordiguistes appelant, par une petite affiche écrite à la main, collée sur les murs de l'université, les 12 millions d'ouvriers en grève à se mettre derrière le drapeau du Parti... en mai 1968 en France.
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [34]
Evènements historiques:
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [36]
Combate : "contra a corrente"… ou contre le C.C.I.?
- 2793 reads
Dans une lettre récente, les librairies "Contra a corrente" du groupe Combate au Portugal nous font part de leur décision de cesser la vente des publications du CCI. Il n'est pas dans les habitudes du CCI de rentrer dans de tels détails dans les pages de ses publications. Cependant, nous ne partageons pas le mépris qu'affichent les "modernistes" pour ce qu'ils appellent "le souci de la marchandise politique". Au contraire, nous pensons que la diffusion la plus large possible de la presse révolutionnaire est une contribution importante à la clarification et constitue ainsi une préoccupation politique élémentaire. De plus, tant que les groupes révolutionnaires restent composés de petites minorités, il leur serait difficile d'assumer entièrement leurs publications sans une certaine contrepartie, souvent faible, à travers les ventes. Mais si nous parlons de la lettre de Combate ici, c'est pour soulever ouvertement la question : pourquoi Combate a pris une telle décision de nous fermer ses librairies ? Dans la lettre, nous ne trouvons qu'un refus, pas une explication.
Sur le plan purement pratique, nous pouvons constater que les publications révolutionnaires, étant donné le reflux de la lutte, ne se vendent plus aussi bien aujourd'hui au Portugal que pendant la période 1974-75. Il nous avait semblé nécessaire de réduire le nombre d'envois (décision qui a été prise entre Combate et les camarades du CCI qui se sont rendus au Portugal cet été). Mais supprimer toute vente est autre chose. Seule une librairie bourgeoise pourrait affirmer comme seul critère : si vos publications ne se vendent pas rapidement et en nombre suffisant, nous n'avons pas d'intérêt à perdre notre temps avec vous. Les librairies "Contra a corrente" à Porto et Lisbonne sont tout de même aux mains d'un groupe qui se veut révolutionnaire, intéressé à rendre plus accessibles les idées des courants communistes parmi les ouvriers. Il nous semble donc qu'il faut écarter toute hypothèse d'ordre "pratique" comme explication de la décision.
Sur le plan politique le CCI n'a jamais caché ses critiques au groupe Combate ni oralement quand nous avons eu l'occasion de rencontrer ces camarades, ni par écrit dans notre presse. Malgré toutes ses faiblesses et ses confusions mises en évidence dans l'article ([1] [37]) "A propos de Combate" dans la Revue Internationale n°7, nous avons toujours considéré Combate comme un des seuls groupes au Portugal à défendre des positions de classe : la dénonciation des mystifications du MFA (Mouvement des Forces Armées), de l'appareil syndical et de la gauche du capital ainsi que la défense des luttes autonomes des ouvriers et l'internationalisme prolétarien. C'est pour cela que nous avons pris contact avec Combate et mis des militants d'autres pays en rapport avec eux. Mais la principale faiblesse de Combate, à savoir son absence de clarté sur la nécessité de constituer une organisation sur la base d'une plate-forme politique cohérente, l'a entraîné inévitablement vers un certain localisme, un appui ambigu aux expériences "autogestionnaires", une confusion de plus en plus grande sur l'orientation des activités des révolutionnaires. Enfin, nous avons constaté que si Combate continue à théoriser ses erreurs, il "ne saurait résister bien longtemps à la terrible contradiction à laquelle il est soumis entre ses propres principes révolutionnaires du départ et la terrible pression de l'idéologie bourgeoise qu'il a laissé pénétrer en son sein en se refusant à donner à ses principes une assise claire et cohérente basée sur les leçons de l'expérience historique de la classe." (Revue Internationale, n°7)
L'ensemble de nos appréciations sur Combate fait partie d'un effort pour contribuer à la clarification des positions révolutionnaires dans la classe ouvrière. Faut-il croire que Combate a la peau si chatouilleuse que la critique lui fait fermer la porte au CCI ? Nous ne travaillons à la confrontation des idées qu'avec des groupes qui se situent dans le camp prolétarien, malgré toutes les confusions possibles en leur sein. Nous ne polémiquons pas avec le stalinisme, le trotskisme ou le maoïsme ; nous les dénonçons purement et simplement comme armes idéologiques du capital. Et nous ne sommes pas étonnés quand des librairies sous contrôle stalinien ou trotskiste (directement ou indirectement) refusent nos publications ou quand les trotskistes - comme ceux d'une librairie de Boston - nous rendent nos revues en ayant pris soin de déchirer préalablement les articles sur le Vietnam. On ne s'épuise pas à demander la "démocratie" à la bourgeoisie. Mais Combate en viendrait-il aussi à utiliser des mesures administratives pour les règlements de comptes politiques ?
A travers les discussions que nous avons eues avec Combate, il se dégage que Combate reproche au CCI d'être fixé sur la nécessité de créer une organisation internationale sur la base des positions de classe claires et tranchées. Nous serions, selon certains de ses membres, un vestige de la "vieille conception" d'une organisation révolutionnaire, repliés sur nous-mêmes, sectaires et incapables de nous "ouvrir aux nouveaux apports de la lutte", surtout au Portugal. Nous regrettons que notre intransigeance sur les positions politiques de classe et notre souci du regroupement des révolutionnaires ne trouvent pas d'écho chez Combate. Nous regrettons également que Combate semble trouver beaucoup plus d'intérêt dans des groupes caractérisés surtout par le flou politique et la recherche de "nouveautés" comme le "self-management" de Solidarity en Grande-Bretagne ou autres libertaires sans définition politique claire. Mais faut-il conclure qu'il n'y a pas pire démagogue que ceux qui se prétendent "libertaires" jusqu'au moment où les divergences les amènent à prendre des mesures répressives ? Nous accuser, nous, de sectaires nous semble un alibi facile.
Il faut se rappeler que les librairies "Contra a corrente" ne diffusent pas uniquement la presse révolutionnaire. On peut comprendre qu'il est impossible de diriger une librairie dans le monde capitaliste d'aujourd'hui avec comme seul appui la presse communiste. En conséquence, à "Contra a corrente" se vendent des publications de toutes sortes: psychologie, romans, livres de Staline et de Mao, textes des trotskistes aussi bien que les publications de Solidaritv, de la CWO et du CCI, en portugais et dans d'autres langues. Devons-nous comprendre que la classe ouvrière au Portugal a besoin de lire les élucubrations de la contre révolution sous la plume de staliniens ou de trotskistes mais qu'elle doit être "protégée" du CCI qui disparaîtra des librairies de Combate ? La canaille stalinienne peut trouver une place pour diffuser ses mystifications et une voix des révolutionnaires être censurée ? Il faudrait alors mettre sur la porte des librairies "Contra a corrente" :
"Il n'existe pas pire ennemi de la classe ouvrière que le CCI et c'est pour cela que vous ne trouverez pas ici sa presse" !
L'enjeu de cette discussion n'est pas simplement la diffusion du CCI. De toute façon, notre presse sera diffusée au Portugal. Mais tout ceci n'est pas digne des efforts des éléments qui aujourd'hui cherchent le chemin de la révolution. Il est révoltant de constater que Combate prend de telles décisions sans aucune explication. Il y a trop de groupes actuellement qui se veulent révolutionnaires mais qui s'érigent en "juge censeur" du mouvement ouvrier : la CWO en est un exemple flagrant avec sa malheureuse conviction que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elles sont de la contre révolution. Il faut combattre cette tendance à établir des frontières de classe chacun à sa guise pour les besoins de sa chapelle. Aujourd'hui, quand la classe ouvrière doit avoir une orientation politique claire afin de pouvoir agir à temps face à la crise du système, quand enfin, après 50 années de triomphe de la barbarie de la contre révolution, il y a une ouverture dans l'histoire, il est lamentable que les groupes révolutionnaires comme Combate se contentent de positions politiques confuses et tombent si facilement dans les mesures répressives contre d'autres courants politiques, mesures qui ne peuvent que rappeler le "bon vieux temps" des staliniens.
Nous demandons donc ouvertement à Combate de reconsidérer ces mesures de suppression de la vente de notre presse et de revenir sur cette décision aberrante.
Le CCI
30 novembre 1976
Lettre de Combate
LIVRARIA CONTRA-A-CORRENTE
Porto, le 9 septembre 1976
Chers camarades,
Il y a quelques jours, dans une réunion, les librairies Contra a Corrente (Porto et Lisbonne) ont décidé de ne plus vendre RI et toutes les autres publications de votre Courant ; pour l'avenir nous voulons seulement recevoir deux numéros pour les archives ; prochainement, nous allons tenter de payer ce qu'on a vendu.
F.S
[1] [38] Cet article a été écrit pendant l'été, avant l'envoi de la lettre de Combate et publié après sa réception. Il ne joue donc aucun rôle particulier dans l'affaire de la librairie, sinon comme résumé général des discussions et des critiques.
Géographique:
- Portugal [39]
Courants politiques:
Revue Internationale no 9 - 2e trimestre 1977
- 2892 reads
La gauche communiste en Russie (1918-1930, 2eme partie)
- 3271 reads
Après 1921, la situation où s'est trouvé le parti bolchevik était un véritable cauchemar. A la suite de la défaite des insurrections ouvrières en Hongrie, en Italie, en Allemagne et ailleurs entre 1918 et 1921, la révolution mondiale a subi un profond reflux qui ne devait jamais être endigué, malgré l'irruption ultérieure de luttes de classe comme en Allemagne et en Bulgarie en 1923, en Chine en 1927. En Russie, tant l'économie que le prolétariat lui-même avaient atteint un niveau proche de la désintégration ; les masses ouvrières s'étaient retirées ou avaient été chassées de la vie politique. N'étant plus un instrument dans les mains de la classe ouvrière, l'Etat des soviets avait effectivement dégénéré en une machine pour la défense de "l'ordre" capitaliste. Prisonniers de leurs conceptions substitutionnistes, les bolcheviks croyaient encore qu'il était possible d'administrer cette machine d'Etat et l'économie capitaliste tout en attendant et même en participant au resurgissement de la révolution mondiale. En réalité, les nécessités du pouvoir d'Etat transformaient les bolcheviks en agents effectifs de la contre-révolution, tant à l'intérieur qu'à l'étranger… En Russie, ils étaient devenus les gardiens d'une exploitation de plus en plus féroce de la classe ouvrière. Bien que la NEP ait amené un certain relâchement de la domination économique de l'Etat, surtout sur les paysans, il n'y eut pas de relâchement de la dictature du parti sur le prolétariat. Au contraire, puisque les bolcheviks considéraient toujours les paysans comme le principal danger pour la révolution en Russie, ils étaient arrivés à la conclusion que les concessions économiques accordées aux paysans devaient être contre balancées par un renforcement de la domination politique du parti bolchevik sur la société russe ; et ceci se traduisait par un renforcement des tendances au monolithisme dans le parti lui-même. La seule façon de construire un rempart prolétarien à l'assaut du capitalisme paysan, c'était alors de resserrer le contrôle du parti et au sein du parti.
Au niveau international, du fait de la place dominante du parti russe au sein de l'IC, les impératifs de l'Etat russe avaient des effets de plus en plus pernicieux sur la politique de celle-ci. Le Front Unique, le Gouvernement ouvrier, de telles "tactiques" réactionnaires étaient, pour une grande part, l'expression de la nécessité de l'Etat russe de trouver des alliés bourgeois dans le monde capitaliste.
Bien que le parti bolchevik n'ait pas encore abandonné définitivement la révolution prolétarienne, toute la logique de la situation dans laquelle il se trouvait le poussait de plus en plus à s'identifier complètement aux besoins du capital national russe; les derniers écrits de Lénine expriment une préoccupation tournant à l'obsession sur les problèmes de la "construction socialiste" dans la Russie arriérée. La victoire du stalinisme a simplement rendu cette logique implicite ; il a éliminé le dilemme entre l'internationalisme et les intérêts de l'Etat russe, en abandonnant simplement le premier en faveur de ces derniers.
Les évènements de ces cinquante dernières années ont montré qu'un parti prolétarien ne peut pas survivre en période de reflux ou de défaite. Ainsi pour les partis communistes, la seule façon de préserver leur existence physique après l'échec de la vague révolutionnaire, c'était de passer avec armes et bagages dans le camp de la bourgeoisie. De plus, en Russie, la tendance à la dégénérescence a été accélérée du fait que le parti s'était confondu avec l'Etat et avait alors à s'adapter encore plus rapidement aux besoins du capital national. Dans une période de défaite, la défense des positions révolutionnaires ne peut être assurée que par de petites fractions qui se détachent du parti en dégénérescence ou survivent à sa mort. Ce phénomène s'est produit en Russie, surtout entre 1921 et 1924 avec l'apparition de petits groupes déterminés à défendre les positions communistes contre les trahisons du parti. Comme nous l'avons vu, l'apparition de tendances oppositionnelles au sein du parti bolchevik, n'était pas nouvelle mais les conditions dans lesquelles ces fractions devaient agir après 1921 différaient de manière dramatique de celles dans lesquelles leurs prédécesseurs avaient travaillé.
Les conditions préalables pour défendre une perspective communiste contre la montée de la contre-révolution résidaient, surtout en Russie, dans la capacité à garder un attachement loyal à cette perspective et à la placer avant tout attachement sentimental, personnel et politique à l'organisation initiale de la classe, maintenant que cette dernière s'était engagée sur la voie de la trahison de classe. Et c'est bien en cela que réside le grand exploit des fractions de gauche russes : leur engagement résolu à mener les tâches communistes contre le parti et contre l'Etat soviétique, dès que ces tâches ne furent plus assumées au sein de ces institutions. Pour la Gauche, les positions communistes passaient avant tout ; si les "héros" de la révolution ne défendaient plus le programme communiste, alors ces héros devaient être dénoncés et abandonnés. Il n'est pas étonnant que les communistes de gauche russes aient été des individus relativement obscurs, surtout des travailleurs qui n'avaient pas fait partie de la direction bolchevik pendant les années héroïques.
Miasnikov avait même l'habitude de se moquer de l'opposition de gauche en disant qu'elle n'était qu'une "opposition de célébrités" qui ne s'opposait à la faction stalinienne que pour leurs propres raisons bureaucratiques ("L'ouvrier communiste", n°6, janvier 1930).
Ces ouvriers révolutionnaires étaient capables de comprendre les conditions qu'affrontait le prolétariat russe beaucoup plus facilement que les officiels bolcheviks de rang élevé qui avaient vraiment perdu le contact avec la classe et n'étaient capables de voir le problème de la révolution qu'en termes d'administration d'Etat. En même temps, cependant, les origines obscures des membres des fractions de gauche étaient souvent un facteur de faiblesse dans ces groupes. Leurs analyses tendaient à se fonder plus sur un pur instinct de classe que sur une formation théorique approfondie. De pair avec les faiblesses historiques du mouvement ouvrier russe, que nous avons déjà évoquées, et l'isolement de la gauche russe vis-à-vis des fractions communistes à l'extérieur, ces facteurs mettaient de sérieuses limites à l'évolution théorique du communisme de gauche en Russie.
En dépit de la capacité des gauches à rompre avec les institutions "officielles" et à s'identifier à la lutte de classe contre elles, l'immense reflux de la classe en Russie posait aux fractions de gauche une série de problèmes difficiles et contradictoires. Malgré sa dégénérescence rapide après 1921, le parti bolchevik restait le centre de la vie politique du prolétariat en Russie ; les conseils, les comités d'usines et les autres organes de masse de la classe étaient morts et l'Etat lui-même était devenu un organe du capital. Du fait de l'apathie et de l'indifférence de la classe, les débats et conflits politiques avaient lieu presque exclusivement dans la sphère du parti. C'est vrai que l'indifférence et l'inactivité de la classe elle-même rendaient la plupart des débats idéologiques au sein du parti dans les années 20 stériles dès le début, mais le fait que le parti était une sorte d'oasis pour la pensée révolutionnaire dans le désert de l'apolitisme de la classe ouvrière, ne pouvait pas être dédaigné par les révolutionnaires.
Cette situation a placé les fractions de gauche devant un horrible dilemme. D'un côté l'apathie des masses et les actes répressifs de l'Etat faisaient qu'il leur était extrêmement difficile de militer au sein du prolétariat "en général". D'un autre côté, tout ce travail en direction du parti était terriblement entravé par l'élimination des fractions en 1921 et l'atmosphère de plus en plus étouffante au sein du parti. Il était presque impossible à n'importe quel groupe véritablement d'opposition de faire un travail légal au sein du parti. Même les critiques relativement modérées exprimées en 1923 par la plate-forme des 46 (le document de fondation de l'opposition de gauche) contenaient le regret que "la libre discussion au sein du parti ait en fait disparu et que la raison sociale du parti ait été étouffée". Pour les tendances à gauche de l'Opposition de gauche, la situation était même pire ; cependant toutes continuaient à allier le travail de propagande au sein "des grandes masses" des usines avec le travail secret au sein des cellules locales du parti. Le groupe Ouvrier, dans son manifeste de 1923, parlait de "la nécessité de constituer le groupe ouvrier du Parti Communiste Russe (bolchevik) sur la base du programme et des statuts du PCR, de façon à exercer une pression décisive sur le groupe dirigeant du parti lui-même". "L'Appel" du groupe la Vérité Ouvrière en 1922 exprimait la vision que "partout dans les usines et les fabriques, dans les organisations syndicales, les universités ouvrières, les écoles des soviets et du parti, l'Union Communiste de la jeunesse et les organisations du parti, doivent être créés des cercles de propagande solidaires de
la Vérité Ouvrière" ([1] [41]). De telles déclarations d'intention démontrent les difficultés extrêmes que rencontraient ces groupes dans leurs tentatives de trouver des solutions organisationnelles nettement tranchées, dans une période de désarroi et de confusion.
Nous devons enfin avoir présent à l'esprit que ces regroupements étaient soumis à la persécution la plus intense et à la répression de la part de l'Etat-Parti. Justement parce que la Russie avait été la "terre des soviets", le pays de la révolution prolétarienne, la contre-révolution devait y être totale, sans merci et implacable, ensevelissant les derniers vestiges de tout ce qui avait été révolutionnaire. Même avant la victoire de la faction stalinienne, les groupes de gauche avaient été soumis aux persécutions de la Guépéou, aux arrestations, aux emprisonnements et à l'exil. Dépourvus de fonds et de matériel, constamment sur la brèche à cause de la police secrète, il leur était difficile d'entreprendre un minimum de travail de propagande. La solidification de la contre-révolution après 1924 a rendu les choses encore plus difficiles.
Et cependant, au cours des sombres années de réaction, les communistes de gauche ont continué à lutter pour la révolution. En 1929 encore, le groupe Ouvrier publiait un journal illégal à Moscou, la Voie ouvrière vers le pouvoir. Même dans les camps de travail staliniens, leur expression politique n'a pu être réduite au silence. Une révolution prolétarienne ne meurt pas facilement. Les révolutionnaires qui luttaient dans des circonstances aussi défavorables, tiraient leur courage du simple fait qu'ils étaient nés d'une révolution de la classe ouvrière. Examinons donc plus en détail les principaux groupes qui ont continué à tenir le drapeau de la révolution en dépit de tout ce qui s'accumulait contre eux.
a) La VERITE OUVRIERE
La Vérité ouvrière s'était constituée à l'automne 1921. Elle semble avoir été surtout composée d'intellectuels et avoir grandi dans le milieu culturel "Pro1etkult" dont le principal animateur était Bogdanov, un théoricien du parti qui avait été en conflit avec Lénine sur des problèmes philosophiques dans les années 20 et qui avait été très en vue dans les tendances de "gauche" du bo1chévisme à cette époque. Dans son "Appel" de 1922, la Vérité ouvrière caractérisait la NEP de "renaissance de rapports capitalistes normaux", comme l'expression d'une profonde défaite du prolétariat russe:
"La classe ouvrière en Russie est désorganisée ; la confusion règne dans les esprits des travailleurs ; sont-ils dans un pays de dictature du prolétariat comme le parti communiste le répète à satiété verbalement et dans la presse ? Ou sont-ils dans un pays où règnent l'arbitraire et l'exploitation, comme la vie le leur dit à chaque instant ? La classe ouvrière mène une existence misérable à une époque où la nouvelle bourgeoisie (c'est-à-dire les fonctionnaires responsables, les directeurs d'usines, les hommes de confiance, les présidents des comités exécutifs, etc.) et les hommes de la NEP vivent dans le luxe et nous rappellent à la mémoire le tableau de la vie de la bourgeoisie de tout temps".
Pour la Vérité ouvrière, l'Etat des soviets était devenu "le représentant des intérêts nationaux du capital... le simple appareil de direction de l'administration politique et de la réglementation économique par l'Intelligentsia". La classe ouvrière a été privée en même temps de ses organes défensifs, les syndicats et de son parti de classe. Dans un manifeste produit au XIIème congrès du parti en 1923, la Vérité ouvrière accusait les syndicats de :
"Se transformer d'organisations pour défendre les intérêts économiques des travailleurs en organisations pour défendre les intérêts de la production, c'est-à-dire du capital étatique d'abord et avant tout" (cité par E.H Carr, The Interregnum).
De même pour le parti, l'Appel affirme que: "Le parti communiste russe est devenu le parti de l'Intelligentsia organisatrice. Le fossé entre le parti communiste et la classe ouvrière s'approfondit de plus en plus".
C'est pourquoi ils déclarent leur intention de travailler à la formation d'un véritable "parti du prolétariat russe", bien qu'ils admettent que leur travail sera "de longue haleine et avant tout idéologique".
Bien que les buts relativement modestes de la Vérité ouvrière semblent exprimer une certaine compréhension de la défaite que la classe avait subie et donc les limites de l'activité révolutionnaire dans une telle période, tout le cadre est faussé par une ambiguïté particulière sur la période historique et les tâches auxquelles doit faire face la classe dans son ensemble.
En se fondant peut-être sur l'idée de Bogdanov, à savoir que tant que le prolétariat n'a pas mûri comme classe capable de s'organiser, la révolution socialiste serait prématurée, ils supposaient que la révolution en Russie devait avoir la tâche d'ouvrir une phase de développement capitaliste :
"Après la révolution et la guerre civile victorieuse, de vastes perspectives se sont ouvertes en Russie, de transformation rapide en un pays capitaliste progressiste. C'est en cela que réside le succès énorme et incontestable de la révolution d'Octobre" (Appel) .
Cette perspective a aussi conduit le groupe la Vérité ouvrière à préconiser une politique étrangère bizarre, en appelant au rapprochement avec les capitalismes "progressistes" d'Amérique et d'Allemagne contre la France "réactionnaire". En même temps le groupe semble n'avoir eu que peu ou pas de contact avec les groupes communistes à l'extérieur de la Russie.
C'étaient des positions comme celles-ci qui ont sans doute conduit le groupe Ouvrier de Miasnikov à affirmer qu'il n'avait "rien de commun avec la soi-disant "Vérité ouvrière", qui essaie d'effacer tout ce qu'il y avait de communiste dans la révolution de 1917 et qui est en conséquence complètement menchevik"(Workers dreadnought, 31 mai 1924), bien que dans son Manifeste de 1923, le groupe Ouvrier ait reconnu que des groupes comme la Vérité ouvrière, le Centralisme Démocratique et l'Opposition Ouvrière contenaient beaucoup d'éléments prolétariens sincères et les ait appelés à se regrouper sur la base du Manifeste du groupe Ouvrier.
A l'époque de la révolution russe, ceux qui parlaient de l'inéluctabilité d'une évolution bourgeoise de la Russie, tendaient à être identifiés aux mencheviks. Mais à la lumière de l'expérience ultérieure, nous préférons comparer les positions de la Vérité ouvrière à l'analyse à laquelle sont arrivées les gauches allemande et hollandaise vers les années 30… Comme la Vérité ouvrière, ces dernières avaient commencé à percevoir réellement la nature du capitalisme d'Etat mais ils ont sapé leurs analyses en arrivant à la conclusion que la révolution russe avait été depuis le début une affaire de l'Intelligentsia qui avait entrepris l'organisation du capitalisme d'Etat dans un pays qui n'était pas mûr pour la révolution communiste. En d'autres termes, l'analyse faite par la Vérité ouvrière est celle d'une tendance révolutionnaire démoralisée et dans la confusion à cause de la défaite de la révolution et par là amenée à mettre en question le caractère originellement prolétarien de cette révolution. En l'absence d'un cadre clair et cohérent dans lequel analyser la dégénérescence de la révolution, de telles déviations sont inévitables, surtout dans les conditions difficiles qu'affrontaient les révolutionnaires en Russie après 1921.
Mais, malgré un certain pessimisme et un certain intellectualisme, la Vérité ouvrière n'a pas hésité à intervenir dans les grèves sauvages qui ont balayé la Russie dans l'été 1923, en essayant d'avancer des mots d'ordre politiques au sein du mouvement général de la classe. Cette intervention a cependant attiré toutes les forces de la Guépéou sur le groupe dont l'échine a été très rapidement brisée dans la répression qui a suivi.
b) Le GROUPE OUVRIER et le PARTI COMMUNISTE OUVRIER
Nous avons vu qu'en grande partie, la faiblesse des groupes comme l'Opposition Ouvrière et la Vérité ouvrière était liée à leur manque de perspectives internationales ; de même nous pouvons dire que la plus importante des fractions communistes de gauche était justement celle qui a mis l'accent sur la nature internationale de la révolution et la nécessité pour les révolutionnaires du monde entier de se regrouper.
C'était le cas de ces éléments en Russie qui correspondaient de très près au KAPD allemand et à ses organisations sœurs.
Le 3 et le 17 juin 1923, le Workers' dreadnought a publié une résolution d'un groupe qui s'était formé peu de temps avant et qui s'appelait le "groupe des communistes révolutionnaires de gauche (parti communiste ouvrier) de Russie". Ils se présentaient comme un groupe qui avait quitté le "parti communiste russe social-démocrate qui avait fait du business sa principale préoccupation" (W.D, 3 juin) ; et bien qu'ils s'engagent à "soutenir tout ce qui est à gauche des tendances révolutionnaires dans le parti communiste russe" et à "accueillir et soutenir toutes les questions et toutes les propositions de l'Opposition Ouvrière qui s'inscrivent dans une saine orientation révolutionnaire", ils insistent sur le fait "qu'il n'y a pas de possibilité de réformer le parti communiste russe de l'intérieur" (W.D, 17 juin). Le groupe dénonçait les tentatives des bolcheviks et du Komintern de compromis avec le capital aussi bien en Russie qu'à l'extérieur et en particulier, il attaquait la politique de front unique du Komintern en disant que c'était un instrument "de la reconstruction de l'économie capitaliste mondiale". (W.D, 17 juin). Depuis que les bolcheviks et le Komintern avaient suivi un cours opportuniste qui ne pouvait mener qu'à leur intégration au capitalisme, le groupe affirmait qu'il était temps de travailler à la construction d'un parti communiste ouvrier de Russie, lié au KAPD en Allemagne, au KAP en Hollande et autres partis de l'Internationale Communiste Ouvrière ([2] [42]).
Le développement ultérieur de ce groupe est mal connu mais il semble avoir été étroitement lié au groupe Ouvrier de Miasnikov, plus connu sous le nom de Groupe Ouvrier Communiste - en fait le PCO de 1922 semble avoir été un précurseur de ce dernier. Le 1er décembre 1923, le Dreadnought annonçait qu'il avait reçu le manifeste du groupe Ouvrier, envoyé par le PCO russe, en même temps qu'une protestation du PCO contre les emprisonnements en Russie de Miasnikov, Kuznetzov et d'autres militants du groupe Ouvrier. En 1924, le KAPD publiait le Manifeste en allemand et parlait du groupe Ouvrier comme de "la section russe de la IVème Internationale". La défense du communisme de gauche, telle que le KAPD en a donné l'exemple, devait en tout cas à partir de ce moment être assurée en Russie par le groupe de Miasnikov.
Gabriel Miasnikov, un ouvrier de l'Oural, s'était distingué dans le parti bolchevik en 1921, quand, tout de suite après le crucial Xème congrès, il avait réclamé "la liberté de la presse, des monarchistes aux anarchistes inclus" (cité par Carr, The Interregnum). Malgré les efforts de Lénine pour le dissuader de mener un débat sur cette question, il refusa de reculer et fut expulsé du parti au début de 1922. En février, mars 1923, il se groupa avec d'autres militants pour fonder "le groupe Ouvrier du parti communiste russe (bolchevik)" et ils publièrent et distribuèrent leur Manifeste au XIIème congrès du PCR. Le groupe commença à faire du travail illégal parmi les ouvriers du parti ou non et semble avoir été présent de façon significative dans la vague de grèves de l'été 1923, en appelant à des manifestations de masses et essayant de politiser un mouvement de classe essentiellement défensif. Leur activité dans ces grèves a suffi pour convaincre la Guépéou qu'ils représentaient une véritable menace ; une vague d'arrestations de certains militants dirigeants porta un coup sévère au groupe.
Mais comme nous l'avons vu, ils ont poursuivi leur travail clandestin, même à une échelle réduite jusqu'au début des années 1930 ([3] [43]). Le Manifeste du groupe Ouvrier est un pas en avant considérable par rapport à l'Appel de la Vérité ouvrière, mais il présente encore les hésitations et les idées à demi-achevées de la gauche communiste à cette époque, surtout en Russie.
Le Manifeste contient les dénonciations habituelles des conditions matérielles épouvantables que subissaient les ouvriers russes et les inégalités qui accompagnaient la NEP et demande : Est-il vraiment possible que la NEP (nouvelle politique économique) se transforme en NEP = la Nouvelle Exploitation du Prolétariat ?
Il poursuit en attaquant la suppression des divergences au sein et en dehors du parti et le danger que le parti ne soit transformé en "une minorité détenant le contrôle du pouvoir et celui des ressources économiques de la nation. ce qui finira en la création d'une caste bureaucratique". Il expose le fait que les syndicats, les soviets et les comités d'usines ont perdu leur fonction d'organes prolétariens, si bien que la classe n'a plus ni le contrôle de la production, ni de l'appareil politique du régime. Il réclame pour régénérer tous ces organes une réforme radicale du système des soviets qui permettra à la classe d’exercer sa domination sur la vie économique et politique.
Ceci nous amène immédiatement au problème majeur que rencontrait la gauche russe dans le début-des années 20. Quelle attitude devait-elle prendre vis-à-vis du régime soviétique ? Est-ce que le régime avait encore un caractère prolétarien ou est-ce que les révolutionnaires devaient appeler à sa destruction? La difficulté était qu'à cette époque, il n'y avait ni l'expérience ni de critères établis pour décider si oui ou non le régime était devenu contre-révolutionnaire. Ce dilemme s'est reflété dans l'attitude ambiguë que le groupe Ouvrier a adopté face au régime. Alors qu'il dénonce les inégalités de la NEP et le danger de "sa dégénérescence bureaucratique", en même temps, il affirme que "la NEP est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays. Elle doit être utilisée pour consolider les positions conquises par le prolétariat en Octobre" ([4] [44]). Le Manifeste énonce alors une série de suggestions pour "l'amélioration" de la NEP - contrôle ouvrier, indépendance vis-à-vis des capitaux étrangers, etc. De la même manière, tout en critiquant la dégénérescence du parti, le groupe Ouvrier, comme nous l'avons vu, avait choisi de travailler parmi les membres du parti et d'exercer des pressions sur la direction du parti. Alors qu'ailleurs le groupe posait la question de savoir si le prolétariat ne pouvait pas être "forcé une fois encore à commencer une nouvelle lutte, et peut-être une lutte sanglante pour renverser l'oligarchie" (cité par Carr, The Interregnum), dans le Manifeste l'accent était surtout mis sur la régénération de l'Etat des soviets et de ses institutions et non sur leur renversement violent.
Cette position de "soutien critique" est encore plus mise en évidence dans le fait qu'en face de la menace de guerre que posait l'ultimatum de Curzon en 1923, on a rapporté que les membres du groupe Ouvrier avaient pris un engagement de résister à "toutes les tentatives de renverser le pouvoir des soviets" (Carr, op.cit.).
Etait-il correct ou non de défendre le régime russe en 1923 ? Là n'est pas la question. Les positions que le groupe Ouvrier a prises alors ne faisaient certainement pas d'eux des contre-révolutionnaires, parce que l'expérience de la classe n'avait pas encore tranché définitivement la question russe. Les ambiguïtés sur la nature du régime russe sont avant tout la manifestation des immenses difficultés que cette question posait aux révolutionnaires dans la confusion et le désarroi de ces années là.
Mais l'aspect le plus important du groupe Ouvrier n'était pas son analyse du régime russe mais sa perspective internationa1iste intransigeante. De façon significative, le Manifeste de 1923 commence par une description puissante de la crise mondiale du capitalisme et de l'alternative devant laquelle se trouve l'ensemble de l'humanité : socialisme ou barbarie. En essayant d'expliquer le retard de la prise de conscience révolutionnaire de la classe ouvrière face a cette crise, le Manifeste attaque de façon éclatante le rôle universellement contre-révolutionnaire de la Social-démocratie :
"Les socialistes de tous les pays sont, à un moment donné, les uniques sauveurs de la bourgeoisie face à la révolution prolétarienne, parce que les masses ouvrières sont habituées à se méfier de tout ce qui vient de leurs oppresseurs, mais quand on leur présente la même chose comme leur intérêt et qu'on l'agrémente de phraséologie socialiste, alors, les travailleurs, trompés par ce langage, croient les traîtres et dépensent leurs énergies dans une lutte sans espoir. La bourgeoisie n'a et n'aura pas de meilleur avocat".
Cette compréhension permet au groupe Ouvrier de faire une série de dénonciations des tactiques du Kominterm, de front unique et de gouvernement ouvrier, comme autant de façons de lier le prolétariat à son ennemi de classe. Bien que moins conscient du rôle réactionnaire des syndicats, le groupe Ouvrier a partagé l'approche du KAPD, selon laquelle, dans la nouvelle période de décadence du capitalisme, toutes les vieilles tactiques réformistes devaient être abandonnées :
"Le temps où la classe ouvrière pouvait améliorer sa condition matérielle et légale par des grèves et son admission au parlement est maintenant irrévocablement terminé. On doit le dire ouvertement. La lutte pour les objectifs les plus immédiats est une lutte pour le pouvoir. Nous devons expliquer par notre propagande que, bien que nous appelions à la grève en diverses occasions, les grèves ne peuvent pas vraiment améliorer les conditions des ouvriers. Mais, vous, travailleurs, n'avez pas encore dépassé les vieilles illusions réformistes et vous poursuivez un combat qui ne fait que vous épuiser. Nous sommes solidaires de vos grèves ; mais il faut le rappeler : ces mouvements ne vous libéreront pas de l'esclavage, de l'exploitation et de la pauvreté sans espoir. La seule voie vers la victoire est la conquête du pouvoir, directement par vos propres mains".
Le rôle du parti est aussi de préparer les masses partout à la guerre contre la bourgeoisie.
La compréhension par le groupe Ouvrier de la nouvelle époque historique semble contenir à la fois les faiblesses et la force de la vision du KAPD sur la "crise mortelle du capitalisme". Pour les deux, une fois que le capitalisme est entré dans sa crise finale, les conditions de la révolution prolétarienne existent à tout moment. Le rôle du parti est alors, vis-à-vis de la classe, celui du détonateur de l'explosion révolutionnaire. Il n'y a nulle part dans le Manifeste une quelconque vision du reflux de la révolution mondiale, nécessitant une analyse minutieuse des nouvelles perspectives ouvertes aux révolutionnaires. Pour le groupe Ouvrier en 1923, la révolution mondiale était autant à l'ordre du jour qu'elle l'avait été en 1917.
C'est pourquoi il pouvait partager les illusions du KAPD sur la possibilité de construire une IVème Internationale en 1922 et aussi tard qu'en 1928-1931, Miasnikov essayait encore d'organiser un parti communiste ouvrier pour la Russie ([5] [45]). Il apparaît que seule la Gauche Italienne a été capable d'apprécier quel était le rôle des fractions communistes dans une période de reflux, quand le parti ne peut plus exister. Pour le KAPD, le Workers' Dreadnought, Miasnikov et d'autres, le parti pouvait exister n'importe quand. Le corollaire de cette vision immédiatiste était une tendance inexorable à la désintégration politique : même en tenant compte des effets de la répression, les communistes de gauche allemands, comme leurs sympathisants russes ou anglais, se sont trouvés dans la quasi impossibilité d'assurer leur existence politique pendant la période de contre-révolution.
Les propositions concrètes avancées par le groupe Ouvrier en ce qui concerne le regroupement international des révolutionnaires manifeste une saine préoccupation de l'unité maximum des forces révolutionnaires, mais elles sont aussi le reflet des mêmes dilemmes au sujet des rapports entre la gauche communiste et les institutions "officielles" en dégénérescence, dilemmes dont nous avons déjà parlé. Ainsi, tout en s'opposant violemment à tout front unique avec les social-démocrates, le Manifeste du groupe Ouvrier appelle à une espèce de front unique de tous les éléments véritablement révolutionnaires, parmi lesquels il incluait les partis de la IIIème Internationale au même titre que les partis communistes ouvriers. On rapporte qu'en une autre occasion le groupe Ouvrier avait commencé des négociations avec la gauche du KPD. groupé autour de Maslow, dans le but d'attirer Maslow dans le "bureau étranger" mort-né. Le KAPD, dans ses commentaires sur le Manifeste, était extrêmement critique sur ce qu'il appelait "les illusions du groupe Ouvrier" : "quant au fait que vous pourriez révolutionner l'Internationale Communiste... la IIIème Internationale n'est plus un instrument de lutte de la classe prolétarienne. C'est pourquoi les partis communistes ont fondé l'Internationale Communiste Ouvrière". Toutefois, le dilemme du groupe Ouvrier sur la nature du régime russe et du Kominterm devait être résolu à la lumière de l'expérience concrète ; la victoire du stalinisme en Russie l'amenait à prendre une ligne de conduite plus intransigeante contre la bureaucratie et son Etat, alors que la décomposition rapide du Kominterm après 1923 rendait inévitable le fait que les futurs "partenaires" internationaux du groupe Ouvrier seraient les vrais communistes de gauche des différents pays.
C'était d'abord et avant tout cette "liaison internationale" avec les survivants de la vague révolutionnaire qui permettait à des révolutionnaires comme Miasnikov d’atteindre un degré de clarté relativement élevé dans l'océan de confusion, de démoralisation et de mensonges qui avaient englouti le mouvement ouvrier russe.
c) LES IRRECONCILIABLES DE L'OPPOSITION DE GAUCHE
Nous ne pouvons envisager toute la question de l'Opposition de gauche ici, bien que sa défense confuse de la démocratie dans le parti, de la révolution chinoise et de l'internationalisme contre la théorie stalinienne du "socialisme dans un seul pays", démontre qu'elle était un courant prolétarien, la dernière étincelle, en fait, de la résistance dans le parti bolchevik et dans le Kominterm. L'insuffisance de sa critique de la contre-révolution montante rend impossible le fait de considérer l'Opposition de gauche comme partie intégrante de la tradition révolutionnaire de la gauche communiste.
Au niveau international, son refus de remettre en question les thèses des quatre premiers congrès du Kominterm l'empêchait de comprendre les causes de la dégénérescence de l'Internationale et d'éviter une répétition dramatique de toutes ces erreurs. En Russie même, l'Opposition de gauche n'a pas réussi à faire la rupture nécessaire avec l'appareil d'Etat-parti, une rupture qui aurait pu le placer solidement sur le terrain de la lutte prolétarienne contre le régime, aux côtés des véritables fractions communistes de gauche. Bien que ses ennemis aient essayé d'accuser Trotski d'être entré en contact avec des groupes illégaux comme la Vérité ouvrière, Trotski lui-même se dissociait explicitement de ces groupes en faisant référence au groupe de Bogdanov comme étant celui de la "Non-Vérité ouvrière" (Carr, Interregnum) et en participant lui-même à la répression de l'ultragauche, par exemple dans la commission qui faisait des recherches sur l'activité de l'Opposition ouvrière en 1922. Tout ce que Trotski admettait, c'est que ces groupes constituaient des symptômes d'une véritable dégénérescence du régime des soviets !
Mais l'Opposition de gauche dans ses premières années, ce n'était pas seulement Trotski. Beaucoup parmi les signataires de la plate-forme des 46 étaient d'anciens communistes de gauche et centralistes démocratiques comme Ossinsky, Smirnov, Pialakov et d'autres. Comme Miasnikov l'a dit :
"Il n'y a pas que de grands hommes dans l'opposition trotskiste, il y a aussi beaucoup d'ouvriers. Et ceux-ci ne veulent pas suivre les leaders ; après quelques hésitations, ils rentreront dans les rangs du groupe Ouvrier" (L'ouvrier communiste, n°6, janvier 1930).
Justement, parce que l'Opposition de gauche était un courant prolétarien, elle a donné naturellement naissance à une aile gauche qui est allée bien au delà des critiques timides du stalinisme par Trotski et de ses disciples "orthodoxes". Vers la fin des années 20, un courant connu sous le nom des "irréconciliables" grandissait au sein de l'Opposition de gauche, composé en grande partie de jeunes ouvriers qui s'opposaient à la tendance des trotskistes "modérés" à se diriger vers une réconciliation avec la faction stalinienne, une tendance qui s'est accélérée après 1928 quand Staline a paru mettre en œuvre rapidement le programme d'industrialisation de l'Opposition de gauche. Isaac Deutscher écrit que parmi les "Irréconciliables" :
"Il devenait déjà évident que 1'Union soviétique n'était p1us un Etat ouvrier ; que 1e parti avait trahi ta révo1ution et que l'espoir de 1e reformer étant devenue sans objet, l'opposition devait se constituer en nouveau parti, prêcher et préparer une nouve1le révolution. Quelques uns voyaient en Sta1ine 1e promoteur du capita1isme agrarien ou même 1e leader d'une "démocratie koulak", alors que pour d'autres, son pouvoir incarnait la domination d'un capita1isme d'Etat imptacab1ement hosti1e au socialisme".
(Le prophète banni, OUP)
Dans son livre, Au pays du grand mensonge, Anton Ciliga donne un témoignage des débats au sein de l'Opposition de gauche qui eurent lieu dans les camps de travail staliniens ; il montre que quelques membres de l'Opposition de gauche défendaient la capitulation devant le système stalinien, que d'autres soutenaient qu'il fallait le réformer, que d'autres encore étaient pour une "révolution politique" pour éliminer la bureaucratie (la position que Trotski devait adopter). Mais les irréconciliables ou les "négateurs", comme il les appelle (Ciliga en faisait partie) :
"Croyaient que non seu1ement l'ordre politique mais aussi l'ordre économique et social étaient étrangers et hostiles au prolétariat. Nous envisageons donc non seulement une révolution politique mais aussi une révolution sociale qui ouvrirait une voie au développement du socialisme. Selon nous, la bureaucratie était une véritable classe, une classe hostile au prolétariat". (reproduit dans les "questions politiques dans les prisons staliniennes", un tract oppositionniste).
En janvier 1930, écrivant dans l'Ouvrier communiste n°6, Miasnikov disait de l’Opposition de gauche que :
"Il n'y a que deux possibilités, soit les trotskistes se regroupent sous le mot d'ordre "guerre aux palais, paix aux maisons", sous l'étendard de la révolution ouvrière, le premier pas que doit faire le prolétariat pour devenir classe dominante, ou ils s'éteindront lentement et passeront individuellement ou collectivement dans 1e camp de la bourgeoisie. Ce sont les deux seuls éléments de l'alternative, il n'y a pas de troisième voie".
Les évènements des années 30, qui ont vu le passage définitif des trotskistes dans les armées du capital, devaient confirmer les prédictions de Miasnikov. Mais encore les meilleurs éléments de l'Opposition de gauche ont été capables de suivre l'autre voie, la voie de la révolution. Dégoûtés par l'incapacité de Trotski à confirmer leurs analyses dans ses écrits à l'étranger, ils ont rompu avec l'Opposition de gauche dans les années 30-32 et ont commencé à travailler avec les survivants du groupe Ouvrier et du groupe du centralisme démocratique en prison, en élaborant une analyse de l'échec de la révolution mondiale et de la signification du capitalisme d'Etat. Comme Ciliga le souligne dans son livre, ils n'avaient plus peur d'aller droit au cœur de la question et d'accepter le fait que la dégénérescence de la révolution n'avait pas commencé avec Staline mais avait pris l'élan même sous l'égide de Lénine et de Trotski. Comme Marx le disait souvent, être radical veut dire aller au fond des choses. Dans les années noires de réaction, quelle meilleure contribution aurait pu faire la gauche communiste que d'avoir creusé sans peur jusqu'aux racines de la défaite du prolétariat ?
Certains peuvent voir les débats menés par les communistes de gauche en prison comme rien d'autre qu'un symbole de l'impuissance des idées révolutionnaires en face du Léviathan capitaliste. Mais même si leur situation était l'expression d'une profonde défaite pour le prolétariat, le simple fait qu'ils aient continué à clarifier les leçons de la révolution dans des circonstances aussi défavorables, est un signe que la mission historique du prolétariat ne peut jamais être liquidée par une victoire temporaire de la contre-révolution. Comme Miasnikov l'écrivait, à propos de l'emprisonnement de Sapranov :
"Maintenant Sapranov a été arrêté. Même 1'exil et l'étouffement de sa voix n'ont pas réussi à diminuer son énergie et la bureaucratie ne pouvait pas se sentir en sécurité vis-à-vis de 1ui tant qu'il n'était pas entre les murs épais d'une prison. Mais un souffle puissant, souffle de la révolution d'Octobre, ne peut pas être mis en prison ; même la tombe ne peut le faire disparaître. Les principes de la révolution sont toujours vivants dans la classe ouvrière en Russie et tant que la classe ouvrière vivra, cette idée ne pourra pas mourir. Vous pouvez arrêter Sapranov mais pas 1’idée de la révolution". (L'ouvrier communiste, 1929)
C'est vrai que la bureaucratie stalinienne a réussi, il y a longtemps, à balayer les dernières minorités communistes en Russie. Mais aujourd'hui, quand une nouvelle vague de luttes prolétariennes internationales trouve un écho assourdi même dans le prolétariat russe, le "souffle puissant" d’un deuxième Octobre est revenu hanter les esprits des bourreaux staliniens à Moscou et de leurs rejetons à Varsovie, Prague et Pékin. Quand les ouvriers de la "patrie du socialisme" se dresseront pour détruire une fois pour toutes l'immense prison de l'Etat stalinien, ils seront enfin capables, en liaison avec leurs frères de classe du monde entier, de résoudre les problèmes posés tant par la révolution de 1917 que par ses plus loyaux défenseurs : les révolutionnaires de la gauche communiste russe.
C.D WARD.
[46] [1]Le Manifeste du groupe Ouvrier est disponible, ainsi que les notes du KAPD, en français dans "Invariance II série n°6". Une version incomplète a paru en anglais dans les numéros suivants du Workers' dreadnought - 1er décembre 1923, 5 janvier 1924, 2 février 1924, 9 février 1924. L’Appel de la Vérité Ouvrière a été publié dans le Socialist Herold, Berlin, 31 janvier 1922 ; des extraits ont paru en anglais dans Daniels : une histoire documentaire du communisme, p.219-223.
[2] [47] Le texte du 17 juin et un autre texte sur le Front Unique par ce même groupe a été reproduit dans Workers' voice, n°14.
[3] [48] L'histoire ultérieure de Miasnikov est celle-ci : de 1923 à 1927, il a passé la plupart de son temps en exil ou en prison à cause de ses activités clandestines. Evadé de Russie en 1927, il a fui en Perse et en Turquie et s'installa définitivement en France en 1930. Pendant cette période, il essayait toujours d'organiser son groupe en Russie. En 1946, pour des raisons mieux connues de lui-même (peut-être parce qu'il attendait une nouvelle révolution après la guerre ?), Miasnikov est retourné en Russie et on n'a plus jamais entendu parler de lui.
[4] [49] Le KAPD a publié le Manifeste du groupe Ouvrier avec ses notes critiques ; il n'acceptait pas l'analyse du groupe Ouvrier sur la NEP. Pour lui, la Russie en 1925 était un pays capitaliste dominé par les paysans. Il soutenait donc "non le dépassement de la NEP mais son abolition violente".
[5] [50] Ecrivant dans L'ouvrier communiste en 1929, Miasnikov faisait un compte rendu d'une conférence tenue en août 1928 par le Groupe Ouvrier, "le groupe des 15" de Sapranov et les survivants de l'Opposition Ouvrière. Arrivée à un niveau d'accord programmatique élevé, la conférence décida que "le Bureau central du Groupe Ouvrier constituerait le Bureau central organisationnel des Partis communistes ouvriers de l'URSS".
La décision de mettre en place des Partis communistes ouvriers pour l'URSS pouvait être l'expression du souci d'assurer l'autonomie de chaque république des soviets et de son Parti communiste, idée exprimée dans le Manifeste de 1923 ; elle montre une tendance "décentralisatrice" qui était critiquée par le KAPD dans ses notes sur le Manifeste.
Sur le centraliste démocratique qu'avait été Sapranov et sur sa compréhension, Miasnikov devait dire ceci : "le camarade Sapranov n'était pas fait du même bois que les leaders de l'opposition des célébrités. Les embrassades et les accolades amicales de Lénine ne l'étouffaient pas et n'enlevaient pas chez lui son esprit critique prolétarien. Et en 1926-27, il réapparut comme leader du "groupe des 15". La plate-forme du "groupe des 15" n'avait aucun lien, ni dans les idées, ni dans les théories avec la plate-forme du centralisme démocratique. C'était une nouvelle plate-forme, d'un nouveau groupe sans autre lien avec le passé du centralisme démocratique que le fait que son porte-parole était Sapranov. Le groupe des 15 devait son nom au fait que sa plateforme avait été signée par 15 camarades. Sur les principaux points, sur son estimation de la nature de l'Etat en URSS, ses idées sur l'Etat ouvrier, le programme des 15 est très proche de l'idéologie du Groupe ouvrier".
"Nous sommes tous soumis à la loi de l'histoire et l'on ne peut introduire l'ordre socialiste qu’à l’échelle internationale. Les bolcheviks ont montré qu'ils pouvaient faire tout ce qu'un parti vraiment révolutionnaire est capable d'accomplir dans les limites des possibilités historiques. Qu'ils ne cherchent pas à faire des miracles! Car une révolution prolétarienne exemplaire et parfaite dans un pays isolé, épuisé par la guerre mondiale, écrasé par l'impérialisme, trahi par le prolétariat international, serait un miracle. Ce qui importe, c'est de distinguer dans la politique des bolcheviks, l'essentiel de l'accessoire, la substance du fortuit. En cette dernière période où les luttes finales décisives nous attendent dans le monde entier, le problème le plus important du socialisme a été et est encore précisément la question brûlante de l'actualité, non pas telle ou telle question de détail de la tactique mais la combativité du prolétariat, l'énergie des masses, la volonté du socialisme de prendre le pouvoir en général. A cet égard, Lénine, Trotski et leurs amis ont les premiers, par leur exemple, ouvert la voie au prolétariat mondial, ils sont jusqu'à présent encore les seuls qui puissent s'écrier comme Hutten : "J'ai osé"!
Voilà ce que la politique des bolcheviks comporte d'essentiel et de durable. En ce sens, ils conservent le mérite impérissable d'avoir ouvert la voie au prolétariat international en prenant le pouvoir politique et en posant le problème pratique de la réalisation du socialisme, d'avoir fait progresser considérablement le conflit entre capital et travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Il ne pouvait être résolu en Russie. Et en ce sens, l'avenir appartient partout au "Bolchevisme".
Rosa Luxembourg, "La Révolution Russe "
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [20]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [21]
Notes pour une histoire de la Gauche Communiste (fraction italienne 1926 - 39)
- 3260 reads
Le texte que nous reproduisons ici fait partie de l'introduction au recueil d'articles de "Bilan" sur la guerre d'Espagne, publié par la section du CCI en Italie (Bilan, I933-I938, "Articoli sulla guerra di Spagna" ; Rivista Internazionale n°I, novembre I976). De ce fait, il ne s'attache pas tant à reprendre les positions de la Gauche italienne (développées, elles, dans les articles eux-mêmes) mais plutôt à rappeler le cadre historique dans lequel elles furent développées.
Nous le reprenons ici non seulement parce que les textes qu'il introduit sont ceux qui sont parus dans les n° 4, 6 et 7 de cette revue, mais aussi parce qu'en donnant un aperçu de ce que furent les principales étapes du combat de la Gauche communiste en Italie dans l'entre-deux guerres pour maintenir en vie l'effort théorique de la classe révolutionnaire, au milieu de la tourmente contre-révolutionnaire qui s'abattit sur le mouvement ouvrier au lendemain de la défaite de la grande vague prolétarienne de la fin de la Première Guerre mondiale. il rend compte d'un exemple impérissable d'une des plus indispensables qualités des révolutionnaires prolétariens - savoir maintenir, dégager et approfondir les expériences historiques de la classe sans céder aux pressions contraires des courants dominants de l'idéologie bourgeoise.
"Je parlerai brièvement et avec la pleine conscience de mes responsabilités. Ce que j'ai à dire est grave pour nous tous et pour le parti, mais on a voulu créer une situation pénible qui me contraint à parler. Indépendamment de toute considération de sincérité et de pureté plus ou moins grande des individus, je dois déclarer au nom de la Gauche que les procédés qui sont utilisés ici, non seulement n'ont pas ébranlé nos positions, mais constituent, avec l'organisation et la préparation du congrès et avec le programme qu’on y expos, l'argument le plus formidable pour renforcer la sérénité de notre jugement. Je dois dire que la méthode utilisée ici nous apparaît malheureusement mais sûrement être une méthode nuisible aux intérêts de notre cause et du prolétariat (...). Nous pensons que c’est notre devoir de dire sans hésitation et avec toute la conscience de nos responsabilités ce fait très grave : qu'aucune solidarité ne pourra nous unir à des hommes, qu'indépendamment de leurs intentions et de leurs caractéristiques psychologiques, nous jugeons être les représentants de la perspective désormais inévitable de l'évolution opportuniste de notre parti (...). Si je suis victime, si nous sommes tous victimes d'une terrible erreur en évaluant ainsi ce qui va arriver, alors je devrai et nous devrons être considérés comme indignes d'être seulement dans le parti et disparaître aux yeux de la classe ouvrière. Mais si cette impitoyable antithèse que nous voyons se profiler est vraie et nous réserve dans l'avenir de douloureuses conséquences, alors nous pourrons au moins dire que nous avons lutté jusqu'à la fin contre les pernicieuses méthodes par lesquelles on nous attaque et que nous avons apporté, en résistant à chaque menace, un peu de clarté dans l'obscure confusion qu'on veut créer ici. Maintenant que j'ai dû parler, jugez-moi comme vous voulez".
Ceci est la "Déclaration de Bordiga" au Congrès de Lyon en I926 (rapportée dans Prométéo, 1er juin 1928) et qui signait l'exclusion définitive de la Gauche par le Parti Communiste d'Italie. Gauche qui avait fondé et dirigé le parti durant les premières années et avait ensuite mené un dur travail d'opposition en son sein, précisément jusqu'au Congrès de Lyon. Le 6ème exécutif élargi de l'Internationale Communiste en février 1926 sanctionnait définitivement sur le plan international aussi la défaite de la Gauche Italienne dans un affrontement direct entre Bordiga et Staline.
Il nous semble nécessaire de donner quelques "dates" et références sur le processus de dégénérescence de l'IC, tout en étant conscients de leurs insuffisances et limites inévitables dans la mesure où elles ne peuvent donner qu'une bien pâle image de tous les bouleversements qu'a connus le mouvement prolétarien pendant ces années.
D'autre part, ce n'est pas l'objet de cette introduction que de traiter de cette période pourtant si riche et si féconde en enseignements et sur laquelle il existe - même si c'est en grande partie sous l'égide de la propagande contre-révolutionnaire - un certain matériel de documentation, mais bien de considérer pendant les années qui suivent I926, l'activité organisée
de ces noyaux communistes qui malgré des conditions pratiquement impossibles, ont su tenir bon, continuer une lutte désespérée et inégale, traqués dans toute l'Europe par le fascisme nazi et les tueurs staliniens, vus par les uns et par les autres comme les pires ennemis, comme des éléments à éliminer ; une activité complètement méconnue et ignorée même de ceux qui veulent s'y rallier, dans une mesure toujours plus faible à vrai dire.
1921 : IIIème Congrès de l'Internationale Communiste ; on présente la théorie du "Front Unique" ; on discute la validité de la scission de Livourne ; du côté des allemands, le KAPD, déjà en marge, rompt avec l'Internationale Communiste.
La gauche communiste semble vaincue. Suite au travail d'Essen du KAPD, l'éphémère KAI est fondée dont le Manifeste constitutif dit entre autres :
"Rien ne peut arrêter la progression des évènements ni obscurcir la vérité. Nous le disons sans réticences inutiles, sans sentimentalisme : la Russie prolétarienne de l'Octobre rouge devient un Etat bourgeois".
1922 : IIème congrès du Parti Communiste d'Italie, thèses de Rome ; IVème congrès de l'IC ; opposition de la gauche italienne à la fusion avec les socialistes ; analyse du fascisme par la gauche.
1923 : arrestation de Bordiga et autres dirigeants du parti communiste en Italie ; bo1chévisation des partis communistes ; l'opposition entre la gauche italienne et l'IC augmente toujours plus.
1924 : en Italie paraît la revue Prométéo ; Bordiga refuse de se présenter aux élections et déclare :
"Je ne serai jamais député et plus vous ferez vos projets sans moi, moins vous perdrez de temps".
Conférence de Côme ; Vème congrès de l'IC.
1925 : Bordiga écrit "La question Trotski" et "Le danger opportuniste et l'Internationale" ; le "comité d'entente" est fondé puis dissout.
1926 : la gauche est exclue du parti et de l'IC ; la période d'émigration commence ; lettre de Bordiga à Korsch.
La lettre que Bordiga envoie à Naples le 28/ 10/1926 à Korsch répond à la tentative de ce dernier de promouvoir un projet d'unification de ce qui restait de la gauche communiste à l'échelle internationale (seul document qui reste de la correspondance de Bordiga avec d'autres révolutionnaires pendant ces années et dont toute trace semble avoir disparu) ; elle nous paraît particulièrement intéressante ; nous en citons donc certains passages fondamentaux :
"Votre façon de vous exprimer (Bordiga parle de Korsch) ne me semble pas bonne. On ne peut pas dire que la révolution russe est une révolution bourgeoise. La révolution de 1917 a été une révolution prolétarienne bien que ce soit une erreur d'en généraliser les leçons "tactiques". Maintenant se pose le problème de ce qu'il advient de la dictature du prolétariat dans un pays, si la révolution ne se poursuit pas dans d'autres pays. Il peut y avoir une contre-révolution ; il peut y avoir un cours dégénérescent dont il s'agit de découvrir et définir les symptômes et les reflets au sein du parti communiste. On ne peut pas simplement dire que la Russie est un pays où le capitalisme est en expansion.
Nous recherchons la construction d'une ligne de gauche vraiment générale et non occasionnelle qui se construise à travers des phases et des développements de situations distantes dans le temps en les affrontant toutes sur le bon terrain révolutionnaire et certainement pas en ignorant leurs caractéristiques distinctes objectives.
De façon générale je pense qu'aujourd'hui, plutôt que l'organisation et ta manœuvre, ce qu'on doit mettre au premier plan, c'est un travail d'élaboration d'une idéologie politique de la gauche internationale basée sur les éloquentes expériences qu'a traversées le Kominterm. En étant bien en deçà de ce point, toute initiative internationale reste difficile.
Il n'est pas nécessaire de vouloir scissionner des partis et de l'Internationale. Il faut laisser s'accomplir l'expérience de la discipline artificielle et mécanique en la suivant dans ses absurdités de procédure tant que c'est possible, sans jamais renoncer aux positions de critique idéologique et politique et sans jamais se solidariser avec la direction qui prévaut.
Je crois que l'un des défauts de l'Internationale actuelle a été de constituer un "bloc d'oppositions" locales et nationales. Il faut réfléchir à cela, bien entendu sans arriver à des exagérations mais pour accumuler des enseignements. Lénine a réalisé beaucoup de travail d'élaboration "spontanée" en comptant regrouper matériellement les divers groupes pour les fondre seulement après à la chaleur de la révolution russe. En grande partie, cela n'a pas réussi".
Donc, en premier lieu, défense du caractère prolétarien de la révolution russe contre les affirmations simplistes sur la "nature bourgeoise" qu'exprimaient tous ceux qui découvraient à l'improviste qu'en Russie "quelque chose n'allait pas". Ensuite, précision du vrai problème qui
se pose : qu'advient-il de la dictature du prolétariat si la révolution ne se poursuit pas dans d'autres pays et avant tout "comment" affronter cette question en dehors de toute solution organisationnelle, d'alliance ou de bloc de type divers, dans le contexte de la période historique reconnue comme la pire contre-révolution en marche et du difficile travail d'analyse, d'étude, de compréhension des erreurs pour la reprise future ?
Parmi ces positions intransigeantes, une phrase de la lettre de Bordiga tranche : "il n'est pas nécessaire de vouloir scissionner des partis et de l'Internationale", quand, de fait, la gauche a déjà été mise dehors. Ce que la gauche défendait là, c'était de rester liée à ce qui était, cinq ans auparavant seulement, l'avant garde du prolétariat mondial, liée à l'espérance que pour la révolution, cela n'en était pas vraiment fini pour des décennies et des décennies ; c'était de rester liée à l'espérance que dans la crise mortelle du capital, la classe ouvrière serrée dans le terrible étau de la crise, puisse encore relever la tête et que sous la poussée de la "base", les positions que la gauche défendait puissent encore triompher dans le parti de l'Internationale ; la reprise ne pouvait avoir lieu si la classe ne savait pas secréter l'avant garde, le parti qui n'existait plus.
A côté de cela, Bordiga exprime aussi son point de vue sur l'IC. Pour lui, elle était effectivement le parti mondial du prolétariat. Au Vème congrès de l'IC (juillet 1924), il dira :
"Je voudrais dire sincèrement que dans la situation présente, c'est l'Internationale du prolétariat révolutionnaire mondial qui doit rendre au parti communiste russe une partie des nombreux services qu'elle a reçus de lui."
D'après Bordiga, donc, l'IC devait s'opposer à l'involution du parti russe et ne pas devenir un instrument de celui-ci, ou bien il n’y aurait vraiment plus d'espoirs… Mais c’est ce qui eut lieu.
Sur ces bases et avec ces préoccupations, la gauche italienne commence et continue son travail dans l'émigration.
"D'UNE CERTAINE MANIERE, NOUS JOUONS UN RÔLE INTERNATIONAL PARCE QUE LE PEUPLE ITALIEN EST UN PEUPLE D'EMIGRANTS DANS LE SENS ECONOMIQUE ET SOCIAL DU TERME ET, APRES L'AVENEMENT DU FASCISME, AUSSI DANS LE SENS POLITIQUE... IL NOUS ARRIVE UN PEU COMME AUX HEBREUX : SI NOUS AVONS ETE BATTUS EN ITALIE, NOUS POUVONS NOUS CONSOLER EN PENSANT QUE LES HEBREUX AUSSI SONT FORTS NON EN PALESTINE MAIS AILLEURS" (Intervention de Bordiga au VIème Exécutif élargi de l'IC).
Toute l'émigration des militants communistes en Italie ne suit pas le même chemin. Si la majeure partie d'entre eux devait quitter l'Italie en 1925-1926, à la suite de l'impitoyable chasse que leur font les fascistes et de leur exclusion du parti communiste au congrès de Lyon ce qui les privait de tout réseau de secours ou de refuge, certains éléments se trouvaient déjà en Autriche d'abord et ensuite, en 1923, en Allemagne, où les combattants révolutionnaires ont vécu de tragiques évènements. Ils s'opposeront aux décisions de l'IC et quitteront le parti communiste d'Italie. Dans la pratique, ils représentent la première opposition de gauche qui s'organise dans l'émigration. En Allemagne, ils gardent le contact avec les Entschie dene Linke ([1] [51]) et avec Karl Korsch ainsi qu'avec les camarades de la gauche qui, en Italie, avait donné naissance au "comité d'entente". A la suite de cette période, il y a eu la tentative de contact entre Korsch et Bordiga, et la lettre dont nous avons déjà parlé. Le groupe quitte ensuite l'Allemagne et rejoint la France à travers la Suisse et, tout en maintenant le contact avec les Allemands, il adhère à un comité des oppositions communistes (qui n'a rien à voir avec l'opposition trotskiste), tout en maintenant la pleine autonomie du groupe.
En 1927 à Pantin, en pleine banlieue parisienne, refuge des émigrés, des sans-abris, des désespérés et des expulsés de la société civile, est constituée la "Fraction de gauche du parti communiste d'Italie" en l'absence de Vercesi (Ottorino Perrone), plus tard l'un des meilleurs partisans de Bilan parce qu'il avait été expulsé de la "démocratique" France. Ce serait facile de parler des vicissitudes de ces camarades, à la recherche d'un travail et d'un abri, persécutés et indésirables dans les démocraties, traqués par les staliniens, et qui partout ont su continuer une lutte intransigeante, défendre et diffuser sans compromis ni peur les positions communistes. D'ailleurs, pour rendre clair quel type de rapports existait avec les staliniens, nous citerons quelques passages d'une lettre d'un certain Togliatti à Iaroslavsky, lettre du 19 avril 1929 :
"La lutte que notre parti doit mener contre les débris de l'opposition bordiguiste qui tente d'organiser en fraction tous les mécontents. Nous devons lutter contre ces gens dans tous les pays où existe l'émigration italienne (Belgique, France, Suisse, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc.) Pour nous, c'est impossible de mener cette lutte si nos partis frères ne nous aident pas. Le PC d'Italie demande au PC d'URSS une aide pour continuer cette lutte déjà difficile et qui peut le devenir encore plus si l'on a des faiblesses. Notre parti n'a rien d'autre à dire. Il demande seulement qu’on use du maximum de rigueur."
Nous ne savons pas si la scission qui voit se scinder en deux formations l'émigration en France, une minorité très réduite et une majorité, a eu lieu avant ou après Pantin, même si les données que nous avons nous font pencher pour la seconde alternative. Le premier groupe qui représente la continuité de ce petit noyau d'émigrants que nous avons déjà vu en Allemagne, donnera vie à Le Réveil Communiste qui paraîtra en 1928 et 1929. La revue ouvrira ses colonne à des groupes de la gauche en Allemagne (au Korsch de Kommunistische Politik et à ce qui restait du KAPD pendant ces années) et aussi à la gauche russe dans la personne de Miasnikov.
Le point central qui caractérisait les positions du Réveil Communiste était la négation de tout caractère prolétarien de l'Etat russe - point sur lequel pendant ces années, les autres éléments qui ont constitué Bilan par la suite étaient plus prudents – et un appui ouvert et manifeste aux positions du KAPD. Au Réveil Communiste va succéder, au début des années 1930, l'Ouvrier Communiste sur des positions ouvertement conseillistes.
Le second groupe est celui qui est connu, à proprement parler, comme la "Fraction de gauche du Parti Communiste d'Italie" ; il publiera Prométéo, journal en langue italienne, de juin 1928 à 1938. tantôt tous les quinze jours, tantôt tous les mois, et Bilan de 1933 à 1938. Les premières années de vie de la Fraction voient le débat avec Trotski, désormais exilé à Prinkipo, et avec les formations qui se réclament de lui et s'organisent surtout en France.
En novembre 1927 paraît Contre le Courant, "organe de l'Opposition Communiste" qui tente d'être le catalyseur des divers groupuscules trotskistes et de favoriser, ou au moins d'initier, un processus de regroupement de toute l'opposition de gauche. Dans le n°12 de 1928 (juin), une "lettre ouverte aux communistes de l'opposition" est envoyée aux organisations suivantes :
- le "Cercle Marx-Lénine" qui publie Bulletin Communiste,
- la "Fraction de la gauche italienne",
- le groupe "Barré-Treint" qui publie Redressement Communiste,
- le groupe "la lutte de classe" dont le chef est Naville
- le "Réveil Communiste" dont on a déjà parlé.
Il ne sortira rien de ce projet (ce n'est qu'en 1930 que la Vérité avec l'appui de Trotski se fera le porte-parole de toute l'opposition trotskiste) mais il est intéressant de voir la réponse du Bureau politique de la Fraction italienne par Vercesi :
"Beaucoup de groupes d'opposition croient devoir se limiter au rôle de cénacle qui enregistre les progrès d'un cours dégénérescent et ne présentent au prolétariat que l’évidence de la vérité qu'on pense avoir trouvée. Et bien nous pensons que nous aurons l'avenir que nous aurons su préparer. Mais la chose la plus importante, c'est d'établir avec quel moyen on peut tracer l'orientation de l'action communiste.
Nous pensons que la crise de l'Internationale dépend de causes très profondes, de son fondement apparemment uniforme mais essentiellement hétérogène, de l'absence d'une politique ferme et d'une tactique communiste, dont découle une altération des principes marxistes qui a conduit à une série de désastres révolutionnaires.
Hors de l'opposition russe, seule notre fraction a élaboré une direction d'action systématique dans une plate-forme qui est due au camarade Bordiga ([2] [52])
Il y a beaucoup d’oppositions. C’est un mal ; mais il n’y a pas d’autre remède que la confrontation de leurs idéologies respectives, la polémique pour parvenir en suite à ce que vous nous proposez.
S’il existe tant d’oppositions, c’est parce qu’il y a plusieurs idéologies qui doivent se manifester dans leur substance et non simplement se rencontrer dans une simple discussion dans un organe commun. Notre mot d’ordre, c’est de pousser à fond notre effort sans se laisser guider par la possibilité d’un résultat qui serait en réalité un nouvel échec.
Nous pensons que si l'Internationale, après avoir officiellement altéré ses programmes, a failli à son rôle de guide la révolution, les partis communistes n'en ont pas moins fait. Vu la nature de la situation que nous vivons, ce sont les organes dans lesquels on doit travailler pour combattre l'opportunisme et ce n'est pas du tout exclu pour en faire le guide de la révolution".
La lettre (publiée dans le n°13 de Contre le Courant) se termine (pour les raisons susdites) par le refus de l'invitation. Comme on le voit, cette réponse de Vercesi reprend celle de Bordiga à Korsch ; à nouveau est affirmée la nécessité d'examiner de façon critique le passé, de tirer les leçons de la dégénérescence et de la vague contre-révolutionnaire qui s'est abattue sur le mouvement prolétarien ; à nouveau la confiance dans une lutte autonome et intransigeante sur les principes, à l'intérieur des partis communistes. Bien plus importants seront les contacts épistolaires entre Prométéo, qui avait commencé à paraître en juin 1928 et Trotski (une bonne documentation se trouve dans le livre de Corvisieri "Trotski et le communisme italien).
Dans la première lettre adressée à Trotski, Prométéo retrace un peu son histoire : la rupture avec Le Réveil Communiste, la constitution en fraction, l'analyse de la situation internationale caractérisée par l'offensive capitaliste, l'ana1yse de la Russie qui divisera - une majorité voyant dans la Russie un Etat prolétarien et une minorité qui se prononce "pour la négation du caractère prolétarien de l'Etat russe" -, la question italienne sur laquelle la fraction refuse de reconnaître que la social-démocratie ou les forces d'opposition démocratique puissent mener une lutte contre le fascisme et affirme que "la classe ouvrière a seulement la possibilité de mener cette lutte sur les bases du programme communiste".
A la suite de la non-participation de la "Fraction" à une conférence de "l'Opposition" à Paris, les rapports avec Trotski deviennent plus tendus et dans une lettre le révolutionnaire russe pose à Prométéo les questions suivantes :
"Vous considérez-vous comme un mouvement national ou comme une partie d'un mouvement international ?
Pourquoi ne pensez-vous pas créer une fraction internationale de votre tendance ?
A quelle tendance appartenez-vous ?
Et Prométéo répond :
"En l’occurrence vous nous invitez à vous dire si nous sommes ou non des communistes.
(...) et maintenant nous répondons à vos questions :
Nous nous considérons comme partie d'un mouvement international.
Nous appartenons, depuis la fondation de 1'IC et même avant à la tendance de gauche.
Nous ne pensons pas créer une fraction internationale de notre tendance parce que nous croyons avoir appris du marxisme que l'organisation internationale du prolétariat n'est pas une somme artificielle de groupes et de personnalités de tous pays autour d'un groupe donné. Par contre, nous pensons que cette organisation doit bien être le résultat de l'expérience du prolétariat de tous les pays."
Des questions de méthode et de principe opposaient donc Prométéo et Trotski : de la part de Prométéo, il n'y avait pas d'acceptation intégrale des quatre premiers congrès de l'IC mais une critique du "front unique" qui (écrit Prométéo) amène "au gouvernement ouvrier-paysan, au comité ang1o-russe, au Kuomitang, aux comités prolétariens antifascistes". Les événements d'Espagne 1930-1931 ont amené la rupture et l'interruption définitive du contact. A Trotski qui écrit dans "La révolution espagnole et les devoirs des communistes" :
"Le mot d'ordre de la répub1ique, naturellement, est aussi un mot d'ordre du prolétariat. Mais pour lui, il ne s'agit pas seulement de changer un roi contre un président, mais d'une épuration radicale de toute la société des immondices du féodalisme", et aussi:
"Les tendances séparatistes posent à la révolution le devoir démocratique de l'autodétermination nationale… Le séparatisme des ouvriers et des paysans est l'enveloppe de 1eur indignation sociale" ;
Prométéo ne pouvait que répondre :
"Il est clair que nous ne pouvons pas le suivre dans cette voie et à lui autant qu'aux dirigeants anarcho-syndicalistes de La CNT, nous répondons en niant de là façon la plus explicite que les communistes doivent prendre place aux premiers rangs de la défense de la république et d'autant moins de la république espagnole." (Prométéo, 23 août 1931)
Une rupture définitive qui ne pouvait qu'aller s'accentuant lorsqu'il s'agira de la nature sociale de l'URSS, de l'analyse de Trotski sur la direction bureaucratique en Russie et sur la défense de la Russie en cas de guerre impérialiste.
En novembre 1933, paraît le premier numéro de Bilan "Bulletin théorique mensuel de la Fraction de gauche du PC d'Italie". Dans l'introduction, le cadre historique dans lequel s'inscrivent précisément le travail de la revue et les tâches que ce groupe révolutionnaire se propose d'assumer, est d'emblée délimité :
"Ce n’est pas un changement de situation historique qui a permis au capitalisme de traverser la tourmente des événements de l’après-guerre : en 1933, tout comme en 1917 et encore plus, le capitalisme se trouve être définitivement condamné en tant que système d’organisation sociale. Ce qui a changé de 1917 à 1933, c’est le rapport de force entre les deux classes fondamentales, entre les deux forces historiques qui agissent dans la période actuelle : le capitalisme et le prolétariat.
Nous sommes aujourd’hui à un terme extrême de cette période : le prolétariat n’est peut-être plus à même d’opposer le triomphe de la révolution à l’explosion d’une nouvelle guerre impérialiste. Toutefois, s’il existe encore des chances de reprise révolutionnaire immédiate, elles consistent seulement dans la compréhension des défaites passées. Ceux qui opposent à ce travail indispensable d'analyse historique le cliché de la mobilisation immédiate des travailleurs ne font que jeter la confusion et empêcher la réelle reprise prolétarienne.
Les cadres pour les nouveaux partis du pro1étariat ne peuvent surgir que de la connaissance profonde des causes de la défaite. Et cette connaissance ne peut supporter aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme.
Tirer le bilan des évènements de l’après-guerre, c'est donc établir les conditions pour la victoire du prolétariat dans tous les pays".
C'est selon cet axe que Bi1an a avancé et travaillé en traitant toujours les questions fondamentales du mouvement révo1utionnaire. De l'analyse de la crise du capitalisme (décadence) à la critique des mouvements de libération nationale, de la délimitation des moments qui rendront à nouveau possib1e la reprise de classe du prolétariat à la critique impitoyable des "partis communistes" et de la Russie - dont la nature sociale n'était pas encore claire - mais son rôle politique ne puissance impérialiste à laquelle la classe ouvrière doit refuser toute forme de soutien vu la proximité de la guerre mondiale, se précisait. Comme moment fondamental du travail révolutionnaire, Bilan sollicitait aussi le débat avec d'autres formations politiques et a publié des textes d'autres camarades.
En 1935, Bilan, de "bulletin théorique mensuel de la Fraction de gauche du PC d'Italie", devient "bulletin théorique mensuel de la Fraction Italienne de la Gauche Communiste", ce qui marque la rupture définitive avec un parti qui est désormais un maillon de la contre-révolution capitaliste ainsi que l'affirmation du caractère international de ses tâches.
En 1936, commencent les divergences sur la question de la guerre d'Espagne qui allaient provoquer une scission dans Bilan. Parallèlement a aussi lieu la rupture des liens qui s’étaient établis fin 1932 avec la "Ligue des Communistes Internationalistes de Belgique", groupe qui venait du trotskisme et avait tout de suite après subi une forte influence conseilliste. En 1932, Bilan et la Ligue se trouveront sur les mêmes positions dans la critique de "l'Opposition Internationale de gauche" (trotskiste) qui, en Allemagne, face à l'attaque fasciste, avait lancé un appel à un front unique pour la défense "des revendications démocratiques" considérées comme autant d'étapes de la lutte pour la révolution communiste.
Cet accord, ainsi que le refus de la solution proposée par l'opposition trotskiste pour la reconstruction du parti communiste, renforçait la possibilité d'un débat et d'un contact entre les deux organisations : débat qui devait avoir comme but la reconstruction du patrimoine historique du prolétariat et se basait sur l'analyse et la réponse politique à donner aux évènements qui se succédaient pendant ces années.
La guerre d'Espagne a signé la rupture d'un débat qui s'était poursuivi pendant six ans et que Bilan avait amplement alimenté. La majorité de la "Ligue des Communistes Internationalistes de Belgique" choisit l'appui à la guerre antifasciste comme la minorité de Bilan et du groupe français "L'Union Communiste". En fait, Hennaut, représentant très important de la Ligue, écrira dans un document daté de février 1937 (et qui sanctionnait la rupture) :
"Nous savons que la défense de la démocratie n'est que l'aspect formel de la lutte ; l'antagonisme entre le capitalisme et le prolétariat n'en est pas l'essence réelle. Et, à condition de n’abandonner en aucune circonstance la lutte de classe, le devoir des révolutionnaires est d'y participer".
Une expression SUBSTANTIELLE de la lutte du capitalisme contre le prolétariat est donc considérée comme une expression FORMELLE de la lutte prolétarienne contre le capitalisme...
Mais ce n'est pas toute la Ligue qui prendra cette position. Une minorité, mais la majorité à Bruxelles, reste sur la position de Bilan. Elle fut expulsée de l'organisation et s'est constituée en "Fraction belge de la Gauche Communiste". De 1937 à 1939, elle a publié Communisme, revue mensuelle ronéotée.
En 1938, Bilan s'arrête et Octobre s'y substitue, "organe mensuel du Bureau International des Fractions de la Gauche Communiste". Cinq numéros d'Octobre ont été publiés, le dernier en août 1939. Un mois plus tard, commencera le deuxième carnage mondial.
Quel est le lien des groupes qui prétendent être la "continuité" (plus ou moins organique) de la Gauche Italienne, avec le travail de la "Fraction" à l'étranger?
Examinons la position du "Parti communiste International" (Programme Communiste) sur ce point.
En paroles, Programme Communiste s'est toujours revendiqué du travail de Bilan et de Prométéo, peut-être pour combler le trou qui va de 1926 à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a jamais cherché à clarifier pour ses militants et ses lecteurs les positions et le travail de Bilan (sinon dans quelques courts articles dans un numéro du journal en 1957 lors de la mort d'Ottorino Perrone, alias Vercesi) qui reste donc pour lui un nom et pas grand chose de plus. C'est probablement par pudeur qu'il en a été ainsi !
Lire Bilan aurait été traumatisant pour ceux qui désormais prenaient un chemin diamétralement opposé à celui indiqué par la "Fraction italienne" dans l'émigration. Aujourd'hui il semble qu'il n'y ait même plus trace de cette fausse pudeur ; non qu'on dise ouvertement qu'il n'y a rien à tirer du travail de Bilan, mais cela se comprend implicitement à la lecture de certains articles qui touchent à la question du mouvement ouvrier des années 1930. Si dans un article de 1971 (Programma Communista, n°21, 1971), on critiquait encore le travail de Trotski qui comportait "toute une série de coalitions hybrides sur la scène de l'opposition internationale" pour dire ensuite "qu'ultérieurement cette opposition pot-pourri se retrouvera dans la IVème Internationale mort-née", en 1973 (Programma Communista, n°19, 1973) on en arrivait à écrire :
"Quand Trotski affirmait la nécessité prioritaire de former un noyau solide basé sur les positions révolutionnaires comme condition, non exclusive ou suffisante, mais indispensable d'une reprise révolutionnaire, plus ou moins proche, et de façon à faire fructifier dans un sens révolutionnaire le prochain confit, il ne faisait pas qu'énoncer une vérité première du marxisme, une vérité d'autant plus importante qu'elle est moins évidente, à tel point qu'elle peut être ignorée et même raillée par la droite, par le centre, par ta "gauche" et même par l'extrême gauche".
Pour celui qui voudrait savoir ce qu'entend Programma Cornmunista par "solidement basé sur des positions révolutionnaires", peut-être le renverra-t-il à l'entrisme dans les partis social-démocrates, ou bien à la défense de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale ?
De quoi s'agit-il d'autre sinon, lorsqu'il parle de "faire fructifier dans un sens révolutionnaire le prochain conflit" selon la tradition trotskiste.
Plus loin, on trouve encore:
"Si Trotski s'est trompé, ce n'est pas pour avoir présenté la nécessité de la IVème Internationale, ni pour avoir conçu une telle nécessité comme un but de travail, au contraire de ceux qui la reconnaissaient abstraitement dans l'atmosphère ouatée des bibliothèques où se sont réfugiés, en s'en faisant un honneur, les Korsch et les Pannekoek".
Et pourquoi n'écrit-on pas aussi les Vercesi et les Bordiga, etc. ? Mais l'article continue :
"Seuls les sectaires sans cervelle peuvent se réjouir d'une tragédie comme celle de la prétendue IVème Internationale tombée parce que devenue la proie des formes les plus hétérogène d'opportunisme et ricaner de satisfaction", pour arriver à son point culminant :
"la IVème Internationale reste à construire".
Enfin ! ! !
Qu'a donc à partager avec la Gauche Communiste et avec Bilan un groupe qui veut :
"Travailler aujourd’hui avec patience, ténacité, modestie, pour rendre possible le jour où le cri de l’avant-garde révolutionnaire du monde entier sera : vive la IVème Internationale !" ?
Messieurs, vous avez dû attendre d'ensevelir des cadavres avant de pouvoir écrire des choses de ce genre qui, d'autre part, ne peuvent être attribuées à la folie d'un quelconque imbécile qui écrirait sous l'anonymat de votre journal, mais sont l’œuvre "collective" du "parti".
Le "Parti Communiste Internationaliste" (Battaglia Communista) se réclame aussi de Bilan. Un numéro de Prométéo - mars 1958 (série II, n°10), revue théorique de Battaglia Communista, fut entièrement dédié à l’œuvre théorico-politique d'Ottorino Perrone (Vercesi). Nous citons quelques extraits de la présentation de ce texte :
"Les évènements de la révolution espagnole, comme ils ont été de loin supérieurs à leurs propres protagonistes, ont ainsi mis en évidence les points forts et les points faibles de notre propre vision : la majorité de Bilan nous apparaît avec une formulation théoriquement impeccable mais qui avait le défaut de rester une simple abstraction; la minorité nous apparaît, d'un autre côté, avoir la préoccupation de prendre le chemin d'une participation qui ne s'est pas toujours avisée d'éviter les virages du jacobinisme bourgeois, même quand on monte des barricades.
Etant donné les possibilités objectives, nos camarades de Bilan auraient dû poser le problème, celui-là même que notre parti devait poser plus tard face à l'appel partisan, en invitant les ouvriers qui se battaient à ne pas tomber dans le piège de la stratégie de la guerre impérialiste".
Exactement. Battaglia Communista défend au tout début du deuxième après-guerre (pour ne pas parler de la participation électorale en 1948) la même position que la minorité de Bilan pendant la guerre d'Espagne. La minorité de Bilan n'est pas allée défendre en Espagne la république contre le fascisme (comme le montrent par ailleurs les textes que nous avons publiés) ([3] [53]), mais pour défendre parmi les miliciens les principes et la tactique communistes.
Mais le problème ne s'arrête pas là. La question centrale, c'est ce que Battaglia appelle notre "formalisme", ou bien des "abstractions" et qui, pour nous, sont un principe, une frontière de classe.
S.
[1] [54] Entschiedene Linke : groupe formé par les expulsés du KPD (avec Schwarz à leur tête) très proche du KAPD (de Berlin) à l'activité duquel participe aussi Korsch. Peu de temps auparavant, c'est aussi la constitution face à la dissolution du KPD d'une "ligue de Spartacus n°2" qui réunissait l'AAUE, le groupe autour de Iwan Katz et d'autres éléments. Par la suite, Korsch se détacha, à cause de ses divergences avec le KAPD, de ces formations et donna vie au Kommunitische Politik.
[2] [55] Selon toute probabilité: on se réfère ici aux thèses présentées par la Gauche au congrès de Lyon.
[3] [56] Voir Revue Internationale n°4 et 7.
Géographique:
- Italie [57]
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [34]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [21]
Premier congres d'Internationalisme (Belgique)
- 2906 reads
La tache première de tout congrès consiste à tirer le bilan de l'activité de l'organisation et à se doter de perspectives pour l'année à venir. Cette préoccupation a pris une importance particulière au cours du premier Congrès d'Internationalisme, section du CCI en Belgique. Rappelons-nous qu'il y a un peu plus d'un an, lors de son congrès de fondation, ce fut de trois groupes (le JLC, le RRS et le VRS), dépassant avec l'aide du CCI leurs confusions antérieures, que naquit la section en Belgique. Trois groupes qu'avait fait surgir la reprise de la lutte prolétarienne, et qui, au cours de plusieurs années de recherche 1aborieuse, tombant souvent dans le piège des idéologies bourgeoises, furent petit à petit gagnés aux positions de classe. A l'époque, cet évènement fut salué par le CCI comme un pas important dans son renforcement, non pas tant pour la nouvelle section en elle-même, que pour l'expérience positive qu'avait constitué l'unification de trois groupes isolés sur la base du programme prolétarien ; celle-ci étant la manifestation de la compréhension croissante, chez les éléments révolutionnaires, de la nécessité de l'unité mondiale. Vaincre les préjugés localistes et réaliser une centralisation effective de la section, surmonter les divisions linguistiques, assumer la publication d'une revue en deux langues (français et néerlandais), s'intégrer dans le travail de l'ensemble du CCI, assimiler les expériences des autres sections et enfin assurer une formation accélérée des militants pour se hisser à la compréhension théorique générale du Courant : telles furent quelques unes des tâches qu'Internationalisme a dû mener à bien au cours de l'année écoulée. L'importance de la synthèse d'un tel travail ne peut être sous-estimée, car c'est seulement l'assimilation complète des difficultés rencontrées au cours des pas précédents qui permet d'accomplir le pas suivant avec assurance.
Après avoir analysé la situation économique et politique aux niveaux international et national ([1] [58]), le congrès a concrétisé la nouvelle étape que s'apprête à franchir la section dans son développement et son renforcement par l'adoption de ses perspectives politiques pour l’année à venir. L'aspect le plus important de celles-ci est sans conteste la décision de publier bientôt Internationalisme mensuellement, en deux langues. Cette augmentation de la fréquence de parution de la revue est le reflet de la multiplication des problèmes qui commencent à se poser à la classe au cours de sa lutte et auxquels l'organisation des révolutionnaires se doit de répondre pour remplir sa fonction au sein du prolétariat. Avec l’approfondissement de la crise et l'exacerbation saccadée de la lutte de classe, les révolutionnaires sont poussés à intervenir de plus en plus intensément, non seulement pour faire face aux besoins immédiats de la lutte, mais encore pour se préparer de façon continue et progressive aux explosions révolutionnaires futures qui germent aujourd'hui dans le sol fertile des luttes quotidiennes.
C'est encore pour se préparer au futur qu'une deuxième tâche d'un congrès consiste à se prononcer sur des questions générales qui ne se posent pas directement dans la pratique, mais qui ne manqueront pas de surgir dans le cours ultérieur de la lutte. Tout comme le second congrès de Révolution Internationale, le premier congrès d’Internationalisme s'est penché sur le problème de la période de transition qui s'étend entre le capitalisme et le communisme achevé. Il s'agit là par excellence d'un problème qui nécessite une réflexion préparatoire. Car, lorsque le prolétariat se soulèvera tout entier contre la bourgeoisie, lorsqu'il balaiera de fond en comble l'Etat bourgeois, dans ce bouillonnement fiévreux qu'est la révolution, les révolutionnaires n'auront jamais trop réfléchi, trop tiré les leçons des expériences passées pour faire face à la nécessité immédiate de l'organisation du pouvoir prolétarien. C'est parce que la dialectique interne des luttes de la classe ouvrière entraîne aujourd'hui celles-ci vers la révolution, c'est parce que chaque lutte porte en filigrane le contenu de la révolution, donc du communisme, que le CCI estime indispensable de prendre position, au cours de son prochain congrès international, sur les grandes lignes des rapports politiques qui existeront dans la période de transition.
L'adoption par le premier congrès d'Internationalisme d'une résolution sur ce sujet s'inscrit donc dans le cadre de la discussion internationale qui prépare le second congrès international.
Et, si la résolution présentée au congrès de Révolution Internationale (publiée dans la Revue Internationale n°8) fut également acceptée par le congrès d'Internationalisme, les discussions n'en furent pas moins controversées et très fructueuses. Le débat fondamental, qui porte sur la nature de l'Etat dans la période de transition, a déjà trouvé une expression dans la Revue Internationale n°6 ; il s'est encore considérablement enrichi d’arguments au cours de la discussion du congrès.
Enfin, le premier congrès d'Internationalisme fut l'occasion de présenter deux textes importants : les thèses sur la lutte de classe en Belgique et les thèses sur la filiation des groupes communistes en Belgique ([2] [59]). Ce congrès fut un moment important de la vie de la section en Belgique, en quelque sorte l'étape qui marquait la tenue de sa constitution effective et le dépassement de ses premières expériences, pour entrer dans une phase d'affirmation politique. Or il est capital de comprendre d'où nous venons pour mieux cerner où nous allons. Ces textes furent ainsi, pour la jeune section en Belgique, un moyen de renouer avec le passé de la classe et de mieux se comprendre comme un maillon de la chaîne qui relie, à travers l'histoire, toutes les luttes et toutes les expressions politiques de la classe.
M.L.
[1] [60] Nous ne reprenons pas ces points ici puisque des textes complets sur la situation internationale, émanant du second congrès de Révolution Internationale ont été publiés dans la Revue Internationale n°8, tandis qu'une résolution sur la situation en Belgique a été publiée dans Internationalisme n°8.
[2] [61] Ces textes seront publiés ultérieurement dans la presse du CCI.
Géographique:
- Belgique [62]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [21]
La Communist Workers'Organisation et les leçons du regroupement des révolutionnaires
- 2960 reads
Une scission importante vient récemment d'avoir lieu au sein du Communist Workers Organisation (CWO), groupe révolutionnaire en Grande-Bretagne qui défend des positions proches de celles du CCI. Bien que les détails de la scission restent obscurs puisque les scissionnistes du CWO ne font apparemment publié aucun texte expliquant pourquoi ils rompent, il semble que la section de Liverpool toute entière -plus ou moins l'ancien Workers'Voice- ait quitté le CWO, lui reprochant son attitude intolérante vis-à-vis des autres groupes et dans la discussion interne. Ceci a peut-être de solides justifications mais l'ancien Workers’Voice (WV) a beau jeu de se plaindre de 1'intolérance vis-à-vis d'autres groupes : il fut le premier de différents groupes à rompre avec le CCI, l'accusant d'être contre-révolutionnaire avec des arguments politiques des plus légers (voir WV n°13, "Statement"). Du peu que nous savons, il semble que le principal motif du groupe de Liverpool pour quitter le CWO est une tendance prononcée au localisme et à l'activisme, une insistance purement verbale d'intervenir dans la lutte de classe, comprenant à la fois l'intervention et la classe ouvrière dans le sens le plus étroit et le plus parcellaire. Ces tendances localistes d'une part et l'échec du groupe de Liverpool à débattre des divergences de façon véritablement politique d'autre part, sont la continuation directe de la pratique de l'ancien WV (voir «Sectarisme illimité» dans WR n°3). Cependant la réaction de ceux qui restent comme le CWO, semble être en droite ligne dans cette tradition de dogmatisme enfermé sur lui-même au point que leurs publications n'ont pas cherché à approfondir les implications politiques de cette scission.
Nous ne voulons pas nous appesantir sur les détails de cette scission. Nous disons simplement qu'elle est la conclusion logique de ce que nous avons qualifié de "regroupement incomplet" (World Révolution (WR), n°5) lorsque Workers’Voice et Revolutionary Perspectives fusionnèrent pour former le CWO en septembre 1975. C'est là le résultat inévitable de la politique d'isolé ment sectaire que le CWO se choisit lorsqu'il rompit avec le CCI. Cet isolement s'est même accru depuis la formation du CWO ; la plupart des contacts avec des éléments révolutionnaires dans d'autres pays (Pour une Intervention Communiste en France, l'ex Revolutionary Workers Group aux USA), n'ont rien donné et le groupe a maintenant perdu une de ses plus fortes sections. Plus que jamais le CWO reste un groupe local pris au piège de l'étroitesse de ses horizons. Bien que le CWO lui-même soit peut-être incapable de comprendre ce qui s'est passé, alors que la période est fondamentalement favorable pour le regroupement des révolutionnaires, il est important pour nous de voir toute l'expérience du CWO comme un problème du ressurgissement du mouvement révolutionnaire et quelles leçons peuvent être dégagées de cette expérience pour le processus de regroupement des révolutionnaires engagé aujourd'hui. Nous saisissons aussi cette occasion pour exprimer nos critiques sur ce que nous considérons être les principales erreurs politiques du CWO ; cette critique servira de réponse à la polémique avec le CCI de l'article du CWO dans Revolutionary Perspectives n°4, "les convulsions du CCI", qui vise a montrer comment le CCI fait partie de la bourgeoisie.
Les problèmes du ressurgissement du mouvement révolutionnaire
Pour comprendre la situation bizarre qui fait qu'en Grande-Bretagne deux groupes révolutionnaires défendent des positions de classe et en même temps n'entretiennent aucune relation entre eux parce que l'un considère l'autre comme "contre-révolutionnaire", il faut revenir plu» sieurs années en arrière quand le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui, faible mais grandissant, commence à émerger de la longue nuit de contre-révolution dont la fin est marquée par la résurgence du prolétariat après 1968.
C'est précisément parce que la contre-révolution qui a suivi la défaite de la vague révolutionnaire des années I917-I923, a été si longue et si profonde que le ressurgissement du mouvement révolutionnaire à la fin des années 60 s'est heurté à de nombreux obstacles et confusions. En effet il n'y a pas de lien automatique entre le niveau de la lutte de classe à un moment donné et la clarté des minorités révolutionnaires du prolétariat. A la suite des événements de mai 1968 en France, le prolétariat international, réagissant aux premiers coups de la crise économique globale qui s'amorce, se lance dans une série de batailles à une échelle que le monde n'avait plus connue depuis cinquante ans. Mais bien que la réapparition du prolétariat sur la scène de l'histoire pose les conditions générales pour la renaissance d'une fraction communiste au sein de la classe, les premiers groupes engendrés par le réveil de la lutte de classe se trouvent devant d'extrêmes difficultés pour comprendre la signification de leur propre existence et les tâches à entre prendre pour lesquels ils ont surgi. Le problème le plus important auquel ils se heurtent est la rupture complète de la continuité organique avec le mouvement révolutionnaire du passé. Dans les périodes précédentes, le prolétariat avait vu ses partis s'effondrer ou le trahir mais chaque fois une nouvelle organisation émergeait peu après, regroupant les meilleurs éléments des anciens partis" et reprenant la synthèse de tous les acquis. Ainsi, bien que la IIème Internationale fut perdue pour le prolétariat lorsqu'elle capitula devant la guerre impérialiste en 1914, l'écroulement ne fut pas total : en quelques années une nouvelle Internationale se reconstituait tel le phénix renaissant de ses cendres, basée sur les éléments de l'ancienne Internationale qui restaient attachés aux principes programmatiques de la classe ouvrière. En rompant avec les partis de la social-démocratie, la nouvelle Internationale Communiste n'avait pas à partir de "zéro" ; elle pouvait compter sur une expérience organisationnelle et une présence au sein de la classe ouvrière entretenue par les révolutionnaires pendant des décades avant le désastre de 1914. Au contraire la défaite de la vague révolutionnaire des années 20, parce qu'elle a lieu dans une nouvelle période où la seule perspective pour le prolétariat est socialisme ou barbarie et donc où seules restent des minorités politiques prolétariennes (ceux qui se basent sur un programme communiste explicite) signifie la quasi disparition du mouvement révolutionnaire de la scène de l'histoire. Les fractions communistes de gauche qui se détachent de l'IC qui dégénère, continuent à jouer leur rôle vital de tirer les leçons de la défaite de la révolution mais n'arrivent pas en fin de compte à résister à l'énorme pression de l'idéologie bourgeoise dans une période de défaite et de démoralisation. L'histoire du mouvement communiste de gauche des années 20 aux années 50 est celle d'une dispersion, d'un isolement croissant.
La rupture tragique dans la continuité avec le mouvement passé signifie que les nouveaux groupes qui surgissent à la fin des années 60 se trouvent privés d'une expérience théorique et organisationnelle vitale , n'ont pas de tradition d'intervention dans la lutte révolutionnaire, sont isolés de la classe,etc.. De plus, le mouvement surgit « parallèlement » à la soi-disant révolte étudiante et beaucoup de nouveaux éléments révolutionnaires viennent au départ du milieu universitaire avec toutes les confusions et les préjugés qui fleurissent dans un tel milieu.
Cette influence petite-bourgeoise est ressentie le plus fortement dans le domaine où les nouveaux groupes révolutionnaires sont les plus confus : la question d'organisation. Les trahisons du parti bolchevik, la transformation des partis révolutionnaires au départ en monstrueuses machines bureaucratiques ont produit et ceci dès les années 20, une réaction dans le mouvement ouvrier tendant à suspecter toute forme d'organisation révolutionnaire comme voulant se substituer à la classe ouvrière. Certaines tendances provenant des Communistes de Conseils des années 30 et 40 ont commencé à évoluer vers la position selon laquelle les organisations révolutionnaires constituent une barrière au développement d'un mouvement prolétarien autonome,
Il n'est guère surprenant que le jeune mouvement révolutionnaire des années 60 adopte au début ces erreurs conseillistes. Beaucoup d'éléments évoluent vers des positions révolutionnaires en réaction aux prétentions bureaucratiques et avant-gardistes des diverses organisations gauchistes ; et si on se rend compte du fait que les conceptions libertaires, situationnistes et autres "anti-autoritaires" sont intimement liées au milieu petit-bourgeois d'où sortent beaucoup de révolutionnaires, on peut voir pourquoi la question d'organisation est une pierre d'achoppement de la majorité des nouveaux courants révolutionnaires. Le rôle des révolutionnaires au sein de la lutte de classe, comment organiser une minorité révolutionnaire, la signification de l'intervention dans la lutte de classe, toutes ces questions sont beaucoup moins nettement comprises que les positions de classe plus générales telles que la nature bourgeoise des syndicats ou des régimes staliniens. Il y a une peur presque réflexe du "léninisme", du "bolchévisme", un sentiment que quiconque met l'accent sur 1'importance de l'organisation révolutionnaire ne peut être que "la même chose" que les trotskystes ou les staliniens, intéressé à s'auto-ériger en faux "leader" de la classe ouvrière. De même, toute tentative d'organiser l'activité révolutionnaire de façon centralisée est suspecte : le seul centralisme qu'on imagine est la hiérarchie bureaucratique des organisations gauchistes. En même temps, les aspects du travail révolutionnaire tels que la publication régulière et méthodique, une approche systématique de l'intervention, de la diffusion des textes, sont souvent considérés comme du "fétichisme organisationnel". Cette méfiance, allant parfois jusqu'à la paralysie en fait de tout travail révolutionnaire, est un produit direct du "traumatisme" de la contre-révolution : hantise compréhensible mais qui doit être dépassée le plus rapidement possible pour que le mouvement révolutionnaire puisse aller plus loin.
A cause de ces problèmes, beaucoup de groupes surgis de la première vague de luttes prolétariennes entre 1968 et 1972 ont complètement disparu et pour la majorité d'entre eux à cause d'une profonde confusion sur l'organisation. Le groupe suédois Internationall Arbetarkamp (IAK) en est un exemple typique. Commençant comme une saine réaction contre le maoïsme, IAK est parvenu tout près de l'élaboration d'une plate-forme communiste claire mais lorsqu'il s'est agi de s'affronter au problème de s'organiser, la peur a repris le dessus. Sous l'influence des idées modernistes comme celle d’Invariance en France, IAK a rapidement commencé à théoriser sa propre décomposition interne, affirmant que tout groupe est un "racket" et bourgeois par nature, que la tâche des communistes est de"vivre comme des communistes" : il n'est pas surprenant que le groupe ait bientôt éclaté entre des individus démoralisés poursuivant leur « propre » évolution vers le "végétarisme", la rédaction de romans "anti-capitalistes", etc..
Un des problèmes principaux pendant cette période a été l'absence d'une tendance politique capable d'agir comme pôle solide de regroupement, d’offrir à des groupes corme IAK une alternative à la désintégration politique. Ceci était inévitable car le mouvement révolutionnaire naissant n'avait d'autre alternative que de croître et mûrir à travers ses propres expériences. Néanmoins, ce processus de maturation s'est développé lentement : un des premiers signes est la disparition de la plupart des courants qui, éblouis par le boom d'après-guerre, avaient rejeté la conception marxiste de la crise et ont aujourd'hui vu leurs fantaisies sur un capitalisme ayant surmonté ses crises, démenties par le net infléchissement de la crise économique après 1973 (situationnisme, Gauche marxiste, ICO, etc.).
Entre 1968 et 1973 s'est poursuivi un processus graduel et continu de décantation dans le mouvement révolutionnaire ; dans ce contexte, la persistance et la persévérance du Courant international (alors représenté par Révolution Internationale en France, Internationalism aux USA et Internationalismo au Venezuela) défendant la nécessité d'une plate-forme politique cohérente comme base du regroupement des révolutionnaires, a été l'expression des besoins objectifs du mouvement révolutionnaire. Pour nous, l'affirmer aujourd'hui n'est pas une question de fanfaronner rétrospectivement ou de nous auto-proclamer arbitrairement pôle de regroupement (l'unique et l'éternel !) comme le CWO semble le prétendre dans leur "Convulsions du CCI". Si le Courant international a été le regroupement révolutionnaire le plus consistant après 1968, c'est par son souci constant de réappropriation et d'approfondissement des acquis du mouvement révolutionnaire passé. Le fait que quelques-uns des membres fondateurs du Courant international aient fait partie directement du mouvement de la Gauche communiste des années 30 à 50 est un élément important bien qu'il n'ait pas été un facteur décisif comme nous l'avons dit, toute continuité organique avec la Gauche communiste ayant finalement été rompue par la contre-révolution. Mais le Courant international s'est engagé à construire une continuité politique avec le mouvement de la Gauche communiste du passé et a ainsi élaboré une plateforme qui s'efforce de synthétiser les contributions fondamentales du mouvement ouvrier historique. Ceci a fait que le Courant tendait à devenir un pôle de regroupement et contribuait à la clarification du mouvement révolutionnaire des années 70. Mais, de par sa propre immaturité, il a fallu longtemps pour que les implications d'une telle orientation soient comprises par le Courant lui-même et beaucoup de conflits internes et de confusions ont du être résolues avant que le Courant international puisse pleinement assimiler la réalité de sa propre existence. Par exemple, il a fallu résoudre les hésitations "anti-organisationnelles" en son sein, exprimées par le départ des éléments activistes du PIC de RI en 1973 et de la "Tendance Communiste" moderniste en 1974, etc.. (Dans les "Convulsions du CCI", le CWO présente ces revers comme signes d'un groupe agonisant ; aujourd'hui on peut les voir clairement comme des maladies de croissance du CCI).
Ainsi, comme la plupart des courants révolutionnaires de l'époque, le Courant international qui est devenu le CCI aujourd'hui, a compris en dernier la question d'organisation, après les questions politiques plus générales ; l'immaturité relative du Courant était inévitable mais devait avoir des répercussions importantes sur certains des premiers efforts de regroupement. C'est ce qui devait apparaître douloureusement en Grande-Bretagne.
Les revers du regroupement en Grande-Bretagne
En mai 1973, divers éléments et individus essayant de clarifier les positions communistes se réunissent à Liverpool pour discuter des perspectives politiques. Il y a trois groupes en Grande-Bretagne : Workers'Voice de Liverpool, qui a rompu avec le trotskisme et essaie de réassimiler les acquis des Communistes de gauche du début des années 20 ; quelques camarades d'Ecosse qui ont scissionné de Solidarity pour défendre une conception marxiste de la crise du capitalisme et un groupe de Londres, dont certains membres ont également scissionne de Solidarity mais qui se considèrent proches des positions de Révolution Internationale et d'Internationalism (qui participent également aux discussions sur le les questions importantes comme les syndicats, l'organisation et la décadence du capitalisme) ; la confusion est grande dans les groupes britanniques et les contributions de RI et Internationalism sont importantes pour essayer de clarifier quelques-uns de ces problèmes.
De nombreuses réunions se poursuivent pendant quelques mois et les groupes en Grande-Bretagne progressent considérablement (le groupe, de Londres devient World Révolution et les éléments en Ecosse Revolutionary Perspectives). La discussion entre les groupes se poursuit de façon fraternelle et constructive et des interventions conjointes ont lieu (par exemple le tract de WR et WV sur le Chili en septembre 1973 au moment de la chute d'Allende). Mais un problème commence à se poser par le fait que WR évolue plus rapidement vers la plateforme et la politique du Courant international que WV et RP. Des questions importantes comme la décadence du capitalisme ou l'alternative de guerre ou révolution, socialisme ou barbarie, soulèvent des hésitations et des incompréhensions de la part de WV, au début RP, tout en niant le problème de la saturation des marchés comme source de la crise capitaliste, assimile le concept général de décadence plus rapidement. RP cependant, exprime des désaccords sur la question de la révolution russe et du parti bolchevik en particulier. Il faut longtemps à RP pour saisir pleinement le caractère prolétarien du parti bolchevik. Ce développement inégal des trois groupes devient une source de complications pour une raison fondamentale : la discussion et la coopération entre les groupes n'ont à aucun moment été fondées sur une conception claire du regroupement des révolutionnaires. Dès le début, le regroupement est vu comme un projet vague et lointain, peut-être seulement nécessaire au début de la révolution. La discussion entre les groupes se mène sur la compréhension tacite que chaque groupe a sa propre"autonomie", ses « propres positions » à développer et à défendre. La fraternité dans la discussion est authentique mais instable dans la mesure où elle n’a pas à faire face à la question difficile d'une réelle implication, une fusion en une seule organisation centralisée à l'échelle internationale. Là encore, le Courant International est le premier à poser la question du regroupement de façon claire. Mais au moment où la question devient explicite, son apparition implicite sans vraiment comprendre ce que cela signifie, a déjà mené à une détérioration des relations entre les groupes en Grande-Bretagne. Ceci se vérifie particulièrement après la Conférence de janvier 1974 lorsque WR change de position sur la révolution russe (l'insurrection d'Octobre était jusque là considérée comme une contre-révolution capitaliste d'Etat dirigée par un parti bolchevik "bourgeois") et montre une volonté claire de prendre part au Courant international de RI-Internationalism-Internacionallsmo. WV interprète cela comme une "capitulation" de WR face aux desseins « semi-bolcheviks » du Courant international (interprétation encore mise en avant par le CWO dans les "convulsions du CCI") et les relations entre WR et WV se détériorent ensuite rapidement. WV se retire de plus en plus dans un refus renfrogné de discuter ses divergences (cf, ''Sectarisme illimité", WR, n°3) et ne répond pas aux diverses lettres qu'écrit WR pour tenter de poursuivre la discussion (il semble qu'aujourd'hui le groupe de Liverpool veuille continuer la mène politique de silence sur ses divergences avec le CWO).
Au moment où le Courant international commence à mettre réellement en avant que le regroupement signifie regroupement aujourd'hui en une seule organisation internationale, il apparaît aux groupes "hors" du Courant que le Courant international (alors rejoint par les groupes en Italie et en Espagne) exprime une sorte de "désir impérialiste" de s'étendre a tout prix et d'incorporer tous les autres groupes pour accroître ses propres prétentions. Le Courant ne parle pas seulement de regroupement, il commence à construire un cadre organisationnel dans lequel le regroupement peut réellement se faire. Ceci provoque une réponse soupçonneuse des autres groupes et pas seulement en Grande-Bretagne. Le Revolutionary Workers'Group (RWG) de Chicago qui a rompu avec le trotskisme et évolue de façon positive vers le Courant commence aussi à se retirer quand la question pratique de son intégration dans le Courant commence à se poser. Quelques éléments de WV et RWG gardent certaines illusions sur la possibilité d'un travail indépendant avec la Tendance Communiste avant sa désintégration politique et sa disparition complète.
En novembre 1974, le silence de WV est rompu par une mise au point affirmant que le Courant est une force contre-révolutionnaire à cause de ses positions sur l'Etat dans la période de transition. RP montre encore une volonté de discuter les questions politiques mais commence à soulever de plus en plus d'objections aux positions du Courant, particulièrement sur la révolution russe et la période de transition. Après avoir discuté la possibilité d'entrer dans le Courant international comme "minorité" et avoir été sévèrement critiqué sur cette position, RP commence à se considérer comme le groupe "le plus clair" et agir comme si lui-même était le pôle de regroupement et non le Courant. Il demande que le Courant qui s'est constitué en janvier 1975 comme Courant Communiste International, change ses positions considérées alors comme des "frontières de classe" sur la question de l'Etat et sur la mort définitive de la révolution russe. A ce stade, sa perspective est de convaincre le CCI de ses "erreurs" qui sont subjectives et ne représentent pas un point étranger à la classe (Lettre ouverte au CCI, RP, février 1975). Peu après, RP abandonne l'espoir de réformer le CCI et se consacre au regroupement avec les autres groupes qui semblent être plus proches de ses propres positions et qui forcent une sorte de "contre-courant" au CCI : WV, RWG et PIC ((Pour une Intervention Communiste), France).
Les discussions avec le RWG et le PIC révèlent des divergences importantes mais en septembre 1975, WV et RP fusionnent pour former le CWO. Il semble au début que les éléments de RP dans le CWO continuent de considérer le CCI comme un groupe "confus" et non-bourgeois, mais plus tard, l'ensemble du CWO adepte la position de l'ancien WV - que le CCI est une faction contre-révolutionnaire du capital avec laquelle toute discussion est inutile. Malgré tout, le CWO affirme dans "Les convulsions du CCI" que c'est le CCI qui a mis fin à la discussion entre les groupes, ce qui est une affirmation invraisemblable si l'on se rappelle les prises de positions ininterrompues du CCI à la fois avant et après la formation du CWO, affirmant sa volonté de maintenir un dialogue avec le CWO, position qu'il maintient encore aujourd'hui, sans mettre aucune condition au débat.
Ceci est d'autant plus invraisemblable quand on considère qu'au cours du processus de regroupement en Belgique, les groupes participants (RRS d'Anvers, VRS de Gand et Journal de luttes de classe de Bruxelles) invitent le CWO à participer à leur conférence en plein accord avec le CCI. Le CWO n'est cependant pas venu et leur silence a été déploré dans les documents issus de la Conférence de 1975 (Revue Internationale n°4 [63]).
Le prix de l'immaturité
Cette brève trajectoire du processus qui a mené à la formation du CWO n'apporte que peu de choses sauf si on analyse les raisons sous-jacentes et si on essaye d'en tirer les leçons. Nous n'entrerons pas dans tous les détails de cette affaire. Notre tache aujourd'hui est de comprendre pourquoi a pu se produire une telle détérioration des relations ; c'est seulement en considérant les caractéristiques générales qu'il sera possible de voir comment à certains moments, des questions secondaires peuvent exacerber un problème Rétrospectivement, il est possible de voir beaucoup de raisons générales pour l'échec de cette tentative de regroupement.
De la part des groupes hors du Courant, les obstacles principaux au regroupement sont des problèmes qui, comme nous l'avons vu, sont communs à beaucoup de groupes qui ont surgi de la période de contre-révolution: une peur du bolchevisme et l'héritage de la contre-révolution et une profonde absence de clarté sur la question d'organisation.
1- Une des principales pommes de discorde entre le CCI et les autres groupes est la révolution russe et les leçons â en tirer. Ce n'est pas par hasard. La révolution russe a été un des événements les plus importants de l'histoire du prolétariat et quiconque échoue à comprendre les leçons de cette expérience n'arrivera pas à se dégager de la contre-révolution. La réaction de quelques éléments du prolétariat à la défaite de cette révolution est le rejet de toute l'expérience comme rien de plus qu'une révolution bourgeoise ou un moment dans l'évolution du capital vers de nouvelles formes. Le parti bolchevik, en particulier, est souvent rejeté de tout le mouvement prolétarien et présenté comme le porteur parfait du capitalisme d'Etat, intéressé à la seule modernisation de la Russie. Ce genre d'interprétation que nous pouvons qualifier vaguement de "conseilliste", a eu une influence importante sur les groupes en Grande-Bretagne quand ils ont surgi, WR se nomme au départ "Conseil Communism" et s'oppose violemment au bolchevisme ; WV passe par une phase explicitement conseilliste lorsqu'il rejette toute idée d'un parti révolutionnaire ; RP commence avec des positions proches d'Otto Ruhle à savoir que tous les partis sont bourgeois et que 1917 en Russie est une révolution bourgeoise. Au contraire, RI, dès le début, insiste sur le caractère prolétarien de l'insurrection d'Octobre et du parti bolchevik. Ceci provoque "naturellement" des soupçons que RI est encore quelque peu teinté de bolchevisme et de léninisme, qu'il se prépare à excuser et défendre toutes les actions anti-ouvrières des bolcheviks après 1917. D'autres soupçons sont provoqués par l'affirmation de RI que pendant la période de transition l'Etat est inévitable, un fléau nécessaire que le prolétariat aura à utiliser mais avec lequel il ne pourra jamais s'identifier. Et comme RI a toujours défendu la nécessité d'un "parti révolutionnaire", ce que dit le Courant sur le regroupement est interprété comme une autre aventure, à la manière trotskyste, de construction du parti.
Echouant à comprendre la méthode du Courant international pour tirer les leçons de l'expérience bolchevik, les autres groupes tendent à voir la « contre-révolution » derrière chaque position qu'ils ne saisissent pas immédiatement.
Après beaucoup de discussions, WR et RP se séparent tous deux de l'interprétation conseilliste et acceptent le caractère prolétarien de la révolution russe et du parti bolchevik. Ils commencent également à parler de la nécessité d'un parti révolutionnaire, mais ils ne considéreront jamais l'idée que l'Etat de transition est quelque chose de distinct de la classe ouvrière et sous-entendent que la position du CCI signifie la répétition de l'erreur des bolcheviks de subordonner les conseils ouvriers à une force étrangère au prolétariat (ce qui est exactement le contraire de la position du CCI qui met l'accent sur la nécessité pour les conseils ouvriers d'exercer leur pouvoir sur toutes les autres institutions de la société !). En même temps, tout en reconnaissant le caractère prolétarien de la révolution russe, WV et RP (et le RWG) commencent à mettre en avant que quiconque ne reconnaît pas que le parti bolchevik est "fini" en 1921 (Kronstadt, la NEP, le front unique), a franchi les "frontières de classe" et devient un apologiste de la contre-révolution. Nous discuterons l'absurdité de cette position plus loin mais même cette absurdité n'est pas sans signification. Jamais auparavant dans l'histoire du mouvement ouvrier, une question de date, une interprétation historique a posteriori, n'a constitué une "frontière de classe". La seule explication possible pour l'intransigeance avec laquelle WV, RP et le RWG ont défendu leur position sur "1921" est qu'ils voient cette date comme une sorte de cordon sanitaire les protégeant d'un lien possible avec la dégénérescence du bolchevisme. C'est comme s'ils voulaient diminuer leurs réticences à accepter le parti bolchevik comme une partie de leur propre histoire en disant "jusque là mais pas plus loin". Ils ont évolué d'une position conseilliste à une position plus cohérente, proche de celle du CCI, comme nous l'avons dit, ils n'ont pas assimile de méthode cohérente pour analyser les erreurs et même les crimes du mouvement ouvrier passé, ni l'approche du problème de la dégénérescence et de la mort des organisations prolétariennes.
2- Les confusions de WV-RP sur le regroupement et l'organisation ont été liées de très près à leur peur du "léninisme" et du "bolchévisme". Particulièrement, WV a considéré pendant longtemps que parler de regroupement aujourd'hui est "substitutionniste". Bien que leur position ait changé ultérieurement (sans explication aucune), la question du regroupement n'a jamais été pleinement clarifiée dans le CWO comme nous le venons. Parallèlement à cette hostilité au regroupement, il y a eu cette réticence vis-à-vis du parti et une difficulté sur la conception de la centralisation. Les idées de WV sur l'organisation ont été plus ou moins fédéralistes : chaque groupe est autonome et a sa propre intervention à faire dans son coin du monde. La perspective d'être absorbé dans un corps international les a remplis d'angoisse. RP a accepté l'idée du regroupement et de la centralisation plus facilement mais la compréhension des implications a été très limitée, ce qui a été démontré par exemple par l'idée d'entrer dans le Courant comme un bloc avec sa propre plateforme au sein de l'organisation et leur basculement ultérieur, de la conception sous-fédéraliste à un monolithisme extrême, pour lequel le regroupement est impossible tant qu'il n'y a pas accord absolu sur tous les points quels qu'ils soient, a montré qu'il n'a pas compris réellement la conception de la centralisation. En général, ni RP, ni WV n'ont abandonné l'idée qu'ils ont leur propre contribution à apporter au mouvement ouvrier, que ce sont eux qui ont fait et clarifié l'essentiel d'une plateforme révolutionnaire : il est vrai, disent-ils que le Courant international les a aidés un tout petit peu mais le principal vient d'eux. Il se sont sortis du gauchisme par leurs propres moyens.
La vérité est quelque peu différente. Ni RP, ni WV, ni le CWO n'ont fait de critique systématique de leur propre passé, nais s'ils l'avaient fait, ils seraient arrivés à quelques conclusions désagréables. Alors que la discussion entre révolutionnaires n'est jamais un monologue et que des deux cotés on a gagné dans les débats qui se sont tenus en Grande-Bretagne, un coup d’oeil rapide aux faits ne laissera aucun doute sur qui a été la source principale de clarification. Le Courant avait déjà un cadre et une plateforme clairs avant que ces discussions s'engagent : ceux de RI (la Déclaration de principes de 1968 et la plateforme de 1972). Quand RP et WV ont commencé à discuter avec le Courant, ils étaient confus sur des questions absolument vitales comme les shop stewards, la révolution russe, la décadence, l'organisation, le mouvement de la gauche communiste et les positions claires vers lesquelles ils ont évolué, ont été les positions que le Courant défendait déjà ; ce qu'ils ont considéré plus tard comme la preuve de leur clarté supérieure (1921, l'Etat, etc.) ont été principalement des confusions qu'ils n'ont jamais surmontées. Le résultat est que les plateformes de WV, de RP et du CWO sont essentiellement des versions affadies de la plateforme du CCI avec en plus leurs propres dadas. Sans l'intervention du Courant, il est peu probable que WV et RP seraient arrivés à une perspective politique relativement claire. Une fois de plus, nous n'affirmons pas cela pour donner du prestige au CCI, nous réaffirmons simplement que les circonstances historiques ont fait que le Courant international a été le premier à élaborer une plateforme politique cohérente, ce qui lui a donné une responsabilité particulière dans le développement d'autres groupes. Autant RP que WV n'ont jamais pu admettre ce fait. Leur désir de défendre leur autonomie et de développer "leurs" idées les a empêchés de voir la nécessité pour les communistes d'unifier leurs efforts et de se regrouper dans une seule organisation.
Mais les erreurs de WV et RP ne peuvent pas expliquer toute l'histoire. Nous n'avons pas affaire ici à des problèmes psychologiques : les hésitations, confusions et craintes de WV-RP sont en grande partie un produit historique de 1'immaturité du mouvement révolutionnaire et cette immaturité a aussi affecté le Courant international en freinant ses propres efforts vers la constitution d'un pôle de regroupement.
Comme nous l'avons vu, bien que les groupes du Courant international aient eu une vision plus cohérente sur les problèmes organisationnels en général, ils ont mis du temps à tirer toutes les conclusions pratiques de cette compréhension globale. Ceci s'applique autant à leur structure interne qu'à la question du regroupement, tous deux étant des aspects de la centralisation. Ce n'est que graduellement qu'il est devenu clair qu'il était nécessaire aujourd'hui de construire une organisation de révolutionnaires centralisée internationalement, laquelle ne serait à son tour qu'un moment de la reconstitution du parti communiste mondial dans une période de lutte de classe intense. Bien qu'il ait imposé sa clarté générale dans la discussion avec les autres groupes, le Courant international n'a pas réussi à poser le problème fondamental du regroupement dès le début. Il n'a pas insisté suffisamment tôt sur le fait que la discussion et la coopération entre les groupes en Grande-Bretagne avaient pour but la clarification sur les points essentiels d'une plateforme communiste et la fusion des différents éléments dans une seule organisation internationale.
Quand les divergences ont surgi entre les groupes, le Courant n'a pas toujours répondu de manière adéquate et c'était là essentiellement le résultat de son inexpérience à traiter de tels problèmes. Le développement de nouveaux groupes est un processus extrêmement délicat qui requiert en même temps qu'une défense intransigeante des positions politiques générales, beaucoup de souplesse et de patience de la part d'un groupe plus mur. Ceci ne veut pas dire que les problèmes auraient pu être évités si le Courant avait fait preuve de plus de"tact" - arrivés à un certain point, le tact et la bonne disposition du Courant ont été interprétés comme des manifestations d'un opportunisme dénué de principes. Mais quand le mouvement révolutionnaire est si jeune et faible, les problèmes secondaires et mêmes personnels peuvent avoir un effet sans commune mesure avec leur importance réelle. Ceci veut dire que la manière de mener une discussion est très importante. Il est nécessaire particulièrement de séparer les problèmes d'importance secondaire de ceux d'importance fondamentale et de mener la discussion à un niveau strictement politique, sans se perdre dans les minuties de la psychologie inter-groupes.
Au manque d'expérience du Courant international à mener de telles discussions, s'ajoutait le fait qu'il n'avait pas encore les moyens organisationnels de diriger le débat vers une conclusion fructueuse. Par le fait que le Courant n'existait pas encore comme une seule organisation unifiée, il n'avait pas les moyens d'élaborer une orientation globale et cohérente dans ses relations avec d'autres groupes. Pour la même raison, il était difficile que les autres groupes le voient comme un pôle de regroupement alors qu'il n'avait pas de plateforme commune et de structure organisationnelle unifiée. Des groupes comme le RWG lui ont reproché effectivement de ne pas être centralisé sans comprendre que la centralisation est un processus qui ne peut être proclamé du jour au lendemain. Toute la perspective du Courant était qu'il devait s'acheminer vers la constitution d'une seule organisation internationale. Mais le fait qu'il n'avait pas encore atteint ce stade devait peser lourdement sur ses premières tentatives de regroupement avec d'autres éléments. De plus, la naissance du CCI s'est accompagnée des inévitables douleurs de l'enfantement qui ont donné lieu à un certain nombre de défections et de scissions :
-
"Cette période d'approfondissement de la compréhension dans le Courant a sans doute troublé tous nos contacts internationaux. Le fait de voir l'organisation déchirée par de violentes polémiques (particulièrement avec la "Tendance Communiste" au sein du CCI) n'a pas inspiré confiance à ceux qui de toute façon étaient imprégnés d'une peur de l'organisation liée à leur "anti-léninisme". Il est difficile d'intégrer de nouveaux éléments dans une organisation pendent sa naissance particulièrement douloureuse". (Leçons du regroupement, texte du CCI).
Si on compare la faillite du regroupement avec RP et WV en Grande-Bretagne avec le regroupement mené à bien après en Belgique, il devient évident que l'existence du Courant en tant que corps unifié était extrêmement importante. Les trois groupes qui ont commencé à discuter les positions révolutionnaires en Belgique, ont démarré avec les mêmes problèmes que les groupes en Grande-Bretagne avaient affrontés : origines différentes, développement inégal vers les positions du CCI... Mais cette fois, le CCI non seulement existait en tant que tel mais avait appris de son expérience négative en Grande-Bretagne et a été capable de situer les discussions dans un cadre cohérent dès le début. Il a été capable de minimiser les problèmes secondaires et d'aider à la clarification de tous les groupes. Pendant cette période, le CCI a mis clairement en avant le fait que le but de la discussion était l'unification des différents éléments dans une même organisation internationale et le CCI a été capable de se présenter comme cette organisation. En fait, il est devenu rapidement clair pour les camarades en Belgique que le CCI était la seule organisation capable de fournir un cadre permettant le regroupement international. L'intervention du PIC et du CWO dans ce processus a simplement révélé leur préoccupation d'attaquer le CCI et de faire obstruction à toute unification dans le mouvement révolutionnaire. La constitution d'Internationalisme comme section belge du CCI, de même que d'autres regroupements qui ont été menés à bien au Canada, en Italie et Espagne, ont prouvé que le CCI avait surmonté beaucoup de ses difficultés du début et commençait à montrer une capacité réelle d'agir comme pôle de regroupement et de clarification.
Il est dommage que beaucoup des leçons amères que le CCI a apprises sur le regroupement - la nécessité de placer la discussion dans un cadre global, la nécessité d'une organisation unifiée et internationale, etc., l'ont été par une expérience négative en Grande-Bretagne mais la défaite a toujours été l'école du mouvement prolétarien. Les conditions qui ont mené à la formation du CWO sont surtout un produit d'une phase particulière dans la reconstitution du mouvement révolutionnaire et ne se répéteront probablement plus. En ce sens le CWO est une anomalie d'une période révolue. La croissance positive du CCI et la fragmentation et l'isolement croissants du CWO le confirment.
L'isolement du CWO
Depuis qu'il s’est créé, le CWO s'est enfermé de plus en plus dans une coquille de sectarisme misanthrope. Son rôle principal a été de semer la confusion parmi les éléments qui s'approchaient des positions communistes, les désorientant avec son insistance obsessionnelle sur les "divergences" avec le CCI. Après tout, qu'est ce qui peut être plus déroutant pour qui commence à comprendre les vraies positions de classe et la différence réelle entre un groupe communiste et un groupe gauchiste, que de découvrir tout d'un coup une série de "nouvelles frontières de classe" ? Il est difficile d'évaluer à l'heure actuelle l'influence confusionniste du CWO dans le mouvement révolutionnaire naissant. Nous avons mentionné leur rôle entièrement négatif dans le processus de regroupement en Belgique. En Grande-Bretagne, ils ont réussi à dévoyer plusieurs éléments dans leur tanière isolationniste, sans parler du fait que les militants du CWO se sont retirés eux-mêmes de la discussion au sein du mouvement révolutionnaire et se sont ainsi privés de la contribution au mouvement qu'il promettaient au début de leur développement.
Mais il serait erroné de surestimer l'influence (négative) du CWO. Dans beaucoup de cas avec les groupes en Belgique, par exemple et avec certains camarades en Grande-Bretagne qui font maintenant partie de WR , ils n'ont pas réussi à convaincre des révolutionnaires qui venaient de surgir que leur point d'appui « contre le CCI » était basé sur des critères politiques sérieux. Maintenant que leur attitude sectaire n'est plus dirigée seulement contre le CCI, ils ont des difficultés à maintenir des contacts avec un certain nombre d'autres groupes et encore plus à se regrouper avec eux. L'attitude qu'ils ont adopté envers le PIC est typique, exigeant que le PIC abandonne tout simplement sa position luxembourgiste sur la crise comme préalable à un regroupement (cf WR n°5 "Un regroupement incomplet"). Ils ont adopté la même attitude sectaire envers un groupe à Goteborg, en Suède en rupture avec l'anarchisme : la réponse du CWO n'a pas été de faire la critique de ses confusions mais d'écrire une attaque retentissante contre le mouvement anarchiste dans l'histoire (cf "Anarchism" dans RP n°3) et insister pour que le groupe de Goteborg réponde à cette attaque avant d'entamer une quelconque discussion. Il n'est pas surprenant que ni le PIC ni le groupe suédois n'aient voulu accepter un tel ultimatum. D'autres contacts internationaux n'ont également mené nulle part. Le CWO a eu un bref flirt avec le groupe Union Ouvrière en France, scission du groupe trotskyste Lutte Ouvrière. Bien que le CWO ait clairement encouragé les premiers efforts d'UO vers des positions révolutionnaires, il a sous-estimé les difficultés sur le plan politique général d'une rupture complète avec un passé organisationnel contre-révolutionnaire. La recherche désespérée du CWO d'autres contacts révolutionnaires après s'être arbitrairement coupé lui-même du CCI et de tous ceux qui ont des contacts avec lui, les a amenés à se bercer d'illusions sur la véritable clarté d'UO et de se jeter dans la proclamation de la victoire d'UO avant la bataille. En tout cas, le "dialogue politique" avec UO semble s'être terminé en un silence embarrassé puisque ce dernier s'est maintenant transformé en une sorte de rassemblement de modernistes. La fin des relations du CWO avec le groupe américain RWG, dont le CWO disait à ses débuts que c'était le groupe qui lui était "le plus proche" (WV 15), a aussi été passée sous silence. Le fait d'être proche du CWO n'a pas empêché le RWG de se démoraliser complètement et de se dissoudre (cf. WR n°5). Après une brève résurrection comme "Groupe Prolétarien Communiste", les vestiges du RWG ont finalement fusionné avec un étrange club de Chicago appelé "Comité pour un Conseil Ouvrier" pour former une ridicule secte semi-moderniste "Forward". "Forward" pense que l’ensemble de l'histoire du mouvement ouvrier depuis Marx jusqu'aux Bolcheviks (et probablement la gauche communiste aussi) n'a été que l'aile gauche du capital et que les luttes revendicatives de la classe (que "Forward" identifie avec mépris et à tort avec le "marchandage syndical") devraient être abandonnées. Leur journal est principalement consacré à des attaques fumeuses contre le CCI et le CWO.
La rupture de ses relations internationales accentue l'isolement du CWO et son incapacité à offrir une perspective réelle pour le regroupement des révolutionnaires. Bien que le CWO ait jusqu'à présent échoué à tirer un bilan de ces tentatives de regroupement, cette série d'échecs doit avoir produit des tensions dans l'organisation ; comme nous l'avons vu, la section de Liverpool qui a scissionné, a donné, parmi les raisons de sa scission, l'attitude intolérante du CWO envers les autres groupes. Lorsqu'un groupe s'enferme sur lui-même comme le CWO, il se crée une immense pression interne qui peut mener à des défections et des scissions soudaines, sans explication. La pression à l'intérieur du CWO a été augmentée par le caractère monolithique du groupe, son insistance sur un accord total sur tous les points de la plateforme, son refus de permettre des positions minoritaires. Comme nous l'avions prédit dans WR n°6, cette conception monolithique de l'organisation :
-
"Mènera non seulement vers deux organisations mais vers une série interminable de scissions, d'expulsions, de dénonciations et de ruptures de relations qui ne pourront pas apporter plus de clarté au programme communiste que la scission présente du CWO d'avec le CCI" ("CWO et la question de l'organisation").
Ce monolithisme n'a jamais permis aux divergences de surgir et d'être débattues publiquement ou même au sein de l'organisation d'après les "scissionnistes". Cela ne peut servir qu'à cacher les divergences réelles et créer une atmosphère étouffante à l'intérieur du groupe ; mais en même temps le CWO a été incapable de se passer d'une structure monolithique. A 1'origine réaction excessive contre le fédéralisme de RP et WV, le monolithisme du CWO est devenu un paravent indispensable pour marquer nettement la séparation d'avec les autres groupes et pour protéger la "virginité" de la plateforme. Mais il est aussi clair que cette structure monolithique n'a jamais réellement éliminé la fragilité du regroupement d'origine entre WV, RP. Le CWO lui-même l'admet dans sa récente lettre au CCI :
-
"Dans le futur, nous devrons faire plus attention dans nos relations avec des éléments qui disent être a accord avec nos positions mais qui cherchent à nous utiliser soit comme bouée de sauvetage pour se maintenir à flot soit comme bouclier contre les autres organisations politiques"'.
Sous l'unité apparente et le "centralisme programmatique" du CWO, il existait encore deux groupes et l’acceptation du groupe de Liverpool des perspectives politiques défendues par le CWO, semble avoir été plutôt superficielle, à en juger par la facile régression de WV vers ses anciennes activités localistes et activistes. Dès le début l'organisation unie du CWO était une création artificielle, construite sur une base politique entièrement inadéquate, comme une sorte de miroir reflétant en négatif l'image du CCI. La scission était donc inscrite dans le groupe dès le début et à moins que le CWO ne change radicalement son orientation présente, il se dirige encore vers des tendances à la désintégration dans l'avenir.
Une des conséquences de l'isolement du CWO est une accumulation de confusion et de conceptions politiques erronées qui, en l'absence de discussions avec d'autres, ne sont pas clarifiées mais servent comme nouvelle justification du caractère "unique" du CWO. Un exemple suffira pour l'instant : dans RP n°5, nous trouvons l'incroyable affirmation que ni le soulèvement du 19 juillet 1936 ni les journées de mai 1937 à Barcelone, n'ont été des expressions d'une lutte prolétarienne. Cette vision est totalement en désaccord avec la position défendue par BILAN (cf. "L'appel de la Gauche communiste" publié dans la Revue Internationale n°7) et de fait obscurcit la signification de ce qui est arrivé en Espagne, en particulier le rôle de l'extrême gauche, rôle d'autant plus important que la bourgeoisie espagnole avait senti de façon aigue le danger prolétarien. Nous ne voulons pas entrer dans les détails de cette question ici : nous la citons comme exemple de la façon dont l'isolement du CWO par rapport au mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui et aux traditions de la gauche communiste est en train de le mener à adopter des positions de plus en plus bizarres et sans fondement. Le CWO continue à défendre des positions de classe et reste dans le camp prolétarien ; sa dégénérescence politique est entrain de se faire lentement mais la prolifération de confusion dans ses rangs accélérera inévitablement cette tendance qui devient de plus en plus apparente.
C.D.WARD
Courants politiques:
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Rupture avec Spartacusbond (Pays Bas)
- 2894 reads
SPARTACUSBOND : SEUL AU MONDE ?
L'article qui suit a été écrit par un camarade hollandais qui a quitté le SPARTACUSBOND (SB). Cet article est composé de différents textes écrits en préparation de la dernière conférence de SB et sert de lettre de rupture avec cette organisation. Le but de l'article est de clarifier pour le monde extérieur les développements qui ont eu lieu au sein de SB et, se faisant, de contribuer aussi au processus de regroupement international des révolutionnaires qui a amené F.K. à rejoindre le CCI, considérant qu'il est "le seul pôle sérieux de regroupement international des révolutionnaires aujourd'hui
LE "SPARTACUSBOND" : SEUL AU MONDE
Depuis la seconde partie des années 60, la lutte ouvrière a repris une forme ouvertement révolutionnaire. Au même moment, nous voyons émerger des noyaux révolutionnaires qui tentent de comprendre la crise du capitalisme et le resurgissement de la lutte de classes. Ces groupes révolutionnaires jettent ainsi les bases pour une reprise des activités de propagande qu'ont menées les organisations révolutionnaires issues de la première vague révolutionnaire du prolétariat mondial, après le massacre inter impérialiste de 1914-18. Ces tentatives sont d'autant plus difficiles que 50 années de contre-révolution ont rompu la continuité organique avec ces partis communistes qui s'étaient organisés dans la 3ème Internationale et avec ces groupes qui sont restés fidèles à la révolution mondiale après la dégénérescence et la désintégration de la 3ème Internationale et du Parti Bolchevik. Il est donc normal que les groupes révolutionnaires surgis pendant ces dernières années engagent une discussion approfondie, dans le but de se réapproprier les acquis historiques de la classe ouvrière, de clarifier les positions de classe et finalement de créer un regroupement international sur la base d'une plate-forme où sont élaborées les positions de classe. Le CCI est le résultat des efforts théoriques et organisationnels de ces groupes révolutionnaires qui ont pris conscience du fait que c'est seulement dans un cadre organisé internationalement qu’ils pourront assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la classe ouvrière.
Tout le monde ne comprend pas immédiatement la portée d'un tel effort et ceci d'autant plus que les nombreuses organisations contre-révolutionnaires existantes contribuent à dévoyer le sens de cet effort. Elles ont, en effet. l'honneur douteux de pouvoir se réclamer d'une continuité organique et vivante avec ces courants qui, l'un après l'autre, se sont révélés être les massacreurs de la classe ouvrière - comme, par exemple, les trotskistes, les staliniens et les maoïstes, tous produits de la dégénérescence de la 3ème Internationale et du Parti Bolchevik.
Les groupes contre-révolutionnaires ne sont pas menacés par le reflux des luttes ouvrières. Au contraire, ils sont l'expression bourgeoise de ce reflux, et l'accélèrent. Leur rôle de mystification consiste à présenter n'importe quelle défaite de la classe ouvrière comme une victoire : le reflux des luttes dans le giron des syndicats, c'est l'expression d'une "unité croissante" ; le retour au parlementarisme, c'est une "lutte politique" ; le retour au nationalisme devient "l'internationalisme prolétarien" et la participation à la guerre, c'est là défense d'un quelconque "pays socialiste".
Le rôle de ces organisations bourgeoises contre-révolutionnaires est clair : mais au sein du camp prolétarien, les efforts pour un regroupement international sont-ils compris par les descendants des gauches allemande et hollandaise, ces groupes qui ne sont pas le produit de la reprise de la lutte de classe aujourd'hui mais qui ont été capables de maintenir une position révolutionnaire sur des questions vitales que la lutte de classe a affronté dans le passé ? Représentent-ils la continuité organique, vivante et non rompue, avec les courants révolutionnaires produits de la vague des années 1917-23 ? En d'autres termes, défendent-ils des positions de classe et accomplissent-ils leurs taches d'organisations révolutionnaires au sein de la classe ? On ne peut pas répondre à ces questions en termes généraux. Dans les pages qui suivent, nous allons examiner le cas du Spartacusbond (SB), organisation hollandaise qui est considérée parfois comme la continuité organique de la Gauche allemande et hollandaise des années 1920, 30 et 40.
LES ORIGINES DU "SPARTACUSBOND"Lorsque le "Communistenbond ‘Spartacus’"(Ligue des communistes 'Spartacus') resurgit de l'illégalité après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de membres du GIC ([1] [67]) d'avant la guerre font partie de ce groupe qui était auparavant un groupe trotskiste. En effet, à l'origine, le “Spartacusbond” était l'une des continuations illégales du RSAP de Sneevliet (Maring) qui, dans le second massacre inter impérialiste, avait pris une position internationaliste prolétarienne cohérente en refusant de choisir un camp ou un autre, et en défendant la lutte de classe. La fraction “Spartacus” en particulier a évolué positivement vers des positions de classe et abandonné les positions trotskistes : compréhension de la nature capitaliste de l'URSS, rejet des syndicats et reconnaissance des comités d'usine comme organisation de lutte de la classe ouvrière, dénonciation du parlementarisme et insistance sur la nature politique de la lutte dans les usines. Dans cette évolution, le groupe "Spartacus" était poussé de l'avant par le GIC, qu'il avait contacté après l'arrestation et l'assassinat de Sneevliet et de 7 autres camarades en 1943. L'étude et la discussion théorique entre les ex trotskistes et les membres du GIC ont évolué si positivement qu'ils ont tous décidé de continuer en tant que "Cormnunistenbond 'Spartacus'" qui a défendu publiquement les positions de classe en Hollande après la dernière guerre mondiale.
La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas amené la révolution prolétarienne qu'ils attendaient en regard des évènements de Russie et d'Allemagne qui s'étaient produits après la Première Guerre mondiale. A la place, le capitalisme s'est engagé dans une phase de reconstruction à laquelle il a tenté d'atteler la classe ouvrière. Les "Eenheidsvakcentrale" (syndicats unis), à la création desquels les Spartacistes avaient contribué pendant les dernières années d'illégalité et qu'ils espéraient voir évoluer, à travers leur propagande pour des comités d'usine, vers un genre d"'Arbeiter Union" comme ceux de la révolution allemande, vont en fait devenir des syndicats ordinaires et pour couronner le tout, vont tomber entre les mains des staliniens. Ils ont rejoint ensuite la "Onafhankelijke Vakbond van Bedrijfsorganisaties", (Alliance Indépendante des organisations d'usine) qui, tout en n'étant pas dominée par les staliniens, est aussi devenue une sorte de syndicat sous la pression de la période de reconstruction ; après quoi les spartacistes l'ont quittée. Avec le déclin des grèves sauvages immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, le "Spartacusbond" est entré dans une périodes difficile. Beaucoup de camarades l'ont quitté et il est devenu un petit groupe tentant désespérément de lutter contre le déclin des luttes ouvrières. La diffusion des positions de classe ne trouvait pas d'audience à cause de l'absence d'un mouvement de classe. Le SB a naturellement tenté d'expliquer cette situation, mais il est peu à peu tombé dans une théorisation de la défaite. Ce processus s'est 1ui-même reflété à travers l'émergence d'une fraction conseilliste dans SB qui a commencé à publier "Daad en Gedachte" ("action et pensée") indépendamment de SB en 1965.
LE CONSEILLISME ([2] [68])
Il faut faire une distinction entre les communistes de gauche d'avant la Seconde Guerre et le conseillisme en tant que courant qui surgit pendant la période de reconstruction. Les germes du conseillisme, qui ont produit la dégénérescence ultérieure, peuvent être trouvés dans certains courants d'avant-guerre au sein des gauches allemande et hollandaise, en particulier dans le communisme de conseils de ²l’Einheidsorganisation² (organisation unitaire) d'Otto Rühle, et dans le communisme de conseils du GIC. Cependant, ces deux courants étaient encore une expression de tentatives sérieuses pour clarifier les problèmes posés par les "Arbeiter Union" (unions d'ouvriers). Nous les appelons donc communistes de conseils et non conseillistes. Bien qu'à l'époque, le rejet par Rühle de la nécessité d'une organisation politique et du parti soit déjà une erreur, on ne peut comprendre cette position que dans le contexte de la confusion qui existait aussi dans le KAPD sur la question des ²Arbeiter Union". Ce n'est que peu à peu qu'a été comprise l'impossibilité pour la classe ouvrière d'avoir désormais des organisations permanentes. Cette compréhension a été exprimée dans les conceptions du GIC. Le communisme de conseils du GIC doit donc être distingué de celui de Rühle.
D'un autre côté, le "conseillisme" se base sur des fragments du communisme de conseils du GIC et de celui d'Otto Rühle. Il ne faut pas voir le "conseillisme" comme une tentative de clarification des vrais problèmes surgis de la lutte de classe. Tout au contraire, il retourne au rejet de Rühle des organisations politiques, à une époque où le problème des organes de lutte de la classe et de leur relation avec l'organisation politique avait été clarifié par le GIC. En ce sens, le "conseillisme" néglige une leçon fondamentale tirée de la lutte des ouvriers.
Les "conseillistes" prennent bien soin de relier leurs positions à celles des révolutionnaires comme Pannekoek. "Daad en Gedachte" se réclame même comme étant la continuation du GIC en disant qu'en 1965 tous les ex membres du GIC qui étaient encore membres du SB sont devenus membres de "Daad en Gedachte² ("D en G", 1976, n°3, p.7). Mais la continuité d'un courant révolutionnaire n'est pas garantie par des personnes. Un courant révolutionnaire ne peut se maintenir que dans le cadre d'une organisation qui diffuse publiquement les positions de classe et ce n'est sûrement pas le cas de "Daad en Gedachte". Au contraire, "D en G" considère que la diffusion des positions de classe est une "pratique de partis", mot qui, dans le vocabulaire "conseilliste", se réfère aux positions social-démocrates et léninistes sur les tâches du parti. Ce qui échappe complètement aux "conseillistes", c'est le fait que depuis la fondation du KAPD en 1920, les révolutionnaires défendent la position selon laquelle les tâches du parti sont de propagande et de clarification de la conscience et que celle de mener la lutte et de prendre le pouvoir doit être accomplie par les masses en lutte et qu'elles utilisent des comités élus dans ce but. Cette conception selon laquelle la tâche urgente du parti est d'intervenir dans la lutte de classe de façon exclusivement propagandiste est une position de classe. En d'autres termes, c'est une position de classe fondamentale que le KAPD avait appris de la pratique des partis réformistes et des syndicats, et de la poursuite de son activité dans la "centrale" du KPD(S) suivant la "direction" de Moscou ([3] [69]). Otto Rühle s'est éloigné du KAPD parce que, d'après lui, il "était payé par Moscou" et suivait la ligne léniniste. Gorter, Hempel et Pannekoek au contraire ont désapprouvé la position de Rühle car ils étaient convaincus que les ouvriers qui les premiers prennent conscience commencent nécessairement par se regrouper ensemble pour étudier et discuter, puis diffusent leurs positions dans l'ensemble de la classe.
Les "conseillistes" pensent trouver un argument supplémentaire ([4] [70]) contre les tâches de propagande du parti dans le fait que les positions de classe ont leur fondement dans l'activité créatrice de la classe ouvrière, et ne sont pas des créations indépendantes de théoriciens de salon contemplant leur nombril. En réalité, les positions de classe sont le résultat de l'étude de la lutte ouvrière par la classe ouvrière. Et donc les positions de classe changent quand la lutte de classe se heurte à un nouvel obstacle et réussit à le surmonter par sa créativité. Pour cette raison, les "conseillistes" pensent qu'il vaut mieux ne pas faire de propagande pour des positions qui risquent dans le futur de s'avérer limitées. Et deuxièmement, ils pensent que cela peut amener à une tentative de voler aux ouvriers la conduite de leur lutte. Une telle opinion se base sur une vision bien trop limitée des positions de classe. Les positions de classe ne sont pas des plans détaillés sur ce que doit faire la classe ouvrière dans chaque situation donnée. Les positions de classe tendent à cristalliser les acquis de l'expérience des plus hauts moments de la lutte de classe – comme ceux de la Commune de Paris, de la révolution russe, de la révolution allemande, par exemple - ainsi que les acquis de l'expérience de la contre-révolution - comme ceux des deux guerres mondiales, par exemple. Les frontières de classe ne sont pas plus qu'une orientation générale, un large cadre où s'inscrit l'action consciente de la classe et qui ne peut être développé qu'à travers des évènements de la lutte de classe de dimension historique mondiale. La peur des "conseillistes" de voir les groupes politiques prendre la direction de la lutte ouvrière s'ils se livrent à des activités de propagande est complètement erronée. Elle est d'autant plus erronée lorsqu'on sait que depuis 1920, les révolutionnaires ont compris qu'au cours de ses luttes, la classe ouvrière produit deux organisations : l'organisation unitaire et l'organisation des révolutionnaires.
Depuis l'éclatement de la Première Guerre mondiale, le capitalisme a prouvé qu'il était entré dans sa phase de décadence et dans l'ère de la révolution. Durant la période de décadence, des améliorations graduelles des conditions de vie de la classe ouvrière au moyen du parlement et des syndicats sont devenues impossibles à cause de l'absence d'un réel développement des forces productives. Et ceci implique que la classe ouvrière ne peut plus s'unir désormais au sein d'organisations permanentes de lutte, ce qu'avaient été dans le passé les syndicats et les partis parlementaires. C'est seulement directement dans les luttes, lorsqu’elle défend ses intérêts immédiats, qu'elle peut temporairement créer des unités organisationnelles. Ces luttes directes tout comme les formes organisationnelles unitaires secrétées dans ces luttes se heurtent toujours à l'impossibilité de gagner des réformes durables dans la période de décadence du capitalisme. Ce qu'il reste alors, ce sont les expériences de la lutte de son organisation et de ses résultats. En élaborant ces expériences, dans le cadre du processus de prise de conscience des ouvriers à travers leurs luttes de la nature des rapports de production capitalistes et de leurs propres formes d'organisation, la classe se prépare à remplir ses tâches historiques : le renversement conscient du capitalisme et la fondations du pouvoir ouvrier basé sur les conseils et dans le but de réaliser la société communiste. La classe ouvrière en train de prendre conscience de sa tâche historique n'est donc pas un fantasmé idéaliste qu'on pourrait injecter dans la classe de l'extérieur. Au contraire, cette conscience est produite de l'élaboration de ses expériences par la classe ouvrière, à travers des discussions intenses autour de différents points de vue.
Afin de diffuser leurs positions le mieux possible, ceux qui ont les mêmes positions s'unissent dans les organisations politiques des révolutionnaires qui elles, sont des expressions permanentes de la lutte de classe pour autant qu'elles se fondent sur l'étude des expériences de cette lutte du point de vue de la classe ouvrière. A côte de ces organisations, existent des organisations de lutte où se développent l'unité et l'indépendance de la classe ouvrière contre le capital et qui sont des expressions temporaires des surgissements de la lutte de classe. Les conseils ouvriers deviennent permanents lorsqu'ils ont détruit l'Etat bourgeois.
RUPTURE AVEC SPARTACUSBONDComprendre la distinction entre les organes unitaires de la classe et l'organisation des révolutionnaires ainsi que leurs rapports mutuels, c'est une nécessité fondamentale pour une organisation des révolutionnaires qui veut remplir ses tâches dans la classe le mieux possible. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons parler de continuité organique et vivante avec la gauche communiste avant la guerre. "D en G" n'est pas la continuation de la gauche hollandaise - aucune équivoque n'est possible là dessus -, bien qu'il soit exagéré de dire que ce n’est qu'un groupe contre-révolutionnaire. Qu'en est-il de SB ?
Il est impossible de retracer ici toute l'histoire de SB. Nous nous bornerons à remarquer que le SB ne s’est pas libéré du "conseillisme" après le départ de la fraction "D en G". Il est vrai que c'est "D en G" qui a le plus contribué à donner des fondements théoriques au "conseillisme", l'a mis en pratique et diffusé à l'échelle internationale de la façon la plus conséquente ; cependant on trouve dans le SB des fragments du conseillisme. Nous pouvons évaluer la nature conseilliste ou communiste de SB en étudiant les thèmes traités lors de la première conférence de SB totalement dédiée à la question de l'organisation des révolutionnaires. La direction des décisions pratiques prises à cette conférence a constitué une raison suffisante pour l'auteur de cet article de quitter le SB. Les arguments développés ici ne sont pas inconnus du SB ; on peut les trouver dans les nombreux textes préparatoires à la conférence et dans les lettres envoyées au SB après la conférence.
A la dernière conférence de SB, la tendance conseilliste à voir tous les acquis historiques et politiques à travers le prisme de la défaite a pris fortement le dessus. Cette conférence dédiée à la question de l'organisation des révolutionnaires, était devenue nécessaire à cause de la manière défectueuse dont travaillait le SB. Après la parution de deux bulletins internationaux, le SB n'a plus semblé capable de réagir face aux différents groupes surgis dans le milieu révolutionnaire. Le SB fonctionnait si mal que même la discussion interne devenait impossible. La conférence aurait dû résoudre ces problèmes en développant une compréhension des tâches et de l'organisation du travail dans une organisation politique. Hélas, la conférence a montré qu'il y avait une confusion terrible dans le SB sur:
a) le regroupement international,
b) les origines dans la gauche allemande et hollandaise,
c) les tâches d'une organisation révolutionnaire,
d) le regroupement des révolutionnaires en Hollande.
a) Le regroupement international
Dans son rapport de la conférence des 25 et 26 septembre, le SB justifie son refus d'élaborer une plate-forme de la façon suivante :
"Dans une plate-forme (thèses), on est obligé de transcrire ses opinions en termes très généraux, parce qu'on doit dire beaucoup de choses en très peu de mots. Donc, en pratique, une plate-forme ne peut être comprise que par d'autres groupes. Elle ne peut être utile que dans ce genre de communications. Spartacus est différent : nous ne sommes pas intéressés en premier lieu par les autres groupes...
Ceux qui cherchent la forme parti avec d'autres groupes, internationalement, ont besoin d'une plate-forme, d'une déclaration élaborée, pour décider s'ils peuvent coopérer et avec qui" (Spartacus, nov. 1976).
A la conférence, l'argument était qu'une plate-forme n'est utile que pour établir des contacts avec d'autres groupes. Nous devons en conclure que le SB pense être la seule organisation révolutionnaire au monde, ou bien que les contacts avec d'autres organisations révolutionnaires n'ont aucune importance. L'isolationnisme de SB n'est évidemment pas un acquis de la gauche hollandaise, comme le montrent les faits suivants :
- Quand, en 1908, Gorter et Pannekoek ont quitté le parti social-démocrate hollandais pour fonder un nouveau parti social-démocrate vraiment marxiste, ils ont tout fait pour rester organisés dans la IIe Internationale. Pendant la même période, Pannekœk participait aussi activement à l'aile gauche du parti social-démocrate allemand.
- Lors du premier massacre impérialiste, Gorter, en particulier, a participé aux efforts de regroupement des gauches à Zimmerwald. qui ont abouti à la fondation de la IIIe Internationale. Pendant la révolution allemande, Pannekoek et Gorter se sont engagés avec passion dans les débats au sein du KPD(S) et du KAPD. Gorter fit un voyage à Moscou pour défendre les positions au Comité Exécutif de la Troisième Internationale. Après le Troisième Congrès du Comintern et que les efforts pour former une opposition eurent échoué, Gorter est devenu l'un des fondateurs du KAI (Kommunistische Arbeiter International ou Internationale Communiste Ouvrière).
- Après les scissions dans le KAPD et dans l'"Union", Canne Meijer et Hempel ont activement contribué au travail de regroupement des révolutionnaires allemands dans le KAU (Kommunistische Arbeiter Union ou Union Communiste Ouvrière).
- Dans le GIC, Canne Meijer, Hempel et Pannekoek ont tiré les leçons des révolutions russe et allemande, tout en gardant un contact permanent avec des camarades en Allemagne, en France, aux Etats-Unis et en Belgique.
- Après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les membres du GIC sortis de l'illégalité ont formé une partie du SB, le SB ne se tenait pas alors à l'écart des discussions internationales. Il avait des contacts en Allemagne, en France et en Belgique. A cette époque, le SB était aussi en contact avec les précurseurs du CCI.
Ces faits montrent clairement qu'il n'y aurait pas eu de Gauche hollandaise si elle ne s'était pas développée dans le cadre de la discussion internationale, au sein des 2e et 3e Internationales, et dans le cadre de contacts internationaux après la dégénérescence de la 3e. Ni la classe ouvrière, ni ses luttes ne s'arrêtent aux frontières nationales. Au contraire, la classe ouvrière constitue une unité qui dépasse les différentes nations ; elle est contrainte à cette unité dans ses luttes parce que le capitalisme qui l'a engendrée et qui est l'objet de sa lutte est organisé internationalement et en marché mondial. Deux guerres mondiales et deux vagues de lutte ouvrière internationale - celle de 1911-20 et celle qui débute aujourd'hui - l'ont prouvé. La nature internationale de la lutte ouvrière signifie aussi que les différentes organisations de révolutionnaires ne peuvent pas s'enfermer derrière les frontières nationales, et donc étudier et discuter la lutte de classe dans ce cadre limité, mais qu'elles doivent au contraire jeter les bases d'un regroupement international.
Malheureusement, c'est typique de l"'isolationnisme" du SB de ne pas avoir invité d'autres groupes à sa Conférence "pour éviter que la discussion ne s'axe trop sur les positions des différents groupes" (Spartacus, Novembre 76). Avant la Conférence, ce qui motivait le refus d'inviter d'autres groupes, c'était que le travail de la Conférence était la base et la pré-condition pour permettre ultérieurement la discussion systématique des positions des différents groupes, Mais lorsqu'à la Conférence s'est exprimée la "position très déviationniste" (Spartacus, nov. 76) qui proposait de traduire les plate-formes de différents groupes étrangers (par exemple, celles de la CWO, du PIC, du RWG, d'Arbetarmakt, dans la mesure où elles n'étaient pas traduites comme l'est celle du CCI) pour pouvoir les étudier et les évaluer, cette proposition fut rejetée. Aussi pouvons-nous craindre que dans les prochaines Conférences du SB, il n'y ait pas non plus d'autres groupes présents. Ce choix d'isolement face au resurgissement de la lutte ouvrière à l'échelle mondiale et aux questions qu'elle fera naître, entraînera inévitablement le SB à une position de plus en plus dogmatique. La progression de la nouvelle vague révolutionnaire l'abandonnera sur la berge, dans le camp bourgeois.
b) Les origines du SB dans les Gauches allemande et hollandaise.
Le SB ne s'est pas borné à refuser d'étudier les plates-formes des groupes existants aujourd'hui ; il a aussi refusé de se pencher sur les programmes des organisations dont il vient : le KPD (S), le KAPD, le KAPN (KAP hollandais), le GIC, et même sur son propre programme de 1945. Son argument était : "Mais tout cela n'est que de la vieille histoire. Maintenant, nous vivons dans une autre époque". Mais le fait est que presque tout ce que le SB met en avant, ce sont des fragments de théories délibérément sorties du contexte de la théorie globale des Gauches allemande et hollandaise. Refuser de l'admettre, n'est pas seulement terriblement arrogant, mais c'est aussi dangereux. C'est justement à cause de cette tendance dans le SB à mettre en avant (de manière superficielle et non critique) tantôt un élément, tantôt un autre des positions de Rosa Luxembourg, Anton Pannekoek, Herman Gorter, Henk Canne Meijer ou Hempel que le SB risque de tomber dans des positions dogmatiques qu'il redoute tellement. Le seul moyen de retrouver les positions de classe et de voir comment elles doivent éventuellement être développées ou changées en conséquence de changements radicaux dans la lutte de la classe, c'est d'étudier les positions fondamentales de la Gauche allemande et hollandaise dans le contexte des circonstances qui les ont fait surgir, et en tenant compte de ce qui nous sépare dans la période actuelle, des communistes d'avant-guerre. Car en en premier lieu, le SB ne connaît pas la globalité des positions de la Gauche allemande et hollandaise. Deuxièmement, le SB n'a jamais entendu parler des positions de la Gauche italienne par exemple. Troisièmement, le SB n'a pas la moindre idée de ce que veut dire "frontière de classe", ce qui l'amène à conclure superficiellement qu'une position "en dehors de son époque" peut être dangereuse ou même contre-révolutionnaire.
L'étude critique des positions de la Gauche allemande et hollandaise ainsi que des organisations existantes aujourd'hui auraient pu pousser le SB à adopter une plate-forme. Dans la façon même dont il rejette l'idée d'une plate-forme, il montre sa tendance à utiliser de façon superficielle des fragments de théorie :
"Notre tâche consiste à rendre nos positions claires aux gens, aux individus qui luttent. En d'autres termes, nous essayons de propager nos positions de classe ; nous tentons de propager la lutte de classe. Avec une plate-forme, on court le risque de se baser trop sur le passé pour juger l'évolution présente, on risque de devenir conservateur" (Spartacus, nov.76, souligné par nous).
Ceci n'est pas une contribution nouvelle du SB. Non, c'est en fait un fragment de théorie tiré de Rosa Luxembourg comme le montre la citation suivante :
"Dans ses grandes lignes, la tactique de lutte de la social-démocratie n'est, en général, pas à "inventer" ; elle est le résultat d'une série ininterrompue de grands actes créateurs de la lutte de classe souvent spontanée, qui cherche son chemin. L'inconscient précède le conscient et la logique du processus historique objectif précède la logique de ses protagonistes. Le rôle des organes directeurs du Parti revêt dans une large mesure un caractère conservateur : comme le démontre l'expérience, chaque fois que le mouvement ouvrier conquiert un terrain nouveau, ces organes le labourent jusqu'à ses limites les plus extrêmes ; mais le transforment en même temps en un bastion contre des progrès ultérieurs de plus vaste envergure".
(Rosa Luxembourg, "Centralisme et démocratie")
Mais chez Rosa Luxembourg, cette conception n'était pas un motif pour s'opposer à l'existence d'un programme du parti. Quelques lignes plus loin, elle écrit :
"Ce qui importe toujours pour la social-démocratie, c'est évidemment, non point la préparation d'une ordonnance toute prête pour la tactique future, ce qui importe, c'est de maintenir l'appréciation historique correcte des formes de lutte correspondant à chaque moment donné, la compréhension vivante de la relativité de la phase donnée de la lutte et de l'inéluctabilité de l'aggravation des tensions révolutionnaires sous l'angle du but final de la lutte de classe".
(Ibid. )
Rosa Luxembourg donne une excellente définition des origines et de la fonction des positions de classe contenues dans la plate-forme ou le programme de toute organisation révolutionnaire. En fait, défendre les positions de classe n'a rien à voir avec "s'efforcer d'être les 'chefs'" des luttes de la classe ouvrière, ni (ce qui en serait le résultat) avec freiner "les expériences souvent spontanées de la lutte de classe".
Le texte de Rosa Luxembourg cité ci-dessus a été écrit dans une période où la décadence du capitalisme n'avait pas commencé et où la classe ouvrière pouvait encore forcer le système à céder des réformes au moyen du parlement et des syndicats. A cette époque, les révolutionnaires militaient dans les organisations social-démocrates parce qu’elles étaient des organisations prolétariennes permanentes de lutte et de propagande. Le programme sur lequel s'est fondé le KAPD en 1920 rendait compte de la période de décadence du capitalisme qui avait commencé en 1914, ce qui s'exprimait dans ce programme par l'inadéquation du parlement et des syndicats comme moyens de lutte du prolétariat et par la distinction entre les organisations unitaires et l'organisation des révolutionnaires. Cette distinction est la continuation de l'approfondissement théorique commencé par Rosa Luxembourg dans son opposition au sein de la social-démocratie. Cette évolution n'est pas du tout le résultat de la recherche d'"intellectuels en chambre", mais vient d'une élaboration profonde des développements de la lutte de classe jusqu'à 1920, qui ont marqué une distinction entre les organisations de lutte et les organisations de révolutionnaires dans la réalité de la lutte de classe. La Première Guerre mondiale et la vague révolutionnaire de 1917-20 ont fait changer les frontières de classe et le programme du KAPD en témoigne. Quand le SB suggère maintenant que les frontières de classe décrites par le KAPD ont changé parce que c'est de "la vieille histoire", il a la responsabilité de démontrer les faits historiques qui le prouvent. C'est notre conviction que, de façon générale, ces faits n'existent pas. Mais le SB a de très bonnes raisons de refuser d’étudier les plates-formes et programme du KAPD et de leur continuation dans la Gauche hollandaise : pour le moment, le SB continue d'exister grâce à son refus conseilliste et activiste de remplir ses tâches en tant qu'organisation des révolutionnaires. Les "conseillistes", les plus vieux militants dans le SB, n'essaient plus de mettre en avant les positions de classe après leur expérience décevante pendant la période de reconstruction maintenant terminée. Les activistes, les plus jeunes du SB, ont peur de perdre dans une organisation de révolutionnaires agissante la sécurité des limites localistes de leur "lieu de travail", de leur "quartier" et de leur niveau théorique : celui du bavardage avec l'ouvrier!
c) Les tâches de l'organisation des révolutionnaires.
Pendant la Conférence, le SB n'a pas pu nier la distinction entre l'organisation des révolutionnaires et les organisations unitaires. Mais il ne l'a fait qu'après de très grands efforts et malgré des "objections" du genre de celle que l'on peut trouver dans le rapport de la Conférence que le SB a publié :
"Mais la conception selon laquelle l'organisation politique est si schématiquement distincte des organisations unitaires qu'elles en arrivent dans la pratique à être même séparées ne colle pas à la réalité. D'abord, il n'arrive pratiquement jamais que dans une lutte ou une action, seuls des intérêts indirects et immédiats soient en cause. C'est précisément dans la lutte concrète que se développent des intérêts et des idées qui transcendent l’aspect immédiat, local et matériel de la lutte. C'est justement là que réside la base de toute évo1ution politique future. Et, en second lieu, dans beaucoup de mouvements, il n'y a pas d'unité de classe, et ce qui domine est la coopération des intérêts concernés (par exemple, les actions dans les quartiers ouvriers). Il doit y avoir une évolution de la part des organisations unitaires et des groupes d'action vers l'étude et l'approfondissement de questions plus générales : une évolution de la pratique vers l'étude de la pratique. Bien entendu, le groupe politique est distinct des groupes d'action, comités de grève, etc. Parce que le groupe politique a la tâche spécifique de remettre les expériences acquises au cours des luttes dans une perspective plus vaste".
(Spartacus, novembre 76).
Ce que dit le SB ici est très correct. Mais ce n'est pas du tout un argument contre la nécessité pour les révolutionnaires de s'organiser sur la base d'une plate-forme politique. Ce n'est pas parce que la conscience se développe dans la lutte, à partir de l'expérience que l'on peut en conclure, que c'est un processus automatique et simultané. C'est pour cela que les éléments qui prennent conscience d'abord se regroupent pour mieux développer et diffuser leurs positions. Le SB semble confirmer cela quand il dit :
"Une plate-forme consiste il rédiger les positions sous forme de thèses. Positions sur l'histoire de la lutte de classe, sur les expériences présentes et internationales, sur le capitalisme et les perspectives futures. Tout le monde a été d'accord sur le fait qu'un groupe politique comme le SB devrait s'attaquer à cette tâche. Il y a eu une longue discussion à ce sujet et aussi beaucoup de confusion, mais dans ce rapport on ne peut qu'être bref ; tout le monde a été d'accord et est toujours d'accord".
(Spartacus, novembre 76)
Mais quelle était la divergence à la Conférence ? D'après le SB :
"La divergence était sur la nécessité (ou non) de rédiger les positions sous la forme de thèses et sur l'accent à mettre sur l'étude de points particuliers". (Spartacus, nov.76).
Bien sûr, la divergence n'était pas sur la forme de thèses, d'essai ou de poème... ou bien de déclaration de principes. La divergence était et est sur le contenu d'une plate-forme, d'une déclaration de principes, quel que soit le mot qu'on emploie. C'est ce que montrent les lignes suivantes :
"Si nous voulons accomplir nos tâches, c'est-à-dire diffuser la vision qui résulte de l'étude, alors nous avons besoin d'une discussion permanente. L'évolution de nombreux groupes a montré en pratique qu'une plate-forme (avec toutes ses conséquences : ligne générale nationale à laquelle les sections doivent obéir, mois de discussion sur la formulation des objectifs, mode de fonctionnement, etc.) ne peut qu'empêcher cette confrontation permanente avec la réalité".
(Spartacus, Nov. 76)
Par "réalité", le SB veut dire la "pratique quotidienne" de l'activiste qui a choisi un certain "champ d'action", c'est-à-dire la lutte partielle et qui ne veut rien entendre des sujets qui, selon lui, n'ont rien à voir avec ça. S'il a choisi un quartier ouvrier, il ne veut pas entendre parler de luttes salariales, pas plus que des luttes de Soweto, de Vitoria, de Gdansk et encore moins des positions de classe élaborées dans les hauts moments de la lutte de classe.
Les activistes sont caractérisés par leur refus de fait de l'organisation des révolutionnaires qu'ils identifient à tort avec le parti léniniste. L'organisation politique est superflue, pensent les activistes, car ils estiment que les positions politiques doivent être directement applicables dans leur "champ d'action". Les positions qui sont les produits des grands moments de la lutte de classe, ou de la lutte de classe dans les autres pays sont considérées comme "théoriques" et "inapplicables". Donc l'activisme est une tendance ahistorique, localiste, qui se restreint principalement à des luttes partielles. Au mieux, l'activisme peut être le reflet d'une lutte ouvrière limitée. L'activisme ne peut jamais aider à dépasser ces limites. Au contraire, il se fait l'apôtre des limitations de la lutte partielle qu'il présente à la classe comme exemplaire. Alors que la classe ouvrière dans son ensemble est toujours obligée d'élargir sa lutte à tous les aspects de la vie et à une partie toujours plus grande de la classe pour pouvoir faire la révolution prolétarienne, alors que dans ce processus, elle rencontre le même type de problèmes qu'elle a dû dépasser dans les révolutions précédentes, les activistes continuent à rejeter les expériences des grands moments révolutionnaires du passé qui ont été élaborées et formulées dans les positions du mouvement ouvrier. Tout comme Lénine, les activistes considèrent ces conceptions théoriques comme quelque chose qui aliène tout simplement la classe ouvrière qui, selon eux, ne lutte que sur la base d'intérêts limités (ce il quoi Lénine ajoute qu'elle ne peut jamais dépasser ce stade sans l'aide de l'intelligentsia). A la différence des léninistes, les activistes en concluent que "L'organisation politique est superflue". En agissant ainsi, ils se retrouvent en compagnie des conseillistes qui ne croient plus à la diffusion des positions de classe parce qu'ils se sont fatigués à lutter contre le reflux du mouvement de la classe pendant les années de la contre-révolution.
Léninistes, activistes et conseillistes sont tous d'accord, malgré leurs autres divergences, pour nier que les positions de classe ont leur origine dans la lutte historique de la classe ouvrière. De là vient leur rejet de l'intervention exclusivement de propagande dans la classe ouvrière par l'organisation des révolutionnaires.
Après tout, l'intervention de propagande dans la classe ne semble complètement naturelle et nécessaire que si l'on pense que les positions sont élaborées à partir des expériences de la classe elle-même et que la propagande est une contribution à l'élaboration de ces expériences au sein de la classe, une contribution à la discussion dans la classe ouvrière.
On trouve une bonne illustration de la tendance du SB à considérer les positions de classe comme le produit de théoriciens "qui contemplent leur nombril" dans les notes marginales du Spartacus d'octobre 76 traitant des luttes ouvrières en Pologne durant l'hiver 1970-71 et l'été 1976. Sur l'auteur de l'édition polonaise, le SB remarque :
"Il est... lui-même prisonnier des conceptions partidaires, conceptions qui néanmoins doivent être distinguées de celles qui correspondent aux théories de capitalisme d'Etat dans lesquelles le Parti "dirige" et "utilise" la classe ouvrière, parti qui doit prendre le pouvoir d'Etat. Cependant l'auteur a la conception d'un parti qui met en avant le but de la lutte, la conquête du pouvoir par les travailleurs et qui stimule toujours les ouvriers à se préparer dans chaque aspect de la lutte pour ce but final. Nous avons l'impression qu'avec ces conceptions, il ne voit pas le fait, immensément important, que la classe ouvrière ne permet pas aux idéaux sociaux de guider sa lutte, mais que la classe ouvrière est inspirée par la réalité sociale qu'elle vit."
(Spartacus, déc. 76)
Comme si le but final de la lutte : la conquête du pouvoir par les travailleurs, était une "invention" du parti ! Même dans les premières années du socialisme scientifique, la conquête du pouvoir par les travailleurs n'était pas le produit d'une pensée abstraite, mais la conclusion de la recherche matérialiste historique de l'essence et du développement du capitalisme. Et, en plus, depuis la révolution russe, la conquête du pouvoir par les travailleurs est un fait d'expérience. Pour les ouvriers de Szczecin durant l'hiver 1970-71, le pouvoir des travailleurs n'était pas un fait inconnu ; dans les faits, ils ont eu le pouvoir entre leurs mains, dans la ville, pendant quelque temps ! Ce pouvoir leur a été arraché par l'arrivée de Gierek dans les chantiers navals. La discussion entre les conseils ouvriers de Szczecin et Gierek et entre les travailleurs eux-mêmes (reproduite dans "Spartacus", oct.76) était centrée sur la question "maintenir le pouvoir des travailleurs ou le laisser à Gierek en échange de la satisfaction des "revendications". A cet égard, la Pologne est un test pour évaluer la position du SB dans une situation révolutionnaire :
"Donc, c'est notre opinion que les ouvriers de Szczecin et de quelques autres villes de Pologne n'étaient pas capables de renverser les Etats capitalistes de l'Est. Ceci n'est pas plus surprenant que la défaite finale des révoltés en Allemagne de l'Est en 1953 et celle des ouvriers hongrois de 1956. Dans un tel isolement les possibilités étaient trop restreintes pour rendre possible la conquête complète du pouvoir par ces travailleurs."
(Spartacus, décembre 76)
d)Le regroupement des révolutionnaires en Hollande
En plein éveil de la lutte de classe révolutionnaire, après 50 ans de contre-révolution, la tendance "conseilliste" du SB à voir tous les événements avec les yeux de la défaite, devient une propagande ouvertement défaitiste. Les récentes luttes ouvrières en Pologne ne sont pas un phénomène isolé derrière le rideau de fer mais font partie de la lutte de classe internationale depuis la deuxième moitié des années 60 : France 1968, Italie et Allemagne 1969, Pays-Bas 1970, Pologne 1970-71, Angleterre 1972, Belgique 1973, Portugal 1974-75, Espagne et de nouveau Pologne 1976, sans mentionner les autres parties du monde.
C'est toujours le devoir des révolutionnaires de diffuser les positions de classe. Dans le passé, ceci était aussi l'opinion du SB :
"C'est seulement quand le troisième groupe d'opposition a quitté les rangs du SB qu'il est devenu clair que la seconde et aussi la troisième scissions avaient vraiment des divergences de principe. Le réel désaccord portait sur la position du SB dans le mouvement ouvrier actuel, dans une période où selon ceux qui ont scissionné il n'y aurait pas de mouvements de masse révolutionnaires, ou, s'il y en avait, ceux-ci ne prendraient pas un caractère révolutionnaire. Le point de vue de ces anciens camarades, c'était que, tout en poursuivant la propagande pour "la production dans les mains des organisations d'usine", "tout le pouvoir aux conseils ouvriers" et "pour une production communiste sur la base d'un calcul des prix en fonction du temps de travail moyen" ([5] [71]), le SB n'avait pas à intervenir dans la lutte des ouvriers telle qu'elle se présente aujourd'hui. La propagande du SB doit être pure dans ses principes et si les masses ne sont pas intéressées aujourd’hui, cela changera quand les mouvements de masse redeviendront révolutionnaires."
("Vit Engenkring" end 47)
C'est le résumé des raisons politiques des deux groupes d'opposition qui ont quitté le SB par ceux qui restaient. La crainte du second et du troisième groupes de l'opposition selon laquelle le SB se "diluerait" quand la lutte des travailleurs reprendrait un caractère révolutionnaire est devenue vraie. Dans une période où la lutte révolutionnaire renaît, c'est devenu une nécessité absolue de défendre les acquis historiques de la classe ouvrière, les positions de classe, avec la plus grande clarté. Le SB en est incapable. Une organisation de révolutionnaires qui n'est pas basée sur la discussion permanente de tous ses membres sur les positions fondamentales rassemblées dans une plate-forme, périra, parce qu'une telle organisation
- n'est pas capable de diffuser au maximum ses positions (qui n'ont pas encore été définies) au sein de la classe qui les a produites dans son expérience même ;
- n'a pas de critères d'appartenance pour ses membres et doit donc, soit s'isoler de nouveaux membres potentiels et mourir, soit ouvrir la porte à toutes sortes de positions ;
- ne peut se distinguer elle-même d'organisations "concurrentes" et devient donc un porteur de confusion au lieu de clarification.
CONCLUSIONLe refus du SB d’engager une discussion dans le but d'écrire une plate-forme aboutit essentiellement au refus de se soumettre à une cure de rajeunissement contre les trois "maladies" de vieillesse exposées plus haut. Le SB existe depuis trente-sept ans mais ceci ne suffit pas à en faire la continuation de la Gauche Hollandaise. C'est surtout par ses positions confuses sur la question de l'organisation des révolutionnaires et de ses tâches que le SB montre qu'il y a eu une véritable rupture dans la continuité avec les communistes d'avant-guerre. Avec les positions qu'a adoptées SB à sa dernière conférence, il serait difficile de le considérer apte à remplir efficacement la fonction de pôle de regroupement des révolutionnaires en Hollande. Et ceci à l'heure où l'évolution de la crise et de la lutte ouvrière exigent plus que jamais un tel regroupement.
Contrairement à la période antérieure, quand la gauche hollandaise était active, la Hollande est aujourd'hui un pays hautement industrialisé avec une classe ouvrière développée. Mais ceci ne doit pas inciter à croire que la constitution d'une organisation des révolutionnaires en Hollande peut être conçue dans le seul cadre national. La bourgeoisie hollandaise, surtout depuis la période de reconstruction, est étroitement liée à l'économie allemande et peut donc s'appuyer sur la position relativement forte de cette dernière ainsi que sur ses propres réserves de gaz naturel pour essayer d'alléger le poids du chômage par un développement des mesures sociales et des subventions étatiques visant à stimuler l'industrie. A cause de ce rythme lent du développement de la crise en Hollande jusqu'à ces derniers temps, la lutte ouvrière a pu être cantonnée et détournée vers des revendications telles que le nivellement des salaires et des nationalisations. Les révolutionnaires savent que les nationalisations et les nivellements des salaires peuvent ralentir la crise pendant un temps mais que, tel un boomerang, celle-ci reviendra inéluctablement. Récemment, la crise a commencé à frapper plus durement et le gouvernement de coalition social-démocrate chrétien est revenu sur certaines mesures sociales ; et la politique de l'échelle mobile des salaires est très menacée par l'inflation. Lentement la classe ouvrière hollandaise commence à se libérer du carcan syndical :.en 1976 on a pu voir des grèves sauvages dans les ports et dans la construction, deux secteurs traditionnellement combatifs de la classe ouvrière. Le PC, les trotskistes, les maoïstes se sont efforcés de jouer leur rôle de caution de gauche de la social-démocratie. Ils se sont employés à ramener les ouvriers dans les syndicats officiels ou dans les mini-syndicats style maoïste. Leur défense du parlementarisme, des nationalisations et de "l'indépendance nationale" est une caricature bourgeoise de la lutte politique.
Etant donné ce développement, bien qu'encore faible, des luttes ouvrières dans le pays, la tâche des révolutionnaires est de rendre les ouvriers conscients d'une part des luttes menées par leurs frères de classe dans d'autres pays frappés plus tôt et plus durement par la crise et, d'autre part, de la perspective historique de ces luttes. Ceci veut dire que la formation d'une organisation des révolutionnaires en
Hollande doit se situer dans une vision et donc dans un cadre international. Par conséquent, l'activité du CCI et surtout de sa section en Belgique par rapport à la Hollande doit être applaudie par les révolutionnaires.
La décision du SB de ne pas entamer une discussion sur une plate-forme n'est pas forcément définitive. Toutes les questions abordées à la dernière conférence reviendront quand le SB essaiera de formuler une "déclaration de principes". Si cette discussion se situe dans un cadre international de confrontation des idées sur les positions de la gauche communiste pendant la période d'avant-guerre et sur les positions des groupes révolutionnaires aujourd'hui, elle sera une contribution vers la création d'un pôle de regroupement des révolutionnaires en Hollande. En plus, le SB pourrait faire une contribution internationale importante en aidant les groupes révolutionnaires qui ont surgi ces dernières années à se réapproprier de façon critique les acquis de la gauche hollandaise. Parce que le SB n'a jamais été et n'est pas aujourd'hui seul au monde.
Fred Kraai
[1] [72] GIC : "Groep(en) van Internationale Communisten" (Groupe(s) de communistes Internationalistes) ; peut être considéré comme la continuation du KAP hollandais.
[2] [73] Nous ne donnons ici un examen critique des positions conseillistes que sur la question d'organisation. On trouvera davantage sur cette question et les positions conseillistes à propos de la révolution russe et des luttes de "libération nationale" dans la Revue Internationale n°2 ("Les épigones du conseillisme").
[3] [74] Le "Kommunistische Arbeiter Partei Deutschlands" (KAPD) a été formé par la majorité du "Kommunistische Partei Deutschlands (Spartakusbund)" qui est sortie de ce parti sur la base de positions conséquentes contre le parlementarisme et contre les syndicats.
[4] [75] Cet argument tiré de la théorie de la connaissance est ainsi formulé par "D en G" : "Dans tout acte spécifique, la pensée précède l'action. Dans l'action des classes et des masses cependant, la signification de l'acte vient ensuite. Là l'action précède la compréhension". Pour le lecteur intéressé par la comparaison avec la position de Pannekoek, il y a un passage dans "Les Conseils Ouvriers" qui s'appelle, et non entièrement par hasard, "Pensée et Action". Nous nous contenterons de la citation suivante :
"C'est seulement lorsque chez les ouvriers -vaguement au début - est présente la compréhension qu'ils ont tout à faire eux-mêmes et que c'est eux qui doivent créer l'organisation du travail dans les usines, que leur action sera le point de départ d'un nouveau et puissant développement.
Eveiller cette compréhension, c'est la tâche la plus importante de notre propagande qui commence avec des individus et des petits groupes pour qui, les premiers, cette compréhension devient claire. Aussi difficile que ce soit au départ, aussi fructueux ce sera car c'est exactement dans la ligne des propres expériences vivantes du prolétariat. Alors, cette idée gagnera les masses comme une flamme et guidera leurs premiers actes. Mais là où quelles que soient les circonstances d'arriération politique et économique qui le causent, cette compréhension manque, l'évolution aura à passer par des hauts et des bas encore plus durs." (Pannekoek)
[5] [76] Cette position du GIC était développée par Hempel quand il a été prisonnier politique ; il a tenté de tirer les leçons des révolutions russe et allemande et de ses propres expériences, aussi bien en ce qui concerne sa participation aux luttes des ouvriers des chantiers navals à Hambourg que ses visites aux Soviets dans les environs de Moscou à l'occasion du 3eme Congrès du Komintern. Le GIC a élaboré les idées de Hempel dans les "Principes de Base de la Production et Distribution Communistes" (en allemand et hollandais) qui constitue une contribution importante sur les aspect économiques de la période de transition.
Géographique:
- Hollande [77]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [21]
Correspondance avec Combate (Portugal)
- 2517 reads
Nous publions ci-dessous une lettre du groupe "COMBATE" du Portugal. Quelques explications s'imposent pour la comprendre et dissiper les malentendus qui se sont produits dans les relations que nous avions avec ce groupe.
Dans l'énorme confusion dans laquelle se déroulaient les événements au Portugal après la chute du régime de Salazar-Caetano, "Combate" paraissait être l'unique groupe se situant sur un terrain de classe. Pour cette raison nous avons toujours cherché à établir et à maintenir les contacts avec ce groupe - en nous rendant sur place, en invitant des camarades responsables de passage à Paris à venir débattre avec nous les problèmes touchant la lutte du prolétariat au Portugal et également, comme cela doit être naturel entre groupes révolutionnaires, en portant les débats et les critiques dans nos publications.
Nos divergences avec "Combate" sont certes de taille. Ce n'est pas là une raison pour les passer sous silence ou se contenter simplement d'échanger "des informations", mais, au contraire, c'est un devoir de tout groupe révolutionnaire de confronter et de discuter ouvertement les divergences. C'est une condition pour parvenir à les clarifier et, éventuellement, à les dépasser.
C'est dans ces dispositions et alors qu'un camarade responsable de "Combate" se trouvait parmi nous que nous avons eu l’ahurissante surprise de recevoir la lettre de "Combate" du 9 septembre, nous informant laconiquement de la décision de suspendre la vente des publications du C.C.I. dans les librairies de "Combate". Notre réponse publiée dans le dernier numéro de la Revue Internationale (n°8) est une protestation véhémente contre une telle décision que nous qualifiions à juste titre d"'aberrante". Nous demandions dans cette lettre des explications, et que "Combate" revînt sur sa décision.
Nous sommes satisfaits de recevoir aujourd'hui les explications et la rectification qui s'imposaient et laissons volontiers de côté les remarques ironiques qui les accompagnent. Les rapports sains qui doivent exister entre les groupes militants de la classe sont pour nous un problème extrêmement grave et dépasse de loin les ironies faciles. En toute occasion nous entendons rester vigilants et fermement décidés à les défendre afin d'extirper les mœurs perverties introduites depuis des décennies par le stalinisme dans la vie de la classe.
Nous retenons la suggestion de republier des pages de "Combate" sur les luttes concrètes. Nous devons cependant faire remarquer que nous divergeons notablement avec "Combate" sur ce que doit être la tâche de la presse révolutionnaire. Alors que pour "Combate" la presse est essentiellement un instrument d'information et de description, elle est pour nous un instrument d'intervention et d'orientation politique.
La question n'est pas une différence entre ouvriers en lutte et "professeurs", mais entre immédiatistes qui se contentent d"'informer" et groupes politiques qui disent leur nom et qui, au sein de la classe et dans ses luttes, défendent une orientation révolutionnaire.
Aussi, souhaitons-nous voir "Combate" défendre plus nettement dans ses colonnes une orientation en la confrontant franchement aux positions d'autres courants politiques.
CONTRA-A-CORRENTE
Lisbonne, le 5 janvier I977
Edicoes - Livraria, "Mons mus parturiens"
Chers camarades,
Vos interprétations sont remarquables et leur lecture est un plaisir, mais les faits sont, hélas, bien plus banals et prosaïques. Il vaut donc toujours mieux s'en assurer avant de brandir le glaive vengeur.
Les faits : un camarade qui a mal compris une décision d'une réunion ; d'autres camarades qui ne lisent pas les lettres une fois écrites. La décision : la librairie de Porto a décidé de ne plus assurer la diffusion de vos publications auprès des librairies de Porto, Lisbonne et Coimbra, en raison des difficultés commerciales. Cela n'a rien à voir avec la vente de vos publications dans nos librairies. D'ailleurs, la librairie de Lisbonne a toujours étalagé vos publications et continuera de le faire.
Nous vous remercions de votre bienveillance en ayant déjà par deux fois jugées les idées de Combate suffisamment dignes d'intérêt pour figurer en tant qu'objet de critique dans les pages de vos publications. Nous tenons pourtant à vous signaler que dans les pages de Combate, vous trouverez maintes informations directement élaborées par des ouvriers sur les luttes concrètes - banales certes, mais qui constituent le petit monde dans lequel la classe ouvrière vit en attendant que les professeurs changent la société. Peut-être quelques-uns de vos lecteurs auraient-ils intérêt à les voir figurer sur vos pages ?
Sa1utations révolutionnaires
Le collectif de Combate
Géographique:
- Portugal [39]
Courants politiques:
Revue Internationale no 10 - 3e trimestre 1977
- 2852 reads
Textes de la Gauche Mexicaine (1937-38)
- 3105 reads
Présentation
- La guerre d'Espagne de 1936-39 devait être une épreuve décisive pour les groupes de gauche issus de la 3ème Internationale passée définitivement dans le camp de la bourgeoisie. Commencée comme une riposte foudroyante et spontanée des masses ouvrières contre le soulèvement de 1'Etat-major de l'armée sous la conduite de Franco, cette riposte de classe s'est vue rapidement déviée et dévoyée de son terrain de classe, avec l'aide de la "gauche", des partis socialiste et stalinien et aussi des anarchistes de la FAI et des syndicalistes de la CNT, pour se transformer en une guerre capitaliste.
Que les partis socialistes et staliniens exaltent la campagne pour la guerre et prennent leur place à la tête de celles-ci n'a rien de surprenant. Passés depuis longtemps dans le camp du capitalisme, ces partis "ouvriers" ne font qu'accomplir leur tâche ; la guerre n'étant rien d'autre que la continuation de la politique de défense des intérêts du capital national sous une autre forme. Par leur passé "ouvrier" et "socialiste", ces partis sont aussi les mieux placés parmi les forces politiques de la bourgeoisie pour mystifier la classe ouvrière, la détourner de sa lutte et l'embrigader dans le massacre impérialiste.
Concernant ces grands partis de la gauche, leur prise de position en faveur de la guerre et leur participation à sa direction est donc tout à fait dans l'ordre des choses. C'est le contraire qui aurait pu être une surprise incompréhensible. Mais comment comprendre que des courants comme les anarcho-syndicalistes, la CNT, ou celui des trotskystes et, derrière eux, la grande majorité des groupes de gauche, ont pu tomber et être pris dans le tourbillon de la guerre ? Les Uns allaient jusqu'à participer dans le gouvernement de défense nationale (Républicain) comme la CNT et le POUM ; les autres, quoique s'opposant à la participation gouvernementale (les trotskystes), ne prêchaient pas moins la participation à la guerre au nom d'un front unique antifasciste aussi large que possible. D'autres, plus radicaux, marchaient dans la guerre au nom de la résistance antifasciste OUVRIERE ; d'autres encore, au nom de l'ennemi n°l à abattre (Franco) sur le front de la guerre, pour mieux pouvoir faire ensuite, après la victoire (? !), la lutte de classe ouvrière. Il y en eut même pour considérer que l'Etat dans la zone républicaine avait complètement disparu ou qu'il n'était plus qu'une simple façade ayant perdu toute signification.
Dans leur immense majorité, ces groupes de gauche qui avaient, durant des années, trouvé la force et leur raison d'être dans la résistance à la dégénérescence des PC et de l'internationale Communiste, ces groupes qui combattaient sans merci le stalinisme au nom de l'Internationalisme prolétarien, se sont cependant laissés happer dans l'engrenage de la guerre par les évènements d'Espagne. Ce fut souvent à contrecoeur il est vrai, émettant beaucoup de critiques et pas mal de réserves, s'accrochant à toutes sortes de justifications fallacieuses pour calmer leurs propres angoisses, que ces groupes ont quand même marché et justifié leur soutien actif à la guerre d'Espagne. Pourquoi ?
Il y avait tout d'abord le phénomène fasciste. Ce problème n'a jamais été clairement et correctement posé ni analysé à fond dans l'Internationale Communiste qui l'a rapidement noyé dans un fatras de considérations de tactique et de manoeuvres savantes de Front Unique. La différence de formes de la dictature bourgeoise Démocratie et Fascisme devenait peu à peu un antagonisme fondamental de la société se substituant à celui d'opposition historique de classe : Prolétariat/Bourgeoisie. Les frontières de classe se trouvaient ainsi complètement escamotées et confondues : Démocratie devenait le terrain de mobilisation du prolétariat, Fascisme un synonyme de capitalisme. Dans cette nouvelle figuration de la division dans la société, le terrain historique du prolétariat, la lutte pour le communisme disparaissait définitivement et il ne restait à la classe ouvrière d'autre choix que de servir d'appendice à l'un ou à l'autre clans de la bourgeoisie, la répugnance et la haine naturelle des ouvriers contre la répression barbare et sans gants des bandes sanglantes du fascisme se prêtaient et ont été remarquablement exploitées par toutes les forces dites démocratiques du capital pour dévoyer le prolétariat, en fixant ses yeux sur un "ennemi principal" pour mieux lui faire oublier que ce n'était là qu'un élément d'une classe qui, face à lui, reste toujours unie en tant que classe ennemie.
L'antifascisme, comme entité se substituant à 1'anticapitalisme, comme front immédiat privilégié de la lutte contre le capitalisme, était devenu la meilleure et la plus précieuse plateforme pour engloutir le prolétariat dans les sables mouvants du capitalisme, et c'est dans ces mêmes sables que se sont laissés entraîner la majorité des groupes de gauche pour s'y perdre. Si des militants isolés ont pu se retrouver après la guerre, il n'en fut pas de même pour les groupes politiques tels l'Union Communiste en France, le Groupe Internationaliste de Belgique, le GIC en Hollande, la minorité de la Fraction Italienne et tant d'autres dont aucun n'a pu se sauver du naufrage.
Une autre pierre d'achoppement sur laquelle devaient trébucher ces groupes de gauche, résidait dans leur compréhension incomplète de la signification profonde, historique, de la guerre dans la phase de déclin du capitalisme. Ils ne voyaient dans la guerre que la seule motivation immédiate, contingente, d'affrontement inter impérialiste. Ils ne percevaient pas qu'au-delà de ces déterminations immédiates et directes, les guerres impérialistes de notre période, expriment l'impasse historique à laquelle est parvenu le système capitaliste comme tel. A ce stade, la seule solution possible aux contradictions devenues insurmontables est leur dépassement par la révolution communiste. A défaut de cette solution, la société s'engage dans un mouvement inexorable de décadence et d'autodestruction. La guerre impérialiste se présente ainsi comme l'unique alternative à la révolution. Ce caractère historique d'un mouvement de destruction et d'autodestruction, en opposition directe à la révolution, marque désormais toutes les guerres actuelles, quelle que soit la forme qu'elles prennent, guerres locales ou guerre généralisée, guerres soi-disant anti-impérialistes, d'indépendance ou de libération nationale, guerre de la démocratie contre le totalitarisme, ou encore qu'elles se présentent à l'intérieur même d'un pays sous la forme de fascisme ou d'anti-fascisme.
Deux groupes, pour s'être solidement ancrés sur le terrain de classe et du marxisme, ont su ne pas succomber à cette double épreuve que constituait la guerre d'Espagne de 1936-39 : les Fractions Italienne et Belge de la Gauche Communiste. Malgré bien des faiblesses, leur oeuvre reste une contribution sérieuse au mouvement révolutionnaire et constitue encore aujourd'hui une source précieuse de réflexion théorique pour les militants. Ils se savaient condamnés au pire des isolements mais leurs convictions ne fléchissaient pas car ils savaient que tel est le lot inévitable de tout groupe authentiquement révolutionnaire dans une période de défaite et de recul du prolétariat débouchant dans la guerre. Et alors que le bruit assourdissant des canons et des bombes de la guerre en Espagne étouffait la faible voix révolutionnaire de la Gauche Communiste, parvenait de l'autre bout du monde, d'un "groupe de travailleurs marxiste", du Mexique, un manifeste que Bilan saluait chaleureusement comme un "rayon de lumière".
C'est à la lumière noire de la guerre d'Espagne qu'un groupe de révolutionnaires, en partie en rupture avec le trotskisme, retrouve le chemin de classe et se constitue pour dénoncer la guerre impérialiste, pour dénoncer tous les pourvoyeurs conscients ou non, pour appeler les ouvriers à rompre avec ces répugnantes alliances de classes des fronts de guerre anti-fascistes. Particulièrement difficile était l'effort de constitution de ce groupe révolutionnaire, tragiquement isolé dans un pays lointain comme le Mexique, soumis à la lourde répression de l'Etat démocratique, attaqué de toutes parts et particulièrement par les trotskystes qui ont déchaîné contre lui une furieuse campagne d'immondes calomnies et de dénonciation policière. Partant de l'opposition à la guerre "antifasciste" d'Espagne, ce groupe a rapidement senti la nécessité impérieuse de remonter le cours de l'histoire et de soumettre à un examen critique et théorique toutes les positions, postulats et pratique des mouvements trotskystes et assimilés.
Sur bien des questions fondamentales, nous partageons avec lui la même démarche et les mêmes conclusions politiques, et tout particulièrement sur la période de décadence et la question nationale. Nous saluons en eux nos prédécesseurs et un moment de la continuité historique du programme du prolétariat. En publiant une première série de documents de ce groupe, nous montrons la vie et la réalité de cette continuité politique en mouvement. Ces documents, archi-ignorés dans le mouvement, trouveront, nous en sommes sûrs, un vif intérêt chez tous les militants révolutionnaires, car ils apportent de nouveaux éléments à la connaissance et à la réflexion des problèmes de la révolution prolétarienne.
Dans un prochain numéro, nous proposons de publier deux textes théoriques de ce groupe, l'un portant sur les nationalisations, l'autre sur la question nationale.
- oOo
Le massacre de Barcelone : Une leçon pour les ouvriers du Mexique !
- Au Mexique, ne doit pas se répéter l'échec subi par les travailleurs d'Espagne. Chaque jour, on nous dit que nous vivons dans une république démocratique, que nous avons un gouvernement ouvrier, que ce gouvernement est la meilleure défense contre le fascisme.>
Les travailleurs d'Espagne croyaient qu'ils vivaient dans une république démocratique, qu'ils avaient un gouvernement ouvrier, que ce gouvernement était la meilleure défense contre le fascisme.
Alors que les travailleurs n'étaient pas sur leurs gardes et qu'ils avaient plus de confiance dans le gouvernement capitaliste que dans leurs propres forces, les fascistes, au vu et au su du gouvernement, préparèrent leur coup du mois de juillet de l'année passée, exactement comme le gouvernement de Cardenas permet aux Cedillo, Morones, Cailles, etc., de préparer leur coup, tandis qu'il endort les ouvriers avec sa démagogie "ouvriériste".
Comment fut-il possible que les travailleurs d'Espagne, en juillet dernier, n’aient pas compris que le gouvernement "anti-fasciste" les avait trahis en permettant la préparation du coup des fascistes ? Comment se fait-il que les travailleurs du Mexique n’aient tiré aucune leçon de cette expérience douloureuse ? Parce que le gouvernement espagnol a continué habilement sa démagogie et parce qu'il s'est présenté devant le front des travailleurs en les trompant encore une fois avec la consigne : le seul ennemi, c'est le fascisme ! En prenant la direction de la guerre que les travailleurs avaient commencée, la bourgeoisie l'a convertie de guerre classiste en guerre capitaliste, en une guerre pour laquelle les travailleurs ont donné leur sang pour la défense de la république de leurs exploiteurs.
Leurs leaders, vendus à la bourgeoisie ont donné la consigne : ne présentez pas de revendication de classe avant que nous ayons vaincu le fascisme ! Et pendant neuf mois de guerre, les travailleurs n'ont organisé aucune grève, ont permis au gouvernement de supprimer leurs comités de base qui avaient surgis aux jours de juillet et d'assujettir les milices ouvrières aux généraux de la bourgeoisie. Ils ont sacrifié leur propre lutte pour ne pas préjuger la lutte contre les fascistes.
Pourquoi Cardenas donne-t’il son appui à Azana ?
Pour entretenir la confiance des travailleurs en leur esprit de classe ? Le gouvernement de Cardenas a un intérêt primordial à ce que les travailleurs du Mexique ne comprennent pas pourquoi le gouvernement anti-fasciste d'Espagne avait permis aux fascistes de préparer leur coup. Parce que s'ils comprenaient ce qui s'était passé en Espagne, ils comprendraient aussi ce qui est entrain de se passer au Mexique.
C'est pour cette raison que Cardenas a donné son appui au gouvernement légalement constitué de Azana et lui a envoyé des armes. Démagogiquement, il a dit que celles-ci étaient destinées à la défense des travailleurs contre les fascistes.
Les dernières nouvelles arrivées d'Espagne ont détruit pour toujours ce mensonge : le gouvernement légalement constitué de Azana utilisa les armes pour dompter les héroïques travailleurs de Barcelone lorsqu'ils durent se défendre contre ce gouvernement qui voulait les désarmer le 4 mai de cette année.
Aujourd'hui comme hier, le gouvernement de Cardenas aide le gouvernement légalement constitué de Azana, mais aujourd'hui non contre les fascistes mais contre les travailleurs. L'oppression sanglante qui succéda au soulèvement des travailleurs de Barcelone a montré la véritable situation en Espagne comme la foudre illuminant la nuit : que d'illusions de neuf mois détruites. Dans sa lutte féroce contre les travailleurs de Barcelone, le gouvernement "anti-fasciste" s'est démasqué. Non seulement, il a envoyé sa police spéciale, ses gardes d'assaut, ses mitrailleuses et ses tanks contre les travailleurs, mais il a libéré des prisonniers fascistes et a retiré du front des régiments "loyaux" en exposant ce front à l'attaque de Franco !
Ces faits ont prouvé que les véritables ennemis du Front Populaire ne sont pas les fascistes mais les travailleurs !
Travailleurs de Barcelone !
Vous avez lutté magnifiquement mais vous avez perdu. La bourgeoisie peut vous isoler. Votre force seule ne pouvait pas être suffisante. Travailleurs de l'arrière-garde, vous devez lutter conjointement avec vos camarades du front, contre l'armée de Franco, mais contre la bourgeoisie elle-même, qu'elle soit fasciste ou "anti-fasciste".
Vous devez envoyer des agitateurs au front avec la consigne : rébellion contre vos généraux ! Fraternisation avec les soldats de Franco - en majorité des paysans tombés dans les filets de la démagogie fasciste et cela parce que le gouvernement de front populaire n'avait pas rempli la promesse de leur donner la terre ! Lutte commune de tous les opprimés, qu'ils soient ouvriers ou paysans, espagnols ou maures, italiens ou allemands contre notre ennemi commun : la bourgeoisie espagnole et ses alliés, 1'impérialisme !
Pour cette lutte, un parti qui soit véritablement le vôtre est nécessaire. Toutes les organisations d'aujourd'hui, des socialistes aux anarchistes, sont au service de la bourgeoisie. Ces derniers jours à Barcelone, elles ont collaboré, une fois de plus avec le gouvernement pour rétablir "l'ordre " et la "paix". Forger ce parti de classe indépendant, voilà la condition de votre triomphe. En avant, camarades de Barcelone, pour une Espagne soviétique.
Fraternisation avec les paysans trompés, dans l'armée de Franco, pour la lutte contre leurs oppresseurs communs, qu'ils soient fascistes ou anti-fascistes !
A bas le massacre des ouvriers et des paysans pour le compte de Franco, Azana et Companys ! Transformons la guerre impérialiste en Espagne en guerre classiste !
Travailleurs du Mexique !
Quand vous insurgerez-vous ? Permettrez-vous à la bourgeoisie mexicaine de répéter la même tromperie qu'en Espagne ? Non ! Nous apprenons la leçon de Barcelone ! La tromperie de la bourgeoisie espagnole a été possible seulement parce que les leaders avaient trahi, comme au Mexique, en abandonnant la défense des intérêts des travailleurs à la magnanimité du gouvernement "ouvriériste" et parce qu'ils ont pu convaincre les travailleurs que la lutte contre le fascisme exigeait une trêve avec la bourgeoisie républicaine.
Les leaders sociaux du Mexique ont abandonné la lutte de conquêtes économiques et ont intégré les travailleurs en les ligotant au gouvernement. Tous les organismes syndicaux et politiques du Mexique appuient l'envoi d'armes de la part du gouvernement de Cardenas aux assassins de nos camarades de Barcelone. Tous donnent leur appui à la démagogie du gouvernement. Aucune organisation n'expose la véritable fonction du gouvernement de Cardenas.
Si les travailleurs du Mexique ne forgent pas un parti véritablement classiste, indépendant, nous subirons la même déroute que celle des travailleurs d'Espagne ! Seul un parti indépendant du prolétariat peut contrecarrer le travail du gouvernement qui sépare les paysans des ouvriers avec la force de la distribution de quelques lopins de terre de la lagune, pour les séparer des ouvriers industriels.
La lutte contre la démagogie du gouvernement, l'alliance avec les paysans et la lutte pour la révolution prolétarienne au Mexique sous le drapeau d'un nouveau parti communiste seront la garantie de notre triomphe et la meilleure aide à nos frères d'Espagne ! Alerte, travailleurs du Mexique ! Nous ne devons pas être surpris par le faux ouvriérisme du gouvernement !
Plus d'armes aux assassins de nos frères d'Espagne !
Luttons pour un parti classiste indépendant ! A bas le gouvernement de Front Populaire ! Vive la dictature du prolétariat !
"Groupe de Travailleurs Marxistes" Mai
1937 - Mexico –
- oOo
République en Espagne, “démocratie” au Mexique (extraits)
- Au premier moment de la lutte en Espagne, le prolétariat lutta comme force indépendante. Ainsi, la lutte commença comme une guerre civile. Mais rapidement la trahison de tous les partis transforma la lutte des classes en collaboration des classes, et la guerre civile en guerre impérialiste.>
Tous les partis (y compris les anarcho-syndicalistes) ont brisé le mouvement de grève pour donner la consigne : aucune revendication de classe avant que nous n'allions gagner la guerre ! Le résultat de cette politique a été que le prolétariat espagnol a abandonné la lutte des classes et a donné son sang pour la défense de la république capitaliste. Au travers de la guerre en Espagne, la bourgeoisie a oeuvré pour unifier dans le cerveau du travailleur espagnol et mondial, ses intérêts de classe avec les intérêts de la démocratie bourgeoise afin de lui faire abandonner ses propres moyens de lutte de classe, pour accepter la méthode de la bourgeoisie : lutte territoriale, prolétaire contre prolétaire. Nous voyons par là comment, dans la même mesure où croît 1'héroïsme du prolétariat espagnol et la solidarité du prolétariat espagnol, la conscience de classe des travailleurs descend au même rythme. La bourgeoisie mondiale, surtout celle dite "démocratique", approuve l'héroïsme du prolétariat espagnol et la solidarité du prolétariat international pour dévoyer la lutte du terrain national au terrain "international" : de la lutte contre sa propre bourgeoisie à la lutte contre le fascisme d'Espagne, d'Allemagne et d'Italie; Cette méthode a donné de grands bénéfices à la bourgeoisie dans tous les pays : c'est ainsi que les grèves ont été brisées. La guerre en Espagne et son utilisation par la bourgeoisie a relié plus étroitement le prolétariat de chaque pays à sa propre bourgeoisie.
Le gouvernement du Mexique dépasse tous les gouvernements capitalistes par sa manière systématique et démagogique d'approuver la guerre en Espagne pour renforcer sa position et relier le prolétariat mexicain à la bourgeoisie. Les organisations ouvrières qui demandent que leur gouvernement envoie des armes en Espagne, donnent en réalité leur appui, non au prolétariat espagnol mais à la bourgeoisie espagnole et à leur propre bourgeoisie. Egalement, les collectes et l'envoi de volontaires au front de bataille n'ont d'autres résultats que de prolonger les illusions du prolétariat d'Espagne et de chaque pays et de fournir de la chair à canon à la bourgeoisie espagnole et internationale.
Le gouvernement actuel du Mexique a pour tâche de continuer l'oeuvre de ses prédécesseurs, c'est à dire détruire le mouvement ouvrier indépendant afin de convertir le Mexique en un territoire d'exploitation certaine pour le compte du capitalisme international. Ce qui a changé par rapport au gouvernement antérieur, c'est seulement la forme dans laquelle s'accomplit cette tâche, c'est à dire l'intensification de la démagogie gauchiste. Le gouvernement actuel se présente aux masses comme l'expression de la véritable démocratie. Le devoir de l'avant-garde du prolétariat est de signaler à sa classe et aux masses travailleuses en général ce qui suit : primo, que la démocratie n'est autre chose qu'une forme de la dictature capitaliste et que la bourgeoisie emploie cette forme lorsque l'autre forme ouverte ne sert pas ; secondo, que la fonction de la démocratie est de corrompre l'indépendance idéologique et organisationnelle du prolétariat ; tertio, que la bourgeoisie complète toujours la méthode violente d'oppression des travailleurs avec la corruption ; quarto, que les méthodes démocratiques d'aujourd'hui tirent leur fonction de la préparation du terrain pour l'oppression brutale du mouvement ouvrier et pour une dictature ouverte pour l'avenir ; que le gouvernement de Cardenas permet aux éléments réactionnaires de l'intérieur et de l'extérieur du gouvernement de forger les instruments pour l'oppression brutale de l'avenir (amnistie, etc.).
Le gouvernement actuel vise à séparer les ouvriers de ses alliés naturels, les paysans pauvres et d'incorporer les organisations des deux classes dans l'appareil étatique. Le gouvernement organise et donne des armes aux paysans afin que ceux-ci les emploient à l'avenir contre le prolétariat. En même temps, il vise à en finir avec toutes les organisations du prolétariat pour former un seul parti et une seule centrale syndicale reliée directement à l'Etat. Le gouvernement profite de la division au sein du prolétariat pour débiliter toutes les organisations existantes ; premièrement en les opposant l'une contre l'autre, secondement en unifiant les sections locales et régionales avec une aide dirigée par l'Etat. Dernièrement, le gouvernement a utilisé Trotsky et les trotskystes pour affaiblir la CTM et les stalinistes. Le devoir de l'avant-garde du prolétariat est de dénoncer et de combattre systématiquement les manoeuvres du gouvernement en intensifiant la lutte anti-gouvernementale au même degré que le gouvernement intensifie son travail de corruption et de démagogie ; secondo, accélérer le travail de préparation d'un parti de classe ; tertio élaborer une tactique révolutionnaire pour l'unification du mouvement syndical pleinement indépendant de l'Etat ; quarto, commencer un travail systématique au sein des ouvriers agricoles et des paysans pauvres pour briser leur confiance dans l'Etat en vue de leur alliance avec le prolétariat des villes.
Chaque gouvernement capitaliste d'un pays semi colonial est un instrument de l'impérialisme. Le gouvernement actuel du Mexique est un instrument de l'impérialisme américain. Dans ses fondements, sa politique sert uniquement l'impérialisme et intensifie l'esclavage des masses mexicaines. Le devoir de l'avant-garde du prolétariat est de démasquer la démagogie anti-impérialiste du gouvernement et de signaler aux masses du continent et du monde que la collaboration du gouvernement mexicain est aujourd'hui indispensable pour l'extension de l'impérialisme, comme l'a prouvé, par exemple, la fonction qu'a développée la délégation mexicaine à la Conférence de Buenos-Aires. Le résultat de la Conférence fut l'intensification de la domination américaine surtout au Mexique.
Les méthodes démagogiques du gouvernement mexicain actuel, par rapport au mouvement ouvrier, et l'agitation dans les campagnes, a inspiré tellement de confiance en l'impérialisme américain que les banques de Wall Street ont offert un grand emprunt au gouvernement mexicain à la condition que les impôts des compagnies pétrolières servent de garantie pour le paiement des intérêts. Le gouvernement accepta cette condition sans rencontrer la moindre opposition dans le pays ainsi qu'il en fut le cas pour le gouvernement antérieur. Ceci lui fut possible grâce à la popularité que l'aide au gouvernement espagnol et la distribution des terres dans la lagune lui avaient donnée, et aussi grâce à l'affirmation que l'emprunt servirait à la construction de machines. Ainsi, nous voyons comment le prolétariat ne peut lutter avec fruit contre la politique intérieure de la bourgeoisie mexicaine sans lutter systématiquement contre sa politique extérieure et comment on ne peut pas lutter contre Cardenas sans lutter contre Roosevelt.
Puisque le gouvernement mexicain dépend par toute sa politique de l'impérialisme américain, il en est de même du droit d'asile pour Trotsky. Il est clair que Cardenas a concédé le droit d'asile pour Trotsky seulement avec l'autorisation de son maître : l'impérialisme américain, lequel escompte utiliser Trotsky pour ses manoeuvres diplomatiques internationales, surtout pour ses négociations avec Staline. Le devoir de l'avant-garde du prolétariat est de signaler cette situation aux travailleurs sans cesser naturellement, en même temps de lutter pour le droit d'asile de Trotsky.
"Groupe de Travailleurs Marxistes" - Mexico –
- oOo
Appel du Groupe de Travailleurs Marxistes du Mexique aux organisations ouvrières du pays et à l’étranger
- Camarades !
Une organisation qui se dit communiste et internationaliste vient de commettre un acte qui démontre qu'elle n'est ni communiste ni internationaliste. La section de la Ligue Communiste Internationaliste a commis le crime de dénoncer un camarade étranger qui habite Mexico en l'accusant de mener dans la classe ouvrière de ce pays une activité contraire à la politique du gouvernement. Notre enquête nous a permis d'établir que ce camarade a appartenu pendant onze ans, de 1920 jusqu'en 1931, au PC allemand et à l'Union Générale des Travailleurs du même pays. De 1931 à 1934, il a été membre du groupe d'émigration allemande de la Ligue Communiste et a rompu avec elle lors du tournant opéré par Trotsky, quand il ordonna aux différentes sections de l'opposition d'entrer dans la IVème Internationale. Depuis quelques années, ce camarade militait aux Etats-Unis dans la "Revolutionary Workers'League" (groupe Ochler) sous le pseudonyme d'Eiffel, comme membre du Comité central et du Bureau politique. Obligé de quitter les Etats-Unis parce que les autorités ne voulaient pas renouveler son passeport, c'est en tant que représentant du BP de Revolutionary Workers'League qu'Eiffel s'était réfugié au Mexique et qu'il travailla dans notre organisation.
Pour toute réponse à notre enquête, à notre demande loyale d'explications, comme il se doit entre organisations ouvrières, la Ligue a répondu par de nouvelles calomnies, combinées à une dénonciation à la police puisque dans sa revue "IVème Internationale", elle donne le nom du camarade, sa nationalité et son pseudonyme politique.
Nous sommes de plus accusés en tant qu'organisation d'être entretenus par les soins d'Hitler et de Staline.
Nous savons que de telles méthodes sont le lot d'organisations qui n'ont plus rien de prolétarien. Ce sont des méthodes staliniennes, des méthodes qu'employèrent auparavant les social-démocrates dans la lutte contre l'avant-garde révolutionnaire, contre les internationalistes. Que la Ligue Communiste s'engage dans cette voie est le signe d'une dégénérescence politique qui n'ose pas affronter la lumière d'une explication franche et honnête des divergences existant entre deux organisations. Nous nous efforcerons maintenant de donner le contenu de nos divergences.
- Le cas Trotsky
Depuis l'arrivée de Trotsky au Mexique, la Ligue a cessé ses attaques contre le gouvernement de Cardenas, elle en assure même la défense. Elle qualifie le gouvernement "d'anti-impérialiste", "d'anti-fasciste", de "progressiste" etc.. Voyant le danger d'une telle politique qui ramenait l'avant-garde au niveau du stalinisme, le camarade Daniel Ayala, alors membre de la Ligue mexicaine, avait demandé que la Ligue ne se considère pas liée par le compromis nécessaire que Trotsky avait dû passer pour obtenir le droit d'asile et qu'elle délivre également Trotsky de ses liens politiques avec l'organisation - le devoir évident pour toute organisation ouvrière, c'est de combattre pour le droit d'asile au camarade Trotsky, sans changer une seule ligne de sa doctrine, de sa propagande.
La Ligue Communiste ne l'a pas compris ainsi et en prenant la responsabilité des actes de Trotsky, elle donne au gouvernement la possibilité d'expulser ce camarade quand l'activité de la Ligue ne lui conviendra pas. Notre proposition comportait donc pour Trotsky une garantie de plus et permettait à la Ligue de conserver son entière indépendance idéologique. Daniel Alaya est devenu membre du Groupe des Travailleurs Marxistes et accusé de provocations, d'agent de la Gépéou, par la section mexicaine de la 4ème Internationale. Depuis, la nouvelle politique de la Ligue au Mexique rejoint celle du stalinisme, à part 1' argumentation théorique différente - un exemple ; Diego Riviéra, un des leaders de la Ligue parle ouvertement de la nécessite pour les travailleurs de défendre "l'indépendance de notre pays" (Excelsior, 3.9.1937). Les trotskystes rejoignent le social-patriotisme, même s'ils lui assignent le but de "défendre l'indépendance de notre pays" contre les tentatives de "soumettre l'administration de notre pays à Moscou". (Excelsior, 3.9.1937).
- La guerre d'Espagne
Dans notre tract du mois de mai 1937 sur le massacre de Barcelone, nous disions : "toutes les organisations syndicales et politiques du Mexique appuient l'envoi d'armes par le gouvernement de Cardenas aux assassins de nos camarades de Barcelone". Nous portions ce jugement et sur le Parti communiste et sur la Ligue, parce qu'ils font partie tous deux intégrante du front unique anti-fasciste dont la fonction est de détruire 1'indépendance idéologique des organisations ouvrières et les incorporer à l'Etat bourgeois.
Auparavant, la Ligue combattait les staliniens pour l'appui qu'ils donnaient au gouvernement Cardenas, dont elle disait qu'"il est en réalité la dictature des capitalistes sous une forme camouflée" et qu'"il représente les intérêts du capital yankee. L'unique raison de son existence, c'est de maintenir le système d'oppression en usant de phrases radicales". Depuis l'arrivée de Trotsky, la Ligue renonce à cette juste conception marxiste des Etats démocratiques bourgeois et agit comme si le gouvernement se tenait au dessus des classes. Les mots d'ordre de la Ligue font écho à ceux qu'on peut lire sur les manchettes de la presse stalinienne : "Le gouvernement doit mettre fin aux abus des capitalistes" ; "Il faut combattre la passivité du gouvernement" ; etc.
Sur la guerre d'Espagne, la Ligue critique l'appui des staliniens au gouvernement démocratique bourgeois, mais elle s'associe à cette trahison parce qu'elle n'explique pas aux ouvriers que la guerre d'Espagne est devenue impérialiste. Au contraire, elle tient le langage des staliniens quand elle dit qu'il est nécessaire de combattre sur le front.
- Notre position sur la guerre d'Espagne
Nous sommes contre l'appui au pouvoir républicain, mais non pour soutenir le pouvoir de Franco. Nous n'acceptons pas l'alternative "avec Azana ou avec Franco". Au contraire, nous pensons que l'unique façon de battre le fascisme, c'est d'abord pour les ouvriers de briser la discipline des oppresseurs "démocrates" parce que le seul front où puisse triompher le prolétariat, c'est le front de classe. La guerre en Espagne, comme toutes les guerres qui sont conduites par la bourgeoisie est une guerre impérialiste et non une guerre civile ; par conséquent, ceux qui recommandent aux ouvriers de donner leur appui à cette guerre trahissent les véritables intérêts de la classe opprimée. C'est seulement en suivant la politique des bolcheviks et autres marxistes révolutionnaires durant la guerre mondiale que les travailleurs pourraient faire leur révolution, en s'insurgeant contre leurs propres généraux et en fraternisant avec les soldats de Franco. C'est la seule manière pour convertir la guerre impérialiste actuelle en guerre civile.
Lénine, Liebknecht travaillèrent pour la défaite de "leur propre gouvernement", c'est-à-dire de la bourgeoisie et pour le triomphe du prolétariat. En Russie, la révolution triompha sur la base de la défaite du gouvernement russe. Mais les révolutionnaires russes utilisèrent cette défaite pour faire la révolution prolétarienne non seulement en Russie mais aussi en Allemagne. La même chose se produirait en Espagne. La rébellion des soldats d'Azana serait le signal de la rébellion pour les soldats qui sont sous la domination de Franco. C'est le seul moyen de faire surgir la révolution prolétarienne de l'actuelle guerre impérialiste. Ceux qui disent au contraire que la révolution surgira à la suite du triomphe du gouvernement Azana, ceux-là mentent ! Ce qui suivra la victoire du gouvernement républicain sera une oppression terrible pour les ouvriers et les paysans d'Espagne, une oppression bien plus sanglante que le massacre des ouvriers de Barcelone par le général démocrate Pezas.
- La guerre de Chine
Oubliant ce qu'il avait dit pendant plusieurs années sur la révolution chinoise, Trotsky affirme aujourd'hui qu'en Chine "Toutes les organisations ouvrières… accomplirent leur devoir jusqu'à la fin de la guerre de libération". Aujourd'hui, Tchang-Kaï-Chek est le héros de la guerre de libération et les ouvriers ont le devoir d'appuyer cette guerre. Mais Trotsky ne nous explique pas comment une guerre sous la direction de la bourgeoisie peut être une guerre de "libération".
Staline dit aussi que les ouvriers chinois "accompliront leur devoir jusqu'à la fin de la guerre de libération sans prendre en considération son programme et son indépendance politique". Tandis que Trotsky affirme qu'ils doivent accomplir leur devoir "sans abandonner d'une façon absolue leur programme et leur indépendance politique". Trotsky parle de lutte indépendante en même temps qu'il l'abandonne en fait. Il vaut la peine d'attirer l'attention sur le petit fait suivant. Une note insérée dans le n°13 de la revue "IVé Internationale" rectifie une erreur glissée dans le texte de l'article que Trotsky avait donné au journal de Mexico "Excelsior" sur la guerre de Chine, où les mots "sans abandonner absolument" avaient été remplacés par les termes staliniens "sans prendre en considération, etc.". Ce qu'il y a de grave et de piquant, c'est que la revue "IVè Internationale" ait reproduit sans rectifier la même version de l'article de Trotsky. Si les leaders eux-mêmes confondent les versions stalinienne et trotskyste, comment les ouvriers pourraient-ils s'y reconnaître en fin de compte ?
Dans le cas de la Chine comme celui de l'Espagne, les ouvriers ne retiendront qu'une chose : en leur demandant d'accomplir leur devoir, la Ligue et le Parti Communiste leur demandent d'abandonner leur propre lutte pour donner l'appui à la bourgeoisie "libératrice", "anti-impérialiste", "démocratique", etc.
- Notre position sur la guerre de Chine
L'unique sauvegarde pour les ouvriers et les paysans chinois, c'est de lutter comme force indépendante contre les deux gouvernements. En organisant la lutte contre leur propre bourgeoisie, les révolutionnaires chinois lèveront les germes de la révolte contre le gouvernement japonais, et de la fraternisation des ouvriers et des paysans des deux pays surgira la révolution prolétarienne. Si les révolutionnaires s'unissent avec la bourgeoisie pour défendre la patrie jusqu'à la fin de la guerre, comme le conseillent Staline et Trotsky, ils favorisent la destruction de la fleur du prolétariat et des paysans des deux pays et, en fin de compte, les deux bourgeoisies adverses sauront trouver Un accord pour assurer en commun l'exploitation des masses chinoises.
Dans toutes les situations, notre position se base sur un seul critère : l'intérêt de classe du prolétariat exige son indépendance absolue ; son unique sauvegarde, c'est la révolution prolétarienne. Toutes les "guerres de libération" et toutes les "guerres anti-fascistes" sont au fond dirigées contre la révolution prolétarienne. Donner son appui à de telles guerres équivaut à lutter contre la révolution prolétarienne.
Les camarades du Groupe des Travailleurs Marxistes concluent qu'ils ne sont ni agents d'Hitler, ni de Mussolini, ni de Staline. Ils prétendent rester des marxistes conséquents, alors que sur les questions fondamentales qui départagent le mouvement ouvrier, les staliniens et les trotskystes se trouvent du même bord.
- "Pour un vrai Parti Communiste du Mexique" éditorial du N°1 de "Comunismo", organe du Groupe de Travailleurs Marxistes
Jamais le mouvement communiste n'a été si effondré et si corrompu que dans ces moments. Il y a longtemps que les dénommés "communistes", stalinistes et trotskystes, ont abandonné le chemin communiste, capitulant devant les fétiches de notre ennemi de classe : la démocratie et le patrie. De vrais communistes, il y a seulement quelques groupes dans quelques pays, comme la "Fraction Italienne de la Gauche Communiste", qui se prépare dans l'exil pour le jour de la révolution prolétarienne dans son pays et une autre "fraction", avec une position politique semblable en Belgique. C'est le travail de ces deux groupes qui nous a inspiré dans notre effort de créer au Mexique un noyau communiste.
Au mois de mai de l'année dernière, nous avions à peine commencé les premières conservations entre plusieurs camarades, la majorité des membres ou ex-membres de la "Ligue Communiste Internationaliste", quand le massacre de nos frères de classe, à Barcelone, par les bourreaux du gouvernement "ouvriériste" d'Azana et Companys nous obligea à lancer une première publication : notre tract intitulé -; "Le massacre de Barcelone, une leçon pour les travailleurs du Mexique". Nous affirmons dans ce tract notre opposition de principe contre la participation des organismes ouvriers dans la guerre en Espagne, que l'on doit caractériser, des deux cotés, comme une guerre impérialiste et nous lançons le mot d'ordre de “défaitisme révolutionnaire” comme l'unique mot d'ordre qui peut séparer le prolétariat de "sa" bourgeoisie et l'amener à la révolution.
En même temps, nous dénonçons la complicité du gouvernement "ouvriériste" du Mexique et de toutes les organisations ouvrières du pays dans la tuerie de nos frères de classe en Espagne. Mais ces bases n'avaient pas quelque chose de spécial au Mexique. Au contraire, elles étaient communes au mouvement communiste dans tous les pays coloniaux et semi coloniaux, comme le démontra avec clarté la déroute de la révolution prolétarienne en Chine. Ces bases fausses avaient pour origine l'état inachevé et en partie incorrect dans lequel l'Internationale Communiste laissa le problème de la lutte prolétarienne dans des pays comme le Mexique ou la Chine.
Notre première tâche, par conséquent, est l'étude critique des positions de l'Internationale Communiste (naturellement pas de l'actuelle qui de communisme n'a plus que le nom mais de celle du temps de Lénine) au sujet de la tactique à suivre dans les pays coloniaux et semi coloniaux. A la seule condition d'accomplir cette tâche, nous pourrons créer des bases solides pour le futur Parti Communiste du Mexique.
En partant des mêmes bases marxistes que celles dont partirent Lénine et les autres communistes de cette époque, mais en tirant les leçons des grandes expériences prolétariennes postérieures, en premier lieu de celle de la révolution chinoise de 1926-1928, nous allons réviser les conclusions tactiques auxquelles aboutirent ces camarades. En d'autres mots, publier une nouvelle thèse sur la lutte dans les pays coloniaux et semi coloniaux est notre tâche la plus urgente. Si nous ne l'avons pas encore accomplie, cela est dû en premier lieu à notre nombre encore assez réduit et à notre manque d'expérience dans un tel travail théorique. C'est la première fois, au Mexique, qu'un groupe de travailleurs attaque les problèmes du pays, d'une manière indépendante, unique et exclusivement du point de vue classiste. Nos amis, au Mexique ou ailleurs doivent être indulgents sur la lenteur ou l'imperfection avec laquelle nous accomplissons cette tâche.
Pendant que se poursuit dans notre groupe la discussion sur les problèmes fondamentaux de la révolution prolétarienne au Mexique, les évènements du jour, comme la "nationalisation" du pétrole, nous obligent et en même temps nous permettent d'attaquer quelques points de ces problèmes bien avant d'arriver à une position complète, que l'on doit chercher dans une étude analytique de toute l'histoire du mouvement ouvrier au Mexique et dans d'autres pays à structure sociale semblable. Dans ce sens nous commençons dans le premier numéro de notre revue "Communismo", la discussion des principes fondamentaux de notre lutte, discussion qui est indispensable pour fonder le futur Parti de la révolution prolétarienne sur des bases solides et vraiment marxistes. Pour ce travail, nous invitons tous les camarades du Mexique et de l'étranger à coopérer.
Nous concluons en affirmant l'urgence de commencer le travail pour préparer les bases programmatiques et organisationnelles pour un nouveau Parti Communiste au Mexique, complètement indépendant de tous les courants qui, à l’intérieur du mouvement ouvrier représentent consciemment ou inconsciemment les intérêts de notre ennemi de classe.
La publication de ce tract, dictée par notre désir de réveiller la conscience prolétarienne contre le massacre à Barcelone et en Espagne en général, mais prématurée car, à cette époque, nous n'avions pas encore une position claire sur les problèmes de notre pays, eut un effet double :
D'un côté, elle provoqua contre notre groupe une furieuse campagne de calomnies de la part de Léon Trotsky et de la dénommée "Ligue Communiste Internationaliste, nous traitant "d'agents du fascisme", dénonçant à la police les camarades qui partagèrent notre point de vue.
D'un autre côté, notre premier tract nous apporta la solidarité du prolétariat de deux pays : les "Fractions Italiennes et belges de la Gauche Communiste", qui non seulement nous défendirent contre ces accusations mais publièrent des traductions du texte intégral de notre tract dans leurs revues "PROMETEO" (en italien) et "BILAN" (en français) et "COMMUNISME" (en français aussi), exprimant leur satisfaction qu'enfin soient apparus au Mexique les premiers "rayons de lumière".
Stimulés par cet appui international et par les lettres que nous envoyèrent les camarades italiens et belges, nous essayions d'accélérer la discussion déjà commencée à l'intérieur de notre groupe en formation; mais les difficultés politiques et personnelles que nous créèrent les accusations et les dénonciations des trotskystes furent si graves que nous perdîmes des mois entiers à notre autodéfense.
A la fin, nous avons pu avancer du travail négatif au travail positif. Ce fut plus difficile que nous ne l'avions pensé. La raison fondamentale est qu'en réalité, dans notre pays, les problèmes de la révolution prolétarienne n'ont jamais été posés dans la forme correcte. Pendant tout le temps de l'existence d'un mouvement communiste au Mexique, celui-ci était envenimé par l'idée de la coopération avec la bourgeoisie "anti-impérialiste" et "progressiste" du pays.
Notre travail, par conséquent, peut se baser sur des expériences positives du prolétariat mexicain, car il n'y en a pas. Au contraire, il doit commencer avec la critique marxiste des Bases fausses sur lesquelles s'est construit dans le passé le mouvement communiste au Mexique.
Le Groupe des Travailleurs Marxistes
Géographique:
- Mexique [79]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [80]
Approfondir:
- Espagne 1936 [81]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Le "Front Uni" [82]
La Grande-Bretagne et la situation internationale (2e congrès de W. R.)
- 2927 reads
Présentation
- Le deuxième congrès de la section du CCI en Grande-Bretagne, World Révolution, s'est tenu en avril de cette année. Les congrès réguliers sont au coeur de la vie de l'organisation des révolutionnaires et sont le lieu où se révèle l'importance de ses tâches et de ses préoccupations. Ils permettent à l'organisation de faire le bilan de son travail passé et de mettre en place les perspectives futures. En particulier, ils révèlent que les révolutionnaires n'ont pas d'autres buts que d'assumer leurs responsabilités au sein de la classe dont ils sont le produit pour "clarifier la marche générale et les buts ultimes du mouvement prolétarien".
Une autre question, l'Etat dans la période de transition du capitalisme au communisme, constitue un sujet important de discussion au congrès, considérant que le problème n'a pas été entièrement "résolu" par l'expérience de la classe ouvrière, comme par exemple, la nature des syndicats dans la décadence du capitalisme, que le prolétariat a dû affronter bien des fois comme des appendices réactionnaires de l'Etat capitaliste. Les révolutionnaires doivent donc consacrer une partie de leurs efforts à clarifier la nature de phase post-révolutionnaire de la lutte du prolétariat, en se basant le plus possible sur l'expérience limitée de la classe, en particulier de la révolution russe. Quoique ce soit seulement la classe ouvrière qui, à travers son expérience pratique puisse résoudre le problème de la période de transition, le prolétariat et ses minorités révolutionnaires doivent théoriquement se préparer aujourd'hui pour cette tâche formidable et à peine comprise qui devra être réalisée dans l'avenir. Le texte du congrès que nous publions dans cette revue, traite de la situation actuelle en Grande-Bretagne. Il est une contribution à l'une des tâches de WR et de tout, le courant: analyser constamment la période actuelle en relation avec les tendances générales du capitalisme décadent. Ce n'est pas par souci académique mais pour rendre concret dans notre intervention dans la classe ouvrière, le contexte de notre orientation politique fondamentale, l'évolution de la situation mondiale vers l'alternative guerre ou révolution, l'incapacité de la bourgeoisie à contrecarrer la crise au niveau politique et économique, la nature des mystifications, en particulier celle de la gauche, et les étapes du développement de la lutte du prolétariat vers la révolution. Un des aspects les plus importants du texte réside dans la tentative de voir la situation britannique dans le cadre international, en se référant aux tendances décrites ci-dessus et qui ont déjà été développées dans les numéros précédents de la Revue Internationale. Nous cherchons toujours à analyser en détail l'évolution de la situation présente de la façon la plus claire et la plus précise possible, en se rappelant qu'elle est un guide pour l'action du prolétariat. Ceci constitue, sous bien des aspects, un appel aux révolutionnaires à comprendre l'urgence de leurs tâches et la nécessité de redoubler les efforts car demain nos analyses seront un instrument politique dans les mains de la classe quand elle influencera directement l'histoire de façon décisive.
S.
- - oOo -
La situation
Dans les 14 années qui vont de 1953 à 1967, l’inflation était en moyenne de 2% par an dans les onze principaux pays industriels du monde. Dans les années 1973-1975, elle était en moyenne de 13%. Dans les années soixante, la production mondiale a augmenté de 6 à7 % par an. Mais, en 1974, la production globale a stagné et a diminué de 10% en 1975. Le volume du commerce mondial augmentait en moyenne de 9% de 1964 à 1974, mais lui aussi a chuté d'environ 6% en 1975.
Cela a entraîné l'augmentation du chômage qui s'est élevé au chiffre officiel de 5,25% de la population active des pays développés, dépassant ainsi du double le taux du "boum" de l'après-guerre. Voici quelques-uns des chiffres clés qui mettent en lumière la gravité de la crise économique qui se développe depuis 1968. Cette crise est due à la réapparition du problème de la saturation du marché mondial, elle marque la fin de la période de reconstruction et met en lumière, une fois de plus la mortalité du système capitaliste.
En 1976 et dans les premiers mois de 1977, nous avons pu voir que la soi-disant reprise, qui était supposée avoir mis fin à la récession de 1975, s'essoufflait immédiatement. Cette "reprise" était fondée sur les bases peu solides que sont la politique de re-stockage et une augmentation de la consommation et elle a donc échoué puis qu'elle ne pouvait influer sur les causes profondes de la crise économique. Le commerce mondial stagnant ne s'est pas véritablement relevé et la croissance industrielle n'a pas fait mieux prouvant que le modeste objectif de 5% calculé par l'OCDE en juillet 1976 était trop optimiste. C'est un taux de croissance de 3,25% qui est dorénavant prévu pour 1977. Ce qui est important, c'est qu'aucune action n'a été engagée à l'égard des aspects fondamentaux des crises capitalistes la sous-utilisation des forces productives et de la force de travail. Au contraire, même pendant la dernière reprise, un processus de rationalisation a été entrepris sur toute l'économie pour réduire autant que possible les coûts de production et de travail.
Il est de plus en plus ridicule de supposer que la politique keynésienne mise au point pour traiter des problèmes de l'économie dans un passé récent, puisse résoudre la crise d'aujourd'hui. D'un côté, la bourgeoisie est maintenant terrifiée par la perspective de la reflation : stimuler la production par d'énormes déficits ne peut que mener à une inflation encore plus désastreuse qu'aujourd'hui sans l'élargissement mondial. Mais d'un autre côté la déflation, par le moyen d'une restriction des crédits, est également alarmante pour la classe dominante. L'économie capitaliste ne peut fonctionner qu'en ayant la rentabilité pour but. Prévoir une expansion faible ou nulle ne peut qu'entraîner une diminution de la "confiance dans les affaires la chute des investissements et, en conséquence, la banqueroute définitive du système. Tracer un chemin entre ces deux maux devient de plus en plus difficile car la profondeur de la crise réduit 1es possibilités offertes à la bourgeoisie.
Un retour au protectionnisme à travers un renforcement de l'étatisation de chaque capital national, c'est-à-dire la politique qui mène à la guerre généralisée, telle est à long terme la seule voie de la bourgeoisie. Les USA vont essayer de préserver, le plus longtemps possible la cohésion du bloc américain, qu'une politique d'autarcie de chaque nation menacerait. Il semble que les USA vont tenter d'utiliser la force relative de l'économie allemande et japonaise pour soutenir les nations plus faibles, comme la Grande-Bretagne, l'Italie, ce qui aura pour corollaire de renforcer encore le capital américain. Déjà des appels sont lancés aux allemands et aux. japonais pour qu'ils développent leur marché intérieur afin de sauver les exportations des pays faibles. Des pourparlers ont aussi commencé, concernant la formation d'un "club de créditeurs", financé par les capitaux forts pour prêter aux économies faibles. Mais même cette stratégie va tôt ou tard s'effondrer. Les surplus commerciaux des économies fortes, avoisinant 4,50 milliards de dollars en 1976, ne peuvent éponger les déficits des faibles qui ont atteint 27 milliards de dollars en 1976. (De plus, nous ne parlons pas des déficits du tiers-monde qui a atteint le chiffre de 24 milliards de dollars en 1976 ni de ceux du bloc soviétique qui a accumulé une dette de 48,5 milliards de dollars).
L'approfondissement de la crise économique va continuer à exacerber les rivalités inter impérialistes entre les blocs américain et soviétique. A un autre niveau, les contradictions entre les intérêts de chaque nation d'un même bloc et ceux de l'ensemble du bloc, entre les secteurs dynamiques et les secteurs retardataires de chaque économie vont s'aggraver. La conséquence la plus importante de la crise sera la détérioration de l'équilibre entre les classes. Mais le calme qui existe encore aujourd'hui dans la lutte de classe nous oblige à nous pencher sur les deux premiers facteurs.
Dans la sphère de la politique internationale, nous venons de voir la tension monter en Afrique Australe. Les voyages de Castro et de Podgorny dans les Etats de la "ligne de front" de l'Afrique Australe et l'aide militaire qui accompagne chacun de ces voyages et l'invasion du Zaïre, sans aucun doute Inspirée par les russes, indiquent les manoeuvres de l'URSS dans cette région du monde. Ce qui caractérise de telles manoeuvres, c'est la tentative de s'attaquer à la supériorité politique et militaire des USA par des moyens militaires et de déstabiliser la situation existante. D'un autre côté, les USA sont en train d'essayer de garder les Etats-clients - la Rhodésie et l'Afrique du Sud - en maintenant une situation stable, à travers l'utilisation des pressions économiques et politiques pour passer graduellement à la domination de la majorité noire. C'est la signification de l'embargo récent des USA sur les exportations rhodésiennes et la résolution de l'ONU inspirée par les USA contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais en dépit des manoeuvres des deux blocs impérialistes dans ce continent, la situation reste en équilibre pour le moment.
L'importance attachée par les USA et la Russie à l'Afrique Australe et au Proche-Orient plutôt qu'au Sud-est Asiatique montre l'intensification de la lutte inter impérialiste dans des endroits qui seront cruciaux dans un troisième carnage inter impérialiste mondial.
Tous les pourparlers sur la limitation des armements stratégiques et sur le danger de prolifération des armes nucléaires, qui sont assez à la mode dans la bourgeoisie, ne peuvent cacher le volume croissant et la sophistication des armements nucléaires détenus et développés par les super-puissances. La cynique défense des "droits de l'homme" par Carter vis à vis du bloc soviétique n'est rien d'autre que le coup d'envoi d'une nouvelle phase de la guerre froide et une voie détournée pour éviter un accord sur l'armement avec les russes. Brejnev a déjà averti les USA de ne pas s'occuper des affaires russes et proclame que Carter met en danger la soi-disant détente. Considérant que les USA ont maintenant besoin de la gauche comme allié dans les pays occidentaux, la cause des "droits de l'homme" - au contraire de "l'anti-communisme", est la plus appropriée pour sa propagande de guerre contre la Russie. La Russie veut éviter la pression politique que son asservissement économique au bloc occidental crée déjà.
La tentative du bloc américain de se renforcer en Europe continue. Nous avons déjà montré que les USA vont augmenter leur emprise économique sur les pays satellites d'Europe. Ceci permet dans une large mesure de superviser les équipes politiques qui seront obligées de mettre en application les mesures économiques. Toutefois ce déroulement des évènements a entraîné des tensions accrues entre les intérêts des USA et ceux de certains pays d'Europe. Face à la crise économique, chaque capital national a intérêt à étatiser l'économie le plus possible, et ceci de façon à non seulement centraliser et concentrer encore plus le capital national mais aussi à faciliter une plus grande exploitation et mystification de la classe ouvrière. Ce dernier objectif est facilité par le fait que les fractions politiques favorisant le capitalisme d'Etat sont le plus souvent de gauche et ont un langage "socialiste". Cependant, comme les faits récents en Espagne, Portugal et Italie l'ont montré, certaines de ces équipes de gauche n'ont pas la confiance des USA ni celle d'importantes fractions de la bourgeoisie locale. Les PC qui sont les plus puissants partis de gauche dans ces pays menacent les secteurs arriérés de la bourgeoisie liés aux USA et ont une affinité (bien qu'affaiblie) avec le bloc soviétique dans leur orientation internationale. Donc, dans ces pays, il y a une grave crise politique principalement due au fait que la solution satisfaisante qui doit être trouvée, doit répondre à la fois aux intérêts des blocs et à ceux du capital national. Cette crise s'intensifie d'autant plus que la situation économique de ces pays se détériore et que la lutte de classe semble s'intensifier. La grande révolte des étudiants en Italie est un symptôme de la décomposition à la fois économique et politique dans ce pays. Mais en dépit de la crise politique en Europe, les USA sont de plus en plus conscients que seule la gauche peut être une garantie de la paix sociale et de la cohésion économique et est donc l'instrument le plus adéquat pour assurer leur hégémonie en Europe.
Par contre, la victoire de la gauche aux municipales en France qui précède sa victoire probable aux élections législatives, semble montrer le chemin de la solution la plus adéquate pour la bourgeoisie nationale et l'ensemble du bloc américain. Ceci déjà parce que le PS de Mitterrand, force dominante de la coalition, est atlantiste, qu'il se chargera probablement d'étatiser graduellement la société et qu'il a le potentiel idéologique adéquat pour mystifier la classe ouvrière.
Dans le bloc soviétique, les tentatives de la bourgeoisie pour maintenir sa cohésion interne avec ses satellites se sont heurtées à des difficultés, l'année dernière. Dans ces pays, le fait que la vie politique et économique ait déjà été absorbée par l'Etat signifie que la bourgeoisie a un champ de manoeuvre très restreint contre la crise actuelle. L'incapacité de la bourgeoisie polonaise, par exemple, de persuader la classe ouvrière d'accepter la hausse brutale des prix en 1976, indique la rigidité extrême des régimes du bloc soviétique, et la profondeur de la crise politique qu'ils ont à supporter comme résultat. En Tchécoslovaquie, les bureaucrates et les gauchistes dissidents du parti donnent à la fraction de la bourgeoisie au pouvoir de sérieuses migraines. La "Démocratie" qu'ils défendent, amènerait, si elle était acceptée, sans aucun doute l'éclatement de la cohésion du bloc soviétique dans son ensemble et de l'appareil d'Etat. Le fait que le mouvement de la Charte 77 coïncide avec la propagande américaine sur les libertés civiles, augmente le danger que représente ce mouvement bourgeois dissident pour les intérêts du bloc soviétique. L'évidente incapacité dans laquelle se trouve la classe dominante tchèque de se servir de ces dissensions (qui se considèrent elles-mêmes comme une arme contre le danger prolétarien), pour mystifier la classe, éclaire sur la banqueroute politique du bloc soviétique.
Les imbroglios de la démocratie bourgeoise dans les dernières élections en Inde ou au Pakistan montrent l'extrême faiblesse de la bourgeoisie dans le tiers-monde alors qu'elle est durement secouée par la crise. Alors que le parti populaire pakistanais de Bhutto et le parti du Congrès de Gandhi sont réellement les forces les plus aptes à gouverner, la force des secteurs de la bourgeoisie moins viables politiquement qui constituaient l'opposition dans ces deux pays, était telle que, dans le cas du Pakistan, il n'a pas pu être écarté ni neutralisé sans que les élections soient manipulées et faussées et que la fraction dominante fasse appel à la force armée pour préserver son pouvoir. En Inde, le fait que l'opposition soit parvenue à ses fins, signifie qu'une période de dislocation politique est à l'ordre du jour dans ce pays, et qu'en conséquence un retour vers le renforcement de l'Etat, en particulier de l'armée, en sera un résultat inévitable à long terme.
Les évènements en Chine de l'année dernière ont aussi montré la fragilité des pays du tiers-monde et des pays "socialistes". L'élimination du secteur le plus arriéré de la bourgeoisie chinoise, les radicaux qui soutenaient l'indépendance nationale, économique, sociale et militaire ne s'est pas achevée sans de violentes secousses dans l'appareil du parti (comme en témoigne la vague d'exécutions ayant lieu actuellement) ni sans l'utilisation de l'armée pour mater la rébellion dans le pays. L'incapacité de la bourgeoisie chinoise à concilier ses différents d'une manière stable et qui va continuer malgré la victoire des "progressistes", proaméricains modérés, montre avec certitude que des convulsions extrêmes auront lieu dans l'appareil politique au fur et à mesure que la crise s'aggravera et que la classe ouvrière reprendra le chemin de la lutte. Par l'intégration plus grande de la Chine et de l'Inde dans le bloc américain, résultat des récents évènements, aggrave les échecs dont l'URSS souffre sur l'arène mondiale.
La situation en Grande-Bretagne
La Grande-Bretagne ne se trouve pas en face de problèmes fondamentalement différents de ceux rencontrés par les autres capitaux européens faibles, bien que sa crise politique soit moins aiguë que d'autres et que ses problèmes économiques aient d'une certaine façon une origine unique. Autrefois, première puissance capitaliste du monde mais éliminée en tant que telle par les deux guerres mondiales, la Grande-Bretagne a perdu ses colonies, sa force militaire, particulièrement sa force navale et sa position d'usurier de la production mondiale. Son PNB ne représente plus aujourd'hui qu'environ 6 % de la production totale des pays de l'OCDE. La productivité faible et sans espoir de son capital, résultat de l'achèvement de son industrialisation au début du siècle, se traduit par le fait que l'âge moyen de l'industrie britannique (aujourd'hui 34 ans) représente trois fois celui de la puissance japonaise ! Ces facteurs aident à expliquer le rapide déclin de la compétitivité britannique sur le marché mondial.
Depuis 1972, la balance commerciale du capital britannique n'est plus excédentaire. Vers l'automne 1976, à la suite d'une forte"course à la livre", celle-ci avait perdu 44,7 de sa valeur d'avant 1967. Le ministre de l'Economie et des Finances, Denis Healy devait faire appel au bloc US, au travers du FMI, pour un prêt de 3,9 milliards de dollars pour préserver la vie de l'économie britannique. Inévitablement, des conditions ont accompagné ce prêt, conditions qui semblent exprimer une stratégie économique et politique dans l'ensemble du bloc américain. Cette stratégie, à son tour, est le reflet du processus de renforcement interne du bloc impérialiste. Au niveau économique, une politique déflationniste était "conseillée", à savoir :
- une réduction draconienne des dépenses du gouvernement qui avaient entraîné un déficit annuel de 11 milliards de livres dans ce secteur ;
- une restriction du crédit pour essayer de diminuer la masse monétaire et contribuer, avec la réduction des dépenses gouvernementales à arrêter le taux d'inflation britannique " au dessus de la moyenne.
- un refus des barrières douanières et du protectionnisme en général.
La stratégie comprenant ces éléments a été clairement conçue dans le sens d'une acceptation d'un affaiblissement continuel de la position compétitive de la Grande-Bretagne sur le marché mondial et pour préserver un maillon de la chaîne capitaliste européenne.
Au niveau politique, un soutien implicite a été donné au gouvernement centre-gauche de Callaghan et de Healy parce que tout en mettant en place la politique économique mentionnée, il allait :
- maintenir son engagement dans le bloc américain au travers de la participation à l'OTAN, son importante capacité nucléaire et son armée en Allemagne fédérale ;
- maintenir son engagement dans le Marché Commun ;
- poursuivre une politique de fusion graduelle des éléments les plus faibles des capitaux privés avec l'Etat sans renverser l'économie mixte, le processus parlementaire et les intérêts américains dans le capital britannique ;
- maintenir l'ordre social au travers de l'alliance avec les syndicats et la mystification du contrat social, tout en continuant d'attaquer la consommation et le niveau de vie des ouvriers.
Toutefois, une telle situation politique et économique ne coïncide pas nécessairement avec les intérêts strictement nationaux de la bourgeoisie britannique qui, à long terme, sont de créer une économie complètement étatisée derrière laquelle la classe ouvrière puisse être mobilisée par une équipe de gauche.
Les contradictions entre les intérêts du bloc impérialiste et de la nation font surgir d'immenses problèmes auxquels se trouve confrontée l'équipe de Callaghan aujourd'hui. La politique déflationniste imposée par le FMI n'améliore pas de manière significative la situation économique britannique qui va probablement empirer en 1977 lorsque les pleins effets de la dévaluation de la livre se feront sentir. Les mesures pour centraliser l'économie et la vie politique dans les mains de l'Etat, mesures qui vont fournir un cadre à long terme pour faire face à la crise n'ont pas lieu très rapidement. En fin de compte, l'équilibre entre les classes et le contrat social sur lequel il est basé, commence à s'effondrer.
Les tentatives que l'actuel gouvernement travailliste a faites pour nationaliser certains secteurs de l'industrie et éliminer les éléments parasites de l'appareil politique et économique, bien qu'assez mitigées, ont cependant rencontré de nombreux obstacles. Le vote sur les nationalisations des chantiers navals a été arrêté par l'opposition de la Chambre des Lords et vient juste de passer maintenant que les conservateurs se sont assurés que l'industrie de réparation des bateaux, encore bénéficiaire, resterait dans les mains du secteur privé. Le rapport Billock, ainsi qu'un plan ingénieux pour étatiser l'industrie avec l'aide des syndicats, ont été finalement mis au rancart après une forte opposition de la part des secteurs traditionnels de la bourgeoisie et des partis de droite. Des mesures pour restreindre l'activité des conservateurs à la Chambre des Lords et nationaliser les banques, sont loin d'être mises en place et de devenir effectives. L'arrêt de ces mesures n'est pas seulement le résultat de la nature modérée du gouvernement travailliste mais aussi de la force électorale des secteurs les plus arriérés de la bourgeoisie. Maintenant, les travaillistes n'ont plus la majorité au Parlement et le gouvernement est obligé de faire une quasi coalition avec l'aile droite : le parti libéral. Cela va sans aucun doute retarder la politique d'étatisation.
Le gouvernement travailliste et ses représentants dans la classe ouvrière- les syndicats - arrivent de plus en plus difficilement à maintenir le contrat social. Les marins lui ont déjà montré leur hostilité en août, l'année dernière, les mineurs et les cheminots semblent aussi promettre de le rejeter dans le futur, les ouvriers de l'industrie automobile, particulièrement, British Leyland, la grande compagnie subventionnée par l'Etat, se sont souvent mis en grève contre les effets du contrat. Alors que la raison mise en avant pour les quatre semaines de débrayage par les outilleurs de British Leyland, était le maintien de droits de négociations différenciés et séparés, sa cause profonde était l'appauvrissement que le blocage des salaires impose à l'ensemble de la classe. Bien que le débrayage ait été contenu par les shop stewards qui ont empêché la généralisation de la grève et le dépassement des préoccupations professionnelles, le refus des ouvriers de rentrer au travail pour le "bienfait de l'intérêt national" (B.L symbolise la faiblesse du capital britannique) montre, en dépit de l'alliance ouverte entre les patrons et les syndicats et l'Etat, la capacité de lutter que la classe promet pour l'avenir.
Tous les principaux syndicats ont été obligés, sentant le mécontentement de la classe, de proclamer leur opposition ou leur doute envers le succès de la troisième phase du contrat social et de jouer serré. Le TUC dans son ensemble a refusé de se compromettre avec la troisième phase jusqu'à ce qu'il puisse voir le contenu du budget des finances, mais considérant que le contrat social est un pilier vital pour la survie de l'économie britannique, il est donc essentiel qu'il dure. Cependant, la bourgeoisie est déjà consciente que des concessions à certains secteurs de travailleurs et une application souple du contrat social à l'avenir sont essentielles si l'on veut la paix sociale.
Les trois axes fondamentaux auxquels se trouve confrontée la bourgeoisie aujourd'hui :
- la nécessité d'accélérer la domination de l'Etat sur la société,
- la nécessité d'éliminer ou de neutraliser les milieux conservateurs de l'économie et de la politique,
- la nécessité de mystifier la classe ouvrière ne peuvent être accomplis à long terme que par un changement vers la gauche de l'actuel gouvernement.
- un plan de réduction des dépenses d'armement et d'engagement dans l'OTAN,
- elle défend une politique d'autarcie (barrières douanières et retrait de la CEE),
- ses plans à long terme sur la"propriété publique" menacent les intérêts spécifiques des USA et compromettent politiquement les secteurs de la bourgeoisie britannique favorable aux USA,
- ses liens étroits avec le PC et certains groupes trotskystes pourraient déterminer une orientation prosoviétique sur l'arène internationale.
Mais en dépit de ces importants obstacles, la gauche travailliste reste la seule fraction de la bourgeoisie dont les perspectives à long terme puissent maintenir l'ordre capitaliste. Pour cette raison et quelles que soient les difficultés qui existent aujourd'hui, un compromis entre le bloc américain et la gauche travailliste pourrait légitimer cette dernière pour le pouvoir dans des perspectives à long terme.
L'adoption de la récente quasi coalition avec les libéraux, premier mouvement dans cette direction depuis la guerre, est le signe de la crise politique qui va de plus en plus affecter la bourgeoisie britannique. A court terme, le "compromis" avec les libéraux signifie un mouvement à droite et une augmentation des difficultés pour préparer lentement une équipe gouvernementale de la gauche travailliste. Il est donc probable que cette dernière prenne le pouvoir dans le futur en réponse au resurgissement de la classe et à l'incapacité de l'équipe actuelle d'y faire face. Cependant, aujourd'hui et dans un avenir immédiat, le régime Callaghan constitue la fraction gouvernementale la plus adaptée. Le pacte libéraux-travaillistes est un signe qu'en dépit de l'impopularité électorale du gouvernement ; la bourgeoisie comprend la nécessité qu'il reste au pouvoir.
La situation en Irlande du Nord est sans aucun doute un obstacle aux efforts de la bourgeoisie britannique pour faire face à la crise. Non seulement, les groupes terroristes rivaux mais aussi les partis parlementaires résistent au pouvoir centralisé de l'Etat britannique. Les infructueuses campagnes terroristes imposent de sévères restrictions de la production dans le nord et la présence continue de l'armée britannique est une saignée sur les ressources militaires de la Grande-Bretagne, qui doivent, de plus, être restreintes pour remplir ses obligations à l'égard de l'OTAN.
La révélation du "sale travail" fait par l'armée en Irlande du Nord et les promesses de Carter pour arrêter l'argent allant des USA à l'IRA semblent montrer que la bourgeoisie envisage un retrait ou une diminution de la présence de troupes britanniques en Irlande du Nord.
LUTTE DE CLASSE
Les attaques contre le niveau de vie et les salaires de la classe constituent les "solutions" les plus importantes de la bourgeoisie à la crise parce que, premièrement c'est un moyen essentiel de réduire le prix des denrées vendues sur le marché et deuxièmement cela l'aide à préparer la classe à des sacrifices pour la nation et finalement à la mobilisation pour la guerre. La première vague de lutte de classe depuis 1968 était une réponse élémentaire du prolétariat aux premières atteintes de la crise sur son niveau de vie. Elle a pris les partis de gauche du capital et les syndicats au dépourvu et les a dépassés un moment. Depuis, la bourgeoisie a regagné du terrain en utilisant dans la plupart des cas ces ennemis les plus implacables de la classe ouvrière que sont les équipes de gauche au pouvoir qui ont persuadé, jusqu'à un certain degré, la classe d'accepter l'austérité "pour le bien du pays" et les syndicats qui ont fidèlement cloisonné la lutte dans des limites acceptables. Ceci a amené un certain reflux pendant lequel la classe a été obligée d'approfondir sa conscience de la situation présente. Ce moment de basse activité est donc, en partie une réponse à la perception implicite que les luttes économiques sont de moins en moins payantes et que seuls la généralisation et l'approfondissement de la lutte peuvent amener des avantages. En même temps, un tel chemin implique aujourd'hui une confrontation consciente avec la gauche. Le sentiment de l'immensité d'un tel pas et de ses implications, le commencement d'une véritable guerre de classe a laissé la classe dans un état passif mais non vaincu.
La bourgeoisie, pour l'avenir, en dépit de son adoption de la gauche, a dévoilé plusieurs des possibilités qui lui sont offertes, pour affronter le prolétariat. A cause de 1'approfondissement de la crise, elle est capable de moins de manoeuvres et une fois que la carte de gauche aura été jouée, elle aura utilisé sa source de mystification la plus importante. L'approfondissement constant de la crise mondiale assure que l'immense affrontement entre les classes est à l'ordre du jour dans le futur. La lutte de classe en Pologne et en Espagne en 1976, le surgissement en Egypte et les grèves en Israël cette année et l'activité de la classe en Ethiopie occidentale sont des signes de résurgence du prolétariat après le calme relatif depuis 1972. Les réponses de la bourgeoisie à la crise, ses conflits inter impérialistes, ses tentatives d'étatiser chaque capital national et tout son jeu politique seront interrompus par la reprise de la lutte de classe. La tendance vers la barbarie capitaliste, qui semble être évidente en ce moment, sera éclipsée lorsque la solution du socialisme deviendra une possibilité plus concrète. Aujourd'hui, les révolutionnaires doivent se préparer à la seconde vague de montée des luttes depuis la fin de la période de la contre-révolution.
S
Vie du CCI:
Géographique:
- Grande-Bretagne [84]
Les confusions politiques de la "Communist Workers' Organisation"
- 2855 reads
Dans le texte "Le CWO et les leçons du regroupement des révolutionnaires" (Rint. 9 [85]), nous avons vu comment les positions sectaires adoptées par le CWO le menaient à la désintégration organisationnelle et à un isolement grandissant du mouvement révolutionnaire. Nous allons examiner maintenant comment cet isolement renforce un certain nombre de confusions théoriques importantes qui sont autant de signes de l'impasse politique dans laquelle s'est enfermé le CWO.
Nous ne pouvons nous étendre ici sur toutes les différences que nous avons avec le CWO. En particulier, nous devrons laisser la question des fondements économiques de la décadence à une date ultérieure, tout en reconnaissant pleinement l'importance de discuter de cette question au sein du mouvement ouvrier. Nous n'aborderons pas non plus la question générale de l'organisation des révolutionnaires, parce que nous avons déjà publié une longue critique des conceptions organisationnelles du CWO (WR 6 et RI 27 et 28 ; "Le CWO et la question de l'organisation"). Nous nous occuperons essentiellement des questions soulevées par la "critique" du CWO au CCI ("Les convulsions du CCI" - Revolutionary Perspectives n°4). Cependant, nous ne nous limiterons pas à ce texte. Les "convulsions" qui sont supposées être une explication des relations entre le CCI et le CWO dans le passé et un exposé de la nature "contre-révolutionnaire" du CCI, constituent un bon point de départ pour une critique des erreurs du CWO, parce que c'est une expression significative de l'irresponsabilité et de l'incohérence croissantes de ce groupe.
Les convulsions de qui ?
Nous n'entendons pas disséquer ce texte dans ses moindres détails. En effet, nous avons déjà répondu à la partie du texte qui constitue la version CWO des rapports entre le CWO et le CCI dans l'article de la Rint n°9, qui faisait un bilan de toute l'expérience et en tirait les leçons pour le regroupement des révolutionnaires. Et la récente scission du CWO a succinctement montré que c'est le CWO et non le CCI, dont les pratiques organisationnelles conduisent à toutes sortes de convulsions. De même il serait futile d'essayer de réfuter chaque attaque faite au CCI dans cet article, la plupart étant, si manifestement absurdes qu'elles peuvent être rejetées par une lecture, même superficielle, des textes du CCI. Par exemple, le CCI est accusé (RP n°4, pages 41-42) de voir les causes de la défaite de la Révolution Russe, non pas dans le reflux de la vague révolutionnaire mondiale mais dans "les erreurs idéologiques des ouvriers russes". Et pourtant, chacun des textes produits par le CCI sur la question russe insiste sur le fait que l’ensemble de l’expérience russe ne peut être compris que si on la replace dans le contexte international : on n'a qu'à se référer par exemple à l'article "la dégénérescence de la révolution russe" (Rint n°3), à la plateforme du CCI, etc.
Des accusations inconsidérées et sans fondement de cette sorte, faites sans références exactes, n'ont pas leur place dans la discussion sérieuse entre révolutionnaires. Ce comportement renforce aussi notre conviction que les attaques du CWO aux positions du CCI servent surtout à mettre en lumière les aberrations du CWO lui-même. Nous aborderons trois points importants dans ce débat :
- La crise, l'intervention, le regroupement.
- -La compréhension de la nature de classe des organismes politiques.
- La Révolution Russe et la période de Transition.
La crise, l’intervention et le regroupement
Beaucoup des accusations contre le CCI sur ces questions ont été traitées dans l'article "Le CWO et la question de l'organisation", aussi nous n'entrerons pas très en détail là-dessus. Mais en bref, le CWO affirme la chose suivante : le CCI n'a pas une vision de la crise présente du capitalisme comme d'un processus qui évolue graduellement vers un effondrement et vers une situation révolutionnaire. Ceci parce que nous adhérons à la théorie Luxemburgiste sur "l'opération de la loi de la valeur" (affirmation naïve, puisque la théorie luxemburgiste de l'accumulation et de la crise se base fermement sur la vision marxiste du système salarié en tant qu'expression de la généralisation de la loi de la valeur). De plus, nos erreurs en économie seraient étroitement liées à notre conception "volontariste" de l'organisation : "pour le CCI, parce que les marchés sont saturés, la crise est là et ne s'approfondira pas plus, ne gagnant qu'en extension. Donc, pour lui, les conditions objectives de la révolution sont déjà avec nous. Ce qui manque c'est l'instrument indispensable. Et le CCI croit qu'il est l'instrument indispensable, et que sa propagande apportera au prolétariat la volonté subjective" (RP n°4, page 38).
En réponse à cette grossière déformation de notre perspective, qu'on nous laisse dire avant tout que se baser sur l'analyse luxemburgiste de la crise ne signifie pas que l'approfondissement de la crise ne puisse être saisi comme un processus. Quand nous disons que le marché mondial est saturé, nous n'entendons pas que tous les marchés du monde sont absolument saturés : ce serait un non-sens car il ne pourrait pas y avoir d'accumulation du tout. Ce que nous disons en réalité, c'est que le marché est saturé, relativement aux besoins d'accumulation du incapacité du marché mondial à s'étendre de manière progressive "au rythme de la capacité de la production" implique que les conditions objectives de la révolution prolétarienne existent depuis 1914 ; mais cela ne veut sûrement pas dire que la révolution est possible dans n'importe quelle conjoncture.
La défaite de la vague révolutionnaire de 17-23 a signifié que cette perspective était reportée pour des dizaines d'années que l'humanité était condamnée à vivre des années la barbarie. Aujourd'hui, le resurgissement de la crise économique et le réveil de la lutte de classe dans le monde entier ouvrent de nouveau la perspective révolutionnaire.
Mais cela ne signifie pas que la crise a atteint son point le plus profond, ou que nous sommes à la veille d'une situation révolutionnaire imminente (voir par exemple les arguments contre l'activisme et le volontarisme dans l'article "Le premier Congrès du CCI" – Rint.5). Le CCI a souligné maintes et maintes fois que la crise présente du système serait un processus long, saccadé, irrégulier et graduel. Ceci parce que le capitalisme a découvert des palliatifs aux effets de la saturation du marché : étatisations, mesures fiscales, secteurs improductifs, économie de guerre, guerres localisées, etc. et peut ainsi éviter l'effondrement brusque du type déclin de 1929. C'est précisément parce que la crise s'approfondit de cette façon que le prolétariat pourra consolider sa force à travers toute une série de luttes, à travers lesquelles il développe la conscience subjective nécessaire pour un assaut politique contre l'ensemble du système. Ce sera un processus dur et pénible dans lequel la classe acquérra une compréhension de sa situation à la dure école de la lutte elle-même. Tant que la classe ne développera pas sa compréhension subjective de cette façon, l'intervention des révolutionnaires gardera un impact relativement faible.
Rien ne peut être plus étranger à nos positions que l' idée selon laquelle tout ce qui manque aujourd'hui c'est que le CCI bondisse sur la scène et "démystifie" la classe et la conduise à la Révolution. Cela serait une prétention absurde de la part d'une organisation qui regroupe une poignée de révolutionnaires ; mais, de toutes façons, ce n'est tout simplement pas notre rôle de "sauver" la classe et ce ne sera pas le rôle du Parti demain. En fait, c'est parce que le CWO a lui-même une vision proche du volontarisme et du substitutionnisme qu'il la"voit" partout ailleurs et chez d'autres.
Pour lui, dans une situation objectivement révolutionnaire, "les communistes essayeront par leur exemple et leur propagande, de diriger cette activité dans la direction du communisme" (RP.4, page 38). L'erreur, c'est que les communistes ne "dirigent" pas la classe ouvrière vers le communisme. Ni aujourd'hui, ni demain, l'organisation des révolutionnaires n'a pas la tâche d'organiser, de démystifier, ou de diriger la classe. L'organisation communiste est un facteur actif dans l'auto organisation et l'autodémystification de la classe. Cela, nous l'avons dit des centaines de fois dans tous nos écrits sur la question de l'organisation : voir par exemple la partie sur l'organisation dans la plateforme du CCI.
Il en découle que, contrairement a ce que dit le CWO (RP.4, page 38) le CCI n'est pas engagé dans l'aventure opportuniste de se poser comme Parti avant que les conditions objectives pour sa constitution réelle ne soient remplies. Le Parti de demain émergera pendant le cours de l'ascension longue et difficile du prolétariat vers sa conscience. Mais ce que le CWO persiste à ne pas comprendre, c'est que le Parti n'est pas un produit automatique ou mécanique de la lutte de classe : ses fondements doivent être consciemment et méthodiquement élaborés par les fractions révolutionnaires qui le précèdent. Et, dès que les possibilités pour un tel travail sont ouvertes par la montée de la lutte de classe, les révolutionnaires sont confrontés à la responsabilité de commencer à s'engager dans le processus qui mène à la constitution du Parti, même si c'est une tâche extrêmement longue et ardue.
En termes concrets, cela signifie travailler au regroupement des révolutionnaires au niveau mondial aujourd'hui. Le CWO, en tout état de cause, ne pense pas que ce soit le moment pour un tel regroupement (RP.4 page 38) et, en fait, le CWO ne fait pas que choisir d'attendre passivement une organisation révolutionnaire internationale sortie du néant, son attitude sectaire actuelle l'oblige à se tourner contre toute tentative de regroupement principiel aujourd'hui. Ce qui amène simplement à mettre en évidence le fait que les révolutionnaires aujourd'hui doivent choisir entre : soit être un facteur actif dans le processus qui mènera à la constitution du Parti, soit en être une entrave, être un obstacle sur le chemin du mouvement révolutionnaire. Il n'y a pas de troisième voie.
La nature de classe des organisations politiques
- "L'histoire est donc affranchie de son caractère de Masse, et la Critique qui prend des libertés avec son objet crie à l' histoire : c'est de telle et telle manière que tu dois être déroulée !" - Marx- Engels, "La Sainte Famille".
A en croire le CWO, les erreurs du CCI sur la crise et l'intervention sont des "lignes de démarcations" et non pas des frontières de classe. Ce qui révèlerait vraiment que nous sommes une organisation du capital, ce sont les positions que nous défendons sur la révolution russe et sur la période de transition dont les leçons sont tirées essentiellement de la révolution russe.
"En termes concrets, ils (le CCI) sont capitalistes parce que :
- ils défendent la Russie capitaliste d'Etat après 1921 ainsi que les Bolcheviks ;
- ils soutiennent qu'un gang capitaliste d'Etat comme l'était l'opposition de gauche trotskyste était un groupe prolétarien ;
- ils défendent l'idée que la classe ouvrière, dans la révolution, doit composer avec les classes capitalistes que sont les paysans et la bourgeoisie internationale."(RP4, page42-43).
Ce passage remarquable montre clairement que le CWO ne sait pas comment on détermine la nature de classe d'une organisation politique. Prétendre que le CCI "défend" la Russie après 21 est la marque d'une confusion. Premièrement, cela obscurcit le problème global qui consiste à analyser la dégénérescence de la révolution, en confondant l'Etat et le Parti, comme si les deux étaient identiques tout au long du processus (cette confusion réapparaît dans leur texte sur la Révolution Russe, comme nous le verrons).
Plus important encore, l'accusation est basée sur l'idée (si chère aux trotskystes) que les révolutionnaires doivent se plonger dans le passé et prendre position sur des questions qui n'avaient pas été encore clarifiées par le mouvement révolutionnaire (la question de la défense ou non de la Russie n'a été tranchée que bien après que la Révolution soit morte). Pour les marxistes, le programme communiste est le produit vivant des luttes passées de la classe ouvrière, une synthèse de toutes les leçons que la classe a apprises au fil de décennies de défaites, d'erreurs et de victoires. C'est quelque chose qui est sécrété à travers le processus historique, et les révolutionnaires sont à tout moment une partie de ce processus. Il n'est pas possible aux révolutionnaires de se poser hors de ce processus et de regarder les évènements passés en termes de : "Ce qu'ils auraient fait" s'ils avaient été là. De telles questions n'ont pas de sens, parce que les révolutionnaires aujourd'hui ne sauraient pas ce qu'ils savent si la classe n'avait pas fait l'expérience de ces luttes et n'était devenue consciente des leçons de ces expériences en y participant. Les révolutionnaires ne peuvent avoir la clarté qu'ils ont aujourd'hui qu'à cause des erreurs et des défaites d'hier ; ce n'est pas une solution que de revenir sur ces défaites en se projetant dans le passé. Le fondement même de la question: "Qu'aurions-nous fait ?", c'est une vision idéaliste du développement de la conscience révolutionnaire, posant la clarté communiste existant dans un éther intemporel, hors du mouvement historique réel de la classe. Bien sûr, les révolutionnaires peuvent analyser le passé et reconnaître les fractions et tendances qui ont exprimé le mieux les nécessités du prolétariat à l'époque, et critiquer les erreurs et les confusions d'autres tendances. Mais ils le font dans le but de clarifier les leçons pour aujourd'hui, pas pour engager de puériles "empoignades" avec les fantômes des traîtres du passé.
A nouveau, l'affirmation du CWO suppose que lorsque les révolutionnaires comprennent qu'une organisation prolétarienne avant eux a pu commettre de profondes erreurs, voire des crimes, ils défendent peu ou prou ces crimes ; en d'autres termes, si le CCI affirme que le Parti Bolchevik, bien qu'en dégénérescence en 1921, n'était pas encore une organisation bourgeoise, alors, il doit "défendre" toutes les actions et politiques contre-révolutionnaires des bolcheviks de cette période : Kronstadt, Rapallo , le Front Unique, etc.. Là encore, notre condamnation sans équivoque de cette politique est attestée par n'importe quel texte de nos publications. Le problème du CWO est qu'il ne comprend pas les critères pour juger précisément du passage d'une organisation prolétarienne dans le camp bourgeois. Cela vaut aussi bien pour son appréciation du Parti Bolchevik, que du CCI. Il n'appartient pas seulement aux révolutionnaires de "juger" de la mort d'une organisation prolétarienne. Cela ne peut être tranché qu'à la lumière de grands évènements historiques : guerres mondiales ou révolutions, qui ne laissent aucun doute sur le camp auquel ils appartiennent. Cela ne saurait être l'affaire d'une "addition au hasard" des positions politiques, l'histoire ayant montré qu'une organisation révolutionnaire peut très bien apporter une contribution vitale au mouvement ouvrier, tout en étant profondément dans l'erreur sur des points cruciaux. Ce fut le cas des Bolcheviks en 1917 (luttes de libération nationale, par exemple) et de Bilan dans les années 30 qui maintenait une position erronée sur le Parti et les syndicats, et même sur l'analyse exacte de l'économie russe. Mais, quand un organisme auparavant prolétarien abandonne ouvertement la position internationaliste, il peut être déclaré définitivement mort pour la classe ouvrière. C'est pourquoi les révolutionnaires disaient que la social-démocratie en 1914 ou le trotskysme en 1939, étaient passés une fois pour toutes dans le camp bourgeois, ayant tous deux participé à la mobilisation de la classe dans le carnage impérialiste mondial. C'est aussi pourquoi l'adoption de la théorie du "socialisme dans un seul pays" a signifié l'abandon définitif de la révolution internationale par les PC, et a démontré qu'ils étaient devenus les défenseurs du capital national et rien d'autre.
D'après le CWO, l'écrasement de l'insurrection de Kronstadt par les Bolcheviks "a placé les Bolcheviks en dehors de la révolution et en a fait une organisation contre-révolutionnaire". (RP.4 page 22). A première vue, il pourrait sembler que la répression physique d'un soulèvement ouvrier soit suffisante pour prouver qu'un parti n'est plus dans le camp prolétarien, mais nous devons garder à l'esprit que le soulèvement de Kronstadt était un évènement sans précédent : les ouvriers se soulèvent contre "l'Etat Ouvrier" et le parti communiste qui le contrôlait. En réprimant la révolte, les Bolcheviks ont sans aucun doute précipité leur propre fin en tant que parti révolutionnaire, mais ils n'abandonnèrent pas pour autant un principe bien établi comme l'opposition à la guerre impérialiste. Au contraire, leur réponse au soulèvement était la conséquence logique des idées défendues par l'ensemble du mouvement ouvrier de l'époque : l'identification entre Etat et dictature du prolétariat et la prise en charge du pouvoir d'Etat par le Parti. L'insurrection de Kronstadt a produit un tel désarroi au sein du mouvement ouvrier (Gauche communiste comprise) précisément parce que le mouvement n'avait pas de critères pour comprendre une telle situation.
Au contraire de ceci, la théorie du socialisme en un seul pays était un rejet explicite de tout ce que les Bolcheviks avaient défendu en 17, et fut dénoncée comme tel par les fractions révolutionnaires de l'époque. Aussi criminelle que soit la réponse des Bolcheviks à l'insurrection de Kronstadt, nous ne pensons pas que ce fut la preuve définitive de leur passage dans le camp bourgeois[1] [86] Les évènements de Kronstadt sont une manifestation violente de la gravité et de la profondeur du processus de régression et de dégénérescence dans lequel s'est trouvé engagée la révolution d'Octobre et le Parti Bolchevik. Mais aussi bien la Révolution et le Parti, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie, contenaient encore en eux des forces vivantes de la classe capables de réactions de classe et qui se sont manifestées effectivement dans ce dernier combat inégal mais décisif : révolution internationale ou intérêt national (socialisme en un seul pays). En prenant Kronstadt comme le point de la mort, on ne comprend pas le sens de luttes épiques qui ont secoué et bouleversé jusqu'à leurs fondements le Parti Bolchevik, l'I.C. et tout le mouvement révolutionnaire international de 1921 à 1927. Le radicalisme verbal sur 21 ne sert finalement au CWO que de prétexte pour ignorer les évènements ultérieurs et pour s'épargner la peine de les analyser et de les comprendre.
Nous pensons aussi que la caractérisation de l'"Opposition de Gauche "comme un" gang du capitalisme d'Etat" depuis le début est une simplification grossière ; cependant, nous ne pouvons en débattre ici (voir la partie de l'article "La Gauche Communiste en Russie 1918-1930" Rint n°9 [85]). Nous préférons traiter de l'affirmation selon laquelle le fait de dire que les Bolcheviks étaient encore dans le camp prolétarien après 21 ou que l'Opposition de Gauche en 23 était un courant prolétarien, fait du CCI un groupe bourgeois.
Comme nous l'avons dit, les révolutionnaires ne dénoncent pas une organisation comme étant bourgeoise avant qu'elle n'ait ôté tout doute possible en abandonnant clairement le terrain international de la classe ouvrière, ce qui en fait une expression du capital national. Un groupe peut avoir bon nombre de confusions, mais s'il appelle au défaitisme révolutionnaire contre la guerre impérialiste, s'il défend la lutte autonome du prolétariat contre le capital national, il doit être considéré comme faisant partie du mouvement ouvrier. Il ne fait aucun doute que le CCI défend cette perspective internationaliste. Ainsi, même si la question de "1921" était une frontière de classe, cela ne suffirait pas à qualifier le CCI de contre-révolutionnaire. De la même façon, même si le CCI avait des confusions dangereuses sur le problème de la période de transition, ce n'est que dans une période révolutionnaire, quand toutes les frontières de classe sur cette question sont clairement tracées que l'on peut dire que les confusions d'un groupe sur ce point l'ont finalement conduit dans le camp ennemi. Porter un tel jugement à l'avance, c'est abandonner la possibilité de convaincre une organisation prolétarienne de ses erreurs, et aussi longtemps qu'une organisation est dans le camp ouvrier, elle est capable de corriger ses erreurs, ou au moins, de produire des fractions qui adopteront une position révolutionnaire.
Mais en tous cas, la question de "21" ne saurait être par définition une frontière de classe (et bien sûr, nous pensons que c'est le CWO et non le CCI qui souffre d'une plus grande confusion sur la période de transition, ainsi que nous le verrons). Les révolutionnaires élaborent des positions communistes, des frontières de classe sur la base de l'expérience passée de la classe, dans le but, non pas de juger rétrospectivement le passé, mais de dresser des poteaux indicateurs pour les luttes présentes et à venir de la classe. Ainsi, la question de la défense de la Russie est devenue, à travers une série d'évènements cruciaux, une frontière de classe écrite en lettres de sang. Cela à cause de son lien direct avec la question clef de l'internationalisme. La deuxième guerre mondiale a montré une fois pour toutes que la défense de l'URSS ne pouvait que conduire à la défense de la guerre impérialiste. Au début des années 20, cette question avait encore à être clarifiée dans le mouvement ouvrier, mais par la suite, la non-défense de l'URSS devient la pierre angulaire de toute perspective révolutionnaire.
Mais alors qu'il n'y a de place pour aucune ambiguïté sur cette question fondamentale, il est impossible de voir comment le problème de la date exacte du passage de l'Etat russe et/ ou des PC à la contre-révolution, pourrait être une frontière de classe aujourd'hui. Le CWO n'avance aucun argument pour expliquer qu'un groupe qui considère que les PC sont morts disons en 26 ou 28 ou que l'Opposition de Gauche de 1923 avait un caractère prolétarien, est un groupe qui défend le capitalisme aujourd'hui. Cela signifie-t-il qu'un tel groupe appelle au front unique avec les PC et les trotskystes ou à la défense de la Russie ? Bien sûr que non. La dénonciation du caractère bourgeois des PC, des trotskystes et de la Russie aujourd'hui sont de véritables frontières de classe parce qu'elles découlent d'une compréhension de la dégénérescence de la Révolution Russe. Ce sont des frontières de classe parce qu'elles ont une influence directe sur les positions que prendront les révolutionnaires, dès aujourd'hui et dans le futur, dans les moments cruciaux de la lutte de classe. Mais, que l'on considère comme date de la mort des PC, 1921, 23, 26 ou 28 est tout à fait secondaire pour la défense de ces frontières de classe.
Peut-on imaginer, par exemple, les conseils ouvriers de demain, dépensant autant d'énergie à débattre du passage des PC dans le camp ennemi qu'ils en utiliseront à chercher les moyens de détruire leur influence réactionnaire sur la classe ouvrière ? Non. Inventer des frontières de classe sur chaque aspect de l'interprétation historique ne sert qu'à détourner l'attention des problèmes réels auxquels s'affronte la classe. A moins de définir les frontières de classe à partir de critères très stricts, on en arrive à en faire ce que bon nous semble ou ce que ses intérêts de petite secte exigent. Après tout, pourquoi restreindre les frontières de classe à la date de la mort du bolchevisme ? Pourquoi ne pas dresser une frontière de classe à propos du passage définitif de l'anarcho-syndicalisme dans le camp bourgeois, ou ne pas prôner la séparation organisationnelle sur la question de quand le blanquisme a cessé d'être un parti du mouvement ouvrier, ou encore si oui ou non Pannekoek a eu raison de quitter la social-démocratie hollandaise en 1907 ? Pourquoi vraiment ne pas mettre autant de frontières de classe qu'on le veut, surtout si cela sert à faire de vous "le seul et l'unique" défenseur du programme communiste intégral...
Puisque le CWO n'a pas de critères clairs pour déterminer de la nature de classe d'une organisation, ses accusations à l'égard du CCI sont tout à fait inconsistantes. Dans l'article "Convulsions ...", il n'apparaît pas clairement si les groupes du Courant International ont jamais été une partie du prolétariat, et pourtant, nous trouvons l'idée que "ceux qui allaient former le CWO ont repris beaucoup d'idées positives de RI" (RP 4, page 36). Des idées positives ? Reprises d'une organisation contre-révolutionnaire ? Et, si le Courant était auparavant prolétarien et qu'il soit passé dans le camp bourgeois, quand et pourquoi cela s'est-il passé ?
Et si la position du CCI sur l'Etat (c'est-à-dire que l'Etat et la dictature du prolétariat ne sont pas identiques) et sur "1921" en font un organe contre-révolutionnaire aujourd'hui, pourquoi le CWO reconnaît-il (cf. RP 5) les précurseurs du CCI -Bilan et d'Internationalisme- comme des organisations communistes, alors que tous deux défendaient une position sur l'Etat dans la période de transition qui est précisément la base de la position majoritaire dans le CCI aujourd'hui ? (De même que pour la mort de l'internationale Communiste, la Gauche Italienne avait coutume de la situer en ... 1933 !). Quels évènements fondamentaux dans la lutte de classe depuis les années 40 ont donc finalement clarifié la question de l'Etat dans la période de transition, à tel point que quiconque défend aujourd'hui les positions de Bilan et d'Internationalisme est contre-révolutionnaire ? Peut-être que le CWO considère que cet évènement fondamental n'est autre que l'apparition du CWO, qui a tranché tous les problèmes une fois pour toutes ? Mais, en réalité, des questions aussi cruciales ne peuvent être définitivement tranchées que par la lutte révolutionnaire de toute la classe ouvrière.
La période de transition et la Révolution Russe
Les erreurs du CWO sur la période de transition sont intimement liées à son incompréhension de la Révolution Russe, et l'étendue de sa confusion sur les deux questions a été péniblement exposé dans sa récente oeuvre sur la Révolution Russe "Révolution et Contre-révolution en Russie 1917-23" (RP 4). L'essence de sa confusion peut se résumer dans sa réaction à l'affirmation du CCI selon laquelle :
- "...L'opération de la loi de la valeur est le produit de l'ensemble du monde capitaliste et ne peut en aucune façon et par aucun moyen être éliminée dans un seul pays (ni même dans un des pays les plus développés) ou dans un ensemble de plusieurs pays". (Rint.3 page 23 -"La Dégénérescence de la révolution russe".)
C'en est trop pour le CWO. Pour lui, cela ne peut que signifier que le CCI défend le capitalisme d'Etat, ou l'autogestion pendant la révolution (RP 4, page 40). Le CWO cependant, ne réussit pas à répondre clairement à la question : la loi de la valeur peut-elle, oui ou non, être abolie dans un seul pays ? Un mode de production communiste peut-il, oui ou non, être réalisé en un seul pays ? Le CWO ne répond pas. Mais ailleurs, il apparaît vraiment qu'il croit que le travail salarié, la loi de la valeur, en bref le capitalisme, peuvent être abolis dans le cadre national. L'article de RP, publié dans Worker's Voice n°15 parle de la construction d'"économies communisées" dans des bastions prolétariens et en général, le CWO semble croire que si un bastion prolétarien se coupe du marché mondial et élimine la forme salaire et l'argent, alors, le mode de production communiste est établi.
Soyons tout à fait clairs à ce propos. L'argent, le salaire, etc., ne sont que des expressions de la loi de la valeur, et à son tour la loi de la valeur est une expression du développement insuffisant, de la fragmentation des forces productives. En somme, une expression de la domination de la pénurie sur l'activité productive des hommes. L'élimination de certains aspects à travers lesquels s'exprime la loi de la valeur ne signifie pas l'élimination de la loi de la valeur elle-même, ce qui ne peut avoir lieu que dans une société d'abondance. Et une telle société ne peut être construite qu'à une échelle mondiale. Même si les ouvriers au sein d'un bastion révolutionnaire éliminaient l'argent et l'échange et distribuaient directement tous les produits à la population, nous devrions encore appeler le mode de production au sein du bastion un mode de production régi par la loi de la valeur parce que tout ce que les ouvriers feraient ou seraient capables de faire serait largement déterminé par leurs relations avec le monde capitaliste extérieur. Les ouvriers seraient encore soumis à la domination, à l'exploitation du capital global. Ils ne feraient que socialiser la misère dans le cadre permis par le blocus capitaliste, parce que jamais un mode de production communiste ne peut appeler une telle misère : la faim, la queue devant les boulangeries, les inévitables marchés noirs, etc.. Une économie "communiste" ce serait mentir à la classe ouvrière et la détourner de sa lutte. Dans une telle situation, la question n'est pas à préconiser une "défense" du capitalisme d'Etat ou de l'autogestion ; la question c'est d'appeler le capitalisme, et de clarifier ainsi le contenu de la lutte du prolétariat contre le capitalisme, à l'intérieur et à l'extérieur de ses bastions. Autrement dit, le mot d'ordre des révolutionnaires sera : continuer à combattre les capitalistes, exproprier la bourgeoisie, détruire le salariat, mais ne jamais entretenir l'illusion que ce combat peut être achevé dans un bastion isolé.
Seule l'extension internationale de la révolution peut répondre à un problème posé dans un bastion, et donc tout doit être subordonné à cette tâche.
L'extension de la révolution est fondamentalement une tâche politique. Le CWO fustige le CCI qui maintient que les tâches politiques de la révolution précèdent et conditionnent le programme économique du prolétariat. Pour lui, les deux aspects sont simultanés : "A aucun moment, dans la réalisation du communisme, les tâches politiques ne peuvent être séparées des tâches économiques, les deux doivent être réalisées simultanément..." (Plateforme du CWO).
Malheureusement, cette position révèle une incompréhension fondamentale de la nature même de la révolution prolétarienne. En tant que classe exploitée, sans propriété, la classe ouvrière ne peut avoir aucune base économique à partir de laquelle sauvegarder sa révolution. Les seules garanties que peut avoir la révolution prolétarienne sont essentiellement politiques : la capacité de la classe à s'auto organiser et à combattre consciemment pour ses buts. Le prolétariat ne peut acquérir une position de force "au sein" du capitalisme, en gagnant graduellement l'industrie et ensuite en s'emparant du pouvoir politique. Au contraire, il doit d'abord détruire l'appareil politique de la bourgeoisie, établir sa domination et ensuite lutter pour la réalisation de son programme social : la construction d'une société sans classe. Le CWO semble d'accord pour dire que le prolétariat doit d'abord prendre le pouvoir politique avant de pouvoir transformer les rapports de production, puisqu'il dénonce l'autogestion comme une mystification capitaliste. Tout cela est très bien, mais pour le CWO, la défense des principes semble s'arrêter aux frontières nationales. Pour lui, une fois que le prolétariat a pris le pouvoir politique dans un pays, les tâches politiques et économiques deviennent soudain, simultanées, et les rapports sociaux communistes peuvent être construits dans le cadre d'un marché mondial capitaliste.
...Mais l'économie capitaliste est mondiale et le prolétariat est une classe mondiale. Cela signifie que la condition minimum pour la création de rapports sociaux communistes est la conquête du pouvoir à un niveau mondial par le prolétariat. Contrairement aux affirmations du CWO (RP 4 page 34), des bastions prolétariens isolés ne peuvent être "sauvés pour le communisme" par une série de mesures économiques. Le seul moyen de "sauver" la révolution, c'est l'activité politique indépendante d'une classe qui s'efforce consciemment d'étendre son pouvoir à l'ensemble du monde. Il n'y a rien d'autre pour éviter à la classe la défaite ; et c'est pourquoi la révolution russe ne pouvait laisser à la classe de soi-disant "acquis matériels" en dépit des stupides falsifications des trotskystes.
Cependant, le vague espoir de trouver des garanties économiques a indubitablement conduit le CWO à présenter une image de la révolution russe qui n'est pas complètement dégagée de l'empreinte du trotskysme, qui, à son tour, ne l'est pas du Parti Bolchevik dégénérescent. Il présente ainsi une image complètement déformée de la Russie des années 17-21. Le fait que sous la pression de l'isolement économique et de la destruction, l'Etat des Soviets ait été amené à suspendre les salaires et les formes monétaires (la période du "communisme de guerre") est vu comme "une étape vers le démantèlement du capitalisme et le commencement de la construction du communisme" (RP.4 page 13).
Nous voyons bien là la confusion du CWO dans toute sa splendeur. Pour lui, le communisme de guerre était vraiment "le communisme"par certains aspects ; c'est souligné par le fait qu'ils disent que le capitalisme est restauré en Russie en 21 (RP.4 page 25).
Quelqu'un dont le soutien aux Bolcheviks ne s'est jamais démenti : Victor Serge disait du communisme de guerre :
- "Le communisme de guerre pourrait être défini comme suit : premièrement réquisition à la campagne, deuxièmement strict rationnement pour la population des villes qui était divisé en catégories, troisièmement "socialisation" complète de la production et du travail, quatrièmement un système très compliqué de distribution pour les stocks restants et les produits manufacturés, cinquièmement le monopole du pouvoir tendant à se concentrer entre les mains d'un Parti unique et à éliminer toute opposition et sixièmement l'Etat de siège et la Tcheka" (“Mémoires d'un Révolutionnaire" - Chapitre.4).
Nous l'avons déjà dit bien des fois dans le passé, et nous le redisons aujourd'hui : le capitalisme n'a jamais été aboli en Russie, et le Communisme de guerre n'était pas l'abolition des rapports sociaux capitalistes. Même si les mesures économiques imposées pendant cette période avaient été le produit direct de l'activité de masse de la classe ouvrière, cela n'aurait pas éliminé la nature capitaliste de l'économie russe après 17.
Mais la réalité, c'est que presque toutes les mesures économiques du "communisme de guerre" ne furent pas imposées par l'activité autonome de la classe -qui en aurait fait au moins des mesures tendant vers le renforcement du pouvoir politique des ouvriers- mais par un corps se séparant de plus en plus de la classe : l'Etat.
Et ici, nous voyons que l'incapacité du CWO à aborder le problème de l'Etat dans la période de transition le conduit à faire l'apologie des mesures capitalistes d'Etats.
Pour le CWO, l'Etat en Russie, de 17 à 21, était un "Etat prolétarien", et donc les mesures de nationalisation et d'étatisation, prises pendant cette période étaient intrinsèquement des mesures communistes.
- "Beaucoup de gens voient dans les décrets de nationalisation, une expression logique du capitalisme d'Etat, alors qu'en fait, ils expriment la rupture des Bolcheviks sous la poussée des évènements, d'avec le capitalisme d'Etat. La première tentative de l'Etat pour contrôler le capital a été abandonnée au profit de ce que demandait la classe, à savoir l'expropriation ou les nationalisations. Les ouvriers et les Bolcheviks étaient clairs sur le fait que ce n'était pas les nationalisations dans un sens capitaliste" (RP page 10).
De plus, l'Etat étant un état prolétarien l'incorporation des comités d'usines et des milices ouvrières dans l'appareil d'Etat ne pouvait être que positive pour la classe (RP.4 pages 6 à 8). Même l'identification du Parti avec l'Etat n'est pas vue comme un danger : "A ce moment là, à savoir début 18, cela n'a aucun sens d'essayer de distinguer entre Parti, classe et soviets ; alors que la majorité de la classe a créé des organes d'Etat dans lesquels le Parti, qui a le soutien de la classe, a une nette majorité, c'est tout à fait formaliste de demander "Qui a le pouvoir ?" (RP.4 page 4).
D'ailleurs hormis quelques critiques ici ou là, le CWO présente la majeure partie de ce qui s'est passé en Russie entre 17 et 21 comme une Bonne Chose, et il devient donc assez difficile de comprendre pourquoi les ouvriers russes ont commencé à se révolter contre ce régime d'Etat dans la période 20-21. En dépit de ses fréquentes références à la révolte de Kronstadt, rien, dans les analyses du CWO, ne parvient à cerner ce contre quoi exactement se révoltaient les ouvriers de Kronstadt et qui était, pour une grande part, précisément les soi-disant mesures communistes du prétendu "Etat Prolétarien" !.
Et les implications des analyses du CWO pour la révolution à venir sont réellement troublantes ; parce que si une économie établie dans un bastion est une économie communiste, quel droit les ouvriers auraient-ils de continuer la lutte, l'exploitation ayant été abolie ? Et si l'Etat est véritablement une expression des aspirations communistes de la classe ouvrière, comment celle-ci pourrait-elle refuser de se subordonner à un tel Etat ? Un indice sur la direction que semble prendre le CWO est donné par son affirmation selon laquelle "la discipline du travail en soi, à la condition qu'elle soit menée par des organes propres à la classe, n'est pas un pêché mortel" (RP.4 page 10). Peut-être ! Mais que sont ces "organes propres à la classe" ? Le Sovnarkom ? Le Vesenklass ? L'Armée Rouge ? La Tcheka ? Le CWO est muet à ce propos. Parce qu'il refuse de considérer le problème de l'Etat de la période de transition tel que l'a posé le CCI ainsi que les fractions communistes du passé comme Bilan et Internationalisme. Le CWO reste attaché à beaucoup d'erreurs du mouvement ouvrier de l'époque de la Révolution Russe. Toutes les leçons sur l'Etat à tirer de la Révolution Russe restent incomprises de lui. Pour le CWO comme pour les Bolcheviks, Etatisation par l'Etat "prolétarien" égale socialisation réelle. Les organes de la classe doivent être fusionné dans l'Etat, et ainsi qu'il transparaît de plus en plus dans les écrits du CWO, le Parti se présente comme candidat au pouvoir d'Etat.
Pour nous, s'il y a une leçon fondamentale à tirer de la Révolution Russe, c'est que les révolutionnaires ne peuvent s'identifier et participer qu'aux luttes autonomes de la classe, avant comme après la prise du pouvoir. Les luttes du prolétariat continueront pendant la période de transition ; c'est en fait le seul facteur dynamique menant à l'abolition de la société de classe. Les communistes ne doivent jamais abandonner leur poste dans la lutte de classe même si cette lutte dresse la classe contre l'économie "socialisée" ou contre l'"Etat-Commune". Jamais plus, la classe ne doit subordonner ses luttes à une force extérieure, tel l'Etat, ou déléguer la direction de ses luttes à une minorité, aussi révolutionnaire soit-elle.
La défense, par le CCI, de l'autonomie de la classe, y compris par rapport à l'Etat transitoire, est interprétée par le CWO comme la défense du fait que "La classe ne détient pas le pouvoir d'Etat, mais donne son soutien à un Etat inter-classiste" (RP.4 page 42). En fait, le CCI reconnaît l'inévitabilité du surgissement d'un pouvoir d'Etat pendant la période de transition, mais réaffirme la thèse marxiste selon laquelle cet Etat est, au mieux, un mal nécessaire que le prolétariat doit considérer avec méfiance et vigilance. Pour pouvoir exercer le pouvoir, la classe doit s'assurer qu'à tout moment elle domine l'Etat, de façon à pouvoir éviter qu'il ne devienne un instrument d'autres classes contre elle-même. Et parce que, comme le disait Engels, le prolétariat"n'utilise pas (l'Etat) dans l'intérêt de la liberté", "nous refusons de considérer l'Etat transitoire comme un organe de transformation communiste".
- "De la Commune de Paris, les révolutionnaires tirent, entre autres, une leçon de la plus haute importance. L'Etat capitaliste ne peut être ni pris, ni utilisé ; il doit être détruit. La Révolution Russe a approfondit cette leçon de manière décisive ; l'Etat aussi "soviétique" ou "ouvrier" soit-il, ne peut être l'organisateur du Communisme... Philosophiquement, l'idée de l'Etat émancipateur est du pur idéalisme hégélien, inacceptable pour le matérialisme historique" (G. MUNIS : "Parti Etat, Stalinisme, Révolution")
Le CWO nous accuse de cacher des intentions contre-révolutionnaires, au sujet de la politique de l'Etat à l'égard des paysans et de la bourgeoisie mondiale. Il nous rappelle que les paysans ne sont pas "neutres", comme si le CCI entretenait des illusions sur les aspirations communistes de la paysannerie. Et parce que nous reconnaissons l'inévitabilité de concessions momentanées à la paysannerie pendant la période de transition, nous sommes suspectés de vouloir vendre les intérêts des ouvriers aux hordes de paysans qui hanteraient nos rêves anachroniques où nous "rejouons" 1917. Ce que dit réellement le CCI sur le problème paysan c'est qu'il ne peut être solutionné en une nuit et certainement pas au sein d'un seul bastion prolétarien, pas plus que la seule violence, bien qu'elle soit parfois inévitable, ne résoudra le problème paysan. La seule solution à ce problème est le développement global des forces productives, vers une société sans classe. Sur le chemin qui y mène le prolétariat devra trouver des moyens de coexistence avec les paysans, d'échange de produits avec eux. Et, au niveau politique, ces relations s'instaureront à travers un Etat des soviets, sous le contrôle de la classe ouvrière.
La seule alternative à la voie du "compromis" avec la paysannerie, ce serait la collectivisation immédiate et forcée. Le CWO se refuse à dire si c'est sa position, mais ce serait, à coup sûr, de la folie que pour la classe ouvrière de tenter cela. En fait, dans des textes précédents, le CWO semblait accepter l'idée de l'échange entre les conseils ouvriers et les paysans, en "d'autres termes, des compromis" (cf. Worker's Voice n° 15 "La Période de Transition"). Le CWO aurait-il sauté par-dessus ses propres frontières de classe ?
Le CCI est aussi accusé de "défendre" que les ouvriers doivent "négocier avec la bourgeoisie internationale", pendant la Révolution. Le CCI ne "défend" rien de semblable. Une fois que le prolétariat a pris le pouvoir dans une aire géographique, nous défendons l'extension de la révolution au monde entier, la poursuite de la guerre civile mondiale contre la bourgeoisie. N'étant pas des "diseuses de bonne aventure", nous ne "savons" pas si la Révolution éclatera simultanément dans tous les pays ; et dans la mesure où la réaction la plus probable de la bourgeoisie mondiale à un bastion prolétarien unique sera d'imposer un blocus économique, nous ne pontifions pas, comme le CWO, l'absolue impossibilité de négociation, ou même d'échange entre le bastion prolétarien et les secteurs de la bourgeoisie mondiale.
Même au plus fort de la crise révolutionnaire en Europe (18-20) les Bolcheviks étaient contraints d'avoir des rapports avec la bourgeoisie internationale et au sens large, aucune guerre dans l'histoire n'a connu une absence complète de relations avec l'ennemi. La guerre civile elle-même ne sera probablement pas une exception malgré l'irréconciabilité des parties en présence. Plutôt que de faire des prédictions hasardeuses sur l'impossibilité de telles négociations, nous devons être capables de distinguer les négociations tactiques des trahisons faites à la classe. Un bastion prolétarien peut supporter certaines limitations, certaines concessions momentanées à la bourgeoisie internationale, pourvu que les ouvriers comprennent ce qu'ils font, se préparent aux conséquences et surtout, pourvu que la Révolution soit dans un cours ascendant. Par exemple, le traité de Brest-Litovsk ne signifiait pas la fin de la Révolution en Russie, en dépit des avertissements de Boukharine. Dans une période de profonde crise révolutionnaire, tel ou tel capitaliste peut être forcé d'offrir des conditions qui sont plus ou moins favorables au bastion prolétarien. Un bastion confronté à la famine se devrait de peser très sérieusement les conséquences de tels compromis, mais il serait absurde de sa part de refuser de considérer tout compromis.
Dans la période de décadence, tout organe surgi de la classe qui tend à devenir un instrument permanent de négociation avec le capital, s'intègre au capital. Cela ne signifie pas cependant que, un organe prolétarien comme un comité de grève, devient bourgeois dès qu'il est mandaté par les ouvriers pour mener des négociations tactiques avec les patrons, tant que sa fonction essentielle demeure l'extension et l'approfondissement des luttes, il reste un organe prolétarien. On peut dire la même chose des organes de pouvoir prolétariens pendant la guerre civile mondiale. Tant qu'ils sont fondamentalement des organes d'extension de la révolution, ils peuvent supporter des négociations temporaires avec l'ennemi, sur, disons le repli des armées, le ravitaillement en nourriture et médicaments, etc.. L'intégration de ces organes dans le capital mondial ne se fait que quand ils entrent en relation commerciale et diplomatique permanente et institutionnalisée avec les états bourgeois et abandonnant objectivement toute tentative d'extension de la révolution mondiale. Mais pour que cela arrive, il faudrait que l'ensemble du mouvement révolutionnaire mondial soit entré dans une phase de profond reflux. De telles transformations des rapports de forces entre les classes n'arrivent pas en une nuit.
A la lumière de la Révolution Russe nous pouvons donner quelques grandes lignes générales concernant les relations entre un bastion prolétarien et le reste du monde, grandes lignes qui seront beaucoup plus utiles que de simples affirmations du genre : "Cela ne peut pas arriver".
- Si le pouvoir des soviets entreprend des négociations avec la bourgeoisie mondiale, elles doivent être sous le contrôle de l'ensemble de la classe ouvrière de ce bastion.
- Les mesures prises pour assurer la survie dans un monde hostile, doivent toujours être subordonnées aux besoins de la lutte de classe, tant à l'intérieur et plus même peut-être à l'extérieur du bastion. Les besoins internationaux de la classe ouvrière doivent toujours prendre le devant par rapport à ceux d'un seul bastion des soviets.
- Découlant du principe de l'impossibilité de former des fronts avec la bourgeoisie, le pouvoir des soviets ne peut jamais faire d'alliance "tactique" avec un impérialisme contre un autre.
Conclusion
Les erreurs théoriques du CWO ont des conséquences importantes pour son travail de groupe révolutionnaire aujourd'hui. Toutes ses ratiocinations théoriques tendent à renforcer son isolement et son sectarisme. Sa vision de la crise et du regroupement souligne son pessimisme sur la possibilité d'unifier le mouvement révolutionnaire dès maintenant. Sa façon de juger les autres organisations prolétariennes, son invention de nouvelles frontières de classe, le conduit de plus en plus à l'idée stérile qu'il est le seul groupe révolutionnaire au monde, ce qui ne peut que l'empêcher de contribuer au processus vivant de discussion et de regroupement qui s'effectue aujourd'hui.
En ce moment, se révèlent les signes qui indiquent que le CWO est en train de s'éveiller à certains des dangers de son isolationnisme. Dans plusieurs lettres, il a diminué l'accusation au CCI d'être contre-révolutionnaire et a insisté au contraire sur le fait que c'est le CCI et non lui, qui a rompu la discussion. Si inexact que cela soit, nous ne pouvons que souhaiter une réévaluation de son attitude.
Nous insistons sur le fait que les divergences au sein du mouvement révolutionnaire ne peuvent être clarifiées que par un débat ouvert, public et honnête. Les critiques que nous faisons ici du CWO sont sans compromis, mais nous avons toujours reconnu que nous nous adressions aux confusions d'une organisation révolutionnaire qui a encore la possibilité d'évoluer de façon positive.
Nous pressons donc le CWO à abandonner ses attitudes antérieures face au débat et à répondre aux critiques faites ici, comprenant que la reprise d'un tel dialogue ne vaut pas pour elle-même, mais comme un moment du regroupement des révolutionnaires vers la reconstitution de l'organisation internationale du prolétariat.
CD. WARD[1] [87] Et cela va, bien sûr, à l'encontre de la position du CWO, pour qui l'année 21 marque aussi la mort de l'IC dans son ensemble, peut-être parce que cela correspond à la position du CWO selon laquelle l'IC était révolutionnaire quand elle "reflétait le caractère prolétarien de l'Etat russe" (RP.4, page 17). En d'autres termes, contrairement à l'idée d'après laquelle l'IC meurt quand elle devient un instrument de la politique de l'état russe, le CWO considère qu'elle est un organe de l'Etat russe dès le début !
Courants politiques:
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Rencontre internationale convoquée par le P.C.I. "Battaglia Comunista" mai 1977
- 2660 reads
- "Avec ses moyens encore modestes, le CCI s'est attelé à la tâche longue et difficile du regroupement des révolutionnaires à l'échelle mondiale autour d'un programme clair et cohérent. Tournant le dos au monolithisme des sectes, il appelle les communistes de tous les pays à prendre conscience des responsabilités immenses qui sont les leurs, à abandonner les fausses querelles qui les opposent, à surmonter les divisions factices que le vieux monde fait peser sur eux. Il les appelle à se joindre à cet effort afin de constituer, avant les combats décisifs, l'organisation internationale et unifiée de son avant-garde. Fraction la plus consciente de la classe, les communistes se doivent de lui montrer son chemin en faisant leur le mot d'ordre : REVOLUTIONNAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !" (Manifeste du CCI, janvier 1976)
La vie des groupes révolutionnaires, leurs discussions et leurs désaccords font partie du processus de prise de conscience qui se développe au sein de la classe ouvrière ; c'est pourquoi, nous sommes radicalement contre toute politique de "discussions cachées" ou d'"accords secrets". Nous publions donc notre point de vue sur ce qu'a été la rencontre internationale qui s'est déroulée à Milan, les 31 avril et 1er mai, à l'initiative du PCI ("Battaglia Commista"). Avant tout, il est nécessaire de clarifier dans quel cadre s'inscrit une telle initiative et pourquoi nous y avons participé. Nous estimons que dans le contexte de confusion politique actuelle et de faiblesse des forces révolutionnaires, il est très important d'insister sur la nécessité du regroupement des révolutionnaires.
Le regroupement des révolutionnaires
La reprise historique des luttes de la classe ouvrière a provoqué le resurgissement de courants révolutionnaires que la plus profonde contre-révolution de l'histoire du mouvement ouvrier avait pratiquement anéantis. Ce resurgissement se manifeste de manière encore dispersée, confuse ou hésitante, ce qui met à l'ordre du jour pour les tâches des communistes, un effort de clarification des positions politiques et un effort de regroupement, deux tâches indissociablement liées. Indissociables parce que, comme l'a montré la Gauche Italienne entre les deux guerres, il n'y a de regroupement possible pour les communistes que sur la base de la plus grande clarté programmatique. Cela dit, nous nous sentons le droit de souligner l'énorme responsabilité face à la classe de certains groupes qui, pour des divergences secondaires, rejettent la discussion et refusent d'unir leurs efforts aux notre, démontrant par là qu'ils ne sont pas capables de dépasser la vision petite-bourgeoise qui consiste à vouloir préserver "son" idée et "son" groupe et à ne pas se concevoir comme partie et produit de la classe. En fait, il devrait être clair qu'à l'image de l'ensemble de la classe, les révolutionnaires doivent tendre aujourd'hui à se regrouper et à centraliser leurs forces au niveau national et international, ce qui signifie rompre l'isolement, contribuer à l'évolution d'autres groupes et ceci à travers un débat clair et une critique constante de sa propre activité.
Quand le CCI n'était constitué que d'un ou deux groupes, il a toujours agi dans ce sens, comprenant qu'on ne peut laisser au hasard la confrontation et les discussions, mais qu'on doit les rechercher et les organiser.
Si le CCI souligne la nécessité fondamentale du travail de regroupement, il met en garde aussi contre toute précipitation. Il faut exclure tout regroupement sur des bases sentimentales et insister sur l'indispensable cohérence des positions programmatiques comme condition première du regroupement.
La contre-révolution, dont nous commençons à sortir, a pesé terriblement sur les organisations de la classe. Les fractions qui étaient sorties de la IIIème Internationale ont résisté de plus en plus difficilement à sa dégénérescence : la majeure partie d'entre elles a disparu et celles qui ont résisté ont du subir un processus de sclérose qui les a fait régresser. L'effort indispensable de clarification passe aujourd'hui :
- de la part des nouvelles organisations, par une réappropriation des acquis des anciennes fractions communistes ;
- de la part des anciennes fractions qui ont survécu, par un effort de critique et d'approfondissement de leurs positions programmatiques et de leurs analyses.
Si d'un côté le CCI rejette la précipitation dans tout processus de regroupement, d'un autre côté, il dénonce le sectarisme qui amène à trouver des prétextes multiples pour ne pas engager ou poursuivre la discussion entre groupes communistes ; malheureusement, ce sectarisme anime aujourd'hui un certain nombre de groupes révolutionnaires qui ne comprennent pas la nécessité de la formation d'un courant communiste solide que la reprise prolétarienne rend indispensable.
La rencontre de "Battaglia Comunista"
On comprend, vu ce qui a été dit avant, l'importance que le CCI a attaché à une telle rencontre. Mais c'est justement la réflexion sur les faiblesses du mouvement ouvrier dans le passé (les hésitations des communistes, la formation tardive de l'Internationale et les difficultés bien connues qui ont suivi sa formation) qui nous permet de comprendre que l'organisation de l'avant-garde du prolétariat doit se former avant l'affrontement décisif et directement centralisée au niveau mondial.
Cette difficulté s'est illustrée dans l'exemple concret suivant : malheureusement, aucun des autres groupes invités ne s'est présenté à la conférence. Certains groupes ont donné leur accord de principe pour participer à la rencontre mais n'ont pas pu venir pour diverses raisons :
- Arbetarmakt de Suède à cause de la distance ;
- Fomento Obrero Revolucionario à cause d'un travail urgent en Espagne ;
- et la CWO (Communist Workers'Organisation, GB) à cause d'un empêchement matériel;
- Le PIC (Pour une Intervention Communiste, France) par contre, a changé de position au dernier moment et a décidé de ne pas venir considérant cette rencontre comme un "dialogue de sourds";
- D'autres groupes "bordiguistes" ou venant du "bordiguisme" n'ont pas daigné répondre à l'invitation.
Dès le début de la rencontre, nous avons fait une déclaration pour regretter l'absence des autres groupes et faire valoir les limites de cette conférence :
- le manque de clarté des critères politiques qui devaient servir de base à une telle rencontre et aux invitations ;
- un certain manque de préparation : peu de textes sont parvenus et qui plus est en retard ; "Battaglia" n'a pas publié les lettres échangées (Voir "Correspondance avec "Battaglia Comunista" dans "Rivoluzione Internazionale" n°5, juin 1976) contrairement à notre insistance ;
- l'"esprit de chapelle" et le manque total de compréhension de la part de certains autres groupes invités du problème du regroupement des révolutionnaires.
Dans de telles conditions, cette rencontre ne pouvait être considérée que comme une simple réunion de confrontation des positions entre "Battaglia" et le CCI. Les débats ont porté sur les points suivants :
- analyse de l'évolution du capitalisme ;
- signification de la crise actuelle et de ses implications ;
- état actuel de la lutte de classe et ses perspectives ;
- fonction des partis dits "ouvriers" (PS, PC,etc.) ;
- fonction des syndicats et le problème des luttes économiques ;
- le problème du parti ;
- les tâches actuelles des groupes révolutionnaires ;
- conclusion sur la portée de cette réunion.
Comme bilan de ces deux jours de discussions animées mais fraternelles, nous pouvons dire qu'il ne s'est pas agi d'un "dialogue de sourds',' ni d'une "rencontre sentimentale" sans principes, mais du début d'une confrontation que nous espérons sincèrement voir se poursuivre entre tous les groupes qui restent encore sur les bases révolutionnaires du communisme. Comme issue concrète et afin de porter les discussions parmi les autres groupes révolutionnaires et dans la classe toute entière, la rencontre a décidé la publication d'un bulletin contenant les textes présentés et une synthèse des interventions, bulletin que les camarades de "Battaglia" ont pris en charge de publier au plus vite. En conclusion nous pouvons dire que, si d'un commun accord nous avons jugé tout à fait prématuré la formation d'un quelconque "comité de coordination", nous considérons que cette conférence a représenté un pas positif, le début d'un processus que nous espérons voir se développer toujours plus.
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [36]
Approfondir:
De l’austro-marxisme à l’austro-fascisme
- 3717 reads
- Pas seulement l'usinisme gramscien, mais encore la forme de conseillisme austro-marxiste semble destinée à parvenir au zénith d'une gloire "marxiste" posthume. Mis à part les vétérans, encore de ce monde, de la social-démocratie, rares étaient ceux qui parlaient de lui et de son ambitieux projet de constituer une Internationale 2 et demie pour faire pièce au Komintern. Or, depuis quelques années, une pléiade d'historiens se met à nous instruire sur le sujet présenté comme une tentative de tenir la balance égale entre la platitude réformiste et "l'extrémisme" bolchevik, lequel aurait fait subir une déformation toute russe donc asiatique au marxisme.
A l'évidence, ces professionnels de l'Histoire connaissent sur le bout des doigts leurs leçons, mais vues au travers du prisme de "l'objectivité"? Le révolutionnaire ne prétendant pas aux honneurs de "l'impartialité" ne peut envisager l'austro-marxisme" que sous l'angle de l'engagement militant. Par austro-marxisme sera désignée l'activité particulièrement maligne de réformisme et de lâcheté devant les tâches révolutionnaires avec lesquelles se sont illustrés ses divers chefs de file. Que ce soient Viktor, Max et Fritz Adler, Renner, Hilferding ou Bauer tous, en divers domaines ont développé la thèse de l'adaptation du socialisme radical pour une Autriche complexe, multinationale, multi religieuse... vouée à la consommation des siècles. Et, il n'est pas fortuit si ce sont ceux-là qui élaborèrent parmi les premiers, la thèse du passage graduel et pacifique au socialisme selon les voies et les moyens adaptés aux particularités nationales de chaque pays.
En fait, ce qu'on exhume du tombeau de l'histoire c'est un mouvement qui, lors de la grandiose lutte de janvier 1918, mit le pied à l'étrier de la contre-révolution. Le trait d'infamie de l'austro-marxisme, qu'aucune thèse universitaire n'effacera, a été de repousser, avec le concours de la prélature catholique, l'action révolutionnaire du prolétariat en Autriche, ce pont indispensable entre la révolution russe et le spartakisme. Convaincus que sans le rétablissement de l'ordre en Autriche, il eût été autrement plus difficile de renverser, dans l'été 1919, les soviets hongrois, quand nous songeons que le grand alibi que s'est donné l'austro-marxisme, c'était d'éviter au prolétariat les calamités sans nom provoquées par la "guerre civile", lui qui l'avait poussé dans les tranchées impérialistes, notre dégoût ne fait que grandir. Quel magnifique parallèle nous permet d'établir Gramsci dissuadant les travailleurs de Turin et Milan de s'emparer du pouvoir politique avec Bauer exhortant les masses ouvrières à ne pas compromettre par des excès la paix honorable et la République. Si, en Italie, à l'habileté du gouvernement Giolotti devant la vague d'occupations de septembre 1920 fit écho le slogan mystificateur du "contrôle ouvrier", en Autriche, au moment des troubles de rue dans Wien et Linz durant les pourparlers de Brest-Litovsk les dirigeants autrichiens discutaient avec les représentants du pouvoir du retour de la légalité en échange de menue monnaie.
Entre l'austro-marxisme et la commère italienne existe un autre point commun. Toutes deux tenaient en sainte horreur les "impatiences risquant de conduire à des actions prématurées condamnées à faire couler inutilement le sang des travailleurs". Toutes deux assuraient que la chute de la bourgeoisie se ferait par un phénomène de capillarité excluant l'intervention des grèves générales et, il va de soi, l'insurrection considérée comme une vieillerie blanquiste. Des deux côtés de l'Adige, la devise était : "Qui va piano, va sano".
La social-démocratie autrichienne pu paraître dans l'accomplissement de ses devoirs de solidarité internationale et, à la veille de l'holocauste, s'auréoler de la notoriété surfaite d'avoir appliqué correctement les principes d'internationalisme. Encore une légende qui ne résiste pas à un examen sérieux et s'écroule comme un château de cartes lorsqu'on sait la façon dont le mouvement ouvrier s'organisa dans le vieil Empire. Dans le cas autrichien, c'est le funeste triomphe du séparatisme et du fédéralisme si contraires au développement de la solidarité prolétarienne[1] [88].
Juriste de profession et avocat politique de l'autonomie territoriale et culturelle, Renner conçut la question de l'État du point de vue le plus platement démocratique. L'Autriche qu'il revendique, c'est celle où toutes les nationalités de l'Empire ont leur propre gouvernement et leur administration particulière. Il se sert du modèle de l'empire médiéval carolingien sous l'autorité duquel vivaient dix nationalités différentes avec pour chacune une langue et un Code spécifiques. La lutte de classe doit avoir pour fonction d'équilibrer les rapports intercommunautaires ; les relations sociales sont des rapports de "Droit" '; l'État une "une autorité territoriale de Droit" ; la société une " association de personnes". Ce faisant la lutte pour la reconnaissance du Droit amènera chacun des groupes de travailleurs -Slovènes, italiens, allemands, hongrois... à la liberté de fonder leurs propres associations culturelles, syndicales et autres. A l'échelle autrichienne, nous obtenons ce que doit être la IIème Internationale et le principe politique des nationalités dans la communauté socialiste future.
Quant à Bauer, sa thèse sur les nationalités ne vaut guère mieux, qui lie la victoire du socialisme à la réalisation du principe éternel des nationalités. Sous le socialisme, que la nation soit grande ou pas, elle pourra construire son économie nationale sur la base de la division mondiale du travail. C'est comme ça : «le socialisme sera à l'image des structures dont s'est d'ores et déjà doté le capitalisme : l'Union Télégraphique Internationale ou la Communauté des chemins de fer.»
Héritiers de la thèse du libéralisme qui fait de l'État une catégorie abstraite planant au dessus des classes, Renner et Bauer ferment de sept sceaux le livre de la jungle capitaliste : la bourgeoisie exploiteuse n'a pas crée un État national pour garantir à son industrie un marché national ; dans le cadre de cet État, elle n'a pas fait goûter à la classe opprimée l'idyllique politique du protectionnisme douanier, des impôts indirects et du sang ; elle ne s'en est pas servi comme instrument de conquête impérialiste. Elle a tout simplement poursuivi la réalisation de la Justice et du Droit.
Au sein de l'Internationale, ni Pannekoek ni Strasser, leader de la Gauche autrichienne, ne purent avaler pareille couleuvre. Leur dénonciation de l'école autrichienne fut implacable. La brochure de Strasser "L'ouvrier et la nation" mettait en garde contre la pénétration de l'idéologie nationale dans l'organisation prolétarienne. Elle annonçait la théorie du défaitisme révolutionnaire en cas de conflit mettant aux prises deux pays et concluait que le socialisme ne connaît plus le fait national. Laquelle brochure fut épuisée dans les deux semaines qui suivirent sa publication. Partis d'une même vision marxiste, Strasser et Pannekoek vont arriver à d'identiques conclusions : il n'y a pas de communauté nationale de destin et de culture, comme le prétend Bauer, entre le prolétaire écrasé par la domination capitaliste et la bourgeoisie, mais lutte irrépressible. Celle-ci débouchera sur une unité nationale constituant alors la seule communauté de destin de l'Humanité entière.
Grâce au comte Stürgkh qui venait depuis peu de mettre le Parlement en vacance, les députés sociaux-démocrates autrichiens n'eurent même pas à voter les crédits de guerre. Mais le Centre salua celui des "frères" allemands dans "l'Arbeiter Zeitung" du 5 août intitulé "le jour de la nation allemande", faisant vibrer, avec maestria, la corde sensible du crin-crin nationaliste.
Dans les hautes sphères du Parti, de la droite (Renner) à la gauche (Bauer), on était traditionnellement pangermaniste, toutefois avec une pointe de poésie : "Patience ! Le jour viendra ou l'on étendra une toile unique au dessus de toutes les terres allemandes". Les "majoritaires" ont approuvé l'ultimatum envoyé à la Serbie et ne manquèrent pas de joindre leurs voix au choeur des interventistes appelant les travailleurs à courber le dos sous la rafale guerrière. Voilà nos militants matérialistes à prier le dieu Mars pour qu'il donne la victoire "à la sainte cause du peuple allemand, un peuple uni, soulevé par une volonté puissante. L'histoire du monde irait à reculons si le bon droit du peuple allemand ne triomphait pas".
"O, bandes de Smerdiakovs" s'écrie alors Trotsky qui n'en peut plus de respirer les miasmes émanés de l'appareil social-démocrate autrichien. Y-a-t’il une opposition réelle à la politique menée par ces laquais ? Oui si l'on considère le "Cercle K. Marx", surgi au sein même du parti avec les "jeunes" (Hilferding, Bauern, M.Adler) qui condamnent la "majorité" pour avoir violé les engagements du Congrès international de Bâle ; oui si l'on estime que le prolétariat pouvait être réveillé de sa torpeur par un acte individuel "exemplaire". Non, si l'on pense que l'on ne peut jamais bâtir une politique révolutionnaire sur un acte terroriste ; non si l'on estime que le seul travail à faire est celui de la construction de la Fraction. C'est pourquoi le coup de feu de F. Adler qui abattit le comte Stürgkh n'avait aucune force salvatrice.
Il serait certes exagéré d'affirmer que l'austro-marxisme est allé jusqu'au noskisme. Toutefois, à la liquidation de la monarchie, le 12 nov.1918, il aura toute latitude pour tenir ses promesses. Excusez du peu : Renner, qui durant le conflit avait défendu la "Grande et unique Europe centrale allemande" connaît son jour de gloire en endossant la livrée de Chancelier du gouvernement de coalition de la première République que l'Autriche se soit donnée ; le chef historique du "Gesamtpartei" V. Adler, autorité incontestée, était nommé Secrétaire d'État aux affaires étrangères ; Seitz élu vice-président du Reicharat, sans compter les autres innombrables sinécures distribuées aux fonctionnaires du parti.
Eux que l'on considérait comme les sommités du marxisme, les représentants distingués de la "culture", les "Schüngeist" (beaux esprits) ne se retrouvaient plus chaque soir à philosopher à perte de vue sur l'apport de la pensée de Kant au marxisme dans la très célèbre brasserie politico littéraire du "Café central". Leur permanence, ils l'avaient établie dans le palais baroque de la Ballhausplatz, occupant les fauteuils encore chauds des ex-premiers ministres Aherental et Beck. Ils préparaient le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, mais ratèrent' leur "Anschluss" pacifique, objectif que réalisa par la voie violente le nazisme quelques années plus tard et qui ne différa du projet austro-marxiste qu'en ce qu'il fut centraliste au lieu d'être fédéraliste.
Mieux que quiconque Trotsky, qui vécut sept années d'émigration en Autriche après l'échec de 1905, a dépeint la social-démocratie de ce pays, ses méthodes de collaboration à peine voilées avec l'État monarchique, ses hommes et leur train de vie dans la capitale, modèle inégalé de "socialisme municipal" :
- "J'écoutais avec le plus vif intérêt, on pourrait presque dire avec respect, leur entretien au Café Central. Mais bientôt des doutes me vinrent. Ces gens-là n'étaient pas des révolutionnaires. Cela se voyait en tout (...) et je crus même reconnaître l'accent du philistin au timbre de leurs voix". ("Ma vie").
Tous ces brillants avocats du "possibilisme", ces honorables citoyens, qui prenaient une part active aux travaux de législature du Reicharat, avaient beaucoup "réalisé". Pour rien au monde, ils n'auraient voulu se laisser lier les mains par des "principes abstraits". Aussi, leur optique de "realpolitik" leur faisait voir dans le dirigeant du premier Soviet de Petrograd un espèce de déclassé lié par "un attachement donquichottesque aux principes". Deux visions du monde s'affrontaient et les travailleurs viennois le comprenaient très bien. Laissons encore témoigner Trotsky : "En même temps, je trouvais sans la moindre peine la langue commune avec les ouvriers sociaux-démocrates que je voyais aux réunions ou à la manifestation du 1er Mai". A ces 1er Mai, chaque année les dirigeants se demandaient avec angoisse si la démonstration pacifique n'allait pas tourner à l'émeute ou "dégénérer" en combat de rue comme cela avait été le cas en 1890 pour réclamer la libération de V. Adler, alors emprisonné pour "haute trahison".
La Wien où vécurent Trotsky et Boukharine était celle de la fin du long règne de Ferdinand, époque de stabilité et d'essor économique avec ses dizaines de milliers de "Biedermayer", incarnation du bon bourgeois chez qui rien ne saurait entamer la belle humeur, content de son bon sens des affaires. Nos austro-marxistes furent de ces Biedermayer qui, au lieu de se griser au son des valses, l'étaient par les flonflons célébrant la montée électorale du Parti. De cette façon, ils célèbrent toujours plus le caractère bureaucratique, militariste et absolutiste de la double Monarchie. C'est parce qu'il abandonna la vision catastrophique de l'histoire qu'il fallut attendre les expressionnistes, Trakl, Kraus ou Musil pour exprimer que cette maison de fous qu'était devenue l'Autriche allait voir s'abattre sur elle des catastrophes imminentes ; que sa civilisation allait s'achever dans la pourriture des charniers.
De même que dans l'Allemagne Bismarckienne, la social-démocratie autrichienne a été durant un lustre, de 1885 à 1891, mise au ban de la société par des lois d'exception du gouvernement Taafe. Pendant cette difficile épreuve, le socialisme fut l'objet de confiscations de journaux, d'arrestations de militants, de procès interminables. Il en sortit en tête haute, ne négligeant rien pour unir l'ensemble des travailleurs dans la lutte indispensable pour le suffrage universel. La Gauche, suivant en cela l'exemple du prolétariat belge, réclamait le recours à la grève générale mais se voyait continuellement objecter l'argutie tactique selon laquelle "il pourrait être avantageux de tromper l'adversaire sur nos forces mais malheur au parti s'il se trompe lui-même sur ses propres forces". Un pareil argument ne concourait qu'à paralyser les forces vives du prolétariat, remettant toujours à demain la lutte qui s'impose d'ores et déjà. C'était bien la Gauche qui voyait la solution juste puisque le suffrage universel ne fut arraché que sous les coups de la grève générale du 28 novembre 1905. Mais pas par elle seulement : la révolution russe y contribua énormément : à Wien, grève générale pour le suffrage universel, à Petrograd grève générale pour la journée de huit heures et ces deux mouvements se complètent organiquement car ils expriment tous deux des besoins de classe.
Dès l'instant où le pouvoir se partagea entre le Monarque et le Parlement, le Parti se lança, tête première dans la brèche constitutionnelle. Dans la serre chaude des concessions, la plante réformiste et opportuniste croît en tout sens pour triompher au congrès de Brno en septembre 1889. On y prononçait la transformation pacifique de l'État, l'extinction en douceur des classes : l'esprit de Lassalle soufflait sur le Congrès. Essentiellement, il s'agissait de faire pression pour tempérer le pouvoir impérial et de substituer au régime monarchique, fonctionnant le plus souvent par décrets-lois, la complète démocratie parlementaire.
Electoralement, la social-démocratie s'affirmait comme le premier parti politique du pays. Aux élections de 1911, les dernières avant l'effondrement de l'Empire, elle avait obtenu des chiffres colossaux avec 25 % des voix; à Wien elle emporta 20 des 33 sièges. C'est le couronnement d'une orientation vulgairement démocratique sur le terrain légal et qui va l'entraîner toujours plus loin. Que le Parti soit devenu typiquement ministérialiste, c'est ce qui dégage de la crise politique de 1906 même s'il s'était offert le luxe de refuser l'entrée dans le cabinet Beck. En principe, il ne refusait pas du tout la collaboration de ses élus avec les gérants de la classe capitaliste mais la recherchait consciemment. Quand l'Internationale, réunie à son congrès d'Amsterdam en 1904 posa le problème de "l'expérience Millerand", socialiste entré dans le cabinet de défense républicaine Waldeck-Rousseau, la délégation autrichienne fit entendre un plaidoyer pour la participation socialiste à un gouvernement bourgeois. En bonne compagnie avec Jaurès et Vandervelde, V. Adler présenta un amendement pour justifier à fond la valeur du ministérialisme.
Avec dépit, il fallait se rendre à l'évidence que tout le travail de près d'un demi-siècle dans le Parlement et les municipalités rendait, en fait, le prolétariat plus malléable à la propagande bourgeoise quand les nuages de la guerre s'accumulaient sur la tête des ouvriers.
La grève générale de 1918
Une poignée de nationalistes serbes, en assassinant l'héritier des Habsbourg allaient déclencher des évènements dont la portée fut inimaginable : la guerre et la révolution mondiales. La Monarchie règne sur 51 millions de sujets dont 40 millions d'allogènes répartis en une douzaine de nationalités sur un territoire couvrant près de 700.000 km2. Lorsque monte l'appel des armes, elle ne peut rien faire d'autre que de jeter son épée dans la balance des forces. Depuis des années que l'Autriche rongeait son frein, elle pouvait se servir de l'attentat de Sarajevo pour rendre la Serbie inoffensive. S'appuyant sur le puissant allié allemand, qui lui donnait carte blanche pour opérer dans les Balkans, elle crut saisir l'occasion pour briser ce que le Comte Czernim appelait "l'encerclement de la Monarchie par la nouvelle ligue balkanique impulsée et dirigée par les russes". Jusqu'alors les autrichiens étaient sortis vainqueurs de toutes les guerres de leur histoire mais cette fois le vent avait tourné, confirmant la défaite de Sadowa devant les prussiens munis de fusils à culasse. Au lieu d'enfoncer comme prévu les lignes serbes en un rien de temps, il fallut repousser les russes en Galicie et attendre une année pour que l'Allemagne vienne en aide à l'Autriche. Lorsque l'Italie entre en jeu, l'armée autrichienne est déjà au bord de l'épuisement. La Hongrie, se rendant compte de la proximité de la défaite, essayait de se séparer de la double Monarchie pour ne pas avoir à payer le tribut du désastre et aussi pour recouvrer son indépendance. Le sort des armes avait décidé autrement que les chancelleries ! Il fallut céder d'immenses territoires : la Bohême-Moravie, la Silésie, la Galicie, la Bukovine, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Dalmatie, la Carniole, l'Istrie, le Tyrol et la Carinthie méridionale. Il ne restait plus qu'une Autriche allemande ramenée à 120.000 km2 avec une dizaine de millions d'âmes, faisant de Vienne un monstre hydrocéphale, tête énorme sur un corps rabougri.
A quelques mois de la débâcle militaire, les conditions de vie se firent, de jour en jour, plus intenables. Le pays avait faim et froid. Quel prolétariat aurait pu accepter la poursuite de la guerre alors que celui de Russie venait de donner l'exemple ? Lorsqu'au début de janvier 1918, le ministre de l'alimentation Höfer décide de réduire de moitié la chiche, ration de pain, à Vienne éclate immédiatement l'action de la classe. Sous l'impulsion des conseils ouvriers, elle se propage à toute la Haute-Autriche, la Styrie industrielle et jusqu'en Hongrie. C'est l'occasion unique de raccourcir la guerre ; c'est la possibilité qui se présente concrètement de voler au secours de la révolution russe menacée.
Alors les savantissimes austro-marxistes qui savent toujours tout et mieux avant que les autres, ces hypocrites amis de la Russie prolétarienne qui, deux mois plus tôt ont déclaré qu'il fallait soutenir les bolcheviks, font paraître dans l'organe central "Arbeiter Zeitung" la déclaration suivante :
- "Dans l'intérêt de la population, nous invitons instamment les travailleurs de toutes les industries alimentaires, les mineurs, les travailleurs du rail, des tramways et autres entreprises de transport, les travailleurs du gaz et de l'électricité A NE PAS ARRETER LE TRAVAIL (...) pour éviter des victimes inutiles, nous demandons avec insistance aux travailleurs de maintenir le calme et d'éviter tous les affrontements de rue".
C'est parce qu'ils ont compris que "le sort des pourparlers ne sera pas réglé à Brest, mais dans les rues de Vienne et de Berlin" que les sociaux-démocrates se placent en tête du mouvement pour mieux l'étouffer, sous couvert de défendre "la cause sacrée, des travailleurs". Ils se chargèrent de porter le coup d'arrêt à la grève qui, en moins de quatre jours, est devenue générale. Devant les assemblées ouvrières, ses représentants présenteront un programme de revendications lu et approuvé auparavant par le président du Conseil Von Seider et le comte Czernim. Tout ce que les ouvriers obtenaient, c'étaient de fort belles promesses, comme seuls peuvent les ciseler en orfèvres les sociaux-démocrates : apparemment radicales, en réalité creuses et sonores.
Instinctivement, les travailleurs ressentaient que les chefs les avaient vendus et, dans un ultime sursaut, refusèrent de reprendre le travail. Alors, pour venir définitivement à bout des dernières poches de résistance, la direction socialiste utilisera ses hommes de confiance pour expulser des assemblées "les irréductibles". Enfin pour faire bonne mesure, elle brandit l'épouvantail de la répression policière. Ces "extrémistes irresponsables" qui sentaient le fagot, c'étaient les éléments qui bientôt allaient fonder le parti communiste. A la fin de la grève, ils lancèrent la proclamation "traîtres et vendus" :
- "La lutte pour arracher la paix générale immédiate si magnifiquement commencée par le prolétariat de Basse-Autriche, auquel s'était jointe la classe ouvrière des autres territoires de la Couronne et de la Hongrie, elle-même a été trahie par la direction du parti, honteusement vendue au gouvernement de l'État de la classe capitaliste et par un soi-disant "conseil ouvrier". Au lieu de pousser le mouvement en avant, à l'exemple de nos frères russes, au lieu de constituer un véritable conseil ouvrier assumant tout le pouvoir, ces lèches-bottes du gouvernement avaient déjà commencé à négocier avec lui. A bas la discipline de cadavre ! Assez de phrases sur la responsabilité et l'unité ! Que chacun de nous porte en lui la conscience de la solidarité prolétarienne !” (dans Programme Communiste n°37).
Révolte dans l’armée
Pendant le mouvement, le préfet de Wien aura noté qu'au début, les autorités étaient débordées, sans aucun moyen d'intervenir de manière énergique et qu'il aurait fallu disposer de dix mille hommes le colonel Kloss, ministre de la Guerre, fit ressortir dans son rapport militaire au Conseil des Ministres du 28 janvier que les ouvriers disposaient d'armes nombreuses et entraient librement dans l'enceinte de l'Arsenal. C'est bien malgré lui que Bauer détruit ses propres thèses de l'isolement et de la répression :
- "L'effet produit par la grève générale sur l'armée fut encore plus lourd de conséquences. L'effervescence des troupes se manifesta par une série de mutineries qui suivit la grève de janvier. Des troupes slovaques à. Judenburg, serbes à Fünfkirchen, tchèques à Rumburg, Maygares à Budapest se mutinèrent"(Voir n° spécial de Critique Communiste).
Où sont les troupes tchèques, croates et de slovènes d'antan qui furent mises à la disposition de Windischgrätz pour mater la révolution démocratique de Wien en 1848 ? Qui se trouvait isolé sinon l'État à qui était refusé le support de baïonnettes de l'armée permanente ? Sur un front s'étendant de l'Adriatique aux plaines de la Pologne et courait le long de la formidable barrière des Alpes, l'armée autrichienne n'avait pas fait preuve d'un "héroïsme admirable". Dès la mobilisation des recrues, à qui l'État-Major faisait prêter serment de bravoure, le moral était peu brillant, comparable en cela à celui des soldats italiens. Dans la boue ou la neige, les soldats autrichiens n'avaient qu'une hâte : en finir au plus vite avec la boucherie. Le soldat autrichien déserte ou passe aux Russes ; s'il refuse de s'exposer aux coups de quelque coté qu'ils viennent, c'est alors le «brave soldat Chveik» simulant l'idiotie pour échapper au front.
Le commandement ne réussissait pas à opposer des forces régulières importantes et sûres aux grévistes, comme le confirmera presque aussitôt la mutinerie des marins de Cattaro que, seule l'intervention des sous-marins allemands, pu réduire. Tout de suite après la grève de janvier, vers le 6 février l'équipage de la flotte autrichienne mouillée dans les eaux de Cattaro, se souleva ; les marins hissent le drapeau rouge, forment" leurs conseils et rejoignent les ouvriers des arsenaux en grève. Un anarchiste, J. Cserny, qui au cours de la future «Révolution des chrysanthèmes» allait servir héroïquement dans le bataillon "les gars de Lénine" en Hongrie, se porta à la pointe du combat, encourageant ses camarades au combat de classe.
En un mot, la "démoralisation" rendait l'armée impropre à ses tâches impérialistes ; l'insubordination des régiments tout entiers, réalisait la vieille prédiction du "général" blanchi sous le harnais de la lutte du prolétariat :
- "A ce point, l'armée se convertit en armée populaire ; la machine refuse le service, le militarisme périt de la dialectique de son propre développement"(Engels "Anti-Dühring").
Pareil mouvement avait pu prendre une ampleur grandiose en Allemagne et surtout en Russie parce que là le parti bolchevik avait su donner une liaison étroite entre les conseils ouvriers et les soviets des soldats et de marins. A la tête de la révolte, marchent résolument les matelots puisque leur service à bord exige d'eux des capacités d'ingéniosité et de discipline car un bateau est une véritable usine flottante. L'Autriche n'était pas devenue une puissance navale, coincée entre l'Allemagne impériale et la Russie tsariste : sa chair à canon est constituée essentiellement de paysans qui sont, par nature peu enclins à se plier à une discipline, fût-elle celle de la révolution.
Mais l'État-Major ne badinait pas envers ceux qui s'étaient laissés emporter par un mouvement de révolte. Czernin, très apprécié de la direction du parti socialiste avec laquelle il entretenait des rapports, on ne peut plus cordiaux, exerça de cruelles représailles sur les mutins, soulevés contre l'absurde discipline de corps et la poursuite insensée de la guerre. Czernin pouvait faire pendre et fusiller des dizaines de mutins, il avait encore et toujours la confiance des socialistes autrichiens, comme jamais auparavant aucun autre homme d'État de l'Autriche ne l'avait eue. "Vous et moi, est-ce que nous ne nous entendions pas bien ensemble" se plaisait à répéter le comte au vieil Adler, lequel ne pouvait que lui répondre en souhaitant de voir son Excellence demeurer fidèle à elle-même et ne pas s'écarter d'une politique qui lui valait l'assentiment de la direction socialiste.
Les choses allaient de mal en pis. Dès le 20 décembre 1917, la classe dominante se rendit a l'évidence qu'il fallait confier rapidement les destinées de l'État à un fondé de pouvoir des plus sûr. Son choix ne fut pas difficile et se porta sans tergiversations sur la social-démocratie qui, durant la paix, avait si bien administré son "patrimoine" de parti responsable.
A un Empereur sur le trône depuis 68 ans, le comte Czernin, particulièrement clairvoyant, télégraphiait :
- "Si nous continuons dans la voie actuelle, nous ne manquerons pas de vivre dans quelque temps des circonstances qui ne le céderont en rien à celles que connaît la Russie".
Les mandarins de la social-démocratie autrichienne, législateurs, bourgmestres ou directeurs de coopératives, s'étaient finalement intégrés dans les rouages du capital financier. Quand il fut plus qu'évident que les revendications économiques des grévistes, pour ne pas mourir de faim, s'orientaient dans la voie politique, leur action fut de se mettre en travers de la lutte du prolétariat pour briser son élan et le détourner de la lutte pour le pouvoir.
C'était bien là ce qu'avait discerné autrefois Trotsky, des représentants du type opposé à de lui du révolutionnaire. La social-démocratie autrichienne était tout à fait représentative “de cet Occident supérieurement développé composée de poltrons qui, en spectateurs paisibles laisseront les russes perdre tout leur sang" (R. Luxembourg).
Lutte contre le Parti Communiste
Il fut particulièrement difficile de constituer le parti communiste pour la réalisation des nouvelles tâches qui trouvèrent les éléments radicaux dans un état d'impréparation lamentable. Même après plusieurs années de massacre, le pôle où l'opposition à une politique d'Union Sacrée suivie par la social-démocratie puisse se cristalliser faisait encore défaut : les Gauches étaient désunies, dispersées autant qu'il était possible.
Koritschoner avait vainement lutté contre le sabotage de la grève de janvier 1918 ; maintenant il remuait ciel et terre pour réunir dans une seule formation distincte les minoritaires de guerre. Sa tâche lui fut facilitée par les discussions engagées à Kienthal par Lénine et Radek. Il rencontra un terrain favorable auprès de certains éléments de l'Association des Etudiants Socialistes ; un groupe de tendance anarchisante "Internationale" ; les syndicalistes révolutionnaires ; l'extrême gauche du groupe socialiste juif de "Poale Sion" et, bien entendu, son propre groupe des "Linksradicale", comprenant J. Strasser qui, comme tant d'autres, avait mis un terme à son activité social-démocrate à l'issue de la grève générale de 1918.
La personnalité de F. Adler fit, pour une part notable, barrage à la constitution de la nouvelle formation révolutionnaire. Celui-ci, à la suite de l'attentat du mois d'octobre 1916 sur la personne du comte Stürgkh était devenu pour toute la classe ouvrière le symbole de l'hostilité à la guerre et du sursaut contre la position chauvine de son parti. Son attitude courageuse lors du procès qui le condamnait à mort, renforça son auréole de martyre. Or, contre toute attente, à sa sortie de prison en novembre 1918, au lieu de servir de drapeau révolutionnaire aux masses, il se remet à la disposition du parti socialiste qui avait proclamé que son acte était celui d'un forcené. Son titre de gloire va servir ainsi à détourner de la lutte pour le pouvoir. Il aura les mains libres pour réunifier tous les conseils en "zentralrätte", instruments d'une lutte difficile contre.... l'aventurisme "communiste" sur le terrain des conseils. La propagande sociale-démocrate contre la scission fut considérable et exerça une profonde influence sur les travailleurs ; elle excita la classe ouvrière contre les communistes en faisant appel à ses pires préjugés. Les mots d'ordre des communistes pour la République des Conseils furent dénoncés comme "agitation effrénée lancée au mépris de toutes les réalités politiques et sociales".
Qui sont réellement ces "énergumènes" dont on dit que leur véritable intention consiste à conduire le pays au chaos ? A Wien, le parti communiste s'appuie sur les ouvriers de districts, ainsi que sur les soldats et démobilisés organisés en milice armée, installée dans une caserne de la Mariahilferstrasse. A Linz, le Soviet des députés des ouvriers et soldats se trouve influencé par les militants communistes. A Salzbourg, le parti possède un appui solide parmi les ouvriers et les paysans, pauvres de la montagne.
L'ancienne armée monarchique était en débandade, les soldats quittaient les casernes pour centrer chez eux. A leur retour de Russie, les prisonniers de guerre, les soldats démobilisés entièrement gagnés aux thèses bolcheviks, rentrent au pays en rapportant tracts, journaux et brochures. Assurément, les appels répétés aux ouvriers, paysans et soldats de tous les pays belligérants ont trouvé un profond écho en Autriche-Hongrie; plus particulièrement, le "Manifeste du Comité Central Exécutif et des Commissaires du Peuple aux ouvriers d'Autriche-Hongrie du 3/11/1918". Même Bauer du reconnaître "dictature du prolétariat", "pouvoir des soviets", on n'entendait que ça dans les rues. Dans les premiers jours de novembre 1918 se constitua le parti communiste pour l'Autriche allemande, avec pour toile de fond les premières manifestations de masses où l'élément le plus important était constitué de soldats démobilisés d'eux-mêmes ou de rapatriés de guerre. Les énergiques militants de la "Linksradicale", groupée autour de Koritschoner, jugeaient la proclamation du parti prématurée puisque tout était à mettre sur pied, depuis les sections locales jusqu'aux organismes centraux. Mais ils finirent par se rallier, le jour même du premier congrès, le 9 novembre 1919.
Après avoir attentivement examiné la situation de décadence irrémédiable du capitalisme, le congrès déclara que la question de participer à la vie parlementaire restaurée par les soins de l'austro-marxisme se posait uniquement pour distraire le prolétariat des voies insurrectionnelles le conduisant à sa dictature de classe. En conséquence, le parti décida à l'unanimité à l'unanimité de dénoncer les fébriles préparatifs électoraux parce que s'effectuant dans la période historique de la révolution prolétarienne.
La Gauche, qui allait diriger le PCA jusqu'à ce que la bolchévisation fasse subir son oeuvre dévastatrice des acquis, en plaçant au sommet deux médiocrités : Fiala et Koplenig, n'eut que très peu de temps devant elle pour charpenter le parti. Elle saisit immédiatement la proclamation officielle de la République, le 12, pour appeler tous les prolétaires et démobilisés à manifester devant le vénérable parlement sous le mot d'ordre "pour la république socialiste" inscrit sur un océan de banderoles. Une foule immense était rassemblée lorsque la fusillade éclata. Alors, en riposte immédiate, un détachement de la "Garde Rouge" occupa la "Neue Freie Presse" et réussit à faire imprimer une proclamation sur l'imminence de la chute définitive de la république bourgeoise.
De la part de la jeune formation communiste, la surestimation des possibilités révolutionnaires était grande avec, en plus, un manque d'unité de vue. Ceux des "Linksradicale" ont même désapprouvé l'occupation du journal, attitude démontrant, hélas, que les groupes ne s'étaient pas encore fondus en un tout cohérent et ordonné. Facilitée par cette discorde, la répression s'abattit à un train d'enfer. A peine constitué, le parti devait passer dans la semi clandestinité : militants pourchassés, locaux sous scellés, journaux interdits, méthodes de gouvernement parfaitement démocratiques que les sociaux-démocrates appliquèrent avec un zèle tout particulier : à Gratz, important centre industriel de Styrie, le "camarade" Resel, commandant militaire de la place, dirigea contre les communistes une terreur en règle.
Durant les premiers mois de 1919, l'Autriche connut une situation épouvantable, mettant à l'ordre du jour la révolution. En Hongrie, dans la nuit du 21 mars, B. Kun et ses compagnons étaient arrachés de la prison par une foule de manifestants : les ouvriers occupèrent les quartiers névralgiques de BudaPest, les conseils proclamèrent la dictature rouge. En Bavière, c'était l'établissement de la république des conseils, le 7 avril. Le parti en Autriche considérant la situation mûre et, fort de ses 50.000 membres fixa l'insurrection pour le 15 juin, pour coïncider avec la date retenue par la commission d'armistice pour la réduction des effectifs militaires.
Soupçonnant la faiblesse des communistes, la social-démocratie se hâta d'accumuler les embûches. Le 13, F.Adler s'adressa aux ouvriers pour les mettre en garde contre un éventuel putsch communiste ; O. Bauer intervint auprès des représentants de la commission pour lui demander de ne pas dégarnir les casernes par un licenciement intempestif de la milice. De la sorte, travaillé par la propagande de l'ex-héros Adler, le conseil ouvrier de Wien se prononça contre l'Insurrection pour se réfugier dans les bras de la démocratie qui ne tarda pas à l'étouffer. Même après l'action de novembre, le parti communiste était loin de posséder une correcte unité de vue sur le problème de l'insurrection.
Faute d'avoir réussi à
prendre solidement appui, tels les bolcheviks, sur une puissante vague de
grèves ouvrières, de ne pas avoir gagné suffisamment d'influence sur les
conseils et de ne pas avoir saisi quel était le moment le plus critique dans
les rangs ennemis, l'insurrection a tourné court. La "Garde Rouge"
attendant en vain le signal de l'attaque se coordonna mal avec le reste des combattants.
La reculade des responsables du parti au dernier moment, leurs atermoiements
coûtèrent la vie à une trentaine de manifestants touchés par la fusillade
ordonnée par le ministre de l'Intérieur, le social-démocrate Eldersch. Le
tragique exemple autrichien nous montre comment il ne faut pas faire
l'insurrection, parce qu'à Wien, elle s'est faite justement sous la forme tant
redoutée du "putsch".
Théorie de la "violence défensive"
A la limite, la dictature du prolétariat exercée par le système des conseils d'ouvriers et de soldats, Adler et Bauer pouvaient le concevoir, mais à une condition expresse : qu'elle se fasse loin de chez eux, chez les voisins "arriérés". Qu'elle surgisse, avec son cortège de violence, dans la Russie où régnait le "despotisme oriental", qu'elle ait lieu en Hongrie ou Tchécoslovaquie, passe encore. Mais pour les travailleurs autrichiens qui disposent depuis des générations de ce réseau serré de municipalités, de crèches, de clubs sportifs, de cités "ouvrières" ou de coopératives, alors "Vade rétro, Satana" :
- "Nous sociaux-démocrates3, concédons aux communistes que dans de nombreux pays où la bourgeoisie oppose sa contrainte au prolétariat, la suprématie de ta bourgeoisie ne pourra être détruite que par la force. Nous concédons que, même en Autriche, des évènements exceptionnels et surtout une guerre pourraient contraindre le prolétariat à utiliser des moyens violents. Mais si des événements extraordinaires ne viennent pas troubler le développement pacifique du pays, la classe ouvrière s'emparera du pouvoir dans peu de temps par les moyens légaux de la démocratie et pourra exercer son pouvoir dans les formes légales de la démocratie".
Ces paroles empreintes d'une rare sagesse, que Bauer prononça en 1924, n'étaient en fait qu'une pétition de principe sans lendemain. Quand, en 1933 arriva l'heure de démontrer dans la pratique la force de cette fameuse théorie de la "violence défensive", le parti dirigé par Bauer s'effondra sans combat.
Plus à "gauche" dans le parti, Adler tient des propos identiques :
- "De son côté, l'Assemblée Nationale serait l'organisme qui décide de toutes les questions politiques et culturelles qui se posent après la réorganisation économique ; l'instrument indispensable de la période transitoire qui préserverait du terrorisme la dictature du prolétariat et qui assure un développement continu et paisible loin des orages d'une guerre civile". (Démocratie et conseils ouvriers, Wien 1919, Maspero 1967, p.100).
En brisant le vieil appareil d'État, la Commune de Paris a aboli la distinction bourgeoise entre législatif et exécutif. A l'opposé de cette expérience historique, Adler veut exprimer sa confiance, toute démocratique, au parlementarisme, ce "moulin a paroles où se décide périodiquement quel membre de la classe dominante écrasera le peuple"(Lénine). Quelle horreur si les conseils venaient à confondre législatif et exécutif. Monsieur de Montesquieu se retournerait dans sa tombe!
Avant la première guerre, la social-démocratie autrichienne justifiait sa position "défensive" par le fait qu'il ne fallait pas perdre les conquêtes obtenues à l'intérieur du capitalisme, depuis l'abrogation des droits douaniers jusqu'aux dispensaires "ouvriers" et boulangeries municipales, barrage à la cherté de la vie (sic). A la fin de la guerre, à cet argument s'en ajouta un autre : celui de "rapport de forces".
On partait de l'idée, réellement fondée, que l'Autriche réduite à la dépendance économique, n'aurait jamais suffi à ses besoins sans l'appui des puissances victorieuses. Tout dépendait du bon vouloir de celles-ci. La guerre civile, rompant l'équilibre des forces aurait immédiatement provoqué l'intervention de l'Entente et, c'en aurait été fini du processus de "socialisation lente" qui, peu à peu, transformait les rapports sociaux de production.
Comme toujours en pareil cas, la prise du pouvoir politique par le prolétariat était rabaissée à un acte putschiste de type blanquiste à empêcher coûte que coûte. Mieux valait tenir que courir et, puis si la classe dominante essayait de réagir à son expropriation, c'est alors qu'interviendrait la "violence défensive".
Qu'entendait donc l'austro-marxisme
par là ? Protéger la Constitution de la République contre toute attaque d'où
qu'elle vienne. Parbleu ! C'est pourquoi il veillera à ce que l'armée
reconstituée dispose d'armes et de matériel en quantité suffisante. En 1923, il
donna corps à sa doctrine en constituant le Schutzband pour seconder l'armée
fédérale numériquement très faible. Ainsi le prolétariat autrichien devenait le
bouclier de la démocratie, une démocratie se faisant chaque jour un peu plus
carnassière.
La socialisation ou "marche lente vers le socialisme"
Une fois la grève de janvier liquidée, la social-démocratie pu se consacrer à un problème qui lui tenait particulièrement à coeur : poursuivre la "socialisation" entamée dans la période de développement organique du capitalisme autrichien.
En mars 1919, Bauer se trouva promu à la tête de La "Commission de socialisation" aux côtés d'experts économiques chrétiens sociaux, où il pu faire la preuve de ses immenses talents d'administrateur. Socialistes et chrétiens sociaux attaquèrent au problème de la "socialisation" les mines de fer et de charbon et de l'industrie lourde. Les anciens trusts et cartels, nés pendant la guerre se convertirent en "Union Industrielle", gérées suivant le principe de la co-gestion.
Bauer ne s'est jamais lassé de répéter qu'il fallait faire l'impossible pour diminuer les frais de production et développer les méthodes le rationalisation en vigueur dans les pays plus développés :
- "De cette manière, les Unions Industrielles diminueront considérablement les dépenses d'établissement et rendront possible la production bon marché (...) Si une union parvient à diminuer des frais de production d'une manière essentielle, le bénéfice des patrons en sera augmenté et, cette augmentation de bénéfice pourra être rapporté à l'État"(La Marche au Socialisme. Wien 1919, chez E.D.I. "Bauer et la révolution" Paris 1968).
Mais la condition indispensable à la réussite du capitalisme "populaire" consistait à ramener dans le bercail social-démocrate les "Arbeiträtte". En tant qu'organisation de lutte, ces derniers s'étaient écroulés sous l'attaque sournoise de la constitution démocratique et, surtout à cause de la chute de la République hongroise des Conseils sous les coups de l'armée française d'Espéry. Ils se transformaient en simples instruments de cogestion pour la fixation des salaires et de stimulant de l'effort productif.
Le 15 mai 1919, la loi officialisait l'existence des conseils ouvriers sous forme de conseils d'entreprise avec mission d'arbitrer les conflits survenant sur les lieux d'exploitation, pour faire cheminer sans heurts le capitalisme autrichien.
Dans le temps où il
fréquentait l'Université, cet O. Bauer avait beaucoup impressionné Kautsky qui
croyait, pas moins, avoir rencontré... Marx ! : "C'est ainsi que je me
représente le jeune Marx". Confondre Marx et Lassalle, qui lui pouvait
flirter avec Bismarck, voilà encore un bel effet d'optique de l’opportunisme !
Épilogue
Les "sages" austro-marxistes qui étaient à la tête du parti social-démocrate le plus parfaitement organisé du monde, se sont félicités d'avoir épargné au prolétariat autrichien le "cauchemar" de la guerre civile. Et ils se sont congratulés de l'avoir engagé dans "une paix Véritablement constructive destinée à durer". En pleine crise révolutionnaire, pour calmer la faim et la colère des masses, ils leur ont jeté l'os de la "sozialpartnershaft" autrement dit la cogestion. Il est vrai qu'à Wien, les socialistes avaient su élever jusqu'à l'art la tactique de la neutralisation du prolétariat par une fourberie rarement égalée.
Une fois le grand précurseur de la révolution russe, Herzen, a dit de Bakounine que ce dernier était parfois trop enclin à prendre le troisième mois de la grossesse pour le terme. En tant que campagnard un peu rustre, notre "batko" n'entendait certainement rien à l'obstétrique sociale et manipulait dangereusement, comme à Lyon en 1871, le bistouri social. Mais nos raffinés docteurs en science de l'austro-marxisme firent pire : ayant refusé d'accoucher l'enfant ; ils récoltèrent en retour... l'austro-fascisme.
Vers les années 1933, l'Autriche se trouvait être le théâtre du dernier acte de la guerre civile commencée en 1918. Cette république modèle, portée sur les fonts baptismaux par les grands officiants de la "voie pacifique au socialisme” ne faisait aucun quartier. Progressivement, la police légale investissait ce qui, naguère, faisait l'orgueil des bonzes.
De même qu'en Italie, dans un dernier sursaut, le prolétariat autrichien prit les armes, non pour sauver les institutions, mais pour vendre le plus chèrement possible sa peau. Des centaines de combattants ouvriers versèrent leur sang, par groupes isolés, sans directive centrale, en dépit de la carence des chefs militaires du "schutzbund" et surtout contre les ordres formels de la Zentrale qui prêchait, encore à ce moment là, la confiance dans les rouages démocratiques. Un grand nombre de membres du parti socialiste se battirent malgré eux, le fusil à la main ce qui, évidemment, permit à la social-démocratie en tant que telle de se retrouver avec l'auréole de martyr de la lutte anti-fasciste.
Après l'héroïque soulèvement de février 1934, les gardes civiques de la "Heimwehren" ratissaient les rues de Wien et de Linz au pas cadencé ; les domiciles des travailleurs étaient perquisitionnés et mis à sac. On pouvait voir alors le débonnaire citoyen Biedermayer, rendu enragé par la crise, donner la chasse aux juifs et aux ouvriers. Monseigneur le prince le Stahrenberg et Monseigneur le très dévôt ; Seipel, faisaient mettre en position les lance-mines de la république pour bombarder les derniers grévistes ; partout, dans les usines, les travailleurs "rouges" étaient remplacés par des employés "patriotes". La démocratie parlait le langage de la poudre dans un État se définissant "totalitaire mais sans arbitraire".
L'austro-marxisme avait beau jeté ses cris perçants de femmelette et proposé aux communistes le pacte d'unité d'action anti-fasciste. C'était bien lui et personne d'autre qui avait préparé le lit du fascisme. Jouant sa sempiternelle carte du "moindre mal", n'avait-il pas tenté un rapprochement avec Dolfuss pour protéger l'Autriche du nazisme ? En 1934, Dolfuss lui marqua toute son ingratitude en le réduisant à l'illégalité.
Avant de disparaître, Bauer eut encore le temps de signer une ultime forfaiture. Il salua, lui l'ennemi de toute violence, la sinistre théorie du socialisme dans un seul pays. Il engagea les travailleurs du monde entier à suivre l'exemple du stalinisme. Il en appela aux partis "ouvriers" des pays démocratiques à conclure l'Union Sacrée avec leurs gouvernements :
- "Quiconque prend position contre l'URSS pendant la guerre, fait le jeu de la contre-révolution et devient notre ennemi mortel".
Quand l'Armée Rouge, en avril 1945, "libéra" Wien, le vieux Renner se vit confier par les russes la tâche de former le gouvernement provisoire et Staline put faire l'éloge du "chancelier d'opérette”. Renner est certainement un des rares politiciens qui, par deux fois au cours de sa vie, eut à mettre sur pied un appareil d'État dans des moments cruciaux pour "sa" bourgeoisie.
Aujourd'hui, l'homme qui est chargé de faire avaler aux travailleurs autrichiens la pilule de l'austérité se nomme Kreisky qui se targue de continuer l'oeuvre de l'austro-marxisme. Nous ne saurions en douter un seul instant.
R. C.
<<>>-oOo -
- "A tous les slogans, comme à tous les arguments nationalistes, on répondra : exploitation, plus-value, lutte de classe. S'ils parlent des revendications d'une école nationale, nous attirerons l'attention sur l'indigence de l'enseignement dispensé aux enfants d'ouvriers qui n’apprennent pas plus que ce dont ils ont besoin pour pouvoir trimer plus tard au service du capital. S'ils parlent de panneaux indicateurs et de charges administratives, nous parlerons de la misère qui contraint les prolétaires à émigrer. S'ils parlent de l'unité de la nation, nous parlerons de l'exploitation et de l'oppression de classe. S'ils parlent de la grandeur de la nation, nous parlerons de la solidarité du prolétariat dans le monde entier."
Pannekoek : "Lutte de classe et nation"
[1] [89] Un parti centralisé, c'est certes ce qui était souhaité... à la condition qu'en son sein soit respectée l'autonomie nationale. Loin d'être à l'image de la communauté d'intérêts de tous les prolétaires, le "Gesamtpartei" ressemblait au manteau d'Arlequin fait de plusieurs petits partis nationaux. Un affirme sa "germanité", un second son "italianité", un troisième sa "ruthénité". Au Reicharat, il était d'usage courant que tel groupe de députés socialistes tchèque vota dans un sens tout à fait contraire à celui des camarades allemands. Moins il sera question de souder le prolétariat en une armée compacte sur l'objectif de classe, plus on occupa l'esprit des travailleurs avec le "fait national", plus vite se fit la débandade. A partir des années 90, la crise séparatiste brisa l'unité ouvrière. On réorganisa les syndicats en donnant entière satisfaction aux tendances séparatistes et, à la fin du siècle, le syndicalisme autrichien était tronçonné en autant de fédérations qu'il existe de groupes nationaux.
Géographique:
- Autriche [90]
Courants politiques:
- Le Conseillisme [91]
Revue Internationale no 11 - 4e trimestre 1977
- 2758 reads
TEXTES DU IIème CONGRES DU COURANT COMMUNISTE INTERNATIONAL
- 2464 reads
Présentation
Nous publions dans ce numéro les principaux textes du second Congrès du Courant Communiste International. Ce Congrès a essentiellement été consacré au réexamen et à la vérification de l'orientation du CCI. Il a été un moment où l'organisation internationale toute entière, tire le bilan et trace les perspectives pour la période à venir.
Ce second Congrès a ainsi réaffirmé avec force, à la lumière de l'expérience, la validité des bases principielles sur lesquelles s'est fondé le CCI, il y a un an et demi :
- la plateforme politique[1] [92],
- les statuts d'une organisation révolutionnaire unie et centralisée internationalement,
- le manifeste du premier Congrès appelant les révolutionnaires à prendre conscience de leurs tâches, par rapport à l'enjeu décisif de notre époque de crise et de lutte de classe[2] [93].
Seule cette basé de principes cohérents donne un sens global à l'activité révolutionnaire et le second Congrès du CCI s'est donné comme tâche la mise en application de ces principes à l'analyse de la situation politique actuelle.
es textes du Congrès parlent d'eux-mêmes, mais on ne peut en saisir toute la portée qu'en les comprenant comme le résultat du travail collectif d'une organisation révolutionnaire. L'élaboration méthodique des perspectives tout comice sa traduction en interventions actives nécessitent la création d'un cadre collectif et organisé. Ce Congrès a donc, considéré l'élargissement général de l'organisation dans ses huit sections territoriales et surtout le développement du travail du CCI en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Hollande comme une vérification de l'orientation défendue et suivie depuis longtemps. Plus que le simple accroissement numérique, l'important a été la capacité du CCI depuis dix-huit mois à diffuser régulièrement ses analyses dans 95 numéros de ses publications, en 7 langues, distribuées un peu partout dans le monde.
Les textes ci-dessous sont aussi le fruit d'une recherche politique et théorique constante du CCI pour pouvoir aller plus loin vers les problèmes que la lutte de classe pose pour l'avenir et notamment sur la période de transition au socialisme. En ce sens, ces textes cristallisent un an et demi d'efforts de discussions aussi bien avec d'autres courants politiques qu'au sein du CCI. La capacité d'élever constamment le niveau politique du CCI et ceci de façon homogène dans toute l'organisation en comptant sur l'apport de tous les militants, a été et reste un axe fondamental du travail, seule façon d'assurer que les révolutionnaires puissent contribuer à l'approfondissement théorique dans le mouvement ouvrier.Expression d'un effort organisationnel et d'une recherche théorique, les travaux du second Congrès expriment aussi la volonté de mieux com-prenùre le milieu révolutionnaire aujourd'hui afin d'oeuvrer vers le regroupement. Nous pré-, sentons donc ces documents à la lumière des récentes tentatives importantes de confrontation entre groupes politiques prolétariens. En mai 1977, le Partito Comunista Internazionalista ("Battaglia Comunista") a convoqué une Conférence Internationale[3] [94] de discussions à laquelle a participé le CCI. D'autres groupes invités (dont la Communist Workers Organisation et Fomento Obrero Revolucionario) n'ont malheureusement pas pu être présents et d'autres comme Pour Une Intervention Communiste ont refusé; mais les débats sur la période actuelle et les implications pour la lutte de classe, sur le rôle des syndicats et sur l'organisation des révolutionnaires ont aidé à dissiper des malentendus, à mieux cerner les points d'accord et les raisons des désaccords. Suite à cette tentative, limitée mais fructueuse de clarification, le CCI a accueilli une délégation du PCI-Battaglia Comunista au second Congrès où ces camarades ont pu porter le débat devant l'ensemble de l'organisation. Les impératifs imposés par le développement de la résistance ouvrière sont aujourd'hui ressentis de façon beaucoup plus forte dans le milieu révolutionnaire en tant qu'impulsion vers les contacts internationaux. En septembre 1977, plusieurs groupes suédois et norvégiens organisent une conférence, de discussions à laquelle le CCI participe.
Un autre élément de la situation actuelle prouvé par l'expérience de ces dernières années, est la' faillite de la théorisation de l'isolement. Ceux qui, en 1975, ont rejeté le regroupement et même tout contact avec le CCI - PIC en France, la CWO en Grande-Bretagne, le Revolutionary Workers 'group aux USA - se sont depuis longtemps disloqués entre eux, condamnant la tentative d'association anti-CCI à la stérilité. La RWC s'est dissoute il y a un an après avoir subi les métamorphoses du modernisme. La CWO, pour sa part avait déjà recueilli l'an passé les premiers fruits amers de l'unification confuse et sectaire entre Revolutionary Perspectives et Workers 'Voice : l'éclatement de leur "regroupement" national en deux morceaux. Tout récemment, au cours de l'été 77, le reste de la CWO a subi une seconde scission et ceux qui quittent la CWO défendent, cette fois-ci la nécessité du regroupement et plus particulièrement expriment la volonté d'entamer une discussion avec le CCI dans ce sens[4] [95].
C'est dans ce contexte général que nous présentons les textes du Congrès qui portent sur trois thèmes principaux :
- Un rapport sur la situation internationale dans lequel est tracés l'évolution actuelle du renforcement de la tendance vers le capitalisme d'Etat dans le bloc de l'Ouest et dans le bloc de l'Est, mettent en relief le développement de l'économie de guerre, réponse du Capital à la crise et les antagonismes inter-impérialistes évoluant, de guerres locales vers une généralisation. Nous tentons d'approfondir à la lumière des événements actuels les analyses de l'économie de guerre faites par la Gauche Communiste dans les années 30.
- Une résolution sur les groupes politiques prolétariens, marquant l'effort de cerner les différents éléments qui constituent le milieu révolutionnaire de notre période, éléments différents de ceux des Partis de masse d'autrefois. Ce texte situe le CCI dans un contexte plus général du développement de la conscience de classe en soulignant la volonté de rejeter le sectarisme et toute prétention à l'exclusivité, chère aux bordiguistes. Cette résolution aborde les groupes politiques et non les cercles de discussion qui peuvent surgir en milieu ouvrier : ces surgissements éphémères, expressions historiques et actuelles de la faiblesse de la présence des organisations révolutionnaires, seront traités spécifiquement dans d'autres textes.
- Sur la période de transition du capitalisme au communisme, le lecteur trouvera deux projets synthétisant le niveau atteint par la discussion dans le CCI. Bien que l'orientation du premier texte ait suscité l'accord de la plupart des membres de l'organisation, le Congrès a préféré ne pas se contenter d'un vote formel sur cette question, considérant qu'il est plus important actuellement de poursuivre plus avant cette discussion et ceci publiquement. Notre principal souci reste en effet la clarification théorique, non seulement dans le CCI mais en stimulant les contributions d'autres courants et éléments révolutionnaires à ce débat complexe.
[1] [96] Revue Internationale n°5
[2] [97] Révolution Internationale n°22
[3] [98] Revue Internationale n°10 et textes de la Conférence Internationale (brochures) (ronéoté en Français et Anglais, n° spécial de "Prométéo" bilingue français-italien)
[4] [99] Les textes de cette scission et une mise au point sur les discussions seront publiés dans le prochain numéro de la Revue Internationale ainsi que dans "Revolutionary Perspectives" (organe de la CWO à notre critique parue clans les n°s 9 et 10 de la Revue Internationale)
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
De la crise à l’économie de guerre
- 2683 reads
Ce rapport sur la situation internationale tente de tracer les perspectives politiques et économiques fondamentales que au cours de l'année à venir. Plus qu'une analyse détaillée de la conjoncture économique et politique actuelle même dans les principaux pays capitalistes -analyses qui se poursuivent aujourd'hui de façon régulière dans les publications des différentes sections territoriales du Courant Communiste International-, nous nous efforcerons de donner les lignes essentielles, les axes fondamentaux qui vont déterminer le cours de l'économie capitaliste pour l'année prochaine et qui vont dessiner l'orientation politique des diverses bourgeoisies nationales et les actions des deux blocs impérialistes. Nous espérons ainsi élaborer une perspective cohérente pour guider l'intervention du CCI dans les batailles de classe décisives qui se préparent de plus en plus : perspective qui sera un des éléments pour que le CCI devienne de plus en plus un facteur actif du développement de la conscience du prolétariat, pour que le CCI puisse devenir un élément vital de l'orage prolétarien qui déracinera et détruira l'Etat capitaliste dans le monde entier et ouvrira la transition au Communisme.
Malgré les proclamations triomphales de "reprise" avec lesquelles politiciens et hommes d'Etat bourgeois ont tenté de calmer leur faim croissante et ont appauvri le monde, ces deux dernières années, la crise économique capitaliste globale s'est approfondie sans relâche. Dans les pays industrialisés du bloc américain (OCDE), la croissance du PNB réel et des exportations a décliné depuis le début de 1977 (voir tableau ci-dessous). Cependant, même ces sombres tableaux n'arrivent pas à traduire la situation catastrophique dans laquelle les pays européens les plus faibles économiquement, comme la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal se trouvent aujourd'hui. Des PNB quasiment stagnants, un effondrement des investissements dans des nouvelles branches et des déficits énormes du commerce et des balances de paiements, ont mené â une dévaluation de fait de leurs monnaies, une chute vertigineuse des réserves d'échange et une poussée des dettes extérieures.
Il en est résulté une hyper-inflation (Grande-Bretagne, 16-17% ; Italie, 21% ; Espagne, 30% ; Portugal, plus de 30%) et un chômage massif (Grande-Bretagne, 1,5 million ; Italie, 1,5 million ; Espagne, 1 million ; Portugal, 500.000 soit 18% de la population officiellement).
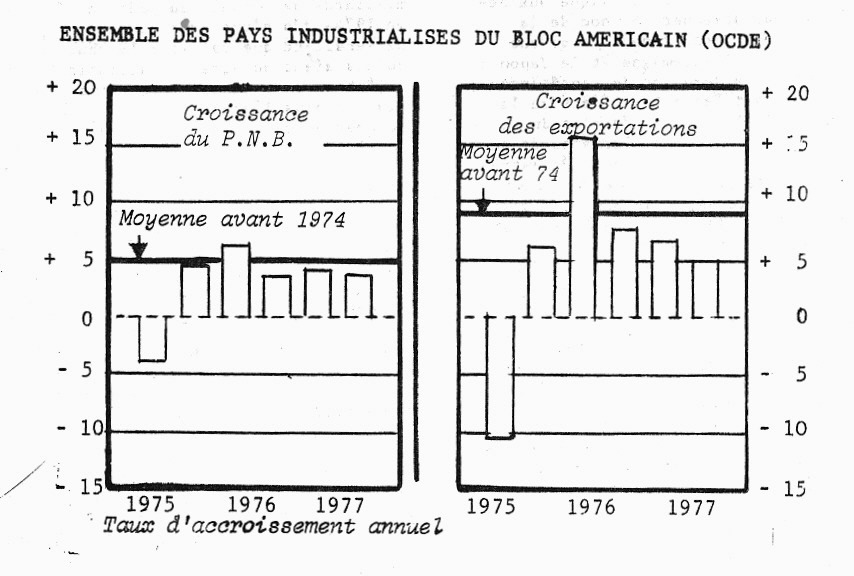
Ces quatre pays sont réellement en faillite et ne sont maintenus à flot que par les prêts et les crédits qui dépendent en dernier ressort du bon vouloir des Etats-Unis. La bourgeoisie de ces hommes malades de l'Europe ne parle même plus de "reprise" ou de "croissance" ; le nouveau mot d'ordre est "stabilisation", euphémisme pour l'austérité draconienne, la déflation et la stagnation auxquelles ils sont condamnés par leur faiblesse économique et les dictats de leurs créanciers. Qui plus est, les rangs de ces hommes malades commencent à être rejoints par la France, la Belgique, le Danemark, la Suède et le Canada, pays dont la puissance économique n'était pas mise en question dans les cercles bourgeois il y a quelques années, mais qui s'enfoncent maintenant rapidement dans le marécage des déficits incontrôlables du commerce et des paiements, des dévaluations, des dettes accrues, de l'hyper-inflation et du chômage montant en flèche, auxquels ont déjà droit leurs proches voisins.
Un coup d'oeil sur les économies puissantes du bloc américain -Etats-Unis, Allemagne, Japon- révèle rapidement une extrême fragilité et de sombres perspectives pour ces mêmes économies qui semblent fortes. La santé apparente de l'Allemagne et du Japon -avec leurs importants surplus commerciaux et leurs monnaies robustes- repose presque exclusivement sur de gros efforts d'exportation massive et un dumping systématique. Parallèlement, les Etats-Unis ont bénéficié d'une série de mesures inflationnistes qui sont arrivées maintenant à leur terme et du fait que le déficit de leur commerce a largement été compensé par d'énormes bénéfices invisibles (paiements d'intérêts, profits d'investissements à l'étranger, transfert de capitaux, etc.) qui échoient au chef de file d'un bloc impérialiste. En effet, bien qu'ils se défendent de s'adonner à une politique aux dépens du voisin pour atténuer le choc de la crise mondiale, c'est précisément ce qu'ont fait les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon ; ils n'ont présenté un semblant de santé économique qu'en reportant les pires effets de la crise sur les nations les plus faibles du bloc. Cependant avec la chute alarmante de nouveaux investissements, avec les mesures extrêmes que prennent les pays au commerce en déficit pour réduire leurs importations, les possibilités pour les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon d'atteindre leurs objectifs de croissance prévus pour 1977 (Etats-Unis, 5,8% ; Allemagne, 5% ; Japon, 6,7%) et de réduire par là leur chômage déjà dangereusement élevé (Etats-Unis, 6,7 millions ; Allemagne, 1,4 million ; Japon, 1,4 million) sans même parler de fournir un quelconque stimulant à leurs "partenaires" plus faibles, apparaissent de plus en plus hypothétiques. Et aucun des trois grands ne se mettra ardemment à relâcher cette pression par de nouveaux budgets inflationnistes, confrontés qu'ils sont au spectre de l'inflation galopante qui se rapproche à nouveau d'un taux à deux chiffres aux Etats-Unis (6,4%) et au Japon (9,4%).
Dans le bloc russe (COMECON), même les bureaux de planification étatiques doivent maintenant reconnaître la présence et l'accroissement du chômage et de l'inflation - effets sans équivoque d'une production capitaliste et de sa crise permanente. L'activité économique du bloc russe a été soutenue par 35 à 40 milliards de dollars en prêts des banques occidentales au cours de ces dernières années (en partie de l'explosion du crédit du bloc américain dans un effort vain de compenser la saturation du marché mondial). Le bloc russe s'est maintenant lancé dans une course à 1'exportation massive, une quête frénétique de marchés du résultat de laquelle dépend le remboursement de ses énormes prêts. Mais cette offensive à l'exportation massive arrive au moment où les pays du bloc américain s'orientent désespérément vers un freinage de la pénétration des importations et où les pays du tiers-monde sont à deux doigts de la banqueroute, mais encore tombe sur les barrières mises à l'octroi de nouveaux prêts (résultant à la fois de considérations financières et politiques) sans lesquels le bloc russe ne peut acquérir la nouvelle technologie qui seule -conjointement avec les attaques planifiées contre la classe ouvrière- pourrait rendre ses marchandises compétitives sur le marché mondial. Ainsi, pares la flambée du commerce et des échanges avec le bloc américain entre 1971 et 1976, le bloc russe se retrouve dans un cul-de-sac économique.
Le "tiers-monde" -y compris les quelques puissances industrielles de second ordre comme l'Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, etc.- s'enfonce chaque jour de plus en plus profondément dans une barbarie croissante. Le monde de cauchemar, de faim, de misère, de camps de travail et de mendicité auquel le capitalisme décadent condamne l'humanité, est déjà une réalité dans des pays constituant les deux tiers de la population mondiale. Les 78 milliards de dollars en prêts au "tiers-monde" en 1974-1976 n'ont pratiquement rien fait pour ne serait-ce que ralentir la chute totale (bien qu'ils aient pu être un palliatif temporaire à l'absence de demande effective condamnant de plus en plus l'appareil industriel du monde à tourner au ralenti). Etant donné la banqueroute complète du "tiers-monde", les nouveaux fonds à venir -à une échelle nettement moindre- ne serviront qu'à reculer l'impossible remboursement des dettes et la faillite qui en découlerait pour les principales banques occidentales. L'austérité brutale que les régimes du "tiers-monde" -"socialistes", "marxistes-léninistes", "nationalistes" et "démocratique”- imposent de plus en plus dans un effort désespéré pour réduire les invraisemblables déficits commerciaux (22 milliards de dollars en 1976 pour les pays importateurs de pétrole avec les seuls pays de l'OCDE) nés de leur dépendance des exportations agricoles et de matières premières, sera le verdict pour les masses.
Nous pouvons mieux comprendre pourquoi la perspective qu'affronte le capital mondial aujourd'hui est une chute inévitable de la production et du commerce, si nous regardons la nature,les fondements et les limites de l'apparent tournant dans la production et le commerce pendant l'hiver 1975-1976 qui a suivi la chute exceptionnelle de 1975 et l'accélération de la production (mais non du commerce) qui a eu lieu l'hiver passé après l'accalmie de l'été dernier. La chute de 1975 a été enrayée en premier lieu par l'intervention hâtive de budgets réflationnistes et une nouvelle explosion massive du crédit, la création de capital fictif, qui peut, pour un court moment, une fois encore compenser la saturation des marchés sous-jacente à la crise mortelle du capitalisme. Il faut ajouter à ces deux facteurs, d'une part le bond dans l'armement dû au re-stockage qui a suivi la chute des stocks alors que la production coulait, d'autre part, la chute de l'épargne des classes moyennes qui a provoqué un mini-boom dans les biens de consommation (voitures, etc.), moins due à une quelconque confiance dans la reprise qu'à une conviction assurée du caractère permanent de l'inflation. Ces deux derniers facteurs ont servi à ce que la croissance des pays de l'OCDE atteigne 7-8% en PNB réel au cours de l'hiver 1975-76, tandis que seule l'explosion du crédit et les mesures fiscales gouvernementales soutiennent le beaucoup plus fragile "bout du tunnel" entrevu cet hiver.
Aujourd'hui, ce qui empêche la poursuite de l'explosion du crédit - sans lequel le commerce mondial se réduirait - apparaît dans ce qui menace de plus en plus les gros emprunteurs comme le Zaïre, le Pérou, le Mexique et le Brésil, les gigantesques déficits du commerce et des paiements qui harcèlent les "tiers-monde", le bloc russe et les pays les plus faibles du bloc américain ? Les sources du crédit se tarissent comme la capacité des pays débiteurs à rembourser leurs dernières dettes. Les nouveaux prêts aux pays du "tiers-monde" -fournis sans enthousiasme par le FMI (Fonds Monétaire International) plutôt que par les banques privées à sec- serviront à assurer le remboursement des prêts précédents avec les intérêts, et non à financer un flux continu de marchandises ; de plus, de tels prêts dépendront du strict contrôle sur les économies des pays débiteurs et l'exigence qu'ils réduisent ou éliminent leurs dettes en diminuant de façon drastique leurs importations. A cette pression considérable qui va contracter le commerce mondial, viennent s'ajouter les limitations politico-financières d'un nouveau bond des prêts massifs au bloc russe sans lesquels le commerce entre les deux blocs déclinera. Finalement, les pays en déficit du bloc américain ont été conduits à la limite de la faillite par leurs énormes dettes et le déficit de leurs balances de paiements. Ayant atteint les limites de leur solvabilité, confrontés â la crise économique, ces pays doivent, soit opter pour le protectionnisme et l'autarcie, soit accepter les ordres et la discipline - ce qui signifie encore des limitations strictes aux importations et une contraction plus avancée du commerce mondial.
Le rétrécissement du commerce mondial ne peut être compensé par une forte hausse de la demande dans les centres industriels vitaux du capitalisme. Les obstacles 2 la poursuite (sans parler d'accélération) des stimulants fiscaux qui ont été pratiquement la seule base de la plus haute demande dans les pays industrialisés du bloc américain, empêchent le lancement de quelconques "programmes de reprise" ambitieux et l'introduction de budgets inflationnistes ou de politiques aptes à permettre un nouveau bond de la production.
Dans ces pays frappés par l'hyper-inflation, tant que les conditions politiques (le niveau de la lutte de classe) le permettent, les coupes sombres dans les "dépenses publiques", la restriction du crédit, en d'autres termes, la politique déflationniste est une nécessité. Dans les économies 'fortes" (Etats-Unis, Allemagne, Japon), la bourgeoisie est très hésitante de peur de laisser libre court à l'hyperinflation que le déploiement de mesures d'austérité a pour le moment tenue en échec. Si les stimulants fiscaux gouvernementaux ne peuvent plus être utilisés comme avant pour empêcher une chute de la production, le plongeon n'en sera que plus dévastateur du fait du déclin catastrophique actuel de nouveaux investissements industriels. Le refus d'investir de la part de la bourgeoisie est lié â la chute prodigieuse et continue du taux de profit depuis que le capital mondial a replongé dans la crise ouverte en 1967 environ. Ce phénomène est illustré par la situation du capital allemand (qui a indiscutablement étalé les premiers assauts de la crise ouverte mieux qu'aucun autre pratiquement) où le taux de profit, après taxes, était de 6 7, pour la période 1960-67, 5,3% pour 1967-71 et 4,1% en 1972-75. La baisse du taux de profit s'est accélérée du fait de l'accroissement des dépenses improductives de l'Etat au fur et à mesure des tentatives de contrebalancer les effets de la saturation du marché mondial, et du fait de contenir les antagonismes de classe portés au rouge par l'approfondissement de la crise. Ceci, et les taux d'intérêts élevés avec lesquels la bourgeoisie tente désespérément de combattre l'hyper-inflation que ces dépenses improductives -mais nécessaires- ont engendrée, réduisent les investissements (particulièrement dans le secteur 1, la production des moyens de production), à tel point qu'une chute de la production se profile menaçante à l'horizon.
L'échec des efforts des différents gouvernements pour stimuler leurs économies et surmonter le les effets de la crise en alternant plans et budgets de "reprise" et d'austérité, inflation galopante et simultanément récession, la persistance et l'aggravation d'une explosion du crédit et simultanément de la chute ravageuse des investissements, la persistance et l'aggravation de la diminution des taux de profit et parallèlement de dépenses "publiques" sans précédent, le chômage massif et d'énormes déficits budgétaires, tout cela montre la faillite totale du Keynésianisme, de la confiance dans la politique fiscale et monétaire, qui a été la pierre angulaire de la politique économique bourgeoise depuis le resurgissement de la crise ouverte en 1967. L'impossibilité de stimuler l'économie sans relancer l'hyper-inflation , l'impossibilité de contrôler l'inflation sans une chute vertigineuse de la production et des profits, les moments toujours plus courts d'oscillations entre récession et inflation galopante, en fait, le caractère permanent et simultané de la récession et de l'inflation, ont démoli les théories économiques (sic) sur lesquelles la bourgeoisie a fondé sa politique.
L'impuissance d'une politique fiscale et monétaire devant un nouveau plongeon du commerce mondial et de la production, impose à la bourgeoisie une nouvelle politique économique pour affronter sa crise mortelle.
La bourgeoisie doit tenter d'échapper à l'effondrement des politiques keynésiennes en recourant de plus en plus à un contrôle totalitaire et direct sur l'ensemble de l'économie par l'appareil d'Etat. Et si d'importantes fractions de la bourgeoisie hésitent encore à admettre que le Keynésianisme a fait son temps, ses représentants les plus éclairés n'ont aucun doute sur le choix à faire. Les porte-parole des groupes financiers et industriels dominants des Etats-Unis l'expriment ainsi :
"Si la politique monétaire et fiscale peut ramener l'équilibre dans l'économie, c'est tout ce dont on a besoin. Toutefois, si les plans échouent, le gouvernement, les syndicats et le patronat peuvent tous s’attendre à une intervention (de l'Etat) à une échelle qui_ ne connaît pas de précédent dans l'histoire". (Business Week, 4.4.77)
Les révolutionnaires doivent être absolument clairs sur la nature des pas que la crise permanente du capitalisme impose à chaque fraction de la bourgeoisie, dans le sens du renforcement du capitalisme d'Etat, nouvelle phase dans l'évolution qu'affronte notre classe :
"Le capitalisme d'Etat n'est pas une tentative de résoudre les contradictions 'essentielles du capitalisme en tant que système d'exploitation de la force de travail mais la manifestation de ces contradictions. Chaque groupe d'intérêts capitaliste essaie de rejeter les effets de la crise du système sur un groupe voisin, en se l'appropriant comme marché et champ d'exploitation. Le capitalisme d'Etat est né de la nécessité pour ce groupe d'opérer sa concentration et de mettre sous sa coupe les marchés qui lui sont extérieurs. L'économie se transforme donc en une économie de guerre". ("'L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective", Internationalisme 1952, republié dans le Bulletin d'Etudes et de Discussion n°8 de RI, p.8/9).
L'économie de guerre qui surgit sur les décombres du keynésianisme n'est en rien une sortie pour la crise mondiale ; ce n'est pas une * politique économique qui peut résoudre les contradictions du capitalisme ou créer les fondements d'une nouvelle étape du développement capitaliste. L'économie de guerre ne peut être comprise qu'en termes d'inévitabilité d'une autre guerre mondiale impérialiste si le prolétariat ne met pas fin au règne de la, bourgeoisie : elle est le cadre indispensable pour les préparatifs de la bourgeoisie à la conflagration mondiale que les lois aveugles du capitalisme et l'approfondissement inexorable de la crise lui imposent. La seule fonction de l'économie de guerre est... la GUERRE ! Sa raison d'être est la destruction effective et systématique des moyens de production et des forces productives et la production des moyens dé destruction - la véritable logique de la barbarie capitaliste.
Seule la mise en place d'une économie de guerre peut maintenant empêcher l'appareil productif capitaliste de s'enrayer. Pour établir pleinement une économie de guerre, cependant, chaque fraction nationale du capital doit :
- soumettre tout l'appareil de production et de distribution au contrôle totalitaire de l'Etat et orienter l'économie vers un seul but : la guerre ;
- réduire férocement la consommation de toutes les classes et couches sociales ;
- accroître massivement le rendement et le degré d'exploitation de la seule classe source de valeur, de toute richesse : le prolétariat.
L'énormité et la difficulté d'une telle entreprise sont la cause de la crise politique croissante dans laquelle se trouve empêtrée la bourgeoisie de chaque pays. L'organisation totalitaire de l'économie et son orientation vers un seul but fait souvent surgir d'âpres luttes entre fractions de la bourgeoisie, du fait que ces fractions aux intérêts particuliers qui seront sacrifiés, combattent contre l'immolation sur l'autel de l'étatisation. La réduction de l'ensemble de la consommation que l'économie de guerre nécessite, provoque d'incessants remous et une âpre opposition dans les rangs des couches moyennes, de la petite-bourgeoisie et des paysans. Mais c'est l'assaut contre le prolétariat -parce qu'il risque d'ouvrir la porte à une guerre de classe généralisée- qui n'est pas seulement la tâche la plus difficile à accomplir par la bourgeoisie dans la situation présente mais encore est la véritable clé de la constitution de l'économie de guerre. L'économie de guerre dépend de façon absolue de la soumission physique et/ou idéologique du prolétariat à l'Etat, du degré de contrôle que l'Etat a sur la classe ouvrière.
Toutefois, l'économie de guerre à l'époque actuelle, n'est pas seulement mise en place à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle d'un bloc impérialiste. L'incorporation dans un des deux blocs impérialistes -chacun dominé par un capitalisme d'Etat continental et colossal, les Etats-Unis et l'URSS- est une nécessité â laquelle même les grandes puissances anciennement impérialistes comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et le Japon, ne peuvent résister. La tendance puissante de la part des Etats-Unis et de la Russie à coordonner, organiser et diriger le potentiel de guerre de leur bloc, intensifie la crise politique de chaque bourgeoisie nationale du fait, d'une part, de la pression à se soumettre aux exigences de consolidation du bloc impérialiste, d'autre part, du besoin de défendre l'intérêt du capital national et engendre des tensions accrues et irrésistibles.
Nous allons voir maintenant les problèmes spécifiques auxquels s'affronte la bourgeoisie aux Etats-Unis et dans le bloc américain et dans le bloc russe, dans l'organisation de leur économie de guerre pour surmonter les différentes résistances qu'elle suscite et pour résoudre leurs crises politiques. Nous verrons ensuite l'accroissement des oppositions inter-impérialistes dans le monde qui mènent inexorablement, quoique graduellement les deux blocs impérialistes vers la guerre mondiale. Finalement, nous tracerons les perspectives d'intensification de la lutte de classe du prolétariat, les obstacles et les tendances à la guerre de classe généralisée.
Les Etats-Unis et le bloc américain
Au cours de ses premiers mois, comme président des Etats-Unis, Jimmy Carter a infligé des coups sévères aux Keynésiens orthodoxes de son administration en combattant le budget initial inflationniste (par l'élimination des réductions de taxes, proposées et des crédits aux nouveaux investissements), Carter a présenté un budget moins large que celui proposé par son prédécesseur Républicain, Gérald Ford. Mais si Carter et son équipe ont vu les limites du Keynésianisme, ils n'ont certainement pas fait battre en retraite le "conservatisme fiscal" et le monétarisme que beaucoup de Républicains tiennent pour la seule réponse gouvernementale à la crise et au spectre de l'inflation galopante. L'administration Carter a vu la totale futilité des tentatives d'arrêter la crise en comptant sur une politique monétaire et fiscale (stimulante ou restrictive) et commence à engager les Etats-Unis vers une nouvelle phase d'économie de guerre et de totalitarisme étatique.
Le seul poste du budget américain â s'accroître à un taux prodigieux est la recherche et la production d'armements. Le boni en avant probable -qui dépend du résultat des pourparlers SALT- des têtes nucléaires Mk-12a ("silo-buster") et des bombardiers B-1 n'est que le commencement d'une nouvelle explosion des armements qui deviendra l'axe de l'activité économique. Qui plus est, les initiatives récentes de l'administration Carter pour soumettre les exportations d'armes plus directement aux intérêts stratégiques américains, et pour limiter l'extension de la technologie nucléaire qui fournit le plutonium sous une forme utilisable pour la fabrication de bombes, ne sont pas des pas vers la limitation des armements, mais beaucoup plus une partie d’une politique d'ensemble pour consolider le bloc américain autour de la domination exclusive des Etats-Unis et pour soumettre l'armement et son développement exclusive, au contrôle, à la volonté et aux visées de l'impérialisme américain.
L'orientation résolue de l'administration Carter vers une économie de guerre et son accélération vers le capitalisme d'Etat apparaît clairement dans sa politique de l'énergie, ses propositions pour l'extension de l'importance et l'échelle du stockage, et ses pas vers la cartellisation du commerce mondial. Les nécessités d'une économie de guerre ont amené le gouvernement à commencer une politique nationale de l'énergie par la mise en place d'agences d'Etat et la proposition de créer une super agence dirigée par un responsable de l'énergie. L'État américain entend dicter le prix de l'énergie, les sortes d'énergie à utiliser et les quantités d'énergie â allouer aux différentes régions et aux divers types de production et de consommation. L'insistance de la politique d'énergie sur les économies est le fer de lance de l'effort de restreindre la consommation de toutes les classes et couches sociales (bien qu'en premier lieu, ce soit pour la classe ouvrière), l'austérité brutale qui est la base d'une économie de guerre. Le développement de nouvelles sources d'énergie pour à la fois assurer "l'indépendance" de l'Amérique en matière d'énergie en temps de guerre, et rendre les autres pays de bloc totalement dépendants des Etats-Unis, va se faire au travers de l'étatisation de l'industrie de l'énergie. L'étatisation complète de l'énergie se produit de deux façons. D'abord, l'Etat américain possède directement la plupart des ressources énergétiques restantes du pays :
"Les meilleures possibilités pour le pétrole et le gaz naturel se trouvent dans les gisements offshore des eaux fédérales. La production de charbon se déplace vers l'ouest où le gouvernement contrôle la plupart des concessions minières même l'uranium de la nation se trouve en grande partie dans le domaine public". (Business Week, 4.4.77)
Ensuite, le développement de la technologie nucléaire et de l'infrastructure nécessaire au traitement du charbon exigent un plan d'Etat et un capital d'Etat, comme le reconnaissent en personne les porte-parole des monopoles des Etats-Unis :
"Développer et mettre en oeuvre une telle technologie nécessaire à grande échelle, dicte des ajustements économiques importants - par exemple, des prix du pétrole plus élevés et la formation massive de capital. Seul, le gouvernement semble capable de diriger un tel effort aussi titanesque". (Ibid)
L'équipe Carter envisage aussi une expansion massive des stocks du gouvernement américain, en ajoutant des stocks "économiques" aux 7,6 milliards de dollars de réserve militaire stratégique de 93 marchandises. Les réserves stratégiques sont faites en vue d'assurer le ravitaillement en cas de guerre. Les stocks économiques de matières premières clés permettent à l'Etat américain de contrôler les prix S la consommation et de faire pression sur les produits étrangers pour casser les prix, à travers sa capacité de mettre en circulation les marchandises stockées sur le marché.
Finalement, l'Etat américain est à l'avant-garde du mouvement de cartellisation du commerce mondial. Par opposition aux cartels Internationaux qui ont dominé le marché mondial à l'époque du capitalisme monopoliste, et qui ont été établis par des trusts "privés", un nouveau type de cartellisation appropriée à l'époque du capitalisme d'Etat et de l'économie de guerre, apparaît. Les cartels organisés aujourd'hui pour fixer et régulariser les prix des matières premières importantes, et pour déterminer le partage des marchés clés à répartir aux différents capitaux nationaux, sont négociés et dirigés directement par les divers appareils de l'Etat.
Deux types de cartels ont été impulsés par l'administration Carter. Les premiers sont les cartels de marchandises qui englobent à la fois pays importateurs et exportateurs, et qui déterminent la marge des prix acceptable et régularisent le mouvement des prix par l'utilisation de stocks-tampons dans les mains soit des gouvernements, soit du cartel. Les Etats-Unis sont maintenant en voie d'organiser de tels cartels pour le sucre et le blé, qui peuvent être lés premiers venus de cartels pour d'autres matières premières et produits agricoles. De tels cartels de marchandises organisés par l'Etat vont tenter de stabiliser les prix des matières premières, élément â la base de toute planification économique d'ensemble, contrebalançant la baisse du taux de profit, tout autant que facilitant une stratégie de "nourriture bon marché", qui abaisserait la valeur de la force de travail et par là-même atténuerait la voie vers une compression des salaires de la classe ouvrière -tout ce qui forme les ingrédients nécessaires â l'économie de guerre.
Le second type de cartels est une réponse directe au rétrécissement du marché mondial et implique une planification étatique non pour l'expansion mais pour la contraction du commerce mondial. Ce qui est mis en place, ce sont des accords entre Etats exportateurs et importateurs pour fixer quotas ou partages d'un marché national pour des marchandises spécifiques pour de nombreux capitaux nationaux en compétition. Les Etats-Unis ont récemment arrangé ce qu’ils nomment avec euphémisme des "accords de discipline de marché" avec le Japon sur les aciers spéciaux et les appareils de TV (ce dernier réduira les importations japonaises aux Etats-Unis de 40%), et sont maintenant en voie de négocier des accords pour diviser les marchés mondiaux pour les textiles, les vêtements, les chaussures et l'acier. Ces cartels représentent l'alternative de Washington à une orgie de protectionnisme et d'autarcie de la part de chaque capital national au sein du bloc américain, un rétrécissement organisé et coordonné des marchés, pour tenter de préserver la cohésion du bloc de l'impact de la crise mondiale.
Parallèlement à ces étapes pour consolider une économie de guerre, l'administration Carter a brandi une nouvelle idéologie de guerre -la croisade pour les "droits de l'homme". A l'époque des guerres mondiales impérialistes, quand la victoire dépend avant tout de la production, quand chaque ouvrier est un "soldat", une idéologie capable de plier l'ensemble de la population à l'Etat et inculquant une volonté de produire et dé se sacrifier est une nécessité pour le capitalisme. Gui plus est, à l'époque où les guerres ne sont pas des combats entre nations mais entre blocs impérialistes, le chauvinisme national seul n'est plus une idéologie suffisante. Comme la bourgeoisie prépare une nouvelle le boucherie mondiale, la lutte pour les "droits de l'homme" remplace l'anti-communisme dans l'arsenal idéologique des impérialismes "démocratiques" du bloc américain, comme ils commencent à mobiliser leurs populations pour la guerre avec les "dictatures totalitaires" du bloc russe (d'autant plus que les pays comme la Chine qui sont incorporés au bloc américain ont des régimes "communistes" et que la participation dans les gouvernements de plusieurs pays d'Europe de l'Ouest des partis "communistes" est prévisible. Derrière les appels moralisateurs de Jimmy Carter à la reconnaissance universelle des droits de l'homme, s'aiguisent les sabres américains.
L'organisation d'une économie de guerre pleinement développée aux Etats-Unis ne se met toutefois pas en place sans une furieuse résistance de la part de beaucoup d'intérêts bourgeois puissants. En particulier, les milieux d'affaires agricoles du "Middle West" s'opposent â ce qu'ils perçoivent comme une stratégie de "nourriture bon marché" ; l'acier, le textile, la chaussure et beaucoup d'autres industries se battent pour un protectionnisme, considérant le souci du gouvernement de la cohésion et de la stabilité du bloc impérialiste mondial comme une trahison de l'industrie américaine ; les intérêts pétroliers du sud-ouest s'opposent violemment à la politique d'énergie de Carter. Tous ces groupes s'organisent pour défendre des intérêts particularistes en résistant à l'étranglement par l'Etat-léviathan de l'ensemble de l'économie. Plus encore, ils essaient de mobiliser des légions de petits et moyens capitalistes (pour qui le capitalisme d'Etat est la sentence de mort) tout comme les classes moyennes désenchantées pour résister au courant d'étatisation, Néanmoins, ce sont les intérêts du capital national global - qui exigent absolument une économie de guerre - qui vaincront dans toute lutte au sein de la bourgeoisie, et ce sont ces fractions de la bourgeoisie qui reflètent au plus près ces intérêts qui dicteront en dernière instance l'orientation de l'Etat capitaliste et détermineront sa politique.
Du fait du décalage qui ne cesse d'augmenter entre le poids économique relativement croissant des Etats-Unis et l'économie affaiblie de l'Europe et du Japon, les Etats-Unis ont la capacité de déterminer, de dicter les priorités économiques et l'orientation des autres pays de son bloc. Oui plus est, avec l'intensification de la crise au sein même de l'Amérique, les Etats-Unis vont avoir de plus en plus à détourner les pires effets de la crise sur l'Europe et le Japon (dans les limites qui ne détruisent pas la cohésion d'ensemble du bloc). Les Etats-Unis mettent maintenant en place une politique visant au rationnement de l'Europe. La manière par laquelle le capital américain impose l'austérité sur les pays en faillite de l'Europe, se trouve dans sa capacité à accorder ou refuser les crédits sans lesquels l'Europe se trouve confrontée à la ruine économique, et par conséquent à contraindre les "hommes malades" du continent à placer le contrôle de leurs économies dans les mains de leur créditeur américain. A la différence des années 20, lorsque les prêts désespérément demandés étaient largement fournis par les banques privées, aujourd'hui -dans des conditions dominantes de capitalisme d'Etat- la masse des crédits est canalisée par des institutions d'Etat ou semi-publiques comme le Trésor, le Système Fédéral de Réserve ou le Fonds Monétaire International, contrôlés par Washington. On a pu voir les plans du capital américain, pour d'un côté réduire énergiquement la consommation en Europe, et d'un autre côté imposer plus fermement à l'Europe les impératifs d'une économie de guerre construite à l'échelle de l'ensemble du bloc impérialiste, dans les négociations récentes du FMI sur les prêts à la Grande-Bretagne, l'Italie et le Portugal. Comme condition du prêt de 3,9 milliards de dollars, le FMI a tenu à ce que la Grande-Bretagne garantisse de ne pas imposer de contrôles permanents de l'ensemble des importations et de ne pas instituer de restrictions monétaires, garanties qui éliminent la possibilité de mesures protectionnistes ou autarciques qui pourraient briser le bloc ou mettre en danger les intérêts américains. Dans le cas de l'Italie, les conditions du FMI au prêt de 530 millions de dollars ont été un début de démantèlement du système d'indexation qui fait automatiquement les ajustements de salaires quand les prix montent, des limites et des contrôles sur les dépenses publiques locales et nationales, et un veto du FMI à l'expansion du crédit. La demande du Portugal d'un prêt d'1,5 milliard de dollars au FMI a rencontré une exigence de dévaluation de 25% de l'escudo pour attaquer les salaires réels et réduire les importations (dont 20% sont de l'alimentation) ; et dans ce cas, les portugais ont dévalué de 15% et les coffres américains ont commencé à s'ouvrir.
Comme partie intégrante de cette politique pour assurer la stabilité de l'ensemble du bloc américain, les Etats-Unis se sont efforcés de répartir l'impact de la crise mondiale plus régulièrement dans son bloc (Amérique mise â part), en imposant à l'Allemagne de l'Ouest et au Japon une politique d'assistance et de soutien aux économies de ces pays d'Europe qui sont prêts de 1'effrondement. Ainsi, les Etats-Unis pressent l'Allemagne et le Japon de réévaluer pour fournir aux pays plus faibles des marchés et réduire de façon significative leurs exportations -ce qui a été en partie accompli au travers d'une réévaluation du mark et du yen. La hausse de la valeur des monnaies allemande et japonaise va ainsi aider à contenir l'offensive des exportations vers l'Amérique, et â réduire la compétitivité des deux principaux rivaux commerciaux des Etats-Unis. Cette politique a commencé à porter ses premiers fruits, puisque le gouvernement Fukuda du japon a laissé le yen s'élever de plus de 7% par rapport au dollar entre janvier et avril 1977.
Si l'une des bases de l'étranglement de l'ensemble des économies des son bloc par l'Amérique est la suprématie de sa puissance financière, son contrôle des ressources d'énergie vitales en est une autre. C'est la "Pax americana" de Washington au Moyen-Orient qui assure à l'Europe et au Japon le pétrole dont dépend maintenant le fonctionnement de leur appareil productif. La ferme opposition des Etats-Unis au développement et à l'extension des réacteurs nucléaires à haut rendement qui produisent leur propre plutonium comme source d'énergie, est en partie due au fait qu'une telle technologie pourrait potentiellement rendre les économies de l'Europe et du Japon indépendantes de l'Amérique en ce qui concerne l'énergie. En abandonnant le développement des réacteurs à haut rendement, les Etats-Unis ne se sacrifient en rien, puisque leurs réserves d'uranium sont là pour faire de l'utilisation de la puissance nucléaire quelque chose de compatible avec le but américain d'indépendance en matière d'énergie. Pour l'Europe et le Japon cependant, l'énergie nucléaire qui dépend de l'uranium et du pétrole les condamne à une dépendance absolue des Etats-Unis en matière d'énergie.
Tout en mettant l'Europe sous rationnement et en dictant l'austérité aux pays de son bloc, il est un domaine ou l'Amérique exige une augmentation massive des dépenses et de la production : l'armement. L'exacerbation des tensions inter-impérialistes et les nécessités d'une économie de guerre ont déjà amené les Etats-Unis à presser ses alliés de l'OTAN â accroître leurs budgets militaires. Les économies européenne et japonaise seront désormais de plus en plus organisées pour la production de canons et non de beurre !
Le besoin d'imposer une austérité draconienne, d'accélérer la tendance qu capitalisme d'Etat, de lancer une attaque contre le prolétariat (dans des conditions d'accroissement de la lutte de classe), et d'ajuster leurs politiques aux diktats américains, a amené les bourgeoisies de l'Europe et du Japon dans les filets d'une crise politique grave. La nature des tâches que ces bourgeoisies doivent essayer d'accomplir, dicte entièrement un cours qui, graduellement ou brutalement (en fonction de la vitesse avec laquelle une économie donnée s'effondre ou de l'acuité de la lutte de classe), amènera la gauche au pouvoir. Dans la conjoncture présente, ce sont des gouvernements de gauche dominés par les partis socialistes et basés sur les organisations syndicales, ou des fronts populaires qui comprennent les partis staliniens, qui sont le mieux adaptés aux besoins de la bourgeoisie.
Parce qu'elle n'est pas liée au capital "privé" aux intérêts particuliers au sein du capital national et aux fractions anachroniques de la bourgeoisie (caractéristique de la droite), la gauche peut mieux imposer le contrôle totalitaire et centralisé de l'Etat sur l'ensemble de l'économie et la réduction draconienne de la consommation de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, marques de l'économie de guerre. Du fait du soutien électoral de la classe ouvrière, de son encadrement à la base et de son idéologie "socialiste", seule la gauche -confrontée à un prolétariat combatif qui devient l'axe de la vie politique- a une chance de dévoyer la lutte de classe et de mettre en place la réduction féroce du niveau de vie du prolétariat, l'intensification de son exploitation et sa soumission idéologique à l'Etat - tout ce dont dépend le succès mortel de l'économie de guerre. Du fait de son atlantisme, son "internationalisme", la gauche (tout au moins les partis socialistes et les syndicats) est la mieux placée pour poursuivre la consolidation d'une économie de guerre à l'échelle de l'ensemble du bloc américain.
On peut, par exemple, voir cette convergence entre gouvernement de gauche et intérêts de. L’impérialisme américain dans les efforts des Etats-Unis d'imposer des politiques économiques différentes selon la force ou la faiblesse des économies de son bloc. Dans les économies plus faibles (Grande-Bretagne, France, Italie, Espagne, Portugal), les Etats-Unis poussent à l'austérité et à la déflation, ce qui cristallise une résistance autour des partis de droite liés au capital "privé" et aux secteurs anachroniques et rétrogrades de la bourgeoisie qui a besoin de subventions massives du gouvernement, de crédit facile et d'une inflation pour maintenir à flot le marché national. Au contraire, c'est le centre-gauche et la gauche qui sont prêts à accepter les "recommandations" du FMI et â imposer les diktats américains. Même la politique de gauche, de nationalisation, qui fait partie intégrante d'une économie de guerre (comme la nationalisation de l'aéronautique et de la construction navale en Grande-Bretagne, ou la nationalisation de Dassault et des monopoles de l'électronique, proposée par le Programme Commun en France), ne mettra pas en péril les intérêts américains et pourra certainement faciliter, le contrôle américain directement au niveau étatique. En Allemagne et au Japon, les Etats-Unis exigent la réévaluation des monnaies et les limitations des exportations, ce qui engendre une opposition considérable de la part de fractions de la bourgeoisie, coalisées autour des partis de droite qui répugnent extrêmement â prendre des mesures de limitation de la compétitivité nationale sur le marché mondial et à ajuster les intérêts du capital national aux intérêts du bloc. C'est au contraire la gauche modérée (SPD en Allemagne, Sociaux-démocrates et aile EDA du parti socialiste au Japon) qui est la plus à même de coordonner les intérêts du capital national et les exigences de l'Amérique.
Le capital américain préfère clairement les Travaillistes, aux Conservateurs en Grande-Bretagne, les. Sociaux-démocrates au Chrétiens-démocrates en Allemagne, au Portugal, Soares et les Socialistes sont mieux adaptés aux intérêts américains que Sa Carneiro et Jaime Neves. En Espagne, Washington veut un gouvernement mené par Suarez avec, participation directe ou indirecte de Felipe Gonzalez et du PSOE et ne tolérerait pas un gouvernement mené par Fraga Iri-barne et l'Alianza Popular. En France, un gouvernement mené par Mitterrand et le parti socialiste a la faveur des américains, plutôt qu'un gouvernement mené par Chirac. Même en Italie, une combinaison Andreotti-Berlinguer est mieux adaptée aux besoins américains qu'un gouvernement mené par Fanfani et l'aile droite des Chrétiens-démocrates.
Et puis, la droite est de plus en plus incapable d'adopter les mesures économiques nécessaires imposées par l'approfondissement de la crise, aussi bien qu'inadéquate à faire face à la menace prolétarienne ; elle est de plus en plus hostile aux intérêts américains, alors que la gauche est le seul véhicule par lequel la bourgeoisie peut de façon réaliste essayer d'établir une économie de guerre dans la conjoncture actuelle. L'inéluctable mouvement de la bourgeoisie vers la gauche semble cependant contredit par .le résultat de récentes élections dans certains pays du bloc américain. Dans nombre de pays, il y a eu une tendance électorale prononcée vers la droite ; victoires de la droite aux élections générales en Australie, Nouvelle Zélande et Suède en 1976 ; gains appréciables du CDU/CSU en Allemagne, la même année ; déplacement considérable vers la droite au Portugal entre les élections d'avril 1975 pour l'Assemblée Constituante et les élections au parlement de l'année suivante ; victoires totales des- conservateurs au parlement et aux élections locales en Grande-Bretagne, cette année ; triomphe des sociaux-chrétiens aux élections générales en Belgique, en avril.
Cette tendance électorale vers la droite se nourrit d'une vague de frustration et de mécontentement de la part des petits et moyens capitalistes, de la petite-bourgeoisie et des classes moyennes, tous ceux qui ont vu leur niveau de vie tomber fortement ces dernières années. Parce que l'Etat capitaliste a hésité à s'attaquer trop directement au prolétariat de peur de provoquer prématurément l'étincelle d'une guerre de classe généralisée ou même d'une vague de grèves massive à laquelle il n'est pas préparé, les classes moyennes -plus fragmentées et qui ne menacent pas directement l'ordre bourgeois- ont été l'objet de beaucoup des premières mesures d'austérité. Il en est résulté que les couches moyennes et leurs frustrations sont devenues momentanément l'axe de la politique dans beaucoup de pays et ceci a provoqué la renaissance électorale actuelle de la droite. Cependant, pour empêcher le krach économique imminent et établir une véritable économie de guerre, la bourgeoisie -malgré ses hésitations- doit rapidement axer son attaque directement contre le prolétariat et tenter d'enrayer la lutte de classe montante qu'elle va provoquer. Et comme la classe ouvrière devient l'axe de la politique. La tendance électorale va bientôt refléter le cours fondamental de la bourgeoisies : un tournant à gauche.
Cependant, même si le déplacement électoral à court terme vers la droite n'a pas altéré ou même ralenti l'évolution résolue de la bourgeoisie vers la gauche dans la constitution des gouvernements (ce qui démontre une fois encore la nature purement décorative des parlements et le caractère seulement mystificateur à l'époque de la décadence capitaliste), si la bourgeoisie avait recherché une ouverture pour effectuer un tournant gouvernemental vers la droite (comme le prétendent les gauchistes), le tournant électoral récent la lui aurait fourni. Au lieu de cela, la bourgeoisie s'est grandement désintéressée des résultats des élections en constituant ou perpétuant une équipe gouvernementale qui exprime le besoin actuel de se baser sur les partis de gauche et les syndicats. Ainsi, en Grande-Bretagne, où une élection générale aurait presque certainement amené le retour d'un gouvernement conservateur, la bourgeoisie tient bon jusqu'à ce que la tendance électorale revienne à la gauche et pour éviter une élection prématurée soutient le gouvernement travailliste avec les votes du parti Libéral. Au Portugal, malgré le Parlement, la bourgeoisie tient à un gouvernement purement socialiste. En Belgique, où les résultats électoraux ont rendu possible un gouvernement Social-Chrétien-Libéral de centre-droit, la bourgeoisie au lieu de cela, est déterminée à constituer un gouvernement Social-Chrétien-Socialiste de centre-gauche avec une base syndicale puissante.
Avec la perspective claire d'une évolution vers la gauche de la bourgeoisie, nous devons maintenant voir la nature des partis staliniens aujourd'hui. La participation des staliniens au gouvernement va devenir de plus en plus, une nécessité pour les bourgeoisies de quelques-uns des pays européens les plus faibles (Italie, France, Espagne), d'autant plus que les staliniens sont les mieux pourvus pour imposer les mesures d'austérité essentielles à la classe ouvrière et dévoyer la lutte de classe. Cependant, la participation stalinienne dans le gouvernement provoque une opposition furieuse -souvent violente- de la part de fractions plus puissantes de la bourgeoisie nationale et une résistance et une méfiance de la part des Etats-Unis. Nous devons être clairs sur le véritable caractère du stalinisme, ses traits distinctifs comme parti bourgeois, pour comprendre ce que sont les sources de cette opposition et de cette méfiance et jusqu'à quel point celles-ci peuvent empêcher que les staliniens n'accèdent au pouvoir.
D'abord, les partis staliniens ne sont pas des partis anti-nationaux ou des agents de Moscou. Tous les partis bourgeois (de droite comme de gauche), quelle que soit leur orientation dans l'arène internationale sont des partis nationalistes :
"A l'époque de l'impérialisme, la défense de l'intérêt national ne peut prendre place qu'au sein du cadre élargi du bloc impérialiste. Ce n'est pas comme une cinquième colonne, comme agent de l'étranger, mais en fonction de son intérêt immédiat ou à long terme, à strictement parler, qu'une bourgeoisie nationale opte pour et adhère à un des blocs qui existe. C'est autour de ce choix pour l'un ou l'autre bloc que la division et la lutte interne au sein de la bourgeoisie prennent place ; mais cette division prend toujours place sur la base d'un seul souci et d'un seul but commun : l'intérêt national, l'intérêt de la bourgeoisie nationale". (Internationalisme, n°30, 1948).
Le nationalisme est et a toujours été la base des partis staliniens, et lorsqu'ils optèrent en 194K) pour le bloc russe, quand se met en place la division de l'Europe entre les deux blocs impérialistes mondiaux, ils n'étaient pas plus une cinquième colonne de Moscou que les sociaux-démocrates ou les chrétiens-démocrates, une cinquième colonne de Washington : ce qui a divisé ces partis bourgeois, était la question de savoir dans quel bloc impérialiste, les intérêts vitaux du capital national seraient les mieux défendus.
Cependant, dans la conjoncture actuelle, alors qu'un changement de bloc de la part d'un des pays d'Europe de l'ouest et du Japon est difficilement possible, sauf à travers la guerre ou -à la dernière limite- par un changement dramatique et fondamental dans l'équilibre mondial entre les deux camps impérialistes, aucune fraction de la bourgeoisie, qui espère avec réalisme venir au pouvoir, ne peut rechercher l'incorporation dans le bloc russe. En ce sens, "l'Eurocommunisme" est la reconnaissance par les staliniens que les intérêts de leurs capitaux nationaux excluent aujourd'hui un changement de bloc. Le nationalisme des partis staliniens dans ces pays prend maintenant la forme d'un soutien aux réponses protectionnistes à l'approfondissement de la crise économique, et d'un engagement vers ce qui n'est encore qu'une tendance embryonnaire à l'autarcie. Si cette orientation de la part des staliniens ne remet pas en question l'incorporation de leur pays dans le bloc américain, elle va néanmoins à 1'encontre des plans du capital américain, qui visent à intégrer plus fortement les différents pays du bloc dans une gigantesque économie de guerre sous le contrôle absolu de Washington. On trouve là une des bases de l'éternelle méfiance des Etats-Unis vis-à-vis des staliniens et sa préférence pour les partis socialistes, pour lesquels les intérêts vitaux du capital national exigent l'ajustement le plus complet des politiques nationales aux besoins de l'ensemble du bloc.
Mais ce n'est pas son soutien à des politiques autarciques -qu'il partage de toute manière avec l'extrême-droite- qui est la caractéristique la plus distinctive du stalinisme, et qui explique la férocité qu'il met à s'opposer aux autres fractions de la bourgeoisie nationale. Les partis staliniens, quelle que soit leur phraséologie actuelle démocratique et pluraliste, sont les défenseurs de la forme la plus totale et la plus extrême du capitalisme d'Etat, du contrôle totalitaire et direct par l'Etat de tous les aspects de la production et de la distribution, du parti unique d'Etat et de la militarisation totale de la société. A l'inverse des autres partis bourgeois (y compris les socialistes), les staliniens n'ont pas d'attaches à un quelconque capital "privé". Tandis que d' d'autres fractions de la bourgeoisie soutiennent une fusion plus ou moins grande entre capital d'Etat et capital "privé", les staliniens au pouvoir veut dire élimination du capital privé et avec lui de tous les autres partis bourgeois. C'est la base de la peur permanente et de l'hostilité des autres fractions bourgeoises envers les staliniens ; et cela explique les nombreuses réserves de l'impérialisme américain, qui exerce encore le plus gros de son contrôle sur ses "alliés", pas encore directement sur l'Etat ou sur une base étatique, mais à travers les liens du capital privé -liens que le stalinisme remettrait en cause.
C'est pour ces raisons qu'à la fois les Etats-Unis et les autres partis de la bourgeoisie en Europe et au Japon sont décidés à maintenir un strict contrôle sur les staliniens même si l'aggravation de la situation économique et politique les amène peu à peu à une participation directe dans le gouvernement, dans un effort pour stabiliser l'ordre bourgeois chancelant. Cependant, comme la situation économique et politique continue à se détériorer et comme s'affirme le besoin d'aller le plus loin possible vers une économie de guerre, il y aura de plus en plus convergence totale entre les besoins vitaux du capital national et programme draconien du stalinisme.
Le bloc russe
La crise permanente du capitalisme mondial pose au bloc russe des problèmes particulièrement aigus : son extrême faiblesse et ses énormes handicaps matériels face à l'intensification de la guerre commerciale contre le bloc américain, et en arrière fond, la préparation aux affrontements militaires pour le repartage du marché.
Les pays du bloc russe doivent essayer de compenser le faible taux productif de la force de travail, l'archaïsme de leur appareil productif par une plus grande extraction de plus-value absolue que leurs rivaux du bloc US." Même la plus drastique baisse de salaire, l'accroissement énorme des cadences et l'allongement de la journée de travail dont la limite est évidente dans la renaissance de combativité ouvrière, ne parviendraient pas à rendre le capital russe compétitif sur un marché rétréci. S'il est vrai que la plus-value n'est le produit que du travail vivant nouvellement ajouté dans le procès de production du capital variable, aussi bien la masse que le taux de plus-value dépendent étroitement du niveau de mécanisation et de technologie du capital que les ouvriers mettent en mouvement, du capital engagé dans le procès productif. C'est pour cette raison que la compétitivité du bloc russe est étroitement liée à l'acquisition de technologie de pointe, qui de toute façon ne peut venir que du bloc US, par achat ou par conquête. Une des différences entre le "socialisme" autarcique de Staline et le "socialisme" mercantile de Brejnev est que, dans le cadre d'une re-division en cours du marché mondial, et l'établissement de nouvelles constellations impérialistes, Staline voyait le dépassement des faiblesses de la Russie d'abord dans les conquêtes militaires (pillage et transport en Russie des industries les plus avancées d'Allemagne, de pays danubiens et de Mandchourie, et ainsi, à travers l'incorporation directe de ces aires dans l'orbite de l'impérialisme russe) alors que dans le cadre d'une stabilisation relative entre les blocs impérialistes (au moins en ce qui concerne les aires les plus industrielles), Brejnev a essayé de compenser le retard russe par le commerce et l'achat massif de technologie à l'Ouest.
Les déficits commerciaux croissants qui sont la preuve inexorable de la même non-compétitivité du capital russe sur le marché mondial, ont rendu l'achat de technologie au bloc US complètement dépendant des emprunts et crédits... Mais la dette étrangère croissante du bloc russe ajouté à son déficit commercial produit un nouveau cycle d'emprunts, financièrement trop risqués pour être entrepris par les banques de l'Ouest. A ceci, s'ajoutent les facteurs politico-militaires qui de plus en plus jouent contre la continuation du déversement de marchandises et de technologie du bloc US dans le COMECON. L'approfondissement de la crise économique intensifie la compétition entre les blocs (particulièrement dans le tiers-monde, où la Russie a une balance positive et où les machines et la technologie de l'Ouest deviennent indispensables à son offensive économique) et développe les contrastes inter-impérialistes. En réponse, l'impérialisme américain, en tant que moment de la consolidation de l'économie de guerre pour le compte de son bloc, n'hésitera pas à subordonner les considérations du commerce à court terme aux objectifs politiques et stratégiques à plus long terme, qui conduiront à un tassement des échanges commerciaux entre les blocs. En fin de compte, conquêtes et guerres seront le seul moyen de l'impérialisme russe pour essayer de dépasser l'archaïsme technique de son appareil productif et des carnages du "socialisme" mercantile avec sa politique de détente, naîtra sur le sol russe une version "revue et corrigée" du "socialisme" autarcique d'hier.
La supériorité stratégique et tactique actuelle du Pacte de Varsovie sur l'OTAN, sur la ligne de partage des deux impérialismes en Europe centrale, ne doit pas masquer l'infériorité matérielle écrasante du bloc russe dans sa tentative de rejoindre les pays industriels du coeur de l'Europe. Le marxisme montre la primauté du facteur économique sur le facteur politico-économique dans tous les heurts entre Etats capitalistes. En dernière analyse, la supériorité économique se traduit en supériorité militaire comme le démontrent les deux guerres inter-impérialistes. L'énorme supériorité de l'appareil productif du bloc US qui ne laisse aucun choix a l'impérialisme russe, sinon une guerre de conquête s'il ne veut pas être étouffé par l'hippopotame US, est ainsi la raison pour laquelle l'impérialisme US possède toutes les cartes maîtresses dans ce jeu de mort avec le rival russe. La bourgeoisie russe est confrontée au dilemme que, pour faire la guerre avec succès, il faut d'abord être économiquement le plus fort, alors que pour asseoir sa supériorité économique dans l'époque de la décadence, il faut d'abord faire la guerre. La seule issue que peut espérer le bloc russe pour faire pencher la balance dans son sens, dans la mesure où il est contraint de préparer la guerre et de compenser son infériorité économique par une meilleure organisation de son économie de guerre, une plus totale intégration de toutes ses ressources -humaines et matérielles- aux nécessités de la production de guerre.
Les formes extrêmes de capitalisme d'Etat dans les pays du bloc russe -résultat de leur faiblesse économique- ne doivent pas nous faire conclure qu'une économie de guerre bien organisée existait déjà. La situation chaotique de la production et de la distribution de denrées alimentaires, dont une bonne organisation est vitale dans une économie de guerre afin de nourrir les producteurs et les utilisateurs d'armes à meilleur marché possible, et ainsi destiner la masse de travail disponible, des machines et des matières premières à la production de matériel de guerre, indique l'ampleur du problème rencontré par la bourgeoisie du bloc russe.
La prédominance de fermes "privées" petites et inefficaces (85% de la production agricole en Pologne) et les parcelles "privées" dans les fermes collectives (au point que 50% du revenu des Kolkhozes russes vient de la vente du produit des lopins privés) aussi bien que les florissants marchés "noirs" ou "libres" pour les denrées alimentaires, montrent que l'Etat n'a pas encore un contrôle totalitaire du secteur II, la production de biens de consommation, une bonne distribution, qui sont essentielles à une économie de guerre. La sujétion de la paysannerie et le contrôle complet de l'agriculture par l'Etat' Léviathan aussi bien que l'élimination des marchés noirs et libres, sont des tâches formidables que la bourgeoisie du bloc russe devra affronter dans les années à venir.
Même dans l'industrie, dont la quasi totalité est nationalisée dans le bloc russe, il y a des obstacles d'importance à la consolidation de l'économie de guerre.
La décentralisation de l'industrie et l'autonomie de l'entreprise qui était un aspect du "socialisme" mercantile,doit d'abord être éliminé si le secteur 1 doit être organisé de manière centralisée autour du but de la production d'armements.
Déjà, une telle entreprise produira des heurts au sein de la bourgeoisie elle-même tels que les directeurs et chefs d'entreprises d'usines particulières et de trusts, essaieront de préserver leurs prérogatives.
La nécessité d'un ordre économique plus unifié et autarcique (dirigé par Moscou) qui pèse sur l'ensemble du bloc, exacerbe aussi les tensions au sein de la bourgeoisie de chaque pays sur la manière d'appliquer les décisions de l'impérialisme russe.
Etant donné la prédominance du facteur politico-militaire, aucune fraction significative de la bourgeoisie d'aucun pays du COMECON ne peut sérieusement remettre en cause l'appartenance au bloc russe. Cependant, il y a de sérieuses divergences entre ces fractions de la bourgeoisie dans chaque pays, qui cherchent à étendre leur commerce avec l'Ouest et à encourager les investissements du capital de l'Ouest afin de stimuler le développement d'industries purement nationales, et d'autres fractions pont qui l'intérêt du capital national implique l'orientation de la vie économique exclusivement autour du bloc et de la construction d'une économie de guerre unifiée.
Le poids politico-militaire écrasant de l'impérialisme russe dans le bloc de l'Est fera en sorte que ce soit cette dernière fraction qui l'emporte dans les heurts au sein de la bourgeoisie.
La profondeur de la crise politique de la bourgeoisie dans le bloc russe de toutes façons, se manifeste crûment par les efforts croissants pour contenir un prolétariat combatif. La profondeur de la crise économique et la nécessité de l'économie de guerre réclament une attaque drastique au niveau de vie et aux conditions de travail déjà abyssaux du prolétariat. Déjà, l'appareil politique de la bourgeoisie, perfectionné pendant le creux de la contre-révolution, quand la classe était écrasée, est mal adapté à la tâche de tromper un prolétariat déclenchant des luttes toujours plus dures et militantes.
La faiblesse économique de toutes les fractions du capital national les a conduit à une dépendance quasi-totale à l'égard de leur appareil militaire et policier pour maintenir l'ordre. De plus, la domination de l'impérialisme russe sur son bloc (à la différence de la situation de l'impérialisme US) dépend presque exclusivement de facteurs militaires. Ainsi, dans une situation historique dans laquelle le recours à la répression physique directe du prolétariat risque de provoquer la guerre de classe généralisée, quand le capital doit d'abord essayer de contrôler le prolétariat économiquement, condition préalable à son écrasement physique, la bourgeoisie du bloc russe a été incapable d'ajuster les formes de sa dictature aux nécessités du nouveau rapport de force entre classes. Chaque relâchement de l'appareil de répression directe risque d'affaiblir l'Etat ; une trop grande utilisation de l'appareil répressif risque d'allumer la flamme prolétarienne. Aussi, la bourgeoisie dans le bloc russe est paralysée face à la tâche urgente de l'attaque du prolétariat.
Les antagonismes inter-impérialistes
Si la production d'armements et la mise en place de l'économie de guerre sont la seule manière d'éviter la chute de l'appareil productif capitaliste, ce n'est en aucune façon une politique économique en soi (quoiqu'en pensent encore de larges secteurs de la bourgeoisie) mais la préparation à une conflagration mondiale, une expression des antagonismes inter-impérialistes que la crise mortelle du capitalisme mène au point de rupture. L'approfondissement inexorable de la crise mondiale n'a pas seulement porté à un point extraordinairement haut les tensions entre les doux blocs impérialistes, mais a aussi clairement révélé les différentes manières pour les impérialismes américains et russes de dominer les autres pays de leurs blocs, et de contrôler les marchés extérieurs, sources de matières premières et réservoir de main-d'oeuvre bon marché. A cause de sa faiblesse économique, la domination de la Russie sur d'autres pays dépend presque exclusivement de l'occupation militaire directe, ou au moins, de l'intervention rapide de ses forces armées. De plus, du fait de la supériorité navale américaine toujours écrasante, les régions sujettes au contrôle militaire de l'impérialisme russe, sont effectivement limitées aux régions d'Eurasie, et à des aires aisément accessibles à l'armée de terre russe.
C'est la clé de la domination russe en Europe de l'Est et en Mongolie, de même que l'incapacité de l'impérialisme russe à avoir un contrôle sur les pays hors d'atteinte de ses tanks. Au contraire, la suprématie de l'appareil productif de l'impérialisme "américain est telle qu'il peut économiquement dominer n'importe quelle partie du monde. La seule barrière à la domination économique américaine est l'hégémonie militaire de l'impérialisme russe dans une aire donnée qui, nous l'avons vu, est, pour des raisons stratégiques (l'infériorité navale) encore limité aujourd'hui à des aires contiguës à la Russie elle-même. L'infériorité économique de la Russie et les limites à ses ambitions militaires sont telles que même quand les fractions bourgeoises, armées et soutenues par elles triomphent dans un conflit inter-impérialistes localisé (Viêt-Nam, Mozambique, Angola…), cela ne signifie pas que le pays en question passe sans équivoque dans le bloc russe. Plutôt, la combinaison du poids économique du bloc US qui va croissant au fur et à mesure que la crise frappe les économies les plus faibles de plus en plus durement, et les limitations stratégiques de l'impérialisme russe produisent souvent une période d'oscillations entre les blocs. La recherche de la part du Viêt-Nam d'investissements du bloc US, de crédit et de commerce, dans un vain effort pour reconstruire une économie délabrée, prouve l'incapacité de la Russie à incorporer fermement dans son bloc, même un régime dont l'existence dépend de son aide militaire. La continuation de la dépendance à l'égard de l'Afrique du Sud par le Mozambique, l'appel au bloc US pour l'extraction et la vente de son pétrole et de ses minerais qui sont, la base de la vie économique de l'Angola, indiquent tous les deux les énormes difficultés que rencontre la Russie à essayer de supplanter l'impérialisme américain dans les points forts d'Afrique.
A cause de sa supériorité économique, môme les défaites militaires des fractions bourgeoises qu'il soutient ne sont suffisantes pour briser la mainmise de l'impérialisme US sur un pays, vu que, en raison de faiblesse économique, aucune sorte d'occupation militaire ne suffit a l'impérialisme russe pour s'assurer le contrôle d'un pays.
C'est la supériorité économique et stratégique qui est la base du continuel déséquilibre entre les deux camps impérialistes en faveur du bloc américain. Les USA sont en train d'éliminer la plus importante tète rie pont que l'impérialisme russe a établie dans l'effort pour s'étendre au coeur de l'Eurasie, son fief. Ainsi, au Moyen-Orient, l'Egypte et le Soudan sont réincorporés politiquement, économiquement et même militairement dans le bloc US, tandis que la Syrie a déjà fait les premiers pas dans ce sens. Le récent effort de l'impérialisme russe pour gagner une place dominante au Liban, via les Palestiniens et le front des gauchistes musulmans (qu’il armait et soutenait diplomatiquement); a été balayé par la seule armée syrienne (soutenue par Washington), que Moscou avait si bien équipée. La défaite militaire au Liban et l'affaiblissement de l'impérialisme russe au Moyen-Orient, ont maintenant conduit la plus influente fraction de l'OLP à reconsidérer son orientation pro-russe. De plus, les USA commencent à remettre en cause jusqu'à l'hégémonie russe en Irak.
Avec le rétablissement de la domination quasi-totale des USA sur le monde arabe, une domination qui embrasse aussi bien les régimes "socialistes" que les “royaumes", l'administration Carter dirige maintenant ses efforts pour imposer un statu quo israélo-arabe, qui impliquerait la formation d'un Etat croupion sur la rive ouest et dans la bande de Gaza.
L'impérialisme US espère établir une "Pax americacana" durable sur la région et faire du Moyen-Orient une solide barrière à l'expansion de l'impérialisme russe, plutôt qu'un passage pour la Russie vers l'Afrique et l'Asie du Sud comme cela se passait précédemment.
La lutte intense entre les deux blocs pour le contrôle de la corne africaine et de la ligne vitale de Babed-el-Mameb, qui commande les routes entre l'Europe et l'Asie, entre maintenant dans une phase décisive. L'apparent triomphe de la Russie en Ethiopie où le régime du colonel Mengistus a opté pour Moscou et où les armes russes permettent une escalade de la guerre barbare en Erythrée ainsi que le fait de mettre le front de libération de l'Erythrée dans la dépendance de l'impérialisme américain, a sa contre-partie dans la réorientation de la Somalie vers le bloc US.
Ceci et l'influence croissante du client américain, l'Arabie Saoudite sur le Sud-Yemen conduisent à un changement du rapport de force interimpérialiste dans la corne orientale, qui pourrait bien laisser l'impérialisme russe avec seulement le bastion éthiopien, dont les parties importantes (Erythrée, Ogaden) seraient détachées par des voisins envieux et des fronts de libération soutenus par les USA. Un régime indépendant en Erythrée soutenu par les USA, un à Djibouti occupé par la France, le Yémen, la Somalie tirés dans le bloc US par l'Arabie Saoudite, feraient (avec l'Egypte et le Soudan, maintenant intégrés dans le camp US) de la Mer Rouge, un lac américain.
En Inde, la défaite d'Indira Gandhi et la victoire de la coalition pro-américaine Janata, la formation d'un gouvernement dirigé par Morarji Desai forgent de nouvelles chaînes économiques liant New-Delhi à Washington en même temps que cela signifie l'élimination des politico-militaires de Moscou (établis au cours de la guerre indo-pakistanaise) dans l'Asie du Sud et l'Océan Indien.
Ce n'est pas l'expansion de l'impérialisme russe nais la consolidation de la mainmise du bloc US sur le sous-continent indien qui s'opère'. Cependant, en Extrême-Orient, l'incroyable croissance des antagonismes inter-impérialistes entre Chine et Russie et les tensions croissantes sur leurs frontières communes font pencher la Chine vers le bloc US, processus qui est accéléré par l'état de son économie. Alors que l'administration Carter se pose déjà la question de la nature de son aide à la Chine dans l'éventualité d'une guerre russo-japonaise et que l'amorce d'un rapprochement sino-indien se fait jour (rapprochement désiré par Washington), tous ces faits sont des signes incontestables de l'affaiblissement du bloc russe dans le continent asiatique.
Les initiatives de Washington au Moyen-Orient et dans la corne orientale, dans le sous-continent indien et en Extrême-Orient ont pour but d'enfermer ces régions dans un cercle de fer, que les Etats-Unis essayent de construire afin de confirmer l'impérialisme russe dans le centre Eurasien. Le succès de la politique de l'impérialisme US dépend en grande partie de sa capacité a stabiliser ces régions et à atténuer les rivalités inter-impérialistes entre les différents Etats - stabilisation de la barbarie, dans laquelle la crise permanente du capitalisme a déjà poussé l'humanité. La seule issue laissée à l'impérialisme russe, s'il a une chance de concurrencer l'impérialisme américain, est de mettre tous ses efforts pour déstabiliser ces régions par son soutien politique et: militaire aux luttes de libération nationale et à certaines fractions de la bourgeoisie dans chacun de ces pays, pour qui le statu-quo imposé par les USA est intolérable. Ainsi, au Moyen-Orient, le seul espoir pour les russes de reprendre du terrain est une nouvelle guerre israélo-arabe.
Dans le sous-continent indien, 1'expansion de l'impérialisme russe ne peut se faire que par une nouvelle guerre indo-pakistanaise -même, si cette fois, la Russie soutient Islamabad et essaie de forger un bloc musulman composé du Pakistan- du BanglaDesh et de l'Afghanistan afin de lutter contre l'Inde soutenue par les USA.
C'est exactement cette politique de déstabilisation que le capital russe a entrepris en Afrique du Sud, où les armes et les fonds vont au front patriotique en Rhodésie, au Swapo en Afrique du Sud-est et à la récente guérilla cubaine en Afrique du Sud même. Les USA voyant: le danger d'une telle déstabilisation pour sa propre domination, essaient d'imposer la règle de la majorité noire en Rhodésie et en Afrique du Sud afin d'asseoir sa domination sur des bases plus solides en soutenant une fraction noire do la bourgeoisie. Dans toutes ces régions, de toute façon, les limites stratégiques de la Russie, même si une politique de déstabilisation ne peut être, évitée, rendent l'occupation militaire directe de la Russie extrêmement difficile.
Il existe une région où la tentative de l'impérialisme russe pour s'étendre à partir de son aire géo-politique offre des possibilités de technologie avancée et n'a pas de limites stratégiques écrasantes, cette région c'est : l'Europe. Le seul pays en Europe où une extension russe serait bénéfique, et qui ne provoquerait pas automatiquement une guerre importante entre les deux blocs impérialistes, c'est : la Yougoslavie.
La mort de Tito va exacerber les contradictions au sein de la bourgeoisie yougoslave : d'un côté les fractions favorables à une orientation pro-russe et de l'autre celles favorables à une orientation pro-américaine. Entre la fraction Serbe, qui domine la bourgeoisie et le nationalisme croissant des fractions Croates et Slovènes, l'impérialisme russe peut, soit provoquer un changement de pouvoir à Belgrade, soit essayer de démembrer la Yougoslavie en fournissant une aide matérielle décisive à l'établissement d'Etats nationaux Serbe et Croates liés à Moscou. Avec sa supériorité matérielle et stratégique en Europe du Sud-est, le spectre de la Russie se dessine dans l'Adriatique.
L'effet d'une telle progression, si elle devait être couronnée de succès, modifierait de manière significative le rapport de force entre les blocs dans l'Europe du Sud et soumettrait l'Italie et la Grèce à une pression croissante de la Russie. A cela il faut ajouter la tension croissante entre la Grèce et la Turquie à propos de Chypre et des droits d'exploitation dans la mer Egée, qui peuvent donner au bloc russe l'occasion de prendre l'impérialisme US de flanc dans la Méditerranée, s'il ne parvient pas à une solution stable pour la région. La concentration de la pression russe dans l'Europe du Sud-est et en Asie Mineure indique le lieu où le prochain conflit impérialiste peut éclater.
La lutte de classe
L'approfondissement de la crise économique, menaçant de paralyser l'appareil productif du capitalisme, et ses manifestations dans l'exacerbation des antagonismes inter-impérialistes, conduisent la bourgeoisie à l'établissement de l'économie de guerre et, en fin de compte, aux préparatifs pour un nouveau massacre mondial. Cependant, le prolétariat partout barre le chemin à l'économie de guerre et à la conflagration mondiale dont elle est la préparation indispensable. La soumission idéologique et physique de la classe ouvrière à l'Etat capitaliste est la condition préalable nécessaire pour installer définitivement une économie de guerre. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie s’affronte à un prolétariat combatif et de plus en plus conscient de ses intérêts.
En effet, la classe ouvrière a réagi de façon combative aux premiers coups de la crise qui a marqué la fin définitive de la période de reconstruction après la seconde guerre mondiale: la vague d'occupations d'usines qui a débouché sur la grève générale de 10 millions d'ouvriers en France en 1968 ; "l'automne chaud" de 1969 en Italie pendant lequel l'industrie a été paralysée par des grèves de masse et des occupations d'usines ; la grève anti-syndicale des mineurs de KIRUNA cette même année, qui a brisé plus de trois décennies de "paix sociale", qui avait valu h la Suède la renommée de "paradis pour le capital" sous le régime social-démocrate; les dures luttes des mineurs de Limbourg en Belgique en 1970 ; les grèves et combats violents de milliers d'ouvriers contre la police qui ont foudroyé les centres industriels de la Pologne pendant l'hiver 1970-71 ; la vague des grèves en Grande-Bretagne qui a culminé dans la grève générale de solidarité avec les dockers en 1972 ; les luttes des ouvriers à SEAT (Barcelone) en 1971 et à Vigo et Ferrol en 1972 qui -élevant des barricades et se battant dans la rue Cintre la police ainsi que les assemblées générales dans les usines- ont marqué la remontée du prolétariat en Espagne ; toutes ces luttes étaient autant de coups portés à la bourgeoisie des métropoles capitalistes, elles ont mis en évidence que l'approfondissement de la crise économique produit un durcissement de la lutte de classe. Par conséquent, si d'un côté, les nécessités économiques obligent la bourgeoisie à faire face au prolétariat rapidement et de façon décidée pour l'écraser, les réalités politiques, d'un autre côté, le rapport de force entre les classes, font que la bourgeoisie essaie d'éviter l'affrontement direct avec la classe ouvrière aussi longtemps que possible.
Par rapport aux années 1968-72, les années qui ont suivi la vague de luttes 1968-72, donnent l'impression d'un recul et d'un creux dans la lutte de classe. En réalité, après avoir encaissé les premiers coups de la crise, la bourgeoisie des métropoles a cherché désespérément à reporter les effets les plus désastreux de la crise sur les pays capitalistes plus faibles ; ainsi, les plus durs affrontements entre prolétariat et bourgeoisie se sont déplacés vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique Latine et la Chine. L'Egypte est la proie de vagues de grèves sauvages depuis 1974 : les usines de textile à Kelvan en 1975, les grèves qui ont paralysé les trois grands centres industriels du pays, Alexandrie, Helwan et Le Caire, en avril 1976, et les grèves et émeutes contre les hausses des prix des produits de première nécessité en janvier de cette année. En Israël, les ouvriers ont répondu à la hausse des prix gigantesque de 1975 par des protestations violentes, et en novembre-décembre 1976, une vague de grèves -touchant 35 7, des travailleurs du pays, s'est attaquée au contrat social imposé par le gouvernement des travaillistes et par les syndicats. En Afrique, en 1976, le prolétariat s'est lancé dans des grèves de; masse aussi bien contre les régimes du capital " noir" que du capital "blanc" : en juillet, les ports de l'Angola ont été paralysés par des grèves que le MFLA a réprimées dans le sang ; en septembre, les mesures d'austérité de la junte "marxiste-léniniste" d'Ethiopie' ont provoqué une grève générale dans les banques, les assurances, dans les secteurs de l'eau, du gaz et de l'électricité, grève générale qui a abouti à un affrontement violent avec l'armé ; en Afrique du Sud, aussi bien dans l'industrie automobile que dans les mines, des grèves dures ont éclaté, tandis qu'en Rhodésie, les chauffeurs d'autobus de Salisbury ont paralysé les transports de la ville pendant plus de quarante jours malgré la répression brutale de la police. En Amérique Latine, le prolétariat a répondu à la crise avec des luttes de plus en plus massives, violentes et unifiées : en Argentine, les ouvriers de l'électricité ont coupé le. courant dans les principales villes, en automne 1976 ; à Cordoba, les ouvriers de l'automobile se sont affrontés aux forces de police ; au Pérou, des luttes semi-insurrectionnelles ont transformé Lima en un champ de bataille, en 1975 et 1976 ; dans les mines d'étain de Bolivie, dans les plantations et usines de textile de Colombie, dans les centres de textile et la zone de fer au Venezuela, le prolétariat a engagé des luttes violentes. En Chine, les années 1975 et 76 ont vu des grèves se généraliser d'usine en usine, saisissant des provinces entières et atteignant des proportions semi-insurrectionnelles ; comme à Kang-Show, lors d'une grève générale qui a duré trois mois, les ouvriers ont attaqué les sièges du Parti et du gouvernement, des barricades ont été dressées dans des quartiers ouvriers et il a fallu dix mille soldats pour ramener l'ordre. Entre 1973 fit 1977, on n'assiste pas à un ralentissement de l'intensité de la résistance du prolétariat aux effets de la crise mais à un déplacement momentané de l'épicentre de la lutte de classe vers la périphérie du monde capitaliste.
Par ailleurs, en ce qui concerne les métropoles capitalistes, même si on dit qu'il y a un décalage entre la profondeur de la crise et la réaction du prolétariat, que la lutte de classe a baissé après 1972, on ne doit pas oublier le fait qu'il n'y a pas eu de défaite politique du prolétariat, que dans aucun des centre du capitalisme mondial, la bourgeoisie n'a écrasé physiquement ou idéologiquement la classe ouvrière. En fait le calme apparent dans la lutte de classe ne signifie pas une diminution de combativité de la classe -même provisoirement- mais une conscience croissante chez les ouvriers du caractère futile en dernière instance des luttes purement économiques. C'est par l'impossibilité de défendre, avec leurs luttes, ne fussent que leurs intérêts"immédiats", que le prolétariat est entrain d'apprendre qu'il doit s'affronter au capital et son Etat avec des luttes directement politiques ; c'est par cette impossibilité qu'il apprend la nécessité de généraliser et politiser ses luttes. La vague de grèves qui s'est répandue à travers l'Espagne comme une traînée de poudre en janvier mars 1976, et les grèves violentes qui ont embrassé la Pologne en juin 1976, ont donné le signe de départ d'une nouvelle phase de généralisation et de radicalisation des luttes prolétariennes dans les métropoles capitalistes. La vitesse avec laquelle se sont généralisées les luttes à Radom (Pologne) et à Vitoria (Espagne), prenant une usine après l'autre, revêtant souvent un caractère insurrectionnel, est un signe indicateur de l'expérience que le prolétariat a déjà acquise et de l'orage prolétarien qui se prépare. Au cours de 1'année dernière, les bourgeoisies d'Italie, de Grande-Bretagne, du Portugal, du Danemark et de Hollande ont dû faire face aux premiers assauts de cette nouvelle vague de luttes ouvrières. Mais ce n'est pas une simple énumération de grèves ni de pays touchés par les luttes qui peut exprimer quelle est la situation réelle du moment présent alors que c'est au niveau mondial que le prolétariat est l'élément déterminant :
- "Les conditions pour l'unité Internationale de la classe sont entrain de se créer lentement ; pour la première fois dans l'histoire, le surgissement de luttes ouvrières est simultanée dans tous les pays du monde autant dans la périphérie (Afrique, Asie, Amérique Latine) que dans le centre (Amérique du Nord, Europe)”. (Accion Proletaria, avril-mai 77).
De même que la réapparition d'une crise ouverte en 1967 a provoqué une vague de luttes combatives du prolétariat dans les années qui ont suivi, de même, la nouvelle phase de la crise, qui oblige la bourgeoisie à mettre en place une économie de guerre et l'amène vers une guerre inter-impérialiste généralisée, deviendra un facteur qui engendrera dans la classa ouvrière la conscience de plus en plus claire de la nécessité d'engager des luttes directement politiques.
Ainsi, la nécessité impérieuse pour la bourgeoisie de mettre Dur pied une économie de guerre deviendra un facteur de poids dans l'accélération du cours vers une guerre de classe généralisée.
La bourgeoisie est amenée il instaurer son économie de guerre conformément aux lois aveugles qui déterminent ses actions ; alors que la classe bourgeoise est incapable de comprendre les forces qui la poussent vers la guerre, les marxistes révolutionnaires peuvent voir clairement quel est le cours que la bourgeoisie sera obligée de suivre et comprendre les tendances de base de l'économie et de la politique capitalistes que la bourgeoisie ne peut voir que confusément.
C'est pour cette raison que le CCI peut tracer les perspectives politiques et économiques fondamentales du capitalisme dans les années à venir. Cependant, la lutte de classe du prolétariat, en devenant directement une lutte politique, n'est pas un produit des lois aveugles, c'est une lutte consciente. Aussi, si les révolutionnaires ne peuvent pas prédire quand les luttes vont surgir -justement à cause du facteur conscient qui en est la clé- ils peuvent et doivent, par leur intervention politique dans la lutte de classe, par l'accomplissement de leur tâche vitale de contribution à la généralisation de la conscience révolutionnaire dans la classe, devenir un facteur actif et décisif dans le surgissement et le développement des luttes politiques qui mèneront vers une guerre de classe généralisée du prolétariat contre la bourgeoisie. C'est cela qui est à l'ordre du jour maintenant.
CCI
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Crise économique [100]
Les groupes politiques prolétariens
- 2560 reads
La caractérisation des différentes organisations qui se réclament du socialisme et de la classe ouvrière est de la plus haute importance pour le CCI. Ce n'est nullement une question abstraite ou de simple théorie mais au contraire qui oriente de façon directe l'attitude du Courant à l'égard de ces organisations et donc son intervention face à elles : soit dénonciation en tant qu'organe et émanation du Capital, soit polémique et discussion en vue de tenter de favoriser leur évolution vers une plus grande clarté et rigueur programmatique ou de permettre et impulser en leur sein l'apparition de tendances à la recherche d'une telle clarté. C'est pour cela qu'il faut se garder de toute appréciation hâtive ou subjective des organisations auxquelles le CCI est confronté et qu'il est nécessaire, tout en se gardant d'un étiquetage formel et rigide, de définir les critères les plus exacts possible d'une telle appréciation. Toute erreur ou précipitation en ce domaine met en cause l'accomplissement de la tâche fondamentale de constitution d'un pôle de regroupement des révolutionnaires et porte en germe des déviations de caractère soit opportuniste, soit sectaire qui seraient des menaces pour la vie même du Courant.
1) Le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière s'exprime en un processus de maturation de sa conscience, processus difficile, en dents de scie, jamais linéaire, connaissant de multiples tâtonnements, remises en question, et qui se manifeste nécessairement dans l'apparition et l'existence simultanée de plusieurs organisations plus ou moins formées et avancées. Ce processus s'appuie sur l'expérience à la fois immédiate et historique de la classe, a besoin des deux pour pouvoir se développer et s'enrichir. Il doit s'approprier les acquis passés de la classe mais, en même temps, il doit être capable de critiquer et dépasser les limites de ces acquis, activité qui n'est à son tour possible qu'à partir d'une réelle assimilation de ces acquis ; et, de fait, les différents courants qui se manifestent dans la classe se distinguent par une plus ou moins grande aptitude à assumer ces différentes tâches. Si la prise de conscience de la classe s'inscrit en rupture avec l'idéologie bourgeoise ambiante, les groupes qui l'expriment et y participent sont eux-mêmes soumis à la pression de cette idéologie ce qui fait constamment peser sur eux une menace de disparition ou d'absorption par la classe ennemie.
Ces caractéristiques générales du processus de développement de la conscience révolutionnaire sont encore plus marquées dans la période de décadence du capitalisme. En effet, cette décadence, tout en jetant les bases pour la destruction du système aussi bien du point de vue objectif (crise mortelle du mode de production) que subjectif (décomposition et déliquescence qui en résultent pour l'idéologie bourgeoise et affaiblissement de son emprise sur la classe ouvrière), a suscité l'apparition d'entraves et difficultés nouvelles à cette prise de conscience. A ce titre, on peut citer :
- l'atomisation que subit la classe en dehors des périodes de lutte intense,
- l'emprise de plus en plus totalitaire de l'Etat sur l'ensemble de la vie sociale,
- l'intégration dans celui-ci de toutes les organisations de masse -partis et syndicats- qui, au siècle dernier, constituaient un lieu de développement de la conscience de classe,
- enfin, le facteur supplémentaire de confusion constitué par les tendances radicales résultant de la décomposition de l'idéologie bourgeoise officielle .
Mais à l'heure actuelle, à l'ensemble de ces conditions, il vient s'ajouter :
- le poids de la plus profonde contre-révolution subie par le mouvement ouvrier, ayant conduit à la disparition ou à la sclérose des courants communistes du passé,
- le fait que la crise aiguë du système qui est à la base de la reprise historique de la classe, ait produit une accentuation violente de la décomposition des divers secteurs des couches moyennes, et particulièrement les milieux intellectuels et étudiants, et dont la radicalisation a produit de multiples écrans de fumée venant compliquer l'effort de la classe révolutionnaire vers une prise de conscience.
2) Dans un tel cadre général du mouvement de la classe vers une prise de conscience de ses tâches historiques, on peut observer l'existence de trois types fondamentaux d'organisations.
En premier lieu, les partis qui, après avoir été des organes de la classe, ont succombé à la pression du capitalisme et ont pris place comme défenseurs du système en assumant une fonction plus ou moins directe de gestion du capital national. Pour de tels partis, l'histoire enseigne :
- que tout retour en arrière vers une activité prolétarienne est impossible,
- qu'à partir du moment de leur changement de camp, leur dynamique n'est plus déterminée que par des besoins du capital ou comme manifestations de la vie de celui-ci ;
- que s'il subsiste dans leur langage et leur programme des références à la classe ouvrière, au socialisme ou à des positions révolutionnaires, c'est uniquement à usage de mystification. En fait, même si les positions de tels partis ne sont, pas toujours cohérentes entre elles, elles sont soutenues par une cohérence générale dans la défense des intérêts capitalistes.
Parmi ces partis, on peut nommer principalement les partis socialistes issus de la 2ème Internationale, les partis communistes issus de la 3ème, de même que les organisations appartenant à l'anarchisme officiel, et également les courants trotskystes. Tous ces partis ont été conduits à tenir une place dans la défense du capital national comme agents du maintien de l'ordre ou rabatteurs pour la guerre impérialiste.
En second lieu, les organisations dont l'appartenance à la classe ouvrière est indiscutable de par leur capacité à tirer les leçons des expériences passées de la classe, à comprendre les données historiques nouvelles, à rejeter toutes les conceptions qui se sont révélées étrangères à la classe ouvrière et dont l'ensemble des positions atteint un haut niveau de cohérence. Même si le processus de prise de conscience n'est jamais achevé, si la cohérence ne peut jamais être parfaite, si les positions de classe demandent un constant enrichissement, on a pu constater à travers l'histoire l'existence de courants qui, à un moment donné, ont représentés les manifestations non exclusives, mais les plus avancées et complètes de la conscience de classe et ont assumé un rôle central dans ce processus.
Dans nos rapports avec de tels groupes, proches du CCI mais extérieurs, notre but est clair. Nous essayons d'établir une discussion fraternelle et approfondie des différentes questions affrontées par la classe ouvrière, afin:
- d'atteindre un maximum de clarté pour le mouvement dans son ensemble,
- d'explorer les possibilités d'un renforcement de l'accord politique et de progression vers le regroupement.
En troisième lieu, des groupements dont, à l'inverse des précédents, la nature de classe n'est pas tranchée de façon nette et qui, manifestation du caractère complexe et difficile du processus de prise de conscience du prolétariat, se distinguent des organisations du second type par le. fait :
- qu'ils sont moins dégagés du poids de l'idéologie capitaliste et plus vulnérables, face à celle-ci,
- qu'ils sont moins capables d'intégrer ou les acquis anciens ou les données nouvelles de la lutte,
- que coexistent dans leur programme, au détriment d'une cohérence solide, des positions prolétariennes et des positions de la classe ennemie,
- qu'ils sont traversés à une échelle bien plus grande, par des tendances contradictoires, d'une part vers l'absorption ou la destruction par le capital, et d'autre part vers un ressaisissement.
Dans le cas de ces groupes, dans la mesure où ils sont plongés dans la confusion, la démarcation qui sépare le camp prolétarien du camp capitaliste, bien qu'elle existe effectivement, est extrêmement difficile à établir de façon formelle. Pour ces mêmes raisons, il est difficile d'en définir une classification précise, on peut cependant les distinguer en trois grandes catégories :
I) Les courants plus ou moins formels qui peuvent se dégager de mouvements embryonnaires et encore confus de la classe,
II) Les courants issus d'organisations passées dans le camp ennemi et rompant avec elles, qui, tous deux, sont une manifestation du processus général de rupture avec l'idéologie bourgeoise.
III) Les courants communistes en voie de dégénérescence, en général comme résultat d'une sclérose et d'un épuisement suite à une incapacité à actualiser leurs positions d'origine.
3) Parmi les groupes du premier type on peut ranger divers courants informels comme le "Mouvement du 22 mars" en 1968, des "groupes autonomes", etc., toutes organisations surgies du mouvement immédiat lui-même et donc sans racine historique, sans programme élaboré, puisqu'établi sur quelques points partiels et vagues, dépourvus d'une cohérence globale et ignorant l'ensemble des acquis historiques de la classe. Ces caractéristiques rendent ces courants très vulnérables, ce qui se manifeste dans la plupart des cas par leur disparition à bref délai ou leur transformation rapide en simple queue des groupes gauchistes. Cependant, de tels courants peuvent également s'engager dans un processus de clarification et d'approfondissement de leurs positions, ce qui les amène à évoluer vers une disparition comme tels et une intégration de leurs membres dans l'organisation politique de la classe.
Face à chacun de ces mouvements, le CCI doit intervenir afin de favoriser et de stimuler une telle évolution positive et tenter de leur éviter une dislocation dans la confusion ou leur récupération par le capitalisme.
4) Concernant les groupes du deuxième type, seuls en font partie les courants qui se séparent de leur organisation d'origine sur la base d'une rupture avec certains points de son programme et non sur la base d'une "sauvegarde" de principes prétendument révolutionnaires en cours de liquidation. En ce sens, on ne doit rien attendre des différentes scissions trotskystes qui régulièrement se proposent de sauvegarder ou revenir à un "trotskysme pur".
Apparus sur la base, d'une rupture programmatique avec leur organisation d'origine, ces groupes se distinguent fondamentalement des fractions communistes qui peuvent apparaître comme réaction à un processus de dégénérescence des organisations prolétariennes. En effet, celles-ci se basent non sur une rupture mais sur une continuité du programme révolutionnaire précisément menacé par le cours opportuniste de l'organisation, même si par la suite elles lui apportent les rectifications et enrichissements imposés par l'expérience. De ce fait, alors que les fractions apparaissent avec un programme révolutionnaire cohérent et élaboré, les courants qui rompent avec la contre-révolution se présentent avec des positions essentiellement négatives, opposées, généralement de façon partielle, à celles de leur organisation d'origine, ce qui ne suffit pas à constituer un programme communiste solide. Leur rupture avec une cohérence contre-révolutionnaire ne peut suffire à leur conférer une cohérence révolutionnaire. De plus, l'aspect nécessairement parcellaire de leur rupture se traduit par la conservation d'un certain nombre de pratiques du groupe d'origine (activisme, carriérisme, manoeuvriérisme, etc.) ou par l'adoption de pratiques symétriques, mais non moins erronées (attentisme, refus de l'organisation, sectarisme, etc.).
Pour l'ensemble de ces raisons, de tels groupes ont en général des probabilités très faibles d'évolution positive comme corps. Leurs déformations d'origine pèsent la plupart du temps trop fortement pour qu'ils puissent se dégager véritablement de la contre-révolution, quand ils ne disparaissent pas purement et simplement. Une telle dissolution est en fin de compte la meilleure issue puisqu'elle peut permettre à leurs militants de se dégager des tares organiques originelles et donc de s'orienter vers une cohérence révolutionnaire.
Cependant, ce qui existe à l'état d'une forte probabilité ne peut jamais être considéré comme une absolue certitude et, en ce sens, le CCI doit se garder de toute prise de position les rejetant de façon irrémédiable dans la contre-révolution, ce qui ne peut que bloquer une évolution positive de tel groupe ou de ses militants. Il peut en effet exister de grandes différences dans la dynamique de tels groupes suivant leur organisation d'origine : si les scissions provenant d'organisations au programme et à la pratique contre-révolutionnaires bien cohérents et affirmés (comme les organisations trotskystes par exemple) sont en général les plus handicapés, par contre, les courants qui se dégagent d'organisations plus informelles et au programme moins élaboré (comme celles venant de l'anarchisme par exemple) ou ayant trahi de façon plus récente, ont de meilleures chances d'évoluer vers des positions révolutionnaires y compris comme corps.
Par ailleurs, le caractère de plus en plus évident, à mesure que s'approfondit la crise du capitalisme, du décalage existant entre la phraséologie radicale des organisations gauchistes et leur politique bourgeoise provoque et va encore provoquer en leur sein la réaction de leurs éléments les plus sains, abusés dans un premier temps par cette phraséologie, et qui viendra alimenter ce genre de scissions.
Dans tous les cas, tout en faisant preuve d'une plus grande prudence qu'à l'égard des groupements du premier type et tout en se gardant de toute tentative de création de "comités" communs avec eux, comme a pu le préconiser le PIC par exemple, le CCI doit intervenir activement dans l'évolution de tels courants, favoriser par ses critiques non pas sectaires mais ouvertes la discussion et la clarification en leur sein et se garder de recommencer ses erreurs passées qui ont conduit par exemple "Révolution Internationale" à écrire "nous doutons de l'évolution positive d'un groupe venant de l'anarchisme" dans une lettre adressée au "Journal des Luttes de Classe" dont les membres allaient, un an plus tard, en compagnie de ceux du RRS et du VRS, fonder la section du CCI en Belgique.
5) Le problème posé par les groupes communistes en cours de dégénérescence est probablement un des plus difficiles à résoudre et demande à être examiné avec un maximum de soins. Le fait que tout franchissement de la frontière entre le camp prolétarien et le camp capitaliste ne puisse se faire qu'à sens unique, qu'une organisation prolétarienne qui passe sur le terrain bourgeois le fasse de façon définitive sans espoir de retour, doit inciter à la plus grande prudence dans la détermination du moment de ce passage et dans le choix des critères permettant une telle détermination.
Il ne faut pas considérer par exemple qu'une organisation est bourgeoise parce qu'elle agit dans les faits comme facteur non de clarification de la conscience de classe mais comme facteur de confusion : toute erreur d'une organisation prolétarienne, et du prolétariat en général, profite évidemment à l'ennemi de classe mais on ne peut pas dire que parce qu'une organisation commet des erreurs même très graves elle est l'émanation de la classe ennemie. Dans une armée, l'existence de mauvaises troupes est incontestablement une faiblesse qui favorise l'autre camp. Doit-on pour cela considérer que de telles troupes trahissent ?
En second lieu, on ne peut considérer que le franchissement d'une frontière de classe par une organisation signifie obligatoirement sa mort comme organe du prolétariat. Parmi les frontières de classe, il en est effectivement qui influent tout particulièrement sur la cohérence globale du programme et dont le franchissement peut constituer un critère décisif : ainsi le soutien de la "défense nationale" place d'emblée une organisation dans le camp de la bourgeoisie. Cependant, si une position erronée, même sur un seul point, éclaire d'une manière ambiguë tout l'ensemble du programme d'un groupe, certaines positions tout en se situant en dehors d'une cohérence communiste, ne l'empêchent pas forcément de maintenir un ensemble de positions authentiquement révolutionnaires. Ainsi, certains courants communistes ont pu apporter des contributions fondamentales à la clarification du programme révolutionnaire tout en conservant des positions nettement fausses sur des points importants (ainsi, la Gauche Italienne qui, sur les questions du substitutionisme, des syndicats et même de la nature de l'URSS, a maintenu des positions et analyses fortement, erronées).
Enfin, un des éléments fondamentaux à prendre en compte est l'évolution du groupe considéré. Un jugement ne doit pas être formulé à partir d'une analyse statique, mais dynamique. Par exemple, à toutes positions identiques, il existe une différence entre un groupe qui surgit aujourd'hui et qui appuie les luttes de libérations nationales,et un groupe qui s'est formé sur la base de la lutte contre la guerre impérialiste et qui, ne comprenant pas de lien entre ces deux positions, capitule sur le premier point.
Alors que pour un groupe récent, toute position contre-révolutionnaire risque de l'entraîner rapidement en bloc sur le terrain de la bourgeoisie, les courants communistes qui se sont trempés dans les grandes épreuves historiques, même s'ils portent en eux des éléments très importants de dégénérescence, n'évoluent pas d'une façon aussi rapide. Les conditions très difficiles dans lesquelles ils ont surgi les ont obligé à se doter d'une armure programmatique et organisationnelle beaucoup plus résistante contre les assauts de la classe dominante. En règle générale, d'ailleurs, leur sclérose est en partie la rançon qu'ils payent à leur attachement et à leur fidélité aux principes révolutionnaires, à leur méfiance à l'égard de toute innovation qui a constitué pour d'autres groupes le cheval de Troie de la dégénérescence, méfiance qui les a conduit à rejeter les actualisations de leur programme rendues nécessaires par l'expérience historique. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'en général seuls les événements majeurs de l'évolution de la société, guerre impérialiste ou révolution, qui constituent des phases essentielles de la vie des organisations politiques, permettent de trancher de façon définitive sur le passage comme corps d'un organisme dans le camp ennemi. Souvent, seules de telles situations sont en mesure de clarifier suffisamment les problèmes pour permettre de déchirer le voile empêchant de comprendre certaines aberrations qui relèvent plus d'un aveuglement d'éléments prolétariens que d'une cohérence dans la contre-révolution. C'est généralement dans ces moments où il n'existe plus de place pour les ambiguïtés que les organes en dégénérescence font la preuve soit de leur passage définitif dans l'autre camp, par une collaboration ouverte avec la bourgeoisie, soit de leur maintien dans le camp ouvrier, par une réaction salutaire démontrant qu'ils constituent encore un terrain fertile pour l'apparition d'une pensée communiste. Mais ce qui est valable pour les grandes organisations de la classe en dégénérescence, l'est beaucoup moins pour les petits groupes communistes, à l'impact limité. Si les premiers sont reçus à tambour battant par la bourgeoisie auprès de laquelle ils sont appelés à jouer un rôle de premier ordre, les seconds, quand ils sont happés dans l'engrenage, pour n'avoir pas de possibilité réelle d'assumer une fonction capitaliste, sont broyés impitoyablement et meurent dans une longue et douloureuse agonie de secte.
6) À l'heure actuelle, on peut distinguer deux grands courants qui entrent dans la caractérisation qui vient d'être faite et qui se trouvent dans un processus semblable de sclérose et de dégénérescence. Il s'agit de groupes venant des Gauches Hollandaises et Allemande, d'une part, et Italienne d'autre part. Parmi eux, certains ont mieux résisté que les autres à cette dégénérescence, notamment "Spartacusbond" pour le premier courant et "Battaglia Communista" pour le second, au point de pouvoir se dégager en bonne partie des positions sclérosées, Par contre, d'autres groupes sont engagés beaucoup plus avant dans une telle involution : par exemple "Programme Communiste". Concernant cette dernière organisation, quel que soit le degré atteint par sa régression, il n'existe cependant pas, à l'heure actuelle, d'élément décisif permettant d'établir qu'elle est passée comme corps dans le camp bourgeois. Il faut mettre en garde contre une appréciation hâtive sur ce sujet qui risque non pas de favoriser, mais d'entraver l'évolution et le travail des éléments ou tendances qui peuvent tenter au sein de ce groupe de résister contre ce cours de dégénérescence, ou de s'en dégager.
A l'égard de l'ensemble de ces groupes, il s'agit de maintenir une attitude sereine alliant l'intransigeance dans la défense de nos positions et la dénonciation de leurs erreurs, à la manifestation de notre volonté de discuter avec eux. Ne pas faire cela traduirait une incompréhension fondamentale de nos responsabilités et du fait que la dégénérescence complète de ces groupes constitue une perte et un affaiblissement pour le prolétariat.
7) Dans la définition de l'attitude générale du CCI à l'égard des différents groupes et éléments pouvant exister ou apparaître autour de lui avec des positions plus ou moins confuses, il faut prendre en considération le fait que nous nous situons aujourd'hui dans une période de reprise historique de la lutte de classe.
Dans les périodes de recul ou de creux prolétarien, comme celle dont nous sommes sortis au milieu des années 60, la préoccupation majeure des noyaux communistes est de sauvegarder la rigueur des principes, ce qui les conduit plutôt à s'isoler à l'égard de la situation ambiante pour ne pas se laisser entraîner par elle. Dans de telles circonstances, il est vain de miser sur l'apparition de nouveaux éléments ou forces révolutionnaires : la tâche difficile de défense des principes communistes menacés par la contre-révolution revient essentiellement aux quelques éléments issus des anciens partis qu'elle n'a pas entraînés et qui sont restés fidèles à ces principes.
Par contre, dans la période de reprise actuelle, tout en portant la plus grande attention à l'évolution des courants communistes venant de la vague révolutionnaire précédente et à la discussion avec eux, nous devons avoir comme préoccupation principale de ne pas nous couper des éléments et groupes qui surgissent nécessairement dans la classe comme manifestation de cette reprise. Nous ne pourrons réellement assumer notre fonction comme pôle de regroupement à leur égard que si nous sommes en même temps capables :
- de nous garder de considérer que nous sommes le seul et unique groupement révolutionnaire existant aujourd'hui ;
- de défendre face à eux nos positions avec fermeté ;
- de conserver à leur égard une attitude ouverte à la discussion, laquelle doit se mener publiquement et non à travers des échanges confidentiels.
Loin de s'exclure, fermeté sur les principes et ouverture dans l'attitude vont de pair : nous n'avons pas peur de discuter précisément parce que nous sommes convaincus de la validité de nos positions.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Période de transition – Projet de résolution
- 2618 reads
La plate-forme du CCI énonce les acquis essentiels du mouvement ouvrier sur les conditions et le contenu de la révolution communiste. Ces acquis peuvent être résumés ainsi :
a) Toutes les sociétés jusqu'à aujourd'hui ont été fondées sur l'insuffisance du développement des forces productives par rapport aux besoins des hommes. De ce fait, à l'exception du communisme primitif, elles ont toutes été divisées en classes sociales aux intérêts antagoniques. Cette division a provoqué l'apparition d'un organe, l'Etat, dont la fonction spécifique a été d'empêcher que ces antagonismes ne conduisent à un déchirement et à une destruction de la société elle-même.
b) Par le progrès que le capitalisme a impulsé au développement des forces productives, il a rendu nécessaire et possible son remplacement et son dépassement par une société fondée sur le plein développement des forces productives, l'abondance, la satisfaction de tous les besoins humains : le communisme. Une telle société n'est plus divisée en classes sociales et de ce fait ne connaît ni ne peut supporter l'existence d'un Etat.
c) Comme par le passé, il existe entre les deux sociétés stables que sont le capitalisme et le communisme, une période de transition pendant laquelle disparaissent les anciens rapports sociaux et se mettent en place les nouveaux. Pendant cette période, subsistent des classes sociales, des conflits entre elles et donc un organe ayant pour fonction d'empêcher que les conflits ne menacent la société : l'Etat.
d) L'expérience de la classe ouvrière a démontré que cet Etat ne peut en aucune façon constituer une continuité organique de l'Etat de la société capitaliste. C'est de fond en comble et à l'échelle mondiale que celui-ci doit être détruit pour que puisse s'ouvrir la période de transition du capitalisme au communisme.
e) La destruction mondiale du pouvoir politique de la bourgeoisie s'accompagne de la prise, du pouvoir à cette échelle par le prolétariat, seule classe qui soit porteuse du communisme. La dictature du prolétariat qui s'instaure sur la société, est basée sur l'organisation générale de la classe : les Conseils Ouvriers. C'est la classe ouvrière dans son ensemble qui seule peut exercer le pouvoir dans le sens de la transformation communiste de la société : contrairement aux classes révolutionnaires du passé, elle ne peut déléguer son pouvoir à une quelconque institution particulière, à aucun parti politique, y compris les partis ouvriers eux-mêmes.
f) Le plein exercice par le prolétariat de sa dictature de classe suppose :
- son armement général, son absolue soustraction à toute soumission à des forces extérieures, le rejet de tous rapports de violence en son sein.
g) La dictature du prolétariat exerce sa fonction de levier de la transformation sociale :
- en expropriant les anciennes classes exploiteuses,
- en socialisant progressivement les moyens de production,
- en menant une politique économique dans le sens
de l'abolition du salariat et de la production marchande, dans celui de la satisfaction croissante des besoins humains.
La plate-forme du CCI, se basant sur l'expérience de la révolution, souligne la"complexité et la gravité du problème posé par les rapports entre la classe ouvrière organisée et l'Etat de la période de transition". Elle estime que "dans la période qui vient, le prolétariat et les révolutionnaires ne pourront pas esquiver ce problème, mais se devront d'y consacrer tous les efforts nécessaires pour le résoudre". C'est dans un tel effort que s'inscrit la présente résolution.
I- SPECIFICITE DE LA PERIODE DE TRANSITION DU CAPITALISME AU COMMUNISME
La période de transition du capitalisme au communisme comporte un certain nombre de points communs avec les autres périodes de transition antérieures. C'est ainsi que, comme par le passé :
La période de transition du capitalisme au communisme ne connaît pas de mode de production propre, mais un enchevêtrement de deux modes de production;
Pendant cette période se développent lentement, au détriment de l'ancien, les germes du nouveau mode de production jusqu'au point de le supplanter;
- le dépérissement de l'ancienne société n'est pas automatiquement maturation de la nouvelle, mais seulement condition de cette maturation :
en particulier, si la décadence du capitalisme exprime le fait que les forces productives ont atteint leur limite de développement dans le cadre de cette société, ces forces productives sont encore insuffisantes pour permettre le communisme et devront donc poursuivre leur développement pendant la période de transition.
Le dernier point commun, qu'il est utile de mettre en évidence, entre toutes les périodes de transition, c'est qu'elles relèvent de la société qui va surgir. Dans la mesure où le communisme se distingue fondamentalement de toutes les autres sociétés, la transition qui y conduit comporte donc toute une série de caractéristiques inédites :
Elle ne marque plus le passage d'une société d'exploitation à une autre société d'exploitation, d'une forme de propriété à une autre forme de propriété mais conduit à la fin de toute exploitation et de toute propriété ;
Elle n'est plus l'oeuvre d'une classe exploiteuse et propriétaire des moyens de production, mais d'une classe exploitée qui n'a jamais possédé et ne possédera jamais, même collectivement, de moyens de production, d'économie propre ;
Elle n'aboutit pas à la conquête du pouvoir politique par la classe révolutionnaire ayant au préalable établi sa domination économique sur la société, mais au contraire, commence et est conditionnée par cette prise du pouvoir. La seule domination que le prolétariat ne pourra jamais exercer sur la société sera de nature politique et non économique ;
Le pouvoir politique du prolétariat n'aura pas pour fonction de stabiliser un état de choses existant, préserver des privilèges particuliers ou l'existence d'une division en classes, mais au contraire de bouleverser continuellement cet état de choses, d'abolir tous les privilèges et toute division en classes.
II - L'État et son rôle dans l’histoire
Suivant les propres termes d'Engels :
- l'Etat n'est pas un pouvoir imposé du dehors de la société, il est un produit de la société à un stade donné de son développement,
- il est l'aveu que cette société s'est engagée dans d'insolubles contradictions, s'étant scindée en oppositions inconciliables entre classes aux intérêts économiques antagonistes,
- il a pour fonction de modérer ce conflit, de le maintenir dans les "limites de l'ordre" afin que les classes antagonistes et avec elles la société ne se consument pas en luttes stériles,
- issu de la société, il se place au-dessus d'elle et tend constamment à lui devenir étranger et à se conserver lui-même,
- sa fonction de préservation de "l'ordre" identifie l'Etat aux rapports de production dominants et donc à la classe qui les incarne, la classe économiquement dominante, et qui, par l'intermédiaire de l'Etat, s'assure la domination politique.
Le marxisme n'a jamais donc considéré l'Etat comme une création ex-nihilo de la classe dominante mais bien comme un produit, une sécrétion organique de l'ensemble de la société. L'identification entre la classe économiquement dominante et l'Etat est fondamentalement le résultat de l'identité de leurs intérêts communs de préservation des rapports de production existants. De même, à partir de la conception marxiste, on ne peut en aucune façon considérer l'Etat comme un agent révolutionnaire, un instrument de progrès historique. En effet, pour le marxisme :
- 1°) La lutte de classe est le moteur de l'histoire ;
- 2°) L'État a pour fonction de modérer la lutte de classe et tout particulièrement au détriment de la classe exploitée.
La seule conclusion découlant logiquement de ces prémices est que dans toute société l'Etat ne peut être autre chose qu'une institution conservatrice par essence et par excellence. Aussi, si l'Etat est dans les sociétés de classe un instrument indispensable au processus productif en ce qu'il assure la stabilité nécessaire à sa continuation, il ne peut jouer ce rôle que par sa fonction d'agent de l'ordre social. Au cours de l'histoire, l'Etat apparaît donc comme un facteur conservateur et réactionnaire de premier ordre, comme une entrave à laquelle se heurtent constamment l'évolution et le développement des forces productives.
Afin de pouvoir assurer son rôle d'agent de sécurité et de conservation, l'Etat s'appuie sur une force matérielle, sur la violence. Dans les sociétés passées, il possède en monopole exclusif toutes les forces de violence existantes : la police, l'armée, les prisons.
Ayant son origine dans la nécessité historique de la violence, trouvant dans l'exercice de la coercition la condition de son épanouissement, l'Etat tend à devenir un facteur indépendant et supplémentaire de violence dans l'intérêt de son auto-conservation, de sa propre existence. La violence, en tant que moyen devient un but en soi, entretenu et cultivé par l'Etat, répugnant de par sa nature même à toute forme de société tendant à se passer de violence en tant que régulateur des rapports entre les hommes.
III- L'État dans la période de transition au communisme
L'existence, dans la période de transition, d'une division de la société en classes aux intérêts antagoniques fait surgir au sein de celle-ci, un Etat. Cet état a pour tâche de garantir les bases de la société transitoire à la fois contre toute tentative de restauration du pouvoir des anciennes classes exploiteuses et contre tout déchirement résultant des oppositions entre les différentes classes non exploitées qui subsistent en son sein.
L'État de la période de transition comporte un certain nombre de différences d'avec celui des sociétés antérieures :
- pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas l'Etat d'une minorité exploiteuse pour l'oppression de la majorité mais au contraire celui de la majorité des classes exploitées et non exploiteuses contre la minorité des anciennes classes dominantes déchues ;
- il n'est pas l'émanation d'une société et de rapports de production stables mais au contraire d'une société dont la caractéristique permanente est le constant bouleversement dans lequel s'opèrent les plus grandes transformations que l'histoire ait connues ;
- il ne peut s'identifier à aucune classe économiquement dominante dans la mesure où il n'existe aucune classe de ce type dans la période de transition ;
- contrairement à l'Etat des sociétés passées, celui de la société transitoire n'a plus le monopole des armes. C'est pour l'ensemble de ces raisons et de leurs implications que les marxistes ont pu parler de "demi-État" au sujet de l'organe surgissant dans la période de transition.
Par contre, cet État conserve un certain nombre de caractéristiques de ceux du passé. Il reste en particulier l'organe gardien du statu-quo, chargé de codifier, légaliser un état économique déjà existant, de le sanctionner, de lui donner force de loi dont l'acceptation est obligatoire pour tous les membres de la société. En ce sens, l'Etat reste un organe fondamentalement conservateur tendant :
- non à favoriser la transformation sociale mais s'opposer à celle-ci,
- à maintenir en vie les conditions qui le font vivre : la division de la société en classes,
- à se détacher de la société, à s'imposer à elle et perpétuer sa propre existence et ses propres privilèges,
- à lier son existence à la coercition, à la violence qu'il utilise nécessairement pendant la période de transition et à tenter de maintenir ce type de régulation des rapports sociaux.
C'est pour cela que l'Etat de la période de transition a été depuis le début considéré par les marxistes comme un "fléau", "un mal nécessaire" dont il s'agit de"limiter les effets les plus fâcheux". Pour l'ensemble de ces raisons, et contrairement à ce qui s'est produit dans le passé, la classe révolutionnaire ne peut s'identifier avec l'Etat de la période de transition.
D'une part, le prolétariat n'est pas une classe économiquement dominante. Il ne l'est ni dans la société capitaliste ni dans la société transitoire. Dans celle-ci, il ne possède aucune économie, aucune propriété même collective mais lutte pour la disparition de l'économie, de la propriété. D'autre part, le prolétariat, classe porteuse du communisme, agent du bouleversement des conditions économiques et sociales de la société transitoire, se heurte nécessairement à l'organe tendant à perpétuer ces conditions. C'est pour cela qu'on ne peut parler ni "d'Etat socialiste", ni "d'Etat ouvrier", ni "d'Etat du prolétariat" durant la période de de transition.
Cet antagonisme entre prolétariat et Etat Se manifeste tant sur le plan immédiat que sur le plan historique.
Sur le terrain immédiat, le prolétariat devra s'opposer aux empiétements et à la pression de l'Etat en tant que représentant d'une société dans laquelle subsistent des classes aux intérêts antagoniques aux siens.
Sur le terrain historique, la nécessaire extinction de l'Etat dans le Communisme, déjà mise en évidence par le marxisme, ne sera pas le résultat de sa dynamique propre mais le fruit d'une pression soutenue de la part du prolétariat qui le dépouillera progressivement de tous ses attributs au fur et à mesure de l'évolution vers la société sans classe.
Pour ces raisons, si le prolétariat doit se servir de l'Etat de la période de transition, il doit conserver sa complète indépendance à l'égard de cet organe. En ce sens, la dictature du prolétariat ne se confond pas avec l'Etat. Entre les deux, existe un rapport de forces constant que le prolétariat devra maintenir en sa faveur : la dictature du prolétariat ne s'exerce pas dans l'Etat ni à travers l'Etat mais sur l'Etat.
Moyens concrets des rapports entre dictature du prolétariat et État de la période de transition
L'expérience de la Commune d'une part, et celle de la révolution en Russie d'autre part, au cours de laquelle l'Etat a constitué l'agent majeur de la contre-révolution en Russie même, ont mis en évidence la nécessité d'un certain nombre de moyens permettant :
- de limiter les aspects "les plus fâcheux de l'Etat",
- d'assurer la pleine indépendance de la classe révolutionnaire,
- de permettre la dictature du prolétariat sur l'Etat.
a) la limitation des caractéristiques les plus néfastes de l'Etat de la société transitoire passe par :
- le fait qu'il ne se constitue pas sur une couche spécialisée, les partis politiques, mais sur la base de délégués élus par les organisations territoriales, les Conseils Locaux et révocables par elle ;
- que toute cette organisation étatique exclue catégoriquement toute participation des couches et classes exploiteuses qui sont privées de tout droit politique ;
- que la rémunération de ses membres, des fonctionnaires,ne peut jamais être supérieure à celle des ouvriers.
b) l'indépendance de la classe ouvrière se manifeste par :
- le programme,
- l'existence de ses partis de classe qui, contrairement aux partis bourgeois, ne peuvent, comme tels, ni s'intégrer à l'Etat, ni assumer de fonction étatique sous peine de dégénérer et de perdre complètement leurs fonctions spécifiques dans la classe, sa propre organisation de classe : les Conseils ouvriers, distincts de toute institution étatique, son armement propre.
Elle s'exerce contre l'Etat et les autres classes de la société :
- en ce qu'elle interdit toute intervention de leur part dans l'activité et l'organisation propre du prolétariat,
- en ce qu'elle se réserve toute possibilité,
- de défendre ses intérêts immédiats par l'utilisation de divers moyens de pression dont la grève.
c) la domination de la dictature du prolétariat sur l'Etat et l'ensemble de la société se base essentiellement :
- sur l'interdiction de toute organisation propre aux autres classes en tant que classes,
- par sa participation hégémonique au sein de l'organisation d'où émane l'Etat,
- sur le fait qu'elle s'impose comme seule classe armée.
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Communisme [101]
Période de transition - Contre-projet de résolution
- 2799 reads
-
"Il faut tenir compte de l'impossibilité d'arriver en une phase qui s'appelle de transition à des notions fixes, complètes, ne souffrant aucune contradiction logique et exempte de toute idée de transition" (Bilan)
A – La période de transition du capitalisme au communisme.
1) La succession des modes de production esclavagiste, féodal, capitaliste ne connaissait pas à proprement parler de périodes de transition. Les nouveaux rapports, sur la base desquels s'édifiait la forme sociale progressive, étaient créés à l'intérieur de l'ancienne société. Le vieux système et le nouveau coexistaient (jusqu'à ce que le second supplante le premier) et cette cohabitation était possible parce qu'entre ces diverses sociétés n'existait qu'un antagonisme de forme alors qu'elles restaient par essence des sociétés d'exploitation. La succession du communisme au capitalisme diffère fondamentalement de celles du passé. Le communisme ne peut émerger au sein du capitalisme parce qu'entre ces deux sociétés, il y a non seulement différence de forme mais également différence de contenu. Le communisme n'est plus une société d'exploitation et le mobile de la production n'est plus la satisfaction des besoins d'une minorité. Cette différence de contenu exclut la coexistence de l'un et de l'autre et crée la nécessité d'une phase transitoire au cours de laquelle les nouveaux rapports et la nouvelle société se développent à l'extérieur du capitalisme.
2) Entre la société capitaliste et la société communiste se place donc une phase de transformation révolutionnaire de celle-ci en celle-là. Cette phase transitoire est non seulement inévitable, mais encore nécessaire, pour combler l'immaturité des conditions matérielles et spirituelles léguées par le capitalisme au prolétariat (immaturité qui interdit le règne immédiat du communisme au sortir de la révolution). Cette période se caractérise par la fusion de deux processus sociaux : l'un de décroissance des rapports et catégories appartenant au système en déclin, l'autre de croissance des rapports et catégories qui relèvent du système nouveau. La spécificité de l'époque de transition réside en ceci : le prolétariat qui a conquis le pouvoir politique (par la révolution) et garanti sa domination (par la dictature) s'engage dans le bouleversement ininterrompu et systématique des rapports de production et des formes de conscience et d'organisation qui en dépendent. Pendant la phase intermédiaire, par des mesures politiques et économiques, la classe ouvrière développe les forces productives laissées en héritage par le capitalisme, en sapant les bases de l'ancien système et en dégageant les bases de nouveaux rapports sociaux fondés sur une répartition de la masse des produits (et des conditions de la production) permettant à tous les producteurs de réaliser la pleine satisfaction, la libre expansion de leurs besoins.
B – Le régime politique de la période de transition.
3) Pour le capitalisme, la substitution de son privilège au privilège féodal, l'époque des révolutions bourgeoises pouvaient s'accommoder d'une coexistence durable entre États capitalistes et États féodaux, voire même pré-féodaux, sans altérer ou supprimer les assises du nouveau système. La bourgeoisie, sur la base de positions économiques conquises graduellement n'avait pas non plus à détruire l'appareil d'État de l'ancienne classe dominante dont elle s'était progressivement emparé. Elle n'eut à supprimer ni la bureaucratie, ni la police, ni la force armée permanente, mais à subordonner ces instruments d'oppression à ses fins propres, parce que la révolution politique (qui n'était pas toujours indispensable) concrétisait une hégémonie économique et ne faisait que substituer juridiquement une forme d'exploitation à une autre. Il en va tout autrement pour le prolétariat qui, n'ayant aucune assise économique et aucun intérêt particulier, ne peut se contenter de prendre tel quel l'ancien appareil d'État. La période de transition ne peut débuter qu'après la révolution prolétarienne dont l'essence consiste en la destruction mondiale de la domination politique du capitalisme et, en premier lieu, des États bourgeois nationaux. La prise du pouvoir politique général dans la société par la classe ouvrière, l'instauration mondiale de la dictature du prolétariat précédent, conditionnent et garantissent la marche de la transformation économique et sociale.
4) Le communisme est une société sans classes et, partant, sans État. La période de transition qui ne se développe réellement qu'après le triomphe de la révolution à l'échelle internationale, est une période dynamique qui tend vers la disparition des classes, mais qui connaît encore la division en classes et la persistance d'intérêts divergents et antagoniques dans la société. Comme telle, elle fait surgir inévitablement une dictature et une forme d'État politique. Le prolétariat ne peut parer à l'insuffisance temporaire des forces productives que lui lègue le capitalisme sans recourir à la contrainte. En effet, l'époque de transition est caractérisée par la nécessité de discipliner et de réglementer l'évolution de la production, de l'orienter vers un épanouissement qui permettra l'établissement de la société communiste. Les menaces de restauration bourgeoise sont également en fonction de cette insuffisance de la production et des forces de production. La dictature et l'utilisation de l'État sont indispensables au prolétariat placé devant la nécessité de diriger 1'emploi de la violence pour extirper les privilèges de la bourgeoisie, dominer celle-ci politiquement et organiser de manière nouvelle les forces de production libérées progressivement des entraves capitalistes.
C – Conditions d’apparition et rôle de l’État dans l’histoire.
5) Dans toute société divisée en classes, afin d'empêcher que les classes aux intérêts opposés et inconciliables ne se détruisent mutuellement, et par là même consument la société, surgissent des superstructures, des institutions, dont le couronnement est l'État. L'État naît pour maintenir les conflits de classes dans des limites déterminées. Cela ne signifie nullement qu'il parvient à concilier les intérêts antagoniques sur un terrain d'entente "démocratique", ni qu'il fasse office de "médiateur" entre les classes. Comme l'État surgit du besoin de discipliner les antagonismes de classes, mais comme en même temps il surgit au milieu du conflit entre les classes, il est en général l'État de la classe la plus puissante, de celle qui s'est imposée politiquement et militairement dans le rapport de force historique, et qui, par l'intermédiaire de l'État, impose et garantit sa domination.
L'État est l'organisation spéciale d'un pouvoir (Engels), c'est l'exercice centralisé de la violence par une classe contre les autres, destinée à fournir à la société un cadre conforme aux intérêts de la classe dominante. L'État est l'organisme qui maintient la cohésion de la société, non en réalisant un soi-disant "bien commun" (parfaitement inexistant), mais en assurant l'ensemble des tâches de domination d'une classe aux divers niveaux économique, juridique, politique et idéologique. Son rôle propre est non seulement de type administratif, mais surtout de maintenir par la violence les conditions de domination de la classe dominante contre les classes dominées, pour assurer 1'extension, le développement, la conservation de rapports de production spécifiques contre les dangers de restauration ou de destruction.
6) Quelles que soient les formes que prennent la société, les classes et l'État, le rôle de celui-ci reste toujours fondamentalement : assurer la domination d'une classe sur les autres. L'État n'est donc pas "par essence une entité conservatrice". Il est révolutionnaire à certaines époques, conservateur ou contre-révolutionnaire à d'autres, parce que loin d'être un facteur autonome dans l'histoire, il est l'instrument, le prolongement, la forme d'organisation de classes sociales qui prennent naissance, mûrissent et disparaissent. L'État est étroitement lié au cycle de la classe et s'avère donc progressif ou réactionnaire selon l'action historique de la classe sur le développement des forces productives de la société (selon qu'elle concourt à favoriser ou à freiner leur développement).
Il faut se garder cependant d'une vision strictement "instrumentaliste" de l'État. Par définition arme de classe dans les conflits immédiats et de sociétés, l'État est affecté en retour par ces mêmes conflits. Loin d'être simplement tributaires de la volonté (traduction de la nécessité) d'une classe d'assurer sa domination, les appareils d'État subissent les pressions des diverses classes et des divers intérêts. Interviennent dans les déterminations d'action de l'État (et les possibilités de son évolution) aussi bien le cadre économique, le niveau du droit, que les rapports de force politiques et militaires. C'est en ce sens que l'État "n'est jamais en avance sur l'état de chose existant". En effet, si l'État permet, à certaines époques, aux classes progressives d'exercer le pouvoir politique, en vue de l'extension de rapports de production déterminés, il est contraint -à ces mêmes époques et pour poursuivre ce même but- de défendre la société nouvelle contre les menaces internes et externes, de relier les aspects épars de la production, de la distribution, de la vie sociale, culturelle, idéologique, et ce, avec des moyens (ceux qui existent et dont il peut disposer) qui ne relèvent pas toujours et forcément du programme de la classe révolutionnaire, d'une tendance de la nouvelle société en train de naître. "Ainsi, il faut considérer que la formule “l'État” est l'organe d'une classe n'est pas d'un point de vue formel, une réponse en soi aux phénomènes qui se déterminent, la pierre philosophale qui doit être recherchée au travers des faits, mais qu'elle signifie qu'entre la classe et l'État se déterminent des rapports qui dépendent de la fonction d'une classe donnée". (Bilan)
D – Nécessité des soviets comme pouvoir d’État du prolétariat.
7) L'État qui succède à l'État bourgeois est une forme nouvelle d'organisation du prolétariat, grâce à laquelle celui-ci se transforme, de classe opprimée, en classe dominante et exerce sa dictature révolutionnaire sur la société. Les Soviets territoriaux (des ouvriers, des paysans pauvres, des soldats...) en tant que puissance étatique du prolétariat signifient :
-
la tentative par le prolétariat en tant que seule classe porteuse du communisme, de lutter pour l'organisation de l'ensemble des classes et couches exploitées ;
-
la continuation à l'aide du système soviétique, de la lutte de classe contre la bourgeoisie qui reste encore la classe la plus puissante même au début de la dictature du prolétariat, même après son expropriation et sa subordination politique.
Le prolétariat a encore besoin d'un appareil d'État, aussi bien pour réprimer la résistance désespérée de la bourgeoisie que pour diriger la grande masse de la population dans la lutte contre la classe capitaliste et la mise en place du communisme. Cette situation n'a nullement besoin d'être idéalisée : "L'État n'étant qu'une, institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour organiser la répression par la force contre ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d'un État populaire libre ; tant que le prolétariat fait encore usage de l'État, ce n'est point dans l'intérêt de la liberté, mais pour réprimer ses adversaires". (Engels)
8) Produit de la division en classes de la société, de la nature inconciliable des antagonismes de classes, la dictature du prolétariat se distingue cependant (et avec elle son État) du pouvoir des classes dominantes dans le passé par les caractéristiques suivantes :
-
le prolétariat n'exerce pas sa dictature en vue de bâtir une nouvelle société d'oppression et d'exploitation. Par conséquent, il n'a nullement besoin, comme les anciennes classes dominantes, de cacher ses buts, de mystifier les autres classes en présentant sa dictature comme le règne de "la liberté, de l'égalité, de la fraternité". Le prolétariat affirme hautement que sa dictature est une dictature de classe ;
-
que les organes de son pouvoir politique sont des organismes qui servent, par leur action, le programme prolétarien, à l'exclusion du programme et des intérêts de toutes les autres classes.
C'est ainsi que Marx, Engels, Lénine, la Fraction parlaient -pouvaient et devaient parler- non d'un État "de la majorité des classes exploitées et non-exploiteuses" (l'encadrement des formations intermédiaires dans l'État n'étant pas synonyme de partage du pouvoir), non d'un État "a-classiste" ou "multiclassiste" (notions idéologiques et aberrantes par définition), mais d'un État prolétarien, d'un État de la classe ouvrière, ce dernier étant l'une des formes indispensables de la dictature du prolétariat.
La domination de la majorité, organisée et dirigée par le prolétariat sur la minorité dépossédée de ses prérogatives, rend inutile le maintien d'une machine bureaucratique et militaire, à laquelle le prolétariat substitue, et son propre armement -pour briser toute résistance bourgeoise- et une forme politique lui permettant d'accéder progressivement (et par devers lui l'ensemble de l'humanité) à la gestion sociale. Il supprime tous les privilèges inhérents au fonctionnement des anciens États (nivellement des traitements, contrôle rigoureux des fonctionnaires : électivité complète et révocabilité à tous moments) ainsi que la séparation réalisée par le parlementarisme entre organismes législatifs et exécutifs. Dès sa formation, l'État de la dictature du prolétariat cesse de la sorte d'être un "État" au vieux sens du terme. A l'État bourgeois se substituent les Soviets, un demi-État, un État-Commune ; l'organe de domination de l'ancienne classe est remplacé par des institutions de principe essentiellement différent.
E – Dépérissement ou renforcement de l’État.
9) Tenant compte des considérations que nous avons évoquées quant aux conditions et à l'ambiance historiques dans lesquelles naît l'État prolétarien, il est évident que le dépérissement de celui-ci ne peut se concevoir que comme le signe du développement de la révolution mondiale et, plus profondément, de la transformation économique et sociale. Dans des conditions de combat défavorables (sur le triple plan politique, militaire, économique), l'État ouvrier peut se trouver contraint de se renforcer, à la fois pour empêcher la désagrégation de la société et pour assurer les tâches de défense de la dictature prolétarienne érigée dans un ou plusieurs pays. Cette obligation réagit à son tour sur sa nature même : l'État acquiert un caractère contradictoire : instrument de classe, il est cependant forcé de répartir les biens -les conditions de la production- et les responsabilités sociales selon des normes qui ne relèvent pas toujours et forcément d'une tendance immédiate vers le communisme. En cohérence avec la conception développée par Lénine, Trotsky, et surtout par Bilan, nous devons donc admettre -au-delà de préoccupations métaphysiques- que l'État ouvrier, bien qu'assurant la domination du prolétariat sur la bourgeoisie, exprime toujours l'impuissance temporaire à supprimer le droit bourgeois. Ce dernier continue à exister, non seulement dans le déroulement économique et social mais dans le cerveau de millions de prolétaires, de milliards d'individus. L'État menace continuellement, même après la victoire politique du prolétariat, de donner vie à des stratifications sociales s’opposant sans cesse davantage à la mission libératrice de la classe ouvrière. Aussi, a certaines époques, "si l'État, au lieu de dépérir, devient de plus en plus despotique, si les mandataires de la classe ouvrière se bureaucratisent, tandis que la bureaucratie s'érige au-dessus de la société, ce n'est pas seulement pour des raisons secondaires, telles que les survivances idéologiques du passé, etc., c'est en vertu de l'inflexible nécessité de former et d'entretenir une minorité privilégiée, tant qu'il n'est pas possible d'assurer l'égalité réelle". (Trotsky). Jusqu'à la disparition de l'État, jusqu'à sa résorption dans une société s'administrant elle-même, celui-ci continue à receler cet aspect négatif : instrument nécessaire de 1'évolution historique, il menace constamment de diriger cette évolution non à l'avantage des producteurs, mais contre eux et vers leur massacre.
F – Le prolétariat et l’État
10) La physionomie spécifique de l'État ouvrier se dévoile en ceci :
-
d'une part, comme arme dirigée contre la classe expropriée, il révèle son côté "fort" ;
-
d'autre part, comme organisme appelé non pas à consolider un nouveau système d'exploitation mais à les abolir tous, il découvre son côté "faible" (parce que dans des conditions défavorables, il tend à devenir le pôle d'attraction des privilèges capitalistes). C'est pourquoi, alors qu'entre la bourgeoisie et l'État bourgeois, il ne pouvait y avoir d'antagonismes, il peut en surgir entre le prolétariat et 1' État transitoire. Avec la fondation de l'État prolétarien, le rapport historique entre la classe dominante et l'État se trouve modifié.
Il faut considérer que :
a) la conquête de la dictature du prolétariat, l'existence de l'État ouvrier sont des conditions nouvelles à l’avantage du prolétariat mondial, non une garantie irrévocable contre toute entreprise de dégénérescence ;
b) si l'État est ouvrier, cela ne signifie nullement qu'il n'y ait aucun besoin ou possibilité pour le prolétariat d'entrer en conflit avec lui, de telle sorte qu'il ne faille tolérer aucune opposition à la politique étatique ;
c) à l'inverse des États du passé, l'État prolétarien ne peut synthétiser, concentrer dans ses appareils, tous les aspects de la dictature. L'État ouvrier se différencie profondément de l'organisme unitaire de classe et de l'organisation qui regroupe l'avant-garde du prolétariat, cette différenciation s'opérant parce que l'État, malgré l'apparence de sa plus grande puissance matérielle, possède, au point de vue politique de moindres possibilités d'action. Il est mille fois plus vulnérable par l'ennemi que les autres organismes ouvriers. Le prolétariat ne peut compenser cette faiblesse que par la politique de classe de son Parti et de Conseils Ouvriers, au moyen desquels il exerce un contrôle indispensable sur l'activité étatique, développera sa conscience de classe et préservera la défense de ses intérêts. La présence agissante de ces organismes est la condition pour que l'État reste prolétarien. Le fondement de la dictature réside non seulement dans le fait que nulle inter diction ne s'oppose au fonctionnement des Conseils Ouvriers et du Parti (proscription de la violence au sein du prolétariat, permanence du droit de grève, autonomie des Conseils et du Parti, liberté de tendance dans ces organes), mais aussi que les moyens leur soient octroyés pour résister à une métamorphose éventuelle de l'État, non vers le dépérissement, mais vers le triomphe de son despotisme.
G – Sur la dictature et les tâches de l’État ouvrier
12) Le rôle du capitalisme, son but, suffisaient à indiquer le rôle de ses différentes formes d'État : maintenir l'oppression au profit de la bourgeoisie. Pour ce qui est du prolétariat, c'est encore une fois, le rôle et le but de la
classe ouvrière qui détermineront le rôle et le but de l'État prolétarien. Mais ici, le critère de la politique menée par l'État n'est plus un élément indifférent pour déterminer son rôle (comme c'était le cas pour la bourgeoisie et pour toutes les classes précédentes), mais un élément d'ordre capital dont va dépendre sa fonction d'appui à la révolution mondiale, et, en définitive, la conservation de son caractère prolétarien.
13) Une politique prolétarienne dirigera l'évolution économique vers le communisme seulement si celle-ci reçoit une orientation diamétralement opposée à celle du capitalisme, si donc elle se dirige vers une élévation progressive et constante des conditions de vie des masses et non vers leur abaissement. Dans la mesure où le permet le contexte politique, le prolétariat doit agir dans le sens d'une diminution constante du travail non payé, ce qui amené inévitablement comme conséquence un rythme de l'accumulation suivant un cours extrêmement ralenti par rapport à celui de l'économie capitaliste. Toute autre politique entraînerait inéluctablement la conversion de l'Etat prolétarien en un nouvel Etat bourgeois à l'image de ce qui s'est passé en Russie.
14) En aucun cas, l'accumulation ne peut se baser sur la nécessité de l'accumulation pour battre la puissance économique et militaire des Etats capitalistes. La révolution mondiale ne peut résulter que de la capacité du prolétariat de chaque pays à s'acquitter de sa mission, de la maturation mondiale des conditions politiques pour l'insurrection. La classe ouvrière ne peut reprendre à la bourgeoisie sa vision de la "guerre révolutionnaire". Dans la période de guerre civile, le contraste ne passe pas entre État(s) prolétarien(s) et Etats capitalistes, mais entre prolétariat mondial et bourgeoisie mondiale. Dans l'activité de l'Etat prolétarien, les domaines économiques et militaires sont forcément d'ordre secondaire.
15) L'État transitoire est essentiellement un instrument de domination politique qui ne peut suppléer à la lutte de classe internationale. L'État ouvrier doit être considéré comme un outil de la révolution mondiale et au grand jamais comme le pôle de concentration de cette dernière. Si le prolétariat obéissait au second des deux critères, il serait forcé de passer à des compromis avec les classes ennemies alors que les nécessités révolutionnaires réclament impérieusement une lutte sans merci contre toutes les formations anti-prolétariennes même au risque d'aggraver la désorganisation économique résultant de la révolution. Toute autre perspective qui partirait de soucis soi-disant "réalistes" ou d'une prétendue "loi du développement inégal" ne pourrait que vicier les fondements de l'État prolétarien et conduire à sa transformation en État bourgeois sous le couvert fallacieux du "socialisme en un seul pays".
16) La dictature du prolétariat doit veiller à ce que les formes et les procédés de contrôle des masses soient multiples et variés afin de parer à toute ombre de dégénérescence et de déformation du pouvoir des Soviets, dans le but également d'arracher sans cesse "l'ivraie bureaucratique", excroissance qui accompagne inévitablement la période transitoire. La sauvegarde de la révolution est conditionnée par l'activité consciente des masses ouvrières. La véritable tâche politique du prolétariat consiste à élever sa propre conscience de classe comme à transformer la conscience de l'ensemble des couches travailleuses, tâche à côté de laquelle l'exercice de la contrainte se manifestant au travers des organismes administratifs et policiers de l'État ouvrier est secondaire (et le prolétariat doit veiller à en limiter les plus fâcheux effets). Le prolétariat ne doit pas perdre de vue ceci : que "tant qu'il fait encore usage de l'État, il ne le fait pas dans l'intérêt de la liberté, mais pour avoir raison de son adversaire".
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Communisme [101]
DEBAT : L’État et la dictature du prolétariat
- 2674 reads
Présentation
Avant l'expérience de la Révolution en Russie, les marxistes avaient une conception du rapport entre le prolétariat et l’État au cours de la période de transition du capitalisme au communisme, qui était relativement simple dans son essence.
On savait que cette transition devrait commencer par la destruction du pouvoir politique de la bourgeoisie et que cette phase ne faisait que précéder, en la préparant, la société communiste qui ne connaîtrait, elle, ni classes, ni pouvoir politique, ni État. On savait qu'au cours de ce mouvement la classe ouvrière devrait instaurer sur le reste de la société sa dictature. On savait aussi qu'au cours de cette période qui porte encore tous les stigmates du capitalisme, en particulier par la subsistance de la pénurie matérielle et des divisions de la société en classes, il subsisterait inévitablement un appareil de type étatique ; on savait enfin, surtout grâce à l'expérience de la Commune de Paris en 1871, que cet appareil ne pourrait pas être l' État bourgeois "conquis" par les ouvriers, mais qu'il serait dans ses formes et dans son contenu une institution transitoire essentiellement différente de tous les États ayant existé jusqu'alors. Mais, en ce qui concerne le problème du rapport entre la dictature du prolétariat et cet État, entre la classe ouvrière et cette institution produit des héritages du passé, on croyait pouvoir résoudre la question par une idée simple : dictature du prolétariat et État de la période de transition sont une et même chose, classe ouvrière armée et État sont identiques. En quelque sorte, au cours de la période de sa dictature, le prolétariat, croyait-on, pourrait reprendre à son compte la célèbre formule de Louis XIV : "L'État c'est moi".
Ainsi, dans le Manifeste Communiste, cet État est décrit comme "Le prolétariat organisé en classe dominante" ; de même, dans la Critique du Programme de Gotha, Marx écrivait :
-
"Entre la société capitaliste et la société communiste se situe la période de transformation révolutionnaire de l'une en l'autre. A cette période correspond également une phase de transition politique où l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat".
Plus tard, à la veille d'Octobre 17, Lénine, en plein combat contre la Social-démocratie qui se vautrait dans le bourbier du premier massacre mondial en participant aux gouvernements des États bourgeois belligérants, reprenait avec force cette idée dans l' État et la Révolution :
-
"... (les marxistes) proclament la nécessité pour le prolétariat, après qu'il aura conquis le pouvoir politique, de détruire entièrement la vieille machine d'État et de la remplacer par une nouvelle, qui consiste dans l'organisation des ouvriers armés ..." ;
ou encore :
-
"La Révolution consiste en ceci : le prolétariat détruit l'"appareil administratif" et l'appareil d’État tout entier pour le remplacer par un nouveau, qui est constitué par les ouvriers armés".
Il découlait tout naturellement de cette vision que l’État de la Période de Transition ne pour rait être autre chose que l'expression la plus achevée, la plus efficace de la classe ouvrière et de son pouvoir. Tout paraissait assez simple dans le rapport entre État et prolétariat puisqu'ils devaient être une seule et même chose. La bureaucratie étatique ? Elle n'existe rait pas ou constituerait un problème sans importance majeure puisque les ouvriers eux-mêmes (même une cuisinière, disait Lénine) assumeraient sa fonction. Envisager sérieusement la possibilité d'un antagonisme, d'une opposition entre classe ouvrière et État sur le terrain économique ? Impossible ! Comment le prolétariat pourrait-il faire grève contre l’État puisque l’État ce serait lui ? Comment l’État pourrait-il, de son côté, chercher à imposer quoi que ce soit de contraire aux intérêts économiques de la classe ouvrière puisqu'il en serait l'émanation directe ? Envisager un antagonisme sur le terrain politique semblait encore plus invraisemblable : l’État ne devait-il pas être l'instrument le plus achevé de la dictature du prolétariat ? Comment pourrait-il exprimer des forces contre-révolutionnaires puisqu'il devait être par définition le fer de lance du combat du prolétariat contre la contre-révolution ?
La Révolution Russe apporta un démenti cinglant à cette vision trop simple, mais qui prédominait inévitablement dans le mouvement ouvrier international qui, à l'exception de l'expérience des deux mois de la Commune de Paris, ne s'était jamais affronté réellement aux problèmes de la Période de Transition dans toute leur complexité.
Ainsi, au lendemain de la prise du pouvoir d'Octobre 17, l'on proclama l'État, "État Prolétarien" ; les meilleurs des ouvriers, les combattants les plus expérimentés furent placés à la tête des principaux organes de l' État ; on interdit les grèves ; on se promit d'accepter toute décision des organes de l'État comme expression des nécessités globales du combat révolutionnaire ; bref, on inscrivit dans les lois et dans la chair de la révolution naissante l'identité tant proclamée entre État et classe ouvrière.
Mais, dès les premiers moments, les impératifs de la subsistance sociale entreprirent de contredire systématiquement le fondé d'une telle identification. Devant les difficultés auxquelles devait faire face la Révolution Russe étouffée progressivement par son isolement international, l'appareil de l'État s'avéra constituer non pas un corps identique aux "ouvriers armés", ni l'incarnation la plus globale de la dictature du prolétariat, mais au contraire un corps de fonctionnaires bien distinct du prolétariat et une force dont les tendances innées n'étaient pas à la révolution communiste, mais au contraire au conservatisme. La bureaucratisation des fonctionnaires chargés de l'organisation de la production, la distribution, le maintien de l'ordre, etc., se développa dès les premiers mois sans que personne, ni même les premiers responsables du Parti Bolchevik à la tête de l'État -qui ne manquèrent pourtant pas de la combattre- n'y puissent rien, et surtout, sans que l'on pût reconnaître dans cette bureaucratie étatique une force contre-révolutionnaire, puisqu'elle était "l'État Prolétarien".
Sur le terrain économique comme sur le terrain politique, un fossé se creusa progressivement entre la classe ouvrière et ce qui était supposé être "son" État. Dès la fin de 1917, des grèves économiques éclataient à Petrograd ; dès 1919, des courants communistes de gauche ouvriers dénonçaient la bureaucratie étatique et son opposition aux intérêts de la classe ouvrière ; en 1920-21, à la fin de la guerre civile, ces antagonismes explosaient ouvertement dans les grèves de Petrograd de 1920 et l'insurrection de Kronstadt de 1921 réprimée par l'Armée Rouge. Bref, dans le combat pour le maintien de son pouvoir, le prolétariat en Russie ne trouve pas dans l'État l'instrument auquel il s'attendait, mais au contraire une force de résistance qui bientôt se transforma en principal protagoniste de la contre-révolution.
La défaite de la Révolution Russe fut certes, en dernière instance, le produit de la défaite de la révolution mondiale et non de l'action de l’État. Mais dans ce combat contre la contre-révolution, l'expérience mit en évidence que l'appareil d’État et sa bureaucratie n'étaient ni le prolétariat, ni même le fer de lance de sa dictature, encore moins une institution à laquelle la classe révolutionnaire en armes devrait se soumettre au nom d'une soi-disant "nature prolétarienne".
Il est vrai que l'expérience du prolétariat en Russie était condamnée à l'échec du moment qu’elle n'était pas parvenue à s'étendre mondialement. Il est certain que la puissance de l'antagonisme État-prolétariat fut une manifestation de la faiblesse du prolétariat mondial et de l'inexistence des conditions matérielles pour un véritable épanouissement de la dictature du prolétariat. Mais ce serait se bercer à nouveau d'illusions que de croire que seule l'ampleur de ces difficultés expliquent cet antagonisme, et que, dans des conditions meilleures, l'identification dictature du prolétariat-État de la Période de Transition resterait valable. La Période de Transition est une phase où le prolétariat affronte une difficulté fondamentale : celle d'établir de nouveaux rapports sociaux alors que par définition, les conditions matérielles de leur épanouissement ne font alors que s'instaurer sous l'action révolutionnaire des ouvriers en armes. Cette difficulté s'est développée en Russie sous ses formes les plus extrêmes, mais elle n'en était pas moins dans son essence la même que le prolétariat retrouvera demain. L'importance des entraves rencontrées par la dictature du prolétariat en Russie ne fait pas de cette expérience une exception qui infirmerait la règle de l'identité Prolétariat-État de la Période de Transition, mais au contraire un facteur qui a permis de mettre en lumière, sous ses formes les plus aiguës, l'inévitabilité et la nature de l'antagonisme qui oppose la force révolutionnaire prolétarienne et l'institution du maintien de l'ordre pendant la Période de Transition.
Depuis sa constitution, le CCI, à la suite des travaux de la Gauche Italienne (Bilan) pendant l'entre-deux-guerres et ceux du groupe Internationalisme, dans les années 40, a entrepris la complexe et indispensable tâche de reprendre, revoir et compléter la compréhension révolutionnaire du rapport entre État et Prolétariat au cours de la Période de Transition à la lumière de l'expérience russe (voir n°s 1, 3 et 6 de la Revue Internationale).
Dans le cadre de cet effort, nous publions ici, d'une part, la lettre d'un camarade qui réagit critiquement aux thèses développées à ce sujet dans la Résolution adoptée par le IIème Congrès de Révolution Internationale, section en France du C.C.I. (voir Revue Internationale n° 6) et d'autre part, une réponse à cette critique.
CCIConscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
DEBAT : Lettre de E.
- 2583 reads
Le marxisme, dans la mesure où il est une connaissance scientifique de la succession des modes et des formes sociales de la production dans le passé, est aussi la prévision des étapes et des caractéristiques fondamentales et indissociables de la succession de l'ultime forme sociale, le communisme à partir de celle où nous vivons. Les formes économiques se transforment selon un processus ininterrompu dans l'histoire de la société humaine. Mais ce processus se traduit sous la forme de périodes de convulsions, de luttes pendant lesquelles l'affrontement politique et armé des classes brise les entraves qui empêchent l'accouchement et le développement accéléré de la nouvelle forme, c'est la période de la lutte pour le pouvoir, dont l'aboutissement est une dictature de la force de demain sur celle d'hier (ou l'inverse jusqu'à une nouvelle crise). Le révisionnisme socialiste de l'avant-dernière guerre avait prétendu effacer la théorie de Marx et d'Engels sur la dictature, et c'est à Lénine que revient le mérite de l'avoir remise sur ses pieds, dans "L'État et la Révolution", où, restaurant complètement le marxisme, il pousse à son terme le devoir théorique de destruction de l'État bourgeois. Lénine, en accord parfait avec la doctrine marxiste, pose ainsi le cadre permettant de distinguer les phases successives de la transition du capitalisme au communisme.
Stade intermédiaire
Le prolétariat a conquis le pouvoir politique et comme toutes les autres classes dans le passé impose sa propre dictature. Ne pouvant abolir d'un seul coup les autres classes, le prolétariat les met hors-la-loi. Ce qui veut dire que l'État prolétarien contrôle une économie, qui dans un secteur toujours plus restreint, non seulement comporte une distribution marchande, mais aussi des formes d'appropriation privée de ses produits et de ses moyens de production, tant individuels qu'associés ; en même temps, par ses interventions despotiques, il ouvre la voie qui mène au stade inférieur du communisme. Comme on voit, contrairement aux assertions de R. sur une prétendue complexité de la conception de l'État et de son rôle chez Lénine, l'essence de celle-ci est très simple : le prolétariat s'érigeant en classe dominante crée son propre organe d'État différent des précédents par la forme, mais gardant par essence la même fonction : oppression des autres classes, violence concentrée contre elles pour le triomphe de ses intérêts historiques comme classe dominante même si ceux-ci coïncident à long terme avec ceux de l'humanité.
Communisme inférieur
Dans cette phase, la société a déjà la disposition des produits en général et en fait la répartition à ses membres, selon un plan de contingentement. Pour une telle tache, il n'y a plus besoin d'échange marchand ni de monnaie : la distribution s'effectue centralement sans échange d'équivalents. A un tel stade, il y a non seulement obligation au travail, mais comptabilisation du temps de travail "effectué" et un certificat qui en atteste : les fameux bons de travail tant discutés, qui ont la caractéristique de ne pouvoir être accumulés, de telle sorte que toute tentative d'accumulation se fasse en pure perte, avec une quote-part de travail ne recevant aucun équivalent. La loi de la valeur est détruite parce que la société "n'accorde aucune valeur aux produits" (Engels). A ce second stade, succède le communisme supérieur, sur lequel nous ne nous attarderons pas.
Comme nous l'avons vu, le marxisme met au début de la phase de transition et comme prémisse nécessaire, la révolution politique violente dont l'issue est l'inévitable dictature de classe. Ce sera par l'exercice de cette dictature qu'avec des interventions despotiques et soutenues par le monopole de la force année que le prolétariat actualisera les profondes "réformes" qui détruiront jusqu'au dernier vestige de la forme capitaliste.
Jusqu'ici, il me semble qu'il n'y a aucune divergence. Les difficultés commencent quand on affirme que "L'État a une nature historique anti-communiste et anti-prolétarienne" et "essentiellement conservatrice" et que donc sa dictature (celle du prolétariat) ne "peut trouver dans une institution conservatrice par excellence sa propre expression authentique et totale". Ici l'anarchisme (pardonnez-moi la brutalité des mots) chassé par la porte rentre par la fenêtre. En fait, on accepte la dictature du prolétariat, mais on oublie qu'État et dictature ou pouvoir exclusif d'une classe sont synonymes.
Avant de critiquer plus spécifiquement quelques affirmations contenues dans le texte pris en exemple, Je veux rappeler les lignes fondamentales de la théorie marxiste de l'État. Chaque État se définit, dans Engels, par un territoire précis et par la nature de la classe dominante, il se définit donc par un lieu, la capitale où se réunit le gouvernement, qui pour le marxisme est le "comité d'administration des intérêts de la classe dominante". Dans la phase du pouvoir féodal au pouvoir bourgeois, se forme la théorie politique -typique de la mystification bourgeoise- qui dans toutes les révolutions historiques a dissimulé le caractère du passage du féodalisme au capitalisme. La bourgeoisie dans sa conscience mystifiée affirme détruire le pouvoir d'une classe non pour y substituer celui d'une autre, mais pour construire un État qui fonde son propre pouvoir sur l'accord et l'harmonisation des exigences de "tout un peuple". Mais dans toutes les révolutions, une série de faits mirent en lumière la robustesse de la dynamique révolutionnaire marxiste fondée sur les classes, la dictature de l'une s'accompagnant de l'a violation de la liberté des autres, et de violence exacerbées contre leurs partis, jusqu'à la terreur, fait aussi inséparable des révolutions purement bourgeoises.
Un des premiers actes à accomplir est la démolition du vieil appareil d'État que la classe arrivée au pouvoir doit entreprendre sans hésitation. Les leçons, déjà tirées par Marx de la Commune de Paris, qui, s'installant à l'Hôtel de Ville, opposa l'État à l'État armé, étouffa dans la terreur (avant d'être étouffée à son tour) même les individus de la classe ennemie, sont celles-là. Et "s'il y eut une faute, ce ne fut pas celle d'avoir été trop féroce mais de ne pas l'avoir été assez".
De cette importante expérience du prolétariat, Marx tira l'enseignement fondamental auquel nous ne pouvons renoncer, que les classes exploiteuses ont besoin de la domination politique pour le maintien de l'exploitation et que le prolétariat en a besoin pour la supprimer complètement. La destruction de la bourgeoisie n'est réalisable qu'à travers la transformation du prolétariat en classe dominante. Cela veut dire que l'émancipation de la classe travailleuse est impossible dans les limites de l'État bourgeois. Celui-ci doit être défait dans la guerre civile et son mécanisme démoli. Après la victoire révolutionnaire, il faut que surgisse une autre forme historique pendant laquelle surgit la société socialiste et s'éteint l'État.
Après cette brève réaffirmation de ce que sont pour moi les piliers de la doctrine marxiste de l'État et du passage d'un système social à un autre, et plus spécifiquement du capitalisme au communisme, je vais m'arrêter sur le texte de la résolution relative à la période de transition. Ce qui saute aux yeux dans un tel document est avant tout le caractère contradictoire de certaines affirmations.
Si, d'un côté on affirme "que la prise du pouvoir politique général. dans la société par le prolétariat précède, conditionne et garantit la poursuite de la transformation économique et sociale", on ne se rend pas compte que prendre le pouvoir politique général, signifie instaurer une dictature sur les autres classes et que l'État est et fut toujours l'organe(différent dans ses caractéristiques : fonctionnement, division des pouvoirs, représentation, selon le mode de production et les classes dont il représentait la domination) de la dictature d'une classe sur les autres.
En outre, quand on affirme que "toute cette organisation exclut catégoriquement toute participation des classes et couches sociales exploiteuses qui pont privées de tout, droit politique et civique", on ne se rend pas compte que toutes les justes caractéristiques de cet État exprimées dans d'autres points du même paragraphe et surtout celle déjà citée de la représentation politique d'une seule classe, ne sont pas de simples différences formelles mais détruisent toutes les assertions qui servent à identifier l'État de la bourgeoisie et de ce fait donnent une base à l'identité tant combattue entre État et dictature du prolétariat.
Mais sur quelles bases arrive-t-on à affirmer la nécessité absolue pour le prolétariat de ne pas identifier sa propre dictature et l'État de la période de transition ? Avant tout parce qu'on affirme que l'État est une institution conservatrice par excellence. On rejoint par là l'anti-historicisme de l'anarchisme et ses oppositions de principe à l'État. Les anarchistes tirent leur conviction de la nécessité de l'affranchissement de sa seigneurie "l'Autorité". R.I. ne va pas jusque là, évidemment, mais exactement comme les anarchistes, juge l'État conservateur et réactionnaire dans toute époque sociale, n'importe quelle aire géographique, quelle que soit la direction vers laquelle il s'oriente, et donc quelle que soit la domination de classe dont il est l'expression, indépendamment de la période historique au cours de laquelle cette domination s'exerce.
Rien de tel pour le marxisme. Pour le marxisme, l'État est avant tout une institution différente selon les époques historiques, tant par ses caractéristiques formelles que par ses fonctions propres. En fait, le matérialisme du marxisme nous enseigne, si on se réfère à l'histoire, que dans le passé et les phases révolutionnaires, à peine une classe a-t-elle conquis le pouvoir qu'elle stabilise le type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite de ses intérêts de classe. L'État assumait alors la fonction révolutionnaire qu'avait la classe -alors révolutionnaire- qui l'avait institué. C'est à dire : faciliter par ses interventions despotiques -après avoir brisé par la terreur la résistance des anciennes classes- le développement des forces productives, en balayant les obstacles qui barrent ce chemin, en stabilisant et en imposant par le monopole des forces armées un cadre de lois et rapports de production qui favorisent ce développement et répondent aux intérêts de la nouvelle classe ou pouvoir. Par exemple, pour n'en citer qu'un, l'État français de 1793 assuma une fonction éminemment révolutionnaire.
Une autre raison est exprimée au même paragraphe du point C : "l'État de la période de transition porte encore tous les stigmates d'une société divisée en classes". C'est une bien étrange raison, puisque tout ce qui sort de la société capitaliste en porte les stigmates. Donc, pas seulement l'État, mais aussi le prolétariat organisé dans les soviets, puisqu'il a grandi et a été éduqué sous l'influence pesante de l'idéologie conservatrice du système capitaliste. Seul, le parti, même s'il ne constitue pas un îlot de communisme au sein du capitalisme, est moins marqué par ces stigmates puisqu'en lui se fondent "volonté et conscience qui deviennent prémisses de l'action, comme résultat d'une élaboration générale historique" (Bordiga). (Ces affirmations peuvent sembler sommaires mais je les éclaircirai par la suite) (* [103]).
Pour conclure, je veux n'arrêter sur la profonde contradiction à laquelle votre vision mène. Vous affirmez en fait :"sa domination (du prolétariat) sur la société est aussi dominante sur l'État et il ne peut l'assurer qu'à travers sa dictature de classe". Je veux répondre avec les paroles classiques de Lénine qui, dans"l'État et la Révolution" souligne encore une fois l'essence de la doctrine marxiste de l'État : 'L' essence de la doctrine de l'État de Marx peut être comprise en profondeur seulement par celui qui comprend que la dictature d'une seul la classe est nécessaire, non seulement pour toutes sociétés de classes en général, non seulement pour le prolétariat après avoir abattu la bourgeoisie mais pour toute la période historique qui sépare le capitalisme de "la société sans classes", du communisme. Les formes de l'État bourgeois sont extraordinairement variées, mais leur substance est unique : tour car. État cent, d'une façon ou d'une autre, et en dernière instance, nécessairement une dictature de la bourgeoisie. Le passage au communisme ne peut naturellement pas produire une énorme abondance et diversité de formes politiques mais sa substance est nécessairement une: la dictature du prolétariat".
Donc, du point de vue marxiste, l'État se définit comme un organe (différent dans la forme et les structures selon les époques historiques, les sociétés de classes et la direction de classe dans laquelle il travaille) au moyen duquel s'exerce la dictature du prolétariat, disposant du monopole de la force armée.
C'est donc un non sens de parler d'un État qui soit soumis à une dictature qui lui est extérieure et qui ne peut alors intervenir despotiquement dans la réalité économique, et sociale pour l'orienter vers une certaine direction de classe.
E.* [104] Dans un prochain numéro de la REVUE INTERNATIONALE, nous publierons la seconde partie de cette lettre, avec notre réponse, sur la question du parti.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
DEBAT : Réponse à E.
- 2506 reads
Deux idées sous-tendent essentiellement la
critique formulée par le camarade E. : la première consiste dans le rejet de
l'affirmation que "l'État est une institution conservatrice par
excellence" ; la seconde, dans la réaffirmation de l'identité État et
dictature du prolétariat au cours de la période de transition, car l'État est
toujours l'État de la classe dominante. Voyons donc de plus près le contenu de
ces deux arguments.
E. écrit : ..."on affirme (dans la résolution de R.I.) que l'État est une institution conservatrice par excellence. On rejoint là l'anti-historicisme de l'anarchisme et ses oppositions de principe à l'État. Les anarchistes tirent leurs convictions de la nécessité de l'affranchissement de sa seigneurie "l'autorité".
R.I. ne va pas jusque là, évidemment, mais exactement corme les anarchistes, juge l'État conservateur et réactionnaire dans toute époque sociale, n'importe quelle aire géographique, cruelle que soit la direction vers laquelle il s'oriente et donc quelle que soit la domination de classe dont il est l'expression, indépendamment de la période historique au cours de laquelle cette domination s'exerce."
Avant de voir pourquoi l'État est effectivement "une institution conservatrice par excellence", répondons à cet argument polémique qui consiste à assimiler notre position à celle des anarchistes.
Notre conception relèverait de l'"anti-historicisme anarchiste" parce qu'elle dégage une caractéristique de l'institution étatique (son caractère conservateur) indépendamment de "l'aire géographique", de la "domination de classe dont il est l'expression" et "de la période historique au cours de laquelle cette domination s'exerce". Mais en quoi dégager les caractéristiques générales d'une institution ou d'un phénomène au travers de l'histoire, indépendamment des formes spécifiques que celle-ci peut connaître suivant la période, relèverait-il d'une conception "a-historique" ? Qu'est ce donc que savoir se servir de l'histoire pour comprendre la réalité ni ce n'est d'abord et avant tout savoir dégager les lois générales qui se vérifient au travers de différentes périodes et conditions spécifiques. Le marxisme est-il "a-historique" lorsqu'il dit que depuis que la société est divisée en classes "la lutte de classes est le moteur de l'histoire" quelle que soit la période historique et quelles que soient les classes ?
On peut mettre en avant la nécessité de distinguer dans chaque État de l'histoire (État féodal, État bourgeois, État de la période de transition, etc.) ce qui lui est particulier, spécifique. Mais comment pourrait-on saisir ces particularités sans savoir par rapport à quelles généralités elles se définissent? Le fait de dégager les caractéristiques générales d'un phénomène au cours de l'histoire, à travers toutes les tonnes particulières aussi différentes soient-elles qu'il ait pu prendre suivant les périodes, est non seulement le fondement même d'une analyse historique mais aussi la condition première pour pouvoir comprendre en quoi consistent les spécificités de chaque expression particulière du phénomène.
Du point de vue marxiste, on peut être tenté de mettre en question la véracité de la loi générale que nous dégageons sur la nature conservatrice de l'État, mais en aucun cas s'attaquer au fait en soi de vouloir reconnaître la caractéristique historique générale d'une institution. Autrement, c'est nier la possibilité de toute analyse historique.
Il nous est ensuite dit que notre position relève encore de l'anarchiste par le fait qu'elle constituerait "une opposition de principe à l'État". Rappelons en quoi consiste cette opposition de principe des anarchistes à l'État : rejetant l'analyse de l'histoire en termes de classe et le déterminisme économique, les anarchistes n'ont jamais compris l'État comme le produit des besoins d'une société divisée en classes, mais comme un mal en soi qui, avec la religion et l'autoritarisme, serait à la base de tous les maux de la société ("je suis contre l'État parce que l'État est maudit", disait Louise Michel). Pour les mêmes raisons ils considèrent qu'entre le capitalisme et le communisme, il n'y a aucun besoin d'une période ce transition et encore moins d'État : l'État ouvra et devra être "aboli","interdit" par décret au lendemain même de l'Insurrection générale.
Qu'y a-t-il de commun entre cette vision et celle qui affirme que l'État, produit de la division de la société en classes, à une essence conservatrice car il a pour fonction de réfréner et de maintenir ce conflit dans l'ordre et la stabilité sociale ? Si nous soulignons le caractère conservateur de cette institution ce n'est pas pour préconiser une indifférence "apolitique" du prolétariat à son égard, ou pour colporter des illusions sur la possibilité de faire disparaître l'institution étatique par quelque interdiction que ce soit tant que la division de la société en classes subsistera, mais pour mettre en lumière pourquoi le prolétariat, loin de se soumettre inconditionnellement à l'autorité de cet État au cours de la période de transition -comme le préconise l'idée qui voit dans l'État l'incarnation de la dictature du prolétariat- doit, au contraire, soumettre cet appareil par un rapport de force permanent à sa propre dictature de classe. Qu'y a-t-il de commun entre cette vision et celle des anarchistes qui rejettent en bloc État, période de transition et surtout la nécessité de la dictature du prolétariat ?
Assimiler cette analyse à la vision anarchiste c'est se payer de mots avec des arguments de polémique dérisoire.
Mais venons-en au problème de fond : pourquoi l'État est-il une institution conservatrice par excellence ?
Le mot conservateur désigne par définition ce ou celui qui s'oppose à toute innovation, ce ou celui qui résiste au bouleversement de l'état de chose existant. Or, l'État, quel qu'il soit, est une institution dont la fonction essentielle n'est autre que celle du maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre existant. Il est le produit du besoin de toute société divisée en classes de se doter d'un organe capable de maintenir par la force un ordre qu'elle n'est pas capable de maintenir de façon spontanée, harmonieuse, du fait même de son déchirement en groupes sociaux aux intérêts économiques antagonistes. Il constitue par là même la force à laquelle doit s'opposer toute action visant à bouleverser l'ordre social, et donc, toute action révolutionnaire.
- "L'État n'eut donc pas un pouvoir imposé du dehors de la société ; il n'est pas davantage "la réalité de l'idée morale", "l'image de la réalité de la raison”, comme le prétend Hegel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en oppositions inconciliables qu'elle est impuissante à conjurer, Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de l'"ordre"; et "ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État". (Souligné par nous)
Dans la fameuse formulation d'Engels dans "L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État", expliquant le besoin auquel correspond l'État et la fonction qui en découle pour celui-ci se trouve clairement énoncé cet aspect essentiel du rôle de cette institution : estomper le conflit entre classes, le maintenir dans les limites de l'ordre. Et quelques pages plus loin, …"l'État est né du besoin de réfréner des oppositions de classes".
Quand on sait que la force qui crée les bouleversements révolutionnaires n'est autre que la lutte des classes, c'est-à-dire, ce "conflit", cette "opposition" que l'État a pour tâche d'estomper" et de "réfréner", il est aisé de comprendre pourquoi l'État est une institution essentiellement conservatrice.
Dans les sociétés d'exploitation où l'État est ouvertement le gardien des intérêts de la classe économiquement dominante, le rôle conservateur de l'État face à tout mouvement tendant à mettre en question l'ordre économique existant et dont l'État est toujours, avec la classe dominante, Je bénéficiaire, apparaît assez clairement. Cependant, cette caractéristique conservatrice n'est pas moins présente dans l'État de la période de transition au communisme.
A chaque pas franchi par la révolution communiste (destruction du pouvoir politique de la bourgeoisie dans un ou plusieurs pays, puis dans le monde entier ; collectivisation de nouveaux secteurs de la production, développements de la collectivisation de la distribution dans les centres industriels, puis dans des régions agricoles avancées, puis arriérées, etc.) à chacune de ces étapes, et tant que le développement des forces productives n'aura pas atteint un degré suffisant permettant que chaque être humain suisse participer réellement à une production collectivisée à l'échelle mondiale et recevoir de la société "selon ses besoins", tant que l'humanité ne sera pas parvenue à ce stade de richesse qui lui permettra de se débarrasser enfin de tous les systèmes de rationnement de la distribution des produits et de s'unifier dans une communauté humaine sans divisions, à chaque pas franchi dans ces conditions, donc, la société devra se doter de règles de vie, de lois sociales stables et uniformes qui lui permettent de vivre en accord avec les conditions de production existantes, sans être pour autant déchirée par les conflits internes entre les classes qui subsistent, en attendant de pouvoir franchir de nouvelles étapes en avant.
Du fait qu'il s'agit de lois qui expriment encore un stade de pénurie, c'est-à-dire, un stade où le bien-être des uns tend à se faire toujours aux dépens du bien-être des autres, il s'agit de lois qui -même en instaurant "l'égalité dans la pénurie"- exigent pour être appliquées un appareil de contrainte et d'administration qui les impose et les fait respecter à l'ensemble de la société. Cet appareil n'est autre que l'État.
Si au cours de la période de transition nous décidions par exemple de distribuer gratuitement les biens de consommation dans ce qui seraient des centres de distribution, alors que la pénurie sévit encore dans la société, nous aurions peut-être quelques milliers ou milliards de personnes qui pourraient, le premier jour, se servir a leur faim -les premiers arrivés aux centres- mais au moins autant d'autres personnes se trouveraient réduites à la famine. Dans le manque, distribuer, même équitablement, impose d'instaurer des règle de rationnement et avec elles, des "fonctionnaires" : l'État des "surveillants et des comptables" dont parlait Lénine.
La fonction de cet État n'est pas une fonction révolutionnaire, même si l'ordre politique existant est celui de la dictature du prolétariat. Sa fonction intrinsèque est dans le meilleur des cas celle de stabiliser, régulariser, institutionnaliser les rapports sociaux existants. La mentalité du bureaucrate de la période de transition (et il n'y a pas d'État sans bureaucrates) n'est pas caractérisée par sa hardiesse révolutionnaire, loin de là. Elle tend invinciblement à être celle de tous les fonctionnaires : le maintien de l'ordre, la stabilité des lois qu'il est chargé de faire appliquer... et autant que possible, la défense de ses intérêts de privilégié. Plus la pénurie qui rend indispensable cet État se prolonge et plus s'accroît la force conservatrice de cet appareil et donc, avec elle, la tendance au resurgissement de toutes les caractéristiques de la vieille société.
Dans le Manifeste Communiste, Marx écrivait :
- "le développement des forces productives cet pratiquement la condition première condition nécessaire (du communisme) pour cette raison encore que l'on socialiserait sans lui l'indigence et que l'indigence ferait recommencer la lutte pour le nécessaire et par conséquent ressusciter tout le vieux fatras..."
La révolution russe où le pouvoir du prolétariat doit rester isolé, condamné à la pire pénurie fut la tragique démonstration par la pratique de cette vision. Mais elle montra du même coup que "le vieux fatras" ressuscitait d'abord et avant tout, là où on croyait que se trouvait l'incarnation de la dictature du prolétariat : dans l'État et sa bureaucratie.
Citons un témoin d'autant plus significatif qu'il fut un des principaux défenseurs de l'identité entre dictature révolutionnaire du prolétariat et État de la période de transition : Léon Trotsky :
- "L'autorité bureaucratique a pour base la pauvreté en articles de consommation et la lutte contre tous qui en résulte. Quand il y a assez de marchandises au magasin, les chalands peuvent venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Sitôt que la queue devient très longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Elle "sait" à qui donner et qui doit patienter "...
- ..."(La bureaucratie) surgit tout au début comme l'organe bourgeois de la classe ouvrière, établissant et maintenant les privilèges de la minorité, elle s'attribue naturellement la meilleure part : celui qui distribue les biens ne s'est encore jamais lésé. Ainsi naît de la société un organe qui, dépassant de beaucoup sa fonction sociale nécessaire, dévient un facteur autonome et en même temps la source de prends dangers pour tout l'organisme social". ("La Révolution Trahie")
Certes, le prochain mouvement révolutionnaire ne connaîtra certainement pas des conditions matérielles aussi désastreuses que le furent celles de la Russie. Mais la nécessité d'une période de transition, une période de lutte contre l'indigence et la pénurie à l'échelle de la planète ne sera pas moins inévitable que la subsistance d'une structure étatique. Le fait de disposer d'un potentiel plus grand de forces productives pour entreprendre la création des conditions matérielles de la société communiste constitue un éléments fondamental de l'affaiblissement de l'État et donc de sa force conservatrice sous la dictature du prolétariat. Mais il n'élimine pas pour autant cette caractéristique. Aussi reste-t-il de la première importance que le prolétariat ait su assimiler les leçons de l'expérience russe et sache voir dans l'État de cette période non pas l'incarnation suprême de sa dictature mais un organe qu'il devra soumettre à sa dictature et par rapport auquel il devra maintenir son autonomie organisationnelle.
Une force de stabilisation, non de bouleversement
Mais, nous dit-on, l'histoire montre que l'État assume une fonction révolutionnaire lorsque la classe qui l'instaure est elle-même révolutionnaire :
- "Dans le passé et dans les phases révolutionnaires, à peine une classe a t’elle conquis le pouvoir qu'elle stabilise le type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite de ses intérêts de classe. L'État assumait alors la fonction révolutionnaire qu'avait alors la classe révolutionnaire qui l'avait institué. C'est à dire : faciliter par ses interventions despotiques -après avoir brisé par la terreur la résistance des anciennes classes- le développement des forces productives en balayant les obstacles qui barrent ce chemin, en stabilisant et imposant par le monopole des forces armées un cadre de lois et de rapports de production qui favorisent ce développement et répondent aux intérêts de la nouvelle classe au pouvoir. Par exemple, pour n'en citer qu'un, l'État français de 1793 assuma une fonction éminemment révolutionnaire".
Il ne s'agit pas ici de jouer avec les mots. "Assumer une fonction révolutionnaire" d'une part, "stabiliser un cadre de lois et de rapports qui répondent aux intérêts de la nouvelle classe au pouvoir" d'autre part, ne décrivent pas la même chose. A partit du moment où la lutte d'une classe révolutionnaire aboutit à établir un rapport de forces dans la société en sa faveur, il est évident que le cadre légal, l'institution étatique qui a pour fonction de stabiliser les rapports de force existants dans la société est amené à traduire ce nouvel état de fait dans les lois et des interventions de l'exécutif pour les faire appliquer. Toute action politique d'envergure dans une société divisée en classes et donc chapeautée par une structure étatique, ne peut atteindre son but sans se traduire, tôt ou tard, par une concrétisation au niveau des lois et de l'action de l'État. C'est ainsi que l'État de 1793 en France, par exemple, fut amené à légaliser des mesures révolutionnaires imposées dans les faits par les forces révolutionnaires : exécution du roi, loi des suspects et instauration de la Terreur contre les éléments réactionnaires, réquisitions et rationnements, confiscation et vente des biens des immigrés, impôt sur les riches, "déchristianisation" et fermeture des églises, etc.. De même l'État des soviets en Russie prit des mesures révolutionnaires, telles la consécration du pouvoir des soviets et la destruction du pouvoir politique de l'ancienne classe, l'organisation de la guerre civile contre les armées blanches, etc…
Mais peut-on dire que l'État ait assumé pour autant la fonction révolutionnaire des classes qui l'ont instauré ?
La question qui se pose est de savoir si ces faits montrent que l'État n'est conservateur que dans la mesure où la classe dominante l'est elle-même, et inversement, révolutionnaire lorsque cette dernière est elle-même révolutionnaire. En d'autres termes, l'État n'aurait aucune tendance conservatrice ou révolutionnaire intrinsèque par lui-même. Il serait tout simplement l'incarnation institutionnelle de la volonté de la classe dominante politiquement, ou, pour reprendre une formulation de Boukharine sur l'État et le prolétariat pendant la période de transition :
- "La raison collective de la classe ouvrière (...) trouve son incarnation matérielle dans l'organisation suprême et universelle, celle de l'appareil d'État", (Questions économiques de la Période de transition -Edts EDI, page 110).
Regardons donc ces événements de plus près, et commençons par :
- "L'État français de 93 fut le plus radical par ses mesures de tous les États bourgeois de l'histoire" (nous traiterons de la révolution russe dans le point suivant).
L'État de 93 est celui de la Convention Nationale, instaurée à la fin de 92 après la destitution de la Monarchie par la Commune Insurrectionnelle de Paris et la terreur imposée par celle-ci la Convention succédait à l'État de l'Assemblée Législative qui avait "organisé" les guerres révolutionnaires, mais dont l'existence se trouve mise en question par la chute du trône et par le pouvoir réel de la Commune Insurrectionnelle dont elle tenta, en vain, de déclarer la dissolution (le 1er septembre, la Législative proclama la dissolution de la Commune mais dut revenir sur sa décision le soir même).
La Législative succédait elle-même à la Constituante qui, après avoir déclaré abolis les droits seigneuriaux et adopté la déclaration universelle des droits de l'homme, avait refusé de prononcer la déchéance du roi.
Avant de voir comment ont été prises les fameuses mesures radicales de 1793, constatons donc déjà que les évènements qui vont de la conquête du pouvoir par la bourgeoisie en 89 à l'avènement de la Convention, trois ans plus tard (septembre 92), n'ont rien à voir avec la description simpliste que nous offre le camarade E. : "Dans le passé et dans les phases révolutionnaires, à peine une classe a t’elle conquis le pouvoir qu'elle stabilise (sic) le type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite de ses intérêts de classe".
Dans la réalité, à peine la bourgeoisie a t’elle conquis le pouvoir politique en 89 que commence un processus long et complexe au cours duquel la classe révolutionnaire, au lieu de stabiliser l'État qu'elle vient d'instaurer, se voit contrainte de le mettre, systématiquement en question pour pouvoir mener à bien sa mission révolutionnaire.
A peine l'État a t’il consacré un nouveau rapport de forces instauré par les forces vives de la société (l'abolition des droits seigneuriaux par la Constituante après les événements de Juillet 89 à Paris, par exemple) que déjà le cadre institutionnel, qui se trouve par cet acte stabilisé, s'avère insuffisant et se transforme en entrave aux nouveaux développements du bouleversement révolutionnaire (refus de la Constituante de prononcer la déchéance du roi et répression par celle-ci des mouvements populaires en ce sens).
Si de 89 a 93, il a déjà fallu à la révolution trois forces étatiques (chacune ayant connu elle-même divers gouvernements), c'est justement parce qu'aucun de ces États ne parvient à "assumer la fonction révolutionnaire de la classe qui l'a institué". Chaque nouveau pas en avant de la révolution prend ainsi la forme d'une lutte, non seulement contre les classes de l'ancien régime, mais aussi contre l'État "révolutionnaire" et son inertie légaliste et conservatrice.
L'année 93 elle-même ne marque pas une "stabilisation du type d'organisation étatique répondant le mieux à la poursuite des intérêts de la bourgeoisie". Elle correspond au contraire à l'apogée de la déstabilisation de l'institution étatique. Il faut attendre Napoléon, ses codes juridiques, sa réorganisation de l'administration et son "Citoyens ! La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencés, elle est finie !" pour que véritablement on puisse commencer à parler de stabilisation[1] [105].
Et comment pourrait-il en être autrement ? Comment une classe véritablement révolutionnaire pourrait-elle traiter, au moment même du combat le représentant du maintien de l'ordre" (même du sien) autrement qu'à coups de pieds pour le faire sortir de ses préoccupations administratives et ses formalités juridiques où il s'attache, suivant le mot d'Engels, à "estomper le conflit (entre classes), à le maintenir dans les limites de ‘l'ordre’".
Croire que l'institution étatique puisse être "l'incarnation matérielle" de la volonté révolutionnaire d'une classe est aussi absurde qu'imaginer qu'une révolution puisse se dérouler dans l'ordre ! ; C’est demander à un organe dont la fonction essentielle est d'assurer la stabilité de la vie sociale, d'incarner l'esprit de subversion qu'il a précisément pour tâche d'étouffer dans les forces vives de la société ; c'est demander à un corps de bureaucrates d'avoir l'esprit d'une classe révolutionnaire.
Une révolution est la formidable explosion des forces vives de la société qui prennent directement en mains la destinée du corps social, bouleversement sans respect ni atermoiements sur toute institution (même créée par elle) qui entrave leur mouvement. La puissance d'une révolution se mesure ainsi en premier lieu dans la capacité de la classe révolutionnaire à ne pas se laisser enfermer dans le carcan légal de ses premières conquêtes, à savoir être aussi impitoyable avec les insuffisances de ses propres premiers pas qu'avec les forces de l'ancien régime. La supériorité politique de la révolution bourgeoise en France par rapport à celle de la bourgeoisie anglaise résida précisément dans sa capacité à ne pas être paralysée par le fétichisme de l'État et d'être parvenue à bouleverser sans cesse et sans pitié sa propre institution étatique jusqu'aux dernières conséquences.
Mais, venons-en donc au fameux État de 93 et à ses mesures, puisqu'il constitue précisément d'une part l'exemple proposé par le camarade E. pour démontrer les soi-disant capacités révolutionnaires de l'institution étatique, et d'autre part, une des plus éclatantes illustrations de l'impuissance de cette institution dans ce domaine.
En fait, les grandes mesures révolutionnaires de la période de 93 n'ont pas été prises par l'initiative de l'État mais contre celui-ci. C'est à l'action directe des fractions les plus radicales de la bourgeoisie parisienne, appuyées et souvent emportées par l'énorme pression du prolétariat des faubourgs de la capitale, qu'elles doivent leur réalisation.
La Commune Insurrectionnelle de Paris, ce corps constitué avec les événements des 9-10 août 92, par les éléments les plus radicaux de la bourgeoisie disposant de la force des bourgeois armés, la Garde Nationale et les Sectionnaires armés des faubourgs reposant essentiellement sur l'élan des masses populaires, c'est ce corps, expression organique directe du mouvement révolutionnaire, qui impose d'abord à la Législative, puis à la Convention -dont elle provoque l'instauration par les élections au suffrage universel indirect et 90% d'abstentions d'électeurs terrorisés- les mesures les plus radicales de la révolution. C'est elle qui provoque la chute du roi le 10 août 92, qui emprisonne la famille royale au Temple le 13, c'est elle qui empêcha sa propre dissolution par l'État de la Législative, elle qui instaura directement les tribunaux révolutionnaires et la terreur des journées de septembre 92 ; c'est elle qui, en 93, impose à la Convention l'exécution du roi, la loi sur les suspects, la proscription des Girondins, la fermeture des églises, l'instauration officielle de la Terreur, etc. Et, comme pour mettre en évidence son caractère de force vive distincte de l'État, elle impose encore à la Convention la prééminence de Paris comme "guide la Nation et tuteur de l'Assemblée", le droit d'intervention directe du "peuple" au besoin contre "ses représentants" et enfin "le droit à l'insurrection" !
L'exemple de Cromwell en Angleterre dissolvant par la force l'Assemblée et faisant apposer sur la porte d'entrée une affiche : "A LOUER", traduit la même nécessité.
Si les événements de 92-93 montrent quelque chose, ce n'est donc pas que l'institution étatique est d'autant plus révolutionnaire que l'est la classe qui la domine, mais au contraire que :
- plus cette classe est révolutionnaire et plus elle est amenée à se heurter au caractère conservateur de l'État ;
- plus elle a besoin de prendre des mesures radicales et plus elle est contrainte de refuser de se soumettre à l'autorité étatique pour soumettre au contraire cette institution à sa dictature.
Nous avons dit au début de ce point : "assumer une fonction révolutionnaire" et "stabiliser un cadre de lois et de rapports qui répondent aux intérêts de la nouvelle classe au pouvoir" ne veut pas dire la même chose. La différence entre les deux dans les phases révolutionnaires, l'histoire La résout par un rapport de forces entre la vraie force révolutionnaire, la classe réelle elle-même, et son expression juridique, l'État.
S'identifier à un organe stabilisateur
Nous avons jusqu'à présent traité de la nature conservatrice de l'État en restant sur un terrain historique général. En revenant au domaine de la période de transition au communisme, nous sommes amenés à voir à quel point cet antagonisme entre révolution et institution étatique, larvé ou ponctuel dans les révolutions du passé, prend dans la révolution communiste un caractère plus profond et irréconciliable.
Le camarade E. nous dit :
- "Les difficultés commencent quand on affirme que l'État a une nature historique anti-communiste et anti-prolétarienne et essentiellement conservatrice et que donc "sa dictature" (celle du prolétariat) ne peut trouver dans une institution conservatrice par excellence sa propre expression "authentique et totale" et l'anarchisme (pardonnes-moi la brutalité des mots) chassé par la porte revient par la fenêtre".
Laissons de côté l'argument polémique qui consiste à traiter notre position d'anarchiste : nous en avons déjà parlé. Et voyons pourquoi le prolétariat ne peut trouver dans une institution conservatrice son "expression authentique et totale".
Nous avons vu comment au cours de la révolution bourgeoise, il se produit des moments où, du fait de la tendance conservatrice qui s'exprimait dans les premières formes de son propre État, la bourgeoisie s'est vue contrainte, à travers ses fractions les plus radicales de prendre une distance réelle par rapport à cette institution et d'imposer sa dictature "despotique" non seulement sur les autres classes de la société, mais aussi sur l'État qu'elle venait d'instaurer.
Cependant, cette opposition entre bourgeoisie et État ne pouvait être que momentanée. Le but des révolutions bourgeoises, aussi radicales et populaires soient-elles, ne peut jamais être autre que l'affermissement et la stabilisation d'un ordre social dont elle est bénéficiaire. Aussi grande que puisse être son opposition à l'ancienne classe dominante, elle ne déstabilise la société et l'institution étatique que pour mieux la figer par la suite, une fois affirmé son pouvoir politique dans un nouvel ordre stable où elle peut, sans entrave, épanouir sa force de classe exploiteuse.
C'est ainsi que l'ouragan révolutionnaire de 93 fut suivi de la soumission de la Commune Insurrectionnelle de Paris au gouvernement du Comité de Salut Public de Robespierre, puis de l'exécution de Robespierre lui-même par la "réaction" de Thermidor, pour aboutir à l'État fort de Napoléon, où État et bourgeoisie se retrouveront fraternellement enlacés dans un désir absolu d'ordre et de stabilité.
En fait, plus se consolide et se développe le système de la bourgeoisie et plus cette dernière se reconnaît entièrement dans son État, garant absolu et conservateur de ses privilèges. Plus la bourgeoisie devient conservatrice et plus elle s'identifie à son gendarme et administrateur.
Il en est tout autrement pour le prolétariat. Le but de la classe ouvrière au pouvoir n'est ni de maintenir son existence comme classe ni de conserver l'État, produit de la société divisée en classes. Son objectif déclaré, c'est la disparition des classes et en conséquence de l'État. La période de transition au communisme n'est pas un mouvement vers la stabilisation du pouvoir prolétarien mais au contraire vers sa disparition. Il en découle, non pas que le prolétariat ne doive pas affirmer sa dictature sur l'ensemble de la société mais qu'il se sert de cette dictature pour bouleverser en permanence l'état de choses existant. Ce mouvement de bouleversement est permanent jusqu'au communisme : toute stabilisation de la révolution prolétarienne constitue pour elle un recul et une menace de mort. La fameuse sentence de Saint-Just : "Ceux qui font une révolution à moitié creusent leur propre tombe" s'applique au prolétariat du fait de sa nature de classe exploitée plus qu'à toute classe révolutionnaire dans l'histoire.
Contrairement à l'idée de Trotsky qui -incapable de reconnaître dans le développement de la bureaucratie après 17 la force de la contre-révolution- parlait d'un "Thermidor prolétarien", il n'y a pas de "thermidor" pour la révolution prolétarienne. Thermidor fut pour la bourgeoisie une nécessité correspondant à la recherche d'une stabilisation de son pouvoir. Pour le prolétariat, toute stabilisation constitue non pas un aboutissement, une réussite, mais une faiblesse, et à moyen terme, un recul de son oeuvre révolutionnaire.
Le seul moment où la stabilisation des rapports sociaux pourrait correspondre aux intérêts du prolétariat serait celui d'une société sans classe, le communisme. Mais alors, il n'y aura plus ni prolétariat, ni dictature du prolétariat, ni État. C'est pourquoi le prolétariat ne peut jamais trouver dans cette institution dont la fonction est"d'estomper le conflit entre les classes" et de stabiliser l'état de choses existant, "son expression authentique et totale".
Contrairement à ce qui se produisait pour la bourgeoisie, le développement de la révolution prolétarienne ne se mesure pas au renforcement de l'institution étatique, mais au contraire à la dissolution de celle-ci dans la société civile, la société des producteurs.
Mais l'attitude du prolétariat au cours de sa dictature à l'égard de l'État -non identification, organisation autonome par rapport à lui et exercice de sa dictature sur lui- se distingue de celle de la bourgeoisie installée, non seulement parce que pour la première, la dissolution de l'appareil étatique est une nécessité, mais aussi -et sans cela cette nécessité ne serait qu'un voeu pieux- parce qu'elle est une possibilité.
Divisée par la propriété privée et la concurrence sur lesquelles elle fonde sa domination économique, la bourgeoisie ne peut engendrer longtemps de corps organisé qui incarne ses intérêts de classe en dehors de l'État. L'État est pour la bourgeoisie non seulement le défenseur de sa domination à l'égard des autres classes, il est aussi le seul lien d'unification de ses intérêts. Dans la division en mille intérêts privés et antagonistes de la bourgeoisie, seul l'État constitue une force capable d'exprimer les intérêts de l'ensemble de la classe. C'est pourquoi, si elle ne pouvait se passer, à un moment donné, ni en France ni en Angleterre, de l'action autonome de ses fractions les plus radicales contre l'État qu'elle avait instauré pour mener à bout sa révolution, elle ne pouvait pas plus prolonger longtemps cet état de choses, sous peine de perdre toute unité politique et donc toute force (voir le sort réservé à la Commune Insurrectionnelle de Paris et à ses dirigeants une fois leur fulgurante action révolutionnaire accomplie).
Le prolétariat ne connaît pas cette impuissance. N'ayant pas d'intérêts antagonistes en son sein et trouvant dans son unité autonome la principale force de son action, le prolétariat peut exister unifié et puissant sans recours à un arbitre armé au-dessus de lui. Sa représentation comme classe, il la trouve en lui-même, dans ses propres organes unitaires : les Conseils Ouvriers.
Ce sont ces Conseils qui doivent et peuvent constituer le seul et véritable organe de la dictature du prolétariat. C'est en eux et en eux seuls que la classe ouvrière trouve son "expression authentique et totale".
Le prolétariat comme classe dominante
Le camarade E. reprend à son compte les positions de Lénine dans "l'État et la Révolution", basées elles-mêmes sur les écrits et l'expérience pratique passée du mouvement prolétarien. Mais il le fait en simplifiant à l'extrême cette position, en oubliant le contexte politique où elle fut définie et évidemment en laissant de côté la plus importante expérience de la dictature du prolétariat : la révolution russe.
Le plus grand et le plus riche moment de l'histoire du combat prolétarien n'aurait d'après E., rien, strictement rien modifié aux formulations des révolutionnaires avant Octobre. Le résultat est une grossière simplification des inévitables insuffisances de la théorie révolutionnaire avant 1917, dans un domaine où la seule expérience existante alors était celle de la Commune de Paris.
E. écrit :
- "L'essence de celle-ci (la conception de l'État et de son rôle chez Lénine) est très simple : le prolétariat s’érigeant en classe dominante crée son propre organe d'État différent des autres par la forme, mais jouant par essence la même fonction : oppression des autres classes, violence concentrée contre elles pour le triomphe de ses intérêts historiques comme classe dominante, même si ceux-ci coïncident à long terme avec ceux de l'humanité".
Il est vrai que l'essence de la fonction de l'État a toujours été le maintien de l'oppression des classes exploitées par la classe exploiteuse. Mais au moment de transporter cette idée à l'analyse de la période de transition au communisme, cette simplicité est plus qu'insuffisante. Et cela pour deux raisons principales :
- premièrement parce que la classe exerçant la dictature n'est pas une classe exploiteuse mais exploitée ;
- deuxièmement, parce que, de ce fait, ainsi que pour les raisons que nous avons vues, le rapport entre prolétariat et État ne peut être celui qui caractérisait la domination des classes exploiteuses.
Dans "l'État et la Révolution", Lénine fut amené à mettre au premier plan cette conception simple de l'État, du fait même de la polémique qu'il y développait contre la social-démocratie. Cette dernière, pour justifier sa participation au gouvernement de l'État bourgeois, prétendait ne voir dans l'État (et l'État bourgeois en particulier) qu'un organe de conciliation entre les classes : elle en déduisait qu'en y participant et développant l'influence électorale des partis ouvriers, on pourrait le transformer en outil du prolétariat pour l'avènement du socialisme. Lénine rappela avec force que dans une société divisée en classes l'État avait toujours été l'État de la classe dominante, l'appareil du maintien du pouvoir de cette dernière, sa force armée contre les autres classes.
La pensée d'une classe révolutionnaire et à fortiori celle d'une classe révolutionnaire exploitée ne peut jamais se développer dans un univers de paisible recherche scientifique. Arme d'un combat global, elle ne peut s'exprimer qu'en opposition violente à l'idéologie dominante dont elle s'attache en permanence à démontrer la fausseté. C'est pourquoi, on ne trouvera jamais un texte révolutionnaire qui ne prenne, d'une façon ou d'une autre, la forme de critique ou de polémique. Même les morceaux les plus "scientifiques" du Capital sont rédigés dans un esprit de combat critique contre les théories économiques de la classe dominante. Aussi faut-il savoir, quand on reprend les écrits révolutionnaires, les replacer en permanence dans le combat auquel ils s'intègrent. La polémique, si elle est vivante, conduit inévitablement à polariser la pensée sur des aspects particuliers de la réalité parce qu'étant les plus importants dans tel combat particulier. Mais ce qui est essentiel dans une discussion ne l'est pas automatiquement dans une autre. Reprendre mot pour mot les formulations et les préoccupations exprimées dans des textes traitant d'un problème particulier pour les appliquer telles quelles, sans les replacer dans leur contexte, à d'autres problèmes fondamentalement différents, conduit la plupart du temps à des aberrations où ce qui pouvait être une simplification nécessaire dans une polémique se transforme, transposé ailleurs, en une absurdité théorique. C'est pourquoi l'exégèse est toujours une entrave pour la théorie révolutionnaire.
Transposer telles quelles les insistances dégagées du combat contre la participation de la social-démocratie dans l'État bourgeois et son rejet de la dictature du prolétariat, aux problèmes posés par le rapport entre la classe ouvrière et l'État de la période de transition au communisme est un exemple de ce type d'erreur. Erreur qui fut souvent commise aussi bien par Marx et Engels que par Lénine et tous les révolutionnaires dont l'union fut forgée au feu du combat contre la social-démocratie pendant la première guerre. Compréhensible peu avant Octobre 17, elle ne l'est cependant plus aujourd'hui.
L'expérience de la révolution russe a mis en évidence à quel point le rapport entre le prolétariat au pouvoir et l'État était différent de celui qu'entretenaient les classes exploiteuses.
Le prolétariat exerçant sa dictature s'affirme comme classe dominante dans la société. Mais dominante n'a rien à voir ici avec le contenu de ce terme dans les sociétés passées. Le prolétariat est classe dominante politiquement, mais non économiquement. Non seulement la classe ouvrière ne peut exploiter aucune autre classe de la société, mais, qui plus est, elle demeure dans une certaine mesure classe exploitée.
Exploiter économiquement une classe, c'est tirer profit de son travail au détriment de sa propre satisfaction, c'est amputer une classe d'une partie du fruit de son travail en la privant par cela de la possibilité d'en jouir. Or, au lendemain de la prise du pouvoir par le prolétariat, la situation économique de la société connaît les deux caractéristiques suivantes :
- Par rapport aux besoins humains (mêmes considérés dans leur définition minimum de ne souffrir ni de faim, ni de froid ni de maladies curables), la pénurie règne en maître absolu pour près de doux tiers de l'humanité ;
- L'essentiel de la production mondiale est réalisée dans les régions industrialisées par une fraction largement minoritaire de la population : le prolétariat.
Dans ces conditions, la marche vers le Communisme implique un énorme effort de production visant à permettre d'une part la plus grande satisfaction des besoins humains et, d'autre part (liée à cette première nécessité) l'intégration au processus productif (à ses niveaux de technicité les plus élevés) de l'immense masse de la population qui est improductive, soit (dans les pays développés) parce qu'elle remplissait des fonctions improductives dans le capitalisme, soit (et c'est le cas pour la majorité dans le tiers-monde) parce que le capitalisme n'avait pu les intégrer à la production sociale. Or, qu'il s'agisse d'augmenter la production de biens de consommation ou qu'il s'agisse de produire les moyens de production qui permettront d'intégrer les masses improductives (le paysannat indigent du tiers-monde ne sera pas intégré à la production socialisée avec des charrues de bois ou d'acier, mais avec les moyens industriels les plus avancés... qu'il faudra créer), cet effort donc repose essentiellement sur le prolétariat.
Tant que subsiste la pénurie dans le monde et tant que le prolétariat reste une fraction de la société (c'est à dire tant que sa condition ne s'est pas étendue à toute la population du globe), il se trouvera à produire un surplus de biens (de consommation et de production) dont il ne bénéficiera qu'à long terme. De ce point de vue, donc, le prolétariat non seulement n'est pas classe exploiteuse mais demeure encore classe exploitée.
Dans les sociétés passées, l'État tendait à s'identifier à la classe dominante et à la défense de ses privilèges dans la mesure où cette classe était économiquement dominante, c'est à dire bénéficiant du maintien des rapports production existants. La tâche de "l'État de maintien de l'ordre est dans une société d'exploitation inévitablement le maintien de l'exploitation et donc des privilèges de l'exploiteur.
Mais au cours de la période de transition au communisme, le maintien des rapports économiques existants, s'il peut constituer, par certains aspects et à court terme, un moyen d'empêcher un recul en deçà des pas franchis par le prolétariat (et c'est en cela que l'État est inévitable au cours de la période de transition), il représente par ailleurs le maintien d'une situation économique où le prolétariat supporte le poids de la subsistance et du développement de l'ensemble de la société. Contrairement à ce qui passait dans les sociétés où la classe politiquement dominante était une classe bénéficiant directement de l'ordre économique existant, au cours de la dictature du prolétariat, la convergence entre État et classe politiquement dominante perd tout fondement économique. Qui plus est, comme organe exprimant les besoins de cohérence de la société et la nécessité d'empêcher que les antagonismes entre classes se développent, l'État tend inévitablement à s'opposer, sur le terrain économique, aux intérêts immédiats de la classe ouvrière. L'expérience russe au cours de laquelle, on vit l'État exiger du prolétariat un effort de production toujours plus grand au nom de la nécessité de pouvoir satisfaire aux exigences de l'échange avec les paysans ou avec les puissances étrangères, mit en évidence, à travers la répression des grèves ouvrières (dès les premiers mois de la révolution) à quel point cet antagonisme pouvait être déterminant dans les rapports entre prolétariat et État.
C'est pourquoi encore le prolétariat au pouvoir ne peut reconnaître dans l'État, comme le voulait Boukharine, "l'incarnation matérielle de sa raison collective", mais un instrument de la société qui ne se soumettra pas à son pouvoir "automatiquement" -comme c'était le cas pour les classes exploiteuses, une fois leur domination politique définitivement assurée- mais qu'il devra au contraire soumettre sans relâche à son contrôle et à sa dictature, s'il ne veut le voir se retourner contre lui, comme en Russie.
Une dictature sur l'État
Mais, dernier argument du camarade E., on nous dit qu'un État qui serait soumis à une dictature qui lui est extérieure, n'aurait pas les moyens de jouer son rôle. Nous oublierons que, si État et dictature d'une classe ne sont pas identiques, il n'y a pas de dictature réelle.
- "En fait, on accepte la dictature du prolétariat, mais on oublie qu'État et dictature, ou pouvoir exécutif d'une classe sont synonymes (...) C'est donc un non-sens de parler d'un État qui soit soumis à une dictature qui lui est extérieure et qui ne peut alors intervenir despotiquement dans la réalité économique et sociale pour l'orienter dans une certaine direction de classe".
Il est vrai qu'il ne peut y avoir de dictature d'une classe quelle qu'elle soit sans qu'existe dans la société une institution de type étatique : d'une part, parce que division de la société en classes implique existence d'un État, d'autre part, parce que tout pouvoir de classe nécessite l'existence d'un appareil qui traduise dans un cadre de lois et de moyens de contraintes son pouvoir dans, la société: l'État. Il est vrai aussi qu'un État qui ne disposerait pas d'un pouvoir réel ne serait pas un État. Mais il est faux de dire que dictature de classe est identique à État et "qu'un État qui soit soumis à une dictature qui lui est extérieure est un non-sens".
La situation de dualité de pouvoir (celui d'une classe d'une part, celui de l'État d'autre part le premier s'exerçant sur le second) s'est déjà produite dans l'histoire, en particulier au cours des grandes révolutions bourgeoises. Et, pour toutes les raisons que nous avons vues, elle s'imposera comme une nécessité au cours de la période de dictature du prolétariat.
Ce qui est réel, c'est qu'une telle situation ne peut s'éterniser sans entraîner la société dans une contradiction inextricable dans laquelle elle se consommerait elle-même. Elle constitue une contradiction vivante qui doit se résoudre inévitablement. Mais la façon dont elle se résout diffère fondamentalement suivant qu'il s'agisse de la révolution bourgeoise ou de la révolution prolétarienne.
Dans le premier cas, cette dualité du pouvoir se résout rapidement par une identification du pouvoir de la classe dominante avec le pouvoir d'État qui sort du processus révolutionnaire renforcé et investi du pouvoir suprême sur l'ensemble de la société, la classe dominante incluse.
Dans le cas de la révolution prolétarienne au contraire, elle se résout dans la dissolution de l'État et la prise en mains de toutes les destinées dé la vie sociale par la société elle-même.
C'est là une opposition fondamentale qui se traduit par des caractéristiques dans le rapport entre classe dominante et État dans la révolution prolétarienne différentes de celles de la révolution bourgeoise, non seulement par la forme mais aussi par le contenu.
Pour mieux cerner ces différences, il est nécessaire de tenter de se représenter les lignes générales des formes du pouvoir du prolétariat au cours de la période de transition telles qu'elles peuvent être esquissées à partir de l'expérience historique du prolétariat. Sans vouloir s'attacher à définir les détails institutionnels d'une telle période, car s'il est une caractéristique majeure des périodes révolutionnaires, c'est que toutes les formes institutionnelles tendent à apparaître comme des coquilles vides que les forces vives de la société remplissent et bouleversent au gré du besoin de leurs affrontements, il est cependant possible de dégager les axes très généraux suivants :
- L'organe du pouvoir direct du prolétariat sera constitué par les organisations unitaires de cette classe, les conseils ouvriers, assemblées de délégués élus et révocables par l'ensemble des prolétaires, c'est à dire l'ensemble des travailleurs produisant de façon collective dans le secteur socialisé (ouvriers de l'ancienne société et travailleurs intégrés au fur et à mesure du développement de la révolution dans le secteur collectivisé). Armés de façon autonome, tels sont les instruments authentiques de la dictature du prolétariat ;
- L'institution étatique est constituée à sa base par les conseils existant sur une base non pas de classe, c'est à dire non pas en fonction de la place occupée dans la production (le prolétariat se doit empêcher toute organisation de classe autre que la sienne) mais géographique : assemblées et conseils de délégués de la population par quartiers, villes, régions, etc. culminant dans un conseil central (qui constitue l'organe central de l'État).
Emanation de ces institutions, se dresse tout l'appareil d'État avec d'une part, ceux chargés du maintien de l'ordre : "surveillants" et armée pendant la guerre civile et, d'autre part le corps des fonctionnaires chargés de l'administration et de la gestion de la production et de la distribution.
Cet appareil de gendarmes et de fonctionnaires pourra être plus ou moins important, plus ou moins dissout dans la population elle-même suivant le cours du processus révolutionnaire, mais il serait illusoire d'ignorer l'inévitabilité de leur existence dans une société qui connaît encore les classes et la pénurie.
La dictature du prolétariat sur l'État de la période de transition, c'est la capacité de la classe ouvrière à maintenir l'armement et l'autonomie de ses conseils par rapport à l'État et à imposer à celui-ci (à ses organes centraux comme à ses fonctionnaires) sa volonté.
La dualité de pouvoir qui en résulte tendra à se résoudre au fur et à mesure que l'ensemble de la population sera intégrée dans le prolétariat et ses conseils et que l'abondance se développant, la fonction des gendarmes et autres fonctionnaires disparaîtra, "le gouvernement des hommes cédant la place à l'administration des choses" par les producteurs eux-mêmes. Le développement du pouvoir du prolétariat se fait dans le même mouvement que la diminution de celui des fonctionnaires de l'État et l'absorption par le prolétariat de l'ensemble de l'humanité transforme son pouvoir de classe en action consciente de la communauté humaine.
Mais, pour qu'un tel processus ait cours, il est nécessaire non seulement que les conditions matérielles de son épanouissement se trouvent réunies (en particulier extension mondiale de la révolution, développement des forces productives) main encore que le prolétariat, force motrice essentielle de ce processus, sache conserver et développer l'autonomie et la force de son pouvoir sur l'État.
Loin de constituer un non-sens, cette dictature de conseils ouvriers à laquelle est soumis l'État et qui lui est "extérieure", représente le mouvement même du dépérissement de l'État.
La révolution russe ne connut pas les conditions matérielles d'un tel épanouissement, mais par les difficultés énormes auxquelles elle se heurta, mit en relief le contenu des tendances intrinsèques de l'appareil étatique, le rôle de ce dernier s'étant trouvé du fait même de ces difficultés amplifié jusqu'aux dernières limites.
Au lendemain d'Octobre 17, existaient en Russie aussi bien les conseils ouvriers, protagonistes d'Octobre, que les conseils d'État, les soviets et leur appareil étatique en développement. Mais, reposant sur la conviction que l'État ne pouvait être distinct de la dictature du prolétariat, les conseils ouvriers se transformèrent en institution étatique s'intégrant dans l'appareil d'État. Avec le développement du pouvoir de la bureaucratie, provoquée par l'absence de toutes les conditions matérielles du développement de la révolution, l'opposition entre État et prolétariat ne tarda pas à apparaître au grand jour, on crut pouvoir résoudre l'antagonisme en plaçant partout où l'on pouvait dans l'appareil étatique, à la place ces fonctionnaires, les ouvriers les plus résolus et les plus expérimentés, les membres du Parti. Le résultat ne fut pas une prolétarisation de l'État, mais une bureaucratisation des révolutionnaires. A la fin de la guerre civile, le développement de l'antagonisme entre classe ouvrière et État aboutit à la répression par l'État des grèves de Petrograd en 1920 puis de l'insurrection des ouvriers de Kronstadt qui revendiquaient entre autres, des mesures contre la bureaucratie et la révocation des délégués aux Soviets.
Il ne s'agit pas d'en déduire ici que si le prolétariat avait gardé l'autonomie de ses conseils à l'égard de l'État et su imposer sa dictature à l'État au lieu de voir dans ce dernier son "incarnation matérielle", la révolution aurait définitivement triomphé en Russie.
La dictature du prolétariat en Russie ne fut pas étouffée par son incapacité à résoudre les problèmes de ses rapports avec l'État mais par l'échec de la révolution dans les autres pays, qui la condamnait à l'isolement. Cependant, son expérience à l'égard de ce problème crucial ne fut ni inutile ni "un cas particulier" sans signification pour l'ensemble du mouvement historique. L'expérience russe jeta une lumière fondamentale sur cette question complexe qui demeurait dans la théorie révolutionnaire encore particulièrement confuse. Non seulement, elle apporta avec les conseils ouvriers et l'organisation Soviétique, une réponse pratique au problème des formes du pouvoir prolétarien, mais elle permit de mieux résoudre ce qui se présentait dans les théories dégagées de l'expérience de la Commune de Paris comme une contradiction : de Marx et Engels à Lénine d'une part, on affirmait que l'État était l'incarnation de la dictature du prolétariat et d'autre part, on tirait de l'expérience de la Commune la leçon que le prolétariat devrait se prémunir contre les "effets nuisibles" (Engels) de cet État en soumettant tous ses fonctionnaires à un contrôle du prolétariat : réduction du revenu à celui d'un ouvrier et révocabilité à tout instant des fonctionnaires d'État par le prolétariat. Si l'État est identique à la dictature du prolétariat, pourquoi celui-ci devrait-il se méfier de ses effets nuisibles ? Comment la dictature d'une classe pourrait-elle avoir des effets contraires à ses propres intérêts ?
En fait, la nécessité d'une distinction nette entre dictature du prolétariat et État ainsi que d'un pouvoir dictatorial de la première sur le second se trouve en germe, sinon comme intuition du moins comme nécessité théorique dans les écrits des révolutionnaires sur cette question avant 17. Ainsi, par exemple, dans "l'État et la Révolution", Lénine est amené à parler d'une distinction entre quelque chose qui serait "l'État des fonctionnaires" et une autre qui serait "l'État des ouvriers armés": "en attendant l'avènement de la phase supérieure du communisme, les socialistes réclament de la société et de l'État qu'ils exercent le contrôle le plus rigoureux sur la mesure de travail et la mesure de consommation ; mais ce contrôle doit commencer par l'expropriation des capitalistes, par le contrôle des ouvriers sur les capitalistes, et il doit être exercé non par l'État des fonctionnaires mais par l'État des ouvriers armés" (souligné dans le texte).
Et dans un autre passage du même ouvrage où il tente de faire une comparaison entre l'économie de la période de transition et l'organisation de la poste dans le capitalisme, il affirme la nécessité du contrôle de ce corps de fonctionnaires par le corps des ouvriers armés :
- "Toute l'économie nationale organisée comme la poste, de façon que les techniciens, les surveillants, les comptables reçoivent, comme tous les fonctionnaires, un traitement n'excédant pas des "salaires d'ouvriers", sous le contrôle et la direction du prolétariat armé : tel est notre but immédiat", (souligné par nous).
La révolution russe montre tragiquement à quel point ce qui pouvait paraître comme une contradiction théorique dans la pensée révolutionnaire exprimait en fait une contradiction réelle entre la dictature du prolétariat et l'État de la période de transition ; elle mit en lumière à quel point "le contrôle et la direction du prolétariat armé" sur l'État constitue une condition sine qua non de l'affirmation de la dictature du prolétariat.
Le camarade E. croit certainement rester fidèle à l'effort théorique du prolétariat tel qu'il se concrétise avant Octobre 17 et en particulier dans "l'État et la Révolution" de Lénine dont il prend ici une défense intransigeante. Mais c'est trahir l'esprit de cet effort que de se camper sur une position qui presque par principe se refuse de mettre en question ces acquis théoriques à la lumière de la plus grande expérience de dictature du prolétariat. Pour conclure, nous ne pouvons que rappeler ce que Lénine écrivait justement dans "l'État et la Révolution" à propos de ce que doit être l'attitude des révolutionnaires dans ce domaine :
- "Marx ne se contenta pas d'admirer l'héroïsme des communards "montant à l'assaut du ciel", selon son expression. Dans le mouvement révolutionnaire des masses bien que celui-ci n’eut pas atteint son but, il voyait une expérience historique d'une portée immense, un certain pas en avant de la révolution prolétarienne universelle, un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements. Analyser cette expérience, y puiser des leçons de tactique, s’en servir pour passer au crible sa théorie : telle est la tâche que Marx se fixe".
"Etant donné qu'il ne nous appartient pas de forger un plan qui vaille pour tous les temps à venir, il est d'autant plus certain que ce que nous devons faire pour le présent, c'est une évaluation critique impitoyable de tout ce qui est, impitoyable au sens où notre critique ne doit craindre ni ses propres résultats ni le conflit avec les pouvoirs établis."
(Karl Marx)
[1] [106]Et encore : l'État
français connaîtra les forte suivit l'Empire Napoléonien et celles de 1848.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Livres - Sur « La Gauche Communisme en Allemagne (1918-21) » de D. Authier et J. Barrot (notes de lecture)
- 3720 reads
Nous saluons d'abord la parution récente de
l'ouvrage de Denis Authier et Jean Barrot, qui manifeste incontestablement un
souci d'analyse d'un point de vue marxiste révolutionnaire et qui met à la
disposition de nombreux camarades, des textes de la Gauche jusqu'alors
introuvables. Il va de soi que l'on ne saurait trop insister sur la nécessité
de telles études qui déchirent un petit bout du voile diffamatoire recouvrant
la richesse des positions de la Gauche Communiste. Le livre est un des seuls[1] [107]
à mettre en avant la perspective communiste ouverte par la révolution en Russie
et ce, dans la période historique des révolutions prolétariennes. Ce travail a
de grandes qualités, mais également des faiblesses que nous allons essayer de
développer ici.
LES RELENTS MODERNISTES
Le livre se présente en deux parties, l'une d'analyse de la situation historique générale et de l'évolution des groupes de la Gauche Communiste, et l'autre en un recueil de textes. De manière générale dans leur analyse, les auteurs ne perçoivent pas nettement le changement de période ouvert par la première guerre mondiale et ne l'analysent pas comme la fin de la période où le mode de production capitaliste développait effectivement les forces productives et où, de plus en plus, ce même mode de production devient une entrave à tout développement ultérieur, entrave concrétisée par la nécessité périodique de détruire massivement une partie de ces forces productives dans des guerres mondiales. Ces camarades n'expriment jamais clairement la cause matérielle qui fait basculer l'ensemble de la social-démocratie et ses organes, partis de masse et syndicats, dans le camp de la bourgeoisie : la fin de la période ascendante et l'ouverture de la période de décadence, où les seules tâches du prolétariat sont la destruction de l'État bourgeois et la constitution mondiale de la dictature des Conseils Ouvriers.
Noyant le phénomène fondamental du changement de période dans des épiphénomènes tels que l'augmentation massive de la productivité du travail permettant l'extraction de plus-value relative, ce que Marx appelle alors la domination réelle du capital, les auteurs tombent dans les sophismes modernistes d'une soi-disant dichotomie entre "l'ancien mouvement ouvrier" (correspondant à la période ascendante) qui serait réformiste et le "nouveau" qui serait lui "pur et dur". De là à parler de "prolétariat allemand (qui) reste globalement réformiste ..." (p.28) ou de "la majorité réformiste de la classe ouvrière ..." (p.89) ..., il n'y a qu'un pas, qu'ils franchissent en assimilant le poids de l'idéologie bourgeoise : le réformisme, à la nature même de la classe ouvrière qui elle ne peut pas, qu'elle le veuille ou non, être "réformiste", "pour le capital" ou autres nouveautés. La classe ouvrière est strictement déterminée par la place socio-économique qu'elle occupe dans la production, qui la contraint à toujours lutter contre le capital ; c'est la lutte de classe. Le changement de période ne fait, lui, "que" changer les conditions de cette lutte qui a toujours été révolutionnaire (cf. La Commune de Paris), mais qui, dans le cadre progressif du système, pouvait arracher des réformes, c'est-à-dire des améliorations réelles de sa condition d'exploitée. Le changement des conditions dans lesquelles la lutte de classe se développe, est donc étroitement lié au changement de période qui marque le passage du système capitaliste dans sa phase de déclin historique. En assimilant la maladie bourgeoise du réformisme, à la nature révolutionnaire du prolétariat, l'on ne comprend plus pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire, porteuse du communisme, l'on ne comprend plus ce qui ferait changer la nature "réformiste" du prolétariat en révolutionnaire, sinon un coup de baguette magique... Non, "le prolétariat est révolutionnaire ou n'est rien" (lettre de Marx à Schweitzer - 1865) signifie que sa lutte a toujours été une lutte contre le capital, une lutte révolutionnaire, une lutte qui d'emblée est politique car elle vise, consciemment ou non, à la destruction de l'État bourgeois. C'est donc bien ce changement des conditions de la lutte prolétarienne qui obligé la classe ouvrière, dans la période de décadence, à s'organiser uniquement dans les organes de la prise du pouvoir, les Conseils Ouvriers, et qui l'oblige à secréter le parti de classe, comme minorité, expression visible de sa conscience de classe. Nous voyons ici très clairement en quoi les Conseils Ouvriers ne sont pas la "découverte d'une forme d'un nouveau mouvement ouvrier", mais correspondent à la matérialisation du contenu invariant qui gît dans les entrailles du prolétariat, contenu que la période historique imposera comme nécessité à l'humanité : le communisme, la société sans classe.
La légende de la Gauche Italienne opposée à la Gauche Allemande
Cette légende, entretenue notamment par les bordiguistes “orthodoxes" du PCI[2] [108] vise à présenter la Gauche Allemande "anarchiste", antagoniquement à la Gauche Italienne "marxiste". Or, s'il est vrai que la Gauche Italienne a développé ses positions par des analyses plus vigoureuses, l'ensemble de la Gauche Internationale est le produit du même mouvement, affirmant, par delà les frontières, les mêmes constantes fondamentalement correctes : l'anti-parlementarisme marxiste, la défiance envers les syndicats, le rejet du frontisme, la nécessité de partis minoritaires, mais forgés par des principes communistes stricts rejetant toutes les anciennes tactiques opportunistes. La démystification de cette légende est particulièrement bienvenue dans cet ouvrage. Barrot et Authier démontrent, même s'il n'y a pas eu la constitution d'une fraction communiste de gauche au niveau international, la présence de cette gauche dans tous les pays (la Belgique avec Van Overstraeten et l'Ouvrier Communiste ne faisant pas exception), et, en particulier, l'existence de liens programmatiques entre la fraction communiste abstentionniste du Parti Socialiste Italien ("Il Soviet") et la Gauche Communiste Allemande (Pannekoek, Gorter). En effet, c'est cette fraction qui chargea, lors de sa conférence en mai 1920 à Florence, ses délégués à l'Internationale Communiste, "de constituer une fraction antiparlementaire conséquente à l'intérieur de la IIIème Internationale ..." et insiste "sur l'incompatibilité des principes et des méthodes communistes avec une participation aux instances représentatives bourgeoises"(* [109]). C'est dans ce même but qu'un an plus tard furent délégués des membres du KAPD (Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne) au 3ème Congrès de l'I.C. Et, de fait, Terraccini, délégué du PC d'Italie à ce même congrès, a soutenu l'intervention du KAPD contre la "tactique" frontiste de la "Lettre ouverte". L'on pourrait encore citer longuement les faits et prises de positions démontrant ce lien programmatique évident entre les différentes Gauches, lien certainement existant du seul fait que toutes les Gauches étaient produites par le même mouvement, celui de la compréhension que la révolution communiste mondiale est à l'ordre du jour et est, la seule solution pour la classe ouvrière. La faiblesse des Gauches s'exprime également clairement dans leur impossibilité de créer une réelle fraction internationale, pouvant lutter efficacement contre la dégénérescence de l'IC, entraînée de plus en plus, du fait de l'écrasement de la révolution mondiale, vers la bourgeoisie. L'on peut citer, outre la Gauche Allemande et Hollandaise, la Gauche Italienne, l'Hongroise avec B. Kun, Varga et Lukàcs, la Bulgare avec I. Gancher, l'Américaine avec J. Reed, l'Anglaise avec Pankhurst, la Française avec Lepetit et Sigrand, la Russe avec l'Opposition Ouvrière et le groupe de Miasnikov... Mais, comme le dit très bien cet extrait du texte "La Gauche Allemande et la question syndicale dans la IIIème Internationale"[3] [110] (cité p. 189) :
- "De même que la Commune fut "fille" (Engels) de l'A.I.T., de même la révolution allemande fut celle de cette Gauche Internationale qui n'eut jamais la force de se donner une organisation unitaire finale, mais dont les grands courants furent la Gauche Allemande, qui dans sa lutte même osa soutenir la direction programmatique donnée par le mouvement révolutionnaire lui-même, et la Gauche Italienne, qui eut la tâche historique de continuer le travail de la Gauche Internationale, le complétant et le formulant dans ses attaques contre la contre-révolution victorieuse ; elle nous a transmis ces armes théoriques... qui formeront la base du mouvement révolutionnaire futur qui, dans la pratique de la Gauche Allemande... trouve un grand exemple historique. La révolution future ne sera pas une question de banale "imitation", il s'agira de suivre "le fil du temps" tiré par la Gauche Communiste Internationale".
La Gauche Allemande et la question du “Parti”
Un élément important encore mis en avant par ce livre est, parmi l'ensemble des faiblesses des communistes en Allemagne, celle qui matérialise le plus toutes les autres, l'incompréhension du caractère indispensable pour le prolétariat d'avoir une avant-garde solide, constituée avant les combats décisifs, et ayant fermement rompu avec tout l'opportunisme et les positions bourgeoises véhiculées par la social-démocratie. Relever les erreurs du passé ne signifie pas qu'il faille rejeter la lutte héroïque de la Gauche Communiste, au contraire, cela permet aux révolutionnaires de tirer du mouvement prolétarien des indications utiles concernant la fonction et le rôle de l'avant-garde communiste. En cela, l'expérience allemande est riche en tâtonnements, en incompréhensions, mais aussi en ruptures lucides avec le substitutionnisme et le carriérisme, caractérisant de plus en plus les PC centristes comme étant amenés, avec le reflux du mouvement, dans le camp de la bourgeoisie par l'adoption du "socialisme dans un seul pays", négation même du programme communiste. D'autre part, il ne faudrait pas voir la Gauche Allemande comme homogène, et entièrement ravagée par l'attentisme, hérité des tergiversations de Rosa Luxembourg à rompre avec la social-démocratie et le refus de la nécessité des minorités révolutionnaires, théorisé, par la suite, par la tendance Essen et l'AAUD-E (Union Générale Ouvrière d'Allemagne Unitaire.) avec 0tto Rhule et "Die Aktion". En effet, les thèses du KAPD sur le rôle du Parti dans la révolution prolétarienne développent largement le besoin pour le prolétariat de se doter de "la forme historique convenable pour le rassemblement des combattants prolétariens les plus conscients, les plus éclairés, les plus disposés à l'action, (qui) est le parti" :
- "Le parti communiste doit donc tout d'abord, de façon absolument tranchante tenir à l'écart de lui tout réformisme et tout opportunisme ; il en est de même pour son programme, sa tactique, sa presse, ses mots d'ordre particuliers et ses actions. En particulier, il ne devra jamais accroître l'effectif de ses membres plus rapidement que ne le permet la force d'absorption du noyau communiste solide"[4] [111]
Dans le même sens, les interventions de Jan Appel au 3ème Congrès de l'IC sont aussi significatives[5] [112] :
- "Le prolétariat a besoin d'un parti -noyau- ultra formé. Il doit en être ainsi. Chaque communiste doit être individuellement un communiste irrécusable -que cela soit notre but- et il doit pouvoir être un dirigeant sur place, dans ses rapports, dans les luttes où il est plongé, il doit pouvoir tenir bon, et ce qui le tient, ce qui l'attache, c'est son programme. Ce qui le contraint à agir, ce sont les décisions que les communistes ont prises. Et là, règne la plus stricte discipline. Là, on ne peut rien changer, ou bien on sera exclu ou sanctionné. Il s'agit donc d'un parti qui est un noyau sachant ce qu'il veut, qui est solidement établi et a fait ses preuves au combat, qui ne négocie plus, mais se trouve continuellement en lutte. Un tel parti ne peut naître que lorsqu'il s'est réellement jeté dans la lutte, quand il a rompu avec les vieilles traditions du mouvement des syndicats et des partis, avec les méthodes réformistes dont fait partie le mouvement syndical, avec le parlementarisme."
Un texte aussi clair ne peut laisser aucun doute sur la nature profondément marxiste du KAPD, et nous permet de comprendre la dynamique qui fait surgir le parti de classe comme continuellement à la tête des luttes. Ce qui signifie qu'en période de contre-révolution, toute constitution de parti n'est qu'un artifice organisationnel qui ne sert que la confusion. Il ne peut rester que de petits groupes préservant les acquis programmatiques et les positions de classe. Mais lorsque la vague ouvrière remonte :
- "Il ne s'agit plus alors de défendre les positions, mais, sur la base de ces positions en constante élaboration, sur la base du programme de classe, d'être capables de cimenter la spontanéité de la classe, d'exprimer la conscience de classe, d'unifier ses forces en vue de l'assaut décisif, en d'autres termes, de construire le parti, moment essentiel de la victoire prolétarienne." (Leçons de la Révolution Allemande in Revue Internationale du C.C.I. n°2).
Pour terminer ces quelques remarques, il nous faut encore signaler que le choix des textes est relativement peu significatif et ne correspond pas aux meilleures productions de la Gauche Allemande, mais les auteurs s’en expliquent eux-mêmes et de toute manière leur publication en français ne peut que contribuer à la reconnaissance de ce courant comme l’un des plus important de la Gauche Communiste Internationale.
Ainsi ce livre vient à point pour satisfaire le besoin pressant du mouvement révolutionnaire renaissant de :
- "Connaître son propre passé pour mieux en faire la critique".
[1] [113] Avec également l'autre excellent ouvrage de D. Authier sur ce sujet, qui regroupe des textes beaucoup plus fondamentaux de la Gauche Allemande : "La Gauche Allemande", textes du KAPD, de l'AAUD... Edition : "Invariance" -Brignoles- voir la critique de ce livre dans "Révolution Internationale" n°6. Pour un aperçu général de cette question, il existe un article paru dans la Revue Internationale du CCI n°2 : "Les leçons de la Révolution Allemande".
[2] [114] Il est d'ailleurs compréhensible pour ces vestales dégénérées du "Parti Communiste International", de camoufler leur vertu léniniste derrière de calomnieuses insinuations, car c'est notamment deux scissions de ce même P.C.I., "Invariance" et le groupe danois "Kommunismen" qui remirent des textes de la Gauche Allemande en circulation.
* [115] (p. 313-314)
[3] [116] Ce texte est justement écrit par la scission du P.C.I. en 1972, "Kommunismen".
[4] [117] Extrait d'"Invariance" n° 8.
[5] [118] Extrait de la "Gauche Allemande".
Géographique:
- Allemagne [119]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [120]