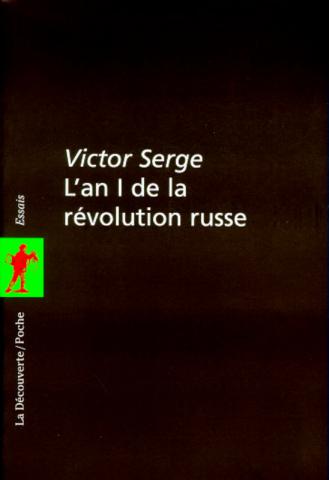Révolution internationale 2017 - n°462 - 467
- 1256 lectures
Révolution Internationale n°462 - janvier février 2017
- 991 lectures
Trump président: la marque d’un système social moribond
- 1028 lectures
Au crépuscule de l’ancienne Rome, les empereurs fous étaient davantage la règle que l’exception. Peu d’historiens doutent désormais que c’était le signe de la décrépitude générale de l’Empire. Aujourd’hui, un clown effrayant a été fait roi de l’État le plus puissant du monde, et pourtant personne ne semble comprendre que c’est le signe que la civilisation capitaliste a également atteint un stade avancé de décadence. Le surgissement du populisme dans les épicentres du système, qui nous a apporté en un court laps de temps à la fois le Brexit et la victoire de Donald Trump, exprime le fait que la classe dominante est en train de perdre le contrôle de la machine politique qu’elle a durant des décennies utilisée pour contrôler la tendance naturelle du capitalisme à son propre effondrement. Nous assistons à une énorme crise politique, produite par la décomposition qui s’accélère de tout l’ordre social, du fait de la complète incapacité de la classe dominante à offrir à l’humanité une quelconque perspective pour le futur. Mais le populisme est aussi un produit de l’incapacité du prolétariat, la classe exploitée, à mettre en avant une alternative révolutionnaire, avec pour résultat qu’il existe un grave danger d’être entraîné dans une réaction basée sur la rage impuissante, la peur, la transformation de minorités en boucs émissaires, et l’illusoire recherche d’un retour à un passé qui n’a jamais vraiment existé. Cette analyse des racines du populisme en tant que phénomène global est développée plus profondément dans notre article : “Contribution sur le problème du populisme”, et nous encourageons tous nos lecteurs à examiner le cadre qu’offre ce texte, ainsi que notre réponse initiale au résultat du Brexit et à l’émergence de la candidature Trump : “Brexit, Trump : des revers pour la bourgeoisie qui ne présagent rien de bon pour le prolétariat”. Ces deux textes sont parus dans la Revue internationale no 157.
Nous avons également publié un article de notre sympathisant américain Henk (article disponible sur le site internet du CCI) : “Trump ou Clinton : aucun des deux n’est un bon choix, ni pour la bourgeoisie, ni pour le prolétariat”. Cet article écrit début octobre examinait les efforts frénétiques des fractions les plus “responsables” de la bourgeoisie américaine, aussi bien démocrates que républicaines, pour empêcher Trump d’accéder à la Maison Blanche 1. Ces efforts ont évidemment échoué, et l’une des causes les plus immédiates de cet échec restera l’incroyable intervention du directeur du FBI, James Comey, juste au moment où Clinton semblait prendre l’avantage dans les sondages. Le FBI, le véritable cœur de l’appareil d’État américain, a lourdement obéré les chances de Clinton de l’emporter en annonçant qu’elle pourrait faire l’objet d’une enquête criminelle du FBI, lequel menait des investigations sur l’usage qu’elle avait fait d’un serveur de mail privé, ce qui allait à l’encontre des principes les plus élémentaires de la sécurité de l’État. Une semaine plus tard, Comey tentait de revenir en arrière en annonçant qu’il n’y avait rien de bien fâcheux dans les éléments que le FBI avait examinés. Mais le mal était fait, et le FBI apportait une contribution majeure à la campagne de Trump, dont les soutiens ont chanté à tue-tête le slogan : “Enfermez-la” 2. L’intervention du FBI n’est qu’une nouvelle expression de la croissante perte de contrôle politique de l’appareil d’État central.
Les communistes ne se battent pas pour le moindre mal
L’article “Trump ou Clinton” commence par réaffirmer clairement la position communiste sur la démocratie bourgeoise et les élections dans la période historique que nous vivons : elles ne sont qu’une gigantesque escroquerie qui n’offre aucun choix pour la classe ouvrière. Peut-être est-ce au cours de cette élection que l’absence de choix a été la plus remarquable, un combat entre le bateleur Trump, arrogant, ouvertement raciste et misogyne, et Clinton qui personnifie l’ordre “néo-libéral”, la forme dominante de capitalisme d’État qui règne depuis trois décennies. Confrontée à un choix entre la peste et le choléra, une part importante de l’électorat, comme c’est toujours le cas dans les élections américaines, n’est pas allée voter du tout ; une estimation initiale de la participation donnait un chiffre d’un peu plus de 54 %, en-dessous de celui de 2012 malgré toutes les pressions pour aller voter. En même temps, beaucoup de ceux qui étaient critiques vis-à-vis des deux camps, notamment de celui de Trump, ont voulu voter Hillary pour choisir le moindre mal. Nous savons quant à nous que s’abstenir d’aller voter aux élections bourgeoises juste parce qu’on n’a aucune illusion sur le choix proposé n’est que le début de la sagesse : il est essentiel, bien que ce soit très difficile lorsque la classe n’agit pas en tant que classe, de montrer qu’il existe une autre façon d’organiser la société, et qu’elle passe par la destruction de l’État capitaliste. Et dans cette période post-électorale, ce rejet de la politique et de l’ordre social existants, cette insistance sur la nécessité pour la classe ouvrière de se battre pour ses intérêts propres en dehors et contre la prison que constitue l’État bourgeois, ne sont pas moins pertinents, parce que beaucoup iront plus loin que le simple réflexe anti-Trump, qui n’est qu’une sorte d’antifascisme revu et corrigé (3 et ne pourra à terme que s’aligner sur l’une ou l’autre faction “démocratique” de la bourgeoisie, très probablement avec celles qui parleront le plus de classe ouvrière et de socialisme, comme Bernie Sanders l’a fait au cours des primaires démocrates 4.
La base sociale du trumpisme
Il n’est pas ici question d’analyser en détail les motifs et la composition sociale de l’électorat de Trump. Il n’y a aucun doute que la misogynie, la rhétorique anti-femmes qui a été si centrale dans sa campagne, a joué un rôle et devrait faire l’objet d’une étude particulière, notamment en tant qu’élément du “retour du masculin” en réaction aux changements sociaux et idéologiques dans les relations de genres au cours de la dernière décennie. De la même façon, nous avons assisté à un sinistre développement du racisme et de la xénophobie dans tous les pays centraux du capitalisme, et cela a joué un rôle clé dans la campagne de Trump. Il existe cependant des éléments particuliers au racisme aux États-Unis qui doivent être analysés : à court terme, la réaction à la présidence d’Obama et la version américaine de la “crise des migrants”, à long terme tout l’héritage de l’esclavagisme et de la ségrégation. Au vu des premiers résultats électoraux, on peut entrevoir la longue histoire de la division raciale aux États-Unis dans le fait que le vote pro-Trump était très largement blanc (même s’il a mobilisé un nombre très significatif d’Hispaniques) alors qu’autour de 88 % des électeurs noirs ont choisi le camp Clinton. Nous reviendrons sur ces questions dans de futurs articles.
Mais ainsi que nous le disons dans notre contribution sur le populisme, nous pensons que l’élément peut-être le plus important de la victoire de Trump a été la rage contre l’“élite” néo-libérale, elle-même identifiée à la globalisation et à la financiarisation de l’économie, des processus macro-économiques qui ont enrichi une petite minorité aux dépends de la majorité, et avant tout aux dépends de la classe ouvrière des vieilles industries manufacturières et minières. “Globalisation” a signifié démantèlement des industries manufacturières et leur transfert vers des pays comme la Chine où la main-d’œuvre est beaucoup moins chère et le profit par conséquent bien plus élevé. Cela a également signifié la “liberté de circulation du travail”, ce qui pour le capitalisme est un autre moyen de faire baisser les coûts de la main-d’œuvre à travers la migration des pays “pauvres” vers les pays “riches”. La financiarisation a signifié pour la majorité la domination de lois du marché toujours plus mystérieuses dans la vie économique. Plus concrètement cela a signifié le krach de 2008 qui a ruiné tant d’investisseurs et d’aspirants propriétaires.
Encore une fois, il faudrait des études statistiques plus détaillées, mais il apparaît que la base électorale de la campagne de Trump était le soutien de blancs peu éduqués et notamment d’ouvriers de la “Rust Belt”, les nouveaux déserts industriels qui ont voté Trump pour protester contre l’ordre politique établi, personnifié par la soi-disant “élite libérale métropolitaine”. Beaucoup de ces mêmes ouvriers ou régions avaient voté pour Obama lors des précédentes élections, et ont soutenu Bernie Sanders lors des primaires démocrates. Leur vote était avant tout un vote contre ; contre l’inégalité de plus en plus grande, contre un système dont ils considèrent qu’il les a privés, eux et leurs enfants, de tout futur. Mais cette opposition avait surtout pour arrière-plan l’absence totale de tout mouvement réel de la classe ouvrière, et elle a donc nourri la vision populiste qui reproche aux élites d’avoir vendu le pays à des investisseurs étrangers, d’avoir donné des privilèges particuliers aux migrants, aux réfugiés et aux minorités ethniques, aux dépends de la classe ouvrière “native”, et aux ouvrières aux dépends des ouvriers masculins. Les éléments racistes et misogynes du trumpisme marchent main dans la main avec les attaques rhétoriques contre les “élites”.
Trump au pouvoir : pas une bonne affaire
Nous n’allons pas spéculer sur ce que sera la présidence Trump ou quelle politique il va essayer de mener. Ce qui caractérise Trump avant tout est son imprévisibilité, il ne sera donc pas facile de prévoir les conséquences de son règne. Cependant, si Trump pouvait raconter tout et son contraire à tout bout de champ sans que cela ne semble aucunement affecter ses soutiens, ce qui a marché pendant la campagne risque de ne pas fonctionner aussi bien une fois aux affaires. Ainsi Trump s’est-il présenté lui-même comme l’archétype du self-made-man, et il parle de libérer le businessman américain de la bureaucratie, mais il a aussi parlé d’un programme massif de restauration des infrastructures dans les centres-villes, de constructions de routes, d’écoles et d’hôpitaux, et de revitalisation de l’industrie des carburants fossiles en abolissant les limites imposées par la protection environnementale, et tout cela implique une intervention lourde de l’État capitaliste dans l’économie. Il s’est engagé à expulser des millions d’immigrants illégaux, alors même qu’une grande part de l’économie américaine dépend de cette main-d’œuvre bon marché. En matière de politique étrangère, il a combiné le langage de l’isolationnisme et du retrait (par exemple en menaçant de réduire l’engagement américain dans l’OTAN) à celui de l’interventionnisme, comme lorsqu’il menaçait de “bombarder le diabolique État islamique”, tout en promettant d’augmenter les budgets militaires.
Ce qui semble certain, c’est que la présidence de Trump sera marquée par des conflits, aussi bien au sein de la classe dominante qu’entre l’État et la société. Il est vrai que le discours de victoire de Trump était un modèle de réconciliation : il sera le “président de tous les Américains”. Et Obama, avant de le recevoir à la Maison Blanche, a expliqué qu’il souhaitait que la transition soit la plus douce possible. De plus, le fait qu’il y a maintenant une large majorité républicaine au Sénat et au Congrès peut signifier, si l’establishment républicain réussit à dépasser sa profonde antipathie envers Trump, qu’il sera capable d’avoir leur soutien pour un certain nombre de décisions, même si les plus démagogiques pourraient bien être mises en attente. Mais les signes de tensions et d’éclats futurs ne sont pas difficiles à voir. Une partie de la hiérarchie militaire, par exemple, est très hostile à certaines options de politique étrangère, si Trump persiste dans son scepticisme envers l’OTAN, ou s’il traduit son admiration de Poutine en tentatives de saper les efforts américains pour contrer la dangereuse résurgence de l’impérialisme russe en Europe de l’Est ou au Proche-Orient. Certaines de ses options de politique intérieure pourraient bien entraîner une opposition de l’appareil sécuritaire, de la bureaucratie fédérale et de certaines parties de la grande bourgeoisie, lesquels pourraient décider de s’assurer que Trump ne les mène pas au suicide. Entre-temps, la disparition politique de la “dynastie Clinton” permettra à de nouvelles oppositions d’émerger, et entraînera peut-être des scissions au sein du Parti démocrate, avec l’émergence probable d’une aile gauche autour de personnalités comme Bernie Sanders qui vont chercher à capitaliser sur l’atmosphère d’hostilité envers l’establishment économique et politique.
Au niveau social, si la Grande-Bretagne de l’après-Brexit peut donner un aperçu, nous verrons probablement une sinistre floraison de xénophobie “populaire” et de groupes ouvertement racistes qui vont se sentir encouragés à réaliser leurs fantasmes de violence et de domination ; en même temps, la répression policière contre les minorités ethniques pourrait bien atteindre de nouveaux sommets. Et si Trump commence sérieusement à réaliser sont programme d’emprisonnement et d’expulsion des “illégaux”, cela pourrait provoquer des résistances de rues, en continuité avec des mouvements que nous avons vus se développer ces dernières années à la suite des meurtres de Noirs par la police. De même, depuis que le résultat de l’élection a été proclamé, on a vu toute une série de manifestations de colère dans différentes villes à travers tous les États-Unis, auxquelles ont participé des jeunes absolument écœurés par la perspective d’un gouvernement mené par Trump.
L’impact international
Au niveau international, la victoire de Trump ressemble, comme il l’a dit lui-même, à un “Brexit plus plus plus”. Elle a déjà donné une impressionnante impulsion aux partis populistes de droite en Europe occidentale, déjà au Front national en France alors que se profilent les élections présidentielles de 2017. Ces partis veulent se retirer des organisations multilatérales du commerce et mettre en place un protectionnisme économique. Les déclarations les plus agressives de Trump ont été dirigées contre la compétition économique chinoise, et cela peut signifier que nous sommes embarqués dans une guerre économique, ce qui, comme dans les années 30, contracterait encore un marché mondial déjà saturé. Le modèle néo-libéral a bien servi le capitalisme mondial au cours des deux dernières décennies, mais il approche maintenant de ses limites, et ce qui nous attend ensuite est porteur du danger que la tendance au “chacun pour soi” que nous avons vue se développer au niveau impérialiste ne soit transférée à la sphère économique, où jusqu’à présent elle a été plus ou moins tenue en échec. Trump a ainsi déclaré que le réchauffement climatique est un mensonge inventé par les Chinois pour soutenir leur exportations, et qu’il a l’intention de dénoncer tous les accords internationaux actuels sur le changement climatique. Nous savons déjà combien ces accords sont limités, mais les ruiner signifierait nous plonger encore plus profondément dans le désastre écologique mondial qui s’annonce.
Nous le répétons : Trump symbolise une bourgeoisie qui a véritablement perdu toute perspective pour la société actuelle. Sa vanité et son narcissisme ne signifient pas qu’il soit lui-même fou, mais il personnifie la folie d’un système qui a usé toutes ses options, sauf celle de la guerre mondiale. Malgré sa décadence, la classe dominante depuis un siècle a été capable d’utiliser ses propres appareils politique et militaire – en d’autres termes, son intervention consciente en tant que classe – pour empêcher une complète perte de contrôle, un dernier effort face à la tendance inhérente au capitalisme de se précipiter vers le chaos. Nous allons maintenant montrer les limites de ce contrôle, même s’il ne faut pas sous-estimer la capacité de notre ennemi de trouver de nouvelles solutions temporaires. Le problème pour notre classe est que l’évidente banqueroute de la bourgeoisie à tous les niveaux – économique, politique, moral – ne génère pas, à l’exception du tout petit groupe de révolutionnaires, de critique révolutionnaire du système, mais est plutôt dévoyée dans la rage et le poison de la division dans nos rangs. Cela entraîne une sérieuse menace pour la possibilité future de remplacer le capitalisme par une société humaine.
Cependant, l’une des raisons pour lesquelles la guerre mondiale n’est pas possible aujourd’hui, malgré la sévérité de la crise du capitalisme, est que la classe ouvrière n’a pas été défaite dans des combats ouverts et porte toujours des capacités intactes de résistance, ainsi que nous l’avons vu au cours de différents mouvements de masse au cours de la dernière décennie, comme la lutte des étudiants français en 2006 contre le CPE ou la révolte des Indignados en Espagne en 2011, ou encore le mouvement des Occupy aux Etats-Unis la même année. En Amérique, on peut distinguer les hérauts de cette résistance dans les manifestations contre les meurtres commis par la police et dans les manifestations anti-Trump qui ont suivi son élection, même si ces mouvements n’ont pas pris de réel caractère de classe et sont très vulnérables à la récupération par des politiciens professionnels de gauche, par différentes catégories de nationalistes ou par l’idéologie démocratique. Pour que la classe ouvrière puisse dépasser à la fois la menace populiste et la fausse alternative offerte par l’aile gauche du capital, il faut quelque chose de plus profond, un mouvement d’indépendance prolétarienne qui soit capable de se comprendre lui-même comme mouvement politique et qui puisse se réapproprier les traditions communistes de notre classe. Ce n’est pas pour l’immédiat, mais les révolutionnaires ont aujourd’hui un rôle à jouer pour préparer un tel mouvement, avant tout en combattant pour la clarté politique et théorique qui peut éclairer le chemin à travers le brouillard de l’idéologie capitaliste sous toutes ses formes.
Amos, 13 novembre 2016
1 Un exemple pour montrer à quel point l’opposition républicaine à Trump est développée : l’ancien président George W. Bush lui-même, pourtant pas vraiment membre de la gauche du parti, a annoncé qu’il voterait blanc plutôt que Trump.
2 Lock her up en anglais.
3 Notre rejet de la politique d’alliances “antifascistes” avec quelque secteur de la classe dominante que ce soit est un héritage de la Gauche communiste d’Italie, qui a très correctement compris que l’antifascisme n’était qu’un moyen d’embrigader la classe ouvrière dans la guerre. Lire : “Antifascisme : une expression de confusion”, un texte de la revue Bilan republié dans la Revue internationale no 101.
4 Pour aller plus loin sur Sanders, lire l’article : “Trump ou Clinton”.
Personnages:
- Donald Trump [3]
Récent et en cours:
Attentat en Allemagne: barbarie terroriste, terreur d’État
- 1062 lectures
Le 19 décembre dernier, un terroriste fonçait en camion sur une foule déambulant au marché de Noël de Berlin, causant 12 morts et environ 50 blessés. Le conducteur, Anis Amri, un jeune migrant embrigadé par l’État islamique (EI), était abattu quatre jours plus tard par la police milanaise.
Ce carnage n’est évidemment pas sans rappeler l’horreur de l’attentat de Nice et confirme le fait que les attaques sanguinaires deviennent une réalité quotidienne et sordide pour les populations des principales puissances capitalistes, comme elles le sont depuis plusieurs années dans de nombreuses autres régions du monde 1. Ces derniers jours, la vie de dizaines de personnes a aussi été fauchée en Turquie et en Irak. En 2016, on dénombre pas moins de quatre attentats et attaques revendiqués par l’EI rien qu’en Allemagne ; l’organisation terroriste cherchait visiblement à frapper un grand coup au cœur de la première puissance européenne, symbole d’une certaine stabilité et prospérité. La barbarie d’un monde capitaliste putréfié, où des régions entières pataugent dans les trafics les plus glauques, les guerres les plus sales et la terreur permanente, se répand désormais dans une Europe jusqu’alors présentée comme un “havre de paix” depuis 1945. Non seulement le chaos impérialiste mondial, auquel les bourgeoisies occidentales contribuent grandement, frappe à présent le cœur historique du capitalisme, mais nous assistons également à l’explosion de la violence accumulée et intériorisée par une partie de la population locale, comme l’ont attesté les précédents attentats en France ou en Belgique, par exemple.
Cet effroyable événement pourrait, par ailleurs, être un facteur supplémentaire de fragilisation de l’appareil politique allemand. En campagne pour, selon toute vraisemblance, conserver la chancellerie fédérale, Angela Merkel est néanmoins contestée jusque dans son propre camp pour sa politique d’accueil des migrants en 2015. Le parti populiste Alternative für Deutschland (AfD) et les factions les plus droitières de la coalition autour de la CDU ont cherché à se renforcer en brandissant le parcours de migrant d’Anis Amri qui confirmerait, selon eux, que des djihadistes se sont bel et bien infiltrés dans les flux migratoires et représenteraient un danger pour le pays. Au-delà des frontières allemandes, l’attentat pourrait contribuer à déstabiliser un peu plus le jeu démocratique des États européens, d’autant plus que le terroriste a pu tranquillement circuler dans plusieurs pays avant d’être abattu.
L’acte barbare perpétré par Anis Amri exprime ainsi par bien des aspects la déliquescence du capitalisme que la bourgeoisie a néanmoins su exploiter pour renforcer l’encadrement totalitaire de la population et justifier la fuite en avant militariste, mal nommée “lutte contre le terrorisme”.
Un prétexte pour renforcer le totalitarisme d’État...
Derrière les élans de solidarité hypocrite des chefs d’État du monde entier, l’attentat du 19 décembre a surtout permis de justifier partout le renforcement de la surveillance généralisée de la population et de l’appareil répressif. Alors que le terroriste n’était pas encore arrêté, la presse du monde entier n’a ainsi pas trouvé de mots assez durs pour incriminer les “failles de l’antiterrorisme allemand”, dénonçant, pêle-mêle, la faible présence de la police dans les rues de Berlin, l’inertie des services de renseignement ou les défaillances de la coopération internationale en la matière. Il est vrai que le traumatisme du nazisme et des méthodes de la Stasi contraint la police à une certaine discrétion, mais l’Allemagne compte, comme ses voisins européens, plusieurs centaines de milliers de policiers et dépenses des dizaines de milliards d’euros pour maintenir l’ordre et assurer la “sécurité nationale”. Les services secrets connaissaient d’ailleurs parfaitement la menace que représentait Anis Amri, déjà fiché et surveillé.
La méfiance de la population en Allemagne sur les mesures sécuritaires n’a néanmoins pas suffi à empêcher l’État d’instrumentaliser l’émotion et les peurs. Angela Merkel déclarait ainsi : “Nous allons à présent examiner de manière intensive ce qui doit être changé dans l’arsenal des mesures dont dispose l’État”. Aussitôt, au nom de “la défense de notre mode de vie et de nos libertés”, les forces de l’ordre étaient massivement déployées dans tout le pays sous l’œil des caméras des journaux de télévision du monde entier.
Le renforcement spectaculaire des services de renseignement et de la surveillance généralisée était également mis ouvertement à l’ordre du jour. Initiée par les États-Unis et leur Patriot Act, suite aux attentats du 11 septembre 2001, la mise en place de dispositifs sécuritaires exceptionnels a fait école dans l’ensemble des grandes démocraties. Ces mesures, qui font souvent passer la Stasi ou le KGB pour une bande d’amateurs, n’ont finalement jamais freiné le développement du terrorisme. En réalité, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une expansion du contrôle totalitaire de l’État confronté au pourrissement sur pied de la société où n’importe quel paumé peut se transformer en boucher, n’importe quelle bande de supporters en horde ultra-violente, n’importe quelle frustration littéralement exploser dans les lieux publics.
Toutefois, si le renforcement sécuritaire ne répond aujourd’hui à aucune menace révolutionnaire immédiate, il n’en constitue pas moins un coup porté à l’avenir de la classe ouvrière. A terme, outre leur banalisation dans les esprits, ces mesures auront pour effet d’intimider, criminaliser et réprimer toute expression sérieuse de remise en cause des rapports sociaux capitalistes, et même toute forme de révolte contre la dégradation toujours plus insoutenable des conditions de vie.
… et justifier la fuite en avant impérialiste
Les gouvernements des grandes puissances ont par ailleurs profité des attentats pour rajouter une couche sur la prétendue nécessité d’intervenir militairement contre l’EI au nom de la “protection de la population”.
Quel grossier mensonge ! Les grandes puissances impérialistes jouent elles-mêmes un rôle absolument central dans la descente de la planète dans l’enfer guerrier permanent ; elles instrumentalisent n’importe quel seigneur de guerre pour la défense de leurs intérêts impérialistes (comme en Syrie où au moment des “révolutions arabes” les puissances occidentales ont soutenu ou armé des groupes islamistes opposants), sont prêtes à s’adjoindre les services du premier groupuscule fondamentaliste venu, et il faudrait soutenir leur “croisade contre le terrorisme” parce qu’elles n’ont rien d’autre à offrir que la fuite en avant guerrière pour tenter vainement de freiner la dynamique chaotique qu’elles ont largement contribué à créer ? Les ancêtres de Al-Qaïda, qui vient de se prendre une raclée par l’armée russe à Alep, n’étaient-ils pas des alliés choyés par les États-Unis dans leur lutte contre l’URSS ? L’EI n’a-t-il pas émergé grâce au soutien actif de l’Arabie saoudite à qui la France n’a pas hésité à vendre armes et avions de guerre pour 10 milliards ? En réalité, la bourgeoisie n’ignore pas que toutes les interventions militaires “contre le terrorisme” continueront à engendrer plus de chaos, plus de terroristes et de bigots fanatiques. Elles sont prises au piège d’un machine infernale, celle de la logique meurtrière du capitalisme, que seule la révolution prolétarienne pourra briser !
EG, 3 janvier 2016
1 Pour mieux comprendre le contexte dans lequel s’inscrit cette vague d’attentats au cœur des grandes puissances capitalistes, nous conseillons la lecture des articles suivants :
Géographique:
- Allemagne [8]
Récent et en cours:
- Terrorisme [9]
Rubrique:
Mort de Fidel Castro: en 2017 la bourgeoisie perdait l’un des siens
- 1269 lectures
Le 25 novembre dernier, Fidel Castro, le dictateur aux cinquante années de pouvoir, le dernier héraut du stalinisme, disparaissait à l’âge de 90 ans. Malgré des tonalités différentes, les hommages des représentants des principales puissances capitalistes, d’Obama à Poutine, de Hollande à Assad, montrent à quel point le champion du stalinisme caribéen fut un agent actif de la bourgeoisie contre le prolétariat mondial durant des décennies. Les hommages les plus élogieux sont bien évidemment venus de la gauche du capital. A commencer par Jean-Luc Mélenchon qui le 26 novembre au soir, devant la statue de Simón Bolivar, s’est laissé aller à une apologie sans bornes de l’ancien dictateur, louant le “défenseur des opprimés”, soulignant les prouesses des médecins cubains auprès des peuples américains, mais passant sous silence les milliers de victimes et de persécutés ayant péri dans les prisons de l’île pour avoir dit ou écrit un mot de travers ou pour avoir eut le “malheur” d’avoir une orientation sexuelle “déviante” comme le raconta Reynaldo Arenas dans son ouvrage : Avant la nuit. Le leader de “la France insoumise” réduit ces faits à de simples “erreurs” et masque le macabre derrière un lyrisme de bas étage : “Fidel ! Fidel ! Mais qu’est-ce qui s’est passé avec Fidel ? Demain était une promesse. Fidel ! Fidel ! L’épée de Bolivar marche dans le ciel.” La classe dominante a toujours su reconnaître la valeur de ses chiens de garde. D’un autre côté, le futur président américain Donald Trump a “condamné” “le dictateur brutal qui a opprimé son peuple” et s’est engagé “à faire tout” pour libérer le peuple cubain. Pure hypocrisie dans la bouche d’un homme qui n’a que faire du sort des Cubains. En réalité, Trump n’a fait que s’opposer à la ligne politique de l’administration Obama tout en restant indécis sur la position qu’il adoptera sur la question cubaine, même si pour le moment, il s’est dit hostile à la levée de l’embargo commercial.
Même mort, Castro n’en finit pas de servir la falsification de la révolution et du communisme sous les traits du capitalisme d’État stalinien. Derrière les hommages plus ou moins bienveillants, les médias et le monde politique en profitent pour enfoncer le clou et drainer une nouvelle fois l’idée du caractère illusoire de la perspective révolutionnaire et du communisme. Car, prétend la bourgeoisie, tous les régimes apparus au xxe siècle en Russie et dans une partie de l’Est de l’Europe, en Chine ou bien encore à Cuba à partir de 1961, et qui, comme chacun sait, ont maintenu dans l’oppression des millions de personnes, prouveraient l’incapacité des hommes à dépasser l’exploitation et la domination d’une classe sociale sur une autre. La disparition de Fidel Castro serait donc une confirmation de la mort de ce “communisme” après la chute du mur de Berlin en 1989 et la disparition de l’URSS en 1991. Au cours des années 1990, la bourgeoisie nous avait déjà servi la même soupe en claironnant la fin de l’histoire et la marche triomphale de l’humanité vers la démocratie et l’économie de marché. Bref, le bonheur à l’état pur ! Il va sans dire que l’histoire récente est venue bousculer quelque peu cet optimisme.
La bourgeoisie sait pertinemment que le régime castriste ne fut en rien communiste, que les classes sociales n’ont pas été abolies, que les moyens de production n’ont jamais été aux mains des producteurs mais ont servi à enrichir et entretenir une cour d’apparatchiks aux ordres du lider máximo, à la table duquel rien ne manquait à l’inverse de celle des habitants de Cuba. Comme l’URSS ou la République populaire de Chine en leur temps, Cuba reste un régime où les moyens de production sont concentrés presque totalement entre les mains de l’État. Ainsi, la “révolution” cubaine n’a jamais mis fin à la loi de la valeur ni à l’exploitation salariale. De même, Castro n’a jamais eu la volonté d’abolir l’État bourgeois. Au contraire, il l’a utilisé pour maintenir sa clique au pouvoir. Ainsi, derrière le mythe de “l’État ouvrier” se cache la réalité du capitalisme d’État, cette tendance propre à la décadence capitaliste identifiée au début du xxe siècle par d’authentiques révolutionnaires et qui n’a cessée de s’affirmer par la suite.
Fidel Castro ou l’antithèse du combat révolutionnaire
En réalité, le parcours de Fidel Castro n’a rien à voir avec le mouvement révolutionnaire. Fils illégitime d’un riche propriétaire terrien, il suivit une scolarité religieuse chez les maristes puis chez les jésuites et obtint les doctorats de droit et de sciences sociales en 1950. Durant ces années, il devient membre de la Fédération des étudiants de l’université, le syndicat gérant l’établissement. Puis en 1947, il adhéra au parti du peuple cubain, un parti ouvertement nationaliste. Il entama ensuite une carrière d’aventurier politique et de putschiste : tentative de renversement du dictateur Trujillo en Équateur en 1948, attaque de la caserne de la Moncada, le 26 juillet 1953, après s’être vu refuser le recours en justice qu’il avait déposé contre Batista pour viol de la Constitution. Après presque deux ans de prison, il est libéré et s’exile au Mexique où il rencontre Ernesto Guevara. Il part ensuite aux États-Unis où il récolte des fonds et crée le Mouvement du 26 juillet (M26). Il débarque à Cuba en décembre 1956 avec 82 hommes et engage une lutte armée contre le régime de Batista. Ce dernier était soutenu par les États-Unis, soucieux pour leurs intérêts commerciaux sur l’île et qui considéraient que le danger que pouvait faire peser le M26 sur le contrôle de cette région était maigre. Après trois ans de guérilla, Castro et ses partisans prennent le pouvoir au nom du “peuple cubain” sans que celui-ci n’ait joué un véritable rôle dans cette prétendue révolution. D’ailleurs, le Mouvement du 26 juillet ne s’est jamais revendiqué du marxisme et de la révolution communiste. Cette clique d’aventuriers agissait au nom du nationalisme et en cela, ils ne luttaient guère pour l’émancipation des travailleurs mais uniquement contre une dictature répressive et corrompue, étroitement liée à la mafia américaine et qui n’avait fait qu’accroître les inégalités sociales. En cela, le M26 ne mettait pas en péril la viabilité de l’État cubain mais visait uniquement à le remodeler sous une apparence plus “démocratique”.
Ainsi, le putsch castriste se distingue nettement de la prise du palais d’Hiver en Octobre 1917 en Russie qui eut au sein des soviets l’assentiment et l’adhésion de milliers d’ouvriers impliqués dans le combat révolutionnaire qui, dépassant le cadre de la Russie, se considéraient comme un premier assaut de la révolution à l’échelle mondiale. C’est une légère différence que les idéologues bourgeois ne jugent pas utile de souligner lorsqu’ils font de la “révolution cubaine” un héritage du mouvement ouvrier. Ainsi, même si quelques éléments du mouvement du 26 juillet se revendiquaient, comme Guevara, d’un prétendu marxisme, la grande majorité, à commencer par Castro lui-même, en était ouvertement très éloignée. D’ailleurs, une fois au pouvoir, Castro reçut l’aide des États-Unis qui, voyant en lui un “humaniste”, ne semblait pas au départ gêner leurs prétentions impérialistes sur l’île cubaine. Les relations furent de courte durée puisque Castro refusa de mettre l’île sous perfusion américaine. Mais dans un contexte de renforcement des blocs, toute véritable indépendance d’un pays tiers était impossible. Très rapidement, Castro dû se ranger dans le camp soviétique afin de s’assurer un appui économique et militaire. La conversion de l’État au socialisme et l’adhésion soudaine au “marxisme-léninisme” consacrait en fait le mécanisme d’absorption de chaque État par l’un des deux camps impérialistes. C’est ainsi que Fidel Castro devint un chef stalinien parmi tant d’autres à cette époque.
Le mythe de la libération nationale
La légende de Castro se forgea avec la guerre froide. Depuis les années 1950, le stalinisme se présentait comme le bloc “progressiste” et “anti-impérialiste” en soutenant les “luttes de libération nationale”, prétendu passage direct vers le socialisme. En réalité, il s’agissait d’affirmer une politique strictement impérialiste. Ainsi, dès 1961-1962, Cuba devient un pion de l’URSS dans le jeu impérialiste qui opposait les deux blocs. En échange d’une aide économique et d’une reconnaissance diplomatique en Amérique centrale et du sud, Cuba servit de sergent et d’ambassadeur impérialiste de l’URSS en Afrique. Des contingents cubains furent enrôlés en Éthiopie, au Mozambique, au Yémen, en Zambie et surtout en Angola ou près de 40 000 soldats cubains assurèrent l’arrivée au pouvoir du MPLA et l’instauration d’un régime pro-soviétique. Pendant que Castro devenait le héraut de la lutte anti-impérialiste, l’URSS continuait à placer sous son aile une partie de l’Afrique.
Mais le mythe de Castro ne serait peut-être pas ce qu’il est sans la figure tutélaire d’Ernesto Guevara. Ce dernier est très souvent présenté comme un révolutionnaire, un internationaliste et un marxiste. En réalité, sa trajectoire est assez proche de son acolyte cubain. Même si Ernesto Guevara a pu se montrer critique ou distant vis-à-vis de l’URSS (au profit de la Chine maoïste), il n’en demeure pas moins qu’à travers ses épopées guerrières, le “Che” a toujours servi non pas l’internationalisme mais “l’anti-impérialisme” américain. Dans le monde bipolaire de la guerre froide, cela ne pouvait que l’amener à défendre les intérêts du camp soviétique. En effet, l’action politique du “Che” n’allait pas plus loin que la lutte à mort contre l’Amérique, ce qui ne pouvait que l’amener à théoriser la lutte nationale comme nec plus ultra du combat révolutionnaire. Lors de son fameux message à la Tricontinentale 1, il fit de la libération nationale “l’élément fondamental” de la lutte contre l’impérialisme. Or, depuis le début de la guerre froide, l’histoire nous a prouvé que ces mouvements, dans différents pays sous-développés, n’ont servi à rien d’autre qu’à la passation du pouvoir d’une clique bourgeoise à une autre. L’impérialisme est une nécessité vitale pour chaque État, petit ou grand. Ainsi, sa négation réside dans la lutte internationale contre le capitalisme dans son ensemble. A ce jour, aucune autre force sociale que le prolétariat conscient de ses buts n’a la potentialité de réaliser cette énorme tâche.
La mort de Castro n’améliorera pas la vie des cubains
Les aficionados du lider máximo n’ont pas hésité à saluer les “bienfaits” du régime pour la population cubaine, une population qui serait bien soignée et bien éduquée. Certes, les services médicaux ont été un des piliers de la politique du régime et les médecins et infirmiers de l’île sont connus pour leur savoir-faire en la matière. De même, Cuba présente l’un des taux d’alphabétisation les plus élevés du monde. Mais, en fait, derrière ces “avancées” se cache la réalité d’une population qui vit toujours dans la terreur et la pauvreté. Jusqu’en 1990, le pays recevait des subventions de l’URSS. La chute de la puissance protectrice et le blocus américain ont montré la supercherie de “l’économie socialiste planifiée”. Sans son argent de poche, le régime dût faire face à de gros problèmes budgétaires qu’il fit peser sur la population par la hausse des impôts et la restriction en biens alimentaires. Aujourd’hui, le livret de fourniture mensuel se résume à cinq œufs, 460 grammes de haricots, 2 kilos de sucre, 225 grammes d’huile, 450 grammes de poulet, 3 kilos de riz, 115 grammes de café, un paquet de pâtes et 225 grammes de “viande” de soja. Cela ne cesse de diminuer et tout autre approvisionnement s’effectue au marché noir. Voilà à quoi en est réduit le régime : contraindre drastiquement ses exploités à la pénurie alimentaire et à la débrouille (pour ceux qui peuvent échanger en dollars) afin ne pas perdre la face.
En fait, l’économie cubaine est fortement dépendante du tourisme, du pétrole vénézuélien et des subsides envoyés par les exilés cubains. Par ailleurs, la production de canne à sucre, principal secteur d’exportation, connaît une crise sans précédent. On voit bien là que les espoirs de “l’économie socialiste” sont loin d’avoir tenus leurs promesses et l’impasse de l’économie cubaine ne fait que le confirmer. Le successeur de Fidel Castro (son frère Raúl) a amorcé une libéralisation progressive de l’économie du pays. Mais cela ne peut qu’encourager la corruption, déjà prégnante dans plusieurs secteurs de l’État, ainsi que le développement d’un “capitalisme sauvage” qui soumettra la classe ouvrière à des conditions de travail et d’existence encore plus difficiles.
Le régime cubain doit gérer la succession de Castro face à une population jeune qui s’identifie peu à “l’héritage socialiste”. Raúl Castro a annoncé qu’il quitterait le pouvoir en 2018 et prévoit de mettre aux commandes Miguel Díaz-Canel qui incarne la jeune génération. Face au risque de naufrage économique, la bourgeoisie cubaine ne peut faire que s’ouvrir au marché mondial et alléger le poids de l’État dans le marché interne. Mais sur le long terme, cela pourrait amener à remettre en cause des décennies de propagande et prendre le risque de mettre en péril le “régime socialiste” à parti unique.
Joffrey, 1er décembre 2016
1 La Conférence de solidarité avec les peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine eut lieu du 3 au 15 janvier 1966 à La Havane. Elle incarne le fameux mouvement tiers-mondiste. Mais les différentes décisions prises lors de cette conférence ne visaient qu’à soutenir le camp soviétique en désignant l’impérialisme américain comme le principal ennemi.
Géographique:
Personnages:
- Fidel Castro [11]
Rubrique:
Espagne: qu’arrive-t-il au PSOE ?
- 1408 lectures
Nous publions ci-dessous de larges extraits d’un article de notre section en Espagne, disponible sur notre site en version originale [12].
PSOE signifie Parti socialiste ouvrier espagnol, mais ce parti n’a plus rien d’ouvrier ni de socialiste. C’est un parti de l’aile gauche du capital. Comme nous le disions lors du mouvement du 15-M (le mouvement des Indignés né le 15 mai 2011) : “PSOE et PP, c’est la même merde” ou “Entre les roses et les mouettes 1 on nous prend pour des gens bêtes”. Nous partageons cet effort de prise de conscience que des milliers de jeunes ouvriers ont exprimé sur les places et dans les rues. Le PSOE est un parti essentiel pour le capital espagnol ; en 40 années de démocratie, il a été plus de la moitié du temps à la tête du gouvernement. Le PSOE est responsable des attaques féroces que les travailleurs ont subies contre leurs conditions de vie pendant le long gouvernement de Felipe Gonzalez (1982-1996) et qui, entre autres souffrances, entraînèrent la destruction d’un million d’emplois. De la même manière, le gouvernement de Zapatero (2004-2011) entama la lourde et cruelle politique de coupes budgétaires sur tous les plans que l’actuel gouvernement [de droite] a poursuivit avec encore plus d’acharnement.
Ces derniers temps, la crise du PSOE est au centre de la scène politique. Il perd des voix à la pelle, ses dirigeants se déchirent dans une bagarre à mort, son Secrétaire général, Pedro Sanchez, a démissionné, ce qui l’a amené à perdre son siège de député… (…)
Avant tout, regardons les faits avec distance historique et internationale
Le PSOE est un parti très expérimenté. Tout au long de son histoire, il a dû affronter de profondes divisions en son sein, qui n’ont pas entravé son unité ni sa capacité à rendre de grands services au capital espagnol. Dans les temps proches, il a pu supporter avec habilité le choc frontal entre Alfonso Guerra et Felipe Gonzalez ou entre Borrell et Almunia. Le PSOE a donc une grande capacité pour gérer ses différentes fractions, autant pour mettre en avant des alternatives différentes pour le capital espagnol et ainsi mystifier le prolétariat que, plus prosaïquement, pour régler des conflits d’intérêt.
Ce savoir-faire du PSOE n’est pas dû à ses mérites particuliers, il le partage avec les autres partis socialistes. Le PS français semblait sur le point de disparaître dans les années 1960 mais, avec Mitterrand, il a su se redresser et conquérir le pouvoir de 1981 à 1995. Entre 2007 et 2011, il a aussi traversé une forte crise qui aurait pu, selon certains, creuser sa tombe, mais en 2012 il a repris le pouvoir avec Hollande.
Dans beaucoup de pays, les partis socialistes constituent la colonne vertébrale de l’État. Ils sont plus capables que d’autres partis de comprendre les intérêts communs de leur capital national et ils sont les plus aptes à contrôler les impulsions particulières de leurs différentes fractions.
Aussi ne doit-on pas négliger tout cela lorsqu’il s’agit d’analyser la fracture la plus récente au sein du PSOE, qui a produit des spectacles lamentables comme celui du Comité fédéral du 1er octobre 2. Nous sommes là face à une crise très grave, sans doute la pire des quarante dernières années, mais il faut aussi tenir compte de la capacité de résistance dont dispose l’appareil socialiste.
La décomposition capitaliste frappe de plein fouet le PSOE
Une des analyses fondamentales que nous défendons et qui concerne toute la société mondiale, est celle de la décomposition du capitalisme. En 1990 nous avons publié les “Thèses sur la décomposition” que nous pensons être toujours pleinement valables. Nous n’allons pas les expliquer ici. Nous insisterons simplement sur le fait que la décomposition est un processus général qui affecte l’ensemble des rapports sociaux capitalistes ainsi que la vie politique au sein de ce système.
On ne peut pas se contenter de parler de décomposition en général, nous devons aussi nous efforcer de comprendre lesquels de ses effets concrets jouent un rôle dans la situation politique du capital espagnol et plus concrètement du PSOE. Ceci nous amène à approfondir les points no 9 et 10 des “Thèses”, qui mettent en avant “la difficulté croissante de la bourgeoisie à contrôler l’évolution de la situation sur le plan politique”, ce qui se traduit, d’un côté, par un désordre croissant dans la cohésion et le fonctionnement des différents partis bourgeois, tiraillés par des tendances centrifuges et la mise en avant d’intérêts de faction. Et, d’un autre côté, par la difficulté pour piloter correctement les mécanismes électoraux ; plus globalement, de tout le jeu politique que la bourgeoisie n’arrive pas toujours à faire correspondre à ce dont elle a besoin 3.
Le désordre dans l’appareil du PSOE
Le spectacle d’intrigues, de chocs frontaux, de défis et de rebellions en abondance que le PSOE nous offre dernièrement peut s’expliquer en grande partie par trois phénomènes qui donnent une idée de l’impact de la décomposition capitaliste sur les partis bourgeois : la fragmentation des partis secoués par de puissantes tendances centrifuges ; l’assaut du parti par toute sorte d’aventuriers politiques ; l’appel à un “pouvoir de la base” par des politiciens ambitieux qui l’utilisent comme levier dans la lutte fractionnelle contre leurs adversaires.
a) La balkanisation du PSOE
En premier lieu, le PSOE souffre aujourd’hui d’un processus évident de balkanisation, chaque baron régional devient non seulement maître de son fief (échappant ainsi de plus en plus à la discipline imposée par le sommet du parti), mais, en outre, veut se payer le luxe de devenir un agent actif dans la recomposition de la politique nationale.
Ceci est vraiment du jamais vu. Dans les années 1930, face à la prolifération de tendances centrifuges, surtout en Catalogne, le PSOE fut en mesure de mettre en place une cohésion ferme contre ces dernières. Du temps de Gonzalez, les barons régionaux obéissaient avec discipline à ce qui était dicté par l’appareil et au-delà de quelques velléités localistes, il ne leur passait même pas par la tête l’idée de mener une politique propre. C’est ce que Guerra expliquait très graphiquement avec sa sentence : “celui qui bouge n’apparaîtra pas sur la photo”.
C’est Zapatero qui a commencé à jouer avec le feu, en faisant un pacte avec le PSC (le parti en Catalogne) vers le “catalanisme politique” qui n’a fait que nourrir les tendances centrifuges régionales. La direction nationale, avec pas mal de difficultés, réussit cependant à les contenir en remplaçant les petits chefs trop ambitieux comme Chaves (en Andalousie) et Rodriguez Ibarra (Estrémadure) ou en les propulsant vers le haut, comme avec Bono (Castille-La Manche).
Aujourd’hui, chaque fédération régionale du PSOE est entre les mains d’un “baron” qui fait ce qui lui plaît sur son domaine, conditionnant la politique centrale avec des alliances, des chantages et des manœuvres en tout genre. L’emprise de la baronne andalouse (Susana Diaz) et de ses alliés est écrasante et cette mainmise n’est pas menée avec une vision nationale unitaire mais comme une somme d’alliances régionales. (...)
b) Les politiciens “aventuriers”
Un deuxième facteur de dislocation et de désordre est le poids de l’aventurisme politique dans le parti. En général, les partis socialistes sont capables d’élire comme secrétaire général des politiciens obéissant aveuglement aux impératifs de l’appareil, même si, bien entendu, ces élus ont leurs propres aspirations. Mais cela a commencé à changer avec les exemples de Blair en Grande-Bretagne et de Schroeder en Allemagne, des outsiders qui se sont emparés du commandement en imposant leur charisme et en déstabilisant l’appareil en plaçant leurs affidés. Le même phénomène est flagrant du côté de la droite : Trump a échappé au contrôle du parti républicain, soulignant ainsi l’impuissance de ses dirigeants traditionnels.
Ce phénomène s’est aussi manifesté en Espagne avec Zapatero, lequel, aidé par une bande d’inconnus hors du noyau central de la vieille garde, surent le hisser au sommet en écartant Bono, choisi par le parti, lequel n’était pas non plus très fiable à cause de ses propres ambitions localistes.
Et cela vient de se répéter avec Pedro Sanchez. Celui-ci n’était pas du tout connu, pas seulement sur la scène politique, mais même au sein de son propre parti. Sanchez réussit à se présenter au secrétariat général du PSOE comme un “homme de paille” pour Susana Diaz et la vieille garde. Dans une espèce de jeu de coquins, tous ont cru qu’il allait être facilement manipulable. Mais dès qu’il a pris les rênes, il a commencé à jouer ses propres cartes, en déclenchant des tensions autant au niveau des leaders régionaux que du noyau central.
Le fait que, d’abord Zapatero et Sanchez par la suite, arrivent à s’imposer contre l’appareil par des coups de main habiles, de façon improvisée et sans la moindre orientation politique propre (si ce n’est celle de se maintenir au pouvoir à tout prix) est révélateur du degré de fracture et de désorientation qui règne au sein des partis socialistes. Autant l’incapacité de l’appareil lui-même que le poids de ces arrivistes portent tous deux la marque de la décomposition.
c) La démagogie du “pouvoir de la base”
Sanchez a introduit un troisième élément de perturbation de la politique et d’organisation du parti.
Malgré son anarchie apparente (il y a toujours des “familles” et des “tendances” qui se chamaillent), le PSOE (comme la plupart des partis socialistes) a fonctionné comme un engrenage bien huilé depuis le sommet jusqu’au groupement local le plus éloigné. Sanchez a mis en place un précédent très dangereux qui pourrait avoir des conséquences bien fâcheuses. Pendant deux ans, il s’est consacré à un travail presque clandestin de visites aux regroupements de base de tout le territoire national, de telle sorte que cette “mobilisation de la base” a été le fondement de son pouvoir au sein du parti et le moyen qu’il a employé à répétition pour faire du chantage à ses rivaux. Le problème c’est qu’une telle structure de pouvoir est très dangereuse parce qu’elle modifie en profondeur l’équilibre d’un appareil qui impose une subordination rigoureuse du syndicat (UGT) et des regroupements locaux aux impératifs du centre. Avec Sanchez, ce sont trois structures de pouvoir qui mettent en péril de tous les côtés la fragile cohésion du parti : le groupe de la vieille garde (Gonzalez et Rubalcaba), les baronnies régionales (avec Diaz à leur tête) et “le pouvoir de la base”, nouveau facteur d’anarchie.
Qu’est-ce que tout cela montre ? L’expression au sein du PSOE de phénomènes de plus en plus généralisés dans la société : le chacun pour soi, la prédominance de l’intérêt particulier sur l’intérêt général, l’enfermement endogamique dans des particularismes locaux, raciaux, de bande, etc. Cela se concrétise dans les partis politiques bourgeois par la rupture de la soumission aveugle aux impératifs du centre. Une telle tendance rend difficile pour les partis leur travail de gestion et de défense de l’intérêt national du capital, en semant encore plus de chaos et de désordre dans la vie politique et sociale.
Des réponses à l’usure du PSOE qui aggravent les problèmes
Le PSOE, comme l’ensemble des partis socialistes, a souffert d’une profonde usure. La cause en est l’engagement sans faille de ce parti dans l’application des mesures anti-ouvrières brutales dont nous avons parlé plus haut. Le mouvement du 15-M montra une prise de conscience de ce fait, en dénonçant le PSOE comme parti “du régime” complément indispensable du PP. Le PSOE a perdu des milliers de voix et cette saignée est particulièrement forte dans les villes : il a perdu 55% du vote urbain. Chez les jeunes aussi, lors des dernières élections, il est arrivé à peine à obtenir le vote de 4% des nouveaux électeurs. Un deuxième facteur de cette usure est le fait que les socialistes, malgré leur souplesse, sont trop reliés aux politiques keynésiennes classiques, ce qu’on pourrait appeler la “deuxième phase historique de capitalisme d’État” (1930-80) 4, caractérisée par le protectionnisme du marché national et les politiques “sociales”. Le passage, depuis les années 1980, à ce qu’on peut appeler “troisième phase du capitalisme d’État”, qui se définit, d’une façon schématique, par la “libéralisation” et la “globalisation”, les a pris à contre-pied et cela a été difficile pour eux de justifier la suite implacable des attaques que ces orientations impliquent en psalmodiant des discours truffés de mesures de “politique sociale ou sociétale”. Cela les a piégés dans un dilemme avec une solution plus que difficile qui leur a fait perdre de leur influence. D’un autre côté, les socialistes ne peuvent pas renoncer au contrôle de la classe ouvrière (étant responsables des syndicats les plus importants), ce qui les oblige à maintenir un discours de “politique sociale” en lien avec le keynésianisme. Et ce sont, en même temps, des partis de gouvernement, indispensables dans le bipartisme des pays démocratiques. Ils risquent de manquer de cohérence dans leur discours, autant pour gouverner que pour être dans l’opposition.
(...) Le PSOE occupe deux espaces difficilement compatibles. C’est un parti avec des responsabilités gouvernementales, mais, en même temps, il doit ‘‘être la voix de ceux qui n’en ont pas”. S’il renonce à celle-ci et se consacre exclusivement à la gestion gouvernementale en apparaissant comme le canal des intérêts économiques du capital, il se place sur un terrain où la droite gagnera toujours. Mais si, pour défendre son deuxième espace, qui est vital pour lui, il essaye d’ouvrir les portes à certaines rengaines populistes du genre de celles utilisées par Podemos, avec un certain succès 5, il va à l’encontre de l’intérêt général de la bourgeoisie espagnole qui cherche à barrer le plus possible le passage aux populismes qui frappent aujourd’hui des pays centraux comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Iglesias, leader de Podemos, et sa suite ont une habilité certaine dans le maniement des thèmes populistes, mais il n’est pas évident que ce soit le cas pour Sanchez et les siens, ce qui l’amène à créer des problèmes graves au sein du PSOE.
L’échec de l’opération de ravalement du bipartisme
Pendant plus d’un demi-siècle, les principales démocraties ont organisé la tendance au parti unique, qui est le propre du capitalisme d’État, par le biais du bipartisme, en tenant les commandes à tour de rôle, avec un parti penchant vers la droite et l’autre vers la gauche.
Le mécanisme bipartite est très usé un peu partout. Ce n’est pas le lieu ici de faire une analyse des causes de cette usure, mais ce qui est certain c’est que, ces dernières années, la bourgeoisie espagnole a mis en route une opération politique pour affronter la crise du bipartisme. Un facteur qui sans doute a influencé cette mise en route est la prise de conscience que le 15-M a exprimée et qui avait amené à une critique très dure du PSOE.
Cette opération politique consistait à faire émerger, à partir de pratiquement rien, deux partis, l’un à droite, Ciudadanos, et l’autre à gauche, Podemos 6, appelés à renouveler l’appareil politique, peut-être en servant d’aiguillon aux deux de toujours, peut-être pour les remplacer s’il le fallait. Mais l’opération n’a pas eu le succès escompté et est en train de causer des ravages importants. Ceci met en évidence le fait que les manœuvres d’ingénierie politique et électorale ne sont pas si faciles que cela en ces temps de décomposition.
Les élections de décembre 2015 n’ont pas produit l’option souhaitée. Il a fallu les répéter en juin 2016. Celles-ci n’ont pas produit non plus le résultat qu’on en attendait et, qui plus est, elles menaçaient d’affaiblir tous les partis, excepté le PP, un parti que pourtant on essayait de “reformer” en se débarrassant du fardeau d’une corruption qui a atteint des niveaux infamants. Au contraire, si on avait continué à répéter les élections, le PP aurait pu obtenir une écrasante majorité absolue.
En fait, le ravage le plus important a été la crise du PSOE. Le résultat électoral de juin a mis uniquement sur ses épaules la responsabilité “d’assurer la gouvernabilité du pays” en livrant le pouvoir au PP. Cela signifie lancer un missile sur un PSOE déjà très affaibli pour toutes les raisons que nous avons mis en avant.
(…) La “rénovation du bipartisme” est en train de finir en fiasco pour le capital espagnol. Elle a fini par poser un sérieux problème au sein de PSOE. Le problème du bipartisme s’est même aggravé, de sorte que sa prétendue rénovation n’a pas servi à endiguer un populisme qui, probablement, tôt ou tard, va en tirer bénéfice.
Il est difficile de savoir comment vont répondre à cet échec le capital espagnol et le PSOE lui-même. Il ne s’agit pas pour nous de faire de prédictions ou des spéculations hasardeuses, mais de partager l’analyse que nous venons d’exposer pour aider à comprendre la situation. Ceci dit, il nous parait nécessaire de rappeler que la bourgeoisie n’est pas seulement victime des effets de la décomposition, mais qu’elle est aussi capable d’y opposer des contre-tendances. Comme nous les disions au début de cet article, l’expérience accumulée par le PSOE en est une.
Le prolétariat et le danger du populisme
L’usure du bipartisme est en partie due au développement de la lutte de classe depuis 1968. Cependant, l’incapacité du prolétariat pour avancer dans la politisation de sa lutte a engendré l’un des thèmes le plus importants que le populisme de droite utilise : l’idée d’une caste politique, corrompue et qui ne jouerait que pour ses propres intérêts. Voilà une vision superficielle qui n’a rien de prolétarien et qui est radicalement réactionnaire.
D’abord parce qu’une telle idée n’analyse pas ce qui se passe en termes historiques et globaux, mais sous le prisme mesquin d’une sociologie de groupes isolés, considérés en tant que tels : la “classe politique”, “l’oligarchie financière”, les “immigrants”… Une telle absolutisation démoniaque des catégories sociales abstraites s’est déjà vue dans le fascisme et le stalinisme, expressions extrêmes de la dégénérescence de la pensée capitaliste.
Ensuite, parce qu’elle n’en recherche pas les causes dans les rapports sociaux de production : elle ne recherche que des coupables en personnalisant et en fabriquant des boucs émissaires. Et c’est ainsi que le chômage et la misère seraient dus à cette caste politique et à ces sinistres financiers, et aux émigrants et autres minorités “indésirables”.
Enfin, une telle analyse ne met pas en cause, bien au contraire, l’intérêt de la nation et de l’État, mais fait tout pour les défendre avec encore plus de ferveur patriotarde contre ces forces obscures “d’en haut” et “d’en bas”.
Ces postulats idéologiques, sont certes gênants pour la politique globale de la bourgeoisie, mais sont surtout extrêmement nuisibles pour le prolétariat. La première racine de la crise du bipartisme a été prolétarienne, mais dans le contexte de la décomposition elle possède un élément dominant réactionnaire et très dangereux pour le prolétariat. Ce ne sera que lorsque celui-ci commencera à mettre en avant son alternative, qu’il pourra se greffer à nouveau sur cette racine initiale en la développant.
C.Mir, 9 novembre 2016
1 La rose est le symbole du PSOE et la mouette celui du PP (parti de droite).
2 Lors de ce comité, Pedro Sanchez, mis en minorité, a quitté la tête du Parti socialiste espagnol [NdT].
3 Dans les pays à démocratie consolidée, les secteurs dominants du capital national arrivent, en général, à faire que le “vote citoyen” décide ce qu’ils veulent. Tout cela est le fait d’une manipulation très sophistiquée et parfaitement organisée par les enquêtes et sondages divers, par le découpage variable des districts électoraux, les scandales sortis à propos, les déclarations des uns et des autres, les interventions “opportunes” des “prescripteurs” de ce qu’on appelle “l’opinion publique”, etc. Ceci, qu’on nomme le “jeu politicien”, devient de plus en plus difficile à manipuler de la part de la bourgeoisie : les résultats du Brexit au Royaume-Uni en sont un exemple éloquent.
4 Dans sa décadence, le capitalisme survit grâce à l’intervention omniprésente de l’État, aussi bien dans sa forme dite “libérale” (qui combine la bureaucratie étatique avec la grande bourgeoisie classique) que sous la forme totalement étatisée (celle qu’on nomme, avec ce grand mensonge du siècle, “socialisme” quand ce n’est pas… “communisme”). Voir le point IV de notre plateforme : https ://fr.internationalism.org/plateforme [13]
5 Il nous parait important de clarifier le fait que Podemos n’est pas un parti populiste. C’est un parti avec une indéniable responsabilité capitaliste qui sait utiliser certains thèmes du populisme pour sa politique globale.
6 Podemos a été fondé en 2014 en s’appuyant sur la structure squelettique d’un groupuscule gauchiste (Izquierda Anticapitalista, Gauche anticapitaliste) et quelques restes rancis et dispersés du 15-M. En un temps record de deux ans, Podemos a obtenu 70 députés. De son côté, Ciudadanos a été propulsé depuis sa structure limitée à la Catalogne à un développement partout en Espagne en une année à peine.
Géographique:
- Espagne [14]
Rubrique:
Exercices “Attentats-Intrusion” dans les écoles: l’État sème la terreur
- 1259 lectures
Ces derniers mois, des scènes incroyables et révoltantes se sont déroulées dans toutes les écoles de France. Tous les élèves (ceux de maternelle également, même si sous la forme “soft” de “jeux” en apparence inoffensifs et anodins) ont dû subir la simulation d’une attaque terroriste. Et le sadisme a dépassé toutes les bornes. Face à l’intrusion d’assaillants imaginaires, les enfants ont été systématiquement séparés en deux groupes : ceux qui parvenaient à s’échapper et ceux qui devaient s’enfermer et attendre. Ces derniers, cachés de quelques minutes à plusieurs heures, par exemple sous des tables, devaient faire silence. Ceux qui faisaient du bruit étaient alors accusés d’être responsables de faire repérer leurs camarades et donc potentiellement de leur mort. Dans certains établissements, le GIGN et les hélicoptères ont même été déployés pour faire plus vrai ! Comble de l’horreur, à la fin de ces exercices “Attentats-Intrusion”, un bilan humain fictif était à chaque fois dressé, le nombre d’enseignants et élèves otages tués variant selon l’imaginaire malades des autorités organisatrices.
Il ne s’agit nullement de dérapages locaux, mais d’une campagne pensée à l’échelle nationale. Le document commun du ministère de l’Intérieur et de l’Éducation nommé : Sécurité des écoles, des collèges et des lycées, en est une preuve affligeante. En voici quelques lignes, mais l’ensemble est de la même eau croupie : “Dans nos écoles, nos collèges et nos lycées, des familles nous confient leurs enfants, des femmes et des hommes travaillent quotidiennement. Leur sécurité à tous constitue un impératif majeur pour le Gouvernement et une priorité pour toute la communauté éducative. Nous devons la vérité aux Français. Nous n’avons donc cessé de le dire, et nous le rappelons encore aujourd’hui : le niveau de menace terroriste est très élevé. Les événements tragiques auxquels notre pays a dû faire face au cours des derniers mois en témoignent. (…) Savoir réagir, c’est former et informer. C’est favoriser l’acquisition d’une culture commune de gestion des risques. Savoir réagir, cela s’apprend. Cela passe par des exercices adaptés à l’âge des élèves, pour les préparer au mieux aux situations de crise. (…) Cette nouvelle culture de la sécurité change notre quotidien, y compris à l’école. Ces nouveaux gestes, ces contrôles, cette vigilance de chaque instant peuvent parfois paraître contraignants. Ils sont cependant absolument nécessaires. (…) La vigilance de tous, y compris de la part des parents d’élèves, est indispensable : (…) il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. (…) Comment développer une culture commune de la sécurité ? La menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires. La mise en place de ces mesures nécessite la coopération de l’ensemble des membres de la communauté éducative. La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous. (…) Toute l’école n’a pas la même conduite à tenir puisqu’elle dépend de la situation vécue : une partie peut s’échapper, l’autre se cacher-s’enfermer.”
L’objectif du gouvernement par ce type de campagne est très clair : que les élèves, les parents et les enseignants se surveillent, qu’ils aient peur et se dénoncent les uns les autres. Pourquoi ? Dans son roman d’anticipation 1984, George Orwell faisait tenir à ses protagonistes cet échange :
“– Comment un homme s’assure-t-il de son pouvoir sur un autre, Winston ?
Winston réfléchit :
– En le faisant souffrir répondit-il.
– Exactement. En le faisant souffrir. L’obéissance ne suffit pas. Comment, s’il ne souffre pas, peut-on être certain qu’il obéit, non à sa volonté, mais à la vôtre ? Le pouvoir est d’infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchirer l’esprit humain en morceaux que l’on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l’on a choisies. Commencez vous à voir quelle sorte de monde nous créons ? C’est exactement l’opposé des stupides utopies hédonistes qu’avaient imaginées les anciens réformateurs. Un monde de crainte, de trahison, de tourment. Un monde d’écraseurs et d’écrasés, un monde qui, au fur et à mesure qu’il s’affinera, deviendra plus impitoyable. Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de souffrance. L’ancienne civilisation prétendait être fondée sur l’amour et la justice, la nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n’y aura pas d’autres émotions que la crainte, la rage, le triomphe et l’humiliation. Nous détruirons tout le reste, tout” 1. Par ces lignes, sont soulignées magistralement deux idées centrales :
– l’un des principaux piliers de la domination d’une classe sur l’ensemble de la société est la terreur d’État.
– cette terreur ne fait que croître quand le système n’a plus de réel avenir à offrir à l’humanité.
En effet, quel futur promet le capitalisme quand les enfants de trois ans sont dressés à ramper sous les tables et à avoir peur de l’étranger, de l’autre, de tous les autres ? Aucun. Seulement la barbarie.
Maurice, 15 décembre 2016
1 Ed. Folio, trad. Amelie Audiberti.
Géographique:
- France [15]
Récent et en cours:
- Terrorisme [9]
Rubrique:
Communiqué: solidarité face à la violence haineuse des racialistes fanatiques
- 1332 lectures
Suite à l’agression des participants à la réunion publique du 28 octobre au local de l’association Mille bâbords à Marseille (1) par une bande de fanatiques se réclamant du racialisme, le CCI tient à apporter toute sa solidarité.
Voici les faits relatés par les agressés eux-mêmes : “Vendredi 28 octobre se tenait sur Marseille, dans le local militant Mille bâbords, une réunion publique autour du texte “Jusqu’ici tout va bien ?” (2). La discussion n’avait pas encore commencé lorsqu’un groupe d’une trentaine de personne a fait irruption dans le lieu. Ce groupe entendait empêcher la discussion prévue (…). Après l’encerclement de l’assistance sous forme de happening, dans un simulacre de nasse, des cris et slogans divers ont fusé : “Notre race existe”, “Ce débat n’aura pas lieu”, “Pas l’histoire vous ne referez”, “Votre avis on s’en fout”, “Regardez vos privilèges”, (…) Aux insultes ont succédé les boules puantes, et des coups répétés, dont certains au visage avec arme, des chaises ont été jetées sur l’assistance, les tables ont été systématiquement jetées au sol, y compris sur une personne en béquille, du gaz lacrymogène a été répandu dans le local et des personnes ont été gazées au visage (yeux et bouche). Les tables de presse, la bibliothèque de Mille bâbords ont été saccagées, des revues et des livres jetés et piétinés. Et pour terminer, ils ont défoncés la vitrine du local. (…) Malgré cette attaque, une intéressante discussion a finalement pu se tenir, comme ce sera le cas partout et à chaque fois que cela s’avérera nécessaire. Face à ces actes extrêmement graves, dont le but avoué est d’empêcher toute discussion critique sur le racialisme, chacun, politiquement et pratiquement, est appelé à prendre ses responsabilités. N’hésitez pas à contacter Mille bâbords pour leur apporter tout votre soutien (3). Des organisateurs et des participants à la soirée” (in “Marseille : Descente racialiste à Mille bâbords. Tentative de mise à sac, coups, gazage et vitrine détruite”).
Les agresseurs ont durant l’attaque distribué un tract intitulé “Anti-racialistes et anti-racialisatrices, stay et protect your home” 4 dans lequel ils crachaient toute leur haine : “Anti-racialisateurs et anti-racialisatrices vous n’aurez jamais la parole, vous n’aurez jamais notre écoute parce que : le capitalisme se fonde sur le pillage, l’esclavage et le colonialisme. “L’abolition de l’esclavage” et les “décolonisations” n’ont pas démoli le racisme structurel et ses répercussions pour le moins d’actualité. Les privilèges des pays occidentaux impérialistes demeurent à un niveau international. Nous refusons votre vision européano-centrée et réactionnaire de la lutte des classes. Il vous suffirait de sortir de votre entre-soi confortable pour voir la réalité dans les rues de Marseille. Nous refusons votre course à l’opprimé et votre incapacité à reconnaître vos privilèges de petits gauchistes blancs de classe moyenne. Nous n’avons pas de temps à perdre avec les négationnistes. Nous saboterons toutes vos initiatives. Nous revendiquons notre autodétermination, notre émancipation, notre libération par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous n’avons pas besoin de votre validation quant aux termes que nous utilisons pour définir qui nous sommes, ce que nous sommes et ce pour quoi nous luttons. En somme on vous chie dessus bande de racistes réactionnaires négationnistes néo-colons... Finalement il va vous falloir assumer : vous n’êtes qu’un des bras armé (de vos claviers) de la république laïcarde qui nous fait gerber !” 5.
Durant les jours qui avaient précédé cette réunion, de nombreux appels à casser du “gouaire” 6 avaient été lancés sur les réseaux sociaux. Il s’agit donc d’un acte prémédité et concerté.
Ces agresseurs appartiennent à un courant particulier du racialisme principalement représenté par le Mouvement des indigènes de la République, dont Houria Bouteldja est l’une des personnalités la plus visible. Le titre de son dernier livre résume à lui seul l’axe central de ce courant de non-pensée : Les Blancs, les juifs et nous. Un ouvrage immonde qui tente de nier la lutte des classes pour la remplacer par une guerre des races (“Je vous le concède volontiers, vous n’avez pas choisi d’être Blancs. Vous n’êtes pas vraiment coupables. Juste responsables” affirme ainsi Madame Bouteldja.). Nous reprenons à notre compte cette idée défendue dans le texte publié sur le site de Mille babords “Jusqu’ici tout va bien ?” : “le racialisme ne peut mener qu’à la guerre de tous contre tous”. Ceci d’autant plus que “la guerre de tous contre tous” est déjà une réalité et que la violence ne fait que s’accroître. Dans ce sens, il est nécessaire de s’y préparer et important d’en débattre.
Pourquoi les participants lors de cette réunion à Mille babords ont-ils été la cible de ce déchaînement de haine et de violence ? Simplement pour ce qu’ils représentent, un effort pour comprendre le monde capitaliste et son évolution, pour se rassembler, débattre et s’organiser, pour participer au développement de la conscience et se réapproprier l’histoire du prolétariat 7, son identité, son combat pour l’émancipation de toute l’humanité. Dans la période actuelle difficile, de telles tentatives sont rares et précieuses.
Alors que l’atonie, la division, l’atomisation et le désespoir exercent un poids dans la société, ceux qui se sont rassemblés ce 28 octobre dans le local de Mille bâbords et qui ont maintenu le débat malgré les coups, eux qui n’ont pas cédé aux provocations, à la peur, aux intimidations et à la répression, révèlent par leur courage et leur ténacité la véritable nature profonde de la classe ouvrière, une classe associée, désintéressée et solidaire.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si une partie de ceux qui gravitent autour ou à l’intérieur de l’association Mille bâbords est issue du mouvement des étudiants contre le CPE de 2006, car ce mouvement avait justement réussi à organiser de véritables débats dans des assemblées générales ouvertes et à mettre au cœur de sa dynamique la question de la solidarité de la classe ouvrière tout entière, de tous les secteurs, de toutes les générations, de tous les quartiers, de toutes les origines, de toutes les couleurs ! A l’époque de ce mouvement contre le CPE, la bourgeoisie avait réagi par la violence policière organisée de l’État et en laissant de jeunes “casseurs” agresser les étudiants dans les manifestations.
Aujourd’hui, les racialistes aussi se chargent de ce sale boulot. Les éléments qui luttent pour le débat ouvert et qui font l’effort de se rassembler et réfléchir ensemble, ont été, ce 28 octobre, la proie d’une attaque haineuse qui préfigure bel et bien les dangers croissants et le caractère protéiforme de la répression bourgeoise. Car oui cette agression planifiée est un acte de répression. La violence et la haine abjectes de ce commando de racialistes, leur promotion de la “lutte des races” comme leur volonté de détruire tout lieu de débat réel révèlent leur no-future, l’idéologie du nihilisme des couches sociales qui ne portent aucun avenir pour l’humanité. Ils sont un pur produit de la décomposition de la société et in fine ils apportent leur petite contribution à la dynamique morbide du capitalisme. Certains de ces éléments n’hésiteront pas à assouvir leur pulsions criminelles par des meurtres si le contexte leur est favorable et si l’occasion se présente.
Aux victimes de ces actes de violences inadmissibles, nous tenons à témoigner notre soutien et toute notre solidarité. Le débat est d’une importance vitale pour le combat révolutionnaire et il est impératif de défendre tout lieu de débat prolétarien !
Le CCI, 4 décembre 2016
1) Sur son site, l’association Mille bâbords située à Marseille se présente ainsi : “Mille bâbords est une médiathèque alternative, un lieu dédié à la promotion et à la connaissance des différents mouvements de luttes sociales. C’est un lieu ouvert, où le public peut se rencontrer, se mettre au courant, découvrir et échanger, sur des pratiques, des interrogations, des points de vues, [...] et voire passer à l’action... Partant du constat d’un manque d’espaces pour que les mouvements sociaux puissent, dans leur diversité, échanger entre eux, et avec un large public, nous avons créé ce lieu, telle une vitrine animée des idées alternatives à une société trop barbare...”.
2) https ://tuttovabene.noblogs.org/ [16] Ce texte dénonce le racialisme comme un poison idéologique nauséabond.
3) Contact : batlarace chez riseup.net.
4) Reste et protège ta maison.
6) Terme raciste anti-Blanc signifiant “porc”.
7) Un débat a récemment eu lieu sur Le Manifeste du Parti communiste de 1848 et un autre sur la Révolution russe est prévu dans les mois à venir.
Rubrique:
Révolution Internationale n°463 - mars avril 2017
- 953 lectures
Campagne présidentielle en France : populisme et anti-populisme, deux expressions de l’impasse capitaliste !
- 1453 lectures
Après la poussée de l’extrême-droite en Autriche, le vote du Brexit au Royaume-Uni, la victoire de Donald Trump aux États-Unis et celle, probable, de Geert Wilders aux Pays-Bas, la France pourrait être la prochaine grande puissance à voir un mouvement populiste aux portes du pouvoir, au moins en mesure d’ébranler sérieusement la mécanique électorale. Si les fractions politiques les plus lucides de la bourgeoisie, de droite ou de gauche, sont loin de rester les bras croisés face à ce risque pour les intérêts objectifs de l’État et de la classe dominante, le scénario d’une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle est pris suffisamment au sérieux pour mobiliser les chancelleries européennes et affoler les marchés financiers. Un tel événement, au cœur du moteur européen, présenterait un très grand danger pour le futur de l’Union et serait, bien plus que le Brexit, un désastre pour l’Allemagne et toutes les bourgeoisies pro-européennes, menaçant potentiellement l’équilibre impérialiste du centre historique du capitalisme.
Une déstabilisation du jeu électoral
Comme nous l’avons déjà souligné dans nos précédents articles sur le sujet 1, l’enracinement du populisme en Europe et aux États-Unis résulte, en premier lieu, de l’affaiblissement historique des partis de gouvernement traditionnels, discrédités par des décennies d’attaques à répétition contre les conditions de vie et de travail, par l’existence insupportable d’un chômage de masse chronique, par le cynisme, l’hypocrisie et la corruption de nombreuses sphères politiques et économiques, et in fine par leur impuissance à faire miroiter aux masses exploitées l’illusoire espérance d’un futur meilleur. Face à une classe ouvrière pour le moment impuissante à défendre sa perspective révolutionnaire et à représenter un danger tangible pour la société capitaliste, l’indiscipline et le chacun pour soi, tant au niveau international que dans les rapports entre les différentes cliques politiques des bourgeoisies nationales, tend à gagner du terrain. Les exemples de ce phénomène sont légion, mais les épisodes de véritables batailles de chiffonniers entre de Villepin et Sarkozy qui, lors de l’affaire Clearstream en 2004, avait promis à son adversaire de le suspendre “sur un crochet de boucher”, ou, en 2012, la rivalité sans merci entre Copé et Fillon pour s’emparer de la présidence du parti de droite, illustrent bien la réalité et les dangers qu’un tel processus fait peser sur la vie politique.
L’autre facteur essentiel pour comprendre la poussée populiste réside dans les faiblesses politiques actuelles de la classe ouvrière, notamment son immense difficulté à elle-même s’identifier comme la seule classe sociale en mesure de renverser l’ordre capitaliste. Face aux attaques incessantes portées par la bourgeoisie, il existe au sein du prolétariat et des couches petites-bourgeoises un véritable sentiment de révolte. Mais, faute de réelle perspective politique prolétarienne, le mécontentement ne peut s’exprimer sur le terrain de la lutte de classe. Aux yeux désabusés de beaucoup de ceux qui ressentent un profond ras-le-bol, le seul exutoire possible semble se réduire au repli sur soi et au rejet de toute forme d’engagement politique, ou bien au soutien de partis qui se sont toujours (et frauduleusement) présentés contre le “système”, marginalisés et stigmatisés par la sphère politico-médiatique tant honnie, et prêts à “purger” la société des “élites” et de “l’étranger”, en réalité un magma idéologique informe et démagogique dans lequel s’entremêlent recherche de boucs-émissaires, frustrations sociales et désespoir.
Tous ces éléments se traduisent par des difficultés croissantes de l’appareil d’État à mettre en œuvre des stratégies lui permettant d’asseoir à sa tête les partis les plus adaptés aux besoins du capital. C’est ainsi qu’une personnalité aussi irresponsable et incompétente que Donald Trump a pu s’emparer de la Maison-Blanche contre à peu près tout ce que la classe politique américaine, les médias et le show-business comptent d’un tant soit peu rationnel.
Aucune force populiste n’a démenti son entière sujétion au “système”, ni sa détermination à défendre, à sa manière, les intérêts de la classe dominante. Pourtant, la montée en puissance de ces mouvances représente un sérieux problème pour la bourgeoisie. La défense du capital national dans la période de décadence ouverte en 1914 s’est jusqu’ici traduite par un resserrement strict des différentes sensibilités politiques autour du pouvoir exécutif et des intérêts communs des différentes fractions de la bourgeoisie au détriment des intérêts particuliers de tel ou tel parti ou clique. Depuis 1945, l’artifice du pluralisme démocratique était globalement assuré par un véritable verrouillage du pouvoir exécutif au moyen d’un jeu d’alternance des partis de gauche et de droite les plus responsables. Les mouvances populistes plus récentes ont, au contraire, des démarches totalement irrationnelles et obscurantistes. Sans claire vision des intérêts objectifs de leur classe et sans réelles compétences, elles risquent à tout moment de semer la pagaille au sommet de l’État et d’entraver sa bonne gestion, comme semble le démontrer chaque jour la catastrophique présidence de Donald Trump.
Une extrême-droite française plus forte que jamais
En France, le Front national (FN) est pour beaucoup l’incarnation des laissés-pour-compte. Si son programme incohérent n’est pas forcément toujours pris au sérieux par ses propres électeurs, il se présente comme une sorte d’ultime recours pour “faire bouger les choses”. Ceci, d’autant plus facilement qu’il a jusqu’à présent pour particularité avantageuse de ne pas avoir été associé à la gestion de l’État. Depuis les années 1980, où le président socialiste, François Mitterrand, avait transformé un insignifiant rassemblement de vieux pétainistes, de petits boutiquiers poujadistes, d’anciens partisans de l’Algérie française et de jeunes skinheads paumés en machine à faire perdre la droite, le FN n’a jamais cessé de progresser sur le plan électoral. L’instrumentalisation mitterrandienne a peu à peu échappé à son créateur, au point que, si le jeu politique qui se poursuit encore aujourd’hui permet à la classe dominante de réactiver régulièrement les campagnes antifascistes destinées à redorer l’image de la république bourgeoise et ses valeurs démocratiques, l’accident du 21 avril 2002 l’a contraint à mener une politique active d’affaiblissement du FN.
Une partie de la droite française, avec à sa tête Nicolas Sarkozy, reprit ainsi à son compte les thèmes et le langage de l’extrême-droite, réduisant, en 2007, la base électorale de Jean-Marie Le Pen à la portion congrue (10,44 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle). Mais l’usure rapide de la “droite décomplexée” au pouvoir et, surtout, l’approfondissement de la décomposition du tissu social et politique (en particulier le ralliement de nombreux anciens électeurs du parti stalinien séduits par le patriotisme outrancier du FN) ont permis à Marine Le Pen, la fille du vieux leader frontiste, d’obtenir un score historique à la présidentielle suivante (17,90 %).
C’est aux élections régionales de 2015 que la bourgeoisie française a réellement pris conscience de l’ampleur du danger que représente le FN, devenu le “premier parti de France” avec plus de 27 % des voix, pour la bonne gestion de ses affaires. Elle a réagi en activant à nouveau, mais avec beaucoup plus de difficultés qu’en 2002, la tactique du “front républicain” ; le Parti socialiste (PS) retira ses listes en faveur de la droite dans deux régions importantes qui risquaient de tomber entre les mains du FN. Mais la victoire du “front républicain” n’a été qu’une parade ponctuelle face à l’inexorable croissance du populisme. Malgré toutes les armes médiatiques ou juridiques que les différentes fractions de la bourgeoisie peuvent utiliser, Marine Le Pen sait que son parti à bel et bien une possibilité d’entrer à l’Élysée.
Face au populisme, les “partis de gouvernement” s’organisent
Le danger que représente désormais le FN pour les intérêts objectifs de la classe dominante accroît les difficultés d’une bourgeoisie qui a déjà fort à faire avec une situation économique qui se dégrade d’année en année. La combativité du prolétariat jusqu’au milieu des années 1980, les archaïsmes de la droite gaulliste et la place que le stalinisme a occupée durant toute une période dans l’appareil d’État entravent encore aujourd’hui la bourgeoisie française qui a hérité d’une énorme bureaucratie et a toujours eu du mal à moderniser ses structures économiques en engageant, dans de bonnes conditions, les réformes nécessaires aux intérêts de son capital national, contrairement à ses concurrents immédiats, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.
L’arrivée en 2012 de François Hollande au pouvoir correspondait clairement à cette nécessaire évolution du capital français, le PS représentant, comme dans de nombreux autres pays, la fraction la plus intelligente de la bourgeoisie et donc la plus à même de mener les attaques sur le plan économique mais aussi idéologique. Néanmoins, la mesure phare de la présidence de Hollande, la réforme du Code du travail avec l’adoption de la “loi El Khomri”, devait l’affaiblir et renforcer la résistance d’un certain nombre de secteurs de la bourgeoisie très attachés à l’interventionnisme étatique et au keynésianisme. Alors que le PS, en particulier son aile social-démocrate, a longtemps assumé le combat contre l’extrême-droite, l’impossibilité de maintenir Hollande au pouvoir et l’affaiblissement du Premier ministre Valls ont rendu sa stratégie caduque.
La droite comptait quant à elle s’appuyer sur une personnalité relativement consensuelle et drapée d’une aura d’homme d’État. Mais la candidature Juppé à la primaire de la droite fut en échec et, contre toute attente, Fillon, l’incarnation de la droite conservatrice “la plus bête du monde”, l’emportait à la faveur d’une autre forme de “révolte électorale” en jouant lui-aussi la carte de l’homme honni des médias. Dès le départ, le nouveau candidat a très mal géré sa victoire, évinçant les sarkozystes de la tête du parti, ne transigeant en rien sur la virulence de son programme que son propre camp qualifie de “radical” et affichant une sympathie déconcertante envers Poutine, en contradiction flagrante avec les orientations impérialistes de l’État français. Le risque étant grand de voir Marine Le Pen l’emporter au second tour de la présidentielle face à une personnalité aussi iconoclaste ; le naufrage de sa candidature, suite à la révélation de ses malversations, semble avoir permis à la bourgeoisie de l’écarter de la course à l’Élysée.
La déconfiture de la droite, le retrait de la candidature de François Hollande et la victoire à la primaire du PS de Benoit Hamon, estampillé “frondeur” et “radical”, ont ouvert la voie au candidat “indépendant”, Emmanuel Macron, présenté comme un homme neuf et peu mêlé aux intrigues politiciennes. En quittant le gouvernement socialiste en 2016, Macron a fini par s’imposer, au gré des événements, comme une alternative crédible aux yeux d’une partie des éléments les plus lucides de la bourgeoisie pour endiguer le populisme. Dans ce qui ressemble de plus en plus à une coalition gauche, centre et droite, un peu comme en Allemagne depuis 2013 avec le cabinet Merkel III, le clan Hollande, une partie significative du centre-droit et même de la droite, tout comme le MEDEF et plusieurs personnalités issues des milieux économiques et intellectuels (Martin Bouygues, Alain Minc, Jacques Attali, etc.) semblent miser tactiquement sur l’ancien banquier d’affaires pour contrer le FN, même si la victoire éventuelle d’un homme sans véritable ancrage dans l’appareil d’État, donc dépendant des sphères aux visions parfois très divergentes qui le soutiennent, ne serait pas sans poser, d’une part, la question de sa capacité à gérer convenablement les affaires de l’État et, d’autre part, celle du risque de voir la dynamique du chacun pour soi s’amplifier davantage.
Sans préjuger du résultat de la prochaine élection, tant la situation semble instable, il apparaît que la bourgeoisie a pleinement conscience que le cirque électoral s’organisant autour de l’alternance des partis traditionnels, la social-démocratie et des conservateurs, est usé et rejeté. Elle cherche donc à s’adapter en tentant de renouveler ses têtes d’affiche avec des personnalités qui prétendent faire de la politique “autrement” et ne pas tremper dans les magouilles d’appareils. Mais cette stratégie, susceptible de fonctionner un certain temps, risque de subir à son tour l’usure rapide du pouvoir et de favoriser les mouvances les plus irrationnelles.
EG, 28 février 2017
1 Voir, notamment “Contribution sur le problème du populisme [19]”, Revue internationale, no 157.
Géographique:
- France [15]
Récent et en cours:
- Elections 2017 [20]
Destruction de l’environnement : folie humaine ou folie du capital ?
- 1477 lectures
Ces derniers mois ont vu la parution d’études scientifiques alarmistes quant à la destruction accrue de l’environnement, parmi lesquelles celles concernant la menace d’extinctions massives de primates et l’accélération de la fonte des glaces arctiques.
La planète sans singes
Selon une vaste étude publiée par trente et un primatologues internationaux et portant sur les 504 espèces de primates non-humains recensées sur la planète, “les scientifiques estiment que 60 % des espèces de singes sont en danger d’extinction en raison d’activités humaines, et 75 % des populations accusent déjà un déclin. Quatre espèces de grands singes sur six ne sont plus qu’à un pas de la disparition, selon la dernière mise à jour de l’UICN [Union internationale pour la conservation de la nature], en septembre 2016. [...] En cause, des menaces multiples, dont le poids n’a cessé de s’accroître au fil des années, et qui souvent s’additionnent. Les habitats des singes disparaissent ainsi sous la pression de l’agriculture (qui affecte 76 % des espèces), de l’exploitation forestière (60 %), de l’élevage (31 %), de la construction routière et ferroviaire, des forages pétroliers et gaziers et de l’exploitation minière (de 2 % à 13 %). De plus, la chasse et le braconnage touchent directement 60 % des espèces. A quoi il faut encore ajouter des périls émergents, tels que la pollution et le changement climatique. […] Les primatologues ont, de la même façon, quantifié l’impact des autres activités humaines sur nos parents quadrupèdes. Les chiffres donnent le tournis. L’expansion de l’agriculture industrialisée, de l’exploitation forestière, des mines ou de l’extraction d’hydrocarbures devrait accroître les routes et réseaux de transport de 25 millions de kilomètres d’ici à 2050 dans les zones de forêt tropicale” 1. Si les pressions exercées sur les primates, notamment la déforestation accélérée à l’échelle planétaire, ne cessent pas rapidement, des extinctions massives d’espèces sont ainsi à prévoir d’ici 25 à 50 ans.
Ces mêmes pressions, auxquelles il faut ajouter la dissémination et la prolifération d’espèces invasives, ne se limitent d’ailleurs pas aux seuls singes mais s’exercent aussi sur l’ensemble du monde vivant. “Les populations de vertébrés ont ainsi chuté de 58 % entre 1970 et 2012 […] Si rien ne change, ces populations pourraient avoir diminué en moyenne des deux tiers (67 %) d’ici à 2020, en l’espace d’un demi-siècle seulement” 2. Une autre étude prenant en compte 82 954 espèces animales et végétales révèle ainsi que 29 % d’entre elles sont aujourd’hui menacées.
Chaleur polaire
Les déforestations massives menaçant directement les primates portent aussi une grande part de responsabilité dans le phénomène actuel de réchauffement climatique, s’ajoutant aux effets de la consommation massive d’énergie fossile productrice de gaz à effet de serre. L’exploitation effrénée des hydrocarbures par les entreprises et les États au mépris de l’environnement, de la santé et de la vie humaine est édifiante de la logique capitaliste de profit et des choix industriels des États défendant dans une concurrence exacerbée leurs intérêts nationaux par tous les moyens. Un seul exemple parmi tant d’autres : la politique du “tout diesel” de l’État français qui s’est intensifiée depuis les années 1980 pour favoriser les constructeurs nationaux. Deux voitures sur trois roulent au gazole (62 % en 2013 contre 7 % en 1979) alors qu’il est avéré que les cancers et les maladies respiratoires provoqués par cette pollution aux particules fines sont directement responsables de 386 000 décès prématurés par an dans le pays.
Alors que 2016 a enregistré le troisième record annuel consécutif de chaleur de l’histoire récente de la Terre, la fonte des glaces de la planète s’accélère, notamment aux pôles. En Arctique, à la fin de l’été 2016, la surface mesurée de la banquise était inférieure de plus de moitié à celle mesurée dans les années 1950 ; l’automne suivant, la température de l’air y a atteint – 5 °C, soit 20 °C au-dessus de la température habituellement relevée en cette saison. “Ces hausses de températures ont aussi pour conséquence de faire fondre la calotte glaciaire, c’est-à-dire la couche de glace accumulée sur de la terre. Et de faire monter le niveau des océans. Ces bouleversements thermiques affectent aussi la circulation de l’eau dans l’océan Atlantique et, par conduction, dans les océans Pacifique et Indien. Selon un rapport publié fin novembre par l’Institut de l’environnement de Stockholm sur la résilience dans l’Arctique, ce changement de régime modifierait les températures océaniques à l’échelle mondiale et le climat d’une manière considérable et brutale”” 3.
Outre la calotte glaciaire, en Sibérie, c’est la fonte du pergélisol qui s’avère lourde de menaces. Libérées par le dégel, des bactéries mortelles d’anthrax ont engendré durant l’été 2016 une épidémie pour la première fois depuis 75 ans dans cette région, entraînant la mort d’un enfant de 12 ans et l’infection de 23 autres personnes, et nécessitant le déploiement sur place de l’armée russe afin de circonscrire l’épidémie. La menace, loin de se limiter à l’anthrax, pourrait prendre la forme d’un resurgissement de maladies aujourd’hui disparues comme la variole, ou de l’apparition de nouvelles maladies encore inconnues dues au réveil et à la dissémination de virus géants découverts ces dernières années dans des dépouilles congelées de mammouths.
Ajoutons à ce tableau déjà bien sombre que le réchauffement de l’Arctique amplifie le relargage par les mers et les sols de cette région d’un puissant gaz à effet de serre, le méthane, qui à son tour accélère le processus de réchauffement climatique…
Quelle folie ! Mais quelle folie ?
La destruction de l’environnement à l’échelle mondiale a certes pour origine l’action de l’être humain sur la nature. Partant de ce constat, chaque nouvelle étude sur le sujet est immanquablement suivie d’appels à notre prise de conscience et de responsabilité afin que cessent ces graves atteintes aux écosystèmes mondiaux, sous-entendant par-là que tout ceci ne serait que la conséquence de la “folie des hommes”.
L’inconvénient de cette vision des choses est qu’elle élude complètement l’origine commune à tous les facteurs actifs dans la destruction de l’environnement : la recherche effrénée de profit caractéristique du mode de production capitaliste. Outre le fait que pour le capitalisme les ressources naturelles représentent un “don gratuit”, “Le capital abhorre l’absence de profit ou un profit minime, comme la nature a horreur du vide. Que le profit soit convenable, et le capital devient courageux : 10 % d’assurés, et on peut l’employer partout ; 20 %, il s’échauffe ; 50 %, il est d’une témérité folle ; à 100 %, il foule aux pieds toutes les lois humaines ; 300 %, et il n’est pas de crime qu’il n’ose commettre, même au risque de la potence” 4. La soi-disant “folie des hommes” se révèle n’être que la folie du capital et sa soif insatiable de profit maximal. A cette logique implacable à laquelle sont soumis tous les États s’ajoute le cynisme des gouvernements relayé par tous les médias de la bourgeoisie qui cherchent à nous culpabiliser en posant ces problématiques sous l’angle des comportements ou des initiatives individuelles, appelant systématiquement à la “bonne volonté de chacun” pour empêcher la prise de conscience nécessaire de la nature destructrice du système capitaliste.
D’ailleurs, très tôt dans son histoire, le capitalisme a eu un impact majeur sur l’environnement planétaire. Dès le xvie siècle, suivant la découverte de l’Amérique et mû par la “soif sacrilège de l’or”, le capitalisme originaire d’Europe entame sa conquête du globe ; c’est de cette période que date le premier bouleversement d’origine humaine de l’environnement naturel à l’échelle mondiale, concomitant au génocide amérindien. “L’arrivée des Européens dans les Caraïbes en 1492 et la conquête des Amériques a mené au plus grand bouleversement de populations depuis les 13 000 dernières années et au premier réseau commercial global reliant l’Europe, l’Afrique, la Chine et les Amériques, provoquant le mélange de biotopes auparavant séparés [...] Le nouveau monde exporte le maïs, les pommes de terre, le cacao et l’ancien envoie le blé et la canne à sucre. Le cheval, la vache, la chèvre et le cochon débarquent aux Amériques. C’est une réorganisation radicale de la vie sur terre. […] Surtout, les Européens amènent avec eux des microbes inconnus dans le nouveau monde. Résultat : les Américains passent de 54 millions en 1492 à 6 millions en 1650 ! Faute de bras, 65 millions d’hectares de terres agricoles sont abandonnées à la forêt et aux landes. Toute cette végétation stocke le CO2 atmosphérique, réduisant le phénomène d’effet de serre et provoquant un petit âge glaciaire” 5.
Une étape qualitative dans la capacité de nuisance environnementale du capitalisme est atteinte avec la révolution industrielle au xixe siècle, qui marque l’apogée de ce mode de production. Car “en faisant connaître un bond prodigieux aux forces productives, le capitalisme a également provoqué un bond de même échelle aux nuisances qui en résultent et qui affectent maintenant l’ensemble du globe terrestre, le capital ayant conquis ce dernier dans sa totalité. Mais là n’est pas l’explication la plus fondamentale puisque le développement des forces productives n’est pas en soi nécessairement significatif de l’absence de maîtrise de celles-ci. Ce qui, en effet, est essentiellement en cause, c’est la manière dont ces forces productives sont utilisées et gérées par la société. Or justement, le capitalisme se présente comme l’aboutissement d’un processus historique qui consacre le règne de la marchandise, un système de production universelle de marchandises où tout est à vendre. Si la société est plongée dans le chaos par la domination des rapports marchands, qui n’implique pas seulement le strict phénomène de la pollution mais également l’appauvrissement accéléré des ressources de la planète, la vulnérabilité croissante aux calamités dites “naturelles”, etc., c’est pour un ensemble de raisons qui peuvent être résumées de la sorte :
– la division du travail et, plus encore, la production sous le règne de l’argent et du capital divisent l’humanité en une infinité d’unités en concurrence ;
– la finalité n’est pas la production de valeurs d’usage, mais, à travers celles-ci, la production de valeurs d’échange qu’il faut vendre à tout prix, quelles qu’en soient les conséquences pour l’humanité et la planète, de manière à pouvoir faire du profit” 6.
Socialisme ou barbarie
Avec l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence au xxe siècle, la perspective d’une destruction irréversible de l’environnement mondial, pouvant à terme rendre la planète hostile à la vie humaine, est désormais envisageable. Jour après jour, les subtils équilibres écologiques de la planète, produits de plus de 3,5 milliards d’années d’évolution, sont un peu plus attaqués par la folie destructrice du capital. Ainsi, selon l’étude publiée par une équipe de 22 chercheurs dans la revue scientifique Nature du 7 juin 2012, “nous approchons à grands pas d’un effondrement imminent et irréversible des écosystèmes, dont les civilisations humaines dépendent. S’ils s’effondrent, notre destin est plus qu’incertain. Parmi les chercheurs, certains avouent être “terrifiés” par leurs conclusions” 7. Autrement dit, le sort que le capitalisme réserve à nos plus proches parents biologiques que sont les singes pourrait n’être que le prodrome de ce qu’il réserverait à l’humanité s’il n’était pas renversé.
Car le seul moyen d’empêcher le capitalisme de continuer à détruire l’environnement planétaire consiste précisément en son renversement révolutionnaire à l’échelle mondiale par l’unique force sociale en mesure de le faire de par sa place dans la société, le prolétariat, et son remplacement par une société mue non par la soif insatiable de profit mais par la satisfaction des besoins humains, dans le respect de la nature et de la vie : le communisme.
DM, 25 février 2017
1 “Les singes pourraient disparaître d’ici vingt-cinq ans à cinquante ans [21]”, Le Monde, 18 janvier 2017.
2 “Plus de la moitié des vertébrés ont disparu en quarante ans [22]”, Le Monde, 27 octobre 2016.
3 “Climat : ainsi fond, fond, fond l’Arctique [23]”, Libération, 9 janvier 2017.
4 T. J. Dunning, cité par Karl Marx dans Le Capital, livre Premier, huitième section, chapitre XXXI : “Genèse du capitaliste industriel”.
5 “Le début de l’Anthropocène remonte à la découverte de l’Amérique [24]”, Science et Avenir, 18 mars 2015.
6 Citation tirée de notre série d’articles “Le monde à la veille d’une catastrophe environnementale”, (I) [25] et (II) [26], Revue internationale nos 135 et 139.
7 “La Terre voit venir le changement d’ère [27]”, Libération, 9 août 2012.
Récent et en cours:
- Ecologie [28]
Rubrique:
Jean-Luc Mélenchon, un serviteur de la nation et du capital
- 1834 lectures
L’image a fait le “buzz” quelques jours sur internet. Alors qu’il s’imagine en terrain conquis en allant – en lever de rideau de son meeting du 26 janvier au soir – à la rencontre de cheminots manifestant à Périgueux contre la suppression de leurs emplois, Jean-Luc Mélenchon se fait interpeller plusieurs fois par des ouvriers refusant la récupération politique de leur mouvement. La dernière invective, évoquant l’absence de respect pour les ouvriers de tous les responsables politiques, de droite comme de gauche, fait sortir le leader de l’autoproclamée “France insoumise” de ses rails : “J’use ma vie à vous défendre ! J’use ma vie !”, faisant de lui… l’autoproclamé défenseur de la classe ouvrière.
Ne nous emballons pas : en fait, le parcours et les positions de Mélenchon font totalement pencher la balance vers une véritable défense du capital national et de sa bourgeoisie.
Né à Tanger d’un père receveur des PTT et d’une mère institutrice, il s’installe en France à 11 ans, dans le Jura. A 17 ans, il est l’un des meneurs du mouvement de son lycée en mai 68 et navigue dans les eaux trotskistes (lambertistes) pendant ses années d’études de philosophie et les débuts de sa carrière d’enseignant et de journaliste.
Puis, comme beaucoup de ses camarades de l’époque, il ne tarde pas à prendre ses distances avec le lambertisme et ne cherche pas à résister aux sirènes d’un Parti socialiste qui, depuis que François Mitterrand en a pris les rênes, rassemble de plus en plus de mouvements et militants de gauche attirés par la perspective de l’exercice des responsabilités démocratiques.
Fini l’espoir du “Grand soir”, place maintenant à l’ambition du pouvoir. A tout juste 25 ans, Mélenchon adhère au PS qu’il ne quittera que 32 ans plus tard, en 2008. Il est élu conseiller général de l’Essonne en 1985 (dont il devient président délégué en 1998), sénateur en 1986 et en 2004, il est nommé ministre délégué en 2000 et pendant deux ans dans le gouvernement de Jospin, avant de devenir député européen en 2009. Une belle carrière politique qui rend difficile de légitimer une proximité avec le monde ouvrier quand on a posé ses fesses aussi longtemps sur le velours des hémicycles et des institutions de la bourgeoisie.
Mais le passé est le passé, nous dira-t-on. Aujourd’hui, Mélenchon n’est plus qu’un “simple” député européen et son projet politique est libéré des contraintes d’un grand parti. En 2008 en effet, Mélenchon claque la porte du parti à la rose et fonde son propre mouvement, le Parti de gauche, avec l’ambition assumée de “rassembler la gauche” et qui lui permet d’obtenir un mandat au parlement européen. En guise de rassemblement, il parviendra à attirer derrière son panache une partie majoritaire d’un PCF touchant le fond des sondages et des résultats électoraux. Du Parti de gauche à la France insoumise en passant par le Front de gauche, Mélenchon a peaufiné son image et lustré son discours. Et pour bien marquer la nouveauté de ses idées, il emprunte à d’autres “troisièmes hommes” le fameux concept de “sixième République”. Jusqu’à rajouter, il y a peu, le “dégagisme” à la française, un néologisme assez mal défini et censé traduire une radicalité massive et populaire (mais surtout démagogique) dont il se proclame lui-même le leader.
Nouvelles ses idées ? Pas vraiment. En fait, il s’agit d’un amas plutôt hétéroclite résultant d’une collecte d’à-peu-près toutes les idées des “anti” et des “sans” de par le monde et qui au final ne forment qu’une resucée de vieux projets politiques qui ont à un moment ou un autre trouvé une place dans un programme politique étiqueté “de gauche” ou “radical” depuis les années 1970. Mais que pouvait-on attendre d’un pur produit de la bourgeoisie, rompu aux méthodes des partis bourgeois et dont le rêve absolu consiste en… une nouvelle constitution ?
On ne pourrait pas commencer le catalogue de ses promesses par autre chose que la refondation du partage des richesses. Vieille revendication de gauche s’il en est. Mais peut-être que notre grand leader populaire voit les choses de façon beaucoup plus radicale : expropriation des capitalistes ? Répartition des richesses à chacun selon ses besoins ? En fait, Mélenchon propose simplement une réforme fiscale et une revalorisation du SMIC. Avec de telles propositions, Mélenchon ne bouleverse pas l’ordre des choses mais, et c’est le plus important pour lui, il s’assure le soutien de la vieille garde gauchiste et stalinienne qui depuis des décennies et à chaque échéance électorale promet de “faire payer les riches”.
Autre mesure centrale dans son programme, l’indépendance économique et politique de la France. Car ne nous y trompons pas, l’internationalisme autoproclamé de Mélenchon n’est que grossier mensonge ! La défense des travailleurs oui, mais des travailleurs français ! La révolution oui, mais la révolution française ! En 2015, il n’hésitait pas à déclarer sur France 3 que “le drapeau tricolore et la Marseillaise sont des symboles révolutionnaires” et confiait en octobre 2016 à un journaliste de RTL qu’il envisageait de ne plus chanter l’Internationale à la fin de ses meetings. Finalement il chante les deux…
Ce qui peut sembler symbolique est au contraire la manifestation de son profond attachement à la nation bourgeoise, qu’il vénère comme tout bourgeois qui se respecte. Son discours sur le contrôle de l’immigration, “le travailleur détaché, qui vole son pain au travailleur qui se trouve sur place” 1, son ironique rejet de “ceux pour qui il est normal que tout le monde puisse s’établir où il veut, quand il veut. Comme si passeports, visas et frontières n’existaient pas” 2 démontre s’il en était besoin que le projet politique de Mélenchon n’est certainement pas en opposition avec les règles du système, en particulier le caractère central de la nation capitaliste qui encadre l’exploitation de la force de travail.
De même, dans une vision très gaullienne, Mélenchon promet de revoir tous les traités européens et tous les traités de libre-échange pour mieux défendre l’intérêt de la France.
Mélenchon promet aussi plus de “démocratie participative” : une assemblée constituante qui pourrait être en partie formée de “citoyens” tirés au sort, des élus révocables en cours de mandat et un recours au référendum plus fréquent. Des propositions communes à tous les candidats “anti-système” qui draguent ouvertement les nombreux déçus des partis traditionnels. Il ratisse ainsi le plus largement possible en donnant le change à tous les “sans” et les “anti”. Mais pas une seule de ses mesures ne remet en cause l’essentiel : l’exploitation capitaliste. Le vieil argument déjà utilisé par les staliniens et les trotskistes depuis la nuit des temps, selon lequel imposer une répartition plus juste des richesses est en soi une remise en cause du capitalisme, ne tient pas. Le système capitaliste ne peut pas être remis en cause si ce qui le fonde ne l’est pas, c’est-à-dire si le salariat, le profit, la nation et l’État sont non seulement maintenus mais confortés à travers des mesures qui visent à en faire les piliers de la société : revalorisation des salaires pour dynamiser la consommation, imposition plus progressive, démocratie participative et “préférence nationale”.
Le discours peut-être contestataire, conspuant les élites et les “ultra-riches”, il ne peut cacher la réalité : Mélenchon est un pur produit du système capitaliste qu’il prétend rejeter et son radicalisme n’est que le résultat d’une stratégie globale de la bourgeoisie pour faire en sorte que le terrain politique soit le plus possible occupé. En gesticulant sur la gauche du PS, Mélenchon flatte son ego de “leader” en pensant à ses maîtres (Castro, Chavez 3... d’emblématiques apôtres du nationalisme !) et cherche à ramasser derrière des propositions rebattues et inoffensives le maximum de ceux qui tentent de s’interroger sur la perspective que le capitalisme nous propose. Ce n’est pas en comptant sur le genre de propositions avancées par Mélenchon, pas plus que celles de n’importe quel autre candidat, que le prolétariat pourra faire triompher sa propre perspective.
GD, 1er février 2017
1 Déclaration en juillet 2016 au Parlement européen.
2 Le choix de l’insoumission, livre d’entretiens avec Marc Endeweld, journaliste à Marianne, éditions du Seuil, 2016.
3 Voir dans RI no 461 notre article : “Mélenchon, un apôtre du modèle stalinien [29]”.
Géographique:
- France [15]
Personnages:
- Jean-Luc Mélenchon [30]
Récent et en cours:
- Elections 2017 [20]
Rubrique:
Affaire Théo: violences policières, terreur d’État
- 1117 lectures
Toute une campagne médiatique s’est déployée il y a peu de temps autour de la scandaleuse affaire Théo, ce jeune homme interpellé violemment par la police le 2 février à Aulnay-sous-Bois, et sodomisé avec la matraque d’un des policiers. A en croire l’IGPN en charge de l’enquête interne de la police : il s’agissait d’un “accident”, un coup de matraque “malencontreux”… mais en aucun cas d’un viol ! Bref, la faute à “pas de chance”. Une telle hypocrisie ne vient que rajouter à l’ignominie de l’agression elle-même.
Au vu des témoignages, ce jeune homme se serait opposé au contrôle musclé d’un groupe de jeunes par des policiers qui se seraient alors retournés contre lui. Nous savons combien les contrôles et interpellations policières ne se font jamais dans la dentelle : mépris, insultes racistes et humiliations en tout genre sont souvent au rendez-vous. Mais une telle violence dans une simple interpellation témoigne de la banalisation des répressions musclées.
Cette agression a logiquement abouti à une indignation légitime qui a pris la forme de messages de soutien, de témoignages, de rassemblements, mais aussi de confrontations violentes avec les flics. Tout ceci, la classe politique ne pouvait l’ignorer : du président Hollande se rendant au chevet de Théo à la secrétaire d’État à l’Aide aux victimes traitant ces policiers de “délinquants”, en passant par le maire de Nice, Christian Estrosi, parlant de “flics voyous” : tous s’y sont mis pour condamner cette “bavure”.
Mais qu’on ne s’y trompe pas ! Derrière leur prétendue “solidarité” envers Théo, l’objectif était avant tout de désamorcer les explosions émeutières et les flambées de colère (sur lesquelles a pesé d’ailleurs un certain black-out) pouvant à leur tour entraîner d’autres dérapages. Il s’agissait de préserver l’image de l’État et d’une institution policière mise à mal et de préserver le “bon déroulement” de la campagne électorale déjà largement éclaboussée par d’autres scandales. Mélenchon, soi-disant plus radical que les autres, y allait de son couplet pour défendre l’image des institutions bourgeoise en déclarant que “L’affaire Théo est le scandale de trop : la police doit être républicaine” (sic).
En revanche, l’indignation chez les jeunes lycéens, mobilisés dans la rue et les lycées contre les violences policières au quotidien, est un sincère cri de colère qui n’a aujourd’hui, hélas, pas les moyens d’éviter l’impasse que représente la confrontation directe avec les flics. Ces jeunes dénoncent pourtant, à travers leur mobilisation, les discours officiels selon lesquels il n’y aurait que de simples “brebis galeuses” au sein d’une police essentiellement “au service de la démocratie et du peuple”, nous “protégeant du terrorisme et des attentats”, au point de nous inciter à les applaudir lors des “manifs citoyennes” après les attentats contre Charlie Hebdo !
Mais les faits sont têtus : il ne fait pas bon d’être noir ou d’origine maghrébine et habitant un quartier populaire. Une récente enquête publique confirme d’ailleurs que les contrôles d’identité sont effectivement très ciblés : les jeunes de 18 à 25 ans sont contrôlés sept fois plus que les autres personnes, 80 % des jeunes hommes “perçus comme Noirs ou Arabes” disent avoir été contrôlés ces cinq dernières années, huit sur dix ont été fouillés, sans parler du tutoiement très fréquent, des insultes ou brutalités en tout genre. En clair, le viol de Théo n’est que l’expression spectaculaire et brutale des stigmatisations et de la répression policière permanente. Cette violence policière est en réalité celle de l’État. Un État qui impose son ordre derrière le masque hypocrite de la démocratie et de la république par la force au quotidien, n’en déplaise à Mélenchon qui clame qu’“une autre police est possible”, en tout cas “une autre république”, faute d’un autre monde. Lénine disait déjà contre ce type de discours que “l’État, c’est l’organisation de la violence destinée à mater une certaine classe”. Et c’est encore et toujours le cas aujourd’hui.
La récupération de ce mouvement de colère a commencé tout de suite : d’abord en jetant le doute sur la moralité de Théo et sa famille, sur la véracité des faits, en stigmatisant bien sûr les “casseurs” de tous poils qui ne cherchent qu’à se “payer du flic” lors de chaque manif. Ensuite, pour relancer la campagne électorale elle-même, sur le terrain de la sécurité et du retour à une “police de proximité” qui permettrait de “renouer du lien avec les jeunes”. Comme si chez les jeunes, l’enjeu était une simple question de “communication” en lieu et place d’une véritable perspective de vie, professionnelle et sociale, que le capitalisme ne peut leur offrir.
La “police de proximité” n’est qu’un cache-sexe de circonstance que Sarkozy a d’ailleurs jeté aux orties, il y a quelques années, en déclarant aux flics en 2003 : “la police n’est pas là pour organiser des tournois sportifs, mais pour arrêter des délinquants, vous n’êtes pas des travailleurs sociaux.” Le programme est donc respecté à la lettre, y compris par la gauche au pouvoir. Et cette gauche, si prompte pourtant à s’indigner aujourd’hui, a toujours été capable, dès les années 1980, de “s’adapter” dans la rue en réactivant, par exemple, ses fameuses brigades de police motorisées, dites “voltigeurs”, à l’origine de la mort de Malik Oussekine lors des manifestations étudiantes de 1986 et réapparues dernièrement en 2016 lors des manifestations contre la loi El Khomri.
Comme quoi, il n’y a aucune illusion à se faire sur la bourgeoisie et sa violence institutionnalisée, il y a d’un côté ses beaux discours, la main sur le cœur, et de l’autre, ses actes qui prouvent le contraire. Nous n’avons rien à attendre d’autre de l’État que la terreur, la répression, l’ordre des exploiteurs au quotidien.
Stopio, 2 mars 2017
Géographique:
- France [15]
Rubrique:
Élections et démocratie: l’avenir de l’humanité ne passe pas par les urnes
- 1791 lectures
Élection après élection, gouvernement après gouvernement, depuis des décennies, aux belles promesses d’un avenir meilleur succède une situation sociale toujours plus rude. Et pourtant, les 23 avril et 7 mai prochains, environ 35 millions de Français vont se rendre une nouvelle fois aux urnes pour élire le futur Président de la République. Pourquoi ? Une large partie de ces “citoyens” vont, sans grand enthousiasme, essayer “d’éviter le pire” et de “défendre les acquis démocratiques”, en éprouvant alors la sensation d’avoir accompli leur devoir.
Voter pour éviter le pire ?
L’extrême-gauche et la gauche se différencient de la droite et de l’extrême-droite tout particulièrement par l’humanisme de leur discours. La solidarité, l’accueil et le partage sont autant de valeurs qui leur sont attribuées. Cette image est d’autant plus tenace qu’est ancré dans les mémoires le passé glorieux de ses partis et militants. La figure de Jean Jaurès, par exemple, entraîne aujourd’hui encore un véritable élan de sympathie. Ainsi, malgré l’expérience de la gauche au pouvoir qui partout dans le monde depuis des décennies rime avec austérité 1, par millions, des ouvriers (salariés, chômeurs, retraités, étudiants précaires) vont régulièrement voter, sans véritable enthousiasme, sans croire à l’embellie, simplement pour éviter le pire, la droite arrogante, sexiste et souvent raciste, et l’extrême droite haineuse. Ce fut ainsi le “Tout sauf Sarkozy !” qui, en tout premier lieu, donna la victoire au socialiste François Hollande en 2007. Seulement, cette illusion d’éviter ainsi le pire ne tient pas face à la véracité des faits historiques. En voici quelques-uns parmi une liste interminable. “Je pense qu’il y a trop d’arrivées, d’immigration qui ne devrait pas être là. (…) On les fait parler français, et puis arrive un autre groupe, et il faut tout recommencer. Ça ne s’arrête jamais (…). Donc, il faut à un moment que ça s’arrête.” Le Pen ? Non… Hollande ! 2. Et de joindre le geste à la parole : expulsions, reconduites et blocages à la frontière records, démantèlement de la jungle de Calais et de multiples camps de Roms, traques d’enfants jusque dans les écoles (dont l’affaire Léonarda)3... Autre exemple : sous Hollande, les expulsions locatives ont bondi de plus de 35 % ! Et contrairement à ceux qui prétendent que Hollande a trahi la gauche, sa politique s’inscrit au contraire en parfaite continuité avec l’œuvre de ses prédécesseurs. Les lois de 1998 et 2000 de la socialiste Aubry sur les 35 heures étaient un masque pour généraliser la flexibilité du travail. C’est le socialiste Rocard qui a publié en 1991 le “livre blanc” sur les retraites, véritable bible de tous les gouvernements de droite comme de gauche depuis lors pour justifier la perpétuelle dégradation du niveau des pensions. C’est le même gouvernement qui a institué la Contribution Sociale Généralisée au nom de la “solidarité nationale”. C’est un ministre “communiste” qui a introduit en 1983 le paiement obligatoire d’un forfait hospitalier. La gauche plus sociale et humaine ? Souvenons-nous que c’est Mitterrand qui affichait le pire des cynismes dans sa défense des intérêts de l’impérialisme français en Afrique quand il déclarait, après avoir poussé au déclenchement des massacres au Rwanda en 1994 : “Les génocides dans ces coins-là, ça n’a pas tellement d’importance.” Là encore, Hollande a marché dans les pas (de bottes) de ses illustres prédécesseurs en armant l’Arabie saoudite qui, ces derniers mois, assassine, décapite et lapide la population au Yémen. Et que dire face aux 20 millions de personnes menacées actuellement de mourir de faim en Afrique de l’Est principalement à cause des guerres sordides auxquelles les États-Unis d’Obama et la France de Hollande ont grandement participé ? Décidément non, la gauche n’est pas un “moindre mal”. Ses discours prétendument humanistes ne servent qu’à ensevelir sous un tombereau de mensonges et d’hypocrisie la même barbarie capitaliste que celle de la droite.
Voter pour défendre la démocratie ?
Si, de l’extrême-droite à l’extrême- gauche, les différents gouvernements à travers la planète et depuis un siècle ont démontré maintes et maintes fois l’inhumanité de leur politique, demeure une idée chevillée au corps et à l’esprit de chaque “citoyen” : voter c’est défendre et faire vivre la démocratie. Your voice, your vote. Ta voix, ton vote. Ce message est omniprésent. Mais qu’en est-il de la réalité du pouvoir de ce petit bout de papier nommé bulletin de vote ?
La démocratie est une mystification car elle présuppose une humanité unifiée, telle qu’elle n’a jamais existé, que ce soit au cours des dernières 5000 années de société de classes ou durant la société primitive, divisée en tribus et en clans. La cohésion sociale, tout au long de l’Histoire, a été assurée par le pouvoir de la classe dominante et de sa machine d’État, au détriment de la masse impuissante des exploités et des opprimés. Dans une de ses premières expressions, le pouvoir d’État a pris la forme sophistiquée de la démocratie, comme dans la Grèce antique, d’où le mot est originaire. La Cité-État athénienne a pu adopter cette forme de gouvernement grâce à l’accroissement de la richesse apportée par un afflux d’esclaves, en lien avec le pillage impérialiste des pays voisins. Le demos, c’est-à-dire le peuple, de la démocratie grecque, ce n’était pas l’ensemble de la population, mais uniquement les citoyens habitant la polis. La masse des esclaves, qui représentait la majorité de la société, ainsi que les femmes et les étrangers, n’avaient pas droit à la citoyenneté. La démocratie, dans la Grèce antique, c’était l’arme de l’État au bénéfice des propriétaires d’esclaves. La démocratie bourgeoise, par essence, n’en est pas tellement différente. Les régimes parlementaires bourgeois du xixe siècle, excluent ouvertement du droit de vote la classe ouvrière par le régime censitaire (il faut être propriétaire pour pouvoir voter). Et quand le suffrage universel est octroyé à l’ensemble de la société, il reste encore à la bourgeoisie de nombreux moyens pour exclure la classe ouvrière de ses affaires politiques : les nombreux liens qui unissent les partis politiques à la bourgeoisie et à l’État, le système de suffrage direct, qui atomise les classes en des individus isolés et prétendument égaux, le contrôle des médias, et donc des campagnes électorales, par l’État, etc. C’est la raison pour laquelle aucune élection organisée par un État démocratique ne donna jamais une majorité aux Partis des classes exploitées. Bien au contraire ! Pendant la Commune de Paris, par exemple, l’Assemblée nationale élue en 1871 fut surnommée : “la Chambre introuvable”, en référence à la Chambre royaliste de 1815, tant la bourgeoisie n’aurait pu rêver meilleur résultat pour ses intérêts, alors même que Paris et une partie de la France étaient emportées par le torrent révolutionnaire.
La démocratie, quelle que soit la période historique où elle a surgi, a toujours été une méthode de gouvernement assurant la domination violente de la minorité sur la majorité, et non l’inverse, comme son nom le laisse croire. Elle n’a jamais été, et ne pourra jamais être un moyen d’autorégulation et de contrôle par l’ensemble de la société. La démocratie est l’organisation politique la plus sophistiquée d’une classe pour dominer la société :
• Elle permet de façon plus efficace et durable, de résoudre les différends au sein de la classe dominante et d’atténuer les luttes pour le pouvoir.
• Elle donne aux masses exploitées la meilleure illusion que les exploiteurs et l’État dirigent dans l’intérêt de l’ensemble de la population.
• Elle donne aussi aux exploités l’illusion qu’ils peuvent, au moins théoriquement, réaliser leurs intérêts au moyen de l’État tel qu’il existe, sans avoir besoin de le renverser.
• Enfin, pour ce qui concerne le futur, face à la menace que représente le prolétariat révolutionnaire, la démocratie répond au besoin de la bourgeoisie de proposer un avenir mythique et idéal qui ne nécessite pas le renversement de l’ordre établi concrètement. Si la “vraie” démocratie n’a jamais existé nulle part, ce serait, dit la bourgeoisie, parce que l’Homme, cette conception philosophique abstraite, hors du temps et de l’Histoire, n’a pas suffisamment essayé de la mettre en œuvre.
Ce n’est donc pas un hasard si les grandes démocraties sont les plus anciens pays capitalistes, là où la bourgeoisie comme le prolétariat ont tous deux une longue expérience de luttes. Plus la classe ouvrière est forte, plus sa conscience et son organisation sont développées, plus la bourgeoisie a besoin de son arme politique la plus efficace. Si l’arrivée de Hitler au pouvoir fut possible, démocratiquement d’ailleurs et soutenu par tous les grands industriels d’Allemagne, lors des élections de 1933, c’est justement que la classe ouvrière avait été préalablement écrasée physiquement et idéologiquement par la social-démocratie allemande pendant la vague révolutionnaire de 1918-1919. Ce n’est pas le délaissement des urnes par les “citoyens” qui a engendré l’arrivée du nazisme au pouvoir mais la défaite dans le sang de la classe ouvrière, vaincue militairement et politiquement par la très démocratique social-démocratie !
La bourgeoisie fait croire que sa bataille la plus importante et la plus longue sera toujours celle de “la démocratie contre la dictature”. Ainsi, la principale justification de l’impérialisme des Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme, c’est la lutte de la démocratie contre la dictature. Des millions d’êtres humains sont massacrés au nom de la démocratie. Après 1945, la démocratie est le principal thème mobilisateur de la Guerre froide menée contre le bloc impérialiste stalinien par le bloc dirigé par les États-Unis. Des pays entiers ont été ravagés au nom de la lutte contre l’expansion du totalitarisme. Après 1989, l’effondrement du bloc de l’URSS marque le début de toute une série d’aventures militaires colossales menées par les États-Unis pour maintenir leur hégémonie mondiale, sous la bannière de la démocratie et des droits de l’Homme, contre les dictateurs fous (guerre du Golfe, intervention en Yougoslavie) ou contre les terroristes démoniaques (guerre en Afghanistan). Ainsi, durant les conflits impérialistes qui ont ravagé la planète depuis plus d’un siècle, la force des “démocraties libérales” a constamment été de faire croire aux prolétaires qui servaient de chair à canon, qu’en se battant pour la démocratie, ce n’était pas les intérêts d’une fraction capitaliste qu’ils défendaient, mais un idéal de liberté face à la barbarie de systèmes dictatoriaux. Et c’est sans honte, avec le cynisme qui les caractérise, que ces mêmes démocraties ne se sont jamais gênées pour soutenir, utiliser ou même mettre en place telle ou telle dictature lorsque cela correspond à leurs besoins stratégiques. Les exemples ne manquent pas : ainsi les États-Unis en Amérique latine ou bien la France dans la plupart de ses ex-colonies africaines. Cette bataille éternelle de la démocratie contre la dictature est donc un mythe idéologique. Le capitalisme dans son ensemble, quel que soit son masque et son organisation politique, est une dictature, un système d’une minorité privilégiée exploitant l’écrasante majorité de l’humanité.
Voter au nom des combats passés ?
Il peut rester encore une raison qui pousse, malgré tout, à aller voter : le suffrage universel a été arraché de haute lutte, à travers des combats souvent sanglants, par la classe ouvrière au XIXe siècle : en Angleterre, avec le mouvement chartiste, en Allemagne entre 1848-49, en Belgique et les immenses grèves de 1893, 1902 et 1913... En France, ce n’est qu’après le bain de sang de la Commune de Paris en 1871 que les travailleurs ont obtenu définitivement le suffrage universel. Cette revendication se trouve même dans Le Manifeste communiste écrit par Marx et Engels en 1848. Mais se pose alors une question : pourquoi cette même bourgeoisie qui, au siècle dernier, réprimait violemment les ouvriers qui demandaient le suffrage universel, fait tant d’efforts aujourd’hui pour que le maximum d’entre eux aillent voter ? Pourquoi ces publicités payées par l’État et martelant : “Votez, votez, votez !” sur toutes les chaînes de télévision, dans la presse et les manuels scolaires ? Pourquoi sur tous les plateaux télés, les “abstentionnistes” sont culpabilisés et désignés comme des citoyens irresponsables mettant en péril la démocratie ? Pourquoi cette différence flagrante entre le xixe siècle et les xxe et xxie siècles ? Pour répondre, il est nécessaire de distinguer deux époques du capitalisme : l’ascendance et la décadence. Au xixe siècle, le capitalisme connaît sa phase d’apogée. La production capitaliste se développe à pas de géant. C’est dans cette période de prospérité que la bourgeoisie assoit sa domination politique sur l’ensemble de la société et élimine le pouvoir de l’ancienne classe régnante : la noblesse. Le suffrage universel et le parlement constituent un des moyens les plus importants de lutte de la fraction radicale de la bourgeoisie contre la noblesse et contre les fractions rétrogrades de celle-là. A ce titre, la démocratie bourgeoise et son idéologie libérale représentent une prodigieuse avancée historique par rapport à l’obscurantisme religieux de la société féodale. La lutte que mène le prolétariat, durant cette période, est directement conditionnée par cette situation du capitalisme. En l’absence de crise mortelle de celui-ci, la révolution socialiste n’est pas à l’ordre du jour. Pour le prolétariat, il est question de renforcer alors son unité et sa conscience en combattant pour des réformes durables, pour tenter d’améliorer ses conditions de vie attaquées en permanence. Les syndicats et les partis parlementaires lui permettant de se regrouper indépendamment des partis bourgeois et démocratiques et de faire pression sur l’ordre existant, au besoin en faisant tactiquement alliance avec des fractions radicales de la bourgeoisie, sont les moyens qu’il se donne pour l’obtention de réformes. Le parlement étant le lieu où les différentes fractions de la bourgeoisie s’unissent ou s’affrontent pour gouverner la société, le prolétariat se doit d’y participer, sous conditions, pour tenter d’infléchir son action dans le sens de la défense de ses intérêts. Avec le xxe siècle, le capitalisme entre dans une nouvelle phase : celle de son déclin historique. Le partage du monde est terminé entre les grandes puissances. Chacune d’entre-elles ne peut s’approprier de nouveaux marchés qu’au détriment des autres. Avec l’agonie du capitalisme s’ouvre, comme dit l’Internationale communiste, “l’ère des guerres et des révolutions”. D’un côté, la Première Guerre mondiale éclate. De l’autre, en Russie (1905 et 1917), en Allemagne (1918-1923), en Hongrie (1919), en Italie (1920), le prolétariat fait trembler le vieux monde par une vague révolutionnaire internationale. Pour faire face à ses difficultés croissantes, le capital est contraint de renforcer constamment le pouvoir de son État. De plus en plus, l’État tend à se rendre maître de l’ensemble de la vie sociale en premier lieu dans le domaine économique. Cette évolution du rôle de l’État s’accompagne d’un affaiblissement du rôle du législatif en faveur de l’exécutif. Plus concrètement, comme le dit le deuxième congrès de l’Internationale communiste : “Le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement et définitivement sorti du Parlement”. Aujourd’hui, en France, comme ailleurs, il est patent que l’Assemblée nationale n’a plus aucun pouvoir, c’est tout au plus une chambre d’enregistrement : la grande majorité (80 %) des lois qu’elle vote est présentée par le gouvernement et une fois votée cette loi doit être promulguée par le Président de la République et, pour prendre effet, doit encore attendre que soit signé le décret d’application par ce même Président. Ce dernier peut d’ailleurs se passer carrément du parlement pour légiférer en ayant recours aux ordonnances ou encore, en France, à l’aide de l’article 16 de la constitution qui lui octroie les pleins pouvoirs. Ce rôle insignifiant du Parlement se traduit par une participation ridicule des députés à ses séances : la plupart du temps, ils ne sont pas plus d’une vingtaine à suivre ses débats, alors qu’il était, au xixe siècle, le lieu de luttes âpres et enflammées, et de discours parfois brillants, comme ceux de Jean Jaurès en France ou de Karl Liebknecht en Allemagne.
En même temps que s’amenuise la fonction politique effective du parlement, la fonction mystificatrice grandit et la bourgeoisie ne s’y trompe pas qui, dès 1917 en Russie et 1919 en Allemagne, brandit l’assemblée constituante contre la révolution prolétarienne et ses conseils ouvriers. Désormais, la démocratie parlementaire sera le meilleur moyen dont disposera la bourgeoisie pour domestiquer le prolétariat.
L’avenir de l’humanité passe par la lutte de classe
La bourgeoisie exerce le pouvoir non dans son ensemble mais en le déléguant à une fraction minoritaire en son sein, regroupée dans les partis politiques. Cela est valable aussi bien dans les démocraties (concurrence entre plusieurs partis) que dans les régimes totalitaires fascistes ou staliniens (parti unique). Ce pouvoir d’une minorité de spécialistes de la politique n’est pas seulement le reflet de la position minoritaire de la bourgeoisie au sein de la société ; il est également nécessaire pour préserver les intérêts généraux du capital national face aux intérêts divergents et concurrents des différentes fractions de cette bourgeoisie. Ce mode de pouvoir par délégation est donc inhérent à la société bourgeoise et se reflète dans chacune de ses institutions et principalement dans le suffrage universel. Celui-ci est même le moyen privilégié par lequel “la population”, en fait la bourgeoise, “confie” le pouvoir à un ou plusieurs partis politiques. Pour l’action révolutionnaire du prolétariat, ce n’est pas à une délégation minoritaire de la classe que revient le rôle d’agir et de prendre le pouvoir mais à l’ensemble de la classe. C’est là la condition indispensable du succès de tout mouvement prolétarien. Le suffrage universel ne peut donc, de quelque façon que ce soit, servir de cadre pour l’engagement révolutionnaire du prolétariat contre l’ordre existant. Loin de favoriser la mobilisation et l’initiative des plus larges masses, il tend au contraire à maintenir leurs illusions et leur passivité. Mai 68, la plus grande grève depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a débouché un mois après sur la plus grande victoire électorale que la droite ait connue en France. La raison de ce décalage réside dans le fait que l’élection d’un député se trouve dans une sphère totalement différente de celle de la lutte de classe. Cette dernière est une action collective, solidaire, où l’ouvrier est accompagné d’autres ouvriers, où les hésitations des uns sont emportées par la résolution des autres, où les intérêts en cause ne sont pas particuliers mais ceux d’une classe. Par contre, le vote fait appel à une notion totalement abstraite, en dehors de cette réalité d’un rapport de forces permanent entre deux classes sociales aux intérêts diamétralement opposés : le citoyen, qui se retrouve seul dans l’isoloir face à un choix pour quelque chose d’extérieur à sa vie quotidienne. C’est le terrain idéal pour la bourgeoisie, celui où la combativité ouvrière n’a aucune possibilité de se manifester réellement. Ce n’est pas par hasard que celle-là fait tant d’efforts pour faire voter. Les résultats électoraux sont justement le terrain où ne s’exprime pas du tout la combativité des masses ouvrières. Au contraire, en France par exemple, la proposition par certains candidats d’une VIe République et d’une nouvelle Constitution pousse à enfermer le raisonnement de l’individu-citoyen dans le cadre étroit des frontières nationales et de la reproduction des rapports sociaux mortifères de concurrence et d’exploitation capitalistes.
La réponse aux contradictions de ce système et aux souffrances croissantes qu’il engendre ne peut être apportée que par la dimension internationale de la lutte du prolétariat et sa pratique mondiale de la solidarité. Afin de libérer la société des conséquences destructrices de la production capitaliste, le communisme doit abolir les classes et la propriété privée, ce qui entraîne un dépérissement de l’État et de la démocratie : “on oublie constamment que la suppression de l’État est aussi la suppression de la démocratie, que l’extinction de l’État est l’extinction de la démocratie. Une telle assertion paraît, à première vue, des plus étranges et inintelligibles ; peut-être certains craindront-ils que nous souhaitions l’avènement d’un ordre social où ne serait pas observé le principe de la soumission de la minorité à la majorité ; car enfin, la démocratie n’est-elle pas la reconnaissance de ce principe ? Non. La démocratie et la soumission de la minorité à la majorité ne sont pas des choses identiques. La démocratie, c’est un État reconnaissant la soumission de la minorité à la majorité ; autrement dit, c’est une organisation destinée à assurer l’exercice systématique de la violence par une classe contre une autre, par une partie de la population contre l’autre partie. Nous nous assignons comme but final la suppression de l’État, c’est-à-dire de toute violence organisée et systématique, de toute violence exercée sur les hommes en général. Nous n’attendons pas l’avènement d’un ordre social où le principe de soumission de la minorité à la majorité ne serait pas observé. Mais, aspirant au socialisme, nous sommes convaincus que dans son évolution il aboutira au communisme et que, par suite, disparaîtra toute nécessité de recourir en général à la violence contre les hommes, toute nécessité de la soumission d’un homme à un autre, d’une partie de la population à une autre ; car les hommes s’habitueront à observer les conditions de la vies élémentaire en société, sans violence et sans soumission.” (Lénine, L’État et la Révolution). La démocratie ne signifiera plus rien dans une société communiste qui aura remplacé le gouvernement des gens et la gestion capitaliste par “l’administration des choses”, dans un monde qui, contrairement au capitalisme, s’accommode et profite de la diversité des besoins et des capacités des individus.
Sandrine, 3 mars 2017
1 Sur le passage des partis socialistes dans le camp bourgeois dans les années 1910 et celui des partis communistes dans les années 1930, lire nos brochures disponibles sur notre site internet.
2 Propos tenus aux journalistes Davet et Lhomme, le 23 juillet 2014.
3 La gauche du capital a une longue expérience de traitement inhumain et barbare des immigrés. L’ensemble de la social-démocratie européenne a, par exemple, soutenu les décisions “courageuses” du gouvernement socialiste espagnol de Zapatero qui en 2005 avait donné l’ordre de tirer sur les migrants, d’en abandonner dans le désert au Sud d’Oujda, de lancer des coups de filet massifs dans les villes marocaines, de multiplier les vols charter de rapatriement vers le Mali et le Sénégal avec des hommes et des femmes entassés dans des autobus de la mort vers le désert du Sahara. Et il ne s’agit pas là d’une spécialité de la gauche démocratique européenne. Aux États-Unis, si l’annonce de Trump d’expulser sous sa présidence entre 2,5 et 3 millions d’immigrés clandestins a fait scandale, le très populaire Obama a fait expulser en catimini, entre 2009 et 2015, 2,5 millions de “clandestins” !
Récent et en cours:
- élections [31]
- Elections 2017 [20]
Questions théoriques:
- Démocratie [32]
Manifestations en Roumanie: la mystification démocratique et le poison nationaliste
- 961 lectures
Les très importantes manifestations qui ont eu lieu depuis janvier en Roumanie contre une réforme du Code pénal menée par le gouvernement social-démocrate pour alléger les peines encourues dans les cas de corruption, proposer une amnistie totale dans les cas de corruption de moins de 200 000 lei (45 000 €) et amnistier d’anciens élus actuellement détenus, sont sans précédent dans ce pays depuis celles qui ont abouti à la déchéance du régime Ceaucescu en 1989. Cet ensemble de lois était en fait taillé “sur mesure” pour amnistier dans les faits, Liviu Dragnea, le président du parti social-démocrate (PSD) au pouvoir, accusé de malversations et d’emplois fictifs portant sur une somme de 100 000 lei.
Le gouvernement a tenté de faire passer ce texte en force par une ordonnance d’urgence dans la nuit du 31 janvier et une heure plus tard, le texte était publié au Journal officiel ! La réponse a été une indignation qui n’a fait qu’enfler le nombre de manifestants : dimanche 22 janvier, 30 000 personnes au moins défilaient à Bucarest, 20 000 dans les autres grandes villes du pays. Le 2 février, 150 000 personnes manifestaient à Bucarest. Le 5 février, c’est presque un demi-million de Roumains qui se trouvaient dans la rue à travers tout le pays, 250 000 rien qu’à Bucarest. “La Roumanie connaît les plus importantes manifestations de masse de son histoire”, titrait Die Welt, le 6 février. Les manifestants ont bravé un thermomètre indiquant – 10 °C. Beaucoup de jeunes de province sont venus manifester dans la capitale en profitant de la gratuité des transports en commun pour les étudiants récemment votée par le gouvernement ! Dans au moins 20 autres villes du pays, il y a eu des manifestations, ce qui montre l’étendue du mécontentement face aux mesures gouvernementales.
Le mépris du gouvernement et du PSD au pouvoir n’a fait qu’accentuer l’indignation des manifestants, Liviu Dragnea qualifiant à la télévision de “Bullshit” ce qui se passait à Bucarest et le Premier ministre Grindeanu affirmant qu’il n’y avait aucune raison pour que le gouvernement démissionne. La question n’est pourtant pas sans enjeu pour la Roumanie, qui souhaite intégrer l’espace Schengen et ne le peut pas pour l’instant du fait d’un rapport défavorable de l’UE sur la corruption dans le pays.
Cependant, le 2 février, le ministre délégué pour le Milieu des affaires démissionnait. Le 8 février, le principal artisan du décret, le ministre de la Justice Florin Iordache, démissionnait à son tour. Le pouvoir ne pouvait que lâcher du lest pour déminer le mécontentement de la population, ce qui s’est avéré insuffisant : le 5 février, le gouvernement retirait les ordonnances incriminées.
En 1990, dans ses Thèses sur la décomposition, le CCI écrivait : “Mais les manifestations de l’absence totale de perspectives de la société actuelle sont encore plus évidentes sur le plan politique et idéologique. Ainsi :l’incroyable corruption qui croît et prospère dans l’appareil politique, le déferlement de scandales dans la plupart des pays tels le Japon (où il devient de plus en plus difficile de distinguer l’appareil gouvernemental du milieu des gangsters), l’Espagne (où c’est le bras droit du chef du gouvernement socialiste qui, aujourd’hui, est directement en cause), la Belgique, l’Italie, la France (où les députés décident de s’amnistier eux-mêmes pour leurs turpitudes).” La situation de corruption généralisée et impudente que l’on voit en Roumanie n’a en effet rien d’une exception ! Cette multiplication des phénomènes de corruption est une caractéristique de la période de décomposition que connaît la société capitaliste toute entière, et ce n’est donc pas un phénomène lié aux tares particulières de politiciens particulièrement sans scrupules. La corruption est constitutive de la société capitaliste, et la décomposition de ladite société, en exacerbant “la débandade générale au sein même de l’appareil étatique, la perte du contrôle sur sa propre stratégie politique, […] constitue […], en réalité, la caricature […] d’un phénomène beaucoup plus général affectant l’ensemble de la bourgeoisie mondiale, un phénomène propre à la phase de décomposition” (Thèses sur la décomposition). La bourgeoisie ayant de plus en plus de mal de fédérer ses propres composantes autour d’un projet politique commun, il est logique que de plus en plus de ses membres ne cherchent qu’à trouver leur intérêt personnel dans les affaires de l’État, et rien d’autre !
Cependant, le phénomène de la décomposition de la société capitaliste ne touche pas que la classe dominante, et les manifestations que nous voyons aujourd’hui en Roumanie et ailleurs nous le montrent clairement. Ces manifestations provoquées par une indignation parfaitement légitime contre la corruption habituelle des politiciens dans un pays où le salaire moyen est d’un peu plus de 300 € mensuels ont été une réaction de colère face à une classe politique pourrie. Il faut cependant constater que ces manifestations ont connu des expressions totalement anti-prolétariennes, religieuses, voire purement nationalistes. Le Président de la république Ihoannis avait rejoint la manifestation du 22 janvier, et les manifestants du 5 février à Bucarest ont chanté l’hymne national, ceux de Timisoara ou de Iasi ont entonné en chœur le “notre Père”. À Ploiesti, 3000 manifestants se sont agenouillés devant le siège du PSD pour implorer le gouvernement de retirer son texte. L’un des principaux slogans des manifestations était : “Dragnea, n’oublie pas : Laura t’attend !”. Laura Codruta Kövesi est la cheffe du parquet national anticorruption (DNA). Que les manifestants mettent leurs espoirs de lutte contre les politiciens corrompus dans une des émanations judiciaires de l’État roumain n’est pas la moindre des contradictions de ce mouvement !
Les revendications des manifestants roumains ne demandaient sur le fond rien de plus que le rétablissement du “dialogue démocratique” ; ainsi que le disait un manifestant, le problème pour lui est que les politiciens “ne veulent pas parler au peuple et établir un dialogue”. En fait, le hiatus entre la vie de politicien corrompu et celle de simple citoyen devient si grotesque qu’il en est devenu insupportable pour une grande partie de la population. Mais pour l’instant la classe ouvrière ne voit pas sa perspective propre, et la bourgeoisie peut facilement la faire adhérer à la revendication de “rétablir la démocratie” pour “rapprocher les élus du peuple”. Ce sont de très classiques revendications populistes, et elles n’ont en tout cas rien de révolutionnaire.
Nous voyons aujourd’hui beaucoup de manifestations très importantes à travers le monde : en Corée du Sud contre la corruption de la présidente Park et de sa “gourou” personnelle, en Angleterre contre le Brexit, aux États-Unis contre la politique de Donald Trump, au Brésil contre les scandales Petrobras et Odebrecht… Ces manifestations ont des points communs très forts avec ce qui se passe en Roumanie, une indignation partagée contre les agissements de certains politiciens corrompus ou partisans de mesures dont les manifestants ne veulent pas entendre parler (comme la rupture nationaliste du Brexit, ou les décrets anti-immigration de Trump), une exaspération face à la situation économique qui se dégrade alors que des politiciens piochent allègrement dans les finances étatiques, une volonté de peser politiquement contre les gouvernants, mais aussi de demander aux politiciens “d’écouter” les citoyens et de se conformer fondamentalement à une certaine morale, notamment en faisant la “transparence” sur leurs actes et leurs finances.
Mais derrière ces expressions confuses d’indignation (tout à fait compréhensibles et respectables par ailleurs), il faut se demander quelle perspective il y a pour le prolétariat. Et là, le pot aux roses se dévoile assez vite : dans un article du 4 février 2017, le journal Le Monde nous le dit très clairement : “[…] ce vol organisé par les dépositaires du pouvoir non seulement soustrait des revenus aux gens honnêtes et à l’économie mais, par son mode de fonctionnement, mine la démocratie et la confiance politique.” Ce genre de revendication est pleinement acceptable, non seulement par les fractions bourgeoises les plus susceptibles d’arriver au pouvoir, mais surtout par les fractions populistes les plus réactionnaires, qui demandent ouvertement que les “corrompus” et les “profiteurs” de l’État “dégagent” ; n’est-ce pas le slogan de Trump qui, pendant sa campagne électorale, promettait de “faire le ménage” à Washington ?
Lorsque le prolétariat se laisse embarquer sur ce terrain, il est totalement impuissant. Or ce que l’on voit pour l’instant dans ces mouvements, partout dans le monde, c’est que le prolétariat se retrouve noyé dans un mouvement pour… combattre les effets les plus visibles de la décomposition sociale, qui touche effectivement la bourgeoisie et est à l’origine du développement du populisme dans certaines de ses fractions. Ce n’est aucunement une perspective émancipatrice pour la classe ouvrière, qui doit combattre son ennemi de toujours : la bourgeoisie en tant que classe exploiteuse et dominante, et les rapports de production capitalistes.
Aujourd’hui, la décomposition qui frappe la bourgeoisie et provoque toujours plus de corruption des élus, une idéologie de “retour en arrière” toujours plus réactionnaire, empêche la classe ouvrière de voir où sont ses intérêts réels. Ce n’est qu’en retrouvant le chemin de la lutte de classe, contre la dégradation de ses conditions de vie et de travail, que la classe ouvrière retrouvera son identité et son véritable combat.
Sven, 22 février 2017
Géographique:
- Europe [33]
Rubrique:
Il y a 100 ans, la Révolution russe: qu’est-ce que les conseils ouvriers ?
- 1045 lectures
Au début du xxe siècle, au cours de ses plus grandes luttes, le prolétariat s’est donné une nouvelle forme d’organisation adaptée à sa tâche révolutionnaire : les conseils ouvriers (ou soviets).
Les conseils ouvriers se caractérisent par :
– leur constitution sur la base des assemblées générales ouvrières ;
– l’élection et la révocabilité à tout moment des délégués, l’unité entre la prise de décision et l’application de cette décision (non séparation entre “législatif” et “exécutif” ) ;
– leur regroupement et centralisation non sur des bases professionnelles ou industrielles mais sur des bases territoriales (ce ne sont pas les typographes ou les travailleurs du textile qui se regroupent comme dans les syndicats, mais les travailleurs d’une entreprise, d’un quartier, d’une ville, d’une région, etc.).
Cette forme spécifique d’organisation de la classe ouvrière est directement adaptée aux tâches qui attendent le prolétariat dans la révolution.
En premier lieu, il s’agit d’une organisation générale de la classe, regroupant l’ensemble des travailleurs. Auparavant, toutes les formes d’organisations ayant existé, y compris les syndicats, ne regroupaient qu’une partie de la classe. Si cela était suffisant pour que le prolétariat puisse exercer une pression sur le capitalisme afin de défendre au mieux ses intérêts dans le système, c’est seulement en s’organisant en totalité que la classe est en mesure d’accomplir sa tâche historique de destruction du système capitaliste et d’instauration du communisme. Si l’action et le pouvoir d’une partie de la bourgeoisie (ses partis politiques) était possible et même nécessaire dans l’accomplissement de sa révolution, c’est que cette classe elle-même ne constituait qu’une partie infime de la population, qu’elle était une classe exploiteuse, et que par ailleurs, seule une minorité d’elle-même pouvait se hisser au-dessus des conflits d’intérêts qui l’ont toujours traversée du fait des rivalités économiques existant entre ses divers secteurs. Par contre, tant du fait qu’il n’existe pas d’antagonismes ni de rivalités au sein du prolétariat que du fait que la société qu’il est appelé à instaurer abolit toute exploitation et toute division en classes, que le mouvement qu’il conduit est “celui de l’immense majorité au bénéfice de l’immense majorité” (Le Manifeste communiste), seule son organisation générale est en mesure d’accomplir cette tâche historique.
En deuxième lieu, l’élection et la révocabilité à tout moment des différentes charges, expriment le caractère éminemment dynamique du processus révolutionnaire, le perpétuel bouleversement tant de la société que celui qui traverse la classe elle-même, notamment dans le développement de sa conscience : ceux qui avaient été nommés pour telle ou telle tâche, ou parce que leurs positions correspondaient à tel niveau de conscience de la classe ne sont plus nécessairement à leur place lorsque surgissent de nouvelles tâches ou que ce niveau de conscience a évolué. Elles expriment également le rejet par la classe en action de toute spécialisation définitive, de toute division en son sein entre “masses et chefs”, la fonction essentielle de ces derniers (les éléments les plus avancés de la classe ) étant justement de tout faire pour que disparaissent les conditions qui ont provoqué leur apparition : l’hétérogénéité du niveau de conscience dans la classe. Si dans les syndicats, même quand ils étaient encore des organes de la classe ouvrière, il pouvait exister des fonctionnaires permanents, c’était dû au fait que ces organes de défense des intérêts ouvriers dans la société capitaliste portaient en eux certaines des caractéristiques de cette société. De même qu’il utilisait des instruments spécifiquement bourgeois comme le suffrage universel et le Parlement, le prolétariat reproduisait en son propre sein certains traits de son ennemi bourgeois tant qu’il cohabitait avec lui et que l’heure de sa destruction n’avait pas encore sonné. La forme d’organisation statique des syndicats exprimait le mode de lutte de la classe ouvrière lorsque la révolution n’était pas encore possible. La forme d’organisation dynamique des conseils ouvriers est à l’image de la tâche qui est enfin à l’ordre du jour : la révolution communiste. De même, l’unité entre la prise de décision et son application exprime ce même rejet de la part de la classe révolutionnaire de toute spécialisation institutionnalisée, elle traduit le fait que c’est toute la classe qui non seulement prend les décisions essentielles qui la concernent mais aussi participe à l’action de transformation de la société.
En troisième lieu, l’organisation sur une base territoriale et non plus professionnelle ou industrielle exprime la nature différente des tâches prolétariennes. Lorsqu’il s’agissait de faire pression sur un patron ou sur un syndicat patronal en vue d’une augmentation des salaires ou de meilleures conditions de travail, l’organisation par métier ou par branche industrielle avait un sens. Même une organisation aussi archaïque que celle du métier permettait une réelle efficacité des travailleurs contre l’exploitation ; notamment, elle empêchait les patrons de faire appel à d’autres ouvriers d’une profession lorsque certains étaient en grève. La solidarité entre typographes, cigariers ou doreurs sur bronze était un embryon d’une réelle solidarité de classe, une étape dans l’unification de la classe ouvrière en même temps qu’elle pouvait faire reculer les patrons. Même si pesaient sur elle les distinctions et divisions propres à l’économie capitaliste, l’organisation syndicale était donc un moyen réel de lutte dans le système. Par contre, lorsqu’il s’agira non plus de faire reculer tel ou tel secteur du capitalisme, mais de s’affronter à lui en totalité, de le détruire et d’instaurer une autre société, l’organisation spécifique des typographes ou des ouvriers du caoutchouc ne saurait avoir le moindre sens. Pour prendre en main l’ensemble de la société, c’est sur une base territoriale que s’organise la classe ouvrière même si les assemblées de base se tiennent au niveau des entreprises.
Une telle tendance existe déjà à l’heure actuelle dans les luttes de résistance contre l’exploitation qui, loin de se donner une forme syndicale, rejettent cette forme pour s’organiser en assemblées générales souveraines, nommer des comités de grève élus et révocables, briser le carcan professionnel ou industriel pour s’étendre au niveau territorial.
D’une part, cette tendance exprime le fait que, dans sa période de décadence, le capitalisme prenant une forme de plus en plus étatique, l’ancienne distinction entre luttes politiques (qui étaient l’apanage des partis ouvriers du passé) et luttes économiques (dont les syndicats avaient la responsabilité) a aujourd’hui de moins en moins de sens : toute lutte économique sérieuse devient politique en s’affrontant à l’Etat : soit à ses policiers, soit à ses représentants dans l’usine, les syndicats. D’autre part, elle indique la signification profonde des luttes présentes comme préparatifs des affrontements décisifs de la période révolutionnaire : même si c’est un aiguillon économique (la crise, l’aggravation intolérable de l’exploitation) qui jette les ouvriers dans ces affrontements, les tâches qui se présentent à eux sont éminemment politiques : attaque frontale et armée contre l’Etat bourgeois, instauration de la dictature du prolétariat.
La Révolution russe et ses conseils ouvriers il y a un siècle sont toujours une source d’inspiration pour la société actuelle. Lire, débattre et tirer les leçons de cette gigantesque expérience du prolétariat est une absolue nécessité pour l’avenir.
CCI
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [34]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Révolution Internationale n°464 - mai juin 2017
- 989 lectures
Présidentielle en France : c’est toujours la bourgeoisie qui gagne les élections
- 1071 lectures
Le nouveau président de la République est enfin élu, cet homme prétendument “nouveau” et “hors système” : Emmanuel Macron.
Celui-ci promet de “changer” la France et de “réunir tous les Français” dans une nouvelle concorde nationale et fraternelle. Il promet de relancer l’économie française et se veut l’homme du renouveau européen, d’une zone euro plus démocratique et économiquement dynamique. Autant d’enjeux de nature exclusivement bourgeoise. C’est sans conteste la classe bourgeoise qui seule peut se réjouir des résultats et ce sont toujours ses propres représentants qui gagnent les élections. Il n’y a là rien de nouveau. La démocratie est l’idéologie derrière laquelle se cache la dictature du capitalisme, son État totalitaire et sa domination sur la société. Depuis plus d’un siècle, le terrain électoral est un piège mystificateur puissant contre le prolétariat. Les élections bourgeoises sont en effet un des moments privilégiés pour la classe dominante afin de se donner des gouvernements conformes à la défense de ses intérêts, tout en développant de manière intensive et concentrée l’idéologie démocratique servant à masquer sa cupidité et la dictature du système capitaliste. À travers celles-ci, elle tente de faire croire que c’est la majorité de la population qui gouverne et décide. Ceci est l’exact contraire de la réalité. La démocratie est bien la dictature la plus idéologiquement sophistiquée permettant à la minorité exploiteuse de dominer la majorité de la population et, au premier rang de celle-ci, le prolétariat. Elle efface les antagonismes d’intérêts de classes pourtant irréconciliables. Elle transforme le prolétariat révolutionnaire en une somme d’individus, de “citoyens-électeurs” isolés, atomisés et impuissants 1.
Des élections marquées par le danger du populisme
C’est un fait évident, la bourgeoisie française dans ses secteurs les plus responsables du point de vue de ses intérêts objectifs était très inquiète de la possibilité de l’arrivée du FN au pouvoir, ce parti bourgeois et défenseur lui-aussi de l’intérêt national mais totalement irrationnel et irresponsable. À ce niveau, Angela Merkel, la chancelière allemande, et son tristement célèbre ministre de l’Économie, le sieur Schlaube, étaient également très préoccupés. Ils n’ont donc pas ménagé leur soutien très actif à la candidature Macron. Merkel ne déclarait-elle pas pendant l’entre deux tours du scrutin français : “Je n’ai aucun doute sur le fait qu’Emmanuel Macron, s’il est élu, ce que je souhaite, sera un président fort” ? Sans oublier l’ancien président américain Obama et la Commission européenne qui n’ont pas arrêté de mener campagne pour soutenir eux-aussi cette candidature. De fait, la bourgeoisie française misait sur deux candidats jugés les plus aptes à gérer au mieux les affaires du capitalisme national, tout en pouvant faire face au FN : messieurs Juppé et Macron. Cependant, la candidature Juppé était dès le départ fort compromise. Celui-ci, ancien Premier ministre, membre d’un parti rejeté par la majorité des français (Les Républicains) et au lourd passé d’homme d’appareil, représentait un fort risque d’échec. Ce que les primaires de la droite ont amplement confirmé avec la victoire surprise de François Fillon. En réalité, des secteurs croissants de la bourgeoisie travaillaient déjà de plus en plus ouvertement à la réussite de “l’homme nouveau” Macron. Le soutien actif du Président sortant, François Hollande, est rapidement devenu un secret de polichinelle. Il en allait de même pour un certain nombre de ténors au sein du Parti socialiste en pleine déconfiture. Ce phénomène était aussi présent au sein de la droite elle aussi en pleine crise. Soutenue par de nombreux milieux d’affaires (financiers et industriels), relayée par les médias, BFM en tête, la campagne était outrancière, mais efficace ! Il fallait promouvoir Macron à tout prix ! Pourquoi une telle volonté, une telle détermination de la part des partis les plus responsables de la bourgeoisie occidentale et française ? Sûrement pas pour défendre l’intérêt du prolétariat ! En vérité, toute cette partie de la classe dominante avait peur de voir le FN accéder au pouvoir et il lui fallait absolument donner l’illusion d’un “renouvellement”.
La bourgeoisie est la classe la plus machiavélique de l’histoire
La bourgeoisie est sans contestation possible la classe exploiteuse la plus intelligente de l’histoire. En tant que classe, elle ne peut jamais perdre totalement de vue où sont ses intérêts et comment les défendre. L’histoire du capitalisme est là pour le démontrer, que ce soit face au prolétariat révolutionnaire ou dans la défense de ses propres intérêts économiques et impérialistes. À ce titre, la montée du populisme dans la plupart des pays occidentaux ne pouvait que l’alarmer et l’inquiéter. Cette grande inquiétude, s’est transformée en préoccupation permanente et prioritaire avec la victoire du Brexit en Grande-Bretagne et celle de Trump aux Etats-Unis. Il ne s’agissait pas là de phénomènes ayant eu lieu dans de petits pays, faibles et secondaires. Deux des bourgeoisies les plus puissantes du monde avaient été incapables d’empêcher la victoire électorale du populisme. L’alarme était non seulement déclenchée mais elle sonnait maintenant en permanence et de manière stridente, d’autant qu’elle menaçait de faire voler en éclats l’Union européenne. Cela ne devait pas se reproduire en France, lieu d’existence d’une puissante formation populiste alors que ce populisme sape les fondements idéologiques mystificateurs avec lesquels la bourgeoisie maintient encore une certaine cohésion sociale (les “Droits de l’homme”, le progrès universel, etc.). Ce parti bourgeois (le FN), rétrograde et irrationnel, est incapable d’encadrer idéologiquement la société en procédant par “exclusion”, en proclamant ouvertement que le monde est en train de sombrer et qu’il faut sauver sa nation et ses ressortissants de souche au détriment du reste de la planète.
Ce qui inquiète en premier lieu les fractions de la bourgeoisie les plus lucides, c’est l’inaptitude de ces partis populistes à défendre de manière efficace et cohérente les intérêts généraux du capital national. La proposition d’un référendum de Marine Le Pen pour sortir de l’Union européenne ou se défaire de l’euro en est une expression très claire. Les partis populistes se caractérisent par une incapacité à savoir quelle politique ils doivent mener, un jour proposant une chose et le lendemain son contraire ; et cela est vrai tant en matière économique, qu’impérialiste. Empêcher le FN d’arriver au pouvoir en France était d’autant prioritaire qu’il était également nécessaire de montrer à la face du monde que la victoire du Brexit et de Trump n’étaient pas les produits d’un phénomène irréversible. Le résultat des élections en France vient de le démontrer de même que le soulagement de bon nombre de grandes chancelleries. C’est en ce sens que ces élections, malgré la fragilité historique de la bourgeoisie, sont une réussite pour celle-ci non seulement en France mais également sur un plan international et particulièrement en Europe.
Les causes profondes de cette nécessaire réaction
La nécessité d’une réaction de la bourgeoisie face à la montée du populisme trouve ses causes premières dans le lent processus d’affaiblissement historique qu’elle subit, y compris dans les principaux pays occidentaux. À la racine de ce processus historiquement irréversible se trouve l’approfondissement de la décomposition du système capitaliste. Cela se traduit notamment par une difficulté croissante à développer une politique sur le long terme, à garantir la cohésion suffisante pour la défense des intérêts nationaux au-delà des intérêts de cliques, de coteries ou de rivalités personnelles. Cette dynamique affecte en premier lieu les partis traditionnels qui sont à la tête des États bourgeois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, ce sont les partis de la droite traditionnelle et le PS qui sont particulièrement touchés, au point d’être en situation de marginalisation. Une très grande majorité de la population ne veut plus de ces partis. À la tête de la France depuis des décennies, ils n’ont fait que, chacun leur tour, développer une austérité et une précarité croissante sans offrir aucune perspective d’avenir un tant soit peu crédible. Gangrenés par les affaires, les pires bagarres de clans et rivalités d’ego, ils ont suscité dégoût et rejet massif. Ils ont fait le lit d’un populisme toujours plus présent et renforcé. Cet affaiblissement des partis les plus responsables et les plus expérimentés de la bourgeoisie nationale est une réalité qui s’impose ainsi à toute la classe bourgeoise et qui peut avoir de graves conséquences, comme nous le voyons aujourd’hui aux Etats-Unis. Or, de nouvelles attaques de la classe ouvrière doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Face à ces enjeux, à la gravité et à l’urgence, les partis traditionnels complètement discrédités ne pouvaient plus assumer aussi facilement leurs tâches. Ils n’auraient été qu’un facteur accélérateur du processus d’affaiblissement historique de la bourgeoisie. Même si rien n’assure encore que les élections législatives du mois de juin prochain donneront une majorité solide à Macron, avec l’immense campagne de sympathie pro-Macron, c’est à la poursuite de cette réaction politique que s’est attelée maintenant une grande partie de la bourgeoisie française et allemande, au-delà de leur concurrence économique et impérialiste bien réelles.
D’énormes attaques en perspective contre les conditions de vie
La bourgeoisie met en place au mieux de ses possibilités actuelles les moyens les plus opérants possibles pour mener une attaque sans précèdent des conditions de vie et de travail. C’est ce que Macron vient de répéter à la face de l’Europe toute entière dans sa récente conférence de presse à Berlin : “Je suis là pour réformer profondément et rapidement la France. Je tiendrai mes promesses de campagne”. Le prolétariat est une nouvelle fois prévenu. Macron va agir, légiférer frontalement et sans retenue. Il propose ainsi de prendre sans tarder une série de mesures dont les prolétaires en tête vont payer les frais, et cela dès cet été, pendant qu’une partie des ouvriers ne sont pas sur leur lieu de travail aux côtés de leurs frères de classe.
Le maître-mot en la matière est flexibilité généralisée, l’objectif étant de pousser beaucoup plus loin encore la loi El Khomri : imposer, sur chaque lieu de travail, le niveau de salaire, de temps de travail réel et de conditions de licenciements au nom de la compétitivité. C’est le renforcement féroce de l’exploitation que prépare ainsi Macron. Mais cela n’est pas suffisant. L’assurance-chômage va également en prendre un sale coup. La hausse de la CSG et le flicage renforcé des chômeurs sont au programme. Quant aux retraites, “les sommes cotisées individuellement détermineront le niveau de pension de chacun”. Ceci est très clair : il faudra travailler plus longtemps pour des retraites encore plus misérables, avec disparition des quelques garanties encore existantes. Et Macron se propose également de supprimer les régimes spéciaux. C’est sa politique pour “réduire”, comme il le dit en paraphrasant l’ancien président Chirac, la “fracture sociale” ! Précarisation et appauvrissement généralisés pour ceux qui travaillent, les chômeurs, les jeunes et les retraités. C’est toute la classe ouvrière qui va ainsi très violemment être attaquée par l’État capitaliste français.
Il n’y a pas d’autre solution que de développer la lutte de classe
Il est clair que les élections ne sont qu’une arme entre les mains de la bourgeoisie. Hier, Hollande et Sarkozy, aujourd’hui, Macron… Mais pour le prolétariat, il n’y a là aucune autre perspective que davantage d’exploitation et de dégradation de ses conditions de vie. La bourgeoisie n’accorde aucune dignité au prolétariat, pas plus qu’à la vie humaine. Seuls comptent sa domination et son profit. Pour cela, Macron peut compter sur d’autres fractions de la bourgeoisie nationale. Mélenchon et son mouvement ont déjà participé activement à renforcer l’idéologie démocratique et républicaine. Dans le futur, ils auront probablement un rôle encore plus important à jouer contre la lutte du prolétariat. Mélenchon, ce vieux routier de l’appareil d’État bourgeois le sait pertinemment ! Comme le savent également les gauchistes et les syndicats, CGT et FO en tête, puisqu’ils préparent déjà ce qu’ils appellent un “troisième tour social”, c’est-à-dire rejouer pleinement leur rôle d’encadrement des luttes pour les saboter et les dévoyer hors du terrain de classe.
Pour une partie de la classe ouvrière, une erreur grave serait de penser pouvoir contester l’ordre capitaliste et remettre en cause ce déferlement prévu d’attaques en tombant dans les bras d’une révolte réactionnaire et populiste, dressant les ouvriers les uns contre les autres. Tout aussi dangereux serait le soutien aux “forces démocratiques” de l’anti-populisme. Des jeunes peu nombreux dans la rue criaient au lendemain du premier tour : “Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron !” Aussi confus que puisse être ce slogan et malgré la grande difficulté dans laquelle se trouve le prolétariat aujourd’hui du point de vue de sa combativité et de sa conscience, un tel slogan, porté par quelques jeunes, exprime en germe l’idée de la lutte de classe et la nécessité d’affirmer la perspective d’une autre société. La révolution communiste reste la seule possibilité réaliste pour construire enfin une société réellement humaine, sans classes sociales et sans exploitation. Pour cela, il faudra s’affronter de manière consciente à la bourgeoise, son État et sa démocratie.
Philippe, 19 mai 2017
1 Voir “Élections et démocratie : l’avenir de l’humanité ne passe pas par les urnes”, Révolution internationale, no 463.
Géographique:
- France [15]
Situations territoriales:
Personnages:
- Emmanuel Macron [40]
Récent et en cours:
- Elections 2017 [20]
Rubrique:
Brexit: le capitalisme britannique se bat pour limiter les dégâts
- 1001 lectures
Après avoir remplacé David Cameron comme Premier ministre britannique, Theresa May a déclaré : “Brexit veut dire Brexit”. Elle a répété ce mantra sous plusieurs formes, pendant les mois qui ont suivi. Cela n’a pas aidé à comprendre dans quelle direction la politique gouvernementale britannique allait s’orienter mais a plutôt contribué à entretenir les incertitudes.
La classe dominante britannique ne s’attendait pas à la victoire du “oui” au Brexit. Dans les mois qui ont suivi, il est devenu évident qu’il n’y avait pas de plan en vue de cette éventualité. Le gouvernement Cameron n’avait pris aucune disposition en ce sens. Ceux qui ont fait campagne pour quitter l’Union européenne sont revenus avec des slogans tels que “350 millions de livres de plus par semaine pour la NHS” mais n’ont pas proposé de mesures concrètes. La bourgeoisie britannique a en partie perdu le contrôle de son appareil politique et a cherché des stratégies pour limiter les dégâts sur l’économie, pour stabiliser une situation qui entraîne, surtout depuis l’arrivée du président Trump aux États-Unis, le développement rapide de perturbations et d’incertitudes.
“L’avenir radieux” de Theresa May
Le Livre blanc de février 2017 du gouvernement utilise près de 25 000 mots pour essayer de résoudre un torrent de contradictions. Dans un discours de janvier, Theresa May a déclaré : “le peuple britannique (…) a voté pour façonner un avenir meilleur.” Le but du Livre blanc est de préparer la voie pour une “sortie de l’UE douce et bénéfique pour les deux parties” et “éviter une rupture traumatisante”. Il reste à voir dans quelle mesure cet avenir sera effectivement “radieux”.
On peut y lire que “nous ne chercherons pas à être des membres du Marché unique, mais nous poursuivrons au contraire un nouveau partenariat stratégique avec l’UE, incluant un accord de libre-échange et un nouvel accord douanier.” Ainsi, le Royaume-Uni va quitter le Marché unique et trouver un compromis avec les 27 pays restants. Pour quitter l’UE, l’accord de seulement 20 pays sur 28 est requis, alors qu’un accord commercial nécessite l’accord des 27 États de l’UE. En ce qui concerne le commerce, le gouvernement pense qu’ “un système basé sur des règles internationales est fondamental pour soutenir le libre-échange et prévenir le protectionnisme”. Néanmoins, pour la Grande-Bretagne, pour qui les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation, la présidence de Trump n’est pas, dans le cadre de rapport d’État à État, une perspective réjouissante, car ce pays semble aller dans une direction protectionniste en mettant en avant “L’Amérique d’abord” et en renégociant les accords commerciaux. Dans le même sens, l’Institut des études fiscales a suggéré que la perte de marchés aurait un énorme impact sur l’économie britannique bien que les contributions au budget européen vont cesser.
Theresa May propose une alternative au Marché unique : “si nous étions exclus du Marché unique, nous serions libres de changer les bases du modèle économique britannique.” Le chancelier de l’Échiquier, Philip Hammond, s’adressant à Welt am Sonntag du 15 janvier 2017, a déclaré : “Si nous n’avons pas l’accès au Marché européen, si nous en sommes exclus, si la Grande-Bretagne doit quitter l’Union sans accord sur l’accès aux marchés, nous pourrions subir des dommages économiques au moins sur le court terme. Dans ce cas, nous pourrions être obligés de changer notre modèle pour retrouver de la compétitivité. Et vous pouvez être sûrs que nous ferons tout ce que nous avons à faire.” La proposition de “faire quelque chose de différent” a été accueillie avec beaucoup de réserve. Est-ce que le Royaume-Uni va devenir un paradis fiscal ? Va-t-il s’enferrer dans une guerre commerciale et tarifaire ? Il y a vraiment beaucoup de possibilités, dont la moindre n’est pas de susciter au Royaume-Uni un renouveau de la production manufacturière, en dépit de vagues promesses en ce sens.
Une des raisons pour lesquelles l’accès du Royaume-Uni au Marché unique paraît impossible à beaucoup de commentateurs est qu’il impliquerait une liberté de circulation pour les citoyens de l’UE. Theresa May a déclaré : “Nous voulons garantir les droits des citoyens européens qui vivent déjà en Grand-Bretagne” ; mais, en même temps, son gouvernement se prépare à utiliser ces trois millions de personnes comme monnaie d’échange. Liam Fox a présenté les émigrés européens en Grande-Bretagne comme “les cartes maîtresses” dans les négociations sur le Brexit. Un document issu d’une fuite du Comité pour les affaires légales du Parlement européen révèle qu’il pourrait y avoir un retour de boomerang de la part de l’UE.
Les contradictions dans la position du gouvernement reflètent la situation inconfortable dans laquelle se trouve le capitalisme britannique. “Nous allons reprendre le contrôle de nos lois”, clame Theresa May, mais, en même temps, “alors que nous adoptons le corps de la loi européenne dans nos règles internes, nous nous assurerons que les droits des travailleurs seront pleinement respectés.” Le but est de prendre tout ce qui est “bénéfique” dans l’UE tout en gardant les avantages de l’indépendance. La bourgeoisie britannique utilisera toutes les manœuvres possibles et rendra l’Europe responsable des éventuelles difficultés. Mais elle ne part pas en position de force.
L’adaptation à la crise
La bourgeoisie britannique s’est historiquement fait remarquer par la capacité de son appareil politique à défendre les intérêts du capital national. Le résultat du referendum a montré une perte de cohésion croissante au sein de la classe dominante, mais il a également montré sa capacité à s’adapter aux difficultés. La démonstration en a été faite après le referendum, avec le “choix” évident de Theresa May comme chef du Parti conservateur pour résoudre une crise gouvernementale temporaire. De même, les batailles légales et parlementaires ultérieures et le rôle des media doivent être appréhendés dans ce contexte. Le procès intenté contre le gouvernement, pour l’empêcher d’agir seul et conserver un rôle pour le Parlement, a provoqué une vague de colère chez les media populistes contre les juges de la cour d’appel : le Daily Mail les a présentés comme “ennemis du peuple”, alors que les media libéraux défendaient “l’indépendance du pouvoir judiciaire”.
Mais ce que l’on considérait comme une “crise constitutionnelle” s’est rapidement estompé. Lorsque l’appel du gouvernement à la Cour suprême a également été rejeté, il y a eu beaucoup moins d’hystérie. La Chambre des communes a fait son travail en entérinant les propositions de l’exécutif, malgré le fait que la majorité des membres du Parlement aurait préféré rester dans l’UE. Le Parti travailliste a été particulièrement utile. Jérémy Corbyn a imposé aux membres du Parlement l’obligation absolue de soutenir les étapes de la législation pour le Brexit. Corbyn a été loyalement soutenu par les trotskistes du Socialist Worker du 9 février 2017 : “Il a avec raison insisté pour que les députés travaillistes votent en faveur d’un projet de loi ouvrant le processus de sortie de l’UE”.
Ailleurs au Parlement, une source gouvernementale a déclaré : “Si les lords ne veulent pas affronter un appel public appelant à leur abolition, ils doivent se soumettre et protéger la démocratie, et accepter ce projet de loi.” Le secrétaire au Brexit, David Davis a appelé ses pairs à “faire leur devoir patriotique”. Les menaces à l’encontre de la Chambre des lords, de la part du Parti conservateur, sont la preuve des divisions qui existent au sein de la bourgeoisie, même si, à un niveau plus profond, elle est unie en tant que partie d’une classe capitaliste d’État.
Les options impérialistes de la bourgeoisie britannique se rétrécissent
Malgré toutes les déclarations de “liberté pour le Royaume-Uni”, en janvier 2017, la visite de Theresa May aux États-Unis et en Turquie a montré la réalité de la position de l’impérialisme britannique. Elle a tendu la main à Donald Trump et essayé de grappiller tout ce qui était possible. La prétendue “relation spéciale” entre les États-Unis et la Grande-Bretagne a toujours été en réalité au bénéfice des premiers et il semble peu probable que ce déséquilibre soit corrigé dans un avenir proche. En Turquie, Theresa May a “adressé un sévère avertissement au président turc Recep Tayyip Erdogan concernant le respect des droits de l’Homme hier, alors qu’elle s’apprêtait à signer un contrat de 100 millions de livres pour un marché d’avions de combat dont le 10 Downing Street espère qu’il permettra à la Grande-Bretagne de devenir le principal partenaire de défense Turque” (The Guardian du 28 /01 /17).
Voilà le visage international que montre actuellement la bourgeoisie anglaise. Les perspectives en dehors de l’UE sont incertaines, elle tente désespérément de recevoir des miettes de l’impérialisme américain, les perspectives pour son secteur financier ne sont pas assurées, mais, au moins, elle peut compter sur la vente d’armes à un pays en conflit. Un document gouvernemental divulgué a donné la liste des industries prioritaires pour les pourparlers sur le Brexit. Parmi les hautes priorités figurent l’aérospatiale, le transport aérien, les services financiers, les transports terrestres (transport ferroviaire exclu), les assurances et les infrastructures bancaires et commerciales. Les priorités inférieures comprennent l’acier, le pétrole et le gaz, les télécommunications, les services postaux et environnementaux, l’eau, les services médicaux et l’éducation. Dans les coulisses se prennent les décisions concernant quels secteurs peuvent survivre ou être sacrifiés et quels secteurs ont besoin d’un soutien plus conséquent.
Dans le Telegraph du 11 février 2017, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne sous-estime pas la capacité de la bourgeoisie anglaise à intriguer et conspirer : “les Anglais vont tenter sans trop d’effort de diviser les 27 États-membres restants.” Et le gouvernement anglais est en position de repli, car comme le dit May : “pour la Grande-Bretagne, pas d’accord du tout vaut mieux qu’un mauvais accord.” Telle est la position d’un “Brexit dur” auquel la bourgeoisie anglaise semble se rallier. L’impitoyable détermination de la bourgeoisie anglaise ne faiblit pas mais sa capacité à fonctionner de façon cohérente dans une période de décomposition croissante s’est abaissée.
Les problèmes auxquels la classe ouvrière doit faire face en Grande-Bretagne font écho à ceux qu’elle rencontre internationalement. En 1989, les transitions dans les régimes d’Europe de l’Est se sont faites sous les yeux d’une classe ouvrière spectatrice, qui n’a joué aucun rôle indépendant. Au cours des deux dernières années, nous avons assisté au développement du terrorisme aux portes de l’Europe de l’Ouest, au referendum sur l’Europe, à l’élection de Donald Trump et à la résurgence du Front national de Marine Le Pen. Là non plus, la classe ouvrière n’a pas été un facteur actif dans cette situation, malgré les changements énormes et le mécontentement de la population contre les élites. La bourgeoisie va tenter d’utiliser la décomposition de son système contre la classe ouvrière, que ce soit par la promotion de l’option populiste ou par des campagnes et des confrontations anti-populistes. Mais, alors que la bourgeoisie défend une société en déclin, la classe ouvrière, elle, a la capacité de créer de nouvelles relations sociales basées sur la solidarité et non sur l’exploitation et le nihilisme.
Car, 15 février 2015
(D’après World Revolution, organe de presse du CCI au Royaume-Uni)
Géographique:
- Grande-Bretagne [41]
Récent et en cours:
- Brexit [42]
Rubrique:
Grève générale en Guyane: l’interclassisme est une impasse !
- 793 lectures
La manifestation du 28 mars dernier en Guyane a rassemblé plus de 10 000 personnes dans les deux principales villes, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni (40 000 selon les organisateurs), sur une population de 250 000 habitants à l’appel des 37 syndicats qui composent l’Union guyanaise des travailleurs (UGT). C’est la mobilisation la plus massive de l’histoire de ce territoire, au lendemain du déclenchement d’une grève générale illimitée appelée par ces mêmes syndicats. Quel sens donner à cette grève ? Quelles sont les perspectives de ce mouvement ?
Ce mouvement traduit un énorme ras-le-bol, un sentiment d’être méprisé dans un contexte où la grande majorité de la population guyanaise s’enfonce dans une misère et une pauvreté effroyables. Il existe un contraste effarant entre la haute technologie développée au centre spatial de Kourou et le sort des villages voisins totalement privés d’éclairage public et même d’eau potable : “la fusée décolle mais, nous, on n’a pas de lumière” proclamait un habitant de la région. Il témoigne aussi d’un écart énorme entre la métropole de la cinquième puissance mondiale et ce département où 50 % de la population a moins de 25 ans mais où 40 % des jeunes quittent le système scolaire sans aucun diplôme, où sévit aussi le chômage (dont le taux officiel est de 22 %), où le taux de suicide est entre dix et vingt fois supérieur à celui de l’hexagone (en particulier au sein de la population d’origine amérindienne), la vie chère (avec des prix en moyenne 40 % plus élevés qu’en métropole), la terrible pénurie sanitaire (délabrement des structures hospitalières et médicales) et l’insécurité face à la criminalité (42 meurtres en un an), la délinquance, et la présence de gangs mafieux (comme dans toute l’Amérique latine) qui traduisent le niveau saisissant de la décomposition de la situation sociale.
Depuis près de 50 ans, les exaspérations et les frustrations se sont accumulées face aux promesses non tenues des “politiques” (seulement en “visite” lors de tournées électorales) et des élus locaux qui ont débouché sur cette explosion générale de mécontentement ; mais cette explosion ne doit pas masquer le caractère fondamentalement interclassiste du mouvement où les réelles revendications ouvrières (réclamant de nouveaux établissements pour l’éducation et la santé, des transports scolaires gratuits, un accès au soin pour tous, etc.) sont noyées ou dévoyées sur un terrain totalement nationaliste au nom de “la défense des intérêts du peuple guyanais” (1). Pourquoi ce mouvement est-il si fortement médiatisé ?
D’une part, justement parce qu’il est embarqué sur le terrain idéologiquement pourri de la mobilisation citoyenne et “populaire” à travers des collectifs “Pou Lagwiyann dékolé” (Pour le décollage de la Guyane) qui ont mené, à la place des élus “qui ont perdu leur légitimité”, les négociations avec les ministres représentants du gouvernement (dont la ministre des Outremers, Ercika Bareigts, qui s’est publiquement excusée devant “le peuple guyanais” et les “500 frères contre la délinquance”. Le mouvement des “500 frères” est d’ailleurs très actif dans les collectifs et n’est autre qu’une milice encagoulée composée en bonne partie de policiers et de personnel de sociétés de sécurité appuyée par le MEDEF (syndicat patronal) local. Ils ont imposé leurs méthodes musclées de commandos et d’actions “coups de poing” obligeant les commerçants à fermer leurs rideaux, le blocage des routes et de l’approvisionnement des stations-services, l’occupation du centre spatial de Kourou, etc. Les “500 frères” et d’autres collectifs similaires, des “Toukans” au “Trop Violans”, mettent constamment en avant les revendications en faveurs de plus de forces de police et de tribunaux mais réclament aussi des mesures franchement xénophobes tels que le démantèlement des squats et l’expulsion des détenus étrangers vers leurs pays d’origine, ou carrément le renvoi de la main-d’œuvre immigrée venant du Brésil, du Surinam ou de Haïti, peuplant de nombreux bidonvilles et assimilée à des délinquants.
Ce battage médiatique a plusieurs buts :
– mettre en avant le dialogue démocratique “à visage découvert”, avec la présence des médias dans les négociations pour donner du crédit à “la pression du peuple guyanais” afin de réclamer… la “protection de l’État français” 2 ;
– faire apparaître le “soutien populaire” de “collectifs citoyens” qui n’ont d’autre objectif que d’empêcher le mouvement de s’exprimer sur un terrain de classe ;
– mettre en avant ses méthodes de lutte en les présentant comme les seuls moyens possibles (l’action déterminée d’une minorité) de “faire bouger les choses” ou déjà “de se faire entendre”, méthodes qui n’ont rien à voir avec celles de la classe ouvrière dans ses luttes 3 ;
– renforcer cet interclassisme à travers le caractère identitaire et nationaliste de la “lutte du peuple guyanais” au nom des “droits démocratiques” en soulignant ses “propres” revendications éducatives, culturelles, “droits” des peuples autochtones (intégrer l’histoire du territoire ou les langues maternelles dans l’éducation, par exemple). Il faut rappeler les impasses des mouvements précédents dans les territoires d’outremer où l’aspect nationaliste et indépendantiste avait pris le dessus à travers l’encadrement syndical du LKP en Guadeloupe en 2009, les divisions interethniques en Martinique en 2010 ou encore à Mayotte en 2011 ;
– servir de repoussoir pour renvoyer une image et un sentiment d’impuissance qui ne peut que renforcer le déboussolement général actuel de la classe ouvrière et ses difficultés à s’affirmer sur son terrain autonome de classe.
À aucun moment, les prolétaires guyanais n’ont été capables d’affirmer la nécessité ni de dégager le besoin d’une telle autonomie et de se battre sur un terrain d’intérêts de classe. Ils n’ont pas su tirer les leçons des mouvements similaires des travailleurs d’outremer des années passées et inscrire leur lutte dans un cadre global et internationaliste. Ce faisant, malgré toute leur colère et leur détermination affichée, ils se condamnent à tomber dans tous les pièges et les illusions (lutte “citoyenne” et “démocratique” des collectifs, “lutte du peuple” enfermé dans le carcan du nationalisme) tendus par la bourgeoisie qui ne peut les conduire que dans une impasse. Cette incapacité reflète toute la faiblesse et les difficultés actuelles de l’ensemble de la classe ouvrière à retrouver et affirmer son identité de classe.
Wim, 13 avril 2017
1) Le caractère interclassiste ressort clairement du cahier de revendications (de 400 pages) du collectif “Pour que la Guyane décolle” (voir le site Internet du collectif sur nougonkasa.fr) qui, à côté de revendications à caractère “social” (volets éducation et formation, santé…) glisse pêle-mêle des propositions réclamant davantage de moyens répressifs face au problème de l’insécurité (plus de police et de tribunaux) ou une plus grande libéralisation en faveur du patronat local, lui permettant notamment de légaliser de juteux trafics de drogue et d’or avec le Brésil voisin, sans oublier le thème particulier des “peuples autochtones”.
2) Alors que le gouvernement à l’issue des négociations n’a accepté qu’un déblocage d’un peu plus d’un milliard d’euros sur les quelque 3 milliards réclamés par les collectifs (en accordant une large part aux demandes de crédits “sécuritaires” ou patronales), ceux-ci ont alors décidé de poursuite le mouvement déjà engagé dans une impasse mais “lâché” par le patronat, en large partie satisfait des “concessions” du gouvernement métropolitain.
3) À la rescousse de ce fourvoiement, les gauchistes apportent leur petite pierre, en vantant comme un “modèle de lutte à suivre” sa prétendue “radicalité” et “combativité” qui vont de “Vive la lutte des travailleurs guyanais !” (LO) au “Soutien au peuple guyanais !” du NPA de Poutou, en passant par “La Guyane au bord de la révolution sociale” (Voix des Travailleurs).
Géographique:
- France [15]
Situations territoriales:
Famine en Afrique de l’Est: silence, le capitalisme tue !
- 1347 lectures
Depuis fin 2016, une grande partie de la population de l’Afrique de l’Est est touchée par une grave famine qui s’abat impitoyablement sur des millions de personnes. Au Soudan du Sud, ce nouvel État qui a proclamé son indépendance en 2011 et n’a connu depuis que la guerre civile, pas moins de 4,9 millions de personnes (soit 42 % de la population !) a besoin d’une aide alimentaire urgente. Selon l’ONG Action contre la faim, 4,4 millions de personnes sont également directement menacées au Nigeria, tout comme la moitié de la population en Somalie (6,2 millions de personnes). Pour compléter ce tableau (loin d’être exhaustif), au Moyen-Orient, plus de 14 millions de Yéménites sont actuellement en situation “d’insécurité alimentaire”. Concrètement, la vie de ces millions d’êtres humains, sur qui la faim s’abat sans discernement d’âge ou de sexe, se résume à l’épouvantable et permanente angoisse de ne pouvoir trouver ni eau (rarement potable) ni nourriture.
La faible médiatisation de ce drame gigantesque a de quoi surprendre 1). Cette fois, on est bien loin des images du ministre Kouchner débarquant sur une plage somalienne, pieds nus et sac de riz sur l’épaule, caméras de télé braquées sur lui. Aucun appel à la mobilisation générale comme lorsqu’un tsunami dévasta l’Asie du Sud-est en 2004. Cette fois, comme la plupart du temps, les populations peuvent crever dans leur coin, en silence et loin des caméras.
En fait, contrairement aux exemples qui suivent, les États n’ont nullement besoin d’un alibi humanitaire pour couvrir une opération militaire imminente ou la conquête de juteux marchés en Afrique de l’Est :
• En 1914, l’invasion de la Belgique par les troupes allemandes préfigurait déjà une longue liste d’instrumentalisation de la détresse des populations civiles. Sur la base d’un rapport-bidon commissionné par la Grande-Bretagne (le Rapport Bryce), artistes et organisations humanitaires (la Croix-Rouge, notamment) véhiculèrent une série de fables sur les atrocités de l’armée allemande : le Boche était ainsi accusé de viols de masse, de tortures et de mutilations. Les troupes commirent évidemment des exactions. Mais, à l’époque, les prétendues révélations sur les comportements des soldats n’étaient fondées sur aucun témoignage : elles furent inventées de toutes pièces et largement exagérées.
• Mais le cynisme humanitaire de la bourgeoisie prit une toute autre dimension après la Seconde Guerre mondiale. La guerre du Biafra entre 1967 et 1970 représente à ce titre un véritable tournant dans cette instrumentalisation. La presse déploya des moyens exceptionnels pour médiatiser la famine qui frappait le pays et dénoncer les atrocités, réelles ou inventées, de l’armée nigériane. Voici ce que déclarait Jacques Foccart, l’homme de la Françafrique, à ce propos : “Les journalistes ont découvert la grande misère des Biafrais. C’est un bon sujet. L’opinion s’émeut et le public en demande plus. Nous facilitions bien sûr le transport des reporters et des équipes de télévision par des avions militaires jusqu’à Libreville et, de là, par les réseaux qui desservent le Biafra” 2. Les images insoutenables d’enfants au ventre ballonné par la dénutrition et de réfugiés affamés déclenchèrent une vague de solidarité internationale que l’État français canalisa sur le terrain de l’aide humanitaire en évacuant sans scrupules sa responsabilité majeure dans le conflit. C’est à cette occasion qu’émergèrent le concept insidieux de “droit d’ingérence” et ses panégyristes, Kouchner en tête. En dénonçant le prétendu génocide perpétré par le pouvoir nigérian, le fondateur de Médecins sans frontières apporta son soutien aux sécessionnistes alors appuyés par la France dans une guerre civile qui allait provoquer plus d’un million de morts. Un pont aérien transportant officiellement des vivres fut mis en place. Mais ce pont humanitaire servait surtout à dissimuler l’envoi d’armes et de mercenaires au gouvernement du Biafra..., ce qui aggrava davantage la situation.
• En novembre 1992, la mise en scène, déjà évoquée plus haut, assurée par l’ineffable Kouchner en Somalie avait été précédée par une intense campagne médiatique allant jusqu’à mobiliser massivement les enfants et les enseignants dans les 74 000 écoles françaises pour que chaque élève apporte en classe un kilo de riz. Cela allait permettre à l’ONU d’officialiser le fameux “droit d’ingérence” et surtout de préparer directement l’envoi des troupes dans le cadre de l’opération militaire Restore Hope, supervisée par les Etats-Unis.
• En 1984-1985, l’instrumentalisation de l’humanitarisme prit d’ailleurs un tour industriel écœurant. L’Éthiopie était alors touchée par une famine qui fit plusieurs centaines de milliers de victimes. En déclenchant partout dans le monde d’immenses campagnes caritatives, les grandes puissances purent se livrer à une rivalité sans merci pour la défense de leurs sordides intérêts impérialistes. Mais de plus, alors même que les concerts et les succès musicaux, comme We Are The World aux États-Unis, passaient en boucle à la radio ou à la télévision, l’aide alimentaire était, avec la complicité des États donateurs, détournée pour financer l’achat d’armes de guerre ! Et pendant ce temps, au Lesotho, la population mourait de faim dans l’indifférence...
• Entre avril 1991 et fin 1996, au lendemain de la guerre du Golfe, “l’aide humanitaire” servit encore de puissante arme de propagande guerrière et fut le prétexte tout trouvé pour couvrir les opérations militaires d’envergure Provide Comfort I et II des Etats-Unis et de leurs alliés au nord de l’Irak, sous prétexte “d’aider” et “protéger” les populations kurdes contre l’armée irakienne.
Nous pourrions multiplier les exemples tant de l’instrumentalisation des crises humanitaires que de l’indifférence coupable, voire complice, dont fait preuve la bourgeoisie. Mentionnons néanmoins un exemple récent particulièrement significatif. En 2010, un séisme frappait Haïti, causant 230 000 morts, et dévastant une partie du pays, dont la capitale, Port-au-Prince. Un déferlement impérialiste s’abattit aussitôt sur l’île. Sous couvert d’urgence humanitaire qu’une énorme campagne médiatique avait préparée 3, chaque État, rangé en ordre de bataille derrière ses 10 000 ONG ( !) et ses milliers de soldats, essaya d’y arracher des occasions d’affaires et une influence politique accrue. Comme pour chaque catastrophe, beaucoup d’États avaient promis une aide financière afin de faciliter leurs ambitions. Mais les différentes bourgeoisies nationales utilisèrent en réalité les 12 milliards promis comme monnaie d’échange pour défendre leurs intérêts particuliers. Une infime fraction des sommes annoncées, qui servit essentiellement à “arroser” la bourgeoisie locale, fut effectivement injectée dans le pays dont la population subit encore aujourd’hui les conséquences du séisme 4.
Aujourd’hui les rares reportages consacrés à la famine au Sud Soudan sont destinés à susciter un sentiment de fatalité et d’impuissance, soit en invoquant simplement la sécheresse ou le dérèglement climatique (comme au Sahel), soit la terreur que font régner les affrontements entre bandes armées locales (comme au Darfour ou en Somalie) en masquant l’intérêt impérialiste à géométrie variable des grandes puissances dans leur aide humanitaire. Que l’on assiste à l’enfoncement des populations dans une détresse oubliée ou à l’exploitation de cette situation par des lamentations tapageuses et cyniques, en réalité, l’objectif idéologique reste celui de détourner de la prise de conscience que la responsabilité majeure de cette situation incombe aux lois du système capitaliste basées sur les rapines et le profit, celles d’un système miné par ses contradictions insurmontables qui plonge l’humanité dans un engrenage de plus en plus dramatique et meurtrier dans sa phase de décomposition.
La seule classe en mesure de faire vivre une authentique solidarité désintéressée, c’est le prolétariat. Tant que les lois du profit et de la concurrence capitaliste domineront ce monde, tant que la classe ouvrière n’y opposera pas son unité et sa solidarité, le chaos, la famine et la barbarie engendrés par le système capitaliste ne cesseront de s’étendre.
Marius, 11 mai 2017
1 En dehors de quelques articles ou reportages publiés en février et mars 2017, et de quelques autres exclusivement sur le Yémen, la presse ne dit presque plus un mot sur ces situations de famine.
2 Foccart parle, T. 1, p. 346, cité par François-Xavier Verschave dans : La Françafrique, le plus long scandale de la République.
3 La classe ouvrière donna sans compter aux ONG qui se constituèrent alors un gigantesque pactole... qui n’arriva jamais aux victimes.
4 Les soldats de l’ONU apportèrent par ailleurs dans leur bagages le choléra qui, comme au Yémen actuellement, se répandit comme une traînée de poudre au milieu des camps de réfugiés et des décombres.
Rubrique:
Polémique avec le PCI: Daech, un avatar décomposé de la lutte de libération nationale !
- 1190 lectures
Dans son numéro no 519 (mars-avril-mai 2016), Le Prolétaire, organe de presse du Parti communiste international (PCI) a fait la critique de notre article : “Attentats à Paris, à bas le terrorisme ! À bas la guerre ! À bas le capitalisme !” (1) Le PCI considérant que nous sommes “superficiels” et “impressionnistes”, ironise sur le fait que le “CCI est choqué” par les attentats, d’où le titre de l’article emprunté à la romancière Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements. En fait, Le Prolétaire confond ici l’indignation prolétarienne face à la barbarie avec ce qu’il imagine être de la sensiblerie petite-bourgeoise ou du pacifisme. Avant de répondre à ces critiques et indépendamment des désaccords que nous pouvons avoir avec cette organisation, nous tenons d’abord à soutenir son initiative polémique. Les polémiques au sein du milieu révolutionnaire ont toujours été la sève vivifiante du combat révolutionnaire. Trop peu fréquentes aujourd’hui, elles sont d’autant plus précieuses, notamment entre les organisations qui défendent les principes de la Gauche communiste. De telles entreprises sont indispensables à la clarification. Elles doivent permettre une confrontation des positions politiques pour alimenter la réflexion en faveur de l’indispensable élaboration théorique nécessaire à l’orientation du prolétariat et de ses minorités en recherche de cohérence des positions révolutionnaires.
Nation ou classe ?
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre ici à toutes les questions soulevées dans ce texte. Selon nous, un point apparaît prioritaire, du fait notamment qu’il est en débat chez des éléments proches du PCI : la question nationale 2. En effet, à la lecture de l’article du Prolétaire, il apparaît qu’au sein même du milieu de sympathisants qui gravitent autour des positions “bordiguistes” existe un questionnement mettant en jeux la question de la nation et de l’internationalisme. Nous apprenons ainsi qu’un participant à une réunion du PCI, et d’autres éléments par ailleurs, se sont sérieusement posés la question de savoir s’il fallait ou non “condamner” Daech, en vertu du “principe de la lutte anti-impérialiste” ! Cette problématique est reformulée ainsi par Le Prolétaire : “Faudrait-il en conclure que l’EI représenterait une force bourgeoise anti-impérialiste, une force qui, en secouant le statu quo, travaillerait sans le vouloir en faveur de la future révolution prolétarienne par l’accentuation du chaos et l’affaiblissement de l’impérialisme dans la région ? Une force qu’il faudrait donc plus ou moins soutenir en dépit de sa brutalité et de ses sinistres traits réactionnaires ?” La réponse du Prolétaire à propos d’un tel soutien (ou, comme le PCI l’écrit, ce “plus ou moins soutien”) est négative. Elle montre que les camarades du PCI se placent du point de vue de la classe ouvrière. On peut, par ailleurs, observer que leur approche sur la question nationale n’est plus tout à fait appliquée de la même manière que durant les années 1980, lorsqu’ils mettaient en avant la possibilité “d’une lutte de libération du peuple palestinien”.
Mais quelle est l’argumentation du Prolétaire aujourd’hui ? Voici une première affirmation : “En raison de l’absence de toute force prolétarienne, l’EI, ainsi que les autres formations armées, “modérées” ou radicales, ont été la réponse contre-révolutionnaire bourgeoise –et non moyenâgeuse ou tribale– à l’ébranlement des équilibres nationaux et régional. L’EI ne lutte pas pour étendre le chaos et affaiblir l’ordre bourgeois, mais pour restaurer à son profit ce dernier (...)”. Les camarades du PCI parlent à juste titre de “l’absence de toute force prolétarienne”. Mais dans le passage d’un autre article du même numéro, en réponse à ces mêmes sympathisants, Le Prolétaire ajoute ceci : “Daech est un ennemi des prolétaires, d’abord des prolétaires de Syrie et d’Irak, puis des prolétaires des pays impérialistes (souligné par nous). Avant de faire des attentats en Europe, il avait fait des attentats en Irak et ailleurs. Avant de faire des attentats en Irak et ailleurs, il avait réprimé les prolétaires dans les régions qu’il contrôle (cas des prolétaires de la voirie à Mossoul qui avaient fait une action de revendication sur leurs conditions de travail et qui pour cette raison ont été exécutés par Daech)”. Un problème majeur réside selon nous dans la formulation évoquant les prolétaires “des pays impérialistes”. Les camarades présupposent, en effet, que certains pays ne seraient pas impérialistes aujourd’hui. Nous ne partageons absolument pas ce point de vue. Le PCI poursuit dans le même extrait en affirmant ceci : “Les prolétaires doivent lutter contre toutes les oppressions nationales, pour l’autodétermination et la liberté de séparation de tous les peuples opprimés ou colonisés (souligné par nous) ; non pas parce que leur idéal est la création d’États bourgeois, mais parce que, pour que puissent s’unir les prolétaires des pays dominants et les prolétaires des pays dominés, les premiers doivent démontrer dans les faits qu’ils ne sont pas solidaires de l’oppression qu’exerce “leur” bourgeoisie et “leur” État, mais qu’ils la combattent au contraire non seulement en paroles mais si possible en pratique. C’est le seul moyen pour que la proposition qu’ils font aux prolétaires des pays dominés, de s’unir sur des bases de classe anti-bourgeoises, puisse être comprise”. Cette position du Prolétaire, qui diffère des élucubrations nationalistes des gauchistes, n’en demeure pas moins dangereuse et très ambiguë depuis ses prémisses. Elle sépare initialement les prolétaires des pays “dominants” de ceux des pays “dominés” et reste enfermée dans la problématique des “oppressions nationales”. Mais, pourrait-on nous rétorquer, cette position du Prolétaire, n’était-elle pas héritée de la tradition du mouvement ouvrier du passé ?
La position de Rosa Luxemburg confirmée par les faits
Ce fût en effet le cas jusqu’à ce que les conditions historiques changent radicalement et que l’expérience de luttes nouvelles ne remettent en cause les pratiques devenues inappropriées pour le combat ouvrier. Lors de son Premier congrès en mars 1919, l’Internationale communiste (IC) reconnaissait que le capitalisme était dans sa phase de déclin et faisait ainsi référence au besoin d’une lutte internationale du prolétariat. Le Manifeste de l’Internationale aux prolétaires du monde entier, commençait par reconnaître que “l’État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l’expansion des forces productives” (3. Dans la même logique, il était souligné que “seule la révolution prolétarienne peut garantir aux petits peuples une existence libre, car elle libérera les forces productives de tous les pays des tenailles serrées par les États nationaux”. Le prolétariat ne pouvait donc s’affranchir que dans le cadre d’une lutte mondiale, dans un même mouvement d’ensemble, unitaire, comprenant les bastions des grandes métropoles. Comme le disait Lénine, “les faits sont têtus”. La tactique qui avait été adoptée par les bolcheviks, pensant pouvoir malgré tout réaliser l’extension de la révolution mondiale en s’appuyant sur le vieux principe de la libération nationale fut un terrible fiasco, précipitant le prolétariat vers l’écrasement et la défaite. Les exemples sont nombreux. En Finlande, la bourgeoisie locale “libérée” profita du “cadeau” des bolcheviks pour écraser l’insurrection ouvrière en janvier 1918. Dans les pays baltes, la même année, la “libération nationale” permettait à la bourgeoisie britannique d’écraser tranquillement la révolution sous les tirs des canons de la marine !
Les apports critiques les plus fertiles sur la question nationale furent élaborés très tôt et avec beaucoup de lucidité par Rosa Luxemburg : “Les bolcheviks eux-mêmes ont aggravé les difficultés objectives de la situation par le mot d’ordre dont ils ont fait le fer de lance de leur politique, le droit des nations à l’autodétermination ou, plus exactement, par ce qui se cache, en fait, derrière cette phraséologie : la ruine de la Russie en tant qu’État... défenseur de l’indépendance nationale même jusqu’au séparatisme, Lénine et ses amis pensaient manifestement faire ainsi de la Finlande, de l’Ukraine (...) autant de fidèles alliés de la Révolution russe. Mais nous avons assisté au spectacle inverse : l’un après l’autre, ces “nations” ont utilisé la liberté qu’on venait de leur offrir pour s’allier en ennemies mortelles de la révolution russe à l’impérialisme allemand et pour transporter sous sa protection même le drapeau de la contre-révolution” (4.
Malgré quelques éléments de clarté sur le sujet au moment du premier congrès de l’Internationale communiste, les défaites ouvrières successives et la montée de l’opportunisme allaient engloutir les efforts fragiles et favoriser la régression théorique. La lucide critique de Rosa Luxemburg ne sera reprise que de façon très minoritaire par une partie de la Gauche italienne, notamment Bilan, une position dont Internationalisme a hérité et que défend aujourd’hui le CCI. Depuis l’épisode de la vague révolutionnaire des années 1920 et la défaite qui a conduit à la terrible période de contre-révolution stalinienne, aucune prétendue lutte de libération nationale n’a pu produire autre chose que des massacres et des embrigadements derrière les nations et puissances impérialistes rivales. Ce qui s’était révélé à l’époque de Lénine comme une erreur tragique s’est confirmé par la suite de manière éclatante par des crimes sanglants. Depuis la Première Guerre mondiale et avec le déclin historique du système capitaliste, toutes les nations, grandes ou petites, sont devenues en réalité des maillons d’une chaîne impérialiste plongeant le monde dans une guerre permanente. À chaque fois, les manœuvres impérialistes sont à l’œuvre, quelle que soit la nation considérée et le prolétariat n’est alors que l’otage de la prétendue “libération” contre une autre fraction bourgeoise, opposé à ses frères de classe sacrifiés. Ce fut le cas par exemple au Soudan qui, après son indépendance en 1956, allait connaître une terrible guerre civile instrumentalisée par les blocs impérialistes de l’Est comme de l’Ouest faisant au moins deux millions de morts. En Angola, après les premiers soulèvements à Luanda en 1961 et l’indépendance en 1975, des années de guerres opposaient les forces du MPLA au pouvoir (Mouvement populaire de libération de l’Angola, soutenu par l’URSS) et les rebelles de l’UNITA (soutenus par l’Afrique du Sud et les États-Unis). Le bilan de cette “lutte de libération” était proche d’un million de morts. La décolonisation et le contexte de Guerre froide ne feront qu’illustrer cela de manière systématique, les prolétaires n’étant que de la chair à canon derrière les drapeaux nationaux.
Des confusions dangereuses
Si Le Prolétaire ne soutient pas Daech, s’il a pu évoluer sur la question nationale, il n’en conserve pas moins certaines confusions qui l’avaient conduit par le passé à abandonner ponctuellement la position de l’internationalisme prolétarien en soutenant, même si ce fut de manière critique, les forces capitalistes de l’Organisation de libération de la Palestine. C’est ce que montre ce passage rédigé à l’époque : “Par son impact dans les masses arabes, la lutte contre Israël constitue un formidable levier dans la lutte sociale et révolutionnaire” (5. Le cadre de la lutte de libération nationale, qui ne pouvait que l’amener au fiasco politique, était ainsi théorisé par Le Prolétaire : “Le marxisme intransigeant, lui, reconnaît, même là où l’intervention autonome du prolétariat n’a pu ou ne peut encore se produire, même si ces révolutions n’ont pu dépasser un horizon national et démocratique, la valeur authentiquement révolutionnaire de bouleversements aussi gigantesques que ceux qui se sont produits en Orient au cours des 60 dernières années, et qu’il serait vain d’ignorer sous prétexte qu’ils n’ont pas conduit au socialisme” (6. L’abandon ponctuel de la position de classe internationaliste à propos du conflit israélo-palestinien allait provoquer une grave crise au sein du PCI conduisant à sa dislocation avec El Oumami sur la base d’un positionnement ouvertement nationaliste arabe que nous dénoncions justement à l’époque : “Pour El Oumami, 1’“union sacrée juive” fait disparaître les antagonismes de classe à l’intérieur d’Israël. Inutile donc de faire des appels au prolétariat d’Israël. C’est exactement le “peuple allemand, peuple maudit” des staliniens pendant la Seconde guerre mondiale. Et quand, au cours d’une manifestation OLP-Solidarité, aux cris de “Sabra et Chatila, vengeance !”, El Oumami se vante d’avoir “capturé un sioniste qui a reçu une terrible raclée”, on est au niveau de “à chacun son boche” du PCF à la fin de la Seconde guerre. El Oumami se joint aux rangs de la bourgeoisie au niveau du chauvinisme le plus abject” (7. La prise de position opportuniste du Prolétaire sur le conflit israélo-palestinien dans les années 1980 est une concession ouverte à l’idéologie gauchiste nationaliste. En soutenant de façon critique la lutte des Palestiniens face à Israël, en les coupant ainsi de leurs frères de classe israéliens sous prétexte de leur allégeance à la bourgeoisie israélienne, Le Prolétaire participait à entériner la division et abandonnait tout principe de solidarité de classe.
Aujourd’hui, Le Prolétaire n’utilise pas la même argumentation que par le passé mais semble évoluer davantage par empirisme. Si le PCI ne sombre pas dans la catastrophe en refusant très nettement tout soutien à Daech, il n’en reste pas moins prisonnier de conceptions encore dangereuses et confuses pour la classe ouvrière, en particulier dans un contexte où le nationalisme reprend quelques couleurs du fait de la propagande étatique et des puissantes campagnes populistes en cours. Les raisons qui se trouvent à la racine du maintien de telles confusions sont liées au terrible fardeau de la contre-révolution stalinienne. Le capitalisme d’État en URSS avait ainsi dénaturé l’expérience de la vague révolutionnaire des années 1920 en exploitant ses pires erreurs pour écraser le prolétariat. Au nom de “l’autodétermination”, du “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, de la “libération nationale des peuples opprimés”, l’État stalinien avait su profiter des erreurs de Lénine pour les pervertir et en faire un dogme éternel qui allait malheureusement conduire certains révolutionnaires, comme ceux du PCI, à tirer de leur côté de fausses leçons en reprenant à leur compte d’anciennes erreurs perçues comme des “vérités révolutionnaires”.
Le PCI sous-estime la réalité du chaos impérialiste
Or, les faits plus récents, depuis les boucheries impérialistes de la Guerre froide, n’ont fait que confirmer encore les positions de Rosa Luxemburg. Maintenir les confusions concernant “l’autodétermination des peuples” est, à notre avis, largement responsable des positions aberrantes qui persistent encore aujourd’hui et qui poussent certains éléments à poser la question aberrante de savoir si Daech doit être appuyé et soutenu par les révolutionnaires dans une lutte soi-disant “anti-impérialiste”. Depuis la disparition du bloc de l’Est, les prétendues luttes de libération nationale n’ont fait qu’alimenter le chaos mondial. C’est ce dont témoigne la naissance des mini-États nés de la dislocation de l’ex-empire stalinien, générant des avortons qui ne savent faire autre chose que propager les miasmes du nationalisme. C’est ce que nous avons pu voir avec l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et la guerre qui s’en est suivie entre les nouvelles nations “libérées”, ce que nous avons pu voir aussi lors du conflit en Tchétchénie (où la ville de Grozny avait été réduite en cendres) ainsi que lors du conflit dans l’enclave ethnique du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan faisant de nombreuses victimes et des milliers de réfugiés au début des années 1990. Une telle logique s’étend également à toutes les fractions bourgeoises sans possession de territoire, les seigneurs de guerre ou autres terroristes qui incarnent l’idéologie nationaliste et la barbarie capitaliste.
Dans son article, le PCI critique également une formule utilisée par notre article, celle de l’idée d’un “pas qualitatif avec les attentats de Paris”. Il faut reconnaître que cette formulation a été critiquée en notre sein et elle peut faire l’objet d’un débat. Mais pas pour les raisons qu’en donne Le Prolétaire qui évoque nos “oublis” des “années de plomb en Italie dans les années soixante-dix”, celle des événements “contre les manifestants algériens tués par la police en 1961”, “les hécatombes dans les pays de l’Est”, etc. En fait, notre formulation, certes critiquable, voulait simplement signifier que ces attentats traduisent une aggravation de la situation chaotique au niveau mondial, ce qui est très différent de l’idée d’une “perte de mémoire” de notre part. En revanche, critiquer nos prétendus “oublis” révèle que, pour les camarades du Prolétaire, ces attentats sont à mettre sur le même plan que ceux perpétrés dans les années 1970 et que les événements du temps de la Guerre froide. En quelque sorte, il n’y aurait rien de nouveau sous le soleil. Cette tendance du Prolétaire à ne pas voir la dynamique réelle de l’impérialisme est liée à une vision figée de l’histoire, persistant à nier la réalité d’une phase de décadence du système capitaliste et de son évolution. En défendant le même principe de “libération nationale” alors que des décennies d’expérience, et les défaites ouvrières qui l’accompagnent, ont démontré sa dangerosité, Le Prolétaire persiste et s’avère difficilement capable de prendre en compte la réalité historique dans le cadre d’une démarche vivante et dialectique. Il ne fait qu’interpréter les événements selon le même dogme immuable, une conception nettement sclérosée, fossilisée de l’histoire et des leçons à tirer pour l’avenir du mouvement ouvrier, qui font que ses positions et analyses se trouvent parfois en décalage avec la réalité et même en opposition avec les besoins de la lutte de classe.
Qu’une organisation de la Gauche communiste soit amenée, ne serait-ce qu’à formuler la question d’un soutien éventuel à Daech vis-à-vis de ses sympathisants ou contacts, ne peut en effet que provoquer “stupeurs et tremblements”. Une telle confusion politique signifie la perte de vue de ce qui fait la vraie force du prolétariat : sa solidarité, son unité internationale et sa conscience de classe.
Contrairement à ce que prétend Le Prolétaire, la classe ouvrière, quelles que soient les conditions, ne doit pas se défendre dans un cadre “national”. Et c’est d’autant plus valable et évident pour celui issue de l’idée fumeuse et archaïque d’un prétendu “grand califat”. Ne possédant que sa force de travail et privé de toute forme de propriété, le prolétariat n’a pas d’intérêts spécifiques autre que son projet révolutionnaire, par-delà les frontières nationales. Son intérêt commun est celui de son organisation et celui du développement de sa conscience. Et parce qu’ils possèdent cela en commun, les prolétaires du monde entier peuvent s’unir grâce à un ciment puissant : celui de la solidarité. Cette solidarité n’est pas une sorte d’idéal ou d’utopie, elle est une force matérielle grâce à laquelle le prolétariat international peut défendre ses intérêts de classe et donc son projet révolutionnaire universel.
RI, mars 2017
1) “Le CCI et les attentats : stupeurs et tremblements”, Le Prolétaire no 519.
2) Parmi d’autres questions importantes (comme notre prétendu pacifisme, le rapport de force entre les classes, etc.) que nous ne pouvons traiter dans le cadre de cet article, on pourra noter celle de la phase de décomposition, situation inédite de la vie du système capitaliste et cadre d’analyse de la période historique, aujourd’hui essentiel pour orienter les activités des révolutionnaires.
3) Manifestes, thèses et résolutions des Quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale Communiste – 1919-1923, fac-similé François Maspéro.
4) Rosa Luxemburg, La Révolution russe.
5) Le Prolétaire no 370 (mars-avril 1983).
6) Le Prolétaire no 164 (7 au 27 janvier 1974).
7) Revue Internationale no 32, “Le Parti communiste international (Programme Communiste) à ses origines, tel qu’il prétend être, tel qu’il est [45]”.
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Terrorisme [9]
Témoignage: l’An I de la Révolution russe
- 1208 lectures
Les quelques lignes extraites de cet ouvrage d’un témoin de la révolution, Victor Serge, constituent un cinglant démenti à l’idéologie en vogue martelée ad nauseam cent ans après par tous les médias selon laquelle Octobre 1917 n’aurait été qu’un vulgaire « coup d’État » perpétré par Lénine et une poignée de bolcheviks.
On était au 6 octobre. La Conférence démocratique, succédané d’un parlement de la révolution, montée par les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, s’était ouverte à Moscou à la mi-septembre. Les grèves l’en avaient chassée, les garçons d’hôtel et de restaurant refusant de servir ses membres. Elle s’était transférée à Petrograd. Elle délibérait maintenant sous la protection de marins choisis parmi les plus sûrs. Et les baïonnettes de ses gardes frémissaient au passage d’un tribun bolchevik : “Quand nous en servirons-nous enfin ?”
Cet état d’esprit était général dans la flotte. Quinze jours avant le 25 octobre, les marins de l’escadre de la Baltique, alors en rade de Helsingfors, exigeaient que l’on ne perdît plus de temps et que l’insurrection “sanctifiât la destruction, qui nous semblait inévitable, de la flotte par les Allemands”. Ils consentaient à périr : mais pour la révolution. Le Soviet de Cronstadt refusait, depuis le 15 mai, de reconnaître le gouvernement provisoire. Après les événements de juillet, les commissaires chargés par Kérenski de procéder à bord des vaisseaux à l’arrestation des “meneurs bolcheviks” n’y avaient obtenu que cette réponse laconique : “Des meneurs, nous en sommes tous !” C’était vrai. La masse avait alors d’innombrables meneurs.
Des délégués des tranchées venaient tenir au Soviet de Petrograd un langage comminatoire : “Jusques à quand durera cette situation intenable ? Les soldats nous ont mandatés pour vous l’annoncer : si des démarches énergiques ne sont pas tentées d’ici au 1er novembre, les tranchées se videront, l’armée tout entière rentrera. Vous nous oubliez ! Si vous ne trouvez pas d’issue à la situation, nous viendrons chasser nous-mêmes nos ennemis, à coups de baïonnette – mais vous vous en irez avec eux !” Telle était, relate Trotski, la voix du front.
Au début d’octobre, l’insurrection naissait partout, spontanément ; les troubles agraires s’étendaient au pays entier. “Les provinces de Toula, Tambov, Riazan, Kalouga se sont soulevées. Les paysans, qui attendaient de la révolution la paix et la terre, déçus, s’insurgent, saisissent les récoltes des propriétaires fonciers, brûlent leurs résidences. Le gouvernement Kérensky réprime lorsqu’il en a la force. Heureusement, ses forces sont restreintes.” “Écraser l’insurrection paysanne, l’avertit Lénine, ce serait tuer la révolution.” Dans les Soviets des villes et les armées, les bolcheviks, naguère encore en minorité, deviennent majorité. Aux élections des doumas (municipalités) de Moscou, ils obtiennent 199 337 suffrages sur 387 262 votants. Il y a sur 710 élus, 350 bolcheviks, 184 cadets, 104 socialistes-révolutionnaires, 31 mencheviks et 41 divers. En cette veille de guerre civile, les partis modérés, moyens, s’effondrent, les partis extrêmes grandissent. Tandis que les mencheviks perdent toute influence réelle et que le Parti socialiste-révolutionnaire, parti gouvernemental, qui paraissait peu de temps auparavant disposer d’une immense influence, passe au troisième plan, les constitutionnels démocrates, cadets, partis de la bourgeoisie, viennent s’aligner, renforcés, en face des révolutionnaires. Aux élections précédentes, en juin, socialistes-révolutionnaires et mencheviks avaient obtenu 70 % des suffrages exprimés ; ils tombent à 18 %. Sur 17 000 soldats consultés, 14 000 votent pour les bolcheviks.
Les soviets se transforment. Citadelles des mencheviks et des socialistes-révolutionnaires, ils se bolchevisent. De nouvelles majorités s’y forment. Le 31 août à Petrograd et le 6 septembre à Moscou, les motions bolchevistes présentées aux soviets obtiennent pour la première fois des majorités. Le 8 septembre, les bureaux menchevistes socialistes-révolutionnaires des deux soviets démissionnent. Le 25 septembre, Trotski est élu président du Soviet de Petrograd. Noguine est porté à la présidence du Soviet de Moscou. Le 20 septembre, le Soviet de Tachkent prend officiellement le pouvoir. Les troupes du gouvernement provisoire le lui reprennent. Le 27 septembre, le Soviet de Reval décide en principe la transmission de tous les pouvoirs aux soviets. Peu de jours avant la révolution d’Octobre, l’artil1erie démocratique de Kérensky tire sur le Soviet insurgé de Kalouga.
Soulignons ici un fait peu connu. À Kazan, l’insurrection d’Octobre triompha avant même d’avoir été déclenchée à Petrograd. Un des acteurs des événements de Kazan a relaté ce dialogue entre militants : “– Mais qu’eussiez-vous fait si les soviets n’avaient pas pris le pouvoir à Petrograd ? – Il nous était impossible de renoncer au pouvoir ; la garnison ne l’eût pas toléré. – Mais Moscou vous eût écrasés ! – Non. Vous avez tort de le croire. Moscou n’aurait pu venir à bout des 40 000 soldats de Kazan.”
Dans l’immense pays, les masses tout entières des classes laborieuses, paysans, ouvriers, soldats vont à la révolution. Montée élémentaire, irrésistible, d’une puissance comparable à celle de l’océan. (...)
Les masses ont des millions de visages ; elles ne sont point homogènes ; elles sont dominées par des intérêts de classe, divers et contradictoires ; elles ne parviennent à la conscience véritable (sans laquelle aucune action féconde n’est possible) que par l’organisation. Les masses soulevées de la Russie de 1917 s’élèvent à la nette conscience de l’action nécessaire, des moyens, des objectifs à atteindre, par l’organe du Parti bolchevique. Ce n’est pas une théorie, c’est l’énoncé d’un fait. Les rapports entre le Parti, la classe ouvrière, les masses laborieuses nous apparaissent ici avec un relief admirable. Ce que veulent confusément les marins de Cronstadt, les soldats de Kazan, les ouvriers de Petrograd, d’Ivanovo-Voznessensk, de Moscou, de partout, les paysans saccageant les demeures seigneuriales, ce qu’ils veulent tous, sans avoir la possibilité d’exprimer nettement leurs aspirations, de les confronter avec les possibilités économiques et politiques, de s’assigner les fins les plus rationnelles, de choisir les moyens les plus propres de les atteindre, de choisir le moment le plus favorable à l’action, de s’entendre d’un bout à l’autre du pays, de s’informer les uns les autres, de se discipliner, de coordonner leur effort innombrable, de constituer, en un mot, une force uniquement intelligente, instruite, volontaire, prodigieuse, ce qu’ils veulent tous, le Parti l’exprime en termes clairs, et le fait. Le Parti leur révèle ce qu’ils pensent. Le Parti est le lien qui les unit entre eux, d’un bout à l’autre du pays. Le Parti est leur conscience, leur intelligence, leur organisation.
Quand les artilleurs des cuirassés de la Baltique, anxieux du danger suspendu sur la révolution, cherchent une voie, l’agitateur bolchevik est là qui la leur montre. Il n’en est pas d’autre, c’est l’évidence. Quand des soldats dans la tranchée veulent exprimer leur volonté d’en finir avec la tuerie, ils élisent au comité du bataillon les candidats du Parti bolchevique. Quand des paysans, las des atermoiements de “leur Parti” socialiste-révolutionnaire, se demandent s’il n’est pas temps d’agir enfin eux-mêmes, la voix de Lénine leur parvient : “Prends la terre, paysan !” Quand les ouvriers sentent 1’intrigue contre-révolutionnaire les environner de toutes parts, la Pravda leur apporte les mots d’ordre qu’ils pressentaient et qui sont aussi ceux de la nécessité révolutionnaire. Devant le placard bolchevique, les passants de la rue miséreuse, attroupés, s’exclament : “Mais c’est ça !” C’est ça. Cette voix est la leur.
C’est pourquoi la marche des masses à la révolution se traduit par un grand fait politique : les bolcheviks, petite minorité révolutionnaire en mars, deviennent en septembre-octobre le parti de la majorité. Distinguer entre les masses et le Parti devient impossible. Ce n’est qu’un flot. Sans doute y a-t-il bien, parmi les foules, d’autres révolutionnaires épars, socialistes-révolutionnaires de gauche (les plus nombreux), anarchistes, maximalistes, qui veulent aussi la révolution : poignée d’hommes emportés par les événements. Meneurs menés. Combien leur conscience des réalités est confuse, nous le verrons par maints traits. Les bolcheviks, eux, grâce à leur juste intelligence théorique du dynamisme des événements, s’identifient à la fois aux masses laborieuses et à la nécessité historique. “Les communistes n’ont pas d’intérêts distincts de ceux du prolétariat tout entier”, est-il écrit dans le Manifeste de Marx et d’Engels. Combien cette phrase écrite en 1847 nous apparaît maintenant juste !
Depuis les émeutes de juillet, le Parti, qui vient de traverser une période d’illégalité et de persécution, n’est que toléré. Il se forme en colonne d’assaut. À ses membres, il demande de l’abnégation, de la passion et de la discipline : il ne leur procure en revanche que la satisfaction de servir le prolétariat. Voyez pourtant grandir ses effectifs. Il comptait, en avril, 72 organisations, fortes de 80 000 membres. Fin juillet, ses effectifs atteignent 200 000 affiliés, groupés dans 162 organisations.
Victor Serge, 1930
Personnages:
- Victor Serge [48]
Rubrique:
Campagne médiatique contre Lénine et la Révolution russe: la révolution “démocratique” de février 1917 utilisée pour falsifier la Révolution d’octobre
- 1487 lectures
Pour le centenaire de la Révolution russe, de nouvelles publications et émissions s’emparent de ce sujet sensible. Tout un flot de propagande se déverse donc à nouveau (1 pour dénaturer les heures héroïques de cet événement grandiose qui fut un des plus importants du xxe siècle, du moins un des plus riches d’enseignements pour le prolétariat mondial. Parmi le foisonnement de l’offre, l’émission TV de la chaîne Arte proposait un titre alléchant : “Lénine, une autre histoire de la Révolution russe” (2. Selon les journalistes du journal Le Monde, “cette évocation est une formidable relecture de l’année 1917 déprise des fables qui l’ont maquillée au fil du temps et au gré des idéologies”. La propagande bourgeoise a toujours véhiculée une “autre histoire de la Révolution” pour mieux enterrer sa véritable histoire, en faisant parler les images à travers des commentaires mensongers plaqués sur des documents d’archives et des films muets. Arte, la chaîne “culturelle” était aussi au rendez-vous de la campagne antibolchevique et anti-léniniste.
Avec de nombreux documents d’archives que nous avons peu l’habitude de voir, l’émission nous plonge dans une sorte de cours d’histoire a priori revisité. Le ton professoral des commentaires cherche d’entrée à instaurer l’autorité des “spécialistes”, maniant l’anaphore (“Ça ne s’est pas passé comme ça...”) et parfois l’ironie feutrée. Par exemple, au moment de prononcer le titre du journal des bolcheviks, la Pravda (la Vérité), on perçoit nettement cette antiphrase ou le téléspectateur est amené à entendre que la Pravda, dans l’esprit du “spécialiste”, n’est que mensonges.
Lénine calomnié et défiguré
L’émission, centrée sur la personnalité de Lénine procède régulièrement et très habilement par oppositions d’images, par antithèses “pédagogiques” dans l’intention de salir une nouvelle fois le combattant qu’était Lénine. Ainsi, d’un côté, on évoque l’exilé en Suisse, totalement “absent” de la scène, avec un plan fixe de la ville de Zurich paisible, le tout accompagné de commentaires et d’une petite musique légère où, en fin de compte, rien ne se passe. Lénine est présenté comme une sorte de planqué totalement à côté de l’histoire. Loin de toute réalité, l’exil est schématiquement réduit aux seuls privilèges des “intellectuels” (sous-entendu déconnectés des masses) et aux “gens aisés”. Cette insistance sociologique qui se base sur une part de réalité n’a d’autre objectif que de souligner le fait que les “masses” sont totalement étrangères aux révolutionnaires. La dimension politique et combative est à peine suggérée, le caractère militant, la dimension réelle du combat de Lénine est occultée, ses polémiques sont totalement passées sous silence. Par net contraste, les plans sur la situation en Russie exposent les événements du terrain, accompagnés d’un montage d’images plus dynamiques. Cette opposition volontairement construite de façon antithétique cherche de manière évidente à disqualifier d’entrée le combat de Lénine qui très rapidement apparaît sous les traits d’un imposteur. Et d’ailleurs, le retour sur sa famille et son enfance, l’évocation de ses anciens combats et, surtout, l’exécution de son frère après sa participation à un attentat contre le tsar, serviront de support à une explication unilatérale consistant à affirmer que Lénine avait comme motivation exclusive pour son engagement révolutionnaire une “soif de vengeance” contre l’aristocratie. N’a-t-il pas dit, comme le rappelle le commentateur de ce documentaire : “ils me le paieront” ?
Dans ce cadre, le marxisme n’est qu’un simple adjuvant devant permettre d’assurer son “pouvoir personnel”. La réalité est aux antipodes de telles calomnies. La démarche désintéressée et solidaire de Lénine, son sens du combat révolutionnaire pour la cause du socialisme ont été la matrice reconnue par tous ses camarades de lutte, par les ouvriers eux-mêmes et, au-delà des polémiques, par toutes les grandes figures du mouvement ouvrier de l’époque et confirmée par la réalité des faits. L’émission, pourtant très documentée, n’a évidemment aucun témoignage disponible dans ce sens. Pourtant, dans sa Révolution russe, Rosa Luxemburg n’hésite pas à affirmer : “Tout ce qu’un parti peut apporter, en un moment historique, en fait de courage, d’énergie, de compréhension révolutionnaire et de conséquence, les Lénine, Trotski et leurs camarades l’ont réalisé pleinement. L’honneur et la capacité d’action révolutionnaire, qui ont fait à tel point défaut à la social-démocratie, c’est chez eux qu’on les a trouvés. En ce sens, leur insurrection d’Octobre n’a pas sauvé seulement la Révolution russe, mais aussi l’honneur du socialisme international.”
Construite de manière chronologique, l’émission évoque 1905, puis les grands événements qui jalonnent les journées de février 1917 pour souligner que les bolcheviks sont politiquement en dehors du coup et ne comprennent absolument rien à la situation. Partant d’une réalité ou les bolcheviks étaient effectivement minoritaires au départ, la plupart en prison, le parti pris est de souligner que Lénine est non seulement souvent “absent”, mais qu’il “navigue à vue” et se retrouve en permanence “ballotté par les événements”. La seule qualité de ce grand révolutionnaire se résumerait uniquement à l’art de la manipulation.
Face à cela, Trotski rétablit la réalité de la démarche de Lénine : “La principale force de Lénine consistait en ceci qu’il comprenait la logique interne du mouvement et réglait d’après elle sa politique. Il n’imposait pas son plan aux masses. Il aidait les masses à concevoir et à réaliser leurs propres plans” (3.
Un plaidoyer mensonger en faveur de la démocratie bourgeoise
Le procédé de l’antithèse, cher à l’émission d’Arte, se poursuit avec le portrait croisé de Lénine et de Kerenski. Là encore, le seul personnage “digne de l’histoire” est Kerenski, véritablement encensé sans pudeur. Kerenski est présenté comme l’incarnation du mouvement des masses aux aspirations prétendument démocratiques. On insiste sur l’accueil qu’il fait aux ouvriers “crasseux” et “sentant la sueur”, les soldats excédés qui l’acclament, sa soi-disant légitimité. Kerenski est présenté comme le grand démocrate qui fait le trait d’union entre le conseil ouvrier, le palais Tauride et la Douma. La réalité, c’est qu’il œuvre pour la réaction, comme le montre sa démarche vis-à-vis de l’ambassadeur américain : “Nous ferons en sorte que les soviets meurent de mort naturelle. Le centre de gravité de la vie politique se déplacera progressivement des soviets vers les nouveaux organes démocratiques de représentation autonome” (4. Tout est dit.
Le commentaire qui occulte tout cela peut ainsi se permettre de présenter le quartier industriel de Vyborg et les 400 000 prolétaires comme spontanément animés d’une même aspiration démocratique et non d’un combat historique révolutionnaire contre le système capitaliste. Les initiatives ouvrières sont bien évoquées, comme par exemple l’extraordinaire traversée de la Neva gelée, à la barbe des troupes réactionnaires, des flics et des autorités postées sur le pont Alexandre II. Mais elles apparaissent comme purement contingentes, sous couvert du simple chaos lié au gré des événements, sans considération aucune pour la dimension consciente et politique des masses ouvrières. De la même manière, le Conseil ouvrier de Petrograd est frauduleusement assimilé à une sorte de parlement populaire et non à ce qu’il représente réellement : un organe de lutte ou se mène le véritable combat politique du prolétariat. Sous prétexte d’une “pluralité” de courants politiques et d’influences bourgeoises et petites bourgeoises durant cette période, le commentateur s’autorise à réduire le soviet à une simple représentation démocratique 5.
Les journées de février sont présentées frauduleusement comme le point culminant de la révolution, alors qu’il n’existait en réalité qu’un double pouvoir : d’un côté celui des conseils, de l’autre celui du gouvernement provisoire, sans issue décisive. La suite des événements, jusqu’à octobre, apparaît comme une sorte de dépossession des conseils par les bolcheviks. En réalité, c’est l’inverse. Ils luttaient contre la réaction qui œuvrait derrière le masque pseudo-révolutionnaire de la gauche démocratique pour tenter d’abuser et de tromper les conseils : “Là où un ministre bourgeois n’aurait pu se présenter pour assurer la défense du gouvernement, devant les ouvriers révolutionnaires ou dans les soviets, on voyait paraître (ou plutôt la bourgeoisie y envoyait) un ministre “socialiste” (Skobélev, Tsérétéli, Tchernov ou d’autres encore) qui œuvrait en conscience au profit de la bourgeoise, suait sang et eau pour défendre le ministère, blanchissait les capitalistes, bernait le peuple en répétant des promesses, des promesses et des promesses, et en lui recommandant d’attendre, d’attendre, d’attendre et d’attendre” (6.
Les événements de février 1917, tout comme ceux de 1905, sont naturellement évoqués en lien avec la lutte du prolétariat contre la guerre. Mais tout le contexte international de la lutte de classe durant l’année 1917 est soigneusement occulté, comme si “l’irruption des masses” en Russie n’était qu’un simple accident lié au particularisme d’un “pays arriéré”. Rien sur la réalité des mutineries et des mouvements de fraternisation des soldats sur tous les fronts, rien sur les grèves un peu partout et la fermentation à l’arrière, sur le fait que débute en réalité une véritable vague révolutionnaire internationale du prolétariat.
L’opposition radicale entre la bourgeoisie, le gouvernement provisoire désirant poursuivre la guerre à tout prix, et les révolutionnaires bolcheviks, Lénine en tête, refusant la boucherie impérialiste, est relayé au second plan et noyé sous le flot des commentaires falsificateurs. Les autres grands faits marquants de la Révolution restent soumis à la même intoxication idéologique : disqualifier les bolcheviks et surtout Lénine. La rigueur même de Lénine et son respect rigoureux des décisions prises au cours des congrès, (comme par exemple en 1903 face à ceux qui refusaient de se soumettre aux décisions votées et à la fronde des Menchéviks7 est calomniée, les commentaires présentant Lénine comme dogmatique et dictateur. Rien n’est plus mensonger ! Pire, Lénine aurait été, selon le commentateur, quelqu’un qui “aura passé toute sa vie à exclure et à diviser”. Ce commentaire arrive à l’occasion du testament de Lénine lorsque ce dernier, sur son lit de mort, demande à ses camarades du Parti bolchevik d’écarter Staline du Comité central du fait de sa cruauté. Comme par enchantement, le commentateur ne dit pas un mot du testament de Lénine, tout simplement parce qu’il contient la preuve qu’il n’y avait aucune “continuité” entre Lénine et Staline. Le mensonge par omission fait partie intégrante du procédé de toutes les campagnes d’intoxication idéologique contre Lénine et la révolution russe. Lénine a toujours été l’artisan patient d’un combat unitaire, défendant “l’esprit de parti” contre tous les opportunistes, contre les “cercles” qui tendaient à refuser l’unité des révolutionnaires en fragmentant d’autant les énergies, affaiblissant les efforts en faveur de la lutte prolétarienne internationale. Ce fut tout le sens de son combat et l’apport de ses Thèses d’Avril. Face à tous les sycophantes et à ceux qui cherchaient à collaborer et à s’accommoder de la classe dominante, des miasmes conservateurs de la démocratie bourgeoise, face à tous les opportunistes, Lénine, en effet, ne courbait pas l’échine et se montrait intransigeant. Il se refusait très justement à toute concession face à l’ennemi de classe, face aux exploiteurs et donc, n’acceptait pas le capitalisme. Bien entendu, le reflux de la vague révolutionnaire et l’encerclement par les troupes de l’Entente, le poids de visions erronées héritées du passé social-démocrate allaient conduire à une situation absolument tragique 8.
En réalité, ce qui dérange les réalisateurs de cette émission, c’est avant tout le fait que Lénine ne soit pas un patriote et qu’il refuse l’union sacrée en souhaitant même, suprême transgression, “la défaite de son propre pays” ! Refuser “l’union sacrée” provoque en effet des “divisions” au sein de la “nation” et une opposition de classe : cela, nous ne le nions pas. À toutes les étapes fondamentales du récit des événements, le commentaire maintient la même ligne officielle faisant passer la moindre erreur pour une trahison !
Durant les journées de juillet, la terrible contre-offensive réactionnaire, la chasse aux bolcheviks ou les masses sont “exposées aux coups” (Trotski), sont l’occasion de souligner que Lénine est “absent”, ou “bafouille” autour de bolcheviks en “panique”. La réalité est que le Parti bolchevik a bien au contraire compris les pièges de la réaction et a pris position contre l’insurrection et la prise du pouvoir qui était prématurée en juillet (les soldats n’étant pas suffisamment solidaires des ouvriers et la situation de la province en retard politiquement sur Petrograd). Dans d’autres circonstances, comme dans une de ses interventions au soviet, Lénine est tellement incompris que son prétendu “délire politique” inquiète sa propre compagne Kroupskaïa “craignant pour sa santé mentale”. Ignoble ! Ainsi, le stress liés à la situation tendue, le surmenage, se transforment aux yeux de nos “experts” en une véritable pathologie mentale. La prétendue “compétition” de Lénine entre les soviets et les bolcheviks, sa volonté de faire main basse sur les conseils et “le pouvoir qui lui monte à la tête”... tout cela relève des mêmes interprétations mensongères. Si les bolcheviks parviennent à déjouer le putsch du général Kornilov au mois d’août, regroupés et retranchés autour du conseil ouvrier à Smolny, c’est finalement pour nous suggérer quasi explicitement que Lénine est in fine lui-même une sorte de “Kornilov” qui a fini par réussir son coup en octobre. Cela, après avoir quitté “sa cabane” à Helsinki et avoir mis en œuvre le sabotage de la démocratie. Le IIe Congrès des soviets devient un simple enjeux démocratique et Lénine un “obsédé de l’insurrection” cherchant de façon insatiable à assouvir à tous prix, encore une fois, son “appétit du pouvoir”. L’argument massue étant que Lénine n’a pas attendu le IIe Congrès des soviets avant d’appeler à la prise du pouvoir, et donc que la révolution aurait été confisquée aux masses prolétariennes. Ce qui est faux : ce n’est pas le dictateur Lénine, ni le Comité central du Parti bolchevik, mais le Comité militaire révolutionnaire (CMR) élu par le soviet de Petrograd qui a appelé à l’insurrection d’Octobre. Et nos “historiens” bourgeois le savent très bien !
Octobre : une insurrection en faveur de la Révolution mondiale et non un “putsch”
Toute la question de la prise du pouvoir d’Octobre, de la décision même de l’insurrection, sont présentés de façon classique par la propagande officielle comme un vulgaire “coup d’État” mené par le CMR totalement contrôlé en sous-main par une poignée de bolcheviks et l’ineffable dictateur Lénine. Ce qu’oublie de dire l’émission, c’est que le CMR est réellement sous le contrôle du soviet de Petrograd. Il s’agirait, aux dire même du commentateur, d’une simple “opération de police” opposée à l’image qu’en donne le film du célèbre cinéaste Eisenstein. Et là encore, l’émission pourtant très bien documentée, s’inspirant de témoignages et sources diverses, se garde bien d’évoquer le point de vue de Trotski qui clarifie les choses : “II n’y eut presque point de manifestations, de combats de rue, de barricades de tout ce que l’on entend d’ordinaire par “insurrection”. La révolution n’avait pas besoin de résoudre un problème déjà résolu. La saisie de l’appareil gouvernemental pouvait être effectuée d’après un plan, avec l’aide de détachements armés relativement peu nombreux, partant d’un centre unique (...) Le calme dans les rues, en octobre, l’absence de foules, l’inexistence de combats donnaient aux adversaires des motifs de parler de la conspiration d’une minorité insignifiante, de l’aventure d’une poignée de bolcheviks. (...) En réalité, les bolcheviks pouvaient ramener au dernier moment la lutte pour le pouvoir à un “complot”, non point parce qu’ils étaient une petite minorité, mais au contraire parce qu’ils avaient derrière eux, dans les quartiers ouvriers et les casernes, une écrasante majorité, fortement groupée, organisée, disciplinée” (9.
De même, le témoignage vivant du journaliste américain John Reed, qui a assisté aux “dix jours qui ébranlèrent le monde”, est totalement occulté : “C’est ainsi, dans le fracas de l’artillerie, dans l’obscurité, au milieu des haines, de la peur et de l’audace la plus téméraire, que naquit la nouvelle Russie (…). Pareils à un fleuve noir emplissant toute la rue, sans chants ni rires, nous passions sous l’Arche Rouge (…). De l’autre côté de l’Arche, nous priment le pas de course, nous baissant et nous faisant aussi petits que possible, puis, nous rassemblant derrière le piédestal de la colonne d’Alexandre (…). Après être restés quelques minutes massée derrière la colonne, la troupe, qui se composait de quelques centaines d’hommes, retrouva son calme et, sans nouveaux ordres, d’elle-même, repartit en avant. Grâce à la lumière qui tombait des fenêtres du Palais d’hiver, j’avais réussi à distinguer que les deux ou trois cents premiers étaient des gardes rouges, parmi lesquels étaient disséminés seulement quelques soldats (…). Un soldat et un garde rouge apparurent dans la porte, écartant la foule : ils étaient suivis d’autres gardes, baïonnette au canon, escortant une demi-douzaine de civils qui avançaient l’un derrière l’autre. C’était les membres du Gouvernement provisoire (…). Nous sortîmes dans la nuit glacée, toute frémissante et bruissante de troupes invisibles, sillonnées de patrouilles (…). Sous nos pieds, le trottoir était jonché de débris de stuc de la corniche du Palais qui avait reçu deux obus du croiseur Aurora. C’était les seuls dégâts causés par le bombardement. Il était trois heures du matin. Sur la Nevski, tous les becs de gaz étaient de nouveau allumés ; le canon de trois Apouces avait été enlevé et seuls les gardes rouges et les soldats accroupis autour des feux rappelaient encore la guerre (…). À Smolny, des bureaux du Comité militaire révolutionnaire semblaient jaillir des éclairs, comme d’une dynamo travaillant à trop grande puissance” (10.
Selon l’émission d’Arte, le soviet à Smolny n’est que pure forme dans la mesure ou le pouvoir est “confisqué” par le “parti unique” et le méchant Lénine. Une sorte de fracture se serait consolidée après la mise en place des commissaires du peuple.
Par un tour de passe-passe dont les médias aux ordres de la classe bourgeoise ont le secret, l’émission d’Arte se termine par des commentaires sur le chaos sanglant engendré par la Révolution d’octobre et qui aurait provoqué l’effondrement définitif du “communisme” en 1989. La matraquage idéologique est encore utilisé à outrance mais, aujourd’hui, avec un objectif particulièrement pernicieux : Oui, il y a bien eu une révolution prolétarienne en Russie mais ce que voulaient ces masses prolétariennes, c’était la démocratie, une démocratie parlementaire comme dans les pays occidentaux, avec sa mystification du “pouvoir du peuple” par le suffrage universel.
Mensonge ! Ce que voulaient les masses prolétariennes, c’était la fin de la guerre de 1914-18. Et seul Lénine et le Parti bolchevik avait ce “programme” révolutionnaire et permettait au prolétariat de prendre en main sa destinée. C’est grâce à Octobre que la Révolution russe et le “bolchevisme” ont mis fin à la boucherie mondiale. Cette vérité historique, nos commentateurs, professeurs d’“histoire” et autres chantres de la démocratie bourgeoise, se gardent bien de la mentionner. Comme le disait Goebbels, chef de la propagande nazie en Allemagne : “Un mensonge énorme porte avec lui une force qui éloigne le doute”. Et dans l’art de la propagande et de la falsification de l’histoire, les idéologues patentés de l’État démocratique n’ont pas grand chose à envier aux “lavages de cerveaux” des régimes nazi ou stalinien.
WH, 13 février 2017
1) Si la propagande est permanente et prend des formes différentes, elle a connu des pics fiévreux, comme au moment de la prise du pouvoir par les bolcheviks, parfois durant la guerre froide, mais aussi et surtout au moment et après l’effondrement de l’URSS durant les années 1990. Voir notre brochure : Octobre 1917 début de la révolution mondiale : les masses ouvrières prennent leur destin en main [50].
2) Émission du vendredi 3 mars, avec la participation de l’historien Marc Ferro, spécialiste de la Russie et de l’URSS. Ce véritable porte-parole de l’histoire officielle n’a cessé d’entretenir et de colporter doctement le plus grand mensonge de l’histoire assimilant le stalinisme au communisme.
3) Trotski, Histoire de la Révolution russe, Tome I, chapitre “Le réarmement du Parti”.
4) John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde.
5) Le fait d’insister sur La Marseillaise reprise par les manifestants, sans en préciser les raisons ni l’état d’esprit réel des masses, le fait de souligner l’obtention du droit de vote des femmes sous le gouvernement provisoire, tout laisse croire, en fin de compte a une simple révolution bourgeoise et purement démocratique.
6) Lénine : Les enseignements de la révolution, point VI.
7) Lire la brochure de Lénine, Un pas en avant deux pas en arrière.
8) Nous n’avons jamais nié les erreurs commises par le Parti bolchevik, ni sa dégénérescence et sa transformation en colonne vertébrale de l’odieuse dictature stalinienne. Le rôle du Parti bolchevik ainsi que la critique implacable de ses erreurs et sa dégénérescence ont été analysés dans différents articles de notre Revue internationale :
–“La dégénérescence de la Révolution russe” et “Les leçons de Kronstadt” (no 3) ;
• “La défense du caractère prolétarien de la Révolution d’Octobre” (nos 12 et 13).
La raison essentielle de la dégénérescence des partis et organisations politiques du prolétariat résidait dans le poids de l’idéologie bourgeoise dans leurs rangs, qui créait constamment des tendances à l’opportunisme et au centrisme (voir “Résolution sur le centrisme et l’opportunisme”, Revue internationale no 44).
9) Trotski, op. cit.
10) John Reed, op. cit.
Géographique:
- Russie [51]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [34]
Personnages:
- Lénine [52]
Révolution Internationale n°465 - juillet août 2017
- 737 lectures
Élections législatives : les gouvernements changent, le capitalisme demeure
- 1023 lectures
C’est toujours la bourgeoisie qui gagne les élections. Puisqu’il s’agit de “choisir” quelle sera la meilleure équipe dirigeante pour gérer la nation au sein de l’arène mondiale. Et cette fois-ci, la bourgeoisie française a particulièrement bien réussi son coup : une campagne démocratique assourdissante faisant croire au “renouveau”, une majorité gouvernementale d’ores et déjà attelée à justifier les “nécessaires sacrifices” pour “moderniser et dynamiser l’économie française, un Président triomphant et plébiscité internationalement, Emmanuel Macron, armé d’un “nouveau parti” 1, “La République en marche !” et d’une majorité absolue au Parlement... Bref, la bourgeoisie française peut se féliciter et se targuer d’un renforcement de son dispositif étatique sur le plan politique et idéologique.
Cette réussite de la bourgeoisie française est d’autant plus retentissante que, presque partout, les autres bourgeoisies nationales sont en difficulté, gangrenées par leurs partis populistes dont la capacité à gérer efficacement et rationnellement l’intérêt du Capital est plus que douteuse. Pour preuves : la victoire du Brexit dans le plus vieux pays capitaliste du monde, la Grande-Bretagne et l’élection de Trump à la tête du plus puissant d’entre-eux. En France, le risque de l’arrivée au pouvoir du Front National devenait donc une préoccupation majeure pour les fractions les plus lucides de la bourgeoisie des pays occidentaux, en particulier face aux dangers d’éclatement de l’Europe, de remise en cause de sa monnaie, de ses institutions dont la France comme l’Allemagne constituent le cœur.
Démocratisme et citoyenneté : une expression de la domination bourgeoise
La tendance au rejet massif des partis traditionnels qui avaient gouverné pendant des décennies, l’indifférence croissante par rapport au jeu des institutions démocratiques bourgeoises devenaient un réel problème pour la classe dominante, pour sa capacité à défendre au mieux ses propres intérêts nationaux. Il s’agissait de mettre à l’écart les vieux politiciens usés et discrédités. La machine à propagande de la bourgeoisie a marché à plein régime : il fallait aussi que la bourgeoisie fasse apparaître un homme fringant et “moderne”, en apparence “neuf” et providentiel, ancien ministre mais sans “casseroles” politiques ou personnelles trop marquantes, disposant d’un nouveau parti au-dessus des “vieux clivages”, pouvant racoler à gauche comme à droite, ouvertement pro-européen, pratiquant une parité entre hommes et femmes... En d’autres termes : un “ravalement de façade” qui masque le fait qu’il ne peut qu’imposer les mêmes conditions de domination capitaliste aux exploités et à l’ensemble de la société. C’était aussi l’entame, essentielle pour ses besoins, d’une remise en ordre de marche de son appareil d’État grippé.
En réalité, l’idéologie démocratique n’est qu’une expression de la domination totalitaire du capital sur la société. La théorie selon laquelle les réformes de la machine et des institutions de l’État démocratique moderne permettraient une adaptation à la défense de tous les citoyens par les citoyens eux-mêmes est une fiction mystificatrice. Tant que la société est basée sur l’existence de classes aux intérêts radicalement antagoniques dont l’une exploite l’autre, la démocratie de l’État s’impose comme l’expression d’une domination de classe 2. La citoyenneté n’est qu’une abstraction mensongère cherchant à camoufler la réalité des conflits de classes. Participer aux élections, c’est se transformer en un citoyen impuissant livré pieds et poings liés à la propagande et aux discours officiels, aux intérêts et aux manipulations de la bourgeoisie.
Il est vrai que le taux d’abstention aux élections législatives est encore plus élevé que celui déjà significativement haut atteint au moment de l’élection présidentielle. A cela s’ajoute les non-inscrits et les votes blancs. Ce phénomène exprime certes une méfiance croissante envers les institutions bourgeoises. D’élections en élections, de désillusions en désillusions envers les politiques menées par les différents gouvernements, une partie importante du prolétariat a tout simplement boycotté ces élections. Et sur ce plan, le phénomène Macron n’a pas eu d’effet significatif. Toutefois, si cette réalité inquiète la bourgeoisie, elle ne constitue pas pour autant en soi un atout pour le prolétariat. La passivité, le repli, l’indifférence parfois à l’égard de la politique sont avant tout le produit d’un manque de perspective qui génère une impuissance, elle-même exploitée par la bourgeoisie pour tenter de culpabiliser les ouvriers et pourrir leur conscience. Se borner à refuser le cirque électoral n’est nullement une solution. Cela doit nécessairement s’accompagner d’une démarche consciente, d’une critique radicale de la société capitaliste, d’une action sur un terrain de classe.
“La République en marche !” pour défendre la nation bourgeoise
Le nouveau gouvernement, malgré les inquiétudes qu’il suscite déjà, peut maintenant se prévaloir de la légitimité des urnes pour passer à l’offensive contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Le gouvernement Macron a immédiatement lancé une politique parfaitement adaptée aux intérêts du capital français. Ceci est particulièrement spectaculaire sur le plan impérialiste et guerrier. La politique de la France en Afrique, comme au Mali par exemple, a été immédiatement soutenue et confirmée, sa participation à la guerre en Syrie et en Irak renforcée. Il semble même que Macron soit prêt à reconnaître le boucher Assad au nom de la realpolitik.
Quant à la relance du couple franco-allemand dans une situation de crise de l’Union européenne, elle se traduit pour l’heure par la tentative de renforcer le rôle de la France en Europe. La volonté affichée de Macron de redynamiser l’appareil politique de l’État français grâce à l’aura qu’il possède actuellement au niveau international, se heurte déjà à l’opposition de Merkel qui, si elle a été le soutien le plus actif de Macron durant toute sa campagne et si son élection a rassuré la bourgeoisie allemande n’est pour autant pas prête à accepter le pied d’égalité et le co-leadership entre les deux pays au sein de l’UE. Pour le moment, les seules mesures prises d’un commun accord consistent à renforcer davantage l’austérité en Grèce et la politique anti-migrants aux frontières de l’Europe...
Mais ce n’est pas seulement dans ces domaines que l’arrivée au pouvoir de Macron implique une évolution importante de la situation. Les médias bourgeois et la nouvelle majorité clament à tue-tête que le capitalisme français n’est pas assez compétitif, malgré les attaques précédentes et la loi El Khomri. Ces réformes, dans la bouche de la bourgeoisie, nous en connaissons le prix. Cela veut dire plus de taxes, un démantèlement accéléré de la protection sociale, plus d’austérité, plus de précarité, plus de flexibilité, plus d’exploitation. Après avoir prétendu faire du “nouveau”, le gouvernement Macron a déjà entrepris de ramener brutalement les exploités à la réalité de l’intensification de la dégradation de leurs conditions d’existence. C’est bien une paupérisation et une précarisation sans fin qui est programmée. Des attaques massives sont déjà annoncées et seront prises notamment au cours des vacances d’été.
L’importance prise par le mouvement La France insoumise, avec son leader charismatique Mélenchon et l’appui éventuel de nouveaux mouvements comme celui de Benoît Hamon, viennent renforcer cette capacité à faire passer les attaques en apportant leur caution “critique” et de prétendue “opposition”, témoignant d’un redéploiement des forces politique les plus éclairées au sein du capitalisme d’État. Mélenchon vient ainsi de prétendre qu’il apporterait à l’Assemblée nationale les revendications de la rue. Tout comme les syndicats qui eux aussi renforcent leur encadrement anti-ouvrier sur les lieux de travail.
S’il y a une leçon que la victoire de Macron nous donne à retenir, c’est qu’il ne faut jamais sous-estimer la capacité de la bourgeoisie à faire face aux aléas de la crise, à ses difficultés politiques. Le renforcement de l’exécutif par Macron, la réorganisation de l’État à laquelle nous assistons sont autant d’armes dans les mains de la bourgeoisie contre le combat historique du prolétariat.
Une seule perspective est possible et réaliste : celle de la révolution communiste
Même si le prolétariat n’a pas pour le moment la force de réagir du fait de son incapacité à se reconnaître comme force politique réelle, ayant une identité propre, celle d’une classe révolutionnaire en mesure de défendre une alternative au capitalisme, il lui faudra réagir et s’opposer à ce capitalisme pourrissant en renouant tout d’abord avec l’expérience de ses luttes. Même s’il n’est pas en mesure, dans la période actuelle, de s’élever sur son terrain de classe et de lutte pour s’opposer à la dégradation de ses conditions de vie, le combat de classe s’imposera à lui, comme cela s’est fait tout au long de l’histoire du capitalisme. Rappelons-nous qu’il y a 100 ans, le prolétariat a su prendre l’initiative de remettre en cause le système capitaliste avec la volonté de le renverser à l’échelle mondiale. Octobre 1917 en Russie, comme première étape d’une vaste vague révolutionnaire internationale, démontre que le prolétariat est historiquement capable de porter des assauts contre le capitalisme avec une démarche consciente et montre à la classe ouvrière d’aujourd’hui que la révolution est non seulement nécessaire mais possible. La réappropriation de cette mémoire est indispensable. Quoi qu’en disent les médias bourgeois, l’avenir de l’humanité n’appartient pas à des politiciens comme Macron et ceux de sa classe, pas plus qu’aux élections et autres assemblées parlementaires. L’avenir appartient en réalité à la lutte historique du prolétariat, au pouvoir des conseils ouvriers et au communisme. La révolution en Russie a été capable de mettre fin à la guerre impérialiste de 1914-1918 avant d’être finalement vaincue dans les années 1920. Mais elle reste un phare qui doit guider la lutte de classe dans la nuit du capitalisme. Tous ceux qui, au sein de la classe prolétarienne, cherchent à rejeter le système capitaliste et aspirent à transformer le monde radicalement doivent s’inscrire dès maintenant dans la perspective d’un combat de classe.
Pour cela, même si c’est difficile, il est nécessaire de se regrouper, de se rencontrer pour débattre et clarifier les immenses questions qui se posent à notre classe. La démarche consciente et la solidarité sont toujours une nécessité vitale pour le prolétariat afin de combattre toutes formes d’illusions démocratiques et s’armer politiquement en vue de résister aux attaques inévitables que ce gouvernement, comme les précédents, va asséner.
Stephan, 8 juillet 2017
1 Créé sous sa houlette un an à peine avant l’élection présidentielle.
2 Voir notre article “Élections et démocratie: l’avenir de l’humanité ne passe pas par les urnes [55]”, Révolution internationale n° 463.
Géographique:
- France [15]
Situations territoriales:
Personnages:
- Emmanuel Macron [40]
Récent et en cours:
- Elections 2017 [20]
Rubrique:
L’incendie de la tour Grenfell : un crime du Capital
- 1023 lectures
Les survivants de l’incendie de la tour Grenfell, ceux qui vivent dans son ombre, ceux qui partout ailleurs vivent dans des tours similaires, ceux qui sont venus manifester leur solidarité, dont la colère les a menés jusqu’à occuper la mairie de Kensington et à marcher sur Downing Street, tous ceux-là étaient parfaitement clairs sur le fait que cette horreur n’est pas une “tragédie” abstraite, et encore moins un acte de Dieu, mais comme le disait une bannière de fortune, “un crime contre les pauvres”, une question de classe rendue d’autant plus évidente par le fait que le Royal Borough de Kensington et Chelsea représentent typiquement l’obscène contraste de richesse qui est la marque de ce système social, le résumant sous la forme très visible et tangible de la “question du logement”.
Bien avant le déclenchement de l’incendie, un groupe d’action de résidents avait averti de l’état dangereux de la tour Grenfell, mais ces avertissements avaient été systématiquement ignorés par le conseil municipal et son agent, le Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation. Cela fait longtemps que l’on soupçonne que le revêtement qui est suspecté d’être la principale cause de la rapide propagation de l’incendie n’avait pas été installé pour le bien-être des résidents de la tour, mais pour en améliorer l’aspect extérieur par égard pour les riches habitants du quartier. Encore une fois, il est bien connu que tout ce quartier est infesté par cette nouvelle génération de propriétaires terriens non résidents qui, poussés par la manie de la bourgeoisie anglaise d’encourager l’investissement étranger, achètent des bâtiments extrêmement chers et dans beaucoup de cas ne se soucient même pas de les louer, les laissant vides pour purement et simplement spéculer dessus. Et bien entendu, la spéculation sur les logements, encouragée par l’État, a été un élément central du krach de 2008, un désastre économique dont le résultat net a été d’élargir encore un peu plus l’énorme fossé entre ceux qui sont riches et ceux qui ne le sont pas. Aujourd’hui acheter une maison coûte cher, particulièrement à Londres qui reste la pièce maîtresse d’une économie de casino reposant sur la dette.
La profondeur et l’étendue de l’indignation provoquée par une telle politique ont été à ce point que les media appartenant à ceux qui sont en haut de l’échelle de la richesse, et contrôlés par eux, n’ont pas eu trop le choix et ont dû emboîter le pas de toute cette rage. Quelques-uns des tabloïds pro-Brexit ont cherché à rendre les règlements de l’UE responsables de l’incendie, mais ont dû faire machine arrière assez vite face à la colère populaire (mais seulement lorsqu’il est apparu que le genre de revêtement utilisé pour “régénérer” Grenfell est interdit dans un pays comme l’Allemagne). Un journal, pourtant pas précisément réputé pour son radicalisme, le Metro de Londres, a affiché en gros titre : “Arrêtez les assassins !”, présenté non comme une citation, mais comme une demande, basée cependant sur la rhétorique du député de Tottenham David Lammy qui a été l’un des premiers à décrire l’incendie comme “un homicide involontaire d’entreprise”. Et tout le monde, à l’exception d’une petite minorité de trolls internet racistes, a évité tout mot désobligeant sur le fait que la majorité des victimes non seulement étaient pauvres, mais étaient des migrants et même des réfugiés. Les nombreuses expressions de solidarité que nous avons vues au lendemain de l’incendie, les dons de nourriture, de vêtements, de couvertures, d’hébergement, de travail dans les centres d’urgence, sont venus des gens sur place, de tous les milieux ethniques et religieux, ne conditionnant aucunement leur aide à l’histoire personnelle des victimes.
Les manifestants ont parfaitement raison d’exiger des réponses sur les causes de cet incendie, de faire pression sur l’État pour qu’il accorde une assistance d’urgence pour les reloger dans le même quartier, certains d’entre eux ont déjà fait référence à la douloureuse expérience des déplacés de l’ouragan Katrina, qui a été utilisé pour procéder à une sorte de nettoyage de classe et ethnique dans les quartiers “désirables” de la Nouvelle-Orléans. De façon tout à fait compréhensible, ceux qui vivent dans les autres grands ensembles veulent un bilan de sécurité et des améliorations dans ce domaine aussi rapidement que possible. Mais il faut absolument examiner les causes profondes de cette catastrophe, pour comprendre que l’inégalité qui en a été si souvent désignée comme un élément-clé est enracinée dans la structure fondamentale de l’actuelle société. C’est particulièrement important parce qu’une grande partie de la colère que tout le monde ressent est dirigée contre des individus et institutions particuliers (Theresa May parce qu’elle a eu peur du contact direct avec les résidents de Grenfell, le conseil municipal ou le KCTMO) plutôt que contre le mode de production qui engendre de tels désastres depuis ses propres entrailles. Si ce point manque, la porte reste ouverte à toutes les illusions sur des solutions capitalistes alternatives, en particulier celles que propose l’aile gauche du capital. Nous avons déjà vu Corbyn à nouveau prendre la tête de la course au jeu de la popularité devant May du fait de sa réponse plus sensible et “terre à terre” aux résidents de Grenfell, notamment son plaidoyer pour des solutions apparemment radicales, comme la “réquisition” de maisons vides pour offrir un logement à ceux qui ont été déplacés 1.
Le capitalisme est à la racine de la crise du logement
Voici comment Marx définissait le problème, en se concentrant particulièrement sur l’impitoyable chasse au profit dans le processus de production :
“Comme l’ouvrier consacre au procès de production la majeure partie de sa vie, les conditions de la production s’identifient en grande partie avec les conditions de son existence. Toute économie réalisée sur ces dernières doit se traduire par une hausse du taux du profit, absolument comme le surmenage, la transformation du travailleur en bête de somme sont, ainsi que nous l’avons montré précédemment, une méthode d’activer la production de la plus-value. L’économie sur les conditions d’existence des ouvriers se réalise par : l’entassement d’un grand nombre d’hommes dans des salles étroites et malsaines, ce que dans la langue des capitalistes on appelle l’épargne des installations ; l’accumulation, dans ces mêmes salles, de machines dangereuses, sans appareils protecteurs contre les accidents ; l’absence de mesures de précaution dans les industries malsaines et dangereuses, comme les mines par exemple. (Nous ne pensons naturellement pas aux installations qui auraient pour but de rendre le procès de production humain, agréable ou seulement supportable, et qui, aux yeux de tout bon capitaliste, constitueraient un gaspillage sans but et insensé)”.
Mais cette tendance à réduire l’espace, à négliger les mesures de sécurité et à tailler dans les coûts de production afin d’augmenter le taux de profit ne s’applique pas moins à la construction de logements destinés à la classe exploitée. Dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre (1845), Engels décrivait avec beaucoup de minutie la surpopulation, la crasse, la pollution et le délabrement des maisons et des rues hâtivement construites pour loger les ouvriers d’usine de Manchester et d’autres cités ; dans La question du logement (1872), il soulignait que ces conditions déclenchaient inévitablement des épidémies :
“Les germes du choléra, du typhus, de la fièvre typhoïde, de la variole et autres maladies dévastatrices se répandent dans l’air pestilentiel et les eaux polluées de ces quartiers ouvriers ; ils n’y meurent presque jamais complètement, se développent dès que les circonstances sont favorables et provoquent des épidémies, qui alors se propagent au-delà de leurs foyers jusque dans les quartiers plus aérés et plus sains, habités par Messieurs les capitalistes. Ceux-ci ne peuvent impunément se permettre de favoriser dans la classe ouvrière des épidémies dont ils subiraient les conséquences ; l’ange exterminateur sévit parmi eux avec aussi peu de ménagements que chez les travailleurs”.
Il est bien connu que la construction du réseau d’égouts de Londres au xixe siècle, un travail d’ingénierie titanesque qui a grandement réduit l’impact du choléra et qui est toujours en fonction aujourd’hui, n’a connu une forte impulsion qu’après la “Grande puanteur” de 1858 qui provenait de la Tamise polluée et qui s’attaquait aux narines des politiciens de Westminster. Les luttes et les revendications ouvrières pour de meilleurs logements ont bien entendu été un facteur pour décider la bourgeoisie à démolir les bidonvilles et à offrir des constructions plus sûres et salubres à ses esclaves salariés. Pour se protéger lui-même des maladies et aussi pour faire cesser la décimation de sa force de travail, le capital a été contraint d’introduire ces améliorations, d’autant que de substantiels profits pouvaient être faits en investissant dans la construction et la propriété. Mais comme Engels l’a noté, même à cette époque de réformes conséquentes, rendues possibles par un mode de production en pleine ascendance, le capitalisme avait tendance à simplement déplacer les bidonvilles d’une zone à une autre. Dans La question du logement, Engels montre comment cela se passe dans la région de Manchester. A notre époque, marquée par la spirale de décadence du système capitaliste à un niveau mondial, le déplacement s’est de façon évidente produit des pays capitalistes “avancés” vers les immenses bidonvilles qui entourent tant de grandes cités de ce que l’on appelle le “Tiers-Monde”.
Le communisme et le logement de l’humanité
C’est pourquoi, en rejetant l’utopie proudhonienne (ultérieurement actualisée par le projet de Thatcher que chacun construise son propre logement social, ce qui a considérablement exacerbé le problème du logement) où chaque ouvrier possède sa propre petite maison, Engels insistait :
“Et aussi longtemps que subsistera le mode de production capitaliste, ce sera folie de vouloir résoudre isolément la question du logement ou toute autre question sociale concernant le sort de l’ouvrier. La solution réside dans l’abolition de ce mode de production, dans l’appropriation par la classe ouvrière elle-même de tous les moyens de production et d’existence” 2.
La révolution prolétarienne en Russie en 1917 a donné un aperçu de ce que, à son stade initial, cette “appropriation” pourrait signifier ; palais et manoirs des riches ont été expropriés pour y loger les familles les plus pauvres. Dans le Londres actuel, à côté des palais et manoirs qui existent, la vertigineuse augmentation des constructions spéculatives lors des dernières décennies nous laisse un énorme lot de tours de prestige, dont une partie n’est habitée que par quelques riches résidents, une autre n’est occupée que par toutes sortes d’activités commerciales parasitaires, et la plus grande partie reste tout simplement invendue et inutilisée. Mais leurs systèmes anti-incendie sont certainement bien meilleurs que ceux de Grenfell. Ce type d’immeubles est l’argument principal pour faire de l’expropriation une solution immédiate au scandale des sans-logis et des logements sous-équipés.
Mais Engels, comme Marx, penchait pour un programme bien plus radical que simplement s’emparer des logements existants. A nouveau, en rejetant les fantaisies proudhoniennes de retour à l’industrie artisanale, Engels pointait le rôle progressiste joué par les grandes cités qui rassemblent des masses de prolétaires capables d’agir ensemble et ainsi de défier l’ordre capitaliste. Et, à nouveau, il insistait sur l’idée que le futur communiste en finirait avec la brutale séparation entre villes et campagnes et que cela signifierait le démantèlement des grandes cités – un projet d’autant plus grandiose à l’époque actuelle que les méga-cités boursouflées d’aujourd’hui font ressembler les grandes villes que connaissait Engels à de paisibles bourgades.
“On avoue donc que la solution bourgeoise de la question du logement a fait faillite : elle s’est heurtée à l’opposition entre la ville et la campagne. Et nous voici arrivés au cœur même de la question ; elle ne pourra être résolue que si la société est assez profondément transformée pour qu’elle puisse s’attaquer à la suppression de cette opposition, poussée à l’extrême dans la société capitaliste d’aujourd’hui. Bien éloignée de pouvoir supprimer cette opposition, elle la rend au contraire chaque jour plus aiguë. Les premiers socialistes utopiques modernes, Owen et Fourier, l’avaient déjà parfaitement reconnu. Dans leurs constructions modèles, l’opposition entre la ville et la campagne n’existe plus. Il se produit donc le contraire de ce qu’affirme M. Sax : ce n’est pas la solution de la question du logement qui résout du même coup la question sociale, mais bien la solution de la question sociale, c’est-à-dire l’abolition du mode de production capitaliste, qui rendra possible celle de la question du logement. Vouloir résoudre cette dernière avec le maintien des grandes villes modernes est une absurdité. Ces grandes villes modernes ne seront supprimées que par l’abolition du mode de production capitaliste et quand ce processus sera en train, il s’agira alors de tout autre chose que de procurer à chaque travailleur une maisonnette qui lui appartienne en propre” 3.
Dans la lignée de cette tradition radicale, le communiste de Gauche italien Amadeo Bordiga a écrit un texte en réponse à l’engouement de l’après Seconde Guerre pour les grands ensembles et les gratte-ciels, une mode revenue en force ces dernières années malgré une série de désastres et malgré l’évidence que vivre dans un grand ensemble exacerbe l’atomisation de la vie urbaine et génère toutes sortes de difficultés sociales et psychologiques. Pour Bordiga, les grands ensembles sont un symbole puissant de la tendance du capitalisme à entasser le plus possible d’êtres humains dans un espace aussi limité que possible, et il n’a pas de mots assez durs pour les architectes “brutalistes” qui en chantaient les louanges 4. “Verticalisme, tel est le nom de cette doctrine difforme ; le capitalisme est verticaliste”.
Le communisme, au contraire, serait horizontal. Plus loin, dans le même article, il explique ce qu’il veut dire par là :
“Quand, après avoir écrasé par la force cette dictature chaque jour plus obscène, il sera possible de subordonner chaque solution et chaque plan à l’amélioration des conditions du travail vivant, en façonnant dans ce but ce qui est du travail mort, le capital constant, l’infrastructure que l’espèce homme a donnée au cours des siècles et continue de donner à la croûte terrestre, alors le verticalisme brut des monstres de ciment sera ridiculisé et supprimé, et dans les immenses étendues d’espace horizontal, les villes géantes une fois dégonflées, la force et l’intelligence de l’animal-homme tendront progressivement à rendre uniformes sur les terres habitables la densité de la vie et celle du travail ; et ces forces seront désormais en harmonie, et non plus farouchement ennemies comme dans la civilisation difforme d’aujourd’hui, où elles ne sont réunies que par le spectre de la servitude et de la faim.”
Amos, 18 juin
1 Dans la vision capitaliste d’État de Corbyn, la réquisition de bâtiments n’est pas le résultat d’une auto-initiative de la classe ouvrière, mais une mesure légale prise par l’État, la même chose que réquisitionner des bâtiments en temps de guerre.
2 La question du logement [56].
3 Idem.
4 Amadeo Bordiga était architecte de formation.
Géographique:
- Grande-Bretagne [41]
Récent et en cours:
- Question du logement [57]
Rubrique:
Attentat à Manchester : le terrorisme montre la putréfaction du capitalisme
- 780 lectures
L’attentat à la bombe contre un concert d’Adriana Grande au Manchester Arena, avec un dispositif rempli d’écrous et de boulons devait tuer ou blesser un grand nombre de jeunes. L’État islamique, dans une déclaration, se vante de ce qu’ “un soldat du califat a été capable de déposer un engin explosif au milieu d’un rassemblement d’Infidèles”, car il a revendiqué “la légitimité de terroriser” les descendants des Croisés dans “une salle de concert indécent”, comme une vengeance contre “leurs violations (par les Infidèles) des terres de l’Islam”.
Ces “Croisés” étaient généralement des jeunes de 14 ou 16 ans. Une des victimes était une petite fille de 8 ans. A l’heure actuelle, il y a 22 morts (parmi lesquels dix avaient moins de 20 ans) et 116 blessés.
De même que la tuerie de masse de novembre 2015 au théâtre du Bataclan à Paris (où 89 personnes ont été tuées), cet attentat visait délibérément des jeunes gens et même des enfants à Manchester. Aujourd’hui, il est de plus en plus évident que ce ne sont pas seulement les adultes mais aussi les enfants qui sont pris dans l’engrenage des conflits impérialistes et pas seulement en Syrie, en Libye, au Yémen, mais aussi à Manchester, Londres, Paris et Nice. Les révolutionnaires condamnent sans équivoque ces actes de terreur, qu’ils soient perpétrés par les plus grandes forces militaires dans le monde ou qu’ils soient le fait d’un conducteur de camion isolé ou d’un kamikaze.
De plus, nous pouvons nous attendre à toujours plus d’expressions du terrorisme en Europe, dans la mesure où des forces militaires (comme Daech), confrontées à des revers militaires en Syrie, déclenchent de nouvelles attaques. Cela fait partie de la logique de l’impérialisme aujourd’hui, dans laquelle terreur et terrorisme font partie intégrante de l’arsenal impérialiste.
Bien que le service de sécurité du M15 ait dit qu’il allait revoir ses procédures, parce que le terroriste de Manchester était dans leur collimateur, l’attentat de Manchester a donné l’opportunité à l’État de durcir le niveau de sécurité et d’ajouter des troupes armées dans les rues aux côtés d’une police renforcée. Les politiciens, qui étaient en pleine campagne électorale générale, se sont unis pour déclarer leurs intentions de “protéger” le peuple britannique, de défendre les “valeurs démocratiques” et ont affirmé qu’ils ne céderaient jamais au terrorisme. Les Tories ont insinué que Jeremy Corbyn, le dirigeant travailliste, n’avait pas été intransigeant sur les questions de sécurité et de terrorisme. Corbyn a riposté en critiquant les Tories sur la suppression de 37 000 postes dans la police et les services de sécurité. Il a affirmé qu’il dépenserait des millions de livres pour développer les services de sécurité et embaucher davantage de policiers et de garde-frontière, montrant par là sa continuité avec les dirigeants du Labour depuis plus de cent ans de militarisme et de répression d’État.
L’hypocrisie de la bourgeoisie internationale
A travers le monde entier, des figures importantes, de Trump à Poutine, ont ajouté leur voix au concert anti-terroriste. Ils ont tous condamné le fait de tuer des enfants comme une expression de la barbarie. L’hypocrisie de ces gangsters impérialistes ne connaît pas de limites. Combien d’enfants ont été tués lors de l’invasion de l’Irak en 2003 ? Une campagne basée sur l’utilisation d’une puissance démesurée et la mise en scène de cette force ont tué un nombre incalculable de personnes, à tel point que les États-Unis et la Grande-Bretagne n’avaient aucun intérêt à les dénombrer. Là, les États-Unis et leurs alliés pouvaient semer la terreur avec des bombes mortelles beaucoup plus sophistiquées que l’arsenal d’un kamikaze solitaire.
Aujourd’hui, de vastes zones ont été détruites par la guerre impérialiste dans des endroits tels que la Syrie, où les protégés des pouvoirs impérialistes, incluant les États-Unis, la Russie, l’Iran, la Turquie et l’Arabie Saoudite parmi d’autres, ne manifestent aucun remord dans le fait de tuer et de mutiler des milliers de personnes, que ce soit à l’appui de la Syrie d’Assad ou dans les multiples milices des nombreuses oppositions.
Nous ne devons pas oublier l’hypocrisie de l’État britannique, après son intervention militaire en Libye, aux côtés de la France, qui a laissé le pays dans un état de chaos et de guerre civile – la famille du kamikaze de Manchester est originaire de Libye. Il semble que son père ait travaillé d’abord dans l’appareil de sécurité de Kadhafi et plus tard, dans une filiale d’Al-Qaïda – ce dernier a à la fois usé l’Intelligence britannique et a été abusé par elle.
Pour donner un autre exemple de l’hypocrisie de nos dirigeants, il suffit de regarder les dernières ventes d’armes par les États-Unis à l’Arabie Saoudite (110 milliards de dollars livrables immédiatement et 350 milliards dans les dix ans). Ce contrat a été annulé par Trump au moment où le bombardement saoudien des rebelles houthis au Yémen continuait et visait particulièrement les hôpitaux et utilisait des bombes à fragmentation contre les civils.
Comment comprendre ce qui est en train de se passer
Comme partout ailleurs face aux attaques ou aux désastres, l’humanité des résidents de Manchester a brillé dans le noir de l’attentat. Les hôtels ont ouvert leurs portes aux victimes, les chauffeurs de taxi ont assuré des transports gratuits, les hôpitaux ont levé les restrictions d’accueil, les gens ont ouvert leurs maisons, offert des tasse de thé et de café, les passants se sont arrêtés pour aider. Cependant, dans les conversations, dans les entrevues télévisées, il y avait beaucoup de confusion sur où va la société. Est-ce que cela va toujours être comme cela ? Peut-on trouver une solution ? Les slogans “Manchester ne perdra pas” ou “le terrorisme ne parviendra jamais à nous diviser” ne sont pas des réponses satisfaisantes.
La guerre et le terrorisme existent partout dans le monde. Mais le rôle des grandes nations capitalistes dans cette barbarie est bien souvent occulté. La période de “paix” qui a suivi la Seconde Guerre mondiale était en réalité une période de guerres locales entretenues en sous-main par les blocs impérialismes de l’Ouest et de l’Est qui défendaient leurs positions par procuration. Pourtant, l’équilibre des forces entre les deux blocs a créé une certaine stabilité dans les relations internationales pendant la Guerre Froide, avec la règle de l’assistance mutuelle de destruction. Avec la fin du Bloc de l’Est en 1989, le monde s’est retrouvé sens dessus-dessous. La stabilité relative qui avait accompagné l’existence des deux blocs s’est trouvée désintégrée et on a commencé à voir la multiplication de crises et de guerres de plus en plus porteuses de chaos. Cette période est la période de décomposition du système capitaliste. La “guerre contre le terrorisme” actuelle et la prolifération des groupes terroristes trouvent leurs racines dans le conflit meurtrier entre les impérialismes américain et russe en Afghanistan. Après l’invasion russe en décembre 1979, les Américains et leurs alliés ont envoyé et soutenu les moudjahidines, en tant que combattants délégués. Les talibans et Al-Qaïda se sont développés au sein des moudjahidines. Ainsi, les groupes terroristes actuels ne constituent pas un quelconque bizarre anachronisme du passé, même s’ils se revendiquent du fondamentalisme religieux, mais ils sont une partie intrinsèque du capitalisme actuel et des conflits impérialistes porteurs de chaos. Un nouveau pas a été franchi après le 11 septembre 2001 : l’invasion d’abord de l’Afghanistan puis de l’Irak a entraîné la déstabilisation de pans entiers du globe, en particulier au Moyen-Orient et a favorisé l’émergence de forces telles que l’auto-proclamé “État islamique”. Les groupes terroristes ont proliféré, créés par la guerre, maintenus en vie par des alliances sordides et la manipulation des grandes puissances. Toutes ces guerres ont mis sur les routes des vagues de réfugiés fuyant les zones de conflits et risquant leur vie pour gagner des endroits relativement protégés en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays riches. A ces réfugiés, se sont ajoutés ceux qui fuyaient la répression consécutive à l’échec du “Printemps arabe” ou la guerre en Syrie ; des réfugiés économiques ont également été jetés sur les routes. Ces personnes, victimes du capitalisme, sont utilisées par les politiciens comme boucs émissaires des exactions des groupes terroristes, qui les rendent également responsables de la chute du niveau de vie depuis les dix dernières années. En réalité, celui-ci est dû à la crise économique de 2007-2008, qui a vu une énorme instabilité du monde économique avec des effondrements boursiers et des faillites bancaires. Cette crise a ruiné des millions d’épargnants et a sapé la confiance dans l’argent (qui, sous le capitalisme, assure la cohésion du tissu social). Cela a généré une crainte et une méfiance énormes entre les gens ainsi qu’une peur de l’avenir. “Face à cette barbarie, dans une zone géographique étendue, du Mali à l’Afghanistan, en passant par la Somalie et jusqu’à la pointe sud de la Turquie, des millions d’êtres humains, mois après mois, ont été forcés de fuir pour seulement rester en vie. Ils sont devenus des “ réfugiés”, qui sont, soit parqués dans des camps, soit raccompagnés à la frontière. Ils arrivent au moment où la crise économique s’aggrave, et au moment où les actes terroristes s’intensifient, ce qui exacerbe fortement la xénophobie. Et, par-dessus tout, alors que le capitalisme s’enfonce dans la décomposition et la désintégration des liens sociaux, la classe ouvrière est incapable d’offrir à l’humanité une autre perspective. Incapable de développer sa conscience et son esprit combatif, son sens de la solidarité internationale et de la fraternité, elle est absente pour l’instant, comme classe, de la situation mondiale” 1. Le danger de cette putréfaction ne doit pas être sous-estimé : si on laisse le capitalisme continuer sur sa lancée, il entraînera l’humanité tout entière dans la destruction. La seule réponse possible est le développement des luttes de la classe ouvrière, et avec elles, de la solidarité qui est une part importante de ces luttes. Cela commence avec le questionnement de la société telle qu’elle est actuellement aussi bien qu’avec la lutte pour nous défendre contre le capitalisme et son État, et non avec des doléances auprès de l’État pour lui demander de bien vouloir nous défendre contre les effets les plus néfastes de la décomposition du capitalisme.
Mx, 29 mai
1 Lire sur le site internet du CCI : “Attentats en France, Allemagne, États-Unis... Le capitalisme porte en lui la terreur comme la nuée porte l’orage [7]” (août 2016), Révolution internationale n° 460.
Géographique:
- Grande-Bretagne [41]
Récent et en cours:
- Terrorisme [9]
Rubrique:
Histoire du Parti socialiste en France – 1878-1920 (Partie I)
- 2452 lectures
En mai 1981, lors de son investiture, François Mitterrand rendait un hommage hypocrite et mensonger à Jean Jaurès, suggérant par-là une filiation du Parti socialiste (PS), qui nous gouverne et nous exploite depuis plusieurs décennies, avec la Deuxième Internationale de l’époque, et spécialement sa “section française”, la SFIO1, dans laquelle ont combattu d’authentiques militants ouvriers de la trempe des Jean Jaurès, Jules Guesde, Paul Lafargue ou l’ancien communard Édouard Vaillant. Aujourd’hui encore, les Hollande, Valls, Royal, Hamon et consorts, tous ces politiciens bourgeois cyniques et hypocrites, se réclament de cet héritage socialiste.
La série que nous débutons avec ce premier article a pour objectif de mieux faire connaître les origines souvent ignorées de ce parti initialement prolétarien afin de mieux mettre en évidence le processus qui le mena ensuite à la trahison et à devenir même un rouage incontournable de l’appareil d’État français. Nous retracerons les grandes étapes de cette évolution, depuis l’élaboration du programme d’inspiration marxiste du POF2 entre 1879 et 1882, la constitution d’un parti socialiste unifié en 1905 et la scission au congrès de Tours en 1920, qui clôtura l’histoire de la SFIO en tant que parti de la classe ouvrière, en passant évidemment par la trahison du principe fondamental de l’internationalisme prolétarien en 1914 avec le vote des crédits de guerre.
Afin de comprendre les étapes de la construction du parti socialiste en France, processus long, chaotique et laborieux, il est nécessaire de revenir sur les conditions très particulières qui ont fortement marqué sa naissance.
Forces et faiblesses dans la constitution d’un parti prolétarien en France : le poids d’un double héritage
La construction d’un parti socialiste unifié en France ne s’est en effet réalisé qu’en mai 19053 et portait alors le poids du lourd héritage de la révolution bourgeoise de 1789 et les effets de l’écrasement de la Commune de Paris en mai 1871. Ce double héritage a pesé négativement sur les épaules du prolétariat et du mouvement ouvrier en France, notamment sur son avant-garde révolutionnaire : il a non seulement affecté la conscience ouvrière et généré des confusions théoriques importantes, mais il a également produit des faiblesses et des fragilités récurrentes que le mouvement ouvrier n’a jamais pu totalement surmonter dans ce pays.
Pourtant, à travers trois événements majeurs qui devaient rayonner sur le mouvement ouvrier international (les révolutions de 1789 et 1793, les journées de juin 1848 et la Commune de 1871) s’était forgé en moins d’un siècle un élément exceptionnel et unique de force et d’assurance, une expérience insurrectionnelle et une tradition combative hors pair.
Les déformations héritées de 1789 et de la Révolution bourgeoise triomphante
Les faiblesses et déformations politiques du mouvement ouvrier en France étaient fortement liées aux aléas de l’histoire de la nation française, particulièrement à une tendance de la plupart des anarchistes, mais aussi parmi de très nombreux socialistes français, à se considérer comme les héritiers de la révolution bourgeoise de 1789. Les références à l’expérience française de 1789, aux armées révolutionnaires de 1792 et à la lutte du “peuple français” contre “l’envahisseur allemand” réactionnaire étaient permanentes dans la défense de leur point de vue révolutionnaire. Cette démarche tintée de jacobinisme introduisait en fait une vision nationale de la révolution en opposition avec la nature et le principe essentiel de l’internationalisme prolétarien.
Cette identification révolutionnaire à la révolution bourgeoise venait du fait que le “petit peuple” (les sans-culottes) avait amplement pris part à la lame de fond révolutionnaire de 1789-1793 contre la morgue et l’arrogance de la monarchie et de l’aristocratie. Ces manifestations insurrectionnelles ont largement occulté l’antagonisme de classe entre bourgeoisie et prolétariat, masquant la confiscation totale du pouvoir par la bourgeoisie. Les pionniers du mouvement socialiste en France allaient ainsi la négliger, voire perdre totalement de vue cette notion d’intérêts distincts, et devenus irréconciliables, avec ceux de la bourgeoisie.
Plusieurs facteurs contenus dans la référence à la révolution de 1789-1793 intervenaient pour expliquer un tel oubli :
- Le poids de la vision d’une bourgeoisie progressiste et éclairée, une vision intellectuelle théorisée par les philosophes des Lumières et marquée par les illusions d’une possible alliance avec cette dernière contre le retour de la monarchie et du bonapartisme ;
- Le rayonnement et l’aura de la révolution de 1789-1793 sur le mouvement ouvrier en général et en France en particulier. Cette fierté se cristallisera sous la forme d’une conception jacobine de la révolution qui va de pair avec un poids du nationalisme, du patriotisme et du républicanisme, avec la vision que la monarchie s’appuie sur les régimes réactionnaires des autres pays et complote son retour au pouvoir avec l’aide de l’étranger.
C’est en réalité d’abord et avant tout le grand soulèvement de juin 1848 à Paris qui permit de vérifier la réalité du prolétariat tel qu’il est défini dans le Manifeste du Parti communiste : une force politique indépendante irrévocablement opposée à la domination du capital. On est saisi par le contraste de la méthode de Marx et Engels qui furent en mesure de tirer les leçons fondamentales des précieuses expériences de juin 1848 et de la Commune de 1871 pour aider la social-démocratie allemande à former un parti socialiste et une nouvelle Internationale sur des bases politiques solides, tandis que les socialistes français s’exaltaient et s’enivraient avec orgueil de leur passé national, s’embourbant dans le patriotisme et faisant ainsi le lit de leur futur social-chauvinisme.
La méthode critique de Marx lui fit ainsi tirer de toutes autres leçons des événements de 1871. Car si la Commune a pu reprendre à son propre compte les principes de la révolution bourgeoise de 1789, ce n’est certainement pas pour leur donner le même contenu. Ainsi, loin d’avoir été un mouvement pour la défense de la patrie contre l’ennemi extérieur, c’est bien pour se défendre contre l’ennemi intérieur, contre “sa” propre bourgeoisie représentée par le gouvernement de Versailles, que le prolétariat parisien refusa de remettre les armes à ses exploiteurs et instaura la Commune. Pour les ouvriers de la Commune, “Liberté, Égalité, Fraternité” signifiait l’abolition de l’esclavage salarié, de l’exploitation de l’homme par l’homme, de la société divisée en classes. Cette perspective d’un autre monde qu’annonçait déjà la Commune, on la retrouve justement dans le mode d’organisation de la vie sociale que la classe ouvrière a été capable d’instaurer pendant deux mois. Car ce sont bien les mesures économiques et politiques impulsées par le prolétariat parisien qui confèrent à ce mouvement sa véritable nature de classe, et non les mots d’ordre du passé dont il se réclamait.4
Mais la leçon essentielle de la Commune de Paris tirée par Marx dans La Guerre civile en France est celle-ci : “la classe ouvrière ne peut se contenter de prendre telle quelle la machine d’État et la faire fonctionner pour son propre compte. Car l’instrument politique de son asservissement ne peut servir d’instrument politique de son émancipation”. Et dans Les Luttes de classes en France, écrit en 1850, on trouvait déjà : “la nouvelle révolution française sera obligée de quitter aussitôt le terrain national et de conquérir le terrain européen, le seul où pourra l’emporter la révolution sociale”.
Les courants socialistes français, même les plus radicaux qui se réclamaient pourtant du marxisme, ignoraient au contraire ces leçons rapidement oubliées ou mal assimilées. Le 23 janvier 1893, Guesde et Lafargue, au nom du POF, lançaient ainsi un appel “aux travailleurs de France”, formule qui résume déjà le degré de confusion qu’ils semaient au sein du prolétariat : “On ne cesse pas d’être patriote en entrant dans la voie internationale qui s’impose au complet épanouissement de l’humanité, pas plus qu’on ne cessait à la fin du siècle dernier d’être Provençal, Bourguignon, Flamand ou Breton, en devenant Français. Les internationalistes peuvent se dire, au contraire, les seuls patriotes parce qu’ils sont les seuls à se rendre compte des conditions agrandies dans lesquelles peuvent et doivent être assurés l’avenir et la grandeur de la patrie, de toutes les patries, d’antagoniques devenus solidaires. (…) Les socialistes français sont encore patriotes à un autre point de vue et pour d’autres raisons : parce que la France a été dans le passé et est destinée à être dès maintenant un des facteurs les plus importants de l’évolution sociale de notre espèce. Nous voulons donc – et ne pouvons pas ne pas vouloir – une France grande et forte, capable de défendre sa République contre les monarchies coalisées et capable de protéger son prochain “89 ouvrier” contre une coalition, au moins éventuelle, de l’Europe capitaliste”. Cette rhétorique non seulement masque et dénature le caractère bourgeois du nationalisme et du patriotisme mais elle véhicule dans sa confusion extrême un poison mortel qui aura des conséquences tragiques : la trahison de l’internationalisme prolétarien par les socialistes dans la guerre de 1914 ! On mesure l’ampleur du fossé que même les plus déterminés des socialistes français ont creusé avec l’internationalisme prolétarien et avec le principe fondamental du marxisme : “les ouvriers n’ont pas de patrie”. On retrouve la même confusion et cette ambiguïté fondamentale dans le texte de Lafargue de 1906 censé dénoncer le “patriotisme de la bourgeoisie” qui au lieu de proclamer que “les patriotes sont les ennemis des ouvriers” entreprend de démontrer qu’ils sont en même temps “les alliés des ennemis de la France”…
La confusion, la perte de vue et même l’oubli des leçons fondamentales par les socialistes français traduisaient une incompréhension fondamentale du marxisme, en particulier dans le POF, aile révolutionnaire pourtant la plus avancée du socialisme français, qui s’en revendiquait ouvertement.5
La sous-estimation des conséquences de l’écrasement de la Commune
Le prolétariat français, comme classe révolutionnaire, fut littéralement décapité par l’écrasement de la Commune de Paris et pareille épreuve ne pouvait que lui laisser une empreinte indélébile. Après les événements de la Commune de Paris, une terrible répression s’abattit sur les mouvements socialistes. Il y eu entre 20 000 et 30 000 morts, plus de 38 500 fugitifs ou exilés et autant d’arrestations. Puis vinrent les arrestations en masse, les exécutions de prisonniers pour l’exemple, les déportations au bagne et les placements de plusieurs centaines d’enfants dans des maisons de correction. Parmi les personnes arrêtées, 78 % étaient des ouvriers, 84 % d’entre-deux furent déportés dans les plus lointaines contrées de l’empire colonial français.
Or, le poids de l’écrasement, de la répression et de l’ampleur de la défaite du prolétariat fut complètement sous-estimé. Avec l’écrasement de la Commune, qui a conduit à la disparition de la Première Internationale après 1872, la bourgeoisie est parvenue à infliger une défaite aux ouvriers du monde entier. Et cette défaite fut particulièrement cuisante pour la classe ouvrière en France, puisqu’elle cessa dès-lors d’être aux avant-postes de la lutte du prolétariat mondial.
Dès 1872, seul l’immédiatisme et l’activisme stérile se manifestèrent. Les ouvriers se réorganisèrent aussitôt en chambre syndicale. Le 28 mai 1872, Jean Barberet, un ouvrier bijoutier devenu journaliste, proche du leader républicain Gambetta, créa le Cercle de l’Union syndicale ouvrière, à partir du regroupement de 23 associations ouvrières. Finalement, le Cercle fut dissous par la police le 22 octobre de la même année, et Barberet emboîta le pas de la politique républicaine de Gambetta l’année suivante en prônant un socialisme républicain et réformiste. En octobre 1876, c’est encore sous l’influence de Barberet que se tint à Paris le premier Congrès ouvrier de France, marqué par l’esprit du mouvement des coopératives et du mutualisme proudhonien. À Londres, les exilés, notamment les amis de Blanqui, s’organisèrent également. Jules Guesde, journaliste condamné pour avoir défendu la Commune, pris néanmoins une orientation nettement plus influencée par le marxisme que les autres partis.
Aux lendemains de la défaite, l’éparpillement et les influences diverses dans le mouvement ouvrier, en grande partie masquées et surmontées par le soulèvement et la constitution de la Commune, se révélèrent au grand jour malgré les efforts pour construire une unité organisationnelle par l’éclatement et les divisions des différents courants socialistes.
La dispersion et la disparité des courants
Une structure socialiste unitaire fut pourtant créée en 1878 sous l’impulsion de Guesde et du courant marxiste : la Fédération du parti des travailleurs socialistes de France (FPTSF). Mais les congrès de 1880 et 1881 virent s’affirmer la désunion des socialistes. À partir de 1882, ils créèrent plusieurs partis.
Les Guesdistes étaient alors de loin le courant le plus déterminé et le plus solide. La FPTSF, formée en parti au Congrès de Lyon en 1878, décida l’année suivante, au congrès de Marseille, d’élaborer un “programme électoral minimum” qui fut en fait dicté par Marx à Guesde. Cette influence marqua notamment ses considérants qui stipulent que ce programme passe par la “propriété collective et ne peut sortir que de l’action révolutionnaire de la classe productive (ou prolétariat) organisée en parti politique distinct”. Ce programme fut confirmé en congrès national au Havre en 1880. Guesde, Lafargue et Deville, furent les principaux animateurs de ce parti qui devint le Parti ouvrier en 1882 puis le Parti ouvrier français en 1893. Le parti se battit non seulement pour des réformes mais aussi pour la conquête du pouvoir politique par les prolétaires. Cette organisation directement inspirée par le marxisme devient d’ailleurs la fraction socialiste la plus nombreuse en France. De 2000 membres du POF en 1889, ce chiffre bondit à 20 000 en 1902, avant de régresser les années suivantes face aux succès du courant réformiste. Dans les années qui suivirent 1880, près du tiers des 200 syndicats corporatistes parisiens adhérèrent au Parti ouvrier. En 1890, le congrès de Lille fit un devoir de chaque militant d’entrer dans la Chambre syndicale de sa corporation.
Cependant, l’existence de ce courant marxiste, lui-même affecté de faiblesses et de confusions politiques, a été contrecarrée par plusieurs scissions dues notamment à de sérieuses influences politiques néfastes. Ainsi, les Possibilistes de Paul Brousse qui fondèrent en 1882 la Fédération des travailleurs socialistes de France (FTSF) subissaient l’influence réformiste du mutualisme fédéraliste et anarchisant proudhonien. Ils affirmaient la nécessité de “fractionner le but idéal socialiste en plusieurs étapes sérieuses, immédiatiser en quelque sorte quelques-unes des revendications pour les rendre enfin possibles”. Leur programme fit une place importante à la conquête des institutions, particulièrement des municipalités et à une alliance avec le parti républicain radical bourgeois. Les Allemanistes de Jean Allemane qui formèrent en 1890 le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR) s’inspiraient dans leur vision fédéraliste d’un syndicalisme autogestionnaire et d’un réformisme municipal. Quant au Comité révolutionnaire central d’Édouard Vaillant (CRC) créé en 1881 qui devient en 1889 le Parti socialiste révolutionnaire (PSR), il mit en avant la vision blanquiste selon laquelle une petite minorité conspirative bien organisée pourrait effectuer des actions révolutionnaires pour entraîner à sa suite la masse du peuple.
Mais ce furent les illusions réformistes et parlementaristes qui constituèrent le plus lourd handicap du socialisme en France. Elles furent la base du programme des socialistes indépendants comme Jaurès et Millerand qui, au nom de la solidarité républicaine, prônaient une politique d’alliance et de compromis avec la bourgeoisie radicale. Ce courant a pris une influence croissante jusqu’à créer en 1898 la Confédération des Socialistes indépendants, qui fusionna en 1902 avec la FTSF de Brousse pour créer le Parti socialiste français.
Réformisme, anarchisme et populisme
Lors du banquet de Saint-Mandé, le 30 mai 1896, Millerand fit un discours qui servit de charte à toutes les tendances réformistes, appelant à l’unité de tous les socialistes autour des trois points suivants :
- substitution progressive de la propriété capitaliste par la propriété sociale ;
- conquête des pouvoirs publics par le suffrage universel ;
- nécessité de ne pas sacrifier la patrie à l’internationalisme.
Ce type de faiblesses et d’abandon des principes prolétariens étaient également à l’œuvre dans la plupart des pays occidentaux les plus développés où se développaient ouvertement le réformisme et le parlementarisme sur la base de la prospérité économique du capitalisme d’alors et du développement du suffrage universel. En Allemagne, par exemple, Bernstein propageait un révisionnisme qui considérait qu’il ne s’agissait plus de renverser le capitalisme par une révolution internationale mais de conquérir graduellement et pacifiquement le pouvoir, y compris au moyen d’alliances avec les partis progressistes de la bourgeoisie. En France, l’ensemble des courants ouvriers furent également marqués par une tendance plus ou moins forte au réformisme. Après quelques succès électoraux aux municipales de 1892 et aux législatives de 1893, plusieurs membres du POF, oubliant leur programme et l’objectif révolutionnaire, finirent même par prôner le réformisme, affirmant que le socialisme pouvaient être atteint par la voie électorale. Au poids du réformisme s’ajoutaient en outre les influences de la tradition artisanale et corporatiste portées par les déformations proudhoniennes et par la fédération jurassienne de Bakounine, traduisant le poids de l’anarchisme en général, mais aussi le poids du populisme boulangiste qui sévit dans le mouvement ouvrier en France, en particulier au sein du blanquisme. En 1889, les deux-tiers des députés boulangistes venaient de la gauche et de l’extrême gauche.
Paul Lafargue écrivit à ce titre : “La crise boulangiste a ruiné le parti radical ; les ouvriers, lassés d’attendre les réformes qui s’éloignaient à mesure que les radicaux arrivaient au pouvoir, dégoûtés de leurs chefs qui ne prenaient les ministères que pour faire pire que les opportunistes, se débandèrent ; les uns passèrent au boulangisme, c’était le grand nombre, ce furent eux qui constituèrent sa force et son danger : les autres s’enrôlèrent dans le socialisme”.
Toutes ces faiblesses expliquent en grande partie les difficultés de constitution d’un parti socialiste unitaire ainsi que ses tares idéologiques congénitales :
- une sous-estimation, voire un mépris pour les luttes économiques. Guesde impose au sein du POF une politique purement opportuniste envers les syndicats qu’il étouffe en subordonnant totalement ceux-ci aux visées électorales et parlementaires du parti et en les réduisant à une masse de manœuvre utilitaire, en particulier dans la CGT, ce qui eut un effet repoussoir en faveur du syndicalisme révolutionnaire, alimenta leur hostilité envers le parti et les poussa dans de nombreux cas dans les bras de l’anarchisme ;
- de nombreuses et fortes confusions sur l’action politique qui favoriseront l’entretien des divisions, handicaperont lourdement les tentatives d’unification du parti et l’armeront mal face à l’infiltration de l’idéologie bourgeoise et la collaboration de classe ;
- la faiblesse relative de l’implantation du marxisme dans le mouvement ouvrier en France, la mauvaise assimilation, les déformations sous une forme vulgarisée et simplifiée par Guesde, Lafargue ou Deville, présentés comme des théoriciens du marxisme. C’est dans une lettre à Lafargue que Marx décocha sa boutade à l’encontre des socialistes français “moi, je ne suis pas marxiste” et Engels lui-même s’opposa à la traduction en allemand des brochures de Deville : Le résumé du Capital, ou Aperçu sur le socialisme scientifique qu’il voyait comme une catastrophe, dont les erreurs et le simplisme vulgarisateur sèmeraient la confusion et le ridicule. Ainsi, Guesde professait comme marxiste l’absurde thèse lassalienne sur “la loi d’airain des salaires”, fermement combattue par Marx et qui consiste à dire que du fait de la concurrence entre ouvriers pour vendre leur force de travail, les salaires ne feront que diminuer et qu’ils devront avec leur famille toujours se contenter du minimum vital sans aucune considération de l’existence de la lutte de classes.
La popularité du blanquisme et de ses “combattants héroïques de la Commune” véhicula une grande confusion dans les moyens de la lutte et imprégna l’organisation révolutionnaire d’un état d’esprit conspiratif et putschiste. Engels, dans un article paru dans Der Volksstaat, le 26 juin 1874, se livra à une critique impitoyable mais profondément juste d’un Programme des Communeux marqué par l’immédiatisme, l’esprit de conspiration, plein de déclarations grandiloquentes et creuses, écrit peu de temps avant et signé à Londres par 33 blanquistes émigrés (dont Vaillant et Eudes).
Malgré tous ses défauts, le POF de Guesde, Lafargue et Deville a joué un rôle déterminant dans la naissance et l’impulsion d’une organisation d’inspiration marxiste en France qui fut la colonne vertébrale de l’introduction et de l’implantation du socialisme.
De même, le fait qu’Édouard Vaillant et ses amis blanquistes se soient ralliés au POF et à l’aile gauche du socialisme et ont lutté pour la constitution unitaire d’un parti socialiste démontre que le blanquisme fut capable d’évoluer ; la conversion de Jaurès lui-même au socialisme aurait été selon plusieurs sources le fruit d’une nuit de discussion avec Guesde à Toulouse le 27 mars 1892.
Nous reviendrons dans un deuxième article de manière plus détaillée sur la position des socialistes français face à deux épreuves qui vont conduire à l’échec les tentatives d’unification des courants socialistes : l’Affaire Dreyfus et le “cas Millerand”. Ces événements ont été l’occasion d’une confrontation entre deux grandes tendances, où chaque camp a montré des faiblesses idéologiques et politiques marquées par l’opportunisme mais aussi des éclairs de lucidité qui montrent qu’une dynamique du débat et une certaine clarification des idées et du programme socialiste fut possible. Nous verrons également comment le succès de l’unification du parti socialiste fut acquis grâce à l’aide déterminante du SPD allemand, de Rosa Luxemburg et de la IIe Internationale.
Wim, 10 mars 2017
1 Section française de l’internationale ouvrière.
2 Parti ouvrier français.
3 Une année charnière pour le mouvement ouvrier international marquée par une vague révolutionnaire en Russie.
4 Voir notre article "La Commune de Paris, premier assaut révolutionnaire du prolétariat [58]", Révolution internationale n° 423.
5 Malgré ses tares et ses confusions, le mouvement ouvrier et le courant socialiste en France représentait, comme le soulignait Marx, un des trois piliers du socialisme scientifique international. Sur la tombe de Lafargue en 1911, Lénine saluait d’ailleurs sa conviction révolutionnaire, sa fidélité au prolétariat et l’immense énergie qu’il avait déployée tout au long de sa vie. L’œuvre de Lafargue est encore très précieuse aujourd’hui pour les générations futures qui auront encore à puiser ou à redécouvrir la force et l’originalité de ses écrits, notamment son pamphlet, Le Droit à la paresse, qui s’élève vigoureusement contre l’idéologie du travail inculquée par la morale bourgeoise pour défendre ses conditions d’exploitation, dénonçant par avance un encensement qui sera repris et érigé en modèle plus tard par les partis staliniens
Géographique:
- France [15]
Conscience et organisation:
Rubrique:
Tensions impérialistes : le terrorisme conduit les ouvriers dans les bras de l’État
- 840 lectures
En septembre 1867, un groupe de Fenians (nationalistes irlandais), membres de l’Irish Republican Brotherhood (Fraternité républicaine irlandaise), fit sauter le mur de la prison de Clerkenwell à Londres pour tenter de libérer un autre membre de l’organisation. L’explosion, qui ne permit d’ailleurs pas de libérer le prisonnier, causa l’effondrement d’un pâté de maisons ouvrières à proximité, tuant 12 personnes et blessant plus d’une centaine de résidents.
A cette époque, Karl Marx et d’autres révolutionnaires soutenaient la cause de l’indépendance irlandaise, en particulier parce qu’ils la considéraient comme une condition préalable essentielle pour briser les liens entre la classe ouvrière en Grande-Bretagne et leur propre classe dirigeante, qui utilisait alors sa domination sur l’Irlande pour créer parmi les travailleurs anglais l’illusion d’être privilégiés, et ainsi les séparer de leurs frères et sœurs de classe irlandais.
Néanmoins, Marx a réagi avec colère à l’action des Fenians. Dans une lettre à Engels, il écrivait : “Le dernier exploit des Fenians à Clerkenwell est une affaire complètement stupide. Les masses londoniennes, qui ont fait preuve d’une grande sympathie à l’égard de la cause irlandaise, en seront furieuses, et cela les conduira directement dans les bras du parti au gouvernement. On ne peut pas attendre des prolétaires de Londres qu’ils acceptent de se faire exploser en l’honneur des émissaires des Fenians. Il y a toujours une sorte de fatalité à propos d’un tel secret, une sorte de conspiration mélodramatique” 1.
La colère de Marx était d’autant plus grande que, peu de temps avant l’explosion de Clerkenwell, de nombreux ouvriers anglais avaient participé à des manifestations en solidarité avec cinq Fenians exécutés par le gouvernement britannique en Irlande.
Dans cette courte citation de Marx, il y a un pertinent résumé de deux des principales raisons pour lesquelles les communistes ont toujours rejeté le terrorisme : le fait qu’il remplace l’action massive et auto-organisée de la classe ouvrière par des conspirations de petites prétendues élites ; et le fait que, par ailleurs, quelles que soient les intentions de ceux qui effectuent de tels actes, leur seul résultat est de remettre l’indépendance de la classe ouvrière entre les mains du gouvernement et de la classe dirigeante.
Le terrorisme hier et aujourd’hui
Beaucoup de choses ont changé depuis que Marx a écrit ces mots. Le soutien aux mouvements d’indépendance nationale, qui avait du sens à une époque où le capitalisme n’avait pas encore épuisé son rôle progressiste, s’est, à partir de la Première Guerre mondiale, inextricablement transformé en soutien d’un camp impérialiste contre un autre. Pour Marx, le terrorisme était une méthode erronée utilisée par un mouvement national qui méritait qu’on le soutienne. A notre époque, alors que seule la révolution prolétarienne peut offrir une voie à suivre pour l’humanité, les mouvements nationaux sont eux-mêmes devenus réactionnaires. Liées aux interminables conflits impérialistes qui affligent l’humanité, les tactiques terroristes reflètent de plus en plus le pourrissement brutal qui caractérise la guerre aujourd’hui. Alors que les groupes terroristes visaient jadis principalement des symboles et des figures de la classe dirigeante (à l’image du groupe russe Volonté du Peuple qui assassina le tsar Alexandre II en 1881), la plupart des terroristes d’aujourd’hui traduisent la logique des États qui mènent la guerre impérialiste en utilisant les attentats et les meurtres aveugles (tels que les bombardements aériens aveugles de populations entières), visant une population qui est accusée des crimes des gouvernements qui les dirigent.
Selon les pseudo-révolutionnaires de gauche d’aujourd’hui 2, derrière les slogans religieux des terroristes d’Al-Qaïda ou de l’EI, nous assisterions à la même vieille lutte contre l’oppression nationale que celle que les Fenians avaient engagée dans le passé, et les marxistes devraient soutenir aujourd’hui de tels mouvements, même s’ils doivent se distancier de leur idéologie religieuse et de leurs méthodes terroristes. Mais comme Lénine l’avait déclaré en réponse aux sociaux-démocrates qui ont utilisé les écrits de Marx pour justifier leur participation à la Première Guerre mondiale impérialiste : “Invoquer aujourd’hui l’attitude de Marx à l’égard des guerres de l’époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx : “Les ouvriers n’ont pas de patrie”, paroles qui se rapportent justement à l’époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l’époque de la révolution socialiste, c’est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois” 3. Les moyens meurtriers qu’utilisent des groupes comme l’EI et leurs sympathisants sont entièrement compatibles avec leurs objectifs ; lesquels ne consistent pas à renverser l’oppression, mais à substituer une forme d’oppression à une autre, et chercher à “gagner” à tout prix la bataille horrible qui oppose un ensemble de puissances impérialistes à un autre (comme l’Arabie Saoudite ou le Qatar, par exemple) qui les soutient. Et leur idéal “ultime” (le califat mondial) même s’il est aussi irréalisable que le “Reich de 1000 ans” d’Hitler, n’en est pas moins une entreprise impérialiste, exigeant des mesures bien éprouvées de rapines et de conquête.
Divisions réelles et fausse unité
Marx avait souligné que l’action des Fenians à Londres entraînerait une rupture entre le mouvement ouvrier en Grande-Bretagne et la lutte pour l’indépendance irlandaise. Cela créerait entre les travailleurs anglais et irlandais des divisions qui ne pouvaient que bénéficier à la classe dirigeante. Aujourd’hui, les terroristes islamistes ne cachent pas le fait que leur objectif est précisément de créer des divisions à travers les atrocités qu’ils pratiquent : la plupart des actions initiales de l’EI en Irak ont ciblé la population musulmane chiite, qu’il considère comme hérétique, dans le but de provoquer sectarisme et guerre civile. La même logique est à l’œuvre en ce qui concerne les attentats terroristes de Londres ou de Manchester : renforcer le fossé entre les musulmans et les non-croyants, les kâfirs (ceux qui rejettent l’islam) et donc hâter le déclenchement du djihad dans les pays centraux. C’est un témoignage supplémentaire que même le terrorisme peut dégénérer dans une société qui elle-même se décompose.
Outre l’extrême-droite ouvertement raciste, qui, comme les djihadistes, souhaite une sorte de “guerre raciale” dans les rues, la principale réaction des gouvernements et des politiciens aux attentats terroristes en Europe consiste à brandir le drapeau national et à proclamer que “les terroristes ne nous diviseront pas”. Ils parlent ainsi de solidarité et d’unité contre la haine et la division. Mais du point de vue de la classe ouvrière, il s’agit là d’une fausse solidarité, le même type de solidarité avec nos propres exploiteurs qui établissent un lien entre les travailleurs et les efforts de guerre patriotiques de l’État impérialiste. Et, en effet, de tels appels à “l’unité nationale” ne sont souvent qu’un prélude à la mobilisation pour la guerre, comme ce fut le cas après la destruction des Twin Towers à New-York en 2001, avec l’invasion américaine de l’Afghanistan et de l’Irak. C’est ce dont Marx avait parlé en évoquant les travailleurs poussés dans les bras du parti gouvernemental. Dans une atmosphère de peur et d’insécurité, lorsque l’on est confrontés à la perspective de massacres au hasard des rues, des bars ou des salles de concert, la réponse compréhensible de ceux qui sont menacés par de telles attaques est d’exiger la protection de l’État et de ses forces de police. Suite aux récentes atrocités à Manchester et à Londres, la question de la sécurité a été un enjeu majeur lors de la récente campagne électorale du Royaume-Uni, les Tories soupçonnant le travailliste Corbyn d’être trop laxiste face au terrorisme, et Corbyn accusant May de réduire le nombre de policiers.
Face aux terroristes d’un côté et à l’État capitaliste de l’autre, la position prolétarienne est de rejeter les deux, de se battre pour les intérêts de la classe ouvrière et ses exigences. La classe ouvrière a un besoin profond de s’organiser de manière indépendante, d’organiser sa défense contre la répression de l’État et les provocations terroristes. Mais compte-tenu de l’actuelle faiblesse de la classe ouvrière aujourd’hui, cette nécessité reste en perspective. Il existe une tendance chez de nombreux travailleurs à ne pas voir d’autre alternative que de rechercher la protection de l’État, alors qu’un autre petit nombre de prolétaires défavorisés peuvent être attirés vers l’idéologie putréfiée du djihadisme. Et ces deux tendances compromettent activement le potentiel de la classe ouvrière à prendre conscience d’elle-même et à s’auto-organiser. Ainsi, toute attaque terroriste et toute campagne de “solidarité” parrainée par l’État en réponse à celle-ci doivent être considérées comme des coups contre la conscience de classe et, finalement, comme des coups contre la promesse d’une société fondée sur une véritable solidarité humaine.
Amos, 12 juin 2017
1) Extrait de K. Marx et F. Engels, Ireland and the irish question (en anglais), Moscou, 1971, p. 150.
2) Voir par exemple : www.marxists.org/history/etol/writers/jenkins/2006/xx/terrorism.html [60], extrait du journal International Socialism, du groupe trotskiste anglais SWP, printemps 2006.
3) Lénine, Le socialisme et la guerre [61], 1915.
Récent et en cours:
- Terrorisme [9]
- Tensions impérialistes [62]
Questions théoriques:
- Terrorisme [63]
Rubrique:
Histoire de La Révolution russe de Trotski (extraits) : "Les bolcheviks pouvaient-ils prendre le pouvoir en juillet ?"
- 983 lectures
En complément de notre article sur les journées de juillet 1917, nous republions ci-dessous des extraits du chapitre que consacre Trotski à cet épisode dans son Histoire de la Révolution russe. De notre point de vue, ces passages présentent un intérêt majeur : la nécessité de la transmission des acquis pour les générations présentes et futures de tirer les leçons de l’expérience du mouvement ouvrier dans les plus hauts moments de son combat. Mais surtout, ils mettent l’accent sur la nécessité primordiale pour les révolutionnaires d’analyser avec la plus grande lucidité quel est le rapport de forces réel entre les classes à un moment, dans une situation donnés et d’évaluer selon des critères précis le degré global de maturité et de conscience atteint par le prolétariat dans son combat.
"Dans une proclamation issue des deux comités exécutifs au sujet des journées de juillet, les conciliateurs en appelèrent avec indignation aux ouvriers et aux soldats contre les manifestants qui, prétendaient-ils, “ont essayé d’imposer par la force des armes leur volonté à vos élus.” (…) En se concentrant autour du Palais de Tauride, les masses criaient aux oreilles du comité exécutif la phrase même qu’un anonyme ouvrier avait servie à Tchernov en lui tendant un poing rude : “Prends le pouvoir quand on te le donne.” Comme réponse, les conciliateurs appelèrent les cosaques. Messieurs les démocrates préféraient ouvrir la guerre civile contre le peuple plutôt que de prendre le pouvoir sans effusion de sang. Les gardes blancs furent les premiers à tirer. Mais l’atmosphère politique de la guerre civile fut créée par les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires.
Se heurtant à la résistance armée de l’organe même auquel ils voulaient remettre le pouvoir, les ouvriers et les soldats perdirent conscience de leur but. Du puissant mouvement des masses, l’axe politique se trouva arraché. La campagne de juillet se réduisit à une manifestation partiellement effectuée avec les moyens d’une insurrection armée. On peut dire tout aussi bien que ce fut une demi-insurrection pour un but qui n’admettait pas d’autres méthodes qu’une manifestation. (…)
Quand, à l’aube du 5 juillet, les troupes “fidèles” pénétrèrent dans l’édifice du Palais de Tauride, leur commandant fit savoir que son détachement se subordonnait intégralement et sans réserve au Comité exécutif central. Pas un mot sur le gouvernement ! Mais les rebelles, eux aussi, consentaient à se soumettre au comité exécutif en tant que pouvoir. Même les troupes appelées du front se mettaient entièrement à la disposition du Comité exécutif. De quelle utilité, dans ce cas, avait été le sang versé ? (…)
Si paradoxal que soit le régime de février, que les conciliateurs décoraient d’ailleurs d’hiéroglyphes marxistes et populistes, les véritables rapports de classes sont suffisamment transparents. Il faut seulement ne pas perdre de vue la nature hybride des partis conciliateurs. Les petits-bourgeois instruits s’appuyaient sur les ouvriers et les bourgeois, mais fraternisaient avec les propriétaires de noble condition et les gros fabricants de sucre. En s’insérant dans le système soviétique, à travers lequel les revendications de la base s’élevaient jusqu’à l’État officiel, le comité exécutif servait aussi de paravent politique à la bourgeoisie. Les classes possédantes se “soumettaient” au comité exécutif dans la mesure où il poussait le pouvoir de leur côté. Les masses se soumettaient au comité exécutif dans la mesure où elles espéraient qu’il deviendrait l’organe de la domination des ouvriers et des paysans. Au Palais de Tauride s’entrecroisaient des tendances de classes contraires, dont l’une et l’autre se couvraient du nom du comité exécutif : l’une par manque de compréhension et par crédulité, l’autre par froid calcul. Or, dans la lutte, il ne s’agissait ni plus ni moins que de savoir qui gouvernerait le pays : la bourgeoisie ou le prolétariat ?
Mais, si les conciliateurs ne voulaient pas prendre le pouvoir, et si la bourgeoisie n’avait pas assez de force pour le détenir, peut-être, en juillet, les bolcheviks pouvaient-ils se saisir du gouvernail ? (…) On pouvait s’emparer de l’autorité même en certains points de la province. En ce cas, le parti bolchevique avait-il raison de renoncer à la prise du pouvoir ? Ne pouvait-il pas, s’étant fortifié dans la capitale et dans quelques régions industrielles, étendre ensuite sa domination à tout le pays ? La question est d’importance.
Rien ne contribua, à la fin de la guerre, au triomphe de l’impérialisme et de la réaction en Europe autant que les quelques mois si courts du “kerenskisme” qui exténuèrent la Russie révolutionnaire et causèrent un préjudice incalculable à son autorité morale aux yeux des armées belligérantes et des masses laborieuses de l’Europe, qui espéraient de la révolution une parole nouvelle. Si les bolcheviks avaient réduit de quatre mois - formidable laps de temps ! - les douleurs de l’accouchement de l’insurrection prolétarienne, ils se seraient trouvés devant un pays moins épuisé, l’autorité de la révolution en Europe eût été moins compromise. Cela n’eût pas seulement donné aux soviets d’énormes avantages dans la conduite des pourparlers avec l’Allemagne, cela aurait exercé une très grosse influence sur la marche de la guerre et de la paix en Europe. La perspective était trop séduisante ! Et, cependant, la direction du parti avait absolument raison de ne pas s’engager dans la voie de l’insurrection armée.
Prendre le pouvoir ne suffit pas. Il faut le garder. Quand, en octobre, les bolcheviks estimèrent que leur heure avait sonné, la période la plus difficile pour eux survint après la prise du pouvoir. Il fallut la plus haute tension des forces de la classe ouvrière pour résister aux innombrables attaques des ennemis. En juillet, cette disposition à une lutte intrépide n’existait pas encore, même chez les ouvriers de Petrograd. Ayant la possibilité de prendre le pouvoir, ils le proposaient cependant au comité exécutif. Le prolétariat de la capitale qui, en son écrasante majorité, était déjà porté vers les bolcheviks, n’avait pas encore coupé le cordon ombilical qui le reliait aux conciliateurs. Il y avait encore pas mal d’illusions en ce sens que, par la parole et par une manifestation, l’on pourrait arriver à tout ; qu’en intimidant les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires, l’on pourrait les stimuler à suivre une politique commune avec les bolcheviks.
Même l’avant-garde de la classe ne se rendait pas clairement compte des voies par lesquelles on peut arriver au pouvoir. Lénine écrivait bientôt : “La réelle faute de notre parti, pendant les journées des 3-4 juillet, révélée à présent par les événements, était seulement en ceci... que le parti croyait encore possible un développement pacifique des transformations politiques au moyen d’un changement de politique dans les Soviets, tandis qu’en réalité les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires s’étaient déjà tellement fourvoyés et liés par leur entente avec la bourgeoisie, et celle-ci était devenue tellement contre-révolutionnaire qu’il ne pouvait plus être question d’un développement pacifique quelconque.”
Si le prolétariat n’était politiquement pas homogène ni suffisamment résolu, il en était de même et d’autant plus de l’armée paysanne. Par sa conduite pendant les journées des 3-4 juillet, la garnison avait créé l’absolue possibilité pour les bolcheviks de prendre le pouvoir. Mais il y avait pourtant dans les effectifs de la garnison des contingents neutres qui, déjà vers le soir du 4 juillet, penchèrent résolument vers les partis patriotes. Le 5 juillet, les régiments neutres se rangent du côté du comité exécutif, tandis que les régiments enclins au bolchevisme s’efforcent de prendre une teinte de neutralité. Cela rendait les mains libres aux autorités beaucoup plus que l’arrivée tardive des troupes du front. Si les bolcheviks, par un excès d’ardeur, s’étaient saisis du pouvoir le 4 juillet, la garnison de Petrograd non seulement ne l’aurait pas conservé, mais elle aurait empêché les ouvriers de le maintenir dans le cas inévitable d’un coup porté du dehors.
Moins favorable encore se présentait la situation dans l’armée sur le front. La lutte pour la paix et la terre, surtout depuis l’offensive de juin, la rendait extrêmement accessible aux mots d’ordre des bolcheviks. Mais ce que l’on appelle le bolchevisme “élémentaire” chez les soldats ne s’identifiait nullement dans leur confiance avec un parti déterminé, avec son comité central et ses leaders, les lettres de soldats de cette époque traduisent très clairement cet état d’esprit de l’armée. (…) Un extrême degré d’irritation contre les sphères supérieures qui les dupent se joint dans ces lignes à un aveu d’impuissance : “Nous, on comprend mal les partis.”
Contre la guerre et le corps des officiers, l’armée était en révolte continue, utilisant à ce propos des mots d’ordre du vocabulaire bolchevique. Mais quant à se mettre en insurrection pour transmettre le pouvoir au parti bolchevique, l’armée n’y était pas encore prête, loin de là. Les contingents sûrs, destinés à écraser Petrograd, furent prélevés par le gouvernement sur les troupes les plus proches de la capitale, sans résistance active des autres effectifs, et ils furent transportés par échelons sans aucune résistance des cheminots. Mécontente, rebelle, facilement inflammable, l’armée restait politiquement amorphe ; dans sa composition, il y avait trop peu de solides noyaux bolcheviques capables de donner une direction uniforme aux pensées et aux actes de l’inconsistante masse des soldats.
D’autre part, les conciliateurs, pour opposer le front à Petrograd et aux ruraux de l’arrière, utilisaient, non sans succès, l’arme empoisonnée dont la réaction, en mars, avait vainement tenté de se servir contre les soviets. Les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks disaient aux soldats du front : la garnison de Petrograd, sous l’influence des bolcheviks, ne vient pas vous faire la relève ; les ouvriers ne veulent pas travailler pour les besoins du front ; si les paysans écoutent les bolcheviks et s’emparent tout de suite de la terre, il ne restera rien pour les combattants. Les soldats avaient encore besoin d’une expérience supplémentaire pour comprendre si le gouvernement préservait la terre au bénéfice des combattants ou bien des propriétaires.
Entre Petrograd et l’armée du front se plaçait la province. Sa réaction devant les événements de juillet peut en elle-même servir de très important critère a posteriori dans la question de savoir si les bolcheviks eurent raison en juillet d’éluder la lutte immédiate pour la conquête du pouvoir. Déjà à Moscou, le pouls de la révolution battait bien plus faiblement qu’à Petrograd (...)"
Léon Trotski 1
1 Histoire de la Révolution russe, T. I, extraits du chapitre “Les bolcheviks pouvaient-ils prendre le pouvoir en juillet ? [64]”, pp. 78 à 83 - coll. Points, Ed. du Seuil.
Géographique:
- Russie [51]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [34]
Personnages:
- Trotski [65]
Rubrique:
Juillet 1917 en Russie : le rôle déterminant du Parti bolchevique face aux manœuvres de la bourgeoisie
- 1027 lectures
Les événements de juillet 1917 à Petrograd, connus sous le nom des “journées de Juillet”, représentent un des épisodes les plus marquants de la Révolution russe. En effet, au cœur de l’effervescence ouvrière de ce début juillet 1917, il revint au Parti bolchevique d’avoir su éviter que le processus révolutionnaire en cours n’accouche d’une tragique défaite suite à un affrontement prématuré provoqué par les forces bourgeoises. Les enseignements que l’on peut tirer encore aujourd’hui de ces événements sont fondamentaux pour la lutte du prolétariat sur le chemin qui conduit à son émancipation.
L’insurrection de février avait conduit à une situation de double pouvoir : celui de la classe ouvrière, organisée dans ses soviets de députés ouvriers et soldats, et celui de la bourgeoisie représenté par le gouvernement provisoire et qui était soutenu par les “conciliateurs” mencheviks et socialistes-révolutionnaires, notamment au sein du Comité exécutif élu par les soviets 1. Cette situation de double pouvoir devenait, au fur et à mesure du développement de la révolution, proprement intenable.
La montée de la révolution
Illusionnés et endormis au départ par les promesses jamais tenues des démagogues mencheviks et sociaux-démocrates sur la paix, la “solution du problème agraire”, l’application de la journée de huit heures, etc., les ouvriers, en particulier ceux de Petrograd, commençaient à se rendre compte que l’Exécutif des Soviets ne répondait en rien à leurs revendications et exigences. Ils percevaient qu’au contraire il servait de paravent au gouvernement provisoire pour réaliser ses objectifs, à savoir, en tout premier lieu, le rétablissement de l’ordre à l’arrière et au front pour pouvoir poursuivre la guerre impérialiste. La classe ouvrière, dans son bastion le plus radical de Petrograd, se sentait de plus en plus dupée, bernée, trahie par ceux-là même à qui elle avait confié la direction de ses Conseils. Bien qu’encore confusément, l’avant-garde ouvrière tendait à se poser la vraie question : qui exerce réellement le pouvoir, la bourgeoisie ou le prolétariat ? La radicalisation ouvrière et la prise de conscience plus affirmée des enjeux va s’effectuer dès la mi-avril, suite à une note provocatrice du ministre libéral Milioukov réaffirmant l’engagement de la Russie avec les alliés dans la continuation de la guerre impérialiste. Déjà meurtris par les privations de toutes sortes, les ouvriers et les soldats répondent immédiatement par des manifestations spontanées, des assemblées massives dans les quartiers et les usines. Le 20 avril, une gigantesque manifestation impose la démission de Milioukov. La bourgeoisie doit reculer (provisoirement) dans ses plans guerriers. Les bolcheviks sont très actifs au sein de ce bouillonnement prolétarien et leur influence s’accroît au sein des masses ouvrières. La radicalisation du prolétariat s’opère autour du mot d’ordre mis en avant par Lénine dans ses Thèses d’avril, “Tout le pouvoir aux soviets” qui, au cours des mois de mai et juin, devient l’aspiration des larges masses ouvrières. Tout au long du mois de mai, le parti bolchevique apparaît de plus en plus comme le seul parti réellement engagé aux côtés des ouvriers. Une activité frénétique d’organisation a lieu dans tous les coins de la Russie, signe de la fermentation révolutionnaire. Tout le travail d’explication et d’engagement des bolcheviks pour le pouvoir des soviets se concrétise d’ailleurs à la Conférence des ouvriers industriels de Petrograd puisque cette fraction du prolétariat, la plus combative, leur donne la majorité dans les comités d’usines, fin mai. Le mois de juin connaît une intense agitation politique culminant de façon spectaculaire le 18 dans une gigantesque manifestation. Appelée à l’origine par les mencheviks pour soutenir le gouvernement provisoire, qui vient de décider une nouvelle offensive militaire, et l’Exécutif du Soviet de Petrograd qu’ils dominent encore, elle se retourne contre les “conciliateurs”. En effet, la manifestation reprend dans son immense majorité les mots d’ordre bolcheviques : “A bas l’offensive !”, “A bas les dix ministres capitalistes !”, “Tout le pouvoir aux soviets !”
Les bolcheviks évitent le piège de l’affrontement prématuré
Alors que les nouvelles de l’échec de l’offensive militaire atteignent la capitale, attisant le feu révolutionnaire, elles ne sont pas encore parvenues dans le reste de ce pays gigantesque. Pour faire face à une situation très tendue, la bourgeoisie entreprend de provoquer une révolte prématurée à Petrograd, d’y écraser les ouvriers et les bolcheviks, puis de faire endosser la responsabilité de l’échec de l’offensive militaire au prolétariat de la capitale qui aurait donné “un coup de poignard dans le dos” à ceux qui sont au front.
Une telle manœuvre est permise par le fait que les conditions de la révolution ne sont pas encore mûres. Bien que montant partout dans le pays chez les ouvriers et les soldats, le mécontentement n’atteint néanmoins pas, et de loin, la profondeur et l’homogénéité qui existe à Petrograd. Les paysans ont encore confiance dans le gouvernement provisoire. Chez les ouvriers eux-mêmes, y compris ceux de Petrograd, l’idée qui domine n’est pas celle de prendre le pouvoir mais bien d’obliger, à travers une action de force, les dirigeants “socialistes” à “le prendre réellement”. Il était certain qu’avec la révolution écrasée à Petrograd et le Parti bolchevique décimé, le prolétariat en Russie ainsi décapité serait bientôt vaincu dans son ensemble.
Petrograd est en effervescence. Les mitrailleurs qui, avec les marins de Cronstadt, constituent une aile avancée de la révolution dans l’armée, veulent agir immédiatement. Les ouvriers en grève font la tournée des régiments et les invitent à sortir dans la rue et à tenir des meetings. Dans ce contexte, un certain nombre de mesures prises “à point nommé” par la bourgeoisie suffisent alors à déclencher la révolte dans la capitale. Ainsi, le parti cadet prend la décision de retirer ses quatre ministres du gouvernement “provisoire” dans le but de relancer, parmi les ouvriers et les soldats, la revendication du pouvoir immédiat aux Soviets. En effet, le refus des mencheviks et des socialistes-révolutionnaires du mot d’ordre “Tout le pouvoir aux soviets !”, fondé jusqu’alors par eux-mêmes par la soi-disant nécessité de collaborer avec les représentants de la “bourgeoisie démocratique” n’a désormais plus de sens. Là-dessus, parmi d’autres provocations, le gouvernement menace de transférer immédiatement les régiments révolutionnaires combatifs de la capitale au front. En quelques heures, le prolétariat de toute la ville se soulève, s’arme et se rassemble autour du mot d’ordre “Tout le pouvoir aux soviets !”.
C’est d’ailleurs dès la manifestation du 18 juin que les bolcheviks avaient déjà mis publiquement en garde les ouvriers contre une action prématurée. Estimant qu’il ne serait pas possible d’arrêter le mouvement, ils décidèrent de se mettre à sa tête en l’appuyant, mais en conférant à la manifestation armée de 500 000 ouvriers et soldats un “caractère pacifique et organisé”. Le soir même, les ouvriers se rendent compte de l’impasse momentanée de la situation, liée à l’impossibilité immédiate de la prise du pouvoir. Le lendemain, suivant les consignes bolcheviques, ils restent chez eux. C’est alors qu’arrivent à Petrograd les troupes “fraîches” venues épauler la bourgeoisie et ses acolytes mencheviks et socialistes-révolutionnaires. Afin de les “vacciner” d’emblée contre le bolchevisme, elles sont accueillies par les coups de fusils de provocateurs armés par la bourgeoisie, mais présentés comme étant des bolcheviks. Commence alors la répression. La chasse aux bolcheviks est ouverte. Elle est placée par la bourgeoisie sous le signe d’une campagne les accusant d’être des agents allemands afin de monter les troupes contre les ouvriers. Il en résulte que Lénine et d’autres dirigeants bolcheviques sont obligés de se cacher, alors que Trotski et d’autres sont arrêtés. “Le coup porté en juillet aux masses et au parti fut très grave. Mais ce coup n’était pas décisif. On compta les victimes par dizaines, mais non point par dizaines de milliers. La classe ouvrière sortit de l’épreuve non décapitée et non exsangue. Elle conserva intégralement ses cadres de combat, et ces cadres avaient beaucoup appris.”
Les leçons de juillet 17
Contre les campagnes actuelles de la bourgeoisie qui présentent la révolution d’Octobre 17 comme un complot bolchevique contre la “jeune démocratie” instaurée par la révolution de février, et contre les partis également démocratiques qu’elle a portés au pouvoir, cadets, socialistes-révolutionnaires et mencheviks, les événements de juillet se chargent eux-mêmes de démentir cette thèse. Ils montrent clairement que les comploteurs ont été ces mêmes partis démocrates, en collaboration avec les autres secteurs réactionnaires de la classe politique russe, et avec la bourgeoisie des pays impérialistes alliés de la Russie, pour tenter d’infliger une saignée décisive au prolétariat.
Juillet 1917 a aussi montré que le prolétariat doit se méfier par dessus tout des partis anciennement ouvriers qui ont trahi, et donc surmonter ses illusions vis-à-vis d’eux. Une telle illusion pesait encore fortement sur la classe ouvrière pendant les journées de juillet. Mais cette expérience a clarifié définitivement que les mencheviks et les socialistes révolutionnaires étaient irrévocablement passés à la contre-révolution. Dès la mi-juillet, Lénine tire clairement cette leçon : “Après le 4 juillet, la bourgeoisie contre-révolutionnaire, marchant avec les monarchistes et les Cent-noirs, s’est adjoint, en partie par l’intimidation, les petits-bourgeois socialistes-révolutionnaires et mencheviks et a confié le pouvoir d’État effectif aux Cavaignac, à la clique militaire qui fusille les récalcitrants sur le front et massacre les bolcheviks à Petrograd” 2.
L’histoire montre qu’une tactique redoutable de la bourgeoisie contre le mouvement de la classe ouvrière consiste à provoquer des confrontations prématurées. En 1919 et 1921 en Allemagne, le résultat fut une répression sanglante du prolétariat. Si la révolution russe est le seul grand exemple où la classe ouvrière a été capable d’éviter un tel piège et une défaite sanglante, c’est surtout parce que le parti de classe bolchevique a pu remplir son rôle décisif d’avant-garde, de direction politique de la classe.
Le Parti bolchevique est convaincu qu’il est de sa responsabilité d’analyser en permanence le rapport de force entre les deux classes ennemies, pour être capable d’intervenir correctement à chaque moment du développement de la lutte. Il sait qu’il est impératif d’étudier la nature, la stratégie et la tactique de la classe ennemie pour identifier, comprendre et faire face à ses manœuvres. Il est imprégné de la compréhension marxiste que la prise du pouvoir révolutionnaire est une sorte d’art ou de science et est parfaitement conscient qu’une insurrection inopportune est aussi fatale que l’échec d’une prise de pouvoir tentée au bon moment. La profonde confiance du parti dans le prolétariat et dans le marxisme, sa capacité à se baser sur la force qu’ils représentent historiquement, lui permettent de s’opposer fermement aux illusions dans la classe ouvrière. Elles lui permettent encore de repousser la pression des anarchistes et “interprètes occasionnels de l’indignation des masses” comme les nomme Trotski 3 qui, guidés par leur impatience petite-bourgeoise, excitent les masses en vue de l’action immédiate.
Mais ce qui fut également décisif dans ces journées de juillet, c’est la profonde confiance des ouvriers russes dans leur parti de classe, permettant à ce dernier d’intervenir en leur sein et même d’assumer son rôle de direction, bien qu’il était clair pour tout le monde qu’il ne partageait ni leurs buts immédiats ni leurs illusions.
Les bolcheviks firent face à la répression qui débute le 5 juillet, sans aucune illusion sur la démocratie et en se battant pied à pied contre les calomnies dont ils étaient la cible. Aujourd’hui, cent ans plus tard, la bourgeoisie qui n’a pas changé de nature, mais au contraire est encore plus expérimentée et cynique, mène avec la même “logique” contre la Gauche communiste une campagne similaire à celle déployée en juillet 1917 contre les bolcheviks. En juillet 1917, elle essaie de faire croire que les bolcheviks, refusant de soutenir l’Entente, sont nécessairement du côté allemand ! Aujourd’hui, elle tente d’accréditer l’idée que, si la Gauche communiste a refusé de soutenir le camp impérialiste “antifasciste” dans la Seconde Guerre mondiale, c’est parce qu’elle et ses successeurs actuels, sont du côté nazi. Aujourd’hui, les révolutionnaires, qui tendent à sous-estimer la signification de telles campagnes à leur encontre qui ne font que préparer de futurs pogroms, ont encore beaucoup à apprendre de l’expérience des bolcheviks qui, après les journées de juillet, ont remué ciel et terre pour défendre leur réputation au sein de la classe ouvrière.
Durant ces journées décisives, l’action du parti bolchevique permit à la révolution montante de surmonter les pièges tendus par la bourgeoisie. Elle n’a rien à voir avec l’exécution d’un plan préconçu par un état-major extérieur à la classe ouvrière, comme a coutume d’en parler la bourgeoisie à propos de la révolution d’Octobre. Elle est au contraire l’œuvre d’une émanation vivante de la classe ouvrière. En effet, trois mois auparavant, le parti bolchevique ne comprenant pas que la révolution de février mettait à l’ordre du jour la prise du pouvoir en Russie par la classe ouvrière, se trouvait dans une situation de profond désarroi devant la situation. Après s’être doté d’une orientation claire, il fut par contre capable, en s’appuyant sur son expérience propre et celle de tout le mouvement ouvrier, de se hisser à la hauteur de ses responsabilités en assumant la direction politique du combat.
KB
2) Lénine, “A propos des mots d’ordre [68]”, Œuvres complètes, tome 25.
3) Trotski, Histoire de la Révolution russe [64].
Géographique:
- Russie [51]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [34]
Rubrique:
Révolution Internationale n° 466 - septembre octobre 2017
- 550 lectures
Face à l’impasse du capitalisme, seul le prolétariat porte un avenir
- 565 lectures
Un panorama de la situation internationale montre l’accentuation de la barbarie et du chaos mondial. La série impressionnante d’attentats durant cet été, frappant de nouveau le cœur du monde capitaliste, ajoutée à la guerre au Moyen-Orient, en sont des illustrations tragiques.
L’impasse d’un mode de production barbare
Quelles que soient les cliques au pouvoir et leurs mesures sécuritaires, elles étalent leur impuissance et la vacuité de leurs promesses lorsqu’elles prétendent vouloir améliorer notre quotidien et notre sécurité. En réalité, leurs conduites sont totalement dictées par des objectifs inverses : assurer l’exploitation maximale du travail salarié en temps de crise et défendre des intérêts impérialistes où les civils sont otages de quadrillages militaires et policiers. Tout ceci confirme l’impasse historique d’une classe dominante bourgeoise à bout de course, soufflant la peste et le choléra pour maintenir ses privilèges et son mode de production obsolète. Au quotidien, la corruption, l’aggravation des tensions entre fractions et cliques bourgeoises, la spirale de la violence, le chômage massif et la paupérisation sont les œuvres majeures d’une crise économique chronique, expression d’un mode de production capitaliste dont l’agonie prolongée menace aujourd’hui l’espèce humaine. Malgré les tentatives désespérées de la part de la classe dominante pour faire émerger des fractions plus lucides, responsables et présentables, comme ce fut le cas en France avec la tentative cependant réussie de mettre au pouvoir un Macron, le discrédit politique des partis traditionnels et les personnalités en panne d’inspiration conduisent le plus souvent les moins aptes à la “gouvernance” pour défendre les intérêts supérieurs du capital : incapacité d’entreprendre de réelles politiques globales et cohérentes, d’avoir une vision en profondeur sur le long terme (autre que celle du profit et de la rentabilité immédiate). Ce phénomène est alimenté par le “populisme”, un produit de la décomposition capitaliste qui s’est enkysté insidieusement dans la société. Dans plusieurs pays, la classe dominante en vient de ce fait à perdre graduellement le contrôle des rouages politiques qu’elle a durant des décennies utilisé pour tenter de freiner les effets politiques les plus néfastes et délétères du capitalisme en faillite. L’État et les fractions les plus conscientes de la bourgeoisie tentent bien de réagir, ponctuellement avec quelques succès, comme on vient de le souligner pour le cas Macron, mais ceci ne fait que retarder ou ralentir ce processus, sans vraiment pouvoir l’enrayer définitivement. Ce dernier s’aggrave au contraire en détériorant la situation. Et en effet, depuis le Brexit et l’élection de Trump, les incertitudes, les revirements et l’imprévisibilité la plus totale n’ont fait que donner un coup de fouet à la dynamique du “chacun pour soi” et à la barbarie croissante. Un peu partout dans le monde, les hommes politiques, au centre des grandes décisions, tendent à exprimer la part la plus sombre de leur personnalité. On observe un Poutine manipulateur et paranoïaque, tout comme Érdogan en Turquie est adepte du culte de la personnalité, un Maduro jusqu’au-boutiste prêt à tout “brûler” au Venezuela, s’agrippant coûte que coûte au pouvoir, un Duterte dirigeant les “escadrons de la mort” et prêt à tuer n’importe quel opposant et à s’en vanter ouvertement, un Kim-Jong-Un, colérique et provocateur, véritable psychopathe..., la liste est trop longue pour continuer. Le plus frappant, c’est surtout qu’au cœur même de grandes nations, notamment de la première puissance mondiale, les États-Unis, on trouve des personnalités comme par exemple un Trump, totalement narcissique, pétri lui aussi de brutalité et d’imprévisibilité. En Grande-Bretagne, les volte-face de Theresa May rendent l’avenir de l’UE très incertain. Comment expliquer la simultanéité de ces profils, aussi multiples que tristement semblables, auparavant l’apanage de quelques “républiques bananières” ?
Tout cela n’est pas le fruit, selon nous, d’un simple hasard, mais un produit de la période historique actuelle. La phase ultime de décomposition du mode de production capitaliste marque l’histoire et la personnalité des hommes de son empreinte. Elle exprime leurs limites en dictant presque leurs actes, ceux de l’impuissance marquée par le sceau de l’aveuglement, de l’irresponsabilité, de l’immoralité et quasiment une soif de répression et de terreur, en se déclarant prêts à faire couler le sang... Parmi les réflexions les plus remarquables du mouvement ouvrier sur la question des portraits politiques, on peut se remémorer les écrits de Trotski : “certains traits de ressemblance sont, naturellement, dus au hasard et n’ont, dans l’histoire, qu’un intérêt anecdotique. Infiniment plus importants sont les traits greffés ou directement imposés par de toutes puissantes circonstances, qui jettent une vive lumière sur les rapports réciproques de l’individu et des facteurs objectifs de l’histoire.”1 Exprimant tout en finesse par un cadre théorique les portraits et les destins croisés du tsar Nicolas II de Russie et du roi Louis XVI en France, Trotski a su parfaitement dépeindre les marques du déclin historique sur ces célèbres figures de l’aristocratie : “Louis et Nicolas étaient les derniers rejetons de dynasties dont la vie fut orageuse. En l’un et l’autre, un certain équilibre, du calme, de la “gaieté” aux minutes difficiles exprimaient l’indigence de leurs forces intimes de gens bien éduqués, la faiblesse de leur détente nerveuse, la misère de leurs ressources spirituelles. Moralement castrats, tous deux, absolument dénués d’imagination et de faculté créatrice, n’eurent que tout juste assez d’intelligence pour sentir leur trivialité et ils nourrissaient une hostilité jalouse à l’égard de tout ce qui est talentueux et considérable. Tous deux se défendirent contre l’invasion d’idées nouvelles et la montée de forces ennemies. L’irrésolution, l’hypocrisie, la fausseté furent en tous deux l’expression non point tant d’une faiblesse personnelle que d’une complète impossibilité de se maintenir sur des positions héritées.”2 Et il ajoute ceci : “les déboires de Nicolas comme ceux de Louis provenaient, non de leur horoscope personnel, mais de l’horoscope historique d’une monarchie de caste bureaucratique. Tous deux étaient, avant tout, les rejetons de l’absolutisme.” Avec la phase de décomposition du capitalisme, on atteint une dimension supplémentaire car les deux dernières classes fondamentales de l’histoire : la bourgeoisie et le prolétariat, dans leur confrontation réciproque, ne parviennent pas pour l’instant à affirmer une perspective ouverte au sein de la société, à donner un sens visible pour notre futur. Notre époque trouve aussi ses “rejetons”, des Louis XVI et des Nicolas II à foison presque plus caricaturaux... Porteurs d’idéologies de plus en plus marquées par la décomposition et du fait de l’absence d’une alternative révolutionnaire pour l’instant, les dirigeants bourgeois ne nous offrent que l’odeur de la terre brûlée. La société est comme bloquée, enfermant l’humanité dans la prison tragique de l’immédiat, plongeant ainsi le monde dans la le chacun pour soi, la rapine, le chaos et la barbarie croissante.
La politique populiste aggrave la situation mondiale
Depuis l’élection de Trump, la situation mondiale s’est fortement dégradée. De par le contexte historique particulier, les actes d’un tel personnage, inspirés par ses vues étriquées de dirigeant d’entreprise despote et mégalomane, animé par une sorte de révolte sournoise, obscurantiste et paradoxalement “anti-élite” qui s’était déjà installée comme référent au sein de la société civile, le pousse à rompre avec les traditions et les codes d’un ordre établi de plus en plus rejeté.
On peut en illustrer les conséquences. On a vu la politique américaine de Trump mettre de l’huile sur le feu en entrant dans le jeu des surenchères militaires avec la Corée du Nord, soulignant en arrière-plan un réel bras de fer de plus en plus tendu et dangereux avec la Chine et d’autres puissances asiatiques. Autre exemple significatif parmi tant d’autres, la conduite de Trump au Moyen-Orient, remettant en cause la politique traditionnelle des États-Unis par des revirements diplomatiques brutaux, notamment contre l’Iran, jetant aussi de l’huile sur le feu de cette poudrière. Du coup, les États-Unis, puissance déclinante, apparaissent encore moins “fiables”, d’autant qu’ils sont eux-mêmes aspirés par la dynamique des tensions militaires, poussés à faire usage des armes sans pouvoir freiner la spirale de guerre. Il en est ainsi à Mossoul, où la guerre entre la coalition et Daesh se soldent par 40000 morts civils, annoncés en catimini par les média, sans qu’une alternative visible au chaos et aux cendres n’apparaisse pour cette région. Alors que le but affiché était de “lutter contre le terrorisme”, le résultat a été contraire : une vague d’attentats accrue, ponctuée par exemple par les tragiques événements de Barcelone et par la recrudescence d’un flux de réfugiés tentant de fuir la guerre et la misère au péril de leur vie. Ces derniers sont, soit refoulés vers des camps, soit livrés à la mort en Méditerranée. L’absence totale de vision politique, l’enlisement dans une logique de guerre ne font que généraliser la violence et les mécanismes de vengeances, diffuser les métastases du terrorisme, diluer et généraliser l’influence de l’idéologie djihadiste vers des zones géographiques plus larges et étendues, comme en Afghanistan.
Ces tensions au Moyen-Orient, porteuses de guerre, ne sont pas uniques. Dans le même sens, les annonces de Trump d’une possible intervention militaire américaine au Venezuela n’ont fait que durcir la position de Maduro au lieu d’apaiser la situation, ce dernier instrumentalisant cette menace américaine pour justifier sa politique. Sur le plan de la politique intérieure aux États-Unis, les déclarations et les actes politiques de Trump n’ont fait que s’accumuler, là aussi, aiguisant les tensions et le discrédit gouvernemental, par exemple les sympathies affichées par le président envers les activistes les plus racistes de l’extrême-droite après les récents incidents de Charlottesville, en Virginie. Tout ceci n’a fait qu’exacerber les tensions au sein même de l’État, ce qui affaiblit d’autant l’image des États-Unis et surtout de son chef dans le monde.
Mais ces tensions politiques et militaires aggravées ne sont pas les seules expressions de l’impasse historique dans laquelle nous plongent le capital et ses dirigeants corrompus. Les décisions prises alimentent aussi la guerre commerciale. Le renforcement du protectionnisme et du “chacun pour soi” économique, malgré une sonnette d’alarme comme celle de la crise financière de 2008, la politique de fermeture exclusive “America First”, ne peut que plonger davantage le monde dans la crise globale, le chômage massif et la misère sociale. La guerre commerciale exacerbée génère en plus des désastres écologiques. Les déclarations de Trump, dépassant les plus audacieuses revendications des lobbies du pétrole, révélant sa froide désinvolture vis-à-vis du réchauffement climatique, ironisant sur les accords de Paris (COP 21) qui avaient pourtant permis à la bourgeoisie de s’acheter une bonne conscience, traduisent bien la folie du capital. Malgré les beaux discours “green washing” dont nous ont abreuvés les média, la réalité du système capitaliste plonge le monde dans un environnement de plus en plus dégradé.
Bref, ce que nous pouvons observer, c’est que les superstructures idéologiques de la société bourgeoise, qui sont affectées par la réalité et l’impasse du mode de production capitaliste en décomposition, agissent elles-mêmes comme forces matérielles de destruction. L’absence de perspective qui affecte la société constitue une lourde entrave pour la seule classe potentiellement capable d’opposer une véritable alternative révolutionnaire, le prolétariat. Le fait de sa perte d’identité de classe et de la propagande cherchant à dénaturer et attaquer son combat révolutionnaire, oblige le milieu politique prolétarien et une organisation révolutionnaire comme le CCI à un très grand esprit de responsabilité. Parce qu’elle est porteuse d’un programme et dotée d’une expérience liée à celle de toute l’histoire du mouvement ouvrier, l’organisation révolutionnaire est indispensable pour favoriser la réflexion et permettre à la classe ouvrière de renouer avec son passé, en particulier celui de la vague de luttes internationales des années 1920, notamment le combat des bolcheviks qui a permis la victoire de l’Octobre rouge. Au moment du centenaire de la Révolution de 1917 en Russie, il s’agit de renouer avec les leçons fondamentales de cette expérience irremplaçable. C’est en s’appropriant ce passé de façon critique, avec un esprit de combat, que le prolétariat pourra préparer à nouveau un futur digne de la communauté humaine mondiale. C’est en combattant pour cette perspective que les révolutionnaires doivent se donner les moyens de défendre les principes du communisme : une société sans classe et sans exploitation.
WH, 28 août 2017
1 Léon Trotski, Histoire de la Révolution russe, Tome 1.
2Idem.
Rubrique:
Ordonnances Macron : “réformistes” ou “contestataires”, les syndicats sont les chiens de garde du capital !
- 837 lectures
Après trois mois d'élaboration, le gouvernement a dévoilé, le 31 août dernier, ses ordonnances visant à réformer le Code du travail. Vis-à-vis de ses concurrents directs, le capitalisme français souffre encore de n'avoir pas su complètement libéraliser le marché du travail à l'image des réformes des lois Hartz en Allemagne ou celles de Blair au Royaume-Uni. Sans se hisser à la hauteur des enjeux et des annonces (Macron devant pulvériser les archaïsmes, libérer les énergies et révolutionner le rapport entre les employeurs et leurs “collaborateurs”), cette énième réforme n'en constitue pas moins une avancée majeure dans la précarisation et la dégradation des conditions de travail, dans la continuité directe de la loi El Khomri adoptée par le gouvernement prétendument socialiste de François Hollande.
Désormais les salariés pourront être mis à la porte de leur entreprise sans aucune véritable justification et avec des indemnités plafonnées, y compris en cas de licenciement abusif ! De la même façon, les licenciements économiques de masse sont considérablement facilités pour les multinationales souhaitant liquider leur filiale sur le territoire français.
Mais que la classe ouvrière ne s'estime pas quitte de nouvelles attaques ; après les salariés du privé, le “Président jupitérien” Macron a promis les pires tourments aux fonctionnaires, aux retraités, aux chômeurs... Déjà durant l'été, le gouvernement, affichant son arrogance, diminuait les aides pour le paiement des loyers des plus démunis tout en réduisant de trois quarts les recettes de l’impôt de solidarité sur la fortune. On ne pouvait adresser message plus explicite !
Les effets délétères de toutes ces mesures sur les conditions de travail et les salaires ne se feront évidemment pas attendre : si la menace de licenciement plane sur toutes les têtes, comment s'opposer aux exigences que la direction pourra imposer dans le cadre du “renforcement du dialogue social” prévus par les ordonnances ? En faisant confiance aux syndicats ? Sûrement pas !
État et syndicats main dans la main contre la classe ouvrière
Un incroyable ballet syndical aux portes des ministères a précédé la publication des ordonnances, les “négociations avec les partenaires sociaux” s'étalant sur plus de cinquante réunions officielles en moins de trois mois ! Fallait-il autant de négociations, pendant lesquelles les syndicats ont, affirment-ils, fait preuve de la plus grande fermeté et d'une vigilance de tous les instants, pour aboutir à l’une des pires attaques économiques que l’État français ait jamais porté à la classe ouvrière ces quarante dernières années ? Le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Jean-Caude Mailly, s'est d'ailleurs ouvertement félicité de la méthode avec laquelle syndicats et gouvernement ont organisé, main dans la main, la précarisation généralisée des travailleurs : “Il y a eu un vrai dialogue social", ajoutant, les yeux pleins d'étoiles : “Ce n’est pas une négociation juridiquement, c’est une concertation. Mais cela ressemblait beaucoup à une négociation.”1
Les syndicats ont donc pu négocier avec Macron-Jupiter et s'en frappent le ventre de satisfaction ! Même le soi-disant contestataire, Philippe Martinez (CGT), n'est en désaccord qu'à… “99%” ! Quel est donc ce point d'accord décisif ? Qu'a donc remporté le prolétariat par la grâce de la négociation syndicale en échange de ses “sacrifices” ? Seulement la possibilité pour un salarié syndiqué ou qui souhaite l’être d’obtenir des formations renforcées ! C'est une nouvelle victoire sur le long chemin du renforcement de la bureaucratie syndicale et surtout... un arbre qui cache mal la forêt.
En effet, ces négociations de pacotille se sont surtout résumées à un partage en bonne et due forme de la gestion syndicale de l'exploitation : contrairement aux annonces initiales du gouvernement qui prévoyait de privilégier les négociations par entreprise, FO a obtenu un renforcement significatif des prérogatives des branches professionnelles, c'est-à-dire à l'échelon où ce syndicat est en position de force... En conséquence : “Force ouvrière a décidé “à l’unanimité” de ne pas participer à la journée d’action prévue le 12 septembre (…). Pourtant, en 2016, FO faisait partie du front syndical contre la loi El Khomri, qui assouplissait les règles du droit du travail dans une moindre mesure. Mais de cette loi travail, “on n’a jamais pu discuter (…), là, on est dans une situation différente", a assuré M. Mailly.”2 Quelle hypocrisie !
Quant à la manifestation prévue le 12 septembre par la “radicale” CGT, elle ne relève ni plus ni moins que d'une classique manœuvre de division par un partage des tâches entre les syndicats “responsables et réformistes” et les syndicats “contestataires et radicaux”, ainsi qu'une manière d'encadrer et d'épuiser les quelques ouvriers les plus combatifs. La CGT a pour intention d'utiliser la manifestation du 12 septembre comme le marqueur d'un échec cuisant ; non seulement la presse annonce déjà, sous couvert de confidences faites au sein de la centrale, que la “journée d'action” risque de n'être qu'un baroud d'honneur, mais la CGT subit encore la concurrence opportune d'une manifestation organisée par le nationaliste hystérique de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à laquelle la centrale appelle presque ouvertement à ne pas participer : “Le secrétaire général de la CGT s’est clairement démarqué de La France insoumise, qu’il n’a pas citée, par rapport à sa manifestation du 23 septembre. (…) Alors que Jean-Luc Mélenchon est soupçonné d’empiéter sur le terrain syndical, M. Martinez lui a décoché une flèche : “C’est bien de souligner l’indépendance de la CGT vis-à-vis des partis politiques.”"3
Les syndicats, un instrument du capitalisme d’État
Derrière les slogans et les positionnements de façade, l'intégration des syndicats à l'appareil d’État, c'est-à-dire à ce qui est devenu le centre hypertrophié et totalitaire de la classe dominante, est aujourd'hui moins masquée idéologiquement du fait des faiblesses actuelles de la classe ouvrière. En d'autres termes, ils sont officiellement associés à la gestion de l'économie nationale et à l'exploitation salariale à tous les niveaux : ils siègent dans les tribunaux du travail de l'État, dans les instances “paritaires” au sein des entreprises et de toutes les administrations, au sein des instances stratégiques de plus haut niveaux, etc. Cette réalité est le produit de leur intégration à l’État depuis l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence. Désormais, le capital n'a strictement plus aucune véritable réforme durable positive à accorder à la classe ouvrière, il doit survivre à la concurrence extrême entre nations en portant toujours davantage d'attaques, ce que la bourgeoisie nomme officiellement “s'adapter au monde qui change”... Du fait de la crise chronique et de l'impasse historique du capitalisme, le syndicalisme a ainsi totalement perdu sa fonction traditionnelle de défense des intérêts des travailleurs en devenant un instrument de répression pur et simple, un outil privilégié de la réaction pour assurer un véritable contrôle social et un sabotage des luttes ouvrières.
Alors que faire ? Comment lutter ? Si la confrontation directe avec les syndicats est nécessaire pour mener à la révolution, il est clair que le prolétariat aura un chemin encore bien long à parcourir avant de pouvoir mettre en avant sa propre perspective et assurer un haut niveau de combativité et de conscience. Le discrédit des centrales syndicales est certes immense, comme en atteste, parmi d'autres exemples, la très faible participation aux élections professionnelles, du moins là où elles ne sont pas rendues obligatoires. Mais la distance entre la méfiance et la capacité de notre classe à développer une lutte unie et autonome, fondée sur les formes prolétariennes de la lutte, les assemblées ouvertes et souveraines, est gigantesque. Face à des “citoyens” atomisés, les syndicats ont les mains libres pour encadrer les rares luttes dispersées, voire les déclencher préventivement. Inversement, face à l'absence de perspective pour le futur, la capacité du prolétariat à imaginer d'autres formes de lutte que celles prônées par le syndicalisme reste très faible.
Dans ce contexte, la tâche essentielle des éléments les plus conscients de la véritable nature du système capitaliste, de son État et ses organes syndicaux, est de contribuer, partout où cela est possible, par la discussion et la clarification politique, au développement de la confiance et de la solidarité nécessaires à la lutte de la classe ouvrière pour le communisme. Se réapproprier les leçons du mouvement ouvrier et des luttes passées, approfondir la compréhension des rapports existant entre les classes et du rôle historique du prolétariat, c'est forger les armes politiques indispensables aux combats de demain !
EG, 5 septembre 2017
1 Le Monde du 23 août 2017 : Réforme du code du travail : les syndicats “vigilants” avant la dernière phase de consultation.
2 Le Monde.fr du 30 août 2017 : Réforme du code du travail : Force ouvrière ne manifestera pas.
3 Le Monde du 30 août 2017 : La CGT souhaite installer le mouvement de contestation dans la durée.
Rubrique:
Moyen-Orient : une expression de l'engrenage meurtrier du capitalisme
- 565 lectures
La poussière du mur de Berlin n’était pas encore totalement retombée qu’à l’été 1990, l’invasion du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein allait donner lieu à la première guerre du Golfe. Les États-Unis étaient parvenus par cette intervention à prendre de court l’ensemble de ses alliés et à les aligner derrière lui pour la “défense du droit international”. Cela, avant que ceux-ci ne puissent profiter de l’ouverture offerte par la disparition de l’ennemi oriental commun pour remettre en cause un statut de leader hérité de l'ancien bloc occidental.
En effet, la disparition de l’URSS signait la fin inévitable d’un ordre mondial structuré en deux blocs, chacun bien rangé derrière un chef à la puissance de feu supérieure, à qui revenait d’assurer la protection de ses alliés mais qui dans le même temps récoltait les bénéfices de son leadership. Dès l’implosion du camp soviétique, les discours de victoire sur la démocratie et la liberté ont envahi tout l’espace disponible. En prenant les armes contre Saddam Hussein, les États-Unis voulaient montrer que leur rôle de leader et responsable de la paix mondiale n’avait pas faibli et qu'aucune partie du monde ne devait se soustraire à un “nouvel ordre mondial” désormais marqué par les “valeurs” du “pays des libertés”.
Ce coup de force était absolument nécessaire pour que les États-Unis préservent leur autorité et que ce brutal rebattage des cartes ne conduise à une poussée incontrôlable des velléités locales. C’est ainsi que dès la fin de l’année 1990 nous étions en mesure d’écrire que “l'invasion du Koweït par l'Irak résulte fondamentalement de la nouvelle situation historique ouverte par l'effondrement du bloc de l'Est. Elle est aussi une manifestation de la décomposition croissante qui touche le système capitaliste. Le gigantesque déploiement de forces armées des grandes puissances, essentiellement des États-Unis à vrai dire, révèle, pour sa part, la préoccupation croissante de ces dernières à l'égard du désordre qui s'étend de plus en plus. Mais, à terme, les réactions des grandes puissances ne pourront donner que le résultat inverse de celui attendu, se transformant en un facteur supplémentaire de déstabilisation et de désordre. A terme, elles ne peuvent qu'accélérer encore la chute dans le chaos et y entraîner l'humanité entière”.1
L’ère de paix qu’on nous promettait alors commençait dans une guerre brutale et sanglante. Le mensonge ne faisait que commencer car plus un seul jour depuis n’allait être dépourvu d’un déchaînement de violence armée, en particulier dans cette région du monde hautement stratégique.
Loin de réduire la planète à un ensemble discipliné derrière l’autorité d’un chef reconnu, cette première guerre du Golfe a marqué le début d’un lent déclin de la puissance américaine. Les “alliés” européens ont eu tôt fait de reprendre leurs distances avant même la fin du conflit, mettant de l’huile sur le feu en poussant à la constitution de puissances locales alliées face en particulier à l’Arabie Saoudite appuyée solidement par les Américains.
Dix ans plus tard, le chaos s’est amplifié, les États-Unis sont débordés et peinent de plus en plus à rassembler derrière eux. Nous résumions alors la situation ainsi au printemps 2001 lors de notre 14e congrès international : “la fragmentation des vieux blocs, dans leur structure et leur discipline, a libéré des rivalités entre nations à une échelle sans précédent, résultant en un combat de plus en plus chaotique de chacun pour soi, des plus grandes puissances mondiales jusqu'aux plus minables seigneurs de la guerre locaux. Ceci a pris la forme d'un nombre de plus en plus grand de guerres locales et régionales, autour desquelles les grandes puissances continuent d'avancer leurs pions à leur avantage. (...) Tout au long de la dernière décennie, la supériorité militaire des États-Unis s'est montrée complètement incapable d'arrêter le développement centrifuge des rivalités inter-impérialistes. Au lieu du nouvel ordre mondial dirigé par les États-Unis, que lui avait promis son père, le nouveau président Bush est confronté à un désordre militaire croissant, avec une prolifération de guerres sur toute la planète.”2
Dans une telle situation, le recours aux solutions politiques devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre et les armes resteront seules à porter les ambitions des puissances impérialistes, qu’elles soient grandes ou petites, en particulier dans cette région du monde à la fois carrefour stratégique sur le plan géographique entre l’Orient et l’Occident et immense réserve de pétrole et de gaz à une époque où la pénurie des hydrocarbures est encore attendue à l’horizon de quelques décennies.
Dans ce contexte, l’attentat du World Trade Center à New York en septembre 2001 est un acte de guerre fondateur d’une période d’enfoncement sans précédent de destructions militaires sans lendemain. Les États-unis iront en représailles s’embourber en Afghanistan en transformant en champ de ruines un pays déjà laminé et peu après, se lanceront dans cette lamentable aventure qu’aura été la deuxième guerre du Golfe, conduisant à l’implosion de l’Irak en un champ de bataille permanent.
Est-ce que les États-Unis, en multipliant les démonstrations de force, auront réussi à imposer leur autorité au reste du monde ? Bien au contraire, la situation leur échappe totalement, leur doctrine “zéro morts” n’est qu’un lointain souvenir(3) et les trois mille milliards de dollars qu’on estime avoir coûté cette guerre n’auront conduit qu’à multiplier les insurrections et le chaos. Les tensions régionales ne cessent d’augmenter, avec souvent l’Arabie Saoudite en tête, contre l’Iran, contre le Qatar.
L’Irak est, comme l’Afghanistan avant lui, réduit de plus en plus à un quasi-champ de dévastation. Alors que le focus est mis dans les médias occidentaux sur le recul de Daesh, rien n’est dit sur ce que cette guerre laisse derrière elle : des régions entières exsangues, des ruines écroulées sur des monceaux de cadavres et des villes (ou ce qu’il en reste) laissées à l’appétit de cliques locales qui finissent par leurs propres affrontements à y supprimer tout espoir de vie.3
La guerre civile en Syrie ne semble pas pouvoir trouver d’autre issue qu’un massacre généralisé. De plus en plus de zones du pays prennent, en bonne partie, le chemin de ce qu’est devenu l’Irak aujourd’hui. Au fur et à mesure que la menace islamiste est “contenue”, les alliances locales se délitent et les tensions se déplacent.
Au Yémen, les affrontements se multiplient, affamant et plongeant la population dans la misère et le dénuement.
Les tensions en Turquie, au Liban ou en Israël font légitimement craindre une extension des conflits armés dans la région, pourtant déjà très enflammée.
Les États-Unis ont-ils réussi à mettre fin au terrorisme, dont il faut rappeler que c’était le principal objectif de ces interventions ? La menace terroriste (et le passage à l’acte) au quotidien partout dans le monde apporte une réponse définitive à la question. Tous les jours ou presque, une terrasse de café, une salle de concert ou un arrêt de bus dans le monde subit l’explosion d’un “martyr” terroriste. Rien que sur les derniers mois, les attentats terroristes dans le monde se comptent par dizaines : les derniers attentats de Barcelone, en Finlande ou en Russie, au Burkina Faso, en Afghanistan et au Nigeria, pour ce qui est du seul mois d’août, en témoignent. En Juillet, ce fut l’Allemagne, l’Egypte, Israël, la Syrie… En juin, les Philippines, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Iran, la Colombie, le France, la Belgique, les États-Unis, le Pakistan, le Mali, Israël, le Nigeria… En mai, encore le Royaume-Uni, l’Indonésie… Sans compter naturellement les attentats presque hebdomadaires en Irak ou Syrie qui font à chaque fois des dizaines de tués. La liste n’en finit pas.
L’embrasement du Moyen-Orient illustre le monde capitaliste décomposé, où le chacun pour soi domine, que ce soit localement par l’affrontement de cliques à la détermination morbide ou plus globalement par le reflet des affrontements entre les grandes puissances défendant leurs intérêts au mépris de toute logique, ne serait-ce qu’économique ! Au delà des massacres et des morts innocentes, c’est l’irrationalité absolue de ces guerres qui stupéfie : même s’il y a du pétrole sous ces terres, y en a-t-il assez pour “rentabiliser” les milliers de milliards qui sont dépensés dans ces affrontements sans fin ? Y a-t-il un seul argument capable de rendre rationnel une telle dévastation ?
N’allons donc pas croire que ce chaos meurtrier restera limité à cette région du monde, que si le Moyen-Orient est davantage touché, c’est uniquement par son caractère stratégique. Car une caractéristique essentielle de la décomposition, c’est que la situation est déterminée par un engrenage guerrier. Les tensions sont sans fin, la course sans limite. Les États s’effondrent et se délitent en multiples cliques rivales. Apparaissent alors des forces de plus en plus incontrôlables, opportunistes et imprégnées de la folie meurtrière de ce monde en chute libre. Cette spirale guerrière, avec ses répercussions toujours plus fortes, jusque dans le cœur du capitalisme, c’est le seul avenir que ce système nous réserve : celui de son autodestruction.
Aucune puissance capitaliste, aussi forte soit-elle, aussi déterminée soit-elle, ne peut enrayer cette spirale de mort car celle-ci est inscrite de façon indélébile dans son histoire et déclin. Seule la classe ouvrière porte une autre perspective, qu’elle devra imposer par sa lutte : la perspective du communisme. Sans l’intervention du prolétariat sur la scène de l’histoire, le capitalisme finira à coup sûr par anéantir l’humanité et réduire la Terre à un vaste désert fumant.
Delix, 8 septembre 2017
1 Golfe persique : le capitalisme, c’est la guerre, Revue Internationale n° 63, 4e trimestre 1990.
2 Résolution sur la situation internationale du 14e congrès du CCI, Revue Internationale n° 106, 3e trimestre 2001.
3 Plus de 4 000 GI’s ont trouvé la mort entre 2003 et 2008 dans le conflit.
Rubrique:
Éducation : un conditionnement de la pensée au service du capital et de l’État
- 1476 lectures
La mécanisation de la production et l’affermissement de la lutte de classes amenèrent la bourgeoisie à saisir tous les avantages qu’elle pouvait tirer de l’imposition d’une éducation ouvrière organisée par l’État.
Les ouvriers dans les usines et leurs enfants dans les écoles
La mise en œuvre de “l’école pour tous” est généralement considérée comme la réussite des projets humanistes et philanthropiques de la bourgeoisie libérale et républicaine, soucieuse d’offrir au peuple une culture et une instruction. Si cette analyse contient une part de vérité, elle reste néanmoins à la surface des choses.
La scolarisation constante et progressive des couches exploitées, en particulier des enfants d’ouvriers, découla inexorablement du développement de la production mécanisée. D’ailleurs, sous l’ère de la production manufacturière, alors que les fabricants avaient besoin d’une force de travail considérable, la scolarisation des jeunes ouvriers n’était pas à l’ordre du jour. Elle le devint avec la complexification de la production et la nécessité d’une force de travail beaucoup mieux formée. Mais aussi, lorsque l’atrophie intellectuelle et physique de la jeunesse, occasionnée par l’âpreté des cadences de travail, commença à préoccuper la classe dominante elle-même.
En Angleterre, l’État tenta d’imposer aux patrons l’obligation de scolariser les jeunes ouvriers. Dans un premier temps, ils balayèrent d’un revers de main cette mesure que l’État lui-même ne pouvait encore assumer. Cette situation ridicule est rapportée en 1857 dans un document officiel : “Le législateur seul est à blâmer, parce qu’il a promulgué une loi menteuse qui, sous l’apparence de pourvoir à l’éducation des enfants, ne renferme en réalité aucun article de nature à assurer la réalisation du but proclamé. Il ne détermine rien, sinon que les enfants doivent être tenus enfermés un certain nombre d’heures – trois – par jour entre les quatre murs d’un local baptisé école, et que les employeurs de ces enfants auront à réclamer un certificat de scolarité chaque semaine d’une personne qui le signera à titre de maître ou de maîtresse d’école.”1
En fait, la bourgeoisie anglaise, auréolée de sa toute puissance, fut très hésitante dans ce domaine et prit un peu trop à la légère l’encadrement idéologique du prolétariat, considérant que la morale religieuse suffisait à le détourner de ses désirs de révolte. L’archaïsme de cette éducation ne fit pas long feu et n’eut aucun résultat. Engels railla cet échec en soulignant que l’État lui-même désavouait cette entreprise : “De l’aveu de toutes les autorités, en particulier de la Commission sur l’emploi des enfants, les écoles ne contribuent à peu près en rien à la moralité de la classe laborieuse. La bourgeoisie anglaise est si impitoyable, si stupide et si bornée dans son égoïsme, qu’elle ne se donne pas même la peine d’inculquer aux ouvriers la morale actuelle, que la bourgeoisie s’est pourtant confectionnée dans son propre intérêt et pour sa propre défense !”
Mais l’éducation sous l’ère industrielle n’eut pas seulement vocation à forger de bons producteurs. Devant le danger que commençait à faire peser la classe ouvrière sur la société capitaliste, l’école devint également un instrument utilisé pour mystifier la réalité. En France, dans les années qui suivirent la Commune de Paris, la diffusion de l’instruction républicaine et de la morale citoyenne se fit d’abord et avant tout dans les écoles. Il s’agissait d’éloigner la jeunesse de ce “spectre qui hantait l’Europe” et ôter toute réalité à l’existence de classes sociales aux intérêts antagoniques. Jules Ferry n’avait pas d’autres idées en tête lorsqu’il fit promulguer les lois instaurant l’école gratuite, laïque et obligatoire. L’ancien préfet de Paris, l’un des responsables du massacre de milliers d’ouvriers durant la Semaine sanglante, fut le maître d’œuvre d’un système éducatif où la diffusion du savoir, le développement de l’esprit critique et l’épanouissement personnel restent écrasés par la fonction idéologique de l’école. Ce que les responsables politiques n’osent guère affirmer aujourd’hui, Ferry le claironnait avec autorité du haut de la tribune de l’Assemblée Nationale :
“Non, certes, l’État n’est point docteur en mathématiques, docteur en lettres ni en chimie. (…) S’il lui convient de rétribuer des professeurs, ce n’est pas pour créer ni répandre des vérités scientifiques ; ce n’est pas pour cela qu’il s’occupe de l’éducation : il s’en occupe pour y maintenir une certaine morale d’État, une certaine doctrine d’État, indispensable à sa conservation”.2
Traumatisée par la grande insurrection ouvrière de 1871, la bourgeoisie française considérait l’école républicaine comme un vaccin qui pourrait la prémunir d’un nouvel assaut du prolétariat. Dès lors, l’idéologie républicaine, érigée en “morale d’État”, serait ce voile mystificateur qui donnerait au professeur la capacité “d’exercer cet apostolat de la science, de la droiture et de la vérité, qu’il faut opposer résolument, de toutes parts, à cet autre apostolat, à cette rhétorique violente et mensongère, (…) cette utopie criminelle et rétrograde qu’ils appellent la guerre de classe !”3
Face à la démonstration de créativité et d’auto-organisation du prolétariat au cours des trois mois que dura la Commune, la bourgeoisie comprit une bonne fois pour toutes qu’elle ne pouvait plus laisser la classe ouvrière s’éduquer toute seule.
Briser le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière
Au tournant du XXe siècle, le durcissement des tensions impérialistes, la militarisation de la société et la marche forcée vers la guerre donnent à l’école une nouvelle dimension : propager le sentiment patriotique, distiller dès l’enfance la toute-puissance de sa propre nation et la méfiance voire la haine de la nation concurrente. Il s’agit de forger des “citoyens-soldats” en inculquant le sens du sacrifice, l’amour d’une patrie qui rayonne dans le monde entier par sa prétendue “œuvre civilisatrice” au sein des colonies. L’Angleterre et la France furent les championnes de ce credo qui ne résistait pourtant pas à la véritable attitude de ces deux puissances dans le monde colonial. Comment l’école a-t-elle été utilisée pour mettre en œuvre cela ? En France, dans les années qui précèdent la guerre, la marche militaire, le maniement des armes et les exercices de tirs sont instaurés dans les écoles et les lycées. Sur la carte de France affichée sur le mur de la salle de classe, une tâche violette attire l’attention des élèves. Il s’agit “des territoires perdus” de l’Alsace et de la Lorraine, clairement mis en évidence afin de stimuler l’esprit de revanche des futurs soldats. Cette propagande patriotique et démocratique ne désemplit guère avec la chute du capitalisme dans sa décadence. Alors que l’État prend une place toujours plus importante dans chaque domaine de la société, l’éducation nationale continue à jouer ce rôle idéologique en apparence plus “soft” aujourd’hui. Or, dans les collèges et les lycées, cette “morale d’État” jalonne la scolarité des adolescents dans de nombreux pays. En France, cela se concrétise par le “culte” des idoles ou icônes républicaines comme le drapeau, la Marianne, la Marseillaise, la laïcité ainsi que par la multiplication de manifestations annexes aux enseignements (comme la journée citoyenne, la journée de la laïcité, la visite des tribunaux...). Derrière le mensonge de l’acquisition “d’un esprit critique et d’une culture de l’engagement”(9) se cache la volonté de faire de la citoyenneté quelque chose de naturel, un horizon indépassable qui cherche à briser la capacité des futurs producteurs à lutter contre la société bourgeoise.
Mais le vice va bien plus loin. De plus en plus, l’école participe à l’instrumentalisation des effets de la décomposition sociale en attisant un climat de terreur. Par exemple, les simulations d’attaques terroristes rendues obligatoires dans tous les établissements scolaires visent à accoutumer les plus jeunes à vivre dans un climat de peur permanente où l’État serait le seul défenseur.
Ce dernier est aussi présenté comme le repoussoir de toutes les idées nauséabondes sécrétées par la société bourgeoise à travers l’action de sa justice. Les programmes scolaires martèlent aux élèves que les discriminations comme le racisme, la xénophobie ou le sexisme sont des actes punis par la loi mais se gardent bien de pousser les élèves à se questionner sur les causes profondes de ces phénomènes ; qui sont ni plus ni moins à chercher dans les fondements de cette société qui pourrit sur pied.4
Un établissement disciplinaire
Dans un de ses principaux ouvrages, Surveiller et punir, Michel Foucault a démontré la transformation qui s’est opérée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles dans la manière de discipliner le corps et l’esprit. L’enfermement devient une nouvelle méthode de contrôle, de mesure et de dressage des individus dans un objectif bien précis, rendre à la fois docile et utile : “est docile un corps qui peut être soumis, qui peut être utilisé, qui peut être transformé et perfectionné.” L’école devient un établissement disciplinaire parmi d’autres. Un endroit clos où la vie est rythmée par un emploi du temps précis, des règles strictes, des sanctions ou des punitions en cas de manquement, une place spécifique (mais variable) à l’intérieur d’un rang :5
“Le “rang” au XVIIIe siècle, commence à définir la grande forme de répartition des individus dans l’ordre scolaire : rangées d’élèves dans la classe, les couloirs, les cours ; rang attribué à chacun à propos de chaque tâche et de chaque épreuve ; rang qu’il obtient de semaine en semaine, de mois en mois, d’années en années, alignement des classes d’âge les unes à la suite des autres (…) Et dans cet ensemble d’alignements obligatoires, chaque élève selon son âge, ses performances, sa conduite, occupe tantôt un rang, tantôt un autre ; il se déplace sans cesse sur ces séries de cases. (…) En assignant des places individuelles, il a rendu possible le contrôle de chacun et le travail simultané de tous. Il a organisé une nouvelle économie du temps d’apprentissage. Il a fait fonctionner l’espace scolaire comme une machine à apprendre, mais aussi à surveiller, à hiérarchiser, à récompenser.”(10)
L’école c’est aussi l’endroit où l’on apprend à se tenir d’une manière particulière. L’écolier doit intégrer une posture unique du corps : une manière de se tenir sur sa chaise, une manière d’écrire, une manière de se comporter dans la salle de classe (ne pas bouger, ne pas parler, ne pas se retourner). Le “temps de la classe”, c’est le temps de toutes les privations. Dans le même esprit que la prison, elle sert à corriger ce qui aux yeux de la société bourgeoise apparaît comme une déviance. Donner au corps une docilité allant de soi, une normalisation afin d’éduquer les futures forces de travail à produire sans “sortir du rang” ! Dès lors, l’individu doit devenir son propre censeur.
L’antichambre de la formation de producteurs toujours plus qualifiés
Comme l’affirmait Marx et Engels dès 1848 dans le Manifeste communiste, la société bourgeoise “ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, donc les rapports de production, donc l’ensemble des conditions sociales”. Dès lors, la production ne cesse de se complexifier et nécessite de reproduire une force de travail toujours plus qualifiée. Seul l’État est capable de prendre en charge cette tâche dans une société où les contradictions des rapports sociaux de production ne cessent de s’amplifier. En 2011, le coût moyen d’un élève de primaire au sein des pays de l’OCDE s’élève à 8296 dollars par an, ce coût moyen est de 9280 dollars pour un élève du secondaire et de 13 958 dollars pour un étudiant. Ainsi, l’État s’adapte aux besoins du capital et lui fournit une main d’œuvre suffisamment éduquée et formée pour poursuivre la production et l’accumulation. Ce n’est pas un hasard si, en France, la programmation informatique fait désormais partie des programmes de mathématiques.
En fait, en tant “qu’atelier” qui contribue en partie à la reproduction de la force de travail, l’école est déjà un lieu de spécialisation et de concurrence. De manière générale, l’évaluation de l’élève sert à identifier sa place potentielle dans le système de production. D’ailleurs, le développement de l’évaluation par compétences (héritée de la logique d’entreprise) ne vise qu’à individualiser l’élève en ciblant de manière extrêmement précise le domaine dans lequel il peut être le plus utile. Toujours dans Surveiller et punir, Michel Foucault avait explicité cela : “L’examen comme fixation à la fois rituelle et “scientifique” des différences individuelles, comme épinglage de chacun à sa propre singularité indique bien l’apparition d’une modalité nouvelle de pouvoir où chacun reçoit pour statut sa propre individualité, et où il est statutairement lié aux traits, aux mesures, aux écarts, aux “notes” qui le caractérisent et font de lui, de toute façon, un “cas.””
De cette façon, l’État sélectionne et oriente les jeunes gens en fonction de leurs compétences potentielles dans la production mais aussi de leur capacité à supporter la prison scolaire.
L’école de la lutte
Il appartient au sens commun d’opposer classe ouvrière et culture. Déjà dans les romans de Zola apparaît cette peinture de l’ouvrier ignare, alcoolique et dépressif de nature. En réalité, la classe ouvrière a démontré à de multiples reprises que l’aspiration à la culture et au savoir fait partie du combat qu’elle mène contre la société bourgeoise. Durant toute la période d’ascendance du capitalisme, elle tenta d’offrir à sa jeunesse une éducation indépendante bien qu’elle s’en vit dépossédée par l’État dans le dernier quart du XIXe siècle comme nous l’avons montré précédemment.
Dans La formation de la classe ouvrière en Angleterre, E.P Thompson décrit ces communautés de tisserands qui, au temps du domestic system, arrivaient à consacrer du temps pour se détendre et s’éduquer et où “chaque district de tisserands possédait ses poètes, biologistes, mathématiciens, musiciens, géologues, botanistes...”
Quand ce modèle de vie traditionnel fut détruit par la production manufacturière, le désir d’éducation s’exprima chez les travailleurs d’usine avec la prolifération des sociétés d’entraide, des clubs, des réseaux de bibliothèques. La classe ouvrière comprit très vite que sa lutte pour l’émancipation de l’humanité l’obligeait à se forger ses propres organisations, ses propres organes de propagande, sa propre analyse du monde. C’est à travers les discussions, les polémiques et sa presse qu’elle améliora ses connaissances, sa capacité de réflexion et la cohérence de sa pensée. Davantage que pour toutes les autres classes révolutionnaires, la théorie est une arme indispensable pour la classe ouvrière.
La compréhension profonde de la réalité est un corollaire indispensable à sa capacité à la transformer. Marx considérait avec beaucoup de sérieux cette dimension éducative et culturelle en participant lui-même à des conférences. Comme le rappelle Engels, “pour la victoire ultime des principes énoncés dans le Manifeste, Marx se fiait uniquement au développement intellectuel de la classe ouvrière, tel qu’il devait résulter nécessairement de l’action et de la discussion commune”.
De la Ligue des Communistes en 1847 au Programme d’Erfurt de la Social-Démocratie allemande en 1891, la revendication pour une éducation libre et accessible à tous fit partie des programmes des organisations révolutionnaires. Non comme une fin en soi mais parce qu’“un prolétariat éduqué ne serait pas disposé à rester dans des conditions d’oppression”, comme le disait Engels.
Au cours de ses luttes, le prolétariat fut aussi capable d’expérimenter de nouvelles mesures éducatives et ainsi se montrer à l’avant-garde dans ce domaine comme les Communards mais surtout les ouvriers de Russie dès 1919. Si dans un premier temps, il s’agissait de pallier l’arriération du pays, à long terme, l’école devait participer à l’abolition complète de la division de la société en classes. L’école “du travail unifié” élaborée dans l’ABC du communisme se proposait de rompre la séparation entre l’éducation mentale et le travail productif : “Les premières activités d’un enfant prennent la forme du jeu ; le jeu doit se transformer graduellement en travail, par une transition imperceptible, de sorte que l’enfant apprend dès son plus jeune âge à regarder le travail non comme une nécessité désagréable ou une punition, mais comme une expression naturelle et spontanée de ses facultés. Le travail doit être un besoin, comme le besoin de manger ou de boire ; ceci doit être instillé et développé dans l’école communiste.” En Russie, ces jalons ont été écrasés dans l’œuf par la contre-révolution mais ils demeurent encore valables aujourd’hui. Leur application dépendra de la capacité du prolétariat à vaincre la bourgeoisie et à détruire l’État afin que l’éducation ne soit plus l’organe de la conservation sociale mais celui de l’émancipation de chacun.
Najek, 3 septembre 2017
1 Jean Vial, Histoire de l’éducation.
2 Ibid.
3 Les premières traces de ce lieu clos sont attestées en Mésopotamie et sont étroitement liées à l’apparition de l’écriture et son appropriation par la classe dominante.
4 H-I Marrou, Histoire de l’éducation dans l’antiquité.
5 Jean Vial, Op. Cit.
6 Cité par F. Engels dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre.
7 Discours de Jules Ferry à la Chambre des députés le 26 juin 1879.
8 Discours à la Sorbonne de Jules Ferry, lors de la séance d’ouverture des cours de formation des professeurs, le 20 novembre 1892.
() Présentation du “parcours citoyen” de l’école primaire au lycée. Site Eduscol, organe du ministère de l’Éducation nationale.
() M. Foucault, Surveiller et punir.
Rubrique:
Brevet des collèges 2017 : un “enseignement moral et civique”... bourgeois !
- 451 lectures
En juin 2017 s’est tenu comme chaque année le diplôme national du brevet. Et cette fois encore l’épreuve “d’enseignement moral et civique” a défrayé la chronique. Il faut dire que l’État ne rate jamais l’occasion d’y étaler sans retenue sa propagande puisque, après tout, cette discipline a été créée tout spécialement pour cela. Cette année donc, sous le titre : Les grands principes de la Défense nationale, a été demandé aux élèves de 3e : “Vous avez été choisi(e) pour représenter la France au prochain sommet de l’Union européenne. Vous êtes chargé(e) de réaliser une note pour présenter une mission des militaires français sur le territoire national ou à l’étranger.
Montrez en quelques lignes que l’armée française est au service des valeurs de la République et de l’Union européenne.” Voilà. Sobre et efficace. Tu as 15 ans et tu veux ton brevet des collèges, alors écris tout le bien que tu penses de l’armée française et des guerres qu’elle mène à travers le monde... en quelques lignes.
Rappelons simplement qu’au moment où ces enfants étaient sommés de se comporter en bons citoyens français en chantant les louanges des valeurs guerrières de la République, deux faits particulièrement barbares s’étalaient dans les colonnes des journaux :
- le soutien de plus en plus notoire de l’État français au gouvernement génocidaire rwandais en 1994 (environ 1 million de morts) ;
- l’utilisation par la coalition internationale en Irak et en Syrie d’armes incendiaires très meurtrières, les obus au phosphore.
Finalement, ce qu’affirme cette épreuve du brevet des collèges est tout à fait exact, effectivement “l’armée française est au service des valeurs de la République” : le nationalisme, l’exploitation, la concurrence économique et guerrière, l’impérialisme, la barbarie.
L’hypocrisie syndicale
“Le SNES-FSU a pris connaissance avec effarement de l’exercice d’enseignement moral et civique (EMC) du Diplôme National du brevet sur lequel ont dû composer les élèves de 3e de série générale en métropole et ne peut que s’en indigner, tant sur le fond que sur la forme. (…) Il s’agit encore une fois de glorifier notre armée, sans demander aux élèves de faire preuve de recul ni du moindre esprit critique, contrairement aux objectifs affichés de l’EMC... Il s’agit bien de propagande, qui entretient la confusion entre l’UE et ses institutions, la République française et “ses valeurs” et qui oblige les candidat(e)s à défendre une opinion partisane”. Cette déclaration du 3 juillet du premier syndicat du secondaire, la FSU, semble en apparence une réaction indignée et légitime. Mais le diable se cache souvent dans les détails. Car au fond, que réclame là la FSU ? Un bon “enseignement moral et civique”, un enseignement développant “l’esprit critique”, pour former des citoyens responsables. Il s’agit là aussi d’un véritable poison idéologique. Tout comme l’impérialisme, qu’on le baptise “guerre humanitaire” ou pas, engendre forcément l’horreur et la mort, l’éducation “à la citoyenneté”, “l’instruction civique”, avec ou sans “esprit critique”, borne l’horizon de la pensée et de la réflexion des élèves en les façonnant inexorablement dans le moule des intérêts de la Nation et du capital. C’est d’ailleurs là la force des bourgeoisies les plus expérimentées et sophistiquées, ne pas imposer par la terreur policière brute un mode unique de pensée mais de favoriser un ensemble de débats d’idées “contradictoires” qui toutes s’inscrivent in fine dans le cadre de l’intérêt du système capitaliste et de ses nations respectives.
La citoyenneté, inexorablement liée au nationalisme
C’est ce lien inextricable entre la citoyenneté et l’idéologie bourgeoise, dont le nationalisme fait partie intégrante, que la FSU tente de dissimuler derrière ses hypocrites cris d’orfraies clamant son “effarement” et sa prétendue défense de “l’esprit critique”. Ainsi, entre mille exemples, voici un extrait du Bulletin officiel n°26 du 30 juin 2016 qui fonde tout particulièrement “les valeurs” de tout “l’enseignement moral et civique” que ce syndicat tente de défendre : “Les ministres de la Défense, de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, (...) déclarent que la compréhension des notions essentielles de défense et de sécurité nationale est indispensable au futur citoyen comme au responsable économique, culturel, social ou environnemental. L’engagement formulé en 1982 par Charles Hernu et Alain Savary, dans le premier protocole “défense éducation nationale”, reste pleinement d’actualité : “La mission de l’éducation nationale est, d’assurer sous la conduite des maîtres et des professeurs, une éducation globale visant à former des futurs citoyens responsables, prêts à contribuer au développement et au rayonnement de leur pays.” (...) L’enseignement de défense et de sécurité nationale, conçu en lien avec la formation à la citoyenneté, est centré sur la défense militaire, qui lui confère sens et visibilité, et concerne l’ensemble des disciplines. Il permet aux élèves de :
- percevoir concrètement les intérêts vitaux ou nécessités stratégiques de la Nation, à travers la présence ou les interventions militaires qu’ils justifient ;
- comprendre le cadre démocratique de l’usage de la force et de l’exercice de la mission de défense dans l’État républicain ;
- appréhender les valeurs inhérentes au métier militaire, à partir de l’étude des aspects techniques. La formation à la citoyenneté et le sens de l’engagement, qui participent au développement de la résilience nationale, figurent dans la définition du “socle commun de connaissances, de compétences et de culture”. (...) Afin d’accroître la portée et l’efficacité de l’enseignement de défense, première étape du “parcours de citoyenneté”, les signataires du présent protocole s’accordent sur la nécessité de sensibiliser aux notions de défense et de sécurité nationale, de façon cohérente et continue, de l’école primaire à l’enseignement supérieur.”
La bourgeoisie est la classe dominante la plus intelligente de l’histoire. Si elle ne se prive pas de la terreur pour maintenir et assurer l’exploitation des ouvriers, l’hypocrisie, la manipulation et le mensonge en sont des piliers tout aussi importants et efficaces. La démocratie, la citoyenneté, le civisme font partie intégrante de l’arsenal idéologique destiné au maintien de l’ordre capitaliste.
Charles, 30 juillet 2017
Géographique:
- France [15]
Rubrique:
Crise politique au Venezuela : le prolétariat exposé à la misère, au chaos et à la répression du capitalisme
- 574 lectures
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur la parution prochaine sur notre site internet d’une prise de position, réalisée dans des conditions très difficiles par la section du CCI au Venezuela, qui cherche à alerter internationalement l’ensemble des prolétaires sur la situation dramatique dans laquelle est plongée la population en général et le prolétariat en particulier de ce pays, pris en otages et exposés à la répression, dans les rivalités sanglantes de cliques bourgeoises.
Comme le soulignent nos camarades d’Internacionalismo dans cet article, les éléments majeurs de cette tragédie sont :
Les salaires ouvriers réduits, leurs prestations sociales amputées ; l’aggravation de la pénurie et du manque d’approvisionnement en nourriture, médicaments et produits de bases dont souffre la population depuis plusieurs années.
A cette situation s’ajoutent plus de 120 morts à ce jour, des milliers de blessés et de détenus, résultats de l’affrontement entre les cliques rivales du capital vénézuélien dans leur lutte pour le pouvoir.
Le désespoir de la population est tel que le nombre de personnes cherchant les moyens de fuir le pays a fortement augmenté. L’augmentation des tensions politiques et l’accentuation de la crise économique menacent de créer une vague de réfugiés semblable à celle produite par les exodes de populations en provenance de Syrie, d’Afghanistan ou de certains pays africains fuyant la barbarie guerrière ou la misère.
Le régime instauré par Chavez est une nouvelle preuve que ni la gauche, ni la droite, ni les secteurs les plus radicaux ne représentent une quelconque issue à l’exploitation et à la barbarie capitaliste, tous doivent être rejetés et combattus consciemment par le prolétariat et les minorités de la classe qui luttent contre l’ordre existant.
Le “socialisme du XXIe siècle” et la prétendue “révolution bolivarienne” n’ont rien à voir avec le socialisme. Il s’agit d’un mouvement patriotique et nationaliste de style stalinien alors que les défenseurs conséquents du socialisme défendent avant tout, à la suite du Manifeste Communiste de 1848, le principe que “les prolétaires n’ont pas de patrie”.
La difficile et dangereuse situation que vit le Venezuela est l’expression de la décomposition du système capitaliste comme un tout, qui s’exprime dans ce pays de manière caricaturale.
L’unique voie de sortie de la situation qui se vit au Venezuela est entre les mains de la classe ouvrière, qui à travers son combat, sa conscience politique, son union et sa solidarité au niveau local comme international, peut canaliser l’indignation et la rage des masses désespérées de la population.
C’est une réalité qu’à l’heure actuelle le prolétariat mondial n’a pas la force de freiner l’avancée de cette barbarie. Cependant, il existe une immense masse de la population qui ne croit plus aux “sorties de crise”. C’est uniquement le prolétariat qui à travers sa lutte consciente et sa solidarité internationale de classe peut arrêter ce drame.
Pour cela, il est urgent que comme minorités révolutionnaires de la classe ouvrière, nous intervenions dans le sens du développement de la conscience et de notre identité de classe : “Ni “socialisme du XXIe siècle”, ni démocratie, ni populisme de droite du style Trump, le prolétariat doit chercher sa propre perspective hors du capitalisme en reprenant le chemin de ses luttes sur son propre terrain de classe.”
Géographique:
- Vénézuela [72]
Rubrique:
Grèves du personnel des maisons de retraites : l'inhumanité du capital
- 735 lectures
Des mouvements de grève ont été déclenchés cet été par les aides-soignants des maisons de retraite dans différents départements : à Brest ou Carhaix, Domme, Bruz et Chateaugiron, Romorantin, Buxy et, en région parisienne, à Argenteuil, à Chatenay-Malabry. Un cas a marqué particulièrement ce mouvement, celui de la maison de retraite des Opalines à Foucherans dans le Jura, un Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ayant duré plus de cent jours, la plus longue grève en France dans ce secteur.
Ce qui a surtout déclenché ces différentes grèves, ce sont tant les conditions de travail déplorables des salariés que les conditions de vie indignes des pensionnaires, un mouvement de révolte contre les exigences où il est demandé au personnel de prendre en charge des personnes souvent en souffrance, sans pouvoir prendre le temps de développer de veritables relations empathiques : “trouver la bonne distance, ne pas s’attacher”, recommandent les formateurs. Ceci, alors que les personnes âgées et les soignants développent nécessairement des sentiments vis-à-vis de ceux qui deviennent comme des “proches”.
Soumis à la pression de la direction, l'arme de la culpabilité est exploitée pour accélérer les cadences et tenter de justifier l’injustifiable, par exemple demander aux soignants d’effectuer en “quinze minutes, la toilette, l’habillement, le petit déjeuner et la prise des médicaments”. Les sous-effectifs se traduisent par des toilettes non-faites ou bâclées, l'assistance au repas de cinq à six résidents en même temps, la douche hebdomadaire (sic !) reportée, etc. Tout ceci, par manque de moyens humains et matériels, au détriment des résidents bien sûr, mais aussi de la santé des aides-soignants, eux-mêmes au bord de l’épuisement. Une fatigue physique, nerveuse et morale qui devient insupportable (le jour du départ du mouvement aux “Opalines”, plusieurs d’entre-eux se sont mises à pleurer au moment du changement d’équipe : “c’était un matin comme les autres (…) mais sans doute un matin de trop”, comme l’a écrit dans un article Florence Aubenas.1
Beaucoup de nos politiciens saluent régulièrement avec zèle le travail du personnel de santé et en particulier celui des infirmiers, des aides-soignants, etc… Pourtant tous ces dirigeants savent très bien que “le secteur compte plus d’accidents et de maladies professionnelles que le BTP”. Quel cynisme ! Suite à des grèves dans les hôpitaux publics, voilà ce que disait déjà un ancien Président de la République, François Mitterrand : “Je dirai même que l'une des revendications les plus justes des infirmières, c'est de demander l'accroissement de leur nombre. On manque d'infirmières. Il faut donc en recruter. Le travail qui revient à celles qui sont là est souvent écrasant, les occupe de jour et de nuit. On dit infirmières, on pourrait dire aussi infirmiers et aides-soignants ; c'est un personnel particulièrement exposé auquel on demande beaucoup, auquel on demande souvent trop.” Vingt-cinq ans plus tard, la situation ne s’est pas améliorée. On mesure là toute l'hypocrisie de la bourgeoisie. Dans de nombreux cas, les maisons de retraite publiques ont été privatisées, l’Etat-patron se désengageant pour diminuer ses dépenses et tenter de vendre des services pour trouver de l’argent frais. En fait, lorsque nous écoutons ce que disent les aides-soignants en grève, c’est une partie de “nos vieux” qu'on livre à l'abandon. Alors que, dans de nombreuses sociétés passées, les anciens étaient respectés et soignés comme les autres membres de la communauté (voire mieux et avec plus d’attention), considérant à juste titre qu’ils pouvaient transmettre le savoir, ils deviennent aujourd'hui de véritables parias sans droit à la parole. Leur expérience de la vie est méprisée par une société où seul le profit et la rentabilité immédiate ont voix au chapitre.
Pour pouvoir survivre, le résident doit être solvable, avoir les moyens de payer avec sa retraite. Si cela ne suffit pas, il a l’obligation d’utiliser ses économies, de vendre ses biens et s’en servir pour payer la différence. Seuls ceux qui ne peuvent pas payer du tout reçoivent différentes allocations de misère. Depuis de nombreuses années, investisseurs ou organismes d’investissement placent de l'argent dans les maisons de retraite ou dans les cliniques au même titre que n’importe qu’elle entreprise susceptible d'être rentable. Ils achètent ainsi des parts dans différentes maisons de retraite ou autres organismes de gestion. Il faut donc que le capital investi génère davantage de capital, plus qu'un “retour sur investissement”.
Dans chaque lieu où les aides-soignants ont fait grève, il y avait bien sûr des marques de soutien de la part des personnes concernées, les résidents, mais aussi de la part de la population à travers une aide matérielle (collectes, produits alimentaires, présence physique aux piquets de grève, etc…). Mais les autres salariés de ces maisons de retraite n’avaient pas la force de rejoindre le mouvement, moins encore les travailleurs des autres secteurs implantés autour et qui pourtant subissent, in fine, la même exploitation et ses conséquences toujours inhumaines. Même s’ils ont pu manifester leur accord avec les revendications des aides-soignants, ils ne se sont pas solidarisés de façon active avec eux : c'est-à-dire qu’ils n’ont pas créé un mouvement de solidarité en rejoignant la grève et en arrêtant le travail eux-aussi. Cette lutte est restée, malheureusement, corporatiste et très isolée. Avec l’idée que ceux sont “NOS” problèmes d’aide-soignants de maison de retraite, qu'il faut lutter pour “NOS” conditions de travail, pour “NOS” revendications. Et même si le reste du personnel des maisons de retraite s’était mis en grève, cela n’aurait pas permis d’éviter le piège du corporatisme. Pour être réellement victorieux, un mouvement doit s'étendre et créer un rapport de force. Dans le contexte actuel de faiblesse de la conscience de la classe ouvrière, un tel niveau de prise en charge du combat n'était pas immédiatement réalisable. Mais cela ne doit pas pousser à la résignation. Au contraire, nous savons qu'il est nécessaire de réfléchir plus largement aux conditions qui permettent de créer une dynamique de lutte : comme le fait d’envoyer des délégations massives aux portes des entreprises, appeler à la solidarité active par la lutte. Appeler à se mettre en grève en soutien et élargir les revendications unitaires. Car ce n'est que par la généralisation rapide d’une lutte que nous pouvons être efficaces, prendre conscience de notre force, préparer les luttes futures et faire reculer, même momentanément, les directions ou l’État pour nous permettre de retrouver notre dignité d’ouvriers. Bref, il est nécessaire de renouer avec l'expérience des luttes du mouvement ouvrier, nécessaire de prendre conscience que nous appartenons à une même classe sociale, le prolétariat, porteur d'un futur, d'une autre société.
Ce ne sont pas les deux embauches et la création d’un “observatoire du bien-être des personnels des Ehpad” à l’Ehpad de Foucherans qui permettent “une victoire sur toute la ligne” comme l’a proclamé L’Humanité2 ou “une fin de grève victorieuse” comme l’annonce LO.3 Quand on connaît l’ensemble des revendications non satisfaites, il faut traiter avec le plus grand mépris ceux qui parlent de “victoire” des aides-soignants qui, eux, vont se retrouver exactement face aux mêmes conditions de travail qu’avant leurs cent jours de grève, voire pire.
Bien sûr, si nous reconnaissons que ces ouvriers viennent de connaître une défaite, cela ne nous empêche pas d’abord de saluer leur lutte. Comme nous l’avons dit, le déclenchement de ce mouvement était au départ pour la défense de la dignité humaine, une réaction d’indignation contre ce que le capitalisme cherche à imposer à tous les prolétaires : des conditions de travail inhumaines, des cadences infernales. C’est aussi pour ces raisons d’indignité et du fait du caractère sensible et scandaleux de cette affaire que l’on a si peu entendu parler de ce mouvement dans les médias. Comme a pu titrer cyniquement France-Info : La France n'aime pas ses vieux ! L'exploitation rime bien avec inhumanité et avec rejet de ceux qui ne peuvent plus servir directement l’appareil de production. Les “vieux”, en effet, ne sont pour le capital que des bouches inutiles à nourrir, deviennent des "charges inacceptables" qu'il faut dépouiller au maximum jusqu'à ce qu’ils crèvent.
A l’avenir, il faudra encore et encore rejeter l’immoralité que cherche à nous faire accepter la bourgeoisie. Nous devons retrouver notre dignité, renouer avec notre identité de classe par la lutte. Seuls le combat et la lutte pourront offrir une réelle perspective politique à cette société d'exploitation qui ne mène qu'à la désolation, à la misère et à la destruction.
Joffrey, 5 septembre 2017
1Le Monde du 18 juillet 2017 : “On ne les met pas au lit, on les jette” : enquête sur le quotidien d’une maison de retraite.
2L’Humanité du 28 juillet 2017 : Maison de retraite : 117 jours de grève et une victoire sur toute la ligne.
3Lutte Ouvrière du 2 août 2017 : Opalines de Foucherans : fin de grève victorieuse !
Géographique:
- France [15]
Situations territoriales:
Rubrique:
Octobre 1917 : la révolution prolétarienne est nécessaire et réalisable
- 1327 lectures
Dans nos discussions, surtout avec de jeunes éléments, nous entendons fréquemment “C’est vrai que ça va très mal, qu’il y a de plus en plus de misère et de guerre, que nos conditions de vie se dégradent, que l’avenir de la planète est menacée. Il faut faire quelque chose, mais quoi ? Une révolution ? Alors ça, c’est de l’utopie, c’est impossible !”. C’est la grande différence entre mai 1968 et aujourd’hui. En 1968, l’idée de révolution était partout présente alors que la crise commençait juste à frapper à nouveau. Aujourd’hui, le constat de la faillite du capitalisme est devenu général mais il existe par contre un grand scepticisme quant à la possibilité de changer le monde. Les termes de communisme, de lutte de classe, résonnent comme un rêve d’un autre temps. Parler de classe ouvrière et de bourgeoisie serait même dépassé.
Or, il existe dans les faits, dans l’histoire, une réponse à ces doutes. Il y a 100 ans, le prolétariat a apporté la preuve, par ses actes, qu’on pouvait changer le monde. La révolution d’Octobre 1917 en Russie, la plus grandiose action des masses exploitées à ce jour, a en effet montré que la révolution n’est pas seulement nécessaire mais qu’elle est aussi possible !
La force d’Octobre 1917 : le développement de la conscience...
La classe dominante déverse un flot continuel de mensonges sur cet épisode. Les ouvrages comme la Fin d’une illusion ou le Livre noir du communisme ne font que reprendre à leur compte une propagande circulant déjà à l’époque : la révolution n’aurait été qu’un “putsch” des bolcheviks, Lénine aurait été un agent de l’impérialisme allemand, etc. Les bourgeois conçoivent les révolutions ouvrières comme un acte de démence collective, un chaos effrayant qui finit épouvantablement.1 L’idéologie bourgeoise ne peut pas admettre que les exploités puissent agir pour leur propre compte. L’action collective, solidaire et consciente de la majorité travailleuse, est une notion que la pensée bourgeoise considère comme une utopie anti-naturelle.
Pourtant, n’en déplaise à nos exploiteurs, la réalité c’est bien qu’en 1917, la classe ouvrière a su se dresser collectivement et consciemment contre ce système inhumain. Elle a démontré que les ouvriers n’étaient pas des bêtes de somme, juste bons à obéir et à travailler. Au contraire, ces événements révolutionnaires ont révélé les capacités grandioses et souvent même insoupçonnées du prolétariat en libérant un torrent d’énergie créatrice et une prodigieuse dynamique de bouleversement collectif des consciences. John Reed résume ainsi cette vie bouillonnante et intense des prolétaires au cours de l’année 1917 :
“La Russie tout entière apprenait à lire ; elle lisait de la politique, de l’économie, de l’histoire, car le peuple avait besoin de savoir. (...) La soif d’instruction si longtemps refrénée devint avec la révolution un véritable délire. Du seul Institut Smolny sortirent chaque jour, pendant les six premiers mois, des tonnes de littérature, qui par tombereaux et par wagons allaient saturer le pays. (...) Et quel rôle jouait la parole ! On tenait des meetings dans les tranchées, sur les places des villages, dans les fabriques. Quel admirable spectacle que les 40 000 ouvriers de Poutilov allant écouter des orateurs social-démocrates, socialistes-révolutionnaires, anarchistes et autres, également attentifs à tous et indifférents à la longueur des discours pendant des mois, à Pétrograd et dans toute la Russie, chaque coin de rue fut une tribune publique. Dans les trains, dans les tramways, partout jaillissait à l’improviste la discussion. (...) Dans tous les meetings, la proposition de limiter le temps de parole était régulièrement repoussée ; chacun pouvait librement exprimer la pensée qui était en lui.”2 La “démocratie” bourgeoise parle beaucoup de “liberté d’expression” quand l’expérience nous dit que tout en elle, est manipulation, théâtre et lavage de cerveau. L’authentique liberté d’expression est celle que conquièrent les masses ouvrières dans leur action révolutionnaire :
“Dans chaque usine, dans chaque atelier, dans chaque compagnie, dans chaque café, dans chaque canton, même dans les bourgades désertes, la pensée révolutionnaire réalisait un travail silencieux et moléculaire. Partout surgissaient des interprètes des événements, des ouvriers à qui on pouvait demander la vérité sur ce qui s’était passé et de qui on pouvait attendre les mots d’ordre nécessaires. (...) Ces éléments d’expérience, de critique d’initiative, d’abnégation, se développaient dans les masses et constituaient la mécanique interne inaccessible au regard superficiel, cependant décisive, du mouvement révolutionnaire comme processus conscient.”3
Cette capacité de la classe ouvrière à rentrer en lutte collectivement et consciemment n’est pas un miracle soudain, elle est le fruit de nombreuses luttes et d’une longue réflexion souterraine. Marx comparait souvent la classe ouvrière à une vielle taupe creusant lentement son chemin pour surgir plus loin à l’air libre de façon soudaine et impromptue. A travers l’insurrection d’Octobre 1917, apparaît la marque des expériences de la Commune de Paris de 1871 et de la révolution de 1905, des batailles politiques de la Ligue des communistes, des Première et IIe Internationales, de la gauche de Zimmerwald, des Spartakistes en Allemagne et du Parti bolchevik en Russie. La Révolution russe est certes une réponse à la guerre, à la faim et à la barbarie du tsarisme moribond, mais c’est aussi et surtout une réponse consciente, guidée par la continuité historique et mondiale du mouvement prolétarien. Concrètement, les ouvriers russes ont vécu avant l’insurrection victorieuse les grandes luttes de 1898, 1902, la Révolution de 1905 et les batailles de 1912-14.
“Il était nécessaire de compter non avec une quelconque masse, mais avec la masse des ouvriers de Pétrograd et des ouvriers russes en général, qui avaient vécu l’expérience de la Révolution de 1905, l’insurrection de Moscou du mois de décembre de la même année, et il était nécessaire qu’au sein de cette masse, il y eut des ouvriers qui avaient réfléchi sur l’expérience de 1905, qui avaient assimilé la perspective de la révolution, qui s’étaient penchés une douzaine de fois sur la question de l’armée.”4
C’est ainsi qu’Octobre 17 fut le point culminant d’un long processus de prise de conscience des masses ouvrières aboutissant, à la veille de l’insurrection, à une atmosphère profondément fraternelle dans les rangs ouvriers. Cette ambiance est perceptible, presque palpable dans ces quelques lignes de Trotski : “Les masses ressentaient le besoin de se tenir serrées, chacun voulait se contrôler lui-même à travers les autres, et tous, d’un esprit attentif et tendu, cherchaient à voir comment une seule et même pensée se développait dans leur conscience avec ses diverses nuances et caractéristiques. (...) Des mois de vie politique fébrile (...) avaient éduqué des centaines et des milliers d’autodidactes. (...) La masse ne tolérait déjà plus dans son milieu les hésitants, ceux qui doutent, les neutres. Elle s’efforçait de s’emparer de tous, de les attirer, de les convaincre, de les conquérir. Les usines conjointement avec les régiments envoyaient des délégués au front. Les tranchées se liaient avec les ouvriers et les paysans du plus proche arrière-front. Dans les villes de cette zone avaient lieu d’innombrables meetings, conciliabules, conférences, dans lesquels les soldats et les matelots combinaient leur action avec celle des ouvriers et des paysans.”5
Grâce à cette effervescence de débats, les ouvriers purent ainsi effectivement gagner à leur cause les soldats et les paysans. La révolution de 1917 correspond à l’être même du prolétariat, classe exploitée et révolutionnaire à la fois qui ne peut se libérer que si elle est capable d’agir de manière collective et consciente. La lutte révolutionnaire du prolétariat constitue l’unique espoir de libération pour toutes les masses exploitées. La politique bourgeoise est toujours au profit d’une minorité de la société. A l’inverse, la politique du prolétariat ne poursuit pas un bénéfice particulier mais celui de toute l’humanité. “La classe exploitée et opprimée (le prolétariat) ne peut plus se libérer de la classe qui l’exploite et l’opprime (la bourgeoisie), sans libérer en même temps et à tout jamais, la société entière de l’exploitation, de l’oppression et des luttes de classes.”(6
... et de l’organisation de la classe ouvrière
Cette effervescence de discussion, cette soif d’action et de réflexion collective s’est matérialisée très concrètement à travers les soviets (ou conseils ouvriers), permettant aux ouvriers de s’organiser et de lutter comme une classe unie et solidaire.
La journée du 22 octobre, appelée par le Soviet de Petrograd, scella définitivement l’insurrection : des meetings et des assemblées se tinrent dans tous les quartiers, dans toutes les usines, et ils furent massivement d’accord : “A bas Kerenski !”7, “Tout le pouvoir aux Soviets !”. Ce ne furent pas seulement les bolcheviks, mais tout le prolétariat de Petrograd qui décida et exécuta l’insurrection. Ce fut un acte gigantesque dans lequel les ouvriers, les employés, les soldats, de nombreux cosaques, des femmes, des enfants, marquèrent ouvertement leur engagement.
“L’insurrection fut décidée, pour ainsi dire, pour une date fixée : le 25 octobre. Elle ne fut pas fixée par une réunion secrète, mais ouvertement et publiquement, et la révolution triomphante eut lieu précisément le 25 octobre (6 novembre dans le calendrier russe) comme il était prévu d’avance. L’histoire universelle a connu un grand nombre de révoltes et de révolutions : mais nous y chercherions en vain une autre insurrection d’une classe opprimée qui ait été fixée à l’avance et publiquement, pour une date annoncée, et qui ait été accomplie victorieusement, le jour annoncé. En ce sens et en de nombreux autres, la révolution de novembre est unique et incomparable.”8
Dans toute la Russie, bien au delà de Petrograd, une infinité de soviets locaux appelaient à la prise du pouvoir ou le prenaient effectivement, faisant triompher partout l’insurrection. Le parti bolchevik savait parfaitement que la révolution n’était l’affaire ni du seul parti ni des seuls ouvriers de Petrograd mais du prolétariat tout entier. Les événements ont prouvé que Lénine et Trotski avaient raison de mettre en avant que les soviets, dès leur surgissement spontané dans les grèves de masse de 1905, représentaient la “forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat”. En 1917, cette organisation unitaire de l’ensemble de la classe en lutte joua, à travers la généralisation d’assemblées souveraines et sa centralisation par délégués éligibles et révocables à tout moment, un rôle politique essentiel et déterminant dans la prise de pouvoir, alors que les syndicats n’y jouèrent aucun rôle.
Aux côtés des soviets, une autre forme d’organisation de la classe ouvrière joua un rôle fondamental et même vital pour la victoire de l’insurrection : le parti bolchevik. Si les soviets permirent à toute la classe ouvrière de lutter collectivement, le parti (représentant quant à lui la fraction la plus consciente et déterminée) eut pour rôle de participer activement au combat, de favoriser le développement le plus large et profond de la conscience et d’orienter de façon décisive (par des mots d’ordre) l’activité de la classe. Ce sont les masses qui prennent le pouvoir, ce sont les soviets qui assurent l’organisation mais le parti de classe est une arme indispensable à la lutte. En juillet 1917, c’est le parti qui épargnait à la classe une défaite décisive.9 En octobre 1917, c’est encore lui qui mit la classe sur le chemin du pouvoir. Par contre, la révolution d’octobre a montré de façon vivante que le parti ne peut et ne doit pas remplacer les soviets : s’il est indispensable que le parti assume la direction politique autant dans la lutte pour le pouvoir que dans la dictature du prolétariat, ce n’est pas sa tâche de prendre le pouvoir. Celui-ci doit rester dans les mains non d’une minorité (aussi consciente et dévouée soit-elle) mais de toute la classe ouvrière à travers le seul organisme qui la représente comme un tout : les soviets. Sur ce point, la révolution russe fut une douloureuse expérience puisque le parti étouffa peu à peu la vie et l’effervescence des conseils ouvriers. Mais sur cette question, ni Lénine et les autres bolcheviks, ni les Spartakistes en Allemagne n’étaient complètement clairs en 1917 et ils ne pouvaient pas l’être. Il ne faut pas oublier qu’octobre 1917 est la première expérience pour la classe ouvrière d’une insurrection victorieuse à l’échelle de tout un pays !
La révolution internationale n’est pas le passé mais l’avenir de la lutte de classe
“La Révolution russe n’est qu’un détachement de l’armée socialiste mondiale, et le succès et le triomphe de la révolution que nous avons accomplie dépendent de l’action de cette armée. C’est un fait que personne parmi nous n’oublie (...). Le prolétariat russe a conscience de son isolement révolutionnaire, et il voit clairement que sa victoire a pour condition indispensable et prémisse fondamentale, l’intervention unie des ouvriers du monde entier” (Lénine, 23 juillet 1918).
Pour les bolcheviks, il était clair que la Révolution russe n’était que le premier acte de la révolution internationale. L’insurrection d’octobre 1917 constituait de fait le poste le plus avancé d’une vague révolutionnaire mondiale, le prolétariat livrant des combats titanesques qui ont failli venir réellement à bout du capitalisme. En 1917, il renverse le pouvoir bourgeois en Russie. Entre 1918 et 1923, il mène de multiples assauts dans le principal pays européen, l’Allemagne. Rapidement, cette vague révolutionnaire se répercute dans toutes les parties du monde. Partout où il existe une classe ouvrière développée, les prolétaires se dressent et se battent contre leurs exploiteurs : de l’Italie au Canada, de la Hongrie à la Chine.
Cette unité et cet élan de la classe ouvrière à l’échelle internationale ne sont pas apparus par hasard. Ce sentiment commun d’appartenir partout à la même classe et au même combat correspond à l’être même du prolétariat. Quel que soit le pays, la classe ouvrière est sous le même joug de l’exploitation, a en face d’elle la même classe dominante et le même système d’exploitation. Cette classe d’exploitée forme une chaîne traversant les continents, chaque victoire ou défaite de l’une de ses parties touche inexorablement l’ensemble. C’est pourquoi la théorie communiste a placé depuis ses origines l’internationalisme prolétarien, la solidarité de tous les ouvriers du monde, à la tête de ses principes. “Prolétaires de tous les pays, unissez-vous”, tel était le mot d’ordre du Manifeste communiste rédigé par Marx et Engels. Ce même manifeste affirmait clairement que “les prolétaires n’ont pas de patrie”. La révolution du prolétariat, qui seule peut mettre fin à l’exploitation capitaliste et à toute forme d’exploitation de l’homme par l’homme, ne peut avoir lieu qu’à l’échelle internationale. C’est bien cette réalité qui était exprimée avec force dès 1847 : “La révolution communiste (...) ne sera pas une révolution purement nationale ; elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés (...). Elle exercera également sur tous les autres pays du globe une répercussion considérable et elle transformera complètement et accélérera le cours de leur développement. Elle est une révolution universelle ; elle aura, par conséquent, un terrain universel.”10
La dimension internationale de la vague révolutionnaire des années 1910-1920 prouve que l’internationalisme prolétarien n’est pas un beau et grand principe abstrait mais qu’il est au contraire une réalité réelle et tangible. Face au nationalisme sanguinaire et viscéral des bourgeoisies se vautrant dans la barbarie de la Première Guerre mondiale, la classe ouvrière a opposé sa lutte et sa solidarité internationale. “Il n’y a pas de socialisme en dehors de la solidarité internationale du prolétariat”, tel était le message fort et clair des tracts circulant dans les usines en Allemagne.11 La victoire de l’insurrection d’octobre 1917 puis la menace de l’extension de la révolution en Allemagne a contraint les bourgeoisies à mettre un terme à la première boucherie mondiale, à cet ignoble bain de sang. En effet, la classe dominante a dû faire taire ses antagonismes impérialistes qui la déchiraient depuis quatre années afin d’opposer un front uni et endiguer la vague révolutionnaire.
La vague révolutionnaire du siècle dernier a été le point culminant atteint par l’humanité jusqu’à ce jour. Au nationalisme et à la guerre, à l’exploitation et à la misère du monde capitaliste, le prolétariat a su ouvrir une autre perspective, sa perspective : l’internationalisme et la solidarité de toutes les masses opprimées. La vague d’Octobre 17 a ainsi prouvé la force de la classe ouvrière. Pour la première fois, une classe exploitée a eu le courage et la capacité de saisir le pouvoir des mains des exploiteurs et d’inaugurer la révolution prolétarienne mondiale ! Même si la révolution devait être bientôt défaite, à Berlin, à Budapest et à Turin et bien que le prolétariat russe et mondial ait dû payer cette défaite d’un prix terrible (les horreurs de la contre-révolution stalinienne, une deuxième guerre mondiale et toute la barbarie qui n’a cessé depuis), la bourgeoisie n’a toujours pas été capable d’effacer complètement de la mémoire ouvrière cet événement exaltant et ses leçons. L’ampleur des falsifications de la bourgeoisie sur Octobre 17 est à la mesure des frayeurs qu’elle a éprouvées. La mémoire d’octobre est là pour rappeler au prolétariat que le destin de l’humanité repose entre ses mains et qu’il est capable d’accomplir cette tâche grandiose. La révolution internationale représente plus que jamais l’avenir !
Pascale
1 Le dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman nommé Anastasia qui présente la Révolution russe comme un coup de Raspoutine ayant jeté un sort maléfique et démoniaque au peuple russe en est une caricature très grossière mais aussi très révélatrice !
2 John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde.
3 Trotski, Histoire de la Révolution russe, chap. “Regroupement dans les masses”.
4 Trotski, Ibid., chap. “Le paradoxe de la révolution de février”.
5 Trotski, Ibid., chap. “La sortie du pré-parlement”.
6 Engels, “Préface de 1883” au Manifeste communiste.
7 Chef du gouvernement provisoire bourgeois formé depuis Février.
8 Trotski, La Révolution de novembre.
9 Lire notre article : Les journées de juillet : le rôle indispensable du parti.
10 F. Engels, Principes du communisme.
11 Formule de Rosa Luxemburg dans La crise de la sociale-démocratie, reprise par de très nombreux tracts spartakistes.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [34]
Rubrique:
Révolution Internationale n° 467 - novembre décembre 2017
- 510 lectures
Affrontements en Catalogne: le passé réactionnaire est dans la démocratie et la nation! Le futur appartient au prolétariat!
- 760 lectures
En Espagne, le prolétariat est aujourd’hui piégé dans un faux choix mortel : nationalisme espagnol ou nationalisme catalan. Il y a tout juste 6 ans, lors du mouvement des Indignés en 2011, de Madrid à Barcelone, les assemblées n’étaient pas couvertes de drapeaux patriotiques. Au contraire ! Les débats étaient traversés d’un sentiment international, d’une ouverture sur le monde, d’une préoccupation pour l’avenir de toute l’humanité, d’une volonté d’étendre une seule et même lutte par-delà les frontières. Les événements actuels en Espagne sont donc la marque d’une profonde régression de la conscience ouvrière, du repli, de la peur et de la division. C’est un coup porté au prolétariat dans tous les pays. Face à cette dynamique dangereuse, il est impératif de réaffirmer que les prolétaires n’ont pas de patrie ! Ni l’Espagne, ni la Catalogne ! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! C’est ce qu’a fait Acción Prolétaria, section du CCI en Espagne, en diffusant dès le lendemain du référendum du 1er octobre le tract dont nous publions la traduction ci-dessous.
Le 1er octobre dernier, les masses populaires conduites par les indépendantistes catalans à la farce du référendum ont été brutalement frappées par la répression du gouvernement espagnol. Les fractions rivales se sont drapées dans le manteau de la démocratie pour mieux justifier, pour les unes, la répression et, pour les autres, le vote. Les catalanistes se sont présentés comme les victimes de la répression pour mettre en avant leur revendication d’indépendance. Le gouvernement Rajoy a justifié sa barbarie répressive au nom de la défense de la Constitution et des droits démocratiques de tous les Espagnols. Les partis “neutres” (Podemos, le parti d’Ada Colau(1), etc.) ont invoqué la démocratie pour s’en prendre à Rajoy et le sommer de “trouver une solution” au conflit catalan.
Nous voulons dénoncer ce piège créé par la lutte entre fractions du capital qui pousse à choisir entre, d’un côté, l’escroquerie d’un référendum truqué et, de l’autre, la répression brutale du gouvernement espagnol. Des deux côtés, c’est la classe ouvrière et tous les exploités qui en sont les victimes.
Tous nous présentent la démocratie comme le Bien suprême. Cependant, ils veulent nous faire oublier que derrière le masque de la démocratie se cache l’État totalitaire. Tout autant que les régimes militaires ou de Parti unique, l’État démocratique est la dictature exclusive du capital qui impose au nom du vote populaire ses intérêts et ses visées contre l’intérêt de tous les exploités et de tous les opprimés.
Pendant la Première Guerre mondiale, avec ses 20 millions de morts, toutes les puissances ont justifié leur barbarie au nom de la défense de la démocratie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que le camp nazi des vaincus ait installé un régime de terreur qui s’appuyait sur des idéologies ouvertement réactionnaires comme “la suprématie de la race aryenne”, le camp des vainqueurs qui rassemblait non seulement les puissances démocratiques mais aussi le brutal régime stalinien de l’URSS s’est paré des atours de la démocratie pour justifier sa participation à une barbarie qui s’est soldée par 60 millions de morts, y compris l’utilisation directe de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. C’est au nom de la défense de la démocratie que la République espagnole a également réussi à embrigader ouvriers et paysans dans le terrible massacre qu’a représenté la guerre civile de 1936 entre les deux fractions de la bourgeoisie (républicaine et franquiste) qui a fait un million de morts.
C’est au nom de la démocratie, en utilisant le régime constitutionnel de 1978 que tous, les franquistes à la façade ravalée comme les champions de la démocratie, nous ont imposé une dégradation inexorable de nos conditions de vie et de travail qui nous a conduits à la situation actuelle où l’emploi stable a été remplacé par la précarité généralisée. A cette dégradation ont contribué aussi bien les dirigeants nationalistes catalans que les dirigeants nationalistes espagnols. Souvenons-nous que le gouvernement autonome d’Artur Mas en 2011-2012 fut le pionnier des coupes claires taillées dans le secteur de la santé, de l’éducation, dans les allocations chômage, etc., et que ces mesures ont été ensuite généralisées à toute l’Espagne par le gouvernement Rajoy !
Dirigeants espagnols comme catalans ont les mains tâchées du sang de leur répression des luttes ouvrières. La démocratie a débuté dans l’Espagne postfranquiste avec la mort de cinq ouvriers au cours de la grève massive de Vitoria en 1976. Sous le gouvernement “socialiste” de Felipe Gonzalez, trois ouvriers furent assassinés au cours de luttes à Gijon, Bilbao et Reinosa. Le gouvernement autonome catalan d’Artur Mas a déchaîné une brutale répression contre les assemblées générales des Indignados faisant cent blessés. Auparavant, en 1934, ses actuels partenaires de l’ERC(2) avaient organisé une milice (les Escamots) spécialisée dans la torture des militants ouvriers.
Et tous se permettent d’enfreindre leurs propres règles démocratiques qu’ils proclament être leur idéal. On a vu la fraction catalaniste imposer de force grâce à un traficotage parlementaire sa procédure pour l’indépendance avec ses urnes bourrées, remplies jusqu’à ras bord de bulletins en faveur du “oui”.
Au nom de la sacro-sainte démocratie se livre une guerre à mort autour d’un autre pilier de la domination capitaliste : la Nation. La Nation n’est pas le regroupement “fraternel” de tous ceux nés sur un même territoire, mais elle est la propriété privée de l’ensemble des capitalistes d’un pays qui organisent à travers l’État l’exploitation et l’oppression de tous leurs assujettis. Les aspirants à une nouvelle “mère patrie”, les indépendantistes catalans, se présentent comme des victimes de la barbarie de leurs rivaux et prétendent que “Madrid nous vole” pour mobiliser de la chair à canon au nom de la “défense d’une véritable démocratie”. Leur “véritable démocratie” consiste dans l’exclusion de ceux qui ne sont pas en communion avec leurs objectifs. Le harcèlement de ceux qui ne vont pas voter, les fichages et les heurts vis-à-vis des non-adeptes de leur cause, le chantage moral envers ceux qui, simplement, veulent garder un esprit critique. Dans toutes les zones sous leur coupe, ils ont imposé la dictature de leurs associations “citoyennes” et, avec les armes de l’insulte, de la calomnie, de l’ostracisme, du harcèlement, du contrôle, ils essaient “d’homogénéiser” la population autour de la Catalogne. Avec un culot chaque fois plus insolent, les groupes indépendantistes déploient des méthodes nazies et théorisent la “pureté” de la “race catalane”.
De leur côté, les démocrates nationalistes espagnols ne sont pas en reste. La haine contre les catalans, la manœuvre de déplacement du siège de grandes entreprises hors de la Catalogne, les mobilisations soi-disant “spontanées” en faveur des forces de répression encouragées par le cri barbare : “Allez-y, on se les fait !” qui rappelle le sinistre : “Allez l’ETA(3), tuez-les !” des nationalistes basques, l’appel à accrocher aux fenêtres des drapeaux sang et or aux couleurs de l’Espagne, tout cela montre le déchaînement de la bête fauve de sinistre mémoire qui, avec le franquisme, a servi de levier pour installer un régime de terreur.
Ce que les deux bandes rivales partagent, c’est l’exclusion et la xénophobie, ainsi toutes deux se rejoignent dans une même haine du migrant, le même mépris envers les travailleurs arabes, latino-américains ou asiatiques, avec leurs slogans répugnants : “ils nous enlèvent le pain de la bouche”, “ils volent nos emplois”, “ils allongent les queues aux portes des services de Santé”, etc., alors que c’est la crise du capitalisme et l’incapacité de ses États, que ce soit celui de l’Espagne ou de la Généralité de Catalogne, qui sont responsables de la dégradation des conditions de vie de tous et qui poussent des milliers de jeunes vers une nouvelle vague d’émigration qui rappelle celle des années 1950-1960, à l’époque franquiste.
Au milieu de cette sauvage confrontation, les “neutres” du parti Podemos et du parti d’Ana Colau tentent de nous faire croire que la démocratie avec son fameux “droit de décider par nous-mêmes” serait le remède qui permettrait la négociation et une “issue citoyenne”. Dans ce concert d’illusions dont on nous berce, est apparue une initiative : “Parlons ensemble” qui veut mettre de côté les deux drapeaux nationaux (celui de l’Espagne et celui de la Catalogne) pour lever le “drapeau blanc” du dialogue et de la démocratie.
Le prolétariat et tous les exploités ne peuvent pas se faire d’illusions. Le conflit qui a germé en Catalogne est du même acabit que les conflits populistes et aventuristes qui ont amené au Brexit en Grande-Bretagne ou à l’intronisation d’un fou irresponsable, Trump, à la tête de la première puissance mondiale. C’est l’expression de la dégénérescence et de la décomposition qui provoque l’aggravation d’une crise, non seulement économique mais également politique au sein des différents États capitalistes.
Pour le capitalisme actuel “tout va bien dans le meilleur des mondes”, “nous allons sortir de la crise”, grâce aux “progrès technologiques” et au dynamisme mondial. Mais, sous cette couche superficielle de vernis brillant, ce qui mûrit souterrainement avec chaque fois plus de force, c’est la violence des contradictions du capitalisme, la guerre impérialiste, la destruction de l’environnement, la barbarie morale, les tendances centrifuges au chacun pour soi sur lesquelles s’appuient (en même temps qu’ils la nourrissent de plus belle) la prolifération de conceptions et d’actions xénophobes, d’exclusions endogamiques.
Ce volcan sur lequel nous dansons est entré en éruption à maintes reprises, comme récemment en Extrême-Orient avec le danger de guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis, mais il se manifeste aussi à travers le conflit catalan. Sous une forme apparemment civilisée et démocratique, entrecoupée de prétendues “négociations” et de “trêves”, la situation va en se dégradant progressivement et fait courir le risque de s’enkyster et de devenir insoluble, ce qui ne peut qu’engendrer des tensions chaque fois plus brutales. Même, si jusqu’à présent, il n’y a pas eu de morts, le danger encouru est chaque fois plus grand. Un climat social de fracture, d’affrontements violents et d’intimidation est en train de s’enraciner dans toute la société, non seulement en Catalogne, mais dans toute l’Espagne. D’ores et déjà, est en train de croître le nombre de personnes qui, ne pouvant plus supporter leur situation, abandonnent leurs amis, leurs enfants, leur travail…
Ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, c’est ce que, face à la barbarie de la Première Guerre mondiale, en 1915, décrivait la révolutionnaire Rosa Luxemburg de manière profonde et prophétique : “Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment”.(4)
Le danger pour le prolétariat et pour le futur de l’humanité, c’est de rester coincé dans cette atmosphère suffocante générée par l’imbroglio catalan qui pousse à ce que les sentiments, les aspirations, les réflexions ne gravitent plus autour de : quel futur est possible pour l’humanité ? Quelle réponse donner à la précarité et aux salaires de misère ? Quelle issue existe face la dégradation générale des conditions de vie ? Mais, au contraire, cela polarise l’attention sur le choix entre l’Espagne et la Catalogne, sur la Constitution, sur le droit à l’autodétermination, sur la nation,... c’est-à-dire sur les facteurs qui ont précisément contribué à nous mener dans la situation actuelle et qui menacent de les porter à leur paroxysme.
Nous sommes conscients de l’état de faiblesse que traverse aujourd’hui le prolétariat, cependant cela ne nous empêche pas de reconnaître que c’est seulement de sa lutte autonome comme classe que peut émerger une solution. La contribution à cette orientation exige de s’opposer aujourd’hui à la mobilisation en faveur de la démocratie, au faux choix entre Espagne et Catalogne, au terrain national. La lutte du prolétariat et l’avenir de l’humanité ne peuvent être réglés seulement qu’en dehors et contre ces terrains pourris que sont la démocratie et la Nation.
CCI, 9 octobre 2017
1) Maire de Barcelone depuis mai 2015, Ada Colau a été élue à la tête d’une coalition Barcelona en Comú (BC) rassemblant divers “mouvements citoyens” catalans (Esquerra Unida i Alternativa, y compris le Parti Communiste Catalan, Verts, Democratia Real Ya !, entre autres) se présentant comme défenseur des droits sociaux, de la démocratie et des intérêts de la Catalogne.
2) Ezquerra Republicana de Catalunya (Gauche républicaine de Catalogne).
3) Euskadi Ta Askatasuna : branche armée du nationalisme basque, responsable d’attentats terroristes, d’assassinats, d’enlèvements, de séquestrations qui ont fait plus de 800 morts, civils comme militaires depuis les années 1960. En contrepartie, l’État central a créé les Groupes antiterroristes de libération (GAL), auteurs de nombreux attentats et assassinats entre 1983 et 1987 dont certains visaient à provoquer la terreur contre des civils et qui avaient pour but d’éradiquer les militants (ou supposé tels) d’ETA.
4) La Crise de la Social-démocratie – Brochure de Junius, chapitre 1 : Socialisme ou barbarie ?
Géographique:
- Espagne [14]
Récent et en cours:
- Catalogne [75]
Editorial: seul le prolétariat peut mettre fin au capitalisme et à ses guerres!
- 619 lectures
Si le XXème siècle a été le plus barbare de l’histoire, avec ses deux Guerres mondiales et son cortège de conflits faisant de la guerre impérialiste une réalité permanente et débouchant sur l’ère terrifiante de l’arme atomique, le nouveau siècle prolonge ce sinistre héritage de nouvelles souffrances.
La survie du capitalisme mène à la destruction de l’humanité
Dans ce contexte général de terreur et de barbarie, la nouvelle polarisation autour de l’arme atomique nord-coréenne, l’escalade des provocations et des insultes incarnées par le duel de personnalités politiques grotesques, Trump et Kim Jong-un, semblant interpréter une sorte de comédie ridicule dont l’improvisation expose les populations civiles au risque toujours possible d’un dérapage nucléaire, constituent les éléments formant la loupe grossissante de ce vers quoi nous conduit le monde capitaliste : la destruction de l’humanité.
Que ce soit en Corée ou en Europe occidentale, indépendamment des cliques au pouvoir ou de la personnalité des dirigeants, c’est exactement le même système économique, le même mode de production qui est à l’œuvre au sein des États.1 Partout, il ne fait que générer les pires maux : misère et pauvreté, précarité, exploitation forcenée, chômage massif, désastres écologiques et massacres en tous genres. Partout dans le monde, les populations civiles et en particulier les prolétaires sont exposés à l’insécurité croissante du monde. Si, en Corée du Nord et en Asie, la peur de la menace nucléaire est plus palpable au niveau local, en Europe occidentale, comme c’est le cas dans d’autres régions du monde déjà en guerre, le terrorisme est devenu une menace permanente qui dresse son épée de Damoclès au-dessus de chacune de nos têtes. Comme toujours, c’est encore le prolétariat qui est l’otage de la classe dominante et qui fait les frais de son système et de sa terreur, de l’irrationalité de son engrenage guerrier. Si le système économique est partout identique, il exploite une même classe sociale au niveau international. Ainsi, dans les deux Corées, en Asie ou ailleurs, qu’ils soient réfugiés, sur le chemin de l’exil ou dans leur lieu d’exploitation, tous nos frères de classe sont attaqués en permanence et subissent un sort qui nous est finalement commun. C’est cette condition d’exploités au niveau international qui fait la réalité de notre unité, au-delà des divisions et des frontières nationales qui ont été dressées par la bourgeoisie et son histoire, au-delà des murs et des barbelés qu’elle continue de dresser entre les uns et les autres, entre frères de classe.
L’avenir appartient toujours au prolétariat
Il est vital de lutter fermement pour défendre l’unité du prolétariat en permanence attaquée, développer ses seules armes : la solidarité et la conscience de classe. C’est en cela, par exemple, que nous nous sentons pleinement solidaires de la déclaration internationaliste des camarades de Corée du Sud que nous publions dans ce numéro (voir page 4). Même si nous ne partageons pas tout ce qu’ils écrivent, notre premier devoir est de les soutenir pour défendre ce combat commun, celui d’une même classe. Ceci est d’autant plus important que la pression du nationalisme qui s’exerce partout dans le monde est particulièrement forte dans les pays de la périphérie du capitalisme. La déclaration des camarades en Corée du Sud est à ce titre d’autant plus courageuse. Ce danger du nationalisme, répétons-le, est une véritable menace pour la classe ouvrière, y compris en Europe occidentale où les divisions et pressions nationales s’exacerbent également, même si cela n’est pas au même niveau et sur le même plan. Ainsi, au sein même des États les plus faibles de la zone euro, par exemple, la gangrène de la fragmentation régionaliste s’installe progressivement et le poison du nationalisme croît. Si cela se vérifie de manière spectaculaire en Catalogne (voir notre article ci-dessous), on retrouve ces mêmes tendances centrifuges plus insidieuses ou embryonnaires, expressions de la phase de décomposition du capitalisme, en Italie, avec le cas des consultations sur l’autonomie régionale en Vénétie ou en Lombardie.
Ce que nous enseigne l’histoire, comme toute l’expérience du mouvement ouvrier, c’est que la seule force capable de s’opposer à cette barbarie, c’est la solidarité et l’unité du prolétariat en lutte. Durant la Première Guerre mondiale, par exemple, le ras-le-bol et le rejet de la boucherie poussèrent le prolétariat à la rébellion, à fraterniser un peu partout sur les fronts, montrant ainsi la réalité de sa force sociale et historique, sa capacité à développer sa solidarité et son unité par-delà les frontières. Et c’est ce qui poussera les bourgeoisies rivales de l’époque à mettre fin à la guerre pour lutter contre la “menace bolchevique” et la vague révolutionnaire qui déferla en Europe notamment, dont le point le plus élevé sera la prise du pouvoir en Octobre 1917 en Russie au terme d’un combat révolutionnaire héroïque (voir notre Manifeste page 8) qui fera trembler la bourgeoisie du monde entier jusqu’au milieu des années 1920. La lutte du prolétariat était bel et bien dirigée contre le système et sa guerre et non simplement contre les seuls excès du commandement militaire : “quant à la thèse officielle des hommes politiques, comme des historiens aux ordres, affirmant que les révoltes de 1917 étaient dirigées contre un commandement incompétent, elle a du mal à résister au fait que c’est dans les deux camps et sur la plupart des fronts qu’elles se sont produites : faut-il croire que la Première Guerre mondiale n’a été conduite que par des incapables ? Qui plus est, ces révoltes se sont produites alors que dans les autres pays on commençait à avoir des nouvelles de la révolution de février en Russie.2 En fait, ce que la bourgeoisie essaie de masquer, c’est le contenu prolétarien indiscutable des mutineries et le fait que la seule véritable opposition à la guerre ne peut provenir que de la classe ouvrière”.3
Aujourd’hui, les organisations révolutionnaires ont la responsabilité majeure de s’appuyer sur les leçons du passé et de comprendre les enjeux de la période historique pour permettre une véritable riposte contre le système d’exploitation et ses terribles menaces. Face aux attaques massives et aux destructions en cours, la seule réponse possible, il n’y en a pas d’autre, c’est d’engager une lutte consciente, solidaire et déterminée pour défendre nos conditions de vie et le futur de nos enfants. Si ce combat doit bien être celui de toute la classe ouvrière mondiale, revient aux prolétaires des pays centraux du capitalisme, d’Europe occidentale notamment, à travers leur expérience historique du combat prolétarien comme des pièges tendus par la bourgeoisie, la responsabilité de montrer le chemin de ce combat vital. Les révolutionnaires se doivent de lutter pour cela, avec un même objectif, celui de défendre le programme politique du prolétariat et le mot d’ordre plus actuel et nécessaire que jamais du Manifeste communiste : “Prolétaires de tous les pays, unissez-vous” !
WH, 24 octobre 2017
1 La Corée du Nord, pays prétendument “communiste”, n’est d’ailleurs que la caricature extrême du capitalisme d’État de type stalinien
2 Suite aux mutineries de l’armée française, une dizaine de milliers de soldats russes qui combattaient sur le front occidental aux côtés des soldats français ont été retirés du front et isolés jusqu’à la fin de la guerre dans le camp de La Courtine. Il ne fallait pas que l’enthousiasme qu’ils manifestaient pour la révolution qui se développait dans leur pays vienne contaminer les soldats français.
31918 - 1919 : la révolution prolétarienne met fin à la guerre impérialiste, Revue Internationale n°96, 1er trimestre 1999.
Histoire du Parti socialiste en France – 1878-1920 (Partie II): le chaotique processus d’unification du parti socialiste en France
- 545 lectures
Les différents courants socialistes en France vont se retrouver confrontés à deux épreuves majeures à la fin du XIXe siècle qui vont les diviser profondément, comme l’ensemble du mouvement ouvrier, et qui constitueront dans ce pays les principaux obstacles à leur unification organisationnelle recherchée par la Deuxième Internationale : l’Affaire Dreyfus et l’entrée du député socialiste Millerand dans le gouvernement.
Les divisions socialistes sur “l’Affaire Dreyfus”
L’Affaire Dreyfus a profondément divisé la bourgeoisie française pendant douze ans entre “dreyfusards” et “antidreyfusards”. La condamnation, fin 1894, du capitaine Dreyfus accusé d’espionnage était un complot judiciaire manigancé par le haut état-major et le ministère de la Guerre dans un contexte particulièrement propice à l’antisémitisme et à la haine de l’Empire allemand, suite à l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871. L’affaire rencontra au départ un écho limité, avant qu’en 1898 l’acquittement du véritable coupable et la publication d’un pamphlet dreyfusard par Emile Zola, J’accuse, provoquent une succession de crises politiques et sociales. L’affaire révéla les clivages de la France de la Troisième République, où l’opposition entre les deux camps suscita de très violentes polémiques nationalistes et antisémites, diffusées par une presse influente. Elle ne s’acheva véritablement qu’en 1906, par un arrêt de la Cour de Cassation qui innocenta et réhabilita définitivement Dreyfus.
Mais cet événement affecta également les rangs des socialistes. Avec raison, Jaurès se lança (et lança les socialistes) dans la défense de Dreyfus au nom de la défense des valeurs intellectuelles et morales du prolétariat : “[Le Parti socialiste] défend non seulement les intérêts matériels et immédiats de la classe ouvrière dans la société capitaliste, mais aussi et surtout ses intérêts généraux et permanents, ses intérêts sociaux, politiques et moraux. Il veut son émancipation intégrale. Il l’élève au-dessus de sa condition de classe exploitée pour lui conquérir celle d’une classe d’avant-garde, d’une classe révolutionnaire”.
Alors que Jaurès soutint que le parti devait se mobiliser pour la défense de Dreyfus et y engager l’ensemble du prolétariat contre l’aile la plus réactionnaire de la bourgeoisie, Guesde et le POF, après avoir un temps soutenu Jaurès contre la droite du parti soucieuse de ne pas perdre des députés aux élections suivantes, finit par prôner la neutralité du prolétariat et du parti en affirmant que ce n’était pas l’affaire du prolétariat de soutenir un camp contre l’autre mais celle de la bourgeoisie, que ni l’un ni l’autre n’ont à s’engager et ont tout à perdre sur un terrain étranger à la classe ouvrière. Guesde entreprit un long combat polémique contre les positions de Jaurès : “La lutte de classe (…) doit être (…) la règle de nos agissements. (…) C’est le terrain exclusif sur lequel nous nous plaçons. (…) Nous ne pouvons reconnaître à la bourgeoisie, lorsqu’une injustice frappe un des siens, le droit de s’adresser au prolétariat, de lui demander de cesser d’être lui-même, de combattre son propre combat, pour se mettre à la remorque des dirigeants les plus compromettants et les plus compromis”.1
Le “cas” Millerand
Mais cette polémique pris rapidement de l’ampleur et une autre dimension à travers le développement et les implications du “cas” Millerand, encore beaucoup plus sérieuses et déterminantes pour les socialistes. Dès le lendemain de l’entrée individuelle du député socialiste Millerand (qui deviendra par la suite président de la République de 1920 à 1924) dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau en juin 1899, aux côtés d’un des pires massacreurs de la Commune, le général de Galliffet. Guesde, Lafargue et Vaillant furent parmi les signataires d’un manifeste adressé aux ouvriers : “Le Parti socialiste, parti de classe, ne saurait devenir, sous peine de suicide, un parti ministériel. Il n’a pas à partager le pouvoir avec la bourgeoisie, dans les mains de laquelle l’État ne peut être qu’un instrument de conservation et d’oppression sociale. (…) Parti d’opposition nous sommes, parti d’opposition, nous devons rester, n’envoyant les nôtres dans les Parlements et autres assemblées électives qu’à l’état d’ennemis, pour combattre la classe ennemie et ses divers représentants politiques”. Guesde défendit avec passion l’idée d’un lien entre le positionnement dans l’Affaire Dreyfus et la complaisance du parti envers le “ministérialisme” de Millerand en affirmant qu’il y avait une continuité dans la dérive : “Pour une œuvre de justice et de réparation individuelle, il s’est mêlé à la classe ennemie, et le voilà maintenant entraîné à faire gouvernement commun avec cette classe”, et insista sur le fait que l’“unité socialiste (...) serait brisée à tout jamais le jour où (...) vous subordonneriez votre action à un morceau de la classe ennemie, qui ne saurait se joindre à nous que pour nous arracher à notre véritable et nécessaire champ de bataille. La Révolution qui vous incombe n’est possible que dans la mesure où vous resterez vous-mêmes, classe contre classe, ne connaissant pas et ne voulant pas connaître les divisions qui peuvent exister dans le monde capitaliste”.
Rosa Luxemburg critiqua, sans toutefois les désigner, l’erreur de méthode dans la position de Guesde et du POF qui, au nom des principes, poussait le prolétariat à se désintéresser de ce qui se passait au sein de la bourgeoisie et des rapports de forces qui pouvaient exister entre ses fractions. Elle affirma par rapport à l’attitude du parti vis-à-vis de l’Affaire Dreyfus que “Jaurès avait raison”. Mais elle soutint également les prises de position de Guesde et du POF pour condamner la complaisance et la dérive dangereuse de Jaurès et d’une grande partie du courant socialiste envers l’entrée de Millerand au sein d’un gouvernement bourgeois. Comme le souligne Rosa Luxemburg le danger majeur d’une telle participation était qu’elle engageait la responsabilité des socialistes dans les agissements de ce gouvernement. La participation d’un socialiste au gouvernement encouragea finalement davantage la bourgeoisie à agir de la manière la plus brutale contre les ouvriers en grève et à recourir en toute occasion à la force armée.
La détermination de Guesde à défendre le point de vue révolutionnaire dans le parti face au cas Millerand permit un ressaisissement du POF lui aussi infecté par le réformisme et le révisionnisme. Mais la confrontation entre Jaurès et ses alliés, d’un côté, et les partisans de Guesde déboucha sur une fracture qui compromit la dynamique unitaire des socialistes français recherchée par la Deuxième Internationale. Cette division éclata au premier congrès de 1899 à Paris qui devait rassembler toutes les tendances en vue d’un regroupement ; en fait ce congrès houleux a cristallisé une rupture profonde induite par les positionnements antagoniques pris à l’occasion de l’affaire Millerand.
Le rôle de l’Internationale dans l’unification du PS
Cette division politique profonde au sein du parti français conduisit à mettre la question de la participation d’un socialiste au gouvernement au cœur du congrès international en septembre 1900 à Paris, salle Wagram, où Guesde et le POF tentèrent de faire condamner l’initiative de Millerand et les positions des “ministérialistes” défendues notamment par Jaurès. La Deuxième Internationale vota une motion proposée par Kautsky qui condamnait l’initiative de Millerand car non dictée par une tactique discutée et mandatée par le parti. Elle refusait néanmoins d’y voir une question de principe.
Cependant, malgré la motion du Congrès, les partisans de Jaurès restaient toujours alliés aux partis bourgeois et continuèrent à soutenir le gouvernement dit “du Bloc des gauches” pour une prétendue “défense” de la République. En devenant un parti qui soutenait toujours et partout la politique du gouvernement, les jaurésistes votèrent des dépenses sans cesse accrues pour la marine et l’armée et financées quasi exclusivement par les impôts indirects pesant de tout leur poids sur les épaules des couches sociales les plus pauvres. Pris dans cet engrenage, les partisans de Jaurès durent également soutenir l’alliance franco-russe, en tant que prétendue “garantie” de la paix européenne. C’est alors que tous les socialistes révolutionnaires, Guesde en tête, ayant compris le danger d’une pareille trahison des principes du socialisme, rompirent leur alliance avec les partisans de Jaurès. Quelque temps après, les blanquistes dirigés par Vaillant firent de même et, en commun avec les guesdistes, créèrent le Parti socialiste de France. Ils déclarèrent une lutte sans merci aux fondateurs du Parti socialiste français dirigé par Jaurès et Millerand.
Cependant, la question se retrouva posée au congrès d’Amsterdam de l’Internationale socialiste en 1904. Après un réquisitoire contre la politique de Jaurès, Guesde fit adopter une résolution qui n’était en fait rien de plus qu’une traduction de celle adoptée l’année précédente par le SPD2 à Dresde, condamnant “les tactiques révisionnistes [dont le résultat] ferait qu’à la place d’un parti travaillant pour la transformation la plus rapide possible de la société bourgeoise existante en un ordre social socialiste, c’est-à-dire révolutionnaire dans le meilleur sens du terme, le parti deviendrait un parti se contentant de réformer la société bourgeoise”. C’était une condamnation explicite de l’entrée de Millerand dans le gouvernement et implicite du réformisme du Parti socialiste français de Jaurès. La politique de participation socialiste à un gouvernement bourgeois fut nettement condamnée par l’Internationale et Millerand exclu du parti. Les positions de soutien de Jaurès à ce gouvernement furent aussi sévèrement critiquées.
Mais, malgré les lourdes accusations formulées contre Jaurès, l’Internationale socialiste poussa à la réconciliation des socialistes français ; elle visait avant tout à rétablir une dynamique d’unification au sein du parti socialiste en France et son secrétaire, Vandervelde, poussa Jaurès et Guesde à se serrer la main et à collaborer activement à cette dynamique d’unification.
La pression et l’aide déterminante du SPD et de l’Internationale parvint ainsi à convaincre Jaurès de la nécessité de cette unification au point qu’il en devint la figure centrale et l’artisan principal. Elle parvint également à convaincre la composante révolutionnaire la plus conséquente du parti français de s’intégrer à cette dynamique d’unification. Sans ce soutien, cette unification n’aurait certainement pas abouti en mai 1905.
Rosa Luxemburg, en fournit un résumé et un commentaire pertinent dans l’article : L’unification des socialistes français, où elle rendit hommage au combat du Parti Socialiste de France en rappelant que “le Parti socialiste de France (formé par des guesdistes et des blanquistes) ne s’est jamais laissé abuser par une quelconque phraséologie démocratique ou nationaliste ; il est toujours demeuré en opposition absolue envers les gouvernements bourgeois et républicains en France”.
Les faiblesses congénitales et les dérives opportunistes
Cependant, ce succès contenait dès l’origine des faiblesses et des limites qui n’avaient pas été prises en compte et qui allaient s’avérer catastrophiques pour le mouvement ouvrier non seulement en France mais aussi pour la Deuxième internationale et, au sein de celle-ci, pour le parti le plus puissant, le SPD. Ces faiblesses congénitales allaient les conduire à la dégénérescence et finalement à la trahison d’août 1914. Quelles étaient ces faiblesses ?
En premier lieu, le poids d’une vision fédéraliste et non pas centralisée dans la Deuxième Internationale qui enfermait chaque parti dans un cadre d’action national donnant prise aux dérives nationalistes. Du fait même que le capital existe divisé en nations, les luttes pour la conquête des réformes (lorsqu’elles étaient possibles) n’avaient pas besoin du terrain international pour aboutir. Ce n’est pas 1e capital mondial qui décidait d’accorder telle ou telle amélioration au prolétariat de telle ou telle nation. C’est dans chaque pays, et dans sa lutte contre sa propre bourgeoisie nationale, que les travailleurs parvenaient à imposer leurs revendications. La Deuxième Internationale, qui correspondait à la période de stabilité des grandes puissances industrielles, souffrait inévitablement de l’enfermement des luttes prolétariennes dans le cadre des réformes. En fait, l’Internationale socialiste marquait, sur le terrain de 1’internationalisme, un recul par rapport à l’AIT. Le parlementarisme, le syndicalisme, la constitution des grands partis de masse, en somme, toute l’orientation du mouvement ouvrier vers des luttes pour des réformes, ont contribué à fractionner le mouvement ouvrier mondial suivant les frontières nationales. La trahison de la Deuxième Internationale en 1914 fut la pire conséquence de trente ans d’enfermement des luttes ouvrières dans les cadres nationaux. Il est d’ailleurs frappant de voir que pas un seul socialiste français ne salua, ne se référa ni même ne releva l’importance historique et internationale de la révolution de 1905 en Russie. Dans le parti, on continua au contraire à se focaliser sur la situation en France et à se gargariser avec le “modèle” de la révolution française.
Par ailleurs, entre 1889 et 1900, l’Internationale n’existait que pendant les sessions des congrès. Le reste du temps, elle n’était pas grand-chose de plus qu’un réseau de relations personnelles entre les différents dirigeants, sans réseau formel de correspondance. Mais même après qu’un Bureau socialiste international (BSI) fut constitué au Congrès de 1900, sa capacité d’action était limitée : le BSI était un simple organisme de coordination dont le rôle se réduisait en grande partie à organiser les congrès et à servir de médiateur dans les conflits ayant lieu entre les partis socialistes ou au sein de ceux-ci. Bien que l’aile gauche de l’Internationale (autour de Lénine et de Luxemburg en particulier) ait considéré les résolutions des congrès comme de véritables engagements, le BSI n’avait aucun pouvoir pour les faire respecter ; il n’avait pas de possibilité de mener une action indépendante des partis socialistes de chaque pays.
Ensuite, le souci permanent d’unité du mouvement socialiste, au départ pleinement justifié par le fait qu’il existait une unité d’intérêts au sein du prolétariat, du fait qu’il y avait un seul prolétariat dans chaque pays, ayant les mêmes intérêts de classe, allait se révéler à double tranchant. Si la Deuxième Internationale était profondément dévouée à l’unité des différents partis socialistes, les efforts qu’elle a concentrés pour cette unité et sa préservation se sont effectués au détriment direct de la défense intransigeante de la clarté et des principes des positions et de l’action révolutionnaires. Cette attitude favorisait au contraire, une position de compromis, de conciliation entre toutes les tendances qui ouvrait la voie (et même leur servait de justificatif) à toutes les dérives opportunistes.
Enfin, cette unification était marquée par les manifestations grandissantes du poids des illusions réformistes, des attitudes opportunistes et conciliatrices, s’appuyant sur les progrès électoraux des partis socialistes et sur ceux du syndicalisme, avec la vision de plus en plus théorisée du caractère inéluctable du socialisme et de la conquête parlementaire, et non plus révolutionnaire, du pouvoir. Cette illusion était particulièrement forte au sein du SPD qui était réellement devenu un parti de masse (plus d’un million de membres à la veille de 1914). Cette croissance numérique donnait l’illusion d’une grande force. Mais, alors que la direction du SPD, aveuglée par le succès électoral, avait axé ses activités sur les élections législatives, le parti perdait de vue l’objectif même du mouvement ouvrier. Ainsi, la montée du courant opportuniste et révisionniste, qui était apparu le plus clairement dans le plus grand parti de la Deuxième Internationale, signifiait que la vie prolétarienne, la combativité et l’indignation morale avaient disparu du SPD, du moins dans les rangs de sa direction et de sa bureaucratie.
Tous ces facteurs rejaillissaient au sein de l’Internationale, ouvrant la voie à l’abandon progressif de ses principes et à leur trahison. Le parti socialiste en France n’y a pas échappé.
Le parti unifié en France fut ainsi très vite confronté à une nouvelle crise face à la question syndicale : les erreurs, le sectarisme et l’opportunisme des guesdistes joueront un rôle tout aussi important que le poids des tendances réformistes et des compromissions avec des fractions bourgeoises ou avec l’appareil d’État, ce qui va enfermer le syndicalisme dans le corporatisme et faciliter à son tour son intégration dans l’appareil d’État. C’est ce que nous développerons dans le prochain article de cette série.
Wim, 30 mars 2017
1 Jules Guesde, Discours en réponse à Jaurès sur “Les deux méthodes”.
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Parti social-démocrate d’Allemagne (fondé en 1875 sous le nom de SAP, renommé SPD en 1890).
Macron, Philippe, Mélenchon et les syndicats: il n’y a rien à “exiger” d’un Etat capitaliste, il faut le combattre
- 637 lectures
Sur le plan des attaques contre la classe ouvrière, le quinquennat Macron est bien lancé. La rentrée se caractérise par une concrétisation tous azimuts des annonces de “réforme” qui ont émaillé l’été. Le décor se singularise par une inquiétante hausse de la CSG (la contribution sociale généralisée, une cotisation sociale créée par la gauche qui taxe uniformément tout type de revenus) dont la compensation promise est plus que fumeuse et reste encore à ce jour à l’état de promesse : baisse des cotisations salariales pour les uns, baisse de la taxe d’habitation pour les autres... Le Premier ministre Philippe le dit lui-même : quand vous ferez les comptes, vous verrez que vous y gagnez. Après tout les promesses n’engagent que ceux qui les croient. En réalité la classe ouvrière se trouve être une fois encore la cible d’attaques frontales, en étant en plus pointée du doigt comme un repaire de “privilégiés” comme les retraités, les fonctionnaires, etc.
Au milieu de ce décor, l’action principale est évidemment jouée par les ordonnances sur le travail. Après la loi El Khomri, l’année dernière, les ordonnances Macron enfoncent un peu plus le clou. Chaque nouvelle loi a toujours eu comme objectif principal de renforcer la productivité, diminuer le coût du travail pour les employeurs, aggraver les conditions de travail, étendre et généraliser la précarité. La bourgeoisie doit chaque fois adapter les conditions d’exploitation du prolétariat pour maintenir sa place face à une concurrence internationale féroce. Aucune réforme ne peut donc améliorer les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, mais les rend chaque fois pires et plus insupportables !
Cependant, jusqu’à maintenant, la bourgeoisie faisait passer la pilule en donnant le change, sous la forme d’une mesure bien médiatisée et présentée comme favorable aux travailleurs, comme un factice durcissement des conditions de licenciement. Par ailleurs, le principe dit “de faveur” était censé protéger les ouvriers des ardeurs démesurées de leurs patrons en interdisant à un accord ou une convention d’entreprise d’introduire une clause moins favorable que les dispositions du Code du travail. Tout ceci n’était que poudre aux yeux, avec un double objectif : présenter l’État et ses lois comme étant du côté des ouvriers face aux patrons sans morale et mettre en avant le travail prétendument indispensable des appareils syndicaux pour porter les revendications ouvrières et obtenir des contreparties inatteignables sans eux.
Mais aujourd’hui, même la poudre aux yeux s’est envolée. La dernière loi à se présenter comme favorable aux travailleurs était sans doute la loi Aubry sur les 35 heures, et on sait quels dégâts sur l’emploi et les conditions de travail elle a généré. La loi El Khomri n’a pas présenté de mesures faussement avantageuses au prolétariat, bien au contraire. Tout au plus a-t-elle “reculé” sur certaines des attaques les plus dures. Aujourd’hui les contreparties ne sont plus possibles et les reculs sont de courte durée.
Les ordonnances de Macron suivent la même logique : en n’allant pas aussi loin que ce qui était annoncé, elles donnent l’impression que l’État est à l’écoute des revendications syndicales. Mais dans le même temps, il introduit dans la loi les fameux “reculs” du gouvernement précédent et poursuit les attaques dans une logique d’ensemble qui consiste à déplacer la régulation de la relation capital-travail vers les organisations syndicales et patronales, c’est-à-dire à alléger le poids très lourd de l’État français qui face à la concurrence des États capitalistes européens et mondiaux, constitue une entrave pour la compétitivité du capital national.
La classe ouvrière n’a pas grand’ chose pour se rassurer dans ces ordonnances et cette inquiétude conduit à un certain mécontentement face à ce qui se présente comme un nouveau lot de sacrifices sans contreparties, même illusoires, même temporaires. Surtout que d’autres attaques sont déjà annoncées : réforme de l’assurance-chômage, unification (comprendre : alignement par le bas) des régimes de retraite, extension de la précarité, etc.
La question de savoir comment s’opposer à cette brutalité se pose et la bourgeoisie le sait parfaitement. Elle tend des pièges idéologiques pour éviter tout développement d’une quelconque réflexion sur la véritable nature de ces attaques et donc sur le seul moyen d’y faire face. Le premier d’entre eux se matérialise dans l’holographique Mélenchon qui entend fédérer toute la colère ouvrière derrière sa bannière de la France insoumise. Mais cette bannière a des reflets tricolores et ce nationalisme clairement revendiqué, la classe ouvrière doit le fuir. Mélenchon est un pur produit de la bourgeoisie qui a fait carrière dans les hautes sphères de l’État et continue de défendre le modèle républicain avec sa VIème République. Un modèle imprégné de son admiration ouverte pour Hugo Chavez, l’ex-dirigeant vénézuélien qui aura acheté la paix sociale à coups de pétrodollars et rendu son pays exsangue économiquement et en proie à la corruption généralisée.1 Mais surtout Mélenchon défend l’idée d’un État “juste”, illusion qu’il faut absolument rejeter et combattre.
Revenant d’exil en avril 1917 en plein cœur du bouillonnement qui allait conduire à l’insurrection d’Octobre, Lénine combattit l’aile opportuniste du parti bolchevique en publiant ses fameuses Thèses d’Avril qui contiennent une leçon vivante et fondamentale pour la classe ouvrière : aucun soutien ne peut être apporté à un État ou un gouvernement bourgeois, ni aucune pression ne peut être exercée sur lui pour qu’il change, dans la mesure où cet État ne peut en aucun cas aller contre sa nature qui consiste à défendre les intérêts de la classe dominante. Lénine écrit dans la troisième thèse : “aucun soutien au gouvernement provisoire ; démontrer le caractère entièrement mensonger de toutes ses promesses, notamment de celles qui concernent la renonciation aux annexions. Le démasquer au lieu d’ “exiger” - ce qui est inadmissible, car c’est semer des illusions - que ce gouvernement, gouvernement de capitalistes, cesse d’être impérialiste”. L’histoire lui donnera tragiquement raison : le gouvernement provisoire défendra la démocratie bourgeoise par les armes, la continuation de la participation à la Guerre mondiale, la terreur et le mensonge.
Aujourd’hui, la bourgeoisie a bien retenu cette leçon et elle tente à nouveau de semer les mêmes illusions sous la houlette d’un démagogue fort en gueule qui se présente comme un défenseur de la cause ouvrière pour enfermer le prolétariat dans une démarche sans issue : la “pression” sur l’État pour “exiger” des réformes “plus justes”. Ce qui était inadmissible de la part d’un parti ouvrier en 1917 est aujourd’hui un clair empoisonnement idéologique de la bourgeoisie pour mieux faire passer ses attaques.
Au-delà de l’encadrement idéologique, Mélenchon pousse aussi les ouvriers dans les bras des forces d’encadrement “physique” du capital : les syndicats. Même s’il se montre critique à leur égard, en reconnaissant leur rôle sur le terrain purement économique, il tend à séparer dans l’esprit de la classe ouvrière l’unité nécessaire entre les luttes revendicatives et leurs dimensions politiques. Il s’agit d’une réelle attaque contre la conscience ouvrière, d’un piège insidieux mais bien réel. Les syndicats mentent sur leur véritable nature. Parfaitement intégrés à l’État, ils “négocient” les réformes sur le terrain économique, c’est-à-dire sur le terrain des rapports de production existants, et demandent, pour ce faire, l’appui des ouvriers. Une démarche qui favorise l’impuissance et la docilité face à des attaques qui apparaissent alors comme inéluctables, voire “nécessaires” pour “l’économie nationale”, les “emplois français” face à la concurrence internationale. Ils lient le destin de la classe ouvrière à celui du capital national alors que tout les oppose. Au lieu de dresser un prolétariat uni face à l’État capitaliste, ils divisent les ouvriers entre secteurs aux revendications particulières. En obtenant des contreparties, en “faisant reculer le gouvernement”, ils se drapent du costume de dernier rempart contre l’avidité sans limite des patrons et d’ultimes défenseurs d’un État prétendument au service de tous. Ils permettent ainsi aux principales attaques de passer tout en préparant les prochaines. Cela, d’autant plus que Mélenchon et la nébuleuse gauchisante qui gravite autour de la France insoumise encadrent de leur côté toute expression politique, dénaturent le moindre questionnement qui existe de manière embryonnaire, notamment au sein d’une partie de la jeunesse ouvrière.
Le prolétariat ne pourra tirer aucune force des mouvements politiques “de gauche” ou des actions syndicales. Bien au contraire : en suivant ces “leaders”, leur programme et leurs mots d’ordre, en déléguant la défense de leurs intérêts aux syndicats et aux politiciens, les ouvriers s’engouffrent dans une impasse : “exiger” d’un gouvernement capitaliste qu’il “renonce” à la défense de ses intérêts pour répondre aux revendications ouvrières. Or, les intérêts de la bourgeoisie et du prolétariat sont diamétralement opposés et ne sont en aucune façon compatibles. Tout appui, tout soutien à une fraction de la bourgeoisie est un affaiblissement politique pour le prolétariat, une attaque idéologique contre sa conscience de classe.
Aujourd’hui, les conditions sont extrêmement difficiles pour la classe ouvrière. L’avancée du capitalisme dans sa phase de décomposition conduit au développement du chacun pour soi, l’évolution du travail et ses managers atomisent les ouvriers et la crise économique accroît la concurrence entre eux pour trouver un emploi. Dans ces conditions, trouver une identité de classe, une identité d’intérêt et démasquer la nature de classe bourgeoise, de l’État et de ses officines pseudo-ouvrières relève forcément d’un processus qui ne pourra qu’être difficile, long et tortueux. Pourtant, il n’y a pas d’autre issue. La classe ouvrière devra nécessairement retrouver le chemin des luttes massives pour retrouver son identité et développer sa conscience, pour comprendre la nature réelle du monde capitaliste et reconnaître les pièges qui lui sont tendus et les faux-amis qui lui sont proposés, pour enfin faire émerger la perspective communiste. Pour cela, il est important de renouer avec son passé, les leçons des grands combats contre le capitalisme, ses leçons tactiques et théoriques. Dans l’histoire, les ouvriers se sont déjà confrontés à leurs ennemis de classe, ils ont déjà expérimenté l’incompatibilité de leurs revendications avec les exigences inexorables de la logique capitaliste. Ils ont déjà démasqué la vraie nature de l’État bourgeois.
Cent ans après la révolution russe de 1917, plus grande expérience révolutionnaire du prolétariat, devant l’état du monde empêtré dans la violence, le chaos, la barbarie guerrière et la misère, et face aux attaques toujours plus fortes portées par la bourgeoisie pour survivre à sa crise, la classe ouvrière doit parvenir à comprendre que la connaissance et les leçons à tirer de sa propre histoire ne sont nullement un passe-temps intellectuel mais constituent au contraire, face à l’enfoncement dans des conditions d’existence et d’exploitation de plus en plus intolérables, face à un monde au bord d’un gouffre qui menace l’avenir de l’humanité, un recours nécessaire où il puisera les forces de forger ses armes pour l’assaut futur qu’il devra porter contre le capitalisme.
GD, 24 octobre 2017
1 Voir notamment nos articles : Mélenchon, un apôtre du modèle stalinien (Révolution Internationale n°461 - novembre décembre 2016) et Jean-Luc Mélenchon, un serviteur de la nation et du capital (Révolution Internationale n°463 - mars avril 2017).
Rubrique:
Ouragans, temblements de terre... la responsabilité du capitalisme est totale
- 410 lectures
“Harvey”, “Irma”, “Maria”, trois ouragans majeurs en l’espace d’un peu plus d’un mois ont touché des îles de la mer des Caraïbes et plusieurs États du territoire des États-Unis ; ces ouragans sont qualifiés de majeurs parce que le vent dépasse 180 km/h et qu’ont lieu des précipitations considérables qui impliquent la dévastation de tous les bâtiments qui n’ont pas été conçus pour leur résister et des territoires qui n’ont pas été protégés contre la montée des eaux. Ces trois ouragans (dont le cœur n’est passé sur aucune grande ville contrairement à Katrina en 2005 qui avait touché de plein fouet la Nouvelle-Orléans) ont entrainé la mort d’au moins 150 personnes et ont provoqué des dégâts considérables : 95 % des bâtiments de l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin étaient rendus inutilisables après le passage “d’Irma” et après le passage de “Maria”, l’île américaine de Porto Rico (3,4 millions d’habitants) s’est retrouvée sans eau, sans électricité et avec des moyens de communication détruits. Les îles de Barbuda et la Dominique sont complètement détruites.
Aujourd’hui, si l’on sait que les ouragans tropicaux font partie de la dynamique des masses d’air océaniques, l’ensemble des grands instituts d’observation et d’études du climat affirment que c’est le réchauffement climatique qui explique le nombre toujours plus important d’ouragans majeurs (aux États-Unis, les trois ouragans les plus coûteux de l’histoire ont eu lieu en une décennie) de même qu’il explique la force croissante des ouragans les plus violents. Ainsi, “Irma” est l’un des ouragans les plus violents que la Terre ait connu, à tel point que les spécialistes pensent qu’il faudrait ajouter des degrés à l’échelle de Saffir-Simpson qui mesure la force des ouragans de 1 à 5, et que la quantité d’eau qui est tombée sur Houston lors du passage d’Harvey est la plus forte enregistrée en un laps de temps aussi court dans l’histoire des États-Unis.
L’ensemble des organismes de recherche et les autorités politiques qui reconnaissent l’influence du réchauffement climatique sur la violence des ouragans affirment en même temps que ce réchauffement climatique est dû “aux activités humaines” rendant ainsi responsables de cette évolution catastrophique tous les hommes, tant les exploités que la classe dominante. Ces messieurs occultent ainsi le fait que dans le capitalisme, c’est la production et le profit qui orientent les activités humaines et que cette tendance destructrice est d’autant plus impérative en période de crise économique.
L’affirmation selon laquelle ce seraient les activités humaines en général qui seraient la cause du réchauffement climatique et de ses conséquences est d’autant plus odieuse que les populations les plus touchées par les ouragans sont particulièrement les plus démunies. Quand les îles des Caraïbes ne sont pas des destinations particulièrement prisées par le tourisme, ce sont des territoires qui ont beaucoup de caractéristiques des pays sous-développés, que ces îles soient indépendantes ou qu’elles appartiennent à un pays développé. Ses habitants ont le plus souvent un revenu très bas (46 % de la population de Porto Rico vit en dessous du seuil de pauvreté) et 28 % de la partie française de l’île de Saint-Martin est au chômage. Les habitants de ces territoires n’ont donc pas pu construire des habitations résistantes à des phénomènes météorologiques aussi extrêmes et les États auxquels ces territoires appartiennent ne les ont évidemment pas aidés à construire des habitations plus solides, même s’ils savent depuis bien longtemps que ces îles sont sur le passage habituel d’ouragans majeurs. La recherche d’économies permet également de comprendre que non seulement des brèches se soient formées dans des digues à proximité de Houston (quatrième ville des États-Unis), mais que des bassins de retenue construits pour contenir l’eau en cas d’inondations se soient révélés trop petits et ont débordé, répandant dans des lieux habités des eaux nauséabondes.
En fait, et c’est bien la preuve d’une dynamique générale qui est celle du capitalisme, on retrouve la même réalité sordide, avec les conséquences du tremblement de terre dans le centre du Mexique. Mexico a été touché dans le passé par de nombreux tremblements de terre (dont un en 1985 qui a fait plus de 10 000 morts) mais pas plus avant 1985 que depuis cette date, les normes antisismiques de construction n’ont été respectées, y compris dans les bâtiments publics comme ces quinze écoles qui se sont effondrées. C’est au sein de l’une d’elles que l’on a vu sur toutes les télévisions du monde des dizaines d’enfants ensevelis. Cet odieux spectacle a été instrumentalisé par la propagande pour mettre en évidence la manière dont les secours sont mis en œuvre.
En réalité, contrairement à tout le battage médiatique mettant en avant les secours, ces derniers se révèlent toujours lents et en retard. Les raisons qui expliquent cette lenteur sont les mêmes que celles qui expliquent l’absence de mesures de prévention tant par rapport aux ouragans qu’aux tremblements de terre. Alors que, sur le terrain de la catastrophe, beaucoup de personnes sont terrorisées par ce qu’elles ont vécu, qu’elles sont hébétées, se retrouvant quelquefois avec leurs enfants au milieu d’un champ de ruines, les secours ne sont intervenus et encore très progressivement qu’au bout de plusieurs jours ! Quelle est la raison d’une telle lenteur ? Les phrases et attitudes méprisantes de Trump par rapport aux victimes de Houston et Porto Rico (il a affirmé que l’île n’avait pas connu de véritable catastrophe et qu’elle avait grevé le budget fédéral) représente à peine une caricature de l’attitude de la classe dominante et de ses États. En effet, les problèmes de compétitivité du capital national et de défense nationale sont à ses yeux infiniment bien plus importants que le fait de sauver des vies humaines. Si le fait d’installer des secours avant la catastrophe a traversé l’idée d’une quelconque autorité, le fait de les acheminer à temps était impossible parce qu’il n’y avait pas de bâtiment assez solide où ils auraient pu être cantonnés, comme ce fut le cas dans la partie française de l’île Saint-Martin ! La lenteur et la faiblesse des secours ont été encore plus significatives après les tremblements de terre au centre et au sud du Mexique, alors que, dans ce cas, aucune difficulté géographique n’existe qui puisse expliquer cette lenteur. En fait, que ce soit au Mexique, dans les îles des Caraïbes, les premiers secours ont été apportés par les habitants eux-mêmes, poussés par leur solidarité, à la mesure de ce qu’ils pouvaient faire.
Une grande partie de la bourgeoisie est consciente des problèmes environnementaux, notamment du réchauffement climatique. Elle ne peut rester les bras croisés sans craindre le coût catastrophique que ce réchauffement climatique annonce et qu’elle sera obligée de ponctionner sur les prolétaires. De même, il est clair que tant le coût considérable de la reconstruction après le passage des ouragans (aux 200 milliards après les ouragans “Harvey” et “Irma” pour les États-Unis, il faut rajouter le coût de la reconstruction après le passage de “Maria”) que la pollution des villes chinoises qui sont un handicap pour les capacités de travail des ouvriers constituent de réels soucis pour la bourgeoisie. Mais, en dehors de la prise de mesures ponctuelles comme la diminution de consommation de charbon dans certaines régions en Chine, le coût que représenteraient des mesures réellement susceptibles d’inverser le réchauffement climatique est impossible du fait qu’elles ne sont pas rentables. Les grandes déclarations ou accords comme la COP21 ne sont, pour l’essentiel, qu’un jeu diplomatique où chaque bourgeoisie essaie de renforcer avec cynisme son influence. Il est tout à fait significatif que l’émission de gaz carbonique, principal gaz à effet de serre, ait continué à augmenter au même rythme en 2016 que dans les années précédentes et que la déforestation de l’Amazonie s’est accélérée cette même année ! Seul le communisme, parce qu’il est un système de production pour les besoins humains et non pour l’obtention du profit pourra prendre les mesures capables d’inverser la terrible crise écologique qui menace l’humanité.
En fait, ce que nous ont montré les différentes fractions de la bourgeoisie par leurs réactions aux dévastations provoquées par les ouragans, est à l’image des charognards et leur utilisation du désastre n’est là que pour renforcer leur propre crédibilité. C’est évidemment le cas de Trump tout comme de Macron qui vont s’exhiber dans les zones sinistrées.
Vitaz, 26 octobre 2017
Récent et en cours:
- Catastrophes [76]
Rubrique:
Face aux tensions impérialistes en Corée: une déclaration internationaliste du groupe “Perspective Communiste Internationale”
- 525 lectures
Nous publions ci-dessous une déclaration du groupe Perspective Communiste Internationale (Corée du Sud) au sujet des tensions impérialistes dans la péninsule coréenne.
Nous avons quelques critiques à faire sur cette déclaration, en particulier son insistance sur l’installation des THAAD (Terminal High Altitude Area Defence, programme de défense antimissile), qui pourrait suggérer l’idée que la classe ouvrière défendrait ses intérêts en luttant contre l’installation de ce nouveau système de défense. Ce n’est pas en faisant campagne contre telle ou telle arme de guerre particulière que la classe ouvrière peut développer sa conscience. La tâche des révolutionnaires est de démontrer l’impasse de l’ensemble du système capitaliste, en participant aux luttes qui correspondent à des revendications de classe, qui peuvent permettre de déchirer le voile d’illusion de “l’unité nationale” et développer une réelle solidarité avec les travailleurs des autres pays.
Néanmoins, nous reconnaissons la voix de la classe ouvrière internationale dans cette déclaration : une voix qui dénonce les impérialistes de toute la classe capitaliste (y compris ceux qui sont censés être “communistes”). Ainsi, nous sommes solidaires, sans réserve, des camarades de la PCI et de tous ceux qui luttent pour un réel internationalisme dans cette région.
Nous condamnons le gouvernement Moon Jae-In et les États-Unis pour le déploiement des THAAD. Suppression des THAAD ! Lutte contre l’État capitaliste ! Lutte contre les gouvernements capitalistes et la menace de guerre impérialiste !
Le 7 septembre, le gouvernement de Moon Jae-In et les États-Unis ont déployé de manière coercitive le programme THAAD sur Sungju-gun Sogong-ri en dépit de l’opposition de la majorité des Coréens, y compris les résidents. Le déploiement du THAAD en Corée du Sud ne contribue pas à la résolution des problèmes liés à l’utilisation de l’arme nucléaire en Corée du Nord et à la paix en Asie du Sud-Est. C’est juste un simulacre de recherche de sécurité. Le THAAD n’est pas seulement un programme qui accroît la menace de guerre de la part des États-Unis, c’est aussi un plan qui place la Corée du Sud en première ligne de la guerre impérialiste.
Nous confirmons à nouveau que le but du développement de l’armement nucléaire en Corée du Nord est le massacre génocidaire de la population civile, en particulier de la classe ouvrière, nonobstant les déclarations de la Corée du Nord sur la nécessité de protéger son régime. En outre, nous n’oublierons jamais que la seule force qui ait jamais utilisé l’arme nucléaire pour massacrer des populations civiles indistinctement est l’Impérialisme américain. L’Histoire a montré que les deux régimes, qui sont différents dans la péninsule coréenne, sont les mêmes en termes d’exploitation de la classe ouvrière et sont ses pires ennemis. Les travailleurs ne doivent choisir aucun des deux.
La montée des tensions en Asie du Sud-Est montre les tendances destructrices du capitalisme. Cependant, les conflits récents montrent que le danger pour l’humanité est plus important qu’avant. Cette fois, il y a un affrontement croissant entre de nombreuses forces. Les États-Unis, la Chine et le Japon, autant que la Corée du Nord, sont en train d’intensifier la course aux armements.
Deux guerres mondiales, la guerre de Corée et de nombreuses autres guerres ont meurtri irrémédiablement la classe ouvrière. Aujourd’hui, la classe ouvrière ne doit pas se laisser entraîner dans le cercle vicieux mortel du capitalisme. Seule, la classe ouvrière peut sauver l’humanité de la barbarie. A cette fin, elle doit échapper aux sirènes du nationalisme et du militarisme. La seule solution est que les travailleurs de la Corée du Sud et du Nord luttent ensemble contre leur propre classe dominante.
Le déploiement des THAAD du gouvernement Moon, qui prétend travailler à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ne contribuerait pas à empêcher le développement de l’arme nucléaire en Corée du Nord, mais ne ferait que mettre de l’huile sur le feu de la confrontation militaire comprenant la compétition pour l’arme nucléaire. La décision d’ajouter et de déployer le THAAD montre également l’hypocrisie et l’incompétence du gouvernement Moon qui affirme poursuivre une politique de paix, un processus démocratique et une diplomatie indépendante. C’est une expression politique de la nature de classe du gouvernement actuel qui sert les intérêts des classes impérialistes et dirigeantes.
Contre le gouvernement Moon Jae-In, qui a commis des crimes aussi monstrueux que ceux du gouvernement Park Geun-hae, moins de quatre mois après la victoire aux élections présidentielles,
La classe ouvrière doit rompre avec le “rêve de Moon Jae-In”, qui consiste à prétendre nettoyer le mal accumulé et à améliorer le régime. La classe ouvrière doit refuser de former un front uni et de coopérer avec le gouvernement Moon. La classe ouvrière doit lutter contre le déploiement des THAAD, ainsi que contre le gouvernement capitaliste et la menace de guerre en Corée.
1. Nous nous opposons à la fois aux menaces de l’impérialisme américain et de ses alliés contre la Corée du Nord (menaces de guerre, campagnes de sécurité) et au développement par la Corée du Nord de l’arme nucléaire contre eux.
2. L’Impérialisme américain, qui a déjà assassiné des civils avec l’arme nucléaire, et la Corée du Nord, avec ses armes nucléaires, qui sont dirigées vers une autre guerre, sont les plus grands dangers pour la classe ouvrière. La classe ouvrière s’oppose à toutes les armes nucléaires.
3. Nous ne pouvons faire confiance à aucune “politique de paix” des pays capitalistes et impérialistes qui revendiquent la paix d’un côté, tout en favorisant la recherche dans le secteur de l’armement et la menace de guerre dans l’intérêt de leur propre régime capitaliste.
4. Nous déclarons que seule la lutte internationale de la classe ouvrière et la révolution prolétarienne peuvent mettre fin à la menace de la barbarie, de la guerre impérialiste et de la destruction nucléaire menaçant l’humanité sous le capitalisme.
5. Suppression du THAAD ! Lutte contre les gouvernements capitalistes et leur menace de guerre impérialiste au delà des frontières de tous les États capitalistes.
Les travailleurs n’ont pas de pays à défendre ! Travailleurs de tous les pays, unissez-vous !
Perspective Communiste Internationale, 7 septembre 2017
Vie du CCI:
Géographique:
- Corée du Sud [77]
Rubrique:
A propos du film "Le jeune Karl Marx"
- 1124 lectures
Voilà un film qui surprend par l’apparente réhabilitation qu’il fait du personnage. Surprenant car en choisissant de traiter cinq années de la vie de Marx, peut-être les plus déterminantes, celles qui s’étalent de 1843 à 1848, Raoul Peck souhaite rompre avec l’image trop caricaturale du génie solitaire agissant en dehors du monde ouvrier. Mais y parvient-il réellement ? Indéniablement, l’angle avec lequel Raoul Peck aborde la vie de Marx corrige quelque peu l’idée selon laquelle Marx et Engels seraient les inventeurs de notions abstraites telles que “lutte de classes”, “révolution” ou “communisme”... Ce film montre, bien que parfois de façon trop caricaturale, comment ces deux hommes, qui vont jouer un rôle déterminant pour le mouvement révolutionnaire, ont été gagnés à une cause née bien avant eux, dans les entrailles du prolétariat des pays les plus industrialisés du XIXème siècle. En cela, nous pensons que la vision de Peck se distingue ouvertement de celle des intellectuels les plus déchaînés qui s’attellent à démontrer, non sans une grande malhonnêteté, que les travaux de Marx portent en eux les germes de la tragédie stalinienne.1 Pour autant, ce film ne rompt pas totalement avec l’image du personnage providentiel ce qui altère considérablement la tentative de mettre en valeur la dimension militante et encore actuelle du personnage ainsi que le rôle décisif que devra jouer le prolétariat dans la transformation de la société.
A juste titre, une place importante est accordée à la rencontre déterminante et à la complicité inaltérable de Karl Marx et Friedrich Engels, ce fils d’industriel en rupture de ban, qui sensibilisa le jeune Marx aux potentialités politiques du monde ouvrier et à l’importance de l’économie politique. Il faut cependant déplorer le manque de subtilité de cette rencontre où la froideur des présentations dans le salon d’Arnold Ruge fait soudainement place aux déclarations de fascination lors d’une nuit de libations et de parties d’échec où les deux hommes arrivent à un accord parfait et Marx de complimenter Engels pour lui avoir ouvert les yeux, énonçant, soudainement, dans un fort état d’ébriété, la célèbre phrase : “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, il s’agit désormais de le transformer”. Paradoxalement, c’est une scène centrale puisqu’elle annonce toute la vision qui sera faite du personnage par la suite. Un Marx ni philosophe, ni historien, ni économiste mais un militant du mouvement révolutionnaire s’adressant aux ouvriers dans des meetings, polémiquant avec Proudhon et son réformisme petit-bourgeois ou avec Weitling et son idéalisme christique. Par ailleurs, les affres de la vie militante ne sont pas négligées. Si la répression est dépeinte d’une manière quelque peu légère où Karl et Friedrich en profitent pour jouer au chat et à la souris avec la police dans les faubourgs de Paris, les désagréments et les traumatismes de l’exil, de la pauvreté, sont montrés dans leur réalité crue. Ces moments mettent plutôt en valeur l’expression et le renforcement des liens d’amitié et d’amour mais aussi ceux engendrés par la passion militante. Raoul Peck reproduit donc tout un milieu révolutionnaire à Paris d’abord, à Bruxelles et à Londres ensuite. Mais malgré tout, ces scènes offrent une image excessivement personnalisée des débats et de la clarification dans le milieu révolutionnaire de l’époque. Par exemple, Raoul Peck semble vouloir attribuer uniquement à Marx le discrédit subi par Weitling au sein de la Ligue des Justes alors que les premiers à remettre en cause, non sans embarras, les visées idéalistes et messianiques de ce dernier sont Schapper2 et une grande majorité des ouvriers de l’Association des ouvriers allemands de Londres. Nous savons que Marx a suivi avec beaucoup d’attention cette polémique puisqu’elle révélait une rupture entre le communisme sentimental et le communisme scientifique que lui-même prônait. A travers la création de comités de correspondance, l’Association de Londres se rapprocha des conceptions de Marx sur la direction à donner à l’évolution du mouvement et par conséquent s’éloignait des conceptions de Weitling. Ainsi, la discussion virulente du Comité de Correspondance de Bruxelles du 30 mars 1846 relatée dans le film, finit de consommer une rupture déjà bien entamée. En fait, le réalisateur reste prisonnier de la vision démocratique du débat et de l’action politique car l’attention est régulièrement portée sur la joute théorique entre des meneurs, des chefs charismatiques, ce qui cache l’essentiel, à savoir l’effervescence théorique et la réflexion collective, complexe, qui caractérisait déjà le mouvement ouvrier à cette époque. Cette confusion prend toute sa dimension dans la manière dont est traité le rapport entre Marx et la Ligue des Justes. Nous sentons que Raoul Peck souhaite mettre en évidence le fait que Marx et Engels aient compris que le salut de l’humanité réside dans le rôle historique qu’est portée à jouer la classe ouvrière. Ces derniers comprenaient aussi qu’il était nécessaire de se détacher de tout idéalisme, de paroles éthérées, illusoires et utopiques sur les fins et les moyens de parvenir à un stade supérieur de la société humaine. La classe ouvrière avait besoin d’une théorie pratique pour comprendre le monde qui l’avait engendré et pour se persuader que sa situation n’était pas intangible mais transitoire. Donner au prolétariat une théorie révolutionnaire et le convaincre de la nécessité d’une telle démarche, c’est ce que le film essaie de mettre en lumière avec une certaine fidélité nous semble-t-il. Pour autant, la manière dont est appréhendé le rapprochement entre Marx et la Ligue des Justes entretient la vision d’un Marx prompt aux intrigues, un Marx ambitieux et jouant de sa stature intellectuelle pour renverser la majorité de l’avant-garde révolutionnaire de l’époque de son côté. En effet, Marx et Engels semblent vouloir séduire les dirigeants de la Ligue, ils font des pieds et des mains pour entrer en contact avec celle-ci, n’hésitent pas à exagérer leur proximité avec Proudhon afin de laisser planer la possibilité de développer des ramifications de comités de correspondance jusque dans l’Est de la France... Contrairement au flou que fait planer le film sur cet événement, c’est la Ligue, sous l’égide de son porte-parole Joseph Moll, qui invita Marx à adhérer. Comme le relatent Boris Nicolaïevski et Otto Maenchen-Helfen dans leur Vie de Karl Marx, “il leur déclara que ses camarades se rendaient compte de la justesse des conceptions de Marx, et qu’ils comprenaient la nécessité de se libérer des anciennes traditions et des formes de la conspiration. Marx et Engels étaient invités à collaborer à l’orientation théorique nouvelle et à la réorganisation”. Cependant, Marx hésitait à accepter, doutant toujours de la réelle volonté de la Ligue à se réorganiser et à jeter à la poubelle ses anciennes conceptions conspiratrices et utopistes. Mais “Moll lui déclara que précisément son adhésion et celle d’Engels étaient indispensables, si la Ligue devait réellement être libérée de tout ce qu’elle comportait de périmé. Surmontant ses scrupules, Marx s’affilia en février 1847”.
Si, en effet, le poids des personnalités était assez fort dans le mouvement ouvrier du XIXème siècle, le film, en isolant l’apport théorique de Marx et Engels, donne finalement l’impression que ce mouvement dépendait exclusivement de personnalités de génie. Cela se vérifie dans le déroulement du congrès de la Ligue des Justes du 1er juin 1847, où d’ailleurs Marx n’assista pas ; officiellement par manque d’argent mais vraisemblablement il souhaitait attendre les décisions du congrès avant d’adhérer de manière définitive à la Ligue. Cette scène est d’ailleurs extrêmement caricaturale car elle présente le déroulement du congrès comme un combat de personnes où semble prévaloir une minorité de militants “d’élite” soutenue ou contestée par les applaudissements et les cris de la grande majorité qui reste dans la passivité. En réalité, il s’agit ici d’une vision déformée du déroulement d’un congrès dans une organisation révolutionnaire.
Malgré l’âpreté de leur condition de vie, les ouvriers politisés attachaient beaucoup d’importance à l’instruction et l’approfondissement des questions politiques à travers la lecture de brochures notamment. Ainsi, les congrès n’étaient pas des sortes de joutes oratoires où chaque camp avait son champion mais le moment fondamental de la vie d’une organisation révolutionnaire avec de longs débats où chaque militant prenait place dans l’expression et la confrontation des positions quelle que soit la capacité théorique de chacun. Dans sa Contribution à l’histoire de la Ligue des Communistes, Engels transmet la réalité studieuse des premiers congrès révolutionnaires du prolétariat. “Au deuxième congrès, qui se tint fin novembre et début décembre de la même année [1847], Marx fut, lui aussi, présent, et dans un débat assez long – la durée du congrès fut de dix jours au moins –, il défendit la nouvelle théorie”.3
En somme, il ne s’agit pas ici de nier le rôle déterminant de Marx et Engels dans l’évolution du mouvement révolutionnaire mais de replacer leur trajectoire dans le milieu prolétarien et de souligner que leur contribution inestimable n’aurait pu exister sans ce grand mouvement de fond toujours actuel qui fait de la classe ouvrière le sujet actif de l’histoire. La caricature que nous fournit le réalisateur voile cette réalité et met l’accent sur la place prépondérante des individualités et de leur rôle providentiel.
L’art n’a pas vocation à servir une cause politique. Cependant, le contenu et la forme d’une œuvre peuvent être amenés à délivrer un message. Si nous soulignons la manière avec laquelle Raoul Peck essaye d’exhumer Marx du cimetière de l’histoire, la manière dont il relate certains moments de sa vie tend à travestir et déformer les enseignements politiques que l’on peut en tirer.4 Et c’est ce que nous tenions à corriger dans cet article
DL, 28 octobre 2017
1 C’est ce qu’on a pu entendre en substance dans l’émission 28 minutes sur Arte lors d’un numéro consacré à Octobre 1917.
2 En tant que porte-parole de l’Association des ouvriers allemands de Londres.
3 Friedrich Engels, Contribution à l’histoire de la Ligue des Communistes.
4 Toutes les œuvres artistiques sont influencées, souvent inconsciemment, par l’idéologie de la classe dominante d’une époque. On le voit très bien à la fin du film où une succession d’images en accéléré est supposée donner une vision des dévastations produites par le capitalisme mais où en réalité tous les amalgames sont possibles, en particulier entre le stalinisme (Che Guevara, Mao, Mandela,...) et le marxisme, alors que Staline fut le bourreau des communistes authentiques qui avaient suivi la démarche de Marx. C’est l’odeur de ce poison subtilement distillé qu’a reconnu le PCF ; c’est pourquoi ce parti stalinien n’a pas tari d’éloges publicitaires pour ce film.