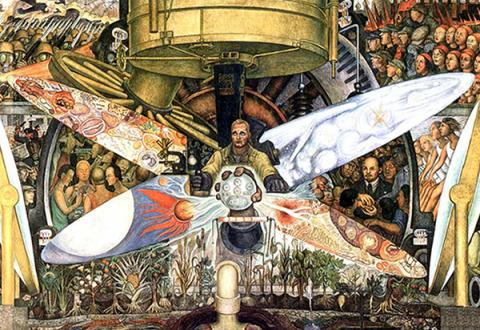Revue Internationale 2014
- 1711 lectures
Première Guerre Mondiale - numéro spécial
- 1425 lectures
100 ans de décadence du capitalisme
- 1931 lectures
Depuis un siècle, nous nous trouvons à un nouveau carrefour dans l'histoire de l'humanité. La classe révolutionnaire a très tôt déjà et avec une clarté aiguë qualifié cette époque charnière avec la formule: "socialisme ou barbarie". La lucidité de l'analyse marxiste que recèle ce slogan et qui s'exprime en lui, ne doit cependant pas être réduite à une formule creuse. C'est pourquoi, nous tenons à en souligner ici brièvement l'importance historique et la profondeur essentielle. En nous penchant sur les origines obscures et dissimulées du genre humain, nous ne pouvons qu'être stupéfaits et impressionnés par les étapes considérables qui ont permis à l'Homme d'opérer son émergence du monde animal et qui ont suivi cette émergence: les langues, l'écriture, les danses, l'architecture, la production d'une profusion de biens, sa capacité à se référer à la diversité et à la profondeur des besoins moraux, culturels, intellectuels et à la valeur de ces besoins, tout cela reflétant une richesse culturelle et une accélération de l'histoire qui nous fait frémir. Mais si nous portons notre attention sur les différentes époques de l'histoire humaine, nous devons aussi reconnaître qu'il n'y pas eu, et qu'il n'y a pas de développement continu et progressif. Encore plus dramatiquement, après l'avènement des sociétés de classes et la naissance des grandes "cultures" nous devons conclure que presque toutes ces dernières ont irrémédiablement disparu et que seules quelques-unes se sont transformées en quelque chose de nouveau. Nous constatons de nombreuses époques de régression culturelle et d'oubli des acquis, généralement accompagnées d'un abrutissement moral des hommes et de la brutalisation énorme des rapports humains. A la base des progrès accomplis par l'espèce humaine réside sa capacité à transformer la nature en vue de la satisfaction de ses besoins, en premier lieu matériels, et dans sa capacité à améliorer et développer ses moyens et techniques de production, ce que Marx appelle les "forces productives". C'est fondamentalement le degré de développement de ces forces productives et la division du travail qu'elles impliquent qui déterminent la façon dont s'organise la société pour les mettre en œuvre, les "rapports de production". Lorsque ces derniers constituent le cadre le plus adéquat au développement des premières, la société connaît un épanouissement, non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan culturel et moral. Mais lorsque ces rapports de production deviennent une entrave à la poursuite du développement des forces productives, la société connaît des convulsions croissantes et se trouve menacée par la barbarie. Pour ne prendre qu'un exemple historique: un des piliers de l'Empire romain était l'exploitation des esclaves, notamment pour les travaux agricoles, mais lorsque de nouvelles techniques agricoles ont fait leur apparition, elles ne pouvaient être mises en œuvre par des producteurs ayant un statut de bétail ce qui constitue une des causes de la décadence et de l'effondrement de cet Empire.
Aujourd'hui, nous pouvons voir l'éclat des grands bonds culturels,1 de la révolution néolithique,, jusqu'à la Renaissance, l'Humanisme et la Révolution russe comme un prélude à la révolution mondiale. Ces bonds culturels sont à chaque fois le résultat de longues périodes de lutte, où les nouveaux rapports sociaux devaient triompher des anciens. Ces grands bonds culturels nous portent vers le prochain saut: la première socialisation mondiale consciente, le socialisme ! Le marxisme, la théorie dont s'est doté le prolétariat dans son combat contre le capitalisme, a la capacité de porter un regard lucide et non mystifié sur l'histoire et de reconnaître les grandes tendances de celle-ci. Cela ne signifie pas qu'il peut lire le futur dans une boule de cristal. Nous ne pouvons pas prédire quand se produira la révolution mondiale, ni même si elle pourra effectivement avoir lieu. Cependant, nous devons défendre et comprendre en profondeur, contre toutes les résistance et incompréhensions qui affectent même certains révolutionnaires, l'énorme importance historique que constitue l'entrée du capitalisme dans sa décadence. L'alternative devant laquelle nous nous trouvons depuis 100 ans peut se résumer ainsi: soit effectuer le prochain saut social et culturel, le socialisme soit la barbarie. La gravité de cette alternative est plus dramatique qu'à n'importe quelle époque connue jusqu'à aujourd'hui du fait que l'accroissement des contradictions entre les forces productives et les rapports de production ouvre la possibilité non seulement du déclin social et culturel, mais de la destruction totale de l'espèce humaine. Pour la première fois dans l'histoire, la question de l'existence-même de l'espèce humaine est en cause dans la décadence d'un mode de production. En même temps, il existe des possibilités historiques immenses pour un développement ultérieur: l'entrée dans la "véritable" histoire consciente de l'humanité. Le modèle capitaliste de socialisation est celui qui a connu la plus grande réussite dans l'histoire de l'humanité. Le capitalisme a absorbé en lui tous les milieux culturels des autres sociétés (pour autant qu'il ne les ait pas détruits) et a créé pour la première fois une société mondiale. La forme centrale de l'exploitation est le travail salarié, permettant l'appropriation et l'accumulation du surtravail dont l'appropriation gratuite du travail coopératif énormément productif, du travail associé, socialisé. C'est ce qui explique l'incomparable explosion technique et scientifique liée à l'histoire de la montée du capitalisme. Mais l'une des particularités de la socialisation capitaliste c'est qu'elle s'est réalisée de façon inconsciente, déterminée par des lois qui, si elle sont l'expression de rapports sociaux déterminés, l'échange force de travail contre salaire, entre les producteurs et les détenteurs des moyens de production, se présentent comme "naturelles", "immuables" et donc extérieures à toute volonté humaine.. C'est dans cette vision de la réalité mystifiée, réifiée, où les être humains et les rapports entre eux deviennent des "choses", que l'augmentation considérable des ressources matérielles, des forces productives apparait comme un produit du capital et non comme le produit du travail humain. Cependant, avec la conquête du monde, il s'avère que la terre est ronde et finie. Le marché mondial est créé (après la destruction des formes alternatives de production, telles que la production textile chinoise, indienne et ottomane). Même si le succès du mode de production capitaliste constitue une étape progressive dans l'histoire humaine, le saut de la révolution industrielle signifie pour la majorité de la population du centre du capitalisme la destruction des formes de vie existant précédemment ainsi qu'une exploitation féroce.alors que dans de grandes parties du reste du monde, il signifie les épidémies, la faim et l'esclavage. Le capitalisme est sans doute le rapport d'exploitation le plus moderne, mais il est finalement tout aussi parasite que ses prédécesseurs. Pour maintenir en marche la machine de l'accumulation, la socialisation capitaliste nécessite toujours plus de matières premières et de marchés, de même qu'il doit pouvoir compter sur une réserve d'êtres humains contraints de vendre leur force de travail pour survivre. C'est pour cela que sa victoire sur les autres modes de production passait par la ruine et la famine des anciens producteurs.
Le capitalisme se présente comme l'objectif et l'apogée du développement humain. Selon son idéologie, il n'y aurait rien en dehors de lui. Pour ce faire, cette idéologie doit occulter deux choses: d'une part que le capitalisme dépend historiquement au plus haut degré des rapports de production et du milieu extra-capitalistes, d'autre part que la socialisation capitaliste, comme toutes les formes qui l'ont précédée dans l'histoire de l'humanité, n'est qu'une étape dans le processus du devenir conscient de l'humanité. La force motrice de l'accumulation produit en permanence des contradictions internes, qui se déchargent de façon éruptive dans les crises. Dans la phase ascendante du capitalisme, ces crises étaient surmontées par la destruction du capital excédentaire et la conquête de nouveaux marchés. Le nouvel équilibre s'accompagnait d'une nouvelle extension des rapports sociaux capitalistes, mais avec le partage du marché mondial entre les puissances centrales du capitalisme, celui-ci atteint, dans les relations mondiales, une limite. A ce moment-là, les grands États nationaux ne peuvent poursuivre leur conquête du monde qu'en se trouvant face à face ; le gâteau étant entièrement partagé, chacun ne pouvait accroitre sa propre part de celui-ci qu'en réduisant celle des autres. Les États développent leurs armements et fondent l'un sur l'autre dans la première guerre mondiale. Les forces productives enchainées par les rapports de production historiquement dépassés se retournent dans la boucherie mondiale en force destructrice dotée d'un potentiel de destruction incroyable. Avec l'entrée du capitalisme dans sa décadence, la guerre devient une guerre de matériels soumettant l'essentiel de la production aux besoins militaires. La machine aveugle de destruction et d'anéantissement entraîne le monde entier dans l'abîme. Bien avant 1914, la gauche de l'Internationale socialiste, les forces révolutionnaires autour de Rosa Luxemburg et de Lénine, ont pris en main de toutes leurs forces la lutte contre la menace du massacre impérialiste. Le marxisme vivant, c'est-à-dire le véritable marxisme, qui n'est pas enfermé dans des dogmes et des formules toutes faites valables de tout temps, a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle guerre entre les États-nations, semblable aux précédentes, mais que celle-ci marquait l'entrée dans la décadence du capitalisme. Les marxistes savaient que nous étions à une croisée des chemins historique (où nous nous trouvons toujours), qui menace pour la première fois de devenir une lutte pour la survie de l'espèce entière. L'entrée du capitalisme dans sa décadence il y a 100 ans est irréversible, mais cela ne signifie pas l'arrêt des forces productives. En réalité, ces forces sont tellement entravées et comprimées par la seule logique de l'exploitation capitaliste que le développement de la société est aspiré dans un tourbillon de plus en plus barbare. Seule la classe ouvrière est capable de donner à l'histoire une direction différente et de construire une nouvelle société. Avec une brutalité inimaginable jusqu'alors nous avons connu la tendance pure de la barbarie capitaliste après la défaite du soulèvement révolutionnaire des années 1917-23. Le cours à une autre guerre mondiale était ouvert, les hommes ont été réduits à des numéros et des matricules, enfermés dans des camps en vue d'une exploitation meurtrière ou de leur assassinat pur et simple. Les meurtres de masse staliniens ont été surpassés par la folie exterminatrice des nazis mais la bourgeoisie "civilisée" elle-même n'a pas voulu rater ce rendez-vous de la barbarie: ce fut l'utilisation de la bombe atomique "démocratique" rasant deux villes deux villes du Japon et infligeant aux survivants d'horribles souffrance. La machine de l'État capitaliste n'a « appris » de l'histoire que dans la mesure où elle s'interdit à elle-même l'autodestruction (la bourgeoisie ne va pas tout simplement se suicider pour laisser la scène de l'histoire au prolétariat), mais c'est seulement le retour de la classe ouvrière après 1968 qui offre une garantie contre le cours ouvert à la guerre. Cependant, si la classe ouvrière a pu barrer le chemin d'un nouvel holocauste mondial, elle n'a pu, pour autant imposer sa propre perspective. Dans cette situation, où aucune des deux classes déterminantes de la société ne pouvait apporter de réponse décisive à une crise économique irréversible et de plus en plus profonde, la société a connu de façon croissante un véritable pourrissement sur pieds, une décomposition sociale croissante rendant encore plus difficile l'accession du prolétariat à une claire conscience de sa perspective historique, une perspective qui était largement répandue dans ses rangs il y a un siècle.
Il y a cent ans et depuis lors, la classe ouvrière a été confrontée à une tâche historique énorme. La classe du travail associé, la classe ouvrière, en tant que porteuse de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, en tant que classe centrale dans la lutte pour l'abolition des classes, doit s'élèver contre cette barbarie. Dans la lutte contre la barbarie nihiliste et amorale du capitalisme, elle est l'incarnation de l'humanité prenant conscience d'elle-même. Elle est la force productive encore enchaînée de l'avenir. Elle recèle en elle le potentiel d'un nouveau bond culturel. Dans la lutte contre l'entrée en décadence du capitalisme toute une génération de révolutionnaires est apparue au plan mondial pour opposer à la socialisation dénaturée et réifiée du capitalisme l'association consciente de la classe ouvrière – guidée par le phare de l'Internationale Communiste.
Avec la révolution russe, elle a pris en main la lutte pour la révolution mondiale. Cette grande tâche d'assumer sa responsabilité pour l'humanité reste toujours pour nous, près de 100 ans après, électrisante et enthousiasmante. Cela montre que même face à la menace d'abrutissement s'élève une indignation morale au cœur de la classe ouvrière, qui est encore une boussole pour nous aujourd'hui. La classe ouvrière souffre avec l'ensemble de la société sous le fardeau de la décadence. L'atomisation et l'absence de perspective attaquent notre propre identité. Dans les confrontations à venir, la classe ouvrière démontrera si elle est capable de reprendre à nouveau conscience de sa tâche historique. C'est peut-être une courte étape historiquement que de passer de l'indignation morale à la politisation de toute une génération. Un nouveau bond culturel dans l'histoire de l'humanité est possible et indispensable, c'est ce que nous enseigne l'histoire vivante.
CCI
1Soyons clair que nous regroupons sous le terme de "culture" tout ce qui fait une société donnée: sa façon de se reproduire matériellement, mais aussi l'ensemble de sa production artistique, scientifique, technique, et morale.
Rubrique:
L'art et la propagande
- 11495 lectures
La vérité et la mémoire
Une visite à l'exposition d'artistes de guerre britanniques, "La vérité et à la mémoire", qui s'est tenu au Musée de Guerre Impérial de Londres en 2014, suscite des réflexions concernant la relation complexe entre l'art, la politique et la propagande.
Pour commencer, il y a un contraste saisissant entre les peintures de "La vérité et la mémoire" et l'exposition spéciale conventionnelle du rez-de-chaussée dédiée à la Première Guerre mondiale 1. Là où l'art est brut, poignant, l'exposition spéciale conventionnelle du musée est insipide et incolore. Dans les juxtapositions d'uniformes militaires, d'armes, les reproductions d'affiches de propagande – un film montrant des champs boueux – il n'y a rien qui soit à même de choquer même le spectateur le plus sensible. Il y a des casques et des vestes destinées aux visiteurs pour être essayées ou pour prendre des selfies, mais il ne faut surtout pas rappeler ce que cette guerre fut vraiment, l'horreur et la puanteur des cadavres dans les tranchées. La Première Guerre mondiale a été assainie et empaquetée pour la consommation touristique et il semble peu probable que ceux qui visitent l'exposition du rez-de-chaussée apprendront beaucoup ; ils n'apprendront en fait rien du tout.
Ce n'est peut-être pas étonnant si l'exposition sur la Première Guerre mondiale, impossible à rater au rez-de-chaussée, est remplie par une file d'attente de familles, tandis que l'exposition sur l'art de guerre, discrètement cachée au troisième étage derrière des portes vitrées opaques, est presque vide. Cette exposition se divise en deux parties, situées sur les côtés opposés du musée : une partie appelée "La vérité" expose des peintures produites pendant le conflit, surtout par des artistes employés par le Bureau de Propagande de Guerre britannique et qui, dans certains cas, servaient en tant que soldat ; l'autre partie, appelée "la Mémoire", contient des peintures produites après la guerre, certaines officielles, d'autres non. Il faut dire que cette section est de loin la moins intéressante, artistiquement et pour ce qu'elle a à dire de la guerre elle-même. Les images sont, pour la plupart, immobiles et presque paisibles ; elles semblent éloignées de la réalité, manquant de réalisme, comme si tant l'artiste que les spectateurs – et certainement l'État – ne voulaient pas se rappeler, mais oublier, ou au moins gommer le souvenir en reléguant prudemment la guerre dans le passé. Seules deux toiles nous frappent avec force. Une, "Une batterie bombardée" de Percy Wyndham Lewis (qui a servi dans l'artillerie) montre les soldats s'affairant sous le feu, réduits à des personnages filiformes semblables à la machine, tandis que ceux qui sont extérieurs à la zone dangereuse sont détachés, indifférents.
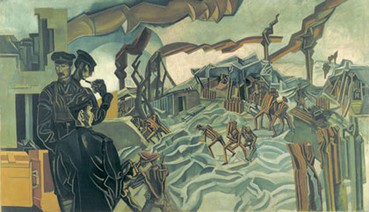
L'autre toile, "A l’assaut" par John Nash (le frère de l'artiste beaucoup plus connu Paul Nash) évoque la futilité des assauts sans fin qui se sont soldés par des dizaines de milliers de morts et un résultat militaire nul ; il y a quelque chose d'affreux dans la marche désespérée des soldats vers la mort certaine, d'autant plus quand nous savons que l'objet de sa toile est une attaque menée par sa propre unité, les 1st Artists Rifles, qui se termina en ne laissant guère un seul homme vivant ou indemne.

On est enclin à penser qu'après la guerre, pour la plupart, les gens ont voulu oublier ou, au moins, retourner à la vie en laissant la guerre derrière eux. À penser aussi que les gouvernements étaient pour le moins heureux qu'il en soit ainsi parce que la Première Guerre mondiale avait discrédité – aux yeux de beaucoup - la société capitaliste et les gouvernements qui l'ont assumée.
Société, idéologie, recherche de la vérité
Plus que n'importe quelle société de classes l'ayant précédée, la société bourgeoise a une relation paradoxale à la vérité. Ceci est dû à deux facteurs : d'une part les conditions et les besoins de la production industrielle ; d'autre part les caractéristiques spécifiques de domination de classe bourgeoise.
Le capitalisme est le premier mode de production qui ne peut pas vivre sans constamment révolutionner et bouleverser le procès de production à travers la mise en œuvre d'innovations scientifiques et techniques. Au début, alors que la société bourgeoise commence à apparaître au sein de sa coquille féodale, ce n'est pas immédiatement visible : En Angleterre l'industrie textile de la laine au 13ème siècle commence à rompre ses liens contraignants avec le système des guildes féodales, mais la technologie demeure en grande partie inchangée. La révolution est sociale, pas encore technique, basée sur les nouvelles façons d'organiser la production et le commerce. Au 17ème siècle, la science expérimentale a pour but de contribuer à l'amélioration de la production et, au 18ème siècle, la recherche scientifique sur la nature est appliquée à l'industrie et devient une force productive à part entière. Aujourd'hui, la mécanique quantique et la théorie de relativité peuvent sembler abstruses et même bizarres – néanmoins, une multitude de produits dans l'utilisation quotidienne dépendent de leurs résultats.
Le capitalisme dépend donc de la science. Mais la science elle-même repose sur deux piliers : la supposition qu'un monde existe indépendant de la pensée, qu'elle soit humaine ou divine ; et la conviction qu'il est possible de comprendre ce monde matériel à travers la recherche et le libre débat 2. Une condition préalable pour le développement du capitalisme et de la société bourgeoise est donc la victoire de Copernic et de Galilée sur l'Église catholique et l'Inquisition : on ne peut pas permettre à l'Église catholique de maintenir son monopole de la pensée.
L'autorité de classe sous le capitalisme est aussi unique. En effet, la classe bourgeoise est la première dans l'histoire à feindre que sa domination de classe n'existe pas, la première à justifier sa propre autorité en la basant sur "la volonté du peuple". La société bourgeoise est donc la plus hypocrite de l'histoire.
Pourtant, s'il n'y avait que cela, une telle domination ne survivrait pas longtemps. La bourgeoisie domine, mais cela ne doit pas se voir ; son hypocrisie doit être sincère. La recherche de la vérité ne peut pas non plus être limitée au domaine de la science, sans embrasser la sphère sociale et artistique, car la science et l'art ne sont pas deux mondes séparés, ils ne sont pas du tout fondés sur des qualités antithétiques ou même différentes de l'esprit humain. Ainsi la bourgeoisie est contrainte de laisser libre cours à la recherche de la vérité autant dans le domaine artistique que dans le domaine scientifique, sous peine de laisser l'avantage à ses concurrents. Ce furent les États-Unis, pas l'Allemagne nazie, qui a réussi dans la production de la bombe atomique.
Il y a une autre caractéristique nouvelle de la société capitaliste : pour la première fois, la classe révolutionnaire est une classe exploitée. Plus important encore, cette classe exploitée est une classe cultivée. Pour la première fois, la classe exploitée doit être instruite pour s'adapter aux complexités de la production capitaliste : les travailleurs doivent pouvoir lire et écrire, prendre en charge de plus en plus des tâches techniques et sociales complexes.
Le capitalisme lui-même instruit et forme la masse des travailleurs dans les compétences nécessaires, à la maîtrise de l'organisation sociale. Ce faisant il les rend aptes à se revendiquer de l'héritage de la connaissance artistique, scientifique et technique de toute l'humanité et de ses réalisations qu'ils utiliseront pour satisfaire les besoins humains, y compris les besoins culturels humains. Plus encore : dans ce qu'elle a montré de meilleur d'elle-même, la classe des prolétaires ne s'est jamais satisfaite des restes de la table de la culture bourgeoise, elle a voulu comprendre cette culture et la faire sienne. "Le marxisme a acquis une importance historique en tant qu'idéologie du prolétariat révolutionnaire du fait que, loin de rejeter les plus grandes conquêtes de l'époque bourgeoise, il a - bien au contraire - assimilé et repensé tout ce qu'il y avait de précieux dans la pensée et la culture humaines plus de deux fois millénaires" 3.
Plus la présence de cette classe cultivée, révolutionnaire et exploitée est importante dans la société, moins la bourgeoisie est à même de s'appuyer seulement sur le mensonge et la répression. Ce n'est que dans des régimes où les ouvriers ont été écrasés - les régimes comme l'Allemagne nazie ou l'URSS staliniste – qu'il est possible à la propagande de ne compter idéologiquement que sur le knout.
La classe dirigeante britannique, peut-être plus que n'importe quelle autre, est consciente de cette situation étrange, changeante et contradictoire ; elle est consciente qu'elle doit développer sa propagande dans deux directions. Nous sommes presque tentés de répondre au célèbre dicton de Winston Churchill selon lequel, "En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être assistée par un garde du corps de mensonges" en le retournant : "les mensonges sont si précieux qu'ils doivent être entourés par un garde du corps de vérité".
L'art et la propagande
"Le vent d'est se lève, Watson." "Je ne crois pas, Holmes. Il fait très chaud." "Cher vieux Watson ! Vous êtes le seul point fixe d’une époque changeante. Un vent d’est se lève néanmoins : un vent comme il n’en a jamais soufflé sur l’Angleterre. Il sera froid et aigre, Watson ; bon nombre d’entre nous n’assisteront pas à son accalmie. Mais c’est toutefois le vent de Dieu; et une nation plus pure, meilleure, plus forte surgira à la lumière du soleil quand la tempête aura passé." 4
Ces mots proviennent de la toute fin de la dernière nouvelle de "Sherlock Holmes", Son dernier coup d’archet, par Arthur Conan Doyle, dans laquelle Holmes déjoue un maître espion allemand juste avant l'éruption de la guerre. Le Holmes fictif ne fait ici que répercuter des sentiments qui ont été exprimés par des personnages réels lors de l'éclatement de la guerre : Collins-Baker, le Conservateur à la Galerie nationale, écrivant en août 1914, a cru que l'art tirerait profit "d'une guerre purificatrice" 5 et ceci n'était pas un point de vue rare dans l'establishment britannique qui espérait que la guerre "régénérerait" l'art et la société et en les débarrassant des perturbations à la fois du Cubisme, du Modernisme, et de tout ce qui constituait une offense au prétendu "bon goût".
Des guerres précédentes avaient été célébrées "avec réalisme" et patriotisme comme appartenant à une série d'engagements héroïques, comme cela avait été le cas avec la Guerre de Crimée par exemple.

Sans aucun doute, l'aile réactionnaire de la classe dirigeante britannique et son entreprise artistique s'attendaient à ce qu'une telle sorte de peinture étouffe les influences étrangères, décadentes et corruptrices. Mais celle-ci s'est révélée être un genre mourant. Comme nous entrons dans l'exposition une illustration de cela s'offre symboliquement à nous, avec le "2e bataillon des "Ox & Bucks" battant la Garde prussienne à Nonne Bosschen" de William Barnes Wollen.
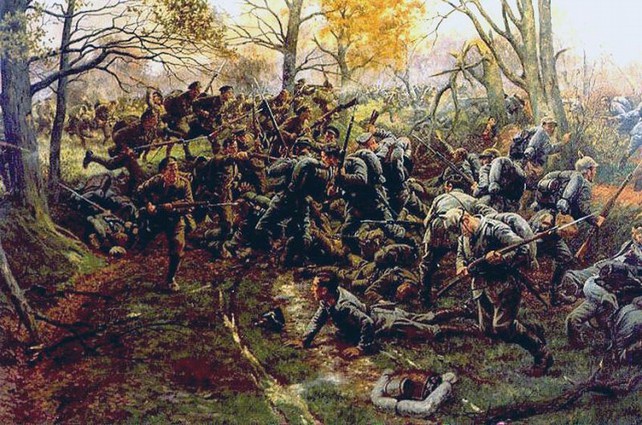
En effectuant un pas dans la pièce suivante, nous nous trouvons dans un monde totalement différent et ici nous voulons nous centrer sur l'évolution de deux artistes qui ont suivi des directions diamétralement opposées du point de vue artistique, comme conséquence de leur expérience de guerre : CRW Nevinson et William Orpen.
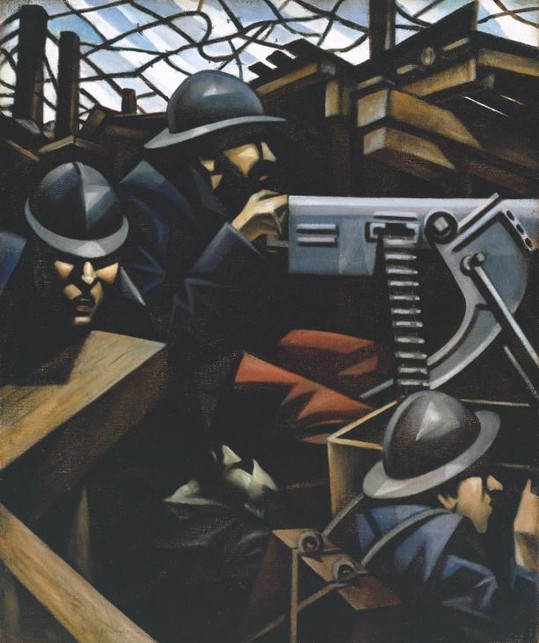 Nevinson avait 25 ans quand la guerre a éclaté. Il rejoint alors "l'Unité d'Ambulance des Amis" montée par les Quakers ; il a été profondément choqué par cette expérience qui, de façon évidente, a éclairé son art. En 1914, il est déjà un peintre paysagiste reconnu ; il est lié au Mouvement Futuriste italien, particulièrement avec le peintre Marinetti qui, plus tard, allait devenir un partisan de Mussolini. En 1914, Marinetti avait déclaré "Nous voulons glorifier la guerre - la seule hygiène du monde" (un sentiment qu'il partageait avec un Catholique tel que le poète Hilaire Belloc, par exemple, et d'autres comme ceux que nous avons cité ci-dessus, et pourtant il n'y a aucune trace de glorification de la guerre dans le travail de Nevinson. Au contraire, Nevinson déclarait en 1915 que, "Contrairement à mes amis Futuriste italiens, je ne glorifie pas la guerre en elle-même, je ne peux non plus accepter la doctrine selon laquelle la guerre est seule source de santé (…) Dans mes représentations (…) J'ai essayé d'exprimer l'émotion produite par la laideur et la grisaille apparentes de la guerre moderne" 6. En 1915, il disait dans le Daily Express : "notre technique Futuriste est le seul moyen possible pour exprimer la grossièreté, la violence et la brutalité des émotions perçues et ressenties sur les champs de bataille actuellement en Europe". Nevinson utilise ces techniques Futuristes de juxtaposition de surfaces planes et de coloration sombre pour montrer l'homme réifié et déshumanisé, transformé en un accessoire de la machine dans une guerre qui a été mécanisée plus que jamais auparavant : sa peinture "La mitrailleuse" (1915) symbolise cette démarche artistique. Dans "Le retour aux tranchées", les soldats ont presque été transformés eux-mêmes en machines.
Nevinson avait 25 ans quand la guerre a éclaté. Il rejoint alors "l'Unité d'Ambulance des Amis" montée par les Quakers ; il a été profondément choqué par cette expérience qui, de façon évidente, a éclairé son art. En 1914, il est déjà un peintre paysagiste reconnu ; il est lié au Mouvement Futuriste italien, particulièrement avec le peintre Marinetti qui, plus tard, allait devenir un partisan de Mussolini. En 1914, Marinetti avait déclaré "Nous voulons glorifier la guerre - la seule hygiène du monde" (un sentiment qu'il partageait avec un Catholique tel que le poète Hilaire Belloc, par exemple, et d'autres comme ceux que nous avons cité ci-dessus, et pourtant il n'y a aucune trace de glorification de la guerre dans le travail de Nevinson. Au contraire, Nevinson déclarait en 1915 que, "Contrairement à mes amis Futuriste italiens, je ne glorifie pas la guerre en elle-même, je ne peux non plus accepter la doctrine selon laquelle la guerre est seule source de santé (…) Dans mes représentations (…) J'ai essayé d'exprimer l'émotion produite par la laideur et la grisaille apparentes de la guerre moderne" 6. En 1915, il disait dans le Daily Express : "notre technique Futuriste est le seul moyen possible pour exprimer la grossièreté, la violence et la brutalité des émotions perçues et ressenties sur les champs de bataille actuellement en Europe". Nevinson utilise ces techniques Futuristes de juxtaposition de surfaces planes et de coloration sombre pour montrer l'homme réifié et déshumanisé, transformé en un accessoire de la machine dans une guerre qui a été mécanisée plus que jamais auparavant : sa peinture "La mitrailleuse" (1915) symbolise cette démarche artistique. Dans "Le retour aux tranchées", les soldats ont presque été transformés eux-mêmes en machines.

Nevinson a entièrement destiné son art en vue d'en faire un acte d'accusation de la guerre et de ses motivations. À propos de sa peinture "La Patrie" (1916) il a écrit "je considère cette toile, tout à fait indépendamment de comment elle est peinte, comme l'expression d'une perspective absolument NOUVELLE sur le soi-disant "sacrifice" que constitue la guerre. C'est le dernier mot sur "l'horreur de guerre" pour les générations à venir" 7.
Les peintures de Nevinson ont été bien reçues quand il les a exposées en novembre 1916, malgré le fait que son style moderne et "étranger" constituait l'illustration de tout ce que le côté le plus patriotique et réactionnaire de la société britannique abhorrait. Mais après deux ans de guerre, la fatigue et la désillusion qu'elle engendrait s'installaient et la critique féroce de Nevinson captait l'opinion mieux que la propagande gouvernementale officielle. Les principaux critiques ont accepté que "des méthodes modernes devenaient nécessaire pour dépeindre la guerre moderne" et même le Times a vu dans son travail "un cauchemar de non réalité insistante, fausse mais réelle, quelque chose qui arrive certainement, mais auquel notre raison ne consentira pas". 8
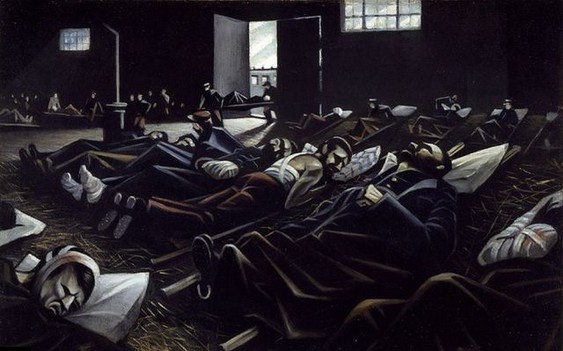
Une autre peinture qui a fait sensation quand elle a été exposée en 1916 était "Les Kensingtons à Laventie" d'Eric Kennington. Cette peinture montre sa propre unité peu avant que lui-même ait été blessé (Kennington apparaît à l'arrière-plan sur la gauche portant un passe-montagne et un casque).
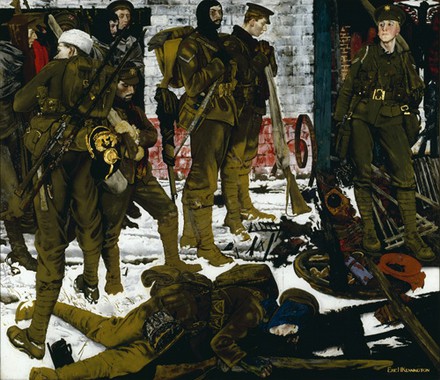
La réception enthousiaste suscitée par le travail de Kennington et de Nevinson était en grande mesure due à la perception par le public de ces peintures comme étant plus véridiques, plus crédibles, que les dessins produits sur la base des photographies ou de comptes rendus de deuxième main dans les magazines illustrés : d'abord, parce qu'ils reflétaient une réalité que les gens savaient être beaucoup plus près de la vérité, tant visuellement qu'au niveau des émotions, ensuite parce que les artistes étaient, ou avaient été, des soldats avec l'expérience réelle de la première ligne.
Ces peintures ont été toutes produites avant que Nevinson ou Kennington aient été employés comme artistes de guerre par le Département Britannique d'Informations. Celui-ci était le successeur du Bureau de Propagande de Guerre, qui avait été secrètement mis en place en août 1914 et s'était initialement concentré sur l'écrit, faisant monter des auteurs devenus célèbres comme John Buchan et HG Wells, afin de soutenir l'effort de guerre britannique. Un des premiers efforts du Bureau portait sur "le Rapport sur les présumées atrocités allemandes" (aussi connu sous le nom Rapport Bryce), qui accusait l'armée allemande de crimes de guerre contre des civils après l'invasion de la Belgique. Avant mai 1916, le président du Bureau, le député du parti libéral Charles Masterman, un allié du Premier ministre Lloyd George, décida de répondre à la demande de dessins pour la presse illustrée en recrutant le célèbre artiste Muirhead Bone (qui avait fait fortement pression en faveur de la mise en place d'un projet officiel d'Artistes de Guerre), lequel fut envoyé pour visiter le front avec une commission honoraire. Les croquis qu'il a fournis, malgré leur excellence graphique, sont insipides et sans vie comparés avec l'évidente émotion à l'état brut dans l'art de Nevinson.
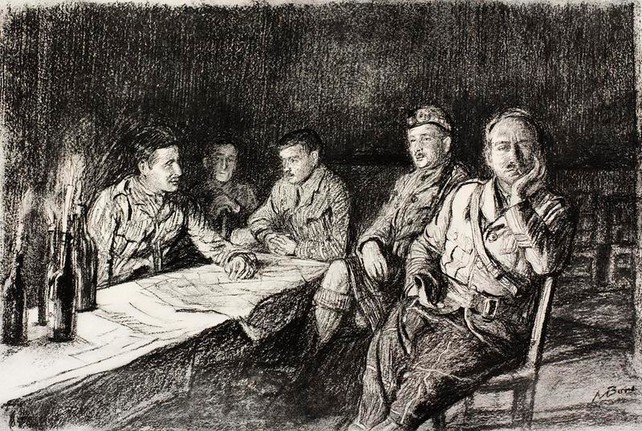
Même son "Cimetière de soldats" est à peine plus exaltant que l'image d'un cimetière de campagne.
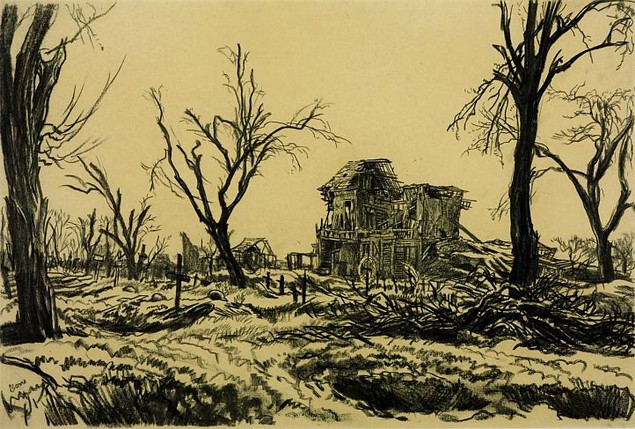
C'est indubitablement ce qui avait incité le Ministère de l'Information à s'ouvrir jusqu'à des artistes plus jeunes, particulièrement ceux servant sur le front dont le public accepterait le travail comme plus authentique. En même temps, faire entrer des artistes sous l'égide du Ministère signifiait que leurs travaux seraient soumis à la censure militaire. Au moment où sa seconde exposition - qui fut un énorme succès - s'ouvrait en 1918, Nevinson semble être arrivé à la conclusion que seul un retour au réalisme était adéquat pour exprimer son horreur de la guerre, comme nous pouvons le voir dans le tableau ironiquement intitulé "Les chemins de la Gloire" - un titre utilisé en 1957 par Stanley Kubrick pour son célèbre film contre la guerre où Kirk Douglas tenait le rôle principal.
L'ironie du titre n'est que trop évidente quand nous voyons les cadavres face contre terre dans la boue, déjà gonflés par la décomposition.
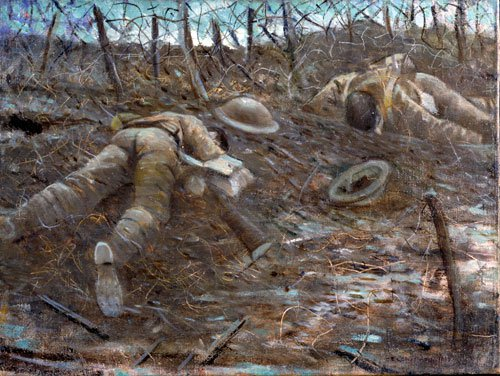
Si le travail précédent de Nevinson a montré l'homme déshumanisé, réduit au statut d'une machine, incorporé dans la machine, on pourrait se demander s'il a senti le besoin de s'échapper de l'esthétique, même une esthétique de la machine, pour montrer la vraie horreur de ce que la guerre faisait non pas aux machines, mais aux êtres humains réels, faits de chair et de sang, avec lesquels nous pouvons nous identifier et avoir de la sympathie - quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec une machine.
Le tableau a été interdit par les autorités. Nevinson l'a quand même accroché à l'exposition, barré d'un grand ruban où était inscrit le mot "Censuré".
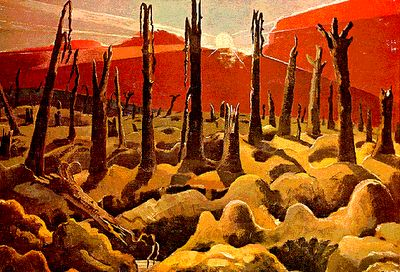
Paul Nash, un autre artiste de guerre qui devait devenir un des peintres paysagistes britanniques les mieux connus du 20e siècle, a fait des remarques amères sur son emploi en tant qu'artiste de guerre : "je ne suis plus un artiste. Je suis un messager qui ramènera l'expression des hommes qui se battent à ceux qui veulent que la guerre continue pour toujours. Faible, inintelligible sera mon message, mais il aura une vérité amère et puisse-t-il brûler leurs âmes maudites". Et le public ne pouvait sûrement pas échapper aux implications de cette peinture intitulée "Nous construisons un nouveau monde".
La vérité a ses droits
Tandis que Nevinson passait du moderniste au traditionnel, un autre artiste très différent se déplaçait presque dans la direction opposée. William Orpen avait presque 40 ans lorsque la guerre a éclaté et il était même alors un portraitiste de la haute société fortunée. Envoyé en France comme artiste de guerre avec le rang de commandant, il a été raillé par certains pour sa situation privilégiée et sûre, bien loin de n'importe quelle expérience de combat et, en effet, les tous premiers portraits qu'il a produits pourraient aisément servir d'images de propagande en directions des troupes britanniques, particulièrement les pilotes présentés par la presse et les machines de propagande comme les nouveaux "chevaliers à l'armure brillante" de la guerre moderne.
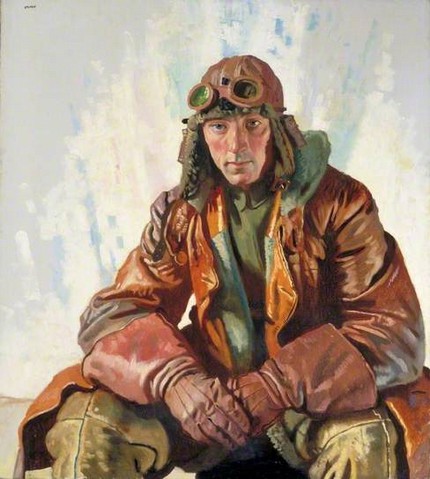
Son portrait du jeune Lieutenant pilote Rhys Davids, tué peu après dans un combat aérien, a été très reproduit.

On a aussi largement loué les portraits d'Orpen des généraux Haig et Trenchard et l'artiste aurait pu s'attacher simplement à continuer à faire plus dans le même genre, mais ce ne fut pas le cas 9. Au contraire, il a été de plus en plus perturbé par les conséquences de la guerre, tant sur les soldats que sur les civils qu'elle concernait, et avec le temps, il s'est de plus en plus tourné vers des peintures qui parfois s'approchent d'un surréalisme à la Dali.
Nous savons qu'il avait été choqué de voir des jeunes prostituées françaises racoler à une cérémonie d'enterrement. C'est peut-être cela qui a inspiré son "Adam et Ève à Péronne".

Cette toile a quelque chose de presque pornographique. Ici il n'y a aucune perte d'innocence – celle-ci est déjà partie depuis longtemps, perdue dans les décombres de guerre que nous voyons à l'arrière-plan. Le foulard modeste d'Eve contraste curieusement avec son décolleté plongeant et avec l'expression d'un certain cynisme sur son visage, tandis que l'indifférence ennuyée du jeune soldat suggère quelqu'un qui a tant vu la mort qu'il est devenu indifférent à la vie.
Le même soldat apparaît dans "La femme folle de Douai" qui dépeint une scène, à laquelle Orpen avait assisté, d'une femme violée peu de temps avant par des soldats allemands qui se battaient en retraite. Ici il apparaît également indifférent au viol, à la tragédie de la victime et au cadavre enterré à la hâte dont le pied dépasse de sa tombe au premier plan.

Cachée dans une pièce à l'arrière de l'exposition se trouve une série de sept gravures de Percy Delf Smith, qui était un artilleur dans les Royal Marines sur le front.
Là où certaines des images d'Orpen reprennent des thèmes de Goya (par exemple, "Le Bombardement, la Nuit"), Smith retourne aux images de la société médiévale décadente avec ses représentations de mort omniprésentes. Ceux-ci sont certainement parmi les tableaux les plus choquants de l'exposition.
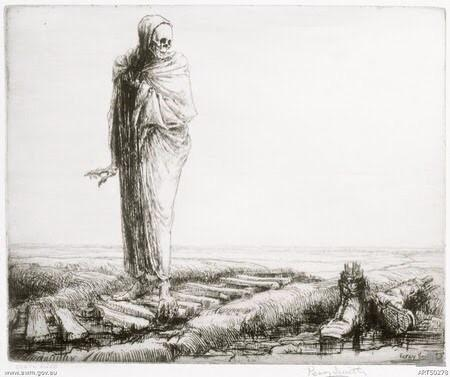
Dans "La Mort effrayée", même la Mort recule devant le massacre, incarné par deux bottes encore habitées de morceaux de jambes, tandis que "la Mort intoxiquée" représente une parodie de danse où la Mort cabriole de façon délirante derrière un soldat sur le point d'embrocher un ennemi sur sa baïonnette.
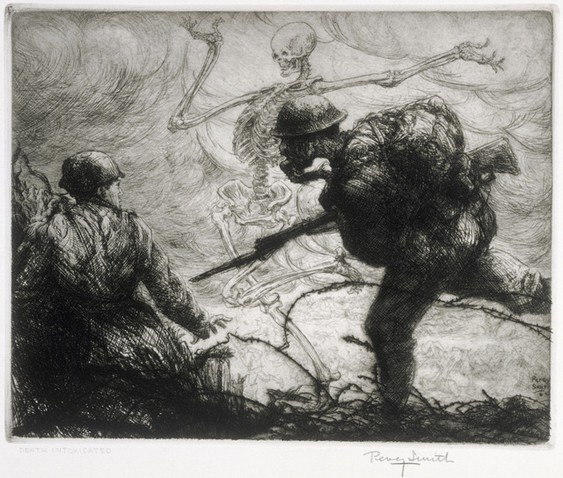
Cela semble assez naturel de vouloir, de presque attendre même, des artistes qui nous émeuvent par leur esprit critique qu'ils partagent nos idées. Naturel, mais profondément erroné. Les artistes qui figurent dans ce texte - et auxquels nous pourrions ajouter des poètes comme Wifred Owen et Siegried Sassoon et les expressionnistes allemands comme Otto Dix ou Käthe Kollwitz - ont été profondément révoltés par la guerre, et plusieurs d'entre eux ont souffert de dépressions nerveuses à différents degrés de gravité à la fin de la guerre. Mais, aucun d'entre eux, n'était en rien sensible à un point de vue politique prolétarien ; dans quelques cas ils n'étaient même pas des gens particulièrement sympathiques.
Nous oublions parfois que les grands maîtres que nous admirons aujourd'hui n'étaient pas seuls, au contraire (à de rares exceptions près) ils étaient les plus grands représentants d'un effort dans lequel beaucoup ont été impliqués. Et quand les artistes se détachent du commun des personnes qui les entoure, quand leur art atteint les hauteurs qui continuent à nous toucher aujourd'hui alors que tant de contemporains de moindre envergure ont été oubliés, alors ils nous communiquent, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui va au-delà de l'artiste lui-même. En de tels moments, l'artiste est à l'écoute de quelque chose dans l'atmosphère sociale, quelque chose qui n'est pas très souvent explicite. Est-ce vraiment un hasard si certains des actes d'accusation les plus cuisants contre la guerre avaient été produits la même année - et auraient presque pu servir d'illustrations dans la Brochure de Junius de Rosa Luxemburg. Dans la Brochure de Junius, Rosa Luxembourg écrit : "Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu’elle est. Ce n’est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l’ordre, de la paix et du droit, c’est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l’anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l’humanité qu’elle se montre toute nue, telle qu’elle est vraiment." N'est-ce pas précisément ceci qui parvient à nous atteindre depuis les tableaux du Musée de Guerre Impérial ? Et, n'est-ce pas précisément parce qu'il a existé, quelque part, un esprit capable de Junius et un mouvement ouvrier ensanglanté et trahi, mais toujours vivant et capable de prendre en charge et de transformer dans l'action sociale les idées de Junius, qu'il pourrait aussi exister un esprit critique artistique capable de parler non pas à la conscience, comme le faisait Luxembourg, mais directement aux émotions (comme pouvait le faire également Luxembourg). De cette manière, ils parlent à quelque chose de constant dans la nature humaine, quelque chose de vraiment humain (comme Marx aurait pu dire) qui ne peut que réagir face au dégoût qu'inspire la monstrueuse machine de mort que le capitalisme était devenu.
Où est l'art de la Seconde Guerre mondiale ?
Le contraste suivant est saisissant. Tandis que la Première Guerre mondiale a produit certains des plus grands peintres du 20e siècle en Grande Bretagne, sans parler de certaines expressions artistiques les plus remarquables en Allemagne, rien de pareil ne peut être dit de la Seconde Guerre mondiale qui n'a produit absolument rien de comparable.
 En partie, cela a été le résultat de l'évolution technologique. Quand les magazines illustrés comme le célèbre Picture Post visèrent à montrer la guerre en images, ils se sont tournés moins vers les artistes que vers les photographes et, en particulier, la nouvelle race de photographes de guerre comme le grand Robert Capa. De façon plus importante encore, la classe dirigeante des deux côtés du conflit avait une compréhension beaucoup plus grande de l'importance de la propagande. Le régime Nazi a exercé un contrôle de l'État sur la production artistique, dénonçant l'Expressionnisme comme étant de "l'art dégénéré" : Otto Dix, quoiqu'il soit resté en Allemagne, s'est enfermé dans un exil auto-imposé, tant personnel qu'artistique, et le grand ennemi de la guerre capitaliste et de la corruption sociale a passé ses dernières années en peignant de manière inoffensive quoique de façon techniquement irréprochable, des portraits comme "Nelly comme Flore" en 1940.
En partie, cela a été le résultat de l'évolution technologique. Quand les magazines illustrés comme le célèbre Picture Post visèrent à montrer la guerre en images, ils se sont tournés moins vers les artistes que vers les photographes et, en particulier, la nouvelle race de photographes de guerre comme le grand Robert Capa. De façon plus importante encore, la classe dirigeante des deux côtés du conflit avait une compréhension beaucoup plus grande de l'importance de la propagande. Le régime Nazi a exercé un contrôle de l'État sur la production artistique, dénonçant l'Expressionnisme comme étant de "l'art dégénéré" : Otto Dix, quoiqu'il soit resté en Allemagne, s'est enfermé dans un exil auto-imposé, tant personnel qu'artistique, et le grand ennemi de la guerre capitaliste et de la corruption sociale a passé ses dernières années en peignant de manière inoffensive quoique de façon techniquement irréprochable, des portraits comme "Nelly comme Flore" en 1940.
Hitler était un grand admirateur de la propagande de guerre britannique et les Anglais eux-mêmes n'ont pas perdu de temps, quand la guerre a commencé, pour installer un "Comité consultatif d'Artistes de Guerre" subordonné au Ministère de l'Information. Il suffit de comparer "La Bataille de Grande-Bretagne", presque lyrique, de Paul Nash avec son "Nous faisons un nouveau monde" pour voir que l'esprit critique du dernier a complètement disparu.

Ou de nouveau, comparez la peinture de 1943 d'Alfred Thomson d'un aviateur blessé recevant des soins, avec la description de la Première Guerre mondiale de Nevinson d'une scène à l'hôpital dans "La Patrie". Ici nous avons une image d'un calme paisible, très loin de l'agonie et l'angoisse de l'hôpital de campagne.

L'esprit critique n'avait pas complètement disparu. Certains des artistes américains de combat qui figurent sur le site PBS 10 "They drew fire" - et sans aucun doute il est significatif que ces hommes ont été confrontés à la terreur de guerre – ont produit un art qui fait écho à l'horreur vécue par les combattants de la Première Guerre mondiale.
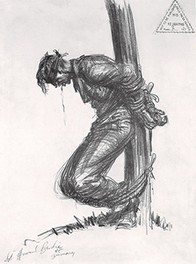 Sur un croquis, l'artiste Howard Brodie a écrit : "Mon souvenir le plus bouleversant de toute la guerre concerne la Bataille des Ardennes, quand des allemands se faisant passer pour des G.I. ont infiltré nos lignes. J'ai entendu dire que nous allions exécuter trois d'entre eux … Un homme sans défense est entièrement différent d'un homme dans l'action. Voir ces trois jeunes hommes délibérément réduits à des cadavres tremblants devant mes yeux m'a réellement brûlé dans mon être. C'est le seul de mes dessins ayant été censuré. Toute la couverture de l'exécution a été censurée".
Sur un croquis, l'artiste Howard Brodie a écrit : "Mon souvenir le plus bouleversant de toute la guerre concerne la Bataille des Ardennes, quand des allemands se faisant passer pour des G.I. ont infiltré nos lignes. J'ai entendu dire que nous allions exécuter trois d'entre eux … Un homme sans défense est entièrement différent d'un homme dans l'action. Voir ces trois jeunes hommes délibérément réduits à des cadavres tremblants devant mes yeux m'a réellement brûlé dans mon être. C'est le seul de mes dessins ayant été censuré. Toute la couverture de l'exécution a été censurée".
Et il n'y a certainement rien de glorieux à propos de "L'aide à un homme blessé" (Eby avait servi dans un équipage ambulancier pendant la Première Guerre mondiale).
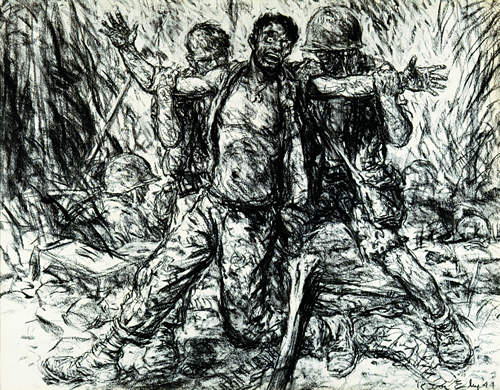
L'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale avait été relativement mineur, l'implication de l'ensemble la population dans le combat y avait été incomparablement moins importante que dans les pays européens et beaucoup moins importante que durant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être pouvons-nous expliquer le puissant impact des tableaux précédents par la naïveté de la classe ouvrière américaine qui, bien qu'elle ait dû affronter dans ses luttes une des fractions les plus brutales de la classe capitaliste, devait encore faire l'expérience de la barbarie folle de la guerre moderne grandeur nature.
Ces images crues de la brutalité de la guerre - et la folie qu'elle inflige à des êtres humains que nous voyons nous fixer depuis les yeux de "l'homme blessé" d'Eby - révèlent une recherche honnête de la vérité artistique, qui montre que l'intégrité et l'humanité ont continué à survivre même au cœur de barbarie. Mais comparé aux œuvres inspirées par la Première Guerre mondiale il y a quelque chose qui manque : un sentiment de critique sociale plus large qui va au-delà de la réaction individuelle aux événements éprouvés individuellement. Marx avait tort lorsqu'il disait que seuls de mauvais artistes mettent des titres à leurs peintures (le plus grand des peintres paysagistes britanniques, William Turner, a non seulement donné de longs titres à ses œuvres, mais il les accompagnait parfois avec des lignes de sa propre poésie) et des titres comme "les Chemins de la gloire" ou "Nous faisons un nouveau monde" soulignent pour nous la protestation plus large de l'artiste contre la guerre, ses causes et ses conséquences.
À cause du "réalisme socialiste", la peinture russe de la Seconde Guerre mondiale était tout sauf réaliste et, durant la Guerre de Corée, les principes du réalisme socialiste semblent avoir été appliqués avec autant d'enthousiasme par les américains que par le chinois.
Le Viêt-Nam : L'art contre la guerre
Ce n'est qu'avec la Guerre du Viêt Nam que l'art revient vraiment à une attaque critique contre la guerre et, ici, c'est un art d'une nouvelle sorte qui vient sur le devant de la scène : la photographie.
La photographie et la peinture relèvent de compétences techniques très différentes : là où le peintre esquisse pour préparer un travail final, le photographe prendra des centaines, parfois même des milliers de clichés. Là où le peintre incrémente son travail, petit à petit, cernant la vérité en ajoutant de la peinture, le photographe rejette, pour aboutir à seul cliché, celui qui incarne le mieux l'événement, la scène ou le visage qu'il essaie de représenter. Et bien sûr, la photographie en noir et blanc implique en particulier un travail subtil avec des produits chimiques dans la chambre noire pour approfondir l'ombre, accentuer et centrer l'attention sur l'essentiel.
À leur plus haute expression, la peinture et la photographie, comme tout l'art, peuvent tous deux exprimer une recherche de la vérité. Et effectivement nous avons des images les plus emblématiques de la Guerre du Viêt Nam, comme la photo de Trang Bang par le photographe vietnamien Nick Ut après l'attaque au napalm du 8 juin, en 1972. Aucune œuvre de la Première Guerre mondiale n'a peint mieux que cette photo l'horreur pure, la barbarie et par-dessus tout l'absurdité de cette guerre.

Nick Ut était un photographe de l'Associated Press, une coopérative d'informations à but non lucratif fondée pendant la Guerre au Mexique de 1846, qui a produit une grande partie du meilleur - le plus émotionnellement vrai – des photos qui sont sorties de la Guerre du Viêt Nam 11. La guerre elle-même venait à un moment très spécifique et a été, à certains égards, unique dans les annales de photographie de guerre. Tout d'abord, elle était "la première guerre dans laquelle les journalistes étaient régulièrement accrédités pour accompagner des forces militaires, non encore soumis à la censure." 12 Ce fut une leçon que les États-Unis, en particulier, allaient apprendre pour des guerres futures. Les Guerres du Golfe, par exemple, ont été rigoureusement censurées avec la vérification systématique des reportages télé avant qu'il ne soient envoyés. Tous ces rapports "en direct" étaient en direct seulement dans le sens où ils arrivaient sur les écrans seulement quelques minutes après avoir été émis alors que le censeur militaire avait déjà vérifié leur contenu au fil de l'eau. Dans de telles conditions, beaucoup de journalistes ont appris à se censurer.

Les clichés d'Ut comme la photo d'Art Greenspon représentant des soldats américains qui attendent un hélicoptère pour évacuer le blessé, sont plus qu’une simple photographie de guerre racontant une histoire saisissante, ils sont aussi une forme de critique sociale. Bien qu'il y ait relativement peu de photos de troupes du Viêt-Cong autres que des prisonniers, il n'existe pas de doute concernant qui sont les victimes principales de la guerre : les civils tout d'abord, bien sûr, mais aussi les "grunts", ainsi que les conscrits G.I. américains ont été appelés pour les distinguer des "lifers" (terme qui désigne les soldats et officiers de carrière engagés à vie), et bien sûr l'armée vietnamienne du Sud et le Viêt-Cong avaient leurs équivalents : dans leur grande majorité, c'était les conscrits, les ouvriers en uniformes qui étaient envoyés dans les situations les plus dangereuses sur les lignes de front.
Si cette forme de critique sociale était possible, ce n'est pas seulement parce que l'armée américaine n'avait pas encore appris la censure. Une image, qu'elle soit une toile ou une photographie, est toujours un moyen de communiquer. L'artiste communique sa vérité, mais il ne peut le faire que si la vérité est aussi écoutée, si dans la société il existe ceux qui sont capables d'entendre et comprendre cette vérité. Ceux qui regardent l'art font aussi partie de sa signification. Ce n'est donc pas un hasard si ces photographies viennent de 1968 et 1972, de la Guerre du Viêt Nam et pas de celle de Corée (tout comme ce n'est pas un hasard si M.A.S.H., un film satirique sur la Guerre de Corée, a été réalisé seulement en 1970), car ceci est la période où les 30 Glorieuses tirent à leur fin, marquée par le renouveau de la lutte de classe qui trouve son expression la plus importante en mai 68 en France.
"L'esprit de l'époque", le Zeitgeist, peut sembler une notion insaisissable, nébuleuse. Pourtant quand nous considérons cette production artistique qui est née de guerres auxquelles il a été mis un terme du fait de l'action de la classe ouvrière, alors qu'elle se révoltait directement contre la guerre elle-même (la Première Guerre mondiale) ou encore parce que les ouvriers révoltés contre les effets de la crise, dont la guerre faisait partie, ont de plus en plus refusé de se battre sous l'uniforme (la Guerre du Viêt Nam), il nous semble clair qu'un tel art n'était possible que parce que dans la société il existe une classe ouvrière aux "chaînes radicales", une classe qui est historiquement opposée à l'état présent de société, même si les ouvriers eux-mêmes n'en sont pas conscients, et beaucoup moins encore les artistes.
Balzac, comme le disait Engels, est allé au-delà de ses propres préjugés de classe en représentant sincèrement ce qu'il voyait. Ainsi les artistes de la Première guerre mondiale nous apportent quelque chose qui va au-delà de ce qu'eux-mêmes étaient parce, sous la surface des choses, ils ont cerné la vérité. La relation entre l'expression artistique dans le capitalisme et la révolte contre celui-ci, n'est en aucun cas une mécanique. L'art n'est pas grand parce qu'il est socialiste. Comme la science, l'art a sa propre dynamique et la première responsabilité de l'artiste est d'être fidèle vis-à-vis de lui-même. On est tenté de paraphraser ce qu'Engels dit de la science : ".... plus il est impitoyable et désintéressée, plus [l’art] est en harmonie avec les intérêts des travailleurs."13
Jens, 27/02/2015
1� La topographie du Musée a sa propre signification. L'exposition sur la Première Guerre mondiale se trouve immédiatement, au rez-de-chaussée, dans une galerie spectaculaire hébergeant des avions et les originaux des missiles V1 et V2 de la Deuxième Guerre mondiale. Les artistes de guerre de l'exposition "La vérité et la mémoire" sont logés beaucoup plus discrètement, dans deux galeries sur les côtés opposés du troisième étage.
2� Le destin de la production agricole de l'URSS Staliniste, comme produit de l'imposition idéologique des théories de Lysenko de l'évolution est un contre-exemple. Et bien sûr, le fait que le monde scientifique échoue souvent à vivre en accord avec cette nécessité ne l'infirme en aucune façon.
3� 8 octobre 1920, Lénine, De la culture prolétarienne.
5� Voir Paul Gough, A terrible beauty, Sansom & Co., 2010, p17.
6� Citation tirée des cartons de présentation généralement pertinents qui annoncent les expositions.
7� Cité dans cette revue intelligente et utile [3] du livre de Paul Gough à propos des artistes de guerre britanniques, A terrible beauty [Une terrible beauté].
8� Extrait d'un carton de présentation.
9� C'est également significatif qu'il ait fait don de sa collection entière de peintures de guerre au Musée de Guerre Impérial, estimant qu'il serait immoral de profiter financièrement de peindre une guerre où tant de gens ont souffert.
11� Voir l'article du New York Times [5].
12� Voir l'article cité précédemment.
13� Engels, “Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande classique”
Personnages:
- Wyndham Lewis [6]
- Paul Nash [7]
- William Orpen [8]
- CRW Nevinson [9]
Evènements historiques:
Rubrique:
1914: le début de la saignée
- 8184 lectures
2014: une année d'oubli
Aujourd'hui, on appelle encore "Grande Guerre" celle qui débuta en août 1914. Pourtant, la Seconde guerre mondiale fit plus de deux fois plus de victimes. Et que dire des guerres sans fin qui, depuis 1945, ont répandu plus de morts et causé davantage de destructions encore.
Pour comprendre pourquoi la guerre de 14-18 est toujours "La Grande Guerre", il suffit de visiter n'importe quel village en France, même le plus isolé, perdu dans les prairies alpines : des familles entières sont là dont les noms sont inscrits sur un marbre commémoratif- des frères, des pères, des oncles, des fils. Ces témoins muets de l'horreur se trouvent non seulement dans les villes et les villages des nations belligérantes européennes, mais jusqu'à l'autre bout du monde : dans le petit hameau de Ross sur l'île australienne de Tasmanie, le mémorial porte les noms de 16 morts et de 44 survivants, qu'on présume issus de la campagne de Gallipoli.
Pendant deux générations après la fin de la guerre, 1914-1918 était synonyme d'un carnage insensé, impulsé par la stupidité aveugle et irréfléchie d'une caste aristocratique dominante, par l'avidité sans bornes des impérialistes, des profiteurs de guerre et des fabricants d'armes. Malgré toutes les cérémonies officielles, toutes les gerbes déposées devant les monuments aux morts et (en Grande Bretagne), le port symbolique de coquelicots à la boutonnière le jour de la commémoration annuelle, cette vision de la Première Guerre mondiale est passée dans la culture populaire des nations belligérantes. En France, le roman autobiographique de Gabriel Chevalier, La Peur, publié en 1930, a connu un succès énorme au point où le livre fut interdit par les autorités. En 1937, le film anti-guerre de Jean Renoir, La Grande Illusion, était projeté sans interruption au cinéma Marivaux de 10 heures jusqu'à 2 heures du matin, battant tous les records d'entrées ; à New York, il est resté 36 semaines à l'affiche.1
Dans l’Allemagne des années 1920, les dessins satiriques de George Grosz descendaient en flammes les généraux, les politiciens et ceux qui avaient profité de la guerre. Le livre de Remarque A l'Ouest, rien de nouveau (Im Westen Nichts Neues) fut publié en 1929 : 18 mois après sa publication, on en avait vendu 2,5 millions d'exemplaires traduits en 22 langues ; la version cinématographique de Universal Studios en 1930 connaissait un succès retentissant aux Etats-Unis, où elle gagna l’Oscar du meilleur film.2
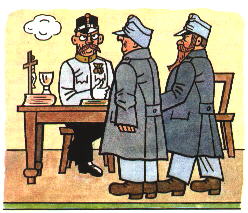 En se désagrégeant, l'Empire austroe-hongrois légua au monde un des plus grands romans anti-guerre : Le brave soldat Chweik (Osudy dobrélo vojáka Švejk za světové války) de Jaroslav Hašek, publié en 1923 et depuis lors traduit en 58 langues – plus que toute autre œuvre en langue tchèque.
En se désagrégeant, l'Empire austroe-hongrois légua au monde un des plus grands romans anti-guerre : Le brave soldat Chweik (Osudy dobrélo vojáka Švejk za světové války) de Jaroslav Hašek, publié en 1923 et depuis lors traduit en 58 langues – plus que toute autre œuvre en langue tchèque.
Le dégoût provoqué par la mémoire de la Première Guerre mondiale a survécu à la saignée encore plus terrible de la Deuxième. Comparée aux horreurs d'Auschwitz et d’Hiroshima, la barbarie du militarisme prussien et de l'oppression tsariste - pour ne pas parler du colonialisme français ou britannique - qui avaient servi de justification à la guerre en 1914, pouvaient sembler presque insignifiants et de ce fait, le massacre dans les tranchées semblait encore plus absurde et monstrueux : on pouvait ainsi présenter la Deuxième Guerre mondiale comme, sinon une "bonne" guerre, au moins une "guerre juste" et nécessaire. Cette contradiction n’est nulle part plus flagrante qu'en Grande-Bretagne, où toute une série de films exaltant la "juste cause" dans le pur style patriotard (Dambusters en 1955, 633 Squadron en 1964, etc.) passaient aux écrans de cinéma pendant les années 1950 et 60, alors qu'en même temps les écrits anti-guerre des "poètes de la guerre" Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, et Robert Graves faisaient partie du cours obligatoire pour les collégiens.3 Peut-être que la plus grande oeuvre de Benjamin Britten, le compositeur britannique le plus célèbre du 20e siècle, est son Requiem de Guerre (1961) qui mit en musique la poésie de Owen, alors que l'année 1969 a vu la sortie de deux films très différents : dans le genre patriotique Battle of Britain, et la satire mordante Oh What a Lovely War! qui réalise une dénonciation musicale de la Première Guerre mondiale en se servant des chansons créées par les soldats dans les tranchées.
Deux générations plus tard, nous nous trouvons à la veille du 100e anniversaire de l'éclatement de la guerre (le 4 août 1914). Étant donné l'importance des anniversaires à chiffre rond et encore plus des centenaires, de grands préparatifs sont en cours pour commémorer ("fêter" n'est guère le mot qui convient) la guerre. En France et en Grande Bretagne, des budgets de plusieurs dizaines de millions en euros ou en sterling ont été alloués ; en Allemagne, pour des raisons évidentes, les préparatifs sont plus discrets et n'ont pas reçu de bénédiction gouvernementale.4
“Qui paie les violons, choisit la musique” : alors que vont recevoir les classes dominantes en échange des dizaines de millions qu'elles ont dépensés afin de “commémorer la Guerre”?
Si nous regardons les sites web des organismes responsables de la commémoration (en France, un organisme spécial a été mis en place par le gouvernement, en Grande-Bretagne - de façon assez appropriée – il s’agir de l’Imperial War Museum) la réponse semble assez claire : ils achètent un des rideaux de fumée idéologique les plus coûteux de l'histoire. En Grande-Bretagne, l'Imperial War Museum se donne pour tâche de récolter les histoires des individus qui ont vécu la guerre afin de les transformer en podcast.5 Le site web du Centenary Project (1914.org) nous propose des événements d'une importance aussi cruciale que l'exhibition du revolver utilisé pendant la Guerre par JRR Tolkien” (sans blague - on suppose que le but est de surfer sur le succès des films "Le Seigneur des Anneaux" tirés des livres dont Tolkien était l'auteur) ; la commémoration d'un dramaturge du Surrey, la collecte par le Musée des Transports de Londres de l’'histoire des bus pendant la Grande Guerre (non mais vraiment !) ; à Nottingham “un grand programme d'événements et d'activités (...) mettront en lumière comment le conflit catalysa des changements sociaux et économiques immenses dans les communautés de Nottinghamshire”. La BBC a produit un "documentaire innovant": "La Première Guerre mondiale vue d'en haut" avec des photos et des films tirés à partir des ballons captifs de l'artillerie. On rendra hommage aux pacifistes par des commémorations sur les objecteurs de conscience. En somme, nous allons être noyés dans un océan de futilités. Selon le Directeur Général de l’Imperial War Museum, “notre ambition est que beaucoup plus de gens comprendront que vous ne pouvez pas comprendre le monde aujourd'hui sans comprendre les causes, le cours, et les conséquences de la Première Guerre mondiale”6 et nous sommes d'accord à 100% avec cela. Mais en réalité, tout est fait - y compris par l'honorable Directeur Général pour nous empêcher de comprendre ses véritables causes et ses réelles conséquences.
En France, le site du centenaire affiche le très officiel Rapport au Président de la République pour commémorer la Grande Guerre daté de septembre 20117 et qui commence avec ces mots du discours du Général de Gaulle lors du cinquantenaire de la guerre en 1964 : "« Le 2 août 1914, jour de la mobilisation, le peuple français tout entier se mit debout dans son unité. Cela n’avait jamais eu lieu. Toutes les régions, toutes les localités, toutes les catégories, toutes les familles, toutes les âmes, se trouvèrent soudain d’accord. En un instant, s’effacèrent les multiples querelles, politiques, sociales, religieuses, qui tenaient le pays divisé. D’un bout à l’autre du sol national, les mots, les chants, les larmes et, par-dessus tout, les silences n’exprimèrent plus qu’une seule résolution". Dans le rapport lui-même nous lisons que "S’il suscitera l’effroi des contemporains face à la mort de masse et aux immenses sacrifices consentis, le Centenaire fera également parcourir un frisson sur la société française, rappelant l’unité et la cohésion nationale affichée par les Français dans l’épreuve de la Première Guerre mondiale". Il paraît donc peu probable que la bourgeoisie française ait l'intention de nous parler de la répression policière brutale des manifestations ouvrières contre la guerre pendant juillet 1914, ni du notoire Carnet B (la liste tenue par le gouvernement des militants anti-militaristes socialistes et syndicalistes à arrêter et interner ou à envoyer au front dès l'éclatement de la guerre – les Britanniques avaient leurs propres équivalents), et encore moins des circonstances de l'assassinat du dirigeant socialiste anti-guerre Jean Jaurès à la veille du conflit ou des mutineries dans les tranchées8...
Comme toujours, les propagandistes peuvent compter sur le soutien de Messieurs les doctes universitaires pour fournir en matériel leurs documentaires et interviews. Nous prendrons ici un seul exemple qui nous semble emblématique : The Sleepwalkers, par l'historien Christopher Clark de l'université de Cambridge, publié en 2012 puis en 2013 en livre de poche, et déjà traduit en français (Les Somnambules) et en allemand (Die Schlafwandler).9 Clark est un empiriste sans complexe, son introduction annonce très clairement son intention : "Ce livre (…) traite moins de pourquoi la guerre a eu lieu que de comment elle est arrivée. Les questions du pourquoi et du comment sont inséparables dans la logique, mais elles nous mènent dans des directions différentes. La question du comment nous invite à regarder attentivement les séquences d'interactions qui ont produit certains résultats. La question du pourquoi, par contre, nous invite à partir à la recherche de causes éloignées et catégoriques : l'impérialisme, le nationalisme, les armements, les alliances, la finance, les idées d'honneur national, les mécanismes de la mobilisation".10 Ce qui manque dans la liste de Clark est, bien évidemment, le capitalisme. Serait-il possible que le capitalisme soit générateur de guerres ? Serait-il possible que la guerre ne soit pas seulement "la politique par d'autres moyens", pour reprendre l'expression bien connue de von Clausewitz, mais plutôt l'expression ultime de la concurrence inhérente au mode de production capitaliste ? Oh que non, que non, jamais de la vie ! Clark donc, s'adonne à nous livrer "les faits" sur le chemin de la guerre, ce qu'il fait avec une immense érudition et dans le moindre détail, jusqu'à la couleur des plumes d'autruche sur le casque de Franz-Ferdinand le jour de son assassinat (elles étaient vertes). Si quelqu'un avait pris la peine de noter la couleur des culottes de son assassin Gavrilo Princip ce jour-là, ce serait aussi dans ce livre.
La longueur du livre, sa maîtrise du détail, rend une omission d'autant plus remarquable. Malgré le fait qu'il consacre des sections entières à la question de "l'opinion publique", Clark n'a absolument rien à dire à propos de la seule partie de "l'opinion publique" qui importait vraiment : la position adoptée par la classe ouvrière organisée. Clark cite longuement des journaux comme le Manchester Guardian, le Daily Mail, ou Le Matin, et bien d'autres depuis longtemps tombés dans un oubli bien mérité, mais il ne cite même pas une seule fois ni le Vorwärts, ni L'Humanité (les journaux respectivement des partis socialistes allemand et français), ni La Vie Ouvrière, l'organe quasi-officiel de la CGT française,11 ni La Bataille Syndicaliste. Ce n'était pas des publications mineures ! Le Vorwärts n'était qu'un parmi les 91 quotidiens du SPD avec une diffusion totale de 1,5 million d'exemplaires (à titre de comparaison, le Daily Mail revendiquait une diffusion de 900 000),12 et le SPD lui-même était le plus grand des partis politiques allemands. Clark mentionne le congrès d’Ièna en 1905 où le SPD refusa d'appeler à la grève générale en cas de guerre, mais il n'y a pas un mot sur les résolutions contre la guerre adoptées aux congrès de l'Internationale Socialiste à Stuttgart (1907) et à Bâle (1912). Le seul dirigeant du SPD à mériter de se trouver dans le livre est Albert Südekum, un personnage relativement mineur à la droite du SPD, dont le rôle de figurant rassure le chancelier allemand Bethmann-Hollweg le 28 juillet, soulignant que le SPD ne s'opposera pas à une guerre "défensive".
A propos de la lutte entre gauche et droite dans le mouvement socialiste et plus largement ouvrier, c'est le silence. A propos du combat politique de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Anton Pannekoek, Herman Gorter, Domela Nieuwenhuis, John MacLean, Vladimir Ilyich Lénine, Pierre Monatte, et tant d'autres, c'est encore le silence. A propos de l'assassinat de Jean Jaurès, silence toujours, rien que du silence...
Évidemment, les prolétaires ne peuvent compter sur l'historiographie bourgeoise pour comprendre vraiment les causes de la Grande Guerre. Tournons-nous donc plutôt vers deux militants remarquables de la classe ouvrière : Rosa Luxembourg, sans aucun doute la plus grande théoricienne de la Social-Démocratie allemande et Alfred Rosmer, un militant fidèle de la CGT française d'avant-guerre. En particulier, nous allons nous baser sur La Crise dans la Social-Démocratie de Rosa Luxembourg (mieux connu sous le nom de Brochure de Junius13) et Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale.14 Les deux œuvres sont très différentes : la brochure de Luxembourg fut écrite en prison en 1916 (elle ne bénéficia d'aucun accès privilégié aux bibliothèques et archives gouvernementales, la puissance et clarté de son analyse en est d'autant plus impressionnante) ; le premier tome15 de l’œuvre de Rosmer, où il traite de la période qui mena à la guerre, fut publié en 1936 et il est le fruit à la fois de son dévouement minutieux à la vérité historique et de sa défense passionnée des principes internationalistes.
La Première Guerre mondiale : son importance et ses causes
On pourrait nous demander si tout cela a vraiment de l'importance. C'était il y a bien longtemps, le monde a changé, que pouvons-nous vraiment apprendre de ces écrits d'un autre âge ?
Nous répondrions que comprendre la Première Guerre mondiale est primordial pour trois raisons.
D'abord, parce que la Première Guerre a ouvert une nouvelle époque : nous vivons toujours dans un monde formé par les conséquences de cette guerre.
Ensuite, parce que les causes sous-jacentes de la guerre sont toujours présentes et opérationnelles : il y a un parallèle on ne peut plus clair entre la montée de la nouvelle puissance allemande avant 1914, et la montée de la Chine aujourd'hui.
Enfin – et c'est peut-être le plus important parce que c'est cela que les propagandistes du gouvernement et les historiens aux ordres veulent surtout nous cacher – il n'y a qu'une seule force capable de mettre fin à la guerre impérialiste : la classe ouvrière mondiale. Comme le dit Rosmer : "les gouvernements savent bien qu'ils ne peuvent se lancer dans la dangereuse aventure qu'est la guerre – et surtout cette guerre – qu'à la condition d'avoir derrière eux la quasi-unanimité de l'opinion et, en particulier, de la classe ouvrière ; pour cela, il faut la tromper, la duper, l'égarer, l'exciter."16 Luxembourg cite la phrase de von Bülow, qui disait que c'était essentiellement par crainte de la social-démocratie que l'on s'efforçait autant que possible de différer toute guerre" ; elle cite également le Vom Heutigen Krieg du Général Bernhardi : "Si de grandes masses échappent au contrôle du haut commandement, si elles sont prises de panique, si l'intendance fait défaut sur une grande échelle, si l'esprit d'insubordination s'empare des troupes, dans ce cas, de telles masses non seulement ne sont plus capables de résister à l'ennemi, mais elles deviennent un danger pour elles-mêmes et pour le commandement de l'armée ; elles font sauter les liens de la discipline, troublent arbitrairement le cours des opérations et placent ainsi le haut commandement devant des tâches qu'il n'est pas en mesure d'accomplir". Et Luxembourg continue : "Des politiciens bourgeois et des experts militaires considéraient donc la guerre moderne menée avec des armées de masse comme un 'jeu risqué', et c'était là la raison essentielle qui pouvait faire hésiter les maîtres actuels du pouvoir à déclencher la guerre et les amener à tout faire pour qu'elle s'achève rapidement au cas où elle éclaterait. L'attitude de la social-démocratie au cours de la guerre actuelle (...) a dissipé leurs inquiétudes, elle a abattu les seules digues qui s'opposaient au torrent déchaîné du militarisme (...) Et ainsi, ces milliers de victimes qui tombent depuis des mois et dont les corps couvrent les champs de bataille, nous les avons sur la conscience."17
Le déclenchement d'une guerre impérialiste mondiale et généralisée (nous ne parlons pas ici des conflits localisés, même des conflits majeurs comme les guerres de Corée ou du Vietnam) est déterminé par deux forces qui s'affrontent : la poussée vers la guerre, vers une nouvelle division du monde entre les grandes puissances impérialistes, et la lutte pour la défense de leur propre existence par les masses laborieuses qui doivent fournir à la fois la chair à canon et l'armée industrielle sans laquelle la guerre moderne est impossible. La Crise dans la Social-Démocratie, et surtout dans sa fraction la plus puissante, la social-démocratie allemande – une crise qui est systématiquement passée sous silence par les historiens universitaires aux ordres – est donc le facteur critique qui a rendu la guerre possible en 1914.
Nous y reviendrons plus en détail dans un article ultérieur, mais ici nous nous proposons de reprendre l'analyse de Luxembourg des rivalités et alliances mouvantes qui ont poussé les grandes puissances inexorablement vers la saignée de 1914.
"Deux lignes de force de l'évolution historique la plus récente conduisent tout droit à la guerre actuelle. L'une part de la période de la constitution des « États nationaux », c'est-à-dire des États capitalistes modernes ; elle a pour point de départ la guerre de Bismarck contre la France. La guerre de 1870, qui, suite à l'annexion de l'Alsace-Lorraine, avait jeté la République française dans les bras de la Russie, provoqué la scission de l'Europe en deux camps ennemis et inauguré l'ère de la folle course aux armements, a apporté le premier brandon au brasier mondial actuel (…) Ainsi, la guerre de 1870 a eu comme conséquences : en politique extérieure, d'amener le regroupement politique de l'Europe autour de l'axe formé par l'opposition franco-allemande ; et dans la vie des peuples européens, d'assurer la domination formelle du militarisme. Cette domination et ce regroupement ont cependant donné ensuite à l'évolution historique un tout autre contenu.
La deuxième ligne de force qui débouche sur la guerre actuelle et confirme avec tant d'éclat la prédiction de Marx18 découle d'un phénomène à caractère international que Marx n'a plus connu : le développement impérialiste de ces vingt-cinq dernières années".19
Les trente dernières années du 19e siècle ont donc vu une expansion rapide du capitalisme à travers le monde, mais aussi l'émergence d'un capitalisme nouveau, dynamique, en expansion et plein de confiance, au cœur même de l'Europe : l'Empire allemand, déclaré dans le palais de Versailles en 1871 après la défaite française lors de la guerre franco-prussienne, dans laquelle la Prusse est entrée comme la plus grande puissance parmi une multiplicité de principautés et de petits États allemands, pour en émerger comme le composant dominant d'une Allemagne nouvelle et unifiée.
"(…) l'on pouvait prévoir", continue Luxembourg, "dès lors que ce jeune impérialisme, plein de force, qui n'était gêné par aucune entrave d'aucune sorte, et qui fit son apparition sur la scène mondiale avec des appétits monstrueux, alors que le monde était déjà pour ainsi dire partagé, devait devenir très rapidement le facteur imprévisible de l'agitation générale".20

Par une de ces bizarreries de l'histoire qui nous permettent de prendre une seule date comme symbole d'une modification de la dynamique de l'histoire, l'année 1898 fut témoin de trois événements qui marquèrent un tel changement.
Le premier était "l'Incident de Fachoda", une confrontation tendue entre les troupes françaises et britanniques qui se disputaient le contrôle du Soudan. A l'époque, il semblait y avoir un vrai danger de guerre entre ces deux pays pour le contrôle de l’Égypte et du canal de Suez, ainsi que pour la domination de l'Afrique. En fin de compte, l'incident s'est terminé par une amélioration des rapports franco-britanniques, formalisée en 1904 avec "l'Entente Cordiale", une tendance de plus en plus marquée pour la Grande-Bretagne de soutenir la France contre une Allemagne que tous les deux voyaient comme une menace. Les deux "Crises marocaines" de 1905 et 191121 montrèrent que dorénavant la Grande-Bretagne s'opposerait aux ambitions allemandes en Afrique du Nord (elle était néanmoins prête à laisser quelques miettes à l'Allemagne : les possessions coloniales du Portugal).
Le deuxième événement était la prise par l'Allemagne du port chinois de Tsingtao (aujourd'hui Qingdao),22 ce qui annonçait l'arrivée de l'Allemagne sur la scène impérialiste en tant que puissance aux aspirations mondiales et non plus seulement européennes – une Weltpolitik, comme on disait en Allemagne à l'époque.
Il est donc assez opportun que l'année 1898 voit également la mort d'Otto von Bismarck, le grand chancelier qui avait guidé l'Allemagne à travers son unification et son industrialisation rapide. Bismarck s'était toujours opposé au colonialisme et à la construction navale, son principal souci sur le plan de la politique étrangère étant d'empêcher l'émergence d'une alliance anti-germanique parmi les autres puissances jalouses – ou inquiètes – face à la montée de l'Allemagne. Mais au tournant du siècle, l'Allemagne était devenue une puissance industrielle de premier ordre, surpassée par les seuls États-Unis, avec les ambitions mondiales qui allaient avec. Luxembourg cite le ministre des Affaires Étrangères d'alors, von Bülow, dans un discours du 11 décembre 1899 : "Si les Anglais parlent d'une Greater Britain, si les Français parlent d'une Nouvelle France, si les Russes se tournent vers l'Asie, de notre côté nous avons la prétention de créer une Grösseres Deutschland... Si nous ne construisions pas une flotte qui soit capable de défendre notre commerce et nos compatriotes à l'étranger, nos missions et la sécurité de nos côtes, nous mettrions en danger les intérêts les plus vitaux du pays. Dans les siècles à venir, le peuple allemand sera le marteau ou l'enclume". Et Luxembourg fait la remarque : "Si on retire les fleurs de rhétorique de la défense des côtes, des missions et du commerce, il reste ce programme lapidaire : pour une Plus Grande Allemagne, pour une politique du marteau à l'égard des autres peuples."23
Au début du 20e siècle, se donner une Weltpolitik exigeait une marine à la hauteur de ses ambitions. Luxembourg montre on ne peut plus clairement que l'Allemagne n'avait aucun besoin économique pressant pour une marine : personne n'allait lui arracher ses possessions en Afrique ou en Chine. La marine était surtout une question de "standing" : pour pouvoir continuer son expansion l'Allemagne devait être vue comme une puissance sérieuse, une puissance avec laquelle il fallait compter, et pour cela une "flotte offensive de première qualité" était un pré-requis. Dans les mots inoubliables de Luxembourg, celle-ci était "une provocation qui visait non seulement la classe ouvrière allemande, mais tous les autres États capitalistes, un poing brandi vers aucun État en particulier, mais vers tous à la fois".
Le parallèle entre la montée de l'Allemagne au tournant des 19e et 20e siècles, et celle de la Chine cent ans plus tard, est évident. Comme celle de Bismarck, la politique étrangère de Deng Xiaoping s'efforçait de n'inquiéter ni les voisins de la Chine, ni la puissance hégémonique mondiale, les États-Unis. Mais avec sa montée au statut de deuxième puissance économique mondiale, le "standing" de la Chine exige qu'elle puisse, au minimum, contrôler ses frontières et protéger ses voies maritimes : d'où son programme de construction navale, de sous-marins et d'un porte-avions, avec sa déclaration récente d'une zone d'identification de la défense aérienne (ADIZ) couvrant les îles Senkaku/Diaoyu.
Ce parallèle n'est pas, bien sûr, une identité, pour deux raisons en particulier : d'abord, l'Allemagne du début du 20e siècle était non seulement la deuxième puissance industrielle après les États-Unis, elle était aussi à l'avant-garde du progrès technique et de l'innovation (comme on peut en juger, par exemple, au nombre de prix Nobel allemands et de l'innovation allemande dans les industries sidérurgiques, électriques, et chimiques) ; deuxièmement, l'Allemagne avait la capacité de transporter sa force militaire partout dans le monde.
Tout comme les États-Unis aujourd'hui se doivent de s'opposer à la menace chinoise à l'égard de son propre "standing" et la sécurité de ses alliés (le Japon, la Corée du Sud et les Philippines en particulier), la Grande- Bretagne aussi ne pouvait que voir une menace dans la montée de la marine militaire allemande, et pire encore une menace existentielle contre l'artère maritime vitale de la Manche et ses propres défenses côtières.24
Cependant, quelles que soient ses ambitions navales, la direction naturelle pour l'expansion d'une puissance terrestre comme l'Allemagne était vers l'Est, plus spécifiquement vers l'Empire ottoman en décomposition ; cela était d'autant plus vrai lorsque ses ambitions en Afrique et en Méditerranée occidentale se trouvaient bloquées par les français et les britanniques. L'argent et le militarisme allaient main dans la main, et le capital allemand a afflué en Turquie,25 jouant des coudes avec ses concurrents britanniques et français. Une grande partie de ce capital était voué au financement de la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad : en réalité, il s'agissait d'un réseau de voies ferrées qui devait relier Berlin à Constantinople, puis au sud de l'Anatolie, la Syrie, et Bagdad, mais aussi la Palestine, le Hedjaz et La Mecque. A une époque où le mouvement des troupes dépendait des chemins de fer, cela donnerait la possibilité à l'armée turque, équipée avec des armes allemandes et entraînée par des militaires allemands, d'envoyer des troupes qui menaceraient à la fois la raffinerie britannique d'Abadan (en Perse, aujourd'hui l'Iran),26 et le contrôle britannique de l’Égypte, du canal de Suez : voici encore une menace allemande directe envers les intérêts stratégiques de la Grande-Bretagne. Pendant une grande partie du 19e siècle, l'expansion russe en Asie Centrale, qui faisait peser une menace sur la frontière perse et sur l'Inde, était le principal danger pour la sécurité de l'Empire britannique ; la défaite de la Russie par le Japon en 1905 avait refroidi ses ardeurs orientales au point qu'en 1907 une convention anglo-russe pouvait – provisoirement du moins – résoudre les disputes entre les deux pays en Afghanistan, en Perse, et au Tibet. L’Allemagne était maintenant le rival à affronter.
Inévitablement, la politique orientale de l'Allemagne lui donnait un intérêt stratégique dans les Balkans, le Bosphore et les Dardanelles. Le fait que la voie du chemin de fer entre Berlin et Constantinople devait passer par Vienne et Belgrade faisait que le contrôle, ou du moins la neutralité de la Serbie, devenait du coup d'une grande importance stratégique pour l'Allemagne. Ceci à son tour la mettait en conflit avec un pays qui – du temps de Bismarck – avait été le bastion de la réaction et de la solidarité autocratique, donc l'allié principal de la Prusse et de l'Allemagne impériale : la Russie.
Depuis la règne de la Grande Catherine, la Russie s'était établie (dans les années 1770) comme puissance dominante de la Mer Noire, évinçant les Ottomans. Le commerce de plus en plus important de l'industrie et de l'agriculture russes dépendait de la liberté de navigation dans le détroit du Bosphore. L'ambition russe visait les Dardanelles et le contrôle du trafic maritime entre la Mer Noire et la Méditerranée (les visées russes sur les Dardanelles avaient déjà mené à la guerre avec la Grande-Bretagne et la France en Crimée en 1853). Luxembourg résume ainsi la dynamique au sein de la société russe qui impulsait sa politique impérialiste : "Dans les tendances conquérantes du régime tsariste s'exprime, d'une part, l'expansion traditionnelle d'un Empire puissant dont la population comprend aujourd'hui 170 millions d'êtres humains et qui, pour des raisons économiques et stratégiques, cherche à obtenir le libre accès des mers, de l'océan Pacifique à l'est, de la Méditerranée au sud, et, d'autre part, intervient ce besoin vital de l'absolutisme : la nécessité sur le plan de la politique mondiale de garder une attitude qui impose le respect dans la compétition générale des grands États, pour obtenir du capitalisme étranger le crédit financier sans lequel le tsarisme n'est absolument pas viable (…) Toutefois, les intérêts bourgeois modernes entrent toujours davantage en ligne de compte comme facteur de l'impérialisme dans l'Empire des tsars. Le jeune capitalisme russe, qui sous le régime absolutiste ne peut naturellement pas parvenir à un épanouissement complet et qui, en gros, ne peut quitter le stade du système primitif de vol, voit cependant s'ouvrir devant lui un avenir prodigieux dans les ressources naturelles immenses de cet Empire gigantesque (…) C'est parce qu'elle pressent cet avenir et qu'elle est, pour ainsi dire par avance, affamée d'accumulation, que la bourgeoisie russe est dévorée par une fièvre impérialiste violente, et qu'elle manifeste avec ardeur ses prétentions dans le partage du monde".27 La rivalité entre l'Allemagne et la Russie pour le contrôle du Bosphore trouva donc inéluctablement son point névralgique dans les Balkans, où la montée de l'idéologie nationaliste caractéristique d'un capitalisme en voie de développement créait une situation de tension permanente et de guerre sanglante intermittente entre les trois États s'étant dégagés de l'Empire ottoman en décomposition : la Grèce, la Bulgarie et la Serbie. Ces trois pays se sont alliés contre les Ottomans dans la Première Guerre des Balkans, puis se sont battus entre eux pour le partage du butin – en particulier en Albanie et en Macédoine – lors de la Deuxième Guerre des Balkans.28
La montée de ces nouveaux États nationaux agressifs dans les Balkans ne pouvait guère laisser indifférent l'autre empire déclinant de la région : l'Autriche-Hongrie. Pour Luxembourg, "la monarchie habsbourgeoise n'est pas une organisation politique d'État bourgeois, mais seulement un trust unissant par des liens assez lâches quelques coteries de parasites sociaux qui veulent se remplir les poches en exploitant au maximum les ressources du pouvoir tant que la monarchie tient encore debout", et l'Autriche-Hongrie se trouvait constamment sous la menace des nouvelles nations qui l'entouraient et qui toutes étaient composées des mêmes ethnies que certaines parties de l'Empire : d'où l'annexion par l'Autriche-Hongrie de la Bosnie-Herzégovine, afin d'empêcher la Serbie de se frayer un accès à la Méditerranée.
En 1914, la situation en Europe ressemblait à un cube de Rubik mortel, ses différentes pièces si étroitement imbriquées qu'en déplacer une devait nécessairement les déplacer toutes.
Les somnambules éveillés
Est-ce que cela veut dire que les classes dominantes, les gouvernements, ne savaient pas ce qu'ils faisaient ? Que – selon le titre du livre de Christopher Clark, Les Somnambules – ils sont, d'une certaine manière, entrés en guerre par accident, que la Première Guerre Mondiale n'était qu'une terrible erreur ?
Nullement. Certes, les forces historiques que décrit Luxembourg, dans ce qui est probablement l'analyse la plus profonde jamais écrite de l'entrée en guerre, tenait la société en tenaille : dans ce sens, la guerre était le résultat des rivalités impérialistes imbriquées. Mais les situations historiques appellent au pouvoir des hommes qui leur sont assortis et les gouvernements qui menèrent l'Europe et le monde à la guerre savaient très bien ce qu'ils faisaient, l'ont fait délibérément. Les années du tournant du siècle jusqu'à l'éclatement de la guerre étaient marquées par des alertes à répétition, chacune plus grave que la précédente : la crise de Tanger en 1905, l'incident d'Agadir en 1911, la Première et la Deuxième Guerre des Balkans. Chacun de ces incidents poussait plus en avant la fraction pro-guerre de chaque bourgeoisie, attisait le sentiment que la guerre était, de toutes façons, inévitable. Le résultat en était une course aux armements insensée : l'Allemagne lança son programme de construction navale et la Grande-Bretagne la suivit ; le France augmenta la durée du service militaire à trois ans ; des emprunts français énormes financèrent la modernisation des chemins de fer russes conçus pour transporter les troupes vers son front occidental, ainsi que la modernisation de la petite mais efficace armée serbe. Toutes les puissances continentales augmentèrent le nombre d'hommes sous les drapeaux.
De plus en plus convaincus que la guerre était inévitable, la question pour les gouvernements européens devenait tout simplement celle du "quand ?". Quand les préparatifs de chacun seraient-ils à leur maximum par rapport à ceux de leurs rivaux ? Parce que cela serait le "bon" moment pour la guerre.
Si Luxembourg voyait dans l'Allemagne le nouveau "facteur imprévisible" de la situation européenne, cela veut-il dire que les puissances de la Triple Entente (la Grande-Bretagne, la France et la Russie) n'étaient que les victimes innocentes de l’agression expansionniste allemande ? C'est la thèse de certains historiens révisionnistes aujourd'hui : non seulement que la lutte contre l'expansionnisme allemand était justifiée en 1914, mais qu'au fond, 1914 n'était que le précurseur de la "bonne guerre" de 1939. Cela est indubitablement vrai, mais les pays de la Triple Entente étaient tout, sauf des victimes innocentes. Et l'idée que seule l'Allemagne était "expansionniste" est risible quand nous comparons la taille de l'Empire britannique – le fruit de l'agression expansionniste britannique – avec celui de l'Allemagne : bizarrement, cela ne semble jamais traverser l'esprit des historiens anglais apprivoisés.29
En réalité, la Triple Entente préparait depuis des années une politique d'encerclement de l'Allemagne (tout comme les États-Unis ont développé une politique d'encerclement de l'URSS pendant la Guerre Froide et essaie de faire aujourd'hui de même avec la Chine). Rosmer montre ceci avec une limpidité inexorable, sur la base des correspondances secrètes entre les ambassadeurs belges des différentes capitales européennes.30
En mai 1907, l'ambassadeur à Londres écrivait : "Il est évident que l'Angleterre officielle poursuit une politique sourdement hostile, qui tend à aboutir à l'isolement de l'Allemagne, et que le roi Edouard n'a pas hésité à mettre son influence personnelle au service de cette idée".31 En février 1909, nous avons des nouvelles de l'ambassadeur à Berlin : "Le roi d'Angleterre affirme que la conservation de la paix a toujours été le but de ses efforts ; c'est ce qu'il n'a pas cessé de dire depuis le début de la campagne diplomatique qu'il a menée à bonne fin, dans le but d'isoler l'Allemagne ; mais on ne peut pas s'empêcher de remarquer que la paix du monde n'a jamais été plus compromise que depuis que le roi d'Angleterre se mêle de la consolider".32 De Berlin à nouveau, nous lisons en avril 1913 : "L'arrogance et le mépris avec lesquels ces derniers [les Serbes] reçoivent les réclamations du cabinet de Vienne ne s'expliquent que par l'appui qu'ils croient trouver à Saint-Pétersbourg. Le chargé d'affaires de Serbie disait ici récemment que son gouvernement ne serait pas allé de l'avant depuis six mois, sans tenir compte des menaces autrichiennes, s'il n'avait pas été encouragé par le ministre de la Russie, Monsieur Hartwig...".33
En France, le développement conscient d'une politique agressive et chauvine était parfaitement clair pour l'ambassadeur belge à Paris (janvier 1914) : "J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que ce sont MM Poincaré, Delcassé, Millerand et leurs amis qui ont inventé et poursuivi la politique nationaliste, cocardière et chauvine dont nous avons constaté la renaissance (…) J'y vois le plus grand péril qui menace aujourd'hui la paix de l'Europe (…) parce que l'attitude qu'a prise le cabinet Barthou est, selon moi, la cause déterminante d'un surcroît de tendances militaristes en Allemagne".34
La réintroduction par la France d'un service militaire de trois ans n'était pas une politique de défense, mais un préparatif délibéré à la guerre. Voici de nouveau l'ambassadeur à Paris (juin 1913) : "Les charges de la nouvelle loi seront tellement lourdes pour la population, les dépenses qu'elle entraînera seront tellement exorbitantes, que le pays protestera bientôt, et la France se trouvera devant ce dilemme: une abdication qu'elle ne pourra souffrir ou la guerre à brève échéance".35
Comment déclarer la guerre
Deux facteurs entraient en ligne de compte dans les calculs des hommes d’État et des politiciens dans les années qui menèrent à la guerre : d'abord, l'évaluation de leurs propres préparatifs militaires et de ceux de leurs adversaires, la seconde – tout aussi importante, même dans la Russie tsariste et autocratique – était la nécessité de paraître devant le monde et devant leurs propres populations, surtout les ouvriers, comme le parti offensé, agissant uniquement pour se défendre. Tous les pouvoirs voulaient entrer dans une guerre que quelqu'un d'autre avait provoquée : "Le jeu consiste à amener l'adversaire à accomplir un acte qu'on pourra exploiter contre lui ou à mettre à profit une décision déjà prise".36
L'assassinat de Franz-Ferdinand, l'étincelle qui mis le feu aux poudres, n'était pas l'œuvre d'un individu isolé : Gavrilo Princip tira le coup mortel, mais il n'était qu'un membre d'un groupe d'assassins organisé et armé par un des réseaux entretenus par les groupes serbes ultra-nationalistes "La Main Noire" et Narodna Odbrana ("La Défense nationale"), qui formaient presque un État dans l’État et dont les activités étaient certainement connues du gouvernement serbe et plus particulièrement de son premier ministre, Nicolas Pasič. La Serbie entretenait des rapports étroits avec la Russie et n'aurait jamais entrepris une telle provocation si elle n'avait pas été assurée du soutien russe contre une réaction de l'Autriche-Hongrie.
Pour le gouvernement de l'Autriche-Hongrie, l'occasion de mettre la Serbie au pas n'était que trop belle.37 L'enquête policière n'avait guère de mal à pointer la Serbie du doigt et les Autrichiens comptaient sur le choc provoqué parmi les classes dirigeantes européennes pour en obtenir le soutien, ou du moins la neutralité, lorsqu'ils s'attaquèrent à la Serbie. Et en effet, l'Autriche-Hongrie n'avait pas d'autre choix que d'attaquer ou d'humilier la Serbie : faire moins aurait apporté un coup dévastateur à son "standing" et son influence dans la région critique des Balkans, la laissant complètement à la merci de son rival russe.
Pour le gouvernement français, une "guerre des Balkans" était le scénario idéal pour lancer une attaque contre l'Allemagne : si l'Allemagne pouvait être poussée dans une guerre pour défendre l'Autriche-Hongrie, et la Russie accourir à la défense des Serbes, la mobilisation française pourrait être dépeinte comme une mesure de défense préventive contre le danger d'une attaque allemande. Mieux encore, il était très peu probable que l'Italie, en principe un allié de l'Allemagne mais avec ses intérêts propres dans les Balkans, entrerait en guerre pour défendre la position de l'Autriche-Hongrie en Bosnie-Herzégovine.
Étant donnée l'alliance à laquelle elle faisait face, l'Allemagne se trouvait en position de faiblesse, avec comme seul allié l'Autriche-Hongrie, ce "tas de décomposition organisée" pour reprendre l'expression de Luxembourg. Les préparatifs militaires en France et en Russie, le développement de leur Entente avec la Grande-Bretagne, amenèrent les stratèges allemands à la conclusion qu'il vaudrait mieux se battre tôt, avant que leurs adversaires ne soient entièrement préparés, que tard. D'où la remarque suivante en 1914 : "Il faut absolument que si le conflit [entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie] s'étend (...,) ce soit la Russie qui en porte la responsabilité".38
La population britannique n’était pas chaude pour partir en guerre pour défendre la Serbie, ni même la France. La Grande-Bretagne aussi avait besoin d'un "prétexte, pour surmonter une partie importante de son opinion publique. L’Allemagne lui en fournit un, excellent, en lançant ses armées à travers la Belgique." Rosmer cite la Tragedy of Lord Kitchener du Viscount Esher, à cet effet : "L'épisode belge fut un coup de fortune qui vint à point donner à notre entrée dans la guerre le prétexte moral nécessaire pour préserver l'unité de la nation, sinon celle du gouvernement".39 En réalité, cela faisait des années que les plans britanniques pour une attaque contre l'Allemagne, préparés depuis longue date en collaboration avec les militaires français, prévoyaient la violation de la neutralité belge...
Tous les gouvernements des pays belligérants devaient donc tromper leur "opinion publique" en lui faisant croire qu'une guerre qu'ils préparaient et cherchaient depuis des années leur avait été imposée. L'élément critique de cette "opinion publique" était la classe ouvrière organisée, avec ses syndicats et ses partis socialistes, qui depuis des années déclamaient clairement leur opposition à la guerre. Le facteur principal ouvrant la route à la guerre était donc la trahison de la social-démocratie et son soutien accordé à ce que la classe dominante appela de façon mensongère une "guerre défensive".
Les causes sous-jacentes de cette trahison monstrueuse du devoir internationaliste le plus élémentaire de la social-démocratie fera l'objet d'un article prochain. Il suffit de dire ici que la prétention de la bourgeoisie française aujourd'hui que "en un instant, s’effacèrent les multiples querelles, politiques, sociales, religieuses, qui tenaient le pays divisé" est un mensonge éhonté. Au contraire, l'histoire des jours précédant l’éclatement de la guerre racontée par Rosmer est celle de manifestations constantes contre la guerre, brutalement réprimées par la police. Le 27 juillet, la CGT appela à une manifestation, et "de 9 heures à minuit (…), une foule énorme a déferlé sans cesse sur les boulevards. D'énormes forces de police avaient été mobilisées (…) Mais les ouvriers qui descendent des faubourgs sur le centre sont si nombreux que la tactique policière [de séparer les manifestants en petits groupes] aboutit à un résultat imprévu : on a bientôt autant de manifestations que de rues. Les violences et les brutalités policières ne peuvent avoir raison de la combativité de cette foule ; toute la soirée, le cri de 'A bas la guerre !' résonnera de l'Opéra jusqu'à la Place de la République".40 Les manifestations continuèrent le jour suivant, s'étendant aux principales villes des provinces.
La bourgeoisie française avait encore un autre problème : l'attitude du dirigeant socialiste Jean Jaurès. Jaurès était un réformiste, à un moment de l'histoire où le réformisme se trouvait coincé entre la bourgeoisie et le prolétariat, mais il était profondément attaché à la défense de la classe ouvrière (c'était justement pour cela que son influence parmi les ouvriers était très grande) et passionnément opposé à la guerre. Le 25 juillet, lorsque la presse rapporte le rejet par la Serbie de l'ultimatum austro-hongrois, Jaurès devait parler devant un meeting électoral à Vaise, près de Lyon : son discours était centré non pas sur l'élection mais sur l'épouvantable danger de guerre. "Jamais, depuis quarante ans l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique (…) Nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes, à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter".41
Au départ, Jaurès a cru aux assurances frauduleuses du gouvernement français selon lesquelles ce dernier oeuvrait pour la paix, mais le 31 juillet, il avait perdu ses illusions et au Parlement appela de nouveau les ouvriers à faire tout leur possible pour s'opposer à la guerre. Rosmer raconte : "le bruit court-il que l'article qu'il va écrire tout à l'heure pour le numéro de samedi de L'Humanité sera un nouveau 'J'accuse !'42 dénonçant les intrigues et les mensonges qui ont mis le monde au seuil de la guerre. Dans la soirée (…) il conduit une délégation du groupe socialiste au Quai d'Orsay. [Le Ministère des Affaires Etrangères] Viviani n'est pas là. C'est le sous-secrétaire d’État qui reçoit la délégation. Après avoir écouté Jaurès, il lui demande ce que comptent faire les socialistes en face de la situation : 'Continuer notre campagne contre la guerre !', répond Jaurès. A quoi Abel Ferry réplique : 'C'est ce que vous n'oserez pas, car vous seriez tué au prochain coin de rue !'.43 Deux heures plus tard, quand Jaurès va regagner son bureau de L'Humanité pour écrire l'article redouté, l'assassin Raoul Villain l'abat ; deux balles de revolver tirées à bout portant ont provoqué une mort presque immédiate".44
Décidément, la classe bourgeoise française ne laissait rien au hasard, afin de s'assurer "l'unité et la cohésion nationales" !
Pas de guerre sans les ouvriers
Lorsque sont déposées les gerbes et quand les grands de ce monde s'inclinent devant le soldat inconnu lors des commémorations, que nos dirigeants se paient des millions d'euros ou de livres, lorsque le clairon sonne pour les morts à la fin des cérémonies solennelles, lorsque les documentaires déferlent sur les écrans de télévision et les doctes historiens nous racontent toutes les causes de la guerre, sauf celles qui comptent vraiment, tous les facteurs qui auraient été sensés l'empêcher, sauf ceux qui aurait vraiment pu peser dans la balance, les prolétaires du monde entier, eux, ont besoin de se souvenir.
Qu'ils se souviennent que la cause de la Première Guerre mondiale n'était pas le hasard historique, mais les rouages impitoyables du capitalisme et de l’impérialisme, que la Grande Guerre a ouvert une nouvelle période de l'histoire, une "époque de guerres et de révolutions" comme le disait l'Internationale Communiste. Cette période est toujours avec nous aujourd'hui, et les mêmes forces qui ont poussé le monde dans la guerre en 1914 sont aujourd'hui responsables des massacres sans fin au Moyen-Orient et en Afrique, alimentant des tensions toujours plus dangereuses entre la Chine et ses voisins dans la Mer de la Chine du Sud.
Qu'ils se souviennent que la guerre ne peut être menée sans ouvriers, comme chair à canon et chair à usine. Qu'ils se souviennent que les classes dominantes doivent s'assurer l'unité pour la guerre et qu'ils ne s'arrêteront à rien pour l'obtenir, depuis la répression brutale jusqu'au meurtre sanglant.
Qu'ils se souviennent que ce sont les mêmes partis "socialistes" qui aujourd'hui se mettent à la tête de toute campagne pacifiste et humanitaire, qui ont trahi la confiance de leurs aïeux en 1914, les laissant désorganisés et sans défense face à la machine de guerre capitaliste.
Qu'ils se souviennent, enfin, que si la classe dominante devait faire un tel effort afin de neutraliser le prolétariat en 1914, c'est parce que seul le prolétariat peut dresser une barrière fiable face à la guerre. Seul le prolétariat mondial porte en lui-même l'espoir de renverser le capitalisme et le danger de guerre, une fois pour toutes.
Il y a cent ans, l'humanité se tenait devant un dilemme dont la solution reste entre les mains du seul prolétariat : socialisme ou barbarie. Ce dilemme est encore devant nous aujourd'hui.
Jens
1Il est ironique de voir que le titre du film est tiré d'un livre d'avant-guerre écrit par l'économiste britannique Norman Angell, qui argumentait le fait que la guerre entre les puissances capitalistes avancées était devenue impossible parce que leurs économies étaient trop étroitement intégrées et interdépendantes - précisément le même genre d'argumentation que nous pouvons entendre aujourd'hui à propos de la Chine et des États-Unis.
2Il va sans dire que, comme toutes les œuvres que nous avons mentionnées ici, A l'ouest, rien de nouveau fut interdit par les Nazis après 1933. Il fut également interdit entre 1930 et 1941 par la censure australienne.
3Il est frappant par contre, que le plus célèbre des poètes de guerre patriotique anglais, Rupert Brooke, n'a jamais connu le combat puisqu'il est mort de maladie en route vers l'assaut sur Gallipoli.
4 Ceci a été l'objet d'une certaine polémique dans la presse allemande.
5Projet très louable en lui-même sans doute, mais qui ne contribuera pas à grand chose pour la compréhension des raisons de la Grande Guerre.
7“Commémorer la Grande Guerre (2014-2020) : propositions pour un centenaire international” par Joseph Zimet de la “Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives”, centenaire.org/sites/default/files/references-files/rapport_jz.pdf.
8Il est frappant de voir que la grande majorité des exécutions pour désobéissance militaire dans l'armée française ont eu lieu pendant les premiers mois de la guerre, ce qui suggère un manque d'enthousiasme qui devait être tué dans l'oeuf d'emblée. (Cf. le rapport au Ministre auprès des Anciens Combattants Kader Arif d'octobre 2013) :
https://centenaire.org/sites/default/files/references-files/rapport_fusi... [13]
9Cela vaut la peine de mentionner ici le fait que le titre Les Somnambules est tiré de la trilogie du même nom écrite par Hermann Broch en 1932. Broch est né en 1886 à Vienne, dans une famille juive, mais s'est converti en 1909 au catholicisme. En 1938, après l'annexion de l'Autriche il fut arrêté par la Gestapo. Cependant, grâce à l'aide d'amis (parmi lesquels James Joyce, Albert Einstein et Thomas Mann), il a pu émigrer aux Etats-Unis où il vécut jusqu'à sa mort en 1951. Die Schlafwandler raconte l'histoire de trois individus respectivement au cours des années 1888, 1905 et 1918, et examine les questions posées par la décomposition des valeurs et la subordination de la moralité aux lois du profit.
10La traduction de l'anglais est de nous.
11Voir notre article "L'anarcho-syndicalisme face à un changement d'époque : la CGT jusqu'à 1914", dans la Revue internationale n°120 : https://fr.internationalism.org/rint/120_cgt [14]
12Cf. Hew Strachan, The First World War ,volume 1
14Éditions d'Avron, mai 1993.
15Le deuxième tome fut publié après la Deuxième Guerre mondiale. Il est bien plus abrégé, puisque Rosmer a dû fuir Paris pendant l'occupation nazie et ses archives furent saisies et détruites pendant la guerre.
16Rosmer, p84.
17Brochure de Junius, chapitre "La fin de la lutte des classes"
18Luxembourg cite ici une lettre de Marx au Braunschweiger Ausschuss : "Celui qui n'est pas complètement assourdi par le tapage de l'heure présente, et qui n'a pas intérêt à assourdir le peuple allemand, doit comprendre que la guerre de 1870 donnera naissance à une guerre entre la Russie et l'Allemagne aussi nécessairement que celle de 1866 a amené celle de 1870. Nécessairement et inéluctablement, sauf au cas improbable du déclenchement préalable d'une révolution en Russie. Si cette éventualité improbable ne se produit pas, alors la guerre entre l'Allemagne et la Russie doit dès maintenant être considérée comme un fait accompli. Que cette guerre soit utile ou nuisible, cela dépend entièrement de l'attitude actuelle des vainqueurs allemands. S'ils prennent l'Alsace et la Lorraine, la France combattra contre l'Allemagne aux côtés de la Russie. Il est superflu d'en indiquer les conséquences funestes".
20Idem.
21La première crise marocaine de 1905 fut provoquée par une visite du Kaiser à Tanger, soi-disant pour soutenir l'indépendance marocaine, en réalité pour y contrer l'influence française. La tension militaire était au plus haut point : la France annula les permissions militaires et avança ses troupes à la frontière allemande, alors que l'Allemagne commençait à rappeler les réservistes sous les drapeaux. En fin de compte, les Français cédèrent et acceptèrent la proposition allemande d'une Conférence internationale, tenue à Algésiras en 1906. Mais les allemands y ont eu un choc : ils se sont trouvés abandonnés par toutes les puissances européennes, plus particulièrement par les Britanniques, ne trouvant de soutien qu'auprès de l'Autriche-Hongrie. La deuxième crise marocaine survint en 1911 lorsqu'une révolte contre le sultan Abdelhafid donna à la France un prétexte pour l'envoi de troupes au Maroc sous couvert d'y protéger les citoyens européens. Les Allemands, quant à eux, ont profité du même prétexte pour envoyer la canonnière Panther dans le port atlantique d'Agadir. Les Britanniques y voyaient le prélude de l'installation d'une base navale allemande sur la côte atlantique, menaçant directement Gibraltar. Le discours de Lloyd George au Mansion House (cité par Rosmer) fut une déclaration de guerre à peine voilée si l'Allemagne ne cédait pas. En fin de compte, l'Allemagne reconnut le protectorat français au Maroc, et reçut en échange quelques marécages à l'embouchure du Congo.
22Les Allemands y établirent la brasserie qui fabrique aujourd'hui la bière "Tsingtao".
23Brochure de Junius, idem.
24L'idée émise par Clark, mais aussi par Niall Fergusson dans The Pity of War, que l'Allemagne est restée loin derrière la Grande-Bretagne dans la course aux armements maritimes, est absurde : contrairement à la marine allemande, la marine britannique devait protéger un commerce mondial, et on voit difficilement comment la Grande-Bretagne pouvait ne pas se sentir menacée par la construction d'une flotte puissante stationnée à moins de 800 kilomètres de sa capitale et encore plus prêt de ses côtes.
25Bien que, dans les textes européens de l'époque, les termes "Turquie" et "Empire ottoman" sont identiques, il est important de se rappeler que le dernier terme est le plus approprié : au début du 19e siècle, l'Empire ottoman couvrait non seulement la Turquie mais aussi ce qu'aujourd'hui sont la Libye, la Syrie, l'Irak, la péninsule d'Arabie, plus une grande partie de la Grèce et des Balkans.
26Cette raffinerie était importante surtout pour des raisons militaires : la flotte britannique venait d'être convertie au fuel à la place du charbon, et alors que la Grande-Bretagne possédait du charbon en abondance, elle n'avait pas de pétrole. La recherche du pétrole en Perse fut impulsée avant tout par les besoins de la Marine Royale de s'assurer de ses fournitures en fuel.
27Junius, Chapitre 4
28La Première Guerre des Balkans éclata en 1912 lorsque les membres de la Ligue des Balkans (la Serbie, la Bulgarie et le Monténégro) s'attaquèrent à l'Empire ottoman avec le soutien tacite de la Russie. Bien qu'elle ne fasse pas partie de la Ligue, la Grèce s'est joint aux combats, à la fin desquels les armées ottomanes se trouvaient battues sur toute la ligne : l'Empire ottoman se trouvait privé pour la première fois en 500 ans de la plupart de ses territoires européens. La Deuxième Guerre des Balkans éclata immédiatement après, en 1913, lorsque la Bulgarie s'attaqua à la Serbie qui avait occupé, avec la connivence de la Grèce, une grande partie de la Macédoine qui avait été promise à la Bulgarie.
30Ces documents furent saisis par les Allemands qui en publièrent de longs extraits après la guerre. Comme Rosmer le signale : "Les appréciations des représentants de la Belgique à Berlin, Paris et Londres, ont une valeur particulière. La Belgique est neutre. Ils ont donc plus de liberté d'esprit que les partisans pour apprécier les événements ; de plus, ils n'ignorent pas qu'en cas de guerre entre les deux grands groupes de belligérants leur petit pays courra de grands risques, notamment de servir de champ de bataille" (Ibid, p68).
31Ibid, p69.
32Ibid, p70.
33Ibid, p70.
34Ibid, p73.
35Ibid, p72.
36Ibid, p87.
37D'ailleurs, le gouvernement austro-hongrois avait déjà essayé de mettre la pression sur la Serbie en divulguant à l'historien Heinrich Friedjung des documents frauduleux censés témoigner d'un complot serbe contre la Bosnie-Herzégovine (cf, Clark, p. 88, édition Kindle).
38Cité par Rosmer, p. 87, à partir de documents allemands publiés après la guerre.
39Rosmer, p. 87.
40Rosmer, p. 102
41Ibid, p. 84.
42Une référence à l'attaque dévastatrice portée par Emile Zola contre le gouvernement pendant l'affaire Dreyfus.
43Rosmer, p. 91. La conversation est rapportée dans la biographie de Jaurès de Charles Rappoport et confirmée dans les propres papiers d’Abel Ferry. (cf. Alexandre Croix, Jaurès et ses détracteurs, Éditions Spartacus, p. 313.
44Jaurès fut tué alors qu'il mangeait au Café du Croissant, en face des bureaux de L'Humanité. Raoul Villain présentait beaucoup de similarités avec Gavrilo Princip : instable, émotionnellement fragile, s'adonnant au mysticisme politique ou religieux – en somme, exactement le genre de personnage que les services secrets utilisent comme provocateur qu'on peut sacrifier sans état d'âme. Après le meurtre, Villain était arrêté et passa la guerre dans la sécurité, sinon le confort, d'une prison. A son procès il fut relâché, et Mme Jaurès se voyait obligée de payer les frais de justice.
Personnages:
- Rosa Luxemburg [18]
- Christopher Clark [19]
- Viviani [20]
- Abel Ferry [21]
- Albert Südekum [22]
- Alfred Rosmer [23]
- Bethman-Hollweg [24]
- Bismarck [25]
- Jean Jaurès [26]
- Raymond Poincaré [27]
- Gavrilo Princip [28]
- von Bülow [29]
- Wilfred Owen [30]
- Jaroslav Hasek [31]
Evènements historiques:
- Première guerre mondiale [10]
- Chemin de fer de Baghdad [32]
- Guerres des Balkans [33]
- Incident de Fashoda [34]
- Crise marocaine [35]
- Empire ottoman [36]
- Tsingtao [37]
Questions théoriques:
- Guerre [38]
Rubrique:
Le chemin vers la trahison de la Social-démocratie allemande
- 2336 lectures
De tous les partis de la 2ème Internationale, le SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) était de loin le plus puissant. En 1914, le SPD comptait plus de 1 million de membres et il avait gagné plus de 4 millions de voix lors des élections législatives de 1912 1 : c'était, en fait, le seul parti de masse en Allemagne et le plus grand parti au Reichstag – bien que sous le régime autocratique impérial du Kaiser Guillaume II, il n'ait eu aucune chance de réellement former un gouvernement.
Pour les autres partis de la 2ème internationale, le SPD était le parti de référence. Karl Kautsky 2, rédacteur en chef de la Neue Zeit, la revue théorique du parti, était reconnu comme étant le "pape du marxisme", le théoricien phare de l'Internationale. Lors du Congrès de 1900 de l'Internationale, Kautsky a rédigé la résolution condamnant la participation du socialiste français Millerand dans un gouvernement bourgeois et, au Congrès de Dresde du SPD de 1903, sous la direction de son président August Bebel 3, il a condamné les théories révisionnistes d'Eduard Bernstein et réaffirmé les objectifs révolutionnaires du SPD. Lénine avait fait l'éloge de "l'esprit de parti" du SPD et de son immunisation face aux petites animosités personnelles comme celles qui avaient conduit les Mencheviks à provoquer la scission dans le POSDR (Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie) après son Congrès de1903 4. Enfin et surtout, la suprématie théorique et organisationnelle du SPD était clairement couronnée de succès sur le terrain : aucun autre parti de l'Internationale ne pouvait revendiquer, même de loin, des succès électoraux comme ceux du SPD et, s'agissant de l'organisation syndicale, seuls les britanniques pouvaient rivaliser avec les allemands quant au nombre et à la discipline de leurs membres.
"Pendant les congrès, au cours des sessions du bureau de l'Internationale socialiste, tout était suspendu à l'opinion des Allemands. En particulier lors des débats sur les problèmes posés par la lutte contre le militarisme et sur la question de la guerre, la position de la social-démocratie allemande était toujours déterminante. "Pour nous autres Allemands, ceci est inacceptable" suffisait régulièrement pour décider de l'orientation de l'Internationale. Avec une confiance aveugle, celle-ci s'en remettait à la direction de la puissante social-démocratie allemande tant admirée : elle était l'orgueil de chaque socialiste et la terreur des classes dirigeantes dans tous les pays." 5
Par conséquent, il était évident, alors que les nuages de la guerre avaient commencé à s'accumuler durant le mois de juillet 1914, que l'attitude de la social-démocratie allemande serait cruciale pour décider de l'issue de cette situation. Les travailleurs allemands – les grandes masses organisées au sein du parti et des syndicats pour l’existence desquels ils avaient mené de durs combats – se trouvaient dans une position où ils étaient les seuls à pouvoir faire pencher la balance : la résistance, la défense de l'internationalisme prolétarien, ou la collaboration de classe et la trahison, et des années de massacre, les plus sanglantes que l'humanité ait jamais connues.
"Et à quoi avons-nous assisté en Allemagne au moment de la grande épreuve historique ? À la chute la plus catastrophique, à l'effondrement le plus formidable. Nulle part l'organisation du prolétariat n'a été mise aussi totalement au service de l'impérialisme, nulle part l'État de siège supporté avec aussi peu de résistance, nulle part la presse autant bâillonnée, l'opinion publique autant étranglée, la lutte de classe économique et politique de la classe ouvrière aussi totalement abandonnée qu'en Allemagne." 6
La trahison de la social-démocratie allemande a provoqué un tel choc pour les révolutionnaires que lorsque Lénine a lu dans le Vorwärts 7 que la fraction parlementaire du SPD avait voté les crédits de guerre, il a pensé d'abord que ce numéro du journal était un faux confectionné par la propagande "noire" du gouvernement impérial. Comment un tel désastre avait-il été possible ? Comment, le fier et puissant SPD avait-il pu, en quelques jours, renier ses promesses les plus solennelles, se transformer, du jour au lendemain, de joyau de l'Internationale ouvrière en arme la plus puissante de l'arsenal guerrier de la classe dirigeante ?
En tentant de répondre à cette question, il peut sembler paradoxal de se concentrer en grande partie dans cet article sur les écrits et les actions d'un nombre relativement restreint d'individus ; après tout, le SPD et les syndicats étaient des organisations de masse, capables de mobiliser des centaines de milliers de travailleurs. Toutefois, il est justifié de procéder ainsi parce que des individus comme Karl Kautsky ou Rosa Luxemburg représentaient des tendances définies au sein du parti. En ce sens, leurs écrits exprimaient des tendances politiques avec lesquelles des masses de militants et de travailleurs – demeurés anonymes dans l'histoire - s'identifiaient. Il est également nécessaire de tenir compte des biographies politiques de ces personnalités si l'on veut comprendre le poids qu'elles avaient dans le parti. August Bebel, Président du SPD de 1892 jusqu'à sa mort en 1913, était l'un des fondateurs du parti et il fut emprisonné, en même temps que Wilhelm Liebknecht, également député au Reichstag, pour son refus de soutenir la guerre de la Prusse contre la France en 1870. Kautsky et Bernstein avaient tous deux été contraints à l'exil à Londres par les lois anti-socialistes de Bismarck, où ils avaient travaillé sous la direction d'Engels. Le prestige et l'autorité morale que cela leur avait donnés dans le parti étaient immenses. Même Georg von Vollmar, l'un des leaders réformistes de l’Allemagne du Sud, s'était tout d'abord fait connaître comme appartenant à l'aile gauche et comme un organisateur dynamique et talentueux dans la clandestinité, ayant connu des peines d'emprisonnement répétées.
C'était donc une génération qui s'était politisée durant la guerre franco-allemande et la Commune de Paris, au cours d'années de propagande clandestine et d'agitation sous la férule des lois anti-socialistes de Bismarck (1878-1890). D'une trempe très différente étaient des hommes comme Gustav Noske, Friedrich Ebert ou Philipp Scheidemann, tous membres de l'aile droite de la fraction parlementaire du SPD, qui ont voté les crédits de guerre en 1914 et ont joué un rôle clé dans la répression de la révolution allemande de 1919 – et dans l'assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht par les Corps Francs. A l’image de Staline plus tard, il s'agissait d'hommes d'appareil, travaillant dans les coulisses plutôt que participant activement au débat public, des représentants d'un parti qui, en grandissant, tendait à ressembler et à s'identifier de plus en plus à l'État allemand dont la chute était pourtant toujours l'objectif officiel.
La gauche révolutionnaire avait pris ses distances avec la tendance grandissante au sein du parti à faire des concessions à la "politique pratique". De façon frappante elle était en grande partie composée d'étrangers et de jeunes (à l'exception notable du vieux Franz Mehring). Mis à part le hollandais Anton Pannekoek et le fils de Wilhelm Liebknecht, Karl, des hommes comme Parvus, Radek, Jogiches, Marchlewski, venaient tous de l'empire russe et s'étaient forgés comme militants dans les conditions difficiles de l'oppression tsariste. Et bien sûr, la figure de gauche la plus exceptionnelle était Rosa Luxemburg, elle qui était un « outsider » dans le parti allemand sur tous les plans possibles : jeune, femme, polonaise, juive et, peut-être pire que tout du point de vue de certains dirigeants allemands, elle dominait intellectuellement et théoriquement les autres leaders du parti, lesquels ne lui arrivaient pas à la cheville.
La fondation du SPD
Le SAP (Parti ouvrier allemand) qui deviendra le SPD, fut fondé en 1875 à Gotha, par la fusion de deux partis socialistes : le SDAP (Parti ouvrier social-démocrate - Sozialdemokratische Arbeiterpartei) 8, dirigé par Wilhelm Liebknecht et August Bebel, et l'ADAV (Association des travailleurs allemands - Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein) initialement fondée par Ferdinand Lassalle en 1863.
La nouvelle organisation avait donc deux origines très différentes. Le SDAP n'avait que six ans d'existence lors de la fusion. Grâce à la relation de longue date de Liebknecht avec Marx et Engels, ces derniers apportèrent une contribution importante au développement du SDAP - même si Liebknecht n'était en rien un théoricien, il joua un rôle important dans l'introduction des idées de Marx chez des hommes comme Bebel et Kautsky. En 1870, le SDAP adopta une ligne résolument internationaliste contre la guerre d'agression de la Prusse contre la France. Ainsi à Chemnitz, une réunion de délégués représentant 50 000 ouvriers saxons, avait adopté à l'unanimité une résolution en ce sens : "Au nom de la démocratie allemande, et spécialement des ouvriers du Parti social-démocrate, nous déclarons que la guerre actuelle est exclusivement dynastique... Nous sommes heureux de saisir la main fraternelle que nous tendent les ouvriers de France. Attentifs au mot d'ordre de l'Association internationale des Travailleurs : Prolétaires de tous les pays unissez-vous ! Nous n'oublierons jamais que les ouvriers de tous les pays sont nos amis et les despotes de tous les pays, nos ennemis !" 9
L'ADAV, en revanche, était restée fidèle à la position de son fondateur, Lassalle, opposé à la grève et convaincu que la cause des travailleurs pourrait avancer au moyen d'une alliance avec l'État bismarckien et, plus généralement, grâce aux recettes du "socialisme d'État" 10. Pendant la guerre franco-prussienne, l'ADAV est restée pro-allemande, son Président d'alors, Mende, allant jusqu'à réclamer que la France paie des réparations de guerre qui soient utilisées pour créer des ateliers nationaux pour les travailleurs allemands 11.
Marx et Engels furent profondément critiques envers le programme adopté lors de la fusion. Cependant les notes marginales de Marx sur ce programme n'ont été rendues publiques que bien plus tard 12, Marx estimant en effet que "Tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une douzaine de programmes" 13. Bien qu'ils se soient abstenus de critiquer ouvertement le nouveau parti, ils firent clairement part de leur point de vue à ses dirigeants et, écrivant à Bebel, Engels soulignait deux points faibles qui, pour n'avoir pas été pris en compte, allaient semer les graines de la trahison de 1914 :
- "le principe de l'internationalisme du mouvement ouvrier est, dans la pratique, complètement abandonné pour le présent, et cela par des gens qui, cinq ans durant et dans les circonstances les plus difficiles, ont défendu hautement ce principe de la façon la plus digne d'éloges. Le fait que les ouvriers allemands sont aujourd'hui à la tête du mouvement européen repose avant tout sur l'attitude vraiment internationale qu'ils ont eue pendant la guerre ; il n'y a pas d'autre prolétariat qui se serait aussi bien conduit. Et c'est aujourd'hui, où partout à l'étranger les ouvriers affirment ce principe avec la même vigueur et où les gouvernements font tous leurs efforts pour l'empêcher de se manifester dans une organisation, qu'ils devraient l'abandonner ?"
- "la seule revendication sociale que le programme fasse valoir est l'aide lassalienne de l'État, présentée sous la forme la moins voilée et telle que Lassalle l'a volée chez Buchez. Et cela, après que Bracke ait prouvé tout le néant d'une pareille revendication ; après que presque tous, sinon tous les orateurs de notre Parti aient été obligés, dans leur lutte contre les lassalliens, de la combattre ! Notre parti ne pouvait pas tomber plus bas dans l'humiliation. L'internationalisme descendu au niveau d'Armand Goegg, le socialisme à celui du républicain-bourgeois Buchez, qui opposait cette revendication aux socialistes pour les combattre !" 14
Ces failles dans la pratique politique n'étaient guère surprenantes étant donné l'assise théorique éclectique du nouveau parti. Quand Kautsky fonda la Neue Zeit en 1883, il avait l'intention qu'elle soit "publiée comme un organe marxiste se fixant la tâche de relever le faible niveau théorique de la social-démocratie allemande, de détruire le socialisme éclectique et de faire remporter la victoire au programme marxiste" ; il écrivait à Engels : "J'ai peut-être réussi mes tentatives pour faire de la Neue Zeit le point de ralliement de l'école marxiste. Je gagne la collaboration de nombreuses forces marxistes, tandis que je me débarrasse de l'éclectisme et du Rodbertussianisme". 15
Dès le départ, y compris au cours de son existence clandestine, le SDAP constitua donc un champ de bataille entre des tendances théoriques contradictoires – comme c'est la norme dans toute organisation prolétarienne en bonne santé. Mais, suivant les mots de Lénine, "sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire", et ces différentes tendances, ou visions de l'organisation et de la société, devaient avoir des conséquences très pratiques.
Au milieu des années 1870, le SDAP regroupait quelque 32 000 membres dans plus de 250 districts et, en 1878, le chancelier Bismarck imposa une loi "anti-socialiste" en vue de paralyser l'activité du parti. Des dizaines de journaux, les réunions, les organisations furent interdits, et des milliers de militants envoyés en prison ou soumis à des amendes. Mais la détermination des socialistes resta intacte face à la loi anti-socialiste. L'activité du SDAP prospéra dans les conditions de semi-illégalité. Être mis hors la loi contraignit le parti et ses membres à s'organiser hors des circuits de la démocratie bourgeoise – même la démocratie limitée de l'Allemagne bismarckienne – et à développer une forte solidarité contre la répression policière et la surveillance permanente de l'État. En dépit du harcèlement policier constant, le parti réussit à maintenir sa presse et à augmenter la circulation de celle-ci, au point où le journal satirique Der wahre Jacob (fondé en 1884) comptait à lui seul 100 000 abonnés.
Malgré les lois anti-socialistes, une activité publique était encore accessible au SDAP : il était encore possible pour les membres du SDAP de participer aux élections au Reichstag en tant que candidats indépendants non affiliés. C'est pourquoi une grande partie de la propagande du parti fut centrée autour des campagnes électorales aux niveaux national et local. Cela peut expliquer à la fois le principe selon lequel la fraction parlementaire devait rester strictement subordonnée aux congrès du parti et à l'organe central du parti, le Vorstand 16, et le poids croissant de la fraction parlementaire dans le parti alors que son succès électoral augmentait.
Bismarck menait la politique classique de la "carotte et du bâton". Alors qu'il empêchait les travailleurs de s'organiser, l'État impérial cherchait à couper l'herbe sous le pied des socialistes en instaurant, à partir de 1883, des primes d'assurance sociale en cas de chômage, de maladie ou de départ à la retraite, et cela une bonne vingtaine d'années avant l'instauration, en France, de la Loi sur les pensions des travailleurs et des paysans (1910) et, en Grande-Bretagne, de la Loi sur l'assurance nationale (1911). À la fin des années 1880, environ 4,7 millions de travailleurs allemands recevaient des indemnités de la sécurité sociale.
Pas plus les lois anti-socialistes que l'introduction de la sécurité sociale n'eurent l'effet escompté, à savoir un affaiblissement du soutien dont jouissait la social-démocratie. Au contraire, entre 1881 et 1890, le résultat électoral du SDAP passa de 312 000 à 1 427 000 voix, faisant de lui le plus grand parti en Allemagne. En 1890, le nombre de ses membres atteignait 75 000 et quelques 300 000 travailleurs avaient rejoint les syndicats. En 1890, le chancelier Bismarck fut limogé par le nouvel Empereur Guillaume II et les lois anti-socialistes furent abrogées.
Au sortir de la clandestinité, le SDAP fut refondé en tant qu'organisation légale, le SPD (Parti social-démocrate allemand - Sozialdemokratische Partei Deutschlands), lors de son congrès d'Erfurt en 1891. Le Congrès adopta un nouveau programme, et bien qu'Engels ait considéré le programme d'Erfurt comme constituant une amélioration par rapport à son prédécesseur de Gotha, il jugea néanmoins nécessaire d'attaquer la tendance à l'opportunisme : "Mais, de toute façon, les choses doivent être poussées en avant. Combien cela est nécessaire, c'est ce que prouve précisément aujourd'hui l'opportunisme qui commence à se propager dans une grande partie de la presse social-démocrate. Dans la crainte d'un renouvellement de la loi contre les socialistes ou se souvenant de certaines opinions émises prématurément du temps où cette loi était en vigueur, on veut maintenant que le Parti reconnaisse l'ordre légal actuel en Allemagne comme pouvant suffire à faire réaliser toutes ses revendications par la voie pacifique (…) Une pareille politique ne peut, à la longue, qu'entraîner le Parti dans une voie fausse. On met au premier plan des questions politiques générales, abstraites, et l'on cache par-là les questions concrètes les plus pressantes, qui, aux premiers événements importants, à la première crise politique, viennent d'elles-mêmes s'inscrire à l'ordre du jour. Que peut-il en résulter, sinon ceci que, tout à coup, au moment décisif, le Parti sera pris au dépourvu et que sur les points décisifs, il régnera la confusion et l'absence d'unité, parce que ces questions n'auront jamais été discutées ? (…) Cet oubli des grandes considérations essentielles devant les intérêts passagers du jour, cette course aux succès éphémères et la lutte qui se livre tout autour, sans se préoccuper des conséquences ultérieures, cet abandon de l'avenir du mouvement que l'on sacrifie au présent, tout cela a peut-être des mobiles honnêtes. Mais cela est et reste de l'opportunisme. Or, l'opportunisme "honnête" est peut-être le plus dangereux de tous." 17
Engels a fait preuve ici d’une remarquable prescience : les déclarations publiques d'intention révolutionnaire devaient se révéler impuissantes sans un plan d'action concret pour les sauvegarder. En 1914, le parti s'est en effet retrouvé "tout à coup pris au dépourvu".
Néanmoins, le slogan officiel du SPD restait : "Pas un homme ni un sou pour ce système", et ses députés au Reichstag refusaient systématiquement tout soutien aux budgets publics, en particulier les dépenses militaires. Cette opposition de principe à tout compromis de classe demeurait une possibilité au sein du système parlementaire parce que le Reichstag n'avait aucun pouvoir réel. Le gouvernement de l'Empire allemand de Guillaume était autocratique, peu différent de celui de la Russie tsariste 18, et l'opposition systématique du SPD n'avait en fait aucune conséquence pratique immédiate.
Dans le sud de l'Allemagne, les choses étaient différentes. Là, le SPD local, sous la direction d'hommes comme Vollmar, affirmait qu'il existait des "conditions particulières" et que si le SPD ne votait pas de façon significative dans les élections des Länder et ne se dotait pas d'une politique agraire faisant appel à la petite paysannerie, il serait voué à l'impuissance et à l'inutilité. Cette tendance apparut dès que le parti fut légalisé lors du Congrès d'Erfurt de 1891 et, dès lors, les députés SPD des parlements provinciaux de Wurtemberg, Bavière et Bade votèrent en faveur de budgets gouvernementaux. 19
La réaction du parti à cette attaque directe contre sa politique, exprimée de façon répétée dans les résolutions des congrès, fut de laisser la question sous le tapis. Une tentative de Vollmar de proposer un programme agraire spécial fut rejetée par le Congrès de Francfort de 1894 mais le même Congrès rejeta également une résolution interdisant le vote de tout député SPD en faveur de n'importe quel budget gouvernemental. On considérait que tant que la politique réformiste pouvait être limitée à "l'exception" du Sud de l'Allemagne, elle pouvait être tolérée. 20
La légalité sape l'esprit de combat du SPD
L'expérience par la classe ouvrière d'une dizaine d'années de semi-illégalité allait rapidement être minée par le poison de la démocratie. Par leur nature même, la démocratie bourgeoise et l'individualisme qui va de pair, sapent les tentatives du prolétariat pour développer une vision de lui-même comme classe historique avec sa propre perspective antagonique à celle de la société capitaliste. Parce qu'elle divise la classe ouvrière en une simple masse de citoyens atomisés, l'idéologie démocratique est un coin inséré en permanence dans la solidarité ouvrière. Au cours de cette période, les succès électoraux du parti, tant en termes de voix que de sièges au Parlement, augmentaient rapidement tandis que de plus en plus de travailleurs étaient organisés dans les syndicats et se trouvaient en mesure d'améliorer leurs conditions matérielles. La puissance politique grandissante du SPD et la force de la classe ouvrière industrielle organisée donnèrent naissance à un nouveau courant politique qui commença à théoriser l'idée que, non seulement il était possible de construire le socialisme au sein du capitalisme, d'œuvrer vers une transition progressive sans qu'il soit nécessaire de renverser le capitalisme par une révolution, mais encore que le SPD devrait avoir une politique étrangère expansionniste spécifiquement allemande : ce courant se cristallisa en 1897 autour de la Sozialistische Monatshefte, une revue hors du contrôle du SPD, dans des articles de Max Schippel, Wolfgang Heine et Heinrich Peus.21
Cette situation inconfortable, mais supportable, explosa en 1898 avec la publication des Préconditions du socialisme et les tâches de la social-démocratie (Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie) de Eduard Bernstein. La brochure de Bernstein expliquait ouvertement ce que lui et d'autres avaient suggéré depuis un certain temps : "pratiquement parlant, écrivait-il en 1896 à Kautsky, nous ne sommes qu'un parti radical ; nous ne faisons que ce que font tous les partis bourgeois radicaux, si ce n'est que nous le dissimulons sous un langage entièrement disproportionné à nos actions et à nos moyens" 22. Les positions théoriques de Bernstein attaquaient les fondements mêmes du marxisme en ce sens qu'il rejetait le caractère inévitable du déclin du capitalisme et de son effondrement final. En se fondant sur la prospérité en plein essor des années 1890, couplée avec la rapide expansion colonialiste du capitalisme à travers la planète, Bernstein faisait valoir que le capitalisme avait surmonté sa tendance vers des crises auto-destructives. Dans ces conditions, le but n'était rien, le mouvement était tout, la quantité devait prévaloir sur la qualité, l'antagonisme entre l'État et la classe ouvrière devait pouvoir être surmonté 23. Bernstein proclamait ouvertement que le principe fondamental du Manifeste communiste, selon lequel les travailleurs n'ont pas de patrie, était "obsolète". Il appelait les travailleurs allemands à apporter leur soutien à la politique coloniale de l'Empereur en Afrique et en Asie. 24
En réalité, toute une époque, celle de l'expansion et de l'ascension du système capitaliste, tirait à sa fin. Pour les révolutionnaires, de telles périodes de profonde transformation historique posent toujours un défi majeur puisqu'ils doivent analyser les caractéristiques de la nouvelle période et développer un cadre théorique pour comprendre les changements fondamentaux en cours, mais aussi adapter leur programme, si nécessaire, tout en continuant à défendre le même objectif révolutionnaire.
L'expansion rapide du capitalisme à travers le globe, son développement industriel massif, la nouvelle fierté de la classe dirigeante et son positionnement impérialiste, tout cela faisait penser au courant révisionniste que le capitalisme durerait toujours, que le socialisme pourrait être introduit à partir du capitalisme, et que l'État capitaliste pourrait servir les intérêts de la classe ouvrière. L'illusion d'une transition pacifique montrait que les révisionnistes étaient devenus les prisonniers du passé, incapables de comprendre qu'une nouvelle période historique se profilait à l'horizon : la période de décadence du capitalisme et de l'explosion violente de ses contradictions. Leur incapacité à analyser la nouvelle situation historique et la théorisation du caractère "éternel" des conditions du capitalisme à la fin du 19e siècle signifiaient aussi que les révisionnistes étaient incapables de voir que les anciennes armes de la lutte, le parlementarisme et la lutte syndicale, n'étaient plus utilisables. La polarisation sur le travail parlementaire comme axe de l'activité du parti, l'orientation en faveur de la lutte pour des réformes au sein du système, l'illusion d'un "capitalisme exempt de crises" et sur la possibilité d'introduire le socialisme pacifiquement dans le capitalisme, montraient fait que'une grande partie de la direction du SPD s'était identifiée avec le système. Le courant ouvertement opportuniste au sein du parti exprimait une perte de confiance dans la lutte historique du prolétariat. Après des années de luttes défensives pour le programme "minimum", l'idéologie démocratique bourgeoise avait pénétré dans le mouvement ouvrier. Cela signifiait que l'existence et les caractéristiques des classes sociales étaient mises en cause, qu'une vision individualiste avait tendance à dominer et à dissoudre les classes dans "le peuple". L'opportunisme jetait par-dessus bord la méthode marxiste d'analyse de la société en termes de lutte des classes et de contradictions de classe ; en fait, l'opportunisme signifiait l'absence de toute méthode, de tout principe et l'absence de toute théorie.
La gauche contre-attaque
La réaction de la direction du parti au texte de Bernstein fut d'en minimiser l'importance (le Vorwärts l'accueillit comme une "stimulante contribution à débattre", déclarant que tous les courants au sein du parti devraient être libres d'exprimer leurs opinions), tout en regrettant, en privé, que de telles idées soient exprimées ouvertement. Ignaz Auer, le secrétaire du parti, écrivait à Bernstein : "Mon cher Ede, on ne prend pas formellement la décision de faire les choses que vous suggérez, on ne dit pas ces choses, on les fait simplement". 25
Au sein du SPD, l'opposition la plus déterminée à Bernstein venait des forces qui n'avaient pas été habituées à la longue période de légalité ayant suivi la fin des lois anti-socialistes. Ce n'est pas par hasard si les opposants les plus clairs et les plus virulents au courant de Bernstein étaient des militants d'origine étrangère et, plus précisément, de l'Empire russe. Parvus, d'origine russe, qui avait émigré en Allemagne dans les années 1890 et qui, en 1898, travaillait comme rédacteur en chef de la presse du SPD à Dresde, le Sächsische Arbeiterzeitung 26, lança une attaque enflammée contre les idées de Bernstein et fut soutenu par la jeune révolutionnaire, Rosa Luxemburg, qui avait émigré en Allemagne en mai 1898 et avait connu la répression en Pologne. Dès qu'elle s'installa en Allemagne, Rosa Luxemburg commença à mener la lutte contre les révisionnistes avec son texte Réforme sociale ou révolution rédigé en 1898-99 (dans lequel elle présente la méthode de Bernstein, réfute l'idée de l'établissement du socialisme par le biais de réformes sociales, dénonce la théorie et la pratique de l'opportunisme). Dans sa réponse à Bernstein, elle souligne que la tendance réformiste avait pris son plein essor depuis l'abolition des lois anti-socialistes et la possibilité de travailler légalement. Le socialisme d'État de Vollmar, l'approbation du budget bavarois, le socialisme agraire Sud-allemand, les propositions de compensations de Heine, la position de Schippel sur les douanes et la milice constituaient les éléments d'une pratique opportuniste grandissante. Elle soulignait le dénominateur commun de ce courant : l'hostilité à l'égard de la théorie : "Ce qui distingue [toutes les tendances opportunistes au sein du parti] en surface ? L'aversion de la "théorie" et cela est naturel étant donné que notre théorie, c'est-à-dire les bases du socialisme scientifique, assigne à notre activité pratique des tâches claires et des limites, tant en ce qui concerne les objectifs à atteindre que les moyens à utiliser et enfin la méthode de la lutte. Naturellement ceux qui ne veulent que courir après les réalisations pratiques développent rapidement un désir de se libérer, c'est-à-dire de séparer la pratique de la théorie." 27
Pour elle, la première tâche des révolutionnaires était de défendre le but final. "Le mouvement comme tel sans lien avec l'objectif final, le mouvement comme but en soi n'est rien, l'objectif final, c'est ce qui compte." 28
Dans un texte de 1903, Stagnation et progrès du marxisme, Rosa Luxemburg considère l'insuffisance théorique de la social-démocratie en ces termes : "l'effort scrupuleux pour rester "dans les limites du marxisme" a parfois été aussi désastreux pour l'intégrité du processus de pensée que l'autre extrême – le désaveu complet de la perspective marxiste et la détermination de manifester "l'indépendance de la pensée" face à tous les dangers".
En attaquant Bernstein, Luxemburg exigeait également que l'organe de presse central du parti défendît les positions décidées par les congrès du parti. Lorsqu'en mars 1899, le Vorwärts répondit que la critique par Luxemburg de la position de Bernstein (dans un article intitulé "Vains espoirs" - Eitle Hoffnungen) était injustifiée, celle-ci répliqua que le Vorwärts "se trouve dans la situation confortable de ne jamais courir le risque d'avoir une opinion erronée ou de changer d'avis, un péché qu'il aime à trouver chez les autres, tout simplement parce qu'il n'a jamais défendu ni ne défend jamais aucune opinion".29
Continuant dans la même veine, elle écrivait : "il y a deux sortes de créatures organiques : celles qui ont une colonne vertébrale et qui peuvent marcher debout, parfois même courir ; et il y en a d'autres qui n'ont aucune colonne vertébrale et ne peuvent donc que ramper et bidouiller", À ceux qui voulaient que le parti abandonne toute position programmatique et tout critère politique, elle répondit lors de la Conférence du parti à Hanovre en 1899 : "si cela signifie que le parti – au nom de la liberté de critique – ne doit pas prendre position ni le déclarer au moyen d'un vote à la majorité, nous ne défendons pas cette position. Nous devons donc protester contre cette idée, parce que nous ne sommes pas un club de discussion mais un parti de combat politique, qui doit défendre certaines visions fondamentales." 30
Le marais vacille
Entre l'aile gauche déterminée, autour de Rosa Luxemburg, et la droite défendant les idées de Bernstein et la révision des principes, il y avait un "marais", que Bebel décrit dans les termes suivants lors du Congrès de Dresde de 1903 : "c'est toujours la même vieille et éternelle lutte entre une gauche et une droite et, entre les deux, le marais. Ce sont des éléments qui ne savent jamais ce qu'ils veulent ou plutôt qui ne disent jamais ce qu'ils veulent. Ce sont les Monsieur-je-sais-tout qui, habituellement, écoutent d'abord pour voir qui dit quoi, ce qui est dit ici et là. Ils sentent toujours où se trouve la majorité et ils rejoignent habituellement la majorité. Nous avons aussi ce genre de gens dans le parti (...) l'homme qui défend sa position ouvertement, au moins je sais où il se trouve ; au moins je peux me battre avec lui. Ou il gagne ou c'est moi, mais les éléments paresseux qui esquivent toujours et évitent toujours une décision claire, qui toujours disent "nous sommes tous d'accord, oui nous sommes tous frères", ce sont les pires. Je les combats le plus durement." 31
Ce marais, incapable de prendre une position claire, vacillait entre ceux qui étaient clairement révisionnistes, la droite, et la gauche révolutionnaire. Le centrisme est l'un des visages de l'opportunisme. Il se positionne toujours entre les forces antagonistes, entre les courants réactionnaires et les courants radicaux, il tente de concilier les deux. Il évite la confrontation ouverte des idées, il fuit le débat, il estime toujours que "un côté n'a pas complètement raison", mais que "l'autre côté n'a pas tout à fait raison non plus". Il considère le débat politique avec des arguments clairs et un ton polémique comme "exagéré", "extrémiste", "troublant", voire "violent". Il pense que la seule façon de maintenir l'unité, afin de préserver l'organisation, est de permettre à toutes les tendances politiques de coexister, y compris celles dont les objectifs sont en contradiction directe avec ceux de l'organisation. Il répugne à prendre en charge ses responsabilités et à se positionner. Le centrisme dans le SPD avait tendance à s'allier avec réticence avec la gauche, tout en regrettant "l'extrémisme" et la "violence" de celle-ci et à empêcher effectivement que soient prises des mesures fermes – telles que l'expulsion des révisionnistes du parti – et que soit préservée la nature révolutionnaire du parti.
Rosa Luxemburg, au contraire, considérait que la seule façon de défendre l'unité du parti en tant qu'organisation révolutionnaire était d'insister sur l'exposition la plus complète et la discussion publique des points de vue opposés.
"En dissimulant les contradictions par "l'unité" artificielle de vues incompatibles, les contradictions ne peuvent qu'atteindre un sommet, jusqu'à ce qu'elles explosent violemment tôt ou tard dans une scission (...) Ceux qui mettent en avant les divergences de vue, et combattent les opinions divergentes, travaillent à l'unité du parti. Mais ceux qui dissimulent les divergences travaillent à une réelle scission dans le parti." 32
Le summum du centrisme à ce moment de la vie du SPD et son plus prestigieux représentant était Karl Kautsky.
Lorsque Bernstein commença à développer son point de vue révisionniste, Kautsky resta silencieux, au début, préférant ne pas s'opposer à son vieil ami et camarade en public. Il ne voyait pas non plus à quel point les théories révisionnistes de Bernstein sapaient les fondements révolutionnaires sur lesquels le parti avait été construit. Comme l'a souligné Luxemburg, dès lors qu'on accepte l'idée que le capitalisme peut durer éternellement, qu'il n'est pas voué à s'effondrer en raison de ses propres contradictions internes, on est inévitablement conduit à abandonner le but révolutionnaire 33. L'échec de Kautsky– comme de la plus grande partie de la presse du parti – était un signe évident de la perte de l'esprit de combat dans l'organisation : le débat politique n'était plus une question de vie ou de mort pour la lutte des classes, il était devenu une préoccupation académique d'intellectuels spécialistes.
L'arrivée de Rosa Luxemburg à Berlin en 1898 (de Zürich où elle venait de terminer avec brio ses études avec une thèse de doctorat sur le développement économique de la Pologne) et ses réactions aux théories de Bernstein, devaient jouer un rôle majeur dans l'attitude de Kautsky.
Lorsque Luxemburg, prenant conscience des hésitations de Bebel et de Kautsky et de leur refus de combattre les vues de Bernstein, critiqua cette attitude dans une lettre à Bebel 34. Elle demanda pourquoi ils n'insistaient pas pour répondre énergiquement à Bernstein et, en mars 1899, après qu'elle eut commencé la série d'articles qui allait devenir plus tard la brochure Réforme sociale ou révolution, elle rapporta à Jogiches : "quant à Bebel, dans une conversation avec Kautsky, je me suis plainte qu'il ne se lève pas ni ne se batte. Kautsky m'a dit que Bebel avait perdu son dynamisme, qu'il avait perdu sa confiance en lui-même et n'avait plus aucune énergie. Je le grondai à nouveau et lui demandai : 'pourquoi ne l'inspirez-vous pas, ne lui apportez-vous pas des encouragements et de l'énergie ?' Kautsky a répondu : 'vous devriez le faire, allez parler à Bebel, vous devriez l'encourager' ". Quand Luxemburg demanda à Kautsky pourquoi lui n'avait pas réagi, il répondit : "Comment puis-je m'impliquer dans des rassemblements et des réunions maintenant, alors que je suis pleinement engagé dans la lutte parlementaire, cela signifie seulement qu'il y aura des affrontements, et où cela mènerait-il ? Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour cela." 35
En 1899, dans Bernstein et le programme social-démocrate – une anti-critique (Bernstein und das sozialdemokratische Programm - Eine Antikritik), Kautsky s'exprima finalement contre les idées de Bernstein sur la philosophie marxiste et l'économie politique ainsi que sur ses vues sur le développement du capitalisme. Mais, néanmoins, il salua le livre de Bernstein comme étant une précieuse contribution au mouvement, s'opposa à l'idée de son expulsion du parti et évita de dire que Bernstein était en train de trahir le programme marxiste. Bref, comme Rosa Luxemburg le conclut, Kautsky voulait éviter toute contestation de la routine plutôt confortable de la vie du parti ainsi que la nécessité de critiquer son vieil ami en public. Comme Kautsky lui-même l'admit en privé à Bernstein : "Parvus et Luxemburg avaient déjà bien saisi la contradiction de votre point de vue avec nos principes programmatiques, alors que je ne voulais pas encore l'admettre et croyais fermement que tout cela était un malentendu (...) C'était mon erreur, je n'étais pas aussi perspicace que Parvus et Luxemburg qui, déjà à l'époque, avaient flairé la ligne de pensée de votre brochure." 36 En fait, dans le Vorwärts, Kautsky minimisait et banalisait l'attaque constituée par la nouvelle théorie révisionniste de Bernstein, disant qu'elle avait été amplifiée hors de toute proportion, d'une manière typique de l'"imagination absurde" d'une mentalité de petit-bourgeois. 37
Loyauté aux amis ou à la classe ?
Par fidélité à son vieil ami, Kautsky estima qu'il devait s'excuser auprès de Bernstein en privé, écrivant : "Il aurait été lâche de rester silencieux. Je ne crois pas que je vous aie fait du mal maintenant que j'ai parlé. Si je n'avais pas dit à August Bebel que je répondrai à votre déclaration, il l'aurait fait lui-même. Vous pouvez imaginer ce qu'il aurait dit, connaissant son tempérament et son insensibilité" 38. Cela signifiait qu'il préférait rester muet et aveugle face à son vieil ami. Il réagit contre son gré et seulement après y avoir été contraint par la gauche. Plus tard, il admit qu'il avait "péché" en permettant à son amitié avec Bernstein de dominer son jugement politique : "Dans ma vie, j'ai péché seulement une fois par amitié, et je regrette encore ce péché à ce jour. Si je n'avais pas tant hésité avec Bernstein, et si je l'avais confronté dès le début avec la netteté nécessaire, j'aurais pu épargner au parti de nombreux problèmes désagréables." 39 Toutefois, cet "aveu" est sans valeur tant qu'il ne va pas à la racine du problème. Bien qu'il ait confessé son "péché", Kautsky ne donna jamais une explication politique plus profonde, donnant les raisons pour lesquelles une telle attitude, basée sur l'affinité personnelle plutôt que sur les principes politiques, était un danger pour une organisation politique. En réalité, cette attitude l'amena à accorder aux révisionnistes une "liberté d'opinion" illimitée au sein du parti. Comme Kautsky le dit à la veille du Congrès du parti de Hanovre : "En général, il faut laisser à chaque membre du parti la possibilité de décider s'il partage encore les principes du parti ou non. En excluant une personne, nous agissons seulement contre ceux qui portent atteinte au parti ; personne n'a encore été exclu du parti à cause de critiques raisonnables, parce que notre parti a toujours hautement apprécié la liberté de discussion. Même si Bernstein n'avait pas mérité tant d'estime pour sa participation dans notre lutte, et pour le fait qu'il a dû s'exiler en raison de ses activités de parti, nous n'envisagerions quand même pas de l'exclure." 40
La réponse de Rosa Luxemburg était claire. "Si grand que soit notre besoin d'autocritique et si larges que soient les limites que nous lui traçons, il doit cependant exister un minimum de principes constituant notre essence et notre existence même, le fondement de notre coopération en tant que membres d'un parti. Dans nos propres rangs, la 'liberté de critique' ne peut pas s’appliquer à ces principes, peu nombreux et très généraux, justement parce qu'ils sont la condition préalable de toute activité dans le Parti, et par conséquent aussi de toute critique exercée à l'endroit de cette activité. Nous n'avons pas à nous boucher les oreilles lorsque ces principes mêmes sont critiqués par quelqu'un qui se trouve en dehors de notre Parti. Mais aussi longtemps que nous les considérons comme le fondement de notre existence en tant que parti, nous devons y demeurer attachés et ne pas les laisser ébranler par nos membres. À ce sujet, nous ne pouvons accorder qu'une liberté : celle d’appartenir ou de ne pas appartenir à notre Parti". 41
L'implication logique de "l'absence de position" de Kautsky, c'est que tout le monde pourrait rester au sein du parti et défendre ce qui lui plaît, que le programme est édulcoré, que le parti devient un "melting pot" d'opinions différentes et non le fer de lance d'une lutte déterminée. L'attitude de Kautsky montra qu'il préférait la fidélité à un ami à la défense des positions de classe. Dans le même temps, il voulut adopter la posture d'un "expert" théorique. Il est vrai qu'il avait écrit quelques livres très importants et précieux (voir ci-dessous), et qu'il jouissait de l'estime d'Engels. Mais, comme Luxemburg le relève dans une lettre à Jogiches : "Karl Kautsky se limite à la théorie" 42. Préférant s'abstenir de toute participation à la lutte pour la défense de l'organisation et de son programme, Kautsky perdit progressivement toute attitude de combat, et cela signifiait qu'il plaçait ce qu'il considérait comme ses obligations envers ses amis au-dessus de toute obligation morale envers son organisation et ses principes. Cela conduisit à ce que la théorie soit détachée de l'action pratique et concrète : par exemple, le précieux travail de Kautsky sur l'éthique, en particulier le chapitre sur l'internationalisme, n'était pas soudé à une défense sans faille de l'internationalisme dans l'action.
Il y a un contraste saisissant entre l'attitude de Kautsky vis-à-vis de Bernstein et celle de Rosa Luxemburg vis-à-vis de Kautsky. À son arrivée à Berlin, Luxemburg entretenait des relations étroites avec Kautsky et sa famille. Mais rapidement elle sentit que la grande estime que la famille de Kautsky lui démontrait devenait un fardeau. Déjà en 1899 elle se plaignait à Jogiches : "Je commence à fuir leurs belles paroles. Les Kautsky me considèrent comme faisant partie de leur famille." (11/12/1899). "Je ressens toutes ces marques d'affection (il est très bien intentionné envers moi, je peux le voir), comme un fardeau terrible, au lieu d'un plaisir. En fait, toute amitié mise en place dans l'âge adulte et plus encore quand elle est basée sur l'appartenance au parti, est un fardeau : elle vous impose certaines obligations, elle est une contrainte, etc. Et justement ce côté de l'amitié est un handicap pour moi. Après la rédaction de chaque article, je me demande : ne sera-t-il pas déçu, cela ne va-t-il pas refroidir notre amitié ?" 43. Elle était consciente des dangers d'une attitude fondée sur des affinités, où les considérations d'obligation personnelle, d'amitié ou des goûts communs, obscurcissent le jugement politique du militant mais, aussi, ce que nous pourrions appeler son jugement moral quant à savoir si une ligne d'action est conforme aux principes de l'organisation 44. Luxemburg osait néanmoins confronter Kautsky ouvertement : "J'ai eu une dispute de fond sur la manière d'aborder les choses avec Kautsky. Il m'a dit en conclusion que je penserai comme lui dans vingt an, ce à quoi j'ai répondu que si c'était le cas, c'est que je serai un zombie dans 20 ans." 45
Lors du Congrès de Lübeck en 1901, Luxemburg fut accusée de déformer les positions des autres camarades, une accusation qu'elle estima diffamatoire et pour laquelle elle exigea une clarification publique. Dans ce but, elle soumit une déclaration pour publication dans le Vorwärts 46. Mais Kautsky, au nom de la Neue Zeit, l'exhorta à retirer sa demande de publication. Elle répondit à Kautsky : "Bien sûr, je suis prête à renoncer à publier ma déclaration dans la Neue Zeit, mais permettez-moi d'ajouter quelques mots d'explication. Si j'étais un de ceux qui, sans considération pour personne, protégeait mes droits et mes intérêts – et ils sont légion dans notre parti – ou plutôt ils sont tous comme ça – j'insisterais naturellement pour la publication, parce que vous-même, en tant que rédacteur en chef, vous admettez que vous avez certaines obligations envers moi dans cette affaire. Mais, tout en admettant cette obligation, vous placez en même temps un revolver d'exhortation et de demande amicales sur mon cœur et me demandez de ne pas faire usage de cette obligation et donc de ne pas défendre mes droits. Eh bien je suis écœurée à l'idée de devoir insister sur ces droits si ceux-ci ne sont accordés qu'au milieu de soupirs et de grincements de dents et quand les gens, non seulement me saisissent par le bras dans l'espoir que je me "défende" moi-même, mais cherchent en plus à me réduire en bouillie, dans l'espoir que je serai ainsi convaincue de renoncer à mes droits. Vous avez gagné ce que vous cherchez, vous êtes libre de toute obligation envers moi dans cette affaire.
Mais il semblerait que vous agissez dans l'illusion que c'est uniquement par amitié et dans mon intérêt. Permettez-moi de détruire cette illusion. En tant qu'ami, vous auriez dû me dire : 'je vous conseille à tout prix et sans condition de défendre votre honneur comme rédacteur, car des écrivains plus grands (...) comme Marx et Engels, ont écrit des brochures entières, mené des guerres de plume sans fin, lorsque quelqu'un osait les accuser de falsification. Vous d'autant plus, comme jeune écrivain ayant beaucoup d'ennemis, devez chercher à obtenir entière satisfaction...' Voilà ce que vous auriez dû me conseiller en tant qu'ami.
L'ami, cependant, a été rapidement relégué au second plan par le rédacteur en chef de la Neue Zeit, et ce dernier n'a qu'un souhait depuis le Congrès du parti [de Lübeck] ; il veut la paix, il veut montrer que la Neue Zeit a appris les manières après avoir reçu une raclée, elle a appris à fermer la bouche 47. Et c'est pour de telles raisons que les droits essentiels d'un rédacteur en chef adjoint et collaborateur régulier... doivent être sacrifiés. Permettons qu'un collaborateur de la Neue Zeit - qui ne fait certainement pas le pire travail – avale même une accusation publique de falsification pourvu que la paix et le calme soient maintenus ! Voilà comment les choses sont, mon ami ! Et maintenant avec les meilleures salutations, votre Rosa". 48
Ici, nous voyons une révolutionnaire jeune, déterminée, et une femme de surcroît, qui déclare que l'autorité d'un "ancien", l'autorité "orthodoxe", expérimentée, devrait assumer sa responsabilité personnelle. Kautsky répondit à Luxemburg : "Vous voyez, nous ne devrions pas contrarier les gens de la fraction parlementaire, nous ne devrions pas laisser l'impression qu'on les prend de haut. Si vous souhaitez leur faire une suggestion, il est préférable de leur envoyer une lettre privée, qui sera beaucoup plus efficace" 49. Mais Rosa Luxemburg tentait de "ranimer" l'esprit combatif chez lui : "Vous devez vraiment vous battre avec les tripes et dans la joie, et non comme s'il s'agissait d'un intermède ennuyeux ; le public est toujours sensible à l'état d'esprit combatif et la joie du combat donne de la résonance à la controverse, et assure la supériorité morale" 50. Cette attitude de ne pas vouloir déranger le cours normal de la vie du parti, de ne pas prendre position dans le débat, de ne pas pousser à la clarification des divergences, de fuir le débat et de tolérer les révisionnistes, éloignait de plus en plus Rosa Luxemburg et montrait au grand jour à quel point la perte de la combativité, de la morale, la perte de conviction, de détermination, étaient devenues la caractéristique dominante de l'attitude de Kautsky : "Je viens de lire son [article] "Nationalisme et internationalisme" et c'était horrible et donnait la nausée. Bientôt je ne serai plus capable de lire un seul de ses écrits. J'ai l'impression qu'une toile d'araignée nauséabonde me recouvre la tête... " 51. "Kautsky devient de plus en plus saumâtre. Il est de plus en plus fossilisé à l'intérieur, il n'a plus aucune préoccupation humaine envers quiconque, sauf sa famille. Je me sens vraiment mal à l'aise avec lui". 52
L'attitude de Kautsky peut aussi être opposée à celle de Luxemburg et Leo Jogiches. Après la rupture de la relation de Rosa Luxemburg avec Leo Jogiches en 1906 (qui lui a causé un stress et une douleur immenses ainsi qu'une grande déception envers lui comme compagnon), ils sont tous deux restés les plus proches camarades jusqu'au jour l'assassinat de Rosa. Malgré des rancunes personnelles profondes, de la déception et de la jalousie, ces sentiments émotionnels profonds consécutifs à la rupture de leur relation ne les ont jamais empêchés de se tenir côte à côte dans la lutte politique.
On pourrait objecter que, dans le cas de Kautsky, son attitude reflétait son manque de personnalité et son caractère, mais il serait plus exact de dire qu'il personnifiait la pourriture morale au sein de la social-démocratie dans son ensemble.
Luxemburg a été forcée, dès le début, de faire face à la résistance de la "vieille garde". Quand elle critiqua la politique révisionniste lors du Congrès de Stuttgart 1898, "Vollmar m'a reproché amèrement, en tant que jeune du mouvement, de vouloir donner des leçons aux anciens vétérans (...) Mais si Vollmar répond à mes explications factuelles par un 'vous novice, je pourrais être votre grand-père', je ne vois cela que comme la preuve qu'il est à court d'arguments." 53. Concernant l'affaiblissement de la combativité des vétérans les plus centristes, dans un article rédigé après le Congrès de 1898, elle déclarait que : "Nous aurions préféré si les anciens combattants avaient repris le combat dès le début du débat (...) Si le débat a décollé, ce n'est pas à cause, mais en dépit du comportement des leaders du parti (...) Abandonnant le débat à son sort, regardant passivement pendant deux jours pour voir vers où le vent souffle et n'intervenant que lorsque les porte-paroles de l'opportunisme furent obligées de se montrer au grand jour, puis faisant des remarques sarcastiques sur le ton tranchant de ceux dont on défend ensuite le point de vue, c'est une tactique qui ne projette pas une bonne image des dirigeants du parti. Et les explications de Kautsky quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas fait de déclaration publique jusqu'à présent sur la théorie de Bernstein, parce qu'il voulait se réserver le droit de dire le dernier mot lors d'un possible débat, ne ressemble pas vraiment à une bonne excuse. En février, il publie l'article de Bernstein sans aucun commentaire éditorial dans la Neue Zeit, puis il reste muet pendant 4 mois, en juin, il ouvre les discussions avec quelques compliments au "nouveau" point de vue de Bernstein, cette nouvelle copie médiocre de socialiste en chambre, puis de nouveau, il reste muet pendant 4 mois, laisse le Congrès du parti commencer, puis déclare au cours du débat qu'il aimerait faire les remarques finales. Nous préférerions que le "théoricien d'office" intervienne toujours dans les débats et ne se contente pas de faire la conclusion de ces questions cruciales ; qu'il ne donne pas l'impression erronée et trompeuse que pendant longtemps, il ne savait pas ce qu'il devait dire." 54
Ainsi, beaucoup de membres de la vieille garde, qui avaient combattu dans les conditions de la Loi anti-socialiste, ont été désarmés par le poids du démocratisme et du réformisme. Ils furent incapables de comprendre la nouvelle période et commencèrent à théoriser l'abandon de l'objectif socialiste. Au lieu de transmettre les leçons de la lutte dans les conditions de la Loi anti-socialiste à une nouvelle génération, ils avaient perdu leur combativité. Et le courant centriste qui se cachait et évitait le combat, en fuyant la bataille ouverte contre l'opportunisme, ouvrait la voie à la montée de la droite.
Tandis que les centristes évitaient la lutte, l'aile gauche autour de Luxemburg montrait son esprit combatif et était prête à assumer ses responsabilités. Voyant qu'en réalité "Bebel lui-même est déjà devenu sénile et laisse aller les choses ; il est soulagé si d'autres luttent, mais lui-même n'a ni l'énergie ni l'élan pour prendre l'initiative. K [Kautsky] se limite à la théorie, personne ne prend aucune responsabilité." 55 "Cela signifie que le parti est sur une mauvaise voie (...) Personne ne le dirige, personne ne prend de responsabilités." L'aile gauche visait à gagner plus d'influence et était convaincue de la nécessité d'agir comme un fer de lance. Luxemburg écrivait à Jogiches : "Encore un an de travail persévérant, positif et ma position sera forte. Pour le moment je ne peux pas atténuer le tranchant de mon discours, parce que nous devons défendre la position la plus extrême" 56. Cette influence ne devait pas être obtenue au prix d'une dilution des positions.
Convaincue de la nécessité d'un leadership déterminé et reconnaissant qu'elle ferait face à la résistance des hésitants, elle voulait pousser le parti. "Une personne, qui de plus n'appartient pas à la clique au pouvoir, qui ne veut compter sur le soutien de personne mais n'utilise que ses propres coudes, une personne préoccupée de l'avenir non seulement à cause d'adversaires aussi évidents que Auer et Cie mais aussi d'alliés (Bebel, Kautsky, Singer), une personne qu'il vaut mieux tenir à distance car elle pourrait les dépasser de plusieurs têtes (…) Je n'ai aucunement l'intention de me limiter à critiquer. Au contraire, j'ai vraiment l'intention et le désir de "pousser" de façon positive, pas les individus mais le mouvement dans son ensemble... de montrer de nouvelles voies, de combattre, de faire la mouche du coche– en un mot, d'être un incitatif permanent pour l'ensemble du mouvement" 57. En octobre 1905, Luxemburg se voit proposer la possibilité de participer au Comité de rédaction du Vorwärts. Elle était intransigeante sur une possible censure de ses positions. "Si à cause de mes articles il y a un conflit avec la direction ou avec le Comité de rédaction, je ne serai pas seule à le quitter, mais c'est l'ensemble de la gauche qui exprimera sa solidarité et quittera le Vorwärts, et le Comité de rédaction sera balayé". Durant une courte période, la gauche gagna une certaine influence.
Le déclin de la vie prolétarienne dans le SPD
Le processus de dégénérescence du parti n'était pas seulement marqué par des tentatives ouvertes d'abandon des positions programmatiques et par le manque de combativité de larges secteurs en son sein. Sous la surface, il existait de façon permanente un courant sous-jacent fait de rancunes mesquines et de dénigrements personnels dirigés contre ceux qui défendaient de la façon la plus intransigeante les principes de l'organisation et perturbaient la façade d'unité. L'attitude de Kautsky vis-à-vis de la critique de Luxemburg à Bernstein, par exemple, était ambivalente. Malgré ses relations amicales avec Luxemburg, il pouvait néanmoins écrire à Bernstein : "Cette méchante créature Luxemburg est mécontente de la trêve jusqu'à la publication de votre brochure, chaque jour, elle inflige un autre coup d'épingle aux 'tactiques'" 58.
Parfois, comme nous le verrons, ce courant souterrain émergeait à la surface à travers des accusations calomnieuses et des attaques personnelles.
C'est surtout la droite qui réagit en personnalisant et faisant de "l'ennemi" au sein du parti un bouc-émissaire. Alors qu'une clarification des divergences profondes à travers une confrontation ouverte était nécessaire, la droite, au lieu d'apporter des arguments au débat, recula et se mit à calomnier les membres les plus importants de la gauche.
Montrant un clair sentiment d'infériorité sur le plan théorique, les membres de la droite répandent des insinuations calomnieuses sur Luxemburg en particulier, faisant des commentaires machistes et des insinuations sur sa vie sentimentale et ses relations sociales "malheureuses" (sa relation avec Leo Jogiches n'était pas connue du parti) : "Cette vieille fille intelligente et méchante viendra également à Hanovre. Je la respecte et considère qu'elle est plus forte que Parvus. Mais elle me déteste du fond de son cœur." 59
Le secrétaire de l'aile droite du parti, Ignaz Auer, admettait auprès de Bernstein : "Même si nous ne sommes pas égaux à nos adversaires, car tout le monde n'est pas capable de jouer un grand rôle, nous ne cédons pas contre la rhétorique et les propos insultants. Mais s'il y avait un divorce "propre", que personne d'ailleurs ne considère sérieusement, Clara [Zetkin] et Rosa se retrouveraient laissées à elles-mêmes. Pas même leurs [amoureux] ne prendraient leur défense, ni les anciens ni les actuels." 60
Le même Auer n'hésita pas à utiliser des intonations xénophobes ; il disait que "les principales attaques contre Bernstein et ses partisans et contre Schippel n'émanaient pas de camarades allemands et ne sont pas venues du mouvement en Allemagne. Les activités de ces personnes, en particulier de Mme Rosa Luxemburg, ont été déloyales et pas bienveillantes entre camarades" 61. Ce type de tonalité xénophobe - notamment contre Luxemburg qui était d'origine juive – est devenu un élément permanent de la campagne de la droite, qui allait évoluer de façon de plus en plus violente au cours des années précédant la Première Guerre mondiale. 62
L'aile droite du parti a même écrit des commentaires satiriques ou des textes sur Luxemburg 63. Luxemburg et d'autres personnalités de gauche avaient déjà été ciblées d'une manière particulièrement vile en Pologne. Paul Frölich rapporte, dans sa biographie de Luxemburg, que beaucoup de calomnies ont été portées contre des personnalités de gauche comme Warski et Luxemburg. Luxemburg a été accusée d'être payée par l'officier de police de Varsovie Markgrafski, lorsqu'elle publia un article sur la question de l'autonomie nationale ; elle a également été accusée d'être un agent rémunéré de l'Okhrana, la police secrète russe. 64
Rosa Luxemburg fut de plus en plus écœurée par l'ambiance au sein du parti. "Chaque contact plus étroit avec le gang du parti crée un tel sentiment de malaise que chaque fois je suis déterminée à dire : à trois miles marins du point le plus bas de la marée basse ! Après avoir été avec eux, je sens une telle odeur de saleté, je ressens une telle faiblesse de caractère, une telle mesquinerie, que je me précipite pour rentrer dans mon trou de souris." 65
C'était en 1899, mais dix ans plus tard, son opinion sur le comportement des dirigeants du parti ne s'était pas améliorée. "Après tout, essayez de rester calme et ne pas oublier qu'en dehors de la direction du parti et des gredins du type Zietz, il y a encore beaucoup de choses belles et pures. En dehors de l'inhumanité immédiate, il [Zietz] manifeste un symptôme douloureux de la misère générale dans laquelle notre "leadership" a sombré, le symptôme d'un état d'esprit effrayant et terriblement pauvre. Une autre fois, cette algue en décomposition sera je l'espère balayée par une vague écumante" 66. Et elle a souvent exprimé son indignation face à l'atmosphère bureaucratique étouffante au sein du parti : "Je me sens parfois vraiment misérable ici et j'ai envie de fuir d'Allemagne. Dans n'importe quel village de Sibérie dont vous avez envie de parler, il y a plus d'humanité que dans l'ensemble de la social-démocratie allemande." 67 Cette attitude de désigner des boucs-émissaires visant à détruire la réputation de la gauche a semé les germes de l'assassinat ultérieur de Rosa Luxemburg par les Corps francs qui la tuèrent, en janvier 1919, sous les ordres du SPD. Le ton employé contre elle au sein du parti préparait l'atmosphère de pogrom contre les révolutionnaires au cours de la vague révolutionnaire de 1918-1923. La diffamation qui, peu à peu, s'était infiltrée dans le parti et l'absence d'indignation à ce sujet, en particulier de la part du centre, ont contribué à désarmer moralement le parti.
Censurer et faire taire l'opposition
En plus de créer des boucs-émissaires, de personnaliser et de mener des attaques xénophobes, les différentes instances du parti, sous l'influence de la droite, commencèrent à censurer les articles de la gauche et de Luxemburg en particulier. Surtout après 1905, alors que la question de l'action de masse était à l'ordre du jour (voir ci-dessous), le parti était de plus en plus tenté de museler Rosa Luxemburg et d'empêcher la publication de ses articles sur la question de la grève de masse et de l'expérience russe. Bien que la gauche ait disposé de bastions dans certaines villes 68, l'ensemble de l'aile droite de l'appareil du parti tentait d'empêcher la propagation des positions de Rosa Luxemburg dans l'organe central du parti, le Vorwärts : "Nous devons malheureusement décliner votre article étant donné que, conformément à un accord entre l'exécutif du parti, le Conseil exécutif de l'organisation provinciale prussienne [du SPD] et le rédacteur en chef, la question de la grève de masse ne peut pas être examinée pour le moment dans le Vorwärts." 69
Comme nous le verrons, le déclin moral et l'affaiblissement de la solidarité au sein du parti eurent un effet nocif quand les tensions impérialistes s'aiguisèrent alors que la gauche insistait sur la nécessité d'y répondre au moyen de l'action de masse.
Franz Mehring, personnalité bien connue et respectée de la gauche, fut également souvent attaqué. Mais, contrairement à Rosa Luxemburg, il s'offensait facilement et avait tendance à se retirer de la lutte lorsqu'il sentait qu'il avait été injustement attaqué. Par exemple, avant le Congrès du parti à Dresde en 1903, Mehring avait dénoncé l'incompatibilité, pour des sociaux-démocrates, d'être affiliés au parti et, en même temps, d'écrire dans la presse bourgeoise. Les opportunistes avaient lancé une campagne de diffamation contre lui. Mehring demanda un tribunal du parti. Celui-ci se réunit et adopta un "jugement clément" contre les opportunistes. Mais, de plus en plus, alors qu'il était soumis à la pression croissante de la droite, Mehring eut tendance à se retirer de la presse du parti. Luxemburg insistait pour qu'il résiste à la pression de la droite et à ses calomnies : "Vous sentirez sûrement que nous approchons de plus en plus des moments où les masses du parti vont avoir besoin d'une direction énergique, impitoyable et généreuse et que, sans vous, nos pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, l'organe central, les primaires au Reichstag et le "journal scientifique", deviendront sans cesse plus pitoyables, mesquins et lâches. Il est clair que nous allons devoir faire face à cet avenir attractif, et nous devons occuper et tenir toutes les positions qui permettent de mettre hors d'action la direction officielle en exerçant le droit de critiquer. (…) Il est donc de notre devoir de tenir le coup et de ne pas faire la faveur aux patrons officiels du parti de plier bagages. Nous devons accepter les luttes et les frictions continuelles, particulièrement quand quelqu'un a attaqué ce saint des saints, le crétinisme parlementaire, aussi fortement que vous l'avez fait. Mais en dépit de tout, ne pas céder un pouce semble être le mot d'ordre juste. La Neue Zeit ne doit pas être livrée tout entière à la sénilité et à la bureaucratie." 70
Le tournant de 1905
Alors que s'ouvrait un nouveau siècle, le fondement sur lequel révisionnistes et réformistes avaient basé leur théorie et leur pratique commençait à s'effriter.
Superficiellement et en dépit de difficultés occasionnelles, la santé de l'économie capitaliste paraissait robuste ; celle-ci poursuivait son expansion irrésistible dans les dernières régions encore inoccupées par les puissances impérialistes, notamment en Afrique et en Chine. L'expansion du capitalisme dans le monde entier avait atteint un stade où les puissances impérialistes ne pouvaient plus étendre leur influence qu'au détriment de leurs rivales. Toutes les grandes puissances se trouvèrent de plus en plus impliquées dans une course aux armements sans précédent, l'Allemagne s'étant en particulier engagée dans un programme de renforcement massif de sa marine de guerre. Bien que peu s'en rendissent compte à l'époque, l'année 1905 marqua un tournant : un conflit entre deux grandes puissances mena à une guerre à grande échelle, et la guerre conduisit au premier surgissement révolutionnaire massif de la classe ouvrière.
La guerre débuta en 1904 entre la Russie et le Japon pour le contrôle de la péninsule coréenne. La Russie subit une défaite humiliante, et les grèves de janvier 1905 furent une réaction directe contre les effets de la guerre. Pour la première fois dans l'histoire, une gigantesque vague de grèves massives secouait un pays tout entier. Le phénomène ne se limitait pas à la Russie. Pas de manière aussi massive, avec des revendications et dans un contexte différents, des mouvements de grève similaires éclatèrent dans une série d'autres pays européens : 1902 en Belgique, 1903 aux Pays-Bas, 1905 dans la région de la Ruhr en Allemagne et aux Pays-Bas. Un certain nombre de grèves sauvages massives eurent également lieu aux États-Unis entre 1900 et 1906 (notamment dans les mines de charbon en Pennsylvanie). En Allemagne, Rosa Luxemburg – à la fois en tant qu'agitateur et journaliste révolutionnaire pour le parti allemand, et comme membre du Comité Central du SDKPiL 71 suivait attentivement les luttes en Russie et en Pologne 72. En décembre 1905, elle estima qu'elle ne pouvait plus rester en Allemagne comme simple observateur et partit pour la Pologne participer directement au mouvement. Fortement impliquée au jour le jour dans le processus de la lutte de classe et l'agitation révolutionnaire, elle fut le témoin direct de la dynamique nouvelle de déploiement de la grève de masse 73. Avec d'autres forces révolutionnaires, elle commença à en tirer les leçons. En même temps que Trotsky écrivait son célèbre livre sur 1905, où il mettait en évidence le rôle des conseils ouvriers, Luxemburg dans son texte, Grève de masse, parti et des syndicats 74 soulignait l'importance historique de la "naissance de la grève de masse" et ses conséquences pour la classe ouvrière au niveau international. Son texte sur la grève de masse fut un premier texte programmatique des courants de gauche dans la 2ème Internationale, visant à tirer les leçons les plus larges et à souligner l'importance d'une action autonome, massive de la classe ouvrière. 75
La théorie de Luxemburg de la grève de masse allait complètement à l'encontre de la vision de la lutte de classe généralement acceptée par le parti et les syndicats. Pour les seconds, la lutte de classe était un peu comme une campagne militaire, dans laquelle la confrontation ne devait être recherchée qu'après que l'armée ait rassemblé une force écrasante, tandis que les dirigeants des syndicats et du parti devaient agir comme un état-major général dirigeant la masse des travailleurs. Tout cela était très éloigné de l'insistance du Luxemburg sur l'auto-activité créatrice des masses, et toute idée selon laquelle les travailleurs eux-mêmes pourraient agir indépendamment de la direction était un anathème pour les dirigeants des syndicats qui, en 1905, furent confrontés pour la première fois à la perspective d'être submergés par une vague massive de luttes autonomes. La réaction de l'aile droite du SPD et de la direction syndicale fut tout simplement d'interdire toute discussion sur la question. Au Congrès des syndicats en mai 1905 à Cologne, elles rejetèrent toute discussion sur la grève de masse comme "répréhensible" 76 et en vinrent à dire que "le Congrès des Syndicats recommande à tous les travailleurs organisés de s'opposer énergiquement à ceci [la propagation de la grève de masse]". Cette attitude annonçait la coopération du SPD et des syndicats avec la classe dirigeante dans la lutte contre la révolution.
La bourgeoisie allemande avait également suivi le mouvement avec attention et voulait avant tout empêcher les travailleurs allemands de "copier l'exemple russe". En raison de son discours sur la grève de masse au Congrès du SPD à Iéna en 1905, Rosa Luxemburg fut accusée "d'incitation à la violence" et condamnée à deux mois de prison. Kautsky, dans le même temps, tentait de minimiser l'importance de la grève de masse, insistant sur le fait qu'elle était avant tout un produit des conditions arriérées de la Russie et ne pouvait être appliquée dans un pays avancé comme l'Allemagne. Il utilisa "le terme 'Méthode russe' comme symbole du manque d'organisation, de primitivisme, de chaos, de sauvagerie" 77. Dans son livre de 1909, Le chemin du pouvoir, Kautsky affirme que "l'action de masse est une stratégie obsolète pour renverser l'ennemi" et il l'oppose à la stratégie de "guerre d'usure" qu'il propose. 78
Le parti de masse contre la grève de masse
Refusant de considérer la grève de masse comme une perspective valable pour la classe ouvrière à travers le monde, Kautsky attaqua la position du Luxemburg comme s'il s'agissait simplement d'une lubie personnelle. Kautsky écrivit à Luxemburg : "Je n'ai pas le temps de vous expliquer les raisons que Marx et Engels, Bebel et Liebknecht ont considéré comme substantielles. En bref, ce que vous voulez est un genre totalement nouveau d'agitation, que nous avons toujours refusé jusqu'à présent. Mais cette nouvelle agitation est d'une nature telle qu'il ne convient pas d'en débattre en public. Si nous publiions l'article, vous agiriez pour votre propre compte, comme une personne individuelle et proclameriez une agitation et une action totalement nouvelles, que le parti a toujours rejetées. Une seule personne, quel que soit son statut, ne peut agir pour son propre compte et créer ainsi un fait accompli, ce qui aurait des conséquences imprévisibles pour le parti." 79
Luxemburg rejeta la tentative de présenter l'analyse et l'importance de la grève de masse comme une "politique personnelle" 80. Bien que les révolutionnaires doivent reconnaître l'existence de conditions différentes dans différents pays, ils doivent avant tout saisir la dynamique globale de l'évolution des conditions de la lutte de classe, en particulier les tendances qui annoncent l'avenir. Kautsky s'opposa à "l'expérience russe" considérée comme expression de l'arriération de la Russie, refusant ainsi indirectement la solidarité internationale et répandant un point de vue empreint de préjugés nationaux, prétendant que les travailleurs en Allemagne avec leurs puissants syndicats étaient plus avancés et leurs méthodes "supérieures"... et cela à un moment où les dirigeants syndicaux combattaient déjà la grève de masse et l'action autonome du prolétariat ! Et quand Luxemburg fut envoyée en prison pour avoir fait la propagande pour la grève de masse, Kautsky et ses partisans ne montrèrent aucun signe d'indignation et ne protestèrent pas.
Luxemburg, qui ne pouvait pas être réduite au silence par ces tentatives de censure, reprocha à la direction du parti de concentrer toute son attention sur la préparation des élections : "Toutes les questions de tactique devraient être étouffées par le délire de joie autour de nos succès électoraux actuels et futurs ? Le Vorwärts croit-il vraiment que l'approfondissement et la réflexion politiques de larges couches du parti pourraient être favorisés par cette atmosphère permanente d'acclamation des futurs succès électoraux un an, peut-être un an et demi avant la tenue des élections et en faisant taire toute autocritique au sein du parti ?" 81
En dehors de Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek était le plus critique de la "stratégie d'usure" de Kautsky. Dans son livre "Différences tactiques dans le mouvement ouvrier" 82 Pannekoek entreprit une critique fondamentale et systématique des "vieux outils" du parlementarisme et de la lutte syndicale. Pannekoek devait aussi être la victime de la censure et de la répression au sein de la Social-Démocratie et de l'appareil syndical et perdit ainsi son emploi à l'école du parti. De plus en plus, aussi bien les articles de Luxemburg que ceux de Pannekoek étaient censurés par la presse du parti. En novembre 1911, pour la première fois, Kautsky refusa de publier un article de Pannekoek dans la Neue Zeit. 83
Ainsi, les grèves de masse de 1905 contraignirent la direction du SPD à montrer son vrai visage et à s'opposer à toute mobilisation de la classe ouvrière qui tentait de reprendre à son compte l'expérience "russe". Bien des années avant le déclenchement de la Guerre, les dirigeants syndicaux étaient devenus un rempart du capitalisme. L'argument consistant à "prendre en compte des conditions différentes de la lutte de classe" était en réalité un prétexte pour rejeter la solidarité internationale, alors que l'aile droite de la social-démocratie essayait de susciter des craintes et même d'attiser le ressentiment national vis-à-vis du "radicalisme russe" ; cela allait constituer une arme idéologique importante dans la guerre qui éclata quelques années plus tard. Après 1905, le centre qui avait été hésitant jusqu'alors, fut progressivement de plus en plus attiré vers la droite. L'incapacité et le refus du centre de soutenir la lutte de la gauche dans le parti voulaient dire que la gauche était plus isolée au sein du parti.
Comme le souligna Luxemburg, "l'effet pratique de l'intervention du camarade Kautsky se réduit donc à cela : il a fourni une couverture théorique à ceux qui, dans le parti et les syndicats, assistent avec un sentiment de malaise à la croissance impétueuse du mouvement de masse, souhaiteraient y mettre un frein et le ramener aussi vite que possible sur le bon vieux chemin commode du train-train parlementaire et syndical. Kautsky a fourni un remède à leurs scrupules de conscience, ceci sous l'égide de Marx et Engels, il leur a en même temps fourni un moyen de briser l'échine d'un mouvement de manifestations qu'il prétendait rendre 'toujours plus puissant'". 84
La menace de guerre et l'Internationale
Le Congrès de l'Internationale à Stuttgart en 1907 tenta de tirer les leçons de la guerre russo-japonaise et de mettre dans la balance le poids de la classe ouvrière organisée contre la menace croissante de guerre. Quelques 60 000 personnes participèrent à une manifestation où les orateurs de plus d'une douzaine de pays mirent en garde contre le danger de guerre. August Bebel proposa une résolution contre le danger de guerre, qui évitait la question du militarisme comme faisant partie intégrante du système capitaliste et ne mentionnait pas la lutte des travailleurs en Russie contre la guerre. Le Parti allemand tenta d'éviter d'être lié par quelque prescription que ce soit quant à son action en cas de guerre, sous la forme d'une grève générale avant tout. Luxemburg, Lénine et Martov proposèrent ensemble un amendement donnant une tournure plus énergique à la résolution : "Au cas où la guerre éclaterait, [les partis socialistes] ont le devoir de s'entremettre pour la faire cesser promptement et d'utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste". 85 Le Congrès de Stuttgart vota à l'unanimité cette résolution, mais par la suite la majorité de la 2ème Internationale ne parvint pas à renforcer son opposition aux préparatifs de guerre croissants. Le Congrès de Stuttgart est entré dans l'histoire comme un exemple de déclarations verbales sans action de la plupart des partis participants 86. Mais ce fut un moment important de coopération entre les courants de l'aile gauche qui, malgré leurs divergences sur beaucoup d'autres questions, prirent une position commune sur la question de la guerre.
En février 1907, Karl Liebknecht publia son livre Militarisme et antimilitarisme avec une attention particulière pour le mouvement international de la jeunesse, dans lequel il dénonçait en particulier le rôle du militarisme allemand. En octobre 1907, il fut condamné à 18 mois de prison pour haute trahison. Au cours de la même année, un dirigeant de l'aile droite du SPD, Noske, déclarait dans un discours prononcé au Reichstag que, dans le cas d'une "guerre de défense", la social-démocratie soutiendrait le gouvernement et "défendrait la patrie avec grande passion... Notre attitude à l'égard de l'armée est déterminée par notre avis sur la question nationale. Nous exigeons l'autonomie de chaque nation. Mais cela signifie que nous insistons également sur la préservation de l'autonomie du peuple allemand. Nous sommes pleinement conscients que c'est notre devoir et notre obligation que de nous assurer que le peuple allemand ne soit pas poussé contre le mur par d'autres peuples" 87. Il s'agissait du même Noske qui, en 1918, devint le "chien sanglant" (suivant ses propres mots) de la répression du SPD dirigée contre les travailleurs.
Brader l'internationalisme pour des succès électoraux
En 1911, l'expédition allemande de la canonnière Panther à Agadir provoqua la seconde crise marocaine avec la France. La direction du SPD avait alors renoncé à toute action antimilitariste afin d'éviter de mettre en péril son succès électoral lors des prochaines élections de 1912. Quand Luxemburg dénonça cette attitude, la direction du SPD l'accusa de trahir les secrets du parti. En août 1911, après beaucoup d'hésitation et de tentatives d'éluder la question, la direction du parti distribua un tract sensé être une protestation contre la politique de l'impérialisme allemand au Maroc. Le tract fut fortement critiqué par Luxemburg dans son article "Notre tract sur le Maroc" 88, ignorant comme elle l'a écrit, que Kautsky en était l'auteur. Kautsky répondit alors par une attaque très personnalisée. Luxemburg riposta : "Kautsky, dit-elle, avait présenté sa critique comme 'un malveillant coup de couteau dans le dos, une perfide attaque contre [Kautsky] en tant que personne.' (…) Le camarade Kautsky aura du mal à douter de mon courage pour faire face ouvertement à une personne, pour critiquer ou me battre contre quelqu'un directement. Je n'ai jamais attaqué personne en embuscade et je rejette fermement l'idée du camarade Kautsky selon laquelle je savais qui avait écrit le tract et que – sans le nommer – je l'avais visé. (…) Mais j'aurais fait attention de ne pas commencer une polémique inutile avec un camarade qui réagit de manière excessive avec un tel déluge de vitupération personnelle, d'amertume et de suspicion contre une critique strictement factuelle, bien que forte, et qui soupçonne une intention personnelle, méchante, une vacherie derrière chaque mot de la critique". 89 Au Congrès du parti de Iéna en septembre 1911, la direction du parti distribua une brochure spéciale contre Rosa Luxemburg, pleine d'attaques contre elle, l'accusant de violation de confidentialité et d'avoir informé le Bureau socialiste international de la 2ème Internationale de la correspondance interne du SPD.
Kautsky déserte la lutte contre la guerre
Bien que dans son livre de 1909, le chemin du pouvoir, Kautsky ait averti que "la guerre mondiale approche dangereusement", en 1911 il prédit que "tout le monde deviendra un patriote" lorsque que la guerre éclatera. Et que si la Social-Démocratie décidait de nager contre le courant, elle serait réduite en miettes par la foule en colère. Il plaçait ses espoirs de paix dans les "pays qui représentent la civilisation européenne" formant des États-Unis d'Europe. Dans le même temps, il commençait à développer sa théorie du "super-impérialisme", faisant reposer cette théorie sur l'idée que le conflit impérialiste n'est pas une conséquence inévitable de l'expansion capitaliste, mais simplement une "politique" que les États capitalistes éclairés pourraient choisir de rejeter. Kautsky pensait déjà que la guerre pourrait reléguer les contradictions de classe à l'arrière-plan et que l'action de masse du prolétariat serait vouée à l'échec, que – comme il dira quand la guerre éclatera - l'Internationale était seulement utile en temps de paix. Cette attitude consistant à être conscient du danger de guerre, mais de s'incliner devant la pression nationaliste dominante et d'esquiver une lutte déterminée, désarmait la classe ouvrière et ouvrait la voie à la trahison des intérêts du prolétariat. Ainsi, d'une part, Kautsky minimisait l'explosivité réelle des tensions impérialistes avec sa théorie du "super-impérialisme" et donc échouait complètement à percevoir la détermination des classes dirigeantes à préparer à la guerre ; et, d'autre part, il cédait à l'idéologie nationaliste du gouvernement (et de plus en plus de l'aile droite du SPD aussi) plutôt que de l'affronter, par crainte pour le succès électoral du SPD. Son épine dorsale, son esprit combatif, avaient disparu.
Alors qu'une dénonciation déterminée de la préparation de la guerre était nécessaire, et que l'aile gauche faisait de son mieux pour organiser des réunions publiques contre la guerre qui attiraient des participants par milliers, la direction du SPD mobilisait jusqu'au bout pour les prochaines élections législatives de 1912. Luxemburg dénonça le silence imposé sur le danger de guerre comme une tentative opportuniste de gagner des sièges au Parlement, sacrifiant l'internationalisme pour d'obtenir plus de voix.
En 1912, la menace pour la paix que représentait la deuxième guerre balkanique conduisit le Bureau socialiste international à organiser d'urgence un Congrès extraordinaire qui se tint en novembre à Bâle, en Suisse, dans le but de mobiliser la classe ouvrière internationale contre le danger imminent de guerre. Luxemburg critiqua le fait que le parti allemand se soit limité à se placer à la queue des syndicats allemands qui avaient organisé quelques manifestations discrètes, faisant valoir que le parti comme organe politique de la classe ouvrière n'avait manifesté qu'un intérêt de pure forme à la dénonciation de la guerre. Alors que quelques partis dans d'autres pays avaient réagi plus vigoureusement, le SPD, le plus grand parti de travailleurs du monde, s'était essentiellement retiré de l'agitation et s'était abstenu de protestations plus mobilisatrices. En fait, le Congrès de Bâle qui, une fois de plus, prit fin avec une grande manifestation et un appel à la paix, masqua en réalité la pourriture et la trahison future d'un grand nombre des partis membres de l'Internationale.
Le 3 juin 1913, la fraction parlementaire du SPD vota en faveur d'une taxe militaire spéciale : 37 députés SPD qui s'opposèrent au vote de cette taxe furent réduits au silence par le principe de la discipline de la fraction parlementaire. La violation ouverte de la devise "pas un seul homme, pas un seul centime" pour le système préparait le vote des crédits de guerre par la fraction parlementaire en août 1914 90. Le déclin moral du parti se révélait également dans la réaction de Bebel. En 1870/71, August Bebel – ainsi que Wilhelm Liebknecht (père de Karl Liebknecht) – s'était distingué par son opposition résolue à la guerre franco-prussienne. Maintenant, quatre décennies plus tard, Bebel fut incapable d'adopter une position résolue contre le danger de guerre. 91
Il devenait de plus en plus évident que, non seulement la droite allait trahir ouvertement, mais aussi que les centristes vacillants avaient perdu tout esprit de combat et échoueraient à s'opposer à la préparation à la guerre d'une manière déterminée. L'attitude défendue par le plus célèbre représentant du "centre", Kautsky, selon lequel le parti devait adapter sa position sur la question de la guerre en fonction des réactions de la population (soumission passive si la majorité du pays se soumettait au nationalisme ou une attitude plus résolue s'il y avait une opposition croissante à la guerre), fut alors justifiée par le risque de "s'isoler soi-même de la plus grande partie du parti". Lorsque, après 1910, le courant autour de Kautsky prétendit être le "centre marxiste", contrairement à la gauche (radicale, extrémiste, non marxiste), Luxemburg étiqueta ce "centre" de représentants de la lâcheté, de la prudence et du conservatisme.
Son abandon de la lutte, son incapacité à s'opposer à la droite et à suivre la gauche dans sa lutte déterminée, participa à désarmer les travailleurs. Ainsi, la trahison d'août 1914 par la direction du parti ne fut pas une surprise ; elle avait été préparée petit à petit dans un processus au coup par coup. Le soutien à l'impérialisme allemand devint tangible lors de plusieurs votes au Parlement à l'appui des crédits de guerre, dans les efforts visant à enrayer les manifestations contre la guerre, dans l'attitude d'ensemble pour prendre parti en faveur de l'impérialisme allemand et l’enchaînement de la classe ouvrière au nationalisme et au patriotisme. Le processus de musellement de l'aile gauche avait été crucial dans l'abandon de l'internationalisme et avait préparé la répression des révolutionnaires en 1919.
L'aveuglement par le nombre et l'intégration graduelle dans l'État
Alors que la direction du SPD avait axé ses activités sur les élections législatives, le parti lui-même était aveuglé par le succès électoral et perdait de vue l'objectif final du mouvement ouvrier. Le parti salua la croissance apparemment sans interruption de ses électeurs, du nombre de ses députés et de celui des lecteurs de la presse du parti. La croissance fut en effet impressionnante : en 1907, le SPD avait 530 000 membres ; en 1913, le chiffre avait plus que doublé à 1,1 million. Le SPD en réalité était le seul parti de masse de la 2ème Internationale et le plus grand parti de n'importe quel parlement européen. Cette croissance numérique donnait l'illusion d'une grande force. Même Lénine fut remarquablement dépourvu de sens critique sur les "chiffres impressionnants" relatifs à l'impact du parti, au nombre de ses électeurs et de ses membres. 92
Bien qu'il soit impossible d'établir une relation mécanique entre l'intransigeance politique et les scores électoraux, les élections de 1907, quand le SPD condamnait encore la répression barbare de l'impérialisme allemand contre les soulèvements des Hereros dans le sud-ouest africain, se soldèrent par un "revers". Le SPD y perdit 38 sièges au Parlement et se retrouva avec 43 sièges "seulement". En dépit du fait que le pourcentage du SPD dans le vote global ait effectivement augmenté, aux yeux de la direction du parti, ce revers électoral signifiait que celui-ci avait été sanctionné par les électeurs et avant tout par les électeurs de la petite bourgeoisie, en raison de sa dénonciation de l'impérialisme allemand. La conclusion qu'elle tirait, c'était que le SPD devait éviter de s'opposer trop fortement à l'impérialisme et au nationalisme, car cela lui coûterait des votes. Au lieu de cela, le parti devait concentrer toutes ses forces sur la campagne pour les prochaines élections, même si cela devait signifier censurer les discussions en son sein et éviter tout ce qui risquait de mettre en péril son score électoral. Lors des élections de 1912, le parti obtint 4,2 millions voix (38,5 % des suffrages exprimés) et remporta 110 sièges. Il était devenu le plus grand parti parlementaire, mais seulement en enterrant l'internationalisme et les principes de la classe ouvrière. Dans les parlements locaux, il avait plus de 11 000 élus. Le SPD comptait 91 journaux et 1,5 millions d'abonnés. Lors des élections de 1912, l'intégration du SPD dans le jeu de la politique parlementaire est allé encore plus loin puisqu'il retira ses candidats dans plusieurs circonscriptions au profit du Parti populaire progressiste (Fortschrittliche Volkspartei), bien que ce parti appuyât inconditionnellement la politique de l'impérialisme allemand. Pendant ce temps, le Sozialistische Monatshefte (en principe une publication indépendante du parti, mais en réalité l'organe théorique des révisionnistes) soutenait ouvertement la politique coloniale de l'Allemagne et les revendications de l'impérialisme allemand pour une redistribution des colonies.
En fait, la mobilisation totale du parti pour les élections législatives alla de pair avec son intégration progressive dans l'appareil d'État. Le vote indirect pour le budget en juillet 1910 93, le renforcement de la coopération avec les partis bourgeois (qui avait jusqu'alors constitué un tabou), le désistement de candidats pour faire élire comme députés des bourgeois du Fortschrittliche Volkspartei, la désignation d'un candidat pour les élections municipales à Stuttgart – telles furent certaines des étapes sur la route de la participation directe du SPD dans l'administration de l'État.
Cette tendance globale à une interconnexion croissante entre les activités parlementaires du SPD et son identification avec l'État fut fustigée par la gauche, en particulier par Anton Pannekoek et Rosa Luxemburg. Pannekoek consacra tout un livre aux Différences tactiques au sein du mouvement ouvrier. Luxemburg, qui était extrêmement attentive à l'effet asphyxiant du parlementarisme, fit pression pour l'initiative et l'action de la base : "L'exécutif le plus idéal d'un parti ne serait en mesure de parvenir à rien, s'enfoncerait involontairement dans l'inefficacité bureaucratique, si la source naturelle d'énergie, la volonté du parti, ne se faisaient pas sentir, si la pensée critique, l'initiative de la masse des membres du parti étaient en sommeil. En fait, c'est plus que cela. Si sa propre énergie, la vie intellectuelle indépendante de la masse du parti, n'est pas assez active, alors les autorités centrales ont la tendance assez naturelle non seulement à rouiller bureaucratiquement mais également à se faire une idée totalement fausse de leur propre autorité et de leur position de force à l'égard du parti. Le plus récent décret dit "secret" de l'exécutif concernant le personnel éditorial du parti peut servir de preuve récente, une tentative de prendre des décisions pour la presse du parti, qu'on ne peut que rejeter de la façon la plus sévère. Toutefois, ici aussi, il est nécessaire de préciser : contre l'inefficacité et les illusions excessives du pouvoir des autorités centrales du mouvement ouvrier, il n'y a pas d'autre chemin que sa propre initiative, sa propre pensée et la vie politique fraîche, palpitante de la large masse du parti." 94
En fait, Luxemburg insistait constamment sur la nécessité pour la masse des membres du parti de se "réveiller" et d'assumer leur responsabilité contre la direction du parti dégénérescente. "Les grandes masses [du parti] doivent s'activer selon leur propre voie, elles doivent être en mesure de développer leur propre énergie de masse, leur propre conduite, elles doivent devenir actives en tant que masses, agir, montrer et développer de la passion, du courage et de la détermination." 95
"Chaque pas en avant dans la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière doit en même temps signifier une indépendance intellectuelle croissante de la masse des ouvriers, la croissance de sa propre activité, l'autodétermination et l'initiative (...) C'est d'une importance vitale pour le développement normal de la vie politique dans le parti, pour garder éveillées et actives la pensée politique et la volonté de la masse du parti. Nous avons, bien sûr, la Conférence annuelle du parti, la plus haute instance qui fixe régulièrement la volonté de tout le parti. Toutefois, il est évident que les conférences des partis ne peuvent que donner de grandes lignes de la tactique pour la lutte social-démocrate. L'application de ces lignes directrices à la pratique exige une pensée infatigable et de l'initiative (...) Vouloir qu'un cadre du parti soit responsable de la tâche énorme de vigilance quotidienne et d'initiative politiques sur une organisation de presque 1 million de membres attendant passivement d'être commandée, c'est la chose la plus incorrecte qui soit du point de vue de la lutte de classe prolétarienne. C'est sans doute cette répréhensible "obéissance aveugle" que, assurément, nos opportunistes veulent voir dans la subordination qui va de soi à toutes les décisions du parti dans son ensemble". 96
La "discipline de fraction" étrangle la responsabilité individuelle
Le 4 Août 1914, la fraction parlementaire du SPD vota à l'unanimité les crédits de guerre. La direction du parti et de la fraction parlementaire avaient exigé la "discipline de fraction". La censure (censure de l'État ou autocensure ?) et la fausse unité du parti suivaient leur propre logique, tout le contraire de la responsabilité individuelle. Le processus de dégénérescence signifiait que la capacité de pensée critique et d'opposition à la fausse unité du parti avait été éliminée. Les valeurs morales du parti furent sacrifiées sur l'autel du capital. Au nom de la discipline du parti, celui-ci exigeait l'abandon de l'internationalisme prolétarien. Karl Liebknecht, dont le père avait osé rejeter le soutien aux crédits de guerre en 1870, cédait maintenant aux pressions du Parti. Ce n'est que quelques semaines plus tard, après un premier regroupement de camarades restés fidèles à l'internationalisme, qu'il osa exprimer ouvertement son rejet de la mobilisation pour la guerre par la direction du SPD. Mais le vote des crédits de guerre par le SPD allemand déclencha une avalanche de soumission au nationalisme dans d'autres pays européens. Avec la trahison du SPD, la 2ème Internationale signa son arrêt de mort et se désintégra.
La montée du courant opportuniste et révisionniste, qui était apparu le plus clairement dans le plus grand parti de la 2ème Internationale, et qui avait abandonné l'objectif du renversement de la société capitaliste, signifiait que la vie prolétarienne, la combativité et l'indignation morale avaient disparu du SPD, ou au moins dans les rangs de sa direction et de sa bureaucratie. En même temps, ce processus fut indissociablement lié à la dégénérescence programmatique du SPD, visible dans son refus d'adopter les nouvelles armes de la lutte des classes, la grève de masse et l'auto-organisation des travailleurs, et l'abandon progressif de l'internationalisme. Le processus de dégénérescence de la social-démocratie allemande, qui n'était pas un phénomène isolé dans la 2ème Internationale, conduisit à sa trahison en 1914. Pour la première fois, une organisation politique des travailleurs n'avait pas seulement trahi les intérêts de la classe ouvrière, elle était devenue l'une des armes les plus efficaces entre les mains de la classe capitaliste. La classe dirigeante en Allemagne pouvait désormais compter sur l'autorité du SPD, et la fidélité qu'il avait inspirée dans la classe ouvrière, pour déclencher une guerre et écraser la révolte contre la guerre de la part des travailleurs. Les leçons de la dégénérescence de la Social-démocratie restent donc d'une importance cruciale pour les révolutionnaires d'aujourd'hui.
Heinrich / Jens
1 . Avec 38,5 % des suffrages exprimés, le SPD avait 110 sièges au Reichstag.
2 . Karl Kautsky est né à Prague en 1854. Son père était chef décorateur et sa mère actrice et écrivaine. La famille s'est installée à Vienne quand Kautsky avait 7 ans. Il a étudié à l'Université de Vienne et rejoint le parti socialiste autrichien (SPÖ) en 1875. A partir de 1880, depuis Zürich, il a contribué à introduire la littérature socialiste en Allemagne.
3 . August Bebel est né en 1840, dans ce qui est maintenant une banlieue de Cologne. Orphelin à 13 ans, il est entré en apprentissage chez un charpentier et, jeune homme, il a beaucoup voyagé en Allemagne. Il rencontra Wilhelm Liebknecht en 1865, et fut immédiatement impressionné par l'expérience internationale de celui-ci ; dans son autobiographie, Bebel se souvient s'être exclamé : "C'est un homme dont vous pouvez apprendre quelque chose" ("Donnerwetter, von dem kann man das lernen", Bebel, Aus Meinen Leben, Berlin 1946, cité dans James Joll, La Deuxième Internationale). Avec Liebknecht, Bebel est devenu l'un des leaders de premier plan de la social-démocratie allemande dans ses premières années.
4 . Ceci est particulièrement visible dans le livre de Lénine, Un pas en avant Deux pas en arrière, concernant la crise du POSDR en 1903. Parlant des futurs Mencheviks, il s'exprime en ces termes : "L’esprit de cercle et le défaut de maturité politique frappant, qui ne peut supporter le vent frais d'un débat public, apparaît ici en toute netteté (…) Imaginez un instant qu’une pareille absurdité, qu'une querelle comme la plainte une "fausse accusation d'opportunisme" ait pu se produire dans le parti allemand ! L'organisation et la discipline prolétariennes ont depuis longtemps fait oublier là-bas cette veulerie d'intellectuels (…). Seul l'esprit de cercle le plus routinier, avec sa logique : un coup de poing dans la mâchoire, ou bien la main à baiser, s'il vous plaît, a pu soulever cette crise d'hystérie, cette vaine querelle et cette scission du Parti autour d'une "fausse accusation d'opportunisme" contre la majorité du groupe Libération du Travail". (Chapitre J, "Ceux qui ont souffert d’être faussement accusés d’opportunisme" - https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1904/05/vil19040500.htm [39])
5 . Rosa Luxemburg, La crise de la Social-Démocratie (encore connue sous le nom de Brochure de Junius).
6 . Rosa Luxemburg. Ibid.
7 . L'organe de presse central du SPD.
8 . Également connu comme Parti eisenachien, du nom de sa ville de fondation, Eisenach.
9 . Première Adresse du Conseil Général de l'AIT sur la guerre franco-allemande.
https ://www.marxists.org/francais/ait/1870/07/km18700723.htm [40]
10 . Une tendance similaire a survécu dans le socialisme français à travers la nostalgie pour le programme des "ateliers nationaux" qui avait suivi le mouvement révolutionnaire de 1848.
11 . Cf. Toni Offerman, dans Between reform and revolution : German socialism and communism from 1840 to 1990, Berghahn Books, 1998, p. 96.
12 . Elle est aujourd'hui connue sous le titre de Critique du Programme de Gotha.
13 . Lettre d'envoi de Karl Marx à W. Bracke, le 5 mai 1875. Dans Critique du Programme de Gotha.
14 . Engels, Sur le Programme de Gotha. Lettre à August Bebel. Mars 1875.
15 . Cité dans Aspects of international socialism 1871-1914 (Aspect du socialisme international 1871-1914). Cambridge University Press & Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Notre traduction.
16 . Le vote au Parlement des crédits de guerre a donc constitué une claire violation des statuts et des décisions du congrès du SPD, comme Rosa Luxemburg l'a souligné.
17 . Engels, Critique du projet de programme social-démocrate de 1891. II - Revendications politiques.
18 . Même si l'autocratie russe était plus extrême, il ne faut pas oublier que l'équivalent russe du Reichstag, la Douma d’État, n'a été appelée que sous la pression du mouvement révolutionnaire de 1905.
19 . Voir la biographie remarquable de Rosa Luxemburg par JP Nettl, p. 81 (édition Schocken brochée de l'édition abrégée Oxford University Press de 1969, avec un essai introductif par Hannah Arendt). Tout au long de cet article, les citations proviennent de l'abrégé ou de l'éditions intégrale.
20 . Il est significatif que, tandis que le parti tolérait le réformisme de l'aile droite, le cercle des "Jungen" ("jeunes"), qui avait violemment critiqué l'évolution vers le parlementarisme, ait été expulsé du parti lors du Congrès d'Erfurt. Il est vrai que ce groupe était essentiellement une opposition intellectuelle et littéraire avec des tendances anarchistes (un certain nombre de ses membres a d'ailleurs dérivé vers l'anarchisme, après avoir quitté le SPD). Il est tout de même significatif que le parti ait réagi beaucoup plus durement face à une critique de la gauche que face à la pratique opportuniste de la droite.
21 . Cf. Jacques Droz, Histoire générale du socialisme, p. 41, Éditions Quadrige/PUF, 1974.
22 . Lettre à Kautsky, 1896, citée par Droz, op. cit., p. 42
23 . Le révisionnisme de Bernstein n'était en aucun cas une exception isolée. En France, le socialiste Millerand rejoignait le gouvernement Waldeck-Rousseau, aux côtés du général Gallifet, le bourreau de la Commune de Paris ; une tendance similaire existait en Belgique ; le mouvement travailliste britannique était complètement dominé par le réformisme et un syndicalisme nationaliste borné.
24 . "La question coloniale (...) est une question de propagation de la culture et, tant qu'il existe de grandes différences culturelles, il s'agit de la propagation, ou plutôt de l'affirmation, de la culture supérieure. Parce que tôt ou tard, il arrivera inévitablement que les cultures supérieures et inférieures entrent en collision et, en ce qui concerne cette collision, cette lutte pour l'existence entre les cultures, la politique coloniale des peuples cultivés doit être évaluée comme un processus historique. Le fait que généralement d'autres buts soient poursuivis avec d'autres moyens et des formes que nous sociaux-démocrates, nous condamnons, peut nous conduire dans des cas particuliers à les rejeter et à lutter contre, mais cela ne peut pas constituer une raison pour que nous changions notre jugement quant à la nécessité historique de la colonisation". (Bernstein, 1907, cité dans Discovering Imperialism, 2012, Haymarket Books, p. 41)
25 . Cf. Nettl, op. cit., p. 101.
26 . Parvus, également connu sous le nom de Alexander Helphand, était une figure étrange et controversée dans le mouvement révolutionnaire. Après quelques années à la gauche de la social-démocratie en Allemagne, puis en Russie pendant la révolution de 1905, il s'installe en Turquie où il créa une société de négoce en armements, s'enrichissant grâce à la guerre des Balkans et, en même temps, mettant en place, en tant que conseiller financier et politique, le mouvement nationaliste "Jeunes Turcs" et éditant la publication nationaliste Yurdu Turk. Pendant la guerre, Parvus devint un partisan ouvert de l'impérialisme allemand, au désespoir de Trotsky qui avait été fortement influencé par ses idées sur la "révolution permanente" (Cf. Deutscher, Le prophète armé, "La guerre et l'Internationale")
27 . Cité dans Nettl, op. cit., p. 133.
28 . Parteitag der Sozialdemokratie, Oktober 1898 in Stuttgart, Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke (Ges. Werke), T. 1/1 p, 241. Notre traduction.
29 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 1/1, p. 565, 29 septembre1899. Notre traduction.
30 . Rosa Luxemburg, 1899, Ges. Werke, T. 1/1, p. 578, 9.-14. Oktober. Notre traduction.
31 . August Bebel, Dresden, 13 septembre 1903, cité par Luxemburg After the Jena Party congress, Ges. Werke, T. 1/1, p. 351. Notre traduction.
32 . "Unser leitendes Zentralorgan", Leipziger Volkszeitung, 22 septembre 1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, T. 1/1, p. 558. Traduit en français par nos soins.
33 . De plus, Bernstein "avait commencé par abandonner le but final pour le mouvement. Mais comme il ne peut y avoir en pratique de mouvement socialiste sans but socialiste, il est obligé de renoncer au mouvement lui-même" (Réforme sociale ou révolution ? Chapitre 4 : L'effondrement.)
34 . "Je suis très reconnaissante pour l'information qui m'aide à mieux comprendre les orientations du parti. Bien sûr, il était clair pour moi que Bernstein et les idées qu'il a présentées jusqu'à maintenant n'étaient plus en ligne avec notre programme, mais il est douloureux que nous ne puissions plus du tout compter sur lui. Mais si vous et le camarade Kautsky aviez cette évaluation, je suis surprise que vous n'ayez pas mis à profit l'atmosphère favorable du Congrès pour lancer immédiatement un débat énergique, mais que vous ayez voulu encourager Bernstein à écrire une brochure, ce qui ne fera que retarder encore plus la discussion". Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 210, lettre à Bebel, 31 octobre 1898. Notre traduction.
35 . Rosa Luxemburg. Ges. Briefe, Bd 1, p. 289, lettre à Leo Jogiches, 11 mars 1899. Notre traduction.
36 . Kautsky à Bernstein, 29 juillet 1899, IISG-Kautsky-Nachlass, C. 227, C. 230, cité dans Till Schelz-Brandenburg, Eduard Bernstein und Karl Kautsky, Entstehung und Wandlung des sozialdemokratischen Parteimarxismus im Spiegel ihrer Korrespondenz 1879 bis 1932, Köln, 1992. Notre traduction.
37 . Rosa Luxemburg, “Parteifragen im Vorwärts”, Ges. Werke, T. 1/1, p. 564, 29 septembre 1899.
38 . Laschitza, Im Lebensrausch, Trotz Alledem, p. 104, 27 octobre 1898, Kautsky-Nachlass C 209 : Kautsky an Bernstein. Notre traduction.
39 . Karl Kautsky à Victor Adler, 20 juillet 1905, in Victor Adler Briefwechsel, a.a.O. S. 463, quoted by Till Schelz-Brandenburg, p. 338). Notre traduction.
40 . Rosa Luxemburg – Ges. Werke, T. 1/1, p. 528, quoting “Kautsky zum Parteitag in Hannover”, Neue Zeit 18, Stuttgart 1899-1900, 1. Bd. S. 12). Notre traduction.
41 . Rosa Luxemburg, "Liberté de la critique et de la science".
https ://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1899/rl189909.htm [41]
42 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 1, p. 279, lettre à Leo Jogiches, 3 mars 1899. Notre traduction.
43 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 1, p. 426, Lettre à Leo Jogiches, 21 décembre 1899. Notre traduction.
44 . Luxemburg mit un point d'honneur à apporter son soutien total, en tant qu'agitateur (elle était une oratrice publique très demandée) même aux membres du parti qu'elle critiquait le plus fortement, par exemple pendant la campagne électorale du révisionniste Max Schippel.
45 . Rosa Luxemburg Ges. Briefe, T. 1, p. 491, Lettre à Leo Jogiches, 7 juillet 1890. Notre traduction.
46 . Rosa Luxemburg, Erklärung, Ges. Werke, T. 1/2 , p. 146, 1er octobre 1901
47 . Lors du Congrès de Lübeck, la Neue Zeit et Kautsky en tant que rédacteur en chef avaient été fortement attaqués par les opportunistes en raison de la controverse sur le révisionnisme.
48 . JP Nettl, Rosa Luxemburg, Vol 1, p. 192 (cette citation est tirée de l'édition intégrale), Rosa Luxemburg, lettre à Kautsky, 3 octobre 1901. Notre traduction.
49 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 1,. P. 565, Lettre à Jogiches, 12 janvier 1902. Notre traduction.
50 . Cité in Nettl, op.cit., p127. Traduit en français par nos soins.
51 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 3, p. 358, Lettre à Kostja Zetkin, 27 juin 1908. Notre traduction.
52 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, T. 3, p. 57, Lettre à Kostja Zetkin, 1er août 1909. Notre traduction.
53 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 1/1, p. 239, p. 245, - Parteitag der Sozialdemokratie 1898 in Stuttgart, Oktober 1898
54 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke BDI 1/1, S. 255, Nachbetrachtungen zum Parteitag 12-14. Oktober 1898, Sächsische Arbeiter-Zeitung Dresden. Notre traduction.
55 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 279, Lettre à Leo Jogiches, 3 mars 1899. Notre traduction.
56 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe Bd 1, p. 384, Lettre à Leo Jogiches, 24 septembre 1899. Notre traduction.
57 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 322, lettre à Jogiches, 1 mai 1899. Notre traduction.
58 . Kautsky à Bernstein, 29 octobre 1898, IISG, Amsterdam, Kautsky-Nicholas, C 210. Notre traduction.
59 . Laschitza, Ibid, p. 129, (Ignatz Auer dans une lettre à Bernstein). Notre traduction. Dans son Histoire générale du socialisme, Jacques Droz décrit Auer de la manière suivante : "C'est un 'praticien', un 'réformiste' de la pratique qui se fait gloire de ne rien connaître aux doctrines, mais nationaliste au point d'exalter devant les auditoires socialistes l'annexion de l'Alsace-Lorraine et de s'opposer à la reconstitution de la Pologne, et cynique jusqu'à nier l'autorité de l'Internationale ; en fait, il couvre l'orientation des Sozialistische Monatshefte et favorise activement le développement du réformisme." (p. 41)
60 . Laschitza, ibid, p. 130. Notre traduction.
61 . Laschitza, ibid, p. 136, in Sächsische Arbeiterzeitung, 29 novembre 1899. Notre traduction.
62 . Rosa Luxemburg fut très tôt consciente de l'hostilité à son égard. Lors du Congrès du parti de Hanovre en 1899, la direction ne voulait pas lui laisser prendre la parole sur la question des douanes. Elle décrivit son attitude dans une lettre à Jogiches : "Nous ferions mieux de régler cela dans le parti, c'est-à-dire dans le clan. Voilà comment les choses fonctionnent avec eux : si la maison brûle, ils ont besoin d'un bouc-émissaire (un juif), si l'incendie a été éteint, le juif est chassé ". (Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 317, lettre à Leo Jogiches, 27 avril 1899). Victor Adler écrit à Bebel en 1910 qu'il avait "suffisamment de bas instincts pour prendre un certain plaisir à ce que Karl [Kautsky] souffre entre les mains de ses amis. Mais c'est vraiment dommage– la chienne toxique va encore faire beaucoup de dégâts, d'autant plus qu'elle est aussi intelligente qu'un singe tandis que d'autre part son sens des responsabilités est totalement absent et sa seule motivation est un désir presque pervers d’auto-justification". (Nettl, 1, p. 432, version intégrale, Victor Adler à Bebel, 5 août 1910). Notre traduction.
63 . Le journal satirique hebdomadaire Simplicissimus a même publié un poème méchant dirigé contre Luxemburg (Laschitza, 136, Simplicissimus, 4. Jahrgang, Nr. 33, 1899/1900, S. 263)
64 . Frölich, Paul, “Gedanke und Tat”, Rosa Luxemburg, Dietz-Verlag Berlin, 1990, p. 62
65 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe Bd 1, S. 316, lettre à Leo Jogiches, 27 avril 1899. Notre traduction.
66 . Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 3 S. 89, lettre à Clara Zetkin, 29 septembre 1909. Notre traduction.
67 . Rosa Luxemburg Ges. Briefe, Bd 3, p. 268, lettre à Kostja Zetkin, 30 novembre 1910. Notre traduction. Ces lignes furent provoquées par la réaction philistine de la direction du parti à un article qu'elle avait écrit sur Tolstoï, qui avait été considéré à la fois comme hors de propos (les disciplines artistiques n'étaient pas importantes) et peu souhaitable dans la presse du parti parce qu'il faisait l'éloge d'un artiste qui était russe et mystique.
68 . Étant donné que le parti avait un grand nombre de journaux, la plupart n'étaient pas sous le contrôle direct de la direction de Berlin. La publication d'articles du courant de gauche dépendait souvent de l'attitude du Comité de rédaction local. L'aile gauche avait la plus grande audience à Leipzig, Stuttgart, Brême et Dortmund.
69 . Nettl 1, p. 421 (édition intégrale). Notre traduction.
70 . Nettl, I, p. 464 (édition intégrale). Notre traduction.
71 . Social-Démocratie du royaume de Pologne et de Lituanie. Le parti a été fondé en 1893 comme social-démocratie du Royaume de Pologne (SDKP), ses membres les plus connus étant Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Julian Marchlewski et Adolf Warszawski. Il est devenu le SDKPiL suite à la fusion avec le Syndicat des travailleurs en Lituanie dirigé par Feliks Dzerzhinski, entre autres. Une de ses plus importantes caractéristiques distinctives était son internationalisme inébranlable, sa conviction que l'indépendance nationale polonaise n'était pas dans l' intérêt des travailleurs et que le mouvement ouvrier polonais devrait au contraire s'allier étroitement avec la social-démocratie russe et les bolcheviks en particulier. Cela constituait en permanence un motif de désaccord avec le parti socialiste polonais (PPS - Polska Partia Socjalistyczna) qui adopta une orientation de plus en plus nationaliste sous la direction de Josef Pilsudski, lequel devint plus tard (de façon similaire à Mussolini) dictateur de la Pologne.
72 . La Pologne, il convient de le rappeler, n'existait pas comme un pays séparé. La plus grande partie de la Pologne historique faisait partie de l'empire des tsars, tandis que les autres parties avaient été absorbées par l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois.
73 . Elle a été arrêtée en mars 1906, avec Leo Jogiches qui était aussi rentré en Pologne. Il y avait de sérieuses craintes pour sa sécurité, le SDKPiL faisant savoir qu'il prendrait des représailles physiques contre des agents du gouvernement s'ils la touchaient. Un mélange de subterfuge et d'aide de sa famille permit de la faire sortir des geôles tsaristes, d'où elle est revenue en Allemagne. Jogiches fut condamné à huit ans de travaux forcés mais réussit à s'évader de prison.
74 . Le texte intégral peut être trouvé sur marxists.org
75 . Voir la série d'articles sur 1905 dans les numéros 120, 122, 123 et 125 de la Revue Internationale.
76 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 2, p. 347
77 . Rosa Luxemburg, “Das Offiziösentum der Theorie”, Ges. Werke, T. 3, p. 307, article published in Neue Zeit, 1912. Notre traduction.
78 . Le débat entre Kautsky, Luxemburg et Pannekoek a été publié en français sous le titre Socialisme, la voie occidentale, Presses Universitaires de France, Paris, 1983.
79 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 2, p. 380, “Theorie und die Praxis”, publié dans la Neue Zeit, 28. Jg, 1909/1910, en réponse à l'article de Kautsky “Was nun ?”. Notre traduction.
80 . Rosa Luxemburg, “Die Theorie und Praxis”, Ges. Werke, T. 2, p. 398.
81 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, S. 441 “Die totgeschwiegene Wahlrechtsdebatte” (“Le débat caché sur les droits électoraux”) 17 août 1910. Notre traduction.
82 . Publié en anglais sous le titre Théorie marxiste et tactiques révolutionnaires.
83 . À l'époque, une autre voix majeure de la gauche en Hollande, Herman Gorter, écrivait à Kautsky. "Des divergences tactiques entraînent souvent une brouille entre amis. Dans mon cas, alors que ma relation avec vous est concernée, ce n'est pas vrai ; comme vous l'avez remarqué. Même si vous avez souvent critiqué Pannekoek et Rosa, avec lesquels je suis d'accord en général (et vous m'avez donc également critiqué) j'ai toujours maintenu le même genre de relation avec vous." Gorter. lettre à Kautsky. Déc. 1914. Kautsky Archive IISG, DXI 283, cité dans Herman Gorter, Herman de Liagre Böhl, Nijmegen, 1973, p. 105). "Par admiration et affections anciennes, nous nous sommes toujours abstenus, autant que possible, de nous battre contre vous dans La Tribune." (De Tribune était la publication de la Gauche hollandaise à cette époque)
84 . Dans "Socialisme, la voie occidentale", p. 123.
85 . Nettl, I, p. 401 (édition intégrale). Notre traduction.
86 . Une faiblesse majeure des déclarations les plus combatives a été l'idée d'une action simultanée. Ainsi, la jeune garde socialiste belge adopta une résolution : "C'est le devoir des partis socialistes et des syndicats de tous les pays de s'opposer à la guerre. Le moyen le plus efficace de cette opposition est la grève générale et l'insubordination en réponse à la mobilisation de guerre." (Le danger de guerre et la 2ème Internationale, J. Jemnitz, p. 17). Mais ces moyens ne pouvaient être utilisés que s'ils étaient adoptés simultanément dans tous les pays, en d'autres termes l'internationalisme intransigeant et l'action antimilitariste étaient subordonnés à la nécessité que tout le monde partage la même position.
87 . Fricke, Dieter, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1869 bis 1917 ; Dietz-Verlag, Berlin, 1987, p. 120. Notre traduction.
88 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 34, publié dans le Leipziger Volkszeitung, 26 août 1911. Notre traduction.
89 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 43, publié dans le Leipziger Volkszeitung, 30 août 1911. Notre traduction.
90 . Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 11
91 . "Je suis dans une situation absolument absurde – je dois assumer la responsabilité de me condamner au silence bien que, si je suivais mes propres désirs je me retournerais contre la direction, me condamnant ainsi." (Jemnitz, p. 73, Lettre de Bebel à Kautsky). Bebel meurt d'une crise cardiaque dans un sanatorium en Suisse, le 13 août.
92 . Dans un article intitulé "Comment V. Zassoulitch anéantit le courant liquidateur", il écrivait : "On compte actuellement en Allemagne environ 1 million de membres du parti. Les électeurs sociaux-démocrates y sont au nombre approximatif de 4,25 millions, et les prolétaires de 15 millions (…) Le million, c'est le parti. Ce million adhère aux organisations du parti ; les 4,25 millions, c'est la 'large couche'. Il met en évidence que "En Allemagne, par exemple, c'est 1/15 environ de la classe qui est organisée dans le parti ; en France, c'est environ 1/140 ; en Allemagne, pour un membre du parti on compte 4 à 5 Sociaux-démocrates de la "couche large" ; en France, 14." Lénine ajoute : "Le parti est la couche consciente et avancée de la classe, il en est l'avant-garde. La force de cette avant-garde est supérieure de dix fois, de cent fois, et davantage à son importance numérique. (…) L'organisation décuple les forces" (septembre 1913, Œuvres complètes, Tome 19. Éditions sociales.)
93 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 2, p. 378
94 . Rosa Luxemburg, "De nouveau sur les masses et les leaders", août 1911, publié initialement dans le Leipziger Volkszeitung. Notre traduction.
95 . Rosa Luxemburg, Ges. Werke, T. 3, p. 253, "Taktische Fragen", Juin 1913. Notre traduction.
96 . "De nouveau sur les masses et les leaders", op. cit. Notre traduction.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Guerre [38]
Rubrique:
Revue Internationale n°153 - août 2014
- 1418 lectures
Conférence internationale extraordinaire du CCI: la "nouvelle" de notre disparition est grandement exagérée!
- 2814 lectures
En mai dernier, le CCI a tenu une conférence internationale extraordinaire. Une crise s'était développée depuis un certain temps dont l'épicentre s'est situé dans notre plus vieille section, la section en France. La convocation d'une conférence extraordinaire, en plus des congrès internationaux réguliers du CCI, a été jugée nécessaire face au besoin vital de comprendre pleinement la nature de cette crise et de développer les moyens de la surmonter. Le CCI a déjà convoqué des conférences internationales extraordinaires dans le passé, en 1982 et en 2002, en accord avec nos Statuts qui prévoient leur tenue lorsque les principes fondamentaux du CCI sont dangereusement mis en question. 1
Toutes les sections internationales du CCI ont envoyé des délégations à cette troisième Conférence extraordinaire et ont participé très activement aux débats. Les sections qui n'ont pu s'y rendre (du fait de la forteresse Schengen) ont adressé à la Conférence des prises de positions sur les différents rapports et résolutions soumis à la discussion.
Les crises ne sont pas nécessairement mortelles
Nos contacts et sympathisants peuvent être alarmés par cette nouvelle ; de même les ennemis du CCI auront certainement un frisson de jubilation. Certains d'entre eux sont déjà convaincus que cette crise est notre crise "ultime" et le signe annonciateur de notre disparition. Mais ce genre de prédictions avait déjà été fait lors de précédentes crises de notre organisation. Au lendemain de la crise de 1981-82 – il y a 32 ans – nous avions répondu à nos détracteurs, comme nous le faisons aujourd'hui, en rappelant ces mots de Mark Twain : "La nouvelle de notre mort est grandement exagérée !"
Les crises ne sont pas nécessairement le signe d'un effondrement ou d'un échec imminent ou irrémédiable. Au contraire, l'existence de crises peut être l'expression d'une saine résistance à un processus sous-jacent qui s'était paisiblement et insidieusement développé jusque-là et qui, laissé à son libre cours, risquait de mener au naufrage. Ainsi, les crises peuvent être le signe d'une réaction face au danger et de la lutte contre de graves faiblesses conduisant à l'effondrement. Une crise peut aussi être salutaire. Elle peut constituer un moment crucial, une opportunité d'aller à la racine de graves difficultés, d'en identifier les causes profondes pour pouvoir les surmonter. Ce qui permettra, en fin de compte, à l'organisation de se renforcer et de tremper ses militants pour les batailles à venir.
Dans la Deuxième Internationale (1889-1914), le Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR) était connu pour avoir traversé une série de crises et de scissions et, pour cette raison, était considéré avec mépris par les partis plus importants de l'Internationale, comme le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) qui semblait voler de succès en succès et dont le nombre de membres ainsi que les résultats électoraux s'amplifiaient régulièrement. Cependant, les crises du parti russe et la lutte pour surmonter ces crises et en tirer les leçons menée par l'aile bolchevique, ont renforcé la minorité révolutionnaire et l'ont préparée à se dresser contre la guerre impérialiste en 1914 et à se porter à l'avant-garde de la révolution d'octobre en 1917. En revanche, l'unité de façade et le "calme" au sein du SPD (qui n'étaient remis en question que par des troublions comme Rosa Luxemburg) a conduit ce parti à s'écrouler complètement et irrévocablement en 1914 avec la trahison totale de ses principes internationalistes face à la Première Guerre mondiale.
En 1982, le CCI a identifié sa propre crise (provoquée par un développement de confusions gauchistes et activistes qui avait permis à l'élément Chénier 2 de faire des dégâts considérables dans notre section en Grande-Bretagne) et en a tiré des leçons pour rétablir plus profondément ses principes concernant sa fonction et son fonctionnement (voir la Revue internationale n° 29 : "Rapport sur la fonction de l'organisation révolutionnaire" et la Revue n° 33 : "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation révolutionnaire"). C'est d'ailleurs à l'issue de cette crise que le CCI a adopté ses Statuts actuels.
Le Parti Communiste International "bordiguiste" (Programme communiste) qui était à l'époque le groupe le plus important de la Gauche communiste a connu, de façon plus grave encore, des difficultés similaires, mais ce groupe n'a pas été en mesure d'en tirer les leçons et a fini par s'effondrer comme un château de cartes avec la perte de la presque totalité de ses sections et de ses membres (Voir la Revue internationale n°32 : "Convulsions dans le milieu révolutionnaire").
En plus d'identifier ses propres crises, le CCI s'est appuyé sur un autre principe enseigné par l'expérience bolchevique : faire connaître les circonstances et les leçons de ses crises internes afin de contribuer à la clarification la plus large (contrairement aux autres groupes révolutionnaires qui cachent au prolétariat l'existence de leurs crises internes). Nous sommes convaincus que les combats pour surmonter les crises internes des organisations révolutionnaires permettent de faire ressortir plus clairement des vérités et des principes généraux concernant la lutte pour le communisme.
Dans la Préface de Un pas en avant, deux pas en arrière, en 1904, Lénine écrivait : "[Nos adversaires] exultent et grimacent à la vue de nos discussions : évidemment, ils s'efforceront, pour les faire servir à leurs fins, de brandir tels passages de ma brochure consacrée aux défauts et aux lacunes de notre Parti. Les social‑démocrates russes sont déjà suffisamment rompus aux batailles pour ne pas se laisser troubler par ces coups d'épingle, pour poursuivre, en dépit de tout, leur travail d'autocritique et continuer à dévoiler sans ménagement leurs propres lacunes qui seront comblées nécessairement et sans faute par la croissance du mouvement ouvrier. Que messieurs nos adversaires essaient donc de nous offrir, de la situation véritable de leurs propres "partis", une image qui ressemblerait même de loin à celle que présentent les procès-verbaux de notre Deuxième Congrès ! 3
A l'instar de Lénine, nous pensons que malgré le plaisir superficiel que nos ennemis éprouvent face à nos difficultés (en les interprétant avec leurs propres lunettes déformantes), les révolutionnaires authentiques apprendront de leurs erreurs et en ressortiront renforcés.
C'est pourquoi nous publions ici, même brièvement, une présentation de l'évolution de cette crise dans le CCI et du rôle qu'a joué notre Conférence extraordinaire pour y faire face.
La nature de la crise actuelle du CCI
L'épicentre de la crise actuelle du CCI a été l'existence au sein de sa section en France de la résurgence d'une campagne de dénigrement, dissimulée à l'ensemble de l'organisation, d'une camarade qui a été diabolisée (à tel point qu'un militant considérait même que sa présence dans l'organisation constituait une entrave au développement de celle-ci). Évidemment, l'existence d'une telle pratique de stigmatisation d'un bouc-émissaire – censé porter la responsabilité de tous les problèmes rencontrés par l'ensemble de l'organisation – est absolument intolérable dans une organisation communiste qui se doit de rejeter le harcèlement endémique existant dans la société capitaliste et résultant de la morale bourgeoise du chacun pour soi et Dieu pour tous. Les difficultés de l'organisation sont de la responsabilité de toute l'organisation. La campagne dissimulée d'ostracisme envers un membre de l'organisation met en question le principe même de solidarité communiste sur lequel le CCI est fondé.
Nous ne pouvions nous contenter de mettre un terme à cette campagne une fois qu'elle était apparue au grand jour suite à sa mise en évidence par l'organe central du CCI.
Ce n'était pas le genre de fait qu'on pouvait balayer comme quelque chose de simplement malencontreux. Il nous fallait aller à la racine et expliquer pourquoi et comment un tel fléau, une remise en cause si flagrante d'un des principes communistes fondamentaux, avait pu se développer de nouveau dans nos rangs. La tâche de la Conférence extraordinaire était de dégager un accord commun sur cette explication et de développer des perspectives pour éradiquer de telles pratiques dans l'avenir.
L'une des tâches de la Conférence extraordinaire était d'entendre et de se prononcer sur le rapport final du Jury d'Honneur qui avait été demandé début 2013 par la camarade diffamée à son insu. Il ne suffisait pas que chacun soit d'accord sur le fait que des calomnies et des méthodes de stigmatisation aient été employées contre la camarade ; il fallait le prouver dans les faits. Il fallait examiner de façon minutieuse la totalité des accusations portées contre cette camarade et identifier leur origine. Les allégations et les dénigrements devaient être dévoilés à l'ensemble de l'organisation afin d'éliminer toute ambiguïté et d'empêcher toute répétition des calomnies à l'avenir. Après un an de travail, le Jury d'Honneur (composé de militants de quatre sections du CCI) a réfuté systématiquement, comme dénuées de tout fondement, toutes les accusations (et particulièrement certaines calomnies honteuses développées par un militant). 4 Le Jury a pu mettre en évidence que cette campagne d'ostracisme était, en réalité, fondée sur l'infiltration dans l'organisation de préjugés obscurantistes véhiculés par l'esprit de cercle (et par une certaine "culture du ragot" héritée du passé et dont certains militants ne s'étaient pas encore débarrassés). En dédiant des forces à ce Jury, le CCI mettait en application une autre leçon du mouvement révolutionnaire : tout militant faisant l'objet de soupçons, d'accusations non fondées ou de calomnies a le devoir de faire appel à un Jury d'Honneur. Refuser de faire cette démarche conduit à reconnaître implicitement la validité des accusations.
Le Jury d'Honneur est un moyen aussi de "préserver la santé morale des organisation révolutionnaires" (comme l'affirmait Victor Serge) 5 puisque la méfiance entre ses membres est un poison qui peut rapidement détruire une organisation révolutionnaire.
C'est d'ailleurs quelque chose de bien connu par la police qui, comme le révèle l'histoire du mouvement ouvrier, a utilisé de façon privilégiée la méthode consistant à entretenir ou provoquer la méfiance pour tenter de détruire de l'intérieur les organisations révolutionnaires. On l'a vu, notamment dans les années 1930 avec les agissements de la Guépéou de Staline contre le mouvement trotskiste, en France et ailleurs. En fait, cibler des militants pour les soumettre à des campagnes de dénigrement et à la calomnie a constitué une arme de premier plan de l'ensemble de la bourgeoisie pour fomenter la méfiance envers le mouvement révolutionnaire et en son sein.
C'est pourquoi les marxistes révolutionnaires ont toujours dédié tous leurs efforts pour démasquer de telles attaques contre les organisations communistes.
À l'époque des procès de Moscou dans les années 1930, Léon Trotski en exil a demandé un Jury d'Honneur (connu sous le nom de Commission Dewey) pour réfuter les calomnies répugnantes portées contre lui par le procureur Vychinski dans ces procès. 6 Marx a interrompu ses travaux sur Le Capital pendant un an, en 1860, pour préparer un livre entier de réfutation systématique des calomnies portées contre lui par Herr Vogt.
En même temps qu'étaient menés les travaux du Jury d'Honneur, l'organisation a cherché les racines profondes de la crise en s'armant d'un cadre théorique. Après la crise du CCI de 2001-2002, nous avions déjà engagé un effort théorique prolongé pour comprendre comment avait pu apparaître au sein de l'organisation une prétendue fraction qui s'était distinguée par des comportements de voyous et de mouchards : circulation secrète de rumeurs accusant une de nos militantes d'être un agent de l'État, vol de l'argent et du matériel de l'organisation (notamment le fichier d'adresses de nos militants et de nos abonnés), chantage, menaces de mort à l'égard d'un de nos militants, publication vers l'extérieur d'informations internes favorisant délibérément le travail de la police, etc. Cette ignoble fraction aux mœurs politiques de gangsters (rappelant celles de la tendance Chénier lors de notre crise de 1981) est connue sous le nom de FICCI (Fraction interne du CCI).7
À la suite de cette expérience, le CCI a commencé à examiner sous un angle historique et théorique le problème de la morale. Dans les Revue internationale n°111 et 112, nous avons publié le "Texte d'orientation sur la confiance et la solidarité dans la lutte du prolétariat", et dans les Revue n°127 et 128 a été publié un autre texte sur "Marxisme et éthique". En lien avec ces réflexions théoriques, notre organisation a mené une recherche historique sur le phénomène social du pogromisme – cette antithèse totale des valeurs communistes qui était au cœur de la mentalité de la FICCI dans ses basses œuvres en vue de détruire le CCI. C'est sur la base de ces premiers textes et du travail théorique sur des aspects de la morale communiste que l'organisation a élaboré sa compréhension des causes profondes de la crise actuelle. La superficialité, les dérives opportunistes et "ouvriéristes", le manque de réflexion et de discussions théoriques au profit de l'intervention activiste et gauchisante dans les luttes immédiates, l'impatience et la tendance à perdre de vue notre activité sur le long terme, ont favorisé cette crise au sein du CCI. Cette crise a donc été identifiée comme une crise "intellectuelle et morale" et a été accompagnée par une perte de vue et une transgression des Statuts du CCI. 8
Le combat pour la défense des principes moraux du marxisme
La Conférence extraordinaire est revenue plus en profondeur sur une compréhension marxiste de la morale dans le but de préparer le cœur théorique de notre activité dans la période à venir. Nous allons poursuivre notre débat interne et explorer cette question comme principal outil de notre régénérescence face à la crise actuelle. Sans théorie révolutionnaire, il ne peut y avoir d'organisation révolutionnaire.
Contenue dans le projet communiste et inséparable de lui se trouve une dimension éthique. Et c'est cette dimension qui est particulièrement menacée par la société capitaliste qui a prospéré sur l'exploitation et la violence, "suant le sang et la boue par tous les pores", comme l'écrivait Marx dans Le Capital. Cette menace s'est particulièrement développée dans la période de décadence du capitalisme où, progressivement, la bourgeoisie a abandonné même ses propres principes moraux qu'elle défendait dans sa période libérale d'expansion du capitalisme. La phase finale de la décadence capitaliste – la période de décomposition sociale – dont l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 a constitué la première grande manifestation – accentue encore plus ce processus. Aujourd'hui, la société bourgeoise est de plus en plus ouvertement, fièrement même, barbare. Nous le voyons dans tous les aspects de la vie sociale : la prolifération des guerres et la bestialité des méthodes utilisées dont le principal objectif semble être d'humilier et de dégrader les victimes avant de les massacrer ; l'accroissement du gangstérisme – et sa célébration au cinéma et dans la musique ; le développement des pogroms à la recherche de boucs-émissaires désignés comme responsables des crimes du capitalisme et de la souffrance sociale ; la montée de la xénophobie envers les immigrés et du harcèlement sur les lieux de travail (le "mobbing") ; le développement de la violence à l'égard des femmes, du harcèlement sexuel et de la misogynie (y compris dans les écoles et parmi les bandes de jeunes des cités ouvrières). Le cynisme, les mensonges et l'hypocrisie ne sont plus considérés comme répréhensibles mais sont enseignés dans les écoles de "management". Les valeurs les plus élémentaires de toute vie sociale –sans parler des valeurs de la société communiste – sont profanées au fur et à mesure que le capitalisme se putréfie.
Les membres des organisations révolutionnaires ne peuvent échapper à l'influence de cet environnement social de pensée et de comportement barbares. Ils ne sont pas immunisés contre cette atmosphère délétère de la décomposition de la société bourgeoise, en particulier quand la classe ouvrière, comme c'est encore le cas aujourd'hui, reste relativement passive et désorientée et, de ce fait, incapable d'offrir une alternative de masse à l'agonie prolongée de la société capitaliste. D'autres couches de la société, pourtant proches du prolétariat dans leurs conditions de vie, constituent un vecteur actif de cette putréfaction. L'impuissance et la frustration traditionnelles de la petite bourgeoisie – cette couche intermédiaire sans avenir historique se situant entre le prolétariat et la bourgeoisie – augmentent de façon démesurée et trouvent une issue dans les comportements pogromistes, dans l'obscurantisme et la "chasse aux sorcières", qui lui procurent la lâche illusion d' "accéder au pouvoir" en pourchassant et persécutant des individus ou des minorités (ethniques, religieuses, etc.) stigmatisés comme "fauteurs de troubles".
Il était particulièrement nécessaire de revenir sur le problème de la morale à la Conférence extraordinaire de 2014. En effet, le caractère explosif de la crise de 2001-2002, les agissements répugnants de la FICCI, les comportements d'aventuriers nihilistes de certains de ses membres, avaient tendu à obscurcir, au sein du CCI, les incompréhensions sous-jacentes plus profondes qui avaient fourni le terreau de la mentalité pogromiste à l'origine de la constitution de cette prétendue "fraction". 9 Du fait de la brutalité de la secousse provoquée par les agissements ignobles de la FICCI il y a une décennie, il a existé par la suite une forte tendance dans le CCI à vouloir revenir à la normale – à chercher un illusoire moment de répit. Il s'est développé un état d'esprit tendant à se détourner d'une démarche théorique et historique envers les questions organisationnelles au bénéfice d'une focalisation sur des questions plus pratiques d'intervention immédiate dans la classe ouvrière et d'une construction régulière mais superficielle de l'organisation. Bien qu'un effort considérable ait été dédié au travail de réflexion théorique en vue du dépassement de la crise de 2001, ce travail était de plus en plus vu comme une question annexe, secondaire, et non comme une question cruciale, de vie et de mort, pour l'avenir de l'organisation révolutionnaire.
La lente et difficile reprise de la lutte de classe en 2003 et la plus grande réceptivité du milieu politique à la discussion avec la Gauche communiste ont tendu à renforcer cette faiblesse. Certaines parties de l'organisation ont commencé à oublier les principes et les acquis organisationnels du CCI et à développer un dédain pour la théorie. Les Statuts de l'organisation qui contiennent les principes de centralisation internationaliste ont tendu à être ignorés au profit des habitudes du philistinisme local et de cercle, du bon sens commun et de la "religion de la vie quotidienne" (comme le disait Marx dans le livre 1 du Capital). L'opportunisme a commencé à se répandre, de façon insidieuse.
Cependant, il y eut une résistance à cette tendance au désintérêt pour les questions théoriques, à l'amnésie politique et à la sclérose. Une camarade en particulier a critiqué ouvertement cette dérive opportuniste et a été, de ce fait, considérée de plus en plus comme "semeur de trouble" et un obstacle au fonctionnement normal, routinier de l'organisation. Au lieu de présenter une réponse politique cohérente aux critiques et arguments de la camarade, l'opportunisme s'est exprimé par de la diffamation personnelle sournoise. D'autres militants (notamment dans les sections du CCI en France et en Allemagne) qui partageaient le point de vue de la camarade contre ces dérives opportunistes, ont été également les "victimes collatérales" de cette campagne de diffamation.
Ainsi, la Conférence extraordinaire a mis en évidence qu'aujourd'hui, comme dans l'histoire du mouvement ouvrier, les campagnes de dénigrement et l'opportunisme vont main dans la main. En fait, les premières apparaissent dans le mouvement ouvrier comme une expression extrême du second. Rosa Luxemburg qui, comme porte-parole de la gauche marxiste, était impitoyable dans ses dénonciations de l'opportunisme, fut systématiquement diffamée par les dirigeants et bureaucrates de la social-démocratie allemande. La dégénérescence du Parti bolchevique et de la Troisième Internationale fut accompagnée par la calomnie et la persécution sans fin de la vieille garde bolchevique, et en particulier de Léon Trotski.
L'organisation se devait donc de revenir au concept classique d'opportunisme organisationnel dans l'histoire du mouvement ouvrier qui inclut les leçons de la propre expérience du CCI.
La nécessité de mener le combat contre l'opportunisme (et son expression conciliatrice sous la forme du centrisme) a constitué un axe central des travaux de la Conférence extraordinaire : la crise du CCI requérait une lutte prolongée contre les racines des problèmes qui avaient été identifiées et qui se trouvent dans une certaine tendance à rechercher un cocon au sein du CCI, à transformer l'organisation en "club d'opinions" et à s'installer dans la société bourgeoise en décomposition. En fait, la nature même du militantisme révolutionnaire est le combat permanent contre le poids de l'idéologie dominante et de toutes les idéologies étrangères au prolétariat qui s'infiltrent insidieusement au sein des organisations révolutionnaires. C'est ce combat qui doit être la norme de la vie interne de l'organisation communiste et de chacun de ses membres.
La lutte contre tout accord superficiel, l'effort individuel de chaque militant pour exprimer ses positions politiques face à l'ensemble de l'organisation, la nécessité de développer ses divergences avec des arguments politiques sérieux et cohérents, la force d'accepter les critiques politiques – telles sont les insistances mises en avant par la Conférence extraordinaire. Comme le souligne la Résolution d'Activités qui a été adoptée à la Conférence : "6d) Le militant révolutionnaire doit être un combattant, pour les positions de classe du prolétariat et pour ses propres idées. Ceci n'est pas une condition optionnelle du militantisme, c'est le militantisme. Sans cela, il ne peut pas y avoir de lutte pour la vérité, qui ne peut apparaître qu'à partir de la confrontation des idées et du fait que chaque militant se lève pour défendre son point de vue. L'organisation a besoin de connaître les positions de tous les camarades, l'accord passif est inutile et contre-productif (…) Prendre sa responsabilité individuelle, être honnête est un aspect fondamental de la morale prolétarienne."
La crise actuelle n'est pas la crise "ultime" du CCI
A la veille de la Conférence extraordinaire, la publication sur Internet d'un "Appel au Camp prolétarien et aux militants du CCI" annonçant "la crise ultime" du CCI a pleinement souligné l'importance de cet esprit de combat pour la défense de l'organisation communiste et de ses principes, en particulier face à tous ceux qui cherchent à la détruire. Cet "appel" particulièrement nauséabond émane d'un soi-disant "Groupe International de la Gauche Communiste" (GIGC), en réalité un déguisement de l'infâme ex-FICCI grâce à son mariage avec des éléments de Klabastalo de Montréal. C'est un texte transpirant la haine et l'appel au pogrom contre certains de nos camarades. Ce texte annonce de façon tapageuse que ce "GIGC" est en possession de documents internes du CCI. Son intention est claire : tenter de saboter notre Conférence extraordinaire, de semer le trouble et la zizanie au sein du CCI en répandant la suspicion généralisée dans nos rangs juste à la veille de cette Conférence internationale (en faisant passer le message : il y a un traître dans le CCI, un complice du "GIGC" qui lui communique nos bulletins internes 10).
La Conférence extraordinaire a pris immédiatement position sur cet "Appel" du GIGC : aux yeux de tous les militants, il a été clair que l'ex-FICCI est en train de faire encore une fois (et de façon encore plus pernicieuse) le travail de la police à la manière que Victor Serge décrit de façon si éloquente dans son livre Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression (rédigé sur la base des archives de la police tsariste découvertes après la révolution d'Octobre 1917). 11
Mais au lieu de monter les militants du CCI les uns contre les autres, le dégoût unanime engendré par les méthodes du "GIGC", dignes de la police politique de Staline et de la Stasi, a servi à mettre en lumière les plus grands enjeux de notre crise interne et a tendu à renforcer l'unité des militants derrière le mot d'ordre du mouvement ouvrier : "Tous pour un et un pour tous !" (rappelé dans le livre de Joseph Dietzgen, que Marx appelait le "philosophe du prolétariat", "L'essence du travail intellectuel humain"). Cette attaque policière du GIGC (ex-FICCI) a fait prendre conscience de façon encore plus claire à tous les militants que les faiblesses internes de l'organisation, le manque de vigilance face à la pression permanente de l'idéologie dominante au sein des organisations révolutionnaires, l'avait rendue vulnérable aux machinations de ses ennemis dont les intentions destructrices sont indubitables.
La Conférence extraordinaire a salué le travail extrêmement sérieux et gigantesque du Jury d'Honneur. Elle a salué également le courage de la camarade qui en a fait la demande et qui avait été ostracisée pour ses divergences politiques 12. Car seuls les lâches et ceux qui se savent coupables refusent de faire la clarté devant ce type de commission qui est un héritage légué par le mouvement ouvrier. Le nuage suspendu au-dessus de l'organisation a été dissipé. Et il était temps.
La Conférence extraordinaire ne pouvait mettre un terme à la lutte du CCI contre cette crise "intellectuelle et morale" – cette lutte continue nécessairement – mais elle a doté l'organisation d'une orientation sans ambiguïté : l'ouverture d'un débat théorique interne sur les "Thèses sur la morale" proposées par l'organe central du CCI. Bien évidemment, nous répercuterons ultérieurement dans notre presse les éventuelles positions divergentes lorsque notre débat aura atteint un niveau suffisant de maturité.
Certains de nos lecteurs penseront peut-être que la polarisation du CCI sur sa crise interne et sur le combat contre les attaques de type policier dont nous sommes la cible, est l'expression d'une "folie narcissique" ou d'un "délire paranoïaque collectif". Le souci de la défense intransigeante de nos principes organisationnels, programmatiques et éthiques serait, selon ce point de vue, une diversion par rapport à la tâche immédiate, pratique et "de bon sens" de développer le plus possible notre influence dans les luttes immédiates de la classe ouvrière. Ce point de vue ne fait que répéter, sur le fond mais dans un contexte différent, l'argument des opportunistes sur le fonctionnement sans à-coups du Parti social-démocrate allemand contre le Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie secoué par les crises au cours de la période ayant précédé la Première Guerre mondiale. La démarche consistant à escamoter les divergences, à refuser la confrontation des arguments politiques, pour "préserver l'unité", et ceci à n'importe quel prix, ne fait que préparer la disparition, tôt ou tard, des minorités révolutionnaires organisées.
La défense des principes communistes fondamentaux, aussi éloignée qu'elle puisse sembler des besoins et de la conscience actuels de la classe ouvrière, est, néanmoins, la tâche première des minorités révolutionnaires. Notre détermination à engager un combat permanent pour la défense de la morale communiste – qui est au cœur du principe de la solidarité – est une clé pour préserver notre organisation face aux miasmes de la décomposition sociale capitaliste qui s'infiltrent inévitablement au sein de toutes les organisations révolutionnaires. Seul l'armement politique, le renforcement de notre travail d'élaboration théorique, peut nous permettre de faire face à ce danger mortel. De plus, sans la défense implacable de l'éthique de la classe porteuse du communisme, la possibilité que le développement de la lutte de classe mène à la révolution et à la construction future d'une véritable communauté mondiale unifiée, serait continuellement étouffée.
Une chose est apparue clairement à la Conférence extraordinaire de 2014 : il n'y aura pas de retour à la normale dans les activités internes et externes du CCI.
Contrairement à ce qui était advenu lors de la crise de 2001, nous pouvons déjà nous réjouir que les camarades qui ont été embarqués dans une logique de stigmatisation irrationnelle d'un bouc émissaire aient pris conscience de la gravité de leur dérive. Ces militants ont décidé librement de rester loyaux au CCI et à ses principes et sont aujourd'hui engagés dans notre combat de consolidation de l'organisation. Comme l'ensemble du CCI, ils sont désormais impliqués dans le travail de réflexion et d'approfondissement théorique qui avait été largement sous-estimé par le passé. En s'appropriant la formule de Spinoza "ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas désespérer mais comprendre", le CCI s'est attelé à la tâche de réappropriation de cette idée fondamentale du marxisme : la lutte du prolétariat pour la construction du communisme n'a pas seulement une dimension "économique" (comme se l'imaginent les matérialistes vulgaires) mais également et fondamentalement une dimension "intellectuelle et morale" (comme le mettaient en avant, notamment, Lénine et Rosa Luxemburg).
Nous sommes donc au regret d'apprendre à nos détracteurs de tous bords qu'il n'y a, au sein du CCI, aucune perspective immédiate d'une nouvelle scission parasitaire, comme cela fut le cas lors de nos crises précédentes. Il n'y a aucune perspective de constitution d'une nouvelle "fraction" susceptible de rejoindre l'"Appel" au pogrom du GIGC contre nos propres camarades ("Appel" frénétiquement relayé par différents "réseaux sociaux" et un dénommé Pierre "Hempel", qui se prend pour le représentant du "prolétariat universel"). Bien au contraire : les méthodes policières du GIGC (sponsorisé par une tendance "critique" au sein d'un parti réformiste bourgeois, le NPA ! 13) n'ont fait que renforcer l'indignation générale des militants du CCI et leur détermination à mener le combat pour le renforcement de l'organisation.
La "nouvelle" de notre disparition est donc grandement exagérée et prématurée !
Courant Communiste International
1 �Comme lors de la conférence extraordinaire de 2002 (voir notre article de la Revue Internationale n° 110 "Conférence extraordinaire du CCI : Le combat pour la défense des principes organisationnels" [https://fr.internationalism.org/french/rint/110_conference.html] [45]), celle de 2014 s'est tenue en remplacement partiel du congrès régulier de notre section en France. Ainsi certaines séances ont été consacrées à la conférence internationale extraordinaire et d'autres au congrès de la section en France dont notre journal Révolution Internationale rendra compte ultérieurement.
2 Chénier était un membre de la section en France qui a été exclu durant l'été 1981 pour avoir mené une campagne secrète de dénigrements des organes centraux de l'organisation, de certains de ses militants les plus expérimentés et visant à dresser les militants les uns contre les autres, des agissements qui rappelaient étrangement ceux des agents du Guépéou au sein du mouvement trotskiste au cours des années 1930. Quelques mois après son exclusion, Chénier a pris des fonctions de responsabilité au sein de l'appareil du Parti Socialiste alors au gouvernement.
4 Parallèlement à cette campagne, s'était développés aussi, dans des discussions informelles au sein de la section en France, des ragots colportés par certains militants de la "vieille" génération dénigrant de façon scandaleuse notre camarade Marc Chirik, membre fondateur du CCI et sans lequel notre organisation n'existerait pas. Ces ragots ont été identifiés comme une manifestation du poids de l'esprit de cercle et de l'influence de la petite bourgeoisie décomposée qui avait profondément marqué la génération issue du mouvement estudiantin de Mai 68 (avec toutes ses idéologies anarcho-moderniste et gauchisantes).
5 Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression
6 �Le Jury d'Honneur du CCI s'est appuyé sur la méthode scientifique d'investigation et de vérification des faits de la Commission Dewey. L'ensemble de ses travaux (documents, procès-verbaux, enregistrements d'entretiens et de témoignages, etc.) est précieusement conservé dans les archives du CCI.
7 Voir notamment à ce sujet nos articles XVe Congrès du CCI, Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période [47] dans la Revue internationale n° 114 (https://fr.internationalism.org/french/rint/114_xv_congress.html [47]), Les méthodes policières de la FICCI dans Révolution internationale n° 330 (https://fr.internationalism.org/ri330/ficci.html [48]) et Calomnie et mouchardage, les deux mamelles de la politique de la FICCI envers le CCI (https://fr.internationalism.org/icconline/2006_ficci [49])
8 L'organe central du CCI (de même que le Jury d'Honneur) a clairement démontré que ce n'est pas la camarade ostracisée qui n'avait pas respecté les Statuts du CCI, mais au contraire les militants qui se sont engagés dans cette campagne de dénigrement.
9 �Les résistances dans nos rangs à développer un débat sur la question de la morale trouvent leur origine dans une faiblesse congénitale du CCI (et qui affecte, en réalité, l'ensemble des groupes de la Gauche communiste) : la première génération de militants rejetaient majoritairement cette question qui n'a pas pu être intégrée à nos Statuts, comme le souhaitait notre camarade Marc Chirik. La morale était vécue par ces jeunes militants de l'époque comme un carcan, un "produit de l'idéologie bourgeoise", à tel point que certains d'entre eux, issus du milieu libertaire, revendiquaient de vivre "sans tabou" ! Ce qui révélait une ignorance affligeante de l'histoire de l'espèce humaine et du développement de sa civilisation.
10 Voir notre "Communiqué à nos lecteurs : Le CCI attaqué par une nouvelle officine de l'État bourgeois" [https://fr.internationalism.org/icconline/201405/9079/communique-a-nos-l... [50].
11 Comme pour confirmer la nature de classe de cette attaque, un certain Pierre Hempel a publié sur son blog d'autres documents internes que l'ex-FICCI lui avait remis. Il a même froidement et publiquement affirmé sur son blog :,"Si la police m'avait fait parvenir un tel docu[ment], je l'en aurais remerciée au nom du prolétariat." ! La "sainte alliance" des ennemis du CCI (constituée, pour une bonne part, par une "amicale d'anciens combattants du CCI" recyclés) sait très bien à quel camp elle appartient !
12 Ce qui avait déjà été le cas au début de la crise de 2001 : lorsque cette même camarade a émis un désaccord politique avec un texte rédigé par un membre du Secrétariat International du CCI (sur la question de la centralisation), ce fut une levée de bouclier de la part de la majorité de ses membres qui, au lieu d'ouvrir un débat pour répondre aux arguments politique de la camarade, ont étouffé ce débat et ont engagé une campagne de calomnie contre elle, dans des réunions secrètes et en colportant des rumeurs dans les section en France et au Mexique, suivant lesquelles cette camarade, du fait de ses désaccords politiques avec des membres de l'organe central du CCI, était une "fouteuse de merde" et même un "flic", selon les dires des deux éléments de l'ex-FICCI (Juan et Jonas) qui sont à l'origine de la fondation du "GIGC".
13 �Il faut constater qu'à ce jour, le "GIGC" n'a toujours pas donné d'explication sur ses relations et convergences avec cette tendance qui milite au sein du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) d'Olivier Besancenot. Qui ne dit mot consent !
Vie du CCI:
Rubrique:
Les guerres de l'été 2014 illustrent l'avancée de la désintégration du système
- 1043 lectures
Durant l'été 2014, alors que la classe dirigeante nous régalait avec les "commémorations" bruyantes de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, l'intensification des conflits militaires a encore une fois confirmé ce que les révolutionnaires avaient déjà compris en 1914 : la civilisation capitaliste est devenue un obstacle au progrès, une menace pour la survie même de l'humanité. Dans la Brochure de Junius, écrite de prison en 1915, Rosa Luxemburg avertissait que si la classe ouvrière ne renversait pas ce système, celui-ci entrainerait nécessairement l'humanité dans une spirale de plus en plus destructrice de guerres impérialistes. L'histoire des 20e et 21e siècles a tragiquement vérifié cette prédiction et, aujourd'hui, après un siècle de déclin du capitalisme, la guerre est de plus en plus omniprésente, plus chaotique et irrationnelle que jamais. Nous avons atteint un stade avancé de la désintégration du système, une phase qui peut être décrite comme la décomposition du capitalisme.
Tous les grands conflits de l'été illustrent les caractéristiques de cette phase :
- La "guerre civile" en Syrie a réduit en ruines une grande partie du pays, détruisant la vie économique et le travail accumulé par les cultures passées, tandis que l'opposition au régime Assad était de plus en plus dominée par les djihadistes de "l'État islamique", dont le sectarisme brutal va au-delà de ce qui était imaginable, même avec Al-Qaïda ;
- Initialement soutenu par les États-Unis contre le régime d'Assad, lui-même soutenu par la Russie, "l'État islamique" a maintenant clairement échappé au contrôle de ses anciens partisans avec, pour résultat, la propagation à l'Irak de la guerre en Syrie, menaçant le pays de désintégration et obligeant les États-Unis à intervenir par des frappes aériennes contre la progression des forces islamiques, et à armer les Kurdes, bien que cette option comporte à son tour le risque de créer une nouvelle entité kurde qui serait un facteur supplémentaire de déstabilisation de toute la région ;
- En Israël / Palestine, une nouvelle campagne de bombardements israéliens, encore plus meurtrière, a fait 2 000 tués, des civils en majorité, sans aucune perspective réelle de faire cesser les tirs de roquettes du Hamas et du Jihad islamique ;
- En Ukraine, le nombre de morts a également augmenté, après le bombardement de zones résidentielles par le gouvernement de Kiev, tandis que la Russie est de plus en plus entraînée dans le conflit avec son soutien à peine déguisé aux "rebelles" pro-russes. En retour, ce conflit a visiblement aiguisé les tensions entre la Russie et les puissances occidentales.
Toutes ces guerres expriment la marche du capitalisme vers la destruction. Elles ne constitueront pas la base d'un nouvel ordre mondial ou d'une phase de prospérité comme après la Seconde Guerre mondiale. Elles sont, comme Rosa Luxemburg l'a écrit à propos de la Première Guerre mondiale, l'expression la plus concrète de la barbarie. Dans le même temps, elles ont un coût terrible pour la classe exploitée, la seule force qui peut stopper la chute dans la barbarie et affirmer la seule alternative possible : le communisme. À nouveau dans la Brochure de Junius, Rosa Luxemburg s'exprime en ces termes : "La guerre est un meurtre méthodique, organisé, gigantesque. En vue d'un meurtre systématique, chez des hommes normalement constitués, il faut cependant d'abord produire une ivresse appropriée. C'est depuis toujours la méthode habituelle des belligérants. La bestialité des pensées et des sentiments doit correspondre à la bestialité de la pratique, elle doit la préparer et l'accompagner".
En Israël, le cri de "Mort aux Arabes" est scandé contre les manifestants pacifistes ; à Paris, des manifestations "antisionistes" y font écho avec le slogan "Mort aux Juifs" ; en Ukraine, les forces pro et anti-gouvernementales sont mues par le nationalisme le plus enragé ; en Irak, les djihadistes menacent les chrétiens et les Yézidis, leur laissant le choix entre la conversion à l'islam ou la mort. Cette ivresse de guerre, cette atmosphère de pogrom, sont une atteinte à la conscience du prolétariat et, dans les zones de conflit, le livrent pieds et poings liés à ses exploiteurs et à leurs mobilisations guerrières.
Ces éléments, ces dangers pour l'unité et la santé morale de notre classe, nécessitent une réflexion approfondie et nous reviendrons sur cette question dans de prochains articles qui analyseront plus en profondeur les conflits impérialistes actuels et l'état de la lutte de classe. En attendant, nous renvoyons le lecteur à notre site Internet et à notre presse territoriale pour les articles sur les affrontements impérialistes actuels.
(15/08/2014)
Sur la nature et la fonction du parti politique du prolétariat (Internationalisme n° 38 – octobre 1948)
- 1521 lectures
Introduction du CCI
Le document que nous publions ci-dessous est paru pour la première fois en 1948 dans les pages d’Internationalisme, la presse du petit groupe Gauche Communiste de France, dont le CCI se réclame depuis sa formation en 1975. Il a été reproduit, au début des années 1970, dans le Bulletin d’études et de discussion publié par le groupe français Révolution internationale qui allait par la suite devenir la section en France du nouveau Courant Communiste International. Le Bulletin était lui-même le précurseur de l’organe théorique du CCI, la Revue internationale, et son but était d’ancrer plus solidement le nouveau groupe RI - et ses très jeunes militants - à travers une réflexion théorique et une meilleure connaissance de l’histoire du mouvement ouvrier, y compris l’histoire de ses confrontations avec les nouvelles questions théoriques posées par l’histoire. 1
Le principal objet de ce texte est d’examiner les conditions historiques qui déterminent la formation et l’activité des organisations révolutionnaires. L’idée même de “détermination” est fondamentale. Bien que la création et le maintien d’une organisation révolutionnaire soient le fruit d’une volonté militante cherchant à être facteur actif de l’histoire, la forme que cette volonté se donne n’existe pas indépendamment de la réalité sociale et surtout indépendamment du niveau de combativité et de conscience dans les larges masses de la classe ouvrière. La conception selon laquelle la création d’un parti de classe ne dépend que de la “volonté” des militants était celle du trotskisme dans les années 1930 mais aussi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du nouveau Partito Comunista Internazionalista, le précurseur des multiples groupes bordiguistes et de l’actuelle Tendance Communiste Internationale (ex-BIPR). L’article d’Internationalisme souligne, à juste raison selon nous, qu’il s’agit ici de deux conceptions fondamentalement différentes de l’organisation politique : l’une volontariste et idéaliste, l’autre matérialiste et marxiste. Au mieux, la conception volontariste ne pouvait mener qu’à un opportunisme congénital - comme ce fut le cas pour le PCInt et ses descendants ; au pire à la conciliation avec l’ennemi de classe et au passage dans le camp de la bourgeoisie.
L’importance de la réflexion théorique et historique sur cette question, pour la jeune génération de l’après-68, est évidente. Elle devait préserver le CCI (même si elle ne l’a pas immunisé, loin s’en faut) des pires effets de l’activisme effréné et de l’impatience typiques de cette période, et qui ont mené tant de groupes et de militants vers le néant politique.
Ce texte reste, nous en sommes profondément convaincus, tout autant d’actualité aujourd’hui pour une nouvelle génération de militants et, plus particulièrement, dans son insistance sur ce fait que la classe ouvrière n’est pas une simple catégorie sociologique mais une classe avec un rôle spécifique à jouer dans l’histoire : celui de renverser le capitalisme et d’édifier la société communiste 2. Le rôle des révolutionnaires dépend aussi des périodes historiques : lorsque la situation de la classe ouvrière fait qu’il lui est impossible d’influer sur le cours des évènements, le rôle des révolutionnaires n’est pas d’ignorer cette réalité et de s'illusionner sur le fait que leur intervention immédiate pourrait changer le cours des évènements, mais de s’atteler à une tâche bien moins spectaculaire, celle de préparer les conditions théoriques et politiques pour l’intervention déterminante dans les luttes de classes du futur.
Introduction d’Internationalisme
Notre groupe s’est donné comme tâche le réexamen des grands problèmes que pose la nécessité de reconstituer un nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire. Il devait considérer 1’évolution de la société capitaliste vers le capitalisme d’État, et ce qui subsiste de 1ancien mouvement ouvrier, servant depuis un certain temps, d’appui à la classe capitaliste peur entraîner le prolétariat derrière elle, il devait aussi examiner ce qui, dans cet ancien mouvement ouvrier, sert de matériel à cette classe dans ce but, et comment. Puis nous avons été amenés à reconsidérer ce qui, dans le mouvement ouvrier, restait acquis et ce qui était dépassé depuis le Manifeste Communiste.
Enfin, il était normal que nous tendions à étudier les problèmes posés par la révolution et par le socialisme. C’est dans ce but que nous avons présenté une étude sur l’État après la révolution et que nous présentons aujourd’hui à la discussion une étude sur le problème du parti révolutionnaire du prolétariat.
Cette question est, rappelons-le, une des questions les plus importantes du mouvement ouvrier révolutionnaire. C’est elle qui opposa Marx et les marxistes aux anarchistes, à certaines tendances socialistes-démocratiques et ensuite, aux tendances syndicalistes-révolutionnaires. Elle est au centre des préoccupations de Marx qui a gardé surtout une attitude critique à l’égard des différents organismes qui se sont nommés partis “ouvriers”, “socialistes”, Internationales et autres. Marx, quoique participant activement, dans des moments donnés, à la vie de certains de ces organismes, ne les considéra jamais que comme des groupes politiques au sein desquels, selon la phrase du Manifeste, les communistes peuvent se manifester comme “avant-garde du prolétariat”. Le but des communistes était de pousser plus loin 1’action de ces organismes et de garder en leur sein toute possibilité de critique et d’organisation autonome. Ensuite, c’est la scission au sein du parti ouvrier social-démocrate russe entre tendance menchevik et bolchevik sur l’idée développée par Lénine dans Que faire ? C’est le problème qui opposa, dans les groupes marxistes ayant rompu avec la social-démocratie, Raden-kommunisten et le KAPD à la troisième Internationale. C’est aussi dans cet ordre de pensée que s’inscrit la divergence entre le groupe de Bordiga et Lénine au sujet de la politique de “front unique” préconisée par Lénine et Trotsky et adoptée par l’IC. C:est enfin sur ce problème que subsiste une des divergences essentielles entre différents groupes, au sein de l’opposition : entre “trotskystes”, “bordiguistes” et c’est ce problème qui fit l’objet des discussions de tous les groupes qui se manifestèrent à cette époque.
Aujourd’hui, nous avons à refaire 1’examen critique de toutes ces manifestations du mouvement ouvrier révolutionnaire. Nous devons dégager dans son évolution - c!’est-à-dire dans la manifestation de différents courants d’idées à ce sujet - un courant qui, selon nous, exprime le mieux l’attitude révolutionnaire, et essayer de poser le problème pour le futur mouvement ouvrier révolutionnaire.
Nous devons également reconsidérer d’une façon critique les points de vue d’où l’on a abordé ce problème, voir ce qu’il y a de constant dans l’expression révolutionnaire du prolétariat, mais aussi ce qu’il y a de dépassé et les problèmes nouveaux qui se posent.
Or, il est bien évident qu’un tel travail ne peut porter des fruits que s’il constitue un objet de discussion entre groupes et au sein des groupes qui se proposent de reconstituer un nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire.
L’étude présentée aujourd’hui constitue donc une participation à cette discussion ; elle s’inscrit dans cet ordre de préoccupations et n’a donc pas d’autre prétention, quoique présentée sous la forme de thèses. Elle a surtout comme but de susciter la discussion et la critique, plus que d’apporter des solutions définitives. C’est un travail de recherche et qui vise moins à l’approbation ou au rejet pur et simple qu’à susciter d’autres travaux de ce genre.
Cette étude a comme objet de préoccupation essentielle “la manifestation de la conscience révolutionnaire” du prolétariat. Mais il y a nombre de questions qui s’inscrivent au programme de ce problème du parti et qui ne sont qu’effleurées : des problèmes organisationnels, des problèmes sur les rapports entre le parti et des organismes tels que les conseils d’ouvriers, des problèmes concernant 1’attitude des révolutionnaires devant la constitution de plusieurs groupes se réclament DU parti révolutionnaire et œuvrant à sa construction, les problèmes que posent les tâches pré et postrévolutionnaires, etc. …
Il convient donc que les militants qui comprennent que la tâche de l’heure est l’examen de ces divers problèmes interviennent activement dans cette discussion, soit au travers de leurs propres journaux ou bulletins, soit dans ce bulletin, pour ceux qui ne disposent pas momentanément d’une telle possibilité d’expression.
Le rôle décisif de la conscience pour la révolution prolétarienne
1. L’idée de la nécessité d’un organisme politique agissant du prolétariat, pour la révolution sociale, semblait être acquise dans le mouvement ouvrier socialiste.
Il est vrai que les anarchistes ont toujours protesté contre le terme “politique” donné à cet organisme. Mais la protestation anarchiste provenait du fait qu’ils entendaient le terme de l’action politique dans un sens très étroit, synonyme pour eux, d’une action pour des réformes législatives : participation aux élections et au parlement bourgeois, etc... Mais ni les anarchistes, ni aucun autre courant dans le mouvement ouvrier ne nient la nécessité du regroupement des révolutionnaires socialistes dans des associations qui, par l’action et la propagande, se donnent pour tâche d’intervenir et d’orienter la lutte des ouvriers. Or, tout groupement qui se donne pour tâche d’orienter dans une certaine direction les luttes sociales est un groupement politique.
Dans ce sens, la lutte d’idée autour du caractère politique ou non politique à donner à ces organisations n’est qu’un débat de mots, cachant au fond, sous des phrases générales, des divergences concrètes sur l’orientation, sur les buts à atteindre et les moyens pour y parvenir. En d’autres termes, des divergences précisément politiques.
Si aujourd’hui surgissent à nouveau des tendances qui remettent en question la nécessité d’un organisme politique pour le prolétariat, c’est une conséquence de la dégénérescence et du passage au service du capitalisme des partis qui furent autrefois des organisations du prolétariat : les partis socialistes et communistes. Les termes de politique et de partis politiques subissent actuellement un discrédit, même dans des milieux bourgeois. Cependant, ce qui a conduit à des faillites retentissantes n’est pas la politique mais CERTAINES politiques. La politique n’étant rien d’autre que l’orientation que se donnent les hommes dans l’organisation de leur vie sociale ; se détourner de cette action, c’est renoncer à vouloir orienter la vie sociale et par conséquent à vouloir la transformer, c’est subir et accepter la société présente.
2. La notion de classe est essentiellement une notion historico-politique, et non simplement une classification économique. Économiquement, tous les hommes font partie d’un et même système de production dans une période historique donnée. La division basée sur les positions distinctes que les hommes occupent dans un même système de production et de répartition et qui ne dépasse pas le cadre de ce système, ne peut devenir le postulat de la nécessité historique du dépassement de celui-ci. La division en catégories économiques n’est alors qu’un moment de la contradiction interne constante se développant avec le système, mais restant circonscrite à l’intérieur des limites de celui-ci. L’opposition historique est en quelque sorte extérieure, dans le sens qu’elle s’oppose à l’ensemble du système pris comme un tout, et cette opposition se réalise dans la destruction du système social existant et son remplacement par un autre basé sur un nouveau mode de production. La classe est la personnification de cette opposition historique en même temps qu’elle est la force sociale-humaine la réalisant.
Le prolétariat n’existe en tant que classe dans le plein sens du terme que dans l’orientation qu’il donne à ses luttes, non en vue de l’aménagement de ses conditions de vie à l’intérieur du système capitaliste, mais dans son opposition à l’ordre social existant. Le passage de la catégorie à la classe, de la lutte économique à la lutte politique, n’est pas un processus évolutif, un développement continu immanent, de façon que 1’opposition historique de classe émerge automatiquement et naturellement après avoir été longtemps contenue dans la position économique des ouvriers. De l’une à l’autre, il y a un bond dialectique qui s’effectue. Il consiste dans la prise de conscience de la nécessité historique de la disparition du système capitaliste. Cette nécessité historique coïncide avec l’aspiration du prolétariat à la libération de sa condition d’exploité et la contient.
3. Toutes les transformations sociales dans l’histoire avaient pour condition fondamentale déterminante le développement des forces productives devenues incompatibles avec la structure par trop étroite de l’ancienne société. C’est aussi dans l’impossibilité de dominer plus longtemps les forces productives qu’il a développées que le capitalisme accuse sa propre fin et la raison de son effondrement et apporte ainsi la condition et la justification historique de son dépassement par le socialisme.
Mais hormis cette condition, les différences dans le déroulement entre les révolutions antérieures (y compris la révolution bourgeoise) et la révolution socialiste, restent décisives et nécessitent une étude approfondie de la part de la classe révolutionnaire.
Pour la révolution bourgeoise, par exemple, les forces de production incompatibles avec le féodalisme, trouvent encore la condition de leur développement dans un système de propriété d’une classe possédante. De ce fait, le capitalisme développe économiquement ses bases lentement et longtemps à l’intérieur du monde féodal. La révolution politique suit le fait économique et le consacre. De ce fait également, la bourgeoisie n’a pas un besoin impérieux d’une conscience du mouvement économique et social. Son action est directement propulsée par la pression des lois du développement économique qui agissent sur elle comme des forces aveugles de la nature et déterminent sa volonté. Sa conscience demeure un facteur de second ordre. El1e retarde sur les faits. Elle est plus enregistrement qu’orientation. La révolution bourgeoise se situe dans cette préhistoire de l’humanité où les forces productives encore peu développées dominent les hommes.
Le socialisme au contraire est basé sur un développement des forces productives incompatible avec toute propriété individuelle ou sociale d’une classe. De ce fait le socialisme ne peut fonder des assises économiques au sein de la société capitaliste. La révolution politique est la première condition d’une orientation socialiste de l’économie et de la société. De ce fait également, le socialisme ne peut se réaliser qu’en tant que conscience des finalités du mouvement, conscience des moyens de leur réalisation et volonté consciente de l’action. La conscience socialiste PRECEDE ET CONDITIONNE l’action révolutionnaire de la classe. La révolution socialiste est le début de l’histoire où l’homme est appelé à dominer les forces productives qu’il a déjà fortement développées et cette domination est précisément l’objet que se pose la révolution socialiste.
4. Pour cette raison, toutes les tentatives d’asseoir le socialisme sur des réalisations pratiquées au sein de la société capitaliste sont par la nature même du socialisme vouées à l’échec. Le socialisme exige, dans le temps un développement avancé des forces productives, pour espace la terre entière, et pour condition primordiale la volonté consciente des hommes. La démonstration expérimentale du socialisme au sein de la société capitaliste ne peut pas dépasser, dans le meilleur des cas, le niveau d’une utopie. Et la persistance dans cette-voie mène de l’utopie à une position de conservation et de renforcement du capitalisme 3. Le socialisme en régime capitaliste ne peut être qu’une démonstration théorique, sa matérialisation ne peut prendre que la forme d’une force idéologique, et sa réalisation que la lutte révolutionnaire du prolétariat contre l’ordre social existant.
Et puisque l’existence du socialisme ne peut se manifester d’abord que dans la conscience socialiste, la classe qui le porte et le personnifie n’a d’existence historique que par cette conscience. La formation du prolétariat en tant que classe historique n’est que la formation de sa conscience socialiste. Ce sont là deux aspects d’un même processus historique inconcevables séparément parce qu’inexistants l’un sans l’autre.
La conscience socialiste ne découle pas de la position économique des ouvriers, elle n’est pas un reflet de leur condition de salariés. Pour cette raison, la conscience socialiste ne se forge pas simultanément et spontanément dans les cerveaux de tous les ouvriers et uniquement dans leurs cerveaux. Le socialisme en tant qu’idéologie apparaît séparément et parallèlement aux luttes économiques des ouvriers, tous les deux ne s’engendrent pas l’un l’autre quoique s’influençant réciproquement et se conditionnant dans leur développement, tous les deux trouvent leurs racines dans le développement historique de la société capitaliste.
La formation du parti de classe dans l’histoire
5. Si les ouvriers ne deviennent “classe par elle-même et pour elle-même” (selon l’expression de Marx et Engels) que par la prise de conscience socialiste, on peut dire que le processus de constitution de la classe s’identifie au processus de formation des groupes de militants révolutionnaires socialistes. Le parti du prolétariat n’est pas une sélection, pas davantage une “délégation” de la classe, mais c’est le mode d’existence et de vie de la classe elle-même. Pas plus qu’on ne peut saisir la matière en dehors du mouvement, on ne peut saisir la classe en dehors de sa tendance à se constituer en organismes politiques. “L’organisation du prolétariat en classe, donc en parti politique” (Manifeste Communiste) n’est pas une formule du hasard, mais exprime la pensée profonde de Marx-Engels. Un siècle d’expérience a magistralement’’ confirmé la validité de cette façon de concevoir la notion de classe.
6. La conscience socialiste ne se PRODUIT pas par génération spontanée mais se REPRODUIT sans cesse, et une fois apparue elle devient dans son opposition au monde capitaliste existant, le principe actif déterminant et accélérant, dans et par l’action, son propre développement. Toutefois ce développement est conditionné et limité par le développement des contradictions du capitalisme. Dans ce sens la thèse de Lénine de la “conscience socialiste injectée aux ouvriers” par le parti en opposition à la thèse de Rosa de la “spontanéité” de la prise de conscience engendrée au cours d’un mouvement partant de la lutte économique pour aboutir à la lutte socialiste révolutionnaire, est certainement plus exact. La thèse de la “spontanéité”, aux apparences démocratiques, a quant au fond, une tendance mécaniste d’un déterminisme économique rigoureux. Elle part d’une relation de cause à effet : la conscience socialiste ne serait que la résultante, l’effet d’un mouvement premier, à savoir, la lutte économique des ouvriers qui l’engendrerait. Elle serait en outre d’une nature fondamentalement passive par rapport aux luttes économiques, qui seront 1’élément actif. La conception de Lénine restitue à la conscience socialiste et au Parti qui la matérialise leur caractère de facteur et de principe essentiellement actifs. Elle ne la détache pas mais l’inclut dans la vie et dans le mouvement.
7. La difficulté fondamentale de la révolution socialiste réside dans cette situation complexe et contradictoire : d’une part la révolution ne peut se réaliser qu’en tant quaction CONSCIENTE de la GRANDE MAJORITE de la classe ouvrière, d’autre part cette prise de conscience se heurte aux conditions qui sont faites aux ouvriers dans la société capitaliste, conditions qui empêchent et détruisent sans cesse la prise de conscience par les ouvriers de leur mission historique révolutionnaire. Cette difficulté ne peut absolument pas être surmontée uniquement par la propagande théorique indépendamment de la conjoncture historique. Mais moins encore que dans la propagande pure, la difficulté ne saurait trouver la condition de sa solution par les luttes économiques des ouvriers. Laissées à leur propre développement interne, les luttes des ouvriers contre les conditions d’exploitation capitaliste peuvent mener tout au plus à des explosions de révolte, c’est- à-dire à des réactions négatives mais qui sont absolument insuffisantes pour leur action positive de transformation sociale, uniquement possible par la conscience des finalités du mouvement. Ce facteur ne peut être que cet élément politique de la classe qui tire sa substance théorique, non des contingences et du particularisme de la position économique des ouvriers, mais du mouvement des possibilités et des nécessités historiques. Seule 1’intervention de ce facteur permet à la classe de passer du plan de la réaction négative au plan de 1’action positive, de la révolte à la révolution.
8. Mais il serait absolument erroné de vouloir substituer ces organismes, manifestations de la conscience et de 1’existence de la classe, à la classe elle-même et ne considérer la classe que comme une masse informe destinée à servir de matériau à ces organismes politiques. Cela serait substituer une conception militariste à la conception révolutionnaire du rapport entre la conscience et l’être, entre le parti et la classe. La fonction historique du parti n’est pas d’être un État-Major dirigeant 1!’action de la classe considérée comme une armée, et comme elle ignorant le but final, les objectifs immédiats des opérations, et le mouvement “d’ensemble des manœuvres”. La révolution socialiste n’est en rien comparable à l’action militaire. Sa réalisation est conditionnée par la conscience qu’ont les ouvriers eux-mêmes dictant leur décision et actions propres.
Le Parti n’agit donc pas à la place de la classe. Il ne réclame pas la “confiance” dans le sens bourgeois du mot, c’est-à-dire d’être une délégation à qui est confié le sort - et la destinée - de la société. Il a uniquement pour fonction historique d’agir en vue de permettre à la classe d’acquérir elle- même la conscience de sa mission, de ses buts et des moyens qui sont les fondements de son action révolutionnaire.
9. Avec la même vigueur que doit être combattue cette conception du Parti État-Major, agissant pour le compte et à la place de la classe, doit également être rejetée cette autre conception qui, partant du fait que “l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes” (Adresse Inaugurale de la première Internationale) prétend nier le rôle du militant et du parti révolutionnaire. Sous le prétexte très louable de ne pas imposer leur volonté aux ouvriers, ces militants s’esquivent de leur tâche, fuient leur propre responsabilité et mettent les révolutionnaires à la queue du mouvement ouvrier.
Les premiers se mettent en dehors de la classe, en la niant et en se substituant à elle, les seconds se mettent non moins en dehors d’elle, en niant la fonction propre à l’organisation de classe qu’est le parti, en se niant comme facteur révolutionnaire et en s’excluant par l’interdiction qu’ils jettent sur leur propre action.
10. Une correcte conception des conditions de la révolution socialiste doit partir des éléments suivants et les englober :
a. Le socialisme n’est une nécessité que du fait que le développement atteint par les forces de production n’est plus compatible avec une société divisée en classes.
b. Cette nécessité ne peut devenir réalité que par la volonté et l’action consciente de la classe opprimée, dont la libération sociale se confond avec la libération de l’humanité de son aliénation aux forces de production auxquelles elle a été assujettie jusqu’à ce jour.
c. Le socialisme étant à la fois nécessité objective et volonté subjective, il ne peut s’exprimer que dans L’ACTION révolutionnaire consciente de sa finalité.
d. L’action révolutionnaire est inconcevable en dehors d’un programme révolutionnaire. De même l’élaboration du programme est inséparable de l’action. Et c’est parce que le Parti révolutionnaire est un “corps de doctrine et une volonté d’action” (Bordiga) qu’il est la concrétisation la plus achevée de la conscience socialiste, et l’élément fondamental de sa réalisation.
11. La tendance à la constitution du Parti du prolétariat se fait dès la naissance de la société capitaliste. Mais tant que les conditions historiques pour le socialisme ne sont pas suffisamment développées, l’idéologie du prolétariat comme la construction du Parti ne peuvent que rester au stade embryonnaire. Ce n’est qu’avec la “Ligue des Communistes” qu’apparaît pour la première fois un type achevé d’organisation politique du prolétariat.
Quand on examine de près le développement de la constitution des partis de classe, il apparaît immédiatement le fait que l’organisation en partis ne suit pas une progression constante, mais au contraire enregistre des périodes de grand développement alternant avec d’autres pendant lesquelles le Parti disparaît. Ainsi l’existence organique du Parti ne semble pas dépendre uniquement de la volonté des individus qui le composent. Ce sont les situations objectives qui conditionnent son existence. Le parti étant essentiellement un organisme d’action révolutionnaire de la classe, il ne peut exister que dans des situations où l’action de la classe se fait jour. En absence de conditions d’action de classe des ouvriers (stabilité économique et politique du capitalisme, ou à la suite de défaites profondes des luttes ouvrières), le parti ne peut subsister. Il se disloque organiquement ou bien il est obligé pour subsister, c’est-à-dire pour exercer une influence, de s’adapter aux conditions nouvelles qui nient l’action révolutionnaire, et alors le Parti inévitablement se remplit d’un contenu nouveau. Il devient-conformiste, c1est-à-dire qu’il cesse d’être le parti de la dévolution.
Marx, mieux que tout autre a compris le conditionnement de l’existence du Parti. A deux reprises, il se fait l’artisan de la dissolution de la grande organisation, en 1851- au lendemain de la défaite de la révolution et du triomphe de la réaction en Europe, une seconde fois en 1873 après la défaite de la Commune de Paris, il se prononce franchement pour la dissolution. La première fois, de la Ligue des Communistes, et la seconde fois, de la première Internationale.
La tâche de l’heure pour les militants révolutionnaires
12. L’expérience de la deuxième Internationale confirme l’impossibilité de maintenir au prolétariat son parti dans une période prolongée d’une situation non révolutionnaire. La participation finale des partis de la deuxième Internationale à la guerre impérialiste de 1914 n’a fait que révéler la longue corruption de 1’organisation. La perméabilité et pénétrabilité, toujours possibles, de l’organisation politique du prolétariat par l’idéologie de la classe capitaliste régnante, prennent dans des périodes prolongées de stagnation et de reflux de la lutte de classe, une ampleur telle que l’idéologie de la bourgeoisie finit par se substituer à celle du prolétariat, qu’inévitablement le parti se vide de son contenu de classe primitif pour devenir l’instrument de classe de l’ennemi.
L’histoire des partis communistes de la troisième Internationale a de nouveau démontré l’impossibilité de sauvegarder le parti dans une période de reflux révolutionnaire et sa dégénérescence dans une telle période.
13. Pour ces raisons, la constitution de partis, celle d’une Internationale par les trotskystes depuis 1935 et la constitution récente d’un Parti Communiste Internationaliste en Italie, tout en étant des formations artificielles, ne peuvent être que des entreprises de confusion et d’opportunisme. Au lieu d’être des moments de la constitution du futur Parti de classe, ces formations sont des obstacles et le discréditent par la caricature qu’elles présentent. Loin d’exprimer une maturation de la conscience, et un dépassement de 1’ancien programme qu’elles transforment en dogmes, elles ne font que reproduire l’ancien programme et se font prisonnières de ces dogmes. Rien d’étonnant que ces formations reprennent les positions arriérées et dépassées de 1:ancien Parti en les aggravant encore, comme la tactique du parlementarisme, syndicalisme, etc. ...
14. Mais la rupture de l’existence organisationnelle du Parti ne signifie pas une rupture dans le développement de l’idéologie de classe. Les reflux révolutionnaires signifient en premier lieu l’immaturité du programme révolutionnaire. La défaite est le signal de la nécessité de réexamen critique de positions programmatiques antérieures, et l’obligation de son dépassement sur la base de l’expérience vivante de la lutte.
Cette œuvre critique positive d’élaboration programmatique se poursuit au travers des organismes émanant de l’ancien Parti. Ils constituent l’élément actif dans la période de recul pour la constitution du futur parti dans une période d’un nouveau flux révolutionnaire. Ces organismes, ce sont les groupes ou fractions de gauche issus du parti après sa dissolution organisationnelle ou son aliénation idéologique. Telles furent : la Fraction de Marx dans la période allant de la dissolution de la Ligue à la constitution de la première Internationale, les courants de gauche dans la deuxième Internationale (pendant la Première Guerre mondiale) et qui ont donné naissance aux nouveaux partis et Internationale en 1919 ; tels sont les fractions de gauche et les groupes qui poursuivent leur travail révolutionnaire depuis la dégénérescence de la troisième Internationale. Leur existence et leur développement sont la condition de l’enrichissement du programme de la révolution et de la reconstruction du parti de demain.
15. L’ancien parti une fois happé et passé au service de la classe ennemie cesse définitivement d’être un milieu où s’élabore et chemine la pensée révolutionnaire, et où peuvent se former des militants du prolétariat. Aussi c’est ignorer le fondement de la notion de parti que d’escompter sur des courants venant de la social-démocratie ou du stalinisme, pour servir de matériaux de construction du nouveau parti de classe. Les trotskystes adhérant aux partis de la deuxième Internationale ou poursuivant 1’hypocrite pratique du noyautage en direction de ces partis, afin de susciter dans ces milieux anti-prolétariens des courants “révolutionnaires” avec qui ils veulent constituer le nouveau parti du prolétariat, montrent par là qu’eux-mêmes ne sont qu’un courant mort, expression d’un mouvement passé et non d’avenir.
De même que le nouveau Parti de la révolution ne peut se constituer sur la base d’un programme dépassé par les événements, de même il ne peut se construire avec des éléments qui restent organiquement attachés à des organismes qui ont cessé à jamais d’être de la classe ouvrière.
16. L’histoire du mouvement ouvrier n’a jamais connu de période plus sombre et un recul plus profond de la conscience révolutionnaire que la période présente. Si l’exploitation économique des ouvriers apparaît comme condition absolument insuffisante pour la prise de conscience de leur mission historique, il s’avère que cette prise de conscience est infiniment plus difficile que ne 1e pensaient les militants révolutionnaires. Peut-être faut-il pour que le prolétariat puisse se ressaisir, que l’humanité connaisse le cauchemar de la Troisième Guerre mondiale et l’horreur du monde en chaos, et que le prolétariat se trouve d’une façon tangible placé dans le dilemme : mourir ou se sauver par la révolution, pour qu’il trouve la condition de son ressaisissement et de sa conscience.
17. Il ne nous appartient pas dans le cadre de cette thèse de rechercher les conditions précises qui permettront la prise de conscience du prolétariat, ni quelles seront les données de groupement et d’organisation unitaire que se donnera le prolétariat pour son combat révolutionnaire. Ce que nous pouvons avancer à ce sujet, et que l’expérience des trente dernières années nous autorise à affirmer, d’une façon catégorique, c’est que ni les revendications économiques, ni toute la gamme des revendications dites “démocratiques” (parlementarisme, droit des peuples à disposer d’eux- mêmes, etc...) ne peuvent servir de fondement à l’action historique du prolétariat. Pour ce qui concerne les formes d’organisation, il apparaît avec encore plus d’évidence que ce ne pourront pas être les syndicats, avec leur structure verticale, professionnelle, corporatiste. Toutes ces formes d’organisation devront être reléguées au musée de l’histoire et appartiennent au passé du mouvement ouvrier. Mais dans la pratique elles doivent être absolument abandonnées et dépassées. Les nouvelles organisations devront être unitaires, c’est-à-dire englober la grande majorité des ouvriers et dépasser le cloisonnement particulariste des intérêts professionnels. Leur fondement sera le plan social, leur-structure la localité. Les conseils ouvriers, tels qu’ils ont surgi en 1917 en Russie et en 1918 en Allemagne, apparaissent comme le type nouveau d’organisation unitaire de la classe, c’est dans ce type de conseils ouvriers et non dans un rajeunissement des syndicats que les ouvriers trouveront le forme la plus appropriée de leur organisation.
Mais quelles que soient les formes nouvelles d’organisation unitaire de la classe, elles ne changent en rien le problème de la nécessité de l’organisme politique qu’est le Parti, ni le rôle décisif qu’il a à jouer. Le parti restera le facteur conscient de l’action de classe. Il est la force motrice idéologique indispensable à 1’action révolutionnaire du prolétariat. Dans l’action sociale il joue un rôle analogue à l’énergie dans la production. La reconstruction de cet organisme de classe est à la fois conditionnée par une tendance se faisant jour dans la classe ouvrière de rupture avec l’idéologie capitaliste et s’engageant pratiquement dans une lutte contre le régime existant en même temps que cette reconstruction est une condition d’accélération et d’approfondissement de cette lutte et la condition déterminante de son triomphe.
18. On ne saurait déduire du fait de l’inexistence, dans la période présente, des conditions requises pour la construction du parti, à l’inutilité ou à l’impossibilité de toute activité immédiate des militants révolutionnaires. Entre “l’activisme” creux des faiseurs de partis, et l’isolement individuel, entre un aventurisme et un pessimisme impuissants, le militant ne saurait faire un choix, mais les combattre comme étant également étrangers à l’esprit révolutionnaire et nuisibles à la cause de la révolution. Rejetant également la conception volontariste de l’action militante qui se présente comme l’unique facteur déterminant le mouvement de la classe et la conception mécaniste du parti, simple reflet du passif du mouvement, le militant doit considérer son action comme un des facteurs qui, dans l’interaction avec les autres facteurs, conditionne et détermine l’action de la classe. C’est en partant de cette conception que le militant trouve le fondement de la nécessité et de la valeur de son activité, en même temps que la limite de ses possibilités et de sa portée. Adapter son activité aux conditions de la conjoncture présente, c’est le seul moyen de la rendre efficiente et féconde.
19. La volonté de construire, en toute hâte et à tout prix, le nouveau parti de classe, en dépit des conditions objectives défavorables et en les violentant, relève à la fois d’un volontarisme aventuriste et infantile et d’une fausse appréciation de la situation et de ses perspectives immédiates, et finalement d’une totale méconnaissance de la notion de parti et des rapports entre le parti et la classe. Aussi, toutes ces tentatives sont fatalement vouées à l’échec, ne réussissant dans les meilleurs des cas qu’à créer des groupements opportunistes se traînant dans les sillages des grands partis de la deuxième et de la troisième Internationales. La seule raison qui justifie alors leur existence n’est plus que le développement en leur sein d’un esprit de chapelle et de secte.
Ainsi toutes ces organisations sont non seulement happées dans leur positivité par leur “activisme” immédiat dans 1’engrenage de l’opportunisme mais encore produisent dans leur négativité un esprit borné propre à des sectes, un patriotisme de clocher, un attachement craintif et superstitieux à ses “chefs”, à la reproduction caricaturale du jeu des grandes organisations, à la déification de règles d’organisation et à la soumission a une discipline “librement consentie” d’autant plus tyrannique et plus intolérable qu’elle est en proportion inverse du nombre.
Dans son double aboutissement, la construction artificielle et prématurée du parti conduit à la négation de la construction de l’organisme politique de la classe, à la destruction des cadres et à la perte, à échéance plus ou moins brève mais certaine, du militant, usé, épuisé, dans le vide et complètement démoralisé.
20. La disparition du Parti, soit par son rétrécissement et sa dislocation organisationnelle comme ce fut le cas pour la première Internationale, soit par son passage au service du capitalisme comme ce fut le cas pour les partis des deuxième et troisième Internationales, exprime dans l’un et l’autre cas la fin d’une période dans la lutte révolutionnaire du prolétariat. La disparition du parti est alors inévitable et aucun volontarisme ou la présence d’un chef plus ou moins génial ne saurait l’en empêcher.
Marx et Engels ont vu à deux reprises l’organisation du prolétariat, à la vie de laquelle ils ont pris part de façon prépondérante, se briser et mourir. Lénine et Luxembourg ont assisté impuissants à la trahison des grands partis sociaux-démocrates. Trotsky et Bordiga n’ont rien pu transformer de la dégénérescence des partis communistes et leur transformation en une monstrueuse machine du capitalisme que nous connaissons depuis.
Ces exemples nous enseignent, non pas l’inanité du Parti comme le prétend une analyse superficielle et fataliste, mais seulement que cette nécessité qu’est le Parti de la classe n’a pas une existence basée sur une ligne uniformément continue et ascendante, que son existence même n’est pas toujours possible, que son développement et son existence sont en correspondance et étroitement liés à la lutte de classe du prolétariat, qui lui donne naissance et qu’il exprime. C’est pourquoi la lutte des militants révolutionnaires au sein du parti au cours de sa période de dégénérescence et avant sa mort en tant que parti ouvrier a un sens révolutionnaire, mais non celui vulgaire que lui ont donné les diverses oppositions trotskystes. Pour ces dernières, il s’agissait de redressements, et pour redresser il fallait avant tout que l’organisation et son unité ne soient pas mises en péril. Il s’agissait pour eux de maintenir 1’organisation dans sa splendeur passée alors que précisément les conditions objectives ne le permettaient pas et que la splendeur de l’organisation ne pouvait se maintenir qu’au prix d’une altération constante et croissante, de sa nature révolutionnaire et de classe. Ils cherchaient dans des mesures organisationnelles les remèdes pour sauver l’organisation, sans comprendre que l’effondrement organisationnel est toujours l’expression et le reflet d’une période de reflux révolutionnaire et souvent la solution de loin préférable à sa survivance et qu’en tout cas ce que les révolutionnaires avaient à sauver c’était non 1’organisation mais l’idéologie de la classe risquant de sombrer dans l’effondrement de l’organisation.
Ne comprenant pas les causes objectives de l’inévitable perte de l’ancien parti, on ne pouvait comprendre la tâche des militants dans cette période. De l’échec de la sauvegarde de l’ancien parti à la classe, on concluait à la nécessité de construire dans l’immédiat un nouveau parti. L’incompréhension ne faisait que se doubler d’un aventurisme, le tout basé sur une conception volontariste du parti.
Une étude correcte de la réalité fait comprendre que la mort de 1’ancien parti implique précisément l’impossibilité immédiate de construire un nouveau parti ; elle signifie l’inexistence dans la période présente des conditions nécessaires pour 1’existence de tout parti, aussi bien ancien que nouveau.
Dans une telle période, seuls peuvent subsister des petits groupes révolutionnaires assurant une solution de continuité moins organisationnelle qu’idéologique, condensant en leur sein l’expérience passée du mouvement et de la lutte de la classe, présentant le trait d’union entre le parti d’hier et celui de demain, entre le point culminant de la lutte et de la maturité de la conscience de classe dans la période de flux passé vers son dépassement dans la nouvelle période de flux dans l’avenir. Dans ces groupes se poursuit la vie idéologique de la classe, l’autocritique de ses luttes, le réexamen critique de ses idées antérieures, l’élaboration de son programme, la maturation de sa conscience et la formation de nouveaux cadres de militants pour la prochaine étape de son assaut révolutionnaire.
21. La période présente que nous vivons est le produit, d’une part de la défaite de la première grandiose vague révolutionnaire du prolétariat international qui a mis fin à la Première Guerre impérialiste et qui a atteint son point culminant dans la révolution d:Octobre 1917 en Russie et dans le mouvement spartakiste de 1918-19, d’autre part par des transformations profondes opérées dans la structure économico-politique du capitalisme évoluant vers sa forme ultime et décadente, le capitalisme d’État. Au surplus, un rapport dialectique existe entre cotte évolution du capitalisme et la défaite de la révolution.
Malgré leur combativité héroïque, malgré la crise permanente et insurmontable du système capitaliste et l’aggravation inouïe et croissante des conditions de vie des ouvriers, le prolétariat et son avant-garde ne purent tenir tête à la contre-offensive du capitalisme. Ils ne trouvèrent pas face à eux le capitalisme classique et furent surpris par ses transformations posant des problèmes auxquels ils n’étaient pas préparés ni théoriquement ni politiquement. Le prolétariat et son avant-garde qui, longtemps et couramment, avaient confondu capitalisme et possession privée des moyens de production, socialisme et étatisation, se sont trouvés déroutés et désemparés devant les tendances du capitalisme moderne à la concentration étatique de l’économie et à sa planification. Dans leur immense majorité, les ouvriers se sont laissé gagner à l’idée que cette évolution présentait un mode de transformation original de la société du capitalisme vers le socialisme. Ils se sont associés à cette œuvre, ils ont abandonné leur mission historique et sont devenus les artisans les plus surs de la conservation de la société capitaliste.
Ce sont là les raisons historiques qui donnent au prolétariat sa physionomie actuelle. Tant que ces conditions prévaudront, tant que l’idéologie de capitalisme d’État dominera le cerveau des ouvriers, il ne saurait être question de reconstruction du parti de classe. Ce n’est que lorsqu’au travers des cataclysmes sanglants qui jalonnent la phase du capitalisme d’État, le prolétariat aura saisi tout 1’abîme qui sépare le socialisme libérateur du monstrueux régime étatique actuel, quand il se manifestera en son sein une tendance croissante à se détacher de cette idéologie qui 1’emprisonne et 1’annihile, que la voie sera à nouveau ouverte à “l’organisation du prolétariat en classe, donc en parti politique”. Cette étape sera d’autant plus vite franchie et facilitée par le prolétariat que les noyaux révolutionnaires auront su faire l’effort théorique nécessaire pour répondre aux problèmes nouveaux posés par le capitalisme d’État et aider le prolétariat à retrouver sa solution de classe et les moyens pour sa réalisation.
22. Dans la période présente, les militants révolutionnaires ne peuvent subsister qu’en formant des petits groupes se livrant à un travail patient de propagande forcément limité dans son étendue, en même temps qu’à un effort acharné de recherches et de clarification théorique.
Ces groupes ne s’acquitteront de leur tâche que par la recherche de contacts avec d’autres groupes sur le plan national et international, sur la base des critères délimitatifs des frontières de classe. Seuls de tels contacts et leur multiplication en vue de la confrontation des positions et la clarification des problèmes permettront aux groupes et militants de résister physiquement et politiquement à la terrible pression du capitalisme dans la période présente et permettre à ce que tous les efforts soient une contribution réelle à la lutte émancipatrice du prolétariat.
Le Parti de demain
23. Le Parti ne saurait être une simple reproduction de celui d’hier. Il ne pourra être reconstruit sur un modèle idéal tiré du passé. Aussi bien que son programme, sa structure organique et le rapport qui s’établit entre lui et l’ensemble de la classe sont fondés sur une synthèse de l’expérience passée et des nouvelles conditions plus avancées de l’étape présente. Le Parti suit l’évolution de la lutte de classe et à chaque étape de l’histoire de celle-ci correspond un type propre de l’organisme politique du prolétariat.
À l’aube du capitalisme moderne, dans la première moitié du 19è Siècle, la classe ouvrière encore dans sa phase de constitution menant des luttes locales et sporadiques ne pouvait donner naissance qu’à des écoles doctrinaires, à des sectes et des ligues. La Ligue des Communistes était l’expression la plus avancée de cette période en même temps que son Manifeste et son Appel de “prolétaires de tous les pays, unissez-vous”, elle annonçait la période suivante.
La première Internationale correspond à l’entrée effective du prolétariat sur la scène des luttes sociales et politiques dans les principaux pays d’Europe. Aussi groupe-t-el1e toutes les forces organisées de la classe ouvrière, ses tendances idéologiques les plus diverses. La première Internationale réunit à la fois tous les courants et tous les aspects de la lutte ouvrière contingente : économiques, éducatifs, politiques et théoriques. Elle est au plus haut point L’ORGANISATION UNITAIRE de la classe ouvrière, dans toute sa diversité.
La deuxième Internationale marque une étape de différenciation entre la lutte économique des salariés et la lutte politique sociale. Dans cette période de plein épanouissement de la société capitaliste, la deuxième Internationale est l’organisation de la lutte pour des réformes et des conquêtes politiques, l’affirmation politique du prolétariat, en même temps qu’elle marque une étape supérieure dans la délimitation idéologique au sein du prolétariat, en précisant et élaborant les fondements théoriques de sa mission historique révolutionnaire.
La Première Guerre mondiale signifiait la crise historique du capitalisme et l’ouverture de sa phase de déclin. La révolution socialiste passa dès lors du plan de la théorie au plan de la démonstration pratique. Sous le feu des événements, le prolétariat se trouvait en quelque sorte forcé de construire hâtivement son organisation révolutionnaire de combat. L’apport programmatique monumental des premières années de la troisième Internationale s’est avéré cependant insuffisant et inférieur à l’immensité des problèmes à résoudre posés par cette phase ultime du capitalisme et de sa transition révolutionnaire. En même temps, l’expérience a vite démontré l’immaturité idéologique générale de l’ensemble de la classe. Devant ces deux écueils, et sous la pression des nécessités surgies des événements et de leur rapidité, la troisième Internationale était amenée à répondre par des mesures organisationnelles : la discipline de fer des militants, etc...
L’aspect organisationnel devant suppléer 1’inachèvement programmatique et le parti à l’immaturité de la classe aboutissaient à la substitution du parti à l’action de la classe elle-même et à l’altération de la notion du parti et des rapports de celui-ci avec la classe.
24. Sur la base de cette expérience, le futur parti aura pour fondement le rétablissement de cette vérité que : la révolution si elle contient un problème d’organisation n’est cependant pas une question d’organisation. La révolution est avant tout un problème idéologique de maturation de la conscience dans les larges masses du prolétariat.
Aucune organisation, aucun parti ne peut se substituer à la classe elle-même, car plus que jamais il reste vrai que “l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes”. Le parti qui est la cristallisation de la conscience de la classe n’est ni différent ni synonyme de la classe. Le parti reste nécessairement une petite minorité ; son ambition n’est pas la plus grande force numérique. À aucun moment il ne peut ni se séparer, ni remplacer l’action vivante de la classe. Sa fonction reste celle d’inspiration idéologique au cours du mouvement et de l’action de la classe.
25. Au cours de la période insurrectionnelle de la révolution, le rôle du parti n’est pas de revendiquer le pouvoir pour lui, ni de demander aux masses de lui faire “confiance”. II intervient et développe son. activité en vue de l’auto-mobilisation de la classe à l’intérieur de laquelle il tend à faire triompher les principes et les moyens d’action révolutionnaires.
La mobilisation de la classe autour du parti à qui elle “confie” ou plutôt abandonne la direction est-une conception reflétant un état d’immaturité de la classe. L’expérience a montré que, dans de telles conditions, la révolution se trouve finalement dans l’impossibilité de triompher et doit rapidement dégénérer en entraînant un divorce entre la classe et le parti. Ce dernier se trouve rapidement dans 1’obligation de recourir de plus en plus à des moyens de coercition pour s’imposer à la classe et devient ainsi un obstacle redoutable pour la marche en avant de la révolution.
Le parti n’est pas un organisme de direction et d’exécution, ces fonctions appartenant en propre à l’organisation unitaire de: la classe. Si les militants du parti, participent à ces fonctions, c’est en tant que membres de la grande communauté du prolétariat.
26. Dans la période postrévolutionnaire, celle de la dictature du prolétariat, le parti n’est pas le parti unique, classique des régimes totalitaires. Ce dernier se caractérise par son identification et son assimilation avec le pouvoir étatique dont il détient le monopole. Au contraire, le parti de classe du prolétariat se caractérise en ce qu’il se distingue de l’État en face de qui il présente l’antithèse historique. Le parti unique totalitaire tend à s’enfler et à incorporer des millions d’individus pour en faire l’élément physique de sa domination et de son oppression. Le parti du prolétariat au contraire, de par sa nature, reste une sélection idéologique sévère, ses militante n’ont pas d’avantages à conquérir ou à défendre. Leur privilège est d’être seulement les combattants les plus clairvoyants et les plus dévoués à la cause révolutionnaire. Le parti ne vise donc pas à incorporer en son sein de larges masses car, au fur et à mesure que son idéologie deviendra celle des larges masses, la nécessité de son existence tendra à disparaître et l’heure de sa dissolution commencera à sonner.
Régime intérieur du parti
27. Les problèmes concernant les règles d’organisation qui constituent le régime intérieur du parti occupent une place aussi décisive que son contenu programmatique. L’expérience passée et plus particulièrement celle des partis de la troisième Internationale ont montré que la conception du parti constitue un tout unitaire. Les règles organisationnelles sont un aspect et une manifestation de cette conception. Il n’y a pas une question d’organisation séparée de l’idée qu’on a sur le rôle et la fonction du parti et du rapport de celui-ci avec la classe. Aucune de ces questions n’existe en soi, mais constitue des éléments constitutifs et expressifs du tout.
Les partis de la troisième Internationale avaient telles règles ou tels régimes intérieure parce qu’ils se sont constitués dans une période d’immaturité évidente de la classe, ce qui les a amenés à substituer le parti à la classe, 1’organisation a la conscience, la discipline à la conviction.
Les règles organisationnelles du futur parti devront donc être fonction d’une conception renversée du rôle du parti, dans une étape plus avancée de la lutte, reposant sur une maturité idéologique plus grande de la classe.
28. Les questions du centralisme démocratique ou organique qui occupèrent une place prépondérante dans la troisième Internationale perdront de leur acuité pour le futur parti. Quand l’action de la classe reposait sur l’action du parti, la question de l’efficacité pratique maxima de cette dernière devait nécessairement dominer le parti, qui d’ailleurs ne pouvait apporter que des solutions fragmentaires.
L’efficacité de l’action du parti ne consiste pas dans son action pratique de direction et d’exécution, mais dans son action idéologique. La force du parti ne repose donc pas sur la soumission disciplinaire des militants mais sur leur connaissance, leur développement idéologique plus grand, leurs convictions plus sures.
Les règles de l’organisation ne découlent pas des notions abstraites, hissées à la hauteur des principes immanents et immuables, démocratie ou centralisme. De tels principes sont vides de sens. Si la règle de décisions prises à la majorité (démocratie) apparaît, à défaut d’une autre, plus appropriée, être la règle à maintenir, cela ne signifie nullement que par définition la majorité possède la vertu d’avoir le monopole de la vérité et des positions justes. Les positions justes découlent de la plus grande connaissance de l’objet, de la plus grande pénétration et du serrement plus étroit de la réalité.
Aussi les règles intérieures de l’organisation sont fonction de l’objectif que se donne et qui est celui du parti. Quelle que soit l’importance de l’efficacité de son action pratique immédiate, qui peut lui donner l’exercice d’une discipline plus grande, elle demeure toujours moins importante que l’épanouissement maxima de la pensée des militants et en conséquence lui est subordonnée.
Tant que le Parti reste le creuset où s’élabore et s’approfondit 1’idéologie de la classe, il a pour règle, non seulement la liberté la plus grande des idées et des divergences dans le cadre de ses principes programmatiques, mais a pour fondement le souci de favoriser et d’entretenir sans cesse la combustion de la pensée, en fournissant les moyens pour la discussion et la confrontation des idées et des tendances en son sein.
29. Vue sous cet angle, rien n’est aussi étranger à la conception du Parti que cette monstrueuse conception d’un parti homogène monolithique et monopoliste.
L’existence de tendances et de fractions au sein du parti n’est pas tolérance, un droit pouvant être accordé, donc sujet à discussion.
Au contraire, l’existence des courants dans le Parti - dans le cadre des principes acquis et vérifiés - est une des manifestations d’une conception saine de la notion du Parti.
Juin 1948, Marco.
1. Aujourd’hui encore nous partageons le fond de l’ensemble des idées présentes dans ce texte et souvent même nous les soutenons à la lettre. C’est le cas en particulier du rôle politique fondamental et irremplaçable du parti du prolétariat pour la victoire de la révolution, mais l’expression suivante du texte ne permet pas au mieux de rendre compte de la dynamique de développement de la lutte de classe et des relations entre la classe et le parti : "Laissées à leur propre développement interne, les luttes des ouvriers contre les conditions d’exploitation capitaliste peuvent mener tout au plus à des explosions de révolte". En effet, le rôle des révolutionnaires doit ici être précisé. Il n'est pas d’apporter la conscience aux ouvriers mais d’approfondir et accélérer le développement de celle-ci dans ses rangs. Pour d’avantage d’éléments concernant notre position sur le sujet, nous renvoyons le lecteur aux articles suivants : "Le communisme n’est pas un bel idéal, il est à l’ordre du jour de l’histoire [1° partie]" dans la Revue internationale n° 90 ; "Question d’organisation ; sommes-nous devenus "léninistes"?" dans les n° 96 et 97 de la Revue internationale ; "1903-1904 : la naissance du bolchevisme (III). La polémique entre Lénine et Rosa Luxembourg" dans la Revue internationale n° 118.
Par ailleurs, nous signalons que nous avons tenté d’améliorer la lisibilité de la republication de cet article d’Internationalisme en corrigeant des coquilles ou des petites erreurs grammaticales et en introduisant des intertitres.
2. La même réflexion théorique sous-tend un autre article, “Les tâches de l’heure”, publié dans Internationalisme en 1946 et réédité dans la Revue internationale n°32 (https://fr.internationalism.org/rinte32/Internationalisme_1947_parti_ou_... [53])
3. C’est ce qu’il est advenu de tous les courants du socialisme utopique qui, devenus des écoles, ont perdu leur aspect révolutionnaire pour se transformer en forces conservatives actives. Voir le Proudhonisme, le Fouriérisme, le coopérativisme, le réformisme et le socialisme d’État.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [55]
Rubrique:
La guerre d'Espagne met en évidence les lacunes fatales de l'anarchisme (I)
- 1543 lectures
Première partie : Programme et pratique
L'article précédent de la série nous a conduits dans le travail du mouvement révolutionnaire alors que celui-ci sortait de la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons montré comment, malgré cette catastrophe, les meilleurs éléments du mouvement marxiste ont continué à se maintenir sur la perspective du communisme. Leur conviction dans cette perspective n'avait pas disparu même si la Guerre mondiale n'avait pas, contrairement à ce que beaucoup de révolutionnaires avaient prédit, provoqué un nouveau surgissement du prolétariat contre le capitalisme et malgré aussi le fait que celle-ci avait aggravé la défaite déjà terrible qui s'était abattu sur la classe ouvrière dans les années 1920 et 1930. Nous nous sommes concentrés en particulier sur les travaux de la Gauche Communiste de France, qui était probablement la seule organisation à comprendre que les tâches de l'heure demeuraient celles d'une fraction, pour préserver et approfondir les acquis théoriques du marxisme afin de construire un pont vers les futurs mouvements prolétariens qui créeraient les conditions pour la reconstitution d'un réel parti communiste. Cela avait été le projet des fractions de gauche italienne et belge avant la guerre, même si une partie importante de cette gauche communiste internationale avait perdu de vue cela avec l'euphorie de courte durée suite à la reprise des luttes ouvrières en Italie en 1943 et la fondation du parti communiste internationaliste en Italie.
Dans le cadre de cet effort pour développer le travail des fractions de gauche avant la guerre, la GCF avait poursuivi le travail consistant à tirer les leçons de la révolution russe et à examiner les problèmes de la période de transition : la dictature du prolétariat, l'État de transition, le rôle du parti et l'élimination du mode de production capitaliste. Nous avons réédité et présenté la thèse de la GCF sur le rôle de l'État, destinée à servir de base pour des débats futurs sur la période de transition au sein du milieu révolutionnaire renaissant du début des années 1970.
Mais avant de procéder à une étude de ces débats, nous avons besoin de faire un retour en arrière sur une étape historique décisive de l'histoire du mouvement ouvrier : l'Espagne 1936-37. Comme nous allons l'argumenter, nous ne sommes pas de ceux qui voient dans ces événements un modèle de révolution prolétarienne étant allé beaucoup plus loin que n'importe point atteint en Russie en 1917-21. Mais cela ne fait aucun doute que la guerre en Espagne nous a appris beaucoup de choses, même si la plupart de ses leçons sont en négatif. En particulier, elle nous offre un aperçu très important des insuffisances de la vision anarchiste de la révolution et une réaffirmation frappante de la vision qui a été préservée et développée par les traditions authentiques du marxisme. Ceci est particulièrement important à souligner compte tenu du fait que, durant les dernières décennies, ces traditions ont souvent été décriées comme étant obsolètes et démodées et que, parmi la minorité politisée de la génération actuelle, les idées anarchistes sous diverses formes ont acquis une influence indéniable.
Cette série a toujours été basée sur la conviction que seul le marxisme fournit une méthode cohérente pour comprendre ce qu'est le communisme et sa nécessité et, en s'appuyant sur l'expérience historique de la classe ouvrière, qu'il est aussi une possibilité réelle et pas seulement le souhait d'un monde meilleur. C'est pourquoi une grande partie de cette série a été reprise avec l'étude des avancées et des erreurs de l'aile marxiste du mouvement ouvrier dans son effort pour comprendre et élaborer le programme communiste. Pour la même raison, elle s'est penchée à certains moments sur les tentatives du mouvement anarchiste pour développer sa vision de la future société. Dans l'article "Anarchisme ou communisme" 1, nous soulignons que la vision anarchiste puise ses origines historiques dans la résistance des couches de la petite bourgeoisie, comme les artisans et petits paysans, au processus de prolétarisation, qui était un produit inévitable de l'émergence et de l'expansion du mode de production capitaliste. Bien qu'un certain nombre de courants anarchistes fassent clairement partie du mouvement ouvrier, aucun d'entre eux n'a réussi à effacer entièrement ces marques de naissance petites-bourgeoises. L'article en question montre comment, dans la période de la Première internationale, cette idéologie essentiellement tournée vers le passé sous-tendait la résistance du clan autour de Bakounine aux avancées théoriques du marxisme à trois niveaux cruciaux : dans la conception de l'organisation des révolutionnaires, qui a été profondément infectée par les méthodes conspiratrices des sectes dépassées ; dans le rejet du matérialisme historique en faveur d'une conception volontariste et idéaliste des possibilités de la révolution ; et dans la conception de la future société, considérée comme un réseau de communes autonomes reliées entre elles par l'échange des marchandises.
Néanmoins, avec le développement du mouvement ouvrier dans la dernière partie du XIXe siècle, les tendances les plus importantes de l'anarchisme tendent à s'intégrer plus fermement dans la lutte du prolétariat et la perspective d'une nouvelle société, et c'est particulièrement vrai du courant anarcho-syndicaliste (bien que, dans le même temps, la dimension de l'anarchisme en tant qu'expression de la révolte de la petite bourgeoisie ait continué de vivre à travers les "actes exemplaires" de la bande à Bonnot et autres) 2. La réalité de cette tendance prolétarienne a été démontrée dans la capacité de certains courants anarchistes à prendre des positions internationalistes face à la Première Guerre mondiale (et, dans une moindre mesure, la Seconde) et dans la volonté d'élaborer un programme plus clair pour leur mouvement. Ainsi, la période de la fin du XIXe siècle aux années 1930 a vu plusieurs tentatives visant à élaborer des documents et des plates-formes à même d'orienter la mise en place du "communisme libertaire" au moyen de la révolution sociale. Un exemple évident en a été La conquête du pain de Kropotkine qui, d'abord, est paru comme une œuvre intégrale en Français en 1892 et a été publié, plus d'une décennie plus tard, en anglais 3. Malgré l'abandon par Kropotkine de l'internationalisme en 1914, cet écrit et d'autres dont il est l'auteur font partie des classiques de l'anarchisme et méritent une critique beaucoup plus développée qu'il n'est possible de le faire dans cet article.
En 1926 Makhno, Arshinov et d'autres publient la plateforme de l'Union générale des anarchistes 4. Il s'agit de l'acte fondateur du courant "plate-formiste" de l'anarchisme, et il appelle aussi à un examen plus approfondi, ainsi qu'à une analyse de sa trajectoire historique depuis la fin des années 1920 à nos jours. Son principal intérêt réside dans les conclusions qu'il tire de l'échec du mouvement anarchiste dans la révolution russe, en particulier l'idée que les révolutionnaires anarchistes doivent se regrouper dans leur propre organisation politique, basée sur un programme clair pour la mise en place de la nouvelle société. C'est cette idée en particulier qui a attiré les foudres d'autres anarchistes – pas moins que Voline et Malatesta - qui l'ont vue comme une expression d'une sorte d'anarcho-bolchevisme.
Dans cet article, cependant, nous nous intéressons d'avantage à la théorie et à la pratique de la tendance anarcho-syndicaliste durant les années 1930. Et ici encore il n'y aucune pénurie de matériel. Dans notre série la plus récente sur la décadence du capitalisme, publiée dans cette revue, nous avons mentionné le texte de l'anarcho-syndicaliste russe exilé Gregory Maximoff, Mon Credo Social. Écrit dans la profondeur de la grande dépression, il témoigne d'un degré remarquable de clarté sur la décadence du système capitaliste, un thème qui n'est presque jamais traité par les anarchistes d'aujourd'hui 5. Le texte contient également une section qui décrit les idées de Maximoff sur l'organisation de la nouvelle société. Durant cette période, il y avait aussi des débats importants dans l'anarcho-syndicalisme "International" créé en 1922 – l'Association Internationale des Travailleurs (AIT) - sur la façon de passer du capitalisme au communisme libertaire. Et sans doute l'écrit le plus pertinent a été la brochure d'Isaac Puente, Communisme libertaire. Publiée en 1932, elle était destinée servir de base à la plate-forme de la CNT lors du Congrès de Saragosse de 1936 et peut donc être considérée comme ayant influencé la politique de la CNT au cours de la "révolution espagnole" qui a suivi. Nous y reviendrons mais, tout d'abord, nous voulons examiner certains des débats de l'AIT, qui sont mis en évidence dans le travail très instructif de Vadim Damier, L'Anarcho-syndicalisme au XXe siècle 6.
Un des principaux débats – sans doute en réaction à la montée spectaculaire des techniques fordistes/tayloristes de production de masse dans les années 1920 – était centré sur la question de savoir si, oui ou non, ce type de rationalisation capitaliste, et bien sûr aussi l'ensemble du processus d'industrialisation, constituaient une expression du progrès, faisant ainsi de la société communiste libertaire une perspective plus tangible, ou simplement une intensification de l'asservissement de l'humanité par la machine. Différentes tendances ont apporté différentes nuances à cette discussion, mais grosso modo les anarchocommunistes se démarquaient en faveur de cette deuxième analyse et articulaient leur position avec un appel à un passage immédiat au communisme ; cela était considéré comme possible même - ou peut-être surtout – dans une société essentiellement agraire. La position alternative était plus généralement défendue par les tendances reliées à la tradition syndicaliste révolutionnaire, qui a eu une vision plus "réaliste" des possibilités offertes par la rationalisation capitaliste tout en faisant valoir, dans le même temps, qu'il y aurait la nécessité d'un certain type de régime de transition économique dans lequel les formes monétaires continueraient d'exister.
Ces divergences ont traversé diverses sections nationales (comme la FAUD allemande), mais la FORA 7 Argentine semble avoir eu une vision plus homogène qu'elle a défendue avec conviction, et elle a été à l'avant-garde des perspectives "anti-industrielles". Elle a rejeté ouvertement les prémices du matérialisme historique, au moins telles qu'elle les avait comprises (pour la plupart des anarchistes, le "marxisme" était un terme fourre-tout définissant quiconque se situait entre, d'une part, le stalinisme, la social-démocratie et, d'autre part, le trotskisme et la gauche communiste) en faveur d'une vision de l'histoire dans laquelle l'éthique et les idées n'avaient pas moins d'importance que le développement des forces productives. Elle a rejeté catégoriquement l'idée selon laquelle la nouvelle société pourrait être formée sur la base de l'ancienne, c'est pourquoi elle a critiqué non seulement le projet de construction du communisme libertaire sur les fondations de la structure industrielle existante, mais aussi le projet syndicaliste d'organiser les ouvriers dans les syndicats industriels qui, une fois venue la révolution, prendraient en charge cette structure et la dirigeraient au nom du prolétariat et de l'humanité. Elle a envisagé une nouvelle société organisée en une fédération de communes libres ; la révolution serait une rupture radicale avec toutes les formes anciennes et procéderait immédiatement au passage à l'étape de la libre association. Une déclaration du 5ème Congrès de la FORA en 1905 – qui, selon le récit d'Eduardo Columbo, allait devenir la base politique pour de nombreuses années – a mis en avant les critiques de la FORA à la forme syndicale : "Nous ne devons pas oublier qu'un syndicat n'est qu' un sous-produit économique du système capitaliste, né des besoins de cette époque. Le maintenir après la révolution impliquerait de maintenir le système qui l'a produit. La doctrine dite du syndicalisme révolutionnaire est une fiction. Nous, en tant qu'anarchistes, nous acceptons les syndicats comme des armes dans la lutte et nous essayons de faire en sorte qu'ils soient aussi proches que possible de nos idéaux révolutionnaires... C'est-à-dire, nous n'entendons pas être dominés au niveau des idées par les syndicats. Nous avons l'intention de les dominer. En d'autres termes, mettre les syndicats au service de la diffusion, de la défense et de l'affirmation de nos idées au sein du prolétariat" 8
Toutefois, les différences entre les "Foristes" et les syndicalistes à propos de la forme syndicale restaient plutôt obscures à bien des égards : d'une part, la FORA se concevait comme une organisation de travailleurs anarchistes plutôt que comme un syndicat "de tous les travailleurs" mais, d'autre part, elle avait émergé et se concevait comme une formation de type syndical organisant des grèves et autres formes d'action de classe.
Malgré la nature incertaine de ces divergences, celles-ci ont donné lieu à des confrontations animées lors du 4e Congrès de la CNT à Madrid en 1931, avec deux approches défendues principalement par la CGT-SR 9 française d'une part et par la FORA, d'autre part. Damier fait les remarques suivantes sur les visions de la FORA : "Les conceptions de la FORA contiennent une critique, brillante pour l'époque, du caractère aliénant et destructeur du système industriel-capitaliste : les propositions de la FORA anticipaient d'un demi-siècle les recommandations et les prescriptions du mouvement écologique contemporain. Néanmoins, leur critique présentait une faiblesse importante : un refus catégorique d'élaborer des notions plus concrètes sur la société de l'avenir, comment y accéder et comment s'y préparer. Selon la pensée des théoriciens argentins, cela aurait porté atteinte à la spontanéité révolutionnaire et à la créativité des masses elles-mêmes. Les ouvriers anarchistes argentins insistaient sur le fait que la réalisation du socialisme n'était pas une question de préparation technique et organisationnelle, mais plutôt la diffusion des sentiments de liberté, d'égalité et de solidarité" (Vadim Damier, "l'Anarcho-syndicalisme au XXe siècle" pp 110-11).
La perspicacité de la FORA concernant la nature des rapports sociaux capitalistes – comme ceux qui s'expriment dans la forme syndicale - sont certes intéressants, mais ce qui frappe une grande partie de ces débats est leur point de départ erroné, leur manque de méthode qui découle de leur rejet du marxisme ou même de l'absence de volonté pour discuter avec les courants marxistes authentiques de l'époque. La critique du matérialisme historique par la FORA ressemble plus à une critique d'une version rigidement déterministe du marxisme, typique de la deuxième Internationale et des partis staliniens. Encore une fois, elle a eu raison d'attaquer la nature aliénée de la production capitaliste et de récuser l'idée que le capitalisme était progressiste en lui-même - surtout dans une période où les relations sociales capitalistes avaient déjà prouvé qu'elles-mêmes étaient devenues un obstacle fondamental au développement humain ; mais leur rejet apparent de l'industrie en tant que telle était tout aussi abstrait et a abouti à une nostalgie passéiste pour les communes rurales locales.
Peut-être plus important a été l'absence de tout lien entre ces débats et des expériences parmi les plus importantes de la lutte de classes dans la nouvelle époque inaugurée par les grèves de masse en Russie en 1905 et la vague révolutionnaire internationale de 1917-23. Ces développements mondiaux et historiques, qui bien sûr incluent également la Première Guerre impérialiste, avaient déjà démontré l'obsolescence des formes anciennes d'organisation ouvrière (partis de masses et syndicats) et donné naissance à de nouvelles : d'un côté les soviets ou conseils ouvriers, constitués dans la chaleur de la lutte et non pas mis en place comme une structure préexistante à celle-ci ; de l'autre côté, l'organisation de la minorité communiste qui n'est plus considérée comme un parti de masse agissant principalement sur le terrain de la lutte pour les réformes. La formation des syndicats révolutionnaires ou industriels dans la dernière partie du XIXe siècle et dans les décennies qui suivirent a été en grande partie une tentative de la part d'une fraction radicale du prolétariat pour s'adapter à la nouvelle époque sans renoncer aux vieilles conceptions syndicalistes (et même sociale-démocrates) prônant la mise en place progressive d'une organisation de masse des travailleurs à l'intérieur du capitalisme, dans le but ultime de prise de contrôle de la société dans une phase de crise aiguë. La suspicion de la FORA envers l'idée de construire la nouvelle société dans la coquille de l'ancienne était justifiée. Cependant, sans aucune référence sérieuse à l'expérience de la grève de masse et de la révolution, dont la dynamique essentielle avait été brillamment analysée par Rosa Luxemburg dans "Grève de masse, parti et syndicats", écrit en 1906, ou aux nouvelles formes d'organisation que Trotsky, par exemple, avait reconnues comme étant un produit de la révolution de 1905 en Russie et d'une importance cruciale, la FORA retomba dans un espoir diffus d'une transformation soudaine et totale et semblait incapable d'examiner les liens réels entre les luttes défensives du prolétariat et la lutte pour la révolution.
La brochure Communisme libertaire de Isaac Puente
Dans les débats de 1931, la majorité de la CNT espagnole se rangea du côté des anarchosyndicalistes plus traditionnels. Mais les idées "communautaires" ont persisté et le programme de Saragosse de 1936, basé sur la brochure de Puente, contenait des éléments des deux.
La brochure de Puente 10 exprime clairement un point de vue prolétarien et son but ultime, le communisme "libertaire", est ce que nous appellerions simplement le communisme, une société fondée sur le principe, comme le dit Puente, "de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins". Dans le même temps, elle constitue une manifestation assez claire de la pauvreté théorique au cœur de la vision anarchiste du monde.
Un longue partie au début du texte est consacrée à argumenter contre tous les préjugés qui font valoir que les travailleurs sont ignorants et stupides, incapables de s'émanciper eux-mêmes, ayant du mépris pour la science, l'art et la culture, qu'ils ont besoin d'une élite intellectuelle, un architecte "social" ou un pouvoir policier, pour administrer la société en leur nom. Cette polémique est parfaitement justifiée. Et pourtant quand il écrit que "ce que nous appelons le sens commun, une compréhension rapide des choses, la capacité intuitive, l'initiative et l'originalité ne sont pas des choses qui peuvent être achetées ou vendues dans les universités", nous nous souvenons que la théorie révolutionnaire n'est pas simplement le bon sens, que ses propositions, étant dialectiques, sont généralement considérés comme outrageuses et absurdes du point de vue du "bon vieux sens commun" que Engels ridiculise dans Socialisme utopique et socialisme scientifique . La classe ouvrière n'a pas besoin d'éducateurs au-dessus d'elle pour s'affranchir du capitalisme, mais elle a absolument besoin d'une théorie révolutionnaire qui permet aller au-delà de la simple apparence et de comprendre les processus plus profonds à l'œuvre dans la société.
Les insuffisances de l'anarchisme à ce niveau se révèlent dans toutes les thèses principales présentées dans le texte de Puente. Au sujet des moyens qu'utilise la classe ouvrière pour confronter et renverser le capitalisme, Puente, à l'image des débats de l'AIT à l'époque, ne tient pas compte de toute la dynamique de la lutte des classes à l'époque de la révolution, qui émerge avec la grève de masse et le surgissement de la forme Conseil. Au lieu de voir que les organisations qui effectueront la transformation communiste expriment une rupture radicale avec les vieilles organisations de classe qui ont été incorporés dans la société bourgeoise, Puente insiste sur le fait que "le communisme libertaire repose sur les organisations qui existent déjà, grâce auxquelles la vie économique dans les villes et villages peut être développée à la lumière des besoins particuliers de chaque localité. Ces organismes sont le syndicat et la municipalité libre". C'est ici où Puente allie syndicalisme et communautarisme : dans les villes, les syndicats prendront le contrôle de la vie publique, à la campagne ce sera les assemblées traditionnelles de village. Les activités de ces organes sont envisagées principalement en termes locaux : ils peuvent également fédérer et former des structures nationales là où c'est nécessaire, mais selon Puente le produit en excédent d'unités économiques locales doit être échangé avec celui des autres. En d'autres termes, ce communisme libertaire peut coexister avec des relations de valeur, et on ne sait pas si c'est une mesure transitoire ou quelque chose qui va exister à perpétuité.
Pendant ce temps, cette transformation se déroule au moyen de "l'action directe" et non à travers l'engagement dans la sphère politique, laquelle est entièrement identifiée avec l'État actuel. Au moyen d'un comparatif entre "organisation basée sur la politique, qui est une caractéristique commune à tous les régimes basés sur l'État, et les organisations basées sur l'économie, dans un régime qui évite l'État", Puente dessine le caractère hiérarchique et exploiteur de l'État et lui oppose la vie démocratique des syndicats et des municipalités libres, basée sur les décisions prises par les assemblées et sur des besoins communs. Il y a deux problèmes fondamentaux dans cette approche : tout d'abord, elle échoue complètement à expliquer que les syndicats – y inclus les syndicats anarcho-syndicalistes comme la CNT - n'ont jamais été des modèles d'auto-organisation ou de démocratie mais sont soumis à une forte pression pour s'intégrer dans la société capitaliste et à devenir eux-mêmes des institutions bureaucratiques qui tendent à se fondre avec l'État. Et deuxièmement, il ignore la réalité de la révolution, dans laquelle la classe ouvrière est nécessairement confrontée à une conjonction de problèmes qui sont inévitablement politiques : l'autonomie organisationnelle et théorique de la classe ouvrière vis-à-vis des partis et des idéologies de la bourgeoisie, la destruction de l'État capitaliste et la consolidation de ses propres organes du pouvoir. Ces lacunes profondes dans le programme libertaire devaient être brutalement mises en lumière par la réalité de la guerre qui a éclaté en Espagne peu après le Congrès de Saragosse.
Mais il y a un autre problème non moins décisif : l'incapacité du texte à prendre en compte la dimension internationale, ce qui explique sa perspective strictement nationale. Il est vrai que le premier parmi les nombreux "préjugés" réfutés dans le texte est "la conviction que la crise n'est que temporaire". Comme ce fut le cas pour Maximoff, la grande dépression des années 30 semble avoir convaincu Puente que le capitalisme est un système en déclin, et le paragraphe suivant le sous-titre a au moins une dimension plus globale, mentionnant la situation de la classe ouvrière en Italie et en Russie. Mais il n'y a pas de tentative d'aucune sorte pour évaluer le rapport de force entre les classes, une tâche primordiale pour les révolutionnaires après une période de 20 ans à peine qui avait connu la Guerre mondiale, une vague révolutionnaire internationale et la série de défaites catastrophiques pour le prolétariat. Et, quand il s'agit d'examiner le potentiel pour le communisme libertaire en Espagne, c'est presque comme si le monde extérieur n'existait pas : il y a une longue partie consacrée à estimer les ressources économiques de l'Espagne, jusqu'aux oranges et pommes de terre, au coton, au bois et à l'huile. Tout l'objectif de ces calculs est de montrer que l'Espagne pourrait exister comme un îlot autosuffisant de communisme libertaire. Bien sûr, Puente estime que "l'introduction du communisme libertaire dans notre pays, isolé parmi les nations de l'Europe, apportera avec lui l'hostilité des nations capitalistes. Prétextant la défense des intérêts de ses sujets, l'impérialisme bourgeois tentera d'intervenir par la force des armes pour écraser notre système à sa naissance". Mais cette intervention sera être entravée par la menace ou bien d'une révolution sociale dans le pays de l'agresseur ou bien de la guerre mondiale contre les autres puissances. Les capitalistes étrangers pourront toutefois préférer employer des armées de mercenaires plutôt que leur propre armée, comme ils l'ont fait en Russie : dans les deux cas, les travailleurs devront être prêts à défendre la révolution les armes à la main. Mais les autres États bourgeois pourraient également chercher à imposer un blocus économique, soutenu par des navires de guerre. Et cela pourrait être un vrai problème car l'Espagne ne dispose pas de certaines ressources essentielles, en particulier du pétrole, et serait obligée de l'importer. La solution à un blocus sur les importations, cependant, n'est pas difficile à trouver : "il est vital que nous rassemblions toutes nos énergies dans la prospections de nouveaux puits de pétrole... le pétrole peut (aussi) être obtenu en distillant de l'Anthracite et de la lignite, dont nous disposons en abondance dans ce pays".
En résumé : pour créer le communisme libertaire, l'Espagne doit devenir autarcique. C'est une pure vision de l'anarchie dans un seul pays 11. Cette incapacité à partir du point de vue du prolétariat mondial allait s'avérer constituer une autre erreur fatale quand l'Espagne est devenue le théâtre d'un conflit impérialiste mondial.
Les événements de 36-37 : révolution sociale ou guerre impérialiste ?
Le modèle anarcho-syndicaliste de la révolution tel qu'exposé dans le texte de Puente et le programme de Saragosse devaient être définitivement mis en lumière et réfutés par les événements historiques importants, déclenchés par le coup d'État franquiste en juillet 1936.
Ce n'est certainement pas l'endroit pour écrire un récit détaillé de ces événements. Nous pouvons nous limiter en rappelant leur schéma général, dans le but de réaffirmer la vision de la gauche communiste à l'époque, à savoir : l'incohérence congénitale de l'idéologie anarchiste était devenue un véhicule pour la trahison de la classe ouvrière.
Il n'y a pas de meilleure analyse des premiers instants de la guerre en Espagne que l'article publié dans le journal de la Fraction de gauche italienne, Bilan n° 34, octobre-novembre 1936 et republié dans la Revue Internationale n° 6 12. Il a été écrit presque immédiatement après les événements par les camarades de Bilan, sans doute après avoir trié une masse d'informations très confuses et déroutantes. C'est remarquable la façon dont ces camarades sont parvenus à dissiper le brouillard dense des mystifications entourant la "révolution espagnole", que ce soit dans la version la plus médiatisée à l'époque par les puissants médias contrôlés par les démocrates et les staliniens, c’est-à-dire une sorte de révolution démocratique bourgeoise contre la réaction féodale-fasciste ; ou bien dans la version des anarchistes et trotskistes qui, tout en présentant la lutte en Espagne comme une révolution sociale étant allé beaucoup plus loin que n'importe quel moment atteint en Russie en 1917, a également servi à renforcer l'opinion dominante selon laquelle la lutte constituait une barrière populaire contre l'avancée du fascisme en Europe.
L'article de Bilan reconnaît sans hésitation que, face à l'attaque de la droite, la classe ouvrière, surtout dans son fief de Barcelone, a répondu avec ses propres armes de classe : la grève spontanée de masse, les manifestations de rue, la fraternisation avec les soldats, l'armement général des travailleurs, la formation de comités de défense et des milices basés sur les quartiers, l'occupation des usines et l'élection des comités d''usine. Bilan a également reconnu que c'était les militants de la CNT-FAI qui avaient partout joué un rôle de premier plan dans ce mouvement qui, par ailleurs, avait embrassé la majorité de la classe ouvrière de Barcelone.
Et pourtant, c'est précisément à ce moment, alors que la classe ouvrière était au bord de la prise du pouvoir politique dans ses propres mains, que les faiblesses programmatiques de l'anarchisme, son insuffisance théorique, devaient s'avérer un handicap mortel.
Tout d'abord, l'échec de l'anarchisme à comprendre le problème de l'État a conduit non seulement à laisser échapper la possibilité d'une dictature prolétarienne – parce que l'anarchisme est "contre tous les types de dictature" – mais peut-être plus important encore, à désarmer totalement les ouvriers face à des manœuvres de la classe dirigeante qui a réussi à reconstituer un pouvoir d'État avec des formes nouvelles et "radicales", étant donné que ses forces traditionnelles avaient été paralysées par le soulèvement prolétarien. Des instruments clés de ce processus ont été le Comité Central des milices contre le fascisme et le Conseil Central de l'économie :
"La constitution du Comité Central des milices devait donner l'impression de 1'ouverture d’une phase de pouvoir prolétarien et la constitution du Conseil Central de l'Economie l'illusion que l'on entrait dans la phase de la gestion d'une économie prolétarienne.
Pourtant, loin d'être des organismes de dualité des pouvoirs, il s'agissait bien d'organismes ayant une nature et une fonction capitalistes, car au lieu de se constituer sur la base d'une poussée du prolétariat cherchant des formes d'unité de lutte afin de poser le problème du pouvoir, ils furent, dès l'abord, des organes de collaboration avec l'État capitaliste.
Le C.C. des milices de Barcelone sera d'ailleurs un conglomérat de partis ouvriers et bourgeois et de syndicats et non un organisme du type des soviets surgissant sur une base de classe, spontanément, et où puisse se vérifier une évolution de la conscience des ouvriers. Il se reliera à la Généralité pour disparaître avec un simple décret lorsque sera constitué, en octobre, le nouveau gouvernement de la Catalogne.
Le C.C. des milices représentera l'arme inspirée par le capitalisme pour entraîner, par l'organisation des milices, les prolétaires en dehors des villes et de leurs localités, vers les fronts territoriaux où ils se feront massacrer impitoyablement, il représentera l'organe qui rétablira l'ordre en Catalogne, non avec les ouvriers, mais contre ceux-ci, qui seront dispersés sur les fronts. Certes, l'armée régulière sera pratiquement dissoute, mais elle sera reconstituée graduellement avec les colonnes de miliciens dont l'État-major restera nettement bourgeois, avec les Sandino, les Villalba et consorts. Les colonnes seront volontaires, elles pourront le rester jusqu'au moment où finiront la griserie et l'illusion de la révolution et réapparaîtra la réalité capitaliste. Alors on marchera à grands pas vers le rétablissement officiel de l'armée régulière et vers le service obligatoire."
La participation immédiate de la CNT et du POUM (Parti Ouvrier d'Unification Marxiste", situé quelque part entre la gauche de la social-démocratie et le trotskisme) dans ces institutions bourgeoises a été un grand coup contre la possibilité pour les organes de classe créés dans les rues et les usines pendant les jours de juillet de se centraliser et d'établir un authentique double pouvoir. Au contraire, ces derniers ont été rapidement vidés de leur contenu prolétarien et incorporés dans les nouvelles structures du pouvoir bourgeois.
Deuxièmement, une question politique brûlante n'était pas confrontée et, faute d'une analyse des tendances historiques au sein même de la société capitaliste, les anarchistes n'avaient aucune méthode pour y faire face : la nature du fascisme et de ce que Bordiga appelait son "pire produit", l'antifascisme. Si la montée du fascisme a été l'expression d'une série de défaites historiques de la révolution prolétarienne, préparant ainsi la société bourgeoise pour un deuxième massacre inter-impérialistes, l'antifascisme n'était pas moins un cri de ralliement pour une guerre impérialiste, pas moins un appel aux travailleurs pour abandonner la défense de leurs propres intérêts de classe au nom d'une "union sacrée" nationale. C'est surtout cette idéologie de l'unité contre le fascisme qui a permis à la bourgeoisie d'écarter le danger de la révolution prolétarienne en détournant la lutte de classe dans les villes vers un conflit militaire à l'avant, sur le front. L'appel à sacrifier tout pour la lutte contre Franco a conduit même les plus passionnés défenseurs du communisme libertaire, comme Durruti, à accepter cette grande manœuvre. Les milices, en étant incorporées dans un organe comme le Comité Central des Milices Antifascistes, dominé par les partis et syndicats tels que la gauche républicaine et nationaliste, les socialistes et les staliniens, qui se sont ouvertement opposés à la révolution prolétarienne, sont devenus des instruments dans une guerre entre deux factions capitalistes, un conflit qui presque immédiatement s'est transformé en un champ de bataille inter-impérialiste général, une répétition pour la prochaine Guerre mondiale. Leurs formes démocratiques, telles que l'élection des officiers, n'y a fondamentalement pas changé quoi que ce soit. C'est vrai que les principales forces bourgeoises de commandement – les staliniens et les républicains – n'ont jamais été à l'aise avec ces formes et, plus tard, insistèrent pour qu'elles se fondent complètement dans une armée bourgeoise traditionnelle, comme l'avait prédit Bilan. Mais également comme Bilan l'a compris, le coup fatal avait déjà été porté dans les premières semaines après le coup d'État militaire.
Il en a été de même avec l'exemple le plus évident de la faillite de la CNT, la décision de quatre de ses dirigeants les plus connus, y compris l'ancien radical Garcia Oliver, de devenir ministres dans le gouvernement central de Madrid, acte de trahison aggravé par leur infâme déclaration selon laquelle, grâce à leur participation au sein du ministère, l'État républicain "avait cessé d'être une force oppressive contre la classe ouvrière, tout comme l'État ne représente plus l'organisme qui divise la société en classes. Et les deux tendront encore moins à opprimer le peuple du fait de l'intervention de la CNT" 13. Il s'agissait de la dernière étape d'une trajectoire qui avait été préparée longtemps à l'avance par la lente dégénérescence de la CNT. Dans une série d'articles sur l'histoire de la CNT, nous avons montré que la CNT, malgré ses origines prolétariennes et les convictions profondément révolutionnaires d'un grand nombre de ses militants, n'a pas pu résister au sein du capitalisme, dans son époque du totalitarisme d'État, à la tendance sans merci pour les organisations ouvrières permanentes de masse à être intégrées à l'État. Cela avait déjà été démontré bien avant les événements de juillet, comme lors des élections de février 1936, quand la CNT a abandonné son abstentionnisme traditionnel en faveur de l'appui tactique à un vote pour la République 14. Et dans la période immédiatement après le coup d'État de Franco, quand le gouvernement républicain était à la dérive totale, le processus de la participation des anarchistes dans l'État bourgeois s'est accéléré à tous les niveaux. Ainsi, bien avant le scandale des quatre ministres anarchistes, la CNT avait déjà rejoint le gouvernement régional de Catalogne, la Generalidad, et au niveau local – sans doute conformément à sa notion plutôt vague de 'municipalités libres' – des militants anarchistes étaient devenus des représentants et des responsables des organes de l'administration locale, c'est-à-dire les unités de base de l'État capitaliste. Comme pour la trahison de la social-démocratie en 1914, ce n'était pas seulement une question de quelques mauvais chefs, mais le produit d'un processus graduel d'intégration de l'ensemble de l'appareil organisationnel dans la société bourgeoise et son État. Bien sûr, au sein de la CNT-FAI et dans le mouvement anarchiste plus large, à l'intérieur et en dehors de l'Espagne, il y eut des voix prolétariennes contre cette trajectoire, même si, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cet article, peu d'entre elles ont réussi à remettre en cause les racines théoriques sous-jacentes de la trahison.
Ah, mais qu'en est-il des collectivisations ? Les anarchistes les plus dévoués et courageux, comme Durruti, n'ont-ils pas insisté sur le fait que l'approfondissement de la révolution sociale était la meilleure façon de vaincre Franco ? Est-ce que ce ne sont pas avant tout les exemples des usines et fermes autogérées, les tentatives de se débarrasser de la forme salariale dans de nombreux villages dans toute l'Espagne, qui en ont convaincu beaucoup, voire des marxistes comme Grandizo Munis 15, que la révolution sociale en Espagne avait atteint des sommets inconnus en Russie, avec sa descente rapide dans le capitalisme d'État ?
Mais Bilan rejetait toute idéalisation des occupations d'usine :
"Lorsque les ouvriers reprirent le travail, là où les patrons avaient fui ou furent fusillés par les masses, se constituèrent des Conseils d'Usine qui furent 1'expression de 1'expropriation de ces entreprises par les travailleurs. Ici intervinrent rapidement les syndicats pour établir des normes tendant à admettre une représentation proportionnelle là où se trouvaient des membres de la CNT et de l'UGT. Enfin, bien que la reprise du travail s’effectua avec la demande des ouvriers de voir appliquées la semaine de 36 heures, l'augmentation des salaires, les syndicats intervinrent pour défendre la nécessité de travailler à plein rendement pour l'organisation de la guerre sans trop respecter une réglementation du travail et des salaires.
Immédiatement étouffés, les comités d’usine, les comités de contrôle des entreprises où l'expropriation ne fut pas réalisée (en considération du capital étranger ou pour d'autres considérations) se transformèrent en des organes devant activer la production et, par-là, furent déformés dans leur signification de classe. Il ne s'agissait pas d'organismes créés pendant une grève insurrectionnelle pour renverser l'État, mais d'organismes orientés vers l'organisation de la guerre, condition essentielle pour permettre la survivance et le renforcement de cet État." (Ibid)
Damier ne s'appesantit pas trop sur les conditions dans les usines "contrôlées par les travailleur". Il est significatif qu'il passe plus de temps à examiner les formes démocratiques des sociétés des collectifs villageois, leur profonde préoccupation pour le débat et l'auto-éducation par le biais des assemblées de comités régulières et élues, leurs tentatives d'en finir avec le salariat. Il s'agissait d'efforts héroïques en effet mais les conditions de l'isolement rural avaient rendu moins urgent un assaut – par la ruse ou la force ouverte – de la part de l'État capitaliste sur les collectivités villageoises. En somme, ces changements dans la campagne n'ont pas altéré le processus général de récupération bourgeoise qui se concentrait sur les villes et les usines, où la discipline au travail pour l'économie de guerre de l'État capitaliste a été imposée rapidement et de façon impitoyable et n'aurait pas pu l'être sans la fiction d'un "contrôle syndical" par l'intermédiaire de la CNT :
"Le fait le plus intéressant dans ce domaine est le suivant : à l'expropriation des entreprises en Catalogne, à leur coordination effectuée par le Conseil de l'Economie en août, au décret d'octobre du gouvernement donnant les normes pour passer à la "collectivisation", succéderont, chaque fois, de nouvelles mesures pour soumettre les prolétaires à une discipline dans les usines, discipline que jamais ils n'auraient toléré de la part des anciens patrons. En Octobre, la CNT lancera ses consignes syndicales où elle interdira les luttes revendicatives de toute espèce et fera de l'augmentation de la production le devoir le plus sacré du prolétaire. A part le fait que nous avons déjà rejeté la duperie Soviétique qui consiste à assassiner physiquement les prolétaires au nom "de la construction d'un socialisme", que personne ne distingue encore, nous déclarons ouvertement qu'à notre avis, la lutte dans les entreprises ne cesse pas un seul moment tant que subsiste la domination de l'État capitaliste. Certainement, les ouvriers devront faire des sacrifices après la révolution prolétarienne, mais jamais un révolutionnaire ne pourra prêcher la fin de la lutte revendicative pour arriver au socialisme. Même pas après la révolution, nous n'enlèverons l'arme de la grève aux ouvriers et il va de soi que lorsque le prolétariat n'a pas le pouvoir - et c'est le cas en Espagne - la militarisation de 1’usine équivaut à la militarisation des usines de n'importe quel État capitaliste en guerre." (Bilan, op. cit.)
Bilan s'appuie ici sur l'axiome que la révolution sociale et la guerre impérialiste sont des tendances diamétralement opposées dans la société capitaliste. La défaite de la classe ouvrière – idéologique en 1914, physique et idéologique dans les années 1930 - ouvre la voie à la guerre impérialiste. La lutte de classe en revanche ne peut être menée qu'au détriment de l'économie de guerre. Grèves et mutineries ne renforcent pas l'effort de guerre national. Ce furent les irruptions révolutionnaires de 1917 et 1918 qui ont obligé les impérialismes belligérants à mettre immédiatement fin aux hostilités.
Il en va de même pour la guerre révolutionnaire. Mais elle peut uniquement être menée lorsque la classe ouvrière est au pouvoir, ce sur quoi Lénine et ceux qui se sont ralliés à lui dans le parti bolchevique ont été très clairs dans la période de février à octobre 1917. Et même dans ce cas, les exigences d'une guerre révolutionnaire menée sur les fronts territoriaux ne créent pas les meilleures conditions pour l'épanouissement de la puissance de la classe et pour une transformation sociale radicale, loin s'en faut. Ainsi entre 1917 et 1920, l'État soviétique a défait les forces contre-révolutionnaires internes et externes au niveau militaire, mais à un prix très élevé : l'érosion du contrôle politique de la classe ouvrière et l'autonomisation de l'appareil d'État.
Cette opposition fondamentale entre guerre impérialiste et révolution sociale a été doublement confirmée par les événements de mai 37.
Ici à nouveau, mais cette fois face à une provocation des staliniens et autres forces de l'État, qui ont tenté de s'emparer du central téléphonique alors contrôlé par les travailleurs, le prolétariat de Barcelone a répondu massivement et avec ses propres méthodes de lutte : grève de masse et barricades. Le "défaitisme révolutionnaire" prôné par la Gauche italienne, fustigé par pratiquement toutes les tendances politiques, des libéraux à des groupes comme Union Communiste, comme étant de la folie et une traîtrise a été mis en pratique par les travailleurs de Barcelone. C'était essentiellement une réaction de défense à une attaque par les forces répressives de l'État républicain mais, une fois de plus, elle a opposé les travailleurs à l'ensemble de la machine d'État, dont les porte-paroles les plus éhontés n'ont pas hésité à les dénoncer comme des traîtres, comme les saboteurs de l'effort de guerre. Et, implicitement, c'était en effet un défi direct à la guerre contre le fascisme, pas moins que la mutinerie de Kiel de 1918 avait été un défi à l'effort de guerre de l'impérialisme allemand et, par extension, au conflit inter-impérialiste dans son ensemble.
Les défenseurs ouverts de l'ordre bourgeois devaient répondre par la terreur brutale contre les travailleurs. Des révolutionnaires ont été arrêtés, torturés, tués. Camillo Berneri, l'anarchiste italien qui avait ouvertement exprimé ses critiques à la politique de collaboration de la CNT a été parmi les nombreux militants enlevés et tués, dans la majorité des cas par les voyous du parti "communiste". Mais la répression ne s'est vraiment abattue sur les travailleurs qu'une fois avoir été persuadés de déposer les armes et de retourner travailler par les porte-paroles de la "gauche", de la CNT et du POUM, qui étaient surtout terrifiés par une fracture dans le front antifasciste. La CNT – comme le SPD dans la révolution allemande de 1918 – était indispensable à la restauration de l'ordre bourgeois.
Dans la deuxième partie de cet article, nous examinerons certaines des tendances anarchistes qui ont dénoncé les trahisons de la CNT au cours de la guerre en Espagne – telles que les amis de Durruti en 1937-38, ou un représentant plus récent de l'anarcho-syndicalisme, comme Solidarity Federation en Grande-Bretagne. Nous essaierons de montrer que, bien qu'il se soit agi de saines réactions prolétariennes, celles-ci ont rarement remis en question les faiblesses sous-jacentes du "programme" anarchiste.
C D Ward
1. Dans la série "Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [10e partie]". Volume I. Revue Internationale n° 79. https://fr.internationalism.org/rinte79/comm.htm [56].
2. Dans notre article de la Revue Internationale n° 120, "L'anarcho-syndicalisme face à un changement d'époque : la CGT jusqu'à 1914" (https://fr.internationalism.org/rint/120_cgt [14]), nous avons souligné que cette orientation de certains courants anarchistes vers les syndicats reposait plus sur la recherche d'un public plus réceptif à leur propagande que sur une réelle compréhension de la nature révolutionnaire de la classe ouvrière.
4. https://nefac.net/node/677 [58]
5. "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme". https://fr.internationalism.org/rint146/pour_les_revolutionnaires_la_gra... [59].
6. En anglais, Black Cat Press, Edmonton, 2009 et initialement publié en russe en russe en 2000. Damier est un membre du KRAS, la section russe de l'AIT. Le CCI a publié un certain nombre de ses déclarations internationalistes sur les guerres dans l'ex-URSS.
7. Fédération Ouvrière Régionale Argentine
8. Traduit de l'anglais par nos soins, à partir de l'ouvrage suivant Anarchism in Argentina and Uruguay in Anarchism Today, édité par David Apter and James Joll Macmillan, 1971. Également accessible sur Internet à l'adresse suivante https://www.libcom.org/files/Argentina.pdf [60].
9. Cette organisation – le SR signifie "Syndicaliste Révolutionnaire" – a été le résultat d'une scission en 1926 avec la CGT "officielle" qui, à l'époque, était dominée par le parti socialiste. Elle est restée un groupe relativement petit et a disparu sous le régime de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Son principal porte-parole lors du Congrès de Saragosse était Pierre Besnard.
10. Accessible en anglais sur le lien https://www.libcom.org/library/libertarian-communism [61]
. "Si ce mode de penser nous paraît au premier abord tout à fait évident, c'est qu'il est celui de ce qu'on appelle le bon sens. Mais si respectable que soit ce compagnon tant qu'il reste cantonné dans le domaine prosaïque de ses quatre murs, le bon sens connaît des aventures tout à fait étonnantes dès qu'il se risque dans levaste monde de la recherche ; et la manière de voir métaphysique, si justifiée et même si nécessaire soit elle dans de vastes domaines dont l'étendue varie selon la nature de l'objet, se heurte toujours, tôt ou tard, à une barrière au-delà de laquelle elle devient étroite, bornée, abstraite, et se perd en contradictions insolubles: la raison en est que, devant les objets singuliers, elle oublie leur enchaînement; devant leur être, leur devenir et leur périr : devant leur repos, leur mouvement; les arbres l'empêchent de voir la forêt". Chapitre II. https://www.marxists.org/francais/marx/80-utopi/utopi-2.htm [62]
11. Notre article sur la CGT, cité à la note 2, soulève la même question à propos d'un livre produit par deux leaders de l'organisation anarcho-syndicaliste française en 1909: "La lecture du livre de Pouget et Pataud Comment nous ferons la révolution, que nous avons déjà cité, est très instructive à cet égard, dans le sens que celui-ci décrit une révolution purement nationale. Les deux auteurs anarcho-syndicalistes n'ont pas attendu Staline pour envisager la construction de "l'anarchisme dans un seul pays" : la révolution ayant réussi en France, tout un passage du livre est consacré à la description du système de commerce extérieur qui continue de s'opérer selon le mode commercial, alors qu'à l'intérieur des frontières nationales, on produit selon un mode communiste".
12. Revue Bilan : "Leçons d'Espagne 1936 (2eme partie)". https://fr.internationalism.org/rinte6/bilan2.htm [63]
13. Traduit de l'anglais par nos soins à partir de Vernon Richards, Lessons of the Spanish Revolution, chapter VI, p 69.
14. Voir à ce sujet la série sur l'histoire de la CNT dans les n° 129 à 133 de la Revue Internationale, en particulier l'article "L'antifascisme, la voie de la trahison de la CNT (1934-1936)". https://fr.internationalism.org/rint133/l_antifascisme_la_voie_de_la_tra... [64]
15. Munis a été une figure de proue du groupe bolchévique-léniniste en Espagne qui était lié à la tendance de Trotsky. Plus tard, il rompt avec le trotskisme sur la question de son soutien à la Seconde Guerre mondiale et évolue vers de nombreuses positions de la gauche communiste. https://fr.internationalism.org/rinte58/Munis_militant_revolutionnaire.htm [65].
Nous avons publié des polémiques avec le groupe fondé plus tard par Munis, Fomento Obrero Revolucionario, sur sa vision de la guerre d'Espagne : https://fr.internationalism.org/rinte29/corresp.htm [66] https://fr.internationalism.org/rinte52/for.htm [67]
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [68]
Rubrique:
Revue Internationale n°154 - 2e semestre 2014
- 2400 lectures
100 ans après la Première Guerre mondiale, la lutte pour les principes prolétariens demeure pleinement d'actualité
- 1422 lectures
Il y a cent ans, la guerre entre dans une nouvelle année de massacres. Elle devait être "terminée pour Noël", mais Noël est passé et la guerre est toujours là.
A partir du 24 décembre, des fraternisations sur les lignes de front ont donné lieu à la "Trêve de Noël". De leur propre initiative et au grand dam des officiers, les soldats – ouvriers ou paysans en uniforme – sont sortis spontanément de leurs tranchées pour échanger bière, cigarettes, et nourriture. Pris de court, les Etats-Majors n'ont pas su réagir sur le champ.
Les fraternisations posent la question : que serait-il passé s'il y avait eu un parti ouvrier, une Internationale, capable de leur donner une vision plus large, de les faire fructifier pour devenir une opposition consciente non seulement à la guerre mais à ses causes ? Mais les ouvriers sont abandonnés par leurs partis : pire, ces partis sont devenus les sergents-recruteurs de la classe dominante. Derrière les pelotons d'exécution qui attendent les déserteurs et les mutins, se tiennent des ministres "socialistes". La trahison des partis socialistes dans la plupart des pays belligérants fait que l'Internationale socialiste s'effondre, incapable de faire appliquer les résolutions contre la guerre adoptées par le congrès de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912 : cet effondrement est le thème d'un des articles de ce numéro.
L'année 1915 s'ouvre. Il n'y aura plus de "Trêve de Noël" : les Etats-Majors, inquiets, feront appliquer la discipline et tonner les canons le Noël prochain afin de tuer dans l'œuf toute velléité de mettre fin à la guerre de la part des soldats et des ouvriers.
Et pourtant, péniblement et sans plan d'ensemble, la résistance ouvrière ressurgit. En 1915 il y aura encore des fraternisations sur le front, de grandes grèves dans la vallée du Clyde en Ecosse, des manifestations d'ouvrières allemandes contre le rationnement. De petits groupes, comme Die Internationale (où milite Rosa Luxembourg) ou le groupe Lichtstrahlen en Allemagne, rescapés de la ruine des partis de l'Internationale, s'organisent malgré la censure et la répression. En septembre, certains participeront à la première conférence internationale des socialistes contre la guerre, à Zimmerwald en Suisse. Cette conférence, et les deux qui suivront, s'affronteront aux mêmes problèmes posés à la 2e Internationale : est-il possible de mener une politique de "paix" sans passer par la révolution prolétarienne ? Peut-on envisager une reconstruction de l'Internationale sur la base de l'unité d'avant 1914 qui s'est avérée apparente et non réelle, ?
Cette fois, c'est la gauche qui va gagner la bataille, et la 3e Internationale qui sortira de Zimmerwald sera explicitement communiste, révolutionnaire, et centralisée : ce sera la réponse à la faillite de l'Internationale, tout comme les Soviets en 1917 seront la réponse à la faillite du syndicalisme.
Il y a presque 30 ans (en 1986) nous avons commémoré le 70e anniversaire de Zimmerwald dans un article publié dans cette Revue. Six ans après l'échec des Conférences internationales de la Gauche communiste 1 nous écrivions : "Comme à Zimmerwald, le regroupement des minorités révolutionnaires se pose aujourd'hui de façon brûlante (...) Face aux enjeux actuels, la responsabilité historique des groupes révolutionnaires est posée. Leur responsabilité est engagée dans la formation du parti mondial de demain, dont l'absence aujourd'hui se fait cruellement sentir (...) L'échec des premières tentatives de conférences (1977-80) n'invalide pas la nécessité de tels lieux de confrontation. Cet échec est relatif : il est le produit de l'immaturité politique, du sectarisme et de l'irresponsabilité d'une partie du milieu révolutionnaire qui paie encore le poids de la longue période de contre-révolution (...) Demain, de nouvelles conférences des groupes se revendiquant de la Gauche se tiendront...".2
Force est de constater que nos espoirs, notre confiance d'alors ont souffert une amère déception. Des groupes ayant participé aux Conférences, seuls restent le CCI et la TCI (ex-BIPR, créé par Battaglia Comunista d'Italie et la CWO de Grande Bretagne peu après les Conférences). 3 Si la classe ouvrière ne s'est pas laissé enrôler sous les drapeaux dans une guerre impérialiste généralisée, elle n'a pas non plus su opposer sa propre perspective à la société bourgeoise. De ce fait, la lutte de classe n'a pas imposé aux révolutionnaires de la Gauche communiste un minimum des sens des responsabilités : les Conférences n’ont jamais été renouvelées, et nos appels répétés à un minimum d’action commune des internationalistes (notamment lors des guerres du Golfe dans les années 1990 et 2000) sont restés sans réponse et lettre morte. L'anarchisme nous offre un spectacle encore plus affligeant, si c'était possible. Avec les guerres en Ukraine et en Syrie, c'est la débandade dans le nationalisme et l'antifascisme dont peu s'en sortent avec honneur (le KRAS en Russie est une exception admirable).
Dans cette situation, caractéristique de la décomposition sociale ambiante, le CCI n'a pas été épargné. Notre organisation est secouée par une crise profonde, qui exige de nous une réflexion théorique et une mise en question toute aussi profonde pour y faire face. C'est le thème de l'article sur notre récente Conférence extraordinaire, également publié dans ce numéro.
Les crises ne sont jamais une situation confortable, mais sans crises il n'y a pas de vie, et elles peuvent être à la fois nécessaires et salutaires. Comme souligne notre article, s'il y a une leçon à tirer de la trahison des partis socialistes et de l'effondrement de l'Internationale, c'est que la voie tranquille de l'opportunisme mène à la mort et à la trahison, et que la lutte politique de la gauche révolutionnaire ne s'est jamais faite sans heurts et sans crises.
CCI, décembre 2014
1 Nous renvoyons le lecteur non informé sur ces conférences à notre article de la Revue internationale n° 22, "Le sectarisme, un héritage de la contrerévolution à dépasser" ; https://fr.internationalism.org/rinte22/conference.htm [70]..
2 Revue internationale n°44, 1er Trimestre 1986.
3 Le GCI étant passé du côté de la bourgeoisie en soutenant le Sentier lumineux péruvien.
Evènements historiques:
Rubrique:
Première Guerre mondiale: comment s'est produite la faillite de la Deuxième internationale
- 4350 lectures
Depuis plus de dix ans, le vacarme lointain des armes faisait écho en Europe, celui des guerres coloniales d'Afrique et des crises marocaines (1905 et 1911), celui de la guerre russo-japonaise de 1904, celui des guerres balkaniques. Les ouvriers d'Europe faisaient confiance à l'Internationale pour tenir à distance la menace d'un conflit généralisé. Les contours de la guerre à venir – déjà prévue par Engels en 1887 1 - se dessinaient de plus en plus clairement, année après, année, au point que les Congrès de Stuttgart en 1907 et de Bâle en 1912 la dénoncèrent clairement : ce n'était pas une guerre défensive mais une guerre de concurrence impérialiste, de pillage et de rapine. L'Internationale et ses partis membres avaient constamment prévenu les ouvriers du danger et menacé de renverser les classes dominantes si elles osaient défier la classe ouvrière, puissante et organisée, et lâcher leurs meutes guerrières. Et pourtant, en août 1914, l'Internationale se désintégra, emportée comme poussière insignifiante tandis que, l'un après l'autre, ses leaders et ses députés aux parlements trahissaient leurs promesses solennelles, votaient les crédits de guerre et appelaient les ouvriers à la boucherie. 2
Comment un tel désastre a-t-il pu se produire ? Karl Kautsky, auparavant le théoricien le plus en vue de l'Internationale, faisait porter la responsabilité sur les ouvriers : "Qui osera affirmer que 4 millions de prolétaires allemands conscients peuvent, sur la simple injonction d'une poignée de parlementaires, faire en 24 heures demi-tour à droite et prendre le contre-pied de leurs objectifs antérieurs ? Si cela était exact, cela témoignerait, certes, d'une terrible faillite non seulement de notre parti, mais aussi de la masse (souligné par Kautsky). Si cette masse était un troupeau de moutons à tel point dépourvus de caractère, il ne nous resterait plus qu'à nous laisser enterrer." 3 Bref, si quatre millions d'ouvriers allemands se laissèrent emmener de force dans la guerre, c'était de leur propre gré, cela n'avait rien à voir avec les parlementaires qui, avec le soutien de la majorité de leurs partis, avaient voté les crédits et qui, en France et en Grande-Bretagne, se firent très vite une place dans des gouvernements bourgeois d'unité nationale. À cette excuse pitoyable et lâche, Lénine apporta une réponse cinglante : "Pensez donc : en ce qui concerne l'attitude à l'égard de la guerre, seule une "poignée de parlementaires" (ils ont voté en toute liberté, protégés par le règlement ; ils pouvaient parfaitement voter contre ; même en Russie, on n'a été ni frappé, ni molesté, ni même arrêté pour autant), une poignée de fonctionnaires, de journalistes, etc., a pu se prononcer avec quelque liberté (c'est-à-dire sans être immédiatement arrêtés et conduits à la caserne, sans courir le risque d'être immédiatement passés par les armes). Aujourd'hui, Kautsky rejette noblement sur les masses la trahison et la veulerie de cette couche sociale dont la liaison avec la tactique et l'idéologie de l'opportunisme a été soulignée des dizaines de fois par ce même Kautsky pendant des années !" 4
Trahis par leurs dirigeants, leurs organisations se changeant en une nuit d'organisations de lutte pour la défense des ouvriers en sergents recruteurs de la boucherie, les ouvriers en tant qu'individus se retrouvaient isolés et seuls à devoir confronter la toute puissance militaire de l'appareil d'État. Comme l'écrivit plus tard un syndicaliste français : "Je n'ai qu'un reproche à me faire (...) ce reproche, c'est - étant antipatriote, antimilitariste - d'être parti comme mes camarades au 4ème jour de la mobilisation. Je n'ai pas eu, quoique ne reconnaissant pas de frontières, ni de patrie, la force de caractère pour ne pas partir. J'ai eu peur, c'est vrai, du poteau d'exécution. J'ai eu peur... Mais, là-bas, sur le front, pensant à ma famille, traçant au fond de ma tranchée le nom de ma femme et de mon fils, je disais : "Comment est-il possible que moi, antipatriote, antimilitariste, moi qui ne reconnais que l'Internationale, je vienne donner des coups à mes camarades de misère et peut-être pour mourir contre ma propre cause, mes propres intérêts, pour des ennemis ?" ". 5
Dans toute l'Europe, les ouvriers avaient fait confiance à l'Internationale, ils avaient cru aux résolutions contre la guerre à venir, adoptées à plusieurs reprises lors de ses congrès. Ils avaient fait confiance à l'Internationale, cette expression la plus haute de la puissance de la classe ouvrière organisée, pour arrêter le bras criminel de l'impérialisme capitaliste.
En juillet 1914, alors que la menace de guerre se faisait de plus en plus imminente, le Bureau de l'Internationale socialiste (BSI) – l'organe le plus analogue à un organe central de l'Internationale – convoqua une réunion d'urgence à Bruxelles. Au début, les dirigeants des partis présents avaient du mal à croire qu'une guerre généralisée puisse vraiment éclater mais au moment où le Bureau se réunit, le 29 juillet, l'Autriche-Hongrie avait déclaré la guerre à la Serbie et imposé la loi martiale. Victor Adler, président du parti social-démocrate d'Autriche, intervint pour dire que son parti était impuissant, aucune tentative n'était prévue pour résister à la mobilisation ni à la guerre elle-même. Aucun plan n'avait été fait pour que le parti entre dans la clandestinité et continue illégalement son activité. La discussion se perdit en délibérations sur le changement de lieu du prochain congrès de l'Internationale qui était prévu à Vienne : aucune action pratique ne fut envisagée. Oubliant tout ce qui avait été dit lors des congrès précédents, les dirigeants continuaient à faire confiance à la diplomatie des grandes puissances pour empêcher la guerre d'éclater, inconscients du fait que, cette fois-ci, toutes les puissances inclinaient à la guerre – ou ils ne voulaient pas le voir.
Le délégué britannique, Bruce Glasier 6, écrivit que "bien que le péril effroyable d'une éruption généralisée de la guerre fût le sujet principal des délibérations, personne, pas même les représentants allemands, ne semblait envisager que puisse avoir lieu une rupture véritable entre les grandes puissances tant que toutes les ressources de la diplomatie n'avaient pas été épuisées." 7 Jaurès déclara même que "le gouvernement français veut la paix et travaille au maintien de la paix. Le gouvernement français est le meilleur allié de la paix de cet admirable gouvernement anglais qui a pris l’initiative de la médiation". 8
Après la réunion du BSI, des milliers d'ouvriers belges se rassemblèrent pour écouter les dirigeants de l'Internationale prendre la parole contre la menace de guerre. Jaurès fit l'un de ses plus grands discours contre la guerre et les ouvriers l'acclamèrent.
Mais un orateur resta remarquablement silencieux : Rosa Luxemburg, la combattante la plus clairvoyante et la plus indomptable de tous, refusa de parler, rendue malade par la veulerie et l'auto-illusion de tout ce qu'elle voyait autour d'elle ; elle seule pouvait voir la lâcheté et la trahison qui allaient emporter les partis socialistes dans le soutien aux ambitions impérialistes de leurs gouvernements nationaux.
Une fois la guerre ouverte, les traitres socialistes de tous les pays belligérants proclamèrent qu'il s'agissait d'une guerre "défensive" : en Allemagne, la guerre avait lieu pour défendre la "culture" allemande contre la barbarie cosaque de la Russie tsariste, en France, c'était pour défendre la république française contre l'autocratie prussienne, en Grande-Bretagne pour défendre "la petite Belgique". 9 Lénine démolit ces prétextes hypocrites, rappelant aux lecteurs les promesses solennelles que les dirigeants de la Deuxième Internationale avaient faites, au Congrès de Bâle en 1912, de s'opposer non seulement à la guerre en général mais à cette guerre impérialiste en particulier dont depuis longtemps le mouvement ouvrier avait vu les préparatifs : "La résolution de Bâle ne parle pas de la guerre nationale, de la guerre du peuple, dont on a vu des exemples en Europe et qui sont même typiques pour la période 1789-1871, ni de la guerre révolutionnaire que les sociaux-démocrates n'ont jamais juré de ne pas faire ; elle parle de la guerre actuelle, engagée sur le terrain de "l'impérialisme capitaliste" et des "intérêts dynastiques", sur le terrain de la "politique de conquête" des deux groupes de puissances belligérantes, du groupe austro-allemand comme du groupe anglo-franco-russe. Plékhanov, Kautsky et consorts trompent tout bonnement les ouvriers en reprenant le mensonge intéressé de la bourgeoisie de tous les pays, qui multiplie ses efforts pour présenter cette guerre de rapine impérialiste, coloniale, comme une guerre populaire, défensive (pour qui que ce soit), et en cherchant à la justifier par des exemples historiques relatifs à des guerres non impérialistes." 10
Sans centralisation, pas d'action possible
Comment fut-il possible que l'Internationale à qui les ouvriers faisaient tant confiance, se soit avérée incapable d'agir ? En réalité, sa capacité d'action était plus apparente que réelle : le BSI était un simple organisme de coordination dont le rôle se réduisait en grande partie à organiser les congrès et à servir de médiateur dans les conflits ayant lieu entre les partis socialistes ou au sein de ceux-ci. Bien que l'aile gauche de l'Internationale – autour de Lénine et de Luxemburg en particulier – ait considéré les résolutions des congrès contre la guerre comme de véritables engagements, le BSI n'avait aucun pouvoir pour les faire respecter ; il n'avait pas de possibilité de mener une action indépendante des partis socialistes de chaque pays – encore moins à l'encontre de leurs désirs – et en particulier du plus puissant d'entre eux : le parti allemand. En fait, bien que le Congrès de fondation de l'Internationale ait eu lieu en 1889, le BSI ne fut pas constitué avant le Congrès de 1900 : jusque-là, l'Internationale n'existait en effet que pendant les sessions des congrès. Le reste du temps, elle n'était pas grand-chose de plus qu'un réseau de relations personnelles entre les différents dirigeants socialistes, dont beaucoup s'étaient connu personnellement pendant les années d'exil. Il n'y avait même pas de réseau formel de correspondance. August Bebel s'était même plaint auprès d'Engels en 1894 du fait que tous les liens avec les autres partis socialistes étaient entièrement entre les mains de Wilhelm Liebknecht : "se mêler des relations de Liebknecht avec l'étranger est tout simplement impossible. Personne ne sait à qui il écrit ni ce qu'il écrit ; il ne parle de ça à personne". 11
Le contraste avec la Première Internationale (l'Association internationale des Travailleurs, AIT) est frappant. Le premier acte de l'AIT à la suite de sa fondation en 1864 à St Martin's Hall (Londres) lors d'une réunion d'ouvriers britanniques et français pour la plupart, fut de formuler un projet de programme organisationnel et de constituer un Conseil général – organisme centralisateur de l'Internationale. Une fois les statuts rédigés, un grand nombre d'organisations en Europe (des partis politiques, des syndicats, même des coopératives) se joignirent à l'organisation sur la base des statuts de l'AIT. Malgré les tentatives de "L'Alliance" de Bakounine de le saboter, le Conseil général, élu par les congrès de l'AIT, bénéficiait de toute l'autorité d'un véritable organe centralisateur.
Ce contraste entre les deux Internationales était lui-même le produit d'une situation historique nouvelle et confirmait en fait les paroles prémonitoires du Manifeste communiste : "Bien qu'elle ne soit pas, quant au fond, une lutte nationale, la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie en revêt cependant d'abord la forme. Le prolétariat de chaque pays doit, bien entendu, en finir avant tout avec sa propre bourgeoisie." 12 Après la défaite de la Commune de Paris en 1871, le mouvement ouvrier est entré dans une période de forte répression et s'est réduit, en particulier en France – où des milliers de Communards furent tués ou exilés dans les pénitenciers des colonies – et en Allemagne où le SDAP (prédécesseur du SPD) dut travailler clandestinement sous les lois antisocialistes de Bismarck. Il était clair que la révolution n'était pas immédiatement à l'ordre du jour comme l'avaient espéré beaucoup de révolutionnaires, y compris Marx et Engels, au cours des années 1860. Economiquement et socialement, les trente années qui vont de 1870 à 1900 13 allaient connaître une période d'expansion massive du capitalisme, à la fois en son sein avec la croissance de la production de masse et de l'industrie lourde au détriment des classes artisanales, et à l'extérieur du monde capitaliste avec l'expansion vers de nouveaux territoires, aussi bien en Europe même qu'au-delà des océans, en particulier aux États-Unis et dans un nombre croissant des possessions coloniales des grandes puissances. Ceci voulait aussi dire une énorme augmentation du nombre d'ouvriers : au cours de cette période, la classe ouvrière devait en effet se transformer d'une masse amorphe d'artisans et de paysans déplacés en une classe du travail associé capable d'affirmer sa propre perspective historique et de défendre ses intérêts économiques et sociaux immédiats. En fait, ce processus avait déjà été annoncé par la Première Internationale : "…les seigneurs de la terre et les seigneurs du capital se serviront toujours de leurs privilèges politiques pour défendre et perpétuer leurs privilèges économiques. Bien loin de pousser à l'émancipation du travail, ils continueront à y opposer le plus d'obstacles possible. (…) La conquête du pouvoir politique est donc devenue le premier devoir de la classe ouvrière. Elle semble l'avoir compris, car en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en France, on a vu renaître en même temps ces aspirations communes, et en même temps aussi des efforts ont été faits pour réorganiser politiquement le parti des travailleurs." 14
Par sa nature même, du fait des conditions de l'époque, cette auto-formation de la classe ouvrière allait prendre des formes spécifiques au développement historique de chaque pays et être déterminée par celui-ci. En Allemagne, les ouvriers luttèrent d'abord dans les conditions difficiles de clandestinité imposées par les lois antisocialistes de Bismarck sous lesquelles la seule action légale possible était au parlement, et où les syndicats se développèrent sous couvert du parti socialiste. En Grande-Bretagne, qui était toujours la puissance industrielle européenne la plus développée, la défaite écrasante de grand mouvement politique du Chartisme en 1848 avait discrédité l'action politique ; l'énergie organisationnelle des ouvriers était en grande partie dédiée à la construction de syndicats ; les partis socialistes restèrent petits et insignifiants sur la scène politique. En France, le mouvement ouvrier était divisé entre Marxistes (le "Parti ouvrier" de Jules Guesde fondé en 1882), Blanquistes inspirés par la tradition révolutionnaire de la grande Commune de Paris (le "Comité révolutionnaire central" de Édouard Vaillant), Réformistes (connus sous le nom de "possibilistes") et syndicats, groupés dans la CGT et fortement influencés par les idées du syndicalisme révolutionnaire. Inévitablement, toutes ces organisations luttaient pour développer l'organisation et l'éducation des ouvriers et pour acquérir des droits politiques et syndicaux contre leur classe dominante respective et donc au sein du cadre national.
Le développement d'organisations syndicales de masse et d'un mouvement politique de masse participa également à redéfinir les conditions dans lesquelles travaillaient les révolutionnaires. L'ancienne tradition blanquiste – l'idée d'un petit groupe conspiratif de révolutionnaires professionnels qui prend le pouvoir avec le soutien plus ou moins passif des masses – était dépassée, la nécessité de construire des organisations de masse l'avait remplacée, des organisations qui forcément devaient opérer dans un certain cadre légal. Le droit de s'organiser, de tenir des assemblées, le droit de libre parole, tout cela devint d'un intérêt vital pour le mouvement de masse : inévitablement, toutes ces revendications étaient une fois de plus posées dans le cadre spécifique de chaque nation. Pour prendre un seul exemple : tandis que les socialistes français pouvaient avoir des députés élus au parlement de la république qui détenait un pouvoir législatif effectif, en Allemagne, le gouvernement ne dépendait pas du Reichstag (le parlement impérial) mais des décisions autocratiques du Kaiser en personne. Il était donc bien plus facile pour les allemands de maintenir une attitude de refus rigoureux d'alliance avec les partis bourgeois puisqu'il était hautement improbable qu'ils soient appelés à le faire ; à quel point cette position de principe était fragile se vit dans la façon dont elle fut ignorée par le SPD dans le Sud de l'Allemagne dont les députés votèrent régulièrement en faveur des propositions de budget par les Landtags régionaux (parlements régionaux).
Néanmoins, au fur et à mesure que les mouvements ouvriers dans plusieurs pays émergeaient d'une période de réaction et de défaite, la nature par définition internationale du prolétariat se réaffirma. En 1887, le Congrès du Parti allemand se tint à St Gallen en Suisse et décida de prendre l'initiative d'organiser un congrès international ; la même année, la réunion du TUC britannique (Trade Unions Congress) à Swansea vota en faveur d'une conférence internationale qui défendrait la journée de huit heures. 15 Ceci mena à la tenue d'une réunion préliminaire, en novembre 1888 à Londres, à l'invitation du comité parlementaire du TUC, à laquelle des délégués de plusieurs pays assistèrent, mais aucun d'Allemagne. Ces deux initiatives simultanées firent rapidement apparaître une scission fondamentale au sein du mouvement du travail, entre les réformistes dirigés par les syndicats britanniques et les possibilistes français d'une part, et les marxistes révolutionnaires dont l'organisation la plus importante était le SDAP d'Allemagne (les syndicats britanniques étaient en fait opposés à toute participation à des initiatives d'organisations politiques).
En 1889 – 100e anniversaire de la Révolution française qui était toujours une référence pour tous ceux qui aspiraient au renversement de l'ordre existant – il se tint non pas un mais deux congrès ouvriers internationaux à Paris : le premier appelé par les possibilistes français, le deuxième par le Parti ouvrier marxiste 16 de Jules Guesde. Le déclin des possibilistes qui a suivi, a fait que le congrès marxiste (appelé d'après le lieu de sa tenue, salle Petrelle) fut ensuite considéré comme le Congrès de fondation de la Deuxième Internationale. Inévitablement, le Congrès était marqué par l'inexpérience et beaucoup de confusion : confusion sur la question très controversée de la validation des mandats des délégués, ainsi que sur les traductions dont se chargeaient les membres de cette assemblée polyglotte qui étaient disponibles. 17 Les aspects les plus importants du Congrès ne furent donc pas ses décisions pratiques mais d'abord et avant tout, le fait qu'il ait eu lieu et ensuite la personnalité des délégués. De France participèrent les gendres de Marx, Paul Lafargue et Charles Longuet, ainsi que Edouard Vaillant, héros de la Commune ; d'Allemagne, Wilhelm Liebknecht et August Bebel ainsi qu'Edouard Bernstein et Klara Zetkin ; de Grande-Bretagne, le représentant le mieux connu était William Morris et c'était en soi indicatif de l'arriération du socialisme britannique puisque les membres de la Socialist League n'étaient que quelques centaines. Un temps fort du Congrès fut la poignée de mains échangée entre les présidents Vaillant et Liebknecht, symbole de la fraternité internationale des socialistes français et allemands.
Dans son évaluation de l'Internationale en 1948, la Gauche communiste de France a donc raison de mettre en avant deux caractéristiques. D'abord, elle "marque une étape de différenciation entre la lutte économique des salariés et la lutte politique sociale. Dans cette période de plein épanouissement de la société capitaliste, la Deuxième Internationale est l’organisation de la lutte pour des réformes et des conquêtes politiques, l’affirmation politique du prolétariat." En même temps, le fait que l'Internationale fut explicitement fondée comme organisation révolutionnaire marxiste "marqu[ait] une étape supérieure dans la délimitation idéologique au sein du prolétariat, en précisant et élaborant les fondements théoriques de sa mission historique révolutionnaire". 18
Le Premier Mai et la difficulté de l'action unifiée
La Deuxième Internationale était fondée mais n'avait pas encore de structure organisationnelle permanente. N'existant que pendant ses congrès, elle n'avait pas de moyen de faire appliquer les résolutions adoptées par ceux-ci. Ce contraste entre l'apparente unité internationale et la pratique des particularités nationales apparut de façon évidente dans la campagne pour la journée de huit heures, centrée sur la manifestation du Premier Mai, qui était l'une des préoccupations majeures de l'Internationale au cours des années 1890.
La résolution la plus importante du Congrès de 1889 fut probablement celle proposée par le délégué français Raymond Lavigne : les ouvriers de tous les pays devaient s'engager dans la campagne pour la journée de huit heures, décidée à St Louis par le Congrès de la American Federation of Labour en 1888, sous la forme de manifestations de masse et d'un arrêt de travail général tous les ans le jour du Premier Mai. Cependant, il apparut rapidement que les socialistes et les syndicats avaient, selon les pays, une idée très différente de ce que signifiaient les célébrations du Premier Mai. En France, en partie du fait de la tradition syndicaliste révolutionnaire des syndicats, le Premier Mai allait vite devenir l'occasion de manifestations massives, menant à des confrontations avec la police : en 1891, à Fourmies dans le Nord, la troupe tira sur une manifestation ouvrière, faisant dix morts dont des enfants. En Allemagne, par contre, les conditions économiques difficiles encourageaient les patrons à transformer les grèves en lock-out, et se combinaient aux réticences des syndicats et du SPD à accepter qu'une intervention extérieure à l'Allemagne dicte leur action, même si elle venait de l'Internationale ; il y avait donc une forte tendance à ne pas appliquer la résolution et à se limiter à la tenue de meetings à la fin de la journée de travail. Les syndicats britanniques partageaient la même réticence.
Le fait que le Parti socialiste le plus puissant d'Europe sonnât ainsi la retraite alarma les Français et les Autrichiens et, lors du Congrès de l'Internationale en 1893 à Zürich, le dirigeant socialiste autrichien Victor Adler proposa une nouvelle résolution qui insistait sur le fait que le Premier Mai devait être l'occasion d'un véritable arrêt de travail : la résolution fut adoptée contre les voix de la majorité des délégués allemands.
Trois mois après seulement, le Congrès du SPD à Cologne réduisait la portée de la résolution de l'Internationale et déclarait qu'elle ne devait être appliquée que par les organisations qui pensaient qu'il était vraiment possible d'arrêter le travail.
L'histoire des arrêts de travail du Premier Mai illustre deux aspects importants qui déterminèrent la capacité – ou l'incapacité – de l'Internationale à agir comme un seul corps. D'une part, il était impossible de ne pas voir que ce qui était possible dans un pays ne l'était pas nécessairement dans un autre : Engels lui-même était dubitatif vis-à-vis des résolutions sur le Premier Mai précisément pour cette raison, craignant que les syndicats allemands ne se discréditent en prenant des engagements qu'ils ne pourraient en fin de compte pas honorer. D'autre part, le fait même d'agir dans un cadre national, combiné aux effets dissolvants du réformisme et de l'opportunisme au sein du mouvement, avait tendance à rendre les partis et les syndicats nationaux jaloux de leurs prérogatives : c'était particulièrement vrai pour les organisations allemandes puisque le parti y étant le plus important de tous, il était encore plus réticent à se voir dicter ses orientations par des partis plus restreints qui auraient dû – c'est ce que pensaient les dirigeants allemands – suivre son exemple.
Les difficultés rencontrées dans cette première tentative d'action internationale unie présageaient mal du futur, quand l'Internationale aurait à agir pour des enjeux bien plus importants.
L'illusion de l'inévitabilité
Lors de la réunion de la salle Pétrelle, non seulement l'Internationale fut fondée mais encore elle fut fondée en tant qu'organisation marxiste. A ses débuts, le marxisme de la Deuxième Internationale, dominé par le parti allemand et, en particulier, par Karl Kautsky qui était responsable de la revue théorique du SPD, la Neue Zeit, avait fortement tendance à avoir une vision du matérialisme historique défendant l'inévitabilité de la transformation du capitalisme en socialisme. C'était déjà évident dans la critique inattendue faite par Kautsky à la proposition de programme du SPD par le Vorstand (le comité exécutif du Parti) qui devait être adopté au Congrès d'Erfurt de 1891. Dans un article publié dans la Neue Zeit, Kautsky décrivait le communisme comme "une nécessité résultant directement de la tendance historique des méthodes de production capitalistes" et critiquait la proposition du Vorstand (rédigé par le dirigeant plus âgé du SPD, Wilhelm Liebknecht) pour faire découler le communisme "non des caractéristiques de la production actuelle mais des caractéristiques de notre parti (…) L'enchaînement de la pensée dans la proposition du Vorstand est le suivant : les méthodes actuelles de production créent des conditions insupportables ; nous devons donc les éliminer. (…) A notre avis, l'enchaînement correct est le suivant : les méthodes actuelles de production créent des conditions insupportables ; cependant, elles créent aussi la possibilité et la nécessité du communisme." 19 Finalement, la proposition de Kautsky d'insister sur la "nécessité inhérente" du socialisme a été intégrée dans le préambule théorique du Programme d'Erfurt. 20
Il est certain que l'évolution du capitalisme rend le communisme possible. C'est également une nécessité pour l'humanité. Mais, dans la conception de Kautsky, c'est aussi de plus en plus quelque chose d'inévitable : la croissance des syndicats, les victoires électorales retentissantes de la social-démocratie, tout cela apparaissait comme le fruit d'une force irrésistible, prévisible avec une précision scientifique. En 1906, à la suite de la révolution russe de 1905, il écrivait que "une coalition des puissances européennes contre la Révolution, comme en 1793, n’est pas à prévoir. (…) Ce n’est donc pas à une coalition contre la Révolution qu’il faut s’attendre". 21 Dans sa polémique avec Pannekoek et Luxemburg, intitulée "La nouvelle tactique", il argumente ainsi : "Pannekoek envisage comme une conséquence naturelle de l'aiguisement des conflits de classe que les organisations prolétariennes soient détruites, que ni droit, ni loi ne les protègent plus. (…) Assurément, la tendance, l'aspiration à détruire les organisations prolétariennes croît chez l'adversaire au fur et à mesure que ces organisations se renforcent et deviennent plus dangereuses pour l'ordre existant. Mais tout autant s'accroît, alors la capacité de résistance de ces organisations, voire, sous nombre d'aspects, leur caractère irremplaçable. Priver le prolétariat de toute possibilité de s'organiser est devenu déjà chose impossible dans les pays capitalistes développés (…) Ainsi, on ne peut aujourd'hui détruire l'organisation prolétarienne que de manière provisoire…" 22
Au cours des dernières années du 19e siècle quand le capitalisme était encore ascendant – profitant de la grande expansion et de la prospérité qui allaient être appelées plus tard La Belle époque en opposition à la période d'après 1914 – l'idée que le socialisme serait un résultat naturel et inévitable du capitalisme constituait sans aucun doute une source de force pour la classe ouvrière. Cela donnait une perspective et une signification historiques à la tâche méticuleuse de construction des organisations syndicales et du parti et cela donnait aux ouvriers une grande confiance en eux-mêmes, dans leur lutte et dans l'avenir - cette confiance dans l'avenir est l'une des différences les plus frappantes dans la classe ouvrière entre le début du 20e siècle et le début du 21e.
L'histoire cependant ne progresse pas de façon linéaire et ce qui fut une force des ouvriers quand ils construisaient leurs organisations, allait se transformer en une dangereuse faiblesse. L'illusion de l'inévitabilité du passage au socialisme, l'idée qu'il pourrait être atteint de façon graduelle par la construction d'organisations ouvrières jusqu'à ce que, presque facilement, il puisse simplement occuper la place laissée vacante par une classe capitaliste dont "la propriété privée des moyens de production est devenue inconciliable avec un sage emploi et avec le plein développement de ces moyens de production" (Programme d'Erfurt), dissimulait le fait qu'une transformation profonde avait lieu dans le capitalisme du 20e siècle. La signification de ce changement des conditions, en particulier pour la lutte de classe, apparut de façon explosive dans la révolution russe de 1905 : soudain, de nouvelles méthodes d'organisation et de lutte – les soviets et la grève de masse – surgirent sur la scène. Tandis que la gauche du SPD – surtout Rosa Luxemburg dans sa célèbre brochure Grève de masse, parti et syndicats – comprenait la signification de ces conditions nouvelles et cherchait à stimuler le débat dans le parti allemand, la droite et les syndicats firent tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher toute discussion de la grève de masse tandis que, dans le SPD, il devenait de plus en plus difficile de publier des articles dans la presse du parti sur ce sujet.
Chez le centre et la droite du SPD, la confiance dans le futur s'était transformée en un aveuglement tel qu'en 1909, Kautsky pouvait écrire : "Maintenant, le prolétariat est devenu si puissant qu'il peut envisager une guerre avec plus de confiance. Nous ne pouvons plus parler d'une révolution prématurée, car il a déjà acquis une si grande force sur la base légale actuelle qu'on peut s'attendre à ce que la transformation de celle-ci créerait les conditions d'un progrès ultérieur.(…) Si la guerre éclatait malgré tout, le prolétariat est la seule classe qui pourrait tranquillement attendre son issue". (Le chemin du pouvoir)
L'unité obscurcit la division
Dans le Manifeste communiste, Marx nous rappelle que "la condition naturelle" des ouvriers sous le capitalisme est celle de la concurrence et de l'atomisation des individus : ce n'est que dans la lutte qu'ils peuvent réaliser une unité qui est elle-même la précondition vitale pour que la lutte réussisse. Ce n'est donc pas par hasard si la plupart des drapeaux syndicaux du 19e siècle portaient le slogan "l'unité c'est la force" ; le slogan exprimait la conscience qu'avaient les ouvriers du fait que l'unité était quelque chose pour quoi il fallait lutter et qu'il fallait sauvegarder précieusement une fois qu'on l'avait réalisée.
L'effort de chercher l'unité existe au sein et entre les organisations politiques de la classe ouvrière dans la mesure où elles n'ont pas d'intérêts distincts à défendre, ni pour elles, ni par rapport à la classe elle-même. Assez naturellement, cet effort vers l'unité trouve son expression la plus haute quand la lutte de classe est historiquement en train de se développer au point qu'il devient possible de créer un parti international : l'AIT en 1864, la Deuxième Internationale en 1889, la Troisième Internationale en 1919. Les trois Internationales elles-mêmes exprimaient l'unification politique grandissante au sein de la classe ouvrière : tandis que l'AIT avait comporté en son sein une très large gamme de positions politiques – des Proudhoniens et des Blanquistes jusqu'aux Lassalliens et aux Marxistes – la Deuxième Internationale s'était déclarée marxiste et les 21 conditions d'adhésion à la Troisième Internationale avaient l'objectif explicite de restreindre ses participants aux éléments communistes et révolutionnaires et de corriger précisément les facteurs qui avaient causé la faillite de la Deuxième, en particulier l'absence de toute autorité centralisatrice capable de prendre des décisions pour l'ensemble de l'organisation.
Néanmoins, toutes les Internationales furent de véritables lieux de débat et de lutte idéologique, y compris la Troisième : en témoigne par exemple la polémique de Lénine contre l'aile gauche et sa réponse à Herman Gorter.
La Deuxième Internationale était profondément dévouée à l'unité des différents partis socialistes, sur la base du fait qu'il y avait un seul prolétariat dans chaque pays, ayant les mêmes intérêts de classe, aussi il ne devait y avoir qu'un seul parti socialiste. Il y eut de constants efforts pour maintenir l'unité des Mencheviks et des Bolcheviks russes après 1903 mais la principale question au cours des premières années de l'Internationale fut l'unification des différents partis français. Cela atteignit un point critique en 1904 au Congrès d'Amsterdam où Jules Guesde présenta une résolution qui n'était en fait rien de plus qu'une traduction de celle adoptée l'année précédente par le SPD à Dresde, condamnant "les tactiques révisionnistes [dont le résultat] ferait qu'à la place d'un parti travaillant pour la transformation la plus rapide possible de la société bourgeoise existante en un ordre social socialiste, c'est à dire révolutionnaire dans le meilleur sens du terme, le parti deviendrait un parti se contentant de réformer la société bourgeoise". 23 C'était une condamnation explicite de l'entrée de Millerand 24 dans le gouvernement et implicite du réformisme du Parti socialiste français de Jean Jaurès. La motion de Guesde fut adoptée à une grande majorité et le Congrès se poursuivit en adoptant unanimement une motion réclamant l'unification des socialistes français : en avril suivant, le Parti socialiste et le Parti ouvrier s'unirent et formèrent la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO). C'est tout à l'honneur de Jaurès d'avoir accepté le vote de la majorité et abandonné ses convictions profondes 25 au nom de l'unité de l'Internationale. 26 Ce moment fut sans doute celui où l'Internationale fut le plus capable d'imposer le principe d'une unité d'action sur ses partis membres.
L'unité d'action, si nécessaire pour le prolétariat en tant que classe, peut être une arme à double tranchant dans les moments de crise. Et l'Internationale était justement en train d'entrer dans une période de crise avec l'augmentation des tensions entre puissances impérialistes et la menace de guerre qui se rapprochait. Comme l'écrivait Rosa Luxemburg : "En dissimulant les contradictions par "l'unité" artificielle de vues incompatibles, les contradictions ne peuvent qu'atteindre un sommet, jusqu'à ce qu'elles explosent violemment tôt ou tard dans une scission (...) Ceux qui mettent en avant les divergences de vue, et combattent les opinions divergentes, travaillent à l'unité du parti. Mais ceux qui dissimulent les divergences travaillent à une réelle scission dans le parti." 27
Nulle part ce danger n'était plus évident que dans les résolutions adoptées contre la menace imminente de la guerre. Les derniers paragraphes de la résolution de Stuttgart en 1907 disent ceci : "Si une guerre menace d'éclater, c'est le devoir des classes travailleuses des pays impliqués et de leurs représentants aux parlements, soutenus par l'activité coordonnée du Bureau socialiste international, d'unir tous leurs efforts pour empêcher l'éclatement de la guerre par les moyens qu'ils estiment les plus efficaces qui, naturellement, varient selon l'acuité de la lutte de classe et celle de la situation politique générale.
Au cas où la guerre éclate malgré tout, c'est leur devoir d'intervenir afin d'y mettre rapidement un terme et par tous les moyens d'utiliser la crise politique et économique créée par la guerre pour réveiller les masses et précipiter la chute de la domination de classe capitaliste."
Le problème est que cette résolution ne dit rien des moyens avec lesquels les partis socialistes devraient intervenir dans la situation : c'est seulement "les moyens qu'ils estiment les plus efficaces". Ceci mettait sous le tapis trois questions majeures.
La première était la grève de masse que la gauche du SPD n'avait eu de cesse de chercher à mettre en avant depuis 1905 contre l'opposition déterminée et largement réussie des opportunistes dans le parti et de la direction syndicale. Les socialistes français, Jaurès en particulier, étaient de fervents défenseurs de la grève générale comme moyen d'empêcher la guerre, bien qu'ils aient entendu par cela une grève organisée par les syndicats sur un modèle syndical et non le surgissement massif d'auto-activité du prolétariat qu'envisageait Rosa Luxemburg, dans un mouvement que le Parti devait stimuler mais ne pourrait lancer de façon artificielle. Il est notable qu'une tentative conjointe du français Edouard Vaillant et de l'écossais Keir Hardie au Congrès de Copenhague en 1910 de faire adopter une résolution engageant l'Internationale à lancer une action de grève générale en cas de guerre fut rejetée par la délégation allemande.
La deuxième était l'attitude que les socialistes de chaque pays devaient adopter si leur pays était attaqué : c'était une question critique puisque dans la guerre impérialiste, un des belligérants apparaît toujours comme "l'agresseur" et l'autre comme "l'agressé". L'époque des guerres nationales progressistes n'était pas loin et les causes nationales telles que l'indépendance de la Pologne ou de l'Irlande étaient toujours à l'ordre du jour socialiste : le SDKPiL 28 de Rosa Luxemburg était très minoritaire, même dans la gauche de l'Internationale, dans son opposition à l'indépendance de la Pologne. Dans la tradition française, la mémoire de la Révolution française et de la Commune de Paris était encore très vivace et on avait tendance à identifier la révolution à la nation : d'où la prise de position de Jaurès selon laquelle "la révolution est nécessairement active. Et elle ne peut l'être qu'en défendant l'existence nationale qui lui sert de base". 29 Pour les allemands, le danger de la Russie tsariste comme soutien "barbare" de l'autocratie prussienne était également un article de foi et, en 1891, Bebel pouvait écrire que "le sol de l'Allemagne, la patrie allemande nous appartient ainsi qu'aux masses tout autant qu'aux autres. Si la Russie, ce champion de la terreur et de la barbarie, venait à attaquer l'Allemagne (…), nous sommes aussi concernés que ceux qui sont à la tête de l'Allemagne". 30
Finalement, malgré toutes leurs déclarations sur les actions prolétariennes qui seraient menées contre la guerre, les dirigeants de l'Internationale (à l'exception de la gauche) continuaient à croire à la diplomatie des classes bourgeoises pour préserver la paix. De ce fait, tandis que le Manifeste de Bâle en 1912 déclarait : "Rappelons aux gouvernements que dans les conditions actuelles en Europe et avec l'état d'esprit de la classe ouvrière, ils ne peuvent déchaîner la guerre sans se mettre eux-mêmes en danger", il pouvait en même temps "considérer que les meilleurs moyens [pour surmonter l'hostilité entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne] doivent être la conclusion d'un accord entre l'Allemagne et l'Angleterre concernant la limitation des armements navals et l'abolition du droit de butin de guerre". Les classes ouvrières étaient appelées à faire de l'agitation pour la paix, non à se préparer au renversement révolutionnaire du capitalisme qui, seul, pouvait garantir cette paix : "Le Congrès fait donc appel à vous, prolétaires et socialistes de tous les pays, à faire entendre votre voix en cette heure décisive ! (…) veiller à ce que les gouvernements soient toujours conscients de la vigilance et de la volonté de paix passionnée de la part du prolétariat ! Au monde capitaliste de l'exploitation et du meurtre de masse, opposons le monde prolétarien de la paix et de la fraternité des peuples !"
L'unité de l'Internationale dont tout espoir d'action unie contre la menace de guerre dépendait, était donc fondée sur une illusion. L'Internationale était en réalité divisée en une aile droite et une aile gauche, la première prête et même impatiente de faire cause commune avec la classe dominante en défense de la nation, la deuxième qui préparait une réponse à la guerre par le renversement révolutionnaire du capital. Au 19e siècle, il était encore possible pour la droite et la gauche de coexister au sein du mouvement ouvrier et de participer à l'organisation des ouvriers comme classe consciente de ses propres intérêts ; avec l'ouverture de "l'époque des guerres et des révolutions", cette unité devint une impossibilité.
Jens (décembre 2014)
1 "Huit à dix millions de soldats s’entr’égorgeront ; ce faisant, ils dévoreront toute l’Europe comme jamais ne le fit encore une nuée de sauterelles. Les dévastations de la guerre de Trente ans, condensées en trois ou quatre années et répandues sur tout le continent : la famine, les épidémies, la férocité générale, tant des armées que des masses populaires, provoquée par l’âpreté du besoin, la confusion désespérée dans le mécanisme artificiel qui régit notre commerce, notre industrie et notre crédit, finissant dans la banqueroute générale. L’effondrement des vieux États et de leur sagesse politique routinière est tel que les couronnes rouleront par douzaines sur le pavé et qu’il ne se trouvera personne pour les ramasser ; l’impossibilité absolue de prévoir comment tout cela finira et qui sortira vainqueur de la lutte ; un seul résultat est absolument certain : l’épuisement général et la création des conditions nécessaires à la victoire finale de la classe ouvrière." Préface à la brochure de Sigismund Borkheim, cité par Lénine, "Paroles prophétiques", Pravda n°133, 2 juillet 1918 (Œuvres complètes, Tome 27, pages 526-527).
2 La Social-Démocratie serbe dont les députés refusèrent de soutenir la guerre malgré les obus qui tombaient sur Belgrade, fut une exception remarquable.
3 Cité par Lénine dans La faillite de la Deuxième Internationale, chapitre VI (Œuvres complètes, Tome 21, pages 242-243)
4 Ibid., page 243.
5 Cité par Édouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier (1871-1936), tome II. Version électronique mise en ligne par la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi. p. 155. https://classiques.uqac.ca/classiques/dolleans_edouard/hist_mouv_ouvrier... [71]
6 Membre du Conseil national du Independent Labour Party, opposé à la Première Guerre mondiale, il tomba malade d'un cancer en 1915 et fut incapable de jouer un rôle actif contre la guerre.
7 Cité par James Joll, The Second International, Routledge & Kegan Paul, 1974, p.165.
8 Cité par James Joll, ibid., p. 165 et dormirajamais.org/jaures-1 [72]. Ce que Jaurès ne savait pas car il ne rentra à Paris que le 29 juillet, c'est que le président français, Raymond Poincaré, avait fait un voyage en Russie et y avait fait tout son possible pour soutenir la détermination de la Russie à entrer en guerre ; Jaurès devait changer de point de vue sur les intentions du gouvernement français à son retour à Paris, dans les jours qui précédèrent son assassinat.
9 La classe dominante britannique gagne le prix de l'hypocrisie puisque l'invasion de la Belgique en vue d'attaquer l'Allemagne faisait partie de ses propres plans.
10 La faillite de la Deuxième Internationale, op.cit, chapitre I, page 213.
11 Cité par Raymond H Dominick, Wilhelm Liebknecht, University of North Carolina Press, 1982, p.344.
12 Chapitre I, "Bourgeois et prolétaires".
13 Cette expansion économique allait continuer jusqu’à la veille de la guerre.
14 Adresse inaugurale de l'Association internationale des Travailleurs, 1864.
15 Joll, op.cit., p. 28.
16 Entretemps, le parti avait pris le nom de Parti ouvrier français.
17 Les difficultés de traduction rappellent beaucoup celles des premiers congrès du CCI !
18 "Sur la nature et la fonction du parti politique du prolétariat", (Internationalisme n° 38 – octobre 1948), https://fr.internationalism.org/revue-internationale/201409/9122/nature-... [73]
19 Voir Raymond H. Dominick, Wilhelm Liebknecht, 1982, University of North Carolina Press, p361.
21 "Ancienne et nouvelle révolution", 9 décembre 1905, https://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1905/12/kautsky_19051209... [75]
22 "La nouvelle tactique", Neue Zeit, 1912 (in Socialisme, la voie occidentale, PUF 1983, page 360)
23 Cité par Joll, op.cit., p. 122.
24 Alexandre Millerand était un associé de Clémenceau et fut l'arbitre du conflit social de Carmaux en 1892. Il fut élu au parlement en 1885 en tant que socialiste radical et devait devenir le dirigeant de la fraction parlementaire du Parti socialiste de France de Jaurès. En 1899, il entra dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau qui était supposé défendre la République française contre les menaces des monarchistes et des militaires antidreyfusards – bien que la réalité de cette menace ait été sujette à débat comme l'a souligné Rosa Luxemburg. Selon Jaurès et Millerand lui-même, il entra dans le gouvernement à sa propre initiative et sans consulter le parti. L'affaire provoqua un scandale immense dans l'Internationale, à la fois parce que, en tant que ministre, il partageait la responsabilité collective de la répression par le gouvernement des mouvements ouvriers et parce que l'un de ses collègues ministres était le Général Galliffet qui avait été à la tête du massacre de la Commune de Paris en 1871.
25 Quels qu’aient pu être ses désaccords avec la façon dont Millerand est entré dans le gouvernement, Jaurès était un réformiste honnête, profondément convaincu de la nécessité pour la classe ouvrière d’utiliser la voie parlementaire pour arracher des réformes à la classe dominante.
26 Ce ne fut pas le cas d'A.Briand et de R.Viviani qui préférèrent quitter le parti plutôt qu'abandonner la perspective d'un portefeuille ministériel.
27 "Unser leitendes Zentralorgan", Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, Bd. 1/1, p. 558 (cité dans notre article sur la dégénérescence du SPD).
28 Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie.
29 Cité par Joll, op.cit, p. 115
30 Ibid., page 114
Conscience et organisation:
Evènements historiques:
Rubrique:
La guerre d'Espagne met en évidence les lacunes fatales de l'anarchisme (II): des voix dissidentes au sein du mouvement anarchiste
- 4696 lectures
Dans la première partie de cet article, nous avons examiné le processus qui a conduit à l'intégration de l'organisation officielle anarcho-syndicaliste, la Confédération nationale du travail (CNT), dans l'État républicain bourgeois en Espagne en 1936-37 et cherché à relier ces trahisons aux faiblesses programmatiques et théoriques sous-jacentes dans la vision du monde de l'anarchisme. Certes, ces capitulations ne sont pas restées sans opposition de la part de courants prolétariens à l'intérieur et à l'extérieur de la CNT : les Jeunesses libertaires, une tendance de gauche du Parti ouvrier d'unification marxiste (POUM) autour de Josep Rebull 1, le groupe bolchevique léniniste (trotskiste) autour de Grandizo Munis, l'anarchiste italien Camillo Berneri qui a édité Guerra di Classe, et en particulier les Amis de Durruti 2, animés entre autres par Jaime Balius. Tous ces groupes étaient composés dans une mesure plus ou moins grande de militants de la classe ouvrière ayant participé aux luttes héroïques de juillet 1936 et de mai 1937. Sans jamais parvenir à la clarté de la Gauche communiste italienne, comme nous l'avons souligné dans la première partie de cet article, ils se sont opposés à la politique officielle de la CNT et du POUM de participation dans l'État bourgeois et de briseur de grève pendant les journées de mai 1937.
Les Amis de Durruti
Les Amis de Durruti étaient peut-être la plus importante de toutes ces tendances. Ce groupe l'emportait numériquement largement sur les autres et a été en mesure de mener une intervention importante durant les journées de mai 1937, distribuant la célèbre brochure qui définit ses positions programmatiques :
"Le Groupe des Amis de Durruti" de la CNT-FAI. Travailleurs ! Junte révolutionnaire ! Tirez sur les coupables ! Désarmez les corps armés ! Socialisez l'économie ! Dissolvez les partis politiques qui se sont retournés contre la classe ouvrière ! Vous ne devez pas abandonner la rue ! La révolution avant tout ! Saluons nos camarades du POUM qui fraternisent avec nous dans la rue ! Vive la révolution sociale ! À bas la contre-révolution !"
Ce tract est une version courte de la liste des revendications que les Amis de Durruti avaient publiée sous la forme d'une affiche murale en avril 1937 :
"Le Groupe des Amis de Durruti. À la classe ouvrière :
1 - Constitution immédiate d’une Junte révolutionnaire formée par les ouvriers de la ville, de la campagne et par les combattants.
2 - Salaire familial. Carte de rationnement. Direction de l’économie et contrôle de la distribution par les syndicats.
3 - Liquidation de la contre-révolution.
4 - Création d’une armée révolutionnaire.
5 - Contrôle absolu de l’ordre public par la classe ouvrière.
6 - Opposition ferme à tout armistice.
7 - Justice prolétarienne.
8 - Abolition des échanges de prisonniers.
Travailleurs, attention ! Notre groupe s’oppose à l’avancée de la contre-révolution. Les décrets sur l’ordre public, soutenus par Aiguadé, ne seront pas appliqués. Nous exigeons la libération de Maroto et des autres camarades détenus.
Tout le pouvoir à la classe ouvrière.
Tout le pouvoir économique aux syndicats.
Contre la Généralité, la Junte révolutionnaire."
Les autres groupes, y compris les trotskistes, avaient tendance à voir les Amis de Durruti comme une avant-garde potentielle : Munis était même optimiste quant à son évolution vers le trotskisme. Mais peut-être l'aspect le plus important du Groupe des Amis de Durruti était que, bien qu'émergeant de la CNT elle-même, il ait reconnu l'incapacité de celle-ci à développer une théorie révolutionnaire et donc le programme révolutionnaire qu'exigeait, à son avis, la situation en Espagne. Agustin Guillamón attire notre attention sur un passage de la brochure Vers une nouvelle révolution, publiée en janvier 1938, où l'auteur, Balius, écrit:
"La CNT était totalement dépourvue de théorie révolutionnaire. Nous n'avions pas de programme concret. Nous ne savions pas où nous allions. Nous avions du lyrisme en abondance : mais quand tout est dit et fait, nous ne savions pas quoi faire avec nos masses de travailleurs ni comment donner de la substance à l'effusion populaire qui avait éclaté à l'intérieur de nos organisations. Ne sachant pas quoi faire, nous avons remis la révolution sur un plateau à la bourgeoisie et aux marxistes qui soutiennent la farce d'antan. Pire, nous avons fourni à la bourgeoisie une marge de manœuvre lui permettant de se reprendre, de se réorganiser et de se comporter comme le ferait un conquérant" 3
Comme indiqué dans notre article de la Revue internationale n° 102, "Anarchisme et communisme", la CNT avait en fait une théorie fumeuse à ce niveau - une théorie justifiant la participation dans l'État bourgeois, surtout au nom de l'antifascisme. Mais le Groupe des Amis de Durruti avait raison dans le sens plus général où le prolétariat ne peut pas faire la révolution sans une compréhension claire et consciente de la direction dans laquelle il se dirige, et c'est la tâche spécifique de la minorité révolutionnaire de développer et d'élaborer une telle compréhension, basée sur l'expérience de la classe dans son ensemble.
Dans cette quête de clarté programmatique, le Groupe des Amis de Durruti a été obligé de remettre en question certains postulats fondamentaux de l'anarchisme, notamment le rejet de la nécessité de la dictature du prolétariat et d'une avant-garde révolutionnaire combattant au sein de la classe ouvrière pour sa réalisation. Guillamón reconnaît clairement l'avancée faite par les Amis de Durruti sur ce plan, en particulier dans son analyse des articles que Balius a écrits en exil :
"Après une lecture de ces deux articles, il faut reconnaître que l'évolution de la pensée politique de Balius, basée sur une analyse de la richesse de l'expérience faite au cours de la guerre civile, l'avait conduit à aborder des questions taboues dans l'idéologie anarchiste : 1 La nécessité pour le prolétariat de prendre le pouvoir. 2 L'inéluctabilité de la destruction de l'appareil d'État capitaliste pour ouvrir la voie à une alternative prolétarienne. 3 Le rôle indispensable d'une direction révolutionnaire" 4. À part les réflexions de Balius, la notion d'une direction révolutionnaire était, dans l'activité pratique du groupe, plus implicite que formulée explicitement, et n'était pas vraiment compatible avec la définition que le Groupe des Amis de Durruti avait de lui-même, à savoir un "groupe d'affinité" ce qui, au mieux, implique une formation politique limitée dans le temps et à des objectifs spécifiques, et non une organisation politique permanente basée sur un ensemble défini de principes programmatiques et organisationnels. Mais la reconnaissance par le groupe de la nécessité d'un organe de pouvoir prolétarien est plus explicite. Elle est contenue dans l'idée de "junte révolutionnaire", dont il admettait qu'elle constituait un certain type d'innovation pour l'anarchisme : "nous introduisons une légère variation de l'anarchisme dans notre programme. La mise en place d'une junte révolutionnaire" 5. Munis, dans une interview au journal français trotskiste Lutte ouvrière, considère la junte comme équivalente à l'idée de soviet et ne doute pas que "Ce cercle de travailleurs révolutionnaires [les Amis de Durruti] représentait un début d'évolution de l'anarchisme en direction du marxisme. Il avait été conduit à remplacer la théorie du communisme libertaire par celle de la "junte révolutionnaire" (soviet) en tant qu'incarnation du pouvoir prolétarien, élu démocratiquement par les travailleurs" 6.
Dans son livre, Guillamón reconnaît cette convergence entre les "innovations" des Amis de Durruti et les positions classiques du marxisme, bien qu'il s'attache à réfuter toute idée selon laquelle le groupe aurait été directement influencé par les groupes marxistes avec lesquels il était en contact, comme les bolcheviks-léninistes. Le groupe lui-même aurait certainement rejeté avec colère l'"accusation" d'évoluer vers le marxisme, qu'il était à peine capable de distinguer de ses caricatures contre-révolutionnaires, comme en témoigne le passage reproduit précédemment de la brochure de Balius. Mais si le marxisme est effectivement la théorie révolutionnaire du prolétariat, il n'est pas surprenant que les prolétaires révolutionnaires, réfléchissant sur les leçons de la lutte de classe, soient amenés à ses conclusions fondamentales. La question de l'influence spécifique dans ce processus de tel ou tel groupe politique n'est pas négligeable mais elle constitue un élément secondaire.
Une rupture incomplète avec l'anarchisme
Néanmoins, malgré ces avancées, le Groupe des Amis de Durruti n'est jamais parvenu à effectuer une rupture profonde avec l'anarchisme. Ils restèrent fortement attachés aux traditions et aux idées anarcho-syndicalistes. Pour rejoindre le groupe, il fallait aussi être membre de la CNT. Comme on peut le voir sur l'affiche du mois d'avril et dans d'autres documents, le groupe considérait toujours que le pouvoir des travailleurs pouvait s'exprimer non seulement à travers une "junte révolutionnaire" ou des comités de travailleurs créés au cours de la lutte mais, également, au moyen du contrôle syndical de l'économie et par l'existence de "municipalités libres" 7 - formules qui révèlent une continuité avec le programme de Saragosse dont nous avons examiné les importantes limites dans la première partie de cet article. Ainsi, le programme élaboré par les Amis de Durruti n'a pas réussi à se baser sur la véritable expérience des mouvements révolutionnaires de 1905 et de 1917 à 1923, où dans la pratique la classe ouvrière était allée au-delà de la forme syndicale et dans lesquels les Spartakistes, par exemple, avaient appelé à la dissolution de tous les organes existants de gouvernement local et leur remplacement par les conseils ouvriers. Il est significatif à cet égard que, dans les colonnes du journal du groupe, El Amigo del Pueblo [L'Ami du peuple], qui cherchait à tirer les leçons des événements de 1936-37, une importante série historique sur l'expérience de la Révolution bourgeoise française ait été publiée, et rien sur les révolutions prolétariennes en Russie ou en Allemagne.
Les Amis de Durruti considéraient certainement la "junte révolutionnaire" comme un moyen pour le prolétariat de prendre le pouvoir en 1937, mais pour autant Munis avait-il raison de dire que la "junte révolutionnaire" équivalait aux soviets ? Il y a ici une zone de flou, sans doute précisément à cause de l'incapacité apparente des Amis de Durruti à se relier à l'expérience des conseils ouvriers en dehors de l'Espagne. Par exemple, la vision du groupe concernant la manière dont la junte se constituerait n’apparaît pas clairement. La voyait-il naître comme émanation directe des assemblées générales dans les usines et dans les milices, ou devait-elle être le produit des travailleurs les plus déterminés eux-mêmes ? Dans un article du n° 6 de El Amigo del Pueblo, le groupe "défend que les seuls participants à la Junte révolutionnaire devraient être les travailleurs de la ville et de la campagne et les combattants qui, à chaque moment crucial du conflit, sont apparus comme les plus fervents défenseurs de la révolution sociale" 8. Guillamón n'a pas de doute quant à l'implication d'une telle vision : "L'évolution de la pensée politique des Amis de Durruti était désormais inéluctable. Après que la nécessité d'une dictature du prolétariat eut été reconnue, la prochaine question à se poser était : à qui revient-il d'exercer cette dictature du prolétariat ? La réponse était : à la Junte révolutionnaire, définie rapidement comme étant l'avant-garde révolutionnaire. Et son rôle? Nous ne pouvons pas croire qu'il soit autre que celui que les marxistes ont assigné au parti révolutionnaire" 9. Mais, de notre point de vue, l'une des leçons fondamentales des mouvements révolutionnaires de 1917 à 1923, et de la révolution russe en particulier, est que le parti révolutionnaire ne peut pas assumer son rôle s'il s'identifie à la dictature du prolétariat. Ici Guillamón semble théoriser les propres ambiguïtés des Amis de Durruti sur cette question ; nous reviendrons plus loin sur ce sujet. En tout cas, il est difficile de ne pas avoir l'impression que la junte était une sorte d'expédient, plutôt que la "forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" telle que des marxistes comme Lénine et Trotsky ont qualifié les soviets. Dans Towards a fresh revolution, par exemple, Balius fait valoir que la CNT elle-même aurait dû prendre le pouvoir : "Quand une organisation a passé toute son existence à prêcher la révolution, elle a l'obligation d'agir chaque fois qu'un ensemble de circonstances favorables survient. Et en juillet, l'occasion s'était présentée. La CNT aurait dû sauter dans le siège de conducteur du pays et donner un sévère coup de grâce à tout ce qui était dépassé et archaïque. De cette façon, nous aurions gagné la guerre et sauvé la révolution" 10. En plus du fait qu'il sous-estime gravement le profond processus de dégénérescence qui avait rongé la CNT bien avant 1936 11, ces propos révèlent à nouveau une incapacité à assimiler les leçons de toute la vague révolutionnaire de 1917-23, qui avait clarifié pourquoi ce sont les soviets et non les syndicats qui sont la forme indispensable de la dictature du prolétariat.
L'attachement des Amis de Durruti à la CNT eut également des répercussions importantes sur le plan organisationnel. Dans leur manifeste du 8 mai, le rôle joué par les échelons supérieurs de la CNT dans le sabotage du soulèvement de mai 1937 est caractérisé sans hésitation comme une trahison ; ceux qu'il dénonçait comme des traîtres avaient déjà attaqué les Amis de Durruti en les traitant d'agents provocateurs, faisant ainsi écho aux calomnies habituelles des staliniens, et les avaient menacés d'expulsion immédiate de la CNT. Cet antagonisme féroce était certes un reflet de la division de classe entre le camp politique du prolétariat et des forces qui étaient devenues une agence de l'État bourgeois. Mais, face à la nécessité d'opérer une rupture décisive avec la CNT, les Amis de Durruti firent marche arrière et acceptèrent d'abandonner l'accusation de trahison en échange de la levée de la demande d'expulsion les concernant, un changement qui sans aucun doute mina la capacité du groupe à continuer à fonctionner de façon indépendante. L'attachement sentimental à la CNT était tout simplement trop fort pour une grande partie des militants, même si un nombre important d'entre eux - et pas seulement des membres des Amis de Durruti ou d'autres groupes dissidents - avaient déchiré leur carte face à l'ordre de démanteler les barricades et de retourner au travail en mai 1937. Cet attachement est résumé dans la décision de Jaoquin Aubi et de Rosa Muñoz de démissionner des Amis de Durruti face à la menace d'expulsion de la CNT : "Je continue à considérer les camarades appartenant aux Amis de Durruti comme des camarades : mais je répète ce que j'ai toujours dit dans des réunions plénières à Barcelone : "la CNT a été le ventre qui m'a donné le jour et la CNT sera ma tombe"" 12
Les limitations "nationales" de la vision des Amis de Durruti
Dans la première partie de cet article, nous avons montré que le programme de la CNT était coincé dans un cadre strictement national qui voyait le communisme libertaire comme étant possible dans le contexte d'un seul pays auto-suffisant. Certes les Amis de Durruti avaient une forte attitude internationaliste à un niveau presque instinctif - par exemple, dans leur appel à la classe ouvrière internationale à venir en aide aux travailleurs insurgés en mai 1937 - mais celle-ci ne s'appuyait pas théoriquement sur une analyse sérieuse du rapport de forces entre les classes à une échelle mondiale et historique, ni sur une capacité à développer un programme basé sur l'expérience internationale de la classe ouvrière, comme nous l'avons déjà noté au sujet de l'imprécision de leur notion de "Junte révolutionnaire". Guillamón est particulièrement cinglant dans les critiques de cette faiblesse telle qu'elle s'exprime dans un chapitre de la brochure de Balius :
"Le chapitre suivant de la brochure aborde le sujet de l'indépendance de l'Espagne. Il est entièrement rempli de notions obtuses, à courte vue ou mieux adaptées à la petite-bourgeoisie. Un nationalisme bon marché et vide est défendu au moyen de références inconsistantes, simplistes, à la politique internationale. Nous allons donc passer ce chapitre, en disant seulement que les Amis de Durruti adhèrent à des idées bourgeoises, simplistes et/ou passéistes en matière de nationalisme" 13.
Les influences du nationalisme étaient particulièrement cruciales dans l'incapacité des Amis de Durruti à comprendre la véritable nature de la guerre d'Espagne. Comme nous l'écrivions dans notre article de la Revue internationale 102, "Anarchisme et communisme" :
"De fait les considérations des Amis de Durruti sur la guerre étaient faites en partant des positions nationalistes étroites et ahistoriques de l'anarchisme, les amenant à comprendre les événements actuels en Espagne en continuité avec les tentatives ridicules de révolution qu'avait faites la bourgeoisie en 1808 contre l'invasion napoléonienne. Alors que le mouvement ouvrier international débattait de la défaite du prolétariat mondial et de la perspective d'une Seconde Guerre mondiale, les anarchistes en Espagne en étaient à Fernand VII et à Napoléon.
"Aujourd'hui se répète ce qui s'est passé à l'époque de Fernand VII. De la même manière se tient à Vienne une réunion des dictateurs fascistes visant à préciser leur intervention en Espagne. Et le rôle qu'avait El Empecinado est joué aujourd'hui par les travailleurs en armes. L'Allemagne et l'Italie manquent de matières premières. Ces deux pays ont besoin de fer, de cuivre, de plomb, de mercure. Mais ces minerais espagnols sont détenus par la France et l'Angleterre. Alors qu'ils essaient de conquérir l'Espagne, l'Angleterre ne proteste pas de manière vigoureuse. En sous-main, elle tente de négocier avec Franco (...) La classe travailleuse a pour devoir d'obtenir l'indépendance de l'Espagne. Ce n'est pas le capital national qui y parviendra, étant donné que le capital au niveau international est intimement lié d'un bout à l'autre. C'est le drame de l'Espagne actuelle. Aux travailleurs il revient la tâche de chasser les capitalistes étrangers. Ce n'est pas un problème patriotique. C'est une question d'intérêts de classe. (Jaime Balius, Vers une nouvelle révolution, 1997, Centre de documentation historico-sociale, Etcétera,p. 32-33.)"
Comme on peut le constater toutes les ficelles sont bonnes pour transformer une guerre impérialiste entre États en guerre patriotique, en guerre "de classes". C'est une manifestation du désarmement politique auquel 1'anarchisme soumet les militants ouvriers sincères comme les Amis de Durruti. Ces camarades, qui cherchaient à lutter contre la guerre et pour la révolution, furent incapables de trouver le point de départ pour une lutte efficace : l'appel aux ouvriers et aux paysans (embrigadés par les deux camps, républicain et franquiste) à déserter, à retourner leurs fusils contre les officiers qui les opprimaient, à revenir à 1'arrière et à lutter par les grèves, par les manifestations, sur un terrain de classe contre le capitalisme dans son ensemble."
Et cela nous amène à la question la plus importante de toutes : la position des Amis de Durruti sur la nature de la guerre d'Espagne. Ici, il ne fait aucun doute que le nom du groupe signifie plus qu'une référence sentimentale à Durruti 14, dont la bravoure et la sincérité étaient très admirées par le prolétariat espagnol. Durruti était un militant de la classe ouvrière, mais il fut totalement incapable de faire une critique approfondie de ce qui était arrivé aux travailleurs espagnols après le soulèvement de juillet 1936 - de la façon dont l'idéologie antifasciste et le transfert de la lutte du front social aux fronts militaires constituaient déjà une étape décisive dans l’entraînement des travailleurs dans un conflit impérialiste. Durruti, comme beaucoup d'anarchistes sincères, était un "jusqu’au-boutiste" 15 quand il s'est agi de la guerre, il affirma que la guerre et la révolution, loin d'être en contradiction l'une avec l'autre, pourraient se renforcer mutuellement pour autant que la lutte sur les fronts soit combinée avec les transformations "sociales'' à l'arrière que Durruti identifiait avec l'instauration du communisme libertaire. Mais, comme Bilan l'a souligné, dans le contexte d'une guerre militaire entre blocs capitalistes, les entreprises industrielles et agricoles autogérées ne pouvaient fonctionner que comme un moyen de mobiliser davantage les travailleurs pour la guerre. Ce fut un "communisme de guerre" qui nourrissait une guerre impérialiste.
Les Amis de Durruti n'ont jamais contesté cette idée que la guerre et la révolution devaient être menées simultanément. Comme Durruti, ils ont appelé à la mobilisation totale de la population pour la guerre, même quand ils ont analysé que la guerre était perdue. 16
La position de Guillamón sur la guerre et ses critiques à Bilan
Pour Guillamón, en résumé, les événements d'Espagne étaient "la tombe de l'anarchisme en tant que théorie révolutionnaire" 17. Nous pouvons seulement ajouter que, malgré l'héroïsme des Amis de Durruti et leurs efforts louables pour développer une théorie révolutionnaire, le sol anarchiste sur lequel ils ont tenté de cultiver cette fleur a prouvé son inhospitalité.
Mais Guillamón lui-même n'est pas exempt d'ambiguïtés sur la guerre d'Espagne et cela est évident dans ses critiques à la Fraction italienne de la Gauche communiste qui publiait Bilan.
Sur la question centrale de la guerre, la position de Guillamón, comme il la résume dans son livre, semble assez claire :
"1. Sans destruction de l'État, il n'y a pas révolution. Le Comité central des milices antifascistes de Catalogne (CCMA) n'était pas un organe de double pouvoir, mais une agence pour la mobilisation militaire des travailleurs, pour l'union sacrée avec la bourgeoisie, en bref, une agence de la collaboration de classe.
2. L'armement du peuple n'a pas de sens. La nature de la guerre militaire est déterminée par la nature de la classe qui la dirige. Une armée qui combat pour la défense d'un État bourgeois, fût-il antifasciste, est une armée au service du capitalisme.
3. La guerre entre un État fasciste et un État antifasciste n'est pas une guerre de classe révolutionnaire. L'intervention du prolétariat dans un des camps est une indication qu'il a déjà été vaincu. L'infériorité technique et professionnelle insurmontable de la part de l'armée populaire ou basée sur des milices était implicite dans la lutte armée sur un front militaire.
4. La guerre sur les fronts militaires impliquait l'abandon du terrain de classe. L'abandon de la lutte de classe signifiait la défaite du processus révolutionnaire.
5. Dans l'Espagne d'août 1936, la révolution n'était plus présente et seule la guerre était possible : une guerre militaire non-révolutionnaire.
6. Les collectivisations et socialisations dans l'économie ne comptent pour rien quand le pouvoir d'État est dans les mains de la bourgeoisie." 18
Cela ressemble beaucoup à une reprise des positions défendues par la Gauche communiste. Mais Guillamón rejette effectivement certaines des positions les plus importantes de Bilan, comme nous pouvons le voir dans un autre document, "Thèses sur la guerre civile espagnole et la situation révolutionnaire créée le 19 juillet 1936", publié en 2001 par Balance 19. Tout en reconnaissant que certains aspects de l'analyse des événements en Espagne par Bilan étaient brillants, il porte des critiques fondamentales à la fois à cette analyse et aux conclusions politiques qui en sont tirées :
1. Bilan n'a pas vu qu'il y avait une "situation révolutionnaire" en juillet 1936. "D'une part, Bilan reconnaît le caractère de classe des luttes de Juillet 36 et Mai 37, mais, d'autre part, non seulement il nie leur caractère révolutionnaire, mais il nie même l'existence d'une situation révolutionnaire. Ce point de vue ne peut s'expliquer que par l'éloignement géographique d'un groupe parisien totalement isolé, qui a donné priorité à ses analyses plutôt qu'à l'étude de la réalité espagnole. Il n'y a pas un seul mot dans Bilan sur la véritable nature des comités, ni sur la lutte du prolétariat de Barcelone pour la socialisation et contre la collectivisation, ni sur les débats et les confrontations dans les Colonnes de la milice concernant la militarisation des milices, ni de critique sérieuse des positions des Amis de Durruti, pour la simple raison que Bilan ignore pratiquement totalement l'existence et l'importance de toutes ces questions. Il était facile de justifier cette ignorance en niant l'existence d'une situation révolutionnaire. L'analyse de Bilan échoue parce que, à son avis, l'absence d'un parti révolutionnaire (bordiguiste) implique nécessairement l'absence d'une situation révolutionnaire".
2. L'analyse que fait Bilan des événements de mai est incohérente : "L'incohérence de Bilan est mise en évidence par l'analyse des journées de mai 1937. Il se trouve que la "révolution" du 19 Juillet, qui a cessé une semaine plus tard d'être une révolution parce que ses objectifs de classe ont été transformés en objectifs de guerre, réapparaît aujourd'hui comme le Phénix de l'histoire, comme un fantôme qui s'était caché dans quelque lieu inconnu. Et maintenant, il se trouve que, en mai 1937, les travailleurs ont été une fois de plus "révolutionnaires", et ont défendu la révolution des barricades. Comment cela a-t-il pu être le cas puisque, selon Bilan, il n'y avait pas eu de révolution ? Ici, Bilan est tout empêtré. Le 19 Juillet (selon Bilan) il y a eu une révolution, mais une semaine plus tard, il n'y avait plus de révolution, car il n'y avait pas le parti (bordiguiste) ; en mai 1937, il y eut une autre semaine révolutionnaire. Mais comment pouvons-nous caractériser la situation entre le 26 Juillet 1936 et le 3 mai 1937 ? On ne nous dit rien à ce sujet. La révolution est considérée comme une rivière intermittente [parfois en surface, parfois souterraine comme la rivière d'Espagne "Guadiana", note du traducteur Libcom] qui émerge sur la scène historique lorsque Bilan veut expliquer certains événements qu'il ne comprend pas et n'est pas capable d'expliquer".
3. La position de Bilan sur le parti et l'idée que c'est le parti, pas la classe, qui fait la révolution, est basée sur un "concept léniniste, totalitaire et substitutionniste du parti".
4. Les conclusions pratiques de Bilan sur la guerre étaient "réactionnaires" : "Selon Bilan, le prolétariat a été plongé dans une guerre antifasciste, c’est-à-dire qu'il a été enrôlé dans une guerre impérialiste entre une bourgeoisie démocratique et une bourgeoisie fasciste. Dans cette situation, les seules positions appropriées étaient la désertion et le boycott, ou bien attendre des temps meilleurs, lorsque le parti (bordiguiste) entrerait sur la scène de l'histoire depuis les coulisses où il attendait son heure". Ainsi : nier l'existence d'une situation révolutionnaire en 1936 a amené Bilan à des "positions politiques réactionnaires telles que briser les fronts militaires, la fraternisation avec les troupes franquistes, couper l'acheminement des armes aux troupes républicaines".
Pour répondre en profondeur aux critiques que porte Guillamón à la Fraction italienne, il faudrait un autre article, mais nous voulons faire quelques remarques :
- Il est faux de dire que Bilan ignorait totalement le mouvement réel de la classe en Espagne. Il est vrai qu'il semblait ne pas connaître les Amis de Durruti, mais il était en contact avec Camillo Berneri. Ainsi, en dépit de ses critiques sévères envers l'anarchisme, il était tout à fait capable de reconnaître qu'une résistance prolétarienne pouvait encore apparaître dans ses rangs. Plus important encore, il a pu, comme Guillamón le reconnaît, percevoir le caractère de classe des événements de juillet 1936 et de mai 1937, et il est tout simplement faux de prétendre qu'il n'a pas dit pas un mot sur les comités qui ont émergé de l'insurrection de juillet : dans la première partie de cet article, nous avons cité un extrait du texte "La leçon des événements d'Espagne" publié dans Bilan n° 36 qui mentionne ces comités, les considère comme des organes prolétariens mais reconnaît également le processus de récupération rapide dont il font l'objet via les "collectivisations". Bilan laisse entendre dans ce même article que le pouvoir était à la portée des travailleurs et que la prochaine étape était la destruction de l'État capitaliste. Mais Bilan avait un cadre historique et international lui permettant d'avoir une vision plus claire du contexte général ayant déterminé l'isolement tragique du prolétariat espagnol - celui de la contre-révolution triomphante et d'un cours vers la guerre impérialiste mondiale, dont le conflit espagnol constituait une répétition générale. Guillamón traite à peine de cela, de la même manière que c'était plus ou moins absent des analyses des anarchistes espagnols à l'époque ;
- Les événements de mai ont confirmé l'analyse de Bilan plutôt que de montrer ses confusions. La lutte des classes, comme la conscience de classe elle-même, est en effet comparable à un fleuve qui peut devenir souterrain pour réapparaître ensuite à la surface : l'exemple le plus important de cela étant les événements révolutionnaires de 1917-1918 qui ont suivi une terrible défaite de la classe sur le plan idéologique en 1914. Le fait que l'élan prolétarien initial de juillet 1936 ait été contrecarré et détourné ne signifie pas que l'esprit combatif et la conscience de classe du prolétariat espagnol avaient été totalement brisés, et ils réapparurent dans une dernière action d'arrière-garde contre les attaques incessantes envers la classe, imposées surtout par la bourgeoisie républicaine. Mais cette réaction a été écrasée par les forces combinées de la classe capitaliste, des staliniens à la CNT, et ce fut un coup dont le prolétariat espagnol ne s'est pas relevé ;
- Rejeter la position de Bilan sur le parti comme étant "léniniste et substitutionniste", comme le fait Guillamón, est un exemple de raccourci douteux, surprenant de la part d'un historien normalement aussi rigoureux. Guillamón laisse entendre que Bilan voyait le parti comme un deus ex machina, qui attend dans les coulisses le moment venu. Cela pourrait être dit à propos des bordiguistes aujourd'hui qui prétendent être le Parti, mais Guillamón ignore totalement la conception de Bilan de ce qu'est la Fraction, qui est basée sur la reconnaissance que le parti ne peut pas exister dans une situation de contre-révolution et de défaite, précisément parce que le parti est le produit de la classe et non l'inverse. Il est vrai que la Gauche italienne n'avait pas encore rompu avec l'idée substitutionniste du parti qui prend le pouvoir et exerce la dictature du prolétariat - mais nous avons déjà montré que Guillamón lui-même n'est pas entièrement dégagé de cette conception, et Bilan avait commencé à élaborer un cadre global permettant de rompre avec le substitutionnisme 20. En Espagne en 1936, Bilan explique l'absence de parti comme le produit de la défaite de la classe ouvrière au niveau mondial et, bien qu'il ne néglige pas la possibilité de soulèvements révolutionnaires, il voyait que les dés étaient jetés, en défaveur du prolétariat. Et comme Guillamón le reconnaît lui-même, une révolution qui ne donne pas naissance à un parti révolutionnaire ne peut pas réussir. Ainsi, contrairement à ce qui fut si souvent faussement affirmé, Bilan n'avait pas une position idéaliste du type "il n'y a pas de révolution en Espagne parce qu'il n'y a pas de parti", mais une position matérialiste "il n'y a pas de parti parce qu'il n'y a pas de révolution".
Là où on peut voir le plus clairement l'incohérence de Guillamón, c'est dans le rejet de la position "défaitiste révolutionnaire" de Bilan sur la guerre. Guillamón accepte l'idée que la guerre a été très rapidement transformée en une guerre non-révolutionnaire, et que l'existence de milices armées, de collectivisations, etc. n'a apporté aucune changement à cela Mais l'idée d'une "guerre non-révolutionnaire" est ambiguë : Guillamón semble réticent à accepter l'idée que c'était une guerre impérialiste et que la lutte des classes ne pouvait se ranimer qu'en revenant au terrain de classe de la défense des intérêts matériels du prolétariat, contre la discipline du travail et les sacrifices imposés par la guerre. Cela aurait certainement sapé les fronts militaires et saboté l'armée républicaine – et c'est précisément la raison de la répression sauvage lors des événements de mai. Et pourtant, quand les choses se gâtent, Guillamón fait valoir que les méthodes classiques de lutte du prolétariat contre la guerre impérialiste - les grèves, les mutineries, les désertions, les fraternisations, les grèves à l'arrière - étaient réactionnaires, même s'il s'agissait d'une "guerre non-révolutionnaire". Ceci est, au mieux, une position centriste qui aligne Guillamón sur tous ceux qui ont cédé au chant des sirènes de la participation à la guerre, des trotskistes aux anarchistes, jusqu'à des parties de la Gauche communiste elle-même. Quant à l'isolement de Bilan, celui-ci l'a reconnu, non comme un produit de la géographie, mais bien de la période sombre qu'il traversait, quand tout autour de lui n'était que trahison des principes de l'internationalisme. Comme il l'a écrit dans un article intitulé précisément "L'isolement de notre Fraction devant les événements d’Espagne" du n° 36 de sa revue (Octobre-Novembre 1936) :
"Notre isolement n'est pas fortuit : il est la conséquence d'une profonde victoire du capitalisme mondial qui est parvenu à gangrener jusqu'aux groupes de la Gauche communiste dont le porte-parole a été jusqu'à ce jour Trotsky. Nous ne poussons pas la prétention jusqu'à affirmer qu'à l'heure actuelle nous restons le seul groupe dont les positions aient été confirmées sur tous les points par la marche des événements, mais ce que nous prétendons catégoriquement c'est que, bien ou mal, nos positions ont été une affirmation permanente de la nécessité d'une action indépendante et de classe du prolétariat. Et c'est sur ce terrain que s'est précisément vérifiée la faillite de tous les groupes trotskistes et semi-trotskistes."
C'était la force de la tradition marxiste italienne qu'elle ait été capable de donner naissance à une Fraction aussi clairvoyante que Bilan. Ce fut une grave faiblesse du mouvement ouvrier en Espagne, caractérisé par la prédominance historique de l'anarchisme sur le marxisme, qu'aucune fraction de ce type n'ait pu y émerger.
Berneri et ses successeurs
Dans le manifeste produit en réponse à l'écrasement de la révolte des travailleurs en mai 1937 à Barcelone, les Fractions italienne et belge de la Gauche communiste ont rendu hommage à la mémoire de Camillo Berneri 21, dont l'assassinat par la police stalinienne fit partie de la répression générale de l'État républicain contre tous ceux qui, travailleurs et révolutionnaires, avaient joué un rôle actif durant les journées de mai et qui, en paroles ou en actes, s'étaient opposés à la politique de la CNT-FAI de collaboration avec l'État capitaliste.
Voici ce qu'écrivaient les Fractions de gauche en juin 1937, dans Bilan n° 41 :
"Les ouvriers du monde entier s'inclinent devant tous les morts et revendiquent leurs cadavres contre tous les traîtres : ceux d'hier, comme ceux d'aujourd'hui. Le prolétariat du monde entier salue en Berneri un des siens, et son immolation à l'idéal anarchiste est encore une protestation contre une école politique qui s'est effondrée au cours des événements d'Espagne : c'est sous la direction d'un gouvernement à participation anarchiste que la police a répété sur le corps de Berneri l'exploit de Mussolini sur le corps de Matteotti !"
Dans un autre article du même numéro, intitulé "Antonio Gramsci – Camillo Berneri", Bilan note que ces deux militants, qui sont morts à quelques semaines d'intervalle, avaient donné leur vie à la cause du prolétariat en dépit de graves lacunes de leurs positions idéologiques :
"Berneri, un chef des anarchistes ? Non, parce que, même après son assassinat, la CNT et la FAI mobilisent les ouvriers sur le danger de leur évincement d’un gouvernement qui est recouvert du sang de Berneri. Ce dernier avait cru pouvoir s’appuyer sur l’école anarchiste pour contribuer à l’œuvre de rédemption sociale des opprimés et c’est un ministère comprenant des anarchistes qui a lancé l’attaque contre les exploités de Barcelone !
Les vies de Gramsci et de Berneri appartiennent au prolétariat qui s’inspire de leur exemple pour continuer sa lutte. Et la victoire communiste permettra aux masses d’honorer dignement les deux disparus, parce qu’elle permettra aussi de mieux comprendre les erreurs dont ils furent les victimes et qui ont dû certainement ajouter, aux sévices de l’ennemi, le tourment intime de voir les événements contredire tragiquement leurs convictions, leurs idéologies."
L'article se termine en disant que le numéro suivant de Bilan reviendrait plus en détail sur ces deux figures du mouvement ouvrier. Dans le numéro en question (Bilan n° 42, juillet-août 1937), il y a en effet un article spécifique consacré à Gramsci qui, bien que d'un intérêt considérable, est en dehors du sujet du présent article. Berneri lui-même est mentionné dans l'éditorial de ce numéro, "La répression en Espagne et en Russie", qui examine les tactiques que la police avait utilisées pour assassiner Berneri et son camarade Barbieri :
"Nous savons aussi comment Berneri a été assassiné. Deux policiers se présentent d’abord chez lui. "Nous sommes des amis", disent-ils. Dans quel but viennent-ils ? Ils viennent se rendre compte où se trouvent deux fusils. Ils retournent, pour faire une simple perquisition, et ils emmènent les deux armes. Ils reviennent une dernière fois et cette fois c’est pour le coup final. Ils sont sûrs que Berneri et son camarade sont désarmés, qu’aucune possibilité de défense ne leur reste, ils procèdent à leur arrestation en vertu d’un mandat légalement décerné par les autorités d’un gouvernement dont font partie les amis politiques de Berneri, les représentants de la CNT et de la FAI. Les femmes de Berneri et de Barbieri apprendront, par la suite, que les cadavres de leurs camarades sont à la morgue.
Nous savons enfin que dans les rues de Madrid et de Barcelone, cela devient courant désormais. Des escadres armées, à la solde des centristes, parcourent les rues et tuent les ouvriers soupçonnés d’idées subversives.
Et tout cela, sans que l’édifice des socialisations, des milices, des syndicats gérant la production, ne soit encore anéanti par une nouvelle réorganisation de l’État capitaliste."
En fait il existe à ce jour différents récits de l'assassinat : celui d'Augustin Souchy contemporain des événements, "La semaine tragique en mai", publié à l'origine dans Spain and the World puis republié dans The May Days Barcelona 1937 (Freedom Press, 1998) qui est très similaire au récit de Bilan. D'autre part, il y a la courte biographie sur Libcom, écrite par Toni 22, et selon laquelle Berneri a été abattu dans la rue après être allé aux bureaux de Radio Barcelona pour parler de la mort de Gramsci. Et il existe encore d'autres variations dans la description des détails. Mais la question essentielle, comme l'a dit Bilan, était que dans la répression générale qui a suivi la défaite de la révolte de mai 1937, il était devenu pratique courante de procéder à l'élimination physique des éléments gênants comme Berneri qui eurent le courage de critiquer le gouvernement social-démocrate/stalinien/anarchiste, et la politique étrangère contre-révolutionnaire de l'URSS. Les staliniens, qui avaient la mainmise sur l'appareil de la police, étaient aux avant-postes de ces assassinats. Bien qu'il ait continué à utiliser le terme "centristes" pour décrire les staliniens, Bilan les voyait clairement pour ce qu'ils étaient : des ennemis violents de la classe ouvrière, des flics et des assassins avec lesquels aucune collaboration n'était possible. Cela tranche totalement avec la position des trotskistes qui continuaient à qualifier les "PC" de partis ouvriers avec qui un front uni était toujours souhaitable, et l'URSS de régime qui doit toujours être défendu contre l'attaque impérialiste.
Quel terrain commun entre Berneri et Bilan ?
Si certains des faits concernant l'assassinat de Berneri demeurent encore assez flous, nous sommes encore moins clairs sur la relation entre la Fraction italienne et Berneri. Notre livre sur la Gauche italienne nous dit que, suite au départ de la minorité de Bilan pour combattre dans les milices du POUM, la majorité envoya une délégation à Barcelone pour tenter de trouver des éléments avec qui un débat fructueux pourrait être possible. Les discussions avec les éléments du POUM se sont révélées infructueuses et "seule l'entrevue avec le professeur anarchiste Camillo Berneri eut des résultats positifs" (p. 129). Mais le livre ne précise pas ce qu'étaient ces résultats positifs. À première vue, il n'y a aucune raison évidente pour laquelle Bilan et Berneri auraient pu trouver un terrain d'entente. Par exemple, si on se penche sur un de ses textes les plus connus, la "Lettre ouverte à la camarade Federica Montseny" 23, datée d'avril 1937, après que celle-ci soit devenue ministre dans le gouvernement de Madrid, nous ne trouvons pas grand-chose permettant de distinguer la position de Berneri de celle de beaucoup d'autres antifascistes de "gauche" à l'époque. À la base de sa démarche - qui est plus un dialogue avec une camarade égarée que la dénonciation d'une traîtresse – il y a la conviction qu'une révolution est effectivement en cours en Espagne, qu'il n'y avait pas de contradiction entre l'approfondissement de la révolution et la poursuite de la guerre jusqu'à la victoire, à condition d'utiliser des méthodes révolutionnaires - mais ces méthodes n'excluaient pas de demander au gouvernement de prendre des mesures plus radicales, comme l'octroi immédiat de l'autonomie politique au Maroc afin d'affaiblir l'emprise des forces franquistes sur leurs recrues d'Afrique du Nord. Certes, l'article est très critique envers la décision des dirigeants de la CNT-FAI d'entrer au gouvernement, mais il y a beaucoup d'éléments dans cet article permettant de soutenir l'affirmation de Guillamón selon laquelle "La critique des Amis de Durruti était encore plus radicale que celle de Berneri, parce que Berneri était critique vis-à-vis de la participation de la CNT dans le gouvernement, alors que le Groupe a critiqué la collaboration de la CNT avec l'État capitaliste" 24 Alors, pourquoi la Fraction italienne fut-elle en mesure de tenir des discussions positives avec lui ? Nous pensons que c'est parce que Berneri, comme la Gauche italienne, était d'abord et avant tout engagé dans la défense de l'internationalisme prolétarien et dans une perspective mondiale, alors que, comme Guillamón l'a lui-même noté, un groupe comme les Amis de Durruti montrait encore des signes du lourd bagage de patriotisme espagnol. Au cours de la Première Guerre mondiale, Berneri avait pris une position très claire : quand il était encore membre du Parti socialiste, il avait travaillé en étroite collaboration avec Bordiga pour exclure les "interventionnistes" 25 du journal socialiste L'Avanguardia. Son article "Burgos et Moscou" 26 portant sur les rivalités impérialistes sous-tendant le conflit en Espagne, publié dans Guerra di Classe n° 6, le 16 décembre 1936, malgré une tendance à appeler la France à intervenir pour défendre ses intérêts nationaux 27, est en même temps clair sur les objectifs antirévolutionnaires et impérialistes de toutes les grandes puissances, fascistes, démocratiques et "soviétique" dans le conflit en Espagne. En fait, Souchy défend l'idée que c'est en particulier cette dénonciation du rôle impérialiste de l'URSS dans la situation en Espagne qui a signé l'arrêt de mort de Berneri.
Dans notre texte "Marxisme et éthique", nous écrivons : "Une caractéristique du progrès moral est l’agrandissement du rayon d’application des vertus et des pulsions sociales, jusqu’à embrasser l’ensemble de l’humanité. La plus haute expression, de loin, de la solidarité humaine, du progrès éthique de la société jusqu’à présent, c’est l’internationalisme prolétarien. Ce principe est le moyen indispensable de la libération de la classe ouvrière, qui pose les bases de la future communauté humaine" 28
Derrière l'internationalisme qui unissait Bilan et Berneri, il y a un profond attachement à la morale prolétarienne - la défense des principes fondamentaux quel qu'en soit le coût : l'isolement, le ridicule, et la menace physique. Comme Berneri l'écrit dans la dernière lettre à sa fille Marie-Louise : "On peut perdre ses illusions sur tout et sur tout le monde, mais pas sur ce que l'on affirme avec sa conscience morale" 29
La position de Berneri contre le "circonstancialisme" adopté par tant de personnes dans le mouvement anarchiste de l'époque – "les principes sont bien beaux, mais dans ces circonstances particulières, nous devons être plus réalistes et plus pragmatiques" - avait certainement touché une corde sensible chez les camarades de la Gauche italienne, dont le refus d'abandonner les principes face à l'euphorie de l'unité antifasciste, de l'immédiatisme opportuniste qui balaya la quasi-totalité du mouvement politique prolétarien à cette époque, les avait en effet obligés à suivre un parcours très solitaire.
Vernon Richards et l'Enseignement de la révolution espagnole
Comme nous l'avons indiqué ailleurs 30, la fille de Camillo Berneri, Marie-Louise Berneri, et le compagnon de celle-ci, l'anarchiste anglo-italien Vernon Richards, faisaient partie des quelques éléments au sein du mouvement anarchiste, en Grande-Bretagne ou à l'étranger, qui ont maintenu une activité internationaliste pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers leur publication War Commentary [Commentaires de guerre]. Le journal "a vivement dénoncé que la lutte idéologique entre la démocratie et le fascisme n'était que le prétexte de la guerre, de même que les dénonciations par les alliés démocratiques des atrocités nazies, n'étaient qu'hypocrisie après leur soutien tacite aux régimes fascistes et à la terreur stalinienne dans les années 1930. Soulignant la nature cachée de la guerre comme lutte de pouvoir entre les intérêts impérialistes britanniques, allemands et américains, War Commentary a également dénoncé l'utilisation de méthodes fascistes par les alliés "libérateurs" et leurs mesures totalitaires contre la classe ouvrière dans leur propre pays" 31. Marie-Louise Berneri et Vernon Richards furent arrêtés à la fin de la guerre et accusés de fomenter l'insubordination parmi les forces armées. Bien que Marie-Louise Berneri ne soit pas passée en jugement en vertu d'une loi stipulant que des conjoints ne peuvent pas être considérés comme ayant comploté ensemble, Vernon Richards fit neuf mois de prison. Marie-Louise Berneri donna naissance à un enfant mort-né et mourut peu après en avril 1949 d'une infection virale contractée lors de son accouchement, une perte tragique pour Vernon Richards et pour le mouvement prolétarien.
Richards publia également un livre qui constitue une référence, Enseignement de la révolution espagnole, sur la base d'articles parus dans le journal Spain and the World au cours des années 1930. Ce livre, d'abord publié en 1953 et dédié à Camillo et à Marie-Louise, est absolument sans faille dans sa dénonciation de l'opportunisme et de la dégénérescence de l'anarchisme "officiel" en Espagne. Dans son introduction à la première édition anglaise, Richards nous dit que certains éléments du mouvement anarchiste "m'avaient suggéré que cette étude fournissait des munitions aux ennemis politiques de l'anarchisme", ce à quoi Richards répondit : "Mis à part le fait que la cause de l'anarchie ne peut certainement pas être lésée par n'importe quelle tentative d'établir la vérité, la base de ma critique n'est pas que les idées anarchistes ont fait la preuve, face à l'expérience espagnole, qu'elles étaient inapplicables, mais que les anarchistes et les syndicalistes espagnols n'ont pas réussi à mettre leurs théories à l'épreuve et ont adopté à la place la tactique de l'ennemi. Je ne vois donc pas comment les partisans de l'ennemi, à savoir les gouvernements et les partis politiques, pourraient utiliser cette critique contre l'anarchisme sans qu'elle se retourne contre eux" 32
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie du mouvement anarchiste avait succombé aux sirènes de l'antifascisme et de la résistance. C'est le cas en particulier d'importants éléments du mouvement espagnol qui ont légué à l'histoire l'image de voitures blindées ornées de bannières CNT-FAI en tête du défilé de la "Libération" à Paris en 1944. Dans son livre, Richards attaque le "mélange d'opportunisme politique et de naïveté" qui a fait adopter aux dirigeants de la CNT-FAI le point de vue selon lequel "tous les efforts devraient être faits pour prolonger la guerre à tout prix jusqu'au déclenchement des hostilités entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, dont tout le monde savait qu'il était inévitable, tôt ou tard. De la même manière que certains espéraient la victoire à la suite de la conflagration internationale, beaucoup de révolutionnaires espagnols ont apporté leur soutien à la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils croyaient que la victoire des "démocraties" (y compris la Russie !) entraînerait la libération automatique de l'Espagne de la tyrannie fasciste de Franco" 33.Encore une fois, cette fidélité à l'internationalisme était intégralement liée à une position éthique forte, exprimée tant au niveau intellectuel qu'à travers l'indignation évidente de Richards face au comportement répugnant et aux auto-justifications hypocrites des représentants officiels de l'anarchisme espagnol.
En réponse aux arguments du ministre anarchiste Juan Peiró, Richards mettait le doigt sur la mentalité du "circonstancialisme" : "tout compromis, toute déviation, nous expliquait-on, n'était pas une "rectification" des "principes sacrés" de la CNT, mais simplement des actions déterminées par les "circonstances" et, une fois celles-ci surmontées, il y aurait un retour aux principes" 34. Ailleurs, il dénonçait la direction de la CNT "prête à abandonner les principes pour la tactique", et pour sa capitulation face à l'idéologie de "la fin justifie les moyens" : "Le fait est que, pour les révolutionnaires ainsi que pour le gouvernement, tous les moyens étaient justifiés pour atteindre le but ; à savoir la mobilisation de l'ensemble du pays sur le pied de guerre. Et dans ces circonstances, l'hypothèse est que tout le monde soutiendrait la "cause". Ceux qui ne le font pas y sont contraints ; ceux qui résistent sont traqués, humiliés, punis ou liquidés".35
Dans cet exemple particulier, Richards parlait de la capitulation de la CNT face aux méthodes bourgeoises traditionnelles pour discipliner les prisonniers, mais il exprimait lucidement la même colère face aux trahisons politiques de la CNT dans toute une série de domaines. Certaines d'entre elles sont évidentes et bien connues :
- L'abandon rapide de la critique traditionnelle de la collaboration avec le gouvernement et les partis politiques en faveur de l'unité antifasciste. Le plus célèbre exemple en était l'acceptation de postes ministériels dans le gouvernement central et la justification idéologique infâme de ce pas par les ministres anarchistes qui affirmèrent que cela signifiait que l'État cessait d'être un instrument d'oppression. Mais Richards fustigeait également la participation des anarchistes à d'autres organes de l'État, comme le gouvernement régional de Catalogne et le Conseil national de défense - que Camillo Berneri avait lui-même reconnu comme faisant partie de l'appareil gouvernemental, en dépit de son étiquette "révolutionnaire", et dont il avait rejeté une invitation à siéger en son sein.
- La participation de la CNT dans la normalisation capitaliste de toutes les institutions qui émergèrent du soulèvement des travailleurs en juillet 1936 : l'incorporation des milices dans l'armée bourgeoise régulière et l'institution du contrôle des entreprises par l'État, même s'il se dissimulait derrière la fiction syndicaliste selon laquelle les travailleurs étaient désormais maîtres chez eux. Son analyse du Plenum national économique étendu de janvier 1938 (chapitre XVII) montre à quel point la CNT avait totalement adopté les méthodes de gestion capitaliste, et son obsession d'augmenter la productivité et de punir les désœuvrés. Mais la pourriture avait certainement commencé à se développer depuis bien plus longtemps, comme le montre Richards en dénonçant la signification pour la CNT de la signature du pacte "Unité d'action" avec le syndicat social-démocrate Union générale des travailleurs (UGT) et le Parti socialiste unifié de Catalogne (PSUC) stalinien - acceptation de la militarisation, de la nationalisation des entreprises avec une mince couche de "contrôle ouvrier", et ainsi de suite 36.
- Le rôle de la CNT dans le sabotage des journées de mai 1937. Richards a analysé ces événements comme une mobilisation spontanée et potentiellement révolutionnaire de la classe ouvrière et comme l'expression concrète d'un fossé croissant entre la base de la CNT et son appareil bureaucratique qui a utilisé toutes ses capacités de manœuvre et de pure tromperie pour désarmer les ouvriers et les remettre au travail.
Mais certains des exposés les plus révélateurs de Richards concernent la manière dont la dégénérescence politique et organisationnelle de la CNT a nécessairement impliqué une corruption morale croissante, surtout de la part des personnes les plus en pointe dans ce processus. Il montre comment cela s'exprimait à la fois dans les déclarations des dirigeants anarchistes et dans la presse de la CNT. Trois expressions de cette corruption en particulier suscitaient sa fureur :
- Un discours de Federica Montseny à un rassemblement de masse le 31 août 1936, où il est dit de Franco et de ses disciples qu'ils sont "cet ennemi manquant de dignité ou de conscience, démuni du sentiment d'être espagnol, parce que s'ils étaient espagnols, s'ils étaient patriotes, ils n'auraient pas laissé déferler sur l'Espagne les troupes régulières et les Maures pour imposer la civilisation des fascistes, non en tant que civilisation chrétienne, mais en tant que civilisation maure ; des gens que nous sommes allés coloniser pour que, maintenant, ils viennent nous coloniser, avec les principes religieux et les idées politiques qu'ils souhaitent imposer au peuple espagnol" 37. Richards commente avec amertume : "Ainsi parlait une révolutionnaire espagnole, l'un des membres les plus intelligents et les plus doués de l'organisation (et encore traité comme une des figures marquantes par la majorité de la section de la CNT en France). Dans cette seule phrase sont exprimés des sentiments nationalistes, racistes et impérialistes. Quelqu'un a-t-il protesté lors de la réunion ?"
- Le culte du leadership : Richards cite des articles de la presse anarchiste qui, presque dès le début de la guerre, visent à créer une aura semi-religieuse autour de figures comme García Oliver : "la mesure de jusqu'où vont les sycophantes est donnée dans un rapport publié dans Solidaridad Obrera (29 août 1936) à l'occasion du départ d'Oliver au front. Il est diversement décrit comme "notre cher camarade", "le militant exceptionnel", "le courageux camarade", "notre camarade le plus aimé" ", et ainsi de suite. Richards ajoute d'autres exemples de cette flagornerie et termine avec le commentaire : "Il va sans dire qu'une organisation qui encourage le culte du chef ne peut pas aussi cultiver un sens des responsabilités chez ses membres, qui est absolument fondamental pour l'intégrité d'une organisation libertaire" 38. Il est à noter que, à la fois, le discours de Montseny et la canonisation d'Oliver proviennent de la période antérieure à celle où ils devinrent ministres.
- La militarisation de la CNT : "Une fois résolue à l'idée de la militarisation, la CNT-FAI se jeta à corps perdu dans la tâche de démontrer à tout le monde que leurs militants de base étaient les plus disciplinés, les membres les plus courageux des forces armées. La presse de la Confédération publia d'innombrables photographies de ses chefs militaires (dans leur uniforme d'officier), les interviewa, écrivit des tribunes élogieuses sur leur promotion au rang de colonel ou de major. Et, alors que la situation militaire s'aggravait, le ton de la presse confédérale devenait plus agressif et militariste. Solidaridad Obrera publiait des listes quotidiennes d'hommes qui avaient été condamnés par les tribunaux militaires à Barcelone et exécutés pour "activités fascistes", "défaitisme" ou "désertion". On pouvait lire le cas d'un homme condamné à mort pour avoir aidé des conscrits à fuir en traversant la frontière… ". Richards cite ensuite un article de Solidaridad Obrera du 21 avril 1938 à propos d'un autre homme exécuté pour avoir quitté son poste, "pour faire un exemple plus fort. Les soldats de la garnison étaient présents et ont défilé devant le corps acclamant la République", et il conclut : "cette campagne pour la discipline et l'obéissance par la peur et la terreur […] n'a pas empêché les désertions des fronts à grande échelle (bien que pas souvent en direction des lignes de Franco) et la chute de la production dans les usines" 39.
Idéologie anarchiste et principe prolétarien
Ces exemples de l'indignation de Richards face à la trahison totale des principes de classe par la CNT sont un exemple de la morale prolétarienne qui est un fondement indispensable à toute forme de militantisme révolutionnaire. Mais nous savons aussi que l'anarchisme a tendance à fausser cette morale avec des abstractions ahistoriques, et ce manque de méthode souligne quelques-unes des principales faiblesses du livre.
La démarche de Richards envers la question syndicale en est une illustration. Derrière la question des syndicats, il y a un élément "invariant" de principe : la nécessité pour le prolétariat de se doter des formes d'association pour se défendre de l'exploitation et de l'oppression du capital. Historiquement, l'anarchisme, tout en restant opposé à tous les partis politiques, a généralement accepté que les syndicats de métier, les syndicats d'industrie de type IWW, ou les organisations anarcho-syndicalistes constituaient une telle forme d'association. Mais, parce qu'il rejette l'analyse matérialiste de l'histoire, il ne peut pas comprendre que ces formes d'association peuvent changer profondément dans différentes époques historiques. D'où la position de la gauche marxiste pour qui, avec l'entrée dans l'époque de décadence du capitalisme, les syndicats et les anciens partis de masse perdent leur contenu prolétarien et sont intégrés dans l'État bourgeois. Le développement de l'anarcho-syndicalisme au début du 20e siècle a constitué une réponse partielle à ce processus de dégénérescence des anciens syndicats et des anciens partis, mais il lui manquait les outils théoriques pour vraiment expliquer le processus, et il s'est ainsi trouvé piégé dans de nouvelles versions de l'ancien syndicalisme : le destin tragique de la CNT en Espagne était la preuve que, dans la nouvelle époque, il n'était pas possible de maintenir le caractère prolétarien et, moins encore, ouvertement révolutionnaire, d'une organisation permanente de masse. Influencé par Errico Malatesta 40 (comme l'était Camillo Berneri), Richards 41 était conscient de certaines des limites de l'idée anarcho-syndicaliste : la contradiction qu'implique la construction d'une organisation qui, à la fois, se proclame pour la défense au jour le jour des intérêts des travailleurs et est de ce fait ouverte à tous les travailleurs et, dans le même temps, est engagée pour la révolution sociale, un objectif qui, à tout moment au sein de la société capitaliste, ne pourra être partagé que par une minorité de la classe. Cela ne pouvait que favoriser les tendances à la bureaucratie et au réformisme qui, tous deux, firent brutalement surface lors des événements de 1936-39 en Espagne. Mais cette vision n'est pas suffisante pour expliquer le processus par lequel toutes les organisations de masse permanentes qui, par le passé avaient pu constituer des expressions du prolétariat, étaient désormais directement intégrées dans l'État. Ainsi Richards, malgré quelques intuitions sur le fait que la trahison de la CNT n'était pas simplement une question de "leaders", est incapable de reconnaître que l'appareil de la CNT lui-même, au terme d'un long processus de dégénérescence, s'était intégré à l'État capitaliste. Cette incapacité à comprendre la transformation qualitative des syndicats est aussi perceptible dans la manière dont il voit la fédération "socialiste" des syndicats, l'UGT : pour lui, alors que toute collaboration avec les partis politiques et le gouvernement constituait une trahison de principe, il était positivement en faveur d'un front uni avec l'UGT qui, en réalité, ne pouvait être qu'une version plus radicale du Front populaire.
La principale faiblesse du livre, cependant, est celle partagée par une écrasante majorité d'anarchistes dissidents et de groupes d'opposition de l'époque, l'idée selon laquelle il y aurait effectivement eu une révolution prolétarienne en Espagne, la classe ouvrière serait réellement arrivée au pouvoir, ou aurait au moins établi une situation de double pouvoir qui aurait duré bien au-delà des premiers jours de l'insurrection de juillet 1936. Pour Richards, l'organe de double pouvoir était le Comité central des milices antifascistes, même s'il savait que le CCMA était devenu plus tard un agent de la militarisation. En fait, comme nous l'avons noté dans l'article précédent, d'après Bilan, le CCMA a joué un rôle crucial dans la préservation de la domination capitaliste, presque dès le premier jour de l'insurrection. À partir de cette erreur fondamentale, Richards est incapable de rompre avec l'idée que nous avons déjà notée dans les positions des Amis de Durruti, à savoir que la guerre d'Espagne était essentiellement une guerre révolutionnaire qui aurait pu simultanément repousser Franco sur le front militaire et établir les bases d'une nouvelle société, au lieu de voir que les fronts militaires et la mobilisation générale pour la guerre étaient en eux-mêmes une négation de la lutte de classe. Bien que Richards fasse des critiques très lucides à la manière concrète dont la mobilisation pour la guerre a conduit à la militarisation forcée de la classe ouvrière, à l'écrasement de son initiative autonome et à l'intensification de son exploitation, il reste ambigu sur des questions telles que la nécessité d'augmenter le rythme et la durée du travail dans les usines afin d'assurer la production d'armes pour le front. Faute d'une vision globale et historique des conditions de la lutte de classe dans cette période, une période de défaite de la classe ouvrière et de préparation d'une nouvelle division impérialiste du monde, il ne saisit pas la nature de la guerre d'Espagne en tant que conflit impérialiste, répétition générale de l'holocauste mondial à venir. Son insistance selon laquelle la "révolution" a fait une erreur clé en n'utilisant pas les réserves d'or de l'Espagne pour acheter des armes à l'étranger démontre (comme pour Berneri avec son appel plus ou moins ouvert à l'intervention des démocraties) une sous-estimation profonde d'à quel point le basculement très rapide du terrain de la lutte de classe au terrain militaire avait également propulsé le conflit dans la cocotte-minute inter-impérialiste mondiale.
Pour Bilan, l'Espagne 1936 a été à l'anarchisme ce que 1914 avait été à la social-démocratie : un acte de trahison historique qui a marqué un changement dans la nature de classe de ceux qui avaient trahi. Cela ne signifie pas que toutes les différentes expressions de l'anarchisme étaient passées de l'autre côté de la barricade, mais - comme avec les survivants du naufrage de la social-démocratie - cela appelait vraiment à un processus d'auto-examen impitoyable, à une profonde réflexion théorique de la part précisément de ceux qui étaient restés fidèles à des principes de classe. Dans l'ensemble, les meilleures tendances au sein de l'anarchisme ne sont pas allées assez loin dans cette autocritique, et certainement pas aussi loin que la Gauche communiste dans l'analyse des échecs successifs de la social-démocratie, de la révolution russe, et de l'Internationale communiste. La majorité - et ce fut certainement le cas avec les Amis de Durruti, les Berneri et Richards - a essayé de préserver le noyau dur de l'anarchisme quand c'est précisément ce noyau qui reflète les origines petites-bourgeoises de l'anarchisme et sa résistance à la cohérence et à la clarté du "parti Marx" (en d'autres termes la tradition marxiste authentique). Le rejet de la méthode matérialiste historique l'a empêchée de développer une perspective claire dans la période d'ascendance du capitalisme et, ensuite, de comprendre les changements dans la vie de l'ennemi de classe et de la lutte prolétarienne à l'époque de la décadence capitaliste. Et il l'empêche toujours de faire sienne une théorie adéquate du mode de production capitaliste lui-même - ses forces motrices et sa trajectoire vers la crise et l'effondrement. Peut-être de façon plus cruciale, l'anarchisme est incapable de développer une théorie matérialiste de l'État - ses origines, sa nature et les modifications historiques qu'il a subi - et des moyens d'organisation du prolétariat pour le renverser : les conseils ouvriers et le parti révolutionnaire. En dernière analyse, l'idéologie anarchiste est un obstacle à la tâche d'élaboration du contenu politique, économique et social de la révolution communiste.
CDW
1. Voir la Revue internationale n° 104, "Document (Josep Rebull, POUM) : Sur les Journées de mai 1937 à Barcelone" [76] https://fr.internationalism.org/rinte104/espagne.htm [76]: Sur les Journées de mai 1937 à Barcelone".
2. Sur ce groupe, l'ouvrage écrit d'un point de vue clairement prolétarien et faisant autorité a été écrit par Agustin Guillamón : The Friends of Durruti Group 1937-39 [Le Groupe des Amis de Durruti 1937-1939] (AK Press, 1996). Nous en parlerons tout au long de cette partie de l'article. Voir aussi l'article de la Revue internationale du CCI n° 102, Anarchisme et communisme ; https://fr.internationalism.org/rinte102/anar.htm [77].
3. Guillamón, The Friends of Durruti Group, p. 78. Notre traduction.
4. The Friends of Durruti Group, p. 92
5. Towards a fresh revolution [Vers une nouvelle révolution], cité dans The Friends of Durruti Group p. 84
6. Lutte ouvrière, 24 février et 3 mars 1939, cité dans The Friends of Durruti Group, p. 98.
7. The Friends of Durruti Group, p. 64.
8. The Friends of Durruti Group, p. 68.
9. Ibid.
10. The Friends of Durruti Group, p. 79.
11. Voir nos articles sur l'histoire de la CNT de la série plus large sur l'anarcho-syndicalisme : "Histoire du mouvement ouvrier - La CNT : Naissance du syndicalisme révolutionnaire en Espagne (1910-1913)" ; [78]https://fr.internationalism.org/rint128/CNT_anarcho_syndicalisme_syndicalisme_revolutionnaire.htm [78] ; "Histoire du mouvement ouvrier : le syndicalisme fait échouer l'orientation révolutionnaire de la CNT (1919-1923)" [79] ; ; [80]https://fr.internationalism.org/rint130/histoire_du_mouvement_ouvrier_le_syndicalisme_fait_echouer_l_orientation_revolutionnaire_de_la_cnt_1919_1923.html [79] ; "La contribution de la CNT à l'instauration de la République espagnole (1921-1931)" https://fr.internationalism.org/rint131/la_contribution_de_la_cnt_a_l_instauration_de_la_republique_espagnole.html [80].
12. Cité dans la préface de The Friends of Durruti Group, p. VII.
13. The Friends of Durruti Group, p. 82.
14. Buenaventura Durruti est né en 1896, fils d'un cheminot. Dès l'âge de 17 ans, il fut impliqué dans des luttes ouvrières combatives - d'abord dans les chemins de fer, puis dans les mines et, plus tard, dans les mouvements de classe massifs qui ont balayé l'Espagne lors de la vague révolutionnaire d'après-guerre. Il rejoignit la CNT à cette époque. Pendant le reflux de la vague révolutionnaire, Durruti fut impliqué dans les combats des "Pistoleros" contre les mercenaires de l'État et des patrons, et mena l'assassinat d'au moins une personnalité de haut rang. Exilé en Amérique du Sud et en Europe au cours de la plus grande partie des années 1920, il fut condamné à mort dans plusieurs pays. En 1931, après la chute de la monarchie, il retourna en Espagne et devint membre de la FAI et du groupe Nosotros, tous deux formés dans le but de lutter contre les tendances de plus en plus réformistes de la CNT. En juillet 1936, à Barcelone, il prit une part très active dans la réponse des travailleurs au coup d'État de Franco, puis forma la Colonne de Fer, une milice spécifiquement anarchiste qui alla combattre sur le front contre les franquistes, alors que dans le même temps elle suscitait ou soutenait les collectivisations agraires. En novembre 1936, il se rendit à Madrid avec un grand contingent de miliciens pour tenter de soulager la ville assiégée, mais fut tué par une balle perdue. 500 000 personnes assistèrent à ses funérailles. Pour celles-ci et pour bien d'autres travailleurs espagnols, Durruti était un symbole de courage et de dévouement à la cause du prolétariat. On peut trouver une courte notice biographique de Durruti en anglais sur libcom.org [81] et en français sur Wikipédia [82].
15. Un terme inventé durant la Première Guerre mondiale pour désigner ceux qui insistaient pour que la guerre soit menée "jusqu'au bout".
16. The Friends of Durruti Group, p. 71.
17. The Friends of Durruti Group, p. 108.
18. The Friends of Durruti Group, p. 10.
19. "Theses on the Spanish Civil War and the revolutionary situation created on July 19, 1936 - BALANCE (Agustín Guillamón)" [83], sur libcom.org. https://libcom.org/library/theses-spanish-civil-war-revolutionary-situation-created-july-19-1936-balance-agust%C3%ADn-gu [83]
20. En particulier, l'insistance selon laquelle le parti ne devait pas s'identifier à l'État de transition, une erreur qu'il considérait avoir été fatale aux Bolcheviks en Russie. Voir à ce sujet un article précédent de cette série, Revue internationale n° 127, "Le communisme (III) : Les années 1930 : le débat sur la période de transition" [84]; https://fr.internationalism.org/rint127/communisme_periode_de_transition.html [84].
21. Camillo Berneri est né dans le nord de l'Italie en 1897, fils d'un fonctionnaire et d'une enseignante. Il travailla lui-même pendant un certain temps comme professeur dans une école de formation des enseignants. Il rejoignit le Parti socialiste italien au cours de son adolescence et, pendant la guerre de 1914-18, avec Bordiga et d'autres, prit une position internationaliste contre le flottement centriste du parti et contre la trahison pure et simple de ses positions par Mussolini. Mais à la fin de la guerre, il était devenu anarchiste et était proche des idées d'Errico Malatesta. Poussé à l'exil par le régime fasciste, il resta une cible des machinations de la police secrète fasciste, l'OVRA. Ce fut durant cette période qu'il écrivit un certain nombre de contributions sur la psychologie de Mussolini, sur l'antisémitisme et sur le régime de l'URSS. Apprenant la nouvelle du soulèvement des travailleurs à Barcelone, il alla en Espagne et combattit sur le front d'Aragon. De retour à Barcelone, il critiqua de façon cohérente les tendances opportunistes et ouvertement bourgeoises dans la CNT, écrivit pour Guerra di Classe [Guerre de classe] et prit contact avec les Amis de Durruti. Comme relaté dans cet article, il fut assassiné par des tueurs staliniens durant les journées de mai 1937.
22. "Berneri, Luigi Camillo, 1897-1937" [85], sur libcom.org. https://libcom.org/article/berneri-luigi-camillo-1897-1937 [85]
23. Guerra di Classe No. 12, 14 avril 1937. Reproduite en anglais sur libcom.org,"The anarchists in government in Spain: Open letter to comrade Federica Montseny - Camillo Berneri" [86] ; https://libcom.org/article/anarchists-government-spain-open-letter-comrade-federica-montseny-camillo-berneri [86]. Cette lettre est partiellement reproduite en français sur le blog "La Bataille socialiste", "1937-04 Lettre ouverte à la camarade Federica Montseny [Berneri]" [87].
24. The Friends of Durruti Group, p. 82.
25. Ce terme désigne en Italie les partisans de la participation de ce pays à la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Entente.
26. Connu également sous le titre "Entre la guerre et la révolution" ; disponible en anglais sur libcom.org "Between the war and the Revolution - Camillo Berneri" [88].
27. Cette position dangereuse est encore plus explicite dans un autre article de Berneri initialement publié dans Guerra di Classe n° 7, 18 juillet 1937, "Non intervention et implication internationale dans la guerre civile espagnole"; . On le trouve en anglais, "Non - intervention and international involvement in the Spanish Civil War" [89] sur le site "The Struggle Site" : https://struggle.ws/berneri/international.html [89].
28. Revue internationale n° 127, "Marxisme et éthique (débat interne au CCI)" [90] ; https://fr.internationalism.org/rint127/ethique_morale.html [90].
29. "Berneri's last letters to his family" [91], sur le site "The Struggle Site". https://struggle.ws/berneri/last_letter.html [91].
30. Voir notre article en anglais, World Revolution n° 270, décembre 2003, "Revolutionaries in Britain and the struggle against imperialist war, Part 3: the Second World War" [92] [Les révolutionnaires en Grande-Bretagne et la lutte contre la guerre impérialiste]. https://en.internationalism.org/wr/270_rev_against_war_03.html [92] Voir également notre article en français, "Notes sur le mouvement anarchiste internationaliste en Grande-Bretagne" ; https://fr.internationalism.org/icconline/2011/notes_sur_le_mouvement_anarchiste_internationaliste_en_grande_bretagne.html [93]" [93]Voir aussi notre brochure en anglais The British Communist Left [la Gauche communiste britannique] p. 101.
31. "Revolutionaries in Britain and the struggle against imperialist war", op. cit.
32. Lessons of the Spanish Revolution, 1995 Éditions Freedom Press, p. 14 [En français : Enseignement de la Révolution espagnole, 1997, Éditions Acratie, disponible en ligne sur le site www.somnisllibertaris.com [94]].
33. Lessons of the Spanish Revolution, pp. 153-4.
34. Lessons of the Spanish Revolution, pp. 179-80.
35. Lessons of the Spanish Revolution, p. 213.
36. Le souci de vérité de Richards signifie aussi que dans son livre, il est loin de faire l'apologie des collectifs anarchistes qui auraient constitué, pour certains, la preuve que la "révolution espagnole" avait largement dépassé la Russie concernant son contenu social. Ce que Richards montre vraiment c'est que, bien que la prise de décisions par les assemblées et les expériences de distribution sans argent aient duré plus longtemps à la campagne, surtout dans les domaines plus ou moins autosuffisants, toute contestation des normes de gestion capitaliste avait été très rapidement éliminée dans les usines, qui ont été plus immédiatement dominées par les besoins de la production de guerre. Une forme de capitalisme d'État gérée par les syndicats réimposa très rapidement la discipline sur le prolétariat industriel.
37. Lessons of the Spanish Revolution, p. 211.
38. Lessons of the Spanish Revolution, p. 181.
39. Lessons of the Spanish Revolution, p. 161. Marc Chirik, un membre fondateur de la Gauche communiste de France et du CCI, faisait partie de la délégation de la majorité de la Fraction qui est allée à Barcelone. Plus tard, il a parlé de l'extrême difficulté des discussions avec la plupart des anarchistes et estimé que certains d'entre eux étaient tout à fait capables de les descendre, lui et ses camarades, pour oser mettre en cause la validité de la guerre antifasciste. Cette attitude est le clair reflet des appels dans la presse de la CNT à l'exécution de déserteurs.
40. Voir par exemple, sur marxists.org, "Syndicalism and Anarchism" [95] [Syndicalisme et anarchisme], 1925.
41. Voir par exemple Lessons of the Spanish Revolution, p. 196.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [96]
Personnages:
- Camillo Berneri [97]
- Jaime Balius [98]
- Vernon Richards [99]
Evènements historiques:
- Guerre d'Espagne [100]
Courants politiques:
- Anarchisme officiel [68]
Approfondir:
Rubrique:
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud: de la naissance du capitalisme à la veille de la Seconde Guerre mondiale
- 2625 lectures
Après l’Afrique de l’Ouest,1 nous entamons une seconde série sur l’histoire du mouvement ouvrier africain avec une contribution portant sur les luttes de classes en Afrique du Sud. Un pays célèbre surtout sur deux plans : d’un côté, ses richesses minières (or, diamant, etc.) grâce auxquelles il s’est relativement développé et, de l’autre, son système monstrueux d’apartheid dont on voit encore aujourd’hui un certain nombre des séquelles. En même temps, l’apartheid accoucha d’une immense "icône", à savoir Nelson Mandela, considéré comme la principale victime mais surtout l’exutoire de ce système d’un autre âge, d’où ses "titres" de "héros de la lutte anti-apartheid" et d’homme de "paix et de réconciliation des peuples d’Afrique du Sud" adulé dans toute la planète capitaliste. L’image médiatique de Mandela voile tout le reste à tel point que l’histoire et les combats de la classe ouvrière sud-africaine avant et pendant l’apartheid sont carrément ignorés ou déformés en étant systématiquement catégorisés dans la rubrique "luttes anti-apartheid" ou "luttes de libération nationale". Bien entendu, pour la propagande bourgeoise, ces luttes ne pouvaient être incarnées que par Mandela. Ceci alors même qu’il est de notoriété publique que, depuis leur arrivée au pouvoir, Mandela et son parti le Congrès National Africain (l’ANC) n’ont jamais été tendres envers les grèves de la classe ouvrière 2.
Le but principal de cette contribution vise à rétablir la vérité historique sur les luttes ayant opposé les deux classes fondamentales, à savoir la bourgeoisie (dont l’apartheid n’était qu’un des moyens de sa domination) et le prolétariat d’Afrique du Sud qui, le plus souvent, est parti en lutte sur ses propres revendications de classe exploitée, d’abord à l’époque de la bourgeoisie coloniale hollando-anglaise puis sous le régime de Mandela/ANC. En d’autres termes, un prolétariat sud-africain dont le combat s’inscrit parfaitement dans celui du prolétariat mondial.
Un bref survol de l'histoire de l'Afrique du sud
Selon certaines sources d’historiens, cette région était occupée initialement par les populations Xhosa, Tswana et Sotho qui s’y installèrent entre 500 et l’an 1000. À ce propos, l’historien Henri Wesseling 3 nous donne l'éclairage suivant : "L’Afrique du Sud n’était pas une terre vierge lorsque des navires européens accostèrent pour la première fois vers 1500 au pied des montagnes de la Table. Elle était peuplée par différentes ethnies, essentiellement nomades. Les colons hollandais les divisèrent en Hottentots et Bochimans. Ils les considérèrent comme deux peuples totalement distincts du point de vue physique et culturel. Les Bochimans étaient plus petits que les Hottentots et parlaient une autre langue qu’eux. En outre, ils étaient plus "primitifs", pratiquant la chasse et la cueillette, alors que les Hottentots avaient atteint le niveau des peuples pasteurs. Cette dichotomie traditionnelle a longtemps dominé l’historiographie. Aujourd’hui, nous n’employons plus ces termes, mais ceux de Khoi ou Khoikhoi pour les Hottentots et celui de San pour les Bochimans, le terme de Khoisan servant à désigner le groupe ethnique qu’ils forment ensemble. En effet, actuellement, on souligne moins la distinction entre ces peuples, essentiellement parce qu’ils sont tous deux très différents des ethnies voisines parlant des langues bantoues et autrefois dénommées Cafres, de l’arabe kafir (infidèles). Ce terme-là est également tombé en désuétude".
On peut noter comment les colons hollandais considéraient les premiers occupants de cette région du monde, selon l’idéologie coloniale établissant des classements entre "primitifs" et "évolués". Par ailleurs l’auteur du propos indique que le terme Afrique du Sud est un concept politique (récent) et que nombre de ses populations sont historiquement originaires des pays voisins (par exemple de l’Afrique australe).
Concernant la colonisation européenne, les Portugais y firent escale les premiers en Afrique du Sud en 1488 et les Hollandais les suivirent en débarquant dans la région en 1648. Ces derniers décidèrent de s’y installer définitivement à partir de 1652, ce qui marque le début de la présence "blanche" permanente dans cette partie de l'Afrique. En 1795, Le Cap fut occupé par les Anglais qui, 10 ans plus tard, s’emparèrent du Natal, tandis que les Boers (Hollandais) dirigèrent le Transvaal et l’État libre d’Orange en parvenant à faire reconnaître leur indépendance par l’Angleterre en 1854. Quant aux divers États ou groupes africains, ils résistèrent longtemps par la guerre à la présence des colons européens sur leur sol avant d’être vaincus définitivement par les puissances dominantes. Au terme des guerres qui les opposèrent aux Afrikaners et aux Zoulous, les Britanniques procédèrent en 1910 à l’unification de l’Afrique du Sud sous l’appellation "Union Sud-Africaine" et ce jusqu’en 1961 où le régime afrikaner décida simultanément de quitter le Commonwealth (communauté anglophone) et de changer le nom du pays.
L’apartheid fut établi officiellement en 1948 et aboli en 1990. Nous y reviendrons plus loin en détail.
Concernant les rivalités impérialistes, l’Afrique du Sud joua en Afrique australe le rôle de "gendarme délégué" du bloc impérialiste occidental et c’est à ce titre que Pretoria intervint militairement en 1975 en Angola, soutenu alors par le bloc impérialiste de l’Est au moyen de troupes cubaines.
L’Afrique du Sud est considérée aujourd’hui comme un pays "émergent" membre des BRIC (Brésil, Russie Inde, Chine) et cherche à faire son entrée dans l’arène des grandes puissances.
Depuis 1994, l’Afrique du Sud est gouvernée principalement par l’ANC, le parti de Nelson Mandela, en compagnie du Parti Communiste et de la centrale syndicale COSATU.
La classe ouvrière sud-africaine émergea à la fin du 19e siècle et constitue aujourd’hui le prolétariat industriel le plus nombreux et le plus expérimenté du continent africain.
Enfin, nous pensons utile d’expliquer deux termes proches mais cependant distincts que nous serons amenés à utiliser souvent dans cette contribution, à savoir les termes "boer" et "afrikaner" ayant à l’origine des racines hollandaises.
Sont appelés Boers (ou Trekboers) les fermiers hollandais (à dominante petite paysanne) qui, de 1835 à 1837, entreprirent une vaste migration en Afrique du Sud en raison de l’abolition de l’esclavage par les Anglais dans la colonie du Cap en 1834. Il se trouve que le terme est encore utilisé aujourd’hui à propos des descendants, directs ou non, de ces fermiers (y inclus des ouvriers d’usine).
Concernant la définition du terme afrikaner, nous renvoyons à l’explication que donne l’historien Henri Wesseling (Ibid.) : "La population blanche qui s’était installée au Cap était de diverses origines. Elle se composait de Hollandais, mais aussi de nombreux Allemands et de huguenots français. Cette communauté avait adopté progressivement un mode de vie propre. On pourrait même dire qu’une identité nationale se constitua, celle des Afrikaners, qui considérèrent le gouvernement britannique comme une autorité étrangère."
Nous pouvons donc dire que ce terme renvoie à une sorte d’identité revendiquée par un nombre de migrants européens de l’époque, une notion que l’on emploie encore dans des publications récentes.
Naissance du capitalisme sud-africain
Si le capitalisme naissant a été marqué dans chaque région du monde comme en Afrique du Sud par des caractéristiques spécifiques ou locales, néanmoins il s’est développé en général selon trois étapes différentes, comme l’explique Rosa Luxemburg 4 :
"Il convient d’y [dans son développement] distinguer trois phases : la lutte du capital contre l’économie naturelle, sa lutte contre l’économie marchande et sa lutte sur la scène mondiale autour de ce qui reste des conditions d’accumulation.
Le capitalisme a besoin pour son existence et son développement de formes de productions non capitalistes autour de lui. Mais cela ne veut pas dire que n’importe laquelle de ces formes puisse lui être utile. Il lui faut des couches sociales non capitalistes comme débouchés pour sa plus-value, comme sources de moyens de production et comme réservoirs de main-d’œuvre pour son système de salariat".
En Afrique du Sud, le capitalisme a emprunté ces trois étapes. Au 19e siècle il y existait une économie naturelle, une économie marchande et une main-d’œuvre suffisante pour développer le salariat.
"À la colonie du Cap et dans les républiques boers, une économie purement paysanne régnait jusqu’aux alentours de 1860. Pendant longtemps, les Boers menèrent la vie d’éleveurs nomades, ils avaient pris aux Hottentots et aux Cafres les meilleurs pâturages, les avaient exterminés ou chassés autant qu’ils le pouvaient. Au 18e siècle, la peste apportée par les bateaux de la Compagnie des Indes orientales leur rendait de grands services en anéantissant des tribus entières de Hottentots et en libérant ainsi des terres pour les migrants hollandais".
(…) En général l’économie des Boers resta, jusqu’aux alentours de 1860, patriarcale et fondée sur l’économie naturelle. Ce n’est qu’en 1859 que le premier chemin de fer fut construit en Afrique du Sud. Certes, le caractère patriarcal n’empêchait nullement les Boers d’être durs et brutaux. On sait que Livingstone se plaignait bien plus des Boers que des Cafres. (…) En réalité, il s’agissait de la concurrence entre l’économie paysanne (incarnée par les Boers) et la politique coloniale du grand capital (anglais) autour des Hottentots et des Cafres, c'est-à-dire autour de leurs territoires et de leurs forces de travail. Le but des deux concurrents était le même : ils voulaient asservir, chasser ou exterminer les indigènes, détruire leur organisation sociale, s’approprier leurs terres et les contraindre au travail forcé pour les exploiter. Seuls les méthodes étaient différentes. Les Boers préconisaient l’esclavage périmé comme fondement d’une économie naturelle patriarcale ; la bourgeoisie anglaise voulait introduire une exploitation moderne du pays et des indigènes sur une grande échelle". (Rosa Luxemburg, Ibid.)
À noter l’âpreté du combat que durent se livrer Boers et Anglais pour la conquête et l’instauration du capitalisme dans cette zone qui se fit, comme ailleurs, "dans le sang et dans la boue". Au final ce fut l’impérialisme anglais qui domina la situation et concrétisa l’avènement du capitalisme en Afrique du Sud comme le relate, à sa manière, la chercheuse Brigitte Lachartre 5 :
"L’impérialisme britannique, lors qu’il se manifesta dans le sud du continent en 1875, avait d’autres visées : citoyens de la première puissance économique de l’époque, représentants de la société mercantiliste puis capitaliste la plus développée d’Europe, les Britanniques imposèrent dans leur colonie d’Afrique australe une politique indigène beaucoup plus libérale que celle des Boers. L’esclavage fut aboli dans les régions contrôlées par eux, tandis que les colons hollandais fuyaient dans l’intérieur du pays pour échapper au nouvel ordre social et à l’administration des colons britanniques. Après avoir vaincu les Africains par les armes (une dizaine de guerres "cafres" en un siècle), les Britanniques s’attachèrent à "libérer" la force de travail : on regroupa d’abord les tribus vaincues dans des réserves tribales dont on restreignait de plus en plus les limites ; on empêcha les Africains d’en sortir sans autorisation et laissez-passer en règle. Mais le vrai visage de la colonisation britannique apparut avec la découverte des mines de diamants et d’or vers 1870. Une ère nouvelle commençait qui opéra une transformation profonde de toutes les structures sociales et économiques du pays : les activités minières entraînèrent l’industrialisation, l’urbanisation, la désorganisation des sociétés traditionnelles africaines, mais aussi des communautés boers, l’immigration des nouvelles vagues d’Européens (…)".
En clair, ce propos peut se lire comme un prolongement concret du processus, décrit par Rosa Luxemburg, selon lequel le capitalisme a vu le jour en Afrique du Sud. En effet, dans sa lutte contre "l’économie naturelle", la puissance économique anglaise dut briser les anciennes sociétés tribales et se débarrasser violemment des anciennes formes de productions comme l’esclavage qu’incarnèrent les Boers qui furent contraints de fuir pour échapper à l’ordre du capitalisme moderne. Précisément, ce fut au milieu de ces guerres entre tenants de l’ancien et du nouvel ordre économique que le pays passa illico au capitalisme moderne grâce à la découverte du diamant (en 1871), puis de l’or (en 1886). La "ruée vers l’or" se traduisit ainsi par une accélération fulgurante de l’industrialisation du pays consécutivement à l’exploitation et à la commercialisation des matières précieuses en attirant massivement les investisseurs capitalistes des pays développés. Dès lors, il fallait recruter des ingénieurs et ouvriers qualifiés, et c’est ainsi que des milliers d’Européens, d’Américains et Australiens vinrent s’installer en Afrique du Sud. Et la ville de Johannesburg de symboliser ce dynamisme naissant par la rapidité de son développement. Le 17 juillet 1896, un recensement y fut organisé et il en ressortit que la ville, qui comptait 3000 habitants en 1887, en comptait 100 000 dix ans plus tard. Ensuite, en un peu plus de dix ans, la population blanche passa de six cent mille à plus d’un million d’habitants. D’autre part dans la même période le produit intérieur brut (le PIB) passa de quelque 150 000 livres à près de quatre millions. Voilà comment l’Afrique du Sud est devenue le premier et l’unique pays africain relativement développé sur le plan industriel, ce qui ne tarda pas d’ailleurs à aiguiser les appétits des puissances économiques rivales 6 :
"Le centre économique et politique de l’Afrique du Sud ne se trouvait plus au Cap, mais à Johannesburg et à Pretoria. L’Allemagne, la plus grande puissance économique européenne, s’était établie dans le Sud-Ouest africain et avait manifesté de l’intérêt pour le Sud-Est africain. Si le Transvaal ne se montrait pas disposé à se soumettre à l’autorité de Londres, l’avenir de l’Angleterre serait remis en cause dans toute l’Afrique du Sud".
En effet, dès cette époque on pouvait voir que derrière les enjeux économiques se cachaient les enjeux impérialistes entre les grandes puissances européennes qui se disputaient le contrôle de cette région. D’ailleurs la puissance britannique fit tout pour circonscrire la présence de sa rivale allemande à l’ouest de l’Afrique du Sud, dans ce qui s’appelle aujourd’hui la Namibie (colonisée en 1883), et ce après avoir neutralisé le Portugal, autre puissance impérialiste aux moyens beaucoup plus limités. Dès lors, l’empire britannique pouvait pavoiser en restant le seul maître aux commandes de l’économie sud-africaine en pleine expansion.
Mais le développement économique de l’Afrique du Sud, propulsé par les découvertes minières, se heurta très vite à une série de problèmes en premier lieu d’ordre social et idéologique. En effet :
"Le développement économique, stimulé par la découverte des mines ne tardera pas à placer les colons blancs devant une contradiction profonde (…). D’une part la mise en place du nouvel ordre économique nécessitait la constitution d’une main-d’œuvre salariée ; de l’autre, la libération de la force de travail africaine hors réserves et hors de leur économie de subsistance traditionnelle mettait en péril l’équilibre racial dans l’ensemble du territoire. Dès la fin du siècle dernier (le 19e), les populations africaines furent donc l’objet d’une multitude de lois aux effets souvent contradictoires. Certaines visaient à les faire migrer dans les zones d’activités économiques blanches pour se soumettre au salariat. D’autres tendaient à les maintenir en partie dans les réserves. Parmi les lois destinées à fabriquer une main-d’œuvre disponible, il y en eut qui pénalisaient le vagabondage et devaient "arracher les indigènes à cette oisiveté et de paresse, leur apprendre la dignité du travail, et leur faire contribuer à la prospérité de l’État". Il y en eut pour soumettre les Africains à l’impôt. (…) Parmi les autres lois, celles sur les laissez-passer avaient pour but de filtrer les migrations, de les orienter en fonction des besoins de l’économie ou de les stopper en cas de pléthore". (Brigitte Lachartre. Ibid.)
On voit là que les autorités coloniales britanniques se trouvèrent dans des contradictions liées au développement des forces productives. Mais on peut dire que la contradiction la plus forte d’alors fut d’ordre idéologique quand la puissance anglaise décida de considérer la main-d’œuvre noire sur des critères administratifs ségrégationnistes en particulier à l’instar des lois sur les laissez-passer et le parcage des africains. En fait cette politique était en contradiction flagrante avec l’orientation libérale ayant conduit à la suppression de l’esclavage.
D'autres difficultés liées aux guerres coloniales se manifestèrent également. Après avoir subi des défaites et gagné des guerres face à ses adversaires Zoulous et Afrikaners entre 1870 et 1902, l’empire britannique dut digérer le coût extrêmement élevé de ses victoires, notamment celle de 1899/1902, aussi bien sur le plan humain qu’économique. En effet, "la guerre des Boers" a été une boucherie : "La guerre des Boers fut la plus grande guerre coloniale de l’ère impérialiste moderne. Elle dura plus de deux ans et demi (du 11 octobre 1899 au 31 mai 1902). Les Britanniques y engagèrent environ un demi-million de soldats, dont 22 000 trouvèrent la mort en Afrique du Sud. Leurs pertes totales, c'est-à-dire l’ensemble de leurs tués, blessés et disparus, s’élevèrent à plus de 100 000 hommes. Les Boers, quant à eux, mobilisèrent près 100 000 hommes. Ils perdirent plus de 7 000 combattants et près de 30 000 des leurs moururent dans les camps. Un nombre indéterminé d’Africains combattaient aux côtés des uns et des autres. Les pertes qu’ils subirent sont elles aussi indéterminées. Des dizaines de milliers d’entre eux perdirent sans doute la vie. Le War Office britannique calcula également que 400 346 chevaux, ânes et mules périrent lors de ce conflit, ainsi que des millions de têtes de bétail appartenant au Boers. Cette guerre coûta aux contribuables britanniques 200 000 000 de livres sterling, soit dix fois le budget annuel de l’armée ou 14 % du revenu national de 1902. Si l’assujettissement des futurs sujets britanniques d’Afrique coûta en moyenne quinze pennies par tête, la soumission des Boers coûta en revanche 1 000 livres sterling par homme". (H .Wesseling. Ibid.)
Autrement dit une sale guerre à ciel ouvert qui inaugura l’entrée du capitalisme britannique dans le 20e siècle. Surtout, on aura remarqué dans les détails de cette horrible boucherie que les camps de concentration hitlériens purent y trouver une source d’inspiration. En effet, le capitalisme britannique fit aménager au total quarante-quatre camps destinés aux Boers où furent emprisonnés environ 120 000 femmes et enfants. À la fin de la guerre, en 1902 on constata que 28 000 détenus blancs y avaient perdu la vie, parmi lesquels 20 000 enfants de moins de 16 ans.
Pourtant ce fut sans remords que le commandant de l’armée britannique Lord Kitchener 7 justifia les massacres en parlant des Boers comme "une espèce de sauvages issue de générations ayant mené une existence barbare et solitaire".
Il s’agit de propos cyniques d’un grand criminel de guerre. Certes on se doit de noter que, dans cette boucherie, les troupes afrikaners ne furent pas en reste en termes de massacres de masse et d’atrocités, et que des dirigeants Afrikaners furent plus tard des alliés de l’armée allemande pendant la Seconde Guerre et ce avant tout pour régler leurs comptes avec la puissance britannique. "Vaincus par l’impérialisme britannique, soumis au système capitaliste, humiliés dans leur culture et leurs traditions, le peuple afrikaner (…) s’organise à partir de 1925-1930 dans un fort mouvement de réhabilitation de la nation afrikaner. Son idéologie revancharde, anticapitaliste, anticommuniste et profondément raciste désigne Africains, métis, Asiatiques et juifs, comme autant de menaces sur la civilisation occidentale qu’ils prétendent représenter sur le continent africain. Organisés à tous les niveaux, école, église, syndicat et en sociétés secrètes terroristes (dont la plus connue est Broederbond), les Afrikaners se montrèrent plus tard de fervents partisans de Hitler, du nazisme et de son idéologie". (Brigitte Lachartre. Ibid.)
Le fait que des ouvriers afrikaner aient été entraînés dans un mouvement adoptant un tel positionnement illustre l’immensité de l’obstacle que devait franchir la classe ouvrière dans ce pays pour se joindre aux combats ouvriers d’autres ethnies.
Ce conflit façonna durablement les rapports entre les colonialismes britannique et afrikaner sur le sol sud-africain jusqu’à la chute de l’apartheid. Aux divisions et haines ethniques entre blancs Britanniques et Afrikaners, se superposaient celles entre, d’une part, ces deux catégories et, d’autre part, les noirs (et autres hommes de couleur) que la bourgeoisie utilisa systématiquement pour briser toutes tentatives d’unité dans les rangs ouvriers.
Naissance de la classe ouvrière
La naissance du capitalisme entraîna la dislocation de bon nombre de sociétés traditionnelles africaines. En effet, à partir des années 1870, l’empire britannique entreprit une politique coloniale libérale en abolissant l’esclavage dans les régions qu’il contrôlait dans le but de "libérer" la force de travail constituée alors de travailleurs agricoles boers et africains. Signalons que les colons boers, eux, continuaient d’exploiter les agriculteurs noirs sous l’ancienne forme d’esclavage avant d’être vaincus par les britanniques. Mais, en dernière analyse, ce fut la découverte de l’or qui accéléra brusquement à la fois la naissance du capitalisme et celle de la classe ouvrière : "Le capital ne manquait pas. Les bourses de Londres et de New York fournirent volontiers les fonds nécessaires. L’économie mondiale, qui était en pleine croissance, réclamait l’or. Les ouvriers affluèrent aussi. L’exploitation minière attira les foules dans le Rand. Les gens vinrent s’y installer non pas par milliers, mais par dizaines de milliers. Aucune ville au monde ne connut alors un développement aussi rapide que Johannesburg" 8.
En effet, en l’espace de 20 ans la population européenne de Johannesburg passa de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers (250 000) dont une majorité d’ouvriers qualifiés, ingénieurs et autres techniciens. Ce sont eux qui donnèrent naissance à la classe ouvrière sud-africaine au sens marxiste du terme, c'est-à-dire ceux qui, sous le capitalisme, vendent leur force de travail en échange d’une rémunération. En fait, il convient de préciser que le capital avait un besoin important et urgent de main-d’œuvre plus ou moins qualifiée qui ne se trouvait pas sur place, d’où le recours aux migrants venus d’Europe et notamment de l’empire britannique. Mais, au fur et à mesure que progressait le développement économique, l’appareil industriel fut acculé à recruter de plus en plus de travailleurs africains non qualifiés se trouvant à l’intérieur du pays ou à l’extérieur, venant notamment du Mozambique et du Zimbabwe. Dès lors la main-d’œuvre économique sud-africaine "s’internationalisa" véritablement.
Comme conséquence de l’arrivée massive en Afrique du Sud des travailleurs d’origine britannique, la classe ouvrière fut d’emblée organisée et encadrée par les syndicats anglais et, au début des années 1880, nombreuses furent les sociétés et corporations qui se créèrent sur le "modèle anglais" (trade-union). Cela veut dire que les ouvriers d’origine sud-africaine, en tant que groupes ou individus sans expérience organisationnelle, pouvaient difficilement s’organiser en dehors des organisations syndicales préétablies 9. Certes, il y eut des dissidences au sein des syndicats comme au sein des partis se réclamant de la classe ouvrière avec tentatives de développer une activité syndicale autonome de la part d’éléments prolétariens radicaux qui ne supportaient plus la "trahison des dirigeants". Mais ceux-là furent très minoritaires.
Comme partout dans le monde où il existe des affrontements de classes sous le capitalisme, la classe ouvrière finit toujours par secréter des minorités révolutionnaires se réclamant, plus ou moins clairement, de l’internationalisme prolétarien. Ce fut aussi le cas en Afrique du Sud. Quelques éléments ouvriers furent à l’origine de luttes mais aussi à l’initiative de la formation d’organisations prolétariennes. Parmi ces éléments nous proposons de présenter trois figures de cette génération sous la forme d’un résumé succinct de leur trajectoire.
- Andrew Dunbar (1879-1964). Immigrant écossais, il fut secrétaire général du syndicat l’IWW (Industrial Workers of the World) créé en 1910 en Afrique du Sud. Il était cheminot à Johannesburg et participa activement à la grève massive de 1909 à l’issue de laquelle il fut licencié. En 1914, il lutta contre la guerre et participa à la création de la Ligue Internationale Socialiste (ISL), tendance syndicaliste révolutionnaire. Il lutta aussi contre les mesures répressives et discriminatoires contre les Africains, ce qui lui attira la sympathie des travailleurs noirs. Il fut d’ailleurs à l’origine de la création du premier syndicat africain "Union africaine" sur le modèle de l’IWW en 1917. Mais sa sympathie pour la révolution russe devenant de plus en plus grande, il décida alors, avec d’autres camarades, de former le "Parti communiste de l’Afrique" en octobre 1920 sur une plate-forme essentiellement syndicaliste et dont il fut secrétaire. En 1921, son organisation décida de fusionner avec le Parti Communiste officiel qui venait de voir le jour. Mais il en fut exclu quelques années plus tard et abandonna dans la foulée ses activités syndicales.
- TW Thibedi (1888-1960). Il fut considéré comme un grand syndicaliste membre de l’IWW (il y adhéra en 1916). Il était originaire de la ville sud-africaine de Vereeniging et exerça un métier d’enseignant dans une école dépendant d’une église à Johannesburg. Dans le cadre de ses activités syndicales il prônait l’unité de classe et l’action de masse contre le capitalisme. Il faisait partie de l’aile gauche du parti nationaliste africain "Congrès national indigène sud-africain" (SANNC). Thibedi lui aussi était membre de l’ISL et lors d'un mouvement de grève dirigé par ce groupe en 1918 il subit avec ses camarades une dure répression policière. Membre du PC sud-africain dès le début, il en fut exclu en 1928 mais, face à la réaction de nombre de ses camarades, il fut réintégré avant d’être définitivement chassé du parti et il décida ensuite de sympathiser brièvement avec la mouvance trotskiste avant d’entrer dans l’anonymat complet. Signalons que les sources dont nous disposons 10 ne donnent pas d’ordre de grandeur des militants trotskistes sud-africains de cette époque.
- Bernard Le Sigamoney (1888-1963). Indien d’origine et issue d’une famille d’agriculteurs, il fut membre actif du syndicat IWW indien et, comme ses camarades précédemment cités, il fut aussi membre de l’ISL. Il s’investit en faveur de l’unité des travailleurs de l’industrie de l’Afrique du Sud, de même que, avec ses camarades de l’ISL, il fut à la tête d’importants mouvements de grève en 1920/1921. Cependant, il ne rejoignit pas le Parti Communiste et décida d’abandonner ses activités politiques et syndicales en allant étudier en Grande Bretagne en 1922. En 1927 il revint en Afrique du Sud (Johannesburg) comme missionnaire pasteur anglican tout en reprenant ses activités syndicales au sein d’organisations proches de l’IWW. Il fut alors dénoncé comme "fauteur de troubles" par les autorités et finit par se décourager en se contentant de ses travaux dans l’église et de la promotion des droits civils des personnes de couleur.
Voilà donc 3 "portraits" de militants à trajectoires syndicales et politiques assez similaires tout en étant d’origine ethnique différente (un européen, un africain et un indien). Mais, surtout, ils partagent une caractéristique commune essentielle : la solidarité de classe prolétarienne et l’esprit internationaliste avec une grande combativité contre l’ennemi capitaliste. Ce furent eux et leurs camarades de lutte les précurseurs des combattants ouvriers actuels en Afrique du Sud.
D’autres organisations, de nature et origine différentes ont eu une action au sein de la classe ouvrière. Il s’agit des principaux partis et organisations 11 se réclamant à l’origine plus ou moins formellement de la classe ouvrière ou prétendant défendre ses "intérêts", ceci à l’exclusion de Parti Travailliste qui est demeuré fidèle à sa bourgeoisie depuis sa participation active à la première boucherie mondiale. Plus précisément nous donnons ici un aperçu 12 de la nature et origine de l’ANC et du PC sud-africain en tant que forces d’encadrement idéologique de la classe ouvrière depuis les années 1920.
- L’ANC. Cette organisation fut créée en 1912 par et pour la petite bourgeoisie indigène (médecins, juristes, enseignants et autres fonctionnaires, etc.), des individus qui réclamaient la démocratie, l’égalité raciale et en se revendiquant du système constitutionnel anglais comme l’illustrent les dires mêmes de Nelson Mandela 13 : "Pendant 37 ans, c'est-à-dire jusqu’en 1949, le Congrès national africain lutta en respectant scrupuleusement la légalité (…) On croyait alors que les griefs des Africains pourraient être pris en considération au terme de discussions pacifiques et que l’on s’acheminerait lentement vers une pleine reconnaissance des droits de la nation africaine".
En ce sens, depuis sa naissance jusqu’aux années 1950 14, l’ANC menait plutôt des actions pacifiques respectueuses de l’ordre établi, et était donc très loin de vouloir renverser le système capitaliste. De même que Mandela se vantait de son combat "anti-communiste" comme le souligne son autobiographie "Un long chemin vers la liberté". Mais l’orientation stalinienne, suggérant une alliance entre la bourgeoisie ("progressiste") et la classe ouvrière, permit à l’ANC de s’appuyer sur le PC pour avoir pied dans les rangs ouvriers, notamment par le biais des syndicats que ces deux partis contrôlent ensemble jusqu’aujourd’hui.
- Le Parti Communiste sud-africain. Le PC fut créé par des éléments se réclamant de l’internationalisme prolétarien et à ce titre fut membre de la Troisième Internationale (en 1921). À ses débuts, il préconisait l’unité de la classe ouvrière et mettait en perspective le renversement du capitalisme et l’instauration du communisme. Mais il devint, dès 1928, un simple bras exécutant des orientations de Staline dans la colonie sud-africaine. En effet, la théorie stalinienne du "socialisme en un seul pays" s’accompagnait de l’idée suivant laquelle les pays sous-développés devaient obligatoirement passer par "une révolution bourgeoise" et que, dans cette optique, le prolétariat pouvait toujours lutter contre l’oppression coloniale mais pas question d’instaurer un quelconque pouvoir prolétarien dans les colonies de l’époque.
Le PC sud-africain appliqua cette orientation jusqu’à l’absurde en devenant même le chien fidèle de l’ANC dans les années 1950, comme l’illustre ce propos : "Le PC fit des offres de service à l’ANC. Le secrétaire général du PC expliquait à Mandela : "Nelson, qu’est-ce tu as contre nous ? Nous combattons le même ennemi. Nous ne parlons pas de dominer l’ANC ; nous travaillons dans le contexte du nationalisme africain". Et au cours de l’année 1950 Mandela accepta que le PC mette son appareil militant au service de l’ANC, en lui offrant ainsi le contrôle sur une bonne partie du mouvement ouvrier et un avantage important permettant à l’ANC de prendre l’hégémonie sur l’ensemble du mouvement anti-apartheid. En échange l’ANC servirait de vitrine légale pour l’appareil du PC interdit." 15
De ce fait, ces deux partis ouvertement bourgeois sont devenus inséparables et se trouvent aujourd’hui à la tête de l’État sud-africain pour la défense des intérêts bien compris du capital national et contre la classe ouvrière qu’ils oppressent et massacrent, comme lors du mouvement de grève des mineurs de Marikana en août 2012.
L’apartheid contre la lutte de classe
Voilà un mot barbare honni aujourd’hui dans le monde entier, même par ses anciens soutiens tant il a longtemps symbolisé et incarné la forme d’exploitation capitaliste la plus ignoble contre les couches et classes appartenant au prolétariat sud-africain. Mais avant d’aller plus loin nous proposons une définition parmi d’autres de ce terme : En langue "afrikaans" parlée par les Afrikaners, apartheid signifie "séparation", plus précisément séparation raciale, sociale, culturelle, économique, etc... Mais derrière cette définition formelle du mot apartheid se cache une doctrine véhiculée par des capitalistes et colonialistes "primitifs" mêlant objectifs économiques et idéologiques : "L’apartheid est issu à la fois du système colonial et du système capitaliste ; à ce double titre, il imprime à la société sud-africaine des divisions de races caractéristiques du premier, et des divisions de classes inhérentes au second. Comme bien d’autres lieux du globe, il y a coïncidence presque parfaite entre races noires et classe exploitée. À l’autre pôle cependant, la situation est moins claire. En effet, la population blanche ne peut pas être assimilée à une classe dominante sans autre forme de procès. Elle est, certes, constituée d’une poignée de détenteurs des moyens de production, mais aussi de la masse de ceux qui en sont dépossédés : ouvriers agricoles et de l’industrie, mineurs, employés du tertiaire, etc. Il n’y a donc pas identité entre race blanche et classe dominante. (…) Or, rien de tel ne s’est jamais produit [la main-d’œuvre blanche côtoyant la main-d’œuvre noire sur un pied d’égalité] ni ne se produira jamais en Afrique du Sud tant que l’apartheid sera en vigueur. Car ce système a pour but d’éviter toute possibilité de création d’une classe ouvrière multiraciale .16 C’est là que l’anachronisme du système de pouvoir sud-africain, que ses mécanismes datant d’une autre époque viennent au secours du système capitaliste qui tend généralement à simplifier les rapports au sein de la société. L’apartheid - dans sa forme la plus complète -est venu consolider l’édifice colonial, au moment où le capitalisme risquait de faire crouler la toute-puissance des Blancs. Le moyen en a été une idéologie et une législation visant à annihiler les antagonismes de classe à l’intérieur de la population blanche, à en extirper les germes, à en gommer les contours et à les remplacer par des antagonismes de races.
En déplaçant les contradictions d’un terrain difficile à contrôler (division de la société en classes antagoniques) sur celui, plus facilement maîtrisable, de la division non antagonique de la société entre races, le pouvoir blanc a pratiquement atteint le résultat escompté : constituer un bloc homogène et uni du côté de l’ethnie blanche - bloc d’autant plus solide qu’il se croit historiquement menacé par le pouvoir noir et le communisme - et de l’autre côté, diviser les populations noires entre elles, par tribus distinctes ou par couches sociales aux intérêts différents.
Les dissonances, les antagonismes de classe qui sont minimisés, ignorés ou gommés du côté blanc, sont encouragés, soulignés et provoqués du côté noir. Cette entreprise de division - facilitée par la présence sur le sol sud-africain de populations aux origines très diverses - est systématiquement menée depuis la colonisation : détribalisation d’une partie des populations africaines, maintien dans les structures traditionnelles d’une autre ; évangélisation et instruction de certains, privation de toute possibilité d’éducation des autres ; instauration de petites élites de chefs et de fonctionnaires, paupérisation des grandes masses ; enfin, mise en place à grand renfort de publicité d’une petite bourgeoisie africaine, métisse, indienne, composée d’individus- tampons prêts à s’interposer entre leurs frères de races et leurs alliés de classe" (Brigitte Lachartre. Ibid.)
Nous sommes globalement d’accord avec le cadre de définition et d’analyse du système d’apartheid de cet auteur. Nous sommes particulièrement de son avis quand elle affirme que l’apartheid est avant tout un instrument idéologique au service du capital contre l’unité (dans la lutte) des différents membres de la classe exploitée, en l’occurrence les ouvriers de toutes couleurs. Autrement dit, le système d’apartheid est avant tout une arme contre la lutte de classe comme moteur de l’histoire, la seule qui soit capable de renverser le capitalisme. Aussi, si l’apartheid fut théorisé et appliqué à fond à partir de 1948 par la fraction Afrikaner la plus rétrograde de la bourgeoisie coloniale sud-africaine, ce sont quand même les Britanniques porteurs de la "civilisation la plus moderne" qui posèrent les jalons de ce système abject. "En effet, c’est dès le début du XIXe siècle que les envahisseurs britanniques avaient pris des mesures législatives et militaires pour regrouper une partie des populations africaines dans les "réserves", laissant ou contraignant l’autre partie à en sortir pour s’employer à travers le pays dans les divers secteurs "économiques. La superficie de ces réserves tribales fut fixée en 1913 et légèrement agrandie en 1936 pour n’offrir à la population (noire) que 13 % du territoire national. Ces réserves tribales fabriquées de toutes pièces par le pouvoir blanc (…) ont reçu le nom Bantoustans (…) "foyers nationaux pour Bantous", chacun d’eux devant théoriquement regrouper les membres d’une même ethnie". (Brigitte Lachartre. Ibid.)
Ainsi, l’idée de séparer les races et les populations fut initiée par le colonialisme anglais qui appliqua méthodiquement sa fameuse stratégie dite "diviser pour régner" en instaurant une séparation ethnique, pas seulement entre blancs et noirs mais plus cyniquement encore entre les ethnies noires.
Cependant, les tenants du système ne purent jamais empêcher l’éclatement de ses propres contradictions générant inévitablement la confrontation entre les deux classes antagoniques. En clair, sous ce système barbare, de nombreuses luttes ouvrières furent menées aussi bien par les ouvriers blancs que par les ouvriers noirs (ou métis et indiens).
Certes, la bourgeoisie sud-africaine a remarquablement réussi à rendre les luttes ouvrières impuissantes en empoisonnant durablement la conscience de classe des prolétaires sud-africains. Cela se traduisit par le fait que certains groupes ouvriers se battaient souvent à la fois contre leurs exploiteurs mais aussi contre leurs camarades d’une ethnie différente de la leur, tombant ainsi dans le piège mortel tendu par l’ennemi de classe. En somme, rares furent les luttes unissant ouvriers d’origines ethniques diverses. On sait que nombreuses furent aussi les organisations dites "ouvrières", à savoir syndicats et partis, qui facilitèrent la tâche au capital en cautionnant cette politique de la "division raciale" de la classe ouvrière sud-africaine. Par exemple, les syndicats d’origine européenne en compagnie du Parti Travailliste sud-africain, défendaient d’abord (voire exclusivement) les "intérêts" des ouvriers blancs. De même, les divers mouvements noirs (partis et syndicats) luttaient avant tout contre le sort réservé aux noirs par le système d’exclusion en réclamant l’égalité puis l’indépendance. Cette orientation fut incarnée principalement par l’ANC. Soulignons ici le cas particulier du PC sud-africain qui, dans un premier temps (début années 1920), essaya d’unir la classe ouvrière sans distinction dans le combat contre le capitalisme mais ne tarda pas à abandonner le terrain de l’internationalisme en décidant de privilégier "la cause noire". C’était le début de sa "stalinisation" définitive.
Mouvements de grève et autres luttes sociales entre 1884 et 2013
Première lutte ouvrière à Kimberley.
Comme par hasard, le diamant qui donna naissance symboliquement au capitalisme sud-africain fut aussi à l’origine du premier mouvement de lutte prolétarienne. En effet, la première grève ouvrière éclata à Kimberley, "capitale diamantaire" en 1884 où les mineurs d’origine britannique décidèrent de lutter contre la décision des compagnies minières de leur imposer le système dit "compound" (camp de travail forcé) réservé jusqu’alors aux travailleurs noirs. Dans cette lutte, les mineurs organisèrent des piquets de grève pour imposer un rapport de force leur permettant de satisfaire leurs revendications. Tandis que pour faire plier les grévistes, les employeurs engagèrent d’un côté des "jaunes" et de l’autre des troupes armées jusqu’aux dents qui ne tardèrent pas à tirer sur les ouvriers. Et on dénombra 4 morts chez les grévistes qui poursuivirent cependant la lutte avec vigueur, ce qui obligea les employeurs à satisfaire leurs revendications. Voilà le premier mouvement de lutte opposant les deux forces historiques sous le capitalisme sud-africain qui se termina dans le sang mais victorieux pour le prolétariat. De ce fait, on peut dire qu’ici débuta la vraie lutte de classe en Afrique du Sud capitaliste, posant les jalons pour les confrontations ultérieures.
Grève contre la réduction des salaires en 1907
Non contents des cadences qu’ils imposèrent aux ouvriers en vue d’un meilleur rendement, les employeurs du Rand 17 décidèrent, courant 1907, de réduire les salaires de 15 %, en particulier ceux des mineurs d’origine anglaise considérés comme "privilégiés". Comme lors de la grève de Kimberley, le patronat recruta des jaunes (afrikaners très pauvres) qui, sans être solidaires des grévistes, refusèrent cependant de faire le sale boulot qu’on leur demandait. Malgré cela le patronat finit par réussir à faire plier les grévistes, notamment grâce à l’usure. Notons ici que les sources dont nous disposons parlent bien de grève d’ampleur mais ne donnent pas de chiffre concernant le nombre des participants au mouvement.
Grèves et manifestations en 1913
Face à la réduction massive des salaires et à la dégradation de leurs conditions de travail, les mineurs entrèrent massivement en lutte. En effet, courant 1913, une grève fut lancée par les ouvriers d’une mine contre les heures supplémentaires que l’entreprise voulait leur imposer. Et il n’en fallut pas plus pour généraliser le mouvement à tous les secteurs avec des manifestations de masse, lesquelles furent néanmoins brisées violemment par les forces de l’ordre. Au final on compta (officiellement) une vingtaine de morts et une centaine de blessés.
Grève des cheminots et des charbonniers en 1914
Au début de cette année-là éclata une série de grèves aussi bien chez les mineurs de charbon que chez les cheminots contre la dégradation des conditions de travail. Mais ce mouvement de lutte se situa dans un contexte particulier, celui des terribles préparatifs de la première boucherie impérialiste généralisée. Dans ce mouvement, on put remarquer la présence de la fraction afrikaner, mais à l’écart de la fraction anglaise. Bien entendu toutes deux bien encadrées par leurs syndicats respectifs dont chacun défendait ses propres "clients ethniques".
Dès lors le gouvernement s’empressa d’instaurer la loi martiale sur laquelle il s’appuya pour briser physiquement la grève et ses initiateurs et en emprisonnant ou en déportant un grand nombre de grévistes dont on ignore encore le nombre exact des victimes. Par ailleurs, nous tenons à souligner ici le rôle particulier des syndicats dans ce mouvement de lutte. En effet, ce fut dans ce même contexte de répression des luttes que les dirigeants syndicaux et du Parti Travailliste votèrent les "crédits de guerre" en soutenant l’entrée en guerre de l’Union Sud-Africaine contre l’Allemagne.
Agitations ouvrières contre la guerre de 1914 et tentatives d’organisation
Si la classe ouvrière fut muselée globalement durant la guerre 1914/18, en revanche quelques éléments prolétariens purent tenter de s’y opposer en préconisant l’internationalisme contre le capitalisme. Ainsi : " (…) En 1917, une affiche fleurit sur les murs de Johannesburg, convoquant une réunion pour le 19 juillet : "Venez discuter des points d’intérêt commun entre les ouvriers blancs et les indigènes". Ce texte est publié par l’International Socialist League (ISL), une organisation syndicaliste révolutionnaire influencée par les IWW américains (…) et formée en 1915 en opposition à la Première Guerre mondiale et aux politiques racistes et conservatrices du parti travailliste sud-africain et des syndicats de métiers. Comptant au début surtout des militants blancs, l’ISL s’oriente très vite vers les ouvriers noirs, appelant dans son journal hebdomadaire L’International, à construire "un nouveau syndicat qui surmonte les limites des métiers, des couleurs de peau, des races et du sexe pour détruire le capitalisme par un blocage de la classe capitaliste" " 18.
Dès 1917, L’ISL organise des ouvriers de couleurs. En mars 1917, elle fonde un syndicat d’ouvriers indiens à Durban. En 1918, elle fonde un syndicat des travailleurs du textile (se déclarant aussi plus tard à Johannesburg) et un syndicat des conducteurs de cheval à Kimberley, ville d’extraction de diamant. Au Cape, une organisation sœur, L’Industrial Socialist League, fonde la même année un syndicat des travailleurs des sucreries et confiseries.
La réunion du 19 juillet est un succès et constitue la base de réunions hebdomadaires de groupes d’étude menés par des membres de L’ISL (notamment Andrew Dunbar, fondateur de L’IWW en Afrique du Sud en 1910). Dans ces réunions, on discute du capitalisme, de la lutte des classes et de la nécessité pour les ouvriers africains de se syndiquer afin d’obtenir des augmentations de salaires et de supprimer le système du droit de passage. Le 27 septembre suivant, les groupes d’étude se transforment en un syndicat, L’Industrial Workers of Africa (IWA), sur le modèle des IWW. Son comité d’organisation est entièrement composé d’Africains. Les demandes des nouveaux syndicats sont simples et intransigeantes dans un slogan : Sifuna Zonke ! ("Nous voulons tout !").
Enfin, voilà l’expression de l’internationalisme prolétarien naissant. Un internationalisme porté par une minorité d’ouvriers mais d’une haute importance à l’époque, car ce fut au moment où nombre de prolétaires étaient ligotés et entraînés dans la première boucherie impérialiste mondiale par le Parti Travailliste traître en compagnie des syndicats officiels. Un autre aspect qui illustre la force et la dynamique de ces petits regroupements internationalistes fut le fait que des éléments (notamment de la Ligue Internationale Socialiste et d’autres) purent s’en dégager pour former le Parti Communiste sud-africain en 1920. Ce furent ces groupes dominés apparemment par les tenants du syndicalisme révolutionnaire qui purent favoriser activement l’émergence de syndicats radicaux en particulier chez les travailleurs noirs ou de couleurs.
Une vague de grèves en 1918
Malgré la dureté des temps d’alors avec les lois martiales réprimant toute réaction ou mouvement de protestation, des grèves purent se produire : "En 1918, une vague sans précédent de grèves contre le coût de la vie et pour des augmentations de salaire, rassemblant ouvriers blancs et de couleur, submerge le pays. Lorsque le juge McFie fait jeter en prison 152 ouvriers municipaux africains en juin 1918, les enjoignant à continuer "d’effectuer le même travail qu'auparavant" mais maintenant depuis la prison sous surveillance d’une escorte armée, les progressistes blancs et africains sont outragés. Le TNT (le Transvaal Native Congres, ancêtre de l’ANC) appelle à un rassemblement de masse des ouvriers africains à Johannesburg le 10 juin". (http//www-pelloutier.net, déjà cité).
On doit souligner ici un fait important ou symbolique : voilà l’unique implication (connue) de l’ANC dans un mouvement de lutte de classe au sens premier du terme. C’est certainement une des raisons expliquant le fait que cette fraction nationaliste ait pu par la suite avoir une influence au sein de la classe ouvrière noire.
Grèves massives en 1919/1920 réprimées dans le sang
Courant 1919 un syndicat radical (Industrial and Commercial Workers Union) composé de noirs et métis mais sans les blancs lança un vaste mouvement de grève notamment chez les dockers du Port-Elisabeth. Mais une fois de plus ce mouvement fut brisé militairement par la police épaulée par des groupes blancs armés et provoquant plus de 20 morts chez les grévistes. Voilà encore des grévistes isolés et ainsi assurée la défaite de la classe ouvrière dans un combat inégal sur le plan militaire.
En 1920 ce furent cette fois les mineurs africains qui déclenchèrent une des plus grandes grèves du pays touchant quelques 70 000 travailleurs. Un mouvement qui dura une semaine avant d’être écrasé par les forces de l’ordre qui, par les armes, liquidèrent un grand nombre de grévistes. À souligner le fait que, malgré sa massivité, ce mouvement des ouvriers africains ne put bénéficier du moindre soutien des syndicats blancs qui refusèrent d’appeler à la grève et de venir en aide aux victimes des balles de la bourgeoise coloniale. Et malheureusement ce manque de solidarité encouragé par les syndicats devint systématique dans chaque lutte.
En 1922 une grève insurrectionnelle écrasée par une armée suréquipée
Fin décembre 1921, le patronat des mines de charbon annonça des réductions massives de salaires et des licenciements visant à remplacer 5 000 mineurs européens par des indigènes. En janvier 1922, 30 000 mineurs décidèrent de partir en lutte contre les attaques des employeurs miniers. En effet, face aux tergiversations des syndicats, un groupe d’ouvriers prit l’initiative de la riposte en se dotant d’un comité de lutte et décrétant une grève générale. De ce fait les mineurs forcèrent ainsi les dirigeants syndicaux à suivre le mouvement, mais cette grève ne fut pas tout à fait "générale" car elle ne concernait que les "blancs".
Face à la pugnacité des ouvriers, l’État et le patronat unis décidèrent alors d’employer les plus gros moyens militaires pour venir à bout du mouvement. En effet, pour faire face à la grève, le gouvernement décréta la loi martiale et regroupa quelques 60 000 mille hommes équipés de mitrailleuses, canons, chars et même des avions.
De leur côté, voyant l’ampleur de l’armement de leurs ennemis, les grévistes se mirent à s’armer en se procurant des armes (fusils et autres) et s’organisant en commandos. Dès lors on assista à une véritable bataille militaire comme dans une guerre classique. Au terme du combat on énuméra du côté ouvrier plus de 200 morts, 500 blessés, 4750 arrestations, 18 condamnations à mort. En clair, il s’est agi là d’une vraie guerre, comme si l’impérialisme sud-africain qui prit part active dans la première boucherie mondiale voulait prolonger son action en bombardant les ouvriers mineurs comme il affrontait les troupes allemandes. En clair, par ce geste la bourgeoisie coloniale britannique fit la démonstration de sa haine absolue du prolétariat sud-africain mais aussi de sa terrible peur de ce dernier.
En termes de leçons à tirer de ce mouvement, il convient de dire que, malgré son caractère très militaire, cette confrontation sanglante fut surtout une vraie guerre de classe, en l’occurrence le prolétariat contre la bourgeoisie, avec cependant des moyens inégaux. Cela ne fait que souligner que la force première de la classe ouvrière n’est pas militaire mais réside avant tout dans son unité la plus large possible. Au lieu de chercher le soutien de l’ensemble des exploités, les mineurs (blancs) tombèrent dans le piège tendu par la bourgeoisie à travers son projet de remplacer les 5 000 ouvriers européens par des indigènes. Cela se traduisit tragiquement par le fait que, durant toute la bataille rangée entre les mineurs européens et les forces armées du capital, les autres ouvriers (noirs, métis et indiens) eux, furent 200 000 à travailler ou à croiser les bras. Il est clair aussi que, dès le départ, la bourgeoisie était visiblement consciente de l’état de faiblesse des ouvriers allant au combat profondément divisés. En fait la recette abjecte "diviser pour régner" a été appliquée ici avec succès bien avant l’instauration officielle de l’apartheid (dont le but principal - rappelons-le - est avant tout contre la lutte de classe). Mais surtout la bourgeoisie profita de sa victoire militaire sur les prolétaires sud-africains pour renforcer son emprise sur la classe ouvrière. Elle organisa des élections en 1924 dont sortirent vainqueurs les partis populistes clientélistes se voulant défenseurs des "intérêts des Blancs", à savoir le Parti National (Boer) et le Parti Travailliste qui formèrent une coalition gouvernementale. Ce fut cette coalition gouvernementale qui promulgua les lois instaurant des divisions raciales allant jusqu’à assimiler à un crime une rupture de contrat de travail par un noir ; ou encore imposant un système de laissez-passer pour les noirs et instaurant des zones de résidence obligatoire pour les indigènes. De même "La barre de la couleur" ("color bar") visait à réserver aux Blancs les emplois qualifiés leur assurant un salaire nettement plus élevé que celui des Noirs ou des Indiens. À cela s’ajoutèrent d’autres lois ségrégationnistes dont celle intitulée "La Loi de Conciliation Industrielle" permettant l’interdiction d’organisations non blanches. Ce fut ce dispositif ultra répressif et ségrégationniste sur lequel s’appuya, en 1948, le gouvernement afrikaner pour instaurer juridiquement l’apartheid.
La bourgeoisie parvint ainsi à paralyser durablement toute expression de lutte de classe prolétarienne et il fallut attendre la veille de la Seconde Guerre mondiale pour voir la classe ouvrière sortir la tête de l’eau en reprenant le chemin des combats de classe. En fait, entre la fin des années 1920 et 1937, le terrain de la lutte fut occupé par le nationalisme : d’un côté, par le PC sud-africain, l’ANC et leurs syndicats, de l’autre, par le Parti National afrikaner et ses satellites.
(à suivre)
Lassou (décembre 2013)
1. Voir la série "Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique, au Sénégal en particulier", dans la Revue internationale : 145, 146, 147, 148 et 149.
2. En août 2012, la police du gouvernement de l’ANC a massacré 34 grévistes des mines de Marikana.
3. Henri Wesseling, Le partage de l’Afrique, Editions Denoel, 1996, pour la traduction française.
4. Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, tom 2, chapitre "La lutte contre l’économie naturelle", Editions Maspero, 1976.
5. Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, Editions Syros, 1977.
6. Henri Wesseling. Ibid.
7. Lord Kitchener, commandant de l’armée britannique d’alors, cité par Henri Wesseling. Ibid.
8. Henri Wesseling, ibid.
9. L’État sud-africain y a certes contribué largement par des lois réprimant toute organisation non blanche.
10. Lucien van der Walt (Bikisha media collective) Site https://zabalaza.net/ [102]
11. Nous reviendrons ultérieurement sur les organisations syndicales se réclamant de la classe ouvrière.
12. Dans l’article suivant on développera sur les rôles des partis/ syndicats agissant au sein de la classe ouvrière.
13. Cité par Brigitte Lachartre. Ibid.
14. C’est au lendemain de l’instauration officielle de l’apartheid en 1948 que le PC et l’ANC entrèrent en lutte armée.
15. Cercle Léon Trotski, Exposé du 29/01/2010, site Internet www.lutte-ouvriere.org [103]
16. Souligné par nous.
17. Nom d'une région, Rand étant un raccourci de Witwatersrand.
18. Une histoire du syndicalisme révolutionnaire en Afrique du Sud, Site : http// www.pelloutier.net [104], 2008.
Géographique:
- Afrique [105]