Revue Internationale n° 147 - 4e trimestre 2011
- 2510 lectures
La catastrophe économique mondiale est inévitable
- 2742 lectures
Ces derniers mois sont intervenus, de façon très rapprochée, des évènements d'une grande portée et qui témoignent de la gravité de la situation économique mondiale : incapacité de la Grèce à faire face à ses dettes ; menaces analogues pour l'Espagne et l'Italie ; mise en garde de la France pour son extrême vulnérabilité face à une éventuelle cessation de paiement de la Grèce ou l'Italie ; blocage à la Chambre des Représentants des États-Unis sur le relèvement du plafond de la dette de l'État ; perte par ce pays de son "triple A" - note maximale qui, jusque-là, caractérisait la garantie de remboursement de sa dette ; rumeurs de plus en plus persistantes sur le risque de faillite de certaines banques, les démentis opposés ne trompant personne, étant donné les suppressions d'emplois massives auxquelles elles ont déjà procédé ; première confirmation de cette rumeur avec la faillite de la banque franco-belge Dexia. Chaque fois, les dirigeants de ce monde courent après les événements mais les brèches qu'ils semblaient avoir colmatées s'ouvrent à nouveau, quelques semaines ou même quelques jours plus tard. Leur impuissance à contenir l'escalade de la crise ne traduit pas tant leur incompétence et leur vue à court terme, que la dynamique actuelle du capitalisme vers des catastrophes qui ne peuvent être évitées : faillites d'établissements financiers, faillites d'États, plongée dans une profonde récession mondiale.
Des conséquences dramatiques pour la classe ouvrière
Les mesures d'austérité prises depuis 2010 sont implacables, plaçant de plus en plus la classe ouvrière - et une grande partie du reste de la population - dans l'incapacité de faire face à leurs besoins vitaux. Énumérer toutes les mesures d'austérité qui ont été mises en place dans la zone euro, ou qui sont en train de l'être, aboutirait à un très long catalogue. Il est malgré tout nécessaire d'en mentionner un certain nombre qui tendent à se généraliser et sont significatives du sort qui est fait à des millions d'exploités. En Grèce, alors qu'en 2010 les impôts sur les biens de consommation avaient été augmentés, l'âge de la retraite repoussé à 67 ans, et les salaires des fonctionnaires réduits brutalement, il a été décidé, au mois de septembre 2011, de mettre au chômage technique 30 000 employés de la fonction publique avec une diminution de 40% de leur salaire, de réduire de 20% le montant des retraites de plus de 1200 euros et d'imposer tous les revenus supérieurs à 5000 euros par an 1. Dans presque tous les pays les impôts augmentent, l'âge de la retraite est relevé et des emplois publics sont supprimés par dizaines de milliers. Il en résulte des dysfonctionnements importants des services publics, y compris ceux revêtant un caractère vital ; ainsi, dans une ville comme Barcelone, les blocs opératoires et les services d'urgence ont réduit leurs heures d'ouverture et des lits d'hôpitaux sont supprimés en masse 2 ; à Madrid, 5000 professeurs non-titulaires ont perdu leur poste 3 et cela a été compensé par l'augmentation de 2 heures de la durée hebdomadaire d'enseignement des professeurs titulaires.
Les chiffres du chômage sont de plus en plus alarmants : 7,9% au Royaume-Uni à la fin août, 10% en zone euro (20% en Espagne) à la fin septembre 4 et 9,1% aux États-Unis à la même période. Durant tout l'été, les plans de licenciements ou de suppression d'emplois se sont succédés : 6500 chez Cisco, 6000 chez Lockheed Martin, 10000 chez HSBC, 30000 chez Bank of America, et la liste n'est pas close. Les revenus des exploités chutent : selon les chiffres officiels, le salaire réel avait diminué de plus de 10% en rythme annuel en Grèce au début 2011, de plus de 4% en Espagne et, dans une moindre mesure, au Portugal et en Italie. Aux États-Unis, 45,7 millions de personnes, soit une augmentation de 12% en un an 5, ne survivent que grâce au système des bons d'alimentation de 30 dollars par semaine délivrés par l'Administration.
Et malgré cela, le pire est encore à venir.
Ainsi, c'est toujours avec plus d'acuité que se pose la nécessité du renversement du système capitaliste avant que, dans son effondrement, il n'entraîne la ruine de l'humanité. Les mouvements de protestation en réaction aux attaques et qui ont eu lieu depuis le printemps 2011 dans un certain nombre de pays, quelles que soient les insuffisances ou les faiblesses qu'ils peuvent exprimer, constituent néanmoins les premiers jalons d'une riposte prolétarienne d'ampleur à la crise du capitalisme (voir à ce sujet l'article "De l'indignation à la préparation des combats de classe" dans ce numéro de la Revue internationale).
Depuis 2008 la bourgeoisie n'est pas parvenue à endiguer la tendance à la récession
L'illusion pouvait exister, au début de l'années 2010, que les États étaient parvenus à mettre le capitalisme à l'abri d'une poursuite de la récession qui avait eu lieu en 2008 et début 2009 et s'était traduite par une chute vertigineuse de la production. A cette fin, toutes les grandes banques centrales du monde avaient procédé à des injections massives de monnaie dans l'économie. C'est à cette occasion que Ben Bernanke, le directeur de la FED (à l'origine du lancement de plans de relance considérables), fut surnommé "Helicopter Ben" tant il paraissait arroser les États-Unis de dollars depuis un hélicoptère. Entre 2009 et 2010, d'après les chiffres officiels que l'on sait toujours surévalués, le taux de croissance était passé aux États-Unis de 2,6% à +2,9% et, dans la zone euro, de 4,1% à +1,7%. Dans les pays émergents, les taux de croissance, qui avaient baissé, semblaient retrouver en 2010 les valeurs antérieures à la crise financière : 10,4% en Chine, 9% en Inde. Tous les États et leurs médias avaient alors entonné le couplet de la reprise alors qu'en réalité la production de l'ensemble des pays développés n'est jamais parvenue à retrouver ses niveaux de 2007. En d'autres termes, en fait de reprise, on peut tout juste parler d'un pallier au sein d'un mouvement de chute de la production. Et ce palier n'a duré que quelques trimestres :
- Dans les pays développés, les taux de croissance ont recommencé à chuter à partir de la mi-2010. La croissance prévue aux États-Unis pour l'année 2011 est de 0,8%. Ben Bernanke a annoncé que la reprise américaine était sur le point de "marquer le pas". Par ailleurs, la croissance des grands pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni) est voisine de 0 et si les gouvernements des pays du Sud de l'Europe (Espagne, 0,6% en 2011 après -0,1% en 2010 6 ; Italie, 0,7% en 2011) 7 sont en train de nous répéter sur tous les tons que leur pays "n'est pas en récession", en réalité, compte tenu des plans de rigueur qu'ils ont subi et vont encore subir, la perspective qui les attend n'est certainement n'est pas très éloignée de ce que connaît actuellement la Grèce, pays dont la chute de la production sera supérieure à 5 % en 2011.
- Pour les pays émergents, la situation est loin d'être brillante. S'ils ont connu des taux de croissance importants en 2010 avaient été, l'année 2011 se présente sous un jour beaucoup moins favorable. Le FMI avait prévu qu'ils connaîtraient une croissance de 8,4% l'an pour l'année 2011 8, mais certains indices montrent que l'activité en Chine est en train de ralentir 9. Il est prévu que la croissance du Brésil passe de 7,5% en 2010 à 3,7% en 2011 10 . Et enfin, les capitaux sont en train de fuir la Russie 11. En bref, contrairement à ce que nous ont rabâché les économistes et beaucoup d'hommes politiques depuis des années, les pays émergents ne seront pas la locomotive permettant un retour de la croissance mondiale. Tout au contraire, ceux-ci vont pâtir au premier chef de la dégradation de la situation des pays développés et connaître ainsi une chute de leurs exportations, lesquelles avaient jusqu'alors été le facteur de leur croissance.
Le FMI vient de revoir ses prévisions qui tablaient sur une croissance de 4% au niveau mondial pour les années 2011 et 2012, en signalant, après avoir précédemment constaté que la croissance s'était "considérablement affaiblie", "qu'il ne peut pas exclure" 12 une récession pour l'année 2012. En d'autres termes, la bourgeoisie est en train de prendre conscience à quel point l'activité économique va se contracter. Au vu d'une telle évolution, on ne peut que se poser la question : pourquoi les banques centrales n'ont-elles pas continué à arroser le monde de monnaie comme elles l'ont fait à la fin de l'année 2008 et en 2009, augmentant ainsi de manière considérable la masse monétaire (elle a été multipliée par 3 aux États-Unis et par 2 dans la zone euro) ? La raison en est que le déversement de "monnaie de singe" sur les économies ne résout pas les contradictions du capitalisme. Il en résulte moins une relance de la production que de l'inflation, cette dernière avoisinant 3% en zone euro, un peu plus aux États-Unis, 4,5% au Royaume-Uni, entre 6% et 9% dans les pays émergents.
L'émission de monnaie papier ou électronique permet que de nouveaux prêts soient consentis… et que l'endettement mondial soit augmenté. Le scénario n'est pas nouveau, c'est comme cela que de grands acteurs économiques du monde se sont endettés à un point tel qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui rembourser leur dette. En d'autres termes, ils sont aujourd'hui insolvables, et parmi eux on compte, rien de moins, que les États européens, l'État américain et l'ensemble du système bancaire.
Le cancer de la dette publique
La zone euro
Les États européens éprouvent de plus en plus de difficultés à honorer le paiement des intérêts de leur dette.
Si c'est dans la zone euro que se sont manifestés en premier des défauts de paiement de certains États, c'est parce que ceux-ci n'ayant pas, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon, la maîtrise de l'émission de leur propre monnaie, ils n'ont pas eu la possibilité de faire marcher la planche à billets pour honorer, en monnaie de singe, les échéances de leur dette. L'émission d'Euros est du ressort de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui est plutôt soumise à la volonté des grands États Européens et, en particulier, de l'Allemagne. Et, comme chacun le sait, multiplier la masse monétaire par deux ou par trois, alors que la production stagne, ne peut que se traduire par le développement de l'inflation. C'est pour éviter cela que la BCE a de plus en plus renâclé à assurer le financement des États qui le nécessitaient afin de ne pas se retrouver elle-même en défaut de paiement.
C'est une des raisons essentielles pour laquelle les pays de la zone euro vivent, depuis un an et demi, sous la menace d'un défaut de paiement de l'État grec. En fait, le problème qui se pose à la zone euro n'a pas de solution car son refus de financer la dette grecque provoquerait la cessation de paiement de la Grèce et sa sortie de la zone euro. Les créanciers de la Grèce, parmi lesquels figurent des États européens et des banques européennes importantes, rencontreraient à leur tour des difficultés pour faire face à leurs propres engagements, et seraient à leur tour menacés de faillite. C'est l'existence même de la zone Euro qui se trouve ainsi mise en question, alors que son existence est essentielle pour les pays exportateurs situés au nord de celle-ci, l'Allemagne en particulier.
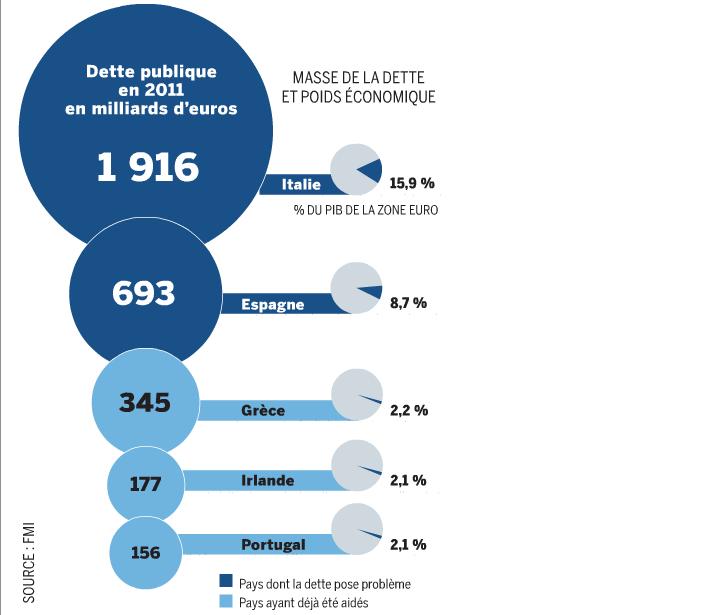
C'est essentiellement la Grèce qui, depuis un an et demi, a polarisé l'attention sur les questions de défaut de paiement. Mais des pays comme l'Espagne et l'Italie vont se trouver dans une situation semblable vu qu'ils n'arriveront jamais à dégager les recettes fiscales nécessaires à l'amortissement d'une partie de leur dette (Cf. Graphique) 13. Un simple regard sur l'ampleur de la dette de l'Italie, dont le défaut de paiement à court terme est très probable, montre que la zone euro ne pourra pas soutenir ce pays pour lui permettre d'assumer ses engagements. Déjà les investisseurs croient de moins en moins en ses capacités de remboursement, et c'est pour cela qu'ils ne consentent à lui prêter de l'argent qu'à des taux très élevés. La situation de l'Espagne est, pour sa part, assez voisine de celle de la Grèce.
Les prises de position des gouvernements et des instances de la zone euro, en particulier du gouvernement allemand, traduisent leur incapacité à faire face à la situation créée par la menace de faillite de certains pays. La majeure partie de la bourgeoisie de la zone euro est consciente du fait que le problème n'est plus de savoir si la Grèce est en défaut de paiement : l'annonce selon laquelle les banques allaient participer au sauvetage de la Grèce pour 21% de sa dette constituait déjà une reconnaissance de cette situation, qui a été confirmée lors du sommet Merkel-Sarkozy du 9 Octobre admettant qu'il y aura défaut de paiement de la Grèce pour 60% de sa dette. Dès lors, le problème qui se pose à la bourgeoisie est de trouver les moyens de faire en sorte que ce défaut de paiement provoque le moins de convulsions possibles au sein de la zone euro, ce qui constitue un exercice particulièrement délicat provocant hésitations et divisions en son sein. Ainsi, les partis politiques au pouvoir en Allemagne sont très divisés sur le fait de savoir s'il faut aider financièrement la Grèce, comment l'aider et s'il faut aussi aider les autres États qui vont à grands pas vers le même défaut de paiement qui touche aujourd'hui ce pays. A titre d'illustration, il est remarquable que le plan décidé le 21 juillet par les autorités de la zone euro pour "sauver" la Grèce et qui prévoit un renforcement de la capacité de prêt du Fonds Européen de Stabilité Financière de 220 à 440 milliards d'euros (avec pour corollaire évident une augmentation de la contribution des différents États), ait été, pendant des semaines, remis en cause par une partie importante des partis au pouvoir en Allemagne. Revirement de situation, il a finalement été massivement voté par le Bundestag le 29 septembre ! De même, jusqu'à début août, le gouvernement allemand refusait que la BCE rachète des titres de la dette souveraine de l'Italie et de l'Espagne. Compte tenu de la dégradation de la situation financière de ces pays, l'État allemand a finalement accepté qu'à partir du 7 août la BCE puisse racheter de telles obligations 14. Si bien que, entre le 7 août le 22 août, la BCE aura racheté pour 22 milliards de dette souveraine de ces deux pays 15 ! En fait, ces contradictions et atermoiements montrent qu'une bourgeoisie aussi importante internationalement que la bourgeoisie allemande ne sait pas quelle politique mener. De manière générale, l'Europe, poussée par l'Allemagne, a plutôt choisi l'austérité. Cela n'exclut pas de permettre de financer a minima les États et les banques par l'instauration du Fonds Européen de Solidarité Financière (ce qui suppose donc aussi l’augmentation des ressources financières de cet organisme), ni d'autoriser la BCE à créer suffisamment de monnaie pour venir en aide à un État ne pouvant plus payer ses dettes, afin que le défaut de paiement n'intervienne pas tout de suite.
Bien sûr le problème n'est pas celui de la bourgeoisie allemande, mais celui de toute la classe dominante car c'est elle dans son ensemble qui, depuis la fin des années 1960, s'est endettée pour éviter la surproduction, et cela à un point tel qu'il est aujourd'hui très difficile de non seulement de rembourser les échéances de la dette mais même d'honorer les intérêts de celle-ci. D'où les économies qu'elle essaie de faire actuellement au moyen de politiques d'austérité draconiennes qui ponctionnent tous les revenus mais, dans le même temps, ne peuvent qu'impliquer une diminution de la demande, accroître la surproduction et accélérer la plongée dans la dépression.
Les États-Unis
Ce pays a été confronté au même type de problème durant l'été 2011.
Le plafond de la dette, qui avait été fixé en 2008 à 14 294 milliards de dollars, a été atteint en mai 2011. Il devait être relevé pour que, de manière analogue aux pays de la zone euro, ils puissent faire face à leurs engagements, y compris intérieurs, c'est-à-dire assurer le fonctionnement de l'État. Même si l'invraisemblable archaïsme et la bêtise du Tea Party ont été un facteur d'aggravation de la crise, ils n'ont pas constitué le fond du problème qui s'est posé au Président et au Congrès des États-Unis. Le vrai problème était bien l'alternative suivante dont il fallait choisir l'un des termes :
- soit poursuivre la politique d'endettement de l'État fédéral, comme le demandaient les démocrates, c'est-à-dire fondamentalement demander à la FED de créer de la monnaie au risque de provoquer une chute incontrôlée de la valeur de cette dernière ;
- soit pratiquer une politique d'austérité drastique comme l'exigeaient les républicains, à travers en particulier la réduction, sur 10 ans, des dépenses publiques de 4000 à 8000 milliards de dollars. A titre de comparaison, le PIB des États-Unis en 2010 était de 14 624 milliards de dollars, ce qui donne une idée de l'ampleur des coupes budgétaires, et donc des suppressions d'emplois publics, impliquées par un tel plan.
En résumé, l'alternative posée cet été aux États-Unis était la suivante : soit prendre le risque d'ouvrir la porte à une inflation pouvant devenir galopante, soit pratiquer une politique d'austérité qui ne pouvait que réduire fortement la demande, provoquer la chute ou même la disparition des profits, avec au bout du compte la fermeture en chaine de toute une série d'entreprises et une chute vertigineuse de la production. Du point de vue des intérêts du capital national, tant le positionnement des Républicains que celui des Démocrates est légitime. Tiraillées par les contradictions qui assaillent l'économie nationale, les autorités américaines de ce pays en furent réduites à des demi-mesures… contradictoires et incohérentes. Le Congrès se trouvera donc à nouveau confronté à la nécessité de réaliser à la fois des milliers de milliards de dollars d'économies budgétaires et un nouveau plan de relance de l'emploi.
L'issue du conflit entre républicains et démocrates montre que, contrairement à l'Europe, les États-Unis ont plutôt choisi l'aggravation de la dette puisque le plafond de la dette fédérale a ainsi été rehaussé de 2100 milliards de dollars jusqu'en 2013 avec, comme contrepartie, des réductions de dépenses budgétaires d'environ 2500 milliards dans les dix ans à venir.
Mais, comme pour l'Europe, cette décision montre que l'État américain ne sait pas quelle politique mener face à l'impasse de son endettement.
L’abaissement de la note de la dette américaine par l'agence Standard and Poor's et les réactions qu'elle a provoquées sont une illustration du fait que la bourgeoisie sait parfaitement qu'elle est dans une impasse et qu'elle ne voit pas quels moyens se donner pour en sortir. Contrairement à bien d'autres décisions des agences de notation depuis le début de la crise des subprimes, la décision de Standard and Poor's de cet été apparaît cohérente : l'agence montre qu'il n'y pas de recettes suffisantes pour compenser l'augmentation de l'endettement accepté par le Congrès et que, en conséquence, la capacité des États-Unis de rembourser leurs dettes a perdu de sa crédibilité. En d'autres termes, pour cette institution, le compromis qui a évité une grave crise politique aux États-Unis en aggravant l'endettement de ce pays va accroître l'insolvabilité de l'État américain lui-même. La perte de confiance des financiers de la planète envers le dollar qui inévitablement résultera de la sentence de Standard and Poor's va tirer ainsi sa valeur à la baisse. Par ailleurs, si le vote de l'augmentation du plafond de la dette fédérale permet d'éviter la paralysie à l'Administration fédérale, les différents États fédérés et les municipalités en faillite le resteront. Depuis le 4 juillet, l'État du Minnesota est en défaut de paiement et il a dû demander à 22 000 fonctionnaires de rester chez eux 16. Un certain nombre de villes américaines (dont Central Falls et Harrisburg, capitale de la Pennsylvanie) sont dans la même situation ; situation que l'État de Californie – et il n'est pas le seul - semble ne pas pouvoir éviter dans un avenir proche.
Face à l'aggravation de la crise depuis 2007, aussi bien la politique économique de la zone euro que celle des États-Unis, n'ont pu éviter aux États de devoir prendre en charge les dettes qui avaient été, à l'origine, contractées par le secteur privé. Ces nouvelles dettes du secteur public n'ont fait qu'accroître la dette publique qui, de son côté, ne cessait de se développer depuis des décennies. Il en a résulté un échéancier de remboursements auxquels les États ne peuvent pas faire face. Aux États-Unis comme dans la zone euro, cela se traduit par des licenciements massifs dans le secteur public, par la baisse sans fin des salaires et l'augmentation, également sans fin, des impôts.
La menace d'une grave crise bancaire
En 2008-2009, après l'effondrement de certaines banques comme Bear Stearns et Northern Rock et la faillite pure et simple de Lehman Brothers, les États avaient volé au secours de beaucoup d'autres en les recapitalisant afin de leur éviter le même sort. Où en est-on à présent de la santé des établissements bancaires ? Elle est à nouveau très mauvaise. Tout d'abord, les livres des comptes bancaires sont loin d'avoir évacué toute une série de créances irrécouvrables. Ensuite, beaucoup de banques sont elles-mêmes détentrices d'une partie de la dette d'États aujourd'hui en difficulté de paiement. Le problème pour elles, c'est que la valeur de la dette ainsi achetée a depuis lors considérablement diminué.
La déclaration récente du FMI, se basant sur sa connaissance des difficultés actuelles des banques européennes et stipulant que celles-ci devaient augmenter leurs fonds propres de 200 milliards, a provoqué en retour des réactions agacées et des déclarations de la part de ces institutions selon lesquelles tout allait bien pour elles. Et cela, alors qu'au même moment, tout témoignait du contraire :
- les banques américaines ne veulent plus refinancer en dollars les filiales américaines des banques européennes et rapatrient les fonds qu'elles avaient placés en Europe ;
- les banques européennes se prêtent de moins en moins entre elles parce qu'elles sont de moins en moins sûres d'être remboursées et préfèrent placer, même à des taux très bas, leurs liquidités à la BCE ;
- conséquence de ce manque de confiance se généralisant, les taux des prêts entre banques ne cessent d'augmenter, même s'ils n'ont pas encore atteint les niveaux de fin 2008 17.
Le comble, c'est que quelques semaines après que les banques aient affirmé leur merveilleuse santé, on assistait à la faillite et à la liquidation de la banque franco-belge Dexia sans qu'aucune autre banque ne soit intéressée à se porter à son secours.
Ajoutons que les banques américaines sont bien mal placées pour "rouler des mécaniques" face à leurs consœurs européennes : du fait des difficultés qu'elles rencontrent, Bank of America vient de supprimer 10% de ses postes de travail et Goldman Sachs, la banque qui est devenue le symbole de la spéculation mondiale, vient de licencier 1000 personnes. Et, elles aussi, préfèrent déposer leurs liquidités à la FED plutôt que de prêter à d'autres banques américaines.
La santé des banques est essentielle pour le capitalisme car celui-ci ne peut pas fonctionner sans un système bancaire qui l'approvisionne en monnaie. Or, la tendance à laquelle nous assistons est celle qui mène au "Credit Crunch", à savoir une situation dans laquelle les banques ne veulent plus prêter dès qu'il y a le moindre risque de non-remboursement. Ce que cela contient, à terme, c'est un blocage de la circulation du capital, c'est-à-dire le blocage de l'économie. On comprend mieux, sous cet angle, pourquoi le problème du renforcement des fonds propres des banques est devenu le premier point à l'ordre du jour des multiples réunions au sommet qui ont lieu au niveau international, avant même la situation de la Grèce qui, pourtant, n'est toujours pas réglée. Au fond, le problème des banques montre l’extrême gravité de la situation économique et illustre à lui seul les difficultés inextricables auxquelles le capitalisme doit faire face.
Lors de la perte de la note AAA par les États-Unis, le quotidien économique français Les Echos titrait le 8 août 2011 en première page : "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu". Lorsque le principal média économique de la bourgeoisie française exprime une telle désorientation, une telle angoisse par rapport à l'avenir, il ne fait en cela qu'exprimer la désorientation de la bourgeoisie elle-même. Depuis 1945, le capitalisme occidental (et le capitalisme mondial après l'effondrement de l'URSS) est basé sur le fait que la force du capital américain constitue en dernière instance le gage ultime garantissant l'ensemble des dollars qui assurent, partout dans le monde, la circulation des marchandises, et donc du capital. Or, l'immense accumulation de dettes que la bourgeoisie américaine a contractées pour faire face, depuis la fin des années 1960, au retour de la crise ouverte du capitalisme, a fini par constituer un facteur accélérateur et aggravant de cette même crise. Tous ceux qui détiennent des parcelles de la dette américaine, à commencer par l'État américain lui-même, détiennent en réalité un avoir… qui vaut de moins en moins. La monnaie dans laquelle celle-ci est libellée, ne peut à son tour que s'affaiblir de même que… l'État américain.
La base de la pyramide sur laquelle le monde est construit depuis 1945 se désagrège. En 2007, lors de la crise financière, le système financier mondial a été sauvé par les banques centrales, c'est-à-dire par les États ; maintenant ceux-ci sont au bord de la faillite et il est hors de question que les banques puissent venir les secourir ; de quelque côté que les capitalistes se tournent, il n'existe rien qui puisse permettre une réelle reprise économique. En effet, une croissance même très faible suppose l'émission de nouvelles dettes pour créer une demande permettant d'écouler les marchandises ; or, même les intérêts des dettes déjà contractées ne sont plus remboursables et précipitent banques et États dans la banqueroute.
Comme on l'a vu, des décisions qui étaient affirmées irrévocables sont remises en cause au bout de quelques jours, des certitudes affirmées quant à la santé de l'économie ou des banques sont démenties tout aussi rapidement. Dans un tel contexte, les États sont de plus en plus amenés à naviguer au jour le jour. Il est probable, mais non certain, justement parce que la bourgeoisie est désorientée par une situation inédite, que pour faire face à l'immédiat, pour gagner un peu de temps, elle continue à arroser de monnaie le capital qu'il soit financier, commercial ou industriel, même si cela induit une inflation qui a déjà commencé, qui va s'accroître et qui va devenir de plus en plus incontrôlable. Cela n'empêchera pas la poursuite des licenciements, des baisses de salaires et des hausses d'impôts ; mais, en plus, l'inflation va aggraver la misère de la très grande majorité des exploités. Le jour même où Les Echos titraient "L'Amérique dégradée, le monde dans l'inconnu", un autre quotidien économique français, La tribune, titrait "Dépassés", à propos des grands décideurs de la planète dont la photo figurait également en "Une". Oui, ceux qui nous ont promis monts et merveille, puis qui nous ont consolés lorsqu'il était devenu évident qu'en fait de merveille c'était le cauchemar qui nous attendait, avouent maintenant qu'ils sont "dépassés". Et s'ils sont "dépassés", c'est parce que leur système, le capitalisme, est définitivement caduc et qu'il est en train d'entraîner la très grande majorité de la population mondiale dans la plus terrible des misères.
Vitaz (10-10-2011)
1 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/09/22/04016-20110922ARTFIG00699-la-colere-gronde-de-plus-en-plus-fort-en-grece.php [2]
2 https://news.fr.msn.com/m6-actualite/monde/espagne-les-enseignants-manif... [3]
3 www.rfi.fr/fr/europe/20110921-manifestations-enseignants-lyceens-espagne [4]
4 Statistique Eurostat
5 Le Monde, 7-8 août 2011
6 finance-economie.com/blog/2011/10/10/chiffres-cles-espagne-taux-de-chomage-pib-2010-croissance-pib-et-dette-publique
7 globalix.fr/la-dynamique-de-la-dette-italiennela-dynamique-de-la-dette-italienne [5]
8 FMI, perspectives de l'économie mondiale, juillet 2010
9 Le Figaro, 3 octobre 2011
10Les Echos, 9 août 2011
11 www.lecourrierderussie.com/2011/10/12/poutine-la-crise-existe [6]
12https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/10/05/97002-20111005FILWWW00435-fmi-recession-mondiale-pas-exclue.php [7]
13Paru dans le journal Le Monde du 5 août 2011.
14Les Echos, août 2011
15Les Echos, 16 août 2011
16www.rfi.fr/fr/ameriques/20110702-faillite-le-gouvernement-minnesota-cesse-activites [8]
17https://www.gecodia.fr/Le-stress-interbancaire-en-Europe-s-approche-du-pic-post-Lehman_a2348.html [9]
Récent et en cours:
- Crise économique [10]
Rubrique:
Mouvement des indignés en Espagne, Grèce et Israël : de l’indignation à la préparation des combats de classe
- 5836 lectures
Dans le dernier éditorial de la Revue internationale no 146, nous rendions compte de la lutte qui se développait en Espagne [1]. Depuis, la contagion de son exemple s’est propagée jusqu’en Grèce et en Israël [2]. Dans le présent article, nous voulons tirer les leçons de ces mouvements et voir quelles perspectives s’en dégagent face à une situation de faillite du capitalisme et d’attaques féroces contre le prolétariat et la grande majorité de la population mondiale.
Il est indispensable pour les comprendre de rejeter catégoriquement la méthode immédiatiste et empiriste qui prédomine dans la société actuelle. Celle-ci analyse chaque événement en lui-même, hors de tout contexte historique et en l’isolant dans le pays où il apparaît. Cette méthode photographique est un reflet de la dégénérescence idéologique de la classe capitaliste, car "le seul projet que cette classe puisse proposer à l’ensemble de la société est celui de résister au jour le jour, au coup par coup, et sans espoir de réussite, à l’effondrement irrémédiable du mode de production capitaliste" [3].
Une photographie peut nous montrer un personnage heureux arborant un large sourire, mais cela peut occulter qu’il affichait quelques secondes avant ou après un rictus angoissé. Nous ne pouvons comprendre les mouvements sociaux de cette façon. On ne peut les voir qu’en les situant à la lumière du passé qui les a fait mûrir et du futur qu’ils annoncent ; il est nécessaire de les situer dans le cadre mondial et non dans le réduit national où ils apparaissent ; et, surtout, ils doivent être compris dans leur dynamique, non par ce qu’ils sont à un moment donné mais par ce qu’ils peuvent devenir du fait des tendances, forces et perspectives qu’ils contiennent et qui surgiront tôt ou tard à la surface.
Le prolétariat sera-t-il capable de répondre à la crise du capitalisme ?
Nous avons publié, au début du xxie siècle, une série de deux articles intitulés "A l'aube du xxie siècle, pourquoi le prolétariat n'a pas encore renversé le capitalisme ?" [4]. Nous y rappelions que la révolution communiste n’est pas une fatalité et que son avènement dépend de l'union de deux facteurs, l’objectif et le subjectif. Le facteur objectif est donné par la décadence du capitalisme [5] et par le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production [6] comme le dit l'article. Le facteur subjectif est lié à l’action collective et consciente du prolétariat.
L’article reconnaît que le prolétariat a raté ses rendez-vous avec l’histoire. Lors du premier – la Première Guerre mondiale –, la tentative de riposte par une vague révolutionnaire mondiale en 1917-23 fut défaite ; lors du deuxième – la Grande dépression de 1929 –, il fut absent comme classe autonome ; lors du troisième – la Seconde Guerre mondiale –, non seulement il fut absent mais il crut en outre que la démocratie et l’État-providence, ces mythes manipulés par les vainqueurs, constituaient réellement sa victoire. Par la suite, avec le retour de la crise à la fin des années 1960, il "n'avait pas manqué le rendez-vous (…) mais, en même temps, nous avons pu mesurer la quantité d'obstacles auxquels il s'est affronté depuis et qui ont ralenti d'autant son chemin vers la révolution prolétarienne" [7]. Ces freins se vérifièrent lors d’un nouvel événement de grande envergure – l’effondrement des régimes soi-disant "communistes" en 1989 –, dans lequel non seulement il ne fut pas facteur actif, mais où il fut victime d’une formidable campagne anti-communiste qui le fit reculer tant au niveau de sa conscience que de sa combativité.
Ce que nous pourrions appeler le "cinquième rendez-vous" de l’histoire s’ouvre à partir de 2007. La crise qui se manifeste plus ouvertement démontre l’échec pratiquement définitif des politiques que le capitalisme avait déployées pour accompagner l’émergence de sa crise économique insoluble. L’été 2011 a mis en évidence que les énormes sommes injectées ne peuvent arrêter l’hémorragie et que le capitalisme est entraîné sur la pente de la Grande dépression, d’une gravité bien supérieure à celle de 1929 [8].
Mais, dans un premier temps, et malgré les coups qui pleuvent sur lui, le prolétariat semble également absent. Nous avions envisagé une telle situation lors de notre XVIIIe Congrès international (2009) : "Mais ce seront probablement, dans un premier temps, des combats désespérés et relativement isolés, même s’ils bénéficient d’une sympathie réelle des autres secteurs de la classe ouvrière. C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de "relance" de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus" [9].
Les mouvements actuels en Espagne, Israël et Grèce montrent que le prolétariat commence à assumer ce "cinquième rendez-vous de l’histoire", à se préparer pour y être présent, à se donner les moyens de vaincre [10].
Dans la série citée plus haut, nous disions que deux des piliers sur lesquels le capitalisme – tout au moins dans les pays centraux – s’est appuyé pour maintenir le prolétariat sous sa coupe étaient la démocratie et ce que l’on nomme "État-providence". Ce que révèlent les trois mouvements actuels c'est que ces piliers commencent à être contestés, bien que confusément encore, contestation qui va se nourrir de l’évolution catastrophique de la crise.
La contestation de la démocratie
La colère contre les politiciens et, en général, contre la démocratie s’est manifestée dans les trois mouvements, comme s’est aussi manifestée l’indignation vis-à-vis du fait que les riches et leur personnel politique soient toujours plus riches et corrompus, que la grande majorité de la population soit traitée comme une marchandise au service des bénéfices scandaleux de la minorité exploiteuse, marchandise jetée à la poubelle quand les "marchés ne vont pas bien" ; les programmes d’austérité drastiques aussi ont été dénoncés, programmes dont personne ne parle jamais lors des campagnes électorales et qui pourtant deviennent la principale occupation de ceux qui sont élus.
Il est évident que ces sentiments et ces attitudes ne sont pas nouveaux : dire du mal des politiciens par exemple a été monnaie courante au cours de ces trente dernières années. Il est clair aussi que ces sentiments peuvent être détournés vers des impasses comme ont tenté de le faire avec persévérance les forces de la bourgeoisie en action dans ces trois mouvements : "vers une démocratie participative", vers un "renouveau de la démocratie", etc.
Mais ce qui est nouveau et revêt une importance significative, c’est que ces thème qui, qu’on le veuille ou non, mettent en question la démocratie, l’État bourgeois et ses appareils de domination, sont l’objet de débats lors d’innombrables assemblées. On ne peut comparer des individus qui ruminent leur dégoût tout seuls, atomisés, passifs et résignés avec ces mêmes individus qui l’expriment collectivement dans des assemblées. Au-delà des erreurs, des confusions, des impasses qui s’y expriment inévitablement et qui doivent être débattues avec la plus grande patience et énergie, l’essentiel se trouve précisément dans le fait que les problèmes soient posés publiquement, ce qui contient en puissance une évidente politisation des grandes masses et, aussi, le principe d’une mise en question de cette démocratie qui a rendu tant de services au capitalisme tout au long du dernier siècle.
La fin du prétendu "État-providence"
Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme instaura ce qui fut appelé "l’État-providence" [11]. Celui-ci a constitué un des principaux piliers de la domination capitaliste au cours des 70 dernières années. Il a créé l’illusion que le capitalisme aurait dépassé les aspects les plus brutaux de sa réalité : l’État-providence garantirait une sécurité face au chômage, pour la retraite, la gratuité des soins de santé et d’éducation, des logements sociaux, etc.
Cet "État social", complément de la démocratie politique, a subi des amputations significatives au cours des 25 dernières années et s’achemine à présent vers sa disparition pure et simple. En Grèce, en Espagne ou en Israël (où c'est surtout la pénurie de logements qui a polarisé les jeunes), l’inquiétude créée par cette suppression des minima sociaux était au centre des mobilisations. Il est bien évident que la bourgeoisie a tenté de les dévoyer vers des "réformes" de la Constitution, l'adoption de lois qui "garantissent" ces prestations, etc. Mais la vague d’inquiétude croissante va contribuer à remettre en cause ces digues qui ont vocation de contrôler les travailleurs.
Les mouvements des Indignés, point culminant de huit années de luttes
Le cancer du scepticisme domine l’idéologie actuelle et infecte également le prolétariat et ses minorités révolutionnaires. Comme on l'a dit plus haut, le prolétariat a raté tous les rendez-vous que l’histoire lui avait donnés durant presqu’un siècle de décadence capitaliste et il en résulte un doute angoissant dans ses rangs concernant sa propre identité et ses capacités, à tel point que même lors de manifestations de combativité, certains rejettent jusqu’au terme de "classe ouvrière" [12]. Ce scepticisme est d’autant plus fort qu’il est alimenté par la décomposition du capitalisme [13] : le désespoir, l’absence de projet concret concernant l’avenir favorisent l’incrédulité et la méfiance envers toute perspective d’action collective.
Les mouvements en Espagne, Israël et Grèce – malgré toutes les faiblesses qu’ils contiennent – commencent à fournir un remède efficace contre le cancer du scepticisme, de par leur existence même et par ce qu’ils signifient dans la continuité des luttes et des efforts de prise de conscience que réalise le prolétariat mondial depuis 2003 [14]. Ils ne sont pas un orage qui éclate soudain dans un ciel d’azur, ils sont le fait d’une lente condensation ces huit dernières années de petites nuées, de crachins, d’éclairs timides qui a progressé jusqu’à atteindre une qualité nouvelle.
Le prolétariat commence à récupérer depuis 2003 de la longue période de recul dans sa conscience et dans sa combativité qu’il a subi à partir des événements de 1989. Ce processus suit un rythme lent, contradictoire et très tortueux, se manifestant par :
– une succession de luttes assez isolées dans divers pays tant du centre que de la périphérie, caractérisées par des manifestations "chargées de futur" : recherche de solidarité, tentatives d’auto-organisation, présence des nouvelles générations, réflexions sur l’avenir ;
– un développement de minorités internationalistes qui recherchent une cohérence révolutionnaire, se posent de nombreuses questions et recherchent le contact entre elles, débattent, tracent des perspectives…
En 2006 éclatent deux mouvements – la lutte contre le CPE en France [15] et la grève massive des travailleurs de Vigo en Espagne – qui, malgré la distance, la différence de conditions ou d’âge, présentent des traits similaires : assemblées générales, extension à d’autres secteurs, massivité des manifestations… C’est comme un premier coup de semonce qui, apparemment, n’a pas de suite [16].
Un an plus tard un embryon de grève massive éclate en Égypte à partir d’une grande usine de textile. Début 2008 éclatent de nombreuses luttes isolées les unes des autres mais simultanées dans un grand nombre de pays, de la périphérie au centre du capitalisme. D’autres mouvements se distinguent, comme la prolifération de révoltes de la faim dans 33 pays durant le premier trimestre 2008. En Égypte, elles sont soutenues et en partie prises en charge par le prolétariat. Fin 2008 éclate la révolte de la jeunesse ouvrière en Grèce, appuyée par une partie du prolétariat. Nous remarquons aussi des germes de réactions internationalistes en 2009 à Lindsay (Grande-Bretagne) et une grève généralisée explosive dans le sud de la Chine (en juin).
Après le recul initial du prolétariat face au premier impact de la crise, comme nous l’avons signalé, celui-là commence à lutter de façon bien plus décidée et, en 2010, la France est secouée par des mouvements massifs de protestation contre la réforme des retraites, des mouvements au cours desquels apparaissent des tentatives d’assemblées interprofessionnelles ; la jeunesse britannique se révolte en décembre contre l’augmentation brutale des coûts de scolarité. L’année 2011 voit les grandes révoltes sociales en Égypte et en Tunisie. Le prolétariat semble prendre de l’élan pour un nouveau saut en avant : le mouvement des Indignés en Espagne, puis en Grèce et en Israël.
Ce mouvement appartient-il à la classe ouvrière ?
Ces trois derniers mouvements ne peuvent se comprendre hors du contexte que nous venons d’analyser. Ils sont comme un premier puzzle qui unit tous les éléments apportés tout au long des huit dernières années. Mais le scepticisme est très fort et beaucoup se demandent : peut-on parler de mouvements de la classe ouvrière puisque celle-ci ne se présente pas comme telle et qu’ils ne sont pas renforcés par des grèves ou des assemblées sur les lieux de travail ?
Le mouvement se nomme "Les Indignés", concept très valable pour la classe ouvrière [17] mais qui ne révèle pas immédiatement ce dont il est porteur puisqu'il ne s’identifie pas directement avec sa nature de classe. Deux facteurs lui confèrent essentiellement une apparence de révolte sociale :
La perte de l’identité de classe
Le prolétariat a traversé une longue période de recul qui lui a infligé des dommages significatifs en ce qui concerne sa confiance en lui-même et la conscience de sa propre identité : "Après l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes soi-disant 'socialistes', les campagnes assourdissantes sur la 'fin du communisme', voire sur la 'fin de la lutte de classe', ont porté un coup sévère à la conscience au sein de la classe ouvrière de même qu’à sa combativité. Le prolétariat a subi alors un profond recul sur ces deux plans, un recul qui s’est prolongé pendant plus de dix ans (…) D’autre part, [la bourgeoisie] a réussi à créer au sein de la classe ouvrière un fort sentiment d’impuissance du fait de l’incapacité de celle-ci à mener des luttes massives" [18]. Ceci explique en partie pourquoi la participation du prolétariat comme classe n’a pas été dominante mais qu’il fut présent à travers la participation des individus ouvriers (salariés, chômeurs, étudiants, retraités…) qui tentent de se clarifier, de s'impliquer selon leur instinct mais à qui manquent la force, la cohésion et la clarté que donne le fait de s’assumer collectivement comme classe.
Il découle de cette perte d’identité que le programme, la théorie, les traditions, les méthodes du prolétariat ne sont pas reconnus somme siens par l’immense majorité des ouvriers. Le langage, les formes d’action, les symboles mêmes qui apparaissent dans le mouvement des Indignés s'abreuvent à d’autres sources. C’est une faiblesse dangereuse qui doit être patiemment combattue pour que se réalise une réappropriation critique de tout le patrimoine théorique, d’expérience, de traditions que le mouvement ouvrier a accumulé au long de ces deux derniers siècles.
La présence de couches sociales non prolétariennes
Parmi les Indignés il y a une forte présence de couches sociales non prolétariennes, en particulier une couche moyenne en voie de prolétarisation. En ce qui concerne Israël, notre article soulignait : "Une autre tactique pour minimiser [ces événements] est de les cataloguer comme représentatifs du mouvement des classes moyennes. Il est vrai que, comme pour tous les autres mouvements, nous assistons à une révolte sociale très large qui peut exprimer le mécontentement de beaucoup de couches différentes de la société, allant des petits entrepreneurs jusqu'aux ouvriers à la chaîne, qui sont toutes touchées par la crise économique mondiale, par l'écart grandissant entre les riches et les pauvres, et, dans un pays comme Israël par l'aggravation des conditions de vie à cause des exigences insatiables de l'économie de guerre. Mais le terme de 'classe moyenne' est devenu un synonyme de paresseux, un terme 'fourre-tout' pour parler de quelqu'un qui a reçu une certaine éducation ou bénéficie d'un travail et, en Israël comme en Afrique du Nord, en Espagne ou en Grèce, un nombre croissant de jeunes gens instruits sont poussés dans les rangs du prolétariat, travaillant dans des emplois précaires mal rémunérés et peu qualifiés où l'on peut embaucher n'importe qui" [19].
Bien que le mouvement semble vague et mal défini, cela ne peut remettre en cause son caractère de classe, surtout si nous considérons les choses dans leur dynamique, dans la perspective de l’avenir, comme le font les camarades du TPTG à propos des mouvements en Grèce : "Ce qui inquiète les politiciens de tous bords dans ce mouvement des assemblées, c’est que la colère et l’indignation prolétariennes (et de couches petite-bourgeoises) grandissantes ne s’exprime plus par le circuit médiatique des partis politiques et des syndicats. Il n’est donc pas aussi contrôlable et il est potentiellement dangereux pour le système représentatif du monde politique et syndical en général" [20].
La présence du prolétariat n’est pas visible en tant que force dirigeante du mouvement ni à travers une mobilisation à partir des centres de travail. Elle réside dans la dynamique de recherche, de clarification, de préparation du terrain social, de reconnaissance du combat qui se prépare. Là se trouve toute son importance, malgré le fait que ce ne soit qu’un petit pas en avant extrêmement fragile. Sur la Grèce, les camarades du TPTG disent que le mouvement "constitue une expression de la crise des rapports de classe et de la politique en général. Aucune autre lutte ne s’est exprimée de façon aussi ambivalente et explosive au cours des dernières décennies" [21] et sur Israël, un journaliste signale, avec ses mots : "ce n'a jamais été l'oppression qui a maintenu l'ordre social en Israël, concernant la communauté juive. C'est l'endoctrinement qui s'en est chargé – l'idéologie dominante, pour utiliser le terme préféré des théoriciens critiques. Et c'est cet ordre culturel qui a été ébranlé dans ce tourbillon de protestations. Pour la première fois, une grande partie de la classe moyenne juive – il est trop tôt pour évaluer l'importance que celle-ci représente – a reconnu que son problème n'était pas vis-à-vis d'autres Israéliens, ni avec les Arabes, ni avec tel ou tel politicien mais avec l'ordre social tout entier, avec le système dans son ensemble. En ce sens, c'est un événement inédit dans l'histoire d'Israël" [22].
Les caractéristiques des luttes futures
Dans cette optique, nous pouvons comprendre les traits de ces luttes comme des caractéristiques que les futures luttes pourront reprendre avec un esprit critique et développer à des niveaux supérieurs :
– l’entrée en lutte de nouvelles générations du prolétariat, avec cependant une différence importante avec les mouvements de 1968 : alors que la jeunesse d’alors tendait à repartir de zéro et considérait que les aînés étaient "vaincus et embourgeoisés", nous voyons aujourd’hui une lutte unie des différentes générations de la classe ouvrière ;
– l’action directe des masses : la lutte a gagné la rue, les places ont été occupées. Les exploités s’y sont retrouvés directement, ils ont pu vivre, discuter et agir ensemble ;
– le début de la politisation : au-delà des fausses réponses qui sont et seront données, il est important que les grandes masses commencent à s’impliquer directement et activement dans les grandes questions de la société, c’est le début de leur politisation comme classe ;
– les assemblées : elles sont liées à la tradition prolétarienne des conseils ouvriers de 1905 et 1917 en Russie, qui s’étendirent en Allemagne et à d'autres pays pendant la vague révolutionnaire mondiale de 1917-23. Elles réapparurent en 1956 en Hongrie et en 1980 en Pologne. Elles sont l’arme de l’unité, du développement de la solidarité, de la capacité de compréhension et de décision des masses ouvrières. Le slogan "Tout le pouvoir aux assemblées !", très populaire en Espagne, exprime la naissance d’une réflexion-clé sur des questions telles que l’État, le double pouvoir, etc. ;
– la culture du débat : la clarté qui inspire la détermination et l’héroïsme des masses prolétariennes ne se décrète pas, pas plus qu’elle n’est le fruit d’un endoctrinement réalisé par une minorité détentrice de "la vérité" : elle est le produit conjugué de l’expérience, de la lutte et particulièrement du débat. La culture du débat a été très présente dans ces trois mouvements : tout a été soumis à la discussion, rien de ce qui est politique, social, économique, humain, n’a échappé à la critique de ces immenses agoras improvisées. Comme nous le disons dans l’introduction à l’article des camarades de Grèce, ce fait a une énorme importance : "l’effort déterminé pour contribuer à l’émergence de ce que les camarades de TPTG appellent 'une sphère prolétarienne publique' qui rendra possible à un nombre grandissant d’éléments de notre classe non seulement d’œuvrer pour la résistance aux attaques capitalistes contre nos conditions de vie mais aussi de développer les théories et les actions qui conduisent ensemble à une nouvelle façon de vivre" [23] ;
– la façon d'envisager la question de la violence : le prolétariat "a été confronté depuis le début à la violence extrême de la classe exploiteuse, la répression lorsqu'il essayait de défendre ses intérêts, la guerre impérialiste mais aussi à la violence quotidienne de l'exploitation. Contrairement aux classes exploiteuses, la classe porteuse du communisme ne porte pas avec elle la violence, et même si elle ne peut s'épargner l'utilisation de celle-ci, ce n'est jamais en s'identifiant avec elle. En particulier, la violence dont elle devra faire preuve pour renverser le capitalisme, et dont elle devra se servir avec détermination, est nécessairement une violence consciente et organisée et doit donc être précédée de tout un processus de développement de sa conscience et de son organisation à travers les différentes luttes contre l'exploitation" [24]. Comme lors du mouvement des étudiants en 2006, la bourgeoisie a tenté plusieurs fois d’entraîner le mouvement des Indignés (particulièrement en Espagne) dans le piège des affrontements violents contre la police dans un contexte de dispersion et de faiblesse, pour ainsi pouvoir discréditer le mouvement et faciliter son isolement. Ces pièges furent évités et une réflexion active sur la question de la violence a commencé à voir le jour [25].
Faiblesses et confusions à combattre
Nous ne voulons pas le moins du monde glorifier ces mouvements. Rien n’est plus étranger à la méthode marxiste que de faire d’une lutte déterminée, pour importante et riche qu’elle soit, un modèle définitif, achevé et monolithique qu’il faudrait suivre à la lettre. Nous comprenons parfaitement ses faiblesses et ses difficultés avec un regard lucide.
La présence d’une "aile démocrate"
Celle-ci pousse à la réalisation d’une "vraie démocratie". Cette démarche est représentée par plusieurs courants, y compris des courants de droite comme en Grèce. Il est évident que les medias et les politiciens s’appuient sur cette aile pour faire en sorte que l’ensemble du mouvement s’identifie à elle.
Les révolutionnaires doivent combattre énergiquement toutes les mystifications, les fausses mesures, les arguments fallacieux de cette tendance. Cependant, pourquoi existe-t-il encore une forte propension à se laisser séduire par les chants de sirène de la démocratie, après tant d’années de tromperies, de mensonges et de déceptions ? Nous pouvons en donner trois raisons. La première se trouve dans le poids des couches sociales non prolétariennes très réceptives aux mystifications démocratiques et à l’interclassisme. La deuxième réside dans la puissance des confusions et des illusions démocratiques très présentes encore dans la classe ouvrière, particulièrement chez les jeunes qui n’ont pas encore pu développer une expérience politique. La troisième, enfin, se trouve dans la pression de ce que nous nommons la décomposition sociale et idéologique du capitalisme qui favorise la tendance à chercher refuge dans une entité "au dessus des classes et des conflits", c’est-à-dire l’État, qui pourrait prétendument apporter un certain ordre, la justice et la médiation.
Mais il y a une cause plus profonde sur laquelle il est important d’attirer l’attention. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx constate que "Les révolutions prolétariennes (…) reculent constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts" [26]. Aujourd’hui, les événements mettent en évidence la faillite du capitalisme, la nécessité de le détruire et de construire une nouvelle société. Pour un prolétariat qui doute de ses propres capacités, qui n’a pas récupéré son identité, cela crée et continuera encore à créer pendant un certain temps la tendance à se raccrocher à des branches pourries, à de fausses mesures "de réformes" et de "démocratisation", même en ayant des doutes. Tout ceci, indiscutablement, donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie qui lui permet de semer la division et la démoralisation et, en conséquence, de rendre plus difficile encore pour le prolétariat la récupération de cette confiance en soi et de cette identité de classe.
Le poison de l’apolitisme
Il s’agit d’une vieille faiblesse que traîne le prolétariat depuis 1968 et qui trouve son origine dans l’énorme déception et le profond scepticisme provoqués par la contre-révolution stalinienne et social-démocrate, qui induit la tendance à croire que toute option politique, y compris celles qui se réclament du prolétariat, n’est qu’un vil mensonge, contiendrait en son sein le ver de la trahison et de l’oppression. C’est ce dont profitent largement les forces de la bourgeoisie qui, occultant leur propre identité et imposant la fiction d’une intervention "en tant que libres citoyens", opèrent dans le mouvement pour prendre le contrôle des assemblées et les saboter de l’intérieur. Les camarades du TPTG le mettent clairement en évidence : "Au début, il y avait un esprit communautaire dans l’effort d’auto-organiser l’occupation de la place et officiellement les partis politiques n’étaient pas tolérés. Cependant, les gauchistes et, en particulier, ceux qui venaient de SYRIZA (coalition de la Gauche radicale) furent rapidement impliqués dans l’assemblée de Syntagma et conquirent des postes importants dans le groupe qui avait été formé pour gérer l’occupation de la place Syntagma et, plus spécifiquement, dans le groupe pour le 'secrétariat de soutien' et celui responsable de la 'communication'. Ces deux groupes sont les plus importants parce qu’ils organisent les ordres du jour des assemblées aussi bien que la tenue des discussions. On doit remarquer que ces gens ne faisaient pas état de leur affiliation politique et qu’ils apparaissaient comme des 'individus'" [27].
Le danger du nationalisme
Celui-ci est plus présent en Grèce et en Israël. Comme le dénonçaient les camarades du TPTG, "le nationalisme (principalement sous sa forme populiste) est dominant, favorisé à la fois par les diverses cliques d’extrême droite et par les partis de gauche et les gauchistes. Même pour beaucoup de prolétaires et de petit-bourgeois frappés par la crise qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, l’identité nationale apparaît comme un dernier refuge imaginaire quand tout le reste s’écroule rapidement. Derrière les mots d’ordre contre 'le gouvernement vendu à l’étranger' ou pour 'le salut du pays', 'la souveraineté nationale', la revendication d’une 'nouvelle constitution' apparaît comme une solution magique et unificatrice" [28].
La réflexion des camarades est aussi juste que profonde. La perte de l’identité et de confiance du prolétariat en sa propre force, le lent processus que traverse la lutte dans le reste du monde, favorise la tendance à "s’accrocher à la communauté nationale", refuge utopique face à un monde hostile et plein d’incertitudes.
Ainsi, par exemple, les conséquences des coupes dans la santé et l’éducation, le problème réel créé par l’affaiblissement de ces services, sont utilisés pour enfermer les luttes derrière les barreaux nationalistes de la revendication d’une "bonne éducation" (car celle-ci nous rendrait compétitifs sur le marché mondial), et d’une "santé au service de tous les citoyens".
La peur et la difficulté pour assumer la confrontation de classe
L’angoissante menace du chômage, la précarité massive, la fragmentation croissante des employés – divisés, sur un même lieu de travail, dans un réseau inextricable de sous-traitants et par une incroyable variété de modalités d’embauche - provoquent un puissant effet intimidateur et rendent plus difficile le regroupement des travailleurs pour la lutte. Cette situation ne peut être dépassée par des appels volontaristes à la mobilisation, pas plus qu’en morigénant les travailleurs pour leur supposée "lâcheté" ou "servilité".
De ce fait, le pas vers la mobilisation massive des chômeurs, des précaires, des centres de travail et d’étude, est rendu plus difficile que ce qu’il pourrait sembler à première vue, difficulté provoquant à son tour une hésitation, un doute et une tendance à s’accrocher à des "assemblées" qui deviennent tous les jours plus minoritaires et dont "l’unité" ne favorise que les forces bourgeoises qui agissent en leur sein. Ceci donne une marge de manœuvre à la bourgeoisie pour préparer ses coups tordus destinés à saboter les assemblées générales de l’intérieur. C’est ce que dénoncent justement les camarades du TPPG : "La manipulation de la principale assemblée sur la place Syntagma (il y en a plusieurs autres dans différents quartiers d’Athènes et dans d’autres villes) par des membres 'non déclarés' des partis et des organisations de gauche est évidente et c’est un obstacle réel à une direction de classe du mouvement. Cependant, à cause de la profonde crise de légitimité du système politique de représentation en général, eux aussi devaient cacher leur identité politique et garder un équilibre – pas toujours réussi – entre d’un côté un discours général et abstrait sur 'l’autodétermination', la 'démocratie directe', 'l’action collective', 'l’antiracisme', le 'changement social', etc., et de l’autre côté contenir le nationalisme extrême, le comportement de voyou de quelques individus d’extrême-droite qui participaient aux regroupements sur la place" [29].
Regarder le futur avec sérénité
S’il est évident que "pour que vive l’humanité, le capitalisme doit mourir" [30], le prolétariat est encore loin d’avoir atteint la capacité d’exécuter la sentence. Le mouvement des Indignés pose une première pierre.
Dans la série mentionnée plus haut, nous disions : "Une des raisons pour lesquelles les prévisions des révolutionnaires du passé sur l'échéance de la révolution ne se sont pas réalisées est qu'ils ont sous-estimé la force de la classe dirigeante, particulièrement son intelligence politique" [31]. Cette capacité de la bourgeoisie à utiliser son intelligence politique contre les luttes est aujourd’hui plus vive que jamais ! Ainsi, par exemple, les mouvements des Indignés dans les trois pays ont été complètement occultés ailleurs, sauf quand il s’en est donné une version light de "rénovation démocratique". Autre exemple, la bourgeoisie britannique a été capable de profiter du mécontentement pour le canaliser vers une révolte nihiliste qui lui a servi de prétexte pour renforcer la répression et intimider la moindre riposte de classe [32].
Les mouvements des Indignés ont posé une première pierre, dans le sens où ils ont fait les premiers pas pour que le prolétariat récupère sa confiance en lui-même et sa propre identité de classe, mais cet objectif reste encore très lointain car il nécessite le développement de luttes massives sur un terrain directement prolétarien qui mette en évidence que la classe ouvrière est capable d’offrir, face à la débâcle du capitalisme une alternative révolutionnaire aux couches sociales non exploiteuses.
Nous ignorons comment nous parviendrons à cette perspective et nous devons rester vigilants envers les capacités et les initiatives des masses, comme celle du 15 mai en Espagne. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que l’extension internationale des luttes sera un facteur essentiel dans ce sens.
Les trois mouvements ont planté le germe d’une conscience internationaliste : lors du mouvement des Indignés en Espagne, il se disait que sa source d’inspiration était la place Tahrir en Égypte [33] ; il avait cherché une extension internationale de la lutte, malgré que cela se soit fait dans la plus grande confusion. De leur côté, les mouvements en Israël et en Grèce ont déclaré explicitement qu’ils suivaient l’exemple des Indignés d’Espagne. Les manifestants d’Israël exhibaient des pancartes qui disaient : "Moubarak, Assad, Netanyahou : tous pareils !", ce qui montre non seulement un début de conscience de qui est l’ennemi mais une compréhension au moins embryonnaire du fait que leur lutte se mène avec les exploités de ces pays et non contre eux dans le cadre de la défense nationale [34]. "A Jaffa, des dizaines de manifestants arabes comme juifs portaient des pancartes écrites à la fois en Hébreu et en Arabe où on pouvait lire "Les Arabes et les Juifs veulent un logement au prix abordable" et "Jaffa ne veut pas d'offres de logements réservées aux riches." (…) Il y a eu des manifestations de Juifs et d'Arabes pour protester contre l'expulsion de ces derniers, partant du quartier de Cheikh Jarrah. A Tel-Aviv, des contacts ont été établis avec les résidents de camps de réfugiés dans les territoires occupés, qui ont visité à leur tour les villages de tentes et ont engagé des discussions avec les manifestants" [35]. Les mouvements en Égypte et en Tunisie comme ceux en Israël changent la donne de la situation, dans une partie de la planète qui est probablement le centre principal de confrontation impérialiste du monde. Comme le dit notre article, "L'actuelle vague de révoltes contre l'austérité capitaliste ouvre la porte à une tout autre solution : la solidarité de tous les exploités face à toutes les divisions religieuses ou nationales ; la lutte de classes dans tous les pays dans le but de faire la révolution dans le monde entier qui sera la négation des frontières nationales et l'abolition des États. Il y a un an ou deux, une telle perspective aurait semblé totalement utopique à la plupart des gens. Aujourd'hui, un nombre croissant de personnes voit la révolution mondiale comme une alternative réaliste à l'ordre du monde capitaliste en train de s'effondrer" [36].
Les trois mouvements ont contribué à la cristallisation d’une aile prolétarienne : tant en Grèce qu'en Espagne, mais aussi en Israël [37], est en train d’émerger une "aile prolétarienne" à la recherche de l’auto-organisation, de la lutte intransigeante à partir de positions de classe et du combat pour la destruction du capitalisme. Les problèmes mais également les potentialités et les perspectives de cette large minorité ne peuvent être abordés dans le cadre de cet article. Ce qui est certain, c’est qu’elle constitue une arme vitale à qui le prolétariat a donné vie pour préparer ses combats futurs.
C. Mir, 23-9-2011
1. Cf. https://fr.internationalism.org/node/4752 [11]. Dans la mesure où cet article analysait en détail cette expérience, nous ne la répéterons pas ici.
2. Cf. les articles sur ces mouvements sur https://fr.internationalism.org/node/4776 [12].
3. Révolution communiste ou destruction de l’humanité, Manifeste du IXe Congrès du CCI, 1991.
4. Cf. Revue internationale nos 103 [13] et 104 [13].
5. Pour débattre de ce concept crucial de décadence du capitalisme, voir entre autres la Revue internationale no 146, "Pour les révolutionnaires, la Grande Dépression confirme l'obsolescence du capitalisme [14]".
6. Revue internationale no 103, "A [13] [13]l'aube [13] [13]du [13] [13]xxi [13]e [13] [13]siècle, [13] [13]pourquoi [13] [13]le [13] [13]prolétariat [13] [13]n'a [13] [13]pas [13] [13]encore [13] [13]renversé [13] [13]le [13] [13]capitalisme ? [13]" : "La deuxième condition de la révolution prolétarienne consiste dans le développement d'une crise ouverte de la société bourgeoise faisant la preuve évidente que les rapports de production capitalistes doivent être remplacés par d'autres rapports de production."
7. Revue internationale no 104, "A [15] [15]l'aube [15] [15]du [15] [15]xxi [15]e [15] [15]siècle, [15] [15]pourquoi [15] [15]le [15] [15]prolétariat [15] [15]n'a [15] [15]pas [15] [15]encore [15] [15]renversé [15] [15]le [15] [15]capitalisme ? II [15]".
8. Cf. "Crise [16] [16]économique [16] [16]mondiale : [16] [16]un [16] [16]été [16] [16]meurtrier [16]".
9. Cf. Revue internationale no 138, "Résolution [17] [17]sur [17] [17]la [17] [17]situation [17] [17]internationale [17]".
10. "Puisqu'il est privé de tout point d'appui économique au sein du capitalisme, sa seule véritable force, outre son nombre et son organisation, est sa capacité à prendre clairement conscience de la nature, des buts et des moyens de son combat", Revue internationale no 103, op. cit.
11. Les nationalisations, de même qu'un certain nombre de mesures 'sociales' (comme une plus grande prise en charge par l'État du système de santé) sont des mesures parfaitement capitalistes (…) Les capitalistes ont tout intérêt à disposer d'ouvriers en bonne santé (…) Cependant, ces mesures capitalistes sont présentées comme des 'victoires ouvrières'", Revue internationale no 104, op. cit.
12. Nous ne pouvons développer ici pourquoi la classe ouvrière est la classe révolutionnaire de la société non plus que pourquoi sa lutte représente l’avenir pour toutes les couches sociales non-exploiteuses, question brûlante comme nous le verrons plus loin lors du mouvement des Indignés. Le lecteur pourra trouver des éléments de réponse pour alimenter le débat sur cette question dans la série de deux articles publiés dans les nos 73 et 74 de la Revue internationale, "Qui [18] [18]peut [18] [18]changer [18] [18]le [18] [18]monde ? [18]".
13. Cf. "La [19] [19]décomposition, [19] [19]phase [19] [19]ultime [19] [19]de [19] [19]la [19] [19]décadence [19] [19]du [19] [19]capitalisme [19]", Revue internationale no 62.
14. Cf. les articles d’analyse de la lutte de classe dans notre Revue internationale.
15. Cf. Revue internationale no 125, "Thèses [20] [20]sur [20] [20]le [20] [20]mouvement [20] [20]des [20] [20]étudiants [20] [20]du [20] [20]printemps [20] [20]2006 [20] [20]en [20] [20]France [20]".
16. La bourgeoisie prend bien garde de cacher ces événements : les révoltes nihilistes des banlieues en novembre 2005 en France sont beaucoup plus connues, y compris dans les milieux politisés, que le mouvement conscient des étudiants cinq mois plus tard.
17. L’indignation n’est ni la résignation ni la haine. Contre la dynamique insupportable du capitalisme, la résignation exprime une passivité, une tendance à rejeter sans voir comment affronter. La haine, de son côté, exprime un sentiment actif puisque le rejet se transforme en lutte, mais il s’agit d’un combat aveugle, privé de perspectives et de réflexion pour élaborer un projet alternatif, elle est purement destructive, assemblant une somme de ripostes individuelles mais ne générant rien de collectif. L’indignation exprime la transformation active du rejet accompagnée par la tentative de lutter consciemment, recherchant l’élaboration concomitante d’une alternative, elle est donc collective et constructive. "… L’indignation amenant à la nécessité d’une régénération morale, d’un changement culturel, les propositions faites – même si elles peuvent parfois paraître naïves ou farfelues – expriment un désir, même timide ou confus, de vouloir "vivre autrement"", "De [21] [21]la [21] [21]Place [21] [21]Tahrir [21] [21]à [21] [21]la [21] [21]Puerta [21] [21]del [21] [21]Sol [21]", ICC on-line.
18. Cf. Revue internationale no 130, "Résolution [22] [22]sur [22] [22]la [22] [22]situation [22] [22]internationale [22]".
19. Cf. ICC on-line, "Révoltes [23] [23]sociales [23] [23]en [23] [23]Israël : [23] [23]Moubarak, [23] [23]Assad, [23] [23]Netanyahou : [23] [23]tous [23] [23]pareils ! [23]".
20. ICC on-line, "Une [12] [12]contribution [12] [12]du [12] [12]TPTG [12] [12]sur [12] [12]le [12] [12]mouvement [12] [12]des [12] [12]'Indignés' [12] [12]en [12] [12]Grèce [12]".
21. Idem.
22. "Révoltes sociales en Israël…", op.cit.
23. "Une contribution du TPTG", op. cit.
24. Revue internationale no 125, "Thèses [20] [20]sur [20] [20]le [20] [20]mouvement [20] [20]des [20] [20]étudiants [20] [20]du [20] [20]printemps [20] [20]2006 [20] [20]en [20] [20]France [20]".
25. Cf CCI-on line, “Qu [24]’ [24]y [24] [24]a-t-il [24] [24]derrière [24] [24]la [24] [24]campagne [24] [24]contre [24] [24]les [24] [24]"violents" [24] [24]autour [24] [24]des [24] [24]incidents [24] [24]de [24] [24]Barcelone ? [24]".
26. Karl Marx, Le [25] [25]18 [25] [25]Brumaire [25] [25]de [25] [25]Louis [25] [25]Bonaparte [25].
27. "Une contribution du TPTG…", op. cit. Cf. aussi ICC on-line, "'L'apolitisme' [26] [26]est [26] [26]une [26] [26]mystification [26] [26]dangereuse [26] [26]pour [26] [26]la [26] [26]classe [26] [26]ouvrière [26]".
28. Idem.
29. Idem.
30. Mot d’ordre de la Troisième Internationale.
31. Revue internationale no 104, op. cit.
32. Cf. "Les [27] [27]émeutes [27] [27]en [27] [27]Grande-Bretagne [27] [27]et [27] [27]la [27] [27]perspective [27] [27]sans [27] [27]avenir [27] [27]du [27] [27]capitalisme [27]".
33. La "Plaza de Cataluña" fut rebaptisée par l’Assemblée "Place Tahrir", ce qui non seulement affirme une volonté internationaliste mais en outre constitue un camouflet au nationalisme catalan qui considère que cette place est son plus beau fleuron.
34. Cité dans "Révoltes sociales en Israël", op. cit. : "Un animateur interrogé sur le réseau RT News a demandé si les manifestations avaient été inspirées par les événements dans les pays arabes. Il a répondu 'Ce qui s'est passé sur la place Tahrir a eu beaucoup d'influence. Cela garde beaucoup d'influence, bien sûr. C'est quand les gens comprennent qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent s'organiser eux-mêmes, ils n'ont plus besoin d'un gouvernement pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ils peuvent commence à dire aux gouvernements ce qu'ils veulent'".
35. Idem.
36. Idem.
37. Dans ce mouvement, "certains ont ouvertement mis en garde contre le danger que le gouvernement pourrait provoquer des affrontements militaires ou même une nouvelle guerre pour restaurer 'l'union nationale' et diviser le mouvement", (idem), ce qui, même encore implicitement, révèle une prise de distance vis-à-vis de l’État israélien d’Union nationale au service de l’économie de guerre et de la guerre.
Récent et en cours:
- Indignés [28]
Contribution à une histoire du mouvement ouvrier en Afrique (III) : les années 1920
- 3546 lectures
Les années 1920 : Face au développement des luttes ouvrières la bourgeoisie française réorganise son dispositif répressif
1923 : "l’accord de Bordeaux" ou le pacte d’une "collaboration de classes"
C’est cette année-là que fut signé "l’accord de Bordeaux", un "pacte d’entente" conclu entre le milieu économique colonial 1 et Blaise Diagne, le premier député africain siégeant à l’Assemblée nationale française. En effet, ayant tiré les leçons de la magnifique grève insurrectionnelle de mai 1914 à Dakar et de ses prolongements les années suivantes 2, la bourgeoisie française se devait de réorganiser son dispositif politique face à la montée inexorable du jeune prolétariat de sa colonie africaine. Ce fut dans ce cadre qu’elle décida de jouer à fond la carte de Blaise Diagne en faisant de lui le "médiateur/pacificateur" des conflits entre les classes, en fait un vrai contre-révolutionnaire. En effet, au lendemain de son élection comme député et en tant que témoin majeur du mouvement insurrectionnel contre le pouvoir colonial dans lequel il avait lui-même été impliqué au départ, Diagne se trouva devant trois possibilités lui permettant de jouer un rôle historique à l’issue de cet événement : 1) profiter de l’affaiblissement politique de la bourgeoisie coloniale au lendemain de la grève générale, dont elle sortit défaite, pour déclencher une "lutte de libération nationale" ; 2) militer pour le programme communiste en portant le drapeau de la lutte prolétarienne dans la colonie, en profitant notamment du succès de la grève ; 3) jouer sa carte politique personnelle en s’alliant avec la bourgeoisie française qui lui tendait la main à ce moment-là.
Finalement Blaise Diagne décida de choisir cette dernière voie, à savoir l’alliance avec la puissance coloniale. En réalité derrière cet acte dit "accord de Bordeaux", la bourgeoisie française ne manifestait pas seulement sa crainte de la classe ouvrière en effervescence dans sa colonie africaine, mais elle était également préoccupée par le contexte révolutionnaire international.
"(…) Devant la tournure que prirent les choses, le gouvernement colonial entreprit de gagner le député noir à sa cause pour mettre sa puissance de persuasion et son courage téméraire au service des intérêts de la colonisation et des maisons de commerce. De cette façon il parviendrait à couper l’herbe sous les pieds à l’effervescence qui s’était emparée des esprits de l’élite africaine à un moment où la révolution d’octobre (1917), le mouvement pan-noir et les menaces du communisme mondial en direction des colonies pourraient exercer une dangereuse séduction sur les consciences des colonisés".
"(…) Tel fut le véritable sens de l’accord de Bordeaux signé le 12 juin 1923. Il marquait la fin du Diagnisme combatif et volontariste et ouvrait une nouvelle ère de collaboration entre colonisateurs et colonisés dont le député sortit dépouillé de tout charisme qui représentait jusque là son atout politique majeur. Un grand élan venait d’être brisé". (Iba Der Thiam) 3
Le premier député noir de la colonie africaine resta fidèle au capital français jusqu’à sa mort
Pour mieux comprendre le sens de cet accord entre la bourgeoisie coloniale et le jeune député, revenons sur la trajectoire de ce dernier. Blaise Diagne fut remarqué très tôt par l’appareil du capital français qui voyait en lui une future carte politique stratégique et le forma d’ailleurs dans ce sens. En effet, Diagne exerçait une forte influence sur la jeunesse urbaine à travers le Parti Jeunes Sénégalais acquis à sa cause. Justement, fort du soutien de la jeunesse, notamment des jeunes instruits et intellectuels, il se lança en avril 1914 dans l’arène électorale et arracha le seul poste de député à pourvoir pour l’ensemble de la colonie de l’AOF (Afrique Occidentale Française). Rappelons qu’on était à la veille des tueries impérialistes de masse et que ce fut dans ces circonstances qu’éclata la fameuse grève générale de mai 1914 où, après avoir mobilisé la jeunesse dakaroise en vue du déclenchement du formidable mouvement de révolte, Diagne essaya de l’arrêter sans succès en voulant éviter ainsi de mettre en péril ses intérêts de jeune député petit bourgeois.
En fait, une fois élu, le député fut chargé de veiller à la protection des intérêts des grands groupes commerciaux d’une part et de faire respecter les "lois de la République" d’autre part. Déjà bien avant la signature de l’accord de Bordeaux, Diagne s’illustra en bon agent recruteur de 72 000 "tirailleurs sénégalais" en vue de la boucherie mondiale de 1914/1918. C’est à cette fin qu’il avait été nommé, en janvier 1918, Commissaire de la République par Georges Clemenceau alors Président du Conseil. Effectivement, face aux réticences des jeunes et de leurs parents à se faire enrôler, il sillonna les villages africains de l’AOF pour convaincre les récalcitrants et, à coup de propagande et d'intimidation, parvint à envoyer au massacre des dizaines de milliers d’africains.
De même il fut un ardent défenseur de cet abominable "travail forcé" dans les colonies françaises, comme l’indique son discours à la XIVe session du Bureau International du Travail à Genève 4.
Tout compte fait, le premier député noir de la colonie africaine, ne fut jamais un véritable défenseur de la cause ouvrière, au contraire, il ne fut en définitive qu’un arriviste contre-révolutionnaire. D’ailleurs la classe ouvrière ne tarda pas à en prendre conscience :
"(…) comme si l’accord de Bordeaux avait convaincu les travailleurs que la classe ouvrière paraissait désormais seule en mesure de prendre le relais et de porter haut le flambeau du combat contre l’injustice pour l’égalité économique, sociale et politique, les luttes syndicales connurent, par une sorte de mouvement pendulaire, une exceptionnelle impulsion." (Thiam, ibid.) 5
En clair, Diagne ne put garder longtemps la confiance de la classe ouvrière et resta fidèle à ses parrains coloniaux jusqu’à sa mort en 1934.
1925 : année de forte combativité et de solidarité face à la répression policière
"Rien que dans le chemin de fer, en effet, l’année 1925 avait été secouée par trois grands mouvements sociaux, dont chacun avait eu des conséquences importantes. Il s'agit, d’une part, de la grève des cheminots indigènes et européens du Dakar - Saint-Louis, du 23 au 27 janvier, déclenchée pour des raisons économiques, d’autre part, de la menace de grève générale dans le Thiès-Kayes envisagée autour précisément de mots d’ordre dont le droit syndical, peu de temps après, enfin de la révolte des travailleurs Bambara en service dans les chantiers de construction du chemin de fer à Ginguinéo, révolte que des soldats appelés pour l’écraser refusèrent de mâter". (Thiam, ibid.)
Et pourtant, le moment n’était pas particulièrement propice à la mobilisation pour la lutte car, en prévention de la combativité ouvrière, l’autorité coloniale prenait une série de mesures extrêmement répressives.
"Au cours de l’année 1925, le département des colonies avait édicté, sur les recommandations des Gouverneurs Généraux, singulièrement celui de l’AOF, des mesures draconiennes touchant notamment la répression de la propagande révolutionnaire.
Au Sénégal, des nouvelles instructions, émanant de la Fédération (des 2 colonies françaises, AOF-AEF), avaient provoqué le renforcement des mesures de surveillance, sur l’ensemble du territoire. Et, dans chacune des colonies du groupe, un service spécial avait été institué, en liaison avec les services de la Sûreté Générale, chargé de centraliser à Dakar, et de recouper, tous les indices perçus aux postes d’écoute.
(…) Un nouveau projet fixant le régime de l’émigration, et de l’identification des indigènes, avait été dressé, au Département, dans le courant du mois de décembre 1925. Les étrangers et les suspects avaient désormais chacun leur casier ; la presse étrangère faisait l’objet d’un contrôle sévère, et les saisies de journaux étaient presque devenues la règle. (…) Le courrier était systématiquement violé, les envois de journaux ouverts et souvent détruits". (Thiam, ibid.)
Une fois encore, le pouvoir colonial trembla dès l’annonce d’un nouvel assaut de la classe ouvrière d’où sa décision d’instaurer un régime policier en vue de contrôler sévèrement toute la vie civile et les mouvements sociaux qui se développaient dans la colonie mais aussi et surtout en cherchant à éviter tout contact entre les ouvriers en lutte dans les colonies avec leurs frères de classe dans le monde, d’où les mesures draconiennes contre la "propagande révolutionnaire". Et pourtant, dans ce contexte, d’importantes luttes ouvrières purent éclater avec vigueur, ce malgré tout l’arsenal répressif brandi par l'État colonial.
Une grève des cheminots à caractère très politique
Le 24 janvier 1925, les cheminots européens et africains partirent ensemble en grève, en se dotant d’un comité de grève énonçant les revendications suivantes :
"Les agents du chemin de fer de Dakar - Saint-Louis ont arrêté le 24 janvier le trafic, à l’unanimité. Ce n’est pas sans réflexion, ni sans amertume qu’ils accomplissent ce geste. Depuis 1921, leurs salaires n’ont reçu aucun relèvement, malgré la hausse constante du coût de la vie à la colonie. Les Européens en majorité ne réalisent pas un salaire mensuel de 1000 francs et un indigène un salaire journalier de 5 francs. Ils demandent que leurs traitements soient relevés pour pouvoir vivre honnêtement". (Thiam, ibid.)
En effet, dès le lendemain, tous les agents des divers secteurs du chemin de fer abandonnèrent machines, chantiers et bureaux, bref une paralysie générale du rail. Mais surtout ce mouvement eut un caractère très politique dans la mesure où il intervint au milieu d’une campagne législative, en obligeant ainsi les partis et leurs candidats à se positionner clairement par rapport aux revendications des grévistes. De ce fait, dès cet instant, les notables politiques et les lobbies du commerce interpellèrent l’administration coloniale centrale en l’incitant à œuvrer immédiatement pour la satisfaction des revendications des salariés. Et, aussitôt après, au bout du deuxième jour de grève, les revendications des cheminots furent pleinement satisfaites. Ce fut d’ailleurs avec jubilation que les membres du comité de grève se permirent de retarder leur réponse dans l’attente du résultat de la consultation de leur base. De même que les grévistes avaient tenu à faire porter par leurs délégués l’ordre de reprise, par écrit, par un train spécial passant par toutes les gares.
"Les travailleurs avaient, une nouvelle fois, remporté une importante victoire, dans des conditions de lutte où ils avaient fait preuve d’une grande maturité, ainsi que d’une fermeté, non exempte de souplesse et de réalisme. (…) Ce succès est d’autant plus significatif qu’il était le fait de tous les travailleurs du réseau, européens comme indigènes, qui, après avoir été opposés par des problèmes de couleur et de relations de travail difficiles, avaient eu la sagesse de taire leurs divergences, dès que le danger d’une législation du travail draconienne se profila à l’horizon. (…) Le gouverneur lui-même n’avait pu s’empêcher de noter la maturité et l’esprit de suite et d’à propos, avec lesquels la grève avait été organisée. La préparation, écrit-il, en avait été fort adroitement menée. Le maire de Dakar, lui-même, connu et aimé des indigènes, n’avait pas été prévenu de leur participation. L’époque de la traite était choisie de façon à ce que le commerce, pour la sauvegarde de ses propres intérêts, soutienne les revendications. Les motifs invoqués, et pour certains justifiés, mettaient la campagne en mauvaise posture. En un mot, concluait-il, tout concordait pour lui faire rendre son maximum d’efficacité et lui donner l’appui de l’opinion publique". (Thiam, ibid.)
Voilà une éclatante illustration du haut niveau de combativité et de conscience de classe dont fit preuve la classe ouvrière de la colonie française, où travailleurs européens et africains prirent en main collectivement l’organisation de leur lutte victorieuse. On a là une belle leçon de solidarité de classe venant comme consolidation des acquis de toutes les expériences précédentes de confrontation avec la bourgeoisie. Et cela rend encore plus évident le caractère internationaliste des combats ouvriers de cette époque, et ce malgré l’effort permanent de la bourgeoisie de "diviser pour régner".
En février 1925, la grève des câblistes fit plier les autorités au bout de 24 heures
Le mouvement des cheminots venait à peine de se terminer que les câblistes partirent en grève, en formulant, eux aussi, de nombreuses revendications dont une forte augmentation de salaire et l’amélioration de leur statut. Et ce mouvement fut arrêté au bout de 24 heures et pour cause…
"Grâce au concours combiné des pouvoirs locaux et métropolitains, grâce à l’intervention heureuse des membres des corps élus, tout revint à l’ordre dans les 24 heures, car satisfaction fut donnée en partie aux câblistes, en ce qui rapportait à l’octroi de l’allocation d’attente à tout le personnel". (Thiam, ibid.)
Aussi, revigorés par ce premier succès, les câblistes (européens et indigènes ensemble) remettaient sur le tapis le reste de leurs revendications en menaçant de repartir immédiatement en grève. En fait, ils profitèrent de la place stratégique qu’ils occupaient dans le dispositif administratif et économique en tant qu’agents hautement qualifiés, donc possédant, de fait, une grande capacité de blocage du fonctionnement des réseaux de communication sur le territoire.
Pour leur part, face aux revendications des agents câblistes accompagnées d’une nouvelle menace de grève, les représentants de la bourgeoisie décidèrent de riposter en lançant une campagne d’intimidation et de culpabilisation à l’encontre des grévistes sur le thème :
"Comment les quelques fonctionnaires qui s’agitent pour exiger les augmentations de solde ne voient-ils pas qu’ils creusent eux-mêmes leur propre fosse ?" (Thiam, ibid.)
En fait, le pouvoir politique et du gros commerce mobilisa d’autres gros moyens de pression sur les grévistes allant jusqu’à les accuser de vouloir "détruire délibérément l’économie du pays" tout en s’efforçant par ailleurs de briser l’unité qui existait entre eux. La pression devenant de plus en plus forte, les ouvriers décidèrent alors de reprendre le travail sur la base des revendications satisfaites à l’issue de la grève précédente.
En fait, cet épisode fut aussi un des moments forts où l’unité entre ouvriers européens et africains se réalisa pleinement dans la lutte.
Rébellion sur les chantiers du chemin de fer Thiès-Kayes le 11 décembre 1925
Une rébellion éclata sur cette ligne où un contingent de travailleurs (une centaine) décida d’en découdre avec son chef, capitaine de l’armée coloniale, personnage cynique et autoritaire, accoutumé à être obéi "au doigt et à l’œil", et qui avait l’habitude de faire subir des sévices corporels aux travailleurs qu’il jugeait "paresseux".
"De l’enquête qui avait pourtant été menée par l’Administrateur Aujas, commandant de cercle de Kaolack, il ressortait qu’une rébellion avait éclaté le 11 décembre par suite de "mauvais traitements" infligés à ces travailleurs. Le commandant de cercle ajoutait, que, sans admettre entièrement ces déclarations, monsieur le capitaine Heurtematte a reconnu qu’il lui arrivait quelquefois de frapper d’un coup de cravache un manœuvre paresseux et récalcitrant. [L’incident] s’est envenimé dès le moment où le capitaine fit attacher à un pieu par des cordes, trois bambaras [terme ethnique], qu’il prit pour les meneurs de l’affaire". (Thiam, ibid.)
Et les choses se gâtèrent pour le capitaine quand il se mit à fouetter ces trois travailleurs car leurs camarades du chantier décidèrent d’en finir pour de bon avec leur tortionnaire et celui-ci ne put sauver sa tête que d’extrême justesse par l’arrivée sur place des tirailleurs appelés à son secours.
"Les tirailleurs dont il était question étaient formés de sujets français originaires du Sénégal oriental et de Thiès ; arrivés sur place et ayant appris ce qui s’était passé, ils refusèrent unanimement l’ordre de tirer sur les travailleurs noirs, ordre que le pauvre capitaine assailli de toutes parts, par une meute menaçante et féroce, leur avait intimé, craignant, disait-il, pour sa vie". (Thiam, ibid.)
Voilà un fait singulier car jusque là on était plutôt habitué à voir les "tirailleurs" comme forces aveugles, acceptant par exemple de jouer docilement le rôle de "jaunes" ou carrément de "liquidateurs" de grévistes. Du coup ce geste de fraternisation ne peut que nous rappeler quelques épisodes historiques où des conscrits refusèrent de briser des grèves ou des révolutions. L’exemple le plus célèbre reste évidemment l’épisode de la révolution russe où un grand nombre de militaires refusèrent de tirer sur leurs frères révolutionnaires en désobéissant aux ordres de leur hiérarchie, ce malgré les gros risques encourus.
L’attitude des "tirailleurs" face à leur capitaine fut d’autant plus réjouissante que le contexte était particulièrement alourdi par une forte tendance à la militarisation de la vie sociale et économique de la colonie. D’ailleurs l’affaire prenait une tournure hautement politique car l’administration civile et militaire se trouvait ainsi bien embarrassée de devoir choisir, soit de sanctionner l’attitude d’insoumission des soldats au risque de resserrer leur solidarité avec les travailleurs, soit d’étouffer l’incident. Et finalement l’autorité coloniale choisit cette dernière solution.
"Mais l’affaire ayant fortement défrayé la chronique et menaçant de compliquer les relations interraciales déjà plus que préoccupantes dans un service comme le chemin de fer, les autorités fédérales comme locales avaient finalement conclu à la nécessité d’étouffer l’incident et de le minimiser, maintenant qu’elles s’étaient rendu compte des conséquences désastreuses que la politique dite de collaboration des races inaugurée par Diagne depuis la signature du pacte de Bordeaux était en train de leur coûter cher". (Thiam, ibid.)
En effet, comme les précédents, ce mouvement de lutte illustra remarquablement les limites du "pacte de Bordeaux" par lequel le député Blaise Diagne pensait avoir garanti la "collaboration" entre exploiteurs et exploités. Mais hélas pour la bourgeoisie coloniale, la conscience de classe était passée par là.
La vigoureuse grève des inscrits maritimes en 1926
Comme l’année précédente, 1926 fut marquée par un épisode de lutte très vigoureuse et très riche en termes de combativité et de solidarité de classe, d’autant plus remarquable que le mouvement fut déclenché dans le même contexte de répression des luttes sociales dans lequel, depuis l’année précédente, nombre de chantiers et d'autres secteurs étaient encadrés en permanence par les forces de police et de gendarmerie, au nom de la "sécurisation" de l’environnement économique.
"Alors que les attentats sur la voie ferrée se poursuivaient inexorablement 6 et que l’agitation gagnait des milieux aussi attachés pourtant à l’ordre et à la discipline que les anciens combattants, les travailleurs des Messageries Africaines de Saint-Louis déclenchaient un ordre de grève, qui allait détenir le record de la durée parmi tous les mouvements sociaux jusque-là étudiés dans cette localité.
Tout avait commencé le 29 septembre lorsqu’un télégramme du Lieutenant-Gouverneur informa le Chef de la Fédération que les inscrits maritimes de la Compagnie des Messageries Africaines à Saint-Louis s’étaient mis en grève pour obtenir des améliorations de salaires. Par un bel esprit de solidarité presque spontané, leurs collègues de la Maison Peyrissac, employés sur le Vapeur Cadenel ayant alors jeté l’ancre à Saint-Louis, bien que non concernés par la revendication avancée, avaient cessé eux aussi le travail dès le premier octobre suivant". (Thiam, ibid.)
Sous la poussée de la hausse effrayante du coût de la vie, beaucoup de secteurs avancèrent des revendications salariales en menaçant de partir en lutte et de ce fait un grand nombre d’entreprises avaient accordé des hausses de salaire à leurs employés. Tel n’avait pas été le cas pour les travailleurs des Messageries, d’où le déclenchement de leur mouvement et le soutien reçu de leurs camarades du Vapeur. Cependant, malgré cela, le patronat resta de marbre et refusa toute négociation avec les grévistes jusqu’au cinquième jour de la grève, laissant le mouvement se poursuivre dans l’espoir de son épuisement à court terme.
"Mais le mouvement, ayant conservé sa cohésion et sa solidarité des premiers jours, le 6 octobre, la Direction des Messageries assaillie de toutes parts par les maisons de commerces et encouragée secrètement par l’Administration à faire preuve de plus de souplesse, vu la précarité de la conjoncture, baissa pavillon, subitement. Elle fit aux équipages les propositions suivantes : "augmentation mensuelle de 50 francs (sans distinction de catégorie) et des denrées pour la pitance (41 francs par mois environ)". (…) Mais les travailleurs concernés, voulant payer leurs collègues de la Maison Peyrissac de leur solidarité agissante, demandèrent et obtinrent que les mêmes avantages leur fussent accordés. La Direction de cette maison s’inclina. Le 6 octobre, la grève prit fin. Le mouvement avait duré huit jours pleins, sans que l’unité des travailleurs se soit émoussée un seul instant. C’était là, un événement d’une grande importance". (Thiam, ibid.)
Nous assistons, là encore, à un mouvement formidable, exemplaire et riche d’enseignements sur la vitalité des luttes de cette époque. En d’autres termes, cette séquence de la lutte fut l’occasion d’une véritable expression de "solidarité agissante" (comme le dit l’auteur cité) entre ouvriers de diverses entreprises. Quel meilleur exemple de solidarité de voir tel équipage exiger et obtenir que les mêmes avantages qu’il arracha à l’issue de sa lutte fussent accordés à ses camarades d’une autre entreprise en "remerciement" du soutien reçu de ces derniers !
Que dire aussi de la combativité et de la cohésion dont les ouvriers des messageries firent preuve en imposant un rapport de force sans faille aux forces du capital !
La longue et dure grève des marins de Saint-Louis en juillet/août 1928
L’annonce de cette grève préoccupait beaucoup les autorités coloniales car elle semblait faire écho aux revendications des marins en France qui s’apprêtaient à partir en lutte au même moment que leurs camarades africains.
Au congrès de la Fédération syndicale internationale (de tendance social-démocrate), tenu à Paris en août 1927, fut lancé un appel à la défense des prolétaires des colonies comme le relate (Thiam, ibid.) :
"Un délégué anglais au Congrès de la Fédération syndicale internationale (FSI) à Paris ; saisissant l’occasion, ce délégué nommé Purcell avait particulièrement insisté sur l’existence dans les colonies de millions d’hommes soumis à une exploitation effrénée, devenus des prolétaires au sens plein du terme, qu’il fallait, désormais, organiser et engager dans des actions revendicatives de type syndical, en recourant notamment à l’arme de la protestation et de la grève. Lui faisant écho, Koyaté (syndicaliste africain) lui-même déclarait que "le droit syndical est à arracher en Afrique noire française par des grèves de masse, dans l’illégalité" ". En France depuis le mois de juin 1928, une agitation se développait chez les ouvriers marins qui réclamaient des augmentations de salaire et on s’attendait donc à une grève le 14 juillet. Or, à la date fixée, ce furent les marins indigènes des compagnies maritimes de Saint-Louis qui entrèrent massivement en grève sur les mêmes revendications que leurs camarades en métropole. Dès lors la réaction des autorités coloniales fut de crier au "complot international" en désignant, entre autres, deux leaders syndicalistes indigènes comme "meneurs" du mouvement. Et pour y faire face, l’Administration de la colonie fit front avec le patronat en combinant manœuvres politiques et mesures répressives pour briser la grève.
"(…) Commencèrent alors d’âpres et longs marchandages. Alors que les marins acceptaient, tout au plus, de réduire leurs demandes de 25 francs seulement, le patronat déclara qu’il était impossible d’attribuer plus de 100 francs par mois aux grévistes. Les travailleurs (qui en réclamaient 250) ayant considéré cette offre insuffisante le mouvement de grève continua de plus belle". (Thiam, ibid.)
En effet, les grévistes de la région de Saint-Louis purent bénéficier spontanément du soutien actif d’autres ouvriers marins (Thiam, ibid) :
"(Archives d'État) Le chef du service de l’Inscription nous apprend, en effet, que le 19, dans l’après midi, le "Cayor" remorqueur venant de Dakar, est arrivé avec le Chaland "Forez". A peine le navire stoppé, l’équipage a fait cause commune avec les grévistes à l’exclusion d’un vieux maître d’équipage et d’un autre marin. Mais nous dit-il, dans la matinée du lendemain 20 juillet, les grévistes ont fait irruption à bord du "Cayor" et ont traîné à terre, de force les deux marins demeurés à leur poste. Une courte manifestation aux abords de la mairie a été dispersée par la police".
La grève se prolongea pendant plus d’un mois avant d’être brisée militairement par le Gouverneur colonial qui délogea de force les équipages indigènes et les remplaça par les troupes. En effet, épuisés par de longues semaines de lutte, privés de ressources financières nécessaires à l’entretien de leur famille, bref pour éviter de crever de faim, les marins durent reprendre le travail, d’où la jubilation gourmande du représentant du pouvoir colonial sur place que traduit son propre récit de l’événement :
"[A la fin de la grève] les marins ont demandé à rembarquer sur les navires de la Société des Messageries Africaines. Ils ont été repris aux anciennes conditions, le résultat de la grève s’est donc traduit, pour les marins, par la perte d’un mois de salaire, alors que s’ils avaient écouté les propositions du Chef du service de l’Inscription maritime, ils bénéficieraient d’un relèvement de solde de 50 à 100 F par mois". (Thiam, ibid.)
Ce repli des grévistes, somme toute réaliste, fut considéré par la bourgeoisie comme une "victoire" pour elle alors que s’annonçait la crise de 1929, dont les effets commençaient à se faire sentir au niveau local. Dès lors le pouvoir colonial ne tarda pas à profiter de sa "victoire" sur les marins grévistes et de la conjoncture pour renforcer davantage son arsenal répressif.
"Placé devant cette situation, le Gouverneur colonial, tirant les leçons des tensions politiques déjà décrétées, des déclarations de Ameth Sow Télémaquem 7 parlant de révolution à faire au Sénégal, de la succession des mouvements sociaux, de la dégradation de la situation budgétaire, et du mécontentement des populations, avait pris deux mesures relevant du domaine de maintien de l’ordre.
Dans la première il avait accéléré le processus, amorcé depuis 1927, en vue d’établir la direction des services de sécurité du Sénégal à Dakar d’où la surveillance de la colonie devait, selon lui, être accentuée. (…) La seconde mesure avait été la mise en application accélérée, elle aussi, de l’instruction règlementant le service de la gendarmerie chargé de la police du Thiès-Niger". (Thiam, ibid.).
En clair, la présence de gendarmes affectés au service d’escorte de trains pour "accompagner" les roulants avec des brigades d’intervention sur toutes les lignes, des mesures visant les individus ou groupes qui seraient arrêtés et mis en prison s’ils devaient braver les ordres de police, tandis que les auteurs de "troubles sociaux" (grèves et manifestations) seraient sévèrement punis. Signalons que tous ces moyens de répression, venant accentuer la militarisation du travail, visaient principalement les deux secteurs qui étaient des poumons sur lesquels reposait l’économie coloniale, à savoir le maritime et le ferroviaire.
Mais, en dépit de ce quadrillage militaire, la classe ouvrière ne cessa pas pour autant de constituer une menace pour les autorités coloniales.
"Pourtant lorsque l’agitation sociale reprit dans des sections du Railway à Thiès, où des menaces de grève furent proférées à la suite du non-paiement des rappels de solde dus au personnel, de la présentation de revendications visant des augmentations de salaires et de la dénonciation de l’incurie d’une administration qui se désintéressait complètement de leur sort, le Gouverneur prit très au sérieux lesdites menaces et en s’employant à constituer, au cours de 1929, une nouvelle police privée, composée cette fois d’anciens militaires, la plupart gradés, qui, sous la direction du Commissaire de la police spéciale, devaient veiller d’une façon permanente à la tranquillité au dépôt de Thiès". (Thiam, ibid.)
Donc, dans cette période de fortes et menaçantes tensions sociales, en lien avec la terrible crise économique mondiale, le régime colonial n’avait pas d’autre moyen que de s’appuyer plus que jamais sur ses forces armées pour venir à bout de la combativité ouvrière.
L’entrée dans la Grande Dépression et la militarisation du travail affaiblissent la combativité ouvrière
Comme on a pu le voir précédemment, le pouvoir colonial n’avait pas attendu l’arrivée de la crise de 1929 pour militariser le monde du travail, car il commença dès 1925 à recourir à l’armée pour faire face à la pugnacité de la classe ouvrière. Mais cette situation combinée de surgissement de la crise économique mondiale et de militarisation du travail dut peser lourdement sur la classe ouvrière de la colonie car, entre 1930 et 1935, il y eut peu de lutte. En fait le seul mouvement de classe conséquent connu fut celui des ouvriers du port de Kaolack 8 :
"(…) Une grève courte mais violente à Kaolack le 1er mai 1930 : 1500 à 2000 ouvriers de seccos d’arachides et du port ont arrêté le travail pendant le chargement des bateaux. Ils réclament le doublement de leurs salaires de 7,50 francs. La gendarmerie intervient ; un gréviste est légèrement blessé. Le travail reprend à 14 heures : les ouvriers ont obtenu un salaire journalier de 10 francs".
Cette grève courte et néanmoins vigoureuse vint clôturer la série de luttes fulgurantes entamées depuis 1914. En d’autres termes, 15 ans d’affrontements de classes au bout desquels le prolétariat de la colonie de l’AOF sut tenir tête à son ennemi et construire son identité de classe autonome.
Pour sa part, dans la même période, la bourgeoisie montra sa vraie nature de classe sanguinaire en utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris les plus féroces, pour tenter de venir à bout de la combativité ouvrière. Mais au bout du compte elle dut cependant reculer régulièrement face aux assauts de la classe ouvrière en cédant souvent totalement aux revendications des grévistes.
1936/1938 : importantes luttes ouvrières sous le gouvernement de Front populaire
Dans la foulée de l’avènement du gouvernement de Front populaire de Léon Blum, on put assister au redémarrage fulgurant de la combativité ouvrière à travers l’éclatement de nombreuses grèves. Ainsi, on ne dénombra pas moins de 42 "grèves sauvages" au Sénégal entre 1936 et 1938, dont celle de septembre 1938 que nous verrons ci-après. Ce fait est d’autant plus significatif que les syndicats venaient d’être légalisés avec de "nouveaux droits" par le gouvernement de Front populaire, en bénéficiant donc d’une légitimité.
Ces mouvements de lutte furent souvent victorieux. Par exemple celui de 1937 où des marins d’origine européenne d’un navire français en escale en Côte d’Ivoire qui, sensibilisés par les conditions de vie misérables des marins indigènes (des Kroumen), incitèrent ces derniers à formuler des revendications visant à améliorer leurs conditions de travail. Mais les ouvriers indigènes furent chassés manu militari par l’administrateur colonial, ce qui mit aussitôt l’équipage français en grève en soutien à leurs camarades africains en obligeant ainsi les autorités à satisfaire pleinement les revendications des grévistes.
Voilà encore un énième acte de solidarité ouvrière qui vint s’ajouter aux nombreux épisodes cités précédemment où l’unité et la solidarité entre européens et africains fut à l’origine d’un bon nombre de luttes victorieuses, ce en dépit de leurs "différences raciales".
1938 : la grève des cheminots suscita la haine de toute la bourgeoisie contre les ouvriers
Un autre mouvement hautement significatif en termes d’affrontement de classes fut la grève des cheminots en 1938, menée par les ouvriers à contrats précaires dont les syndicats "négligeaient" les revendications. En l’occurrence des journaliers ou auxiliaires, plus nombreux et plus démunis chez les cheminots, payés à la journée en travaillant les dimanches et jours fériés, jours de maladie compris et en faisant 54 heures par semaine sans aucune des prérogatives accordées aux agents titulaires, le tout avec un emploi révocable chaque jour.
Ce sont donc ces cheminots-là qui déclenchèrent la célèbre grève de 1938 9 :
"(…) Le mouvement a d’ailleurs éclaté spontanément et en dehors de l’organisation syndicale. Le 27 septembre, les cheminots auxiliaires (non titulaires) du Dakar-Niger se mettent en grève à Thiès et à Dakar pour protester contre le déplacement arbitraire d’un de leurs camarades.
Le lendemain, au dépôt de Thiès, les grévistes organisent un barrage pour empêcher les "jaunes" de venir travailler. La police du Dakar-Niger tente d’intervenir, mais elle est vite débordée ; la direction du chemin de fer fait appel à l’administrateur qui envoie la troupe : les grévistes se défendent à coups de pierres ; l’armée fait feu. Il y a six morts et trente blessés. Le lendemain (le 29) la grève est générale sur tout le réseau. Le jeudi 30, un accord est signé entre les délégués ouvriers et le gouvernement général sur les bases suivantes :
1) Pas de sanctions ; 2) Pas d’entrave au droit d’association ;3) Indemnisation des familles de victimes nécessiteuses ; 4) Examen des revendications.
Le 1e octobre, le syndicat donne l’ordre de reprise du travail".
Nous voyons, là encore, une autre lutte spectaculaire et héroïque livrée par les cheminots, en dehors des consignes syndicales, qui firent plier la puissance coloniale, ce malgré le recours à son bras sanguinaire, en l’occurrence l’armée, comme l’indique le nombre de morts et de blessés sans compter les dizaines d’ouvriers jetés en prison. D’ailleurs, pour mieux mesurer le caractère barbare de la répression, voici le témoignage d’un ouvrier peintre, un des rescapés du carnage 10 :
"Lorsque nous apprîmes l’affectation à Gossas de Cheikh Diack, un violent mécontentement gagna les milieux des travailleurs, surtout les auxiliaires dont il était le porte-parole. Nous décidâmes de nous y opposer par la grève qui éclata le lendemain où notre dirigeant rejoignit son poste. En me réveillant ce jour-là, un mardi - je m’en souviendrai toujours - j’entendais des coups de feu. J’habitais à proximité de la Cité Ballabey. Quelques instants après, j’ai vu mon frère Domingo partir précipitamment vers le Dépôt. Je me jetai à sa poursuite, conscient du danger qu’il courait. Bientôt je le vis franchir la ligne du chemin de fer et tomber quelques mètres plus loin. Lorsque j’arrivai près de lui, je le crus victime d’un malaise, car je ne voyais aucune blessure, quand je le relevai, il poussa un gémissement rauque. Le sang coulait à flots d’une blessure qu’il portait près de l’épaule gauche. Il expira quelques instants après dans mes bras. Ivre de rage, je fonçai sur le soldat en face de moi. Il tira. J’avançai toujours sans savoir que j’étais blessé. Je crois que c’est la colère qui grondait en moi qui me donna la force de l’atteindre et de lui arracher son fusil, son ceinturon, son calot, après l’avoir assommé, avant de tomber évanoui".
Ce récit illustre la férocité des tirailleurs sénégalais envers les ouvriers "indigènes", ignorant l’exemple de leurs collègues qui avaient refusé de tirer sur les ouvriers lors de la rébellion sur le chantier de Thiès en 1925. Reste à saluer la combativité et le courage dont firent preuve les ouvriers grévistes dans la défense de leurs intérêts et de leur dignité de classe exploitée.
Il faut noter ici le fait qu’avant de partir en grève, les ouvriers furent harcelés par toutes les forces de la bourgeoisie, partis et divers notables, patronat et syndicats. Tous ces représentants de l’ordre du capital lancèrent injures et intimidations aux ouvriers qui osèrent partir en grève sans "bénédiction" de personne sauf d’eux-mêmes et, de fait, en rendant fous et hystériques les chefs religieux musulmans qui se déchaînèrent contre les grévistes, ce à la demande du Gouverneur, comme le rappelle Nicole Bernard-Duquenet (ibid.) :
"Il (le gouverneur) fait aussi appel aux chefs religieux et coutumiers ; Seydou Nourou Tall, qui a souvent joué un rôle d’émissaire du gouverneur général, parle à Thiès (devant les ouvriers grévistes) ; Cheikh Amadou Moustapha Mbacke parcourt le réseau en expliquant qu’un bon musulman ne doit pas faire grève car c’est une forme de rébellion".
Une fois n’est pas coutume, nous sommes tout à fait d’accord avec ce cynique marabout pour dire que faire grève est bien un acte de rébellion, pas seulement contre l’exploitation et l’oppression, mais aussi contre l’obscurantisme religieux.
Quant aux syndicats, qui ne furent pas à l’initiative de la lutte des cheminots, ils durent quand même prendre le "train en marche" pour ne pas perdre totalement le contrôle du mouvement. Et voici décrit leur état d’esprit par le délégué des grévistes 11
"(…) Nous demandions une augmentation de 1,50 francs par jour pour les débutants jusqu’à 5 ans d’ancienneté, 2,50 francs de 5 à 10 ans, et 3,50 francs au dessus de 10 ans ainsi qu’une indemnité de déplacement en faveur des chefs de train, convoyeurs, mécaniciens etc.(…) Si invraisemblable que cela puisse paraître, ces revendications accueillies favorablement par la Direction du réseau, furent au contraire battues en brèche par le Syndicat des Travailleurs Indigènes du Dakar-Niger qui groupait les agents cadres. En effet, celui-ci ne pouvait pas se résigner à nous voir emporter cette première manche. Ses dirigeants cultivaient et tentaient de monopoliser le droit exclusif à la revendication auprès des autorités du réseau. La conjoncture syndicale de l’époque faite de rivalités, de luttes obscures intestines et de surenchère sur la fidélité à l’égard du patronat, explique largement une telle prise de position. Le résultat est que je fus muté à Dakar. On eut, en haut lieu, la candeur de croire que cette mutation pouvait étouffer le mouvement revendicatif qui avait pris naissance chez les "gagne-petit" ".
Encore une terrible démonstration du rôle d’agent traître à la cause ouvrière et de "négociateur de paix sociale" qu’exerce le syndicalisme au bénéfice du capital et de l’Etat bourgeois. Bref comme le dit Nicole Bernard-Duquenet (ibid.) :
"Aussi est-il à peu près certain que les secrétaires des syndicats ont tout fait pour enrayer les menaces de grève qui auraient pu gêner les autorités.
Mais en plus des forces militaro-policières, syndicales, patronales et religieuses, ce fut surtout leur porte-parole, à savoir la presse aux ordres (de droite et de gauche) qui s’acharna comme un charognard affamé contre les grévistes :
Le "Courrier colonial" (du patronat) :
"Dans la métropole, on a eu trop longtemps à déplorer les désastreuses conséquences des grèves se produisant un peu partout, sur des mots d’ordre d’agitateurs le plus souvent étrangers, ou à la solde de l’étranger, pour que les gouvernements coloniaux se hâtent de refreiner énergiquement toute velléité de transformer nos colonies en champ d’actions de gréviculture" ;
"L’Action française" (droite) :
"Ainsi, alors que les responsables marxistes de l’émeute sont clairement établis, le ministre des Colonies envisage de prendre des sanctions contre les tirailleurs sénégalais (et non contre les grévistes). Et tout cela pour plaire aux socialistes et sauver leur créature, le Gouverneur général De Coppet, dont on verra la scandaleuse carrière". "
Voilà donc un aperçu de ce que fut l’attitude des vautours médiatiques de la droite. Pourtant en ce domaine la presse de gauche ne fut guère moins acharnée :
"Les journaux proches du Front populaire sont très amers. L’A.O.F. impute la grève à des agents provocateurs, une "grève absurde" (…).
Le Périscope Africain parle d’une grève "frisant la rébellion" alors qu’aucun gréviste ne faisait partie du syndicat indigène. Le Bulletin de la Fédération des fonctionnaires flétrit l’usage des balles pour disperser les grévistes, interprète la grève comme une émeute, les auxiliaires n’étant ni des cégétistes, ni des communistes. Ils ne sont même pas syndiqués. "Aux fascistes les responsabilités".
Le Populaire (SFIO) impute la responsabilité des incidents à un "parti local de droite violemment hostile à la CGT et aux menées fascistes de certains syndicalistes (allusion au porte-parole des grévistes)"." (Nicole Bernard-Duquenet, ibid.)
Et pour caractériser toutes ces ignobles réactions anti-ouvrières, écoutons les conclusions de l’historien Iba Der Thiam 12 quand il dit ceci :
"Comme on le voit, on ne vit à gauche, comme à droite, dans les événements survenus à Thiès, que le prolongement de la politique intérieure française, c'est-à-dire, une lutte opposant démocrates et fascistes, en l’absence de toute motivation sociale concrète et plausible.
C’est cette erreur d’appréciation, qui expliquerait dans une large mesure, pourquoi la grève des cheminots de Thiès n’a jamais été correctement appréhendée par les syndicats français, même les plus avancés.
(…) Les récriminations de l’AOF et du Périscope Africain, contre les grévistes, ressemblent sur bien des points aux articles du Populaire et de l’Humanité".
Autrement dit, une attitude similaire entre la presse de droite et de gauche face au mouvement des cheminots. Voilà, tout est dit dans ce dernier paragraphe ; en effet, on voit là l’unanimité des forces de la bourgeoisie, nationales et coloniales, contre la classe ouvrière qui lutta contre la misère et pour sa dignité. Manifestement, ces réactions haineuses de la presse de gauche envers les ouvriers grévistes confirmèrent avant tout l’encrage définitif du "PC" au sein du capital français, sachant que c’était déjà le cas du "PS" depuis 1914. Aussi, il faut se rappeler que ce comportement anti-ouvrier s’inscrivait dans le contexte d’alors des préparatifs militaires en vue de la seconde boucherie mondiale, pendant laquelle la gauche française joua un rôle actif d’embrigadement du prolétariat en France métropolitaine et dans les colonies africaines.
Lassou (à suivre)
1 Il s’agit du gros commerce dominé par les négociants bordelais comme Maurel & Prom, Peyrissac, Chavanel, Vézia, Devès, etc., groupe dont le monopole du crédit s’exerçait sur l’unique Banque de l’Afrique Occidentale.
2 Une grève générale et une émeute de 5 jours étendue à toute la région de Dakar, paralysant totalement la vie économique et politique et obligeant la bourgeoisie coloniale à céder aux revendications des grévistes (voir la Revue internationale n° 146).
3 Iba Der Thiam, Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Éditions L’Harmattan, 1991.
4 Voir Afrique noire, l'Ère coloniale 1900-1945, Jean Suret-Canale, Éditions Sociales, Paris 1961.
5 Il vaut ici la peine de rappeler ce que nous avons déjà signalé à l'occasion de la publication de la première partie de cet article dans la Revue Internationale n° 145. "Si nous reconnaissons largement le sérieux des chercheurs qui transmettent les sources de référence, en revanche nous ne partageons pas forcément certaines de leurs interprétations des évènements historiques. Il en est de même sur certaines notions, par exemple quand les mêmes parlent de "conscience syndicale" à la place de "conscience de classe" (ouvrière), ou encore "mouvement syndical" (au lieu de mouvement ouvrier). Reste que, jusqu’à nouvel ordre, nous avons confiance en leur rigueur scientifique tant que leurs thèses ne se heurtent pas aux faits historiques ou n’empêchent pas d’autres interprétations".
6 Les informations dont nous disposons ne donnent pas d’indication sur les auteurs de ces attentats.
7 Syndicaliste africain, membre de la Fédération syndicale internationale, de tendance social-démocrate.
8 Nicole Bernard-Duquenet, Le Sénégal et le Front populaire, L’Harmattan, 1985
9 Jean Suret-Canale, op. cit.
10 Antoine Mendy, cité par la publication Sénégal d’Aujourd’hui, n° 6, mars 1964.
11 Cheikh Diack, cité par le même journal Sénégal d’Aujourd’hui.
12 Iba Der Thiam, La grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938, Mémoire de Maîtrise, Dakar 1972.
Géographique:
- Afrique [29]
Le syndicalisme-révolutionnaire en Allemagne (III) : la FVDG syndicaliste-révolutionnaire au cours de la Première Guerre mondiale
- 2802 lectures
L'épreuve de l'heure : Union sacrée ou internationalisme ?
Main dans la main avec la social-démocratie qui vote publiquement les crédits de guerre le 4 août 1914, les directions des grands syndicats sociaux-démocrates s’inclinent également devant les plans de guerre de la classe dominante. À la conférence des comités directeurs des syndicats sociaux-démocrates du 2 août 1914, où il fut décidé de suspendre toute grève et toute lutte revendicative pour ne pas troubler la mobilisation dans la guerre, Rudolf Wissell exprime le paroxysme du chauvinisme qui a envahi les syndicats sociaux-démocrates : "Si l'Allemagne est vaincue dans la lutte actuelle, ce qu'aucun de nous n'espère, alors toutes les luttes syndicales après la fin de la guerre sont vouées à l'échec et inutiles. Si l’Allemagne triomphe, alors une conjoncture ascendante s’inaugure et les moyens de l’organisation n’auront ensuite pas besoin de peser autant dans la balance." 1 La logique effrayante des syndicats consiste à lier directement le sort de la classe ouvrière à l’issue de la guerre : si "leur propre nation" et leur classe dominante tirent profit de la guerre, alors c’est aussi un bénéfice pour les ouvriers, parce qu'on peut compter ensuite sur des concessions de politique intérieure pour la classe ouvrière. Par conséquent, il faut soutenir tous les moyens en vue de la victoire militaire de l'Allemagne.
L'incapacité des syndicats sociaux-démocrates et du SPD à adopter une position internationaliste face à la guerre n’est pas surprenante. Quand on enchaîne la défense des intérêts de la classe ouvrière au cadre national, quand on encense le parlementarisme bourgeois comme panacée au lieu de prendre comme orientation politique l’antagonisme international entre la classe ouvrière et le capitalisme, cela conduit inévitablement dans le camp du capital.
Effectivement la classe dominante en Allemagne n’a pu faire la guerre que grâce à la conversion publique du SPD et de ses syndicats ! Les syndicats sociaux-démocrates n’ont pas seulement joué un rôle de suiveurs. Non, ils ont développé une véritable politique de guerre, de propagande chauvine et ont constitué le facteur crucial dans l'établissement d'une intensive production de guerre. Le "réformisme socialiste" s'était transformé en "social-impérialisme" comme l’a formulé Trotski en 1914.
Parmi les ouvriers qui, dans les premiers temps de la déclaration de guerre en Allemagne, ont tenté de nager contre le courant, nombre d’entre eux étaient influencés par le syndicalisme révolutionnaire. La grève sur le paquebot "Vaterland" 2 en mai-juin 1914, peu avant le début de la guerre, constitue un exemple de l’affrontement entre les fractions combatives de la classe ouvrière et la centrale syndicale social-démocrate qui défendait l’Union Sacrée. Le plus grand paquebot du monde de l'époque constituait l’orgueilleux emblème de l'impérialisme allemand. Une partie de l'équipage, comportant une forte présence d’ouvriers de la fédération industrielle syndicaliste révolutionnaire, s’était mise en grève pendant le voyage inaugural Hambourg-New York. La Fédération des Ouvriers Allemands des Transports social-démocrate s'est opposée avec agressivité à cette grève : "Par conséquent, tous ceux qui ont participé à ces assemblées de syndicalistes révolutionnaires ont commis un crime contre les marins. (…) Nous rejetons par principe les grèves sauvages. (…) Et dans la gravité des temps présents, où il s'agit de rassembler toutes les forces des travailleurs, les syndicalistes révolutionnaires mènent leurs tentatives de division parmi les ouvriers et se revendiquent par-dessus le marché du mot d’ordre de Marx : l’émancipation des travailleurs ne peut être que l’œuvre des travailleurs eux-mêmes." 3 Les appels à l’unité du mouvement ouvrier par les syndicats sociaux-démocrates n'étaient plus que des phrases pour s’assurer du contrôle des mouvements dans la classe ouvrière afin de la faire basculer dans "l'union pour la guerre" en août 1914.
On ne peut pas du tout faire le reproche aux syndicalistes-révolutionnaires en Allemagne d’avoir abandonné la lutte des classes dans les semaines avant la déclaration de la guerre. Au contraire, pendant un court temps, ils ont formé un centre de ralliement de prolétaires combatifs : "Là arrivèrent des ouvriers qui entendaient pour la première fois le terme de syndicalisme révolutionnaire et escomptaient ici du jour au lendemain assouvir leurs désirs révolutionnaires." 4 Toutes les organisations de la classe ouvrière, le courant syndicaliste révolutionnaire y compris, devaient cependant faire face à une autre tâche. Outre maintenir la lutte des classes, il était indispensable de démasquer le caractère impérialiste de la guerre qui se profilait.
Quelle a été l'attitude de la FVDG syndicaliste révolutionnaire par rapport à la guerre ? Le 1er août 1914, elle a clairement pris position dans son organe principal Die Einigkeit contre la guerre imminente, non en tant que pacifistes naïfs, mais en tant qu’ouvriers recherchant la solidarité avec ceux des autres pays : "Qui veut la guerre ? Pas le peuple laborieux, mais une camarilla militaire de vauriens, qui dans tous les États européens est avide de gloire martiale. Nous travailleurs ne voulons pas de guerre ! Nous l’exécrons, elle assassine la culture, elle viole l'humanité et augmente jusqu’à la monstruosité le nombre des estropiés de la guerre économique actuelle. Nous travailleurs voulons la paix, la paix intégrale ! Nous ne connaissons pas d’Autrichiens, de Serbes, de Russes, d’Italiens, de Français, etc. Frères du travail, voilà notre nom ! Nous tendons les mains aux travailleurs de tous les pays pour empêcher un crime atroce qui produira des torrents de larmes dans les yeux des mères et des enfants. Les barbares et les individus hostiles à toute civilisation peuvent bien voir dans la guerre une sublime et sainte expression - les hommes au cœur sensible, les socialistes, portés par une conception du monde faite de justice, d'humanité et d'amour des hommes, dédaignent la guerre ! Par conséquent, travailleurs et camarades, élevez partout la voix en protestation contre ce crime contre l'humanité qui se prépare ! Il coûte leurs biens et leur sang aux pauvres, mais il apporte le profit aux riches, gloire et honneur aux représentants du militarisme. A bas la guerre !"
Le 6 août 1914 se produisait l'attaque des troupes allemandes contre la Belgique. Franz Jung, un sympathisant syndicaliste révolutionnaire de la FVDG et ultérieurement membre du KAPD, dresse le tableau de ses expériences saisissantes dans le Berlin de ces jours-là, pris dans l’ivresse guerrière : "Pour le moins toute une foule fondit sur les quelques douzaines de manifestants pour la paix, auxquels je m'étais joint. Autant que je me le rappelle, cette manifestation avait été organisée par les syndicalistes révolutionnaires autour de Kater et de Rocker. Une banderole tendue entre deux perches a été brandie, un drapeau rouge déployé et la manifestation "A bas la guerre !" a commencé à s’ordonner en rangs. Nous ne sommes pas allés loin." 5
Laissons s’exprimer une autre révolutionnaire de l'époque, l'anarchiste internationaliste Emma Goldman : "En Allemagne Gustav Landauer, Erich Mühsam, Fritz Oerter, Fritz Kater, et beaucoup d'autres camarades restaient en liaison. Évidemment, nous n’étions qu’une poignée en comparaison des millions grisés par la guerre, cependant nous sommes parvenus à diffuser dans le monde entier un manifeste de notre Bureau International et nous dénoncions chez nous avec la dernière énergie la véritable nature de la guerre." 6 Oerter et Kater étaient les principaux membres expérimentés de la FVDG. La FVDG a solidement maintenu sa position contre la guerre pendant toute la durée du conflit. Cela constitue incontestablement la force la plus saillante de la FVDG - mais curieusement le chapitre de son histoire le moins documenté.
Dès le début de la guerre, la FVGD a été immédiatement interdite. Beaucoup de ses membres - elle en comptait en 1914 encore environ 6000 - ont été placés en détention ou envoyés de force au front. Dans la revue Der Pionier, un autre de ses organes, la FVDG écrit le 5 août 1914 dans l'éditorial "Le Prolétariat international et la guerre mondiale imminente" que "chacun sait que la guerre entre la Serbie et l'Autriche n'est qu’une expression visible de la fièvre guerrière chronique…". La FVDG décrit comment les gouvernements de Serbie, d'Autriche et d'Allemagne ont réussi à gagner la classe ouvrière à la "furie guerrière" et dénonce à ce propos le SPD et le mensonge de la prétendue "guerre défensive" : "L’Allemagne ne sera jamais l’agresseur, c’est cette conception que ces messieurs du gouvernement nous inculquent déjà, et c’est pour cette raison que les sociaux-démocrates allemands, comme leur presse et leurs orateurs, l’ont déjà mis en sûre perspective, se retrouveront comme un seul homme dans les rangs des armées allemandes." Le numéro 32 du 8 août 1914 de "Die Einigkeit" fut le dernier numéro distribué aux militants.
Un antimilitarisme internationaliste
Dans la partie introductive de cette série d'articles sur le syndicalisme révolutionnaire, nous avons fait une distinction entre l’antimilitarisme et l’internationalisme. "L'internationalisme se base sur la compréhension du fait que, si le capitalisme est un système mondial, il reste néanmoins incapable de dépasser le cadre national et la concurrence de plus en plus effrénée entre les nations. En tant que tel, il engendre un mouvement visant à renverser la société capitaliste au niveau international, par une classe ouvrière unie elle aussi au niveau international. (…) L'antimilitarisme, par contre, n'est pas forcément internationaliste puisqu'il tend à prendre comme ennemi principal, non pas le capitalisme en tant que tel, mais seulement un aspect de celui-ci." 7 Dans quel camp la FVDG s'est-elle rangée
Dans la presse de la FVDG de cette période, on trouve peu d’analyses politiques fouillées ou développées concernant les causes de la guerre ou les relations entre les différentes puissances impérialistes. Cette lacune provient de la vision syndicaliste de la FVDG. Celle-ci se concevait, à ce moment surtout, comme une organisation de lutte sur le plan économique, même si, plutôt qu'un syndicat, elle était en réalité beaucoup plus une coordination de groupes défendant des idées syndicalistes. Les dures confrontations avec le SPD qui prirent fin en 1908 avec son exclusion, avaient produit dans les rangs de la FVDG une aversion exacerbée de la "politique" et, conséquence supplémentaire, la perte de l'héritage des combats passés contre l'idéologie de la séparation entre économie et politique, véhiculée par les grands syndicats de la social-démocratie. Bien que la compréhension par la FVDG de la dynamique de l'impérialisme n'ait pas été réellement à la hauteur des nécessités, cette organisation était cependant inévitablement poussée par la guerre à adopter un positionnement fortement politique.
L'histoire du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne montre, à l'exemple de la FVDG, que les analyses théoriques sur l'impérialisme ne suffisent pas à elles seules pour adopter une position vraiment internationaliste. Un sain instinct prolétarien, un profond sentiment de solidarité avec la classe ouvrière internationale, sont également indispensables - et c'est précisément cela qui formait l’épine dorsale de la FVDG en 1914.
La FVDG se qualifie généralement d’"antimilitariste" dans ses publications ; on y trouve à peine le terme d’internationalisme. Mais pour rendre pleine justice aux syndicalistes révolutionnaires de la FVDG, il est absolument nécessaire de prendre en considération la vraie nature de son travail d'opposition contre la guerre. Le point de vue de la FVDG sur la guerre ne faisait pas partie de ceux qui se bornaient aux frontières nationales ni de ceux bercés par les illusions répandues par le pacifisme quant à la possibilité d'un capitalisme pacifique. Contrairement à la grande majorité des pacifistes qui, pour la plupart, se sont trouvés immédiatement après la déclaration de guerre dans les rangs de la défense de la nation contre le militarisme étranger, prétendument le plus barbare, la FVDG a, le 8 août 1914, mis clairement la classe ouvrière en garde contre toute coopération avec la bourgeoisie nationale : "Les travailleurs ne doivent donc pas crédulement faire confiance en l'humanité du moment, celle des capitalistes et des patrons. La fureur guerrière actuelle ne doit pas brouiller la conscience des antagonismes de classe existant entre le Capital et le Travail." 8
Pour les camarades de la FVDG il ne s’agissait pas de combattre seulement un aspect du capitalisme, le militarisme, mais d’intégrer la lutte contre la guerre à la lutte générale de la classe ouvrière pour le dépassement du capitalisme à l’échelle mondiale, comme l’avait formulé Karl Liebknecht déjà en 1906 dans sa brochure "Militarisme et antimilitarisme". En 1915, dans l’article "Antimilitarisme !", celui-ci avait, à juste titre, critiqué les formes héroïques et radicales en apparence de l’antimilitarisme comme la désertion, qui livre encore plus l’armée aux mains des militaristes par l’élimination des meilleurs antimilitaristes, en conséquence de quoi "toutes les méthodes opérant uniquement individuellement ou exercées individuellement sont à rejeter par principe". Dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire international, il y eut les points de vue les plus différents sur la lutte antimilitariste. Domela Nieuwenhuis, un représentant historique de l’idée de la grève générale, en a défini les moyens en 1901 dans sa brochure "Le Militarisme" comme un curieux mélange de réformes et d’objection individuelle. Il en va tout autrement pour la FVDG ; celle-ci partageait la préoccupation de Liebknecht selon laquelle c’est la lutte de classe de tous les travailleurs collectivement – et non pas l'action individuelle – qui constitue l’unique moyen contre la guerre.
La réalisation de la presse de la FVDG, assurée surtout par le secrétariat (Geschäftskommission) à Berlin se composant de 5 camarades autour de Fritz Kater, exprimait fortement les propres positions politiques de ces camarades du fait de la cohésion organisationnelle lâche du FVDG. L'internationalisme dans la FVDG ne se limite toutefois pas à une minorité de l'organisation comme dans la CGT syndicaliste révolutionnaire en France. Il ne s'est pas produit de scission en son sein sur la question de la guerre. Ce sont plutôt la répression contre l'organisation et les incorporations forcées sur le front qui ont eu pour conséquence que seule une minorité a pu maintenir une activité permanente. Des groupes syndicalistes révolutionnaires restaient encore actifs principalement à Berlin et dans environ 18 autres localités. Suite à l'interdiction de Die Einigkeit en août 1914, ils restèrent en liaison par le biais de la Mitteilungsblatt, puis après la suppression de celle-ci en juin 1915, à travers l'organe Rundschreiben, interdit à son tour en mai 1917. La forte répression contre les syndicalistes révolutionnaires internationalistes en Allemagne fait que leurs publications ont, dès le début de la guerre, plutôt pris le caractère de bulletins internes que de revues publiques : "Les comités directeurs, ou les personnes de confiance, doivent immédiatement n’éditer que le nombre nécessaire d’exemplaires pour leurs membres existants et ne distribuer le bulletin qu’à ceux-ci." 9
Les camarades de la FVDG ont aussi eu le courage de s'opposer à la mobilisation de la majorité de la CGT syndicaliste révolutionnaire en France pour la participation à la guerre : "Toute cette excitation à la guerre de la part de socialistes, de syndicalistes et d’antimilitaristes internationaux ne contribue pas le moins du monde à ébranler nos principes." 10, écrivirent-ils à propos de la capitulation de la majorité de la CGT. La question de la guerre était devenue la pierre de touche dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire international. S’opposer à la grande sœur CGT syndicaliste révolutionnaire exigeait une solide fidélité à la classe ouvrière, alors que la CGT et ses théories avaient constitué durant des années un important point de repère dans l’évolution de la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. Au cours de la guerre, les camarades de la FVDG soutiennent la minorité internationaliste, autour de Pierre Monatte, sortie de la CGT.
Pourquoi la FVDG est-elle restée internationaliste ?
Tous les syndicats en Allemagne en 1914 ont succombé à la fièvre nationaliste de la guerre. Pourquoi la FVDG fut-elle une exception ? Il est impossible de répondre à cette question en invoquant seulement la "chance" d’avoir possédé, comme ce fut le cas, un secrétariat (Geschäftskommission) ferme et internationaliste. De même qu’on ne peut pas expliquer la capitulation des syndicats sociaux-démocrates face à la question de la guerre par la "poisse" d’avoir eu à leur tête des directions traitres.
La FVDG a tout aussi peu acquis une solidité internationaliste du simple fait de sa claire évolution vers le syndicalisme révolutionnaire à partir de 1908. L'exemple de la CGT française montre que le syndicalisme révolutionnaire de l'époque n'a pas représenté en soi une garantie d'internationalisme. On peut dire en général que ni la profession de foi de marxisme, d'anarchisme ou bien de syndicalisme révolutionnaire n’offre en soi la garantie d’être internationaliste.
La FVDG a rejeté le mensonge patriotique de la classe dominante, avec dans ses rangs la social-démocratie, d'une pure "guerre défensive" (un piège dans lequel Kropotkine est tragiquement tombé). Elle a dénoncé dans sa presse la logique selon laquelle chaque nation se présente comme "l’agressée", l'Allemagne par le sombre tsarisme russe, la France par le militarisme prussien, etc. 11 Cette clarté ne pouvait se développer que sur la base de la conception de l’impossibilité de pouvoir désormais distinguer, au sein du capitalisme, des nations plus modernes ou des nations plus arriérées, et que le capitalisme dans son ensemble était devenu destructeur pour l'humanité. La position internationaliste s'est distinguée à l'époque de la Première Guerre mondiale surtout par la dénonciation politique de la "guerre défensive". Ce n’est pas par hasard si Trotski a consacré, à l’automne 1914, une brochure entière à cette question. 12 La FVDG argumentait aussi en recourant à des principes humains : "Le socialisme place les principes humains au-dessus des principes nationaux." (…) "Il est (…) difficile de se trouver du côté de l’humanité plongée dans l’affliction, mais si nous voulons être des socialistes, là est notre place." 13 La question de la solidarité et de la relation humaine aux autres travailleurs du monde entier constitue une base pour l’internationalisme. L'internationalisme de la FVDG exprimé en 1914 de façon prolétarienne contre la guerre étaitun signe de la force du mouvement syndicaliste révolutionnaire en Allemagne par rapport à la question décisive de la guerre.
Les racines fondamentales de l'internationalisme de la FVDG se trouvent toutefois surtout dans l’histoire de sa longue opposition au réformisme qui s'insinuait dans le SPD et les syndicats sociaux-démocrates. Son aversion pour la panacée universelle du parlementarisme du SPD a joué un rôle essentiel puisqu'elle empêcha justement, contrairement aux syndicats sociaux-démocrates, son intégration idéologique dans l'État capitaliste.
Dans les années immédiatement avant l`éclatement de la Guerre mondiale, il se manifesta une opposition entre trois tendances au sein de la FVDG : une exprimant l'identité syndicale, une autre la résistance contre "la politique" (du SPD) et une troisième la propre réalité de FVDG comme un ensemble de groupes de propagande (réalité qui, comme on l'a déjà expliqué, a aussi freiné la capacité à produire des analyses claires de l`impérialisme). Cette confrontation n'a pas produit que des faiblesses. Face à la politique ouvertement chauvine du SPD et des autres syndicats, le vieux réflexe de la résistance contre la dépolitisation des luttes ouvrières, assez fort jusqu'au débat sur la grève de masse en 1904, s'était trouvé ravivé.
Même si, comme le décrit notre précédent article, la résistance de la FVDG au réformisme portait en elle d’étranges faiblesses comme l’aversion envers "la politique", ce qui était déterminant en 1914, c'était l'attitude par rapport à la guerre. La contribution internationaliste de la FVDG était à ce moment beaucoup plus importante, pour la classe ouvrière, que ses faiblesses.
La saine réaction de ne pas se replier sur l’Allemagne, en dépit des conditions les plus difficiles, avait été décisive pour le maintien d'une fermeté internationaliste. La FVDG a recherché le contact non seulement avec la minorité internationaliste de Monatte dans la CGT, mais aussi avec d'autres syndicalistes révolutionnaires au Danemark, en Suède, en Espagne, en Hollande (Nationaal Arbeids Secretariaat) et en Italie (Unione Sindacale Italiana) qui tentaient de s'opposer à la guerre.
Une coopération insuffisante avec les autres internationalistes en Allemagne
Avec quelle force la voix internationaliste de la FVDG pouvait-elle se faire entendre dans la classe ouvrière pendant la guerre ? Elle s’est opposée vigoureusement aux perfides organes d’intégration à l’Union Sacrée. Comme formulé dans son organe interne, Rundschreiben, elle s'est opposée de façon très conséquente à la participation à des comités de guerre 14 : "Certainement pas ! De telles fonctions ne sont rien pour ceux de nos membres ou fonctionnaires (…) personne ne peut exiger cela d'eux." 15 Mais dans les années 1914-1917, elle s’adresse presque exclusivement à ses propres membres. Avec une estimation réaliste de l'impuissance présente et de l'impossibilité de pouvoir faire vraiment obstacle à la guerre, mais surtout avec une crainte légitime de la destruction de l’organisation, Fritz Kater au nom du secrétariat (Geschäftskommission) s’adressa le 15 août 1914 dans la Mitteilungsblatt aux camarades de la FVDG : "Nos points de vue sur le militarisme et la guerre, comme nous les avons défendus et propagés depuis des décennies, dont nous nous portons garants jusqu’à la fin de la vie, ne sont pas admissibles à une époque d'enthousiasme débridé en faveur de la guerre, on nous condamne au silence. C’était à prévoir et donc l'interdiction n’a absolument pas été pour nous une surprise. Nous devons ainsi nous résigner au silence, au même titre aussi que tous les autres camarades du syndicat."
Kater exprime d'une part l'espoir de maintenir les activités comme avant la guerre (ce qui cependant était impossible du fait de la répression) et d'autre part l'objectif minimal de sauver l'organisation : "Le secrétariat (Geschäftskommission) est toutefois d'avis qu’il agirait en oubliant ses devoirs s’il cessait maintenant, avec l’interdiction des journaux, toutes les autres activités. Cela, il ne le fera pas. (…) Il maintiendra les liaisons entre les différentes organisations et fera tout ce qui est nécessaire pour empêcher leur décomposition."
La FVDG a survécu en effet à la guerre. Cela non pas sur la base d'une stratégie de survie particulièrement habile ou d’appels insistants à ne pas quitter l'organisation. C'est clairement son internationalisme qui a constitué tout le temps de la guerre un point d’ancrage pour ses membres.
Lorsqu’en septembre 1915 l’appel international contre la guerre du Manifeste de Zimmerwald retentit avec un grand écho, celui-ci a été salué solidairement par la FVDG. Cela surtout en raison de sa proximité avec la minorité internationaliste de la CGT présente à Zimmerwald. Mais la FVDG nourrissait une méfiance envers une grande partie des groupements de la conférence de Zimmerwald, parce que ceux-ci étaient encore par trop reliés à la tradition du parlementarisme. Cela il est vrai n’était pas injustifié, six des présents, parmi eux Lénine, avaient déclaré : "Le manifeste accepté par la conférence ne nous satisfait pas complètement. (…) Le manifeste ne contient aucune caractéristique claire des moyens de combattre la guerre." 16. La FVDG n'avait pas non plus, contrairement à Lénine, la clarté nécessaire sur les moyens pour combattre la guerre. Sa méfiance exprimait plutôt un manque d'ouverture par rapport aux autres internationalistes comme le montrent clairement ses relations avec ceux d'Allemagne.
Pourquoi n'y a-t-il pas eu en Allemagne même de coopération entre l'opposition internationaliste du Spartakusbund et les syndicalistes révolutionnaires de la FVDG ? Pendant une longue période, il y a eu entre eux de profonds fossés qui n’avaient pu être comblés. Karl Liebknecht, 10 ans auparavant, dans le débat sur la grève de masse, avait durement généralisé à la FVDG les faiblesses individualistes de l’un de ses porte-paroles temporaires, Rafael Friedeberg. Pour autant que nous sachions, les révolutionnaires autour de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht n’ont pas non plus recherché le contact avec la FVDG pendant les premières années de la guerre, certainement à cause d'une sous-estimation des capacités internationalistes des syndicalistes révolutionnaires.
La FVDG elle-même a eu vis-à-vis de Liebknecht, la figure symbolique du mouvement contre la guerre en Allemagne, une attitude très fluctuante empêchant tout rapprochement. D’une part, elle ne put jamais pardonner à Liebknecht son approbation des crédits de guerre en août 1914, votés non par conviction mais exclusivement sur la base d’une conception fausse de la discipline de fraction qu’il a lui-même critiquée par la suite. Toutefois, dans sa presse, la FVDG a toujours pris sa défense quand il fut victime de la répression. La FVDG ne croyait pas l'opposition révolutionnaire au sein du SPD capable de se défaire du parlementarisme, une étape qu’elle-même n’avait accomplie que par sa séparation du SPD en 1908. Une profonde méfiance existait. Ce n'est que fin 1918, lorsque le mouvement révolutionnaire envahit complètement l'Allemagne, que la FVDG appelle ses membres à adhérer temporairement au Spartakusbund en double affiliation.
Rétrospectivement, ni la FVDG ni les Spartakistes n'ont suffisamment cherché le contact sur la base de leur position internationaliste pendant la guerre. C'est plutôt la bourgeoisie qui a mieux reconnu le point commun internationaliste de la FVDG et des Spartakistes que ces deux organisations elles-mêmes : la presse contrôlée par la direction du SPD a souvent essayé de dénigrer les Spartakistes comme étant les proches de la "tendance Kater." 17
Si, à l’aune de l'histoire de la FVDG pendant la Première Guerre mondiale, nous pouvons tirer un enseignement pour aujourd'hui et l'avenir, c'est bien le suivant : la nécessité de chercher le contact avec les autres internationalistes, même s’il existe des différences sur d'autres questions politiques. Cela n'a absolument rien à voir avec un "front unique" (qui en raison d’une faiblesse sur les principes recherche même la coopération avec des organisations du camp bourgeois) comme en a connu l'histoire du mouvement ouvrier dans les années 1920-30, mais au contraire avec la reconnaissance du point commun prolétarien le plus important.
Mario 5. 8. 2011
1 H.J. Bieber : Gewerkschaften in Krieg und Revolution, 1981, tome 1, p. 88, (notre traduction)
2 "Patrie" en allemand.
3 Voir Folkert Mohrhof, Der syndikalistische Streik auf dem Ozean-Dampfer "Vaterland“ 1914, 2008, (notre traduction)
4 Die Einigkeit, principal organe de la FVDG, 27 juin 1914, article de Karl Roche, "Ein Gewerkschaftsführer als Gehilfe des Staatsanwalts“, (notre traduction)
5 Franz Jung, Der Weg nach unten, Nautilus, p.89, (notre traduction)
6 Emma Goldman, Living My Life, p.656, (notre traduction). En février 1915, Emma Goldman s’est publiquement prononcée avec d’autres anarchistes internationalistes, tels Berkman et Malatesta, contre l’approbation de la guerre par la principale figure de l’anarchisme, Kropotkine, et d’autres. La FVDG salua dans la Mitteilungsblatt du 20 février 1915 cette défense de l’internationalisme vis-à-vis de Kropotkine par des anarchistes révolutionnaires.
7 "Ce qui distingue le mouvement syndicaliste révolutionnaire [30]", Revue internationale n° 118.
8 Die Einigkeit, n° 32, 8 août 1914
9 Mitteilungsblatt, 15 août 1914
10 Mitteilungsblatt, 10 octobre 1914. Cité d’après Wayne Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War. Cet ouvrage est, avec les documents originaux de la FVDG, la seule (et très précieuse) source sur le syndicalisme révolutionnaire allemand au cours de la Première Guerre mondiale.
11 Voir entre autres Mitteilungsblatt, novembre 1914 et Rundschreiben, août 1916.
12 La Guerre et l‘Internationale
13 Mitteilungsblatt, 21 novembre 1914
14 Ces comités de guerre (Kriegsausschüsse) ont été fondés après février 1915, d’abord dans l’industrie métallurgique de Berlin, entre représentants des associations patronales de la métallurgie et des grands syndicats. Le but poursuivi était de faire cesser la tendance croissante chez les ouvriers à trop souvent changer de lieu de travail à la recherche de salaires plus élevés, le début de la saignée de la société par les massacres ayant provoqué une pénurie des forces de travail. Cette fluctuation "incontrôlée" était, aux yeux du gouvernement et des syndicats, nuisible à l’efficacité de la production de guerre. La mise en place de ces comités s'était basée sur une tentative précédente lancée dès août 1914 par le leader syndical social-démocrate Theodor Leipart visant la formation de Kriegsarbeitsgemeinschaften (collectifs de guerre avec les employeurs) qui, sous couvert hypocrite d’agir en faveur de la classe ouvrière pour "combattre le chômage" et réguler le marché du travail, visaient en réalité à mettre tout en œuvre pour rendre plus efficace la production pour la guerre.
15 Cité d‘après W. Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War.
16 Déclaration de Lénine, Zinoviev, Radek, Nerman, Höglund, Berzin à la conférence de Zimmerwald, cité par J. Humbert-Droz, L’Origine de l’Internationale Communiste, p.144
17 Vorwärts, 9 janvier 1917
Géographique:
- Allemagne [31]
Courants politiques:
Décadence du capitalisme (XI) : le boom d'après-guerre n'a pas renversé le cours du déclin du capitalisme
- 3634 lectures
Dans les articles précédents de cette série, nous avons montré que les marxistes (et même certains anarchistes) partageaient en grande partie le même point de vue sur l'étape historique atteinte par le capitalisme au milieu du 20e siècle. La guerre impérialiste dévastatrice de 1914-18, la vague révolutionnaire internationale qui avait pris place dans son sillage et la dépression économique mondiale sans précédent qui avait marqué les années 1930, tous ces événements étaient considérés comme la preuve irréfutable du fait que le mode de production bourgeois était entré dans sa phase de déclin, l'époque de la révolution prolétarienne mondiale. L'expérience du deuxième massacre impérialiste ne remit pas en cause ce diagnostic ; au contraire, il constituait une preuve encore plus décisive du fait que le système avait fait son temps. Victor Serge avait déjà écrit à propos des années 1930 qu'il était "minuit dans le siècle" - une décennie qui avait vu la contre-révolution vaincre sur tous les fronts au moment même où les conditions objectives du renversement du système n'avaient jamais été si nettement développées. Mais les événements de 1939-45 ont montré que la nuit pouvait s'obscurcir encore plus.
Comme nous l'avons écrit dans le premier article de cette série 1 : "Le tableau de Picasso, Guernica, est célébré à juste raison comme une représentation sans précédent des horreurs de la guerre moderne. Le bombardement aveugle de la population civile de cette ville espagnole par l'aviation allemande qui soutenait l'armée de Franco, constitua un grand choc car c'était un phénomène encore relativement nouveau. Le bombardement aérien de cibles civiles avait été limité durant la Première Guerre mondiale et très inefficace. La grande majorité des tués pendant cette guerre étaient des soldats sur les champs de bataille. La Deuxième Guerre mondiale a montré à quel point la capacité de barbarie du capitalisme en déclin s'était accrue puisque, cette fois, la majorité des tués furent des civils : "L'estimation totale en pertes de vies humaines causées par la Deuxième Guerre mondiale, indépendamment du camp dont elles faisaient partie, est en gros de 72 millions. Le nombre de civils atteint 47 millions, y compris les morts de faim et de maladie à cause de la guerre. Les pertes militaires se montent à environ 25 millions, y compris 5 millions de prisonniers de guerre" 2. L'expression la plus terrifiante et la plus concentrée de cette horreur est le meurtre industrialisé de millions de Juifs et d'autres minorités par le régime nazi, fusillés, paquets par paquets, dans les ghettos et les forêts d'Europe de l'Est, affamés et exploités au travail comme des esclaves jusqu'à la mort, gazés par centaines de milliers dans les camps d'Auschwitz, Bergen-Belsen ou Treblinka. Mais le nombre de morts civils victimes du bombardement des villes par les protagonistes des deux côtés prouve que cet Holocauste, ce meurtre systématique d'innocents, était une caractéristique générale de cette guerre. En fait, à ce niveau, les démocraties ont certainement surpassé les puissances fascistes, et les tapis de bombes, notamment de bombes incendiaires, qui ont recouvert les villes allemandes et japonaises confèrent, en comparaison, un air plutôt "amateur" au Blitz allemand sur le Royaume-Uni. Le point culminant et symbolique de cette nouvelle méthode de massacre de masse a été le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et de Nagasaki ; mais en termes de morts civils, le bombardement "conventionnel" de villes comme Tokyo, Hambourg et Dresde a été encore plus meurtrier."
Contrairement à la Première Guerre mondiale à laquelle avait mis fin l'éclatement des luttes révolutionnaires en Russie et en Allemagne, le prolétariat n'a pas secoué les chaînes de la défaite à la fin de la Deuxième. Non seulement il avait été écrasé physiquement, en particulier par l'assommoir du stalinisme et du fascisme, mais il avait également été embrigadé idéologiquement et physiquement derrière les drapeaux de la bourgeoisie, essentiellement à travers la mystification de l'antifascisme et de la défense de la démocratie. Il y eut des explosions de lutte de classe et des révoltes à la fin de la guerre, en particulier dans les grèves qui éclatèrent dans le nord de l'Italie et qui avaient clairement un esprit internationaliste. Mais la classe dominante s'était bien préparée à de telles explosions et elle les a traitées avec une cruauté impitoyable, en particulier en Italie où les forces alliées, guidées de main de maître par Churchill, ont permis aux forces nazies de réprimer la révolte ouvrière pendant qu'elles-mêmes bombardaient les villes du nord touchées par les grèves ; pendant ce temps, les staliniens faisaient de leur mieux pour recruter les ouvriers combatifs dans la résistance patriotique. En Allemagne, la terreur des bombardements des villes élimina toute possibilité que la défaite militaire du pays permette une répétition des luttes révolutionnaires de 1918. 3
Bref, l'espoir qui avait animé les petits groupes révolutionnaires ayant survécu au naufrage des années 1920 et 30 – qu'une nouvelle guerre donne lieu à un nouveau surgissement révolutionnaire – s'éteignit rapidement.
L'état du mouvement politique prolétarien après la Deuxième Guerre mondiale
Dans ces conditions, le petit mouvement révolutionnaire qui avait maintenu des positions internationalistes au cours de la guerre, après une brève période de revitalisation à la suite de l'effondrement des régimes fascistes en Europe, fut confronté aux conditions les plus difficiles quand il entreprit d'analyser la nouvelle phase de la vie du capitalisme après six ans de carnage et de destruction. La plupart des groupes trotskistes avaient signé leur sentence de mort en tant que courant prolétarien en soutenant au cours de la guerre le camp Allié, au nom de la défense de la "démocratie" contre le fascisme ; cette trahison se confirma avec leur soutien ouvert à l'impérialisme russe et à ses annexions en Europe de l'Est après la guerre. Il existait encore un certain nombre de groupes qui avaient rompu avec le trotskisme et maintenu une position internationaliste contre la guerre, comme les RKD d'Autriche, le groupe autour de Munis, et l'Union communiste internationaliste en Grèce animée par Aghis Stinas et Cornelius Castoriadis, qui forma le groupe Socialisme ou Barbarie par la suite. Les RKD, dans leur hâte d'analyser ce qui avait conduit le trotskisme à la mort, commencèrent par rejeter le bolchevisme et finirent par abandonner complètement le marxisme. Munis évolua vers des positions communistes de gauche et fut toute sa vie convaincu que la civilisation capitaliste était profondément décadente, appliquant cette vision avec une grande clarté à des questions clé telles que la question syndicale et la question nationale. Mais il semble qu'il ne parvint pas à comprendre comment cette décadence était liée à l'impasse économique du système : dans les années 1970, son organisation, le Ferment ouvrier révolutionnaire (FOR), quitta les Conférences de la Gauche communiste parce que les autres groupes participants pensaient tous qu'il y avait une crise économique ouverte du système, position qu'elle rejetait. Comme nous le verrons plus loin, Socialisme ou Barbarie fut abusé par le boom qui débuta dans les années 1950 et remit également en cause les fondements de la théorie marxiste. De ce fait, aucun des anciens groupes trotskistes ne semble avoir apporté de contribution durable à la compréhension marxiste des conditions historiques auxquelles était maintenant confronté le capitalisme mondial.
L'évolution de la Gauche communiste hollandaise après la guerre donne également des indications sur la trajectoire générale du mouvement. Il y eut un bref renouveau politique et organisationnel avec la formation du Spartacusbond en Hollande. Comme nous le montrons dans notre livre La Gauche communiste hollandaise, ce groupe retrouva momentanément la clarté du KAPD, non seulement en reconnaissant le déclin du système mais aussi en abandonnant la peur conseilliste du parti. Cette attitude fut facilitée par son ouverture à d'autres courants révolutionnaires, en particulier envers la Gauche communiste de France. Mais cela ne dura pas longtemps. La majorité de la Gauche hollandaise, en particulier le groupe autour de Cajo Brendel, fit vite marche arrière vers des conceptions anarchisantes de l'organisation et une démarche ouvriériste qui ne voyait que peu d'intérêt à situer les luttes ouvrières dans leur contexte historique général.
Les débats dans la Gauche communiste d'Italie
Le courant révolutionnaire qui avait été le plus clair sur la trajectoire suivie par le capitalisme dans les années 1930 – la Gauche communiste d'Italie – ne fut pas épargné par le désarroi qui avait affecté le mouvement révolutionnaire à la fin de la guerre. Au départ, la plus grande partie de ses membres a vu, dans l'éclatement d'une révolte prolétarienne significative en Italie du nord en 1943, l'expression d'un changement de cours historique, les frémissements de la révolution communiste qu'on attendait. Les camarades de la Fraction française de la Gauche communiste internationale, qui s'était formée au cours de la guerre dans la France de Vichy, partageaient initialement ce point de vue mais estimèrent rapidement que la bourgeoisie, profitant de toute l'expérience de 1917, était bien préparée à de telles explosions et avait utilisé tout son arsenal d'armes pour les écraser impitoyablement. En revanche, la majorité des camarades restés en Italie, rejointe par les membres de la Fraction italienne rentrée d'exil, avait déjà proclamé la constitution du Parti communiste internationaliste (qu'on désignera comme PCInt, pour le distinguer des "Parti communiste international" ultérieurs). La nouvelle organisation avait une claire position internationaliste contre les deux camps impérialistes, mais elle s'était constituée à la hâte et rassemblait toute une série d'éléments politiquement différents et en grande partie disparates ; et ceci allait donner lieu à de nombreuses difficultés dans les années suivantes. La majorité des camarades de la Fraction française s'opposa à la dissolution de la Fraction italienne et à l'entrée de ses membres dans le nouveau parti. Elle allait rapidement mettre ce dernier en garde contre l'adoption de positions qui marquaient une claire régression par rapport à celles de la Fraction italienne. Sur des questions aussi centrales que les rapports entre le parti et les syndicats, la volonté de participer aux élections et la pratique organisationnelle interne, la Fraction française décelait une manifestation claire d'un glissement vers l'opportunisme.4 Le résultat de ces critiques fut que la Fraction française fut exclue de la Gauche communiste internationale et se constitua en Gauche communiste de France (GCF).
L'une des composantes du PCInt était la "Fraction des Socialistes et des Communistes" à Naples autour d'Amadeo Bordiga ; et le projet de former le parti avec Bordiga, qui avait joué un rôle incomparable dans la formation du Parti communiste d'Italie au début des années 1920 et dans la lutte contre la dégénérescence de l'Internationale communiste par la suite, constituait un élément central dans la décision de proclamer le parti. Bordiga avait été le premier à critiquer ouvertement Staline dans les sessions de l'IC, le dénonçant en face comme fossoyeur de la révolution. Mais depuis le début des années 1930 et au cours des premières années de la guerre, Bordiga s'était retiré de la vie politique malgré les nombreux appels de ses camarades pour qu'il reprenne l'activité. En conséquence, les acquis politiques développés par la Fraction italienne – sur les rapports entre la fraction et le parti, les leçons qu'elle avait tirées de la révolution russe, sur le cours du déclin du capitalisme et son impact sur des problèmes comme la question syndicale et la question nationale - lui échappèrent en grande partie et il resta figé sur les positions des années 1920. En fait, dans sa détermination à combattre toutes les formes d'opportunisme et de révisionnisme incarnées par les constants "nouveaux tournants" des partis "communistes" officiels, Bordiga commença à développer la théorie de "l'invariance historique du marxisme" : selon cette vision, ce qui distingue le programme communiste, c'est sa nature fondamentalement immuable, et cela implique que les grands changements qui eurent lieu dans les positions de l'IC ou de la Gauche communiste, quand ils rompirent avec la social-démocratie, ne constituaient qu'une "restauration" du programme d'origine incarné par le Manifeste communiste de 1848.5 Cette démarche avait pour implication logique qu'il n'y avait pas eu de changement d'époque dans la vie du capitalisme au 20e siècle ; le principal argument de Bordiga contre la notion de décadence du capitalisme se trouve dans la polémique contre ce qu'il appelait "la théorie de la courbe descendante" : "La théorie de la courbe descendante compare le développement historique à une sinusoïde : tout régime (par exemple le régime bourgeois) commence par une phase ascendante, atteint un point maximum, après quoi un autre régime remonte. Cette vision est celle du réformisme gradualiste : il n’y a pas de bonds, de secousses, ni de sauts. [...] La vision marxiste peut être représentée schématiquement par un certain nombre de courbes toujours ascendantes jusqu’à des sommets (en géométrie «points singuliers» ou «points de rupture») suivis d’une chute, presque verticale, puis, tout en bas, d’une autre branche historique ascendante, c’est-à-dire un nouveau régime social [...] L’affirmation courante selon laquelle le capitalisme est dans sa phase descendante et ne peut plus remonter, contient deux erreurs: le fatalisme et le gradualisme." (Réunion de Rome, avril 1951 6).
Bordiga écrit aussi : "Pour Marx 1e capitalisme croît sans arrêt au-delà de toute limite…" 7. Le capitalisme serait constitué d'une série de cycles dans lesquels chaque crise, succédant à une période d'expansion "illimitée", est plus profonde que la précédente et pose la nécessité d'une rupture complète et soudaine avec le vieux système.
Nous avons répondu à ces arguments dans les Revue internationale n° 48 et 55 8, et rejeté l'accusation de Bordiga selon laquelle la notion de déclin du capitalisme ouvre la porte à une vision gradualiste et fataliste ; nous avons expliqué pourquoi de nouvelles sociétés ne naissent pas sans que les êtres humains aient fait une longue expérience de l'incompatibilité de l'ancien système avec leurs besoins. Mais dans le PCInt déjà, des voix s'élevaient contre la théorie de Bordiga. Tout le travail de la Fraction n'avait pas été perdu parmi les forces qui avaient constitué le PCInt. Face à la réalité de l'après-guerre – principalement marquée par un isolement croissant des révolutionnaires d'avec la classe et transformant inévitablement une organisation qui avait pu se prendre pour un parti en un petit groupe communiste – deux tendances principales surgirent, ce qui prépara le terrain de la scission de 1952. Le courant autour d'Onorato Damen, ancêtre de l'actuelle Tendance communiste internationaliste (TCI), conserva la notion de décadence du capitalisme – c'est ce courant qui constituait la cible principale de la polémique de Bordiga sur "la courbe descendante" – et cela lui permit de maintenir la clarté de la Fraction sur des questions clés telles que la caractérisation de la Russie comme une forme de capitalisme d'État, l'accord avec Rosa Luxemburg sur la question nationale et la compréhension de la nature capitaliste des syndicats (cette dernière position était défendue de façon particulièrement claire par Stefanini qui avait été l'un des premiers de la Fraction en exil à comprendre leur intégration dans l'État capitaliste).
Le numéro de l'été 2011 de Revolutionary Perspectives, journal de la Communist Workers' Organisation (groupe affilié à la TCI au Royaume-Uni), republie l'introduction de Damen à la correspondance que ce dernier avait échangée avec Bordiga à l'époque de la scission. Damen, se référant à la conception de Lénine d'un capitalisme moribond et au point de vue de Rosa Luxemburg sur l'impérialisme en tant que processus précipitant l'effondrement du capitalisme, rejette la polémique de Bordiga contre la théorie de la courbe descendante : "Il est vrai que l'impérialisme accroît énormément et fournit les moyens de prolonger la vie du capital mais, en même temps, il constitue le moyen le plus sûr de l'abréger. Ce schéma d'une courbe toujours ascendante non seulement ne montre pas cela mais, dans un certain sens, le nie." (Traduit de l'anglais par nous)
De plus, comme Damen le souligne, la vision d'un capitalisme en ascendance perpétuelle en quelque sorte permet à Bordiga de laisser des ambiguïtés sur la nature et le rôle de l'URSS : "Face à l'alternative de rester ce que nous avons toujours été, ou de pencher vers une attitude d'aversion platonique et intellectualiste vis-à-vis du capitalisme américain et de bienveillante neutralité envers le capitalisme russe simplement du fait qu'il n'est pas encore mûr du point de vue capitaliste, nous n'hésitons pas à réaffirmer la position classique que les communistes internationalistes ont défendue envers tous les protagonistes du second conflit impérialiste et qui n'est pas d'espérer la victoire de l'un ou l'autre des adversaires mais de chercher une solution révolutionnaire à la crise capitaliste."
A cela, nous pourrions ajouter que cette idée selon laquelle les parties les moins développées de l'économie mondiale pourraient contenir une forme de "jeunesse" du capitalisme et donc un caractère progressiste a amené le courant bordiguiste à une dilution encore plus explicite des principes internationalistes avec son soutien au mouvement des "peuples de couleur" dans les anciennes colonies.
C'est une marque du repliement de la Gauche italienne dans les confins de l'Italie après la guerre que la plus grande partie du débat entre les deux tendances au sein du PCInt soit longtemps restée inaccessible au monde qui ne parlait pas italien. Mais il nous semble que, tandis que le courant de Damen était de façon générale bien plus clair sur les positions de classe fondamentales, aucun des deux courants n'avait le monopole de la clarté. Bordiga, Maffi et d'autres avaient raison dans leur intuition que la période qui s'ouvrait, encore caractérisée par le triomphe de la contre-révolution, signifiait inévitablement que les tâches théoriques seraient prioritaires sur un travail de large agitation. La tendance de Damen, en revanche, comprenait encore moins qu'un véritable parti de classe, capable de développer une présence effective au sein de la classe ouvrière, n'était tout simplement pas à l'ordre du jour dans cette période. En ce sens, la tendance de Damen perdit complètement de vue les clarifications cruciales de la Fraction italienne, précisément sur la question de la Fraction en tant que pont entre l'ancien parti dégénéré et le nouveau parti rendu possible par le renouveau de la lutte de classe. En fait, sans véritable élaboration, Damen établit un lien injustifié entre le schéma de Bordiga d'une courbe toujours ascendante – schéma indiscutablement faux - et la théorie de "l'inutilité de créer un parti dans une période contre-révolutionnaire" qui, de notre point de vue, était essentiellement valide. Contre cette idée, Damen propose la suivante : "la naissance du parti ne dépend pas, et nous sommes d'accord là-dessus, ‘du génie ou de la valeur d'un leader ou d'une avant-garde’, mais c'est l'existence historique du prolétariat en tant que classe qui pose, non pas de façon simplement épisodique dans le temps et l'espace, la nécessité de l'existence de son parti."
On pourrait également dire que le prolétariat a en permanence "besoin" de la révolution communiste : à un niveau c'est vrai, mais cela ne nous amène nulle part pour comprendre si le rapport de forces entre les classes fait de la révolution quelque chose de tangible, à sa portée, ou si c'est une perspective pour un futur plus lointain. De plus, si nous mettons en relation ce problème général avec les spécificités de l'époque de déclin du capitalisme, la logique de Damen apparaît encore plus boiteuse : les conditions réelles de la classe ouvrière dans la période de décadence, en particulier l’absorption de ses organisations de masse permanentes dans les mâchoires du capitalisme d'État, ont clairement rendu non pas moins mais plus difficile pour le parti de classe de se maintenir en dehors des phases d'intenses surgissements prolétariens.
La contribution de la Gauche communiste de France
La GCF, bien que formellement exclue de la branche italienne de la Gauche communiste, fut bien plus fidèle à la conception développée par l'ancienne Fraction italienne sur le rôle de la minorité révolutionnaire dans une période de défaite et de contre-révolution. C'est aussi le groupe qui fit les avancées les plus importantes dans la compréhension des caractéristiques de la période de décadence. Il ne s'est pas contenté de répéter ce qui avait été compris dans les années 1930 mais avait pour but d'arriver à une synthèse plus profonde : ses débats avec la Gauche hollandaise lui permirent de surmonter certaines erreurs de la Gauche italienne sur le rôle du parti dans la révolution et affinèrent sa compréhension de la nature capitaliste des syndicats. Et ses réflexions sur l'organisation du capitalisme dans la période de décadence lui permirent de développer une vision plus claire des profonds changements dans le rôle de la guerre et dans l'organisation de la vie économique et sociale qui marquaient cette période. Ces avancées furent résumées avec une clarté particulière dans deux textes clés : le "Rapport sur la situation internationale" de la Conférence de juillet 1945 de la GCF 9 et "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective" publié dans Internationalisme n°46 en 1952. 10
Le rapport de 1945 était centré sur la façon dont la fonction de la guerre capitaliste avait changé entre la période d'ascendance et celle de décadence. La guerre impérialiste constituait l'expression la plus concentrée du déclin du système :
"Il n'existe pas une opposition fondamentale en régime capitaliste entre guerre et paix, mais il existe une différence entre les deux phases ascendante et décadente de la société capitaliste et partant une différence de fonction de la guerre (dans le rapport de la guerre et de la paix), dans les deux phases respectives. Si dans la première phase, la guerre a pour fonction d'assurer un élargissement du marché, en vue d'une plus grande production de consommation, dans la seconde phase la production est essentiellement axée sur la production de moyens de destruction, c'est-à-dire en vue de la guerre. La décadence de la société capitaliste trouve son expression éclatante dans le fait que des guerres en vue du développement économique - période ascendante -, l'activité économique se restreint essentiellement en vue de la guerre - période de décadence.
Cela ne signifie pas que la guerre soit devenue le but de la production capitaliste, le but restant toujours pour le capitalisme la production de plus-value, mais cela signifie que la guerre prenant un caractère de permanence est devenue le mode de vie du capitalisme décadent." ("Rapport sur la situation internationale" de la Conférence de juillet 1945)
En réponse à ceux qui défendaient que le caractère destructeur de la guerre ne constituait qu'une continuation du cycle classique de l'accumulation capitaliste et était donc un phénomène totalement "rationnel", la GCF mettait en avant le caractère profondément irrationnel de la guerre impérialiste – pas seulement du point de vue de l'humanité mais même de celui du capital lui-même :
"La production de guerre n'a pas pour objectif la solution d'un problème économique. A l'origine, elle est le fruit d'une nécessité de l'État capitaliste de se défendre contre les classes dépossédées et de maintenir par la force leur exploitation, d'une part, et d'assurer par la force ses positions économiques et de les élargir, aux dépens des autres États impérialistes. (…) La crise permanente pose l'inéluctabilité, l'inévitabilité du règlement des différends impérialistes par la lutte armée. La guerre et la menace de guerre sont les aspects latents ou manifestes d'une situation de guerre permanente dans la société. La guerre moderne est essentiellement une guerre de matériel. En vue de la guerre une mobilisation monstrueuse de toutes les ressources techniques et économiques des pays est nécessaire. La production de guerre devient aussi l'axe de la production industrielle et le principal champ économique de la société.
Mais la masse des produits représente-t-elle un accroissement de la richesse sociale ? A cette question, il faut répondre catégoriquement par la négative, la production de guerre, toutes les valeurs qu'elle matérialise, est destinée à sortir de la production, à ne pas se retrouver dans la reprise du procès de la production et à être détruite. Après chaque cycle de production, la société n'enregistre pas un accroissement de son patrimoine social, mais un rétrécissement, un appauvrissement dans la totalité" (Idem)
Ainsi, la GCF considérait la guerre impérialiste comme une expression de la tendance du capitalisme sénile à s'autodétruire. On pourrait dire la même chose du mode d'organisation devenu dominant dans la nouvelle époque : le capitalisme d'État.
Dans "L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective", la GCF analysait le rôle de l'État dans la survie du système dans la période de décadence ; là encore, la distorsion de ses propres lois par le capitalisme est typique de l'agonie qui mène à son effondrement :
"Devant l'impossibilité de s'ouvrir de nouveaux marchés, chaque pays se ferme et tend désormais à vivre sur lui-même. L'universalisation de l'économie capitaliste, atteinte au travers du marché mondial, se rompt : c'est l'autarcie. Chaque pays tente de se suffire à lui-même ; on y crée un secteur non rentable de production, lequel a pour objet de pallier aux conséquences de la rupture du marché. Ce palliatif même aggrave encore la dislocation du marché mondial.
La rentabilité, par la médiation du marché, constituait avant 1914 l'étalon, mesure et stimulant, de la production capitaliste. La période actuelle enfreint cette loi de la rentabilité : celle-ci s'effectue désormais non plus au niveau de l'entreprise mais à celui, global, de l'État. La péréquation se fait sur un plan comptable, à l'échelle nationale ; non plus par l'entremise du marché mondial. Ou bien, l'État subventionne la partie déficitaire de l'économie, ou bien l'État prend en mains l'ensemble de l'économie.
De ce qui précède, on ne peut conclure à une "négation" de la loi de la valeur. Ce à quoi nous assistons tient en ce que la production d'une unité de la production semble détachée de la loi de la valeur cette production s'effectuant sans considération apparente de sa rentabilité.
Le surprofit monopolistique se réalisait au travers de prix "artificiels", cependant sur le plan global de la production, celle-ci demeurait liée à la loi de la valeur. La somme des prix, pour l'ensemble des produits, n'exprimait rien d'autre que la globale valeur des produits. Seule la répartition des profits entre divers groupes capitalistes se trouvait transformée : les monopoles s'arrogeaient un surprofit aux dépens des capitalistes moins bien armés. De même peut-on dire que la loi de la valeur joue au niveau de la production nationale. La loi de la valeur n'agit plus sur un produit pris individuellement, mais sur l'ensemble des produits. On assiste à une restriction du champ d'application de la loi de la valeur. La masse totale du profit tend à diminuer du fait de la charge que fait peser l'entretien des branches déficitaires sur les autres branches de l'économie."
Nous avons dit que personne ne détenait le monopole de la clarté dans les débats au sein du PCInt ; on peut dire la même chose de la GCF. Face à la sombre situation du mouvement ouvrier au lendemain de la guerre, elle allait jusqu'à conclure non seulement que les anciennes institutions du mouvement ouvrier, partis et syndicats, étaient irréversiblement intégrées dans le Léviathan de l'État capitaliste, mais aussi que la lutte défensive elle-même avait perdu son caractère de classe :
"Les luttes économiques des ouvriers ne peuvent plus amener que des échecs - au mieux le maintien habile de conditions de vie d'ores et déjà dégradées. Elles lient le prolétariat aux exploiteurs en l'amenant à se considérer solidaire du système en échange d'une assiette de soupe supplémentaire (et qu'il n'obtiendra, en fin de compte, qu'en améliorant sa "productivité")." (L'évolution du capitalisme et la nouvelle perspective)
Il est certainement juste que les luttes économiques ne pouvaient permettre aucun acquis durable dans la nouvelle période mais l'idée qu'elles ne servent qu'à attacher le prolétariat à ses exploiteurs n'était pas correcte : au contraire, elles continuaient de constituer une précondition indispensable pour briser cette "solidarité avec le système".
La GCF ne voyait pas non plus de possibilité que le capitalisme puisse connaître une reprise quelconque après la guerre. D'un côté, elle pensait qu'il y avait un manque absolu de marchés extra-capitalistes permettant un véritable cycle de reproduction élargie. Dans sa polémique légitime contre l'idée de Trotski qui voyait dans les mouvements nationalistes des colonies ou des anciennes colonies une possibilité de saper le système impérialiste mondial, elle défendait :
"En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles perdent donc leur caractère de débouchés, ce qui rend moins énergique la résistance des vieux impérialismes aux revendications des bourgeoisies coloniales. A ceci s'ajoute le fait que les difficultés propres à ces impérialismes ont favorisé l'expansion économique - au cours des deux guerres mondiales - des colonies. Le capital constant s'amenuisait en Europe, tandis que la capacité de production des colonies ou semi-colonies augmentait, amenant une explosion du nationalisme indigène (Afrique du Sud, Argentine, Inde, etc...). Il est significatif de constater que ces nouveaux pays capitalistes passent, dès leur création, en tant que nations indépendantes, au stade de capitalisme d'État présentant ces mêmes aspects d'une économie tournée vers la guerre que l'on décèle par ailleurs.
La théorie de Lénine et de Trotski s'effondre. Les colonies s'intègrent au monde capitaliste et, par là même, le renforcent d'autant. Il n'y a plus de "maillon le plus faible : la domination du capital est également répartie sur la surface entière du globe."
Il est vrai que la guerre avait permis à certaines colonies situées en dehors du terrain principal du conflit de se développer dans un sens capitaliste et que, globalement, les marchés extra-capitalistes étaient devenus de plus en plus inadéquats pour fournir un débouché à la production capitaliste. Mais il était prématuré d'annoncer leur disparition totale. En particulier, l'éviction des vieilles puissances comme la France et la Grande-Bretagne de leurs anciennes colonies, avec leurs rapports en grande partie parasitaires vis-à-vis de leurs empires, a permis au grand vainqueur de la guerre – les États-Unis - de trouver de nouveaux champs lucratifs d'expansion, en particulier en Extrême-Orient 11. A la même époque, il existe des marchés extra-capitalistes non encore épuisés dans certains pays européens (en France notamment) constitués en grande partie par ce secteur de la petite paysannerie qui n'a pas encore été intégré dans les rouages de l'économie capitaliste.
La survivance de certains marchés solvables extérieurs à l'économie capitaliste a constitué l'un des facteurs qui a permis au capitalisme de se ranimer après la guerre pendant une période d'une longueur inattendue. Mais c'était beaucoup lié à la réorganisation politique et économique plus générale du système capitaliste. Dans le rapport de 1945, la GCF avait reconnu que, bien que le bilan global de la guerre fût catastrophique, certaines puissances impérialistes pouvaient quand même se renforcer grâce à leur victoire dans la guerre. En fait, les États-Unis en étaient sortis dans une position de force sans précédent qui leur a permis de financer la reconstruction des puissances européennes et japonaise ravagées par la guerre, évidemment pour leurs propres intérêts impérialistes et économiques. Et les mécanismes utilisés pour revivifier et étendre la production au cours de cette phase furent précisément ceux que la GCF avait identifiés : le capitalisme d'État, en particulier sous sa forme keynésienne, qui a permis une certaine "harmonisation" forcée entre la production et la consommation, non seulement au niveau national mais, également, international, à travers la formation d'énormes blocs impérialistes ; et, allant de pair, une véritable déformation de la loi de la valeur, sous la forme de prêts massifs et même de "cadeaux" tout court de la part des États-Unis triomphants envers les puissances vaincues et ruinées, ce qui a permis à la production de reprendre et de croître non sans que commence à s’accroître, de façon irréversible, une dette qui ne pourra jamais être remboursée, à la différence du développement du capitalisme ascendant.
Ainsi en se rechapant à l'échelle globale, le capitalisme a connu, pour la première fois depuis la "Belle Époque" au début du 20e siècle, une période de boom. Ce n'était pas encore visible en 1952 quand dominait encore l'austérité d'après-guerre. Ayant analysé avec justesse qu'il n'y avait pas eu de revitalisation du prolétariat après la guerre, la GCF conclut de façon erronée qu'une troisième guerre mondiale était à l'ordre du jour pour bientôt. Cette erreur participa à accélérer la disparition du groupe qui se dissout en 1952 – l'année où avait lieu la scission dans le PCInt. Ces deux événements confirmaient que le mouvement ouvrier vivait encore dans l'ombre de la profonde réaction qui avait suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23.
"Le grand boom keynésien"
Au milieu des années 1950, quand la phase d'austérité absolue tirait à sa fin dans les pays capitalistes centraux, il devenait clair que le capitalisme connaissait un boom sans précédent. En France, cette période est connue sous le nom des "Trente Glorieuses" ; d'autres l'appellent "le grand boom keynésien". La première expression est évidemment plutôt inexacte. On peut certainement douter du fait qu'elle ait duré trente ans 12, et elle fut moins que glorieuse pour une partie très importante de la population globale. Néanmoins, elle connut des taux de croissance très rapides dans les pays occidentaux, et même dans ceux de l'Est, bien plus léthargiques et économiquement arriérés, il y eut une poussée de développement technologique qui suscita des discussions sur la capacité de la Russie de "rattraper" l'Ouest comme le suggéraient de façon frappante les succès russes initiaux dans la course à l'espace. Le "développement" de l'URSS était toujours basé sur l'économie de guerre, comme dans les années 1930. Mais bien que le secteur d'armement continuât à peser lourdement à l'Ouest, les salaires réels des ouvriers des principaux pays industrialisés augmentèrent de façon importante (en particulier relativement aux conditions très dures qui avaient prévalu durant la période de reconstruction de l'économie) et le "consumérisme" de masse devint un élément de la vie de la classe ouvrière, combiné à des programmes sociaux importants (santé, vacances, paiement des congés maladie) et un taux de chômage très bas. C'est ce qui permit au Premier ministre conservateur britannique, Harold Macmillan, de proclamer de façon paternaliste que "la plus grande partie de notre population n'a jamais vécu aussi bien" (discours à Bedford, juillet 1957).
Un économiste universitaire résume ainsi le développement économique au cours de cette période :
"Rien qu'un bref coup d'œil aux chiffres et aux taux de croissance révèle que la croissance et la reprise après la Deuxième Guerre mondiale furent étonnamment rapides. Si l'on considère les trois plus importantes économies d'Europe occidentale – la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne – la Deuxième Guerre mondiale leur a infligé bien plus de dommages et de destructions que la Première. Et (sauf pour la France) les pertes humaines ont été également plus grandes pendant la Deuxième. A la fin de la guerre, 24% des Allemands nés en 1924 étaient morts ou disparus, 31% handicapés ; après la guerre, il y avait 26% de plus de femmes que d'hommes. En 1946, l'année qui suivit la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le PNB par tête dans les trois plus grandes économies européennes avait chuté d'un quart par rapport au niveau d'avant-guerre de 1938. C'était équivalent à la moitié de la chute de la production par tête en 1919 par rapport au niveau d'avant-guerre en 1913."
Pourtant le rythme de la reprise d'après la Deuxième Guerre surpassa rapidement celui d'après la Première. En 1949, le PNB moyen par tête dans les trois grands pays avait quasiment retrouvé son niveau d'avant-guerre et, comparativement, la reprise avait deux ans d'avance sur le rythme d'après la Première Guerre. En 1951, six ans après la guerre, le PNB par tête était supérieur de plus de 10% à celui d'avant-guerre, un niveau de reprise qui ne fut jamais atteint au cours des onze années d'après la Première Guerre, avant que ne commence la Grande Dépression. Ce qui fut accompli en six ans après la Deuxième Guerre, avait pris seize ans après la Première.
La restauration de la stabilité financière et le libre jeu des forces du marché permirent à l'économie européenne de connaître deux décennies d'une croissance rapide jamais vue. La croissance économique européenne entre 1953 et 1973 fut deux fois plus rapide que tout ce qu'on avait connu jusqu'alors et qu'on a connu depuis pour une telle période. Le taux de croissance du PNB était de 2% par an entre 1870 et 1913, de 2,5% par an entre 1922 et 1937. Comparativement, la croissance s'accéléra incroyablement jusqu'à 4,8% par an entre 1953 et 1973, avant de ralentir à la moitié de ce taux de 1973 à 1979." (Traduit de l'anglais par nous.13)
Socialisme ou Barbarie : théoriser le boom
Sous le poids de cette avalanche de faits, la vision marxiste du capitalisme comme système sujet aux crises et entré dans sa période de déclin depuis quasiment un demi-siècle s'est trouvé mise en cause sur tous les fronts. Et étant donné l'absence de mouvements de classe généralisés (avec quelques exceptions notables comme les luttes massives dans le bloc de l'Est en 1953 et en 1956), la sociologie officielle s'est mise à parler de "l'embourgeoisement" de la classe ouvrière, de la récupération du prolétariat par la "société de consommation" qui semblait avoir réglé les problèmes de gestion de l'économie. La mise en question des principes fondamentaux du marxisme affecta inévitablement des éléments qui se considéraient comme des révolutionnaires. Marcuse accepta l'idée que la classe ouvrière des pays avancés s'était plus ou moins intégrée au système et estima que le sujet révolutionnaire était désormais constitué par les minorités ethniques opprimées, les étudiants révoltés des pays avancés et les paysans du "Tiers-Monde". Mais l'élaboration la plus cohérente à l'encontre des catégories marxistes "traditionnelles" provint du groupe Socialisme ou Barbarie (S ou B) en France, un groupe dont les communistes de gauche de la GCF avaient salué la rupture avec le trotskisme officiel.
Dans Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne rédigé par le principal théoricien du groupe, Paul Cardan/Cornelius Castoriadis, celui-ci analyse les principaux pays capitalistes au milieu des années 1960 et conclut que le capitalisme "bureaucratique" "moderne" est parvenu à éliminer les crises économiques et peut donc poursuivre indéfiniment son expansion.
"Le capitalisme est parvenu à contrôler le niveau de l’activité économique à un degré tel que les fluctuations de la production et de la demande sont maintenues dans des limites étroites et que des dépressions de l’ordre de celles d’avant-guerre sont désormais exclues (…)
(…) il y a une intervention consciente continue de l'État en vue de maintenir l’expansion économique. Même si la politique de l'État capitaliste est incapable d’éviter à l’économie l’alternance de phases de récession et d’inflation, encore moins d’en assurer le développement rationnel optimum, elle a été obligée d’assumer la responsabilité du maintien d’un 'plein emploi' relatif et de l’élimination de dépressions majeures. La situation de 1933, qui correspondrait aujourd’hui aux États-Unis à un chômage de 30 millions, est absolument inconcevable, ou bien conduirait à l’explosion du système dans les vingt-quatre heures ; ni les ouvriers, ni les capitalistes ne la toléreraient plus longuement." 14
Ainsi, la vision du capitalisme de Marx comme un système sujet aux crises ne n'applique qu'au 19e siècle et non plus à notre époque. Il n'y a pas de contradictions économiques "objectives" et les crises économiques, si elles ont lieu, ne seront désormais essentiellement que des accidents (il existe une introduction datée de 1974 à ce livre qui décrit précisément la récession de cette période comme le produit de "l'accident" de l'augmentation des prix du pétrole 15). La tendance à l'effondrement comme résultat de contradictions économiques internes - en d'autres termes le déclin du système – ne constitue plus la base d'une révolution socialiste dont il faut chercher ailleurs les fondements. Cardan défend l'idée que, tandis que les convulsions économiques et la pauvreté matérielle peuvent être surmontées, ce dont le capitalisme bureaucratique ne peut se débarrasser, c'est l'augmentation de l'aliénation au travail et dans les loisirs, la privatisation croissante de la vie quotidienne 16 et, en particulier, la contradiction entre le besoin du système de traiter les ouvriers comme des objets stupides seulement capables d'obéir à des ordres et la nécessité d'un appareil technologique de plus en plus sophistiqué qui s'appuie sur l'initiative et l'intelligence des masses pour lui permettre de fonctionner.
Cette démarche reconnaissait que le système bureaucratique avait fondamentalement annexé les anciens partis ouvriers et les syndicats 17, augmentant le manque d'intérêt des masses pour la politique traditionnelle. Il critiquait férocement le vide de la vision du socialisme défendue par la "gauche traditionnelle" dont la défense d'une économie totalement nationalisée (additionnée d'un peu de contrôle ouvrier si l'on prend la version trotskiste) n'offrait tout simplement aux masses qu'un renforcement des conditions présentes. Contre ces institutions fossilisées et contre la bureaucratisation débilitante qui affectait toutes les habitudes et les organisations de la société capitaliste, S ou B défendait la nécessité de l'auto-activité des ouvriers à la fois dans la lutte quotidienne et comme seul moyen d'atteindre le socialisme. Comme ce dernier était présenté autour de la question essentielle de qui contrôle vraiment la production dans la société, il y avait là une base bien plus solide pour la création d'une société socialiste que la vision "objectiviste" des marxistes traditionnels qui attendaient la prochaine grande dégringolade pour entrer en scène et mener les ouvriers à la terre promise, non sur la base d'une véritable élévation de la conscience, mais simplement sur celle d'une sorte de réaction biologique à l'appauvrissement. Un tel schéma de la révolution, pour faire court, ne pourrait jamais mener à une véritable compréhension des rapports humains.
"Et quelle est l’origine des contradictions du capitalisme, de ses crises et de sa crise historique ? C’est l’"appropriation privée", autrement dit la propriété privée et le marché. C’est cela qui fait obstacle au "développement des forces productives", qui serait par ailleurs le seul, vrai et éternel objectif des sociétés humaines. La critique du capitalisme consiste finalement à dire qu’il ne développe pas assez vite les forces productives (ce qui revient à dire qu’il n’est pas assez capitaliste). Pour réaliser ce développement plus rapide, il faudrait et il suffirait que la propriété privée et le marché soient éliminés : nationalisation des moyens de production et planification offriraient alors la solution à la crise de la société contemporaine.
Cela d’ailleurs les ouvriers ne le savent pas et ne peuvent pas le savoir. Leur situation leur fait subir les conséquences des contradictions du capitalisme, elle ne les conduit nullement à en pénétrer les causes. La connaissance de celles-ci ne résulte pas de l’expérience de la production, mais du savoir théorique portant sur le fonctionnement de l’économie capitaliste, savoir accessible certes à des ouvriers individuels, mais non pas au prolétariat en tant que prolétariat. Poussé par sa révolte contre la misère, mais incapable de se diriger lui-même puisque son expérience ne lui donne aucun point de vue privilégié sur la réalité ; le prolétariat ne peut être, dans cette optique, que l’infanterie au service d’un état-major de spécialistes, qui eux, savent, à partir d’autres considérations auxquelles le prolétariat comme tel n’a pas accès, ce qui ne va pas avec la société actuelle et comment il faut la modifier. La conception traditionnelle sur l’économie et la perspective révolutionnaire ne peut fonder, et n’a fondé effectivement dans l’histoire, qu’une politique bureaucratique.
Certes Marx lui-même n’a pas tiré ces conséquences de sa théorie économique ; ses positions politiques sont allées, la plupart du temps, dans un sens diamétralement opposé. Mais ce sont ces conséquences qui en découlent objectivement, et ce sont elles qui ont été affirmées de façon de plus en plus nette dans le mouvement historique effectif, aboutissant finalement au stalinisme. La vue objectiviste de l’économie et de l’histoire ne peut être que la source d’une politique bureaucratique, c’est-à-dire d’une politique qui, sauvegardant l’essence du capitalisme, essaye d’en améliorer le fonctionnement." 18
Dans ce texte, il est clair que Cardan ne cherche pas à distinguer la "gauche traditionnelle" – c'est-à-dire l'aile gauche du capital – des authentiques courants marxistes qui survécurent à la récupération par le capitalisme des anciens partis et qui défendirent vigoureusement l'auto-activité de la classe ouvrière malgré leur adhésion à la critique par Marx de l'économie politique. Ces derniers (malgré les discussions d'après-guerre entre S ou B et la GCF) ne sont presque jamais mentionnés ; mais, plus centralement, malgré la continuation de l'attachement à Marx contenu dans ce passage, Cardan ne cherche pas à expliquer pourquoi Marx ne tira pas de conclusions "bureaucratiques" de son économie "objectiviste", pas plus qu'il ne cherche à mettre en lumière le gouffre qui sépare la conception du socialisme de Marx de celle des staliniens et des trotskistes. En fait, ailleurs, dans le même texte, il accuse la méthode de Marx d'objectivisme, d'ériger d'implacables lois économiques vis-à-vis desquelles les êtres humains ne peuvent rien, de tomber dans la même réification de la force de travail qu'il critiquait lui-même. Et malgré son approbation ici et là des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844, Cardan n'accepte jamais le fait que la critique de l'aliénation est à la base de l'ensemble de l'œuvre de Marx qui n'est rien d'autre qu'une protestation contre la réduction de la puissance créatrice de l'homme à une marchandise mais qui, en même temps, reconnaît cette généralisation des rapports marchands comme la base "objective" du déclin ultime du système. De même, malgré une reconnaissance du fait que Marx a vu un aspect "subjectif" à la détermination de la valeur de la force de travail, cela n'empêche pas Cardan de tirer la conclusion que "Marx, qui a découvert la lutte des classes, écrit un ouvrage monumental analysant le développement du capitalisme, ouvrage d’où la lutte des classes est totalement absente." (Cardan, Ibid.)
De plus, les contradictions économiques que Cardan écarte sont présentées de façon très superficielle. Cardan s'aligne sur l'école néo-harmoniste (Otto Bauer, Tugan-Baranovski, etc.) qui tenta d'appliquer les schémas de Marx dans le 2e livre du Capital pour prouver que le capitalisme pouvait poursuivre l'accumulation sans crises : pour Cardan, le capitalisme régulé de la période d'après-guerre avait finalement apporté l'équilibre nécessaire entre la production et la consommation, éliminant le problème du "marché" pour toujours. C'est vraiment une simple resucée du keynésianisme, et les limites inhérentes à la réalisation d'un "équilibre" entre la production et le marché allaient se révéler très rapidement. Il expédie la baisse du taux de profit brièvement dans un appendice. L'aspect le plus parlant de cette partie est quand il écrit :
"L'argument dans son ensemble est de plus hors de propos : c'est une diversion. Nous ne l'avons discuté que parce que c'est devenu une obsession dans les esprits de beaucoup de révolutionnaires honnêtes, qui ne peuvent pas se défaire des chaînes de la théorie traditionnelle. Quelle différence cela fait-il pour le capitalisme dans son ensemble que les profits soient aujourd'hui disons de 12 % en moyenne, alors qu'ils étaient de 15 % il y a un siècle ? Cela ralentirait-il l'accumulation et ainsi l'expansion de production capitaliste comme parfois dit dans ces discussions ? Et même en supposant que ce soit le cas : ET ALORS ? Quand et de combien ? […] Et même si cette "loi" était juste, pourquoi cesserait-elle de l'être sous le socialisme ?
Le seul "fondement" de cette "loi" chez Marx est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le capitalisme lui-même ; c'est le fait technique qu'il y a de plus en plus de machines et de moins en moins d'hommes [les actionnant, NDLR]. Sous le socialisme, les choses seraient "encore pires". Le progrès technique serait accéléré et, ce qui, dans le raisonnement de Marx, s'oppose à la baisse du taux de profit sous le capitalisme, à savoir l'augmentation du taux d'exploitation, n'aurait pas d'équivalent sous le socialisme. Une économie socialiste connaitrait-elle un blocage à cause d'une pénurie de capital à accumuler ?" 19
Ainsi, pour Cardan, une contradiction fondamentale enracinée dans la production de valeur elle-même n'a pas d'importance parce que le capitalisme traverse une période d'accumulation accélérée. Pire : il y aura toujours (pourquoi pas ?) production de valeur dans le socialisme puisque la production de marchandises en elle-même n'amène pas inéluctablement à la crise et à l'effondrement. En fait, l'utilisation des catégories capitalistes de base comme la valeur et la monnaie pourrait même s'avérer une façon rationnelle de distribuer le produit social, comme Cardan l'explique dans la brochure Sur le contenu du socialisme (publiée à l'été 1957 dans Socialisme ou Barbarie n° 22).
Cette superficialité a empêché Cardan de saisir la nature contingente et temporaire du boom d'après-guerre. 1973 n'était pas un accident et n'a pas eu pour première cause l'augmentation des prix du pétrole, c'était la réapparition manifeste des contradictions fondamentales du capitalisme que la bourgeoisie avait tant cherché à nier et qu'elle avait tenté de conjurer au cours des 40 dernières années, avec plus ou moins d'effet. Aujourd'hui plus que jamais, la prédiction de Cardan qu'une nouvelle dépression était impensable semble ridiculement obsolète. Ce n'est pas surprenant que S ou B et son successeur en Grande-Bretagne, Solidarity, aient disparu entre les années 1960 et 90, lorsque la réalité de la crise économique s'est révélée de plus en plus sévère à la classe ouvrière et à ses minorités politiques. Cependant, beaucoup des idées de Cardan – comme son rejet du "marxisme classique" comme étant "objectiviste" et niant la dimension subjective de la lutte révolutionnaire – se sont avérées remarquablement persistantes, comme nous le verrons dans un autre article.
Gerrard
1 "Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [33]", Revue internationale n° 132,
2 https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties [34]
3 Voir "La lutte de classe contre la guerre impérialiste : les luttes ouvrières en Italie 1943 [35]", Revue internationale n° 75,
4 Voir notre livre La Gauche communiste d'Italie pour plus de détails sur la façon dont s'est formé le PCInt. Pour les critiques portées par la GCF à la plateforme du parti, lire "Le Deuxième Congrès du PCInt en Italie [36]" dans Internationalisme n° 36, juillet 1948, republié dans la Revue internationale n°36.
5 "L'invariance" bordiguiste, comme nous l'avons souvent montré, est en réalité très variable. Ainsi, tout en insistant sur la nature intégrale du programme communiste depuis 1848 et donc la possibilité du communisme depuis cette époque, Bordiga, par loyauté aux congrès de fondation de l'IC, était également obligé d'admettre que la guerre avait marqué l'ouverture d'une crise historique générale du système. Comme Bordiga l'a écrit lui-même dans les "Thèses caractéristiques du parti" en 1951 : "Les guerres impérialistes mondiales démontrent que la crise de désagrégation du capitalisme est inévitable du fait que celui-ci est entré définitivement dans la période où son expansion n'exalte plus historiquement l'accroissement des forces productives, mais lie leur accumulation à des destructions répétées et croissantes." https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vami/vamimfebif.html [37]. Nous avons écrit plus longuement sur l'ambiguïté des bordiguistes concernant le problème du déclin du capitalisme dans la Revue internationale n° 77, 1994 :"Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre - Polémique avec Programme Communiste sur la guerre impérialiste ", https://fr.internationalism.org/rinte77/decad.htm [38]
6 https://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1951-theorie-action-dans-doctrine-marxiste.htm [39]
7 "Dialogue avec les morts", 1956.
8 "Comprendre la décadence du capitalisme" (1 et 5) , https://fr.internationalism.org/rinte48/decad.htm [40] et https://fr.internationalism.org/french/rinte55/decad.htm [41]
9 Republié en partie dans la Revue internationale n° 59, au sein de l'article "Il y a 50 ans : les véritables causes de la 2 [42]e [42] guerre mondiale [42]".
10 Republié [43] dans la Revue internationale n° 21.
11 Dans ses articles "Crises et cycles dans l'économie du capitalisme agonisant", publiés en 1934 dans les numéros 10 et 11 de Bilan (republiés dans les numéros 102 [44] et 103 [45] de la Revue internationale), que nous avons examinés dans le précédent article de cette série, Mitchell avait affirmé que les marchés asiatiques constitueraient l'un des enjeux de la guerre à venir. Il n'a pas développé cette affirmation, mais cela vaudrait la peine de se pencher sur cette question, étant donné que, dans les années 1930, l'Asie et l'Extrême-Orient en particulier constituaient une région du globe où subsistaient des vestiges considérables des civilisations pré-capitalistes, et étant donné l'importance de la capitalisation de cette région pour le développement du capitalisme au cours des dernières décennies.
12 La fin des années 1940 fut une période d'austérité et de privations dans la plupart des pays européens. Ce n'est pas avant le milieu des années 1950 que la "prospérité" commença à se faire sentir dans des parties de la classe ouvrière et les premiers signes d'une nouvelle phase de crise économique apparurent vers 1966-67, devenant évidente au niveau global au début des années 1970.
13 Slouching Towards Utopia? The Economic History of the Twentieth Century – chapitre XX "The Great Keynesian Boom : 'Thirty Glorious Years' ", J.Bradford DeLong, Université de Californie, Berkeley et NBER, février 1997
14 Cornelius Castoriadis. Brochure n°10. Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne [46]. Chap. I : "Quelques traits importants du capitalisme contemporain".
15 Cette introduction à la réédition anglaise de 1974 est disponible dans la brochure n° 9.
16 Les situationnistes, dont la vision de l' "économie" était très influencée par Cardan, sont allés bien plus loin dans la critique de la stérilité de la culture capitaliste moderne et de la vie quotidienne.
17 La critique des syndicats est cependant limitée : le groupe avait beaucoup d'illusions sur le système des shop-stewards britanniques qui en réalité avait fait depuis longtemps la paix avec la structure syndicale officielle.
18 Cornelius Castoriadis, op. cit., Chap. II : "La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel"
19 Ibid. Notre traduction à partir de la version anglaise de l'ouvrage mentionné de Castoriadis, Modern Capitalism and Revolution ; Appendix – The “Falling Rate of Profit” ; https://libcom.org/library/modern-capitalism-revolution-paul-cardan [47].
