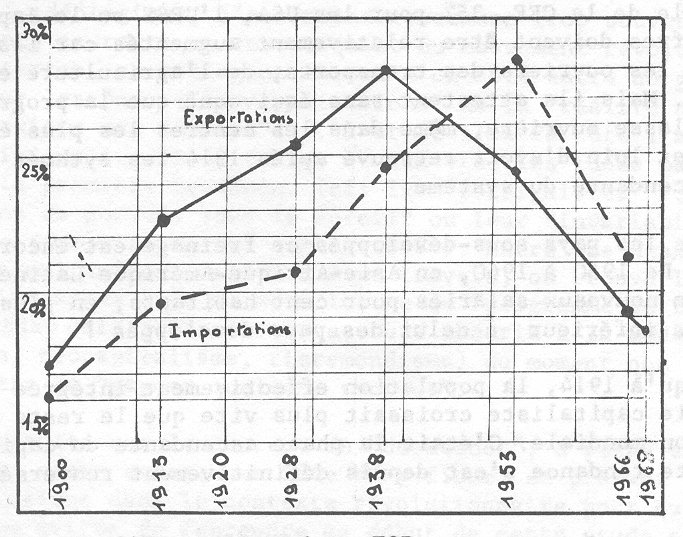Revue Internationale 2010 - n° 140 - 143
- 3209 lectures
Revue Internationale n° 140 - 1er trimestre 2010
- 2605 lectures
Sauver la planète? no, they can't!
"Copenhague se termine sur un échec" (Guardian, Royaume-Uni), "Fiasco à Copenhague", "Résultat grotesque", "Pire qu’inutile" (Financial Times, Royaume-Uni), "Un sommet pour rien" (The Asian Age, Inde), "La douche froide", "Le pire accord de l’histoire" (Libération, France)…La presse internationale est donc presque unanime [1], ce sommet annoncé comme historique s’est révélé catastrophique. Au final, les pays participants à cette grand-messe ont signé un accord en forme de vague promesse lointaine, qui n’engage à rien ni personne : réduire le pic de réchauffement à 2°C en 2050. "L’échec de Copenhague est au-delà de ce que l'on imaginait de pire" selon Herton Escobar, le spécialiste des sciences du quotidien O Estado De São Paulo (Brésil), "Le plus grand événement diplomatique de l'Histoire n’a pas produit le moindre engagement" [2]. Tous ceux qui avaient cru au miracle, la naissance d’un capitalisme vert, ont vu, à l’image de la banquise arctique et de l’Antarctique, leurs illusions fondre d’un coup d’un seul.
Un sommet international pour apaiser les inquiétudes
Le Sommet de Copenhague a été précédé d’une immense campagne publicitaire. Le battage médiatique orchestré à l’échelle internationale fut même assourdissant. Toutes les chaînes de télévisions, les journaux, les magazines ont fait de cet événement un moment historique. Les exemples sont légions.
Dès le 5 juin 2009, le film-documentaire de Yann Arthus Bertrand, Home, état des lieux dramatique et implacable de l’ampleur de la catastrophe écologique mondiale, a été diffusé simultanément et gratuitement dans 70 pays (à la télévision, sur Internet, dans des cinémas).
Des centaines d’intellectuels et d’associations écologiques ont multiplié les déclarations grandiloquentes pour "réveiller les consciences" et "exercer une pression citoyenne sur les décideurs". En France, la fondation Nicolas Hulot a lancé sous forme d’ultimatum :"L’avenir de la planète et avec lui, le sort d’un milliard d’affamés […] se jouera à Copenhague. Choisir la solidarité ou subir le chaos, l’humanité a rendez-vous avec elle-même". Aux Etats-Unis, le même message d’urgence et de gravité a été délivré : "Les nations du monde se réunissent à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009 pour une conférence sur le climat qui est annoncée comme celle de la dernière chance. Ça passe ou ça casse, marche ou crève ou peut-être, littéralement, nage ou coule. De fait, on peut avancer sans se tromper qu’il s’agit de la réunion diplomatique la plus importante de l’histoire du monde." (Bill McKibben, écrivain et militant américain, dans la revue Mother Jones [3]).
Le jour de l’ouverture du sommet, 56 journaux de 45 pays ont pris l’initiative inédite de parler d’une seule voix au travers d’un seul et même éditorial : "A moins que nous nous unissions pour mener une action décisive, le changement climatique va ravager notre planète. […] Le changement climatique […] aura des conséquences indélébiles et nos chances de le dominer se joueront pendant les 14 prochains jours. Nous appelons les représentants des 192 pays réunis à Copenhague à ne pas hésiter, à ne pas sombrer dans les querelles, à ne pas se rejeter la faute les uns sur les autres[…]. Le changement climatique affecte tout le monde et doit être résolu par tout le monde." [4]
Tous ces discours contiennent une moitié de vérité. Les recherches scientifiques montrent que la planète est en effet bel et bien en train d’être ravagée. Le réchauffement climatique s’aggrave et, avec lui, la désertification, les incendies, les cyclones… La pollution et l’exploitation intensive des ressources entraînent la disparition massive d’espèces. 15 à 37% de la biodiversité devrait disparaître d'ici à 2050. Aujourd'hui, un mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, un tiers des amphibiens et 70% des plantes sont en danger d’extinction [5]. Selon le Forum humanitaire mondial, le "changement climatique" entraînerait la mort de 300 000 personnes par an (dont la moitié de malnutrition) ! En 2050, il devrait y avoir "250 millions de réfugiés climatiques" [6]. Alors, oui, il y a urgence. Oui, l’humanité est confrontée à un enjeu historique et vital !
Par contre, l’autre moitié du message est un grossier mensonge destiné à bercer d’illusions le prolétariat mondial. Tous en appellent au sens de la responsabilité des gouvernants et à la solidarité internationale face au "danger climatique". Comme si les Etats pouvaient oublier ou dépasser leurs intérêts nationaux propres pour s’unir, coopérer, s’entraider au nom du bien être de l’humanité ! Toutes ces histoires ne sont que des contes à dormir debout inventés pour rassurer une classe ouvrière inquiète de voir la planète peu à peu détruite et des centaines de millions de personnes en souffrir [7]. La catastrophe environnementale montre clairement aux yeux de tous que seule une solution internationale est envisageable. Pour éviter que les ouvriers ne réfléchissent de trop par eux-mêmes à une "solution", la bourgeoisie a voulu prouver qu’elle était capable de mettre de côté ses divisions nationales ou, pour reprendre l’éditorial international des 56 journaux, de "ne pas sombrer dans les querelles", de "ne pas se rejeter la faute les uns sur les autres" et de comprendre que "le changement climatique affecte tout le monde et doit être résolu par tout le monde."
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet objectif est raté et bien raté ! Si Copenhague a bien montré une chose c’est que le capitalisme n’est et ne peut être qu’une "usine à gaz".
Il n’y avait d’ailleurs aucune illusion à se faire, rien de bon ne pouvait sortir de ce sommet. Le capitalisme détruit l’environnement depuis toujours. Déjà, au 19e siècle, Londres était une immense usine crachant sa fumée et déversant ses déchets dans la Tamise. Ce système produit dans l’unique but de faire du profit et accumuler du capital, par tous les moyens. Peu importe si, pour ce faire, il doit raser des forêts, piller les océans, polluer les fleuves, dérégler le climat… Capitalisme et Ecologie sont forcément antagoniques. Toutes les réunions internationales, les comités, les sommets (tel celui de Rio de Janeiro en 1992 ou celui de Kyoto en 1997) n’ont toujours été que des cache-sexes, des cérémonies théâtralisées pour faire croire que les "grands de ce monde" se soucient de l’avenir de la planète. Les Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Bill McKibben et autres Al Gore [8] ont voulu nous faire croire qu’il en serait cette fois-ci autrement, que face à l’urgence de la situation, les hauts-dirigeants allaient se "ressaisir". Pendant que tous ces idéologues brassaient de l’air, ces mêmes "hauts-dirigeants" affûtaient leurs armes éco… nomiques ! Car là est la réalité : le capitalisme est divisé en nations, toutes concurrentes les unes des autres, se livrant sans répit une guerre commerciale et, s’il le faut, parfois militaire.
Un seul exemple. Le pôle Nord est en train de fondre. Les scientifiques y voient une véritable catastrophe écologique : montée des eaux, modifications de la salinité et des courants marins, déstabilisation des infrastructures et érosion des côtes suite à la fonte du pergélisol, libération du CO2 et du méthane de ces sols dégelés, dégradation des écosystèmes arctiques [9]… Les Etats y voient, eux, une "opportunité" d’exploiter des ressources jusqu’ici inaccessibles et d’ouvrir de nouvelles voies maritimes libérées des glaces. La Russie, le Canada, les Etats-Unis, le Danemark (via le Groenland) se livrent actuellement une guerre diplomatique sans merci, n’hésitant pas à utiliser l’arme de l’intimidation militaire. Ainsi, en août dernier, "Quelque 700 membres des Forces canadiennes, provenant des armées de terre, de mer et de l'air, participent à l'opération pancanadienne NANOOK 09. L'exercice vise à prouver que le Canada est capable d'affirmer sa souveraineté dans l'Arctique, une région convoitée par les États-Unis, le Danemark et, surtout, la Russie, dont certaines récentes tactiques, comme l’envoi d’avion ou de sous-marins, ont irrité Ottawa." [10] Car, effectivement, depuis 2007, l’Etat russe envoie régulièrement ses avions de chasse survoler l’arctique et parfois les eaux canadiennes comme au temps de la Guerre Froide.
Capitalisme et Ecologie sont bel et bien pour toujours antagoniques !
La bourgeoisie ne parvient même plus à sauver les apparences
"L’échec de Copenhague" est donc tout sauf une surprise. Nous l’avions d’ailleurs annoncé dans notre Revue Internationale n°138 dès le 3e trimestre 2009 : "Le capitalisme mondial est totalement incapable de coopérer pour faire face à la menace écologique. En particulier dans la période de décomposition sociale, avec la tendance croissante de chaque nation à jouer sa propre carte sur l'arène internationale, dans la concurrence de tous contre tous, une telle coopération est impossible." Il est plus surprenant, par contre, que tous ces chefs d’Etat n’aient même pas réussi à sauver les apparences. D’habitude, un accord final est signé en grandes pompes, des objectifs bidons sont fixés et tout le monde s’en félicite. Cette fois-ci, il s’agit officiellement d’un "échec historique". Les tensions et les marchandages sont sortis des coulisses et ont été portés au devant de la scène. Même la traditionnelle photo des chefs d’Etats, s’auto-congratulant, bras-dessus, bras-dessous, et affichant de larges sourires d’acteurs de cinéma, n’a pu être réalisée. C’est tout dire !
Ce désaveu est tellement patent, ridicule et honteux que la bourgeoisie a dû faire profil bas. Aux bruyants préparatifs du Sommet de Copenhague a succédé un silence tout aussi assourdissant. Ainsi, au lendemain même de la rencontre internationale, les médias se sont contentés de quelques lignes discrètes pour faire un "bilan" de l’échec (en rejetant d’ailleurs systématiquement la faute sur les autres nations), puis ont évité soigneusement de revenir sur cette sale histoire les jours suivants.
Pourquoi, contrairement aux habitudes, les chefs d’Etats n’ont-ils pas réussi à faire semblant ? La réponse tient en deux mots : crise économique.
Contrairement à ce qui est affirmé partout depuis des mois, la gravité de la récession actuelle ne pousse pas les chefs d’Etat à saisir la "formidable opportunité" de plonger tous ensemble dans "l’aventure de la green economy". Au contraire, la brutalité de la crise attise les tensions et la concurrence internationale. Le sommet de Copenhague a fait la démonstration de la guerre acharnée que sont en train de se livrer les grandes puissances. Il n’est plus l’heure pour eux de faire semblant de bien s’entendre et de proclamer des accords (même bidons). Ils sortent les couteaux, tant pis pour la photo !
Depuis l’été 2007 et le plongeon de l’économie mondiale dans la plus grave récession de l’histoire du capitalisme, il y a une tentation croissante de céder aux sirènes du protectionnisme et une montée du chacun pour soi. Evidemment, de par sa nature même, le capitalisme est divisé depuis toujours en nations qui se livrent une guerre économique sans merci. Mais le krach de 1929 et la crise des années 1930 avaient révélé aux yeux de la bourgeoisie le danger d’une absence totale de règles et de coordinations internationales du commerce mondial. En particulier, après la Seconde Guerre mondiale, les blocs de l’Est et de l’Ouest s’étaient organisés en leur sein et avaient édifié un minimum de lois organisant les relations économiques. Partout, par exemple, le protectionnisme outrancier avait été interdit car identifié comme un facteur nocif pour le commerce mondial et donc, in fine, pour toutes les nations. Ces grands accords (tel que Bretton Woods, 1944) et les institutions chargée de faire respecter ces nouvelles règles (tel que le Fond Monétaire International) ont effectivement participé à amoindrir les effets du ralentissement économique qui frappe le capitalisme depuis 1967.
Mais la gravité de la crise actuelle est venue mettre à mal toutes ces règles de fonctionnement. La bourgeoisie a bien tenté de réagir de façon unie, en organisant les fameux G20 de Pittsburgh et de Londres, mais le chacun pour soi n’a cessé, mois après mois, de gagner du terrain. Les plans de relance sont de moins en moins coordonnés entre les nations et la guerre économique monte en agressivité. Le Sommet de Copenhague est venu confirmer de façon éclatante cette tendance.
Il faut dire que, contrairement aux mensonges sur une prétendue "sortie du tunnel" et sur une reprise de l’économie mondiale, la récession ne cesse de s’aggraver et a même subi une nouvelle accélération en cette fin d’année 2009. "Dubaï, la faillite en ligne d’émir", "La Grèce est au bord de la faillite" (Libération, respectivement des 27 novembre et 9 décembre) [11]. Ces annonces ont été comme des coups de tonnerre. Chaque Etat sent son économie nationale véritablement en danger et est conscient que l’avenir est à une récession de plus en plus profonde. Pour empêcher l’économie capitaliste de s’enfoncer trop rapidement dans la dépression, la bourgeoisie n’a en effet pas eu d’autre choix depuis l’été 2007 que de créer et injecter massivement de la monnaie et de creuser par-là même les déficits publics et budgétaires. Ainsi, comme le pointe un rapport de novembre 2009 publié par la banque Société Générale "Le pire pourrait être devant nous". Selon cette banque, "les récents plans de sauvetage mis en place par les gouvernements mondiaux ont simplement transféré des passifs du secteur privé au secteur public, créant une nouvelle série de problèmes. Premier d’entre eux, le déficit. […] Le niveau de la dette paraît tout à fait insoutenable à long terme. Nous avons pratiquement atteint un point de non-retour en ce qui concerne la dette publique" [12]. L’endettement global est beaucoup trop élevé dans la plupart des économies des pays développés, par rapport à leur PIB. Aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne, la dette publique représentera ainsi 125% du PIB dans deux ans. Au Royaume-Uni, elle s’élèvera à 105% et au Japon, à 270% (toujours d’après le rapport). Et la Société Générale n’est pas la seule à tirer la sonnette d’alarme. En mars 2009, le Crédit Suisse avait établi la liste des dix pays les plus menacés par la faillite, en comparant l’importance des déficits et le PIB. Pour l’instant, cette sorte de "Top 10" a "tapé dans le mille" puisqu’il était constitué, dans l’ordre, de l’Islande, la Bulgarie, la Lituanie, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la Lettonie, la Roumanie, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l’Irlande et la Hongrie [13]. Autre preuve de cette inquiétude, sur les marchés financiers un nouveau sigle est apparu : PIGS. "Aujourd’hui ce sont les PIGS : Portugal, Italie, Grèce, Espagne [Spain en anglais, NDLR] qui font trembler la planète. Après l’Islande et Dubaï, ces quatre pays surendettés de la zone euro sont considérés comme possible bombes à retardement de l’économie mondiale" [14].
En réalité, tous les Etats face à leur déficit abyssal vont devoir réagir et mener une politique d’austérité. Concrètement, cela signifie qu’ils vont :
- développer une très forte pression fiscale (augmenter les impôts) ;
- diminuer encore plus drastiquement les dépenses en supprimant des dizaines ou des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, en réduisant de façon draconienne les allocations retraites, les indemnités chômages, les aides familiales et sociales, les remboursements de soins,…
- et, évidemment, mener une politique de plus en plus agressive, sans foi ni loi, sur le marché du commerce international.
Bref, cette situation économique désastreuse exacerbe la concurrence. Chaque Etat est aujourd’hui peu enclin à accepter la moindre concession ; il livre une bataille acharnée pour la survie de son économie nationale contre les autres bourgeoisies. C’est cette tension, cette guerre économique qui a rejailli à Copenhague.
Les quotas écologiques comme armes économiques
A Copenhague, tous les Etats sont donc venus non pas pour sauver la planète mais pour se défendre bec et ongles. Leur seul but était, pour chacun, d’utiliser "l’écologie" pour faire adopter des règles qui les avantageaient et qui, surtout, handicapaient les autres.
Les Etats-Unis et la Chine sont accusés, par la majorité des autres pays, d’être les principaux responsables de l’échec. Ils ont effectivement refusé tous deux que soit fixé un quelconque objectif chiffré de baisse de production de CO2, principal responsable du réchauffement climatique. Il faut dire qu’à ce petit jeu, les deux plus gros pollueurs de la planète étaient aussi ceux qui, forcément, avaient le plus à perdre [15]. "Si les objectifs du GIEC [16] sont retenus [c’est à dire une baisse de 40% de CO2 d’ici à 2050, NDLR], en 2050, chaque habitant du monde ne devra plus émettre que 1,7 tonne maximum de CO2 par an. Or, chaque américain en produit en moyenne 20 tonnes !" [17]. Quant à la Chine, son industrie tourne presque exclusivement grâce aux centrales à charbon qui "engendrent 20% des émissions mondiales de ce gaz. C’est plus que tous les transports réunis : voitures, camions, trains, bateaux et avions" [18]. On comprend aussi pourquoi tous les autres pays tenaient tant à "fixer des objectifs chiffrés" de baisse du CO2 !
Mais il ne faut pas croire ici que les Etats-Unis et la Chine ont fait cause commune pour autant. L’Empire du milieu a, au contraire, lui aussi exigé une baisse de 40% d’émission de CO2 d’ici à 2050 pour… les Etats-Unis et l’Europe. Elle devait, par contre, en être naturellement soustraite en tant que "pays émergent". "Les pays émergents, notamment l'Inde et la Chine, réclamaient aux pays riches de forts engagements sur la réduction des gaz à effet de serre mais refusaient d'être soumis à des objectifs contraignants." [19]
L'Inde a utilisé à peu près le même stratagème, une baisse pour les autres mais pas pour elle, en justifiant sa politique par le fait "qu'elle abrite des centaines de millions de pauvres et que le pays ne peut guère se permettre des efforts considérables". Les "pays émergents" ou "en voie de développement", souvent présentés dans la presse comme les premières victimes du fiasco de Copenhague, n’ont ainsi pas hésité à instrumentaliser la misère de leurs populations pour défendre leurs intérêts de bourgeois. Le délégué du Soudan, qui représentait l'Afrique, n’a pas hésité à comparer la situation à celle de l'holocauste. "C'est une solution fondée sur des valeurs qui ont envoyé six millions de personnes dans les fours en Europe." [20] Ces dirigeants, qui affament leur population et qui parfois même les massacrent, osent aujourd’hui, sans vergogne, invoquer leurs "malheurs". Au Soudan, par exemple, ce n’est pas dans l’avenir à cause du climat mais dès aujourd’hui, par les armes, que des millions de personnes se font massacrer !
Et l’Europe, elle qui joue à la dame de bonne vertu, comment a-t-elle défendu "l’avenir de la planète" ? Prenons quelques exemples. Le président français Nicolas Sarkozy a fait une déclaration tonitruante à l’avant-dernier jour du sommet, "Si on continue comme ça, c'est l'échec. […] tous, nous devrons faire des compromis […] L'Europe et les pays riches, nous devons reconnaître que notre responsabilité est plus lourde que les autres. Notre engagement doit être plus fort. […] Qui osera dire que l'Afrique et les pays les plus pauvres n'ont pas besoin de l'argent ? […] Qui osera dire qu'il ne faut pas un organisme pour comparer le respect des engagements de chacun ?" [21] Derrière ces grandes tirades se cache une réalité bien plus sinistre. L’Etat français et Nicolas Sarkozy se sont battus pour une baisse chiffrée des émissions de CO2 et, surtout, pour que… le nucléaire, ressource vitale de l’économie hexagonale, ne soit en rien limité ! Cette énergie pourtant fait aussi peser une lourde menace, telle une épée de Damoclès, au dessus de l’humanité. L’accident de la centrale de Tchernobyl a fait entre 4000 et 200 000 morts selon les estimations (selon que l’on intègre ou non les victimes de cancers liés aux radiations). Avec la crise économique, dans les décennies à venir, les Etats auront de moins en moins les moyens d’entretenir les centrales et les accidents seront de plus en plus probables. Et dés aujourd’hui, le nucléaire pollue massivement. L’Etat français fait croire que ses déchets radioactifs sont traités "proprement" à La Hague alors que, pour faire des économies, il en exporte une grande partie en douce en Russie : "c’est près de 13 % des matières radioactives produites par notre parc nucléaire qui dorment quelque part au fin fond de la Sibérie. Précisément dans le complexe atomique de Tomsk-7, une ville secrète de 30 000 habitants, interdite aux journalistes. Là-bas, chaque année, depuis le milieu des années 1990, 108 tonnes d’uranium appauvri issues des centrales françaises viennent, dans des containers, se ranger sur un grand parking à ciel ouvert." [22] Autre exemple. Les Pays d’Europe du Nord sont réputés pour être à la pointe de l’écologie, de vrais petits modèles. Et pourtant, en ce qui concerne la lutte contre la déforestation,… "la Suède, la Finlande, ou l’Autriche freinent des quatre fers pour que rien ne bouge" [23]. La raison ? Leur production énergétique est extrêmement dépendante du bois et ils sont de grands exportateurs de papier. La Suède, la Finlande et l’Autriche se sont donc retrouvées à Copenhague aux côtés de la Chine qui, elle, en tant que premier producteur mondial de meubles en bois, ne voulait pas non plus entendre parler d’une quelconque limitation de la déforestation.Il ne s’agit pas là d’un détail : "La déforestation est en effet responsable d’un cinquième des émissions mondiales de CO2." [24] et "La destruction des forêts pèse lourd dans la balance climatique […]. Environ 13 millions d'hectares de forêts sont coupés chaque année, soit l'équivalent de la surface de l'Angleterre, et c'est cette déforestation massive qui a fait de l'Indonésie et du Brésil les troisième et quatrième plus gros émetteurs de CO2 de la planète." [25] Ces trois pays européens, officiellement preuves vivantes qu’une économie capitaliste verte est possible (sic !), "se sont vu décerner le prix de Fossil of the Day [26] lors du premier jour des négociations pour leur refus d’endosser leur responsabilité en matière de conversion des terres forestières." [27]
Un pays résume à lui seul tout le cynisme bourgeois qui entoure "l’écologie" : la Russie. Depuis des mois, le pays de Poutine crie haut et fort qu’il est favorable à un accord chiffré sur les émissions de CO2. Cette position peut surprendre quand on connaît l’état de la nature en Russie. La Sibérie est polluée par la radioactivité. Ses armes nucléaires (bombes, sous-marins…) rouillent dans des cimetières. L’Etat russe serait-il pris de remords ? "La Russie se présente comme la nation modèle en matière d’émissions de CO2. Mais ce n’est qu’un tour de passe-passe. Voici pourquoi. En novembre, Dimitri Medvedev [le président russe, NDLR] s’est engagé à réduire les émissions russes de 20% d’ici à 2020 (sur la base de 1990 [28]), soit plus que l’Union européenne. Mais il n’y a là aucune contrainte puisque, en réalité, les émissions russes ont déjà diminué de… 33% depuis 1990 en raison de l’effondrement du PNB russe après la chute de l’Union soviétique. En fait, Moscou cherche à pouvoir émettre plus de CO2 dans les années à venir afin de ne pas brider sa croissance (si celle-ci revient…). Les autres pays ne vont pas accepter cette position facilement.[29]".
Jamais le capitalisme ne sera "vert". Demain, la crise économique va frapper encore plus fort. Le sort de la planète sera alors le dernier des soucis de la bourgeoisie. Elle ne cherchera qu’une seule chose : soutenir son économie nationale, en s’affrontant toujours plus durement aux autres pays, en fermant les usines pas assez rentables, quitte à les laisser pourrir sur place, en réduisant les coûts de production, en coupant dans les budgets sur l’entretien des usines et des centrales énergétiques (nucléaires ou à charbon), ce qui signifiera aussi plus de pollution et d’accidents industriels. Voici l’avenir que nous réserve le capitalisme : une crise économique profonde, une infrastructure pourrissantes et ultra-polluantes et des souffrances croissantes pour l’humanité.
Il est temps de détruire le capitalisme avant qu’il ne détruise la planète et ne décime l’humanité !
Pawel (6 janvier 2010)
1. Seuls les journaux américains et chinois évoquent un "succès", "un pas en avant". Nous expliquerons pourquoi un peu plus loin.
2. www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091220/not_imp484972,0.php [2]
3. https://www.courrierinternational.com/article/2009/11/19/un-sommet-plus-important-que-yalta [3]
4. https://www.courrierinternational.com/article/2009/12/07/les-quotidiens-manifestent-pour-la-planete [4]
5. https://www.planetoscope.com/biodiversite [5]
6. www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468 [6]
7. Il n’est pas à exclure qu’une grande partie des intellectuels et responsables d’association écologiques croient eux-mêmes aux histoires qu’ils inventent. C’est d’ailleurs même très probablement le cas.
8. Prix Nobel de la paix pour sa lutte contre le réchauffement climatique avec son film-documentaire "Une vérité qui dérange" !
9. m.futura-sciences.com/2729/show/f9e437f24d9923a2daf961f70ed44366&t=5a46cb8766f59dee2844ab2c06af8e74
10. ici.radio-canada.ca/nouvelle/444446/harper-exercice-nord [7]
11. La liste ne fait ici que s’allonger puisque depuis la fin 2008, début 2009, l’Islande, la Bulgarie, la Lituanie et l’Estonie sont déjà estampillées "Etat en faillite".
12. Rapport [8] rendu public par le Telegraph (journal anglais) du 18 novembre 2009.
13. Source : weinstein-forcastinvest.net/apres-la-grece-le-top-10-des-faillites-a-venir
14. Le nouvel Observateur, magazine français, du 3 au 9 décembre.
15. D’où le cri de victoire de la presse américaine et chinoise (souligné dans notre introduction) pour qui, l’absence d’accord est "un pas en avant".
16. Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
17. Le nouvel Observateur du 3 au 9 décembre, numéro spécial Copenhague.
18. Idem.
19. www.nouvelobs.com/rue89 [9]
20. Les Echos du 19 décembre 2009.
21. Le Monde du 17 décembre 2009.
22. "Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie", Libération du 12 octobre 2009.
23. Euronews (chaîne de télévision européenne) du 15 décembre 2009 (fr.euronews.net/2009/12/15/copenhague-les-emissions-liees-a-la-deforestation-font-debat)
24. www.rtl.be/info/monde/international/wwf-l-europe-toujours-faible-dans-la-lutte-contre-la-deforestation-143082.aspx [10]
25. La Tribune (quotidien français) du 19 décembre 2009.
26. Ce prix est décerné par un regroupement de 500 ONG liées à l’environnement et "récompense" les individus ou les Etats qui, pour user d’un euphémisme, "traînent des pieds" dans la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la semaine de Copenhague, presque tous les pays ont eu droit à leur Fossil of the Day.
27. Le Soir (quotidien belge) du 10 décembre 2009.
28. 1990 est l’année de référence pour les émissions de gaz à effet de serre, pour tous les pays, depuis le Protocole de Kyoto.
29. Le nouvel Observateur du 3 au 9 décembre.
L'immigration et le mouvement ouvrier
- 5944 lectures
Avec l’aggravation de la crise économique et de la décomposition sociale, partout dans le monde les conditions de vie sont de plus en plus intolérables, en particulier dans les pays du Tiers-Monde. La misère, les catastrophes naturelles, les guerres, le nettoyage ethnique, la famine, la barbarie totale sont la réalité quotidienne pour des millions de gens et leurs effets cumulés poussent à l’émigration de masse. Des millions de personnes fuient vers les grandes métropoles capitalistes ou vers d’autres pays également sous-développés mais qui sont dans une situation un peu moins désespérée.
Les Nations Unies estiment que 200 millions d’immigrés – environ 3% de la population mondiale – vivent hors de leur pays d’origine, le double de 1980. Aux Etats-Unis, 33 millions d'habitants sont nés à l'étranger, environ 11,7 %de la population ; en Allemagne, 10,1 millions, 12,3 % ; en France, 6,4 millions, 10,7 % ; au Royaume Uni, 5,8 millions, 9,7 % ; en Espagne, 4,8 millions, 8,5 % ; en Italie, 2,5 millions, 4,3 % ; en Suisse, 1,7 million, 22,9% et aux Pays-Bas, 1,6 million. 1 Les sources gouvernementales et médiatiques estiment qu’il y a plus de 12 millions d’immigrés clandestins aux Etats-Unis et plus de 8 millions en Union européenne. Dans ce contexte, l’immigration est devenue une question politique brûlante dans toutes les métropoles capitalistes, et même dans le Tiers-Monde, comme les récentes émeutes anti-immigrés en Afrique du Sud l'ont montré.
Bien qu’il existe des variations selon les pays et leurs spécificités, l’attitude de la bourgeoisie face à cette immigration massive suit en général le même schéma en trois volets : 1) encourager l’immigration pour des raisons économiques et politiques 2) simultanément la restreindre et tenter de la contrôler et 3) orchestrer des campagnes idéologiques pour attiser le racisme et la xénophobie contre les immigrés afin de diviser la classe ouvrière.
Encourager l’immigration : La classe dominante compte sur les travailleurs immigrés, légaux ou illégaux, pour occuper des emplois mal payés, peu attractifs pour les ouvriers du pays, et pour servir d’armée de réserve de chômeurs et de main d'œuvre sous-employée, afin de faire baisser les salaires de toute la classe ouvrière et de pallier à la diminution de la main d’œuvre résultant du vieillissement de la population et de la baisse des taux de natalité. Aux Etats-Unis, la classe dominante est tout à fait consciente que des industries entières comme le petit commerce, la construction, le traitement de la viande et de la volaille, les services de nettoyage, les hôtels, la restauration, les services de santé à domicile et de garde d’enfants reposent grandement sur le travail immigré, légal ou illégal. C’est pourquoi les revendications de l’extrême droite de renvoyer 12 millions d’immigrés illégaux et de réduire l’immigration légale ne représentent en aucun cas une alternative politique rationnelle pour les fractions dominantes de la bourgeoisie américaine et ont été rejetées comme irrationnelles, impraticables et nuisibles pour l’économie des Etats-Unis.
Restreindre et contrôler : En même temps, la fraction dominante reconnaît la nécessité de résoudre la question du statut des immigrés sans papier afin de garder un contrôle sur une multitude de problèmes sociaux, économiques et politiques, y compris l'existence et l'attribution de services médicaux, sociaux, éducatifs et d'autres services publics, ainsi que toute une série de questions légales relatives aux enfants d’immigrés nés aux Etats-Unis et à leurs biens. C’était la toile de fond de la réforme sur l’immigration proposée au printemps 2007 aux Etats-Unis qui a été soutenue par l’administration Bush et les Républicains, par les Démocrates (y compris leur aile gauche incarnée par l'ancien sénateur Edward Kennedy), et par les grandes entreprises. Loin d’être en faveur de l’immigration, la loi demandait de restreindre la frontière et de la militariser, la légalisation des immigrés sans papiers déjà présents dans le pays et des mesures de contrôle des futurs immigrés. Tout en proposant des moyens aux immigrés illégaux déjà présents dans le pays de légaliser leur statut, elle ne constituait en aucun cas une "amnistie" et comportait des délais et des amendes énormes.
Les campagnes idéologiques : les campagnes de propagande contre les immigrés varient selon les pays, mais le cœur de leur message est remarquablement similaire ; il vise en premier lieu les "Latinos" aux Etats-Unis et les Musulmans en Europe, sous prétexte que ces derniers immigrés, en particulier les sans-papiers, seraient responsables de l’aggravation de la crise économique et des conditions sociales auxquelles est confrontée la classe ouvrière "du pays", car ils prendraient ses emplois, feraient baisser ses salaires, encombreraient les écoles avec leurs enfants, mettraient à sec les programmes d’assistance sociale, augmenteraient la criminalité et tous les autres malheurs sociaux auxquels on pourrait penser. C’est un exemple classique de la stratégie du capitalisme de diviser pour régner, diviser les ouvriers entre eux de sorte qu’ils s'accusent mutuellement d'être responsables de leurs problèmes, qu’ils se bagarrent pour des miettes, plutôt que de comprendre que c’est le système capitaliste le responsable de leurs souffrances. Cela sert à saper la capacité de la classe ouvrière à reprendre conscience de son identité de classe et de son unité, ce que la bourgeoisie redoute par dessus tout. Le plus typique, c’est que la division du travail au sein de la bourgeoisie assigne à l’aile droite la tâche d’attiser et d'exploiter le sentiment anti-immigrés dans toutes les grandes métropoles capitalistes, avec un succès plus ou moins grand, trouvant un écho dans certains secteurs du prolétariat ; mais nulle part il n’a atteint le niveau de barbarie des émeutes xénophobes contre les immigrés en Afrique du Sud en mai 2008.
L’aggravation des conditions dans les pays sous-développés dans les années à venir, qui comprend non seulement les effets de la décomposition et de la guerre mais, aussi, du changement climatique, signifie que la question de l’immigration prendra probablement encore plus d'importance dans le futur. Il est crucial que le mouvement ouvrier soit clair sur la signification du phénomène de l’immigration, sur la stratégie de la bourgeoisie face à celle-ci, sur sa politique et ses campagnes idéologiques, et sur la perspective du prolétariat sur cette question. Dans cet article nous examinerons le rôle historique de l'immigration de populations dans l’histoire du capitalisme, l’histoire de la question de l’immigration au sein du mouvement ouvrier sur, la politique d’immigration de la bourgeoisie et une orientation pour l’intervention des révolutionnaires sur l’immigration.
L’immigration et le développement capitaliste
Dans sa période ascendante, le capitalisme accordait une importance énorme à la mobilité de la classe ouvrière comme facteur de développement de son mode de production. Sous le féodalisme, la population travailleuse était attachée à la terre, ne se déplaçant quasiment pas au cours de toute sa vie. En expropriant les producteurs agricoles, le capitalisme a contraint de larges populations à quitter la campagne pour la ville, à vendre leur force de travail, fournissant une réserve indispensable de force de travail. Comme l’a noté Révolution Internationale dans son article "La classe ouvrière, une classe d’immigrés",2 "Au début du capitalisme, pendant sa période d’ "accumulation primitive", les liens des premiers travailleurs salariés avec leurs seigneurs féodaux furent rompus et "[les révolutions] dépouillant de grandes masses de leurs moyens de production et d'existence traditionnels, les lancent à l'improviste sur le marché du travail, prolétaires sans feu ni lieu. Mais la base de toute cette évolution, c'est l'expropriation des cultivateurs" 3 ". Comme l’a écrit Lénine, "le capitalisme entraîne inévitablement une mobilité de la population dont les régimes économiques antérieurs n'avaient pas besoin et qui, sous ces régimes, ne pouvait pas exister sur une échelle un tant soit peu importante" 4 (cités dans World Revolution n °300). Avec l’avancée de l’ascendance, la migration massive avait une importance décisive pour le développement du capitalisme dans sa période d’industrialisation. Le mouvement et le déplacement de masses d’ouvriers vers les lieux où le capital en avait besoin; étaient essentiels. De 1848 à 1914, 50 millions de personnes quittèrent l’Europe, la grande majorité alla s’installer aux Etats-Unis. Rien qu’entre 1900 et 1914, 20 millions de personnes émigrèrent d’Europe aux Etats-Unis. En 1900, la population américaine était approximativement de 75 millions; en 1914 d’environ 94 millions - ce qui veut dire qu’en 1914, plus d’un cinquième était composée de nouveaux immigrés – sans compter ceux qui étaient arrivés avant 1900. Si l’on comptabilise les enfants d'immigrés nés aux Etats-Unis, l’impact des immigrés sur la vie sociale est encore plus significatif. Pendant cette période, la bourgeoisie américaine a essentiellement suivi une politique d’ouverture complète à l’immigration (à l’exception de restrictions envers les immigrés d’Asie). Ce qui motivait les ouvriers immigrés à se déraciner, était la promesse d’améliorer leur niveau de vie, la fuite de la pauvreté et de la famine, de l’oppression et du manque de perspectives.
De pair avec sa politique encourageant l’immigration, la bourgeoisie n’hésita pas à mener, en même temps, des campagnes xénophobes et racistes pour diviser la classe ouvrière. On montait ceux qu’on appelait les ouvriers "natifs" ("native" workers, ouvriers "du pays", "de souche"), - et dont certains étaient eux-mêmes de la deuxième ou troisième génération descendant d’immigrés – contre les nouveaux arrivants qu'on dénonçait pour leurs différences linguistiques, culturelles et religieuses. Même parmi les nouveaux arrivants, les antagonismes ethniques étaient utilisés pour alimenter la stratégie de division. Il est important de se rappeler que la peur et la méfiance envers les étrangers ont de profondes racines psychologiques dans cette société, et le capitalisme n’a jamais hésité à exploiter ce phénomène pour ses propres fins sordides. La bourgeoisie, américaine en particulier, a utilisé cette tactique de "diviser pour régner" pour contrecarrer la tendance historique à l’unité de la classe ouvrière et mieux asservir le prolétariat. Dans une lettre à Hermann Schlüter, en 1892, Engels notait : "Votre bourgeoisie sait beaucoup mieux que le gouvernement autrichien lui-même jouer une nationalité contre l'autre : Juifs, Italiens, Bohèmes, etc., contre Allemands et Irlandais, et chacun d'eux contre les autres." C’est une arme idéologique classique de l’ennemi de classe.
Alors que l’immigration dans la période d’ascendance du capitalisme a été en grande partie alimentée pour satisfaire aux besoins de force de travail d’un mode de production historiquement progressiste, en développement et s’étendant rapidement, dans la décadence, avec le ralentissement des taux de croissance exponentiels, les motifs de l’immigration résultèrent de facteurs beaucoup plus négatifs. La nécessité de fuir la persécution, la famine et la pauvreté qui a poussé des millions d’ouvriers pendant la période d’ascendance à émigrer pour trouver un travail et une vie meilleure, s’est accrue inévitablement dans la période de décadence, à un degré d’urgence supérieur. Les nouvelles caractéristiques de la guerre dans la décadence notamment ont donné une nouvelle impulsion à l’émigration de masse et au flot de réfugiés. Dans l’ascendance, les guerres se limitaient avant tout au conflit entre armées professionnelles sur les champs de bataille. Avec le début de la décadence, la nature de la guerre se transforma de façon significative, impliquant toute la population et tout l’appareil économique du capital national. Terroriser et démoraliser la population civile devint un objectif tactique primordial et amena à des migrations massives de réfugiés au 20e et maintenant au 21e siècle. Au cours de la guerre actuelle en Irak par exemple, on estime à deux millions les réfugiés recherchant la sécurité en Jordanie et en Syrie surtout. Les émigrants qui fuient leur pays d’origine sont encore persécutés sur la route par les policiers et les militaires corrompus, la mafia et les criminels qui leur extorquent leurs biens, les brutalisent et les volent au cours de leur voyage désespéré vers ce qu’ils espèrent une vie meilleure. Beaucoup d’entre eux meurent ou disparaissent en cours de route, certains tombent entre les mains de trafiquants d’hommes. Il faut remarquer que les forces de la justice et de l’ordre capitalistes semblent incapables ou ne veuillent pas faire quoi que ce soit pour soulager des maux sociaux qui accompagnent l’immigration massive de la période actuelle.
Aux Etats-Unis, la décadence s’est accompagnée d’un changement abrupt : d’une politique de large ouverture à l’immigration (sauf en ce qui concerne les restrictions de longue date envers les Asiatiques) à des politiques gouvernementales d’immigration extrêmement restrictives. Avec le changement de période économique, il y eut globalement moins besoin d’un afflux continuel et massif de force de travail. Mais ce ne fut pas la seule raison d’une immigration plus contrôlée, des facteurs racistes et « anti-communistes » intervenant également. .Le National Origins Act, loi adoptée en 1924, limita le nombre d’émigrants venant d’Europe à 150 000 personnes par an et fixa le quota pour chaque pays sur la base de la composition ethnique de la population américaine en 1890 – avant la vague massive d’émigration en provenance d’Europe de l’Est et du Sud. Les ouvriers immigrés d’Europe de l’Est étaient en partie visés sur la base d’un racisme éhonté afin de ralentir l’augmentation d’éléments "indésirables" comme les Italiens, les Grecs, les Européens de l’Est et les Juifs. Pendant la période de "Peur rouge" aux Etats-Unis qui a suivi la Révolution russe, les ouvriers immigrés d’Europe de l’Est étaient considérés comme incluant probablement un nombre disproportionné de "Bolcheviks" et ceux d’Europe du Sud, d’anarchistes. En plus de restreindre le flot des immigrés, la loi de 1924 créa, pour la première fois aux Etats-Unis, le concept d’ouvrier étranger non immigrant - qui pouvait venir aux Etats-Unis mais n’avait pas le droit d’y rester.
En 1950, le McCarran-Walter Act fut promulgué. Très influencé par le McCarthysme et l’hystérie anti-communiste de la Guerre froide, cette loi imposait de nouvelles limites à l’immigration sous couvert de lutte contre l’impérialisme russe. A la fin des années 1960, avec le début de la crise ouverte du capitalisme mondial, l’immigration américaine se libéralisa, augmentant le flot d’immigrés vers les Etats-Unis, qui venaient non seulement d’Europe, mais aussi d’Asie et d’Amérique latine, reflétant en partie le désir du capitalisme américain d’égaler le succès des puissances européennes en drainant leurs anciens pays coloniaux de travailleurs intellectuels qualifiés et talentueux, comme les scientifiques, les docteurs en médecine, les infirmiers et d’autres professions – ce qu’on appelle "la fuite des cerveaux" des pays sous-développés, et pour fournir des ouvriers agricoles peu payés. La conséquence inattendue des mesures de libéralisation fut l’augmentation spectaculaire de l’immigration, tant légale qu’illégale, en particulier en provenance d’Amérique latine.
En 1986, la politique américaine anti-immigration fut mise à jour avec la promulgation du Simpson-Rodino Immigration and naturalization Control Reform Act qui traitait de l’afflux d’immigrés illégaux venant d’Amérique latine et imposait, pour la première fois dans l’histoire de l’Amérique, des sanctions (amendes et même emprisonnement) contre les employeurs qui embauchaient en connaissance de cause des ouvriers sans papiers. L’afflux d’immigrés illégaux s’était intensifié avec l’effondrement économique des pays du Tiers-Monde pendant les années 1970, et avait déclenché une vague d'émigration des masses appauvries fuyant le dénuement au Mexique, à Haïti et au Salvador ravagé par la guerre. L'énormité de cette vague hors de contrôle est reflétée par le nombre record de 1,6 million d'arrestations d’immigrés clandestins en 1986 par la police américaine de l’immigration.
Au niveau des campagnes idéologiques, l’utilisation de la stratégie "diviser pour régner" face à l’immigration, déjà utilisée comme outil tactique contre le prolétariat pendant l’ascendance du capitalisme, a atteint de nouveaux sommets pendant la décadence. Les immigrés sont accusés d'envahir les métropoles, de faire baisser les salaires et de les dévaloriser, d’être la cause de l’épidémie de criminalité et de "pollution" culturelle, de remplir les écoles, d'alourdir les programmes sociaux – bref de tous les problèmes sociaux imaginables. Cette tactique ne se limite pas aux Etats-Unis mais est également utilisée en France, en Allemagne et dans toute l’Europe où les immigrés d’Europe de l'Est servent de boucs-émissaires pour les calamités sociales dues à la crise et au capitalisme en décomposition, dans des campagnes idéologiques remarquablement similaires, démontrant ainsi que l'immigration de masse est une manifestation de la crise économique globale et de la décomposition sociale qui s'aggravent dans les pays moins développés. Tout ceci a pour but de créer des obstacles et de bloquer le développement de la conscience de classe dans la classe ouvrière, d'essayer d’embobiner les ouvriers pour qu’ils ne comprennent pas que c’est le capitalisme qui crée les guerres, la crise économique et tous les problèmes sociaux caractéristiques de sa décomposition sociale.
L'impact social de l'aggravation de la décomposition et des crises qui vont avec ainsi que le développement de la crise écologique amèneront sans aucun doute des millions de réfugiés vers les pays développés dans les années à venir. Si ces mouvements massifs et soudains de populations sont traités autrement que l’immigration de routine, ils le sont toujours d’une façon qui reflète l’inhumanité fondamentale de la société capitaliste. Les réfugiés sont souvent parqués dans des camps, séparés de la société qui les entoure et seulement relâchés et intégrés lentement, parfois après de nombreuses années ; ils sont plus traités comme des prisonniers et des indésirables que comme des membres de la communauté humaine. Une telle attitude est en totale opposition avec la solidarité internationaliste qui constitue clairement la perspective prolétarienne.
La position historique du mouvement ouvrier sur l'immigration
Confronté à l’existence de différences ethniques, de race et de langue chez les ouvriers, historiquement, le mouvement ouvrier a été guidé par le principe : "les ouvriers n’ont pas de patrie", un principe qui a influencé à la fois la vie interne du mouvement ouvrier révolutionnaire et l'intervention de ce mouvement dans la lutte de classe. Tout compromis envers ce principe représente une capitulation envers l’idéologie bourgeoise.
Ainsi, par exemple, en 1847, les membres allemands de la Ligue des Communistes exilés à Londres, bien que préoccupés au premier chef par la propagande envers les ouvriers allemands, ont adhéré à la vision internationaliste et ont "maintenu des relations étroites avec les réfugiés politiques de toutes sortes de pays." 5 A Bruxelles, la Ligue a "organisé un banquet internationaliste pour démontrer les sentiments fraternels que les ouvriers avaient pour les ouvriers des autres pays... Cent vingt ouvriers participèrent à ce banquet dont des Belges, des Allemands, des Suisses, des Français, des Polonais, des Italiens et un Russe". 6 Vingt ans plus tard, la même préoccupation a poussé la Première Internationale à intervenir dans les grèves avec deux objectifs centraux : empêcher la bourgeoisie de faire venir des briseurs de grève de l'étranger et apporter un soutien direct aux grévistes comme elle le fit envers les fabricants de tamis, les tailleurs et les vanniers à Londres et envers les fondeurs de bronze à Paris. 7 Lorsque la crise économique de 1866 provoqua une vague de grèves à travers toute l'Europe, le Conseil général de l'Internationale "soutint les ouvriers par ses conseils et son assistance et mobilisa la solidarité internationale du prolétariat en leur faveur. De cette façon, l'Internationale priva la classe capitaliste d'une arme très efficace et les patrons ne purent plus freiner la combativité de leurs ouvriers en important une main d'œuvre étrangère bon marché... Là où elle avait de l'influence, elle cherchait à convaincre les ouvriers que c'était dans leur intérêt de soutenir les luttes salariales de leurs camarades étrangers." 8 De même, en 1871, lorsque le mouvement pour la journée de 9 heures se développa en Grande-Bretagne, organisé par la Nine Hours League et non par les syndicats qui restèrent en dehors de la lutte, la Première Internationale lui apporta son soutien en envoyant des représentants en Belgique et au Danemark pour "empêcher les intermédiaires des patrons de recruter des briseurs de grève dans ces pays, ce qu'ils réussirent avec beaucoup de succès." 9
L'exception la plus marquante à cette position internationaliste eut lieu aux Etats-Unis en 1870-71 où la section américaine de l'Internationale s'opposa à l'immigration d'ouvriers chinois aux Etats-Unis parce que les capitalistes les utilisaient pour faire baisser les salaires des ouvriers blancs. Un délégué de Californie se plaignit du fait que "les Chinois ont fait perdre des milliers d'emplois aux hommes, femmes et enfants blancs". Cette position exprimait une interprétation erronée de la critique portée par Marx au despotisme asiatique en tant que mode de production anachronique dont la domination en Asie devait être renversée pour que le continent asiatique s'intègre dans les rapports de production modernes et pour que se constitue un prolétariat moderne en Asie. Le fait que les travailleurs asiatiques ne soient pas encore prolétarisés et soient donc susceptibles d'être manipulés et surexploités par la bourgeoisie, n'a malheureusement pas constitué une impulsion pour étendre la solidarité à cette main d'œuvre et pour l'intégrer dans la classe ouvrière américaine dans son ensemble, mais a servi à donner une explication rationnelle à l'exclusion raciste.
Quoi qu'il en soit, la lutte pour l'unité de la classe ouvrière internationale se poursuivit dans la Deuxième Internationale. Il y a un peu plus de cent ans, au Congrès de Stuttgart de 1907, l'Internationale rejeta massivement une tentative opportuniste proposant de soutenir la restriction par les gouvernements bourgeois de l'immigration chinoise et japonaise. L'opposition fut si grande que les opportunistes furent en fait contraints de retirer leur résolution. A la place, le Congrès adopta une position anti-exclusion pour le mouvement ouvrier dans tous les pays. Dans le Rapport qu'il fait de ce Congrès, Lénine écrivit : "Sur cette question [de l'immigration] également se fit jour en commission une tentative de soutenir d'étroites conceptions de corporation, d'interdire l'immigration d'ouvriers en provenance des pays arriérés (celle des coolies venus de Chine, etc.). C'est là le reflet de l'esprit "aristocratique" que l'on trouve chez les prolétaires de certains pays "civilisés" qui tirent certains avantages de leur situation privilégiée et qui sont pour cela enclins à oublier les impératifs de la solidarité de classe internationale. Mais au Congrès proprement dit, il ne se trouva pas d'apologistes de cette étroitesse petite-bourgeoise de corporation, et la résolution répond pleinement aux exigences de la social-démocratie révolutionnaire." 10
Aux Etats-Unis, lors des Congrès du Parti socialiste, en 1908, 1910 et 1912, les opportunistes cherchèrent à présenter des résolutions permettant d’échapper à la décision du Congrès de Stuttgart et exprimèrent leur soutien à l'opposition de l'AFL (American Federation of Labor) à l’immigration. Mais ils furent battus à chaque fois par des camarades qui défendaient la solidarité internationale de tous les ouvriers. Un délégué admonesta les opportunistes en disant que pour la classe ouvrière "il n’y a pas d’étrangers". D’autres insistèrent sur le fait que le mouvement ouvrier n’a pas à se joindre aux capitalistes contre des groupes d'ouvriers. En 1915, dans une lettre à la Socialist Propaganda League (le précurseur de l'aile gauche du Parti socialiste qui allait fonder, plus tard, le Communist Party et le Communist Labor Party aux Etats-Unis), Lénine écrivait : "Dans notre lutte pour le véritable internationalisme et contre le "jingo-socialisme", notre presse dénonce constamment les chefs opportunistes du S.P. d'Amérique, qui sont partisans de limiter l'immigration des ouvriers chinois et japonais (surtout depuis le congrès de Stuttgart de 1907, et à l'encontre de ses décisions). Nous pensons qu'on ne peut pas, à la fois, être internationaliste et se prononcer en faveur de telles restrictions." 11
Historiquement, les immigrés ont toujours joué un rôle important dans le mouvement ouvrier aux Etats-Unis. Les premiers marxistes révolutionnaires émigrèrent aux Etats-Unis après l’échec de la révolution de 1848 en Allemagne et établirent des liens vitaux avec le centre de la Première Internationale en Europe. Engels introduisit certaines conceptions problématiques dans le mouvement socialiste aux Etats-Unis, concernant les immigrés ; certains aspects étaient justes, mais d’autres étaient erronés et eurent finalement un impact négatif sur les activités organisationnelles du mouvement révolutionnaire américain. Friedrich Engels était préoccupé de la lenteur avec laquelle le mouvement ouvrier commençait à se développer aux Etats-Unis. Il pensait que cela venait de certaines spécificités de la situation en Amérique, notamment de l'absence de tradition féodale avec son fort système de classes, et de l’existence de la Frontier qui servait de soupape de sécurité à la bourgeoisie et permettait aux ouvriers mécontents de fuir leur existence de prolétaires pour devenir fermiers ou colons à l’Ouest. Un autre aspect était le gouffre qui séparait les ouvriers natifs des Etats-Unis et les ouvriers immigrés sur le plan des possibilités économiques ainsi que l’incapacité des ouvriers immigrés de communiquer avec les ouvriers du pays. Par exemple, pour critiquer les immigrés socialistes allemands de ne pas apprendre l’anglais, Engels écrivit : "Ils devront retirer tous les vestiges de leur costume d’étranger. Ils doivent devenir complètement des Américains. Ils ne peuvent attendre que les Américains viennent vers eux ; ce sont eux, la minorité et les immigrés, qui doivent aller vers les Américains qui constituent la vaste majorité de la population et sont nés là. Pour faire cela, ils doivent commencer par apprendre l’anglais." 12 Il est vrai qu’il existait chez les révolutionnaires immigrés allemands dans les années 1880 une tendance à se limiter au travail théorique et à laisser de côté le travail envers les masses des ouvriers du pays, ceux de langue anglaise, ce qui suscita les commentaires d’Engels. Il est également vrai que le mouvement révolutionnaire mené par les immigrants devait s’ouvrir aux ouvriers américains parlant anglais, mais l’insistance sur l’américanisation du mouvement qui était implicite dans les remarques d’Engels s’avéra désastreuse pour le mouvement ouvrier car elle eut pour conséquence de laisser les ouvriers les plus formés et expérimentés dans des rôles secondaires et d'en remettre la direction entre les mains de militants peu formés, dont la qualité première était d’être nés dans le pays et de parler anglais. Après la Révolution russe, l’Internationale communiste poursuivit la même politique et ses conséquences furent encore plus désastreuses pour le jeune Parti communiste. L’insistance de Moscou pour que les militants nés aux Etats-Unis soient nommés à la direction catapulta les opportunistes et les carriéristes comme William Z. Foster à des postes clé, rejeta les révolutionnaires d’Europe de l’Est qui avaient des penchants pour le communisme de gauche à la périphérie du Parti et accéléra le triomphe du stalinisme dans le Parti aux Etats-Unis.
De même, une autre remarque d’Engels était aussi problématique: "Il me semble que le grand obstacle aux Etats-Unis réside dans la position exceptionnelle des ouvriers du pays… (La classe ouvrière du pays) a développé et s’est aussi, dans une grande mesure, organisée elle-même en syndicats. Mais elle garde toujours une attitude aristocratique et quand c’est possible, laisse les emplois ordinaires et mal payés aux immigrants dont seulement une petite partie adhère aux syndicats aristocratiques." 13. Même si elle décrivait de façon tout à fait juste la façon dont les ouvriers du pays et les immigrés étaient effectivement divisés entre eux, elle sous-entendait de façon erronée que c’étaient les ouvriers américains et pas la bourgeoisie qui étaient responsables du gouffre entre les différentes parties de la classe ouvrière. Alors que ces commentaires parlaient des divisions dans la classe ouvrière immigrée blanche, les nouveaux gauchistes les interprétèrent, au cours des années 1960, dans le sens de donner une base à la "théorie" du "privilège de la peau blanche". 14
De toutes façons, l’histoire même de la lutte de classe aux Etats-Unis a réfuté la vision d’Engels selon laquelle l’américanisation des immigrés constituait une pré-condition à la constitution d’un mouvement socialiste fort aux Etats-Unis. La solidarité et l’unité de classe au delà des aspects ethniques et linguistiques furent une caractéristique centrale du mouvement ouvrier au tournant du 20e siècle. Les partis socialistes américains avaient une presse de langue étrangère et publiaient des dizaines de journaux, quotidiens et hebdomadaires, en plusieurs langues. En 1912, le Socialist Party publiait aux Etats-Unis 5 quotidiens en anglais et 8 dans d’autres langues, 262 hebdomadaires en anglais et 36 dans d’autres langues, 10 mensuels d’actualité en anglais et 2 dans d’autres langues, et ceci n’inclut pas les publications du Socialist Labor Party. A l'intérieur du Socialist Party, il existait 31 fédérations de langue étrangère : arménienne, bohémienne, bulgare, croate, tchèque, danoise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hispanique, hongroise, irlandaise, italienne, japonaise, juive, lettonne, lithuanienne, norvégienne, polonaise, roumaine, russe, scandinave, serbe, slovaque, slovène, slave du sud, espagnole, suédoise, ukrainienne, yougoslave. Ces fédérations constituaient la majorité de l’organisation. La majorité des membres du Communist Party et du Communist Labor Party, fondés en 1919, étaient des immigrés. De même le développement des Industrial Workers of the World (IWW) dans la période qui a précédé la Première Guerre mondiale provenait essentiellement de l’adhésion des immigrés, et même les IWW à l’Ouest qui comptaient beaucoup d’Américains "de naissance", comportaient des milliers de Slaves, de Chicanos et de Scandinaves dans leurs rangs.
La lutte la plus fameuse des IWW, la grève dans le textile à Lawrence en 1912, montra la capacité de solidarité entre les ouvriers immigrés et non immigrés. Lawrence était une ville industrielle du Massachusetts où les conditions de travail étaient déplorables. La moitié des ouvriers étaient des adolescentes entre 14 et 18 ans. Les ouvriers qualifiés étaient en général des gens qui parlaient anglais de descendance anglaise, irlandaise ou allemande. Les ouvriers non qualifiés étaient des Canadiens français, des Italiens, des Slaves, des Hongrois, des Portugais, des Syriens et des Polonais. Une baisse des salaires dans l’une des usines suscita une grève chez les femmes tisserandes polonaises qui s’étendit rapidement à 20 000 ouvriers. Un comité de grève organisé avec les IWW comprenait deux représentants de chaque groupe ethnique et réclamait 15 % d’augmentation de salaire et pas de représailles contre les grévistes. Les réunions pendant la grève étaient traduites en vingt-cinq langues. Lorsque les autorités répondirent par la répression violente, le comité de grève lança une campagne en envoyant plusieurs centaines d’enfants de grévistes chez des sympathisants de la classe à New York. Quand le second convoi de 100 enfants partit pour se rendre chez des sympathisants dans le New Jersey, les autorités s’en prirent aux mères et aux enfants, les arrêtèrent et les molestèrent devant la presse nationale ; cela eut pour résultat un déploiement national de solidarité. Les IWW utilisèrent la même tactique, lors d’une grève dans le secteur de la soie à Paterson, dans le New Jersey, en 1913, en envoyant les enfants d’ouvriers immigrés grévistes chez des "mères de grèves" dans d'autres villes ; à cette occasion encore, les ouvriers démontrèrent leur solidarité de classe par delà les barrières ethniques.
Au cours de la guerre, le rôle des émigrés et immigrants de l’aile gauche du mouvement socialiste fut particulièrement important. Par exemple, Trotsky participa à une réunion, le 14 janvier 1917 à Brooklyn, chez Ludwig Lore, immigrant d’Allemagne, pour planifier un "programme d’action" des forces de gauche du mouvement socialiste américain ; il venait d’arriver la veille à New York ; participèrent aussi Boukharine qui résidait déjà aux Etats-Unis et travaillait comme éditeur de Novy Mir, l’organe de la Fédération socialiste de Russie ; plusieurs autres immigrés russes ; S.J. Rutgers, révolutionnaire hollandais, compagnon de lutte de Pannekoek ; et Sen Katayama, émigré japonais. Selon des témoins visuels, les Russes dominèrent la discussion ; Boukharine défendait la scission immédiate de la gauche avec le Socialist Party, et Trotsky que la gauche devait rester dans le Parti pour le moment, mais devait développer sa critique en publiant tous les quinze jours une publication indépendante ; c’est cette dernière position qui fut adoptée par la réunion. S’il n’était pas rentré en Russie après la révolution de février, Trotsky aurait probablement été à la tête de l’aile gauche du mouvement américain. 15 La coexistence de plusieurs langues ne constituait pas un obstacle au mouvement ; au contraire, c’était un reflet de sa force. Lors d’une manifestation massive en 1917, Trotsky s’adressa à la foule en russe et d’autres en allemand, finnois, anglais, letton, yiddish et lithuanien. 16
La théorisation bourgeoise de l’idéologie anti-immigrés
Les idéologues bourgeois défendent l’idée que les caractéristiques de l’émigration massive actuelle vers l’Europe et les Etats-Unis sont totalement différentes de celles de l'émigration dans des périodes précédentes de l’histoire. Il y a derrière cela l’idée que, aujourd'hui, les immigrés affaiblissent, détruisent même les sociétés qui les accueillent, refusent de s’intégrer dans leur nouvelle société et en rejettent les institutions politiques et la culture. En Europe, le livre de Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, publié en 2007, défend l’idée que l’immigration musulmane est responsable du déclin européen.
Le professeur de sciences politiques bourgeois, Samuel P. Huntington de l’Université de Harvard, dans son livre publié en 2004, Who Are We: The Challenges to America's National Identity défend le point de vue que les immigrés d’Amérique latine, les Mexicains en particulier, qui sont arrivés aux Etats-Unis au cours des trois dernières décennies parleront probablement moins l’anglais que les précédentes générations d’immigrés venant d’Europe parce qu’ils parlent tous la même langue, qu’ils sont concentrés dans les mêmes régions et sont confinés dans des enclaves où l’on parle espagnol, qu’ils sont moins intéressés à s’assimiler d’un point de vue linguistique et culturel et sont encouragés à ne pas apprendre l’anglais par les gauchistes qui fomentent des politiques identitaires. Huntington déclare en plus que la "bifurcation", la division de la société américaine selon des lignes de division raciale noirs/blancs qui a existé pendant des générations, est aujourd’hui menacée d’être déplacée/remplacée par une "bifurcation" culturelle entre les immigrés de langue espagnole et les américains de souche qui parlent anglais, ce qui met en jeu l’identité et la culture nationales américaines.
Laqueur comme Huntington s'enorgueillissent de leur éminente carrière d'idéologues de la Guerre froide au service de la bourgeoisie. Laqueur est un érudit juif conservateur, survivant de l’Holocauste, farouchement pro-sioniste, anti-arabe, et consultant du Centre d’Etudes internationales et stratégiques (CSIS) de Washington qui a servi de "groupe de réflexion" pendant la Guerre froide en étroit lien avec le Pentagone à partir de 1962. L'ancien Secrétaire d'Etat de Bush à la Défense, Rumsfeld, a régulièrement consulté le CSIS. Huntington, professeur de sciences politiques à Harvard, a été conseiller de Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam et, en 1968, a recommandé une politique de grand bombardement des campagnes vietnamiennes afin de saper le soutien des paysans au Viêt-Cong et les forcer à aller dans les villes. Plus tard, il a travaillé avec la Commission trilatérale dans les années 1970, est l’auteur du rapport sur la Governibility of Democracies (La crise de la démocratie : Rapport sur La gouvernabilité des démocraties à la Commission trilatérale) en 1976. A la fin des années 1970, sous l’administration Carter, il a servi comme coordonnateur politique du Conseil national de Sécurité. En 1993, il a écrit un article dans Foreign Affairs qui est devenu un livre par la suite, intitulé Le choc des civilisations (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), dans lequel il développe la thèse selon laquelle, après l’effondrement de l’URSS, ce serait la culture et non plus l’idéologie qui deviendrait la base la plus importante des conflits dans le monde. Il prévoyait qu’un choc de civilisations imminent entre l’Islam et l’Occident constituerait le conflit international central dans le futur. Bien que le point de vue de Huntington sur l’immigration en 2004 ait été en grande partie écarté par les intellectuels spécialisés dans l’étude des populations et les questions de l’immigration et de l’assimilation, ses vues ont été largement répandues par les médias et les experts en politique autour de Washington.
Les protestations d'Huntington sur le fait que les immigrés de langue étrangère refuseraient d’apprendre l’anglais, résisteraient à l’assimilation et contribueraient à la pollution culturelle, n’ont rien de nouveau aux Etats-Unis. A la fin des années 1700, Benjamin Franklin avait peur que la Pennsylvanie ne soit submergée par la "nuée" des immigrés d’Allemagne. "Pourquoi la Pennsylvanie", demandait Franklin, "fondée par les Anglais, devrait-elle devenir une colonie d’étrangers qui seront bientôt si nombreux qu’ils nous germaniseront plutôt que nous les anglicisions ?". En 1896, le président Francis Walker de l’Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), économiste influent, mettait en garde contre le fait que la citoyenneté américaine pourrait être dégradée par "l’accès tumultueux de multitudes de paysans ignorants et brutalisés des pays d’Europe de l’Est et du Sud". Le président Théodore Roosevelt était si contrarié par l’afflux d’immigrés de langue étrangère qu’il proposa : "Il faut exiger de tous les immigrés qui viennent ici qu'ils apprennent l’anglais dans les cinq ans ou qu'ils quittent le pays". L’historien de Harvard, Arthur Schlesinger Senior, a déploré de la même façon "l’infériorité" sociale, culturelle et intellectuelle des immigrés d’Europe du Sud et de l’Est. Toutes ces plaintes et ces peurs d’hier sont remarquablement similaires à celles de Huntington aujourd’hui.
La réalité historique n'a jamais donné raison à ces peurs xénophobes. Même s’il a toujours existé, dans chaque groupe d’immigrés, une certaine partie qui cherchait à apprendre l’anglais à tout prix, à s’assimiler rapidement et à réussir économiquement, habituellement, l’assimilation s'est développée de façon graduelle – en général sur une période de trois générations. Les immigrants adultes conservaient en général leur langue maternelle et leurs traditions culturelles aux Etats-Unis. Ils vivaient dans des quartiers d’immigrés où ils parlaient leur langue dans la communauté, dans les magasins, dans les réunions religieuses, etc. Ils lisaient des livres et des journaux dans leur langue natale. Leurs enfants, immigrés quand ils étaient très jeunes ou nés aux Etats-Unis, étaient en général bilingues. Ils apprenaient l’anglais à l’école et, au 20e siècle, étaient entourés par l’anglais dans la culture de masse, mais parlaient aussi la langue de leurs parents à la maison et se mariaient en général au sein de leur communauté ethnique. A la troisième génération, les petits-enfants des immigrés perdaient en général l’habitude de parler la langue de leurs grands parents et tendaient à ne parler que l’anglais. Leur assimilation culturelle était marquée par une tendance croissante à se marier en dehors de la communauté ethnique d’origine. Malgré l'importance de l'immigration hispanique au cours des dernières années, les mêmes tendances à l'assimilation semblent perdurer de la même façon dans la période actuelle aux Etats-Unis, selon de récentes études du Pew Hispanic Center et de l'Université de Princeton. 17
Cependant, même si la vague actuelle d’immigration était qualitativement différente des précédentes, quelle importance cela aurait-il ? Si les ouvriers n’ont pas de patrie, pourquoi serions-nous concernés par la question de l’assimilation ? Engels a défendu l'américanisation dans les années 1880 non comme une fin en soi, comme une sorte de principe intemporel du mouvement ouvrier, mais comme un moyen de construire un mouvement socialiste de masse. Mais, comme nous l’avons vu, l'idée que l’américanisation constituerait une pré-condition nécessaire pour développer l’unité de la classe ouvrière a été réfutée par la pratique du mouvement ouvrier lui-même au début du 20e siècle, qui a démontré, sans équivoque possible, que le mouvement ouvrier peut embrasser la diversité et le caractère international du prolétariat et construire un mouvement uni contre la classe dominante.
Alors que les récentes émeutes dans les bidonvilles d’Afrique du Sud constituent un signal d’alerte par rapport au fait que les campagnes anti-immigrés de la bourgeoisie mènent à la barbarie dans la vie sociale, il est évident que la propagande capitaliste exagère la colère anti-immigrés dans la classe ouvrière des métropoles. Aux Etats-unis par exemple, malgré les grands efforts des médias bourgeois et la propagande d'extrême-droite pour attiser la haine contre les immigrés sur les questions de langue et de culture, l’attitude dominante dans la population en général, y compris chez les ouvriers, est de considérer que les immigrés sont des travailleurs qui cherchent à gagner leur vie pour soutenir leurs familles, qu’ils font un travail trop pénible et trop mal payé pour les ouvriers "du pays" et qu’il serait insensé de les renvoyer. 18 Dans la lutte de classe elle-même, il y a de plus en plus de manifestations de solidarité entre ouvriers immigrés et ouvriers "de souche", qui rappellent l'unité internationaliste à Lawrence en 1912. Par exemple, il y a eu les luttes de 2008 comme le soulèvement en Grèce où les ouvriers immigrés ont rejoint la lutte, ou la grève de la raffinerie de Lindsey en Grande-Bretagne en 2009 où les immigrés ont clairement exprimé leur solidarité, ou encore, aux Etats-Unis, lors de l'occupation par les ouvriers immigrés hispaniques de l'usine Window and Door Republic devant laquelle les ouvriers "natifs" se sont rassemblés pour montrer leur soutien en apportant notamment de quoi manger.
L'intervention des révolutionnaires sur la question de l'immigration
D’après ce que rapportent les médias, 80 % des Britanniques pensent que le Royaume Uni fait face à une crise de population du fait de l’immigration ; plus de 50 % ont peur que la culture britannique ne disparaisse ; 60 % que la Grande-Bretagne est plus dangereuse du fait de l’immigration ; et 85 % veulent que l’on diminue ou mette un terme à l’immigration. 19 Le fait qu’il existe une réceptivité à la peur irrationnelle exprimée dans le racisme et la xénophobie propagée par l'idéologie bourgeoise chez certains éléments de la classe ouvrière ne nous surprend pas dans la mesure où l'idéologie de la classe dominante, dans une société de classe, exerce une immense influence sur la classe ouvrière jusqu'à ce que se développe une situation ouvertement révolutionnaire. Cependant, quel que soit le succès de l'intrusion idéologique de la bourgeoisie dans la classe ouvrière, pour le mouvement révolutionnaire, le principe selon lequel la classe ouvrière mondiale est une unité, les ouvriers n’ont pas de patrie, est un principe de base de la solidarité prolétarienne internationale et de la conscience de la classe ouvrière. Tout ce qui insiste sur les particularismes nationaux, aggrave, manipule ou contribue à la "désunion" de la classe ouvrière est contraire à la nature internationaliste du prolétariat comme classe, et est une manifestation de l’idéologie bourgeoise que les révolutionnaires combattent. Notre responsabilité est de défendre la vérité historique : les ouvriers n’ont pas de patrie.
Quoi qu’il en soit, comme d’habitude, les accusations de l’idéologie bourgeoise contre les immigrés sont plus un mythe qu’une réalité. Il y a bien plus de probabilités que les immigrés soient victimes de criminels qu'ils ne soient des criminels eux-mêmes. De façon générale, les immigrés sont honnêtes, des ouvriers qui travaillent dur, surexploités au-delà de toute limite, pour gagner de quoi vivre et envoyer de l’argent à leur famille restée "au pays". Ils sont souvent floués par des patrons peu scrupuleux qui les paient moins que le salaire minimum et refusent de payer leurs heures supplémentaires, par des propriétaires tout aussi peu scrupuleux qui leur font payer des loyers exorbitants pour de vrais taudis, et par toutes sortes de voleurs et d’agresseurs – qui tous comptent sur la peur des immigrés envers les autorités qui les empêche de porter plainte. Les statistiques montrent que la criminalité a tendance à augmenter chez les seconde et troisième générations dans les familles d’immigrés ; pas parce qu’ils proviennent de l’immigration mais du fait de leur pauvreté continuellement oppressante, de la discrimination et du manque de perspectives en tant que pauvres.20
Il est essentiel d’être clair sur la différence existant aujourd’hui entre la position de la Gauche communiste et celle de tous les défenseurs d'une idéologie anti-raciste (y compris ceux qui se prétendent révolutionnaires). Malgré la dénonciation du caractère raciste de l'idéologie anti-immigrés, les actions qu'ils préconisent restent sur le même terrain. Au lieu de souligner l’unité fondamentale de la classe ouvrière, ils mettent en avant ses divisions. Dans une version mise à jour de la vieille théorie du "privilège de la peau blanche", on blâme, avec des arguments moralistes, les ouvriers qui se méfient des immigrés, et pas le capitalisme pour son racisme anti-immigrés ; et on poursuit même en glorifiant les ouvriers immigrés comme des héros plus purs que les ouvriers de souche. Les "anti-racistes" soutiennent les immigrés contre les non-immigrés au lieu de mettre en avant l’unité de la classe ouvrière. L’idéologie multiculturelle qu'ils propagent dévoie la conscience de classe des ouvriers sur le terrain de la "politique d’identité" pour laquelle c’est "l’identité" nationale, linguistique, ethnique qui est déterminante, et pas l’appartenance à la même classe. Cette idéologie empoisonnée dit que les ouvriers mexicains ont plus en commun avec les éléments mexicains bourgeois qu’avec les autres ouvriers. Face au mécontentement des ouvriers immigrés confrontés aux persécutions qu’ils subissent, l'anti-racisme les enchaîne à l’Etat. La solution qui est proposée aux problèmes des immigrés est invariablement d’avoir recours à la légalité bourgeoise, que ce soit en recrutant les ouvriers pour les syndicats, ou pour la réforme de la loi sur l’immigration, ou en enrôlant les immigrés dans la politique électorale ou la reconnaissance formelle de "droits" légaux. Tout sauf la lutte de classe unie du prolétariat.
La dénonciation par la Gauche communiste de la xénophobie et du racisme contre les immigrés se distingue radicalement de cette idéologie anti-raciste. Notre position est en continuité directe avec celle qu’a défendue le mouvement révolutionnaire depuis la Ligue des communistes et le Manifeste communiste, la Première Internationale, la gauche de la Deuxième Internationale, les IWW et les Partis communistes à leurs débuts. Notre intervention insiste sur l’unité fondamentale du prolétariat, dénonce les tentatives de la bourgeoisie de diviser les ouvriers entre eux, s’oppose au légalisme bourgeois, aux politiques identitaires et à l’interclassisme. Par exemple, le CCI a défendu cette position internationaliste aux Etats-Unis en dénonçant la manipulation capitaliste visant à ce que les manifestations de 2006 (en faveur de la légalisation des immigrés) aient été composées principalement d’immigrés hispaniques. Comme nous l’avons écrit dans Internationalism 21, ces manifestations étaient "dans une grande mesure une manipulation bourgeoise", "totalement sur le terrain de la bourgeoisie qui a provoqué les manifestations, les a manipulées, contrôlées et ouvertement dirigées", et étaient infestées de nationalisme, "que ce soit le nationalisme latino qui à surgi au début des manifestations ou la ruée écœurante pour affirmer son récent américanisme " qui "avait pour but de court-circuiter totalement toute possibilité pour les immigrés et les ouvriers de souche américaine de reconnaître leur unité essentielle."
Par dessus tout, nous devons défendre l’unité internationale de la classe ouvrière. Comme internationalistes prolétariens, nous rejetons l’idéologie bourgeoise et ses constructions sur "la pollution culturelle", la "pollution linguistique", "l’identité nationale", "la méfiance envers les étrangers" ou "la défense de la communauté ou du quartier". Au contraire, notre intervention doit défendre les acquis historiques du mouvement ouvrier : les ouvriers n’ont pas de patrie ; la défense de la culture nationale, de la langue ou de l’identité n’est pas une tâche ni une préoccupation du prolétariat ; nous devons rejeter les tentatives de tous ceux qui cherchent à utiliser les conceptions bourgeoises pour exacerber les différences au sein de la classe ouvrière, pour saper son unité. Quelles que soient les intrusions d'une idéologie de classe étrangère qui ont pu historiquement avoir lieu, le fil rouge qui traverse toute l'histoire du mouvement ouvrier est la solidarité et l'unité de classe internationaliste. Le prolétariat vient de beaucoup de pays, parle beaucoup de langues mais est une seule classe mondiale dont la responsabilité historique est d'affronter le système d'exploitation et d'oppression capitaliste. Nous considérons la diversité ethnique, culturelle, linguistique de notre classe avant tout comme une force et nous soutenons la solidarité internationale prolétarienne face aux tentatives de nous diviser entre nous. Nous devons transformer le principe "les ouvriers n'ont pas de patrie" en une réalité vivante qui contient la possibilité de créer une communauté humaine authentique dans une société communiste. Toute autre perspective constitue un abandon du principe révolutionnaire.
Jerry Grevin
1 Rainer Muenz : "Europe : Population and Migration in 2005 [11]"
2 Révolution internationale n° 253, février 1996.
3 Marx, Le Capital, Vol.I, chapitre 26, "L'accumulation primitive" (Ed. La Pléiade)
4 Le développement du capitalisme en Russie " VI. "La mission" historique du capitalisme [12]".
5 Franz Mehring, Karl Marx, traduit de l'anglais par nous.
6 Ibid.
7 GM Stekloff, History of the First International, Angleterre 1928, traduit de l'anglais par nous.
8 Franz Mehring, op.cit.
9 Ibid.
10 "Le Congrès socialiste internationale de Stuttgart", publié le 20 octobre 1907 dans le n°17 de Prolétari, Oeuvres complètes, Tome 13, p. 79, Editions sociales. Nous laissons de côté la discussion de la question de l' "aristocratie ouvrière", implicite dans le texte de Lénine.
11 Lettre au secrétaire de la SPL [13], 9 novembre 1915.
12 Lettre aux Américains, traduit de l'anglais par nous.
13 Lettre à Schlüter, op.cit
14 La "White Skin Privilege Theory" ou "théorie du privilège de la peau blanche" a été concoctée par les nouveaux gauchistes des années 1960 qui prétendaient que la classe dominante et la classe ouvrière blanche avaient un deal pour accorder aux ouvriers blancs un niveau de vie supérieur, aux dépens des ouvriers noirs qui subissaient le racisme et la discrimination.
15 Cf. Theodore Draper, The Roots of American Communism
16 Ibid.
17 Voir "2003-2004 Pew hispanic Center.the Kaiser Family Foundation Survey of Latinos: Education" et Rambaut, reuben G., Massey, Douglas, S. and Bean, Frank D. "Linguistic Life Expectancies: Immigrant Language Retention in Southern California. Population and Development", 32 (3): 47-460, septembre 2006
18 "Problems and Priorities", PollingReport.com.
19 Sunday Express, 6 avril 2008
20 States News Service, Immigration Fact Check : Responding to Key Myths, 22 juin 2007.
21 Internationalism, n° 139, été 2006 : « Immigrant demonstrations : Yes to the unity with the working class ! No to the unity with the exploiters [14]!”
Récent et en cours:
- Immigration [15]
Rubrique:
L'automne chaud 1969 en Italie, un moment de la reprise historique de la lutte de classe (I)
- 7093 lectures
Ce qu'il reste généralement en mémoire de "l’Automne chaud italien" 1, qui est intervenu il y a juste 40 ans, c'est un ensemble de luttes qui ont secoué l’Italie du Piémont à la Sicile et qui ont changé de façon durable le cadre social et politique de ce pays. Mais il ne s’agissait pas d’une spécificité italienne puisque, à la fin des années 1960, on a pu assister, particulièrement en Europe mais pas seulement, au développement d’une série de luttes et de moments de prise de conscience dans le prolétariat, qui montraient, dans leur ensemble, que quelque chose avait changé : la classe ouvrière revenait sur la scène sociale. Elle reprenait sa lutte historique contre la bourgeoisie, après la longue nuit des années de contre-révolution où l’avaient plongée la défaite des années 1920, la Seconde Guerre mondiale et l’action contre-révolutionnaire du stalinisme. Le "Mai français" de 1968 2, les grèves en Pologne de 1970 3 et les luttes en Argentine 4 de 1969-73 constituent, avec l’Automne chaud en Italie, les moments les plus importants de cette nouvelle dynamique qui affecte tous les pays du monde, ouvrant une nouvelle période d’affrontements sociaux qui, avec des hauts et des bas, perdure jusqu’à maintenant.
Comment en est-on arrivé à l’Automne chaud ?
Instruite par l'expérience de Mai 68, la bourgeoisie italienne ne se laisse pas surprendre par l'explosion de luttes en 1969, comme cela était arrivé à la bourgeoisie française l'année précédente. Cela ne l'empêchera pas toutefois de se trouver parfois débordée face aux évènements. Ceux-ci ne sont pas apparus comme un éclair dans un ciel bleu. En réalité, de multiples facteurs, tant au niveau national qu’au niveau international, concourent alors à créer une atmosphère nouvelle dans la classe ouvrière italienne et particulièrement chez les jeunes.
Le climat international
Au niveau international, une frange importante de la jeunesse est sensibilisée par un ensemble de situations, notamment :
- La guerre du Vietnam 5, qui apparaît comme le combat entre David-Vietnam et Goliath-USA. Indignés par les atroces massacres au napalm et autres violences infligées par l’armée américaine aux populations locales, beaucoup ont été portés à s’identifier à la résistance Viêt-Cong et à prendre parti pour le "pauvre petit" Vietnam contre le puissant "impérialisme" américain 6 ;
- L’épopée de Che Guevara 7, avec son auréole de héros se battant pour la libération de l’humanité, et d’autant plus vénéré par des générations successives qu’il a été assassiné par l’armée bolivienne et les forces spéciales de la CIA en octobre 1967 ;
- Les menées des guérilleros palestiniens 8, en particulier celles du FPLP de George Habache, qui se développent dans le contexte des réactions hostiles au résultat de la Guerre des six jours, menée et gagnée en juin 1967 par Israël contre l’Égypte, la Syrie et la Jordanie ;
- L’écho international du "communisme chinois" présenté comme la véritable expression d’instauration du communisme, par opposition au "communisme soviétique" bureaucratisé. En particulier, la "révolution culturelle" 9 déclenchée par Mao Zedong dans la période 1966-1969, se définit comme une lutte pour revenir à l’application orthodoxe de la pensée marxiste-léniniste.
Aucun de ces faits n’est lié de près ou de loin à la lutte de classe du prolétariat en vue du renversement du capitalisme : les horreurs subies par la population vietnamienne dans la guerre sont le fait des antagonismes impérialistes entre les deux blocs rivaux qui se partagent alors le monde ; la résistance incarnée par les guérilleros, qu’ils soient palestiniens ou guevaristes, n’est autre qu’un moment de la lutte à mort entre ces deux blocs pour la domination sur d’autres régions du monde ; quant au "communisme" en Chine, il est tout aussi capitaliste que celui existant en URSS et la dite "révolution culturelle" n’est en fait qu’une lutte pour le pouvoir entre la faction de Mao et celle de Deng Xiaoping et Liu Shaoqi.
Néanmoins, tous ces événements témoignent d’une profonde souffrance de l’humanité inspirant à beaucoup d’éléments un dégoût profond pour les violences de la guerre et un sentiment de solidarité vis-à-vis des populations qui en sont victimes. Quant au maoïsme, s’il ne représente en rien une solution face aux maux de l’humanité, mais bien une mystification et une entrave supplémentaires en travers du chemin de son émancipation, il alimente une contestation internationale concernant la nature réelle du "communisme" en Russie.
Dans ce contexte, l’explosion des luttes étudiantes et ouvrières du Mai français a un écho international tel qu’elle représente un point de référence et un facteur d’encouragement pour les jeunes et les prolétaires du monde entier. Mai 68 est en fait la démonstration du fait que non seulement on peut lutter mais aussi gagner. Ce même Mai, cependant, au moins dans sa composante des luttes étudiantes, a été préparé par d’autres mouvements, comme ceux qui s’étaient produits en Allemagne avec l’expérience de la Kritische Universität 10 et la formation du SDS (Socialistischer Deutscher Stundentenbund), ou en Hollande avec celle des Provos, ou encore aux États-Unis avec le parti des Black Panthers. Nous sommes en quelque sorte dans une époque où tout ce qui se passe dans le monde a un grand écho dans tous les autres pays du fait de la réceptivité importante qui existe, surtout parmi la jeune génération de prolétaires et d’étudiants qui sera un protagoniste essentiel de l’Automne chaud. L’angoisse et la réflexion ambiantes inspireront des personnages charismatiques du monde du spectacle, comme Bob Dylan, Joan Baez, Jimmy Hendrix et d’autres dont les chansons évoquent tantôt les revendications des peuples et des couches sociales historiquement réprimées et exploitées (comme les noirs d’Amérique), tantôt les atrocités de la guerre (comme celle du Vietnam) et exaltent la volonté de s’émanciper.
Politisation sur le plan national
En Italie aussi, comme en France auparavant, l’affaiblissement de la chape de plomb qu’avait constitué le stalinisme pendant toutes les années de contre-révolution permet le développement d’un phénomène de maturation politique constituant le terrain favorable à l’émergence de diverses minorités qui reprendront un travail de recherche et de clarification. Par ailleurs, l’arrivée d’une nouvelle génération de prolétaires se traduit par une plus grande combativité débouchant sur des caractéristiques nouvelles de la lutte et des expériences d’affrontements de rue qui marqueront la classe ouvrière.
L’expérience des Quaderni Rossi (QR, Cahiers Rouges)
Au début des années 1960, alors que nous nous trouvions encore en pleine contre-révolution, de petits groupes d’éléments – critiques vis-à-vis du stalinisme – ont cherché, autant que cela leur était possible à « repartir de zéro ». De fait, à cette époque, le PCI (Parti communiste italien) passé à la contre-révolution et stalinisé lui aussi comme les autres PC dans le monde, dispose d'une base importante de membres et de sympathisants, en partie grâce à l’auréole héritée du vieux parti révolutionnaire fondé par Bordiga en 1921. La longue vingtaine d’années du fascisme en Italie et la disparition des partis "démocrates" ont évité au PCI, plus qu’aux autres PC, d’être identifié comme véritable ennemi de classe par la grande masse des ouvriers. Cependant, déjà dans les années 1950, et encore plus dans les années 60, ont commencé à apparaître, au sein même du PCI, des minorités cherchant à revenir aux vraies positions de classe. On revient surtout à Marx alors que Lénine est moins lu pendant cette période. On redécouvre aussi Rosa Luxembourg.
Une des expériences qui fait référence pendant cette période est celle des Quaderni Rossi, groupe à l’intérieur du PCI, né autour de la personne de Raniero Panzieri et qui, au cours de son existence (1961-1966), n’a publié que 6 numéros d’une revue qui va cependant avoir un poids énorme dans l’histoire de la réflexion théorique de la gauche en Italie. C’est à cette revue que l’on peut faire remonter l’origine du courant qui prendra le nom de "operaismo" dont nous parlerons ensuite. Les deux principaux groupes de l’opéraïsme italien, Potere Operaio et Lotta Continua, viennent de cette même matrice. Le travail des Quaderni Rossi se partage entre la relecture du Capital, la "découverte" des Grundrisse de Marx et les recherches sur la nouvelle composition de la classe ouvrière. "(…) Quaderni Rossi, la revue de Raniero Panzieri, Vittorio Foa, Mario Tronti et Alberto Asor Rosa, entre 1961 et 1966 s’est trouvée en avance sur l’intuition qui sera au centre de la ligne politique de Lotta Continua : la révolution ne sortira pas des urnes ou des partis (…) ; il s’agit de libérer l'expression de l'antagonisme entre les ouvriers et l'exploitation, antagonisme qui ne doit pas être canalisée dans les accords d'entreprise et les réformes, mais plutôt soustraite à la tutelle des syndicalistes et des ingénieurs et axée sur la perspective du contrôle de la production et d’un changement global du système" 11.
Panzieri a pour projet de rassembler des tendances et des points de vue plutôt variés et éloignés, alors que la période, encore fortement marquée par la contre-révolution, n’autorise pas une entreprise de cet ordre. Ainsi, "au début de 1962, alors que s’ouvrait à peine le débat sur le premier numéro de la revue, le groupe des syndicalistes se retire ; en juillet de la même année, après les événements de la Place Statuto, il y a un premier départ des interventionnistes (qui vont produire le journal "Gatto selvaggio" (Chat sauvage)" 12.
Parallèlement à l’expérience des QR, a lieu dans la région de Venise une autre expérience, de moindre ampleur politique cependant, Progresso Veneto. Celui qui sera le trait d’union entre les deux expériences est un personnage qui deviendra très célèbre par la suite et qui commence sa carrière politique comme conseiller municipal de la commune de Padoue : il s’agit de Toni Negri. Le Progresso Veneto, actif entre décembre 1961 et mars 1962, est le lieu où commence à se forger l’opéraisme vénitien, avec une référence particulière à la région industrielle de Porto Marghera. QR et Progresso Veneto travaillent en symbiose pendant un certain temps jusqu’à ce que le groupe du Veneto (Vénétie) subisse, en juin 1963, une scission entre opéraïstes et socialistes plus fidèles au parti d’appartenance.
Mais la scission la plus importante est celle qui se produit en 1964 au sein de QR. Du groupe d’origine vont sortir Mario Tronti, Alberto Asor Rosa, Massimo Cacciari, Rita Di Leo et d’autres pour fonder Classe Operaia (Classe ouvrière). Tandis que Panzieri reste fixé sur une recherche de type sociologique, sans impact significatif sur la réalité, Classe Operaia se propose d’avoir une présence et une influence immédiate dans la classe ouvrière, jugeant que les temps sont mûrs pour cela : "A nos yeux, leur travail semblait une sophistication intellectuelle, par rapport à ce que nous considérions comme étant une exigence pressante, c'est-à-dire faire comprendre au syndicat comment il devait faire son métier de syndicaliste et au parti comment il devait faire la révolution" 13.
Classe Operaia sera rejoint par une partie des opéraïstes de Progresso Veneto, et va être dirigé par Mario Tronti. Au début au moins, Negri, Cacciari et Ferrari Bravo y participent. Mais la nouvelle revue connaît elle-même une vie difficile : la rédaction vénitienne de Classe Operaia commence à prendre lentement ses distances avec celle de Rome. De fait, alors que les romains se rapprochent de la maison mère PCI, les vénitiens donnent naissance à Potere Operaio qui sort au début comme supplément à Classe Operaia sous forme d’une revue-tract. Classe Operaia commence à agoniser en 1965, mais le dernier fascicule est de mars 1967. Ce même mois naît Potere Operaio, en tant que journal politique des ouvriers de Porto Marghera 14.
En dehors de Quaderni Rossi et de ses différents épigones, il y a en Italie un réseau dense d’autres initiatives éditoriales, parfois nées dans des domaines culturels spécifiques comme le cinéma ou la littérature, qui acquièrent progressivement plus d’ampleur politique et un certain caractère militant. Des publications comme Giovane Critica, Quaderni Piacentini, Nuovo Impegno, Quindici, Lavoro Politico, sont aussi des expressions et des composantes de cette maturation qui conduira aux événements des deux années 68-69.
On voit donc qu’il existe un long travail politique articulé à l’aube de l’Automne chaud qui permet, au moins au niveau des minorités, le développement d’une pensée politique et la récupération, encore que très partielle, du patrimoine des classiques du marxisme. Mais il faut encore souligner que celles qui vont devenir les formations opéraistes les plus significatives des années 1970 sont profondément enracinées dans la culture politique du vieux PCI et qu’elles se développent à une époque bien antérieure à celle de la grande explosion des luttes de 1969 et de celles des étudiants de 1968. Avoir le parti stalinien comme point de départ et de référence, même si c’est en négatif à travers sa critique, constitue, comme nous le verrons, la limite la plus forte à l’expérience des groupes opéraistes et pour le mouvement de l’époque lui-même.
La "nouvelle" classe ouvrière
Au niveau social, le facteur probablement déterminant du développement de la situation fut la forte croissance de la classe ouvrière dans les années du miracle économique, aux dépens surtout des populations de la campagne et des zones périphériques du sud. "En résumé, nous nous trouvons devant une élite d’ouvriers professionnels qui sont entourés d’une grande majorité d’ouvriers sans qualification qui travaillent sur des cycles extrêmement brefs, quelquefois quelques secondes, soumis à un contrôle rigide du temps qu’ils mettent dans le travail à la pièce et sans aucune perspective de carrière professionnelle" 15. Cette nouvelle génération de prolétaires qui vient du sud ne connaît pas encore le travail en usine et ne s’est pas encore soumise à ses contraintes ; par ailleurs, étant jeunes et occupant souvent leur premier emploi, ces prolétaires ne connaissent pas le syndicat et, surtout, ne subissent pas le poids des défaites des décennies passées, de la guerre, du fascisme, de la répression, mais seulement le bouillonnement de ceux qui découvrent un monde nouveau et veulent le modeler à leur gré. Cette "nouvelle" classe ouvrière, jeune, non politisée ni syndiquée, sans ce poids de l'histoire sur elle, fera, en grande partie, l’histoire de l’Automne chaud.
Les mouvements de juillet 1960 et les affrontements de Piazza Statuto de juillet 1962.
Les luttes ouvrières de l’Automne chaud ont un prélude significatif au début des années 60, lors de deux épisodes de lutte importants : les mouvements de rue de juillet 60 et les affrontements de Piazza Statuto en juillet 62 à Turin.
Ces deux épisodes, bien qu’éloignés dans le temps de l’époque 68-69, en représentent d’une certaine façon, des prémices importantes. De fait, la classe ouvrière s’est trouvée en situation de faire l'expérience des attentions de l’État à son égard.
Les mouvements de juillet 1960 démarrent à partir de la protestation contre la tenue du congrès du parti néo-fasciste à Gènes, qui est l’occasion de déclencher dans toute l’Italie une série de manifestations qui sont férocement réprimées : "A San Ferdinando di Puglia, les ouvriers étaient en grève pour le contenu des accords d'entreprise, comme dans toute l’Italie. La police les attaque, arme au poing : trois ouvriers sont gravement blessés. A Licata, dans la région d’Agrigente, se déroule une grève générale contre les conditions de travail. Le 5, la police et les carabiniers chargent et tirent sur le cortège mené par le maire DC [Démocrate Chrétien], Castelli : le commerçant Vicenzo Napoli, 25 ans, est tué d’un coup de fusil. (…) Le jour suivant, un cortège qui se dirigeait vers le sanctuaire de Porta San Paolo – le dernier bastion de la défense de Rome contre les Nazis – est chargé et violemment bastonné. (…) Une nouvelle grève générale éclate. Se produit alors une nouvelle et furieuse réaction du gouvernement qui ordonne de tirer à vue : cinq morts et vingt deux blessés par arme à feu à Reggio Emilia le 7.(…) Le premier à tomber est Lauro Ferioli, ouvrier de 22 ans. A côté de lui, un instant après, tombe aussi Mario Serri, 40 ans, ex-partisan : les tueurs sont deux agents postés au milieu d’arbres. (…) Une rafale de mitraillette fauchera plus tard Emilio Reverberi, 30 ans. Enfin, alors qu’est enregistrée la voix furieuse d’un commissaire qui crie "tirez dans le tas", c’est au tour de Afro Tondelli, 35 ans, de tomber. Comme on peut le voir sur un document photographique, il a été assassiné froidement par un policier qui s’est agenouillé pour mieux viser…" 16.
Les forces de l’ordre, comme on le voit, n’ont jamais d’égards pour les pauvres, pour les prolétaires qui revendiquent. Deux ans après, les mêmes violences policières se répètent lors des affrontements de Piazza Statuto à Turin déclenchés sur un terrain strictement ouvrier. L’UIL et la SIDA, deux syndicats qui avaient déjà démontré clairement à l’époque de quel côté ils se situaient, signent séparément avec la direction de Fiat et en toute hâte, des accords d'entreprise complètement défavorables aux travailleurs : "6 à 7000 personnes, exaspérées d’apprendre cela, se réunirent dans l’après-midi sur la Piazza Statuto, face au siège de l’UIL. Pendant deux jours, la place va être le théâtre d’une série d’affrontements extraordinaires entre les manifestants et la police : les premiers, armés de frondes, de bâtons et de chaînes, cassaient les vitrines et les fenêtres, érigeaient des barricades rudimentaires, chargeaient de façon répétée les cordons de police ; celle-ci ripostait en chargeant les foules en jeep, en asphyxiant la place avec des gaz lacrymogènes, et en frappant les manifestants à coups de crosse de fusil. Les affrontements se prolongèrent tard le soir, aussi bien le samedi 7 que le lundi 9 juillet 1962. Les dirigeants du PCI et de la CDIL, parmi lesquels Pajetta et Garavini, cherchaient à convaincre les manifestants de se disperser, sans succès. Mille manifestants furent arrêtés et plusieurs, dénoncés. La plus grande partie était composée de jeunes ouvriers, en majorité du sud." 17.
On doit à Dario Lanzardo 18 un compte-rendu lucide de ces journées, incluant des témoignages officiels concernant toutes les violences gratuites exercées par la police et les carabiniers, non seulement sur les manifestants mais aussi sur n’importe quelle personne circulant par malheur dans les parages de Piazza Statuto. Si on considère tous les massacres effectués par les forces de l’ordre, depuis la fin de la guerre jusqu'à l’Automne chaud lors de manifestations de prolétaires en lutte, alors on comprend vraiment la différence entre la période noire de la contre-révolution – pendant laquelle la bourgeoisie avait complètement les mains libres pour faire ce qu’elle voulait contre la classe ouvrière – et la phase de reprise des luttes pendant laquelle il est préférable pour elle de s’en remettre d’abord à l’arme de la mystification idéologique et au travail de sabotage des syndicats. En réalité, ce qui changera avec l’Automne chaud, considéré comme une manifestation de la reprise de la lutte de classe au niveau national et international, c’est justement le rapport de forces entre les classes, au niveau national et international. C’est cela la clef pour comprendre la nouvelle phase historique qui s’ouvre à la fin des années 1960, et pas une prétendue démocratisation des institutions. De ce point de vue, la position prise par le PCI sur les affrontements illustre parfaitement le positionnement politique bourgeois qui est le sien depuis quatre décennies : "… l’Unità du 9 juillet définira la révolte comme "des tentatives provocatrices de hooligans" et les manifestants comme "des éléments incontrôlés et exaspérés", "des petits groupes d’irresponsables", des "jeunes voyous", des "anarchistes, internationalistes" 19.
De l’automne étudiant à l’Automne chaud
Parler d’Automne chaud est plutôt restrictif quand on aborde un épisode historique qui, comme on a pu le voir, plonge ses racines dans une dynamique au niveau local et international qui remonte à plusieurs années en arrière. D’ailleurs, le mouvement n’a pas duré une seule saison, comme cela a été le cas pour le Mai français, mais il se maintiendra à un haut niveau pendant au moins deux ans, de 1968 à 1969, avec un retentissement qui s'étendra jusqu’à la fin de 1973.
Le mouvement prolétarien durant ces deux années et même les suivantes est profondément marqué par l’explosion des luttes étudiantes, le 68 italien. C’est pourquoi il est important de revenir sur chaque épisode pour y suivre le développement, progressif et impressionnant, de la maturation de la lutte de classe opérant son retour sur la scène historique en Italie.
Le 68 étudiant
Les écoles et surtout les universités perçoivent fortement les signaux du changement de la phase historique. Le boom économique qui s’était produit, en Italie comme dans le reste du monde, après la fin de la guerre, avait permis aux familles ouvrières de bénéficier d'un niveau de vie moins misérable et aux entreprises de compter sur un accroissement massif de leur main d’œuvre. Les jeunes générations des classes sociales les moins favorisées peuvent désormais accéder aux études universitaires pour se former à un métier, acquérir une culture plus large, avec à la clé l'accession à une position sociale plus satisfaisante que celle de leurs parents. Cependant, l’entrée massive de ces couches sociales moins favorisées à l’université ne conduisit pas seulement à un changement de la composition sociale de la population étudiante mais il en a aussi résulté une certaine dépréciation de l'image des diplômés. Désormais ils ne sont plus, comme auparavant, formés pour remplir un rôle de direction, mais pour s’intégrer dans l'organisation de la production – industrielle ou commerciale – où l’initiative individuelle est de plus en plus limitée. Ce cadre socioculturel explique, au moins en partie, les raisons du mouvement de la jeunesse durant ces années : contestation du savoir dogmatique dont la détention est le privilège d’une caste de mandarins universitaires aux méthodes moyenâgeuses, de la méritocratie, de la sectorisation, d’une société perçue comme vieillissante et repliée sur elle-même. Les manifestations étudiantes avaient déjà commencé en février 1967 avec l’occupation du Palais Campana à Turin, mouvement qui s'était progressivement étendu à toutes les autres universités, depuis Normale de Pise, la faculté de sociologie de Trente, jusqu’à la faculté catholique de Milan et ainsi de suite en allant vers le sud et pendant des mois et des mois jusqu’à l’explosion finale de 1968. Pendant cette période, les groupes politiques à large audience que nous connaîtrons dans les années 1970 n’existent pas encore, mais c’est la période durant laquelle naissent les différentes cultures politiques qui seront à la base de ces groupes. Parmi les expériences qui marqueront le plus profondément la suite, il y a certainement celle de Pise, où était présent un groupe important d’éléments qui publiait déjà un journal, Il Potere Operaio, (appelé "pisan" pour ne pas le confondre avec l’autre, issu de Classe Operaia). Il Potere Operaio est déjà en réalité un journal ouvrier dans la mesure où il est publié comme journal d’usine d’Olivetti d'Ivrea. En effet, le groupe pisan, dans lequel on retrouve les noms des leaders les plus connus de ces années, avait dès le début comporté comme trait distinctif la référence à la classe ouvrière et l'intervention en son sein. Plus généralement, il existe au sein de tout le mouvement étudiant de l’époque la tendance à se tourner vers la classe ouvrière et à en faire la principale référence et le partenaire idéal, même si c’est de manière plus ou moins explicite. La plupart des villes sont gagnées par la contestation étudiante, et il arrive que des délégations d’étudiants se rendent régulièrement devant les usines pour distribuer des tracts et, plus généralement, pour établir une alliance avec le monde ouvrier, qui est de plus en plus ressenti comme celui auquel ils appartiennent. Cette identification de l’étudiant comme partie de la classe ouvrière sera même théorisée par quelques composantes de la mouvance plus opéraïste.
Le développement des luttes ouvrières
Comme nous l’avons dit, 1968 en Italie marque aussi le début d’importantes luttes ouvrières : "Au printemps 68, il se produit dans toute l’Italie une série de luttes dans les usines qui ont comme objectif des augmentations de salaire égales pour tous qui soient en mesure de compenser les "maigres" accords de 1966. Parmi les premières usines à se mobiliser, il y a la Fiat où les ouvriers mènent le plus grand conflit depuis plus de 14 ans, et à Milan où partent en grève Borletti, Ercole Marelli, Magneti Marelli, Philips, Sit SIEMENS, Innocenti, Autelco, Triplex, Brollo, Raimondi, Mezzera, Rhodex, Siae Microelettronica, Seci, Ferrotubli, Elettrocondutture, Autobianchi, AMF, Fachini, Tagliaferri, Termokimik, Minerva, Amsco et une autre vingtaine de petites entreprises. (…) Au début, la lutte est dirigée par les vieux activistes et par le syndicat extérieur à l’usine, et donc dirigée de façon plutôt autoritaire, mais après un mois, de jeunes ouvriers s’imposent, qui "critiquent vivement les syndicalistes et les membres du CI 20 sur la façon de lutter et sur les étapes de la lutte", et qui modifient qualitativement les formes de la mobilisation, avec des piquets très durs et des cortèges à l’intérieur pour obliger les employés à faire grève. Une fois, ces ouvriers ont prolongé spontanément une grève de quelques heures, obligeant les syndicats à les appuyer. Ce souffle de la jeunesse provoque une participation massive à la lutte, les heures de grève se multiplient, des manifestations se produisent à travers les rues de Sesto San Giovanni, parviennent à défoncer le portail du bâtiment qui héberge la direction de l’entreprise. Les grèves continuent, bien que l’Assolombarda pose comme condition de l’ouverture de négociations l’arrêt de celles-ci : la participation est totale chez les ouvriers et presque nulle au contraire chez les employés". 21
A partir de là, tout va crescendo : "Le bilan de 69 à la Fiat est un bulletin de guerre : 20 millions d’heures de grève, 277.000 véhicules perdus, boom (37%) des ventes de voitures étrangères" 22.
Ce qui change profondément avec les luttes de l’Automne chaud, c’est le rapport de forces dans l’usine. L’ouvrier exploité et humilié par les rythmes de travail, les contrôles, les punitions continuelles, entre en conflit quotidien avec le patron. L’initiative ouvrière ne concerne plus tant les heures de grève mais comment mener ces grèves. Il se développe rapidement une logique de refus du travail qui équivaut à une attitude de refus de collaborer à la stratégie de l’entreprise, en restant fermement ancrée dans la défense des conditions de vie ouvrière. Il s’ensuit une nouvelle logique quant aux modalités de la grève qui vise à ce qu'un minimum d’efforts de la part des ouvriers cause le maximum de dommages pour les patrons. C’est la grève sauvage dans laquelle ne fait grève qu’un nombre réduit d’ouvriers dont dépend cependant le cycle complet de production. En changeant à tour de rôle le groupe qui entre en grève, on réussit ainsi à bloquer autant de fois l’usine avec le minimum de "frais" pour les ouvriers.
Une autre expression du changement du rapport de forces entre classe ouvrière et patronat, c’est l’expérience des cortèges à l’intérieur des usines. Au début, ces manifestations se produisent dans les longs couloirs et allées des établissements Fiat et d’autres industries importantes et sont des expressions de protestation. Elles deviennent ensuite la pratique adoptée par les ouvriers pour convaincre les hésitants, les employés en particulier, de se joindre à la grève : "Les cortèges à l’intérieur partaient toujours de la carrosserie, souvent de l’atelier de vernissage. On entendait dire qu’un atelier quelconque avait repris le travail, ou alors qu’ils avaient concentrés les non grévistes dans le bureau 16, celui des femmes. Alors, nous passions et nous ramassions tout le monde. Nous faisions la pêche au chalut. Mirafiori est tout en couloirs et dans les endroits étroits, personne ne pouvait s’échapper. Bientôt, ce ne fut plus nécessaire : dès qu’on nous voyait, les gens ralentissaient la chaîne et nous suivaient." 23
En ce qui concerne la représentativité ouvrière, ce qui est caractéristique de cette période, c’est le slogan : "nous sommes tous délégués", ce qui signifie le refus de toute médiation syndicale et qu’on impose au patronat un rapport de forces direct au moyen de la lutte des ouvriers. Il est important de revenir sur ce mot d’ordre qui se propagera tout au long des luttes, imprégnera longtemps la lutte de classe durant ces années. Cette expérience est précieuse en particulier face aux doutes qu’ont parfois aujourd’hui les minorités prolétariennes qui voudraient engager une lutte en dehors des syndicats mais qui ne voient pas comment faire en n’étant pas elles-mêmes reconnues par l’État.
Ce n'est pas le problème des ouvriers à l'époque de l’Automne chaud : quand il le faut, ils luttent, font grève, en dehors des syndicats et contre leurs consignes ; mais ils ne poursuivent pas toujours un but immédiat : dans cette phase, la lutte des ouvriers est l’expression d’une énorme combativité, d’une volonté longtemps refoulée de répondre aux intimidations du patronat ; elle n’a pas nécessairement besoin de motifs et d’objectifs immédiats pour s’exprimer, elle est son propre stimulant, crée un rapport de forces, change progressivement l'état d'esprit de la classe ouvrière. Le syndicat n’a dans tout cela qu’une présence éphémère. En réalité, le syndicat, comme la bourgeoisie pendant ces années, reste à l'écart, du fait de la force de la lutte de la classe ouvrière. Il fait la seule chose qu’il puisse faire : chercher à se maintenir la tête hors de l'eau, suivre le mouvement et ne pas trop se faire dépasser par lui. Par ailleurs, une réaction aussi forte au sein de la classe est aussi l’expression du manque d’un véritable enracinement des syndicats dans le prolétariat et donc de leur capacité à prévenir ou à bloquer la combativité comme cela arrive au contraire aujourd’hui. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il existe alors une profonde conscience antisyndicale dans la classe ouvrière. En fait, les ouvriers bougent malgré les syndicats, pas contre eux, même si il y a des avancées significatives de la conscience, comme l'illustre le cas des Comités Unitaires de Base (CUB) dans le milanais : "les syndicats sont des "professionnels de la négociation" qui ont choisi avec les soi-disant partis des travailleurs la voie de la réforme, c’est-à-dire la voie de l’accord global et définitif avec les patrons".24
Les années 1968-69 sont un rouleau compresseur de luttes et de manifestations, avec des moments de forte tension comme dans les luttes dans la région de Syracuse, qui aboutissent aux affrontements d’Avola 25, ou celles de Battipaglia qui engendrent des affrontements très violents 26. Mais les affrontements de Corso Traiano à Turin en juillet 1969 représentent certainement une étape historique dans cette dynamique. En cette occasion, le mouvement de classe en Italie réalise une étape importante : la confluence entre le mouvement ouvrier et celui des avant-gardes étudiantes. Les étudiants, ayant plus de temps disponible et étant plus mobiles, réussissent à apporter une contribution importante à la classe ouvrière en lutte, qui en retour, à travers la jeunesse qui s’éveille, prend conscience de son aliénation, et exprime sa volonté d’en finir avec l’esclavage de l’usine. Le lien entre ces deux mondes donnera une forte impulsion aux luttes qui se produiront en 1969 et, en particulier, à celle de Corso Traiano. Nous citons ici un long extrait d’un tract de l’assemblée ouvrière de Turin, rédigé le 5 juillet, parce qu’il représente non seulement un excellent compte-rendu de ce qui s’est passé, mais aussi un document qui a une très grande qualité politique :
"La journée du 3 juillet n’est pas un épisode isolé ou une explosion incontrôlée de révolte. Elle arrive après cinquante journées de luttes qui ont rassemblé un nombre énorme d’ouvriers, bloqué complètement le cycle de production, représenté le point le plus élevé d’autonomie politique et organisationnelle qu’aient atteint les luttes ouvrières jusqu’à maintenant en détruisant toute capacité de contrôle du syndicat.
Complètement expulsés de la lutte ouvrière, les syndicats ont tenté de la faire sortir des usines vers l’extérieur et d’en reconquérir le contrôle en appelant à une grève générale de 24 heures pour bloquer les loyers. Mais encore une fois l’initiative ouvrière a eu le dessus. Les grèves symboliques qui se transforment en congés, avec quelques défilés çà et là, ne servent que les bureaucrates. Dans les mains des ouvriers, la grève générale devient l’occasion de s’unir, pour généraliser la lutte menée dans l’usine. La presse de tout bord se refuse à parler de ce qui se passe à Fiat ou dit des mensonges à son propos. C’est le moment de briser cette conjuration du silence, de sortir de l’isolement, de communiquer à tous, avec la réalité des faits, l’expérience des ouvriers de Mirafiori.
Des centaines d’ouvriers et d’étudiants décident en assemblée de convoquer pour le jour de la grève un grand cortège qui, partant de Mirafiori, ira dans les quartiers populaires, afin d’unir les ouvriers des différentes usines. (…)
C’en est trop pour les patrons. Avant même que le cortège ne se forme, une armée de gros bras et de policiers se jette sans aucun avertissement sur la foule, matraquant, arrêtant, lançant des grenades lacrymogènes (…) En peu de temps, ce ne sont pas seulement les avant-gardes ouvrières et étudiantes qui font face mais toute la population prolétarienne du quartier. Des barricades s’érigent, on répond aux charges de la police par des charges. Pendant des heures et des heures, la bataille continue et la police est obligée de battre en retraite. (…)
Dans ce processus, le contrôle et la médiation des syndicats ont été jetés par-dessus bord : au-delà des objectifs partiels, la lutte a signifié :
- le refus de l’organisation capitaliste du travail,
- le refus du salaire lié aux exigences du patron pour la production,
- le refus de l’exploitation dans et en dehors de l’usine.
Les grèves, les cortèges, les assemblées internes, ont fait sauter la division entre les ouvriers et ont fait mûrir l’organisation autonome de classe en donnant les objectifs :
- toujours garder l’initiative dans l’usine contre le syndicat,
- 100 lires d’augmentation du salaire de base égale pour tous,
- seconde catégorie pour tous,
- réelles réductions du temps de travail.
(…) La lutte des ouvriers de la Fiat a de fait reproduit à un niveau massif les objectifs déjà formulés au cours des années 68-69 par les luttes des plus grandes concentrations ouvrières en Italie, de Milan à Porto Marghera, d’Ivrea à Valdagno. Ces objectifs sont :
- forte augmentation du salaire de base égale pour tous,
- abolition des catégories,
- réduction immédiate et drastique des horaires de travail sans diminution de salaire,
- égalité immédiate et complète entre ouvriers et employés." 27
Comme on l’a déjà dit, toute une série de points forts de l’Automne chaud peuvent être perçus dans ce tract. D’abord l’idée de l’égalité, c'est-à-dire que les augmentations doivent être égales pour tous, indépendamment de la catégorie d’origine, et non assujetties à la rentabilité du travail. Ensuite, la récupération de temps libre pour les ouvriers, pour pouvoir avoir une vie, pour pouvoir faire de la politique, etc. De là, la revendication de réduction des horaires de travail et le refus affirmé du travail à la tâche.
Dans ce même tract, il est rapporté que, sur la base de ces éléments, les ouvriers turinois réunis en assemblée après les affrontements du 3 juillet proposent à tous les ouvriers italiens d’entamer une nouvelle phase de lutte de classe plus radicale, qui fasse avancer, sur les objectifs mis en avant par les ouvriers eux-mêmes, l’unification politique de toutes les expériences autonomes de luttes faites jusque là.
A cette fin, un rassemblement national des comités et des avant-gardes ouvrières est convoqué à Turin :
1. pour confronter et unifier les différentes expériences de lutte sur la base de ce qu’a signifié la lutte à Fiat,
2. pour mettre au point les objectifs de la nouvelle phase de confrontation de classe qui, partant des conditions matérielles dans lesquelles se trouvent les ouvriers, devra investir toute l’organisation sociale capitaliste.
Ce qui se tiendra les 26/27 juillet au Palasport de Turin sera un "rassemblement national des avant-gardes ouvrières". Des ouvriers de toute l’Italie, qui rendent compte des grèves et des manifestations, parlent et avancent des revendications comme l’abolition des catégories, la réduction de l’horaire de travail à 40 heures, des augmentations de salaires égales pour tous en absolu et pas en pourcentage et la reconnaissance de la parité avec les employés. "Toute l’industrie italienne est représentée : par ordre d’intervention, après Mirafiori, la Pétrochimie de Marghera, la Dalmine et Il Nuovo Pignone de Massa, Solvay de Rossignano, Muggiano de La Spezzia, Piaggio de Pontedera, l’Italsider de Piombino, Saint Gobain de Pise, la Fatme, l’Autovox, Sacet et Voxon de Rome, la SNAM, Farmitalia, Sit Siemens, Alfa Romeo et Ercole Marelli de Milan, Ducati et Weber de Bologne, Fiat de Marina di Pisa, Montedison de Ferrare, Ignis de Varese, Necchi de Pavie, la Sir de Porto Torres, les techniciens de la Rai de Milan, Galileo Oti de Florence, les comités unitaires de base de Pirelli, l’arsenal de la Spezzia" 28. Quelque chose qu’on n’avait jamais vu, une assemblée nationale des avant-gardes ouvrières de toute l’Italie, un moment où la classe ouvrière s’affirme et auquel il n’est possible d’assister que dans un moment de forte montée de la combativité ouvrière, comme l’était justement l’Automne chaud.
Les mois qui suivent, ceux qui sont restés dans la mémoire historique comme "l’Automne chaud", se déroulent selon la même ligne. Les nombreux épisodes de lutte, dont une intéressante documentation photographique peut être trouvée sur le site de La Repubblica 29, s’enchaînent les uns aux autres à une cadence infernale. En voici une sélection non exhaustive :
2/09 : grève des ouvriers et des employés à Pirelli pour la prime à la production et les droits syndicaux. A Fiat, les ouvriers des départements 32 et 33 de Mirafiori se mettent à lutter, contrevenant aux directives syndicales, contre la discrimination de l’entreprise sur les changements de catégorie ;
4/09 : Agnelli, patron de Fiat, met à pied 30 000 travailleurs ;
5/09 : la tentative des directions syndicales d’isoler les ouvriers d’avant-garde de Fiat échoue, Agnelli est obligé de retirer les mises à pied ;
6/09 : plus de deux millions de métallos, d’employés du bâtiment et de la chimie partent en lutte pour le renouvellement du contrat salarial ;
11/09 : à la suite de la rupture des négociations concernant le renouvellement du contrat des métallos le 8 septembre, un million de métallurgistes fait grève dans toute l’Italie. À Turin, 100 000 ouvriers bloquent la Fiat ;
12/09 : grève nationale des ouvriers du bâtiment, tous les chantiers du pays sont fermés. Manifestations des métallurgistes à Turin, Milan et Tarente ;
16-17/09 : grève nationale de 48 heures des ouvriers de la chimie, grève nationale dans les cimenteries et nouvelle journée de lutte des ouvriers du bâtiment ;
22/09 : manifestation de 6000 ouvriers d’Alfa Roméo à Milan. Journée de lutte des métallurgistes à Turin, Venise, Modène et Cagliari ;
23-24/09 : nouvelle grève générale de 48 heures des ouvriers des cimenteries ;
25/09 : lock-out à Pirelli, suspension pour un temps indéterminé de 12.000 ouvriers. Réaction immédiate des ouvriers qui bloquent tous les établissements du groupe ;
26/09 : manifestation des métallurgistes à Turin où un cortège de 50 000 ouvriers part de Fiat. Grève générale à Milan et manifestations de centaines de milliers d'ouvriers qui imposent ainsi à Pirelli la fin du lock-out. Cortèges de dizaines de milliers de travailleurs à Florence et Bari ;
29/09 : manifestations des métallurgistes, ouvriers de la chimie et du bâtiment à Porto Marghera, Brescia et Gènes ;
30/09 : grève des ouvriers du bâtiment à Rome, manifestations de 15 000 métallurgistes à Livourne ;
7/10 : grève des métallurgistes dans la province de Milan, 100 000 ouvriers provenant de 9 cortèges se rejoignent sur la Place du Dôme ;
8/10 : grève générale nationale des employés de la chimie. Grève dans la région de Terni. Manifestations des métallurgistes à Rome, Sestri, Piombino, Marina di Pisa et L’Aquila ;
9/10 : 60 000 métallurgistes font grève à Gènes. Grève générale dans le Frioul et la Vénétie Julienne ;
10/10 : pour la première fois, se tient une assemblée à l’intérieur des ateliers de Fiat-Mirafiori. Des assemblées et des défilés ont également lieu à l’intérieur des autres usines du groupe. La police charge à l’extérieur des établissements. Grève à Italsider de Bagnoli contre la suspension de 5 ouvriers ;
16/10 : les hospitaliers, les cheminots, les postiers, les travailleurs des administrations locales et les ouvriers journaliers partent en lutte pour le renouvellement de leurs contrats. Des grèves générales ont lieu dans les provinces de Palerme et Matera ;
22/10 : 40 usines de Milan gagnent le droit de faire des assemblées ;
8/11 : le contrat des ouvriers du bâtiment est signé : il prévoit l’augmentation de 13% sur les plus basses rétributions, la réduction graduelle du temps de travail à 40 heures, le droit de faire des assemblées sur les chantiers ;
13/11 : affrontements très durs entre les ouvriers et la police à Turin ;
25/11 : grève générale dans la chimie ;
28/11 : des centaines de milliers de métallurgistes animent, à Rome, une des plus grandes et des plus combatives manifestations qui ait jamais eu lieu en Italie pour soutenir leurs revendications ;
3/12 : grève totale des ouvriers des carrosseries à Fiat, manifestation des employés des administrations locales ;
7/12 : un accord est trouvé pour le contrat dans la chimie : il prévoit des augmentations de salaire de 19.000 lires par mois, un horaire hebdomadaire de 40 heures sur 5 jours, et trois semaines de congés payés ;
8/12 : accord sur le contrat dans les entreprises de la métallurgie dans lesquelles l’État a une participation : le contrat prévoit l’augmentation de 65 lires par heure, augmentation égale pour tous, la parité légale entre ouvriers et employés, le droit de faire des assemblées dans l’entreprise pendant les heures de travail à raison de 10 heures par an, payées, et 40 heures de travail hebdomadaire ;
10/12 : grève générale des ouvriers agricoles pour le pacte national, des centaines de milliers manifestent dans toute l’Italie. Début de la grève de 4 jours des employés des sociétés pétrolières privées pour le renouvellement du contrat ;
19/12 : grève nationale des travailleurs de l’industrie pour soutenir le conflit des métallurgistes. Nouvelle grève nationale des ouvriers agricoles ;
23/12 : signature de l’accord pour le nouveau contrat des métallurgistes : il prévoit des augmentations salariales de 65 lires par heure pour les ouvriers et de 13.500 lires par mois pour les employés, le treizième mois, le droit de faire des assemblées dans l’usine, la reconnaissance des représentants syndicaux d’entreprise et la réduction de l’horaire de travail à 40 heures par semaine ;
24/12 : le pacte national pour les ouvriers agricoles est signé après 4 mois de lutte, il prévoit la réduction progressive de l’horaire de travail à 42 heures par semaine et 20 jours de congés 30.
Cet enchaînement impressionnant de luttes n'est pas seulement le produit d'une forte poussée ouvrière mais porte aussi la marque des manœuvres des syndicats qui dispersent les luttes en autant de foyers distincts allumés à l'occasion du renouvellement des contrats collectifs venant à échéance dans différents secteurs et entreprises. C'est le moyen par lequel la bourgeoisie parvient à faire en sorte que le mécontentement social profond qui se fait jour ne débouche sur un embrasement généralisé.
Ce développement énorme de la combativité, accompagné de moments de clarification significatifs dans la classe ouvrière, rencontrera également d'autres obstacles importants dans la période qui va suivre. La bourgeoisie italienne, comme celle des autres pays qui ont dû faire face au réveil de la classe ouvrière, n’est pas restée les mains dans les poches et, à côté des interventions frontales effectuées par les corps de police, elle a cherché graduellement à contourner l’obstacle en utilisant d’autres moyens. Ce que nous verrons dans la deuxième partie de l’article, c’est que la capacité qu’a la bourgeoisie de reprendre le contrôle de la situation se fonde principalement sur les faiblesses d’un mouvement prolétarien qui, malgré son énorme combativité, manquait encore d’une conscience de classe claire et dont même les avant-gardes n’avaient pas la maturité et la clarté nécessaires pour jouer leur rôle.
1/11/09 Ezechiele
1 Du mois de juillet 1969 et pendant plusieurs mois.
2 Voir : Revue internationale n°133 [16] et 134 [17], Mai 68 et la perspective révolutionnaire (I et II), 2008.
3 Voir : Lutte de classe en Europe de l’Est [18] (1970-1980), Revue Internationale n°100.
4 Dans les années 73-74, le Cordobazo, la grève de Mendoza et la vague de luttes qui a submergé le pays, ont alors représenté la clef de l’évolution sociale. Sans revêtir un caractère insurrectionnel, ces luttes ont néanmoins constitué le signal d’un réveil du prolétariat en Amérique du sud. Voir : Révoltes populaires en Argentine : seule l’affirmation du prolétariat sur son terrain peut faire reculer la bourgeoisie [19]. Revue internationale n°109, 2002.
5 Voir : Notes sur l’histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale [20], 2ème partie. Revue Internationale n°114.
6 "C’est ainsi qu’est né le slogan : ‘l’Université est notre Vietnam’ ; les guérilleros vietnamiens combattent contre l’impérialisme américain, les étudiants font leur révolution contre le pouvoir et l’autoritarisme académique". Alessandro Silj, Malpaese, criminalità, corruzione e politica nell’Italia della prima Republica 1943-1994, Donzelli Ed., Rome 1994, p. 92 ;
7 Voir : Che Guevara : mythe et réalité (à propos de courriers d’un lecteur) [21], dans Révolution Internationale n°384 ; Quelques commentaires sur une apologie d’Ernesto"Che" Guevara (à propos d’un livre de Besancenot) [22], in Révolution Internationale n°388.
8 Voir : Le conflit Juifs/Arabes : la position des internationalistes dans les années 30 : Bilan n° 30 et 31 [23], in Revue Internationale n°110 ; Notes sur l’histoire des conflits impérialistes au Moyen-Orient (1ère partie, 2ème partie et 3ème partie) in Revue Internationale N°115 [24], 117 [25] et 118 [26] ; Affrontements Hamas/Fatah : la bourgeoisie palestinienne est aussi sanguinaire que les autres [27], in Révolution Internationale n°381.
9 Voir : Le maoïsme :un pur produit de la contre-révolution [28], in Révolution Internationale n°371 ; Chine 1928-1949 :maillon de la guerre impérialiste, I [29] et II [30], in Revue Internationale n°81 [29] et 84 [30] ; Cina : il capitalismo di stato, dalle origini alla Rivoluzione Culturale (I et II) in Rivoluzione Internazionale n°5 et 6.
10 Voir : Silvia Castillo, Controcultura e politica nel Sessantotto italiano.
11 Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua. Sperling et Kupfer Eds., p. 13.
12 Luca Barbieri, Il caso 7 aprile. Cap. III, www.indicius.it [31]
13 Interview de Rita Di Leo in L’operaismo degli anni sessanta. Dai ‘Quaderni rossi’ a ‘classe operaia’. Giuseppe Trotta et Fabio Milana, Edition DeriveApprodi. www.deriveapprodi.com [32]
14 Voir : Luca Barbieri, Il caso 7 aprile. Cap. III, www.indicius.it [31]
15 Emiliano Mentasti, La guardia rossa racconta. Storia del Comitato operaio della Magneti Marelli. p. 25, Editions Colibri.
16 Giorgio Frasca Polara, Tambroni e il luglio "caldo” del 60, www.libertaegiustizia.it/primopiano/pp_leggi_articolo.php?id=2803&id_tit... [33]
17 La rivolta operaia di piazza Statuto del 1962, lotteoperaie.splinder.com/post/5219182/la+rivolta+operaia+di+piazza+S.
18 Dario Lanzardo, La rivolta di piazza Statuto, Torino, Luglio 1962, Feltrinelli.
19 La rivolta operaia di piazza Statuto del 1962, lotteoperaie.splinder.com/post/5219182/la+rivolta+operaia+di+piazza+S.
20 CI est l’abréviation pour Commissions Internes, officiellement des structures représentant les travailleurs dans les conflits dans l’entreprise, en fait une expression du contrôle du syndicat sur les travailleurs. Elles ont fonctionné jusqu’à l’Automne chaud et ont été ensuite remplacées par les Conseils d’usine (CdF).
21 Emilio Mentasti, La guardia rossa racconta. Storia del Comitato operaio della Magneti Marelli. p. 37, Edition Colibri.
22 Aldo Cazzulo, I raggazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua. Pp. 75-76. Sperling et Kupfer Eds.
23 Aldo Cazzulo, I raggazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua. Pp. 60. Sperling et Kupfer Eds.
24 Document du CUB de Pirelli (Bicocca), "Ibm e Sit Siemens", cité dans Alessandro Silj, Mai piu senza fucile, Vallecchi, Florence 1977, pp. 82-84
25 "La lutte entreprise par les travailleurs agricoles de la province de Syracuse le 24 novembre, à laquelle participaient les ouvriers agricoles d’Avola, revendiquait l’augmentation du salaire journalier, l’élimination des différences de salaire et d’horaire entre les deux zones dans lesquelles la province était divisée, l’introduction d’une loi visant à garantir le respect des contrats, la mise en place des commissions paritaires de contrôle, obtenues dans la lutte en 1966 mais qui n’avaient jamais fonctionné. (…) Les ouvriers agricoles firent des blocages de routes et furent chargés par la police. Le 2 décembre, Avola participa en masse à la grève générale. Les journaliers mirent en place à partir de la nuit des blocages de route sur la Nationale pour Noto, et les ouvriers étaient à leurs côtés. Dans la matinée, les femmes et les enfants arrivèrent. Vers 14 heures, le Vicequesteur (sous-préfet de police) de Syracuse, Samperisi, donna l’ordre à la compagnie de Celere, rejointe par celle de Catania, d’attaquer.(…) Ce jour là, la brigade de Celere sonna trois fois la charge, tirant sur la foule qui pensait qu’il s’agissait de tirs à blanc. Les ouvriers agricoles cherchèrent un abri ; certains lancèrent des pierres. Ce scénario de guerre dura à peu près une demie heure. A la fin, Piscitello, député communiste, ramassa sur le goudron plus de deux kilos d’obus. Le bilan fut de deux journaliers morts, Angelo Sigona et Giuseppe Scibilia, et de 48 blessés, dont 5 graves. (www.attac-italia.org [34]).
26 "Nous descendions dans la rue avec la générosité habituelle des jeunes aux côtés des travailleurs et des travailleuses qui faisaient grève contre la fermeture des manufactures de tabac et de sucre. La fermeture de ces entreprises, mais aussi des sous-traitants, mettait en crise toute la ville, compte-tenu du fait qu’à peu près la moitié de la population en tirait l’unique source de revenu. La grève générale fut l’unique issue possible et fut ressentie comme telle et menée par toute la ville, et même nous, les étudiants ; beaucoup d’entre nous, bien qu’ils ne fussent pas de Battipaglia, ressentirent la nécessité de participer dans la mesure où nous comprenions l’importance de ces deux manufactures pour l’économie de la ville. On ressentait aussi un autre motif pour la grève générale : c’était l’occasion d’apporter la solidarité à ceux de la manufacture de tabac qui occupaient l’établissement de Santa Lucia, depuis bientôt une dizaine de jours. Le spectre d’une crise pesait sur la ville, crise qui avait déjà frappé avec la fermeture de quelques conserveries et qui se profilait comme étant dramatique pour des milliers de travailleurs qui allaient inévitablement perdre leur travail. (…) Très rapidement, il y eut des moments de tension et, comme cela arrive souvent, ils se transformèrent en véritables mouvements. Battipaglia devint le théâtre d’affrontements violents, des barricades s’érigèrent, toutes les issues par route furent bloquées et la gare fut occupée. La police chargea, et ce qui devait être une grande journée de solidarité vis-à-vis de ceux qui voulaient garder leur poste de travail se transformé en une insurrection populaire. Le bilan : deux morts, des centaines de blessés, des dizaines de véhicules brûlés (ceux de la police et de privés) et des dégâts incalculables. (…) Pour avoir raison d’une ville blessée et en colère, il fallut aux forces de l’ordre, environ une vingtaine d’heures". (Témoignage rapporté dans le blog : massimo.delmese.net/marx1-mini [35]).
27 www.nelvento.net/archivio/68/operai/traiano02.htm [36]
28 Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua. p. 67, Sperling etKupfer Editeurs.
29 https://static.repubblica.it/milano/autunnocaldo/ [37]
30 du site : www.pmli.it/storiaautunnocaldo.htm [38]
Géographique:
- Italie [39]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [40]
Qu'est ce que les conseils ouvriers ? (I) : pourquoi les conseils ouvriers surgissent-ils en 1905 ?
- 5088 lectures
Le 2 mars 1919, lors de la session inaugurale du Premier Congrès de l’Internationale communiste, Lénine affirmait que le "système des soviets" (conseils ouvriers en langue russe), après avoir été "du latin" pour les grandes masses ouvrières était devenu très populaire et, surtout, était devenu une pratique de plus en plus généralisée ; et il citait comme exemple un télégramme qui venait d’arriver d’Angleterre qui disait : "Le gouvernement de la Grande-Bretagne avait reçu le Conseil des députés ouvriers constitué à Birmingham et promis de reconnaître les Soviets comme des organes économiques." 1.
Aujourd’hui, 90 ans plus tard, des camarades de différents pays nous écrivent pour nous demander : "que sont les Conseils ouvriers ?", en reconnaissant que c’est un sujet dont ils ne savent pratiquement rien et sur lequel ils voudraient pouvoir se faire une idée.
Le poids de la plus terrible contre-révolution de l’histoire, les difficultés qui, depuis 1968, entravent la politisation des luttes de la classe ouvrière ; la falsification, voire le silence complet que les moyens de communications et de culture imposent sur les expériences historiques du prolétariat, font que les mots tels que soviet ou conseil ouvrier, qui étaient pourtant si familiers pour les générations ouvrières des années 1917-23, sont aujourd’hui quelque chose d’étrange ou interprété avec un sens radicalement différent de celui qu'ils avaient à l’origine. 2
Ce sera donc là l’objectif de cet article : contribuer à répondre très simplement à ces questions : que sont les Conseils ouvriers ? Pourquoi ont-ils surgi ? À quelles nécessités historiques répondaient-ils ? Sont-ils sont toujours d’actualité à l’époque présente ?
Pour répondre à ces questions, nous allons nous appuyer sur l’expérience historique de notre classe, une expérience constituée tout autant par les révolutions de 1905 et 1917 que par les débats et les écrits des militants révolutionnaires : Trotsky, Rosa Luxemburg, Lénine, Pannekoek …
Les conditions historiques dans lesquelles naissent les Conseils ouvriers
Pourquoi les Conseils ouvriers surgissent-ils en 1905 et non pas en 1871 lors de la Commune révolutionnaire de Paris ? 3
On ne peut comprendre le surgissement des Conseils ouvriers lors de la révolution russe de 1905 qu’en analysant l’ensemble des facteurs suivants : les conditions historiques de la période, les expériences de lutte que le prolétariat avait faites et l’intervention des organisations révolutionnaires.
Concernant le premier facteur, le capitalisme se trouvait au sommet de son évolution, mais il montrait des signes de plus en plus évidents du début de son déclin, particulièrement sur le terrain impérialiste. Trotsky, dans ses ouvrages 1905 et Bilan et perspectives, sur lesquels nous allons nous appuyer, met en avant que "En liant tous les pays entre eux par son mode de production et son commerce, le capitalisme a fait du monde entier un seul organisme économique et politique", et plus précisément, "Cela donne immédiatement aux événements qui se déroulent actuellement un caractère international, et ouvre un large horizon. L'émancipation politique de la Russie sous la direction de la classe ouvrière élèvera cette classe à des sommets historiques inconnus jusqu'à ce jour et en fera l'initiatrice de la liquidation du capitalisme mondial, dont l'histoire a réalisé toutes les prémisses objectives 4." Produits de cette nouvelle période, des mouvements massifs et des grèves générales avaient déjà fait irruption de par le monde avant 1905 : grève générale en Espagne en 1902 et en Belgique en 1903 et jusqu’en Russie même à différents moments.
Nous en arrivons au deuxième facteur. Les conseils ouvriers ne surgissent pas du néant comme un éclair dans un ciel bleu. Dans les années qui précèdent, de nombreuses grèves éclatent en Russie à partir de 1896 : la grève générale des ouvriers du textile de Saint-Pétersbourg en 1896 et 1897 ; les grandes grèves qui, en 1903 et 1904, ébranlèrent tout le sud de la Russie ; etc. Elles constituent autant d'expériences où se manifestent des tendances à la mobilisation spontanée, où se créent des organes de luttes qui ne correspondent plus typiquement aux formes syndicales de lutte, préparant ainsi le terrain pour les luttes de 1905 : "On ne manquera pas de faire remonter l'histoire de la période présente des luttes de masse aux grèves générales de Saint-Pétersbourg. Celles-ci sont importantes pour le problème de la grève de masse parce qu'elles contiennent déjà en germe tous les éléments principaux des grèves de masse qui suivirent" (Rosa Luxemburg ; Grève de masse, parti et syndicats).
Par ailleurs, et concernant le troisième facteur, les partis prolétariens (les bolcheviks et autres tendances) n'avaient évidemment pas fait une propagande préalable sur le thème des conseils ouvriers puisque leur surgissement les a surpris ; ils n'avaient pas non plus mis en place des structures d'organisation intermédiaires pour les préparer. Et, cependant, leur travail politique incessant de propagande a grandement contribué à leur surgissement. C'est ce que met en évidence Rosa Luxemburg à propos des mouvements spontanés comme celui de la grève des ouvriers du textile de Saint-Pétersbourg en 1896 et 1897 : "Tout d'abord l'occasion qui déclencha le mouvement fut fortuite et même accessoire, l'explosion en fut spontanée. Mais dans la manière dont le mouvement fut mis en branle se manifestèrent les fruits de la propagande menée pendant plusieurs années par la social-démocratie" (Grève de masse, parti et syndicats). A ce propos, elle clarifie de façon rigoureuse quel est le rôle des révolutionnaires : "Il est hors du pouvoir de la social-démocratie de déterminer à l'avance l'occasion et le moment où se déclencheront les grèves de masse en Allemagne, parce qu'il est hors de son pouvoir de faire naître des situations historiques au moyen de simples résolutions de congrès. Mais ce qui est en son pouvoir et ce qui est de son devoir, c'est de préciser l’orientation politique de ces luttes lorsqu'elles se produisent et de la traduire par une tactique résolue et conséquente" (Ibid).
Cette analyse permet de comprendre la nature du grand mouvement qui secoue la Russie au cours de l’année 1905 et qui connaît son étape décisive dans les trois derniers mois de cette année-là, d’octobre à décembre, pendant lesquels va se généraliser le développement des conseils ouvriers.
Le mouvement révolutionnaire de 1905 a son origine immédiate dans le mémorable "Dimanche sanglant", le 22 janvier 1905 5. Ce mouvement connaît un premier reflux en mars 1905 pour ressurgir, par différents chemins, en mai et juillet 6. Pendant cette période, cependant, il prend la forme d’une série d’explosions spontanées manifestant un faible niveau d’organisation. Par contre, à partir du mois de septembre, la question de l’organisation générale de la classe ouvrière occupe le premier plan : on entre dans une phase de politisation croissante des masses, au sein desquelles apparaissent les limites de la lutte immédiate revendicative mais aussi l’exaspération causée aussi bien par la brutalité du tsarisme que par les hésitations de la bourgeoisie libérale 7.
Le débat de masse
Nous venons de rappeler le terreau historique sur lequel naissent les premiers soviets. Mais quelle est leur origine concrète ? Est-ce qu’ils sont le résultat de l’action délibérée d’une minorité audacieuse ? Ou, au contraire, ont-ils surgi mécaniquement des conditions objectives ?
Si la propagande révolutionnaire menée depuis des années a, comme on l'a dit, contribué au surgissement des soviets, et si Trotsky a joué un rôle de premier plan au sein du Soviet de Saint-Pétersbourg, le surgissement des soviets ne fut le résultat direct ni de l’agitation ni des propositions organisationnelles des partis marxistes (divisés à ce moment-là entre bolcheviks et mencheviks) ni non plus de l'initiative de groupes anarchistes comme le présente Voline dans son livre La Révolution inconnue. 8 Voline 9 situe l’origine de ce premier soviet entre la moitié et la fin de février de 1905. Sans mettre en doute la vraisemblance de ces faits, il est important de signaler que cette réunion – que Voline lui-même qualifie de "privée" - a pu être un élément supplémentaire contribuant au processus vers le surgissement des soviets, mais elle n'en constitua pas leur acte de naissance.
Il est d'usage de considérer le soviet d’Ivanovo-Vosnesensk comme le premier ou l'un des premiers. 10 Au total, 40 à 50 soviets ont été identifiés ainsi que quelques soviets de soldats et de paysans. Anweiler insiste sur leur origines disparates : "Leur naissance se fit ou bien sous forme médiatisée, dans le cadre d’organismes de type ancien – comités de grève ou assemblées de députés, par exemple – ou bien sous forme immédiate, à l’initiative des organisations locales du Parti social-démocrate, appelées en ce cas à exercer une influence décisive sur le soviet. Les limites entre le comité de grève pur et simple et le conseil des députés ouvriers vraiment digne de ce nom étaient souvent des plus floues, et ce ne fut que dans les principaux centres de la révolution et de la classe laborieuse tels que (Saint-Pétersbourg mis à part) Moscou, Odessa, Novorossiisk et le bassin du Donetz, que les conseils revêtirent une forme d’organisation nettement tranchée." 11
Ainsi, la paternité des soviets ne peut être attribuée à tel ou tel personnage ou telle minorité, mais ils ne sont pas nés du néant, par génération spontanée. Fondamentalement, ils ont été l’œuvre collective de la classe : des initiatives multiples, des discussions, des propositions surgies ici ou là, tout cela tissé avec le fil de l’évolution des événements, et avec l’intervention active des révolutionnaires, a abouti à la naissance des soviets. En regardant de plus près ce processus, nous pouvons identifier deux facteurs déterminants : le débat de masse et la radicalisation croissante des luttes.
La maturation de la conscience des masses qu’on observe depuis septembre 1905 s’est concrétisée dans le développement d’une formidable volonté de débattre. Le bouillonnement de discussions animées dans les usines, les universités, les quartiers, apparaît comme un phénomène "nouveau" qui surgit significativement pendant le mois de septembre. Trotsky cite quelques témoignages : "Des assemblées populaires absolument libres dans les murs des universités, alors que, dans la rue, c'est le règne illimité de Trepov12, voilà un des paradoxes les plus étonnants du développement politique et révolutionnaire pendant l'automne de 1905". Ces réunions sont de plus en plus massivement fréquentées par les ouvriers, "'Le peuple' emplissait les corridors, les amphithéâtres et les salles. Les ouvriers allaient tout droit à l'université en sortant de l'usine", dit Trotsky, qui ajoute à la suite : "L'agence télégraphique dépeint avec horreur le public qui s'était amassé dans la salle des fêtes de l'université de Saint-Vladimir. D'après les télégrammes, on voyait dans cette foule, outre les étudiants, une multitude de personnes des deux sexes venues du dehors, des élèves de l'enseignement secondaire, des adolescents des écoles privées, des ouvriers, un ramassis de gens de toute espèce et de va-nu-pieds" 13
Mais il ne s’agit pas du tout d’un "ramassis de gens" comme l’affirme avec mépris l’agence d’information, mais d’un collectif qui discute et réfléchit avec ordre et méthode, en se tenant à une discipline élevée et avec une maturité reconnue même par un chroniqueur du journal bourgeois Rouss (La Russie), cité par Trotsky : "Savez-vous ce qui m'a le plus frappé au meeting de l'université. C'est l'ordre merveilleux, exemplaire, qui régnait. On avait annoncé une suspension dans la salle des séances et j'allai rôder dans le corridor. Le corridor de l'université, c'est maintenant la rue tout entière. Tous les amphithéâtres qui donnaient sur le corridor étaient pleins de monde ; on y tenait des meetings particuliers, par fractions. Le couloir lui-même était bondé, la foule allait et venait (…). On aurait cru assister à un "raout", mais l'assemblée était plus nombreuse et plus sérieuse que dans les réceptions habituelles. Et cependant, c'était là le peuple, le vrai peuple, le peuple aux mains rouges et toutes crevassées par le travail, au visage terreux comme l'ont les gens qui passent leur vie dans des locaux fermés et malsains" 14.
C’est le même état d’esprit qu’on peut observer depuis le mois de mai dans la ville industrielle citée précédemment, Ivanovo-Vosnesensk : Les assemblées plénières se déroulent tous les matins à partir de neuf heures. Une fois la séance [du Soviet] terminée, l’assemblée générale des ouvriers commençait et elle examinait toutes les questions en rapport avec la grève. On rendait compte de son déroulement, des négociations avec les patrons et les autorités. Après la discussion on soumettait à l’assemblée les propositions préparées par le Soviet. Ensuite, les militants des partis faisaient des discours d’agitation sur la situation de la classe ouvrière et la réunion continuait jusqu’à ce que le public soit gagné par la fatigue. À ce moment-la, la foule se mettait à chanter des hymnes révolutionnaires et on mettait fin à l’assemblée. Et ainsi tous les jours" 15
La radicalisation des luttes
Une petite grève dans l’imprimerie Sitin de Moscou qui avait éclaté le 19 septembre allait allumer la mèche de la grève générale massive d’octobre durant laquelle les soviets se généraliseront. La solidarité avec les imprimeurs de Sitin avait porté la grève à plus de 50 imprimeries moscovites ce qui déboucha, le 26 septembre, sur une réunion générale de typographes qui prit le nom de Conseil. La grève s’étend à d’autres secteurs : aux boulangeries, aux industries métallurgiques et textiles. L’agitation gagne, d’un coté, les chemins de fer et, de l’autre, les imprimeurs de Saint-Pétersbourg qui se solidarisent avec leurs camarades de Moscou.
Un autre front organisé surgit de façon inattendue : une Conférence des représentants des cheminots à propos des Caisses de retraite débute à Saint-Pétersbourg le 20 septembre. La Conférence lance un appel à tous les secteurs ouvriers, en ne se limitant pas à cette question-là mais mettant en avant la nécessité de faire des réunions d’ouvriers de différentes branches et de proposer des revendications économiques et politiques. Encouragée par les télégrammes de soutien qui arrivent de tout le pays, la Conférence convoque une nouvelle réunion pour le 9 octobre.
Peu de temps après, le 3 octobre, "L'assemblée des députés ouvriers des corporations de l'imprimerie, de la mécanique, de la menuiserie, du tabac et d'autres, adopte la résolution de constituer un conseil (soviet) général des ouvriers de Moscou" 16.
La grève des cheminots qui avait surgi spontanément sur quelques lignes du réseau ferré devient grève générale à partir du 7 octobre. Dans ce contexte, la réunion convoquée pour le 9 se transforme en "congrès des délégués cheminots à Saint-Pétersbourg, on formule et on expédie immédiatement par télégraphe sur toutes les lignes les mots d'ordre de la grève des chemins de fer : la journée de huit heures, les libertés civiques, l'amnistie, l'Assemblée constituante" 17.
Les réunions massives à l’université avaient été parcourues par un débat de grande intensité sur la situation, les expériences vécues, les alternatives d’avenir, mais en octobre la situation change : ces débats ne s’éteignent pas mais, au contraire, mûrissent pour devenir lutte ouverte, une lutte qui, à son tour, commence à se doter d’une organisation générale, laquelle non seulement dirige la lutte mais intègre et démultiplie ce débat massif. La nécessité de se regrouper et de se réunir, d’unifier les différents foyers de grève avait été posée de manière particulièrement aiguë par les ouvriers de Moscou. Se donner un programme avec des revendications économiques et politiques adaptées à la situation et en accord avec les possibilités réelles de la classe ouvrière, voilà ce que le congrès des cheminots avait pu apporter. Débat, organisation unifiée, programme de lutte : voilà les trois piliers sur lesquels vont se bâtir les Soviets. C’est bien donc la convergence d’initiatives et de propositions des différents secteurs de la classe ouvrière qui sont à l’origine des Soviets et absolument pas le "plan" d’une quelconque minorité. Dans les soviets se concrétise ce qui, 60 ans plus tôt, dans le Manifeste communiste, paraissait une formulation utopique : "Tous les mouvements ont été jusqu’à maintenant réalisés par des minorités pour des minorités. Le mouvement prolétarien est un mouvement indépendant de l’immense majorité au profit de l’immense majorité".
Les Soviets, organes de lutte révolutionnaire
"Le 13 au soir, dans les bâtiments de l'Institut technologique, eut lieu la première séance du futur soviet. Il n'y avait pas plus de trente à quarante délégués. On décida d'appeler immédiatement le prolétariat de la capitale à la grève politique générale et à l'élection des délégués" 18.
Ce Soviet lançait l’appel suivant : "La classe ouvrière, disait l'appel rédigé à la première séance, a dû recourir à l'ultime mesure dont dispose le mouvement ouvrier mondial et qui fait sa puissance : à la grève générale... Dans quelques jours, des événements décisifs doivent s'accomplir en Russie. Ils détermineront pour de nombreuses années le sort de la classe ouvrière ; nous devons donc aller au-devant des faits avec toutes nos forces disponibles, unifiées sous l'égide de notre commun soviet... " 19
Ce passage montre la vision globale, la large perspective que possède l’organe qui vient de naître de la lutte. D’une manière simple, il exprime une vision clairement politique et en cohérence avec l’être profond de la classe ouvrière, en se reliant avec le mouvement ouvrier mondial. Cette conscience est à la fois expression et facteur actif de l’extension de la grève à tous les secteurs et à tout le pays, une grève pratiquement généralisée à partir du 12 octobre. La grève paralyse l’économie et la vie sociale, mais le Soviet veille à ce que cela n’entraîne pas une paralysie de la lutte ouvrière elle-même. Comme le montre Trotsky, "Elle [la grève] ouvre une imprimerie quand elle a besoin de publier les bulletins de la révolution, elle se sert du télégraphe pour envoyer ses instructions, elle laisse passer les trains qui conduisent les délégués des grévistes" 20. La grève "ne consiste pas simplement dans une interruption du travail pour attendre les événements, n'est pas une passive protestation des bras croisés. Elle se défend, et, de la défensive, passe à l'offensive. Dans plusieurs villes du Midi, elle élève des barricades, fait main basse sur les magasins des armuriers, s'arme et fournit une résistance sinon victorieuse, du moins héroïque "21.
Le Soviet est la scène active où se déroule un débat autour de trois axes :
-
Quel rapport avoir avec les paysans ? Etant des alliés indispensables, comment et dans quelles conditions peuvent-ils être intégrés dans la lutte ?
-
Quel est le rôle de l’armée ? Est-ce que les soldats vont déserter de l’engrenage répressif du régime ?
-
Comment s’armer pour assumer l’affrontement décisif avec l’État tsariste qui devient de plus en plus inévitable ?
Dans les conditions de 1905, ces questions pouvaient être posées, mais elles ne pouvaient pas être résolues. Ce sera la Révolution de 1917 qui leur donnera la réponse. Ceci dit, toutes les capacités qui se sont développées en 1917 n’auraient pas pu être envisagées sans les grands combats de 1905.
On imagine la plupart du temps que des questions comme celles posées ci-dessus ne peuvent être que l’apanage de petits cénacles composés "de stratèges de la révolution". N’empêche que dans le cadre des soviets, elles ont été l’objet d’un débat massif avec la participation et les apports de milliers d’ouvriers. Ces pédants qui considèrent les ouvriers incapables de s’occuper de telles affaires, auraient pu vérifier que ceux-ci en parlaient avec le plus grand naturel, devenaient des experts passionnés et engagés, et versaient dans le creuset de l’organisation collective leurs intuitions, leurs sentiments, leurs connaissances remâchées pendant des années. Comme l’évoque de façon imagée Rosa Luxemburg : "Dans les conditions de la grève de masse, l’honnête père de famille devient un révolutionnaire romantique".
Si le 13, il y avait à peine 40 délégués à la réunion du Soviet, par la suite, le nombre se multiplie jour après jour. La première décision de toute usine qui se déclare en grève est d’élire un délégué auquel on donne un mandat consciencieusement adopté par l’assemblée. Il y a des secteurs qui hésitent : les travailleurs du textile de Saint-Pétersbourg, contrairement à leurs collègues moscovites, ne rejoindront la lutte que le 16. Le 15, "Afin d'amener les abstentionnistes à la grève, le soviet mit au point toute une série de moyens de pression gradués, depuis les exhortations jusqu'à l'emploi de la violence. On ne fut pas obligé, toutefois, d'en arriver à cette extrémité. Lorsque les appels imprimés restaient sans effet, il suffisait de l'apparition d'une foule de grévistes, parfois même de quelques hommes, pour que le travail cessât. 22".
Les réunions du soviet étaient aux antipodes de ce qu’est un parlement bourgeois ou une controverse académique entre universitaires. "Aucune trace de verbosité, cette plaie des institutions représentatives ! Les questions sur lesquelles on délibérait – l'extension de la grève et les exigences à présenter à la douma étaient de caractère purement pratique et les débats se poursuivaient sans phrases inutiles, en termes brefs, énergiques. On sentait que chaque seconde valait un siècle. La moindre velléité de rhétorique se heurtait à une protestation résolue du président, appuyée par toutes les sympathies de l'austère assemblée." 23
Ce débat vif et pratique, à la fois profond et concret, révélait une transformation de la conscience et de la psychologie sociale des ouvriers et, en même temps, constituait un puissant facteur de développement de celles-ci. Conscience : compréhension collective de la situation sociale et de ses perspectives, de la force concrète des masses en action et des objectifs qu’elles doivent se donner, identification des amis et des ennemis, ébauche d’une vision du monde et de son avenir. Mais en même temps psychologie sociale : facteur à la fois distinct mais concomitant avec la conscience, facteur qui s’exprime dans l’attitude morale et vitale des ouvriers, dans leur solidarité contagieuse, dans leur empathie vis-à-vis des autres, dans leur capacité d’ouverture et d’apprentissage, de dévouement désintéressé à la cause commune.
Cette transformation mentale peut apparaître utopique et impossible à ceux qui ne voient les ouvriers que sous le prisme de la normalité quotidienne où ils peuvent apparaître comme des robots atomisés, sans la moindre initiative ni sentiment collectif, détruits par le poids de la concurrence et de la rivalité. Et c’est l’expérience de la lutte massive et, dans son déroulement, la formation des Conseils ouvriers qui montrent comment ceux-ci sont le moteur d’une telle transformation, tel que Trotsky l’exprime : "Le socialisme n'a pas pour but de créer une psychologie socialiste comme prémisse du socialisme, mais de créer des conditions de vie socialiste comme prémisses d'une psychologie socialiste." 24
Les Assemblées générales et les Conseils élus par elles et responsables devant elles deviennent autant le cerveau que le cœur de la lutte. Cerveau pour que des milliers d’êtres humains puissent penser à haute voix et puissent prendre des décisions à la suite d’une période de réflexion. Cœur pour que ces êtres cessent de se percevoir comme des gouttes perdues dans un océan de personnes inconnues les unes des autres et potentiellement hostiles pour devenir une partie active d’une large communauté qui les intègre tous et fait que tous se sentent solides et soutenus.
En se construisant sur ces solides fondations, le Soviet érige le prolétariat en pouvoir alternatif face à l’État bourgeois. Il devient une autorité de plus en plus reconnue socialement. "Au fur et à mesure du développement de la grève d'octobre, le soviet devenait tout naturellement le centre qui attirait l'attention générale des hommes politiques. Son importance croissait littéralement d'heure en heure. Le prolétariat industriel avait été le premier à serrer les rangs autour de lui. L'Union des syndicats, qui avait adhéré à la grève dès le 14 octobre, dut presque immédiatement reconnaître son protectorat. De nombreux comités de grève (…) réglaient leurs actes sur ses décisions." 25
Beaucoup d’auteurs anarchistes et conseillistes ont présenté les soviets comme les porte-drapeaux d’une idéologie fédéraliste bâtie sur l’autonomie locale et corporatiste qui serait opposée au centralisme supposé "autoritaire et castrateur" propre au marxisme. Une réflexion de Trotsky répond à ces objections : "Le rôle de Saint-Pétersbourg dans la révolution russe ne peut entrer en comparaison avec celui de Paris dans la révolution qui achève le XVIIIe siècle. Les conditions générales de l'économie toute primitive de la France, l'état rudimentaire de ses moyens de communication, d'une part et, de l'autre, sa centralisation administrative permettaient à Paris de localiser en fait la révolution dans ses murailles. Il en fut tout autrement chez nous. Le développement capitaliste suscita en Russie autant de foyers révolutionnaires séparés qu'il y avait de centres industriels ; et ceux-ci, tout en gardant l'indépendance et la spontanéité de leurs mouvements, restaient étroitement reliés entre eux" 26.
Nous voyons là, dans la pratique, ce qui signifie centralisation prolétarienne, laquelle se trouve aux antipodes du centralisme bureaucratique et castrateur qui est le propre de l’État et, en général, des classes exploiteuses qui ont existé dans l’histoire. La centralisation prolétarienne ne se fonde pas sur la négation de l’initiative et la spontanéité de ses différentes composantes, mais, au contraire, elle contribue avec tous ses moyens à leur développement. Comme le remarque Trotsky "Le chemin de fer et le télégraphe décentralisaient la révolution, malgré le caractère centralisé de l'Etat ; et en même temps ces moyens de communication donnaient de l'unité à toutes les manifestations locales de la force révolutionnaire. Si, en fin de compte, on peut admettre que la voix de Saint-Pétersbourg eut une influence prépondérante, cela ne veut pas dire que toute la révolution se soit rassemblée sur la perspective Nevski ou devant le Palais d'Hiver ; il faut entendre seulement que les mots d'ordre et les méthodes de lutte que préconisait Saint-Pétersbourg trouvèrent un puissant écho révolutionnaire dans tout le pays." 27.
Le Soviet était la colonne vertébrale de cette centralisation massive : "…nous devons accorder la plus haute place au conseil, ou soviet, des députés ouvriers -poursuit Trotsky. C'est en effet la plus importante organisation ouvrière que la Russie ait connue jusqu'à ce jour. De plus, le soviet de Saint-Pétersbourg fut un exemple et un modèle pour Moscou, Odessa et plusieurs autres villes. Mais il faut dire surtout que cette organisation, qui était vraiment l'émanation de la classe des prolétaires, fut l'organisation type de la révolution. Tous les événements pivotèrent autour du soviet, tous les fils se rattachèrent à lui, tous les appels vinrent de lui" 28.
Le rôle des soviets à la fin du mouvement
Vers la fin octobre 1905, on s’aperçoit clairement que le mouvement est placé devant une alternative : ou c’est l’insurrection ou c’est l’écrasement.
L’objectif de cet article n’est pas d’analyser les facteurs qui amenèrent à la seconde issue 29 : le mouvement déboucha en effet sur une défaite et le régime tsariste – à nouveau maître de la situation - déploya une répression brutale. Cependant, la manière dont le prolétariat livra une bataille acharnée et héroïque mais pleinement consciente, réussit à préparer l’avenir. La douloureuse défaite de décembre 1905 prépara l’avenir révolutionnaire de 1917.
Le Soviet de Saint-Pétersbourg a eu un rôle décisif dans ce dénouement : il a fait tout ce qui était possible pour préparer dans les meilleures conditions un affrontement inévitable. Il constitua des patrouilles ouvrières à caractère initialement défensif (contre les expéditions punitives des Cents Noirs organisés par le Tsar et composés par la lie de la société), aménagea des dépôts d’armes et organisa et entraîna des milices.
Mais, en même temps, et en tirant des enseignements des insurrections ouvrières du 19e siècle 30, le Soviet de Saint-Pétersbourg mit en avant que la clé de la situation était l’attitude des troupes, et c’est pour cela que le gros de ses efforts s’est concentré sur comment gagner les soldats à sa cause.
Et, en fait, les appels et les tracts adressés aux armées, les invitations faites aux troupes pour assister aux séances du Soviet ne tombaient pas dans le vide. Elles faisaient écho à un certain degré de maturation du mécontentement parmi les soldats qui avait abouti à la mutinerie du cuirassé Potemkine (immortalisée par le fameux film) ou au soulèvement de la garnison de Kronstadt en octobre.
En novembre 1905, le Soviet appelle à une grève suivie massivement et dont les objectifs étaient directement politiques : le retrait de la loi martiale en Pologne et l’abolition du Tribunal militaire spécial chargé de juger les marins et les soldats de Kronstadt. Cette grève, qui a réussi à intégrer des secteurs ouvriers n'ayant jamais lutté jusque là, a été reçue avec une énorme sympathie de la part des soldats. Cependant, la grève montra également l’épuisement des forces ouvrières et l’attitude majoritairement passive chez les soldats et les paysans, surtout en province, ce qui précipita l’échec de la grève.
Une autre contribution du Soviet à la préparation de l’affrontement, ce sont les deux mesures apparemment paradoxales qui ont été prises en octobre et novembre. Dès qu’il a compris que la grève d’octobre retombait, le Soviet proposa aux assemblées ouvrières que tous les ouvriers reprennent le travail à la même heure. Ce fait fut une démonstration de force qui mettait en évidence la détermination et la discipline consciente des ouvriers. L’opération a été reprise avant l'affaiblissement du mouvement en novembre. C’était un moyen de préserver les énergies pour l’affrontement général, en montrant à l’ennemi la fermeté et l’unité inébranlables des combattants.
La bourgeoisie libérale russe, dès qu’elle prit conscience de la menace prolétarienne, serra ses rangs autour du régime tsariste. Ce régime s’est alors senti renforcé et a entrepris une chasse systématique aux soviets. On s’est rapidement rendu compte que le mouvement ouvrier en province était en train de refluer. Malgré cela, le prolétariat de Moscou lança l’insurrection qui n’a été écrasée qu’au bout de 14 jours de combats acharnés.
Cet écrasement de l’insurrection de Moscou fut le dernier acte des trois cents jours de liberté, de fraternité, d’organisation et de communauté, vécus par les "simples ouvriers" comme se plaisaient à les appeler les intellectuels libéraux. Durant les deux derniers mois, ces "simples ouvriers" avaient construit un édifice simple, d’un fonctionnement alerte et rapide, qui avait atteint en peu de temps un pouvoir immense, les soviets. Mais, avec la fin de la révolution, ils semblèrent avoir disparu sans laisser de trace, enterrés pour toujours… En dehors des minorités révolutionnaires et des groupes d’ouvriers avancés, personne n'en parlait plus. Et pourtant, en 1917, ils sont revenus sur la scène sociale avec une vocation universelle et une force irrésistible. Nous verrons tout cela dans notre prochain article.
C.Mir, 5-11-09
1 Les 4 premiers congrès de l’Internationale communiste (Editions Librairie du Travail, Page 6 )
2 Le mot "soviet" est aujourd’hui relié au régime barbare de capitalisme d’État qui a régné dans l’ancienne URSS et le mot "soviétique" apparaît aujourd’hui comme synonyme de l’impérialisme russe pendant la longue période de la Guerre froide (1945-89).
3 Malgré le fait que Marx reconnaisse dans la Commune "la forme enfin trouvée de la dictature du prolétariat" et qu’elle contienne de remarquables signes avant-coureurs de ce que seront plus tard les Soviets, la Commune de Paris est plutôt reliée aux formes organisationnelles de démocratie radicale propres aux masses urbaines durant la Révolution française : « Ce fut le Comité central de la Garde nationale, placé à la tête d’un système de conseils de délégués des soldats qui s’était institué dans les unités de l’armée, qui prit l’initiative de proclamer la Commune. Les clubs de bataillon, organismes de base, avaient élu des conseils de légion, dont chacun envoya trois représentants siéger parmi les 60 membres du Comité central. Il était prévu qu’une assemblée générale des délégués de compagnie, révocables à tout instant, se tiendrait chaque mois" (Les Soviets en Russie, d’Oskar Anweiler, traduction française de Serge Bricianer, page 12)
4 Citation reprise par Trotsky de sa préface à la traduction russe de l'Adresse au jury, de F. Lassalle, dans Bilan et perspectives, ch. 8 "Un gouvernement ouvrier en Russie et le socialisme [41]".
5 Nous ne pouvons pas ici développer une chronique de ces événements. Voir "Il y a 100 ans : La Révolution de 1905 en Russie (I) [42]".
6 Le livre de Rosa Luxemburg Grève de masse, parti et syndicats décrit et analyse avec beaucoup de clarté la dynamique du mouvement avec ses hauts et ses bas, avec ses moments ascendants et ses moments de reflux soudains.
7 La Russie, dans la situation mondiale d’apogée et du début de déclin du système capitaliste, était prisonnière de la contradiction entre le frein que le tsarisme féodal signifiait pour le développement capitaliste et la nécessité pour la bourgeoisie libérale de s’appuyer sur ce système non seulement en tant qu’appareil bureaucratique pour son développement, mais aussi en tant que forteresse répressive contre l’émergence impétueuse du prolétariat. Lire le livre de Trotsky cité ci-dessus.
8 "…un soir où, comme d'habitude, il y avait chez moi plusieurs ouvriers - et que Nossar était des nôtres [Nossar fut le premier président du Soviet de Saint-Pétersbourg en octobre 1905] - l'idée surgit parmi nous de créer un organisme ouvrier permanent : une sorte de comité ou plutôt de conseil qui veillerait sur la suite des événements, servirait de lien entre tous les ouvriers, les renseignerait sur la situation et pourrait, le cas échéant, rallier autour de lui les forces ouvrières révolutionnaires." kropot.free.fr/Voline-revinco.htm [43]
9 Voline fut un militant anarchiste qui est resté toujours fidèle au prolétariat dénonçant la Deuxième Guerre mondiale à partir d’une position internationaliste.
10 Il est né le 13 mai 1905 dans la ville industrielle d’Ivanovo-Vosnesensk au centre de la Russie. Pour plus de détails, lire l’article de la Revue internationale nº 122 sur 1905 (2ª partie)
11 Oskar Anweiler, Les Soviets en Russie (1905-1921) aux Editions Gallimard, 1972.
12 NDLR : Fiodor Fiodorovitch Trepov, militaire de formation, fut chef de la police tsariste à Varsovie entre 1860 et 1861 puis entre 1863 et 1866. Il exerça ces mêmes fonctions à Petersbourg dans les années 1874-1880. Il était connu pour la brutalité de ses méthodes de répression, se signalant en particulier par l’écrasement des émeutes estudiantines comme à l'Institut Technologique en janvier 1874 et celle de la manifestation de la cathédrale de Kazan en 1876 (source Wikipedia).
13 Trotsky, 1905 [44], "La grève d’octobre"
14 Idem.
15 Andres Nin, Los Soviets en Rusia, p. 17, (traduit de l’espagnol par nous).
16 Trotsky, 1905 [44], "La grève d’octobre, II".
17 Idem, III.
18 Idem, "Formation du soviet des députés ouvriers"
19 Idem (citation de Trotsky)
20 Idem, "La grève d’octobre", III.
21 Idem, VI.
22 Idem, "Formation du soviet des députés ouvriers"
23 Ibidem.
24 Léon Trotsky, Bilan et Perspectives, [41] Chap. "7 “Les prémisses du socialisme
25 Trotsky, 1905 [44] "Formation du Soviet des députés ouvriers".
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem
29 Consulter particulièrement l’article de la Revue internationale nº 123 sur 1905 et le rôle des soviets (2ª Partie) [45].
30 Surtout des combats de barricade dont Engels avait pu comprendre l’épuisement dans son "Introduction" à La Lutte de classe en France de Marx. Cette "Introduction", écrite en 1895, est devenue très connue parce que la critique portée par Engels aux combats de barricade fut utilisée par les opportunistes de la Social-démocratie pour cautionner le rejet de la violence et l’emploi exclusif des méthodes parlementaires et syndicalistes.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
La science et le mouvement marxiste : le legs de Freud
- 4931 lectures
Le CCI a publié récemment, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin, plusieurs articles à propos de ce grand scientifique et de sa théorie sur l'évolution des espèces. 1 Ces articles s'inscrivaient dans ce qui a toujours été présent dans le mouvement ouvrier, l'intérêt pour les questions scientifiques, et qui s'exprime au plus haut niveau dans la théorie révolutionnaire du prolétariat, le marxisme. Celui-ci a développé une critique des visions religieuses et idéalistes de la société humaine et de l'histoire qui avaient cours dans les sociétés féodale et capitaliste mais qui imprégnaient aussi les théories socialistes qui ont marqué les premiers pas du mouvement ouvrier, au début du 19e siècle. A l'encontre de ces dernières, il s'est donné comme un de ses objectifs de fonder la perspective de la future société qui délivrera l'être humain de l'exploitation, de l'oppression et de l'ensemble des maux qui l'accablent depuis des millénaires non pas sur une "réalisation des principes d'égalité et de justice" mais d'une nécessité matérielle découlant de l'évolution même de l'histoire humaine, et de la nature dont elle fait partie, elle-même mue, en dernier ressort, par des forces matérielles et non par des forces spirituelles. C'est pour cela que le mouvement ouvrier, à commencer par Marx et Engels eux-mêmes, à toujours porté une attention toute particulière à la science.
La science a précédé de beaucoup l'apparition du mouvement ouvrier et même de la classe ouvrière. On peut même dire que cette dernière n'a pu se développer à large échelle qu'avec le progrès des sciences qui constituèrent une des conditions de l'essor du capitalisme, mode de production basé sur l'exploitation du prolétariat. En ce sens, la bourgeoisie est la première classe de l'histoire qui ait eu besoin, de façon inéluctable, de la science pour son propre développement et l'affirmation de son pouvoir sur la société. C'est en faisant appel à la science qu'elle a combattu l'emprise de la religion qui constituait l'instrument idéologique fondamental de défense et de justification de la société féodale. Mais plus encore, la science a constitué le soubassement de la maîtrise des technologies de la production et des transports, condition de l'épanouissement du capitalisme. Lorsque celui-ci a atteint son apogée, permettant de ce fait le surgissement sur la scène sociale de ce que le Manifeste Communiste appelle son "fossoyeur", le prolétariat moderne, la bourgeoisie s'est empressée de renouer avec la religion et les visions mystiques de la société qui ont le grand mérite de justifier le maintien d'un ordre social basé sur l'exploitation et l'oppression. Ce faisant, si elle a continué à promouvoir et à financer, toutes les recherches qui lui étaient indispensables pour garantir ses profits, pour accroitre la productivité de la force de travail et l'efficacité de ses forces militaires, elle s'est détournée de l'approche scientifique pour ce qui relève de la connaissance de la société humaine.
Il revient au prolétariat, dans sa lutte contre le capitalisme et pour le renversement de ce dernier, de reprendre le flambeau sur des terrains de la connaissance scientifique abandonnés par la bourgeoisie. C'est ce qu'il a fait dès le milieu du 19e siècle en opposant à l'apologétique dans laquelle s'était convertie l'étude de l'économie, c'est-à-dire du "squelette de la société", une vision critique et révolutionnaire de cette étude, une vision nécessairement scientifique telle qu'elle s'exprime, par exemple, dans Le capital de Karl Marx. C'est pourquoi les organisations révolutionnaires du prolétariat ont la responsabilité d'encourager l'intérêt pour les connaissances et recherches scientifiques, notamment dans les domaines qui se rapportent à la société humaine, à l'être humain et son psychisme, domaines par excellence où la classe dominante a intérêt à cultiver l'obscurantisme. Cela ne signifie pas que pour faire partie d'une organisation communiste, il soit nécessaire d'avoir fait des études scientifiques, d'être en mesure de défendre la théorie de Darwin ou de résoudre une équation du second degré. Les bases d'adhésion à notre organisation sont consignées dans notre plate-forme avec laquelle tout militant doit être en accord et qu'il a pour responsabilité de défendre. De même, sur toute une série de questions, comme par exemple l'analyse que nous faisons de tel ou tel aspect de la situation internationale, l'organisation se doit d'avoir une position laquelle est consignée, en général, dans les résolutions adoptées par chacun de nos congrès ou par les réunions plénières de notre organe central. Dans ces cas-là, il n'est pas obligatoire que chaque militant partage une telle prise de position. Le simple fait que ces résolutions soient adoptées suite à une discussion et un vote indique qu'il peut parfaitement exister des points de vue différents lesquels, s'ils se maintiennent et lorsqu'ils sont suffisamment élaborés, s'expriment publiquement dans notre presse comme on peut le constater avec le débat sur la dynamique économique du boom qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
Concernant les articles abordant des questions culturelles (critique de livre ou de film, par exemple) ou scientifiques, non seulement ils n'ont pas vocation à rencontrer l'adhésion de chaque militant (comme c'est le cas avec la plate-forme), mais ils ne sauraient, en général, être considérés comme représentant la position de l'organisation comme c'est le cas pour les résolutions adoptées par les congrès. Ainsi, tout comme les articles que nous avons publiés sur Darwin, l'article qui suit, rédigé à l'occasion des 70 ans de la disparition de Sigmund Freud, n'engage pas le CCI comme tel. Il doit être considéré comme une contribution à une discussion ouverte non seulement aux militants du CCI qui ne partagent pas son contenu, mais également à l'extérieur de notre organisation. Il s'inscrit dans une rubrique de la Revue Internationale, que le CCI tient à rendre la plus vivante possible, et qui a pour vocation de rendre compte des réflexions et discussions touchant aux questions culturelles et scientifiques. En ce sens, il constitue un appel aux contributions pouvant défendre un point de vue différent que celui qui y est exprimé.
CCI
Le legs de Freud
Le 23 septembre 1939, Sigmund Freud mourait à Hampstead, dans ce qui est aujourd’hui le Musée Freud à Londres. Quelques semaines auparavant avait débuté la Seconde Guerre mondiale. Il y a une histoire qui raconte que Freud, écoutant la radio ou parlant à son petit-fils (les versions varient), et répondant à la question brûlante : "est-ce que ce sera la dernière guerre ?", aurait laconiquement répondu : "En tous cas, ce sera ma dernière guerre".
Freud s’était exilé de sa maison et de son cabinet de Vienne peu après que les nervis nazis eurent pénétré dans son appartement et arrêté sa fille, Anna Freud, relâchée peu après. Freud faisait face à la persécution du pouvoir nazi mis en place après l’Anschluss entre l’Allemagne et l’Autriche, non seulement parce qu’il était juif, mais aussi parce qu’il était la figure fondatrice de la psychanalyse, discipline condamnée par le régime comme un exemple de la "pensée juive dégénérée" : les travaux de Freud, au même titre que ceux de Marx, d’Einstein, de Kafka, de Thomas Mann et d’autres, ont eu l’honneur d’être parmi les premiers livrés aux flammes des autodafés en 1933.
Mais les Nazis n’étaient pas les seuls à haïr Freud. Leurs homologues staliniens avaient également décidé que les théories de Freud devaient être dénoncées du haut des chaires de l'État. Tout comme il mit un terme à toute expérimentation dans l’art, l’éducation et dans d'autres sphères de la vie sociale, le stalinisme triomphant mena une chasse aux sorcières contre les tenants de la psychanalyse en Union soviétique et, en particulier, contre ceux qui estimaient que les travaux de Freud étaient compatibles avec le marxisme. Le pouvoir des soviets avait eu, au départ, une tout autre attitude. Bien que les bolcheviks n'aient nullement adopté une démarche homogène vis-à-vis de cette question, nombre de bolcheviks connus comme Lounatcharski, Boukharine et Trotsky lui-même avaient des sympathies pour les buts et les méthodes de la psychanalyse ; de ce fait, la branche russe de l’Association internationale de Psychanalyse avait été la première au monde à obtenir le soutien, y compris financier, d’un État. Au cours de cette période, l’un des buts fondamentaux de cette branche a été de créer une "école pour les orphelins" qui devait élever et soigner les enfants traumatisés par la perte de leurs parents au cours de la guerre civile. Freud lui-même portait un grand intérêt à ces expériences : il était particulièrement curieux de savoir jusqu’à quel point les différents efforts pour élever les enfants de façon collective, et non sur la base confinée et tyrannique du noyau familial, joueraient sur le complexe d’Œdipe qu’il avait identifié comme une question centrale dans l’histoire psychologique de l'individu. En même temps, des bolcheviks comme Lev Vygotsky, Alexander Luria, Tatiana Rosenthal et M.A. Reisner apportaient des contributions à la théorie psychanalytique et exploraient ses relations avec le matérialisme historique. 2
Tout cela prit fin lorsque la bureaucratie stalinienne eut assuré son emprise sur l’État. Les idées de Freud furent de plus en plus dénoncées comme petite-bourgeoises, décadentes et avant tout idéalistes, alors que la démarche plus mécaniste de Pavlov et sa théorie du "réflexe conditionné" étaient promues comme exemple de la psychologie matérialiste. À la fin des années 1920, il y eut une formidable inflation de textes rédigés par les porte-parole du régime s’opposant à Freud de façon pernicieuse, une série de "défections" de ses anciens adeptes comme Aron Zalkind, et même des attaques hystériques contre une "morale relâchée" crapuleusement associée aux idées de Freud dans ce qui fut plus généralement le "Thermidor de la famille" (selon l'expression de Trotsky).
La victoire finale du stalinisme contre le "Freudisme" fut entérinée au Congrès sur le Comportement humain de 1930, en particulier à travers le discours de Zalkind qui ridiculisa l'ensemble de la démarche freudienne et avança que sa vision du comportement humain était totalement incompatible avec "la construction du socialisme" : "Comment pouvons-nous utiliser la conception freudienne de l’homme dans la construction socialiste ? Nous avons besoin d’un homme socialement "ouvert", qui soit facile à collectiviser, à transformer rapidement et en profondeur dans son comportement – un homme qui sache se montrer solide, conscient et indépendant, bien formé politiquement et idéologiquement…" (cité dans Miller, Freud and the Bolsheviks, Yale, 1998, p. 102, traduit par nous). Nous savons très bien ce que cette "formation" et cette "transformation" signifiaient réellement : briser la personnalité humaine et la résistance des travailleurs au service du capitalisme d’État et de son impitoyable Plan quinquennal. Dans cette vision, il n’y avait évidemment pas de place pour les subtilités et la complexité de la psychanalyse, qui pouvait être utilisée pour montrer que le "socialisme" stalinien n'avait guéri aucune des maladies de l'humanité. Et, bien entendu, le fait que la psychanalyse avait joui d'un certain degré de soutien de la part de Trotsky, à présent exilé, était monté en épingle dans l’offensive idéologique contre les théories de Freud.
Et dans le monde "démocratique" ?
Mais qu’en est-il des représentants du camp démocratique du capitalisme ? L’Amérique de Roosevelt n’a-t-elle pas fait pression pour que Freud et sa famille proche puissent quitter Vienne. Et la Grande-Bretagne n’a-t-elle pas attribué une confortable demeure à l’éminent Professeur et Docteur Freud ? La psychanalyse n’est-elle pas devenue en Occident, notamment aux États-Unis, une sorte de nouvelle église orthodoxe de psychologie, certainement rentable pour beaucoup de ses praticiens ?
En fait, la réaction des intellectuels et des scientifiques aux théories de Freud dans les démocraties a toujours été très mélangée, faite de vénération, de fascination et de respect, combinés à l'indignation, la résistance et le mépris.
Mais au cours des années qui ont suivi la mort de Freud, on a vu deux tendances majeures dans la réception de la théorie psychanalytique : d’un côté, une tendance parmi ses propres porte-parole et praticiens à diluer certaines de ses implications les plus subversives (comme l’idée que la civilisation actuelle est nécessairement fondée sur la répression des instincts humains les plus profonds) au profit d’une démarche plus pragmatique et révisionniste, plus apte à se faire accepter socialement et politiquement par cette même civilisation ; et, d’un autre côté, chez un certain nombre de philosophes, de psychologues appartenant à des écoles rivales et d'auteurs ayant plus ou moins de réussite commerciale, une tendance à rejeter de plus en plus l'ensemble du corpus des idées freudiennes parce qu'elles auraient été subjectives, invérifiables et fondamentalement non-scientifiques. Les tendances dominantes de la psychologie moderne (il y a des exceptions, comme dans la "neuro-psychanalyse" qui réexamine le modèle freudien de la psyché en fonction de ce que nous connaissons aujourd’hui de la structure du cerveau) ont abandonné le voyage de Freud sur la "route royale vers l’inconscient", son effort pour explorer la signification des rêves, des mots d'esprit, des lapsus et autres manifestations immatérielles, au profit de l’étude de phénomènes plus observables et mesurables : les manifestations physiologiques, externes des états mentaux, et les formes concrètes de comportement chez les êtres humains, les rats et d'autres animaux observés dans des conditions de laboratoire. En matière de psychothérapie, l’État-providence, très intéressé à réduire les coûts potentiellement énormes induits par le traitement de l’épidémie grandissante de stress, de névroses et de maladies mentales classiques engendrée par le système social actuel, favorise les solutions rapides telles que les "thérapies cognitives et comportementales" plutôt que les efforts de la psychanalyse pour pénétrer aux racines profondes des névroses 3. Surtout, et c’est particulièrement vrai pour les deux dernières décennies, on a vu un véritable torrent de livres et d’articles tenter de faire passer Freud pour un charlatan, un fraudeur ayant fabriqué ses preuves, un tyran vis-à-vis de ses disciples, un hypocrite et (pourquoi pas ?) un pervers. Cette offensive a beaucoup de traits en commun avec la campagne anti-Marx lancée au lendemain de l’effondrement du prétendu "communisme" à la fin des années 80 et, tout comme cette dernière campagne avait donné naissance au Livre noir du communisme, on nous a servi maintenant un Livre noir de la psychanalyse 4 qui consacre pas moins de 830 pages à traîner Freud et tout le mouvement psychanalytique dans la boue.
Le marxisme et l'inconscient
L’hostilité à la psychanalyse n’a pas surpris Freud : elle a confirmé qu’il avait visé juste. Après tout, pourquoi aurait-il été populaire en développant l'idée que la civilisation (au moins la civilisation actuelle) est antithétique aux instincts humains et en infligeant une blessure, en portant un nouveau coup à "l'amour-propre naïf" de l’homme – selon son expression ?
"C'est en attribuant une importance pareille à l'inconscient dans la vie psychique que nous avons dressé contre la psychanalyse les plus méchants esprits de la critique. Ne vous en étonnez pas et ne croyez pas que la résistance qu'on nous oppose tienne à la difficulté de concevoir l'inconscient ou à l'inaccessibilité des expériences qui s'y rapportent. Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique, lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours, à la suite des travaux de Charles Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique." (Introduction à la psychanalyse, Troisième partie, Conférence 18, "Rattachement à une action traumatique – l’inconscient", 1917 5)
Pour les marxistes, cependant, il n'y a rien de choquant dans l'idée que la vie consciente de l’homme soit – ou ait été jusqu’ici – dominée par des motifs inconscients. Le concept marxiste d’idéologie (qui englobe toutes les formes de conscience sociale avant l'émergence de la conscience de classe du prolétariat) est ancré exactement sur cette notion.
"Chaque idéologie, une fois constituée, se développe sur la base des éléments de représentation donnés et continue à les élaborer ; sinon elle ne serait pas une idéologie, c'est-à-dire le fait de s'occuper d'idées prises comme entités autonomes, se développant d'une façon indépendante et uniquement soumises à leurs propres lois. Que les conditions d'existence matérielles des hommes, dans le cerveau desquels se poursuit ce processus mental, en déterminent en fin de compte le cours, cela reste chez eux nécessairement inconscient, sinon c'en serait fini de toute idéologie." (Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande classique, 1888, IV "Le matérialisme dialectique" 6)
Le marxisme reconnaît donc que, jusqu’à aujourd’hui, la conscience que l’homme a de sa position réelle dans le monde a été inhibée et déformée par des facteurs dont il n’est pas conscient, que la vie sociale telle qu'elle a été constituée jusqu’ici a créé des blocages fondamentaux dans les processus mentaux de l'homme. Un clair exemple en est l’incapacité historique de la bourgeoisie d’envisager une forme de société supérieure, autre que le capitalisme, du fait que cela impliquerait sa propre disparition. C’est ce que Lukács appelait un "inconscient conditionné de classe" (Histoire et conscience de classe). Et on peut aussi envisager la question du point de vue de la théorie de Marx sur l'aliénation : l’homme aliéné est séparé de son semblable, de la nature et de lui-même, tandis que le communisme dépassera cette dichotomie et que l’homme y sera pleinement conscient de lui-même.
Trotsky défend la psychanalyse
Parmi tous les marxistes du 20e siècle, c’est probablement Trotsky qui a contribué le plus à l'ouverture d'un dialogue avec les théories de Freud, qu’il avait rencontrées au cours de son séjour à Vienne en 1908. Alors qu’il était toujours impliqué dans l’État soviétique mais de plus en plus marginalisé, Trotsky insistait sur le fait que la démarche de Freud envers la psychologie était fondamentalement matérialiste. Il s’opposait à ce qu’une école particulière de psychologie devienne la ligne "officielle" de l’État ou du parti, mais au contraire appelait à un débat large et ouvert. Dans Culture et socialisme, écrit en 1925/26, Trotsky évalue les démarches différentes des écoles freudienne et pavlovienne, et esquisse ce qu'il pense que devrait être l’attitude du parti vis-à-vis de ces questions :
"La critique marxiste de la science doit être non seulement vigilante mais également prudente, sinon elle pourrait dégénérer en un véritable sycophantisme, en une famousovtchina. Prenons par exemple la psychologie. L'étude des réflexes de Pavlov se situe entièrement sur la voie du matérialisme dialectique. Elle renverse définitivement le mur qui existait entre la physiologie et la psychologie. Le plus simple réflexe est physiologique, mais le système des réflexes donnera la "conscience". L'accumulation de la quantité physiologique donne une nouvelle qualité, la qualité "psychologique". La méthode de l'école de Pavlov est expérimentale et minutieuse. La généralisation se conquiert pas à pas depuis la salive du chien jusqu'à la poésie (c'est-à-dire jusqu'à la mécanique psychique de celle-ci et non sa teneur sociale), bien que les voies vers la poésie ne soient pas encore en vue.
C'est d'une manière différente que l'école du psychanalyste viennois Freud aborde la question. Elle part, tout d'abord, de la considération que les forces motrices des processus psychiques les plus complexes et les plus délicats s'avèrent être des nécessités physiologiques. Dans ce sens général, cette école est matérialiste, si l'on écarte la question de savoir si elle ne donne pas une place trop importante au facteur sexuel au détriment des autres facteurs (mais c'est déjà là un débat qui s'inscrit dans le cadre du matérialisme). Pourtant, le psychanalyste n'aborde pas expérimentalement le problème de la conscience, depuis les phénomènes primaires jusqu'aux phénomènes les plus élevés, depuis le simple réflexe jusqu'au réflexe le plus complexe; il s'évertue à franchir d'un seul bond tous les échelons intermédiaires, de haut en bas, du mythe religieux, de la poésie lyrique ou du rêve, directement aux bases physiologiques de l'âme.
Les idéalistes enseignent que l'âme est autonome, que la 'pensée' est un puits sans fond. Pavlov et Freud, par contre, considèrent que le fond de la 'pensée' est constitué par la physiologie. Mais tandis que Pavlov, comme un scaphandrier, descend jusqu'au fond et explore minutieusement le puits, de bas en haut, Freud se tient au-dessus du puits et d'un regard perçant, s'évertue, au travers de la masse toujours fluctuante de l'eau trouble, de discerner ou de deviner la configuration du fond. La méthode de Pavlov, c'est l'expérimentation. La méthode de Freud, la conjecture, parfois fantastique. La tentative de déclarer la psychanalyse 'incompatible' avec le marxisme et de tourner le dos sans cérémonie au freudisme est trop simpliste, ou plutôt trop 'simplette'. En aucun cas nous ne sommes tenus d'adopter le freudisme. C'est une hypothèse de travail qui peut donner — et qui incontestablement donne — des hypothèses et des conclusions qui s'inscrivent dans la ligne de la psychologie matérialiste. La voie expérimentale amène, en son temps, la preuve. Mais nous n'avons ni motif ni droit d'élever un interdit à une autre voie, quand bien même elle serait moins sûre, qui s'efforce d'anticiper des conclusions auxquelles la voie expérimentale ne mène que bien plus lentement." 7
En fait, Trotsky a très rapidement mis en question la démarche quelque peu mécaniste de Pavlov, qui tendait à réduire l’activité consciente au fameux "réflexe conditionné". Dans un discours prononcé peu après la publication du texte cité plus haut, Trotsky se demandait si on pourrait vraiment parvenir à une connaissance des sources de la poésie humaine à travers l’étude de la salivation canine (voir Notebooks de Trotsky, 1933/35, Writings on Lenin, Dialectics and Evolutionism, traduits en anglais et introduits par Philip Pomper, New York, 1998, p. 49). Et dans les réflexions ultérieures sur la psychanalyse contenues dans ces "carnets philosophiques", composés en exil, il insiste bien plus sur la nécessité de comprendre le fait que reconnaître une certaine autonomie de la vie psychique, si elle est conflictuelle avec une version mécaniste du matérialisme, est en réalité parfaitement compatible avec une vision plus dialectique du matérialisme :
"Il est bien connu qu’il existe toute une école de psychiatrie (la psychanalyse, Freud) qui en pratique ne tient aucun compte de la physiologie, se basant sur le déterminisme interne des phénomènes psychiques tels qu'ils sont. Certaines critiques accusent donc l’école freudienne d’idéalisme. […] Mais en elle-même la méthode de la psychanalyse, qui prend comme point de départ 'l’autonomie' des phénomènes psychologiques, ne contredit nullement le matérialisme. Tout au contraire, c’est précisément le matérialisme dialectique qui nous amène à l’idée que la psyché ne pourrait même pas se former si elle ne jouait pas, dans certaines limites il est vrai, un rôle autonome et indépendant dans la vie de l’individu et de l’espèce.
Tout de même, nous approchons ici une question en quelque sorte cruciale, une rupture dans le gradualisme, une transition de la quantité en qualité : la psyché, qui émerge de la matière, est 'libérée' du déterminisme de la matière et peut de façon indépendante, par ses propres lois, influencer la matière."
(Carnets de Trotsky, op.cit., p. 106, notre traduction)
Trotsky affirme ici qu’il existe une véritable convergence entre le marxisme et la psychanalyse. Pour les deux, la conscience, ou plutôt l’ensemble de la vie psychique, est un produit matériel du mouvement réel de la nature et non une force existant en-dehors du monde ; elle est le produit de processus inconscients qui la précèdent et la déterminent. Mais elle devient à son tour un facteur actif qui, dans une certaine mesure, développe sa dynamique propre et qui, plus important, est capable d’agir et de transformer l’inconscient. C’est là la seule base d’une démarche qui fait de l’homme plus qu’une créature des circonstances objectives, et qui le rend capable de changer le monde autour de lui.
Et nous en arrivons ici à ce qui est, peut-être, la plus importante conclusion que tire Trotsky de son investigation dans les théories de Freud. Freud, rappelons-le, avait affirmé que la principale blessure infligée par la psychanalyse au "narcissisme naïf" de l’homme, était la confirmation que l’ego n’est pas maître dans sa propre maison, que dans une large mesure sa vision et son approche du monde sont conditionnées par des forces instinctives qui ont été refoulées dans l’inconscient. Freud lui-même, à une ou deux occasions, a été jusqu’à envisager une société qui aurait dépassé la lutte sans fin contre les privations matérielles et ainsi n’aurait plus à imposer cette répression à ses membres 8. Mais dans l’ensemble, son point de vue restait prudemment pessimiste du fait qu'il ne voyait pas de voie pouvant mener à une telle société. Trotsky, en tant que révolutionnaire, était tenu de soulever la possibilité d’une humanité pleinement consciente qui deviendrait ainsi maîtresse dans sa propre maison. En fait, pour Trotsky, la libération de l’humanité de la domination de l’inconscient devient le projet central de la société communiste : "Enfin, l'homme commencera sérieusement à harmoniser son propre être. Il visera à obtenir une précision, un discernement, une économie plus grands, et par suite, de la beauté dans les mouvements de son propre corps, au travail, dans la marche, au jeu. Il voudra maîtriser les processus semi-conscients et inconscients de son propre organisme : la respiration, la circulation du sang, la digestion, la reproduction. Et, dans les limites inévitables, il cherchera à les subordonner au contrôle de la raison et de la volonté. L'homo sapiens, maintenant figé, se traitera lui-même comme objet des méthodes les plus complexes de la sélection artificielle et des exercices psycho-physiques.
Ces perspectives découlent de toute l'évolution de l'homme. Il a commencé par chasser les ténèbres de la production et de l'idéologie, par briser, au moyen de la technologie, la routine barbare de son travail, et par triompher de la religion au moyen de la science. Il a expulsé l'inconscient de la politique en renversant les monarchies auxquelles il a substitué les démocraties et parlementarismes rationalistes, puis la dictature sans ambiguïté des soviets. Au moyen de l'organisation socialiste, il élimine la spontanéité aveugle, élémentaire des rapports économiques. Ce qui permet de reconstruire sur de tout autres bases la traditionnelle vie de famille. Finalement, si la nature de l'homme se trouve tapie dans les recoins les plus obscurs de l'inconscient, ne va-t-il pas de soi que, dans ce sens, doivent se diriger les plus grands efforts de la pensée qui cherche et qui crée ?" (Littérature et révolution, 1924, Ed. La Passion)
Évidemment, dans ce passage, Trotsky regarde vers un futur communiste très lointain. La priorité de l'humanité dans les premières phases du communisme portera sûrement sur les couches de l'inconscient où les origines des névroses et des souffrances mentales peuvent être dépistées, tandis que la perspective de contrôler des processus physiologiques encore plus fondamentaux soulève d'autres questions qui vont au delà de cet article et qui, de toutes façons, ne seront probablement posées que dans une culture communiste d'un niveau plus avancé.
Les communistes aujourd’hui peuvent être d’accord ou pas avec beaucoup d’idées de Freud. Mais il est sûr que nous devons exprimer la plus grande méfiance vis-à-vis des campagnes actuelles contre Freud et conserver une démarche la plus ouverte possible, comme le défendait Trotsky. Et, au minimum, nous devons admettre que tant que nous vivrons dans un monde où les "mauvaises passions" de l’humanité peuvent exploser avec une force terrifiante, où les relations sexuelles entre les êtres humains, qu'elles soient emprisonnées dans des idéologies médiévales, ou dévaluées et prostituées sur le marché, continuent à être une source de misère humaine indicible, où, pour la grande majorité des hommes, les forces créatrices de l’esprit restent largement étouffées et inaccessibles, les problèmes abordés par Sigmund Freud restent non seulement aussi pertinents aujourd’hui que lorsqu'ils furent soulevés pour la première fois, mais aussi que leur résolution sera certainement un élément irremplaçable dans la construction d’une société réellement humaine.
Amos
1 Voir "Darwinisme et marxisme" d'Anton Pannekoek dans les numéros 137 [48] et 138 [49] de la Revue Internationale, de même que les articles "Darwin et le mouvement ouvrier [50]", "A propos du livre L'effet Darwin : une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation [51]" et "Le 'darwinisme social', une idéologie réactionnaire du capitalisme [52]", respectivement dans les numéros 399, 400 et 404 de Révolution Internationale.
2 Les paroles suivantes de Lénine, rapportées par Clara Zetkin, montrent que les bolcheviks n'avaient pas une démarche unilatérale envers les théories de Freud –même si on peut aussi penser que les critiques de Lénine portaient plus sur les défenseurs de ces théories que sur les théories elles-mêmes : "La situation en Allemagne même exige la concentration extrême de toutes les forces révolutionnaires, prolétariennes, pour la lutte contre la réaction de plus en plus insolente ! Mais les militantes discutent de la question sexuelle, et des formes du mariage dans le passé, le présent et le futur. Elles considèrent que leur tâche la plus importante est d'éclairer les travailleuses sur ce point. L'écrit le plus répandu en ce moment est la brochure d'une jeune camarade de Vienne sur la question sexuelle. C'est de la foutaise ! Ce qu'il y a là-dedans, les ouvriers l'ont lu depuis longtemps dans Bebel. Cela n'est pas exprimé d'une façon aussi ennuyeuse, comme dans cette brochure, mais avec un caractère d'agitation, d'attaque contre la société bourgeoise. La discussion sur les hypothèses de Freud vous donne un air 'cultivé' et même scientifique, mais ce n'est au fond qu'un vulgaire travail d'écolier. La théorie de Freud est également une 'folie' à la mode. Je me méfie des théories sexuelles et de toute cette littérature spéciale qui croît abondamment sur le fumier de la société bourgeoise. Je me méfie de ceux qui ne voient que la question sexuelle, comme le prêtre hindou ne voit que son nuage. Je considère cette surabondance de théories sexuelles, qui sont pour la plupart des hypothèses, et souvent des hypothèses arbitraires, comme provenant d'un besoin personnel de justifier devant la morale bourgeoise sa propre vie anormale ou hypertrophique, ou du moins l'excuser. Ce respect déguisé de la morale bourgeoise m'est aussi antipathique que cette importance accordée aux questions sexuelles. Cela peut paraître aussi révolutionnaire que cela voudra, c'est, au fond, profondément bourgeois. C'est surtout une mode d'intellectuels. Il n'y a pas de place pour cela dans le parti, dans le prolétariat conscient." ("Souvenirs sur Lénine [53]", Clara Zetkin, Janvier 1924).
3 Nous voulons cependant préciser que cet article n'a pas pour objet de juger de l'efficacité thérapeutique de la démarche de Freud. Nous ne sommes pas qualifiés pour cela et, de toutes façons, il n'y a pas de lien mécanique entre l'application pratique de la théorie freudienne et la théorie de l'esprit qui la sous-tend – encore plus du fait que "soigner" les névroses dans une société qui les engendrent en permanence, est un problème qui se pose en fin de compte sur un plan social et non individuel. Ce sont les fondements de la théorie de l'esprit de Freud que nous envisageons ici, et c'est avant tout ces fondements que nous considérons comme un vrai héritage pour le mouvement ouvrier.
4 Le livre noir de la psychanalyse, Catherine Meyer, Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux et Jacques Van Rillaer, Les Arènes, Paris, France, 2005
5 classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/intro_a_la_psychanalyse/intro_psychanalyse_2.rtf [54]
6 www.marxists.org/francais/engels/works/1888/02/fe_18880221_4.htm [55]
7 https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/culture.htm [56]
8 Contrairement au cliché si souvent répété selon lequel Freud "réduirait tout au sexe", il a clairement affirmé que "la base sur laquelle repose la société humaine est, en dernière analyse, de nature économique : ne possédant pas assez de moyens de subsistance pour permettre à ses membres de vivre sans travailler, la société est obligée de limiter le nombre de ses membres et de détourner leur énergie de l'activité sexuelle vers le travail. Nous sommes là en présence de l'éternel besoin vital qui, né en même temps que l'homme, persiste jusqu'à nos jours." (Introduction à la psychanalyse [54], Conférence 20, La vie sexuelle de l’homme).
En d’autres termes : la répression est le produit d’organisations sociales des hommes dominées par la pénurie matérielle. Dans un autre passage, dans L’avenir d’une illusion (1927), Freud a montré une compréhension de la nature de classe de la société "civilisée" et s'est même permis au passage d’en envisager le stade ultérieur : "Mais lorsqu’une culture n'est pas parvenue à dépasser l’état où la satisfaction d’un certain nombre de participants présuppose l'oppression de certains autres, de la majorité peut-être - et c’est le cas de toutes les cultures actuelles -, il est alors compréhensible que ces opprimés développent une hostilité intense à l’encontre de la culture même qu’ils rendent possible par leur travail, mais aux biens de laquelle ils n’ont qu’une part trop minime. […] L’hostilité à la culture manifestée par ces classes est si patente qu’en raison d’elle on n’a pas vu l’hostilité plutôt latente des couches sociales mieux partagées. Il va sans dire qu'une culture qui laisse insatisfaits un si grand nombre de participants et les pousse à la révolte n'a aucune chance de se maintenir durablement et ne le mérite pas non plus. » (L’avenir d’une illusion, chapitre 2 p. 12, Quadrige/PUF, 1995). Ainsi l’ordre actuel non seulement n’a "aucune perspective d’existence durable", mais il pourrait peut-être y avoir une culture qui aurait "dépassé l'état" à partir duquel toute division de classe (et, par conséquent, les mécanismes de répression mentale existant jusqu’ici) deviendrait superflue.
Personnages:
- Freud [57]
Récent et en cours:
- Marxisme et science [58]
Revue Internationale n° 141 - 2e trimestre 2010
- 2457 lectures
Face à la faillite de plus en plus évidente du capitalisme ... un seul avenir, la lutte de classe !
Jamais la faillite du système capitaliste n'aura été aussi évidente. Jamais, non plus, autant d’attaques aussi massives contre la classe ouvrière n'avaient été planifiées. Quels développements de la lutte de classe peut-on attendre dans cette situation ?
La gravité de la crise ne permet plus à la bourgeoisie d'en cacher la réalité
La crise des subprimes en 2008 a débouché sur une crise ouverte de dimension mondiale impliquant une chute de l'activité économique sans équivalent depuis 1929 :
- en quelques mois, de très nombreux établissements financiers ont été renversés comme une chaîne de dominos ;
- les fermetures d'usines se sont multipliées avec des centaines de milliers de licenciements partout dans le monde.
Les moyens mis en œuvre par la bourgeoisie pour éviter que l'effondrement ne soit encore plus brutal et profond n'ont pas été différents des politiques successives appliquées depuis le début des années 1970, à travers le recours au crédit. C'est ainsi qu'une nouvelle étape dans l'endettement mondial a été franchie, accompagnée d'un accroissement inégalé de la dette mondiale. Mais aujourd'hui, le montant de la dette mondiale est tel qu'il est devenu commun de parler de "crise de l'endettement" pour caractériser la phase actuelle de la crise économique.
La bourgeoisie a évité le pire, pour l'instant. Ceci dit, non seulement il n'y a pas eu de reprise, mais un certain nombre de pays présentent des risques sérieux d'insolvabilité, avec des taux d'endettement supérieurs à 100% du PIB. Parmi ceux-ci, non seulement la Grèce est en première ligne mais également le Portugal, l'Espagne (5e économie du l'UE), l'Irlande et l’Italie. La Grande-Bretagne, bien qu'elle n'ait pas atteint ces niveaux d'endettement, présente des signes que les spécialistes qualifient de très inquiétants.
Face au niveau de gravité atteint par la crise de surproduction, la bourgeoisie ne dispose que d'un seul recours : l’Etat. Mais celui–ci dévoile à son tour sa fragilité. La bourgeoisie ne fait que repousser les échéances tandis que tous les acteurs économiques n'ont d'autre issue que la fuite en avant qui devient de plus en plus difficilement praticable et risquée : s'endetter toujours davantage. Les fondements historiques de la crise tendent ainsi à devenir plus évidents. Contrairement au passé, la bourgeoisie ne peut plus camoufler la réalité de la crise et montre à visage découvert qu’il n’y a pas de solution possible au sein de son système.
Dans un tel contexte, l'insolvabilité d'un pays1 désormais incapable de rembourser les échéances de sa dette, peut provoquer une réaction en chaîne conduisant à l'insolvabilité de nombreux acteurs économiques (banques, entreprises, autres pays). Bien sûr, la bourgeoisie essaie encore de brouiller les pistes en polarisant l’attention sur la spéculation et les spéculateurs. Le phénomène de spéculation est réel mais ce mécanisme imprègne tout le système et pas seulement quelques "profiteurs" ou "patrons voyous". La finance folle, c'est-à-dire l'endettement sans limite et la spéculation à tout va, a été favorisée par le capitalisme comme un tout, comme un moyen de repousser les échéances de la récession. Tel est le mode de vie même du capitalisme aujourd'hui. Aussi c'est dans le capitalisme lui-même , incapable de survivre sans des injections nouvelles de crédits, de plus en plus massives, que réside le cœur du problème.
Quels remèdes la bourgeoisie concocte-t-elle à présent face à la crise de l'endettement ? La bourgeoisie est en train de tenter de faire passer un terrible plan d’austérité en Grèce. Un autre également est en préparation en Espagne. En France, de nouvelles attaques sur les pensions de retraites sont planifiées.
Les plans d'austérité peuvent-ils contribuer à relâcher l'étreinte de la crise ?
Les plans d'austérité constituent-ils un moyen pour une nouvelle reprise ? Permettront-ils de réhausser, au moins partiellement, le niveau de vie durement attaqué des prolétaires au cours de ces deux dernières années de crise ?
Certainement pas ! La bourgeoisie mondiale ne peut pas se permettre de laisser "couler" un pays comme la Grèce (malgré les déclarations tonitruantes et démagogiques d’Angela Merkel), sans courir le risque de conséquences analogues pour certains de ses créditeurs, mais la seule aide qu'elle puisse lui apporter, c'est de nouveaux crédits à un taux "acceptable" (cependant les prêts à 6% récemment imposés par l’UE à la Grèce sont déjà particulièrement élevés). En retour, des garanties de rigueur budgétaire sont exigées. L'assisté doit faire la preuve qu'il ne va pas constituer un puits sans fond engouffrant "l'aide internationale". Il est donc demandé à la Grèce de "réduire son train de vie" pour réduire le rythme de la croissance de ses déficits et de son endettement. Ainsi, à la condition que soient durement attaquées les conditions de vie de la classe ouvrière, le marché mondial des capitaux fera à nouveau confiance à la Grèce qui pourra attirer à elle les prêts et les investissements étrangers.
Ce n'est pas le moindre paradoxe de constater que la confiance à accorder à la Grèce dépend de sa capacité à réduire le rythme de l'accroissement de sa dette, et non pas de le stopper, ce qui serait d'ailleurs impossible. C'est-à-dire que la solvabilité de ce pays vis-à-vis du marché mondial des capitaux est suspendue à une augmentation de sa dette qui ne soit "pas trop importante". En d'autres termes, un pays déclaré insolvable à cause de son endettement peut devenir solvable même si cet endettement continue de croître. D’ailleurs, la Grèce elle-même a tout intérêt à faire planer la menace de son "insolvabilité" pour tenter de fléchir les taux d’intérêt de ses créanciers qui, s’ils n’étaient pas du tout remboursés, enregistreraient une perte sèche du montant de leurs créances et se trouveraient à leur tour rapidement "dans le rouge". Dans le monde actuel surendetté, la solvabilité est essentiellement basée non sur une réalité objective mais sur une confiance … pas réellement fondée.
Les capitalistes sont obligés d'adhérer à cette croyance, sinon ils doivent cesser de croire à la pérennité de leur système d'exploitation. Mais si les capitalistes sont obligés d'y croire, ce n'est pas le cas pour les ouvriers ! Les plans d’austérité permettent somme toute à la bourgeoisie de se rassurer mais ne résolvent en rien les contradictions du capitalisme et ne peuvent même pas enrayer la croissance de la dette.
Les plans d'austérité exigent une réduction drastique du coût de la force de travail, ce qui va être appliqué dans tous les pays puisque tous, à des degrés divers, sont confrontés à des problèmes énormes d'endettement et de déficit. Une telle politique qui, dans le cadre du capitalisme, ne connaît pas de réelle alternative, peut éviter un vent de panique, voire provoquer une mini-relance bâtie sur du sable, mais certainement pas assainir le système financier. Elle peut encore moins résoudre les contradictions du capitalisme qui le poussent à s'endetter toujours davantage sous peine d'être secoué par des dépressions de plus en plus brutales. Mais il faut aussi faire accepter ces plans d'austérité à la classe ouvrière. C'est pour la bourgeoisie un enjeu de taille et elle a aussi les yeux braqués sur la réponse des prolétaires à ces attaques.
Avec quel état d'esprit la classe ouvrière aborde-t-elle cette nouvelle vague d'attaques ?
Déjà, depuis le début des années 2000, le discours de la bourgeoisie "acceptez de vous serrer la ceinture pour que cela aille mieux demain" ne parvient généralement plus à illusionner la classe ouvrière, même s'il existe sur ce plan des différences d'un pays à l'autre. La récente aggravation de la crise ne s'est pas traduite jusqu'à présent par une amplification des mobilisations de la classe ouvrière au cours de ces deux ou trois dernières années. La tendance serait même plutôt inverse pour ce qui concerne l'année 2009. Les caractéristiques de certaines des attaques portées, notamment les licenciements massifs, ont en effet rendu la riposte de la classe ouvrière plus difficile puisque, face à ceux-ci :
- les patrons et les gouvernements se replient derrière un argument péremptoire : "Nous n’y sommes pour rien si le chômage augmente ou si vous êtes licenciés : c’est la faute de la crise."
- en cas de fermeture d’entreprise ou d’usine, l’arme de la grève devient inopérante, ce qui accentue le sentiment d’impuissance et le désarroi des travailleurs.
Néanmoins, même si ces difficultés pèsent encore lourdement sur la classe ouvrière, la situation n'est pas bloquée. C'est ce qu'illustre un changement d'état d'esprit au sein de la classe exploitée et se traduit par un frémissement de la lutte de classe.
L'exaspération et la colère des travailleurs sont nourries par une indignation profonde face à une situation de plus en plus scandaleuse et intolérable : la survie même du capitalisme a, entre autres, pour effet de faire apparaître plus crûment que jamais deux "mondes différents" au sein de la même société. Dans le premier, on trouve l'immense majorité de la population qui subit toutes les injustices et la misère et qui doit payer pour le second, le monde de la classe dominante, où il est fait un étalage indécent et arrogant de la puissance et de la richesse.
En lien plus direct avec la crise actuelle, l'idée répandue selon laquelle "ce sont les banques qui nous ont mis dans une mouise dont on ne peut pas sortir" (alors qu'on voit les Etats eux-mêmes approcher de la cessation de paiement) trompe de moins en moins et catalyse la colère contre le système. On voit ici les limites du discours de la bourgeoisie qui désignait les banques comme responsables de la crise actuelle pour tenter d'épargner son système comme un tout. Le "scandale des banques" éclabousse l'ensemble du capitalisme.
Même si la classe ouvrière à l’échelle internationale reste encore sonnée et désemparée face à l’avalanche des coups que lui portent tous les gouvernements de gauche comme de droite, elle n’est pas pour autant résignée ; elle n'est pas restée sans réaction au cours de ces derniers mois. En effet, les caractéristiques fondamentales de la lutte de classe qui avaient marqué certaines mobilisations ouvrières depuis 2003, refont leur apparition sous une forme plus explicite. C'est le cas, en particulier, de la solidarité ouvrière qui tend à nouveau à s'imposer comme un besoin fondamental de la lutte, après avoir été tant dénaturée et dépréciée dans les années 1990. A présent, elle se manifeste sous la forme d'initiatives, certes encore très minoritaires, mais porteuses d'avenir.
En Turquie, aux mois de décembre et janvier derniers, la lutte des ouvriers de Tekel a constitué un phare pour la lutte de classe. Elle a uni dans le même combat des ouvriers turcs et kurdes (alors qu'un conflit nationaliste divise ces populations depuis des années) comme elle a fait preuve d'une volonté farouche d'étendre la lutte à d'autres secteurs et s'est opposée de façon déterminée au sabotage des syndicats.
Au cœur même du capitalisme, alors que l'encadrement syndical, plus puissant et sophistiqué que dans les pays périphériques, permet encore d'empêcher l'explosion de luttes aussi importantes, on assiste aussi à un regain de la combativité de la classe ouvrière. Ainsi, les mêmes caractéristiques se sont vérifiées début février en Espagne, à Vigo. Là, les chômeurs sont allés trouver les travailleurs actifs des chantiers navals et ils ont manifesté ensemble, en rassemblant d’autres travailleurs jusqu’à obtenir l’arrêt du travail dans tout le secteur naval. Ce qui fut le plus remarquable dans cette action, c'est le fait que l'initiative avait été prise par les travailleurs licenciés des chantiers navals, lesquels avaient été remplacés par des travailleurs immigrés "qui dorment dans des parkings et qui mangent tout juste un sandwich par jour". Loin de susciter des réactions xénophobes de la part des ouvriers avec qui ils avaient été mis en concurrence par la bourgeoisie, ces derniers se sont solidarisés contre les conditions d'exploitation inhumaines réservées aux travailleurs immigrés. Ces manifestations de solidarité ouvrière s'étaient déjà produite également en Grande-Bretagne à la raffinerie de Lindsey de la part d'ouvriers du bâtiment en janvier et en juin 2009 de même qu'en Espagne dans les chantiers navals de Sestao en avril 2009 2.
Dans ces luttes, même si c'est de façon encore limitée et embryonnaire, la classe ouvrière a démontré non seulement sa combativité mais aussi sa capacité à contrer les campagnes idéologiques de la classe dominante pour la diviser, en exprimant sa solidarité prolétarienne, en unissant dans un même combat des ouvriers de différentes corporations, secteurs, ethnies ou nationalités. De même, la révolte des jeunes prolétaires, organisés en assemblées générales et qui avait attiré le soutien de la population, en décembre 2008 en Grèce, avait fait craindre à la classe dominante, la "contagion" de l’exemple grec aux autres pays européens, en particulier chez les jeunes générations scolarisées. Aujourd'hui, ce n’est pas un hasard si les yeux de la bourgeoisie sont à nouveau tournés vers les réactions des prolétaires en Grèce face au plan d’austérité imposé par le gouvernement et les autres Etats de l’Union européenne. Ces réactions ont valeur de test pour les autres Etats menacés par la faillite de leur économie nationale. D’ailleurs, l’annonce quasiment simultanée de plans similaires a également précipité dans la rue des dizaines de milliers de prolétaires qui ont manifesté en Espagne ou au Portugal. Ainsi, malgré les difficultés qui pèsent encore sur la lutte de classe, un changement d’état d’esprit est néanmoins en train de s’opérer dans la classe ouvrière. Partout dans le monde, l’exaspération et la colère s’approfondissent et se généralisent dans les rangs ouvriers.
Les réactions aux plans d’austérité et aux attaques
En Grèce...
En Grèce, le gouvernement a annoncé le 3 mars un nouveau plan d'austérité, le troisième en trois mois, impliquant une hausse des taxes à la consommation, la réduction de 30% du 13e mois et de 60% du 14e mois de salaire, primes touchées par les fonctionnaires (soit une diminution de 12% à 30% en moyenne de leur salaire) ainsi que le gel des pensions de retraites des fonctionnaires et des salariés du secteur privé. Mais ce plan passe très mal dans la population, notamment chez les ouvriers et les retraités.
En novembre-décembre 2008, le pays avait été secoué pendant plus d’un mois par une explosion sociale, menée principalement par la jeunesse prolétarienne, à la suite de l'assassinat d'un jeune par la police. Cette année, les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement socialiste menaçaient de déclencher une explosion non seulement parmi les étudiants et les chômeurs mais aussi parmi les bataillons principaux de la classe ouvrière.
Un mouvement de grève générale le 24 février 2010 contre le plan d’austérité a été largement suivi et une mobilisation des fonctionnaires du gouvernement a rassemblé autour de 40 000 manifestants. Un grand nombre de retraités et de fonctionnaires ont également manifesté le 3 mars dans le centre d'Athènes.
Les événements qui ont suivi ont montré encore plus clairement que le prolétariat était mobilisé : "Quelques heures seulement après l'annonce des nouvelles mesures, des travailleurs licenciés de l'Olympic Airways ont attaqué les brigades de la police anti-émeute gardant le siège de la compagnie et ont occupé le bâtiment, dans ce qu'ils appellent une occupation à durée indéterminée. L'action a conduit à la fermeture de la principale rue commerçante d'Athènes, pour de longues heures." (blog sur libcom.org)
Dans les jours précédant la grève générale du 11 mars, une série de grèves et d’occupations ont eu lieu : les travailleurs licenciés d’Olympic Airways ont occupé pendant 8 jours le siège de la Cour des Comptes tandis que les salariés de la compagnie d’électricité occupaient les agences pour l’emploi au nom du "droit des futurs chômeurs que nous sommes", selon l’un d’eux. Les ouvriers de l'Imprimerie nationale ont occupé leur lieu de travail et refusé d'imprimer les textes légaux des mesures d'économie en misant sur le fait que tant que la loi n'est pas imprimée, elle n'est pas valide... Les agents du fisc ont arrêté le travail pendant 48h, les salariés des auto-écoles dans le Nord du pays ont fait 3 jours de grève ; même les juges et autres officiers de justice ont stoppé toute activité pendant 4 heures chaque jour. Aucune poubelle n'a été vidée pendant plusieurs jours à Athènes, à Patras et à Thessalonique, les éboueurs ayant bloqué les grands dépôts de ces villes. Dans la ville de Komitini, les ouvriers de l’entreprise textile ENKLO ont mené une lutte avec marches de protestation et grèves : deux banques ont été occupées par les travailleurs.
Mais si la classe ouvrière en Grèce se trouve plus largement mobilisée qu'au cours des luttes de novembre-décembre 2008, les appareils d’encadrement de la bourgeoisie ont été mieux préparés et efficaces pour saboter la riposte ouvrière.
En effet, la bourgeoisie a pris les devants pour détourner la colère et la combativité des travailleurs vers des impasses politiques et idéologiques. Celles-ci sont parvenues à évacuer toutes les potentialités de prise en mains de la lutte et de la solidarité prolétariennes qui avaient commencé à prendre forme à travers le combat des jeunes générations ouvrières fin 2008.
L’exaltation du patriotisme et du nationalisme est largement utilisée pour diviser les ouvriers et les isoler de leurs frères de classe dans les autres pays : en Grèce, l’élément le plus mis en avant est le fait que la bourgeoisie allemande refuse d’aider l'économie grecque et le gouvernement du PASOK ne se prive pas d'exploiter les sentiments anti-allemands qui survivent encore de l'occupation nazie.
Le contrôle par les partis et les syndicats a permis d’isoler les ouvriers les uns des autres. Ainsi les salariés d’Olympic Airways n'ont permis à aucun étranger à la compagnie de pénétrer dans le bâtiment public qu’ils occupaient et les dirigeants syndicaux l'ont fait évacuer sans la moindre décision d’une AG. Quand d’autres ouvriers ont voulu se rendre dans les locaux du Trésor public, occupés par ceux de l’Imprimerie Nationale, ils furent sèchement refoulés sous prétexte "qu’ils n’appartenaient pas au ministère" !
La profonde colère des ouvriers en Grèce s’est exprimée contre le PASOK et les dirigeants syndicaux qui lui sont inféodés. Le 5 mars, le leader de la GSEE, centrale syndicale du secteur privé, a été malmené et frappé alors qu’il tentait de prendre la parole devant la foule et a dû être secouru par la police anti-émeute et se réfugier dans le bâtiment du Parlement, sous les huées de la foule l’invitant ironiquement à aller où il est à sa place : dans le nid des voleurs, des assassins et des menteurs.
Mais le PC grec (KKE) et son officine syndicale, le PAME, se présentent comme des alternatives "radicales" au PASOK alors qu'ils entretiennent une campagne pour focaliser la responsabilité de la crise sur les banquiers ou sur "les méfaits du libéralisme".
En novembre-décembre 2008, le mouvement avait été largement spontané et avaient tenu des assemblées générales ouvertes dans les écoles occupées et les universités. Le siège du Parti communiste (KKE), comme le siège de sa confédération syndicale du PAME, avait été lui-même occupé, ce qui était le signe d'une claire méfiance envers les appareils syndicaux et les staliniens, lesquels avaient dénoncé les jeunes manifestants à la fois comme des lumpen-prolétaires et des enfants gâtés de la bourgeoisie.
Mais cette fois-ci, le PC grec s'est ostensiblement mis à l’avant-garde des grèves, manifestations et occupations les plus radicales : "Le matin du 5 mars, les travailleurs du PAME syndicat affilié au Parti communiste occupait le ministère des finances (…) ainsi que la mairie du district de Trikala. Plus tard, le PAME a fait également occuper 4 émetteurs de TV dans la ville de Patras, et la station de télévision d’Etat de Thessalonique, obligeant les journalistes d'information à lire une déclaration contre les mesures gouvernementales" 3. Beaucoup de grèves ont également été déclenchées à l’initiative du PC qui avait appelé dès le 3 mars à une "grève générale" et à une manifestation pour le 5, et dès le 4 dans différentes villes. Le PAME a intensifié les actions spectaculaires, occupant tantôt le ministère des finances, tantôt investissant les locaux de la Bourse.
Le 11 mars, toute la Grèce a été paralysée à 90% pendant 24 heures par le mouvement de colère de la population suite au second appel en moins d’un mois des deux principaux syndicats à la grève générale. Au total, plus de 3 millions de personnes (sur une population totale de 11 millions) y ont pris part. La manifestation du 11 mars a été la plus massivement suivie à Athènes depuis 15 ans et elle a montré la détermination de la classe ouvrière à riposter à l’offensive capitaliste.
... et ailleurs
Dans toutes lés régions du monde, en Algérie, en Russie, au sein de la main-d’œuvre immigrée des Emirats, surexploitée et privée de toute protection sociale, chez les prolétaires anglais et parmi les étudiants réduits à une situation précaire dans l’ex-plus riche Etat de l’Amérique, la Californie, la situation actuelle témoigne d’une tendance de fond vers la reprise de la lutte de classe à l’échelle internationale.
La bourgeoisie est confrontée à une situation où, en plus des licenciements dans les entreprises en difficulté, les Etats doivent assumer frontalement les attaques contre la classe ouvrière pour lui faire supporter le coût de la dette. Le responsable direct des attaques, l'Etat en l'occurrence, est cette fois beaucoup plus facilement identifiable que dans le cas des licenciements face auxquels il peut même se présenter comme le "protecteur", même peu puissant, des salariés. Le fait que l'Etat apparaisse clairement pour ce qu'il est, le premier défenseur des intérêts de toute la classe capitaliste contre l'ensemble de la classe ouvrière, est un facteur qui favorise le développement de la lutte de classe, de son unité et de sa politisation.
Tous les éléments qui se développent dans la situation actuelle constituent les ingrédients pour l'explosion de luttes massives. Mais ce qui sera le détonateur de celles-ci est très certainement l'accumulation de l'exaspération, du ras le bol et de l'indignation. L'application par la bourgeoisie des différents plans d'austérité planifiés dans différents pays, va constituer autant d'occasions d'expériences de lutte et de leçons pour la classe ouvrière.
Les luttes massives, une étape future importante pour le développement de la lutte de classe … mais pas la dernière
L'effondrement du stalinisme et, surtout, son exploitation idéologique par la bourgeoisie fondée sur le plus grand mensonge du siècle identifiant les régimes staliniens au socialisme, ont laissé des traces présentes encore aujourd'hui dans la classe ouvrière.
Face aux "évidences" assénées par la bourgeoisie : "le communisme, ça ne marche pas ; la preuve, c’est qu’il a été abandonné au bénéfice du capitalisme par les populations concernées", les ouvriers ne pouvaient que se détourner du projet d’une société alternative au capitalisme.
La situation qui en a résulté est, de ce point de vue, très différente de celle qu'on a connue à la fin des années 1960. A cette époque, le caractère massif des combats ouvriers, notamment avec la grève de mai 1968 en France et "l’automne chaud" italien de 1969, avait mis en évidence que la classe ouvrière peut constituer une force de premier plan dans la vie de la société. L’idée qu’elle pourrait un jour renverser le capitalisme n’appartenait pas au domaine des rêves irréalisables, contrairement à aujourd'hui.
La difficulté à entrer massivement en lutte manifestée par le prolétariat depuis les années 1990 résulte d'un manque de confiance en lui-même, qui n'a pas été dissipé par le renouveau de la lutte de classe de l'année 2003.
Ce n'est que le développement des luttes massives qui permettra au prolétariat de récupérer la confiance en ses propres forces et de mettre à nouveau en avant sa perspective propre. C'est donc une étape fondamentale dans laquelle les révolutionnaires doivent favoriser la capacité de la classe ouvrière à comprendre les enjeux de ses combats dans leur dimension historique, à reconnaître ses ennemis et à prendre en main elle-même ses luttes.
Pour importante que soit cette étape future de la lutte de classe, elle ne signifiera pas pour autant la fin des hésitations du prolétariat à s'engager résolument dans la voie qui mène à la révolution.
Déjà en 1852, Marx, mettait en évidence le cours difficile et tortueux de la révolution prolétarienne, contrairement à celui des révolutions bourgeoises qui, "comme celles du 18e siècle, se précipitent rapidement de succès en succès" 4.
Cette différence, entre prolétariat et bourgeoisie, lorsqu'ils agissent comme classes révolutionnaires, résulte des différences existant entre les conditions de la révolution bourgeoise et celles de la révolution prolétarienne.
La prise du pouvoir politique par la classe capitaliste avait constitué le point d'arrivée de tout un processus de transformation économique au sein de la société féodale. Au cours de celui-ci, les anciens rapports de production féodaux, ont progressivement été supplantés par les rapports de production capitalistes. C'est sur ces nouveaux rapports économiques que la bourgeoisie s'est appuyée pour conquérir le pouvoir politique.
Tout différent est le processus de la révolution prolétarienne. Les rapports de production communistes, qui ne sont pas des rapports marchands, ne peuvent se développer au sein de la société capitaliste. Du fait qu'elle est la classe exploitée dans le capitalisme, privée par définition de la propriété des moyens de production, la classe ouvrière ne dispose pas, et ne peut disposer, de points d'appui économiques pour la conquête du pouvoir politique. Ses points d'appui sont sa conscience et son organisation dans la lutte. Contrairement à la bourgeoisie révolutionnaire, le premier acte de la transformation communiste des rapports sociaux doit consister en un acte conscient et délibéré : la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale par l'ensemble du prolétariat organisé en conseils ouvriers.
L'immensité de cette tâche est évidemment de nature à faire hésiter la classe ouvrière, à la faire douter de sa propre force. Mais c'est le seul chemin pour la survie de l'humanité : l'abolition du capitalisme, de l'exploitation et la création d'une nouvelle société.
FW (31 mars)
1. Bien entendu, la faillite d’un Etat n’a pas du tout les mêmes caractéristiques que celle d’une entreprise : s’il devenait incapable de rembourser ses dettes, il n’est pas question qu’un Etat mette la "clef sous la porte", puisse licencier tous ses fonctionnaires et dissoudre ses propres structures (police, armée, corps enseignant ou administratif…) même si, dans certains pays (notamment en Russie ou certains pays d’Afrique), les fonctionnaires ont pu, du fait de la crise, ne pas être payés pendant des mois…
2. Lire les articles suivants : "Grèves en Angleterre : Les ouvriers du bâtiment au centre de la lutte [60]" ; Sur la Turquie : "Solidarité avec la résistance des ouvriers de Tekel contre le gouvernement et les syndicats ! [61]" ; Sur l’Espagne : "A Vigo, l’action conjointe des chômeurs et des ouvriers des chantiers navals [62]"
3. D’après libcom.org [63]
4. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte.
Hommage à notre camarade Jerry Grevin
- 1868 lectures
Notre camarade Jerry Grevin, militant de longue date de la section américaine du CCI, est mort subitement d'une crise cardiaque le 11 février 2010. Sa mort prématurée est une perte énorme pour notre organisation et tous ceux qui le connaissaient : sa famille a perdu un mari, un père et un grand-père tendre et affectueux ; ses compagnons de travail à l'université où il enseignait ont perdu un collègue estimé ; les militants du CCI, dans sa section et dans le monde entier, ont perdu un camarade très aimé et totalement dévoué.
Jerry Grevin est né en 1946 à Brooklyn, dans une famille ouvrière de la deuxième génération d'immigrants juifs. Ses parents avaient un esprit critique qui les mena à entrer au Parti communiste des Etats-Unis, puis à le quitter. Le père de Jerry avait été profondément choqué par la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki à laquelle il avait assisté en tant que membre des forces américaines d'occupation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait jamais parlé de cette expérience et que son fils ne l'ait connue que bien plus tard, Jerry était convaincu qu'elle avait exacerbé l'état d'esprit anti-patriotique et anti-guerre qu'il avait hérité de ses parents.
L'une des grandes qualités de Jerry, et qui ne s'est jamais démentie, était son indignation brûlante et inébranlable contre toute forme d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Dès sa jeunesse; il a énergiquement pris part aux grandes causes sociales de l'époque. Il participa aux grandes manifestations contre la ségrégation et l'inégalité raciale organisées par le Congress of Racial Equality (CORE) dans le Sud des Etats-Unis. Cela nécessitait un courage certain puisque des militants et des manifestants subissaient quotidiennement de mauvais traitements, des bastonnades et étaient même assassinés ; et Jerry étant juif, non seulement il combattait les préjugés racistes, il en était lui-même l'objet. 1
Pour sa génération, aux Etats-Unis en particulier, l'autre question cruciale de l'époque était l'opposition à la Guerre du Vietnam. Exilé à Montréal au Canada, il fut l'animateur d'un des comités qui faisait partie du "Second Underground Railroad" 2 pour aider les déserteurs de l'armée américaine à fuir les Etats-Unis et à commencer une nouvelle vie à l'étranger. Il s'engagea dans cette activité non comme pacifiste mais avec la conviction que la résistance à l'ordre militaire pouvait et devait faire partie d'une lutte de classe plus large, contre le capitalisme, et il participa à la publication militante, de courte durée, Worker and Soldier. Plusieurs années après, Jerry eut la possibilité de consulter une partie –largement censurée- de son dossier au FBI: son épaisseur et les détails qu'il comportait –le dossier était régulièrement mis à jour dans la période où il militait dans le CCI- lui procurèrent une certaine satisfaction de constater que ses activités inquiétaient les défenseurs de l'ordre bourgeois et induisirent de sa part quelques commentaires caustiques envers ceux qui pensent que la police et les services de renseignements "ne s'occupent pas" des petits groupes insignifiants de militants aujourd'hui.
A son retour aux Etats-Unis dans les années 1970, Jerry travailla comme technicien des téléphones dans une des principales compagnies téléphoniques. C'était une période de bouillonnement de la lutte de classe avec la crise qui commençait à frapper et Jerry participa aux luttes à son travail, aux petites comme aux grandes, en même temps qu'il participait à un journal appelé Wildcat, prônant l'action directe et publié par un petit groupe du même nom. Bien qu'il ait été déçu par l'immédiatisme et l'absence d'une perspective plus large – c'est la recherche d'une telle perspective qui l'amena à rejoindre le CCI –cette expérience directe, à la base, couplée à ses grandes capacités d'observation et à une attitude humaine envers les travers et les préjugés de ses collègues de travail, lui apporta une vision profonde de la façon dont se développe concrètement la conscience dans la classe ouvrière. Comme militant du CCI, il illustrait souvent ses arguments politiques d'images vivantes tirées de son expérience.
Une de celles-ci décrivait un incident dans le Sud des États-Unis où son groupe de techniciens du téléphone de New York avait été envoyé travailler. Un ouvrier du groupe, un noir, était persécuté par la direction pour une prétendue faute , en fait totalement mineure; les New-Yorkais prirent sa défense, à la grande surprise de leurs collègues du Sud : "Pourquoi s'en faire ?" demandèrent-ils "ce n'est qu'un nègre". Ce à quoi un des New-Yorkais répondit vigoureusement que la couleur de la peau n'avait aucune importance, que les ouvriers étaient tous ouvriers ensemble et devaient se défendre mutuellement contre les patrons. "Mais le plus remarquable concluait Jerry, c'est que le type qui avait pris le plus fort la défense de l'ouvrier noir était connu du groupe pour être lui-même raciste et avoir déménagé à Long Island pour ne pas habiter dans un quartier noir. Et cela montre comment la lutte et la solidarité de classe constituent le seul véritable antidote au racisme".
Une autre histoire qu'il aimait raconter, concernait sa première rencontre avec le CCI. Pour citer l'hommage personnel d'un camarade : "Comme je l'ai entendu raconter un million de fois, c'est quand il rencontra pour la première fois un militant du CCI à une époque où il était, comme il le décrivait lui-même, "un jeune individualiste immédiatiste", écrivant et diffusant ses articles seul, qu'il se rendit compte que la passion révolutionnaire sans organisation ne pouvait qu'être une flamme passagère de jeunesse. C'est quand le militant du CCI lui dit: "OK, tu écris et tu es marxiste, mais que fais-tu pour la révolution?". Jerry racontait souvent cette histoire à la suite de quoi il ne dormit pas de toute la nuit. Mais ce fut une nuit blanche qui porta prodigieusement ses fruits". Beaucoup auraient pu se décourager face au commentaire abrupt du CCI, mais pas Jerry. Au contraire, cette histoire (qu'il racontait en s'amusant de son état d'esprit de l'époque) révèle une autre facette de Jerry: sa capacité à accepter la force d'un argument et à changer de point de vue s'il était convaincu par d'autres idées – une qualité précieuse dans le débat politique qui est l'âme d'une véritable organisation prolétarienne.
La contribution de Jerry au CCI est inestimable. Sa connaissance du mouvement ouvrier aux Etats-Unis était encyclopédique; sa plume alerte et son écriture colorée ont fait vivre cette histoire pour nos lecteurs dans les nombreux articles qu'il a écrits pour notre presse aux Etats-Unis (Internationalism) et pour la Revue internationale. Il avait aussi une maîtrise remarquable de la vie politique et de la lutte de classe aux Etats-Unis aujourd'hui et ses articles sur l'actualité, tant pour notre presse que pour nos bulletins internes, ont été des apports importants pour notre compréhension de la politique de la première puissance impérialiste mondiale.
Sa contribution à la vie interne et à l'intégrité organisationnelle du CCI a également été importante. Pendant des années, il a été un pilier de notre section américaine, un camarade sur qui on pouvait toujours compter pour être aux avant-postes quand des difficultés se présentaient. Pendant les difficiles années 1990, quand le monde entier –mais particulièrement peut-être les Etats-Unis- était inondé par la propagande sur "la victoire du capitalisme", Jerry ne perdit jamais la conviction de la nécessité et de la possibilité d'une révolution communiste, il ne cessa jamais de communiquer avec ceux qui l'entouraient et avec les rares nouveaux contacts de la section. Sa loyauté à l'organisation et à ses camarades était inébranlable, d'autant plus que, comme il le disait lui-même, c'était sa participation à la vie internationale du CCI qui lui donnait du courage et lui permettait de "recharger ses batteries".
Sur un plan plus personnel, Jerry était aussi extraordinairement drôle et doué pour raconter des histoires. Il pouvait –et cela arrivait souvent – faire rire pendant des heures une audience d'amis ou de camarades avec des histoires le plus souvent tirées de ses observations de la vie. Alors que ses histoires déployaient parfois des piques aux dépens des patrons ou de la classe dominante, elles n'étaient jamais cruelles ou méchantes. Au contraire, elles révélaient son affection et sa sympathie pour ses semblables, de même qu'une capacité bien trop rare à se moquer de ses propres faiblesses. Cette ouverture aux autres est sans doute ce qui a fait de Jerry un professeur efficace (et apprécié) – profession qu'il a embrassée tard, quand il était déjà dans la quarantaine.
Notre hommage à Jerry serait incomplet si nous ne mentionnions pas sa passion pour la musique Zydeco (un style de musique ayant pour origine les créoles de Louisiane et qui y est toujours jouée). Le danseur de Brooklyn était connu dans les festivals de Zydeco de l'arrière-pays de Louisiane, et Jerry était fier de pouvoir aider de jeunes groupes de Zydeco inconnus à trouver des lieux et une audience pour jouer à New York. C'était tout Jerry : enthousiaste et énergique dans tout ce qu'il entreprenait, ouvert et chaleureux avec les autres.
Nous ressentons d'autant plus vivement la perte de Jerry que ses dernières années ont été parmi les plus heureuses. Il était ravi de devenir le grand-père d'un petit-fils adoré. Politiquement, il y avait le développement d'une nouvelle génération de contacts autour de la section américaine du CCI et il s'était lancé dans le travail de correspondance et de discussion avec toute son énergie coutumière. Son dévouement avait porté ses fruits dans les Journées de Discussion tenues à New York quelques semaines seulement avant sa mort, qui avaient rassemblé de jeunes camarades de différentes parties des Etats-Unis, dont beaucoup se rencontraient pour la première fois. A la fin de la réunion, Jerry était ravi et il voyait celle-ci, et tout l'avenir qu'elle incarnait, comme l'un des couronnements de son activité militante. Il nous paraît donc juste de donner, pour terminer, la parole à deux jeunes camarades qui ont participé aux Journées de Discussion. Pour JK : "Jerry était un camarade de confiance et un ami chaleureux...Sa connaissance de l'histoire du mouvement ouvrier aux Etats-Unis ; la profondeur de son expérience personnelle dans les luttes des années 1970 et 1980 et son engagement à maintenir la flamme de la Gauche communiste aux Etats-Unis pendant la difficile période qui a suivi la prétendue "mort du communisme" étaient incomparables". Pour J : "Jerry a été une sorte de guide politique pour moi au cours des 18 derniers mois. Il était aussi un ami très cher (...) Il voulait toujours discuter et aider les camarades plus jeunes à apprendre comment intervenir et à comprendre les leçons historiques du mouvement ouvrier. Sa mémoire vivra dans chacun de nous, dans le CCI et à travers toute la lutte de classe."
CCI
1. En 1964, il y eut une affaire tristement célèbre où trois jeunes militants des droits civiques (James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner) furent assassinés par des officiers de police et des membres du Ku Klux Klan. Deux d'entre eux étaient des Juifs de New York.
2. Le nom "Underground Railroad" était une référence à un réseau, créé au 19e siècle avant la Guerre civile, de cachettes et de militants anti-esclavagistes qui aidaient les esclaves en fuite à gagner le Nord des États-Unis et le Canada.
Personnages:
- Jerry Grevin [64]
Qu'est-ce que les conseils ouvriers ? (II) : de février à juillet 1917 : resurgissement et crise
- 3827 lectures
Le but de cette série est de répondre à une question que se posent beaucoup de camarades (lecteurs et sympathisants), surtout parmi les plus jeunes : que sont les conseils ouvriers ? Dans le premier article de cette série 1, nous avons vu comment ils apparurent pour la première fois de l’histoire à la chaleur de la Révolution de 1905 en Russie et comment la défaite de cette dernière entraîna leur disparition. Dans ce deuxième article, nous allons voir comment ils réapparurent lors de la Révolution de Février 1917 et de quelle manière, sous la domination des anciens partis révolutionnaires mencheviques et socialistes-révolutionnaires (SR) qui avaient trahi la classe ouvrière, ils s’éloignèrent de la volonté et de la conscience croissante des masses ouvrières jusqu’à devenir, en juillet 1917, un point d’appui de la contre-révolution 2.
Pourquoi les soviets disparaissent-ils entre 1905 et 1917 ?
Oskar Anweiler, dans son ouvrage Les Soviets en Russie (3), souligne comment de nombreuses tentatives eurent lieu pour faire revivre les soviets à la suite de la défaite de la révolution en décembre 1905. Un Conseil de chômeurs vit ainsi le jour au printemps 1906 à Saint-Pétersbourg, qui envoya des délégués aux usines pour pousser à la renaissance du soviet. Une réunion qui regroupa 300 délégués en été 1906 ne donna rien à cause des difficultés à reprendre la lutte. Ce Conseil se décomposa peu à peu avec l’affaiblissement de la mobilisation, et disparut définitivement au printemps 1907. A Moscou, Kharkov, Kiev, Poltava, Ekaterinbourg, Bakou, Batoum, Rostoum et Kronstadt apparurent aussi des conseils de chômeurs plus ou moins éphémères tout au long de 1906.
Des soviets apparurent aussi sporadiquement en 1906-1907 dans certaines villes industrielles de l’Oural. C’est cependant à Moscou qu’eut lieu la tentative la plus sérieuse de constituer un soviet. Une grève éclata en juillet et s’étendit rapidement à de nombreuses concentrations ouvrières. Celles-ci mandatèrent rapidement quelques 150 délégués qui parvinrent à se réunir et à constituer un Comité exécutif, lançant des appels à l’extension de la lutte et à la formation de soviets de quartier. Les conditions n’étaient cependant pas celles de 1905 et le gouvernement, constatant le peu d’écho suscité par la mobilisation à Moscou, déchaîna une violente répression qui vint à bout de la grève et du tout nouveau soviet.
Puis les soviets disparurent de la scène sociale jusqu'en 1917. Cette disparition étonne bien des camarades qui se demandent comment il est possible que les mêmes ouvriers, qui avaient participé avec tant d’enthousiasme aux soviets en 1905, les aient condamnés à l’oubli ? Comment comprendre que la forme "conseil", qui avait démontré son efficacité et sa force en 1905, puisse disparaître comme par enchantement pendant une bonne douzaine d'années ?
Pour répondre à cette question, on ne peut partir du point de vue de la démocratie bourgeoise qui considère la société comme une somme d'individus, "libres et souverains", aussi "libres" de constituer des conseils que de participer à des élections. Si c'était le cas, comment comprendre alors que les millions de citoyens qui "avaient décidé" de se constituer en soviets en 1905 "choisirent" ensuite de délaisser cette forme d'organisation durant de longues années ?
Un tel point de vue ne peut parvenir à comprendre que la classe ouvrière n’est pas une somme d’individus "libres et autodéterminés", mais une classe qui ne parvient à s’exprimer, agir et s’organiser que lorsqu'elle s'affirme à travers son action collective dans la lutte. Cette dernière n’est pas alors la résultante de "décisions individuelles" mais bien le produit dynamique de la conjonction d’un ensemble de facteurs objectifs (la dégradation des conditions d’existence et l’évolution générale de la société), et de facteurs subjectifs (l'indignation, l’inquiétude sur l’avenir qui en découle, l'expérience de la lutte et le développement de la conscience de classe animés par l’intervention des révolutionnaires). L’action et l’organisation de la classe ouvrière sont un processus social, collectif et historique qui traduit une évolution du rapport de force entre les classes.
De plus, cette dynamique de la lutte de classe doit à son tour être replacée dans le contexte historique qui permet la naissance des soviets. Pendant la période historique d’ascendance du système capitaliste – et en particulier durant "l’âge d’or" entre 1873 et 1914 – le prolétariat avait pu constituer de grandes organisations permanentes de masse (en particulier, les syndicats) dont l’existence était une des conditions premières pour mener des luttes victorieuses. Dans la période historique qui s’ouvre au début du 20e siècle, celle de la décadence du capitalisme, marquée par l'éclatement de la Première Guerre mondiale, l’organisation générale de la classe ouvrière se construit dans et par la lutte, disparaissant avec elle si celle-ci ne peut aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au combat révolutionnaire pour détruire l’État bourgeois.
Dans de telles conditions, les acquis des luttes ne peuvent plus s’évaluer de façon comptable, en une somme de gains sonnants et trébuchants pouvant se consolider d’année en année, ni par une organisation de masse permanente. Ces acquis se concrétisent par des gains "abstraits" (évolution de la conscience, enrichissement du programme historique grâce aux leçons des luttes, perspectives pour l’avenir…) conquis dans les grands moments d’agitation puis qui disparaissent de l'appréhension immédiate des larges masses pour se replier dans le petit univers de minorités, donnant ainsi l’illusion de n’avoir jamais existé.
Février 1917 : les soviets surgissent dans le feu de la lutte
Entre 1905 et 1917, les soviets furent ainsi réduits à n’être plus qu’une "idée" orientant la réflexion mais aussi la lutte politique d’une poignée de militants. La méthode pragmatique qui n’accorde d’importance qu’à ce qui peut se voir et se toucher, ne permet pas de comprendre que l’idée même des soviets contenait une immense puissance matérielle. En 1917, Trotski écrivait : "il est hors de doute que le prochain, le nouvel assaut de la révolution sera suivi partout de l’institution de conseils ouvriers" 4. Les grands acteurs de la Révolution de Février furent effectivement les soviets.
Les minorités révolutionnaires, et plus particulièrement les bolcheviks après 1905, avaient défendu et propagé l’idée de constituer des soviets pour pousser la lutte en avant. Ces minorités gardèrent vivante dans la mémoire collective de la classe ouvrière la flamme des conseils ouvriers. C’est pour cela que, lors de l’éclatement des grèves de février qui prirent rapidement une grande ampleur, il y eut de nombreuses initiatives et appels pour la constitution de soviets. Anweiler souligne que "cette pensée surgit autant dans les usines paralysées que dans les cercles intellectuels révolutionnaires. Des témoignages directs affirmaient que dans certaines usines, dès le 24 février, on élisait des personnes de confiance pour un Soviet qui était en train de se construire" (traduit de l’édition en espagnol, p. 110). Autrement dit, l’idée des soviets qui, pendant longtemps, était restée cantonnée à quelques minorités, fut largement prise en charge par les masses en lutte.
En deuxième lieu, le Parti bolchevique contribua significativement au surgissement des soviets. Et il y contribua non pas en se basant sur un schéma organisationnel préalable ou en imposant une chaîne d’organisations intermédiaires qui au bout conduiraient à la formation des soviets, mais sa contribution fut quelque chose de bien différent, comme on va le voir, en lien avec un dur combat politique.
Pendant l’hiver de l’année 1915, lorsque quelques grèves ont commencé à surgir, surtout à Petersburg, la bourgeoisie libérale avait imaginé un plan pour embrigader les ouvriers dans la production de guerre, proposant que, dans les entreprises, soit élu un Groupe ouvrier au sein des Comités des industries de guerre. Les mencheviks se présentèrent et, ayant obtenu une large majorité, tentèrent d’utiliser le Groupe ouvrier pour présenter des revendications. Ils proposaient, de fait, à l’image des syndicats dans les autres pays européens, d’utiliser une "organisation ouvrière" vendue à l’effort de guerre.
Les bolcheviks s’opposèrent à cette proposition en octobre 1915 par la bouche de Lénine : "Nous sommes contre la participation aux Comités des industries de guerre, qui aident à mener la guerre impérialiste réactionnaire" 5. Les bolcheviks appelèrent à l’élection de comités de grève et le Comité du parti de Petersburg proposa que "les délégués des fabriques et ateliers, élus à la représentation proportionnelle, devront former le Soviet panrusse des députés ouvriers" 6.
Dans un premier temps, les mencheviks, avec leur politique électorale en faveur du Groupe ouvrier, contrôlèrent la situation d’une main de fer. Les grèves de l’hiver 1915 et celles, bien plus nombreuses, de la seconde moitié de 1916 restèrent sous la tutelle du Groupe ouvrier menchevique malgré que, ici où là, apparurent des comités de grève. Ce n'est qu'en février que le grain commença à germer.
La première tentative de constituer un soviet eut lieu lors d’une réunion improvisée qui se déroula au Palais de Tauride le 27 février. Ceux qui y participèrent n’étaient pas représentatifs ; il y avait des éléments du Parti menchevique et du Groupe ouvrier avec quelques représentants bolcheviques et d'autres éléments indépendants. Et là surgit un débat très significatif qui mit sur la table deux options totalement opposées : les mencheviks prétendaient que la réunion devait s’autoproclamer Comité provisoire du Soviet; le bolchevik Chliapnikov "s’[y] opposa, arguant que cela ne pouvait se faire en l’absence de représentants élus par les ouvriers. Il demanda leur convocation urgente et l’assemblée lui donna raison. Il fut décidé de finir la session et de lancer les convocations aux principales concentrations ouvrières et aux régiments insurgés" 7.
La proposition eut des effets foudroyants. La nuit même du 27, elle commença à se répandre dans de nombreux quartiers, les usines et les casernes. Des ouvriers et des soldats veillaient à suivre de près le développement des événements. Le lendemain, il y eut de nombreuses assemblées dans les usines et les casernes et, les unes après les autres, prirent la même décision : constituer un soviet et élire un délégué. Dans l’après-midi, le palais de Tauride était rempli de fond en comble de délégués d’ouvriers et de soldats. Sukhanov, dans ses Mémoires 8, décrit la réunion qui allait prendre la décision historique de constituer le soviet : "au moment de l’ouverture de la séance il y avait quelques 250 députés, mais de nouveaux groupes entraient sans cesse dans la salle" 9. Il raconte comment, au moment de voter l’ordre du jour, la session fut interrompue par des délégués de soldats qui voulaient transmettre les messages de leurs assemblées de régiment respectives. Et l’un d’eux fit le résumé suivant : "Les officiers ont disparu. Nous ne voulons plus servir contre le peuple, nous nous associerons avec nos frères ouvriers, tous unis pour défendre la cause du peuple. Nous donnerons nos vies pour cette cause. Notre assemblée générale nous a demandé de vous saluer". Sukhanov ajoute : "Et avec une voix étouffée par l’émotion, au milieu des ovations de l’assemblée frémissante, le délégué ajouta : Vive la Révolution !" 10.La réunion, constamment interrompue par l’arrivée de nouveaux délégués qui voulaient transmettre la position de ceux qu’ils représentaient, aborda au fur et à mesure les différentes questions : formation de milices dans les usines, protection contre les pillages et les agissements des forces tsaristes. Un délégué proposa la création d’une "commission littéraire" pour rédiger un appel adressé à tous le pays, ce qui fut approuvé à l'unanimité 11. L’arrivée d’un délégué du régiment Semionovski – réputé pour sa fidélité au Tsar et son rôle répressif en 1905 - entraîna une nouvelle interruption. Le délégué proclama : "Camarades et frères, je vous apporte les salutations de tous les hommes du régiment Semionovski. Tous jusqu’au dernier, nous avons décidé de nous joindre au peuple". Ceci provoqua "un courant d’enthousiasme qui parcourut toute l’assemblée" (Sukhanov). L’assemblée organisa un "état-major de l’insurrection" occupant tous les points stratégiques de Petersburg.
L’assemblée du Soviet n’avait pas lieu dans le vide. Les masses étaient mobilisées. Sukhanov souligne l’ambiance qui entourait la séance : "La foule était très compacte, des dizaines de milliers d’hommes s’y étaient rendus pour saluer la révolution. Les salons du palais ne pouvaient plus contenir autant de gens et, devant les portes, les cordons de la Commission militaire arrivaient tout juste à contenir une foule de plus en plus nombreuse" (idem, p. 56).
Mars 1917 : un gigantesque réseau de soviets s'étend sur toute la Russie
En 24 heures, le Soviet se rendit maître de la situation. Le triomphe de l’insurrection de Petersburg provoqua l’extension de la révolution à tout le pays. "Couvrant tout le territoire russe, le réseau des conseils locaux de députés ouvriers et soldats constituait en quelque sorte la charpente osseuse de la révolution" 12.
Comment a pu se produire une telle ramification gigantesque qui, en si peu de temps, s’est étendue sur tout le territoire russe ? Il y a des différences entre la formation des soviets en 1905 et en 1917. En 1905, la grève s’est déclenchée en janvier et les vagues successives de grève ne débouchèrent sur aucune organisation massive sauf quelques exceptions. Les soviets commencèrent à se constituer vraiment en octobre. Par contre, en 1917, c’est dès le début de la lutte que sont créés les soviets. Les appels du Soviet de Petersburg le 28 février tombèrent sur un sol fertile. La célérité impressionnante avec laquelle ce Soviet s’est constitué est, par elle-même, significative de la volonté de le faire surgir qui animait de larges couches d’ouvriers et de soldats.
Les assemblées étaient quotidiennes. Elles ne se limitaient pas à élire le délégué au Soviet. Il arrivait souvent que celui-ci soit massivement accompagné jusqu’au lieu de l’assemblée générale. Par ailleurs et parallèlement, des soviets de quartier se constituaient. Le Soviet lui-même avait fait un appel en ce sens et, le jour même, les ouvriers du quartier combatif de Vyborg, une agglomération prolétarienne de la banlieue de Petersburg, avaient pris les devants en constituant un Soviet de District et en lançant un appel très combatif pour que de tels soviets soient formés dans tout le pays. Les ouvriers de bien d’autres quartiers populaires suivirent leur exemple les jours suivants.
Et c’est de la même manière que les assemblées d’usine constituèrent des conseils d’usine. Ceux-ci, bien qu'étant nés pour répondre à des besoins revendicatifs et d’organisation interne du travail, ne se limitaient pas à cet aspect et devenaient de plus en plus politisés. Anweiler reconnaît que "Avec le temps, les Conseils d’Usine ont acquis une organisation solide à Petersburg, représentant, dans une certaine mesure, une concurrence par rapport au Conseil des Députés Ouvriers. Ils se sont associés aux conseils de rayon (quartier), et leurs représentants élisaient un conseil central avec, à sa tête, un comité exécutif. Etant donné qu’ils encadraient les travailleurs directement dans leur lieux de travail, leur rôle révolutionnaire a pris de plus en plus d’importance au fur et à mesure que le Soviet [de Petersburg] devenait une institution durable et commençait à perdre le contact étroit avec les masses" (p. 133, idem).
Ainsi, la formation de soviets s’est répandue dans toute la Russie, telle une traînée de poudre. A Moscou "le 1er mars eurent lieu les élections des délégués des usines et le Soviet tint sa première séance en élisant un Comité Exécutif de 30 membres. Le lendemain s’est constitué définitivement le Conseil ; on fixa des normes de représentativité, on élut les délégués pour le Soviet de Petersburg et on approuva la formation du nouveau gouvernement provisoire (…) La marche triomphale de la révolution qui depuis Petersburg s’est propagée à toute la Russie était accompagnée d’une vague révolutionnaire d’activité organisationnelle dans toutes les couches sociales qui a eu sa plus forte concrétisation dans la formation de soviets dans toutes les villes de l’Empire, depuis la Finlande jusqu’à l’océan Pacifique" 13
Même si les soviets s’occupaient d’affaires locales, leur préoccupation principale concernait les problèmes généraux : la guerre mondiale, le chaos économique, l’extension de la révolution à d’autres pays et ils prirent des mesures pour concrétiser ces préoccupations. Il est à souligner que l’effort pour centraliser les soviets est venu "d’en bas" et non d’en haut. Comme c'est dit ci-dessus, le Soviet de Moscou avait décidé d’envoyer des délégués au Soviet de Petersburg, le considérant tout naturellement comme le centre de tout le mouvement. Anweiler souligne que "les conseils d’ouvriers et de soldats des autres villes envoyaient leurs délégués à Petersburg ou gardaient des observateurs en permanence auprès du Soviet" (p. 129). Dès la mi-mars, des initiatives pour des congrès régionaux de soviets ont commencé à se faire jour. À Moscou une Conférence de cette nature eut lieu les 25-27 mars avec la participation de 70 conseils ouvriers et de 38 conseils de soldats. Dans le bassin du Donetz, il y eut une Conférence ayant les mêmes caractéristiques où se réunirent 48 soviets. Tout cet effort a culminé dans la tenue d’un Premier Congrès des soviets de toute la Russie qui eut lieu du 29 mars au 3 avril et regroupa des délégués de 480 soviets.
Le "virus organisationnel" se répandit aux soldats qui, écœurés par la guerre, désertaient les champs de bataille, se mutinaient, expulsaient les officiers et décidaient de rentrer chez eux. Contrairement à 1905 où ils n’existèrent pratiquement pas, les conseils de soldats se mirent à foisonner et à proliférer dans les régiments, les cuirassés, les bases navales, les arsenaux… L'armée regroupait un conglomérat de classes sociales, essentiellement des paysans, les ouvriers étant une minorité. Malgré cette hétérogénéité, la majorité de ces soviets s’unirent au prolétariat. Comme le signale l’historien et économiste bourgeois Tugan Baranovski, "ce n’est pas l’armée qui a déclenché l’insurrection, ce sont les ouvriers. Ce ne sont pas des généraux, mais des soldats qui se sont rendus à la Douma d’Empire 14. Et les soldats ont soutenu les ouvriers non point pour obtempérer docilement à des injonctions de leurs officiers, mais… parce qu’ils se sentaient apparentés par le sang aux ouvriers, en tant que classe de travailleurs, comme eux-mêmes" 15.
L’organisation soviétique gagna progressivement du terrain jusqu’à s’élargir fortement à partir de mai 1917, quand la formation de conseils de paysans commença à agiter des masses habituées depuis des siècles à être traitées comme du bétail. C’était là aussi une différence fondamentale avec 1905, qui n’avait connu que relativement peu de soulèvements paysans, totalement désorganisés.
Que toute la Russie se couvre d’un gigantesque réseau de conseils est un fait historique d’une immense portée. Comme le signale Trotski, "dans toutes les révolutions précédentes, sur les barricades se battaient des ouvriers, de petits artisans, un certain nombre d’étudiants ; des soldats prenaient leur parti ; ensuite, la bourgeoisie cossue, qui avait prudemment observé les combats des barricades par la fenêtre, recueillait le pouvoir" (16), mais il n’en fut pas ainsi cette fois. Les masses cessèrent de se battre "pour d’autres" et se préparèrent à se battre pour elles-mêmes à travers les conseils. Elles s’occupaient de toutes les affaires de la vie économique, politique, sociale et culturelle.
Les masses ouvrières étaient mobilisées. L’expression de cette mobilisation était les soviets et, autour d’eux, tout un gigantesque réseau d’organisations de type soviétique (conseils de quartier et conseils d’usine), réseau qui se nourrissait, et, à son tour, impulsait une quantité impressionnante d’assemblées, de réunions, de débats, d’activités culturelles qui se démultipliaient… Des ouvriers, des soldats, des femmes, des jeunes s’adonnaient à une activité fébrile. Ils vivaient dans une sorte d’assemblée permanente. On arrêtait le travail pour assister à l’assemblée de l’usine, au soviet de la ville ou du quartier, aux rassemblements, aux meetings, aux manifestations. Il est significatif qu’après la grève de février, il n’y ait eu pratiquement pas de grèves, excepté à des moments particuliers et dans des situations ponctuelles ou locales. Contrairement à une vision restrictive de la lutte, limitant celle-ci à la grève, l’absence de grèves ne voulait pas dire démobilisation. Les ouvriers étaient en lutte permanente, mais la lutte de classe, comme le disait Engels, constitue une unité formée par la lutte économique, la lutte politique et la lutte idéologique. Et les masses ouvrières étaient en train d'assumer simultanément ces trois dimensions de leur combat. Des actions massives, des manifestations, des rassemblements, des débats, la circulation de livres et de journaux…, les masses ouvrières russes, avaient pris leur propre destin en main et trouvaient en leur sein des réserves inépuisables de pensée, d’initiatives, de recherche, tout était abordé sans relâche dans des forums intensément collectifs.
Avril 1917 : le combat pour "tout le pouvoir aux soviets"
"Le soviet prit possession de tous les bureaux de postes et de télégraphes, de la radio, de toutes les gares, des imprimeries, de sorte que sans son autorisation il était impossible d’envoyer un télégramme, de sortir de Petersburg ou de publier un manifeste", reconnaît dans ses Mémoires un député du Parti Cadet 17. Et cependant, comme le signale Trotski, il existait un terrible paradoxe depuis février : le pouvoir des soviets avait été confié par la majorité (menchevique et socialiste-révolutionnaire) à la bourgeoisie, l’obligeant pratiquement à créer le Gouvernement provisoire 18, présidé par un prince tsariste et composé de riches industriels, de cadets et, pour faire bien, du "socialiste" Kérenski 19.
Le Gouvernement provisoire, à l’abri derrière les soviets, poursuivait sa politique guerrière et se souciait peu de trouver des solutions aux graves problèmes qui se posaient aux ouvriers et aux paysans. Cela menait les soviets à l’inefficacité et donc à la disparition, comme on peut le dégager de ces déclarations de dirigeants socialistes-révolutionnaires : "Les soviets n’aspirent nullement à rassembler l’Assemblée constituante où siègent les députés de toute la Russie […] Pas plus qu’ils ne sont un pouvoir parallèle à l’Assemblée nationale, pas plus, ils ne s’alignent sur le Gouvernement provisoire. Conseillers du peuple qui luttent pour ses intérêts […], ils ont conscience de ne représenter qu’une partie du pays et de ne jouir de la confiance que des seules masses populaires dans l’intérêt desquelles ils combattent. C’est pourquoi les soviets se sont toujours refusés à prendre en mains le pouvoir et à former un gouvernement" 20.
Au début du mois de mars, un secteur de la classe ouvrière commença cependant à prendre conscience du fait que les soviets tendaient à servir de paravent et d'instrument à la politique de la bourgeoisie. Il y eut alors des débats très animés dans quelques soviets, comités d’usine et conseils de quartiers sur la "question du pouvoir". L’avant-garde bolchevique était alors à la traîne, son Comité central 21 ayant précisément adopté une résolution de soutien critique au Gouvernement provisoire, malgré de fortes oppositions dans différentes sections du parti 22.
Le débat redoubla d’intensité en mars. "Le Comité de Vyborg rassembla dans un meeting des milliers d’ouvriers et de soldats qui, presqu’unanimement, adoptèrent une résolution sur la nécessité de la prise de pouvoir par le Soviet […] La résolution de Vyborg, en raison de son succès, fut imprimée et placardée au moyen d'affiches. Mais le Comité de Petrograd jeta son interdit formel sur cette résolution…" 23.
L’arrivée de Lénine en avril transforma radicalement la situation. Lénine, qui suivait avec inquiétude, depuis son exil en Suisse, les quelques informations qui arrivaient jusqu’à lui sur l’attitude honteuse du Comité central du Parti bolchevique, était parvenu aux mêmes conclusions que le Comité de Vyborg. Dans ses Thèses d’Avril, il le formula clairement : "Ce qu’il y a d’original dans l’actualité russe, c’est la transition de la première étape de la révolution, qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d’organisation du prolétariat, à sa deuxième étape, qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie" 24.
Beaucoup d’auteurs ne voient pas dans cette intervention décisive de Lénine une expression du rôle d’avant-garde du parti révolutionnaire et de ses militants les plus remarquables mais, au contraire, la considèrent comme un acte d’opportunisme politique. Selon eux, Lénine aurait saisi au vol l’opportunité d’utiliser les soviets comme plate-forme pour conquérir le "pouvoir absolu", délaissant son habit de "jacobin rigoureux" pour prendre celui d’un anarchiste partisan du "pouvoir direct des masses". De fait, un ancien membre du parti décocha que : "Pendant de nombreuses années, la place de Bakounine dans la révolution russe est restée inoccupée ; maintenant, elle est prise par Lénine" 25.(Traduit pas nous)
Cette légende est radicalement fausse. La confiance de Lénine envers les soviets venait en fait de très loin, des leçons qu’il avait tirées de la Révolution de 1905. Dans un projet de résolution qu’il proposa en 1906 au IVe Congrès du Parti, il disait que "ces soviets étant des embryons du pouvoir révolutionnaire, leur force et leur importance dépendent entièrement de la force et du succès de l’insurrection", pour ajouter que "de telles institutions, si elles ne s’appuient pas sur une armée révolutionnaire et ne renversent pas les autorités gouvernementales (c’est-à-dire si elles ne se transforment pas en gouvernement révolutionnaire), seront inévitablement vouées à leur perte" 26. En 1915, il revint sur cette même idée : "Les conseils des députés ouvriers et autres institutions analogues doivent être considérés comme des organes insurrectionnels, des organes du pouvoir révolutionnaire. C’est seulement en liaison avec le développement de la grève de masse et avec l’insurrection […] que ces institutions peuvent être réellement utiles" 27.
Juin-juillet 1917 : la crise des soviets
Lénine était cependant conscient que le combat ne faisait que commencer : "Ce n’est qu’en luttant contre cette inconscience confiante des masses (lutte qui ne peut et ne doit se livrer qu’avec les armes idéologiques au moyen de la persuasion amicale, en se référant à l’expérience vivante) que nous pourrons vraiment nous débarrasser du déchaînement actuel de phrases révolutionnaires et réellement impulser tant la conscience du prolétariat que celle des masses, l’initiative locale, l' audace et la résolution". 28. (Traduit de l'espagnol pas nous)
Cela se vérifia amèrement lors du Premier Congrès des soviets de toutes les Russies. Convoqué pour unifier et centraliser le réseau des différents types de soviets éparpillés sur tout le territoire, ses résolutions allaient non seulement à l’encontre de la révolution mais débouchaient sur la destruction des soviets. Aux mois de juin et juillet est apparu au grand jour un problème politique grave : la crise des soviets, leur éloignement de la révolution et des masses.
La situation générale était marquée par un désordre total : hausse générale du chômage, paralysie des transports, perte des récoltes dans les campagnes, rationnement général. Les désertions se multipliaient dans l’armée ainsi que les tentatives de fraternisation avec l’ennemi sur le front. Le camp impérialiste de l’Entente (France, Grande-Bretagne et depuis peu États-Unis) faisait pression sur le Gouvernement provisoire pour qu’il lance une offensive générale contre le front allemand. Les délégués mencheviques et SR, complaisants face à cette demande, firent adopter une résolution au Congrès des soviets pour soutenir l’offensive militaire alors qu’une importante minorité, qui ne regroupait pas que les bolcheviks, était contre. Pour comble, le Congrès rejeta une proposition de limiter la journée de travail à huit heures et se désintéressa du problème agraire. De porte-voix des masses, il devint le porte-voix de ce qu’elles haïssaient par-dessus tout, la continuation de la guerre impérialiste.
La mise en circulation des résolutions du Congrès – et, en particulier, celles qui soutenaient l’offensive militaire – provoqua une profonde déception dans les masses. Celles-ci se rendirent compte que leur organisation leur glissait entre les doigts et commencèrent à réagir. Les soviets de quartier de Petersburg, le Soviet de la ville voisine de Kronstadt et divers conseils d’usine et les comités de plusieurs régiments proposèrent une grande manifestation le 10 juin dont l’objectif serait de faire pression sur le Congrès pour qu’il change de politique et s’oriente vers la prise de pouvoir, expulsant les ministres capitalistes.
La réponse du Congrès fut d’interdire temporairement les manifestations sous prétexte du "danger" d’un "complot monarchiste". Les délégués du Congrès furent mobilisés pour se déplacer dans les usines et les régiments pour "convaincre" les ouvriers et les soldats. Le témoignage d’un délégué menchevique est éloquent : "Toute la nuit durant, la majorité du Congrès, plus de cinq cents de ses membres, sans fermer l’œil, par équipes de dix, parcoururent les fabriques, les usines et les casernes de Petrograd, exhortant les hommes à s’abstenir de la manifestation. Le Congrès, dans un bon nombre de fabriques et d’usines et aussi dans une certaine partie de la garnison, ne jouissait d’aucune autorité… Les membres du Congrès furent accueillis très souvent d’une manière fort inamicale, parfois avec hostilité et, fréquemment, furent éconduits avec colère" 29.
Le front de la bourgeoisie avait compris la nécessité de sauver son principal atout – la séquestration des soviets – contre la première tentative sérieuse des masses pour les récupérer. Elle le fit avec son machiavélisme congénital, en utilisant les bolcheviks comme têtes de turcs, lançant une furieuse campagne contre eux. Au Congrès des cosaques qui se tenait en même temps que le Congrès des soviets, Milioukov proclama que "les bolcheviks étaient les pires ennemis de la Révolution russe… Il est temps d’en finir avec ces messieurs" 30. Le Congrès cosaque décida "de soutenir les soviets menacés. Nous autres, cosaques, ne nous querellerons jamais avec les soviets" 31. Comme le souligne Trotski, "contre les bolcheviks, les réactionnaires étaient prêts à marcher même avec le soviet pour l’étouffer d’autant plus tranquillement ensuite" 32. Le menchevik Liber montra clairement l’objectif en déclarant au Congrès des soviets : "Si vous voulez avoir pour vous la masse qui se dirige vers les bolcheviks, rompez avec le bolchevisme".
La violente contre-offensive bourgeoise contre les masses se faisait dans une situation où, dans leur ensemble, elles étaient encore politiquement faibles. Les bolcheviks le comprirent et proposèrent l’annulation de la manifestation du 10 juin, ce qui ne fut accepté qu'à contrecœur par quelques régiments et les usines les plus combatives.
Lorsque parvint cette nouvelle au Congrès des soviets, un délégué proposa que soit convoquée une manifestation "véritablement soviétique", le 18 juin. Milioukov analyse ainsi cette initiative : "Suite à des discours au ton libéral au Congrès des soviets, après avoir réussi à empêcher la manifestation armée du 10 juin… les ministres socialistes sentirent qu’ils étaient allés trop loin dans leur rapprochement avec nous, que le terrain fuyait sous leurs pieds. Effarés, ils se retournèrent brusquement vers les bolcheviks". Trotski le corrige avec justesse : "Il ne s'agissait pas, bien entendu, d'un virage vers les bolcheviks, mais de quelque chose de bien différent, une tentative de se tourner vers les masses, contre les bolcheviks" 33. (Traduit de l'espagnol par nous)
Ce fut un cuisant échec pour le Congrès des soviets dominé par la bourgeoisie. Les ouvriers et les soldats participèrent massivement à la manifestation du 18 juin, brandissant des banderoles réclamant tout le pouvoir aux soviets, la destitution des ministres capitalistes, la fin de la guerre, appelant à la solidarité internationale… Les manifestations reprenaient les orientations bolcheviques et exigeaient le contraire de ce que demandait le Congrès.
La situation empirait. Pressée par ses alliés de l’Entente, la bourgeoisie russe était dans une impasse. La fameuse offensive militaire s’était soldée par un fiasco, les ouvriers et les soldats voulaient un changement radical de politique des soviets. Mais la situation n’était pas si claire dans les provinces et dans les campagnes où, malgré une certaine radicalisation, la grande majorité restait fidèle aux SR et favorable au Gouvernement provisoire.
Le moment était venu pour la bourgeoisie de tendre une embuscade aux masses à Petersburg en provoquant un affrontement prématuré qui devait lui permettre d’asséner un rude coup à l’avant-garde du mouvement et d’ouvrir ainsi les portes à la contre-révolution.
Les forces de la bourgeoisie se réorganisaient. Des "soviets d’officiers" s’étaient constitués, dont la tâche était d’organiser des forces d’élite pour écraser militairement la révolution. Encouragées par les démocraties occidentales, les bandes noires tsaristes relevaient la tête. Selon les propres termes de Lénine, la vieille Douma fonctionnait comme un bureau contre-révolutionnaire sans que les leaders social-traîtres des soviets lui opposent le moindre obstacle.
Une série de provocations subtiles fut programmée pour pousser les ouvriers de Petersburg dans le piège d’une insurrection prématurée. Le Parti Cadet retira tout d’abord ses ministres du Gouvernement provisoire pour que celui-ci ne soit plus composé que de "socialistes". C’était une sorte d’invitation à ce que les ouvriers réclament la prise immédiate du pouvoir et se lancent à l’insurrection. L’Entente lança ensuite un véritable ultimatum au Gouvernement provisoire : il fallait choisir entre les soviets ou un gouvernement constitutionnel. Enfin, la plus violente provocation fut la menace de déplacer les régiments les plus combatifs de la capitale vers les régions frontalières.
Des masses importantes de travailleurs et de soldats de Petersburg mordirent à l’hameçon. A partir de nombreux soviets de quartiers, d'usines et de régiments, une manifestation armée fut appelée pour le 4 juillet. Son mot d'ordre était la prise du pouvoir par les soviets. Cette initiative montrait que les ouvriers avaient compris qu'il n'y avait pas d'issue en dehors de la révolution. Mais, en même temps, ils réclamaient que le pouvoir soit assumé par les soviets tels qu'ils étaient alors constitués, c'est-à-dire avec la majorité aux mains des mencheviks et des socialistes révolutionnaires dont la préoccupation était d'inféoder les soviets à la bourgeoisie. Cette scène, désormais célèbre, où un ouvrier s'adresse à un membre menchevique du Soviet, "pourquoi ne prends-tu pas le pouvoir une bonne fois pour toutes ?", est significative des illusions persistantes au sein de la classe ouvrière. C'était demander que le loup entre dans la bergerie ! Les bolcheviks mirent en garde contre le piège qui était tendu. Ils ne le firent pas avec suffisance, hissés sur un piédestal et disant aux masses à quel point elles se trompaient. Ils se mirent à la tête de la manifestation, coude à coude avec les ouvriers et les soldats, pour contribuer de toutes leurs forces à ce que la riposte soit massive mais ne dérape pas vers un affrontement décisif dont la défaite était écrite d’avance 34.
La manifestation s’acheva dans l’ordre et ne se lança pas à l’assaut révolutionnaire. Le massacre fut évité, ce qui fut une victoire des masses pour l’avenir. Mais la bourgeoisie ne pouvait pas reculer, elle devait poursuivre son offensive. Le Gouvernement provisoire, entièrement constitué de ministres "ouvriers", déchaîna alors une répression brutale particulièrement orientée contre les bolcheviks. Le Parti fut déclaré hors-la-loi, de nombreux militants furent emprisonnés, l’ensemble de la presse interdite, Lénine dut passer à la clandestinité.
Par un effort difficile mais héroïque, le Parti bolchevique avait contribué de façon décisive à éviter la défaite des masses, leur dispersion et la débandade qui les menaçait à travers leur désorganisation. Le Soviet de Petersburg, par contre, soutenu par le Comité exécutif élu lors du récent Congrès des soviets, touchait le fond de l’ignominie en avalisant le déchaînement d'une répression brutale et la réaction.
Comment la bourgeoisie a-t-elle pu dévoyer les soviets ?
L’organisation des masses en conseils ouvriers, dès février 1917, a signifié pour celles-ci la possibilité de développer leur force, leur organisation et leur conscience en vue de l’assaut final contre le pouvoir de la bourgeoisie. La période qui s’ensuivit, dite période de dualité de pouvoir entre prolétariat et bourgeoisie, a constitué une phase critique pour les deux classes antagoniques, pouvant aboutir, pour l’une et l‘autre, à une victoire politique et militaire sur la classe ennemie.
Pendant toute cette période, le niveau de conscience des masses, encore faible relativement aux nécessités d’une révolution prolétarienne, constituait une brèche au sein de laquelle la bourgeoisie devait tenter de s’engouffrer pour faire avorter le processus révolutionnaire en gestation. Elle disposait pour cela d’une arme d’autant plus dangereuse que pernicieuse, le sabotage de l'intérieur exercé par des forces bourgeoises agissant sous un masque "ouvrier" et "radical". Ce cheval de Troie de la contre-révolution fut constitué à l'époque, en Russie, par les partis "socialistes", mencheviks et SR.
Au début, beaucoup d'ouvriers entretenaient des illusions sur le Gouvernement provisoire et le voyaient comme une émanation des soviets, alors qu'en réalité il était leur pire ennemi. Quand aux mencheviks et socialistes-révolutionnaires, ils jouissaient d’une confiance importante parmi les grandes masses ouvrières qu’ils parvenaient à illusionner avec leurs discours radicaux, leur phraséologie révolutionnaire, ce qui leur permit de dominer politiquement la très grande majorité des soviets. C’est à partir de cette position de force qu’ils s’efforcèrent effectivement de vider ces organes de leur substance révolutionnaire pour les mettre au service de la bourgeoisie. S’ils n’y parvinrent finalement pas, c’est parce que les masses mobilisées en permanence, faisaient leur propre expérience les conduisant, avec l'appui du Parti bolchevique, à démasquer les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires à mesure que ceux-ci étaient amenés à assumer l’orientation du Gouvernement provisoire sur des questions aussi fondamentales que celles de la guerre et des conditions de vie.
Nous verrons dans un prochain article comment, dès la fin août 1917, les soviets parvinrent à se régénérer et à devenir réellement des plates-formes pour la prise du pouvoir, qui culmina dans la victoire de la Révolution d’Octobre.
C. Mir, 8 mars 2010
1 Cf. la Revue internationale no 140 [65].
2 Nous disposons aujourd’hui de beaucoup de matériel pour connaître en détails comment se développa la Révolution russe mais aussi pour voir le rôle décisif que joua le Parti bolchevique. En particulier l’Histoire de la Révolution russe de Trotski, Dix jours qui ébranlèrent le monde de John Reed, nos brochures sur la Révolution russe ainsi que de nombreux articles de notre Revue internationale, cf. les nos 71-72, 89 à 91 [66].
3 Cet auteur très antibolchevique narre cependant les faits de façon très fidèle et reconnaît avec impartialité les apports des bolcheviks, ce qui contraste d’ailleurs avec les jugements sectaires et dogmatiques qu’il assène de temps en temps.
4 Cité par Oskar Anweiler, op. cité.
5 Ídem
6 Ídem.
7 Gerald Walter, Vision d’ensemble de la Révolution russe.
8 Publiées en 1922 en 7 volumes, elles apportent le point de vue d’un socialiste indépendant, collaborateur de Gorki et des mencheviks internationalistes de Martov. Même s’il était en désaccord avec les bolcheviks, il soutint la Révolution d’Octobre. Cette citation et les suivantes sont extraites et traduites d’un résumé de ses Mémoires, publié en espagnol.
9 D’après Anweiler, il y avait autour de 1000 délégués à la fin de la session et, lors des suivantes, il y a eu jusqu’à 3000.
10 Œuvre citée, p. 54
11 Cette commission proposera l’édition permanente d’un journal du Soviet: Izvestia (Les Nouvelles) qui paraîtra régulièrement à partir de ce moment-là.
12 Anweiler, op. cité.
13 Anweiler, œuvre citée p. 121
14 Chambre des députés.
15 Cité par Trotski dans son Histoire de la Révolution russe, T. I.
16 Idem.
17 Parti constitutionnel démocratique (KD), de la grande bourgeoisie, formé précipitamment en 1905. Son dirigeant était Milioukov, éminence grise de la bourgeoisie russe de l’époque.
18 Trotski raconte comment la bourgeoisie était paralysée et comment les chefs mencheviques se servirent de leur influence dans les soviets pour lui remettre le pouvoir sans conditions, de sorte que Milioukov "ne se gênait pas pour afficher sa satisfaction et son agréable surprise » (Mémoires de Soukhanov, menchevik qui vécut de près les événements au sein du Gouvernement provisoire).
19 Cet avocat, très populaire dans les cercles ouvriers avant la révolution, finit par être nommé chef du Gouvernement provisoire et dirigea alors les différentes tentatives d’en finir avec les ouvriers. Ses intentions sont révélées par les mémoires de l’ambassadeur anglais de l’époque : "Kerenski m’exhorta à la patience en m’assurant que les soviets finiraient par mourir de mort naturelle. Ils céderaient bientôt leurs fonctions à des organes démocratiques d’administration autonome ».
20 Cité par Anweiler, op. cité.
21 En faisaient partie Staline, Kamenev et Molotov. Lénine était exilé en Suisse et n’avait pratiquement pas de moyens de contacter le parti.
22 Lors d’une réunion du Comité du Parti de Petrograd, célébrée le 5 mars, fut rejeté le projet de résolution présenté par Chliapnikov qui disait : "L’impératif de l’heure réside dans la formation d’un gouvernement révolutionnaire provisoire issu de l’unification des conseils locaux des députés ouvriers, paysans et soldats. Avant de passer à la conquête intégrale du pouvoir central, il est indispensable […] de consolider le pouvoir des conseils des députés ouvriers et soldats" (cité par Anweiler, op. cité).
23 Trotski, op. cité.
24 Nous ne pouvons aborder dans cet article le contenu de ces Thèses, extrêmement intéressantes au demeurant. Cf. la Revue internationale no 89, "Les Thèses d’avril, phare de la révolution prolétarienne [67]».
25 Cité par Trotski, op. cit.
26 Cité par Anweiler, op. cit.
27 Idem.
28 Lénine, Oeuvres choisies. Lenin Obras Escogidas tomo II página 50 edición española
29 Cité par Trotski, op. cité.
30 Que le chef de la bourgeoisie en Russie se permette de parler au nom de la Révolution russe révèle bien tout le cynisme typique de cette classe !
31 Régiments caractérisés par leur obéissance au tsar et à l’ordre établi. Ils furent les derniers à passer du côté de la révolution.
32 Trotski, op. cité.
33 Toutes ces citations sont extraites de Trotski, op. cité.
34 Voir notre article sur "Les journées de juillet et le rôle indispensable du parti [68]", Revue internationale no 90. Nous renvoyons nos lecteurs à cet article pour une analyse plus détaillée de cet événement.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [69]
Rubrique:
Décadence du capitalisme (VI) : La théorie du déclin du capitalisme et la lutte contre le révisionnisme
- 4310 lectures
Engels entrevoit l'arrivée de la crise historique du capitalisme
D'après un certain courant intellectuel, composé de marxologues, de conseillistes et d'anarchistes, la théorie marxiste est devenue stérile après la mort de Marx en 1883 ; selon eux, les partis sociaux-démocrates de la Deuxième Internationale auraient été dominés par la pensée d'Engels. Ce dernier ainsi que ses partisans auraient transformé la méthode d'investigation de Marx en un système de pensée à demi mécaniste qui assimilerait, à tort, la critique sociale radicale à la démarche des sciences de la nature. Ils accusent également la "pensée d'Engels" de revenir de façon quasi mystique aux dogmes hégéliens, en particulier lorsqu'il tente d'élaborer une "dialectique de la nature". Dans la conception de ce courant, ce qui est naturel n'est pas social, et ce qui est social n'est pas naturel. Si la dialectique existe, elle ne peut s'appliquer qu'à la sphère sociale.
Cette rupture dans la continuité entre Marx et Engels (qui, sous sa forme la plus extrême, rejette quasiment l'ensemble de la Deuxième Internationale considérée comme un instrument de l'intégration du mouvement ouvrier au service des besoins du capital) est souvent utilisée pour rejeter toute notion de continuité dans l'histoire politique de la classe ouvrière. De Marx - que peu de nos "anti-Engels" rejettent (au contraire, ils sont fréquemment devenus des "experts" de tous les détails du problème de la transformation de la valeur en prix ou d'autres aspects partiels de la critique faite par Marx à l'économie politique), on nous convie à sauter à pieds joints par dessus Engels, Kautsky, Lénine et par dessus les Deuxième et Troisième Internationales. Et tout en reconnaissant, à contre-cœur, que certaines parties de la Gauche communiste ont réalisé certains développements théoriques malgré leur parenté douteuse, on considère qu'après Marx, ce sont quelques intellectuels clairsemés... qui assurent la continuité véritable de sa théorie. Seuls ces brillants individus auraient vraiment compris Marx au cours des dernières décennies – il ne s'agit, en fait, personne d'autre que les partisans de la thèse "anti-Engels".
Nous ne pouvons ici répondre à l'ensemble de cette idéologie. Comme tous les mythes, elle se base sur certains éléments de la réalité qui sont distordus et amplifiés hors de toute proportion. Au cours de la période de la Deuxième Internationale, période au cours de laquelle le prolétariat se constituait comme classe en une force organisée au sein de la société capitaliste, il y a eu en effet une tendance à schématiser le marxisme et à en faire une sorte de déterminisme, en même temps que les idées réformistes exerçaient un poids réel sur le mouvement ouvrier ; et même les meilleurs marxistes, y compris Engels, n'y échappèrent pas 1. Mais même si Engels a commis des erreurs importantes au cours de cette période, écarter platement les travaux d'Engels après la mort de Marx en tant que négation et détournement de la pensée réelle de Marx est absurde étant donnée la coopération très étroite que les deux hommes ont entretenue du début à la fin de leurs relations. C'est Engels qui a assuré l'énorme tâche d'éditer et de publier Le Capital de Marx, dont les Volumes II et III cités par ceux qui dressent un mur entre Marx et Engels. Pense-t-on que cela aurait été possible si Engels avait été réellement été porteur des incompréhensions qui lui sont prêtées ?
L'un des tenants principaux de la ligne de pensée "anti-Engels" est le groupe Aufheben en Grande Bretagne, dont la série "Décadence : Théorie du déclin ou déclin de la théorie" 2, semble considérée par certains comme ayant porté le coup fatal à la notion moribonde de décadence du capitalisme, vu le nombre de fois où cette série est citée par tous ceux qui sont hostiles à cette notion. A son point de vue, la décadence du capitalisme est fondamentalement une invention de la Deuxième Internationale : "La théorie de la décadence du capitalisme est apparue pour la première fois dans la Deuxième Internationale. Le programme d'Erfurt soutenu par Engels établissait que la théorie du déclin et de l'effondrement du capitalisme était un point central du programme du parti" (Aufheben n°2, traduit par nous). Et ils citent les passages suivants :
"Ainsi la propriété privée des moyens de production change sa nature originelle en son contraire. (...) Jadis ce mode de propriété accélérait la marche de l'évolution sociale. La propriété privée est aujourd'hui la cause de la corruption, de la banqueroute de la société. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir si l’on veut ou non maintenir la propriété privée des moyens de production. Sa disparition est certaine. La question qui se pose est la suivante : la propriété privée des moyens de production doit-elle entraîner dans sa chute la société tout entière ; la société doit-elle, au contraire, se débarrasser du fardeau néfaste qui l'écrase, pour, devenue libre et en possession de nouvelles forces, continuer à suivre la voie que lui prescrivent les lois de l'évolution ? (p.110-111) Les forces productives qui se sont développées au sein de la société capitaliste ne sont plus compatibles avec le mode de propriété qui forme sa base. Vouloir maintenir cette forme de propriété, c'est rendre à l'avenir son progrès social impossible, c'est condamner la société à la stagnation et au déclin (...) (p.112) La société capitaliste est parvenue au terme de son chemin. Sa dissolution n'est plus qu'une affaire de temps. L'irrésistible évolution économique conduit nécessairement à la banqueroute du mode de production capitaliste. La constitution d'une nouvelle société, destinée à remplacer celle qui existe, n'est plus seulement souhaitable, elle est devenue inévitable. (p.141) En l'état actuel des choses, la civilisation capitaliste ne peut se maintenir. Il nous faut soit aller vers lesocialisme, soit retomber dans la barbarie. (p.142)"
Dans le résumé qui présente l'article suivant de la série, dans Aufheben n°3, l'argument selon lequel le concept de décadence trouve ses racines dans "le marxisme de la Deuxième Internationale" est encore plus explicite :
"Dans la première partie, nous avons examiné comment cette notion de déclin ou de décadence du capitalisme a ses racines dans le marxisme de la Deuxième Internationale et a été maintenue par deux courants qui se réclament être les vrais continuateurs de la "tradition marxiste classique" – le trostkysme-léninisme et le communisme de gauche ou de conseils." (notre traduction)
Bien que la citation qu'Aufheben présente comme faisant partie du Programme d'Erfurt, semble provenir plutôt des commentaires de Kautsky sur le Programme (Le programme socialiste 1892 3), le préambule au Programme contient effectivement une référence à la notion de déclin du capitalisme et affirme même que cette période est déjà ouverte :
"L'abîme qui sépare les possédants et les non-possédants est encore élargi par les crises qui ont leur principe dans l'essence du mode de production capitaliste, crises qui deviennent toujours plus étendues et plus dévastatrices, qui font de l'insécurité générale l'état normal de la société et fournissent la preuve que les forces productives de la société actuelle ont trop grandi pour cette société, que la propriété privée des moyens de production est devenue inconciliable avec un sage emploi et avec le plein développement de ces moyens de production." 4
En réalité, et bien que du point de vue d'Aufheben, le Programme d'Erfurt soit très dépendant de la théorie de la décadence, une lecture rapide de celui-ci donne plutôt l'impression qu'il n'y a aucun lien entre l'évaluation globale du système mentionnée plus haut et les revendications mises en avant dans le Programme, qui sont toutes des revendications minimales pour lesquelles il faut se battre au sein de la société capitaliste ; et même les nombreuses critiques détaillées portées par Engels et d'autres marxistes à ces revendications ne font quasiment aucune référence au contexte historique dans lequel celles-ci sont posées. 5
Ceci dit, il est vrai que dans les travaux d'Engels et d'autres marxistes de la fin du 19e siècle, on trouve de plus en plus de références à la notion d'entrée du capitalisme dans une crise de sénilité, une période de déclin.
Mais alors que pour Aufheben, cette notion s'éloignerait de Marx – qui, affirment-ils, a seulement dit que le capitalisme était un système "transitoire" et n'a jamais mis en avant l'idée d'un processus objectif de déclin ou d'effondrement du capitalisme comme fondement pour les luttes révolutionnaires du prolétariat contre le système – nous avons pour notre part cherché à montrer dans les précédents articles de cette série que le concept de décadence du capitalisme (comme des précédentes sociétés de classes) faisait partie intégrante de la pensée de Marx.
Il est vrai aussi que les écrits de Marx sur l'économie politique ont été produits au cours de la phase encore ascendante d'un capitalisme triomphant. Ses crises périodiques étaient des crises de jeunesse qui permettaient de propulser la marche impériale de ce mode de production dynamique sur toute la surface du globe. Mais Marx avait également vu, dans ces convulsions, les signes avant-coureurs de la chute finale du système et déjà commencé à entrevoir des manifestations de l'achèvement de la mission historique du capitalisme avec la conquête des régions les plus reculées de la planète, tandis que, dans le sillage des événements de la Commune de Paris, il affirmait que la phase des héroïques guerres nationales avait touché à sa fin dans "la vieille Europe".
De plus, au cours de la période qui a suivi la mort de Marx, les signes avant-coureurs d'une crise aux proportions historiques et pas seulement une répétition des anciennes crises cycliques, se manifestaient de plus en plus clairement.
Ainsi, par exemple, Engels a réfléchi sur la signification de la fin apparente du "cycle décennal" de crises et sur le début de ce qu'il appela une dépression chronique affectant la première nation capitaliste, la Grande-Bretagne. Et tandis que de nouvelles puissances capitalistes se frayaient leur chemin sur le marché mondial, l'Allemagne et les Etats-Unis avant tout, Engels vit que cela aboutirait inévitablement à une crise de surproduction encore plus profonde :
"L'Amérique va casser le monopole industriel de l'Angleterre – ou ce qui en reste – mais l'Amérique ne peut succéder à ce monopole. Et à moins qu'un pays ait le monopole des marchés mondiaux, au moins dans les branches décisives du commerce, les conditions – relativement favorables – qui existaient ici en Angleterre de 1848 à 1870 ne peuvent se reproduire nulle part, et même en Amérique, la condition de la classe ouvrière doit sombrer de plus en plus. Car s'il y a trois pays (disons l'Angleterre, l'Amérique et l'Allemagne) qui sont en concurrence sur un pied d'égalité pour la possession du Weltmarkt (marché mondial, en allemand dans le texte), il n'y a pas d'autre possibilité qu'une surproduction chronique, chacun des trois étant capable de produire la totalité de ce qui est requis." (Engels à Florence Kelley Wischnewetsky, 3 février 1886, traduit de l'anglais par nous)
En même temps, Engels voyait la tendance du capitalisme à engendrer sa propre ruine avec la conquête accélérée des régions non capitalistes qui entouraient les métropoles capitalistes :
"Car c'est l'un des corollaires nécessaires de la grande industrie qu'elle détruise son propre marché interne par le processus même par lequel elle le crée. Elle le crée en détruisant la base de l'industrie intérieure de la paysannerie. Mais sans industrie intérieure, les paysans ne peuvent vivre. Ils sont ruinés en tant que paysans ; leur pouvoir d'achat est réduit au minimum : et jusqu'à ce qu'en tant que prolétaires, ils se soient installés dans de nouvelles conditions d'existence, ils ne fourniront qu'un très pauvre marché aux nouvelles usines créées.
La production capitaliste étant une phase économique transitoire est pleine de contradictions internes qui se développent et deviennent évidentes en proportion de son développement. Cette tendance à détruire son propre marché interne en même temps qu'elle le crée, est l'une de ces contradictions. Une autre est la situation insoluble à laquelle cela mène et qui se développe plus vite dans un pays qui n'a pas de marché extérieur, comme la Russie, que dans les pays qui sont plus ou moins aptes à entrer en concurrence sur le marché mondial ouvert. Cette situation sans issue apparente trouve une sortie, pour ces derniers pays, dans des convulsions commerciales, dans l'ouverture violente de nouveaux marchés. Mais même alors, le cul de sac vous éclate à la figure. Regardez l'Angleterre. Le dernier nouveau marché qui pourrait apporter un renouveau de prospérité temporaire en s'ouvrant au commerce anglais est la Chine. Aussi le capital anglais insiste pour construire des chemins de fer chinois. Mais des chemins de fer en Chine signifient la destruction de la base de toute la petite agriculture chinoise et de l'industrie intérieure, et comme il n'existera même pas le contrepoids de la grande industrie chinoise, des centaines de millions de gens se trouveront dans l'impossibilité de vivre. La conséquence en sera une émigration énorme telle que le monde n'en a pas encore connue, l'Amérique, l'Asie, l'Europe submergées par les chinois qui sont haïs, une concurrence pour le travail avec les ouvriers d'Amérique, d'Australie et d'Europe sur la base du niveau de vie chinois, le plus bas de tous – et si le système de production n'a pas changé en Europe d'ici là, il devra alors changer.
La production capitaliste travaille à sa propre ruine et vous pouvez être sûr qu'elle le fera aussi en Russie." (Lettre à Nikolai Danielson, 22 septembre 1892, traduite de l'anglais par nous)
La croissance du militarisme et de l'impérialisme, visant avant tout à achever la conquête des aires non capitalistes de la planète, ont également permis à Engels de voir avec une extrême lucidité les dangers que cette évolution ferait courir en retour au centre du système – en Europe, menaçant d'entraîner la civilisation dans la barbarie tout en accélérant en même temps la maturation de la révolution.
"Aucune guerre n'est plus possible pour l'Allemagne prussienne sauf une guerre mondiale et une guerre mondiale d'une étendue et d'une violence inimaginables jusqu'ici. Huit à dix millions de soldats se massacreront et ce faisant dévoreront toute l'Europe jusqu'à la laisser plus anéantie qu'aucun nuage de sauterelles ne l'a jamais fait. La dévastation de la Guerre de Trente ans condensée en trois, quatre années et répandue sur le continent tout entier : la famine, les fléaux, la chute généralisée dans la barbarie, celle des armées comme celle des masses des populations ; une confusion sans espoir de notre système artificiel de commerce, d'industrie et de crédit aboutissant dans la banqueroute générale, l'effondrement des anciens Etats et de leur sagesse traditionnelle d'élite à un point tel que les couronnes vont tomber par douzaines et il n'y aura personne pour les ramasser ; l'impossibilité absolue de prévoir comment cela finira et qui sortira vainqueur ; un seul résultat est absolument certain : l'épuisement général et la création des conditions pour la victoire finale de la classe ouvrière." (15 décembre 1887, traduit de l'anglais par nous)
Au demeurant cependant, Engels ne voyait pas cette guerre comme un facteur de rapprochement inévitable de la perspective socialiste : il avait peur avec raison que le prolétariat ne soit aussi affecté par l'épuisement général et que cela le rende incapable d'accomplir sa révolution (d'où, pourrait-on ajouter, une certaine attraction pour des schémas quelque peu utopiques qui pourraient retarder la guerre, comme le remplacement des armées permanentes pas des milices populaires). Mais Engels avait des raisons d'espérer que la révolution éclaterait avant une guerre pan-européenne. Une lettre à Bebel (24-26 octobre 1891) exprime ce point de vue "optimiste" :
"... Selon les rapports, vous avez dit que j'avais prévu l'effondrement de la société bourgeoise en 1898. Il y a une légère erreur quelque part. Tout ce que j'ai dit, c'est que nous pourrions peut-être prendre le pouvoir d'ici 1898. Si cela n'arrive pas, la vieille société bourgeoise pourrait encore végéter un moment, pourvu qu'une poussée de l'extérieur ne fasse pas s'effondrer toute la vieille bâtisse pourrie. Un vieil emballage moisi comme ça peut survivre à sa mort intérieure fondamentale encore quelques décennies si l'atmosphère n'est pas troublée." (traduit de l'anglais par nous)
Dans ce passage, on trouve à la fois les illusions du mouvement de l'époque et sa force théorique sous-jacente. Les acquis durables du parti social-démocrate, surtout dans le domaine électoral et en Allemagne, donnèrent naissance à des espoirs excessifs sur la possibilité d'une progression inexorable vers la révolution (et la révolution elle-même allait jusqu'à être considérée en termes semi-parlementaires, malgré les mises en garde répétées contre le crétinisme parlementaire qui constituait un aspect central du bourgeonnement rapide de l'idéologie réformiste). En même temps, les conséquences de l'incapacité du prolétariat à prendre le pouvoir sont clairement établies : la survie du capitalisme pendant plusieurs décennies comme un "vieil emballage moisi" – bien qu'Engels comme la plupart des révolutionnaires de l'époque n'avait sûrement jamais imaginé que le système pourrait survivre dans sa phase de déclin encore un siècle ou plus. Mais le soubassement théorique permettant d'anticiper une telle situation est clairement établi dans ce passage.
Luxemburg mène la bataille contre le révisionnisme.
Pourtant, précisément parce que l'expansion impérialiste des dernières décennies du 19e siècle a permis au capitalisme de connaître des taux de croissance énormes, on se rappelle cette période comme celle d'une prospérité et d'un progrès sans précédent, d'une augmentation constante du niveau de vie de la classe ouvrière, non seulement grâce aux conditions objectives favorables mais aussi du fait de l'influence croissante du mouvement ouvrier organisé en syndicats et dans les partis sociaux-démocrates. C'était le cas, en particulier, en Allemagne et c'est dans ce pays que le mouvement ouvrier fut confronté à un défi majeur : la montée du révisionnisme.
Précédés par les écrits d'Edouard Bernstein à la fin des années 1890, les révisionnistes défendaient que la social-démocratie devait reconnaître que l'évolution du capitalisme avait invalidé certains éléments fondamentaux de l'analyse de Marx – surtout la prévision de crises toujours plus grandes et l'appauvrissement du prolétariat qui devait s'ensuivre. Le capitalisme avait montré qu'en utilisant le mécanisme du crédit et en s'organisant en trusts et en cartels gigantesques, il pouvait surmonter sa tendance à l'anarchie et à la crise et, sous l'impulsion d'un mouvement ouvrier bien organisé, faire des concessions de plus en plus grandes à la classe ouvrière. Le but "ultime", la révolution, incarné dans le programme du parti social-démocrate, devenait donc superflu et le parti devait se reconnaître pour ce qu'il était vraiment : un parti social-démocrate réformiste, avançant vers une transformation graduelle et pacifique, la transformation du capitalisme en socialisme.
Un certain nombre de figures de la gauche de la social-démocratie répliquèrent à ces arguments. En Russie, Lénine polémiqua contre les économistes qui voulaient réduire le mouvement ouvrier à une question de pain ; en Hollande, Gorter et Pannekoek menèrent la polémique contre l'influence croissante du réformisme dans les domaines syndical et parlementaire. Aux Etats-Unis, Louis Boudin rédigea un livre important, The Theoretical System of Karl Marx (1907), en réponse aux arguments des révisionnistes – nous y reviendrons plus loin. Mais c'est surtout Rosa Luxemburg en Allemagne qui est associée à la lutte contre le révisionnisme dont le cœur était la réaffirmation de la notion marxiste de déclin et d'effondrement catastrophique du capitalisme.
Quand on lit la polémique de Luxemburg contre Bernstein, Réforme sociale ou Révolution, on est frappé du point auquel les arguments mis en avant par ce dernier ont été répétés depuis, quasiment à chaque fois que le capitalisme a donné l'impression –quoique superficielle – de surmonter ses crises.
"D’après Bernstein, un effondrement total du capitalisme est de plus en plus improbable parce que, d’une part, le système capitaliste fait preuve d’une capacité d’adaptation de plus en plus grande et que, d’autre part, la production est de plus en plus différenciée. D’après Bernstein, la capacité d’adaptation du capitalisme se manifeste dans le fait qu’il n’y a plus de crise générale ; ceci, on le doit au développement du crédit, des organisations patronales, des communications, et des services d’information ; dans la survie tenace des classes moyennes, résultat de la différenciation croissante des branches de la production et de l’élévation de larges couches du prolétariat au niveau des classes moyennes ; enfin, dans l’amélioration de la situation économique et politique du prolétariat, grâce à l’action syndicale." (chapitre 1, "La méthode opportuniste") 6
Combien de fois en effet n'avons pas entendu que les crises appartiennent au passé et cela, pas seulement de la part des idéologues officiels de la bourgeoisie mais aussi de ceux qui proclament défendre une idéologie bien plus radicale, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme est organisé à l'échelle nationale ou même internationale, parce qu'il a la possibilité infinie de recourir au crédit et à d'autres manipulations financières ; combien de fois nous a-t-on dit que la classe ouvrière avait cessé d'être une force révolutionnaire parce qu'elle n'était plus dans la misère absolue que décrit Engels dans son livre sur les conditions de la classe ouvrière à Manchester en 1844, ou parce qu'elle se distinguerait de moins en moins des classes moyennes ? C'était notamment le grand refrain des sociologues des années 1950 et 1960, auquel les adeptes de Marcuse et de Castoriadis ont apporté un vernis radical ; et on a ressorti la rengaine du placard une nouvelle fois dans les années 1990, après l'effondrement du bloc de l'Est et avec le boom financé par le crédit dont le vernis factice ne s'est révélé que très récemment.
Contre ces arguments, Luxemburg a souligné que l' "organisation" du capital en cartels et au moyen du crédit était une réponse aux contradictions du système et tendait à exacerber ces contradictions à un degré supérieur et plus dévastateur.
Luxemburg considérait le crédit essentiellement comme un moyen de faciliter l'extension du marché tout en concentrant le capital dans un nombre de mains de plus en plus limité. A ce moment de l'histoire, c'était certainement le cas – il existait une véritable possibilité pour le capitalisme de s'étendre et le crédit accélérait cette expansion. Mais, en même temps, Rosa Luxemburg saisissait l'aspect destructeur du crédit du fait que cette expansion du marché constituait aussi la prémisse du futur conflit avec la masse des forces productives mises en mouvement :
"Ainsi le crédit, loin de contribuer à abolir ou même à atténuer les crises, en est au contraire un agent puissant. Il ne peut d’ailleurs en être autrement. La fonction spécifique du crédit consiste - très généralement parlant - à corriger tout ce que le système capitaliste peut avoir de rigidité en y introduisant toute l’élasticité possible, à rendre toutes les forces capitalistes extensibles, relatives et sensibles. Il ne fait évidemment ainsi que faciliter et qu’exaspérer les crises, celles-ci étant définies comme le heurt périodique entre les forces contradictoires de l’économie capitaliste." (chapitre 2, "L'adaptation du capitalisme", ibid.)
Le crédit n'était pas encore ce qu'il est en grande partie devenu aujourd'hui – pas tant un moyen d'accélérer l'expansion du marché réel, mais un marché artificiel en lui-même, dont le capitalisme est de plus en plus dépendant. Mais sa fonction comme remède qui aggrave le mal est devenue ainsi plus évidente à notre époque, et avant tout depuis ce qui est appelé le "credit crunch" en 2008.
De même, Luxemburg considérait la tendance du capitalisme et des capitalistes à s'organiser au niveau national et même international non comme une solution aux antagonismes du système mais comme une force potentielle qui les exacerbe à un niveau supérieur et plus destructeur :
" (...) ils aggravent la contradiction entre le caractère international de l’économie capitaliste mondiale et le caractère national de l’Etat capitaliste, parce qu’ils s’accompagnent toujours d’une guerre douanière générale ; ils exaspèrent ainsi les antagonismes entre les différents Etats capitalistes. À cela il faut ajouter l’influence révolutionnaire exercée par les cartels sur la concentration de la production, son perfectionnement technique, etc.
Ainsi, quant à l’action exercée sur l’économie capitaliste, les cartels et les trusts n’apparaissent pas comme un "facteur d’adaptation" propre à en atténuer les contradictions, mais bien plutôt comme l’un des moyens qu’elle invente elle-même pour aggraver sa propre anarchie, développer ses contradictions internes, accélérer sa propre ruine." (idem)
Ces prévisions, surtout quand l'organisation du capital est passée de la phase des cartels à celle des "trusts d'Etat national" qui s'affrontaient pour le contrôle du marché mondial en 1914 –allaient se trouver pleinement validées au cours du 20e siècle.
Luxemburg répondit aussi aux arguments de Bernstein selon lesquels le prolétariat n'avait pas besoin de faire la révolution puisqu'il jouissait d'une augmentation de son niveau de vie grâce à son organisation efficace en syndicats et à l'activité de ses représentants au parlement. Elle montrait que les activités syndicales comportaient des limites internes, les décrivant comme un "travail de Sisyphe", nécessaire mais constamment limité dans ses efforts d'accroître la part des ouvriers dans les produits de leur travail du fait de l'accroissement inévitable du taux d'exploitation apporté par le développement de la productivité. L'évolution ultérieure du syndicalisme dans la vie du capitalisme allait mettre encore mieux en évidence ses limites historiques, mais même à une époque où l'activité syndicale (ainsi que dans les domaines d'action parallèles du parlement et des coopératives) avait encore une validité pour la classe ouvrière, les révisionnistes altéraient déjà la réalité en défendant l'idée que ces activités pouvaient assurer à la classe ouvrière une amélioration constante et infinie de ses conditions de vie.
Et alors que Bernstein voyait une tendance à l'atténuation des rapports de classe à travers la prolifération d'entreprises à petite échelle et donc la croissance de la classe moyenne, Luxemburg affirmait l'existence de la tendance qui allait devenir prédominante dans le siècle suivant : l'évolution du capitalisme vers des formes de concentration et de centralisation gigantesques, tant au niveau des entreprises "privées" que de l'Etat et des alliances impérialistes. D'autres membres de la gauche révolutionnaire comme Boudin répondaient à l'idée selon laquelle la classe ouvrière allait devenir une classe moyenne en défendant que beaucoup de "cols blancs" et de techniciens qui étaient supposés engloutir le prolétariat étaient eux-mêmes, en réalité, un produit du processus de prolétarisation – là encore une tendance qui allait être très marquées au cours des dernières décennies. Les paroles de Boudin en 1907 retentissent de façon très moderne de même que les arguments spécieux qu'elles combattent :
"Une très grande proportion de ce qu'on appelle la nouvelle classe moyenne et qui apparaît comme telle dans les statistiques sur les revenus, constitue en réalité une partie du prolétariat ordinaire, et la nouvelle classe moyenne, quelle qu'elle soit, est bien plus petite que ce qui apparaît dans les tableaux des revenus. Cette confusion provient, d'une part, du vieux préjugé profondément ancré selon lequel Marx aurait attribué uniquement au travail manuel la propriété de créer de la valeur et, d'autre part, de la séparation de la fonction de gérant d'avec celle de propriétaire – effectuée par les corporations, comme on l'a noté auparavant. Dans ces circonstances, de larges parties du prolétariat sont comptées comme faisant partie de la classe moyenne, c'est-à-dire la couche inférieure de la classe capitaliste. C'est le cas pour ces activités, nombreuses et croissantes, dont la rémunération est appelée "salary" au lieu de "wage". Toutes ces personnes salariées, quel que soit leur salaire, qui constituent la majeure partie, et certainement une grande portion, de la "nouvelle" classe moyenne, font tout autant partie du prolétariat que le simple ouvrier journalier." (The Theoretical System of Karl Marx, 1907, traduit de l'anglais par nous)
En route vers la débâcle de la civilisation bourgeoise
La crise économique ouverte d'aujourd'hui a lieu dans un stade très avancé du déclin du capitalisme. Luxemburg répondait à Bernstein dans une période qu'elle caractérisait, avec une remarquable lucidité une fois encore, comme une période qui n'était pas encore celle du déclin mais dont l'approche devenait de plus en plus évidente. Ce passage est écrit en réponse à la question empirique (et empiriste) de Bernstein : pourquoi n'avons-nous pas assisté à l'ancien cycle décennal depuis le début des années 1870 ? Luxemburg insiste dans sa réponse sur le fait que ce cycle est en réalité l'expression de la phase de jeunesse du capitalisme ; maintenant le marché mondial se trouvait dans une "période de transition" entre sa période de croissance maximum et l'ouverture d'une époque de déclin :
"Le marché mondial se développe toujours. L'Allemagne et l'Autriche ne sont entrées dans la phase de véritable production industrielle à grande échelle que dans les années 1870 ; la Russie seulement dans les années 1880 ; la France est encore en grande partie à un stade de petite production ; les Etats balkaniques, pour la plus grande partie, ne se sont pas encore débarrassés des chaînes de l'économie naturelle ; et ce n'est que dans les années 1880 que l'Amérique, l'Australie et l'Afrique sont entrés dans un commerce étendu et régulier de biens avec l'Europe. Aussi, d'une part, nous avons maintenant derrière nous une ouverture soudaine et vaste de nouvelles aires d'économie capitaliste comme c'est arrivé périodiquement jusqu'aux années 1870 ; et nous avons derrière nous, pour ainsi dire, des crises de jeunesse qui ont suivi ces développements périodiques. D'autre part, nous ne sommes pas encore arrivés au degré de développement et d'épuisement du marché mondial qui produira la collision périodique, fatale entre les forces productives et les limites du marché, qui constitue la véritable crise de vieillesse du capitalisme. Nous sommes dans une phase où les crises n'accompagnent plus la montée du capitalisme et pas encore son déclin." (chapitre 2, traduit de l'anglais par nous)
Il est intéressant de noter que dans la deuxième édition de sa brochure, publiée en 1908, Luxemburg a omis ce passage et le paragraphe suivant, et mentionne la crise de 1907-1908, qui avait précisément pour centre les nations industrielles les plus puissantes : évidemment, pour Luxemburg, "la période de transition" touchait déjà à sa fin.
De plus elle fait aussi allusion au fait que l'attente précédente d'une nouvelle période qui s'ouvrirait pas "une grande crise commerciale" pourrait s'avérer une erreur – déjà dans Réforme sociale ou Révolution, elle souligne la croissance du militarisme, une évolution qui allait la préoccuper de plus en plus. C'est sûrement la possibilité que l'ouverture de la nouvelle période soit marquée par la guerre et non par une crise économique ouverte qui se trouve probablement derrière l'observation suivante :
"Dans la thèse socialiste affirmant que le point de départ de la révolution socialiste serait une crise générale et catastrophique, il faut à notre avis distinguer deux choses : l’idée fondamentale qu’elle contient et sa forme extérieure.
L’idée est celle-ci : on suppose que le régime capitaliste fera naître de lui-même, à partir de ses propres contradictions internes, le moment où son équilibre sera rompu et où il deviendra proprement impossible. Que l’on ait imaginé ce moment sous la forme d’une crise commerciale générale et catastrophique, on avait de bonnes raisons de le faire, mais c’est finalement un détail accessoire pour l’idée fondamentale elle-même." (Ch.1)
Mais quelle que soit la forme prise par "la crise de sénilité" du capitalisme, Rosa Luxemburg insistait sur le fait que sans cette vision de la chute catastrophique du capitalisme, le socialisme devenait une simple utopie :
"Pour le socialisme scientifique la nécessité historique de la révolution socialiste est surtout démontrée par l’anarchie croissante du système capitaliste qui enferme celui-ci dans une impasse. Mais si l’on admet l’hypothèse de Bernstein : l’évolution du capitalisme ne s’oriente pas dans le sens de l’effondrement - alors le socialisme cesse d’être une nécessité objective. (...) La théorie révisionniste est confrontée à une alternative : ou bien la transformation socialiste de la société est la conséquence, comme auparavant, des contradictions internes du système capitaliste, et alors l’évolution du système inclut aussi le développement de ses contradictions, aboutissant nécessairement un jour ou l’autre à un effondrement sous une forme ou sous une autre ; en ce cas, même les "facteurs d’adaptation" sont inefficaces, et la théorie de la catastrophe est juste. Ou bien les " facteurs d’adaptation " sont capables de prévenir réellement l’effondrement du système capitaliste et d’en assurer la survie, donc d’abolir ces contradictions, en ce cas, le socialisme cesse d’être une nécessité historique ; il est alors tout ce que l’on veut sauf le résultat du développement matériel de la société. Ce dilemme en engendre un autre : ou bien le révisionnisme a raison quant au sens de l’évolution du capitalisme - en ce cas la transformation socialiste de la société est une utopie ; ou bien le socialisme n’est pas une utopie, et en ce cas la théorie des " facteurs d’adaptation" ne tient pas. That is the question : c’est là toute la question." (idem)
Dans ce passage, Luxemburg fait ressortir avec totale clarté le rapport intime entre le point de vue révisionniste et le rejet de la vision marxiste du déclin du capitalisme et, inversement, la nécessité de cette théorie comme pierre de touche d'une conception cohérente de la révolution.
Dans le prochain article de cette série nous examinerons comment Luxemburg et d'autres ont cherché à situer les origines de la crise qui s'approchait dans le processus sous-jacent de l'accumulation capitaliste.
Gerrard
1 Voir par exemple l'article : "1895-1905 : la perspective révolutionnaire obscurcie par les illusions parlementaires [70]", Revue internationale n°88
2 Aufheben n° 2 et 3 https://libcom.org/article/aufheben [71]
3 Edition française Les bons caractères, 2004.
4 https://www.marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm [72]
5 https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/00/18910000.htm [73]
6 https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1898/r_ou_r1_1.html [74]
Questions théoriques:
- Décadence [75]
Rubrique:
La surproduction chronique, une entrave incontournable à l’accumulation capitaliste (débat interne au CCI (V))
- 5444 lectures
La dette mondiale atteint des sommets faramineux ne permettant plus comme avant de "relancer l’économie", au moyen d’un nouvel accroissement de l'endettement, sans mettre à mal la crédibilité financière des Etats et la valeur des monnaies. Face à cette situation, il est de la responsabilité des révolutionnaires d'analyser en profondeur les moyens par lesquels le capitalisme est parvenu jusqu'à présent à prolonger artificiellement la vie de son système à travers tout un ensemble de "tricheries" vis-à-vis de ses propres lois. C'est la seule méthode fournissant la clé d'une évaluation pertinente de l'impasse à laquelle se trouve actuellement confrontée la bourgeoisie mondiale.
L'étude de la période dite des Trente Glorieuses, tant louée et regrettée par la bourgeoisie, ne doit pas faire exception à cette attention de la part des révolutionnaires à qui il revient, bien sûr, de prendre en charge la nécessaire réfutation des interprétations qu’en donnent les défenseurs du capitalisme, en particulier lorsqu’ils veulent nous convaincre qu’il peut être réformé 1, mais également de participer à la confrontation fraternelle des différentes points de vue existant sur ce sujet au sein du camp prolétarien. C'est l'objet du débat que notre organisation a ouvert il y a maintenant bientôt deux ans dans les colonnes de la Revue internationale 2.
La vision développée par notre brochure La décadence du capitalisme selon laquelle les destructions opérées durant la Seconde Guerre mondiale auraient été, à travers le marché de la reconstruction, à l'origine du boom des années 1950 et 1960, a fait l’objet d'une critique dans le CCI, notamment de la part de la thèse que nous défendons dite des marchés extra-capitalistes et de l'endettement. Comme son nom l'indique, cette thèse considère que c'est la vente aux marchés extra-capitalistes et la vente à crédit qui ont été, durant les années 1950 et 1960, le moteur de l'accumulation capitaliste et non pas les mesures keynésiennes, comme le soutien une autre thèse dite du keynésiano-fordisme 3. Dans la Revue internationale n° 138 est parue une contribution signée Salome et Ferdinand défendant ce dernier point de vue et qui, en avançant un ensemble d'arguments non encore discutés publiquement, est venue ainsi relancer le débat. Tout en répondant aux arguments de ces deux camarades, cet article se fixe les objectifs suivants : rappeler les fondements de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement ; présenter des éléments statistiques qui, selon nous, illustrent sa validité ; examiner ses implications sur le cadre global d’analyse du CCI de la période de décadence du capitalisme 4.
Les principaux arguments théoriques en présence
L'analyse défendue dans la Décadence du capitalisme prêtait une certaine rationalité économique à la guerre (la guerre vue comme ayant des retombées économiques positives). En ce sens, elle était contradictoire avec de textes plus anciens de notre organisation qui mettaient quant à eux en évidence que "toutes ces guerres, comme les deux guerres mondiales (…), contrairement à celles du siècle dernier, (…) n'ont permis un quelconque progrès dans le développement des forces productives, mais n'ont eu d'autre résultat que des destructions massives laissant complètement exsangues les pays où elles se sont déroulées (sans compter les horribles massacres qu'elles ont provoqués)." 5
L’erreur de notre brochure résulte, selon nous, d’une application hâtive et erronée du passage suivant du Manifeste communiste : "Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens." En effet, le sens de ces lignes n'est pas d’attribuer à la destruction des moyens de production la vertu d’ouvrir un nouveau marché solvable à même de relancer la machine économique. En conformité avec l’ensemble des écrits économiques de Marx, il convient d’interpréter les effets de la destruction de capital (ou plutôt de la dévalorisation de celui-ci) comme participant à désengorger le marché et à freiner la tendance à la baisse du taux de profit 6.
La thèse dite du Capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste offre une interprétation de la "prospérité" des années 1950 et 1960 différente à la fois de celle défendue par la Décadence du capitalisme et de celle défendue par la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement : "L’accroissement assuré des profits, des dépenses de l’État et l’augmentation des salaires réels, ont pu garantir la demande finale si indispensable au succès du bouclage de l’accumulation capitaliste" 7. Face à cette idée, les deux arguments suivants ont déjà été avancés :
a) Augmenter les salaires au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail constitue purement et simplement, du point de vue capitaliste, un gaspillage de plus-value qui n'est en aucune manière capable de participer au processus de l'accumulation. De plus, s'il est vrai que l’augmentation de la consommation ouvrière (au moyen d'augmentations de salaires) et des dépenses de l'État permettent d'écouler une production accrue, cela a pour conséquence une stérilisation de la richesse produite qui ne trouve pas à s'employer utilement pour valoriser le capital.8
b) Parmi les ventes effectuées par le capitalisme, la partie qui peut être dédiée à l'accumulation du capital, et qui participe ainsi à l'enrichissement réel de celui-ci, correspond aux ventes réalisées dans le commerce avec des marchés extra-capitalistes (intérieurs ou externes). C'est effectivement le seul moyen permettant au capitalisme de ne pas se trouver dans cette situation décrite par Marx où "des capitalistes s'échangent entre eux et consomment leur production", ce qui "ne permet en rien une valorisation du capital" 9.
Dans leur article de la Revue internationale n° 138, les camarades Salome et Ferdinand reviennent sur le sujet. A cette occasion, ils précisent, de façon tout à fait appropriée à notre avis, ce qu'ils considèrent être le cadre de ce débat : "Il peut être répondu (…) qu'un tel accroissement du marché est insuffisant pour réaliser toute la partie de la plus-value nécessaire à l'accumulation. Cela est vrai d'un point de vue général et à long terme. Nous, défenseurs de la thèse du capitalisme d'État keynesiano-fordiste, ne pensons pas avoir trouvé une solution aux contradictions inhérentes du capitalisme, une solution qui puisse se répéter à volonté."
Ils illustrent au moyen d’un schéma (basé sur ceux que Marx utilise dans le second volume du Capital, pour présenter le problème de la reproduction élargie) comment l’accumulation peut se poursuivre malgré le fait qu’une partie de la plus-value soit délibérément reversée aux ouvriers sous forme d'augmentations de salaire. De leur point de vue, la même logique sous-jacente explique également le caractère non indispensable d'un marché extra-capitaliste au développement du capitalisme : "Si les conditions sont celles que les schémas présupposent et si nous en acceptons les conséquences (conditions et conséquences qui peuvent être analysées séparément), par exemple un gouvernement qui contrôle toute l'économie peut théoriquement l'organiser de telle sorte que l'accumulation fonctionne selon le schéma ."
Pour les camarades, le bilan pour le capitalisme de cette redistribution de plus-value, bien qu’elle ralentisse l'accumulation, est néanmoins positif, en permettant un élargissement du marché intérieur : "Si ce profit est suffisamment élevé, les capitalistes peuvent augmenter les salaires sans perdre tout l'accroissement de la plus-value extraite" (…) "Une augmentation générale des salaires signifie également un accroissement de ces marchés" (…) "Le seul effet "nuisible" de ce "gaspillage de plus-value" réside dans le fait que l'augmentation de la composition organique du capital est plus lente que le rythme frénétique qu'elle aurait sinon".
Nous sommes d’accord avec le constat que font les camarades concernant les effets de ce "gaspillage de plus-value". Mais, à propos de celui-ci, ils disent également : "on ne peut pas affirmer que ce "gaspillage de plus-value" ne prenne en aucune manière part au processus d'accumulation. Au contraire, cette distribution des profits obtenus par l'augmentation de la productivité participe pleinement de l'accumulation". Il est clair, comme les camarades le reconnaissent eux-mêmes, que le gaspillage en question ne participe pas au processus de l’accumulation à travers l’injection de capital dans le procès de production. En effet, il détourne, de sa finalité capitaliste que représente l’accumulation, du capital pouvant être accumulé. Qu’il ait une utilité momentanée pour la bourgeoisie, sans aucun doute, puisqu’il permet de maintenir artificiellement, voire d’augmenter, un certain niveau d’activité économique. Il diffère ainsi dans le temps les problèmes d’insuffisance de débouchés pour la production capitaliste. C’est bien là le propre des mesures keynésiennes mais, encore une fois, cela n’est pas participer au processus d’accumulation. C’est participer au processus productif dans les conditions de la décadence du capitalisme où ce système, de plus en plus entravé dans son fonctionnement "normal", doit multiplier les dépenses improductives pour maintenir l'activité économique. En effet, ce gaspillage s’ajoute à celui déjà énorme constitué par les dépenses militaires ou d’encadrement de la société, etc. Motivé par la nécessité de créer un marché intérieur artificiel, il est une dépense tout aussi irrationnelle et improductive que ces dépenses là.
Si les mesures keynésiennes ont favorisé la croissance très importante des PIB (Produits Intérieurs Bruts) des principaux pays industrialisés dans les années 1950-60, donnant ainsi l'illusion d'un retour durable à la prospérité de la phase d'ascendance du capitalisme, la richesse réellement créée durant cette période s’est accrue à un rythme nécessairement beaucoup plus modeste puisqu’une partie significative de l’accroissement du PIB était faite de dépenses improductives 10.
Pour en terminer avec cette partie, nous examinerons une autre implication du raisonnement des camarades qui permettrait que, "À ce niveau, il n'y a aucune nécessité de marchés extra-capitalistes". Contrairement à ce que les camarades annoncent, nous n'avons pas trouvé le moindre argument nouveau qui mette en question la nécessité d’un acheteur extérieur aux relations de production capitalistes. Le schéma qu’ils proposent met effectivement en évidence que "un gouvernement qui contrôle toute l'économie peut théoriquement l'organiser" de telle sorte que soit réalisé l’élargissement de la production (par l’augmentation tant des moyens de production que celle des moyens de consommation), sans recourir à un acheteur extérieur et en versant aux ouvriers plus que ce qui est nécessaire au coût social de la reproduction de leur force de travail. Très bien, mais ceci ne représente pas l’accumulation élargie telle qu'elle est pratiquée sous le capitalisme. Plus précisément, l’accumulation élargie ne pourrait pas être pratiquée de la sorte sous le capitalisme quel que soit le niveau de contrôle de l’Etat sur la société, et cela qu’un sursalaire soit versé ou non aux ouvriers.
L’explication que donne Rosa Luxemburg de cette impossibilité lorsqu’elle décrit la boucle sans fin des schémas de l’accumulation élargie (élaborés par Marx dans le livre II du Capital) se réfère aux conditions concrètes de la production capitaliste : "D'après le schéma de Marx, le mouvement [de l'accumulation] part de la section I, de la production des moyens de production. Qui a besoin de ces moyens de production accrus ? A cela, le schéma répond : c'est la section II qui en a besoin, pour pouvoir fabriquer plus de moyens de consommation. Mais qui a besoin de ces moyens de consommation accrus ? Le schéma répond : précisément la section I, parce qu'elle occupe maintenant plus d'ouvriers. Nous tournons manifestement dans un cercle. Produire plus de moyens de consommation, pour pouvoir entretenir plus d'ouvriers, et produire plus de moyens de production, pour pouvoir occuper ce surplus d'ouvriers, est du point de vue capitaliste une absurdité" (L'accumulation du Capital ; paragraphe Analyse du schéma de la reproduction élargie de Marx);
Il est, à ce stade de la réflexion, tout à fait opportun d'examiner une remarque des camarades : "S'il n'y avait pas de crédit et s'il était nécessaire de réaliser en argent toute la production annuelle d’un seul coup sur le marché, alors, oui, il devrait exister un acheteur externe à la production capitaliste. Mais ce n'est pas le cas." Nous sommes d’accord avec les camarades pour dire qu’il n'est pas nécessaire qu'à chaque cycle de la production intervienne un acheteur externe, d’autant plus qu'il existe le crédit. Ceci dit, cela n'élimine pas le problème mais ne fait simplement que l'étaler et le différer dans le temps, en permettant qu'il se pose moins souvent mais à chaque fois de façon plus importante 11. Dés lors qu’un acheteur extérieur est présent au bout, par exemple, de 10 cycles d'accumulation ayant impliqué la coopération des secteurs I et II, et qu'il achète alors autant de moyens de production ou de consommation qu'il en est nécessaire pour rembourser les dettes contractées au cours de ces 10 cycles d'accumulation, alors tout va bien pour le capitalisme. Mais s’il n’y a pas au bout du compte un acheteur extérieur, les dettes accumulées ne peuvent jamais être remboursées ou alors seulement au moyen de nouveaux emprunts. La dette enfle alors inévitablement et démesurément jusqu’à l’éclatement d’une crise qui n'a pour effet que d'impulser un nouvel endettement. C’est exactement ce processus que nous voyons se répéter sous nos yeux, de façon de plus en plus grave, depuis la fin des années 1960.
Redistribuer une partie de la plus-value extraite sous forme d’augmentations de salaire ne revient, en fin de compte, qu'à augmenter le coût de la force de travail. Mais cela n’élimine en rien le problème de "la boucle sans fin" mise en évidence par Rosa Luxemburg. Dans un monde constitué uniquement de capitalistes et d'ouvriers, il n’existe pas de réponse à la question que Marx ne cesse de se poser dans le Capital (Livre II) "mais d'où vient l'argent nécessaire au financement de l’augmentation tant des moyens de production que de consommation" ? Dans un autre passage de L'accumulation du Capital Rosa Luxemburg reprend à con compte cette problématique en l’explicitant très simplement : "Une partie de la plus-value, la classe capitaliste la consomme elle-même sous forme de moyens de consommation et conserve dans sa poche l'argent échangé contre eux. Mais qui lui achète les produits où est incorporée l'autre partie, la partie capitalisée, de la plus-value ? Le schéma répond : en partie les capitalistes eux-mêmes, en fabriquant de nouveaux moyens de production, au moyen de l'élargissement de la production ; en partie de nouveaux ouvriers, qui sont nécessaires pour utiliser ces nouveaux moyens de production. Mais pour pouvoir faire travailler de nouveaux ouvriers avec de nouveaux moyens de production, il faut - du point de vue capitaliste - avoir auparavant un but pour l'élargissement de la production, une nouvelle demande de produits à fabriquer (…) D'où vient l'argent pour la réalisation de la plus-value dans les conditions de l'accumulation, c'est-à-dire de la non consommation, de la capitalisation d'une partie de la plus-value ?" (Paragraphe Analyse du schéma de la reproduction élargie de Marx) En fait, Marx lui-même fournira une réponse à cette question en désignant les "marchés étrangers" 12.
Faire intervenir un acheteur extérieur aux relations de production capitalistes résout, selon Rosa Luxemburg, le problème de la possibilité de l’accumulation. Cela résout également cette autre contradiction des schémas de Marx résultant du rythme différent de l'évolution de la composition organique du Capital dans les deux sections (celle des moyens de production et celle des moyens de consommation) 13. Les deux camarades reviennent dans leur texte sur cette contradiction mise en évidence par Rosa Luxemburg : "cette distribution des profits obtenus par l'augmentation de la productivité" (…) "atténue précisément le problème identifié par R. Luxemburg dans le chapitre 25 de L’accumulation du capital, où elle fait valoir fermement qu'avec la tendance vers une composition organique du capital toujours plus grande, un échange entre les deux secteurs principaux de la production capitaliste (production de moyens de production d'une part, de moyens de consommation de l'autre) est impossible à long terme". A ce propos les camarades font le commentaire suivant : "F. Sternberg considère ce point de réflexion de R. Luxemburg comme le plus important de "tous ceux qui ont soigneusement été évités par ceux qui critiquent Rosa Luxemburg" (Fritz Sternberg, El imperialismo ; Siglo XXI editores, p 70)." Sur ce point également nous ne partageons pas la position des camarades ni celle de Sternberg, laquelle ne correspond pas réellement à la manière dont Rosa Luxemburg a posé le problème.
En effet, pour Rosa Luxemburg elle-même, cette "contradiction" se résout dans la société par le placement d' "une portion toujours plus grande de la plus-value accumulable dans la section des moyens de production au lieu de la section des moyens de consommation. Comme les deux sections de la production ne sont que deux branches de la même production sociale totale ou si l'on veut deux succursales appartenant au même "capitaliste total", on ne peut rien objecter à l'hypothèse d'un transfert constant d'une partie de la plus-value accumulée d'une section à l'autre, selon les besoins techniques ; cette hypothèse correspond en fait à la pratique courante du capital. Cependant cette supposition n'est valable que tant que nous envisageons la plus-value capitalisable en termes de valeur." (L'accumulation du capital ; chapitre Les contradictions du schéma de la reproduction élargie - souligné par nous). Cette dernière supposition impliquant l'existence "d’acheteurs extérieurs" intervenant régulièrement dans la succession des cycles d'accumulation.
En fait, si une telle "contradiction" présente le risque d'aboutir à l’impossibilité de l’échange entre les deux sections de la production, c’est essentiellement dans le monde abstrait des schémas de la reproduction élargie dés lors qu’on ne fait pas intervenir un "acheteur extérieur". En effet, "le progrès technique doit se traduire, d'après Marx lui-même, par l'accroissement relatif du capital constant par rapport au capital variable ; par conséquent il y a nécessairement une modification constante dans la répartition de la plus-value capitaliste entre c et v". Or "Les capitalistes du schéma ne sont pas en mesure d'effectuer à leur gré cette modification car la capitalisation dépend a priori de la forme matérielle de leur plus-value [Ndlr : moyens de production ou moyens de consommation]. Puisque d'après l'hypothèse de Marx, l'élargissement de la production ne peut se faire qu'avec les moyens de production et de consommation produits dans le monde capitaliste" (Rosa Luxemburg ; L'accumulation du capital ; chapitre Les contradictions du schéma de la reproduction élargie).
Nous concevons tout à fait que les camarades n'aient jamais été convaincus par les démonstrations de Rosa Luxemburg quant à la nécessité d'un acheteur extérieur pour permettre l'accumulation capitaliste (ou, à défaut, d’un recours au crédit mais qui sera alors "non remboursable"). Par contre, nous n'avons pas identifié en quoi les objections qu'ils formulent en s'appuyant notamment sur Sternberg, dont nous avons de bonnes raisons de penser qu'il n'avait pas réellement assimilé le fond de la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg 14, sont à même de remettre en cause des positions cardinales de cette théorie.
Comme nous l’avons déjà souligné dans des contributions antérieures, le fait que les sursalaires versés aux ouvriers ne servent à augmenter ni le capital constant ni le capital variable est déjà suffisant pour conclure au gaspillage total (du point de vue de la rationalité capitaliste) que représentent ces dépenses. Du point de vue strictement économique, le même effet aurait été produit par l’augmentation des dépenses personnelles des capitalistes. Mais il n’était pas nécessaire, pour parvenir à cette conclusion, de recourir à Rosa Luxemburg 15. Ceci étant dit, si nous avons jugé nécessaire de répondre aux objections faites par ces camarades à la théorie de l'accumulation du capital défendue par Rosa Luxemburg, c'est par ce que nous estimons que le débat sur cette question contribue à donner une assise plus large et profonde à la compréhension non seulement du phénomène des Trente Glorieuses mais également au problème de la surproduction dont on peut difficilement nier qu'il se trouve au cœur des problèmes actuels du capitalisme.
La part des marchés extra-capitalistes et de l’endettement dans l’accumulation des années 1950 et 1960
Deux facteurs sont à l’origine de l’augmentation des PIB durant cette période :
-
l’augmentation de la richesse réelle de la société à travers le processus d’accumulation du capital ;
-
toute une série de dépenses improductives en augmentation comme conséquence du développement du capitalisme d’Etat et plus particulièrement des politiques keynésiennes alors mises en place.
Nous nous intéressons, dans cette partie, à la manière dont l’accumulation s’est effectuée. C’est l’ouverture et l’exploitation accélérée des marchés extra-capitalistes qui avaient été à l’origine de la phase de très forte expansion du capitalisme débutée au sein de la deuxième moitié du 19e siècle et à laquelle la Guerre de 1914 avait mis un terme. La phase de décadence du capitalisme étant caractérisée globalement par l’insuffisance relative de tels marchés en regard des besoins toujours plus importants d’écoulement des marchandises, doit on en déduire que les marchés extra-capitalistes n’ont plus joué qu’un rôle marginal dans l’accumulation durant cette période de la vie du capitalisme ouverte par la guerre en 1914 ? Si c’est le cas, alors ces marchés ne peuvent pas expliquer, même en partie, l’accumulation réalisée dans les années 1950 et 1960. C’est la réponse que donnent les camarades dans leur contribution : "Pour nous, le mystère des Trente Glorieuses ne peut s’expliquer par des restes de marchés extra-capitalistes, alors que ceux-ci sont insuffisants depuis la Première Guerre mondiale en regard des nécessités de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme". Pour notre part, nous pensons au contraire que les marchés extra-capitalistes ont joué un rôle important dans l’accumulation, en particulier au début des années 1950, lequel a décru ensuite progressivement jusqu’à la fin des années 1960. A mesure qu’ils devenaient insuffisants, c’est l’endettement qui prenait le relais, en jouant le rôle de l’acheteur extérieur au capitalisme, mais évidemment il s’agissait d’un endettement d’une "qualité nouvelle", ayant cette caractéristique de ne plus pouvoir être réduit. En fait, c’est à cette période qu’il faut remonter pour trouver l’origine du phénomène d’explosion de la dette mondiale telle qu’on la connaît aujourd’hui, même si bien évidemment la contribution en valeur des décennies 1950 et 1960 à la dette mondiale actuelle est dérisoire.
Les marchés extra-capitalistes
Statistiquement, c’est en 1953 que culmine la part des exportations des pays développés en direction des pays coloniaux, évaluée en pourcentage des exportations mondiales (voire figure 1, la courbe des importations des pays coloniaux étant supposée la même que celle des exportations des pays développés en direction des pays coloniaux). Le taux de 29% alors atteint donne une indication de l’ordre de grandeur de l’importance des exportations en direction des marchés extra-capitalistes des pays coloniaux puisque, à l’époque, les marchés coloniaux sont encore très majoritairement extra-capitalistes. Par la suite, ce pourcentage diminuera pour se situer à 22% des exportations en 1966. Dans la réalité, la décroissance de ce pourcentage, relativement cette fois aux PIB et non plus aux exportations, est plus rapide encore puisque, durant cette période, les PIB augmentent plus rapidement que les exportations.
Figure 1. Importations des marchés coloniaux en pourcentage des importations mondiales (Schéma repris de BNP Guide statistique 1972 ; Sources : P. Bairoch op. cit. – Communiqué OCDE, novembre 1970)
Aux exportations en direction des marchés extra-capitalistes des colonies, il convient d’ajouter les ventes qui sont effectuées, au sein de pays capitalistes comme la France, le Japon, l’Espagne, etc., à des secteurs qui, comme le secteur agricole, ne sont encore que peu intégrés dans les relations de production capitaliste. De même, en Europe orientale il subsiste encore un marché extra capitaliste, alors que l’issue de la Première Guerre mondiale avait condamné l’expansion capitaliste dans ces pays à la stagnation 16.
Ainsi donc, si l’on considère l’ensemble des ventes effectuées par les régions dominées par des relations de production capitaliste en direction de celles produisant encore selon des relations précapitalistes, qu’il s’agisse des marchés extérieurs ou intérieurs, on s’aperçoit que celles-ci ont pu soutenir une partie importante de la croissance réelle des Trente Glorieuses, tout au moins au début des années 1950. Nous reviendrons dans la dernière partie de cet article sur l'appréciation du niveau de saturation des marché au moment de l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, afin d’en faire une caractérisation plus fine.
L’endettement
Au tout début de notre débat interne, les tenants de la thèse du keynésiano-fordisme opposaient à notre hypothèse accordant un rôle à l’endettement dans les années 1950 et 1960 pour soutenir la demande le fait que "la dette totale n’augmente pratiquement pas pendant la période 1945-1980, ce n’est que comme réponse à la crise qu’elle explose. L’endettement ne peut donc expliquer la vigoureuse croissance d’après-guerre". Toute la question est de savoir ce que recouvre ce "pratiquement pas" et si, malgré tout, cela ne serait pas suffisant pour permettre le bouclage de l’accumulation, en complément des marchés extra-capitalistes.
Il est assez difficile de trouver des données statistiques concernant l'évolution de la dette mondiale durant les années 1950-60 pour la plupart des pays, sauf pour les Etats-Unis.
Nous disposons de l’évolution de la dette totale et du PNB américains, année par année, entre 1950 et 1969. L’étude de ces données (Figure 2) doit nous permettre de répondre à la question suivante : est-il possible que, chaque année, l’accroissement de la dette ait été suffisant pour assumer cette partie de l’augmentation du PIB qui ne correspond pas à des ventes effectuées en direction des marchés extra-capitalistes ? Comme on l’a déjà dit, dès lors que ceux-ci font défaut, c’est à l’endettement qu’il revient de jouer le rôle d’acheteur extérieur aux rapports de production capitalistes 17.
|
Année |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
|
GDP |
257 |
285 |
328 |
346 |
365 |
365 |
398 |
419 |
441 |
447 |
484 |
504 |
520 |
560 |
591 |
632 |
685 |
750 |
794 |
866 |
932 |
|
Dette |
446 |
486 |
519 |
550 |
582 |
606 |
666 |
698 |
728 |
770 |
833 |
874 |
930 |
996 |
1071 |
1152 |
1244 |
1341 |
1435 |
1567 |
1699 |
|
%annuel Dette/GDP |
|
171 |
158 |
159 |
160 |
166 |
167 |
167 |
165 |
172 |
172 |
174 |
179 |
178 |
181 |
182 |
182 |
179 |
181 |
181 |
182 |
|
%sur la période ΔDette /ΔGDP |
185% |
||||||||||||||||||||
|
Δannuel GDP |
|
28 |
44 |
17 |
19 |
0 |
33 |
21 |
22 |
6 |
36 |
20 |
16 |
40 |
30 |
42 |
53 |
65 |
44 |
72 |
67 |
|
Δannuel Dette |
|
40 |
33 |
31 |
31 |
24 |
60 |
33 |
30 |
41 |
63 |
41 |
56 |
66 |
75 |
81 |
93 |
97 |
94 |
132 |
132 |
|
(Δannuel Dette- |
|
12 |
-11 |
14 |
12 |
24 |
27 |
11 |
8 |
35 |
27 |
21 |
40 |
26 |
45 |
39 |
40 |
32 |
50 |
60 |
65 |
Figure 2. Evolution comparée du PIB (GDP) et de la dette aux Etats-Unis entre 1950 et 1960 18
Source (GDP et Dette): Federal Reserve Archival System for Economic research
https://fraser.stlouisfed.org/publications/scb/page/6870 [77]
https://fraser.stlouisfed.org/publications/scb/page/6870/1615/download/6... [78]
|
Année |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
|
%annuel Dette/GDP |
22 |
39 |
47 |
67 |
75 |
Figure 3.Evolution de la dette en RDA entre 1950 et 1970. Sources : Survey of Current Business (07/1975) - Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6)
L’augmentation de la valeur de la dette en pourcentage de l’augmentation de la valeur du PIB est, sur la période concernée, de 185%. En d'autres termes, l'augmentation en valeur de la dette est presque le double, en 20 ans, de l'augmentation du PIB. En fait, ce résultat démontre que l'évolution de l'endettement aux Etats-Unis est tel qu'il aurait largement pu, globalement durant la période considérée, assurer à lui seul la croissance du PIB de ce pays (et même participer à celle de certains autres d'autres pays) sans qu'il ait été nécessaire d'avoir recours à la vente aux marchés extra-capitalistes. Par ailleurs, on observe que chaque année, à l’exception de 1951, l’augmentation de la dette est supérieure à celle du PIB (c’est seulement en 1951 que la différence entre l’augmentation de la dette et l’augmentation du PIB est négative). Ce qui signifie que, pour chacune de ces années sauf une, c’est l’endettement qui aurait pu avoir assumé l’augmentation du PIB, ce qui est plus que nécessaire étant donné la contribution des marchés extra-capitalistes à la même époque.
La conclusion de cette réflexion concernant les Etats-Unis est la suivante : l’analyse théorique selon laquelle le recours au crédit avait pris le relais de la vente aux marchés extra-capitalistes pour permettre l’accumulation n’est pas démentie par la réalité même de l'évolution de l’endettement dans ce pays. Et, si une telle conclusion ne peut pas être généralisée de façon automatique à l'ensemble des pays industrialisés, le fait qu'elle concerne le plus grosse puissance économique mondiale, lui confère une certaine universalité que confirme par ailleurs le cas de la RDA. En effet, concernant ce pays, nous disposons de statistiques relatives à l’évolution de la dette en fonction du GNP (Figure 3) qui illustrent la même tendance.
Quelles implications pour notre analyse de la décadence ?
Quel niveau de saturation des marchés en 1914 ?
La Première Guerre mondiale éclate au faîte de la prospérité de l'économie capitaliste mondiale. Elle n'est précédée d'aucune crise se manifestant ouvertement sur le plan économique mais, néanmoins, c'est bien l'inadéquation croissante entre le développement des forces productives et les rapports de production qui se trouve à l'origine du conflit mondial et, avec lui, de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Le développement de ce système étant conditionné par la conquête de marchés extra-capitalistes, la fin de la conquête coloniale et économique du monde par les métropoles capitalistes conduit celles-ci à s'affronter entre elles pour se disputer leurs marchés respectifs.
Contrairement à l'interprétation des camarades Salome et Ferdinand, une telle situation ne signifie pas que "les marchés extra-capitalistes (…) sont insuffisants depuis la Première Guerre mondiale en regard des nécessités de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme". En effet, si tel avait été le cas, la crise se serait manifestée au niveau purement économique avant 1914.
Ce sont ces caractéristiques de la période (rivalités impérialistes autour des territoires non capitalistes encore libres) que traduit précisément la citation suivante de Rosa Luxemburg : "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe." (L'accumulation du capital - Le protectionnisme et l'accumulation ; souligné par nous). A plusieurs reprise Rosa Luxemburg reviendra sur la description de l'état du monde à cette époque : "A côté des vieux pays capitalistes il existe, même en Europe, des pays où la production paysanne et artisanale domine encore aujourd'hui de loin l'économie, par exemple la Russie, les pays balkaniques, la Scandinavie, l'Espagne. Enfin, à côté de l'Europe capitaliste et de l'Amérique du Nord, il existe d'immenses continents où la production capitaliste ne s'est installée qu'en certains points peu nombreux et isolés, tandis que par ailleurs les territoires de ces continents présentent toutes les structures économiques possibles, depuis le communisme primitif jusqu'à la société féodale, paysanne et artisanale." (La critique des critiques. Souligné par nous)"
En fait, "la guerre mondiale, tout en étant un produit en dernière instance des contradictions économiques du système, a éclaté avant que ces contradictions aient pu se manifester au niveau "purement" économique. La crise de 1929 a donc été la première crise économique mondiale de la période de décadence." (Résolution sur la situation internationale du 16e congrès du CCI)
Si 1929 constitue la première manifestation significative, pendant la décadence, de l'insuffisance des marchés extra-capitalistes, cela signifie-t-il que, après cette date, il n'est pas possible que ces derniers aient joué un rôle significatif dans la prospérité capitaliste ?
Les vastes zones précapitalistes présentes de par le monde en 1914 n'ont pas pu "être asséchées" durant les 10 ans qui ont précédé 1929, période qui n'a pas été marquée par une intense activité économique mondiale. De même, durant les années 1930 et une bonne partie des années 1940, l’économie fonctionne au ralenti. C'est la raison pour laquelle, la crise de 1929, si elle illustre les limites des marchés extra-capitalistes atteintes à cette époque, ne marque pas pour autant la fin de toute possibilité que ceux-ci jouent un rôle significatif dans l’accumulation du capital.
L'exploitation d'un marché extra-capitaliste vierge, ou la meilleure exploitation d'un ancien marché extra-capitaliste, dépend en grande partie de facteurs tels que la productivité du travail dans les métropoles capitalistes dont résulte la compétitivité des marchandises produites ; les moyens de transport dont dispose le capital pour assurer la circulation des marchandises. Ces facteurs ont constitué le moteur de l'expansion du capitalisme à travers le monde, comme le mettait déjà en évidence Le Manifeste communiste 19. De plus, le mouvement de décolonisation a pu, en soulageant les échanges du poids considérable de l'entretien de l'appareil de domination coloniale, favoriser la rentabilité de certains marchés extra-capitalistes.
Le cycle "crise – guerre – reconstruction – nouvelle crise" en question
Le CCI avait très tôt corrigé une interprétation fausse de la réalité selon laquelle la Première Guerre mondiale aurait été la conséquence d’une crise économique ouverte. Comme nous l’avons vu à propos de cette période, la relation de cause à effet "crise – guerre" n’acquiert un sens universel (excluant toutefois le facteur lutte de classe) dés lors seulement que le terme crise est considéré au sens large, en tant que crise des rapports de production.
Quant à la séquence "guerre – reconstruction – nouvelle crise", nous avons également vu qu’elle ne permettait pas de rendre compte de la prospérité des années 1950 et 60 qui, en aucune manière, ne peut être mise sur le compte de la reconstruction consécutive à la Seconde Guerre mondiale. Il en va d’ailleurs de même concernant la reprise consécutive à la Première Guerre mondiale, durant laquelle le capitalisme renoue avec la dynamique antérieure à la guerre, basée sur l’exploitation des marchés extra-capitalistes, mais selon un rythme bien moindre qui porte la marque de l’état de guerre et des destructions occasionnées par celle-ci. Il y a effectivement eu reconstruction mais, loin de favoriser l’accumulation, celle-ci a plutôt signifié des faux frais nécessaires au redémarrage de l’économie.
Et depuis 1967, date à laquelle le capitalisme entre à nouveau dans une période de turbulences économiques, les crises se sont succédées, le capitalisme a ravagé la planète en multipliant les conflits impérialistes sans pour autant créer les conditions d’une reconstruction synonyme de retour même momentané et limité à la prospérité.
Ainsi que le CCI l’a toujours mis en évidence, l’entrée en décadence n’a pas signifié la fin de l’accumulation comme le traduit la poursuite de la croissance après 1914 et jusqu’à nos jours, quoique globalement à un rythme inférieur à celui de la période faste de l’ascendance du capitalisme (la majeure partie de la seconde moitié du 19e siècle jusqu’à 1914). Celle-ci s’est poursuivie sur la base de l’exploitation des marchés extra-capitalistes jusqu’au moment où ils furent totalement épuisés. C’est alors l’endettement non remboursable qui a dû prendre le relais en accumulant également des contradictions de plus en plus insurmontables.
Ainsi donc, et contrairement à ce qu'induit la représentation "crise – guerre – reconstruction – nouvelle crise", le mécanisme destruction / reconstruction n’a pas constitué un moyen permettant à la bourgeoisie de prolonger les jours du capitalisme, pas plus suite à la Première Guerre mondiale que suite à la Seconde. Les instruments privilégiés d'une telle entreprise, le keynésianisme et surtout l'endettement, s’ils ont pu avoir des effets immédiats allant dans le sens de repousser l’échéance des conséquences ultimes de la surproduction, n'ont pas été à coup nuls et encore moins miraculeux. L'abandon des mesures keynésiennes dans les années 1980 et surtout l’impasse actuelle de l’endettement généralisé et abyssal en constituent les preuves éclatantes.
Sílvio
1 Face à la crise, il ne manque pas de voix "à gauche" (et même aujourd’hui dans une grande partie de la droite) pour préconiser un retour aux mesures keynésienne comme l’illustre le passage suivant extrait d’un document de travail de Jacques Gouverneur, enseignant à l’Université Catholique de Louvin (Belgique). Comme le lecteur pourra s’en apercevoir, la solution qu’il préconise repose sur la mise à profit de l’augmentation de la productivité pour mettre en place de mesures keynésiennes et des politiques alternatives, … du type de celles qui, face à l’aggravation de la situation économique, ont été mises en avant par la gauche du capital depuis la fin des années 1960 afin de mystifier la classe ouvrière quant à la possibilité de réformer ce système : "Pour sortir de la crise et résoudre le problème du chômage, faut-il réduire – ou faudrait-il au contraire augmenter – les salaires, les prestations de sécurité sociale (allocations de chômage, pensions, remboursements de soins de santé, allocations familiales), les dépenses publiques (enseignement, culture, travaux publics, …) ? En d’autres termes : faut-il continuer à mettre en œuvre des politiques restrictives d’inspiration néolibérale (comme on le fait depuis le début des années 1980) ou faut-il au contraire préconiser un retour à des politiques expansives d’inspiration keynésienne (appliquées pendant la période de croissance 1945-1975) ? (…) En d’autres termes : les entreprises peuvent-elles augmenter simultanément leurs profits et leurs débouchés ? Il faut pour cela que deux conditions soient remplies. La première condition consiste en une augmentation de la productivité générale, en ce sens qu’avec un même nombre de travailleurs (ou d’habitants), l’économie produit un volume plus grand de biens et services. De manière imagée, une augmentation de la productivité sur une période donnée (…) élargit la taille du "gâteau" produit, augmente le nombre de "parts de gâteau" à répartir Dans une période où la productivité augmente, la mise en œuvre de politiques keynésiennes constitue la deuxième condition pour que les entreprises disposent simultanément de profits plus élevés et de débouchés élargis. (…) La perpétuation des politiques néolibérales multiplie les drames sociaux et débouche sur une contradiction économique majeure : elle accentue le divorce entre la croissance des profits globaux et celle des débouchés globaux. Mais elle favorise les entreprises et les groupes dominants : ceux-ci continuent donc à exercer une pression efficace sur les pouvoirs publics (nationaux et supranationaux) en vue de prolonger ces politiques globalement néfastes. Le retour à des politiques keynésiennes supposerait un changement dans le rapport de forces actuellement en vigueur ; il ne suffirait cependant pas pour résoudre les problèmes économiques et sociaux mis en évidence par la crise structurelle du système capitaliste. La solution à ces problèmes passe par la mise en œuvre de politiques alternatives : augmentation des prélèvements publics (essentiellement sur les profits) pour financer des productions socialement utiles, réductions du temps de travail pour développer l’emploi et le temps libre, glissement dans la composition des salaires pour promouvoir la solidarité." www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/FR_JG_Quelles_politiques_ [79]économiques_contre_la_crise_et_le_chômage_1.pdf (souligné par nous).
2 La présentation du débat ainsi que celle des trois principales positions en présence a été effectuée au sein de l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale, dans la Revue internationale n° 133. Par la suite ont été publiés successivement les articles suivants : Origine, dynamique, et limites du capitalisme d’Etat keynésiano-fordiste (Revue internationale n° 135) ; Les bases de l'accumulation capitaliste et Économie de guerre et capitalisme d’État (Revue internationale n° 136) ; En défense de la thèse ‘Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste’ (Revue internationale n° 138).
3 En défense de la thèse Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste (Réponse à Silvio et à Jens), Revue internationale n° 138.
4 Si la présente contribution ne revient pas sur des réponses de Salome et Ferdinand à la thèse L’économie de guerre et le capitalisme d’Etat, c'est parce que nous avons estimé moins prioritaire (même si nécessaire) la discussion des questions soulevées par cette dernière thèse et sur lesquelles nous aurons l'occasion de nous pencher. En effet, celles-ci ne sont pas déterminées d'abord et avant tout par une conception particulière des ressorts de l'accumulation mais plutôt par les conditions géopolitiques qui influent sur sa réalisation.
5 Cité dans l’article d’ouverture du débat dans le Revue internationale n° 133 : extrait du Rapport sur le Cours historique adopté au 3e congrès du CCI, citant lui-même le Rapport adopté à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France et provenant de l'article Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme publié en 1988, dans la Revue internationale n° 52.
6 Lire à ce sujet l’article de la série La décadence du capitalisme, Les contradictions mortelles de la société bourgeoise (Revue internationale n° 139).
7 Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste (Revue Internationale n° 135)
8 Voir l’article Les bases de l’accumulation capitaliste (Revue internationale n° 136)
9 Voir la thèse Les marchés extra-capitalistes et l’endettement dans l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (Revue internationale n° 133). La référence à l'œuvre de Marx est la suivante : Le capital, Livre III, section III : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, Chapitre X : Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation.
10 Voir sur cette question la présentation de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l’endettement dans l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (Revue internationale n° 133)
11 Il est indéniable que le crédit joue un rôle régulateur et permet d’atténuer l'exigence de marchés extra-capitalistes à chaque cycle tout en la maintenant de façon globale. Mais cela ne change rien au problème de fond qui peut se ramener, comme le fait Rosa Luxemburg, à l'étude d'un cycle abstrait qui est la résultante des cycles élémentaires des divers capitaux : "Un élément de la reproduction élargie du capital social est, tout comme pour la reproduction simple que nous avons supposée plus haut, la reproduction du capital individuel. Car la production, qu'elle soit simple ou élargie, ne se poursuit en fait que sous la forme d'innombrables mouvements de reproduction indépendants de capitaux individuels" (L’accumulation du capital ; souligné par nous). De même, il est évident que seulement certains de ces cycles sont amenés à faire intervenir l’acheteur extérieur.
12 Cette réponse se trouve (entre autres) dans le livre III du capital "Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables ? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation" (Section III : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, Chapitre X : Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation)
13 L'élévation de la composition organique (c'est-à-dire la croissance plus rapide du capital constant par rapport au capital variable) dans la section des moyens de production est en moyenne plus rapide que dans celle des moyens de consommation, du fait des caractéristiques techniques propres à l’une et à l’autre de ces deux sections.
14 Malgré les excellentes illustrations et interprétations du développement du capitalisme mondial qu'il a réalisées, en s'appuyant sur la théorie de Rosa Luxemburg, en particulier dans Le conflit du siècle, on peut néanmoins s'interroger sur son assimilation en profondeur de cette théorie. En effet, Sternberg analyse dans ce même ouvrage la crise des années 1930 comme ayant résulté de l'incapacité du capitalisme a avoir su, à cette époque, synchroniser l'augmentation de la production avec celle de la consommation : "Le test qui consistait à synchroniser, sur la base de l'économie de profit capitaliste et sans expansion extérieure majeure, d'une part l'accroissement de la production et de la productivité, et, d'autre part, l'augmentation de la consommation, se solda donc par un échec. La crise fut le résultat de cet échec" (p 344). Laisser entendre qu'une telle synchronisation est possible sous le capitalisme, est le début de l’abandon de la rigueur et de la cohérence de la théorie de Rosa Luxemburg. C’est d’ailleurs ce que confirme l’étude la période post-Seconde Guerre mondiale faite par Sternberg où celui-ci développe sa conception selon laquelle il existe la possibilité d'une transformation de la société notamment à travers les nationalisations prises en charge par l'Etat et l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. La citation suivante en donne un aperçu : " …, la réalisation intégrale du programme travailliste de 1945 aurait constitué un grand pas vers la socialisation complète de l'économie anglaise, palier à partir duquel d'autres étapes sur la même voie auraient sans doute été franchies plus aisément (…) Au cours des premières années d'après-guerre, le gouvernement travailliste s'employa à exécuter le mandat que le peuple lui avait ainsi confié. S'en tenant strictement aux moyens et méthodes de la démocratie traditionnelle, il fit subir des modifications radicales à l'Etat, à la société et à l'économie capitalistes." (Chapitre Le monde d'aujourd'hui ; p 629). Le but n'est pas ici de faire la critique radicale du réformisme de Sternberg. Il s'agit seulement de mettre en évidence en quoi sa démarche réformiste incluait nécessairement une sous-estimation considérable des contradictions économiques qui assaillent la société capitaliste, sous-estimation peu compatible avec la théorie de Rosa Luxemburg telle qu'elle est exposée dans L'accumulation du Capital.
15 Comme l’illustre cette partie de notre critique effectuée dans Les bases de l'accumulation du capital (Revue internationale n° 136) qui s’appuie sur les écrits de Paul Mattick. En effet, pour ce dernier, contrairement à Rosa Luxemburg, il n’est pas nécessaire de faire intervenir un acheteur extérieur aux relations de production capitaliste pour que l’accumulation soit possible.
16 Fritz Sternberg, Le conflit du Siècle. III - La stagnation du capitalisme ; l'arrêt de l'expansion capitaliste ; l'arrêt de l'expansion extérieure du capitalisme ; p. 254.
17 Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la fonction de l’endettement n’est pas limitée à la création d’un marché artificiel.
18 %annuel Dette/GDP = (Dette/GDP)*100 ; %sur la période ΔDette/ΔGDP = ((Dette en 1969 - Dette en 1949) / (GDP en 1969 - GDP en 1949))*100 ; Δ annuel GDP = GDP en (n) - GDP en (n-1) ; Δ annuel Dette de l’année (n) = Dette l’année n - Dette de l’année (n-1) ;
19 "Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers." (souligné par nous).
Questions théoriques:
- L'économie [80]
L'Union Libre des Syndicats Allemands en marche vers le syndicalisme révolutionnaire
- 2918 lectures
Dans la première partie de cet article 1, nous avons rendu compte de la controverse au sein du mouvement syndical allemand et du SPD qui a mené à la création de l'Union Libre des Syndicats Allemands (Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, FVDG), l’organisation qui sera le précurseur du syndicalisme révolutionnaire allemand. Cet aperçu embrassait une période allant des années 1870 à1903. La FVDG, fondée en 1897, se présentait alors explicitement, et ce jusqu’en 1903, comme une partie combative du mouvement syndical social-démocrate. Elle n’avait aucun lien avec le syndicalisme révolutionnaire ou l’anarchisme, qui étaient très présents dans d’autres pays comme la France ou l’Espagne. La FVDG a défendu de façon très conséquente, au niveau théorique, la nécessité que les ouvriers organisés au sein des syndicats s’occupent non seulement des questions économiques mais également des questions politiques.
En raison du contexte d’éparpillement lors de sa naissance sous les lois antisocialistes et des démêlés avec la Confédération générale syndicale, la FVDG n’est toutefois pas parvenue à développer en son sein une coordination suffisante pour mener la lutte collective. L’organisation clairement syndicaliste révolutionnaire qui existe déjà dans les IWW aux États-Unis est, sur la question de la centralisation de l’activité, très en avance sur la FVDG. Le penchant permanent à la dispersion fédéraliste, même si celle-ci n’est pas encore théorisée au sein de la FVDG, demeure une faiblesse constante de cette organisation. Face à la grève de masse qui s’annonce, la répugnance envers la centralisation du combat va constituer de plus en plus clairement une entrave à l'activité politique de la FVDG.
La discussion autour des nouvelles formes de lutte apparues avec la grève de masse de la classe ouvrière au début du 20e siècle constitue pour la FVDG un grand défi et a pour conséquence que cette dernière commence à évoluer vers le syndicalisme révolutionnaire. Une évolution qui ne fait que se renforcer jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale, comme nous allons l'illustrer dans cet article.
La grève de masse repousse dans l’ombre le vieil esprit syndicaliste1
Au niveau international, le tournant du 20e siècle voit de plus de plus se faire jour les prémisses de la grève de masse en tant que nouvelle forme de la lutte de classe. Par sa dynamique tendant spontanément à l’extension, propice au dépassement du cadre de la branche professionnelle, et par sa prise en compte de revendications politiques, la grève de masse se différencie des anciens schémas des combats de classe syndicaux du 19e siècle, entièrement organisés par les appareils syndicaux, limités à la corporation et à des revendications économiques. Dans les grèves de masse qui éclosent partout dans le monde se manifeste aussi une vitalité de la classe ouvrière qui tend à rendre caduques les grèves longuement préparées et complètement dépendantes de l’état des caisses de grèves syndicales.
Déjà en 1891avait eu lieu en Belgique une grève de 125 000 ouvriers puis en 1893 une autre de 250 000 travailleurs. En 1896 et 1897 se produisit la grève générale des ouvriers du textile de Saint-Pétersbourg en Russie. En 1900 ce fut le tour des mineurs de l’État américain de Pennsylvanie puis, en 1902 et 1903, de ceux d’Autriche et de France. En 1902 une nouvelle grève de masse eut lieu en Belgique pour le suffrage universel et, en 1903, ce fut le tour des cheminots aux Pays-Bas. En septembre 1904 eut lieu un mouvement national de grève en Italie. En 1903 et 1904 de grandes grèves ébranlèrent tout le Sud de la Russie.
L’Allemagne, malgré ses puissants syndicats forts de leurs traditions et sa classe ouvrière concentrée et organisée, n’a pas été à ce moment là l’épicentre de ces nouveaux épisodes de lutte de classes qui s’étendaient tels de violents raz-de-marée. La question de la grève de masse en fut d’autant plus passionnément discutée dans les rangs de la classe ouvrière en Allemagne. Le vieux schéma syndical de la "lutte de classe contrôlée", qui ne devait pas perturber le sacro-saint "ordre public", entrait en conflit avec l’énergie du prolétariat et la solidarité qui se déployait dans les nouvelles luttes de masse. Arnold Roller écrivit ainsi en 1905, au cours d’une lutte des mineurs de la Ruhr à laquelle 200 000 ouvriers prirent part : "On (les syndicats) s’est cantonné à conférer à la grève le caractère d’une sorte de démonstration paisible, attentiste, afin peut-être d’obtenir de la sorte des concessions par reconnaissance de cette "conduite raisonnable". Les mineurs des autres bassins organisés dans un esprit semblable, comme en Saxe, en Bavière, etc. témoignent leur solidarité en soutenant la grève et paradoxalement en faisant des heures supplémentaires pour produire des milliers de tonnes de charbon en plus – qui seront expédiées et utilisées par l’industrie au service du Capital pendant la grève (…) Pendant que les travailleurs dans la Ruhr souffrent de la faim, leurs représentants au Parlement négocient et obtiennent quelques promesses d’améliorations – légales – mais seulement pour après la reprise du travail. Bien entendu, la direction syndicale allemande a refusé l’idée d’exercer une pression réellement forte sur le patronat par l’extension de la grève à l’ensemble du secteur charbonnier. " 2
L’un des éléments déclencheurs les plus importants du célèbre "débat sur la grève de masse" en 1905/1906 au sein du SPD et des syndicats allemands fut sans aucun doute la puissante grève de masse de 1905 en Russie qui dépassait alors par sa dimension et sa dynamique politique tout ce qui s’était vu jusque-là 3.
Pour les syndicats, les grèves de masse signifiaient une remise en cause directe de leur existence et de leur fonction historique. Leur rôle d’organisation de défense économique permanente de la classe ouvrière n’était-il pas dépassé ? La grève de masse de 1905 en Russie, réaction directe à l’effrayante misère engendrée dans la classe ouvrière et la paysannerie par la guerre russo-japonaise, avait précisément montré que les questions politiques comme la guerre et, en fin de compte, la révolution se trouvaient maintenant au centre du combat ouvrier. Ces questions dépassaient de très loin le carcan de la pensée syndicale traditionnelle. Ainsi que l’écrivait très clairement Anton Pannekoek : "Tout ceci concorde fort bien avec le véritable caractère du syndicalisme, dont les revendications ne vont jamais au-delà du capitalisme. Le but du syndicalisme n'est pas de remplacer le système capitaliste par un autre mode de production, mais d'améliorer les conditions de vie à l'intérieur même du capitalisme. L'essence du syndicalisme n'est pas révolutionnaire mais conservatrice" 4
Reprocher aux dirigeants des syndicats puissamment enracinés en Allemagne leur manque de flexibilité parce qu’ils ne sympathisaient pas avec la forme de lutte de la grève de masse politique ne nous donne pas le fin mot de l’histoire. Leur attitude défensive vis-à-vis de la grève de masse résultait simplement de la nature et de la conception des organisations syndicales qu’ils représentaient, et qui ne pouvaient assumer les nouvelles exigences de la lutte de classe.
Il est évident que les organisations politiques et les partis de la classe ouvrière ont alors été obligés de comprendre la nature du combat engagé par les ouvriers eux-mêmes au moyen de la grève de masse. Cependant, "pour l’écrasante majorité des dirigeants sociaux-démocrates, il n’y avait qu’un axiome : la grève générale, c’est la folie générale!" 5. Ne voulant pas admettre la réalité, ils croyaient voir dans le déclenchement de la grève de masse uniquement et très schématiquement la "grève générale" qui était mise en avant par les anarchistes et les partisans de l’ancien co-fondateur de la social-démocratie hollandaise, Domela Nieuwenhuis. Quelques décennies auparavant, dans son texte Les Bakouninistes à l’œuvre daté de 1873, Engels avait, de façon tout à fait fondée, taxé de complète stupidité la vision d’une grève générale préparée dans les coulisses comme un scénario d’insurrection écrit d’avance. Cette ancienne vision de la "grève générale" consistait en ceci que grâce à un arrêt du travail simultané et général mené par les syndicats, le pouvoir de la classe dominante serait affaibli et mis à bas en quelques heures. En ce sens, les directions du SPD et des syndicats justifiaient leurs réticences et utilisaient les mots d’Engels comme une sentence pour rejeter en bloc et ignorer toute amorce de débat sur les grèves de masse réclamé par la Gauche autour de Rosa Luxemburg au sein du SPD.
L’examen plus précis de la fausse opposition entre "la grève générale anarchiste" et "le solide travail syndical" montre cependant clairement que le vieux rêve anarchiste de la grandiose grève générale économique et la conception des grandes centrales syndicales sont en fait très proches. Pour ces deux conceptions, ce qui comptait était exclusivement le nombre de combattants et elles balayaient la nécessité de prendre en charge les questions politiques désormais contenues, au moins potentiellement, dans les luttes massives.
La FVDG qui, jusqu’ici, avait toujours mis en avant l’activité politique des ouvriers était-elle en mesure d’apporter une réponse ?
La position de la FVDG sur la grève de masse
Motivé par les expériences de mouvements massifs en Europe à la fin du 19e siècle et au début du 20e, le débat sur la grève de masse s’est ouvert au sein de la FVDG en 1904 en vue du Congrès socialiste d’Amsterdam, congrès qui approchait et où cette question était à l’ordre du jour. Dans les rangs de la FVDG où l’on cherchait d’abord à comprendre le phénomène de la grève de masse, ce débat se heurtait à une certaine conception du travail syndical. Dans sa conception générale d’un travail syndical bien mené, la FVDG ne se distinguait sur le fond aucunement des grandes centrales syndicales sociales-démocrates. Cependant, sa faible influence ne la mettant pas en situation de pouvoir contrôler la lutte de classe, la question de la grève de masse y était bien plus ouverte que dans les grandes organisations syndicales.
Gustav Kessler, co-fondateur du courant "Localiste" et autorité politique au sein de la FVDG, est mort en juin 1904. C'est lui qui, au sein de la direction de la FVDG, avait représenté le plus fortement l’orientation vers la Social-démocratie. Le caractère très hétérogène de la FVDG, union des fédérations de métiers, a toujours laissé se constituer des tendances anarchistes minoritaires, comme celle autour d’Andreas Kleinlein Platz. La mort de Kessler et l’élection de Fritz Kater à la tête de la commission exécutive de la FVDG à l’été 1904 ouvrirent précisément une période de plus grande ouverture vis-à-vis des idées syndicalistes révolutionnaires.
C’était avant tout le syndicalisme révolutionnaire français de la CGT, avec son concept de "grève générale", qui semblait pouvoir apporter une réponse à une partie de la FVDG. Sous l’influence de Kessler, la FVDG avait, jusqu’au début de 1904, refusé de faire officiellement de la propagande en faveur de la grève générale. De façon agacée, la FVDG se posa alors la question de savoir si les différentes expressions récentes de la grève de masse de par le monde étaient ou non une confirmation historique de l'ancienne et théâtrale vision de la grève générale.
Deux documents expriment la meilleure compréhension de la grève de masse par la FVDG : la brochure éditée par Raphael Friedeberg en 1904, Parlementarisme et grève générale, ainsi qu’une résolution votée en août de la même année par la FVDG. Le point de vue de Friedeberg (il est resté membre du SPD jusqu’en 1907) a été très influant au sein du syndicat et a nourri ensuite toute sa réflexion. 6.
La brochure de Friedeberg se consacre essentiellement à une critique correcte et finement formulée de l’influence destructrice et abrutissante du parlementarisme tel qu’il était alors pratiqué par la direction social-démocrate : "La tactique parlementaire, la surestimation du parlementarisme, sont trop enracinées dans les masses du prolétariat allemand. Elles sont également trop confortables ; tout doit résulter de la législation, tous les changements dans les rapports sociaux ; tout ce qu'il suffit de faire à chacun, c’est de déposer tous les deux ans son bulletin socialiste dans l’urne. (…) Voilà un bien mauvais moyen d’éducation du prolétariat. (…) Je veux bien concéder que le parlementarisme a eu une tâche historique à remplir dans le développement historique du prolétariat, et qu’il l’aura encore." Comme on le voit, cet anti-parlementarisme n’avait pas le caractère d’un refus de principe, mais correspondait à un stade historique alors atteint au sein duquel ce moyen de propagande pour le prolétariat était devenu totalement inefficace.
De la même façon que Rosa Luxemburg, il a souligné le caractère émancipateur du grand mouvement de grève de masse pour le prolétariat : "À travers la grève, les ouvriers s’éduquent. Elle leur donne une force morale, leur apporte un sentiment de solidarité, une façon de penser et une sensibilité prolétariennes. L’idée de la grève générale offre aux syndicats un horizon tout aussi large que le lui a donné jusqu’ici l’idée du pouvoir politique du mouvement." Il a également écrit sur l’aspect éthique du combat de la classe ouvrière : "Si les ouvriers veulent renverser l’État de classe, s’ils veulent ériger un nouvel ordre mondial, ils doivent être meilleurs que les couches qu’ils combattent, celles qu’ils veulent écarter. C’est pourquoi ils doivent apprendre à repousser tout ce qui est bas et vil en elles, tout ce qui n’est pas éthique. C’est là le caractère principal de l’idée de grève générale, d’être un moyen de lutte éthique."
Ce qui est caractéristique du texte de Friedeberg, c’est l’utilisation du terme "grève générale" même lorsqu’il parle de la grève de masse politique concrète de l’année écoulée.
Même si le ressort de la brochure de Friedeberg est une réelle indignation contre l’esprit conservateur qui règne dans les grandes centrales syndicales, indignation qu’il partage avec Luxemburg, il en arrive à de tout autres conclusions :
- Il rejette clairement la tendance qui existait dans la FVDG à s’intéresser à des questions politiques : "nous ne menons aucun combat politique et, par conséquent, nous n’avons besoin d’aucune forme de combat politique. Notre combat est économique et psychologique." C’est là une nette rupture avec la position qu’avait auparavant la FVDG. En traçant, de façon superficielle, un trait d'égalité entre "parlementarisme" et "combat politique", il rejette la dynamique politique que la grève de masse avait exprimée.
- De plus, Friedeberg élabore une vision (certes très minoritaire au sein même de la FVDG) non matérialiste du combat de classe, basée sur une conception psychologique et sur la stratégie du "refus de la personnalité" - qu’il appelait "psychisme historique". On voit précisément ici qu’il suit certaines conceptions clairement anarchistes selon lesquelles c’est l’esprit de rébellion individuelle qui est l’élément moteur de la lutte de classe et pas le développement collectif de la conscience de classe.
- Bien que Friedeberg ait très correctement cloué au pilori l’idée réformiste social-démocrate de la prise graduelle du pouvoir d’État par le prolétariat, il tendait à adopter une conception gradualiste du même type, mais avec une touche syndicaliste : "Rien que ces dernières années, les syndicats ont accru leurs effectifs de 21% et sont parvenus à dépasser le million d’adhérents. Étant donné que de telles choses se conforment en quelque sorte à des lois, nous pouvons affirmer que, dans trois ou quatre ans nous aurons deux millions de syndiqués, et dans dix ans entre trois et quatre millions. Et lorsque l’idée de la grève générale aura pénétré plus profondément dans le prolétariat […] elle poussera entre quatre et cinq millions d’ouvriers à cesser le travail et ainsi à éliminer l’État de classe." En réalité, l’enrôlement toujours plus important de la classe ouvrière dans les syndicats n’offrait aucunement de meilleures conditions pour la révolution prolétarienne mais, au contraire, constituait un obstacle pour celle-ci.
Derrière la propagande autour d’un "moyen de lutte sans violence pure", on voit aussi chez Friedeberg une énorme sous-estimation de la classe dominante et de la brutale répression qu’elle sait déchaîner dans une situation révolutionnaire : "la caractéristique principale de l’idée de grève générale, c’est d’être un moyen de lutte éthique. […] Ce qui se produira après, lorsque nos adversaires voudront nous réprimer, lorsque nous serons en état de légitime défense, on ne peut pas aujourd’hui le déterminer."
Pour l’essentiel, Friedeberg a vu dans la grève de masse la confirmation de la vieille idée anarchiste de la grève générale. Sa plus grande faiblesse résidait dans le fait de ne pas avoir reconnu que la grève de masse qui venait ne pouvait se développer qu’en tant qu’acte politique de la classe ouvrière. En rupture avec la tradition de la FVDG, qui jusqu’alors avait constamment mis en garde contre toute lutte purement économique, il réduisait la perspective de la grève de masse à ce seul aspect. La base de la FVDG n'était pas unie derrière la conception de Friedeberg qui était le représentant d’une aile minoritaire évoluant vers l’anarchisme et entraînant la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. Cependant les positions de Friedeberg furent pour une courte période l’étendard de la FVDG. Friedeberg lui-même se retira de la FVDG en 1907 pour retourner dans une communauté anarchiste à Ascona.
La FVDG ne pouvait pas comprendre la grève de masse en suivant les théories de Friedeberg. L’esprit révolutionnaire qui se développait et qui se manifestait dans cette nouvelle forme de combat de la classe ouvrière posait la question de la fusion entre les questions politiques et économiques. La question de la grève générale qui se retrouvait maintenant sur le devant de la scène à la FVDG, représentait par rapport à la grève de masse un pas en arrière, une fuite vis-à-vis des questions politiques.
Cependant, malgré toutes ces confusions qui remontaient ainsi à la surface à travers les écrits de Friedeberg, le débat au sein de la FVDG a permis de remuer le mouvement ouvrier allemand. Il lui revient le mérite, bien avant la rédaction de brochures lumineuses et célèbres sur la grève de masse de 1905 (comme celles de Luxemburg ou de Trotsky) d’avoir soulevé cette question au sein du SPD.
Il n’est guère étonnant que la conception de la révolution de la FVDG (qui était elle-même l’union de différents syndicats) à cette époque ait continué à mettre en avant les syndicats en tant qu’organes révolutionnaires. Un pas en avant de la part de la FVDG aurait été qu’elle mette elle-même en question sa propre forme d’organisation. D’un autre côté, même Rosa Luxemburg comptait encore beaucoup sur les syndicats qu’elle décrivait dans beaucoup de pays comme un produit direct et en droite ligne de la grève de masse (par exemple en Russie). Il fallut attendre encore presque cinq ans avant que le livre de Trotsky, 1905, qui racontait l’expérience des conseils ouvriers en tant qu’organes révolutionnaires en lieu et place des syndicats, ne soit publié 7. Ce qui resta constant dans la FVDG et les organisations qui lui ont succédé, ce fut leur cécité vis-à-vis des conseils ouvriers et leur attachement viscéral au syndicat en tant qu’organe de la révolution. Une faiblesse qui devait s'avérer fatale lors du soulèvement révolutionnaire après la guerre en Allemagne.
Négociations secrètes pour contrecarrer la grève de masse et le débat à Mannheim en 1906
Au sein du SPD, un combat en règle s’engagea sur la question de savoir s’il fallait discuter de la grève de masse au Congrès du Parti en 1906. La direction du Parti chercha fébrilement à estampiller les manifestations les plus importantes de la lutte de classe comme dépourvues d’intérêt pour la discussion. Le Congrès du SPD de 1905 à Iéna ne s’était prononcé que pour la forme, dans une résolution qui proclamait que la grève de masse était "éventuellement une mesure à propager". La grève de masse était réduite à n'être qu'un ultime moyen de défense contre un éventuel retrait du droit de vote. Les leçons tirées de la grève de masse en Russie par Rosa Luxemburg furent caractérisées de "romantisme révolutionnaire" par la majorité de la direction du SPD et elles furent déclarées n'avoir aucune application possible à l’Allemagne.
Il n’est pas surprenant que juste après le Congrès d’Iéna, en février 1906, la direction du SPD et la commission générale des principaux syndicats se soient mis d’accord dans des pourparlers secrets pour œuvrer ensemble à empêcher des grèves de masse. Cet arrangement fut quand même démasqué. La FVDG publia dans son journal Die Einigkeit (L’Unité) des parties du procès-verbal de cette réunion qui lui était tombé dans les mains. Entre autres, on y lisait : "Le comité directeur du Parti n’a pas l’intention de propager la grève générale politique, mais cherchera, dans la mesure de son possible, à l’empêcher". Cette publication souleva au sein de la direction du SPD, "l’indignation de ceux qui étaient pris la main dans le sac" et rendit bon gré mal gré indispensable la remise à l’ordre du jour du débat sur la grève de masse au Congrès du Parti des 22 et 23 septembre 1906.
Les premiers mots de Bebel, dans son discours inaugural au Congrès de Mannheim, reflétaient la lâcheté et l'ignorance de la direction du Parti, qui se voyait fort incommodée par l’obligation de se confronter à une question qu’elle avait dans les faits espéré éviter : "Lorsque nous nous sommes séparés l’an dernier après le Congrès d’Iéna, personne n’a pressenti que nous aurions à nouveau cette année à discuter de la grève de masse. […] Du fait de la grosse indiscrétion de l’Einigkeit à Berlin, nous voilà face à un grand débat." 8. Afin de se sortir de l’embarras des discussions secrètes, mises en lumière par l’Einigkeit, Bebel tourna purement et simplement en dérision la FVDG et la contribution de Friedeberg : "Comment, en présence d’un tel développement et de la puissance de la classe des patrons vis-à-vis de la classe ouvrière, il est possible d’obtenir quelque chose avec des syndicats organisés localement, comprenne qui le pourra. De toute façon, la direction du Parti et le Parti lui-même dans sa grande majorité pensent que ces syndicats locaux sont totalement impuissants à assumer les devoirs de la classe ouvrière 9." Qui fut, huit ans plus tard, face au vote des crédits de guerre, "totalement impuissant à assumer les devoirs de la classe ouvrière" ? Précisément cette même direction du SPD ! La FVDG au contraire fut, en 1914, face à la question de la guerre, capable de prendre une position prolétarienne.
Au cours des très indigents débats sur la grève de masse qui eurent lieu lors du Congrès, au lieu d’arguments politiques, on s’échangea surtout des récriminations et justifications bureaucratiques, comme si les militants du Parti devaient s’en tenir à la résolution sur la grève de masse prise l’année précédente au Congrès d’Iéna, ou à celle du Congrès des syndicats de mai 1906, laquelle avait clairement rejeté la grève de masse. Le débat tourna pour l’essentiel autour de la proposition de Bebel et Legien de lancer un ultimatum aux membres du Parti organisés au sein de la FVDG afin qu’ils retournent dans la grande centrale syndicale, sous peine de se faire exclure immédiatement du Parti en cas de refus.
Au lieu de se pencher sur les leçons politiques à tirer des grèves de masse victorieuses, ou d’aborder les conclusions de la brochure de Rosa Luxemburg parue une semaine auparavant, le débat était réduit à une lamentable querelle juridico-politicienne !
Alors que le délégué invité de la FVDG, rédacteur de l’Einigkeit de Berlin, était tourné en ridicule, Rosa Luxemburg s’éleva de façon véhémente contre la machination destinée à mettre sous le boisseau le débat politique central sur la grève de masse à l’aide de moyens formels et purement disciplinaires : "En outre je trouve irresponsable que le Parti soit de quelque manière utilisé comme férule contre un groupe de syndicalistes déterminé, et que nous devions endosser la querelle et la discorde au sein du Parti. Il ne fait quand même aucun doute, que dans les organisations localistes se trouvent vraiment beaucoup de bons camarades, et il serait irresponsable si, pour servir directement les syndicats dans cette question, nous introduisions la brouille dans nos rangs. Nous respectons l'avis que les localistes ne doivent pas pousser le litige dans les syndicats au point d’entraver l'organisation syndicale ; mais au nom de la sacro-sainte égalité des droits, on doit reconnaître quand même au moins la même chose pour ce qui concerne le Parti. Si nous excluons directement les anarcho-socialistes du Parti, comme le comité directeur du Parti le propose, nous donnerons un bien triste exemple : nous ne serons capables de détermination et d’énergie que dès lors qu’il s’agit de délimiter notre Parti sur sa gauche, alors que nous laisserons avant comme après les portes très largement ouvertes sur sa droite.
Von Elm nous a rapporté, en illustration de ce qu’il appelle l’absurdité anarchiste, que dans l’Einigkeit ou dans une conférence des organisations locales, il se serait dit : "La grève générale est le seul moyen de lutte de classe réellement révolutionnaire à prendre en compte". Bien entendu, c’est une absurdité et rien d’autre. Cependant, chers amis, cela n’est pas plus éloigné de la tactique sociale-démocrate et de nos principes que les propos de David nous expliquant que le seul moyen de lutte de la social-démocratie est la tactique légale parlementaire. On nous dit que les localistes, les anarcho-socialistes, sapent peu à peu les principes sociaux-démocrates par leur agitation. Mais lorsqu’un membre des comités centraux comme Bringmann se prononce par principe contre la lutte de classe comme il l’a fait lors de votre conférence en février, c’est tout autant un travail de sape des principes de base de la social-démocratie." 10
Comme lors du Congrès du Parti de 1900, lors du débat sur les syndicats à Hambourg, Luxemburg s’oppose à la tentative d’utiliser les faiblesses de la FVDG comme un prétexte facile pour étouffer les questions centrales. Elle voyait que le grand péril ne provenait pas d’une minorité syndicale comme la FVDG, évoluant vers le syndicalisme révolutionnaire et dont les militants au sein du SPD se situaient souvent du côté de son aile gauche, mais bien plutôt du centre et de la droite du Parti.
La scission de la FVDG et la rupture définitive avec le SPD en 1908
La FVDG n'a nullement représenté pour la direction réformiste du SPD et la confédération syndicale centrale le même danger que l'aile révolutionnaire de la social-démocratie autour de Liebknecht et de Luxemburg. Cependant, l'aile révolutionnaire ne pouvait pas ne pas tenir compte de la FVDG uniquement en raison du fait que cette dernière constituait une petite minorité et qu’elle ne reconnaissait pas vraiment les enseignements des grèves de masse. L'émergence internationale de mouvements syndicalistes révolutionnaires puissants à partir de 1905, comme les IWW aux États-Unis, faisait des tendances syndicalistes révolutionnaires un danger potentiel pour le réformisme.
La stratégie, inaugurée en 1906 au Congrès du Parti à Mannheim, de faire pression sur les membres de la FVDG pour qu’ils entrent dans les syndicats centraux, s'est poursuivie pendant des mois. D'une part, on a offert à des membres connus et combatifs des syndicats locaux des postes rémunérateurs dans les bureaucraties des syndicats sociaux-démocrates. D'autre part, pour le Congrès du SPD à Nuremberg qui devait avoir lieu en 1908, est parue à nouveau une motion sur l'incompatibilité de la double affiliation SPD et FVDG.
Mais la FVDG échoua surtout à cause de ses ambiguïtés et des différences d’orientations au sein de ses associations professionnelles. À l’époque où il s’agissait de comprendre la grève de masse politique et l'émergence des conseils ouvriers, elle se déchira dans un affrontement interne sur la question de rejoindre les centrales syndicales ou de s’engager dans une voie syndicaliste révolutionnaire subordonnant les questions politiques aux questions économiques. À son Congrès extraordinaire de janvier 1908, la FVDG examina une motion des syndicats de maçons demandant de dissoudre la FVDG pour adhérer aux syndicats centraux. Bien que cette motion ait été rejetée, cela signifiait la scission de la FVDG et donc la fin de la longue histoire d'une immense opposition syndicale qui s'était appuyée sur la tradition prolétarienne de la social-démocratie. Plus d’un tiers de ses membres quitta immédiatement la FVDG pour rejoindre les grands syndicats. Le nombre d’adhérents tomba de 20 000 à moins de 7000 en 1910.
Il était alors facile à la direction de la social-démocratie de sceller, en septembre 1908, la scission avec la FVDG au Congrès du Parti par l'interdiction définitive de la double affiliation FVDG et SPD. Dès lors, les vestiges de la FVDG ne constituaient plus un danger sérieux pour les Legien et consorts.
Dans l'histoire de la naissance du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, l'année 1908 marque ainsi le début d'une nouvelle étape, celle d’un revirement d’orientation déclaré en faveur du syndicalisme révolutionnaire, et cela de la part d'un peu moins de la moitié des membres de la FVDG.
Vers le syndicalisme révolutionnaire
Vu que la FVDG dans sa genèse était apparue comme mouvement d'opposition syndicale solidement lié à la social-démocratie, donc à une organisation politique du mouvement ouvrier, elle ne s'était jamais caractérisée, avant 1908, comme syndicaliste révolutionnaire. En effet, le syndicalisme révolutionnaire ne signifie pas seulement un engagement tout feu tout flamme exclusivement dans les activités syndicales, mais aussi l’adoption d’une conception qui considère le syndicat comme la seule et unique forme d'organisation pour le dépassement du capitalisme - un rôle que celui-ci, de par sa nature d’organe de lutte pour des réformes, n’a jamais pu et ne pourra jamais jouer.
Le nouveau programme de 1911, "Que veulent les Localistes ? Programme, buts et moyens de la FVDG", significatif de la voie qu’elle empruntait, exprimait désormais ce point de vue de la façon suivante : "La lutte émancipatrice des travailleurs est principalement une lutte économique que le syndicat, conformément à sa nature en tant qu'organisation des producteurs, doit conduire sur tous les plans. (…) Le syndicat (et non le parti politique) est seul en mesure de permettre de façon requise l’épanouissement du pouvoir économique des travailleurs…" 11
Les années précédentes, les grandes grèves de masse avaient témoigné de la dynamique spontanée de la lutte des classes et avaient vu l’abandon par les Bolcheviks en 1903 du concept de "parti de masse", clarifiant dans le même temps la nécessité des organisations de minorités politiques révolutionnaires. Toutefois, le nouveau programme de la FVDG, certes avec bonne volonté et tout en combattant le vieux "dualisme", partait sur des conclusions fausses : "C’est pourquoi nous rejetons le dualisme nuisible (bipartition), tel qu’il est pratiqué par la social-démocratie et les syndicats centraux qui s’y rattachent. Nous entendons par là la division absurde des organisations ouvrières entre une branche politique et une branche syndicale. (…) Puisque nous rejetons la lutte parlementaire et l’avons remplacée par la lutte politique directe par des moyens syndicaux et non pas pour le pouvoir politique, mais pour l’émancipation sociale, tout parti politique ouvrier tel que la social-démocratie perd toute raison d’être." 12
Ce nouveau programme exprimait une complète cécité par rapport à l'émergence historique et au caractère révolutionnaire des conseils ouvriers et se réfugiait dans la théorisation pleine d'espoir d'un nouveau type de syndicat :
- alternative au parti de masse (de fait) périmé,
- alternative aux grands syndicats bureaucratisés,
- organe de la révolution,
- et, finalement, architecte de la nouvelle société.
Quelle tâche considérable !
À la façon caractéristique du syndicalisme révolutionnaire, la FVDG défendait à cette époque un clair rejet de l'État bourgeois et du parlementarisme débridé. Elle soulignait correctement la nécessité de la lutte de la classe ouvrière contre la guerre et le militarisme.
Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, la FVDG ne s'est pas rapprochée de l’anarchisme. Les théories de Friedeberg l'ayant mené de la social-démocratie vers l’anarchisme dans les années 1904-07, bien qu'elles aient servi d'emblème, n'ont pas pour autant signifié un basculement de l’ensemble de l'organisation dans l’anarchisme. Au contraire, les forces fortement orientées vers le syndicalisme révolutionnaire réunies autour de Fritz Kater craignaient également une "tutelle" de la part des anarchistes, du type de celle exercée par le SPD sur les syndicats. Dans l’Einigkeit d'août 1912, Kater caractérisait encore l'anarchisme comme "tout aussi superflu que tout autre parti politique" 13. Il serait faux de partir du principe que ce serait la présence en son sein d'anarchistes avérés qui aurait conduit la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. L’hostilité envers les partis politiques, née des dures controverses avec le SPD, s’étendait dans les années d’avant-guerre également aux organisations anarchistes. Ce n'est en aucune manière non plus l'influence du charismatique anarchiste Rudolf Rocker à partir de 1919 qui aurait introduit cette hostilité envers les partis politiques dans l'organisation qui a succédé à la FVDG, la FAUD. Une telle évolution avait en effet déjà clairement eu lieu avant. R. Rocker ne fit que théoriser, dans les années 1920, beaucoup plus nettement que cela n’avait été le cas avant la guerre, cette hostilité du syndicalisme révolutionnaire allemand envers les partis politiques.
Les années précédant l’éclatement de la guerre en 1914 ont été marquées pour la FVDG par un repli sur elle-même. Les grands débats avec les organisations mères étaient terminés. La scission avec la Confédération syndicale centrale avait eu lieu en 1897. La rupture avec le SPD dix bonnes années plus tard, en 1908.
Il se produisit alors une situation curieuse révélant le paradoxe qui ressurgit constamment avec le syndicalisme révolutionnaire : se définissant en tant que syndicat voulant s’ancrer parmi un maximum de travailleurs, la FVDG a toutefois été réduite à un minimum de membres. Parmi ses 7000 adhérents environ, seule une faible partie était vraiment active. Elle n'était plus un syndicat ! Les vestiges de la FVDG formaient plutôt des cercles de propagande en faveur des idées syndicalistes révolutionnaires, et avaient plutôt un caractère de groupe politique. Mais ils ne voulaient pas être une organisation politique !
Les vestiges de la FVDG sont restés - et c'est pour la classe ouvrière une question absolument centrale - sur un terrain internationaliste et se sont opposés, malgré toutes leurs faiblesses, aux efforts de la bourgeoisie en faveur du militarisme et de la guerre. La FVDG et sa presse ont été interdites en août 1914, immédiatement après la déclaration de la guerre, et beaucoup de ses membres encore actifs ont été emprisonnés.
Dans un prochain article, nous examinerons le rôle des syndicalistes révolutionnaires en Allemagne jusqu’en 1923, période qui couvre la Première Guerre mondiale, la révolution allemande et la vague révolutionnaire mondiale.
Mario, 6.11.2009
1 "La naissance du syndicalisme révolutionnaire dans le mouvement ouvrier allemand [81]", Revue Internationale n° 137
2. Arnold Roller (Siegfried Nacht) : Die direkte Aktion ("L’action directe"), 1912. (notre traduction) Roller incarnait au sein de la FVDG l’aile anarchiste jusque-là très minoritaire.
3. Voir les Revue Internationale n° 120 [42], 122 [82], 123 [45], 125 [83] en anglais, espagnol et français.
4. Anton Pannekoek, Le Syndicalisme, International Council Correspondance, n° 2 - Janvier1936., Rédigé en anglais sous le pseudonyme de John Harper. (Notre traduction)
5. Paul Frölich, Rosa Luxemburg, sa vie et son œuvre, chapitre : "La grève politique de masse". Ed. L’Harmattan, p.168
6. Friedeberg lui-même ne venait pas de l’anarchisme mais était élu local du SPD et membre de la direction berlinoise du Parti social-démocrate.
7. Trotsky écrivit d’abord en 1907 Notre révolution. Quelques chapitres servirent de base à 1905, lequel fut écrit en 1908/1909.
8 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Mannheim, 23. bis 29. September 1906 (Procès-verbal des débats du Congrès du Parti Social-démocrate allemand, Mannheim, 1906), page 227.(Notre traduction)
9. Ibidem, page 295. .(Notre traduction)
10. Ibidem, , page 315 (ou dans les Œuvres complètes de Rosa Luxemburg, Tome 2 page 174).
11. Notre traduction
12. Notre traduction
13. Voir Dirk H. Müller, Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte vor 1918, p.191-198.
Courants politiques:
Revue Internationale n° 142 - 3e trimestre 2010
- 2867 lectures
Le capitalisme est dans une impasse, les cures d'austérité ou les plans de relance n'y changeront rien
"Le G20 à la recherche d'une nouvelle façon de gouverner le monde". C'est là une bien grande ambition que prêtaient certains médias 1 à ce nouveau sommet des "grands" de ce monde, mais, une ambition à la hauteur de l'état catastrophique de la planète !
Qu'il existe l'attente d'une amélioration est une évidence alors que, de par le monde et depuis plus de deux ans, c'est à un rythme accéléré que s'abattent les attaques contre la classe ouvrière. L'économie mondiale, malgré les annonces quotidiennes d'une reprise imminente ou déjà à l'œuvre, est installée dans la stagnation et son futur apparaît de plus en plus sombre. Face à cela, la réunion des personnalités qui ont en charge la gestion de cette économie mondiale et donc, entre leurs mains, le sort des habitants de la planète, paraissait devoir décider de moyens réels permettant une amélioration.
La réunion des pays du G8 (préparatoire du G20) devait ainsi décider de la politique à suivre pour permettre à l'économie mondiale de sortir de la crise : poursuite des plans de relance comme le recommandent et le font les États-Unis, ou bien mise en œuvre de plans d'austérité afin d'écarter les menaces de faillite qui concernent un nombre croissant d'États, comme les recommandent et les appliquent déjà les pays les plus importants de l'Union européenne. Le G20 devait, quant à lui décider, d'une part, la taxation des banques en vue de constituer un "fond de résolution" des crises financières, celle qui a débuté en 2007 n'étant de fait pas résolue même si ses effet les plus dévastateurs en ont momentanément été contenus ; il devait, d'autre part, s'atteler à la "régulation du système financier" avec pour objectif d'éviter des actions spéculatives "particulièrement déstabilisatrices" et d'orienter les capacités financières ainsi "libérées" vers les progrès de la production. Qu'est-il sorti de ce sommet ? Rien. La montagne n'a pas accouché d'une souris, elle n'a accouché de rien du tout. Aucune décision n'a été prise sur quelque problème que ce soit ; comme nous le verrons plus en détail dans la suite de cet article, les participants n'ont pu que constater leur désaccord complet : "Sur les sujets qui devaient constituer le gros de ce G20 il y a encore peu, les participants au sommet de Toronto ont jugé qu'il était urgent d'attendre. Les divergences restent trop importantes, l'impréparation aussi." 2 Il fallait bien le sens de l'à propos du président français Sarkozy pour tenter de relativiser ce constat d'échec et d'impuissance de la bourgeoisie mondiale en commentant "on ne peut pas prendre des décisions historiques à chaque sommet" !
Les précédents G20 avaient promis de mettre en œuvre des réformes s'appuyant sur les leçons de l'affaire des "subprimes" et de la crise financière qui s'en est suivie. Cette fois-ci, il n'y a même pas de promesses. Pourquoi les grands gestionnaires du capitalisme mondial se montrent-ils incapables de prendre la moindre décision ? Le fond du problème c'est qu'il n'y a pas de solution à la crise du capitalisme autre que le renversement de ce mode de production historiquement sénile. Il existe également une autre explication possible, plus circonstancielle : les chefs d'État et de gouvernement ayant en général conscience que l'économie mondiale s'enfonce toujours plus dans un gouffre sans fond, ils ont la sagesse d'éviter de se trouver, dans quelques mois, dans l'obligation de prononcer la fameuse phrase de l'ancien président de la Côte d'Ivoire F. Houphouët Boigny : "Nous étions au bord du gouffre, nous avons fait un grand pas en avant" 3 car, cette fois-ci, les termes étant de circonstance, cela ne ferait rire personne.
La fin des plans de relance et le retour de la dépression
L’éclatement de la crise financière, en 2008, avait entraîné dans son sillage une chute de la production de l'essentiel des pays du monde (un simple ralentissement pour la Chine et l’Inde). Pour tenter d'endiguer le phénomène, la bourgeoisie dans la plupart des pays, avait été amenée à mettre en place des plans de relance, ceux de la Chine et des États-Unis étant de loin les plus importants. Si ces plans ont permis un rattrapage partiel de l’activité économique mondiale et une stabilisation de celle des pays développés, leurs effets sur la demande, la production et les échanges sont néanmoins en train de s’épuiser.
Malgré toute la propagande sur la reprise dans laquelle nous serions engagés, la bourgeoisie est désormais obligée d’admettre que la situation n’évolue pas dans cette direction. Aux États-Unis, la croissance qui était prévue à 3,5% pour 2010 a été révisée en baisse à 2,7% ; le nombre de chômeurs s’accroît de nouveau de semaine en semaine et l’économie américaine a recommencé à détruire des emplois 4 ; de manière générale, les nombreux indicateurs créés pour mesurer l’activité économique des États-Unis montrent une croissance qui a tendance à faiblir. Dans la zone euro, la croissance n’a été que de 0,1% au premier trimestre et la Banque Centrale Européenne prévoit qu’elle atteindra 1% pour toute l’année 2010. Les mauvaises nouvelles ne cessent d'arriver : la croissance de la production manufacturière est de moins en moins forte et le chômage a recommencé à augmenter, sauf pour l'Allemagne. Il est prévu que le PIB de l’Espagne continuera de diminuer en 2010 (- 0,3%). Il est significatif que, tant aux États-Unis qu’en Europe, l’investissement continue à diminuer, ce qui veut dire que les entreprises ne prévoient pas une réelle croissance de la production.
Par-dessus tout, l’Asie, la région du monde qui devait devenir le nouveau centre de gravité de l’économie mondiale, est en train de voir son activité décélérer. En Chine, l’indice du Conference Board qui était prévu en hausse de 1,7% pour le mois d’avril n’augmente finalement que de 0,3% ; ce chiffre est corroboré par tous ceux qui ont été publiés dernièrement. Si les chiffres mensuels concernant un pays ne sont pas nécessairement significatifs d’une tendance générale, le fait que, dans les grands pays de la région, l’activité ait pris la même direction au même moment, est significatif d'une tendance sérieuse : ainsi l’indice de l’activité économique en Inde traduit lui aussi un ralentissement et, au Japon, les chiffres du mois de mai pour la production industrielle et la consommation des ménages sont en baisse.
Enfin, confirmant cette inflexion qui dément les fanfaronnades des médias sur la reprise économique, l’indice "Baltic Dry Index" qui mesure l’évolution du commerce international est, lui aussi, orienté à la baisse.
La faillite des États
Tandis que l'évolution des différents indices économiques témoigne d'une rechute dans la dépression, des États éprouvent des difficultés croissantes à assumer le remboursement de leur dette. Cela n'est pas sans rappeler la crise des "subprimes" qui avait vu l'incapacité de nombreux ménages américains à rembourser les prêts qui leur avaient été consentis. Il y a quelques mois, c'était au tour de l'État grec de se retrouver sur la sellette alors qu'était suspectée une situation de l'état de ses finances bien plus grave que celle annoncée initialement. Dans le même temps, la solvabilité de plusieurs autres États européens (affublés gracieusement du qualificatif de PIIGs construit à partir de leur initiales et évocateur du terme "pig" – cochon en anglais), le Portugal, l’Irlande, l’Italie, l'Espagne en plus de la Grèce, était mise en doute par les agences de notation financière. Il est certain que la spéculation à leur encontre a aggravé leurs difficultés et que le rôle joué par les fameuses agences de notation (qui ont été créées par de grandes banques) est loin d’être clair. Il n'en demeure pas moins que ce qui est fondamentalement en cause dans cette crise de confiance affectant ces pays est l'ampleur de leurs déficits budgétaires (à des niveaux inégalés depuis la Deuxième Guerre mondiale) et de leur dette publique, la politique de relance menée, peu ou prou, par les différents États n'étant pas pour rien dans cette situation. Il en a résulté un affaiblissement des réserves monétaires des différents Trésors publics et, en conséquence, des difficultés toujours plus importantes des États concernés pour rembourser les intérêts des prêts qui leur avaient été accordés. Or, le paiement du service de la dette, au minimum, est la condition indispensable pour que les grands organismes bancaires mondiaux continuent à prêter. Mais les PIIGs ne sont pas les seuls à connaître une très forte augmentation des déficits publics et, en conséquence, de la dette publique. Ainsi, les agences de notation ont menacé explicitement la Grande-Bretagne d’abaisser sa note et de lui faire rejoindre les rangs peu honorables des PIIGs, si elle ne faisait pas un gros effort pour diminuer ses déficits publics. Ajoutons, pour faire bonne mesure, que le Japon (qui, dans les années 1990, a été pronostiqué comme devant supplanter les États-Unis au niveau du leadership économique mondial) a atteint un endettement public qui correspond au double de son PIB 5. En fait, une telle liste que l’on pourrait encore allonger nous amène à la conclusion que la tendance au défaut de paiement de la dette souveraine des États est une tendance mondiale parce que tous les États ont été touchés par l’aggravation de la crise de l'endettement à partir de 2007 et que tous ont subi des déséquilibres semblables à ceux de la Grèce et du Portugal.
Mais il n'y a pas que les États dont la situation financière s’approche de l’insolvabilité. Le système bancaire, lui aussi, se trouve dans une situation de plus en plus grave, pour les raisons suivantes :
- tous les spécialistes savent et disent que les comptes des banques n’ont pas été apurés des "produits toxiques" qui ont présidé à la faillite de nombreuses institutions financières, survenue à la fin 2008 ;
- les banques, confrontées à ces difficultés, n’ont pas cessé pour autant de spéculer sur le marché financier mondial par l’achat de produits très risqués. Tout au contraire, elles ont dû continuer à jouer sur ce registre pour tenter de faire face aux pertes massives qu’elles venaient de subir ;
- l’aggravation de la crise depuis la fin 2007 a provoqué de nombreuses faillites d’entreprises, si bien que beaucoup de ménages, se retrouvant sans emploi, ne purent plus, contrairement aux années précédentes, rembourser les différents prêts qu’ils avaient contractés.
Une illustration de cette situation a été fournie récemment, le 22 mai, lorsqu’une caisse d’épargne en Espagne nommée Caja Sur a été mise sous tutelle de l’État. Mais cet événement n’était qu’une petite partie (la face émergée de l'iceberg) de ce que représentent les difficultés éprouvées par les banques ces derniers mois. D’autres banques en Europe ont été dégradées par les agences de notation (Caja Madrid en Espagne, BNP en France) mais, surtout, la BCE a informé le monde financier que les banques européennes allaient devoir déprécier leurs actifs de 195 milliards d’euros dans les deux prochaines années et que leurs besoins de capitaux, jusqu’en 2012, se montaient à 800 milliards d’euros. Un événement survenu récemment constitue, sur un autre plan, une vérification éclatante de la fragilité actuelle du système bancaire : l’entreprise allemande Siemens a décidé de créer sa propre banque, une institution qui serait ainsi à son service et à celui de ses clients. La raison en est simple : ayant déjà perdu la bagatelle de 140 Millions d’euros lors de la faillite de Lehman Brothers, cette entreprise a peur que le même phénomène se reproduise avec les liquidités qu'elle sera amenée à déposer aux guichets de banques "classiques". On a d’ailleurs appris, à cette occasion, que Siemens n’avait rien inventé puisque l’entreprise Veolia, alliée à British American Tobacco et d’autres entreprises de moindre importance, avait fait la même chose en janvier 2010 6. Il est clair que, si des entreprises dont la solidité n’est pour le moment pas en cause, ne déposent plus leur trésorerie aux guichets des grandes banques, la situation de ces dernières ne va pas s’arranger !
Mais ce qu’il est particulièrement important de souligner, c’est que les problèmes d’insolvabilité des États et des banques ne peuvent que se cumuler : c’est déjà le cas, mais ce phénomène ne peut que prendre de l'ampleur dans les semaines et les mois à venir ; en clair, la "faillite" d’un État, s’il n’était pas "secouru" par les autres comme cela a été fait pour la Grèce, provoquerait la faillite des banques qui lui ont prêté massivement. Les créances des banques allemandes et françaises à l’égard des États regroupés sous le terme de PIIGs se montant à environ 1000 milliards d’euros, il apparaît clairement que le défaut de paiement de ces pays aurait des conséquences incalculables sur l'Allemagne et la France et, par ricochet, sur l’économie mondiale.
Aujourd’hui c'est l’Espagne qui est dans l’œil du cyclone de la crise financière. La BCE a annoncé que les banques espagnoles, pas assez crédibles pour emprunter sur le marché, se sont refinancées auprès d'elle du montant exorbitant de 85,6 milliards d’euros, pour le seul mois de mai. De plus, il se dit, dans les salles de marché, que l’État espagnol devrait s’acquitter, fin juillet ou début août, d'une somme considérable 7. C’est donc dans un délai particulièrement court que de telles sommes doivent être trouvées et c’est bien parce que la situation est dramatique que le directeur du FMI, D. Strauss-Kahn, et le Secrétaire d’État adjoint au Trésor des États-Unis, C. Collins, se sont succédés à Madrid. Un plan de sauvetage de la dette souveraine espagnole d’un montant de 200 ou 250 milliards d’euros serait à l'étude.
Si autant de monde se presse autour de l’Espagne, c’est que les problèmes posés par sa situation financière peuvent être très lourds de conséquences :
- si, n’étant pas secouru, l’État espagnol faisait faillite, cela provoquerait une défiance générale à l’égard de l’Euro et de tout paiement libellé dans cette monnaie ; en d’autres termes, la zone euro se trouverait considérablement mise à mal ;
- la France et l’Allemagne, c’est-à-dire les économies les plus fortes de la zone euro, ne peuvent pas prendre en charge les engagements auxquels l’Espagne ne peut faire face sous peine d’une déstabilisation grave de leurs propres finances et, finalement, de l' ensemble de leur économie (analyse développée par l’économiste P. Artus 8).
Cela signifie que l'aide à l’État espagnol permettant à celui-ci d’éviter le défaut de paiement sur sa dette souveraine ne peut être le fruit que d’une entente de l’ensemble des pays occidentaux, et que le prix à payer en sera nécessairement la fragilisation de leur propre situation financière. Et, dans la mesure où, comme nous l’avons vu, la plupart des États sont dans une situation s'approchant de celle de l’Espagne, cela exige de leur part la mise en place d'une politique visant à éviter des impossibilités de remboursement en cascade de leur dette souveraine.
De tout ce qui précède, il ressort que le capitalisme n’a plus les moyens de renverser le cours de l’aggravation de la crise telle qu'elle se manifeste depuis 2007.
Les divergences des États sur la politique à mener
"Rigueur ou relance : le désaccord persistant des dirigeants du G8" titrait le journal Le Monde dans son édition des 27 et 28 juin. Malgré le langage diplomatique employé, il ressort clairement que le désaccord entre les différents pays est complet. La rigueur est voulue par la Grande-Bretagne et l’Allemagne qui entraîne avec elle la zone euro ; la relance est souhaitée par les États-Unis et, à un degré moindre, par la Chine. Quels sont le contenu et les raisons d’un tel désaccord ?
Le constat de la gravité des implications, pour l’Europe et le monde, de la faillite de l’État grec a amené l’Europe et le FMI à finalement organiser le sauvetage de la dette souveraine de la Grèce et ce, malgré les divergences qui s'étaient manifestées entre les États devant participer à ce sauvetage. Mais cet événement a provoqué un infléchissement important de la politique de l'ensemble des pays de la zone euro :
- Tout d’abord, tous se sont finalement accordés sur la nécessité de prendre les moyens de secourir les États ayant besoin de l’être, car des défauts de paiement de leur part ébranleraient tout le système financier européen, avec le risque qu'il s'effondre. C’est pour cela qu’a été créé un fonds de soutien de 750 milliards d’euros, approvisionné pour deux tiers par les pays membres de la zone euro et pour un tiers par le FMI, qui est censé permettre aux États qui se retrouveraient en défaut de paiement de faire face à leurs engagements. Dans le même sens, au vu de la situation des banques de la zone euro, la Banque Centrale Européenne accepte de prendre en charge les créances plus ou moins douteuses qui lui sont présentées par celles-ci ; c’est ce qui vient de se produire, comme on l'a vu, avec les banques espagnoles.
- Ensuite, pour diminuer le risque de défaut de paiement, les États ont décidé d’assainir leurs propres finances publiques et leur propre système bancaire. Pour cela, ils ont lancé des plans d’austérité qui vont signifier une baisse du niveau de vie de la classe ouvrière, d'une importance comparable à celle qu’elle a connue dans les années 1930. Le nombre des attaques est tellement important que leur énumération dépasserait de loin la taille de cet article. Prenons des exemples significatifs. En Espagne, le salaire des fonctionnaires a été diminué de 5% et 13 000 postes ont été supprimés. En France, en plus de la réforme des retraites qui vise à retarder d’au moins deux ans le départ en retraite et à ne remplacer qu’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, il a été décidé de supprimer 100 000 postes de la fonction publique sur la période 2011-2013 ; il est mis fin aux mesures de relance décidées en 2009 ; la hausse des sommes collectées au titre des impôts devra être de 5 milliards d’euros. En Grande-Bretagne, le plan Osborne prévoit une diminution des dépenses des ministères de 25% en cinq ans ("les ministères sanctuarisés" comme la santé ne sont cependant pas touchés par cette mesure) ; toute une série d’allocations sociales dont bénéficient les plus faibles sont gelées ; la TVA passe de 17,5% à 20% ; il a été calculé que le plan Osborne allait aboutir à la suppression de 1,3 million d’emplois. En Allemagne, 14 000 emplois de fonctionnaires seront supprimés d’ici 2014 et l’indemnisation des chômeurs de longue durée sera diminuée. Dans tous les pays les investissements publics sont diminués.
La logique proclamée de ces mesures est la suivante : tout en sauvant le système financier par le soutien aux banques en difficulté et aux États risquant de se trouver en défaut de paiement, il s’agit d’assainir les finances publiques pour pouvoir à nouveau emprunter par la suite, afin de permettre un redémarrage futur de la croissance. En fait, derrière cet objectif affiché, il y a d’abord la volonté de la bourgeoisie allemande de préserver ses intérêts économiques : pour ce capital national qui a misé sur sa capacité à vendre ses marchandises – en particulier ses machines-outils et sa chimie - au reste du monde, il est hors de question de faire supporter par une hausse de ses coûts de production les frais d’une relance ou d'un soutien (au-delà d’un certain niveau) à d'autres pays européens en difficulté. Il en résulterait en effet une perte de compétitivité de ses marchandises. Et comme ce pays est le seul à pouvoir soutenir les autres pays européens, il impose à tous une politique d’austérité, même si cela ne correspond pas à leurs intérêts.
Le fait que le Royaume-Uni, qui ne subit pas les contraintes de la zone euro, mette en œuvre la même politique est significatif de la profondeur de la crise. Pour cet État, l'heure n'est plus à la relance alors que son déficit budgétaire pour l’année 2010 atteint 11,5% du PIB. Il en résulterait de trop grands risques de défaut de paiement sur la dette souveraine et, ce faisant, d’effondrement de la Livre sterling. Il faut également noter que le Japon – compte tenu de l'ampleur de sa dette publique - a adopté la même politique d’austérité. De plus en plus de pays pensent désormais que leurs déficits et leur dette publique sont devenus trop dangereux, le défaut de paiement sur la dette souveraine signifiant en effet un affaiblissement considérable du capital national. Ils optent ainsi pour une politique d’austérité qui ne peut mener qu’à la déflation 9.
Or, c’est bien l’entrée dans une dynamique déflationniste qui fait peur aux États-Unis. Ils accusent les européens de s’engager dans un "épisode Hoover" (du nom du Président des États-Unis en fonction en 1930), ce qui revient à accuser les États européens d’engager le monde dans une dépression et une déflation comme celles des années 1929-1932. D’après eux, même s’il est légitime de vouloir diminuer les déficits publics, il faudra le faire plus tard, lorsque "la reprise" sera vraiment engagée. En défendant une telle politique, les États-Unis défendent leurs propres intérêts car, étant émetteurs de la monnaie de réserve mondiale, créer de la monnaie supplémentaire pour alimenter la reprise ne leur coûte que des écritures de compte. Ceci dit, cela n'empêche pas que leur crainte est bien réelle de voir l’économie mondiale s’engager dans la déflation.
Au fond, quelle que soit l’option souhaitée ou adoptée, les changements de politique effectués ces derniers temps de même que les craintes exprimées par différentes fractions de la bourgeoisie mondiale sont révélatrices du désarroi qui existe en son sein : il n'existe plus de bonne solution !
Quelles perspectives ?
L’effet des politiques de relance est terminé et c'est une rechute dans la dépression qui s'amorce. Une telle dynamique implique pour les entreprises des difficultés croissantes à dégager des profits suffisants, ne serait-ce que pour ne pas disparaître. La politique d'austérité que vont mettre en place un grand nombre de pays ne va qu'aggraver la chute dans la dépression et engendrer la déflation dont certaines manifestations commencent à apparaître.
Il ne fait pas de doute que l'espoir selon lequel une politique d'austérité assainira les finances publiques et permettra un endettement futur est une pure illusion. En effet, selon les calculs du FMI, la conséquence du plan d'austérité grec implique, pour ce pays, une perte de 8% de son PIB. De même, une baisse du PIB espagnol est déjà prévue. De plus, les plans d'austérité ne peuvent que provoquer une baisse des rentrées fiscales et participer ainsi à creuser les déficits que, justement, les mesures d’austérité draconiennes essaient de réduire ! Il faut s'attendre à une chute de la production de la plupart des pays du monde et du commerce mondial pour la fin 2010 et pour le début 2011 avec toutes les conséquences que cela aura pour le développement de la misère d'une partie toujours plus grande de la classe ouvrière et une dégradation des conditions de vie de tous les ouvriers.
Il n'est pas impossible que, au vu de la chute accélérée dans la dépression qui va résulter des politiques d'austérité, intervienne au bout de quelques mois un changement de politique et que soit adoptée celle prônée par les États-Unis. En effet, les six derniers mois nous montrent que la bourgeoisie, n'ayant plus guère de marge de manœuvre, est maintenant incapable de prévoir au delà du très court terme : on faisait une politique de relance il y a seulement un an ! Si une nouvelle politique de relance était adoptée, elle signifierait une forte émission monétaire (certains disent que les États-Unis s’apprêteraient à la mettre en œuvre). Mais alors, il faudrait s’attendre à la chute générale de la valeur des monnaies, c'est-à-dire une explosion de l'inflation, en d'autres termes de nouvelles attaques dramatiques contre le niveau de vie des travailleurs.
Vitaz (03/07/2010)
1 Ce n'était rien de moins que le titre de première page du journal Le Monde du 26 juin 2010
2 Le Monde, 29 juin 2010
3 https://www.dicocitations.com/citations/citation-7496.php [86]
4 Après 5 mois consécutifs de créations d'emplois, ce sont 125 000 qui ont été détruits au mois de juin, ce qui est plus que ne le redoutaient les analystes. Voir l'article "Après cinq mois de créations d'emplois, les États-Unis se remettent à en détruire [87]".
5 C'est, entre autre, le fait qu'il possède actuellement les deuxièmes réserves de change du monde qui permet au Japon de n'être pas noté par les agences de notation aussi sévèrement que le sont nombre de pays beaucoup moins endettés que lui.
6 www.lemonde.fr/economie/article/2010/06/29/siemens-cree-sa-banque-afin-de-s-affranchir-des-etablissements-traditionnels_1380459_3234.html [88]
7 Il s'agirait de 280 Milliards d’euros. Bien sûr, de par leur origine (les salles de marché), de tels chiffres sont officieux et ont évidemment été démentis par les autorités car, dans ce cas, même le silence serait interprété comme une confirmation et engendrerait une panique indescriptible.
8 Journal Le Monde, 16 avril 2010,
9 Baisse des prix durable, provoquée dans ce cas par l'insuffisance de la demande, elle-même conséquence des programmes d'austérité.
Qu'est-ce que les conseils ouvriers (III) : la révolution de 1917 (de juillet à octobre), du renouvellement des conseils ouvriers à la prise du pouvoir
- 4434 lectures
La série Que sont les conseils ouvriers ? se propose de répondre à la question en analysant l'expérience historique du prolétariat. Il ne s'agit pas d'élever les soviets au niveau d'un modèle infaillible qu’il s’agirait simplement de .copier ; nous cherchons à les comprendre tant dans leurs erreurs que dans leurs succès, pour armer les générations actuelles et futures à la lumière de cette compréhension.
Dans le premier article, nous avons vu comment ils naquirent avec la Révolution de 1905 en Russie 1, dans le deuxième comment ils furent la pièce maîtresse de la Révolution de Février 1917 et comment ils entrèrent dans une crise profonde en juin-juillet 1917 jusqu'à être pris en otage par la contre-révolution bourgeoise 2.
Dans ce troisième article, nous verrons comment ils furent reconquis par la masse des travailleurs et des soldats qui purent ainsi prendre le pouvoir en octobre 1917.
Après la défaite de juillet, la bourgeoisie se propose de détruire les soviets
Dans les processus naturels comme dans les processus sociaux, l'évolution ne se fait jamais linéairement mais bien à travers des contradictions, des convulsions, des contretemps dramatiques, des pas en arrière et des bonds en avant. Tout ceci est encore plus évident avec le prolétariat, classe qui, par définition est privée de la propriété des moyens de production et ne dispose d'aucun pouvoir économique. Sa lutte suit un processus convulsif et contradictoire, fait de reculs, de perte apparente de ce qui est qui paraissait acquis à jamais, de longs moments d’apathie et de découragement.
Après la Révolution de Février, les travailleurs et les soldats semblaient voler de succès en succès, le bolchevisme augmentait sans cesse son influence, les masses – surtout celles de la région de Petrograd – allaient vers la révolution. Celle-ci paraissait mûrir comme un fruit.
Toutefois, juillet mit en évidence ces moments de crise et d’hésitation typiques de la lutte prolétarienne. "Une défaite directe fut essuyée par les ouvriers et les soldats de Petrograd qui, dans leur élan en avant, s'étaient heurtés, d'un côté, au manque de clarté et aux contradictions de leurs propres desseins, d'autre part, à l'état arriéré de la province et du front" 3.
La bourgeoisie en profita pour engager une furieuse offensive : les bolcheviks furent calomniés comme agents de l'Allemagne" 4 et arrêtés en masse ; des bandes paramilitaires furent organisées qui les brutalisaient dans la rue, organisaient le boycott de leurs meetings, assaillaient leurs locaux et leurs imprimeries. Les redoutables Cent Noir tsaristes, les cercles monarchiques, les associations officielles reprirent le haut du pavé. La bourgeoisie – avec l’aval des diplomaties anglaise et française – aspirait à détruire les soviets et à implanter une dictature féroce 5.
La révolution entamée en février parvenait à un point où le spectre de la défaite devenait on ne peut plus présent : "Bien des gens crurent que la révolution était en somme arrivée à son point mort. En réalité, c'était la Révolution de Février qui avait tout donné d'elle jusqu'au fond. Cette crise intérieure de la conscience des masses, combinée avec la répression et la calomnie, mena à la perturbation et à des reculades, à des paniques en certains cas. Les adversaires s'enhardirent. Dans la masse elle-même monta à la surface tout ce qu'il y avait d'arriéré, d'inerte, de mécontent, à cause des commotions et des privations" 6.
Les bolcheviks impulsent la riposte des masses
Toutefois, en ce moment difficile, les bolcheviks surent être un bastion essentiel des forces prolétariennes. Poursuivis, calomniés, secoués par de violents débats dans leurs propres rangs et par la démission de bon nombre de militants, ils ne cédèrent pas ni ne tombèrent dans la débandade. Leurs efforts se concentrèrent à tirer les leçons de la défaite et en particulier la leçon essentielle : comment les soviets avaient-ils pu être pris en otage par la bourgeoisie et menacer de disparaître ?
De février à juillet s’était maintenue une situation de double pouvoir : les soviets d'une part et, de l’autre, le pouvoir de l'État bourgeois, qui n'avait pas été détruit et avait encore suffisamment d’atouts pour pouvoir se reconstituer pleinement. Les événements de juillet avaient fait exploser un équilibre impossible entre soviets et pouvoir d'État : "L'état-major général et le commandement supérieur de l'armée, consciemment ou à demi-consciemment, secondés par Kerenski que les socialistes-révolutionnaires, même les plus en vue, traitent maintenant de Cavaignac 7, se sont pratiquement emparés du pouvoir d'État et ont déclenché la répression contre les unités révolutionnaires du front. Ils ont commencé à désarmer les troupes et les ouvriers révolutionnaires de Petrograd et de Moscou, à étouffer et à mater le mouvement de Nijni Novgorod, à arrêter les bolcheviks et à fermer leurs journaux, non seulement sans décision des tribunaux, mais encore sans décret du gouvernement. (…) l'objet véritable de la dictature militaire qui règne aujourd'hui sur la Russie avec l'appui des cadets et des monarchistes : préparer la dissolution des Soviets" 8.
Lénine démontrait également comment les mencheviks et les SR "ont définitivement trahi la cause de la révolution en la livrant aux contre-révolutionnaires et en transformant leurs propres personnes, leurs partis et les Soviets en feuilles de vigne de la contre-révolution". (idem.).
Dans de telles conditions, "Tous les espoirs fondés sur le développement pacifique de la révolution russe se sont à jamais évanouis. La situation objective se présente ainsi : ou la victoire complète de la dictature militaire ou la victoire de l'insurrection armée des ouvriers (…) Le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux Soviets" fut celui du développement pacifique de la révolution qui était possible en avril, mai, juin et jusqu'aux journées du 5 au 9 juillet" (idem).
Dans son livre Les Soviets en Russie, Anweiler 9 utilise ces analyses pour essayer de démontrer que "Ainsi se trouvait pour la première fois érigée en but, sous une forme à peine voilée, la dévolution exclusive du pouvoir aux bolcheviks, but jusqu'alors camouflé sous le mot d'ordre 'tout le pouvoir aux soviets'" 10.
Ici apparaît l'accusation désormais célèbre et maintes fois réitérée selon laquelle Lénine aurait "utilisé les soviets de façons tactique pour conquérir le pouvoir absolu". Une analyse de l'article que Lénine a écrit par la suite démontre toutefois que ses préoccupations étaient radicalement différentes de celles que lui attribue Anweiler : il cherchait comment sortir les soviets de la crise dans laquelle ils se débattaient, comment les tirer du mauvais pas qui conduisait à leur disparition.
Dans l'article "À propos des mots d’ordre", Lénine s’est prononcé sans équivoque : "Après l'expérience de juillet 1917, c'est précisément le prolétariat révolutionnaire qui doit prendre lui-même le pouvoir : hors de là, pas de victoire possible pour la révolution (…) Les Soviets pourront et devront faire leur apparition dans cette nouvelle révolution ; pas les Soviets d'aujourd'hui, pas ces organes d'entente avec la bourgeoisie, mais des organes de lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie. Nous resterons, alors aussi, partisans d'un État bâti sur le type des Soviets, c'est certain. Il ne s'agit pas de disserter sur les Soviets en général, mais de combattre la contre-révolution actuelle et la trahison des Soviets actuels" 11. Plus précisément, il affirme : "Un nouveau cycle commence, où entrent les classes, les partis, les Soviets, non pas anciens, mais rénovés au feu des combats, aguerris, instruits, régénérés à travers la lutte" (idem).
Ces écrits de Lénine s’inscrivaient dans un débat orageux qui traversa les rangs du Parti bolchevique, et se cristallisa lors du VIe Congrès du Parti, qui se tint du 26 juillet au 3 août dans la clandestinité la plus rigoureuse et en l’absence de Lénine et de Trotsky, particulièrement recherchés par la police. Dans ce Congrès, trois positions s’exprimèrent : la première, désorientée par la défaite de juillet et par la dérive des soviets, préconisait ouvertement de "les négliger" (Staline, Molotov, Sokolnikov) ; la seconde plaidait pour maintenir tel quel l'ancien mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets" ; la troisième préconisait de s’appuyer sur les organisations "de base" (conseils d'usines, soviets locaux, soviets de quartiers) pour reconstituer le pouvoir collectif des travailleurs.
A la mi-juillet, les masses commencent à récupérer
Cette dernière position tapait dans le mille. Dès la mi-juillet, les organisations soviétiques "de base" avaient entamé un combat pour la rénovation des soviets.
Dans le deuxième article de cette série, nous avons vu qu'autour des soviets, les masses s’étaient organisées dans un gigantesque réseau d'organisations soviétiques de tout type, qui exprimaient leur unité et leur force 12. Le sommet du réseau soviétique – les soviets des villes – ne flottait pas sur un océan de passivité des masses ; celles-ci, bien au contraire, exprimaient une intense vie collective concrétisée par des milliers d'assemblées, de conseils d’usines, de soviets de quartiers, d’assemblées interdistricts, de conférences, rencontres, meetings… Dans ses Mémoires, Soukhanov 13 nous donne une idée de l'atmosphère qui régnait lors de la Conférence des Conseils d’usine de Petrograd : " Le 30 mai s'ouvrit dans la salle Blanche une conférence des comités de fabrique et d'usine de la capitale et des environs. Cette conférence avait été préparée "à la base" ; son plan avait été mis au point dans les usines sans aucune participation des organismes officiels chargés des questions du travail, ni même des organes du Soviet. (…). La conférence était réellement représentative : des ouvriers venus de leurs établis participèrent en grand nombre et activement à ses travaux. Pendant deux jours, ce Parlement ouvrier discuta de la crise économique et de la débâcle dans le pays" 14
Même aux pires moments qui succédèrent aux journées de juillet, les masses purent conserver ces organisations, qui furent moins touchées par la crise que "les grands organes soviétiques" : le Soviet de Petrograd, le Congrès des soviets et son Comité exécutif, le CEC (Comité exécutif central).
Deux raisons concomitantes expliquent cette différence : d'abord, les organisations soviétiques "d’en bas" étaient directement convoquées sous la pression des masses qui, ressentant des problèmes ou des dangers, appelaient à la tenue d'une assemblée et parvenaient à la tenir en quelques heures. La situation des organes soviétiques "d’en haut" était très différente : "Mais ce qu'il [le Soviet] gagnait en matière de bon fonctionnement, il le perdait sur le plan du contact direct avec une partie considérable des masses. Quasi quotidiennes pendant ses premières semaines d'existence, les séances plénières du Soviet allaient s'espaçant et n'attiraient souvent qu'un nombre restreint de députés. L'Exécutif du soviet s'affranchissait à vue d'œil de la surveillance que les députés étaient censés exercer sur lui." 15
Deuxièmement, mencheviks et SR se concentrèrent dans le noyau bureaucratique des grands organes soviétiques. Soukhanov, décrit l'atmosphère d’intrigues et de manipulations qui émanait du Soviet de Pétrograd : "Le Présidium du Soviet, qui avait été à l'origine un organe de procédure intérieure, tendit à se substituer au Comité exécutif dans ses fonctions, et à le supplanter. En outre, il se renforça d'un organisme permanent et quelque peu occulte qui reçut le nom de "Chambre des Etoiles". On y retrouvait les membres du Présidium et une sorte de camarilla composée d'amis dévoués à Tchkhéidzé et à Tseretelli. Ce dernier, avec tout le déshonneur et toute l'indignité que cela comportait, devint l'un des responsables du dictatorialisme au sein du Soviet." 16
Par contre, les bolcheviks menaient une intervention active et quotidienne dans les organes soviétiques de base. Leur présence était très dynamique, ils étaient souvent les premiers à proposer des assemblées et des débats, l'adoption de résolutions capables de donner une expression à la volonté et à l'avancée des masses.
Le 15 juillet, une manifestation d’ouvriers des grandes usines de Petrograd se concentra devant le bâtiment du Soviet, dénonçant les calomnies contre les bolcheviks et exigeant la libération des prisonniers. Le 20 juillet, l'assemblée de l'usine d'armements de Sestroretsk demandait le règlement des salaires qui avaient été retenus aux ouvriers pour leur participation aux journées de juillet ; ils consacrèrent l’argent récupéré à financer la presse contre la guerre. Trotsky raconte comment, le 24 juillet, "une assemblée des ouvriers de vingt-sept entreprises du district de Peterhof vota une résolution protestant contre le gouvernement irresponsable et sa politique contre-révolutionnaire" 17
Trotsky souligne aussi que le 21 juillet arrivèrent à Petrograd des délégations de soldats du front. Ils étaient las des souffrances qu'ils y avaient vécues et de la répression que les officiers déchaînaient contre les éléments les plus en vue. Ils s’adressèrent au Comité exécutif du Soviet qui n’en fit pas le moindre cas. Plusieurs militants bolcheviques leur conseillèrent alors de prendre contact avec les usines et les régiments de soldats et de marins. L'accueil y fut radicalement différent : ils furent reçus comme des frères, écoutés, nourris et logés. "Dans une conférence que personne d'en haut n'avait convoquée, qui avait surgi d'en bas, il y eut, comme participants, des délégués de vingt-neuf régiments du front, de quatre-vingt-dix usines de Petrograd, de matelots de Kronstadt et des garnisons de la banlieue.
Au centre de la conférence se trouvaient des délégués venus des tranchées; parmi eux, il y avait aussi quelques jeunes officiers. Les ouvriers de Petrograd écoutaient les hommes du front avec avidité, tâchant de ne pas perdre un mot de ce qu'ils disaient. Ceux-ci racontaient comment l'offensive et ses conséquences dévoraient la révolution. D'obscurs soldats, qui n'étaient pas du tout des agitateurs, décrivaient dans des causeries simplistes le traintrain journalier de la vie du front. Ces détails étaient bouleversants, car ils montraient clairement la remontée de tout ce qui était le plus détesté dans le vieux régime", indique Trotsky qui ajoute ensuite : "Bien que, parmi les délégués du front, les socialistes-révolutionnaires fussent vraisemblablement en majorité, une violente résolution bolcheviste fut adoptée presque à l'unanimité : il n'y eut que quatre abstentions. La résolution adoptée ne restera pas lettre morte : une fois séparés, les délégués raconteront la vérité, diront comment ils ont été repoussés par les leaders conciliateurs et comment ils ont été reçus par les ouvriers" (idem).
Le soviet de Kronstadt – un des postes d'avant-garde de la révolution – se fit aussi entendre : "Le 20 juillet, un meeting sur la place de l'Ancre exige la remise du pouvoir aux soviets, l'envoi au front des Cosaques ainsi que des gendarmes et des sergents de ville, l'abolition de la peine de mort, l'admission à Tsarskoié-Sélo de délégués de Kronstadt pour vérifier si Nicolas II, dans sa détention, est suffisamment et rigoureusement surveillé, la dislocation des "Bataillons de la mort", la confiscation des journaux bourgeois, etc." (idem). À Moscou, les conseils d'usine avaient décidé de tenir des sessions communes avec les comités de régiment et, fin juillet, une Conférence de conseils d’usines à laquelle furent invités des délégués des soldats adopta une résolution de dénonciation du gouvernement et la revendication de "nouveaux soviets pour remplacer le gouvernement". Lors des élections, le premier août, six des dix conseils de quartier de Moscou avaient une majorité bolchevique.
Face aux augmentations de prix décidées par le Gouvernement et aux fermetures d'usines organisées par les patrons, grèves et manifestations massives commencèrent à proliférer. Y prenaient part des secteurs de la classe ouvrière jusqu'alors considérés comme "attardés" (papier, tanneries, caoutchouc, concierges, etc.).
Dans la section ouvrière du Soviet de Petrograd, Soukhanov rapporte un fait significatif : "La section ouvrière du Soviet créa un Présidium, qu'elle ne possédait pas auparavant, et ce Présidium se trouva composé de bolcheviks" 18.
En août se tint à Moscou une Conférence nationale dont l'objectif était, comme le dénonce Soukhanov, "d'étouffer l'opinion de "toute la démocratie" à l'aide de l'opinion de "tout le pays", libérant ainsi le gouvernement de "toute la nation" de la tutelle de toutes sortes d'organisations ouvrières, paysannes, zimmerwaldiennes, semi-allemandes, semi-juives, et autres groupes de voyous" 19.
Les travailleurs perçurent le danger et de nombreuses assemblées votèrent des motions proposant la grève générale. Le Soviet de Moscou les rejeta toutefois, par 364 votes contre 304, mais les soviets de quartier protestèrent contre cette décision, "les usines réclamèrent immédiatement de nouvelles élections au soviet de Moscou, qui s'était non seulement laissé distancer par les masses, mais était tombé dans un grave antagonisme avec elles. Dans le soviet de rayon de Zamoskvorietchie (faubourg de Moscou au sud de la Moscova), en accord avec les comités d'usine, on exigea que les députés qui avaient marché 'contre la volonté de la classe ouvrière' fussent remplacés, et cela par cent soixante-quinze voix contre quatre, devant dix-neuf abstentions !" 20 plus de 400 000 travailleurs entrèrent en grève, laquelle s’étendit à d'autres villes comme Kiev, Kostrava et Tsatarin.
La mobilisation et l’auto-organisation des masses fait échouer le coup de Kornilov
Ce que nous venons de rapporter ne constitue qu'un petit nombre de faits significatifs, pointe de l'iceberg d'un processus très vaste qui montre le tournant marqué par rapport aux attitudes qui avaient prédominé de février à juin, plus passives, encore marquée de beaucoup d'illusions et à la mobilisation qui était restée plus restreinte aux lieux de travail, aux quartiers ou à la ville :
– les assemblées unitaires de travailleurs et de soldats, ouvertes à des délégués paysans, prolifèrent. Les conférences de soviets de quartiers et d'usines invitent à leurs travaux des délégués des soldats et des marins ;
– la confiance croissante envers les bolcheviks : calomniés en juillet, l'indignation vis-à-3vis de la persécution dont ils furent victimes, alimente la reconnaissance toujours plus vaste de la validité de leurs analyses et de leurs mots d’ordre ;
– la multiplication de revendications exigeant la rénovation des soviets et la prise du pouvoir.
La bourgeoisie ressent que les succès obtenus en juillet risquent de partir en fumée. L'échec de la Conférence nationale de Moscou a été un coup dur. Les ambassades anglaise et française poussent à prendre des mesures "décisives". C’est dans ce contexte qu’apparaît le "plan" de coup militaire du général Kornilov 21. Soukhanov souligne que "Milioukov, Rodzianko et Kornilov, eux, comprirent ! Frappés de stupeur, ces vaillants héros de la révolution se mirent à préparer d'urgence, mais en secret, leur action. Pour donner le change, ils ameutèrent l'opinion contre une entreprise prochaine des bolcheviks" 22.
Nous ne pouvons pas ici faire une analyse de tous les détails de l'opération 23. L’important est que la mobilisation gigantesque des masses d’ouvriers et de soldats parvint à paralyser la machine militaire déchaînée. Et ce qui est remarquable, c’est que cette réponse eut lieu en développant un effort d'organisation qui donnera le coup de pouce définitif à la régénération des soviets et à leur marche vers la prise du pouvoir.
Dans la nuit du 27 août, le Soviet de Pétrograd proposa la formation d'un Comité militaire révolutionnaire pour organiser la défense de la capitale. La minorité bolchevique accepta la proposition mais ajouta qu'un tel organe "devait s'appuyer sur les masses des ouvriers et des soldats" 24. Au cours de la session suivante, les bolcheviks firent une nouvelle proposition, acceptée à contrecœur par la majorité menchevique, "le partage des armes dans les usines et les quartiers ouvriers" (idem.) chose qui, dès qu'elle fut annoncée, donna lieu à ce que "Dans les quartiers, d'après la presse ouvrière, se formèrent aussitôt "des files impressionnantes d'hommes désireux de faire partie de la Garde rouge". Des cours s'ouvrirent pour le maniement du fusil et le tir. En qualité de moniteurs, on fit venir des soldats expérimentés. Dès le 29, des compagnies (droujiny) se formèrent dans presque tous les quartiers. La Garde rouge se déclara prête à faire avancer immédiatement un effectif comptant quarante mille fusils (…) L'entreprise géante de Poutilov devient le centre de la résistance dans le district de Peterhof. On crée en hâte des droujiny de combat. Le travail dans l'usine marche et jour et nuit : on s'occupe du montage de nouveaux canons pour former des divisions prolétariennes d'artillerie". 25.
A Petrograd, "… les soviets de quartier se resserrèrent entre eux et décidèrent de déclarer la conférence interdistricts ouverte en permanence ; d'introduire leurs représentants dans l'état-major formé par le Comité exécutif ; de créer une milice ouvrière ; d'établir le contrôle des soviets de quartiers sur les commissaires du gouvernement ; d'organiser des équipes volantes pour l'arrestation des agitateurs contre-révolutionnaires" (idem.). Ces mesures "représentaient l'appropriation d'importantes fonctions, non seulement du gouvernement mais même du Soviet de Pétrograd (…) L'entrée des quartiers de Pétrograd dans l'arène de la lutte modifia du coup la direction et l’ampleur de celle-ci. De nouveau se découvrit, par l'expérience, l’inépuisable vitalité de l'organisation soviétique : paralysée d'en haut par la direction des conciliateurs, elle se ranimait, au moment critique, en bas, sous l'impulsion des masses" (idem. souligné par nous)
Cette généralisation de l'auto-l'organisation des masses s’étendit à tout le pays. Trotsky cite le cas de Helsingfors, où "l'assemblée générale de toutes les organisations soviétiques créa un Comité révolutionnaire qui délégua à la maison du général-gouverneur, à la Kommandantur, au contre-espionnage et à d'autres très importantes institutions ses commissaires. Dès lors, sans la signature de ces derniers, pas un ordre n'est valable. Les télégraphes et les téléphones sont pris sous contrôle" (idem), et il se passa un événement très significatif : "Le lendemain, au Comité, se présentent des Cosaques du rang, ils déclarent que tout le régiment est contre Kornilov. Des représentants des Cosaques sont pour la première fois introduits dans le Soviet" (idem).
Septembre 1917 : la rénovation totale des soviets
L’écrasement du coup de Kornilov provoqua une inversion spectaculaire du rapport de forces entre les classes : le Gouvernement provisoire de Kerenski avait été en-dessous de tout. Les masses furent les seuls protagonistes de ces événements, par dessus tout, à travers le renforcement et la revitalisation générale de leurs organes collectifs. La réponse à Kornilov fut "le départ d'une transformation radicale de toute la conjoncture, une revanche sur les Journées de Juillet. Le Soviet pouvait renaître !" 26
Le journal du parti cadet 27, Retch, ne se trompait pas quand il indiquait : "Dans les rues sont déjà présents des multitudes de travailleurs armés qui terrorisent les habitants pacifiques. Dans les soviets, les bolcheviks exigent énergiquement la liberté de leurs camarades emprisonnés. Tout le monde est convaincu qu'une fois terminé le mouvement du général Kornilov, les bolcheviks, rejetés par la majorité du Soviet, emploieront toute leur énergie à l’obliger à suivre, ne serait-ce que partiellement, leur programme". Retch se trompait toutefois sur une chose : ce ne furent pas les bolcheviks qui obligèrent le soviet à suivre leur programme, ce furent les masses qui obligèrent les soviets à adopter le programme bolchevique.
Les ouvriers avaient acquis une énorme confiance en eux-mêmes et ils voulaient l'appliquer à la rénovation totale des soviets. Ville après ville, soviet après soviet, dans un processus vertigineux, les vieilles majorités social-traîtres furent écartées et de nouveaux soviets à majorité bolchevique et autres groupements révolutionnaires (socialistes-révolutionnaires de gauche, mencheviks internationalistes, anarchistes) émergeaient après des débats et des votes massifs.
Soukhanov décrit ainsi l'état d'esprit des travailleurs et des soldats : "Poussés par l'instinct de classe et, dans une certaine mesure, la conscience de classe ; par l'influence idéologique organisée des bolcheviks ; las de la guerre et des charges qui en découlaient ; déçus par la stérilité de la révolution qui ne leur avait encore rien donné ; irrités contre les maîtres et les gouvernants qui jouissaient, eux, de toutes leurs aises ; désireux enfin d'user du pouvoir conquis, ils souhaitaient livrer une bataille décisive" 28.
Les épisodes de cette reconquête et de la rénovation des soviets sont légion. "Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, toujours sous la présidence du même Tchkhéidzé, le Soviet vota pour le pouvoir des ouvriers et des paysans. Les membres de la base des factions conciliatrices soutinrent presque tous la résolution des bolcheviks. La motion concurrente de Tsérételli recueillit une quinzaine de voix. Le présidium conciliateur n'en croyait pas ses yeux. De droite, l'on exigea un vote nominal qui dura jusqu'à trois heures du matin. Pour ne point voter ouvertement contre leurs partis, bien des délégués sortirent. Et pourtant, malgré tous les moyens de pression, la résolution des bolcheviks obtint, après pointage, 279 voix contre 115. C'était un fait de grande importance. C'était le commencement de la fin. Le présidium, abasourdi, déclara qu'il déposait ses pouvoirs" 29.
Le 2 septembre, une Conférence de tous les soviets de Finlande adopte une résolution pour la remise du pouvoir aux soviets, par 700 voix pour, 13 contre et 36 abstentions. La Conférence régionale des soviets de toute la Sibérie approuve une résolution dans le même sens. Le Soviet de Moscou va également dans le même sens le 5 septembre, lors d’une session dramatique, où est approuvée une motion de défiance envers le Gouvernement provisoire et le Comité exécutif. "Le 8, la résolution des bolcheviks est adoptée au Soviet des députés ouvriers de Kiev par une majorité de 130 voix contre 66, bien que la fraction bolcheviste officielle ne comptât que 95 membres" (idem). Pour la première fois, le Soviet de députés paysans de la province de Petrograd choisit un bolchevik comme délégué.
Le moment culminant de ce processus a été la session historique du Soviet de Petrograd, le 9 septembre. D’innombrables réunions dans des usines, les quartiers et les régiments l'avaient préparée. Environ 1000 délégués allèrent à une réunion où le Bureau proposa d’annuler le vote du 31 août. Le vote exprima un résultat qui signifiait le rejet définitif de la politique des social-traîtres : 519 votes contre l’annulation et pour la prise du pouvoir par les soviets, 414 votes pour le présidium et 67 abstentions.
On pourrait penser, en regardant les choses de manière superficielle, que la rénovation des soviets n’a été qu’un simple changement de majorité, celle-ci passant des social-traîtres aux bolcheviks.
Il est certain – et nous le traiterons plus longuement dans le prochain article de cette série – que dans la classe ouvrière et, par conséquent, dans ses partis, pesait encore fortement une vision contaminée par le parlementarisme, selon laquelle la classe choisissait "des représentants qui agissaient en son nom", mais il est important de comprendre que là n’était pas l’essentiel de la rénovation des soviets.
1) La rénovation se construit sur l'énorme réseau de réunions des soviets de base (conseils d'usine, de quartiers, comités de régiment, réunions conjointes). Après le coup de Kornilov, ces réunions se multiplièrent à l'infini. Chaque session de soviet unifiait et donnait une expression décisive à une infinité de réunions préparatoires.
2) Cette auto-organisation des masses fut propulsée de manière consciente et active par les soviets renouvelés. Tandis que les soviets précédents s’autonomisaient et ne convoquaient que de rares sessions massives, les nouveaux convoquaient quotidiennement des sessions ouvertes. Alors que les anciens soviets craignaient et désapprouvaient même les assemblées dans les usines et les quartiers, les nouveaux les convoquaient continuellement. Autour de chaque débat significatif ou important, le soviet appelait à tenir des réunions "à la base" pour adopter une position. Face à la 4e coalition du Gouvernement provisoire (25 septembre) : "Outre la résolution du Soviet de Saint-Pétersbourg refusant de soutenir la nouvelle coalition, une vague de meetings déferla à travers les deux capitales et la province. Des centaines de milliers d'ouvriers et de soldats, protestant contre la formation du nouveau gouvernement bourgeois, s'engagèrent à mener contre lui une lutte résolue et exigèrent le pouvoir les Soviets." 30
3) La multiplication de congrès régionaux de soviets – qui parcourent comme une traînée de poudre tous les territoires russes depuis le milieu de septembre – s'avère spectaculaire. "Durant ces semaines se tiennent de nombreux congrès de soviets locaux et régionaux, dont la composition et le développement reflétaient l'atmosphère politique des masses. Le déroulement du Congrès de Conseils députés ouvriers, soldats et paysans à Moscou dans les premiers jours d'octobre fut significatif de la bolchevisation rapide. Alors qu'au début de la réunion la résolution présentée par les SR, qui s’opposait à la cession du pouvoir aux soviets, recueillait 159 votes contre 132, la fraction bolchevique obtenait trois jours plus tard, lors d’un autre vote, 116 votes contre 97. Dans d'autres congrès de conseils furent aussi acceptées les résolutions bolcheviques, qui exigeaient la prise du pouvoir par les soviets et la destitution du Gouvernement provisoire. A Ekaterinbourg, 120 délégués de 56 Conseils de l'Oural se réunirent le 13 octobre, 95 parmi eux étaient bolcheviks. A Saratov, le Congrès territorial de la région de la Volga rejeta une résolution menchevique-SR et adopta la résolution bolchevique" 31.
Mais il est important de préciser deux éléments qui nous paraissent fondamentaux.
Le premier est le fait que les résolutions bolcheviques obtiennent la majorité signifiait beaucoup plus qu'une simple délégation de vote à un parti. Le Parti bolchevique était le seul parti clairement partisan non seulement de la prise du pouvoir mais mettant en avant une façon concrète de le faire : une insurrection consciemment préparée qui renverserait le Gouvernement provisoire et démonterait le pouvoir de l'État. Tandis que les partis social-traîtres annonçaient qu'ils voulaient obliger les soviets à se faire hara-kiri, tandis que d'autres partis révolutionnaires faisaient des propositions irréalistes ou vagues, seuls les bolcheviks étaient convaincus que "… le Soviet de députés ouvriers et soldats ne peut être qu'un organisme insurrectionnel, qu'un organe du pouvoir révolutionnaire. Sinon les Soviets ne sont que de vains hochets qui conduisent infailliblement à l'apathie, à l'indifférence, au découragement des masses légitimement écoeurées par la répétition perpétuelle de résolutions et de protestations" 32
Il était donc naturel que les masses ouvrières accordent leur confiance aux bolcheviks, non pour leur donner un chèque en blanc, mais comme instrument de leur propre combat qui arrivait à son point culminant : l'insurrection et la prise du pouvoir.
"Le camp de la bourgeoisie s'alarma enfin avec raison. La crise était claire pour chacun. Le mouvement des masses, visiblement, débordait ; l'effervescence dans les quartiers ouvriers de Saint-Pétersburg était manifeste. On n'écoutait que les bolcheviks. Devant le fameux Cirque Moderne, où venaient parler Trotsky, Volodarski, Lounatcharski, on voyait des queues sans fin et des foules que le vaste bâtiment ne pouvait plus contenir. Les agitateurs invitaient à passer des discours aux actes et promettaient le pouvoir au Soviet pour le plus proche avenir." ; c'est ainsi que Soukhanov, pourtant adversaire des bolcheviks, décrivait l'atmosphère régnant à la mi-octobre 33.
Deuxièmement, les faits qui s'accumulent en septembre et octobre révèlent un changement important dans la mentalité des masses. Comme nous l'avons vu dans l'article précédent de la série, le mot d’ordre "Tout le pouvoir aux soviets", énoncé timidement en mars, argumenté théoriquement par Lénine en avril, massivement proclamé lors des manifestations de juin et juillet, avait été jusqu'alors davantage une aspiration qu'un programme d'action consciemment assumé.
Une des raisons de l'échec du mouvement de juillet était que la majorité réclamait que les Soviets "obligent" le Gouvernement provisoire à nommer des "ministres socialistes".
Cette division entre Soviet et Gouvernement révélait une incompréhension évidente de la tâche de la révolution prolétarienne, qui n'est certainement pas de "choisir son gouvernement" et de conserver par conséquent la structure du vieil État, mais bien de détruire l’appareil d'État et d’exercer le pouvoir directement. Dans la conscience des masses, bien que, comme nous le verrons dans un prochain article, la multitude de problèmes nouveaux et les confusions ait été considérable, se faisait jour une compréhension beaucoup plus concrète et précise du mot d’ordre "Tout le pouvoir aux soviets".
Trotsky montre comment, ayant perdu le contrôle du Soviet de Petrograd, les social-traîtres emportèrent tous les moyens à leur disposition, les concentrant dans leur dernier bastion : le CEC : "Le Comité exécutif central supprima en temps voulu au Soviet de Pétrograd les deux journaux qu'il avait créés, tous les services de direction, toutes les ressources financières et techniques, y compris les machines à écrire et les encriers. De nombreuses automobiles qui, depuis les Journées de Février, avaient été mises à la disposition du Soviet, se trouvèrent sans exception livrées à l'Olympe conciliateur. Les nouveaux dirigeants n'avaient ni caisse, ni journal, ni appareils de bureaux, ni moyen de transport, ni porte-plume, ni crayons. Rien que des murs dépouillés et l'ardente confiance des ouvriers et des soldats. Cela se trouva parfaitement suffisant" 34.
Le Comité militaire révolutionnaire, organe soviétique de l'insurrection
Début octobre, une marée de résolutions provenant de soviets du pays tout entier réclame la tenue du Congrès des soviets, reportée constamment par les social-traîtres, dans le but de matérialiser la prise du pouvoir.
Cette orientation constitue une réponse tant à la situation en Russie qu’à la situation internationale. En Russie, les révoltes de paysans se répandent dans presque toutes les régions, la prise des terres est généralisée ; dans les casernes, les soldats désertent et retournent dans leurs villages, manifestant une fatigue croissante face à une situation de guerre inextricable ; dans les usines, les travailleurs doivent faire face au sabotage de la production par une partie des chefs d'entreprise et des cadres supérieurs ; l’ensemble de la société est menacée par la famine, due au désapprovisionnement total et à la pénurie, au coût de la vie qui ne cesse de croître. Sur le front international se multipliaient les désertions, l'insubordination de troupes, les fraternisations entre soldats des deux bords, ;une vague de grèves balaye l’Allemagne, une grève générale explose en août 1917 en Espagne. Le prolétariat russe doit prendre le pouvoir non seulement pour répondre aux problèmes insolubles du pays mais, surtout, pour ouvrir une brèche par laquelle puisse se développer la révolution mondiale contre les souffrances terribles causées par trois années de guerre.
La bourgeoisie utilise ses armes contre la montée révolutionnaire des masses. En septembre, elle tente de tenir une conférence démocratique qui échoue à nouveau, comme celle de Moscou. De leur côté, les social-traîtres font tout leur possible pour retarder le Congrès des soviets, dans le but de maintenir dispersés et désorganisés les soviets de tout le pays et d'éviter ainsi leur unification pour la prise du pouvoir.
Mais l'arme la plus redoutable et qui se précise toujours plus est la tentative de saboter la défense de Petrograd pour que l'armée allemande écrase le bastion le plus avancé de la révolution. Kornilov, le "patriote", avait déjà tenté ce coup en août, quand il abandonna la Riga 35 révolutionnaire à l'invasion des troupes allemandes qui y "rétablirent l'ordre" dans le sang. La bourgeoisie, qui fait de la défense nationale son credo, l’utilise comme pire poison contre le prolétariat, n'hésite pas une seconde à s’allier avec ses pires rivaux impérialistes quand elle voit son pouvoir menacé par l'ennemi de classe.
C'est à partir de cette question de la défense de Petrograd, que les discussions du Soviet aboutirent à la formation d'un Comité militaire révolutionnaire, composé de délégués élus du Soviet de Petrograd, de la Section de soldats de ce Soviet, du Soviet de délégués du Carré baltique, de la Garde rouge, du Comité régional des soviets de la Finlande, de la Conférence des conseils d'usine, du Syndicat ferroviaire et de l'Organisation militaire du Parti bolchevique. À la tête de ce Comité fut nommé Lasimir, un jeune et combatif membre des SR de Gauche. Les objectifs de ce comité concernaient tant la défense de Petrograd que la préparation du soulèvement armé, deux objectifs qui "s'excluaient jusqu'alors l'un l'autre, se rapprochaient maintenant en fait : ayant pris en main le pouvoir, le Soviet devra se charger aussi de la défense militaire de Petrograd" 36.
Le lendemain même fut convoquée une Conférence permanente de toute la garnison de Petrograd et de la région. Avec ces deux organismes, le prolétariat se dotait des moyens pour l'insurrection, moyens nécessaire et indispensable pour la prise du pouvoir.
Dans un précédent article de la Revue internationale, nous avons mis en évidence comment – à l’encontre des légendes tissées par la bourgeoisie qui présente Octobre comme "un coup d'État bolchevique" – l'insurrection a été l’œuvre des soviets et plus concrètement de celui de Pétrograd 37. Les organes qui ont préparé méticuleusement, pas à pas, la défaite armée du Gouvernement provisoire, dernier rempart de l'État bourgeois, furent le Comité militaire révolutionnaire et la Conférence permanente des garnisons. Le CMR obligea le Quartier général de l'armée à soumettre à son aval tout ordre et toute décision, aussi insignifiants soient-ils, le paralysant ainsi totalement. Le 22 octobre, lors d’une assemblée dramatique, le dernier régiment récalcitrant – celui de la forteresse Pierre et Paul- accepta de se soumettre au CMR. Le 23 octobre, lors d’une journée émouvante, des milliers d'assemblées de travailleurs et de soldats s’impliquaient définitivement dans la prise du pouvoir. L’échec et mat exécuté par l'insurrection du 25 octobre, qui occupa le Quartier général et le siège du Gouvernement provisoire, défit les derniers bataillons restés fidèles à celui-ci, arrêta des ministres et des généraux, occupa les centres de communications, et posa ainsi les conditions pour que le lendemain, le Congrès des Soviets de toute les Russies assume la prise du pouvoir 38.
Dans le prochain article de cette série, nous verrons les problèmes gigantesques auxquels les soviets durent faire face après la prise du pouvoir.
C.Mir 6-6-10
1 Revue internationale [65] n [65]o [65] 140 [65]
2 Revue internationale [89] n [89]o [89] 141 [89]
3. Trotsky, Histoire de la Révolution russe, Tome 2, "Les masses exposées aux coups [90]".
4. Voir la réfutation très documentée de cette thèses dans le chapitre "Le mois de la grande calomnie [91]",dans Histoire de la Révolution russe de Trotsky, Tome 2.
5. Le General Knox, chef de la mission anglaise, disait: "Je ne m'intéresse pas au gouvernement de Kerensky, il est trop faible ; il faut une dictature militaire, il faut des Cosaques, ce peuple a besoin du knout ! La dictature est exactement ce qu'il faut." Ainsi s’exprimait le représentant du gouvernement de la plus ancienne démocratie", cité par Trotsky dans "Le soulèvement de Kornilov [92]", Tome 2.
6. Trotsky, Histoire de la Révolution russe, Tome 2, "Les masses exposées aux coups [90]".
7. Cavaignac : général français (1802-1857), sabre-peuple, bourreau de l’insurrection des ouvriers parisiens en 1848.
8. Lénine, "La situation politique (Quatre thèses) [93]", 23 (10) juillet 1917.
9. Cf. références dans le précédent article de cette série.
10. Les soviets en Russie, Le bolchevisme et les conseils de 1917; Expériences tactiques p 214
11. Lénine, "A propos des mots d’ordre [94]", mi-juillet 1917.
12. Voir l’article précédent de cette série [89], le sous-titre "Mars 1917 : un gigantesque réseau de soviets s'étend sur toute la Russie", Revue internationale no 141.
13. Soukhanov, menchevik internationaliste, scission de gauche du menchevisme dans laquelle militait Martov. Il a publié des Mémoires en 7 tomes. Un abrégé La révolution russe a été publié, d'où nous tirons les citations en français, Editions Stock, 1965.
14. Soukhanov, La révolution russe ; Le Triomphe de la réaction ; Autour de la coalition p. 210.
15. Anweiler, op. cit. Les soviets de 1917 ; Le conseil de Petrograd, p. 134
16. Soukhanov, La révolution russe ; Le Triomphe de la réaction ; Dans les profondeurs p. 223.
17. "Les masses exposées aux coups [90]", Trotsky, op. cit.
18. Soukhanov, La révolution russe ; Contre-révolution et désagrégation de la démocratie ; Après le juillet : deuxième et troisième coalitions, page 306.
19. Soukhanov. La honte de Moscou, page 310
20. "Kérensky et Kornilov [95]", Trotsky, Histoire de la révolution russe, Tome 2.
21. Kornilov : militaire assez incompétent qui se fit remarquer par ses constantes défaites sur le front, puis fut encensé par les partis bourgeois et considéré comme un "héros de la Patrie" après les journées de Juillet.
22. Soukhanov, La bourgeoisie unifiée dans l’action, page 312.
23. Voir Trotsky, Histoire de la révolution russe, Tome 2. On peut consulter les chapitres "La contre-révolution relève la tête", "Kérensky et Kornilov", "Le complot de Kérensky" et "Le soulèvement de Kornilov".
24. Soukhanov, La bourgeoisie unifiée dans l’action, page 317
25. Trotsky, La révolution russe, Tome 2, "La bourgeoisie se mesure avec la démocratie [96]".
26. Soukhanov, La bourgeoisie unifiée dans l’action, page 314
27. Le parti cadet : Parti constitutionnel démocrate, principal parti bourgeois de l’époque.
28. Soukhanov, La désagrégation de la démocratie après le soulèvement de Kornilov, page 330
29. Trotsky, La révolution russe, Tome 2, "Marée montante [97]".
30. Soukhanov, La préparation de l’artillerie, page 351
31. Anweiler, op. cit. Le bolchevisme et les conseils de 1917; Bolchevisation des soviets et préparatifs insurrectionnels, p. 228. Dans les pages suivantes, il fait une liste des nombreux congrès régionaux qui couvrirent pratiquement tout l’empire et décidaient dans leur majorité la prise de pouvoir.
32. Lénine. Thèses pour le rapport à la conférence du 8 octobre de l'organisation de Pétersburg. Sur le mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets". 8 octobre 1917.
33. Soukhanov, La préparation de l’artillerie, page 364.
34. La révolution russe, Tome 2, "Marée montante [97]".
35. Capitale de l’Estonie, qui faisait alors partie de l’Empire russe.
36. Trotsky, La révolution russe, Tome 2, "Le Comité militaire révolutionnaire [98]"
37. Voir notre article "La révolution d'Octobre 1917 : œuvre collective du prolétariat", 2e partie, "La prise du pouvoir par les soviets [99]", Revue internationale n° 72, 1er trimestre 1993.
38. Dans notre article "1917, la révolution russe : l'insurrection d'Octobre, une victoire des masses ouvrières [100]", Revue internationale n°91, 4e trimestre 1997, nous développons une analyse détaillée sur la façon dont l'insurrection du prolétariat n'a rien à voir avec une révolte ou une conspiration, quelles sont ses règles et le rôle indispensable que joue en son sein le parti du prolétariat.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [69]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Décadence du capitalisme (VII) : Rosa Luxemburg et les limites de l'expansion du capitalisme
- 4932 lectures
Comme nous l'avons vu dans le précédent article [102] de la série, l'attaque des révisionnistes contre le marxisme s'est centrée sur la théorie de l'inévitabilité du déclin du capitalisme, selon laquelle les contradictions insolubles existant dans les rapports de production capitalistes constitueront une entrave insurmontable au développement des forces productives. Le révisionnisme d'Edouard Bernstein, que Rosa Luxemburg réfuta de façon si lucide dans sa brochure Réforme sociale ou Révolution, se basait en grande partie sur des observations empiriques qui découlaient de la période d'expansion et de prospérité sans précédent que les nations capitalistes les plus puissantes avaient connue au cours des dernières décennies du 19e siècle. Il ne prétendait guère fonder la critique de la vision "catastrophique" de Marx sur une investigation théorique approfondie des théories économiques de ce dernier. Sous bien des aspects, les arguments de Bernstein étaient similaires à ceux qu'ont développé plus tard beaucoup d'experts bourgeois, au cours du boom économique d'après-guerre et, à nouveau, pendant la phase de "croissance" bien plus précaire des premières années du 21e siècle. C'était en gros : le capitalisme fonctionne, donc il fonctionnera toujours.
Mais d'autres économistes de l'époque, qui n'étaient pas encore complètement déconnectés du mouvement ouvrier, cherchèrent à fonder leur stratégie réformiste sur une démarche "marxiste". Tel fut le cas du Russe Tougan-Baranowsky qui publia, en 1901, un livre intitulé Studies in the Theory and History of Commercial Crises in England. A la suite des travaux de Struve et de Boulgakov quelques années auparavant, Tougan-Baranowski faisait partie de ce qu'on appelait "les marxistes légaux" et son étude s'inscrivait dans la réponse de ceux-ci au courant des populistes russes qui voulaient démontrer que le capitalisme serait confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir en Russie ; l'une de ces difficultés consistant en l'insuffisance de marchés pour écouler sa production. Comme Boulgakov, Tougan tenta d'utiliser les schémas de la reproduction élargie de Marx, dans le Volume II du Capital, pour prouver qu'il n'existait pas de problème fondamental de réalisation de la plus-value dans le système capitaliste, qu'il était possible à ce dernier, comme "système clos", d'accumuler indéfiniment et de manière harmonieuse. Rosa Luxemburg résuma ainsi cette tentative : "Sans aucun doute, les marxistes russes «légaux» ont triomphé de leurs adversaires, les "populistes", mais ils ont trop triomphé. Tous les trois, Struve, Boulgakov, Tougan-Baranowsky ont, dans l'ardeur du combat, prouvé plus qu'il ne fallait. Il s'agissait de savoir si le capitalisme en général et le capitalisme russe en particulier était susceptible de se développer et les trois marxistes cités ont si bien démontré cette capacité qu'ils ont même prouvé par leurs théories la possibilité de la durée éternelle du capitalisme."1
La thèse de Tougan suscita une réponse rapide de la part de ceux qui défendaient toujours la théorie marxiste des crises, en particulier du porte-parole de "l'orthodoxie marxiste", Karl Kautsky qui, reprenant les conclusions de Marx, mit notamment en avant le fait que ni les capitalistes, ni les ouvriers ne pouvant consommer l'ensemble de la plus-value produite par le système, ce dernier était alors sans cesse poussé à conquérir de nouveaux marchés en dehors de lui-même :
"Les capitalistes et les ouvriers qu'ils exploitent constituent un marché pour les moyens de consommation produits par l'industrie, marché qui s'agrandit avec l'accroissement de la richesse des premiers et le nombre des seconds, moins vite cependant que l'accumulation du capital et que la productivité du travail, et qui ne suffit pas à lui seul pour absorber les moyens de consommation produits par la grande industrie capitaliste. L'industrie doit chercher des débouchés supplémentaires à l'extérieur de sa sphère dans les professions et les nations qui ne produisent pas encore selon le mode capitaliste. Elle les trouve et les élargit sans cesse, mais trop lentement. Car ces débouchés supplémentaires ne possèdent pas, et de loin, l'élasticité et la capacité d'extension de la production capitaliste.
Depuis le moment où la production capitaliste s'est développée en grande industrie, comme c'était déjà le cas en Angleterre au 19e siècle, elle possède la faculté d'avancer par grands bonds, si bien qu'elle dépasse en peu de temps l'extension du marché. Ainsi chaque période de prospérité qui suit une extension brusque du marché est condamnée à une vie brève, la crise y met un terme inévitable. Telle est en quelques mots la théorie des crises adoptée généralement, pour autant que nous le sachions, par les «marxistes orthodoxes» et fondée par Marx." Kautsky (Neue Zeit n°5, 1902) cité par RL dans la Critique des critiques 2
A peu près à la même époque, en publiant the Theoretical System of Karl Marx 3, un membre de l'aile gauche de l'American Socialist Party, Louis Boudin, a participé au débat avec une analyse similaire et même plus développée, et publiait.
Tandis que Kautsky, comme le souligne Rosa Luxemburg dans L'Accumulation du capital et dans la Critique des critiques (1915), avait posé le problème de la crise en termes de "sous-consommation", et dans le cadre plutôt imprécis de la vitesse relative de l'accumulation et de l'expansion du marché 4, Boudin la situait de façon plus exacte dans le caractère unique du mode de production capitaliste et dans ses contradictions qui l'amenaient au phénomène de surproduction :
"Dans les anciens systèmes esclavagiste et féodal, un problème comme la surproduction n'a jamais existé du fait que la production ayant pour but la consommation familiale, la seule question qui se soit jamais présentée était : quelle part de la production sera attribuée à l'esclave ou au serf et combien ira au propriétaire d'esclave ou au seigneur féodal. Une fois que les parts respectives des deux classes étaient déterminées, chacune procédait à la consommation de sa part sans rencontrer de nouveau problème. En d'autres termes, la question portait toujours sur la façon de diviser les produits et la question de la surproduction ne se posait pas du fait que les produits ne devaient pas être vendus sur le marché mais être consommés par les personnes directement concernées par leur production, en tant que maître ou en tant qu'esclave... Il n'en va pas de même pour notre industrie capitaliste moderne. Il est vrai que toute la production à l'exception de la portion qui va aux ouvriers, va comme par le passé au maître, aujourd'hui au capitaliste. Mais le problème ne se termine pas là du fait que le capitaliste ne produit pas pour lui-même mais pour le marché. Il ne veut pas s'accaparer les biens que produisent les ouvriers mais il veut les vendre et, s'il ne les vend pas, ils n'ont absolument aucune valeur pour lui. Entre les mains du capitaliste, les marchandises vendables sont sa fortune, son capital, mais lorsqu'elles deviennent invendables, toute la fortune contenue dans ses entrepôts de marchandises, fond dès que celles-ci ne sont pas monnayables.
Alors qui va acheter les marchandises à nos capitalistes qui ont introduit de nouvelles machines dans leur production et, de ce fait, grandement augmenté leur production ? Evidemment, d'autres capitalistes peuvent vouloir ces produits mais, quand on considère la production de la société dans son ensemble, que va faire la classe capitaliste de la production accrue que les ouvriers ne peuvent consommer ? Les capitalistes ne peuvent l'utiliser en gardant chacun sa propre production, ni en se l'achetant entre eux. Et cela pour une raison très simple, du fait que la classe capitaliste ne peut utiliser elle-même tout le surproduit que les ouvriers produisent et qu'elle s'approprie en tant que profits de production. C'est déjà exclu par les prémisses mêmes de la production capitaliste à grande échelle et l'accumulation du capital. La production capitaliste à grande échelle implique l'existence de vastes quantités de travail cristallisé sous la forme de chemins de fer, de bateaux à vapeur, d'usines, de machines et d'autres produits manufacturés qui n'ont pas été consommés par les capitalistes et qui représentent leur part ou profit de la production des années précédentes. Comme on l'a déjà établi précédemment, toutes les grandes fortunes de nos rois, princes et barons capitalistes modernes et autres grands dignitaires de l'industrie, avec ou sans titres, consistent en outils sous une forme ou une autre, c'est-à-dire sous une forme non consommable. C'est cette part des profits capitalistes que les capitalistes ont "économisée" et donc non consommée. Si les capitalistes consommaient tout leur profit, il n'y aurait pas de capitalistes dans le sens moderne du mot, il n'y aurait pas d'accumulation de capital. Pour que le capital puisse accumuler, les capitalistes ne doivent en aucune circonstance consommer tout leur profit. Le capitaliste qui le fait, cesse d'être un capitaliste et succombe dans la concurrence avec ses pairs capitalistes. En d'autres termes, le capitalisme moderne présuppose l'habitude d'économiser des capitalistes, c'est à dire que cette part des profits des capitalistes individuels ne doit pas être consommée mais mise de côté pour accroître le capital existant... Il ne peut donc consommer toute sa part du produit manufacturé. Il est donc évident que ni l'ouvrier, ni le capitaliste ne peut consommer l'ensemble du produit accru de la manufacture. Qui donc va l'acheter ?" (traduit de l'anglais par nous)
Boudin essaie ensuite d'expliquer la façon dont le capitalisme traite ce problème. Luxemburg en cite un long passage dans une note de L'Accumulation du capital et le présente comme "une critique brillante" du livre de Tougan 5:
"Le surproduit créé dans les pays capitalistes n'a pas entravé - à quelques exceptions près que nous mentionnerons plus tard - le cours de la production parce que la production a été répartie de façon plus habile dans les différentes sphères ou bien parce que la production de cotonnades a cédé la place à une production de machines mais parce que, à cause du fait que quelques pays se sont transformés plus tôt que d'autres en pays capitalistes, et qu'aujourd'hui encore il reste quelques pays sous-développés du point de vue capitaliste, les pays capitalistes ont à leur disposition un monde véritablement extérieur où ils ont pu exporter les produits qui ne peuvent être consommés par eux-mêmes, que ces produits soient des cotonnades ou des produits sidérurgiques. Ce qui ne veut absolument pas dire que le remplacement des cotonnades par les produits de l'industrie sidérurgique en tant que produits essentiels des pays capitalistes les plus importants serait dénué de signification. Au contraire il est de la plus grande importance, mais sa signification est tout autre que celle que lui prête Tougan-Baranowsky. Elle annonce le début de la fin du capitalisme. Aussi longtemps que les pays capitalistes ont exporté des marchandises pour la consommation, il y avait encore de l'espoir pour le capitalisme de ces pays. Il n'était pas encore question de savoir quelle était la capacité d'absorption du monde extérieur non capitaliste pour les marchandises produites dans les pays capitalistes et combien de temps elle persisterait encore. L'accroissement de la fabrication de machines dans l'exportation des principaux pays capitalistes aux dépens des biens de consommation indique que les territoires qui, autrefois, se trouvaient à l'écart du capitalisme et, pour cette raison, servaient de lieu de décharge pour ses surproduits, sont aujourd'hui entraînés dans l'engrenage du capitalisme et montre encore que leur propre capitalisme se développe et qu'ils produisent eux-mêmes leurs biens de consommation. Aujourd'hui, au stade initial de leur développement capitaliste, ils ont encore besoin de machines produites d'après le mode capitaliste. Mais plus tôt qu'on ne le pense, ils n'en auront plus besoin. Ils produiront eux-mêmes leurs produits sidérurgiques, de même qu'ils produisent dès maintenant leurs cotonnades et leurs principaux biens de consommation. Alors ils cesseront non seulement d'être un lieu d'absorption pour le surproduit des pays capitalistes proprement dits, mais encore ils auront eux-mêmes un surproduit qu'à leur tour ils ne pourront placer que difficilement". (Die Neue Zeit, 25e année, 1e vol., Mathematische Formeln gegen Kart Marx, cité par Luxemburg dans une note du chapitre 23 de L'Accumulation du capital) 6
Boudin va donc plus loin que Kautsky et insiste sur le fait que l'achèvement proche de la conquête du globe par le capitalisme signifie aussi "le début de la fin du capitalisme".
Rosa Luxemburg examine le problème de l'accumulation
A l'époque où ce débat avait lieu, Rosa Luxemburg enseignait à l'école du Parti à Berlin. Y exposant à grands traits l'évolution historique du capitalisme comme système mondial, elle fut amenée à revenir de façon plus approfondie sur les travaux de Marx, à la fois du fait de son intégrité comme professeur et comme militante (elle avait horreur de rabâcher des idées connues en les présentant seulement sous une nouvelle forme mais considérait que c'était la tâche de tout marxiste de développer et d'enrichir la théorie marxiste), et du fait de la nécessité de plus en plus urgente de comprendre les perspectives auxquelles le capitalisme mondial faisait face. En re-examinant Marx, elle avait trouvé beaucoup d'éléments pour soutenir son point de vue selon lequel le problème de la surproduction par rapport au marché constitue une clé pour comprendre la nature transitoire du mode de production capitaliste (voir "Les contradictions mortelles de la société bourgeoise" dans la Revue n°139). Rosa avait parfaitement conscience que les schémas de la reproduction élargie de Marx dans le Volume II du Capital étaient conçus par leur auteur comme un modèle théorique purement abstrait, utilisé pour étudier la question de l'accumulation, qui, pour la clarté de l'argumentation, prenait comme hypothèse une société uniquement composée de capitalistes et d'ouvriers. Il lui semblait néanmoins qu'il en résultait l'idée que le capitalisme pouvait accumuler de façon harmonieuse dans un système clos, disposant de la totalité de la plus-value produite à travers l'interaction mutuelle des deux branches principales de la production (le secteur des biens de production et celui des biens de consommation). Il apparut à Rosa Luxemburg que c'était en contradiction avec d'autres passages de Marx (dans le Volume III du Capital par exemple) qui insistent sur la nécessité d'une expansion constante du marché et, en même temps, établissent une limite inhérente à cette expansion. Si le capitalisme pouvait s'autoréguler, il pouvait y avoir des déséquilibres temporaires entre les branches de la production mais il ne devait pas y avoir de tendance inexorable à produire une masse de marchandises inabsorbables, de crise de surproduction insoluble ; si la tendance du capitalisme à l'accumulation simplement par elle-même générait constamment l'augmentation de la demande nécessaire pour réaliser l'ensemble de la plus-value, alors comment les marxistes pouvaient-ils argumenter, contre les révisionnistes, que le capitalisme était destiné à entrer dans une phase de crise catastrophique qui fournirait les bases objectives de la révolution socialiste ?
A cette question, Luxemburg répondit qu'il était nécessaire de replacer l'ascendance du capitalisme dans son véritable contexte historique. On ne pouvait saisir l'ensemble de l'histoire de l'accumulation capitaliste que comme un processus constant d'interaction avec les économies non capitalistes qui l'entouraient. Les communautés les plus primitives qui vivaient de chasse et de cueillette et n'avaient pas encore produit de surplus social commercialisable n'avaient aucune utilité pour le capitalisme et devaient être balayées à travers des politiques de destruction directe et de génocide (même les ressources humaines de ces communautés tendaient à être inutilisables pour du travail d'esclave). Mais les économies qui avaient développé un surplus commercialisable et où la production de marchandises en particulier était déjà développée en leur sein (comme dans les grandes civilisations d'Inde et de Chine), fournissaient non seulement des matières premières mais d'énormes débouchés pour la production des métropoles capitalistes, permettant au capitalisme des pays centraux de surmonter l'engorgement périodique de marchandises (ce processus est décrit de façon éloquente dans Le Manifeste communiste). Mais comme le souligne aussi Le Manifeste, même quand les puissances capitalistes établies tentèrent de restreindre le développement capitaliste de leurs colonies, ces régions du monde devinrent inéluctablement parties intégrantes du monde bourgeois, ruinant les économies pré-capitalistes et les convertissant aux délices du travail salarié –déplaçant ainsi le problème de la demande additionnelle requise pour l'accumulation à un autre niveau. Ainsi, comme Marx lui-même l'avait annoncé, plus le capitalisme tendait à devenir universel, plus il était destiné à s'effondrer : "L'universalité vers quoi tend sans cesse le capital rencontre des limites immanentes à sa nature, lesquelles, à un certain stade de son développement, le font apparaître comme le plus grand obstacle à cette tendance et le poussent à son autodestruction." (Grundrisse) 7
Cette démarche permit à Rosa Luxemburg de comprendre le problème de l'impérialisme. Le Capital n'avait fait que commencer à traiter la question de l'impérialisme et de ses fondements économiques, question qui, à l'époque où le livre avait été écrit, n'était pas encore devenue le centre des préoccupations des marxistes. Maintenant, ceux-ci étaient confrontés à l'impérialisme non seulement comme une poussée pour la conquête du monde non capitaliste mais, aussi, comme un aiguisement des rivalités inter-impérialistes entre les principales nations capitalistes pour la domination du marché mondial. L'impérialisme était-il une option, une commodité pour le capital mondial, comme l'entendaient beaucoup de ses critiques libéraux et réformistes, ou était-il une nécessité inhérente à l'accumulation capitaliste à un certain stade de sa maturité ? Là encore, les implications étaient vastes car si l'impérialisme n'était qu'une option supplémentaire pour le capital, on pouvait alors argumenter en faveur de politiques plus raisonnables et pacifiques. Luxemburg conclut cependant que l'impérialisme était une nécessité pour le capital – un moyen de prolonger son règne qui l'entraînait aussi inexorablement vers sa ruine.
"L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe. Cependant le champ d'expansion offert à l'impérialisme apparaît comme minime comparé au niveau élevé atteint par le développement des forces productives capitalistes ; il faut tenir compte en effet de la masse énorme du capital déjà accumulé dans les vieux pays capitalistes et qui lutte pour écouler son surproduit et pour capitaliser sa plus-value, et, en outre, de la rapidité avec laquelle les pays pré-capitalistes se transforment en pays capitalistes. Sur la scène internationale, le capital doit donc procéder par des méthodes appropriées. Avec le degré d'évolution élevé atteint par les pays capitalistes et l'exaspération de la concurrence des pays capitalistes pour la conquête des territoires non capitalistes, la poussée impérialiste, aussi bien dans son agression contre le monde non capitaliste que dans les conflits plus aigus entre les pays capitalistes concurrents, augmente d'énergie et de violence. Mais plus s'accroissent la violence et l'énergie avec lesquelles le capital procède à la destruction des civilisations non capitalistes, plus il rétrécit sa base d'accumulation. L'impérialisme est à la fois une méthode historique pour prolonger les jours du capital et le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y mettre objectivement un terme. Cela ne signifie pas que le point final ait besoin à la lettre d'être atteint. La seule tendance vers ce but de l'évolution capitaliste se manifeste déjà par des phénomènes qui font de la phase finale du capitalisme une période de catastrophes." 8
La conclusion essentielle de L'Accumulation du capital était donc que le capitalisme entrait dans "une période de catastrophes". Il est important de noter qu'elle ne considérait pas – comme cela a souvent été dit de façon erronée – que le capitalisme était sur le point de succomber. Elle établit très clairement que le milieu non capitaliste "représente [géographiquement] aujourd'hui encore la plus grande partie du globe" et que des économies non capitalistes existaient non seulement dans les colonies mais dans de grandes parties de l'Europe elle-même 9. Il est certain que l'échelle de ces zones économiques en terme de valeur allait en diminuant relativement à la capacité croissante du capital à générer de nouvelles valeurs. Mais le monde avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir un système de capitalisme pur comme imaginé dans les schémas de la reproduction de Marx :
"Si on le comprend bien, le schéma marxiste de l'accumulation est par son insolubilité même le pronostic exact de l'effondrement économique inévitable du capitalisme, résultat final du processus d'expansion impérialiste, l'expansion se donnant pour but particulier de réaliser ce qui était l'hypothèse de départ de Marx : la domination exclusive et générale du capital.
Ce terme final peut-il être jamais atteint dans la réalité ? Il s'agit à vrai dire d'une fiction théorique, pour la raison précise que l'accumulation du capital n'est pas seulement un processus économique mais un processus politique." 10
Pour Rosa Luxemburg, un monde uniquement constitué de capitalistes et d'ouvriers était "une fiction théorique" mais plus on s'approcherait de ce point, plus le processus d'accumulation deviendrait difficile et désastreux, déchaînant des calamités qui ne seraient pas "simplement" économiques, mais également militaires et politiques. La guerre mondiale qui éclata peu de temps après la publication de L'Accumulation, constituait une confirmation éclatante de ce pronostic. Pour Rosa Luxemburg, il n'y a pas un effondrement purement économique du capitalisme et encore moins un lien automatique, garanti, entre l'effondrement capitaliste et la révolution socialiste. Ce qu'elle annonçait dans son travail théorique était précisément ce qu'allait confirmer l'histoire catastrophique du siècle suivant : la manifestation croissante du déclin du capitalisme comme mode de production, mettant l'humanité face à l'alternative socialisme ou barbarie, et appelant spécifiquement la classe ouvrière à développer l'organisation et la conscience nécessaires au renversement du système et à son remplacement par un ordre social supérieur.
Une tempête de critiques
Rosa Luxemburg pensait que sa thèse n'était pas tellement sujette à controverse, précisément parce qu'elle l'avait fermement basée sur les écrits de Marx et des partisans de sa méthode. Pourtant, elle fut accueillie par un déluge de critiques – non seulement de la part des révisionnistes et des réformistes mais, également, de la part de révolutionnaires comme Pannekoek et Lénine qui, dans ce débat, se trouva non seulement aux côtés des marxistes légaux de Russie mais également des austro-marxistes qui faisaient partie du camp semi-réformiste dans la social-démocratie:
"J'ai lu le nouveau livre de Rosa L'Accumulation du capital. Elle s'embrouille de façon choquante. Elle a distordu Marx. Je suis très content que Pannekoek et Eckstein et O. Bauer l'aient tous condamnée d'un commun accord et exprimé contre elle ce que j'avais dit en 1899 contre les Narodinikis." 11
Le consensus se fit sur l'idée que Luxemburg avait tout simplement mal lu Marx et inventé un problème qui n'existait pas : les schémas de la reproduction élargie montrent que le capitalisme peut en fait accumuler sans aucune limite inhérente dans un monde purement composé d'ouvriers et de capitalistes. Les calculs de Marx sont justes après tout, ça doit donc être vrai. Bauer était un peu plus nuancé : il reconnaissait que l'accumulation ne pouvait avoir lieu que si elle était alimentée par une demande effective croissante, mais il apportait une réponse simple : la population s'accroît, donc il y a plus d'ouvriers, et donc une augmentation de la demande – solution qui revenait au point de départ du problème puisque ces nouveaux ouvriers ne pouvaient toujours consommer que le capital variable qui leur était transféré par les capitalistes. La question essentielle – que maintiennent quasiment tous les critiques de Luxemburg jusqu'à nos jours – est que les schémas de la reproduction montrent en fait qu'il n'existe pas de problème insoluble de réalisation pour le capitalisme.
Luxemburg était très consciente du fait que les arguments développés par Kautsky (ou par Boudin, mais celui-ci était évidemment une figure bien moins connue du mouvement ouvrier) pour défendre au fond la même thèse n'avaient pas provoqué la même indignation :
"Il reste que Kautsky a réfuté en 1902, dans l'ouvrage de Tougan-Baranowsky, exactement les mêmes arguments que ceux que les «experts» opposent aujourd'hui à ma théorie de l'accumulation, et que les «experts» officiels du marxisme attaquent dans mon livre comme une déviation de la foi orthodoxe ce qui n'est que le développement exact, appliqué au problème de l'accumulation, des thèses soutenues par Kautsky il y a quatorze ans contre le révisionniste Tougan-Baranowsky et qu'il appelle "la théorie des crises généralement adoptée par les marxistes orthodoxes"." 12
Pourquoi une telle indignation ? Elle est facile à comprendre venant des réformistes et des révisionnistes qui se préoccupaient avant tout de rejeter la possibilité d'un effondrement du système capitaliste. De la part de révolutionnaires, elle est plus difficile à saisir. Nous pouvons certainement signaler le fait – et il est très significatif du caractère hystérique des réactions- que Kautsky n'avait pas cherché à faire le lien entre ses arguments et les schémas de la reproduction 13 et n'apparut pas, de ce fait, comme un "critique" de Marx. Peut-être ce conservatisme est-il au coeur de beaucoup des critiques portées à Rosa Luxemburg : la vision selon laquelle Le Capital est une sorte de bible qui fournit toutes les réponses pour comprendre l'ascendance et le déclin du mode de production capitaliste – un système fermé en fait ! Luxemburg en revanche défendait avec vigueur que les marxistes devaient considérer Le Capital pour ce qu'il était – une oeuvre de génie mais inachevée, en particulier ses Volumes II et III ; et qui, de toute façon, ne pouvait inclure tous les développements ultérieurs de l'évolution du système capitaliste.
Au milieu de toutes ces réponses scandalisées, il y eut cependant au moins une défense très claire de Luxemburg, écrite au moment des soulèvements de la guerre et de la révolution : "Rosa Luxemburg, marxiste", par le Hongrois Georg Lukàcs, qui était, à ce moment là, un représentant de l'aile gauche du mouvement communiste. L'article de Lukàcs, publié dans le livre Histoire et conscience de classe (1922), commence par souligner la principale considération méthodologique dans la discussion de la théorie de Luxemburg. Il défend l'idée que ce qui distingue fondamentalement la vision prolétarienne de la vision bourgeoise du monde est le fait que, tandis que la bourgeoisie est condamnée par sa position sociale à examiner la société du point de vue d'une unité atomisée, en concurrence, seul le prolétariat peut développer une vision de la réalité comme totalité :
"Ce n'est pas la prédominance des motifs économiques dans l'explication de l'histoire qui distingue de façon décisive le marxisme de la science bourgeoise, c'est le point de vue de la totalité. La domination, déterminante et dans tous les domaines, du tout sur les parties, constitue l'essence de la méthode que Marx a empruntée à Hegel et qu'il a transformée de manière originale pour en faire le fondement d'une science entièrement nouvelle. La séparation capitaliste entre le producteur et le processus d'ensemble de la production, le morcellement du processus du travail en parties qui laissent de côté le caractère humain du travailleur, l'atomisation de la société en individus qui produisent droit devant eux sans plan, sans se concerter, etc., tout cela devait nécessairement avoir aussi une influence profonde sur la pensée, la science et la philosophie du capitalisme. Et ce qu'il y a de fondamentalement révolutionnaire dans la science prolétarienne, ce n'est pas seulement qu'elle oppose à la société bourgeoise des contenus révolutionnaires, mais c'est, au tout premier chef, l'essence révolutionnaire de la méthode même. Le règne de la catégorie de la totalité est le porteur du principe révolutionnaire dans la science."
Il poursuit en montrant que l'absence de cette méthode prolétarienne avait empêché les critiques de Luxemburg de saisir le problème qu'elle avait soulevé dans L'Accumulation du capital :
"... la justesse ou la fausseté de la solution que Rosa Luxemburg proposait au problème de l'accumulation du capital n'était pas le centre du débat conduit par Bauer, Eckstein, etc. On discutait au contraire pour savoir s'il y avait seulement là un problème et l'on contestait avec la dernière énergie l'existence d'un véritable problème. Ce qui peut parfaitement se comprendre, et est même nécessaire du point de vue méthodologique des économistes vulgaires. Car si la question de l'accumulation est d'une part traitée comme un problème particulier de l'économie politique, d'autre part considérée du point de vue du capitaliste individuel, il n'y a là effectivement aucun problème.
Ce refus du problème entier a un lien étroit avec le fait que les critiques de Rosa Luxemburg sont passés distraitement à côté de la partie décisive du livre ("Les conditions historiques de l'accumulation") et, logiques avec eux-mêmes, ont posé la question sous la forme suivante : les formules de Marx qui reposent sur le principe isolant, admis par souci méthodologique, d'une société composée exclusivement de capitalistes et de prolétaires sont-elles justes et quelle en est la meilleure interprétation ? Ce n'était chez Marx qu'une hypothèse méthodologique à partir de laquelle on devait progresser pour poser les questions de façon plus large, pour poser la question quant à la totalité de la société, et c'est ce qui a complètement échappé aux critiques. Il leur a échappé que Marx lui-même a franchi ce pas dans le premier Volume du Capital à propos de ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Ils ont lu – consciemment ou inconsciemment – le fait que justement par rapport à cette question tout Le Capital n'est qu'un fragment interrompu juste à l'endroit où ce problème doit être soulevé, qu'en conséquence Rosa Luxemburg n'a rien fait d'autre que de mener jusqu'au bout, dans le même sens, ce fragment, le complétant conformément à l'esprit de Marx.
Ils ont cependant agi en toute conséquence. Car du point de vue du capitaliste individuel, du point de vue de l'économie vulgaire, ce problème ne doit en effet pas être posé. Du point de vue du capitaliste individuel, la réalité économique apparaît comme un monde gouverné par les lois éternelles de la nature auxquelles il doit adapter son activité. La réalisation de la plus-value et l'accumulation s'accomplissent pour lui sous la forme d'un échange avec les autres capitalistes individuels (à vrai dire, même ici, ce n'est pas toujours le cas, c'est seulement le cas le plus fréquent). Et tout le problème de l'accumulation aussi n'est que le problème d'une des formes des multiples transformations que subissent les formules Argent-Marchandise-Argent et Marchandise-Argent-Marchandise au cours de la production, de la circulation, etc. Ainsi la question de l'accumulation devient pour l'économie vulgaire une question de détail dans une science particulière, et elle n'a pratiquement aucun lien avec le destin du capitalisme dans son ensemble ; sa solution garantit suffisamment l'exactitude des "formules" marxistes qui doivent tout au plus être améliorées –comme chez Otto Bauer – pour être "adaptées à l'époque". Pas plus qu'en leur temps les élèves de Ricardo n'avaient compris la problématique marxiste, Otto Bauer et ses collègues n'ont compris qu'avec ces formules la réalité économique ne peut, par principe, jamais être embrassée puisque ces formules présupposent une abstraction (société considérée comme se composant uniquement de capitalistes et de prolétaires) à partir de la réalité d'ensemble ; ces formules donc ne peuvent servir qu'à dégager le problème, ne sont qu'un tremplin pour poser le vrai problème." 14
Un passage des Grundrisse que Lukàcs ne connaissait pas encore, confirme cette démarche : l'idée que la classe ouvrière constitue un marché suffisant pour les capitalistes est une illusion typique de la vision étroite de la bourgeoisie :
"Nous n'avons pas encore à considérer ici le rapport d'un capitaliste donné aux ouvriers des autres capitalistes. Ce rapport ne fait que révéler l'illusion de chaque capitaliste, mais ne change rien au rapport fondamental capital-travail. Sachant qu'il ne se trouve pas vis-à-vis de son ouvrier dans la situation du producteur face au consommateur, chaque capitaliste cherche à en limiter au maximum la consommation, autrement dit la capacité d'échange, le salaire. Il souhaite, naturellement, que les ouvriers des autres capitalistes consomment au maximum sa propre marchandise ; mais le rapport de chaque capitaliste à ses ouvriers est le rapport général du capital au travail. C'est de là précisément que naît l'illusion que, ses propres ouvriers exceptés, toute la classe ouvrière se compose pour lui de consommateurs et de clients, non d'ouvriers, mais de dépenseurs d'argent. On oublie que, selon Malthus, "l'existence même d'un profit sur n'importe quelle marchandise présuppose une demande extérieure à celle de l'ouvrier qui l'a produite", et que par conséquent "la demande de l'ouvrier lui-même ne peut jamais être une demande adéquate". Etant donné qu'une production en met en mouvement une autre et qu'elle se crée ainsi des consommateurs chez les ouvriers d'un tiers capital, chaque capital a l'impression que la demande de la classe ouvrière, telle qu'elle est posée par la production elle-même, est une "demande adéquate". Cette demande posée par la production elle-même l'incite et doit l'inciter à dépasser les limites proportionnelles où elle devrait produire par rapport aux ouvriers ; d'autre part, si la "demande extérieure à celle des ouvriers eux-mêmes" disparaît ou s'amenuise, la crise éclate." 15
En mettant en question la lettre de Marx, Luxemburg a montré plus que tout autre qu'elle était fidèle à son esprit ; mais il y a bien d'autres écrits de Marx qui pourraient être cités pour défendre l'importance centrale du problème qu'elle souleva.
Dans les prochains articles, nous examinerons comment le mouvement révolutionnaire a cherché à comprendre le processus de déclin du capitalisme tel qu'il s'est déroulé sous ses yeux au cours des décennies tumultueuses de 1914 à 1945.
Gerrard
1 L'Accumulation du capital, chapitre 24 [103].
2 Critique des critiques [104]
3 Parue pour la première fois sous forme de livre publié par Charles Kerr (Chicago) en 1915, cette étude se base sur une série d'articles publiés, de mai 1905 à octobre 1906, dans la revue International Socialist Review.
4. Citation de Rosa Luxemburg : "Ne tenons pas compte de l'ambiguïté des termes de Kautsky, qui appelle cette théorie une explication des crises "par la sous-consommation" ; or une telle explication fait l'objet des railleries de Marx dans le deuxième livre du Capital. Faisons abstraction également du fait que Kautsky ne s'intéresse qu'au problème des crises sans voir, semble-t-il, que l'accumulation capitaliste, en dehors même des variations de la conjoncture, constitue à elle seule un problème. Enfin n'insistons pas sur le caractère vague des affirmations de Kautsky - la consommation des capitalistes et des ouvriers ne croît "pas assez vite" pour l'accumulation, celle-ci a donc besoin d'un "marché supplémentaire" - qui ne cherche pas à saisir avec plus de précision le mécanisme de l'accumulation." (Critique des critiques [104]).
Il est intéressant de noter que tant de critiques de Rosa Luxemburg – y compris ceux qui étaient "marxistes" – l'accusent de sous-consommationisme, alors qu'elle rejette cette notion si explicitement ! Il est évidemment tout à fait exact que Marx argumente à plusieurs occasions que "la raison ultime de toutes les crises réelles est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses" (Le Capital, Volume III, chapitre 30, Ed. La Pléiade, Tome 2, chapitre XVII, page 1206), mais Marx prend soin de préciser qu'il ne se réfère pas "au pouvoir de consommation absolu", mais au "pouvoir de consommation, qui a pour base des conditions de répartition antagoniques qui réduisent la consommation de la grande masse de la société à un minimum variable dans des limites plus ou moins étroites. Il est, en outre, restreint par le désir d'accumuler, la tendance à augmenter le capital et à produire de la plus-value sur une échelle plus étendue." (Le Capital, Volume III, chapitre 15, Ed. La Pléiade, Tome 2, chapitre X, page 1024-25) En d'autres termes, les crises ne résultent pas de la réticence de la société à consommer autant qu'il est physiquement possible, ni du fait que les salaires seraient trop "bas" – ce qu'il faut préciser du fait des nombreuses mystifications à ce sujet qui émanent en particulier de l'aile gauche du capital. Si c'était le cas, on pourrait alors éliminer les crises en augmentant les salaires et c'est précisément ce que Marx ridiculise dans le Volume II du Capital. Le problème réside plutôt dans l'existence de "conditions de répartition antagoniques", c'est à dire dans le rapport du travail salarié lui-même qui doit toujours permettre une "plus-value" en plus de ce que le capitaliste paie aux ouvriers.
5 La principale critique de Luxemburg à Boudin portait sur l'idée apparemment visionnaire selon laquelle les dépenses d'armement constituaient une forme de gaspillage ou de dépenses inconsidérées ; ce point de vue allait à l'encontre de celui de Luxemburg sur "le militarisme, champ d'action du capital", élaboré dans un chapitre du même nom dans L'Accumulation du capital. Mais le militarisme ne pouvait être champ d'accumulation du capital qu'à une époque où existaient des possibilités réelles que la guerre – les conquêtes coloniales pour être exact – ouvrent de nouveaux marchés substantiels pour l'expansion capitaliste. Avec le rétrécissement de ces débouchés, le militarisme devient vraiment un pur gaspillage pour le capitalisme global : même si l'économie de guerre semble fournir une "solution" à la crise de surproduction en faisant tourner l'appareil économique (de façon la plus évidente dans l'Allemagne de Hitler par exemple et pendant la Seconde Guerre mondiale), elle constitue en réalité une immense destruction de valeur.
6 https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1913/rl_accu_k_23.htm [105]
7 Editions La Pléiade, Oeuvres, Tome 2, publié sous le nom de Principes d'une critique de l'économie politique, partie II : "Le capital", "Marché mondial et système de besoins", pages 260-61
8 L'Accumulation du capital, III, 31: "Le protectionnisme et l'accumulation [106]".
9 "En réalité dans tous les pays capitalistes, et même dans ceux où la grande industrie est très développée, il existe, à côté des entreprises capitalistes, de nombreuses entreprises industrielles et agricoles de caractère artisanal et paysan, où règne une économie marchande simple. A côté des vieux pays capitalistes il existe, même en Europe, des pays où la production paysanne et artisanale domine encore aujourd'hui de loin l'économie, par exemple la Russie, les pays balkaniques, la Scandinavie, l'Espagne. Enfin, à côté de l'Europe capitaliste et de l'Amérique du Nord, il existe d'immenses continents où la production capitaliste ne s'est installée qu'en certains points peu nombreux et isolés, tandis que par ailleurs les territoires de ces continents présentent toutes les structures économiques possibles, depuis le communisme primitif jusqu'à la société féodale, paysanne et artisanale." (Critique des critiques, I [104]).
Voir l'article "La surproduction chronique, une entrave incontournable de l'accumulation capitaliste [107]" pour une contribution à la compréhension du rôle joué par les marchés extra-capitalistes dans la période de décadence capitaliste.
10 Critique des critiques, [108] II, V [108].
11. Dans La Genèse du Capital chez Marx (The making of Marx's Capital, Pluto Press, 1977), Roman Rosdolsky fait une excellente critique de l'erreur commise par Lénine en se mettant aux côtés des légalistes russes et des réformistes autrichiens contre Luxemburg (p. 472 édition en anglais). Bien qu'il ait lui aussi des critiques à porter à Luxemburg, il insiste sur le fait que le marxisme est nécessairement une théorie "de l'effondrement" et souligne la tendance à la surproduction identifiée par Marx comme étant la question clé pour la comprendre. En fait, ses critiques à Luxemburg sont assez difficiles à déchiffrer. Il insiste sur le fait que la principale erreur de Luxemburg résidait dans le fait qu'elle ne comprenait pas que les schémas de la reproduction étaient simplement un "dispositif heuristique" et, pourtant, toute l'argumentation de Luxemburg contre ses critiques porte précisément sur le fait que ce schéma ne peut qu'être utilisé comme un dispositif heuristique et non comme une description réelle de l'évolution historique du capital, ni comme une preuve mathématique de la possibilité d'une accumulation illimitée. (p.490, édition anglaise)
12 Critique des critiques, I [104].
13. Plus tard, Kautsky s'aligna lui-même sur la position des austro-marxistes : "Dans son oeuvre majeure, il critique fortement "l'hypothèse" de Luxemburg selon laquelle le capitalisme doit s'effondrer pour des raisons économiques ; il affirme que Luxemburg "est en contradiction avec Marx qui a démontré le contraire dans le deuxième Volume du Capital, c'est-à-dire dans les schémas de la reproduction"." (Rosdolsky, op cit., citant Kautsky dans La conception matérialiste de l'histoire, traduit de l'anglais par nous.)
14 In Histoire et conscience de classe, Les Editions de Minuit, pages 47 et 51-52
15. Grundrisse ou Principes d'une critique de l'économie politique; Ed. La Pléiade, Tome II, "II. Le Capital", p.267-268. Marx explique aussi ailleurs que l'idée selon laquelle les capitalistes eux-mêmes peuvent constituer le marché pour la reproduction élargie, est basée sur une incompréhension de la nature du capitalisme : "Le capital poursuit, en effet, non la satisfaction des besoins, mais l'obtention d'un profit, et sa méthode consiste à régler la masse des produits d'après l'échelle de la production et non celle-ci d'après les produits qui devraient être obtenus ; il y a donc conflit perpétuel entre la consommation comprimée et la production tendant à franchir la limite assignée à cette dernière, et comme le capital consiste en marchandises, sa surproduction se ramène à une surproduction de marchandises. Un phénomène bizarre c'est que les mêmes économistes qui nient la possibilité d'une surproduction de marchandises admettent que le capital puisse exister en excès. Cependant quand ils disent qu'il n'y a pas de surproduction universelle, mais simplement une disproportion entre les diverses branches de production, ils affirment qu'en régime capitaliste la proportionnalité des diverses branches de production résulte continuellement de leur disproportion ; car pour eux la cohésion de la production tout entière s'impose aux producteurs comme une loi aveugle, qu'ils ne peuvent vouloir, ni contrôler. Ce raisonnement implique, en outre, que les pays où le régime capitaliste n'est pas développé consomment et produisent dans la même mesure que les nations capitalistes. Dire que la surproduction est seulement relative est parfaitement exact. Mais tout le système capitaliste de production n'est qu'un système relatif, dont les limites ne sont absolues que pour autant que l'on considère le système en lui-même. Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables ? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation. En résumé toutes les objections que l'on oppose aux phénomènes si tangibles cependant de la surproduction (phénomènes qui se déroulent malgré ces objections), reviennent à dire que les limites que l'on attribue à la production capitaliste n'étant pas des limites inhérentes à la production en général, ne sont pas non plus des limites de cette production spécifique que l'on appelle capitaliste. En raisonnant ainsi on oublie que la contradiction qui caractérise le mode capitaliste de production, réside surtout dans sa tendance à développer d'une manière absolue les forces productives, sans se préoccuper des conditions de production au milieu desquelles se meut et peut se mouvoir le capital."
Le Capital, Volume III, chapitre 15 : "le développement des contradictions immanentes de la loi [109]", 3e partie.- souligné par nous.
Questions théoriques:
- L'économie [80]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (1e partie)
- 2618 lectures
Nous publions ci-après le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (PCR, parti bolchevique) et dont un des leaders les plus en vue fut Miasnikov (cf. note 1 en fin d'article), d'où l'appellation fréquente de "Groupe de Miasnikov". Ce groupe fait partie de ce qu'on appelle la Gauche communiste 1, au même titre que d'autres groupes en Russie même et dans d'autres parties du monde, en Europe en particulier. Les différentes expressions de ce courant trouvent leur origine dans la réaction à la dégénérescence opportuniste des partis de la Troisième Internationale et du pouvoir des soviets en Russie. Il s'agit là une réponse prolétarienne sous la forme de courants de gauche, comme il en avait existé auparavant face au développement de l’opportunisme de la Seconde Internationale.
Notre présentation
En Russie même, dés 1918, apparaissent au sein du parti bolchevique des fractions de gauche 2 expressions de différents désaccords avec la politique de celui-ci 3. C'est en soi une preuve du caractère prolétarien du bolchevisme. Parce qu'il était une expression vivante de la classe ouvrière, la seule classe qui peut faire une critique radicale et continuelle de sa propre pratique, le parti bolchevique a engendré sans cesse des fractions révolutionnaires. A chaque étape de sa dégénérescence, se sont élevées à l'intérieur même du parti des voix qui protestaient, se sont formés des groupes à l'intérieur du parti ou qui s'en séparaient pour dénoncer l'abandon du programme initial du bolchevisme. Ce n'est que quand le parti a finalement été enterré par ses fossoyeurs staliniens qu'il n'a plus secrété de telles fractions. Les communistes de gauche russes étaient tous des bolcheviks. C'étaient eux qui défendaient une continuité avec le bolchevisme des années héroïques de la révolution, alors que ceux qui les ont calomniés, persécutés et exécutés, aussi célèbres qu'ils aient été, rompaient avec l'essence du bolchevisme.
Le retrait de Lénine de la vie politique fut l'un des facteurs qui précipita l'éclatement d'une crise ouverte dans le parti bolchevique. D'un côté, la fraction bureaucratique, un bloc instable constitué initialement par le "triumvirat" Staline, Zinoviev et Kamenev dont le principal ciment était la volonté d'isoler Trotski, parvenait à consolider son emprise sur le parti. Pendant ce temps, Trotski, malgré de considérables hésitations, était contraint d'évoluer vers une position ouvertement oppositionnelle au sein du parti.
En même temps, le régime bolchevique était confronté à de nouvelles difficultés sur le plan économique et social. Pendant l'été 1923, la première crise de "l'économie de marché" instaurée par la NEP menaçait l'équilibre de toute 1’économie. Tout comme la NEP avait été introduite pour contrer l'excessive centralisation par l'Etat du Communisme de guerre qui avait résulté dans la crise de 1921, il devenait évident que la libéralisation de l'économie exposait la Russie à certaines des difficultés les plus classiques de la production capitaliste. Ces difficultés économiques et, par dessus tout, la réponse qu'y apportait le gouvernement – une politique de coupes dans les emplois et les salaires comme dans n'importe quel Etat capitaliste "normal" – aggravaient à leur tour la condition de la classe ouvrière qui se trouvait déjà à la limite de la misère. En août-septembre 1923, des grèves spontanées avaient commencé à s'étendre aux principaux centres industriels.
Le triumvirat qui était avant tout intéressé à la préservation du statu quo, avait commencé à considérer la NEP comme la voie royale au socialisme en Russie ; ce point de vue était théorisé en particulier par Boukharine qui était passé de 1'extrême-gauche du parti à l'extrême-droite et qui a précédé Staline dans la théorie du socialisme en un seul pays quoiqu'à "un rythme d'escargot", à cause du développement d'une économie de marché "socialiste". Trotski, d'un autre côté, avait déjà commencé à demander plus de centralisation et de planification étatique pour répondre aux difficultés économiques du pays. Mais la première prise de position claire de l'opposition émanant de l'intérieur des cercles dirigeants du parti a été la Plate-forme des 46, soumise au Bureau politique en octobre 1923. Les 46 étaient composés à la fois de proches de Trotski comme Piatakov et Préobrajensky, et d'éléments du groupe Centralisme démocratique comme Sapranov, V.Smirnov et Ossinski. Il n'est pas insignifiant que le document ne porte pas la signature de Trotski : la crainte d'être considéré comme faisant partie d'une fraction (alors que les fractions avaient été interdites en 1921) a certainement influencé son attitude. Néanmoins, sa lettre ouverte au Comité central, publiée dans la Pravda de décembre 1923 et sa brochure Cours nouveau exprimaient des préoccupations très similaires à celles de l'opposition et le plaçaient définitivement dans les rangs de celle-ci.
A l'origine, la Plate-forme des 46 était une réponse aux problèmes économiques dans lesquels se trouvait le régime. Elle prenait fait et cause pour une plus grande planification étatique contre le pragmatisme de l'appareil dominant et sa tendance à élever la NEP au rang de principe immuable. Ce devait être un thème constant de l'opposition de gauche autour de Trotski et, comme nous le verrons, pas l'une de ses forces. Plus important était l'avertissement lancé concernant l'étouffement de la vie interne du parti 4.
En même temps, la Plate-forme prenait ses distances avec ce qu'elle appelait des groupes d'opposition "malsains", même si elle considérait ces derniers comme des expressions de la crise du parti. Cela faisait sans aucun doute référence à des courants comme Le Groupe ouvrier autour de Miasnikov et La Vérité ouvrière autour de Bogdanov qui avaient surgi à la même époque. Peu après, Trotski adoptait un point de vue similaire : le rejet de leurs analyses comme trop extrêmes, tout en les considérant en même temps comme des manifestations de la mauvaise santé du parti. Trotski ne voulait pas non plus collaborer avec les méthodes de répression qui avaient pour but d'éliminer ces groupes.
En fait, ces groupes ne peuvent absolument pas être écartés comme des phénomènes "malsains". Il est vrai que La Vérité ouvrière exprimait une certaine tendance au défaitisme et même au menchevisme ; comme la plupart des courants de la Gauche allemande et hollandaise, son analyse de la montée du capitalisme d'Etat en Russie était affaiblie par la tendance à mettre en question la révolution d'Octobre elle-même et à la considérer comme une révolution bourgeoise plus ou moins progressive 5.
Ce n'était pas du tout le cas du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (bolchevique), dirigé par des ouvriers bolcheviques de longue date comme Miasnikov, Kuznetsov et Moiseev. Le groupe se fit d'abord connaître en avril-mai 1923 par la distribution de son Manifeste, juste après le 13e Congrès du parti bolchevique. L'examen de ce texte confirme le sérieux du groupe, sa profondeur et sa perspicacité politiques.
Le texte n'est pas dépourvu de faiblesses. En particulier, il est entraîné dans la "théorie de l'offensive", qui ne voit pas le reflux de la révolution internationale et la nécessité qui en découle de luttes défensives de la classe ouvrière. C'était l'autre face de la médaille par rapport à l'analyse de l'Internationale communiste qui voyait le recul de 1921 mais en tirait des conclusions largement opportunistes. De la même façon, le Manifeste adopte un point de vue erroné sur le fait qu'à l'époque de la révolution prolétarienne, les luttes pour de plus hauts salaires n'auraient plus de rôle positif.
Malgré cela, les forces de ce document pèsent bien plus que ses faiblesses :
- son internationalisme résolu. Contrairement au groupe L'Opposition ouvrière de Kollontaï, il n’y a pas trace de localisme russe dans son analyse. Toute la partie introductive du Manifeste traite de la situation internationale, situant clairement les difficultés de la révolution russe dans le retard de la révolution mondiale, et insistant sur le fait que le seul salut pour la première résidait dans le renouveau de la seconde : "Le travailleur russe (...) a appris à se considérer comme soldat de l'armée mondiale du prolétariat international et à voir dans ses organisations de classe les troupes de cette armée. Chaque fois donc qu'est soulevée la question inquiétante du destin des conquêtes de la révolution d'Octobre, il tourne son regard là-bas, au-delà des frontières où sont réunies les conditions pour une révolution, mais d'où, néanmoins, la révolution ne vient pas."
- sa critique aiguisée de la politique opportuniste du Front unique et du slogan du Gouvernement ouvrier ; la priorité accordée à cette question constitue une confirmation supplémentaire de l'internationalisme du groupe puisqu'il s'agissait avant tout d'une critique de la politique de l'Internationale communiste. Sa position n’était pas non plus teintée de sectarisme : il affirmait la nécessité de l'unité révolutionnaire entre les différentes organisations communistes (comme le KPD et le KAPD en Allemagne) mais rejetait complètement l'appel de l'Internationale à faire bloc avec les traîtres de la social-démocratie et son dernier argument fallacieux selon lequel la révolution russe avait précisément réussi parce que les bolcheviks auraient utilisé de façon intelligente la tactique du front unique : "... la tactique qui devait conduire le prolétariat insurgé à la victoire ne pouvait être celle du front unique socialiste mais celle du combat sanglant, sans ménagement, contre les fractions bourgeoises à la terminologie socialiste confuse. Seul ce combat pouvait apporter la victoire et il en fut ainsi. Le prolétariat russe a vaincu non en s'alliant aux socialistes-révolutionnaires, aux populistes et aux mencheviks, mais en luttant contre eux. (…) Il est nécessaire d'abandonner la tactique du "Front unique socialiste" et d'avertir le prolétariat que "les fractions bourgeoises à la phraséologie socialiste ambiguë" – à l'époque actuelle tous les partis de la Deuxième internationale – marcheront au moment décisif les armes à la main pour la défense du système capitaliste."
- son interprétation des dangers qu'affrontait l'Etat soviétique – la menace du "remplacement de la dictature du prolétariat par une oligarchie capitaliste ". Le Manifeste retrace la montée d'une élite bureaucratique et la perte des droits politiques de la classe ouvrière, et réclame la restauration des comités d'usine et par dessus tout que les soviets prennent la direction de l'économie et de l'Etat. (6)
Pour le Groupe ouvrier, le renouveau de la démocratie ouvrière constituait le seul moyen de contrer la montée de la bureaucratie, et il rejetait explicitement l'idée de Lénine qui voyait dans l'établissement d'une Inspection ouvrière un moyen d'aller de l'avant, alors que ce n’était qu’une tentative de contrôler la bureaucratie par des moyens bureaucratiques.
- son profond sens des responsabilités. Contrairement aux notes critiques ajoutées par le KAPD quand il publia le Manifeste en Allemagne (Berlin, 1924) et qui exprimaient la sentence prématurée de mort de la révolution russe et de l'Internationale communiste de la part de la Gauche allemande, le Groupe ouvrier est très prudent avant de proclamer le triomphe définitif de la contre-révolution en Russie ou la mort de l'Internationale. Pendant la "crise de Curzon" de 1923, au moment où il semblait que la Grande-Bretagne allait déclarer la guerre à la Russie, les membres du Groupe ouvrier s'engagèrent à défendre la république soviétique en cas de guerre et, surtout, il n'y a pas la moindre trace de répudiation de la révolution d'Octobre et de l'expérience bolchevique. En fait, 1'attitude adoptée par le groupe sur son propre rôle correspond très précisément à la notion de fraction de gauche telle qu'elle a été élaborée plus tard par la Gauche italienne en exil. Il reconnaissait la nécessité de s'organiser indépendamment et même clandestinement, mais le nom du groupe (Groupe ouvrier du Parti communiste russe – bolchevique) tout comme le contenu de son Manifeste démontrent qu'il se considérait en totale continuité avec le programme et les statuts du parti bolchevique. Il appelait donc tous les éléments sains au sein du parti, de la direction comme des différents groupements d'opposition comme La Vérité ouvrière, l'Opposition ouvrière et le Centralisme démocratique à se regrouper et à mener une lutte décidée pour régénérer le parti et la révolution. Et sous bien des aspects, c'était une politique bien plus réaliste que l'espoir qu'avaient les "46" de faire abolir le régime de factions dans le parti "en premier lieu" par la faction dominante elle-même.
En somme, il n'y avait rien de malsain dans le projet du Groupe ouvrier, et il n'était pas une simple secte sans influence dans la classe. Des estimations évaluent à environ 200 le nombre de ses membres à Moscou, et il était totalement cohérent quand il disait se trouver aux côtés du prolétariat dans sa lutte contre la bureaucratie. Il chercha donc à mener une intervention politique active dans les grèves sauvages de l'été et de l'automne 1923. En fait, c'est pour cette raison même et à cause de l'influence croissante du groupe au sein du parti que 1'appareil déchaîna sa répression contre lui. Comme il l'avait prévu, Miasnikov subit même une tentative d’assassinat "lors d'une tentative d'évasion". Miasnikov survécut et quoique emprisonné puis forcé à l'exil après s'être échappé, il poursuivit son activité révolutionnaire à l'étranger deux décennies durant. Le groupe en Russie fut plus ou moins disloqué par des arrestations de masse, bien qu'il soit clair dans L'énigme russe, le précieux rapport d'A. Ciliga sur les groupes d'opposition en prison à la fin des années 1920, qu’il ne disparut pas complètement et continua d'influencer "l'extrême-gauche" du mouvement d'opposition. Néanmoins, cette première répression ne présageait vraiment rien de bon : c'était la première fois qu'un groupe ouvertement communiste souffrait directement de la violence de l'Etat sous le régime bolchevique.
Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe
En guise de préface
Tout ouvrier conscient que ne laissent indifférent ni les souffrances et les tourments de sa classe, ni la lutte titanique qu’elle mène, a certainement réfléchi plus d’une fois au destin de notre révolution à tous les stades de son développement. Chacun comprend que son sort est lié de façon très étroite à celui du mouvement du prolétariat mondial.
On lit encore dans le vieux programme social-démocrate que "le développement du commerce crée une liaison étroite entre les pays du monde civilisé" et que "le mouvement du prolétariat devait devenir international, et qu’il est déjà devenu tel".
Le travailleur russe, lui aussi, a appris à se considérer comme soldat de l’armée mondiale du prolétariat international et à voir dans ses organisations de classe les troupes de cette armée. Chaque fois donc qu’est soulevée la question inquiétante du destin des conquêtes de la révolution d’Octobre, il tourne son regard là-bas, au-delà des frontières où sont réunies les conditions pour une révolution mais d’où, néanmoins, la révolution ne vient pas.
Mais le prolétaire ne doit pas se plaindre ni baisser la tête parce que la révolution ne se présente pas à un moment déterminé. Il doit au contraire se poser la question : que faut-il faire pour que la révolution arrive ?
Quand le travailleur russe tourne ses regards vers son propre pays, il voit la classe ouvrière, qui a accompli la révolution socialiste, assumer les plus dures épreuves de la NEP (Nouvelle économie politique) et, face à elle, les héros de la NEP toujours plus gras. Comparant leur situation à la sienne, il se demande avec inquiétude : où allons-nous exactement ?
Il lui vient alors les pensées les plus amères. Il a supporté, lui, le travailleur, la totalité du poids de la guerre impérialiste et de la guerre civile ; il est fêté, dans les journaux russes, comme le héros qui a versé son sang dans cette lutte. Mais il mène une vie misérable, au pain et à l’eau. Par contre, ceux qui se rassasient du tourment et de la misère des autres, de ces travailleurs qui ont déposé leurs armes, ceux-là vivent dans le luxe et la magnificence. Où allons-nous donc ? Qu’adviendra-t-il après ? Est-il vraiment possible que la NEP, de "Nouvelle économie politique", se transforme en Nouvelle exploitation du prolétariat ? Que faut-il faire pour détourner de nous ce péril ?
Quand ces questions se posent à l’improviste au travailleur, il regarde machinalement en arrière afin d’établir un lien entre le présent et le passé, comprendre comment on a pu arriver à une telle situation. Aussi amères et instructives que soient ces expériences, le travailleur ne peut s’y retrouver dans le réseau inextricable des événements historiques qui se sont déroulés sous ses yeux.
Nous voulons l’aider, dans la mesure de nos forces, à comprendre les faits et si possible lui montrer le chemin de la victoire. Nous ne prétendons pas au rôle de magiciens ou de prophètes dont la parole serait sacrée et infaillible ; au contraire nous voulons qu’on soumette tout ce que nous avons dit à la critique la plus aiguë et aux corrections nécessaires.
Aux camarades communistes de tous les pays !
L’état actuel des forces productives dans les pays avancés et particulièrement dans ceux où le capitalisme est hautement développé donne au mouvement prolétarien de ces pays le caractère d’une lutte pour la révolution communiste, pour le pouvoir des mains calleuses, pour la dictature du prolétariat. Ou l’humanité sombrera dans la barbarie en se noyant dans son propre sang en d’incessantes guerres nationales et bourgeoises, ou le prolétariat accomplira sa mission historique : conquérir le pouvoir et mettre fin une fois pour toutes à l’exploitation de l’homme par l’homme, à la guerre entre les classes, les peuples, les nations ; planter le drapeau de la paix, du travail et de la fraternité.
La course aux armements, le renforcement accéléré des flottes aériennes d’Angleterre, de France, d’Amérique, du Japon, etc., nous menacent d’une guerre inconnue jusqu’ici dans laquelle des millions d’hommes périront et les richesses des villes, des usines, des entreprises, tout ce que les ouvriers et les paysans ont créé par un travail épuisant, sera détruit.
Partout, c’est la tâche du prolétariat de renverser sa propre bourgeoisie. Plus vite il le fera dans chaque pays, plus vite le prolétariat mondial réalisera sa mission historique.
Pour en finir avec l’exploitation, l’oppression et les guerres, le prolétariat ne doit pas lutter pour une augmentation de salaire ou une réduction de son temps de travail. Ce fut nécessaire autrefois, mais il faut aujourd’hui lutter pour le pouvoir.
La bourgeoisie et les oppresseurs de toute sorte et de toute nuance sont très satisfaits des socialistes de tous les pays, précisément parce qu’ils détournent le prolétariat de sa tâche essentielle, la lutte contre la bourgeoisie et contre son régime d’exploitation : ils proposent continuellement de petites revendications mesquines sans manifester la moindre résistance à l’assujettissement et à la violence. De cette façon, ils deviennent, à un certain moment, les seuls sauveteurs de la bourgeoisie face à la révolution prolétarienne. La grande masse ouvrière accueille en effet avec méfiance ce que ses oppresseurs lui proposent directement ; mais si la même chose lui est présentée comme conforme à ses intérêts et enrobée de phrases socialistes, alors la classe ouvrière, troublée par ce discours, fait confiance aux traîtres et gaspille ses forces en un combat inutile. La bourgeoisie n’a donc pas et n’aura jamais de meilleurs avocats que les socialistes.
L’avant-garde communiste doit avant tout chasser de la tête de ses camarades de classe toute crasse idéologique bourgeoise et conquérir la conscience des prolétaires pour les conduire à la lutte victorieuse. Mais pour brûler ce bric-à-brac bourgeois, il faut être un des leurs, des prolétaires, partager tous leurs maux et peines. Quand ces prolétaires qui ont jusqu’ici suivi les commis de la bourgeoisie, commencent à lutter, à faire des grèves, il ne faut pas les écarter en les blâmant avec mépris – il faut, au contraire, rester avec eux dans leur lutte en expliquant sans relâche que cette lutte ne sert qu’à la bourgeoisie. De même, pour leur dire un mot de vérité, on est parfois forcé de monter sur un tas de merde (se présenter aux élections) en souillant ses honnêtes souliers révolutionnaires.
Certes, tout dépend du rapport de forces dans chaque pays. Et il se pourrait qu’il ne soit nécessaire ni de se présenter aux élections, ni de participer aux grèves, mais de livrer directement une bataille. On ne peut pas mettre tous les pays dans le même sac. On doit naturellement chercher de toutes les façons à conquérir la sympathie du prolétariat ; mais pas au prix de concessions, d’oublis ou de renoncements aux solutions fondamentales. Celui-là doit être combattu qui, par souci de succès immédiat, abandonne ces solutions, ne guide pas, ne cherche pas à conduire les masses mais les imite, ne les conquiert pas mais se met à leur remorque.
On ne doit jamais attendre l’autre, rester immobile parce que la révolution n’éclate pas simultanément dans tous les pays. On ne doit pas excuser sa propre indécision en invoquant l’immaturité du mouvement prolétarien et encore moins tenir le langage suivant : "Nous sommes prêts pour la révolution et même assez forts ; mais les autres ne le sont pas encore ; et si nous renversons notre bourgeoisie sans que les autres en fassent autant, qu’arrivera-t-il alors ?".
Supposons que le prolétariat allemand chasse la bourgeoisie de son pays et tous ceux qui la servent. Que se produira-t-il ? La bourgeoisie et les social-traîtres fuiront loin de la colère prolétarienne, se tourneront vers la France et la Belgique, supplieront Poincaré et Cie de régler son compte au prolétariat allemand. Ils iront jusqu’à promettre aux Français de respecter le traité de Versailles, leur offrant peut-être en sus la Rhénanie et la Ruhr. C’est-à-dire qu’ils agiront comme le firent et le font encore la bourgeoisie russe et ses alliés sociaux-démocrates. Naturellement, Poincaré se réjouira d’une si bonne affaire : sauver l’Allemagne de son prolétariat, comme le firent les larrons du monde entier pour la Russie soviétique. Malheureusement pour Poincaré et Cie, à peine les ouvriers et les paysans qui composent leur armée auront-ils compris qu’il s’agit d’aider la bourgeoisie allemande et ses alliés contre le prolétariat allemand, qu’ils retourneront leurs armes contre leurs propres maîtres, contre Poincaré lui-même. Pour sauver sa propre peau et celle des bourgeois français, celui-ci rappellera ses troupes, abandonnera à son sort la pauvre bourgeoisie allemande avec ses alliés socialistes, et cela même si le prolétariat allemand a déchiré le traité de Versailles. Poincaré chassé du Rhin et de la Ruhr, on proclamera une paix sans annexion ni indemnité sur le principe de l’autodétermination des peuples. Il ne sera pas difficile pour Poincaré de s’entendre avec Cuno et les fascistes ; mais l’Allemagne des conseils leur brisera les reins. Quand on dispose de la force, il faut s’en servir et non tourner en rond.
Un autre danger menace la révolution allemande, c’est l’éparpillement de ses forces. Dans l’intérêt de la révolution prolétarienne mondiale, le prolétariat révolutionnaire tout entier doit unir ses efforts. Si la victoire du prolétariat est impensable sans rupture décisive et sans combat sans merci contre les ennemis de la classe ouvrière (les social-traîtres de la Deuxième Internationale qui répriment les armes à la main le mouvement révolutionnaire prolétarien dans leur pays – soi-disant libre), cette victoire est impensable sans l’union de toutes les forces qui ont pour but la révolution communiste et la dictature du prolétariat. C’est pourquoi nous, Groupe ouvrier du Parti communiste russe (bolchevique), qui nous comptons, organisationnellement et idéologiquement, parmi les partis adhérant à la IIIe Internationale, nous nous tournons vers tous les prolétaires révolutionnaires communistes honnêtes en les appelant à unir leurs forces pour la dernière et décisive bataille. Nous nous adressons à tous les partis de la IIIe Internationale comme à ceux de la IVe Internationale communiste ouvrière 7, ainsi qu’aux organisations particulières qui n’appartiennent à aucune de ces internationales mais poursuivent notre but commun, pour les appeler à constituer un front uni pour le combat et la victoire.
La phase initiale s’est achevée. Le prolétariat russe, en se fondant sur les règles de l’art révolutionnaire prolétarien et communiste, a abattu la bourgeoisie et ses laquais de toute espèce et de toute nuance (socialistes-révolutionnaires, mencheviks, etc.) qui la défendaient avec tant de zèle. Et bien que beaucoup plus faible que le prolétariat allemand, il a comme vous le voyez repoussé toutes les attaques que la bourgeoisie mondiale dirigeait contre lui à l’incitation des bourgeois, des propriétaires fonciers et des socialistes de Russie.
C’est maintenant au prolétariat occidental qu’il incombe d’agir, de réunir ses propres forces et de commencer la lutte pour le pouvoir. Ce serait évidemment dangereux de fermer les yeux devant les dangers qui menacent la révolution d’Octobre et la révolution mondiale au sein même de la Russie soviétique. L’Union Soviétique traverse actuellement ses moments les plus difficiles : elle affronte tant de déficiences, et d’une telle gravité, qu’elles pourraient devenir fatales au prolétariat russe et au prolétariat du monde entier. Ces déficiences dérivent de la faiblesse de la classe ouvrière russe et de celles du mouvement ouvrier mondial. Le prolétariat russe n’est pas encore en mesure de s’opposer aux tendances qui d’un côté conduisent à la dégénérescence bureaucratique de la NEP et, de l’autre, mettent en grand péril les conquêtes de la révolution prolétarienne russe, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le prolétariat du monde entier est directement et immédiatement intéressé à ce que les conquêtes de la révolution d’Octobre soient défendues contre toute menace. L’existence d’un pays comme la Russie en tant que base de la révolution communiste mondiale est déjà une garantie de victoire et, en conséquence, l’avant-garde de l’armée prolétarienne internationale – les communistes de tous les pays – doit exprimer fermement l’opinion encore muette du prolétariat sur les déficiences et sur les maux dont souffrent la Russie soviétique et son armée de prolétaires communistes, le PCR (bolchevique).
Le Groupe ouvrier du PCR (bolchevique), qui est le mieux informé sur la situation russe, entend commencer l’œuvre.
Nous ne pensons pas qu’en tant que prolétaires communistes, nous ne puissions pas parler de nos défauts sous prétexte qu’il y a, de par le monde, des social-traîtres et des gredins qui pourraient utiliser ce que nous disons contre la Russie soviétique et le communisme. Toutes ces craintes sont sans fondement. Que nos ennemis soient ouverts ou cachés est tout à fait indifférent : ils demeurent ces artisans de malheur qui ne peuvent vivre sans nous nuire, nous, prolétaires et communistes qui voulons nous libérer du joug capitaliste. Que s’ensuit-il ? Devons-nous à cause de cela passer sous silence nos maladies et nos défauts, ne pas en discuter ni prendre des mesures pour les extirper ? Qu’adviendra-t-il si nous nous laissons terroriser par les social-traîtres et si nous nous taisons ? Dans ce cas les choses peuvent aller si loin qu’il ne restera plus que le souvenir des conquêtes de la révolution d’Octobre. Ce serait d’une grande utilité pour les social-traîtres et un coup mortel pour le mouvement communiste prolétarien international. C’est justement dans l’intérêt de la révolution prolétarienne mondiale et de la classe ouvrière que nous, Groupe ouvrier du PCR (bolchevique), commençons sans trembler à poser dans sa totalité la question décisive du mouvement prolétarien international et russe, face à l’opinion des social-traîtres. Nous avons déjà observé que ses défauts peuvent s’expliquer par la faiblesse du mouvement international et russe. La meilleure aide que le prolétariat des autres pays puisse apporter au prolétariat russe, c’est une révolution dans son propre pays ou, au moins, dans un ou deux pays de capitalisme avancé. Même si à l’heure actuelle les forces n’étaient pas suffisantes pour réaliser un tel but, elles seraient dans tous les cas en mesure d’aider la classe ouvrière russe à conserver les positions conquises lors de la révolution d’Octobre, jusqu’à ce que les prolétaires des autres pays se soulèvent et vainquent l’ennemi.
La classe ouvrière russe, affaiblie par la guerre impérialiste mondiale, la guerre civile et la famine, n’est pas puissante, mais devant les périls qui la menacent actuellement, elle peut se préparer à la lutte précisément parce qu’elle a déjà connu ces dangers ; elle fera tous les efforts possibles pour les surmonter et elle y réussira grâce à l’aide des prolétaires des autres pays.
Le Groupe ouvrier du PCR (bolchevique) a donné l’alarme et son appel trouve un large écho dans toute la grande Russie soviétique. Tout ce qui, dans le PCR, pense de façon prolétarienne et honnête se réunit et commence la lutte. Nous réussirons certainement à éveiller dans la tête de tous les prolétaires conscients la préoccupation du sort qui guette les conquêtes de la révolution d’Octobre, mais la lutte est difficile ; on nous a contraints à une activité clandestine, nous opérons dans l’illégalité. Notre Manifeste ne peut être publié en Russie : nous l’avons écrit à la machine et diffusé illégalement. Les camarades qui sont soupçonnés d’adhérer à notre Groupe sont exclus du parti et des syndicats, arrêtés, déportés, liquidés.
A la Douzième Conférence du PCR (bolchevique), le camarade Zinoviev a annoncé, avec l’approbation du parti et des bureaucrates soviétiques, une nouvelle formule pour opprimer toute critique de la part de la classe ouvrière, en disant : "Toute critique à l’égard de la direction du PCR, qu’elle soit de droite ou de gauche, est du menchevisme" (cf. son discours à la XIIe Conférence). Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si les lignes fondamentales de la direction n’apparaissent pas justes à un ouvrier communiste quelconque et que, dans sa simplicité prolétarienne, il commence à les critiquer, on l’exclura du parti et du syndicat, on le livrera à la Guépéou (Tcheka). Le centre du PCR ne veut tolérer aucune critique car il se considère aussi infaillible que le pape de Rome. Nos soucis, les soucis des travailleurs russes au sujet du destin des conquêtes de la révolution d’Octobre, tout cela est déclaré contre-révolutionnaire. Nous, le Groupe ouvrier du PCR (bolchevique), devant le prolétariat du monde entier, déclarons que l’Union soviétique est une des plus grandes conquêtes du mouvement prolétarien international. C’est justement à cause de cela que nous lançons le cri d’alarme, parce que le pouvoir des soviets, le pouvoir du prolétariat, la victoire d’Octobre de la classe ouvrière russe menacent de se transformer en une oligarchie capitaliste. Nous déclarons que nous empêcherons de toutes nos forces la tentative de renverser le pouvoir des soviets. Nous le ferons, bien qu’on nous persécute et nous emprisonne au nom de ce pouvoir des soviets. Si le groupe dirigeant du PCR déclare que nos soucis au sujet de la révolution d’Octobre sont illégaux et contre-révolutionnaires, vous pouvez, prolétaires révolutionnaires de tous les pays et, avant tout, vous qui adhérez à la IIIe Internationale, exprimer votre opinion décisive sur la base de la lecture de notre Manifeste. Camarades, les regards de tous les prolétaires de Russie inquiets à cause des dangers qui menacent le grand Octobre sont dirigés sur vous. Nous voulons qu’à vos réunions vous discutiez de notre Manifeste et que vous insistiez pour que les délégués de vos pays au Ve Congrès de la IIIe Internationale soulèvent la question des fractions à l’intérieur des partis et de la politique du PCR vis-à-vis des soviets. Camarades, discutez de notre Manifeste et faites des résolutions. Sachez, camarades, que vous aiderez ainsi la classe ouvrière de Russie, épuisée et martyrisée, à sauver les conquêtes de la révolution d’Octobre. Notre révolution d’Octobre est une partie de la révolution mondiale !
Au travail camarades !
Vivent les conquêtes de la révolution d’Octobre du prolétariat russe !
Vive la révolution mondiale !
Les deux premières parties du Manifeste s'intitulent Le caractère de la lutte de classe du prolétariat" et "Dialectique de la lutte de classe". Nous avons pris le parti de ne pas les publier ici (bien qu'elles figurent évidemment dans notre livre) dans la mesure où ce sont des rappels de la vision de la marche de l'histoire et du rôle de la lutte de classe au sein de celle-ci telle qu'elle est exposée par Marx, notamment dans le Manifeste communiste de 1848. Il nous est apparu préférable d'entrer directement dans la partie du document qui exprime l'analyse élaborée par le Groupe ouvrier de la période historique à laquelle se confrontait le prolétariat mondial à ce moment-là.
Les Saül et les Paul dans la révolution russe
Tout ouvrier conscient qui a appris les leçons de la révolution, voyait lui-même comment les classes différentes se sont « miraculeusement » transformées de Saül en Paul, de propagandistes de la paix en propagandistes de la guerre civile et vice-versa. Si on se souvient des événements des quinze-vingt dernières années, on se représentera assez clairement ces transformations.
Regardez la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, les prêtres, les socialistes révolutionnaires et les mencheviks. Qui parmi les prêtres et propriétaires fonciers a prôné la guerre civile avant 1917 ? Personne. Mieux, tout en prônant la paix universelle et l’état de grâce, ils ont jeté les gens en prison, les ont fusillés et pendus pour avoir osé faire une telle propagande. Et après Octobre ? Qui prônait et prône jusqu’ici la guerre civile avec tant de passion ? Ces mêmes enfants fidèles du christianisme : les prêtres, les propriétaires fonciers et les officiers.
Et est-ce que la bourgeoisie, représentée par les démocrates constitutionnels, ne fut point jadis partisane de la guerre civile contre l’autocratie ? Souvenez-vous de la révolte à Vyborg. Milioukov ne dit-il pas, du haut de la tribune du gouvernement provisoire : « Nous tenons le drapeau rouge dans nos mains, et on ne pourra nous l’arracher qu’en passant sur nos cadavres ? » A vrai dire, il prononça aussi des paroles bien différentes devant la Douma d’Etat : « Cette loque rouge qui nous blesse les yeux à tous ». Mais on peut dire avec certitude qu’avant 1905, la bourgeoisie était favorable à la guerre civile. Et en 1917, sous le Gouvernement provisoire qui a proclamé avec le plus de virulence « la paix, la paix civile, l’union entre toutes les classes de la société : voilà le salut de la nation ! »? C’étaient eux, la bourgeoisie, les Cadets. Mais après Octobre ? Et qui continue aujourd’hui à crier comme des enragés : « à bas les soviets, à bas les bolcheviks, la guerre, la guerre civile : voilà le salut de la nation ! »? Ce sont eux, les mêmes bons maîtres et « révolutionnaires » pleurnicheurs, qui ont à présent l’air de tigres.
Et les socialistes-révolutionnaires ? N’ont-ils pas en leur temps assassiné Plehve, le grand-duc Serge Alexandrovitch, Bogdanovitch et autres piliers de l’ancien régime ? Et ces révolutionnaires violents n’ont-ils pas appelé à l’union et à la paix civile en 1917, sous le même Gouvernement provisoire ? Oui, ils y ont appelé, et comment ! Et après Octobre ? Sont-ils restés aussi épris de paix ? Que non ! Ils se transformèrent de nouveau en violents... mais r-r-réactionnaires cette fois, et tirèrent sur Lénine. Ils prônent la guerre civile.
Et les mencheviks ? Ils furent partisans d’une insurrection armée avant 1908, d’une journée du travail de 8 heures, d’une réquisition des propriétés foncières, d’une république démocratique et, de 1908 à 1917, se rallièrent à une sorte de « collaboration de classes », pour la liberté des coalitions et les formes légales de lutte contre l’autocratie. Ils ne s’opposèrent pourtant pas au renversement de cette dernière mais certes, non pendant la guerre, car ils sont patriotes, voire « internationalistes » ; avant Octobre 1917, ils prônent la paix civile et, après Octobre, la guerre civile, comme les monarchistes, les Cadets et les socialistes-révolutionnaires.
Est-ce que ce phénomène est propre à nous, les Russes ? Non. Avant le renversement du féodalisme, les bourgeoisies anglaise, française, allemande, etc., prônaient et menaient la guerre civile. Après que le féodalisme fut tombé en poussière et que la bourgeoisie eut pris le pouvoir, elle devint propagatrice de la paix civile, surtout au vu de l’apparition d’un nouveau prétendant au pouvoir, la classe ouvrière qui la combattait à outrance.
Cherchez maintenant où la bourgeoisie est favorable à la guerre civile. Nulle part ! Partout, excepté dans la Russie soviétique, elle prône la paix et l’amour. Et quelle sera son attitude quand le prolétariat aura pris le pouvoir ? Restera-t-elle propagatrice de la paix civile ? Appellera-t-elle à l’union et la paix ? Non, elle se transformera en propagatrice violente de la guerre civile et mènera cette guerre à outrance, jusqu’au bout.
Et nous, prolétaires russes, est-ce que nous faisons exception à cette règle ?
Pas du tout.
Si on prend la même année 1917, nos conseils de députés ouvriers sont-ils devenus des organes de guerre civile ? Oui. Ils prennent d’ailleurs le pouvoir. Voulaient-ils que la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, les prêtres et autres personnes maltraitées par les conseils se révoltent contre eux ? Ne voulaient-ils pas que la bourgeoisie et tous ses grands et petits alliés se soumettent sans résistance ? Oui, ils le voulaient. Le prolétariat était donc pour la guerre civile avant la prise du pouvoir, et contre après sa victoire, pour la paix civile.
Il est vrai que dans toutes ces transformations, il y a beaucoup d’inertie historique. Même à l’époque où tous (des monarchistes aux mencheviks, y inclus les socialistes-révolutionnaires) ont mené la guerre civile contre le pouvoir soviétique, c’était sous le mot d’ordre de « paix civile ». En réalité le prolétariat a voulu la paix, mais a dû appeler encore à la guerre. Même en 1921, dans une des circulaires du Comité central du PCR, s’entrevoit cette incompréhension de la situation : le mot d’ordre de la guerre civile était considéré même en 1921 comme l’indice d’un fort esprit révolutionnaire. Mais on ne peut voir là qu’un cas historique qui n’ébranle pas du tout notre point de vue.
Si actuellement en Russie, en consolidant le pouvoir prolétarien conquis par la révolution d’Octobre, nous prônons la paix civile, tous les éléments prolétariens honnêtes devront cependant s’unir fermement sous le mot d’ordre de guerre civile, sanglante et violente, contre la bourgeoisie du monde entier.
La classe ouvrière voit actuellement avec quelle hystérie les couches exploiteuses de la population des pays bourgeois prônent la paix civile et universelle, l’état de grâce. Il faut donc comprendre dès à présent que si demain, le prolétariat de ces pays bourgeois prend le pouvoir, tous les pacifistes d’aujourd’hui, des propriétaires fonciers jusqu’aux Internationales II et II½, mèneront la guerre civile contre le prolétariat.
Avec toute la force et l’énergie dont nous sommes capables, nous devons appeler le prolétariat de tous les pays à la guerre civile, sanglante et impitoyable ; nous sèmerons le vent, car nous voulons la tempête. Mais avec encore plus de force nous ferons la propagande de la paix civile et universelle, l’état de grâce, partout où le prolétariat aura triomphé et pris le pouvoir.
Les propriétaires fonciers, les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires de tous les pays prôneront quant à eux la paix civile dans tous les pays où règne l’oppression capitaliste, et la guerre civile encore plus cruelle et sanglante partout où le prolétariat aura pris le pouvoir.
Les tâches principales d’aujourd’hui
Le développement des forces productives dans tous les pays a fait en sorte que la phase qui fait du capitalisme lui-même un facteur de destruction de ces mêmes forces touche à sa fin. La guerre mondiale et les événements qui s’ensuivirent, la paix de Versailles, la question des dommages de guerre, Gênes, La Haye, Lausanne, Paris et enfin l’occupation de la Ruhr par la France, auxquels s’ajoutent le chômage immense et la vague des grèves sans fin, montrent explicitement que la dernière heure de l’exploitation capitaliste est déjà arrivée et que les expropriateurs doivent être eux-mêmes expropriés.
La mission historique du prolétariat consiste à sauver l’humanité de la barbarie où l’a plongée le capitalisme. Et il est impossible de l’accomplir par la lutte pour des sous, pour la journée de travail de 8 heures, pour les concessions partielles que le capitalisme peut lui accorder. Non, le prolétariat doit s’organiser fermement en vue de la lutte décisive pour le pouvoir.
Il est des moments où toute propagande en faveur de grèves pour l’amélioration des conditions matérielles du prolétariat dans les pays capitalistes avancés est une propagande nuisible qui entretient le prolétariat dans les illusions, dans l’espoir d’une amélioration réelle de son niveau de vie dans le cadre de la société capitaliste.
Les ouvriers avancés doivent prendre part aux grèves et, si les circonstances le permettent, les diriger. Ils doivent proposer des revendications pratiques pour le cas où la masse prolétarienne espèrerait encore pouvoir améliorer ses conditions en suivant cette voie ; une pareille attitude augmentera leur ascendant sur le prolétariat. Mais ils doivent stipuler fermement que ce n’est pas une voie vers le salut, vers l’amélioration des conditions de vie de la classe ouvrière. S’il était possible d’organiser le prolétariat en vue de la lutte décisive en le soutenant décidément dans tous ses conflits avec le capital, il ne faudrait pas s’en priver. Il vaut mieux se mettre à la tête de ce mouvement et proposer des revendications audacieuses et catégoriques, pratiques et compréhensibles au prolétariat, tout en lui expliquant que s’il ne prend pas le pouvoir, il ne sera pas à même de changer ses conditions d’existence. Ainsi, pour le prolétariat, chaque grève, chaque conflit sera une leçon qui prouvera la nécessité d’une conquête du pouvoir politique et d’une expropriation des expropriateurs.
Ici les communistes de tous les pays doivent adopter la même attitude qu’aux parlements – ils n’y vont pas pour faire un travail positif de législation, mais en vue de la propagande, de la destruction de ces parlements par le prolétariat organisé.
De même, lorsqu’il y a la nécessité de faire la grève pour un sou, pour une heure, il faut y participer, mais pas pour entretenir l’espoir d’améliorer réellement la condition économique ouvrière. Au contraire, il faut dissiper ces illusions, utiliser chaque conflit pour organiser les forces du prolétariat tout en préparant sa conscience à la lutte finale. Jadis, la revendication d’une journée de travail de huit heures avait été révolutionnaire, elle a aujourd’hui cessé de l’être dans tous les pays où la révolution sociale est à l’ordre du jour. Nous abordons ici directement le problème du front uni.
A suivre ….
La suite du Manifeste qui sera publié dans les numéros suivants de la Revue internationale comporte les têtes de chapitre suivantes :
- Le front unique socialiste
- La question du front uni dans le pays où le prolétariat est au pouvoir (démocratie ouvrière)
- La question nationale
- La Nouvelle politique économique (NEP)
- La NEP et la campagne
- La NEP et la politique tout simplement
- La NEP et la gestion de l’industrie
Note de fin de document
1. Gabriel Miasnikov, un ouvrier de l'Oural, s'était distingué dans le parti bolchevique en 1921 quand, tout de suite après le crucial 10e Congrès, il avait réclamé "la liberté de la presse, des monarchistes aux anarchistes inclus", (cité par Carr, The Interregnum). Malgré les efforts de Lénine pour le dissuader de mener un débat sur cette question, il refusa de reculer et fut expulsé du parti au début de 1922. En mars 1923, il se regroupa avec d'autres militants pour fonder le "Groupe Ouvrier du Parti communiste russe (bolchevique)" et celui-ci publia et distribua son Manifeste au XIIe Congrès du PCR. Le groupe commença à faire du travail illégal parmi les ouvriers, appartenant ou non au parti, et semble avoir été présent de façon significative dans la vague de grèves de l'été 1923, en appelant à des manifestations de masses et essayant de politiser un mouvement de classe essentiellement défensif. Son activité dans ces grèves a suffi pour convaincre la Guépéou qu'il représentait une véritable menace et une vague d'arrestations de certains dirigeants porta un coup sévère au groupe. Cependant, il poursuivit son travail clandestin jusqu'au début des années 1930 bien qu'à une échelle réduite. L'histoire ultérieure de Miasnikov est la suivante : de 1923 à 1927, il passe la plupart de son temps en exil ou en prison à cause de ses activités clandestines ; évadé de Russie en 1927, il fuit en Perse et en Turquie (où il connaîtra également la prison) et s'installe définitivement en France en 1930. Durant cette période, il essaie toujours d'organiser son groupe en Russie. A la fin de la guerre, il demande à Staline la permission de retourner en URSS. Staline envoya un avion le chercher. À partir du jour où il retourna dans son pays, on n’a plus eu de nouvelles de lui. Et pour cause ! Il fut, après un jugement secret par un tribunal militaire, fusillé dans une prison de Moscou, le 16 novembre 1945.
1 Lire notre article La gauche communiste et la continuité du marxisme [111].
2 Le CCI a déjà publié en anglais et en russe une brochure La gauche communiste russe dédiée à l'étude des différentes expressions de la Gauche communiste en Russie. Une version est également en préparation en français. La version anglaise incluait le Manifeste du Groupe ouvrier mais, depuis sa publication, une nouvelle version plus complète de ce Manifeste a été exhumée en Russie. C'est cette dernière version (inédite en français) que nous publions aujourd'hui et qui sera intégrée dans la future édition en français.
3.. Lire notre article La Gauche communiste en Russie dans les Revue internationale n°8 [112] et 9 [113].
4.. "Les membres du parti qui ne sont pas satisfaits de telle ou telle décision du comité central, qui ont à l'esprit tel ou tel doute, qui relèvent en privé telle ou telle erreur, telle ou telle irrégularité ou telle ou telle confusion, ont peur d'en parler dans les réunions du parti et ont même peur d'en parler dans une conversation. (...) Aujourd'hui, ce n'est pas le parti, pas ses larges masses, qui promeut et choisit les membres des comités provinciaux et du comité central du Parti communiste de Russie. Au contraire, c’est de plus en plus la hiérarchie du secrétariat du parti qui recrute les membres des conférences et des congrès qui deviennent à leur tour de plus en plus les assemblées exécutives de cette hiérarchie. (...) La position qui s'est créée s'explique par le fait que le régime est la dictature d'une faction au sein du parti. (...) Le régime factionnel doit être aboli et ce doit être fait, en premier lieu, par ceux qui l'ont créé ; il doit être remplacé par un régime d'unité fraternelle et de démocratie interne du parti."
5.. Lire dans la Revue internationale n°8 et 9 l'article La Gauche communiste en Russie, déjà cité.
6.. Cependant, le Manifeste semble aussi défendre que les syndicats doivent devenir des organes de la centralisation de la direction économique – vieille position de l'Opposition ouvrière que Miasnikov avait critiquée en 1921.
7. Il s'agit de la KAI (Internationale des ouvriers communistes, 1921-22) fondée à l'initiative du KAPD, à ne pas confondre avec la IVe Internationale trotskiste.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [114]
La gauche du Parti communiste de Turquie
- 4163 lectures
Le but de cet article est d'introduire la nouvelle édition en anglais de notre brochure sur la gauche du Parti communiste turc (Türkiye Komünist Partisi, TKP) qui sera publiée intégralement dans les prochains numéros de la Revue internationale. La première édition a été publiée en 2008 par le groupe turc Enternasyonalist Komünist Sol (Gauche communiste internationaliste, EKS) qui, à l'époque, avait déjà adopté les positions de base du CCI comme principes et avait commencé à discuter la plateforme du CCI. En 2009, EKS a rejoint le CCI pour former la section de notre organisation en Turquie, publiant Dünya Devrimi (Révolution mondiale).
La nouvelle édition de la traduction en anglais fait suite à la publication d'une nouvelle édition en turc dans laquelle certains aspects de la brochure originale ont été clarifiés par de plus nombreuses références au matériel turc d'origine. Elle comprend également un appendice (publié pour la première fois en turc moderne et en anglais) : la déclaration de fondation du TKP à Ankara en 1920.
Le corps de la brochure présente toujours une certaine difficulté pour le lecteur non turc du fait qu'il fait référence à des événements historiques, bien connus de n'importe quel écolier turc mais très peu sinon pas du tout en dehors de la Turquie. Plutôt que d'alourdir le corps du texte avec des explications qui ne sont pas nécessaires pour le lecteur turc, nous avons choisi d'ajouter quelques notes explicatives dans la version anglaise et de présenter, dans cet article, un bref survol du contexte historique global qui, nous l'espérons, facilitera la lecture sur cette période complexe. 1
Ce survol historique sera lui-même divisé en deux parties : dans la première, nous nous centrerons sur les événements qui ont mené à la création de l'Etat turc et à la formation du TKP ; dans la seconde, nous examinerons les débats qui ont eu lieu autour des fondements théoriques de la politique de l'Internationale communiste envers les mouvements nationaux à l'Est, en particulier tels qu'ils s'expriment dans l'adoption des "Thèses sur la question nationale" au Deuxième Congrès de l'Internationale.
La chute de l'Empire ottoman
La République turque fondée par Mustapha Kemal Atatürk dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale est née sur les ruines de l'Empire ottoman. 2 L'Empire (également connu sous le nom de La Sublime Porte) n'était pas un Etat national mais le résultat d'une série de conquêtes dynastiques qui – au moment de sa plus grande extension au début du 17e siècle – s'étendait jusqu'à Alger sur la côte nord-africaine, comprenait l'Irak, la Syrie, la Jordanie, Israël et le Liban actuels et la plus grande partie de la côte de l'Arabie saoudite, y inclus les villes saintes de La Mecque et de Médine ; sur le continent européen, les Ottomans conquirent la Grèce, les Balkans et la plus grande partie de la Hongrie. Depuis le règne de Selim Le Magnifique au début du 16e siècle, le sultan avait toujours endossé le titre de calife, c'est-à-dire de chef de tout l'Ummah – la communauté islamique. Pour autant qu'une analogie puisse être faite avec l'histoire européenne, les sultans ottomans combinaient donc les attributs temporels et spirituels de l'empereur romain et du pape.
Mais au début du 19e siècle, l'Empire ottoman fut soumis à la pression croissante de l'expansionnisme des Etats capitalistes européens modernes, menant à sa désintégration graduelle. L'Egypte s'en sépara de facto après son invasion par Napoléon en 1798 qui en fut chassé par une alliance des troupes britanniques avec les forces locales ; elle devint un protectorat britannique en 1882. Les troupes françaises conquirent l'Algérie au cours d'une série de conflits sanglants entre 1830 et 1872, tandis que la Tunisie devenait en 1881 un protectorat français. La Grèce gagna son indépendance en 1830 après une guerre menée avec l'aide de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. Ce processus de désintégration se poursuivit jusqu'au début du 20e siècle. En 1908, la Bulgarie déclara son indépendance et l'Autriche-Hongrie officialisa l'annexion de la Bosnie ; en 1911, l'Italie envahit la Libye tandis qu'en 1912, l'armée ottomane était sérieusement bousculée par la Bulgarie, la Serbie et la Grèce au cours de la Première Guerre des Balkans. En réalité, la survie de la Sublime Porte était due, en partie, aux rivalités des puissances européennes dont aucune ne voulait permettre à ses rivaux de profiter de l'effondrement de l'Empire ottoman à ses dépens. Aussi la France et la Grande-Bretagne qui, comme on l'a vu, étaient parfaitement capables de dépouiller l'Empire dans leur intérêt propre, s'unirent pour le protéger des avancées de la Russie au cours de la Guerre de Crimée de 1853-56.
Sur le plan interne, l'Empire ottoman était une mosaïque d'unités ethniques dont la seule cohésion provenait du Sultanat et de l'Etat ottoman lui-même. Le Califat s'appliquait de façon limitée puisque l'Empire comprenait d'importantes populations juives et chrétiennes, sans mentionner toute une variété de sectes musulmanes. Même en Anatolie – la région qui correspond en gros à la Turquie moderne – il n'y avait pas d'unité nationale ou ethnique. La majorité de la population turque, en grande partie composée de paysans travaillant dans des conditions extrêmement arriérées, vivait côte-à-côte avec des Arméniens, des Kurdes, des Azéris, des Grecs et des Juifs. De plus, même si une sorte de capital turc existait, la vaste majorité de la bourgeoisie industrielle et commerçante montante n'était pas turque mais arménienne, juive et grecque, et les autres principaux acteurs économiques relevaient du capital étranger, français ou allemand. La situation en Turquie était ainsi comparable à celle de l'Empire tsariste où un appareil d'Etat despotique et dépassé chapeautait une société civile qui, malgré tous ses aspects arriérés, était néanmoins intégrée dans l'ensemble du capitalisme mondial. Mais, à la différence de la Russie, l'appareil d'Etat ottoman n'était pas basé sur une bourgeoisie nationale dominante économiquement.
Bien que le Sultanat ait fait quelques tentatives de réformes, les expériences de démocratie parlementaire limitée furent de courte durée. Des résultats plus concrets provinrent de la collaboration avec l'Allemagne pour la construction de lignes de chemin de fer reliant l'Anatolie à Bagdad et Al-Hejaz (La Mecque et Médine) ; celles-ci avaient une importance particulière aux yeux de la Grande-Bretagne au cours des années qui précédaient la guerre puisqu'elles pouvaient permettre à l'Empire ottoman et à l'Allemagne de constituer une menace pour les champs de pétrole perses (critiques pour l'approvisionnement de la flotte britannique) d'une part et, de l'autre, envers l'Egypte et le canal de Suez (l’artère du commerce avec l'Inde). La Grande-Bretagne n'était pas non plus enthousiaste face à la demande du Sultan que des officiers allemands entraînent l'armée ottomane à la stratégie et à la tactique modernes.
Pour la jeune génération de révolutionnaires nationalistes qui allaient former le mouvement des "Jeunes Turcs", il était évident que le Sultanat était incapable de répondre à la pression imposée par les puissances impérialistes étrangères, et de construire un Etat moderne et industriel. Cependant le statut minoritaire (à la fois national et religieux) des classes industrielles et marchandes signifiait que le mouvement révolutionnaire national Jeune Turc qui fonda le "Comité d'Union et de Progrès" (CUP, en turc Ýttihat ve Terakki Cemiyeti) en 1906, était en grande partie composé non d'une classe industrielle montante mais d'officiers de l'armée et de fonctionnaires de l'Etat turc frustrés. Au cours de ses premières années, le CUP reçut aussi un soutien considérable de la part des minorités nationales (y compris du parti arménien Dashnak et de la population de Salonique qui se trouve aujourd'hui en Grèce) et, au début du moins, de la Fédération socialiste ouvrière de Avraam Benaroya. Bien que le CUP s'inspirât des idées de la Révolution française et de l'efficacité de l'organisation militaire allemande, il ne pouvait à proprement parler être considéré comme nationaliste puisque son but était de transformer et de renforcer l'Empire ottoman multiethnique. Ce faisant il entra inévitablement en conflit avec les mouvements nationalistes émergents dans les Etats des Balkans et avec la Grèce en particulier.
Le soutien au CUP grandit rapidement dans l'armée, au point que ses membres décidèrent, en 1908, de mener un putsch militaire qui réussit et força le Sultan Abdulhamit à faire appel à un parlement et à accepter des ministres du CUP dans son gouvernement qu'ils dominèrent rapidement. La base populaire du CUP était cependant si limitée qu'il fut rapidement éjecté du pouvoir et ne put rétablir son autorité qu'en occupant militairement la capitale Istanbul. Le Sultan Abdulhamit fut contraint d'abdiquer et fut remplacé par son jeune frère, Mehmet V. L'Empire ottoman, au moins en théorie, était devenu une monarchie constitutionnelle que les Jeunes Turcs espéraient convertir en un Etat capitalisme moderne. Mais le fiasco de la Guerre des Balkans (1912-1913) allait démontrer on ne peut plus clairement l'arriération de l'Empire ottoman par rapport aux puissances plus modernes.
La "révolution Jeune Turque", nom sous lequel on la connaît, établit donc le schéma pour la création de la république turque et aussi pour les Etats qui allaient émerger plus tard de l'effondrement des empires coloniaux : un Etat capitaliste mis en place par l'armée en tant que seule force de la société ayant une cohésion suffisante pour empêcher le pays d'exploser.
Ce serait fastidieux de rendre compte des mésaventures de l'Empire ottoman qui ont suivi son entrée dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne. 3 Il suffit de dire qu'en 1919, l'Empire était vaincu et démantelé : ses possession arabes avaient été réparties entre la Grande-Bretagne et la France tandis que la capitale elle-même était occupée par les troupes alliées. La classe dominante grecque qui avait participé à la guerre aux côtés des Alliés, voyait maintenant une opportunité de réaliser la Megali Idea : une "Grande Grèce" qui incorporerait à l'Etat grec les parties de l'Anatolie qui avaient été grecques du temps d'Alexandre – essentiellement la côte de la mer Egée incluant le grand port d'Izmir et la partie côtière de la mer Noire connue sous le nom de Pontus. 4 Comme ces régions étaient largement peuplées par des Turcs, une telle politique ne pouvait être mise en oeuvre qu'au moyen de pogroms et de nettoyage ethnique. En mai 1919, avec le soutien tacite de la Grande-Bretagne, l'armée grecque occupa Izmir. Le gouvernement ottoman affaibli, entièrement dépendant de la bonne volonté, peu fiable et intéressée, de la Grande-Bretagne et de la France, fut incapable de résister. La résistance allait venir, non du Sultanat discrédité d'Istanbul, mais du plateau central d'Anatolie. C'est là que le "Kémalisme" entra dans l'histoire.
Pratiquement au moment où la Grèce occupait Izmir, Mustapha Kemal Pasha – connu dans l'histoire sous le nom de Kemal Atatürk – quitta Istanbul pour Samsun sur la côte de la Mer Noire ; en tant qu'inspecteur de la 9e armée, ses tâches officielles étaient de maintenir l'ordre et de superviser le démantèlement des armées ottomanes selon l'accord de cessez-le-feu établi avec les alliés. Son but véritable était de galvaniser la résistance nationale contre les puissances d'occupation et, dans les années qui suivirent, Mustapha Kemal allait devenir la figure dirigeante au sein du premier mouvement turc véritablement national qui mena à l'abolition du Sultanat et à la liquidation de l'Empire ottoman, à l'expulsion des armées grecques de l'Anatolie occidentale et à la création de la République turque actuelle en 1922.
La première Assemblée nationale turque se tint à Ankara en 1920. La même année, les événements en Russie commencèrent une nouvelle fois à jouer un rôle important dans l'histoire de la Turquie et réciproquement.
Les deux années qui avaient suivi la révolution d'Octobre avaient été tragiques pour le nouveau pouvoir révolutionnaire : l'Armée rouge avait dû repousser l'intervention directe des puissances capitalistes et mener une guerre civile sanglante contre les armées blanches de Koltchak en Sibérie, de Denikine sur le Don (la région nord-est de la mer Noire) et de Wrangel en Crimée. En 1920, la situation commençait à se stabiliser : des "républiques soviétiques" avaient été créées ou étaient sur le point de l'être à Tachkent, Bokhara, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie. Les troupes britanniques avaient été forcées de quitter Bakou (au cœur de l'industrie pétrolière de la mer Caspienne et le seul centre réellement prolétarien de la région), mais constituaient une menace toujours présente en Perse en en Inde. Dans ces circonstances, la question nationale était d'une importance pressante et immédiate pour le pouvoir soviétique et pour le mouvement ouvrier dont la plus haute expression politique était l'Internationale communiste : les mouvements nationaux constituaient-ils une force de la réaction ou une aide potentielle pour le pouvoir révolutionnaire comme l'avaient été les paysans en Russie ? Comment le mouvement ouvrier devait-il se comporter dans des régions où les ouvriers étaient toujours une minorité ? Que pouvait-on attendre de mouvements comme la Grande Assemblée nationale à Ankara qui semblait au moins avoir en commun avec la Fédération socialiste russe des Républiques soviétiques le même ennemi sous la forme de l'impérialisme britannique et français ?
Le débat sur la question nationale
En 1920, ces questions furent au cœur des débats du Deuxième Congrès de l'IC qui adopta les "Thèses sur la question nationale" et au Premier Congrès des Peuples de l'Orient, connu sous le nom de Congrès de Bakou. Ces événements constituèrent, pour ainsi dire, le contexte théorique des événements en Turquie et c'est d'eux que nous nous occuperons maintenant.
En présentant les "Thèses sur la question nationale", Lénine déclara : "En premier lieu, quelle est l'idée essentielle, fondamentale de nos thèses ? La distinction entre les peuples opprimés et les peuples oppresseurs. (...) A l'époque de l'impérialisme, il est particulièrement important pour le prolétariat et l'Internationale communiste de constater les faits économiques concrets et, dans la solution de toutes les questions coloniales et nationales, de partir non de notions abstraites, mais des réalités concrètes." 5
L'insistance de Lénine sur le fait que la question nationale ne pouvait être comprise que dans le contexte de "l'époque de l'impérialisme " (ce que nous appellerions l'époque de la décadence du capitalisme) était partagée par tous les participants au débat qui suivit. Beaucoup ne partageaient pas, cependant, les conclusions de Lénine et tendaient à poser la question en termes similaires à ceux qu'avait utilisés Rosa Luxemburg 6: "A une époque d'impérialisme sans frein, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne servent que comme moyens de tromperie, à mettre les masses au service de leur ennemi mortel, l'impérialisme.(...) Aucune nation opprimée ne peut gagner sa liberté et son indépendance des mains des Etats impérialistes. (...) Les petites nations dont les classes dominantes sont des appendices de leurs frères de classe des grandes puissances, ne sont que des pions dans le jeu impérialiste des grandes puissances et sont maltraitées pendant la guerre exactement comme les masses ouvrières, dans le seul but d'être sacrifiées sur l'autel des intérêts capitalistes après la guerre." 7
Quand nous étudions les débats sur la question nationale, nous voyons émerger trois positions.
La position de Lénine et les "Thèses sur la question nationale"
La position de Lénine était profondément influencée par la situation de la Russie soviétique sur l'arène mondiale : "...dans la situation internationale d'aujourd'hui, après la guerre impérialiste, les relations réciproques des peuples et tout le système politique mondial sont déterminés par la lutte d'un petit groupe de nations impérialistes contre le mouvement soviétique et les Etats soviétiques, à la tête desquels se trouve la Russie des Soviets. (...) Ce n'est qu'en partant de là que les questions politiques peuvent être posées et résolues d'une façon juste par les partis communistes, aussi bien des pays civilisés que des pays arriérés." 8
Parfois cette position allait jusqu'à rendre la révolution prolétarienne dangereusement dépendante de la révolution nationale en Orient : "La révolution socialiste ne se fera pas simplement, ni principalement, par la lutte du prolétariat de chaque pays contre sa propre bourgeoisie – non, ce sera la lutte de toutes les colonies et de tous les pays opprimés par l'impérialisme, de tous les pays dépendants, contre l'impérialisme." (Traduit de l'anglais par nous) 9
Le danger d'une telle position est précisément qu'elle tend à faire dépendre le mouvement ouvrier de n'importe quel pays et l'attitude de l'IC envers celui-ci non des intérêts de la classe ouvrière internationale et des rapports entre eux des ouvriers des différents pays, mais des intérêts étatique de la Russie soviétique.10 La question de savoir que faire quand les deux types d'intérêts entrent en conflit reste sans réponse. Pour prendre un exemple très concret, que devait être l'attitude des ouvriers et des communistes turcs dans la guerre entre le mouvement nationaliste de Mustapha Kemal et les forces d'occupation grecques ? Le défaitisme révolutionnaire adopté par l'aile gauche des partis communistes turc et grec, ou le soutien à la diplomatie et au militarisme de la Russie soviétique à l'Etat turc naissant avec le point de vue de vaincre la Grèce du fait qu'elle était une arme entre les mains de l'impérialisme britannique ?
La position de Manabendra Nath Roy
Au cours du Deuxième Congrès de l'IC, M.N. Roy 11 présenta des "Thèses complémentaires sur la question nationale" qui furent débattues en commission et présentées avec celles de Lénine pour adoption par le Congrès. Pour Roy, la poursuite de la survie du capitalisme dépendait des "superprofits" venant des colonies. "L'une des sources majeures dont le capitalisme européen tire sa force principale se trouve dans les possessions et dépendance coloniales. Sans le contrôle des marchés étendus et du vaste champ d'exploitation qui se trouvent dans les colonies, les puissances capitalistes d'Europe ne pourraient maintenir leur existence même pendant un temps très court. (...) Le surprofit obtenu par l'exploitation des colonies est le soutien principal du capitalisme contemporain, et aussi longtemps que celui-ci n'aura pas été privé de cette source de surprofit, ce ne sera pas facile à la classe ouvrière européenne de renverser l'ordre capitaliste." 12
Ceci amenait Roy à considérer que la révolution mondiale dépendait de la révolution des masses travailleuses d'Asie. "L'Orient s'éveille ; et qui sait si la formidable marée, celle qui balaiera la structure capitaliste d'Europe occidentale, ne viendra pas de là. Ce n'est pas une lubie fantaisiste, ni un rêve sentimental. Que le succès final de la révolution sociale en Europe dépende largement sinon totalement, d'un soulèvement simultané des masses laborieuses d'Orient est un fait qui peut être scientifiquement prouvé." 13. Cependant, du point de vue de Roy, la révolution en Asie ne dépendait pas d'une alliance du prolétariat avec la paysannerie. Il la considérait comme incompatible avec le soutien au mouvement nationaliste démocratique : "... le fait d'aider à renverser la domination étrangère dans les colonies ne signifie pas qu'on donne adhésion aux aspirations nationalistes de la bourgeoisie indigène ; il s'agit uniquement d'ouvrir la voie au prolétariat qui y est étouffé. (...) On peut constater l'existence dans les pays dépendants de deux mouvements qui chaque jour se séparent de plus en plus. Le premier est le mouvement nationaliste bourgeois-démocratique, qui a un programme d'indépendance politique sous un ordre bourgeois ; l'autre est celui de l'action de masse des paysans et des ouvriers pauvres et ignorants luttant pour leur émancipation de toute espèce d'exploitation". 14 Les objections de Roy amenèrent à retirer du projet de Thèses de Lénine l'idée de soutien aux mouvements "démocratiques bourgeois" et à la remplacer pas le soutien aux mouvements "nationaux révolutionnaires". Le problème réside cependant en ce que la distinction entre les deux restait extrêmement confuse dans la pratique. Qu'est-ce qu'était exactement un mouvement "national révolutionnaire" qui n'était pas également "démocratique bourgeois" ? De quelle façon était-il "révolutionnaire" et comment les caractéristiques d'un tel mouvement "national" pouvaient-elles se réconcilier avec la revendication d'une révolution prolétarienne internationale ? Ces questions ne furent jamais clarifiées par l'IC et leurs contradictions inhérentes ne furent pas résolues.
La position de Sultanzade
Il existait une troisième position, à gauche, dont l'un des porte-parole le plus clair était certainement Sultanzade 15, délégué du Parti communiste perse nouvellement créé. Sultanzade rejetait l'idée selon laquelle des révolutions nationales pouvaient se libérer de leur dépendance vis-à-vis de l'impérialisme ainsi que celle selon laquelle la révolution mondiale dépendait des événements en Orient : "... le destin du communisme à travers le monde dépend-il du succès de la révolution sociale en Orient, comme le camarade Roy vous l'assure ? Certainement pas. Beaucoup de camarades au Turkestan commettent cette erreur. (...) Supposons que la révolution communiste ait commencé en Inde. Les ouvriers de ce pays seraient-ils capables de résister à l'attaque de la bourgeoisie du monde entier sans l'aide d'un grand mouvement révolutionnaire en Angleterre et en Europe ? Evidemment non. L'extinction de la révolution en Chine et en Perse est un clair exemple de cela. (...) Si quelqu'un essayait de procéder selon les Thèses dans des pays qui ont déjà dix ans d'expérience ou plus (...) cela voudrait dire jeter les masses dans les bras de la contre-révolution. Notre tâche est de créer et maintenir un mouvement purement communiste en opposition au mouvement démocratique-bourgeois. Tout autre évaluation des faits pourrait mener à des résultats déplorables." 16
La voix de Sultanzade n'était pas isolée et des points de vue similaires étaient défendus ailleurs. Dans son rapport au Congrès de Bakou, Pavlovitch (qui, selon certaines sources 17, avait travaillé avec Sultanzade sur ce rapport) déclara que si "les séparatistes irlandais atteignaient leur but et réalisaient leur idéal d'un peuple irlandais indépendant, (...) le lendemain, l'Irlande indépendante tomberait sous le joug du capital américain ou de la Bourse française et, peut-être, d'ici un ou deux ans, l'Irlande combattrait la Grande-Bretagne ou un autre Etat en s'étant alliée avec l'un des prédateurs de ce monde à la poursuite de marchés, de mines de charbon, de parts de territoires en Afrique et, une nouvelle fois, des centaines de milliers d'ouvriers britanniques, irlandais, américains et autres mourraient dans cette guerre. (...) L'exemple (...) de la Pologne bourgeoise qui se conduit maintenant comme le bourreau des minorités nationales vivant sur son territoire et sert de gendarme au capitalisme international dans sa lutte contre les ouvriers et les paysans russes ; ou l'exemple des Etats des Balkans - la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro, la Grèce – qui se disputent les dépouilles des nations qui étaient hier encore sous le joug turc et veulent chacun les annexer ; et beaucoup d'autres faits du même genre montrent que la formation des Etats nationaux en Orient où le pouvoir est passé des mains de la domination étrangère qui a été chassée à celles des capitalistes et des propriétaires locaux ne constitue pas en elle-même un grand pas en avant pour ce qui est de l'amélioration de la position des masses du peuple. Dans le cadre du système capitaliste, tout Etat nouvellement formé qui n'exprime pas les intérêts des masses travailleurs mais sert les intérêts de la bourgeoisie constitue un nouvel instrument d'oppression et de coercition, un nouveau facteur de guerre et de violence. (... ) Si la lutte en Perse, en Inde et en Turquie devait mener simplement à la venue au pouvoir des capitalistes et des propriétaires terriens de ces pays avec leurs parlements et leurs sénats nationaux, les masses du peuple n'y auront rien gagné. Tout Etat nouvellement formé serait rapidement entraîné, par le cours même des événements et la logique inéluctable des lois de l'économie capitaliste, dans le cercle vicieux du militarisme et de la politique impérialiste et, après quelques décennies, il y aurait une nouvelle guerre mondiale (...) dans l'intérêt des banquiers et des patrons français, allemands, britanniques, indiens, chinois, perses et turcs (...) Seule la dictature du prolétariat et, de façon générale, des masses ouvrières, libérées de l'oppression étrangère et ayant renversé complètement le capital, apportera aux pays arriérés une garantie que des pays ne deviendront pas – comme c'est le cas des Etats qui se sont formés à partir des fragments de l'Empire austro-hongrois et de la Russie tsariste : la Pologne, la Hongrie blanche, la Tchécoslovaquie, la Géorgie, l'Arménie, ou de ceux formés des fragments de la Turquie, la Grèce de Venizelos et le reste – un nouvel instrument de guerre, de pillage et de coercition." Grigori Safarov (qui allait jouer un rôle important dans le développement du Parti communiste turc) posa le problème plus clairement dans son Problemy Vostoka : "(...) il faut souligner que seul le développement de la révolution en Europe rend la victoire de la révolution agraire paysanne en Orient possible. (...) le système impérialiste des Etats n'offre pas de place à des républiques paysannes. Un nombre insignifiant de cadres de prolétaires et semi-prolétaires ruraux locaux peut entraîner avec eux de larges masses paysannes dans la bataille contre l'impérialisme et les éléments féodaux, mais ceci requiert une situation révolutionnaire internationale qui leur permette de s'allier au prolétariat des pays avancés." 18
Il est sûr que le rapport de Pavlovitch que nous venons de citer n'est pas un modèle de clarté et contient un nombre d'idées contradictoires 19. A un autre endroit du rapport par exemple, il se réfère à "la Turquie révolutionnaire" ("L'occupation de la Thrace et d'Adrianople a pour but d'isoler la Turquie révolutionnaire et la Russie des Balkans révolutionnaires."). Il va même jusqu'à reprendre une suggestion des "camarades turcs" (probablement le groupe autour de Mustafa Suphi) selon qui "la question des Dardanelles doit être décidée par les Etats qui bordent la mer Noire, sans la participation de Wrangel 20, ni de l'Entente", et continue en disant : "Nous saluons chaleureusement cette idée dont la réalisation constituerait une première étape décisive vers une fédération de tous les peuples et de tous les pays qui bordent la mer Noire." (op. cité) Cela montre que les révolutionnaires de l'époque étaient confrontés, dans la pratique et dans des conditions extrêmement difficiles, à des problèmes nouveaux qui n'avaient pas de solution facile. Dans une telle situation, une certaine confusion était probablement inévitable.
Remarquons au passage cependant, que ces positions "de gauche" n'étaient pas mises en avant par des intellectuels occidentaux ni des révolutionnaires en chambre mais, précisément, par ceux qui devaient mettre en pratique la politique de l'IC.
La question nationale dans la pratique
Il faut souligner que les positions que nous avons fait ressortir ici de façon plutôt schématique n'existaient pas comme un seul bloc. L'IC était confrontée à des questions et à des problèmes qui étaient entièrement nouveaux : le capitalisme dans son ensemble était encore à un tournant, un moment charnière entre sa période d'ascendance triomphale et "l'époque des guerres et des révolutions" (pour utiliser l'expression de l'IC) ; l'opposition entre la bourgeoisie et le prolétariat trouvait son expression dans une opposition entre le pouvoir soviétique et les Etats capitalistes ; et les communistes d'Orient devaient "s'adapter à des conditions spécifiques que n'avaient pas connues les pays européens." 21
Il faut dire que face à ces nouvelles questions, les dirigeants de l'IC faisaient parfois preuve d'une naïveté surprenante. Voici ce que déclare Zinoviev au Congrès de Bakou : "Nous pouvons soutenir une politique démocratique telle qu'elle prend forme actuellement en Turquie et qui fera peut-être son apparition demain dans d'autres pays. Nous soutenons et nous soutiendrons les mouvements nationaux comme celui de Turquie, de Perse, d'Inde et de Chine (...), la tâche de ce mouvement (national actuel) est d'aider l'Orient à se libérer de l'impérialisme britannique. Mais nous avons notre propre tâche à mener, non moins grande – aider les travailleurs d'Orient dans leur lutte contre les riches et les aider, ici et maintenant, à construire leurs propres organisations communistes, (...) à les préparer à une réelle révolution du travail." 22 Zinoviev ne faisait rien d'autre que reprendre le Rapport de Lénine sur la question nationale au 2e Congrès de l'IC : "en tant que communistes, nous ne soutiendrons les mouvements bourgeois de libération dans les pays coloniaux que si ces mouvements sont vraiment révolutionnaires et si leurs représentants ne s'opposent pas à l'entraînement et l'organisation de la paysannerie d'une façon révolutionnaire." (op. cité)
En effet, la politique défendue par Zinoviev – et qu'au début, le pouvoir soviétique allait chercher à mettre en pratique – s'appuyait sur l'idée que les mouvements nationaux accepteraient le pouvoir soviétique comme allié tout en permettant que les communistes aient les mains libres pour les renverser. Mais les dirigeants nationalistes comme Mustapha Kemal n'étaient ni idiots ni aveugles vis-àvis de leurs intérêts propres. Kemal – pour prendre l'exemple turc – était prêt à laisser les communistes s'organiser tant qu'il avait besoin du soutien de la Russie soviétique contre la Grèce et la Grande-Bretagne. La détermination de Kemal à maintenir sous contrôle l'enthousiasme populaire pour le communisme – qui existait certainement et gagnait du terrain, même si c'était de façon confuse – amena même à la création bizarre d'un parti communiste "officiel" dont le comité central comprenait les généraux dirigeants de l'armée ! Ce PC était parfaitement clair (en fait bien plus clair que l'IC) sur la totale incompatibilité du nationalisme et du communisme. Comme l'écrivait l'organe du PC officiel", Anadoluda Yeni Gün : "Actuellement, le programme des idées communistes est non seulement nocif, mais il est même ruineux pour notre pays. Quand un ouvrier réalise qu'il ne doit pas y avoir de patrie, il n'ira pas la défendre ; en entendant qu'il ne doit pas y avoir de haine entre nations, il n'ira pas combattre les Grecs." 23 L'idéologue du Parti, Mahmud Esat Bozkurt, déclare sans ambiguïté : "Le communisme n'est pas un idéal, mais un moyen pour les Turcs. L'idéal pour les Turcs, c'est l'unité de la nation turque." 24
Bref, le pouvoir soviétique était un allié acceptable pour les nationalistes dans la mesure où il agissait non comme expression de l'internationalisme prolétarien, mais comme celle des intérêts nationaux russes.
Les conséquences de la politique de l'IC vis-à-vis de la Turquie ont été clairement exprimées dans les Mémoires d'Agis Stinas publiés en 1976 : "Le gouvernement russe et l'Internationale communiste avaient caractérisé la guerre menée par Kemal comme une guerre de libération nationale et l'avaient "en conséquence" jugée progressiste et, pour cette raison, soutenue politiquement, diplomatiquement et en lui envoyant des conseillers, des armes et de l'argent. Si l'on considère que Kemal combattait une invasion étrangère pour en libérer le sol turc, sa lutte avait un caractère de libération nationale. Mais était-elle pour autant progressiste ? Nous le croyions et le soutenions alors. Mais comment pourrions-nous aujourd'hui défendre la même thèse ? N'est progressiste à notre époque et ne peut être considéré comme progressiste que ce qui contribue à élever la conscience de classe des masses ouvrières, à développer leur capacité à lutter pour leur propre émancipation. En quoi la création de l'Etat turc moderne y a-t-il contribué ? Kemal (...) jeta les communistes turcs dans les geôles ou les pendit, puis tourna finalement le dos à la Russie, établissant des relations cordiales avec les impérialistes et se chargeant de protéger leurs intérêts. La politique juste, en accord avec les intérêts de la révolution prolétarienne, aurait été d'appeler les soldats grecs et turcs à fraterniser, et les masse populaires à lutter ensemble, sans se laisser arrêter par les différences nationales, raciales et religieuses, pour la république des conseils ouvriers et paysans en Asie mineure. Indépendamment de la politique de la Russie et des objectifs de Kemal, le devoir des communistes grecs était bien sûr la lutte intransigeante contre la guerre." 25 (nous soulignons).
L'importance de l'expérience de la gauche en Turquie ne réside pas dans son héritage théorique mais dans le fait que la lutte entre le nationalisme et le communisme à l'Est alla jusqu'au bout, non dans le débat mais sur le terrain, dans la lutte de classe. 26 Le combat de la gauche en Turquie contre l'opportunisme au sein du Parti et contre la répression de l'Etat kémaliste qui plongea les mains dans le sang des ouvriers dès sa naissance, met à nu de façon implacable les erreurs et les ambiguïtés des Thèses de l'IC sur la question nationale. La lutte de Manatov, Haçioglu et de leurs camarades appartient à l'héritage internationaliste du mouvement ouvrier.
Jens
1. Pour ce faire, nous nous sommes beaucoup appuyés sur la récente biographie de Kemal Atatürk par Andrew Mango, et sur l'Histoire de la révolution russe de EH Carr, en particulier le chapitre sur "L'auto-détermination dans la pratique" dans le volume intitulé La révolution bolchevique. Le lecteur de langue française peut consulter le long article critique publié dans Programme communiste [115] n°100 [115] (décembre 2009) qui, malgré l'inévitable aveuglement des bordiguistes sur la question nationale, contient des données historiques utiles.
2. Le fait que la Turquie n'existait pas en tant que telle durant la plus grande partie de la période traitée dans la brochure permet d'une certaine façon d'expliquer que la Préface originale de l'EKS décrive la Turquie comme "un obscur pays du Moyen-Orient" ; pour le reste, l'ignorance indubitable des affaires turques par la grande majorité du monde de langue anglaise justifie l'expression. Il est amusant de voir que Programme Communiste préfère l'attribuer aux "préjugés du citoyen d’une des «grandes puissances» qui dominent le monde" sur la base de la supposition absolument non fondée que cette Préface aurait été écrite par le CCI. Devons-nous en conclure que les propres préjugés du PCI le rendent incapable d'imaginer qu'une position internationaliste sans compromis puisse être adoptée par un membre de ce qu'il aime appeler "les peuples olivâtres" ?
3. Parmi tous les crimes perpétrés au cours de la Première Guerre mondiale, le massacre des Arméniens mérite une mention spéciale. De peur que la population arménienne chrétienne ne collabore avec la Russie, le gouvernement CUP et son Ministre de la Guerre, Enver Pasha, entreprit un programme de déportation massive et de massacres menant à l'extermination de centaines de milliers de civils.
4. Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Megali_Idea [116]
5. "Rapport de la commission nationale et coloniale [117]", 2e Congrès de l'IC, 26 juillet 1920.
6. Dans la critique qu'il fait à la brochure d'EKS, Programme communiste cherche à opposer Lénine à Luxemburg et va jusqu'à dire que Luxemburg, sous le nom de "Junius", "avance... un programme national de défense de la patrie!". Il est vrai que Luxemburg comme la plupart de ses contemporains n'était pas toujours libérée d'ambiguïtés et de références démodées à la question nationale telle qu'elle avait été traitée au 19e siècle par Marx et Engels, et plus généralement par la Social-démocratie. Nous avons déjà signalé ces ambiguïtés dans la Revue internationale n°12 (1978) où nous avons défendu la critique que Lénine en avait faite dans son article sur la Brochure de Junius. Il est également juste qu'une analyse économique correcte ne mène pas automatiquement à une position politique correcte (pas plus qu'une analyse économique incorrecte n'invalide des positions politiques de principe correctes). Cependant, Programme communiste n'est malheureusement pas à la hauteur de Lénine quand il cite en les tronquant honteusement les textes de Rosa Luxemburg pour éviter que ses lecteurs puissent lire en quoi consistait le prétendu "programme national" de celle-ci : "Oui, les sociaux-démocrates doivent défendre leur pays lors des grandes crises historiques. Et la lourde faute du groupe social-démocrate du Reichstag est d'avoir solennellement proclamé dans sa déclaration du 4 août 1914 : « A l'heure du danger, nous ne laisserons pas notre patrie sans défense », et d'avoir, dans le même temps, renié ses paroles. Il a laissé la patrie sans défense à l'heure du plus grand danger. Car son premier devoir envers la patrie était à ce moment de lui montrer les dessous véritables de cette guerre impérialiste, de rompre le réseau de mensonges patriotiques et diplomatiques qui camouflait cet attentat contre la patrie ; de déclarer haut et clair que, dans cette guerre, la victoire et la défaite étaient également funestes pour le peuple allemand ; de résister jusqu'à la dernière extrémité à l'étranglement de la patrie au moyen de l'état de siège ; de proclamer la nécessité d'armer immédiatement le peuple et de le laisser décider lui-même la question de la guerre ou de la paix ; d'exiger avec la dernière énergie que la représentation populaire siège en permanence pendant toute la durée de la guerre pour assurer le contrôle vigilant de la représentation populaire sur le gouvernement et du peuple sur la représentation populaire ; d'exiger l'abolition immédiate de toutes les limitations des droits politiques, car seul un peuple libre peut défendre avec succès son pays ; d'opposer, enfin, au programme impérialiste de guerre - qui tend à la conservation de l'Autriche et de la Turquie, c'est-à-dire de la réaction en Europe et en Allemagne -, le vieux programme véritablement national des patriotes et des démocrates de 1848, le programme de Marx, Engels et Lassalle." (nous soulignons). https://www.marxists.org/francais/luxembur/junius/rljgf.html [118]
7. Article "Ou – ou", 16 avril 1916, traduit de l'anglais par nous. Cela ne veut pas dire que les délégués qui faisaient écho à certaines positions de Luxemburg se soient considérés comme "luxemburgistes" car il n'est pas du tout évident qu'ils aient même connu les écrits de cette dernière.
8. ibid. note 6
9. Rapport de Lénine au Second Congrès des organisations communistes des peuples d'Orient, Novembre 1918, cité dans Le marxisme et l'Asie, Carrère d'Encausse et Schram.
10. Un exemple frappant de la domination des intérêts de l'Etat russe se rencontre dans l'attitude du pouvoir soviétique face au mouvement dans le Guilan (Perse). L'étude de ce mouvement dépasse le cadre de cet article mais les lecteurs intéressés peuvent trouver certaines informations dans l'étude de Vladimir Genis Les Bolcheviks au Guilan, publiée dans Les Cahiers du Monde russe, juillet – septembre 1999.
11. Manabendra Nath Roy (1887 – 1954). Né sous le nom de Narenra Nath Bhattacharya et connu sous celui de M. N. Roy, il était un révolutionnaire indien bengali, connu internationalement comme militant et théoricien politique. Il fonda le Parti communiste en Inde et au Mexique. Il commença son activité politique dans l'aile extrémiste du nationalisme indien mais évolua vers des positions communistes pendant un séjour à New York au cours de la Première Guerre mondiale. Il s'envola pour Mexico pour échapper à la surveillance des services secrets britanniques et y participa à la fondation du Parti communiste. Il fut invité à assister au Deuxième Congrès de l'IC et collabora avec Lénine dans la formulation des "Thèses sur la question nationale".
12. M.N. Roy, Discours au 2 [119]e [119] Congrès de l'IC [119], juillet 1920.
13. Traduit de l'anglais par nous. M.N. Roy, The awakening of the East [120].
14. ibid. note 12
15. Sultanzade était en fait d'origine arménienne ; son vrai nom était Avetis Mikailian. Il est né en 1890 dans une famille de paysans pauvres de Marageh (au Nord-Ouest de la Perse). Il rejoignit les Bolcheviks en 1912, probablement à Saint Petersburg. Il travailla pour l'IC à Bakou et au Turkestan, et fut l'un des principaux organisateurs du Premier Congrès du Parti communiste perse à Anzali en juin 1920. Il assista au Deuxième Congrès de l'IC en tant que délégué du Parti perse. Il resta à gauche de l'Internationale et s'opposa aux "dirigeants nationalistes" de l'Est (tels que Kemal) ; il critiqua également très sévèrement les prétendus "experts" de l'IC sur l'Orient et la Perse. Il mourut dans les purges staliniennes entre 1936 et 1938. Voir l'étude de Cosroe Chaqeri sur Sultanzade dans Iranian Studies, printemps – été 1984.
16. Traduit de l'anglais par nous, The Second Congress of the Communist International, Vol.1 New Park
17. Voir Cosroe Chaqeri, op. cit. Dans les Cahiers du monde russe, 40/3, juillet-septembre 1999, Vladimir Genis mentionne un rapport rédigé par Pavlovitch et Sultanzade, à la demande de Lénine à la suite du 2e Congrès de l'IC, sur "Les objectifs du parti communiste en Perse". Le Rapport propose de mener une propagande massive "en vue de la liquidation complète de la propriété privée et du transfert des terres aux paysans" car "la classe des propriétaires ne peut être le support de la révolution, que ce soit dans le combat contre le shah ou, même, contre les Anglais."
18. Cité dans Le marxisme et l'Asie, Carrère d'Encausse et Schram
19. Mais il est significatif que Pavlovitch pose les questions en ces termes.
20. Wrangel était l'un des généraux des armées blanches dont les campagnes contre la révolution étaient financées par les grandes puissances – dans le cas de Wrangel, par la France en particulier.
21. Traduit de l'anglais par nous, Lénine cité dans Le marxisme et l'Asie, op. cit.
22. Traduit de l'anglais par nous.
23. Traduit de l'anglais par nous, cité par George S. Harris dans The origins of Communism in Turkey.
24. Ibid.
25. Mémoires, Editions La Brèche-PEC, 1990, chapitre 2 "Le réveil des masses populaires", page 42. Pour un résumé de la vie de Stinas, voir la Revue internationale [121] n°72 [121].
26. Comme l'écrit la brochure, "l'aile gauche du Parti communiste turc était formée autour de l'opposition au mouvement de libération nationale pour des raisons pratiques, du fait de ses terribles conséquences pour les ouvriers, ne leur apportant que des souffrances et la mort". Quand le groupe EKS a écrit la brochure, il était bien conscient – comme le CCI - que la gauche turque n'occupe pas la même place dans le développement théorique et organisationnel de la Gauche communiste que la Gauche italienne par exemple. C'est pourquoi la brochure s'intitule The left wing of the TKP ("l'aile gauche du PCT") et non The Turkish Communist Left ("la gauche communiste turque"). Apparemment, cette distinction n'est pas claire pour Programme communiste. Mais alors Programme communiste tend à traiter la Gauche communiste comme sa propriété personnelle et défend l'idée que seule la Gauche italienne "se situait, elle, sur la base du marxisme orthodoxe" (l'expression "marxisme orthodoxe" est elle-même une notion grotesque qui est totalement – osons le dire – non marxiste ). Programme communiste continue par de longs développements sur tous les différents courants, de droite et de gauche, dans "le jeune mouvement communiste" et nous informe savamment qu'ils pouvaient être "de droite" ou "de gauche" selon les changements de la politique de l'IC, citant la caractérisation de Bordiga par Zinoviev en 1924. Mais pourquoi ne mentionne-t-il pas la brochure de Lénine écrite contre "les communistes de gauche", spécifiquement en Italie, Allemagne, Hollande et Grande-Bretagne ? Contrairement à Programme communiste, Lénine n'avait aucune difficulté à voir qu'il y avait quelque chose de commun entre "les communistes de gauche" – même si nous ne partageons évidemment pas sa description du communisme de gauche comme une "maladie infantile".
Courants politiques:
- Gauche Communiste [114]
Revue Internationale n° 143 - 4e trimestre 2010
- 2217 lectures
Débâcle économique, catastrophes "naturelles", chaos impérialiste, ....
Le capitalisme est un système en faillite qu'il faut abattre
Depuis la crise du système financier en 2008, plus rien ne semble pouvoir camoufler la profondeur de la crise historique que traverse le capitalisme. Alors que les attaques contre la classe ouvrière pleuvent, que la misère se répand, les tensions impérialistes s'aiguisent, la faim continue de frapper plusieurs centaines de millions de personnes, les catastrophes naturelles se font toujours plus meurtrières. La bourgeoisie elle-même ne peut nier l'ampleur des difficultés ni dessiner l'horizon chimérique d'un avenir meilleur sous sa domination. C’est ainsi que, jusque dans ses organes de propagande, elle concède que la crise actuelle est la plus grave qu’ait connu le capitalisme depuis celle des années 1930, que le développement de la misère est un mal avec lequel il nous faudra "apprendre à vivre." Mais la bourgeoisie est une classe disposant de nombreuses capacités d'adaptation : s'il lui faut admettre, un peu contrainte par l'évidence de la situation, beaucoup par calcul politique, que les choses vont mal et qu’elles ne sont pas prêtes de s’améliorer, elle sait, dans le même temps, présenter les problèmes de manière suffisamment fallacieuse pour épargner le système capitaliste comme un tout. Les banques font faillite, entraînant dans leur sillage l'économie mondiale ? La faute aux traders ! L'endettement de certains États est tel qu'ils se déclarent en cessation de paiement ? La faute aux gouvernements corrompus ! La guerre ravage une partie de la planète ? Un manque de volonté politique ! Les catastrophes environnementales se multiplient causant toujours plus de victimes ? La faute à la nature ! Si des divergences existent dans les multiples analyses que propose la bourgeoisie, elles se rejoignent toutes sur un point essentiel qui consiste à dénoncer telle ou telle forme de gouvernance mais pas le capitalisme comme mode de production. En réalité, l'ensemble des calamités qui s’abattent sur la classe ouvrière est le résultat des contradictions qui, tous les jours un peu plus fortement, étranglent la société quel qu'en soit le mode de gouvernement, dérégulé ou étatique, démocratique ou dictatorial. Pour mieux camoufler la faillite de son système, la bourgeoisie prétend également que la crise économique débutée en 2008 reflue légèrement. Cette dernière est non seulement loin d'être terminée mais, de plus en plus explicitement, elle exprime l’approfondissement de la crise historique du capitalisme.
Le capitalisme s'enfonce dans la crise
La bourgeoisie se félicite parfois des perspectives positives qu’annoncent les indicateurs économiques, en particulier les chiffres de la croissance qui commencent timidement à repartir à la hausse. Mais derrière ces "bonnes nouvelles", la réalité est bien différente. Dès 2008, afin d'éviter le scénario catastrophe de la crise des années 30, la bourgeoisie a dépensé des milliards pour soutenir les banques en grandes difficultés et mis en place des mesures keynésiennes. Ces mesures consistent, notamment, à diminuer les taux directeurs des banques centrales, qui déterminent le prix du crédit, et, pour l’État, à engager des dépenses de relance économique, souvent financées par l’endettement. Une telle politique est censée avoir pour effet bénéfique le développement d'une forte croissance. Or, aujourd'hui, ce qui frappe d'emblée, c’est l’extrême mollesse de la croissance mondiale au regard des astronomiques dépenses de relance et de l’agressivité des politiques inflationnistes. Les États-Unis se trouvent ainsi dans une situation que les économistes bourgeois, faute de pouvoir s’appuyer sur l’analyse marxiste, ne comprennent pas : l’État américain s’est endetté de plusieurs centaines de milliards de dollars et le taux directeur de la FED est proche de zéro ; pourtant, la croissance devrait s’élever à seulement 1,6% en 2010, contre les 3,7% espérés. Comme l’illustre le cas américain, si, depuis 2008, la bourgeoisie a momentanément évité le pire en s‘endettant massivement, la reprise n’est pas vraiment là. Incapables de comprendre que le système capitaliste est un mode de production transitoire, prisonniers de schémas sclérosés, les économiste bourgeois ne voient pas l’évidence : le keynésianisme a fait la preuve de son échec historique depuis les années 1970 parce que les contradictions du capitalisme sont désormais insolubles, y compris par la tricherie de l’endettement avec les lois fondamentales du capitalisme.
L’économie capitaliste se maintient péniblement depuis de nombreuses décennies par le gonflement prodigieux de la dette de tous les pays du monde afin de créer artificiellement un marché destiné à absorber une partie de la surproduction chronique. Mais la relation du capitalisme à l’endettement s’apparente à de l’opiomanie : plus il consomme, moins la dose est suffisante. En d'autres termes, la bourgeoisie a maintenu la tête hors de l’eau en s’agrippant à une planche de salut pourrie qui a fini par craquer en 2008. C’est ainsi qu’à l’inefficacité patente des déficits budgétaires s’ajoute le risque d'insolvabilité de nombreux pays, en particulier la Grèce, l’Italie, l'Irlande ou l'Espagne. Dans ce contexte, les gouvernements de tous les pays sont réduits à naviguer au jour le jour, modifiant leurs politiques économiques, de la relance à la rigueur en fonction des événements, sans que rien ne puisse durablement améliorer la situation. L’État, ultime recours contre la crise historique qui étrangle le capitalisme, n’est définitivement plus en mesure de camoufler son impuissance.
Partout dans le monde, des attaques sans précédent contre la classe ouvrière continuent de s’abattre aussi rapidement que les taux de chômage augmentent. Les gouvernements, de droite comme de gauche, imposent aux prolétaires des réformes et des coupes budgétaires d'une brutalité peu commune, comme en Espagne où, entre autres choses, les fonctionnaires ont vu leur salaire diminuer de 5% cette année par le gouvernement socialiste de Zapatero qui promet déjà leur gel en 2011. En Grèce, c’est notamment l'âge moyen de départ à la retraite qui a augmenté de 14 ans tandis que les pensions sont gelées jusqu‘en 2012. En Irlande, pays que la bourgeoisie vantait encore récemment pour son dynamisme, le taux officiel de chômage s’élève à 14%, tandis que les salaires des fonctionnaires ont également été allégés de 5 à 15% tout comme les indemnités des chômeurs ou les allocations familiales. D'après l’Organisation Internationale du Travail, le nombre de chômeurs dans le monde est passé de 30 millions, en 2007, à 210 millions, aujourd'hui1. On pourrait multiplier les exemples car, sur tous les continents, la bourgeoisie fait payer à la classe ouvrière le prix fort de la crise. Mais derrière les plans d'austérité hypocritement appelés réformes, derrière les licenciements et les fermetures d‘usine, des familles entières sombrent dans la pauvreté. Aux États-Unis, près de 44 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté d'après un rapport du Census Bureau, soit une augmentation de 6,3 millions de pauvres en deux ans, qui viennent s’ajouter aux trois précédentes années qui avaient déjà connu un fort développement de la pauvreté. La décennie a d'ailleurs été marquée aux États-Unis par une forte diminution de la valeur des bas revenus.
Il n’y a pas qu’au sein des "pays riches" que la crise se paie par la misère. Récemment, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (plus connue sous le sigle : FAO.) se félicitait d'observer en 2010 un recul de la sous-alimentation qui touche particulièrement l’Asie (578 millions de personnes) et l’Afrique (239 millions), pour un total de 925 millions de personnes dans le monde. Ce que les statistiques ne révèlent pas immédiatement, c’est que ce chiffre reste largement supérieur à celui publié en 2008, avant que les effets de l’inflation spéculative des prix de l’alimentation ne se fassent sentir jusqu’à provoquer une série d'émeutes dans de nombreux pays. Le recul significatif des prix agricoles a, certes, fait modestement "reculer la faim dans le monde" mais la tendance sur plusieurs années, c’est-à-dire indépendamment de la conjoncture économique immédiate, est indéniablement à la hausse. D'ailleurs, les canicules de l’été en Russie, en Europe de l’Est et, récemment, en Amérique latine ont très sensiblement diminué le rendement des récoltes mondiales, ce qui, dans un contexte d'augmentation des prix, va inévitablement faire croître la malnutrition l’an prochain. Ainsi, il n’y a pas qu’au niveau économique que la faillite du capitalisme s‘exprime. Les dérèglements climatiques et la gestion bourgeoise des catastrophes environnementales constituent une cause croissante de mortalité et de dénuement.
Le capitalisme détruit la planète
Cet été, de violentes catastrophes se sont abattues sur les populations partout dans le monde : les flammes ont embrasé la Russie, le Portugal et de nombreux autres pays ; des moussons dévastatrices ont noyé le Pakistan, l’Inde, le Népal et la Chine sous la boue. Au printemps, le Golfe du Mexique connaissait la pire catastrophe écologique de l’histoire après l’explosion d'une plate-forme pétrolière. La liste des catastrophes de l’année 2010 est encore longue. La multiplication de ces phénomènes et leur gravité croissante ne sont pas le fruit du hasard car de l’origine des catastrophes jusqu'à à leur gestion, le capitalisme en porte une très lourde responsabilité.
Récemment, la rupture du réservoir mal entretenu d'une usine de production d'aluminium a engendré une catastrophe industrielle et écologique en Hongrie : plus d'un million de mètres cubes de "boue rouge" toxique s'est répandu autour de l'usine, causant plusieurs morts et de nombreux blessés. Les dégâts environnementaux et sanitaires sont très importants. Or, pour "minimiser les impacts" de ces déchets, les industriels retraitent la boue rouge de la manière suivante : soit ils la rejettent dans la mer par milliers de tonnes, soit ils l'entreposent dans d'immense bassin de rétention, à l'image de celui qui a cédé en Hongrie, alors que des technologies existent depuis longtemps pour recycler de pareils déchets, en particulier dans le bâtiment et l'horticulture.
La destruction de la planète par la bourgeoisie ne se limite cependant pas aux innombrables catastrophes industrielles qui frappent chaque année de nombreuses régions. Selon l’avis de nombreux scientifiques, le réchauffement de la planète joue un rôle majeur dans la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes : "Ce sont des événements qui sont appelés à se reproduire et à s’intensifier dans un climat perturbé par la pollution des gaz à effet de serre" selon le vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Et pour cause, de 1997 à 2006, alors que la température de la planète ne cessait d'augmenter, le nombre de catastrophes, de plus en plus dévastatrices, a augmenté de 60 % par rapport à la décennie précédente, entraînant dans leur sillage de plus en plus de victimes. D'ici 2015, le nombre de victimes de catastrophes météorologiques devrait augmenter de plus de 50%.
Les scientifiques des compagnies pétrolières peuvent s’agiter en déclarant que le réchauffement planétaire n’est pas le résultat d'une pollution massive de l’atmosphère, l’ensemble des recherches scientifiques sérieuses démontre une corrélation évidente entre le rejet des gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et la multiplication des catastrophes naturelles. Cependant, les scientifiques se trompent lorsqu’ils affirment qu’un peu de volonté politique des gouvernements est en mesure de changer les choses. Le capitalisme est incapable de limiter les rejets de gaz à effet de serre car il devrait alors aller à l'encontre de ses propres lois, celles du profit, de la production à moindre frais et de la concurrence. C’est la nécessaire soumission à ces lois qui fait que la bourgeoisie pollue avec, entre autres exemples, son industrie lourde, ou qu’elle fait inutilement parcourir à ses marchandises des milliers de kilomètres.
La responsabilité du capitalisme dans l’ampleur de ces catastrophes ne se limite d'ailleurs pas à la pollution atmosphérique et au dérèglement climatique. La destruction méthodique des écosystèmes, à travers, par exemple, la déforestation massive, le stockage des déchets dans les zones naturelles de drainage, ou l’urbanisation anarchique, parfois jusque dans le lit des rivières asséchées et au cœur de secteurs notablement inflammables, ont fortement aggravé l’intensité des catastrophes.
La série d'incendies qui a frappé la Russie au cœur de l’été, en particulier une large région autour de Moscou, est significative de l’incurie de la bourgeoisie et de son impuissance à maîtriser ces phénomènes. Les flammes ont embrasé des centaines de milliers d'hectares causant un nombre indéterminé de victimes. Pendant plusieurs jours, une épaisse fumée, dont les conséquences sur la santé ont été catastrophiques au point de doubler le taux quotidien de mortalité, a envahi la capitale. Et pour faire bonne mesure, des risques nucléaires et chimiques importants menacent encore les populations bien au-delà des frontières russes à cause, notamment, des incendies sur des terres contaminées par l’explosion de la centrale de Tchernobyl et des entrepôts d'armes et de produits chimiques plus ou moins oubliés dans la nature.
Un élément essentiel pour comprendre le rôle de la bourgeoisie dans l’envergure des incendies est l’état stupéfiant d'abandon des forêts. La Russie est un pays immense doté d'un parc forestier très important et dense, nécessitant un soin particulier pour circonscrire rapidement les débuts d'incendies afin d'éviter qu’ils ne se répandent jusqu’à devenir incontrôlables. Or, beaucoup de massifs forestiers russes ne sont même pas dotés de voies d'accès, si bien que les camions de pompiers sont incapables d'atteindre le cœur de la plupart des incendies. La Russie compte d'ailleurs seulement 22 000 pompiers, soit moins qu’un petit pays comme la France, pour lutter contre les flammes, et les gouverneurs régionaux, notablement corrompus, préfèrent employer les maigres moyens dont ils disposent pour la gestion des forêts à l'achat de voitures de luxe, comme l'ont révélé plusieurs scandales.
Le même cynisme vaut pour les fameux feux de tourbière, zones dont le sol est constitué de matière organique en décomposition particulièrement inflammable : en plus de laisser les tourbières à l’abandon, la bourgeoisie russe a favorisé la construction d'habitations sur ces zones alors que des incendies avaient déjà fortement sévi en 1972. Le calcul est bien simple : sur ces secteurs dangereux, les promoteurs immobiliers ont pu acheter des terrains, déclarés constructibles par la loi, à un prix dérisoire.
C’est de cette manière que le capitalisme transforme des phénomènes naturels humainement maîtrisables en véritables catastrophes. Mais, en matière d'horreur, la bourgeoisie ne s’arrête devant rien. C’est ainsi qu’autour des dévastatrices inondations qui ont frappé le Pakistan, s’est jouée une lutte impérialiste des plus crapuleuses.
Durant plusieurs semaines, des pluies torrentielles se sont abattues sur le Pakistan, occasionnant des inondations majeures, des glissements de terrain, des milliers de victimes, plus de 20 millions de sinistrés et des dégâts matériels considérables. La famine et la propagation de maladies, notamment le choléra, sont venues empirer une situation déjà désespérée. Pendant plus d'un mois, au milieu de cet horrible tableau, la bourgeoisie pakistanaise et son armée n’ont fait qu’étaler une incompétence et un cynisme hallucinants, accusant l’implacabilité de la nature, alors que, comme en Russie, entre urbanisation anarchique et services de secours impuissants, les lois du capitalisme apparaissent comme l’élément essentiel pour comprendre l’ampleur de la catastrophe.
Mais un aspect particulièrement écœurant de cette tragédie est la manière dont les puissances impérialistes essayent encore de tirer profit de la situation, au détriment des victimes, en utilisant les opérations humanitaires comme alibi. En effet, les États-Unis soutiennent, dans le cadre de la guerre avec l’Afghanistan voisin, le gouvernement très contesté de Youssouf Raza Gilani, et ont très rapidement profité des événements pour déployer un important contingent "humanitaire" constitué de porte-hélicoptères, de navires d'assaut amphibies, etc. Sous le prétexte d'empêcher un soulèvement des terroristes d'Al-Qaida, que favoriseraient les inondations, les États-Unis freinent, autant que faire se peut, l’arrivée de "l’aide internationale" venant d'autres pays, "aide humanitaire" elle aussi constituée de militaires, de diplomates et d'investisseurs sans scrupules.
Comme pour chaque catastrophe d'ampleur, tous les moyens sont mis en œuvre par tous les États pour faire valoir leurs intérêts impérialistes. Parmi ces moyens, la promesse de dons est devenue une opération systématique : tous les gouvernements annoncent officiellement une manne financière substantielle qui n’est officieusement accordée qu’en échange de la satisfaction des ambitions des donateurs. Par exemple, à ce jour, 10 % seulement de l’aide internationale promise en janvier 2010 après le tremblement de terre à Haïti a été effectivement versée à la bourgeoisie haïtienne. Et le Pakistan ne fera bien sûr pas exception à la règle ; les millions promis ne seront versés qu’à titre de commission d'État contre services rendus.
Les fondements du capitalisme, la recherche du profit, la concurrence, etc., sont donc, à tous les niveaux, au cœur de la problématique environnementale. Mais les luttes autour du Pakistan illustrent également les tensions impérialistes croissantes qui ravagent une partie de la planète.
Le capitalisme sème le chaos et la guerre
L’élection de Barack Obama à la tête de la première puissance mondiale a suscité beaucoup d'illusions sur la possibilité de pacifier les rapports internationaux. En réalité, la nouvelle administration américaine n’a fait que confirmer la dynamique impérialiste ouverte avec l’effondrement du bloc de l’Est. L'ensemble de nos analyses selon lesquelles "la discipline rigide des blocs impérialistes" devait, suite à l'effondrement du bloc de l'Est, céder la place à l’indiscipline et à un chaos rampant, à une lutte généralisée de tous contre tous et à une multiplication incontrôlable des conflits militaires locaux s’est pleinement vérifiée. La période ouverte par la crise et l’aggravation considérable de la situation économique n’a fait qu’aiguiser les tensions impérialistes entre les nations. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, pas moins de 1 531 milliards de dollars auraient été dépensés dans les budgets militaires de tous les pays en 2009, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 2008 et de 49% par rapport à 2000. Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte les transactions illégales d'armement. Même si la bourgeoisie de certains États se trouve contrainte, crise oblige, de rogner sur ses dépenses militaires, fondamentalement la militarisation croissante de la planète est le reflet du seul futur qu'elle réserve à l'humanité : la multiplication des conflits impérialistes.
Les États-Unis, avec leurs 661 milliards de dépenses militaires en 2009, bénéficient d'une supériorité militaire absolument incontestable. Pourtant, depuis l’effondrement du bloc de l’Est, le pays est de moins en moins en mesure de mobiliser d'autres nations derrière lui, comme en avait témoigné la guerre d'Irak débutée en 2003 où, en dépit du retrait annoncé récemment, les troupes américaines comptent encore plusieurs dizaines de milliers de soldats. Non seulement les États-Unis n’ont pas été en mesure de fédérer beaucoup d'autres puissances sous leur bannière, notamment la Russie, la France, l’Allemagne et la Chine mais, en plus, d‘autres se sont petit à petit désengagées du conflit, en particulier le Royaume-Uni et l'Espagne. Surtout, la bourgeoisie américaine semble de moins en moins capable d'assurer la stabilité d'un pays conquis (les bourbiers afghan et irakien sont symptomatiques de cette impuissance) ou d'une région, comme l'illustre la manière dont l'Iran défie les Etats-Unis sans crainte de représailles. L’impérialisme américain est ainsi nettement sur le déclin et cherche à reconquérir son leadership perdu depuis plusieurs années à travers des guerres qui, finalement, l’affaiblissent considérablement.
Face aux États-Unis, la Chine tente de faire prévaloir ses ambitions impérialistes à travers l'effort d'armement (100 milliards de dollars de dépenses militaires en 2009, avec des augmentations annuelles à deux chiffres depuis les années 90) et sur le terrain. Au Soudan, par exemple, comme dans beaucoup d'autres pays, elle s’implante économiquement et militairement. Le régime soudanais et ses milices, armés par la Chine, poursuivent le massacre des populations accusées de soutenir les rebelles du Darfour, eux-mêmes armés par la France, par l’intermédiaire du Tchad, et les États-Unis, ancien adversaire de la France dans la région. Toutes ces manœuvres écœurantes ont engendré la mort de centaines de milliers de personnes et le déplacement de plusieurs millions d'autres.
Les États-Unis et la Chine sont loin de porter à eux seuls la responsabilité du chaos guerrier sur la planète. En Afrique, par exemple, la France, directement ou par milices interposées, essaye de sauver ce qu’elle peut de son influence, notamment au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Congo, etc. Les cliques palestiniennes et israéliennes, soutenus par leurs parrains respectifs, poursuivent une guerre interminable. La décision israélienne de ne pas prolonger le moratoire sur la construction dans les territoires occupés, alors que "négociations de paix" organisées par les États-Unis se poursuivent, montre d'ailleurs l'impasse de la politique Obama qui voulait se distinguer de celle de Bush par plus de diplomatie. La Russie, à travers la guerre en Géorgie ou l’occupation de la Tchétchénie, essaye de recréer une sphère d'influence autour d'elle. La litanie des conflits impérialistes est trop longue pour que nous puissions l’exposer ici de manière exhaustive. Néanmoins, ce que la multiplication des conflits révèle, c'est que toutes les fractions nationales de la bourgeoisie, puissantes ou pas, n'ont d'autre alternative à proposer que répandre le sang en défense de leurs intérêts impérialistes.
La classe ouvrière reprend le chemin de la lutte
Face à la profondeur de la crise dans laquelle s’enfonce le capitalisme, la combativité ouvrière n’est manifestement pas à la hauteur des enjeux, le poids des défaites du prolétariat pèse encore lourdement sur la conscience de notre classe. Mais les armes de la révolution se forgent au cœur des luttes que la crise commence à développer significativement. Depuis plusieurs années de nombreuses luttes ouvertes ont éclaté, parfois simultanément au niveau international. La combativité ouvrière s’exprime ainsi simultanément au sein des pays "riches" - en Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis, en Grèce, en Irlande, en France, au Japon, etc. - et des pays "pauvres." Si la bourgeoisie des pays riches diffuse l’idée crapuleuse et mensongère que les travailleurs des pays pauvres s’approprient les emplois de ceux des pays riches, elle prend bien soin d'imposer un quasi black-out sur les luttes de ces ouvriers qui feraient apparaître qu'eux aussi sont victimes des mêmes attaques que le capitalisme en crise impose dans tous les pays.
En Chine, dans un pays où la part des salaires dans le PIB est passée de 56% en 1983 à 36% en 2005, les ouvriers de plusieurs usines ont cherché à s’émanciper des syndicats, malgré de fortes illusions sur la possibilité d'un syndicat libre. Surtout, les ouvriers chinois ont réussi à coordonner eux-mêmes leur action et à élargir leur lutte au-delà de l’usine. Au Panama, une grève a éclaté le 1er juillet dans les bananeraies de la province de Bocas de Toro pour réclamer le paiement des salaires et s‘opposer à une réforme antigrève. Là aussi, malgré une vive répression policière et les multiples sabotages syndicaux, les travailleurs ont immédiatement cherché, et avec succès, à étendre leur mouvement. La même solidarité et la même volonté de se battre collectivement ont animé un mouvement de grève sauvage au Bangladesh, violemment réprimé par les forces de l'ordre.
Dans les pays centraux, la réaction ouvrière en Grèce s'est poursuivie à travers de nombreuses luttes, en particulier en Espagne où les grèves se multiplient contre les mesures draconiennes d'austérité. La grève organisée par les travailleurs du métro de Madrid est significative de la volonté des ouvriers d'étendre leur lutte et de s'organiser collectivement à travers des assemblées générales. C'est pour cela qu'elle a été le cible d'une campagne de dénigrement orchestrée par le gouvernement socialiste de Zapatero et ses médias. En France, si les syndicats parviennent à encadrer les grèves et les manifestations, la réforme visant à allonger l'âge de départ à la retraite provoque la mobilisation d'une large frange de la classe ouvrière et donne lieu à des expressions, certes très minoritaires mais également très significatives, d'une volonté de s'organiser en dehors des syndicats à travers des assemblées générales souveraines et d'étendre les luttes.
Evidemment, la conscience du prolétariat mondial est encore insuffisante et ces luttes, quoique simultanées, ne sont pas immédiatement en mesure de créer les conditions d'un même combat au niveau international. Néanmoins, la crise dans laquelle s’enfonce le capitalisme, les cures d'austérité et la misère croissante vont inévitablement produire une multiplication de luttes toujours plus massives à travers lesquelles les ouvriers développeront petit à petit leur identité de classe, leur unité, leur solidarité, leur volonté de se battre collectivement. Ce terrain est le terreau d'une politisation consciente du combat ouvrier pour son émancipation. Le chemin vers la révolution est encore long mais, comme l’écrivaient Marx et Engels dans le Manifeste communiste : "La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort ; elle a produit aussi les hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires."
V. (08/10/10)
1. Ces statistiques mettent en évidence une augmentation générale officielle du chômage que les tricheries de la bourgeoisie ne peuvent plus dissimuler. Il faut cependant être conscient que ces chiffres sont loin de refléter l'ampleur du phénomène puisque, dans tous les pays, y compris ceux où la bourgeoisie a dû aller le plus loin dans la mise en place d'un dispositif d'amortisseurs sociaux, le fait de ne pas retrouver de travail a pour conséquence qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus considéré comme chômeur.
L'automne chaud 1969 en Italie, un moment de la reprise historique de la lutte de classe (II)
- 4091 lectures
Dans l’article précédent nous avons évoqué la grande lutte menée par la classe ouvrière en Italie à la fin des années 60, passée à l’histoire sous le nom "d’automne chaud", dénomination qui, comme nous l’avons rappelé dans cet article, est trop étroite pour désigner une phase de lutte qui a impliqué les prolétaires en Italie au moins pendant les années 1968-1969 et qui a laissé des traces profondes au cours des années suivantes. Nous avions également mis en lumière comment cette lutte en Italie n’a pas été qu’un des nombreux épisodes au sein d’un processus de reprise internationale de la lutte de classe après la longue période de contre-révolution subie par le monde entier après la défaite de la vague révolutionnaire des années 20. La conclusion de ce premier article rappelait que ce développement énorme de combativité, accompagné de moments importants de clarification dans la classe ouvrière, allait rencontrer cependant, dans la période qui allait suivre, des obstacles importants. La bourgeoisie italienne, comme celle des autres pays qui avaient dû faire front au réveil de la classe ouvrière, n’est pas restée longtemps les bras croisés et, à côté des interventions directes des corps de police, elle a cherché progressivement à contourner l’obstacle par des moyens divers. Comme nous allons le voir dans cet article, la capacité de récupération de la bourgeoisie se base largement sur les faiblesses d’un mouvement prolétarien qui, malgré une énorme combativité, était encore privé d’une conscience de classe claire et dont les avant-gardes elles-mêmes n’avaient pas la maturité ni la clarté nécessaires pour jouer leur rôle.
Les faiblesses de la classe ouvrière pendant l’Automne chaud
Les faiblesses de la classe ouvrière au moment de l’automne chaud sont principalement liées à la rupture organique profonde qui s’était produite dans le mouvement ouvrier après la défaite de la vague révolutionnaire des années 20 et à la domination étouffante du stalinisme. Cela avait joué de façon doublement négative sur la conscience de la classe ouvrière. D’un côté, tout le patrimoine politique de classe avait été effacé, la perspective du communisme étant confondue avec les programmes interclassistes de nationalisations et la lutte de classe elle-même toujours plus confondue avec la lutte pour la "défense de la patrie" ! 1 De l’autre côté, la continuité apparente dans le passage de la vague révolutionnaire des années 20 à la phase la plus atroce de la contre-révolution, avec les purges staliniennes et les millions de prolétaires massacrés au nom du "communisme", a imprimé dans la tête des gens, grâce aussi à la propagande perverse de la bourgeoisie sur les communistes qui seraient des gens toujours prêts à opprimer et exercer la violence contre les hommes, l’idée qu’effectivement le marxisme et le léninisme devaient être rejetés ou, pour le moins, profondément révisés. Ainsi, quand la classe ouvrière se réveille, au niveau italien et international, elle n’est épaulée par aucune organisation révolutionnaire aux bases théoriques solides qui puisse soutenir son effort de reprise. De fait, presque tous les nouveaux groupes qui se reconstituent sur la lancée de la reprise de la lutte de classe à la fin des années 60, bien que reprenant en main les classiques, le font avec un certain a priori critique qui ne les aidera pas à retrouver ce dont ils ont besoin. Par ailleurs, même les formations de la Gauche communiste qui avaient survécu pendant les longues années de la contre-révolution, n’étaient pas restées politiquement indemnes. Les conseillistes, témoignage presque effacé de l’expérience héroïque de la gauche germano-hollandaise des années 20, encore terrorisés par le rôle néfaste que pourrait assumer dans le futur un parti dégénéré qui, comme le parti stalinien, établirait sa domination sur l’Etat et sur le prolétariat, se retranchaient de plus en plus dans une posture de "participants aux luttes" sans jouer de rôle quelconque d’avant-garde et en gardant pour eux tout l’héritage des leçons du passé. Il en a été de même, d'une certaine façon, de la part des bordiguistes et de la gauche italienne d’après 1943 (Programme Communiste et Battaglia Comunista), qui eux, au contraire, revendiquent avec force un rôle pour le parti. Paradoxalement, du fait de leur incapacité à comprendre la phase dans laquelle ils se trouvaient et d’une sorte d’adulation pour le parti, conjuguée à une certaine sous-estimation des luttes ouvrières lorsqu'elles sont menées en l'absence d'organisations révolutionnaires, ils se sont refusé à reconnaître, dans l’automne chaud et dans les luttes de la fin des années 60, la reprise historique de la classe au niveau international. De ce fait, leur présence à l’époque a été pratiquement nulle. 2 C’est pourquoi les nouveaux groupes politiques qui s’étaient formés pendant les années 60, soit du fait de la méfiance issue de la confrontation avec les expériences politiques précédentes, soit du fait de l’absence de références politiques déjà présentes, ont été poussés à réinventer des positions et un programme d’action. Le problème, toutefois, c’est qu’ils avaient comme point de départ l’expérience vécue au sein du vieux parti stalinien décrépi. D’où cette génération nombreuse de militants qui s’affichent en opposition à de tels partis et aux syndicats, rompant les ponts avec les partis de gauche, mais aussi partiellement avec la tradition marxiste, allant à la recherche d’une voie révolutionnaire dans la "nouveauté" qu’ils pensent trouver dans la rue, développant grandement le spontanéisme et le volontarisme, parce que, ce qui se présente encore sous l’habit officiel, c’est ou le stalinisme ancienne manière (URSS et PCI) ou la forme nouvelle des "chinois".
L’idéologie dominante de l’Automne chaud : l’opéraïsme
C’est dans ce contexte que se développe l’opéraïsme, l’idéologie dominante de l’automne chaud. La réaction justifiée des prolétaires qui reprirent la lutte de classe contre les structures bureaucratisées et asphyxiantes du PCI 3 et des syndicats, les conduisit à retirer toute confiance à ces structures et à mettre toute cette confiance dans la classe ouvrière elle-même. Ce sentiment s’exprime bien dans l’intervention d’un ouvrier de l’Om de Milan au Palasport de Turin à l’occasion d’une assemblée de la toute nouvelle Lotta Continua en janvier 1970 :
"A la différence du Parti communiste, nous ne sommes pas dirigés par 4 bourgeois. (…) Nous, nous ne ferons pas comme le PCI, parce que ce sont les ouvriers qui seront les guides de cette organisation". 4
Le jugement porté sur les syndicats est de fait particulièrement sévère :
"Nous ne pensons ni qu’on peut changer le syndicat "de l’intérieur", ni qu’on doive en construire un nouveau plus "rouge", plus "révolutionnaire", plus "ouvrier", sans bureaucrates. Nous, nous pensons que le syndicat est un rouage du système des patrons… et qu’il doit donc être combattu comme les patrons". 5
Nous chercherons donc dans cet article à présenter les principaux aspects de l’opéraïsme, en particulier dans sa version défendue par Toni Negri – qui reste jusqu’à aujourd’hui un des représentants les plus reconnus de ce courant politique – de façon à pouvoir dégager ce qui a fait sa force mais ce qui a été aussi la cause de son échec par la suite. Pour ce faire, nous nous réfèrerons à l’œuvre de Toni Negri, Dall’operaio massa all’operaio sociale. Intervista sull’operaismo. 6 Commençons par une définition de l’opéraïsme :
"Ce qu’on a appelé "opéraïsme" naît et se forme en tant que tentative de réponse politique à la crise du mouvement ouvrier des années 50, crise déterminée fondamentalement par les événements historiques dans le mouvement autour du 20e Congrès". 7
Déjà, dans ce passage, il est visible que malgré la rupture profonde avec les forces officielles de gauche, la définition de celles-ci – et en particulier du PCI – est complètement inadéquate et ne s’enracine pas dans une compréhension théorique profonde. Le point de départ est la prétendue "crise du mouvement ouvrier des années 50" alors que, au contraire, ce qui est défini comme "mouvement ouvrier" à l’époque, ce n’est que l’internationale de la contre-révolution stalinienne, dans la mesure où la vague révolutionnaire avait déjà été défaite dans les années 20 et la grande partie des cadres politiques ouvriers anéantie parce que dispersée et massacrée. Cette ambiguïté vis-à-vis du PCI s’exprimera au travers d’un rapport "amour-haine" vis-à-vis du parti d’origine et expliquera comment, avec le temps, tant d’éléments n’ont rien trouvé de mal à revenir au bercail. 8
L’opéraïsme se base à l’origine sur ce qui a été défini comme ouvrier-masse, c’est-à-dire la nouvelle génération de prolétaires qui, venant en grande partie du sud dans une phase d’expansion et de modernisation de l’industrie qui dure de la seconde moitié des années 50 aux premières années 60, va remplacer l’ancienne image de l’ouvrier professionnel ; cette nouvelle génération était en général astreinte à un travail non qualifié et répétitif. Le fait que cette composante du prolétariat, jeune et sans histoire, ait été bien moins sensible aux sirènes du stalinisme et du syndicalisme et beaucoup plus prête à se lancer dans la lutte, a amené les opéraïstes de l’époque à se laisser aller à une analyse sociologique selon laquelle le PCI aurait été l’expression de couches d’ouvriers professionnels, d’une aristocratie ouvrière. 9 Nous verrons plus loin où a conduit cette sorte de purisme social au niveau des choix politiques.
De la conception partidiste à la dissolution du mouvement
Le contexte des années 60, la force énorme et la durée du mouvement de classe en Italie à cette période, le manque d’une expérience qui aurait pu être transmise directement par des organisations prolétariennes préexistantes, ont fait croire à la génération de jeunes militants de l’époque qu’on était arrivé dans une situation révolutionnaire 10 et qu’il fallait établir, face à la bourgeoisie, un rapport de conflit permanent, une sorte de dualité de pouvoir. Il incombait donc aux groupes qui défendaient cette idée (principalement Potere Operaio) d’assumer un rôle dirigeant dans les débats du mouvement ("agir comme un parti") et de développer une action continue et systématique contre l’Etat. Voila comment s’exprimait Toni Negri à ce propos :
"L’activité politique de Potere Operaio sera donc celle de rassembler systématiquement le mouvement de classe, les différentes situations, les différents secteurs de la classe ouvrière et du prolétariat et de les amener vers des échéances, à des moments d’affrontement de masse qui puissent causer des dommages à cette réalité de l’Etat telle qu’elle se présente. L’exercice d’un contre-pouvoir, comme contre-pouvoir lié à des expériences particulières mais qui vise toujours plus à se garantir et à s’exercer contre le pouvoir de l’Etat : cela est aussi un sujet fondamental de l’analyse et une fonction de l’organisation" 11.
Malheureusement, l’absence de critiques des pratiques du stalinisme a conduit les groupes, opéraïstes ou non, à se retrancher derrière des logiques relevant de celles du stalinisme. Parmi celles-ci, l’idée de "l’action exemplaire", capable de pousser les masses à adopter un certain comportement, s’est révélée particulièrement pesante :
"Je n’avais pas des positions pacifistes" dit Negarville, un des chefs du service d’ordre qui avait cherché, et trouvé, l’affrontement avec les policiers sur le Corso Traiano (3 juillet 1969 : 70 policiers blessés, 160 manifestants arrêtés). "L’idée de l’action exemplaire qui provoque la réaction de la police fait partie de la théorie et de la praxis de Lotta Continua depuis le début, les affrontements dans la rue sont comme les batailles ouvrières pour le salaire, fonctionnels au début du mouvement", dit Negarville ; il n’y a rien de pire qu’une manifestation pacifique ou qu’un bon contrat ; ce qui compte, ce n’est pas d’atteindre un objectif mais la lutte, la lutte continue justement. 12
Cette logique est la même que celle qui poussera, plus tard, les différentes formations terroristes à défier l’Etat, sur le dos de la classe ouvrière, en comptant sur le fait que plus on porte l’attaque au cœur de l’Etat, plus les prolétaires auront du courage. L’expérience nous a démontré au contraire que chaque fois que des bandes terroristes ont volé l’initiative à la classe ouvrière, en la mettant dans une situation de chantage objectif, la conséquence a été systématiquement une paralysie de la classe ouvrière. 13
Cette recherche de l’affrontement continu produisit cependant, à la longue, autant un épuisement des énergies qu’une difficulté, pour ces formations opéraïstes, à trouver un espace pour une réflexion politique sérieuse et nécessaire :
"En fait, la vie organisationnelle de Potere Operaio est continuellement interrompue par la nécessité de répondre à des échéances qui, souvent et de plus en plus, dépassent la capacité d’y répondre massivement ; par ailleurs, l’enracinement au niveau de la masse est souvent faible, ce qui exclut la capacité de tenir des échéances." 14
Par ailleurs, le mouvement de lutte de la classe, après avoir manifesté un grand élan avec le développement de luttes encore importantes au début des années 70, commençait cependant à décliner, ce qui a provoqué la fin de l’expérience de Potere Operaio avec la dissolution du groupe en 1973 :
"… dès que nous avons compris que le problème que nous posions était, dans la situation et le rapport de force donnés, insoluble, nous nous sommes dissous. Si nous n’arrivions pas avec nos forces à résoudre ce problème, à ce moment là, c’était la force du mouvement de masse qui devait le résoudre d'une façon ou d'une autre ou, tout au moins, proposer une nouvelle façon de poser le problème." 15
L’hypothèse de départ, selon laquelle on était en présence d’une attaque ouvrière contre le capital, permanente et croissant de manière linéaire, et donc devant les conditions matérielles de la construction "d’un nouveau parti révolutionnaire", s’est révélée bien vite non fondée et ne correspondant pas à la réalité négative du "reflux".
Mais plutôt que d’en prendre acte, les opéraïstes se sont fait prendre par un subjectivisme croissant, en imaginant avoir mis le système économique en crise par ses luttes et en perdant petit à petit tout support matérialiste dans leurs analyses, rejoignant parfois des points de vue définitivement interclassistes.
De l’opéraïsme à l’autonomie ouvrière
Les thèmes politiques qui ont caractérisé l’opéraïsme ne sont pas toujours les mêmes ni toujours mis en avant avec la même vigueur. Néanmoins, toutes les positions de Potere Operaio (et de l’opéraïsme en général) sont marqués par cette exigence d’opposition frontale continuelle à l’Etat, une opposition ostentatoire en continu en tant que signal d’action politique, d’expression de vitalité. Ce qui va changer graduellement, par contre, c’est la référence à la classe ouvrière ou mieux, à l’image de l’ouvrier à laquelle on fait référence qui, après avoir été celle de l’ouvrier-masse, s’est diluée progressivement dans celle d’un soi-disant "ouvrier social" quand il y a eu moins de luttes. C’est cette modification de la référence sociale qui explique d’une certaine manière toute l’évolution, ou plus exactement, l’involution politique de l’opéraïsme.
Pour tenter d’expliquer cette évolution des positions de l’opéraïsme, on invoque un dessein du capital qui tend à défaire la combativité ouvrière, auparavant concentrée dans l’usine, en dispersant la classe sur le territoire.
"… la restructuration capitaliste commençait à s’identifier à une opération colossale sur la composition de la classe ouvrière, opération de dissolution de la forme dans laquelle la classe s’était constituée et déterminée dans les années 70. Dans ces années prévalait l’ouvrier-masse en tant que figure charnière de la production capitaliste et de la production sociale de valeur concentrée sur l’usine. La restructuration capitaliste était obligée, du fait de cette rigidité politique interne entre production et reproduction, de jouer sur l’isolement de l’ouvrier-masse dans l’usine par rapport au processus de socialisation de la production et à l’image de l’ouvrier qui devenait plus diffuse socialement. Par ailleurs, dans la mesure où le processus de production s’étendait socialement, la loi de la valeur commençait à ne jouer que formellement, c'est-à-dire qu’elle ne jouait plus sur le rapport direct entre travail individuel, déterminé, et la plus-value extorquée, mais sur l’ensemble du travail social." 16
L’image de l’ouvrier de référence devient ainsi celle d’un "ouvrier social" fantomatique, image d’autant plus fumeuse que, malgré les précisions de Negri 17, le mouvement de l’époque y a vu un peu de tout.
En réalité, avec la transition de l’ouvrier-masse à l’ouvrier social, l’opéraïsme lui-même se dissout (Potere Operaio) ou dégénère dans le parlementarisme (Lotta Continua) ; un nouveau phénomène apparaît : celui de l’autonomie ouvrière 18 qui se veut la continuation, en forme de mouvement, de l’expérience opéraïste.
L’Autonomie Ouvrière naît en fait en 1973 au Congrès de Bologne, dans une période où toute une partie de la jeunesse se reconnaît dans la figure de l’ouvrier social inventée par Toni Negri. Pour ce "jeune prolétariat", la libération ne passe plus par la conquête du pouvoir, mais par le développement "d’une aire sociale capable d’incarner l’utopie d’une communauté qui se réveille et qui s’organise en dehors du modèle économique, du travail et du salariat" 19 et donc par la mise en action d’un "communisme immédiat". La politique devient "luxurieuse", dictée et soumise au désir et aux besoins. Construit autour de centres sociaux, où se rencontrent les jeunes des quartiers populaires, ce "communisme immédiat" se traduit dans la pratique par la multiplication d’actions directes, parmi lesquelles principalement "les expropriations prolétariennes", imaginées comme sources de "salaire social", "les auto-réductions, les occupations de sites d’hébergement", publics et privés, et une expérience confuse d’autogestion et de vie alternative. De plus, l’attitude volontariste, qui prend ses désirs pour des réalités, se renforce, jusqu’à imaginer une situation dans laquelle la bourgeoisie subit l’assaut de l’ouvrier social :
"… maintenant désormais, la situation italienne est dominée par un contre-pouvoir irréductible, radical, qui n’a plus rien à faire, simplement, avec l’ouvrier des usines, avec la situation établie par le 'Statut des travailleurs' ou par des constructions institutionnelles post-soixante-huitardes déterminées. Nous nous trouvons au contraire dans une situation dans laquelle, au sein de tout le processus de reproduction – et ce doit être souligné – l’auto-organisation ouvrière est acquise en termes désormais définitifs" 20.
Cette analyse ne s’est pas limitée à la situation italienne, mais a été étendue au niveau international, surtout aux pays où l’économie est la plus développée, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. La conviction que le mouvement ouvrier est dans une position de force est tellement puissante qu’elle fait croire à Toni Negri (et aux autonomes de l’époque) que désormais les Etats ont décidé de mettre la main au portefeuille pour tenter d’endiguer l’offensive prolétarienne en distribuant une plus grande partie du revenu :
"… ce sont des phénomènes que nous connaissons parfaitement dans les économies plus avancées que la nôtre, des phénomènes qui se sont réalisés complètement pendant toutes les années 60, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où la possibilité de bloquer le mouvement était vraiment recherchée, d’un côté à travers la destruction des avant-gardes subjectives du mouvement, de l’autre, de manière importante, à travers la capacité de contrôle, qui se fondait sur une disponibilité énorme de cash, sur une articulation énorme de la distribution du revenu." 21
Ainsi donc, dans une situation dans laquelle "tout le processus de la valeur n’existe plus", les patrons auraient été même disposés à ne plus rien gagner si ce n’est "restaurer les règles de l’accumulation" et "socialiser de façon complète les instruments de contrôle et de commande". 22 En d’autres termes, on s’imagine avoir déstabilisé l’Etat avec sa lutte, l’avoir mis en crise sans même se rendre compte que, de plus en plus, il ne restait dans la rue qu' une jeunesse qui avait de moins en moins à voir avec le monde de l’usine et du travail et qui, par conséquent, avait de moins en moins la capacité d’imposer un rapport de force à la bourgeoisie.
Ce qui est caractéristique de cette période, c’est le concept d’ "autovalorisation ouvrière" qui, au-delà des aspects liés aux conquêtes matérielles, se référait "à des moments de contre pouvoir", c'est-à-dire "à des moments politiques d’autodétermination, de séparation de la réalité de classe de celle qui est globalement la réalité de la production capitaliste" 23. Dans ce contexte, "la conquête prolétarienne du revenu" aurait été capable de "détruire parfois l’équation de la loi de la valeur". 24 Ici, on confond la capacité de la classe d’obtenir de plus hauts salaires et donc de réduire la part de plus value extorquée par les capitalistes avec une prétendue "destruction" de la loi de la valeur. La loi de la valeur par contre, comme l’a démontré toute l’histoire du capitalisme, tient bien la route et a survécu jusque dans les pays du soi-disant "socialisme réel" (les pays de l’Est qu’on appelait à l’époque, insidieusement, communistes).
Nous pouvons voir, d’après tout cet ensemble, qu’il existait, au sein du milieu de l’autonomie ouvrière, la grande illusion que le prolétariat pourrait, au sein de la société bourgeoise, créer et jouir de positions de contre pouvoir relativement "stables", alors que le rapport de double pouvoir est une condition particulièrement précaire, typique des périodes révolutionnaires qui, soit évoluent en une offensive victorieuse de la révolution prolétarienne, avec l’affirmation du pouvoir exclusif de la classe ouvrière et l’anéantissement du pouvoir bourgeois, soit dégénèrent en défaite de la classe.
C’est cette déconnexion importante d’avec la réalité matérielle, les bases économiques de la lutte, qui a amené au développement fantaisiste et estudiantin des positions politiques de l’autonomie.
Parmi les positions particulièrement en vogue chez les militants de l’autonomie ouvrière, il y avait le refus du travail en rapport étroit avec celle sur la théorie des besoins. A l’observation pertinente que l’ouvrier doit tendre à ne pas rester englué dans la logique des intérêts patronaux et à réclamer la satisfaction de ses besoins fondamentaux, les théoriciens de l’autonomie superposent une théorie qui va plus loin, identifiant l’autovalorisation ouvrière au sabotage de la machine patronale, jusqu’à prétendre qu’il y a un plaisir dans cette action de sabotage. C’est ce qui ressort de la description satisfaite que fait Toni Negri quand il parle de la liberté qu’ont pris les ouvriers d’Alfa Romeo quand ils se mettent à fumer sur les chaînes sans s’occuper des dégâts causés à la production. Il ne fait aucun doute que, à certains moments, on éprouve une profonde satisfaction à faire quelque chose qui est inutilement défendu, à faire de toute façon quelque chose qu’on te refuse avec l’arrogance de la force. C’est une satisfaction psychologique et même physique. Mais qu’est ce que cela a à voir avec les conclusions qu’en tire Toni Negri pour qui ce fait de fumer aurait été "une chose super-importante (…) importante, du point de vue théorique, presque autant que la découverte que c’est la classe ouvrière qui détermine le développement du capital" ??? Selon Negri, "la sphère des besoins" n’est plus celle des besoins matériels, objectifs, naturels, mais quelque chose qui crée petit à petit, "qui passait à travers, et réussissait à dominer, toutes les occasions qu’offrait la contre culture".
D’une certaine manière, le juste refus de rester aliéné, non seulement matériellement, mais aussi mentalement, à son poste de travail, ce qui s’exprime dans les entorses à la discipline d’usine, est présenté comme "un fait qualitatif formidable ; un fait qui se rapporte exactement à la dimension de l’expansion des besoins. Que signifie en fait jouir du refus du travail, quoi d’autre cela pourrait-il signifier sinon avoir construit en son sein même une série de capacités matérielles de jouissance qui sont complètement alternatives au rythme travail-famille-bar, et utiles à la rupture de ce monde fermé, en découvrant dans l’expérience de la révolte, des capacités et un pouvoir alternatif radical". 25
En réalité, c’est en se perdant derrière ces chimères vides et privées de toute perspective que l’opéraïsme, dans sa version ouvrier social, dégénère complètement en se dispersant dans nombre d’initiatives séparées, visant chaque fois à revendiquer la satisfaction des besoins de telle ou telle catégorie, à mille lieues de l’expression de cette solidarité de classe qui s’était exprimée pendant l’automne chaud et qui ne reviendra que plus tard quand la parole reviendra à la classe ouvrière.
Réactions de l’Etat et épilogue de l’Automne chaud
Comme nous l’avons dit au début de cet article, la capacité de récupération de la bourgeoisie s’est en grande partie fondée sur les faiblesses du mouvement prolétarien que nous avons évoquées. Il faut cependant dire que la bourgeoisie, après s'être révélée complètement surprise dans un premier temps, a été ensuite capable de lancer une attaque sans précédent contre le mouvement ouvrier, autant de façon directe sur le plan de la répression, que sur le plan de manœuvres de toutes sortes.
Au niveau de la répression
C’est l’arme classique de la bourgeoisie contre son ennemi de classe, même si ce n’est pas l’arme décisive qui lui permet de créer vraiment un rapport de force contre le prolétariat. Entre octobre 1969 et janvier 1970, il y a plus de trois mille mises en accusation d’ouvriers et d’étudiants.
"Les étudiants et les ouvriers, plus de trois mille entre octobre 69 et janvier 70, ont été poursuivis. Les articles du code fasciste, qui punissent ‘la propagande subversive’ et ‘l’instigation à la haine entre les classes’ ont été exhumés. La police et les carabiniers confisquaient les oeuvres de Marx, Lénine et Che Guevara". 26
Au niveau du jeu fascisme/antifascisme
C’est l’arme classique contre le mouvement étudiant, moins dans les conflits avec la classe ouvrière, qui consiste à dévoyer le mouvement dans des affrontements de rue stériles entre bandes rivales, avec le recours obligé, à un certain niveau, aux composantes "démocratiques et antifascistes" de la bourgeoisie. En bref, c’est une façon de faire rentrer les moutons à la bergerie.
Au niveau de la stratégie de la tension
C’est sûrement le chef d’œuvre de la bourgeoisie italienne dans ces années, qui a réussi à changer profondément le climat politique. Tout le monde se souvient du massacre de la Banque de l’Agriculture, Place Fontana à Milan, le 12 décembre 1969, qui a fait 16 morts et 88 blessés. Mais tout le monde ne sait pas, ou ne se souvient pas, qu’à partir du 25 avril 69, l’Italie a souffert d’une série ininterrompue d’attentats :
"Le 25 avril, deux bombes explosent à Milan, une à la Gare centrale et l’autre, qui fait une vingtaine de blessés, au stand Fiat de la Foire. Le 12 mai, trois engins explosifs, deux à Rome et un à Turin, n’explosent pas par pur hasard. En juillet, l’hebdomadaire ‘Panorama’ se fait l’écho de rumeurs d’un coup d’Etat de droite. Des groupes néofascistes lancent un appel à la mobilisation, le PCI met ses sections en état d’alerte. Le 24 juillet, un engin explosif similaire à ceux découverts à Rome et à Turin est trouvé, non explosé, au Palais de Justice de Milan. Le 8 et le 9 août, huit attentats contre les chemins de fer provoquent des dégâts importants et font quelques blessés. Le 4 octobre, à Trieste, un explosif déposé dans une école élémentaire et programmé pour exploser à l’heure de sortie des enfants, n’explose pas du fait d’un défaut technique ; on accuse un militant d’Avanguardia Nazionale (un groupe d'extrême droite, ndt). A Pise, le 27 octobre, le bilan d’une journée d’affrontements entre la police et des manifestants qui réagissent à une manifestation de fascistes italiens et grecs, est d’un mort et cent vingt cinq blessés. (…) Le 12 décembre, quatre engins explosifs explosent à Rome et Milan. Les trois de Rome ne font pas de victime, mais celui de Milan, place Fontana en face de la Banque de l’Agriculture, fait 16 morts et 88 blessés. Un cinquième engin explosif, à Milan toujours, est retrouvé intact. Ainsi commence, pour l’Italie, ce qui a été défini effectivement comme la longue nuit de la République". 27
En ce qui concerne la période suivante, le rythme ne s’est que légèrement abaissé, mais n’a jamais cessé. De 1969 à 1980, on a enregistré 12 690 attentats et autres moments de violence pour des raisons politique, qui ont fait 362 morts et 4490 blessés. Parmi eux, le nombre de morts et de blessés par attentats se monte respectivement à 150 et 551, au total onze attentats, le premier en décembre 69, Piazza Fontana à Milan, le plus grave (85 morts et 200 blessés) à la gare de Bologne en août 1980. 28
"… l’État violent se révéla au-delà de toute attente : il organisait les attentats, déjouait les enquêtes, arrêtait des innocents, en tuait un, Pinelli, avec en plus la bénédiction de quelques journaux et de la TV. Le 12 décembre a représenté la découverte d’une dimension imprévue de la lutte politique et même la révélation de l’ampleur du front contre lequel nous devions nous battre (…). Avec la Piazza Fontana, on découvrit donc un nouvel ennemi : l’État. Avant, les adversaires étaient le professeur, le chef d’équipe, le patron. Les références étaient transnationales, de différentes régions du monde : le Vietnam, le Mai français, les Black Panthers, la Chine. La révélation de l’Etat terroriste ouvrait un nouvel horizon aux luttes : celui des complots, de l’instrumentalisation des néofascistes" 29
Le but évident de cette stratégie était d’intimider et désorienter le plus possible la classe ouvrière, répandre la peur des bombes et de l’insécurité, ce en quoi elle a partiellement réussi. Cela a eu aussi un autre effet, certainement plus néfaste. Dans la mesure où, avec la Piazza Fontana, on découvrait, au moins, au niveau de minorités, que c’était l’État le véritable ennemi, celui avec lequel il fallait régler les comptes, une série de composantes prolétariennes et étudiantes allaient virer vers le terrorisme en tant que méthode de lutte.
La dynamique terroriste encouragée
La pratique du terrorisme est devenue ainsi la façon dont beaucoup de camarades courageux, mais aventureux, ont détruit leur vie et leur engagement politique dans une pratique n'ayant rien à voir avec la lutte de classe. Cette pratique a de plus conduit aux pires résultats, en provoquant un recul de toute la classe ouvrière devant la double menace de la répression de l’État d’une part et du chantage du monde "brigadiste" et terroriste d’autre part.
Les syndicats récupèrent via les Conseils d'Usine
Le dernier élément, mais sûrement pas en terme d’importance, sur lequel la bourgeoisie s’est appuyée a été le syndicat. Ne pouvant compter sur la répression pour tenir le prolétariat à distance, le patronat qui, pendant toutes les années d'après-guerre jusqu’à la veille de l’automne chaud, avait été fortement hostile au syndicat, se redécouvrait démocratique et amoureux des bonnes relations dans les entreprises. La tromperie, évidemment, c’est que ce qu’on n'arrive pas à obtenir avec de mauvaises relations, on cherche à l’avoir avec les bonnes, en recherchant le dialogue avec les syndicats considérés comme uniques interlocuteurs en mesure de contrôler les luttes et les revendications ouvrières. Ce plus grand champ démocratique offert aux syndicats, qui se traduira par l’établissement et le développement des Conseils d’Usine, forme de syndicalisme de base dans lesquels il n’est pas nécessaire d’avoir une carte pour participer, a donné aux travailleurs l’illusion d’avoir conquis cela eux-mêmes et qu’ils pouvaient faire confiance à ces nouvelles structures pour continuer leur lutte. En fait, la lutte des ouvriers, bien que souvent très critique dans les rapports avec les syndicats, n’a pas réussi à en faire une critique radicale, se bornant à en dénoncer les inconséquences.
Pour conclure …
Dans ces deux articles, nous avons cherché à montrer, d’un côté, la force et les potentialités de la classe ouvrière, de l’autre, l’importance que son action soit soutenue par une conscience claire de la route à parcourir. Le fait que les prolétaires qui s'étaient réveillés à la fin des années 60 à la lutte de classe, en Italie et dans le monde entier, n’aient pas disposé de la mémoire des expériences du passé et qu’ils aient dû s’appuyer seulement sur des acquis empiriques qu’ils pouvaient accumuler petit à petit, a constitué l’élément majeur de la faiblesse du mouvement.
Aujourd’hui, dans les différentes évocations de 68 en France et de l’automne chaud italien, nombreux sont ceux qui se laissent aller à des soupirs de nostalgie en pensant que cette époque est bien lointaine et que des luttes semblables ne peuvent plus resurgir. Nous pensons que c’est vraiment le contraire. De fait, l’automne chaud, le Mai français et l’ensemble des luttes qui ont secoué la société mondiale à la fin des années 60, n’ont été que le début de la reprise de la lutte de classe, mais les années qui ont suivi ont vu un développement et une maturation de la situation. Aujourd’hui, en particulier, il existe, au niveau mondial, une présence plus significative des avant-gardes politiques internationalistes (bien qu'encore encore ultra minoritaires), qui, contrairement aux groupes sclérosés du passé, sont capables de débattre entre elles, de travailler et d’intervenir ensemble, leur objectif commun à toutes étant le développement de la lutte de classe. 30 De plus, il n’y a pas aujourd'hui dans la classe seulement une combativité de base permettant l'éclosion de luttes un peu partout dans le monde 31. Il y a aussi le sentiment diffus que désormais cette société dans laquelle nous vivons n’a plus rien à offrir à qui que ce soit, sur le plan économique comme sur celui de la sécurité vis-à-vis des catastrophes environnementales ou des guerres, etc. Et un tel sentiment tend à se répandre, à tel point qu’il arrive quelquefois d’entendre parler de la nécessité de la révolution par des personnes qui n’ont aucune expérience politique. En même temps, la plupart de ces personnes considèrent que la révolution n'est pas possible, que les exploités n'auront pas la force de renverser le système capitaliste :
"On peut résumer cette situation de la façon suivante : à la fin des années 1960, l’idée que la révolution était possible pouvait être relativement répandue mais celle qu’elle était indispensable ne pouvait pas s’imposer. Aujourd’hui, au contraire, l’idée que la révolution soit nécessaire peut trouver un écho non négligeable mais celle qu’elle soit possible est extrêmement peu répandue.
Pour que la conscience de la possibilité de la révolution communiste puisse gagner un terrain significatif au sein de la classe ouvrière, il est nécessaire que celle-ci puisse prendre confiance en ses propres forces et cela passe par le développement de ses luttes massives. L’énorme attaque qu’elle subit dès à présent à l’échelle internationale devrait constituer la base objective pour de telles luttes. Cependant, la forme principale que prend aujourd’hui cette attaque, celle des licenciements massifs, ne favorise pas, dans un premier temps, l’émergence de tels mouvements. En général, (…) les moments de forte montée du chômage ne sont pas le théâtre des luttes les plus importantes. Le chômage, les licenciements massifs, ont tendance à provoquer une certaine paralysie momentanée de la classe. (…) C’est pour cela que si, dans la période qui vient, on n’assiste pas à une réponse d’envergure de la classe ouvrière face aux attaques, il ne faudra pas considérer que celle-ci a renoncé à lutter pour la défense de ses intérêts. C’est dans un second temps, lorsqu’elle sera en mesure de résister aux chantages de la bourgeoisie, lorsque s’imposera l’idée que seule la lutte unie et solidaire peut freiner la brutalité des attaques de la classe régnante, notamment lorsque celle-ci va tenter de faire payer à tous les travailleurs les énormes déficits budgétaires qui s’accumulent à l’heure actuelle avec les plans de sauvetage des banques et de "relance" de l’économie, que des combats ouvriers de grande ampleur pourront se développer beaucoup plus." (Résolution sur la situation internationale du 18e congrès du CCI, 2009, Revue internationale n° 138)
Ce sentiment d'impuissance a pesé et pèse encore sur la génération actuelle de prolétaires et explique par moments les hésitations, les retards, le manque de réactions face aux attaques de la bourgeoisie. Mais nous devons voir notre classe avec la confiance qui nous vient de la connaissance de son histoire et de ses luttes passées ; nous devons travailler pour relier les luttes du passé avec celles du présent ; nous devons participer aux luttes et donner en leur sein courage et confiance dans l’avenir, accompagnant et stimulant la reconquête par le prolétariat dans sa prise de conscience que le futur de l'humanité repose sur ses épaules, et qu'il a la capacité d'accomplir cette tâche immense.
Ezechiele (23/08/10)
1. Voir en particulier le rôle néfaste de la "résistance au fascisme» qui, au nom d’une prétendue "lutte pour la liberté", conduira les prolétaires à se faire massacrer pour une fraction de la bourgeoisie contre une autre d’abord dans la guerre d’Espagne (1936-1939) et ensuite dans la Seconde Guerre mondiale.
2. "Ayant formé le Parti en 1945, alors que la classe était encore soumise à la contre-révolution et n'ayant pas ensuite fait la critique de cette formation prématurée, ces groupes (qui continuaient à s'appeler "parti") n'ont plus été capables de faire la différence entre la contre-révolution et la sortie de la contre-révolution. Dans le mouvement de mai 1968 comme dans l'automne chaud italien de 1969, ils ne voyaient rien de fondamental pour la classe ouvrière et attribuaient ces événements à l'agitation des étudiants. Conscients par contre du changement du rapport de forces entre les classes, nos camarades de Internacionalismo (et notamment MC, ancien militant de la Fraction et de la GCF) ont compris la nécessité d'engager tout un travail de discussion et de regroupement avec les groupes que le changement de cours historique faisait surgir. A plusieurs reprises, ces camarades ont demandé au PCInt de lancer un appel à l'ouverture d'une discussion entre ces groupes et à la convocation d'une conférence internationale dans la mesure où cette organisation avait une importance sans commune mesure avec notre petit noyau au Venezuela. A chaque fois, le PCInt a rejeté la proposition arguant qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Finalement, un premier cycle de conférences a pu se tenir à partir de 1973 à la suite de l'appel lancé par Internationalism, le groupe des États-Unis qui s'était rapproché des positions de Internacionalismo et de Révolution Internationale, fondée en France en 1968. C'est en grand partie grâce à la tenue de ces conférences, qui avaient permis une décantation sérieuse parmi toute une série de groupes et d'éléments venus à la politique à la suite de mai 68, qu'a pu se constituer le CCI en janvier 1975". (Tiré de "Les trente ans du CCI : s’approprier le passé pour construire l’avenir [123]")
3. Sur le PCI, voir les deux articles "Breve Storia del PCI ad uso dei proletari che non vogliono credere piu a niente ad occhi chiusi" I (1921-1936) et II (1936-1947) (Rivoluzione Internazionale n° 63 et 64). ("Brève histoire du PCI à l'usage des prolétaires qui ne veulent plus croire les yeux fermés"). Le roman d’Ermanno Rea, Mistero napoletano, (Ed. Einaudi) est particulièrement intéressant, pour comprendre la pesanteur des rapports au sein du PCI de ces années)
4. Aldo Cazzulo, "I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978. Storia critica di Lotta Continua" Sperling et Kupfer, Eds, p. 8.
5. "Tra servi e padroni", in Lotta Continua du 6 décembre 1969, cité aussi dans Aldo Cazzullo, op.cit.p. 89.
6. Antonio Negri, "De l'ouvrier-masse à l'ouvrier social. Entretien sur l'opéraïsme". En italien, édition Ombre Corte.
7. Antonio Negri, op.cit, p. 36-37.
8. On ne peut qu’être impressionné par la quantité d’éléments dans le monde d’aujourd’hui, qui sont des personnages publics, politiques, journalistes, écrivains, avec des positions politiques de centre gauche ou même de droite, qui sont passés hier par des groupes de la gauche extra-parlementaire et, en particulier, par l’opéraïsme. N’en citons que quelques uns : Massimo Cacciari, député PD (Margherita avant) et deux fois maire de Venise ; Alberto Asor Rosa, écrivain et critique littéraire ; Adriano Sofri, journaliste modéré à La Repubblica et Il Foglio ; Mario Tronti, revenu au PCI au niveau du comité central et élu sénateur ; Paolo Liguori, journaliste avec des responsabilités directoriales dans différents journaux télévisés et autres entreprises éditoriales de Berlusconi... Et la liste pourrait se poursuivre avec des dizaines et des dizaines d’autres noms.
9. Nous ne partageons pas l’analyse de Lénine sur l’existence d’une aristocratie ouvrière au sein de la classe ouvrière. Voir notre article : "L’aristocratie ouvrière : une théorie sociologique pour diviser la classe ouvrière [124]" (Revue Internationale n° 25).
10. Idée largement répandue aussi au niveau international.
11. Antonio Negri, op. cit., p. 105
12. Aldo Cazzullo, op. cit., p. XII
13. Voir à ce propos "Terreur, terrorisme et violence de classe [125]" (Revue Internationale n° 14) ; "Sabotage des lignes SNCF : des actes stériles instrumentalisés par la bourgeoisie contre la classe ouvrière [126]" (ICC on line, 2008) ; "Débat sur la violence (II) : il est nécessaire de dépasser le faux dilemme : pacifisme social-démocrate ou violence minoritaire [127]". (ICC on line, 2009)
14. Antonio Negri, op. cit., p. 105
15. Antonio Negri, op. cit. p. 108
16. Antonio Negri, op. cit., p. 113
17. "Quand on dit ‘ouvrier social’, on dit vraiment, avec une précision extrême, que de la plus-value est extraite de ce sujet. Quand nous parlons ‘d’ouvrier social’, nous parlons d’un sujet qui est productif et quand nous disons qu’il est productif, nous disons qu’il est producteur de plus-value, à terme ou immédiatement". Antonio Negri, op. cit. p.18
18. Sur cette question, voir nos articles: "L’Area della Autonomia: la confusione contro la classe operaia (1)" (Rivoluzione Internazionale n°8) et (2) (Rivoluzione Internazionale n° 10)
19. N. Balestrini, P. Moroni, "L’orda d’oro", Milano, SugarCo Edizioni, 1988, p. 334
20. Antonio Negri, op.cit.,p. 138
21. Antonio Negri, op.cit.,p. 116-117
22. Antonio Negri, op.cit.,p. 118
23. Antonio Negri, op.cit.,p. 142
24. Antonio Negri, op.cit.,p. 142
25. Antonio Negri, op.cit.,p. 130-132
26. Alessandro Silj, "Malpaese, Criminalità, corruzione et politica nell’Italia della prima Repubblica 1943-1994", Donzelle Editeur, p. 100-101
27. Alessandro Silj, op. cit., p. 95-96
28. Alessandro Silj, op. cit., p. 113
29. Témoignage de Marco Revelli, à l’époque militant de Lotta Continua. In : Aldo Cazzullo, op. cit., p. 91
30. Il n’est pas possible de reporter ici la liste des différents articles relatifs à cette nouvelle génération d’internationalistes, nous invitons donc les lecteurs à visiter notre site sur lequel ils pourront trouver un grand nombre d’informations.
31. Sur le développement actuel de la lutte de classe, nous renvoyons aussi à notre site web, en attirant en particulier l’attention sur la lecture des articles à propos de Vigo (Espagne), la Grèce et Tekel (Turquie).
Géographique:
- Italie [39]
Qu'est-ce que les conseils ouvriers (IV) : 1917-21 : les soviets tentent d'exercer le pouvoir
- 4933 lectures
Dans les articles précédents de cette série, nous avons suivi l’apparition des conseils ouvriers (soviets en russe) au cours de la Révolution de 1905, leur disparition puis leur resurgissement au cours de la Révolution de 1917, leur crise et leur reprise en mains par les ouvriers, qui les amena à la prise de pouvoir en octobre 1917 1. Nous aborderons dans cet article la tentative d'exercice du pouvoir par les soviets, moment fondamental dans l'histoire de l’humanité : "car pour la première fois ce n'est pas une minorité, ce ne sont pas uniquement les riches, uniquement les couches instruites, c'est la masse véritable, l'immense majorité des travailleurs qui édifient eux-mêmes une vie nouvelle, tranchent en se fondant sur leur expérience, les problèmes si ardus de l'organisation socialiste" 2.
Octobre 1917- avril 1918 : l’ascension des soviets
Animées par un extraordinaire enthousiasme, les masses d’ouvriers s’attelèrent à la tâche de consolider et poursuivre ce qu’elles avaient commencé avant la Révolution. L’anarchiste Paul Avrich décrit l'atmosphère de ces premiers mois en soulignant qu'il existait "un degré de liberté et un sentiment de puissance qui furent uniques dans toute son histoire [celle de la classe ouvrière russe]" 3.
Le mode de fonctionnement que tenta de mettre en place le pouvoir soviétique était radicalement différent de celui de l’Etat bourgeois où l’Exécutif – le Gouvernement – jouit de pouvoirs pratiquement absolus tandis que le Législatif – le Parlement – et le Judiciaire qui, théoriquement, doivent le contrebalancer, lui sont en réalité fortement subordonnés. En tout état de cause, les trois pouvoirs sont totalement séparés de la grande majorité de la population dont le rôle est limité à déposer régulièrement le bulletin de vote dans l’urne 4. Le pouvoir soviétique se basait quant à lui sur deux prémisses complètement nouvelles :
– la participation active et massive des ouvriers ;
– ce sont eux – c’est-à-dire la masse de travailleurs – qui débattent, décident et exécutent.
Comme le dit Lénine au IIe Congrès des Soviets : "La force se manifeste, de l'avis de la bourgeoisie, quand les masses vont aveuglément à l'abattoir [...] La bourgeoisie ne reconnaît comme fort un gouvernement que s'il peut, usant de toute la puissance du mécanisme gouvernemental, jeter les masses où elle l'entend. Notre conception de la force est différente. A notre avis, un gouvernement est fort de la conscience des masses. Il est fort quand ces masses savent tout, jugent de tout, acceptent tout consciemment." 5.
Dès qu’ils eurent pris le pouvoir, les soviets se heurtèrent cependant à un obstacle : l'Assemblée constituante ; celle-ci représentait la négation même de toutes ces prémisses et le retour au passé : la délégation de pouvoir et son exercice par une caste bureaucratique de politiciens.
Face au tsarisme, le mouvement ouvrier en Russie avait revendiqué l'Assemblée constituante comme pas en avant vers une République bourgeoise, mais la Révolution de 1917 avait largement dépassé ce vieux mot d’ordre. Le poids du passé se révéla dans l’influence qu’il continuait à avoir, y compris après la proclamation du pouvoir soviétique, non seulement auprès de vastes masses d’ouvriers mais également auprès de nombreux militants du Parti bolchevique qui considéraient cette Assemblée constituante compatible avec le pouvoir des soviets.
"L'une des fautes les plus graves et les plus lourdes de conséquences que la coalition bourgeoise socialiste commit, ce fut d'ajourner, sous des prétextes essentiellement juridiques, les élections [à l'Assemblée constituante]" 6. Les gouvernements qui se succédèrent entre février et octobre 1917 l'avaient ajournée maintes et maintes fois, trahissant de fait ce qu'eux-mêmes présentaient comme leur aspiration ultime. Les bolcheviks – non sans divisions et contradictions en leur sein – avaient durant cette période été ses principaux défenseurs, tout en sachant son incohérence avec le mot d’ordre de "Tout le pouvoir aux soviets !".
Ainsi se fit jour un paradoxe : trois semaines après la prise du pouvoir par les soviets, ceux-ci accomplirent la promesse de convoquer des élections pour l'Assemblée constituante. Ces élections donnèrent la majorité aux socialistes-révolutionnaires de droite (299 sièges), suivis de loin par les bolcheviks (168), puis par les socialistes-révolutionnaires de gauche (39) et autres groupes de moindre importance.
Comment est-il possible que le résultat électoral donne la victoire aux perdants d'Octobre ?
Plusieurs facteurs l’expliquent, mais le plus évident en Russie à ce moment précis est que le vote met sur un pied d'égalité des "citoyens" dont la condition est radicalement antagonique : ouvriers, patrons, bureaucrates, paysans, etc., ce qui favorise toujours la minorité exploiteuse et la conservation du statu quo. Plus généralement, il existe un autre facteur qui affecte la classe révolutionnaire : le vote est un acte où l'individu atomisé se laisse porter par de multiples considérations, influences et intérêts particuliers, donnés par l’illusion d’être un "citoyen" hypothétiquement libre et n’exprimant donc en rien la force active d'un collectif. L’ouvrier "citoyen individuel" qui vote dans l’isoloir et l’ouvrier qui participe à une assemblée sont comme deux personnes différentes.
L'Assemblée constituante fut toutefois complètement inopérante. Elle se discrédita elle-même. Elle prit quelques décisions grandiloquentes qui restèrent sans effet, ses réunions se limitant à n’être qu’une succession de discours ennuyeux. L'agitation bolchevique, appuyée par des anarchistes et des socialistes-révolutionnaires de gauche, posa clairement le dilemme Soviets ou Assemblée constituante et participa ainsi à la clarification des consciences. Après de multiples avatars, l'Assemblée constituante fut tranquillement dissoute en janvier 1918 par les matelots chargés d'en monter la garde pour assurer sa sécurité.
Le pouvoir exclusif passa aux mains des soviets au travers desquels les masses ouvrières réaffirmèrent leur existence politique. Pendant les premiers mois de la révolution et au moins jusqu'à l'été 1918, l'auto-activité permanente des masses, que nous avions déjà vu se manifester dès février 1917, non seulement se poursuivit mais s’amplifia et se renforça. Les travailleurs, les femmes, les jeunes, vivaient dans une dynamique d'assemblées, de conseils d'usine, de quartier, de soviets locaux, de conférences, de meetings, etc. "La première phase du régime soviétique fut celle de l'autonomie presque illimitée de ses institutions locales. Animés d'une vie intense et de plus en plus nombreux, les Soviets, à la base, se montrèrent jaloux de leur autorité" 7. Les soviets locaux discutaient prioritairement d'affaires concernant toute la Russie mais aussi de la situation internationale, en particulier du développement des tentatives révolutionnaires 8.
Le Conseil des commissaires du peuple, créé par le IIe Congrès des Soviets, n'était pas conçu comme un gouvernement de fait, c'est-à-dire comme un pouvoir indépendant monopolisant toutes les affaires mais, au contraire, comme l'animateur et le moteur de l'action massive. Anweiler cite la campagne d'agitation dirigée par Lénine en ce sens: "Le 18 novembre, Lénine appela les travailleurs à prendre en main propre toutes les affaires publiques : vos soviets sont à partir de maintenant des organes de gouvernement tout-puissants, qui décident de tout" 9. Ce n'était pas de la rhétorique. Le Conseil des commissaires du peuple ne disposait pas, comme les gouvernements bourgeois, d’une constellation impressionnante de conseillers, fonctionnaires de carrière, gardes du corps, collaborateurs, etc. Comme le raconte Victor Serge 10, cet organe comptait un chef de service et deux collaborateurs. Ses sessions consistaient à examiner chaque affaire avec des délégations ouvrières, des membres du Comité exécutif des Soviets ou du Soviet de Petrograd et de Moscou. "Le secret des délibérations du Conseil des ministres" avait été aboli.
En 1918, se tinrent quatre congrès généraux des soviets de toute les Russies : le IIIe en janvier, le IVe en mars, le Ve en juillet et le VIe en novembre. Ceci montre la vitalité et la vision globale qui animaient les soviets. Ces congrès généraux, qui requéraient un immense effort de mobilisation – les transports étaient paralysés et la guerre civile rendait très compliqué le déplacement des délégués – exprimaient l'unité globale des soviets et concrétisaient leurs décisions.
Les congrès étaient animés par de vifs débats où participaient non seulement les bolcheviks, mais aussi les mencheviks internationalistes, les socialistes-révolutionnaires de gauche, les anarchistes, etc. Les bolcheviks y exprimaient même leurs propres divergences. L’atmosphère était celle d’un profond esprit critique, ce qui fit dire à Victor Serge : "pour être honnêtement servie, [la révolution] doit sans cesse être mise en garde contre ses propres abus, ses propres excès, ses propres crimes, ses propres éléments de réaction. Elle a donc un besoin vital de la critique, de l'opposition, du courage civique de ceux qui l'accomplissent" 11.
Aux IIIe et IVe Congrès, il y eut un débat orageux sur la signature d'un traité de paix avec l'Allemagne – Brest-Litovsk 12 – centré sur deux questions : comment pouvait se maintenir le pouvoir soviétique en attendant la révolution internationale ? Comment pouvait-il contribuer réellement à celle-ci ? Le IVe Congrès fut le théâtre d'une confrontation aiguë entre bolcheviks et socialistes-révolutionnaires de gauche. Le VIe congrès se centra sur la révolution en Allemagne et adopta des mesures pour la soutenir, entre autres l'envoi de trains contenant d’énormes quantités de blé, ce qui exprimait l’énorme solidarité et le dévouement des travailleurs russes qui étaient à ce moment-là rationnés : 50 grammes de pain quotidien à peine !
Les initiatives des masses traversaient tous les aspects de la vie sociale. Nous ne pouvons ici en effectuer une analyse détaillée. Nous nous contenterons de mettre en avant la création de tribunaux de justice dans les quartiers ouvriers, conçus comme d’authentiques assemblées où se discutaient les causes des délits ; les sentences qui y étaient adoptées visaient à modifier la conduite des malfaiteurs et non à punir ou se venger. "Du public, raconte la femme de Lénine, plusieurs ouvriers ainsi que des ouvrières prirent la parole et leurs interventions eurent quelquefois des accents enflammés. 'L'avocat' ne cessait pas, dans son embarras, d'éponger son front en sueur, après quoi l'accusé, le visage baigné de larmes, promit de ne plus battre son fils. A vrai dire, il ne s'agissait pas tellement d'un tribunal que d'une réunion populaire exerçant un contrôle sur la conduite des citoyens. Sous nos yeux, l'éthique prolétarienne était en train de prendre corps." 13
D'avril à décembre 1918 : crise et déclin du pouvoir soviétique
Toutefois, ce puissant élan allait déclinant et les soviets s’altéraient, s'éloignant de la majorité des ouvriers. En mai 1918, parmi la classe ouvrière à Moscou et à Petrograd, circulaient déjà des critiques croissantes sur la politique des soviets dans ces deux villes. Comme cela avait le cas en juillet-septembre 1917, il y eut une série de tentatives de rénovation des soviets 14 ; dans les deux villes en question se tinrent des conférences indépendantes qui, bien qu'elles fussent fondées sur des revendications économiques, se donnaient comme principal objectif la rénovation des organes soviétiques. Les mencheviks y obtinrent la majorité. Ceci poussa les bolcheviks à rejeter ces conférences et à les taxer de contre-révolutionnaires. Les syndicats furent mobilisés pour les démanteler et elles disparurent rapidement.
Cette mesure contribua à saper les bases de l'existence même des soviets. Dans l'article précédent de cette série, nous avons montré que les soviets ne flottaient pas dans le vide mais qu’ils étaient la figure de proue du grand vaisseau prolétarien formé par d’innombrables organisations soviétiques, les comités d’usine, les conseils de quartier, les conférences et assemblées de masses, etc. Dès le milieu de 1918, ces organismes commencèrent à décliner et disparurent progressivement. Les comités d'usine (dont nous reparlerons) disparurent les premiers, puis les soviets de quartier entrèrent à leur tour dans une agonie qui dura de l'été 1918 à leur totale disparition, fin 1919.
Les deux ingrédients vitaux des soviets sont le réseau massif d'organisations soviétiques de base et leur rénovation permanente. La disparition des premières s’est accompagnée de l'élimination progressive de la seconde. Les soviets tendaient à montrer toujours les mêmes visages, évoluant peu à peu vers une bureaucratie inamovible.
Le Parti bolchevique contribua involontairement à ce processus. Pour combattre l'agitation contre-révolutionnaire que les mencheviks et autres partis développaient dans des soviets, ils eurent recours à des mesures administratives d'exclusion, ce qui contribua à créer une lourde atmosphère de passivité, de crainte du débat, de soumission progressive aux diktats du Parti 15.
Cette démarche répressive fut épisodique à ses débuts mais finit par se généraliser dès les premiers mois de 1919, quand les organes centraux du Parti réclamèrent ouvertement aux soviets leur subordination complète à leurs propres comités locaux et l'exclusion des autres partis.
Le manque de vie et de débat, la bureaucratisation, la subordination au Parti, etc., se font de plus en plus lourds. Au VIIe Congrès des soviets, Kamenev reconnaît que "Les assemblées plénières des soviets, en tant qu'institutions politiques, pâtissent souvent de cet état de choses ; on ne s'y occupe que de questions purement techniques (...). Il est rare que les soviets tiennent des assemblées générales et, quand les députés se rassemblent enfin, c'est uniquement pour approuver un rapport, écouter un discours, etc." 16. Ce Congrès, tenu en décembre 1919, eut comme thème central de discussion la renaissance des soviets et il y eut des contributions non seulement de la part des bolcheviks, qui se présentèrent pour la dernière fois en exprimant des positions différentes entre eux , mais également des mencheviks internationalistes – Martov, leur leader, y participa très activement.
Il y eut un effort pour mettre en pratique les résolutions du Congrès. En janvier 1920 se tinrent des élections cherchant la rénovation soviétique, dans des conditions de liberté totale. "Martov, reconnut au début de l'année 1920, que, sauf à Petrograd où des élections "à la Zinoviev" continuaient à être organisées, le retour à des méthodes plus démocratiques était général et favorisait souvent les candidats de son parti" 17.
De nombreux soviets réapparurent et le Parti bolchevique tenta de corriger les erreurs de concentration bureaucratique auxquelles il avait progressivement participé. "Le gouvernement soviétique annonça son intention d'abdiquer une partie des prérogatives qu’il s’était arrogées et de rétablir dans ses droits le Comité exécutif [des Soviets, élu par le Congrès] chargé, d'après la Constitution de 1918, de contrôler l'activité des Commissaires du peuple". 18
Ces espoirs s’évanouirent rapidement toutefois. L’intensification de la guerre civile, avec l'offensive de Wrangel et l'invasion polonaise, l'aggravation de la famine, la catastrophe économique, les révoltes de paysans, fauchèrent ces intentions à la racine, "l'état de délabrement de l'économie, la démoralisation des populations, l'isolement croissant d'un pays ruiné et d'une nation exsangue, la base même et les conditions d'une renaissance soviétique s'étaient évanouies." 19
L'insurrection de Kronstadt en mars 1921, avec sa revendication de soviets totalement renouvelés et qui exerceraient effectivement le pouvoir, fut le dernier râle d’agonie ; son écrasement par le Parti bolchevique signa le décès pratiquement définitif des soviets comme organes ouvriers 20.
La guerre civile et la création de l'Armée rouge
Pourquoi les soviets furent-ils entraînés, contrairement à septembre 1917, sur une pente qu’ils ne pourront pas remonter ? Si le manque d'oxygène auquel seul le développement de la révolution mondiale aurait pu apporter une solution, a été le facteur fondamental, nous allons cependant analyser les autres facteurs, "internes". Nous pouvons les résumer à deux facteurs essentiels, fortement reliés entre eux : la guerre civile et la famine d’une part et, de l’autre, le chaos économique.
Commençons par la guerre civile 21. C’était une guerre organisée par les principales puissances impérialistes : la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis, le Japon, etc., qui unirent leurs troupes à toute une masse hétéroclite de forces armées, "les Blancs", appartenant à la bourgeoisie russe défaite. Cette guerre dévasta le pays jusqu'en 1921 et provoqua plus de 6 millions de morts et un nombre incalculable de destructions. Les Blancs effectuaient des représailles d’un sadisme et d'une barbarie inouïs. "La terreur blanche en fut partiellement responsable [de l'effondrement du pouvoir des soviets], les victoires de la contre-révolution s'accompagnant le plus souvent non seulement du massacre d'un grand nombre de communistes mais de l'extermination des militants les plus actifs des Soviets et, en tout cas, de la suppression de ceux-ci." 22
Nous voyons ici la première des causes de l'affaiblissement des soviets. L'armée blanche supprima les soviets et assassina indistinctement tous leurs membres.
Mais des causes plus complexes s’ajoutèrent à ces massacres. Pour répondre à la guerre, le Conseil des commissaires du peuple adopta en avril-mai 1918 deux décisions importantes : la formation de l'Armée rouge et la constitution de la Tcheka, organisme chargé de démanteler les complots contre-révolutionnaires. C'était la première fois que ce Conseil adoptait une décision sans débat préalable avec les soviets ou, du moins, avec le Comité exécutif.
La constitution d'une Tcheka comme organe policier était inévitable au lendemain de la révolution. Les complots contre-révolutionnaires se succédaient, tant de la part des socialistes-révolutionnaires de droite, des mencheviks, des Cadets, que des centuries monarchistes, des cosaques, encouragés par les agents anglais et français. L’organisation d'une Armée rouge fut aussi une nécessité impérieuse dès que commença la guerre.
Ces deux structures – la Tcheka et l’Armée rouge –, ne sont pas de simples instruments que l’on peut utiliser à sa convenance, ce sont des organes étatiques et, en tant que tels, ils sont du point de vue du prolétariat des armes à double tranchant ; la classe ouvrière est obligée de s’en servir tant que le prolétariat n’a pas triomphé définitivement au niveau mondial, mais leur utilisation comporte de graves dangers car ceux-ci tendent à s'autonomiser vis-à-vis du pouvoir prolétarien.
Pour quelle raison fut donc créée une armée, alors que le prolétariat disposait d’un organe soviétique militaire qui avait dirigé l’insurrection, le Comité militaire révolutionnaire 23 ?
A partir de septembre 1917, l’armée russe était entrée dans une franche décomposition. Dès que la paix fut déclarée, les conseils de soldats se démobilisèrent rapidement. La seule aspiration de la majorité des soldats était de retourner dans leurs villages. Pour paradoxal que cela puisse paraître, les conseils de soldats – mais aussi dans une moindre mesure de matelots – qui s’étaient généralisés après la prise de pouvoir par les soviets, s’attachaient essentiellement à organiser la dissolution de l’armée, en évitant la fuite des appelés dans le désordre et en réprimant les bandes de soldats qui se servaient de leurs armes pour piller et terroriser la population. Début janvier 1918, l’armée n’existait plus. La Russie était à la merci de l’armée allemande. La paix de Brest-Litovsk obtint cependant une trêve qui permit de réorganiser une armée pour défendre efficacement la révolution.
A ses débuts, l’Armée rouge était une armée de volontaires. Les jeunes des classes moyennes et les paysans évitaient de s’engager, et ce furent les ouvriers des usines et des grandes villes qui formèrent son contingent initial. Il en résulta une véritable saignée dans les rangs de la classe ouvrière, qui dut sacrifier ses meilleurs éléments dans une guerre sanglante et cruelle. "Comme on le sait, les meilleurs ouvriers ont dû, par suite de la guerre, quitter les villes en masse, ce qui a eu maintes fois pour effet de rendre difficiles la formation d'un soviet dans tel ou tel chef-lieu de gouvernement ou de cercle, et la création des conditions nécessaires à son fonctionnement régulier" 24.
Nous abordons ici la seconde cause de la crise des soviets : ses meilleurs éléments furent absorbés par l’Armée rouge. Pour s’en faire une idée réelle, Petrograd en avril 1918 mobilisa 25 000 volontaires, dans leur grande majorité des ouvriers militants, et Moscou 15 000, alors que l’ensemble du pays comptait 106 000 volontaires au total.
Quant à la troisième cause de cette crise, elle ne fut autre que l’Armée rouge elle-même qui considérait les soviets comme un obstacle. Elle tendait à éviter leur contrôle et demandait au gouvernement central qu’il les empêche de s’immiscer dans ses affaires. Elle rejetait aussi les propositions de soutien de la part des unités militaires propres des soviets (Gardes rouge, guérilléros). Le Conseil des commissaires du peuple se plia à toutes les exigences de l’armée.
Pourquoi un organe créé pour défendre les soviets se retourne-t-il contre eux ? L’armée est un organe étatique dont l'existence et le fonctionnement ont nécessairement des conséquences sociales, vu qu'il exige une discipline aveugle, une hiérarchie rigide dans son état-major, avec un corps d’officiers qui n’obéissent qu’à l’autorité gouvernementale. C’est pour pallier à cette tendance que fut créé un réseau de commissaires politiques formé d’ouvriers de confiance, destiné à contrôler les officiers. Les effets de cette mesure furent malheureusement très limités et même contreproductifs, puisque ce réseau devint à son tour une structure bureaucratique supplémentaire.
Non seulement l’Armée rouge échappa toujours plus au contrôle des soviets, mais elle imposa en outre ses méthodes de militarisation à la société entière, contraignant encore plus, si c’était possible, la vie de ses membres. Dans son livre l’ABC du communisme, Preobrajensky parle même de dictature militaire du prolétariat !
Les impératifs de la guerre et la soumission aveugle aux exigences de l’Armée rouge amenèrent le gouvernement à former, durant l’été 1918, un Comité militaire révolutionnaire qui n’avait rien de commun avec celui qui dirigea la Révolution d’Octobre, comme le démontre le fait que sa première décision fut de nommer des Comités révolutionnaires locaux qui imposèrent leur autorité aux soviets. "Une décision du Conseil des commissaires du Peuple obligeait les Soviets à se plier inconditionnellement aux instructions de ces comités." 25
L’Armée rouge, comme la Tcheka, cessèrent progressivement d’être ce pourquoi elles avaient été conçues, des armes de défense du pouvoir des soviets, et s’en dégagèrent, s’autonomisèrent, pour finalement se retourner contre lui. Si dans un premier temps les organes de la Tcheka rendaient compte de leurs activités aux soviets locaux et tentaient d’organiser un travail commun, les méthodes expéditives qui les caractérisaient prévalurent rapidement et s'imposèrent à la société soviétique. "Le 28 août 1918, l'autorité centrale de la Tcheka donnait en effet pour instruction à ses commissions locales de récuser toute autorité des Soviets. C'étaient ces commissions, au contraire, qui devaient imposer leur volonté aux instances soviétiques. Elles y réussirent sans peine dans les nombreuses régions affectées par les opérations militaires" 26.
La Tcheka rongeait tellement le pouvoir des soviets qu’en novembre 1918, une enquête révélait que 96 soviets exigeaient la dissolution des sections de la Tcheka, 119 demandaient leur subordination aux institutions légales soviétiques et 19 seulement approuvaient ses agissements. Cette enquête fut parfaitement inutile d’ailleurs puisque la Tcheka continua d’accumuler de nouveaux pouvoirs. " 'Tout le pouvoir aux Soviets' a cessé d'être le principe sur lequel se fonde le régime, affirmait par ailleurs un membre du commissariat du Peuple à l'Intérieur; il est remplacé par une nouvelle règle : 'Tout le pouvoir à la Tcheka' " 27
Famine et chaos économique
La guerre mondiale léguait un terrible héritage. L’appareil productif de la majorité des pays d’Europe était exsangue, la circulation des biens de consommation et de la nourriture était profondément perturbée quand elle n’était pas totalement paralysée. "La consommation des vivres avait diminué de trente à cinquante pour cent. La situation des Alliés était meilleure, grâce à l'appui de l'Amérique. L'hiver 1917-1918, marqué en France et en Angleterre par les rationnements les plus rigoureux et par la crise des combustibles, avait cependant été très dur" 28.
La Russie avait cruellement souffert de cette situation. La Révolution d’Octobre n’avait pu s’y attaquer, d’autant qu’elle se heurta à un puissant galvaniseur du chaos : le sabotage systématique pratiqué tant par les chefs d’entreprise qui préféraient la politique de la terre brûlée plutôt que de livrer les instruments de production au prolétariat que par toute la couche des techniciens, dirigeants et même de travailleurs hautement spécialisés qui étaient hostiles au pouvoir soviétique. Les soviets se heurtèrent dès leur prise de pouvoir à une grève massive de fonctionnaires, de travailleurs des télégraphes et des chemins de fer, manipulés par les syndicats dirigés par les mencheviks. Cette grève était fomentée et dirigée à travers la courroie de transmission syndicale par "un gouvernement occulte [qui] fonctionnait, présidé par M. Prokopovitch qui avait officiellement pris la succession de Kerenski, "démissionnaire". Ce ministère clandestin dirigeait la grève des fonctionnaires, de concert avec un comité de grève. Les grandes firmes de l'industrie, du commerce et de la banque, telles que la Banque agricole de Toula, la Banque populaire de Moscou, la Banque du Caucase continuaient à payer leurs fonctionnaires en grève. L'ancien Exécutif panrusse des Soviets (mencheviks et socialistes-révolutionnaires) faisait de ses fonds, dérobés à la classe ouvrière, le même usage." 29
Ce sabotage vint s’ajouter au chaos économique généralisé rapidement aggravé par la guerre civile. Comment s’attaquer à la famine qui ravage les villes ? Comment garantir ne serait-ce qu’un approvisionnement minimum ?
Ici se concrétisent les effets désastreux d’un phénomène qui caractérise 1918 : la coalition sociale qui avait renversé le gouvernement bourgeois en Octobre 1917 s’était volatilisée. Le pouvoir soviétique avait été une "coalition", pratiquement sur un pied d’égalité, entre les soviets d’ouvriers, de paysans et de soldats. Ces derniers s’étaient à quelque exception près volatilisés dès la fin de 1917, laissant le pouvoir soviétique privé d’armée. Mais que firent les soviets de paysans qui possédaient pourtant la clé pour assurer l’approvisionnement des villes ?
Le décret sur la répartition des terres adopté par le IIe Congrès des soviets s’appliqua dans la plus grande confusion, ce qui favorisa un nombre incalculable d’abus et même si beaucoup de paysans pauvres purent accéder à une parcelle, les grandes gagnantes furent la riche et la moyenne paysannerie qui augmenta considérablement son patrimoine, ce qui se concrétisa par leur domination quasi-généralisée dans les soviets de paysans. L’égoïsme caractéristique des propriétaires privés s’en trouvait encouragé. "Le paysan, recevant en échange de son blé des roubles-papier avec lesquels il ne pouvait acheter qu'à grand peine une quantité de plus en plus restreinte d'articles manufacturés, recourait au troc : vivres contre objets. Une tourbe de petits spéculateurs s'interposaient entre lui et la ville" 30. Ces paysans ne vendaient leur production qu’aux spéculateurs qui se l'accaparaient, aggravant ainsi la pénurie et faisant exploser les prix 31.
En juin 1918, un décret du gouvernement soviétique met en place des comités de paysans pauvres pour combattre cette situation. Leur objectif était de créer une force pour tenter de ramener les soviets de paysans vers le prolétariat en organisant la lutte de classe dans les campagnes, mais aussi de tenter de mettre en place des brigades de choc afin d’obtenir les céréales et les aliments qui soulageraient la terrible famine dans les villes.
Ces comités se dédièrent surtout, "de concert avec des détachements d'ouvriers en armes, [à] confisquer le blé et [à] réquisitionner le bétail et le matériel des paysans riches pour les répartir entre les miséreux, voire [à] redémembrer les terres" 32. Le bilan de cette expérience fut globalement négatif. Ils ne parvinrent ni à garantir l’approvisionnement des villes affamées, ni à rénover les conseils de paysans. Et le comble, c’est qu’en 1919 les bolcheviks changèrent de politique pour tenter de gagner à eux la paysannerie moyenne et ils ont dissous par la force les comités de paysans pauvres.
La production moderne capitaliste fait dépendre l'approvisionnement des produits agricoles de l'existence d'un vaste système de transports hautement industrialisés et fortement liés à toute une série d'industries de base. Sur ce terrain, l'approvisionnement de la population affamée se heurta à l’effondrement généralisé de l'appareil productif industriel dû à la guerre et accentué par le sabotage économique et l’éclatement de la guerre civile à partir d'avril 1918.
Les conseils d’usine auraient pu avoir un rôle déterminant. Comme nous l’avons vu dans l’article précédent de cette série, ils jouaient un rôle très important d’avant-garde du système soviétique. Ils auraient aussi pu contribuer à combattre le sabotage des capitalistes et éviter la pénurie et la paralysie.
Ils tentèrent d’ailleurs de se coordonner pour monter un organisme central de contrôle de la production et de lutte contre le sabotage et la paralysie des transports 33, mais la politique bolchevique s’opposa à cette orientation. Celle-ci concentra la direction des entreprises en un corps de fonctionnaires dépendants du pouvoir exécutif, ce qui s’accompagna, dans un premier temps, de mesures de restauration du travail à la pièce puis s’acheva par une militarisation brutale qui atteignit ses niveaux les plus élevés en 1919-20. Par ailleurs, elle renforça les syndicats. Ce corps de fonctionnaires, farouche adversaire des conseils d’usine, mena une intense campagne qui s’acheva par la disparition de ces derniers fin 1918 34.
La politique bolchevique tentait de combattre la tendance de certains conseils d’usine, particulièrement en province, à se considérer comme les nouveaux propriétaires et à se concevoir comme des unités autonomes et indépendantes. Cette tendance avait en partie ses origines dans "la difficulté d'établir des circuits réguliers de distribution et d'échange, ce qui provoqua l'isolement de nombreuses usines et centres de production. Ainsi apparurent des usines fort semblables à des "communes anarchistes" vivant repliées sur elles-mêmes." 35
Tendance à la décomposition de la classe ouvrière russe
Il est évident que ces tendances favorisaient la division de la classe ouvrière. Mais il ne s’agissait pas de tendances générales et elles auraient pu être combattues au moyen du débat au sein des conseils d’usine eux-mêmes dans lesquels, nous l’avons vu, cette vision globale était présente. La méthode choisie, s’appuyer sur les syndicats, contribua à détruire ces organismes qui étaient la pierre angulaire du pouvoir prolétarien et globalement favorisa l’aggravation d’un problème politique fondamental des premières années du pouvoir soviétique, qui avait été occulté par l’enthousiasme des premiers mois : "L'affaiblissement progressif de la classe ouvrière russe, une perte de vigueur et de substance qui finira par provoquer son déclassement presque total et, en quelque sorte, sa provisoire disparition" 36.
En avril 1918, 265 des 799 principales entreprises industrielles de Petrograd ont disparu, la moitié des travailleurs de cette ville n’a pas de travail ; sa population en juin 1918 compte un million et demi de personnes, alors qu'elle était de deux millions et demi un an auparavant. Moscou a perdu un demi-million d'habitants au cours de cette courte période.
La classe ouvrière souffre de la faim et des maladies les plus terrifiantes. Jacques Sadoul, observateur partisan des bolcheviks, décrit ainsi la situation à Moscou au printemps 1918 : "Dans les faubourgs, c'est la misère affreuse. Épidémies : typhus, variole, maladies infantiles. Les bébés meurent en masse. Ceux qu'on rencontre sont défaillants, décharnés, pitoyables. Dans les quartiers ouvriers, on croise trop souvent de pauvres mamans pâles, maigres, portant tristement entre leurs bras, dans le petit cercueil de bois argenté, qui semble un berceau, le petit corps inanimé qu'un peu de pain ou de lait eût conservé en vie" 37.
Beaucoup d’ouvriers s’enfuirent vers la campagne pour se consacrer à des activités agricoles précaires. La pression terrifiante de la famine, des maladies, des rationnements et des files d’attente fait que les ouvriers sont obligés de consacrer la journée entière à tenter de survivre. Comme en témoigne un ouvrier de Petrograd en avril 1918, "Voici encore une foule d'ouvriers qui ont été renvoyés. Bien que nous soyons des milliers, on n'entend pas un mot qui ait trait à la politique ; personne ne parle de la révolution, de l'impérialisme allemand ou de tout autre problème d'actualité. Pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui peuvent à peine se tenir debout, toutes ces questions paraissent terriblement lointaines." 38
Le processus de crise de la classe ouvrière russe est si alarmant qu’en octobre 1921, Lénine justifie la NEP 39 en disant que "Les capitalistes vont bénéficier de notre politique, et ils vont créer un prolétariat industriel qui, chez nous, en raison de la guerre, de la ruine et des destructions terribles, est déclassé, c'est-à-dire qu'il a été détourné de son chemin de classe et a cessé d'exister en tant que prolétariat" 40.
Nous avons présenté tout un ensemble de conditions générales qui, s’ajoutant aux inévitables erreurs, affaiblirent les soviets jusqu’à les conduire à leur disparition comme organes ouvriers. Dans le prochain article de cette série, nous aborderons les problèmes politiques qui participèrent d'aggraver l'effet de cette situation.
C.Mir (01-9-10)
1. Voir les Revue internationale nos 140 [65], 141 [89] et 142 [128].
2. Lénine, Lettre aux ouvriers américains, 22 août 1918. Œuvres, Editions Sociales, Tome 28.
3. Cité par Marcel Liebman, Le Léninisme sous Lénine, tome II, page 190. C’est un ouvrage très intéressant et documenté, émanant d’un auteur non communiste.
4. Il a existé une phase de la vie du capitalisme, alors qu'il était encore un système progressiste, pendant laquelle le Parlement était le lieu où les différentes fractions de la bourgeoisie s’unissaient ou s’affrontaient pour gouverner la société. Le prolétariat se devait d’y participer pour tenter d’infléchir l'action de la bourgeoisie dans le sens de la défense de ses intérêts et ceci malgré les dangers de mystification qu’une telle politique pouvait lui faire encourir. Cependant, même à cette époque, les trois pouvoirs ont toujours été séparés de la grande majorité de la population.
5. Cité par Victor Serge, militant anarchiste convaincu au bolchevisme, dans L’An I de la Révolution russe, page 84, Chapitre III. "Les grands décrets".
6. Oskar Anweiler, les Soviets en Russie, p. 261 chapitre V, Première partie, "Assemblée constituante ou République soviétique ?"
7. Marcel Liebman, op. cit., page 31.
8. Le suivi de la situation en Allemagne, les nouvelles de grèves et de mutineries occupaient une grande part des discussions.
9. Oskar Anweiler, op. cit., page 275, chapitre V, 2e partie, "Le système bolcheviste des conseils".
10. Victor Serge, op. cit., page 99. Chapitre III, "L’initiative des masses".
11. Marcel Liebman, op. cit., page 94.
12. Ce Traité fut signé entre le pouvoir soviétique et l’Etat allemand en mars 1918. Au prix d’importantes concessions, il permit au pouvoir soviétique d’obtenir une trêve qui lui permit de se maintenir et il démontra clairement au prolétariat international sa volonté d’en finir avec la guerre. Voir nos articles : "Octobre 17, début de la révolution prolétarienne (2e partie) [129]", Revue internationale no 13, 1978, et "Le communisme n’est pas un bel idéal " (8 [130]e [130] partie) : "La compréhension de la défaite de la Révolution russe [130]", Revue internationale no 99, 1999.
13. Marcel Liebman, op. cit., page 176.
14. Voir dans cette série, la Revue internationale no 142, "La Révolution de 1917…", partie "Septembre 1917, la rénovation totale des soviets [128]".
15. Il faut préciser que ces mesures ne furent pas accompagnées de restrictions quant à la liberté de la presse. Dans son livre cité plus haut, Victor Serge affirme que "La dictature du prolétariat hésita longtemps à supprimer la presse ennemie. (…) ce n'est qu'en juillet 1918 que les derniers organes de la bourgeoisie et de la petite- bourgeoisie furent supprimés. La presse légale des mencheviks n'a disparu qu'en 1919 ; celle des anarchistes hostiles au régime et des maximalistes a paru jusqu'en 1920 ; celle des socialistes-révolutionnaires de gauche, plus tard encore." (Note en bas de page 109, Chapitre III. "Réalisme prolétarien et rhétorique révolutionnaire".
16. Oskar Anweiler, op. cit., page 299, chapitre V, 2e partie, "Le système bolcheviste des conseils".
17. Marcel Liebman, op. cit., page 35. Zinoviev, militant bolchevik, avait de grandes qualités et fut un grand animateur aux origines de l’Internationale communiste, mais il se distingua cependant par sa roublardise et ses manœuvres.
18. Íbidem.
19. Íbidem.
20. Nous ne pouvons ici analyser en détails les événements de Kronstadt, leur sens et les leçons qu’ils apportèrent. Voir à ce sujet "https://fr.internationalism.org/rinte3/kronstadt.htm [131]", Revue internationale no 3, 1975, et "Comprendre Kronstadt [132]", Revue internationale no 104, 2001.
21. Cf. Victor Serge, op. cit., pour un récit de la guerre civile en 1918.
22. Marcel Liebman, op. cit., page 32.
23. Cf. dans cette série, Revue internationale no 142, "La révolution de 1917 (de juillet à octobre), du renouvellement des conseils ouvriers à la prise du pouvoir [128]", sous-titre "Le Comité militaire révolutionnaire, organe soviétique de l'insurrection".
24. Intervention de Kamenev citée par Oskar Anweiler. op. cit., p. 299.
25. Marcel Liebman, op. cit., page 33.
26. Idem, page 32.
27. Idem, page 164.
28. Victor Serge, op. cit., page 162. Chapitre V, “Le problème en janvier1918”.
29. Victor Serge, op. cit., page 99. Chapitre III, “Le sabotage”.
30. Idem, page 227. Chapitre VI, " Le problème".
31. Idem. Victor Serge souligne qu’une des politiques des syndicats consistait en la création de commerces coopératifs qui se consacraient à spéculer sur la nourriture au grand profit de leurs membres.
32. Oskar Anweiler, op. cit., page 301, chapitre V, 2e partie, "Le système bolcheviste des conseils".
33. Oskar Anweiler, op. cit., page 279, rapporte que "Quelques semaines après Octobre, certains conseils centraux des comités de fabrique, tels qu'il en existait dans beaucoup de villes, se consultèrent dans le dessein avoué de s'organiser de manière indépendante à l'échelon national, ce qui aurait eu comme effet d'instaurer leur dictature économique."
34. Ibidem. Anweiler rapporte que "Ne se bornant plus à empêcher la tenue d'un congrès panrusse des comités de fabrique, les syndicats réussirent à se les annexer et à en faire leur organe au plus bas échelon." p. 279.
35. Marcel Liebman, op. cit. page 189.
36. Idem, page 23.
37. Idem, page 24.
38. Idem, page 23.
39. NEP: Nouvelle politique économique, appliquée en mars 1921 après les événements de Kronstadt, qui faisait de larges concessions à la paysannerie et au capital national et étranger. Voir la Revue internationale no 101, dans la série "Le communisme n’est pas un bel idéal", l’article "1922-23 : les fractions communistes contre la montée de la contre-révolution [133]".
40. Lénine, La Nouvelle politique économique et les tâches des services d'éducation politique, 17 octobre 1921. Œuvres, tome 33, Editions Sociales.
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Décadence du capitalisme (VIII) : l'âge des catastrophes
- 2779 lectures
Même si les révolutionnaires actuels sont loin de tous partager l'analyse de l'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin avec l'éclatement de la Première Guerre mondiale, ce n'était pas le cas de ceux qui ont dû réagir face à cette guerre et ont participé aux soulèvements révolutionnaires ayant suivi. Au contraire, comme le montre le présent article, la majorité des marxistes partageaient ce point de vue. De même, pour eux, la compréhension qu'on était entré dans une nouvelle période historique était indispensable pour revigorer le programme communiste et les tactiques qui en découlaient.
Dans le précédent article de cette série, nous avons vu que Rosa Luxemburg, par son analyse des processus fondamentaux sous-tendant l'expansion impérialiste, prévoyait que les calamités que subissaient les régions pré-capitalistes du globe, allaient revenir au cœur même du système, dans l'Europe bourgeoise. Et comme elle le soulignait dans sa Brochure de Junius (dont le titre original est La crise de la social-démocratie allemande), rédigée en prison en 1915, l'éclatement de la guerre mondiale en 1914 n'était pas seulement une catastrophe du fait de la destruction et de la misère qu'elle faisait pleuvoir sur la classe ouvrière des deux camps belligérants, mais aussi parce qu'elle avait été rendue possible par le plus grand acte de trahison de l'histoire du mouvement ouvrier : la décision de la majorité des partis sociaux-démocrates, jusqu'alors phares de l'internationalisme, éduqués dans la vision marxiste du monde, de soutenir l'effort de guerre des classes dominantes de leurs pays respectifs, d'entériner le massacre mutuel du prolétariat européen, malgré les retentissantes déclarations d'opposition à la guerre qu'ils avaient adoptées lors des nombreuses réunions de la Deuxième Internationale et de ses partis constitutifs au cours des années qui avaient précédé.
Ce fut la mort de l'Internationale ; elle avait maintenant éclaté en différents partis nationaux dont de grandes parties, le plus souvent leurs organes dirigeants, agirent comme agents recruteurs dans l'intérêt de leur propre bourgeoisie : on les désigna comme les "social-chauvins" ou les "social-patriotes" ; ils entraînèrent avec eux également la majorité des syndicats. Dans cette terrible débâcle, une autre partie importante de la social-démocratie, "les centristes", se vautra dans toutes sortes de confusions, incapable de rompre définitivement avec les social-patriotes, s'accrochant à d'absurdes illusions sur la possibilité d'accords de paix et, comme dans le cas de Kautsky, l'ancien "pape du marxisme", tournant fréquemment le dos à la lutte de classe au nom du fait que l'Internationale ne pouvait qu'être un instrument de paix, pas de guerre. Au cours de cette époque traumatisante, seule une minorité maintint fermement les principes que toute l'Internationale avait adoptés sur le papier à la veille de la guerre – avant tout le refus d'arrêter la lutte de classe du fait qu'elle mettrait en danger l'effort de guerre de sa propre bourgeoisie et, par extension, la volonté d'utiliser la crise sociale apportée par la guerre comme moyen de hâter la chute du système capitaliste. Mais, face à l'état d'esprit d'hystérie nationaliste qui dominait au début de la guerre, "l'atmosphère de pogrom" dont parle Luxemburg dans sa brochure, même les meilleurs militants de la gauche révolutionnaire se trouvèrent en butte aux doutes et aux difficultés. Quand Lénine prit connaissance de l'édition du Vorwärts, journal du SPD, qui annonçait que le parti avait voté les crédits de guerre au Reichstag, il pensa que c'était un faux, concocté par la police politique. Au parlement allemand, l'anti-militariste Liebknecht vota au début les crédits de guerre par discipline de parti. L'extrait suivant d'une lettre de Rosa Luxemburg montre à quel point elle ressentait que l'opposition de gauche dans la social-démocratie avait été réduite à une petite collection d'individus :
"Je voudrais entreprendre l'action la plus énergique contre ce qui se passe au groupe parlementaire. Malheureusement, je trouve peu de gens disposés à m'aider.[...] On ne peut jamais joindre Karl (Liebknecht), car il court de tous les côtés comme un nuage dans le ciel ; Franz (Mehring) montre peu de compréhension pour une action autre que littéraire, la réaction de ta mère (Clara Zetkin) est hystérique et absolument désespérée. Mais en dépit de tout cela, j'ai l'intention d'essayer de voir ce que l'on peut faire." (Lettre à Konstantin Zetkin, fin 1914) 1
Chez les anarchistes c'était aussi la confusion ou la trahison ouverte. Le vénérable anarchiste Kropotkine appela à la défense de la civilisation française contre le militarisme allemand (ceux qui suivirent son exemple furent appelés "les anarchistes des tranchées"), et le leurre du patriotisme s'avéra particulièrement fort dans la CGT en France. Mais l'anarchisme, précisément du fait de son caractère hétérogène, ne fut pas ébranlé jusqu'en ses fondements de la même façon que le fut le "parti marxiste". De nombreux groupes et militants anarchistes continuèrent à défendre les mêmes positions internationalistes qu'auparavant. 2
L'impérialisme : le capitalisme en déclin
Evidemment, les groupes de l'ancienne gauche de la social-démocratie devaient s'atteler à la tâche de réorganisation et de regroupement afin de mener le travail fondamental de propagande et d'agitation malgré la frénésie nationaliste et la répression étatique. Mais ce qu'il fallait, surtout, c'était une révision théorique, un effort rigoureux pour comprendre comment la guerre avait pu balayer des principes défendus depuis si longtemps par le mouvement. D'autant plus qu'il était nécessaire de déchirer le voile "socialiste" dont les traîtres déguisaient leur patriotisme, en utilisant les paroles de Marx et Engels, les sélectionnant soigneusement et, surtout, en les sortant de leur contexte historique, pour justifier leur position de défense nationale – surtout en Allemagne où avait existé une longue tradition du courant marxiste qui soutenait les mouvements nationaux contre la menace réactionnaire posée par le tsarisme russe.
La nécessité d'une recherche théorique complète a été symbolisée par Lénine qui passa calmement son temps, au début de la guerre, à lire Hegel à la bibliothèque. Dans un article récemment publié dans The Commune, Kevin Anderson du Marxist Humanist Comittee (Comité marxiste humaniste) américain défend l'idée que l'étude de Hegel conduisit Lénine à la conclusion que la majorité de la Deuxième Internationale, y compris son mentor Plekhanov (et par extension lui-même), n'avaient pas rompu avec le matérialisme vulgaire, et que leur ignorance de Hegel les avait amenés à avoir peu de maîtrise de la véritable dialectique de l'histoire.3 Et, évidemment, l'un des principes dialectiques sous-jacents de Hegel est que ce qui est rationnel à une époque, devient irrationnel à une autre. Il est certain que c'est la méthode que Lénine utilisa pour répondre aux social-chauvins – Plekhanov en particulier – qui cherchaient à justifier la guerre en se référant aux écrits de Marx et Engels :
"Les social-chauvins russes (Plekhanov en tête) invoquent la tactique de Marx dans la guerre de 1870 ; les social-chauvins allemands (genre Lensch, David et Cie) invoquent les déclarations d'Engels en 1891 sur la nécessité pour les socialistes allemands de défendre la patrie en cas de guerre contre la Russie et la France réunies... Toutes ces références déforment d'une façon révoltante les conceptions de Marx et d'Engels par complaisance pour la bourgeoisie et les opportunistes... Invoquer aujourd'hui l'attitude de Marx à l'égard des guerres de l'époque de la bourgeoisie progressive et oublier les paroles de Marx : "Les ouvriers n'ont pas de patrie", paroles qui se rapportent justement à l'époque de la bourgeoisie réactionnaire qui a fait son temps, à l'époque de la révolution socialiste, c'est déformer cyniquement la pensée de Marx et substituer au point de vue socialiste le point de vue bourgeois." (Le socialisme et la guerre, 1915) 4
Là résidait la clé de la question : le capitalisme était devenu un système réactionnaire comme Marx l'avait prévu. La guerre le prouvait et cela impliquait une réévaluation complète de toutes les anciennes tactiques du mouvement, une compréhension claire des caractéristiques du capitalisme dans sa crise de sénilité et donc des nouvelles conditions auxquelles la lutte de classe était confrontée. Chez les fractions de gauche, cette analyse fondamentale de l'évolution du capitalisme était universelle. Rosa Luxemburg, dans la Brochure de Junius, sur la base d'une réinvestigation approfondie du phénomène de l'impérialisme au cours de la période qui avait mené à la guerre, reprit ce qu'Engels avait annoncé : l'humanité serait confrontée au choix socialisme ou barbarie ; et elle déclarait que ce n'était plus une perspective mais une réalité immédiate : "cette guerre est la barbarie". Dans le même document, Luxemburg défendait qu'à l'époque de la guerre impérialiste débridée, l'ancienne stratégie de soutien à certains mouvements de libération nationale avait perdu tout contenu progressiste : "A l'époque de cet impérialisme déchaîné il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : l'impérialisme."5
Trotsky, qui écrivait dans Nashe Slovo, évoluait dans une direction parallèle, défendant que la guerre était le signe que l'Etat national lui-même était devenu une entrave à tout progrès humain ultérieur : "L'Etat national est dépassé – comme cadre pour le développement des forces productives, comme base pour la lutte de classe et, en particulier, comme forme étatique de la dictature du prolétariat. " (Nashe Slovo, 4 février 1916, traduit de l'anglais par nous.)
Dans une oeuvre plus connue, L'impérialisme stade suprême du capitalisme, Lénine – comme Luxemburg – reconnaissait que le conflit sanglant entre les grandes puissances mondiales exprimait le fait que ces puissances s'étaient désormais partagé toute la planète et que, de ce fait, le gâteau impérialiste ne pouvait qu'être re-réparti à travers de violents règlements de comptes entre ogres capitalistes : "...le trait caractéristique de la période envisagée, c'est le partage définitif du globe, définitif non en ce sens qu'un nouveau partage est impossible, - de nouveaux partages étant au contraire possibles et inévitables, - mais en ce sens que la politique coloniale des pays capitalistes en a terminé avec la conquête des territoires inoccupés de notre planète. Pour la première fois, le monde se trouve entièrement partagé, si bien qu'à l'avenir il pourra uniquement être question de nouveaux partages, c'est-à-dire du passage d'un "possesseur" à un autre, et non de la "prise de possession" de territoires sans maître." 6
Dans le même livre, Lénine caractérise "le stade suprême" du capitalisme comme celui du "parasitisme et du déclin" ou du "capitalisme moribond". Parasitaire parce que – en particulier dans le cas de la Grande-Bretagne - il voyait une tendance à ce que la contribution des nations industrialisées à la production de la richesse globale soit remplacée par une dépendance croissante vis à vis du capital financier et des superprofits extraits des colonies (un point de vue qu'on peut certainement critiquer mais qui contenait un élément d’intuition, comme en témoigne aujourd'hui l'essor de la spéculation financière et l'avancement de la désindustrialisation de certaines des nations les plus puissantes). Le déclin (qui ne signifiait pas pour Lénine une stagnation absolue de la croissance) du fait de la tendance du capitalisme à abolir la libre concurrence au profit du monopole signifiait le besoin croissant que la société bourgeoise cède la place à un mode de production supérieur.
L'impérialisme de Lénine souffre d'un certain nombre de faiblesses. Sa définition de l'impérialisme est plus une description de certaines de ses manifestations les plus visibles ("les cinq caractéristiques " si souvent citées par les gauchistes pour prouver que telle ou telle nation, ou bloc de nations, n'est pas impérialiste) qu'une analyse des racines du phénomène dans le processus de l'accumulation comme l'avait fait Luxemburg. Sa vision d'un centre capitaliste avancé vivant de façon parasitaire des superprofits tirés des colonies (et corrompant ainsi une frange de la classe ouvrière, "l'aristocratie ouvrière", amenant cette dernière à soutenir les projets impérialistes de la bourgeoisie) ouvrait une brèche pour la pénétration de l'idéologie nationaliste sous la forme du soutien aux mouvements de "libération nationale" dans les colonies. De plus, la phase monopolistique (dans le sens de cartels privés gigantesques) avait déjà, au cours de la guerre, cédé la place à une expression "supérieure" du déclin capitaliste : l'énorme croissance du capitalisme d'Etat.
Sur cette dernière question, la contribution la plus importante est certainement celle de Boukharine qui fut l'un des premiers à montrer qu'à l'époque de "l'Etat impérialiste", la totalité de la vie politique, économique et sociale a été absorbée par l'appareil d'Etat, par dessus tout dans le but de mener la guerre avec les impérialismes rivaux :
"Contrairement à ce qu'était l'Etat dans la période du capitalisme industriel, l'Etat impérialiste se caractérise par un accroissement extraordinaire de la complexité de ses fonctions et par une brusque incursion dans la vie économique de la société. Il révèle une tendance à prendre en charge l'ensemble de la sphère productive et l'ensemble de la sphère de la circulation des marchandises. Les types intermédiaires d'entreprises mixtes seront remplacés par une pure régulation par l'Etat car, de cette façon, le processus de centralisation peut se développer. Tous les membres des classes dominantes (ou, plus exactement de la classe dominante car le capitalisme financier élimine graduellement les différents sous-groupes des classes dominantes, les unissant en une seule clique de capitalisme financier) deviennent actionnaires ou partenaires d'une gigantesque entreprise d'Etat. Assurant auparavant la préservation et la défense de l'exploitation, l'Etat se transforme en une organisation exploiteuse unique centralisée qui est confrontée directement au prolétariat, objet de cette exploitation. De même que les prix du marché sont déterminés par l'Etat, ce dernier assure aux ouvriers une ration suffisante pour la préservation de leur force de travail. Une bureaucratie hiérarchique remplit les fonctions organisatrices en plein accord avec les autorités militaires dont la signification et la puissance s'accroissent sans interruption. L'économie nationale est absorbée par l'Etat qui est construit de façon militaire et dispose d'une armée et d'une marine immenses et disciplinées. Dans leur lutte, les ouvriers doivent s'affronter à toute la puissance de ce monstrueux appareil, car toute avancée de leur lutte s'affrontera directement à l'Etat : la lutte économique et la lutte politique cesseront d'être deux catégories et la révolte contre l'exploitation signifiera une révolte directe contre l'organisation étatique de la bourgeoisie." ("Vers une théorie de l'Etat impérialiste", 1915, traduit de l'anglais par nous).
Le capitalisme d'Etat totalitaire et l'économie de guerre allaient s'avérer les caractéristiques fondamentales du siècle à venir. Etant donné l'omniprésence de ce monstre capitaliste, Boukharine concluait à juste raison que, désormais, toute lutte ouvrière significative n'avait d'autre choix que de se confronter à l'Etat et que la seule voie pour que le prolétariat aille de l'avant était de "faire exploser" l'ensemble de l'appareil – de détruire l'Etat bourgeois et de le remplacer par ses propres organes de pouvoir. Ceci signifiait le rejet définitif de toutes les hypothèses sur la possibilité de conquérir pacifiquement l'Etat existant, ce que Marx et Engels n'avaient pas entièrement rejeté, même après l'expérience de la Commune, et qui était devenu de plus en plus la position orthodoxe de la Deuxième Internationale. Pannekoek avait déjà développé cette position en 1912 et, lorsque Boukharine la reprit, Lénine au début l'accusa vivement de tomber dans l'anarchisme. Mais pendant qu'il élaborait sa réponse, et stimulé par la nécessité de comprendre la révolution qui se déroulait en Russie, Lénine fut une nouvelle fois saisi par la dialectique toujours en évolution et arriva à la conclusion que Pannekoek et Boukharine avaient eu raison – une conclusion formulée dans L'Etat et la révolution, rédigé à la veille de l'insurrection d'Octobre.
Dans le livre de Boukharine L'impérialisme et l'économie mondiale (1917), il y a aussi une tentative pour situer le cours vers l'expansion impérialiste dans les contradictions économiques identifiées par Marx ; il souligne la pression exercée par la baisse du taux de profit mais reconnaît également la nécessité d'une extension constante du marché. Comme Luxemburg et Lénine, le but de Boukharine est de démontrer que précisément du fait que le processus de "mondialisation" impérialiste avait créé une économie mondiale unifiée, le capitalisme avait rempli sa mission historique et ne pouvait désormais qu'entrer en déclin. C'était tout à fait cohérent avec la perspective soulignée par Marx quand il écrivait que "la tâche propre de la société bourgeoise, c'est l'établissement du marché mondial, du moins dans ses grandes lignes et d'une production fondée sur cette base." (Lettre de Marx à Engels, 8 octobre 1858, ES, Tome V)
Ainsi, contre les social-chauvins et les centristes qui voulaient revenir au statu quo d'avant guerre, qui dénaturaient le marxisme pour justifier leur soutien à l'un ou l'autre des camps belligérants, les marxistes authentiques affirmèrent de façon unanime qu'il n'y avait plus de capitalisme progressiste et que son renversement révolutionnaire était désormais historiquement à l'ordre du jour.
L'époque de la révolution prolétarienne
Ce fut la même question fondamentale de la période historique qui se posa à nouveau en Russie 1917, point culminant d'une vague internationale montante de résistance du prolétariat à la guerre. Comme la classe ouvrière russe, organisée en soviets, se rendait de plus en plus compte que le fait de s'être débarrassée du tsarisme, n'avait résolu aucun de ses problèmes fondamentaux, les fractions de droite et les centristes de la social-démocratie firent campagne, de toutes leurs forces, contre l'appel des Bolcheviks à la révolution prolétarienne et pour que les soviets règlent leur compte non seulement aux anciens éléments tsaristes mais aussi à toute la bourgeoisie russe qui considérait la révolution de Février comme sa propre révolution. La bourgeoisie russe était soutenue en ce sens par les Mencheviks qui reprenaient les écrits de Marx pour montrer que le socialisme ne pouvait être construit que sur la base d'un système capitaliste pleinement développé : comme la Russie était bien trop arriérée, elle ne pouvait évidemment aller plus loin que la phase d'une révolution bourgeoise démocratique et les Bolcheviks n'étaient qu'une bande d'aventuriers qui cherchaient à jouer à saute-mouton avec l'histoire. La réponse apportée par Lénine dans les Thèses d'avril était une nouvelle fois cohérente avec sa lecture de Hegel qui avait déjà souligné la nécessité de considérer le mouvement de l'histoire comme un tout. Elle reflétait en même temps son profond engagement internationaliste. C'est évidemment absolument juste que les conditions de la révolution doivent mûrir historiquement, mais l'avènement d'une nouvelle époque historique ne se juge pas à l'aune de tel ou tel pays pris séparément. Le capitalisme, comme le montrait la théorie de l'impérialisme, était un système global et donc son déclin et la nécessité de son renversement mûrissaient également à une échelle globale : l'éclatement de la guerre impérialiste mondiale le prouvait amplement. Il n'y avait pas une révolution russe isolée : l'insurrection prolétarienne en Russie ne pouvait qu'être le premier pas vers une révolution internationale ou, comme l'exprima Lénine dans son discours qui fit l'effet d'une bombe, adressé aux ouvriers et aux soldats qui étaient venus l'accueillir à son retour d'exil à la Gare de Finlande à Petrograd : "Chers camarades, soldats, matelots et ouvriers, je suis heureux de saluer en vous la révolution russe victorieuse, de vous saluer comme l'avant-garde de l'armée prolétarienne mondiale... L'heure n'est pas loin où, à l'appel de notre camarade Karl Liebknecht, les peuples retourneront leurs armes contre les capitalistes exploiteurs... La révolution russe accomplie par vous a ouvert une nouvelle époque. Vive la révolution socialiste mondiale !..."
Cette compréhension que le capitalisme tout à la fois avait rempli les conditions nécessaires à l'avènement du socialisme et était entré dans sa crise historique de sénilité – puisque ce sont les deux faces de la même pièce – est également contenue dans la phrase bien connue de la Plateforme de l'Internationale communiste rédigée à son Premier Congrès en mars 1919 : "Une nouvelle époque est née. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat." 7
Lorsque la gauche révolutionnaire internationaliste se réunit au Premier Congrès de l'IC, l'agitation révolutionnaire déclenchée par la révolution d'Octobre était à son point le plus haut. Bien que le soulèvement "spartakiste" à Berlin en janvier ait été écrasé et que Luxemburg et Liebknecht aient été sauvagement assassinés, la république des soviets venait de se former en Hongrie, l'Europe et des parties des Etats-Unis et d'Amérique du Sud connaissaient des grèves de masse. L'enthousiasme révolutionnaire de l'époque est exprimé dans les textes fondamentaux adoptés par le Congrès. En accord avec le discours de Rosa Luxemburg au Congrès de fondation du KPD, l'aube d'une nouvelle époque signifiait que l'ancienne distinction entre le programme minimum et le programme maximum n'était plus valable, par conséquent la tâche de s'organiser au sein du capitalisme au moyen de l'activité syndicale et de la participation au parlement en vue de gagner des réformes significatives avait historiquement perdu sa raison d'être. La crise historique du système capitaliste mondial, exprimée non seulement par la guerre impérialiste mondiale mais aussi par le chaos économique et social qu'elle avait laissé dans son sillage, signifiait que la lutte directe pour le pouvoir organisé en soviets était maintenant à l'ordre du jour d'une façon réaliste et urgente, et ce programme était valable dans tous les pays, y compris dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. De plus, l'adoption de ce nouveau programme maximum ne pouvait être mis en oeuvre que par une rupture complète avec les organisations qui avaient représenté la classe ouvrière au cours de l'époque précédente mais avaient trahi ses intérêts dès qu'elles avaient dû passer le test de l'histoire – le test de la guerre et de la révolution, en 1914 et en 1917. Les réformistes de la social-démocratie, la bureaucratie syndicale étaient désormais définis comme les laquais du capital, pas comme l'aile droite du mouvement ouvrier. Le débat au Premier Congrès montre que la jeune Internationale était ouverte aux conclusions les plus audacieuses tirées de l'expérience directe du combat révolutionnaire. Bien que l'expérience russe ait suivi un chemin en quelque sorte différent, les Bolcheviks écoutaient sérieusement le témoignage des délégués d'Allemagne, de Suisse, de Finlande, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'ailleurs, qui argumentaient que les syndicats n'étaient plus seulement inutiles mais étaient devenus un obstacle contre-révolutionnaire direct – des rouages de l'appareil d'Etat, et que les ouvriers s'organisaient de plus en plus en dehors et contre eux à travers la forme d'organisation des conseils dans les usines et dans les rues. Et comme la lutte de classe se centrait précisément sur les lieux de travail et dans les rues, ces centres vivants de la lutte de classe et de la conscience de classe, apparaissaient, dans les documents officiels de l'IC, en contraste frappant avec la coquille vide du parlement, instrument qui, lui aussi, était non seulement inadéquat pour la lutte pour la révolution prolétarienne mais aussi un instrument direct de la classe dominante, utilisé pour saboter les conseils ouvriers, comme l'avaient clairement démontré à la fois la Russie en 1917 et l'Allemagne en 1918. De même, le Manifeste de l'IC était très proche de la position que Luxemburg avait développée selon laquelle les luttes nationales étaient dépassées et les nouvelles nations montantes étaient devenues de simples pions des intérêts impérialistes rivaux. A ce stade, ces conclusions révolutionnaires "extrêmes" semblaient à la majorité découler logiquement de l'ouverture de la nouvelle période.8
Les débats au Troisième Congrès
Lorsque l'histoire s'accélère, comme ce fut le cas à partir de 1914, les changements les plus dramatiques peuvent avoir lieu en l'espace d'une année ou deux. Au moment où l'IC se réunissait pour son Troisième Congrès, en juin/juillet 1921, l'espoir d'une extension immédiate de la révolution, si fort lors du Premier Congrès, avait subi les coups les plus sévères. La Russie avait traversé trois ans de guerre civile épuisante et, bien que les Rouges aient vaincu militairement les Blancs, le prix en fut politiquement mortel : de larges parties des ouvriers les plus avancés avaient été décimées, l'Etat "révolutionnaire" s'était bureaucratisé au point que les soviets en avaient perdu le contrôle. Les rigueurs du "Communisme de guerre" et les excès destructeurs de la terreur rouge avaient fini par susciter une révolte ouverte dans la classe ouvrière : en mars, des grèves massives éclatèrent à Petrograd, suivies par le soulèvement armé des marins et des ouvriers de Cronstadt qui appelaient à la renaissance des soviets et à la fin de la militarisation du travail et des actions de répression de la Tcheka. Mais la direction bolchevique, enchaînée dans l'Etat, ne vit dans ce mouvement qu'une expression de la contre-révolution blanche et le supprima de façon impitoyable et sanglante. Tout cela était l'expression de l'isolement croissant du bastion russe. La défaite faisait suite à celle des républiques soviétiques de Hongrie et de Bavière, à la défaite des grèves générales de Winnipeg, Seattle, Red Clydeside, à celle des occupations d'usine en Italie, du soulèvement de la Ruhr en Allemagne et de beaucoup d'autres mouvements de masse.
De plus en plus conscients de leur isolement, le parti agrippé au pouvoir en Russie et d'autres partis communistes ailleurs commencèrent à avoir recours à des mesures désespérées pour étendre la révolution, comme la marche de l'Armée rouge sur la Pologne et l'Action de Mars en Allemagne en mars 1921 – deux tentatives ratées de forcer le cours de la révolution sans développement massif de la conscience de classe et de l'organisation nécessaires à une véritable prise du pouvoir par la classe ouvrière. Pendant ce temps, le système capitaliste, quoique saigné à blanc par la guerre et manifestant toujours des symptômes d'une profonde crise économique, parvint à se stabiliser sur les plans économique et social, en partie grâce au nouveau rôle joué par les Etats-Unis comme force motrice industrielle et banquier du monde.
Au sein de l'Internationale communiste, le Deuxième Congrès de 1920 avait déjà ressenti l'impact des précédentes défaites. Ce fut symbolisé par la publication par Lénine de la brochure La maladie infantile du communisme qui fut distribuée au Congrès 9. Au lieu de s'ouvrir à l'expérience vivante du prolétariat mondial, l'expérience bolchevique – ou une version particulière de celle-ci - était maintenant présentée comme un modèle universel. Les Bolcheviks avaient eu un certain succès à la Douma après 1905, la tactique du "parlementarisme révolutionnaire" était donc présentée comme ayant une validité universelle ; les syndicats s'étaient formés récemment en Russie et n'avaient pas perdu tout signe de vie prolétarienne... les communistes de tous les pays devaient donc faire tout ce qu'ils pouvaient pour rester dans les syndicats réactionnaires et chercher à les conquérir en éliminant les bureaucrates corrompus. A côté de cette codification des tactiques syndicale et parlementaire, en totale opposition vis-à-vis des courants communistes de gauche qui les rejetaient, vint l'appel à construire des partis communistes de masse, en incorporant en grande partie les organisations comme l'USPD en Allemagne et le Parti socialiste en Italie (PSI).
L’année 1921 montra d'autres manifestations du glissement vers l'opportunisme, du sacrifice des principes et des buts à long terme au profit de succès à court terme et de la croissance numérique. Au lieu d'une claire dénonciation des partis sociaux-démocrates comme agents de la bourgeoisie, on avait maintenant le sophisme de la "lettre ouverte" à ces partis, ayant pour but de "forcer les dirigeants à se battre" ou, s'ils ne le faisaient pas, à se démasquer face à leurs membres ouvriers. Bref, l'adoption d'une politique de manœuvres dans laquelle les masses doivent en quelque sorte être dupées pour développer leur conscience. Ces tactiques allaient être rapidement suivies par la proclamation de celle du "front unique" et par le slogan encore plus sans principes de "Gouvernement ouvrier", sorte de coalition parlementaire entre les sociaux-démocrates et les communistes. Derrière toute cette course à l'influence à tout prix se trouve le besoin de l'Etat "soviétique" de faire face à un monde capitaliste hostile, de trouver un modus vivendi avec le capitalisme mondial, au prix d'un retour à la pratique de la diplomatie secrète qui avait été très clairement condamnée par le pouvoir soviétique en 1917 (en 1922, l'Etat "soviétique" signait un accord secret avec l'Allemagne, lui fournissant même des armes qui allaient servir à abattre les ouvriers communistes un an après). Tout cela indiquait l'accélération de la trajectoire qui s'éloignait de la lutte pour la révolution et s'orientait vers l'incorporation dans le statu quo capitaliste – pas encore définitive mais indiquant le chemin de la dégénérescence qui allait culminer dans la victoire de la contre-révolution stalinienne.
Cela ne voulait pas dire que toute clarté ou tout débat sérieux sur la période historique ait disparu. Au contraire, les "communistes de gauche", réagissant à ce cours opportuniste, allaient baser encore plus solidement leurs arguments sur le point de vue que le capitalisme était entré dans une nouvelle période : le programme du KAPD de 1920 commençait donc par la proclamation que le capitalisme était dans sa crise historique et qu'il mettait le prolétariat face au choix "socialisme ou barbarie" 10 ; la même année, les arguments de la gauche italienne contre le parlementarisme partent des prémisses selon lesquelles les campagnes pour les élections parlementaires avaient eu leur validité dans la période passée mais que l'avènement d'une nouvelle époque invalidait cette ancienne pratique. Mais même parmi les voix "officielles" de l'Internationale existait toujours une tentative authentique de comprendre les caractéristiques et les conséquences de la nouvelle période.
Le Rapport et les Thèses sur la situation mondiale présentées par Trotsky au Troisième Congrès en juin/juillet 1921 offraient une analyse très lucide des mécanismes auxquels avait recours un capitalisme profondément mal en point pour assurer sa survie dans la nouvelle période – notamment la fuite dans le crédit et le capital fictif. Analysant les premiers signes d'une reprise d'après-guerre, le rapport de Trotsky sur la crise économique mondiale et les nouvelles tâches de l'Internationale communiste posait ainsi les questions : "Comment s'est fait le relèvement lui-même, comment peut-il être expliqué ? En premier lieu, par des causes économiques : les relations internationales ont été renouées, quoique dans des proportions restreintes, et partout nous observons une demande des marchandises les plus variées ; il s'explique ensuite par des causes politiques et financières : les gouvernements européens avaient eu peur de la crise qui devait se produire après la guerre et avaient pris leurs mesures pour faire durer ce relèvement artificiel qui avait été provoqué par la guerre. Les gouvernements ont continué à mettre en circulation du papier-monnaie en grande quantité, ils ont lancé de nouveaux emprunts, taxé les bénéfices, les salaires et le prix du pain, ils couvraient ainsi une part des salaires des ouvriers démobilisés en puisant dans les fonds nationaux, et créaient une activité économique artificielle dans le pays. De cette façon, pendant tout ce temps, le capital fictif continuait à croître, surtout dans les pays où l'industrie baissait."11
Toute la vie du capitalisme depuis cette époque n'a fait que confirmer ce diagnostic d'un système qui ne pouvait se maintenir à flot qu'en violant ses propres lois économiques. Ces textes cherchaient aussi à approfondir la compréhension selon laquelle, sans une révolution prolétarienne, le capitalisme déchaînerait certainement de nouvelles guerres encore plus destructrices (même si les déductions sur une confrontation imminente entre l'ancienne puissance britannique et la puissance américaine montante étaient loin du compte bien que non sans fondement). Mais la clarification la plus importante contenue dans ce document et d'autres était la conclusion que l'avènement de la nouvelle période ne signifiait pas que le déclin, la crise économique ouverte et la révolution seraient simultanés – une ambiguïté qu'on peut trouver dans la formulation d'origine de l'IC en 1919, "Une nouvelle époque est née", qui pouvait être interprétée comme signifiant que le capitalisme était entré simultanément dans une crise économique "finale", une phase ininterrompue de conflits révolutionnaires. Cette avancée dans la compréhension est peut-être plus clairement exprimée dans le texte de Trotsky "Les enseignements du Troisième Congrès de l'IC", rédigé en juillet 1921. Il commençait ainsi : "Les classes ont leur origine dans le processus de production. Elles sont capables de vivre tant qu'elles jouent le rôle nécessaire dans l'organisation commune du travail. Les classes perdent pied si leurs conditions d'existence sont en contradiction avec le développement de la production, c'est-à-dire le développement de l'économie. C'est dans une telle situation que se trouve actuellement la bourgeoisie. Cela ne signifie pas du tout que la classe qui a perdu ses racines et qui est devenue parasitaire doive périr immédiatement. Quoique les fondements de la domination de classe reposent sur l'économie, les classes se maintiennent grâce aux appareils et organes de l'Etat politique : armée, police, parti, tribunaux, presse, etc. A l'aide de ces organes, la classe dominante peut conserver le pouvoir des années et des dizaines d'années même quand elle est devenue un obstacle direct au développement social. Si cet état de choses se prolonge trop longtemps, la classe dominante peut entraîner dans sa chute le pays et la nation qu'elle domine... La représentation purement mécanique de la révolution prolétarienne, qui a uniquement pour point de départ la ruine constante de la société capitaliste, poussait quelques groupes de camarades à la théorie fausse de l'initiative des minorités qui font écrouler par leur hardiesse "les murs de la passivité commune du prolétariat" et des attaques incessantes de l'avant-garde du prolétariat comme nouvelle méthode de combat dans les luttes et de l'emploi des méthodes de révoltes armées. Inutile de dire que cette sorte de théorie de la tactique n'a rien à faire avec le marxisme." 12
Ainsi, l'ouverture du déclin n'excluait pas des reprises au niveau économique, ni des reculs du prolétariat. Evidemment, personne ne pouvait voir à quel point déjà les défaites de 1919-21 avaient été décisives, mais il existait un besoin brûlant de clarifier que faire maintenant, dans une nouvelle époque mais pas dans un moment immédiat de révolution. Un texte séparé, les Thèses sur la tactique, adopté par le Congrès, mettait très justement en avant la nécessité que les partis communistes prennent part aux luttes défensives afin de développer la confiance et la conscience de la classe ouvrière, et ceci, de pair avec la reconnaissance que le déclin et la révolution n'étaient en aucun cas synonymes, constituait un rejet nécessaire de "la théorie de l'offensive" qui avait largement justifié la démarche semi-putschiste de l'Action de mars. Cette théorie – selon laquelle les conditions objectives étant mûres, le parti communiste devait mener une offensive insurrectionnelle plus ou moins permanente pour pousser les masses à l'action – était défendue principalement par la gauche du parti communiste allemand, par Bela Kun et d'autres et non, comme c'est souvent dit de façon erronée, par la Gauche communiste à proprement parler même si le KAPD et des éléments proches de lui n'étaient pas toujours clairs sur cette question. 13
A ce sujet, les interventions des délégations du KAPD au Troisième Congrès sont extrêmement instructives. Contredisant l'étiquette de "sectaire" qui lui était accolée dans les Thèses sur la tactique, l'attitude du KAPD au Congrès fut un modèle de la façon responsable dont une minorité doit se conduire dans une organisation prolétarienne. Bien qu'il ait disposé d'un temps extrêmement restreint pour ses interventions et dû supporter les interruptions et les sarcasmes des supporters de la ligne officielle, le KAPD se considérait comme participant pleinement au déroulement du Congrès et ses délégués étaient très disposés à souligner les points d'accord quand ils en avaient ; ils n'étaient pas du tout intéressés à mettre en avant leurs divergences pour elles-mêmes, ce qui constitue l'essence de l'attitude sectaire. 14 Par exemple, dans la discussion sur la situation mondiale, un certain nombre de délégués du KAPD partageaient beaucoup de points de l'analyse de Trotsky, notamment la notion selon laquelle le capitalisme était en train de se reconstruire au plan économique et de reprendre le contrôle sur le plan social : ainsi Seeman souligna la capacité de la bourgeoisie internationale de mettre temporairement de côté ses rivalités inter-impérialistes afin de faire face au danger prolétarien, en Allemagne en particulier.
L'implication de ceci – en particulier du fait que le rapport de Trotsky et les Thèses sur la situation mondiale étaient en grande partie orientées pour rejeter la "théorie de l'offensive" et ses partisans – c'est que le KAPD ne défendait pas qu'il ne pourrait pas y avoir de stabilisation du capital ni que la lutte devait être offensive à tout moment.Et il exprima explicitement ce point de vue dans nombre d'interventions.
Sachs, dans sa réponse à la présentation de Trotsky sur la situation économique mondiale, dit ainsi que : "Nous avons vu certes hier en détail comment le camarade Trotsky – et tous ceux qui sont ici seront, je pense, d' accord avec lui - se représente les rapports entre d'un côté les petites crises et les petites périodes d'essors cycliques et momentanés et, de l'autre côté, le problème de l'essor et du déclin du capitalisme, envisagé sur de grandes périodes historiques. Nous serons tous d'accord que la grande courbe qui allait vers le haut va maintenant irrésistiblement vers le bas, et qu'à l'intérieur de cette grande courbe, aussi bien lorsqu'elle montait que maintenant qu'elle descend, se produisent des oscillations." (La gauche allemande, p.21) 15
Ainsi, quelles que soient les ambiguïtés ayant existé dans la vision du KAPD sur "la crise mortelle", il ne considérait pas que l'ouverture de la décadence signifiait un effondrement soudain et définitif de la vie économique du capitalisme.
De même, l'intervention de Hempel sur la tactique de l'Internationale montre clairement que l'accusation de "sectaire" portée au KAPD pour son supposé refus des luttes défensives et son prétendu appel à l'offensive à tout moment était fausse : "Maintenant la question des actions partielles. Nous disons que nous ne repoussons aucune action partielle. Nous disons : chaque action, chaque combat, car c'est une action, doit être mis au point, poussé en avant. On ne peut pas dire : nous repoussons ce combat-ci, nous repoussons ce combat-là. Le combat qui naît des nécessités économiques de la classe ouvrière, ce combat doit par tous les moyens être poussé en avant. Justement dans un pays tel que l'Allemagne, l'Angleterre et tous les autres pays de démocratie bourgeoise qui ont subi pendant 40 ou 50 ans une démocratie bourgeoise et ses effets, la classe ouvrière doit être d'abord habituée aux luttes. Les mots d'ordre doivent correspondre aux actions partielles. Prenons un exemple : dans une entreprise, dans différentes entreprises, une grève éclate, elle englobe un petit domaine. Là le mot d'ordre ne saurait être : lutte pour la dictature du prolétariat. Ce serait une absurdité. Les mots d'ordre doivent aussi être adaptés aux rapports de force, à ce que l'on peut attendre en un lieu donné." (ibid. p.40)
Mais derrière beaucoup de ces interventions, il y avait l'insistance du KAPD sur le fait que l'IC n'allait pas assez loin dans sa compréhension qu'une nouvelle période de la vie du capitalisme et donc de la lutte de classe s'était ouverte. Sachs, par exemple, ayant exprimé son accord avec Trotsky sur la possibilité de reprises temporaires, défendit que : "ce qui n'a pas été exprimé dans ces Thèses, ...c'est justement le caractère fondamentalement différent de cette époque de déclin vis-à-vis de l'époque antérieure d'essor du capitalisme considéré dans sa totalité" (ibid., p.21) et que cela avait des implications sur la façon dont le capitalisme survivrait désormais : "le capital reconstruit son pouvoir en détruisant l'économie". (ibid. p.22), un point de vue visionnaire sur la façon dont le capitalisme allait continuer comme système dans le siècle qui allait suivre. Hempel, dans la discussion sur la tactique, tire les implications de la nouvelle période concernant les positions politiques que les communistes doivent défendre, en particulier sur les questions syndicale et parlementaire dans la tactique. Contrairement aux anarchistes auxquels le KAPD a souvent été assimilé, Hempel insiste sur le fait que l'utilisation du parlement et des syndicats avait été juste dans la période précédente : "...si l'on se remet en mémoire les tâches qu'avait le vieux mouvement ouvrier, ou mieux, le mouvement ouvrier précédent l'époque de cette irruption de la révolution directe, il avait pour tâche, d'un côté, grâce aux organisations politiques de la classe ouvrière, les partis, d'envoyer des délégués au parlement et dans les institutions que la bourgeoisie et la bureaucratie avaient laissées ouvertes à la représentation de la classe ouvrière. C'était l'une des tâches. Cela fut mis à profit et à l'époque c'était juste. Les organisations économiques de la classe ouvrière avaient de leur côté la tâche de se préoccuper d'améliorer la situation du prolétariat au sein du capitalisme, de pousser à la lutte et de négocier lorsque la lutte s'arrêtait...telles étaient les tâches des organisations ouvrières avant la guerre. Mais la révolution arriva ; d'autres tâches se firent jour. Les organisations ouvrières ne pouvaient pas se conformer à la lutte pour les augmentations de salaires et s'en satisfaire ; elles ne purent plus poser – comme leur but principal – celui d'être représentées au parlement et d'extorquer des améliorations pour la classe ouvrière " (ibid. p.33) et de plus "en permanence nous faisons l'expérience que toutes les organisations de travailleurs qui prennent ce chemin, en dépit de tous leurs discours révolutionnaires, se dérobent dans les luttes décisives" (ibid. p.34), et c'est pourquoi la classe ouvrière avait besoin de créer de nouvelles organisations capables d'exprimer la nécessité de l'auto-organisation du prolétariat et de la confrontation directe avec l'Etat et le capital ; ceci était valable tant pour les petites luttes défensives que pour les luttes massives plus vastes. Ailleurs Bergmann définit les syndicats comme les rouages de l'Etat et montre qu'il est donc illusoire de vouloir les conquérir : "Nous sommes fondamentalement de l'avis qu'il faut se dégager des vieux syndicats. Non parce que nous aurions une soif de destruction, mais parce que nous voyons que ces organisations sont devenues réellement, dans le pire sens du terme, des organes de l'Etat capitaliste pour réprimer la révolution." (ibid., p. 56) Dans la même veine, Sachs critiqua la régression vers la notion de parti de masse et la tactique de la lettre ouverte aux partis sociaux-démocrates – c'étaient des régressions soit vers des pratiques sociales-démocrates et des formes d'organisation dépassées ou, pire, vers les partis sociaux-démocrates eux-mêmes qui étaient passés à l'ennemi.
* * *
En général, l'Histoire est écrite par les vainqueurs ou, du moins, par ceux qui apparaissent comme tels. Dans les années qui suivirent le Troisième Congrès, les partis communistes officiels restèrent des organisations capables d'inspirer la loyauté de millions d'ouvriers, le KAPD éclata rapidement en plusieurs composantes dont peu maintinrent la clarté exprimée par ses représentants à Moscou en 1921. Désormais, les erreurs vraiment sectaires apparurent au premier plan, en particulier dans la décision hâtive de la tendance d'Essen du KAPD, autour de Gorter, de fonder une "quatrième internationale" (la KAI ou Internationale communiste ouvrière) alors que ce qui était nécessaire dans une phase de recul de la révolution était le développement d'une fraction internationale qui combatte la dégénérescence de la Troisième Internationale. Cet enterrement prématuré de l'Internationale communiste s'accompagna logiquement d'un tournant dans l'analyse de la révolution d'Octobre, de plus en plus considérée comme une révolution bourgeoise. Le point de vue de la tendance Schröder dans la KAI qui considérait qu'à l'époque de la "crise mortelle", les luttes pour les salaires étaient opportunistes, était également sectaire ; d'autres courants commencèrent à mettre en question la possibilité même d'un parti politique du prolétariat, donnant naissance à ce qui est devenu connu sous le nom de "conseillisme". Mais ces manifestations d'un affaiblissement et d'une fragmentation plus générale de l'avant-garde révolutionnaire étaient le produit de la défaite et de la contre-révolution qui s'aggravaient ; en même temps, le maintien, au cours de cette période, des partis communistes en tant qu'organisations de masse influentes était aussi le produit de la contre-révolution bourgeoise, mais avec cette terrible particularité que ces partis s'étaient mis à l'avant-garde de cette contre-révolution, à côté des bouchers fascistes et démocratiques. D'un autre côté, les positions les plus claires du KAPD et de la gauche italienne, produits des plus hauts moments de la révolution et solidement ancrées dans la théorie du déclin du capitalisme, ne disparurent pas, en grande partie grâce au travail patient de petits groupes de révolutionnaires, souvent extrêmement isolés ; quand les brumes de la contre-révolution commencèrent à se dissiper, ces positions trouvèrent une nouvelle vie avec l'émergence d'une nouvelle génération de révolutionnaires et elles restent des acquis fondamentaux sur lesquels le futur parti de la révolution devra se construire.
Gerrard
1. Citée dans J.P. Nettl, "La vie et l'œuvre de Rosa Luxemburg", Ed. Maspero, Tome II, p.593
2. Ce serait intéressant cependant de faire plus de recherches sur les tentatives actuelles au sein du mouvement anarchiste d'analyser la signification de la guerre.
3. "Lenin's Encounter with Hegel after Eighty Years: A Critical Assessment [135]"
4. www.marxists.org/francais/lenin/works/1915/08/vil19150800.htm [136]
5. chapitre annexe "Thèses sur les tâches de la social-démocratie [137]".
6. "Le partage du monde entre les grandes puissances [138]".
7 www.marxists.org/francais/inter_com/1919/ic1_19190300d.htm [139]
8. Pour plus d'éléments sur les discussions lors du Premier Congrès de l'Internationale, voir l'article de la Revue internationale n°123 "La théorie de la décadence au cœur du matérialisme historique – De Marx à la Gauche communiste (2) [140]".
9 Signalons que cette lettre n'est pas restée sans réponse ni critiques, notamment celle de Gorter au camarade Lénine [141].
10. "La crise économique mondiale, née de la guerre mondiale, avec ses effets économiques et sociaux monstrueux, et dont l’image d’ensemble produit l’impression foudroyante d’un unique champ de ruines aux dimensions colossales, ne signifie qu’une seule chose : le crépuscule des dieux de l’ordre mondial bourgeois-capitaliste est entamé. Aujourd’hui il ne s’agit pas d’une des crises économiques périodiques, propres au mode de production capitaliste ; c’est la crise du capitalisme lui-même ; secousses convulsives de l’ensemble de l’organisme social, éclatement formidable d’antagonismes de classes d’une acuité jamais vue, misère générale pour de larges couches populaires, tout cela est un avertissement fatidique à la société bourgeoise. Il apparaît de plus en plus clairement que l’opposition entre exploiteurs et exploités qui s’accroît encore de jour en jour, que la contradiction entre capital et travail, dont prennent de plus conscience même les couches jusque là indifférentes du prolétariat, ne peut être résolue. Le capitalisme a fait l’expérience de son fiasco définitif ; il s’est lui-même historiquement réduit à néant dans la guerre de brigandage impérialiste, il a créé un chaos, dont la prolongation insupportable place le prolétariat devant l’alternative historique : rechute dans la barbarie ou construction d’un monde socialiste." www.left-dis.nl/f/kapd1920f.htm [142]
11 www.trotsky-oeuvre.org/21/07/210725_NE1.html [143].
12 www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1921/07/lt19210712.htm [144]
13. Par exemple le paragraphe introductif du programme du KAPD, cité dans la note, peut facilement être interprété comme décrivant une crise finale et définitive du capitalisme et, par rapport au danger de putschisme, certaines activités du KAPD pendant l'Action de Mars sont certainement tombées dans cette tendance, comme par exemple l'alliance avec le VKPD dans l'utilisation de ses membres chômeurs pour tenter d'entraîner littéralement par la force les ouvriers à rejoindre la grève générale, et dans ses rapports ambigus avec les forces armées "indépendantes" menées par Max Hoelz et d'autres (Voir également l'intervention de Hempel au Troisième Congrès (La gauche allemande, p. 41) qui reconnaît que l'Action de Mars n'aurait pas pu renverser le capitalisme mais insiste aussi sur la nécessité de lancer le slogan de renversement du gouvernement – une position qui semble manquer de cohérence puisque, pour le KAPD, il n'était pas question de défendre aucune sorte de Gouvernement "ouvrier" sans la dictature du prolétariat.
14 L'attitude de Hempel envers les anarchistes et les syndicalistes-révolutionnaires était également exempte d'esprit sectaire, et soulignait la nécessité de travailler avec toutes les expressions authentiquement révolutionnaires de ce courant (voir La gauche allemande, pp. 44-45)
15 Edité par Invariance, La vieille taupe, La vecchia talpa, 1973.
Questions théoriques:
- Décadence [75]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Le Manifeste du Groupe ouvrier du Parti communiste russe (2e partie)
- 2374 lectures
Nous avons publié la première partie du Manifeste dans le numéro précédent de la Revue internationale. Pour rappel, le Groupe ouvrier du Parti communiste russe, dont ce Manifeste est l’émanation, fait partie de ce qu’on appelle la Gauche communiste, constituée de courants de gauche ayant surgi en réponse à la dégénérescence opportuniste des partis de la Troisième Internationale et du pouvoir des soviets en Russie.
Les deux chapitres suivants de ce document que nous publions ci-dessous constituent une critique aiguisée de la politique opportuniste du front unique et du slogan de Gouvernement ouvrier. En replaçant cette critique dans son contexte historique, c’est réellement à une tentative d’appréhender les implications du changement de période historique que se livre le Manifeste. Pour lui, la nouvelle période rend caduque toute politique d’alliance avec des fractions de la bourgeoisie, vu que celles-ci sont désormais toutes également réactionnaires. De même, passer des alliances avec des organisations comme la social-démocratie, qui ont déjà fait la preuve de leur trahison, ne peut que conduire à un affaiblissement du prolétariat. De plus, le Manifeste est parfaitement clair sur ce fait que, dans la nouvelle période, ce n’est plus la lutte pour des réformes qui est à l’ordre du jour, mais bien celle pour la prise du pouvoir. Cependant, la rapidité avec laquelle des changements historiques considérables sont intervenus n’a pas permis, même aux révolutionnaires les plus clairs, de prendre le recul nécessaire pour en comprendre en profondeur les implications précises. Cela arrive aussi au Groupe ouvrier qui ne fait pas la différence entre lutte pour des réformes et lutte économique de résistance du prolétariat, face aux empiètements permanents du capital. Tout en ne refusant pas de participer à ces dernières, par solidarité, il juge cependant que seule la prise du pouvoir est de nature à libérer le prolétariat de ses chaînes, sans prendre en compte le fait que la lutte économique et politique forment un tout.
Enfin, face à la limitation de la liberté de parole imposée au prolétariat, y compris après la fin de la guerre civile, le Manifeste réagit très fermement et lucidement en s’adressant aux dirigeants : "comment voulez-vous résoudre la grande tâche de l’organisation de l’économie sociale sans le prolétariat ?"
Le front uni socialiste
Avant d’examiner le contenu de cette question, il est nécessaire de nous remettre en mémoire les conditions dans lesquelles les thèses du camarade Zinoviev au sujet du front unique furent débattues et acceptées en Russie. Du 19 au 21 décembre 1921 eut lieu la Douzième Conférence du PCR (bolchevik), au cours de laquelle fut posée la question du front unique. Jusqu’alors, rien n’avait été écrit dans la presse ni discuté à ce sujet dans les réunions du parti. Cependant, à la Conférence, le camarade Zinoviev se laissa aller à livrer de rudes attaques et la Conférence fut si surprise qu’elle céda tout de suite et approuva les thèses à mains levées. Nous rappelons cette circonstance non pour offenser qui que ce soit, mais pour attirer avant tout l’attention sur le fait que, d’une part, la tactique du front unique fut discutée de façon très hâtive, quasi "militairement", et que, d’autre part, en Russie même, elle est réalisée de façon tout à fait particulière.
Le PCR (bolchevik) fut le promoteur de cette tactique au sein du Komintern (IC) 1. Il convainquit les camarades étrangers que nous, révolutionnaires russes, avions vaincu justement grâce à cette tactique du front unique et qu’elle avait été édifiée en Russie sur base de l’expérience de toute l’époque pré-révolutionnaire et particulièrement à partir de l’expérience de la lutte des bolcheviks contre les mencheviks.
Tout ce que les camarades venus de différents pays connaissaient, c’est que le prolétariat russe avait vaincu, et ils voulaient de même vaincre leur bourgeoisie. On leur expliquait à présent que le prolétariat russe avait vaincu grâce à la tactique du front unique. Comment leur aurait-il été alors possible de ne pas approuver cette tactique ? Ils croyaient sur parole que la victoire de la classe ouvrière russe était le résultat de la tactique du front unique. Ils ne pouvaient pas faire autrement, puisqu’ils ne connaissaient pas l’histoire de la Révolution russe. Le camarade Lénine a condamné un jour très durement celui qui se fie simplement aux mots, mais il ne voulait vraisemblablement pas dire qu’on ne devait pas le croire lui sur parole.
Quelle leçon pouvons-nous alors tirer de l’expérience de la Révolution russe ?
A une époque, les bolcheviks soutenaient un mouvement progressiste contre l’autocratie :
a) "la social-démocratie doit soutenir la bourgeoisie tant que cette dernière est révolutionnaire ou opposée au tsarisme" ;
b) "c’est pourquoi la social-démocratie doit être favorable au réveil d’une conscience politique de la bourgeoisie russe mais, d’un autre côté, elle est obligée de dénoncer le caractère limité et l’insuffisance du mouvement d’émancipation de la bourgeoisie partout où ils s’expriment" (Résolution du IIe Congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, "De l’attitude envers les libéraux", août 1903).
La résolution du IIIe Congrès, qui s’est tenu en avril 1905, reproduit ces deux points en recommandant aux camarades :
1) d’expliquer aux ouvriers la nature contre-révolutionnaire et anti-prolétarienne du courant bourgeois-démocrate quelles que soient ses nuances, des libéraux modérés représentés par les vastes couches des propriétaires fonciers et des fabricants jusqu’au courant le plus radical comprenant "l’Union de l’émancipation" et les groupes variés des gens des professions libérales ;
2) de lutter ainsi énergiquement contre toute tentative de la part de la démocratie bourgeoise de récupérer le mouvement ouvrier et de parler au nom du prolétariat et de ses groupes divers.Dés 1898 la social-démocratie était favorable à un "front uni" (comme on dit actuellement) avec la bourgeoisie. Mais ce front uni a connu 3 phases :
1) en 1901, la social-démocratie soutient tout "mouvement progressiste" opposé au régime existant ;
2) en 1903, elle se rend bien compte de la nécessité de dépasser "les bornes du mouvement de la bourgeoisie";
3) en 1905, en avril, elle fait des pas concrets "en conseillant vivement aux camarades de dénoncer la nature contre-révolutionnaire et anti-prolétarienne du courant bourgeois-démocrate, toutes nuances comprises", en lui disputant énergiquement l’influence sur le prolétariat.
Mais quelles que furent les formes de soutien à la bourgeoisie, il est hors de doute que pendant une certaine période, avant 1905, les bolcheviks formèrent un front uni avec la bourgeoisie.
Et que penserions-nous d’un "révolutionnaire" qui, en fonction de l’expérience russe, aurait proposé un front uni avec la bourgeoisie aujourd’hui ?
Au mois de septembre 1905, la Conférence convoquée spécialement pour débattre la question de la "Douma de Boulyguine" a défini l’attitude de cette dernière envers la bourgeoisie de la façon suivante : "Par cette illusion d’une représentation du peuple, l’autocratie aspire à s’attacher une grande partie de la bourgeoisie lasse du mouvement ouvrier et désirant de l’ordre ; en s’assurant de ses intérêt et de son soutien, l’autocratie vise à écraser le mouvement révolutionnaire du prolétariat et de la paysannerie."
La résolution des bolcheviks proposée au Congrès d’unification du POSDR (avril 1906) révèle le secret du changement de politique des bolcheviks, de son soutien passé à la bourgeoisie à la lutte contre elle : "Quant à la classe des grands capitalistes et des propriétaires fonciers, on voit leur passage très rapide de l’opposition à un arrangement avec l’autocratie pour écraser ensemble la révolution". Comme "la tâche principale de la classe ouvrière au moment actuel de la révolution démocratique est l’achèvement de cette révolution", il faut former "un front uni" avec des partis qui le veulent aussi. Pour cette raison, les bolcheviks ont renoncé à tout accord avec les partis à la droite des Cadets et ont conclu des pactes avec les partis à leur gauche, à savoir les socialistes-révolutionnaires (SR), les socialistes populaires (NS) et les travaillistes, ont donc construit "un front uni socialiste" dans la lutte pour la marche conséquente de la révolution démocratique.
Est-ce que la tactique des bolcheviks était juste à cette époque ? Nous ne croyons pas que parmi les combattants actifs de la Révolution d’octobre se trouvent des gens contestant la justesse de cette tactique. Nous constatons donc que de 1906 à 1917 inclus, les bolcheviks ont prôné "un front uni socialiste" dans la lutte pour une marche conséquente de la révolution démocratique s’achevant par la formation d’un Gouvernement révolutionnaire provisoire qui aurait dû convoquer une Assemblée constituante.
Personne n’a jamais considéré et n’a pu considérer cette révolution comme étant prolétarienne, socialiste ; tous ont bien compris qu’elle était bourgeoise-démocratique ; et néanmoins, les bolcheviks ont proposé et ont eux-mêmes suivi la tactique d’un "front uni socialiste" en s’unissant en pratique avec les SR, les mencheviks, les NS et les travaillistes.
Quelle fut la tactique des bolcheviks quand se posa la question de savoir si on devait lutter pour la révolution démocratique ou pour la révolution socialiste ? La lutte pour le pouvoir des conseils réclame-t-elle aussi le "front uni socialiste" ?
Les révolutionnaires marxistes considèrent toujours le parti des socialistes-révolutionnaires comme étant une "fraction démocratique-bourgeoise" à la "phraséologie socialiste ambiguë" ; ce qui a été confirmé, dans une grande mesure, par son activité durant toute la révolution jusqu’à l’heure actuelle. En tant que fraction démocratique-bourgeoise, ce parti ne pouvait pas se proposer la tâche pratique d’une lutte pour la révolution socialiste, pour le socialisme ; mais il chercha, en utilisant une terminologie "socialiste ambiguë", à empêcher à tout prix cette lutte. S’il en est ainsi (et il en est ainsi), la tactique qui devait conduire le prolétariat insurgé à la victoire ne pouvait être celle du front uni socialiste, mais celle du combat sanglant, sans ménagement, contre les fractions bourgeoises à la terminologie socialiste confuse. Seul ce combat pouvait apporter la victoire et il en fut ainsi. Le prolétariat russe a vaincu non en s’alliant aux socialistes-révolutionnaires, aux populistes et aux mencheviks, mais en luttant contre eux.
Il est vrai que vers octobre, les bolcheviks ont réussi à faire scissionner les partis SR 2 et mencheviks 3 en libérant les masses ouvrières de la captivité d’une terminologie socialiste obscure, et ont pu agir avec ces scissions [de gauche], mais ça ne peut guère être considéré comme un front uni avec les fractions bourgeoises.
Qu’est-ce que l’expérience russe nous enseigne ?
1) Dans certains moments historiques, il faut former un "front uni" avec la bourgeoisie dans les pays où la situation est plus ou moins semblable à celle qui existait en Russie avant 1905.
2) Dans les pays où la situation est à peu près semblable à celle de la Russie entre 1906 et 1917, il faut renoncer à la tactique d’un "front uni" avec la bourgeoisie et suivre la tactique d’un "front uni socialiste".
Dans les pays où il s’agit d’une lutte directe pour le pouvoir du prolétariat, il est nécessaire d’abandonner la tactique du "front uni socialiste" et d’avertir le prolétariat que "les fractions bourgeoises à la phraséologie socialiste ambiguë" – à l’époque actuelle tous les partis de la Seconde Internationale – marcheront au moment décisif les armes à la main pour la défense du système capitaliste.
Il est nécessaire, pour l’unification de tous les éléments révolutionnaires qui ont pour but le renversement de l’exploitation capitaliste mondiale, qu’ils s’alignent avec le Parti communiste ouvrier d’Allemagne (KAPD), le Parti communiste ouvrier de Hollande et les autres partis qui adhèrent à la IVe Internationale 4. Il est nécessaire que tous les éléments révolutionnaires prolétariens authentiques se détachent de ce qui les emprisonne : les partis de la Seconde Internationale, de l’Internationale deux et demi 5 et de leur "phraséologie socialiste ambiguë". La victoire de la révolution mondiale est impossible sans une rupture principielle et une lutte sans quartier contre les caricatures bourgeoises du socialisme. Les opportunistes et les social-chauvins, en tant que serviteurs de la bourgeoisie et par là ennemis directs de la classe prolétarienne, deviennent, plus spécialement aujourd’hui, liés comme ils le sont aux capitalistes, des oppresseurs armés dans leurs propres pays et dans les pays étrangers (cf. Programme du PCR bolchevik). Telle est donc la vérité sur la tactique du front unique socialiste qui, comme le soutiennent les thèses de l’Exécutif de l’IC, serait fondée sur l’expérience de la Révolution russe, alors qu’elle n’est en réalité qu’une tactique opportuniste. Une telle tactique de collaboration avec les ennemis déclarés de la classe ouvrière, qui oppriment les armes à la main le mouvement révolutionnaire du prolétariat dans tous les pays, est en contradiction ouverte avec l’expérience de la Révolution russe. Pour rester sous le signe de la révolution sociale, il est nécessaire de réaliser un "front uni" contre la bourgeoisie et ses serviteurs socialistes de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi.
Comme on le dit ci-dessus, la tactique du "front uni socialiste" garde toute sa valeur révolutionnaire dans les pays où le prolétariat lutte contre l’autocratie, soutenue par la bourgeoisie, et pour la révolution bourgeoise-démocratique.
Et là où le prolétariat combat encore l’autocratie à laquelle s’oppose aussi la bourgeoisie, il faut suivre la tactique du "front uni" avec la bourgeoisie.
Quand le Komintern exige des partis communistes de tous les pays qu’ils suivent coûte que coûte la tactique du front uni socialiste, c’est une exigence dogmatique qui entrave la résolution des tâches concrètes conformément aux conditions de chaque pays et nuit incontestablement à tout le mouvement révolutionnaire du prolétariat.
A propos des thèses de l’Exécutif de l’Internationale communiste
Les thèses qui en leur temps furent publiées dans la Pravda montrent clairement de quelle façon les "théoriciens" de l’idée du "front unique socialiste" comprennent cette tactique. Deux mots seulement sur l’expression "front unique". Chacun sait à quel point étaient "populaires" en Russie en 1917 les social-traîtres de tous les pays et en particulier Scheidemann, Noske et Cie. Les bolcheviks, les éléments de base du parti qui avaient peu d’expérience, criaient à chaque coin de rue : "Vous, traîtres perfides de la classe ouvrière, nous vous pendrons à des poteaux télégraphiques ! Vous portez la responsabilité du bain de sang international dans lequel vous avez noyé les travailleurs de tous les pays. Vous avez assassiné Rosa Luxemburg et Liebknecht. Les rues de Berlin, grâce à votre action violente, furent rouges du sang des travailleurs qui s’étaient soulevés contre l’exploitation et l’oppression capitalistes. Vous êtes les auteurs de la paix de Versailles ; vous avez porté d’innombrables blessures au mouvement prolétarien international, parce que vous le trahissez à chaque instant."
Il faut également ajouter qu’on n’a pas décidé de proposer aux ouvriers communistes le "front unique socialiste", c’est-à-dire un front unique avec Noske, Scheidemann, Vandervelde, Branting et Cie. Un tel front unique doit être d’une façon ou d’une autre masqué et c’est ainsi qu’il fut procédé. Les thèses ne sont pas simplement intitulées "le front unique socialiste", mais "thèses sur le front unique du prolétariat et sur l’attitude vis-à-vis des ouvriers appartenant à la Deuxième Internationale, à l’Internationale Deux et demi et celle d’Amsterdam, de même que vis-à-vis des ouvriers adhérant aux organisations anarchistes et syndicalistes". Pourquoi une sauce si longue ? Voyez-vous, le camarade Zinoviev lui-même qui, naguère encore, invitait à collaborer à l’enterrement de la Deuxième Internationale, invite maintenant à des noces avec elle. De là le titre à rallonge. En réalité, on a parlé d’accord non avec les ouvriers, mais avec les partis de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi. Tout ouvrier sait, même s’il n’a jamais vécu dans l’émigration, que les partis sont représentés par leur Comité central, là où siègent les Vandervelde, les Branting, les Scheidemann, les Noske et Cie. Ainsi, c’est avec eux également que s’établira l’accord. Qui est allé à Berlin à la Conférence des trois Internationales ? A qui l’Internationale communiste s’est-elle fiée corps et âme ? A Wels, à Vandervelde, etc.
Mais a-t-on cherché à obtenir une entente avec le KAPD, étant donné que le camarade Zinoviev soutient que là se trouvent les éléments prolétariens les plus précieux ? Non. Et pourtant le KAPD se bat pour organiser la conquête du pouvoir par le prolétariat.
Il est vrai que le camarade Zinoviev a affirmé dans les thèses qu’on ne vise pas à une fusion de l’Internationale communiste avec la Deuxième Internationale, à l’égard de laquelle il a rappelé la nécessité de l’autonomie organisationnelle : "L’autonomie absolue et l’indépendance totale d’exposer ses positions pour chaque parti communiste qui conclut tel ou tel accord avec les partis de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi". Les communistes s’imposent la discipline dans l’action mais ils doivent conserver le droit et la possibilité – non seulement avant et après mais si c’est nécessaire aussi durant l’action – de se prononcer sur la politique des organisations ouvrières sans exception. En soutenant le mot d’ordre "de l’unité maximale de toutes les organisations ouvrières dans toute action pratique contre le front capitaliste, les communistes ne peuvent pas renoncer à exposer leurs positions" (cf. les thèses du CC du Komintern pour la conférence du PCR de 1921).
Avant 1906, dans le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, il y eut deux fractions qui avaient autant d’autonomie que le prévoient les thèses du Komintern citées ci-dessus.
Discipline dans les pourparlers et autonomie de jugement sont formellement reconnues par les statuts du PCR (bolchevik) dans la vie interne du parti. On doit faire ce que la majorité a décidé et on peut seulement exercer le droit à la critique. Fais ce qu’on te commande, mais si tu es vraiment trop scandalisé et convaincu qu’on est en train de nuire à la révolution mondiale, tu peux, avant, pendant et après l’action, exprimer librement ta rage. Cela revient à renoncer aux actions autonomes (tout comme Vandervelde a signé le traité de Versailles et s’est compromis).
Dans ces mêmes thèses, l’Exécutif proposa le mot d’ordre de gouvernement ouvrier qui doit se substituer à la formule de la dictature du prolétariat. Qu’est-ce exactement qu’un gouvernement ouvrier ? C’est un gouvernement constitué par le Comité central réduit du parti ; la réalisation idéale de ces thèses se rencontre en Allemagne où le président Ebert est socialiste et où se forment des gouvernements avec son agrément. Même si cette formule n’est pas acceptée, les communistes devront appuyer par leur vote les premiers ministres et les présidents socialistes comme Branting en Suède et Ebert en Allemagne.
Voila comment nous nous représentons l’autonomie de critique : le président du Komintern, le camarade Zinoviev, entre au CC du Parti social-démocrate et, en y voyant Ebert, Noske, Scheidemann, se jette sur eux le poing levé en criant : "Perfides, traîtres de la classe ouvrière !" Ils lui sourient aimablement et s’inclinent bas devant lui. "Vous avez assassiné Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, les chefs du prolétariat allemand, nous vous pendrons à la potence !" Ils lui sourient encore plus aimablement et s’inclinent encore plus bas. Le camarade Zinoviev leur offre le front unique et propose de former un gouvernement ouvrier avec participation communiste. Ainsi, il troque le gibet contre le fauteuil ministériel et la colère contre la sympathie. Noske, Ebert, Scheidemann et Cie iront dans les assemblées ouvrières et raconteront que l’IC leur a consenti une amnistie et offert des postes ministériels à la place de la potence. Ceci pourtant à une condition, que les communistes reçoivent un ministère […] 6. Ils diront à toute la classe ouvrière que les communistes ont reconnu la possibilité de réaliser le socialisme en s’unissant avec eux et non contre eux. Et ils ajouteront : regardez un peu ces gens ! Ils nous pendaient et enterraient d’avance ; finalement ils sont venus à nous. Et bon, nous leur pardonnerons comme ils nous ont évidemment pardonné. Une amnistie mutuelle.
L’Internationale communiste a donné à la Deuxième Internationale une preuve de sa sincérité politique et elle a reçu une preuve de misérabilisme politique. Qu’y a-t-il en réalité à l’origine de ce changement ? Comment se fait-il que le camarade Zinoviev offre à Ebert, à Scheidemann et à Noske des fauteuils ministériels au lieu du gibet ? Il y a peu de temps il chantait l’oraison funèbre de la Deuxième Internationale et, à présent, il en ressuscite l’esprit. Pourquoi chante-t-il désormais ses louanges ? Verrons-nous vraiment sa résurrection et la réclamerons-nous réellement ?
Les thèses du camarade Zinoviev répondent effectivement à cette question : "la crise économique mondiale devient plus aiguë, le chômage s’accroît, le capital passe à l’offensive et manœuvre avec adresse ; le niveau de vie du prolétariat est compromis" Ainsi une guerre est inévitable. Il en découle que la classe ouvrière se dirige plus à gauche. Les illusions réformistes se détruisent. La large base ouvrière commence maintenant à apprécier le courage de l’avant-garde communiste... et de ce fait... on doit constituer le front unique avec Scheidemann. Et vraiment, c’est partir de très haut pour arriver bien bas.
Nous ne serions pas objectifs si nous ne rapportions pas encore quelques considérations fondamentales que le camarade Zinoviev avance pour défendre le front unique dans sa thèse. Le camarade Zinoviev fait une merveilleuse découverte : "On sait que la classe ouvrière lutte pour l’unité. Et comment y arriver sinon à travers un front unique avec Scheidemann ?". Tout ouvrier conscient qui, sensible aux intérêts de sa classe et de la révolution mondiale, peut se demander : la classe ouvrière a-t-elle commencé à lutter pour l’unité juste au moment où on affirme la nécessité du "front unique" ? Quiconque a vécu parmi les travailleurs, depuis que la classe ouvrière est entrée dans le champ de la lutte politique, connaît les doutes qui assaillent tout ouvrier : pourquoi les mencheviks, les socialistes-révolutionnaires, les bolcheviks, les trudoviki (populistes) luttent-ils donc entre eux ? Tous désirent le bien du peuple. Et pour quels motifs se combattent-ils ? Tout ouvrier connaît ces doutes, mais quelle conclusion doit-on en tirer ? La classe ouvrière doit s’organiser en classe indépendante et s’opposer à toutes les autres. Nos préjugés petit-bourgeois doivent être surmontés ! Telle était alors la vérité et telle elle le reste aujourd’hui.
Dans tous les pays capitalistes où se présente une situation favorable à la révolution socialiste, nous devons préparer la classe ouvrière à la lutte contre le menchevisme international et les socialistes-révolutionnaires. Les expériences de la Révolution russe devront être prises en considération. La classe ouvrière mondiale doit s’enfoncer cette idée dans la tête, à savoir que les socialistes de la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi sont et seront à la tête de la contre-révolution. La propagande du front unique avec les social-traîtres de toutes les nuances tend à faire croire qu’eux aussi combattent en définitive la bourgeoisie, pour le socialisme et non contre. Mais seule la propagande ouverte, courageuse, en faveur de la guerre civile et de la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière peut intéresser le prolétariat à la révolution.
L’époque où la classe ouvrière pouvait améliorer sa propre condition matérielle et juridique à travers les grèves et l’entrée au parlement est définitivement passée. On doit le dire ouvertement. La lutte pour les objectifs les plus immédiats est une lutte pour le pouvoir. Nous devons démontrer à travers notre propagande que, bien que nous ayons souvent appelé à la grève, nous n’avons pas réellement amélioré notre condition d’ouvriers, mais vous, travailleurs, vous n’avez pas encore dépassé la vieille illusion réformiste et menez une lutte qui vous affaiblit vous-mêmes. Nous pourrons bien être solidaires de vous dans les grèves, mais nous reviendrons toujours vous dire que ces mouvements ne vous libéreront pas de l’esclavage, de l’exploitation et de la morsure du besoin inassouvi. L’unique voie qui vous conduira à la victoire est la prise du pouvoir par vos mains calleuses.
Mais ce n’est pas tout. Le camarade Zinoviev a décidé de motiver solidement la tactique d’un front uni : nous sommes habitués à comprendre la notion relative à "l’époque de la révolution sociale" comme le moment actuel, ce qui veut dire que la révolution sociale est à l’ordre du jour ; mais en pratique il se révèle que "l’époque de la révolution sociale est un processus révolutionnaire à long terme". Zinoviev conseille de retomber sur terre et d’attirer les masses ouvrières. Mais nous avions déjà attiré les masses en nous unissant de différentes façons avec les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires (SR) depuis 1903 jusqu’en 1917 et, comme on le voit, nous avons fini par triompher, c’est pourquoi, pour vaincre Ebert, Scheidemann et Cie, il nous faut... (mais non, pas les combattre…) nous unir à eux.
Nous ne discuterons pas si l’époque de la révolution sociale est un processus de longue durée ou non, et si oui, combien de temps prendra-t-il, car cela ressemblerait à une dispute de moines sur le sexe des anges ou à une discussion visant à trouver à partir de quel cheveu perdu commence la calvitie. Nous voulons définir la notion même de "l’époque de la révolution sociale" Qu’est-ce que c’est ? С’est d’abord l’état des forces productives matérielles qui commencent à être antinomiques à la forme de propriété. Est-ce qu’il y a des conditions matérielles nécessaires pour que la révolution sociale soit inévitable ? Oui. Est-ce qu’il manque quelque chose ? Il manque des conditions subjectives, personnelles : que la classe ouvrière des pays capitalistes avancés se rende compte de la nécessite de cette révolution, non dans un avenir lointain, mais dès aujourd’hui, dès demain. Et pour cela, que doivent faire les ouvriers avancés, l’avant-garde qui s’en rend déjà compte ? Sonner le tocsin, appeler à la bataille en utilisant dans leur propagande en faveur de la guerre civile ouverte toute sorte de choses (les lock-out, les grèves, l’imminence de la guerre, l’abaissement du niveau de vie) et en préparant, en organisant la classe ouvrière pour une lutte immédiate.
Dit-on que le prolétariat russe a triomphé parce qu’il s’était uni avec les mencheviks et les SR ? C’est une baliverne. Le prolétariat russe a vaincu la bourgeoisie et les propriétaires fonciers grâce à sa lutte acharnée contre les mencheviks et les SR.
Dans un de ses discours sur la nécessité d’une tactique de front uni, le camarade Trotski dit que nous avons triomphé, mais qu’il faut analyser comment nous nous sommes battus. Il prétend que nous avons marché en front uni avec les mencheviks et les SR parce que nous, les mencheviks et les SR avons siégé dans les mêmes conseils. Si la tactique du front uni consiste à siéger dans une même institution, alors le chef des travaux forcés et les bagnards font eux aussi un front uni : les uns et les autres sont au bagne.
Nos partis communistes siègent dans les parlements – est-ce que ça veut dire qu’ils font un front uni avec tous les députés ? Les camarades Trotski et Zinoviev devraient raconter aux communistes du monde entier que les bolcheviks eurent raison de ne pas participer au "pré-parlement" convoqué par le socialiste-révolutionnaire Kerenski en août 1917, non plus qu’au Gouvernement provisoire dirigé par les socialistes (ce qui fut une leçon utile), au lieu de dire des choses plutôt douteuses sur un soi-disant front uni des bolcheviks, des mencheviks et des SR.
Nous avons déjà évoqué l’époque où les bolcheviks avaient fait un front uni avec la bourgeoisie. Mais quelle était cette époque ? Avant 1905. Oui, les bolcheviks ont prôné le front uni avec tous les socialistes – mais quand ? Avant 1917. Et en 1917, lorsqu’il s’agissait de lutter pour le pouvoir de la classe ouvrière, les bolcheviks se sont unis avec tous les éléments révolutionnaires, des SR de gauche aux anarchistes de toute espèce pour combattre à main armée les mencheviks et les SR qui, eux, faisaient un front uni avec la soi-disant "démocratie", c’est-à-dire avec la bourgeoisie et les propriétaires fonciers. En 1917, le prolétariat russe se plaça à la pointe de "l’époque de la révolution sociale" dans laquelle vit déjà le prolétariat des pays capitalistes avancés. Et dans laquelle il faut utiliser la tactique victorieuse du prolétariat russe de 1917 tout en tenant compte des leçons des années qui s’ensuivirent : la résistance acharnée de la part de la bourgeoisie, des SR et des mencheviks face à la classe ouvrière russe qui a pris le pouvoir. Ce sera cette tactique qui unira la classe ouvrière des pays capitalistes avancés, car cette classe est en train de "se débarrasser des illusions réformistes" ; ce ne sera pas le front uni avec la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi qui lui apportera la victoire, mais la guerre contre elles. Voilà le mot d’ordre de la révolution sociale mondiale future.
La question du front uni dans le pays où le prolétariat est au pouvoir (démocratie ouvrière)
Tous les pays où l’assaut socialiste a déjà eu lieu, où le prolétariat est la classe dirigeante, exigent une approche chaque fois différente. À noter qu’on ne peut pas élaborer une tactique valable pour toutes les étapes du processus révolutionnaire dans chaque pays différent, ainsi qu’une même politique pour tous les pays au même stade du processus révolutionnaire.
Si on se souvient de notre propre histoire (pour ne pas aller loin), celle de notre lutte, on verra qu’en combattant nos ennemis, nous avons utilisé des procédés bien différents.
En 1906 et les années suivantes, c’étaient les "trois piliers" : la journée de travail de 8 heures, la réquisition des terres et la république démocratique. Ces trois piliers comprenaient la liberté de parole et de presse, d’association, de grève et de syndicat, etc.
En février 1917 ? "À bas l’autocratie, vive l’Assemblée constituante !". C’est le cri des bolcheviks.
Pourtant, en avril-mai, tout s’oriente dans un autre sens : il y a la liberté d’association, de presse et de parole, mais la terre n’est pas réquisitionnée, les ouvriers ne sont pas au pouvoir ; on lance alors le mot d’ordre "Tout le pouvoir aux conseils !"
A cette époque, toute tentative de la bourgeoisie de nous coudre la bouche provoquait une résistance acharnée : "Vive la liberté de parole, de presse, d’association, de grève, de syndicat, de conscience ! Empare-toi de la terre ! Contrôle ouvrier de la production ! De la paix ! Du pain ! Et de la liberté ! Vive la guerre civile !"
Mais voilà Octobre et la victoire. Le pouvoir est à la classe ouvrière. L’ancien mécanisme étatique de l’oppression est complètement détruit, le nouveau mécanisme de l’émancipation est structuré en conseils de députés ouvriers, de soldats, etc.
Est-ce qu’à cette époque le prolétariat a dû proclamer le mot d’ordre de la liberté de presse, de parole, d’association, de coalition ? A-t-il pu permettre à tous ces messieurs, des monarchistes aux mencheviks et SR, de prôner la guerre civile ? Plus que ça, a-t-il pu, en tant que classe dirigeante, accorder la liberté de parole et de presse à quelques-uns de son milieu qui auraient aussi prôné la guerre civile ? Non et encore non !
Toute propagande pour la guerre civile contre le pouvoir prolétarien qui venait d’être organisé aurait été un acte contre-révolutionnaire en faveur des exploiteurs, des oppresseurs. Plus "socialiste" aurait été cette propagande, plus de mal aurait-elle pu faire. Et pour cette raison, il était nécessaire de procéder à "l’élimination la plus sévère, impitoyable de ces propagandistes de la famille prolétarienne même".
Mais voilà le prolétariat capable de supprimer la résistance des exploiteurs, de s’organiser en tant que pouvoir unique dans le pays, de se construire en autorité nationale reconnue même par tous les gouvernements capitalistes. Une nouvelle tâche s’impose à lui : organiser l’économie du pays, créer les biens matériels autant que possible. Et cette tâche est aussi immense que la conquête du pouvoir et la suppression de la résistance des exploiteurs. Plus que ça, la conquête du pouvoir et la suppression de la résistance des exploiteurs ne sont pas des objectifs en soi, mais des moyens pour aboutir au socialisme, à plus de bien-être et de liberté que sous le capitalisme, sous la domination d’une classe et l’oppression de l’autre.
Pour résoudre ce problème, la forme d’organisation et les moyens d’action utilisés pour supprimer les oppresseurs ne marchent plus, de nouvelles approches sont nécessaires.
Vu nos faibles ressources, vu les ravages horribles faits par les guerres impérialiste et civile, s’impose la tâche de créer des valeurs matérielles pour montrer en pratique à la classe ouvrière et aux groupes alliés parmi la population la force attractive de cette société socialiste créée par le prolétariat : montrer qu’elle est bonne non seulement parce qu’il n’y a plus de bourgeois, de gendarmes et autres parasites, mais parce que le prolétariat s’y sent maître, libre et sûr que toutes les valeurs, tous les biens, chaque coup de marteau sert à améliorer la vie, la vie des indigents, des opprimés, des humiliés sous le capitalisme, que ce n’est pas le royaume de la faim, mais celui de l’abondance jamais vue nulle part ailleurs. Voilà une tâche qui reste à faire par le prolétariat russe, tâche qui surpasse celles qui la précèdent.
Oui, elle les surpasse, car les deux premières tâches, la conquête du pouvoir et l’éradication de la résistance des oppresseurs (compte tenu de la haine acharnée du prolétariat et de la paysannerie envers les propriétaires fonciers et les bourgeois), sont certainement grandes, mais moins importantes que le troisième but. Et aujourd’hui tout ouvrier pourrait se demander : pourquoi a-t-on fait tout ça ? Fallait-il en faire tant ? Fallait-il verser le sang ? Fallait-il subir des souffrances sans fin ? Qui résoudra ce problème ? Qui sera l’artisan de notre fortune ? Quelle organisation le fera ?
Il n’est pas de sauveur suprême,
Ni dieu, ni césar, ni tribun ;
Producteurs,
sauvons-nous nous-mêmes !
Décrétons le salut commun !
Pour résoudre ce problème, il faut une organisation qui représente une volonté unie de tout le prolétariat. Il faut des conseils de députés ouvriers en tant qu’organisations industrielles présentes dans toutes les entreprises reprises à la bourgeoisie (nationalisées) qui devront soumettre à leur influence les couches immenses des compagnons de route.
Mais que sont actuellement nos conseils ? Ressemblent-ils même un tout petit peu aux conseils de députés ouvriers, c’est-à-dire aux "noyaux de base du pouvoir d’Etat dans les fabriques et les usines" ? Ressemblent-ils aux conseils du prolétariat qui représentent sa volonté unie de vaincre ? Ils sont vidés de leur sens, d’une base industrielle.
La longue guerre civile qui mobilisait l’attention de tout le prolétariat vers les objectifs de destruction, de résistance aux oppresseurs, a ajourné, effacé toutes les autres tâches et – sans que le prolétariat s’en aperçoive – a modifié son organisation, les conseils. Les conseils de députés ouvriers dans les usines sont morts. Vive les conseils de députés ouvriers !
Et n’est-ce pas la même chose avec la démocratie prolétarienne en général ? Est-ce que nous devons avoir une attitude similaire envers la liberté de parole et de presse pour le prolétariat qu’à l’époque de la guerre civile acharnée, de la révolte des esclavagistes ? Est-ce que le prolétariat, qui a pris le pouvoir, qui a su se défendre de mille ennemis terribles, ne peut pas se permettre d’exprimer ses pensées maintenant, en s’organisant pour surmonter des difficultés immenses dans la production, en dirigeant cette production et le pays entier ?
Que les bourgeois soient réduits au silence, certes, mais qui osera disputer le droit de libre parole d’un prolétaire qui a défendu son pouvoir sans ménager son sang ?
Qu’est-ce pour nous que la liberté de parole et de presse, est-ce un dieu, un fétiche ?
Nous ne nous faisons d’idole
Ni sur la terre, ni dans les cieux
Et ne nous prosternons
devant personne !
Pour nous, il n’existe aucune véritable démocratie, aucune liberté absolue en tant que fétiche ou idole, et même aucune véritable démocratie prolétarienne.
La démocratie n’était et ne sera jamais qu’un fétiche pour la contre-révolution, la bourgeoisie, les propriétaires fonciers, les prêtres, les SR, les mencheviks de tous les pays du monde. Pour eux, elle n’est qu’un moyen d’obtenir leurs buts de classe.
Avant 1917, la liberté de parole et de presse pour tous les citoyens fut notre revendication de programme. En 1917, nous avons conquis ces libertés et les avons utilisées pour la propagande et l’organisation du prolétariat et de ses compagnons de route, dont des intellectuels et des paysans. Après avoir organisé une force capable de vaincre la bourgeoisie, nous, les prolétaires, nous nous sommes mis au combat et avons pris le pouvoir. En vue d’empêcher la bourgeoisie d’utiliser la parole et la presse pour mener la guerre civile contre nous, nous avons refusé la liberté de parole et de presse non seulement aux classes ennemies, mais aussi à une partie du prolétariat et de ses compagnons de route – jusqu’au moment où la résistance de la bourgeoisie sera brisée en Russie.
Mais avec l’appui de la majorité des travailleurs, nous en avons fini avec la résistance de la bourgeoisie ; pouvons-nous maintenant nous permettre de nous parler entre nous, les prolétaires ?
La liberté de parole et de presse avant 1917, c’est une chose, en 1917 une autre, en 1918-20 une troisième et en 1921-22, un quatrième type d’attitude de notre parti envers cette question.
Mais se peut-il que les ennemis du pouvoir soviétique utilisent ces libertés pour le renverser ?
Peut-être ces libertés seraient-elles utiles et nécessaires en Allemagne, en France, en Angleterre, etc., si ces pays étaient dans la même phase du processus révolutionnaire, car il y a là-bas une classe ouvrière nombreuse et il n’y a pas de paysannerie immense. Mais chez nous, ce mince prolétariat qui a survécu aux guerres et au désastre économique est usé, affamé, a froid, est saigné à blanc, exténué ; est-il difficile de le pousser à sa perte, à la voie menant au renversement du pouvoir soviétique ? Outre le prolétariat, il existe aussi en Russie une grande partie de la paysannerie qui est loin de l’opulence, qui vit péniblement. Qui garantit que la liberté de parole ne sera pas utilisée pour former une force contre-révolutionnaire avec cette paysannerie ? Non, quand nous aurons nourri un peu l’ouvrier, donné quelque chose au paysan, alors on verra ; mais maintenant il ne faut pas y songer. Tels sont à peu près les raisonnements des communistes bien-pensants.
Qu’il nous soit permis de poser une question : comment voulez-vous résoudre la grande tâche de l’organisation de l’économie sociale sans le prolétariat ? Ou bien voulez-vous la résoudre avec un prolétariat qui dise oui et amen chaque fois que le veulent ses bons pasteurs ? En avez-vous besoin ?
"Toi ouvrier, et toi paysan, restez tranquilles, ne protestez pas, ne raisonnez pas parce que nous avons de braves types, qui sont aussi des ouvriers et des paysans à qui nous avons confié le pouvoir et qui l’utilisent de façon telle que vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes soudainement arrivés dans le paradis socialiste". Parler ainsi signifie avoir foi dans les individus, dans les héros, non pas dans la classe, parce que cette masse grise aux idéaux médiocres (du moins le pensent ainsi les chefs) n’est rien de plus qu’un matériau avec lequel nos héros, les fonctionnaires communistes, construiront le paradis communiste. Nous ne croyons pas aux héros et faisons appel à tous les prolétaires afin qu’ils n’y croient pas. La libération des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.
Oui, nous, prolétaires, sommes épuisés, affamés, nous avons froid et nous sommes las. Mais les problèmes que nous avons devant nous, aucune classe, aucun groupe du peuple ne peut les résoudre pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Si vous pouvez nous démontrer que les tâches qui nous attendent, à nous ouvriers, peuvent être accomplies par une "intelligence", même si c’est une intelligence communiste, alors nous serons d’accord pour lui confier notre destin de prolétaires. Mais personne ne peut nous démontrer cela. Pour cette raison, il n’est pas du tout juste de soutenir que le prolétariat est fatigué et n’a pas besoin de savoir ni de décider quoi que ce soit.
Si la situation en Russie est différente des années 1918-20, différente doit être aussi notre attitude sur cette question.
Quand vous, camarades communistes bien-pensants, vous voulez casser la gueule à la bourgeoisie, c’est bien ; mais le problème, c’est que vous levez la main sur la bourgeoisie et que c’est nous, les prolétaires, qui avons les côtes cassés et la bouche pleine de sang.
En Russie, la classe ouvrière communiste n’existe pas. Il existe simplement une classe ouvrière dans laquelle nous pouvons trouver des bolcheviks, des anarchistes, des socialistes-révolutionnaires et d’autres (qui n’appartiennent pas à ces partis mais tirent d’eux leurs orientations). Comment doit-on entrer en rapport avec elle ? Avec les "cadets" démocrates constitutionnels bourgeois, professeurs, avocats, docteurs, aucune négociation ; pour eux, un seul remède : le bâton. Mais avec la classe ouvrière c’est une toute autre chose. Nous ne devons pas l’intimider, mais l’influencer et la guider intellectuellement. Pour cela aucune violence, mais la clarification de notre ligne de conduite, de notre loi.
Oui, la loi est la loi, mais pas pour tous. À la dernière Conférence du parti, lors de la discussion sur la lutte contre l’idéologie bourgeoise, il apparut qu’à Moscou et à Petrograd, on compte jusqu’à 180 maisons d’édition bourgeoises et on entend les combattre à 90 %, selon les déclarations de Zinoviev, non avec des mesures répressives mais à l’aide d’une influence ouvertement idéologique. Mais en ce qui nous concerne comment veut-on nous "influencer" ? Zinoviev sait comment on a cherché à influencer certains d’entre nous. Si on nous concédait au moins la dixième partie de la liberté dont jouit la bourgeoisie !
Qu’en pensez-vous, camarades ouvriers ? Ce ne serait pas mal du tout, n’est ce pas ? Donc de 1906 à 1917 on a eu une tactique, en 1917 avant octobre une autre, depuis octobre 1917 jusqu’à fin 1920 une troisième et, depuis le commencement de 1921, une quatrième. […]
(À suivre)
1. NDLR :Komintern, nom russe de la Troisième Internationale ou Internationale communiste (IC).
2 NDLR : Les socialiste-révolutionnaires de gauche ("SR de gauche"), favorables aux soviets, se séparent du parti socialiste-révolutionnaire en septembre 1917.
3 NDLR : Lors du Congrès des Soviets du 25 octobre 1917, les 110 délégués mencheviques, minoritaires (sur 673 délégués), quittèrent la salle au moment de la ratification de la révolution d'Octobre, pour dénoncer un "coup d'État bolchevique".
4. NDLR : il s'agit, rappelons-le, de la KAI (Internationale communiste ouvrière, 1922-24) fondée à l’initiative du KAPD, à ne pas confondre avec la IVe Internationale trotskiste.
5 NDLR : L’Union internationale des partis socialistes, qu’on appelait l’Internationale Deux et demi, "parce qu'elle se situait entre la deuxième et la troisième". Lire à ce propos la critique faite à ce regroupement dans Moscou sous Lénine d’Alfred Rosmer, dans le chapitre "Les délégués des trois internationales à Berlin [145]".
6 NDLR Ici, comme à un autre endroit du texte, les symboles […] signifient qu'un un court passage que nous ne sommes pas parvenus à interpréter a été supprimé.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [114]