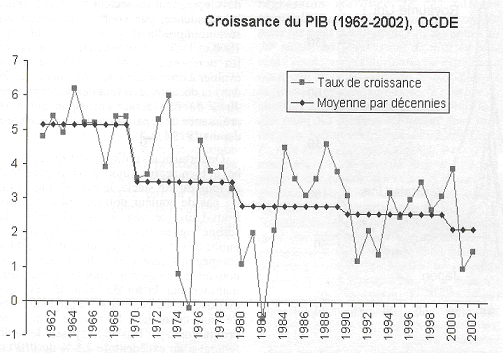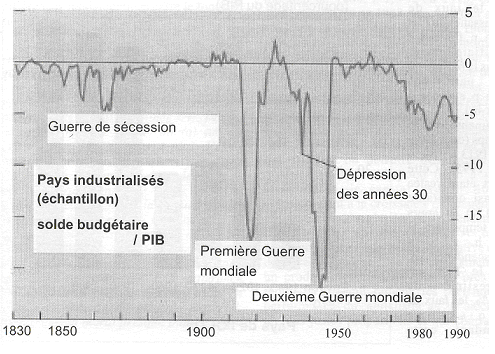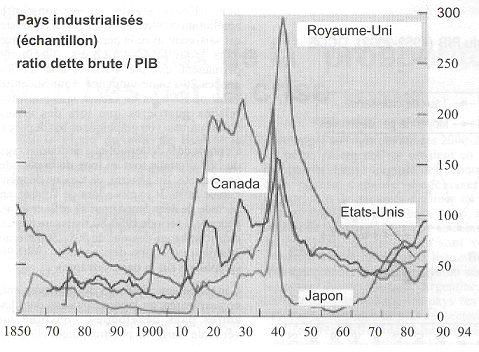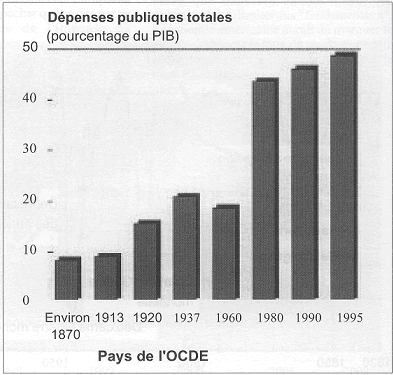Revue Internationale no 114 - 3e trimestre 2003
- 4322 lectures
Face aux attaques massives du capital, le besoin d'une riposte massive de la classe ouvrière
- 2586 lectures
Face à l’attaque frontale sur les retraites en France comme en Autriche, des secteurs entiers de la classe ouvrière se sont mis en lutte avec une détermination comme il n’y en avait pas eu depuis la fin des années 1980. En France, pendant plusieurs semaines, des manifestations à répétition ont rassemblé plusieurs centaines de milliers d’ouvriers du public mais aussi du privé : un million et demi de prolétaires étaient dans les rues des principales villes du pays le 13 mai, près d’un million lors de la seule manifestation parisienne du 25 mai et, le 3 juin, il y avait encore 750 000 personnes mobilisées. Le secteur de l’Education nationale s’est retrouvé à la pointe de la combativité du mouvement social dans ce pays, en particulier du fait qu’il était le plus brutalement attaqué. En Autriche, face à des attaques similaires concernant les retraites, on a assisté aux manifestations les plus massives depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 100 000 personnes le 13 mai, près d’un million (sur un pays comptant moins de 10 millions d’habitants) le 3 juin. A Brasilia, capitale administrative du Brésil, une manifestation a rassemblé 30 000 employés du service public le 11 juin, mobilisés contre une réforme de l’impôt, de la sécurité sociale mais, là encore, surtout des retraites, imposée par le nouveau "gouvernement de gauche" de Lula. En Suède, 9000 employés municipaux et des services publics se sont mis en grève contre les coupes claires dans les budgets sociaux.
La bourgeoise fait payer la crise du capitalisme à la classe ouvrière
Jusqu'ici, la bourgeoisie était parvenue à relativement étaler ses attaques anti-ouvrières dans le temps et à les mener paquets par paquets, par secteurs, par régions, par pays. Le fait majeur de l’évolution de la situation actuelle, c’est que, depuis la fin des années 1990, elle a entrepris de les porter de façon plus brutale, plus violente, plus massive. C’est un indice de l’accélération de la crise mondiale qui se traduit par deux phénomènes majeurs et concomitants à l’échelle internationale : le retour de la récession ouverte et un nouveau bond en avant dans l'endettement.
La plongée dans une nouvelle récession touche aujourd’hui de plein fouet les pays centraux, les pays du coeur du capitalisme : le Japon depuis plusieurs années et maintenant l’Allemagne. Officiellement, l’Allemagne est entrée dans une nouvelle période de récession (pour la deuxième fois en 2 ans). D’autres Etats européens, notamment les Pays-Bas, sont dans la même situation. Cette récession menace sérieusement les Etats-Unis depuis deux ans où les taux de chômage remontent et où les déficits de la balance commerciale comme les déficits budgétaires de l’Etat fédéral se creusent à nouveau. Le journal français Le Monde du 16 mai sonne l’alerte sur le risque de déflation qui fait resurgir le spectre des années 1930 : "Non seulement l’espoir d’une reprise au lendemain de la guerre contre l’Irak s’amenuise de jour en jour, mais, à la place, la crainte grandit de voir l’économie américaine s’enfoncer dans une spirale de baisse des tarifs (…) Un scénario catastrophe où les prix des actifs et des biens de consommation ne cessent de baisser, les profits s’effondrent, les entreprises diminuent les salaires et licencient, entraînant un nouveau recul de la consommation et des prix. Les ménages et les entreprises, trop endettés, ne peuvent plus faire face à leurs engagements, les banques exsangues restreignent le crédit sous l’œil impuissant de la Réserve fédérale. Il ne s’agit pas seulement d’hypothèses d’experts en mal de sensations fortes. C’est ce que le Japon vit depuis plus de dix ans avec, de temps à autre, de courtes périodes de rémission". Ce que la bourgeoisie appelle déflation n’est autre qu’un enfoncement durable dans la récession où le "scénario" décrit ci-dessus devient une réalité, où la bourgeoisie ne parvient pas à utiliser le crédit comme facteur de relance. Cela apporte un démenti à tous ceux qui pensaient que la guerre en Irak allait permettre de relancer l’économie mondiale alors qu'elle a représenté un gouffre pour celle-ci. En réalité, la guerre et l'occupation qui perdure, représentent en premier lieu une ponction importante pour l'économie américaine (1 milliard de dollars par semaine pour l'armée d'occupation) et britannique. De plus, tous les prolétaires sont mis à contribution dans la course aux armements qui s’accélère partout dans le monde (entre autres, à travers les nouveaux programmes militaires européens).
La seconde caractéristique de la situation économique, c’est la fuite en avant dans un endettement d’une ampleur colossale qui représente une véritable bombe dans la période à venir et qui affecte toutes les économies, depuis les entreprises jusqu’aux gouvernements nationaux en passant par les ménages, dont le taux d’endettement n’a jamais été aussi élevé (voir l'article sur la crise dans ce numéro de la Revue).
Comme chaque fois qu’il est confronté ouvertement à la crise et à ses contradictions, le capitalisme tente de la surmonter avec les deux seuls moyens dont il dispose :
- d’une part, il intensifie la productivité du travail en soumettant de plus en plus les ouvriers, producteurs de plus-value, à des cadences infernales ;
- d'autre part, il s'attaque directement au coût du capital variable, autrement dit la part du paiement de la force de travail, en le réduisant toujours plus. Il dispose de plusieurs moyens pour cela : la multiplication des plans de licenciements ; la baisse des salaires dont la variante la plus utilisée pour faire face à la concurrence est de recourir à la "délocalisation" ou aux travailleurs immigrés pour se procurer la main d’œuvre la moins chère possible ; la réduction du coût du salaire social en taillant dans tous les budgets sociaux (retraites, santé, indemnisation du chômage).
Le capitalisme est contraint d’agir de plus en plus simultanément sur l’ensemble de ces plans, c’est-à-dire que partout les Etats sont poussés à s’attaquer en même temps à TOUTES les conditions de vie de la classe ouvrière. La bourgeoisie n’a pas d’autre choix, dans sa logique de profit, que de mener des attaques massives et frontales. Elle prend évidemment soin de planifier et de coordonner le rythme de ces attaques selon les pays pour éviter toutefois une simultanéité des conflits sociaux sur la même question.
Depuis les années 1970, avec la généralisation du chômage massif et le sacrifice de milliers d’entreprises et des secteurs les moins rentables de l’économie, des millions d’emplois ont disparu et la bourgeoisie dévoile son incapacité d’intégrer de nouvelles générations d’ouvriers dans la production. Mais, à l’heure actuelle, un autre cap a été franchi : tout en continuant à licencier à tour de bras, ce sont tous les budgets sociaux qui sont dans la ligne de mire de la bourgeoisie. Dans certains pays centraux, comme les Etats-Unis, la "protection sociale" a toujours été quasiment inexistante. Mais, dans ce pays en particulier, les entreprises finançaient la plupart du temps la retraite de leurs salariés. La base des "scandales financiers" de ces dernières années, dont l'exemple le plus spectaculaire est celui d’Enron, c’est qu’elles ont profité de ces placements pour les investir dans des actions en bourse et que cet argent est parti en fumée dans des spéculations hasardeuses, sans que les entreprises puissent payer la moindre pension et sans qu’elles aient les moyens de rembourser les salariés spoliés, c’est-à-dire réduits à la misère noire. Dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, la protection sociale a été déjà largement démantelée. Le cas de la Grande-Bretagne est particulièrement édifiant sur ce qui attend l’ensemble de la classe ouvrière : depuis les "années Thatcher", il y a vingt ans, les retraités sont payés sur des fonds de pensions. Mais la situation s’est encore dégradée fortement depuis. En transformant les retraites en fonds de pension, on avait fait croire que les actions de ces fonds allaient rapporter beaucoup d’argent. C’est l’inverse qui s’est produit. Ces dernières années, la chute vertigineuse de leur cotation a entraîné des centaines de milliers d’ouvriers dans la misère (la retraite de base garantie par l’Etat est d’environ 120 Euros par semaine) et plus de 20 % d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, condamnant un grand nombre d’entre eux… à ne pas prendre de retraite et à travailler jusqu’à plus de 70 ans ou jusqu’à leur mort pour survivre, généralement avec de petits boulots très mal rémunérés. Beaucoup d’ouvriers connaissent une situation angoissante dans laquelle ils se trouvent incapables de payer leur logement ou leurs frais médicaux. L’hospitalisation des personnes âgées devant recourir à des traitements lourds pour assurer leur survie n’est même plus prise en charge. Ainsi, les hôpitaux comme les cliniques anglaises refusent les dialyses aux patients âgés qui n’ont pas les moyens de payer, les condamnant directement à la mort. Ceux qui n’ont pas les revenus suffisants pour se faire soigner peuvent crever. Plus généralement, les reventes de maisons ou d’appartements dont les ouvriers ne peuvent plus honorer les traites ont été multipliées par quatre en deux ans alors que 5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (ce chiffre a doublé depuis les années 1970) et que le chômage connaît aujourd’hui la plus forte augmentation depuis 1992. Le premier pays capitaliste a avoir mis en place le Welfare State (l'Etat providence) au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu le premier laboratoire d’essai pour son démantèlement.
Un tournant dans l'aggravation des attaques
Aujourd’hui, ces attaques se généralisent, se "mondialisent", faisant voler en éclats le mythe des "acquis sociaux". La nature de ces nouvelles attaques est significative. Elles portent sur les retraites, les indemnisations des chômeurs et les dépenses de santé. Ce qu'elles font apparaître partout de plus en plus clairement, c'est l’incapacité croissante de la bourgeoisie de financer les budgets sociaux. Le fléau du chômage et la fin du Welfare State sont deux expressions majeures de la faillite globale du capitalisme. C'est ce que viennent illustrer des attaques récentes dans un certain nombre de pays :
· En France, concernant les retraites, il ne s’agit pas seulement d’aligner le public sur le privé en portant de 37,5 à 40 ans la durée de cotisation pour avoir droit à une retraite à "taux plein". Le gouvernement a aussi annoncé l’augmentation progressive de cette durée à 42 ans qui sera ensuite allongée au-delà, en fonction du niveau de l'emploi. Les cotisations seront augmentées pour tous les salariés afin de renflouer les caisses de retraite, sans compter l’obligation de recourir à des fonds de pensions ou à des retraites complémentaires payantes. Suivant le discours officiel, c'est un facteur purement démographique, le "vieillissement" de la population, qui serait responsable du déficit des caisses de retraite et deviendrait un "fardeau" insupportable pour l’économie. Il n'y aurait pas assez de "jeunes" pour payer les retraites d'un nombre croissant de "vieux". En réalité, les jeunes entrent de plus en plus tard dans la vie active, non seulement à cause de l'allongement de la scolarité rendue nécessaire par les progrès techniques de la production mais surtout parce qu'ils trouvent de plus en plus difficilement un emploi (l'allongement de la scolarité étant d'ailleurs un moyen de masquer le chômage des jeunes). C'est en réalité la montée inexorable du chômage (qui représente au moins 10 % de la population en âge de travailler) et de la précarité qui est la cause principale de la baisse des cotisations et des déficits des régimes de retraite. En fait, beaucoup de patrons ne sont pas intéressés à conserver dans leur effectif les travailleurs âgés, qui sont en général mieux payés que les jeunes alors qu'ils ont moins de forces et sont moins "adaptables". Derrière le discours sur la nécessité de travailler plus longtemps, il y a surtout la réalité d'une chute massive du niveau des pensions de retraite. D’ores et déjà, dès leur mise en oeuvre, les mesures prévues vont se traduire par une chute du pouvoir d’achat des retraités allant de 15 à 50%, y compris pour les salariés les plus mal payés. Une autre "réforme", celle de la sécurité sociale, dont les mesures doivent être arrêtées à l’automne prochain, a déjà commencé avec une liste de 600 médicaments qui ne sont plus remboursés alors qu’une liste de 650 autres va être rendue publique et immédiatement applicable par décret en juillet.
· En Autriche, une attaque comparable à celle de la France vise principalement les retraites. Mais là, la durée des cotisations qui était déjà de 40 ans, doit passer à 42 ans et pour une majorité de salariés à 45 ans avec une amputation de leur montant pouvant atteindre jusqu’à 40 % pour certaines catégories. Le chancelier conservateur Schlüssel a profité des élections anticipées en février pour former un nouveau gouvernement de droite classique et homogène suite à la "crise" de septembre 2002 qui avait mis fin à l’encombrante coalition avec le parti populiste de Haider et a permis à la bourgeoisie d’avoir les mains plus libres pour porter ces nouvelles attaques.
· En Allemagne, le gouvernement rouge-vert a mis en œuvre un programme d’austérité baptisé "agenda 2010" qui s’attaque simultanément à plusieurs "volets sociaux". Il s’agit en premier lieu d’une réduction drastique des allocations chômage. La durée de l’indemnisation qui était de 36 mois sera réduite à 18 mois pour les plus de 55 ans et à 12 mois pour les autres. Après cela, les ouvriers licenciés n’ont pas d’autre ressource que "l’aide sociale" (qui représente environ 600 Euros pas mois). Ce qui équivaut à diviser par deux le montant des pensions de retraite pour 1 million et demi de travailleurs réduits au chômage alors même que l’Allemagne est en train de franchir le cap des 5 millions de chômeurs. Concernant les dépenses de santé, il est prévu une baisse des prestations de l’assurance maladie (diminution des taux de remboursement comme des visites médicales, restriction des arrêts maladie). A titre d’exemple, à partir de la sixième semaine d’arrêt maladie par an, la Sécurité sociale n’indemnisera plus et les assurés devront cotiser à une assurance privée pour prétendre à un remboursement. Ces restrictions sur les dépenses de santé sont cumulées avec une hausse des cotisations maladie à l’œuvre depuis début 2003 pour tous les salariés. Parallèlement, le régime des retraites sera aussi attaqué à terme en Allemagne : élévation de l’âge de départ à la retraite qui est déjà de 65 ans en moyenne, augmentation des cotisations des salariés, suppression de la revalorisation annuelle automatique des pensions. Depuis le début de l’année sont appliqués des hausses d’impôts (retenus à la source sur les salaires), des mesures d’encouragement pour les travaux intérimaires, un développement de la précarité du travail, des contrats à temps partiel ou à durée limitée.
· Aux Pays-Bas, après s’être débarrassé comme en Autriche de son aile populiste, le nouveau gouvernement de coalition (chrétiens-démocrates, libéraux, réformateurs) s’est empressé d’annoncer un plan d’austérité basé sur les restrictions budgétaires dans le domaine social (plan qui prévoit une économie de 15 milliards d’Euros) avec notamment une réforme radicale de l’indemnité chômage et des critères de l’incapacité de travail ainsi qu’une révision générale de la politique salariale.
· En Pologne, les dépenses de santé sont aussi attaquées. En dehors des soins pour les maladies très graves encore remboursés à 100 %, la plupart des soins ne sont remboursés qu’à 60 ou 30 %. Des maladies "bénignes" comme une grippe ou une angine ne le sont pas du tout. Le statut des fonctionnaires ne les protège pas des licenciements.
· Au Brésil, nous avons également vu plus haut que le Parti des Travailleurs de "Lula" est à la pointe des coupes dans les budgets sociaux en Amérique latine.
· Dans le cadre de l’élargissement de l’Union européenne, la directive donnée le 9 juin par le Bureau International du Travail pour les années qui viennent est de faire passer le financement des caisses de retraite pour 5 des 10 pays concernés (la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Lituanie et l’Estonie) à la charge des seuls ouvriers, alors qu'il était jusqu'à présent pris en charge par l’employeur, l’Etat et le salarié.
Il s’avère donc que, quel que soit le gouvernement en place, de droite ou de gauche, ce sont les mêmes attaques qui sont mises en œuvre.
Pendant ce temps, les plans de licenciements massifs s’accumulent de plus belle : 30 000 suppressions d’emploi chez Deutsche Telekom, 13 000 à France Télécom, 40 000 à la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands), 2000 supplémentaires à la SNCF (chemins de fer français). Fiat vient d’annoncer la suppression de 10 000 emplois sur le continent européen, après les licenciements de 8100 ouvriers fin 2002 dans la péninsule italienne, Alstom 5000. La compagnie aérienne Swissair a prévu d’éliminer 3000 emplois supplémentaires dans un secteur particulièrement affecté par la crise depuis deux ans. La banque d’affaires américaine Merrill Lynch a licencié 8000 salariés depuis l’an dernier. 42 000 emplois ont été perdus au cours du premier trimestre 2003 en Grande-Bretagne. Aucun pays, aucun secteur n’est épargné. Par exemple, d’ici 2006, il est prévu des fermetures d’entreprises sur le sol britannique au rythme de 400 par semaine. Partout, la précarité des emplois est en train de devenir la règle.
C'est donc face à cette aggravation qualitative de la crise et des attaques contre ses conditions de vie qu'elle entraîne, que la classe ouvrière s'est mobilisée dans les récentes luttes.
Le rapport de forces entre les classes
La première chose qu’il faut souligner à propos de ces luttes, c’est qu’elles constituent un démenti cinglant à toutes les campagnes idéologiques qui nous avaient été assénées suite à l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes staliniens. Non, la classe ouvrière n’a pas disparu ! Non, ses luttes n’appartiennent pas à un passé révolu ! Elles démontrent que la perspective est toujours orientée vers des affrontements de classe, malgré le déboussolement et l’énorme recul de la conscience de classe que les bouleversements de l’après-1989 avaient provoqués. Un recul encore accentué par tous les autres ravages d’une décomposition sociale avancée, tendant à faire perdre aux prolétaires leurs points de repère et leur identité de classe, et par les campagnes de la bourgeoisie, antifascistes, pacifistes en passant par les mobilisations "citoyennes". Face à cette situation, les attaques de la bourgeoisie et de l’Etat les poussent à nouveau à s’affirmer sur un terrain de classe et à renouer, à terme, avec les expériences passées et les besoins vitaux de la lutte. Ainsi, les ouvriers sont amenés à faire à nouveau l'expérience du sabotage de la lutte par les organes d’encadrement de la bourgeoisie que sont les syndicats et les gauchistes. De façon plus significative encore, au sein de la classe ouvrière, commencent à émerger, malgré l’amertume de la défaite immédiate, des questions plus profondes sur le fonctionnement de la société qui, à terme, tendent à mettre en cause les illusions semées par la bourgeoisie.
Pour comprendre quelle est la portée de ces attaques et ce que représentent ces événements par rapport à l’évolution du rapport de forces dans la lutte de classe, la méthode marxiste n’a jamais consisté à rester le nez collé aux luttes ouvrières elles-mêmes mais à cerner quel est l’objectif majeur poursuivi par la classe ennemie, quelle stratégie elle développe, à quels problèmes elle est confrontée à un moment donné. Car pour lutter contre la classe dominante, la classe ouvrière doit toujours non seulement identifier qui sont ses ennemis, mais comprendre ce qu’ils font et manigancent contre elle. En effet, l’étude de la politique de la bourgeoisie est habituellement la clé la plus importante pour comprendre le rapport de forces global entre les classes. Ainsi, Marx a consacré énormément plus de temps, de pages et d’énergie à examiner, disséquer les moeurs et à démonter l’idéologie de la bourgeoisie pour mettre en évidence la logique, les failles et les contradictions du capitalisme qu’à décrire et examiner en soi les luttes ouvrières. C’est pourquoi, face à un événement d’une toute autre portée, dans sa brochure sur Les luttes de classe en France en 1848, il analysait ainsi essentiellement les ressorts de la politique bourgeoise. Lénine, proclamait lui aussi en 1902 dans Que faire ?: "La conscience des masses ouvrières ne peut être une conscience de classe authentique si les ouvriers n’apprennent pas, à partir de faits et d’événements concrets et par-dessus tout politiques, d’actualité, à observer l’autre classe dans toute sa vie intellectuelle, morale et politique. (...) Ceux qui concentrent l’attention, l’observation et la conscience de la classe ouvrière exclusivement, ou même principalement sur elle-même ne sont pas des sociaux-démocrates", autrement dit pas de vrais révolutionnaires. Récemment, dans sa résolution sur la situation internationale adoptée à son 15e congrès, le CCI réaffirmait encore "Le marxisme a toujours insisté sur le fait qu’il ne suffisait pas d’observer la lutte de classe seulement sous l’angle de ce que fait le prolétariat : puisque la bourgeoisie aussi mène une lutte de classe contre le prolétariat et sa prise de conscience, un élément clé de l’activité marxiste, a toujours été d’examiner la stratégie et la tactique de la classe dominante pour devancer son ennemi mortel" (Revue Internationale n°113). La négligence de l’étude de l’ennemi de classe a toujours été typique de tendances ouvriéristes, économistes et conseillistes au sein du mouvement ouvrier. Cette vision oublie une donnée élémentaire qui doit servir de boussole fondamentale dans l’analyse d’une situation donnée, c’est qu’en dehors de situations directement pré-révolutionnaires, ce n’est jamais le prolétariat qui est à l’offensive. Dans les autres cas, c’est toujours la bourgeoisie en tant que classe dominante qui attaque et oblige le prolétariat à répondre et qui, de façon permanente et organisée, s’adapte non seulement à ce que font les ouvriers mais s’attache à prévoir leurs réactions car la classe exploiteuse, elle, ne cesse de surveiller son adversaire irréductible. Elle dispose d’ailleurs pour cela d’instruments spécifiques qui lui servent en permanence d’espions pour prendre la température sociale, les syndicats.
Aussi, face à la situation actuelle, la première question à se poser, c’est pourquoi la bourgeoisie mène ces attaques de cette façon.
La stratégie de la bourgeoisie pour faire passer ses attaques économiques
Les médias ont largement évoqué la comparaison du mouvement en France avec les grèves de novembre-décembre 1995 dans le secteur public contre le gouvernement Juppé qui avait donné lieu à des rassemblements comparables. En 1995, l’objectif essentiel du gouvernement était de profiter de la campagne idéologique de toute la bourgeoisie sur la pseudo-faillite du marxisme et du communisme, consécutive à l’effondrement des régimes staliniens, d’exploiter le recul de la conscience de classe pour renforcer et recrédibiliser l’appareil d’encadrement syndical, en gommant toute l’expérience accumulée des luttes ouvrières entre 1968 et les années 1980, notamment sur la question syndicale. Même si une partie économique du plan Juppé (consacré à la réforme du financement de la sécurité sociale et à l’institution d’un nouvel impôt appliqué à tous les revenus) est passée en catimini sous le gouvernement Jospin dans les mois qui ont suivi, le volet consacré précisément à la retraite (suppression des régimes spéciaux les plus "favorables" du secteur public) n’avait pu aboutir et avait même été délibérément sacrifié par la bourgeoisie pour faire passer cela comme une "victoire des syndicats". Ainsi, la bourgeoisie avait voulu montrer cette grève comme "une "victoire ouvrière" grâce aux syndicats qui avaient fait reculer le gouvernement, comme une lutte exemplaire en lui assurant une publicité médiatique phénoménale à l’échelle internationale. La classe ouvrière dans tous les pays était ainsi invitée à faire du "décembre 95 français" la référence incontournable de tous ses combats à venir, et surtout à voir dans les syndicats, qui avaient été si "combatifs", si "unitaires" et si "déterminés" tout au long des événements, leurs meilleurs alliés pour se défendre contre les attaques du capital. Ce mouvement a d’ailleurs servi de référence essentielle aux luttes syndicales en Belgique tout de suite après et en Allemagne six mois plus tard pour redorer le blason de la combativité syndicale passablement terni dans le passé. Aujourd’hui, le niveau de la crise économique n’est plus le même. La gravité de la crise capitaliste oblige la bourgeoisie nationale à s’attaquer de front au problème. La remise en cause du régime des retraites n’est qu’une des premières mesures d’une longue série de nouvelles attaques massives et frontales en préparation.
Ce n’est jamais de manière improvisée que la bourgeoisie affronte la classe ouvrière. Toujours elle tente de l’affaiblir le plus possible. Pour ce faire, elle a souvent employé la tactique qui consiste à prendre les devants, à susciter le déclenchement de mouvements sociaux avant que de larges masses ouvrières ne soient prêtes à les assumer, en provoquant certains secteurs plus disposés à se lancer immédiatement dans le mouvement. L’exemple historique le plus marquant est l’écrasement, en janvier 1919, des ouvriers berlinois qui s’étaient soulevés suite à une provocation du gouvernement social-démocrate, mais qui restèrent isolés de leur classe, pas encore prête à se lancer dans la confrontation générale avec la bourgeoisie. L’actuelle attaque sur les retraites en France a elle aussi été accompagnée de toute une stratégie visant à limiter les réactions ouvrières qui devaient, tôt ou tard, résulter de cette attaque. A défaut de pouvoir éviter la lutte, la bourgeoisie devait faire en sorte que celle-ci se termine par une défaite ouvrière douloureuse, afin que le prolétariat doute à nouveau de sa capacité à réagir en tant que classe aux attaques. Elle a donc choisi de faire crever l’abcès avant terme et de provoquer un secteur, celui du personnel de l’Education nationale au moyen d’attaques supplémentaires et particulièrement lourdes, afin qu’il parte le premier en lutte, qu’il s’épuise le plus possible, et essuie la défaite la plus cinglante. Ce n’est pas la première fois que la bourgeoisie française ou ses consœurs européennes provoquent un secteur au sein d'une manœuvre contre la classe ouvrière. Avant l’Education nationale aujourd’hui, elle l’avait déjà fait par exemple en 1995 avec les cheminots de la SNCF.
Déjà sous le gouvernement Jospin, par la voix du ministre Allègre, la bourgeoisie avait annoncé son intention de "dégraisser le mammouth" de l’Education nationale qui représentait de loin le plus fort contingent de fonctionnaires. Comme la plupart des fonctionnaires (sauf la défense, l’intérieur et la justice, c’est-à-dire les corps chargés de la répression étatique), il a été soumis à des coupes budgétaires prévoyant le non-remplacement de fait de 3 postes sur 4, hormis les enseignants. De plus, fin 2002, a été annoncée, avec un début de mise en œuvre, la suppression de milliers "d’auxiliaires d’enseignement", sous la forme d’emplois jeunes dans les écoles primaires et de surveillants pour les établissements du secondaire (lycées, collèges). Ces suppressions de poste, en plus de priver d’emploi de nombreux jeunes, représentent une aggravation insupportable des charges de travail pour les enseignants et les laissent isolés en première ligne face à des élèves de plus en plus difficiles avec le poids grandissant de la décomposition sociale (drogue, violence, délinquance, problèmes sociaux et familiaux, etc.).
Ainsi, ce secteur déjà lourdement affecté, non seulement devait subir l’attaque générale sur les retraites mais on lui en a infligé encore une autre supplémentaire, spécifique, le projet de décentralisation des personnels non enseignants. Pour ces derniers, cela revient à se trouver placés sous une autre autorité administrative, non plus nationale mais régionale, avec un contrat de travail moins avantageux et à terme plus précaire. C’était donc une véritable provocation pour que le conflit se focalise sur ce secteur. La bourgeoisie a également choisi le moment de l’attaque lui permettant de bénéficier de deux butoirs à la mobilisation : la période des examens pour les enseignants et celle des congés d’été concernant la classe ouvrière dans son ensemble. De même, afin de "casser" la combativité, diviser et démoraliser le mouvement, particulièrement dans l’Education nationale, le gouvernement avait prévu d’avance de lâcher un peu de lest, qui ne lui coûtait pas grand-chose, sur son projet de "décentralisation". Elle a retiré, pour pouvoir en préserver l’essentiel, un tout petit morceau de cette attaque spécifique, la décentralisation pour les personnels les plus proches des enseignants (les psychologues, les conseillers d’orientation, les assistantes sociales). En favorisant une minorité du personnel concerné, (représentant 10 000 salariés), au détriment des techniciens et ouvriers de service (100 000 salariés), elle savait aussi pouvoir diviser l’unité du mouvement et désamorcer la colère des enseignants. Pour parachever la défaite, le gouvernement a mis le paquet en se refusant à négocier le paiement des jours de grève avec les "consignes de rigueur" (retrait intégral et étalement des retenues sur salaire limité à deux mois) mises en avant par le premier ministre Raffarin : "La loi prévoit des retenues de salaire pour les grévistes. Le gouvernement applique la loi". La bourgeoisie savait aussi pouvoir compter sur une collaboration sans faille des syndicats et des gauchistes pour se partager le travail et pour diviser et désorienter le mouvement en freinant les uns pour les dissuader de se mettre en lutte, en poussant au contraire les autres résolument dans la lutte, exhortant ensuite les uns à se montrer "responsables", "raisonnables" et les autres "à tenir" et à "étendre" la lutte dans une attitude "jusqu’au boutiste" avec des appels à la "grève générale" en plein reflux pour étendre la défaite, notamment chez les enseignants.
On en revient donc aujourd’hui à un schéma beaucoup plus classique dans l’histoire de la lutte de classes : le gouvernement cogne, les syndicats s’y opposent et prônent l’union syndicale dans un premier temps pour embarquer massivement des ouvriers derrière eux et sous leur contrôle. Puis le gouvernement ouvre des négociations et les syndicats se désunissent pour mieux porter la division et la désorientation dans les rangs ouvriers. Cette méthode, qui joue sur la division syndicale face à la montée de la lutte de classe, est la plus éprouvée par la bourgeoisie pour préserver globalement l’encadrement syndical en concentrant autant que possible le discrédit et la perte de quelques plumes sur l’un ou l’autre appareil désigné d’avance. Cela signifie aussi que les syndicats sont à nouveau soumis à l’épreuve du feu et que le développement inévitable des luttes à venir va poser à nouveau le problème pour la classe ouvrière de la confrontation avec ses ennemis pour pouvoir affirmer ses intérêts de classe et les besoins de son combat.
Chaque bourgeoisie nationale s’adapte au niveau de combativité ouvrière pour imposer ses mesures. Alors que les 35 heures sont partout présentées comme une conquête sociale, elles ont constitué en fait une attaque de premier ordre contre le prolétariat en Allemagne et en France où les lois sur les 35 heures ont pu servir de modèle à d’autres Etats, puisqu'elles permettent à la bourgeoisie de généraliser la "flexibilité" des salariés adaptée en fonction des besoins de l’entreprise (intensification de la productivité, diminution ou suppression des pauses, travail le week-end, non paiement des heures supplémentaires, etc.) Les ouvriers travaillant dans les "Länder" de l’ex-Allemagne de l’Est viennent "d'obtenir" la promesse de passer aux "35 heures" en 2009 comme ceux de l’Ouest, alors que cette mesure leur était refusée jusque là sous le prétexte du niveau inférieur de leur productivité. Le syndicat des métallos IG-Metall n’a cessé de chercher à détourner les ouvriers de leurs revendications (notamment pour des hausses de salaire) en organisant toute une série de grèves et de manifestations sur ce thème. Aujourd’hui encore, cette perspective, jugée trop lointaine par les syndicats, sert à IG-Metall pour pousser les ouvriers de l’Est à réclamer les 35 heures pour tout de suite, autrement dit les encourager à se faire exploiter davantage le plus rapidement possible… Alors que pour les mesures d’austérité de "l’agenda 2010", en dehors de manifestations dans quelques villes (comme à Stuttgart le 21 mai), le même syndicat des métallos s’est contenté de faire circuler des pétitions (tandis que le syndicat des services organisait une manifestation nationale réservée aux ouvriers de ce secteur à Berlin le 17 mai).
Les perspectives pour l’avenir de la lutte de classe
Pendant des années, face à l’aggravation de la crise dont les premières conséquences pour la classe ouvrière ont été la brutale montée du chômage, les charrettes de licenciements, entraînant une paupérisation considérable au sein de la classe ouvrière, la bourgeoisie a mené toute une politique visant à masquer en priorité l’ampleur du phénomène du chômage. Pour cela, elle a recouru à la manipulation constante des statistiques officielles, aux radiations massives des chômeurs dans les agences pour l’emploi, au travail à temps partiel, aux contrats précaires, à l’encouragement au retour des "femmes au foyer", aux stages et aux emplois jeunes sous-payés ou non payés. En outre, elle n’a cessé d’encourager, favoriser, multiplier pour les salariés les plus âgés, les mises en pré-retraite, les départs à la retraite anticipés, les cessations progressives d’activité en faisant miroiter la perspective d’un raccourcissement de la durée du travail en même temps qu'on montait en épingle l'allongement de l'espérance de vie de la population (dans laquelle les ouvriers sont d'ailleurs les plus mal lotis). Parallèlement, pour les ouvriers en activité, cette propagande visait à leur faire accepter une détérioration dramatique de leurs conditions de vie et de travail liée aux suppressions de postes au nom de la nécessité de moderniser les modes de gestion, de faire face à la concurrence. On leur a demandé de se soumettre à la hiérarchie, aux impératifs de la productivité pour sauvegarder leur emploi. Pour contenir la montée du mécontentement social, face à cette détérioration accélérée de leurs conditions d’existence, l’abaissement de l’âge de la retraite a été mis en avant comme un exutoire orchestré par la bourgeoisie et même instrumentalisé en abaissant légalement l’âge du droit à la retraite dans certains pays. En France notamment, la légalisation de la retraite à 60 ans, adoptée sous la gauche, a pu être présentée sous un jour particulièrement social alors qu’elle ne faisait qu’officialiser une réalité de fait.
Aujourd’hui, l’aggravation de la crise ne permet plus comme avant à la bourgeoisie de payer les ouvriers à la retraite, de rembourser les frais médicaux. Avec le développement parallèle du chômage, un nombre croissant de travailleurs peuvent de moins en moins et, demain, ne pourront plus justifier du nombre d’années requis pour "bénéficier" d’une retraite décente. A partir du moment où les prolétaires cessent de produire de la plus-value, ils deviennent un fardeau, une charge pour le capitalisme si bien que pour ce système, la meilleure solution, et celle vers laquelle il s’oriente cyniquement, est qu’ils meurent le plus vite possible.
C’est pourquoi l’attaque brutale et ouverte portée sur les retraites se traduit par une très vive inquiétude qui s’exprime par un réveil de la combativité mais aussi par le fait qu'elle ouvre la porte à un questionnement en profondeur sur les perspectives d’avenir réelles pour la société qu’offre le capitalisme.
En 1968, un des facteurs majeurs du ressurgissement de la classe ouvrière et de ses luttes sur la scène de l’histoire à l’échelle internationale, avait été constitué par la fin brutale des illusions portées par la période de reconstruction qui avait permis, le temps d’une génération, une situation euphorisante de plein emploi durant laquelle les conditions de vie de la classe ouvrière avaient connu une nette amélioration, après le chômage des années 1930, le rationnement et les famines de la guerre et de l’après-guerre. La bourgeoisie s’était elle-même persuadée que cette période de prospérité n’aurait pas de fin, qu’elle avait résolu le problème de la crise économique et que le spectre des années 1930 avait disparu définitivement. Dès les premières manifestations de la crise ouverte, la classe ouvrière avait ressenti non seulement les atteintes à ses conditions de vie et de travail, mais aussi que l'avenir se bouchait, qu’une nouvelle période de stagnation économique et sociale croissante s’installait sous l’effet de la crise mondiale. L’ampleur des luttes ouvrières à partir de mai 68 et la réapparition de la perspective révolutionnaire ont pleinement révélé que les mystifications bourgeoises sur la "société de consommation" et "l'embourgeoisement du prolétariat" se trouvaient mises à mal. Toutes proportions gardées, la nature des attaques actuelles contient des similitudes avec la situation de l'époque. Il ne s’agit évidemment pas d’identifier les deux périodes. 1968 a constitué un événement historique majeur, marquant la sortie de plus de quatre décennies de contre-révolution ; il a eu une portée et une signification considérables pour le prolétariat international auxquelles la situation actuelle ne saurait être comparée.
Mais aujourd’hui, on assiste à l’effondrement de ce qui apparaissait en quelque sorte comme une consolation après des années de bagne salarié et qui a constitué un des piliers permettant au système de "tenir" pendant vingt ans : la retraite à 60 ans, avec la possibilité, à partir de cet âge-là, de goûter une vie tranquille, dégagée de nombreuses contraintes matérielles. Aujourd'hui, les prolétaires se voient contraints d'abandonner cette illusion de pouvoir échapper pendant les dernières années de leur vie à ce qui est vécu de plus en plus comme un calvaire : la dégradation des conditions de travail dans un environnement où sévissent les pénuries d’effectifs, l’augmentation constante des charges de travail, l’accélération des cadences. Soit ils devront travailler plus longtemps ce qui veut dire une amputation de la durée de cette période où ils pouvaient enfin échapper à l'esclavage salarié, soit, pour ne pas avoir cotisé assez longtemps, ils seront réduits à une misère noire, le tourment des privations se substituant à celui des cadences infernales. Cette situation nouvelle pose pour tous les ouvriers la question du futur.
De plus, l’attaque sur les retraites concerne et touche tous les ouvriers, jette un pont sur le fossé qui s’était creusé entre les générations d’ouvriers alors que le poids du chômage reposait surtout sur les épaules des jeunes générations et tendait à les isoler dans le "no future". C’est pour cela que toutes les générations d’ouvriers jusqu’aux plus jeunes se sont senti impliquées, alertées par cette attaque sur les retraites dont la nature même est susceptible de créer un sentiment d’unité dans la classe et de faire germer une réflexion en profondeur sur l’avenir que réserve la société capitaliste.
Avec cette nouvelle étape dans l’aggravation de la crise, apparaissent les ingrédients et mûrissent les germes pour la remise en cause de certains garde-fous idéologiques édifiés par la bourgeoisie au cours des années précédentes : la classe ouvrière n’existe plus, il est possible d’améliorer ses conditions de vie et de réformer le système ne serait-ce que pour profiter d'une fin de vie paisible ; tout ce qui poussait les ouvriers à la résignation envers leur sort. Cela entraîne une maturation des conditions pour que la classe ouvrière retrouve la conscience de sa perspective révolutionnaire. Les attaques unifient les conditions pour une riposte ouvrière à une échelle de plus en plus large, au-delà des frontières nationales. Elles tissent une même toile de fond pour des luttes plus massives, plus unitaires et plus radicales.
Elles constituent le ferment d'un lent mûrissement des conditions pour l’émergence de luttes massives qui sont nécessaires à la reconquête de l’identité de classe prolétarienne et pour faire tomber peu à peu les illusions, notamment sur la possibilité de réformer le système. Ce sont les actions des masses elles-mêmes qui permettront la réémergence de la conscience d’être une classe exploitée porteuse d’une autre perspective historique pour la société. Pour cela, la crise est l’alliée du prolétariat. Pour autant, le chemin que doit se frayer la classe ouvrière pour affirmer sa propre perspective révolutionnaire n’a rien d’une autoroute, il va être terriblement long, tortueux, difficile, semé d’embûches, de chausse-trapes que son ennemi ne peut manquer de dresser contre elle.
C’est une défaite que viennent de subir les prolétaires dans leurs luttes contre les attaques de l’Etat sur les retraites, en France et en Autriche notamment. Néanmoins, cette lutte a constitué une expérience positive pour la classe ouvrière en premier lieu parce qu'elle a réaffirmé son existence et sa mobilisation sur son terrain de classe.
Face aux autres attaques que la bourgeoisie prépare contre elle, la classe ouvrière n’a pas d’autre choix que de développer son combat. Elle connaîtra inévitablement d’autres échecs avant de pouvoir affirmer sa perspective révolutionnaire. Comme Rosa Luxemburg le soulignait avec force dans son dernier article, L’ordre règne à Berlin, rédigé à la veille de son assassinat par la soldatesque aux ordres du gouvernement social-démocrate : "Les luttes partielles de la révolution finissent toutes par une ‘défaite’. La révolution est la seule forme de ‘guerre’ – c'est encore une des lois de son développement - où la victoire finale ne peut être préparée que par une série de ‘défaites’". Mais Rosa Luxemburg ajoutait : "A une condition il est vrai ! Car il faut étudier dans quelles conditions la défaite s'est chaque fois produite." (Die Rote Fahne, 14 janvier 1919) Effectivement, pour que ses "défaites" participent de la victoire finale, il faut que le prolétariat soit capable d'en tirer des enseignements. En particulier, il va devoir comprendre que les syndicats sont partout des organes de défense des intérêts de l'Etat contre les siens propres. Mais plus généralement, il doit prendre conscience qu'il doit affronter un adversaire, la bourgeoisie, qui sait manœuvrer pour défendre ses intérêts de classe, qui peut compter sur toute une panoplie d'instruments pour protéger sa domination, depuis ses flics et ses prisons jusqu'à ses partis de gauche et même ses "révolutionnaires" estampillés (les groupes gauchistes, notamment trotskistes) et qui surtout dispose de tous les moyens (y compris ses "universitaires") pour tirer ses propres enseignements des affrontements passés. Comme le disait encore Rosa Luxemburg : "La révolution n'agit pas à sa guise, elle n'opère pas en rase campagne, selon un plan bien mis au point par d'habiles "stratèges". Ses adversaires aussi font preuve d'initiative, et même en règle générale, bien plus que la révolution." (Ibid.) Dans son combat titanesque contre son ennemi capitaliste, le prolétariat ne pourra compter que sur ses propres forces, sur son auto-organisation et surtout sur sa conscience..
Wim (22 juin)
Géographique:
- France [1]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [3]
Après la guerre en Irak : Le "nouvel ordre mondial" signifie toujours plus de chaos
- 3963 lectures
Les trois semaines de guerre éclair en Irak ont largement confirmé la validité de l'expression selon laquelle, avant même que la première balle soit tirée, "la première victime de la guerre, c'est la vérité". En fait, jamais auparavant une guerre n'a été autant médiatisée, "vendue", surtout à la population américaine, avec toute la technique et la sophistication de l'industrie cinématographique hollywoodienne.
D'abord, la mise en scène, avec l'épouvantable dictateur menaçant toute l'humanité avec ses armes de destruction massive, comme dans un film de James Bond. Heureusement, il y a le président Bush, déterminé et courageux, qui vient prendre les choses en main ! Il se veut rassurant : la guerre sera courte et peu coûteuse ; les GIs libérateurs seront accueillis les bras ouverts par une population en liesse.
Seulement, les commanditaires du film savent pertinemment qu'il n'en sera pas ainsi et qu'une fois la guerre engagée, il faudra vendre l'idée d'une longue occupation. Alors, ils ont recours aux techniques du film d'action, où le héros doit toujours se trouver en mauvaise posture au milieu du film, sans quoi le dénouement perdrait tout intérêt - en mauvaise posture, de surcroît, parce que notre héros refuse de se servir des méthodes criminelles de son adversaire. On nous a donc servi, pendant une semaine, le piétinement de l'avancée américaine confrontée à une résistance plus importante que prévue de "terroristes fanatisés". Tout semble tourner mal, et voilà qu'on nous remonte le moral avec un "remake" du "Il faut sauver le soldat Ryan"([1] [4]) : l'opération montée pour arracher le soldat Jessica Lynch des mains de ses tortionnaires arabes. Surfant sur la vague de ce nouvel élan, les "boys" surgissent d'un coup du désert, fondent sur Bagdad comme la cavalerie sur un campement sioux, l'affreux tyran est évincé du pouvoir et le soleil peut se coucher sur Old Glory([2] [5]) flottant au-dessus d'un Irak enfin libre, heureux et prospère.
Le problème est que le film est très loin de la réalité.
Nous ne savons pas quels étaient les calculs de l'Etat-major américain, ni pourquoi l'offensive américaine a semblé piétiner pendant sa deuxième semaine. Par contre, on peut affirmer que le sauvetage de Jessica Lynch était une pure falsification([3] [6]), et que l'avancée de l'armée américaine a eu lieu sous le couvert d'un déluge de feu, y compris des bombes à fragmentation, larguées sur les populations civiles. Si les "armes de destruction massive" que la guerre devait arracher des mains du tyran Saddam restent désespérément introuvables, on a vu en revanche à l'œuvre celles des croisés de la "coalition". Et aujourd'hui, la "liberté" et "l'ordre" que les forces d'occupation devaient apporter, se sont révélés être la "liberté" pour les bandes armées de tous bords d'imposer leur "ordre" à une population démunie de tout. Les seuls cadavres qu'on nous montre, sont ceux des victimes de l'ancien régime vieux de 12 ans, non pas ceux bien plus récents, et qui doivent se compter aussi par milliers, des soldats et des civils ensevelis sous la puissance de feu terrifiante de la plus grande machine de guerre de la planète, une armée qui à elle seule engloutit plus de la moitié des dépenses mondiales d'armement. On ne peut faire absolument aucune confiance aux médias, qu'ils soient américains essayant de nous convaincre du bien fondé de la guerre, ou européens en train de soutenir les exigences de leurs gouvernements (parmi lesquels l'Etat français n'est pas le moindre) cherchant à se réintroduire dans la région par le biais des Nations Unies. Il n'y a qu'un point de repère fiable dans ce monde de mensonges, c'est le point de vue de classe.
Il faut donc commencer par placer la situation en Irak, et plus généralement au Moyen Orient, dans son contexte international, celui des rivalités qui opposent les Etats-Unis aux autres grandes puissances, puisque c'est le jeu stratégique entre ces puissances, et surtout la volonté américaine d'encercler l'Europe et de freiner l'expansion de l'Allemagne, qui a engendré la guerre.
Comme nous l'avions écrit en 1990, l'effondrement du bloc russe et la désagrégation du bloc américain qui devait inévitablement s'ensuivre, "ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales (...) du fait de la disparition de la discipline imposée par la préseuce des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus fréquents en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est plus faible" (Revue Internationale n°61). "Dans la nouvelle période historique où nous somntes rentrés (...) le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au 'chacun pour soi', où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire" ("Militarisme et décomposition", Revue Internationale n°64).
Les années qui ont suivi la première guerre du Golfe, celle de 1991, ont vu une contestation grandissante de l'autorité américaine par les puissances rivales (poussée allemande et positionnement des forces françaises et britanniques dans les Balkans en particulier), ainsi qu'une indiscipline permanente de la part d'Etats qui devaient lui être parfaitement inféodés (faillite totale du "processus de paix" d'Oslo en Israël, ainsi que des efforts de Clinton pour stabiliser la situation entre Israël et la Palestine). Le fait qu'après le 11 septembre 2001, les Etats-Unis aient frappé un grand coup, sans précédent, pour montrer leur force et rétablir leur autorité, est donc déjà largement inscrit dans la réalité de 1989 telle que nous l'avions analysée à l'époque.
A ce niveau-là, la guerre a clairement affirmé la puissance de feu écrasante des forces armées américaines et l'incapacité totale de "l'Europe" de s'y opposer. Jamais les bourgeoisies française et allemande n'étaient montées autant au créneau qu'avant la guerre. Jamais non plus, elles ne se sont trouvées aussi seules. La France a été abandonnée par ses alliés latins "naturels" - l'Italie et l'Espagne. L'Allemagne a pu voir la plupart des pays de l'Europe de l'Est où son influence économique est pourtant largement dominante non seulement prendre position en faveur des Etats-Unis, mais, pire encore, participer activement dans la guerre : la Hongrie a fourni des camps d'entraînement aux forces d'opposition irakiennes embarquées avec l'armée américaine, alors que la Pologne a envoyé des troupes en Irak. Le fait que ces troupes (environ 2000 hommes) se voient octroyer aujourd'hui une zone d'occupation en Irak n'est certainement pas en raison de leurs qualités militaires, mais un moyen de plus pour les Etats-Unis de pousser à la division en Europe entre l'Allemagne et ses voisins. II est probable que, dans un proche avenir, les Etats-Unis vont encore plus étendre leur emprise sur la zone d'influence traditionnelle allemande, puisque la Bulgarie et la Roumanie, avec leurs ports sur la Mer noire, devront accueillir une partie des 80 000 hommes des troupes américaines actuellement basées en Allemagne.([4] [7])
Face à la surpuissance si brutalement affichée par les Etats-Unis, les efforts actuels de la France et de l'Allemagne de monter une force militaire européenne risquent presque de les ridiculiser plus qu'autre chose : cette force, basée sur les commandos belges et les services secrets luxembourgeois, vient de prendre position en Macédoine avec un effectif total de 350 hommes. Mais ce n'est pas pour autant que les deux alliés vont désarmer, bien au contraire. La détermination franco allemande de continuer à revendiquer des "droits" face aux Etats-Unis et surtout de se donner les moyens de les défendre est néanmoins clairement affirmée par le lancement de deux programmes de haute technologie de grande envergure: le système européen de GPS([5] [8]) et le gros porteur militaire d'Airbus.
L'extrême faiblesse de la coalition franco-allemande sur le plan militaire est encore plus évidente face à la victoire rapide et spectaculaire des Etats-Unis en Irak, qui a démontré on ne peut plus clairement que non seulement les Américains détiennent une puissance écrasante - ce que tout le monde savait mais surtout qu'ils sont prêts à s'en servir. Dans un premier temps après la guerre, le "camp de la paix" (la France, l'Allemagne et la Russie) a essayé d'imposer un retour de son influence en s'opposant à la levée des sanctions des Nations Unies contre l'Irak, et en insistant sur le fait que la recherche, infructueuse à ce jour, des ADM devrait être entre les mains de l'équipe onusienne des inspecteurs de Hans Blix. Ces Etats espéraient ainsi maintenir en vie le programme de l'ONU dit "pétrole contre nourriture" qui en fait plaçait les profits tirés des ressources pétrolières irakiennes sous le contrôle de l'ONU. En effet c'est à travers l'ONU qu'ils peuvent, jusqu'à un certain point, contrer les visées américaines. Le but était de décourager la mise en vente du pétrole irakien par les forces d'occupation en lui enlevant tout cadre légal dans le système du commerce mondial. Mais cette tentative a fait long feu face à la détermination américaine d'imposer sa volonté selon le principe "possession vaut loi". De surcroît, si les gouvernements du "camp de la paix" ont pu s'attribuer le beau rôle en opposant le "droit international" aux menées guerrières des Etats-Unis et en se servant de cette mystification pacifiste pour encourager les énormes manifestations "anti-guerre", aujourd'hui les rôles sont inversés. Ce sont les forces d'occupation qui se présentent comme investies d'une oeuvre humanitaire en remettant en état de marche l'infrastructure et l'économie irakienne pour les "rendre à leur peuple", alors que le "camp de la paix" risque au contraire de donner l'impression (tout à fait justiftée) qu'il met en avant ses propres intérêts sordides au détriment de la remise sur pied dès que possible de l'économie dont dépend la population nouvellement "libérée" de l'Irak.
Face au refus brutal du gouvernement américain d'envisager un quelconque rôle pour l'ONU dans la reconstruction de l'Irak, le "camp de la paix" s'est trouvé obligé de faire marche arrière et de lever ses objections. Le 9 mai, à la suite d'une réunion au sommet avec le président polonais Aleksander Kwasniewski, Schrôder déclare : "Nous sommes prêts à trouver des solutions pragmatiques (...) Je pense que nous pouvons arriver à une conclusion satisfaisante", alors que Chirac affirme "l'esprit constructif et d'ouverture" de la France en ajoutant que "la guerre c'est une chose, la gestion de da paix en est une autre".([6] [9]) Une fois que leurs rivaux ont battu en retraite, les Etats-Unis ont beau jeu de se montrer bon prince et d'accepter la prolongation du mandat onusien sur la vente du pétrole irakien des quatre mois qu'ils avaient proposés à... six mois, et de demander la désignation d'un "représentant spécial" de l'ONU plutôt qu'un simple "coordinateur". Peu importent les mots, l'essentiel c'est que le "camp de la paix" a été obligé de donner son aval à la présence en Irak des troupes américaines pour une période indéterminée. La force armée fera le reste.
Cela dit, ce n'est pas pour autant que les gouvernements français et allemand vont abandonner leurs tentatives de se réintroduire sur le terrain. La France d'abord, a organisé récemment un grand exercice de séduction auprès de l'Algérie, y compris par la visite du Président Chirac lui-même. De même, la nouvelle présence de forces françaises en Côte d'Ivoire et maintenant au Congo montre clairement une tentative de retour en force de la France dans son pré-carré africain traditionnel. Du côté allemand, la visite en Algérie de Joschka Fischer, accompagné d'une équipe des services secrets, semble indiquer que l'Allemagne et la France ont décidé momentanément de mettre de côté leur rivalité dans la région afin de faire face aux menées des Etats-Unis et de défendre les positions françaises au Maghreb. .
La France et l'Allemagne n'ont pas désarmé non plus au niveau plus global. Battue en brèche à l'ONU, la France a ainsi décidé de se servir de la conférence du G8 à Evian([7] [10]) pour faire de nouveau contrepoids aux Etats-Unis, en y invitant 22 pays "en voie de développement" dont aucun n'a soutenu la guerre américaine.
Un autre grand perdant de la guerre, c'est la Grande-Bretagne qui s'était rangée du côté américain, non pas par une amitié indéfectible mais pour défendre ses propres intérêts impérialistes dans la région et aussi pour tenter de retenir les Etats-Unis dans le cadre de l'ONU et du "droit international". En réalité, la bourgeoisie britannique sait aussi bien que la française qu'elle a besoin de lier les Etats-Unis à l'ONU afin de préserver au maximum sa propre influence sur son "allié" surpuissant. Ainsi, dès la fin de la guerre, le gouvernement de Tony Blair insistait auprès des Américains pour que l'ONU retrouve un rôle prépondérant en Irak. Ces derniers ont refusé aux Anglais plus poliment qu'aux Français, mais non moins nettement, et les Anglais n'ont pas eu d'autre choix que de se résigner avec l'espoir (pour le moment déçu) de pouvoir ramasser quelques miettes parmi les juteux contrats de reconstruction. Cette incapacité de faire prévaloir les intérêts britanniques, et le sentiment d'avoir sacrifié son influence en Europe pour rien, trouve son expression aujourd'hui en Grande Bretagne dans une intense campagne anti-Blair autour des ADM introuvables.
"Pax americana" au Moyen-Orient?
Bien que la situation soit actuellement très mouvante, de sorte qu'il est difficile de faire des prévisions précises à court terme, trois éléments principaux ressortent de la stratégie américaine actuelle au Moyen Orient.
Premièrement, l'intention affichée clairement et de façon répétée par les dirigeants américains de maintenir une force d'occupation massive en Irak dans le moyen terme, malgré son coût faramineux ( 1 milliard de dollars par semaine). Les Etats-Unis vont ainsi maintenir une ligne d'occupation, allant du sud de la péninsule arabique jusqu'en Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan) en passant par l'Irak et l'Afghanistan. En même temps, ils essaient d'associer d'autres pays à la force d'occupation (l'Inde en est l'exemple le plus récent, avec qui des pourparlers se poursuivent actuellement), et donc d'utiliser encore l'Irak comme un moyen de diviser leurs rivaux. Par contre, il est clair qu'ils n'admettront aucun "partenaire" dans leur gestion de la région, c'est pourquoi la "feuille de route" pour la Palestine - qui était parrainée par les Etats-Unis, l'ONU, l'Union européenne et la Russie - sera mise en oeuvrc par les Etats-Unis seuls.
Deuxièmement, les Etats-Unis semblent vouloir associer l'Iran à leur dispositif diplomatico-militaire dans la région. Déjà, pendant la guerre en Afghanistan, ils ont pu bénéficier de la coopération et de renseignements apportés par les forces spéciales iraniennes. Plus significatif encore est le marchandage avec l'Iran autour du sort réservé au Moudjahidines du peuple, le groupe d'opposition iranien, soutenu et armé par Saddam, ayant des bases en Irak, près de la frontière iranienne. Washington, en effet, aurait obtenu la bienveillance iranienne pendant la guerre en promettant de bombarder les bases des Moudjahidines. Seulement les forces américaines - qui n'ont rien à apprendre en matière de perfidie de leurs prédécesseurs britanniques - n'ont pas joué franc jeu et n'ont bombardé qu' une base vide, laissant intacte la capacité de combat des Moudjahidines. La fin de la guerre venue, ces derniers pouvaient servir de pion dans un marchandage avec l'Iran. C'est effectivement ce qui semble s'être passé : aux dernières informations (10/05/2003, Associated Press), l'année américaine a entouré la zone contrôlée par les Moudjahidines en exigeant leur reddition immédiate et sans condition - ouvrant ainsi la voie pour un futur massacre par les forces pro-iraniennes. Pourquoi une telle volte-face? Elle n'est certainement pas étrangère à la visite du président iranien Muhammad Khatami au Liban, pendant laquelle il aurait fortement fait pression sur le Hezbollah pour qu'il mette fin à son activité militaire contre les Israéliens dans le sud du Liban sur la frontière avec Israël.
En Irak même, c'est pratiquement dès son arrivée, que le nouveau chef civil de l'occupation, Jerry Bremer, a annoncé qu'il n'accepterait pas le retour des hauts fonctionnaires du régime baasiste et a accordé ses actes à ses paroles en en congédiant plusieurs de leurs postes. En même temps, il a intégré les hommes du SCIRI([8] [11]) au comité consultatif de l'administration d'occupation.
C'est le "gros lot" en perspective pour Washington qui peut envisager non seulement d'utiliser l'Iran dans son jeu autour d'Israël et de la Palestine, mais en plus d'y éclipser l'influence européenne, allemande en particulier. Va-t-on voir bientôt des expressions ouvertes d'amitié entre le pilier iranien de "l'Axe du mal" et le "Grand Satan"?
On peut, de toute façon, s'attendre à voir les marchandages, les tentatives de séduction et la pression s'accroître autour de l'Iran dans la période qui vient, alors qu'Américains et Européens essaient d'y renforcer leur influence. Si les Etats-Unis jouent plus sur le registre de la pression (avec l'encouragement ouvert des récentes manifestations anti-gouvernementales à Téhéran et les menaces à peine voilées à propos du programme nucléaire iranien([9] [12]), la France essaie apparemment de jouer la séduction avec la récente opération contre le centre politique des Moudjahidines du peuple dans la banlieue parisienne.'([10] [13])
La question palestinienne
Cela dit, pour le moment, la question palestinienne reste la plus sensible parmi les trois éléments. S'il y a une chose sur laquelle tous les commentateurs des médias bourgeois sont d'accord, c'est que pour imposer durablement leur ordre au Moyen Orient, les Etats-Unis doivent se donner les moyens de régler le conflit israélo-palestinien. L'Intifada, avec son lot quotidien de tueries dont la population palestinienne est la principale victime, est devenue un véritable point de fixation pour les pays arabes. Pour les classes dirigeantes, elles-mêmes déstabilisées par l'exaspération ressentie par les classes exploitées, c'est la preuve quotidienne que le parrain américain se moque royalement de leurs intérêts, ce qui limite l'avantage qu'ils trouvent à soutenir l'ordre de l'impérialisme des Etats-Unis.
George Bush est donc revenu à la charge sur la question palestinienne en essayant d'imposer une "feuille de route" pour la paix, aux israéliens et à l'Autorité palestinienne de Yasser Arafat. Pour ce faire, il a mis en jeu son autorité et celle des Etats-Unis comme jamais un président ne l'avait fait auparavant sur la question palestinienne. II a non seulement insisté pour qu'Israël accepte un Etat palestinien "viable" avec une continuité de territoire, mais il a désigné un émissaire - John Wolf - qui doit rester sur place pour veiller à la "pax americana", alors que Condoleeza Rice devient conseillère du président avec la responsabilité particulière de cette question.
Face à une telle pression, les premiers ministres d'Israël et de Palestine n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter le 'déal". Mahmoud Abbas s'est engagé à mettre fin aux attaques terroristes. Sharon à son tour doit commencer à démanteler certaines des colonies les plus récentes ou les moins bien installées. La viabilité de l'accord reste pourtant extrêmement incertaine. Rien que le temps d'écrire cet article, nous avons assisté à des revirements à répétition de la situation. Dans un premier temps, le Jihad islamique a accepté l'accord, et même le Hamas s'est dit prêt à mettre fin à ses attaques contre les civils. Mais Tsahal n'a pas arrêté ses attaques contre les palestiniens, et c'est à peine quelques jours après le sommet d'Aqaba ou Sharon et Mahmoud Abbas se sont serré la main autour de l'accord que le Hamas, le Jihad Islamique et les Brigades al-Aqsa ont lancé une nouvelle attaque armée contre un poste de l'armée israélienne, tuant quatre soldats et indiquant très clairement qu'ils n'ont pas l'intention de respecter les engagements d'Abbas. C'est d'autant plus inquiétant pour ce dernier que les Brigades al-Aqsa font partie de son propre mouvement et de celui d' Arafat, E1-Fatah.
A l'heure où nous écrivons, l'armée israélienne continue de cibler les responsables du Hamas, et le gouvernement égyptien essaie de venir en aide au processus en rafistolant un accord entre le Hamas et Mahmoud Abbas.
II est quasiment impossible de prévoir comment les choses vont évoluer dans le court terme. Par contre, il est clair que la situation d'ensemble de la région reste complètement dominée par ce phénomène caractéristique de la décomposition de la société capitaliste : la guerre de tous contre tous et l'incapacité même des Etats-Unis d'imposer leur disciplne sur les puissances de troisième ordre comme l'Iran, encore moins sur les diverses bandes armées qui se battent chacune pour leurs intérêts particuliers. Un autre aspect caractéristique du conflit, c'est la nature profondément réactionnaire et même irrationnelle de ces mêmes bandes, que ce soit celles des colons israéliens qui rêvent de recréer l'Eretz Israel de David et Salomon ou les bandes non moins brutales du Hamas qui veulent revenir à l'Etat islamique mythique de l'époque de Mahomet. Que ces groupements puissent mettre en cause les intérêts et les désirs des Etats-Unis montre à quel point la désagrégation de la discipline autrefois imposée par "l'ordre" des deux blocs impérialistes est complète.
Au milieu de la confusion qui caractérise la situation
au Moyen-Orient, une chose est néanmoins parfaitement claire : l'intervention
des Etats-Unis en Irak n'a absolument rien réglé dans la région. Toutes les
rivalités locales en Irak restent entières. Plus encore, la disparition de
Saddam Hussein fait sauter un verrou qui leur avait jusque là imposé une certaine
stabilité. Le vide du pouvoir laissé par l'effondrement de l'Etat irakien
introduit, en plus, un nouvel élément d'instabilité dans la région qui va
offrir un point d'appui pour que les puissances rivales sèment le désordre dans
la pax americana.
II n'y aura pas de "super-impérialisme"
Au début du 20e siècle, le courant réformiste de la social-démocratie allemande - et notamment Karl Kautsky - qui allait trahir le prolétariat pendant la guerre, a défendu l'idée que la concentration progressive du pouvoir dans la société capitaliste allait aboutir dans l'émergence d'un "super-impérialisme" et que celui-ci mettrait fin aux conflits impérialistes en imposant sa volonté sur le monde entier.
Cette idée est aujourd'hiu reprise dans une version plus moderne et "de droite" par certains "penseurs" des "think-tanks" américains. Ceux-ci commencent à prôner ouvertement un "nouveau colonialisme", où les Etats-Unis imposeraient leur ordre sur les "Etats en faillite" afin de les refaire sur le modèle de la "démocratie libérale" américaine.''([11] [14])
Mais loin d'apporter de l'ordre, les efforts de la super-puissance américaine d'imposer son autorité attisent les rivalités entre les puissances de deuxième et troisième ordre - jusqu'au gangstérisme local des milices religieuses, nationalistes, et autres - et poussent ces dernières à chercher les moyens de défendre leurs propres intérêts.
Avant 1989, la confrontation entre les deux super-puissances (russe et américaine) contenait les conflits dans un certain cadre. Aujourd'hui, aucune puissance ne peut s'opposer frontalement aux EtatsUnis. Elles ne peuvent qu'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues en soutenant en sous-main d'autres velléités d'opposition. De surcroît, pour les Etats plus démunis, la guerre contre l'Irak est loin de constituer un avertissement préventif efficace contre la détention des armes de destruction massive. Bien au contraire, la victoire écrasante des Etats-Unis en Irak - un pays qui très visiblement ne possédait pas d'ADM - ne peut que pousser des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, l'Inde ou le Pakistan, à développer ou à maintenir leur propre armement nucléaire. Ils y seront aidés par des Etats de deuxième ordre qui chercheront ainsi (comme la Russie en Iran) à fidéliser des clients prêts à s'opposer aux ambitions américaines.
L'épouvantable boucherie de la première guerre mondiale a démontré la vacuité de la théorie de Kautsky sur le "super-impérialisme". La guerre, et la révolution d'Octobre qui y a mis fin, ont confirmé que seule la révolution prolétarienne est capable, en renversant la barbarie du capitalisme, de libérer l'humanité de la guerre et de la misère.
Jens, 17 juin 2003
[1] [15] Film récent sur la Deuxième guerre mondiale, qui raconte une opération de sauvetage montée par l'armée américaine afin de récupérer un GI perdu derrière les lignes allemandes-la coïncidence est vraimanttrop frappante.
[2] [16] Le drapeau américain
[3] [17] Un reportage de la BBC a révélé que les troupes irakiennes avaient abandonné le terrain bien avant l'opération, que Jessica Lynch n'avait pas été torturée mais au contraire soignée du mieux possible par l'équipe de l'hôpital qui avait même tenté de la ramener aux avant-postes américains mais qui s'est fait tirer dessus et a dû abandonner.
[4] [18] Financial Times, 08/05/03. Toutes les informations sont tirées du site www.ft.corn [19].
[5] [20] Un système qui est d'une futilité totale sur le plan commercial, puisqu'il va faire double emploi avce celui des américains.
[6] [21] Financial Times, 09/05/03.
[7] [22] Sous présidence fran4ai,cpar le hasard de la rotation.
[8] [23] Supreme Council for Islamic Revolution in Irak, inféodé à l'Iran
[9] [24] Voir The: Economist du 14 juin 2003
[10] [25] Ce centre était installé depuis 20ans, sans jamais le moindre ennui de la part des autorités françaises - il était au contraire protégé par les gendarmes jusqu'à il y a quelques jours, avant cette opération quasi-militaire que le gouvernement de Raffarin a eu l'incroyable culot de placer sous l'enseigne "anti-terroriste".
[11] [26] Un exemple parmi d'autres de cette tendance est la suggestion par Max Singer du très sérieux Hudson Institutc que les EU devraient occuper les provinces orientales (et pétrolifères) de l'Arabie Saoudite, et les transformer en Etat chiite d'obédience américaine.
Géographique:
- Irak [27]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [28]
Questions théoriques:
- Décomposition [29]
XVe Congrès du CCI : Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période
- 3608 lectures
Fin mars, le CCI a tenu son 15e congrès. La vie des organisations révolutionnaires est partie prenante du combat du prolétariat. Il appartient donc à celles-ci de faire connaître à leur classe, notamment à leurs sympathisants et aux autres groupes du camp prolétarien, le contenu des travaux de ce moment de la plus haute importance que constitue leur congrès. C'est l'objet du présent article.
Le 15e congrès revêtait pour notre organisation une importance toute particulière ; pour deux raisons essentielles.
D'une part, nous avons connu depuis le précédent congrès, qui s'est tenu au printemps 2001, une aggravation très importante de la situation internationale, sur le plan de la crise économique et surtout sur le plan des tensions impérialistes. Plus précisément, le congrès s'est déroulé alors que la guerre faisait rage en Irak et il était de la responsabilité de notre organisation de préciser ses analyses afin d'être en mesure d'intervenir de la façon la plus appropriée possible face à cette situation et aux enjeux que représente pour la classe ouvrière cette nouvelle plongée du capitalisme dans la barbarie guerrière.
D'autre part, ce congrès se tenait alors que le CCI avait traversé la crise la plus dangereuse de son histoire. Même si cette crise avait été surmontée, il appartenait à notre organisation de tirer le maximum d'enseignements des difficultés qu'elle avait rencontrées, sur leur origine et les moyens de les affronter.
L'ensemble des discussions et travaux du congrès a été traversé par la conscience de l'importance de ces deux questions, lesquelles s'inscrivaient dans les deux grandes responsabilités de tout congrès : l'analyse de la situation historique et l'examen des activités qui en découlent pour l'organisation. Tous ces travaux se sont basés sur des rapports discutés au préalable dans l’ensemble du CCI et ils ont débouché sur l’adoption de résolutions donnant le cadre de référence pour la poursuite du travail au niveau international.
Dans le précédent numéro de la Revue internationale, nous avons publié la résolution sur la situation internationale qui a été adoptée par le congrès. Comme chaque lecteur de cette résolution peut le constater, le CCI analyse la période historique actuelle comme la phase ultime de la décadence du capitalisme, la phase de décomposition de la société bourgeoise, celle de son pourrissement sur pied. Comme nous l'avons mis en avant à de nombreuses reprises, cette décomposition provient du fait que, face à l'effondrement historique irrémédiable de l’économie capitaliste, aucune des deux classes antagoniques de la société, bourgeoisie et prolétariat, ne parvient à imposer sa propre réponse : la guerre mondiale pour la première, la révolution communiste pour la seconde. Ces conditions historiques, comme nous le verrons plus loin, déterminent les caractéristiques essentielles de la vie de la bourgeoisie aujourd'hui ; mais pas seulement : elles pèsent aussi lourdement sur le prolétariat ainsi que sur ses organisations révolutionnaires.
C'est donc dans ce cadre qu'ont été examinés, non seulement l'aggravation des tensions impérialistes que l'on connaît à l'heure actuelle, mais aussi les obstacles que rencontre le prolétariat sur son chemin vers les affrontements décisifs contre le capitalisme de même que les difficultés auxquelles a été confrontée notre organisation.
L'analyse de la situation internationale
Pour certaines organisations du camp prolétarien, notamment le BIPR, les difficultés organisationnelles rencontrées par le CCI dernièrement, comme celles qu'il avait connues en 1981 et au début des années 1990, proviennent de son incapacité à fournir une analyse appropriée de la période historique actuelle. En particulier, notre analyse de la décomposition est considérée comme une manifestation de notre "idéalisme".
Nous pensons que l'appréciation du BIPR concernant les origines de nos difficultés organisationnelles révèle en réalité une sous-estimation des questions d'organisation et des leçons tirées par le mouvement ouvrier à ce sujet. Cependant, il est vrai que la clarté théorique et politique est une arme essentielle pour une organisation qui prétend être révolutionnaire. En particulier, si elle n'est pas en mesure de comprendre les véritables enjeux de la période historique dans laquelle elle mène son combat, elle risque d'être ballottée par les événements, de sombrer dans le désarroi et finalement d'être balayée par l'histoire. Il est vrai aussi que la clarté ne se décrète pas. Elle est le fruit d’une volonté, d’un combat pour forger de telles armes. Elle exige d’affronter les questions nouvelles que pose l’évolution des conditions historiques avec méthode, la méthode marxiste.
Il s'agit là d'une tâche et d'une responsabilité permanentes dans les organisations du mouvement ouvrier. Cette tâche a revêtu une importance plus aiguë à certaines périodes, comme à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le développement de l’impérialisme annonçait l’entrée prochaine du capitalisme dans sa phase de décadence. Engels, se projetant dans cette analyse, avait été capable d’annoncer, dès les années 1880, l’alternative historique qui se dessinait : Socialisme ou Barbarie. Rosa Luxemburg, au congrès de l’Internationale socialiste à Paris, en 1900, prévoyant l’entrée en décadence du capitalisme, envisageait comme possible que cette nouvelle période soit inaugurée par la guerre : "Il est possible que la première grande manifestation de la faillite du capitalisme qui est devant nous, ne soit pas la crise mais l’explosion de la guerre". Franz Mehring, un des porte-parole de la gauche au sein de la social-démocratie, mesurait dès 1899, dans la Neue Zeit, toute la responsabilité historique qui désormais allait plus fortement reposer sur la classe ouvrière : "L’époque de l’impérialisme est l’époque de la faillite du capitalisme. Si la classe ouvrière n’est pas à la hauteur, c’est l’ensemble de l’humanité qui est menacée." Mais cette détermination à vouloir analyser et comprendre la période, afin de forger les armes de la lutte, n’était pas le fait de tous et de chacun dans la social-démocratie. Sans parler du révisionnisme de Bernstein ni des discours des adorateurs de la "bonne vieille tactique éprouvée", on a vu un Kautsky, la référence théorique de toute l'Internationale socialiste, défendre l’orthodoxie des positions marxistes mais refuser de les utiliser pour analyser la nouvelle période qui s’ouvrait. Le renégat Kautsky (comme l'a qualifié par la suite Lénine) pointait déjà chez le Kautsky qui ne voulait pas regarder en face la nouvelle période et qui, notamment, se refusait à considérer comme inéluctable la guerre entre les grandes puissances impérialistes.
En pleine contre-révolution, dans les années1930 et 40, la Fraction italienne de la Gauche communiste, puis la Gauche communiste de France ont poursuivi cet effort pour analyser, "sans ostracisme" (comme l'écrivait Bilan, la revue de la Fraction italienne), autant l'expérience passée que les nouvelles conditions historiques qui se présentaient. Cette attitude est celle du combat qu’a toujours mené l’aile marxiste dans le mouvement ouvrier pour faire face à l’évolution de l’histoire. Elle est aux antipodes de la vision religieuse de "l’invariance", chère au courant bordiguiste, qui voit le programme non comme le produit d’une lutte théorique permanente pour analyser la réalité, tirer des leçons, mais comme un dogme révélé depuis 1848 auquel "il ne faut pas changer une virgule". La tâche d’actualiser et d'enrichir, en permanence, les analyses et le programme, dans le cadre du marxisme, est une responsabilité essentielle pour le combat.
C'est la préoccupation qui animait les rapports préparés pour le congrès et qui a traversé ses débats. Le congrès a eu le souci d'inscrire ses travaux dans le cadre de la vision marxiste de la décadence du capitalisme et de sa phase actuelle de décomposition. Il a rappelé que la vision de la décadence non seulement était celle de la Troisième Internationale, mais qu’elle est une base même de la vision marxiste. C’est ce cadre et cet éclairage historique qui ont permis au CCI de mesurer la gravité de la situation dans laquelle la guerre devient un facteur de plus en plus permanent dans la vie de la société.
Plus précisément, le congrès se devait d'examiner dans quelle mesure le cadre d'analyse que s'est donné le CCI a été capable de rendre compte de la situation présente. Suite à la discussion, le congrès a conclu qu'il n'était pas utile de remettre en cause ce cadre, bien au contraire. La situation actuelle et son évolution constituent en fait une pleine confirmation des analyses que le CCI s'était données dès la fin de 1989, au moment même de l’effondrement du bloc de l’Est. Les événements actuels, comme l'antagonisme croissant entre les États-Unis et leurs anciens alliés qui s'est manifesté ouvertement dans la crise récente, la multiplication des conflits guerriers avec l'implication directe de la première puissance mondiale faisant chaque fois plus l'étalage de sa force militaire étaient déjà prévus dans les Thèses que le CCI a élaborées en 1989-90.[1] Le CCI, dans son congrès, a réaffirmé aussi que l’actuelle guerre en Irak ne se réduit pas, comme certains secteurs de la bourgeoisie voudraient le faire croire, pour en minimiser la gravité, à une "guerre pour le pétrole". Dans cette guerre, le contrôle du pétrole représente un enjeu stratégique pour la bourgeoisie américaine et non pas d’abord économique. C'est un des moyens de chantage et de pression que les Etats-Unis veulent se donner pour contrer les tentatives d'autres puissances, comme les grands Etats d'Europe et le Japon, de jouer leur propre carte sur l'échiquier impérialiste mondial. En fait, derrière l'idée que les guerres actuelles auraient une certaine "rationalité économique", il y a un refus de prendre en compte l'extrême gravité de la situation dans laquelle se trouve le système capitaliste aujourd'hui. En soulignant cette gravité, le CCI s'est délibérément placé dans la démarche du marxisme qui ne donne pas aux révolutionnaires pour tâche de consoler la classe ouvrière, mais au contraire de lui faire mesurer l'importance des dangers qui menacent l'humanité et donc de souligner l'ampleur de sa propre responsabilité.
Et, dans la vision du CCI, la nécessité pour les révolutionnaires de faire ressortir face au prolétariat toute la gravité des enjeux actuels est d'autant plus importante que celui-ci éprouve à l'heure actuelle les plus grandes difficultés à retrouver le chemin des luttes massives et conscientes contre le capitalisme. C'était donc un autre point essentiel de la discussion sur la situation internationale : sur quoi peut on aujourd'hui fonder la confiance que le marxisme a toujours affirmée dans la capacité de la classe exploitée de renverser le capitalisme et de libérer l'humanité des calamités qui l'assaillent de façon croissante.
Quelle confiance peut-on avoir dans la classe ouvrière pour faire face à ces enjeux historiques ?
Le CCI a déjà, et à de nombreuses reprises, mis en évidence que la décomposition de la société capitaliste pèse d'un poids négatif sur la conscience du prolétariat[2]. De même, dès l'automne 1989, il a souligné que l'effondrement des régimes staliniens allait provoquer des "difficultés accrues pour le prolétariat" (titre d'un article de la Revue internationale n°60). Depuis, l'évolution de la lutte de classe n'a fait que confirmer cette prévision.
Face à cette situation, le congrès a réaffirmé que la classe conserve toutes ses potentialités pour parvenir à assumer sa responsabilité historique. Il est vrai qu’elle est encore aujourd’hui dans une situation de recul important de sa conscience, suite aux campagnes bourgeoises assimilant marxisme et communisme à stalinisme et établissant une continuité entre Lénine et Staline. De même, la situation présente se caractérise par une perte de confiance marquée des prolétaires en leur propre force et dans leur capacité de mener même des luttes défensives contre les attaques de leurs exploiteurs, pouvant les conduire à perdre de vue leur identité de classe. Et il faut noter que cette tendance à une perte de confiance dans la classe s'exprime même dans les organisations révolutionnaires, notamment sous la forme de poussées subites d'euphorie face à des mouvements comme celui en Argentine à la fin 2001 (présenté comme une formidable poussée prolétarienne alors qu'il était englué dans l'interclassisme). Mais une vision matérialiste, historique, à long terme, nous enseigne, comme le disent Marx et Engels qu'il ne s'agit pas de considérer "ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe ce qu'il est et ce qu'il sera historiquement contraint de faire conformément à cet être." (La Sainte Famille). Une telle vision nous montre notamment que, face aux coups très forts de la crise du capitalisme, qui se traduisent par des attaques de plus en plus féroces, la classe réagit et réagira nécessairement en développant son combat.
Ce combat, à ses débuts, sera fait d’une série d’escarmouches, lesquelles annonceront un effort pour aller vers des luttes de plus en plus massives. C’est dans ce processus que la classe se comprendra à nouveau comme une classe distincte, ayant ses propres intérêts et tendra à retrouver son identité, aspect essentiel qui en retour stimulera sa lutte. De même, la guerre qui tend à devenir un phénomène permanent, qui dévoile chaque jour plus les tensions très fortes qui existent entre les grandes puissances et surtout le fait que le capitalisme est incapable d'éradiquer ce fléau, qu'il ne peut qu'en accabler toujours plus l'humanité, favorisera une réflexion en profondeur de la classe. Toutes ces potentialités sont contenues dans la situation actuelle. Elles imposent aux organisations révolutionnaires d’en être conscientes et de développer une intervention pour les faire fructifier. Intervention essentielle, notamment en direction des minorités et des éléments en recherche au niveau international.
Mais pour être à la hauteur de leur responsabilité, il faut encore que les organisations révolutionnaires soient en mesure de faire face, non seulement aux attaques directes que la classe dominante tente de leur porter, mais aussi à toute la pénétration en leur sein du poison idéologique que celle-ci diffuse dans l'ensemble de la société. En particulier, il est de leur devoir de combattre les effets les plus délétères de la décomposition qui, de la même façon qu'ils affectent la conscience de l'ensemble du prolétariat, pèsent également sur les cerveaux de leurs militants, détruisant leurs convictions et leur volonté d'œuvrer à la tâche révolutionnaire. C'est justement une telle attaque de l'idéologie bourgeoise favorisée par la décomposition que le CCI a dû affronter au cours de la dernière période et c'est la volonté de défendre la capacité de l'organisation à assumer ses responsabilités qui a été au centre des discussions du congrès sur les activités du CCI.
Les activités et la vie du CCI
Le congrès a tiré un bilan positif des activités de notre organisation depuis le précédent congrès, en 2001. Au cours des deux dernières années, le CCI a montré qu’il était capable de se défendre face aux effets les plus dangereux de la décomposition, notamment les tendances nihilistes qui ont saisi un certain nombre de militants qui se sont constitués en "fraction interne". Il a su combattre les attaques de ces éléments dont l’objectif était, clairement, de le détruire. Dès le début de ses travaux, avec une totale unanimité, le congrès, après la conférence extraordinaire tenue en avril 2002,[3] a une fois de plus ratifié tout le combat mené contre cette camarilla et stigmatisé ses comportements de provocateurs. C’est avec une totale conviction qu’il a dénoncé la nature anti-prolétarienne de ce regroupement. Et c'est de façon unanime qu'il a prononcé l'exclusion des éléments de la "fraction" qui avaient mis un point d'orgue à leurs agissements contre le CCI en publiant (et en se revendiquant de cette publication) sur leur site Internet des informations faisant directement le jeu des services de police de l'État bourgeois.[4] Ces éléments, bien qu'ayant refusé de venir au congrès (comme ils y étaient invités) et ensuite de présenter leur défense face à une commission spéciale nommée par celui-ci, n'ont trouvé d'autre chose à faire, dans leur bulletin n° 18, qu'à poursuivre leurs campagnes de calomnies contre notre organisation, faisant la preuve que leur souci n'était nullement de convaincre l'ensemble des militants de celle-ci des dangers dont la menace une prétendue "faction liquidationniste", suivant leurs propres termes, mais de la discréditer le plus possible, faute d'avoir réussi à la détruire.[5]
Comment ces éléments avaient-ils pu développer au sein de l’organisation une action qui la menaçait à ce point de destruction ?
Par rapport à cette question, le congrès a mis en évidence un certain nombre de faiblesses qui se développaient au niveau de son fonctionnement, faiblesses qui sont essentiellement en lien avec un esprit de cercle qui revenait en force, favorisé par le poids négatif de la décomposition de la société capitaliste. Un aspect de ce poids négatif est le doute et la perte de confiance dans la classe, ne voyant que sa faiblesse immédiate. Loin de favoriser l’esprit de parti, cela favorise la tendance à ce que les liens affinitaires et donc la confiance dans des individus se substituent à la confiance dans les principes de fonctionnement. Les éléments qui vont former la "fraction interne" étaient une expression caricaturale de ces déviations et de cette perte de confiance dans la classe. Leur dynamique de dégénérescence s’est servie de ces faiblesses, qui pèsent sur toutes les organisations prolétariennes aujourd’hui, et qui pèsent d’autant plus dangereusement que la plupart n’en ont aucune conscience. C’est avec une violence jamais connue à ce jour dans l’histoire du CCI, que ces éléments ont développé leurs menées destructrices. La perte de confiance dans la classe, l’affaiblissement de la conviction militante, se sont accompagnées d’une perte de confiance dans l’organisation, dans ses principes et d’un mépris total pour ses statuts. Cette gangrène pouvait contaminer toute l’organisation et saper la confiance et la solidarité dans ses rangs et donc ses fondements mêmes.
Le congrès a abordé sans crainte la mise en évidence des faiblesses de type opportuniste qui avaient permis que le clan autoproclamé "fraction interne" menace autant la vie même de l’organisation. Il a pu le faire parce que le CCI sort renforcé du combat qu’il vient de mener.
Par ailleurs, c’est parce que le CCI lutte contre toute pénétration de l’opportunisme qu’il apparaît comme ayant une vie mouvementée, faite de crises qui se répètent. C’est notamment parce qu’il a défendu sans concession ses statuts et l’esprit prolétarien qu’ils expriment qu’il a suscité la rage d’une minorité gagnée par un opportunisme débridé, c'est-à-dire un abandon total des principes, en matière d'organisation. Sur ce plan, le CCI a poursuivi le combat du mouvement ouvrier, de Lénine et du parti bolchevique en particulier, dont les détracteurs stigmatisaient les crises à répétition et les multiples combats sur le plan organisationnel. A la même époque, la vie du parti social démocrate-allemand était beaucoup moins agitée mais le calme opportuniste qui le caractérisait (altéré seulement par des "troublions" de gauche comme Rosa Luxemburg) annonçait sa trahison de 1914. Les crises du parti bolchevique construisaient la force qui a permis la révolution de 1917.
Mais la discussion sur les activités ne s'est pas contentée de traiter de la défense directe de l'organisation contre les attaques qu'elle subit. Elle a particulièrement insisté sur la nécessité de poursuivre l'effort de développement de la capacité théorique du CCI tout en constatant que le combat contre ces attaques a profondément stimulé cet effort. Le bilan de ces deux dernières années met en évidence un enrichissement théorique : sur les questions d’une vision plus historique de la confiance et de la solidarité dans le prolétariat, éléments essentiels de la lutte de classe ; sur le danger d’opportunisme qui guette les organisations incapables d’analyser un changement de période ; sur le danger du démocratisme. Et cette préoccupation de la lutte sur le terrain théorique est partie prenante, comme nous l'ont enseigné Marx, Rosa Luxemburg, Lénine, les militants de la Fraction italienne et bien d'autres révolutionnaires, de la lutte contre l'opportunisme, menace mortelle pour les organisations communistes.
Enfin, le congrès a fait un premier bilan de notre intervention dans la classe ouvrière à propos de la guerre en Irak. Il a constaté la très bonne capacité de mobilisation du CCI à cette occasion puisque, dès avant le début des opérations militaires, nos sections ont réalisé une diffusion très significative de notre presse dans de nombreuses manifestations, produisant quand nécessaire des suppléments à la presse régulière et engageant des discussions politiques avec de nombreux éléments qui ne connaissaient pas notre organisation auparavant. Dès que la guerre a éclaté, le CCI a immédiatement publié un tract international traduit en 13 langues[6] qui a été distribué dans 14 pays et plus de 50 villes, particulièrement devant les usines, et placé sur notre site Internet.
Ainsi, ce congrès a été un moment qui a exprimé le renforcement de notre organisation. Le CCI se revendique hautement du combat qu’il a mené et qu’il poursuit pour sa défense, pour la construction des bases du futur parti et afin de développer sa capacité pour intervenir dans le combat historique de la classe. Il est convaincu d’être, dans ce combat, un maillon dans la chaîne des organisations du mouvement ouvrier.
Le CCI, avril 2003
1 Voir notamment à ce sujet les "Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est" (Revue internationale 60) rédigées deux mois avant la chute du mur de Berlin et "Militarisme et décomposition" (daté du 4 octobre 1990 et publié dans la Revue internationale n° 64).
2 Voir notamment : "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme", points 13 et 14 (Revue internationale n°62, republié sans le n°107)
3 Voir notre article "Conférence extraordinaire du CCI : le combat pour la défense des principes organisationnels" dans la Revue internationale n°110.
4 Voir à ce sujet notre article "Les méthodes policières de la 'FICCI'", dans Révolution internationale n°330.
5 Une des calomnies permanentes de la "FICCI" est que la "faction liquidationniste" qui dirige le CCI emploie à l'égard des minoritaires des méthodes "staliniennes" afin de faire régner la terreur et d'empêcher toute possibilité d'exprimer des divergences au sein de l'organisation. En particulier, la "FICCI" n'a eu de cesse d'affirmer que de nombreux membres du CCI désapprouvaient en réalité la politique menée actuellement contre les agissements des membres de cette prétendue "fraction". La résolution adoptée par le 15e congrès à propos des agissements des membres de la "FICCI" fixait ainsi le mandat de la Commission spéciale chargée de recevoir la défense des éléments concernés :
"Les modalités de constitution et de fonctionnement de cette commission sont les suivantes :
- elle est composée de 5 membres du CCI appartenant à 5 sections différentes, 3 du continent européen et 2 du continent américain ;
- elle est composée majoritairement de militants non membres de l’organe central du CCI ;
- elle devra examiner avec la plus grande attention les explications et les arguments fournis par chacun des éléments concernés.
Par ailleurs, ces derniers auront toute latitude de se présenter individuellement ou ensemble devant la Commission, de même que de se faire représenter par l'un ou plusieurs d'entre eux. Chacun d’eux aura également la possibilité de demander le remplacement de 1 à 3 des 5 membres de la Commission désignés par le Congrès par des militants du CCI de son choix, sachant évidemment que la Commission définitive ne pourra pas être à géométrie variable. Elle comportera 5 membres et elle sera composée au moins par deux membres désignés par le congrès et au plus par 3 militants du CCI correspondant aux souhaits exprimés majoritairement par les éléments concernés.
La décision de rendre exécutoire l’exclusion de chacun de ces éléments ne pourra être prise qu’à la majorité des 4/5 des membres de la Commission."
Avec de telles modalités, il suffisait que les membres de la FICCI trouvent dans tout le CCI deux militants qui auraient pu être opposés à leur exclusion pour que la décision de celle-ci ne devienne pas exécutoire. Ils ont préféré ironiser sur les modalités de recours que nous leur proposions en continuant à vociférer contre nos méthodes "staliniennes" et "iniques". Ils savaient parfaitement qu'ils ne trouveraient personne au sein du CCI pour prendre leur défense tant est grande l'indignation et le dégoût que leurs comportements ont provoqué chez TOUS les militants de notre organisation.
6 Les langues de nos publications territoriales plus le portugais, le russe, l'hindi, le bengali, le farsi et le coréen
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Crise économique : Les oripeaux de la "prospérité économique" arrachés par la crise
- 2702 lectures
- Après la chute du mur de Berlin, la multiplication des guerres et génocides est rapidement venu infirmer tous les discours sur le prétendu nouvel ordre mondial qui en résulterait. Par contre, force est de constater que toutes les campagnes idéologiques sur la "démocratie" et la "prospérité" capitaliste ont rencontré un certain écho et pèsent fortement sur la conscience de classe des exploités.
L'effondrement du bloc de l'Est devait ouvrir de gigantesques "nouveaux marchés" et préluder à un développement économique dans un nouvel "ordre mondial" de paix et de démocratie. Au cours des années 1990, les prévisions concernant ce prétendu développement économique ont été soutenues par un battage médiatique sur les pays "émergents", comme le Brésil ou les pays du Sud-Est asiatique. La "nouvelle économie" prenait le relais dès la fin des années 1990 et était censé ouvrir une nouvelle phase d'expansion fondée sur une révolution technologique. Qu'en est-il en réalité? Autant de prophéties mensongères ! Après les pays les plus pauvres du Tiers Monde, qui connaissent des reculs nets de leur PIB par habitant depuis deux à trois décennies, ce fut la chute du " second monde " avec l'effondrement économique des pays du bloc de l'Est, et la banqueroute de la Russie et du Brésil en 1998 ; le Japon est tombé en panne au début des années 90 et, huit années plus tard, l'ensemble de la zone du Sud-Est asiatique a été sérieusement mis à mal. Cette dernière, qui fut longtemps considérée par les idéologues du capitalisme comme le nouveau pôle de développement du 21ème siècle, rentrait dans le rang, et pendant ce laps de temps, les économies dites "intermédiaires" ou "émergentes" se sont toutes, l'une après l'autre, plus ou moins effondrées. Pendant que l'e-économic se transformait en e-krach dans les pays développés au cours des années 2000-2001, les pays "émergents" se muaient en pays plongeants. Là, la fragilité des économies n'est guère capable d'encaisser un endettement de quelques dizaines de pour cent du Produit Intérieur Brut. Ainsi, après la crise de la dette du Mexique au début des années 1980, d'autres pays sont venus progressivement rallonger la liste : Brésil, Mexique encore en 1994, pays du sud-est asiatique, Russie, Turquie, Argentine, etc. La récession qui frappe les pays les plus développés ne concerne plus des secteurs de vieilles technologies (charbonnages, sidérurgie, etc.) ou déjà arrivées à maturité (chantiers navals, automobile, etc.), mais carrément des secteurs de pointe, ceux-là même qui étaient appelés à être les fleurons de la " nouvelle économie ", le creuset de la prétendue "nouvelle révolution industrielle" : l'informatique, Internet, les télécommunications, l'aéronautique, etc. Dans ces branches, c'est par centaines que se comptent les faillites, les restructurations, les fusions-acquisitions et par centaines de milliers les licenciements, les baisses de salaire avec la dégradation des conditions de travail.
Aujourd'hui, avec le krach des valeurs boursières du secteur censé être à l'origine de cette nouvelle prospérité et avec la récession qui exerce déjà ses ravages, les mystifications idéologiques de la bourgeoisie par rapport à la crise ont commencé à s'éroder sérieusement. C'est pourquoi la bourgeoisie multiplie les fausses explications sur les difficultés économiques actuelles. I1 s'agit pour elle de cacher au maximum la gravité de la maladie de son système économique au prolétariat afin d'empêcher que ce dernierne prenne conscience de l'impasse du capitalisme.
Le capitalisme s'enfonce inexorablement dans la crise
Contrairement à ce que nous raconte la classe dominante, la dégradation économique n'est pas le produit de l'effondrement des Twin Towers aux Etats-Unis, même si cela a pu constituer un facteur aggravant, en particulier pour certains secteurs économiques tels que le transport aérien ou le tourisme. Le ralentissement brutal de la croissance américaine date de l'éclatement de la bulle Internet en mars 2000 et le niveau d'activité économique était déjà faible à la fin de l'été 2001 (voir le graphique ci-dessous).
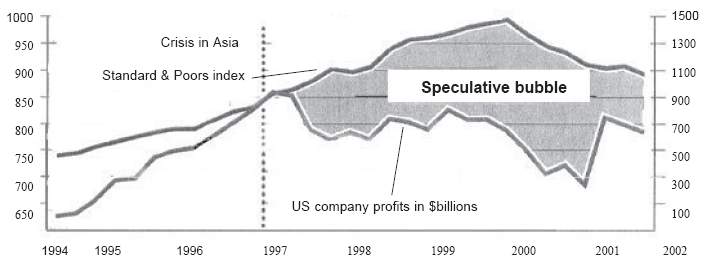
Comme le soulignent les experts de l'OCDE : "Le ralentissement éconornique qui a débuté aux Etats-Unis en 2000 et a gagné d'autres pays, s'est transformé en un recul mondial de l'activité économique auquel peu de pays ou de régions ont échappé". (Le Monde, 21/11/2001). La crise économique actuelle n'a donc rien de spécifiquement américain.
Le capitalisme est entré dans sa sixième phase de récession ouverte depuis le resurgissement de la crise sur la scène de l'histoire à la fin des années 60 : 1967, 1970-71, 1974-75, 1980-82, 1991-93, 2001-?, sans compter l'effondrement des pays du Sud-Est asiatique, du Brésil, etc., dans les années 1997-1998. Depuis, chaque décennie se solde par un taux de croissance inférieur à la précédente : 1962-69 : 5,2% ; 1970-79 : 3,5`% ; 1980-89 : 2,8% ; 1990-99 : 2,6% ; 2000-2002 : 2,2'%. En 2002, la croissance de la zone Euro atteint péniblement + 0,7% alors qu'elle se maintenait encore à 2,4% aux Etats-Unis, chiffre néanmoins moins élevé que dans les années 1990. Au demeurant, à se limiter aux "fondamentaux", l'économie américaine aurait dû marquer le pas dès 1997, car le taux de profit avait déjà cessé de progresser (voir le graphique ci-dessous).
Ce qui caractérise la récession actuelle, aux dires des commentateurs bourgeois eux mêmes, c'est la rapidité et l'intensité de son développement. Les Etats-Unis, la première économie du monde, ont très rapidement plongé dans la récession. Le repli du PIB américain est plus rapide que lors de la récession précédente et l'aggravation du chômage atteint un record inégalé depuis la crise de 1974. Le Japon, la deuxième économie du monde, ne se porte pas mieux. Ainsi même avec des taux d'intérêt réels négatifs (au Japon, les ménages et les entreprises gagnent de l'argent en empruntant !), la consommation et l'investissement ne redémarrent pas. Malgré des plans de relance massifs, l'économie nippone vient de replonger dans la récession pour la troisième fois. C'est la plus forte crise depuis 20 ans et, selon le FMI, le Japon pourrait connaître, pour la première fois depuis l'après-guerre, deux années consécutives de contraction de l'activité économique. Avec ces multiples plans de relance successifs, le Japon rajoute à son endettement bancaire astronomique, un endettement public qui est devenu le plus élevé de tous les pays industrialisés. Ce dernier représente aujourd'hui 130 % du PIB et devrait atteindre 153 % en 2003.
L'intensification des contradictions du capitalisme décadent
Au 19e siècle, dans la période ascendante du capitalisme, le solde budgétaire des finances publiques (différence entre les recettes et les dépenses) de six grands pays (Etats-Unis, Japon, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie) n'est que ponctuellement en déficit, essentiellement pour cause de guerres. Il est par ailleurs stable et en constante amélioration entre 1870 et 1910. Le contraste est saisissant avec la période de décadence dans laquelle le déficit est quasiment permanent, excepté 4 années à la fin des années 20 et une vingtaine d'années entre 1950 et 1970, et se creuse tant pour des raisons guerrières que lors des crises économiques (voir le graphique ci-dessous).
Le poids de la dette publique en pourcentage du PIB diminue tout au long de la période ascendante. En général, ce taux ne dépasse jamais 50%. Il explose lors de l'entrée en période de décadence pour ne refluer qu'au cours de la période 1950-80, mais sans jamais redescendre au-dessous de 50%,. Il remonte ensuite au cours des années 1980-90 (voir le graphique ci-dessous).
Cette montagne de dettes qui s'accumulent, non seulement au Japon mais aussi dans les autres pays développés, constitue un véritable baril de poudre potentiellement déstabilisateur à terme. Ainsi, une grossière estimation de l'endettement mondial pour l'ensemble des agents économiques (Etats, entreprises, ménages et banques) oscille entre 200 et 300`% du produit mondial. Concrètement, cela signifie deux choses : d'une part, que le système a avancé l'équivalent monétaire de la valeur de deux à trois fois le produit mondial pour pallier à la crise de surproduction rampante et, d'autre part, qu'il faudrait travailler deux à trois années pour rien si cette dette devait être remboursée du jour au lendemain. Si un endettement massif peut aujourd'hui encore être supporté par les économies développées, il est par contre en train d'étouffer un à un les pays dits "émergents". Cet endettement phénoménal au niveau mondial est historiquement sans précédent et exprime à la fois le niveau d'impasse dans lequel le système capitaliste s'est enfoncé mais aussi sa capacité à manipuler la loi de la valeur afin d'assurer sa pérennité. Si, dans la dernière période, "en tant que puissance dominante, les Etats-Unis ont pu s'arroger le droit de faire financer leur effort d'investissernent et de soutenir une croissance de la consommation très vigoureuse" ("Après l'euphorie, la gueule de bois", Revue Internationale n° 111), aucun autre pays n'aurait pu se permettre le déficit commercial qui a accompagné la croissance des Etats-Unis. "Il en est résulté une crise classique de surproduction se matérialisant par un retournement de la courbe du profit et un ralentissement de l'activité aux USA, quelques mois avant le 11 septembre" (idem). I1 n'y a donc là rien d'extraordinaire ni de quoi spéculer sur un nouveau retour de la croissance basé sur une soi-disant nouvelle révolution technologique. Les discours théoriques autour de la "nouvelle économie", le bluff de cette dernière et les récentes fraudes comptables mettent sérieusement à mal la fiabilité des données de la comptabilité nationale - américaine en particulier - à la base des calculs du PIB. Depuis l'éclatement des affaires Enron, Andersen, etc., on a vu qu'une bonne partie de la nouvelle économie était fictive. Des centaines de milliards de dollars, qui avaient été imputés dans la comptabilité des entreprises, n'étaient que des subterfuges et se sont volatilisés. Ce cycle s'est d'ailleurs clos sur un krach boursier qui fut particulièrement sévère dans le secteur qui était justement appelé à porter le nouveau capitalisme sur les fonts baptismaux.
La fable du "moins d'Etat"
"Les causes directes dit renforcement de l'Etat capitaliste à notre époque traduisent toutes les difficultés dues à l'inadaptation définitive du cadre des rapports capitalistes au développement atteint par les forces productive." (La décadence du capitalisme, brochure du CCI).
On essaie de nous faire croire qu'avec la libéralisation et la mondialisation, les Etats n'ont pratiquement plus rien à dire, qu'ils ont perdu leur autonomie face aux marchés et aux organismes supranationaux comme le FMI, l'OMC, etc., mais lorsqu'on consulte les statistiques, force est de constater que malgré vingt années de "néolibéralisme", le poids économique global de l'Etat (plus précisément du secteur dit"non marchand" : dépenses de toutes les administrations publiques, y compris les dépenses de sécurité sociale) n'a guère reculé. Il continue de croître, même si c'est à un rythme moins soutenu, pour atteindre une fourchette de + 45 à 50% pour les 32 pays de l'OCDE avec une valeur basse autour de 351% pour les Etats-Unis et le Japon et une valeur haute de 60 à 70% pour les pays nordiques (voir graphique ci-après).
Oscillant autour de 10% tout au long de la phase ascendante du capitalisme, la part de l'Etat (secteur non marchand) dans la création de valeur ajoutée grimpe progressivement au cours de la phase de décadence pour avoisiner 50% en 1995 dans les pays de l'OCDE (source : Banque Mondiale, rapport sur le développement dans le monde, 1997).
Cette statistique est révélatrice du gonflement artificiel des taux de croissance dans l'époque de la décadence du capitalisme dans la mesure où la comptabilité nationale prend partiellement en compte deux fois la même chose. En effet, le prix de vente des produits marchands incorpore les impôts dont le montant sert à payer les dépenses de l'Etat, à savoir le coût des services non marchands (enseignement, sécurité sociale, personnel des services publics). L'économie bourgeoise évalue la valeur de ces services non marchands comme étant égale à la somme des salaires versés au personnel qui est chargé de les produire. Or, dans la comptabilité nationale, cette somme est rajoutée à la valeur ajoutée produite dans le secteur marchand (le seul secteur productif) alors qu'elle est déjà incluse dans le prix de vente des produits marchands (répercussion des impôts et des cotisations sociales dans le prix des produits).
Dés lors, dans la période de décadence, le PIB et le taux de croissance du PIB gonflent artificiellement dans la mesure où la part des dépenses publiques augmente avec le temps (de + 10% en 1913 à + 50% en 1995). Cette part étant restée quasi constante (10%) au cours du temps dans la phase d'ascendance. Là, si le PIB est surestimé de 10 %, les taux de croissance pendant cette période reflètent correctement la réalité du développement du secteur productif. Dans la décadence, par contre, l'explosion du secteur improductif- particulièrement entre 1960 et 1980 - vient artificiellement doper les performances du capitalisme. Pour évaluer correctement la croissance réelle dans la décadence, il faut défalquer près de 40 % du PIB actuel correspondant à la croissance de la part du secteur improductif depuis 1913 !
Quant au poids politique des Etats, il s'est bel et bien accru. Aujourd'hui, comme tout au long du 20e siècle, le capitalisme d'Etat n'a pas de couleur politique précise. Aux Etats-Unis, ce sont les républicains (la "droite") qui prennent l'initiative d'un soutien public à la relance et qui subventionnent les compagnies aériennes et les assureurs. Le pouvoir encourage d'ailleurs directement leur maintien par la loi du "chapitre II" qui autorise les sociétés à se protéger facilement de leurs créanciers. La relance budgétaire programmée par Bush a fait passer le solde fédéral d'un excédent de 2,5% du PIB en 2000 à un déficit estimé par le FMI à 1,5 % du PIB en 2002, soit une relance d'une ampleur comparable à celle des plus dispendieux Etats européens. La Banque Centrale (la Fédéral Réserve) pour sa part, très étroitement liée au pouvoir, a baissé ses taux d'intérêt au fur et à mesure que la récession se précisait afin d'aider à la relance de la machine économique : de 6,5 % à 1,75%, -2 % entre le début et la fin 2001. Cela permet, entre autres, aux ménages surendettés de souscrire davantage de prêts ou de les renégocier à la baisse. Enfin, la cohérence de cette nouvelle orientation implique une baisse du dollar permettant de rétablir la compétitivité des produits américains et de regagner ainsi des parts de marché. Au Japon, les banques ont été renflouées à deux reprises par l'Etat et certaines ont même été nationalisées. En Suisse, c'est l'Etat qui a organisé la gigantesque opération de renflouement de la compagnie aérienne nationale Swissair, etc. Même en Argentine, avec la bénédiction du FMI et de la Banque Mondiale, le gouvernement a recours a un vaste programme de travaux publics pour essayer de recréer des emplois. Si, au 19° siècle, les partis politiques instrumentalisaient l'Etat pour faire passer prioritairemcnt leurs intérêts, dans la période de décadence, ce sont les impératifs économiques et impérialistes globaux qui dictent la politique à suivre, quelle que soit la couleur du gouvernement en place. Cette analyse fondamentale, dégagée par la Gauche communiste, a été amplement confirmée tout au long du 20° siècle et est plus que jamais d'actualité aujourd'hui que les enjeux sont encore plus exacerbés.
Le développement des dépenses militaires
C'est à Engels que revient d'avoir énoncé, à la fin du 19° siècle, ce qui sera l'alternative historique de la phase de décadence du capitalisme : "socialisme ou barbarie". Rosa Luxemburg en dégagera nombre d'implications politiques et théoriques et l'Internationale communiste en fera sa formule caractérisant la nouvelle période : "l'ère des guerres et des révolutions". Enfin, ce sont les Gauches communistes, en particulier la Gauche communiste de France, qui systématiseront et approfondiront la place et la signification de la guerre dans la phase ascendante et dans la décadence du capitalisme.
On peut affirmer sans conteste que, contrastant avec la phase ascendante, la décadence du capitalisme a été caractérisée par la guerre sous toutes ses formes : guerres mondiales, guerres locales permanentes, etc. A ce propos, comme petit complément historique très utile, nous ne résistons pas à la tentation de citer des extraits de la fresque de l'historien Eric Flobsbawm (1994) dans son livre L'âge des extrêmes, qui campe sous forme de bilans respectifs, les différences fondamentales entre le long 19, siècle et le "court 20' siècle" :
"Comment dégager le sens du court vingtième siècle du début de la première guerre mondiale à l'effondrement de l'URSS -de ces années qui, comme nous le vovons avec le recul, forme une période historique cohérente désormais terminée ? (...) Dans le court vingtième siècle, on (a) tué ou laissé mourir délibérément plus d'êtres humains que jamais auparavant dans l'histoire. (...) Il fut sans doute le siècle le plus meurtrier dont nous avons gardé la trace, tant pur l'échelle, la fréquence et la longueur des guerres qui l'ont occupé (et qui ont à peine cessé un instant depuis les années 1920) mais aussi par l'ampleur des plus grandes famines de l'histoire aux génocides systématiques. A la différence du "long 19' siècle" qui semblait et fut en effet une période de progrès matériel, intellectuel et moral presque ininterrompu (...) on a assisté depuis 1914 à une régression marquée de ces valeurs jusqu'alors considérées comme normales dans les pays développés. (...) Au cours du 20° siècle, les guerres ont de plus en plus visé l'économie et 1’infrastructure des Etats ainsi que leurs populations civiles. Depuis la première guerre mondiale, le nombre de victimes civiles a été bien plus important que celui des victimes militaires dans tous les pays belligérants, sauf aux Etats-Unis. (... ) En 1914, cela faisait un siècle qu'il n’y avait plus eu de grande guerre (..). La plupart des guerres mettant aux prises des grandes puissances avaient été relativement rapides. (...) la durée de la guerre se comptait en mois ou même (comme dans la guerre de 1886 entre la Prusse et l'Autriche) en semaines. Entre l871 et 1914, l'Europe n'avait pas connu de conflit amenant les armées de grandes puissances à franchir les frontières ennemies. (...) Il n'y eut aucune guerre mondiale. (...) Tout cela changea en 1914 (...) 1914 inaugure "l'ère des massacres" (...) la guerre moderne implique tous les citoyens el mobilise la plupart d'entre eux (..), elle se mene avec des armements qui requièrent un détournement de toute l'économie pour les produire et sont employés en quantités ininmaginables ; elle engendre des destructions inouïes, mais aussi domine et transforme du tout au tout la vie des pays impliqués. Or, tous ces phénomènes sont propres aux guerres du 20° siècle. (..) La guerre a-t-elle servi la croissance économique ? En lui sens, il est clair que non (...) Sur cette montée de la barbarie après 1914, il n’y a malheureusement aucun doute".
Cette "ère des massacres", inaugurée par la première guerre mondiale et contrastant avec un long 19° siècle nettement moins meurtrier, est attestée par l'importance relativement faible des dépenses militaires dans le produit mondial et sa quasi-constance tout au long de la phase ascendante du capitalisme, alors qu'elles augmentent fortement par la suite. De 2% du produit mondial en 1860, à 2,5 % en 1913, elles atteignent 7,2% en 1938 pour se situer aux environs de 8,4% dans les années 1960 et plafonner aux environs de 10% au moment du sommet de la guerre froide à la fin des années 1980. (Sources : Paul Baïroch pour le produit mondial et le SIPRI pour les dépenses militaires). L'armement a ceci de particulier que, contrairement à une machine ou à un bien de consommation, il ne peut être consommé de façon productive (il ne peut que rouiller ou détruire des forces de production). Il correspond donc à une stérilisation de capital. Aux +40 % correspondant à la croissance des dépenses improductives dans la période de décadence, il faut donc encore rajouter +6 % correspondant à l'augmentation relative des dépenses militaires... ce qui nous amène à un produit mondial surévalué de près de moitié. Voilà qui ramène les prétendues performances du capitalisme au 20° siècle à de plus justes proportions et qui contraste fortement avec cette ère de "progrès matériel, intellectuel et moral presque ininterrompu" du long 19° siècle.
L'avenir reste dans les mains de la classe ouvrière
Ce qui est absolument certain, c'est qu'avce le développement de la récession au niveau international, la bourgeoisie imposera une nouvelle et violente dégradation du niveau de vie de la classe ouvrière. Sous prétexte d'état de guerre et au nom des intérêts supérieurs de la nation, la bourgeoisie américaine en profite pour faire passer ses mesures d'austérité déjà prévues depuis longtemps, car rendues nécessaires par une récession qui se développait : licenciements massifs, efforts productifs accrus, mesures d'exception au nom de l'anti-terrorisme mais qui servent fondamentalement comme terrain d'essai pour le maintien de l'ordre social. Après l'effondrement du bloc de l'Est, la course aux armements s'était ralentie pendant quelques années mais très rapidement, vers le milieu des années 1990, elle est repartie. Le 11 septembre a permis de justifier le développement encore plus considérable des armements. Les dépenses militaires des Etats-Unis représentent 37 % des dépenses militaires mondiales qui sont en hausse dans tous les pays. Partout dans le monde, les taux de chômage sont de nouveau fortement orientés à la hausse alors que la bourgeoisie avait réussi à camoufler une partie de l'ampleur réelle de ce phénomène par des politiques de traitement social - c'est-à-dire la gestion de la précarité - et par des manipulations grossières des statistiques. Partout en Europe, les budgets sont révisés à la baisse et de nouvelles mesures d'austérité sont programmées. Au nom de la stabilité budgétaire, dont le prolétariat n'a que faire, la bourgeoisie européenne est en train de revoir la question des retraites (abaissement des taux et allongement de la vie active) et de nouvelles mesures sont envisagées pour faire sauter "les freins au développement de la croissance" comme disent pudiquement les experts de l'OCDE, à savoir "atténuer les rigidités" et "favoriser l'offre de travail" via une précarisation accrue et une réduction de toutes les indemnisations sociales (chômage, soins de santé, allocations diverses, etc.). Avec le krach boursier, les systèmes de retraite par capitalisation apparaissent aujourd'hui pour ce qu'ils sont : une duperie pour encore plus spolier les revenus de la classe ouvrière. Au Japon, l'Etat a planifié une restructuration dans 40% des organismes publics : 17 vont fermer et 45 autres seront privatisés. Enfin, pendant que ces nouvelles attaques viennent frapper le prolétariat au coeur du capitalisme mondial, la pauvreté se développe de façon vertigineuse à la périphérie du capitalisme. La situation des pays dits "émergents" est significative à cet égard avec la situation dans des pays comme l'Argentine, le Venezuela, le Brésil. En Argentine, le revenu moyen par habitant a été divisé par trois en trois ans. C'est une débâcle qui dépasse en ampleur celle des Etats-Unis dans les années 1930. La Turquie et la Russie sont toujours sous perfusion et suivies à la loupe.
A cette situation d'impasse économique, de chaos social et de misère croissante pour la classe ouvrière, celle-ci n'a qu'une réponse à apporter : développer massivement ses luttes sur son propre terrain de classe dans tous les pays. Aucune "alternance démocratique", aucun changement de gouvernement, aucune autre politique ne peut apporter un quelconque remède à la maladie mortelle du capitalisme. La généralisation et l'unification des combats du prolétariat mondial qui ne peuvent aller que vers le renversement du capitalisme, sont la seule alternative capable de sortir la société de cette impasse. Rarement dans l'histoire, la réalité objective n'avait aussi clairement mis en évidence que l'on ne peut plus combattre les effets de la crise capitaliste sans détruire le capitalisme lui-même. Le degré de décomposition atteint par le système, la gravité des conséquences de son existence sont tels que la question de son dépassement par un bouleversement révolutionnaire apparaît et apparaîtra de plus en plus comme la seule issue "réaliste" pour les exploités. L'avenir reste dans les mains de la classe ouvrière.
(Décembre 2002 ; Extraits du rapport sur la crise économique adopté par le XVe congrès du CCI)
Sources: Croissance du PIB (1962-2001): OCDE
Ratio solde budgétaire/PlB (en % du PIB) Paul Masson et Michael Muss : "Long term tendencies in budget déficits and Debts", document de travail du FMI 95/l28 (décembre 1995)
Alternatives Economique (Hors série) : "L'état de l'économie 2003".
Maddison : "L'économie mondiale 1820-1992, OCDE et Deux siècles de révolution industrielle", Pluriel H 8413
Récent et en cours:
- Crise économique [33]
Notes sur l'histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale, 2e partie
- 3851 lectures
Nous continuons ici les "Notes sur l'histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale", que nous avons commencé à publier dans le précédent numéro de la Revue internationale. La Guerre du Vietnam : des divergences sur la politique impérialiste secouent la bourgeoisie américaine
L’engagement des Etats-Unis au Vietnam suit immédiatement la défaite française en Indochine où ils vont tenter de récupérer les régions perdues pour l’Occident. La stratégie, nouvelle manifestation de l’endiguement,[1] consiste à empêcher les pays de tomber les uns après les autres sous l'influence de l’impérialisme russe, ce que le secrétaire d’Etat d’Eisenhower, Dulles, avait appelé la "théorie des dominos".[2] Le but est de transformer la séparation temporaire du Vietnam en une zone Nord et une zone Sud, créée par les accords de Genève, en une division permanente comme dans la péninsule coréenne. C’est dans ce sens que la politique américaine de détournement des accords de Genève, initiée sous le régime républicain d’Eisenhower, continue sous Kennedy qui envoie les premiers conseillers militaires au Vietnam au début des années 60. L’administration Kennedy joue un rôle capital dans la gestion du pays, autorisant même un coup d’Etat militaire et l’assassinat du président Diem en 1963. L'impatience manifestée par la Maison Blanche à l'égard du général qui reporte l'assassinat de Diem a été amplement documentée. A la suite de l'assassinat de Kennedy en 1963, Johnson poursuit l’intervention militaire américaine au Vietnam, intervention qui va devenir la plus longue guerre menée par l’Amérique.
La bourgeoisie américaine reste unie derrière cette entreprise, alors même qu’un bruyant mouvement anti-guerre, sous la houlette des gauchistes et des pacifistes, s’amplifie. Le mouvement anti-guerre, très marginal dans la politique américaine, sert de soupape de sécurité vis-à-vis des étudiants radicaux et des activistes noirs. L’offensive du Têt, lancée en janvier 1968 par le Vietnam du Nord et le FNL dans le Sud, comportant des attaques suicides contre l’ambassade américaine et le palais présidentiel à Saïgon, aboutit de fait à une défaite sanglante pour les staliniens. Cependant, sa tentative même vient démentir la propagande de longue date des militaires américains selon laquelle la guerre se déroulait très bien et que la victoire n'était qu'une question de mois. Des membres importants de la bourgeoisie commencent alors à mettre la guerre en question puisqu’il apparaît clairement qu’elle sera longue, contrairement à la recommandation faite par Eisenhower quand il a quitté ses fonctions, sur la nécessité d’éviter de s’embourber dans une guerre prolongée en Asie.
Simultanément, se profile une autre orientation stratégique pour l’impérialisme américain, contraint de s’occuper aussi du Moyen-Orient - stratégiquement important et riche en pétrole - où l'impérialisme russe progresse dans le monde arabe.
Une commission d’anciens membres éminents du parti démocrate presse alors Johnson de renoncer à ses plans de réélection et de se concentrer sur la façon de mettre fin à la guerre ; fondamentalement, c'est un coup d'Etat interne dans la bourgeoisie américaine. En mars, Johnson déclare à la télévision qu’il ne cherchera, ni n’acceptera d'être présenté par son parti pour être réélu, et qu’il consacrera toute son énergie à mettre fin à la guerre. Au même moment, reflet de divergences croissantes au sein de la bourgeoisie sur la politique impérialiste à mener, les médias américains prennent le train du mouvement anti-guerre, et celui-ci passe de phénomène marginal gauchiste au centre de la politique américaine. Par exemple, Walter Cronkite, présentateur des informations sur une des plus grandes chaînes de télévision, qui termine chacune de ses émissions par le slogan "and that's the way it is" ("et il en est ainsi"), va au Vietnam et revient en annonçant qu'il faut arrêter la guerre. La chaîne NBC démarre un programme du dimanche soir, appelé "Vietnam This Week", qui diffuse à la fin de chaque émission une séquence présentant des photos de jeunes américains de 18 et 19 ans tués cette semaine-là au Vietnam – une manouvre de propagande anti-guerre qui vise à donner un caractère "personnel" aux conséquences de la guerre.
Les difficultés de Johnson sont exacerbées par l'émergence de la crise économique ouverte et le fait que le prolétariat n'est pas idéologiquement battu ; alors qu’il avait tenté une politique de "guns and butter" (des fusils et du beurre) – faire la guerre sans qu'il soit nécessaire de faire des sacrifices matériels à l'arrière – la guerre se révèle alors trop coûteuse pour soutenir cette politique. En réponse au retour de la crise ouverte aux Etats Unis, une vague grandissante de grèves sauvages se développe de 1968 à 1971, dans lesquelles s’impliquent souvent des vétérans du Vietnam mécontents et en colère. Ces grèves causent de sérieuses difficultés politiques à la classe dominante américaine. 1968 est en fait le signal de bouleversements aux Etats-Unis avec le développement simultané de désaccords internes au sein de la bourgeoisie et du mécontentement grandissant dans le pays. Deux semaines après que Johnson ait annoncé son retrait de la course aux présidentielles, le leader des droits civiques, le pasteur Martin Luther King, qui avait rejoint le mouvement anti-guerre en 1967 et dont on disait qu'il était prêt à renoncer à la protestation non-violente, est assassiné, ce qui provoque de violentes émeutes dans 132 villes américaines. Début juin, Robert Kennedy, le plus jeune frère de John F. Kennedy, qui avait participé au cabinet de son frère comme procureur général et qui était présent à la Maison Blanche en 1963 lorsque l’administration Kennedy attendait impatiemment le résultat de la mission de l’exécution de Diem, mais qui était désormais devenu un candidat anti-guerre aux élections primaires démocrates pour la présidence, est également assassiné après avoir gagné la primaire de Californie. Il y a de violents affrontements dans les rues lors de la Convention du parti démocrate en juillet, où la gauche du parti lutte âprement contre les forces de Humphrey forcées de continuer la guerre. Nixon, le républicain conservateur, gagne les élections, en promettant qu’il a un plan secret pour mettre fin à la guerre.
Pendant ce temps, à partir d’octobre 1969, le New York Times publie le planning des manifestations pour un moratoire au Vietnam, en page 2 du quotidien, afin d'y assurer une participation massive. Les politiciens des grands courants politiques et les célébrités commencent à s’exprimer lors des rassemblements. L’administration Nixon négocie avec les staliniens vietnamiens, mais elle ne parvient pas à mettre fin à la guerre. Cependant, malgré la continuation de la guerre, des pressions s'exercent sur Nixon pour qu’il fasse des progrès rapides dans la mise en place de la détente prévue par Johnson, y compris par des visites diplomatiques à Moscou et la négociation des traités de contrôle des armements. Il y a même des analystes bourgeois, bien qu'ils n'aient évidemment pas une compréhension marxiste de la globalité de la crise du capitalisme, qui font observer que l’intérêt porté par les Américains à la détente avec Moscou et à l’apaisement temporaire de la Guerre froide est dicté par les difficultés économiques liées au début de la crise ouverte et à la réémergence du prolétariat dans la lutte de classe. Par exemple David Painter note qu’aux Etats-Unis, "la guerre avait exacerbé les difficultés économiques de longue date (...) qui nourrissaient l'inflation et sapaient de plus en plus l’équilibre de la balance des paiements américaine" (Encyclopedia of US Foreign Policy). Brzezinski parle des "difficultés économiques américaines" (op cit.) et George C. Herring observe : "En 1969, [la guerre] avait accru les problèmes économiques et politiques de façon critique et contraint à revoir des politiques qui n'avaient pas été remises en cause depuis plus de 20 ans. Les dépenses militaires massives avaient provoqué une inflation galopante qui rompait avec la prospérité d'après-guerre et suscitait un mécontentement croissant", tout cela "poussait l'administration de Richard M. Nixon à rechercher la détente avec l'Union soviétique" (Encyclopedia of American Foreign Policy).
En 1971, Nixon abandonne le système économique de Bretton Woods,[3] mis en place depuis 1944, en suspendant la convertibilité du dollar en or, ce qui amène immédiatement la libre cotation des devises internationales et, de facto, la dévaluation du dollar. En même temps, Nixon crée un impôt protectionniste de 10% sur les importations et un contrôle des prix et des salaires au niveau intérieur. Certains analystes et des journalistes bourgeois commencent même à parler d’un déclin permanent de l’impérialisme américain et de la fin du "siècle américain".
Les divisions au sein de la bourgeoisie, centrées sur le désengagement du Vietnam et la réorientation vers le Moyen-Orient, sont renforcées par les troubles continus et les difficultés au Moyen-Orient, notamment le boycott du pétrole arabe. Kissinger s’engage simultanément et sans succès dans des négociations avec les Vietnamiens et joue personnellement la "navette diplomatique" au Moyen-Orient. En matière de détente, Nixon prend l’initiative d’une ouverture vers la Chine qui a rompu idéologiquement avec Moscou, ce qui ouvre alors de nouvelles perspectives pour l’impérialisme américain. L’attitude qui avait prévalu pendant la Guerre froide consistant à refuser de reconnaître le régime de Mao et à considérer Taïwan comme le gouvernement légitime de toute la Chine, avait été maintenue grâce à toute une rhétorique idéologique anti-communiste et "en défense de la liberté" pendant les années 50 et 60 ; elle est abandonnée afin de courtiser la Chine pour qu'elle rejoigne le camp américain dans la Guerre froide, ce qui devrait permettre d'encercler militairement la Russie non seulement à l’ouest, en Europe, au sud avec la Turquie, au nord (avec les bases de missiles américains et canadiens autour du pôle), mais aussi à l’est.[4] Cette nouvelle option impérialiste ne fait que renforcer l’exigence de la classe dominante de mettre fin à la guerre au Vietnam, puisque la liquidation de cette guerre constitue une condition préalable à l’alliance de la Chine avec les Etats-Unis. En tant que puissance régionale, la Chine a de grands intérêts en jeu dans un conflit en Asie du Sud-Est et soutient, à l’époque, le Vietnam du Nord. C’est l'incapacité à accomplir ce changement d’orientation de la politique étrangère vers le Moyen-Orient et à mettre fin à la guerre afin d’amener la Chine dans le bloc de l’Ouest, qui conduit à l’incroyable bouleversement politique de la période du Watergate et au départ de Nixon (le belliqueux vice-président Agnew, l’homme de main de Nixon pour ses basses œuvres, avait déjà été contraint de démissionner sur des accusations de corruption) pour préparer une transition en bon ordre vers un président intérimaire acceptable : Gerald R. Ford.
Huit mois après la démission de Nixon, avec Ford à la Maison Blanche, Saïgon tombe aux mains des staliniens, et l’impérialisme américain se retire de l’imbroglio vietnamien. La guerre avait coûté la vie à 55 000 Américains et à au moins 3 millions de Vietnamiens. Carter entre à la Maison Blanche en 1977 et, en 1979, les Etats-Unis reconnaissent officiellement la Chine continentale qui va désormais occuper le siège de la Chine (jusqu'alors occupé par le Taiwan) au Conseil de Sécurité de l’ONU.
La période 1968-76 illustre l’incroyable instabilité politique allant de pair avec de sérieuses divergences au sein de la bourgeoisie américaine sur la politique impérialiste. En huit ans, il y eut :
- quatre présidents (Johnson, Nixon, Ford, Carter) : deux furent contraints de démissionner (Johnson et Nixon) ;
- les assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy, et une tentative d’assassinat de George Wallace, le candidat du parti populiste de droite en 1972 ;
- l’implication du FBI et de la CIA dans l’espionnage des adversaires politiques à l'intérieur du pays qui fit tomber le discrédit sur ces deux institutions et amena une législation de "réforme" pour réduire formellement leurs pouvoirs. Le fait que, sous Nixon, la clique dirigeante ait utilisé des agences de l’Etat (FBI et CIA) pour s’assurer un avantage décisif sur les autres fractions de la classe dominante, fut intolérable pour ces dernières qui se sont senties directement menacées. Ce qu’on a appelé la crise de la sécurité nationale, à la suite du 11 septembre 2001, a permis à ces agences de fonctionner une fois encore sans entrave.
Après la Guerre froide, les ajustements de la politique impérialiste américaine à la disparition d’un monde bipolaire
L’effondrement du bloc russe à la fin des années 1980 constitue une situation sans précédent. Un bloc impérialiste disparaît, non pas à la suite de sa défaite dans la guerre impérialiste, mais de son implosion sous la pression de l’impasse historique dans la lutte de classe, des pressions économiques et de l’incapacité à continuer de participer à la course aux armements avec le bloc rival. Alors que la propagande américaine célèbre sa victoire sur l’impérialisme russe et glorifie le triomphe du capitalisme démocratique, 1989 se révèle être une victoire à la Pyrrhus pour l'impérialisme américain qui voit rapidement son hégémonie remise en cause au sein même de son ancienne coalition, du fait de la disparition de la discipline qui permettait la cohésion des deux blocs. La disparition soudaine de l’affrontement entre deux pôles qui avait caractérisé l’arène impérialiste pendant 45 ans, lève la contrainte d’adhérer à une discipline de bloc à laquelle étaient auparavant soumises les puissances de deuxième et de troisième ordre : la tendance au "chacun pour soi" au sein de la décomposition du capitalisme s’impose rapidement au niveau international. Les impérialismes plus faibles, nouvellement enhardis, commencent à jouer leur propre carte, refusant désormais de soumettre leurs intérêts à ceux des Etats-Unis. La première expression de cette décomposition était déjà apparue une décennie avant, en Iran, où la révolution menée par Khomeini a été le premier exemple dans lequel un pays parvenait à rompre avec le bloc américain sans que les Etats-Unis ne parviennent à le ramener dans leur giron et sans être, en même temps, gagné par le bloc russe. Auparavant, les pays de la périphérie du capitalisme mondial avaient pu jouer un bloc contre l’autre et avaient même pu changer de camp, mais aucun n’était parvenu à se maintenir en dehors du système bipolaire. En 1989, cette tendance devient dominante sur le terrain inter-impérialiste.
Les responsables politiques américains doivent soudainement s'adapter à une nouvelle disposition des forces sur le terrain international. Les activités expansionnistes de l’Allemagne sont particulièrement alarmantes pour les Etats-Unis. La guerre du Golfe contre l’Irak qui prend comme prétexte l’invasion du Koweït par l’Irak, "agression" que les Etats-Unis ont eux-mêmes suscitée, quand l’ambassadeur américain avait dit aux irakiens que son pays n'interférerait pas dans un conflit Irak-Koweït, est le moyen utilisé par les Etats-Unis pour réaffirmer leur domination et rappeler aux nations tentées par le "chacun-pour-soi" que les Etats-Unis restent la seule superpuissance au monde et qu’ils sont prêts à user de leur puissance militaire en qualité de gendarme du monde. Contre leur volonté et sans enthousiasme, les puissances européennes, y compris celles qui avaient entretenu des relations économiques et politiques avec l’Irak, se voient obligées non seulement d’approuver formellement les projets de guerre des Etats-Unis, mais même de rallier la "coalition internationale". La guerre est un formidable succès pour l’impérialisme américain qui démontre sa supériorité militaire, son armement moderne et sa volonté d’exercer son pouvoir. Aux Etats-Unis, Bush père bénéficie d’une incroyable popularité politique, au point d’obtenir 90% d’opinions favorables dans les sondages après la guerre.
Cependant, Bush s'avère incapable de consolider le succès américain dans le Golfe. La contrainte exercée sur les puissances qui veulent jouer leur propre carte au niveau international, se révèle être un phénomène très temporaire. Les avancées de l’Allemagne dans les Balkans reprennent et s'accélèrent avec l’éclatement de la Yougoslavie et "l’épuration ethnique". L’incapacité de l’administration Bush à consolider les acquis de la guerre du Golfe et à formuler une réponse stratégique efficace dans les Balkans constitue un facteur central dans son échec aux élections en 1992. Pendant la campagne présidentielle, Clinton rencontre les dirigeants du Pentagone et leur assure qu’il autorisera les raids aériens dans les Balkans et poursuivra une politique déterminée pour établir une présence américaine sur le terrain dans cette région, politique qui avait constitué un aspect de plus en plus important de la politique impérialiste américaine au cours de la précédente décennie. Malgré les critiques des républicains, durant la campagne électorale de 2000, vis-à-vis de la politique de Clinton consistant à impliquer des troupes dans des interventions militaires sans en avoir planifié l’issue, l’invasion de l’Afghanistan effectuée par l’administration G.W. Bush, les projets d’invasion de l'Irak et l’envoi de troupes dans plusieurs pays du monde (les troupes américaines sont actuellement stationnées dans 33 pays) sont en continuité de la politique de Clinton.
Pendant le mandat de Clinton, une divergence politique significative se développe au sein de la bourgeoisie américaine au sujet de la politique asiatique, l’extrême-droite s’opposant à la stratégie de partenariat en Extrême-Orient avec la Chine plutôt qu’avec le Japon. La droite considère la Chine comme un régime communiste anachronique, risquant d’imploser, et un allié peu fiable – un ennemi potentiel, en fait. C'est ce désaccord qui constitue la toile de fond des différents scandales de la fin des années 90 et de l’impeachment de Clinton. Cependant, tous les anciens présidents encore vivants des deux partis (à l’exception de Reagan atteint de la maladie d’Alzheimer) approuvent la stratégie politique adoptée par rapport à la Chine et s’opposent à l’impeachment. La droite paye un fort tribut pour avoir échoué dans son attaque contre Clinton. Newt Gingrich[5] est rejeté de la vie politique et d’autres leaders qui avaient soutenu l’impeachment sont démis de leurs fonctions. Dans ce contexte, il est important de noter que, quand il y a des divergences importantes au sein de la bourgeoisie sur la politique impérialiste et que les enjeux sont élevés, les combattants n'hésitent pas à déstabiliser l’ordre politique.
Les récentes divergences au sein de la classe dominante américaine au sujet de l’action unilatérale en Irak
En 1992, Washington adopte consciemment une orientation très claire pour sa politique impérialiste dans la période d’après Guerre froide, à savoir une politique basée sur "l'engagement fondamental de maintenir un monde unipolaire dans lequel les Etats-Unis n'aient pas d'égal. Il ne sera permis à aucune coalition de grandes puissances d'atteindre une hégémonie sans les Etats-Unis" (prof. G. J. Ikenberry, Foreign Affairs, sept-oct. 2002). Cette politique vise à empêcher l’émergence de toute puissance en Europe ou en Asie qui puisse remettre en cause la suprématie américaine et jouer le rôle de pôle de regroupement pour la formation d’un nouveau bloc impérialiste. Cette orientation, initialement formulée dans un document de 1992 (1992 Defense Planning Guidance Policy Statement) rédigé par Rumsfeld, durant la dernière année du premier mandat Bush, établit clairement cette nouvelle grande stratégie : "Empêcher la réémergence d'un nouveau rival, sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou ailleurs, qui représenterait une menace du type de celle exercée auparavant par l'Union soviétique (...) Ces régions incluent l'Europe occidentale, l’Asie orientale, le territoire de l'ex-Union soviétique et l'Asie du Sud-Est (...) Les Etats-Unis doivent montrer la direction nécessaire pour établir et protéger un nouvel ordre qui tienne la promesse de convaincre ses rivaux potentiels qu'ils n'ont pas besoin d'aspirer à un rôle plus important ni d'avoir une attitude agressive pour protéger leurs intérêts légitimes. (...) Sur les questions autres que militaires, nous devons tenir suffisamment compte des intérêts des nations industrielles avancées afin de les décourager de mettre en cause notre leadership ou de chercher à renverser l'ordre économique et politique établi... Nous devons maintenir les mécanismes de dissuasion des rivaux potentiels de ne serait-ce qu'aspirer à un rôle régional ou global plus grand".
Cette politique continue sous l'administration Clinton qui entreprend un formidable programme de développement de l'armement visant à décourager les ambitions de tout rival potentiel ; c’est l’annonce de la politique de stratégie militaire nationale de 1997 (1997 National Military Strategy) : "Les Etats-Unis resteront la seule puissance globale du monde à court terme, mais opéreront dans un environnement stratégique caractérisé par la montée de puissances régionales, de défis asymétriques comprenant les armes de destruction massive, des dangers transnationaux et la probabilité d'événements incontrôlés qu'on ne peut prévoir exactement". Cette politique, reprise et poursuivie par l’actuelle administration Bush et exprimée dans le Quadrennial Defense Review Report, paru le 30 septembre 2001, moins de trois semaines après l'attaque du World Trade Center, considère comme un "intérêt national à long terme" le but "d’empêcher toute domination hostile de régions critiques, en particulier en Europe, dans le nord-est asiatique, le littoral asiatique oriental,[6] et le Moyen-Orient et le Sud-Ouest asiatique". Le Quadriennal Report défend l'idée que "une stratégie et une politique bien ciblées peuvent (...) dissuader les autres pays de se lancer dans des compétitions militaires à l'avenir". Et dans le National Security Strategy 2002, l'administration Bush affirme : "Nous serons assez forts pour dissuader des adversaires potentiels de poursuivre un effort militaire dans l'espoir de dépasser ou d'égaler la puissance des Etats-Unis". En juin 2002, dans son discours lors de la cérémonie de remise des diplômes de West Point, le président Bush a affirmé encore que "l'Amérique détient et a l'intention de garder une puissance militaire impossible à défier - rendant ainsi vaine toute course aux armements déstabilisatrice d'autres zones et limitant les rivalités au commerce et à d'autres occupations pacifiques". Tout ceci se combine pour démontrer la continuité essentielle de la politique impérialiste américaine, au-delà des divergences entre partis, depuis bien plus d'une décennie, depuis la fin de la Guerre froide. Par "continuité", nous ne voulons pas dire évidemment que la mise en œuvre de ces orientations ait été identique à tous les niveaux. Il y a eu, bien sûr, des ajustements, en particulier au niveau pratique, de cette orientation, liés aux changements du monde pendant la dernière décennie. Par exemple, la capacité de l’impérialisme américain à organiser une "coalition" internationale pour soutenir ses aventures militaires s'est trouvée confrontée à des difficultés croissantes au cours du temps, et la tendance des Etats-Unis à intervenir de plus en plus seuls, à agir unilatéralement, dans leurs efforts stratégiques pour prévenir le risque d’apparition d’un rival asiatique ou européen, a atteint des niveaux qui provoquent de sérieux débats au sein même de la classe dominante.
Ces débats sont l’expression de la reconnaissance des difficultés auxquelles est confronté l’impérialisme américain. Bien qu’elle soit incapable d’avoir une conscience "complète" du développement des forces économiques et sociales dans le monde au sens marxiste, il est clair que la bourgeoisie, et la bourgeoisie américaine en particulier, est tout à fait capable de reconnaître certains éléments clés dans l’évolution de la situation internationale. Par exemple, un article intitulé "L'impérialiste hésitant : Terrorisme, Etats en faillite et le cas de l'empire américain", de Sebastian Mallaby, note que les hommes politiques américains reconnaissent l’existence d’un "chaos" croissant sur l’arène internationale, le phénomène d’Etats "en faillite" qui sont incapables de maintenir un minimum de stabilité dans leur société et les dangers qui en découlent d’une émigration massive et incontrôlée et d’un flux de réfugiés des pays de la périphérie vers les pays centraux du capitalisme mondial. Dans ce contexte, Mallaby écrit : "La logique du néo-impérialisme contraint aussi l'administration Bush à résister. Le chaos dans le monde est trop menaçant pour qu'on l'ignore et les méthodes existantes pour traiter ce chaos qui ont été essayées, se sont avérées insuffisantes". (Foreign Affairs, mars-avril 2002). Mallaby et d'autres bourgeois américains, théoriciens de politique étrangère, mettent en avant la nécessité pour les Etats-Unis, en tant que superpuissance mondiale, d’agir pour stopper l'avancée de ce chaos, même s’ils doivent le faire seuls. Ils parlent même ouvertement d’un "nouvel impérialisme" que les Etats-Unis doivent instaurer pour bloquer les forces centrifuges qui tendent à déchirer la société dans son ensemble. Dans la situation internationale actuelle, ils reconnaissent aussi que la possibilité de faire pression sur les anciens alliés des Etats-Unis au sein d’une "coalition internationale" comme au temps de la guerre du Golfe de 1990-91, est quasiment nulle. D'où le fait que la pression, déjà identifiée dans la presse du CCI, poussant les Etats-Unis à agir unilatéralement au niveau militaire, grandit incommensurablement. La prise de conscience de la nécessité de se préparer à agir unilatéralement remonte au gouvernement Clinton, quand des membres de celui-ci ont commencé à discuter ouvertement de cette option et ont préparé le terrain à des actions unilatérales de l'impérialisme américain. (Voir par exemple le document de Madeleine Albright, "The testing of American Foreign Policy", dans Foreign Affairs, nov-déc 1998). Ainsi donc, le gouvernement Bush agit en continuité avec la politique mise en place sous Clinton : les Etats-Unis obtiennent en Afghanistan la "bénédiction" de la communauté internationale pour leurs opérations militaires, sur la base de manipulations idéologique et politique à la suite du 11 septembre, et mènent alors seuls les opérations au sol, empêchant même leur proche allié, la Grande-Bretagne, de prendre une part du gâteau. Même si la bourgeoisie est consciente de la nécessité pour les Etats-Unis d’agir unilatéralement en définitive, la question de savoir quand et jusqu’où aller dans l’action unilatérale est une question tactique sérieuse pour l’impérialisme américain. La réponse n’est pas guidée par les précédents de la Guerre froide, quand les Etats-Unis intervenaient souvent sans la consultation de l’OTAN et des autres alliés, mais pouvaient compter sur leur puissance et leur influence en tant que tête de bloc pour obtenir l’assentiment des autres (comme ce fut le cas en Corée, dans la crise des missiles de Cuba, au Vietnam, pour les missiles Pershing et Cruise au début des années 1980, etc.). La réponse à cette question aura aussi un impact important sur l’évolution ultérieure de la situation internationale. Il faut remarquer en particulier que le débat qui a eu lieu pendant l’été 2002, a d'abord commencé chez les dirigeants du parti républicain, en fait entre les spécialistes traditionnels des affaires étrangères du parti républicain. Kissinger, Baker, Eagleburger, et même Colin Powell étaient d’avis d’être prudents et ne pas agir unilatéralement trop tôt en argumentant qu’il était encore possible, et préférable, d’obtenir l’approbation de l’ONU pour déclencher les hostilités américaines contre l’Irak. Des commentateurs bourgeois aux Etats-Unis ont même évoqué la possibilité que les anciens spécialistes républicains de la politique étrangère aient parlé au nom de George Bush père quand ils ont pris position pour une répétition de la démarche employée lors de la précédente Guerre de Golfe. Les démocrates, même la gauche du parti, ont été remarquablement silencieux dans cette controverse au sein du parti au pouvoir, à l’unique exception de la brève incursion de Gore sous les projecteurs, lorsqu'il a essayé de gagner des points auprès de la gauche des démocrates en émettant l'avis selon lequel la guerre contre l’Irak serait une erreur, du fait qu'elle détournerait l’attention de la préoccupation centrale, à savoir la guerre contre le terrorisme.
La question pour nous est de savoir quelle est la signification de ces divergences au sein de la bourgeoisie de l’unique superpuissance mondiale.
D’abord, il est important de ne pas exagérer l’importance du récent débat. Les précédents historiques démontrent largement que, quand il y a des divergences sérieuses sur la politique impérialiste au sein de la bourgeoisie américaine et que les protagonistes du débat mesurent l’ampleur des enjeux, ils n'ont pas peur de poursuivre leur orientation politique, même au risque de provoquer un bouleversement politique. Il est clair que le récent débat n’a pas abouti à des conséquences politiques semblables à celles observées par exemple pendant le conflit du Vietnam. En aucun cas, ce débat n’a menacé l’unité fondamentale de la bourgeoisie américaine sur sa politique impérialiste. De plus, le désaccord ne portait pas sur la question de la guerre en Irak, sur laquelle l’accord était presque complet au sein de la classe dominante américaine. Toutes les parties étaient d’accord avec cet objectif politique, non pas en raison de ce qu’aurait fait, ou menacé de faire, Saddam Hussein, ni par désir de se venger de la défaite de Bush père, ni pour stimuler les profits pétroliers d'Exxon au sens matérialiste vulgaire, mais à cause de la nécessité de lancer à nouveau un avertissement aux puissances européennes qui voudraient jouer leur propre carte au Moyen-Orient, à l’Allemagne en particulier, avertissement ayant pour but de signifier que les Etats-Unis n’ont pas peur d’utiliser la force militaire pour maintenir leur hégémonie. Par conséquent, il n'est ni surprenant ni accidentel que ce soit l’Allemagne qui ait été la plus véhémente à s’opposer aux préparatifs de guerre américains, puisque ce sont ses intérêts impérialistes qui sont en premier lieu pris pour cible par l’offensive américaine.
Le débat au sein des cercles dirigeants américains s’est centré sur quand et sur quelles bases déchaîner la guerre et, peut-être de manière plus critique, sur le niveau jusqu'où les Américains devaient agir seuls dans la situation actuelle. La bourgeoisie américaine sait parfaitement qu’elle doit être prête à agir unilatéralement, et qu’agir unilatéralement aura des conséquences significatives pour elle sur le terrain international. Cela contribue indubitablement à isoler davantage l'impérialisme américain, à provoquer de plus grandes résistances et de plus grands antagonismes au niveau international et pousse les autres puissances à rechercher des alliances possibles pour faire face à l’agressivité américaine, tout ceci ayant un plus grand impact sur les difficultés que va rencontrer l’impérialisme américain dans la période à venir. Le moment précis que choisissent les Etats-Unis pour abandonner tout semblant de recherche de soutien international à leurs actions militaires et pour agir unilatéralement, constitue donc une décision tactique qui a des implications stratégiques importantes. En mars 2002, Kenneth M. Pollack, actuellement directeur adjoint du Conseil des Affaires étrangères et, auparavant, directeur des Affaires du Golfe au Conseil National de Sécurité pendant l'Administration Clinton, parlait ouvertement de la nécessité pour le gouvernement de déclencher rapidement la guerre contre l’Irak avant que ne disparaissent la fièvre guerrière, attisée avec un tel succès aux Etats-Unis après le 11 septembre, et la sympathie internationale créée par les attaques terroristes qui avait facilité l’accord d’autres nations avec les actions militaires américaines. Comme le dit Pollack : "Trop tarder poserait autant de problème que trop peu, parce que l'élan gagné par la victoire en Afghanistan pourrait être brisé. Aujourd'hui, le choc des attaques du 11 septembre est encore frais et le gouvernement américain comme le public sont prêts à faire des sacrifices - en même temps que le reste du monde reconnaît la colère américaine et hésiterait à se mettre du mauvais côté. Plus longtemps nous attendons pour envahir, plus difficile ce sera d'avoir un soutien international et intérieur, même si la raison de l'invasion a peu, sinon rien, à voir avec les relations de l'Irak avec le terrorisme. (...) Les Etats-Unis peuvent, en d'autres termes, se permettre d'attendre un peu avant de s'en prendre à Saddam, mais pas indéfiniment." (Foreign Affairs, mars-avril 2002). L’opposition à l’intervention militaire américaine en Irak, aussi bien dans la classe ouvrière américaine qui ne s’est pas entièrement rangée derrière cette guerre, que dans le monde chez des puissances de deuxième et troisième ordre, laisse en fait supposer que les Etats-Unis ont peut-être trop attendu avant d’attaquer l’Irak.
Il est clair que les éléments les plus prudents de l’équipe dirigeante, notamment Colin Powell qui a défendu une politique de pression diplomatique pour gagner l’approbation du Conseil de Sécurité de l’ONU sur une action militaire en Irak, étaient majoritaires dans l’administration à l'automne dernier et, comme les événements l’ont montré, leur tactique s’est avérée efficace pour obtenir un vote unanime qui a fourni aux Etats-Unis le prétexte pour entrer en guerre contre l’Irak quand ils le souhaitaient. Mais il est clair qu'en février, le résultat obtenu à l'automne s'était largement amoindri du fait que la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine s’opposaient ouvertement aux plans de guerre américains, trois d'entre eux ayant le droit de veto au Conseil de Sécurité. Les critiques au sein de la bourgeoisie américaine exprimaient des préoccupations concernant le manque d'habileté de l'administration Bush pour manœuvrer et gagner un soutien international à la guerre (voir par exemple les récents commentaires du Sénateur Joseph Biden, le haut responsable démocrate au Comité des relations extérieures du sénat).
Les contradictions inhérentes à la situation actuelle soulèvent de très sérieux problèmes aux Etats-Unis. La décomposition et le chaos au niveau mondial rendent impossible la création de nouvelles "coalitions" au niveau international. Par conséquent, Rumsfeld et Cheney ont raison d'insister sur le fait qu’il ne sera plus jamais possible de constituer une coalition internationale à l’image de celle de 1990-91. Cependant, il est impossible d’imaginer que l’impérialisme américain permette qu’une telle situation l’entrave dans ses actions militaires pour défendre ses propres intérêts impérialistes. D’un autre côté, si les Etats-Unis mènent effectivement une intervention militaire unilatérale, quel que soit le succès obtenu à court terme, cela ne fera que les isoler un peu plus sur le plan international, leur aliénera les plus petits pays, rendra ces derniers contestataires et enclins à résister de plus en plus à la tyrannie de la superpuissance. Mais, par ailleurs, si les Etats-Unis reculent et ne mènent pas seuls la guerre dans le cadre actuel, ce sera une sérieuse démonstration de faiblesse de la part de la superpuissance qui ne fera qu’inciter les puissances plus petites à jouer leur propre carte et remettre en cause directement la domination américaine.
La question pour les révolutionnaires n’est pas de tomber dans le piège de prédire à quel moment précis la bourgeoisie américaine engagera une guerre unilatérale, en Irak dans un futur proche ou sur une autre scène plus tard, mais de comprendre clairement quelles sont les forces à l’oeuvre, la nature du débat au sein des cercles dirigeants américains, et les sérieuses implications de cette situation pour la poursuite du chaos et de l’instabilité à l'échelle internationale dans la période à venir.
JG, février 2003
1 "Endiguement", en anglais "containment", était la politique adoptée par l'impérialisme américain après la deuxième guerre mondiale d'endiguer toute extension de la zone d'influence russe.
2 La "théorie des dominos" voulait que la chute sous influence russe d'un pays dans une région disputée par les deux grands impérialismes (à l'occurrence, le sud-est asiatique) serait suivie inéluctablement par la chute des pays voisins.
3 La conférence de Bretton Woods établit le nouvel ordre monétaire et économique d'après-guerre, dominé par les Etats-Unis. Il mit en place, entre autres, le Fond Monétaire International, et le système d'échange basé sur le dollar à la place de l'étalon-or.
4 Cette politique d’encerclement de l’URSS ressemble remarquablement à l’actuelle politique envers l’Europe.
5A l'époque, le dirigeant du parti républicain dans la Chambre des représentants du Congrès américain, aujourd'hui totalement discredité.
6Selon le Pentagone, "le littoral asiatique oriental est une région qui s'étend du sud du Japon, passe par l'Australie et comprend le Golfe du Bengale".
Géographique:
- Etats-Unis [34]
Questions théoriques:
- Impérialisme [35]
160 ans après la publication de La question juive
- 4201 lectures
Marx et la question juive
Dans le dernier numéro de la Revue internationale, nous avons publié un article sur le film de Polanski, Le pianiste, qui porte sur le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943 et sur le génocide nazi des juifs d'Europe. Soixante ans après l'horreur indicible de cette campagne d'extermination, on aurait pu s'attendre à ce que l'antisémitisme soit définitivement relégué au passé - les conséquences du racisme antisémite étant si claires qu'il aurait dû être discrédité une fois pour toutes. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. En fait toutes les vieilles idéologies antisémites sont aussi toxiques et aussi répandues que jamais même si leur cible principale s'est déplacée de l'Europe au monde "musulman", et en particulier, au "radicalisme islamique" personnifié par Ousama Ben Laden qui, dans toutes ses prises de position, n'a jamais manqué de s'attaquer "aux croisés et aux juifs" en tant qu'ennemis de l'islam et comme cibles appropriées pour les attaques terroristes. Un exemple typique de cette version "islamique" de l'antisémitisme nous est fourni par le site Internet "Radio Islam" dont le slogan est "Race ? Une seule race humaine". Le site se dit opposé à toute forme de racisme, mais à y regarder de plus prés, il est clair que sa préoccupation principale, c'est "le racisme juif envers les non-juifs" ; en fait, il s'agit d'une archive de textes antisémites classiques, depuis les protocoles des sages du Sion, une contre façon tsariste de la fin du 19e Siècle, qui se prétend être le procès-verbal d'une réunion de la conspiration juive internationale et constituait une des bibles du parti nazi, jusqu'à Mein Kampf de Hitler et autres invectives plus récentes du leader de "Nation of Islam" aux Etats-Unis. Louis Farrakhan.
Ce genre de publications -qui prennent à l'heure actuelle de très grandes proportions- montrent que la religion est devenue aujourd'hui l'un des principaux véhicules du racisme et de la xénophobie, qui encourage les attitudes de pogrom et divise la classe ouvrière et les couches opprimées de façon générale. Et nous ne parlons pas seulement d'idées, mais de justifications idéologiques pour de vrais massacres, qu'ils impliquent les serbes orthodoxes. les catholiques croates ou les musulmans bosniaques en ex Yougoslavie, les protestants et les catholiques en Irlande du Nord, les musulmans et les chrétiens en Afrique et en Indonésie, les hindous et les musulmans en Inde, ou les juifs et les musulmans en Israël/ Palestine.
Dans deux précédents articles de cette Revue -"La résurgence de l'Islam, un symptôme de la décomposition des relations sociales capitalistes" dans la Revue n109 et "Le combat du marxisme contre la religion, la source fondamentale de la mystification religieuse est l'esclavage économique" dans la Revue n°110- nous avons montré que ce phénomène était une véritable expression de l'enfoncement dans la décomposition de la société capitaliste. Dans cet article, nous voulons nous centrer sur le problème des juifs, non seulement parce que le fameux article de Karl Marx "A propos de la question juive" a été publié il y a 160 ans, en 1843, mais aussi parce que Marx dont toute la vie a été dédiée à la cause de l'internationalisme prolétarien, est cité aujourd'hui par un théoricien de l'antisémitisme -en général de façon désapprobatrice, mais pas toujours. Le site Radio Islam est instructif à ce sujet : l'article de Marx y apparaît sur la même page que les Protocoles des Sages de Sion, même si le site publie aussi des dessins humoristiques du genre de ceux de Der Sturmer qui insultent Marx pour être juif lui-même.
Cette accusation contre Marx n'est pas nouvelle. En 1960, Dagobert Runes publiait l'article de Marx en y mettant un titre à lui : Un monde sans juifs et qui sous-entendait que Marx était le premier représentant de la "solution finale" du problème juif. Dans une histoire dcs juifs plus récente, l'intellectuel anglais d'extrême-droite, Paul Johnson, a porté des accusations similaires et n'a pas hésité à trouver une composante antisémite à l'idée même de vouloir abolir l'échange comme base de la vie sociale. Au minimum, Marx serait un juif "qui se hait lui-même" (ce qui est aujourd'hui la plupart du temps un qualificatif donné par l'ordre établi sioniste envers tous ceux d'origine juive qui portent des critiques à l'Etat d'Israël).
Contre toutes ces distorsions grotesques, le but de cet article est non seulement de défendre Marx contre ceux qui cherchent à l'utiliser contre ses propres principes, mais aussi de montrer que le travail de Marx fournit le seul point de départ pour comprendre et dépasser le problème de l'antisémitisme.
Le contexte historique de l'article de Marx sur La question juive
II est inutile de présenter ou de citer l'article de Marx en dehors de son contexte historique. Cet article, "A propos de la question juive"([1] [36]), fait partie de la lutte générale menée pour le changement politique en Allemagne semi-féodale. La question de savoir s'il fallait ou non accorder aux juifs les mêmes droits civiques qu'aux autres habitants de l'Allemagne constituait un débat spécifique dans cette lutte. En tant que rédacteur de la Rheinische Zeitung, Marx avait eu au départ l'intention de faire une réponse aux écrits antisémites et ouvertement réactionnaires d'un certain Hernies qui défendait l'idée qu'il fallait maintenir les juifs dans le ghetto et voulait préserver à l'Etat sa base chrétienne. Mais après que l'hégélien de gauche Bruno Bauer fut entré dans la bagarre avec deux articles : "La question juive" et "La capacité des juifs et des chrétiens d'aujourd'hui de se libérer", Marx estima qu'il était plus important de polémiquer avec le point de vue de Bauer qu'il considérait comme faussement radical.
Nous devons aussi rappeler que dans cette période de sa vie, Marx était en train d'accomplir une transformation politique et de passer du point de vue de la démocratie radicale au communisme. Il était en exil à Paris et était influencé par les artisans communistes français (Cf. "Comment le prolétariat a gagné Marx au conununisme", dans la Revue internationale n°69) ; c'est à la fin de 1843, dans sa Critique de la philosophie du droit de Hegel, que Marx reconnut dans le prolétariat la classe porteuse d'une nouvelle société. En 1844, il rencontra Engels qui l'aida à comprendre l'importance des fondements économiques de la vie sociale; les manuscrits économiques et philosopiques, écrits la même année. constituent sa première tentative de compréhension de toute cette évolution dans sa véritable profondeur. En 1845, il écrivait les Thèses sur Feuerbach qui expriment sa rupture définitive avec le matérialisme unilatéral de ce dernier.
La polémique avec Bauer sur la question des droits civiques et de la démocratie, publiée dans les : Annales francos-allemandes, constitue sans aucune équivoque un moment de cette évolution.
A l'époque, Bruno Bauer était le porte parole de la "gauche" en Allemagne, bien que les germes de son évolution ultérieure vers la droite puissent déjà se percevoir dans l'attitude qu'il adopte envers la question juive sur laquelle il prend une position apparemment radicale mais qui, en fin de compte, aboutit à préconiser de ne rien faire pour changer l'état des choses existant. Selon Bauer, il était inutile de revendiquer l'émancipation politique des juifs dans un Etat chrétien : pour pouvoir réaliser une véritable émancipation, il était avant tout nécessaire, pour les juifs comme pour les chrétiens, d'abandonner leurs croyances et leur identité religieuses ; dans un Etat vraiment démocratique, il n'y aurait pas d'idéologie religieuse. En fait, s'il y avait quelque chose à faire, cela incombait beaucoup plus aux juifs qu'aux chrétiens : du point de vue des hégéliens de gauche, le christianisme constituait la dernière enveloppe religieuse au sein de laquelle s'était exprimée historiquement la lutte pour l'émancipation humaine. Ayant rejeté le message universel du christianisme, les juifs avaient encore deux degrés à franchir tandis que les chrétiens n'en avaient plus qu'un.
La transition entre ce point de vue et la position ultérieure ouvertement antisémite de Bauer n'est pas difficile à voir. Marx peut très bien l'avoir pressentie mais dans sa polémique, il commence par défendre la position selon laquelle accorder des droits civiques "normaux" aux juifs - qu'il appelle "l'émancipation politique", constituerait "un grand pas en avant" ; en fait, cela avait déjà caractérisé les précédentes révolutions bourgeoises (Cromwell avait permis aux juifs de rentrer en Angleterre et le code Napoléon accordait les droits civiques aux juifs). Cela devait faire partie de la lutte plus générale pour se débarrasser des barrières féodales et créer un Etat démocratique moderne qui n'avait que trop tardé, notamment en Allemagne.
Mais Marx était déjà conscient que la lutte pour la démocratie politique ne constituait pas le but final. L'article Sur "La question juive" semble marquer une avancée significative par rapport au texte qu'il avait écrit peu de temps auparavant, la Critique de la philosophie politique de Hegel. Dans ce dernier, Marx pousse sa pensée démocrate radicale à l'extrême, et y défend l'idée que la démocratie réelle - le suffrage universel - signifie la dissolution de l'Etat et de la société civile. Dans "La question juive", au contraire, Marx affirme qu'une émancipation purement politique - il utilisé même l'expression de "démocratie accomplie" -est loin de répondre à une véritable émancipation humaine.
C'est dans ce texte que Marx reconnaît clairement que la société civile est la société bourgeoise - une société d'individus isolés en concurrence sur le marché. C'est une société de séparation et d'aliénation (c'est le premier texte dans lequel Marx utilise ces termes) dans laquelle les puissances mises en oeuvre par les hommes eux-mêmes - pas seulement le pouvoir de l'argent mais aussi celui de l'Etat lui-même - deviennent inévitablement des forces étrangères dominant la vie humaine. Ce problème n'est pas résolu par la réalisation de la démocratie politique et des droits de l'homme. Celle-ci reste fondée sur la notion du citoyen atomisé et non sur une véritable Communauté. "Ainsi, aucun des prétendus droits de l’homme ne s'étend au-delà de l'homme égoïste, au delà de l'homme comme membre de la société civile, savoir un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé st son caprice prive, l'individu sépare de la communauté. Bien loin que l'homme ait été considéré, dans ces droits-là, comme un être générique, c'est au contraire la vie générique elle même, la société, qui apparait comme un cadre extérieur aux individus, une entrave à leur indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leur propriété et de leur personne égoïste ".
Une preuve supplémentaire du fait que l'aliénation ne disparaît pas avec la démocratie politique, soulignait Marx, était fournie par l'exemple de l'Amérique du Nord : formellement, la religion et l'Etat y étaient séparés ; pourtant c'était par excellence le pays de l'observance religieuse et des sectes.
Aussi, tandis que Bauer défend l'idée que la lutte pour l'émancipation politique des juifs comme tels est une perte de temps, Marxd éfend et soutient cette revendication : "Aussi ne disons-nous pas aux juifs, avec Baller : vous ne pouvez être politiquement émancipés, sans vous émanciper radicalement du judaïsme. Nous leur disons plutôt : c'est parce que vous pouvez être émancipés politiquement, sans vous détacher complétement et définitivement du judaisme, que l'émancipation politique elle-même n'est pas l'émancipation humaine. Si vous, juifs, vous désirez votre émancipution politiques sans vous émanciper vous-mêmes humainement, c'est que l'imperfection et la contradiction ne sont pas seulement en vous, mais ils sont inhérentes à l'essence et à la catégorie de l’émancipation politique". Concrètement, cela voulait dire que Marx acceptait la demande faite par la communauté juive locale de rédiger une pétition en faveur des libertés civiques pour les juifs. Cette démarche vis-à-vis des réformes politiques devait constituer une attitude caractéristique du mouvement ouvrier pendant la phase ascendante du capitalisme. Mais Marx regardait déjà plus loin sur le chemin de l'histoire - vers la société communiste future - même s'il ne la nomme pas encore ainsi dans "La question juive". C'est la conclusion de la première partie de sa réponse à Bauer : "C'est seulement lorsque l'homme individuel, réel, aura recouvré en lui-même le citoyen abstrait et qu'il sera devenu, lui, homme individuel, un être générique dans sa vie empirique, dans son travail individuel, dans ses rapports individuels ; lorsque l'homme aura reconnu et organisé ses forces propres comme forces sociales et ne retranchera donc plus de lui la force sociale sous l'aspect de la force politique : c'est alors seulement que l'émancipation humaine sera accomplie".
Le prétendu antisémitisme de Marx
C'est la deuxième partie du texte, en réponse au deuxième article de Baller, qui a attiré contre Marx les foudres de toutes parts et dont la nouvelle vague d'antisémitisme islamique aujourd'hui fait un emploi abusif au service de sa vision obscurantiste du monde. « Quel est le culte profane du juif ? Le trafic. Quel est son dieu ? L'argent.(...) L'argent est le dieu jaloux d’Israël, devant qui nl autre dieu ne doit exister. L'argent avilit tous les dieux (les hommes : il les transforme en une marchandise. L'argent est la valeur universelle de toutes choses. constituée pour soi-même. C'est pourquoi il a dépouillé le monde entier, le monde des hommes ainsi que la nature, de leur valeur originelle. L'argent, c'est l'essence aliénée du travail et de la vie de l'homme, et cette essence étrangère le domine, et il l'adore. Le dieu des juifs . s'est mondanise, il s'est changé en dieu du monde,. La lettre de change est le vrai dieu du juil… » C'est de ce passage et d'autres, dans "La question juive", dont on s'est emparé pour prouver que Marx serait un des pères fondateurs de l'antisémitisme moderne ; son article aurait donné une respectabilité au mythe raciste du parasite juif assoiffé de sang.
II est vrai que bien des formulations utilisées par Marx dans cette partie, ne pourraient pas l'être de la même façon aujourd'hui. I1 est également vrai que ni Marx ni Engels n'étaient totalement affranchis de tout préjugé bourgeois et que certaines de leurs prises de position, en particulier sur les nationalités, le reflètent. Mais en conclure que Marx et le marxisme lui-même sont indélébilement marqués par le racisme est une contre façon de sa pensée.
Toutes ces formules doivent être placées dans leur contexte historique approprié. Comme l'explique Hal Draper dans l'appendice de son livre Karl Marx’s Theorie of Revolution (Vol. 1, Monthly Review Press, 1977), l'identification entre le judaïsme et le commerce ou le capitalisme faisait partie du langage de l'époque et était reprise par nombre de penseurs radicaux et de socialistes, y compris des juifs radicaux comme Moses Hess qui influençait Marx à l'époque (et a eu en fait une influcnce sur cet article même).
Trevor Ling, historien des religions, critique l'article de Marx sous un autre angle : "Marx avait un style journalistique mordant et agrémentait ses pages de nombreuses tournures de phrases intelligentes et satiriques. La sorte d’écrits dont on vient de donner des exempIes, est vigoureusement pamphlétaire, excite les passions, mais n'a pas grand chose à offrir en terme d’analyse sociologique utile. De grandes entités superflicielles comme le « judaisme » ou le « christianisme », quand elles sont utilisées dans ce genre de contexte, ne correspondent pas à des réalités historiques : ce sont des étiquettes apposées par Marx à ses propres constructions, artificielles et mal conçuees". (Ling, Karl Marx and Religion, Macmillan Press, 1980). Pourtant quelques phrases mordantes de Marx fournissent des outils bien plus tranchants pour examiner une question en profondeur que tous les ouvrages savants des académiciens. De toutes façons, Marx n'essaie pas ici de faire une histoire de la religion juive qui ne peut être réduite à une simple justification du mercantilisme, ne serait-ce que parce qu'elle puise ses origines dans une société où les rapports marchands avaient un rôle très secondaire et que sa substance reflète aussi l'existence de divisions de classe entre les juifs eux-mêmes (par exemple, dans les diatribes des prophètes contre la corruption de la classe dominante dans l'Israël antique). Comme nous l'avons vu, ayant défendu la nécessité que la population juive ait les mêmes "droits civiques" que les autres citoyens, Marx n'utilise l'analogie verbale entre le judaïsme et les rapports marchands que pour aspirer à une société libérée des rapports marchands, ce qui est le véritable sens de sa phrase de conclusion : "L’émancipation sociale du juif, c'est l'émancipation de la société libérée du judaisme". Cela n'a rien à voir avec un quelconque plan d'élimination des juifs, malgré les insinuations répugnantes de Dagobert Rune ; cela signifie que tant que la société sera dominée par les rapports marchands, les êtres humains ne pourront pas contrôler leur propre puissance sociale et resteront étrangers les uns aux autres.
En même temps, Marx fournit une vraie base pour analyser la question juive d'un point de vue matérialiste - tâche qui a été menée à bien par d'autres marxistes plus tard, comme Kautsky et notamment, Abraham Leon[2 [37]]). Contrairement à l'interprétation idéaliste qui cherchait à expliquer la survie opiniàtre des juifs par leur conviction religieuse, Marx souligne que la survie de leur identité séparée et de leurs convictions religieuses s'expliquait par le rôle qu'ils avaient rempli dans l'histoire : "Le judaïsme s'est conservé non pas en dépit d l'histoire, mais grâce à l’histoire". Et c'est en fait profondément lié aux relations qu'ont entretenus les juifs avec le commerce : "Ne cherchons pas le secret du juif dans sa religion, mais cherchons le secret de la religion dans le juif réel". Et c'est ici que Marx utilise lejeu de mot entre le judaïsme en tant que religion et le judaïsme comme synonyme de marchandage et de pouvoir financier, cc qui se basait sur un fond de réalité : le rôle économique et social particulier joué par lesjuifs dans l'ancien système féodal.
Leon, dans son livre The Jewish Question, a Marxist Interpretation, fonde son étude sur ces quelques phrases limpides de "La question juive" et sur une autre, dans Le Capital, qui parle des "juifs [vivant] dans les pores de la société polonaise"([3] [38]) de façon comparable à d'autres "peuples marchands" dans l'histoire. A partir de ces quelques éléments, il développe l'idée que les juifs dans l'antiquité et dans le féodalisme, ont fonctionné comme un "peuple-classe", en grande partie attaché à des rapports de commerce et d'argent dans des sociétés qui étaient fondées, de façon prédominante, sur une économie naturelle. Dans le féodalisme en particulier, cette situation était codifiée dans les lois religieuses qui interdisaient aux chrétiens de faire de l'usure. Mais Leon a aussi montré que le lien des juifs avec l'argent n'a pas toujours été limité à l'usure. Dans les sociétés antique et féodale, les juifs étaient un peuple marchand, personnifiant les rapports de commerce qui ne dominaient pas encore l'économie mais reliaient des communautés dispersées dont la production était principalement tournée vers l'usage, tandis que la classe dominante s'appropriait et consommait directement la plus grande part du surplus. C'est cette fonction socio économique particulière (qui était évidemment une tendance générale et non une loi absolue chez tous les juifs) qui a fourni la base matérielle à la survie de la "corporation" juive au sein de la société féodale ; a contrario, là où les juifs ont développé d'autres activités comme l'agriculture, ils ont en général été très rapidement assimilés.
Mais ceci ne veut pas dire que les juifs ont été les premiers capitalistes (question qui n'est pas complètement claire dans le texte de Marx parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore complètement saisi la nature du capital) ; au contraire, c'est la montée du capitalisme qui a coïncidé avec une des pires phases de persécution des juifs. Contrairement au mythe sioniste selon lequel la persécution des juifs a constitué une constante de toute l'histoire - et que les juifs ne cesseront d'être persécutés que lorsqu'ils seront tous réunis dans un seul pays ([4] [39]) -Leon montre quctant qu'ils ontjoué un rôle "utile" dans les sociétés pré-capitalistes, les juifs étaient la plupart du temps tolérés et, souvent, spécifiquement protégés par les monarques qui avaient besoin de leurs qualifications et de leurs services. C'est l'émergence d'une classe marchande "autochtone" qui s'est mise à utiliser ses profits pour les investir dans la production (par exemple, le commerce de la laine anglaise, clé pour comprendre les origines de la bourgeoisie anglaise) qui a sonné l'heure du désastre pour les juifs ; ceux-ci incarnaient une forme d'économie marchande désormais dépassée et étaient considérés comme un obstacle au développement de ces nouvelles formes. C'est ce qui a poussé un nombre croissant de commerçants juifs à se consacrer à la seule forme de commerce qui leur était accessible - l'usure. Mais cette pratique a amené les juifs à entrer en conflit direct avec les principaux débiteurs de la société - d'une part les nobles, et les petits artisans et les paysans de l'autre. Il est significatif, par exemple, que les pogroms contre les juifs cri Europe occidentale eurent lieu dans la période où le féodalisme avait commencé son déclin et le capitalisme sa montée. En Angleterre, en 1189-90, les juifs d'York et d'autres villes furent massacrés et la totalité de la population juive expulsée. Les pogroms étaient souvent provoqués par les nobles qui avaient de grosses dettes envers les juifs et qui trouvaient des partisans tout prêts parmi les petits producteurs qui étaient également souvent endettés vis-à-vis des prêteurs juifs les uns et les autres espéraient bénéficier d'une annulation de leurs dettes crâce au meurtre et à l'expulsion des usuricrs, et Se saisir de leurs propriétés. L'émigration juive d'Europe occidentale vers l'Europe orientale à l'aube du développement capitaliste permettait un retour vers des régions plus traditionnelles et encore féodales où les juifs pouvaient retrouver leur propre rôle plus traditionnel ; en revanche, les juifs qui sont restés ont tendu à s'assimiler dans la société bourgeoise environnante. Notamment, une fraction juive de la classe capitaliste (personnifiée par la famille Rothschild) est le produit de cette époque : parallèlement s'est développé un prolétariat juif, bien que les ouvriers juifs, à l'Ouest comme à l'Est, aient été concentrés essentiellement dans la sphère artisanale et non dans l'industrie lourde, et que la majorité des juifs ait continué à appartenir de façon disproportionnée à la petite-bourgeoisie, souvent en tant que petits commerçants.
Ces couches -petits commerçants, artisans, prolétaires- sont jetées dans la misère la plus abjecte avec le déclin du féodalisme à l'est et l'émergence d'une infrastructure capitaliste qui contenait déjà bien des signes de son déclin. A la fin du 19° siècle, ont lieu de nouvelles vagues de persécution dans l'Empire russe, provoquant un nouvel exode des juifs vers l'ouest ce qui, de nouveau, "exporte" le problème juif dans le reste du monde, en particulier en Allemagne et en Autriche. Cette période voit se développer le mouvement sioniste qui, de la droite à la gauche, met en avant l'idée que le peuple juif ne pourra jamais être normalisé tant qu'il n'aura pas de patrie - argument dont la futilité fut, selon Léon, confirmée par l'Holocauste lui-même, puisque l'apparition d'une petite "patrie juive" en Palestine n'a en rien pu l'empêcher([5] [40]).
Leon, écrivant en plein milieu de l'Holocauste nazi, montre comment le paroxysme d'antisémitisme atteint en Europe nazie est l'expression de la décadence du capitalisme. Fuyant la persécution tsariste en Europe de l'Est et en Russie, les masses juives immigrées n'ont pas trouvé, en Europe occidentale, un havre de paix et de tranquillité mais une société capitalistc qui devait bientôt être déchirée par d'insolubles contradictions, ravagée par la guerre et la crise économique mondiale. La défaite de la révolution prolétarienne après la Première Guerre mondiale avait non seulement ouvcrt le cours à une secondc boucherie impérialiste, mais aussi à une forme de contre-révolution qui exploita à fond les vieux préjugés antisémites, utilisant le racisme anti-juif, à la fois pratiquement et idéologiquemcnt, comme base pour concourir à la liquidation de la menace prolétarienne et adapter la société à une nouvelle guerre. Comme le Parti Communiste International dans la brochure Auschwitz et le grand alibi, Léon se concentre particulièrement sur l'utilisation faite par le nazisme des convulsions de la Petite-bourgcoisie, ruinée par la crise capitaliste et proie facile pour une idéologie qui lui promettait non seulement de la libérer de ses concurrents juifs, mais encore lui permettait officiellement de faire main basse sur leurs propriétés (méme si l'Etat nazi n'a pas vraiment permis à la petite-bourgeoisie allemande d'en bénéficier et s'est approprié la part du lion pour développer et maintenir sa vaste économie de guerre).
En même temps, comme le montre Léon, une nouvelle fois, l'utilisation dc l'antisémitisme comme un socialisme d'imbécile,,,, une fausse critique du capitalisme, permit à la classe dominante d'entraîner certains secteurs de la classe ouvrière, en particulier les couches les plus marginales ou celles qui étaient écrasées par le chômage. En fait, la notion de "national"socialisme était en partie une réponse directe de la classe dominante au lien étroit qui avait été établi entre l'authentique mouvement révolutionnairc et une couche d'intellectuels ct d'ouvriers juifs qui, comme Lénine l'a souligné, gravitait naturellement vers le socialisme international en tant que seule solution à leur situation d'éléments persécutés et sans abri de la société bourgeoise. Le socialisme international était qualifié de machination de la conspiration juive mondiale et les prolétaires étaient enjoints d'agrémenter leur socialisme de patriotisme. Il faut aussi souligner que cette idéologie s'est reflétée dans l'URSS stalinienne où la campagne d'insinuations contre "les cosmopolites sans racines" servait de couverture à des sous-entendus antisémites contre l'opposition internationaliste à l'idéologie et à la pratique du "socialisme en un seul pays".
Cela montre que la persécution des juifs fonctionne aussi au niveau idéologique et a besoin d'une idéologie qui la justifie. Au Moyen Age, c'était le mythe chrétien des assassins du Christ, des empoisonneurs de puits, des meurtres rituels d'enfants chrétiens : Shylock et sa livre de chair([6] [41]). Dans la décadence du capitalisme, c'est le mythe d'une conspiration juive mondiale qui aurait fait apparaître le capitalisme comme le communisme pour imposer sa domination sur les peuples aryens.
Dans les années 1930, Trotsky notait que le déclin du capitalisme engendrait une terrible régression sur le plan idéologique :"Le fascisrne a amené à la politique les basfonds de la société. Non seulement dans les maisons paysannes, mais aussi dans les gratte-ciel des villes vivent encore aujourd’hui, à côté du XXe siécle, le Xe et le XIIe siècles. Des centaines de millions de gens utilisent le courant électique, sans cesser de croire à la force magique des gestes et des incantations. Le pape à Rome prêche à la radio sur le miracle de la transmutation de l'eau en vin. Les étoiles de cinéma se font dire la bonne aventure. Les aviateurs qui dirigent de merveilleuses mécaniques, créées par le génie de l'homme, portent des amulettes sous leur combinaison. Quelles réserves inépuisables d'obscurantisme, d'ignorance et de barbarie ! Le désespoir les a fait se dresser, le fascisme leur a donné un drapeau. Tout ce qu'un développement sans obstacle de la société aurait dû rejeter de l'organisme national, sous la forme d'excréments de la culture, est maintenant vomi : la civilisaition capitaliste vomit une barbarie non digérée. Telle est la physiologie du national socialisme". ("Qu'est-ce que le nationalsocialisme ?" 10 mai 1933)
On retrouve tous ces éléments dans les fantasmes nazis à propos des juifs. Le nazisme n'a pas fait de secret sur sa régression idéologique - il est revenu ouvertement aux dieux pré-chrétiens. Le nazisme en fait était un mouvement occultiste qui s'est emparé du contrôle direct des moyens de gouvernement ; et comme les autres occultismes, il considérait qu'il menait une bataille contre une autre puissance satanique secrète - en l'occurrence, les juifs. Et ces mythologies qu'on peut certainement examiner en elles-mêmes, sous tous leurs aspects psychologiques, développent leur propre logique et nourrissent le monstre qui a mené aux camps de la mort.
Néanmoins, on ne peut jamais séparer cette irrationalité idéologique des contradictions du système capitaliste - ce n'est pas, comme ont tenté de le démontrer de nombreux penseurs bourgeois, l'expression d'une sorte de principe métaphysique du mal, un mystère insondable. Dans l'article sur le film de Polanski "Le pianiste" dans la Revue internationale n°113, nous avons cité la brochure du PCI (Auschwitz ou le grans alibi) à propos du froid calcul "raisonné" qui se tenait derrière l'holocauste - l'industrialisation du meurtre et l'utilisation des cadavres pour en tirer le maximum de profit. Mais il existe une autre dimension que cette brochure n'aborde pas : l'irrationalité de la guerre capitaliste elle même. Ainsi la "solution finale", sous la forme de la guerre mondiale qui lui a fourni son contexte, est provoquée par les contradictions économiques et ne renonce pas à la course au profit, mais en même temps, elle devient un facteur supplémentaire dans l'exacerbation de la ruine économique. Et si l'économie de guerre requérait l'utilisation du travail forcé, toute la machinerie des camps de concentration est aussi devenue un immense fardeau pour l'effort de guerre allemand.
La solution de la question juive
160 ans plus tard, l'essence de ce que Marx a mis en avant conune solution de la question juive, reste valable : l'abolition des rapports capitalistes et la création d'une réelle communauté humaine. Evidenunent, c'est aussi la seule solution possible à tous les problèmes nationaux qui subsistent : le capitalisme s'est avéré incapable de les résoudre. La manifestation actuelle du problème juif qui est spécifiquement liée au conflit impérialiste au Moycn-Orient, en constitue la meilleure preuve.
La "solution" mise en avant par le « mouvementde libération nationale juif », le sionisme, est devenue le nœud dit problème. La source principale du regain actuel d'antisémitisme n'est plus directement liée à la fonction particulière des juifs dans les Etats capitalistes avancés, ni au problème de l'immigration juive dans ces régions. Dans ces pays, depuis la Seconde Guerre mondiale, la cible du racisme a porté sur les vagues d'immigration en provenance des anciennes colonies ; dernièrement, dans les protestations contre les "demandeurs d'asile", c'est aux victimes des dévastations économiques, écologiques et militaires que le capitalisme en décomposition inflige à la planète, que s'adresse le racisme. L'antisémitisme "moderne" est d'abord et avant tout lié au conflit du Moyen-Orient. La politique crûment impérialiste d'Israël dans la région et le soutien sans faille que lui ont apporté les Etats-Unis ont revitalisé tous les vieux mythes sur le complot juif international. Des millions de musulmans sont convaincus par le mythe urbain selon lequel "40 000 Juifs se sont tenus éloignés des Tours jumelles le 11 septembre parce qu'on les avait avertis à l'avance de l'attaque" - "les juifs en sont les auteurs". Et cela en dépit du fait que ceux qui le proclament, sont des gens qui défendent Ben Laden et applaudissent les attaques terroristes ! ([7] [42]) Le fait que plusieurs membres dirigeants de la clique qui entoure Bush, les "néoconservateurs" qui sont aujourd'hui les avocats les plus résolus et les plus explicites du "nouveau siècle américain", soient juifs (Wollbwitz, Perle, etc.) a apporté de l’eau à ce moulin, en lui donnant parfois une tournure de gauche. En Grande Bretagne récemment, il y a eu une controverse sur le fait que Tain Dalyell, figure "anti-guerre" de la gauche du Labour Party, a ouvertement parlé de l'influence du "lobby juif" sur la politique étrangère américaine et même sur Blair, et il a été défendu contre les accusations d'antisémitisme par Paul Foot du Socialist Workers Party qui a seulement regretté qu'il ait parlé de juifs et non de sionistes. Dans la pratique réelle, la distinction entre les deux est de plus en plus obscurcie dans les discours des nationalistes et du Jihad qui dirigent la lutte armée contre Israël. Dans les années 1960 et 70, l'OLP et les gauchistes qui la soutenaient, disaient qu'ils voulaient vivre en paix avec les juifs dans une Palestine détnocratique et laïque ; mais aujourd'hui, l'idéologie de l'Intifada submerge celle du radicalisme islamique et ne cache pas qu'elle veut expulser les juifs de la région ou les exterminer complètement. Quant au trotskisme, il a depuis longtemps rejoint les rangs du pogrom nationaliste. Nous avons déjà mentionné qu'Abraham Leon avait dit que le sionisme ne pouvait rien faire pour sauver les juifs de l'Europe dévastée par la guerre ; aujourd'hui, on peut ajouter que les juifs les plus menacés de destruction physique sont ceux qui se trouvent précisément sur la terre promise du sionisme. Non seulement le sionisme a bâti une immense prison pour les Arabes palestiniens qui vivent sous le régime humiliant de l'occupation militaire et de la violence brutale ; il a aussi emprisonné les juifs d'Israël eux-mêmes dans une horrible spirale de terrorisme et de contre-terreur qu'aucun "processus de paix" impérialiste ne semble capable d'arrêter.
Le capitalisme dans sa décadence a ranimé tous les démons de haine et de destruction qui ont toujours hanté l'humanité, et il les a armés avec les armes les plus dévastatrices qu'on n'ait jamais connues. Il a permis le génocide à une échelle sans précédent dans l'histoire et il ne montre aucun signe d'apaisement ;malgré l'holocauste des juifs, malgré les cris de "Plus jamais", nous assistons non ouvertement à un virulent renouveau d'antisémitisme, mais à des carnages ethniques à une échelle comparable à celle de l'Holocauste, comme le massacre de centaines de milliers de Tutsis au Rwanda en l'espace de quelques semaines, ou les séries continuelles de nettoyage ethnique qui ont ravagé les Balkans pendant lesa nnées 1990. Ce retour du génocide est une caractéristique du capitalisme décadent dans sa phase finale - celle de sa décomposition. Ces terribles événements nous donnent un aperçu de l'avenir que l'aboutissement ultime de la décomposition nous réserve : l'autodestruction de l'humanité. Et comme pour le nazisme dans les années 1930, ces massacres s'accompagnent des idéologies les plus réactionnaires et apocalyptiques sur toute la planète - le fondamentalisme islamique, fondé sur la haine raciale et le mysticisme du suicide, en est l'expression la plus évidente, mais pas la seule : nous pouvons également parlé du fondamentalisme chrétien qui commence à avoir de l'influence aux plus hauts échelons du pouvoir dans la nation la plus puissante du monde, de l'emprise croissante de l'orthodoxie juive sur l'Etat d'Israël, du fondamentalisme hindou en Inde qui, comme son jumeau musulman au Pakistan, détient des armes nucléaires, jusqu'au renouveau "fasciste" en Europe. Et nous ne devons pas non plus ôter de la liste la religion de la démocratie ; tout comme elle l'a fait pendant l'Holocauste, la démocratie aujourd'hui, cette bannière déployée sur les tanks américains et britanniques en Afghanistan et en Irak, s'est montrée être une face de la pièce dont les religions sont l'autre, plus ouvertement irrationnelles : une feuille de vigne pour la répression totalitaire et la guerre impérialiste. Toutes ces idéologies sont l'expression d'un système social qui a atteint une impasse totale et n'offre rien d'autre à l'humanité que la destruction.
Le capitalisme dans son déclin a créé une myriade d'antagonismes nationaux qu'il s'est montré incapable de résoudre ; il n'a fait que les utiliser pour poursuivre sa route dans la guerre impérialiste. Le sionisme qui n'a su poursuivre son but en Palestine qu'en se subordonnant d'abord aux besoins de l'impérialisme britannique, puis à ceux de l'impérialisme américain, est un clair exemple de cette règle. Mais contrairement à ce que proclame l'idéologie anti-sioniste, ce n'est absolument pas un cas particulier. Tous les mouvements nationalistes ont opéré exactement de la même façon, y compris le nationalisme palestinien qui a été l'agent de différentes puissances impérialistes, petites ou grandes, depuis l'Allemagne nazie jusqu'à l'URSS, en passant par l'Irak de Saddam, sans oublier certaines puissances modernes d'Europe. Le racisme et l'oppression nationale sont des réalités de la société capitaliste, mais aucun schéma d'autodétermination nationale ni de regroupement des opprimés en une foule de mouvements "parcellaires" (les noirs, les gays, les femmes, les-juifs, les musulmans, etc.) ne constitue une réponse au racisme et à l'oppression. Tous ces mouvements se sont avérés des moyens supplémentaires pour diviser la classe ouvrière et l'empêcher de voir sa véritable identité. Ce n'est qu'en développant cette identité, à travers des luttes pratiques et théoriques, que la classe ouvrière peut surmonter toutes les divisions dans ses rangs et se constituer en une puissance capable de prendre le pouvoir au capitalisme.
Cela ne signifie pas que toutes les questions nationales, religieuses, culturelles disparaîtront automatiquement dès que la lutte de classe aura atteint un certain degré. La classe ouvrière fera la révolution bien avant de s'être débarrassée du bagage des siècles, ou plutôt au cours même du processus où elle s'en défera ; et dans la période de transition au communisme, elle devra s'affronter à une foule de problèmes ayant trait à la croyance religieuse et à l'identité ethnique et culturelle au fur et à mesure qu'elle cherchera à unir l'humanité en une communauté globale. Il est vrai que le prolétariat victorieux ne supprimera jamais par la force les expressions culturelles particulières pas plus qu'il ne mettra la religion hors la loi ; l'expérience de la révolution russe a démontré que de telles tentatives ne font que renforcer l'emprise d'idéologies dépassées. La mission de la révolution prolétarienne, comme l'argumente avec force Trotsky, c'est de jeter les fondements matériels pour faire la synthèse de tout ce qu'il y a de mieux dans les différentes traditions culturelles de l'histoire humaine - pour créer la première culture vraiment humaine. Et ainsi nous revenons à Marx de 1843 : la solution de la question juive, c'est la réelle émancipation humaine qui permettra enfin à l'homme d'abandonner la religion en extirpant les racines sociales de l'aliénation religieuse.
Amos
[1] [43] Karl Marx, (Oeuvres, Editions Gallimard, Collection "Bibliotheque de la Pléiade", Tome III "Philosophie", page 347 et suivantes.
[2] [44] Abraham Léon était un juif né en Pologne qui a grandi en Belgique dans les années 1920-30. II a commencé sa vie politique comme membre du groupe précurseur "Socialiste Sioniste" Hashomair Hatzair, mais il a rompu avec le sionisme après les procès de Moscou qui l'ont poussé vers l'Opposition trotskiste. La profondeur et la clarté de son livre montrent que pendant cette période, le trotskisme étaittoujours un courant du mouvement ouvrier ; et meme si le livre a été écrit au montent où il était en train de cesser de l'être (au début des années 1940, pendant l'occupation allemande de la Belgique), les bases marxistes continuent d'y briller. Leon fut arrêté en 1944 et mourut à Auschwitz
[3] [45] Livre III, chapitrc XIII - Karl Marx, Oeuvres, Editions Gallimard, Collection "Bibliothèque de la Pléiade". Tome II "Economie".
[4] [46] Comme Leon le met en évidence, l'idée que les problèmes des juifs remontent tous à la destruction du temple par les romains et au fait qu'il s'en serait suivi une diaspora, constitue également un mythe ; en fait il existait déjà une importante diaspora juive dans l'antiquité, avant les événements qui ont présidé à la disparition finale de l'antique "patrie", juive.
[5] [47] En réalité, le sionisme était l'une des nombreuses forces bourgeoises à s'opposer au "sauvetage" des juifs d'Europe en Ieur permettant de fuir Amérique ou ailleurs, sinon en Palestine. Le héros sioniste David Ben Gourion l'a exprimé très clairement dans une lettre à l'Exécutif sioniste datée du 17 décembre 1938 : « le destin des juifs en Allemgne n’est pas une fin mais un début. D’autres Etats antisémites apprndront d’Hitler. Des millions de juifs sont confrontés à l’annihilation, le problème des réfugiés a pris des proportions planétaires et urgentes. La Grande-Bretagne tente de distinguer la question des réfugiés de celle de la Palestine… Si les juifs ont à choisir entre les réfugiés – sauver les juifs des camps de concentration – et aider un musée national en Palestine, la pitié aura le dessus et toute l’énergie du peuple sera canalisée dans le sauvetage des juifs de différents pays. Le sioniqme sera balayé, pas seulemnt dans l’opinion publuque mondiale, en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, mais aussi dans l’opinion publique juive. Si nous permettons de faire une séparation entre le problème des réfugiés et celui de la Palestine, nous mettons en jeu l’existence du sionisme. » En 1943 qunad l’holocuste battait son plein, Itzhak Greenbaum, directeur de l’agence juive du Comité de secours, écrivait à l’executif sioniste que : « Si on me demande de donner de l’argent de l’Appel juif uni (United Jewish Appeal) pour secourir les juifs ? Je réponds « Non et je rediis non ». A mon avis, nous devons resister à cette vague qui met les activités sionistes au second plan ». De telles attitudes - qui sont parfois arrivées jusqu'à la collaboration ouverte entre le nazisme et le sionisme - démontrent la "convergence" théorique entre le sionisme ct l'antisémitisme puisque tous deux ont en commun l'idée que la haine des juifs, est une vérité éternelle.
[6] [48] Shylock est un personnage dans la pièce de Shakespeare Le marchand de Venise. Il est représenté comme l'archétype du juif usurier, qui prête de l'argent au protagoniste de la pièce en exigeantd de son client "une livre de sa chair" comme garantie.
[7] [49] Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de conspiration autour du 11 septembre ; mais faire porter la faute à la catégorie fictive "Les juifs" ne sert qu'à couvrir la culpabilité d'une catégorie réelle, la bourgeoisie, et en particulier l'appareil d’Etat de la bourgeoisie américaine. Voir notre article sur cette question dans la Revue internationale n°108 : "les Tours jumelles, Pearl Harbour et le machiavelisme de la bourgeoisie".
Questions théoriques:
- Religion [50]
Heritage de la Gauche Communiste:
Notes pour une histoire du mouvement ouvrier au Japon, 2e partie
- 3371 lectures
Nous poursuivons ici la publication d’une courte étude sur l’histoire du mouvement révolutionnaire au Japon dont une première partie est parue dans la Revue internationale n°112. Le débat sur les moyens de la lutte
Les événements révolutionnaires de 1905 en Russie provoquèrent comme un tremblement de terre dans tout le mouvement ouvrier. Dès que les conseils ouvriers furent formés, dès que les ouvriers lancèrent les grèves de masse, l’aile gauche de la Social-Démocratie (avec Rosa Luxemburg dans son texte Grève de masses, Parti et syndicats, Trotsky dans son ouvrage sur 1905, Pannekoek dans plusieurs textes, notamment sur le parlementarisme) commença à tirer les leçons de ces luttes. L’insistance sur l’auto-organisation de la classe ouvrière dans les conseils, la critique du parlementarisme qui étaient mises en avant en particulier par Rosa Luxemburg et Pannekoek, n’étaient pas le résultat de lubies anarchistes mais une première tentative pour comprendre les leçons de la nouvelle situation à l’aube de la décadence du mode de production capitaliste et pour essayer d’interpréter les nouvelles formes des luttes.
En dépit de l’isolement international relatif des révolutionnaires au Japon, le débat sur les conditions et les moyens de la lutte qui se déroula aussi parmi eux, reflétait l'effervescence qui existait à l'échelle internationale dans la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires. De façon beaucoup plus claire qu’auparavant, deux tendances s’affrontèrent. D’un côté, la tendance autour de Kotoku qui exprimait de forts glissements anarchistes, puisque toute son insistance tournait autour de "l’action directe" : la grève générale et le syndicalisme révolutionnaire. Kotoku alla aux Etats-Unis en 1905/1906, prit connaissance des positions des IWW syndicalistes et établit des contacts avec les anarchistes russes. Le courant anarcho-syndicaliste publia le journal Hikari (La Lumière) à partir de 1905. De l’autre côté, Katayama défendait inconditionnellement la voie parlementaire au socialisme dans Shinkigen (Les Temps nouveaux). En dépit des divergences entre les deux ailes, elles fusionnèrent en 1906 pour former le Parti socialiste du Japon (Nippon Shakaito) qui, comme le proposait Katayama, devait lutter pour le socialisme "dans les limites de la Constitution". Le Parti Socialiste du Japon exista du 24 juin 1906 au 22 juillet 1907 et publia Hikari jusqu’en décembre1906.[1]
En février 1907, se tint le 1er Congrès du nouveau Parti socialiste au cours duquel plusieurs points de vues s’affrontèrent. Après avoir élu un délégué au Congrès de Stuttgart de la Deuxième Internationale, la discussion commença. Kotoku ne mâcha pas ses mots contre le travail parlementaire et revendiqua des méthodes d'action directe (chokusetsu kodo) : "Ce n’est pas par le suffrage universel et la politique parlementaire, absolument pas, que s’accomplira une vraie révolution ; pour atteindre les objectifs du socialisme, il n’y a pas d’autres moyens que l’action directe des travailleurs unis... Trois millions d’hommes qui se préparent pour les élections, cela ne sert à rien pour la révolution (car cela) ne représente pas trois millions d’hommes conscients et organisés..." Tazoe défendit la lutte sur le terrain strictement parlementaire, la majorité se prononça pour une résolution intermédiaire présentée par T.Sakai. Elle se contentait de retirer des statuts les termes "dans les limite de la Constitution". Dans le même temps, les membres avaient le libre choix de participer à des mouvements pour le droit de vote généralisé ou à des mouvements antimilitaristes et antireligieux. Les positions de Kotoku dégénérèrent vers l'anarchisme et il ne parvint pas à s'approprier la critique qui commençait à être développée par l’aile gauche de la Deuxième Internationale vis-à-vis de l’opportunisme de la Social-Démocratie, contre le parlementarisme et le syndicalisme.
Après ce débat, Kotoku qui se revendiqua de l'anarchisme à partir de 1905, agit de plus en plus comme un obstacle à la construction d’une organisation ; son point de vue empêchait surtout les éléments en recherche d'approfondir leur connaissance et leur compréhension du marxisme. Il voulait proposer la perspective de "l’action directe". Au lieu d'encourager l'approfondissement théorique des positions politiques, contribuant de la sorte à la construction de l’organisation, il était poussé vers un activisme frénétique. Dès que le Congrès fut terminé, le Parti socialiste fut interdit par la police.
Après un renouveau de grèves en 1907, il y eut un autre recul de la lutte de classe entre 1909 et 1910. Pendant ce temps, la police faisait la chasse aux révolutionnaires. Le simple fait d’être muni de drapeaux rouges était déjà considéré comme un délit. En 1910, Kotoku fut arrêté. Beaucoup de socialistes de gauche le furentégalement. En janvier 1911, Kotoku et onze autres socialistes furent condamnés à mort, sous le prétexte d’avoir voulu assassiner l’empereur. La presse socialiste fut interdite de même que les meetings, et les livres socialistes qu'on put trouver dans les librairies et bibliothèques furent brûlés. Confrontés à cette répression, beaucoup de révolutionnaires s’exilèrent ou se retirèrent de toute activité politique. La longue période de "l’hiver japonais" (fuyu) commença. Les révolutionnaires qui ne s’exilèrent pas et les intellectuels utilisèrent dorénavant une maison d’édition - Baishunsha - pour publier leurs textes mais dans des conditions d’illégalité. Afin d’échapper à la censure, les articles étaient écrits de façon ambiguë.
En Europe, la répression et l’imposition des lois anti-socialistes n’avaient pu empêcher la croissance de la Social-Démocratie (Cf. le cas du SPD ou même, avec une répression encore plus sévère, le cas du POSDR en Russie et du SdKPIL, en Pologne et Lituanie). Le mouvement ouvrier au Japon eut beaucoup de mal à se développer dans des conditions de répression et à se renforcer, de même qu’à être en mesure de former des organisations révolutionnaires fonctionnant avec un esprit de parti, c'est à dire dépassant les pratiques de cercles et le rôle prépondérant des individus qui avaient toujours un poids dominant dans le mouvement au Japon. L’anarchisme, le pacifisme et l’humanitarisme avaient toujours une grande influence. Ni au niveau programmatique, ni au niveau organisationnel, le mouvement ne put se hisser à un stade lui permettant de sécréter une aile marxiste significative. En dépit de premiers contacts avec la Deuxième internationale, il restait encore à établir des liens étroits avec elle.
Malgré ces spécificités, on doit cependant reconnaître que la classe ouvrière au Japon s’était intégrée à la classe ouvrière internationale et bien que n'ayant pas une longue expérience de lutte de classe ni les acquis programmatiques et organisationnels du mouvement révolutionnaire en Europe, elle s’affrontait quasiment aux mêmes questions et faisait montre de tendances similaires. En ce sens, l’histoire de la classe ouvrière au Japon s'apparente plus à celle de la classe aux Etats-Unis ou d’autres pays plus périphériques où une aile marxiste n’a pas réussi à s’imposer et où l’anarcho-syndicalisme jouait toujours un rôle majeur.
La classe ouvrière et la Première Guerre mondiale
Bien que le Japon ait déclaré la guerre à l’Allemagne en 1914 afin de s’emparer de ses positions coloniales (en quelques mois, le Japon conquit les avant-postes coloniaux allemands dans l’Océan pacifique et à Tsningtao (Chine), le territoire japonais ne fut jamais touché par les combats. Du fait que le centre de la guerre se situait en Europe, le Japon ne participa directement à celle-ci que lors de sa première phase. Après ses premiers succès militaires contre l’Allemagne, il s’abstint de toute nouvelle activité militaire et, d’une certaine façon, adopta une attitude de neutralité. Tandis que la classe ouvrière en Europe était confrontée à la question de la guerre de façon de plus en plus dramatique, celle du Japon était, elle, confrontée à un "boom" économique résultant de la guerre. En effet, le Japon étant devenu un grand fournisseur d’armes, il y avait une énorme demande de main-d’œuvre. Le nombre d’ouvriers d’usine doubla entre 1914 et 1919. En 1914, quelques 850 000 salariés travaillaient dans 17 000 entreprises, en 1919, 1 820 000 travaillaient dans 44 000 entreprises. Alors que les salariés masculins représentaient jusque là une faible part de la main-d’œuvre, en 1919, ils en représentaient 50%. A la fin de la guerre, il existait 450 000 mineurs. Ainsi la bourgeoisie japonaise tira de grands bénéfices de la guerre. Grâce aux débouchés gigantesques du secteur de l’armement pendant la guerre, le Japon put évoluer d’une société principalement dominée par le secteur agricole vers une société industrielle. La croissance de la production entre 1914 et 1919 fut de 78%.
De même, du fait de cette implication limitée dans la guerre du Japon, la classe ouvrière japonaise n’a pas eu à faire face à la même situation que celle d'Europe. La bourgeoisie n’eut pas à mobiliser en masse et à militariser la société comme cela fut le cas pour les puissances européennes. Cela permit aux syndicats japonais d'éviter d'avoir à créer une "union sacrée" avec le capital, comme ce fut le cas en Europe et d’être démasqués comme étant des piliers de l’ordre capitaliste. Tandis que les ouvriers en Europe étaient confrontés à la fois à la sous-alimentation et aux gigantesques massacres impérialistes causant 20 millions de morts, à la guerre de tranchées et à un terrible carnage dans les rangs de la classe ouvrière, tout cela fut épargné aux ouvriers japonais. C’est la raison pour laquelle il manqua au Japon cette impulsion constituée par la lutte contre la guerre qui radicalise le combat ouvrier, comme ce fut le cas en Europe, en Allemagne et en Russie plus particulièrement. Il n’y eut aucune fraternisation comme cela se produisit entre les soldats russes et allemands.
Un tel contraste dans la situation de différents secteurs du prolétariat mondial durant la Première guerre mondiale constitue une expression du fait que, contrairement à ce que les révolutionnaires pensaient à cette époque, les conditions de la guerre impérialiste ne sont pas les plus favorables pour le développement et la généralisation de la révolution mondiale
Les révolutionnaires en Europe qui mirent en avant une position internationaliste et des perspectives internationales peu après le début de la guerre et qui se rencontrèrent pendant l’été 1915 à Zimmerwald et plus tard à Kienthal, pouvaient se référer à la tradition révolutionnaire de la période d’avant la Première Guerre mondiale (la position des marxistes du 19e siècle, les résolutions de la Deuxième internationale aux Congrès de Stuttgart et de Bâle). A l'inverse, les socialistes du Japon devaient payer le prix de l’isolement et leur résistance internationaliste ne pouvait s’appuyer sur une tradition profonde, solidement ancrée sur le marxisme. Tout comme en 1904/1905, ce sont principalement les voix pacifistes et humanitaires contre la guerre qui se firent entendre. En effet, les révolutionnaires au Japon n'étaient pas en mesure de reprendre la perspective popularisée par l’avant-garde révolutionnaire à Zimmerwald s'appuyant sur l'analyse du fait que la Seconde internationale était morte, qu’une nouvelle Internationale devait être formée et que la guerre ne pouvait être stoppée qu’en transformant la guerre impérialiste en guerre civile.
Néanmoins, les révolutionnaires au Japon, qui étaient peu nombreux, surent prendre conscience de la responsabilité qui leur incombait. Ils firent entendre leur voix internationaliste dans les journaux qui étaient interdits,[2] ils se réunissaient secrètement et ils firent de leur mieux, malgré leurs forces limitées, pour diffuser les positions internationalistes. Si Lénine et les activités des Bolcheviks étaient à peine connus, par contre la position internationaliste des Spartakistes allemands et le combat courageux de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg reçurent beaucoup d’attention.[3]
Emeutes de la faim en août 1918
Même si le Japon avait connu un certain "boom" économique pendant et grâce à la guerre, l'entrée dans la période de décadence en 1914 était fondamentalement un phénomène à l'échelle mondiale avec des répercussions dans tous les pays, y compris ceux qui avaient été épargnés par les ravages de la Première guerre mondiale. Le capital japonais ne pouvait pas rester à l'écart de la crise permanente de surproduction, résultant de la saturation relative du marché mondial. De même, la classe ouvrière au Japon allait devoir confronter le même changement des conditions et des perspectives qui s'imposaient au prolétariat à l'échelle internationale.
Bien que les salaires aient augmenté dans tous les secteurs industriels de 20 à 30 %, à cause d'une pénurie de main d'œuvre, les prix grimpèrent entre 1914 et 1919 de 100%. Les salaires réels chutèrent globalement d’une base de 100 en 1914 à 61 en 1918. Ces augmentations des prix très importantes obligèrent la classe ouvrière à mener une série de luttes défensives.
Entre 1917 et 1918, le prix du riz doubla. Durant l’été 1918, les ouvriers commencèrent à manifester contre cette augmentation. Nous n’avons pas d’informations sur des grèves dans les usines ni sur l’extension de revendications à d’autres domaines. Apparemment des milliers d’ouvriers descendirent dans la rue. Cependant, ces manifestations ne débouchèrent pas sur une forme organisée plus marquée, ni sur aucune revendication ou objectif spécifiques. Des magasins semblent avoir été pillés. En particulier, les ouvriers agricoles et la main d’œuvre récemment prolétarisée, de même que les Burakumin (les exclus sociaux) semblent avoir joué un rôle très actif dans ces pillages. Beaucoup des maisons et d’entreprises furent mises à sac. Il semble n’y avoir eu aucune unification entre des revendications économiques et des revendications politiques. Contrairement au développement des luttes en Europe, il n’y eut aucune assemblée générale ni aucun conseil ouvrier. Après la répression du mouvement, quelques 8 000 ouvriers furent arrêtés. Plus de 100 personnes furent tuées. Le gouvernement démissionna pour des raisons tactiques. La classe ouvrière s’était soulevée spontanément mais, en même temps, le manque de maturation politique en son sein était d’une évidence dramatique.
Bien que les luttes ouvrières puissent surgir spontanément, le mouvement ne peut développer sa pleine force que s’il peut s’appuyer sur une maturation politique et organisationnelle. Sans cette maturation plus profonde, un mouvement s’effondre rapidement. Ce fut le cas au Japon : ces mouvements s’effondrèrent aussi vite qu’ils avaient surgi. Il ne semble pas non plus y avoir eu d’intervention organisée de la part d’une organisation politique. Sans l’activité obstinée des Bolcheviks et des Spartakistes, les mouvements en Russie et en Allemagne auraient capoté très vite. Au Japon, une telle intervention organisée a fait défaut de façon irrémédiable. Mais, malgré la différence des conditions en Europe et au Japon, la classe ouvrière dans ce pays allait faire un grand pas en avant.
L’écho de la Révolution russe au Japon
Lorsque, en février 1917, la classe ouvrière en Russie amorça le processus révolutionnaire et, en octobre, prit le pouvoir, ce premier soulèvement prolétarien réussi trouva également un écho au Japon. La bourgeoisie japonaise comprit immédiatement le danger que représentait la révolution en Russie. Dès avril 1918, elle fut une des premières à participer de la façon la plus déterminée à la mise sur pied d’une armée contre-révolutionnaire. Le Japon fut le dernier pays à retirer ses troupes de Sibérie en novembre 1922.
Mais alors que la nouvelle de la Révolution russe se propageait très vite de Russie vers l’Ouest, que le développement révolutionnaire en Russie avait un grand impact - en particulier en Allemagne - et menait à la déstabilisation des armées d’Europe centrale, cet écho fut très limité au Japon. Non seulement les facteurs géographiques contribuèrent à cet état de fait (plusieurs milliers de kilomètres séparaient le Japon du centre de la révolution, Pétrograd et Moscou) mais, surtout, la classe ouvrière au Japon avait été moins radicalisée pendant la guerre. Cependant, elle devait prendre part, à travers ses éléments les plus avancés, à la vague révolutionnaire de luttes internationales qui se déroula entre 1917 et 1923.
La réaction des révolutionnaires
Au début, les nouvelles de la Révolution russe se propagèrent très lentement et par fragments au Japon. Les premiers articles sur cet événement n’apparurent dans la presse socialiste qu’en mai et juin 1917. Sakai envoya un message de félicitations dans des conditions d’illégalité, message qui fut imprimé par Katayama aux Etats-Unis dans le journal des ouvriers immigrés Heimin (Commoners), dans le journal des IWW, Internationalist Socialist Review et, également; dans des journaux russes. Au Japon, Takabatake fut le premier à faire un compte rendu du rôle des soviets dans Baibunsha, mettant l’accent sur le rôle décisif des révolutionnaires. Cependant, le rôle que jouèrent les différents partis pendant la révolution n’était pas encore connu.
Le niveau d’ignorance sur les événements en Russie et sur le rôle des Bolcheviks peut être perçu à travers les premières déclarations des révolutionnaires les plus en vue. Ainsi, Arahata écrivait en février 1917 : "Aucun d’entre nous ne connaissait les noms de Kerensky, Lénine et Trotsky". Et pendant l’été 1917, Sakai parlait de Lénine comme d’un anarchiste et même encore en avril 1920, il affirmait que "le bolchevisme est en quelque sorte similaire au syndicalisme". Même l’anarchiste Osogui Sakae écrivait en 1918 que "la tactique bolchevique était celle de l’anarchisme."
Enthousiasmés par ce qui se passait en Russie, Takabatake et Yakamawa écrivirent un Manifeste (ketsugibun) en mai 1917 à Tokyo qu’ils envoyèrent au POSDR. Cependant, à cause du chaos dans les transports, il n’arriva jamais aux révolutionnaires de Russie. Comme il n’y avait pratiquement pas de contacts directs entre le milieu de révolutionnaires en exil (la plupart des éléments révolutionnaires émigrés à l’étranger vivaient, comme Katayama, aux Etats-Unis) et le centre de la révolution, le Manifeste ne fut publié que deux ans plus tard, au Congrès de fondation de l’Internationale communiste en mars 1919.
Ce message des socialistes japonais affirmait : "Depuis le début de la Révolution russe, nous avons suivi vos actions courageuses avec enthousiasme et une profonde admiration. Votre travail a eu une grande influence sur la conscience de notre peuple. Aujourd’hui, nous sommes indignés que notre gouvernement ait envoyé des troupes en Sibérie sous toutes sortes de prétextes. Cela est, sans aucun doute, un obstacle au libre développement de votre révolution. Nous regrettons profondément d’être aussi faibles pour contrer le péril qui vous menace à cause de notre gouvernement impérialiste. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit du fait de la persécution du gouvernement qui nous accable. Cependant, vous pouvez être assurés que le drapeau rouge flottera bientôt sur tout le Japon dans le proche avenir.
Parallèlement à cette lettre, nous vous joignons une copie de la résolution approuvée à notre réunion du 1e mai 1917.
Salutations révolutionnaires, le Comité Exécutif des Groupes Socialistes de Tokyo et Yokohama".
Résolution des socialistes japonais :
"Nous, socialistes du Japon, réunis à Tokyo le 1e mai 1917, exprimons notre profonde sympathie pour la Révolution russe que nous suivons avec admiration. Nous reconnaissons que la Révolution russe est à la fois une révolution politique de la bourgeoisie contre l’absolutisme médiéval et une révolution du prolétariat contre le capitalisme contemporain. Transformer la Révolution russe en une révolution mondiale n’est pas l’affaire des seuls socialistes russes ; c’est la responsabilité des socialistes du monde entier.
Le système capitaliste a d’ores et déjà atteint son stade de développement le plus élevé dans tous les pays et nous sommes entrés dans l’époque de l’impérialisme capitaliste pleinement développé. Afin de ne pas être trompés par les idéologues de l’impérialisme, les socialistes de tous les pays doivent défendre inébranlablement les positions de l’Internationale et toutes les forces du prolétariat international doivent être dirigées contre notre ennemi commun, le capitalisme mondial. C’est seulement ainsi que le prolétariat sera en mesure de remplir sa mission historique.
Les socialistes de Russie et de tous les autres pays doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la guerre et soutenir le prolétariat des pays en guerre pour retourner leurs armes, aujourd’hui dirigées vers leurs frères de l’autre côté des tranchées, contre les classes dominantes de leur propre pays.
Nous avons confiance dans le courage des socialistes russes et de nos camarades du monde entier. Nous sommes fermement convaincus que l’esprit révolutionnaire se propagera et imprégnera tous les pays.
Le Comité Exécutif du Groupe socialiste de Tokyo." (publié dans "Premier Congrès de l’Internationale communiste", mars 1919)
Résolution du 5 mai 1917 des socialistes de Tokyo-Yokohamma
"En même temps que la Révolution russe est, pour une part, une révolution politique effectuée par la classe montante commerciale et industrielle contre la politique du despotisme médiéval, elle est également, pour une autre part, une révolution sociale menée par la classe des gens du peuple (heimin) contre le capitalisme.
C’est pourquoi, en l’occurrence, il est de la responsabilité de la Révolution russe - et au même moment, de tous les socialistes du monde entier - d’exiger résolument la fin immédiate de la guerre. La classe des gens du peuple (zheimin) de tous les pays en guerre doit être rassemblée et sa puissance de lutte réorientée de sorte à être dirigée contre la classe dominante de son propre pays. Nous avons confiance dans la lutte héroïque du Parti socialiste russe et dans les camarades de tous les pays et nous attendons avec impatience le succès de la révolution socialiste".
Ces mêmes socialistes de Tokyo envoyèrent un télégramme à Lénine et une copie à l’USPD et au SPD d’Allemagne.
"Le moment de la réorganisation sociale du monde, quand notre mouvement sera reconstitué et quand, avec les camarades de tous les pays, nous travaillerons ensemble du mieux que nous pourrons, ce moment n’est probablement pas très éloigné. Nous espérons que dans cette phase critique de trêve et dans ces moments importants, nous pourrons vous contacter. En ce qui concerne la fondation d’une Internationale des socialistes qui est prévue prochainement, si nous le pouvons, nous vous enverrons une délégation et nous sommes en train de nous y préparer. Espérant la reconnaissance de notre organisation (Baibunsha), votre soutien et beaucoup de conseils...les représentants des socialistes de Tokyo vous saluent."
Ce message montre les orientations internationalistes, les efforts vers le regroupement et le soutien à la fondation d’une nouvelle Internationale. Cependant, il est difficile de dire quelles furent les préparations précises entreprises par Baibunsha à cette époque. Tandis que ce message fut intercepté par la police secrète et ne fut probablement jamais reçu par les Bolcheviks, le SPD et l’USPD le gardèrent secret et ne le publièrent jamais.
Comme en témoignent ces déclarations, la révolution agit comme une étincelle puissante sur les révolutionnaires. En même temps, l’impact de la révolution sur l’ensemble de la classe ouvrière du pays fut certainement plus faible. Contrairement à beaucoup de pays à l’ouest de la Russie (la Finlande, l’Autriche, la Hongrie, l’Allemagne etc..) où la nouvelle du renversement du Tsar et de la prise du pouvoir par les Conseils ouvriers avait provoqué un enthousiasme énorme et une vague de solidarité irrépressible, entraînant l’intensification des luttes des ouvriers "dans leur propres pays", il n’y eut pas de réaction directe parmi les masses ouvrières du Japon. A la fin de la Première Guerre mondiale, la combativité était en augmentation - cependant pas parce que la révolution avait débuté en Russie. La raison résidait plus dans un contexte économique : le boom des exportations pendant la guerre s’était rapidement tari après l'arrêt de celle-ci. La colère des ouvriers était dirigée contre l’augmentation des prix et une vague de licenciements. En 1919, 2 400 "conflits du travail", impliquant quelques 350 000 ouvriers, furent dénombrés, avec un léger déclin du mouvement en 1920, avec 1000 conflits impliquant 130 000 ouvriers. Ce mouvement subit un recul après 1920. Les luttes ouvrières restèrent plus ou moins cantonnées au terrain économique, il n’y eut pratiquement pas de revendications politiques. C’est la raison pour laquelle il n’y eut aucun conseil ouvrier, contrairement à l’Europe, ou même aux Etats-Unis et à l’Argentine où la Révolution russe avait inspiré les ouvriers de la Côte Ouest et de Buenos Aires en radicalisant leur mouvement.
Entre 1919 et 1920, quelques 150 syndicats furent créés et tous agirent comme un obstacle à la radicalisation des ouvriers. Les syndicats ont été le fer de lance et l’arme la plus pernicieuse de la classe dominante pour contrer la combativité montante. C’est ainsi qu’en 1920, la Labour Union League, Rodo Kumiai Domei, la Fédération nationale des syndicats, fut créée. Jusqu’alors, le mouvement syndical était divisé en plus de 100 syndicats.
Au même moment, un large "mouvement de la démocratie" fut lancé avec le soutien de la bourgeoisie en 1919, mettant en avant la revendication du droit de vote généralisé et une réforme électorale. Comme dans d’autres pays européens, le parlementarisme servit de bouclier contre les luttes révolutionnaires. Ce sont surtout les étudiants japonais qui furent les principaux protagonistes de cette revendication.
Le débat sur les nouvelles méthodes de lutte
Sous l’impulsion de la Révolution russe et de la vague de luttes internationale, un processus de réflexion se produisit également parmi les révolutionnaires au Japon. Inévitablement, ce processus de réflexion fut marqué par des contradictions. D’un côté les anarcho-syndicalistes (ou ceux qui se déclaraient tels) apportèrent leur adhésion aux positions des Bolcheviks puisqu’ils étaient les seuls qui avaient accompli avec succès une révolution visant à la destruction de l’Etat. Ce courant maintenait que la politique des Bolcheviks prouvait le bien fondé de leur rejet d’une orientation purement parlementaire (Gikau-sei-saku contre Chokusetsu-kodo line)
Lors de ce débat de Février 1918, Takabatake défendit l'idée que la question des luttes économiques et politiques était très complexe. La lutte pouvait inclure les deux dimensions - l’action directe et la lutte parlementaire. Le parlementarisme et le syndicalisme n’étaient pas les seuls éléments composant le mouvement socialiste. Takabatake s’opposa aussi bien au rejet par l’anarcho-syndicalisme de la "lutte économique" qu’à l’attitude individualiste d’Osugi. Alors que Takabatake, de façon très confuse, mettait sur le même plan "l’action directe" et le mouvement de masse, son texte faisait partie d’un processus général de clarification des moyens de la lutte à l’époque. Yamakawa soulignait que l’identification d’un mouvement politique avec le parlementarisme n’était pas valable. De plus il déclara : "je pense que le syndicalisme a dégénéré à cause de raisons que je ne comprends pas suffisamment."
Malgré l’expérience limitée et le niveau de clarification théorético-programmatique également limité de ces questions, il est important de reconnaître que ces voix au Japon étaient en train de remettre en cause les vieilles méthodes syndicales et la lutte parlementaire et qu’elles étaient à la recherche de réponses à la nouvelle situation. Cela démontre que la classe ouvrière était confrontée aux mêmes questions et que les révolutionnaires au Japon étaient aussi englobés dans le même processus, tentant de se confronter à la nouvelle situation.
Au Congrès de fondation du KPD allemand, les leçons de la nouvelle époque par rapport à la question syndicale et parlementaire commencèrent à être tirées bien que de manière tâtonnante. La discussion sur les conditions de la lutte dans la nouvelle époque était d’une importance historique mondiale. De telles questions ne pouvaient être clarifiées qu'à la condition qu'existent une organisation et un cadre de discussion. Isolé internationalement, sans organisation, le milieu révolutionnaire japonais ne pouvait qu'éprouver de grandes difficultés pour pousser plus avant la clarification. C’est pourquoi, il est d’autant plus important d’être conscient de ces efforts pendant cette phase de mise en cause des anciennes méthodes syndicales et parlementaires sans tomber dans le piège de l’anarchisme.
Les tentatives de clarification et de construction d’une organisation
La Révolution en Russie, les nouvelles conditions historiques de la décadence du capitalisme, le déploiement de la vague de luttes internationales mirent au défi les révolutionnaires au Japon. Il est évident que la clarification et la recherche de réponses à ces questions ne pouvaient avancer que s’il y avait un pôle de référence marxiste. La formation d’un tel pôle se heurta à de gros obstacles parce que sa pré-condition résidait dans une claire décantation entre une aile anarchiste, hostile à toute organisation révolutionnaire et une aile qui affirmait la nécessité d’une organisation révolutionnaire mais qui, cependant, était encore incapable d’entreprendre sa construction de façon déterminée.
Le milieu politique au Japon mit longtemps à se porter à la hauteur de la tâche du moment car il était entravé dans ses avancées par une tendance à se focaliser sur le pays lui-même. Il était également marqué par la prédominance de l'esprit de cercle et de personnalités en vue qui ne s'étaient approchées du marxisme que tout récemment et qui n'étaient que faiblement déterminées à construire une organisation de combat du prolétariat.
Ainsi, parmi les personnalités les plus connues (Yamakawa, Arahata et Sakai), Yamakawa était encore convaincu en 1918 qu’il devait écrire une "critique du marxisme". Cependant, lors de l’édition de mai de la New Society, Sakai, Arahata et Yamakawa affirmèrent leur soutien au Bolchevisme. En février 1920, ils firent un compte rendu de la fondation de l'Internationale communiste dans leur journal, la New Social Review (Shin Shakai Hyoron) - qui, en septembre 1920, changea son nom en Shakaishugi - Socialisme. Au même moment, ces révolutionnaires étaient très actifs dans les cercles d’études tels que la Friday Society (Shakai shugi kenkyu - Etudes socialiste) et la Wednesday Society (Shakai mondai kenkyu - études des problèmes sociaux). Leurs activités étaient moins orientées vers la construction de l’organisation que vers la publication de journaux qui furent pour la plupart éphémères et qui n’étaient pas structurellement rattachés à une organisation. Avec cet arrière-plan de confusions et d’hésitations sur la question organisationnelle chez les révolutionnaires au Japon, l'Internationale communiste elle-même allait jouer un rôle important dans les tentatives de construction d’une organisation.
(A suivre)
DA
1) En tout, 194 membres furent déclarés ; parmi eux, 18 commerçants, 11 artisans, 8 paysans, 7 journalistes, 5 employés de bureau, 5 docteurs, 1 officier de l’Armée du salut. Il y avait peu d’ouvriers. Les femmes n’étaient pas admises puisque l’interdiction pour elles de s’organiser était encore en vigueur. De plus, la majorité des membres avait moins de 40 ans. En janvier 1907, le quotidien Nikkan Heimin Shibun fut créé. Il réussit à se vendre en dehors de la région. Il fut d’abord diffusé à 30 000 exemplaires. Contrairement à Hikari qui servait d'organe central, il n’était pas considéré comme l’organe du Parti. En avril 1907, il cessa de paraître. Alors que de premières tentatives de présenter l’histoire de la Deuxième internationale dans le journal théorique furent entreprises, journal qui diffusait à quelques 2 000 exemplaires, le journal lui-même devint rapidement le porte-parole de l’anarchisme. A la différence des grands pays industriels européens, où le poids de l’anarcho-syndicalisme allait en décroissant avec le développement de l’industrialisation et de l’organisation des ouvriers dans la social-démocratie, l’influence de l’anarchisme était dans une dynamique ascendante au Japon de même qu’aux Etats-Unis.
2) Arahata et Ogusi publièrent, d’octobre 1914 jusqu'à mars 1915, le mensuel Heimin Shinbun ; d’octobre 1915 à janvier 1916, Kindai shiso, qui étaient des voix internationalistes.
3) Dans le journal Shinshakai, une page spéciale intitulée Bankoku jiji (Notes Internationales) était dédiée à la situation internationale. Même si le nombre d’exemplaires restait faible, beaucoup de nouvelles sur la trahison du SPD et les activités des internationalistes étaient données. La publication était imprimée avec des photos de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht en tant que représentants les plus prestigieux de l’internationalisme en Allemagne. Par exemple, les articles étaient intitulés : "Clara Zetkin arrêtée - La situation dans le Parti Socialiste français après l’assassinat de Jaurès - L’attitude de Kautsky et de Liebknecht au Reichstag par rapport au 4 août 1914 sur les crédits de guerre - La division du SPD - L’attitude du va-t-en-guerre Scheidemann et le neutre Kautsky - Les grèves et les soulèvements en Italie pendant la guerre - La libération de prison de Rosa Luxemburg - Sur la situation des prisonniers en Russie - Explications sur le Manifeste de Zimmerwald - Liebknecht arrêté - La 2e Conférence Internationale des Partis Socialistes à Kienthal et l’opportunité pour la Gauche de fonder une nouvelle Internationale - La minorité anti-guerre social-démocrate arrêtée à cause de sa propagande du "Manifeste de Zimmerwald" - La situation à la Conférence de Parti du SPD - La menace de grèves des cheminots américains."
Géographique:
- Japon [52]