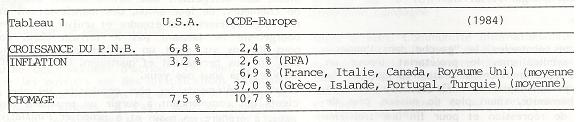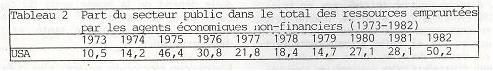Revue Internationale no 42 - 3e trimestre 1985
- 2649 lectures
Situation internationale : simultanéité des luttes ouvrières et obstacle syndical
- 2578 lectures
De la Grande Bretagne à 1'Espagne, du Danemark au Brésil et à l'Afrique du Sud, les luttes ouvertes de la classe ouvrière ne se ralentissent dans une pays que pour exploser plus violemment dans un autre la défaite des mineurs britanniques ne fut pas, comme celle des travailleurs polonais, suivie d'une période de reflux au niveau international.
C'est tout le sous-sol de l'ordre social capitaliste qui continue d'être lentement, mais systématiquement sapé et retourné par l'affirmation d'un mouvement de fond prolétarien. Un mouvement qui comme le montre les récentes grandes luttes ouvrières, tend de plus en plus à toucher les grands centres industriels de chaque pays (souvent encore relativement préservés). Un mouvement qui à travers des heurts de plus en plus répétés avec les appareils syndicaux, leurs stratégies de démobilisation et de démoralisation et avec leurs formes "radicales", "de base", se fraie un chemin en poussant de plus en plus ces combats vers l'extension et 1'auto-organisation.
PERSPECTIVES DE LA TROISIEME VAGUE DE LUTTE DE CLASSE
Nombre d'ouvriers, nombre de groupes révolutionnaires ont cru que la défaite de la grève des mineurs en Grande-Bretagne marquait la fin de l'actuelle vague internationale de lutte, vague que nous vivons depuis septembre 1983, depuis la grève du secteur public qui avait paralyse la Belgique pendant deux semaines. Ils ne voyaient pas de différence entre la défaite subie en Pologne en 1981 et la défaite dans la grève des mineurs en Grande-Bretagne. Il y a défaite et défaite. Le 13 décembre 1981 marquait le début d'une période de recul international de la lutte. Aujourd'hui, il n'en est rien. En plus, cette grève des mineurs dans le plus vieux pays capitaliste a porté un sérieux coup aux illusions colportées par le syndicalisme sur le corporatisme. Dans notre tract distribué dans dix pays sur les leçons de la grève des mineurs, nous soulignons que " la longueur de la lutte n’est pas sa force réelle. Face aux grèves longues, la bourgeoisie sait s’organiser : elle vient de le prouver. La véritable solidarité, la véritable force des ouvriers, c’est l’extension des luttes. " (C.C .I., le 8 mars 1985). Les mouvements de grève au Danemark et en Suède nous enseignent que le prolétariat est en train de tirer immédiatement les leçons.
Ces ouvriers et ces révolutionnaires étaient ainsi les victimes à la fois du silence presque complet des médias sur l'existence de mouvements et de grèves dans le monde entier, et à la fois de la propagande délibérée de l'ensemble des bourgeoisies nationales sur la prétendue absence de combativité ouvrière aujourd'hui.
Cette propagande est mensongère. Nous renvoyons le lecteur à toutes nos Revues Internationales de 1984, ainsi qu'aux différents journaux et revues territoriaux du CCI. Même s'il faut reconnaître que dans certains pays comme l'Italie et la France, le mécontentement ouvrier ne s'est pas vraiment exprimé depuis le printemps 1984. Nous y reviendrons.
Comme nous l'avons souvent déjà dénonce, la censure, le silence, le "black-out" de la presse bourgeoise sont presque totaux sur les grèves ouvrières. De plus en plus une des tâches des organisations révolutionnaires va être de fournir dans leur presse ces informations indispensables. Pour cela, il faut que ces mêmes organisations sachent reconnaître l'existence de cette troisième vague de lutte et obtenir des informations. Ces questions sont politiques. Pour la première, nous renvoyons le lecteur à l'article paru dans le dernier numéro de cette revue, sur la méthode. La seconde dépend de la capacité politique des groupes révolutionnaires à être de réelles organisations centralisées et internationales (Revue Internationale No 40, "10 ans du CCI.")
Jamais dans l'histoire du prolétariat, une telle simultanéité internationale de lutte n'a existe. Jamais. Pas même durant la vague révolutionnaire des années 1917-23. En l'espace d'un an, c'est tous les pays d'Europe occidentale (sauf peut-être la Suisse) qui ont vécu des luttes défensives ouvrières contre l'attaque généralisée du capitalisme. Ces luttes ouvrières ont lieu en même temps. A plusieurs reprises dans les mêmes pays, voire les mêmes secteurs. Elles ont les mêmes causes et les mêmes revendications. Elles se confrontent aux mêmes obstacles que leur opposent les différentes bourgeoisies : l'isolement et la division.
Cette similitude et cette simultanéité internationales des luttes ouvrières dégagent la perspective de la généralisation consciente de ces dernières dans les principaux pays européens. Perspective qui avait été si cruellement absente en 1980-81 et avait laissé la classe ouvrière isolée en Pologne. De la capacité du prolétariat à généraliser son combat dépend sa capacité future à passer à l'offensive contre les différents Etats capitalistes afin de les détruire et d'imposer sa dictature de classe et le communisme.
Nous n'en sommes pas là. Bien loin encore. Cependant, Si peu d'ouvriers en sont conscients, le chemin est déjà entrepris. Non pas dans la généralisation internationale même, mais dans les différentes tentatives encore timides d'extension et d'auto-organisation. Ou plutôt, dans l'effort d'organiser l'extension des différentes luttes, dans l'effort de rompre l'isolement et la division maintenus par les syndicats entre usines, corporations, villes, régions, entre jeunes et vieux, ouvriers avec encore du travail et ouvriers au chômage. Et c'est là que se trouve l'inévitable et nécessaire Chemin vers la généralisation internationale consciente des luttes ouvrières.
Dans la Revue Internationale No 37, nous avons su reconnaître la reprise de la lutte de classe qui venait d'avoir lieu. Nous en avons dégagé la signification par rapport à la défaite subie par le prolétariat en Pologne en 1981 et le recul international des luttes qui s'en est suivi. Nous en avions aussi relevé les caractéristiques qui se sont amplement vérifiées. Dans ces derniers mois et particulièrement en avril :
1) la tendance au surgissement de mouvements spontanés ne s'est pas démentie. En Espagne, à Valence (Ford), dans les postes à Barcelone, à Madrid, se sont déclenchés des mouvements qui ont surpris les syndicats. Dans les postes toujours, dans les mines encore, et dans d'autres secteurs, se sont déroulées des grèves sauvages, "illégales" contre l'avis des syndicats en Grande-Bretagne.
Mais c'est surtout la grève de 300 000 ouvriers au "petit" Danemark de 3 millions d'habitants, qui a le plus clairement exprimé cette tendance au surgissement de mouvements spontanés. Après l'appel du syndicat L.O. à reprendre le travail, 200 000 travailleurs restent en grève presque jusqu'à la mi-avril.
Autre confirmation de cette caractéristique, les surgissements spontanés de manifestations de chômeurs à Barcelone, et de comités de chômeurs en France. Ils sont encore isolés et peu nombreux, mais nous savons qu'ils vont se multiplier.
C'est toujours contre ou malgré les syndicats que surgissent ces mouvements spontanés. Et cela, malgré leur attention et leur "prévoyance", un an et demi après la reprise des luttes. Et cela, malgré la volonté syndicale d'occuper le terrain à coups de "journées d'action".. C'est dire la conscience croissante parmi les ouvriers de la nécessité de prendre l'initiative dès le début des grèves et des luttes, de ne pas la laisser dans les mains des syndicats.
2) la tendance à des mouvements de grande ampleur frappant tous les secteurs est elle aussi toujours présente. Evidemment, la meilleure illustration en est la grève au Danemark qui a paralysé tous les secteurs de la production. Au même moment, en Espagne, c'est dans l'automobile (Ford et Talbot), dans les chemins de fer, les chantiers navals, dans les postes, parmi les ouvriers agricoles, etc.
En Suède, en mai, ce sont 20 000 travailleurs de la fonction publique qui se mettent en grève. Un mois après le Danemark. 80 000 sont lock-outés. Une grande partie du pays est paralysée. Au même moment, de petits mouvements éclatent dans les usines automobiles, vite étouffés.
Au Brésil, 400 000 travailleurs ont pris part au mois de mars, d'avril et de mai, aux mouvements de grèves dans les usines d'automobiles et métallurgiques de Sao Paolo, dans les services publics et les transports.
Ces quelques exemples récents s'ajoutent aux précédents en Belgique, en France l'an dernier, à la Grande-Bretagne l'été passe, etc.
Au moment d'écrire cet article, depuis plusieurs jours, se poursuit aux Pays-Bas, une grève de quelques 150.000 travailleurs de la Construction, tandis que l'aéroport de Schipol-Amsterdam est bloqué par les aiguilleurs et les travailleurs au sol qui sont en grève. Le trafic est détourné sur Bruxelles-Zaventem où des menaces de grève se font aussi sentir. De plus en plus, la question qui se pose au prolétariat dans chaque pays est d'organiser et de coordonner ces luttes massives qui tendent à dépasser tout corporatisme et toute division.
3) la tendance à l'auto organisation et à l'extension s'affirme chaque fois davantage.
En Espagne, les ouvriers des postes à Barcelone et les ouvriers agricoles de Sagunto furent capables de produire des assemblées générales souveraines ouvertes à tous et en particulier aux groupes révolutionnaires. Mais dans la mesure où la principale fonction de ces assemblées -l'extension de la lutte- n'a pu se réaliser, celles-ci furent vidées de leur sang, de leur raison d'être, de leur caractère de classe, d'organe de lutte par les syndicats. Ce sont la C.N.T. (le syndicat anarchiste) et les Comisiones Obreras -CCOO- (syndicat du P.C.) qui finirent par prendre en main le comité de grève de Barcelone. Ce sont eux qui réussirent finalement à exclure le CCI. de l'assemblée générale alors que nous défendions la nécessité d'étendre la grève. Ce sont eux qui sabotèrent la grève en l'étouffant dans l'isolement.
C'est le même problème que n'avaient pas su résoudre les ouvriers des mines et des docks lors de la grève de ces derniers en solidarité avec celle des mineurs en Grande-Bretagne. C'était les syndicats qui avaient gardé le contrôle des assemblées et de l'"organisation" des grèves. Désorganisation plutôt.
Sans extension, l'auto organisation perd son sens et sa principale fonction aujourd'hui, et les assemblées sont vidées de leur contenu par les syndicats.
Par contre, au Danemark, c'est le problème inverse auquel s'est confronté le prolétariat. L'extension fut réalisée parfois par des meetings tenus par les ouvriers de différentes usines. Déjà, dès le 17 mars, juste avant l'éclatement de la grève à tous les secteurs, la section du CCI en Suède écrivait sur l'accélération des événements au Danemark "faisant face à une attaque terrible de leurs conditions de vie, la baisse des salaires et le chômage croissant (environ 14 %, mais beaucoup plus dans la région de Copenhague), les ouvriers du Danemark sont prêts à lutter. Le fait que les dockers, tout comme les conducteurs d 'autobus, victimes des manoeuvres de la bourgeoisie avec la social-démocratie dans 1'opposition lors des grèves de 193.2-84, ne soient pas défaits, mais bien au contraire aux premières lignes de la situation actuelle, confirme notre analyse de la présente période et, plus important encore dans la situation actuel le, le potentiel d'extension exprimé dans les différentes grèves de ces dernières semaines, et même dans le fait que la bourgeoisie se prépare à appeler a une grève générale de manière à s'opposer à la conscience de plus en plus généralisée au sein de la classe de la nécessité de lutter et d'étendre ses luttes." (17 mars 1983) Difficile de mieux prévoir !
Contrairement à l'Espagne, au Danemark l'extension et l'unification se sont dans un premier temps réalisées. Les ouvriers se sont alors heurtés à la difficulté de coordonner leur lutte, de la contrôler, de l'organiser au moyen d'assemblées générales, de comités de grève. Ils laissèrent les mains libres à la bourgeoisie, particulièrement au syndicalisme de base, aux fameux "tillidsmen" tenus par le P.C. ("hommes de confiance", équivalent des "shop-stewards" en Grande-Bretagne) pour désorganiser le mouvement, le dévier, remplacer les revendications initiales sur les salaires par "les 35 heures" et la "démission du gouvernement Schuter", de droite, jusqu'à freiner, puis détruire le début prometteur d'unification de la lutte.
C'est pour cela que le tract que le CCI a distribué le 8 avril à la grande manifestation à Copenhague appelait les ouvriers à"prendre 1'initiative afin de repousser la bourgeoisie qui veut briser l'unité grandissante des luttes ouvrières
Le seul moyen d'y parvenir est d'organiser la lutte eux-mêmes :
- en appelant à des assemblées massives dans les lieux de travail qui élisent des comités de grève responsables uniquement devant 1'assemblée et révocables s'ils n'appliquent pas les décisions de 1'assemblée;
- en envoyant des dé légat ions aux autres lieux de travail pour demander aux autres ouvriers de se joindre à la grève en prenant l'initiative de discussions communes sur les revendications et les besoins de la lutte."
Sans contrôle de l'ensemble des ouvriers en lutte sur leurs organes de combat dont ils se dotent, assemblées, piquets de grève, délégations, comités, pour regrouper et unifier l'ensemble des ouvriers, la bourgeoisie et ses syndicats reprennent pied, occupent le terrain et vident et les organes de lutte et les buts de la lutte et les revendications de leur contenu prolétarien, de leur contenu unificateur. Sans auto organisation, il ne peut y avoir de réelle et durable ex-tension, de réelle unification du combat prolétarien.
4) Nous avons déjà souligné l'existence et l'importance de la simultanéité des luttes d'aujourd'hui : Entre janvier et mai 198 5, c'est la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, où des dizaines de luttes contre les licenciements se déroulent, plus de 200 000 grévistes en Grèce, au Portugal ; 500 000 au Danemark et jusqu'à la Norvège et la Suède, après l'Islande en octobre où toute l'île fut paralysée durant plusieurs semaines par une grève générale de tout le secteur public.
Nous ne pouvons citer tous les pays européens où eurent lieu des mouvements significatifs et où la tension et la combativité sont grandes. Mais malgré le silence de la bourgeoisie, n'oublions pas les grèves ouvrières qui ont eu lieu en Afrique du Sud, au Chili, au Brésil.
La liste pourrait être encore plus longue, surtout si nous la reprenions depuis septembre 1983. Dans cette simultanéité internationale, le prolétariat répond au problème posé en 1981 par l'isolement du prolétariat en Pologne. "Comme en Pologne, la bourgeoisie va essayer d'isoler la lutte des ouvriers au Danemark." (tract du CCI au Danemark, le 8 avril 1983). La simultanéité des grèves ouvrières"exprime une prise de conscience de la classe de ses intérêts et constitue un pas vers la capacité d'unifier son combat internationalement."(Revue Internationale No 40). Avec la simultanéité nationale et internationale des luttes, l'extension et son organisation sont directement et concrètement réalisables. C'est pour cela que la bourgeoisie avec ses partis de gauche dans l'opposition et ses syndicats tente d'occuper le terrain social afin de tuer dans l'oeuf la moindre volonté d'unification des ouvriers en lutte. Ce combat contre les syndicats et la gauche, pour l'extension et l'unification des luttes ouvrières, va déterminer le développement de la perspective de généralisation internationale de ces luttes. Avec la simultanéité, cette généralisation trouve un terrain éminemment favorable.
5) Parmi les caractéristiques de la troisième vague que nous venons de voir, certaines se sont précisées. En particulier :
- de plus en plus, les grèves ont lieu dans les secteurs clé de l'industrie ; de plus en plus, dans les grandes concentrations ouvrières et dans les grandes villes ;
- les revendications tendent à devenir plus globales. Elles portent essentiellement sur les salaires et sur tout sur le chômage. Comme le notait notre section aux Pays-Bas dans un communiqué sur la lutte de classe dans ce pays,"la question du chômage est l'élément essentiel, crucial pour le développement des combats ouvriers. Tous les licenciements annoncés presque sans cesse poussent en permanence les ouvriers à se mettre en lutte."
6) Enfin la dernière caractéristique que nous avions mise en évidence s'est largement confirmée elle aussi: le rythme lent du développement des luttes.
Les ouvriers en Europe se trouvent être au centre de cette troisième vague de lutte ; même si les luttes du prolétariat des autres continents sont importantes, tant dans l'immédiat que pour le futur, même si ces luttes sur les autres continents s'intègrent tout à t'ait dans cette vague. Mais ce sont les ouvriers d'Europe occidentale qui l'ont déclenchée ; c'est eux qui en déterminent le rythme. Ils sont confrontés à l'éventail complet des mystifications bourgeoises et en particulier à la démocratique et à la parlementaire. C'est dans ces vieux pays d'Europe que la bourgeoisie a su le mieux se préparer à attaquer le prolétariat. Pour cela, elle a disposé ses principales forces de gauche (PS, PC, rejoignent les trotskystes et autres gauchistes) dans l'opposition sans responsabilité gouvernementale, leur permettant ainsi de dévoyer et de saboter les luttes de l'intérieur en se présentant comme les défenseurs des ouvriers (cf. Revue Internationale n°26).
Dans cette mesure, il ne fallait pas, et il ne faut toujours pas s'attendre à de brusques surgissements spontanés de la grève de niasse comme c'était arrivé en Pologne en 1980. Non. C'est au contraire à l'issue d'un processus long et difficile d'affrontement à la gauche dans l'opposition et aux syndicats, que le prolétariat sera capable de développer des grèves de masse et la généralisation internationale de son combat.
C'est donc à un rythme lent que se développent les luttes dans^ cette troisième vague. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Bien au contraire, si le rythme est lent, la profondeur de la réflexion, de la maturation de la conscience, de l'affrontement n'en est que plus certaine. A travers cette confrontation au cours des luttes contre la gauche et le syndicalisme, la classe ouvrière cherche la voie de son combat contre le capitalisme, elle commence à reconnaître ses ennemis et surtout ses faux amis, elle apprend à lutter et use les mystifications démocratiques et syndicales pour l'ensemble du prolétariat international. Sa conscience de classe s'étend et s'approfondit.
LE SYNDICALISME : LE FER DE LANCE DE L'ATTAQUE DU CAPITALISME CONTRE LA CLASSE OUVRIERE
1) Une stratégie de démobilisation
Une des principales armes qu'emploient les syndicats est l'arme des "journées d'action". Oh, non pas pour mobiliser les ouvriers sur des mystifications syndicales comme ils le faisaient dans les années 70. Non, ça ne marche plus d'ailleurs. Il s'agit pour la bourgeoisie d'occuper le terrain par ses syndicats, d'ôter toute initiative aux ouvriers, les déboussoler et les démoraliser en essayant de leur faire rentrer dans la tête que décidemment "la lutte ne paie pas".
Et pour cela, les journées d'action par secteur, par usine, ou par ville ou région - quand elles ne sont pas de grosses concentrations ouvrières- sont utilisées au maximum : un mécontentement, une menace de licenciement, une tension régnant quelque part, immédiatement les syndicats proposent pour "mobiliser", "préparer" et "étendre la lutte" une journée d'action à une date lointaine car "il faut se préparer sérieusement" ; et ils prévoient même parfois une manifestation, voire une marche sur la capitale, mais là aussi, à une date indéterminée et une fois précisée... repoussée une, deux fois, etc.. Ils convoquent à la "journée" sur des revendications catégorielles, ou ils appellent à la manifestation, et surtout aux "marches" sur les capitales en prenant bien soin de ne pas indiquer, ou seulement au dernier moment, l'heure et le lieu ! Ils s'assurent ainsi qu'aucun groupe d'ouvriers d'autres secteurs ne viendra rejoindre la manifestation. Ils s'assurent ainsi contre tout danger de regroupement ouvrier, d'unification et d'extension des luttes et des manifestations. Ils immobilisent ainsi, dans un premier temps, la classe ouvrière pour, dans un deuxième temps, faire croire que ce sont les ouvriers qui sont apathiques, qui ne sont pas combatifs. Ils tentent par cette stratégie d'entretenir dans la classe ouvrière un manque de confiance dans ses propres forces, une passivité qui permette de faire passer les attaques des conditions de vie. Et lorsque la lutte s'enclenche néanmoins ils préviennent le mouvement de masse par une"grève générale", ou une "journée d'action" qui parodient l'extension et sanctionnent la démobilisation des ouvriers.
Des exemples ?
En Espagne, lors des grèves dans les chantiers navals, dans les postes. Les CCOO du P.C. sont très efficaces dans cette tactique de démobilisation. En France, lors de la manifestation des ouvriers de Renault menacés de licenciements le 10 mai dernier.
Parfois ça ne marche pas : comme au Danemark où, après avoir "promis une grève générale" dont l'appel fut repoussé à plusieurs reprises, le syndicat L.O. appela à la grève une fois celle-ci inévitable, vu la combativité. Cette arme, étroitement liée à la tactique de la gauche dans l'opposition, est particulièrement efficace en France jusqu'à présent. Les syndicats réussissent ainsi à déboussoler et à démoraliser les ouvriers; ils renforcent leur apathie et leur passivité en pariant sur la méfiance croissante des ouvriers à l'égard de la gauche et des syndicats. Le PC et son syndicat la C.G.T. en France. Cette tactique réussit à paralyser momentanément le prolétariat dans ce pays malgré un mécontentement croissant et lourd de menaces pour la bourgeoisie de ce pays.
En Italie, c'est encore plus subtil. La bourgeoisie immobilise l'attention sur l'organisation par les syndicats, le PC et les gauchistes, d'un référendum sur l'échelle mobile des salaires. Il faut donc réunir d'abord les signatures nécessaires pour que le référendum ait lieu. Première campagne de déboussolement. Ensuite sur le vote au référendum proprement dit. Deuxième campagne !
Seuls le Parti Communiste Internationaliste ("Battaglia Comunista"), "Il Partito" de Florence et le CCI ont su dénoncer cette manoeuvre contre la classe ouvrière. Mais celle-là ne pourra éternellement détourner l'attention des ouvriers face à l'accentuation de la crise et face à l'existence et au développement des luttes dans tous les pays.
2) Nous avons déjà à maintes reprises dénoncé le danger du syndicalisme de base pour la classe ouvrière.
C'est avec un langage radical, "opposé" aux dirigeants "modérés" du T.U.C., le syndicat britannique, que Scargill, le chef du syndicat des mineurs (N.U.M.) a pu maintenir la grève dans la corporation, ce qui l'a menée à son échec. Et pour cela, il n'a pas hésité à employer la "violence" des piquets de grève contre les bobbies anglais, du moment que ces piquets ne cherchaient pas à rompre l'isolement dont souffrait la grève. II a même été jusqu'à se faire matraquer, pas trop quand même, et se faire arrêter, pas très longtemps non plus.
Ce sont les "tillidsmen", les délégués à la base, qui ont réussi à ramener et à éteindre la grève au Danemark sur le terrain syndicaliste et bourgeois. C'est la C.N.T. anarchiste qui a saboté l'extension de la grève des postes à Barcelone.
Grâce à son langage radical, gauchiste, parfois violent, grâce à son contrôle sur les organes de lutte dont se dotent les ouvriers, un des dangers du syndicalisme de base pour le prolétariat est de pouvoir accomplir une des priorités de la bourgeoisie aujourd'hui: empêcher par tous les moyens la politisation des luttes, interdire aux organisations révolutionnaires ainsi qu'aux ouvriers les plus combatifs, d'intervenir dans les luttes.
C'est ainsi que les syndicats se sont violemment opposés à ce que le CCI prenne la parole à l'usine d'automobiles Jaguar en Grande-Bretagne. C'est ainsi que le PC danois, contrôlant les "tillidsmen" tentait de répandre le bruit que les militants du CCI étaient des agents de la CI.A. C'est ainsi que la C.N.T. et les CCOO ont fini, au bout de plusieurs jours d'efforts, par nous expulser de l'assemblée générale lors de la grève des postes à Barcelone.
C'est ainsi que les trotskystes de la IVe Internationale ont fini par interdire l'accès au CCI du comité de chômeurs à Pau en France en nous menaçant, entre autres, d'appeler la police !
Enfin, le dernier aspect du sale boulot que jouent le syndicalisme de base et les gauchistes est la tentative d'encadrer les chômeurs en renforçant le rôle des syndicats de chômeurs là où ils existent déjà, en les créant là où ils n'existent pas : en Belgique, où le chômage est depuis longtemps particulièrement important ils agissent au sein des organismes syndicaux destinés aux chômeurs (ceux de la FGTB et d'autres syndicats); en France ce sont principalement les gauchistes, le P.C., qui essaient aujourd'hui de "noyauter" les comités de chômeurs qui commencent à surgir afin d'empêcher qu'ils deviennent des, comités ouverts à tous les ouvriers en lutte ; afin d'éviter qu'ils deviennent des lieux de regroupement ouvrier et de discussion politique ; afin surtout de saboter toute tentative d'unification et de centralisation de ces différents comités ; afin d'isoler les sans-travail du reste de leur classe et les rendre impuissants dans leur combat quotidien à travers leurs revendications pour simplement manger et survivre.
QUE FAIRE ?
Malgré tous ces obstacles, la "gauche dans l'opposition" et le syndicalisme, le prolétariat trouve un "allié" dans l'approfondissement catastrophique de la crise économique du capitalisme. Celui-ci n'a plus rien à offrir à l'humanité, sinon plus de misère, plus de famine, plus de répression et pour fin une troisième guerre mondiale.
Le prolétariat n'est pas battu. L'actualité de cette troisième vague de lutte, sa dynamique, nous le prouvent amplement. Face à la terrible attaque qu'il subit, le prolétariat se doit de développer une réponse qui fasse peur à la bourgeoisie, une réponse qui inverse le rapport de force qui lui est aujourd'hui défavorable, une réponse qui lui permette de s'opposer réellement à l'appauvrissement universel et absolu que lui impose le capitalisme, une réponse qui lui ouvre la perspective de la généralisation internationale de sa lutte. C'est pour cela qu'il se doit de bien reconnaître qui sont ses ennemis, comment il doit les combattre et vers où le mène son combat. C'est tout le sens de la "politisation" de ses luttes.
Le prolétariat ne doit pas laisser l'initiative à la bourgeoisie, à ses partis de gauche et aux syndicats qui vont organiser l'isolement et la défaite. C'est aux ouvriers de prendre l'initiative. "Mais pour accomplir une action politique de masse, il faut d'abord que le prolétariat se rassemble en masse ; pour cela, il faut qu'il sorte des usines et des ateliers, des mines et des hauts-fourneaux et qu'il surmonte cette dispersion et cet éparpillement auquel le condamne le joug capitaliste."(Rosa Luxemburg, "Grève de masse, parti et syndicats"). C'est aux ouvriers à prendre l'initiative de la grève, des assemblées, des délégations aux autres usines, des comités de chômeurs, de leur union, des manifestations et des meetings ouvriers pour étendre et unifier les luttes. La bourgeoisie ne laissant pas le terrain libre, comme nous l'avons vu, c'est un combat qui va devenir de plus en plus permanent et quotidien. Cette bataille se déroule déjà sous nos yeux.
C'est aux éléments les plus combatifs, les plus conscients qui commencent à surgir un peu dans tous les pays, à prendre en main et à proposer l'initiative du combat prolétarien à l'ensemble de leur classe.
C'est aux organisations révolutionnaires qu'échoit "le devoir comme toujours de devancer le cours des choses, de chercher à le précipiter" disait Rosa Luxemburg, car elles sont appelées à en prendre de plus en plus la "direction politique". C'est pour cela que les ouvriers les plus combatifs, les groupes communistes doivent mener cette bataille politique quotidienne dans les usines, dans les assemblées, dans les comités, dans les manifestations. C'est pour cela qu'ils doivent s'imposer contre les manoeuvres des syndicats. C'est pour cela qu'ils doivent mettre en avant et défendre les revendications et les propositions de marche concrètes et immédiates qui vont dans le sens de l'extension, du regroupement et de l'unification des luttes.
De l'issue de cette bataille dépend la capacité du prolétariat à "accomplir une action politique de masse" qui fasse reculer momentanément la' bourgeoisie dans son attaque contre le prolétariat, et surtout, qui ouvre, grâce à la généralisation internationale de son combat, la perspective de l'assaut révolutionnaire du prolétariat contre le capitalisme, de sa destruction et de l'avènement du communisme. Pas moins.
26.3.83 R.L.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
Où en est la crise économique? : L’entrée dans la récession
- 3070 lectures
L'année 1984 s'est terminée en fanfare pour la capitalisme américain avec la réélection de Reagan à la présidence des Etats-Unis. Pendant toute sa campagne électorale, celui-ci a pu se targuer d'avoir vaincu la crise économique, d'avoir vaincu l'inflation revenue à 3,2 % en 1984, d'avoir résorbé le chômage en le ramenant de 9,6 % en 83 à 7,3 % en 84, d'avoir revitalisé la production avec un taux de croissance record de 6,8 % toujours en 84, et enfin d'avoir restauré la suprématie du roi-dollar dont le cours a culminé a clés sommets jamais atteints. On a ainsi vu s'orchestrer une grande messe à la gloire du capitalisme américain, à sa puissance, à sa santé, pour faire croire qu'enfin, après des années d'échec, la politique économique du matamore Reagan, les fameuses "Reaganomics" étaient la solution enfin trouvée à la crise économique mondiale qui, depuis deux décennies, fait de plus en plus gravement sentir ses effets sur l'économie planétaire.
Le capitalisme américain est puissant, nul ne peut le nier : pas simplement par la puissance de ses armes, mais surtout par la puissance de son économie qui contrôle la plus grande partie de l'économie mondiale. Les USA sont le premier producteur qui fournit 20 à 23 % du total de la production mondiale ; ils sont aussi le premier marché, la principale puissance financière dont la monnaie s'est imposée aux capitalistes du monde entier et avec laquelle se font 80 % des échanges mondiaux, et qui en 1982 constituait 11% des réserves de devises des grandes banques centrales des pays industrialisés. L'ensemble de l'économie mondiale dépend de la bonne santé du capitalisme américain, et si le capitalisme américain est puissant, par contre il est en mauvaise santé, et l'économie mondiale avec lui.
L'euphorie électorale passée, plus question de taux de croissance record du PNB pour 1983. Le ton a changé à Washington, le nouveau mot d'ordre de l'administration Reagan est : "il faut que l'économie américaine atterrisse en douceur." Dans la mesure où un "atterrissage" de l'économie américaine signifie un "atterrissage" de l'économie mondiale, et que nous sommes tous les passagers de cet avion là, on ne peut que se demander ce que signifie cette annonce du pilote.
Pour quelles raisons faut-il atterrir?
Si l'économie américaine se porte si bien que l'a prétendu Reagan, pourquoi faut-il qu'elle atterrisse maintenant ? Les effets de la reprise américaine se sont à peine fait sentir sur l'économie européenne (Voir Tableau 1), alors que les pays sous-développés ont continué à voir leur économie s'effondrer systématiquement.
La reprise américaine n'a pas été une reprise mondiale, elle aura été brève ; c'est en fait une reprise avortée.
Cette situation montre, par rapport aux années 70, une très forte dégradation de l'économie mondiale. Les USA sont aujourd'hui incapables de répéter ce qu'ils avaient pu faire dans le passé : relancer provisoirement l'économie mondiale, jouer le rôle de locomotive. Aucune politique économique ne peut aujourd'hui permettre au capitalisme de masquer longtemps ses contradictions. La reprise américaine n'a pu se faire que par un endettement pharamineux des USA dont la dette publique dépasse aujourd'hui les 1500 milliards de dollars, et la dette cumulée de l'Etat, des entreprises et des ménages, le chiffre astronomique de 6000 milliards de dollars (2 fois le PNB annuel des USA), tandis qu'en 1985 les investissements étrangers aux USA deviennent supérieurs aux avoirs américains à l'étranger, les USA devenant ainsi débiteurs vis-à-vis du reste du monde. (Voir Revue Internationale n°41, "Dollar : le roi est nu"). Mais même les déficits budgétaires et commerciaux gigantesques accumulés par les USA ne sont pas suffisants pour résorber le trop-plein de surproduction de l'économie mondiale. Et cette politique, les USA ne peuvent continuer à la mener sans risquer rapidement une crise monétaire catastrophique autour du dollar. Il faut atterrir d'urgence, les USA ne peuvent maintenir leur taux de croissance, ils ne peuvent continuer à s'autoriser de tels déficits budgétaires et commerciaux. L'avion n'a plus beaucoup de carburant et ses moteurs fonctionnent mal.
UN SEUL TERRAIN D'ATTERRISSAGE : LA RECESSION MONDIALE
Dans la situation de marasme dans laquelle se trouve l'économie mondiale, une chute ou un arrêt de la croissance aux USA ne peut signifier qu'une plongée dans une récession mondiale profonde et durable : les pays sous-développés se sont toutes ces années enfoncés dans la récession sans issue pour en sortir. L'Europe et le Japon n'ont pu maintenir une croissance tout à fait relative que par l'ouverture du marché américain ; si celui-ci se contracte, ils seront les premiers touchés et menacés de voir leurs exportations, et donc leur production s'effondrer.
L'atterrissage dont nous parle le pilote va se faire sur un terrain en pente, sur la pente de la récession. Lors de la précédente récession, la production américaine avait chuté de 11 % entre1981et 1982. Mais le pilote se veut rassurant, il nous annonce un "atterrissage en douceur".
Un atterrissage en douceur?
"Tout va bien" nous dit-on, mais les passagers commencent à être inquiets. Ces derniers mois ont vu le dollar jouer au yoyo, varier de plus de 10 % en quelques mois ; les faillites bancaires aux USA se sont multipliées et, comme en 1929, les épargnants paniques ont fait la queue devant les guichets fermés. Le temps est à la tourmente, l'avion est secoué. Pour le premier trimestre 85, les économistes de Washington prévoyaient un taux de croissance en baisse à 3 %. Après de constantes évaluations en baisse - 2,8 %, 2,1 %, 1,6 % - le gouvernement américain a du annoncer en mai un taux de croissance de 0,7 % pour le 1er trimestre 85, en rythme annuel. Le pilote navigue à vue, il ne sait trop où il va.
De plus, on ne peut qu'avoir quelques doutes sur sa capacité à piloter. L'échec de la reprise à la Reagan marque l'impuissance de la bourgeoisie face à la crise économique mondiale de surproduction. Les recettes de Reagan, malgré toute sa propagande, ne sont pas nouvelles, ce sont celles du capitalisme d'Etat : réduction des impôts pour relancer la consommation intérieure, grands programmes d'armement pour relancer l'industrie (195 milliards de dollars en 83, 184 en 84). Pour atténuer les secousses de la crise économique, pour empêcher l'effondrement de pans entiers de la production, l'Etat présidé par Reagan est obligé, comme tous les autres, d'intervenir de plus en plus fréquemment et de contrôler de plus en plus étroitement les processus économiques (Voir Tableau 2). Contrairement à tous ses discours, Reagan a quasi nationalisé la Continental Illinois en faillite, et subventionné l'agriculture américaine avec un budget de 2 milliards de dollars. Mais ces recettes éprouvées depuis 40 ans ne suffisent plus pour éviter la récession, l'effondrement de l'économie mondiale.
Reagan veut un "atterrissage en douceur", mais cette "douceur" signifie pour le prolétariat 5u monde entier encore plus de misère, encore plus de chômage. Dans la situation de combativité de la classe ouvrière aujourd'hui, avec l'aggravation de la situation économique, la situation sociale va devenir explosive. On comprend dans ces conditions que la bourgeoisie freine le plus possible cette plongée dans la récession, qu'elle veuille cet "atterrissage en douceur". Mais comment y parvenir ? La question qui se pose aux économistes du monde entier, ce n'est plus : comment sortir de la crise ; mais : comment y plonger le plus doucement possible.
Aujourd'hui, Reagan fait appel à ses alliés européens et japonais pour qu'ils relancent leur économie afin de contrebalancer les effets de la baisse de croissance américaine sur l'économie mondiale. Mais cette mesure ne peut être qu'un palliatif provisoire de plus, car c'est tout ce qui reste au capitalisme mondial ; freiner de toutes ses forces l'arrivée de l'inéluctable, la plongée accélérée dans une récession comme l'humanité n'en a pas encore connue.
Freiner la récession revient pour tous les Etats à s'endetter encore plus. Une telle politique, conjuguée avec la récession qui jette les ouvriers au chômage, plonge les entreprises dans la faillite, met les Etats en cessation de paiement, ne peut mener qu'à une explosion de l'inflation. Aujourd'hui, cette inflation continue à faire des ravages à la périphérie du capitalisme, dans les pays les moins développés, et ces derniers mois ont vu dans les pays les plus développés, qui croyaient l'avoir jugulé, son taux remonter : ainsi aux USA, si en 1984 l'inflation a été de 3,2 %, d'avril 84 à avril 85, elle a été de 3,7 %.
L"'atterrissage" dans la récession ne peut qu'avoir lieu, mais ils ne se fera pas "en douceur". Nul économiste de la bourgeoisie n'ose prévoir les conséquences de la fin de la reprise aux USA. Elles sont catastrophiques : chômage, misère, faillites, inflation. Mais si elles sont catastrophiques pour l'économie capitaliste, c'est d'abord sur le plan politique : l'aggravation des conditions de vie qui en découle pour la classe ouvrière ne peut que signifier une accentuation de la reprise de la lutte de classe qui se développe depuis l'automne 83. Avec l'effondrement de l'économie capitaliste, c'est, vu la combativité actuelle du prolétariat, la perspective révolutionnaire qui s'annonce comme seule alternative réelle.
JJ. 9/6/85.
Récent et en cours:
- Crise économique [3]
Chômage massif et extension de la lutte de classe
- 2882 lectures
Impitoyablement, le chômage fauche aujourd'hui des millions d'existences et s'impose comme le phénomène le plus important et marquant de la vie sociale dans tous les pays. Les mois et années à venir ne verront que se confirmer cette hémorragie.
Les grandes vagues de licenciements alimentent cette progression du chômage dont il y a quelques années, dans les pays industrialisés, l'arrivée sur un marché du travail bouché des jeunes générations était encore la principale source. Ces grandes vagues de licenciements n'épargnent aucune couche de la population ouvrière. Ouvriers d'industrie et employés, techniciens ou main d'oeuvre non qualifiée, jeunes ou adultes, hommes ou femmes, immigrés ou non. Le chômage pénètre ainsi toute la vie sociale et lui impose sa marque de fer rouge. Des millions de personnes se retrouvent directement sous sa coupe, des millions d'autres en vivent quotidiennement la menace, tous en subissent la pression.
Cette situation de chômage massif qui, loin de régresser dans les mois et années qui viennent, va se développer à un rythme soutenu, conduit irrésistiblement à une paupérisation absolue de toute la classe ouvrière. Ce chômage massif est la manifestation la plus aiguë et directe de la crise historique du capitalisme. Il en exprime de façon nette et tranchée la nature et les causes, crise de surproduction, en l'occurrence, surproduction de force de travail, crise où le rapport capitaliste du travail salarié se révèle trop étroit pour contenir toutes les richesses produites par le travail des générations passées et présentes,et qu'il promet ainsi à la destruction y compris la "force de travail", source de toutes les richesses.
Manifestation la plus criante de la crise historique du capitalisme, ce chômage massif et chronique qui gangrène en largeur et profondeur toute la vie sociale n'est pas une "première" historique. Avant d'être "résorbé" par la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes dans la seconde guerre mondiale, il a aussi profondément marqué toute la période des années 20 jusqu'à la fin des années 30 .
Contrairement à toutes les idées reçues et curieusement entretenues par l'idéologie dominante, la profonde démoralisation, démobilisation et finalement soumission de la classe ouvrière à tous les embrigadements fascistes, staliniens ou démocratiques, n'est pas à mettre sur le compte des chômeurs "toujours prêts à se jeter dans les bras de la première dictature venue", mais sur celui de la profonde contre-révolution et de la trahison des organisations politiques du prolétariat qui a accompagné cette puissante contre-révolution. Même durant ces années, le chômage a, malgré tout, déterminé de grandes luttes, en France et aux USA,par exemple. Mais l'époque n'étant plus à la révolution, mais à la guerre, ces luttes ont finalement été dévoyées grâce aux organisations politiques staliniennes et social-démocrates, dévoiement grandement facilité par un développement gigantesque du capitalisme d'Etat avec les politiques de grands travaux et de réarmement massif.
Aujourd'hui, le chômage massif fait sa réapparition, mais dans un contexte totalement différent, et dans cette situation radicalement différente- des années 30 où le joug de la contre-révolution n'écrase plus la classe ouvrière, la lutte des chômeurs qui commence à poindre, menace de contribuer grandement au bouleversement gigantesque de tout l'ordre social établi. Et ce n'est sûrement pas la maladresse avec laquelle s'expriment les premiers mots d'ordre et les premières revendications de cette lutte qui nous amèneront à penser le contraire, car comme le disait K.Marx, en tirant le bilan des révolutions de 1848 :
"Dans le premier projet de constitution rédigé avant les journées de juin, se trouvait encore le droit au travail, première formule maladroite où se résument les exigences révolutionnaires du prolétariat On le transforma en droit à l'assistance Or, quel est l'Etat moderne qui, d'une manière ou d'une autre, ne nourrit pas ses indigents ! Le droit au travail est au sens bourgeois un contresens, un désir vain, pitoyable; mars derrière le droit au travail, il y a le pouvoir sur le capital; derrière le pouvoir sur le capital, l'appropriation des moyens de production, leur subordination à la classe ouvrière associée, c'est à dire la suppression du salariat, du capital et de leurs rapports réciproques. Derrière le droit au travail, il y avait l'insurrection de juin" (K. Marx. "Les luttes de classe en France", Ed. Sociales, p.81)
L'IMPACT DU CHOMACE
Le chômage est un signe particulièrement distinctif du mode de production capitaliste, et d'une manière ou d'une autre, à chaque stade de son évolution historique, il s'est imposé comme un situation inhérente à la condition ouvrière. Lors de l'apparition du capitalisme, au sortir du mode de production féodal, lors de son développement ultérieur avec la réalisation du marché mondial, durant toute la période de décadence, époque des grandes crises, guerres mondiales et révolutions, que nous vivons.
Mais, si le chômage est inhérent à la condition ouvrière où le travail prend la forme de marchandise "force de travail" qui s'achète et se vend en échange d'un salaire selon les conditions du marché, on ne peut tirer de cette vérité générale, que de tout temps, le chômage a toujours eu la même signification, le même impact et les mêmes déterminations sur la classe ouvrière, sa conscience et sa lutte.
Le chômage des centaines de milliers de sans-travail dans toute l'Europe de la fin du féodalisme, où serfs, paysans, artisans étaient arrachés à leurs conditions, moyens de travail, de subsistances, avec lesquels ils faisaient corps, par l'avènement et le développement du machinisme et de la manufacture, n'a déjà pas la même signification et le même impact que le chômage qui s'impose lors de la marche en avant du machinisme et de la grande industrie. Dans cette période historique qui s'étend grossièrement de 1830 à 1900, on assiste à un chômage permanent certes, toujours- alimenté par la paupérisation de paysans et d'artisans, mais à une échelle bien plus limitée qu'au début du 19ème siècle, ainsi qu'à un chômage limité à certaines corporations ou branches d'industrie, dû aux crises passagères et ponctuelles limitées à ces branches d'industrie.
Avec la première guerre mondiale, la crise généralisée et permanente de l'ensemble du mode de production capitaliste, qui n'épargne aucun pays, aucune corporation et branche d'industrie détermine un chômage d'u ne autre signification et d'une autre sorte au sein de la population ouvrière. Ce chômage dont les caractéristiques sont propres à notre période de décadence est bien plus différent des autres formes antérieures du chômage que celles-ci ne le sont entre elles.
Le chômage enfanté par les secousses de la crise mondiale du capital tend premièrement à devenir permanent. Mis à part les périodes de guerre où les ouvriers, comme le reste de la population, sont occupés soit à s'entretuer ou à produire les armes nécessaires aux massacres, le chômage massif domine la condition ouvrière : de 1920 à 1940, 20 ans de chômage généralisé dans tous les pays industrialisés. L'immense boucherie de la seconde guerre mondiale avec ses 50 millions de morts et plus, et l'occupation des bras qui restaient valides après la guerre pendant la reconstruction d'un monde ravagé par les destructions, ne permettra de repousser la question du chômage que pour une dizaine d'années, ou guère plus. Dès la fin des années 60, le chômage, comme problème de fond,fait sa réapparition et il ne sera contenu et cantonné à la jeunesse pendant les années 70 que par le faux fuyant économique des politiques inflationnistes d'endettement généralisé des années d'illusions. Aujourd'hui, la crise reprend tous ses droits, s'impose, et le chômage à nouveau, explose littéralement.
C'est dans ces conditions que la question du chômage acquiert ne signification différente pour le développement de la conscience de classe et la lutte de classe, signification très différente de celle qui dominait au siècle dernier.
Au siècle passé, la conscience que pouvait déterminer le chômage au sein de la classe ouvrière ne pouvait qu'être très limitée. Jamais, à cette époque, le chômage n'apparaît comme une situation irréversible. Le chômage est extrêmement cruel pour la classe ouvrière lorsqu'elle est atteinte, mais l'époque, est, elle, totalement différente. Le capitalisme bouleverse constamment les conditions de la production; dans chaque crise, il tire une énergie nouvelle, en sort renforcé pour continuer sa marche triomphale à travers le monde. Une grande partie des chômeurs, ou anciens paysans sont aspirés dans le sillage de cette marche triomphale. C'est l'époque de la colonisation où des centaines de millions de personnes émigrent vers des continents gigantesques : Amérique, Afrique, Asie... A côté de l'émigration massive de populations d'Europe, l'origine sociale des chômeurs, serfs, paysans, ou artisans permet aussi souvent à la bourgeoisie de se servir de cette masse de chômeurs pour faire une pression générale sur l'ensemble de la classe ouvrière, ses conditions de travail et d'existence et ses salaires, voire les employer comme "jaunes" et briseurs de grèves. Même s'il s'agissait du chômage produit par une crise dans une branche d'industrie déterminée, le cloisonnement, sinon l'opposition qui régnait entre les différentes branches d'industrie, rendait l'impact du chômage sur toute la classe ouvrière et sa conscience très limité. De même, quand il s'agissait du "volant de chômage" ou "armée de réserve industrielle", la pression sur les salaires qui en résultait, ne permettait pas plus à cette forme de jouer un rôle particulièrement positif dans l'unification et le développement de la conscience de classe de la classe ouvrière. Mis à part la grande crise de 1847 qui n'épargna aucune catégorie ou secteur ouvrier, et le mouvement ludiste durant les tous premiers développements du machinisme, les chômeurs et le chômage en général, ne furent pas amenés à jouer un rôle particulier dans l'avancée de la lutte de classe du siècle dernier.
Cette situation change radicalement avec l'ouverture et la course effrénée de la décadence du capitalisme. Les chômeurs, dans leur immense majorité, ne sont plus des anciens paysans ou artisans, mais des ouvriers ou employés, qui, depuis des générations étaient insérés dans la production industrielle. Ce n'est plus une catégorie ou une corporation particulière, où les ouvriers sont victimes du chômage, mais toutes, comme c'est le cas pour toutes les villes, régions, pays. Ce chômage n'est plus conjoncturel, mais irréversible, sans avenir. Ce chômage qui concentre toutes les caractéristiques de la décadence du capitalisme et est une de ses principales manifestations ne peut déterminer dans la classe ouvrière que des réactions qualitativement différentes de celles du siècle dernier.
Ainsi, dès l'après première guerre mondiale, ce sera en Allemagne par exemple, les chômeurs qui souvent seront à l'avant-garde du mouvement révolutionnaire. Alors que les syndicats du siècle dernier ne regroupaient pas de chômeurs dans leurs rangs, toujours en Allemagne, où, avec la Russie, la classe ouvrière était l'avancée de la révolution internationale, on trouve dans les organisations révolutionnaires une forte proportion de chômeurs.
En pénétrant profondément et indistinctement toutes les couches de la classe ouvrière, le chômage détermine dans l'ensemble de la population ouvrière, une situation commune où toutes les barrières catégorielles, corporatistes, usinistes, locales, régionales, nationales, disparaissent pour ne laisser apparaître que ce que la classe ouvrière dans son ensemble a de commun -situation, condition, intérêts - effaçant ou mettant de côté toute spécificité face aux conditions et perspectives qu'impose la crise du capitalisme, situation où la classe ouvrière prend conscience "qu'on ne lui a pas fait un tort particulier, mais tous les torts". C'est ainsi que même en dehors de toute période de luttes ouvertes, le chômage généralisé qui se développe, en emportant comme des têtus de paille toutes les petites mesures par lesquelles la bourgeoisie et les Etats essaient de l'entraver, de le ralentir sans oser même espérer le stopper, tend à dissoudre rapidement tout esprit corporatiste inculqué et entretenu par les syndicats depuis des années.
Non seulement, le chômage tend à dissoudre tout esprit corporatiste, mais dans le même mouvement, il place l'ensemble de la classe ouvrière face à un problème de fond, qui réclame de manière on ne peut plus pressante, des solutions de fond impliquant toute la classe ouvrière.
Pour que la révolution sociale soit possible, Rosa Luxemburg déclarait déjà au début de ce siècle : ".il faut que le terrain social soit labouré de fond en comble, que ce qui est en bas apparaisse à la surface, que ce qui est en haut soit enfoui profondément..."
(Grève de masse, parti et syndicats. Editions Maspéro, page 1 13).
Et bien, ce travail là, nous pouvons constater que le chômage massif, généralisé, chronique et sans avenir, est en train de particulièrement contribuer à le réaliser. Et il n'y a rien de plus fort aujourd'hui que le développement du chômage pour enfouir profondément toutes les illusions passées, les séparations qui les ont couvées et faire remonter à la surface tout ce qui unit la classe ouvrière face à la crise généralisée du capitalisme.
LE CHOMAGE ET L'ILLUSION DU CAPITALISME D'ETAT
Nous avons ici défendu qu'à notre époque, le développement du chômage avait joué et jouera un rôle extrêmement important dans le développement de la conscience de classe et dans la lutte de classe en général. Dans l'introduction de cet article, nous disions aussi que, même dans une des plus noires périodes du mouvement ouvrier, les années 30, un des* derniers sursauts de la classe ouvrière/ avant d'être embrigadée dans la seconde guerre mondiale, avait eu pour base la lutte contre le chômage. Il faut constater qu'à cette époque, l'écrasement de toute perspective révolutionnaire avec la grande vague de contre-révolution et le travail d'embrigadement des partis qui avaient trahi la classe prolétarienne, ne pouvaient permettre à la classe ouvrière de dégager une perspective révolutionnaire, vouant ainsi toutes ses luttes à l'échec Ceci est le fond de la question.
Mais pour mieux cerner ce qui distingue notre époque au sein même de cette période de décadence, et en particulier, la différence avec les années 30, il faut prendre en considération l'immense développement du capitalisme d'Etat qui est venu accompagner et faciliter cet embrigadement de la classe ouvrière dans la guerre.
Pendant ces années qui précèdent la seconde guerre mondiale, les différents Etats nationaux engagent toutes les réserves économiques, s'endettent sans compter pour financer, sous l'égide de l'Etat tout puissant, grands travaux et armement massif, qui, à la veille de la guerre épongent en grande partie le chômage. Ainsi, aux USA par exemple :
"L'écart qui séparait à ce moment la production de la consommation fut attaqué de 3 côtés à la fois : 1° Contractant une masse de dettes sans cesse accrue, 1 'Etat exécute une série de vastes travaux publics (. . .)
2° L'Etat augmenta le- pouvoir d'achat des masses laborieuses ;
a) en introduisant le principe d'accords collectifs garantissant des salaires minimum et édictant des limitations de la durée du travail, tout en renforçant la position générale des organisations ouvrières et notamment du syndicalisme
b) en créant un système d'assurance contre le chômage et par d'autres mesures sociales destinées à empêcher une nouvel le réduction du niveau de vie des masses
3° De plus, l'Etat tenta, par une série de mesures telles que des limitations imposées à la production agricole et des subventions destinées à soutenir les prix agricoles, d'augmenter le revenu de la population rurale de façon à permettre à la majorité des exploitants de rejoindre le niveau de vie des classes moyennes urbaines" (F.Sternberg. "Le conflit du siècle", p.389).
Il ne faut d'autre part pas oublier que cette intervention des Etats s'accompagne en même temps d'un quadrillage et d'un encadrement de la population extrêmement poussé. Pour continuer avec l'exemple des USA, nous pouvons citer :
"Du fait des modifications décisives qui s'étaient opérées sous 1'égide du New-Deal dans la structure sociale américaine, la situation du syndicalisme changea du tout au tout. Le New-Deal encouragea en effet le mouvement syndical par tous les moyens ('...). Au cours d'un bref espace de temps qui va de 1933 à 1939, le nombre de syndiqués a fait plus que tripler. A la veille de la deuxième guerre mondiale, il y a plus de deux fois plus de cotisants qu'aux meilleurs moments d'avant la crise, bien plus que dans toute 1'histoire des USA" (Idem).
LA PERSPECTIVE DU CHOMAGE MASSIF
L'on ne peut saisir l'impact décisif du chômage sur la situation sociale des pays industrialisés si l'on n'a pas clairement pris conscience que celui-ci, loin d'être conjoncturel, est irréversible, pas plus d'ailleurs, si l'on ne comprend pas que celui-ci, loin d'être à son apogée, n'en est encore qu'à ses débuts. Avant de répondre à la question : est-ce que le chômage va continuer à se développer, et si oui, comment ? on peut déjà essayer de considérer quelles conditions devraient être réunies pour qu'il soit simplement maintenu à son niveau actuel. Même en comptant sur une reprise de l'économie mondiale qui aujourd'hui a fait long feu, l'OCDE, qui pourtant n'est jamais avare d'affirmations optimistes établissait dès 1983 dans son rapport sur les perspectives économiques :
"Pour maintenir le chômage à son' niveau actuel, en fonction de 1 'augmentation prévisible de la population active, il faudrait créer de 18 à 20 millions d'emplois d'ici la fin de la décennie De plus, il faudrait encore 15 millions d 'emplois supplémentaires si l'on voulait revenir au niveau de chômage de 1979, soit 19 mi liions de personnes sans travail
Cela reviendrait à créer 20 000 emplois par jour entre 1984 et 1989, alors qu 'après le premier choc pétrolier, entre 1975 et 1980, _les 24 pays membres n'en avaient dégagés que 11 500 respectivement" (Rapport OCDE 1983)
D'ores et déjà, tout retour en arrière se révèle donc impossible et si l'on fait le point sur la situation actuelle, on peut établir que :
"Ce sont déjà plus de 2,5 millions de chômeurs que recensent en France les statistiques officiel les, 2,7 en Espagne, 3,2 mi 11 ions en Grande-Bretagne, 2,5 millions en RFA, et dans- la première puissance économique du monde, les USA, 8,8 millions.C'est déjà 17,1% de la population active qui est au chômage aux Pays-Bas, 19,3% en Belgique, 25% au Portugal , suivant ces mêmes chiffres officiels' ("Manifeste sur le problème du chômage". R.I., mai 83).
Le résultat est donc là, simple, net et terriblement tangible. Le chômage représente à l'heure actuelle 10 à 12% en moyenne de la population active des pays industrialisés. Il est irréversible, et plus grave encore, la nouvelle récession qui s'annonce menace d'emporter avec elle, dans les mois et les prochaines années qui viennent, une masse encore plus considérable de personnes dans le tourbillon du chômage. Dans le dernier numéro de cette revue, nous notions déjà cette accélération :
"Avec le ralentissement de la reprise, ces derniers mois ont vu une relance du chômage : 600.000 chômeurs de plus pour la CEE en janvier, 300. 000 pour la seule RFA qui, avec cette progression, bat son record de 1953 avec 2,62 millions de chômeurs".
(Revue Internationale n°1. "Dollar, le roi est nu", p.7).
L'évolution du chômage est d'autant plus rapide, ses conséquences plus graves et profondes, qu'elle est de plus en plus alimentée directement par les licenciements. Quand le chômage se manifestait encore principalement par la difficulté de nouvelles générations à trouver un emploi, son évolution n'avait pas forcément pour corollaire une baisse du nombre de salariés en activité. Aujourd'hui, oui.
Cette augmentation croissante de la masse des chômeurs et son corollaire, la diminution de la population salariée, a pour conséquence directe la quasi-faillite de toutes les caisses d'assurance chômage. Un nombre plus grand d'allocations à verser et de moins en moins de cotisants rend tout système d'assurance ou de couverture sociale impossible. Les systèmes d'assurance chômage, dans la mesure où ils existent - ce qui n'est le cas que pour un petit nombre de pays- n'ont jamais été un cadeau de l'Etat, "une oeuvre sociale"; les allocations versées comme indemnités aux chômeurs temporaires sont une ponction sur les caisses alimentées par des cotisations obligatoires retirées directement aux salaires. Dans des situations où les taux de chômage sont peu élevés et les périodes d'inemploi courtes, un tel système peut même financièrement s'avérer "juteux" pour l'Etat qui le gère comme tout système d'assurance, mais il devient carrément impossible dans une situation de crise et de chômage massif. Forcément, dans de telles situations comme aujourd'hui, les cotisations augmentent sans cesse, les allocations sont réduites à peau de chagrin pour des périodes de plus en plus courtes, et les caisses sont constamment déficitaires avec un déficit croissant.
En conclusion de ce survol rapide sur les perspectives du chômage, nous pouvons affirmer :
- le chômage sera dans les mois et les années qui viennent de plus en plus massif, les chômeurs devenant la catégorie la plus importante et de loin de la population. La grande période de chômage qui s'ouvre devant nous et qui a commencé depuis longtemps par ce que l'on appelle le chômage des jeunes n'a rien de conjoncturel; elle est irrémédiable. Elle est la manifestation la plus directe et criante de la crise historique du capital, du salariat et de leurs rapports réciproques;
- tous les systèmes d'assurance, de couvertures diverses ne sont pas devant nous, mais derrière. Le capitalisme ne pouvant digérer un chômage massif, les chômeurs n'ont pas à attendre que l'Etat leur fasse de cadeau, ils n'auront que ce qu'ils gagneront. En effet, si le capital, même avec le concours, l'assistance et l'intervention massive de l'Etat, ne parvient plus dans le cadre de ses lois juridiques, économiques et sociales à assurer un lien entre les forces et moyens de production, les marchandises produites et les besoins de la société, face à ces besoins, ces moyens de production et de subsistance n'en continuent pas moins à exister, et par leur lutte, les chômeurs doivent et peuvent continuellement essayer de les arracher aux mains du capitalisme.
Au sein de la lutte générale du travail contre le capital, la lutte des chômeurs contre la situation qu'on leur impose exprime de façon limpide le fond, la nature et la perspective de la lutte ouvrière : l'assujettissement de toutes les richesses à la satisfaction des besoins de l'humanité, et cela, même si comme le disait K.Marx : " ces exigences révolutionnaires sont exprimées dans des formules maladroites". Cela n'a rien d'étonnant dans la mesure où dans le chômage se trouve condensée et résumée toute la condition ouvrière. Situation où la classe ouvrière touche le fond de sa condition face à un monde dont l'anachronisme des lois éclate au grand jour avec cette immense surproduction qui n'engendre que misère, dégénérescence et mort alors qu'elle pourrait soulager et libérer l'humanité d'un immense fardeau.
C'est dans un tel contexte que les propagandes humanitaristes dans la bouche desquelles le mot "solidarité" prend le sens de "mendicité", où le geste prend les allures de l'assistance, révèlent leurs caractères caricaturalement réactionnaires.
LEUR SOLIDARITE ET LA NOTRE
L'exploitation de la notion de "solidarité" a des fins qui n'ont rien à voir ni avec les besoins des luttes ouvrières, et encore moins, avec la perspective d'émancipation de la classe ouvrière, n'est pas nouvelle. On l'a vu à l'oeuvre ces dernières années, dans le travail de cloisonnement corporatiste réalisé par les divers syndicats, et en particulier, dans la grève des mineurs, en Angleterre. Avec le développement du chômage, -ce dévoiement prend une forme caricaturale, ce qui a au moins l'avantage d'en éclairer toute la tartufferie et l'inefficacité.
Depuis que les systèmes d'assurance sociale manifestent leur faillite et leur incapacité à faire face ou tout au moins à cacher les aspects les plus criants de la condition de chômage, les appels à la solidarité "contre le fléau social" ne cessent plus. L'Etat, pour commencer, instaure de nouvelles cotisations sociales à prélever sur les salaires au nom bien sûr de "la solidarité", les organisations charitables en appellent au don, les syndicats, nouveaux ou anciens -quand ils ne se cantonnent pas aux slogans nationalistes du style "produisons allemand, français, etc..."-en appellent au "partage du travail".
Pour commencer, les nouvelles cotisations sociales ou l'augmentation des anciennes ne résoudront rien et ne peuvent avoir qu'un impact très limité sur la condition des chômeurs. Avec l'augmentation constante du chômage, l'augmentation de ces cotisations deviendrait une spirale sans fin, grevant d'autant les salaires sur lesquels vivent déjà souvent plusieurs personnes. De fait, ce ne sont plus des "cotisations", encore moins un "geste de solidarité", mais un impôt sur la crise du capitalisme qu'on prélève sur une population ouvrière qui en subit déjà largement les conséquences et assume la plus grande partie de la charge des chômeurs, car les chômeurs ne sont pas sur la planète Mars, mais dans les familles d'ouvriers ou d'employés. Quand ils sont seuls, alors leur situation devient rapidement invivable.
Quant aux dons et autres "gestes charitables", leur inefficacité par rapport à l'immensité du problème et des. besoins parle d'elle-même. Cette histoire de "solidarité" par la "charité" nous ramène plusieurs années en arrière, dans les années 30 :
"La société était engagée à résoudre ses problèmes locaux par un accroissement de leur travail de charité Aussi tardivement qu'en 1931, le président Hoover était d'avis que le maintien d'un esprit de mutuelle assistance par le don volontaire est d'une importance infinie pour l'avenir de 1'Amérique Aucune action gouvernementale, aucune doctrine économique ni projet ne peut remplacer cette responsabilité imposée par Dieu, de l'homme individuel ou de la femme envers leurs prochains'. (Adress on unemployement relief, 18 octobre 193 1 ).
Cependant, moins d'une année plus tard, 'la responsabilité imposée par Dieu' fut reconnue impotente. Les fonds de 1'Etat et de 1'aide locale étaient épuisés. La radicalisation des travailleurs tout autant que des masses progressaient rapidement : marche de la faim, manifestations spontanées de toutes sortes, et même des pillages devenaient de plus en plus fréquents". (Living Marxism. N°4, août 1938).
De toutes ces démarches qui en appellent à la solidarité pour faire face à la question du chômage, il nous reste à- considérer celle prônée plus spécifiquement par les syndicats, le fameux "Partage du travail". Cela fait d'ailleurs un sacré bout de temps que les syndicats, en particulier, ceux d'obédience social-démocrate, tentent de polariser l'attention de la classe ouvrière sur "la lutte pour les 35h". Au fond de l'idéologie syndicale qui prône ce "partage du travail", c'est une certaine vision de la crise actuelle que l'on retrouve. Dans leur travail idéologique, ces syndicats défendent le point de vue selon lequel la crise actuelle qui enfante un chômage massif n'est qu'une crise conjoncturelle, période charnière qui aboutirait à une nouvelle expansion de l'économie mondiale où les nouvelles technologies seraient peines. C'est dans cette perspective "rose" qu'ils demandent à la classe ouvrière d'accepter ce bouleversement et la préparation d'un avenir mythique.
Ces mots d'ordre de "partage du travail" ne sont pas si nouveaux que ça : dans les années 30 déjà, les IWW ([1] [4]) mettaient en avant des orientations d'action semblables :
"Les syndicats de chômeurs de 1'IWW avaient pour opinion que les secours ne pouvaient pas résoudre la question du chômage, et c'est pourquoi, il était nécessaire de renvoyer les sans-travail au travail, en raccourcissant la journée de travail pour tous les travailleurs à 4 heures. Leur politique était de faire le 'piquet de grève des industries' pour impressionner les ouvriers au travail" (Idem).
Autant dire tout de suite que de telles actions n'ont jamais abouti, même de manière insignifiante aux résultats recherchés. Au contraire, pour opposer une partie de la classe ouvrière à une autre, on ne peut rêver mieux. Et de fait, derrière toutes ces mascarades de solidarité, c'est fondamentalement, le seul but recherché. Toute la bourgeoisie et les différentes boutiques qui, par leurs idéologies et leurs actions s'y rattachent veulent bien considérer le problème des chômeurs dans la mesure où ceux-ci veulent bien être considérés comme des indigents et des assistés. Elles veulent bien prendre en compte une "nécessaire solidarité" dans la mesure où c'est la classe ouvrière qui paye.
Tous ces mots d'ordre sont d'ailleurs peu mobilisateurs et ne suscitent que méfiance quand ce n'est pas carrément le dégoût, et on le comprend aisément. Mais cet échec à mobiliser aujourd'hui la masse des chômeurs qui sont pourtant dans une situation dramatique est d'une certaine manière leur victoire. Une victoire sans éclat et panache peut-être, mais une victoire tout de même. Dans la situation actuelle, il vaut mieux pour l'Etat et les syndicats remporter de petites victoires en travaillant à la démobilisation générale que de tenter de grandes victoires dans de grands rassemblements, car les risques et les enjeux sont immenses. Avec les chômeurs, ces risques sont décuplés, car en dehors des usines et des bureaux, ils sont difficilement encadrables dans les structures syndicales traditionnelles et, face à la pression des besoins, la mollesse et les revendications syndicales traditionnelles peu adaptées.
Il est arrivé une fois dans l'histoire, où la bourgeoisie a fait l'erreur de rassembler la masse des chômeurs en croyant créer une armée facilement manipulable contre le reste de la classe ouvrière. Elle s'en est vite mordue les doigts et n'est pas prête de recommencer la même erreur. C'était en 1848 où comme le rapporte K.Marx :
"A côté de la garde mobile, le gouvernement décida de rassembler encore autour de lui une armée d'ouvriers industriels. Des centaines de mille d'ouvriers, jetés sur le pavé de la' crise et de la révolution, furent enrôlés par le ministre Marie dans les prétendus ateliers nationaux. Sous ce nom pompeux, se dissimulait seulement 1'occupation des ouvriers à des travaux de terrassement fastidieux, monotones et improductifs, pour un salaire de 23 sous Des workhouses anglais en plein air, voilà ce qu'étaient ces ateliers nationaux et rien de plus Le gouvernement provisoire croyait avoir formé avec ces ateliers une seconde armée prolétarienne contre les ouvriers eux-mêmes. Pour cette fois, la bourgeoisie se trompa au sujet des ateliers nationaux, comme les ouvriers se trompaient au sujet de la garde mobile Elle avait créé une armée pour 1'émeute" ("Lutte de classe en France. Ed.Sociales, p.81).
C'est ainsi que tout rassemblement des chômeurs dans des manifestai ions ou dans des comités est une force qui les contient toutes. Rassemblés massivement, les chômeurs sont directement amenés à prendre conscience de l'immensité du problème qu'ils représentent et de l'inanité de tous les discours syndicaux. Non seulement, les chômeurs en se mobilisant, prennent conscience de leur force, mais aussi des liens qui les unissent à toute la classe ouvrière dont ils ne forment pas une entité séparée.
De ce point de vue, il ne saurait y avoir plusieurs luttes différentes de la classe ouvrière. Depuis des années d'ailleurs, l'ensemble de la lutte de classe est essentiellement dominée par la lutte contre les licenciements. Depuis des années, la question du chômage est ainsi particulièrement présente comme détermination du combat. La seule différence aujourd'hui, c'est que les chômeurs menacent de rompre leur isolement et de ne pas accepter leur sort; cela veut-il dire qu'ils doivent mener un combat séparé de celui de l'ensemble de la classe ouvrière ? Sûrement pas. Si l'on se fonde sur l'expérience des luttes passées, on peut justement constater que les causes des défaites résidaient justement dans l'isolement corporatiste, régional, catégoriel dont les syndicats se sont faits les champions. Aujourd'hui, alors que la lutte ouvrière montre tous les signes d'un élargissement de son front social avec l'apparition de la lutte des chômeurs, alors que cet élargissement peut et doit contribuer à briser toutes les séparations qui jusqu'ici se sont révélées si néfastes pour l'ensemble de la classe ouvrière, nous devons combattre de toutes nos forces les nouvelles séparations, voire oppositions. Celles-là même utilisées par les syndicats pour mener à la défaite des luttes contre les licenciements hier, et qu'ils essaient encore d'introduire dans la lutte générale contre le chômage.
Si les chômeurs dans leurs luttes ne pouvaient compter sur la solidarité active des ouvriers encore au travail, alors ils seraient incapables de faire plier la bourgeoisie et l'Etat sur quoi que ce soit. Il en serait de même si les chômeurs d'une manière ou d'une autre, n'apportaient pas leur solidarité aux ouvriers actifs en lutte.
Cette extension de la lutte de classe qui est encore en germe, non seulement contient la possibilité de créer au sein de la société un rapport de force qui soit favorable à la classe ouvrière pour la défense de ses intérêts immédiats, mais de plus, de cette extension et unification de la classe ouvrière, dépend la possibilité de dégager une perspective qui déchire enfin l'horizon bouché de la crise historique du capitalisme.
Prénat[1] [5] "Industrial Workers of the World", organisation syndicaliste révolutionnaire"au début de ce siècle.
Questions théoriques:
- L'économie [6]
- Décadence [7]
Les communistes et la question nationale 3ème partie
- 3539 lectures
Le débat pendant la vague révolutionnaire et les leçons pour aujourd'hui
Dans de précédents articles, nous avons examiné les débats qui se sont menés parmi les communistes au sujet des rapports entre la révolution prolétarienne et la question nationale :
- à la veille de la décadence capitaliste sur la question de savoir si les révolutionnaires devaient défendre "le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" (voir la Revue Internationale No 34) ;
- durant la première guerre mondiale, dans la Gauche de Zimmerwald, sur les implications des nouvelles conditions de la décadence pour le vieux "programme minimum" de la social-démocratie et de la nature de classe des guerres nationales (voir Revue Internationale No 37).
Dans ce troisième et dernier article, nous voulons examiner le moment qui a constitué le test le plus crucial pour le mouvement révolutionnaire : les événements historiques qui se sont déroulés à partir de la prise du pouvoir par le prolétariat russe en 1917 jusqu'au second congrès de l'Internationale Communiste en 1920 ; depuis les premiers pas optimistes dans le sens de la destruction du capitalisme jusqu'aux premiers signes de défaite des luttes prolétariennes et à la dégénérescence du mouvement en Russie.
C'est durant ces années que les erreurs des Bolcheviks sur la question de l'autodétermination des peuples furent pour la première fois mises en pratique et qu'à la recherche d'alliés, la nouvelle Internationale Communiste (I.C.) s'est engagée dans un cours opportuniste de soutien aux luttes de libération nationale dans les colonies. Si l'I.C. était encore une force révolutionnaire à cette époque, elle avait déjà fait les premiers pas fatals vers sa capitulation à la contre-révolution bourgeoise. Ceci met en relief la nécessité de faire aujourd'hui la critique de cette expérience prolétarienne afin d'éviter que de telles erreurs ne se répètent -question que bien peu arrivent à comprendre dans le milieu révolutionnaire actuel (voir l'article sur le "Bureau International pour le Parti Révolutionnaire" -B.I.P.R.-, dans la Revue Internationale No 41).
L'erreur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la pratique
L'établissement de la dictature du prolétariat en Russie en 1917 a posé concrètement la question : quelle classe dirige ? Face à la menace d'une extension à l'échelle mondiale du pouvoir des soviets, la bourgeoisie, quelles que fussent ses aspirations nationales, était confrontée à la nécessité de lutter pour sa survie en tant que classe. Même dans les recoins les plus arriérés du vieil empire tsariste, la question que posait l'Histoire était non pas la lutte pour des "droits démocratiques" ou l'achèvement de la révolution bourgeoise mais la confrontation des classes. Les mouvements nationalistes étaient devenus le jouet des puissances impérialistes dans leur lutte contre la menace prolétarienne.
Au milieu de cette guerre de classe, les Bolcheviks furent vite forcés d'accepter que derrière la reconnaissance du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" se trouvait la contre-révolution : dès 1917, l'Ukraine n'avait usé de son indépendance que pour s'allier à l'impérialisme français et se retourner contre le prolétariat. Comme nous l'avons déjà vu, il y avait dans le parti bolchevik, face à cette politique, une forte opposition menée par Boukharine et Piatakov ainsi que Dzerjinski, Lunacharsky et d'autres. En 1917, Piatakov avait presque porté le débat dans le parti en mettant en avant le slogan : "A bas toutes les frontières". Sous l'influence de Lénine, on était arrivé à un compromis ; l'autodétermination pour la classe ouvrière dans chaque pays. Mais ceci laissait telles quelles toutes les contradictions de cette politique. |
Le groupe autour de Piatakov qui était majoritaire dans le parti en Ukraine, s'opposa à ce compromis et appela au contraire à la centralisation de toutes les forces prolétariennes dans l'Internationale Communiste comme seule voie pour maintenir l'unité de la classe ouvrière contre la fragmentation nationale. À l'époque, Lénine ridiculisa les arguments des Bolcheviks de gauche ; mais après avoir vu la dégénérescence ultérieure de la révolution russe, leur insistance apparaît doublement valable. Quand Lénine dénonçait leur position comme étant du "chauvinisme Grand Russe", il révélait une vision nationale du rôle des révolutionnaires, alors que ceux-ci se placent du point de vue des intérêts de la révolution mondiale.
C'est dans les parties les plus développées de l'empire tsariste que les résultats désastreux de la politique des Bolcheviks ont été les plus clairs, et c'est là-dessus que Rosa Luxemburg a concentré ses attaques contre la mise en pratique du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" (écrits qui furent publiés après sa mort). En Pologne comme en Finlande, il y avait une bourgeoisie nationaliste développée, effrayée de toute révolution prolétarienne. Les deux pays ne se virent concéder l'indépendance que pour trouver un appui à leur existence auprès des deux puissances impérialistes. C'est sous le mot d'ordre du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" que la bourgeoisie de ces pays massacra ouvriers et communistes, dissolut les soviets et permit qu'une partie de son territoire serve de tremplin aux armées de l'impérialisme et de la réaction des Blancs.
Rosa Luxemburg y a vu une amère confirmation de ses polémiques d'avant-guerre contre Lénine :
- "Les bolcheviks sont partiellement responsables de ce que la défaite militaire ait abouti à l'effondrement et à la ruine en Russie. Les bolcheviks eux-mêmes ont considérablement aggravé les difficultés objectives de la situation par le mot d'ordre dont ils ont fait le fer de lance de leur politique, le "droit des nations à l'autodétermination" ou, plus exactement, par ce qui se cache, en fait, derrière cette phraséologie : la ruine de la Russie en tant qu'Etat...Défenseurs de l'indépendance nationale, même jusqu'au "séparatisme", Lénine et ses amis pensaient manifestement faire ainsi de la Finlande, de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lituanie, des pays de la Baltique, du Caucase, etc. autant de fidèles alliés de la révolution russe. Mais nous avons assisté au spectacle inverse : l'une après l'autre, ces "nations" ont utilisé la liberté qu'on venait de leur offrir pour s'allier en ennemies mortelles de la révolution russe à l'impérialisme allemand et pour transporter sous sa protection en Russie même le drapeau de la contre-révolution". (R. Luxemburg "La révolution russe" - Petite collection Maspéro, Rosa Luxemburg, Oeuvres II pp.71 et 73).
La mise en pratique du "droit des nations à l'autodétermination" après 1917 a mis en lumière la contradiction entre les intentions originelles de Lénine -l'affaiblissement de l'impérialisme- et les résultats, qui ont été la constitution de remparts contre la révolution prolétarienne vers lesquels la bourgeoisie a canalisé les luttes de la classe ouvrière à travers des guerres nationales et des massacres. Par conséquent, le bilan de cette expérience est strictement négatif.
LE PREMIER CONGRES DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE
La troisième Internationale (I.C.), dans l'invitation à son premier congrès en 1919, proclamait l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence... "une époque de désintégration et d'effondrement de tout le système capitaliste mondial". L'I.C. mettait en avant une claire perspective internationale pour la classe ouvrière : le système capitaliste dans son ensemble n'était plus progressif et devait être détruit par l'action de masse des ouvriers organisés en conseils ouvriers ou en soviets. La révolution mondiale qui avait commencé avec la prise du pouvoir politique par les soviets en Russie, montrait concrètement que la destruction de l'État capitaliste était immédiatement à l'ordre du jour.
Dans la première année de son existence, l'I.C. n'a pas fait spécifiquement référence au soutien aux luttes de libération nationale ni au "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes". Au contraire, elle posait clairement la nécessité de la lutte de classe internationale. L'I.C. était née au sommet de la vague révolutionnaire qui avait forcé la guerre impérialiste à s'arrêter et la bourgeoisie en guerre à s'unir contre la menace prolétarienne. La lutte de classe au coeur du capitalisme -en Allemagne, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, et en Amérique- a donné une énorme impulsion à l'Internationale dans la clarification des besoins de la révolution mondiale qui semblait alors au bord de la victoire, et pour cette raison, les principaux textes du premier congrès représentent sous bien des angles le zénith de la clarté de l'Internationale.
Le Manifeste de l'Internationale (adressé aux) prolétaires du monde entier donne une perspective très large, historique, a la question nationale, puisqu'il commence par la reconnaissance que "l'État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l'expansion des forces productives". ("Manifestes, thèses et résolutions des quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale Communiste," 1919-1923 - Fac-similé François Maspéro- p. 31)
Dans cette perspective, deux questions sont traitées :
- les petites nations opprimées d'Europe qui ne possédaient qu'une indépendance illusoire et avaient compté, avant la guerre, sur les antagonismes continuels entre puissances impérialistes. Ces nations avaient leurs propres prétentions impérialistes et s'appuyaient maintenant sur les garanties de l'impérialisme allié qui derrière le mot d'ordre du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" les opprimait et exerçait sa coercition sur elles : "Seule la révolution prolétarienne peut garantir aux petits peuples une existence libre, car elle libérera les forces productives de tous les pays des tenailles serrées par les États nationaux..." (Ibid, p. 32)
- les colonies qui avaient également été entraînées dans la guerre (impérialiste) pour combattre aux côtés de l'impérialisme. Ceci avait posé de façon aiguë leur rôle de fournisseurs de chair à canon des grandes puissances et avait mené à une série d'insurrections et de fermentation révolutionnaire en Inde, à Madagascar, en Indochine, etc. A nouveau, le Manifeste soulignait que : "L'affranchissement des colonies n'est concevable que s'il s'accomplit en même temps que celui de la classe ouvrière des métropoles. Les ouvriers et les paysans, non seulement de l'Annam, d'Algérie ou du Bengale mais encore de Perse et d'Arménie ne pourront jouir d'une existence indépendante que le jour où les ouvriers d'Angleterre et de France, après avoir renversé Lloyd George et Clemenceau, prendront entre leurs mains le pouvoir gouvernemental... Esclaves des colonies d'Afrique et d'Asie l'heure de la dictature prolétarienne en Europe sonnera pour vous comme l'heure de votre délivrance." (Ibid, p.34)
Le message de l'I.C. est clair. La libération des masses à travers le monde ne pourra avoir lieu qu'avec la victoire de la révolution prolétarienne dont la clé est entre les mains des ouvriers des pays centraux du capitalisme, grâce aux luttes des concentrations ouvrières les plus fortes et les plus expérimentées. Le chemin pour les masses des pays sous-développés se trouve dans l'union "sous le drapeau des soviets ouvriers, de la lutte révolutionnaire pour le pouvoir et la dictature du prolétariat, sous le drapeau de la troisième Internationale..." (Ibid, p. 34).
Ces brefs points, basés sur la reconnaissance de la décadence du capitalisme, brillent encore aujourd'hui comme des phares de clarté. Mais ils ne présentent guère de stratégie cohérente à suivre par le prolétariat et son parti dans une période révolutionnaire. Il était encore nécessaire de clarifier la question vitale de la nature de classe des luttes de libération nationale ainsi que de définir l'attitude de la classe ouvrière vis-à-vis des masses opprimées et des couches non-exploiteuses des pays sous-développés que le prolétariat devait mettre de son côté dans la lutte contre la bourgeoisie mondiale.
Ces questions furent traitées par le second congrès de l'I.C. en 1920. Mais si ce congrès, avec une plus grande participation et un débat plus profond, fit des avancées dans la concrétisation des leçons de la révolution russe et la nécessité d'une organisation centralisée et disciplinée des révolutionnaires, y apparurent également les premiers signes d'une régression par rapport à la clarté du premier congrès -les prémisses des tendances à l'opportunisme et au centrisme dans la jeune Internationale Communiste. Tout effort pour faire un bilan des travaux du second congrès doit commencer avec ces faiblesses qui se sont révélées fatales quand la vague révolutionnaire a reflué.
L'opportunisme a pu prendre racine dans les conditions d'isolement et d'épuisement du bastion russe. Déjà au moment du 1er congrès, la révolution en Allemagne avait reçu un sérieux coup avec le meurtre de Liebknecht, Luxemburg et de plus de 20 000 ouvriers. Mais l'Europe était embrasée par les luttes révolutionnaires qui menaçaient encore de renverser la bourgeoisie. Au moment où les délégués se rassemblaient pour le second congrès, le rapport de forces avait déjà commencé à pencher substantiellement en faveur de la bourgeoisie et les bolcheviks en Russie étaient obligés de penser en termes d'un long siège se prolongeant plutôt qu'à une défaite rapide du capitalisme mondial. Aussi, alors qu'au premier congrès on mettait l'accent sur l'imminence de la révolution en Europe de l'ouest et sur les énergies spontanées de la classe ouvrière, le second congrès soulignait :
- le problème de l'organisation du mouvement des soviets à travers le monde,
- la nécessité de construire la défense du bastion russe.
Minés par les terribles exigences de la famine et de la guerre civile, les bolcheviks se mirent à faire des compromis avec la clarté d'origine de l'I.C. en faveur d'alliances avec des éléments douteux, ou même tout à fait bourgeois parmi les débris de la seconde Internationale en faillite, afin de construire des "partis de masse" en Europe qui apporteraient un maximum d'aide au bastion russe. La recherche d'un soutien possible au sein des mouvements de luttes de libération nationale dans les pays sous-développés doit être considérée dans la même optique.
La couverture de ce cours opportuniste était la guerre contre l'aile gauche de l'Internationale, annoncée par Lénine dans sa fameuse brochure "La maladie infantile du communisme : le gauchisme". En fait, dans son discours d'ouverture du second congrès, Lénine soulignait toujours que "l'opportunisme est notre principal ennemi...En comparaison avec cette tâche, la correction des erreurs de la tendance 'de gauche' du communisme sera facile" (second congrès).
Cependant, dans une situation de reflux de la lutte de classe, cette tactique ne pouvait que laisser la porte plus grande ouverte à l'opportunisme tout en affaiblissant ses adversaires les plus intransigeants, l'aile gauche. Comme Pannekoek l'écrivit plus tard à l'anarchiste Muhsam : "Nous considérons que le congrès est coupable de s'être montré non pas intolérant mais bien trop tolérant. Nous ne reprochons pas aux chefs de la 3e Internationale de nous exclure ; nous les critiquons de chercher à inclure autant d'opportunistes que possible. Dans notre critique, nous ne sommes pas préoccupés par nous-mêmes, mais par les tactiques du communisme ; nous ne critiquons pas le fait secondaire que nous-mêmes soyons exclus de la communauté des communistes, mais bien le fait essentiel que la 3e Internationale suit en Europe occidentale une tactique à la fois erronée et désastreuse pour le prolétariat". ( « Die Aktion », 19 mars 1921)
Ceci s'est avéré également correct en ce qui concerne la position de l'I.C. sur les luttes de libération nationale.
Le second congrès : "l'opportunisme est notre ennemi principal" (Lénine dans son discours introductif)
Les Thèses sur la question nationale et coloniale adoptées au second congrès révèlent avant tout une tentative peu aisée de concilier une position internationaliste de principe et de dénonciation de la bourgeoisie, avec un soutien direct à ce qui est appelé des mouvements "révolutionnaires nationaux" dans les pays arriérés et les colonies :
- "Conformément à son but essentiel -la lutte contre la démocratie bourgeoise, dont il s'agit de démasquer l'hypocrisie- le Parti communiste, interprète conscient du prolétariat en lutte contre le joug de la bourgeoisie, doit considérer comme formant la clef de voûte de la question nationale, non des principes abstraits et formels, mais :
1. - une notion claire des circonstances historiques et économiques ; 2. - la dissociation précise des intérêts des classes opprimées, des travailleurs, des exploités, par rapport à la conception générale des soi-disant intérêts nationaux, qui signifient en réalité ceux des classes dominantes ; 3. - la division tout aussi nette et précise des nations opprimées, dépendantes, protégées, -et oppressives et exploiteuses, jouissant de tous les droits, contrairement à l'hypocrisie bourgeoise et démocratique qui dissimule, avec soin, l'asservissement (propre à l'époque du capital financier de l'impérialisme) par la puissance financière et colonisatrice, de l'immense majorité des populations du globe à une minorité de riches pays capitalistes."(Ibid, p.57)
Cette thèse établit la primauté de la lutte contre la démocratie bourgeoise pour le Parti communiste, point réitéré dans bien d'autres textes de l'I.C. et c'était crucial pour une approche marxiste. Le second point d'importance est le rejet de l'"intérêt national" qui n'appartient qu'à la bourgeoisie. Comme le Manifeste Communiste l'avait proclamé avec la plus grande clarté 70 ans auparavant, les ouvriers n'ont pas de patrie à défendre. L'antagonisme fondamental dans la société capitaliste est la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat qui seul peut offrir une dynamique révolutionnaire de destruction du capitalisme et pour la construction du communisme, et toute tentative pour voiler cette opposition d'intérêts historiques, qu'elle soit consciente ou non, défend les intérêts de la classe dominante.
C'est dans ce sens que l'on doit comprendre le troisième point dans cette deuxième thèse qui est bien plus vague et en reste à une simple description de la situation de l'impérialisme mondial dans lequel la majorité des pays sous-développés était l'objet d'un impitoyable pillage par une minorité de pays hautement développés. Même dans les "nations opprimées", il n'y avait pas d'"intérêt national" à défendre pour le prolétariat. La lutte contre le patriotisme était un principe fondamental du mouvement prolétarien qui ne pouvait être mis en causé et, plus loin, les thèses insistent sur l'importance primordiale de la lutte de classe : "il résulte de ce qui précède que la pierre angulaire de la politique de l'Internationale Communiste dans les questions coloniale et nationale, doit être le rapprochement des prolétaires et des travailleurs de toutes les nations et de tous les pays pour la lutte commune contre les possédants et la bourgeoisie." (Ibid. p.57)
Cependant, il y avait une ambiguïté dans cette insistance sur la division entre nations oppressives et opprimées, une ambiguïté qui a été exploitée par la suite pour tenter de justifier une politique du prolétariat apportant son soutien direct aux luttes de libération nationale des pays sous-développés dans le but d'"affaiblir" l'impérialisme. Ainsi, tandis qu'il était nécessaire pour les partis communistes de "démontrer sans cesse que le gouvernement des soviets seul peut réaliser l'égalité des nationalités en unissant les prolétaires d'abord, l'ensemble des travailleurs ensuite, dans la lutte contre la bourgeoisie."
Sur la même lancée, il était établi qu'il était nécessaire d'assurer "un concours direct par l'intermédiaire du Parti communiste, à tous les mouvements révolutionnaires des pays dépendants ou lésés dans leurs droits." (Ibid, 9ème thèse, p. 58)
Il y a une ambiguïté introduite ici. Quelle est exactement la nature de classe de ces "mouvements révolutionnaires"? Ce n'est pas une référence au milieu politique du prolétariat embryonnaire des pays sous-développés. Le même malaise dans les termes traverse toutes les thèses qui parfois parlent de mouvements "révolutionnaires de libération", parfois de mouvements de "libération nationale". En plus, la forme concrète que devait prendre ce soutien direct, était laissée aux décisions de chaque Parti communiste là où ils existaient.
Il y a au moins la reconnaissance dans la même thèse des dangers potentiels d'un tel soutien car elle avertit que : "Il est nécessaire de combattre énergiquement les tentatives faites par des mouvements émancipateurs qui ne sont en réalité ni communistes, ni révolutionnaires pour arborer les couleurs communistes. L'Internationale Communiste ne doit soutenir les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés, qu'à la condition que les éléments des futurs partis communistes soient groupés et instruits de leurs tâches particulières , c'est-à-dire, de leur mission de combattre le mouvement bourgeois et démocratique. L'I.C. doit entrer en relations temporaires et former aussi des alliances avec les mouvements révolutionnaires dans les colonies et les pays arriérés sans toutefois jamais fusionner avec eux et en conservant toujours le caractère indépendant de mouvement prolétarien même dans sa forme embryonnaire." (Ibid, thèse 11, p.58)
Ici concrètement la question est de savoir si les luttes de libération nationale dans les colonies avaient encore un caractère progressif. Il n'y avait pas encore une clarté sans équivoque sur le fait que l'époque des révolutions démocratiques bourgeoises s'était définitivement close pour toute l'Afrique, l'Asie et l'Orient. Même les communistes qui en Europe occidentale s'étaient opposés durant la guerre au slogan de "auto-détermination", faisaient une exception pour les colonies. L'expérience du prolétariat n'avait pas encore clairement établi que même dans les coins les plus reculés du globe, la période d'ascendance du capital avait pris fin, et que même dans les colonies, la bourgeoisie ne pouvait plus survivre qu'en se tournant contre "son" prolétariat.
Mais la plus sérieuse faiblesse du second congrès fut de ne pas débattre ouvertement de la question, en particulier quand l’orientation de beaucoup de contributions de communistes des pays sous-développés tendait à rejeter tout soutien à la bourgeoisie, même dans les colonies.
Dans la Commission sur la question nationale et coloniale, il y eut un débat autour des "thèses supplémentaires" développées par le communiste des Indes, M.N. Roy qui, tout en partageant beaucoup de points de vue avec Lénine et la majorité de l'I.C, mettait en lumière la contradiction croissante entre les mouvements bourgeois nationalistes qui poursuivaient une politique d'indépendance tout en préservant l'ordre capitaliste, et les intérêts des petits paysans. Roy voyait comme la plus importante tâche de l'I.C. : "la formation de partis communistes qui organisent les ouvriers et les paysans et les conduisent à la révolution et à l'établissement de la République soviétiste.(...) Ainsi, les masses des pays arriérés, conduites par le prolétariat conscient des pays capitalistes développés, arriveront au communisme sans passer par les différents stades du développement capitaliste". (Thèses supplémentaires sur la question nationale et coloniale, thèses 7 et 9, p.60)
Ceci impliquait une lutte contre la domination des mouvements bourgeois nationalistes. Pour soutenir ses thèses, Roy soulignait l'industrialisation rapide de colonies comme l'Inde, l'Égypte, les Indes occidentales néerlandaises et la Chine et la croissance conséquente du prolétariat ; en Inde il y avait eu d'énormes vagues de grèves et le développement d'un mouvement parmi les masses exploitées en dehors du contrôle des nationalistes.
Le débat dans la commission portait sur le principe pour l'I.C. de soutenir des mouvements nationalistes bourgeois dans les pays arriérés. Il y eut une tentative vers la compréhension que la bourgeoisie impérialiste encourageait activement de tels mouvements pour ses propres buts réactionnaires, comme Lénine le reconnaît dans son discours d'introduction du congrès : "Une certaine compréhension mutuelle est apparue entre la bourgeoisie des pays exploiteurs et celle des colonies, de sorte que très souvent, peut-être même dans la plupart des cas, la bourgeoisie des pays opprimés tout en soutenant les mouvements nationaux, combat néanmoins tous les mouvements révolutionnaires et les classes révolutionnaires, en accord à un certain niveau avec la bourgeoisie impérialiste, c'est-à-dire avec elle." (Le second congrès -souligné par nous)
Mais la "solution" à la divergence dans la Commission avec laquelle Roy fut d'accord, fut d'adopter les deux types de thèses et de remplacer "bourgeois démocratique" par "national-révolutionnaire" : "La question à ce sujet, c'est qu'en tant que communistes nous ne soutiendrons les mouvements bourgeois de libération dans les pays coloniaux que s'ils sont réellement révolutionnaires et si leurs représentants ne s'opposent pas à entraîner et organiser la paysannerie de façon révolutionnaire. Si ce n'est pas le cas, alors les communistes ont le devoir de lutter contre la bourgeoisie réformiste" (Ibid. souligné par nous).
Étant donné le grand malaise dans l'I.C. pour apporter son soutien à des mouvements nationalistes, c'était une façon claire d'esquiver le problème ; c'est à dire du centrisme. Le changement des mots n'avait en réalité aucun contenu et ne faisait qu'obscurcir l'alternative historique posée par l'entrée du capitalisme dans son époque de décadence : soit la lutte de classe internationale contre l'intérêt national de la bourgeoisie, soit la subordination de la lutte de classe à la bourgeoisie et à ses mouvements nationalistes contre-révolutionnaires. L'acceptation de la possibilité d'un soutien aux luttes de libération 'nationale dans les pays sous-développés par la majorité centriste de l'I.C. a ouvert le chemin vers des formes d'opportunisme plus ouvertes.
Le congrès de Bakou et les conséquences de l'opportunisme
Cette tendance opportuniste se renforça après le 2nd congrès. Immédiatement après, un congrès des Peuples d'Orient se tenait à Bakou où les chefs de l'I.C. réaffirmèrent leur soutien aux mouvements bourgeois nationalistes et défendirent même un appel à une "guerre sainte" contre l'impérialisme britannique.
Les politiques défendues par le parti mondial du prolétariat étaient de plus en plus dictées par les besoins contingents de la défense de la République Soviétique plutôt que les intérêts de la révolution mondiale. Le second congrès avait établi cela comme axe central de l'I.C. Le congrès de Bakou suivit cet axe, s'adressant en particulier aux minorités nationales des pays voisins de la République Soviétique assiégée où l'impérialisme britannique menaçait de renforcer son influence et donc de servir de tremplin à une intervention armée contre le bastion russe.
Les beaux discours du congrès ainsi que les déclarations de solidarité entre le prolétariat européen et les paysans de l'Orient malgré beaucoup de choses correctes sur la nécessité des soviets et de la révolution, ne suffisaient pas à cacher le cours opportuniste vers un soutien sans discrimination aux mouvements nationalistes : "Nous faisons appel, camarades, aux sentiments guerriers qui animèrent les peuples d'Orient dans le passé, quand ces peuples, conduits par leurs grands conquérants, avancèrent sur l'Europe. Nous savons, camarades, que nos ennemis vont dire que nous appelons à la mémoire de Genghis Khan et à celle des grands califes conquérants de l'Islam. Mais nous sommes convaincus qu'hier (dans le congrès -NdlR) vous avez sorti couteaux et revolvers non dans un but de conquête, non pour transformer l'Europe en cimetière. Vous les avez brandis, avec les ouvriers du monde entier, dans le but de créer une civilisation nouvelle, celle de l'ouvrier libre." (Radek, cité dans Le Congrès des Peuples d'orient).
Le Manifeste adopté par le congrès concluait sur une injonction aux peuples de l'Est à se joindre "à la première réelle guerre sainte, sous la bannière rouge de l'Internationale Communiste" ; plus spécifiquement, une croisade contre "l'ennemi commun, l'impérialisme britannique."
Déjà à l'époque, il y eut des réactions à ces tentatives éhontées de réconcilier le nationalisme réactionnaire avec l'internationalisme prolétarien. Lénine lui-même mettait en garde contre le fait de "peindre le nationalisme en rouge". De façon significative, Roy critiqua le congrès avant qu'il se tînt et refusa d'assister à ce qu'il qualifiait de "cirque de Zinoviev", tandis que John Reed, le communiste de gauche américain, faisait également des objections amères à "cette démagogie et cette parade".
Cependant, de telles réponses ne s'adressaient pas aux racines du cours opportuniste qui était suivi, mais restaient au contraire sur un terrain centriste de conciliation avec des expressions plus ouvertes d'opportunisme, se cachant derrière les thèses du second congrès ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a couvert une multitude de manquements dans le mouvement révolutionnaire.
Déjà en 1920, ce cours opportuniste avait pour implication un soutien direct au mouvement nationaliste bourgeois de Pasha Kemal en Turquie bien qu'à cette époque Kemal ait apporté son soutien au pouvoir religieux du sultan. Il était loin de la politique de l'Internationale, comme le notait Zinoviev, mais "en même temps nous disons que nous sommes prêts à aider toute lutte révolutionnaire contre le gouvernement britannique" (Congrès des Peuples d'Orient).
L'année suivante, le leader de cette "lutte révolutionnaire" fit exécuter les chefs du parti communiste de Turquie. Malgré cela, les Bolcheviks et l'I.C. continuèrent à voir des "potentialités révolutionnaires" dans ce mouvement nationaliste jusqu'à ce que Kemal fasse alliance avec l'Entente en 1923, choisissant d'ignorer le massacre des ouvriers et des communistes afin de s'allier un pays stratégiquement important, aux frontières de la Russie.
Les politiques de l'I.C. en Perse et en Extrême-Orient eurent les mêmes résultats désastreux, montrant que Kemal n'était pas un "accident", mais simplement l'expression de la nouvelle époque de décadence du capitalisme dans laquelle le nationalisme et la révolution prolétarienne sont tout à fait irréconciliables.
Les résultats de tout cet opportunisme furent fatals pour le mouvement ouvrier. Avec la révolution mondiale qui s'enfonçait dans une défaite de plus en plus profonde et le prolétariat en Russie épuisé et décimé par la famine et la guerre civile, l'I.C. devint de plus en plus l'instrument de la politique extérieure des bolcheviks qui se trouvaient eux-mêmes dans le rôle d'administrateurs du capital russe. D'erreur très sérieuse dans le mouvement ouvrier, la politique de soutien aux luttes de libération nationale s'était transformée à la fin des années 20 en stratégie impérialiste d'une puissance capitaliste.
Un moment décisif dans le processus d'involution fut la politique de l'I.C. de soutien aux nationalistes violemment anti-ouvriers du Kuomingtang en Chine qui mena, en 1927, à la trahison et au massacre de l'insurrection des ouvriers de Shanghai. De tels actes de trahison ouverte démontrèrent que la fraction stalinienne qui avait entre-temps acquis une domination presque complète de l'I.C. et de ses partis, n'était plus un courant opportuniste dans le mouvement ouvrier mais une expression directe de la contre-révolution capitaliste.
Mais c'est néanmoins un fait que les racines de cette politique résident dans des erreurs et des faiblesses au sein du mouvement ouvrier et que c'est le devoir des communistes d'exposer ces racines aujourd'hui afin de mieux s'armer contre le processus de dégénérescence, parce que :"Le stalinisme ne tombe pas du ciel et ne surgit pas du néant. Et s'il est absurde de jeter l'enfant avec l'eau sale de la baignoire, de condamner l'Internationale Communiste parce qu'en son sein a pu se développer et triompher le stalinisme (...) il n'est pas moins absurde de prétendre que l'eau de la baignoire a toujours été absolument pure et parfaitement limpide, de présenter l'histoire de 1' 'Internationale Communiste' divisée en deux périodes, dont l'une, la première, serait du cristal pur, révolutionnaire, sans la moindre tâche, sans défaillance aucune et brusquement - interrompue par l'explosion de la contre-révolution. Ces imageries d'un paradis bienheureux et d'un horrible enfer sans aucun lien entre eux, n'a rien à voir avec un mouvement réel, telle l'histoire du mouvement communiste où la continuité se fait au travers de profondes ruptures et où les futures ruptures ont leurs germes dans le processus de la continuité." ("Introduction aux textes de la Gauche mexicaine, sur la question nationale" -Revue Internationale N°20, p.24, 25).
Le second congrès a mis en lumière les dangers pour le mouvement ouvrier de l'opportunisme et du centrisme dans ses propres rangs; et si l'opportunisme ne réussit finalement à triompher que dans des conditions de profond reflux de la lutte de classe internationale et d'isolement du bastion russe, c'est d'abord dans toutes les vacillations et les hésitations du mouvement révolutionnaire qu'il a pris racine, mettant à profit tous les efforts pleins de "bonnes intentions", pour aplanir les différences avec des mots bien tournés plutôt que l'honnêteté dans la confrontation de sérieuses divergences.
Ce sont ces caractéristiques typiques du centrisme qui animent clairement le communiste de gauche hollandais Sneevliet (Maring) dans le second congrès où apparemment, c'est lui qui a résolu le problème des divergences entre les thèses de Lénine et celles de Roy en proposant, en tant que secrétaire de la commission sur la question nationale et coloniale que le congrès adopte les deux. En fait Sneevliet était d'accord avec Lénine sur la nécessité de faire des alliances temporaires avec des mouvements nationalistes bourgeois. Dans la pratique, c'est ce point de vue qui a dominé la politique de l'I.C. et non le rejet préconisé par Roy, de telles alliances.
Sneevliet fut désigné par le Comité Exécutif de l'I.C. pour aller en Chine en 1921 comme représentant de l'Extrême-Orient. Il y fut convaincu que le Kuoming-tang nationaliste chinois avait un "potentiel révolutionnaire" et écrivit dans l'organe officiel de l'I.C. : "Si nous, communistes, qui tentons d'établir des liens avec les ouvriers du Nord de la Chine, voulons réussir, nous devons prendre soin de maintenir des rapports fraternels avec les nationalistes. Les thèses du second congrès doivent être appliquées à la Chine par l'offre de notre soutien actif aux éléments nationalistes du sud (c'est-à-dire le Kuominqtanq). Notre tâche est de maintenir les éléments nationalistes révolutionnaires à nos côtés et d'entraîner tout le mouvement à gauche." (Kommunistische Internationale, 13 septembre 1922)
Cinq ans après, ces mêmes "éléments révolutionnaires" décapitaient ouvriers et communistes dans les rues de Shangaï dans une orgie de massacres.
Il est important de souligner que Sneevliet n'était qu'une expression individuelle du danger de centrisme et d'opportunisme auquel le mouvement révolutionnaire était confronté. Son point de vue est partagé par la majorité de l'I.C.
Il était partagé également, dans une mesure plus ou moins grande, même par les communistes de gauche qui ne réussirent pas à défendre clairement leurs positions. Ceux qui, comme Boukharine et Radek, s'étaient opposés au slogan du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" semblaient maintenant accepter les vues de la majorité, tandis que la gauche italienne autour de Bordiga et de la Fraction Communiste Abstentionniste, bien qu'opposée à la tactique opportuniste du "parlementarisme révolutionnaire", soutenait pleinement les thèses de Lénine. La gauche allemande, basant sa position sur celle de Rosa Luxemburg, était dans la meilleure position dans l'I.C. parmi toutes les fractions, pour faire une intervention de principe déterminée contre le soutien aux luttes de libération nationale, mais les délégués du K.A.P.D., dont Rühle, ne participèrent pas au débat, et c'était dû, en partie du moins, à leurs préjugés conseillistes. Les acquis théoriques des Gauches d'Europe occidentale issus des débats dans la Gauche de Zimmerwald pendant la guerre, ne furent pas concrétisés dans le second congrès. C'est seulement avec la défaite de la vague révolutionnaire à la fin des années 20 que les quelques fractions de gauche ayant survécu, en particulier la Gauche italienne autour de la revue Bilan, furent capables de conclure que le prolétariat ne pouvait apporter aucun soutien aux mouvements nationalistes, même dans les colonies. Pour Bilan le massacre de Chine 1927 prouvait que "Les thèses de Lénine au second congrès doivent être complétées en changeant radicalement leur contenu... le prolétariat indigène ne peut devenir le protagoniste d'une lutte anti-impérialiste qu'en se rattachant au prolétariat international " (Bilan N°16, février 1935). Ce sont la Gauche italienne et, plus tard, les Gauches du Mexique et de France qui furent finalement capables de faire une synthèse supérieure des travaux de Rosa Luxemburg sur l'impérialisme et de l'expérience de la vague révolutionnaire de 1917-23.
Les leçons pour le présent
Ces erreurs de l'I.C. ne peuvent absolument pas servir d'excuse pour les révolutionnaires d'aujourd'hui. Il y a longtemps que les staliniens sont passés dans le camp de la contre-révolution, y emportant l'I.C. avec eux. Pour les trotskystes la "possibilité" de soutien aux luttes nationalistes dans les colonies se transforma en soutien inconditionnel, et sur ce chemin ils finirent par participer à la seconde guerre impérialiste mondiale.
Dans le camp prolétarien, les bordiguistes de la Gauche italienne dégénérescente ont inventé la théorie des aires géographiques selon laquelle, pour la vaste majorité de la population mondiale dans les pays sous-développés, la "révolution démocratique-bourgeoise anti-impérialiste" était encore « à l'ordre du jour». Les bordiguistes, en figeant chaque point et chaque virgule des thèses du second congrès, ont pris la relève de l'opportunisme et du centrisme de l'I.C. La preuve des dangers contenus dans les tentatives d'appliquer des politiques impossibles dans la décadence du capitalisme, c'est la désintégration à laquelle arriva le Parti communiste international (Programma comunista)[1] en 1981 après avoir été complètement ronge par l'opportunisme vis-à-vis des divers mouvements nationalistes (voir Revue Internationale No 32) ce qui nous amène finalement aux "bordiguistes embarrassés" du Parti communiste internationaliste (Battaglia Comunista)[2], maintenant partiellement regroupes avec la Communist Workers Organisation[3] -voir l'article sur le B.I.P.R.[4], Revue Internationale N°40 et 41). En tant que groupe du milieu politique, Battaglia défend une position contre les luttes de libération nationale dans la décadence, mais il montre une singulière difficulté à rompre définitivement avec l'opportunisme et le centrisme de l'I.C. sur cette question et d'autres questions vitales. Par exemple, dans son texte préparatoire à la deuxième conférence des groupes de la Gauche communiste en 1978, B.C. n'a pas réussi à faire une quelconque critique des positions de la 2e Internationale, ou de la pratique de l'I.C, préférant par contre défendre sa position en citant Lénine en 1916 dans sa polémique contre Rosa Luxemburg ! La vision de B.C. d'un futur parti "transformant des mouvements de libération nationale en révolution prolétarienne" réintroduit le danger de l'opportunisme par la fenêtre et l'a déjà amené, avec la C.W.O., à un flirt avec le groupe nationaliste iranien, l'U.C.M. (maintenant "Parti Communiste d'Iran" -un groupe maoïste). Ces rapports ont été justifiés par la nécessité d'"aider de nouveaux militants à s'orienter", venant d'un pays "qui n'a aucune tradition, ni histoire communiste, un pays sous-développé" (Document présenté par B.C. à une réunion publique à Naples en juillet 1983).
Cette attitude paternaliste n'est pas seulement une excuse pour la pire forme d'opportunisme, c'est une insulte au mouvement communiste dans les pays sous-développés, un mouvement qui, malgré les timides excuses de Battaglia, a une histoire riche et fière d'opposition de principe aux luttes nationalistes bourgeoises. C'est une insulte au militant du Parti communiste perse qui, au second congrès de l'I.C., avertissait que : "Si l'on doit tenter de procéder conformément aux thèses dans des pays qui ont déjà dix années d'expérience ou plus, ou dans ceux où le mouvement a déjà eu le pouvoir, cela voudrait dire jeter les masses dans les bras de la contre-révolution. La tâche est de créer et de maintenir un mouvement purement bourgeois-démocratique." (Sultan Zadeh, cité dans Le second congrès de l'I.C.)
C'est une insulte à la position du communiste indien Roy (qui était en réalité délégué du Parti Communiste mexicain). C'est une insulte à ceux du jeune Parti communiste chinois comme Chang Kuo Tao qui s'est opposé à la politique officielle de l'I.C. d'entrisme dans le Kuomingtang nationaliste.
Gorter parla une fois du programme communiste qui devait être "dur comme l'acier, clair comme la glace". Avec les prises de position opaques et malléables à l'infini de Battaglia Comunista, nous revenons sur le terrain du second congrès de l'I.C. cinquante ans après : le terrain de l'opportunisme et du centrisme avec une touche de chauvinisme paternaliste en plus. C'est un terrain que les révolutionnaires doivent combattre et éviter constamment aujourd'hui. Telle est la leçon la plus durable des débats passés des communistes sur la question nationale.
S. RAY
Courants politiques:
Approfondir:
Questions théoriques:
- Impérialisme [10]
Heritage de la Gauche Communiste:
Jan Appel, un révolutionnaire n'est plus
- 2956 lectures
Le 4 mai 1985, la dernière grande figure de l'Internationale Communiste, JAN APPEL, s'est éteinte à l'âge de 95 ans Le prolétariat n'oubliera jamais cette vie, une vie de lutte pour la libération de l'humanité
La vague révolutionnaire du début de ce siècle a échoué Des milliers de révolutionnaires marxistes furent tués en Russie et en Allemagne, certains même se suicidèrent Mais, malgré cette longue nuit de contre-révolution, Jan Appel resta fidèle aux marxisme, il resta fidèle à la classe ouvrière, convaincu que la révolution prolétarienne devait venir
Jan Appel fut formé et trempé dans le mouvement révolutionnaire d'Allemagne et de Hollande au début de ce siècle. Il combattit côte à côte avec Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Lénine, Trotsky, Gorter, Pannekoek. Il combattit dans la révolution en Allemagne, en 1919. Il fut de ceux qui ne trahirent jamais la cause du prolétariat. Il fut un représentant digne de cette masse anonyme des générations mortes du prolétariat. Leur lutte historique a toujours renoncé à la glorification des personnes ou à la recherche de titres de gloire. Tout comme Marx, Engels, Jan Appel n'avait pas de comptes à rendre à la presse à sensation capitaliste
Mais il était aussi plus que cette masse anonyme de militants révolutionnaires courageux qui fut produite par la vague révolutionnaire du mouvement ouvrier du début de notre siècle. Il a laissé des traces qui permettent aux révolutionnaires d'aujourd'hui de reprendre le flambeau Jan Appel était capable de reconnaître ceux qui, tout aussi anonymes et pour le moment encore réduits à une petite minorité, continueront le combat communiste. Avec fierté, nous avions ainsi accueilli Jan Appel au Congrès de fondation du Courant Communiste International en 1976 à Paris. Les sigles utilisés dans cet article sont expliqués p.18.
Né en 1890 dans le Mecklenburg en Allemagne, Jan Appel a commencé très jeune à travailler dans les chantiers navals de Hambourg. Dès 1908, il est un membre actif du SPD. Dans les années tourmentées de la guerre, il participe aux discussions sur les questions nouvelles qui se posent à la classe ouvrière : l'attitude face à la guerre impérialiste et face à la révolution russe. C'est ce qui le conduisit, fin 1917, début 1918, à se joindre aux radicaux de gauche de Hambourg qui prirent une position claire contre la guerre pour la révolution. Il donna ainsi suite à l'appel de juillet 1917 des IKD de Hambourg demandant à tous les ouvriers révolutionnaires d'oeuvrer pour la constitution d'un ISPD en opposition à la politique réformiste-opportuniste de la majorité du SPD. Poussé par les combats ouvriers de fin 1918, il adhérera aussi au Spartakusbund de Rosa Luxemburg et prendra, après l'unification dans le KPD(S) une position responsable dans le groupe du district de Hambourg.
1918 fut surtout l'année des grandes grèves à Hambourg et dans toute l'Allemagne après novembre, dans lesquelles Appel se trouva au premier plan. Les ouvriers des chantiers navals furent en effet longtemps les combattants de pointe qui, dès le début, adoptèrent une attitude révolutionnaire, et poussés par les IKD et le KPD(S), furent le fer de lance dans les combats contre les orientations du SPD réactionnaire, de l'USPD centriste et des syndicats réformistes. Ce fut en leur sein que les hommes de confiance révolutionnaires, et après les AAU, virent le jour. Citons Appel lui-même : "En janvier de l'année 1918, les travailleurs de l'armement et des chantiers navals (sous contrôle militaire) en arrivèrent partout à se révolter contre la camisole de force de la guerre, contre la faim, le dénuement, la misère. Et ceci par la grève générale. Au début, la classe ouvrière, les prolétaires sous 1'uniforme, ne comprirent pas ces travailleurs (...) La nouvelle de ce mouvement, de ce combat de la classe ouvrière, pénétra jusque dans le dernier recoin. Et lorsque le rapport de forces eut assez mûri, lorsqu'il n'y eut plus rien à sauver de l'économie militaire et du soi-disant Empire allemand, alors, la classe ouvrière et les soldats firent ce que leur avaient appris les pionniers de janvier 1918" (Hempel, pseudonyme de Jan Appel, au 3ème Congrès de l'Internationale Communiste, juillet 1921). Et sur les grèves de novembre à Hambourg, Appel raconta : "Quand, en novembre 1918, les marins se révoltèrent et les ouvriers des chantiers à Kiel arrêtèrent le travail, nous apprîmes au chantier militaire de Vulkan, par des ouvriers de Kiel, ce qui s'était passé. Il s'en suivit alors une assemblée secrète sur le chantier, 1'usine étant sous occupation militaire. Le travail s'arrêta, mais les ouvriers restèrent ensemble, dans l'entreprise. Une délégation de 17 volontaires fut envoyée à la centrale des syndicats, pour exiger la déclaration d'une grève générale. Nous avons exigé une assemblée. Mais il s'en suivit alors une attitude opposée au mouvement de la part des dirigeants connus du SPD et des syndicats. Pendant des heures se déroulèrent des discussions acerbes. Pendant ce temps, sur le chantier Bloom und Vos, où travaillaient 17 000 ouvriers, une révolte spontanée éclata. Alors, tous les ouvriers quittèrent les usines, au chantier Vulkan également (où travaillait Appel), et se dirigèrent vers la maison des syndicats. C'est à ce moment que les dirigeants disparurent. La révolution avait commencé." (Appel, 1966, discussion avec H.M.Bock).
Ce furent alors surtout les hommes de confiance révolutionnaires élus à ce moment-là qui organisèrent les ouvriers dans des conseils d'entreprise, indépendamment des syndicats. Jan Appel fut élu pour son rôle actif et prépondérant dans les événements, président des hommes de confiance révolutionnaires. Ce fut également lui qui, avec Ernst Thâlmann, fut désigné comme homme de confiance révolutionnaire de l'USPD pendant une assemblée de masse après l'assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, pour organiser la nuit suivante une marche sur la caserne de Barenfeld, afin d'armer les ouvriers. Le manque de centralisation des Conseils, surtout avec Berlin, l'effritement et surtout la faiblesse du KPD(S) qui venait de se former, ne permirent pas au mouvement de se développer, et deux semaines plus tard, le mouvement se tassa. Ce fut alors la période où toute l'attention fut orientée vers le renforcement de l'organisation.
Pour les ouvriers en lutte, les syndicats étaient des organes morts. Début 1919, les syndicats locaux, de Hambourg entre autres, furent dissous, les contributions et les caisses réparties parmi les chômeurs. En août, la Conférence du district du nord du KPD (S), avec Hambourg comme fer de lance, obligea ses membres à quitter les syndicats. Selon Appel : "A ce moment là, nous arrivâmes à la conclusion que les syndicats n'étaient pas utilisables pour la lutte révolutionnaire, et cela amena dans une assemblée des hommes de confiance révolutionnaires à la propagande pour la constitution d'organisations d'entreprise révolutionnaires, comme base pour les Conseils. A partir de Hambourg, cette propagande pour la formation d'organisations d'entreprise se répandit et cela amena aux 'Allgemeine Arbeiter Unionen' (aau)." (Ibid.). Le 15 août, les hommes de confiance révolutionnaires se réunirent à Essen avec l'approbation de la centrale du KPD(S) pour fonder les AAU. Dans le journal KAZ apparurent à cette époque différents articles expliquant le fondement de cette décision et pourquoi les syndicats n'avaient plus de raison d'être pour la classe ouvrière dans la période de décadence, et donc révolutionnaire, du système capitaliste.
Jan Appel, comme président des hommes de confiance révolutionnaires, et organisateur actif, fut alors aussi élu comme président du KPD(S) de Hambourg. Dans les mois qui suivirent, les tensions et conflits entre la centrale de Paul Levi et surtout la section du nord du KPD(S) se multiplièrent autour de la question des syndicats, des AAU et du parti de masse. Lorsque eut lieu le 2ème Congrès du KPD en octobre 1919 à Heidelberg, où les questions de l'utilisation du parlementarisme et des syndicats furent discutées et votées, Appel, comme président et délégué du district de Hambourg, prit clairement position contre les thèses opportunistes qui allaient à 1'encontre du développement révolutionnaire. L'opposition, pourtant majoritaire, fut exclue du parti. Au Congrès même, 25 participants furent immédiatement exclus. Le groupe de Hambourg dans sa quasi-totalité se déclara en accord avec l'opposition, suivi par d'autres sections. Après différentes tentatives de l'opposition au sein du KPD(S), finalement, en février 1920, toutes les sections en accord avec l'opposition furent exclues. Mais ce n'est qu'en mars que toute tentative pour redresser le KPD (S) de l'intérieur cessa. Mars 1920 fut en effet la période du putsch de Kapp, pendant laquelle la centrale du KPD(S) lança un appel à la grève générale, tout en préconisant une "opposition loyale", négociant pour éviter toute révolte armée révolutionnaire. Aux yeux de l'opposition, cette attitude trancha et fut le signe clair de l'abandon de toute politique révolutionnaire.
Lorsqu'en avril 1920 le groupe de Berlin quitta le KPD, les bases furent jetées pour la construction du KAPD, et 40000 membres, parmi eux Jan Appel, quittèrent le KPD.
Dans les combats insurrectionnels de la Ruhr de mars 1920, de nouveau Jan Appel se trouva au premier plan, dans les unions, dans les assemblées, dans les luttes. Sur la base de sa participation active dans les combats depuis 1918 et de ses talents organisationnels, les participants au Congrès de fondation du KAPD désignèrent Appel et Franz Jung pour les représenter à Moscou auprès de l'Internationale Communiste. Ils devaient discuter et négocier sur l'adhésion à la 3ème Internationale et sur l'attitude traîtresse de la centrale du KPD pendant l'insurrection de la Ruhr. Pour parvenir à Moscou, ils durent détourner un navire. Une fois sur place, ils eurent des discussions avec Zinoviev, président de l'Internationale Communiste, et avec Lénine. Sur la base du manuscrit de Lénine "Le gauchisme, maladie infantile du communisme", ils discutèrent longuement, réfutant entre autres les fausses accusations de syndicalisme (c'est-à-dire le rejet du rôle du parti) et de nationalisme. Ainsi, Appel, dans ses articles, "Informations de Moscou" et "Où veut en venir Ruhle", dans la KAZ, défendit la position que Laufehberg et Wolffheim devaient être exclus "parce qu'on doit avoir plus de confiance dans les communistes russes que dans les nationalistes allemands qui ont quitté le terrain de la lutte de classe". Appel déclara aussi qu'il avait "jugé que Ruhle aussi ne se trouvait plus sur le terrain du programme du Parti ; si cette vision s'avère être fausse, alors 1'exclusion de Ruhle ne se pose pas. Mais les délégués avaient le droit et le devoir à Moscou de défendre le programme du Parti."
Il fallut encore plusieurs voyages à Moscou pour que le KAPD fût admis comme organisation sympathisante de la 3ème Internationale et pût ainsi participer au 3ème Congrès en 1921.
Appel travailla entre temps, sous le faux nom de Jan Arndt, un peu partout en Allemagne, et fut actif là où le KAPD ou l'AAUD l'envoyèrent. Ainsi, il devint responsable de l'hebdomadaire "Der Klassenkampf" de l'AAU dans la Ruhr où il resta jusqu'en novembre 1923.
Au 3ème Congrès de l'Internationale Communiste, en 1921, de nouveau Appel, avec Meyer, Schwab et Reichenbach, furent les délégués pour mener les négociations ultimes au nom du KAPD, contre l'opportunisme grandissant au sein de l'IC. Ils tentèrent vainement, avec des délégués de Bulgarie, Hongrie, Luxembourg, du Mexique, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de Belgique et des Etats-Unis, de former une opposition de gauche. Fermement, en ignorant les sarcasmes des délégués bolcheviks ou du KPD, Jan Appel, sous le pseudonyme de Hempel, souligna à la fin du 3ème Congrès quelques questions fondamentales pour la révolution mondiale d'aujourd'hui.. Souvenons-nous de ses paroles : ".Il manque aux camarades russes une compréhension des choses telles qu'elles se passent en Europe occidentale. Les camarades russes comptent avec une population telle que celle qu'ils ont en Russie. Les russes ont vécu une longue domination tsariste, ils sont durs et solides, tandis que chez nous le prolétariat est pénétré par le parlementarisme et en est complètement infesté. En Europe, il s'agit de faire quelque chose d'autre. Il s'agit de barrer la route à 1'opportunisme et 1'opportunisme chez nous, c'est 1'utilisation des institutions bourgeoises dans le domaine économique. Les camarades russes ne sont pas non plus des surhommes, et ils ont besoin d'un contrepoids, et ce contrepoids ce doit être une troisième internationale liquidant toute tactique de compromis, parlementarisme et vieux syndicats. "
Appel fut arrêté en novembre 1923, à cause du détournement du navire avec lequel la délégation s'était rendue à Moscou en 1920. En prison, il prépara une étude sur le mouvement ouvrier et en particulier sur la période de transition vers le communisme, à la lumière des leçons des événements de Russie.
Il fut libéré fin 1925, mais l'Allemagne était devenue dangereuse pour lui et il obtint un travail dans un chantier naval en Hollande. Ainsi, à partir d'avril 1926, commença sa période d'activité politique en Hollande. Il prit contact immédiatement avec Canne Meyer, qu'il ne connaissait pas personnellement, afin de pouvoir s'intégrer dans la situation aux Pays-Bas. A partir de ce contact, des ex-membres du CPH et/ou ex-KAPH se regroupèrent lentement, et à partir de 1927 se fonda le GIC qui publiera une revue, PIC, ainsi qu'une édition en allemand. Ils suivirent de près l'évolution du KAPD en Allemagne et s'orientèrent plus vers les thèses du KAP Berlin, en opposition au groupe autour de Gorter. Pendant 4 ans, le GIC étudia et discuta l'étude qu'Appel avait faite en prison, et le livre "Les fondements de la production et de la distribution communistes" fut publié en 1930 avec les AAU de Berlin, livre qui fut discuté et critiqué par des révolutionnaires dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui.
Appel fit encore plusieurs contributions importantes pendant les années difficiles de la contre-révolution, jusqu'à la seconde guerre mondiale, contre les positions des PC dégénérés et devenus bourgeois. Le GIC travailla en contact avec d'autres petites organisations révolutionnaires dans différents pays (comme la Ligue des Communistes Internationalistes en Belgique, le groupe autour de Bilan, "Union Communiste" en France, le groupe autour de P.Mattick aux Etats-Unis, etc.), et fut un des courants les plus importants de cette période à maintenir en vie l'internationalisme. A partir de 1933, Appel dut se tenir en retrait, vu que l'Etat hollandais en ami de l'Allemagne hitlérienne l'avait expulsé. Jusqu'en 1948, Appel vécut dans la clandestinité sous le nom de Jan Vos.
Pendant et après la seconde guerre mondiale cependant, Appel et d'autres membres du GIC se regroupèrent avec le "Spartacusbond", issu du "Marx-Lenin-Luxemburg Front", seule organisation internationaliste en Hollande jusqu'en 1942. Les membres du GIC qui s'attendaient, tout comme d'autres organisations révolutionnaires de cette période, à des mouvements de classe importants après la guerre, jugèrent important de se regrouper, même s'il existait encore des divergences entre eux, pour préparer une organisation révolutionnaire plus importante, plus forte, afin de jouer un rôle plus prépondérant dans les mouvements. Mais les mouvements ne se développèrent pas, et de nombreuses discussions eurent lieu dans le groupe sur le rôle et les taches de l'organisation politique. Appel resta dans le "Spartacusbond" et défendit des positions contre les positions conseillistes qui se renforçaient au sein du groupe. Les membres du GIC quittèrent presque tous le groupe en 1947 pour se perdre très vite dans le néant. En témoigne une lettre de Pannekoek, devenu lui aussi conseilliste, de septembre 1947 : "...Et maintenant que le mouvement de masse fort n'est pas venu, ni l'afflux de jeunes ouvriers (on avait compté là-dessus, que ça devait se produire après la guerre, et c'était sûrement le motif fondamental du GIC pour se regrouper avec le "Spartacusbond" dans la dernière année de guerre), c'est en fait logique pour le GIC de reprendre son ancien rôle, de ne pas empêcher le "Spartacusbond" de reprendre son ancien rôle du RSP. Selon mes informations, on discute pour le moment dans le GIC sur quelles formes de propagande choisir. Il est dommage que Jan (Appel) soit resté avec les gens du "Spartacus bond". Déjà dans le passé, j'avais remarqué comment son esprit et ses conceptions sont déterminés par ses expériences dans le grand mouvement allemand qui était le point culminant de sa vie; c'est là qu'il avait formé sa compréhension des techniques de 1'organisation des conseils. Mais il était trop un homme d'action pour se contenter de simple propagande. Mais vouloir être homme d'action dans une période où le mouvement de masse n'existe pas encore mène facilement à des formulations de formes d'actions impures et mystificatrices pour 1'avenir. Peut-être c'est quand même positif que dans le "Spartacusbond" ils gardent -un élément fort."
Par accident, Appel fut redécouvert par la police hollandaise en 1948. Après de multiples difficultés, on lui permit de rester aux Pays-Bas mais en lui interdisant toute activité politique. Appel dut ainsi quitter formellement le "Spartacusbond" et la vie politique organisée.
Après 1948, Appel resta néanmoins en contact avec ses vieux camarades, tant aux Pays-Bas qu'ailleurs, entre autres avec "Internationalisme" (prédécesseur du CCI) dans la fin des années 40 et dans les années 50. C'est pourquoi Jan Appel fut à nouveau présent lorsqu'à la fin des années 60 fut fondé "Révolution Internationale", future section en France du CCI, résultat des luttes massives du prolétariat en 1968. Puis, avec de nombreuses visites de camarades et sympathisants du CCI, nous vîmes Jan Appel contribuer à la formation de la nouvelle génération de révolutionnaires, participer à la constitution formelle du CCI en 1976, une dernière fois, passant ainsi le flambeau et les enseignements d'une génération révolutionnaire à celle d'aujourd'hui.
Jusqu'à la fin, Jan Appel fut convaincu que "seule la lutte de classe est importante". Nous poursuivons son combat.
Pour le CCI, A.Bai
Bibliographie dans la Revue Internationale :
"Le danger 'conseilliste' " (40);
"Le Communisten-bond Spartacus et le courant conseilliste"(39, 38);
"La faillite du conseillisme", "Les conceptions de l'organisation dans la gauche germano-hollandaise" (37);
"Critique de 'Lénine philosophe' de Pannekoek" (30,28,27,25);
"Réponse au 'communisme de conseil', Danemark" (25);
"La gauche hollandaise" (21,16,17);
"Rupture avec Spartacusbond"(9);
"Les épigones du conseillisme à 1'oeuvre : Spartacusbond, Daad en Gedachte" (2).
LISTE DES SIGLES UTILISES DANS L'ARTICLE :
GIC : Groupe des Communistes Internationaux.
KAZ : Journal Communiste Ouvrier.
USPD : Parti Social-démocrate Indépendant d'Allemagne.
RSP: Parti Socialiste Révolutionnaire, scission du CPH (1925-35), d'où sort le RSAP (Sneevliet), qui se transforme en "Marx-Lenin-Luxemburg Front"(MLL Front) en 1940.
KPD(S) : Parti Communiste d'Allemagne (Spartacus).
KAPD : Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne.
CPH : Parti Communiste de Hollande.
KAPH : Parti Communiste Ouvrier de Hollande (de Gorter).
PIC : Matériel de presse des Communistes Internationaux.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Correspondance internationale : en Inde, l'émergence d'un nouveau regroupement communiste
- 3106 lectures
PRESENTATION
L'effort de prise de conscience du prolétariat s'exprime nécessairement par l'émergence constante de groupes, de minorités qui s'organisent pour participer au développement de cet effort dans l'ensemble de la classe. Plus la lutte de classe se développe, plus la prise de conscience mûrit dans les entrailles de la société, plus nombreux sont les éléments et groupes qui surgissent. L'apparition d'un nouveau groupement en Inde, dans le cadre des principes fondamentaux de la lutte du prolétariat à notre époque, constitue une expression de cette tendance permanente du prolétariat à la prise de conscience de son être révolutionnaire et de la présente maturation de la conscience de la classe.
Ce groupe s'est baptisé "Communist Internationalist" ([1] [13]) et vient de publier le premier numéro d'un bulletin qui :se donne pour tâche de participer à "la clarification et au regroupement des éléments et individus à la recherche d'une clarté révolutionnaire". Nous publions ci-dessous les principes de base à travers lesquels ils se définissent pour le moment.
Le fait que ce groupe surgisse en Inde constitue une démonstration éclatante du caractère unitaire du prolétariat comme classe mondiale, qui défend les mêmes intérêts et mène le même combat, quelle que soit la diversité des conditions dans lesquelles il. se trouve. Même si le prolétariat des pays sous-développés vit dans des conditions d'isolement national et international telles qu'il peut difficilement ouvrir la dynamique de la révolution mondiale ([2] [14]), il n'en est pas moins une partie totalement intégrante de la classe ouvrière mondiale. C'est l'être historique et mondial de la classe qui produit des minorités révolutionnaires. C'est pourquoi, les minorités révolutionnaires du prolétariat ne sont pas immédiatement dépendantes de l'expérience du prolétariat là où elles se trouvent, et peuvent surgir dans des pays sous-développés. Le CCI lui-même en est une expression : sa plus ancienne section est née au Venezuela.
Comme le lecteur pourra s'en rendre compte, les positions du CCI ont été un facteur crucial dans la clarification du groupe en Inde. Elles lui ont notamment permis de se rattacher à l'expérience historique de la classe, celle des Internationales et des Gauches communistes. Sans un rattachement et une compréhension critique de l'expérience historique de sa classe, aucun groupement révolutionnaire ne saurait s'enraciner.
LA RUPTURE AVEC LE GAUCHISME
Les positions du CCI ont servi de pôle de clarification pour les éléments de ce groupe qui, depuis 1982, avaient engagé un processus plus ou moins confus de rupture avec un groupe maoïste ([3] [15]). Elles les ont aides à mener à bien ce processus et à accomplir pleinement cette rupture qui est la condition sine qua non d'une évolution positive vers des positions communistes. Beaucoup d'analyses du CCI les ont aidés, mais nous voudrions souligner ce qui a constitué la pierre de touche de cette réelle rupture : la question nationale.
Dans les pays sous-développés, la mystification la plus importante de la bourgeoisie, celle qui trouve un écho dans la situation de misère de la population et du prolétariat, est le nationalisme, sous toutes ses formes, contre "l'impérialisme". C'est derrière ce slogan que les bourgeoisies nationales des pays sous-développés, spoliées par les plus grandes puissances, tentent de faire l'unité des mécontentements. Si nous regardons la Pologne où se sont déroulés à plusieurs reprises de formidables combats du prolétariat, nous devons nous rappeler la force du nationalisme anti-russe. Dans les pays d'Amérique Latine, "l'impérialisme yankee" a été dans les années 70 le grand thème de dévoiement de la part des gauchistes, défenseurs des "luttes de libération nationale". En Inde, l'idée de "nation opprimée" avec toutes les divisions nationales qui traversent cet Etat constitué tardivement, pèse très fortement. Le mythe de la "nation indienne", "indépendante" des grandes puissances impérialistes, est le fer de lance des mystifications de la bourgeoisie, masquant ainsi les caractéristiques de notre époque, à savoir l'impossibilité de tout développement et indépendance nationaux, et le réel ennemi du prolétariat : la bourgeoisie mondiale et nationale.
La "question nationale" n'est pas nouvelle : elle a posé beaucoup de problèmes et fait commettre bien des erreurs au mouvement ouvrier ([4] [16]). La compréhension que le terrain prolétarien contient la rupture avec toute forme de nationalisme par le groupe "Communist Internationalist" est l'un des critères majeurs qui nous permet de saluer aujourd'hui son émergence comme expression du prolétariat, comme groupement communiste.
Malheureusement, des groupes du milieu révolutionnaire, Battaglia Comunista (BC) et Communist Workers Organisation (CWO), n'ont pas la clarté des nouvelles énergies qui se dégagent aujourd'hui de la lutte de classe. D'Inde, ils rapportent dans les pages de leur presse, les nouvelles d'un groupe, le Revolutionary Proletarian Party (RPP), dont les camarades de "Communist Internationalist" nous disent :
"Nous pensons que leurs efforts (du RPP) pour rompre avec le gauchisme ne se sont pas bloqués ; en fait, ils n'ont jamais commencé d'efforts dans ce sens (...) ; sur la question nationale, ils n'ont même pas essayé de rompre avec le nationalisme fanatique de leur organisation-mère Le moindre internationalisme pour eux est aberrant Développant leur attaque hystérique contre les positions du CCI, dans leur publication en hindi, ils mettent en avant les idées de "socialisme (bien sûr comme 'première étape') 'en un seul pays', de 'nationalisme prolétarien', et d'autres positions tout à fait gauchistes ( .) L'enthousiasme de la CWO et ses relations avec le RPP et 1 'UCM ne font que montrer la confusion de la CWO " (Lettre du 1/4/85).
Sur cette question, BC et la CWO justifient leurs concessions aux "mouvements nationaux" par les spécificités... "nationales" des pays sous-développés ([5] [17]), et ne voient pas que, ce faisant, ils font le jeu d'une des mystifications les plus pernicieuses dans les pays sous-développés, le nationalisme. Et en fin de compte ils en sont eux-mêmes le jouet. Mais BC et la CWO ne veulent pas nous croire. Le CCI, disent-ils, est indifférentiste, voudrait un prolétariat pur, il est hors du réel...
Voila la force du nouveau groupe "Communist Interna-tionalist". Il est un argument concret, éminemment réel, contre les justifications de BC-CWO à leur opportunisme envers le gauchisme des RPP et autre UCM. L'arrivée de nouvelles forces aux positions communistes est un renforcement de tout le milieu prolétarien, pas seulement en forces numériques, mais aussi en argumentation concrète, pratique.
LES PERSPECTIVES
Comme nous l'avons dit plus haut, la clarté politique pour des éléments qui se sont détachés du gauchisme
et ont traversé tout un processus d'évolution à partir de celui-ci, passe par une claire rupture avec leur passé, et notamment la compréhension du caractère bourgeois du gauchisme. Dans les pays capitalistes avancés, c'est surtout la question du parlementarisme et, de plus en plus, du syndicalisme, qui sont la principale mystification que l'on doit démasquer dans le gauchisme. Dans les pays sous-développés, c'est avant tout le nationalisme.
Le groupe "Communist Internationalist" a 'accompli cette rupture, et adopté les positions fondamentales du prolétariat dans la période de décadence. Les perspectives de discussion pour la clarification des positions communistes qu'ils se donnent dans leur déclaration, le but de regroupement des éléments révolutionnaires qui surgissent et l'orientation vers l'intervention dans la lutte de classe qu'ils affirment et qu'ils ont déjà réalisée en publiant deux tracts lors d'événements en Inde (l'assassinat d'Indira Gandhi, puis les élections), sont des traits caractéristiques d'une expression authentiquement prolétarienne. Ces camarades ont encore du chemin à parcourir, comme ils le disent eux-mêmes, pour développer une pleine cohérence. Mais leur émergence constitue une nouvelle contribution à la lutte historique du prolétariat, un pas vers la formation de son parti mondial dans les perspectives d'affrontements de classe à venir. Pour notre part, nous contribuerons de toutes nos forces, comme c'est notre orientation depuis le début de notre existence, à la clarification et au regroupement des forces révolutionnaires qui se dégagent. Salut au groupe "Communist Internationalist".
CCI
Ce que nous sommes
Après des décennies d'une longue contre-révolution, la reprise mondiale du prolétariat a commencé dans les années 60 avec la réapparition de la crise ouverte du capitalisme décadent. Depuis, d'un côté le capital s'est enfoncé dans l'abîme de la crise s'approfondissant ; de l'autre, les luttes de la classe ouvrière ont été de plus en plus fières et conscientes.
Dans une perspective qui s'ouvre vers la révolution prolétarienne mondiale, des expressions politiques de la classe, ses minorités révolutionnaires, ont surgi et surgissent encore. Et si ces groupes sont le produit des efforts de prise de conscience de la classe, ceci a été vrai à un niveau encore plus rudimentaire en ce qui concerne nos propres efforts.
Bien qu'il y ait ici (en Inde) une longue tradition de luttes héroïques de la classe, ce sont les traits de la reprise mondiale de la classe qui ont commencé à arracher le masque du stalinisme et à faire succomber le mythe d'un socialisme russe et chinois. C'est sous la pression de ces luttes et sous l'influence directe et puissante de leur impact que certains éléments ici dont nous-mêmes, avons tenté de nous dégager du gauchisme, du stalinisme et du maoïsme (Naxalbari) et de faire de premiers pas vers des positions communistes. Contrairement à l'Europe où les nouveaux éléments et groupes révolutionnaires qui surgissaient, avaient à leur disposition le trésor que constituent les analyses de la gauche communiste, et pouvaient s'appuyer dessus, nos efforts initiaux ont été le résultat de purs instincts prolétariens.
Mais un simple instinct de classe ne suffit pas. Pour développer ces premiers efforts, il était essentiel qu'ils soient fermement basés sur le terrain solide de la longue expérience historique de la classe et de sa synthèse -le marxisme. Les analyses du CCI. ont été d'une grande aide pour nous dans cette direction.
Ces efforts nous ont convaincus qu'une position communiste ne peut que partir d'un ferme rejet de courants capitalistes tels que le stalinisme, le trotskysme et le maoïsme, et en se reliant au riche héritage des première, deuxième et troisième Internationales.
Mais ceci n'était pas encore suffisant. Nous vivons dans une époque, celle de la décadence du capitalisme, qui n'a commencé que récemment, en 1917-18. Toutes ses implications pour la tactique prolétarienne n'étaient pas clairement comprises alors. Mais aujourd'hui, après soixante-dix ans d'expérience, on ne peut passer à côté de cela sans abandonner les positions de classe.
En 1914 le système capitaliste est entré dans sa phase de décadence à cause de la saturation du marché mondial. La tendance au capitalisme d'Etat s'est développée dans tous les pays pour maintenir en vie le capitalisme décadent. L'Etat a commencé à se développer sous une forme monstrueuse, absorbant et intégrant toutes les sphères de la vie en son sein. Au cours de ce processus, le monstrueux Etat capitaliste a intégré toutes les anciennes organisations réformistes de la classe en son sein et les a transformées en ses propres appendices. Toutes les vieilles tactiques concernant les syndicats, les parlements, les fronts et les libérations nationales ont perdu leur ancien caractère prolétarien.
Les positions des fractions de gauche de la 3e Internationale ont représenté de premiers efforts pour rejeter les vieilles tactiques à la lumière du changement des conditions, et pour en adopter de nouvelles à la place. Ensuite, avec la dégénérescence de la révolution russe et du Comintern, les fractions de gauche ont non seulement lutté contre la contre-révolution stalinienne et, plus tard, ses supporters trotskystes, mais ont approfondi leur compréhension du caractère contre-révolutionnaire des syndicats, de l'activité parlementaire, du frontisme, des luttes de libération nationale et de toutes les sortes de nationalisme, à travers une profonde analyse de la décadence du capitalisme en fonction de laquelle elles ont développé leur tactique.
Nous pensons que l'expérience des dernières décennies a démontré maintes et maintes fois que ces positions étaient correctes. C'est notre ferme conviction que garder en vue ces positions, les comprendre et les assimiler, est essentiel pour toute intervention fructueuse dans les luttes de la classe.
C'est dans ce but que nous avons orienté nos efforts tous ces derniers temps. Nous avons essayé de comprendre l'expérience de la classe entre la première grande vague révolutionnaire et la reprise dans les années 60 et d'en assimiler les leçons. Nous avons aussi trouvé pour cet effort une aide valable avec le CCI.
Mais ceci n'est pas un effort valable une fois pour toutes. C'est un processus long et continu. Ce bulletin a pour but de permettre à ce processus de se poursuivre et de le pousser plus loin à une échelle supérieure et plus large. Nous aimerions donc avoir un débat sur la longue expérience historique de la classe avec les éléments qui surgissent et voudront que des leçons soient tracées à partir de l'expérience des luttes actuelles de la classe. Nous nous engageons à ouvrir les pages de ce bulletin à des éléments et groupes qui adoptent les positions communistes et sont intéressés à mener un débat honnête.
Mais ce travail de compréhension de l'expérience de la classe et d'apprentissage de ses leçons n'est pas notre but en soi. Comme révolutionnaires, notre but est d'enrichir notre compréhension des positions communistes afin de baser la défense de ces positions sur un terrain ferme et nos interventions dans la classe sur ces positions. En fait, le plus important pour^ nous, c'est cette intervention, la rendre fructueuse et,à travers elle, se réapproprier toutes les leçons de l'expérience passée de la classe. Ainsi, en les assimilant, la classe pourra réaliser toutes les possibilités latentes existant dans ses luttes présentes et à venir.
Tout cela nécessite un effort systématique et organisé. Etant donné le rôle décisif des révolutionnaires dans les luttes de la classe, il est essentiel que les débats du bulletin soient dirigés pour aider les éléments et individus à la recherche d'une clarté révolutionnaire et pour développer un pôle de regroupement. Le bulletin devra garder constamment en vue ce but extrêmement important.
Nous avons mentionné l'importante contribution du CCI dans notre développement vers des positions communistes. Même si nos positions sont le résultat de nos efforts pour comprendre et assimiler les analyses du CCI, nous pensons qu'il est nécessaire de clarifier la forme de nos relations actuelles avec le CCI.
BIEN QU'IL SYMPATHISE AVEC LE CCI, LE BULLETIN N'EST, EN AUCUN CAS, UNE PUBLICATION DU CCI, NI PARTIE DE SON CADRE ORGANI-SATIONNEL.
C'EST LE BULLETIN SEUL QUI PORTE LA RESPONSABILITE POLITIQUE DES IDEES EXPRIMEES DANS SES PAGES.
Communist Internationalist
[1] [18] Adresse : Post Box n°25 - N.I.T FARIDABAD 121001 - HARYANA STATE - INDE
[2] [19] Voir l'article "Le prolétariat d'Europe occidentale.", Revue Internationale n°3 1.
[3] [20] Nous publierons ultérieurement un article sur 1'évolution et les leçons de 1'expérience de ces camarades
[4] [21] Voir dans ce n° "Les communistes et la question nationale, III" ainsi que les Revues Internationales n°34 et 36.
[5] [22] Voir "La formation du BIPR : le bluff d'un regroupement", Revues Internationales n°40 et 4 7
Géographique:
- Inde [23]
Courants politiques:
Débat interne : les glissements centristes vers le conseillisme
- 2920 lectures
Dans le précédent numéro de la Revue Internationale est paru un article de discussion signé JA et intitulé "Le CCI et la politique du moindre mal", exprimant les positions d'un certain nombre de camarades qui se sont récemment constitués en "tendance". Faute de temps (1'article nous étant parvenu quelques jours seulement avant la publication de la Revue), nous n'avions pas apporté de réponse à cet article lors de sa parution : nous nous proposons donc de le faire dans le présent numéro. Cependant, cette réponse ne sera pas exhaustive dans la mesure où le texte de la camarade JA aborde une multitude de questions diverses qu'on ne saurait traiter de façon sérieuse dans un seul article. Le fait que nous n'apportions pas de réponse à la totalité des arguments et questions contenus dans le texte ne signifie donc nullement que nous désirions esquiver ces questions (sur lesquelles nous serons amenés à revenir), mais tout simplement que nous préférons permettre au lecteur de se faire une idée claire et précise des positions de 1'organisation, plutôt que semer la confusion en mélangeant tous les sujets comme le fait malheureusement la camarade JA dans son article.
Le texte de JA a en effet pour caractéristique d'apporter bien plus de confusion que de clarté sur la véritable teneur des questions en débat : le lecteur non informé de ce débat risque de s'y perdre complètement. En fait ce texte ne fait qu’exprimer de façon particulièrement significative (on pourrait dire presque caricaturale) la confusion dans laquelle se débattent eux-mêmes à l1heure actuelle les camarades qui ont décidé de constituer une "tendance". C'est pour cela, qu'avant même de pouvoir répondre directement à l'article de la camarade JA, il est nécessaire -et de notre responsabilité- que nous présentions au lecteur un certain nombre d'éléments sur la façon dont le débat est apparu et s'est développé dans notre organisation, ne serait-ce que pour rectifier et éclaircir ce que dit là-dessus cet article.
L'ORIGINE DU DEBAT
Les difficultés du CCI en 1981
Comme pour l'ensemble des organisations communistes, les années 80, "années de vérité" ([1] [25]), ont été un test pour le CCI. L'aggravation considérable de la crise du capitalisme durant ces années, l'intensification des tensions entre blocs impérialistes, l'ampleur croissante des enjeux et de la portée des luttes ouvrières, ont mis à l'épreuve la capacité des groupes révolutionnaires de se hisser à la hauteur de leurs responsabilités. Cette épreuve s'est traduite, au sein du milieu prolétarien, par des convulsions importantes allant jusqu'à la désagrégation de certaines organisations comme "Programme Communiste" (accompagnée par une évolution de ses débris vers le gauchisme), la disparition complète d'autres groupes comme "Pour une Intervention Communiste", la fuite en avant dans des pratiques parfaitement opportunistes (flirt du tandem "Battaglia Comunista"-"Communist Workers Organisation" avec des groupes nationalistes kurdes-iraniens, participation des "Nuclei Leninisti Internazionalisti" à toutes sortes de"collectifs"avec les gauchistes et au référendum en Italie) ([2] [26]). Pour sa part, le CCI n'a pas été épargné puisque :
"Depuis son 4ème Congrès (1981), le CCI a connu la crise la plus grave de son existence. Une crise qui a secoué profondément 1'organisation, lui a fait frôler 1'éclatement, a provoqué directement ou indirectement le départ d'une quarantaine de ses membres, a réduit de moitié les effectifs de sa deuxième section territoriale. Une crise qui s'est traduite par tout un aveuglement, une désorientation comme le CCI n'en avait pas connus depuis sa création. Une crise qui a nécessité, pour être dépassée, la mobilisation de moyens exceptionnels : la tenue d'une Conférence Internationale extraordinaire, la discussion et 1 'adoption de textes d'orientation de base sur la fonction et le fonctionnement de 1'organisation révolutionnaire, 1'adoption de nouveaux statuts." (Revue Internationale n°35, Présentation du 5ème Congrès du CCI).
Un redressement effectif, mais incomplet : les déviations conseillistes
Avec la Conférence extraordinaire de janvier 82, le 5ème Congrès du CCI (juillet 83) devait représenter un moment important du ressaisissement de notre organisation après les difficultés rencontrées en 1981. Cependant, malgré l'adoption de rapports et résolutions (voir Revue Internationale n°35) tout à fait corrects et qui ont conservé leur validité, ce congrès devait révéler, par ses débats, l'existence au sein de l'organisation d'un certain nombre de faiblesses sur trois questions essentielles :
- l'évolution des conflits impérialistes dans la période actuelle ;
- les perspectives du développement de la lutte de classe ;
- le processus de prise de conscience du prolétariat.
Sur le premier point, on pouvait constater une certaine tendance à la sous-estimation de l'ampleur de ces conflits, à considérer que, puisque le cours historique est à l'heure actuelle aux affrontements de classe généralisés (et non à la guerre mondiale comme dans les années 30) ([3] [27]), nous allions assister à une atténuation progressive des tensions entre blocs impérialistes.
Sur le deuxième point, il s'était développé dans les débats du Congrès la thèse suivant laquelle le recul des luttes ouvrières constaté par le CCI dès 1981 serait de "longue durée" et qu'il faudrait un "pas qualitatif" dans la conscience et les luttes du prolétariat pour qu'on puisse assister à une nouvelle vague de combats de classe. Quelques mois après le Congrès, cette thèse -qui pourtant ne figurait ni dans le rapport, ni dans la résolution sur la situation internationale- devait révéler son caractère pernicieux et dangereux en empêchant de nombreux camarades et plusieurs sections du CCI de reconnaître l'importance des luttes dans le secteur public en Belgique et aux Pays-Bas de l'automne 83 comme les premières manifestations d'une reprise générale des combats ouvriers.
Sur le troisième point, il avait été exposé tant au Congrès que dans les textes internes et sans que cela provoque de réfutation sensible de la part de l'organisation, une analyse nettement conseilliste du processus de prise de conscience du prolétariat dont on peut se faire une idée par les extraits qui suivent :
"...la formule 'maturation souterraine de la conscience est à rejeter. D'abord parce que le seul et unique creuset de la conscience de classe c'est sa lutte massive et ouverte. D'autre part, les moments de recul dans la lutte marquent une régression de la conscience. La formule maturation souterraine de la conscience exprime une confusion entre deux processus qui, même s'ils sont étroitement liés, sont différents : le développement des conditions objectives et la prise de conscience.
Placés au centre du processus historique capitaliste, la classe ouvrière et surtout ses fractions centrales peuvent comprendre et traduire dans le fait de la prise de conscience la maturation des conditions objectives, mais cela elles ne peuvent le faire seulement que dans la lutte, c'est-à-dire dans l'affrontement avec le capitalisme (...).
La conscience de classe n'avance pas comme dans un cours scolaire... Phénomène global, il implique nécessairement une vision d'emblée globale et d'ensemble et pour cela son seul creuset c'est la lutte massive et ouvrière (...).
Cette formule ("maturation souterraine de la conscience") sous-estime un phénomène qui se produit dans les moments de recul : la régression qui s'opère dans la classe, une régression de la conscience. Et cela il ne faut pas avoir peur de le reconnaître parce que de la même façon que la lutte ouvrière se déroule en dents de scie, la conscience ne se développe pas de manière linéaire mais au contraire fait des avancées et des reculs. (...)Ce sont deux facteurs qui déterminent le niveau et le développement de la prise de conscience: la maturation de la crise historique du capitalisme et le rapport de forces entre les classes. Ces deux facteurs posés à 1 'échelle mondiale déterminent dans chaque période de la lutte de classe la clarté sur ses buts historiques, les confusions, les illusions,les concessions mêmes à 1'ennemi (...) cela se fait en donnant une réponse aux problèmes posés dans les luttes précédentes par les nouvelles luttes."
Les camarades qui s'identifiaient avec cette analyse pensaient être en accord avec les conceptions classiques du marxisme (et donc du CCI) sur le problème de la conscience de classe. En particulier, ils ne rejetaient nullement de façon explicite la nécessité d'une organisation des révolutionnaires dans le développement de celle-ci. Mais en fait, ils avaient été conduits à faire leur une vision conseilliste :
- en faisant de la conscience un élément uniquement déterminé et jamais déterminant de la lutte de classe ;
- en considérant que "le seul et unique creuset de la conscience de classe, c'est la lutte massive et ouverte", ce qui ne laissait aucune place aux organisations révolutionnaires ;
- en niant toute possibilité pour celles-ci de poursuivre un travail de développement et d'approfondissement de la conscience de classe dans les moments de recul de la lutte,
La seule différence majeure entre cette vision et le conseillisme, c'est que ce dernier va jusqu'au bout de sa démarche en rejetant explicitement la nécessité des organisations communistes, alors que nos camarades n'allaient pas jusque là.
La résolution de janvier 1984
Face aux différentes faiblesses qui s'étaient manifestées au sein du CCI, son organe central devait adopter en janvier 1984 une résolution en trois volets (conflits impérialistes, perspectives des luttes de classe, développement de la conscience) dont nous reproduisons ici le dernier (points 7 et 8).
7. Ce sont donc 1'aggravation de la crise et les attaques économiques contre la classe ouvrière qui constituent le moteur essentiel du développement des luttes et de la conscience de la classe. C'est notamment pour cela qu'à l'heure actuelle, et pour un bon moment encore, c'est la riposte aux agressions contre le niveau de vie des ouvriers, et non aux menaces de guerre, qui sera le facteur de leur mobilisation, même si les luttes économiques constituent en fait un obstacle à ces menaces. Cependant il ne faut pas donner à cette constatation matérialiste élémentaire, au rejet de la vision idéaliste critiquée plus haut, une interprétation restrictive et unilatérale étrangère au marxisme. Il faut se garder en particulier de la thèse qui ne voit la maturation de la conscience de classe que comme résultat ou reflet de la maturation des conditions objectives', qui considère que les luttes provoquées par cette 'maturation des conditions objectives' sont le 'seul creuset' où se forge la conscience, laquelle 'régresserait' à chaque recul des luttes. A une telle vision, il est nécessaire d'opposer les points suivants :
a) Le marxisme est une démarche matérialiste et dialectique : la pratique de la classe est praxis, c'est-à-dire qu'elle intègre comme facteur actif la conscience de la classe. La conscience n'est pas seulement déterminée par les conditions objectives et par la lutte, elle est également déterminante dans la lutte. Ce n'est pas un simple résultat statique de la lutte mais elle a sa propre dynamique et devient à son tour 'force matérielle ' (Marx).
b) Même si elles font partie d'une même unité et agissent l'une sur l'autre, il est faux d'identifier la conscience de classe avec la conscience de la classe ou dans la classe, c'est-à-dire son étendue à un moment donné. Autant cette dernière relève d'un grand nombre de facteurs, aussi bien généraux-historiques que contingents-immédiats -notamment le développement des luttes- autant la première est connaissance de soi, non seulement dans1'existence immédiate de la classe, dans son présent, mais également dans son devenir. La condition de la prise de conscience est donnée par 1 'existence historique de la classe capable d'appréhender son avenir, et non pas les luttes contingentes-immédiates. Celles-ci, 1'expérience, apportent de nouveaux éléments à son enrichissement, notamment dans les moments d'intense activité du prolétariat. Mais elles ne sont pas les seules : la conscience surgissant avec 1'existence a également sa propre dynamique : la réflexion, la recherche théorique, qui sont autant d'éléments nécessaires à son développement.
c) Les périodes de recul de la lutte ne déterminent pas une régression ni même un arrêt dans le développement de la conscience de classe : 1'ensemble de 1 'expérience historique, depuis 1'approfondissement de la théorie après la défaite de la révolution de 1848 jusqu'au travail des gauches en pleine contre-révolution atteste du contraire. Là encore, il est nécessaire de distinguer ce qui relève d'une continuité dans le mouvement historique du prolétariat : 1 élaboration progressive de ses positions politiques et de son programme, de ce qui est lié aux facteurs circonstanciels : 1'éten due de leur assimilation et de leur impact dans 1 'ensemble de la classe.
d) Ce n'est pas uniquement dans et au cours des luttes futures que se donnée la réponse aux questions et problèmes posés dans les luttes passées. En effet, non seulement les organisations révolutionnaires contribuent largement dans les après- luttes, et avant que ne surgissent des luttes nouvelles, à tirer les leçons des expériences vécues par la classe et à les propager en son sein, mais il se fait dans la tête de 1'ensemble des ouvriers tout un travail de réflexion qui va se manifester dans ses luttes nouvelles. Il existe une mémoire collective de la classe, et cette mémoire contribue également au développement de la prise de conscience et à son extension dans la classe, comme on a pu le constater une nouvelle fois en Pologne où les luttes de 80 révélaient 1'assimilation de l'expérience de celles de 70 et 76. Sur ce plan, il importe de souligner la différence existant entre une période de recul historique du prolétariat -le triomphe de la contre-révolution- où les leçons de ses expériences sont momentanément perdues pour sa très grande majorité, des périodes comme aujourd'hui, où ce sont les mêmes générations ouvrières qui participent aux vagues successives de combats contre le capitalisme et qui intègrent progressivement dans leur conscience les enseignements de ces différentes vagues.
Les luttes massives et ouvertes sont effectivement un riche creuset du développement de la conscience et surtout de la rapidité de son extension dans la classe. Cependant, elles ne sont pas le seul. L'organisation des révolutionnaires constitue un autre creuset de la prise de conscience et de son développement, un outil indispensable à la classe pour sa lutte immédiate et historique.
Pour cet ensemble de raisons, il existe, entre les moments de lutte ouverte, une 'maturation souterraine' de la conscience (la 'vieille taupe' chère à Marx), laquelle peut s'exprimer tant par l'approfondissement et la clarification des positions politiques des révolutionnaires que par une réflexion et une décantation dans 1'ensemble de la classe, un dégagement des mystifications bourgeoises.
8. En fin de compte, toute conception qui fait découler la conscience uniquement des conditions objectives et des luttes que celles-ci provoquent est incapable de rendre compte de 1'existence d'un cours historique. Si, depuis 1968, le CCI a mis en évidence que le cours historique présent est différent de celui des années 30, que 1'aggravation de la crise économique ne débouche pas vers la guerre impérialiste mondiale mais vers des affrontements de classe généralisés, c'est justement parce qu'il a été en mesure de comprendre que la classe ouvrière d'aujourd'hui n'est plus, et de loin, aussi perméable aux mystifications bourgeoises -notamment le mythe de 1'URSS et 1'antifascisme- qui avaient permis de dévoyer son mécontentement, d'épuiser sa combativité et de 1'embrigader sous les drapeaux bourgeois.
Avant même que ne s'engage la reprise historique des luttes à la fin des années 60, la conscience du prolétariat était donc déjà la clé de toute la perspective de la vie de la société en cette fin de siècle."
LE DEVELOPPEMENT DU DEBAT ET LA CONSTITUTION D'UNE "TENDANCE"
Les "réserves" sur le point 7 de la résolution et leur caractérisation par le CCI
Lorsque cette résolution fut adoptée, les camarades du CCI qui avaient auparavant développé la thèse de la "non-maturation souterraine" avec toutes ses implications conseillistes s'étaient rendu compte de leur erreur. Aussi se prononcèrent-ils fermement en faveur de cette résolution et notamment son point 7 qui avait comme fonction spécifique de rejeter les analyses qu'ils avaient élaborées auparavant. Par contre, on vit surgir de la part d'autres camarades des désaccords sur ce point 7 qui les conduisirent soit à le rejeter en bloc, soit à le voter "avec réserves" en rejetant certaines de ses formulations. On voyait donc apparaître dans l'organisation une démarche qui, sans soutenir ouvertement les thèses conseillistes, que la résolution condamnait, consistait à servir de bouclier, de parapluie à ces thèses en se refusant à une telle condamnation ou en atténuant la portée de celle-ci. Face à cette démarche, l'organe central du CCI était amené à adopter en mars 84 une résolution rappelant les caractéristiques :
"- de 1'opportunisme en tant que manifestation de la pénétration de 1'idéologie bourgeoise dans les organisations prolétariennes et qui s'exprime notamment par :
. un rejet ou une occultation des principes révolutionnaires et du cadre général des analyses marxistes ;
. un manque de fermeté dans la défense de ces principes ;
- du centrisme en tant que forme particulière de l'opportunisme caractérisée par :
. une phobie à 1'égard des positions franches, tranchantes, intransigeantes, allant jusqu'au bout de leurs implications ;
. 1'adoption systématique de positions médianes entre les positions antagoniques ;
. un goût de la conciliation entre ces positions;
. la recherche d'un rôle d'arbitre entre celles-ci ;
. la recherche de l'unité de 1'organisation à tout prix y compris celui de la confusion, des concessions sur les principes, du manque de rigueur, de cohérence et de continuité dans les analyses. "
Ensuite, la résolution "souligne le fait que, au même titre que toutes les autres organisations révolutionnaires de 1 'histoire du mouvement ouvrier, le CCI doit se défendre de façon permanente contre la pression constante et le danger d'infiltration en son sein de 1'idéologie bourgeoise." Elle considère que, "comme pour toutes les autres organisations, la tendance au centrisme constitue une des faiblesses importantes du CCI et parmi les plus dangereuses". Elle "estime que cette faiblesse s'est manifestée en de multiples occasions dans notre organisation et notamment (...) :
- lors du développement d'une démarche conseilliste au nom du rejet de la notion de 'maturation souterraine de la conscience par une réticence très nette à rejeter vigoureusement cette démarche;
- (en janvier 84) par une difficulté à se prononcer clairement, par des hésitations et des 'réserves' non ou peu explicitées (...), à l'égard de la résolution sur la situation internationale."
Puis la résolution "met fermement en garde 1'ensemble du CCI contre le danger de centrisme". Elle "appelle toute 1'organisation à prendre pleinement conscience de ce danger afin de le combattre avec détermination chaque fois qu'il se manifestera."
Enfin, la résolution estime "qu'une des menaces importantes à 1'heure actuelle est constituée par les dérapages vers le conseillisme -dérapages dont l'analyse rejetant la 'maturation souterraine' constitue une illustration- et qui, dans la période qui vient de luttes massives du prolétariat dans les pays centraux du capitalisme, constituera pour 1 'ensemble de la classe et ses minorités révolutionnaires, un réel danger, plus important, quant à son influence néfaste, que le danger d'entraînement vers des conceptions substitutionnistes." Et la résolution conclut "qu'il existe à 1 'heure actuelle au sein du CCI, une tendance au centrisme - c'est-à-dire à la conciliation et au manque de fermeté - à 1'égard du conseillisme."
La tendance au centrisme à l'égard du conseillisme
Cette tendance au "centrisme à l'égard du conseillisme" devait s'illustrer dans les "explications de votes" qui avaient été demandées aux camarades ayant voté "avec réserves" le point 7 de la résolution ou l'ayant rejeté. Si certains camarades reconnaissaient leurs propres doutes et manque de clarté, d'autres attribuaient à la résolution elle-même ce manque de clarté en l'accusant:
- "de frôler de trop près des conceptions qui voient dans la lutte révolutionnaire deux consciences" (comme la conscience socialiste et la conscience trade-unioniste telles qu'elles sont distinguées par Kautsky et Lénine) ;
- d'utiliser des formulations "qui laissent la porte ouverte à des interprétations de type 'Kautsky-léninistes' du processus de prise de conscience de la classe ouvrière" OU ayant "une résonance toute hégélienne" ou encore ne disant "rien d'autre que ce que disent, par exemple, les bordiguistes" de "flirter avec des conceptions léninistes", de "constituer une régression" par rapport au "dépassement du léninisme" opéré antérieurement par le CCI ;
-de "s'enfermer dans une démarche qui ferait croire que la conscience de classe est une donnée achevée" qui "est dans les mains d'une minorité et que la contribution de la classe ouvrière dans son ensemble historiquement ne serait que de l'accepter, 1'assimiler."
Une des caractéristiques des "réserves" était donc d'attribuer à la résolution des idées qui ne s'y trouvaient pas et qu'elle rejetait même explicitement (comme on peut s'en rendre compte en la relisant). On y voyait en particulier des conceptions "bordiguistes" ou "léninistes", ce qui est l'accusation classique des conseillistes à l'égard des positions du CCI (tout comme les groupes "léninistes" ou "bordiguistes" considèrent ces positions comme "conseillistes"). Les concessions au conseillisme étaient encore plus flagrantes lorsque telle "réserve" tendait à renvoyer dos à dos les analyses conseillistes apparues auparavant et leur critique par le point 7 de la résolution, en considérant que si les premières "pour démontrer une idée fausse étaient amenées à citer une idée juste", la seconde "pour rappeler des idées justes est maladroitement conduite à combattre ce qui était correct" dans ces analyses. Ces concessions s'exprimaient également dans telle autre "réserve" qui considérait que ces analyses "viennent plus d'une exagération abusive dans le débat sur la maturation souterraine... que d'un conseillisme sournois et délibéré". C'était là de belles illustrations de la "démarche centriste à l'égard du conseillisme" telle qu'elle avait été identifiée par le CCI, puisque ces réserves : se posaient en arbitre entre les positions qui s'affrontaient ; venaient au secours de la position conseilliste en se refusant de l'appeler par son nom ; créaient des rideaux de fumée (par exemple, l'introduction des épithètes "sournois" et "délibéré" qui n'étaient jamais apparues dans le débat) afin de faire obstacle à la clarté du débat.
Cette démarche, nous la retrouvons dans le texte de la camarade JA (Revue n°41, p.32) lorsqu'il essaie de présenter "les origines du débat" :
"Bien que la maturation souterraine soit rejetée à la fois explicitement par "Battaglia-CWO" par exemple (...), ce rejet étant parfaitement conséquent avec la théorie 'léniniste ' de la conscience 'trade-unioniste' de la classe, et à la fois par des théorisations du conseillisme dégénéré (...), l'organisation a décidé que le rejet de la maturation était en lui-même uniquement le fruit du conseillisme latent en nos rangs".
Il suffit de relire les extraits cités plus haut des analyses apparues dans le CCI rejetant la notion de "maturation souterraine de la conscience" pour se rendre compte que la démarche employée pour opérer un tel rejet est bien de nature conseilliste (même si d'autres que les conseillistes, et avec d'autres arguments, rejettent également cette notion). Encore faut-il, pour être en mesure de faire ce constat, ne pas être soi-même victime d'une vision conseilliste. Les camarades qui ont critiqué le point 7 se sont focalisés sur cette question de la "maturation souterraine" sans voir qu'elle s'appuyait sur une démarche conseilliste, parce qu'ils sont en fin de compte d'accord avec une telle dé marche même s'ils ne vont pas jusqu'au bout de toutes ses implications (autre caractéristique du centrisme) .C'est pour cela d'ailleurs que le point 7 de la résolution ne traite de la "maturation souterraine "que dans son 6ème et dernier paragraphe après avoir réfuté l'ensemble des maillons du raisonnement qui conduit au rejet de cette notion. Pour le CCI, comme pour le marxisme en général, il importe d'attaquer les conceptions qu'il combat à. la racine sans se contenter de faire un sort à telle ou telle brindille. C'est la différence entre une critique de fond propre au marxisme et une critique superficielle affectionnée par toutes les visions étrangères au marxisme, notamment le conseillisme .
L'escamotage des problèmes par les camarades "réservistes"
Cette incapacité des camarades "réservistes" à réfuter véritablement les conceptions conseillistes qui s'étaient introduites dans l'organisation, s'est illustrée dans le fait qu'ils n'ont jamais proposé une autre formulation du point 7 malqré les demandes répétées du CCI, et bien qu'ils se soient engagés à le faire en avril 84. Il n'y a là rien de bien mystérieux : lorsqu'on est soi-même d'une vision conseillisante, on est bien mal armé pour condamner le conseillisme. C'est d'ailleurs ce qu'ont compris certains de ces camarades: ayant échoué dans leur effort de reformuler ce point, ils ont pris conscience de leurs erreurs conseillistes et ont finalement apporté à ce point un soutien sans réserve comme l'avaient fait dès janvier 84 les camarades qui avaient élaboré l'analyse conseilliste de la "non-maturation souterraine". Les autres camarades, par contre, ont préféré escamoter le problème : pour tenter de masquer leur incapacité à condamner clairement le conseillisme, ils ont commencé à soulever toute une série d'autres questions étrangères au débat initial. C'est ainsi, qu'entre autres objections (nous ferons grâce au lecteur d'une liste exhaustive), il a été soulevé :
1°. que "rien n'autorise à décider unilatéralement, sans preuves, que le CCI se trouve dans ce débat en présence d'une tendance conseilliste ou de conciliation vis-à-vis du conseillisme", qu'on avait à faire avec "une campagne donquichottesque contre des moulins à vent conseillistes et centristes" ;
2°. que la résolution de mars 84 donne une "définition psychologisante et comportementale du centrisme", "une définition purement subjective du centrisme en termes de comportement et non plus en termes politiques" ;
3°. qu'on ne peut pas de toute façon parler de centrisme dans le CCI, puisque le centrisme, comme l'opportunisme en général, sont des phénomènes spécifiques de la période ascendante du capitalisme, idée qu'on retrouve dans le texte de JA.
4°. que, de ce fait, on ne pouvait en aucune façon considérer que l'USPD, donné dans le débat comme exemple de parti centriste, appartenait à la classe ouvrière ; que c'était dès l'origine "l'expression de la radicalisation de 1'appareil politique de la bourgeoisie, une première expression du phénomène du gauchisme, cette barrière extrême de 1'Etat capitaliste contre la montée révolutionnaire" (article de JA).
Nous n'entrerons pas dans cet article dans une réfutation de ces objections, irais il importe à leur sujet de préciser quelques points.
1°. On comprend tout à fait que les camarades qui sont eux-mêmes prisonniers d'une démarche centriste envers le conseillisme considèrent que le combat engagé par le CCI contre cette démarche n'est pas autre chose qu'une "campagne donquichottesque contre des moulins à vent conseillistes et centristes" : tout le monde connaît l'histoire du cavalier qui ne retrouve pas le cheval sur lequel il est assis. Cependant, la myopie et la distraction -de même que l'ignorance (comme disait Marx contre Weitling)- ne sont pas des arguments.
2°. Leur tentative d'opposer dans la définition du centrisme les "termes politiques" aux "termes de comportement" démontre qu'ils n'ont pas compris une des bases du marxisme : dans le combat de classe, le comportement est une question éminemment politique. Les hésitations, les vacillations, l'indécision, l'esprit de conciliation, le manque de fermeté dont peut faire preuve dans ce combat la classe ouvrière ou son organisation révolutionnaire, ne sont nullement réductibles à de la "psychologie", mais sont des données politiques qui témoignent de capitulations ou de faiblesses face à la pression de l'idéologie bourgeoise et face à l'ampleur, sans précédent dans l'histoire, des taches qui attendent le prolétariat. Les marxistes ont toujours posé le problème en ces termes. C'est ainsi que Rosa Luxemburg, dans sa polémique contre l'opportunisme, pouvait écrire : "Le petit jeu politique de 1'équilibre qui se traduit par les formules : 'd'une part, d'autre part', 'oui, mais', cher à la bourgeoisie d'aujourd'hui, tout cela trouve son reflet fidèle dans le mode de pensée de Bernstein, et le mode de pensée de Bernstein est le symptôme le plus sensible et le plus sûr de son idéologie bourgeoise". (Réforme ou Révolution).
De même lorsqu'elle se proposait d'expliquer la capitulation honteuse de la social-démocratie le 4 août 1914, elle invoquait, à côté des "causes objectives", "la faiblesse de notre volonté de lutte, de notre courage, de notre conviction" (La crise de la Social-Démocratie).
C'est pour cela également que Bordiga définissait le parti révolutionnaire comme "un programme et une volonté d'action" et que la plateforme du CCI caractérise les révolutionnaires comme "les éléments les plus déterminés et combatifs dans les luttes de la classe" (point 17b.).
3°. L'idée que l'opportunisme et le centrisme sont des menaces constantes pour les organisations révolutionnaires, et non spécifiques de la période ascendante du capitalisme, n'est nullement une "nouvelle orientation" du CCI comme l'écrit la camarade JA dans son article. C'était au contraire un acquis de l'organisation qu'on retrouve non seulement dans de nombreux articles de notre presse, mais également dans des prises de position officielles du CCI telles que la Résolution adoptée par le CCI à son 2ème Congrès sur "les groupes politiques prolétariens" où l'on peut lire : "toute erreur ou précipitation en ce domaine (les critères définissant la nature de classe d'une organisation)... porte en germe des déviations de caractère soit opportuniste, soit sectaire qui seraient des menaces pour la vie même du courant" de même que "(les fractions communistes qui peuvent apparaître comme réaction à un processus de dégénérescence des organisations prolétariennes) se basent non sur une rupture, mais sur une continuité du programme révolutionnaire précisément menacé par le cours opportuniste de 1'organisation". (Revue Internationale n°ll).
Ces notions étaient également des acquis pour la camarade JA elle-même lorsqu'elle écrivait dans la Revue Internationale n°36 (à propos de la démarche de "Battaglia Comunista") : "Au début des années 20, la majorité centriste de l'Internationale Communiste, les Bolcheviks en tête, préfère éliminer la Gauche pour s'allier à la Droite (Indépendants en Allemagne, etc...). Si 1'histoire se répète en farce, 1'opportunisme reste, lui, toujours le même". (Réponse aux réponses). On ne saurait être plus clair. Il faut donc constater qu'en plus d'être myopes et un peu distraits les camarades de la minorité ont aussi la mémoire courte…. et pas mal de culot.
4°. Toute l'insistance des camarades de la minorité sur la question de la nature de classe de l'USPD (insistance qu'on retrouve dans l'article de JA alors que ce n'est pas son sujet) n'est en fait qu'une diversion. Même si on considérait que l'USPD était une organisation bourgeoise (comme cela a été écrit à tort il y a dix ans dans la Revue Internationale, ce que la camarade JA se plaît à rappeler) cela ne remettrait nullement en cause l'idée que l'opportunisme et le centrisme sont aujourd'hui encore des dangers pour les organisations prolétariennes, sont "toujours les mêmes" comme le disait si bien JA il y a un an et demi.
L'hétérogénéité des critiques aux orientations du CCI
Outre les remarques qui précèdent, il faut signaler que les différentes objections soulevées contre les orientations du CCI ne provenaient pas des mêmes camarades, lesquels pendant près d'une année ont défendu dans l'organisation des positions divergentes.
C'est ainsi que, parmi les camarades de la minorité, certains ont voté contre le point 7 de la résolution de janvier 84, d'autres ont voté pour avec réserves et d'autres pour sans réserves tout en rejetant explicitement les arguments des "réservistes". De même, la thèse de l'inexistence des phénomènes de l'opportunisme et du centrisme dans la période de décadence du capitalisme n'a été défendue pendant longtemps que par certains camarades minoritaires (en fait, ceux qui, par ailleurs, étaient d'accord avec le point 7), alors que les autres considéraient que l'opportunisme et le centrisme :
- soit n'ont jamais été des maladies des organisations prolétariennes mais des expressions directes de la bourgeoisie (à l'image des bordiguistes qui qualifient "d'opportunistes" des organisations bourgeoises comme les PS et les PC) ;
- soit ils peuvent exister (et se sont déjà manifestés) dans le CCI, mais pas à l'égard du conseillisme.
Encore faut-il préciser que ces différentes positions n'étaient pas forcément défendues par des camarades différents, certains les défendant successivement même simultanément (!). Enfin, la position sur le danger de conseillisme telle qu'elle est exprimée dans le texte de JA n'était pas non plus celle de la totalité des camarades minoritaires pendant très longtemps.
Une "tendance" sans bases cohérentes
Jusqu'à la fin de l'année 84, cette hétérogénéité entre les positions des différents camarades minoritaires s'est exprimée dans le débat et était d'ailleurs reconnue par ces camarades eux-mêmes. Aussi, la constitution d'une "tendance" au début 85 par ces mêmes camarades fut-elle une surprise pour le CCI. Aujourd'hui, ces camarades affirment partager une même analyse sur les trois questions principales ayant provoqué des désaccords depuis janvier 84 :
- le point 7 de la résolution;
- le danger de conseillisme;
- la menace de l'opportunisme et du centrisme dans les organisations prolétariennes,
Ce que la camarade JA exprime en ces termes :
" C'est au moment des "réserves" sur cette formulation du point 7 que s'est introduite dans l'organisation la nouvelle orientation du "conseillisme, le plus grand danger", du "centrisme par rapport au conseillisme" et du centrisme appliqué à 1'histoire du mouvement ouvrier dans la période de décadence. La minorité actuelle qui se constitue en tendance se situe contre 1'ensemble de cette nouvelle orientation, considérant qu'elle pose le danger d'une régression dans notre armement théorique".
Pour sa part, le CCI considère qu'il ne s'agit pas là d'une véritable tendance présentant une orientation alternative positive à celle de l'organisation, mais d'un rassemblement de camarades dont le véritable ciment n'est ni la cohérence de leurs positions, ni une profonde conviction de ces positions, mais une démarche contre les orientations du CCI dans son combat contre le conseillisme comme cela transparaît d'ailleurs dans le passage du texte de J.A qui précède.
Cependant, si le CCI estime que la constitution de la "tendance" n'est pas autre chose que la poursuite de la politique d'escamotage dans laquelle se sont laissé entraîner depuis un an les camarades en désaccord, il ne leur accorde pas moins les droits d'une tendance - qui sont reconnus par nos principes d'organisation tels qu'ils sont énoncés, par exemple, dans le "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires" (Revue Internationale N° 33). Les camarades minoritaires pensent qu'ils sont une tendance ; le CCI pense le contraire mais préfère convaincre ces camarades de leur erreur plutôt que de les empêcher de fonctionner comme une tendance. Par contre, il est de la responsabilité du CCI de dire claire-, ment, comme il est fait dans cet article, ce qu'il pense de la démarche de ces camarades de même que de l'article de J.A qui constitue une illustration de cette démarche.
L'ARTICLE DE LA CAMARADE J.A : UNE ILLUSTRATION DE LA DEMARCHE DES CAMARADES MINORITAIRES
Nous avons vu que les glissements centristes vers le conseillisme des camarades en désaccord s'étaient traduits tout au long du débat par une tendance de la part de ces camarades à escamoter les véritables problèmes en discussion. C'est encore cette démarche qu'emploie le texte de la camarade J.A lorsqu'il se propose de répondre à l'article de la Revue Internationale N° 40 et à l'analyse du CCI sur le "danger du conseillisme". Nous ne pouvons citer ici tous les exemples de cette démarche : cela risquerait d'être fastidieux. Nous nous contenterons d'en signaler un certain nombre parmi les plus significatifs.
La prétendue "politique du moindre mal" du CCI
Le titre, ainsi que divers passages de l'article de J.A suggèrent ou même affirment nettement que l'analyse du CCI relèverait d'une "politique du moindre mal" :
" Toute la problématique de choisir entre "sous" et "sur"-estimer la parti, toute la politique du moindre mal que le CCI a toujours rejetée au niveau théorique, il l'introduit aujourd'hui au niveau pratique sous couvert de vouloir donner une perspective "concrète" à la classe : il faut dire au prolétariat que le danger conseilliste est plus grand que celui du substitutionisme, sinon le prolétariat n'aurait pas une 'perspective'!". (Revue Internationale N° 41, page 29).
Nous sommes obligés de dire que soit la camarade J.A ne sait pas de quoi elle parle, soit elle falsifie de façon délibérée et proprement inadmissible nos positions.
La "politique du moindre mal" consiste, comme son nom l'indique, à choisir un mal contre un autre. Elle s'est particulièrement illustrée dans les années 30, de la part du trotskysme notamment, par un choix entre deux maux capitalistes, la démocratie bourgeoise et le fascisme, au bénéfice de cette première. Elle conduisait à appeler les ouvriers à privilégier la lutte contre le fascisme au détriment des autres aspects de la lutte contre l'Etat capitaliste. Elle emboutissait à soutenir (quand ce n'était pas à y participer directement) l'embrigadement des ouvriers dans un camp de la guerre impérialiste. En politique les mots ont le sens que leur a conféré l'histoire : l'essence de la "politique du moindre mal" telle qu'elle s'est illustrée dans l'histoire, c'est la soumission des intérêts du prolétariat aux intérêts d'un secteur capitaliste et donc à l'ensemble du capitalisme. Utiliser cette notion à propos des positions du CCI, c'est suggérer que le CCI est engagé sur le même chemin que celui qui a conduit, par exemple, le trotskysme dans le camp bourgeois. Nous osons espérer que c'est plus par ignorance que de propos délibéré que la camarade J.A s'est laissée aller à substituer à l'argument polémique la simple insulte gratuite, bien qu'on puisse penser le contraire lorsqu'elle écrit que "quand une organisation introduit le raisonnement du moindre mal, elle ne dit jamais explicitement qu'il faut tordre les principes. C'est plutôt une logique d'engrenage". Mais même si c'est par ignorance, celle-ci n'est pas plus "un argument"aujourd'hui que du temps de Marx.
Pour ce qui est de la façon dont le CCI pose le problème, il est clair qu'en aucune façon il n'appelle à choisir entre le mal conseilliste et le mal substitutionniste : l'un et l'autre constituent, s'ils ne sont pas dépassés par le prolétariat, des dangers mortels pour la révolution.
La question qui est posée par le CCI n'est donc pas : "lequel est préférable à l'autre ?", mais bien "lequel exercera le plus d'influence dans la période à venir ?" de façon à ce que l'organisation et l'ensemble de la classe soient les mieux armés possible face aux embûches qui vont se présenter. Lorsqu'on se promène, on peut par exemple être mordu par un serpent venimeux ou écrasé par une voiture. Les deux dangers sont mortels et doivent être évités avec une égale méfiance. Cependant, tout être sensé cheminant dans un sentier de forêt portera son attention sur le premier danger sans que cela veuille dire qu'il "préfère" être écrasé par une voiture. Cette image, déjà employée dans le débat interne a du paraître trop"simpliste" à la camarade JA. Elle préfère attribuer au CCI des positions qui ne sont pas les siennes : c'est évidemment plus facile pour les combattre mais cela ne fait pas avancer d'un pouce le débat, sinon en mettant en évidence l'indigence des arguments des camarades de la "tendance" et leur propension à escamoter les vraies questions.
"Le plus grand danger, c'est la bourgeoisie".
"La divergence ne porte pas sur le danger du conseillisme mais... sur la nouvelle théorie unilatérale du conseillisme le plus grand danger parce qu'elle s'accompagne d'un rabaissement du substitutionnisme au niveau du "moins grand danger"; parce qu'elle détourne 1'attention du véritable danger essentiel pour le prolétariat que représente 1'Etat capitaliste et ses prolongements au sein de la classe ouvrière (les partis de gauche, les gauchistes, le syndicalisme de base et tout le mécanisme de la récupération capitaliste à l'époque du capitalisme d'Etat) pour se focaliser sur de prétendues tares conseillistes du "prolétariat des pays avancés" (Idem, p.28) "Cette théorie détourne 1'attention du véritable danger essentiel pour la classe ouvrière -1'Etat capitaliste et ses prolongements au sein de la classe ouvrière- et ne fait qu'émousser dans la confusion notre critique du substitutionnisme présenté comme le 'moindre mal'".
Comme on peut le voir, la question du "moindre mal" n'est pas la seule à faire l'objet d'une falsification des positions du CCI. La camarade JA fait également dire au CCI que le conseillisme serait le plus grand danger menaçant la classe ouvrière. Elle fait ainsi la preuve soit de sa mauvaise foi, soit de son incompréhension de la différence entre un superlatif et un comparatif ce qui est pourtant du programme de l'école primaire. Dire que le conseillisme est dans la période actuelle et à venir un plus grand danger pour la classe ouvrière que le substitutionnisme est toute autre chose que dire que le conseillisme est le plus grand danger, dans l'absolu. D'ailleurs, avec le même manque élémentaire de rigueur, JA nous fait "rabaisser le substitutionnisme au niveau du 'moins grand danger'". Vaut-il la peine d'expliquer à la camarade JA que si, dans un groupe on constate que "Pierre est le plus grand" ou que "Pierre est plus grand que Paul", cela ne veut pas dire nécessairement que Paul soit le plus petit, à moins que le groupe soit réduit à ces deux éléments ce qui, dans la question débattue voudrait dire que le CCI ne voit pour la classe ouvrière que deux dangers : celui de conseillisme et celui de substitutionnisme. La camarade JA ne va pas jusqu'à affirmer une telle absurdité mais c'est pourtant l'accusation implicite qui est contenue dans sa lourde insistance sur le "véritable danger essentiel pour le prolétariat: 1'Etat capitaliste et ses prolongements au sein de la classe ouvrière". Franchement, si c'était pour nous apprendre que le plus grand danger qui menace le prolétariat vient de la classe ennemie et de son Etat, ce n'était pas la peine que la camarade JA se donne la peine d'écrire son article : nous le savions déjà. Et là encore le débat n'a pas beaucoup avancé sinon en faisant apparaître qu'en plus de la falsification des positions du CCI, il existe un autre moyen d'escamoter les vrais problèmes : enfoncer des portes ouvertes.
La caricature comme moyen de ne pas débattre sur le fond
Pour escamoter les vraies questions, il n'est pas toujours nécessaire d'enfoncer des portes ouvertes ou de falsifier les positions qu'on prétend combattre, on peut également se contenter de les caricaturer. La camarade JA ne s'en prive pas. Ainsi, l'article de la Revue n°40 sur "le danger du conseillisme" décrit dans sa partie sur "conditions d'apparition et caractéristiques du conseillisme", comment le conseillisme a gangrené la gauche allemande en la faisant glisser vers le rejet du centralisme, le localisme, un néo-syndicalisme révolutionnaire, l'usinisme, l'ouvriérisme, l'individualisme. Il montre que si ce ne sont pas des caractéristiques spécifiques du conseillisme, celui-ci est amené à tomber dans ce genre de pièges à travers tout un processus, un enchaînement logique, qui part de la négation ou de la sous-estimation du rôle du parti révolutionnaire. De même, il essaye de mettre en évidence comment dans la période qui suit 1968, le poids du conseillisme a conduit beaucoup de groupes à sombrer dans le modernisme, 1'immédiatisme et l'activisme, notamment comme expression de la pression de l'idéologie de la petite bourgeoisie révoltée.
Lorsque la camarade JA se propose de nous dire ce qu'elle a compris de cette argumentation, elle nous démontre soit qu'elle ne l'a pas compris, soit qu'elle ne s'est pas donné la peine de la comprendre. Qu'on en juge :
"En quoi consisteraient ces 'réflexes conseillistes' de la montée de la lutte de classe, comment on les reconnaît ? Selon 1'article, ils sont l'ouvriérisme, le localisme, le suivisme, le modernisme, l'apolitisme des ouvriers, la petite-bourgeoisie, 1'immédiatisme, l'activisme et l'indécision. En somme, tous les maux de la terre le conseillisme serait à lui tout seul le mal permanent du mouvement ouvrier !
Puisque toutes les faiblesses subjectives de la classe ouvrière deviennent, par ce jeu de définitions, 'des réflexes conseillistes', le remède est... le parti. En d'autres termes, le CCI, le milieu politique prolétarien et la classe ouvrière toute entière se protégeront contre 1'immédiatisme, la petite bourgeoisie, 1'hésitation, etc... En reconnaissant dès à présent le danger n°l de 'sous-estimer', 'minimiser' le parti".
Il suffira au lecteur de relire l'article de la Revue n°40 pour constater que ce qui y est décrit comme un processus dont on met en évidence le lien de causalité qui enchaîne les différentes étapes n'a rien à voir avec la photographie chaotique présentée par la camarade JA. Cette façon de caricaturer les positions du CCI est peut-être efficace pour convaincre celui qui est déjà convaincu ou celui pour qui une pensée rigoureuse est un carcan intolérable. Elle n'est pas par contre très efficace pour clarifier le véritable débat.
Pour conclure cette partie, on peut préciser à l'intention de la camarade JA et de l'ensemble des camarades de la "tendance" que la brochure du CCI "Organisations communistes et conscience de classe", dont ces camarades ne cessent de se réclamer, mérite les mêmes reproches que fait l'article de JA à l'article sur "le danger du conseillisme", notamment lorsqu'elle affirme (p.54) :
"Il est logique que cette conception immédiatiste de la conscience de classe conduise les conseillistes à verser dans 1'ouvriérisme et le localisme…."
"Mais poussée à ses ultimes conséquences, 1'apologie que les conseillistes font de la lutte strictement économique du prolétariat aboutit à 1 'autodissolution pure et simple de toute organisation révolutionnaire".
Les non réponses de la camarade JA
Les différentes techniques d'escamotage du débat qu'on vient de voir (et qui sont beaucoup plus amplement utilisées dans l'article de JA que ce que nous en signalons ici) sont complétées par la technique la plus simple qui soit : on ignore purement et simplement les arguments les plus importants de l'analyse qu'on prétend combattre. C'est ainsi que les arguments suivants du texte sur "le danger du conseillisme" ne trouvent pas le début d'une réponse dans l'article de JA :
- le poids du substitutionnisme par le passé était lié à l'héritage de la conception social-démocrate du parti comme "éducateur" et "représentant ou état-major de la classe" ;
- ces conceptions ont pu prendre pied dans une période de croissance du prolétariat et donc d'immaturité de celui-ci (ce qui est particulièrement net dans les pays plus arriérés avec un prolétariat jeune et faible) ;
- ces conceptions auront beaucoup moins de poids sur le prolétariat après l'expérience de la contre-révolution stalinienne et toute la réflexion théorique de la gauche communiste sur celle-ci et sur le rôle du parti dans la révolution ;
- le fait que la prochaine vague révolutionnaire partira nécessairement des pays avancés, avec le prolétariat le plus ancien et le plus expérimenté affaiblira d'autant le poids du substitutionnisme dans l'ensemble de la classe ouvrière : en ce sens, l'expérience de la révolution en Allemagne entre 1918 et 1923 -avec le poids non du substitutionnisme mais du conseillisme sur les éléments les plus avancés de la classe- est beaucoup plus significatif pour la révolution à venir que l'expérience de la révolution en Russie où le substitutionnisme joua le rôle négatif que l'on sait
- ce poids du conseillisme sera d'autant plus renforcé dans cette révolution qu'elle se fera contre les partis staliniens et socio-démocrates dont la méfiance qu'ils inspirent aux ouvriers se répercutera, et se répercute déjà sous forme d'une méfiance à l'égard de toute organisation politique ;
- y compris celle des révolutionnaires prétendant lutter pour la défense des intérêts prolétariens ;
- la contre-révolution de près d'un demi-siècle subie par la classe ouvrière et la rupture organique qu'elle a provoquée dans ses organisations communistes non seulement conduit un grand nombre d'ouvriers parmi les plus combatifs à ne pas comprendre la nécessité de s'engager dans ces organisations mais est responsable chez les militants de celles-ci d'une énorme difficulté à comprendre toute l'importance de leur rôle, le caractère absolument indispensable du parti révolutionnaire et des organisations qui le préparent, l'énorme responsabilité qui pèse sur leurs épaules, toutes, manifestations de déviations conseillistes.
Le fait que la camarade JA escamote la réponse à cette argumentation (dont seule la trame est ici reproduite) qui est justement centrale dans la défense de l'analyse du CCI est significatif de l'incapacité de la "tendance" à opposer des arguments serieux à cette analyse. Le plus ironique de l'affaire est certainement le fait qu'un des rares arguments sérieux contenus dans le texte de JA, probablement le plus important dans la défense de la position de la "tendance" reste pratiquement inexploité, comme si la camarade JA préférait attaquer une forteresse au lance pierre alors qu'elle dispose quand même d'un canon (même s'il est de calibre insuffisant).
Un argument sérieux
On a l'impression que c'est presque par mégarde que la phrase suivante se trouve dans le texte de JA :
"En réduisant le substitutionnisme, expression idéologique de la division du travail dans les sociétés de classes, à une quantité négligeable, la nouvelle théorie arrive à une minimisation du danger de 1'Etat capitaliste, son appareil politique et le mécanisme de son fonctionnement idéologique".
Laissons de côté la façon cavalière (affectionnée par JA) dont est évoquée la "quantité négligeable" que serait pour le CCI le substitutionnisme. Ce n'est évidemment pas une position du CCI. Le fait est que le substitutionnisme est incontestablement une "expression idéologique de la division du travail dans les sociétés de classe". En ce sens, on peut être amené à en conclure que puisque des millénaires de société de classe imprègnent toute la société y compris la classe révolutionnaire, celle-ci aura les plus grandes difficultés à se débarrasser du poids idéologique lié à la division hiérarchique du travail qui a prévalu depuis ces millénaires et notamment sous la forme du substitutionnisme. En fait, cela a été particulièrement valable dans le passé où le substitutionnisme qui s'exprimait notamment dans les sectes babouvistes ou blanquistes résultait directement de l'influence du schéma de la révolution bourgeoise où c'est nécessairement un parti qui prend le pouvoir (par exemple, les jacobins) pour le compte de l'ensemble de sa classe. Ce modèle de la révolution bourgeoise a continué d'exercer une influence très forte dans la classe ouvrière -qui tendait à y voir le seul modèle possible de la révolution- tant qu'elle ne s'est pas engagée elle-même dans des combats massifs contre le capitalisme et dans des tentatives révolutionnaires. Mais l'accumulation de ces expériences positives et négatives (comme la dégénérescence de la révolution d'une part et d'autre part l'éloignement dans le temps des révolutions bourgeoises en Russie) ont permis au prolétariat de se dégager progressivement de ce poids du passé. Cela veut-il dire que le substitutionnisme ne peut plus menacer la classe ouvrière ou ses organisations politiques ? Il est évident que non et le CCI, comme on peut le constater dans l'article de la Revue n°40, a toujours été clair là-dessus. La question posée est plutôt : suivant quelles modalités, avec quel impact ce poids continuera-t-il à peser ? En ce sens, dans "Le 18 Brumaire", Marx nous donne une clé lorsqu'il montre que si les révolutions bourgeoises s'habillaient nécessairement des oripeaux du passé, "ce poids des générations mortes qui pèse sur le cerveau des vivants" tendra à s'amenuiser avec la révolution prolétarienne "qui tire sa poésie de 1'avenir". La révolution prolétarienne ne pourra avoir lieu que sur la base d'une rupture radicale avec des siècles de domination de l'exploitation capitaliste, des millénaires de division de la société en classes et en ayant en vue la société communiste ("la poésie de l'avenir") ce qui comporte en particulier la nécessaire rupture avec le substitutionnisme. Par contre un élément pèsera très longtemps sur le prolétariat, comme il a déjà pesé considérablement dans le passé, un élément qui, s'il est exploité et activé en permanence par l'idéologie bourgeoise résulte d'une caractéristique propre de la classe ouvrière qu'elle ne partage avec aucune des autres classes révolutionnaires du passé. C'est le fait que le prolétariat est la seule classe de l'histoire qui soit à la fois, classe révolutionnaire et classe exploitée. Cet élément a pesé sous forme d'une difficulté très grande pour la classe -et pour sa minorité révolutionnaire- à faire la relation entre ces deux aspects de son être, une relation qui ne soit ni une identité ni non plus une séparation. Ce qu'exprime en bonne partie le conseillisme par son rejet du rôle des organisations communistes, c'est une difficulté à concevoir le prolétariat comme classe au devenir révolutionnaire -dont l'existence de ces organisations est justement une des manifestations. C'est pour cela que le conseillisme en arrive à rejoindre l'anarcho-syndicalisme chez qui les organes de lutte du prolétariat comme classe exploitée- les syndicats- devaient être les organes de gestion de la future société. C'est pour cela que le conseillisme sombre inéluctablement dans l'économisme ou l'usinisme qui expriment cette incapacité de concevoir la lutte du prolétariat comme autre chose qu'une lutte tristement limitée aux lieux de travail où les ouvriers sont exploités et qui tournent le dos à une vision générale, sociale, mondiale, politique du processus révolutionnaire.
Ainsi, lorsqu'on essaie d'examiner les difficultés auxquelles sera confrontée la classe ouvrière dans son chemin vers la révolution, il importe de prendre en compte 1'ensemble et non seulement certains des éléments historiques qui déterminent et détermineront ces difficultés. Sinon, la perspective que l'on dégage est faussée et de bien piètre utilité pour les combats qui attendent le prolétariat. Encore, faut-il évidemment estimer qu'une telle perspective présente une utilité pour ces combats et ne pas tomber dans la vision de C.W.O (Battaglia Comunista) pour qui l'analyse du cours historique (vers la guerre mondiale ou vers des affrontements de classe généralisés) n'est d'aucun intérêt. C'est ce que semble contester la camarade JA lorsqu'elle ironise : "il faut dire au prolétariat que le danger conseilliste est plus grand que celui du substitutionnisme, sinon le prolétariat n'aurait pas une perspective". Ce qu'elle propose en somme, c'est : pas de perspective !
LE FOND DE LA DEMARCHE DE J.A. : LES GLISSEMENTS CONSEILLISTES
En réalité, de façon contradictoire (puisque vers la fin de son texte elle semble dire que ni le substitutionnisme ni le conseillisme ne seront un danger suite à la faillite après 1968 des courants se réclamant de la gauche italienne et de la gauche allemande) ce qui ressort au fond de l'argumentation de JA, c'est que le substitutionnisme est un bien plus grand danger que le conseillisme.
C'est pour cela qu'elle s'applique longuement dans son texte à identifier substitutionnisme et gauchisme, substitutionnisme et contre-révolution alors que l'article de la Revue n°40 montrait justement que le substitutionnisme est une "erreur mortelle" certes, mais concerne le rapport entre la classe et ses propres organisations et non celle de la bourgeoisie.
C'est pour cela qu'elle écrit : "on escamote de plus en plus le fait que donner un rôle bourgeois au Parti ne défend pas mieux son rôle indispensable que de rejeter toute notion de parti : les deux conceptions, aussi bien 1'une que 1'autre, nient la fonction réelle du parti". Alors qu'en réalité, le débat sur le rôle du parti se situait depuis le siècle dernier au sein du marxisme qui a toujours défendu la nécessité d'un parti révolutionnaire alors que le rejet de tout parti est extérieur au marxisme et trouve ses premiers défenseurs chez les anarchistes. Pour être en mesure de dire que le rôle du parti n'est pas de prendre le pouvoir, il faut d'abord reconnaître qu'il a un rôle.
En fin de compte, ce qu'aspire à démontrer la thèse de la "tendance" défendue par JA dans son article, même si elle ne le dit pas ouvertement, c'est qu'il n'existe aucune menace de conseillisme notamment dans les organisations révolutionnaires, et plus particulièrement dans le CCI. Comme cela, les camarades de la "tendance" peuvent être tranquilles : ils ne peuvent en aucune façon être victimes de glissements vers le conseillisme et le CCI ne fait que combattre des "moulins à vent".
Pour la "tendance", il n'y a pas de réel danger de conseillisme. Pour le CCI, ce danger est une menace réelle. La preuve : la démarche de la "tendance".
F.M.