Revue Internationale n°166
- 258 lectures
Présentation de la Revue n°166
- 80 lectures
Notre précédent numéro de la Revue internationale était entièrement dédié à la signification et aux implications de l'irruption du Corona Virus. Nous y mettions en évidence l'importance historique de cet évènement, le plus important depuis l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 de même que sa signification, une nouvelle étape de l'enfoncement du capitalisme dans sa phase de sa décadence, celle de sa décomposition. Nous nous étions également penchés sur les implications de la pandémie sur la crise économique -une accélération considérable de celle-ci devant déboucher sur une récession plus importante encore que celle des années 1930– et sur la lutte de classe, avec des difficultés renforcées pour la classe ouvrière du fait des conséquences aggravées de la décompositions sur la vie de la société. Cet évènement venait confirmer le risque que le rythme du développement de la lutte de classe, en regard de celui de la décomposition, ne soit pas suffisant pour permettre une révolution victorieuse du prolétariat et ensuite l'édification d'une nouvelle société sur les ruines de la société actuelle ravagée par plus d'un siècle de décadence du capitalisme.
Avec le présent numéro de la Revue, nous poursuivons notre intervention sur la pandémie, sous différents angles, et publions également d'autres articles.
Un premier article, "L'épidémie du COVID révèle le délabrement du capitalisme mondial", met en évidence les très grandes difficultés rencontrées par la bourgeoisie face à la première vague de contagion par le virus, alors que de nouvelles vagues ont laissé la bourgeoisie désemparée, incapable de contenir la pandémie et ses conséquences sociales. Et pour causes, tous les ingrédients à l'origine de la pandémie ne peuvent être éliminées au sein même du capitalisme, a fortiori dans la phase ultime de sa décadence : Il n'y avait eu aucune anticipation face à la menace notoire de pandémies, avant que l'une d'entre elles –celle du Covid- ne fasse irruption ; le délabrement du système de soin car non rentable du point de vue capitaliste ; chacun pour soi exacerbé entre les fractions nationales de la bourgeoisie mondiale, et même au sein des frontières nationales, toutes en prise avec la guerre commerciale que la crise ne fait qu'exacerber … Le bilan social, imputable au capitalisme et non à la pandémie, ce sont des millions d'ouvriers jetés au chômage dans le monde, la pauvreté qui s'est étendue et approfondie de façon considérable. Cernées par les dangers de la contagion, la réalité du chômage et la plongée dans la pauvreté, des parties importantes de la population mondiale, de grandes masses précarisées, sombrent dans le désespoir.
À ce propos, nous publions à la suite de cet article un témoignage historique, "La Conservation de la Santé en Russie Soviétiste" concernant la manière dont le prolétariat de la Russie des soviets avait été capable de prendre en charge le problème de la santé dans les années 1918 et 19, et en particulier celui des pandémies qui sévissaient déjà, dans conditions extrêmement difficiles alors que le pays était en butte sur son propre territoire à la coalition de la bourgeoisie internationale à travers l'action des armées blanches visant à affaiblir, pour le détruire, le pouvoir du prolétariat.
Comme cela ressort de cette présentation, le CCI a fourni un effort théorique important en vue de comprendre la signification historique de cette pandémie qui ne peut être réduite à la seule répétition atemporelle des lois du capitalisme, mais est la fois expression et facteur d'aggravation de la phase actuelle de décomposition du capitalisme. La situation aux États-Unis est venue confirmer de manière éclatante le poids de la décomposition dans la vie du capitalisme et notamment l'épisode du capitole aux lorsque "les hordes trumpistes ont violemment tenté d’empêcher la succession démocrate, encouragée par le président en exercice lui-même, comme dans une “république bananière”, ainsi que l’a reconnu George W. Bush." Notre article "Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue", montre en quoi la crise politique actuelle de la démocratie américaine, symbolisée par l’attaque du Capitole, s’ajoute aux conséquences chaotiques et autodestructrices de la politique impérialiste américaine, et montre plus clairement que les États-Unis, qui demeurent encore la plus grande puissance mondiale, sont aujourd’hui le principal acteur de la décomposition du capitalisme.
Nous tenons également à signaler dans cette présentation de la Revue qu'en vue d'accroître et renforcer l'audience de notre intervention nous avons réalisé un tract, "Pandémie du COVID: Barbarie capitaliste généralisée ou Révolution prolétarienne mondiale", diffusé dans les quelques occasions qui se sont présentées à nous et que nous avons essayé de faire circuler le plus possible sur Internet.
Il est établi que le COVID a pu se transmettre de l'animal à l'homme du fait justement de certaines caractéristiques de la décomposition du capitalisme : déforestation à outrance, urbanisation sauvages, proximité entre l'homme et les animaux capables de lui transmettre des virus, hygiène limite … Face à toutes les aberrations du capitalisme dans sa phase finale actuelle, nous avons jugé opportun de publier un article intitulé mettant en évidence quelle devra être l'œuvre de la dictature du prolétariat : "Le programme communiste dans la phase de décomposition du capitalisme : Bordiga et la grande ville", article bâti sur la base de nos propres réflexions et celles suscitées par un article de Bordiga intitulé "Le programme immédiat de la révolution", écrit en 1953. Pour notre article, le texte de Bordiga "conserve un intérêt considérable en essayant de comprendre quels seraient les principaux problèmes et priorités d'une révolution communiste qui aurait lieu, non pas à l'aube de la décadence du capitalisme, comme en 1917-23, mais après un siècle entier au cours duquel le glissement vers la barbarie n'a cessé de s'accélérer, et où la menace pour la survie même de l'humanité est bien plus grande qu'il y a cent ans." Par rapport à la pandémie actuelle, l'article met évidence les limites de tous les services de santé existants, même dans les pays capitalistes les plus puissants, notamment parce qu'ils n’échappent pas à la logique de concurrence entre les unités capitalistes nationales. Face à une telle situation, il faut une médecine, des soins de santé et une recherche qui ne soient pas gérés par l'État, mais véritablement socialisés, et qui ne soient pas nationaux mais "sans frontières" : en bref, un service de santé planétaire.
Nous poursuivons, dans ce numéro de la Revue, la publication de notre série initiée lors du "Centenaire de la fondation de l'Internationale communiste en 1919". Le Congrès de fondation avait été un véritable pas en avant pour l’unité du prolétariat mondial, néanmoins la méthode alors adoptée, privilégiant le plus grand nombre plutôt que la clarté des positions et des principes politiques, n’avait pas armé le nouveau parti mondial. Pire, elle le rendait vulnérable face à l’opportunisme rampant au sein du mouvement révolutionnaire. Contrairement à ce que prévoyaient Lénine et les bolcheviks, l'opportunisme au sein du parti s'est approfondi et a fini par prendre, avec la dégénérescence de la révolution, une place prépondérante, précipitant la fin de l’IC en tant que parti de classe. C'est ce qu'illustre cette troisième partie de notre série.
Le dernier article publié dans ce numéro de la Revue, "La difficile évolution du milieu politique prolétarien depuis mai 1968" est la suite d'une série de deux, dont le premier fut publié dans la Revue 163. Celui-ci couvrait la période 1968-1980, qui avait connu les développements les plus importants au sein du milieu prolétarien international, suite aux évènements de 1968 en France. Si la résurgence de la lutte de classe avait donné un élan significatif à la relance du mouvement politique prolétarien, et donc au regroupement de ses forces, cette dynamique avait commencé à se heurter à des difficultés dès le début des années 1980. Déjà à cette époque, le milieu politique prolétarien traversait une crise majeure, marquée par l'échec des conférences internationales de la Gauche Communiste, les scissions au sein du CCI et l'implosion du Parti Communiste International bordiguiste (Programme Communiste). L'échec général de la classe à politiser ses luttes a aussi signifié que la croissance très sensible du milieu politique prolétarien de la fin des années 60 et des années 70 avait commencé à ralentir ou à stagner. Dans cette deuxième partie, nous mettons en évidence l'impact négatif sur l'évolution du MPP d'un certain nombre de facteurs, en particulier la décomposition de la société et le développement du parasitisme politique.
La minorité révolutionnaire, en tant que partie de la classe, n'est pas épargnée par les pressions d'un système social en désintégration qui n'a manifestement aucun avenir, se traduisant par la fuite vers des solutions individuelles, vers une perte de confiance dans l'activité collective, la méfiance envers les organisations révolutionnaires et le désespoir face à l'avenir.
Par ailleurs, au début des années 2000, le CCI avait été confronté à une grave crise interne avec en son cœur un clan regroupant des militants diffamant des camarades, diffusant des rumeurs selon lesquelles l'un d'entre eux était un agent de l'État manipulant les autres. Ce clan allait donner naissance à une organisation parasitaire à part entière, la FICCI dont les membres ont été exclus du CCI pour des agissements indignes de militants communistes, notamment le vol des fonds de l'organisation et la publication d'informations internes sensibles qui auraient pu mettre nos militants en danger vis-à-vis de la police. Depuis lors, ce groupe, qui a ensuite changé de nom pour devenir le Groupe International de la Gauche Communiste, a donné de nouvelles preuves qu'il incarne une forme de parasitisme si abject qu'il est impossible de le distinguer des activités de la police politique. Cette situation n'a malheureusement pas provoqué au sein du camp prolétarien la réponse adéquate, en exprimant une solidarité capable d'exclure du camp prolétarien des pratiques (et ceux qui s'y livrent) étrangères au mouvement ouvrier.
La période 2004-2011 a donné lieu à l'émergence de nouvelles forces à la recherche de réponses révolutionnaires à l'impasse de l'ordre social. Le CCI a réagi le plus largement possible à ces développements, ce qui était absolument nécessaire : sans transmission de l'héritage de la Gauche Communiste à une nouvelle génération, il ne peut y avoir aucun espoir d'un mouvement vers le parti du futur. Mais il y avait d'importantes faiblesses dans notre intervention, opportunistes en particulier, illustrée en particulier par l'intégration précipitée des camarades qui allaient former la section turque du CCI en 2009, laquelle quittera le CCI en 2015. Cet exemple est significatif du fait que les futures intégrations dans les organisations du camp de la gauche communiste devraient pouvoir bénéficier des leçons de ses expériences depuis la reprise historique de Mai 1968 et sur lesquelles nous revenons largement au sein de l'article en deux parties dédié à l'évolution du MPP depuis 1968.
Malgré les dangers très tangibles de cette dernière phase de décadence capitaliste, nous ne pensons pas que la classe ouvrière ait dit son dernier mot. Un certain nombre d'éléments témoigne d'un processus de politisation communiste au sein d'une minorité, petite mais significative, qui s'oriente vers les positions de la Gauche Communiste.
Le 14 02 2021
La pandémie du COVID-19 révèle le délabrement du capitalisme mondial
- 171 lectures
Depuis plus d'un an toutes les bourgeoisies du monde sont en prise avec l'épidémie de Coronavirus, sans qu'une sortie de tunnel soit aujourd'hui réellement en vue. Jusqu’à présent, c’étaient les pays les plus pauvres et sous-développés qui payaient le plus lourd tribu aux maladies, épidémiques ou endémiques. Ce sont maintenant les pays les plus développés qui sont ébranlés dans leur fondation par la pandémie de Covid-19.
Il y a plus d'un siècle, l'éclatement de la Première Guerre mondiale signifiait l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence. L'effondrement du bloc de l'Est et la dissolution de celui de l'Ouest en 1990 et l'onde de choc mondiale qui s'ensuivit, avec des bouleversements considérables, constituaient des symptômes de la désagrégation mondiale de la société, signaient l'entrée du capitalisme dans la phase ultime de sa décadence, celle de sa décomposition.
Et après le capitalisme ? Si le prolétariat mondial parvient à le renverser avant qu'il ne détruise l'humanité, ce sera alors l'humanité unifiée dans la société communiste qui, face aux problèmes de la maladie et autres calamités, sera capable de donner une réponse qui ne soit pas sapée par l'exploitation, la concurrence et l'anarchie capitalistes.
La pandémie, un phénomène social qui a pour terrain le délabrement du monde
Aux États-Unis, on compte aujourd'hui au moins 25 millions de contaminés, et plus de 410 000 morts. Il y a eu plus de morts du Covid que de soldats américains tués lors de la seconde guerre mondiale ! Au mois d'avril dernier, le nombre de morts avait déjà dépassé celui des morts pendant la guerre du Vietnam ! Dans la grande métropole de Los Angeles, 1 habitant sur 10 est contaminé ! En Californie, les hôpitaux sont pleins à craquer. Au début de la crise sanitaire, toute la population américaine a été frappée par les immenses tranchées où on entassait des morts "non réclamés" dans l'État de New-York, sur Hart Island. En Europe, la Suède qui naguère était réputée pour le "bienêtre social" de ses citoyens avait misé, au début de la pandémie, sur l'obtention rapide d'une immunité collective. Elle vient de battre un record national – celui du nombre de décès - détenu depuis la grande famine de 1869.
La pandémie du Covid-19 n'est pas une catastrophe imprévisible qui répondrait aux lois obscures du hasard et de la nature ! Le responsable de cette catastrophe planétaire, de plus de deux millions de morts, c'est le capitalisme lui-même. Contrairement aux épidémies d'origine animale du passé (comme la peste introduite au Moyen-Âge par les rats) aujourd'hui, cette pandémie est due essentiellement à l'état de délabrement de la planète. Le réchauffement climatique, la déforestation, la destruction des territoires naturels des animaux sauvages, de même que la prolifération des bidonvilles dans les pays sous-développés, ont favorisé le développement de toute sorte de nouveaux virus et maladies contagieuses.
Si ce nouveau virus a été capable de surprendre et paralyser la bourgeoisie c'est parce les études scientifiques sur les coronavirus ont été partout abandonnées il y a une quinzaine d’années, car le développement du vaccin était jugé… “non rentable” ! À côté de cela, l'essentiel des recherches scientifiques et technologiques de pointe, aux États-Unis en particulier, ciblaient prioritairement des produits pour lesquels un marché juteux était garanti ou bien étaient consacrées essentiellement au secteur militaire, avec y compris la recherche d'armes bactériologiques.
Par ailleurs, alors que le monde est encore loin d'avoir maitrisé l'actuelle pandémie, d'autres menaces plus terrifiantes encore[1] –comme le Nipah- et ayant la même cause sont déjà identifiées, sans qu'aucune de ces maladies n'ait à ce jour donné lieu à des projets de recherches des entreprises pharmaceutiques[2] :
La bourgeoisie surprise par la première vague, désemparée par les suivantes
Déjà plusieurs vaccins ont déjà été mis au point en un temps record, ce qui illustre les capacités technologiques qui pourraient être mises au service du bien-être de l'humanité. Néanmoins, aujourd'hui encore, comme au début de l'épidémie, un ensemble de problèmes font obstacle à une réelle prise en charge de la maladie, et ils sont la conséquence directe du fait que ce système est clairement au service d'une classe exploiteuse qui ne se préoccupe de la santé de la population que pour préserver la force de travail de ceux qu'elle exploite.
En effet, le système de santé a été complètement débordé du fait que, face à l'aggravation de la crise économique, dans tous les pays, les gouvernements de droite comme de gauche, n'ont cessé depuis des décennies de réduire les budgets sociaux, les budgets de la santé et de la recherche. Le système de santé n'étant pas rentable, ils ont supprimé des lits, fermé des services hospitaliers, supprimé des postes de médecins, aggravé les conditions de travail des soignants, détruit des stocks de masques jugés trop coûteux à entretenir, .... des respirateurs ont fait défaut en beaucoup d'hôpitaux.
Pour limiter l'emballement de la pandémie, la bourgeoisie n'a pas été capable de faire mieux que recourir à des méthodes moyenâgeuses comme le confinement. Partout, elle doit imposer des couvre-feux, la distanciation sociale, les visages humains masqués. Les frontières sont verrouillées, tous les lieux publics et culturels sont fermés dans la plupart des pays d'Europe. Jamais l'humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'avait vécu une telle épreuve.
De plus, la concurrence entre les différentes fractions de la bourgeoise, tant au niveau international que dans chaque pays, exacerbée par l'aggravation de la crise économique, avait clairement constitué, dès le début de la pandémie, un facteur d'approfondissement de la crise sanitaire, donnant lieux à l'expression ouverte des rivalités tellement acérées parfois qu'elles avaient été qualifiées de "guerres" par les médias.
La "guerre des masques" est un exemple édifiant de la concurrence cynique et effrénée à laquelle s'étaient livrés tous les États, chacun s’arrachant ce matériel de survie à coup de surenchères et même par le vol pur et simple !
La "guerre pour arriver parmi les premiers à produire un vaccin efficace", dans laquelle chaque pays, en concurrence avec tous les autres, garde jalousement les résultats de ses travaux pour essayer d'arriver dans le groupe de tête de ceux qui se partageront le juteux marché. Une telle situation de chacun pour soi empêche toute coordination et coopération internationale pour éradiquer cette pandémie et des délais de production d'un vaccin bien plus long que s'il avait été le produit d'une coopération internationale
La "guerre pour obtenir des vaccins en grande quantité" dont l'enjeu est considérable. En effet, les pays qui, grâce à la vaccination, arriveront parmi les premiers à obtenir l'immunité collective, seront aussi les premiers à pouvoir entreprendre la remise sur pieds de leur appareil productif et de leur économie. Le problème est que, même si le vaccin commence à être produit en grande quantité au sein d'un certain nombre de pays, il l'est toutefois en nombre insuffisant par rapport aux besoins. Cette situation a donné lieu à des tensions très importantes entre, par exemple, l'Union Européenne et le Royaume Uni, alors que ce dernier se trouvait dans l'incapacité d'honorer, dans les quantités et délais contractuels, les commandes du vaccin AstraZeneca (Britannique-Suédois) passées par l'UE. Pour y parvenir, il aurait été obligé de réduire son propre approvisionnement en vaccins de cette fabrication. Face à cela, l'Union Européenne a haussé le ton et l'Allemagne est allée jusqu'à menacer de prendre des mesures de rétorsion en "retenant" les vaccins BioNTech-Pfitzer fabriqués sur le territoire de l'Union Européenne et destinés à la vente au Royaume Unis. Conséquence de ce durcissement, de nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles ont surgi à propos du "protocole nord-irlandais", partie cruciale du traité du Brexit[3].
Les médias européens s'étaient félicité de la bonne tenue de l'Europe face au séisme économique provoqué par l'irruption de la pandémie, notamment grâce à l'obtention de certains accords : l'un portant sur la mutualisation des dettes nouvelles au sein de l'UE, l'autre déléguant la Commission européenne pour l’achat des vaccins destinés aux Etats membres. Mais dans les coulisses, certains des États membres, et pas des moindres, comme l'Allemagne ont passé des contrats spécifiques avec Pfizer-BioNTech, Moderna et Curevac, ce qui "a provoqué un séisme à Bruxelles"[4].
Fait inattendu, l'Allemagne, qui jusque-là avait fait très bonne figure avec un taux de mortalité bien inférieur à celui de tous les pays industrialisés, a commencé à rivaliser d'incohérence avec d'autres pays dits développés comme la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. "Avec près de 2,1 millions d'infections en un an, l'Allemagne affiche un taux de mortalité de 2,4 %, équivalent à celui de la France.."[5], la moitié des cas de surmortalité survenus au cours des deux vagues de pandémie en Allemagne est liée à l'infection des seniors. Lorsque les premiers vaccins sont arrivés, rares sont les pays industrialisés dans lesquels l'anarchie capitaliste et le crétinisme administratif ne sont pas invités dans la gestion calamiteuse de leur distribution aux différents centres de vaccination ; il en a été de même pour les aiguilles et autre matériel médical. Fait significatif que quelque chose est défaillant dans la société, les gouvernements ont dû, dans un certain nombre de pays, faire appel à l'armée afin que des militaires soutiennent les services médicaux, prennent en charge la logistique de la distribution, le suivi des commandes, mais aussi protègent les vaccins contre le vol.
Alors qu'il y a pénurie de vaccins dans les pays les plus industrialisés, ceux-ci sont absents de pays les moins riches, essentiellement fournis par des vaccins chinois[6] dont l'efficacité n'est pas probante. À contrario, si L'État d'Israël a pu obtenir les doses nécessaires pour pouvoir vacciner toute sa population, c'est parce qu'il a acheté le vaccin Pfizer 43% plus cher que le prix négocié par l'Union Européenne.
L'agonie du capitalisme dans sa phase finale de décomposition empeste la société
Des millions d'ouvriers ont été jetés brutalement au chômage dans le monde, la pauvreté s'est étendue et approfondie de façon considérable. Cernées par les dangers de la contagion, la réalité du chômage et la plongée dans la pauvreté, des parties importantes de la population mondiale, de grandes masses précarisées, sombrent dans le désespoir. Dans les métropoles industrialisées, l'isolement forcé résultant des diverses mesures de confinement a des conséquences sur la santé mentale des populations, ce dont témoignent l'engorgement des services psychiatrique et l'augmentation des suicides.
Si, pour des fractions importantes de la classe ouvrière, la situation résultant de la pandémie constitue un acte d'accusation sans appel de la bourgeoisie, pour des parties significatives de la population, toute réflexion est par contre polluée par toutes sortes de théories complotistes. C'est le cas notamment aux Etats-Unis, le pays le plus développé du monde, à l'avant-garde de la science. Alors que la pandémie avait déjà commencé à déferler sur le continent américain, une grande partie de la population aux États-Unis s'imaginait que le Covid-19 n'existait pas et que c'était un complot pour torpiller la réélection de Trump ! D'autres versions, moins outrancières mais tout aussi illustratives de théories fantasques, ont fleuri, voyant derrière les mesures de restriction de la liberté de mouvement la main de ceux qui nous manipulent cherchant un prétexte pour nous "confiner" ou permettre aux compagnies pharmaceutiques de faire leur beurre. Des manifestations ont eu lieu sur ce thème dans certains pays. En Espagne, des participants scandaient "les hôpitaux sont vides", et en Israël, ce sont des juifs ultraorthodoxes qui manifestaient. L'extrême-droite s'est aussi invitée à certaines de ces manifestations, aux Pays-Bas en particulier. Dans ce pays, on a assisté à de véritables émeutes avec ponctuellement des débordements ciblant des postes de santé.
Cette crise est le produit de la phase actuelle de décomposition au sein de la décadence du capitalisme et une illustration de ses manifestations. Perte de contrôle de la classe dominante sur son propre système, aggravation sans précédent du "chacun pour soi", montée des thèses et idéologies les plus irrationnelles, tels sont les traits marquants de la situation créée par l'irruption de cette pandémie. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, elles ont envahi la société, se signalant par la montée des idéologies les plus irrationnelles, réactionnaires et obscurantistes, la montée du fanatisme religieux à la base de l'État islamiste et ses jeunes kamikazes embrigadés dans la "Guerre sainte" au nom d'Allah.
Toutes ces idéologies réactionnaires ont été aussi le fumier qui a permis le développement de la xénophobie et du populisme dans les pays centraux, et surtout aux États-Unis. Celui-ci a connu une culmination avec la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier par les troupes de choc de Trump. Cette attaque ahurissante contre le temple de la démocratie américaine a donné au monde entier une image désastreuse de la première puissance mondiale. Le pays de la Démocratie et de Liberté est apparu comme une vulgaire république bananière du Tiers-Monde (comme le reconnaissait l'ex-président George Bush lui-même) avec le risque d'affrontements armés dans la population civile.[7]
L'accumulation de toutes ces manifestations de la décomposition, à l'échelle mondiale et sur tous les plans de la société, montre que le capitalisme est bien entré, depuis trente ans, dans une nouvelle période historique : la phase ultime de sa décadence, celle de la décomposition.
Plus que jamais, la survie de l'humanité dépend de la capacité du prolétariat de renverser le capitalisme avant qu'il ne rende impossible toute forme de vie en société sur la planète. De plus, les caractéristiques de la future société communiste rendront impossible une telle vulnérabilité de la société face à la maladie comme c'est le cas aujourd'hui face à la pandémie de Covid.
Comment la société communiste future fera face aux pandémies
Il ne nous appartient pas, dans le cadre de ce court article, d'entrer dans les considérations du type "Pourquoi, aujourd'hui, une telle société serait-elle possible, alors qu'elle ne s'est pas réalisée dans le passé ?" ou encore "comment le prolétariat révolutionnaire prendra en charge le renversement du capitalisme à l'échelle mondiale et la transformation des rapports de production". Le CCI a déjà consacré de nombreux articles à cette question. Nous ne nous risquerons pas non plus à imaginer quelle serait la vie des membres de la société délivrée de l'aliénation des sociétés de classe, mais nous pouvons cependant affirmer que l’aliénation et le chacun pour soi prennent des formes de plus en plus brutales et inhumaines dans le capitalisme agonisant. Nous allons nous limiter ici à l'aspect économique et ses conséquences sociales directes.
- Le communisme n'est pas seulement un vieux rêve de l'humanité ou le simple produit de la volonté humaine, mais il se présente comme la seule société capable de surmonter les contradictions qui étranglent la société capitaliste. De de fait, ses caractéristiques économiques seront les suivantes ;
- le seul mobile de la production est la satisfaction des besoins humains ;
- les biens produits cessent d'être des marchandises, des valeurs d'échange, pour devenir uniquement des valeurs d'usage ; en d'autres termes on produira pour les besoins des hommes et non pas pour le marché ;
- la propriété privée des moyens de production, qu'elle soit individuelle comme dans le capitalisme des origines ou étatique comme dans le capitalisme décadent (dans sa version stalinienne, fasciste ou démocratique), cède la place à leur socialisation. C'est-à-dire la fin de toute propriété, partant, de toute existence de classes sociales et, donc, de toute exploitation.
En passant en revue les facteurs qui sont à l'origine des très grandes difficultés rencontrées par la société pour se défendre face à la pandémie du Covid, et aussi pour faire face aux conséquences sociales tragiques de cette dernière, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le poids qu'auraient eu ces mêmes facteurs dans une société communiste. En fait, il auraient été inexistants :
- Nous savons qu'à l'origine de la pandémie se trouve l'état de délabrement de la planète, qui s'aggravait avec l'enfoncement du capitalisme dans sa décadence, plus particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que : "la destruction impitoyable de l'environnement par le capital prend une autre dimension et une autre qualité, l'époque dans laquelle toutes les nations capitalistes sont obligées de se concurrencer dans un marché mondial sursaturé ; une époque, par conséquent, d'économie de guerre permanente, (…) une époque caractérisée par le pillage désespéré des ressources naturelles par chaque nation essayant de survivre dans un combat de rats sans merci pour le marché mondial "[8]. Une fois la bourgeoise défaite politiquement à l'échelle mondiale, une tâche prioritaire sera de réparer les séquelles que le capitalisme a infligées à la planète et de rendre cette dernière apte à permettre l'épanouissement de la vie sur terre. C'est ainsi que seront également éliminées les possibilités d'apparition de pandémies du type de celle du Covid-19.
- Néanmoins, rien ne garantit que d'autres pandémies avec une origine différente de celle du Covid-19 ne pourront pas voir le jour à l'avenir ! C'est la raison pour laquelle, soucieuse de la survie et du bien-être de ses membres, la nouvelle société développera ses connaissances scientifiques en vue d'anticiper au mieux la survenue d'éventuelles maladies inconnues. Un tel effort de la société pourra être considérable en comparaison de ce qu'est capable de faire le capitalisme, dans la mesure où il ne sera plus assujetti à la réalisation de profit mais destiné à la satisfaction des besoins humains. Pour cela, il y aura diffusion et centralisation de tout le savoir à l'échelle planétaire, et non pas "protection" et rétention des connaissances motivée la réalisation de profit et conséquence de la concurrence. Les maladies et les risques qu'elles impliquent ne seront plus cachées pour que "l'économie puisse continuer à tourner", mais la réaction sera collective et responsable sans soumission aucune à des lois économiques "au-dessus" des hommes.
- Ce dernier facteur fait que, contrairement à la situation présente, les installations sanitaires, non soumises à la loi du profit, pourront en permanences être améliorées et non pas laissées à l'abandon.
- Même dans une société communiste, on ne peut cependant pas exclure, malgré l'importance qui sera alors accordée à la prévention, que l'humanité soit amenée à faire face à l'imprévu, à travers, par exemple, la nécessité de fabriquer dans les meilleurs délais d'un vaccin ou un traitement. Il ressort clairement des caractéristiques de la société communiste, sans concurrence entre différentes parties de celle-ci, qu'elle pourrait alors mobiliser au service de cet objectif les forces associées de l'ensemble de l'humanité, tout le contraire de ce qui s'est produit avec la fabrication d'un vaccin contre le Covid. En fait, ce n'est pas spéculer que d'affirmer que l'humanité sera confrontée à des dangers bien réels, qui seront la conséquence des dommages, peut-être irréversibles pour certains, que le capitalisme décadent et en décomposition lèguera aux générations futures. Face à ceux-ci, le prolétariat devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, sanitaires et de restauration de l'environnement pour que vive l'humanité libérée des lois aveugles du capitalisme.
- Et si, malgré un effort toujours plus poussé de prévention par rapport à tout ce qui pourrait menacer l'espèce humaine, l'humanité devait se trouver affectée par de dures épreuves, c'est solidairement, comme un seul homme, qu'elle y ferait face et non pas en rejetant sur le pavé une partie d'entre elle, comme aujourd'hui les millions de laissés pour compte des "bienfaits" du capitalisme.
Entre le moment où le prolétariat aura commencé à renverser le pouvoir politique de la bourgeoisie dans un certain nombre de pays, puis à l'échelle mondiale (un monde sans frontières) et le moment où sera instaurée une société sans classes sociales, sans exploitation, sans argent, …. le prolétariat devra diriger la transition société dans cette direction … et cela prendre beaucoup de temps. Néanmoins, même s'il n'est pas possible de commencer à transformer la société avant la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale, le prolétariat au pouvoir aura face à la maladie une attitude différente de celle de la bourgeoisie. C'est ce qu'illustre l'article que nous publions ci-après, "La Prise en charge de la Santé en Russie Soviétiste" qui est relatif aux mesures prise par le pouvoir des Soviets entre juillet 1918 et juillet 1919.
Alors oui ! La transformation communiste est nécessaire, mais aussi la révolution est possible !
Nous avons jusqu'à maintenant mis l'accent sur les dangers que la décomposition du capitalisme faisait courir à la société et à la possibilité même de la révolution prolétarienne. C'était notre responsabilité car il appartient aux révolutionnaires de parler clairement à la classe ouvrière sans lui masquer les difficultés auxquelles elle va être confrontée. Mais il leur appartient aussi, en particulier face au scepticisme ambiant, de montrer qu'il existe la possibilité d'une issue révolutionnaire à la situation actuelle. Celle-ci résultera d'une part du fait que, bien que connaissant des difficultés importantes, la classe ouvrière n'a pas subi de défaite importante, l'empêchant de réagir, comme dans les années 1930, aux attaques de la bourgeoisie. Et celles-ci pleuvent déjà, et ce n'est qu'un début.
En effet, la crise sanitaire ne peut qu‘aggraver encore plus la crise économique. Et on le voit déjà avec les faillites d’entreprises, les charrettes de licenciements depuis le début de cette pandémie. Face à l’aggravation de la misère, à la dégradation de toutes ses conditions de vie dans tous les pays, la classe ouvrière n’aura pas d’autre choix que de lutter contre les attaques de la bourgeoisie. Même si, aujourd’hui, elle subit le choc de cette pandémie, même si la décomposition sociale rend beaucoup plus difficile le développement de ses luttes, elle n’aura pas d’autre choix que de se battre pour survivre. Avec l’explosion du chômage dans les pays les plus développés, lutter ou crever, voilà la seule alternative qui va se poser aux masses croissantes de prolétaires et aux jeunes générations !
C’est dans ses combats futurs, sur son propre terrain de classe et au milieu des miasmes de la décomposition sociale, que le prolétariat va devoir se frayer un chemin, pour retrouver et affirmer sa perspective révolutionnaire.
Malgré toutes les souffrances qu’elle engendre, la crise économique reste, aujourd’hui encore, la meilleure alliée du prolétariat. Il ne faut donc pas voir dans la misère que la misère, mais aussi les conditions du dépassement de cette misère.
Sylver (17 02 2021)
[1] Le Nipah s’est manifesté dans les années 1995/1999 en Malaisie et à Singapour chez des éleveurs de porcs, il a réapparu de manière épisodique au Bengladesh et en Inde orientale en 2011 puis au Cambodge en 2012 (aux abords notamment des temples touristiques d’Angkor Vat) avant de se manifester en Chine et en Thaïlande en 2020, c’est-à-dire dans des zones de forêts tropicales asiatiques. Il est transmis par l’urine ou la salive des chauves-souris frugivores chassées de leur milieu naturel (du fait des incendies, de la sécheresse, de la déforestation, des pratiques agricoles) vers l’environnement humain proche et se transmet à l’homme via les élevages porcins. Outre des symptômes similaires au Covid, il provoque aussi des encéphalites foudroyantes (son taux de mortalité varie effectivement entre 40 et 75%). Sa période d'incubation et infectieuse, très large, peut varier de 5 jusqu’à 45 jours !!! Source OMS, Virus Nipah [2]
[2] Source La fondation néerlandaise. Pharmaceutical giants not ready for next pandemic, report warns [3]
[3]. Journal Le Monde. "Nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles à propos du "protocole nord-irlandais", partie cruciale du traité du Brexit [4]".
.[4]. Journal Le Monde du 3 février 2021". "Il est stipulé que les participants s'engagent à ne pas contractualiser individuellement avec les mêmes laboratoires. L'Allemagne a pourtant reconnu avoir passé des contrats avec Pfizer-BioNTech, Moderna et Curevac." Covid-19 : après la Hongrie, le vaccin russe Spoutnik pourrait séduire d’autres pays européens [5]..
[5]. Journal Les Echos du 12 février 2021. Coronavirus : les 50.000 morts qui font frémir l'Allemagne [6]
[6]. "En septembre déjà, l'ONG Oxfam estimait que les pays riches, représentant seulement 13 % de la population mondiale, avaient mis la main sur plus de la moitié (51 %) des doses des principaux vaccins à l'étude". Journal Le Monde. "Essais cliniques, production, acheminement… Les six défis de la course au vaccin contre le Covid-19." [7]
[7]. À propos de la situation aux États-Unis, lire note article "Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue [8]". Essais cliniques, production, acheminement… Les six défis de la course au vaccin contre le Covid-19 [7]
[8]. "Ecologie : c'est le capitalisme qui pollue la terre [9]". Revue internationale n° 63.
Evènements historiques:
Rubrique:
La prise en charge de la santé dans la Russie des soviets
- 159 lectures
Nous publions ci-dessous un article relatif à l'évolution de la situation sanitaire dans la Russie des soviets en juillet 1919, un an après la mise sur pied du Commissariat de l'hygiène publique. C'est dans un contexte très défavorable que cette politique sanitaire a alors été mise en œuvre puisque, depuis la prise du pouvoir par le prolétariat en octobre 1917, la Russie subit sur son territoire les menées contre-révolutionnaires soutenues par les gouvernements de l'Entente. Ainsi, au début 1919, la Russie est complètement isolée du reste du monde et confrontée à l'activité tant des armées blanches que des troupes des "démocraties occidentales". Et néanmoins, dans les conditions matérielles parmi les plus difficiles qu'il soit possible d'imaginer, la méthode alors mise en œuvre par le prolétariat, notre méthode, en tout point opposée à celle de la bourgeoisie aujourd'hui confrontée à la pandémie du coronavirus, parvient à des résultats qui, à l'époque, constituent un pas en avant considérable.
S'il nous est apparu opportun de souligner comment deux méthodes s'opposent, celle du prolétariat et celle de la bourgeoisie, ce n'est pas seulement pour mettre en évidence l'incapacité de la bourgeoise à sortir l'humanité de la barbarie dans laquelle elle plonge le monde. C'est aussi pour défendre l'honneur et les réalisations de la classe ouvrière révolutionnaire lorsqu'elle s'élançait à la conquête du monde lors de la première vague révolutionnaire mondiale, alors que depuis sa défaite, les mensonges de la bourgeoisie stalinienne et démocratique n'ont eu de cesse, chacune à leur manière, d'en salir et dénaturer les objectifs.
Il y a certes des concepts et des formulations qui apparaissent dans l'article et que nous ne partageons pas aujourd'hui : par exemple, l'idée de la nationalisation comme étape vers le socialisme ou même l'affirmation que l'exploitation capitaliste a déjà été abolie en Russie, ainsi qu'une partie du langage "médical" (enfants "anormaux" ou "retardés", etc.). Les mesures prises par le pouvoir soviétique à cette époque avaient essentiellement un caractère d'urgence et elles ne pouvaient pas, à elles seules, échapper aux pressions d'un système mondial capitaliste encore dominant. Mais malgré cela, la détermination du nouveau pouvoir soviétique à centraliser, remettre en service et améliorer rapidement les services de santé, à les retirer des mains des exploiteurs et à les mettre librement à la disposition de toute la population, découlait d'une méthode fondamentalement prolétarienne qui reste valable aujourd'hui et pour l'avenir.
La Conservation de la Santé en Russie Soviétiste
(N.A. Semachko)
Conditions générales du travail du Commissariat de l'hygiène publique
Le Commissariat de l'hygiène publique, créé par le décret du Conseil des Commissaires du peuple le 21 Juillet 1918, a dressé au mois de juillet 1919 le bilan de son travail annuel.
Les conditions extérieures défavorables dans lesquelles s'accomplit le travail des Commissariats du Peuple se répercutèrent visiblement sur l'appareil le plus sensible destiné à protéger ce que l'homme a de plus cher : sa vie et sa santé. Le lourd héritage qui nous fut légué par le régime capitaliste et par la guerre impérialiste, tout en entravant l'œuvre de création soviétiste, pesait très lourdement sur l'organisation médicale et sanitaire. Les difficultés rencontrées dans l'approvisionnement, la désorganisation économique, le blocus de la Russie des Soviets par les impérialistes, la guerre civile, —tout cela contrecarrait péniblement les mesures prises en vue de prévenir les maladies et de les guérir. Il est difficile de mettre en œuvre des mesures sanitaires préventives quand l'alimentation insuffisante affaiblit l'organisme humain et le prédispose aux maladies, quand la population manque des objets les plus indispensables à l'accomplissement des proscriptions élémentaires de l'hygiène ; ou d'organiser un traitement médical rationnel, lorsque, grâce au blocus maintenu par les "alliés" nous sommes privés des médicaments les plus indispensables, et que les difficultés dans l'approvisionnement alimentaire ne nous permettent pas d'organiser de traitement diététique.
Et néanmoins, l'état sanitaire de la Russie Soviétiste est en ce moment tout aussi bon et même bien meilleur que celui des territoires limitrophes, se trouvant sous le joug des gardes blancs " gouverneurs suprêmes " de pays abondamment approvisionnés et largement pourvus en produits de toutes sortes, en médicaments et en personnel médical. Cet été, la Russie Soviétiste n'eut presque pas de cas de choléra ; tandis que dans la satrapie[1] de Dénikine[2], le choléra, comparable à un large torrent, fit d'importants ravages. La Russie Soviétiste vint, cet été, presque complètement à bout de l'épidémie de typhus. En Sibérie, en Oural, dans les territoires que nous libérons de Koltchak le typhus fait rage ; les prisonniers de l'armée de Koltchak sont presque tous infectés de maladies épidémiques. Nous avons supporté facilement l'épidémie de grippe espagnole, bien plus facilement même que l'Europe Occidentale; l'épidémie de choléra de l'année écoulée fut relativement courte, et seule l'épidémie de typhus revêtit l'hiver passé un caractère assez sérieux. Les raisons qui font que nous avons lutté avec suffisamment de succès, en dépit de conditions difficiles, contre les épidémies et les maladies, ces satellites inévitables de la boucherie impérialiste —consistent dans les méthodes nouvelles appliquées par le Pouvoir Soviétiste.
Les épidémies, de tout temps et en tout lieu, exercent surtout leurs ravages parmi les pauvres, parmi les classes laborieuses. Le Pouvoir Soviétiste est le pouvoir des travailleurs. En défendant les intérêts de la classe déshéritée il protège du même coup la santé du peuple. L'abolition de l'exploitation capitaliste donna la possibilité d'établir le règlement de la protection sanitaire du travail : elle permit de recourir aux mesures les plus efficaces pour la protection de la maternité et de l'enfance; l'abolition de la propriété mobilière et foncière permit de résoudre équitablement la question des logements: le monopole du pain eut pour résultat de permettre en premier lieu la répartition des réserves disponibles aux classes laborieuses; la nationalisation des pharmacies permit de distribuer également et économiquement les maigres réserves de médicaments, en les arrachant des mains des spéculateurs, etc... On peut dire que nul autre pourvoir dans les difficiles circonstances actuelles n'aurait pu avoir raison des obstacles incommensurables et apparemment invincibles qui existaient dans le domaine de la protection de la santé publique. Toutefois, il est encore une circonstance qui facilita notre travail dans ces conditions, c'est la concentration de tout le service médical dans les mains d'un seul organe dûment autorisé : le Commissariat de l'hygiène publique. Un seul organe avait été créé qui mena la lutte selon un plan unifié avec la plus grande économie de forces et de moyens. Cet organe vint remplacer le travail désordonné et fractionné des institutions diverses, les agissements mal combinés de plusieurs organes qui s'occupaient de la santé du peuple. La science et la pratique médicale démontraient depuis longtemps la nécessité d'une pareille centralisation du travail en un seul organe compétent. Ce sujet fut surtout débattu très vivement avant la guerre dans des ouvrages spéciaux russes et internationaux. Ainsi le médecin français Mirman écrivait dès 1913 dans l'Hygiène :
- "Très souvent il arrive qu'un préfet s'intéresse à la santé publique et veuille se rendre utile. Désireux d'acquérir l'appui du gouvernement, il doit à Paris visiter tous les ministères et s'entretenir avec tous les chefs de service d'une dizaine d'administrations. Il faut une grande persévérance pour ne pas abandonner la route, pour ne pas jeter le manche après la cognée, tant on finit par être désespéré par toutes ces formalités. Il s'agit surtout de la lutte contre les maladies sociales, la tuberculose et l'alcoolisme, par exemple. Voyons dans quel département ministériel peut être préparée, commencée et organisée la lutte contre la tuberculose. Elle dépend actuellement: du ministère du Travail (logements à bon marché, assurance mutuelle, hygiène des ateliers et des magasins), du ministère de l'Agriculture (hygiène de l'alimentation et analyse du lait), du ministère de l'Intérieur (prescriptions sanitaires aux communes et désinfection), du ministère de l'Instruction publique (inspection médicale des écoles). Lorsque le gouvernement sera interpellé sur les mesures qu'il compte entreprendre pour la défense de la race contre son ennemi le plus acharné, — quatre ministres devront prendre part aux débats (sans compter l'armée, la marine et les colonies) ; bref, par suite de la distribution des services de l'hygiène publique entre les différents ministères et administrations, il n'y a personne parmi les membres du gouvernement qui soit directement responsable de l'hygiène et de la santé publique. L'organisation d'un ministère de l'Hygiène publique mettra de l'ordre dans ce chaos et créera un système au lieu de l'arbitraire actuel."
Cette centralisation de l'œuvre médicale fut réalisée en Russie par le décret du gouvernement soviétiste du 21 juillet 1918. Ce décret créa "le Commissariat de l'Hygiène publique" nanti de tous les droits d'un ministère indépendant et comprenant les sections suivantes : Section sanitaire-épidémiologique, Section des traitements médicaux, Section pharmaceutique, Section des fournitures médicales et générales, Section de la lutte contre les maladies sociales (maladies vénériennes, prostitution et tuberculose), Section de la protection de l'enfance (inspection sanitaire des écoles, soins spéciaux aux enfants anormaux, organisation de la culture physique, etc...). Section des services sanitaires militaires et des voies de communication, etc...
L'administration pratique de toute l'œuvre médico-sanitaire se trouve entre les mains des organisations ouvrières des Soviets de Députés Ouvriers et Députés de l'Armée Rouge. Toutes les mesures sanitaires fondamentales se réalisent avec le concours énergique des organisations ouvrières (rappelons, par exemple, les travaux connus de la Commission, travaux ayant rendu les plus inappréciables services dans la liquidation du choléra et du typhus).
Telles sont les causes fondamentales, créatrices de nouvelles conditions dans l'œuvre sanitaire et médicale et qui, en dépit des conditions extérieures particulièrement pénibles, facilitent le travail. Dans le chapitre suivant, nous donnerons un aperçu sommaire du travail du Commissariat. Ici, nous comparerons, à titre d'exemple concret, l'organisation médico-sanitaire de la ville de Moscou d'avant la révolution d'octobre avec cette même organisation dans son état actuel, après deux années d'existence du Pouvoir Soviétiste
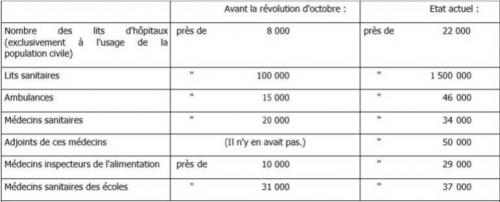
Il faut y ajouter les nouvelles organisations médico-sanitaires créées par le Pouvoir Soviétiste à l'usage de la population la plus pauvre ; assistance gratuite à domicile (cette question fut à l'ordre du jour pendant 10 ans et avant le mois d'octobre 1917, elle se trouvait encore à l'état de discussion). Actuellement, 80 médecins et près de 160 infirmières sont occupés à cette assistance et sont répartis dans les différents quartiers de la ville ; il faut aussi citer des postes de secours pour les cas urgents et dans ce but des services permanents de médecins et d'automobiles sanitaires ont été institués. Mentionnons encore la lutte récemment entreprise contre la tuberculose et la syphilis, en tant que maladies sociales ; une action importante, destinée à populariser les connaissances sanitaires ; une assistance gratuite et largement organisée pour les traitements dentaires (10 ambulances avec 25 fauteuils) ; la mise à la portée de la population de l'assistance psychiatrique (traitements au moyen de rayons) ; la gestion des pharmacies nationalisées, ainsi que la bonne répartition de leurs produits, etc...
Et cette énumération d'exemples n'épuise pas encore tout ce qui fut nouvellement créé par le Pouvoir Soviétiste a Moscou dans le domaine de l'hygiène publique au cours d'une existence de deux années. Ce qui vient d'être mentionné, se rapporte à la quantité. Quant à la qualité, — elle a été égalisée du fait qu'on a fait disparaître l'usage qui divisait la médecine en deux classes : celle dite " de premier ordre " pour les riches et de " troisième ordre " pour les pauvres.
Les meilleurs spécialistes de Moscou reçoivent maintenant les malades dans les hôpitaux de la ville ; et l'on peut affirmer qu'il n'y a pas un grand spécialiste, — docteur ou professeur, — auquel un habitant quelconque de la capitale soviétiste ne puisse s'adresser pour un conseil gratuit.
Cette aide médicale est organisée de fanon semblable, mais naturellement sur une autre échelle, dans toutes les autres villes.
C'est ainsi que le Pouvoir Soviétiste sut organiser l'œuvre médico-sanitaire au cours des deux années écoulées, au milieu de conditions essentiellement défavorables.
Une année de travail
Le développement du travail du Commissariat de l'Hygiène publique, son œuvre organisatrice et la lutte menée contre les épidémies, qui se succédaient, ont été simultanés. L'été dernier, une tourmente de grippe espagnole s'abattit sur toute la Russie. On envoya en divers endroits des commissions à l'effet d'étudier cette maladie encore peu connue, aussi bien que pour la combattre efficacement ; toute une série de conférences scientifiques furent organisées et des enquêtes furent menées sur place. Comme résultat de ces études on put constater la parenté de la grippe espagnole avec l'influenza (grippe) ; des ouvrages spéciaux furent édités traitant de cette maladie sous une forme scientifique et populaire.
L'épidémie de grippe espagnole passa très vite et relativement bien. Beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile fut la lutte contre l'épidémie de typhus, qui prit une grande extension surtout pendant l'hiver de 1918-1919. Il suffit de dire que jusqu'à l'été 1919 près d'un million et demi de personnes furent atteintes de cette maladie. Cette épidémie ayant été prévue, le Commissariat de l'Hygiène publique ne fut pas pris au dépourvu. Dès l'automne de 1918, une série de consultations avec les représentants des sections locales et avec les spécialistes bactériologues avait lieu ; on esquissa le plan de la lutte qui permit d'envoyer en province des instructions précises. On soumit à la ratification du Conseil des Commissaires du Peuple un décret sur les mesures à prendre pour la lutte contre le typhus. Des réunions scientifiques furent organisées en même temps que des expériences étaient tentées avec application d'un sérum pour prévenir et traiter le typhus. On édita de nombreuses brochures scientifiques, des livres populaires et des feuilles concernant le typhus. L'épidémie de choléra qui s'était sensiblement propagée en été et en automne 1918 et qu'on attendait en 1919 ne prit pas cette année d'extension considérable, malgré le danger direct de contamination qui nous venait des troupes de Denikine où sévissait le choléra. Comme mesures préventives on purifia l'eau potable (chlorification), en même temps que les vaccinations anticholériques se faisaient sur une plus vaste échelle. Enfin, un décret sur la vaccination obligatoire fut promulgué et confirmé par le Conseil des Commissaires du Peuple le 10 avril 1919, comblant ainsi une lacune capitale de notre législation sanitaire. Ce décret eut pour but de prévenir une épidémie de petite vérole qui menaçait de se développer en 1918-1919 ; pour compléter ce décret, on élabora des instructions pour les institutions locales, des règlements sur l'entretien, des étables pour l'élevage des jeunes veaux destinés à la préparation du vaccin. On assigna près de 5 millions 1/2 pour réaliser ce décret et près de 5 millions de vaccins furent distribués contre la petite vérole.
Il était matériellement impossible, dans notre république isolée de l'Europe, de se procurer des vaccins médicaux et des sérums. Le Commissariat de l'Hygiène publique nationalisa promptement tous les instituts bactériologiques importants, aussi bien que les étables où étaient élevés les veaux destinés à la préparation du vaccin ; des étables spéciales furent créées (notamment dans le gouvernement de Saratov) : on les munît de tout le nécessaire, on élargit leur travail ; l'approvisionnement de ces institutions en matériel nécessaire fut centralisé, organisé en sorte que, lors des épidémies, le pays ne manqua ni de sérum, ni de vaccin.
Il faut surtout souligner, que toute la lutte pratique contre les épidémies se faisait sur de nouveaux principes, à savoir, sur les principes de la participation directe de toute la population et avant tout, des masses ouvrières et paysannes. Même les correspondants des journaux bourgeois, séjournant en Russie, durent reconnaître que le Pouvoir Soviétiste luttait contre les épidémies d'une façon toute nouvelle, en mobilisant pour cela toute la population. Des services irremplaçables et inestimables furent rendus lors de la lutte contre les épidémies par les commissions, surnommées « commissions ouvrières », composées des représentants de Syndicats, de Comités de Fabriques et d'Usines et d'autres organisations prolétariennes et paysannes. Les Commissions Ouvrières, affectées aux sections du Commissariat de l'Hygiène publique, veillaient activement au maintien de la propreté, prenaient des mesures énergiques pour l'organisation des bains de vapeur et des buanderies à l'usage de la population, facilitaient la possibilité de se procurer de l'eau bouillante pendant l'épidémie de choléra et travaillaient a la propagande sanitaire.
Le Commissariat de l'Hygiène publique, afin de prêter un appui financier à ses collaborateurs sur les lieux — assigna aux Comités Exécutifs locaux pour la lutte contre les épidémies 292 millions de roubles du 1 er octobre 1918 au 1er octobre 1919.
En vue de prévenir le développement des maladies et des épidémies — le Commissariat prenait soin de la surveillance sanitaire de l'eau, de l'air et du sol ; il élaborait et appliquait des mesures en conséquence, s'occupait de questions d'hygiène alimentaire, etc... Les soins concernant les logements destinés à la population laborieuse eurent ici une importance particulière. Le Commissariat de l'Hygiène publique fit accepter par le Conseil des Commissaires du Peuple le décret sur l'inspection sanitaire des habitations, prépara des inspections et des règlements relatifs aux logements et organisa des cours pour la préparation d'inspecteurs de logements.
Tout le travail antiépidémique et sanitaire était mené parallèlement à la propagande sanitaire la plus énergique au sein des masses populaires ; des brochures furent éditées, à Moscou et en province ; des musées d'hygiène sociale et des expositions sur la conservation de la santé furent organisés. Un institut scientifique de l'hygiène publique est en cours de préparation pour être ouvert et le sera très prochainement. On étudiera dans cet institut les questions scientifiques sanitaires d'hygiène et de lutte contre les maladies contagieuses.
Dans le domaine des traitements médicaux, le Commissariat s'occupa l'année passée de centraliser toutes les institutions médicales disséminées jusqu'alors dans les divers ministères et départements. Malgré toutes les conditions défavorables au développement de ce genre de traitement ce dernier fut organisé d'après un système uniforme, et en plusieurs endroits non seulement n'en souffrit pas, mais au contraire, s'améliora et s'élargit ; on fit beaucoup, en particulier, pour obtenir des traitements médicaux gratuits et accessibles a tous.
La lutte contre les maladies vénériennes et contre la tuberculose fut l'objet d'une attention particulière du Commissariat de l'Hygiène publique : il créa des organes spéciaux en province, ouvrit des ambulances ou des hôpitaux pour les malades, intensifia la production des préparations spéciales pour le traitement de la syphilis (plus de 60 kilogrammes de 606 furent employés), accrut le nombre de sanatoria au centre aussi bien qu'en province pour combattre la tuberculose, organisa dans plusieurs endroits des ambulances (dispensaires} et prêta une attention particulière à la tuberculose infantile. Mais le point capital fut l'entreprise sur une vaste échelle de l'œuvre de propagande sanitaire, qui donna la possibilité d'établir un lien vivant avec les organisations ouvrières, ce qui est d'une très grande importance dans la lutte contre les maladies sociales. Denikine nous coupa des principales villes d'eau du Sud ; toutes les autres villes d'eau, Lipez, Staraïa-Roussa, Elton, Sergiyevsk, etc., furent largement fréquentées par les travailleurs. Là, où auparavant les bourgeois se soignaient contre l'obésité et contre les conséquences de la débauche, là où ils brûlaient leur vie par les deux bouts — les ouvriers et les paysans de la Russie Soviétiste trouvent maintenant refuge et soulagement.
On sait que la Russie recevait tous ses médicaments de l'étranger (surtout d'Allemagne). Nous n'avions presque pas d'industrie pharmaceutique. On comprend, aisément, dans quelle situation catastrophique la Russie Soviétiste fut mise par le blocus impérialiste. Le Commissariat de l'Hygiène publique nationalisa promptement l'industrie et le commerce pharmaceutiques et sauva, grâce à cette mesure, les provisions pharmaceutiques du pillage et de la spéculation. En collaboration avec le Conseil Supérieur de l'Economie nationale, on organisa rapidement de nouvelles fabriques, où la production des médicaments fut intensifiée. Les remèdes furent réquisitionnés par dizaines et par centaines de kilogrammes chez les spéculateurs. Le dépôt central du Commissariat de l'Hygiène publique envoya en province, rien que pour la population civile, au cours de 10 mois (septembre 1918-juin 1919), pour 24 millions et demi de médicaments, pour 9 millions de matériel de pansement, pour 1 million et demi d'instruments chirurgicaux, presque pour 1 million de toutes sortes de matériel pour traitement des malades, pour 1 million et demi de vaccins et de sérums, pour 300 000 roubles d'appareils de Rœntgen, etc. Et chaque mois, la livraison des fournitures s'accroît.
Le service militaire sanitaire dans cette guerre, à la différence des autres, fut organisé sur de nouvelles bases. Le pouvoir d'Etat ayant adopté pour principe la création d'une médecine organisée sur un plan uniforme, devait logiquement inclure le service sanitaire militaire dans l'organisation générale du Commissariat de l'Hygiène publique, en retirant les services sanitaires militaires du ressort immédiat et exclusif des organes de l'Administration militaire, comme il en avait été jusque-là. Par une telle organisation, une direction uniforme de toute l'œuvre médico-sanitaire de la République est assurée par le Commissariat de l'Hygiène publique. Un front sanitaire unique se crée dans le pays, ce qui est indispensable surtout pour l'accomplissement systématique des mesures antiépidémiques.
Une pareille structure donna la possibilité de sauver l'armée des ravages des maladies épidémiques qui régnaient dans le pays (le typhus de famine, le typhus abdominal, le typhus récurrent, la petite vérole, la dysenterie, le choléra et autres maladies) et cela malgré les conditions générales extrêmement difficiles de la période transitoire que nous traversons. Il y eut dans l'armée 20 à 30 cas de choléra, les cas de typhus de famine atteignirent, avant l'automne, un maximum de 4 à 5 % dans toute l'armée, les cas de dysenterie 0,01 %, de typhus récurrent près de ½ %. Le service de santé militaire se trouva en état de préparer un grand nombre de lits de malades, bien pourvus matériellement, dont la proportion3, par rapport aux effectifs de l'armée rouge, est de 1 pour 7. Tous les points d'évacuation possédant plus de 2 000 lits de malades disposent d'hôpitaux ou de sections pour les différents genres d'assistance spéciale. Le principe de l'utilisation des médecins selon leur spécialité se réalise de jour en jour.
Tous les points d'évacuation sont pourvus de laboratoires chimio-bactériologiques. Presque tous disposent d'un cabinet pour traitement par rayons Rœntgen.
- Les mesures sanitaires-hygiéniques générales sont appliquées d'une façon régulière.
La campagne de vaccination pour la préservation du choléra et du typhus égala, sous le rapport du pourcentage, les résultats de la campagne 1914-1917.
Pour le traitement des soldats atteints de maladies vénériennes, il y a 11 hôpitaux spéciaux avec 4 630 places ; de plus, dans 49 hôpitaux, des sections pour ces malades sont installées ; un traitement d'ambulance a été créé pour les vénériens et la Première Ambulance modèle du Département militaire pour le traitement des maladies cutanées et vénériennes a été ouverte. Afin de lutter contre la propagation des maladies vénériennes, une campagne active est menée, au moyen de projections lumineuses, pour faire connaître la nature et les dangers de ces maladies.
Pour la première fois, l'assistance dentaire est largement organisée dans l'armée. Il a été ouvert dans les circonscriptions militaires 68 ambulances pour le traitement dentaire et 62 sur le front. De plus, des ateliers spéciaux sont créés pour la préparation des râteliers. La centralisation de toute l'œuvre médico-sanitaire dans un seul commissariat spécial et autonome permit d'organiser rationnellement le travail du traitement médical et le travail sanitaire dans l'année sans porter un préjudice tant soit peu considérable aux intérêts de la population civile. Ce principe fut si largement réalisé que, même pendant la mobilisation du personnel médical, les intérêts de la population civile furent attentivement observés et les travailleurs indispensables du corps médical furent exemptés du service à l'armée. Près de 25 % des médecins furent ainsi libérés dans les cas où on les reconnaissait indispensables.
- Le nombre des médecins mobilisés et envoyés au front donne un médecin sur 300 ou 400 soldats de l'armée rouge.
L'œuvre de propagande sanitaire est l'objet d'une attention particulière, Dans tous les organes d'administration militaire sanitaire ont été introduites des sections ou des personnes chargées de l'éducation sanitaire des corps de troupes. On distribue une grande quantité de littérature de propagande sanitaire, on organise des cours, des conférences populaires, ainsi que des expositions sanitaires et hygiéniques mobiles et permanentes. On procède sur une large échelle à la préparation du personnel médical subalterne et secondaire, principalement des sœurs de charité et des infirmières rouges.
La conservation de la santé des enfants n'occupe nulle part une place plus prépondérante que dans la Russie Soviétiste. Non seulement les médecins mais toute la population est conviée à cette œuvre. Un Conseil de la Conservation de la santé des enfants fut créé au mois de novembre 1917. Il fut composé de médecins du Commissariat de l'Hygiène publique et de représentants des organisations prolétariennes (des syndicats, des Comités de fabriques et d'usines), de l'Union de la Jeunesse Communiste et des représentants des masses laborieuses.
L'intérêt pour la conservation de la santé des enfants se renforça beaucoup parmi les médecins et pédagogues grâce aux deux congrès panrusses de l'hygiène sanitaire des écoles (au mois de mars et au mois d'août). Partout, — non seulement au centre, mais aussi dans les villes provinciales, — s'ouvrirent des sous-sections pour la conservation de la santé infantile, sous-sections rattachées aux sections de l'hygiène publique de gouvernements et en majeure partie aux sections de district.
Le travail de la conservation de la santé infantile se divise en trois branches principales : 1° inspection sanitaire dans toutes les institutions enfantines, dans les écoles, dans les garderies, dans les écoles maternelles, dans les crèches, etc. ; 2° culture physique ; 3° classification des enfants d'après l'état de leur santé et leur répartition parmi les institutions médico-pédagogiques (les écoles forestières et les écoles auxiliaires, les colonies pour les enfants moralement défectueux, etc.).
Afin que toutes les tâches concernant la conservation de la santé des enfants, tâches que se pose la République Soviétiste, soient accomplies d'après un plan défini, on organisa au centre, près de la Section, douze institutions modèles médico-pédagogiques servant à faire connaître en province l'élaboration scientifique et pratique des questions et des mesures sur la conservation de la santé infantile. En octobre 1918, un institut de culture physique avec écoles expérimentales (urbaines et suburbaines) fut ouvert pour les enfants physiquement et moralement bien portants. Cet institut est un laboratoire du travail de l'enfance et d'exercices physiques (sport et gymnastique) et en même temps un instructeur de l'éducation ouvrière socialiste des jeunes générations. Toutes les expériences sur les écoliers sont faites auprès de cet institut où s'élabore pratiquement les processus du travail dans l'école unique du travail de la Russie Soviétiste. Des cours d'instructeurs d'éducation physique y sont aussi donnés.
Les ambulances (des écoles) infantiles sont des organes d'enquêtes sur les enfants ainsi que des organes de traitement. Ces ambulances classent les enfants dont l'état nécessite un traitement ou un allègement du programme d'éducation : a) les enfants malades sont placés dans des hôpitaux et dans des écoles-sanatoriums ; b) les enfants faibles et tuberculeux sont dirigés sur des écoles en plein air (écoles forestières, écoles de steppes) ; c) une autre partie est envoyée dans des écoles auxiliaires et dans des colonies médico-éducatrices. Là où il y a suffisamment d'éléments, les soins dentaires sont donnés dans des ambulances spéciales pour enfants. Dans une ambulance spéciale, les enfants tuberculeux sont examinés par un groupe de médecins (groupe de la lutte contre la tuberculose). Dispensaires : on y étudie la vie de famille de l'enfant prolétarien en même temps qu'on lui donne les soins qu'il nécessite en alimentation (des clubs-réfectoires sont installés à cet effet), en vêtements, en chaussures, en médicaments, huile de foie de morue, etc.
La Section de la Conservation de la santé de l'enfance prend pour principe immuable de son action qu'aucun enfant tombé malade ne doit rester sans recevoir une direction pédagogique dans une institution correspondante médico- pédagogique. Toutes les institutions destinées à la lutte contre la défectuosité physique (surdité, cécité), intellectuelle et morale, sont réunies autour d'un centre général — l'Institut de l'Enfant débile et retardataire. Cet institut possède une section d'observation expérimentale et cinq autres institutions, à savoir : une école auxiliaire pour les légers degrés de défectuosité intellectuelle, une école-hôpital pour les degrés profonds de défectuosité intellectuelle, une école- sanatorium pour les enfants psychiquement malades et les enfants névrosés, une colonie médicale et d'éducation et un institut de sourds-muets. Des médecins et des pédagogues spécialistes enseignent, dans ces institutions, aux futurs pédagogues l'éducation des enfants anormaux.
Pour la première fois dans le monde entier et uniquement dans la Russie Soviétiste, il fut décrété, dès le début de 1918, que les enfants âgés de moins de 18 ans ayant transgressé la loi ne peuvent être reconnus criminels, bien que pouvant être socialement dangereux et même nuisibles à la société. Ces enfants sont les tristes victimes des conditions anormales d'autrefois, de la société bourgeoise et n'ont besoin que d'une rééducation. Les délits de ces délinquants- mineurs ne peuvent être jugés par des juges ordinaires, et ne doivent être soumis — exclusivement — qu'à la Commission pour les délinquants-mineurs avec la participation obligatoire d'un médecin psychiatre et d'un pédagogue, ayant les mêmes droits que les représentants de la justice. De pareilles Commissions avec un personnel d'éducateurs- inspecteurs à domicile sont actuellement créées partout, tant dans les villes de gouvernements que dans les villes de districts. Des points de distribution et d'évacuation sont placés auprès de ces Commissions. Les enfants-délinquants sont, de ces points, rendus à leurs parents ou envoyés dans des colonies médicales et d'éducation. En général, comme toutes les autres institutions médico-pédagogiques, les établissements pour les enfants débiles et retardataires sont ouverts dans les villes de gouvernements et dans les villes de districts.
Actuellement sont ouvertes dans beaucoup de villes de gouvernements : des ambulances infantiles (des écoles), des écoles auxiliaires et des colonies pour les enfants moralement défectueux. Les écoles forestières et les écoles- sanatoriums se rencontrent plus rarement. L'ambulance infantile (des écoles) représente le type de l'institution médico- pédagogique le plus répandu dans les villes de district.
De quelle façon peut-on réaliser la conservation de la santé des enfants dans la période de crise alimentaire que traverse la Russie en ce moment ? La Section de la Conservation de la Santé infantile attachée au Commissariat de l'Hygiène publique porta dès son origine la plus sérieuse attention à la solution de cette question. Au commencement de l'année 1918, le premier convoi des enfants de Petrograd était dirigé, par les soins de cette section sur des colonies. La Section partit de ce principe que dans les conditions urbaines, il fallait avant tout assurer la nourriture de l'enfant, et le placer ensuite dans des conditions hygiéniques. Trois commissariats ont été appelés à collaborer à cette grande tâche par le pouvoir soviétiste, ce sont : le Commissariat de l'Instruction Publique, le Commissariat de l'Approvisionnement et le Commissariat de l'Hygiène publique (organisation des réfectoires diététiques pour les enfants malades et en convalescence après maladies graves). Le Conseil des Commissaires du Peuple institua l'alimentation infantile gratuite par son décret du 17 mai 1919. L'alimentation gratuite des enfants au-dessous de 10 ans est en vigueur dans les deux capitales et dans les rayons industriels des gouvernements non producteurs. Ce décret donna naissance à la répartition socialiste des produits entre les enfants. Mais sans attendre ce décret, la Section de la Conservation de la Santé de l'enfance avait reçu 50 000 000 de roubles en 1919 pour l'alimentation gratuite des enfants.
- Au mois de novembre 1918 la Section obtint à cet effet, le prélèvement d'un impôt spécial.
Si l'on donne un coup d'œil rétrospectif sur ce qui avant la révolution avait été fait en Russie pour la conservation de la santé de l'enfance, on peut dire que tout se résumait à rien ou presque rien. Le budget de l'Etat ne possédait même pas de paragraphe spécial. Après la révolution, le jeune pays socialiste se mit avec énergie à organiser cette action nouvelle. Au cours de deux années, au centre aussi bien qu'en province, on reconnut la nécessité de la conservation la plus minutieuse de la santé des enfants. Ce résultat fut atteint en dépit des conditions difficiles créées par la désorganisation économique. La santé de l'enfance doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes — voilà le principe de la Russie Soviétiste, et il n'est pas moins cher aux ouvriers qu'aux paysans. L'Etat Ouvrier et Paysan porte au plus haut degré la conservation de la santé de l'enfance, se rendant compte parfaitement que les jeunes communistes soit le gage de la future Russie Socialiste — et que seule une génération saine de corps et d'esprit peut préserver les conquêtes de la Grande Révolution Socialiste de Russie et amener le pays à une complète réalisation du régime communiste.
Source : Marxists.org. La conservation de la santé en Russie Soviétiste [11]
[1] Ndlr: Division administrative
[2] Ndlr: Chefs des forces armées de volontaires blancs contre la révolution
Géographique:
- Russie [12]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [13]
Récent et en cours:
- Coronavirus [14]
- COVID-19 [15]
Rubrique:
Pandémie de Covid-19: Barbarie capitaliste généralisée ou Révolution prolétarienne mondiale (Tract international)
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 123.2 Ko |
- 996 lectures
Nous publions, ci-dessous, un “tract numérique” internationale sur la crise sanitaire du Covid-19 sous la forme car, dans les conditions actuelles de confinement, il n’est clairement pas possible de distribuer une version imprimée de ce tract en grand nombre. Nous demandons à tous nos lecteurs d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour diffuser ce texte (réseaux sociaux, forums Internet, etc.) et de nous écrire pour nous informer des réactions, des discussions que cela suscite, et bien sûr pour nous faire part de leur propre opinion sur l’article. Il est plus que jamais nécessaire que tous ceux qui luttent pour la révolution prolétarienne expriment leur solidarité les uns avec les autres et maintiennent leurs liens. Même si nous devons nous isoler physiquement pour le moment, nous pouvons encore nous rassembler politiquement !
Une hécatombe ! Des morts par milliers chaque jour, des hôpitaux à genoux, un “tri” odieux entre les malades jeunes et vieux, des soignants à bout de forces, contaminés et qui parfois succombent. Partout le manque de matériel médical. Des gouvernements qui se livrent une concurrence effroyable au nom de “la guerre contre le virus”, des marchés financiers en perdition, des scènes de rapine surréalistes où les États se volent les uns les autres les cargaisons de masques, des dizaines de millions de travailleurs jetés dans l’enfer du chômage, des tombereaux de mensonges proférés par les États et leurs médias… Voilà l’effrayant spectacle que nous offre le monde d’aujourd’hui ! La pandémie du Covid-19 représente la catastrophe sanitaire mondiale la plus grave depuis la grippe espagnole de 1918-19 alors que, depuis, la science a fait des progrès extraordinaires. Pourquoi une telle catastrophe ? Comment en est-on arrivé là ?
On nous dit que ce virus est différent, qu’il est beaucoup plus contagieux que les autres, que ses effets sont beaucoup plus pernicieux et mortifères. Tout cela est probablement vrai mais n’explique pas l’ampleur de la catastrophe. Le responsable fondamental de ce chaos planétaire, de ces centaines de milliers de morts, c’est le capitalisme lui-même. La production pour le profit et non pour les besoins humains, la recherche permanente de la plus grande rentabilité au prix de l’exploitation féroce de la classe ouvrière, les attaques toujours plus violentes contre les conditions de vie des exploités, la concurrence effrénée entre les entreprises et les États, ce sont toutes ces caractéristiques propres au système capitaliste qui se sont conjuguées pour aboutir au désastre actuel.
L’incurie criminelle du capitalisme
Ceux qui dirigent la société, la classe bourgeoise avec ses États et ses médias, nous disent d’un air consterné que l’épidémie était “imprévisible”. C’est un pur mensonge digne de ceux proférés par les “climato-sceptiques”. Depuis longtemps les scientifiques ont envisagé la menace d’une pandémie comme celle du Covid-19. Mais les gouvernements ont refusé de les écouter. Ils ont même refusé d’écouter un rapport de la CIA de 2009 (“Comment sera le monde de demain”) qui décrit, avec une exactitude sidérante les caractéristiques de la pandémie actuelle. Rien n’a été fait pour anticiper une telle menace. Pourquoi un tel aveuglement de la part des États et de la classe bourgeoise qu’ils servent ? Pour une raison bien simple : il faut que les investissements rapportent du profit, et le plus vite possible. Investir pour l’avenir de l’humanité ne rapporte rien, ne fait pas monter les cours de la Bourse. Il faut aussi que les investissements contribuent à renforcer les positions de chaque bourgeoisie nationale face aux autres sur l’arène impérialiste. Si les sommes démentielles qui sont investies dans la recherche et les dépenses militaires avaient été consacrées à la santé et au bien-être des populations, jamais une telle épidémie n’aurait pu se développer. Mais au lieu de prendre des mesures face à cette catastrophe sanitaire annoncée, les gouvernements n’ont eu de cesse d’attaquer les systèmes de santé, tant au plan de la recherche que des moyens techniques et humains.
Si les gens crèvent et tombent aujourd’hui comme des mouches, au cœur même des pays les plus développés, c’est en premier lieu parce que les gouvernements, partout, ont réduit les budgets destinés à la recherche sur les nouvelles maladies ! Ainsi, en mai 2018, Donald Trump a supprimé une unité spéciale du Conseil de Sécurité Nationale, composée d’éminents experts, chargée de lutter contre les pandémies. Mais l’attitude de Trump n’est qu’une caricature de celle adoptée par tous les dirigeants. Ainsi, les études scientifiques sur les coronavirus ont été partout abandonnées il y a une quinzaine d’années, car le développement du vaccin était jugé… “non rentable” !
De même, il est parfaitement écœurant de voir les dirigeants et les politiciens bourgeois de droite comme de gauche pleurnicher sur l’engorgement des hôpitaux et sur les conditions catastrophiques dans lesquelles sont contraints de travailler les soignants, alors que les États ont mené une politique méthodique de “rentabilisation” du système de soins au cours des cinquante dernières années, particulièrement depuis la grande récession de 2008. Partout, ils ont limité l’accès des populations aux services de santé, diminué le nombre de lits des hôpitaux et accru la charge de travail et l’exploitation du personnel soignant ! Que penser de la pénurie généralisée des masques et autres moyens de protection, de gel désinfectant, de tests de dépistage ? Ces dernières années, la plupart des États ont abandonné la constitution des stocks de ces produits vitaux, pour faire des économies. Ces derniers mois, ils n’ont rien anticipé face à la montée de la propagation du Covid-19 repérée pourtant depuis novembre 2019, certains d’entre eux allant jusqu’à répéter pendant des semaines, afin de cacher leur irresponsabilité criminelle, que les masques étaient inutiles pour les non-soignants.
Et que dire des régions du monde chroniquement démunies comme le continent africain ou l’Amérique latine ? À Kinshasa (RDC), les dix millions d’habitants devront compter sur cinquante respirateurs ! En Afrique centrale, des flyers sont distribués, donnant des consignes sur comment se laver les mains quand la population n’a pas même d’eau à boire ! Partout, monte le même cri de détresse : “On manque de tout face à la pandémie !”.
Le capitalisme, c’est la guerre de tous contre tous
La concurrence féroce que se livre chaque État dans l’arène mondiale rend même impossible un minimum de coopération pour endiguer la pandémie. Lorsqu’elle a démarré, il était plus important aux yeux de la bourgeoisie chinoise de tout faire pour masquer la gravité de la situation, pour protéger son économie et sa réputation, l’État n’ayant pas hésité à persécuter puis laisser mourir le premier médecin qui avait tiré la sonnette d’alarme ! Même le semblant de régulation internationale que s’était donné la bourgeoisie pour gérer la pénurie a totalement volé en éclats, de l’impuissance de l’OMS à imposer des directives jusqu’à l’incapacité de l’Union européenne de mettre en place des mesures concertées. Cette division aggrave considérablement le chaos en engendrant une perte totale de maîtrise sur l’évolution de la pandémie. La dynamique du chacun pour soi et l’exacerbation de la concurrence généralisée sont clairement devenues la caractéristique dominante des réactions de la bourgeoisie.
“La guerre des masques”, comme la nomme les médias, est un exemple édifiant de la concurrence cynique et effrénée à laquelle se livrent tous les États. Aujourd’hui, chaque État s’arrache ce matériel de survie à coup de surenchères et même par le vol pur et simple ! Les États-Unis s’approprient sur les tarmacs chinois, au pied des avions, les cargaisons de masques promises à la France. La France confisque les chargements de masques en provenance de la Suède vers l’Espagne et transitant par ses aéroports. La République tchèque confisque à ses frontières les respirateurs et masques destinés à l’Italie. L’Allemagne fait disparaître incognito les masques à destination du Canada. On peut même voir cette foire d’empoigne entre différentes régions d’un même pays, comme en Allemagne et aux États-Unis. Voilà le vrai visage des “grandes démocraties” : la loi fondamentale du capitalisme, la concurrence, la guerre de tous contre tous, a produit une classe de flibustiers, de voyous de la pire espèce !
Des attaques sans précédent contre les exploités
Pour la bourgeoisie, “ses profits valent plus que nos vies”, comme le criaient les grévistes du secteur automobile en Italie. Partout, dans tous les pays, elle a retardé au maximum la mise en place des mesures de confinement et de protection de la population pour préserver, coûte que coûte, la production nationale. Ce n’est pas la menace d’un amoncellement de morts qui l’a finalement fait décréter le confinement. Les multiples massacres impérialistes depuis plus d’un siècle, au nom de ce même intérêt national, ont définitivement prouvé le mépris de la classe dominante pour la vie des exploités. Non, de nos vies, elle n’en a cure ! Surtout que ce virus a “l’avantage” pour la bourgeoisie, de faucher surtout les personnes âgées et les malades, autant “d’improductifs” à ses yeux ! Laisser le virus se répandre et faire son œuvre “naturelle”, au nom de “l’immunité collective”, était d’ailleurs le choix initial de Boris Johnson et d’autres dirigeants. Ce qui dans chaque pays a fait peser la balance en faveur du confinement généralisé, c’est la crainte d’une désorganisation de l’économie et, dans certains pays, du désordre social, de la montée de la colère face à l’incurie et aux hécatombes. D’ailleurs, bien qu’elles concernent la moitié de l’humanité, les mesures de confinement relèvent bien souvent de la pure mascarade : des millions de personnes sont obligées de s’entasser chaque jour dans des trains, des métros et des bus, dans les ateliers d’usines et les grandes surfaces ! Et déjà, partout, la bourgeoisie cherche à “déconfiner” le plus rapidement possible, alors même que la pandémie frappe le plus durement, en réfléchissant à la façon de provoquer le moins de remous et de contestation possibles, en projetant de remettre au travail les ouvriers, secteur par secteur, entreprise par entreprise.
La bourgeoisie perpétue et prépare de nouvelles attaques, des conditions d’exploitation encore plus forcenées. La pandémie a déjà mis des millions de travailleurs au chômage : dix millions en trois semaines aux États-Unis. Beaucoup d’entre eux, en raison d’emplois irréguliers, précaires ou temporaires, ont été privés de tout type de revenu. D’autres, qui n’ont que de maigres subventions ou aides sociales pour survivre, sont menacés de ne plus pouvoir payer leur loyer et d’être privés d’accès aux soins. Les ravages économiques ont déjà commencé à la faveur de la récession mondiale qui se profile : explosion du prix des denrées alimentaires, licenciements massifs, réductions de salaire, précarisation accrue, etc. Tous les États adoptent des mesures de “flexibilité” d’une violence inouïe, en appelant à l’acceptation de ces sacrifices au nom de “l’unité nationale dans la guerre contre le virus”.
L’intérêt national que la bourgeoisie invoque aujourd’hui n’est pas le nôtre ! C’est cette même défense de l’économie nationale et cette même concurrence généralisée qui lui a servi, par le passé, à mettre en œuvre les coupes budgétaires et les attaques contre les conditions de vie des exploités. Demain, elle nous servira les mêmes mensonges quand, après les ravages économiques causés par la pandémie, elle exigera que les exploités se serrent encore plus la ceinture, acceptent encore plus d’exploitation et de misère !
Cette pandémie est l’expression du caractère décadent du mode de production capitaliste, l’une des nombreuses manifestations du degré de délitement et de déliquescence de la société aujourd’hui, comme la destruction de l’environnement et la pollution de la nature, le dérèglement climatique, la multiplication des foyers de guerres et de massacres impérialistes, l’enfoncement inexorable dans la misère d’une part croissante de l’humanité, l’ampleur prise par les migrations des réfugiés, la montée de l’idéologie populiste et des fanatismes religieux, etc. () C’est un révélateur de l’impasse du capitalisme, un indicateur de la direction vers laquelle ce système et sa perpétuation menacent d’enfoncer et d’entraîner toute l’humanité : dans le chaos, la misère, la barbarie, la destruction et la mort.
Seul le prolétariat peut transformer le monde
Certains gouvernements et médias bourgeois affirment que le monde ne sera plus jamais le même qu’avant cette pandémie, que les leçons du désastre vont être tirées, qu’enfin les États vont s’orienter vers un capitalisme plus humain et mieux géré. Nous avions entendu le même baratin lors de la récession de 2008 : la main sur le cœur, les États et les dirigeants du monde déclaraient la “guerre à la finance”, promettaient que les sacrifices exigés pour sortir de la crise seraient récompensés. Il suffit de regarder l’inégalité croissante dans le monde pour constater que ces promesses de “régénération” du capitalisme n’étaient que de purs mensonges pour nous faire avaler une énième dégradation de nos conditions de vie.
La classe des exploiteurs ne peut pas changer le monde pour faire passer la vie et les besoins sociaux de l’humanité devant les lois impitoyables de son économie : le capitalisme est un système d’exploitation, une minorité dominante tirant ses profits et ses privilèges du travail de la majorité. La clef pour l’avenir, la promesse d’un autre monde, réellement humain, sans nations ni exploitation, réside seulement dans l’unité et la solidarité internationale des ouvriers dans la lutte !
L’élan de solidarité spontanée qu’éprouve aujourd’hui toute notre classe face à la situation intolérable infligée aux travailleurs de la santé, les gouvernements et les politiciens du monde entier le dévoient en faisant campagne pour les applaudissements aux fenêtres et aux balcons. Certes, ces applaudissements réchauffent le cœur de ces travailleurs qui, avec courage et dévouement, dans des conditions de travail dramatiques, soignent les malades et sauvent des vies humaines. Mais la solidarité de notre classe, celle des exploités, ne peut se réduire à une somme d’applaudissements pendant cinq minutes. Elle est, en premier lieu, de dénoncer l’incurie des gouvernements, dans tous les pays, quelle que soit leur couleur politique ! Elle est d’exiger des masques et tous les moyens de protection nécessaires ! Elle est, quand c’est possible, de se mettre en grève en affirmant que tant que les soignants n’auront pas de matériel, tant qu’ils seront ainsi précipités vers la mort à visage découvert, les exploités qui ne sont pas dans les hôpitaux, ne travailleront pas !
Aujourd’hui confinés, nous ne pouvons mener de luttes massives contre ce système assassin. Nous ne pouvons pas nous rassembler, exprimer ensemble notre colère et afficher notre solidarité sur notre terrain de classe, à travers des luttes massives, des grèves, des manifestations, des regroupements. À cause du confinement, mais pas seulement. Aussi parce que notre classe doit se réapproprier une force qu’elle a déjà eue maintes fois dans l’histoire mais qu’elle a pourtant oublié : celle de s’unir dans la lutte, de développer des mouvements massifs face aux ignominies de la bourgeoisie.
Les grèves qui ont éclaté dans le secteur automobile en Italie ou dans la grande-distribution en France, devant les hôpitaux new-yorkais ou ceux du nord de la France, comme l’énorme indignation des travailleurs refusant de servir de “chair à virus”, ne peuvent être aujourd’hui que des réactions dispersées car coupées de la force de toute une classe unie. Elles montrent néanmoins que les prolétaires ne sont pas résignés à accepter comme une fatalité l’irresponsabilité criminelle de ceux qui les exploitent !
C’est cette perspective de combats de classe que nous devons préparer. Parce qu’après le Covid-19, il y aura la crise économique mondiale, le chômage massif, de nouvelles “réformes” qui ne seront que de nouveaux “sacrifices”. Alors dès maintenant, préparons nos luttes futures. Comment ? En discutant, en échangeant, sur les réseaux, les forums, le téléphone, chaque fois que possible. En comprenant que le plus grand fléau n’est pas le Covid-19, mais le capitalisme, que la solution n’est pas de s’unir derrière l’État assassin mais au contraire de se dresser contre lui, que l’espoir ne réside pas dans les promesses de tel ou tel responsable politique mais dans le développement de la solidarité ouvrière dans la lutte, que la seule alternative à la barbarie capitaliste, c’est la révolution mondiale !
L’AVENIR APPARTIENT À LA LUTTE DE CLASSE !
CCI, 10 avril 2020
Evènements historiques:
Récent et en cours:
- Coronavirus [14]
- COVID-19 [15]
Rubrique:
Les États-Unis et le capitalisme mondial engagés sur une voie sans issue
- 158 lectures
L’administration Trump avait déjà provoqué une série de fiascos aussi humiliants que mortifères pour la bourgeoisie américaine (notamment en aggravant d’une manière dramatique la pandémie de Covid en 2020) mais il y avait toujours l’espoir, parmi les fractions les plus éclairées de la classe dirigeante américaine, que le fait d’avoir un narcissique incompétent au pouvoir n’était qu’un cauchemar passager, dont elles se réveilleraient bientôt. Malheureusement, la victoire électorale du Parti démocrate n’a pas entraîné la transition espérée, ni pour la nouvelle administration de Joe Biden ni pour le nouveau Congrès.
Pire encore : sous l’œil des caméras de télévision, une émeute a eu lieu au Capitole, temple sacré de la démocratie américaine, à l’incitation du chef de l’État sortant qui a rejeté les résultats de l’élection présidentielle ! Les hordes trumpistes ont violemment tenté d’empêcher la succession démocrate, encouragée par le président en exercice lui-même, comme dans une “république bananière”, ainsi que l’a reconnu George W. Bush. Il s’agit vraiment d’un moment politiquement significatif dans la décomposition du capitalisme mondial.
L’automutilation populiste du Royaume-Uni avec le Brexit a pu apparaître comme une décision absurde pour les autres pays, parce que la Grande-Bretagne est une puissance de moindre importance que les États-Unis, mais la menace d’instabilité que représente l’insurrection au Capitole, a provoqué une onde de choc et de peur dans toute la bourgeoisie mondiale.
La tentative de destituer Trump, pour la deuxième fois, pourrait bien échouer à nouveau, et, dans tous les cas, elle galvanisera les millions de ses partisans au sein de la population, y compris une part significative du Parti républicain.
L’investiture du nouveau président le 20 janvier, qui est généralement l’occasion d’un spectacle d’unité et de réconciliation nationales, ne le sera pas : Trump n’y assistera pas, contrairement à la coutume, et Washington sera sous haute protection militaire pour empêcher toute nouvelle attaque venant des partisans de Trump. La perspective n’est donc pas le rétablissement en douceur et à long terme de l’ordre et de l’idéologie démocratiques traditionnels par la nouvelle administration Biden, mais une accentuation (d’une nature de plus en plus violente) des divisions entre la démocratie bourgeoise classique et le populisme, ce dernier ne disparaissant pas avec la fin du régime Trump.
Les États-Unis : du statut de superpuissance à celui d’épicentre de la décomposition
Depuis 1945, la démocratie américaine est le fleuron du capitalisme mondial. Ayant joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a largement contribué à transformer l’Europe et le Japon en ruines. Elle a ensuite pu sortir le monde des décombres et le reconstruire à son image pendant la guerre froide. En 1989, avec la défaite et la désintégration du bloc russe rival, les États-Unis semblaient être au sommet de leur domination et de leur prestige mondial. George Bush Senior annonçait l’avènement d’un nouvel ordre mondial. Washington pensait pouvoir maintenir sa suprématie en empêchant toute nouvelle puissance de devenir un concurrent sérieux pour sa domination mondiale. Mais, au lieu de cela, l’affirmation de sa supériorité militaire a accéléré le désordre mondial avec une série de victoires à la Pyrrhus (guerre du Golfe, guerre dans les Balkans dans les années 1990) et de coûteux échecs de politique étrangère en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Les États-Unis ont de plus en plus sapé les alliances sur lesquelles reposait leur ancienne domination mondiale, ce qui a encouragé d’autres puissances à agir pour leur propre compte.
La puissance et la richesse des États-Unis n’ont d’ailleurs pas réussi à atténuer les convulsions croissantes de l’économie mondiale : l’étincelle de la crise de 2008 est venue de Wall Street et a plongé les États-Unis et le monde entier dans la récession la plus grave depuis la réapparition de la crise ouverte en 1967.
Les conséquences sociales et politiques des revers américains, et l’absence d’alternative ont accru les divisions et le désordre dans l’État bourgeois et dans la population en général. Ce qui a conduit à un discrédit croissant des normes politiques établies par le système politique américain.
Les présidences précédentes de Bush et Obama n’ont pas réussi à forger un consensus durable pour l’ordre démocratique traditionnel au sein de la population. La “solution” de Trump n’a pas consisté à résoudre cette désunion mais à l’accentuer davantage par une politique de vandalisme virulente et incohérente qui a encore plus déchiqueté le consensus politique national et a piétiné les accords militaires et économiques avec ses anciens alliés sur la scène mondiale. Tout cela s’est fait sous la bannière de “l’Amérique d’abord”, mais, en réalité, cela accéléré la perte progressive du statut des États-Unis.
En une phrase, la crise politique actuelle de la démocratie américaine, symbolisée par l’attaque du Capitole, s’ajoute aux conséquences chaotiques et autodestructrices de la politique impérialiste américaine, et montre plus clairement que les États-Unis, qui demeurent encore la plus grande puissance mondiale, sont aujourd’hui le principal acteur de la décomposition du capitalisme.
La Chine ne peut pas combler le vide
La Chine, malgré sa puissance économique et militaire croissante, ne sera pas en mesure de combler le vide créé par la perte de leadership américain. D’autant plus que ces derniers sont toujours capables d’empêcher la croissance de l’influence chinoise, avec ou sans Trump. Par exemple, un des plans de l’administration Biden est d’intensifier la politique anti-chinoise avec la formation d’un D10, une alliance des pouvoirs “démocratiques” (le G7 plus la Corée du Sud, l’Inde et l’Australie). Le rôle que cela jouera dans l’aggravation des tensions impérialistes n’a pas besoin d’être démontré.
Mais ces tensions ne peuvent être canalisées vers la formation de nouveaux blocs impérialistes compte tenu de l’aggravation de la décomposition du capitalisme et la dynamique prédominante du chacun pour soi.
Les dangers pour la classe ouvrière
En 1989, nous avions prédit que la nouvelle période de décomposition du capitalisme allait entraîner des difficultés accrues pour le prolétariat. Les événements récents aux États-Unis confirment à nouveau cette prédiction.
Le plus important par rapport à la situation aux États-Unis est le danger que des parties de la classe ouvrière soient mobilisées derrière les luttes de plus en plus violentes des fractions opposées de la bourgeoisie, c’est-à-dire non seulement sur le terrain électoral mais aussi dans la rue. Une partie de la classe ouvrière peut être trompée par un faux choix entre le populisme et la défense de la démocratie, seule alternative offerte par l’exploitation capitaliste.
D’autres couches non exploiteuses risquent d’être progressivement propulsées dans l’action politique sur ce terrain miné par toute une série de facteurs : les effets de la crise économique, l’aggravation de la catastrophe écologique, le renforcement de la répression étatique et de son caractère raciste, qui les conduit à servir de relais aux campagnes bourgeoises comme le mouvement “Black Lives Matter” ou de support aux luttes interclassistes.
Néanmoins, la classe ouvrière internationale, dans la période de décomposition, n’a pas été vaincue comme dans les années 1930 ; ses réserves de combativité restent intactes et les nouvelles attaques économiques qui s’annoncent contre son niveau de vie (dont la facture des dommages économiques causés par la pandémie de Covid) obligeront le prolétariat à réagir sur son terrain de classe.
Un défi pour les organisations révolutionnaires
L’organisation révolutionnaire a un rôle limité mais très important à jouer dans la situation actuelle car, bien qu’elle ait encore peu d’influence, et même pour une longue période à venir, la situation de la classe ouvrière dans son ensemble amène néanmoins une petite minorité à adopter des positions de classe révolutionnaires, notamment aux États-Unis mêmes.
Le succès du travail de transmission à cette minorité repose sur un certain nombre de besoins ; dans le contexte actuel, il est important de combiner, d’une part, une rigueur et une clarté programmatiques à long terme, liées, d’autre part, à la capacité de l’organisation à avoir une analyse cohérente et évolutive de l’ensemble de la situation mondiale : son cadre historique et ses perspectives.
Au cours de l’année écoulée, la situation mondiale a battu de nouveaux records dans la putréfaction du capitalisme mondial : la pandémie de Covid, la crise économique, la crise politique aux États-Unis, la catastrophe environnementale, le sort des réfugiés, la misère de parties de plus en plus importantes de la population mondiale. La dynamique du chaos s’accélère et devient de plus en plus imprévisible, mettant à l’épreuve nos analyses et exigeant une capacité à les modifier et à les adapter, si nécessaire, en fonction de cette accélération.
CCI, 16 janvier 2021
Géographique:
- Etats-Unis [17]
Personnages:
- Joe Biden [18]
Evènements historiques:
Rubrique:
100 ans après la fondation de l’Internationale Communiste, quelles leçons pour les combats du futur ? (3e partie)
- 224 lectures
Dans les précédentes parties de cette étude, nous avons commencé à identifier les conditions dans lesquelles s’était formée la IIIe Internationale ou Internationale Communiste (IC) au mois de mars 1919. Dans un contexte très compliqué, les révolutionnaires de l’époque n’étaient pas parvenus à clarifier en amont toutes les nouvelles questions et les nouveaux défis qui s’imposaient au prolétariat.
Par ailleurs, le processus de regroupement des forces révolutionnaires s’était caractérisé par un manque de fermeté à l’égard des principes révolutionnaires lors de sa formation. C’est une des leçons que la fraction de la Gauche italienne groupée autour de la revue Bilan puis surtout de la Gauche Communiste de France (Internationalisme) tirèrent de l’expérience de l’IC : "la méthode "large", soucieuse avant tout de rassembler immédiatement le plus grand nombre au dépens de la précision programmatique et principielle, devait conduire à la constitution de partis de masses, véritables colosses aux pieds d’argile qui devaient retomber à la première défaite sous la domination de l’opportunisme"[1]
Alors que le Congrès de fondation avait été un véritable pas en avant pour l’unité du prolétariat mondial, l’évolution de l’IC dans les années suivantes fut essentiellement marquée par des reculs qui désarmèrent la révolution face à des forces contre-révolutionnaires qui ne cessaient pas de gagner du terrain. L’opportunisme rampant dans les rangs du parti, n’a pas été éliminé comme le prévoyaient Lénine et les bolcheviks. Au contraire, avec la dégénérescence de la révolution, il a fini par prendre une place prépondérante et a précipité la fin de l’IC en tant que parti de classe. Cette dynamique opportuniste déjà visible lors du IIe Congrès ne fit que s’approfondir par la suite, aussi bien sur le plan programmatique qu’organisationnel, comme nous essaierons de le démontrer dans cet article.
1920-21 : Le recul de la vague révolutionnaire
Au lendemain du IIIe Congrès de l’IC[2], les révolutionnaires comprennent que la victoire de la révolution sera plus difficile que prévu. Quelques jours après la fin du congrès, Trotsky analysait la situation ainsi : "Le troisième Congrès constate la ruine des fondements économiques de la domination bourgeoise. En même temps, il met énergiquement les ouvriers conscients en garde contre la croyance naïve qu’il en résulte automatiquement la chute de la bourgeoisie, provoquée par les offensives incessantes du prolétariat. Jamais l’instinct de conservation de la classe bourgeoise n’avait créé des méthodes de défense et d’attaques aussi variées qu’à présent. Les conditions économiques de la victoire de la classe ouvrière sont visibles. Sans cette victoire, c’est la ruine, la perte de toute civilisation qui nous menace dans un avenir plus ou moins proche. Mais cette victoire peut seulement être conquise par une direction raisonnable des combats et en première ligne, par la conquête de la majorité de la classe ouvrière. C’est l’enseignement principal du troisième Congrès."[3]
Nous sommes loin ici de l’enthousiasme débordant du congrès de fondation où, lors du discours de clôture, Lénine affirmait que "la victoire de la révolution prolétarienne est assurée dans le monde entier. La fondation de la république internationale des Conseils est en marche." Entre-temps, les assauts du prolétariat lancés dans plusieurs pays se confrontèrent à la riposte de la bourgeoisie. Et tout particulièrement l’échec de la prise du pouvoir en Allemagne en 1919 dont l’importance fut sous-estimée par les révolutionnaires.
Comme l’affirmait une grande majorité dans les rangs de l’IC, la crise du capitalisme et sa chute dans la décadence ne pouvaient que précipiter les masses sur la voie de la révolution. Cependant, la conscience de l’ampleur du but à atteindre et des moyens avec lesquels y parvenir étaient loin d’être à un niveau suffisant. Cette situation fut particulièrement visible à la suite du deuxième Congrès, une période marquée par une série de difficultés qui isolèrent davantage le prolétariat en Russie :
- En Europe de l’Ouest, les luttes ouvrières n’eurent guère la réussite escomptée. En Italie, la bourgeoisie parvint à canaliser et à stériliser le mouvement. En Allemagne, l’action aventuriste de mars 1921[4], pilotée par le KPD avec l’appui de l’IC, se termina par un échec cuisant et démoralisateur.
- Sur le plan militaire, l’offensive de l’Armée Rouge contre la Pologne prit fin avec la défaite et la retraite devant Varsovie, empêchant ainsi d’établir le pont entre la classe ouvrière en Russie et celle d’Europe occidentale.
- En Russie même, la guerre civile engendra d’importantes pénuries alimentaires et une situation économique et sociale dramatique qui nécessitèrent de mettre fin à l’économie de guerre et ses nationalisations pour réinstaurer un certain niveau d’échanges marchands. À cette fin, la Nouvelle politique économique (NEP) fut mise en place à partir de mars 1921.
- Au même moment, eut lieu la répression de l’insurrection des marins de Kronstadt. Une erreur qui eut des conséquences désastreuses dans les relations entre les masses et le Parti communiste de Russie.
Si la bourgeoisie internationale, à ce moment-là, n’était pas parvenue à annihiler totalement la révolution prolétarienne, il n’en demeure pas moins que le cœur de celle-ci, la Russie des Soviets, était particulièrement isolé. Si Lénine avait caractérisé la situation par "un certain équilibre qui, pour extrêmement instable qu’il soit, n’en a pas moins créé une conjoncture originale dans la situation mondiale"[5], avec le recul, nous pouvons aujourd’hui affirmer que les multiples échecs et les difficultés qui se firent jour entre 1920 et 1921, étaient déjà les prodromes de l’échec de la vague révolutionnaire. C’est dans ce contexte particulièrement difficile que nous proposons d’analyser la politique de l’IC. Une politique qui, sur de nombreux points, poursuivra son recul opportuniste de plus en plus marqué.
I- Les conséquences désastreuses du soutien "aux mouvements de libération nationale"
A- Une question non tranchée dans le mouvement révolutionnaire
La question nationale figurait parmi les questions non tranchées dans le mouvement révolutionnaire au moment où fut constituée l’IC. S’il est vrai que, durant la période d’ascendance du capitalisme, les révolutionnaires ont parfois soutenu des luttes nationales, il ne s’agissait pas d’un principe. Le débat avait rejailli dans les années précédant la Première Guerre mondiale. Rosa Luxemburg fut l’une des premières à comprendre que l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence signifiait également que chaque État-nation possédait une nature impérialiste. Par conséquent, la lutte de libération d’une nation sur une autre ne visait qu’à défendre les intérêts d’une bourgeoisie nationale sur une autre et en aucun cas la cause de la classe ouvrière.
Les bolcheviks adoptèrent une position qui se situait plutôt au centre de la social-démocratie puisque le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes figurait dans le programme de 1903 : ils conservaient "leur position avec un acharnement qui ne s’expliquait que par le fait que la Russie tsariste restait le représentant par excellence de l’oppression nationale (la "prison des peuples") ; et en tant que parti principalement "grand russe" (géographiquement parlant), ils pensaient que soutenir les peuples opprimés par la Russie à faire sécession était la meilleure politique pour gagner leur confiance. Bien que cette position fut erronée (l’histoire nous l’a prouvé), elle restait basée sur une perspective de classe. Dans cette période où les "sociaux-impérialistes" allemands, russes et autres plaidaient contre la lutte de libération nationale des peuples opprimés par les impérialismes allemand et russe, les bolcheviks mettaient en avant le slogan "d’autodétermination nationale" comme moyen de miner ces impérialismes et créer les conditions de l’unification de tous les ouvriers."[6] Si Lénine considérait que "le droit des nations à l’autodétermination" était une revendication caduque pour les pays occidentaux, la situation était différente dans les colonies où la floraison des mouvements de libération nationale participait à la formation d’un capitalisme indépendant et par conséquent contribuait à l’apparition d’un prolétariat. Dans ces conditions, l’autodétermination nationale demeurait une revendication progressiste aux yeux de Lénine et de la majorité du parti bolchevik.
En comprenant que l’impérialisme n’était pas simplement une forme de pillage perpétré par les pays développés aux dépens des nations arriérées mais bien l’expression de l’ensemble des rapports capitalistes mondiaux, Rosa Luxemburg fut en mesure de développer la critique la plus clairvoyante à l’égard des luttes de libération nationale en général et de la position des bolcheviks en particulier. À rebours de la vision fragmentée des bolcheviks qui considéraient que le prolétariat n’avait pas nécessairement les mêmes tâches en fonction de la zone géographique concernée, Rosa Luxemburg adopta une démarche qui consistait à décrire un processus global, celui du marché dont l’expansion n’était désormais plus possible : "dans ce contexte, il était impossible à tout nouvel État d’apparaître sur le marché mondial de façon indépendante où de mener à bien le processus d’accumulation primitive en dehors de cette barbarie généralisée" [7]
Ce faisant, "dans le monde capitaliste contemporain, il ne peut y avoir de guerre de défense nationale".[8] Cette capacité à saisir que toute bourgeoisie nationale ne pouvait agir qu’au sein du système impérialiste, l’amena à critiquer la politique nationale menée par les bolcheviks après 1917 quand les Soviets octroyèrent l’indépendance à l’Ukraine, la Finlande, la Lituanie, etc., afin de "gagner les masses". Les lignes qui suivent prophétisent admirablement les conséquences de la politique nationale de l’IC dans les années 20 : "L’une après l’autre, ces nations ont utilisé la liberté qu’on venait de leur offrir pour s’allier en ennemies mortelles de la Révolution russe à l’impérialisme allemand et pour transporter sous sa protection en Russie même le drapeau de la contre-révolution"[9]
B- Le congrès de Bakou
La question nationale fut abordée pour la première fois dans les rangs de l’IC lors du deuxième Congrès mondial. Partant de la conception erronée de l’impérialisme défendue par les bolcheviks notamment, le Congrès considérait comme "nécessaire de poursuivre la réalisation de l’union la plus étroite de tous les mouvements émancipateurs nationaux et coloniaux avec la Russie des Soviets, en donnant à cette union des formes correspondantes au degré d’évolution du mouvement prolétarien parmi le prolétariat de chaque pays, ou du mouvement émancipateur démocrate bourgeois parmi les ouvriers et les paysans des pays arriérés ou de nationalités arriérées."[10]
Le congrès des peuples de l’Orient tenu à Bakou du 1er au 8 septembre 1920 avait pour tâche de mettre en pratique les orientations du deuxième Congrès mondial qui s’était terminé quelques semaines plus tôt. Près de 1900 délégués, provenant essentiellement du Proche-Orient et d’Asie centrale se réunirent. Si près des 2/3 des organisations représentées se réclamait du communisme, leur adhésion s’avérait extrêmement superficielle. Et pour cause, "les élites nationales orientales étaient davantage attirées par l’organisation et l’efficacité des modes d’action proposées par les bolcheviks que par l’idéologie communiste."[11] C’est pourquoi ce rassemblement était en réalité un grand souk politique composé de multiples classes et couches sociales venues toutes pour des raisons différentes mais bien peu avec la ferme intention d’œuvrer consciemment au développement de la révolution prolétarienne dans le monde. La description de la composition du congrès dressée par Zinoviev devant le Comité exécutif de l’IC après son retour de Bakou se passe de commentaire : "Le congrès de Bakou se composait d’une fraction communiste et d’une fraction beaucoup plus nombreuse de sans-parti. Cette dernière se divisait à son tour en deux groupes : l’un effectivement constitué d’éléments sans-parti, auquel il faut rattacher les représentants de la paysannerie et de la population semi-prolétaire des villes, l’autre formé des gens qui se désignent comme sans-parti mais appartiennent en fait à des partis bourgeois."[12]
Pour de nombreuses délégations, la structuration d’un mouvement révolutionnaire communiste en Orient demeurait secondaire, voire sans intérêt. Pour beaucoup d’entre elles, il s’agissait de s’assurer l’aide de la Russie des Soviets pour repousser le colonisateur britannique afin de pouvoir assouvir leur rêve de souveraineté nationale.
Quelle fut l’attitude des représentants de l’IC devant ces revendications ostensiblement bourgeoises ? Au lieu de défendre l’internationalisme prolétarien avec la plus grande fermeté, la délégation de l’IC affirma son soutien aux mouvements bourgeois nationalistes, et appela les peuples de l’Est à joindre "la première réelle guerre sainte, sous la bannière rouge de l'Internationale Communiste" afin de partir en croisade contre "l'ennemi commun, l'impérialisme britannique."
Les concessions importantes accordées aux partis nationalistes et toute la politique menée à Bakou étaient déjà dictées par les besoins de la défense de la République soviétique plutôt que par les intérêts de la révolution mondiale. Cet axe central de l’IC établi lors du second Congrès montre à quel point la tendance opportuniste gagnait du terrain. Il y eut bien sûr des critiques à ces tentatives de réconcilier nationalisme et internationalisme prolétarien : Lénine mit en garde contre le fait de "peindre le nationalisme en rouge" ; John Reed, présent à Bakou, fit également des objections à "cette démagogie et à cette parade". Cependant, "de telles réponses ne s'adressaient pas aux racines du cours opportuniste qui était suivi, mais restaient au contraire sur un terrain centriste de conciliation avec des expressions plus ouvertes d'opportunisme, se cachant derrière les thèses du second Congrès ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a couvert une multitude de manquements dans le mouvement révolutionnaire."[13]
C- L’IC devient peu à peu un instrument de l’impérialisme russe
Le recul de la révolution en Europe de l’Ouest et l’isolement du prolétariat en Russie dans des conditions dramatiques amenèrent l’IC à devenir progressivement l’instrument de la politique extérieure des bolcheviks, eux-mêmes devenant, au fil des années, l’administrateur du capital russe.[14] Si cette évolution fatale pour la révolution est en partie liée à des conceptions erronées des bolcheviks au sujet des relations entre la classe, le parti et l’Etat dans la période de transition, la raison principale réside dans la dégénérescence irréversible de la Révolution à partir des années 1920.[15]
C’est d’abord et surtout au nom de la défense de l’Etat soviétique que les bolcheviks et l’IC vont nouer des alliances ou soutenir directement des mouvements de libération nationale. Dès 1920, le parti mondial apporta son soutien au mouvement de Kemal Atatürk dont les intérêts étaient très éloignés de la politique de l’Internationale, comme le concédait Zinoviev. Mais cette alliance était un moyen de repousser les Britanniques dans la région. Bien qu’il fit exécuter les "chefs" du Parti communiste de Turquie quelques temps plus tard, l’IC continua à croire aux "potentialités" de ce mouvement nationaliste et maintint son alliance à ce pays stratégique pour l’intégrité de l’Etat russe. Cela n’empêcha pas Kemal de se retourner contre son allié en faisant alliance avec l’Entente dès 1923.
Si la politique de soutien aux luttes de libération nationale fut, pendant tout un temps, une position erronée au sein du mouvement ouvrier, elle s’est transformée à la fin des années 1920 en stratégie impérialiste d’une puissance capitaliste comme une autre. Le soutien apporté par l’IC aux nationalistes du Kuomingtang en Chine qui mena aux massacres des ouvriers de Shanghai en 1927 est un épisode décisif de cette involution. Auparavant, l’IC avait apporté son soutien au mouvement nationaliste dirigé par Abd El-Krim lors de la Guerre du Rif (1921-1926) ou encore aux Druzes et aux Syriens en 1926.
Par conséquent, "de tels actes de trahison ouverte démontrèrent que la fraction stalinienne qui avait entretemps acquis une domination presque complète de l'I.C. et de ses partis, n'était plus un courant opportuniste dans le mouvement ouvrier mais une expression directe de la contre-révolution capitaliste."[16]
II- Gagner les masses au détriment des principes
A- la formation de partis communistes "de masse" en Occident.
Comme nous l’avions indiqué dans la première partie de cette étude[17], il n'existait qu’une poignée de partis communistes véritablement constitués lors du congrès de fondation en mars 1919. Dans les semaines qui suivirent, l’Internationale engagea tout un travail visant à former des partis communistes : "Dès le premier jour de sa fondation, l’Internationale Communiste s’est donnée pour but, clairement et sans équivoque, non pas de former de petites sectes communistes cherchant à exercer leur influence sur les masses ouvrières uniquement par l’agitation et la propagande, mais de prendre part à la lutte des masses ouvrières, de guider cette lutte dans le sens communiste et de constituer dans le processus du combat de grands partis communistes révolutionnaires."[18] Cette orientation reposait sur la conviction d’une extension rapide de la Révolution en Europe occidentale et par conséquent sur un besoin pressant de munir la classe ouvrière des différents pays de partis permettant d’orienter l’action révolutionnaire des masses.
Par conséquent, les bolcheviks poussèrent non seulement à former des partis communistes de masses le plus vite possible mais aussi sur la base d’un compromis entre l’aile gauche du mouvement ouvrier, et l’aile centriste qui n’avait pas rompu avec les visions et les faiblesses de la Seconde Internationale. Dans la plupart des cas, ces partis ne pouvaient être engendrés ex nihilo mais devaient découler d’une décantation à l’intérieur des partis socialistes de la IIe Internationale. Ce fut notamment le cas du Parti communiste d’Italie formé lors du congrès de Livourne en janvier 1921 ou encore du Parti communiste français qui vit le jour lors du congrès de Tours en décembre 1920. Ainsi, dès leur naissance, ces partis comportaient en leur sein toute une série de scories et de faiblesses organisationnelles qui ne pouvaient que compliquer davantage la capacité de ces organisations à orienter les masses sur la voie la plus claire. Si Lénine et les principaux animateurs de l’Internationale avaient pleinement conscience des concessions accordées et du danger que cela pouvait représenter, ils misaient sur la capacité du parti à les combattre en son sein. En réalité, Lénine le premier sous-estimait grandement le danger. L’adoption des 21 conditions pour l’adhésion à l’IC lors du IIe Congrès mondial, considérée à juste titre comme un pas en avant dans la lutte contre le réformisme, resta par la suite dans les tiroirs. Toute la démarche de Lénine reposait sur l’idée que la marche vers la révolution ne pouvait être rompue, que le développement de l’IC au détriment de la IIe Internationale et l’Internationale "deux et demie" était un fait quasiment acquis.[19]
Dans une situation où les masses n’étaient pas encore capables de prendre le pouvoir, la tâche des partis communistes consistait donc à "hâter la révolution, sans toutefois la provoquer artificiellement avant une préparation suffisante".[20] Pour ces raisons, l’une des orientations du deuxième Congrès résidait dans le "groupement de toutes les forces communistes éparses, la formation dans chaque pays d’un Parti Communiste unique (ou le renforcement des partis déjà existants) afin de décupler le travail de préparation du prolétariat à la conquête du pouvoir sous forme de dictature du prolétariat."[21] Orientation tout à fait juste mais qui reposait sur une pratique erronée.
Ainsi, s’explique la fusion aberrante entre l’USPD[22] et le KPD lors du congrès de Halle le 12 octobre 1920. L’exemple le plus significatif demeure très probablement celui de la création du Parti communiste français (PCF). Ce dernier s’est constitué en décembre 1920 au congrès de Tours à travers une scission d’avec la SFIO dont les principaux dirigeants s’étaient ralliés à "l’Union sacrée" et à la Première Guerre mondiale. Sa naissance est le fruit d’un compromis, encouragé par l’IC, entre la gauche (minoritaire et faible) et un fort courant majoritaire centriste. Comme nous l’avons mis en évidence dans notre brochure sur l’histoire du PCF[23] : "Cette tactique est désastreuse parce que l’adhésion ne se fait pas, fait unique dans l’histoire des PC européens, sur les "21 conditions d’admission à l’IC" qui exigeaient en particulier une rupture complète et définitive avec la politique opportuniste du centrisme envers le réformisme, le social-patriotisme, le pacifisme, mais sur des critères nettement moins sélectifs. L’objectif de cette tactique de l’IC était d’entraîner la majorité à se séparer de la droite de la social-démocratie, parti de gouvernement bourgeois et ouvertement patriotard. [...] Le centre largement majoritaire au sein du nouveau parti est infesté d’opportunistes, peu ou prou "repentis" d’avoir trempé dans l’Union sacrée. [...] En même temps, vient s’agréger au parti une autre composante importante, imbibée de fédéralisme anarchisant (surtout représenté au sein de la Fédération de la Seine), qui se retrouvera en chaque occasion, sur le plan organisationnel, aux côtés du centre contre la gauche pour s’opposer à la centralisation internationale et surtout aux orientations de l’IC sur le jeune Parti communiste français." Gangréné par l’opportunisme, le PCF allait subir de plein fouet la dégénérescence de l’IC qui commençait à poindre lors du IIIe Congrès. Il deviendra par la suite un des principaux agents du stalinisme.[24] Il en fut de même en Italie puisque à la suite de la scission d’avec le Parti Socialiste d’Italie lors du congrès de Livourne, le PC d’Italie se composait d’une gauche marxiste et communiste résolument engagée dans la lutte contre l’opportuniste au sein de l’IC et d’un centre amené par Gramsci et Togliatti, incapable de comprendre la fonction politique des Soviets (organes du pouvoir centralisé) et sous-estimant le rôle politique du parti. Par la suite, le centre du parti servira de point d’appui à l’IC pour exclure la gauche durant la période de "bolchevisation".
Enfin, l’exemple le plus caricatural reste peut-être celui du PC de Tchécoslovaquie formé autour de la tendance de Sméral qui soutint la monarchie des Habsbourg durant toute la guerre impérialiste de 1914-1918.
Comment expliquer de telles compromissions ? Comment expliquer que les bolcheviks, ayant mené un si dur combat en leur sein durant des années pour la préservation et l’intransigeance des principes, en venaient à accepter de telles concessions ? La Gauche communiste d’Italie se pencha avec attention sur cet épisode et apporta une première réponse : "Il est évident qu’il ne s’agit pas là d’une soudaine conversion des bolcheviks à un autre procédé de formation des Partis Communistes, mais essentiellement d’une perspective historique qui prévoyait la possibilité d’éluder le chemin difficile parcouru pour la fondation du Parti bolchevik. Lénine et les bolcheviks escomptaient, en 1918-1920, le déclenchement immédiat de la révolution mondiale et, de ce fait, concevaient la fondation des Partis Communistes dans les différents pays comme autant d’appoints à l’œuvre révolutionnaire de l’État russe qui leur apparaissait l’élément essentiel du bouleversement du monde capitaliste."[25]
Indéniablement, le coup d’arrêt porté à la révolution au cours de cette période et les efforts désespérés pour faire face à cela amena Lénine et les bolcheviks à baisser la garde sur la défense des principes et ainsi se faire happer par l’opportunisme. Mais ce sont également les erreurs persistantes sur les tâches du parti et les relations de celui-ci avec la classe qui contribuèrent à forcer la formation des PC dans la confusion la plus totale au cours d’une période marquée par les premiers reculs du prolétariat.
B- La création de partis communistes "fantômes" en Orient
La méthode opportuniste à travers laquelle l’IC laissa se former des partis membres trouva son ultime expression dans l’éclosion des PC dans le monde colonial.
Après le congrès de Bakou, l’Exécutif de l’IC avait mis sur pieds un bureau central d’Asie, en charge du travail en direction des pays du Moyen-Orient jusqu’en Inde. Cet organe composé de Sokolnikov, Grefori Safarov et MN Roy s’installa à Tachkent en Ouzbékistan. Puis en janvier 1921, un secrétariat de l’IC pour l’Extrême-Orient vit le jour et s’installa à Irkoutsk. Ainsi, face aux reculs de la révolution en Europe occidentale, l’IC voulait se donner les moyens de "hâter" cette fois-ci la révolution en Orient. C’est dans cet objectif, qu’entre 1919 et 1923, l’Orient et l’Extrême-Orient virent fleurir des partis communistes sur des bases théoriques et politiques pour le moins extrêmement fragiles.
Avant cette période, des PC avaient vu le jour en Turquie, en Iran, en Palestine, en Egypte mais comme le fait remarquer l’historien trotskiste Pierre Broué : "Les problèmes n’ont pas manqué entre l’Internationale et ces partis communistes qui ne savaient rien du communisme et représentaient des pays où les couches proprement prolétariennes étaient insignifiantes, ce qui n’empêchait pas leurs dirigeants de se réclamer d’une pureté doctrinale et d’un schéma ouvriériste rigoureux dans la révolution qu’ils croyaient proche."[26]
En Inde, les éléments qui s’étaient rapprochés de l’Internationale avaient tous un passé nationaliste, le plus connu étant MN Roy[27]. L’IC donna l’ordre au groupe formé autour de ce dernier d’entrer dans le Parti du Congrès nationaliste, dirigé par Gandhi, en s’alliant d’abord "l’aile gauche" dite "révolutionnaire" et "communiste" puis toutes les fractions opposantes à Gandhi après les débordements du 4 février 1922 lors d’une campagne de désobéissance civile lancée par Gandhi lui-même[28]. Roy fut amené à défendre un programme ouvertement opportuniste au sein du Parti du Congrès : indépendance nationale, suffrage universel, abolition de la grande propriété, nationalisation des services publics... De plus, le but n’était pas de faire adopter son programme mais provoquer son rejet de la part de la direction du parti qui ainsi se "démasquerait". L’entreprise connut un échec cinglant. Le programme de Roy ne trouva aucun écho favorable et la vie du groupe "communiste" dégénéra très vite dans des querelles internes. Les communistes furent par la suite sévèrement réprimés. Ils furent arrêtés puis jugés pour conspiration, ce qui mit un terme à la politique de l’IC en Inde.[29]
En Asie de l’Est, l’IC adopta peu ou prou la même démarche irresponsable. La structuration d’un mouvement communiste en Chine fut menée par le bureau d’Extrême-Orient par des prises de contacts avec des intellectuels et étudiants gagnés au "bolchévisme". Le PC de Chine (PCC) fut constitué lors d’une conférence se déroulant à Shanghai en juillet 1921. Constitué à ses débuts de quelques dizaines de militants, il connut un accroissement numérique significatif par la suite, atteignant près de 60 000 membres en 1927. Si ce renforcement numérique exprimait la volonté révolutionnaire qui animait la classe ouvrière chinoise dans un contexte d’intenses luttes sociales, il n’en demeure pas moins que les adhésions s’effectuèrent sur des bases politiques et théoriques très superficielles. Toujours la même méthode irresponsable qui, là encore, ouvrait la porte au désarmement du parti face à la politique opportuniste qu’allait mener l’IC à l’égard du Kuomindang. En janvier 1922, la Conférence des peuples d’Orient réunie à Moscou posait les bases de la collaboration de classe afin de former "le bloc anti-impérialiste". Dans la foulée, à la demande de l’Exécutif de l’IC, le PCC lançait le mot d’ordre de "Front unique anti-impérialiste avec le Kuomindang" et l’adhésion individuelle des communistes à ce dernier. Cette politique de collaboration de classe était le résultat des négociations engagées en secret entre l’URSS et le Kuomindang. Dès juin 1923, le IIIe congrès du PCC votait l’adhésion des membres du parti au Kuomindang. Si dans un premier temps, cette politique de subordination à un parti bourgeois trouva des oppositions au sein du jeune parti, y compris de la part de sa direction[30]. Sa fragilité politique et sa faible expérience le rendait incapable de combattre efficacement les directives erronées et suicidaires de l’Exécutif de l’Internationale. Quoi qu’il en soit, "cette politique eut les plus funestes conséquences sur le mouvement de la classe ouvrière en Chine. Tandis que le mouvement de grèves et les manifestations se développaient spontanément et impétueusement, le parti communiste, noyé au sein du Kuomintang, s'avérait incapable d'orienter la classe ouvrière, de faire preuve d'une politique de classe indépendante. La classe ouvrière, dépourvue également d'organisations unitaires comme les conseils ouvriers pour sa lutte politique, s'en remit, à la demande du PCC lui-même, au Kuomintang, c'est-à-dire accorda sa confiance à la bourgeoisie."[31]
Nous pourrions donner encore de nombreux exemples de partis communistes formés dans des pays arriérés avec une classe ouvrière très faible qui, dans le tourbillon de la défaite, deviendront très vite des organisations bourgeoises. Retenons que la constitution de "partis de masses", en Occident comme en Orient, fut un facteur qui aggrava la difficulté du prolétariat à faire face au reflux de la vague révolutionnaire en le rendant incapable de se replier en bon ordre.
C- La politique de front unique
Lors du IIIe Congrès, l’IC adopta la position du "Front unique ouvrier"[32]. Il s’agissait de nouer des alliances avec les organisations de la social-démocratie, mener des actions communes avec des revendications similaires et ainsi pouvoir démasquer le rôle contre-révolutionnaire de ces organisations auprès des masses.
Cette orientation qui trouva sa pleine concrétisation lors du IVe Congrès était une volteface totale avec le Congrès de fondation au cours duquel la nouvelle internationale affirmait sa claire détermination à combattre de toutes ses forces le courant social-démocrate en invitant "les ouvriers de tous les pays à entamer la lutte énergique contre l’Internationale jaune et à préserver les masses les plus larges du prolétariat de cette Internationale de mensonge et de trahison".[33] Qu’est-ce qui pouvait pousser, deux ans plus tard, l’IC à adopter une politique d’alliance à l’égard des partis qui s’étaient transformées en agents les plus efficaces de la contre-révolution ?
Avaient-ils fait "amende honorable" en se plaçant sur la voie du repentir ? Bien évidemment non, là encore il s’agissait de "ne pas se couper des masses" : "L’argumentation de l’I.C. pour justifier la nécessité de front unique se basait principalement sur le fait que le reflux avait renforcé le poids de la social-démocratie, et que, pour lutter contre elle, il ne fallait pas se couper des travailleurs prisonniers de cette mystification. Pour cela, il fallait travailler à sa dénonciation par des moyens qui allaient de l’alliance pour les partis les plus forts (en Allemagne, le PC s’est prononcé pour l’unité du front prolétarien et a reconnu possible d’appuyer un gouvernement ouvrier unitaire), à l’entrisme pour les partis les plus faibles ("il est maintenant du devoir des communistes d’exiger, par une campagne énergique, leur admission dans le Labour Party", citations des thèses sur l’unité du front prolétarien du 4ème Congrès, 1922)"[34]
Cette ligne opportuniste fut combattue et dénoncée âprement par les groupes composant la gauche de l’IC. Le KAPD mena le combat dès le IIIe congrès avant d’être exclu de l’IC tout de suite après. La gauche du PC d’Italie lui succéda notamment lors du IVe Congrès en déclarant que le parti n’accepterait "pas de faire partie d’organismes communs à différentes organisations politiques... (il) évitera aussi de participer à des déclarations communes avec des partis politiques, lorsque ces déclarations contredisent son programme et sont présentées au prolétariat comme le résultat de négociations visant à trouver une ligne d’action commune."[35] Le rejet du Front unique était également assumé par le Groupe ouvrier de Miasnikov qui indiquait dans son Manifeste la position la plus conforme aux intérêts de la révolution envers les partis de la IIe Internationale : "Ce ne sera pas le front uni avec la Deuxième Internationale et de l’Internationale Deux et demi qui lui apportera la victoire, mais la guerre contre elles. Voilà le mot d’ordre de la révolution sociale mondiale future." L’histoire devait donner raison à la clairvoyance et à l’intransigeance des groupes de gauche. Dans ces circonstances, le rôle du parti n'était pas de suivre la direction de la classe mais de défendre le programme et les principes révolutionnaires en son sein. Dans la période de la décadence du capitalisme, le retour à un "programme minimum", même sur une base temporaire, était devenu impossible. Avec l’inversion du rapport de force, l’idéologie dominante regagnait de l'influence parmi les masses. Dans ces circonstances, le rôle du parti n’était pas d’épouser la trajectoire de la classe mais de défendre au sein de cette dernière les principes et le programme révolutionnaire. Dans la période de décadence du capitalisme, le retour à un "programme minimum", même de manière temporaire, était désormais impossible. C’est une autre leçon que tira la Gauche communiste d’Italie par la suite : "en 1921, la modification de la situation ne changeait pas les caractères fondamentaux de l’époque comme les tourmentes révolutionnaires de 1923, de 1925, 1927 et 1934 (pour ne nommer que les plus importantes) devaient pleinement le confirmer. [...]
Une telle modification de la situation devait évidemment avoir des conséquences sur les partis communistes. Mais le problème était le suivant : devait-on modifier la substance de la politique des partis communistes ou devait-on déduire de la contingence défavorable la nécessité d’appeler les masses à se concentrer autour des luttes partielles, restant orientées vers une issue révolutionnaire[36], dès que l’appel direct à l’insurrection n’était plus possible immédiatement avec les défaites encourues ? Le 3ème Congrès, l’Exécutif Élargi de 1921 et plus ouvertement le 4ème Congrès devaient donner à ce problème une solution préjudiciable aux intérêts de la cause. Cela se fait surtout au travers du problème du front unique."[37]
Conclusion
Comme nous venons de le voir, la période allant du deuxième à l’après-IIIe Congrès de l’IC est marquée par une percée significative de l’opportunisme dans les rangs du parti. Celui-ci fut la conséquence directe de sa politique erronée consistant à "conquérir les masses" au prix de tous les compromis et toutes les concessions : soutien aux luttes de libération nationale, alliance avec les partis traîtres de la social-démocratie, participation au travail parlementaire et dans les syndicats, formation des partis de masse... L’IC tournait le dos à ce qui avait fait la force des fractions de gauche au sein de la IIe Internationale et tout particulièrement de la fraction bolchevik : l’intransigeance dans la défense des principes et du programme communistes. C’est d’ailleurs déjà ce que rappelait Herman Gorter à Lénine en 1920 : "Vous agissez maintenant dans la IIIe Internationale tout autrement que jadis dans le parti des maximalistes. Ce dernier fut conservé très "pur" et l’est peut-être toujours encore. Tandis que dans l’Internationale, on doit accueillir d’après vous tout de suite ceux qui sont communistes pour une moitié, pour un quart et même pour un huitième [...] La Révolution russe l’a emporté par la "pureté", par la fermeté des principes. [...] Au lieu d’appliquer maintenant aussi à tous les autres pays cette tactique éprouvée, et de renforcer ainsi de l’intérieur la IIIe Internationale, on fait présentement volteface et tout comme la social-démocratie jadis, on passe à l’opportunisme. Voici qu’on fait tout entrer : les syndicats, les Indépendants, le centre français, une portion du Labour Party."[38]
L’erreur fondamentale de l’Internationale communiste fut de considérer qu’elle pouvait à elle seule "conquérir" les masses ouvrières, les extraire de l’influence de la social-démocratie et ainsi élever leur niveau de conscience en les amenant sur le chemin du communisme.
De là découlait la politique de Front unique pour mieux démasquer et dénoncer la social-démocratie, la participation au parlementarisme pour mieux utiliser les divisions au sein des partis bourgeois, le travail dans les syndicats afin de les redresser du côté de la révolution et du camp prolétarien[39]. Aucune de ces tentatives n’eut l’effet escompté. Au contraire, elles ne firent que précipiter l’IC vers la trahison du camp prolétarien. Car au lieu d’élever la conscience de classe, cette tactique ne fit que répandre la confusion et la désorientation parmi les masses, en les rendant plus vulnérables face aux pièges et aux réactions de la bourgeoisie. Bien que les groupes de la gauche de l’IC ne soient jamais parvenus à s’unifier, tous se rejoignaient sur le caractère suicidaire de cette politique considérée comme la "perte du mouvement ouvrier", "la mort de la révolution". Ces groupes défendaient dans le fond une toute autre vision des relations que le parti devait nouer avec la classe[40]. Le rôle du parti n’était pas de bercer le prolétariat d’illusions et encore moins de l’embringuer dans des tactiques douteuses et dangereuses mais plutôt d’élever le niveau de conscience par une défense sans concessions des principes du prolétariat et veiller à ce que celui-ci ne s’en écarte pas. Telle était la seule et véritable boussole permettant de continuer à s’orienter dans la direction de la révolution alors que la vague qui s’était dressée en Octobre 1917 en Russie connaissait ses premiers reflux.
(À suivre)
Najek, 16 juin 2020.
[1] Cité dans Internationalisme n° 7 (année 1946): "À propos du 1er congrès du Parti communiste internationaliste d'Italie", republié dans la Revue internationale n°162. [20]
[2] Ce Congrès s’est déroulé entre le 21 juin et le début du mois de juillet 1921.
[3] Léon Trotsky, "Les enseignements du IIIe Congrès de l’Internationale Communiste", juillet 1921. L'idée de conquête de la majorité de la classe ouvrière, dans le contexte d'alors, contient déjà en germe l'idée de gagner les masses au détriment des principes, comme nous le montrerons plus avant dans cet article.
[4] "Révolution allemande (IX) : L'action de mars 1921, le danger de l'impatience petite-bourgeoise [21]" ; Revue internationale n° 93
[5] "Thèses du rapport sur la tactique du P.C.R présenté au IIIe Congrès de l’Internationale Communiste."
[6] Nation ou classe, brochure du CCI.
[7] L'émergence de la Chine en tant que candidat impérialiste majeur à la fin du XXe siècle ne remet pas en cause cette analyse globale : d'abord parce qu'elle intervient dans les circonstances spécifiques provoquées par la décomposition capitaliste, et ensuite parce que son développement en tant qu'État hautement militarisé et expansionniste n'a aucun contenu progressiste.
[8] Rosa Luxemburg, Brochure de Junius ou La Crise de la social-démocratie, 1915.
[9] Rosa Luxemburg, La Révolution russe, 1918.
[10] "Thèses sur les questions nationale et coloniale" du IIème congrès de l'IC.
[11] Edith Chabrier, "Les délégués du premier Congrès des peuples d’Orient (Bakou, 1er-8 septembre 1920)", in Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 26, n°1, Janvier-Mars 1985, pp. 21-42.
[12] Idem.
[13] "Les communistes et la question nationale (3ème partie", Revue Internationale n°42, 3e trimestre 1985.
[14] Idem.
[15] Voir "La dégénérescence de la Révolution russe", Revue internationale n°3.
[16] "Les communistes et la question nationale (3ème partie)", Revue Internationale n°42, 3e trimestre 1985.
[17] "Centenaire de la fondation de l’Internationale Communiste - Quelles leçons tirer pour les combats du futur ? [22]", Revue internationale n° 162.
[18] Thèses sur la tactique, partie 3 : la tâche la plus importante du moment", IIIe Congrès de l’IC.
[19] "Les Partis de l’Internationale Communiste deviendront des partis de masses révolutionnaires, s’ils savent vaincre l’opportunisme, ses survivances et ses traditions, dans leurs propres rangs, en cherchant à se lier étroitement aux masses ouvrières combattantes, en puisant leurs buts dans les luttes pratiques du prolétariat, en repoussant au cours de ces luttes aussi bien la politique opportuniste de l’aplanissement et de l’effacement des antagonismes insurmontables que les phrases révolutionnaires qui empêchent de voir le rapport réel des forces et les véritables difficultés du combat.", "Thèses sur la tactique", IIIe Congrès de l’IC.
[20] "Les tâches principales de l’Internationale Communiste", Deuxième Congrès de l’IC, juillet 1920.
[21] Idem.
[22] Parti social-démocrate indépendant d’Allemagne dont la majorité n’avait pas rompu avec le réformisme et rejetait de fait la dictature du prolétariat et l’organisation en conseils ouvriers.
[24] Pour une approche plus détaillée voir : "Comment le PCF a quitté le camp du prolétariat", in Comment le PCF a trahi ?, brochure du CCI.
[25] "En marge d’un anniversaire", revue Bilan n°4, février 1934.
[26] Pierre Broué, Histoire de l’Internationale communiste. 1919-1943, Fayard, 1997.
[27] Celui-ci, forcé à l’exil au Mexique par l’Empire brtitannique, avait d’ailleurs exercé une influence néfaste lors de la création du PC mexicain en août/septembre 1919 sur les bases déjà fortement imprégnées d’opportunisme de l’IC sur le continent américain.
[28] Bien que MN Roy fut opposé à une telle tactique.
[29] Op. Cit., Histoire de l’Internationale communiste.
[30] L’un des membres fondateurs du parti, Chen Duxiu portait une critique lucide sur cette orientation : "La raison principale de notre opposition était celle-ci : Entrer dans le Guomindang, c’était introduire la confusion dans l’organisation de classe, entraver notre politique et se subordonner à elle. Le délégué de l’IC dit textuellement : "La présente période est une période dans laquelle les communistes doivent effectuer un travail de coolies pour le Guomindang." A partir de ce moment-là, le parti n’était déjà plus le parti du prolétariat, il se transformait en extrême-gauche de la bourgeoisie et commençait à dégringoler dans l’opportunisme" [Chen Duxiu, Lettre à tous les camarades du PC chinois, 10 décembre 1929, in Pierre Broué, La Question chinoise dans l’Internationale communiste.
[31] "Chine 1928-1949 : maillon de la guerre impérialiste (I)", Revue internationale n°81, 2e trimestre 1995.
[32] La "lettre ouverte" adressée le 7 janvier 1921 par la centrale du KPD aux autres organisations (SPD, USPD, KAPD) appelant à mener une action commune parmi les masses et les luttes à venir, fut l’une des prémices de cette politique.
[33] "Résolution sur la position envers les courants socialistes et la conférence de Berne", Premier Congrès de l’IC.
[34] "Front unique, front anti-prolétarien", Révolution internationale n°45, janvier 1978.
[35] Intervention de la délégation du PC d’Italie lors du IVe Congrès de l’IC, in La Gauche communiste d’Italie. Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire, Courant communiste international.
[36] Etant donné, qu’à ce moment-là, les conditions étaient devenues moins favorables pour l’extension de la révolution, avec le recul dont nous disposons, il aurait été plus adapté de parler de "luttes partielles orientées" vers une perspective révolutionnaire.
[37] Revue Bilan, Avril 1934.
[38] Herman Gorter, Réponse à Lénine sur "La maladie infantile du communisme", 1920.
[39] La question syndicale a été déjà abordée dans la partie II, nous n’y revenons pas dans cette partie. Retenons cependant, qu’alors que le Ier Congrès mondial avait acté la faillite des syndicats tout comme celle de la social-démocratie (bien que le débat au sein du parti n’était pas clôt sur la nature prolétarienne ou non des syndicats après la Première Guerre mondiale), l’IC revient sur sa position et préconise leur régénérescence par la lutte en leur sein afin de bannir leur direction et gagner les masses au communisme. Cette tactique illusoire préconisée par le IIIème Congrès mondial par l’appel à la formation de l’Internationale Syndicale Rouge sera combattue par certains groupes de gauche (tout particulièrement par la Gauche allemande) qui considérait à juste titre que les syndicats n’étaient plus des organes de lutte prolétarienne.
[40] En dépit du fait qu’une grande partie de la gauche allemande et hollandaise prit par la suite la voie de la négation du parti en formant le courant conseilliste.
Conscience et organisation:
Questions théoriques:
- Internationalisme [25]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
Le programme communiste dans la phase de décomposition du capitalisme - Bordiga et la grande ville
- 633 lectures
"Lumières vives, grande ville, qui sont allées à la tête de mon bébé" (Chanson de Jimmy et Mary Reed, 1961)
Introduction
Cet article est écrit en plein milieu de la crise mondiale de Covid-19, une confirmation étonnante que nous vivons la phase d'agonie de la décadence capitaliste. La pandémie, qui est le produit de la relation profondément déformée entre l'humanité et le monde naturel sous le règne du capital, met en évidence le problème de l'urbanisation capitaliste que les révolutionnaires précédents, notamment Engels et Bordiga, ont analysé de manière assez approfondie. Bien que nous ayons examiné leurs contributions sur cette question dans des articles précédents de cette série[1], il semble donc opportun de soulever à nouveau la question. Nous approchons également du 50e anniversaire de la mort de Bordiga en juillet 1970, l'article peut donc également servir d'hommage à un communiste dont nous apprécions beaucoup le travail, malgré nos désaccords avec nombre de ses idées. Avec cet article, nous commençons un nouveau "volume" de la série sur le communisme, spécifiquement destiné à examiner les possibilités et les problèmes de la révolution prolétarienne dans la phase de décomposition du capitalisme
La révolution face à la décomposition du capitalisme
Dans une partie précédente de cette série, nous avons publié un certain nombre d'articles qui examinaient comment les partis communistes qui ont émergé pendant la grande vague révolutionnaire de 1917-23 avaient essayé de faire passer le programme communiste de l'abstrait au concret -pour avancer une série de mesures à prendre par les conseils ouvriers dans le processus de prise de pouvoir des mains de la classe capitaliste[2]. Et nous pensons qu'il est toujours parfaitement valable pour les révolutionnaires de se poser la question : quels seraient les fondements du programme que l'organisation communiste du futur -le parti mondial- serait obligée de mettre en avant dans un authentique mouvement révolutionnaire ? Quelles seraient les tâches les plus urgentes auxquelles la classe ouvrière serait confrontée lorsqu'elle s'orienterait vers la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale ? Quelles seraient les principales mesures politiques, économiques et sociales à mettre en œuvre par la dictature du prolétariat, qui reste la condition politique préalable nécessaire à la construction d'une société communiste ?
Les mouvements révolutionnaires de 1917-23, tout comme la guerre impérialiste mondiale qui les a alimentés, ont été la preuve évidente que le capitalisme était entré dans : l’époque de sa décadence, "décisive pour la révolution sociale". Depuis lors, le progrès et même la survie de l'humanité sont de plus en plus menacés si le rapport social capitaliste n'est pas dépassé à l'échelle mondiale. En ce sens, les objectifs fondamentaux d'une future révolution prolétarienne sont en pleine continuité avec les programmes qui ont été mis en avant au début de la période de décadence. Mais cette période dure maintenant depuis plus d'un siècle et, selon nous, les contradictions accumulées au cours de ce siècle ont ouvert une phase terminale de déclin capitaliste, la phase que nous appelons décomposition, dans laquelle le maintien du système capitaliste contient le danger croissant que les conditions mêmes d'une future société communiste soient sapées. C’est particulièrement évident au niveau "écologique" : en 1917-23, les problèmes posés par la pollution et la destruction de l'environnement naturel étaient bien moins étendus qu'aujourd'hui. Le capitalisme a tellement faussé "l'échange métabolique" entre l'homme et la nature qu'une révolution victorieuse devrait, à tout le moins, consacrer une énorme quantité de ressources humaines et techniques à la simple réparation du gâchis que le capitalisme nous aura légué. De même, tout le processus de décomposition, qui a exacerbé la tendance à l'atomisation sociale, à l'attitude du "chacun pour soi" inhérente à la société capitaliste, laissera une empreinte très néfaste sur les êtres humains qui devront construire une nouvelle communauté fondée sur l'association et la solidarité. Il faut également rappeler une leçon de la révolution russe : étant donnée la certitude que la bourgeoisie résistera de toutes ses forces à la révolution prolétarienne, la victoire de celle-ci impliquera une guerre civile qui pourrait causer des dommages incalculables, non seulement en termes de vies humaines et de nouvelles destructions écologiques, mais aussi au niveau de la conscience, puisque le terrain militaire n'est pas du tout le plus propice à l'épanouissement de l'auto-organisation, de la conscience et de la morale prolétariennes. En Russie, en 1920, l'État soviétique est sorti victorieux de la guerre civile, mais le prolétariat en avait largement perdu le contrôle. Ainsi, lorsque l'on tente de comprendre les problèmes de la société communiste "telle qu'elle émerge de la société capitaliste, qui donc à tous égards, économiquement, moralement et intellectuellement, porte encore, à sa naissance, les marques de la vieille société de laquelle elle émerge"[3], il faut reconnaître que ces marques de naissance seront probablement beaucoup plus laides et potentiellement plus dommageables qu'elles ne l'étaient à l'époque de Marx et même de Lénine. Les premières phases du communisme ne seront donc pas un réveil idyllique un beau matin de mai, mais un long et intense travail de reconstruction à partir de ruines. Cette reconnaissance devra éclairer notre compréhension de toutes les tâches de la période de transition, même si nous continuons à fonder nos anticipations de l'avenir sur la conviction que le prolétariat peut effectivement mener à bien sa mission révolutionnaire - malgré tout.
Le contexte historique du "programme immédiat pour la révolution" de Bordiga
Tout au long de cette longue série, nous avons tenté d’expliquer le développement du projet communiste en tant que fruit de l’expérience historique réelle de la lutte de classe et de la réflexion des minorités les plus conscientes du prolétariat sur cette expérience. Et dans cet article, nous voulons utiliser cette méthode historique, en examinant une tentative d'élaborer une version mise à jour des "programmes immédiats" de 1917-23, elle-même devenue une partie de l’histoire du mouvement communiste. Nous nous référons au texte écrit en 1953 par Amadeo Bordiga et publié dans Au fil du Temps (Sul Filo del Tempo), "Le programme immédiat de la révolution", que nous avons déjà mentionné dans un article précédent de cette série[4] avec l'engagement d’y revenir plus en détail. De notre point de vue, il est essentiel que toute future tentative de formuler un semblable "programme immédiat" se base sur les points forts de ces précédents efforts au lieu de critiquer radicalement leurs faiblesses. L’ensemble de ce texte, qui a le mérite d’être court, est le suivant :
1) Le gigantesque mouvement de reprise prolétarienne du premier après-guerre, dont la puissance se manifesta à l'échelle mondiale et qui s'organisa en Italie dans le solide parti de 1921, montra clairement que le postulat urgent était la prise du pouvoir politique, et que le prolétariat ne le prend pas par la voie légale mais par l'insurrection armée, que la meilleure occasion naît de la défaite militaire de son propre pays et que la forme politique qui suit la victoire est la dictature du prolétariat. La transformation économique et sociale constitue une tâche ultérieure dont la dictature crée la condition première.
2) Le Manifeste des communistes a établi que les mesures sociales successives qui se révèlent possibles ou que l'on provoque «despotiquement», différent selon le degré de développement des forces productives dans le pays où le prolétariat a vaincu et selon la rapidité avec laquelle cette victoire s'étend à d'autres pays, la marche au communisme supérieur étant extrêmement longue. Il a indiqué les mesures qui convenaient en 1848 pour les pays européens les plus avancés et rappelé qu'elles constituaient non pas le programme du socialisme intégral, mais un ensemble de mesures qu'il qualifiait de transitoires, immédiates, variables et essentiellement «contradictoires».
3) Par la suite (et ce fut un des éléments qui poussèrent certains à prétendre que la théorie marxiste n'était pas stable, mais devait être continuellement réélaboré en fonction des résultats de l'histoire), de nombreuses mesures alors dictées à la révolution prolétarienne furent prises par la bourgeoisie elle-même dans tel ou tel pays, telles que l'instruction obligatoire, la Banque d'État, etc...
Cela n'autorisait pas à croire que soient changées les lois et les prévisions précises du marxisme sur le passage du mode de production capitaliste au socialisme et de toutes leurs formes économiques, sociales et politiques; cela signifiait seulement que changeait et devenait plus facile la première période post-révolutionnaire, l'économie de transition qui précède le stade du socialisme inférieur et le stade ultime du socialisme supérieur ou communisme intégral.
4) L'opportunisme classique consista à faire croire que toutes ces mesures pouvaient, de la première à la dernière, être appliquées par l'État bourgeois démocratique sous la pression du prolétariat ou même grâce à la conquête légale du pouvoir. Mais dans ce cas, ces différentes «mesures» auraient été adoptées dans l'intérêt de la conservation bourgeoise et pour retarder la chute du capitalisme si elles étaient compatibles avec lui, et si elles étaient incompatibles, jamais l'État ne les aurait appliquées.
5) L'opportunisme actuel, avec la formule de la démocratie populaire et progressive dans les cadres de la constitution et du parlementarisme, remplit une tâche historique différente et pire encore. Tout d'abord, il fait croire au prolétariat que certaines de ses mesures propres peuvent être intégrées dans le programme d'un État pluripartite représentant toutes les classes, c'est-à-dire qu'il manifeste le même défaitisme que les sociaux-démocrates d'hier à l'égard de la dictature de classe. Ensuite et surtout, il pousse les masses organisées à lutter pour des mesures sociales «populaires et progressives», qui sont directement opposées à celles que le pouvoir prolétarien s'est toujours proposées, dès 1848 et le Manifeste.
6) On ne peut mieux montrer toute l'ignominie d'une pareille involution qu'en énumérant les mesures qu'il faudrait prendre à la place de celles du Manifeste il y a plus d'un siècle, et qui incluent toutefois les plus caractéristiques d'entre elles, dans le cas où la prise du pouvoir deviendrait possible à l'avenir dans un pays de l'Occident capitaliste.
7) La liste de ces revendications est la suivante:
- «Désinvestissement des capitaux», c'est-à-dire forte réduction de la partie du produit formée de biens instrumentaux et non pas de biens de consommation.
- «Élévation des coûts de production» pour pouvoir, tant que subsisteront salaire, marché et monnaie, donner des payes plus élevées pour un temps de travail moindre.
- «Réduction draconienne de la journée de travail», au moins à la moitié de sa durée actuelle, grâce à l'absorption des chômeurs et de la population aujourd'hui occupée à des activités antisociales.
- Après réduction du volume de la production par un plan de «sous-production» qui la concentre dans les domaines les plus nécessaires, «contrôle autoritaire de la consommation» en combattant la vogue publicitaire des biens inutiles, voluptuaires et nuisibles, et en abolissant de force les activités servant à propager une psychologie réactionnaire.
- Rapide «abolition des limites de l'entreprise» avec transfert autoritaire non pas du personnel, mais des moyens de travail en vue du nouveau plan de consommation.
- «Rapide abolition des assurances» de type mercantile pour les remplacer par l'alimentation sociale des non-travailleurs jusqu'à un minimum vital.
- «Arrêt de la construction» d'habitations et de lieux de travail à la périphérie des grandes villes et même des petites, comme mesure d'acheminement vers une répartition uniforme de la population sur tout le territoire. Réduction de l'engorgement, de la rapidité et du volume de la circulation en interdisant celle qui est inutile.
- «Lutte ouverte contre la spécialisation professionnelle» et la division sociale du travail par l'abolition des carrières et des titres.
- Plus près du domaine politique, évidentes mesures immédiates pour soumettre à l'État communiste l'école, la presse, tous les moyens de diffusion et d'information, ainsi que tout le réseau des spectacles et des divertissements.
8) Il n'est pas étonnant que les staliniens et leurs homologues réclament tout le contraire par leurs partis d'Occident, non seulement dans leurs revendications «institutionnelles», c'est-à-dire politico-légales, mais aussi dans leurs revendications «structurelles», c'est-à-dire économico-sociales. Cela leur permet d'agir de concert avec le parti qui dirige l'État russe et ses satellites où la tâche de transformation sociale consiste à passer du pré-capitalisme au plein capitalisme, avec tout le bagage de revendications idéologiques, politiques, sociales et économiques purement bourgeoises que cela comporte, et qui ne manifeste d'horreur que pour le féodalisme médiéval.
Les renégats d'Occident sont plus infâmes que leurs compères de l'Est, du fait que ce danger-là, qui reste encore matériel et bien réel dans l'Asie en ébullition, est inexistant pour les pays alignés sur la métropole capitaliste bouffie d'orgueil d'Outre-Atlantique, pour les prolétaires qui sont sous sa botte civilisées libérale et «onusienne»."
Ce texte a été publié dans l’année qui a suivi la scission du Parti Communiste International qui s’était formé en Italie au cours de la guerre, à la suite d’une importante vague de grèves ouvrières[5]. La scission, cependant –tout comme l'incapacité de maintenir la Gauche Communiste de France en vie –malgré les efforts de Marc Chirik- suite à la décision de le disperser en 1952, était une expression du fait que, contrairement aux espoirs de nombreux révolutionnaires, la guerre n’avait pas donné naissance à une nouvelle insurrection ouvrière, mais à l’approfondissement de la contre-révolution. Les désaccords entre "damenistes" et "bordiguistes" au sein du Parti Communiste International en Italie concernaient en partie des appréciations divergentes de l’après-guerre. Bordiga et ses partisans avaient tendance à avoir une meilleure compréhension du fait que la période était celle d’une montée de la réaction[6]. Et pourtant, ici nous avons Bordiga qui formule une liste de revendications qui serait plus adaptées à un moment de lutte révolutionnaire ouverte. Le texte apparaît ainsi plus comme une sorte d’expérience de la pensée que comme une plate-forme dont un mouvement de masse devrait s’emparer. Cela pourrait expliquer dans une certaine mesure certaines des plus évidentes faiblesses et lacunes du document, bien que, dans un sens plus profond, elles soient le produit de contradictions et d’incohérences qui étaient déjà inhérentes à la vision du monde bordiguiste.
En lisant les remarques qui introduisent et concluent ce texte, on peut voir qu’il a été écrit en tant que partie d’une polémique plus large contre ce que les bordiguistes caractérisent comme les courants "réformistes", en particulier les staliniens, ces faux héritiers de la tradition de Marx, Engels et Lénine. La principale raison pour laquelle les bordiguistes considèrent les Partis communistes officiels comme réformistes n’est pas qu’ils partagent les illusions des trotskystes sur le fait qu’ils seraient encore des organisations ouvrières, mais bien plus parce que les staliniens sont de plus en plus devenus partisans de former des fronts nationaux avec les partis bourgeois traditionnels et se font les avocats d’une "transition" graduelle vers le socialisme à travers la formation de "démocraties populaires" et de différentes coalitions parlementaires. Contre ces aberrations, Bordiga réaffirme les fondements du Manifeste Communiste qui considère comme point de départ la nécessité d’une conquête violente du pouvoir par le prolétariat (avec le recul, nous pouvons souligner le gouffre séparant Bordiga de beaucoup de ses "porte-paroles", notamment les courants "communisateurs" qui citent souvent Bordiga mais vomissent son insistance de la nécessité d’une dictature du prolétariat et du Parti communiste). En même temps, toujours en visant les staliniens, Bordiga disait clairement que alors que les mesures spécifiques "transitionnelles" préconisées à la fin du second chapitre du Manifeste de 1848 –impôt sur le revenu lourd et progressif, création d’une banque d’État, contrôle étatique des communications et des industries les plus importantes, etc.– devaient former l’épine dorsale du programme économique des "réformistes", elles ne devaient pas être considérées comme des vérités éternelles : le Manifeste lui-même met en avant qu’elles ne doivent "pas être considérées comme le socialisme complet, mais comme des étapes qui doivent être comprises comme préliminaires, immédiates et essentiellement contradictoires", et correspondent à un bas niveau du développement capitaliste à l’époque où elles ont été élaborées ; et de même un certain nombre d’entre elles ont été mises en place par la bourgeoisie elle-même.
On pourrait être pardonné de prendre cela pour une réfutation de l'invariance, c’est-à-dire de l’idée que le programme communiste est resté pour l’essentiel inchangé depuis au moins 1848. En fait, Bordiga fustige les staliniens parce qu’ils "ne suivent pas une théorie fixée, mais pensent qu’elle requiert des développements perpétuels du fait des changements historiques". Et à nouveau, il fait valoir que les "corrections" qu’il propose au programme immédiat "sont différentes de celles que le Manifeste énumère ; cependant ses caractéristiques sont les mêmes". Nous trouvons cela contradictoire et pas convaincant. Alors qu’il est vrai que certains éléments-clé du programme communiste, comme la nécessité de la dictature du prolétariat, ne changent pas, l’expérience historique a également apporté de profondes évolutions dans la compréhension de comment cette dictature peut se mettre en place et des formes politiques qui la composent. Cela n’a rien à voir avec le "révisionnisme" des -sociaux-démocrates, des staliniens ou d’autres qui peuvent invoquer le prétexte de " s’adapter à l’air du temps" pour justifier leur désertion du camp prolétarien.
De nombreux inconvénients, mais quelques avantages importants
En examinant les "corrections" apportées par Bordiga aux mesures proposées par le Manifeste, on pourrait aussi être pardonné de ne voir que leurs faiblesses, notamment :
- Malgré tous les enseignements des mouvements révolutionnaires de entre 1905 et 1923, il n'y a ici aucune indication sur les formes de pouvoir politique prolétarien les plus adaptées pour mettre en œuvre la transition vers le communisme. Aucune référence aux soviets, aucune tentative de s'appuyer sur des exemples comme le programme du KPD de 1918 qui met particulièrement l'accent sur la nécessité de démanteler les institutions de l'État bourgeois, locales et centrales, et d'installer à leur place le pouvoir des conseils ouvriers ; aucune leçon tirée de la dégénérescence de la révolution russe sur les relations entre le parti et la classe, ou entre le parti et l'État. En effet, la seule mention d'une forme quelconque de pouvoir politique à la suite de la révolution est celle de "l'État communiste", une contradiction atroce dans les termes, comme le soutient l'article précédent de cette série par le biais des contributions de Marc Chirik[7]. Ici encore, nous sommes confrontés aux faiblesses sous-jacentes de la "doctrine" bordigiste : les formes d'organisation ne sont pas importantes, ce qui compte, c'est le contenu injecté par le parti, qui est destiné à exercer la dictature du prolétariat au nom des masses. De plus, si Bordiga a bien sûr raison d'insister dans le point 5 sur le fait que la production et la consommation seront basées sur un plan global, son ignorance de la question de savoir comment la classe ouvrière prendra et gardera le pouvoir entre ses propres mains à tous les niveaux, du plus local au plus global, implique une vision hiérarchique de la centralisation. Ceci est particulièrement évident dans le paragraphe traitant des domaines de l'éducation et de la culture, où une sorte de monopole d'État est clairement préconisé. Nous pouvons mettre cela en contraste avec l'opinion de Trotsky selon laquelle l'État postrévolutionnaire devrait avoir une approche "anarchiste" sur la question de l'art et de la culture -par laquelle il voulait dire que l'État devrait intervenir le moins possible dans les questions de style artistique, de goût ou de créativité, et ne devrait pas exiger que tout l'art serve de propagande à la révolution. Plus généralement, sa liste de mesures ne fait guère état de la nécessité d'une vaste lutte politique, morale et culturelle pour surmonter les habitudes et les attitudes héritées non seulement du capitalisme, mais aussi de milliers d'années de sociétés de classes. Il parle bien de la nécessité de lutter contre "la spécialisation professionnelle et la division sociale du travail", mais une telle lutte exige quelque chose de plus qu'une interdiction des titres honorifiques, tandis que l'appel à supprimer "la possibilité de faire carrière" n'a de sens que dans le contexte d'une réorganisation globale de la production et de l'élimination du système salarial.
- Bordiga était parfaitement conscient que l'abolition "des salaires, de l'argent et du marché" est une caractéristique centrale du communisme, et nous savons qu'il ne sera pas possible de s'en passer du jour au lendemain. Mais à part le fait qu'il préconise "plus de rémunération pour moins de temps de travail", Bordiga ne nous donne aucune indication sur les mesures qui peuvent être prises - et ce dès le début de la révolution - pour éliminer ces catégories-clés du capitalisme. En ce sens, les corrections de Bordiga ne s'appuient pas sur les propositions de Marx dans la Critique du programme Gotha (le système des bons de temps de travail, sur lequel nous devrons revenir dans un autre article), ni ne les critiquent de manière cohérente.
Et pourtant, le document conserve pour nous un intérêt considérable en essayant de comprendre quels seraient les principaux problèmes et priorités d'une révolution communiste qui aurait lieu, non pas à l'aube de la décadence du capitalisme, comme en 1917-23, mais après un siècle entier au cours duquel le glissement vers la barbarie n'a cessé de s'accélérer, et où la menace pour la survie même de l'humanité est bien plus grande qu'il y a cent ans.
Les méthodes de la reconstruction communiste
Le document de Bordiga ne tente pas de dresser un bilan des succès et des échecs de la révolution russe au niveau politique, et ne fait, en fait, qu'une référence superficielle à la vague révolutionnaire qui a suivi la Première Guerre mondiale. Toutefois, à un certain égard, il cherche à appliquer une leçon importante des politiques économiques adoptées par les bolcheviks : les propositions de Bordiga sont pertinentes car elles reconnaissent que la voie vers l'abondance matérielle et une société sans classes ne peut pas être basée sur un programme d'"accumulation socialiste", dans lequel la consommation est toujours soumise à la "production au nom de la production" (qui est en fait une production pour la valeur), le travail vivant étant soumis au travail mort. Certes, la révolution communiste est devenue une nécessité historique car les rapports sociaux capitalistes sont devenus une entrave au développement des forces productives. Mais du point de vue communiste, le développement des forces productives a un contenu très différent de celui qu’il a dans la société capitaliste, où il est motivé par la recherche du profit et donc par le désir d'accumuler. Le communisme utilisera certainement pleinement les progrès scientifiques et technologiques réalisés sous le capitalisme, mais il les mettra au service de l'homme, de sorte qu'ils deviennent les serviteurs du véritable "développement" que le communisme propose : la pleine floraison des forces productives, c'est-à-dire des pouvoirs créatifs des individus. Un exemple suffira ici : avec le développement de l'informatisation et de la robotisation, le capitalisme nous a promis la fin de la corvée et une "société de loisirs". En réalité, ces bienfaits potentiels ont apporté la misère du chômage ou du travail précaire à certains, et une charge de travail accrue à d'autres, avec la pression croissante sur les employés pour qu'ils continuent à travailler sur leur ordinateur partout et à tout moment de la journée.
Concrètement, les quatre premiers points de son programme impliquent : de cesser de se centrer sur la production de machines dans le but de produire plus de machines, et d’orienter la production vers la consommation directe. Sous le capitalisme, bien sûr, cette dernière a signifié la production de "biens de consommation inutiles, nuisibles et de luxe" toujours plus nombreux -illustrés aujourd'hui par la production d'ordinateurs ou de téléphones portables de plus en plus sophistiqués, conçus pour tomber en panne après une période limitée et ne pouvant être réparés, ou par les industries de l’automobile immensément polluantes et de la mode éphémère, dans lesquelles la "demande des consommateurs" est poussée jusqu'à la frénésie par la publicité et les médias sociaux. Pour la classe ouvrière au pouvoir, la réorientation de la consommation sera axée sur la nécessité urgente de répondre aux nécessités fondamentales de la vie pour tous les êtres humains et partout sur la planète. Nous devrons revenir sur ces questions dans d'autres articles, mais nous pouvons mentionner certaines des plus évidentes :
- La nourriture. Le capitalisme en déclin a présenté à l'humanité une gigantesque contradiction entre les possibilités de produire suffisamment de nourriture pour tous, et la sous-alimentation réelle et permanente qui hante de grandes parties de la planète, y compris des pans de la population des pays les plus avancés, alors que dans les pays centraux comme dans les pays plus périphériques, des millions de personnes souffrent d'obésité et d'un régime alimentaire de mauvaise qualité délibérément maintenu par les entreprises de production et de commercialisation agroalimentaires, qui contribuent aussi énormément aux émissions mondiales de carbone, à la déforestation et à d'autres menaces pour l'écologie mondiale comme la pollution par les plastiques. L'approvisionnement mondial en eau est également devenu un problème fondamental, exacerbé par le réchauffement climatique. La classe ouvrière devra donc nourrir le monde mais sans recourir aux méthodes capitalistes qui nous ont conduits dans cette impasse, notamment "l'agriculture industrielle" contemporaine avec sa cruauté révoltante envers les animaux et son lien probable avec les maladies pandémiques. Elle devra résoudre l'antagonisme entre une alimentation abondante et une alimentation saine. Et tout cela sur la base d'une transformation socio-économique qui ne peut être résolue immédiatement : c'est une chose, par exemple, d'exproprier le grand "agrobusiness" et les sources étatiques de production alimentaire, une autre d'intégrer les petits exploitants ou les paysans dans une production coopérative puis associée, ce qui prendra du temps car il sera impossible de dépasser immédiatement les relations d'échange entre le secteur socialisé et les petits exploitants.
- Le logement : le problème des sans-abri est devenu endémique dans tous les pays capitalistes, et notamment dans les villes du centre capitaliste ; des millions de personnes sont rassemblées dans les vastes bidonvilles qui entourent les villes du "Sud mondialisé" (et, là encore, dans certaines parties du "Nord mondialisé") ; et au cours des dernières décennies, la prolifération des guerres et la destruction de l'environnement ont créé un problème de réfugiés d'une ampleur inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des millions d'autres personnes vivant dans des conditions désespérées dans des camps qui offrent peu de protection contre les maladies et contre toutes sortes d'exploitation, y compris les formes modernes d'esclavage. Dans le même temps, les grandes villes du monde se sont lancées dans une frénésie de construction principalement consacrée à la spéculation, aux appartements de luxe et aux activités économiques qui n'auraient pas leur place dans une société communiste. L'expropriation à grande échelle de ces bâtiments mal utilisés et mal conçus peut apporter une solution temporaire aux pires expressions du phénomène des sans-abri, mais à long terme, le logement de l'humanité communiste ne peut pas se fonder sur le rafistolage d'un parc immobilier déjà inadéquat et de plus en plus délabré où les résidents sont entassés dans des grands corps de bâtiments ou des cités-dortoirs ressemblant à des cages. Le relogement d'une grande partie de la population mondiale pose un défi bien plus important : le dépassement de la contradiction entre ville et campagne, qui n'a rien de commun avec l'expansion effrénée des villes à laquelle nous assistons dans cette phase du capitalisme. Nous y reviendrons plus loin.
- Les soins de santé : la santé, comme le conclut chaque rapport sur la santé publique, est une question sociale et de classe. Ceux qui sont mal nourris et mal logés, avec un accès limité aux soins de santé, meurent beaucoup plus tôt que ceux qui mangent bien, ont un logement décent et peuvent recevoir un traitement médical adéquat lorsqu'ils sont malades. La pandémie actuelle de Covid-19, cependant, expose les limites de tous les "services de santé" existants, même dans les pays capitalistes les plus puissants, notamment parce qu'ils n’échappent pas à la logique de concurrence entre les unités capitalistes nationales, alors qu'une pandémie ne respecte pas les frontières nationales et cela souligne la nécessité de quelque chose qui ne peut être qu'un cauchemar non seulement pour les grands consortiums pharmaceutiques et tous les Trump de ce monde, mais aussi pour cette version de gauche du nationalisme qui refuse que nous voyions au-delà de "notre service national de santé" : une médecine, des soins de santé et une recherche qui ne soient pas gérés par l'État, mais véritablement socialisés, et qui ne soient pas nationaux mais "sans frontières" : en bref, un service de santé planétaire.
Pas de gaspillages , nous n'en voulons pas
Mais en même temps, ces tâches certes immenses, qui ne sont que le point de départ d'une nouvelle culture humaine, ne peuvent être envisagées comme le résultat d'une augmentation brutale de la journée de travail. Au contraire, elles doivent être liées à une réduction drastique du temps de travail, sans laquelle, ajoutons-le, la participation directe des producteurs à la vie politique des assemblées générales et des conseils ne sera pas possible. Et cette réduction doit être obtenue dans une large mesure par l'élimination du gaspillage : le gaspillage du chômage et des "activités socialement inutiles et nuisibles".
Déjà au début du capitalisme, dans un discours prononcé à Elberfeld en 1845, Engels stigmatisait le fait que le capitalisme ne pouvait pas éviter une terrible mauvaise utilisation de l'énergie humaine et insistait sur le fait que seule une transformation communiste pouvait résoudre le problème.
- "Du point de vue économique, l'organisation actuelle de la société est certainement la plus irrationnelle et la moins pratique que nous puissions concevoir. L'opposition des intérêts a pour conséquence qu'une grande quantité de force de travail est utilisée sans que la société n’y gagne rien, et qu'une quantité substantielle de capital est inutilement perdue sans se reproduire. Nous le voyons déjà dans les crises commerciales ; nous voyons comment des masses de marchandises, que les hommes ont toutes produites avec beaucoup d'efforts, sont bradées à des prix qui causent des pertes aux vendeurs ; nous voyons comment des masses de capital, accumulées avec beaucoup d'efforts, disparaissent sous les yeux mêmes de leurs propriétaires à la suite de faillites. Mais parlons un peu plus en détail du commerce d'aujourd'hui. Réfléchissez au nombre de mains entre lesquelles doit passer chaque produit avant d'arriver au consommateur réel. Considérez, messieurs, combien d'intermédiaires superflus et de spéculateurs et escrocs se sont maintenant interposés entre le producteur et le consommateur ! Prenons, par exemple, une balle de coton produite en Amérique du Nord. La balle passe des mains du planteur à celles d'un quelconque comptoir commercial du Mississippi et descend le fleuve jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Là, elle est vendue -pour la deuxième fois, car l'agent l'a déjà achetée au planteur- vendue, peut-être, au spéculateur, qui la revend à nouveau, à l'exportateur. La balle se rend maintenant à Liverpool où, une fois de plus, un spéculateur avide tend les mains vers elle et la saisit. Cet homme l'échange ensuite avec un commissionnaire qui, supposons, est un acheteur pour une maison allemande. La balle se rend donc à Rotterdam, en amont du Rhin, en passant par une douzaine de mains d’agents intermédiaires qui la déchargent et la chargent une douzaine de fois, et ce n'est qu'alors qu'elle arrive entre les mains, non pas du consommateur, mais du fabricant, qui en fait d'abord un article de consommation, et qui vend peut-être son fil à un tisserand, qui dispose de ce qu'il a tissé pour l'imprimeur textile, qui fait ensuite affaire avec le grossiste, qui traite ensuite avec le détaillant, qui vend finalement la marchandise au consommateur. Et tous ces millions d'intermédiaires, spéculateurs, propriétaires ou gérants commerciaux , exportateurs, commissionnaires, transporteurs, grossistes et détaillants, qui ne contribuent en fait en rien à la marchandise elle-même -ils veulent tous en vivre et faire des bénéfices- et ils le font aussi, en moyenne, sinon ils ne pourraient pas subsister. Messieurs, n'y a-t-il pas de moyen plus simple et moins coûteux d'acheminer une balle de coton d'Amérique en Allemagne et de mettre le produit fabriqué à partir de cette balle entre les mains du vrai consommateur que cette entreprise compliquée qui consiste à la vendre dix fois et à la charger, la décharger et la transporter d'un entrepôt à l'autre cent fois ? N'est-ce pas là un exemple frappant du gaspillage multiple de la force de travail provoqué par la divergence des intérêts ? Un mode de transport aussi compliqué est hors de question dans une société rationnellement organisée. Pour reprendre notre exemple, de même qu'il est facile de connaître la quantité de coton ou de produits manufacturés en coton dont une colonie a besoin, il sera tout aussi facile pour l'autorité centrale de déterminer la quantité dont ont besoin tous les villages et cantons du pays. Une fois ces statistiques établies -ce qui peut facilement être fait en un an ou deux- la consommation annuelle moyenne ne changera que proportionnellement à l'augmentation de la population ; il est donc facile, au moment opportun, de déterminer à l'avance la quantité de chaque article dont la population aura besoin - la totalité de cette grande quantité sera commandée directement auprès de la source d'approvisionnement ; il sera alors possible de s'en procurer directement, sans intermédiaire, sans plus de retard et de déchargement que ne l'exige réellement la nature du voyage, c'est-à-dire avec une grande économie de main-d'œuvre ; il ne sera pas nécessaire de payer les spéculateurs, les petits et les grands négociants, leur ratissage. Mais ce n'est pas tout : de cette manière, ces intermédiaires ne sont pas seulement rendus inoffensifs pour la société, ils lui sont en fait rendus deviendront encore utiles. Alors qu'ils accomplissent aujourd'hui au détriment de tous un travail au mieux superflu, mais qui leur permet néanmoins de gagner leur vie, souvent même d’amasser de grandes richesses, alors qu'ils sont donc aujourd'hui directement préjudiciables au bien général, ils seront alors libres d'exercer un travail utile et d'exercer une profession dans laquelle ils pourront faire leurs preuves en tant que membres effectifs, et non plus seulement apparents et fictifs, de la société humaine, et en tant que participants à son activité dans son ensemble"[8] .
Engels énumère ensuite d'autres exemples de ce gaspillage : la nécessité, dans une société fondée sur la concurrence et l'inégalité, de maintenir des institutions extrêmement coûteuses mais totalement improductives telles que les armées permanentes, les forces de police et les prisons ; le travail humain consacré au service de ce que William Morris appelait "le luxe somptueux des riches" ; et enfin, l'énorme gaspillage de la force de travail engendré par le chômage, qui atteint des niveaux particulièrement scandaleux lors des crises "commerciales" périodiques du système. Il oppose ensuite le gaspillage du capitalisme à la simplicité essentielle de la production et de la distribution communistes, qui est calculée sur la base des besoins des êtres humains et du temps global nécessaire au travail qui satisfera ces besoins.
Tous ces maux capitalistes, observables pendant la période de montée et d'expansion du capitalisme, sont devenus beaucoup plus destructeurs et dangereux pendant l'époque du déclin du capitalisme : la guerre et le militarisme se sont emparés de plus en plus de l'ensemble de l'appareil économique et constituent une telle menace pour l'humanité que c'est certainement l'une des priorités les plus urgentes de la dictature du prolétariat (que Bordiga ne mentionne pas, même si "l'ère atomique" avait déjà clairement commencé au moment où il a écrit ce texte) sera de débarrasser la planète des armes de destruction massive accumulées par le capitalisme -surtout parce qu'il n'y a aucune garantie que, face à son renversement définitif par la classe ouvrière, la bourgeoisie ou ses factions ne préfèrent détruire l'humanité plutôt que de sacrifier leur domination de classe.
Un capitalisme militarisé ne peut également fonctionner qu'à travers la croissance cancéreuse de l'État, avec sa propre armée permanente de bureaucrates, de policiers et d'espions. Les services de sécurité, en particulier, ont pris des proportions gigantesques, tout comme leur image miroir, les bandes mafieuses qui font respecter leur ordre brutal dans de nombreux pays de la périphérie capitaliste.
De même, la décadence capitaliste, avec son vaste appareil bancaire, financier et publicitaire plus que jamais indispensable à la circulation des biens produits, a largement gonflé le nombre de personnes impliquées dans des formes d'activité quotidienne fondamentalement inutiles ; et les vagues successives de "mondialisation" ont rendu encore plus évidentes les absurdités de la circulation des marchandises à l'échelle de la planète, sans parler de son coût croissant au niveau écologique. Et la quantité de travail consacrée aux exigences de ce qu'on appelle aujourd'hui les "super-riches" n'est pas moins choquante qu'à l'époque d'Engels -non seulement dans leur besoin inépuisable de domestiques mais aussi dans leur soif de luxes vraiment inutiles comme les jets privés, les yachts et les palais. Et au pôle opposé, à une époque où la crise économique du système a elle-même tendance à devenir permanente, le chômage est moins un fléau cyclique que permanent, même lorsqu'il se dissimule sous la prolifération d’emplois de courte durée et du sous-emploi. Dans ce que l'on appelle le tiers monde, la destruction des économies traditionnelles a entraîné le développement intensif du capitalisme dans certaines régions, mais elle a également créé un gigantesque "sous-prolétariat" vivant dans les conditions les plus précaires dans les "townships" d'Afrique ou les "favelas" du Brésil et du reste de l'Amérique latine.
Ainsi, Bordiga - même s'il n'était pas cohérent dans sa compréhension de la décadence du système - avait compris que la mise en œuvre du programme communiste à cette époque ne signifierait pas avancer vers l'abondance par un processus d'industrialisation très rapide, comme les bolcheviks avaient tendance à le supposer, étant données les conditions "arriérées" auxquelles ils étaient confrontés en Russie après 1917. Certes, il nécessitera le développement et l'application des technologies les plus avancées, mais il se concrétisera dans un premier temps par un démantèlement planifié de tout ce qui est nocif et inutile dans l'appareil de production existant, et par une réorganisation globale des ressources humaines réelles que le capitalisme ne cesse de dilapider et de détruire.
Le mouvement communiste d'aujourd'hui - même s'il a tardé à reconnaître l'ampleur du problème - ne peut s'empêcher d'être conscient du coût écologique du développement capitaliste au cours du siècle dernier, et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est plus évident pour nous que cela ne l'était pour les bolcheviks que nous ne pouvons pas arriver au communisme par les méthodes de l'industrialisation capitaliste, qui sacrifie à la fois la force de travail humain et la richesse naturelle aux exigences du profit, à l'idole de la valeur et de son accumulation. Nous comprenons maintenant que l'une des principales tâches du prolétariat est de mettre un terme à la menace du réchauffement climatique et de nettoyer le gigantesque gâchis que le capitalisme nous aura légué : la destruction massive des forêts et des espaces sauvages, la contamination de l'air, de la terre et de l'eau par les systèmes de production et de transport existants. Certaines parties de cet "héritage" nécessiteront de nombreuses années de recherche et de patient travail pour être surmontées -la pollution des mers et de la chaîne alimentaire par les déchets plastiques n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et comme nous l'avons déjà mentionné, la satisfaction des besoins les plus fondamentaux de la population mondiale (alimentation, logement, santé, etc.) devra être cohérente avec ce projet global d'harmonisation entre l'homme et la nature.
C'est tout à l'honneur de Bordiga d'avoir pris conscience de ce problème dès le début des années 50 : son intuition de la centralité de cette dimension se manifeste surtout dans sa position sur le problème des "grandes villes", qui s'inscrit pleinement dans la pensée de Marx et surtout d'Engels.
Démanteler les mégalopoles
La ville et la civilisation ont les mêmes racines, historiquement et étymologiquement. Parfois, le terme "civilisation" est étendu pour inclure l'ensemble de la culture et de la morale humaines[9]: en ce sens, les chasseurs-cueilleurs d'Australie ou d'Afrique constituent également une civilisation. Mais il ne fait aucun doute que le passage à la vie urbaine, qui est la définition la plus généralement utilisée de la civilisation, a représenté un développement qualitatif dans l'histoire humaine : un facteur d'avancement de la culture et de l'histoire elle-même, mais aussi les débuts définitifs de l'exploitation des classes, et de l'État. Avant même le capitalisme, comme le montre Weber, la ville est aussi inséparable du commerce et de l'économie monétaire[10]. Mais la bourgeoisie est la classe urbaine par excellence, et les villes médiévales sont devenues les centres de la résistance à l'hégémonie de l'aristocratie féodale, dont la richesse est avant tout basée sur la propriété foncière et l'exploitation des paysans. Le prolétariat moderne n'en est pas moins une classe urbaine, formée à partir de l'expropriation des paysans et de la ruine des artisans. Poussée dans les conurbations construites à la hâte à Manchester, Glasgow ou Paris, c'est là que la classe ouvrière a pris conscience d'être une classe distincte opposée à la bourgeoisie et a commencé à envisager un monde au-delà du capitalisme.
Au niveau de la relation de l'homme avec la nature, la ville présente le même double aspect : elle est le centre du développement scientifique et technologique, ouvrant le potentiel de libération vis-à-vis de la pénurie et de la maladie. Mais cette "maîtrise de la nature" croissante, qui se produit dans des conditions d'aliénation de l'homme par rapport à lui-même et à la nature, est également inséparable de la destruction de la nature et des catastrophes écologiques récurrentes. Ainsi, le déclin des cultures citadines sumériennes ou mayas s'explique par une forme de dépassement de la ville par elle-même, épuisant le milieu environnant de forêts et d'agriculture, et dont l'effondrement a porté des coups terribles à l'orgueil de civilisations qui avaient commencé à oublier leur intime dépendance vis-à-vis de la nature. De même, les villes, dans la mesure où elles ont entassé les êtres humains comme des sardines, n'ont pas réussi à résoudre le problème fondamental de l'élimination des déchets, et ont inversé les relations séculaires entre les hommes et les animaux, sont devenues le terreau de fléaux tels que la peste noire à l'époque du déclin féodal ou le choléra et le typhus qui ont ravagé les villes industrielles du capitalisme primitif. Mais là encore, nous devons considérer l'autre facette de la dialectique : la bourgeoisie montante a pu comprendre que les maladies qui frappent ses esclaves salariés pouvaient également atteindre les portes des demeures capitalistes et miner tout leur édifice économique. Elle a ainsi pu commencer et mener à bien d'étonnantes prouesses d'ingénierie dans la construction de systèmes d'égouts qui fonctionnent encore aujourd'hui, tandis que l'expertise médicale, à l’évolution rapide, était mobilisée pour éliminer des formes de maladies jusqu'alors chroniques.
Dans l'œuvre de Friedrich Engels en particulier, on peut trouver les éléments fondamentaux pour une histoire de la ville d'un point de vue prolétarien. Dans Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État, il retrace la dissolution des anciens "gens", l'organisation tribale basée sur les liens de parenté, qui laisse la place à la nouvelle organisation territoriale de la ville, marquée par la division irréversible en classes antagonistes et avec elle l'émergence du pouvoir étatique, dont la tâche est d'empêcher ces divisions de déchirer la société. Dans La condition de la classe ouvrière en Angleterre, il brosse un tableau des conditions de vie infernales du jeune prolétariat, de la saleté et des maladies quotidiennes des bidonvilles de Manchester, mais aussi le bouillonnement de la conscience et de l'organisation de classe qui, en fin de compte, joueront le rôle décisif pour contraindre la classe dirigeante à accorder des réformes significatives aux travailleurs.
Dans deux ouvrages ultérieurs, l'Anti-Duhring et La question du logement, Engels se lance dans une discussion sur la ville capitaliste dans une phase où le capitalisme a déjà triomphé au cœur de l'Europe et des États-Unis et est sur le point de conquérir le monde entier. Et on peut remarquer qu'il conclut déjà que les grandes villes ont dépassé les limites de leur viabilité et devront disparaître pour répondre à l'exigence du Manifeste communiste : l'abolition de la séparation entre la ville et la campagne. Rappelons ici que dans les années 1860, Marx se préoccupait aussi de plus en plus de l'impact destructeur de l'agriculture capitaliste sur la fertilité des sols et notait, dans l'ouvrage de Liepig, que l'anéantissement de la couverture forestière dans certaines régions d'Europe avait un impact sur le climat, en augmentant les températures locales et en diminuant les précipitations[11]. En d'autres termes : de même que Marx discernait des signes de la décadence politique de la classe bourgeoise après l'écrasement de la Commune de Paris et que, dans sa correspondance avec les révolutionnaires russes vers la fin de sa vie, il cherchait des moyens pour que les régions où le capitalisme devait encore triompher pleinement puissent éviter le purgatoire du développement capitaliste, Engels et lui avaient commencé à se demander si, en ce qui concernait le capitalisme, trop c'était trop[12]. Peut-être que les bases matérielles d'une société communiste mondiale avaient déjà été posées et que de nouveaux "progrès" pour le capital auraient un résultat de plus en plus destructeur ? Nous savons que le système, par son expansion impérialiste dans les dernières décennies du XIXe siècle, allait prolonger sa vie de plusieurs décennies supplémentaires et fournirait la base d'une phase de croissance et de développement stupéfiante, ce qui conduirait certains éléments du mouvement ouvrier à remettre en question l'analyse marxiste de l'inévitabilité de la crise et du déclin du capitalisme, pour que les contradictions non résolues du capital explosent au grand jour lors de la guerre de 1914-18 (qu'Engels avait également anticipée). Mais les questions de recherche sur l'avenir qu'ils avaient commencé à poser précisément au moment où le capitalisme avait atteint son apogée étaient parfaitement valables à l'époque et sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui.
Dans "La transformation des rapports sociaux [27]"[13], nous avons examiné comment les révolutionnaires du XIXe siècle -en particulier Engels, mais aussi Bebel et William Morris- avaient fait valoir que la croissance des grandes villes avait déjà atteint le point où l'abolition de l'antagonisme entre ville et campagne était devenue une réelle nécessité, d'où la nécessité de mettre fin à l'expansion des grandes villes au profit d'une plus grande unité entre l'industrie et l'agriculture et d'une répartition plus équitable des habitations humaines sur la Terre. C'était une nécessité non seulement pour résoudre des problèmes urgents tels que l'élimination des déchets et la prévention de la surpopulation, de la pollution et des maladies, mais aussi comme base d'un rythme de vie plus humain en harmonie avec la nature.
Dans "Damen, Bordiga et la passion pour le communisme [28]"[14], nous avons montré que Bordiga -peut-être plus que tout autre marxiste au XXe siècle- était resté fidèle à cet aspect essentiel du programme communiste, en citant par exemple son article de 1953 Espace contre ciment [29] [15], qui est une polémique passionnée contre les tendances contemporaines en matière d'architecture et d'urbanisme (domaine dans lequel Bordiga lui-même était professionnellement qualifié), qui étaient motivées par le besoin du capital de rassembler le plus grand nombre possible d'êtres humains dans des espaces de plus en plus restreints -une tendance caractérisée par la construction rapide de tours supposées s'inspirer des théories architecturales de Le Corbusier. Bordiga est impitoyable envers les fournisseurs de l'idéologie moderne de l'urbanisme :
- "Quiconque applaudit de telles tendances ne doit pas être considéré uniquement comme un défenseur des doctrines, des idéaux et des intérêts capitalistes, mais comme un complice des tendances pathologiques du stade suprême de décadence et de dissolution du capitalisme" (donc, aucune hésitation sur la décadence ici !). Ailleurs dans le même article, il affirme : "Le verticalisme, c’est ainsi que cette doctrine déformée s'appelle ; le capitalisme est verticaliste. Le communisme sera "horizontaliste". Et à la fin de l'article, il anticipe avec joie le jour où "les monstres de ciment seront ridiculisés et supprimés" et où les "villes géantes seront dégonflées" afin de "rendre la densité de la vie et du travail uniforme sur les terres habitables".
Dans un autre ouvrage, Espèce humaine et croûte terrestre [30][16], Bordiga cite abondamment l'ouvrage d'Engels La question du logement, et nous ne pouvons pas éviter de céder à la tentation de faire de même. Il s'agit de la dernière partie de la brochure, où Engels s'en prend à Mülberger, disciple de Proudhon, pour avoir affirmé qu'il est utopique de vouloir surmonter l'antagonisme "inévitable" entre ville et campagne :
- "L'abolition de l'antithèse entre ville et campagne n'est ni plus ni moins utopique que l'abolition de l'antithèse entre capitalistes et travailleurs salariés. De jour en jour, elle devient de plus en plus une exigence pratique de la production industrielle et agricole. Personne n'a exigé cela avec plus d'énergie que Liebig dans ses écrits sur la chimie de l'agriculture, dans lesquels sa première revendication a toujours été que l'homme rende à la terre ce qu'il lui prend, et dans lesquels il prouve que seule l'existence des villes, et en particulier des grandes villes, l'empêche. Quand on observe comment, ici à Londres seulement, une quantité de fumier plus importante que celle produite par tout le royaume de Saxe est déversée chaque jour dans la mer avec une dépense de sommes considérables, et quand on observe quels travaux colossaux sont nécessaires pour éviter que ce fumier n'empoisonne tout Londres, alors la proposition utopique d'abolir l'antithèse entre ville et campagne se voit donner une base particulièrement pratique. Et même Berlin, comparativement insignifiante, se vautre dans ses propres ordures depuis au moins trente ans.
D'autre part, il est tout à fait utopique de vouloir, comme Proudhon, transformer la société bourgeoise actuelle tout en maintenant le paysan en tant que tel. Seule une répartition aussi uniforme que possible de la population sur l'ensemble du pays, seule une liaison intégrale entre la production industrielle et agricole ainsi que l'extension nécessaire des moyens de communication - qui suppose l'abolition du mode de production capitaliste - pourraient sauver la population rurale de l'isolement et de l’abrutissement dans lesquels elle végète presque sans changement depuis des milliers d'années" [17].
Plusieurs pistes de réflexion sont proposées dans ce passage, et Bordiga en est bien conscient. Premièrement, Engels insiste sur le fait que le dépassement de l'antagonisme entre ville et campagne est intimement lié au dépassement de la division générale du travail capitaliste - un thème développé plus loin dans l'Anti-Dühring, en particulier la division entre travail intellectuel et travail manuel qui semble si insurmontable dans le processus de production capitaliste. Le dépassement des conditions de ces deux séparations, tout comme celles de la division entre le capitaliste et le travailleur salarié, est indispensable pour l'émergence d'un être humain complet. Et contrairement aux schémas des proudhoniens rétrogrades, l'abolition du rapport social capitaliste n'implique pas la préservation de la petite propriété des paysans ou des artisans ; c’est en transcendant les clivages ville-campagne et les divisions industrie-agriculture que les paysans pourront être sauvés de l'isolement et d’un état intellectuel qui végète autant que les citadins pourront être libérés du surpeuplement et de la pollution.
Deuxièmement, Engels soulève ici, comme il le fait ailleurs, le problème simple mais souvent éludé des excréments humains. Dans leurs premières formes "sauvages", les villes capitalistes n'ont pratiquement rien prévu pour le traitement des déchets humains, et en ont très vite payé le prix en générant des épidémies, notamment la dysenterie et le choléra - fléaux qui hantent encore les bidonvilles de la périphérie capitaliste, où les installations d'hygiène de base sont notoirement absentes. La construction du système d'égouts a certainement représenté un pas en avant dans l'histoire de la ville bourgeoise. Mais le simple fait d'évacuer les déchets humains est en soi une forme de gaspillage puisqu'ils pourraient être utilisés comme engrais naturel (comme c'était d'ailleurs le cas dans l'histoire antérieure de la ville).
En se remémorant l'époque du Londres ou du Manchester d'Engels, on pourrait facilement dire : ils pensaient que ces villes étaient déjà devenues beaucoup trop grandes, beaucoup trop éloignées de leur environnement naturel. Qu'auraient-ils fait des avatars modernes de ces villes ? L'ONU a estimé qu'environ 55% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des grandes villes, mais si la croissance actuelle des villes se poursuit, ce chiffre atteindra environ 68% d'ici 2050[18].
C'est un véritable exemple de la "croissance de la décadence" du capitalisme, et Bordiga a eu la prescience de voir cela dans la période de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Les anthropologues qui cherchent à définir l'ouverture de la période de ce qu'ils appellent "l'ère anthropocène" (qui signifie essentiellement l'ère où l'activité humaine a eu un impact fondamental et qualitatif sur l'écologie de la planète) la font généralement remonter à la diffusion de l'industrie moderne au début du XIXe siècle - en bref, à la victoire du capitalisme. Mais certains parlent aussi d'une "Grande Accélération" qui a eu lieu après 1945, et on peut voir le poids de cette dernière s'accélérer encore plus après 1989 avec la montée en puissance de la Chine et d'autres pays "en développement".
Les conséquences de cette croissance sont bien connues : la contribution de la mégalopole au réchauffement de la planète par la construction sauvage, la consommation d'énergie et les émissions de l'industrie et des transports, qui rendent également l'air irrespirable dans de nombreuses villes (déjà relevées par Bordiga dans l'ouvrage Espèce humaine et croûte terrestre : "Quant à la démocratie bourgeoise, elle s'est abaissée au point de renoncer à la liberté de respirer"). L'expansion incontrôlée de l'urbanisation a été un facteur essentiel de la destruction des habitats naturels et de l'extinction des espèces ; enfin, les mégacités ont révélé leur rôle d'incubateur de nouvelles maladies pandémiques, dont la plus mortelle et la plus contagieuse -Covid-19- paralyse à l'heure actuelle l'économie mondiale et laisse une traînée de mort et de souffrance dans le monde entier. En effet, les deux dernières "contributions" se sont probablement réunies dans l'épidémie du Covid-19, qui est l'une des nombreuses épidémies où un virus a sauté d'une espèce à l'autre. C'est devenu un problème majeur dans des pays comme la Chine et dans de nombreuses régions d'Afrique où les habitats des animaux sont en train d'être détruits, ce qui entraîne une augmentation considérable de la consommation à travers la vente clandestine sur des marchés parallèles de viande d’animaux sauvages avec des espèces qui pullulent désormais en lisière de centres urbains, et où les nouvelles villes, construites pour répondre à la frénésie de croissance économique de la Chine, ont des contrôles d'hygiène minimalistes.
Surmonter l'antagonisme
Dans la liste des mesures révolutionnaires contenues dans l'article de Bordiga, le point 7 est le plus pertinent pour le projet d'abolition de l'antagonisme entre ville et campagne :
- "Arrêt de la construction» d'habitations et de lieux de travail à la périphérie des grandes villes et même des petites, comme mesure d'acheminement vers une répartition uniforme de la population sur tout le territoire. Réduction de l'engorgement, de la rapidité et du volume de la circulation en interdisant celle qui est inutile".
Ce point semble particulièrement d’actualité aujourd'hui, alors que pratiquement chaque ville est le théâtre d'une élévation "verticale" implacable (la construction d'énormes gratte-ciels, en particulier dans les centre-villes) et d'une extension "horizontale", dévorant la campagne environnante. La revendication est tout simplement la suivante : stop ! Le gonflement des villes et la concentration insoutenable de la population en leur sein sont le résultat de l'anarchie capitaliste et sont donc essentiellement non planifiés, non centralisés. L'énergie humaine et les possibilités technologiques actuellement engagées dans cette croissance cancéreuse doivent, dès le début du processus révolutionnaire, être mobilisées dans une autre direction. Même si la population mondiale a considérablement augmenté depuis que Bordiga a calculé, dans Espace contre Ciment, qu’ "en moyenne, notre espèce a un kilomètre carré pour vingt de ses membres"[19], la possibilité d'une répartition beaucoup plus rationnelle et harmonieuse de la population sur la planète demeure, même en tenant compte de la nécessité de préserver de grandes zones de nature sauvage -une nécessité mieux comprise aujourd'hui parce que l'immense importance de la préservation de la biodiversité sur la planète a été scientifiquement établie, mais c'était déjà quelque chose d'envisagé par Trotsky dans Littérature et Révolution [20].
L'abolition de l'antagonisme ville-campagne a été déformée par le stalinisme en un sens : tout paver, construire des "casernes d'ouvriers" et de nouvelles usines sur chaque champ et dans chaque forêt. Pour le communisme authentique, cela signifiera cultiver des champs et planter des forêts au milieu des villes, mais aussi que des communautés viables puissent être implantées dans une étonnante variété d'endroits sans détruire tout ce qui les entoure, et qu'elles ne soient pas isolées car elles auront à leur disposition les moyens de communication que le capitalisme a en effet développés à une vitesse ahurissante. Engels avait déjà évoqué cette possibilité dans La question du logement et Bordiga la reprend dans Espace contre ciment [31] :
- "Les formes de production les plus modernes, qui utilisent des réseaux de stations réalisations technologiques de tout genre, comme les centrales hydroélectriques, les communications, la radio, la télévision, donnent de plus en plus une discipline opérationnelle unique à des travailleurs répartis en petits groupes à d'énormes distances. Ce qui est acquis, c'est le travail associé, avec ses enchevêtrements de plus en plus vastes et merveilleux, tandis que la production autonome disparaît de plus en plus. Mais la densité technologique que nous avons évoquée diminue sans arrêt. Si l'agglomération urbaine et productive subsiste, ce n'est donc pas parce qu'elle permettrait de réaliser la production dans les meilleures conditions, c'est à cause de la permanence de l'économie du profit et de la dictature sociale du capital ".
La technologie numérique a bien sûr fait progresser ce potentiel. Mais dans le capitalisme, le résultat général de la "révolution Internet" a été d'accélérer l'atomisation de l'individu, tandis que la tendance au "travail à domicile" - particulièrement mise en évidence par la crise liée au Covid-19 et aux mesures d'accompagnement de l'isolement social - n'a pas du tout réduit la tendance à l'agglomération urbaine. Le conflit entre, d'une part, le désir de vivre et de travailler en association avec les autres et, d'autre part, la nécessité de trouver un espace pour bouger et respirer, ne peut être résolu que dans une société où l'individu n'est plus en désaccord avec la communauté.
Réduisez votre vitesse
Comme pour la construction d'habitations humaines, il en va de même pour la ruée folle des transports modernes : arrêtez, ou du moins, ralentissez !
Là encore, Bordiga est en avance sur son temps. Les modes de transport capitaliste par voies de terre, de mer et des airs, basés en grande partie sur la combustion d’énergies fossiles, sont responsables de plus de 20 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone[21], tandis que dans les villes, ils sont devenus une source majeure de maladies cardiaques et pulmonaires, touchant particulièrement les enfants. Le nombre annuel de victimes d'accidents de la route dans le monde s'élève à 1,35 million, dont plus de la moitié sont des usagers les plus "vulnérables" : piétons, cyclistes et motocyclistes[22]. Et ce ne sont là que les inconvénients les plus évidents du système de transport actuel. Le bruit constant qu'il génère ronge les nerfs des citadins, et la subordination de l'urbanisme aux besoins de la voiture (et de l'industrie automobile, si centrale dans l'économie capitaliste actuelle) produit des villes sans cesse plus fragmentées, avec des zones résidentielles divisées les unes des autres par le flux incessant du trafic. Pendant ce temps, l'atomisation sociale, caractéristique essentielle de la société bourgeoise et de la ville capitaliste en particulier, est non seulement illustrée mais renforcée par le fait que le propriétaire et conducteur d'une voiture soit en concurrence pour l'espace routier avec des millions d'âmes pareillement atomisées.
Bien entendu, le capitalisme a dû prendre des mesures pour tenter d'atténuer les pires effets de tout cela : la "taxe carbone" pour freiner les déplacements polluants excessifs, la "modération du trafic" et les voies piétonnes sans voiture dans les centres villes, le passage à la voiture électrique.
Aucune de ces "réformes" ne permet de résoudre le problème, car aucune d'entre elles ne s'attaque au rapport social capitaliste qui en est à la base. Prenons l'exemple de la voiture électrique : l'industrie automobile a prévu ce qui l'attendait et tend à se tourner de plus en plus vers cette forme de transport. Mais, même en mettant de côté le problème de l'extraction et de l'élimination du lithium nécessaire aux batteries, ou la nécessité d'augmenter la production d'électricité pour alimenter ces véhicules, qui ont tous un coût écologique important, une ville pleine de véhicules électriques serait légèrement plus silencieuse et un peu moins polluée, mais toujours dangereuse pour les piétons et les voitures.
Il est possible que le communisme fasse effectivement un usage important (mais sans doute pas exclusif) des véhicules électriques. Mais le vrai problème est ailleurs. Le capitalisme doit fonctionner à une vitesse vertigineuse parce que "le temps, c'est de l'argent" et que le mode de transport des marchandises est dicté par les besoins de l'accumulation, qui inclut le temps de "rotation" et donc le transport dans ses calculs globaux. Le capitalisme est également motivé par la nécessité de vendre le plus grand nombre de produits possible, d'où la pression constante pour que chaque individu ait sa propre possession personnelle -encore une fois, la voiture privée est devenue un symbole de richesse et de prestige personnel, la clé de la "liberté de sur la route" à une époque d'embouteillages incessants.
Le rythme de vie dans les villes d'aujourd'hui est bien plus élevé (même avec les embouteillages) qu'il ne l'était dans la deuxième partie du XIXe siècle, mais dans La femme et le socialisme[23], publié pour la première fois en 1879, August Bebel envisageait déjà la ville du futur, où "le bruit, l'entassement et la précipitation angoissants de nos grandes villes avec leurs milliers de véhicules de toutes sortes cessent substantiellement : la société prend un aspect de plus grand repos" (p. 300).
La précipitation et la congestion qui rendent la vie urbaine si stressante ne peuvent être surmontées que lorsque l'envie d'accumuler aura été supprimée, au profit d'une production planifiée pour distribuer librement les valeurs d'usage nécessaires. Dans l'élaboration des réseaux de transport de l'avenir, un facteur clé sera évidemment de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et les autres formes de pollution, mais la nécessité de parvenir à un "plus grand repos", un certain degré de calme et de tranquillité, tant pour les résidents que pour les voyageurs, sera certainement prise en compte dans la globalité du problème. Comme il y aura beaucoup moins de pression pour se rendre d'un point A à un point B au rythme le plus rapide possible, les voyageurs auront plus de temps pour profiter du voyage lui-même : peut-être, dans un tel monde, le cheval reviendra-t-il dans certaines parties du monde, les voiliers en mer, les dirigeables dans le ciel, tandis qu'il sera également possible d'utiliser des moyens de transport beaucoup plus rapides en cas de besoin[24]. En même temps, le volume du trafic sera considérablement réduit si l'on parvient à briser l'addiction à la propriété personnelle des véhicules et si les voyageurs peuvent avoir accès à divers types de transports publics gratuits (bus, trains, bateaux, taxis et véhicules sans propriétaire). Nous devons également garder à l'esprit que, contrairement aux nombreuses villes capitalistes occidentales où la moitié des appartements sont occupés par des propriétaires ou des locataires célibataires, le communisme sera une expérience de formes de vie plus communautaires ; et dans une telle société, voyager en compagnie d'autres personnes peut devenir un plaisir plutôt qu'une course désespérée entre des concurrents hostiles.
Nous devons également garder à l'esprit qu’un bon nombre des trajets qui encombrent le système de transports, ceux qui permettent d’exercer des emplois inutiles tels que ceux liés à la finance, aux assurances ou à la publicité, n'auront pas leur place dans une société sans argent. Les "heures de pointe" quotidiennes appartiendront au passé.
Ainsi, les rues d'une ville où le vrombissement de la circulation aura été réduit à un ronronnement retrouveront certains de leurs anciens avantages et usages, comme les aires de jeux pour les enfants, par exemple.
Là encore, nous ne sous-estimons pas l'ampleur des tâches à accomplir. Bien que la possibilité de vivre de manière plus communautaire ou associée soit contenue dans la transition vers un mode de production communiste, les préjugés égoïstes qui ont été fortement exacerbés par plusieurs centaines d'années de capitalisme, ne disparaîtront pas de manière automatique et constitueront en effet souvent de sérieux obstacles au processus de communisation. Comme l'a dit Marx :
- "La propriété privée nous a rendus si stupides et unilatéraux qu'un objet n'est à nous que lorsque nous le possédons, lorsqu'il existe pour nous en tant que capital ou lorsque nous le possédons directement, le mangeons, le buvons, le portons, l'habitons, etc. Bien que la propriété privée ne conçoive toutes ces réalisations immédiates de la possession que comme des moyens de vie, et que la vie qu'elles servent est la vie de la propriété privée, du travail et de la capitalisation. Par conséquent, tous les sens physiques et intellectuels ont été remplacés par la simple distanciation de tous ces sens - le sens de la propriété." (Manuscrits économiques et philosophiques de 1844, chapitre "Propriété privée et communisme").
Rosa Luxemburg a toujours soutenu que la lutte pour le socialisme n'est pas seulement une question "de pain et de beurre" mais que "Au point de vue moral, la lutte ouvrière renouvellera la culture de la société"[25]. Cet aspect culturel et moral de la lutte des classes, et surtout de la lutte contre le "sentiment de propriété", se poursuivra certainement tout au long de la période de transition vers le communisme.
CDW
[1] La transformation des rapports sociaux selon les révolutionnaires de la fin du 19e siècle [27], Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [13° partie] -Revue internationale n° 85 ; Les années 1950 et 60 : Damen, Bordiga et la passion du communisme [28], Revue internationale n° 158.
[2] 1918 : Le programme du parti communiste allemand [32], Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [3° partie] -Revue internationale n° 93 et 1919 : le programme de la dictature du prolétariat [33], Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [5° partie] -Revue internationale n° 95.
[4] Damen, Bordiga et la passion du communisme, Revue Internationale n° 158, https://en.internationalism.org/international-review/201609/14092/1950s-and-60s-damen-bordiga-and-passion-communism [35]
[5] Il faut souligner que ce texte a été adopté en tant que « document du parti » de la nouvelle organisation, et n’est pas simplement une contribution individuelle.
[6] Mais les damenistes étaient plus clairs sur beaucoup de leçons de la défaite de la Révolution russe et sur les positions du prolétariat dans la période du capitalisme décadent. Voir : Damen, Bordiga et la passion du communisme.
[7] Marc Chirik et l'État de la période de transition [36], Le communisme est à l'ordre du jour de l'histoire - Revue internationale n° 165
[8] Speeches in Elberfeld. Discours d’Elberfeld dans notre traduction.
Voir par exemple À propos du livre L'effet Darwin : une conception matérialiste des origines de la morale et de la civilisation [37].
[10] Max Weber, La ville, 1921.
[11] Voir Kohei Saito, Karl Marx’s Ecosocialism, New York, 2017
[12] Sur Marx et la question russe, voir un article précédent de cette série, Marx de la maturité : communisme du passé, communisme du futur [38], Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [11e partie] -Revue internationale n° 81.
[13] Série "Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [13° partie]"- Revue internationale n° 85 ;
[14] Revue internationale n° 158.
[15] Il Programma Comunista, No. 1 of 8-24 Janvier 1953.
[16] Il Programma Comunista no. 6/1952, 18 décembre 1952.
[17] Téléchargeable à cette adresse [39].
[18] Two-thirds of global population will live in cities by 2050, UN says [40] (Les deux-tiers de la population du globe vivront dans les villles en 2050, selon l’ONU).
[19] Bordiga a donné le nombre de 2,5 milliards. Aujourd’hui c’est plutôt 6,8 milliards. Nations Unies.
[20] Littérature et Révolution [41]. Voir aussi Trotsky et la “culture prolétarienne [42], Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [13° partie] – Revue internationale n° 111.
[22] Lire "Road safety facts".
[23] Téléchargeable à cette adresse [44].
[24] Bien sûr, les gens pourront encore apprécier le plaisir de voyager à une vitesse vertigineuse, mais peut-être que dans une société rationnelle, ces plaisirs se limiteront à des lieux réservés à cet effet.
[25] Arrêts et progrès du marxisme [45], 1903 [46].
Personnages:
- Bordiga [47]
Questions théoriques:
- Décomposition [48]
- Communisme [49]
Rubrique:
Il y a cinquante ans, mai 68 : la difficile évolution du milieu politique prolétarien (II)
- 225 lectures
Dans la première partie de cet article, nous avons examiné certains des développements les plus importants au sein du milieu prolétarien international après les événements de Mai 68 en France. Nous avons constaté que, si la résurgence de la lutte de classe avait donné un élan significatif à la relance du mouvement politique prolétarien, et donc au regroupement de ses forces, cette dynamique avait commencé à se heurter à des difficultés dès le début des années 80. Nous reprenons l'histoire à partir de ce point. Cette "histoire" ne prétend nullement être exhaustive et nous ne nous excusons pas du fait qu'elle soit présentée du point de vue " partisan " du CCI. Elle peut être complétée à l'avenir par des contributions de ceux qui peuvent avoir des expériences et des perspectives différentes.
La grève de masse en Pologne en 1980 a démontré la capacité de la classe ouvrière à s'organiser indépendamment de l'Etat capitaliste, à unifier ses luttes dans tout un pays, à unir ses revendications économiques et politiques. Mais comme nous l'avons dit à l'époque : comme en Russie en 1917, le problème pouvait se poser en Pologne, mais il ne pouvait être résolu qu'à l'échelle internationale. La classe ouvrière d'Europe de l'Ouest en particulier s'était vue lancer un défi : face à l'aggravation irréversible de la crise capitaliste, il serait nécessaire d’atteindre les mêmes sommets d'auto-organisation et d'unification de ses luttes, mais en même temps aller au-delà du mouvement en Pologne au niveau de la politisation. Les ouvriers polonais, luttant contre un régime brutal qui prétendait que les sacrifices qu'il exigeait étaient tous des pas sur la voie d'un avenir communiste, n'avaient pas pu, au niveau politique, rejeter tout une série de mystifications politiques, en particulier que leurs conditions pourraient s'améliorer avec un régime démocratique qui permette aux "syndicats libres" d'organiser la classe ouvrière. C'était la tâche spécifique des travailleurs de l'Ouest, qui avaient connu de nombreuses années d'amère expérience de la fraude de la démocratie parlementaire et du rôle de sabotage des syndicats formellement séparés de l'Etat capitaliste, de développer une perspective véritablement prolétarienne : la grève de masse progressant vers la confrontation directe avec le système capitaliste, ce qui constitue l'objectif d'une société véritablement communiste.
Et il ne fait aucun doute que les travailleurs de l'Ouest ont bien relevé le défi en luttant contre une nouvelle série d'attaques qui visaient leur niveau de vie, menée en grande partie par des régimes de droite au pouvoir, prêts à imposer des niveaux de chômage massifs pour "réduire" l'appareil économique gonflé et hérité de la période keynésienne de l'après-guerre. En Belgique, en 1983, les travailleurs ont fait des pas importants vers l'extension de la lutte - ne comptant pas sur les délibérations des responsables syndicaux mais envoyant des délégations massives dans d'autres secteurs pour les inviter à rejoindre le mouvement. Dans les deux années qui ont suivi, les grèves des ouvriers de l'automobile, de l'acier, de l'imprimerie et surtout des mineurs au Royaume-Uni ont constitué la réponse du prolétariat au nouveau régime "thatchérien".
Elles contenaient un réel potentiel d'unification à condition de se débarrasser de l'idée syndicaliste obsolète selon laquelle on peut vaincre l'ennemi capitaliste en résistant le plus longtemps possible enfermés dans un secteur. Ailleurs en Europe - parmi les cheminots et les travailleurs de la santé en France, ou les travailleurs de l'éducation en Italie - les travailleurs sont allés plus loin en essayant de rompre l'emprise paralysante des syndicats, en s'organisant en assemblées générales avec des comités de grève élus et révocables, et en faisant des efforts timides pour coordonner ces comités.
Comme nous l'avons affirmé dans la première partie de cet article, il était absolument nécessaire que les petites organisations révolutionnaires qui existaient à l'époque, même avec leurs moyens limités, participent à ces luttes, fassent entendre leur voix par la presse, des tracts, des interventions dans les manifestations, sur les piquets de grève et dans les assemblées générales, fassent des propositions concrètes pour étendre et auto-organiser la lutte, jouent un rôle dans la formation des groupes d' ouvriers combatifs qui cherchent à stimuler la lutte et à en dégager les leçons les plus importantes. Le CCI a consacré une bonne partie de ses ressources dans les années 1980 à la réalisation de ces tâches, et nous avons produit un certain nombre de polémiques avec d'autres organisations prolétariennes qui, à notre avis, n'avaient pas suffisamment saisi le potentiel de ces luttes, surtout parce qu'il leur manquait une vision générale et historique de la "marche" du mouvement de la classe[1].
Et pourtant, comme nous l'avons également reconnu ailleurs[2], nous avons nous-mêmes manqué de clarté sur les difficultés croissantes de la lutte. Nous avons eu tendance à sous-estimer l'importance des lourdes défaites subies par des secteurs emblématiques comme les mineurs au Royaume-Uni, la réelle hésitation de la classe à rejeter les méthodes et l'idéologie syndicales : même quand il y avait une forte tendance à s'organiser en dehors des syndicats, l'extrême-gauche de la bourgeoisie a créé de faux syndicats, voire des "coordinations" extra-syndicales pour maintenir la lutte dans les limites de la défense d’intérêts sectoriels et finalement du syndicalisme. Et surtout, malgré la détermination et la combativité de ces luttes, il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans le sens de dégager une perspective révolutionnaire. La politisation du mouvement est restée, au mieux, embryonnaire.
Depuis la fin des années 1980, nous soutenons que cette situation - celle d'une classe ouvrière suffisamment forte pour résister à la poussée vers une autre guerre mondiale, et pourtant incapable d'offrir à l'humanité la perspective d'une nouvelle forme d'organisation sociale - constituait une sorte d'impasse sociale qui a ouvert ce que l'on appelle la phase de la décomposition sociale. L'effondrement du bloc de l'Est en 1989, qui a marqué l'entrée définitive dans cette nouvelle phase du déclin du capitalisme, a été comme une sonnette d'alarme qui nous a fait profondément réfléchir sur le destin du mouvement de classe international qui s'était manifesté par vagues successives depuis 1968. Nous avons commencé à comprendre que la nouvelle période poserait des difficultés considérables à la classe ouvrière, notamment (mais pas seulement) à cause de la puissante campagne idéologique déchaînée par la bourgeoisie qui proclamait la mort du communisme et la réfutation finale du marxisme.
Dans la première partie de cet article, nous avons noté que, déjà au début des années 80, le milieu politique prolétarien avait traversé une crise majeure, marquée par l'échec des conférences internationales de la Gauche Communiste, les scissions au sein du CCI et l'implosion du Parti Communiste International bordiguiste (Programme Communiste). Les principales organisations politiques de la classe ouvrière sont ainsi entrées dans cette période nouvelle et incertaine dans un état d'affaiblissement et de désunion. L'échec général de la classe à politiser ses luttes a aussi signifié que la croissance très sensible du milieu politique prolétarien de la fin des années 60 et des années 70 avait commencé à ralentir ou à stagner. Par ailleurs, de notre point de vue, aucune des organisations existantes, à part le CCI, ne disposait du cadre théorique permettant de comprendre les caractéristiques de la nouvelle phase de décadence : certaines d'entre elles, comme les bordiguistes, rejetaient plus ou moins totalement le concept de décadence, tandis que d'autres, comme Battaglia Comunista et la CWO - Communist Workers Organisation - désormais regroupées au sein du BIPR (Bureau International pour le Parti révolutionnaire) disposaient d'un concept de décadence mais n’étaient pas intéressées à évaluer le rapport de force historique entre classes (que nous appelions la question du "cours historique"). L'idée d'une impasse sociale n'avait donc aucun sens pour eux.
L'impact de la décomposition
Le principal danger de la décomposition pour la classe ouvrière est qu'elle sape progressivement le fondement même de sa nature révolutionnaire : sa capacité, voire son besoin fondamental, d'association. La tendance au "chacun pour soi" est inhérente au mode de production capitaliste, mais elle prend une nouvelle intensité, voire une nouvelle qualité, dans cette phase finale de décadence capitaliste. Cette tendance peut être produite par des facteurs matériels et idéologiques - par la dispersion physique des concentrations prolétariennes à la suite de licenciements et de délocalisations massifs, et par l'effort délibéré de divisions entre travailleurs (nationales, raciales, religieuses, etc.) ; par la concurrence pour l'emploi ou les avantages sociaux et par les campagnes idéologiques sur les joies de la consommation ou de la démocratie. Mais son effet global est de miner la capacité du prolétariat à se considérer comme une classe avec des intérêts spécifiques, à se rassembler comme une classe contre le capital. Ceci est intimement lié à la diminution des luttes de la classe ouvrière au cours des trois dernières décennies.
La minorité révolutionnaire, en tant que partie de la classe, n'est pas épargnée par les pressions d'un système social en désintégration qui n'a manifestement aucun avenir. Pour les révolutionnaires, le principe de l'association s'exprime dans la formation d'organisations révolutionnaires et l'engagement dans des activités militantes organisées. La tendance contraire est la fuite vers des solutions individuelles, vers une perte de confiance dans l'activité collective, la méfiance envers les organisations révolutionnaires et le désespoir face à l'avenir. Quand le bloc de l'Est s'est effondré et que la perspective d'une profonde baisse de la lutte de classe a commencé à se manifester, notre camarade Marc Chirik, qui avait vécu toute la force de la période de contre-révolution et avait résisté à son impact par son activité militante dans les fractions de la Gauche Communiste, a dit un jour : "Maintenant nous allons voir qui sont les vrais militants". Malheureusement, Marc, décédé en 1990, n’est plus là pour nous aider à nous adapter à des conditions où nous nageons souvent à contre-courant, même s'il a certainement tout fait pour nous transmettre les principes organisationnels à même de constituer les meilleurs moyens de défense face aux tempêtes à venir.
Dans la première partie de cet article, nous avons déjà expliqué que les crises sont un produit inévitable de la situation des organisations révolutionnaires dans la société capitaliste, du bombardement incessant de l'idéologie bourgeoise sous ses diverses formes. Le CCI s'est toujours ouvert de ses propres difficultés et divergences internes, même s’il vise à les présenter de manière cohérente plutôt que de chercher à simplement "tout mettre sur la table". Et nous avons également insisté sur le fait que les crises devraient toujours obliger l'organisation à en tirer des leçons et à renforcer ainsi son propre arsenal politique.
La décomposition progressive de la société capitaliste tend à rendre ces crises plus fréquentes et plus dangereuses. Cela a certainement été le cas au CCI dans les années 90 et au début de ce siècle. Entre 1993 et 1995, nous avons fait face à la nécessité de nous confronter aux activités d'un clan qui s'était profondément enraciné dans l'organe central international du CCI, une "organisation au sein de l'organisation" qui avait une étrange ressemblance avec la Fraternité internationale des bakouninistes au sein de la Première Internationale, y compris le rôle prépondérant joué par un aventurier politique, JJ, imprégné des pratiques manipulatrices de la franc-maçonnerie. De telles prédilections pour l'occultisme étaient déjà une expression de la puissante marée d'irrationalité qui tend à balayer la société de nos jours. En même temps, la formation de clans au sein d'une organisation révolutionnaire, quelle que soit leur idéologie spécifique, est parallèle à la recherche de fausses communautés qui est une caractéristique sociale beaucoup plus large de cette période.
La réponse du CCI à ces phénomènes a été de les mettre en lumière et d'approfondir sa connaissance quant à la manière dont le mouvement marxiste s'était historiquement défendu contre eux. Nous avons ainsi produit un texte d'orientation sur le fonctionnement qui s'enracine dans les batailles organisationnelles de la Première Internationale et du POSDR, Parti ouvrier social-démocrate de Russie[3], et une série d'articles sur la lutte historique contre le sectarisme, l'aventurisme, la franc-maçonnerie, le parasitisme politique[4]. Ces articles ont en particulier identifié Bakounine en tant qu’exemple de l'aventurier déclassé qui utilise le mouvement ouvrier comme tremplin pour ses propres ambitions personnelles, et la Fraternité internationale en tant qu’exemple précoce du parasitisme politique - d'une forme d'activité politique qui, tout en travaillant en surface pour la cause révolutionnaire, mène un travail de dénigrement et de destruction qui ne peut servir que l'ennemi de classe.
Le but de ces textes n'était pas seulement d'armer le CCI contre les risques d’infection par la moralité et les méthodes de classes qui sont étrangères au prolétariat, mais de stimuler aussi un débat au sein de tout le milieu prolétarien autour de ces questions. Malheureusement, nous n'avons reçu que peu ou pas de réponse à ces contributions de la part des groupes sérieux du milieu, tels que le BIPR, qui avait tendance à les considérer seulement comme d’étranges chevaux de bataille du CCI. Ceux qui étaient déjà ouvertement hostiles au CCI - comme les restes du Communist Bulletin Group (CBG) s'en sont emparés comme preuve finale que le CCI avait dégénéré en une secte bizarre qui devait être évitée à tout prix[5]. Nos efforts pour fournir un cadre clair afin de comprendre le phénomène croissant du parasitisme politique - les thèses sur le parasitisme publiées en 1998[6] - ont suscité le même genre de réactions. Et très vite, le manque de compréhension de ces problèmes par le milieu ne s'est pas seulement traduit par une attitude de neutralité à l'égard d'éléments qui ne peuvent que jouer un rôle destructeur envers le mouvement révolutionnaire. Comme nous le verrons, il a conduit de la "neutralité" à la tolérance, puis à une coopération active avec ces éléments.
Le développement du parasitisme politique
Au début des années 2000, le CCI a de nouveau été confronté à une grave crise interne. Un certain nombre de militants de l'organisation, toujours membres de l'organe central international, qui avaient joué un rôle actif dans la dénonciation des activités du clan JJ, se sont regroupés en un nouveau clan qui reprenait certains des thèmes du précédent, notamment en ciblant des camarades qui avaient défendu le plus fermement les principes organisationnels, voire en diffusant des rumeurs selon lesquelles l'un d'entre eux était un agent de l'État manipulant les autres.
La "Fraction interne du courant communiste international" (FICCI) a amplement démontré depuis lors qu'il existe souvent une ligne de démarcation mince entre l'activité d'un clan au sein de l'organisation et celle d'une organisation parasitaire à part entière. Les éléments qui ont formé la FICCI ont été exclus du CCI pour des agissements indignes de militants communistes, notamment le vol des fonds de l'organisation et la publication d'informations internes sensibles qui auraient pu mettre nos militants en danger vis-à-vis de la police. Depuis lors, ce groupe, qui a ensuite changé de nom pour devenir le Groupe International de la Gauche Communiste, a donné de nouvelles preuves qu'il incarne une forme de parasitisme si féroce qu'il est impossible de le distinguer des activités de la police politique. En 2014, nous avons été obligés de dénoncer publiquement ce groupe qui avait à nouveau réussi à voler du matériel interne au CCI et qui cherchait à l'utiliser pour dénigrer notre organisation et ses militants[7].
Il est clair qu'un groupe qui se comporte de cette manière est un danger pour tous les révolutionnaires, quelles que soient les positions politiques formellement correctes qu'il défend. La réponse d'un milieu communiste qui comprendrait la nécessité d'une solidarité entre ses organisations serait d'exclure du camp prolétarien de telles pratiques et ceux qui s'y livrent ; il faudrait à tout le moins renouveler les traditions du mouvement ouvrier pour qui ce type de comportement, ou, des accusations contre la probité d'un militant ou d'une organisation révolutionnaire exigeaient la formation d'un "Jury d'honneur" pour établir la vérité sur ces conduites ou accusations[8] . En 2004, cependant, une série d'événements que nous avons appelés l'affaire "Circulo" a montré à quel point le mouvement politique prolétarien actuel s'est éloigné de ces traditions.
En 2003, le CCI est entré en contact avec un nouveau groupe en Argentine, le Nucleo Comunista Internationalista (NCI). Après d'intenses discussions avec le CCI, il y a eu un rapprochement incontestable vers les positions de notre organisation et la question de former éventuellement une section du CCI en Argentine a été posée. Cependant, un membre de ce groupe, que nous avons appelé "B", détenait le monopole de l'équipement informatique à la disposition des camarades et donc de la communication avec d'autres groupes et individus, et il était devenu clair au cours de nos discussions que cet individu se considérait comme une sorte de gourou politique qui s'était arrogé la tâche de représenter le NCI dans son ensemble. Lors de la visite de la délégation du CCI en 2004, B" a demandé que le groupe soit immédiatement intégré au CCI. Nous avons répondu que nous étions avant tout intéressés à la clarté politique et non à la création de franchises commerciales et qu'il fallait encore beaucoup de discussions avant qu'une telle étape puisse être franchie. Son ambition d'utiliser le CCI comme tremplin pour son prestige personnel ainsi contrarié, B a alors fait volte-face en adoptant un brusque revirement : à l'insu des autres membres du NCI, il est entré en contact avec la FICCI et, avec leur soutien, il a soudain déclaré que le NCI avait rompu avec le CCI à cause de ses méthodes staliniennes et avait formé un nouveau groupe, le Circulo de Comunistas Internacionalistas. Jubilation de la part de la FICCI qui s'est fait une joie de publier cette grande nouvelle dans son bulletin. Mais le pire, c'est que le BIPR - qui était aussi entré en contact avec la FICCI, sans doute flatté par la déclaration de cette dernière selon laquelle, maintenant que le CCI avait complètement dégénéré, il était devenu le véritable pôle du regroupement des révolutionnaires - a également publié la déclaration du Circulo sur son site Internet, en trois langues.
La réponse du CCI à cette lamentable affaire a été très circonstanciée. Après avoir établi les faits - que le nouveau groupe était en fait une pure invention de B, et que les autres membres du NCI n'avaient rien su de la prétendue scission avec le CCI - nous avons écrit une série d'articles dénonçant le comportement aventurier de B, l'activité parasitaire de la FICCI - et l'opportunisme du BIPR, qui était prêt à prendre tout un tas de calomnies contre le CCI au pied de la lettre, sans aucune tentative d'enquête, et avec l'idée de démontrer que "quelque chose bouge en Argentine " - loin du CCI mais dans leur direction du BIPR. Ce n'est que lorsque le CCI a formellement prouvé que B était effectivement un imposteur politique, et lorsque les camarades du NCI eux-mêmes ont nié avoir rompu avec le CCI, que le BIPR a discrètement supprimé les documents du Circulo de son site Web, sans donner aucune explication et encore moins fait aucune forme d’autocritique. Une attitude tout aussi ambiguë s'est manifestée à peu près à la même période lorsqu'il est devenu évident que le BIPR avait utilisé une liste d'adresses volées par la FICCI lors de son expulsion du CCI pour annoncer une réunion publique du BIPR à Paris[9].
Cette affaire démontre que le problème du parasitisme politique n'est pas une simple invention du CCI, et encore moins un moyen de faire taire ceux qui s'opposent à nos analyses, comme cela a été affirmé. C'est un réel danger pour la santé du milieu prolétarien et un sérieux obstacle à la formation du futur parti de classe. C'est ce que concluent nos thèses sur le parasitisme :
- "Ce qui était valable au moment de l’AIT le reste aujourd’hui. La lutte contre le parasitisme constitue une des responsabilités essentielles de la Gauche communiste. Elle se rattache étroitement à la tradition de ses combats acharnés contre l’opportunisme. Elle est, à l’heure actuelle, une des composantes fondamentales pour la préparation du parti de demain et conditionne en partie, de ce fait, tant le moment où celui-ci pourra surgir que sa capacité à jouer son rôle lors des luttes décisives du prolétariat ".
Les groupes parasites ont pour fonction de semer la division dans le camp prolétarien en répandant des rumeurs et des calomnies, en y introduisant des pratiques étrangères à la morale prolétarienne, comme le vol et les manœuvres en coulisse. Le fait que leur principal objectif ait été de construire un mur autour du CCI, de l'isoler des autres groupes communistes et d’empêcher des éléments émergents de s’engager avec nous ne signifie pas qu'ils ne font que nuire au CCI - tout le milieu et sa capacité à coopérer en vue de former le parti du futur sont affaiblis par leur activité. De plus, comme leurs attitudes nihilistes et destructrices sont le reflet direct du poids croissant de la décomposition sociale, on peut s'attendre à ce qu'elles soient de plus en plus présentes dans la période à venir, surtout si le milieu prolétarien reste ouvert au danger qu'elles représentent.
2004-2011 : l'émergence de nouvelles forces politiques et les difficultés rencontrées
L'article sur notre expérience avec le NCI traite de la relance de la lutte de classe et de l'apparition de nouvelles forces politiques. Le CCI avait noté des signes de cette reprise en 2003, mais la preuve la plus claire que quelque chose était en train de changer était la lutte des étudiants contre la loi sur le Contrat Première Embauche (CPE) en France en 2006, un mouvement qui montrait une réelle capacité d'auto-organisation en assemblées et qui menaçait de s'étendre aux secteurs salariés, obligeant ainsi le gouvernement à annuler le CPE. La même année, la forme "assemblée" a été adoptée par les sidérurgistes de Vigo qui ont également montré une réelle volonté d'intégrer d'autres secteurs dans le mouvement. Et à la suite du krach financier de 2008, en 2010, nous avons assisté à une lutte importante des étudiants universitaires et du secondaire autour des frais d’inscription et des bourses au Royaume-Uni, et à un mouvement contre les "réformes" des retraites en France. L'année suivante, 2011, a vu l'éclatement du "printemps arabe", une vague de révoltes sociales où l'influence du prolétariat variait d'un pays à l'autre mais qui, en Egypte, en Israël et ailleurs a donné au monde l'exemple de l'occupation des places publiques et de la tenue d’assemblées régulières - un exemple repris par le mouvement Occupy aux Etats-Unis, par les assemblées en Grèce et de façon plus importante encore par le mouvement des Indignados en Espagne. Ce dernier, en particulier, a jeté les bases d'un certain degré de politisation à travers des débats animés sur l'obsolescence du capitalisme et la nécessité d'une nouvelle forme de société.
Cette politisation à un niveau plus général s'est accompagnée de l'apparition de nouvelles forces à la recherche de réponses révolutionnaires à l'impasse de l'ordre social. Un certain nombre de ces forces était orienté vers les positions et les organisations de la Gauche Communiste. Deux groupes différents de Corée du Sud ont été invités aux congrès du CCI durant cette période, ainsi que le groupe EKS de Turquie et de nouveaux contacts aux États-Unis. Des discussions ont commencé avec des groupes ou cercles de discussion en Amérique du Sud, dans les Balkans et en Australie ; certains de ces groupes et cercles sont devenus de nouvelles sections du CCI (Turquie, Philippines, Équateur, Pérou). La TCI a également gagné de nouvelles forces depuis de cette période.
Il y a eu aussi un développement important d'un courant internationaliste dans l'anarchisme, qui s'est manifesté par exemple dans les discussions sur le forum internet libcom, et dans la croissance de nouveaux groupes anarcho-syndicalistes qui ont critiqué le syndicalisme "institutionnalisé" d'organisations comme la CNT.
Le CCI a réagi le plus largement possible à ces développements, ce qui était absolument nécessaire : sans transmettre l'héritage de la Gauche Communiste à une nouvelle génération, il ne peut y avoir aucun espoir d'un mouvement vers le parti du futur.
Mais il y avait d'importantes faiblesses dans notre intervention. Quand nous disons que l'opportunisme et le sectarisme sont des maladies du mouvement ouvrier, le résultat de la pression constante de l'idéologie des autres classes sur le prolétariat et ses organisations politiques, nous ne l'utilisons pas seulement comme un moyen de critiquer d'autres organisations, mais comme une moyen d’évaluer notre propre capacité à résister à cette pression et à maintenir les méthodes et acquis de la classe ouvrière dans toutes les dimensions de notre activité.
La section turque du CCI, intégrée en 2009, a quitté le CCI en 2015 pour former un groupe de courte durée, Pale Blue Jadal. Dans notre tentative de dresser le bilan de cet échec, nous avons mis en lumière nos propres erreurs opportunistes dans le processus de leur intégration :
- "Notre intégration du groupe EKS en tant que section turque du CCI a été un processus infesté d'opportunisme. Nous ne proposons pas ici de préciser les raisons de cette situation : il suffit de dire que nous avons essayé de forcer le rythme de l'histoire, et c'est une recette classique de l'opportunisme.
Forcer le rythme, bien sûr, c'était à notre propre niveau ; cela signifiait principalement de décider d'accélérer les discussions avec le groupe EKS, qui allait devenir notre section en Turquie. En particulier, nous avons décidé :
- 1. De réduire drastiquement le temps consacré aux discussions organisationnelles avec les membres d'EKS avant leur intégration, au motif que l'art de construire une organisation s'apprend essentiellement par l'expérience.
- 2. D’intégrer l'EKS en tant que groupe et non en tant qu'individus. Bien que nos statuts le prévoient, il y a le danger que les nouveaux militants se voient, non pas d'abord et avant tout comme des militants individuels d'une organisation internationale, mais comme des membres de leur groupe d'origine"[10].
Comme nous l'avons fait valoir dans la première partie de cet article, opportunisme et sectarisme vont souvent de pair. Et, rétrospectivement, certains éléments de notre réponse à l'affaire Circulo peuvent certainement être considérés comme sectaires. Compte tenu d'une part de l'émergence de nouvelles forces politiques, d'autre part des dernières preuves de la difficulté du BIPR à se comporter selon des principes clairs et du sectarisme inaltérablement rigide des bordiguistes, le CCI avait une certaine tendance à conclure que le "vieux milieu" était déjà épuisé et que nos espoirs pour l'avenir devaient reposer sur ces nouvelles forces que nous commençons à rencontrer.
C'était le côté sectaire de notre réaction. Mais encore une fois, il avait aussi un côté opportuniste. Pour convaincre le nouveau milieu que nous n'étions pas sectaires, en 2012 nous avons fait de nouvelles ouvertures à la TCI, plaidant pour une reprise des discussions et des travaux communs qui avaient été perturbés depuis l'échec des conférences internationales au début des années 80. C'était correct en soi et c'était la continuation d'une politique que nous avions menée, sans grand succès, tout au long des années 80 et 90[11]. Mais pour lancer ce processus, nous avons accepté à première vue l'explication que la TCI a fournie concernant son comportement dans l'affaire Circulo : qu’il s’agissait essentiellement de l'œuvre d'un camarade qui était mort par la suite. Mis à part la moralité douteuse d'une telle approche de sa part, elle n'a apporté absolument aucune clarification de la part de la TCI sur sa volonté de renoncer à former une alliance avec des éléments qui n'avaient pas vraiment leur place dans le milieu prolétarien. Et à la fin, les discussions que nous avons entamées avec la TCI se sont vite enlisées sur ce fossé jusqu'ici infranchissable de la question du parasitisme - la question de savoir quels groupes et éléments peuvent être considérés comme des composantes légitimes de la Gauche Communiste. Et ce n'était pas le seul exemple d'une tendance du CCI à mettre de côté cette question vitale parce qu'elle était résolument impopulaire dans le milieu prolétarien. Elle comprenait également l'intégration de l'EKS qui n'a jamais été d'accord avec nous sur la question du parasitisme, et des approches auprès de groupes que nous considérions nous-mêmes comme parasites, tels que le CBG (approches qui ne mènent nulle part).
Les articles du CCI de cette période montrent un optimisme compréhensible quant au potentiel des nouvelles forces (voir par exemple l'article sur notre 18e congrès[12]). Mais il y avait en même temps une sous-estimation de beaucoup des difficultés de ces nouveaux éléments qui étaient apparus dans la phase de décomposition.
Comme nous l'avons dit, un certain nombre d'éléments issus de cette recrudescence se sont dirigés vers la Gauche Communiste et certains ont été intégrés dans ses principales organisations. Dans le même temps, nombre de ces éléments n'ont pas survécu très longtemps - non seulement la section turque du CCI, mais aussi le NCI, le groupe de discussion formé en Australie[13], et un certain nombre de contacts qui sont apparus aux États-Unis. Plus généralement, l'influence de l'anarchisme sur cette nouvelle vague d'éléments "en recherche" a été omniprésente, exprimant dans une certaine mesure le fait que le traumatisme du stalinisme et l'impact qu'il a eu sur la notion d'organisation politique révolutionnaire étaient encore un facteur opérationnel dans la deuxième décennie après l'effondrement du bloc russe.
Le développement du milieu anarchiste à cette époque n'a pas été entièrement négatif. Par exemple, le forum Internet libcom, qui a fait l'objet de nombreux débats politiques internationaux au cours de la première décennie de son existence, était dirigé par un collectif qui avait tendance à rejeter le gauchisme et les formes de mode de vie anarchiste et à défendre certaines des bases de l'internationalisme. Certains d'entre eux étaient issus de l'activisme superficiel du milieu "anticapitaliste" des années 1990 et avaient commencé à considérer la classe ouvrière comme la force du changement social. Mais cette quête a été en grande partie bloquée par le développement de l'anarcho-syndicalisme, qui réduit la reconnaissance tout à fait valable du rôle révolutionnaire de la classe ouvrière à une perspective économique incapable d'intégrer la dimension politique de la lutte de classe, et qui remplace l'activisme limité à la rue par l'activisme au travail (la notion de formation des "organisateurs" et de "syndicats révolutionnaires"). Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce milieu a aussi été influencé par les théories de la "communisation", qui est l'expression très explicite d'une perte de conviction que le communisme ne peut se réaliser que par la lutte de la classe ouvrière. Mais le paradoxe est plus apparent que réel, puisque le syndicalisme et la communisation reflètent une tentative de contourner la réalité qu'une lutte révolutionnaire est aussi une lutte pour le pouvoir politique, et exige la formation d'une organisation politique prolétarienne. Plus récemment, libcom et d'autres expressions du mouvement anarchiste ont été aspirées dans diverses formes de politique identitaire, ce qui constitue la poursuite de l'éloignement par rapport à un point de vue prolétarien[14]. Pendant ce temps, d'autres secteurs du mouvement anarchiste ont été complètement aspirés par les prétentions du nationalisme kurde d'avoir établi une sorte de Commune révolutionnaire à Rojava.
Il faut dire aussi que le nouveau milieu - et même les groupes révolutionnaires établis - avaient peu de défenses contre l'atmosphère morale délétère de la décomposition et en particulier l'agression verbale et les attitudes qui infestent souvent les réseaux sociaux. Sur libcom, par exemple, les membres et sympathisants des groupes communistes de Gauche, et du CCI en particulier, ont dû se battre avec acharnement pour franchir un mur d'hostilité dans lequel les calomnies des groupes parasites comme le CBG étaient généralement considérées comme allant de soi. Et alors que certains progrès au niveau de la culture du débat semblaient se produire dans les premières années de libcom, l'atmosphère s'est nettement détériorée à la suite de l’implication du "collectif libcom" dans le scandale "Aufhebengate". À cette occasion, la majorité du collectif a adopté une attitude de clique en défendant un de ses amis du groupe Aufheben qui avait clairement montré avoir coopéré avec les stratégies policières contre des manifestations de rue[15].
D'autres exemples de ce type de décadence morale parmi ceux qui professent la cause du communisme pourraient être donnés, le membre du groupe de communisateurs grec, Blaumachen, qui est devenu ministre du gouvernement SYRIZA étant peut-être l'un des plus évidents[16]. Mais les groupes de la Gauche Communiste n'ont pas été épargnés par ces difficultés non plus : nous avons déjà mentionné les alliances douteuses que le BIPR a établies avec certains groupes parasites. Et plus récemment, le BIPR a d'abord été contraint de dissoudre sa section au Canada qui avait adopté une attitude apologétique envers l'un de ses membres qui s'était livré à des abus sexuels, tandis qu'un groupe de sympathisants grecs s'est soudainement retrouvé dans le nationalisme le plus féroce face à la crise de l'immigration[17]. Et le CCI lui-même a connu ce que nous avons appelé une "crise morale et intellectuelle" lorsque l'une de nos camarades, parmi les plus déterminés dans son opposition aux politiques opportunistes que nous avions adoptées dans certaines de nos activités (et qui avait été auparavant la cible des clans des années 90), a été soumise à une campagne la prenant comme "bouc émissaire"[18]. Un "Jury d'honneur" constitué au sein de l'organisation a estimé que toutes les charges retenues contre elle étaient nulles et non avenues.
Ces événements démontrent que la question du comportement, de l'éthique et de la morale a toujours été un élément clé dans la construction d'une organisation révolutionnaire digne de ce nom. Le mouvement révolutionnaire ne pourra pas surmonter ses divisions sans affronter cette question.
Problèmes contemporains et perspectives futures
Les signes d'une relance de la lutte de classe apparue en 2006-2011 ont été largement éclipsés par une vague réactionnaire qui s'est traduite par la montée du populisme et l'installation d'une série de régimes autoritaires, notamment dans un pays comme l'Egypte qui était au centre du "printemps arabe". La résurgence du chauvinisme et de la xénophobie a touché certains des domaines-mêmes où, en 2011, les premiers signes d'une nouvelle floraison internationaliste semblaient apparaître, notamment la vague du nationalisme en Catalogne, qui auparavant avait été au cœur du mouvement des Indignados. Et si la montée du nationalisme met en évidence le danger des conflits impérialistes sanglants dans la période à venir, elle souligne également l'incapacité totale du système existant, déchiré par la rivalité et la concurrence, à faire face à la menace croissante de destruction de l'environnement. Tout cela contribue à créer un climat généralisé de déni de l'avenir apocalyptique que nous réserve le capitalisme, ou de nihilisme et de désespoir.
Bref, le sombre climat social et politique ne semble pas propice au développement d'un nouveau mouvement révolutionnaire, qui ne peut être présagé que par la conviction qu'un avenir alternatif est possible.
Et encore une fois, peu de progrès ont été réalisés dans l'amélioration des relations entre les groupes communistes existants, où il semble qu'à un pas en avant succèdent deux pas en arrière : ainsi, si en novembre 2017 la CWO a accepté l'invitation du CCI pour faire une présentation lors de notre journée de discussion sur la révolution d'Octobre, depuis lors ils ont constamment rejeté toute autre initiative de ce type.
Cela signifie-t-il, comme l'a récemment affirmé un membre de la CWO, que le CCI est démoralisé et pessimiste quant à l'avenir de la lutte des classes et au potentiel pour la formation du parti de demain ? [19]
Nous ne voyons certainement aucun sens à nier les difficultés bien réelles auxquelles la classe ouvrière est confrontée et à développer une présence communiste en son sein. Une classe qui a de plus en plus perdu le sens de sa propre existence en tant que classe n'acceptera pas facilement les arguments de ceux qui, contre toute attente, continuent d'insister sur le fait que le prolétariat non seulement existe mais détient la clé de la survie de l'humanité.
Et pourtant, malgré les dangers très tangibles de cette dernière phase de décadence capitaliste, nous ne pensons pas que la classe ouvrière ait dit son dernier mot. Il reste un certain nombre d'éléments indiquant les possibilités d'un éventuel rétablissement de l'identité et de la conscience de classe parmi les nouvelles générations du prolétariat, comme nous l'avons affirmé lors de notre 22e Congrès dans notre résolution sur la lutte de classe internationale[20].
Et nous assistons également à un nouveau processus de politisation communiste au sein d'une minorité, petite mais significative, de cette nouvelle génération, qui prend souvent la forme d'une interaction directe avec la Gauche Communiste. Des personnes en quête d'éclaircissements ainsi que de nouveaux groupes et cercles sont apparus aux Etats-Unis en particulier, mais aussi en Australie, en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud, C'est un véritable témoignage de la capacité de la "vieille taupe" de Marx à continuer à avancer sous la surface des événements.
Comme les nouveaux éléments apparus il y a une dizaine d'années, ce nouveau milieu est confronté à de nombreux dangers, notamment l'offensive diplomatique de certains groupes parasites et l'indulgence des organisations prolétariennes comme le BIPR à leur égard. Il est particulièrement difficile pour beaucoup de ces jeunes camarades de comprendre le caractère nécessairement à long terme de l'engagement révolutionnaire et la nécessité d'éviter l'impatience et les précipitations. Si leur apparence exprime un potentiel qui réside encore profondément dans les entrailles de la classe ouvrière, il est vital pour eux de reconnaître que leurs débats et activités actuels n'ont de sens que dans le cadre d'un travail vers l'avenir. Nous reviendrons sur cette question dans de prochains articles.
De toute évidence, les organisations existantes de la Gauche Communiste ont un rôle clé dans la lutte pour l'avenir à long terme de ces nouveaux camarades. Et ceux-ci ne sont pas à l'abri des dangers, comme nous l'avons déjà mentionné à propos de la vague précédente d'"éléments de recherche". En particulier, ils doivent éviter de courtiser toute popularité facile en évitant de discuter de questions difficiles ou d'édulcorer leurs positions dans le but de "gagner un public plus large". Une tâche centrale des organisations communistes existantes est fondamentalement la même que celle des Fractions qui se sont détachées de l'Internationale Communiste en dégénérescence afin de jeter les bases d'un nouveau parti lorsque les facteurs objectifs et surtout les facteurs subjectifs de la situation auront mis cela à l'ordre du jour : un combat intransigeant contre l'opportunisme sous toutes ses formes, et pour une rigueur maximale dans le processus de clarification politique.
Amos
[1] Voir par exemple: Revue internationale n° 55, "Décantation du milieu politique prolétarien et oscillations du BIPR [50]" ; Revue internationale n° 56 "Vingt ans depuis 1968 : l'évolution du milieu politique depuis 1968 (3ème partie) [51]".
[2] Voir par exemple le "Rapport sur la lutte des classes au 21e congrès du CCI [52]", dans la Revue internationale n° 156.
[3] Revue internationale n° 109, La question du fonctionnement de l'organisation dans le CCI [53].
[4] Publié dans les numéros 84, 85, 87, 88 de la Revue internationale.
[5] Revue internationale n° 83, Parasitisme politique : le “C.B.G” fait le travail de la bourgeoisie.
[6] Revue internationale n° 94, Thèses sur le parasitisme [54].
[8] Le jury d’honneur : une arme pour la défense des organisations révolutionnaires (Partie 1) [56] ; Le jury d’honneur : une arme pour la défense des organisations révolutionnaires (Partie 2) [56]
[9] Sur l’affaire Circulo , voir par exemple la Revue internationale n°120, Le Núcleo Comunista Internacional : Un effort de prise de conscience du prolétariat en Argentine [57] ; la Revue internationale n° 121, Polémique avec le BIPR : Une politique opportuniste de regroupement qui ne conduit qu'à des "avortements" [58].
[11] Par exemple, les appels au milieu prolétarien lancés par nos congrès de 1983, 1991 et 1999, ces deux derniers ont accompagné une proposition d'intervention conjointe contre les guerres dans le Golfe et dans les Balkans ; la tenue d'une réunion commune sur la révolution russe en 1997, etc.
[12] Revue Internationale n° 138 : 18e congrès du CCI : vers le regroupement des forces internationalistes [60].
[14] Lire en anglais On recent attacks on the ICC on libcom [62]
[15] Lire en anglais Aufhebengate [63]
[16] Lire en anglais "Dialectical delinquents".
[17] Lire en anglais ICT Statement on the Dissolution of the GIO [64]
[18] Revue internationale n° 153, Conférence internationale extraordinaire du CCI : la "nouvelle" de notre disparition est grandement exagérée! [65]
[19] "Et où en est le CCI aujourd'hui ? Est-il le vestige démoralisé et vaincu d'une organisation autrefois plus grande, construite sur l'illusion que la révolution était à nos portes. Aujourd'hui, il se console en parlant de chaos et de décomposition (ce qui est vrai mais est le résultat de la crise capitaliste qui s'aggrave et non d'une paralysie de la lutte des classes comme le soutient le CCI). Quand le CCI affirme qu'aujourd'hui ils ne sont qu'une "fraction" (et ment ouvertement en disant que cela n'a toujours été qu'une fraction !), ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a rien à faire sinon écrire de stupides polémiques contre d'autres organisations (mais cela a été la méthode du CCI depuis 1975)". Article signé par la rédactrice en chef du forum, Cleishbotham, sur le forum BIPR à la suite d'une discussion sur le rapport de forces entre les classes avec un sympathisant du CCI : The Party, Fractions and Periodisation [66].
[20] Revue internationale n° 159, "22ème congrès du CCI : Résolution sur la lutte de classe internationale [67]"
Structure du Site:
- Séries [68]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [69]
