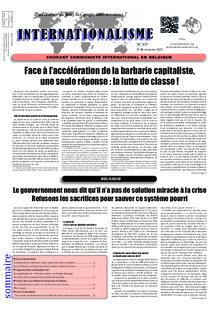Internationalisme - les années 2020
- 227 lectures
Structure du Site:
Internationalisme - 2020
- 78 lectures
Internationalisme n° 372 - 1e & 2e trimestre 2020
- 65 lectures
Instabilité politique en Belgique et COVID-19: Les prolétaires ne doivent pas payer pour le pourrissement croissant du système
- 148 lectures
Près d'un an après les élections du 26 mai 2019, les partis politiques continuent de se chamailler à propos de la formation d'une coalition gouvernementale et laissent la gestion des problèmes à un gouvernement « d’affaires courantes ». Entre-temps, le budget et les finances publiques dérapent et la pandémie de Covid-19 sévit. Quelle est la cause de cette dérive politique et quelles en sont les implications pour la gestion de la crise sanitaire et de la catastrophe économique qui l’accompagne ?
1. La crise des partis politiques traditionnels
A côté du vote protestataire massif et de la montée des courants populistes, l’autre résultat significatif des élections du 26 mai 2019 a été le recul important des familles politiques traditionnelles, qui dominent le jeu parlementaire au sein de l'appareil d'État bourgeois depuis près de 200 ans.
Depuis la création de la Belgique, le Parti catholique et le Parti libéral occupent une place centrale dans l’appareil politique de la bourgeoisie et, depuis la première guerre mondiale, cela a également été le cas pour le Parti socialiste. Tout au long du XXe siècle, ces partis ont continué à jouer un rôle capital dans le jeu politique et dans la gestion de l'appareil d'État. Ce n'est que pendant l’entre-deux-guerres que les partis flamingants et fascistes (principalement le VNV et Rex) perturbent temporairement l’agencement des forces politiques et à partir des années 1970, c'est à nouveau le cas avec l’avènement de partis linguistiques régionalistes (le Rassemblement Wallon, le Front des Francophones, la Volksunie et plus tard la NVA).
Au début des années 2000, il devient cependant de plus en plus difficile pour ces familles traditionnelles de contrôler le jeu électoral. Cela était déjà évident après les élections de 2007, menant à de difficiles négociations gouvernementales pendant194 jours, et surtout après les élections de 2010, où il a fallu 541 jours avant qu'un nouveau gouvernement de coalition puisse être formé. Ces difficultés se sont fortement intensifiées après les élections de mai 2019. Certes, le parti nationaliste flamand, la NVA, le plus grand parti de Flandre, a aussi fort reculé, ce qui a également conduit à des tensions internes, mais ce sont principalement les 3 familles traditionnelles qui subissent des pertes électorales sévères :
- pour les chrétiens-démocrates flamands (CD&V), le résultat constitue un creux historique en Flandre, alors que la famille démocrate-chrétienne est devenue quasi inexistante en Wallonie;
- la famille socialiste reste la plus importante de Wallonie, mais avec le score le plus bas jamais enregistré; en Flandre, les socialistes obtiennent encore un maigre 10% des voix;
- la famille libérale a également été sanctionnée: elle a reculé en Wallonie et encore plus clairement en Flandre.
Les résultats désastreux ont conduit à des tensions diverses au sein de ces partis traditionnels. Au sein de la famille libérale, un conflit ouvert a éclaté chez les libéraux flamands (VLD) entre l'aile libérale de gauche autour de Bart Somers et Mathias De Clercq et leurs concurrents libéraux de droite autour d'Egbert Lachaert et Vincent Van Quickenborne. Parmi les libéraux francophones (MR), des politiciens inconnus et inexpérimentés, comme Pierre-Yves Bouchez et Sophie Wilmès, ont été mis à la tête du parti et même du gouvernement «d’affaires courantes» après la «fuite» vers des postes très lucratifs au sein de l’UE de l’ex Premier ministre Charles Michel et du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders. Chez les chrétiens-démocrates flamands, l'élection d'un nouveau président de parti a mené à un parti divisé : le candidat de «l'establishment» (Coens) a gagné difficilement contre le candidat des «rénovateurs» (Mahdi). Enfin, chez les socialistes flamands décimés du SP.a, aucune figure de proue du parti n’a osé se présenter à la présidence, abandonnant la tâche à un illustre inconnu : Conner Rousseau, 26 ans.
2. Une expression de la perte de contrôle croissante de la bourgeoisie sur son jeu politique
La perte de crédibilité des partis politiques classiques et les manœuvres politiciennes affligeantes qui en découlent ne se limitent pas à la Belgique. C'est une tendance qui apparaît également dans plusieurs autres pays d'Europe occidentale :
- «les années écoulées sont plutôt caractérisées par une tendance irréversible au déclin des partis socialistes.» (...) «le parti socialiste a disparu en Italie, est menacé de disparition en France, en Hollande ou en Grèce, est en crise profonde en Allemagne, en Espagne ou en Belgique»[1] ;
- Les partis à la droite du spectre politique ont également subi un recul électoral important. Les Républicains (à droite) en France, la CDU en Allemagne et le CDA aux Pays-Bas ont vu le nombre de leurs électeurs diminuer progressivement, tandis que les chrétiens-démocrates en Italie ont pratiquement disparu de la scène politique.
Le déclin des partis traditionnels s'est accompagné d'une forte émergence de mouvements, de partis ou de personnalités populistes dans la plupart des pays européens et aux États-Unis, alimentant une contestation profonde des élites politiques établies. Ce sentiment «anti-gestionnaire» est également fortement présent en Belgique et ne se limite pas à des partis populistes comme le Vlaams Belang. Une étude réalisée par des politologues de cinq universités belges a conclu que l'aversion pour l'establishment politique, l'une des caractéristiques essentielles du populisme, augmente dans la société et qu'un climat général anti-politique se développe même parmi les électeurs. Les Belges considèrent majoritairement leurs politiciens comme des incapables et près de 60% pensent que les politiciens ne comprennent pas ce qui se passe dans la société.
Cette aversion et cette colère envers les «élites politiques» établies se reflètent d'une part dans l’ascension rapide de mouvements et de leaders populistes. D’autre part, cela conduit aussi à l'affaiblissement électoral et à la déstabilisation politique des partis traditionnels, comme nous le vivons en Belgique. Ces deux phénomènes, l'émergence de mouvements et de figures populistes et l'érosion des partis politiques traditionnels, sont des manifestations claires de l'une des expressions les plus caractéristiques de la période actuelle de décomposition du capitalisme: la perte de contrôle croissante par la classe dirigeante de la machine politique. L'élection de Trump, en 2016, l’illustrait déjà de manière évidente : «Pour ceux d'entre eux qui ont perdu espoir de devenir "grands" à nouveau, leur soutien à Trump était avant tout une sorte de vandalisme politique, une vengeance aveugle contre l'élite dirigeante ».[2] La présidence de Trump depuis 2017 symbolise la folie d'un système dont les possibilités s'épuisent. La victoire électorale [en 2018] des populistes du «Mouvement 5 étoiles» de Di Maio et de la «Lega Nord» de Salvini en Italie le montre aussi clairement: «La présence du phénomène populiste et le discrédit des partis historiques expliquent aussi la difficulté croissante pour la bourgeoisie internationale et, en particulier en Italie, de contrôler le cirque électoral et de prédire son issue.».[3]
Le déclin électoral des partis traditionnels en Belgique et les dérives politiques qui en résultent ne sont donc rien d'autre qu'une expression locale de cette tendance générale à la perte de contrôle de l’appareil politique, à laquelle est confrontée la bourgeoisie dans tous les pays. Quelles en sont les conséquences en période de violentes secousses comme nous les subissons aujourd'hui?
3. Manoeuvres politiciennes et crise du covid-19 : la facture est présentée aux travailleurs
Du fait de cette instabilité politique, l'État est «dirigé» depuis un an par un gouvernement «d’affaires courantes», que tous les poids lourds politiques ont quitté, et qui se caractérise par un immobilisme et une absence de gestion à long terme. Les conséquences de ce cirque cynique au sein de la classe dirigeante sont incalculables pour la population et surtout pour la classe ouvrière.
Des perspectives économiques médiocres et le dérapage des finances publiques trahissaient déjà en février un État en situation financière et économique précaire. Selon les prévisions de la Commission européenne à l'époque, l'économie belge était l'un des élèves les plus faibles d'une classe européenne aux performances globales peu brillantes, et cela en partie en raison du déficit budgétaire et de l'endettement persistants du pays, ce qui a eu pour conséquence que des mesures n’ont pu être prises pour constituer des réserves. Au contraire, il s'est avéré que l'inaction et les tergiversations du gouvernement d’affaires courantes ont eu pour conséquence que le déficit budgétaire, qui s'élevait à 9 milliards d'euros en 2019, augmenterait à 12 milliards d'euros en 2020. C'est dans cette situation de faiblesse que l’ouragan Corona a fondu sur l'économie belge, qui se voit confrontée dès à présent à 1.250.000 «chômeurs techniques», à des pertes économiques d’au moins 40 milliards d'euros et à une baisse du PNB, provisoirement estimée à environ 7%.
Le bras de fer pathétique entre partis bourgeois a atteint un sommet cynique au début de la crise du covid-19. Alors que les travailleurs du secteur de la santé se préparaient au raz de marée de la pandémie, les efforts pour former un gouvernement d'urgence avec les principaux partis politiques pour faire face aux répercussions de la crise sur les soins de santé et l'économie se sont transformés en un cirque politicien répugnant. Les tentatives ont échoué en fin de compte parce que les deux principaux partis (le PS wallon et la NVA flamande) ont tous deux exigé le poste de Premier ministre pour exploiter politiquement la crise. De fait, à travers ce poste, ils espéraient tirer un avantage politique et personnel de la gestion de la crise du Covid-19. Finalement, il a été décidé de laisser cette responsabilité au gouvernement d’affaires courantes, dirigé par des politiciens de second ordre, qui a reçu certains «pouvoirs spéciaux». Cette irresponsabilité politique ne faisait que préfigurer l’irresponsabilité sur le plan sanitaire.
Comme pour d'autres pays européens, il est vite apparu que la bourgeoisie belge, pour des raisons d’économies budgétaires et parce qu’elle était plus occupée par les escarmouches politiques entre partis, est entrée dans la pandémie sans préparation et sans coordination: les réserves stratégiques de matériel médical (masques, combinaisons de sécurité, protections oculaires, matériel de test ...) avaient été démantelées, la coordination entre les actions du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux était lacunaire. Tandis que le gouvernement dans sa communication de crise se cache hypocritement derrière les recommandations des scientifiques, le personnel des hôpitaux, des maisons de repos, des soins à domicile, ou dans le secteur alimentaire est souvent exposé au virus sans protection adéquate. Dans les maisons de soins et de repos plus particulièrement, une tragédie se déroule : des dizaines de milliers de personnes âgées infectées par le virus sont isolées dans ces institutions et des milliers y meurent. Les réactions indignées de nombreux travailleurs de la santé et les grèves dans les transports publics ou les supermarchés pour exiger d’appliquer des mesures de protection adéquates montrent que la classe ouvrière n’est pas dupe de l'hypocrisie et du cynisme du gouvernement et des partis politiques.
L'instabilité de l'appareil politique bourgeois et les tensions croissantes au sein et entre les fractions politiques de la bourgeoisie sont, tout comme d’ailleurs la prise en charge par la bourgeoisie de la crise du covid-19, des expressions de la tendance croissante au «chacun pour soi», qui caractérise la phase actuelle de décomposition du système capitaliste. Pour les travailleurs, cela ne fera que rendre la note de la crise encore plus salée. Car une chose est certaine : cette note sera présentée à la classe ouvrière, sur ce point, il n'y a pas de désaccord entre les partis politiques qui se chamaillent! Un comité fédéral présidé par un virologue et le gouverneur de la Banque nationale est déjà en train de doser le rapport entre risques sanitaires et dommages économiques afin de relancer l'économie nationale dans les plus brefs délais. Et il va de soi que des sacrifices seront demandés aux travailleurs sur le plan sanitaire, mais aussi et surtout sur le plan économique et salarial, «en compensation des sacrifices que l'État a consentis pour ses citoyens», comme les porte-paroles de la bourgeoisie l’expriment de manière particulièrement cynique.
Dennis & Jan/ 11.04.20
[1] Rapport sur l'impact de la décomposition sur la vie politique de la bourgeoisie [3], 23e Congrès du CCI
[2] L'élection de Trump et le délitement de l'ordre capitaliste mondial [4], Revue Internationale 158
[3] Élections en Italie : le populisme est un problème pour la bourgeoisie, un obstacle pour le prolétariat [5], Révolution Internationale 471
Situations territoriales:
- Belgique [6]
Récent et en cours:
- Coronavirus [7]
- Corona [8]
- COVID-19 [9]
- SARS-CoV-2 [10]
Rubrique:
Réunion Publique à Utrecht: Un moment dans le débat sur les "grèves pour le climat"
- 87 lectures
Depuis la deuxième moitié de l’année 2019, la question du climat est une fois de plus au centre de l’attention médiatique au niveau mondial. Des manifestations surtout de jeunes se sont succédées dans 270 villes du monde pour protester contre la détérioration du climat et la destruction de l’environnement. L’inquiétude pour l’avenir de la planète et de l’espèce humaine elle-même est totalement justifiée et il ne fait aucun doute que c’est le système actuel de production qui entraîne des changements des conditions climatiques, atmosphériques et reproductives de la planète aux conséquences toujours plus catastrophiques (voir les articles du CCI sur ce sujet). Face à cet avenir menaçant, il n’est pas étonnant que tant de jeunes soient très inquiets et veulent faire quelque chose pour y remédier.
C’est dans ce contexte que le CCI a organisé une réunion publique à Utrecht en octobre 2019 sur le thème “Seule la société communiste sans classes peut rétablir une harmonie avec la nature". Elle a attiré des jeunes qui avaient participé aux mouvements importants en Hollande et avaient rencontré le CCI présent avec sa presse dont un article intitulé: "Face à la destruction de l’environnement: l’idéologie “verte” au service du capitalisme!” ( Internationalisme N° 371). L’exposé introductif du CCI a posé d’emblée la problématique : "...il ne fait aucun doute que le système actuel conduit l'humanité vers une catastrophe environnementale. Le défi est :- Qu'en faisons-nous ? - Comment mettre fin à cette spirale destructrice ? - Par qui et comment cette logique destructrice peut-elle être combattue ?". Il a appelé à un débat ouvert où se confrontent les positions, se posent les doutes, les interrogations (et non pas des confrontations de personnes). De fait, la discussion a été sérieuse et vivante. De nombreux questionnements ont été exprimés, tels par exemple "est-ce que le mouvement autour du climat, dans ses objectifs, ses approches et ses méthodes constitue un véritable combat pour résoudre le problème ou constitue-t-’il un piège qui ne peut que conduire au découragement et à l'amertume d'être utilisé et trompé?". Certains intervenants soutenaient le mouvement car il pouvait selon eux mettre un rayon dans la roue de la machine et saboter le système, d’autres regrettaient le manque de radicalité dans ses méthodes, d’autres encore s’interrogeaient sur le peu de présence d’ouvriers et la quasi absence des syndicats… L’idée que réformer le système capitaliste responsable de la destruction de la planète, des guerres, du chômage, de la précarité n’offre aucune solution, que la seule perspective est de le renverser et que seule la classe ouvrière peut le faire à travers sa lutte au niveau mondial, était nouvelle pour certains de ces (très) jeunes participants. Présenter la classe ouvrière comme la seule capable d’offrir une alternative à l’humanité est d’autant plus difficile à comprendre que celle-ci n’exprime guère son identité de classe ces dernières décennies, instillant le doute quant à sa capacité à réaliser cette tâche gigantesque. C’est une lourde responsabilité qui revient aux organisations politiques telles que le CCI d’expliquer cette perspective patiemment à travers sa presse, son intervention dans les mouvements, ses réunions publiques.
L’expression de l’enthousiasme pour le débat, la volonté de tous les participants de poursuivre la discussion entamée, certains s’engageant même dans une mise en question leur positionnement présent, souligne le processus de réflexion engagé à cette réunion publique. Cela fait partie intégrante du processus de prise de conscience de la classe ouvrière des enjeux et d’une volonté de mobilisation pour y faire face.
CCI / 10.05.2020
Récent et en cours:
- grève pour le climat [11]
Rubrique:
Internationalisme n° 373 - 3e & 4e trimestre 2020
- 45 lectures
La deuxième vague de COVID-19 en Belgique et aux Pays-Bas: L'impuissance des états et gouvernements à contrôler la pandémie
- 66 lectures
Il est étonnant de voir à quel point des pays disposant des technologies les plus avancées sont incapables de contrôler et de contenir la propagation du virus Covid-19. Selon les partisans de la théorie du complot, tout cela cache quelque chose. Il y a bien quelque chose derrière tout cela, mais pas une conspiration. En vérité, la crise du covid-19 révèle un mode de production capitaliste en déclin qui non seulement entrave de plus en plus le développement des forces productives de la société, mais menace également la survie même de l’humanité.
Les gouvernements n’ont pas été une fois de plus surpris mais ont une fois de plus failli!
Pour le moment, la deuxième vague frappe aussi fort que la première. C’est à nouveau une catastrophe en ce qui concerne la santé et certains secteurs de l’économie, victimes d’un large confinement. Comment est-ce possible? Les autorités n’ont-elles rien appris de la première vague? Apparemment très peu, car, dans les mois qui ont précédé la deuxième vague, les gouvernements se sont satisfaits de quelques mesures superficielles pour la galerie.
Après la première vague, la bourgeoisie aux Pays-Bas et en Belgique a eu amplement le temps de tirer les leçons et de prendre les mesures nécessaires pour limiter pour le moins l’impact d’une deuxième vague et pour garantir des soins adéquats aux patients atteints du corona, par exemple en développant une bonne stratégie de tests de dépistage, en mettant au point la recherche et l’identification des contacts («tracking and tracing ») en formant davantage de personnel médical et infirmier, en créant davantage de lits de soins intensifs, ….
En tout état de cause, les gouvernements des deux pays avaient déclaré qu'en cas de deuxième vague, ils ne se résigneraient pas à l'inévitabilité d'un nouveau confinement général qui fermerait tous les secteurs non essentiels de l'économie. Ils avaient l'intention de limiter les mesures dans un premier temps à quelques secteurs particuliers et locaux de la société, puis d'attendre de voir comment la deuxième vague allait se développer. Cette approche à court terme s'est avérée désastreuse.
Et puis subitement, la deuxième vague annoncée était là et les gouvernements ont déclaré être soi-disant surpris par son ampleur. Cet argument n'était déjà pas valable pour la première vague puisque des études internationales sur les virus de maladies transmissibles avaient déjà régulièrement mis en garde contre le danger de pandémies avant 2020. La dernière mise en garde date de septembre 2019, c'est-à-dire juste la veille de la pandémie actuelle, et est exprimée dans le rapport de l'OMS «The World at Risk. Annual Report on Global Preparedness for Health Emergencies »[1] Et pour la deuxième vague, l’argument de la surprise est encore moins valable. Tous les experts de tous les pays dans le domaine de la virologie et de l’épidémiologie avaient clairement et plus d’une fois averti que le virus était toujours présent et qu’une deuxième vague serait inévitable. Mais le choix de la rentabilité du système d’exploitation - la production de plus-value- a bien sûr été le facteur décisif. Et une fois de plus, les conséquences sont catastrophiques: des hôpitaux inondés, un personnel infirmier débordé et des milliers de morts supplémentaires.
La négligence cynique et l’impuissance dans la gestion des gouvernements
Les nombreux décès inutiles des première et deuxième vagues sont le résultat de la négligence coupable et de l'incompétence des autorités occidentales. C'est aussi le verdict accablant d'un livre publié cet été par Richard Horton, le rédacteur en chef de The Lancet. Il considère les nombreux décès inutiles comme «la preuve d'une inconduite systématique des autorités, de négligences irresponsables qui constituent un manquement aux devoirs des responsables publics»[2]. La situation politique aux Pays-Bas et en Belgique ne constitue nullement une exception à cette tendance générale. Au contraire, les deux gouvernements ont commis tant d'erreurs au printemps et à l'automne que le contrôle de l'épidémie leur a complètement échappé des mains aux moments les plus forts.
Le comportement irresponsable des politiciens était dans de nombreux cas non seulement constitué de décisions erronées, mais était principalement motivé par une politique cynique qui accordait la priorité aux intérêts économiques du capital national et en acceptait les risques sanitaires «collatéraux» pour la population:
Alors que des millions de personnes devaient, chaque jour, prendre les transports publics pour se rendre au travail, le gouvernement a échoué à mettre en place des transports publics suffisants, où chacun avait suffisamment d'espace et où personne n'avait à craindre d'être infecté ;
Bien que diverses données montrent que les entreprises et les écoles sont les principales sources de contamination, il a été décidé de les garder ouvertes à tout prix;[3]
Alors qu’un pays comme le Sénégal a réussi à mettre en place une politique de test efficace et à grande échelle, les Pays-Bas et la Belgique ont complètement échoué dans ce domaine. Le fait que les Pays-Bas et la Belgique n'aient pas réussi à le faire est pour le moins le signe d'une mauvaise hiérarchisation des priorités et, au pire, d'une négligence délibérée;
Alors que les deux gouvernements ont dépensé des dizaines de milliards d'euros en 2008 pour sauver les banques, le personnel de santé reçoit, en 2020, une salve d'applaudissements et une aumône pour être d’emblée renvoyé au front. Quant aux hôpitaux, encore plus que lors de la 1ère vague, ils ont été inondés par les malades atteints du Covid dans un système de santé une fois de plus au bord de l'effondrement. La différence d'approche est choquante, alors que des vies humaines sont en jeu.
Néanmoins, le nouveau gouvernement belge a déclaré qu'il ne prendrait aucune mesure contre les responsables de cette gestion catastrophique de la première vague. Ce qui est tout à fait compréhensible de son point de vue, car ce serait dévoiler les choix cyniques de la classe dirigeante et l'échec systématique du système. Au contraire, le programme de relance du nouveau gouvernement De Croo tente, avec de belles promesses et des mesures superficielles, d'inculquer l'idée que la crise s'est abattue sur nous, que personne ne peut rien y faire, et que nous devons donc être unis pour affronter les conséquences de la crise et y faire face.[4] (voir l’article sur le nouveau gouvernement en Belgique).
Comment ça, personne ne pouvait rien y faire? La mort de milliers de civils aurait bel et bien pu être évitée. Les gouvernements belge et néerlandais ont délibérément négligé leur devoir de prise en charge de leurs résidents respectifs[5] au profit du maintien de la production. La maximisation du profit, qui pour la bourgeoisie a la force d'une loi de la nature, signifie qu'elle ne peut que donner la priorité absolue à la production, en essayant d’en restreindre autant que possible tous les effets nocifs.
Le «chacun pour soi» et la bataille entre les Etats nationaux
Une autre manifestation qui rend la gestion de la crise du covid encore plus chaotique est la lutte entre les États. Lors de la première vague, nous avions déjà pu constater comment les États se sont battus pour obtenir des masques buccaux et des vêtements de protection. Ce «chacun pour soi», si caractéristique de la période de décomposition, s’exprime en pleine intensité aujourd'hui dans la guerre pour les vaccins dont nous avons déjà parlé dans la CCI.[6] En juin, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et l’Italie s’étaient déjà mis d’accord entre eux pour être les premiers à avoir accès à un vaccin contre le covid-19. Cette tendance a pris une telle ampleur ces derniers mois que le directeur de l'OMS a dû mettre en garde contre le «nationalisme vaccinal».
Des vaccins sont actuellement développés à un rythme sans précédent pour se protéger contre le corona. Et à un rythme tout aussi effréné, les gouvernements concluent des contrats simples, doubles et triples avec toutes sortes de sociétés pharmaceutiques afin de réserver suffisamment de vaccins pour leur population. Dans cette folie, le plan COVAX de l'OMS pour assurer une distribution correcte et équitable du nombre encore limité de vaccins dans le monde est complètement foulé du pied. Malgré les déclarations rassurantes du président de la commission, U. Von der Leyen, et du «président» européen, Ch. Michel, selon lesquels il existe suffisamment de vaccins pour tous les pays du monde, l'Union Européenne agit également de manière très agressive pour conquérir suffisamment de vaccins, pleinement soutenue par les gouvernements néerlandais et belge.
La négation des mesures contre le coronavirus
La décadence du mode de production capitaliste a ouvert une phase de décomposition du système, dans laquelle le « chacun pour soi » et la désintégration de la cohésion sociale auront un poids de plus en plus important. Cela s'exprime aussi fortement dans cette crise du covid, en particulier sous la forme d'un nombre croissant de protestations de groupes tels que « Virus Truth » (anciennement Virus Frenzy) qui, le 24 octobre à La Haye, a de nouveau réussi à rassembler plusieurs centaines de personnes pour protester contre les mesures covid « antidémocratiques ». Une manifestation similaire, prévue pour le 25 octobre à Bruxelles et qui devait rassembler au moins autant de personnes, a été interdite par les autorités.
Afin de cacher leurs propres échecs, les gouvernements tentent de faire porter la responsabilité de l'émergence et de l'expansion de la deuxième vague au «comportement irresponsable des citoyens» et en particulier à la «jeunesse désobéissante et égoïste». C'est d'autant plus cynique que ce sont essentiellement les autorités elles-mêmes qui «ont fait entrer le loup dans la bergerie» en donnant la priorité absolue à la sauvegarde de la capacité de production et en omettant d’intervenir à temps dans la prise de mesures préventives nécessaires qui auraient pu endiguer la deuxième vague. Dans un contexte de perte croissante de contrôle sur la société, leurs actions «nulles» ont conduit à une perte de crédibilité encore plus grande, pour lesquelles ces mêmes autorités doivent payer la note aujourd’hui: de larges pans de la population se sentent de moins en moins concernés par les directives du gouvernement et prennent leur propres décisions. Ces derniers mois, la police est intervenue à plusieurs endroits et a effectué d’innombrables raids pour stopper des fêtes « illégale ». Le scepticisme à l'égard des vaccins annoncés est également élevé.
La fuite dans la pensée conspiratrice
« Certains parmi ceux qui en ont assez des mesures doutent de la réalité de la propagation du virus et de la gravité de l’infection. Il y a beaucoup d’idées fausses qui circulent sur Internet ainsi que des théories complotistes », explique Steven Van Gucht, virologue en Belgique. Des influenceurs sur les réseaux sociaux en Belgique[7] font croire à ceux qui les suivent que le coronavirus est une invention, appellent à ne pas suivre les mesures et se déclarent ouvertement contre un vaccin.
Des parties de plus en plus importantes de la population recourent à des explications pseudo-scientifiques à propos de l'existence de la pandémie et celles-ci leur fournissent des arguments pour remettre en question les avis avancés par les experts et pour contester les mesures du gouvernement. L’augmentation du nombre de négationnistes du coronavirus est tout aussi importante que le nombre de personnes infectées par le virus. Une étude de Kieskompas montre qu'aux Pays-Bas, une personne sur dix croit que la pandémie au covid-19 fait partie d'une conspiration contre l'humanité.
Plus la pandémie dure longtemps, plus les sentiments au sein de la population commencent à devenir amers. Au cours des six derniers mois, quatre mâts 5G aux Pays-Bas et deux en Belgique ont été incendiés car, selon les tenants de cette théorie, ce n'est pas le coronavirus qui nous rend malades, mais les radiations des mâts 5G qui affaiblissent notre système immunitaire. Dernièrement, à Breda aux Pays-Bas, une allée de testing a été assaillie par des négationnistes du covid, qui ont saccagé du matériel et intimidé un contrôleur.
La classe ouvrière à la croisée des chemins
Dans les circonstances actuelles, il existe également un risque croissant qu'une partie de la classe soit entraînée dans des manifestations populistes contre les mesures de confinement, telles qu’elles ont eu lieu à grande échelle dans d'autres pays d'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Jusqu'à présent, ni aux Pays-Bas ni en Belgique, cela ne s'est produit: la classe ouvrière n'a pas été activement impliquée dans ces manifestations, mais la situation où une telle implication était exclue dans les deux pays est à présent bel et bien révolue.
Les travailleurs sont toujours capables de se battre sur leur propre terrain pour défendre leur santé contre les conditions de travail dangereuses, comme chez InBev, Colruyt, Carrefour, etc. Cependant, cela devient de plus en plus difficile car le chantage exercé tant par l'État que par les entreprises commence à peser de plus en plus lourd sur la volonté de lutte de la classe ouvrière. Le mécontentement et la colère suscités par la négligence du gouvernement n'ont pas disparu, mais les chances que cela se traduise dans la période à venir par une combativité ouverte sont minces.
Cependant, la classe ouvrière conserve toujours sa mémoire historique et sa conscience de classe. C'est un phare qui peut l'empêcher de devenir la proie de l'irrationalité croissante et de l'incohérence de la pensée qui caractérisent la pensée conspirationniste dans les protestations populistes. C'est aussi un programme solide qui montre comment la perspective de la lutte des classes ouvre la voie à une société dans laquelle la domination de l'économie sur l'homme, mais aussi l'opposition entre la société et la nature, peuvent être surmontées. Ainsi, l'harmonie avec la nature, qui pourra alors être rétablie, fera que les virus zoonotiques (transmissibles de l'homme à l'animal) apparaîtront moins souvent n
Dennis & Jos/03.12.2020
[1] Pour plus d'informations sur les différentes études et mises en garde, voir Ignacio Ramonet : «La pandémie et le système mondial» , 14.01.2020.
[2] Richard Horton, “The COVID-19 Catastrophe. What’s gone wrong and how to stop it happening again”, Polity Press, 2020.
[3] Plus de 21% des infections se produisent au travail. L’éducation (19,5 %), les contacts avec le cercle familial élargi (17,3 %) et les loisirs (15,8 %) viennent ensuite. (Recherche par les onze cabinets de médecine générale de la médecine pour le peuple, PVDA/PTB)
[4] Le nouveau gouvernement belge De Croo : une « équipe dynamique » pour restaurer la confiance dans la politique ? [13]
[5] En ce qui concerne les maisons de repos belges, le rapport d'Amnesty International parle même de violations des droits de l'homme: le droit à la santé, le droit à la vie et l'interdiction de la discrimination ont été, selon l'étude, violés.
[7] En Belgique, on a eu recours à des »influencers», des personnes influentes sur les réseaux sociaux pour informer sur le covid certains groupes de jeunes, qui ne sont pas atteints par les canaux d'information habituels.
Géographique:
Situations territoriales:
Rubrique:
Le nouveau gouvernement belge De Croo: Une «équipe dynamique» pour restaurer la confiance dans la politique?
- 31 lectures
Au cours des dix dernières années, la population en Belgique - et plus particulièrement les travailleurs - ont été mis à rude épreuve, tout d’abord par la «mondialisation» de l'économie et les délocalisations qui y sont associées, ainsi que par la crise financière et le nombre élevé de faillites. Ces conditions ont conduit à une augmentation du chômage et de l'insécurité de l'emploi (contrats flexibles et contrats «zéro heure»). En outre, ils ont assisté aux différentes crises politiques qui ont accentué la mauvaise gestion des affaires publiques et à un gaspillage financier. En conséquence, les problèmes sur le plan des soins de santé et de la migration, ainsi qu'en ce qui concerne l’équilibre budgétaire et le fardeau de la dette, n'ont fait qu'empirer, renforçant l'impression que ce « malgoverno » a laissé le pays complètement à l’abandon.
Les intrigues politiques, qui durent depuis le début de 2019, ont été alimentées et intensifiées au début de cette année par l’éclatement de la crise du coronavirus. La combinaison de cette dernière avec la crise politique a produit un mélange explosif et a mené à une fuite de responsabilité de la part des «dirigeants» politiques et, en conséquence, à un chaos considérable dans la gestion du pays. Les forces politiques établies ont laissé faire le sale boulot de gestion de la crise sanitaire part un gouvernement d’affaires courantes qui se heurtait régulièrement aux initiative « sauvage » des dirigeants régionaux et locaux. Le manque de confiance entre les différents niveaux de pouvoir et l'échec de la communication publique ont mis le système en pagaille de sorte que la Belgique compte aujourd’hui le plus grand nombre de décès par corona pour 100.000 habitants dans le monde entier.
Crédibilité lourdement entamée du « politique »
Dans l'article d'avril de cette année, nous rapportions qu’«Une étude réalisée par des politologues de cinq universités belges a conclu que l’aversion pour l’establishment politique, l’une des caractéristiques essentielles du populisme, augmente dans la société et qu’un climat général antipolitique se développe même parmi les électeurs».[1]
Au cours des six derniers mois, ce sujet est resté plus que jamais d'actualité. L'enquête quinquennale sur la jeunesse de l'hebdomadaire Humo montre que seuls 12 % des jeunes Flamands ont confiance dans les politiciens, contre 15 % il y a cinq ans. (22-09-2020) Des experts, des leaders d'opinion et des sondages confirment que «les Belges semblent avoir peu confiance dans les partis politiques, dans la «politique politicienne» (Carl Devos sur Radio1; 9-3-2020).
Les partis politiques eux-mêmes sont également bien conscients de l'aversion croissante de la population pour la «politique politicienne». C'est pourquoi, selon Egbert Lachaert, président des libéraux flamands (Open VLD), l'un des principaux objectifs du nouveau gouvernement De Croo est d'œuvrer à la restauration de la confiance, car «après deux ans de stagnation, cela n'est pas vraiment illogique». Le cynisme de la bourgeoisie ne connaît pas de limites. Deux années de stagnation sont un véritable euphémisme pour la négligence totale de ses tâche de gestionnaires et l'attitude cynique dont elle fait preuve à l'égard de sa «propre» population.
Après un an et demi de manœuvres politiques des plus dégoûtantes, nous devrions désormais saluer avec des acclamations ce nouveau gouvernement qui est en grande partie composé de partis co-responsables du chaos. Ces mêmes partis qui ont considérablement perdu aux dernières élections et dont certains d'entre eux, un an plus tard, ne digèrent toujours pas cette défaite. Lorsque, fin septembre, les partis ont dû se mettre d'accord sur la participation au gouvernemen « Vivaldi »,[2] il est apparu clairement à quel point par exemple les relations sont encore fragiles au sein de la démocratie-chrétienne flamande (CD&V).
L’interminable formation du gouvernement, qui a duré presque aussi longtemps qu'en 2010-2011, est l'expression non seulement de la faiblesse et de la division au sein de la bourgeoisie belge, mais aussi d'une irresponsabilité abjecte des partis de gauche et de droite, d'une impuissance totale de l'appareil politique de la bourgeoisie à gérer les intérêts opposés entre ses différentes fractions et à affronter la crise : des partis apparaissant comme le fief des élites établies et le pourrissement des relations entre eux voilà le bilan que nous devons tirer de ces événements politiques.
.... et forte pression sur l'économie
En avril, nous écrivions déjà : «Selon les prévisions de la Commission européenne à l’époque, l’économie belge était l’un des élèves les plus faibles d’une classe européenne (…..). C’est dans cette situation de faiblesse que l’ouragan Corona a fondu sur l’économie belge»[3]
La confiance de la population dans l'économie belge est également tombée à son plus bas niveau au cours des six derniers mois. En avril, elle était descendue à -26, après quoi elle est remontée légèrement, jusqu'à ce qu'elle retombe en août à son niveau d'avril. Sur l'ensemble de la période d'avril à octobre, la moyenne de la confiance des consommateurs est restée négative de 21 points.
Sur l'ensemble des investisseurs, seuls 18 % ont vu l'économie belge se redresser au cours des mois d'octobre-novembre-décembre, tandis que 53 % craignaient un ralentissement (Baromètre des investisseurs ING du 15-09-2020). En outre, la crise du coronavirus a un impact sévère sur les perspectives d'investissement pour 2021, qui menacent également d'être l'année prochaine de 21% inférieures à la normale.
Sur la base d'une enquête menée les 19, 20 et 21 octobre par l'Economic Risk Management Group du gouvernement belge, il ressort que les entreprises belges estiment que leur chiffre d'affaires à la fin du mois d'octobre sera inférieur de 14 % à ce qu'il était avant la crise. Depuis le mois d'août, la reprise des investissements est au point mort. Aucune amélioration du chiffre d'affaires n'est attendue au quatrième trimestre.
La confiance dans l'économie a atteint son niveau le plus bas et la confiance dans le gouvernement belge pour aider l'économie à se remettre sur pied est également extrêmement restreinte. Dans la période qui a précédé la crise du coronavirus, l'absence de toute coordination nationale pour combler le déficit budgétaire a failli mettre la Belgique sur la touche européenne. Et pendant la période de la crise du coronavirus, la population est devenue encore plus sceptique quant aux efforts des autorités pour revitaliser l'économie.
Contrer l'antipolitique au moyen d'un « programme stimulant »
Il n'est donc pas surprenant que le nouveau gouvernement ait un objectif principal en tête : sous la devise « une Belgique prospère, solidaire et durable », il s'est fixé pour tâche de restaurer la confiance de la population dans les décisions politiques et dans l'économie. Comment compte-t-il s'y prendre? :
Par le biais (de la présentation) d'une équipe gouvernementale jeune et fraîche qui doit symboliser l'innovation et entend mettre fin à l'ancienne politique socialement destructrice.
L'âge moyen du nouveau gouvernement est de 44 ans et la moitié des ministres sont des femmes. C'est une équipe aux nombreux nouveaux visages, sans passé politique chargé. Le choix d’une autre façon de faire de la politique doit constituer le ciment forgeant l'unité du nouveau gouvernement : « C'est un groupe qui a choisi de laisser les contradictions derrière lui », dit le 1er ministre. De Croo. Ainsi, personne ne sera cloué au pilori pour les erreurs récentes. Le gouvernement s’engage à « sortir de la crise », mais chacun devra y mettre du sien.
Alors que, selon le président du syndicat socialiste Thierry Bodson, il y a « une véritable rupture avec les cinq dernières années » (Het Nieuwsblad, 1-10-2020), le PVDA/PTB (Parti des Travailleurs Belges) plus « à gauche », reproche au gouvernement de ne pas être assez à gauche (De Standaard, 1-10-2020), mais, avec la critique selon laquelle un gouvernement plus à gauche aurait dû être constitué pour répondre aux besoins du capitalisme actuel, le PVDA/PTB est en fait un très bon complément à la politique du gouvernement et remplit parfaitement son rôle d'opposition de gauche.
Au moyen d'un programme «stimulant» qui se présente comme innovant, durable et social.
- Innovant : le gouvernement De Croo veut faire de la Belgique une championne du numérique. «La Belgique du futur est la Belgique numérique», déclare le nouveau Premier ministre De Croo, « le gouvernement va investir dans une nouvelle croissance. Dans les secteurs d'avenir ». Il s'agit d'un plan d'action ambitieux, dont l'objectif principal est de créer 1.000 nouvelles entreprises (start-ups ) et 50.000 emplois.
- Durable : le nouveau gouvernement soutient l'Accord de Paris sur le climat et le Green Deal européen. Il veut également décourager l'utilisation des combustibles fossiles en leur imposant une taxe supplémentaire. « Toutes les nouvelles voitures de société doivent être exemptes de gaz à effet de serre d'ici 2026. » Enfin, la réutilisation des produits est encouragée, une attention particulière étant accordée aux synthétiques tels que le plastique.
- Social : dans ce domaine, le plan prévoit d'augmenter à terme les pensions les plus basses et les prestations minimales. De plus, les travailleurs hospitaliers recevront une augmentation de salaire et du personnel supplémentaire sera recruté. Enfin, il vise à réduire le coût des services de garde d'enfants, à plus de financement pour les aides-soignants et à doubler le congé parental.
Compte tenu des circonstances extrêmement dangereuses d’une deuxième vague, prévenir l’effondrement des soins de santé et de l'économie est, bien entendu, la priorité numéro un du moment. Ainsi, la bourgeoisie ne peut tout simplement pas se permettre de laisser la santé de la force de travail être massivement affectée. Même si elle est incapable de réduire réellement l'ampleur de la pandémie, elle devra continuer à prendre des mesures pour éviter que sa crédibilité en tant que classe dirigeante ne s'érode davantage. En conséquence, afin de limiter les dommages que la pandémie causera à l'économie, les dépenses sous forme de soutien financier aux entreprises et aux travailleurs - cependant nettement moins importantes que sous le gouvernement d’affaires courantes Wilmès - seront maintenues même si c’est à contrecœur, mais dans ce cas, nécessité oblige.
Le plan du nouveau gouvernement est incontestablement du pur bluff et n'a rien de durable et de social. Il n'a qu'un seul but : tromper la population, et en particulier la classe ouvrière. Nous expliciterons dans la partie suivante en quoi consiste en réalité le fameux plan gouvernemental.
Les travailleurs paieront la facture
Le gouvernement exploite les mesures temporaires de soutien financier et surtout son image «rafraîchissante» et le caractère «social» de son programme pour rétablir la confiance dans la politique et, en particulier, obtenir le ralliement de la classe ouvrière à la perspective d'un plan d'urgence de sauvetage de l'économie belge. Sous la devise «personne n'est responsable de la crise», les travailleurs doivent déjà se préparer à l'ère post-coronavirus où ils devront se serrer la ceinture pour, en collaboration avec leur ennemi de classe, remettre l'économie belge sur pied. Et n’en doutons pas, c’est la classe ouvrière qui devra finalement payer la note.
1.La bourgeoisie ne distribue jamais de cadeaux. Elle s'efforcera toujours de réduire au minimum absolu l’ensemble du capital variable (salaires, prestations sociales, pensions) nécessaire à la reproduction de la force de travail. Au sein du capitalisme, il y a « une lutte incessante entre le capital et le travail, par laquelle le capitaliste s'efforce constamment de réduire les salaires ... ou la valeur du travail plus ou moins jusqu'à sa limite minimale ».[4]
La Belgique fait partie d'un système mondial qui soumet tous les coins de la planète à ses lois. Cela signifie que, si la Belgique veut maintenir son économie à flot dans la guerre commerciale acharnée, elle devra réduire les coûts salariaux, intensifier au maximum le rythme de travail et, si nécessaire, même prolonger la journée de travail. Sur un certain nombre de ces points, elle est fort en retard par rapport aux autres pays d'Europe occidentale. La Belgique, par exemple, a le plus faible niveau de flexibilité du marché du travail en Europe, à l'exception du Portugal. En outre, le taux d’activité y est bien inférieur à 70 % et le coût total des prestations sociales y est nettement plus élevé que dans les pays voisins.
Ces données illustrent comment la lutte contre la « fraude sociale » doit être envisagée. Le gouvernement veut mettre en œuvre des mesures visant à soumettre le «facteur travail» à un régime plus strict. Elle veut porter le taux d'activité à 80 % et accroître la flexibilité du travail en prévoyant des dispositions pour réduire le nombre de contrats à durée indéterminée, pour stimuler une mise au travail flexible, des emplois à temps partiel, pour introduire des modalités de licenciement plus souples, etc. En conséquence, il sera plus difficile d’entrer en ligne de compte pour des prestations sociales et donc d’en bénéficier.
Le gouvernement se vante de ses projets de développement durable: «Cela fait de cet accord l'accord de coalition le plus vert de l'histoire de notre pays», a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. Les représentants d'Ecolo-Groen sont bien sûr enthousiastes, mais sont plutôt silencieux quant à savoir qui doit payer la facture pour cela. Le nouveau gouvernement adhère au « principe que le pollueur paie », mais qui n'est pas un pollueur? En fait, cela signifie que tout le monde devra payer.
Prenons l'exemple de la transition nucléaire, l'un des chevaux de bataille d'Ecolo-Groen. Le nouveau gouvernement s'est engagé à respecter la décision de fermer toutes les centrales nucléaires d'ici 2025. La Commission européenne n'est pas convaincue de sa faisabilité et l'une des questions les plus cruciales est de savoir d'où l'argent devrait provenir pour cette transition. Le Bureau fédéral du plan a calculé en 2018 que les coûts annuels de l'énergie (importée) seraient de 750 à 900 millions plus élevés que si deux réacteurs nucléaires restent ouverts 10 ans de plus. Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, n'a pas tourné autour du pot. « La transition vers une économie plus verte et vers la neutralité carbone de l'UE d'ici 2050 sera incroyablement complexe, difficile, lourde et coûteuse » (La Libre Belgique, 10/12/2020).
Pour le député vert Kristof Calvo, rien de tout cela n'est un problème; selon lui, ce seront « les grandes fortunes et les grands pollueurs [;] les Arcelors de ce monde, les entreprises énergivores », qui seront facturés pour payer les mesures «vertes». (Knack; 3-02-2019). Si ce plan échoue, selon Ecolo-Groen, de l'argent supplémentaire pourra également être imprimé. « Nous l'avons fait pour sauver les banques. Nous devons donc faire cela aussi pour sauver le climat » (Bart Staes; HLN; 10-03-2019). Ces déclarations révèlent que l'argent devra être mis sur la table, d’une manière ou d’une autre. Et ce ne seront pas des montants négligeables. Il est clair que les travailleurs peuvent se préparer à des taxes supplémentaires pour payer les plans écologiques du gouvernement.[5]
L'impasse des protestations bourgeoises et de l'interclassisme
Le nouveau gouvernement donne l'impression de défendre «la population laborieuse». Son image «progressiste» est destinée à les gagner à son «autre politique». Cependant, les travailleurs ne doivent pas se laisser berner par l'apparence extérieure du gouvernement et par ses vagues plans. Dans un capitalisme en décadence, il est hors de question d'améliorer durablement leurs conditions de vie, et la classe ouvrière n'a rien à gagner mais tout à perdre si elle se laisse séduire par le discours «progressiste» des laquais de la bourgeoisie.
Certes, les conditions de la lutte ouvrière sont actuellement très difficiles. Aujourd'hui, elle est régulièrement occultée par des formes de lutte démocratique bourgeoise contre les « inégalités » (mouvement Black Lives Matter-BLM), des protestations d'autres couches non exploiteuses de la société (étudiants, commerçants, ...) ou même des manifestations communes d'entrepreneurs et travailleurs (dans le secteur de l'hôtellerie ou les compagnies de taxi).De plus, plusieurs manifestations ont eu lieu en Belgique mais surtout aux Pays-Bas contre les mesures de confinement national prises par le gouvernement.
Toutes ces protestations, bien qu'elles soient généralement alimentées par le mécontentement et l'indignation face aux conditions misérables et violentes du capitalisme, restent néanmoins embourbées dans les revendications d'un capitalisme « à visage humain ». Parce qu’un tel capitalisme est aujourd’hui impossible - pour que ce monde redevienne vivable, le capitalisme doit être détruit - ces manifestations n'offrent aucune solution aux « fléaux » inhumains déclenchés par le capitalisme en décomposition. Elles restent simplement piégées dans la logique capitaliste et, bien souvent, elles sont récupérées par les courants politiques les plus réactionnaires qui rongent la société, comme le populisme.
Les mouvements sur un terrain bourgeois (comme le BLM) et même les manifestations interclassistes, dans lesquelles différentes couches sociales expriment leurs revendications (mouvement des «gilets jaunes»), ne se terminent pas accidentellement par une violence aveugle: « N'ayant évidemment à offrir aucune perspective de transformation radicale de la société pour abolir la pauvreté, les guerres, l'insécurité croissante, et autres calamités du capitalisme en agonie, ils ne peuvent alors qu'être porteurs de toutes les tares de la société capitaliste en décomposition. »[6]
Tous ces types de protestations se transforment souvent en affrontements violents, donnant l'impression d'être très radicaux. Ils sont aussi souvent accompagnées de campagnes médiatiques de grande ampleur dont le but essentiel est de dévoyer les ouvriers de leur terrain de classe, de les noyer dans ces manifestations et ainsi de les empêcher d'agir en tant que classe distincte avec leurs propres moyens de lutte et revendications.
Néanmoins, la détérioration drastique des conditions de vie impose aux travailleurs de renforcer leur volonté de lutte, comme nous l’avons vu dans certaines parties de la Belgique au cours des six derniers mois. Le 14 juin, des centaines d'agents de la santé sont descendus dans la rue pour obtenir un meilleur financement des soins de santé : une augmentation des salaires et plus de main d'œuvre féminine et masculine. Des travailleurs de diverses entreprises se sont également opposés aux conditions de travail dangereuses dues au coronavirus, à la fermeture d’entreprises et aux licenciements, à l’augmentation du rythme de travail. Ce sont ces luttes, aussi limitées soient-elles dans leur portée et leur durée, qui montrent la voie.
Ce n'est qu'en luttant en tant que classe, de façon autonome, avec leurs propres revendications, que les travailleurs peuvent parvenir à une véritable rupture avec la logique capitaliste du profit pour le profit, de l'accumulation pour l'accumulation, bref, de l'exploitation effrénée de la force de travail, de la nature et finalement de la vie. C'est le seul et unique «programme stimulant» que les minorités communistes organisées doivent présenter à la classe ouvrière n
Dennis / 15.12.2020
[1] Instabilité politique en Belgique et COVID-19: Les prolétaires ne doivent pas payer pour le pourrissement croissant du système [18]
[2] Gouvernement "Vivaldi" : les couleurs des 4 saisons : bleu (libéraux), rouge (socialistes), jaune (démocrates-chrétiens) et vert (écologistes).
[3] Instabilité politique en Belgique et COVID-19: Les prolétaires ne doivent pas payer pour le pourrissement croissant du système [18]
[4] Salaire, prix et profit [19], Karl Marx.
Géographique:
- Belgique [15]
Situations territoriales:
Personnages:
Rubrique:
Pays-Bas: le gauchisme et la crise de covid-19 La mystification d’un nouveau départ au sein du capitalisme
- 53 lectures
La pandémie de covid-19 a plongé le monde dans la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. De plus, le ralentissement économique n’a jamais été aussi important depuis les années 1930. La faillite matérielle du capitalisme se fait sentir dans la vie quotidienne de quiconque se retrouve au chômage ou fait faillite et se trouve ainsi confronté à une réduction drastique ou à une perte totale de revenus. Il en va de même pour les personnes qui ont dû engager des frais médicaux excessifs pour se soigner du coronavirus, pour celles obligées de gagner leur vie sur un lieu de travail insuffisamment protégé contre le virus ou celles qui ont pris en charge les soins et l’assistance aux malades au risque de leur propre vie.
Aux Pays-Bas aussi, les signes d’alarme ont commencé à retentir. Non seulement le gouvernement néerlandais a été terriblement négligent dans la lutte contre la propagation du virus, mais il a également complètement perdu le contrôle dès les premiers signes de l’épidémie.[1] Aujourd’hui encore, il n’a pas lancé le programme de tests de dépistage et de recherche de contacts (« tracking and tracing »), qui joue un rôle clé dans le contrôle et la réduction de l'épidémie. Les GGD (services de santé municipaux ou communaux) n'ont pas assez de chercheurs en poste pour exécuter ces tests face au nombre croissant de personnes infectées. C’est pourquoi moins de la moitié des personnes infectées sont identifiées comme source de l’infection.[2]
De plus, au cours du deuxième trimestre de 2020, l'économie néerlandaise a traversé une profonde récession comme cela ne s'est pas produit depuis les années 1930:
- en avril, mai et juin, l'économie s'est contractée de 8,5%;
- au cours du même trimestre, le nombre de chômeurs a augmenté de 150.000;
- sur la même période, le nombre de ménages avec des dettes problématiques est passé à 1 million;
- dans la même période, la confiance des consommateurs est passée de -2 en janvier 2020 à -26 en juillet.
Si la situation ne change pas radicalement - ce qui ne semble pas être le cas– on s’attend à ce que:
- le nombre de faillites augmentera de 35 % en 2020 par rapport à 2019;
- le nombre de chômeurs officiellement enregistrés cette année va doubler pour atteindre 7 % de la population active;
- le nombre de ménages ayant des dettes problématiques passera à 2 millions en 2020;
- l'activité économique (PIB) diminuera de plus de 5 % sur l'ensemble de l'année 2020.
L'opposition extra-parlementaire renforce la mystification.
La classe ouvrière se pose de sérieuses questions quant à la capacité du système existant à fournir une réponse au chaos causé par la pandémie, quant à son aptitude à offrir une perspective d'existence saine et digne. Dans ce contexte, cet été, la coalition d'organisations (de base) #BeterUitDeCrisis, qui «a vu comment les problèmes s'accumulaient et en a eu assez des querelles parlementaires et de l'incompétence politique», a présenté un Manifeste de revendications consistant en «cinq changements de cap cohérents, soutenus par une sélection de mesures, pour parvenir à une société plus juste, plus saine et plus sûre».[3] L'initiative de cette action a été prise par le groupe « DeGoedeZaak » (« LaBonneCause ») et est aujourd’hui soutenue par une cinquantaine d'organisations et de groupes, dont les organisations trotskistes « Socialisme.nu (GIS) » et « Grenzeloos » (SAP).
Ces deux organisations trotskistes ont rejoint l'initiative parce qu'elles sont conscientes du fait que des brèches se creusent dans le système capitaliste. D’autant plus que les discours traditionnels de la droite et de la gauche, qui se ressemblent de plus en plus, commence à perdre de sa crédibilité auprès de plus en plus de travailleurs. C’est pourquoi ils approuvent le projet de reprendre un nouveau départ: «Cette crise nous offre ce moment. Saisissons-le à deux mains!». (Le Manifeste de #BeterUitDeCrisis). Mais quel genre de départ veulent-ils faire et sur quoi celui-ci est-il basé? Dans quelle mesure les plans présentés par les signataires du Manifeste suivent-ils «une autre voie»?
Le Manifeste nous présente une autre société qui «est au service de toutes les couches de la société, pas seulement des 1%», dans laquelle les gens «se concentrent sur la vie plutôt que sur la prospérité» et où il ne s'agit pas «d'accumuler la richesse, mais de la redistribuer» (Idem). Cela paraît un objectif louable auquel personne ne s'opposera, mais n'exige-t-il pas une société différente, non capitaliste? Cela ne nécessite-t-il pas un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs existants? Cela ne devrait-il pas être le résultat d’un bouleversement révolutionnaire? Autant de questions auxquelles le Manifeste ne répond pas.
Le Manifeste ne critique pas fondamentalement les contradictions existantes, qui font que des changements essentiels ne peuvent être apportés que par une lutte de classe sans concessions. Le Manifeste semble sous-entendre qu’ils peuvent être atteints dans le cadre des relations de production existantes du travail salarié et du capital. Le gouvernement bourgeois n'est pas présenté comme l'ennemi de classe, mais comme « notre gouvernement » qui est « obligé » de « changer de cap ». L'appel du Manifeste s'adresse donc à la «société » y compris à « notre gouvernement ».
Dénonçant les contradictions, le Manifeste s'appuie sur le slogan bien connu du mouvement Occupy selon lequel 99% des gens «paient le plus lourd tribut» tandis que le 1% de riches « ne font qu’améliorer leur sort ». C'était déjà un grand leurre lors du mouvement Occupy, qui assimilait le système bancaire au capitalisme et appelait «notre gouvernement» à protéger les 99% de la population de l'extorsion financière des banquiers: « les personnes de couleur, les personnes à faibles revenus et à revenus précaires, les personnes handicapées, les personnes sans permis de séjour » .[4]
À l’appui de ses « revendications », #BeterUitDe Crisis mène des actions comme la mise en place d'une piste d’atterrissage de 40 mètres de long vers la Chambre des représentants dans le but de dénoncer le soutien financier de 3,4 milliards d'euros à la KLM, qui est une gifle pour les personnes qui en ont beaucoup plus besoin. Selon l'organisation, il est absolument nécessaire de se concentrer sur la vie des gens plutôt que sur le marché. Après les vacances d’été, #BeterUitDeCrisis entend poursuivre les actions sans relâche jusqu’à ce que le Parlement agisse vraiment comme une représentation du peuple plutôt que des multinationales et des 1% des plus riches.
Contrairement à ce que suggère le Manifeste, la principale contradiction n’est pas entre riches et pauvres. « Le conflit fondamental dans la société capitaliste est entre la bourgeoisie dirigeante et la classe ouvrière qui produit toute la valeur dans la société. La lutte des travailleurs ne consiste pas à attaquer les riches en tant qu'individus, mais d'attaquer, de démanteler et de remplacer les relations sociales fondamentales du capital (travail salarié et production pour le profit) et l'État qui tente de les maintenir en vie malgré le fait qu'ils sont la raison fondamentale de l'appauvrissement de la grande majorité de la population »[5].
Le rôle perfide des trotskistes et de l’extrême gauche de la bourgeoisie
Au sein du capitalisme, il n'y a qu'une seule classe révolutionnaire, qui n'a rien à perdre sauf ses chaînes, et c'est la classe ouvrière, une chose que «Socialisme.nu» (GIS) et «Grenzeloos» (SAP) doivent parfaitement savoir, à en croire du moins des publications très récentes:
- « Après tout, nous avons les moyens de créer un monde sans faim, sans exploitation, sans avoir à mettre en balance des vies humaines et des intérêts économiques. Pour rendre cela possible, nous devons nous organiser en tant que classe ouvrière pour vaincre le système capitaliste une fois pour toutes»;[6]
- et encore: «Maintenant, la classe ouvrière doit combattre la classe qui est à l'origine de la crise. Au centre de notre lutte socialiste, nous devons mener une lutte de classe contre la crise capitaliste et contre la classe qui l’engendre» . [7]
Ces citations donnent-elles une indication concernant la politique de ces organisations? Oui et non. D’une part, les trotskistes veulent attirer les travailleurs qui se posent de plus en plus de questions sur l’échec du mode de production actuel sur un terrain totalement inoffensif pour le capitalisme et sa classe dirigeante. Car adhérer et faire campagne au sein de #BeterUitDeCrisis, noient les travailleurs dans une opposition civique composée des nuances les plus exotiques de la société: les femmes FNV (syndicat de gauche), les futurs agriculteurs, la Green Cross Netherlands, la Fondation Anima Mundi, et ainsi de suite qui ne vise rien d’autre que donner un visage plus « démocratique » à l’exploitation.
D'autre part, pour que cette politique mystificatrice réussisse, ils doivent bien sûr se faire passer pour des défenseurs «sincères» et «radicaux» des intérêts des travailleurs, la seule classe capable de renverser ce système. Dans leurs déclarations générales et leurs textes, ils s’élèvent souvent contre «le système capitaliste», contre «le système d'esclavage salarial» et contre «le système d'exploitation», afin de récupérer le mécontentement des travailleurs pour le ramener au niveau des objectifs concrets vers une lutte stérile contre ...... les riches: « prenons l'argent là où il est » et « que les riches paient pour la crise » ou encore « une taxe corona pour les très riches », etc.
La raison pour laquelle ces deux organisations trotskystes ont rejoint l'initiative #BeterUitDeCrisis a donc tout à voir avec leur fonction de factions d'extrême gauche de la bourgeoisie. Leur tâche spécifique est de leurrer les travailleurs avec des mensonges du genre: «le contrôle démocratique des moyens de production» serait suffisant pour parvenir à «une répartition équitable des richesses». Il devrait être clair pour tout le monde que ce conte de fées, que nous avons entendu à maintes reprises, ne changera fondamentalement rien à l’exploitation et à la misère croissantes.
En fin de compte, les trotskystes ne luttent pas du tout pour une société fondamentalement différente. En témoignent leur soutien «critique» aux syndicats, leur soutien «critique» aux différents mouvements nationalistes et leur soutien «critique» aux partis parlementaires de gauche, autant de formes de politique dans lesquelles le capitalisme n'est jamais remis en question. Au contraire, conformément à leur fonction dans la société bourgeoise, leur objectif politique n'est pas seulement de maintenir l'État bourgeois mais même de le renforcer face à une société de plus en plus en proie à la décomposition alors que la structure de cet État présente des lacunes toujours plus importantes.[8]
Il en va de même dans ce cas-ci : si le gouvernement et le parlement eux-mêmes ne parviennent pas à endiguer la crise, qui touche réellement tous les aspects de la vie sociale, il y a encore cette opposition extra-parlementaire trotskyste pour leur donner un coup de main. Au moment où le capitalisme montre de façon flagrante son incompétence à offrir une issue à la décadence de son système, et où tout le monde est en quelque sorte menacé dans son existence immédiate et même dans sa vie, les trotskystes «révolutionnaires» avec d'autres surgissent avec leur propagande pour «une société plus juste, plus saine et plus sûre» (Manifeste de #BeterUitDeCrisis).
Ce faisant, les trotskystes tentent d'empêcher les éléments de la classe ouvrière, qui ont perdu toute illusion dans le système capitaliste et qui ne voient plus l'intérêt de lui accorder encore plus de crédit, d'entamer une réflexion sérieuse menant à une alternative, à savoir une société qui ne soit pas basée sur l'exploitation et l'oppression, libre de toute domination de classe par le capital, et dans laquelle le but de la production est de satisfaire les besoins humains.
Le nouveau départ, c’est une société communiste
Les conséquences de la pandémie qui a atteint des proportions catastrophiques, ne peuvent pas être résolues dans le cadre du système capitaliste existant: les capitaux nationaux s'entretuent de plus en plus chaque jour dans la guerre commerciale mondiale afin de s'approprier la plus grande part possible du marché à l’échelle planétaire. Et tout est soumis à cette guerre commerciale, y compris les vies humaines, à moins qu'une pandémie ne menace de causer encore plus de pertes au niveau des forces productives et de la valeur ajoutée qu'un confinement.
Un système basé sur la propriété privée des moyens de production - que cette propriété appartienne à un entrepreneur individuel, à une entreprise ou à un État souverain, ne change pas essentiellement la forme de propriété et donc l'appropriation privée de la plus-value produite par les travailleurs salariés - est un système impitoyable qui sacrifie tout un chacun pour atteindre son but: l’accumulation insatiable de valeur ajoutée. Un tel système plonge le monde entier dans la barbarie, et la crise du coronavirus actuelle en est la preuve la plus profonde et la plus flagrante.
L’enjeu est de taille et les difficultés sans précédent. La route vers une société communiste est parsemée d’obstacles majeurs. C'est pourtant le seul moyen de sortir de cette misère barbare. Et la seule force qui peut y parvenir est la classe ouvrière qui, exclue de cette société et de la richesse qu'elle produit, expropriée et dépossédée, n'a rien d'autre que sa force de travail à vendre n
Dennis /10.032020
[1] “Hoe Nederland de controle verloor De corona-uitbraak van dag tot dag [26]”, nrc.nl, 19 juni 2020.
[2] “De ja-knikkers van Hugo de Jonge - De GGD heeft het zwaar” [27], De Groene Amsterdammer, 10 juni 2020.
[5] The crisis brings ever deepening poverty [29] (La crise entraîne toujours plus de pauvreté), CCI, 2011.
[6] Une réponse socialiste à Covid-19 [30], Socialisme.nu, 21 juillet 2020.
[7] La crise n'est pas une opportunité, mais l'ennemi [31], Grenzeloos, 8 avril 2020.
[8] Pandémie du Covid-19: Le capitalisme est responsable de la catastrophe sanitaire!, CCI, 2011.
Géographique:
- Hollande [16]
Rubrique:
Internationalisme - 2021
- 54 lectures
Internationalisme n° 374 - 1e & 2e trimestre 2021
- 36 lectures
Gestion de La crise du covid-19 en Belgique: Derrière la mascarade de "l’équipe des 11 millions", des contradictions et des divisions persistantes
- 46 lectures
Fin 2020, nous décrivions comme suit l’approche défaillante de la crise Covid-19 par la bourgeoisie belge: « Les intrigues politiques, qui durent depuis le début de 2019, ont été alimentées et intensifiées au début de cette année par l’éclatement de la crise du coronavirus. La combinaison de cette dernière avec la crise politique a produit un mélange explosif et a mené à une fuite de responsabilité de la part des "dirigeants" politiques et, en conséquence, à un chaos considérable dans la gestion du pays. Les forces politiques établies ont laissé faire le sale boulot de gestion de la crise sanitaire par un gouvernement d’affaires courantes qui se heurtait régulièrement aux initiatives "sauvages" des dirigeants régionaux et locaux. Le manque de confiance entre les différents niveaux de pouvoir et la pagaille dans la communication publique ont dominé de sorte que la Belgique compte aujourd’hui le plus grand nombre de décès covid pour 100.000 habitants dans le monde entier ».[1]
Pour tenter de dissiper cette image d'irresponsabilité et de chaos omniprésents, une équipe gouvernementale fédérale « nouvelle et fraîche » a été nommée début octobre 2020, le gouvernement De Croo. Elle se donnait pour but de mettre fin à l'ancienne « culture de la chamaillerie », d’opter « résolument pour l'unité », à travers une gestion cohérente et un programme innovant : « une équipe de 11 millions de Belges! ». Après 9 mois de gouvernement, qu’en est-il de ces belles promesses ?
1. L'approche de la pandémie reste chaotique
À l'instar de ses rivales européennes, la bourgeoisie belge n'a tiré que peu ou pas d'enseignements de la première vague de la pandémie : les possibles mesures d'accompagnement visant à surveiller et à contenir la pandémie, telles que le suivi et le repérage avec mise en quarantaine obligatoire des personnes infectées lors de voyages à l'étranger, se sont révélées être un échec total. De toute façon, le gouvernement De Croo, avec le ministre « socialiste » de la Santé F. Vandenbroucke à sa tête, s'était fixé pour objectif de ne pas se résigner à l'inévitabilité d'un nouveau confinement général lors de la deuxième vague, qui aurait imposé une mise à l’arrêt de toutes les partes non essentielles de l'économie. Par conséquent, depuis novembre, le cœur inébranlable de la politique gouvernementale a été de maintenir ouvert à tout prix les secteurs productifs
de l'économie et, en appui à cela, de garantir l’ouverture des crèches et les écoles primaires, même si les mesures de protection telles que l'aération des locaux ou l’utilisation d’(auto)tests dans les entreprises et les écoles n'ont pas permis de maîtriser les infectons ou les nouvelles variantes, de sorte que les mesures d'assouplissement ont dû être régulièrement revues ou reportées.
Ensuite, la campagne de vaccination a démarré lentement, avec de grandes différences entre les régions (la région de Bruxelles-Capitale est loin derrière les autres régions, les villes d'Anvers et de Gand sont aussi en retard par rapport au reste de la Flandre, par exemple). Ici aussi, des scandales ont éclaté au niveau d‘autorités municipales qui ont permis la vaccination prioritaire de leurs propres employés et de leur famille en bafouant l’ordre de vaccination convenu. Bref, malgré une meilleure centralisation des actons par le gouvernement De Croo, l'impuissance à gérer efficacement la pandémie est restée flagrante et a entraîné début 2021 des milliers de décès supplémentaires, tristement superflus.
2. Les chamailleries entre les différents partis politiques se poursuivent
L'une des raisons pour lesquelles la gestion de la pandémie continue d'être inefficace et incohérente est le fait que les différents partis tout comme les différents gouvernements régionaux font constamment des déclarations et des propositions qui remettent en question ou même sapent les plans et les mesures du gouvernement fédéral. Lorsque le gouvernement a imposé des mesures strictes, celles-ci ont été ouvertement remises en question par des présidents de partis gouvernementaux eux-mêmes (de celui du MR libéral à celui d'Ecolo, qui a ouvertement déclaré qu'il ne suivrait pas ces mesures). Lorsque le gouvernement fédéral a proposé un plan
d’assouplissement prudent, les gouvernements régionaux (la Flandre en particulier) et les partis (du parti socialiste francophone aux libéraux-démocrates flamands) se sont immédiatement lancés dans une surenchère de mesures d'assouplissement tandis que certains bourgmestres et municipalités ont ouvertement déclaré qu'ils ne contrôleraient plus le respect des mesures (comme à Liège ou Middelkerke). Enfin, même le premier ministre libéral s’est heurté à son ministre « socialiste » de la santé, qui estimait que De Croo ne tenait pas suffisamment compte de la situation préoccupante des hôpitaux.
Certains se demandent peut-être pourquoi la bourgeoisie aborde les problèmes de manière aussi incontrôlée ? Cela n'a rien à voir avec de la mauvaise volonté et encore moins avec un plan machiavélique. La crise historique du système de production capitaliste exacerbe déjà en soi les contradictions internes, et la décomposition pullulante, dont la crise de Covid-19 elle-même est une expression et un accélérateur, attise le « chacun pour soi » à tel point que la bourgeoisie a de plus en plus de mal à contrôler son propre appareil politique. C'est là que réside l'explication fondamentale des tensions croissantes au sein de l'appareil politique de la bourgeoisie belge.
3. Les tensions montent au sein de la société
Des tensions et des protestations se sont exprimées dans toutes sortes de groupes de la société : des patrons de cafés et des restaurateurs aux traiteurs, du secteur culturel aux centres sportifs amateurs et aux fitness. De plus, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans des parcs ou des squares et ont ignoré les mesures corona (comme « La Boum » 1 et 2 dans le bois de la Cambre bruxellois), tandis que les maires étaient de plus en plus réticents à assurer l'ordre public.
À cela s'ajoute l'errance désespérée d'un soldat paumé du corps d'élite, adepte des théories d'extrême-droite et conspiratonnistes. Il a dévalisé un arsenal d'armes (jusqu'à des lance-roquettes contre des véhicules blindés) de la caserne où il était stationné et menace de tuer un certain nombre de décideurs politiques et de virologues parce qu’ils imposeraient une dictature covid. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de personnes le saluent comme le « Robin des Bois moderne », tandis que la police et les forces militaires tentent de l'arrêter depuis des semaines.
La pandémie n’aboutit donc de toute évidence pas à l'imposition par l'État bourgeois d'une discipline de fer à sa population. Cependant, le danger est ailleurs : que les travailleurs rejoignent les campagnes de groupes spécifiques (tels les commerçants ou le secteur culturel) ou celles pour la défense des « libertés individuelles qui seraient en danger »; que de jeunes ouvriers soient entraînés dans des campagnes pour récupérer leur liberté: « Je veux retrouver ma liberté; Je veux faire ce que je veux ». De tels mouvements n'ont rien de positif et menacent d'entraîner les travailleurs dans des protestations égoïstes de certains groupes contre d'autres groupes de la société, dans lesquelles toute forme de solidarité sur une base prolétarienne (la seule qui offre une issue à la misère) est totalement absente. Au début de la crise du covid, il y avait encore des expressions de solidarité envers le personnel infirmier. Aujourd'hui, ces groupes de protestataires considèrent le personnel infirmier comme des gens mesquins qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Ils sont l'expression de la montée sans précédent de l'égoïsme, du « chacun pour soi »et du manque de perspective qui caractérisent cette phase de décomposition du système capitaliste.
4. Attiser la division entre les travailleurs afin de leur faire payer la crise
Grâce à sa politique cynique consistant à tout faire pour que les entreprises restent ouvertes, le gouvernement De Croo a réussi à limiter les dégâts sur le plan économique : en 2020, l'économie a connu un recul de 6,3 %, ce qui est la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale, mais celle-ci est comparable à celle de l'Allemagne: 6 %, et est nettement inférieure à celle de la France ou de l'Italie, qui ont connu une baisse de plus de 10 %. Grâce à une politique de subventions massives et inconditionnelles aux entreprises et aux travailleurs, la Belgique est également l'un des pays les plus performants d'Europe en termes de faible croissance du taux de chômage (de 3,6 % à 3,7 % ; l'Allemagne de 2,4 % à 2,9 %).
Toutefois, ces mesures de soutien ont un prix élevé: « En 2020, le déficit budgétaire du pays devrait atteindre un peu plus de 10 % du produit intérieur brut (PIB). C'est plus que dans les pays voisins. Et le rééquilibrage budgétaire est également plus lent. D'ici 2023, le déficit en Allemagne aura été réduit à environ 1% et aux Pays-Bas à environ 2%, tandis qu’en Belgique, il restera à 6% »(Agence Belga, 23.03.21). Le déficit des finances publiques a fortement augmenté (dette de 115 % du PNB en 2020, 120 % en 2023; les Pays-Bas ont vu leur taux d'endettement passer de 60 à 72 %. L'Allemagne est passée de 60 % à 70 %) et de nombreuses entreprises qui étaient censées faire faillite en raison de la crise ont été maintenues artificiellement en vie pour le moment. De nombreuses sociétés fictives auraient même été créées pendant le confinement pour profiter des généreuses mesures de soutien.
En fin de compte, c'est la classe ouvrière qui paiera dans les années à venir la facture de la crise Covid-19 sur le plan des salaires et des conditions de vie. Tout d'abord, son pouvoir d'achat sera affecté dans les mois et les années à venir par la hausse de l'inflation : plus de 2% en avril et environ 4% d'ici la fin de l'année (De Morgen, 19.05.2021). Ensuite, l'accord salarial central, promu par le gouvernement, impose une modération salariale claire : au cours des deux prochaines années, seule une augmentation salariale maximale de 0,4 %, hors adaptation à l'indice du coût de la vie, est autorisée.
En même temps, la bourgeoisie a commencé à activer une politique du « diviser pour mieux régner » afin d'étouffer toute velléité de résistance solidaire et unifiée contre sa politique. Déjà fin 2020, le gouvernement De Croo a conclu un accord avec le personnel hospitalier, qui impliquait des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail, sans inclure dans cet accord le personnel d'entretien ou les autres travailleurs de la santé. Dans l'accord salarial central qui a été mis en œuvre en mai 21, la possibilité a été donnée de négocier une prime supplémentaire pouvant aller jusqu'à 500 €, mais uniquement pour les « entreprises performantes ». Les syndicats s'opposent à cette prime au nom de la liberté de négocier une augmentation salariale plus forte en fonction de la « performance » des entreprises. Autrement dit, après avoir collaboré avec le gouvernement et les patrons pour maintenir le niveau la production nationale pendant le confinement, les syndicats revendiquent désormais le droit de diviser les travailleurs selon la logique de la production capitaliste et du « chacun pour soi ». De cette manière, ils veulent saper encore plus la solidarité mutuelle entre les travailleurs mieux payés dans les entreprises « performantes » et les travailleurs moins bien payés dans les entreprises ou les secteurs « non-performants ».
Bref, l'impuissance de la bourgeoisie à mener une politique cohérente contre le Covid-19 et ses difficultés croissantes à contrôler sa structure politique n'offrent aucun avantage aux travailleurs. Une politique d'austérité est en train d'être mise en place, avec la pleine collaboration des syndicats, qui les mettra sous pression dans les années à venir. D’autre part, il existe le danger que ces mêmes travailleurs soient entraînés dans toutes sortes de tensions sociales et de contradictions entre les différents groupes de la société, qui menacent de saper encore plus leur identité et leur autonomie de classe/
Jos / 06.06.2021
[1] Le nouveau gouvernement belge De Croo: Une «équipe dynamique» pour restaurer la confiance dans la politique?; [13] Internationalisme 372, 3e-4e trimestre 2020
Situations territoriales:
Personnages:
- Alexander De Croo [33]
Evènements historiques:
Rubrique:
Les Pays-Bas après les élections: La fin de la stabilité politique?
- 72 lectures
Des élections législatives ont eu lieu aux Pays-Bas au printemps dernier. Elles ont été suivies avec intérêt dans toute l’Europe, chacun se demandant si Rutte parviendrait à remporter un quatrième mandat de Premier ministre et serait ainsi en mesure de poursuivre sa politique des dix dernières années, une politique caractérisée par l’austérité et la stabilité politique. Par ailleurs, le résultat de ces élections pouvait également apporter des indications quant à l’issue des importantes élections en Allemagne cet automne et en France au printemps prochain.
Les Pays-Bas : un modèle de stabilité politique
Dans différents pays du monde, le virus du populisme a déjà révélé ses effets dévastateurs ces dernières années. Le référendum britannique sur la sorte de l'UE a déclenché le développement d’un processus politique chaotique, dont les effets résonnent encore aujourd'hui. La présidence de Trump aux États-Unis a alimenté le chaos dans le pays, qui a eu pour apothéose la prise d'assaut apocalyptique du Capitole par une horde d'extrémistes de droite. En Hongrie, Orban ne réussit à contrer le chaos imminent qu'en resserrant le contrôle à la « manière stalinienne ». En Italie, le gouvernement de coalition des deux parts populistes, a été marqué par 14 mois de confit et a laissé l'Italie dans une discorde encore plus grande qu'auparavant.
Jusqu'à présent, les Pays-Bas étaient un modèle de stabilité politique. Hormis le fiasco de la participation gouvernementale de la « Liste Pim Fortuyn (LPF) » en 2002-2003 et l'échec de l’appui du PVV de Wilders au gouvernement en 2010-2012, la bourgeoisie des Pays-Bas a réussi à maîtriser assez bien les conséquences de l'avancée populiste. En 2017, le PVV populiste avait certes amélioré son score pour devenir le deuxième parti le plus important, devançant légèrement le CDA chrétien-démocrate et les libéraux de gauche de D66, mais il se situait toujours loin derrière le la droite libérale, le VVD de Rutte.
Rutte lui-même symbolisait cette stabilité, il est le symbole d’une bourgeoisie qui comprend l'art du jeu politique et qui a réussi jusqu'à présent à neutraliser les « excès » populistes, expressions de la phase de décomposition.
Le début des difficultés politiques
Le gouvernement Rutte II, qui a débuté en 2012, avait été formé assez rapidement, en particulier parce qu'il ne comprenait que deux partis. En revanche, la formation de Rutte III a constitué la plus longue formation gouvernementale de l'histoire parlementaire néerlandaise. Cela était en parte dû au fait qu'il avait fallu quatre partis pour former un gouvernement majoritaire, disposant d’une majorité au Parlement. C’était également lié à une méfiance mutuelle accrue entre les différents parts. Malgré son titre, « Confiance dans l'avenir », le minutieux accord de coalition, dans lequel tout était fixé jusque dans les détails, exprimait bien plus la méfiance que la confiance.
Les résultats des élections de 2019 pour les États provinciaux et le Sénat fournissaient déjà une première indication des difficultés croissantes de la bourgeoisie néerlandaise à conserver le contrôle de ses institutions politiques. Lors de ces élections, le « Forum pour la démocratie », un autre parti populiste, surgissait du néant pour obtenir du premier coup 16 % des voix, devenant ainsi le plus grand parti politique des Pays-Bas et, avec le VVD, le plus grand parti au Sénat. Ce gigantesque renforcement de l’escadre populiste dans la politique néerlandaise était un premier avertissement.
Cette tendance a été absolument confirmée par les résultats des élections parlementaires du 17 mars 2021. Jamais auparavant les populistes n'avaient obtenu autant de sièges que lors de ces élections; ensemble, ils obtiennent 28 des 150 sièges. C'est encore plus que les 26 sièges que la LPF a obtenus en 2002. Mais le plus important est le fait que le Parlement n'a jamais été aussi fragmenté, morcelé en 17 (et maintenant même 18) fractions politiques. Ce nombre est encore plus élevé qu'en Belgique où, du fait de la division communautaire des partis, deux versions (une francophone et une néerlandophone) de la plupart des partis existent. La seule famille politique classique qui résiste est la libérale, la droite libérale du VVD de Rutte et le centre-libéral du D66.
Les chrétiens-démocrates (CDA), qui faisaient également parte du gouvernement Rutte III, ont subi une perte importante. Les partis verts et de gauche se sont réduits pour devenir des « mini partis » avec moins de 10 sièges chacun. Les populistes, eux aussi, sont divisés en quatre « communautés » qui s'excommunient entre elles. Des partis tels que le « Parti pour les animaux » ou le « Mouvement des paysans » entrent au Parlement.
Dans l'actuelle Chambre des représentants, seuls 4 partis représentent plus de 10% des voix, tandis que 13 partis obtiennent moins de 10% des voix.
Le « chacun pour soi » de la décomposition exacerbe aussi toutes sortes d'effets, tels que des parlementaires qui essaient de « se profiler » dans les médias et qui ne se tiennent plus à la loyauté envers leur propre part ou envers la coalition gouvernementale. En janvier 2021, cette situation est devenue funeste pour le gouvernement Rutte, qui ne disposait que d’une majorité d'un seul siège au parlement. En raison de son incapacité totale à gérer la question de l'allocation pour la garde d'enfants [1], le parlement avait annoncé qu'il introduirait une motion de censure contre le gouvernement. Lorsque ce dernier s'est rendu compte que même certains membres des partis de la coalition soutiendraient la motion, il a été contraint de présenter sa démission.
Une résistance croissante contre le « Roi Soleil » Rutte
Le processus de formation d'un nouveau gouvernement de coalition a débuté à la fin du mois de mars. Mais juste au moment où les discussions allaient commencer, un nouvel affrontement a éclaté entre les parlementaires et Rutte.
Après avoir appris que, pour l'un des députés (le député CDA Pieter Omtzigt), qui s'était profilé de manière un peu trop explicite dans les débats contre Rutte III, les négociations visaient à « trouver une fonction ail-
Leurs », la Chambre des représentants a voulu savoir ce qu'il en était. Au cours du débat qui a suivi, il s'est avéré que ce sujet avait été abordé lors des discussions entre Rutte et les deux explorateurs (les précurseurs des informateurs), ce que Rutte a d'abord nié avec véhémence. Ce n'est que quand il a reconnu humblement les faits, qu'il s'est repent et qu'il a promis des améliorations (« une nouvelle culture administrative ») que Rutte a pu éviter une motion de censure qui le visait personnellement.
Le fait que ce type de députés était également un sujet de discussion régulier au sein du conseil des ministres n'était pas connu à époque, mais est apparu plus tard. Le parlement a exigé la publication
des procès-verbaux du Conseil des ministres du second semestre 2019 et il est apparu qu' « ils ne voulaient pas de questions critiques et ils ont tout essayé, par le biais d'autres personnes, afin de les intimider et de les museler » (Azarkan du parti DENK). Hors du débat qui a suivi la publication des procès-verbaux, Mark Rutte a une nouvelle fois promis de faire mieux et de tenir désormais davantage compte du parlement en tant que « contre-pouvoir ».
Les affrontements d'avril 2021 entre le gouvernement et les parlementaires ont rendu la formation d'un nouveau gouvernement beaucoup plus difficile. Toutes les belles promesses faites par Rutte, suite aux prétendues « machinations » du gouvernement envers les députés, semblent avoir eu peu d'effet. Le rapport final publié début mai par Tjeenk Willink, le troisième « informateur » depuis le 17 mars, montre que sur les 18 partis au Parlement, six en tout cas ne considèrent plus Rutte [2] comme suffisamment crédible pour former un nouveau gouvernement avec lui.
L'un des fondements sur lesquels la bourgeoisie s'appuie pour défendre son système politique contre la pression toujours plus forte de la décomposition est la mise en avant (ou la création, comme en France) de personnalités populaires capables d'unir une parte importante de la population et des forces politiques autour d'elles. Nous l'avons vu avec Merkel en Allemagne, Macron en France et récemment avec Draghi en Italie. C'était également le cas de Rutte aux Pays-Bas au cours des dix dernières années. La campagne actuelle contre Rutte est une manifestation supplémentaire du fait que la bourgeoisie néerlandaise tend à perdre la régie de son jeu politique et que le contrôle lui échappe de plus en plus.
Le « chacun pour soi » compromet toute prise en charge de la crise
Plusieurs mois ont passé et la formation du gouvernement n'a pas progressé d'un pouce. Le « groupe de réflexion sur la crise du coronavirus » du Conseil Economique et Social (SER), le principal organe consultatif du gouvernement, a formulé des axes pour la relance de l'économie et des activités sociales. Ces axes donnent la priorité à la relance de l'économie et à l'anticipation de la prospérité future, tout en veillant à ce que les acquis sociaux tels que les soins de santé restent intacts. Au cœur des plans de la bourgeoisie pour la période à venir se trouve donc la transition de la crise vers la reprise, agrémentée par quelques zestes de durabilité et de numérisation.
La bourgeoisie néerlandaise ne semble donc pas opter pour un gouvernement qui mette immédiatement en œuvre une austérité drastique et qui présente immédiatement la note pour les mesures de soutien financier d'environ 40 milliards d'euros de l'ère Corona. La question demeure toutefois: quels sont les cinq ou six partis qui se retrouveront sur un programme de gouvernement qui ne les mènera pas encore plus avant sur le chemin de l’implosion? Et sous la direction de qui ce programme sera-t-il mis en œuvre?
Malgré les beaux plans élaborés actuellement par la bourgeoisie pour la formation d'un nouveau gouvernement, nous ne devons pas nous faire d'illusions. La bourgeoisie sait qu'elle ne peut pas continuer à dépenser de l'argent et à augmenter la dette nationale en toute impunité. Ce qu'elle fait depuis le début de la pandémie, c'est essentiellement danser sur la corde raide. Et ce, dans le contexte d'une économie nettement plus faible et plus fragile que lors de la crise bancaire de 2008. Les économistes prévoient qu'une telle politique conduira inévitablement à une intensification des chocs financiers et à une déstabilisation de la monnaie.
L'absence de contrôle du « jeu » politique ne peut qu'aggraver la situation, car les effets de la décomposition ne se limitent plus à des phénomènes de superstructure comme le populisme, les flux de réfugiés, l'écologie, la
décomposition de l'idéologie mais touchent de plus en plus directement la base économique du système capitaliste [3], comme nous l'avons vu avec la pandémie: la propagation illimitée du virus a plongé le monde dans une crise profonde, comparable au krach de 1929.
Les difficultés actuelles de la bourgeoisie néerlandaise à former un nouveau gouvernement stable, capable de conduire le pays à travers les tempêtes actuelles et à venir, expriment de manière frappante la tendance au "chacun pour soi", qui pénètre progressivement tous les recoins de la société bourgeoise [4]. Avec la politique à court terme qui tend à prédominer de plus en plus dans la phase de décomposition, les conditions économiques ne feront qu'empirer; les conséquences de ceci se répercuteront sans nul doute sur les couches exploitées de la population et en premier lieu sur la classe ouvrière.
Dennis / 2021.06.07
[1] Dans l'affaire dite des allocations familiales, des dizaines de milliers de familles néerlandaises ont été accusées à tort par le fisc, ces dernières années, de fraude à l'allocation pour la garde d'enfants. En conséquence, ces familles ont rencontré de graves problèmes, non seulement financiers (on les a obligés de restituer des dizaines de milliers d’euros), mais aussi des problèmes liés au logement, aux soins et à l'éducation des enfants. C'est devenu un véritable scandale en raison du fait que le gouvernement n'a pas voulu révéler la gravité et l'étendue de ces dérives au parlement.
[2] Après dix ans de gouvernement ininterrompu, de 2010 à 2020, Rutte a commencé à montrer certains traits autocratiques: il dicte ce qu'il faut faire ; Rutte et « gouverner » sont devenus presque synonymes, comme l'a souligné Ploumen du PvdA (social-démocratie): « Rutte se comporte comme un Roi-Soleil. »
[4] Les émeutes du week-end du 23 et 24 janvier 2021 étaient sans précédent selon les normes néerlandaises. Ce n'est pas en soi le grand nombre de gens dans la rue qui est significatif, mais le fait que les émeutes se soient déroulées simultanément dans 25 endroits, qu'ici et là des rues test Covid aient été détruites et qu'à Twente même un hôpital ait été attaqué. Cela prouve clairement que les effets de la décomposition sont de plus en plus répandus.
Personnages:
- Mark Rutte [36]
Evènements historiques:
Récent et en cours:
- COVID-19 [9]
- Coronavirus [7]
- Corona [8]
- élections 2021 Pays-Bas [37]
Rubrique:
Internationalisme n° 375 - 3e & 4e trimestre 2021
- 38 lectures
Hausse de prix, réorganisations, travail plus dur et plus long... S' opposer à l'intensification de l'exploitation!
- 55 lectures
Après l’énorme chute économique enregistrée au cours de la première année de la pandémie, la bourgeoisie belge mise depuis l'été dernier sur une relance. Suite à la crise Covid-19, le contexte dans lequel doit se dérouler cette «reprise» est devenu très complexe et imprévisible, et confronte la bourgeoisie à une accumulation d'obstacles qui la conduiront inévitablement à intensifier ses attaques contre les conditions de vie et de travail des travailleurs.
Avant la pandémie de mars 2020, l’économie belge était déjà gravement touchée par une perte de compétitivité, une croissance économique inférieure à la moyenne de la zone euro, un niveau d’endettement des entreprises relativement élevé et une dette publique élevée.[1] Ce constat avait déjà amené Bar Van Craeynest, économiste en chef au Voka (l’organisation du patronat flamand), à exprimer son inquiétude face au déclin permanent de l’économie belge: « Après de graves crises économiques dans les années 1970 et de nouveau après 2008, notre économie a marqué à chaque fois un recul. Ensuite, le rythme de la croissance économique «normale» a ralenti pour ne jamais revenir au niveau d’avant la crise (…) Avant la crise actuelle, notre potentiel de croissance était déjà tombé à un maigre 1,2%. Nous ne pouvons plus nous permettre d’aller encore plus bas. »[2]
Les graves conséquences de la crise du Covid
La contraction économique en 2020 due à la pandémie a été sans précédent : 8,5 %. Elle a été plus importante que la contraction économique d'il y a dix ans pendant la crise financière et même la plus forte contraction depuis la seconde guerre mondiale. En 2021, la croissance attendue est de 5,4 %. Mais cela ne signifie pas que l'économie a déjà remonté la pente.
Si l'on compare les prévisions de croissance pour 2021 à celles de 2019, on constate toujours une contraction de 3%. Une reprise significative prendra certainement des années, à condition, bien sûr, qu›une reprise progressive de 3 % ou plus soit possible en 2021 et 2022.
Les efforts financiers consentis pour soutenir l'économie pendant la pandémie ont déjà considérablement augmenté la dette publique pour la seule année 2020: « les mesures de soutien aux entreprises et aux ménages ont grevé le déficit public, qui s’est établi à 9,4% du PIB. Sous l’effet combiné du déficit élevé et du recul du PIB, la dette publique a bondi à 114,1 % du PIB. »[3] La même dette publique ne diminuera pas ou très peu en 2021, malgré la fragile reprise économique, avec un déficit budgétaire estimé à environ 6,8%. Selon le journal De Tijd, le déficit nominal pour 2021 du gouvernement fédéral et des trois gouvernement régionaux réunis est estimé à 7,28% du PIB, soit 35,7 milliards d’euros.
En outre, « les déficits de 2020-2021 ne sont que partiellement temporaires. D'après les estimations du Bureau du plan (et confirmées par d'autres organisations), après cette crise, nous continuons à faire face à des déficits importants » .[4] L'augmentation de la dette au cours des dix-huit derniers mois, tant au niveau des gouvernements fédéral et régionaux qu›au niveau des entreprises, a rendu les fondements de toute reprise infiniment plus difficiles. Les fondamentaux sont devenus beaucoup plus instables, ce qui accélère considérablement l'apparition de chocs économiques (tels que l'inflation et les prix de l'énergie aujourd'hui), et aggrave leurs conséquences.
Si les interventions massives de l'État au cours des dix-huit derniers mois ont permis d'éviter une faillite sur deux et d'éviter l'explosion du chômage, on peut s'attendre à ce que la fin de la perfusion «coronaire» provoque une vague de faillites. Cela affectera principalement de nombreuses petites et moyennes entreprises qui ne seront plus en mesure de rembourser leurs dettes jusqu›à présent partiellement financées par les aides d'État. Dans le commerce de détail non alimentaire, en particulier, mais aussi dans des secteurs tels que l'hôtellerie, les événements et le tourisme, de nombreuses faillites et licenciements sont à prévoir. Près d'un quart des restaurants de la province d'Anvers, qui proposent un service complet à table, sont aujourd'hui en difficulté[5]). Des dizaines de milliers de travailleurs seront mis en chômage total ou partiel.
Tant que le virus n'a pas disparu et continue de peser sur la société et l'économie, l'adage de la bourgeoisie belge est «apprendre à vivre avec le virus», même si cela se fait au détriment de la santé des travailleurs et de leurs familles. L'économie doit être maintenue à tout prix : «The show must go on». Déjà lors de la troisième vague en 2021, son objectif politique avait été de maintenir ouverts les secteurs les plus importants de l'économie, ainsi que, bien sûr, les crèches et les écoles, afin d'assurer la présence des travailleurs au travail.
La bourgeoisie s'efforce d'éviter une rechute de la fragile reprise. Le mot d'ordre de la nouvelle déclaration du gouvernement pour le budget 2022 était « ne pas ralentir la croissance, mais la soutenir». Dans ce contexte, le gouvernement fédéral en Belgique a décidé de prolonger une partie des mesures d'aide économique liées à la crise du Covid jusqu'au 31 décembre 2021 (procédure simplifiée, chômage temporaire, droit de crédits-ponts pour les secteurs à partir d'une baisse de 65% du chiffre d'affaires).
Les travailleurs ont également reçu quelques miettes pour leur contribution au maintien de l'ouverture de l’économie: 0,4% d'augmentation salariale sur une période de deux ans (ce qui ne compense pas l’adaptation des salaires à un indice des prix lacunaire), une augmentation du salaire minimum légal, une diminution des cotisations sociales sur les salaires bruts les plus bas qui rapporte quelques dizaines d'euros par an, la suppression progressive de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les revenus faibles et moyens, ce qui donne un avantage de 50 euros pour une personne seule et 150 euros par an pour un ménage à deux personnes. Enfin, les travailleurs aux revenus les plus modestes reçoivent une indemnité unique de 80 euros pour la hausse des prix de l'énergie. L’objectif de ces «concessions» est de dresser un écran de fumée pour détourner l’attention des travailleurs des projets futurs du gouvernement.
Plans gouvernementaux pour 2022 et au-delà
Les discussions relatives à ces mesures d'aide sont un leurre. Les véritables enjeux budgétaires concernent le relèvement de l'âge de la retraite, l'augmentation du taux d'emploi, sans oublier la transition énergétique vers des sources d'énergie plus durables. Ce sont ces pistes qui, outre les licenciements croissants, mèneront à terme à une grave atteinte aux conditions de vie de la classe ouvrière.
1. Un contrôle renforcé des malades de longue durée. Le gouvernement prévoit d'imposer aux malades de longue durée un régime plus sévère, avec un «accompagnement» plus rigoureux vers le même ou un autre travail. Il veut ainsi remettre au travail 5.000 malades de longue durée par an. Le manque de coopération envers cet «accompagnement» peut être sanctionné par une réduction de l'allocation. Pour le moment, cette sanction reste faible (2,5% des allocations), mais elle permet de franchir un cap et d’envisager d’autres mesures afin d'intensifier la pression sur les malades de longue durée et sur les chômeurs. L'objectif est de porter le taux d'emploi à 80 %.
2. L'augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans en 2030. Le fait que le taux d'emploi en Belgique soit proportionnellement si faible s'explique aussi par le fait que relativement peu de travailleurs de plus de 60 ans sont encore au travail. En outre, les prestations de retraite pèsent trop lourdement sur les dépenses publiques. C'est la raison pour laquelle l'âge de la retraite doit être relevé. La décision de principe à ce sujet a été prise il y a longtemps, mais sa mise en œuvre concrète, qui doit commencer en 2025, doit encore être négociée avec les syndicats, ce qui impliquera encore beaucoup de tractations et de manœuvres.
3) la transition énergétique concernant le nucléaire et les centrales au gaz. La transition vers une autre forme de production d'énergie renouvelable se poursuit.[6] Ces coûts (construction de nouvelles centrales au gaz ou maintien en activité de certaines centrales nucléaires) se chiffreront en milliards et seront presque certainement répercutés sur le consommateur sous la forme de factures énergétiques mensuelles élevées. En outre, les voyages en avion risquent également de devenir plus chers, tandis que les habitations nouvellement acquises devront obligatoirement être isolées et les véhicules diesel ou à essence remplacés par des appareils électriques, ce qui augmentera considérablement le coût de la vie.
Crise du Covid, crise économique, crise climatique, crise du logement : manifestations de la décomposition capitaliste
Les différentes crises se succèdent de plus en plus rapidement, avec des conséquences de plus en plus graves : la crise du Covid-19, la crise économique, la crise climatique, la crise du logement. Et la bourgeoisie n'a pas de solution.
1. la crise du Covid-19. À la fin de l'été, la bourgeoisie présenta la crise du Covid-19 comme terminée, mais moins d'un mois plus tard, le nombre d'infections a de nouveau augmenté. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une quatrième vague et même après, la crise pandémique ne sera pas terminée. Aussi longtemps que la majorité de la population mondiale et une partie importante de la population belge n'aura pas reçu d'anticorps ou n'en aura pas reçu suffisamment, de nouveaux cas apparaîtront en Belgique. Entre-temps, les hôpitaux sont sous pression, car depuis plus d'un an et demi, le personnel soignant effectue son travail sous une très forte contrainte.
2. la crise économique. Selon la bourgeoisie, elle était liée aux confinements généraux, qui ont dû être proclamés dans tout le pays. Mais maintenant qu›il n'y a plus de confinement, outre la menace de licencier des dizaines de milliers de travailleurs, nous sommes confrontés à la hausse des prix de l'énergie, à l'augmentation de l'inflation due à l'affaiblissement de l'euro, à une pénurie de pièces de production due à la perturbation des lignes d'approvisionnement mondiales ainsi qu’à l'instabilité géopolitique, et à un manque de main-d'œuvre qui paralyse régulièrement la production et les services. Une reprise économique stable semble hors de question pour l'instant.
3. La crise climatique. Les conséquences des inondations, qui ont touché des centaines de milliers de familles en Wallonie l'été dernier et fait de plus d'un millier de familles des sans-abris,[7] sont encore loin d'être réglées. En novembre, quatre mois plus tard, 10.000 familles n'ont toujours pas accès à l'eau ou au gaz. De nombreuses personnes doivent encore compter sur la Croix-Rouge pour obtenir des repas chauds. La reconstruction exigera au moins 4 milliards d'euros, et probablement bien plus. Le gouvernement wallon n'a pratiquement aucune marge de manœuvre, car il est déjà dans le rouge à hauteur de 4 milliards d'euros. Malgré cela, le gouvernement fédéral refuse d'avancer plus de 1,2 milliard pour permettre cette reconstruction.
4. la crise du logement. Comme les Pays-Bas, la Belgique connaît également une crise du logement.[8] Il y a 300.000 ménages belges à la recherche d'un logement décent. L'importante pénurie de logements dans le secteur social, qui ne représente que 7% du total des logements, pousse les gens vers le marché locatif privé, alors que près de la moitié des logements du secteur privé ne répondent pas aux besoins de base. De nombreuses familles sont obligées de se réfugier dans des taudis, des boxes de garage et des arrière-chambres dans les combles.[9] En 2016, le Comité européen du risque systémique (CERS) a constaté que les dettes des ménages en Belgique, où 72 % des logements sont occupés par leur propriétaire, augmentent dangereusement. Pour la première fois en 2016, elles étaient supérieures à la moyenne de la zone euro.
Ces différentes crises peuvent en fait être ramenées à une seule crise : la crise historique du capitalisme. Il est illusoire de croire que le capitalisme en décadence permettra une reprise économique durable. Le capitalisme est ravagé par une crise économique permanente depuis un siècle, en particulier depuis la fin des années 60. Et depuis une trentaine d'années, il a plongé le monde dans une spirale de pourriture et de barbarie sanglante.
Un timide réveil de la combativité ouvrière
Au cours des cinq années du gouvernement Michel (2014-2019), les salaires réels ont baissé de 2,4 %, le salaire minimum a baissé et le nombre de travailleurs pauvres (dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian) a augmenté de 16 % .[10] Eurostat a calculé que sur les 4,6 millions de Belges ayant un emploi, on estime que 230.000 n'ont pas un revenu suffisant pour vivre. 1,8 million de Belges ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté .[11] Et la dernière période de corona a rendu très difficile pour les ouvriers de résister à la pression de la bourgeoisie.
Ces derniers mois, cette tendance semble s'inverser.
La lutte contre les réductions de salaire, contre le prolongement de la durée de travail, contre la charge de travail trop élevée, contre le manque de personnel, contre l’augmentation des prix est la base essentielle pour mener une résistance aux plans d’attaques de la bourgeoisie. Aujourd’hui, la résistance se montre timidement à travers des actions dans divers secteurs comme dans les Centres D’Ieteren du 1er au 21 septembre, parmi le personnel hospitalier à Bruxelles le 6 septembre, chez Ikea à Liège le 16 septembre, à l’aéroport de Charleroi le 20 septembre, à la SNCB le 8 octobre, chez Lidl et ALDI la 2ème quinzaine d’octobre.
Les conditions de la lutte de la classe ouvrière sont cependant très complexes et contradictoires. Alors que certains secteurs ont été durement touchés par la crise du Covid-19 et sont confrontés à des restructurations, des fermetures et des licenciements, certains secteurs souffrent d'une pénurie de main-d’œuvre et imposent une charge de travail croissante aux travailleurs. En outre, la conscience de l'existence d'une classe exploitée face au capital est encore quasi absente, ce qui permet de séparer facilement les petites et rares manifestations ouvrières et même de les entraîner facilement dans des mouvements «citoyens», comme les manifestations climatiques[12] et les manifestations contre la vaccination.[13] Même si nous saluons la lutte des travailleurs contre la détérioration des conditions de travail, les licenciements et la réduction de leurs salaires dans la mesure où c'est la seule possibilité de mettre un terme à la détérioration imposée par le capital, la voie vers une lutte en tant que classe unie n'est pas une autoroute.
La bourgeoisie, consciente que ses plans d'austérité peuvent susciter la colère des travailleurs et compte sur les syndicats pour saboter toute lutte, lancer des actions prématurées sans perspectives, détourner l'attention vers de faux pistes qui amplifient le sentiment d'impuissance face à la misère. Les syndicats sont des experts dans la répartition des ouvriers par secteur, par usine, par catégorie. Lors des confinements, nous avons vu comment ils ont manœuvré pour isoler les travailleurs des entreprises «performantes» de ceux des entreprises «moins performantes»». Les négociations sur l'accord salarial sont actuellement menées par les syndicats secteur par secteur : la SNCB, puis l'enseignement, puis le secteur hospitalier. Ils renforcent ainsi l'idée qu›il n'existe pas de classe, mais différentes catégories de travailleurs ayant des intérêts distincts.
Mais le capitalisme reste une société de classe, dans laquelle le capital et le travail sont directement opposés et ont des intérêts absolument opposés. La classe ouvrière, qui en tant que classe exploitée fait partie de cette société de classe, mais qui ne peut affirmer son être en tant que classe révolutionnaire que comme négation de cette même société, n'a aucun intérêt à maintenir le système, qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans une crise économique, causant souffrance et misère à des parties toujours plus grandes de la classe, et les laisse littéralement sur le carreau.
Dans sa lutte, la classe ouvrière ne peut pas compter sur les syndicats ou la gauche, aussi radicaux que soient leurs discours, elle ne peut même pas compter sur les faiblesses de la bourgeoisie, mais uniquement sur sa propre force, c'est-à-dire : son auto-organisation et sa conscience. Ce n'est que dans et par la lutte qu›elle peut retrouver sa confiance en soi et sa propre identité en tant que classe et prendre conscience des enjeux de la lutte. Plus que jamais, la nécessité de renverser ce mode de production historiquement sénile se fait sentir, il n'existe pas de voie plus facile.
Dennis/2021.11.16
[1] Voir : Ecolo/Groen et Vlaams Belang, vainqueurs des élections : «Les dérives dangereuses de l'idéologie verte et du populisme»; Internationalisme 371.
[2] Bart Van Craeynest, « les réformes sont la voie à suivre pour sortir de cette crise, qu›attendons-nous? » ; 04/04/2021.
[3] Banque nationale de Belgique ; 20/04/2021.
[4] Vodka Paper, "De houdbaarheid van onze overheidsfinanciën", juin 2021.
[5] Voir: « Nous sommes confrontés à une vague de faillites », le 23 septembre 2021.
[6] Dans l'article Covid-19 «Politique de crise en Belgique: Derrière la mascarade de 1 équipe de 11 millions», les oppositions et les divisions inchangées (internationalisme 374), nous avons expliqué en détail comment la crise du Covid-19, elle-même expression et accélérateur de la décomposition du capitalisme, exacerbe le «chacun pour soi» et exacerbe les oppositions bourgeoises. Les récents événements qui ont entouré la nouvelle centrale à gaz de Vilvorde illustrent parfaitement la tendance à faire prévaloir l'intérêt de la région, ou de son propre parti, sur l'intérêt national.
[7] Voir : « Inondations, sécheresse, incendies... Le capitalisme mène l'humanité à une catastrophe mondiale! »
[8] Interview avec Hugo Beersmans, porte parole de « Woonzaak »: «Crise du logement: depuis 2014, la Flandre est compétente pour l'Habitat mais refuse d'intervenir».
[9] Voir l'article dans ce journal : « Le capitalisme provoque la crise du logement », Internationalisme 375.
[10] Voir : Baromètre socio-économique FGTB : le 7 octobre 2019, « vers plus de sécurité et de qualité ».
[11] Voir : « Travailler et vivre pourtant dans la pauvreté : cela existe également en Belgique»; 04/01/2019.
[12] Voir dans ce journal : « Nouvelles «manifestations pour le climat»: Le capitalisme détruit la planète! »
[13] Voir l'article dans ce journal : « La défense de la démocratie n'est pas un vaccin contre le capitalisme, c'est un virus mortel pour le prolétariat »
Situations territoriales:
Rubrique:
Manifestations pour le logement aux Pays-Bas: Le capitalisme est à l'origine de la crise du logement
- 85 lectures
Ger Rolsma, candidat à la présidence du parti socialiste néerlandais (PvdA), déclare sur son blog : « Je m'oppose à la libéralisation du marché du logement » (Recht op wonen). Dans cette déclaration, il spécule sur l'ignorance des jeunes. Après tout, cette libéralisation n'est pas une politique qui s’impose seulement aujourd'hui et, de plus, elle n'a pas été initiée contre la volonté du PvdA. Au contraire, le PvdA a été dans les années 1990 à la source de la libéralisation du marché du logement. Une piqûre de rappel rapide :
- Dès l’entrée en fonction du gouvernement Kok I en 1994 (premier ministre socialiste), les sociétés de logement n'ont plus reçu de subventions ou des prêts bon marché de l'État pour la construction de logements à loyer modéré. Par la suite, ces mêmes sociétés ont commencé à gérer leur affaire comme une entreprise commerciale, vendant un grand nombre de logements sociaux et démolissant les logements sociaux non rentables.
- En 2000, le gouvernement Kok II, dirigé par le même premier ministre socialiste, a publié un mémorandum sur le logement intitulé Mensen, Wensen Wonen (les gens, les souhaits, le logement), qui stipulait que d'ici 2010, l'accession à la propriété devait couvrir 65 % du parc immobilier total. Pour y parvenir, il fallait transformer chaque année 20.000 logements locatifs privés et 50.000 logements sociaux en logements à vendre. (Voir: Vrije markt, vrije toegang?)
- Ainsi, À l'initiative du parti socialiste néerlandais, un demi-million de logements sociaux locatifs ont disparu du parc immobilier jusqu'en 2009. Au cours de la période 2009-2015, selon le syndicat des locataires (Woonbond), 262.400 logements auraient disparu (voir : Groot tekort aan huurwoningen) et 100.000 autres au cours des cinq dernières années, ce qui signifie qu'entre 750.000 et un million de logements sociaux ont disparu au cours des 25 dernières années, soit un quart du total de ceux-ci.
Les conséquences de cette opération, qui dure depuis 25 ans, se font aujourd'hui sentir dans les statistiques.
Les logements à acheter sont devenus beaucoup trop chers pour la plupart des jeunes. Ils doivent donc louer. Mais les loyers dans le secteur privé sont également beaucoup trop chers. Reste donc le secteur locatif social. Cependant, il y a tellement peu de ces logements aujourd'hui que, pour pouvoir en obtenir un dans une ville comme Amsterdam, il faut attendre quinze ans. Dans les autres grandes villes, les choses évoluent dans le même sens.
En outre, au moins 80.000 logements sociaux sont dans un état médiocre ou très mauvais, selon les données de la Housing Corporation Authority. Les locataires peuvent ainsi être confrontés à des fuites, des murs et des plafonds moisis, des balcons impraticables ou des châssis pourris. (Voir: Des dizaines de milliers de logements sociaux en mauvais état et parfois mûrs pour la démolition ; RTL News, 18-09-2021)
En réaction à cette crise du logement qui touche des centaines de milliers de gens qui cherchent une habitation, plusieurs comités ont été constitués à Amsterdam et à Rotterdam, comme le «Bond Precaire Woonvorm», «Recht Op Stad», «niet te Koop», et «Verdedig Noord». Ils ont lancé des actions de protestation : le 12 septembre à Amsterdam et le 17 octobre à Rotterdam. Parallèlement, des manifestations en faveur du logement ont également été organisées à Tilburg, Nimègue, Arnhem, La Haye, Utrecht et Groningue.
Le logement est un aspect essentiel de la vie de la classe ouvrière, mais cela ne signifie pas que toute lutte contre la crise du logement se déroule sur son terrain. Des parties de la classe ouvrière ont certes participé aux manifestations actuelles, mais elles l'ont fait sur une base individuelle, «dissoutes» dans une masse informe composée de personnes issues de différentes couches de la société. Les travailleurs qui ont soutenu ces slogans, tels que «Garantir des logements suffisants et abordables !», ne l'ont pas fait en tant que travailleurs mais en tant que citoyens qui, en exerçant des pressions, espèrent que les autorités feront quelque chose pour remédier à la pénurie de logements. Mais c'est un vain espoir.
En effet, cette crise du logement n'est pas seulement le résultat de la libéralisation. Même un recul de la libéralisation ne résoudra pas la crise. La pénurie de logements est une caractéristique du capitalisme. Depuis son instauration, il n'a jamais été capable de fournir à la population, et en particulier à la classe ouvrière, des logements convenables et abordables. C'est parce que le logement est fondamentalement une marchandise dont le prix, à côté du prix du terrain, est en principe déterminé par les mêmes facteurs qui déterminent aussi le prix d'une voiture ou d'un manteau d’hiver.
L’article ci-dessous est une version abrégée d’un article publié sur le site internet en anglais.[1] Il traite surtout de la crise du logement au Royaume-Uni, mais l'analyse qu›il développe est parfaitement valable pour tous les autres pays capitalistes, y compris les Pays-Bas et la Belgique.
---
Depuis le milieu des années 1980, il n'y a plus eu de chiffres officiels sur le nombre de personnes qui squattent en Grande-Bretagne, mais un article récent du Guardian a révélé qu'entre 20.000 et 50.000 personnes le font, principalement dans des propriétés désaffectées depuis longtemps.[2] Cette situation s'inscrit dans le contexte général d'un nombre croissant de personnes qui se battent pour garder un toit au-dessus de leur tête. Ainsi, les chiffres relatifs aux sans-abris ont augmenté ces dernières années : en Angleterre, 110.000 familles se sont déclarées sans-abri en 2011-2012, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. 46% de ces familles étaient reconnues comme sans-abri par les autorités locales, ce qui représente une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente.
L'organisation caritative Crisis, dont le site web a fourni les chiffres ci-dessus souligne que ces chiffres officiels sont probablement très imprécis, étant donné que la majorité des sans-abris sont cachés car ils ne se présentent pas dans les lieux, tels les refuges officiels pour sans-abri, que le gouvernement utilise pour collecter ses données. Les données sur le nombre de personnes qui dorment dans la rue constituent un autre indicateur de l'aggravation du problème du logement. Les chiffres officiels indiquent qu'en 2011, plus de 2.000 personnes ont dormi dans les rues en Angleterre toute la nuit, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à 2010. Mais encore une fois, le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé, puisque les organisations non gouvernementales rapportent que plus de cinq mille cinq cents personnes dormaient dans les rues de Londres en 2011-2012, soit une augmentation de 43% par rapport à l'année précédente.
Au niveau de la planète, on estime qu'au moins 10 % de la population mondiale est touchée. De nombreux bidonvilles autour de villes telles que Mumbai, Nairobi, Istanbul et Rio de Janeiro sont en grande partie constitués de squatters.[3] Les types de logements, les services dont disposent les habitants ou l’absence de ceux-ci, le type de travail effectué et la composition de la population varient. Mais, dans leur ensemble, ils montrent que, malgré tous les biens produits et l'argent qui circule dans le monde, le capitalisme n'est toujours pas capable de répondre de manière adéquate à l'un des besoins humains les plus élémentaires. Cet article a pour objet d'en examiner les raisons.
Logement et capitalisme
Le point de départ est la reconnaissance que la forme que prend la question du logement au sein du capitalisme est déterminée par les paramètres économiques, sociaux et politiques de la société bourgeoise. Dans ce système, les intérêts de la classe ouvrière et d'autres classes exploitées comme la paysannerie sont toujours subordonnés à ceux de la bourgeoisie. Sur le plan économique, il y a deux dynamiques importantes. D'une part, le logement pour les ouvriers est un coût et, par conséquent, est soumis au même désir de réduction des coûts que tous les autres éléments liés à la reproduction de cette classe. D'autre part, le logement peut également être une source de profit pour une partie de la bourgeoisie, que ce logement soit offert à la classe ouvrière ou à une autre partie de la société. En termes sociaux et politiques, le logement soulève pour la classe dirigeante des questions de santé et de stabilité sociale, mais il offre également des possibilités de contrôle physique et idéologique de la classe ouvrière et des autres classes exploitées. C'était vrai aux premiers jours du capitalisme et cela reste vrai aujourd'hui.
Dans les premières années du capitalisme, la création de bidonvilles était une partie inhérente du développement capitaliste. La bourgeoisie avait besoin d'une main-d’œuvre bon marché, et les mauvaises conditions, la démoralisation et les maladies étaient au début de la période industrielle une conséquence secondaire. Dans certains cas, une partie de la classe capitaliste a également profité de la location d'appartements et de maisons vétustes à la classe ouvrière. Plus tard, au XIXe siècle, le capitalisme a commencé à chercher des solutions au problème du logement, notamment parce que ses conséquences ne se limitaient pas à la classe ouvrière. Ces réformes n'ont pas résolu le fond du problème. Renvoyons au livre de Friedrich Engels, «Sur le problème du logement», dans lequel il écrit : «La même nécessité économique qui a créé [le bidonville] dans un endroit le crée aussi dans un autre. Et tant que la forme capitaliste de production existera, il sera insensé de chercher une solution au seul problème du logement, ou à tout autre problème social qui concerne le sort des travailleurs». La suite de l’article est encore une illustration de l'impuissance de la bourgeoisie à résoudre le problème du logement.
La Première Guerre mondiale a produit un déficit de 610.000 logements en Angleterre, et de nombreux bidonvilles d'avant-guerre n'ont pas été démantelés. Au lendemain de la guerre, les autorités locales ont été autorisées à évacuer les bidonvilles et à construire des logements locatifs. Entre 1931 et 1939, plus de 700.000 logements ont été construits, relogeant les quatre cinquièmes des personnes vivant dans des bidonvilles (3). La plupart des nouvelles maisons ont été construites dans de grandes banlieues à la périphérie de grandes villes comme Liverpool, Birmingham, Manchester et Londres. Certaines autorités locales ont expérimenté la construction de blocs d'appartements. Mais ces efforts représentent bien peu face aux deux millions et demi de logements construits à titre privé et vendus à la classe moyenne et aux parties mieux payées de la classe ouvrière. Néanmoins, cela ne signifie pas la fin des bidonvilles et le surpeuplement grave continue d’exister dans de nombreux quartiers populaires. La Seconde Guerre mondiale a entraîné un recul dans la mesure où la construction de logements a pratiquement cessé et que les centres villes ont été exposés aux bombardements. L'après-guerre a été le témoin du programme de construction de logements par l’Etat le mieux coordonné de l'histoire britannique, qui a culminé à la fin des années 1950, lorsque plus de 300.000 logements sociaux étaient construits chaque année. Cette fois-ci, une des caractéristiques les plus marquantes était la construction de grands immeubles d'appartements. Des aides à la construction privée étaient également accordées et, en 1975, 52,8 % des logements étaient des propriétés privées, contre 29,5 % en 1951 (la location de logements privés passait de 44,6 % à 16 % au cours de la même période).[4]
En Grande-Bretagne et dans les autres grandes puissances capitalistes, l’après-guerre a rendu possibles d'importants changements en matière de logement. Le «boom» d'après-guerre, fondé sur les améliorations très importantes de la productivité après les ravages de la guerre, a donné à l'État les moyens d'augmenter les dépenses dans un certain nombre de domaines, dont le logement. Comme nous l'avons déjà noté, les bombardements avaient détruit ou endommagé certains quartiers ouvriers importants dans les villes qui étaient des centres de production. Les industries qui se sont développées après la guerre, comme l'industrie automobile, ont entraîné la construction de nouvelles usines, souvent en dehors des anciennes concentrations. Cela a nécessité la construction de logements pour les travailleurs. Il y avait également un motif politique pour répondre aux besoins sociaux et réduire ainsi le risque de troubles après la guerre.
Toutefois, le «boom» de l'après-guerre n'a pas atteint de nombreuses régions du monde. Il s'agit notamment de quelques pays occidentaux, comme l'Irlande, où la grande pauvreté et les bidonvilles ont persisté jusqu›au «boom» économique des années 1980. Mais il s'agit principalement de ce que l'on appelle le «tiers monde», qui comprend essentiellement les continents et les pays qui ont fait l'objet d'une domination impérialiste de la part des grands pays capitalistes. En bref, la plupart des pays du monde. De ce point de vue, il devient clair que l'argument d'Engels est non seulement confirmé, mais confirmé à une échelle qu›il n'aurait pu imaginer.
Se loger dans un capitalisme en décomposition
Aujourd'hui, un milliard de personnes vivent dans des bidonvilles et la majorité de la population mondiale est désormais urbaine. La plupart de ces bidonvilles se trouvent dans le «Tiers Monde» et, dans une moindre mesure, dans certaines parties du vieux bloc de l'Est (qui fut appelé autrefois le «Second Monde»). La situation est nouvelle. Dans le livre Planet of Slums (Planète des bidonvilles), publié en 2006, l'auteur, Mike Davis, affirme que «la plupart des mégalopoles du Sud ont un parcours commun : un régime de croissance relativement lente, voire ralentie, puis une accélération brutale vers une croissance rapide dans les années 1950 et 1960, les immigrants ruraux étant alors de plus en plus casés dans des bidonvilles périphériques».[5] La croissance lente ou ralentie de beaucoup de ces villes était le résultat de leur statut de colonie des grandes puissances. En Inde et en Afrique, les dirigeants coloniaux britanniques avaient promulgué des lois visant à empêcher la population indigène du pays de s'installer dans les villes et à contrôler les mouvements et le mode de vie des citadins. L'impérialisme français a imposé des restrictions similaires dans les régions d'Afrique sous son contrôle. Il semble logique de penser que ces restrictions étaient liées au statut de nombre de ces pays en tant que fournisseurs de matières premières à leurs maîtres coloniaux. Mais même en Amérique latine, où l’emprise coloniale était clairement moins stricte, la bourgeoisie locale pouvait être tout aussi opposée à l'intrusion de sa population rurale dans les villes. À la fin des années 1940, par exemple, une répression sévère était mise en place contre les squatters qui s'installaient dans des centres urbains tels que Mexico à la suite de la politique d'industrialisation locale visant à remplacer les importations.
Cette situation a changé lorsque le colonialisme a pris fin et que le capitalisme s'est mondialisé. Les villes ont commencé à augmenter en taille et en nombre. En 1950, il y avait 86 villes dans le monde avec une population de plus d'un million d'habitants. En 2006, elles étaient 400 et en 2015, elles devraient être 550. Les centres urbains ont absorbé la majeure partie de la croissance démographique mondiale au cours des dernières décennies et la population active urbaine s'élevait à 3,2 milliards en 2006.[6] Ce dernier point met en évidence le fait que dans des pays comme le Japon, Taïwan et, plus récemment, l'Inde et la Chine, cette croissance est liée au développement de la production. En Chine, des centaines de millions d'agriculteurs ont quitté les campagnes pour s'installer dans les villes, en particulier dans les zones côtières où l'industrialisation a été la plus importante ; des centaines de millions d'autres vont probablement suivre. En 2011, la majorité de la population chinoise était urbaine.[7]
Cela peut donner l'impression que le processus du XIXe siècle se poursuit ; que le développement chaotique initial sera remplacé par une progression plus soutenue de la chaîne de valeur de la production, avec la hausse des salaires, de la richesse et des marchés intérieurs qui en résulte. Ceci est utilisé pour étayer l'argument selon lequel le capitalisme reste dynamique et progressiste, et qu›il permettra, avec le temps, de sortir les pauvres de la pauvreté, de nourrir les affamés et de loger les habitants des bidonvilles.
Mais ce n'est pas l'histoire complète de la période actuelle. Dans de nombreux autres pays, il n'existe aucun lien entre le développement des villes et des bidonvilles qui y sont associés, et le développement de la production.
On peut en voir les conséquences dans les bidonvilles qui entourent de nombreuses villes du sud. Si ce sont les mégapoles qui font la une des journaux, la majorité des citadins pauvres vivent dans des villes de second ordre, souvent peu ou pas équipées et qui n'attirent guère l'attention. Les récits des conditions de vie des habitants de ces bidonvilles qui traversent Planet of Slums reflètent des parties de l'analyse d'Engels. Dans les centres villes, les pauvres s'entassent non seulement dans les vieilles maisons et dans les nouveaux immeubles construits pour eux par des spéculateurs, mais aussi dans les cimetières, sur les rivières et dans les rues. La plupart des habitants des bidonvilles vivent cependant à la périphérie des villes, souvent sur des terrains pollués, menacés par des catastrophes environnementales ou inhabitables pour d'autres raisons. Leurs maisons sont souvent faites de morceaux de bois et de vieilles bâches en plastique, souvent sans infrastructures et soumises à l'expulsion par la bourgeoisie, ainsi qu'à l'exploitation et à la violence de divers spéculateurs, de propriétaires négligents et de bandes criminelles qui contrôlent le secteur. Dans certaines zones, les squatters obtiennent la propriété légale du terrain et parviennent à obtenir des autorités municipales qu'elles fournissent des services de base. Partout, ils sont victimes d'exploitation. Comme en Angleterre au XIXème siècle, la misère rapporte de l'argent. De grands et petits spéculateurs construisent des propriétés, parfois légales, parfois illégales, et requièrent des loyers comparables pour ces locaux loués aux appartements urbains les plus chers des riches. Le manque de services offre d'autres possibilités, notamment la vente d'eau.
La bourgeoisie continue à essayer de «résoudre» la crise du logement que sa société crée. Comme par le passé, cela est toujours limité par ce qui est compatible avec les intérêts du système capitaliste et de la bourgeoisie au sein de ce système. D'une part, on a tenté de résoudre le problème au bulldozer, en expulsant des millions de pauvres, qu'il s'agisse de travailleurs, d'anciens agriculteurs, de petits commerçants ou de rebuts de la société, de leurs maisons et en les refoulant dans de nouveaux bidonvilles. Ou encore à la campagne, loin des yeux, des oreilles et des nez des riches. D'autre part, toute une bureaucratie a été créée pour résoudre le problème du logement, telle le FMI, la Banque mondiale, l'ONU et les ONG internationales et locales ; mais ils le font toujours dans le cadre du capitalisme. Dans ce cas, il existe une alliance très inhabituelle entre les soi-disant radicaux, qui veulent donner «une voix» aux pauvres, et les institutions capitalistes internationales telles que la Banque mondiale, qui veulent trouver une solution de marché qui encourage l’esprit d’entreprise et la propriété.
Enfin, il y a l'objectif non explicité, mais toujours présent, de diviser les exploités au moyen du mélange habituel de cooptation et d'oppression. Ainsi, les organisations qui commencent par des revendications radicales, comme les groupes de squatters, finissent souvent par collaborer avec la classe dirigeante une fois que quelques concessions leur ont été faites. Chez certains idéologues, on trouve même des échos du passé, comme l'idée que la solution consiste à donner aux pauvres des droits légaux sur les terres où ils vivent. Engels montre que cette «solution» ramène rapidement au problème initial, car elle ne modifie pas le principe de base de la société capitaliste selon lequel «le capitaliste a la possibilité de payer la force de travail ce qu›elle coûte, mais d'en tirer beaucoup plus qu›elle ne coûte en forçant le travailleur à travailler plus longtemps qu›il n'est nécessaire afin de dépasser le coût de la force de travail».[8]
Dans les vieux pays capitalistes d'Europe occidentale et des États-Unis, le retour de la crise économique ouverte à la fin des années 1960 a entraîné deux changements majeurs qui ont eu un impact sur le logement de la classe ouvrière. Le premier était la nécessité de limiter les dépenses de l'État, notamment les allocations versées aux travailleurs ; le second a été le déplacement du capital des investissements productifs vers la spéculation, où les rendements semblaient plus élevés.
La réduction des dépenses publiques a d'abord entraîné un ralentissement du nombre de logements sociaux construits, puis, sous Thatcher, la vente du parc de logements sociaux et la limitation de la poursuite de la construction par les autorités locales. Mais rien de tout cela n'a commencé avec Thatcher. Nous avons déjà souligné les efforts consentis par les gouvernements travailliste et conservateur pour promouvoir la propriété privée avant et après la Seconde Guerre mondiale, principalement par le biais d'une réduction des impôts sur les prêts hypothécaires. La vente de logements sociaux a réduit non seulement le coût du capital pour la construction de logements, mais aussi le coût de leur entretien, étant donné que le nouveau propriétaire en était lui-même responsable. L'idée que la propriété foncière contribuerait à contenir la menace de la classe ouvrière remonte à encore plus loin.
La spéculation financière est devenue de plus en plus fébrile à mesure que la lutte pour un rendement rentable du capital s'intensifiait ces quarante dernières années. La déréglementation financière qui a caractérisé à la fois le Royaume-Uni et les États-Unis dans les années 1980 a permis à la bourgeoisie de développer des formes de spéculation de plus en plus complexes. Dans les années 1990, l'argent a été injecté dans une série de nouveaux instruments basés sur l'extension du crédit à des secteurs de plus en plus importants de la classe ouvrière. L'évolution des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis est typique de cette approche. Les spéculateurs pensaient qu›ils étaient en sécurité en raison de la complexité des instruments financiers dans lesquels ils investissaient et de la notation élevée qu›ils recevaient d'agences de notation comme Standard and Poor. L'effondrement du marché des subprimes en 2007 a montré qu›il s'agissait d'une illusion et a jeté les bases d'un effondrement plus large qui a suivi, un effondrement dont les conséquences sont toujours visibles.
La première bulle immobilière a éclaté dans les années 1990 et a plongé de nombreuses personnes dans une situation de réserves financières négatives, entraînant un grand nombre de saisies. Cette fois-ci, la bourgeoisie a encore réussi à limiter l'impact, de sorte qu›il y a eu moins de saisies. Toutefois, le prix du logement est devenu moins abordable grâce à la combinaison de la hausse continue des bulles et du durcissement des conditions de crédit après 2007, de sorte que de nombreux jeunes ne peuvent plus se permettre d'acheter. Dans le même temps, le secteur de la location est devenu plus petit. L'offre de la municipalité est limitée et strictement contrôlée, avec des critères qui condamnent les jeunes à des logements petits et minables, quand ils ne finissent pas dans un B&B. Avec les nouvelles restrictions sur les aides locatives, les familles seront jetées à la rue et obligées de déménager de leur zone d'habitation, ce qui fait que l'une des rares options est de squatter un des milliers d'immeubles abandonnés. Et nous revoilà à notre point de départ.
La réponse à la question du logement
Le problème du logement auquel sont confrontés les travailleurs et d'autres classes exploitées dans le monde prend des formes très différentes d'un pays à l'autre et divise souvent les victimes du capitalisme. Il peut sembler y avoir un fossé infranchissable entre un jeune travailleur vivant en marge d'une ville comme Pékin ou Mumbai dans un squat, sur un terrain inondé par les crues ou infesté de poisons industriels, et un jeune travailleur qui ne peut prétendre à un appartement social à Londres ou obtenir une hypothèque sur une maison à Birmingham. Pourtant, la question qui se pose à tous les travailleurs est de savoir comment vivre en tant qu›êtres humains dans une société qui est soumise à l'extraction des profits du plus grand nombre en faveur d’une minorité. Et quels que soient les changements dans la forme et la portée de la question, son contenu reste toujours le même. La conclusion d’Engels reste aussi valable aujourd'hui qu›il y a plus d'un siècle : «Dans une telle société, la privation de logement n'est nullement une coïncidence, c'est une institution nécessaire ; on ne peut remédier au problème - avec toutes les conséquences de l'hygiène, etc... - que lorsque toute la structure de la société qui en est coupable est fondamentalement transformée»(9) n
North/11.1.2013
[1] Capitalism produces the housing crisis; ICConline 2013
[2] The Guardian 03-12-2012, Squatters are not home stealers (les squatters ne sont pas des voleurs de maison). Une partie de la campagne idéologique pour légitimer la nouvelle loi contre le squattage consistait à publier un compte rendu détaillé des propriétaires de maisons qui ont retrouvé leur maison squattée après une période d'absence.
[3] Stevenson British Society 1914-45, chapter 8 “Housing and town planning”. Penguin Books, 1984.
[4] Cfr: Morgan, The People’s Peace. British History 1945-1990. Oxford University Press, 1992.
[5] Davis, Planet of Slums, Chapitre 3, “The Treason of the State”, Verso 2006. Les paragraphes suivants s’inspirent largement de ce chapitre.
[6] Ibid., Chapitre 1, “The Urban Climateric”, pp. 1-2.
[7] UN Habitat, The State of China’s Cities 2012-2013, Executive Summary, p. VIII.
[8] Friedricht Engels Sur la question du logement, partie 2, « Comment la bourgeoisie traite la question du logement ».
Rubrique:
Le Parti communiste Belge: De la révolution à la contre-révolution
- 135 lectures
"Il y a tout juste cent ans, le 4 septembre 1921, était fondé le Parti communiste de Belgique" annonce CARCOB/ Archives communistes dans un mail en septembre. Pourquoi revenir sur cet anniversaire, sur ce jalon dans l’histoire du mouvement ouvrier en Belgique ? Le marxisme n'est pas une théorie morte, invariante. C'est une méthode vivante, une manière de confronter la réalité du point de vue de la classe ouvrière. Dans ce cadre, un combat continu doit être mené pour défendre l'analyse marxiste contre le glissement vers des positions bourgeoises, pour l'approfondir, pour analyser correctement les nouvelles expériences de la lutte de classe. C’est dans ce sens qu’il faut tirer les leçons du combat pour la fondation du PCB et de sa dégénérescence ultérieure, qu’il faut défendre l’approche marxiste contre les mensonges bourgeois, comme par exemple l’idée que le parti a été fondé le 4 septembre 1921, alors qu’il était en réalité constitué dès novembre 1920.
Nous republions ici un article d’Internationalisme 188 (1993) qui retrace le cadre général de l’histoire du PCB. Nous reviendrons dans des articles ultérieurs plus en détail sur les différentes phases de son existence : la lutte pour la fondation du PCB après la trahison de la social-démocratie, le combat contre l’opportunisme croissant en son sein et son passage définitif dans le camp de la bourgeoisie au début de la Seconde Guerre Mondiale.
En votant les crédits de guerre, l'aile opportuniste des partis sociaux-démocrates passait en 1914 dans le camp de la bourgeoisie. Elle choisissait la défense nationale de l'Etat bourgeois et trahissait l'internationalisme prolétarien. Cela signait la mort de la IIème Internationale. Mais les gauches marxistes continuaient encore pendant quelques années la lutte contre la dégénérescence dans ces partis. Elles essayaient de convaincre des positions marxistes et de regrouper le plus d'éléments sains possible, d'abord dans et ensuite à côté du vieux parti, pour former de nouveaux partis, les partis communistes, et une nouvelle internationale, la IIIème
C'était un coup dur de constater que la social-démocratie, qui dans certains pays comme l'Allemagne était devenue une puissante organisation du prolétariat, disparaissait des mains des ouvriers en tant qu'arme de lutte. Il était également difficile de faire une analyse complète et concluante de tout ce qui avait changé depuis le début du 20' siècle dans les conditions de la lutte de classe. Dans son "Accumulation du capital", Rosa, Luxembourg avait bien tracé le cadre d'analyse général : le capitalisme était entré dans sa phase de décadence. Mais c'étaient les bolcheviks et la fraction abstentionniste (anti-parlementariste) du PSI italien qui allaient le plus loin au niveau des conséquences politiques. Les bolcheviks étaient les plus clairs sur la question la plus brûlante du moment, la guerre mondiale. Alors que tout le monde, des pacifistes aux "socialistes minoritaires", imploraient la paix, ils appelaient à "la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile". De la guerre devait sortir la révolution. Et cela n'était pas seulement confirmé en Russie en 1917, mais dans une vague révolutionnaire qui déferlait sur le monde jusqu'en 1927 (Chine).
Les conséquences de l'entrée dans la période de "guerres et révolutions" étaient synthétisées dans les positions sur lesquelles était fondée l'Internationale Communiste en 1919 : les réformes ne sont plus possibles, partout la révolution prolétarienne est à l'ordre du jour. Parlementarisme, syndicalisme, fronts avec des fractions bourgeoises, tout cela était valable dans la période précédente, celle de l'ascendance du capitalisme, et est maintenant dépassé. Un parti de masse, tel que la social-démocratie, n'est plus adapté à la nouvelle période dans laquelle la conviction et la clarté politique d'une petite avant-garde est déterminante.
Fondation du P.C.B. : défense du marxisme contre l'opportunisme de la social-démocratie
Le Parti Ouvrier Belge (POB), section de la IIème Internationale, s'est toujours montré très conciliant avec la bourgeoisie, malgré que ce soit justement en Belgique que, au début du siècle passé (1902), la première grèves de masse radicale se déclenchait, annonciatrices du nouveau type de luttes qui sera développé plus tard en Russie en 1905 et 1917. Néanmoins, pendant la première guerre mondiale, à partir de 1916, surgissent également en Belgique des groupes à la gauche du POB, dans les Jeunes Gardes Socialistes à Gand, Anvers, Bruxelles, Liège, Charleroi, etc. La résistance à la guerre en constitue le premier motif, mais très vite, la révolution russe devient pour eux le phare vers lequel ils s'orientent. Progressivement, ils arrivent à des positions marxistes et ils essaient de se regrouper. En 1920, le Parti Communiste Belge (PCB) est fondé. Il défend les positions du second congrès de l'IC, sauf au niveau du parlementarisme, où l'IC, malgré la résistance des partis ouest-européens, a déjà fait un pas en arrière. Le PCB reste avec ferveur anti-parlementaire.
Il y avait également une minorité d’ "hésitants" au sein du POB, les "socialistes minoritaires" groupés dans "Les Amis de l'Exploité". Pendant la guerre, ils avaient seulement insisté sur la tenue d'une "conférence de paix" avec les sociaux-démocrates allemands à Stockholm (c'est-à-dire tenter de ranimer le cadavre de la IIème Internationale). Ils n'étaient pas très enthousiastes pour la révolution russe. Leur critique des dirigeants sociaux-démocrates avait le ton radical, mais en pratique, ils ne proposaient rien à la place. Ils voulaient en fait revenir au programme du POB d'avant la guerre, celui de Quaregnon (15 juillet 1894).. C'étaient des centristes typiques : critique radicale des leaders couplée au colmatage des brèches dans la social-démocratie, toujours sous prétexte de "ne pas perdre le contact avec les masses". En 1921, ils ont enfin accepté de rompre avec le POB. Mais parce qu'ils estiment que le PCB existant est sectaire, n'est pas un parti pour l'action de masse mais un regroupement de 4 ou 5 groupes de propagande, plutôt anarchisant que communiste, ils fondent un deuxième Parti Communiste.
La révolution se faisant attendre dans d'autres pays que la Russie et, après les défaites en Allemagne, Italie, Hongrie, l'IC remet de plus en plus en question les positions 'radicales de son premier congrès. Elle prône la fusion avec la gauche de la social-démocratie. En Belgique également se réalise en 1921 la fusion des deux partis, dans laquelle les positions radicales, marxistes du premier PCB sont mises sous le tapis. Au fur et à mesure que l'IC dévie vers des positions opportunistes et que la révolution russe s'embourbe dans son isolement, les vieux "Amis de l'Exploité" deviennent de plus en plus enthousiastes, alors que les marxistes se font de plus en plus critiques à propos de l'évolution en Russie.
Les fractions de la gauche communiste : faire le bilan marxiste de la dégénérescence de la révolution russe
Des choix déchirants doivent être faits parce que la révolution mondiale se fait attendre : paix avec l'Allemagne à Brest-Litovsk, communisme de guerre, "Nouvelle Politique Economique". Dans un contexte d'isolement de la révolution, le Parti Bolchevik tend de plus en plus à se substituer à la classe, et à fusionner avec l'Etat, un processus qui a mené à l'écrasement de l'insurrection de Kronstadt en 1921. L'IC joue également un rôle de plus en plus douteux dans les soulèvements ouvriers dans les autres pays (actions putschistes du KPD en Allemagne se soldant par un bain de sang, alliances avec la bourgeoisie des "peuples opprimés"). Ces développements suscitent une discussion continue, tant chez les bolcheviks mêmes que dans les autres partis du Comintern. Des groupes d'opposition se forment contre les positions et décisions que le PCUS en tant que "parti d'Etat" est contraint de prendre et qui vont mener à sa stalinisation. En 1921, les groupes d'opposition en Russie sont interdits. Les communistes de gauche hollandais et allemands (KAPD) sont exclus de l'IC. Ceux-ci mettent toutes les erreurs faites en Russie sur le dos du parti bolchevik. Les expressions les plus extrêmes, de la gauche allemande (précurseurs du courant "conseilliste") rejetteront le parti comme un mal inutile (ce qui n'était certainement pas la position du KAPD au premier congrès de l'IC). Ils vont si loin dans leur critique qu'ils rejettent la révolution russe comme non prolétarienne. En 1922, Gorter et cie. fondent l'Internationale Communiste Ouvrière (KAI) mort-née.
Tout comme dans les autres partis communistes, la Russie est au centre des discussions dans le PCB. Le courant marxiste dans le PCB respecte la discipline de parti et désapprouve même la publication de textes "officieux" de l'Opposition russe (autour de Trotski, et de ses "Leçons d'Octobre" etc.). Le PCB se limite à demander "plus d'information" à Moscou.
Ce n'est qu'au début de 1928, quand Trotski et ses amis ont déjà été exclus du PCUS et que Staline a définitivement abandonné, avec la théorie du "socialisme dans un seul pays", l'internationalisme prolétarien du PCUS, que le débat sur la Russie est ouvert dans le parti belge. Au nom de la minorité marxiste, War van Overstraeten démontre le glissement vers la droite du PCUS : à propos de la révolution chinoise (où les communistes et les ouvriers révolutionnaires de la Commune de Shanghai en 1927 ont été livrés par l'IC à la répression sanglante du Kuomintang nationaliste), à propos de la lutte contre les paysans koulak, mais surtout sur le "socialisme dans un seul pays". Il demande la réintégration des oppositionnels dans le PCUS, mais continue à s'opposer à l'activité de fraction. Son rapport est rejeté et, l'un après l'autre, les leaders de la minorité seront exclus du parti.
L'opposition se regroupe à côté du PCB et se demande ce qu'il faut faire : former un deuxième parti (ce qui implique qu'on considère que le vieux parti n'est plus ouvrier et que la Russie ne connaît donc plus un régime prolétarien), oeuvrer pour le redressement du PCB en demandant d'être réintégrés, ou bien former une fraction du parti. L'opposition belge est beaucoup moins claire sur cette question que la fraction italienne ("Fraction Italienne de la Gauche Communiste", qui publie Bilan à partir de 1933). A la différence des groupes qui fondaient précipitamment un nouveau parti ou même une nouvelle Internationale, la gauche italienne procédait toujours avec méthode. Tant que l'Internationale n'est pas morte, et qu'il y subsiste encore un souffle de vie, elle continue à y travailler. Sa conception de l'organisation est unitaire, la scission est pour elle un mal qu'il faut éviter, pour ne pas disperser les forces qui tendent vers une organisation centralisée internationale. C'est seulement lorsque la mort de l'Internationale est assurée, qu'elle envisage de se constituer en organisme autonome. La constitution du parti passe d'abord par la fondation de la fraction de l'ancien parti qui maintient son ancien programme révolutionnaire, et c'est seulement lors de bouleversements révolutionnaires qu'elle se proclame parti. C'est la tâche de la fraction de tirer sans préjudices le bilan des expériences révolutionnaires de l'après-guerre afin de préparer la classe aux nouvelles confrontations.
En 1935, Bilan arrive à la conclusion "Qu'en 1933 s'est clôturée définitivement, par la mort de la III' Internationale, la phase où se posait l'éventualité de la régénérescence de l'IC grâce à la victoire de la révolution prolétarienne dans un secteur du capitalisme (..) Que les partis centristes, encore organiquement liés au cadavre de la IIIème Internationale, opèrent déjà dans le concert de la contre-révolution" et "Que la fraction de gauche affirme clôturée la phase envisagée en 1928, quant à une possible régénérescence des partis et de l'IC (...). " (Bilan no. 18, avril-mai 35)
L'Opposition Internationale de Trotski se désintéresse de l'objectif que se donne la Fraction Italienne, faire un bilan approfondi de l'échec de la vague révolutionnaire. De profondes divergences apparaissent bientôt dans l'opposition : sur la question du parti (redressement ou nouveau parti), sur la caractérisation du régime en Russie (prolétarien ou capitaliste d'Etat), sur l'attitude vis-à-vis du fascisme montant en Allemagne. Tant la gauche belge qu'italienne se heurtent au refus de Trotski de discuter avec eux. La fédération de Charleroi (avec Lesoil) quitte l'opposition belge avant que ne soit conclu le débat sur la nature impérialiste ou non de la politique russe envers la Chine (l'attaque par l'Armée rouge qui voulait s'emparer du chemin de fer de Mandchourie en 1929) et elle adhère à l'Opposition Internationale de Trotski. Ceux qui restent (avec Hennaut) forment en 1932 la Ligue des Communistes Internationalistes (LCI) qui constitue une communauté de travail avec le groupe Bilan en Belgique.
La grande divergence entre les deux organisations est la question du fascisme. Pour Bilan, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre la démocratie bourgeoise et le fascisme. Au contraire : le pire produit du fascisme est justement l'anti-fascisme, analyse confirmée en 1936 par la période du Front populaire en France : "Sous le signe du Front populaire, la "démocratie" est parvenue au même résultat que le 'fascisme" : l'écrasement du prolétariat (...) " en vue de la 2e guerre mondiale (Bilan no. 29, mars-avril 36).
Les événements dramatiques de la guerre en Espagne vont amener des ruptures au sein des deux organisations. La majorité de Bilan considère que l'Espagne est le prélude d'une deuxième guerre mondiale et appelle au défaitisme révolutionnaire. La majorité de la LCI appelle les ouvriers à lutter contre Franco pour ensuite balayer les restes du gouvernement républicain et prendre eux-mêmes le pouvoir. Patiemment, Bilan critiquait la LCI qui prétendait pouvoir "dépasser la phase antifasciste pour arriver au stade du socialisme ; ", alors que Bilan écrivait : "pour nous il s'agit de nier le programme de l'antifascisme, car sans cette négation la lutte pour le socialisme devient impossible" (Bilan no. 39, jan-févr. 39). La minorité de la LCI (avec Mitchell) fonde en avril 37 la Fraction Belge de la Gauche Communiste Internationale, sur les mêmes positions que la fraction italienne.
Le P.C.B. devient un parti du capital national
A partir de 1933, l'anti-fascisme est la mystification centrale du PCB, avec laquelle il fournit une contribution non négligeable à la mobilisation des ouvriers pour la deuxième guerre mondiale et à l'apaisement des luttes ouvrières "pour ne pas jouer la carte du fascisme ". Contrairement au POB, le PCB réussit à maintenir les luttes insurrectionnelles de 1935 et 36 sous contrôle pour la bourgeoisie. Pendant un court moment, lors du pacte de non agression germano-russe, le PCB prône la neutralité belge, mais pour le reste il est, avant et pendant la guerre (dans la résistance), un farouche défenseur du capital national. Il en est remercié après la guerre par quelques postes de ministre.
Depuis, dans les rares lieux où il pouvait encore exercer une influence sur les ouvriers (port d'Anvers, mines et sidérurgie wallonnes), il a continué, dans les syndicats et à la gauche du PSB (Parti Socialiste Belge), à être le fidèle défenseur des intérêts de la bourgeoisie belge en maintenant le contrôle sur les actions de grève. Dans des pays tels que la France ou l'Italie, où la social-démocratie est plus faible, le Parti Communiste a eu l'occasion de montrer clairement qu'il n'est pas seulement la "cinquième colonne" de l'impérialisme de Moscou, mais en premier lieu une fraction fiable de la bourgeoisie nationale (comme l’ont démontré le "compromis historique" en Italie ou le "Front commun" en France).
Depuis 1933 au plus tard, le PCB est le parti de la contre-révolution stalinienne. Bien qu'elle était majoritaire en 1928 en Belgique, l'opposition n'a pu conquérir le parti. Le flambeau du "parti d'octobre 17" est alors passé dans les mains de la Gauche Communiste Internationale. Et ses successeurs créeront demain de nouveau le parti de la révolution.
Octobre 2021 / Sur la base d’un article paru dans Internationalisme 188
Conscience et organisation:
Personnages:
- Joseph Jacquemotte [41]
- War Van Overstraeten [42]
- Léon Lesoil [43]
- Adhémar Hennaut [44]
- Mitchell [45]
Evènements historiques:
- Fondation PCB [46]
Rubrique:
Internationalisme 2022
- 50 lectures
Internationalisme n° 377 - 3e & 4e trimestre 2022
- 63 lectures
La destruction de la nature fait du communisme une nécessité brûlante
- 97 lectures
Au premier semestre 2022, comme au cours de tant d'années précédentes, la planète a été ravagée par de nombreux incendies de forêt en France, au Maroc, en Corée du Sud, en Turquie et en Argentine ; des inondations catastrophiques au Pakistan, en Inde, en Afrique du Sud, à Madagascar et au Brésil ; des tempêtes tropicales aux Philippines, au Mozambique, à Cuba et en Floride, des vagues de chaleur sans précédent en Inde et au Pakistan. L'augmentation de la température a considérablement accru le risque de catastrophes climatiques extrêmes. L'ampleur de la dévastation qui en résulte est effrayante : elle révèle l'accélération de la décomposition du capitalisme.
L'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de 2022 a eu lieu au Pakistan. Au premier semestre 2022, le pays a été frappé par une vague de chaleur sans précédent, avec des températures de plus de 50°C, tandis qu'au second semestre 2022, quelques mois plus tard, un tiers du pays a été inondé et a rendu la situation complètement catastrophique. À Jacobabad, une ville de 200.000 habitants, les températures ont d'abord atteint plus de 49°C, puis toutes les rues ont été inondées. Le Pakistan est connu pour sa vulnérabilité au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Cette année, des milliers de personnes sont mortes au Pakistan, dont 1.400 rien que des inondations. De nombreuses zones touchées par les inondations reçoivent le strict minimum de soutien de la part des autorités. Mais le capitalisme n'est pas intéressé à sauver des vies humaines.
Les conséquences désastreuses de la hausse des températures
La planète n'a jamais été aussi chaude. Depuis 1880, la température de la Terre a augmenté de 0,08°C par décennie, mais depuis 1981, le réchauffement a augmenté de plus du double : 0,18°C par décennie. En moyenne, sur les terres et les océans, les températures de surface en 2021 ont été de 1,04°C supérieures à celles des deux dernières décennies du XIXe siècle. Selon les Centres nationaux d'information sur l'environnement (NCEI), neuf des dix années les plus chaudes sont survenues après 2005, et les cinq années les plus chaudes de l'histoire sont toutes survenues après 2015. La NASA a confirmé cette observation, notant que la période 2010-2019 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. La National Oceanicand Atmospheric Administration (NOAA) a constaté que les gaz à effet de serre piégeront 49 % plus de chaleur dans l’atmosphère en 2021 qu’en 1990
Mais quelle est la relation entre la hausse des températures et les perturbations et les extrêmes toujours croissants des conditions météorologiques? Il n'existe aucune preuve irréfutable qu'une tornade ou une inondation dans une quelconque région du monde soit causée par la hausse des températures. Au cours des 30 dernières années, le nombre de catastrophes liées au climat a triplé, et cette augmentation vient indirectement étayer l'hypothèse selon laquelle la majorité des catastrophes météorologiques sont dues au réchauffement de la planète et, en dernier ressort, à une "intervention humaine" irresponsable et destructrice. Avec une quasi-certitude, les scientifiques peuvent donc conclure que le réchauffement de l'atmosphère, des océans et des terres est à l'origine de la plupart des "catastrophes naturelles" de plus en plus dévastatrices.
L'augmentation de la température de l'air et de l'eau entraîne une élévation du niveau des mers et une fonte massive des calottes glaciaires, des tempêtes très violentes et des vents plus forts, des vagues de chaleur prolongées et des sécheresses plus sévères, des pluies diluviennes et des inondations massives, rendant de plus en plus de régions de la planète inhabitables. Et comme conséquence directe de ces conditions de crise, nous avons vu que :
-entre 2011 et 2020, les destructions associées dans le monde ont totalisé environ 2,5 billions de dollars, soit près de 50 % de plus qu'au cours de la période 2001-2010 ;
-depuis 2008, chaque année, plus de 20 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer, un nombre qui augmente chaque année pour atteindre 30,7 millions rien qu'en 2020 ;
-de 1970 à 2019, plus de 11 000 catastrophes ont été signalées et attribuées à des risques naturels dans le monde, avec plus de deux millions de décès enregistrés.
La destruction de la nature par l'homme a une très longue histoire, mais dans les premières formes de société, cette destruction était si limitée que la nature était capable de s'en remettre. Au sein du capitalisme, cela a radicalement changé: il a développé des forces productives capables de changer l'apparence de la nature dans des régions entières en un laps de temps relativement court. Au cours de la révolution industrielle, par exemple, l'exploitation des mines de cuivre et de charbon dans le sud du Pays de Galles (Grande-Bretagne) a entraîné la destruction de grandes forêts en quelques décennies, modifiant à jamais le paysage.
Mais les humains ne peuvent pas impunément apporter des changements aussi radicaux à la nature. "À chaque étape, il nous est rappelé qu'en aucun cas nous ne devons dominer la nature comme un conquérant sur un peuple étranger. (...) Pour chaque victoire, la nature se venge sur nous"[1]. Aujourd'hui, ou plutôt au cours des dernières décennies, nous pouvons voir comment la nature, après 140 ans de pillage impitoyable par le capital, commence à se "venger" à l'échelle mondiale. Les processus enclenchés par la destruction de la nature se retournent contre la société comme un boomerang, sous la forme d'une augmentation rapide des catastrophes naturelles aux conséquences durables et de plus en plus dévastatrices.
Le réchauffement climatique est inhérent au mode de production capitaliste.
Dans les conditions capitalistes, chaque unité de capital doit s'accumuler et se développer sous l'impulsion de la concurrence avec les autres capitaux. Elle doit produire aussi efficacement que possible, avec la productivité la plus élevée et le coût le plus bas possible. Toute activité du capital vise constamment la croissance du profit et l’augmentation de l’exploitation de la nature : force de travail, sol, matières premières, etc. La rentabilité est le point de départ et d'arrivée de toute entreprise capitaliste.
Au sein du capitalisme, l'objectif n'est pas la création de produits plus utiles ("valeurs d'usage"), mais l'expansion de la production de marchandises pour le profit. Le capital a fait de l'augmentation de l'échelle de production, de l'expansion du marché et de la reproduction de la valeur à plus grande échelle, une fin en soi. Et plus le capital s'accumule, plus il peut s'accumuler. L'accumulation pour l'accumulation, la production pour la production, voilà ce qui caractérise le capitalisme. La poursuite perpétuelle de chaque cycle de production à une échelle toujours plus grande finit par devenir, dans la période de décadence du capitalisme, une logique complètement irrationnelle et même destructrice.
Pour le capital, la nature est un "don gratuit", elle n'a pas de prix, sauf pour la découverte et l'extraction, elle n'a pas de coût. D'un point de vue capitaliste, la nature est un réservoir de ressources que l'on peut piller à loisir. Ainsi, dans les comptes des entreprises capitalistes, tous les coûts sont notés avec précision (transport, machines, travail, etc.), mais pas les dommages causés à la nature par le processus de production capitaliste. Parfois, les dommages causés à la nature sont réparés, mais la plupart du temps pas par l’entreprise qui les a causés
Dans la période de décadence du capitalisme, et en particulier en raison des besoins de l'économie de guerre, chaque État national est obligé de renforcer son emprise sur la société et de soumettre de plus en plus de parties de la vie économique à son contrôle direct. Le capitalisme d'État est devenu la forme dominante et a enfermé de plus en plus le capital privé dans son carcan. Aujourd’hui, la totalité du capital d’une nation est concentrée autour de l’appareil d’État. Ainsi, la concurrence impitoyable entre les entreprises privées est largement engloutie et transformée en concurrence acharnée entre les États-nations.
Qu'est-ce que cela a à voir avec le problème du réchauffement climatique ? Cela signifie que les décisions les plus importantes dans la lutte contre le réchauffement climatique ne dépendent pas des décisions du capital privé, mais de la politique des États-nations. Et le bilan de la politique des États nationaux en matière de protection du climat n'est pas positif. Au contraire, à l'époque des blocs impérialistes, jusqu'en 1989, lorsque les nations étaient sous le joug du chef de bloc et forcées de coopérer, la bourgeoisie s'est déjà montrée incapable de faire quoi que ce soit de substantiel pour empêcher la poursuite de la destruction de la nature. Mais dans la phase actuelle de décomposition du capitalisme, où la cohésion des blocs n'existe plus et où les relations entre les nations sont dominées par le "chacun pour soi", par des forces centrifuges croissantes et un chaos militaire grandissant, la situation n'a fait qu'empirer . Toute tentative de définir une politique commune pour sauver le climat du réchauffement et prévenir des catastrophes météorologiques de plus en plus dramatiques est devenue illusoire. Toutes les tendances actuelles vont dans le sens d'un chaos politique croissant, dans lequel toute tentative d'établir un consensus mondial entre les États-nations est vouée à l'échec. Cela est vrai même lorsque ces tentatives se présentent comme "socialistes", le rêve des factions gauchistes de la bourgeoisie. Et toutes les conférences internationales pour la "protection" de la nature de ces 30 dernières années témoignent de cet échec.
La destruction de la nature au point qu'elle ne peut plus vraiment se rétablir est directement liée au capitalisme. Le capitalisme est absolument incapable de changer les lois économiques (la course à l'expansion, à la concentration et à l'augmentation des profits) qui sont responsables des dommages toujours plus importants causés à la nature. La société bourgeoise se montre "comme le magicien qui n'est plus capable de contrôler les forces du monde souterrain qu'il a conjurées avec ses sorts"[2] [2]. La hausse des températures et le réchauffement de la planète sont inhérents au mode de production capitaliste.
Cela signifie que, pour arrêter cette dynamique catastrophique, nous devons nous débarrasser du mode de production capitaliste. Il n'est pas nécessaire de s'étendre ici sur les nombreuses prédictions sombres mais réalistes ou sur les divers scénarios apocalyptiques qui nous attendent si la hausse des températures n'est pas arrêtée. On peut trouver de nombreux documents sur Internet, dans des magazines et des livres et, bien sûr, sur notre site web, par exemple l'article "Le monde à la veille d'une catastrophe écologique", (Revue internationale, édition française, anglaise et espagnole n° 135). Cependant, il y a une chose qui doit être mentionnée, c'est le fait que nous nous approchons rapidement du "point de non-retour". Nous sommes dangereusement proches de l'émergence des "effets de rétroaction", dans lesquels les émissions de carbone provenant de la fonte des tourbières et du pergélisol arctique, et en particulier le méthane, qui peut réchauffer l'atmosphère 20 fois plus que le carbone, augmentent si rapidement qu'il est impossible de les arrêter, entraînant la poursuite du réchauffement de la planète même si toutes les émissions humaines devaient cesser.
Changement climatique et guerre
L'industrie de la guerre est très polluante. On estime que les émissions des armées, et des industries qui les approvisionnent, représentent environ 5 % des émissions mondiales, soit plus que l'air et le transport maritime réunis. L'armée américaine émet à elle seule plus de gaz à effet de serre par an que des pays comme l'Espagne, le Portugal ou la Suède, et autant que les émissions annuelles de 257 millions de voitures. Le Cost of War Research Project de Boston a calculé que les émissions dues à toutes les opérations militaires américaines entre 2001 et 2017 sont estimées à environ 766 millions de tonnes de CO2.
En février 2022, l'armée américaine a publié sa première stratégie climatique (ACS), qui vise à réduire de moitié ses émissions d'ici 2030, par exemple en électrifiant ses véhicules de combat et non tactiques, en alimentant ses bases en électricité sans carbone et en développant des chaînes d'approvisionnement mondiales propres.
Pour une institution qui émet régulièrement des dizaines de milliers de kilotonnes de dioxyde de carbone par an et qui est responsable de la pollution environnementale la plus toxique à partir de matériaux comme l'agent orange, le carburant pour fusées et les mousses toxiques pour la lutte contre les incendies, ce plan est tout à fait hypocrite. Il s'agit d'une illustration parfaite de la campagne de "lavage écologique" de l'armée américaine : totalement inadéquate et une grande tactique de diversion.
Le militarisme continue d'empoisonner la planète et de contribuer au réchauffement climatique. Les conséquences environnementales de la guerre en Ukraine sont déjà désastreuses. Il existe des preuves d'une grave pollution de l'air et d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'intensité et de la constance des combats. Des missiles russes ont attaqué un certain nombre d'installations pétrolières et gazières en Ukraine. Les incendies qui en ont résulté ont provoqué de fortes émissions. Rien qu'au cours des cinq premières semaines de la guerre, 36 attaques russes contre des infrastructures de combustibles fossiles ont été enregistrées, entraînant des incendies prolongés qui ont libéré des particules de suie, de méthane et de carbone dans l'atmosphère. L'armée ukrainienne a riposté et mis le feu aux infrastructures pétrolières du côté russe.
Et ce n'est pas tout. Les deux parties n'hésitent pas à utiliser la centrale nucléaire de Zaporizja, la plus grande d'Europe, comme cible de leurs affrontements militaires. Les quatre lignes électriques à haute tension, qui sont censées alimenter la centrale pour la sécurité et le système de refroidissement, entre autres, sont régulièrement détruites par les bombardements. Ainsi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré le 9 septembre que le risque d'un accident nucléaire à la centrale avait "considérablement augmenté". Toute nouvelle destruction des infrastructures autour de la centrale pourrait déjà avoir des conséquences énormes, voire une catastrophe nucléaire de l'ampleur de celle de Fukushima.
Les pays d'Europe occidentale ont accepté de se débarrasser des combustibles fossiles provenant de Russie. Wouter De Vriendt, du parti des Verts, a parlé devant le Parlement fédéral belge d'une grande opportunité "de se débarrasser des combustibles fossiles". Mais la réalité est très différente. La guerre en Ukraine ne sera pas une percée dans le passage à une énergie plus propre. Le gaz et le pétrole russes seront remplacés par des combustibles fossiles, dont certains sont encore plus polluants, comme le gaz de schiste et l'exploitation du lignite. L'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas ont hypocritement annoncé la levée des restrictions sur les centrales électriques à combustibles fossiles et ont prolongé la durée de vie d'une douzaine de centrales au charbon qui devraient fermer d'ici 2030. En fait, les pays occidentaux utilisent la guerre en Ukraine comme un alibi pour renforcer leurs propres industries de combustibles fossiles.
La "décroissance" : une fausse solution aux catastrophes climatiques croissantes
Le mot "décroissance" a été formulé pour la première fois en 1972 lorsque André Gorz a soulevé la question de la relation entre la croissance et le capitalisme. Le mouvement de la "décroissance" proprement dit a vu le jour environ 30 ans plus tard. En 2002, le magazine français Silence a publié un numéro spécial sur la "décroissance", qui a suscité un vif intérêt de la part du public. En 2008, la première conférence internationale sur la "décroissance" pour la durabilité environnementale et la justice sociale a eu lieu à Paris. Cela a donné un véritable élan au mouvement et plusieurs publications importantes ont vu le jour par la suite.
Il n'existe pas d'idéologie de la "décroissance" clairement définie. L'un des points approuvés par l'ensemble du mouvement est qu'il existe des limites à la croissance et que l'objectif est donc de remplacer la croissance quantitative par une croissance ou un développement qualitatif. La "dégravité", nous dit-on, peut être réalisée de nombreuses façons, mais les suggestions les plus courantes sont l'arrêt de la production de biens de consommation inutiles, de biens à obsolescence intégrée ou de biens qui ne peuvent être réparés, l'élimination progressive des combustibles fossiles, le remplacement des transports privés par des transports publics, le démantèlement de l'industrie de l'armement et du complexe militaro-industriel, etc.
Ces propositions ont beaucoup de sens en elles-mêmes. La question est de savoir si elles pourront un jour être mises en œuvre dans le cadre du capitalisme. Ils sont "fondés sur un constat très précis : dans le système capitaliste, la production n'a pas pour but de répondre aux besoins de l'humanité, mais de faire du profit, et ce faisant, non seulement elle ne crée pas de bien-être (loin de là), mais elle détruit la planète". La solution, pour les partisans de la "décroissance", est donc de consommer mieux et moins. [Mais la théorie de la décroissance n'aborde qu'une partie du problème et de manière superficielle ; elle ne va pas au cœur du problème."[3] . [3]
Au sein du mouvement écologiste, certains courants l'ont également compris, affirmant que le capitalisme est à l'origine de la crise climatique et que "toute véritable alternative à cette dynamique perverse et destructrice doit être radicale - c'est-à-dire s'attaquer aux racines du problème : le système capitaliste. (...) La décroissance écosocialiste est une telle alternative". [4]Bien sûr, nous sommes d'accord sur le fait que le capitalisme ne peut pas résoudre le problème du réchauffement climatique, car il est inhérent à la logique de son système. Le capitalisme lui-même doit donc être aboli.
Mais les propositions réelles de ces "écosocialistes" pour créer les conditions nécessaires à l'abolition du capitalisme sont loin d'être radicales. S'ils prônent " l'appropriation sociale des principaux (ré)moyens de production "[5], nous sommes laissés dans le flou total quant à savoir qui doit s'approprier ces (ré)moyens de production. Le peuple, comme on le suggère ? Mais dans une société de classes, le "peuple" en tant que catégorie n'existe pas, ou n'existe que comme une abstraction. Et il est impossible d'attribuer les moyens de production à une abstraction. La seule conclusion qui reste est qu'ils doivent être pris en charge par l'État, dont les écosocialistes ne prévoient pas la destruction.
Ainsi, la formulation selon laquelle "les décisions les plus importantes concernant les priorités de production et de consommation seront prises par le peuple lui-même" est principalement une couverture pour les tendances démocratiques de base des auteurs, qui ne dépasse pas les limites du mode de production capitaliste.
Malgré son langage "radical", l'idéologie de l'écosocialisme est un excellent outil pour détourner les véritables préoccupations concernant la crise climatique de la nécessité d'un changement fondamental des relations sociales vers l'impasse d'une réforme impossible de l'ordre existant.
Mais pire encore, l'idée de "décroissance" dans un régime capitaliste d'État peut également servir de justification idéologique à de nouvelles attaques contre les conditions de vie des travailleurs. Elle pourrait être utilisée pour appeler les travailleurs à réduire leur consommation en faveur d'une politique "écologique" menée par l'État. Au final, cela ne signifierait que plus d'austérité.
Le capitalisme ne peut pas être réformé. C'est un système d'exploitation moribond qui entraîne l'humanité dans l'abîme. Par conséquent, toute lutte réelle contre la poursuite de la destruction de la nature sera impossible tant que le capitalisme régnera sur la planète. Un véritable changement dans la relation entre l'homme et la nature ne peut commencer que sous la dictature du prolétariat. L'équilibre entre l'homme et la nature "ne peut exister que dans le fait que l'homme socialisé, les producteurs associés, règlent rationnellement leur métabolisme avec la nature".[6]
Dennis/octobre 2022
[1] Friedrich Engels, "Le rôle du travail dans le passage du singe à l'homme". [49]
[2] Karl Marx et Friedrich Engels, "Le Manifeste Communiste [50]".
[3] "Journée d'échanges à Marseille : un débat ouvert et fraternel sur «Un autre monde est-il possible ?», ICConline - 2008.
[4] Michael Löwy, BengiAkbulut, Sabrina Fernandes et Giorgos Kallis "Pour une décroissance écosocialiste".
[5] Ibidem
Rubrique:
Le gouvernement nous dit qu’il n’a pas de solution miracle à la crise - Refusons les sacrifices pour sauver ce système pourri
- 69 lectures
Les prix du gaz et de l'électricité sont multipliés par 3 ou 4, l'inflation dépasse les 11 % (et plus de 15 % aux Pays-Bas) et les prix des denrées alimentaires montent en flèche. De tels chiffres n’avaient plus été atteints depuis les années 1970 du siècle dernier. Aux familles ouvrières confrontées à la hausse vertigineuse de leurs factures d'énergie et des prix dans les supermarchés, ce qui ne leur laisse souvent le choix qu’entre baisser le chauffage ou réduire les achats de nourriture, le gouvernement De Croo, a annoncé des mesures pour tenter d'apaiser l’inquiétude et la colère croissantes. Après la réunion du Comité consultatif fédéral (regroupant le gouvernement fédéral et les trois gouvernements régionaux) fin août, et un conclave budgétaire du gouvernement fédéral en septembre, il a appelé à faire confiance à la préoccupation sociale du gouvernement : "Il n'y a pas de solution miracle, mais nous sommes très clairs : nous allons tout mettre en œuvre pour nous en sortir". Assez d’hypocrisie !
La vérité de « Il n’y a pas de solutions miracles ».
Un rapide survol de la situation financière de l’État révèle effectivement qu’il ne faut rien attendre de la bourgeoisie belge et de son gouvernement. Les finances de l'État belge sont dans un état déplorable, comme le souligne le dernier rapport du comité de suivi - composé de fonctionnaires de différents ministères - qui indique que le budget fédéral pour l'année prochaine se dirige vers un déficit de 23 milliards d'euros, soit 3 milliards de plus que la précédente estimation de juillet de cette année. Ce rapport tablait alors encore sur un déficit budgétaire de 3,5 %, mais il est maintenant déjà estimé à 4 %. Selon la Banque Nationale, à politique inchangée, les déficits atteindront même 4,5% cette année et en 2023 et 5% en 2024. En 2019 déjà, les finances de l’État étaient problématiques et la dette dépassait les 100% du PIB. Depuis, la crise au Covid-19 a creusé en 2020 un déficit budgétaire d’environ 10% du produit intérieur brut (PIB) et les inondations dramatiques de l’été 2021, causées par la crise climatique, a demandé une intervention publique de 4 milliards d'euros. Bref, aujourd’hui, les caisses sont vides, « La dette nationale globale semble hors de contrôle » (De Standaard, 12/10/2022), tandis qu’une récession économique pointe le nez.
L’illusion de « nous allons tout mettre en œuvre pour nous en sortir"
Les négociations autour du budget 2023-2024 et les « oppositions » entre les différents partis au gouvernement, entre socialistes et libéraux, entre écologistes et chrétiens-démocrates, ont constitué un grand show politique et médiatique qui, au-delà du besoin pour chaque « famille politique » de se profiler, visait essentiellement deux objectifs :
- convaincre la population et la classe ouvrière que le gouvernement faisait effectivement de son mieux pour adoucir le choc et donc que la colère face à la situation ne devait pas se retourner contre lui ;
- préparer la population et surtout à nouveau la classe ouvrière au caractère irrémédiable des vagues d’austérité : « nous avons tout mis en œuvre mais hélas, il n’y a pas de miracle » !
En réalité, que représentent les mesures prises par le gouvernement ? « Le coût de toutes les mesures visant à réduire la facture énergétique s'élève déjà à 10 milliards d'euros. Une taxe sur les bénéfices excédentaires devrait contribuer à payer le prix de revient des nouvelles mesures » (La secrétaire d’État au budget, dans DS, 12-10-2022). Un simple calcul démontre toutefois que cette taxe sur les surprofits des entreprises énergétiques, estimée à 3 milliards d’euros, reste tout d’abord hypothétique et sera de toute façon largement insuffisante pour couvrir le coût de la facture énergétique de l’État Belge. De plus, les mesures prises pour soutenir les travailleurs et leurs familles, ne sont guère plus que du bricolage à la marge et atténueront à peine l'impact de la hausse des prix de l'énergie et de l’inflation.
Et le pire est encore devant nous. Dans les prochains mois, une « récession mondiale » est annoncée qui entraînerait déjà une baisse de 0,2% du PIB d’octobre à décembre, même si la Belgique, très dépendante des marchés mondiaux pour son importation d’énergie et ses exportations, espère encore que l’UE pourra partiellement réduire l’impact de la récession sur son économie. Déjà, le coût croissant de l’énergie met près de 30% des entreprises en difficulté et certaines sont obligées de réduire, voire d’arrêter leur production (industrie métallurgique, industrie chimique, horticulture sous serre, etc.) : 200 entreprises belges ont demandé le chômage temporaire pour 10 684 travailleurs (données de l’agence pour l’emploi, DS 14/10/2022)). En outre, sous la pression internationale, la Belgique participe pleinement à l’effort militaire accru demandé aux pays de l’OTAN suite à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Fin février 2022, le gouvernement Vivaldi a adopté un plan d'investissement, le Plan Star, qui prévoit une augmentation de 10 milliards d'euros des dépenses militaires d'ici 2030. En mars 2022 (après le déclenchement de la guerre), une enveloppe supplémentaire d'un milliard d'euros a été ajoutée pour la législature actuelle (jusqu'en 2024), afin d'améliorer « la capacité de déploiement de l’armée » dans des opérations militaires.
Bref, les promesses de la bourgeoisie belge sont illusoires et trompeuses : face à la récession, aux catastrophes climatiques, à la guerre, à l’afflux de réfugiés, au déficit budgétaire et à la dette, "les possibilités ne sont pas infinies", comme le reconnaît le ministre-président de la Flandre J. Jambon. En réalité, la bourgeoisie belge, comme ses consœurs, n’a qu’une alternative : imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. La compensation limitée des hausses de l’énergie et de l’inflation est déjà une attaque contre les conditions de vie des travailleurs, tout comme des mesures budgétaires telle la limitation du crédits-temps pour motif de "soins aux enfants" ou la norme de croissance des soins de santé réduite à 2% à partir de 2024. Mais le gouvernement laisse entendre que le budget 2023 - 2024 est temporaire et diverses pistes de rationalisation sont déjà mises en œuvre ou envisagées : les hausses de salaires accordées aux fonctionnaires fédéraux et aux policiers ont été réduites et reportées à plus tard, l'indexation, automatique des salaires est dans le viseur et l’idée d’un « saut d’index » a été avancée ainsi que la révision du mode de liaison des pensions des fonctionnaires au bien-être, des administrations communales suppriment des postes de personnel statutaire et enfin, certaines entreprises appliquent déjà des baisses de salaire.
Refuser de faire des sacrifices est déjà une victoire
Le développement des restrictions et des attaques visant la classe ouvrière, comme conséquence d’un système économique dans l’impasse sur tous les plans, impose une transformation de l’indignation et de la colère qui montent dans les rangs ouvriers en une résistance active pour la défense de leurs intérêts de classe. À cet égard, les travailleurs belges doivent prendre exemple sur la résistance combattive de leurs frères de classe au Royaume-Uni et en France aujourd'hui (lire les tracts « L'été de la colère au Royaume-Uni. La bourgeoisie exige de nouveaux sacrifices, la classe ouvrière répond par la lutte [52] » et « Grèves dans les raffineries françaises et ailleurs... La solidarité dans la lutte, c’est la force de notre classe ! [53] » ainsi que l’article « Le retour de la combativité du Prolétariat mondial »). Ils doivent s’en inspirer pour surmonter leur désarroi et renforcer leur détermination à ne plus avaler les sacrifices et les rationalisations économiques. La tension sociale qui s’accroît avec des grèves spontanées dans plusieurs succursales des supermarchés Delhaize, des mouvements sociaux à l'aéroport de Charleroi, au service clientèle d'ENGIE Electrabel à Gand, chez les cheminots de la SNCB ou dans les transports communs en Wallonie, dans le secteur de la culture en Flandre contre la détérioration des conditions de travail ou pour des revendications salariales, indiquent que, malgré les campagnes de la bourgeoisie pour mettre en valeur sa préoccupation sociale, la classe ouvrière n’est plus disposée à accepter les sacrifices en Belgique aussi.
Cependant, les travailleurs doivent être attentifs à un danger propre au contexte actuel. L’impact de la crise énergétique et de l’inflation ne touche pas seulement les travailleurs, mais également les indépendants, les commerçants, les petits patrons qui s’insurgent aussi contre les conditions actuelles. Dès lors, le danger de mouvements interclassistes, type « gilets jaunes » ou de révoltes populistes (« je refuse de payer mes factures ») est intense et est d’ailleurs stimulé par des campagnes de partis comme le Parti du Travail de Belgique (PTB). Les travailleurs ne doivent pas se laisser submerger par de tels mouvements et se laisser isoler en tant que simples « citoyens ». La force de leur combat réside dans leur capacité à se mobiliser sur des revendications et un mode d’organisation propre à la classe ouvrière.
La bourgeoisie belge est parfaitement consciente – et les mouvements sociaux en Grande-Bretagne et en France le lui rappellent chaque jour – que la mise en œuvre d’une politique d'austérité implique nécessairement d’affronter une classe ouvrière qui semble retrouver sa combativité. Pour ce faire, elle dispose cependant d’une arme redoutable : les syndicats. Une des armes de ceux-ci pour détourner et désamorcer la combativité ouvrière est la campagne syndicale visant à "abolir la loi sur les normes salariales", afin d’obtenir des négociations "libres" dans les entreprises entre patrons et syndicats. Par ce biais, ces derniers veulent en vérité diviser les mouvements par entreprise et opposer les secteurs économiquement forts aux les secteurs économiquement faibles. Par ailleurs, depuis le printemps 2022, ils ont mis en place une série d’actions éparses visant à fragmenter et à épuiser la volonté de résistance ouvrière face aux mesures : en juin, une réunion convoquée par le front commun des syndicats à laquelle 70.000 personnes ont participé, grève d’un jour dans les chemins de fer le 5 octobre, regroupements de militants devant les centrales nucléaires et autres centrales de production d’électricité fin octobre ou encore grève générale d’un jour le 9 novembre, espérant ainsi « lâcher de la pression ». Toutes ces actions, s'inscrivent dans la stratégie des syndicats qui consiste à laisser les travailleurs se défouler pour éviter les explosions de colère spontanées et « sauvages ». Comme leurs collègues en Grande-Bretagne ou en France, les syndicats belges visent par tous les moyens à occuper le terrain et à étouffer dans l'œuf toute réaction décidée des travailleurs.
La bourgeoisie ne peut d’aucune façon « résoudre » la crise qui est fondamentalement une crise historique de son système. Elle ne peut qu’en détourner les conséquences sur la classe ouvrière qui subit les attaques et est censée accepter les sacrifices pour soutenir l'économie nationale dans sa compétition avec d'autres nations capitalistes. Ces sacrifices ne servent que les intérêts de la bourgeoisie, et d'un système en perdition. Cependant, « l’atmosphère sociale » est en train de changer, comme l’illustre les luttes de résistance en Grande-Bretagne et en France et aussi la circonspection actuelle du gouvernement De Croo envers l’imposition de mesures contre les travailleurs en Belgique. Dans ce sens, entrer en lutte pour refuser des sacrifices est déjà une victoire qui ne pourra que renforcer parmi les travailleurs le développement de la solidarité et de la prise de conscience de leur force, ainsi, qu’à terme, de leur capacité à proposer une alternative pour ce système totalement en faillite.
Hugo S./22.10.2022
Situations territoriales:
Personnages:
- Alexander De Croo [33]
Rubrique:
Internationalisme 2023
- 22 lectures
Internationalisme n° 378 - 1e & 2e trimestre 2023
- 65 lectures
La dynamique de la lutte désamorcée par les propositions fallacieuses des groupes « gauchistes »
- 146 lectures
Comme dans de nombreux pays d’Europe occidentale, la classe ouvrière en Belgique, mais surtout aux Pays-Bas, a mené ces dernières semaines et ces derniers mois la lutte contre les atteintes à ses conditions de vie et de travail avec une combativité que nous n’avions pas vue dans ces pays depuis longtemps.
- Aux Pays-Bas, la bourgeoisie a même parlé d'une vague de grèves. Les actions de grève répétées des travailleurs de la chaîne de grands magasins Bijenkorf et du transport régional, qui se déroulaient depuis plusieurs mois, ont été rejointes en janvier par le personnel municipal, les travailleurs des ateliers protégés, le personnel d'autres chaînes de distribution, les chauffeurs d'Uber, du transport d’handicapés et d'élèves ou des compagnies d'autocars, les travailleurs des hôpitaux, de l'industrie et du commerce des boissons, de PostNL, de Douwe Egberts ou encore de l'entreprise de transformation de la pomme de terre Aviko.
- En Belgique, au cours de la même période, il y a eu des grèves et des arrêts de travail du personnel du CPAS à Bruxelles, des fonctionnaires fédéraux, des travailleurs de Bpost, des pompiers à Bruxelles, des mouvements dans le secteur public (à but non lucratif) et dans les transports publics, parmi les gardiens de prison et les bagagistes à Zaventem, au centre de distribution Decathlon de Willebroek et dans plus de 100 supermarchés Delhaize.
Les travailleurs des deux pays suivent ainsi l'exemple de leurs frères de classe au Royaume-Uni et en France.[1] Mais la lutte reste extrêmement fragmentée, chacun faisant grève dans son coin, menant des actions pendant des jours différents, sans manifestations de masse ni assemblées où les travailleurs peuvent discuter et décider de l'évolution des luttes. Comment surmonter ces limites de la lutte ? Plusieurs organisations de gauche - se disant "socialistes", "communistes" ou "marxistes" - proposent des solutions à première vue très radicales. La question est de savoir si elles le sont vraiment et, surtout, si elles répondent aux besoins des luttes ouvrières aujourd'hui. Examinons de plus près à quoi correspondent leurs propositions pour les luttes actuelles.
« Les syndicats doivent mieux organiser la lutte »
Voilà ce que les groupes « gauchistes » proposent aux Pays-Bas : « Il est temps que le FNV (le plus grand syndicat aux Pays-Bas), en accord avec sa base, concrétise politiquement ses revendications justifiées de la campagne 'Les Pays-Bas méritent mieux’ » et décide en conséquence de « mobiliser massivement sa base pour cela» ».[2] En Belgique, le Parti socialiste de lutte (PSL) déclare que "les membres de la FGTB doivent se mobiliser pour un syndicat plus combatif et plus démocratique".[3]
Ce que ces groupes font croire aux travailleurs, en réponse à la réticence des syndicats à être plus déterminés dans l’organisation des actions syndicales, doit tout simplement être dénoncé. En effet, c’est consciemment que par exemple la FNV, avec d’autres syndicats, a organisé la lutte de cette manière dans la période récente. Cela découle de son rôle au sein du capitalisme, qui n'est pas de rendre la lutte efficace, mais au contraire de l’entraver, de décourager les travailleurs et de saper leur volonté de lutter.
Depuis plus d'un siècle, le syndicat n'est plus une "auto-organisation des travailleurs" et ne pourra jamais plus le devenir. L'histoire des cent dernières années montre que tous les syndicats ont systématiquement sapé les luttes des travailleurs. Même les syndicats prétendument radicaux et combatifs[4], présentés comme exemples par les groupes de la « gauche radicale », n'ont jamais, après la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-1923, défendu les intérêts de la classe ouvrière.
L'orientation proposée aux travailleurs par ces groupes, à savoir de s'engager au sein du syndicat pour orienter ceux-ci vers une voie plus radicale, n'a pour effet que de détourner les travailleurs les plus critiques vers des actions sans perspectives quine changent rien au fond et stimulent donc au découragement.
« Il faut sauver les syndicats de la trahison des dirigeants »
"Si les syndicats ne sont pas combattifs, c'est à cause des dirigeants ", nous disent les « syndicalistes de combat ». Selon « Socialistisch Alternatief » (section de l’Alternative Internationale Socialiste aux Pays-Bas et équivalent du PSL en Belgique), le manque de combativité de la FNV serait dû à "la trahison de types comme Wim Kok"[5], qui ont accédé à la tête du syndicat. Pour sa part, le GIS (Groupe des socialistes internationaux) estime qu'il y a quelque chose de fondamentalement pourri dans la FNV, si quelqu'un "comme Van Doesburg a pu prospérer dans la FNV pendant si longtemps, tout en n’œuvrant pas pour ses membres, mais pour l'ennemi de classe". [6]
La ritournelle de la trahison des dirigeants syndicaux est aussi vieille que le monde. Au cours des cent dernières années, tous les dirigeants syndicaux se sont toujours retournés contre la classe ouvrière. Ce n'est pas parce qu'ils auraient rejoint le camp de la bourgeoisie, mais parce que l'organisation qu'ils dirigeaient n'était plus une organisation de la classe ouvrière, mais une organisation de l'État bourgeois.
L'intégration du syndicat dans l'État bourgeois est le résultat du changement des conditions historiques objectives, qui ont fondamentalement modifié le contenu de la lutte des travailleurs au cours des cent dernières années. Depuis l'éclatement de la première guerre mondiale, qui a marqué le début de la crise historique du capitalisme, aucune amélioration durable au sein du capitalisme n'est possible. Par conséquent, l’objectif réel de la lutte des travailleurs ne consiste plus en une amélioration progressive des conditions de travail et de vie, alors que celles-ci pouvaient encore être arrachées à l’État au 19e siècle, mais vise le renversement global et immédiat du capitalisme décadent. Comme l'a dit Lénine, depuis le début du 20e siècle, "derrière chaque grève se cache l'hydre de la révolution”.
Et du fait de ce changement des enjeux historiques de la lutte, le syndicat, en tant qu'appareil essentiellement destiné à obtenir des améliorations au sein du capitalisme (ce qui n'est plus possible aujourd’hui), a été englouti par l'État bourgeois.
Par conséquent, l'appel des groupes « gauchistes » à "reconquérir les syndicats" en "expulsant les dirigeants corrompus" également ne conduit en aucun cas au renforcement de la dynamique de lutte et de la force prolétarienne. Il encourage les travailleurs à s'efforcer de reconquérir une organisation de l’État bourgeois en leur sein, ce qui ne fait qu'accroître l’emprise syndicale sur la classe ouvrière et entraîner les travailleurs vers une défaite certaine.
« Il faut lutter pour la qualité des services publics »
Une autre position que ces organisations "gauchistes" mettent régulièrement en avant est la défense des services publics - transports publics, soins aux malades, aux personnes âgées et aux handicapés, éducation, culture... - et elles mettent particulièrement l'accent sur la défense de la qualité de ces services. Les services publics constituent, selon le SAP aux Pays-Bas, " ensemble la base de la construction d'une société véritablement solidaire et écologique, fondamentalement opposée à la logique de l'argent et du profit".[7] Selon le PVDA/PTB en Belgique, ce sont les services publics qui "garantissent une société chaleureuse, où ce sont les gens qui priment et non les profits. C'est pourquoi je soutiens les travailleurs et les syndicats des services publics dans leur lutte pour le respect et des investissements".[8]
Là encore, un rejet sans équivoque s'impose. Les services publics, qu'ils soient privatisés ou non, sont avant tout des instruments au service de l'État bourgeois et il est donc totalement insensé de prétendre qu'ils servent la "communauté". Mais surtout, les travailleurs de ces entreprises sont tout autant exploités que dans n'importe quelle entreprise. Dans les services publics aussi, le rythme de travail augmente, des restructurations sont implémentées, les salaires sont réduits et les travailleurs sont licenciés.
De plus, aujourd'hui, introduire des réformes "socialistes" dans un système capitaliste en voie de décomposition est une aberration. La "lutte pour la qualité des services publics" n'a donc rien de commun avec la lutte des travailleurs pour défendre leurs conditions de travail et de vie, mais conduit à mélanger leurs intérêts avec ceux de certaines instances de l'Etat bourgeois.
En fait, ce que proposent ces groupes va directement à l'encontre des besoins de la lutte, qui consiste à unir au-delà des frontières des entreprises et des secteurs, et représente un appel déguisé aux travailleurs pour qu'ils abandonnent leur lutte en tant que classe indépendante.
Les faux amis des travailleurs
"Les socialistes révolutionnaires soutiennent les actions" ! [9] Ce n’est sûrement pas le cas des organisations comme le PSL, « Vonk/Révolution », le PTB (Parti du travail en Belgique) en Belgique ou « Socialistisch Alternatief », GIS, SAP/Grenzeloos[10] aux Pays-Bas. Ils tendent des pièges et avancent de fausses perspectives pour empêcher la dynamique de la lutte de se renforcer et de s'approfondir. Et cela n'arrive pas par hasard. C'est parce qu'ils font partie, non pas du camp de la classe ouvrière, mais de l'appareil politique de la bourgeoisie. "Le fait qu'ils aient moins d'influence ou qu'ils adoptent un langage plus radical ne diminue pas le caractère essentiellement bourgeois de leur programme et de leur nature, mais fait d'eux des recruteurs utiles".[11] Leur tâche consiste donc à utiliser un langage en apparence radical dans le but d’enfermer la lutte ouvrière dans la logique capitaliste du profit, de la rentabilité et de la réduction des coûts dans l'intérêt de la compétitivité de l'économie nationale.
L’histoire a prouvé que lorsque les travailleurs agissent comme une seule classe, ils sont capables d’agir de manière autonome, de débattre, de prendre des initiatives et de développer la créativité et, dans une telle dynamique, de repousser les attaques de la bourgeoisie barbare et de s’engager sur le chemin de la société communiste. En conséquence, les organisations révolutionnaires appellent dans leur intervention les travailleurs à prendre la lutte en main en organisant des assemblées générales et des comités de grève élus. Par ailleurs, les exemples de luttes ouvrières des cent dernières années démontrent aussi sans le moindre doute que, dans le développement de leurs luttes, les travailleurs se sont constamment heurtés aux manœuvres des syndicats. C’est pourquoi les révolutionnaires doivent dénoncer en permanence la nature anti-ouvrière de ces organisations. Et dans ce contexte, il est tout aussi essentiel de démasquer et de dénoncer les soi-disant organisations de «gauche radicale», qui prétendent soutenir le combat ouvrier mais qui, en réalité, sabotent son développement et sa dynamique.
Dennis / 2023.04.10
[1] Voir le tract international du CCI: Partout la même question: Comment développer la lutte? Comment faire reculer les gouvernements? [55]
[2] traduction de “Grenzeloos, Nederland verdient beter ‒ Nederland heeft stevige eisen en actie nodig om van Rutte en de werkgevers te winnen [56]”
[3] traduction de “LSP, Gerommel aan de top van het ABVV. Voor een strijdbare vakbond met democratie van onderuit [57],13 juli 2020”
[4] Parmi les exemples les plus connus, citons la Confederacion Nacional de Trabajo (CNT) en Espagne, l'Industrial Workers of the World (IWW) aux États-Unis, l'Eenheidsvakcentrale (EVC) aux Pays-Bas juste après la Seconde Guerre mondiale, la Freie Arbeiter Union (FAU) en Allemagne après la même guerre.
[5] traduction de “Socialistisch Alternatief, Strijdbaarheid neemt toe in Nederland [58]”
[7] traduction de“SAP, Geconfronteerd met toenemende onzekerheid en verslechterende werkomstandigheden: haal het geld daar waar het zit! [60]”
[8] Hedebouw (PTB), "Een warme samenleving bouw je op sterke openbare diensten", 10 maart 2023
[9] traduction de “Socialistisch Alternatief, Strijdbaarheid neemt toe in Nederland [58]”
[10] Tous ces groupes sont des descendants directs ou indirects de la Quatrième Internationale, fondée par Trotski en 1938, qui a basculé dans le camp de la bourgeoisie lors de la Seconde Guerre mondiale en participant à la guerre impérialiste contre l'Allemagne nazie. Seuls quelques uns se sont retournés contre cette trahison de l’IVème Internationale, dont Nathalie Trotsky.
[11] La plateforme du CCI [61], point13 : La nature contre-révolutionnaire des partis "ouvriers".
Rubrique:
Internationalisme n° 379 - 3e & 4e trimestre 2023
- 46 lectures
Positions internationalistes contre la guerre
- 214 lectures
Les tensions atteignent partout un point d'ébullition en raison des affrontements horriblement violents entre le régime du Hamas à Gaza et l'État d'Israël. Une atmosphère d'hystérie règne dans les deux camps. En représailles à l'attaque terroriste du Hamas, les colons juifs armés de Cisjordanie ont déjà tué cinq Palestiniens au cours de cette première semaine de guerre, tandis que l'armée israélienne s'efforce d'anéantir Gaza. Dans une atmosphère aussi oppressante, il est très difficile de suivre la voie internationaliste qui refuse de choisir l'un ou l'autre camp. Il faut du courage pour défendre publiquement une perspective prolétarienne cohérente. Mais heureusement, certaines voix internationalistes se font entendre. Même si nous ne partageons pas toutes les positions développées dans leurs articles, elles sont une lumière dans les ténèbres de la barbarie actuelle déclenchée par la bourgeoisie internationale.
Parmi ces voix, il y a deux autres organisations de la gauche communiste. La première est la Tendance Communiste Internationaliste avec la déclaration « La dernière boucherie au Moyen-Orient fait partie de la marche vers la guerre généralisée ».[1] La seconde est Il Partito Comunista avec l'article « Guerre à Gaza, contre la guerre impérialiste, pour la guerre de classe révolutionnaire ».[2]
Mais il y a aussi au moins deux groupes anarchistes qui ont publié une position internationaliste contre les atrocités commises par le capitalisme au Moyen-Orient. Le premier est le Groupe Communiste Anarchiste qui a publié l'article « Ni Israël, ni Hamas ! ».[3] L'autre article est celui du réseau Anarcom, intitulé « Ni un État, ni deux États ! Aucun 'État' ne mettra fin au massacre de notre Classe ! ».[4]
Ainsi, malgré la campagne assourdissante des gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays, et de la gauche bourgeoise pour soutenir la « cause palestinienne », plusieurs organisations en Europe et en Amérique du Nord sont restées fidèles aux principes internationalistes du prolétariat mondial.
Nous reviendrons en temps utile sur certaines des positions adoptées par les différents groupes.
WR/14.10.2023
Récent et en cours:
Rubrique:
«Nouvel élan» ou encore plus de chaos et d'instabilité ? Quel que soit le gagnant, aucune solution pour la classe ouvrière !
- 77 lectures
La campagne bourgeoise pour les élections parlementaires bat son plein. Tous les partis ont présenté leurs manifestes électoraux et leurs listes de candidats. D'après les sondages, les résultats devraient être assez serrés et pourraient déboucher sur un séisme parlementaire, car il n'est pas exclu que les cinq partis populistes, qui possèdent actuellement environ 25 sièges à la chambre, obtiennent ensemble plus de 75 sièges après les élections du 22 novembre et constituent ainsi une majorité au parlement.
Cette montée du populisme n'est évidemment pas un phénomène typiquement néerlandais, c›est quelque chose que l'on voit partout dans le monde, les exemples les plus célèbres étant Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis ou Modi en Inde. En Europe aussi, il y a divers gouvernements soutenus par des partis populistes, comme en Italie, en Suède, en Hongrie et en Pologne.
L'extrême fragmentation de la scène politique
La fragmentation extrême de la scène politique néerlandaise (près de 20 partis sont représentés au parlement) est l'expression de la perte de contrôle croissante de la bourgeoisie sur son appareil politique. Pendant longtemps, la vie politique néerlandaise, sous la direction du premier ministre Marc Rutte, a été un modèle de stabilité et la bourgeoisie était parvenue à maîtriser raisonnablement la croissance populiste. Mais au cours des deux dernières années, la situation politique s'est considérablement dégradée.
En 2021, la bourgeoisie avait déjà été confrontée à d'énormes difficultés pour constituer un nouveau gouvernement. Lorsqu'il a finalement été formé, nous avions écrit que « Les difficultés actuelles de la bourgeoisie néerlandaise à former un nouveau gouvernement stable, capable de conduire le pays à travers les tempêtes actuelles et à venir, expriment de manière frappante la tendance au chacun pour soi, (…) avec la politique à court terme qui tend à prédominer de plus en plus dans la phase de décomposition. »[1]
La décision de M. Rutte de faire tomber son propre gouvernement et de se retirer de la vie politique, suivi en cela par les dirigeants politiques de presque tous les autres partis traditionnels, donnant ainsi plus ou moins libre cours à la vague populiste, ouvre une nouvelle phase dans le développement du « chacun pour soi ». La situation actuelle est donc infiniment plus grave qu'en 2001, par exemple, lorsque la Liste Pim Fortuyn (LPF) avait effectué une percée: le « déclin » des partis traditionnels, tant sur le plan quantitatif (nombre de sièges) que qualitatif (ampleur des scandales), est aujourd'hui beaucoup plus avancé. En outre, ce n'est plus un seul parti populiste qui monte à l’assaut de la capitale politique, mais trois grands partis accompagnés de quelques petits.
L'irresponsabilité du populisme
Le populisme est une manifestation typique de la phase actuelle de décomposition du capitalisme[2] et l'expression la plus claire de la tendance à la perte de contrôle de la bourgeoisie sur son jeu politique. Cela était déjà évident aux Pays-Bas au cours des 20 dernières années, à travers les difficultés qu’a rencontrées la bourgeoisie à « obtenir » un résultat électoral permettant la formation d'un gouvernement apte à défendre ses intérêts. En donnant maintenant au populisme tout l'espace dont il a besoin pour gagner en influence, la situation ne fera qu'empirer et les chances de former un gouvernement stable deviennent beaucoup plus faibles. Après tout, le populisme n'est guère plus qu'une sorte de révolte contre l'élite politique et n'offre aucune perspective alternative pour la gestion du capitalisme. La politique de ces partis, « s'ils appliquaient leur programme, ne pourraient conduire qu'à une sorte de vandalisme qui ne ferait qu'aggraver encore l'instabilité .»[3]
En bref, l'irresponsabilité et l'instabilité des partis populistes ne feront que rendre la situation politique plus précaire et chaotique pour la bourgeoisie.
Le populisme affecte d’ailleurs également gravement les partis de gestion traditionnels. Par exemple, le parti chrétien-démocrate (CDA) risque d'être décimé. Ce parti, qui par le passé a obtenu plusieurs dizaines de sièges parlementaires et a été un pilier de la politique néerlandaise pendant de nombreuses années, a été érodé par le populisme. Lors des prochaines élections, il risque de devenir un parti insignifiant avec 5 sièges ou moins. Des personnalités comme Mona Keijzer et Pieter Omtzigt sont partis vers respectivement les partis populistes BoerBurgerBeweging (BBB) et Nieuw Sociaal Contract (NSC). Entre-temps, un grand nombre d'autres membres du CDA ont également abandonné le navire en détresse et ont rejoint un des partis populistes.
Pour maintenir l'économie néerlandaise à flot dans un contexte de concurrence internationale acharnée, la bourgeoisie a besoin d'un gouvernement stable, capable de trancher des nœuds et de prendre des décisions de grande envergure. Or, les cadres politiques des partis populistes, beaucoup plus touchés par les effets de la décomposition, ne sont « nullement préparés à prendre en charge les affaires de l'État (…) Les options économiques et politiques portées par le populisme ne constituent nullement une option réaliste de gestion du capital national. »[4]
L'illusion d’un « nouvel élan »
Cependant, cela ne signifie pas que la bourgeoisie néerlandaise reste les bras croisés. Faisant de nécessité vertu, elle utilise le chaos politique pour faire croire aux travailleurs que ces élections portent sur des choix fondamentaux et qu'il s'agit de donner un « nouvel élan » à la démocratie.
Ainsi, les partis populistes et d’autres combinaisons occupent la quasi-totalité de l'échiquier politique pour offrir un exutoire à tous les votes de protestation possibles. Les trois grands partis populistes s’adressent chacun à une frange de l'électorat : le Parti de la Liberté (PVV) prône la réduction du nombre de demandeurs d'asile ; le BBB dénonce les excès de la politique verte; le NSC promet une politique honnête et sans compromis. En outre, à l'autre extrémité de l’échiquier politique, un nouveau pôle antipopuliste a émergé ; le regroupement PvdA-GroenLinks (Le Parti du Travail social-démocrate et la Gauche Verte) vise également à rallier à lui des électeurs mécontents avec son ‘poing sur la table pour des Pays-Bas verts et sociaux’.
Un autre élément susceptible de stimuler la campagne est le fait qu'environ la moitié des partis se présenteront aux élections avec un nouveau chef de parti, Frans Timmermans, qui dirige l’alliance PvdA-GroenLinks, étant l'un des plus en vue. Les nouveaux chefs de parti suscitent de nouvelles attentes et peuvent raviver les illusions sur la représentation parlementaire. Par ailleurs, tous les partis politiques, en dehors des nouveaux partis BBB et le NSC, ont également remplacé la moitié de leurs candidats par de nouveaux.
La montée des partis populistes est l'expression d'un pourrissement de l'appareil politique de la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie ne serait pas une classe dirigeante si elle n'utilisait pas ce pourrissement à son profit (et, bien sûr, contre la classe ouvrière). Grâce à ces mêmes partis populistes, qui se présentent comme une nouvelle alternative aux partis établis, le piège des élections est renforcé, « à la fois à travers les électeurs qu'ils mobilisent et ceux qui se mobilisent pour voter contre eux. Bien qu'ils soient en partie le produit de la désillusion croissante envers les partis traditionnels, ils peuvent aussi contribuer à renforcer l'image de ces derniers. » [5]
Bref, la bourgeoisie engage tous ses atouts pour tenter d’attirer et de mobiliser la classe ouvrière sur le terrain de ses élections.
Les élections parlementaires contre la lutte des travailleurs
Les élections sont un mécanisme de légitimation du pouvoir de classe de la bourgeoisie, qui présente son pouvoir de classe comme le pouvoir du peuple. En ce sens, il s'agit d'une vaste campagne de tromperie, principalement dirigée contre la classe ouvrière.[6] Elle tente de faire croire aux travailleurs qu'il n'y a rien de mieux que la démocratie parlementaire et de les persuader d'abandonner la lutte des classes, et ceci alors que, précisément, dans les premiers mois de 2023, les travailleurs néerlandais ont montré à travers une ample vague de grèves, qu’ils en avaient assez de l’incessante austérité qu’ils devaient accepter pour garantir la compétitivité de l’économie nationale
Les travailleurs ne doivent se faire aucune illusion : quels que soient les partis qui gagneront le 22 novembre, qu'ils soient au gouvernement ou dans l’opposition, ils n'apporteront aucune solution. Les problèmes majeurs liés au pourrissement du capitalisme (réchauffement climatique, flux de réfugiés, crise économique, et la guerre comme un catalyseur important de tous les autres problèmes mentionnés) ne peuvent être résolus au sein du capitalisme et donc certainement pas par chaque bourgeoisie nationale individuellement. Le traitement administré par la bourgeoisie ne fera qu'aggraver la maladie du patient.
En outre, toutes les mesures prises par la bourgeoisie pour tenter de désamorcer l'accumulation des crises s'accompagneront d'attaques radicales en particulier contre les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Raison de plus pour les travailleurs d'ignorer tout ce cirque électoral et de se concentrer sur le combat pour la défense de leurs conditions matérielles, au travail comme à la maison, en tant que salarié ou chômeur. Ce n'est que dans cette lutte contre les attaques économiques du gouvernement et des patrons qu'ils pourront développer une lutte révolutionnaire contre ce système d'exploitation et d'oppression. La classe ouvrière est la seule force de la société qui ait la capacité, à travers le renversement de la domination de la bourgeoisie et la destruction de l'État capitaliste, y compris la démocratie parlementaire, d’endiguer la vague barbare qui, sous la domination du capitalisme, mène vers la destruction de l’humanité.
Dennis/14.10.2023
Géographique:
- Hollande [16]
Personnages:
- Mark Rutte [36]
Récent et en cours:
Rubrique:
Internationalisme 2024
- 33 lectures
Internationalisme n° 380 - 1e & 2e trimestre 2024
- 54 lectures
Campagne électorale en Belgique : Répandre l'illusion que les élections peuvent conjurer la crise du capitalisme
- 61 lectures
En Belgique, les élections pour le Parlement européen, le Parlement fédéral et pour les trois parlements régionaux auront lieu le 9 juin. De l'extrême gauche à l'extrême droite, la bourgeoisie est unie pour tenter d'enthousiasmer la population, en particulier les nouveaux jeunes électeurs et la classe ouvrière par le biais de tests électoraux à grande échelle, de sondages, d'enquêtes sur les médias sociaux, de séances d'information dans les écoles, etc. afin qu'ils participent à ce cirque électoral. C’est la fête par excellence de la "démocratie" bourgeoise, qui permettrait soi-disant aux travailleurs grâce à un "juste choix" d’imposer "leur" politique à l'État bourgeois, bien sûr dans les limites de "ses" lois du marché capitaliste, de "son" effort de guerre, de "sa" crise économique, de "sa" crise climatique, de "sa" crise des réfugiés, et nous pourrions en ajouter d'autres à la liste.
La bourgeoisie a déjà fait son choix
Qu'il n'y ait aucun doute, quelle que soit la composition des gouvernements à venir, pour elle le choix final est fait depuis longtemps, pas besoin d'élections pour cela, car pour elle il n'y a pas d'autre voie ! Sous la pression d'une situation mondiale troublée, de nombreuses décisions importantes seront prises dans la période à venir pour défendre les intérêts nationaux de la bourgeoisie. Voilà le véritable casse-tête de la bourgeoisie, car le gouvernement devra avoir la capacité de prendre rapidement des mesures d'envergure. Bien que l'économie belge, avec une croissance de 1,5 %, semble faire mieux que la moyenne européenne, la réalité est que la production industrielle en Belgique est tombée à son niveau le plus bas depuis la pandémie et qu'en février de cette année, elle était inférieure de près de 7 % à ce qu'elle était un an plus tôt. La Belgique est soumise à une forte pression en raison d'un déficit budgétaire beaucoup trop élevé (4,4 %), et l'UE a imposé à ses États membres des règles budgétaires stipulant que ce déficit doit être ramené à 1,5 % du PIB d'ici à 2031. Pour ce faire, la Belgique devrait réduire son déficit d'au moins 27 milliards, soit 4 milliards par an, au cours des sept prochaines années. Mais le taux d'endettement de 105 % du PIB doit également être ramené en dessous de 100 %. Les agences de notation menacent d'abaisser la note de la Belgique, ce qui augmenterait encore la charge des intérêts. En outre, plusieurs questions, que le gouvernement fédéral actuel a repoussées ou auxquelles il a répondu par des mesures timides, devront être abordées en profondeur ; il s’agit par exemple des mesures de réduction des émissions d'azote, de la poursuite de la réforme des pensions et de la fiscalité, ou de la limitation des dépenses de chômage ou de la gestion des centres d'asile et des prisons.
L'instabilité de la situation mondiale qui provoque un véritable tourbillon de crises augmente la pression et nécessite de nouveaux efforts comme l'augmentation des dépenses de défense au niveau des de 2 %, exigés par l'OTAN, ou encore l'augmentation des dépenses pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique et de la pollution de l'environnement et pour mener à bien la transition énergétique (de plusieurs dizaines de milliards). Cela accroît encore la pression sur l'économie belge, qui subit aussi de plus en plus les conséquences des mauvaises performances de l'économie allemande, déjà en récession depuis un an, qui pourrait entraîner de nombreux licenciements en Belgique cette année (par exemple chez Audi Forest ou dans l'industrie chimique).
Il est évident qu'un seul programme s’impose pour la bourgeoisie : la défense de l'économie nationale dans le chaos économique, militaire et écologique mondial actuel implique automatiquement une réduction des budgets de dépenses sociales et de la masse salariale dans tous les secteurs.
L'instabilité croissante de l'appareil politique
Dans un numéro précédent d'Internationalisme, nous avions relevé une aversion croissante pour l'élite politique en Belgique. "Une étude menée par des politologues de cinq universités belges a conclu que l'aversion pour l'establishment politique, l'une des caractéristiques essentielles du populisme, se développe dans la société et qu'une humeur antipolitique générale se développe même parmi les électeurs" (Instabilité politique en Belgique et COVID-19 : les travailleurs ne doivent pas en payer la facture ! [75]). En 2019, un électeur sur six en Flandre déjà n’a pas voté pour un parti politique. Une étude récente menée dans des villes wallonnes, comme Verviers, confirme cette tendance pour l'ensemble du pays. (Voir De Standaard Weekblad : Verviers se sent oubliée, 20 avril 2024)
Le populisme exploite ce mécontentement et ce manque de perspectives. Il cherche des boucs émissaires et prétend ne pas faire partie de la politique bourgeoise et qu’il ne protégerait pas les intérêts du capital. Le « Vlaams Belang » (VB), qui, selon les sondages, , deviendrait le plus grand parti de Flandre et peut-être même du pays, comme le PVV aux Pays-Bas, surfe sur cette orientation. Bien que son programme ne soit pas fondamentalement contre l'UE, contre l'OTAN et contre le soutien à l'Ukraine, il dénonce essentiellement, comme d'autres partis populistes, la prétendue islamisation de la société et s'oppose à l'"élite" politique. Son président, Tom van Grieken, l’a une fois de plus clairement souligné dans un discours le 21 janvier de cette année : "L'élite politique est en train de gommer l'identité flamande, aliénée de sa culture, privée de ses normes et de ses valeurs, privée de son individualité ». (L’extrême droite ressuscitée - Nie wieder ! [76]) Par ailleurs, le parti travailliste de gauche (PVDA/ PTB) s'oppose également à l'élite politique, à l'UE et à l'OTAN.
Les mêmes sondages montrent que le paysage politique belge est également de plus en plus morcelé et fragmenté. Sous la pression des effets de la décomposition historique du capitalisme, l'appareil politique devient de plus en plus instable, touché par la tendance au "chacun pour soi", et la bourgeoisie en perd de plus en plus le contrôle. A l'exception du MR (libéraux francophones) et du CD&V (chrétiens-démocrates flamands), les partis qui composent actuellement la coalition gouvernementale fédérale sont en perte de vitesse dans les sondages. Certains d'entre eux risquent d'être réduits à l'état de parti marginaux.
Le système politique belge est déjà très complexe et fragmenté en raison du fait qu'il n'y a pas de partis nationaux, mais qu'ils sont établis par communauté linguistique (à l'exception du PVDA/ PTB). En outre, la structure gouvernementale est également divisée en une composante fédérale, une composante régionale et une composante communautaire. Cela signifie que la formation d'équipes gouvernementales cohérentes, capables de défendre les intérêts de la capitale belge dans les années à venir, tant au niveau fédéral que régional, et de prendre les mesures nécessaires, peut s'avérer une tâche complexe.
L'illusion qu'il existe un "bon choix" dans le système actuel
Les élections ne représentent nullement une alternative à la crise du système. Leur but est précisément de convaincre la population, et en particulier la classe ouvrière, du contraire, de lui faire croire que voter a un sens, que c'est ainsi qu'elle pourra faire de "bons choix" pour assurer "notre prospérité". La campagne électorale insiste sur le fait qu'il n'y a pas de meilleur système que la démocratie, parce qu'elle serait le seul système qui permette d'aborder les problèmes de manière rationnelle "avec le peuple et pour le peuple", dans un cadre défini par l'économie nationale et avec le rôle de l'État national en tant que gardien du "bien commun" contre les intérêts particuliers des entreprises privées. Ainsi, l'électorat pourrait, par exemple à travers le "choix de la rupture" du PTB, imposer une politique fondamentalement différente à une nouvelle majorité gouvernementale.
Mais la réalité est tout autre, car, en tant que gardien de l'économie nationale, l'État défend totalement les intérêts du capital et la domination de la bourgeoisie. De ce point de vue, il n'y a pas d'autre politique que la réduction de la dette nationale, le rétablissement de l'équilibre budgétaire, l'investissement dans l'équipement moderne de l'armée et la production d'armes, ce qui doit automatiquement conduire à la réduction des dépenses sociales et à la diminution de la masse salariale. Ainsi, les élections ne sont rien d'autre qu'un mécanisme de camouflage et de cautionnement de cette domination de classe. Les élections sont une grande campagne de tromperie, principalement dirigée contre la classe ouvrière, pour qu'elle renonce à lutter pour ses intérêts de classe en faveur des intérêts généraux de son ennemi de classe. Dans ce contexte, l'un des mensonges les plus grossiers de la campagne électorale est la prétendue opposition entre les partis "raisonnables" qui « défendent » les valeurs démocratiques, et les partis "déraisonnables" (comme le VB et le PVDA/PTB) qui « menacent » ces valeurs. Tous deux n’offrent aucune perspective, car ils sont liés à la logique irrationnelle du maintien en vie d'un capitalisme dépassé.
Face aux attaques idéologiques de la bourgeoisie, dont la campagne électorale est l'une des plus importantes, la classe ouvrière doit préserver son indépendance. En tant que seule force sociale capable d'apporter une solution à la misère, au chaos et à la destruction croissants dans le monde, elle doit développer une conscience claire et profonde de la voie qu'elle doit emprunter dans sa lutte. Cette lutte ne suivra pas la voie parlementaire bourgeoise, mais devra nécessairement transcender les frontières de ce système capitaliste dépassé, un système qui a atteint sa date de péremption avec des guerres qui n’apportent que génocide et ruines, une incapacité à faire face à la crise climatique, une crise économique qui ferme les entreprises, détruit les biens, crée des masses de réfugiés, la pauvreté, la famine et le désespoir parce qu'il y a SUREPRODUCTION ! Alors que l'on produit suffisamment de biens pour nourrir 1,5 fois la population mondiale : "Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, - l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise; au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle; et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein" (Marx&Engels, Manifeste communiste, cm.pdf (marxists.org). [50]
Géographique:
- Belgique [15]
Situations territoriales:
- Belgique [6]
Récent et en cours:
Rubrique:
Le PVV de Wilders, devient le plus grand parti des Pays-Bas : Populisme et anti-populisme : Deux visages politiques de la classe dirigeante
- 97 lectures
En novembre, selon les commentateurs bourgeois, un raz-de-marée politique a eu lieu aux Pays-Bas. Les élections ont donné aux partis populistes un peu moins qu’une majorité absolue, mais le PVV (Parti pour la liberté) de Geert Wilders est devenu de loin le plus grand parti. Un certain nombre de partis traditionnels, piliers du système politique pendant des décennies, ont vu leurs sièges au parlement réduits de moitié, comme les chrétiens-démocrates, ou ont survécu grâce à la formation d’un cartel comme celui entre les sociaux-démocrates du PvdA avec la Gauche Verte. Dans un précédent article, nous posions la question de la situation politique aux Pays-Bas après les élections : un « nouvel élan » ou encore plus de chaos et d’instabilité ?[1] Mais il est désormais certain que cette dernière dominera de plus en plus la scène politique aux Pays-Bas dans la période à venir.
La croissance constante du populisme aux Pays-Bas
Ce n’est pas la première fois qu’un parti populiste aux Pays-Bas réalise des gains aussi importants. En 2002, la liste Pim Fortuyn l’avait déjà fait, suivie en 2010 par le PVV de Wilders, en 2019 par le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet, et lors des élections sénatoriales de 2023 par le BBB (Mouvement agriculteur-citoyen). Mais en novembre 2023, le populisme a réussi à conquérir une position de premier plan sans précédent dans la politique néerlandaise.
En l’absence de l’ancien Premier ministre Mark Rutte, qui a réussi à neutraliser les précédentes explosions populistes, Wilders a habilement joué sur le mécontentement face à la misère existante en émaillant sa propagande d’une campagne ouvertement raciste anti-immigrés pour « faire passer les Néerlandais en premier ». « Nous devons reprendre le contrôle de nos frontières, de notre argent et de nos lois. Nous devons également reprendre notre souveraineté nationale. Nous devons reconquérir les Pays-Bas » [2] . Il s’agit clairement d’une politique du bouc émissaire : les migrants à la recherche d’un logement sont accusés d’être responsables de la pénurie de logements. La gauche qui défend les mesures climatiques est accusée d’être responsable du coût de la vie. L’élite politique (les « remplisseurs de poches ») est accusée d’être responsable de la perte de l’identité néerlandaise. C’est ce cocktail démagogique avec lequel le PVV a réussi à gagner près d’un quart des Néerlandais.
Le populisme n’est pas seulement un phénomène néerlandais, mais une réalité mondiale
Bien que les Pays-Bas aient été l’un des premiers pays occidentaux où le populisme a pu acquérir une influence majeure, il ne s’agit pas d’un phénomène typiquement néerlandais. Le populisme s’est déjà fait un nom par des victoires électorales retentissantes ou des participations gouvernementales dans différents pays : en Europe par la participation du Mouvement 5 étoiles ou de la Ligue du Nord en Italie, et par le « mouvement » du Brexit ou le groupe dirigeant autour de Boris Johnson au sein du parti conservateur en Grande-Bretagne. En Amérique du Sud, en raison de la montée en puissance, d’abord de Bolsenaro au Brésil et actuellement de Milei en Argentine. Aux États-Unis, la candidature de Trump pour le Parti républicain à l’approche de l’élection présidentielle de novembre.
Le populisme, qui a le vent en poupe depuis le début du XXIe siècle :
- « n’est pas, bien sûr, le résultat d’une volonté politique consciente de la part des secteurs dirigeants de la bourgeoisie ». Au contraire, elle confirme la tendance à « une perte croissante de contrôle de la classe dominante sur son appareil politique »[3].
- s’accompagne d’une « perte fondamentale de confiance dans les 'élites' (...) parce qu’ils sont incapables de rétablir la santé de l’économie, de mettre fin à l’augmentation constante du chômage et de la misère ». Cependant, cette révolte contre les dirigeants politiques n’aboutit en rien à « une perspective alternative au capitalisme » [4].
Le populisme est une expression typique de la pourriture sur pied du capitalisme, une réaction à l’accumulation de problèmes qui ne sont pas vraiment abordés par les partis politiques établis, ce qui conduit à des difficultés croissantes. Tous ces problèmes non résolus alimentent à la fois les contradictions internes entre les fractions bourgeoises et la rébellion de la petite bourgeoisie, et c’est là le terreau du comportement vandaliste des tendances populistes.
Tant que la classe ouvrière ne parviendra pas à poursuivre de manière décisive son alternative révolutionnaire à la décomposition capitaliste par le développement de sa lutte, les courants populistes continueront à dominer l’agenda politique. Caractérisés par l’absence d’une vision de l’avenir de la société et la tendance à se tourner vers le passé pour chercher des boucs émissaires qu’ils peuvent tenir pour responsables de l’évolution catastrophique actuelle, ces populistes, avec leurs positions irrationnelles, déstabiliseront de plus en plus la scène politique bourgeoise.
Perte de contrôle sur l’appareil politique et antagonismes croissants entre les fractions bourgeoises
Dans les années 1990, le système politique néerlandais reposait essentiellement sur 3 ou 4 partis centraux : le CDA chrétien-démocrate, le PvdA socialiste, le VVD libéral et D66. Ces dernières années, il est devenu une mosaïque en constante changement avec un nombre croissant de partis dissidents. Non seulement les députés passent régulièrement d’un parti à l’autre, mais le nombre de partis augmente également régulièrement au cours du mandat d’un gouvernement, car les députés se séparent et continuent d’être une « faction d’un seul homme ». C’est le résultat, d’une part, de contradictions au sein de la bourgeoisie néerlandaise qui remontent plus clairement à la surface, et d’autre part, d’un mécontentement général à l’égard de la gouvernance des partis traditionnels, qui se traduit par l’émergence de partis qui se profilent autour d’un thème spécifique.
Les contradictions au sein de la bourgeoisie concernant l’emprise croissante de l’UE sur la politique néerlandaise deviennent de plus en plus évidentes par l’opposition :
- à ce qui était considéré comme une perte de souveraineté au profit d’un « super-État européen » non démocratique et bureaucratique, les Pays-Bas ont voté contre l’introduction d’une constitution européenne lors d’un référendum en 2005 ;
- à l’accord d’association avec l’Ukraine en 2016, les Pays-Bas ont été le seul pays de l’UE à rejeter l’accord en raison de leur opposition à la prise de décision « antidémocratique » de Bruxelles et pour éviter que la corruption ukrainienne ne déferle ;
- par les partis populistes rejetant toute participation à une armée européenne et certains s’opposent même à une coopération accrue dans le domaine militaire avec un pays comme l’Allemagne.
En 2024, le Parlement est "pris" par toute une série de partis populistes, plus ou moins importants, dont les positions convergent vers une aversion pour la loi européenne sur la préservation de la nature, contre la politique migratoire européenne, contre les livraisons d’armes à l’Ukraine, mais aussi contre l’UE et l’OTAN. En outre, chacun de ces partis a également son propre fer de lance politique : pour le PVV, c'est "moins de Marocains", pour le NSC " à bas la politique de l’ombre", et pour le BBB "pas de diktat de La Haye".
Les élections de novembre dernier ont rendu la situation extrêmement compliquée pour la bourgeoisie néerlandaise, en particulier en ce qui concerne l’UE. Parce qu’avec un ou deux partis populistes au gouvernement, ce qui a peu de chances d’être évité, un fort vent anti-UE va de toute façon souffler. Ici et là, on parle même d’une « sortie » des Pays-Bas de l’UE (Nexit). Bien qu’il n’aille probablement pas aussi loin que le Brexit, le vent anti-UE exercera une forte pression sur la position des Pays-Bas au sein de l’UE. Bien que les différents partis populistes ne fassent pas confiance à « l’élite » établie, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils se font mutuellement confiance, bien au contraire. Lors des négociations sur la formation d’un nouveau gouvernement, la méfiance mutuelle était déjà très claire. L’instabilité du système politique aux Pays-Bas et son impact sur la politique à l’égard de l’Europe dans son ensemble menacent de prendre des proportions inquiétantes pour la bourgeoisie.
Campagnes populistes et anti-populistes
Le populisme est l’expression typique de la phase de décomposition du capitalisme, du chacun pour soi, des frictions croissantes au sein de la bourgeoisie, qui réduisent de plus en plus sa capacité à formuler une réponse cohérente aux différentes crises. Mais la bourgeoisie est assez intelligente pour utiliser les effets négatifs de la décomposition contre son plus grand ennemi : la classe ouvrière. Elle utilise ainsi le phénomène populiste pour créer une contradiction fictive et promouvoir massivement l'anti-populisme :
- D’un côté, les partis populistes ouvrent la voie en utilisant « des allégations, des accusations et la diabolisation de l’autre » (Sigrid Kaag du parti de centre-gauche D'66). Ce faisant, on fait preuve d’une forme de démagogie à l’encontre de l’ordre politique existant et des ‘élites’ politiques dirigeantes, et d’une disqualification des mesures prises, ce qui est certainement bien accueilli par une partie de la population néerlandaise. Dans le même temps, les partis populistes parviennent également à séduire une partie de la population, non seulement par des mesures irréalistes telles que la fermeture des frontières aux migrants, mais aussi par des mesures « sociales » tout aussi trompeuses en faveur de "leur propre peuple", telles que l’abaissement de l’âge de la retraite, une augmentation du salaire minimum et une baisse des primes de santé ;
- D’autre part, les organisations de gauche attisent le feu en présentant le populisme comme le plus grand danger qui nous menace. Non seulement par l’ultra-gauche, mais même par la propagande sociale-démocrate, le populisme est plus ou moins assimilé au totalitarisme, au racisme ou même au fascisme. Frans Timmermans, le candidat de gauche au poste de Premier ministre, s’est immédiatement exclamé après la victoire électorale du PVV : « L’heure est venue pour nous de défendre la démocratie ! ». L'anti-populisme maintient donc son refus catégorique, pour des "raisons de principe", de siéger dans une combinaison gouvernementale avec le PVV.
Tout comme le Royaume-Uni a été divisé en un camp pro et anti-Brexit il y a quelques années, les Pays-Bas sont actuellement divisés en un camp pro-Wilders et un camp anti-Wilders. En attisant cette opposition, la bourgeoisie tente de rallier une partie de la classe ouvrière derrière elle et de l'attirer dans des actions allant de blocages de nouveaux centres pour demandeurs d'asile à des manifestations contre des rassemblements de populistes, qui visent à saper la lutte sur le terrain de classe et à mobiliser les travailleurs aux objectifs de l'un ou l'autre camp bourgeois.
Quel que soit le camp au pouvoir, les attaques contre leurs revenus et leurs conditions de vie se poursuivront sans relâche car elles sont le résultat des ondes de choc militaires, économiques et environnementales qui secouent le système capitaliste. Les travailleurs doivent donc continuer à mener la bataille sur le terrain où ils peuvent, en toute indépendance, développer pleinement leur force. En suivant l'exemple des travailleurs du Royaume-Uni qui, malgré des années de campagne assourdissante sur le Brexit entre "Remainers" et "Leavers", ont tout de même développé une lutte unie d'un an contre les effets de la crise du "coût de la vie" à partir de l'été 2022. Également aux Pays-Bas, la classe ouvrière a montré il y a un an qu'elle avait la volonté et la capacité de s'opposer aux mesures désastreuses de la bourgeoisie[5]. En s'inscrivant dans la dynamique des luttes ouvrières internationale de l’année écoulée au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, elle peut s’engager dans une résistance internationale contre ce système obsolète et moribond, qui va de catastrophe en catastrophe.
Dennis/2024.03.15
[1] https://fr.internationalism.org/content/11210/nouvel-elan-ou-encore-plus-chaos-et-dinstabilite-quel-soit-gagnant-aucune-solution [78]
[2] Programme électoral du PVV
[4] Idem
Géographique:
- Hollande [16]
Personnages:
- Wilders [80]
- Geert Wilders [81]
Récent et en cours:
Rubrique:
Internationalisme n° 381 - 3e & 4e trimestre 2024
- 56 lectures
La coalition "Arizona" prépare une attaque frontale contre les conditions de travail et de vie
- 129 lectures
Maintenant que toutes les élections (fédérales, régionales, locales) sont passées, les nationalistes flamands de la NVA et les libéraux francophones du MR, respectivement les plus grands partis politiques de Flandre et de Wallonie, ainsi que les démocrates-chrétiens (CD&V et ‘Les Engagés’) et les socialistes flamands de ‘Vooruit’, poursuivent les négociations en vue de former un gouvernement fédéral dont l’objectif principal sera de « remettre de l’ordre dans les finances de l’État ». Avant même que le nouveau gouvernement ne soit formé, ses projets pour les années à venir ont déjà fait l’objet de nombreuses « fuites ». Ceux-ci montrent que la classe ouvrière belge peut se préparer à une nouvelle attaque frontale contre ses revenus et ses conditions de travail. Alors que, d’un côté, les travailleurs sont licenciés en masse, de l’autre côté, le nouveau gouvernement "Arizona" veut faire des coupes sombres dans les dépenses de sécurité sociale, y compris dans les retraites. Quant aux salariés, ils voient leur travail devenir encore plus précaire et flexible afin que les patrons puissent tirer d’avantage de profit de leur force de travail.
Les conséquences de la crise du capitalisme sont reportées sur les travailleurs
Pour comprendre ce qui pousse la bourgeoisie à se lancer dans une telle offensive, il faut examiner en particulier les effets de la crise internationale et des guerres sur l'économie belge.
De par la concurrence acharnée sur le marché mondial, l’industrie chimique anversoise, fleuron des exportations belges, subit de plein fouet la pression asiatique. En 2023, les exportations ont chuté de 18 % et les ventes de 14 %. Cette pression concurrentielle entraîne aussi dès à présent des conséquences considérables sur les secteurs de l’ automobile et des autocars.
Des pays comme la Belgique sont de plus en plus impliqués dans la guerre en Ukraine, ce qui oblige à renforcer l’arsenal militaire. En outre, l’OTAN demande que la Belgique consacre non pas 1,1 %, mais au moins 2 % de son PIB à l’armement.
Enfin, les derniers chiffres dressent un tableau extrêmement inquiétant de l’économie européenne, ce qui entraîne une stagnation des exportations belges. En particulier, la récession persistante en Allemagne, principal partenaire commercial de la Belgique, pèse sur l’économie belge.
Les conséquences se font déjà clairement sentir. Au printemps, 1 600 travailleurs ont été licenciés chez Van Hool (autocars) à Lierre. En septembre, 440 travailleurs ont perdu leur emploi chez le fabricant de puces Belgan à Audenarde. Chez Audi à Bruxelles, 1400 travailleurs seront licenciés, et les 1600 restants le seront probablement en avril 2025. Cette situation a évidemment des conséquences directes sur l’emploi chez les sous-traitants et les fournisseurs. 2024 est déjà l’année où le nombre de licenciements collectifs sera le plus élevé de la décennie.
Un deuxième élément qui a un impact important sur la politique de la bourgeoisie belge est la décision de la Commission européenne de resserrer les cordons de la bourse des États membres.[1] Les pays dont la dette est supérieure à 90 % du PNB et/ou dont le déficit budgétaire annuel est supérieur à 3 % seront contraints par l'UE de réduire fortement les dépenses. La Belgique, avec une dette publique de 105 % et un déficit budgétaire de 4,6 %, fait également partie de ces pays. La nécessité de combler un déficit de 27 milliards d'euros au cours des 5 à 7 prochaines années représente pour le nouveau gouvernement belge le défi le plus important à relever depuis des décennies.
Pour relever ce double défi, la bourgeoisie belge veut déclencher une vague de coupes dans les dépenses et de rationalisations, qui affecteront l’ensemble de la classe ouvrière. Ainsi, la coalition « Arizona » envisage une attaque frontale contre la sécurité sociale et les services sociaux :
- Forte réduction des dépenses sur les pensions par l’abolition de toutes les formes de retraite anticipée, par l’octroi de prestations de retraite complètes uniquement en cas de « travail effectif » pendant au moins 35 ans, et par une limitation drastique de toute période « assimilée » à du travail ;
- Réduction considérable des allocations de chômage, en limitant leur durée dans le temps à deux ans ;
- Réduction des dépenses pour les malades de longue durée : toute personne qui retombe malade moins de 12 semaines après avoir repris le travail n’aurait désormais plus droit à un salaire garanti ;
- Arrêt de l’augmentation sytématique des allocations en parallèle avec celle des salaires des travailleurs ;
- Mise en œuvre d’une réduction de 2 % de l’ensemble des fonctionnaires et des coûts de fonctionnement des administrations publiques.
En outre, les partis de la coalition prévoient également d’accroître considérablement l’exploitation de la main-d’œuvre en rendant le marché du travail encore plus flexible. Les entreprises auront davantage de possibilités d’employer des travailleurs sans contrat de travail fixe, avec des horaires irréguliers, pour des travaux de courte durée, etc. En outre, l’interdiction du travail le dimanche, du travail de nuit et lors des jours fériés sera supprimée dans tous les secteurs. Les heures supplémentaires ne seront rémunérées qu’à partir de minuit et non plus à partir de 20h. Enfin, les travailleurs verront leurs revenus fondre car le pécule de vacances, la prime de fin d’année, les bonus, etc. seront désormais exclus de l’indexation des salaires, c’est-à-dire de l’adaptation automatique, bien que partielle, des salaires à l’augmentation du coût de la vie.
Bref, des milliers de travailleurs sont licenciés, mais, selon les plans des partenaires de l’ « Arizona », le nombre d’exclus des allocations de chômage va augmenter. Le rythme de travail dans les entreprises détruit la santé des travailleurs, mais le nouveau gouvernement veut obliger les malades à reprendre le travail ! La hausse des prix réduit notre pouvoir d’achat, mais les salaires pour le travail de nuit et de week-end sont réduits. Il est temps pour les travailleurs d’arrêter cette orientation : « ça suffit »
Les syndicats et la gauche se préparent à désamorcer toute résistance contre ces mesures
La bourgeoisie est bien consciente de ce que ces plans pourraient déclencher au sein de la classe ouvrière, à un moment où celle-ci a déjà montré sur le plan international qu'elle reprenait le chemin de la lutte après des décennies de déclin.[2] Lors de la vague de luttes en Grande-Bretagne de 2022, l'été de la colère, la bourgeoisie savait déjà parfaitement que l'aggravation de la crise et les conséquences de la guerre allaient s’approfondir et que, dans ce contexte, elle devait inévitablement déclencher de nouvelles attaques. Le fait qu'un mouvement massif s’est développé à l’époque face aux premières attaques, fondamentalement similaires pour toutes les secteurs du prolétariat, non seulement en Grande-Bretagne mais dans toute l'Europe et même dans d’autres parties du monde, a beaucoup inquiété la bourgeoisie. C'est pourquoi celle-ci attache de l'importance à bien se préparer et à déployer les forces nécessaires pour encadrer et détourner la résistance attendue.
Ainsi, les syndicats affirment aujourd’hui sans équivoque que les attaques contre la classe ouvrière seront générales et étendues. Comme l’a récemment déclaré Miranda Ulens du syndicat socialiste FGTB, « cela constitue un démembrement gigantesque de notre État-providence ». Ce syndicat semble donc vouloir organiser la résistance, mais, en réalité, il ne fait qu'exprimer son mécontentement face au caractère unilatéral des mesures d’austérité proposées, dans le cadre desquelles les travailleurs seraient « utilisés pour augmenter les profits des actionnaires » et devraient payer la facture. En réalité, la FGTB ne s'oppose nullement à la nécessité de l'austérité, car elle estime elle aussi que tout le monde doit se serrer la ceinture pour défendre l'économie nationale contre la concurrence internationale acharnée. Donc, quand les syndicats appellent à des manifestations et à des grèves, ce n'est pas pour lutter contre l'austérité et les rationalisations, mais pour lutter pour une « répartition plus équitable » des charges et, surtout, pour éviter ainsi que les travailleurs engagent une lutte intransigeante, sur leur propre terrain de classe, contre les attaques du gouvernement et du patronat.
Le 16 septembre, les syndicats ont déjà organisé une manifestation commune sous le slogan : « L'industrie est à nous » .[3] Cette manifestation a été présentée comme un moyen de pression sur le gouvernement, les syndicats défendant la position selon laquelle « l’industrie doit rester ici », comme l’a déclaré la présidente de l’ACV, Ann Vermorgen, dans son discours du 16 septembre. Toute cette manifestation était, bien entendu, un acte de tromperie grossière à l’égard des travailleurs. Tout d’abord, le point de vue selon lequel « l’ndustrie est à nous » est un mensonge. Après tout, nous ne vivons pas dans une société communiste avec une propriété commune des moyens de production, mais dans une société capitaliste avec une propriété privée, et dans laquelle les patrons possèdent les usines. En outre, le mot d’ordre selon lequel « l’industrie doit rester ici [en Belgique] » est une position nationaliste pur jus, qui n’a rien à voir avec les intérêts des travailleurs. La crise économique est mondiale et les travailleurs n’ont aucun intérêt à se ranger sous la bannière de bourgeoisies nationales et à se quereller entre eux pour savoir dans quel pays les emplois devraient disparaître. En fait, la manifestation syndicale n’avait d’autre but que de présenter aux travailleurs une fausse perspective et ainsi de détourner leur lutte vers une impasse.
Les syndicats sont soutenus par les gauchistes dans cette politique insidieuse. Ainsi, le Parti Socialiste de Lutte (PSL) écrit : « La manifestation du 16 septembre peut être le début d›une lutte pour préserver les moyens de production, les emplois et le savoir-faire de l'entreprise ». Le groupe « Vonk » rejoint ce chœur : « La bonne initiative des syndicats du constructeur automobile Audi à Bruxelles, visant à organiser une manifestation nationale « pour l›avenir de l›industrie », est un premier pas ». Selon le PVDA/PTB, les manifestations syndicales sont tout à fait justifiées car« Au cours des deux dernières années, le groupe Audi a réalisé les plus gros bénéfices de son histoire, grâce au travail acharné de la main-d'œuvre ».
Et dans le cas où les travailleurs refuseraient de continuer à suivre les syndicats, mais voudraient se battre pour des alternatives qui ouvrent de véritables perspectives, à contre-courant de la logique de la crise, ces organisations gauchistes sont prêtes à encadrer cette résistance, pour ensuite ramener les travailleurs dans le sillage des syndicats. Et pour cela, aucune conception n›est trop radicale. Ainsi, une de ces organisations gauchistes appelle à lutter pour l›expropriation de l›usine Audi à Forest, à élargir la lutte des travailleurs d›Audi en les invitant à des réunions syndicales dans d›autres entreprises, et si nécessaire, dans une approche syndicaliste de base, à lancer des actions sans les dirigeants syndicaux. Mais aucune de ces actions proposées ne devrait, bien sûr, selon cette organisation bourgeoise, se dérouler en dehors du cadre syndical existant.
Sous la pression des travailleurs, les syndicats ont récemment été amenés à reconnaître plusieurs grèves, comme à la compagnie des transports intercommunaux « De Lijn » les 10 et 11 septembre, chez le personnel au sol de l›aéroport de Charleroi les 12 et 13 septembre, chez Ontex à Eeklo le 13 septembre, de nouveau chez « De Lijn » le lundi 23 septembre, chez le personnel de sécurité de l›aéroport de Bruxelles le 1er octobre et à nouveau « De Lijn » le 11 octobre. Sous le thème « On ne peut plus attendre », le syndicat chrétien ACV a annoncé une grève nationale dans le secteur du non-marchand pour le jeudi 7 novembre. Le développement de la combativité parmi les travailleurs s’était déjà manifesté le 23 avril dernier lorsque le personnel enseignant de Wallonie et de Flandre avait manifesté ensemble à Bruxelles pour la première fois depuis des décennies. Cela est aussi apparu à travers les messages de solidarité que les travailleurs d'Audi ont reçus d'anciens travailleurs du constructeur d’autocars Van Hool et de travailleurs de l'éducation. Pour faire barrage contre l'attaque généralisée que prépare la coalition « Arizona », ces noyaux de combativité croissante devront s'étendre et s'unir en un vaste mouvement de résistance ouvrière.
Dennis/ octobre 2024.
[1] La Commission européenne tente de maintenir la valeur de l’euro. Au deuxième trimestre 2022, l’euro a atteint son plus bas niveau historique par rapport au dollar américain. Il s’est depuis quelque peu redressé, mais la pression sur l’euro reste forte.
[2] Voir aussi : Après la rupture de la lutte des classes, la nécessité de la politisation
[3] On pouvait également lire sur une banderole « Audi est à nous » lors de la manifestation du 16 septembre.
Situations territoriales:
- Belgique [6]
Récent et en cours:
- coalition Arizona [84]
- élections Belgique 2024 [77]
Rubrique:
La solidarité et l’unité sont la force de notre lutte
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| 706.23 Ko |
- 169 lectures
Au-delà des frontières régionales et linguistiques, services publics et secteur privé, La solidarité et l’unité sont la force de notre lutte
Les coupes les plus drastiques depuis des décennies
Ce n’est plus un secret pour personne : les gouvernements fédéral et régionaux économiseront des dizaines de milliards chacun dans le cadre de leurs compétences respectives et tous les secteurs de la classe ouvrière seront touchés afin de rendre l’économie belge plus compétitive et plus rentable. Alors que les travailleurs des entreprises privées sont licenciés en masse (27.000 en 2024), l’indexation automatique des salaires sera limitée, les primes pour les heures supplémentaires et le travail de nuit diminuées, la flexibilité du travail augmentée, le droit aux allocations de chômage restreint, des coupes sombres opérées dans les pensions et l’assurance maladie, le nombre total de fonctionnaires réduit, la titularisation du personnel enseignant mise en péril, etc
Et ce alors que les conditions de travail deviennent partout de plus en plus insupportables : sous-emploi, accélération des cadences, effacement de la frontière entre vie professionnelle et vie privée, augmentation des prix due à l’inflation, réduction de toutes sortes de subventions, catastrophes environnementales croissantes, dépression, burn-out.
Il n’y a pas seulement la perspective d’une baisse de la croissance économique et les politiques économiques protectionnistes de Trump, mais aussi le coût croissant des tensions et des guerres impérialistes, y compris les dépenses militaires en forte hausse, qui sont à l’origine de la campagne d’austérité de la classe dirigeante. Dans tous les pays, ils tentent effectivement de répercuter sur les travailleurs les conséquences de “leur” crise de surproduction, c’est-à-dire des biens qu’ils ne peuvent plus vendre avec un profit suffisant sur les marchés disponibles. Le travail doit coûter moins cher. Une fois de plus, ce qui est au centre des préoccupations n’est pas le bien-être ou les besoins des travailleurs , mais la vente rentable de biens et de services.
La bourgeoisie est déterminée à poursuivre son attaque
La bourgeoisie n’a que trop bien compris que ces plans provoqueraient des réactions dans de larges parties de la classe. Les “fuites” bien orchestrées ont servi de thermomètre pour mesurer l’opposition à ces plans avant qu’ils ne soient réellement mis en œuvre. C’est principalement aux syndicats qu’il incombe d’encadrer et de détourner à temps cette résistance attendue. Ils ont vu l’inquiétude et le mécontentement des travailleurs grandir de semaine en semaine et ne sont pas restés passivement sur la touche afin d’empêcher le mécontentement de se manifester par des actions “incontrôlées”.
Des tactiques éprouvées sont à nouveau utilisées : isoler et diviser les différents secteurs alors que les mesures touchent tout le monde ! Une manifestation uniquement pour le personnel de la santé et de l’aide sociale en novembre; puis le 13 décembre une journée d’action en protestation contre les “mesures d’austérités Européennes”. Pour la journée d’action du 13 janvier, seule une grève contre la “réforme des pensions” a été annoncée dans les chemins de fer. Ce n’est que bien plus tard, sous la pression sociale, que les syndicats ont décidé que l’enseignement y participerait également et plus tard, d’autres secteurs, tels que les postiers, s’y sont joints. En Wallonie, les syndicats ont organisé de leur côté des journées de grève séparées pour les enseignants de la communauté française, évitant ainsi une participation massive de leur part à Bruxelles le 13 janvier. La manifestation du 13 février porte pour sa part sur la “défense du service public”, comme si les travailleurs du secteur privé ou les chômeurs ne devaient pas être défendus ! Les mobilisations sont également enfermées dans les différentes régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles. Bref, l’objectif est de planifier une série de journées d’action sans espoir, en essayant à chaque fois de limiter les mobilisations en les concentrant sur certains secteurs ou sous-aspects des plans d’austérité, pour finalement épuiser la volonté de se battre et ouvrir la voie à des concessions de grande envergure envers les plans d’austérité.
La solidarité et l’unité sont la force de notre lutte
La force et le dynamisme de la mobilisation du 13 janvier ont précisément consisté à ne pas se laisser isoler et à ne pas attendre passivement. Au lieu des 5000 manifestants “attendus” ou plutôt “espérés” par le syndicat, une grève massive a eu lieu dans différents secteurs et plus de 30000 manifestants se sont rassemblés à Bruxelles en provenance de toutes les régions. Le mouvement s’est étendu à d’autres secteurs que l’éducation et le rail, au mépris de l’intention initiale des syndicats. La mobilisation a ainsi montré que le mécontentement va au-delà d’une mesure particulière ou d’une “réforme” spécifique. Plutôt que d’attendre passivement que les mesures finales tombent, elle exprime une volonté d’entreprendre des actions offensives contre l’orientation annoncée des attaques.
Pour parer véritablement aux attaques contre nos conditions de vie, nous devons mener la bataille le plus largement possible dans l’unité, indépendamment de l’entreprise, du secteur ou de la région dans lesquels nous travaillons. Tous les travailleurs sont “dans le même bateau”. Tous ces groupes ne sont pas des mouvements séparés mais un groupe collectif : ouvriers et employés, syndiqués et non-syndiqués, immigrés et autochtones”, comme l’a dit un enseignant en grève à Los Angeles en mars 2023.
La classe ouvrière belge a accumulé une expérience importante dont la lutte actuelle doit tirer les leçons. Tant des grèves passées en Belgique, comme celle de 1983 et certainement celle de 1986, qui ont rassemblé des centaines de milliers de travailleurs des secteurs public et privé et des régions wallonne, bruxelloise et flamande, que des mouvements de grève qui ont eu lieu au cours des trois dernières années dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, Et ceci afin d’éviter certaines des principales faiblesses qui les ont caractérisés :
En 2022-23, en Grande-Bretagne, les travailleurs d’entreprises de secteurs différents, parfois distantes de moins de 100 mètres, n’ont pas cherché à se solidariser et à unir leurs luttes.
En 2023, en France, les travailleurs ont participé en masse à 14 “journées d’action” contre les plans de retraite du gouvernement, mais n’ont pas réussi à élargir la lutte à des grèves dans les entreprises et les bureaux. L’épuisement de la combativité était inévitable.
Notre force est l’unité, la solidarité dans la lutte ! Unifier la lutte dans un seul et même mouvement :
surmonter la division entre les travailleurs de part et d’autre de la frontière linguistique, des régions flamande, wallonne et bruxelloise
surmonter la division entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé et les chomeurs ;
se mettre en grève et envoyer des délégations massives vers d’autres travailleurs pour qu’ils rejoignent la lutte et gagnent de plus en plus de travailleurs à la lutte ;
organiser des assemblées générales pour discuter ensemble des besoins de la lutte et s’unir autour de revendications communes.
C’est cette dynamique de solidarité, d’expansion et d’unité qui a toujours ébranlé la bourgeoisie au cours de l’histoire.
Courant Communiste International
24 janvier 2025
Venez en discuter lors la réunion publique le samedi 1er mars à Bruxelles: rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles de 14h à 18h
Vie du CCI:
- Interventions [86]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Réforme des retraites [88]
- Coupes budgettaires [89]
Rubrique:
Internationalisme 2025
- 28 lectures
Signification et dynamique de la vague de lutte en Belgique
- 89 lectures
Le bombardement massif par les États-Unis, dans la nuit 21 au 22 juin, de cibles militaires en Iran constitue une nouvelle étape de l’aggravation des tensions et du chaos guerrier, de la désolation et la barbarie sans trêve dans la région.Face la gamme étendue des différentes formes de soutien d’un camp impérialiste contre un autre qui vont occuper toute la scène médiatique et sociale, les prolétaires de tous les pays doivent rejeter toute prétendue « solution » au conflit qui vise à les enchaîner dans le soutien à tel ou tel pays, à telle ou telle fraction bourgeoise. Les révolutionnaires doivent combattre pour le seul principe qui mérite d’être défendu, l’internationalisme prolétarien. La seule lutte qui pourra délivrer l’humanité de la barbarie guerrière, c’est la lutte de classe, pour le renversement de ce système miné par la crise et les besoins de l’économie de guerre.Face à la gravité de la situation et l’importance cruciale de défendre l’internationalisme prolétarien, le CCI organise une réunion publique internationale en ligne, le samedi 28 juin à 15h (heure de Paris). Les lecteurs qui souhaitent participer à cette discussion peuvent adresser un message sur notre adresse électronique ([email protected] [90]) ou dans la rubrique « nous contacter » de notre site internet. Les modalités techniques pour se connecter à la réunion publique seront communiquées ultérieurement.
Les réunions publiques à Marseille et à Bruxelles, initialement prévues pour discuter de notre Manifeste sur l’écologie, sont maintenues. Lors de ces rassemblement physique, une connexion sera établie avec la réunion publique :
- Marseille, le 28 juin à 15h. Adresse : Mille Bâbords 61 Rue Consolât 13001 Marseille
- Bruxelles, le 28 juin 2025 à 15h. Adresse : Pianofabriek - Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
Le CCI tient le samedi 28 juin 2025 une réunion publique à Bruxelles sur le thème : « Signification et dynamique de la vague de lutte en Belgique »
Depuis 8 mois, la classe ouvrière belge mène une lutte massive contre les plans d'austérité des gouvernements fédéral et régionaux (26 milliards d'euros) à travers une succession de manifestations et de journées générales de grève mensuelles, entrecoupées de grèves et de manifestations dans certains secteurs (les chemins de fer, l'enseignement ou encore le secteur public...). Une nouvelle « journée de grève générale » est prévue le 25 juin prochain, juste avant les mois d'été. Il est donc temps de dresser un premier bilan.
La dynamique internationale du mouvement en Belgique ?
Les « économies » budgétaires qui touchent toutes les couches et tous les secteurs de la classe ouvrière, mais aussi la résistance massive qui s'y oppose, doivent être replacées dans un contexte historique et international : la crise de surproduction du système capitaliste, qui s'accélère dans la période actuelle de décomposition du système et oblige la bourgeoisie mondiale à s'attaquer à la classe ouvrière. Les manifestations de la putréfaction du capitalisme, telles que les guerres, les catastrophes écologiques... et les coûts qu'elles entraînent, renforcent à leur tour cette nécessité. La résistance à cet état de fait en Belgique n'est pas non plus une spécificité. Elle s'inscrit dans une dynamique historique et internationale importante, dans laquelle la classe ouvrière n'accepte plus passivement la dégradation continue de ses conditions de vie et de travail depuis des décennies. Lancé au Royaume-Uni en 2022, ce mouvement de lutte connu aujourd'hui sous le nom de « l'été de la colère », a été suivi en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne... et en Belgique.
En Belgique, la résistance ouvrière s'est immédiatement manifestée dès les premières rumeurs de «sacrifices sociaux», avant même que les mesures concrètes ne soient annoncées, et à chaque mobilisation, les travailleurs se sont présentés en nombre toujours plus important pour culminer, lors de la journée d'action de janvier, à 100.000 manifestants. Issus de tous les secteurs (public et privé), de Flandre et de Wallonie, ils ont exprimé leur volonté de dépasser les clivages sectoriels et régionaux et de mener une lutte globale contre les attaques.
Quels sont les obstacles qui freinent le mouvement de lutte ?
Les syndicats, qui depuis le début du mouvement fin 2024 ont organisé toutes sortes d'actions pour ne pas perdre le contrôle, ont lancé à partir de février 2025 une contre-offensive visant à saper la dynamique de lutte. À partir de ce moment, la division du mouvement et la discorde sont organisées: grèves dans certains secteurs avec des revendications spécifiques, division entre les syndicats, report d'une grève générale de tous les secteurs à six semaines plus tard, accent mis par les médias sur la perturbation des transports publics et des services, sondages d'opinion visant à démontrer que la population soutient les mesures gouvernementales, etc.
De plus, la bourgeoisie et les médias insistent sur la gravité du contexte international. La crise, la guerre des droits de douane, la nécessité des coûts de l'économie de guerre et le développement de l'armement seraient inévitables, le message étant que les mesures d'austérité sont nécessaires et que la lutte est donc inutile.
Quelles perspectives pour la lutte et quelle responsabilité pour une organisation révolutionnaire ?
La bourgeoisie parviendra-t-elle, par le biais des syndicats, à briser le mouvement de lutte avant la période estivale, comme elle l'espère, ou une dynamique de réflexion s'amorcera-t-elle au sein de la classe ouvrière à partir de l'expérience de lutte passée ? Les travailleurs continueront-ils à compter sur les syndicats pour organiser la lutte ou s'opposeront-ils au sabotage de la lutte par les syndicats ? Continueront-ils à limiter la lutte à des revendications sectorielles ou régionales ou établiront-ils de plus en plus le lien entre la modération salariale et la réduction des allocations sociales d'une part, et l'augmentation gigantesque des budgets militaires d'autre part ? Et enfin, quelle est la responsabilité de l'organisation révolutionnaire dans ce contexte ?
Venez en discuter avec le CCI lors de sa Réunion Publique à Bruxelles, le 28 juin 2025 de 14h00 à 18h00
Adresse : Pianofabriek - Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles
Situations territoriales:
Rubrique:
Bruxelles
- 20 lectures
- Calendrier [91]
Adresse:
Pianofabriek- Rue du fort 35, 1060 Saint-Gilles
Date:
Type de rencontre:
Thème:
Introduction:
Le CCI tient le samedi 28 juin 2025 une réunion publique à Bruxelles sur le thème : « Signification et dynamique de la vague de lutte en Belgique »
Depuis 8 mois, la classe ouvrière belge mène une lutte massive contre les plans d'austérité des gouvernements fédéral et régionaux (26 milliards d'euros) à travers une succession de manifestations et de journées générales de grève mensuelles, entrecoupées de grèves et de manifestations dans certains secteurs (les chemins de fer, l'enseignement ou encore le secteur public...). Une nouvelle « journée de grève générale » est prévue le 25 juin prochain, juste avant les mois d'été. Il est donc temps de dresser un premier bilan.
La dynamique internationale du mouvement en Belgique ?
Les « économies » budgétaires qui touchent toutes les couches et tous les secteurs de la classe ouvrière, mais aussi la résistance massive qui s'y oppose, doivent être replacées dans un contexte historique et international : la crise de surproduction du système capitaliste, qui s'accélère dans la période actuelle de décomposition du système et oblige la bourgeoisie mondiale à s'attaquer à la classe ouvrière. Les manifestations de la putréfaction du capitalisme, telles que les guerres, les catastrophes écologiques... et les coûts qu'elles entraînent, renforcent à leur tour cette nécessité. La résistance à cet état de fait en Belgique n'est pas non plus une spécificité. Elle s'inscrit dans une dynamique historique et internationale importante, dans laquelle la classe ouvrière n'accepte plus passivement la dégradation continue de ses conditions de vie et de travail depuis des décennies. Lancé au Royaume-Uni en 2022, ce mouvement de lutte connu aujourd'hui sous le nom de « l'été de la colère », a été suivi en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne... et en Belgique.
En Belgique, la résistance ouvrière s'est immédiatement manifestée dès les premières rumeurs de «sacrifices sociaux», avant même que les mesures concrètes ne soient annoncées, et à chaque mobilisation, les travailleurs se sont présentés en nombre toujours plus important pour culminer, lors de la journée d'action de janvier, à 100.000 manifestants. Issus de tous les secteurs (public et privé), de Flandre et de Wallonie, ils ont exprimé leur volonté de dépasser les clivages sectoriels et régionaux et de mener une lutte globale contre les attaques.
Quels sont les obstacles qui freinent le mouvement de lutte ?
Les syndicats, qui depuis le début du mouvement fin 2024 ont organisé toutes sortes d'actions pour ne pas perdre le contrôle, ont lancé à partir de février 2025 une contre-offensive visant à saper la dynamique de lutte. À partir de ce moment, la division du mouvement et la discorde sont organisées: grèves dans certains secteurs avec des revendications spécifiques, division entre les syndicats, report d'une grève générale de tous les secteurs à six semaines plus tard, accent mis par les médias sur la perturbation des transports publics et des services, sondages d'opinion visant à démontrer que la population soutient les mesures gouvernementales, etc.
De plus, la bourgeoisie et les médias insistent sur la gravité du contexte international. La crise, la guerre des droits de douane, la nécessité des coûts de l'économie de guerre et le développement de l'armement seraient inévitables, le message étant que les mesures d'austérité sont nécessaires et que la lutte est donc inutile.
Quelles perspectives pour la lutte et quelle responsabilité pour une organisation révolutionnaire ?
La bourgeoisie parviendra-t-elle, par le biais des syndicats, à briser le mouvement de lutte avant la période estivale, comme elle l'espère, ou une dynamique de réflexion s'amorcera-t-elle au sein de la classe ouvrière à partir de l'expérience de lutte passée ? Les travailleurs continueront-ils à compter sur les syndicats pour organiser la lutte ou s'opposeront-ils au sabotage de la lutte par les syndicats ? Continueront-ils à limiter la lutte à des revendications sectorielles ou régionales ou établiront-ils de plus en plus le lien entre la modération salariale et la réduction des allocations sociales d'une part, et l'augmentation gigantesque des budgets militaires d'autre part ? Et enfin, quelle est la responsabilité de l'organisation révolutionnaire dans ce contexte ?
Venez en discuter avec le CCI lors de sa Réunion Publique à Bruxelles, le 28 juin 2025 de 14h00 à 18h00
Adresse : Pianofabriek - Rue du fort 35, 1060 Saint-Gilles