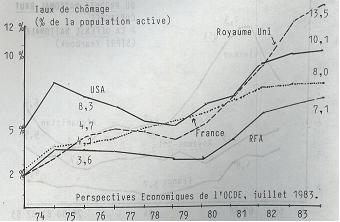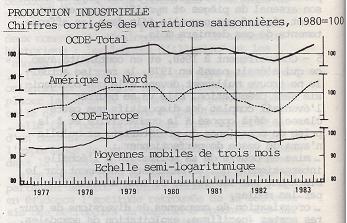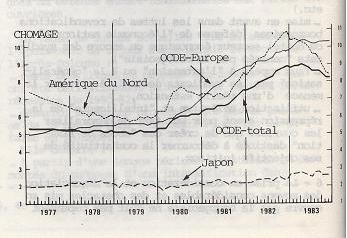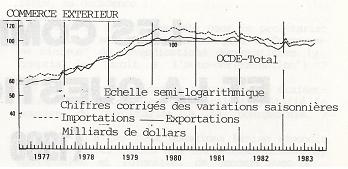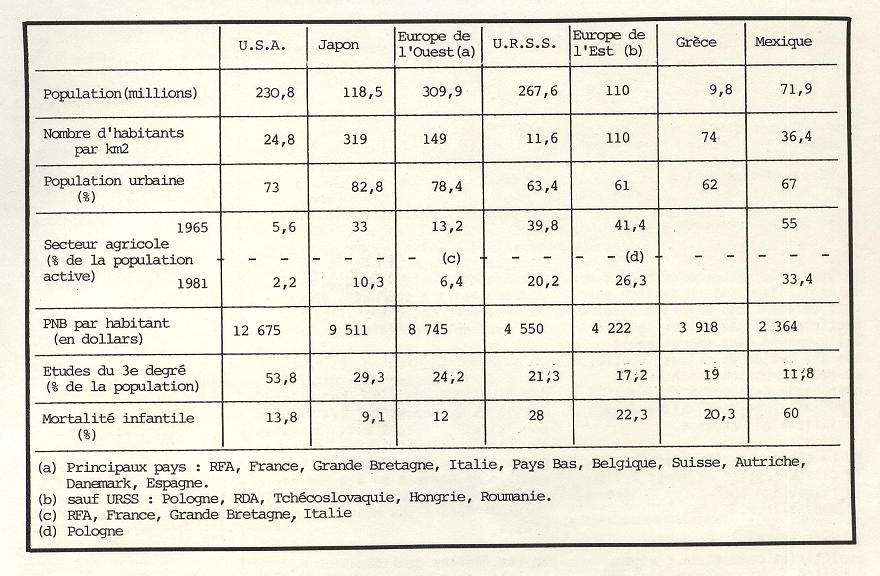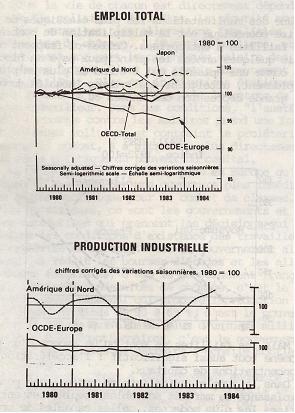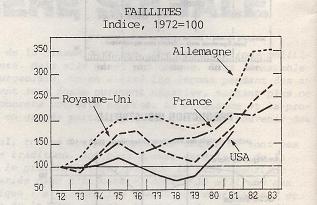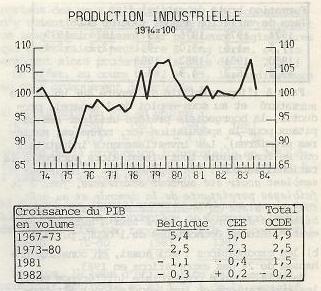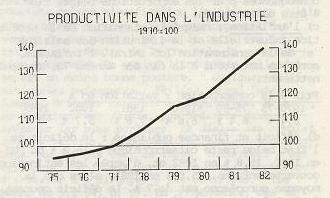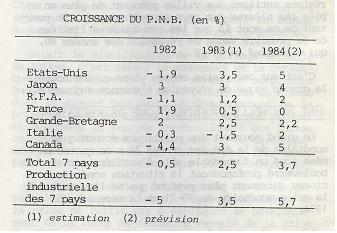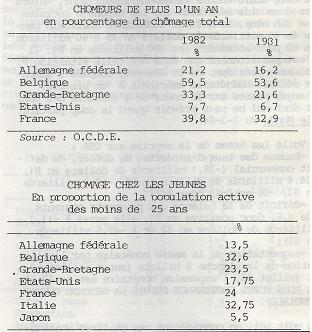Revue Int. 1984 - 36 à 39
- 3552 lectures
Revue Internationale no 36 - 1e trimestre 1984
- 2457 lectures
Conflits inter impérialistes, lutte de classe: l'histoire s'accélère
- 2542 lectures
"Jamais depuis les années 30, l'impasse totale dans laquelle se "trouve l'économie capitaliste ne s'était révélée avec une tel-"le évidence ; jamais depuis la dernière guerre mondiale, la "bourgeoisie n'avait déployé de tels arsenaux militaires, n'avait mobilisé de tels efforts en vue de la production de moyens "de destruction ; jamais depuis les années 20, le prolétariat "n'avait mené des combats de l'ampleur de ceux qui ont secoué "la Pologne et l'ensemble de la classe régnante en 1980-81. "Cependant, ce n'est là qu'un début. En particulier, si aujourd'hui les dirigeants bourgeois semblent se consoler en bavardant sur "la reprise économique"; ils ont du mal à masquer que "le plus fort de la crise est devant nous. De même, le recul "mondial des luttes ouvrières qui a suivi les formidables combats de Pologne ne constitue qu'une pause avant les énormes "affrontements de classe qui mettront en mouvement les détachements décisifs du prolétariat mondial, celui des grandes métropoles industrielles et notamment d'Europe occidentale" (Résolution sur la situation internationale, 5e Congrès du CCI Revue Internationale n°35)
Les années80, à la suite des années 70, dominées par l'illusion d'une reprise économique, sont bien des ANNEES DE VERITE. Si, après 1'invasion de 1'Afghanistan par les troupes russes, le développement de la grève de masse des ouvriers en Pologne a montré, dès 1'aube des années 80, comment se concrétisait 1'alternative historique : guerre impérialiste ou révolution communiste, les années qui ont suivi la défaite partielle du prolétariat mondial en Pologne, ont été marquées par une avancée des tensions impérialistes sans que la classe ouvrière se manifeste de façon significative.
Déboussolée par 1'activité de la gauche dans 1'opposition et par d'intensives campagnes idéologiques centrées sur la guerre, en partie démoralisée par la défaite en Pologne, la classe ouvrière a marqué une pause dans ses luttes qui a d'autant plus facilité la forte accélération des préparatifs guerriers de la bourgeoisie.
Cependant, 1'enfoncement toujours plus rapide du capitalisme dans la crise, alors que le prolétariat mondial n'est pas vaincu, pas écrasé, fait que cette pause des luttes ne pouvait être que provisoire. Aujourd'hui, le renouveau de la combativité de la classe ouvrière dans les pays centraux, vient montrer que le repli se termine.
L'histoire s'accélère sous la poussée de 1'aggravation de la crise. Comprendre cette accélération, tant sur le plan des tensions inter impérialistes que sur celui de la lutte de classe, constitue une tâche essentielle des organisations révolutionnaires aujourd'hui si elles veulent être à même de remplir leur fonction dans la classe demain.
L’AGGRAVATION DES TENSIONS IMPERIALISTES
Depuis l'invasion russe de l'Afghanistan, le prolétariat est soumis à une propagande intensive sur la guerre. Rien que ces derniers mois : un bœing 747 avec des centaines de passagers à bord abattu par les russes au dessus de l'île Sakhaline ; des centaines de soldats américains et français tues dans des attentats meurtriers à Beyrouth ; un débarquement de marines américains dans une minuscule île des Caraïbes, la Grenade ; des avions français et israéliens qui bombardent au Liban, avec, en toile de fond, des conflits anciens qui non seulement n'en finissent pas mais, au contraire, s'exacerbent : la guerre Iran-Irak qui a fait déjà des centaines de milliers de morts et de blessés, les guerres au Tchad, Angola, Mozambique, Sahara occidental, Nicaragua, Salvador, Cambodge, etc. La liste des conflits qui viennent illustrer l'exacerbation des tensions guerrières est longue. Et pas un qui ne soit prétexte à une intensification du matraquage obsédant du bloc occidental destiné à paralyser le prolétariat en lui faisant peur et en lui communiquant un sentiment d'impuissance, et à dénoncer l'agressivité du bloc russe, même si parfois, l'influence de celui-ci y est insignifiante.
Comme toute propagande, celle-ci s'appuie sur une réalité : avec l'entrée dans les"années de vérité", s'aggravent toutes les grandes tendances propres à la décadence capitaliste, notamment la tendance à l'aiguisement des tensions militaires.
"Face la crise qui se développait, la bourgeoisie s'est cramponnée pendant des années à l'espoir qu'il y avait des solutions... Aujourd'hui, la bourgeoisie déchante. De façon sourde mais lancinante, elle découvre qu'il n'y a pas de solution à la crise... Réalisant qu'elle est dans une impasse, il ne lui reste que la fuite en avant. Et pour elle, la fuite en avant, c'est la marche vers la guerre". (Les années 80, années de vérité, Revue Internationale n°20).
C'est dans ce contexte qu'on assiste à une modification qualitative de l'évolution des conflits impérialistes. Contrairement à la propagande assénée quotidiennement par tous les médias du bloc occidental, la caractéristique majeure de cette évolution consiste en une offensive du bloc américain contre le bloc russe. Celle-ci vise à parachever l'encerclement de l'URSS par le bloc occidental, à dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct. Elle a pour but d'expulser définitivement l'URSS du Moyen-Orient en réintégrant la Syrie au sein du bloc occidental. Elle passe par une mise au pas de l'Iran et la réinsertion de ce pays dans le bloc US comme pièce majeure de son dispositif militaire. Elle a pour ambition de se poursuivre par une récupération de l'Indochine. Elle vise, en fin de compte, à étrangler complètement l'URSS; à lui retirer son statut de puissance mondiale.
Une des caractéristiques principales de cette offensive, c'est l'emploi de plus en plus massif de sa puissance militaire par le bloc US, notamment par l'envoi de corps expéditionnaires américains ou d'autres pays centraux du bloc (France, GB, Italie) sur le terrain des affrontements. Cette caractéristique correspond au fait que la carte économique, employée abondamment par le passé pour mettre la main sur les positions de l'adversaire, ne suffit plus :
- du fait des ambitions présentes du bloc US ;
- du fait surtout de l'aggravation de la crise mondiale elle même qui crée une situation d'instabilité interne dans les pays secondaires sur lesquels s'appuyait auparavant le bloc US.
A cet égard, les événements d'Iran ont été un révélateur. L'effondrement du régime du Shah et la paralysie que cela a occasionnée pour le dispositif américain dans cette région, ont permis à l'URSS de marquer des points en Afghanistan. Ils ont convaincu la bourgeoisie américaine de mettre sur pied sa force d'intervention rapide (et lui ont permis de faire "avaler" facilement cette décision à la population traumatisée par l'exploitation de l'affaire des otages de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979) et de réorienter sa stratégie impérialiste.
De même aujourd'hui, le meilleur bastion militaire du bloc occidental au Proche-Orient : Israël, se retrouve dans une situation économique et sociale difficile, ce qui impose une présence militaire directe accrue du bloc au Liban.
La difficulté de plus en plus grande du bloc US à entretenir son avancée contre le bloc russe par sa puissance économique alors que la crise frappe toujours plus fort, le pousse à subordonner de plus en plus totalement son économie à ses besoins militaires. Depuis longtemps, étant donnée sa faiblesse économique, l'URSS a du, pour maintenir sa domination sur son bloc, sacrifier la compétitivité de son économie aux besoins de sa puissance militaire par un développement hypertrophié de son économie de guerre. La primauté du militaire sur l'économique est une tendance générale de la décadence du capitalisme qui s'accélère aujourd'hui et que les années de vérité mettent à nu.
Cette tendance ne manifeste pas la force du capital, mais constitue au contraire la preuve de son affaiblissement. La fuite en avant dans l'économie de guerre et vers la guerre elle-même est le produit de l'affaissement du marché mondial sursaturé. La production d'armements a ceci de particulier qu'elle n'est destinée ni à la reproduction de la force de travail, ni à la production de moyens de production, mais à la destruction ; elle est elle-même une stérilisation et une destruction de capital.
Dans tous les pays, les programmes d'armements se développent depuis la fin des années 70. Les commandes d'armes de l'Etat américain sont un des facteurs déterminants de la "reprise" économique actuelle. Mais cette destruction massive de capital ne fait qu'accentuer à terme les effets de la crise et accélérer la faillite du capitalisme mondial (voir article dans ce n°).
LE PROLETARIAT : FREIN A LA GENERALISATION DES CONFLITS
La banqueroute du capital mondial pousse la bourgeoisie vers la guerre comme l'ont dramatiquement montré les deux holocaustes impérialistes de ce siècle. La crise économique aujourd'hui est plus profonde et plus forte que toutes celles qui ont précédé. Dans ces conditions, comment se fait-il qu'aucun des multiples conflits impérialistes ne se soit encore généralisé dans une 3e guerre mondiale ?
La classe ouvrière reste un obstacle décisif à la guerre mondiale. Ce n'est pas l'accumulation des armements les plus destructeurs qui freine les tendances bellicistes de la bourgeoisie. Mais depuis 1968, celle-ci n'est pas parvenue à assurer la soumission de cette principale force sociale du monde capitaliste qu'est le prolétariat.
La guerre impérialiste généralisée serait une guerre totale. Il faut à la bourgeoisie un prolétariat docile qui fasse tourner à plein les usines, qui accepte une militarisation totale du travail, de la vie sociale, qui subisse sans broncher le rationnement alimentaire le plus draconien, qui joue le rôle d’exécutant soumis de l'Etat bourgeois, au nom de la patrie, au nom du drapeau national, au coude à coude avec ses exploiteurs.
Le développement des luttes ouvrières contre les effets de la crise depuis 1968, au coeur du capitalisme mondial : en Europe, c’est-à-dire au centre des rivalités impérialistes entre les deux blocs qui se partagent le monde, démontre que cette condition n'est pas remplie. C'est cette reprise des combats du prolétariat à l'échelle mondiale à la fin des années 60 qui a imposé à la bourgeoisie américaine de retirer ses 400 000 hommes du ViêtNam devant les risques de conflagration sociale qui s'accumulaient.
La classe capitaliste doit entamer et briser cette résistance du prolétariat pour avoir les coudées franches et en découdre sur le terrain des affrontements impérialistes. Les campagnes idéologiques sur la guerre menées de façon intensive depuis l'invasion de l'Afghanistan par les troupes du bloc russe, n'ont pas d'autre but que de paralyser le prolétariat et lui faire accepter un effort de guerre et des interventions militaires croissantes. Ces campagnes s'adressent d'abord aux fractions de la classe ouvrière dans les pays industrialisés, et notamment d'Europe dont le rôle a toujours été déterminant par le passé pour permettre une marche à la guerre généralisée. En effet, l'embrigadement du prolétariat européen derrière l'étendard national et les mystifications bourgeoises a permis les deux guerres mondiales. Nous ne sommes pas dans la même situation aujourd'hui. Nulle part, des fractions importantes du prolétariat ne se trouvent vaincues, soumises, embrigadées par la bourgeoisie. Partout les luttes de résistance contre l'austérité montrent que le potentiel de combativité de la classe ouvrière est intact, loin d'être brisé.
Il y a deux ans, Reagan, devant le tollé suscité par l'envoi de quelques dizaines de milliers de "conseillers anti-guérillas" au Salvador, avait affiché son but : surmonter le "syndrome du ViêtNam", c'est-à-dire les réticences de la population des Etats Unis à l'envoi de soldats américains dans des conflits ouverts. On peut voir aujourd'hui, avec les milliers de soldats dépêchés au Liban ou à la Grenade, que la bourgeoisie occidentale, à coup de campagnes intensives, a avancé sur ce plan. Cependant, nous sommes encore loin de la période de contre-révolution durant laquelle les Etats Unis pouvaient, sans coup férir, envoyer 16 000 hommes au Liban pour rétablir l'ordre. La bourgeoisie a encore du chemin à parcourir si elle veut briser la résistance de la classe ouvrière et s'ouvrir la route de la 3e guerre mondiale.
Ainsi, depuis 1968, le prolétariat reste une préoccupation déterminante de la bourgeoisie car elle sait qu'il est le principal danger auquel elle se trouve confrontée. Un exemple marquant de cette situation réside dans l'organisation actuelle de l'appareil politique de la bourgeoisie : de plus en plus, elle tend, pour faire face à la lutte de classe, à mettre ses fractions de gauche dans l'opposition, alors que les besoins de la guerre mondiale nécessitent l'union nationale, ce qu'elle ne peut faire pour le moment. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la lutte de classe.
Mais même si la classe ouvrière joue un rôle de frein aux tendances bellicistes, cela ne signifie pas pour autant que les tensions inter impérialistes cessent d'exister. Au contraire, celles-ci ne peuvent que s'exacerber sous la poussée de la crise. La lutte du prolétariat ne peut empêcher l'éclatement des multiples conflits impérialistes localisés ; ce qu'elle empêche, c'est leur généralisation dans un troisième holocauste.
Les tensions inter impérialistes ne disparaissent pas dans le capitalisme : le capital suppose la guerre; et les illusions pacifistes, c'est-à-dire d'un capitalisme pacifique, sont un des pires poisons pour la classe ouvrière. Même durant la grève de masse en Pologne 80, quand les deux blocs se sont entendus comme "larrons en foire" pour isoler le prolétariat de Pologne et lui imposer la défaite, les tensions inter impérialistes -même si elles ont été mises au second plan- n'ont pas disparu pour autant : les conflits ont continué à la périphérie et les programmes d'armements ont fait un bond en avant dans les budgets des principales puissances impérialistes.
Le niveau de lutte de classe actuel, s'il empêche l'ouverture d'une 3e guerre mondiale, n'est pas suffisant pour faire reculer la bourgeoisie sur le plan militaire. Les ouvriers de Pologne ont posé la question de la généralisation internationale de la grève de masse au coeur de l'Europe, question à laquelle ils ne pouvaient répondre par eux-mêmes dans la situation d'isolement où ils se trouvaient. C'est seulement cette perspective qui peut faire reculer la bourgeoisie à l'échelle mondiale et préparer le terrain de la révolution communiste qui, mettant fin au capital, mettra fin à toutes les guerres. Cette perspective est entre les mains du prolétariat d'Europe occidentale, le plus à même, par son histoire, par son expérience, sa concentration, de la mettre en avant. De sa capacité de lutter, de s'opposer aux attaques de la bourgeoisie dépend l'avenir de l'humanité.
LA REPRISE DE LA LUTTE DE CLASSE
Alors que le thème de la guerre est omniprésent, obsédant, à travers le battage permanent de tous les médias ; alors que le prolétariat est soumis à un martelage incessant où, dans l'infernale logique du capitalisme, les cadavres viennent justifier les cadavres, tous les moyens d'information sont par contre soumis à un black-out sur les luttes de classe.
Pourtant, après un creux réel au lendemain de la défaite en Pologne, les grèves qui se déroulent depuis quelques mois en Europe sont significatives d'une reprise des combats de classe ; elles viennent confirmer que le prolétariat, loin d'être vaincu, garde intact son potentiel de combativité et qu'il est prêt à s'exprimer avec ampleur.
A cet égard, la grève du secteur public en Belgique durant le mois de septembre est exemplaire ; elle constitue le mouvement de luttes ouvrières le plus important depuis les combats de Pologne 80. Il en est ainsi par la conjonction des éléments suivants :
- le nombre de travailleurs impliqués (plusieurs centaines de milliers dans un pays qui ne compte que 9 millions d'habitants) ;
- le fait que ce mouvement a touché un des pays les plus industrialisés du monde, de plus vieux capitalisme, situé en plein coeur des énormes concentrations prolétariennes d'Europe occidentale ;
- la dynamique qui s'est exprimée au démarrage du mouvement : surgissement spontané des luttes qui a pris de court et a débordé les syndicats ; tendance à l'extension ; dépassement des clivages communautaires et linguistiques ;
- l'énorme mécontentement qui s'est révélé dans ces luttes et qui va croissant ;
- le fait que ce mouvement prend place dans un contexte international de surgissements sporadiques mais significatifs de la combativité ouvrière (en Grande Bretagne dans l'automobile ; en France, dans les centres de tris postaux ; en Hollande dans les services publics, etc.).
Le black-out imposé par les Etats aux moyens d'information sur cette grève durant une dizaine de jours dans les pays riverains de la Belgique (France, RFA, GB) met en évidence la crainte que la classe dominante éprouve d'une extension des explosions de mécontentement en Europe occidentale.
Ces luttes paraissent bien insignifiantes si on les compare à la flambée magnifique qu'avait constituée la grève de masse en Pologne 80. Pourtant, elles se développent dans un contexte différent qui leur donne toute leur valeur et leur sens.
La faiblesse de l'encadrement syndical "officiel" et la rigidité de l'Etat polonais ont permis la dynamique (extension et auto organisation) de la grève de masse à l'échelle nationale. Cependant, dans leur isolement, les travailleurs de Pologne se sont cassés le nez sur les illusions du syndicalisme à l'occidentale, "démocratique", véhiculées par Solidarnosc.
"Par contre, le prolétariat d'Europe occidentale, parce qu'il n'est pas dans la même situation d'isolement, parce qu'il a accumulé depuis des décennies toute une expérience de luttes où il s' est confronté aux syndicats, à la gauche, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crise le pousse à lutter, parce que son potentiel de combativité est intact, se trouve aujourd'hui dans des conditions meilleures qu'il n'en a jamais connues pour clarifier aux yeux du prolétariat mondial la véritable nature des syndicats, de la gauche et de la démocratie". (Rapport sur la situation internationale, 5e Congrès du CCI, Revue Internationale n° 35).
La grève en Belgique a manifesté des faiblesses qui continuent de peser sur la classe ouvrière et qui se sont notamment révélées par l'absence de remise en cause claire des syndicats et par l'absence d'auto organisation des luttes. Cependant, ces faiblesses ne sauraient atténuer ou masquer 1'importance du mouvement. En fait, alors que la "gauche dans l'opposition" mise en place activement à partir de 79 dans la plupart des pays avait réussi à épuiser et à venir à bout de la poussée ouvrière des années 78-80, les grèves de Belgique de septembre 83 constituent la première remise en cause d'envergure de l'efficacité de cette carte bourgeoise. Elles sont un indice indiscutable du fait que la classe ouvrière se remet de la défaite subie en Pologne 81, que le recul de ses combats qui marque les années 81-82, a pris fin.
A l'heure où la crise économique atteint maintenant de plein fouet les métropoles du capitalisme, la bourgeoisie ne peut plus différer ses programmes d'austérité,ni les étaler dans le temps. La classe exploiteuse est obligée de plus en plus d'attaquer toutes les fractions du prolétariat en même temps, au coeur du monde industriel de la vieille Europe. Ainsi la classe ouvrière est de plus en plus poussée à exprimer à une échelle toujours plus massive ses réserves de combativité. Les conditions de l'extension et de la généralisation se réunissent car le prolétariat doit faire face à une attaque générale de la bourgeoisie. Les conditions de l'auto organisation se rassemblent parce que le prolétariat est amené à se confronter à la gauche et à ses syndicats en luttant contre l'austérité de l'Etat et que l'approfondissement de la crise se traduit par une usure des mystifications démocratiques et syndicales imposées depuis 50 ans par la bourgeoisie derrière le mythe de 1'Etat-providence.
Les luttes en Belgique, en France, en Hollande, etc., annoncent les luttes d'envergure qui prendront place dans le futur. La reprise de la lutte de classe de l'automne 83 n'en est qu'à ses débuts, "Dans les pays avancés d'Occident et notamment en Europe de 1'Ouest, le prolétariat ne pourra déployer pleinement la grève de masse qu'à 1'issue de toute une série de combats, d'explosions violentes, d'avancées et de reculs, au cours desquels il démasquera progressivement tous les mensonges de la gauche dans 1'opposition, du syndicat et du syndicalisme de base". (Résolution sur la situation internationale du 5e Congrès du CCI, Revue Internationale n° 35)
Dans la mesure où le cours historique est la résultante du rapport de forces entre les classes, il peut sembler paradoxal dans la période actuelle d'assister en même temps à une accélération des tensions inter impérialistes et à la reprise de la lutte de classe. Le rapport entre les classes, entre le prolétariat et la bourgeoisie, n'est pas un rapport mécanique, immédiat ; c'est un rapport de forces historique. Devant 1 'exacerbation des contradictions provoquées par la crise, il faut une réponse à un degré qualitatif supérieur de la lutte de classe pour faire reculer la bourgeoisie et préparer l'assaut final contre le règne barbare du capital.
Ce que la reprise de la lutte de classe annonce aujourd'hui, ce sont les futures grèves de masse de dimension nationale d’abord, et leur généralisation internationale ensuite qui permettront au prolétariat de mettre en avant la perspective révolutionnaire. Sur ce chemin le prolétariat d'Europe, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte impérialiste, il est confronté au problème de la guerre de manière de plus en plus directe, devra assumer consciemment son opposition à celle-ci.
Plus que jamais, le prolétariat mondial aujourd'hui sera contraint de faire sien le mot d'ordre du prolétariat révolutionnaire du début du siècle : GUERRE ou REVOLUTION !
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Questions théoriques:
- Impérialisme [2]
Où en est la crise? : Le poids des dépenses militaires
- 2897 lectures
C'est avec une vigueur retrouvée que les grands pays industrialisés ont renforcé leur présence armée sur des théâtres d'opérations militaires, présence qui s'était ralentie depuis le retrait des troupes américaines du Vietnam en 1975. En 1982, le "wargame" grandeur nature des îles Malouines a clairement confirmé un tournant de la politique militaire du bloc de l'Ouest, prélude à l'"interposition" au Liban de corps expéditionnaires américain, français, britannique et italien la même année, "interposition" devenue intervention directe en 1983.
A cette politique correspond une intensification des dépenses militaires qui manifeste la fuite en avant du capitalisme vers la seule issue qu'il peut donner à la crise définitive de son système d'exploitation, la guerre généralisée. Cependant, le poids massif de l'économie de guerre remonte aux années 1930 ; aujourd'hui, la politique d'armements ne peut en aucune façon fournir un palliatif à la crise comme ce fut le cas à l'époque. Au contraire, cette politique ne fait qu'accélérer la plongée du capitalisme dans l'abîme de la crise ; elle se révèle incapable de résorber le chômage massif au coeur des centres industriels ; elle ne permet pas une reprise économique réelle. Ainsi s'accentuent les conditions d'une riposte de la classe ouvrière qui commence à s'engager dans les pays du coeur du capitalisme.
L'ACCELERATION DES DEPENSES MILITAIRES
Les grands pays capitalistes vont assurer de plus en plus directement les basses besognes de l'affrontement militaire entre rivaux impérialistes qui s’étaient poursuivi par petits pays interposés. Dans les années 1970, les grandes puissances ont tendu à ralentir 1’accélération des dépenses militaires, déléguant leur rôle de gendarme à leurs alliés du tiers-monde face au bloc russe. Cependant, ce ralentissement relatif n'a jamais été une diminution. Les dépenses militaires mondiales n'ont jamais cessé de croître, particulièrement dans le tiers-monde et dans le bloc de l'Est.
Après avoir tenté d'utiliser principalement leur prépondérance économique sur le marché mondial contre le bloc adverse, avec 1'accélération actuelle de la crise, les grands pays de l'Ouest sont à nouveau contraints d'accélérer leur politique d'armements.
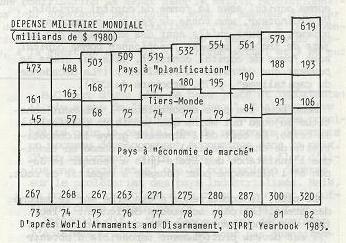
La production industrielle de ces pays tourne aujourd'hui au mieux à 75 % de ses capacités et 1'investissement se tasse : même les analystes de la bourgeoisie les plus convaincus de la "reprise" économique américaine -d'ailleurs de moins en moins nombreux- restent perplexes face au fait que cette soi-disant "reprise" s'accompagne d'une chute des investissements. La pression à la baisse du taux de profit s'accélère, et ceci d'autant plus pour les puissances industrielles que la productivité ne cesse de s'accroître.
Aux Etats-Unis, y compris dans des secteurs de pointe comme l'électronique, les faillites se multiplient. Dans l'automobile et l'aéronautique, les compagnies géantes comme Chrysler, Boeing, Mac Donnell Douglas, etc. ne doivent leur survie que grâce aux commandes militaires : chars pour Chrysler, avions Awacks pour Boeing, avions de combat pour Douglas.
La France, second producteur d'armements du bloc de l'Ouest, subit un nouveau freinage sans précédent dans l'industrie -agro-alimentaire, mines, sidérurgie, électronique. La construction aéronautique est de plus en plus fusionnée entre secteur civil et militaire et dominée par les responsables nationaux de l'armement : l'aviation civile stagne (Airbus) ; le secteur militaire est le seul qui résiste encore quelque peu à la récession.
Avec les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, le Japon prend une part grandissante dans la production d'armements, notamment dans l'électronique indispensable à la stratégie militaire actuelle. De même, l'Allemagne de l'Ouest, qui, tout comme le Japon, est un pays soi-disant à "bas profil" en matière militaire, dépense autant que la France dans ce domaine.
De plus, les chiffres officiels ne dévoilent qu'une partie de ce qui est réellement consacré à l'armement. En 1981 par exemple, 25 % de la recherche mondiale étaient officiellement consacrés au domaine militaire ; en fait, 90 % des programmes de recherche sont sous le contrôle de l'armée. Tous les "progrès techniques" dans la société civile ne sont que des retombées de l'industrie des armes. En informatique par exemple, les standards internationaux de programmation scientifique ou de gestion sont décidés par le Pentagone.
La crise ouverte révèle que c'est toute l'économie capitaliste qui est orientée vers la guerre, une économie de guerre qui n'est plus capable d'assurer l'accumulation du capital, et moins encore de développer une quelconque satisfaction des besoins humains. Au contraire, la proportion d'investissements dans les moyens de destruction ne cesse d'augmenter : selon la Banque Mondiale, 10 % des dépenses mondiales d'armements représentent ce que coûterait la résolution du problème de la faim dans le monde ; ces dépenses atteignent aujourd'hui la somme astronomique de plus d'un million de dollars... par minute.
LES DEPENSES MILITAIRES ACCELERENT LA CRISE DU CAPITALISME
"Les armes ont cette particularité majeure de posséder une valeur d'usage qui ne leur permet en aucun cas d'entrer sous quelque forme que ce soit dans le processus de production. Une machine à laver peut servir à reconstituer la force de travail, tout comme du pain ou des chemises. Par le contenu de leur valeur d'usage, ces biens peuvent servir comme capital sous la forme de capital variable. Un ordinateur, une tonne de fer ou une machine à vapeur, en tant qu'ils sont des moyens ou des objets de travail peuvent fonctionner comme capital sous forme de capital constant. Mais des armes ne peuvent que détruire ou rouiller". ("La décadence du capitalisme", p. 75, brochure du CCÏ).
Même pour les pays exportateurs l'armement constitue aujourd'hui moins que jamais un palliatif à la crise. Le coût de l'armement grève la compétitivité de chaque capital national comme en témoigne l'insistance des Etats-Unis à réarmer le Japon et l'Allemagne pour pousser à répartir ce coût.
De plus, la concurrence s'exacerbe sur le marché des armes. Les pays acheteurs deviennent à leur tour des concurrents dans beaucoup de domaines :
"Il est devenu pratiquement impossible d'obtenir des contrats à l'exportation sans accepter de rétrocéder aux clients une partie du savoir-faire". (L'Expansion, p.83, 1er déc.83).
Enfin, les achats ne peuvent se faire que grâce à des prêts des grandes puissances que de plus en plus de pays sont totalement incapables de rembourser. L'armement ne permet pas de retarder les effets de la crise : il ne sert qu'au maintien et à l'accentuation des positions stratégiques dans la rivalité entre Est et Ouest derrière les chefs de file des deux blocs : URSS et USA.
De même que l'URSS fait payer son armement par ses alliés, les USA font payer leur armement grâce à la place particulière du dollar comme monnaie refuge internationale. En drainant par des taux d'intérêts élevés les capitaux spéculatifs sur le dollar les USA font financer leur déficit budgétaire par les autres pays ; de plus,du fait du renchérissement du dollar,ils payent moitié prix leurs achats à ces pays. En 1982, le déficit budgétaire ([1] [3]) américain correspond d'ailleurs exactement au budget de la défense nationale (Survey of Current Business, 7/83). La "reprise" américaine ne repose que sur l'utilisation de la planche à billets, sur du papier, et la pression inflationniste que cela va inévitablement engendrer mène vers une nouvelle poussée d'hyper-inflation menaçant le système monétaire international, danger contre lequel précisément la bourgeoisie avait du réorienter sa politique à la fin des années 1970.
Mais c'est dans l'extension du chômage massif que le capitalisme signe sa faillite complète. Alors qu'avant la 2ème guerre mondiale la production d'armements avait permis une résorption spectaculaire du chômage -de 5 331 000 à 172 000 chômeurs aux USA entre 1933 et 1938, de 3 700 000 à 200 000 en Allemagne-, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec le gigantesque accroissement de la productivité des techniques de pointe, le niveau du réarmement actuel des grands pays industrialisés n'a d'effet que négligeable sur le chômage. Celui-ci n' a cessé d ' augmenter et ne peut que s ' accélérer.
Moins que jamais la production d'armements ne fournit un véritable débouché pour le capitalisme. Elle devient une charge de plus en plus lourde pour chaque économie nationale.
MG.
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Débat avec Battaglia Comunista sur les thèses de son 5ème congrès
- 2517 lectures
COURS HISTORIQUE: LES ANNEES 80 NE SONT PAS LES ANNEES 30
Savoir dans quel sens se dessine 1'histoire, vers où va la société : allons-nous vers une nouvelle guerre mondiale ? Allons-nous, au contraire, vers des affrontements de classe qui poseront la question de la révolution prolétarienne ?
C'est là une question de base, fondamentale, pour quiconque prétend jouer un rôle actif et conscient dans la lutte de classe.
C'est pourquoi, lors de ses congrès, une organisation politique prolétarienne consacre toujours une bonne partie de ses travaux à l'analyse de la situation mondiale, cherchant à cerner le mieux possible quelle est la dynamique générale du rapport de force entre les classes.
Battaglia Comunista (Parti Communiste Internationaliste), a tenu au début de novembre 82 son 5ème Congrès et vient de rendre publics ses travaux dans le n°7 de sa revue Prometeo de juin 1983. La question y est abordée même si c'est en partie pour affirmer qu'on ne peut pas répondre à ce genre de questions
B.C a affirmé dans un texte récent (distribué à la réunion publique du CCI à Naples, en juillet 83) qu'il considère les thèses du dit congrès comme une contribution au débat dans le milieu révolutionnaire et qu'elles"attendent encore d'être discutées dans leur substance politique". Nous ne pouvons discuter ici de toutes les questions abordées par le congrès de B.C ("crise et impérialisme", "tactique d'intervention du parti révolutionnaire la "phase de transition du capitalisme au communisme") sous peine de rester sommaires. Nous nous tiendrons, dans cet article, à la question du cours historique actuel et à ce qui s'en dégage au travers des thèses du congrès de B.C.
PEUT-ON ALLER EN MEME TEMPS VERS LA GUERRE MONDIALE ET VERS LA REVOLUTION ?
A la question de savoir quelle est la perspective actuelle pour la lutte de classe, Battaglia répond que tout ce qu'on peut dire pour le moment c'est que ce sera peut-être la guerre, peut-être la révolution, peut-être les deux. Il n'y a, d'après B.C, aucun élément sérieux qui permette d'affirmer que l'une de ces issues soit plus probable que les autres. Voici un exemple de comment elle formule cette idée.
"L'effondrement général de 1'économie se traduit de façon immédiate par 1'alternative : guerre ou révolution. Mais la guerre elle-même en marquant un virage en soi catastrophique dans la crise du capitalisme et un brusque bouleversement dans les échafaudages superstructures du système, ouvre les possibilités de1'effondrement de ceux-ci et donc 1'ouverture, au sein-même de la guerre, d'une situation révolutionnaire et de la possibilité d'affirmation du parti communiste. Les facteurs qui déterminent 1'éclatement social, au sein duquel le parti trouvera les conditions de sa croissance rapide et de son affirmation, que ce soit dans la période qui précède le conflit, pendant le conflit ou immédiatement après celui-ci, ne sont pas quantifiables. On ne peut donc pas déterminer a priori à quel moment un tel éclatement aura lieu (exemple polonais). " Tactique d'intervention du parti révolutionnaire/ Prometeo, juin 83.
B.C part d'une idée de base juste et importante: il n'y a pas de "troisième issue". L'alternative est guerre ou révolution et il n'y a aucune possibilité pour le capitalisme de reprendre désormais un nouveau développement économique dans la paix. C'est important, entre autres, face au flot d'illusions "pacifistes" que la bourgeoisie déverse sur le prolétariat des pays industrialisés. Mais, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est insuffisant comme détermination d'une perspective.
Battaglia dit : "Les facteurs qui déterminent 1'éclatement social (...) ne sont pas quantifiables. On ne peut donc pas déterminer a priori à quel moment un tel éclatement aura lieu".
Mais, ce dont il s'agit ce n'est pas de déterminer le jour et l'heure d'une éventuelle révolution prolétarienne, mais plus simplement et plus sérieusement de savoir si la bourgeoisie mondiale dispose des moyens de conduire le prolétariat des pays industrialisés à une troisième guerre mondiale ou bien si, au contraire, non embrigadée et poussée par la crise, la classe ouvrière se prépare à des affrontements qui poseront la question de la révolution communiste mondiale.
En disant que la situation révolutionnaire peut se produire avant, pendant ou après une prochaine guerre, Battaglia s'avoue incapable de se prononcer sur la perspective historique actuelle.
B.C justifie cette incapacité en disant que la situation de crise économique peut conduire simultanément à l'une ou à l'autre issue historique.
Il y aurait en quelque sorte deux tendances parallèles et ayant des chances égales de se concrétiser l'une corme l'autre. Il est vrai que du point de vue objectif, la crise économique exacerbe simultanément les antagonismes d'intérêt entre les classes sociales et les antagonismes entre puissances capitalistes rivales. Mais l'aboutissement de l'un ou l'autre de ces antagonismes dépend en dernière instance d'un seul et même facteur: la conscience et la pratique du prolétariat.
C'est la même classe, la classe exploitée, qui, soit s'affirme comme protagoniste de la révolution, soit, disloquée, sert de chair à canon et de producteur des moyens matériels de la guerre impérialiste.
L'état d'esprit, la conscience d'une classe, prête à bouleverser 1'ordre social capitaliste et à bâtir une nouvelle société est radicalement différent de celui qui caractérise des ouvriers atomisés, brisés, "solidaires" de leur classe dominante au point d'accepter de s'entretuer sur les champs ide bataille au nom de"leurs" patries respectives. Marcher avec des drapeaux rouges vers la construction d'une humanité unifiée, ce n'est pas la même chose que marcher en rangs par quatre derrière un drapeau national pour égorger les prolétaires du ploc impérialiste adverse. La classe ouvrière ne peut pas partager en même temps ces deux états d'esprit qui s'excluent totalement.
C'est là une évidence que certainement Battaglia accepterait sans réticences. Mais ce qu'elle semble ignorer c'est que les processus qui conduisent à l'une ou l'autre de ces situations s'excluent tout autant.
Le processus qui conduit vers 1'issue révolutionnaire est caractérisé par un dégagement croissant du prolétariat de l'emprise de l'idéologie dominante et un développement de sa conscience et de sa combativité ; celui qui conduit vers la guerre, à l'inverse, se traduit par une adhésion croissante des ouvriers aux valeurs capitalistes ( et à leurs représentants politiques et syndicaux ) et par une combativité qui, soit tend quasiment à disparaître, soit ne s'exprime que dans une perspective politique totalement contrôlée par la bourgeoisie.
Ce sont là deux processus bien différents, antagoniques, s'excluant aussi l'un l'autre.
Quiconque analyse l'histoire en sachant voir le rôle de protagoniste central du prolétariat, sait que la marche vers la guerre ne peut pas être la même que la marche vers des situations révolutionnaires.
Affirmer que les deux processus peuvent se dérouler simultanément sans que l'on puisse déterminer quelle tendance tend à l'emporter, c'est tout simplement raisonner en mettant entre parenthèses, en faisant abstraction de la classe révolutionnaire, de sa conscience et de sa combativité.
COMMENT RECONNAITRE LE COURS VERS LA GUERRE ?
Battaglia clame aujourd'hui être le seul héritier authentique des acquis de la Fraction de la Gauche Italienne pendant l'entre deux guerres. Mais un des mérites principaux de ce dernier courant,qui a traversé sur un terrain de classe la période noire de la contre-révolution triomphante,n'est autre que sa capacité à avoir reconnu lucidement le recul de la révolution dès les années 20 et l'ouverture d'un cours vers la guerre dans les années 30. S'il a été capable de voir dans la guerre d'Espagne et dans les grèves de 36 en France non pas "le début de la révolution en Europe", comme un Trotski pouvait le croire, mais des moments qui s'inscrivaient déjà dans une marche vers la guerre mondiale, c'est parce qu'il avait su raisonner en termes de cours historique et replacer les événements particuliers immédiats dans la dynamique globale du rapport de forces entre classes au niveau historique et mondial. Il suffit de se pencher sur l'histoire des périodes qui ont précédé les deux guerres mondiales pour voir à quel point ces événements majeurs n'ont pas éclaté comme des éclairs dans un ciel bleu, mais furent le résultat d'un processus de préparation au cours duquel la conscience du prolétariat fut systématiquement détruite par la bourgeoisie jusqu'à permettre l'embrigadement des prolétaires.
La Gauche Communiste de France, en 1945, en reprenant la méthode qui fut celle de la Gauche Italienne donna un remarquable résumé de ce que fut ce processus de préparation à la guerre :
"C'est l'arrêt de la lutte de classe, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la. déviation de ses luttes que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, envidant ses luttes de leur contenu révolutionnaire, en les engageant sur les, rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de 1'éclatement de la guerre impérialiste.
Ceci doit être compris non d'un point de vue étroit et limité d'un secteur national isolé, mais internationalement.
Ainsi, la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constaté en 1913 en Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de plus près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masse, gloire et fierté de la Deuxième Internationale, n'est aient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier, miné et pourri par 1'opportunisme régnant en maître devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de guerre.
La réalité ne se traduit pas dans la photo chronologique des événements. Pour la comprendre, il faut saisir le mouvement sous-jacent, interne, les modifications profondes qui se sont produites avant qu'elles n'apparaissent à la surface et soient enregistrées par des dates.
On commettrait une grave erreur en voulant rester fidèle à 1'ordre chronologique de 1'histoire et présenter la guerre de 1914 comme la cause de 1'effondrement de la 2ème Internationale quand. en réalité, l'éclatement de la guerre fut directement conditionné par la dégénérescence opportuniste préalable du mouvement ouvrier international. Les fanfaronnades de la phrase internationaliste se faisaient sentir d'autant plus extérieurement qu'intérieurement triomphait et dominait la tendance nationaliste. La guerre de 1914 n'a fait que mettre en évidence, au grand jour, 1'embourgeoisement des partis de la 2ème Internationale, la substitution de leur programme révolutionnaire initial, par l'idéologie de l'ennemi de classe, leur rattachement aux intérêts de la bourgeoisie nationale.
Ce processus interne de destruction de la conscience de classe a manifesté son achèvement ouvertement dans 1'éclatement de la guerre de 1914 qu'il a conditionné.
L'éclatement de la seconde guerre mondiale était soumis aux mêmes conditions.
On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerre impérialistes.
La première s'achève avec 1'épuisement de la grande vague révolutionnaire de 1'après 17 et consiste dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, dans la défaite de la gauche exclue de l'IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme a travers de la théorie de la pratique du "socialisme en un seul pays".
La deuxième étape est celle de 1'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue 1'alternative historique du capitalisme/socialisme:1'Allemagne par 1'écrasement physique du prolétariat et 1'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l'IC et la faillite de l'opposition de gauche de Trotski qui, incapable de regroupe le énergies révolutionnaires, s'engage dans la coalition de la fusion avec des groupements et des courants opportunistes de la gauche socialiste, s'oriente vers des pratiques de bluff et d'aventurisme en proclamant la formation de la 4ème Internationale.
La troisième étape fut celle du dévoiement total du mouvement ouvrier des pays "démocratiques". Sous le masque de défense des "libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a, en réalité, cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de la bourgeoisie nationale, de sa patrie capitaliste. L'anti-fascisme était la plateforme, 1'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres au prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale.
Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif, la destruction de la conscience de classe par l'empoisonnement des masses, par 1'idéologie anti-fasciste, 1'adhésion des masses la future guerre impérialiste au travers de leur mobilisation dans les "fronts populaires", les grèves dénaturées et déviées de 1936. La guerre anti-fasciste espagnole, la victoire définitive du capitalisme d'Etat en Russie se manifestant entre autres, par la répression féroce et le massacre physique de toute velléité de réaction révolutionnaire, son adhésion à la SDN, son intégration dans un bloc impérialiste et 1'instauration de 1'économie de guerre en vue de la guerre impérialiste se précipitant. Cette période enregistre également la liquidation de nombreux groupes révolutionnaires et des Communistes de Gauche surgis de la crise de l'IC et qui, au travers de 1'adhésion à l'idéologie anti-fasciste à la défense de "l'Etat ouvrier en Russie", sont happés dans 1'engrenage du capitalisme et définitivement perdus en tant qu'expression de la vie de la classe. Jamais l'histoire n'a encore enregistré pareil divorce entre la classe et les groupes qui expriment ses intérêts et sa mission. A l’avant-garde se trouve dans un état d'absolu isolement et réduite quantitativement à de petits îlots négligeables.
L'immense vague de la révolution jaillie à la fin de la première guerre impérialiste a jeté le capitalisme international dans une telle crainte qu 'il a fallu cette longue période de désarticulation des bases du prolétariat pour que la condition soit requise pour le déchaînement de la nouvelle guerre impérialiste mondiale". Rapport à la Conférence de juillet de la Gauche Communiste de France.( 1945)
Comme on le voit, le cours historique qui conduit à la guerre a des manifestations spécifiques, prolongées dans le temps et reconnaissables - même si elles ne sont pas "quantifiables" comme le voudrait Battaglia- pour pouvoir se risquer à se prononcer.
On peut, peut-être, affirmer qu'il n'est pas toujours aisé de reconnaître un tel processus, mais c'est tourner le dos aux responsabilités des révolutionnaires, c'est se résigner à l'impuissance et à l'inutilité que de prétendre qu'il est, de façon générale, impossible de déterminer le cours historique.
COMMENT RECONNAITRE LE COURS VERS DES AFFRONTEMENTS DE CLASSE DECISIFS ?
Le processus qui conduit à la création de situations révolutionnaires est très différent de celui qui conduit à la guerre . La marche vers la guerre est un mouvement qui ne rompt pas avec la logique même du système dominant.
Pour les prolétaires, aller à la guerre, c'est aller au bout de leur soumission au capital sur tous les plans... jusqu'au sacrifice de la vie elle-même. Il n'y a pas de changement fondamental dans le rapport entre classe dominante et classe exploitée. Le rapport "normal", dans"les règles de l'ordre" est simplement poussé à une de ses formes les plus extrêmes.
En réalité, le cours qu'on pourrait appeler 'normal ' de la société capitaliste est vers la guerre. La résistance de la classe ouvrière qui peut remettre en cause ce cours apparaît comme une sorte "d'anomalie", comme allant à "contre-courant" d'un processus organique du monde capitaliste. C'est pour cela que, si on examine les huit décennies de notre siècle, on en trouvera à peine un peu plus de deux, au cours desquelles le rapport de forces aura été suffisamment en faveur du prolétariat, pour qu 'il puisse barrer le chemin à la guerre impérialiste (1905-12, 1917-23, 1968-80) ". (Revue Internationale n°21, 2ème trimestre 1980, "Révolution ou guerre").
En ce sens, le cours de montée de la lutte de classe est beaucoup plus fragile, instable et heurté que celui vers la guerre. De ce fait, il peut être interrompu et renversé par une défaite décisive face à la bourgeoisie, alors que le cours vers la guerre ne peut être interrompu, éventuellement, que par la guerre elle-même.
" Alors que le chemin de la victoire est unique pour le prolétariat : 1'affrontement armé et généralisé contre la bourgeoisie; celle-ci dispose de divers moyens pour défaire son ennemi : soit en épuisant la combativité dans des impasses (c'est la tactique présente de la gauche), soit en l'écrasant paquet par paquet (comme en Allemagne 1919 et 1923), soit en l'écrasant physiquement lors d'un choc frontal (qui est toutefois le type d'affrontement le plus favorable au prolétariat)." (ibid.)
Cours vers la révolution et cours vers des affrontements de classe décisifs.
C'est pour tenir compte de cette "réversibilité" du cours vers la révolution que, lorsque nous cherchons à rendre compte de la situation présente, nous préférons parler de "cours vers des affrontements de classe".
" L'existence d'un cours à 'l'affrontement de classe' signifie que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour déchaîner une nouvelle boucherie mondiale ; auparavant, elle devra affronter et battre la classe ouvrière. Mais cela ne préjuge pas de 1'issue de cet affrontement, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que celui de 'cours à la révolution'. (Revue Internationale n° 35, Résolution sur la situation internationale, 5ème Congrès du CCI).
C'est pour cela que nous employons moins le terme de "cours vers la révolution"... et non parce que nous aurions bouleversé notre analyse sur la question du cour actuel, comme le prétend Battaglia dans un souci de fausse polémique qui évite les vraies questions (cf. la réponse publique à notre "Adresse aux groupes politiques prolétariens" du 5ème Congrès du CCI).
Le terme de cours vers la révolution se justifie essentiellement en fonction de la nécessité d'affirmer qu'il n'y a pas de troisième issue en dehors du dilemme : guerre ou révolution. Mais, sans autre précision, cette formulation peut laisser entendre une conclusion qui, elle, ne peut être affirmée avec certitude, du moins au stade actuel du développement du cours historique : nous savons que nous allons vers des affrontements de très grande ampleur entre prolétariat et bourgeoisie qui, une fois encore poseront la question de la révolution, et non vers la guerre. Mais on ne peut préjuger de l'issue de cet affrontement.
La révolution PENDANT la guerre ?
L'histoire fournit beaucoup plus d'exemples de situations où le rapport de forces est totalement en faveur de la classe dominante que de périodes où le prolétariat a ébranlé ou limité réellement son pouvoir. De ce fait, il y a moins de références historiques pour définir les caractéristiques de ce que peut être le cheminement vers des affrontements révolutionnaires que dans le cas d'un cours vers la guerre. Et cela est d'autant plus vrai que l'expérience des mouvements révolutionnaires prolétariens importants dans le passé s'est généralement inscrite dans des guerres ou immédiatement après (la Commune de Paris 1871, 1905 et 1917 en Russie, 1918-19 en Allemagne). Or, la guerre crée des conditions telles que, même si, comme en 1914-18, elle provoque le développement d'une vague de luttes révolutionnaires, celle-ci ne parvient pas - du fait même de la guerre - à devenir véritablement internationale.
La guerre peut provoquer des mouvements révolutionnaires et cela de façon extrêmement rapide :
les premières grèves significatives en Russie et en Allemagne ont lieu en 1915 et 1916 ; la révolution éclate "à peine" deux ou trois ans après. Deux ou trois ans qui sont cependant des périodes de guerre mondiale, d'histoire accélérée qui équivalent, au niveau du rapport entre les classes, à des décennies d'exploitation et de crise "pacifique" .
Cependant, ".cette même guerre impérialiste (1914-18) portait e elle toute une série d'obstacles à la généralisation des luttes révolutionnaires à 1'échelle mondiale :
- la division entre pays belligérants et pays "neutres" : dans ces derniers pays, le prolétariat ne subit pas de dégradation massive de ses conditions de vie;
- la division entre"pays vainqueurs" et "pays vaincus": dans les premiers, le prolétariat a été le plus souvent une proie facile pour la fierté chauvine déversée massivement par la bourgeoisie; dans les seconds si la démoralisation nationale créait de meilleures conditions pour le développe ment de 1 'internationalisme, elle ne fermait pas la porte, au contraire, au développement de sentiments de revanche (cf. le "national bolchevisme" en Allemagne) ;
- face à un mouvement révolutionnaire né de la guerre impérialiste, il restait comme recours à la bourgeoisie d'interrompre celle-ci (cf. Allemagne en novembre 1918) ;
- une fois la guerre impérialiste terminée, la possibilité de reconstruction qui s'offre au capitalisme et donc d'une certaine amélioration du fonctionnement de son économie a brisé 1'élan prolétarien en le privant de son aliment de base : la lutte économique et le constat de faillite du système.
Par contre,le développement progressif d'une crise générale de l'économie capitaliste, s'il ne permet pas une prise de conscience aussi rapide des véritable enjeux de la lutte ni de la nécessité de 1'internationalisme, élimine cependant les obstacles énumérés ci-dessus en se sens :
- qu'il tend à mettre le prolétariat de tous les pays sur un même plan : la crise mondiale n'épargne aucune économie nationale,
- qu'il n'offre à la bourgeoisie aucune porte de sortie sinon celle d'une nouvelle guerre impérialiste qu'elle ne pourra déchaîner tant que le prolétariat n'aura pas été battu". (Revue Internationale numéro 26, 3ème trimestre 81, "Résolution sur la lutte de classe" du 4ème Congrès du CCI).
L'histoire ne peut donc fournir toutes les caractéristiques de ce que peut être un cours ascendant de lutte en une période comme l'actuelle, caractérisée non par la guerre mais par un lent enfoncement de la société dans la crise économique.
On peut cependant identifier un tel cours, premièrement de façon "négative", c'est-à-dire par le fait qu'il ne possède pas les caractéristiques essentielles du cours vers la guerre ; deuxièmement, par le fait qu'il est marqué aussi bien par un dégagement de la part du prolétariat de l'emprise de l'idéologie dominante que par un développement de sa propre conscience et combativité de classe.
LE COUPS HISTORIQUE ACTUEL
Le 5ème congrès de Battaglia ne se prononce pas véritablement sur les perspectives de la lutte de classe. Il maintient un flou tout comme le 2ème congrès du PCInt. en. 1948 sur la rnême question. (Voir article dans ce numéro). Mais à propos de la situation actuelle les thèses du congrès affirment : "Si aujourd'hui le prolétariat, face à la gravité et aux coups subis par les attaques répétées de la bourgeoisie, ne s 'est vas encore montré en mesure de répondre, cela signifie seulement que le long travail de contre-révolution mondiale est encore à 1'oeuvre au sein des consciences ouvrières". (Synthèse du rapport de politique générale)
Battaglia n'a jamais compris l'importance de la rupture historique avec la contre-révolution que constitua la vague de grèves ouverte par 1968 en France. B.C considère qu'en réalité aujourd'hui, tout comme dans les années 30, "le long travail de la contre-révolution mondiale est encore à 1'oeuvre au sein des consciences ouvrières".
Dans une grande mesure B.C ne voit pas encore la différence qualitative qu'il y a entre les années 80 et les années 30. Elle ne perçoit pas comment le fait que la crise économique détruise systématiquement les mystifications idéologiques qui écrasent le prolétariat et qui ont permis dans le passé de l'embrigader dans la guerre, crée des conditions historiques qualitativement différentes pour la lutte prolétarienne.
"Le fait - disent les thèses du 5ème congrès de B.C. - d'avoir cédé pendant des décennies à l'opportunisme, en un premier temps, à la contre-révolution des partis centristes ensuite, le fait d'avoir subi le poids de 1'écroulement des mythes politiques comme celui de la Russie et de la Chine, la frustration d'espérances émotivo-politiques comme celles créées artificiellement avec la guerre du Viêt-Nam, a engendré dans le choc avec cette vaste et destructrice crise économique, un prolétariat fatigué et déçu, mais pas pour autant vaincu définitivement ". (idem)
Il est normal que B.C. constate, au moins, que depuis la 2ème guerre mondiale le prolétariat n'a pas été massivement écrasé et n'est pas "vaincu définitivement". Mais au delà de cette constatation B.C. ne continue à voir dans le prolétariat et ses luttes que le "long travail de la contre-révolution", la fatigue et la déception.
Qu'en est-il en réalité ?
Comme on l'a vu précédemment, l'existence d'une combativité ouvrière ne suffit pas à caractériser un cours vers des affrontements révolutionnaires : les luttes à la veille de la 1ère guerre mondiale, imbues d'esprit réformiste, d'illusions sur la démocratie et sur une intarissable prospérité capitaliste, celles de la 2ème moitié des années 30 détournées et annihilées dans l'impasse de"l'anti-fascisme" et donc de la défense d'un capitalisme "démocratique", démontrent que sans développement de la conscience prolétarienne la combativité de classe ne suffit pas à entraver le cours vers la guerre.
Depuis la fin des années 60, la combativité ouvrière a connu aux quatre coins de la planète, à travers des périodes de recul et de reprise, un renouveau qui tranche sans équivoque avec les périodes précédentes. De Mai 68 en France à la Pologne de 1980-81 la classe ouvrière a démontré que loin d'être déçue et fatiguée, elle possédait des potentialités de combat intactes et qu'elle savait les rendre effectives.
Mais qu'en est-il au niveau de sa conscience ?
On peut ici distinguer deux processus qui, tout en étant étroitement liés n'en sont pas pour autant identiques. Il y a d'une part le développement de la conscience prolétarienne par son dégagement de l'emprise de l'idéologie dominante et, d'autre part, le développement "en positif" de cette conscience par l'affirmation de 1'autonomiefde l'unité et de la solidarité de classe.
Sur le premier plan, la crise économique et ses effets dévastateurs qu'aucun régime, d'Est ou d'Ouest, aucun parti au gouvernement de droite ou de gauche ne parvient à enrayer, ont porté les plus rudes coups aux mystifications bourgeoises sur la possibilité d'un capitalisme éternellement prospère et pacifique, sur le "Welfare state", sur la nature ouvrière des pays de l'Est et autres régimes soi-disant "socialistes", sur la démocratie bourgeoise et le vote comme moyen de "changer les choses", sur le chauvinisme et le nationalisme dans les pays les plus industrialisés, sur la nature ouvrière des partis de gauche et leurs centrales syndicales... (nous renvoyons nos lecteurs à nos textes qui ont plus largement développé cette question, en particulier "le cours historique", rapport adopté par le 3ème congrès du CCI -Revue Internationale N° 18, 3ème trimestre 1979).
Sur le 2ème plan, le développement "en positif" de la conscience de classe, celui-ci ne peut être évalué qu'en regard des manifestations de lutte ouverte du prolétariat considérées non pas de façon locale ou statique mais dans leur dynamique au niveau mondial. Or, les luttes des 15 dernières années de mai 68 aux grèves du secteur public en Belgique en septembre 83, si elles n'ont pas encore atteint des degrés de conscience révolutionnaire généralisée -ce qu'il serait enfantin de leur exiger au stade actuel de leur développement- n'en sont pas moins marquées par une nette évolution vers l'autonomie à l'égard des appareils d'encadrement de la bourgeoisie (syndicats, partis de gauche) et vers des formes d'auto organisation et d'extension de la lutte. Le seul fait que la bourgeoisie soit de plus en plus systématiquement contrainte d'avoir recours au "syndicalisme de base", surtout dans les "pays démocratiques" pour contenir et dévoyer la combativité ouvrière, parce que le mouvement de désyndicalisation s'accélère et que les directions syndicales sont de moins en moins capables de se faire obéir, suffit à lui seul à démontrer le sens de la dynamique de la conscience ouvrière. Contrairement à ce qui s'est produit dans les années 30, où les luttes se sont accompagnées d'un développement du syndicalisme et de l'emprise des forces bourgeoises sur le mouvement, les luttes de notre époque tendent à affirmer leur autonomie et leur capacité d'extension par dessus les barrières que ces forces leur opposent.
Il reste, bien sûr, encore un long chemin à parcourir au prolétariat pour parvenir à l'affirmation de sa conscience révolutionnaire pleinement épanouie. Mais s'il faut attendre que ce point soit atteint pour se prononcer sur le sens du mouvement actuel, -comme semble le faire Battaglia -il faut renoncer à toute analyse sérieuse du cours historique présent.
Le 5ème congrès de B.C semble avoir consacré beaucoup d'efforts à l'analyse de la crise économique actuelle. Et c'est là un aspect important pour la compréhension de l'évolution historique présente -à la condition toutefois que cette analyse soit correcte, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais la meilleure analyse économique devient inutile pour une organisation révolutionnaire si elle ne s'accompagne pas d'une juste appréciation de la dynamique historique de la lutte de classe. Et dans ce domaine le congrès de B.C se présente avec plus de 40 ans de retard.
A en juger par les travaux de son 5ème congrès, tout indique, que Battaglia, au niveau de son analyse de la lutte de classe, n'est pas encore entrée dans les années de vérité, les années 80.
R.V.
Courants politiques:
Questions théoriques:
A propos de l'adresse aux groupes politiques prolétariens du 5eme congres du CCI
- 2490 lectures
REPONSE AUX REPONSES
A son 5ème Congrès International,le CCI a adressé à tout le milieu politique prolétarien un Appel (cf. Revue Internationale n°35) pour qu'il prenne conscience de ses responsabilités dans la gravité de la situation historique actuelle. Les contradictions destructrices du système capitaliste, aiguisées par la crise mondiale, précisent chaque jour davantage 1'alternative devant la classe ouvrière : guerre ou révolution. "Mais 1'avant-garde politique du prolétariat, au lieu de servir de phare dans la tourmente sociale qui se développe, est au contraire souvent ballottée par les événements incapable de dépasser son éparpillement et son sectarisme qui sont le legs de la contre-révolution." (Adresse du 5ème Congrès).
L'"Appel" du CCI ne contient pas de solution miracle à cette situation. Nous avons voulu insister sur le fait que 1'intervention dans les luttes et surtout la préparation aux combats futurs "ne sauraient être assurées par une simple somme d'efforts de chaque groupe pris individuellement. Il s'agit d'établir une coopération consciente entre toutes les organisations non pas pour réaliser des regroupements hâtifs, artificiels, mais pour engendrer une volonté et une démarche qui donnent toute son importance à un travail systématique de débats, de confrontations fraternelles entre forces politiques prolétariennes". (Ibid.).
Nous avons dit clairement dans l "Adresse" : "l'heure n'est pas venue pour l'appel à des nouvelles conférences des groupes communistes." Après l'échec des Conférences Internationales de 1977 à 1980, il s'agit aujourd'hui d'en tirer les leçons et poursuivre par d'autres moyens le débat sur les questions politiques qui restent à clarifier, notamment la question sur laquelle les Conférences se sont disloquées sans clarté réelle : le rôle, la fonction du futur parti du prolétariat.
Nous allons répondre ici brièvement aux propositions qui nous ont été faites et aux arguments mis en avant par ceux qui ont répondu.
Il faut dire tout de suite que le fait même que des organisations politiques aient ressenti le besoin de répondre et de s'expliquer est déjà une chose positive. Nous sommes contents de constater que les organisations politiques du prolétariat ne sont pas sourdes.
Mais les révolutionnaires ont beau être optimistes par nature, nous avons parfois la fâcheuse impression que les réponses à 1'"Adresse" expriment moins une conviction profonde qu'une réaction "réflexe" : on sauve la face en répondant mais on se lave les mains par ailleurs en n'allant pas au POND de la question. On continue à penser dans son for intérieur : si d'autres organisations ont des problèmes, tant mieux ! Qu'elles débarrassent le plancher au plus vite. Chacun construit "son" parti et défend "son" territoire. On est pour la confrontation des positions politiques, bien sûr, mais c'est plutôt un "pourquoi pas". On ne la considère pas comme une nécessité vitale, une activité à part entière.
On se réveille à la nécessité de penser ou agir collectivement seulement quand il y a des événements ponctuels, mais comme activité systématique, comme préoccupation constante, on ne comprend toujours pas.
On continue à opposer l'intervention dans la classe" à l'intervention "dans le milieu", cette dernière étant vue comme une activité annexe, voire stérile, même si on ne le dit pas à haute voix. Pourtant, si les groupes politiques étaient réellement convaincus que :
- la conscience de classe ne vient pas de l'extérieur de la classe elle-même et n'est pas injectée de dehors comme le prétend la position léniniste de "Que faire ?" ;
- la classe ouvrière donne naissance à son milieu politique pour que les idées de la classe puissent s'exprimer et se clarifier ; alors, tous les groupes comprendraient dans les faits, et pas seulement dans des phrases, que les débats dans le milieu sont le reflet des besoins de la classe. Ils comprendraient que les discussions ne sont pas superflues et que les thèmes de débat ne sont pas le fait du hasard. Ils comprendraient enfin que la clarification nécessaire à la classe ouvrière internationale doit aussi s'exprimer dans un mouvement vers la clarification de son milieu politique. Il ne suffit pas de faire la comptabilité des groupes en voie de disparition dans le milieu comme si on assistait à un "match" macabre : sans la clarification réelle des erreurs, le milieu dans son ensemble continuera à traîner des incompréhensions qui nuiront inévitablement à la possibilité d'une révolution victorieuse.
Aujourd'hui, on reconnaît qu'une décantation de grande envergure se produit dans le milieu politique. Les groupes politiques sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Mais ils sont passifs face à ce processus. Ils ne reconnaissent pas la nécessité d'une clarification consciente active pour faire en sorte que cette décantation ne soit pas une pure perte. Ils ne reconnaissent pas non plus que c'est le sectarisme et la peur qui ont saboté les Conférences Internationales, empêchant le milieu politique prolétarien de s'assumer consciemment. Aujourd'hui, seule la confrontation des positions peut aider tous les groupes à évoluer vers une cohérence politique et à assurer une intervention à la hauteur des exigences historiques.
Nous avons reçu des lettres du Communist Bulletin Group (Grande-Bretagne) , du Groupe Communiste Internationaliste (Belgique), de la Communist Workers’Organisation (Grande-Bretagne) et du PCI-Battaglia Comunista (Italie) . Le Fomento Cforero Revolutionario nous promet une réponse en décembre 83. Les éléments du Groupe Volonté Communiste prévoient un bilan de leur trajectoire politique pour bientôt. En commençant par le petit bout...
COMMUNIST BULLETIN GROUP (Grande-Bretagne)
Comment distinguer le bavardage d'un discours sincère ? En s'assurant que les paroles se concrétisent par des actes en conséquence. Talk is cheap (parler n'engage à rien). Le CBG écrit : "Nous voulons exprimer notre solidarité avec la démarche et les préoccupations exprimées dans 1'Adresse. " ; "Le débat ouvert, fraternel et constant, est une nécessité matérielle pour le milieu révolutionnaire" ."Nous devons combattre pour la reconnaissance de 1'existence d'un milieu politique prolétarien.". (Lettre du CBG). Parfait ! Le seul hic -et il est de taille- c'est que, à l'origine de ce groupe,se trouve 1'ex-section du CCI d'Aberdeen (également ex-section de la CWO ; ce sont les mêmes) qui a couvert et justifié le vol du matériel et de 1 ' argent du CCI en péchant dans les eaux troubles de Chénier (Voir Revue Internationale n°28) . Ces "camarades" ont eu connaissance des manoeuvres de Chénier pendant des mois et ils ont justifié le vol une fois celui-ci accompli, comme "normal en cas de scission". Notre condamnation de ces pratiques était qualifiée de "réaction de petits bourgeois propriétaires". Jusqu'à aujourd'hui, le CBG dans son ensemble a justifié politiquement ces actes et ces prises de position. Jusqu'à aujourd'hui, il a refusé de nous rendre ce qu'il a pris lui. Dans les premiers numéros de The Bulletin, il se revendiquait de ce comportement en se vautrant dans le colportage de racontars aussi vils que stupides contre le CCI. Maintenant, (sans doute en voyant que l'attitude précédente n'a pas mené au résultat escompté) il essaye de se blanchir les mains en défendant hypocritement "la nécessité de polémiques saines". Que le ton soit hystérique ou douceâtre ne change rien au fait qu'on ne peut lire nulle part dans la presse du CBG un désaveu politique du vol qui a été à l'origine du groupe.
Comment oser parler de"solidarité", de "reconnaissance du milieu politique du prolétariat" quand le fondement n'existe pas? Le CBG a le toupet d'oser nous écrire : "L'existence de ce milieu engendre une communauté d'obligations et de responsabilités".
Mais cela se traduira en vol le jour où vous serez en désaccord avec le CBG et il justifiera le vol comme "anti-petit-bourgeois". Peut-être pourrions-nous le formuler ainsi : quand on scissionne, on peut voler ce qu'on veut, mais quand on a enfin un groupe à soi, enfin maître chez soi... 1!accession à la propriété assagit les petits voyous. Ou peut-être en ayant attiré vers eux de nouveaux camarades, les anciens espèrent-ils se cacher derrière. Changez de nom, changez de vie. Ce n'est pas sérieux. S'il y a des camarades un tant soit peu sincères dans le CBG, la moindre des choses serait qu'ils fassent un effort pour comprendre et agir en conséquence. On ne peut pas parler de reconnaître- l'existence du milieu politique dans un texte et faire le contraire dans les faits.
Quand El Oumami a scissionne du PCI en volant du matériel en France, nous avons montré une solidarité sur cette question primaire. Nous aurons à l'avenir la même attitude de défense du milieu politique prolétarien contre les attaques destructrices quel que soit le groupe concerné. Au moins dans le cas d'El Oumami, ce dernier avait-il des positions politiques gauchistes cohérentes avec ses actes. Mais qu'en est-il pour le CBG ?
Quelles sont les positions du CBG ? Celles (plus ou moins) du CCI ! Voila un autre groupe dont l'existence est parasitaire. Que représente-t-il face au prolétariat ? Une version provinciale de la plateforme du CCI avec la cohérence en moins et le vol en plus. Mais il y a sans doute une évolution dans l'air. La plupart des petits cercles qui scissionnent sans avoir préalablement clarifié les positions commencent par suivre le chemin de la facilité en adoptant la même plateforme que le groupe d'origine. Mais bientôt, pour justifier une existence séparée, on découvre maintes questions secondaires divergentes et à la fin on change les principes. Ce fut le cas du PIC (Pour une Intervention Communiste, aujourd'hui disparu), du GCI dans une certaine mesure, et le CBG prend déjà le même chemin en rejetant la cohérence sur la question de l'organisation. Cependant, cela ne nous a jamais empêchés de polémiquer avec ces autres groupes, ni de les considérer comme partie du milieu prolétarien en général, ni d'en inviter certains aux Conférences Internationales. Mais il n'en va pas de même pour le CBG. Un groupe politique qui ne respecte pas "la communauté des obligations et responsabilités" au point de participer aux actes visant à nuire à d'autres organisations du prolétariat, se met de lui-même en dehors du milieu politique et mérite l'ostracisme qu'il recueille. Jusqu'à ce que la question fondamentale de la défense des organisations politiques du prolétariat ne soit comprise, nous répondons par une fin de non-recevoir à la lettre du CBG. Ils se sont trompés d'adresse.
GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE (Belgique)
Le GCI nous écrit : "Nous sommes donc principiellement en accord avec la nécessité du regroupement, de la centralisation mondiale des forces communistes sur base du programme. Mais ceci signifie pour nous non pas le primat de la conscience sur 1'être (préalable des discussions et échanges d'idées), mais la nécessité d'une convergence réelle pratico-théorique comme base, comme ciment sur lequel les débats et polémiques peuvent et doivent se développer. C'est pourquoi, nous formulons de réelles propositions de travail et non les éternelles palabres en circuit fermé que ont, pour 1 'instant, vos réunions publiques :
1) Nous estimons qu'il est vital que le peu de groupes ouvriers développent ensemble des mesures et des pratiques élémentaires de sécurité et de solidarité afin d'opposer un front compact aux attaques de plus en plus virulentes de la répression étatique et para-étatique. Qu'en pensez-vous ?
2) Face à 1'importante vague de luttes que nous venons de connaître et au rôle de briseurs de grève qu'ont une fois de plus joué les syndicats, nous estimons qu'il est fondamental et opportun de développer une campagne de propagande, d'agitation, d'actions, centrées sur cette question : syndicats=briseurs de grève ; organisation autonome en dehors et contre eux ; solidarité avec les victimes de la répression, etc. Nous pensons que c'est sur ce terrain, et uniquement sur celui-là que se démontre la réelle volonté de lutte". (Lettre du GCI, 29/9/83).
Nous n'avons rien contre les actions communes s'il se présente des situations qui les requièrent. Sur la défense des organisations politiques du prolétariat, au moins, nous partageons le soucis du GCI et telle a toujours été notre pratique (la prise de position de la section du CCI en Belgique face aux calomnies d'Amada maoiste contre le GCI ; la position sur Chénier ; contre les attaques d'El Oumami à la Fête de LO en France). D'autres cas peuvent se présenter. Cependant, pour nous, l'efficacité de ce "type d'actions" ne relève pas d'une préparation contre la répression "en soi" (groupes de défense ? préparation militaire ?) ni de fronts sans principes pour la défense des victimes, mais d'accords de principe solides sur l'existence et la nécessité de la défense du milieu prolétarien. Ceci ne peut pas se faire "uniquement sur le terrain d'actions" mais en passant nécessairement par ce que le GCI voit comme les "éternelles palabres" -discussions et débats, prises de position publiques dans nos réunions, dans la presse, etc. Il en est de même pour la dénonciation des syndicats : pour nous, celle-ci ne se réduit pas à des bombages ou "campagnes de propagande". Nous ne connaissons que trop ce que sont les "campagnes" dont le PIC fut si friand pendant des années et qui ne font que cacher la confusion et l'incapacité d'un véritable travail révolutionnaire. La dénonciation des syndicats est un travail de longue haleine requérant un cadre permettant que l'intervention ne soit pas une agitation ponctuelle, mais s'intègre dans une activité constante de presse, tracts, grèves, manifestations, etc., et ceci au niveau international. Mettre en avant les "projets d'actions communes" comme base, c'est mettre l’activité révolutionaire sur la tête et la conduire au casse-gueule.
Il semblerait que le GCI tombe dans l'idée que l'agitation est le"seul terrain"de la confrontation. Une telle démarche introduit en permanence une séparation entre "théorie" et "action" qui mène en fait la théorie dans les ornières d'un académisme stérile, et d'autre part 1'"action" dans celles non moins stériles de l'activisme. Cette logique mènerait au bout du compte à priver la lutte de classe de son arme essentielle, la prise de conscience.
Le GCI nous accuse d'idéalisme, d'hégélianisme, de donner "le primat de la conscience sur 1'être". Dans la réponse de la section du CCI en Belgique à la lettre du GCI (Internationalisme, déc.83), nous avons écrit : "Tout comme un homme ne respire pas pour respirer, mais pour vivre, le CCI, s'il existe et discute, ce n'est pas pour discuter comme dans un salon de thé, mais pour dégager une intervention claire au sein des luttes. L'alternative n'est donc pas entre la théorie ou la pratique, mais la question est de savoir quelles interventions, sur quelles bases, sur quelles positions ?
Tout comme ce fut au nom du primat de 1’être sur la conscience que 1'IC fit passer sa politique de front unique, c'est au nom de ce même argument que le PCI interdisait toute discussion et intervention politique dans la lutte des immigrés, que le GCI a fait un foin autour de comités fantômes disparaissant aussi vite qu'ils étaient apparus (France) et a fait expulser de fait le CCI du comité de chômeurs de Bruxelles, car il fallait choisir entre 'coller une affiche ou discuter de la décadence',
Nous avons vu le résultat de toutes ces démarches : la faillite de 1'IC, 1'éclatement du PCI, la disparition de tous les comités du GCI, une scission dans ce même GCI... Cette logique qui veut à tout prix que 1'agitation soit le seul terrain de la confrontation mène à 1'apolitisme et à l'activisme". (Réponse d'Internationalisme).
Nous ne refusons pas des actions communes ; ajoutons même que le mouvement de grèves en Belgique en septembre 83 aurait requis de telles actions. Mais elles ne s'improvisent pas ; elles nécessitent une analyse et un accord politique commun qui passent nécessairement par ce que le GCI appelle des"éternelles palabres".
Si nous nous sommes attardés autant sur les implications de la démarche de la lettre du GCI, c'est parce que cette démarche n'est pas propre à ce groupe. Loin de là. Combien de fois n'entendons-nous pas des groupes dire: "de toute façon, chacun a ses positions ; personne ne va changer ; alors pourquoi parler?" Et dans la mesure où des groupes politiques ne cherchent pas à défendre leurs positions par des arguments rationnels et dans un cadre de principes, mais plutôt à se fuir et à s'ignorer les uns les autres, le milieu politique du prolétariat stagne effectivement. Alors, certains concluent, comme le GCI, qu'il faut se rapprocher par des "actions ponctuelles" (en ce sens, le bilan que nous promettent les éléments du GVC, ex-PIC, sera très intéressant sur ce point) ; d'autres,au contraire,veulent bien polémiquer, mais à condition qu'aucune prise de position commune ne ressorte ; c'était le cas dans les Conférences Internationales "muettes" (Voir Bévue Internationale n°17) . Et voila l'impasse.
BATTAGLIA CQMUNISTA (PARTI COMMUNISTE INTERNATIONALISTE, Italie)
Ce groupe, avec ses racines dans la Gauche Italienne, sa plateforme, est un groupe révolutionnaire qui représente un courant d'idées sérieux dans le milieu politique. Sa volonté de polémiquer, de confronter les positions politiques dans la presse et les réunions publiques est un fait indiscutable. Battaglia a participé à une réunion publique du CCI à Naples sur le thème "Crise du milieu révolutionnaire : comment répondre ?", en élaborant un document pour l'occasion. Ensuite, il a répondu à notre adresse par une lettre envoyée à tous les groupes qui ont participé aux Conférences Internationales.
Battaglia commence cette réponse en critiquant le CCI : "Nous refusons la conception du CCI relativement au camp révolutionnaire lui-même. C'est-à-dire, qu'il n 'est pas clair en ne distinguant pas camp révolutionnaire et camp des forces politiques prolétariennes". Si on entend par "organisations révolutionnaires" les groupes munis d'une plateforme politique cohérente, avec une structure organisationnelle et une intervention régulière et systématique dans la lutte de classe et si on entend par "milieu politique prolétarien" les groupes révolutionnaires, mais aussi des groupes sans plateforme, sans cohérence, sans racines historiques, qui, dans une mouvance générale, se réclament du prolétariat, nous pouvons être d'accord. Malgré des erreurs occasionnelles de vocabulaire, nous avons toujours défendu la nécessité de cette distinction. C'est pour cela que nous avons tant insisté auprès de Battaglia en 1977 pour que les Conférences Internationales se délimitent par des critères politiques clairs.
Malheureusement, Battaglia utilise cette distinction à sa manière : "Qui est en crise ? Certainement le CCI. Certainement le PCI. Certainement pas les forces (peu nombreuses) qui ont évalué la situation et les problèmes de 1'expérience polonaise, qui n'ont pas été victimes de positions mécanistes ou idéalistes, et qui ont en substance, de solides positions doctrinaires" (sic) ([1] [8]). "Ce n'est pas une crise du milieu révolutionnaire, mais un nettoyage? Du camp prolétarien". Merci pour lui. Alors quelles sont les organisations du vrai camp révolutionnaire ? Ta. CWC ? si on en juge par sa surestimation de la lutte de classe en Pologne (lorsqu'elle appelait les ouvriers à "la révolution maintenant !"), ce n'est pas elle non plus l'heureuse élue. Mais Battaglia se tait à ce sujet. Il reste... Battaglia ! Il faut croire que le triste aboutissement de la mélomanie du PCI-Proqramma n’a rien appris à Battaglia.
Mais attendez. Il veut bien réhabiliter la CWO. L'objectif de toute cette argumentation est de justifier l'élimination du CCI des Conférences Internationales. Les polémiques dans la presse, c'est pour le milieu "vaste et agité", mais les Conférences sont "pour le travail vers la formation du parti". Selon Battaglia, et la CWO, au fur et à mesure des trois Conférences, ils se sont aperçus que le CCI ne défend pas la même position qu'eux sur le Parti. Face à cette révélation, BC a "assumé la responsabilité qu'on est en droit d'attendre d'une force sérieuse dirigeante"(sic) en introduisant, sur cette question, un critère sélectif supplémentaire inacceptable par le CCI. Que BC et ses amis cessent de jouer la candeur surprise. Depuis toujours, depuis bien avant les Conférences en 1977, le CCI n'a jamais eu une position léniniste sur le Parti. Si c'est cela qui a empêché les Conférences de continuer, il ne fallait pas les commencer. Quant à "assumer sa responsabilité", nous citons un extrait de notre lettre de juin 1980 :
"Faut-il considérer que votre décision d'éliminer le CCI n'a été prise qu'au cours de la Conférence elle-même ? Si tel était le cas, on ne pourrait que rester pantois devant votre sous-estimation irresponsable de l'importance tant d'une telle décision que des Conférences elles-mêmes et devant votre démarche improvisée et précipitée qui tournerait complètement le dos aux exigences d'un travail patient et systématique qui est tellement indispensable aux révolutionnaires.
Mais, à la Conférence, vous avez affirmé qu'il ne s'agissait nullement d'une décision improvisée mais que vous aviez déjà évoqué ,dans le passé, la nécessité d'une 'sélection'. Faut-il vous rappeler, camarades, que lors de la réunion du comité technique de novembre 79, nous vous avons clairement interrogés sur vos intentions quant à l'avenir des conférences ainsi que sur votre apparente volonté d'écarter le CCI et que c'est tout aussi clairement que vous avez répondu être favorables à leur poursuite avec tous les participants y compris le CCI,
Si, effectivement, vous pensiez qu'il était temps, d'introduire un critère supplémentaire beaucoup plus sélectif pour la convocation de futures conférences, la seule attitude sérieuse, responsable et compatible avec le souci de clarté et discussion fraternelle qui doit animer les groupes révolutionnaires, aurait été de demander explicitement que cette question soit mise à l'ordre du jour de la Conférence et que des textes soient préparés sur cette question. Mais, à aucun moment au cours de la préparation de la 5ème Conférence, vous n'avez explicitement soulevé une telle question. Ce n'est qu'à la suite de tractations de coulisse avec la CWO que vous avez en fin de conférence lancé votre petite bombe." (Procès Verbal de la 3ème Conférence des Groupes de la Gauche Communiste, p. 2 de la lettre du CCI).
Et après avoir écarté le CCI, B.C et la CWO font une 4ème Conférence, point culminant de la décantation du "camp prolétarien" vers le "camp révolutionnaire", de la formation du Parti, avec le SUCM, ("Supporters étudiants du Mouvement de l'Unité Communiste"), un groupe qui est en voie de "former le Parti" en Iran avec le Komala qui pratique la lutte armée pour la libération du Kurdistan en alliance militaire avec le PDK (Parti Démocratique Kurde). Quel est ce groupe avec lequel B.C a "pris ses responsabilités" ? Selon les lettres que B.C a envoyées au SUCM en juillet et septembre 83, l'UCM "sous-estime le défaitisme révolutionnaire", et sa position de "défense des acquis de la révolution (islamique) n'exclut pas la participation à la guerre Iran/Irak". L'UCM défend les guerres "justes" et B.C fait la leçon à ses étudiants "supporters" sur comment comprendre la baisse du taux de profit sur trois pages de sa lettre. Bien sûr, B.C proteste contre le "social-chauvinisme" de l'UCM - mais si gentiment- et il chuchote au SUCM de ne pas, tout de même, aller jusqu'à la défense de l'Etat.
Au CCI, B.C écrit en parlant de notre "incapacité congénitale", notre "inconsistance théorique", que "seuls des militants incompétents et incurables" peuvent avoir nos idées. Au SUCM, il écrit par contre quelque chose dans le style : "Permettez-nous de vous dire, chers camarades, que l'organisation dont vous êtes les supporters pourrait être caractérisée par un net penchant stalinien (osons-nous le dire ! ) ". Que de douceurs pour nos frères "en évolution" du Tiers-Monde. Pour le CCI n'importe quelle grossièreté suffirait. La seule fois où B.C perd son calme, c'est quand il apprend que l'UCM a fait une réunion du "Comité International de Solidarité avec l'Iran"... "pour fêter la constitution d'un comité pour la construction du Parti Communiste de 1' Iran" une réunion en Italie avec le 'Nuclei', 'Lega Leninista’ et d'autres, mais sans B.C !
En réalité, le vrai problème de B.C et de la CWO (qui le suit fidèlement), ce n'est pas d'établir une distinction entre camp prolétarien et camp révolutionnaire, mais de ne pas voir la différence entre camp prolétarien et camp bourgeois. Au moins le SUCM semble-t-il plus clair ; il écrit à BC : "soit vous êtes avec le CCI, soit vous êtes avec nous".
Aujourd'hui, B.C semble vouloir faire un peu machine arrière sur le SUCM et il envoie à différentes organisations la correspondance qu'il a échangée récemment avec ce groupe. Mais dans sa lettre de réponse à l'Appel du CCI, il s'obstine à défendre sa démarche. Un pas en avant, deux pas en arrière.
Comment se fait-il qu'une organisation politique comme B.C avec toute son expérience ait pu se laisser entraîner dans un flirt avec le SUCM, un groupe de supporters des organisations bourgeoises, style stalinien ?
Il est vrai que les organisations politiques ne sont pas infaillibles. Mais il ne s'agit pas ici d'une erreur d'enthousiasme à propos d'un groupe inconnu. Depuis plus d'un an et en connaissance de cause, nous mettons BC et la CWD en garde contre le contenu bourgeois des positions politiques du SUCM. Aujourd'hui, la fusion en cours entre UCM/ Iran et Komala, les communiqués militaires que nous recevons du SUCM sur la lutte armée en Iran (combien de tanks détruits, combien de personnes tuées pour la libération du Kurdistan) ainsi que des documents et des tracts en langage stalinien ne laissent aucun doute (pour des militants qui ne seraient pas "incompétents ou incurables") à leur sujet. Le seul doute qui existe à propos du SUCM c'est de savoir exactement qui est derrière. B.C ne s'est jamais posé la question de savoir d'où venaient les fonds énormes dont dispose ce groupe de dissidents iraniens, capable de couvrir en un an et demi tous les pays principaux d'Europe avec sa propagande ? D'où vient son intérêt à pénétrer les petits groupes du milieu prolétarien actuel sans influence par rapport aux objectifs de Komala ? Le SUCM est un groupe très "fin" qui sait parler le langage de tout un chacun dans le milieu, qui sait flatter les flatteurs.
Il n'est pas, comme prétend toujours B.C, un "groupe en évolution". Comment un groupe venant du stalinisme, en alliance avec la bourgeoisie, peut-il "évoluer" vers le prolétariat ? Cette frontière de classe est infranchissable pour une organisation politique. A force de patauger dans cette boue, c'est B.C et la CWO qui vont évoluer vers la bourgeoisie. "Savoir faire une ligne de démarcation nette vis-à-vis des groupes infestés de social- patriotisme c'est le minimum que nous puissions exiger d'organisations du sérieux et de 1'importance de B.C et du CWO." (Rivoluzione Internazionale, n°33, nov.83)
BC s'est laissée prendre par le bout du nez parce que le SUCM, UCM et Komala parlent du parti, et BC et la CWO sont obnubilés par le mot "parti". Ils venaient d'écarter le CCI sous prétexte que nous serions "contre le parti" ; alors combien attirant était cet SUCM exotique "pour le parti". Que ce soit le parti bourgeois du nationalisme kurde n'est que secondaire.
B.C s’est trompe parce qu'il a un penchant (peut-on dire "congénital") pour les opérations opportunistes. D'après leur réponse à l'Adresse, B.C et la CWO "sont les seuls à faire ce travail vers le Tiers-monde". Si B.C avait réellement fait un travail vers le prolétariat du Tiers-monde, il aurait su être intransigeant dans la dénonciation du nationalisme, comme le CCI peut l'être dans son intervention par rapport aux "guérilleros" en Amérique latine et ailleurs. Toute cette argumentation de condescendance envers les militants du Tiers-monde (qui seraient pour ainsi dire tellement arriérés qu'il faut juger leurs positions avec 1'"indulgence" d'un Battaglia) n'est qu'une insulte aux communistes anti-nationalistes dans le Tiers-monde et un alibi pur et simple pour BC. Battaglia n'est pas plus clair sur le programme à suivre en Europe qu'ailleurs. Ce n'est pas une question de géographie et ne date pas de 1983. Dans la Revue Internationale n° 32, nous avons publié les documents du PCI d'Italie de 1945 quand Battaglia et Programma étaient ensemble dans le PCI. Leurs ambiguïtés par rapport aux partisans, des "forces en évolution" pendant la "libération" de l'Italie parlent d'elles-mêmes. Battaglia nous a répondu qu'il faut savoir se salir les mains. Eh bien, l'aventure avec le SUCM n'est pas étonnante.
Mais la principale raison qui détermine la politique oscillante de BC quant au milieu politique du prolétariat, la délimitation de ce milieu et les responsabilités de BC dans ce cadre, c'est l'insuffisance de sa plateforme criblée de questions "tactiques" sur le syndicalisme, l'électoralisme, la libération nationale.
Battaglia se vante de ses "solides positions doctrinaires". Mais où sont-elles ? Certainement pas dans la nouvelle édition de sa plateforme.
Par contre, il faut croire que le CCI hante son sommeil. Il n'a de cesse d'attribuer au CCI ses propres faiblesses. Selon BC, le CCI souffre de "questions ouvertes". Que veut-il dire par là exactement ? Tout ce que nous savons, c'est que la plateforme de BC n'a évidemment pas de "questions ouvertes" ; ce sont des trous béants qui ne permettent pas de distinguer les frontières de classe. Sur toutes les questions principales, y compris la question du parti, BC ne fait que reprendre et répéter les positions de la 3ème Internationale, y compris les erreurs en les aggravant par des formulations vagues et contradictoires.
Dans les positions du PCI-Battaglia, on ne trouve jamais un rejet franc, clair, des positions erronées de l'Internationale Communiste sur les questions nationale, syndicale et électorale, ni même un rejet des erreurs du PCI depuis 1943, mais seulement, à l'occasion, des atténuations dans les affirmations, et rien de plus. Lorsque BC affirme parfois le contraire de ces positions de l'IC, ce n'est que du bout des lèvres, et c'est enveloppé de tant d'ambiguïtés "diplomatiques", "tactiques", que tout reste fondamentalement la même chose. BC continue à se tortiller et à se plaire dans l'équivoque.
Marx constatait que l'histoire se répète, d'abord en tragédie, ensuite en farce.
Au début des années 20, la majorité centriste de l'Internationale Communiste, les Bolcheviks en tête, préfère éliminer la Gauche pour s'allier à la Droite (Indépendants en Allemagne, etc.). C'était une politique fatale, une tragédie pour le mouvement communiste.
En 1945, le P.C.I. d'Italie, nouvellement créé, préfère éliminer la G.C.F. (cf., l'article sur le 2ème Congrès du P.C.I. dans ce n° de la Revue), pour s'allier avec les rescapés de la participation volontaire dans la guerre impérialiste en Espagne-36, avec les rescapés de la participation au Comité Anti-fasciste de Bruxelles, avec les rescapés du flirt avec la Résistance et la Libération Nationale. C'était encore une tragédie pour le milieu communiste, mais tenant déjà de la farce jouée par des mégalomanes.
Aujourd'hui, on préfère saboter les Conférences Internationales, afin d'éliminer le courant communiste le plus intransigeant, pour chercher alliance avec l'U.C.M. et autres défenseurs des Libérations Nationales d'Iran et du Kurdistan, transfuges de 60 ans de stalinisme, et qu'on prend pour les pauvres "embryons du futur Parti Communiste" dans le Tiers Monde.
Cette fois, c'est la farce complète !
C'est d'autant plus une farce, que ce n'est pas l'unité massive du prolétariat qui, comme Lénine, préoccupe Battaglia, mais plus prosaïquement la défense de sa petite chapelle.
En cela, les "juniors" d'aujourd'hui ne se distinguent pas de leurs "seniors" de 1 945 : même démarche, mêmes positions. Peut-être un peu édulcorées, mais avec une bonne dose d'hypocrisie et de mauvaise foi en plus.
Si l'histoire se répète en farce, l'opportunisme reste, lui, toujours le même.
Le problème avec BC, c'est que sa réponse à l'Adresse, comme ses positions politiques, est insaisissable. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Contrairement au PCI-Programma qui est fermé à tout rapport avec d'autres organisations révolutionnaires, le PCI-Battaglia est plus ouvert vers l'extérieur avec des positions plus évoluées sur certains points. Mais si Programma a une cohérence dans ses erreurs, Battaglia a ses erreurs dans l'incohérence.
CQMMUNIST WORKERS ORGANISATION (Grande-Bretagne)
La CWO nous écrit dans sa lettre de septembre 83: "Nous sommes d'accord que la classe ouvrière et ses minorités se trouvent dans une situation difficile et dangereuse aujourd’hui mais quand vous parlez de crise dans le milieu révolutionnaire, ce n'est pas de la même crise dont nous parlons... C'est notre isolement en tant que communistes de la classe." (Lettre au CCI, septembre 83). Mais l'isolement comme tel ne provoque pas de crise. Pour la CWO, la perte des énergies militantes aujourd'hui est à mettre sur le même plan que dans le passé. Sommes-nous alors en pleine contre-révolution ?
La CWO considère que l'Adresse "est 1 'expression de la crise du CCI". Rejette-t-il donc la discussion ? Finalement non. "Bien qu'il ne soit pas possible de poursuivre des rapports entre nos deux tendances au niveau des Conférences Internationales, cela n'exclut pas le débat. " Ainsi, la CWO propose une réunion publique de confrontation des positions de la CWO et du CCI sur "la situation actuelle de la lutte de classe et la responsabilité des révolutionnaires". Nous avons accepté cette proposition tout à fait valable.
Mais dans sa lettre, la CWO fait part d'un certain nombre de reproches au CCI et nous profitons de cette réponse pour parler de certaines d'entre elles (parler de toutes serait au-dessus des forces d'un Hercule).
- Selon la lettre de la CWO, le CCI n'est pas "sérieux" parce que "la CWO a offert au CCI l'occasion de se solidariser avec l'intervention internationaliste (de la CWO) sur la guerre Iran-Irak, mais le CCI a refusé pour des raisons ridicules". (Pour notre réponse voir World Révolution n°59, avr.83).
La CWO refuse dans le cadre principiel des Conférences internationales, de prendre une position commune contre la guerre impérialiste et les tensions inter impérialistes parce que, selon la même lettre, ce n'était que des"positions communes vagues et sans signification à propos de banalités évidentes1.' Mais elle veut que le CCI cautionne ses ambiguïtés dangereuses par rapport au SUCM ? La CWO ne sort pas de tract pour chaque guerre locale dans le monde, mais juste pour Iran-Irak, et bien que le tract ait pu prendre position sur des "banalités", il s'est concrétisé par le rapprochement SUCM-CWO.
- De même, dans la réponse à l'Adresse, la GOnous reproche de ne pas l'inviter aux Congrès duCCI tandis qu'elle nous invite aux siens.
Pendant des années, nous avons invité BC et la CWO à nos différents Congrès et ils sont venus ainsi que des délégations d'autres groupes politiques. Mais après la rupture des Conférences Internationales, après avoir été écartés par les manoeuvres de BC et de la CWO, nous considérons qu'inviter ces groupes à nos réunions internes serait un non-sens. La CWO ne veut pas que le CCI assiste à des Conférences entre groupes, mais il veut venir à nos Congrès ? Elle nous rejette des Conférences, mais nous invite à ses Congrès ? A-t-elle une pensée logique ? Mesure-t-elle la portée de ses actes ? Dans l’article "Le soi-disant bordiguisme de la CWO" (RP n°20, 2ème Série) , la CWO ne veut pas parler d'elle. Elle préfère défendre son frère aîné Battaglia Comunista contre un sinistre complot : le CCI a appelé BC "bordiguiste". Si le mot vous gêne, camarades, retirez-le. Cela ne change rien au fond. La vérité, c'est que dans l'article comme dans sa lettre, la CWO est furieuse contre le CCI parce que nous avons publié les documents concernant l'opportunisme du PCI par rapport aux "partisans". En fait ces articles visaient surtout Programma, mais le chapeau brûle sur la tête de Battaglia et la CWO. Remarquez, ils ont raison. BC était entre 1945 et 1952 à la tête du PCI "uni". Mais, que répond la CWO : elle crie "maman" et tape du pied. "Mensonges !" Mais elle n'explique rien et justifie tout.
- Selon la CWO, "avant 1975, le CCI n'a jamais mentionné le peint", comme si on avait "caché" l'existence de BC à la CWO par peur que ces deux titans ne se rencontrent. Nous avons parlé de Battaglia, mais la CWO avait les oreilles bouchées à l'époque. Au début des années 70, ce groupe sortait du milieu libertaire et considérait la révolution russe comme une révolution bourgeoise, le parti bolchevik comme un parti bourgeois. Même quand, en fin, il a reconnu la révolution d'octobre et l'IC, ce n'était que du bout des lèvres. Pour la CWD, la contre-révolution aurait été définitive en 1921 (elle ne précisait pas si c'était en janvier ou en décembre), mais cela suffisait pour dénoncer le CCI comme "groupe contre-révolutionnaire" à cause de cette date fatidique de 1921. A l'époque, nous étions léninistes parce que nous parlions de Bilan, mais aujourd'hui, on nous taxe de conseillistes parce que la CWO a découvert Battaglia. Le CWO a connu tellement de zigzags dans sa vie qu'il n'est pas à un "zig" près. C'est parce que la CWO est née en ignorant tout de l'histoire du mouvement ouvrier, c'est parce qu'elle n'a jamais voulu suivre une vraie cohérence dans son attitude par rapport aux organisations politiques prolétariennes qu'elle en est réduite à des polémiques du style de RP n°20.
- Nous ne pouvons pas répondre à tout ici, mais nous voulons encore traiter un dernier point important : la CWO nous accuse dans RP n°20 de condamner son rapprochement avec BC. C'est faux. Nous sommes toujours pour le regroupement des organisations dès qu'elles se trouvent sur les mêmes positions politiques principielles. Nous n'aurions jamais condamné le regroupement de BC et de la CWO au sein des Conférences Internationales... Nous avons suivi le même chemin nous-mêmes avec la formation de notre section en Suède à la même époque. Nous sommes contre la perpétuation de petites chapelles. Si des groupes sont d'accord, qu'ils s'unissent. Cela ai de à la clarification des positions pour le prolétariat.
Nous allons encore plus loin : nous connaissons la CWO depuis longtemps et en comparant son rapprochement actuel avec BC aux mésalliances que ses réactions "anti-CCI" ont failli produire par le passé (avec le PIC, le Revolutionary Workers Group de Chicago, etc.), nous disons : très bien !
La question que nous posons à la CWD est la suivante : pourquoi maintenez-vous une existence séparée ? De deux choses l'une : soit vous êtes d'accord avec la plateforme de BC et alors ses ambiguïtés sur les questions électorale, syndicale et nationale sont les vôtres ; soit, vous n'êtes pas d'accord et alors où pont les textes de discussion entre vous.
La CWO veut attendre de voir si le CCI est "réellement sérieux", si son Adresse est "sincère". Notre Adresse exprime notre position de toujours sur la nécessité d'un dialogue dans le milieu politique du prolétariat. Depuis plus de quinze ans, nous n'avons pas varié d'un iota sur ce point. Nous ne sommes pas des caméléons comme la CWD qui change de couleur tous les deux trois ans. Si la CWO a la mémoire courte, nous nous chargerons de la lui rafraîchir.
PERSPECTIVES
Les groupes nous écrivent : vos suggestions sont vagues. Que voulez-vous au juste avec cette Adresse ?
Nous voulons appeler à un changement d'esprit dans le milieu politique de notre classe : la fin des prétentions et de l'arrogance dans l'isolement; la fin des faux-fuyants, de l'activisme dangereux, du flou artistique sur les principes.
D'abord sur le fond. Il faut cesser de faire de la question du parti un alibi. Il faut la discuter sérieusement sans anathèmes, et sans tourner en rond sur des formules creuses. Il faut répondre clairement sur des questions élémentaires pour que le débat puisse s'approfondir ensuite :
- la conscience de classe vient-elle de l'extérieur de la classe comme Lénine l'a écrit dans "Que faire ?" ?
- le parti de classe a-t-il été dans l'histoire ou sera-t-il demain l'unique creuset ou dépositaire de la conscience de classe ?
- est-ce le parti qui devra prendre le pouvoir ?
- le parti peut-il s'imposer à la classe par des rapports de force comme dans les événements de Kronstadt en 1921 ?
- que nous apportent comme critique, modification, élaboration sur la question du parti la révolution russe et l'expérience de la première vague révolutionnaire ainsi que la dégénérescence en Russie et de l'Internationale Communiste ?
Voila les questions de base auxquelles il faut _ apporter une réponse en poussant à fond la critique des erreurs ou insuffisances du passé et en profitant de l'ensemble de l'apport de la Gauche Communiste Internationale, sans exclusive "italienne", "allemande" ou autre.
Même Programma, après quarante ans de fermeture et de suffisance, est obligé aujourd'hui par les événements d'ouvrir un débat en son sein sur le parti, sa fonction et son organisation. Mais pourquoi seulement à l'intérieur ? Est-ce une maladie honteuse que la discussion politique avec le milieu que notre classe produit aujourd’hui canne elle l'a produit dans tous les moments importants de son histoire ? Est-ce que la confrontation des positions politiques est un luxe, une annexe à l'activité "normale", quelque chose qu'on fait si on a le temps, ou est-ce une nécessité, la seule façon de vérifier le bien-fondé de nos contributions politiques vitales pour les combats décisifs de notre classe ?
Il est indiscutable que l'absence des Conférences Internationales pèse aujourd'hui : pour répondre à l'accélération de l'histoire, pour aider à ce que les énergies militantes ne se perdent pas dans les convulsions du milieu politique, pour présenter un cadre principiel aux nouveaux éléments de la classe qui surgissent, pour orienter la clarification dans tous les pays, surtout dans les pays qui n'ont pas eu le temps de développer des traditions marxistes. Et il est aussi indiscutable que les Conférences Internationales se sont disloquées à cause du sectarisme dans le milieu : le PIC qui refusait le "dialogue de sourds", le FOR qui ne voulait pas "discuter la crise économique" et qui s'est retiré avec éclat de la 2ème Conférence, Programma qui n'y voyait qu'une empoignade entre "fouteurs" et "foutus", les actions de Battaglia et de la CWO que nous avons critiquées.
Créer ce nouvel esprit est la seule façon de rendre possibles à l'avenir de nouvelles Conférences, la seule façon d'assurer une décantation consciente dans le milieu, de travailler vers de nouveaux efforts de regroupement qui seront absolument nécessaires.
Car qui oserait prétendre que le milieu politique du prolétariat ne sera jamais rien d'autre que ce qu'il est aujourd'hui ?
JA
[1] [9] Dans Battaglia, la crise ne se traduit jamais clairement, franchement par des oppositions et confrontations de divergences politiques pour la simple raison qu'il n'y a pas de discussions ni de vie politique véritables dans l'organisation. On ne confronte pas, on vote simplement avec les pieds en quittant individuellement, silence et discrètement 1'organisation. C'est moins visible mais pas pour autant moins critique. Quant à se targuer d'avoir "en substance des solides positions doctrinaires", nous nous contenterons de renvoyer à la lecture/dans ce numéro de la Revue, de l'article sur le 2ème Congrès du PCI d'Italie de 1948. Cette lecture donnera l'exacte mesure de ces "solides positions doctrinaires" de Battaglia.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [10]
Le deuxième congres du parti communiste internationaliste (Internationalisme n°36, juillet 1948)
- 3201 lectures
Le texte d'Internationalisme n°36 (juillet 1948) publié ci-dessous est une critique des faiblesses politiques et organisationnelles du Parti Communiste Internationaliste à ses débuts. Nous avons déjà réédité à plusieurs reprises des articles polémiques d'Internationalisme contre le PCI (Voir les Revues Internationales n°32, 33, 34 notamment). Le texte ci-dessous, en passant en revue l'ensemble des positions du PCI à son 2ème Congrès, permet de donner une idée précise de ce qu'étaient les orientations de ce groupe. Les faiblesses critiquées à l'époque existent encore aujourd'hui -flou sur les questions nationale et syndicale, sur le rôle, la fonction et le fonctionnement de 1'organisation révolutionnaire, absence de perspectives claires sur la période, etc.- et n'ont fait que s'accentuer jusqu'à provoquer la dislocation quasi-totale du principal continuateur du PCI, Programme Communiste, 1'an dernier (Voir la Revue Internationale n°32). Elles ne sont pour autant pas les faiblesses du seul PCI-Programme Communiste et ces questions doivent être abordées par 1 'ensemble des groupes révolutionnaires. C'est pourquoi nous republions ce texte à 1'occasion de la discussion suscitée par 1' "Adresse aux groupes politiques prolétariens" (Revue Internationale n°35) que le CCI a lancée face à la crise et à la dispersion actuelles du milieu révolutionnaire (Voir l'article de réponse aux réponses à 'adresse dans ce numéro). L'avant-propos, extrait de la réédition précédente de ce texte, fait allusion à plusieurs textes : nous n'en republions ici qu'un seul ; les autres textes se trouvent dans le Bulletin d'Etudes et de Discussion de Révolution Internationale n°7, juin 1974.
AVANT-PROPOS
Les textes que nous publions plus loin sont des controverses souvent passionnés qui ont agité les extraits ([1] [11]) et des articles parus dans "Internationalisme", organe du groupe Gauche Communiste de France. Ces textes, qui datent de près de 30 ans, totalement inconnus pour la grande majorité des militants, présentent cependant un grand intérêt aujourd'hui encore.
La lutte révolutionnaire du prolétariat pour son un mouvement historique. Une fois surgies, on ne saurait concevoir les luttes comme un commencement nouveau telle que le prétendent tant de groupes qui viennent de surgir ([2] [12]) , mais seulement comme leur continuation et leur dépassement. L'histoire de la lutte révolutionnaire n'est pas une addition de moments morts mais tout un mouvement vivant qui se poursuit et se continue contenant en lui son"passé". Il ne saurait y avoir de dépassement sans contenir les acquis des expériences passées. En publiant ces écrits vieux de 30 ans, nous entendons contribuer à une meilleure connaissance d'une période particulièrement obscure et ignorée, celle qui suit la 2ème guerre mondiale, et les débats et controverse souvent passionné qui ont agité les faibles groupes révolutionnaires d'alors. Si la proche perspective est aujourd'hui tout autre qu'alors, les problèmes soulevés dans la discussion, leur compréhension et solution demeurent toujours au centre de la préoccupation des groupes et militants révolutionnaires d'aujourd'hui. Tels sont : les problèmes de l'analyse de la période historique que nous vivons, les guerres impérialistes, la nature et la fonction des syndicats, les mouvements dits de libération nationale, le parlementarisme, les problèmes de la révolution prolétarienne, les tâches des révolutionnaires, les rapports Parti Classe, et tout particulièrement celui du moment historique de la constitution du Parti
LA GAUCHE ITALIENNE : MYTHE ET REALITE
Le PCI (Programme Communiste) prétend être la continuation organique ininterrompue de la Gauche Italienne, continuation à la fois organisationnel et politique. C’est là un mythe. Seule l’ignorance de la plupart des propres membres du PCI et le silence prudent des autres lui donnent force et un semblant de vérité. Une fois exclue du PC, la Gauche Italienne se constitue en Fraction à l’étranger (Pantin 1929). Jusqu'en 43-45, la Fraction à l'étranger sera la seule organisation de la Gauche Italienne. En Italie même ne subsistera aucun groupe organisé et les anciens militants seront dispersés et réduits par la répression à une inactivité totale. Quand en 43-45 se constitue en Italie le PCI, cela se fait indépendamment de la Fraction et séparément d'elle - aussi bien sur le plan organisationnel que politique. Le PCI ne s'est d'ailleurs jamais réclamé comme continuité organique de la Fraction et est toujours ambigu quant à considérer la Fraction comme une expression et continuité de la Gauche Italienne. Il s'ensuit que la continuité organique tant réclamée a existé avec un trou d'interruption de près de 20 ans (et quels 20 ans !) , ou bien qu'elle n'a jamais existé et n'est qu'un mythe qu'elle entretient pour des raisons de convenance particulière et de mystification.
L'activité de la Fraction Italienne jusqu'à sa dissolution en 1945 constitue une très importante contribution au développement de la théorie communiste, de même que ses prises de position politiques face aux événements sont profondément enracinées sur le terrain de la classe révolutionnaire et c'est autour de la Fraction Italienne que vont se former des groupes en Belgique et en France pour constituer la Gauche Communiste Internationale.
Il est nécessaire de prendre connaissance des positions de la GCI, de lire leurs textes, et tout particulièrement la revue BILAN, même dans leur forme de "balbutiement" (comme ils le disaient eux-mêmes) pour se rendre compte et mesurer tout le recul et régression que représentent les positions politiques actuelles du PCI par rapport à la GCI.
LA CRISE ET LA FIN DE LA "GAUCHE COMMUNISTE INTERNATIONALE".
La GCI ne représente pas, en vérité, tout le courant de la Gauche Communiste issu de la 3ème Internationale, mais seulement une de ses branches ; les autres branches sont la Gauche Allemande, la Gauche Hollandaise et aussi la Gauche Anglaise. Mais elle se présente d'une façon plus homogène, plus organisée et dans une certaine mesure plus cohérente. Cela lui permettra de résister plus longtemps à la pression terrible qu'exercent sur les révolutionnaires les défaites successives du prolétariat, la dégénérescence de l'I.C, le triomphe de la contre-révolution stalinienne en Russie et l'ouverture d'un cours de réaction généralisée et enfin la guerre impérialiste. Subissant cette écrasante pression des événements, la GCI s'efforce de dégager les enseignements, afin qu'ils puissent servir de matériaux programmatiques pour et dans la reprise de la lutte de classe du prolétariat. Un tel travail pour si grand qu'ait été l'effort et le mérite de la GCI, n'allait pas sans défaillances et vacillations.
Dans une période générale de recul, chaque nouvel événement devait produire une nouvelle réduction numérique de l'organisation, et provoquer de graves perturbations politiques. Aucun groupe révolutionnaire ne peut prétendre être à l'abri et présenter une garantie à l'influence pernicieuse des événements. Pas plus que d'autres, la GCI n'y a échappé. La guerre d'Espagne a été une première secousse, provoquant discussion et scission, l'approche et l'éclatement de la seconde guerre mondiale a profondément ébranlé la GCI, provoquant des divergences gui allèrent se creusant, ouvrant une crise profonde en son sein. Les textes que nous publions ci-dessous donnent une idée assez exacte des divergences qui opposaient les tendances, et qui devaient aboutir à la dissolution des Fractions et leur absorption par le nouveau Parti créé en Italie d'une part, et au surgissement de la Gauche Communiste de France et sa séparation d'avec la GCI d'autre part.
LA DISSOLUTION DES FRACTIONS.
Les deux premiers textes portent essentiellement sur la question de la dissolution de la Fraction Italienne. C'est alors une question centrale, non seulement parce que la dissolution signifiait un arrêt brusque de clarification nécessaire des problèmes débattus mais aussi parce que cela constituait un abandon de positions défendues de façon acharnée par la Fraction durant toute son existence, et touchant à la conception même du Parti et impliquant une analyse fausse de la période et de la perspective.
L'existence du Parti est étroitement liée et conditionnée par la période et l'état de la lutte de classe du prolétariat. Autant dans une période de développement des luttes la classe sécrète en son sein l'organisation politique : le Parti ([3] [13]) organe de mobilisation politique de la classe, autant les défaites décisives ouvrant une longue période de recul entraînent inévitablement la disparition ou la dégénérescence du Parti. Dans de telles périodes, quand la contre-révolution a eu raison de la classe et de ses organisations, vouloir reconstituer le Parti à nouveau relève d'une conception volontariste et mène à l'aventurisme et au pire opportunisme. C'est contre une telle conception volontariste de construction artificielle, préconisée par Trotski que la Gauche Communiste a livré, dans les années 30, les plus violentes batailles.
La proclamation du PCI en Italie s'est faite sans s'embarrasser d'aucune analyse du moment ni de la perspective. Tout comme les trotskystes, cela fut un acte de pur volontarisme. Mais plus fondamental encore est le fait que la constitution du nouveau Parti, le PCI d'Italie, s'est faite sans aucun lien ni organisationnel, ni politique, avec la Fraction Italienne de la Gauche Communiste. La Fraction est cet organisme révolutionnaire vivant qui surgit et subsiste une fois que l'ancien Parti a été happé dans l'engrenage de la contre-révolution et détruit comme organisation de classe.
La Fraction ne saurait "se dissoudre" pour renter ensuite et individuellement dans un Parti, constitué à part et indépendamment d'elle. Ceci est par définition impossible et politiquement inconcevable. La dissolution de la Fraction Italienne et l'entrée de ses membres dans le PC d'Italie, formé hors et indépendamment d'elle, constituaient le pire liquidationnisme et un suicide politique. On comprend que la GCF se soit catégoriquement refusée à s'associer à une telle politique et qu'elle l'ait critiquée violemment.
La continuité organique de la Fraction n'existe pas aujourd'hui. Elle a été coupée, interrompue par cinquante ans de réaction. Cependant, la question de la dissolution garde tout son intérêt pour les révolutionnaires qui surgissent aujourd'hui. Ces groupes sont le produit et l'expression de la nouvelle période que nous vivons de reprise de luttes de classe. Ils sont donc les noyaux du futur Parti. Ce futur Parti ne sera pas un surgissement spontané du néant mais bien le résultat du développement et de l'accentuation de la lutte de classe et de l'oeuvre de groupes révolutionnaires existants. On ne saurait parler de la dissolution de ces groupes précédant un hypothétique Parti, sorti on ne sait trop d'où. Une telle vision enlève toute signification et toute valeur à l'activité de ces groupes. Au contraire, on doit voir dans l'existence et l'activité de ces groupes les matériaux avec lesquels se construira le futur Parti. Leur dissolution et la constitution du Parti ne sont pas des actes séparés dans le temps mais un acte simultané. On peut, avec plus de raisons, parler de leur transformation en Parti que de leur "dissolution" parce qu'ils sont des éléments constitutifs du futur Parti. Loin d'être prétention et auto flatterie, cette vision donne le sens et la gravité de la responsabilité que portent les groupes et leur activité, et qu'ils doivent savoir assumer pleinement. Toute autre vision est bavardage et dilettantisme.
Le PCI prétend à une continuité invariante de son programme et de ses positions. Sa pratique politique serait irréprochable et est donnée en exemple de pureté révolutionnaire. La lecture des textes que nous publions fait table rase de cette légende. C'est avec surprise et étonnement que beaucoup de lecteurs apprendront la véritable histoire et la somme de confusions et d'erreurs sur lesquelles se constitue le PCI. De la proclamation du Parti à l'analyse de la période de l'après-guerre, des élucubrations sur l'économie de guerre à la participation au Comité anti-fasciste à Bruxelles, de la participation aux élections à la prise de position sur la question des syndicats, tout annonce un éclectisme et un opportunisme politique. Cela donne toute la mesure qui sépare le PCI de la Fraction et l'énorme régression du premier par rapport à la seconde. C'est avec intérêt qu'on lira les critiques acerbes qu'en fait INTERNATIONALISME. On doit constater que ces critiques se sont avérées pleinement justifiées et restent valables aussi aujourd'hui en face des erreurs invariables du PCI.
Juan.
LE DEUXIEME CONGRES DU P.C.I. EN ITALIE (1948)
Sur la base de divers compte-rendus, écrits et oraux, on peut se faire une idée assez précise de ce qu'a été le Congrès du PCI d'Italie,
Nous avons d'abord celui publié dans notre dernier Internationalisme, qui donne une idée assez complète des débats du Congrès.
Dans la Battaglia Communista) organe du PCI d'Italie et dans Internationalisme, organe de la fraction belge, nous trouvons des articles traitant des travaux du Congrès.
Enfin la réunion publique organisée par la fraction française.
L'impression générale qui se dégage est comme l'a écrit le camarade Bernard en tête de son article, que cela " aurait pu ne pas être un Congrès car les problèmes traités l'ont été d'une manière plutôt étriquée ".
Pour s'en convaincre, il suffit de lire la presse du PCI d'Italie, et de ses sections en Belgique et en France. Le délégué de France a dit dans son compte-rendu oral :"Le Congrès n'a traité d'aucun des problèmes fondamentaux n'a fait aucune analyse poussée de l'évolution actuelle du capitalisme et de ses perspectives. De tout son ordre du jour, il n'a discuté que les possibilités d'action du parti dans la situation présente"
De son côté, la fraction belge, dans son dernier bulletin, consacre au Congrès un article d'une petite page ronéotypée dans lequel elle se contente de donner "résumées grosso modo les deux tendances qui se révélèrent au Congrès" et de conclure que celui-ci a décidé "d'entreprendre une discussion approfondie sur l'analyse du capitalisme dans son stade actuel".
Que nous sommes loin des fanfaronnades qui accompagnèrent la formation du Parti en 1945, des salutations enthousiastes et grandiloquentes sur la " reconstruction du premier Parti de classe dans le monde par le prolétariat italien", et de tout le bluff qui a continué pendant deux années autour de l1 activité et des succès de masses de ce Parti.
Aujourd'hui, le résultat de trois années d'activisme a ramené les camarades à plus de modestie et à des réflexions plutôt amères malgré certains jeunes néophytes comme la déléguée française qui ne peut terminer son compte-rendu sans finir, comme c'est la tradition en Russie, par cette phrase : " Et nous disons merci au PCI d'Italie".
LE RECRUTEMENT: OBJECTIF NUMERO UN DU PARTI
Pendant la première période, le Parti s'est laissé griser par son recrutement. A ce recrutement il a sacrifié la clarté des positions politiques, évitant de pousser trop à fond les problèmes pour ne pas "gêner"la campagne de recrutement et ne pas "troubler" les adhérents déjà acquis. Farouchement et catégoriquement il a tenu a ne pas porter, ni devant les ouvriers ni devant les membres du Parti ni devant la Conférence constitutive de fin 1945, la discussion sur la lamentable expérience de la participation d'une de ses sections et des camarades, futurs dirigeants du Parti, au Comité de Coalition Antifasciste italien de Bruxelles. Expérience qui a duré depuis la libération jusqu'à la fin de la guerre et que ces camarades continuèrent à revendiquer comme politique juste et révolutionnaire. Toujours pour ne pas "gêner" le recrutement et peut-être aussi parce qu'on a soi-même partagé cette conception (ce qui serait plus grave), on flatte les ouvriers qui faisaient partie de ces organismes militaires qu'étaient les diverses formations armées de la Résistance. A leur sujet, la plateforme du Parti adoptée à 3a Conférence de 1945 dit :
" En ce qui concerne la lutte partisane et patriotique contre les allemands et les fascistes, le Parti dénonce la manoeuvre de la bourgeoisie internationale et nationale qui avec sa propagande pour la renaissance d'un militarisme d'Etat officiel (propagande qu'elle sait vide de sens) vise à dissoudre et à liquider les organisations volontaires de cette lutte qui dans beaucoup de pays ont déjà été attaquées par la répression armée".
Et tout en mettant en garde contre les illusions suscitées par ces organisations parmi les ouvriers, la plateforme les caractérise ainsi : " ces mouvements qui n'ont pas une organisation politique suffisante (à part d'être "partisane et patriotique", que fallait-il donc de plus au PCI ?) expriment tout au plus la tendance des groupes prolétariens locaux à s 'organiser et à s 'armer pour conquérir et conserver le contrôle des situations locales et donc du pouvoir".
Ainsi, pour ne pas risquer sa popularité et les possibilités de son recrutement, le parti s'est gardé de les dénoncer pour ce qu'elles étaient réellement, et pour le rôle qu'elles jouaient, et a préféré flatter les ouvriers de "ces tendances qui constituent un fait historique de premier ordre".
Tout aussi bien que sur cette question, le PCI n'a pas eu le souci de pousser plus à fond l'analyse de l'évolution du capitalisme moderne.
Nous trouvons, bien sûr, et même très couramment, l'affirmation que le capitalisme évolue vers une forme nouvelle, le capitalisme d'Etat, mais le Parti n'avait pas pour autant une idée précise de ce qu'est exactement le capitalisme d'Etat, ce que cela signifie historiquement et de ce que cela comporte comme transformations profondes des structures du système capitaliste.
Dans le § 14 où est traité le problème du capitalisme d'Etat, la plateforme parle de "ré accumulation des richesses entre les mains des entrepreneurs et des bureaucrates d'Etat qui ont leurs intérêts liés à ces derniers ". N'ayant vu dans le capitalisme d'Etat que l'unité de classe des Etats avec les entrepreneurs privés face au prolétariat, mais n'ayant pas vu ce qui les oppose et distingue les premiers des seconds, la plateforme dénonce "des mots d'ordre ineptes de socialisation des monopoles qui ne servent qu'à travestir ce renforcement". Dans les nationalisations qui sont la structure économique du capitalisme d'Etat, la plateforme ne voit rien d'autre qu'une manoeuvre "des puissants monopoles industriels et bancaires "qui" feront payer à la collectivité le passif de la reconstruction de leurs entreprises".
Avec une telle analyse du capitalisme moderne et de ses tendances, qui n'allait pas plus loin que celle déjà énoncée en 1920, il était normal qu'on reprenne sur le plan de la politique, sans rien changer, les positions essentielles de la IIIème Internationale d'il y a 25 ans : le parlementarisme révolutionnaire et la politique syndicale.
Quels en étaient les résultats ? Après près de trois ans, le Parti enregistre la perte de la moitié de ses adhérents. Des groupes entiers de militants se sont détachés, les uns. pour former le groupe trotskyste POI, les autres la Fédération autonome de Turin, la majorité dans l'indifférence et le dégoût de toute activité militante.
Nous avons, en somme, la reproduction de ce qui s'est passé pour les partis trotskystes dans les autres pays. Le Parti n'a pas renforcé ses positions parmi les ouvriers. La fuite de la recherche théorique, l'imprécision et l'équivoque de ses positions ne lui ont pas davantage gardé ses militants. Dans son objectif numéro un qui était de recruter à tout prix, le renforcement numérique, le Parti enregistre aujourd'hui un fiasco, un échec cuisant qu'il n'était pas difficile de prévoir et de lui prédire.
UN PARTI SANS CADRES
Mais il y a encore une chose plus grave que la défection de la moitié des membres, c'est le niveau idéologique extrêmement bas des militants restant dans le Parti. Bernard nous parle de la " fonction scénique" de la majorité des délégués au Congrès, de leur non-participation aux débats. Frédéric disait que les délégués ouvriers estimaient que les analyses théoriques générales les dépassaient et ne pouvaient être leur fait, que ce travail incombe aux intellectuels.
Vercesi exprime cette vérité : " Pour courir derrière des chimères, le travail d'éducation des militants qui est dans un état déplorable a été négligé ". Encore que Vercesi porte une bonne part de responsabilité pour cet état déplorable auquel il a contribué pendant trois années par son refus de porter publiquement la discussion, de crainte de "troubler" les militants.
C'est le trait typique de toutes ces formations artificielles qui se proclament pompeusement partis, de ne pas comprendre que le fondement subjectif du nouveau parti ne se trouve pas dans le volontarisme mais dans l'assimilation véritable par les militants de l'expérience passée et dans la solution des problèmes contre lesquels l'ancien parti s'est heurté et s'est brisé. Avoir voulu agir sur la base de la répétition d'anciennes formules et positions, fussent-elles celles des Thèses de Rome, sans tenir compte des changements fondamentaux apportés par les 25 dernières années, c'était accrocher l'action dans le vide, user en vain les énergies et gaspiller des forces et un temps précieux qui devait et pouvait utilement servir à la formation des cadres pour le parti et la lutte à venir.
L'absence des cadres et la négligence de leur formation, voilà le plus clair du bilan révélé par le Congrès du PCI.
EXISTE-T-IL UN PARTI EN ITALIE?
Numériquement très réduit par la perte de la moitié de ses membres, absence de cadres, "manque complet d'une analyse de l'évolution du capitalisme moderne"(Vercesi), voilà pour ce qui est des conditions subjectives. Quant aux conditions objectives, période de concentration du capitalisme qui " a été conditionnée par la défaite internationale que le prolétariat a subie et par la destruction de celui-ci comme classe ". (Document de la CE à la suite du Congrès. Voir "Nos directives de marche" dans la Battaglia Communista du 3/10 juillet). Que reste-t-il donc des conditions nécessaires justifiant la construction du Parti ? Rien, strictement rien, sinon le volontarisme et le bluff, familiers aux trotskystes.
Au Congrès, le rapporteur Damen a essayé de justifier la proclamation du Parti. Nous laissons de coté l'argument qui veut que les ouvriers italiens soient "politiquement plus sains"'que ceux des autres pays. De tels arguments ne montrent rien d'autre que la persistance des sentiments nationalistes même chez des militants très avancés. L'ouverture d'un cours révolutionnaire ne peut que se faire à l'échelle internationale, de même la brisure avec l'idéologie capitaliste ne peut être une manifestation isolée du prolétariat révolutionnaire d'Italie en or d'un seul pays. Le patriotisme du prolétariat révolutionnaire d'Italie n'a pas plus de valeur que le patriotisme du socialisme en un seul pays. Cet argument donc mis à part, Damen justifie la proclamation du Parti par le fait qu'une fraction n'aurait pu servir de pôle d'attraction pour les ouvriers^ ce qui est vrai pour une période où les conditions pour la polarisation du prolétariat autour d'un programme révolutionnaire sont présentes, mais qui n'est absolument pas le cas en Italie, ni nulle part ailleurs.
Finalement, Damen énonce que la fraction n'a de raison d'être que tant qu'il s'agit "d'opposition et de résistance idéologique à 1'opportunisme dans le Parti jusqu'au moment de la lutte ouverte qui ne peut être menée que par un organisme politique qui ait les caractéristiques et les tâches du Parti?
Le même thème, nous l'avons entendu développé dans la réunion de la FFGC. Que de chemin à rebours parcouru depuis le Congrès de la Fraction Italienne de 1935 ! C'est là un argument type du trostkysme qui, pendant les années d'avant-guerre soutenait contre nous la thèse qu'avec la mort de l'ancien Parti, la condition est donnée pour la proclamation du nouveau Parti. Alors que c'est le contraire qui est vrai, la mort de ' l'ancien Parti ou son passage à l'ennemi de classe signifiant précisément l'absence de conditions pour l'existence du parti révolutionnaire. Ce Parti étant conditionné par une orientation révolutionnaire se manifestant dans le prolétariat.
Quand les camarades Vercesi et Daniels, au Congrès, nient que le PCI puisse réellement jouer un rôle de Parti, ils ne font que reprendre la thèse que nous avons développée depuis 1945 sur l'absence de conditions de constitution du Parti, et du même coup, ils reconnaissent implicitement que le PCI ne remplit pas davantage les tâches d'une fraction, c'est-à-dire l'élaboration programmatique et la formation de cadres. Nous n'avons ici rien d'autre que la traduction en italien des artifices et du comportement des trotskystes dans les autres pays.
Pour Damen, le Parti est un fait, "un coin enfoncé dans la crise du capitalisme". Si cela peut le consoler, nous lui apprendrons toutefois que les trotskystes ne voient pas différemment leur parti dans les autres pays.
Pour Vercesi n'existent ni le "coin enfoncé", ni "la brisure, même minime du capitalisme", ni le parti qui n'est qu'une fraction élargie.
Malheureusement dirons-nous, il n'existe en Italie ni parti, ni fraction élargie, ni influence sur les masses, ni formation de cadres. L'activité menée par le PCI tendant à compromettre l'immédiat de l'un et l'avenir de l'autre.
LA VERIFICATION DES PERSPECTIVES
Une orientation vers la fondation du parti pouvait avoir sa raison d'être dans la période de 1943 à 1945 qui s'ouvrait avec les événements de juillet 43 en Italie, la chute de Mussolini, le mécontentement grandissant en Allemagne, et qui permettait aux militants révolutionnaires d1 espérer un développement d'un cours de brisure avec la guerre impérialiste et la transformation de celle-ci en un vaste mouvement de crise sociale. L'erreur fondamentale des militants du PCI et surtout de ses sections en France et en Belgique fut de persister dans cette perspective après la fin des hostilités alors que les impérialismes russe et américain sont parvenus à occuper l'Allemagne, à disperser à travers le monde et à encadrer dans les camps de prisonniers les millions d'ouvriers allemands, en un mot à contrôler ce foyer capital de révolte et centre de la révolution européenne.
Mais loin de comprendre que la cessation de la guerre sans mouvement de révolte signifiait une défaite consommée par le prolétariat, une nouvelle période de recul ouvrant avec elle le cours vers la nouvelle guerre impérialiste, la GCI, au contraire, échafaudait des théories sur l'ouverture d'un cours de luttes de classes, voyait dans la fin de la guerre la condition de la reprise des luttes révolutionnaires où comme elle l'écrivait en corrigeant Lénine " la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile commence après la fin de la guerre".
Toute l'orientation de la GCI était basée sur cette perspective, et tous les événements étaient examinés sous cet angle. Ainsi, on prenait les événements sanglants d'Algérie, de Grèce, du Proche-Orient pour des prémisses de la crise révolutionnaire, on saluait les grèves économiques comme les mouvements de radicalisation des masses, on soutenait à fond le mouvement et l'action syndicale dont on se donnait pour tâche de conquérir la direction, enfin on préconisait comme tâche immédiate la construction dans tous les pays du Parti de classe. En même temps on se faisait des gorges chaudes, on raillait ces "pessimistes" que nous étions, ces "docteurs et théoriciens en chambre" pour qui on affichait un hautain mépris.
Aujourd'hui toute cette perspective est par terre. Et Vercesi est absolument dans le vrai, et ne fait que reprendre la critique que nous formulions contre le PCI quand il déclare : "L’interprétation que la guerre aurait ouvert un cycle révolutionnaire s’est révélée complètement fausse"'.
Si l'activité révolutionnaire n'a de valeur que pour autant qu'elle est fondée sur des précisions basées sur une analyse exacte de la situation et du cours, la reconnaissance par le Congrès du non fondé de la perspective signifie la condamnation implicite et l'écroulement de toute la politique et l'activité passée du Parti, basée sur cette perspective.
Toutefois, nous devons mettre en garde contre l'orientation exprimée par la tendance Vercesi postulant son analyse sur les "capacités de renaissance de l’économie capitaliste au travers du système de planification, de la disparition de crises cycliques et de la concurrence à l’intérieur des Etats". Cette conception n'est pas nouvelle; elle se rattache à la vieille théorie de renforcement économique du capitalisme, théorie dite de l'économie de guerre, et que nous avons à maintes reprises, avant et pendant la guerre, eu l'occasion d'analyser et de combattre.
Aujourd'hui, un nombre croissant de militants du PCI a ressenti et compris la stérilité d'un activisme en l'absence d'une analyse de la situation. Bien que cela vienne avec un retard de trois années, nous considérons ce fait comme le seul résultat positif qui s'est manifesté dans le Congrès. Nous souscrivons entièrement à l'idée de Daniels quand il déclare : " Les armes que possède le mouvement sont vieilles de 25 ans et toutes émoussées. Le capitalisme a transformé entre temps toute sa structure et toutes ses méthodes de lutte; le Parti de classe doit en faire autant s1il veut être un jour le guide de la classe ouvrière, et en préparer le réveil".
LA VIE INTERIEURE DU PARTI DISCIPLINE OU CONSCIENCE DES MILITANTS
Nous avons à plusieurs reprises, critiqué la tendance à la bureaucratisation dans le PCI d'Italie. Faisant allusion à cette critique, la déléguée française, dans son compte-rendu, de répliquer : "assistaient au Congrès et à ses débats souvent passionné pouvaient se rendre compte de la démocratie qui règne dans le Parti, et de la gratuité de l1accusation de bureaucratisation".
On pourrait avec autant de raison citer en exemple les assises des partis trotskystes et même des partis socialistes. Là aussi, on discute " librement" et passionnément. Ce qui importe n'est pas la plus ou moins grande démocratie dans les Congrès, mais de savoir sur quoi est basée l'activité des militants, sur la trique de la "discipline librement consentie" ou sur la conviction des positions et la plus grande conscience des militants ? La camarade citait le cas où le PCI excluait des militants pour divergences politique, et elle ajoutait : "comme tout Parti qui se respecte". En effet, le nombre des exclusions prononcées par le PCI est frappant, mais il faut ajouter qu'au grand jamais ces exclusions ne sont faites après les discussions dans l'ensemble du Parti, seule méthode qui aurait permis à ces crises d'être un moment de clarification des idées pour tous les militants, mais sont toujours prononcées par la direction.
Le Congrès a, par exemple, révélé l'existence de divergences profondes dans le Parti, mais en vain cherchera-t-on dans la presse du Parti et cela même dans les semaines précédent le Congrès la moindre discussion et controverse. Cela aurait évidemment risqué de troubler les membres, et porter atteinte au prestige et partant, à la discipline. On préfère non moins évidemment venir au Congrès pour constater, comme Vercesi : " II y a des délégués parlementaristes, d'autres favorables à une espèce de compromis avec le centrisme (stalinisme). La majorité est sans idées claires et suit des voies différentes selon les zones".
Plus catégorique et plus cinglant encore est Daniels, parlant pour ce qui concerne le Congrès lui-même. Il constate : " Il y a une tendance au Congrès à passer sous silence les erreurs du passé et à renoncer à discuter les problèmes qui peuvent provoquer d'amples débats, au travers desquels le Parti pourrait vraiment renaître à une vie nouvelle et mettre à nu tout ce qui, sous l'excuse de la défense des positions traditionnelles, cache d'opportunisme et empêche une claire élaboration idéologique et une conséquente assimilation de la part des militants".
C'est ainsi qu'on doit comprendre la vie intérieure saine de l'organisation et fonder la force, l'efficacité de l'activité de chacun des membres sur la continuelle et plus ample confrontation des idées, suscitée et entretenue par toute la vie du Parti.
Par contre, quand Maffi, grand chef du Parti, déclare s'être "abstenu de traiter tel problème" parce que " je savais que cette discussion aurait pu empoisonner le Parti", nous disons que ce souci manifeste incontestablement et au plus haut point la tendance à l'ossification et à la bureaucratisation de la vie intérieure de l'organisation.
Et c'est parce que c'est cette dernière conception qui prévaut dans le PCI que nous avons pu assister à cette fin absurde du Congrès dont nous parle Bernard, où "Vercesi s'est en quelque sorte excusé d'avoir été un trouble-fête et d'avoir amené le trouble parmi les militants". 'Parce que, en fin de compte, les uns pas plus que les autres n'admettent l'existence des tendances et des fractions au sein du Parti : pour les uns comme pour les autres, le Parti reste une organisation monolithique, homogène et monopoliste
LA QUESTION DE LA PARTICIPATION AUX ELECTIONS
Une des questions qui a provoqué les débats les plus orageux fut celle de la participation aux élections. Bien sur, personne ne préconise une politique de parlementarisme actif. Cela ressort moins d'une certitude de l'inutilité de l'action parlementaire que du fait que les forces présentes du Parti ne lui donnent aucune possibilité d'avoir réellement des élus. Aussi peut-on se permettre d'économiser un débat qui, de toute façon, ne serait que théorique, et comme tout débat théorique ne peut que "troubler inutilement le Parti". C'est pour la même raison que le Parti aux dernières élections pouvait se payer à bon marché d'être révolutionnaire à l'extrême, au point d'inviter les électeurs à ne pas voter, même pour lui. Mais nous connaissons déjà le cas d'un élu au conseil municipal qui a finalement trouvé de bonnes raisons pour garder son mandat d'élu. Après tout, la justification définitive de tout parlementarisme se trouve dans ces arguments théoriques donnés par Damen, pour justifier la participation du PCI à la campagne électorale. Damen dit : " Si la bourgeoisie est contrainte (?) d'adopter un moyen de lutte qui peut être exploité utilement par le parti de classe pour être retourné contre elle, l'avant-garde révolutionnaire ne peut renoncer à l'utiliser et à s'infiltrer dans la composition électorale".
Aucun trotskyste ne manquerait de souscrire à cette argumentation. C'est du pur et du pire Lénine de la Maladie Infantile du Communisme. La vérité est que le prolétariat ne peut utiliser pour sa lutte émancipatrice « le moyen de lutte politique» propre à la bourgeoisie et destinée à son asservissement. Il en était tout autrement à une période antérieure d'avant 1914 quand le prolétariat ne pouvait pas encore poser comme objectif concret immédiat, la transformation révolutionnaire de la société, d'où découlait la nécessité de lutter sur le terrain même du capitalisme pour lui arracher le maximum de réformes. Le parlementarisme révolutionnaire en tant qu'activité réelle n'a, en fait, jamais existé pour la simple raison que l'action révolutionnaire du prolétariat quand elle se présente à lui, suppose sa mobilisation de classe sur un plan extra-capitaliste, et non la prise des positions à l'intérieur de la société capitaliste, ce que Damen a appelle " l'utilisation" et " l'infiltration" intérieure.
La politique du parlementarisme révolutionnaire a largement contribué à corrompre les partis de la IIIème Internationale, et les fractions parlementaires ont servi de forteresses de l'opportunisme, aussi bien dans les partis de la IIIème qu'autrefois dans les partis de la IIème Internationale. Mais le participationniste croit avoir trouvé un argument impressionnant en déclarant : "Le problème abstentionniste est désormais dépassé, car il n'avait de raison d'être que dans une période ou une précision de principe, face au courant parlementaire du vieux parti socialiste, était nécessaire. Aujourd'hui où il n'y a plus de doute possible sur le caractère nettement antiparlementaire du PCI, celui-ci peut adopter cette méthode de lutte". Voilà un raisonnement pour le moins astucieux : dans le vieux parti parlementaire nous devions être antiparlementaires mais maintenant, puisque notre parti est antiparlementaire, alors nous pouvons faire du parlementarisme. Nous ne doutons pas que cette argumentation puisse impressionner les patriotes du parti qui, pas un instant, n'osent mettre en doute son infaillibilité révolutionnaire, garantie a priori et à jamais.
Ceux par contre, qui ont connu l'IC pour y avoir milité ou simplement pour avoir étudié son histoire, seront probablement moins enclins à ouvrir un tel crédit à n'importe quel parti, fût-il même le Parti de Damen et de Maffi.
Croit-on vraiment que le Parti Bolchevik et l'IC dans ses premières années, étaient moins sincèrement révolutionnaires que le PCI d'Italie ? Ils offraient au moins autant de garantie, ne serait-ce que par le fait qu'ils exprimaient les positions programmatiques les plus avancées du prolétariat de l'époque alors que le PCI d'Italie, d'après ses propres aveux, retarde notablement. Cependant, toutes les précautions prises par l'IC (lire les thèses du 11° Congrès sur le parlementarisme révolutionnaire) n'ont pas empêché cette politique de devenir un levier de l'opportunisme. C'est que la dégénérescence du Parti n'est pas uniquement fonction de la situation générale et de rapports de forces entre classes, mais est encore fonction de la politique pratiquée par le Parti. Le prolétariat a trop payé durant ces derniers 25 ans pour que les militants d'avant-garde oublient cette vérité première.
A quel point est savonneuse la pente participationniste, nous le constatons par les résultats obtenus, auxquels on se réfère volontairement à chaque instant pour prouver la force et l'influence du parti.'
Le rapporteur au Congrès n'a pas manqué de citer que dans telle région, la liste du Parti aux dernières élections, a obtenu quatre fois plus de voix. Comme si on pouvait parler de force et d'influence du Parti alors que la vente de la presse baisse, que l'organisation a perdu la moitié de ses membres, et que le niveau idéologique des membres, de l'aveu même des responsables, est "lamentable". En entendant Damen parler des victoires du Parti, on ne peut manquer de penser qu'il y a des victoires qui sont les pires des défaites.
Peut-être ne serait-il pas inutile, pour calmer un peu la fièvre des participationnistes, de leur citer l'exemple du parti trotskyste en France qui en 1946 avait également obtenu un succès groupant sur ses listes près de 70.000 voix.
Cela n'a pas empêché ce parti de voir la masse de ses électeurs fondre comme neige au soleil aux élections suivantes, et un an après, voir fondre ses propres rangs. Une bonne partie de ses militants poussant la logique à aller vers les masses à fond, a fini par aller au Rassemblement Démocratique Révolutionnaire où le nombre est plus grand et où leurs paroles peuvent avoir plus d'écho.
Car c'est exactement ainsi que raisonne le camarade Damen : "En participant aux élections" dit-il aux anti-participationnistes le parti a pu pénétrer dans les grandes masses, porter la nouvelle parole, essayer de donner corps aux vagues aspirations de sortir des chemins battus". Pris par un noble sentiment de semer la bonne parole, l'idée ne lui vient pas à l'esprit que pour lever, la semence doit être faite en terrain approprié, sinon ce n'est qu'un gaspillage de grains et d'énergies. Le révolutionnaire n'a pas à s'inspirer des missionnaires de l'Armée du Salut allant prêcher la parole divine dans les bordels. La conscience socialiste ne s'acquiert pas dans n'importe quelles conditions, elle n'est pas le fait de l'action volontariste, mais présuppose une tendance de détachement des ouvriers d'avec l'idéologie bourgeoise, et ce n'est sûrement pas les campagnes électorales, moments de choix de l'abrutissement des ouvriers qui offrent cette condition.
Il y a longtemps qu'il a été mis en évidence que les racines psychologiques de l'opportunisme sont, aussi paradoxal que cela puisse paraître, son impatience d'agir, son incapacité d'accepter le temps de recul et d'attente. Il lui faut immédiatement " pénétrer dans les masses, porter la nouvelle parole". Il ne prend pas le temps de regarder où il met les pieds. Il est impatient de planter le drapeau du socialisme, oubliant dans sa précipitation que ce drapeau n'a de valeur que pour autant qu'il est planté sur un terrain de classe du prolétariat et non quand il est jeté sur le premier tas de fumier du capitalisme.
Malgré l'orthodoxie léniniste, la trique de la discipline et les succès enregistrés, la résistance des militants contre la politique de la participation augmentait sans cesse. Cela prouve que le PCI d'Italie repose sur des éléments de base très sains. Mais malgré les vives critiques, le Congrès n'a pas résolu la question. Le compromis accepté de renoncer à la participation aux élections de Novembre laisse cependant la question de principe ouverte. Le culte de l'unité et de " ne troublons pas les membres de base" ont prévalu sur la clarté et l'intransigeance des positions. Ce n'est qu'un recul pour mieux sauter. Les militants révolutionnaires ne sauraient se contenter longtemps de ces demi-mesures. Avec ou sans 1 *assentiment des chefs de file, ils devront liquider ces " vieilles armes émoussées " ou se liquider eux-mêmes en tant que révolutionnaires.
LE PROBLEME SYNDICAL
C’est assurément la position prise sur le problème syndical qui présente le fait saillant du Congrès.
Quelle était la position antérieure du PCI ? La plus platement orthodoxe, une copie conforme des thèses de l'IC.
" Le travail au sein des organisations économiques syndicales des travailleurs, en vue de leur développement et de leur renforcement, est une des premières tâches politiques du Parti."
" Le parti aspire à la reconstruction d'une confédération syndicale unitaire, indépendante des commissions d'Etat et agissant avec les méthodes de la lutte de classe et de l'action directe contre le patronat, depuis les revendications locales et de catégories jusqu'aux revendications générales de classes ... Les Communistes ne proposent et ne provoquent la scission des syndicats du fait que les organismes de direction seraient conquis ou détenus par d'autres partis " (Plateforme du PCI - 1946).
C'est sur cette base qu'a été fondé le travail dans les syndicats et allant jusqu'à la participation, là où cela a été possible, surtout en province et dans les petits syndicats, dans les commissions et directions syndicales. Il a soutenu sans réserves les luttes revendicatives économiques considérant ces luttes comme " une des premières tâches politiques du Parti".
Cette conception fut longtemps un principe pour la GCI. Une des raisons de l'hostilité de la GCI à notre égard était notre position antisyndicale. Nous ne pouvons donc qu'exprimer notre satisfaction de voir le PCI abandonner aujourd'hui la plus grande partie de ses vieilles positions concernant l'organisation syndicale, et les revendications économiques.
Nous ne pouvons que souscrire à cette définition:
" Le Parti affirme catégoriquement que le syndicat actuel est un organe fondamental de l'Etat capitaliste y ayant pour but d’emprisonner le prolétariat dans le mécanisme productif de la collectivité nationale " ou encore " la classe ouvrière, au cours de son attaque révolutionnaire3 devra détruire le syndicat comme un des mécanismes les plus sensibles de la domination de classe du capitalisme". Nous souscrivons d'autant plus volontiers que nous retrouvons là, non seulement les idées que nous avons défendues depuis longtemps, mais la reproduction jusqu'à nos propres termes et expressions ([4] [14]).
Remarquons cependant que dans la question syndicale, comme dans bien d'autres questions, le PCI a laissé une fois de plus une petite fenêtre ouverte permettant à l'occasion la repénétration de ces mêmes idées qu'on vient de rejeter par la porte.
Par exemple quand le PCI déclare "son indifférence concernant la question formelle de l'adhésion ou non du travailleur au syndicat", il ne fait que prendre une position passive qui cache mal son attachement affectif au syndicat. Dire que "ce serait pêcher par abstraction que propager le mot d'ordre de la sortie des syndicats; mot d'ordre concevable seulement quand les situations historiques poseront les conditions objectives pour le sabotage du syndicat", c'est chercher des prétextes sophistiqués pour ne pas choquer les sentiments arriérés des masses. Si on est convaincu que le syndicat est et ne peut désormais être qu'un organisme d'Etat capitaliste, avec la fonction d'emprisonner les ouvriers au service de la conservation du régime capitaliste, on ne peut rester "indifférent" au fait que l'ouvrier en fait ou non partie organiquement, pas plus que nous ne restons indifférents au fait que les ouvriers fassent ou non partie des maquis, des comités de libération nationale, des partis ou toutes autres formations politiques du capitalisme.
Il n'est jamais venu à l'esprit d'un militant sérieux que l'abandon par les ouvriers des formations politiques du capitalisme dépend de ce qu'il lancera ou non le mot d'ordre. Il sait parfaitement que cela sera le résultat des conditions objectives; mais cependant cela ne l'empêche pas, mais au contraire, exige de lui de faire de la propagande et d'appeler les ouvriers à déserter ces organisations de la bourgeoisie. La désertion des organisations du capitalisme n'est pas seulement une manifestation mais également une condition de la prise de conscience des ouvriers. Et cela reste valable aussi bien pour les organisations syndicales que pour les organisations politiques. De toutes façons, l'indifférence en matière de positions politiques n'est que le camouflage d'un acquiescement effectif et honteux.
Mais il y a mieux. Le PCI dénonce les syndicats mais préconise le rassemblement des ouvriers dans la fraction syndicale. Qu'est-ce donc que cette fraction syndicale ?
" C'est -dit d'abord le document de la CE déjà cité- le réseau des groupes d'usines du parti qui agissant sur la base unitaire de son programme etc ...constituent la fraction syndicale".
On serait tenté de croire à la première lecture qu'il s'agit tout simplement de cellules du Parti, mais à examiner de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit de toute autre chose. Premièrement, on comprend difficilement pourquoi l'ensemble des cellules d'usines se constitueraient en un organisme à part, séparant et divisant l'unité du Parti en deux : d'un côté les ouvriers groupés à part dans les cellules d'usines et d'un autre côté les non-ouvriers groupés on ne sait exactement où, mais également à part.
Deuxièmement, la gauche italienne s'est toujours opposée dans l'IC à l'introduction de cette structure des cellules d'usines, voyant en elles une tendance à l'ouvriérisme et un moyen bureaucratique d'étouffer la vie idéologique du Parti ([5] [15]). Il serait vraiment surprenant que le PCI rompe aujourd'hui avec cette position traditionnelle et plus que jamais valable. Troisièmement, quelles peuvent donc être les tâches spécifiques des membres ouvriers du Parti distinctes des taches de l'ensemble du Parti, et finalement on ne comprend pas que cet organisme centralisé, unifié sur le plan de l'ensemble du pays, constituerait et porterait précisément le nom de ... fraction syndicale.
En vérité la fraction syndicale n'est pas les cellules d'usines du Parti, mais bien une organisation séparée, distincte du Parti créée par celui-ci et dirigée par lui. Certainement le Parti ne se fait pas trop d'illusions sur l'ampleur que peut prendre cette organisation dans l'immédiat : " dans la situation actuelle, c'est la réduction de la fraction syndicale aux seuls membres du parti et_ à quelques sympathisants, agissant dans l'usine ou dans le syndicat, qui se vérifiera le plus souvent". Mais ce n'est pas pour cela que le Parti crée cette organisation; il la destine à une fonction bien plus importante :
" II ne dépend pas d’un effort volontariste du Parti mais de l'évolution de la situation générale et de la dynamique des luttes sociales, que des prolétaires, syndiqués ou non, inscrits ou non à d'autres partis, se rassemblent autour de nos groupes d'usine".
De ces textes, il ressort clairement que la fraction syndicale a une double fonction. Dans l'immédiat " agissant dans l'usine ou dans le syndicat", et de servir dès à présent de noyaux autour desquels se rassembleront demain les ouvriers de toutes les tendances, de tous les partis, en quelques sorte des embryons de soviets.
Il est à remarquer que le PCI qui craint de "pêcher par abstraction" en préconisant la désertion des syndicats en l'absence des conditions objectives nécessaires, ne craint cependant pas le péché de bluff en constituant aujourd'hui les embryons de futurs soviets.
D'une part, le parti a renoncé à son action dans les syndicats et à l'illusion de pouvoir agir, actuellement, dans les masses, d'autre part il reprend la même action syndicale et le travail des masses, non directement mais par l'intermédiaire d'une organisation spéciale créée à cette fin :1a fraction syndicale. Aussi ne pourrait-on rien lui reprocher, chacun a son compte et tout le monde est content.
Ainsi le pas en avant fait dans la question a été immédiatement suivi de deux pas en arrière ([6] [16])
Finalement l'erreur d'hier a été doublée d'une confusion d'aujourd'hui. En ajoutant la confusion nouvelle à l'erreur passée, ça ne fait toujours qu'une confusion dans l'erreur et on n'a pas avancé d'un iota.
CONCLUSIONS
Nous venons de faire l'examen des travaux du P.C.I. Si on ne peut pas parler de son apport dans la clarification des problèmes fondamentaux de l'époque, de l'avis même de ses partisans on peut constater que le plus clair de son travail consistait dans le bouleversement total qu'il a apporté dans les positions et l'orientation prises à sa Conférence constitutive.
On trouverait difficilement un autre exemple dans les annales des groupes politiques, où une plateforme constitutive se trouve être aussi profondément malmenée et infirmée, dans un laps de temps aussi court.
Notre époque peut avec raison être caractérisée par ces changements brusques et la rapidité de son cours. Mais on ne saurait attribuer à cela le vieillissement surprenant de la Plateforme du P.C.I. car elle était déjà hors du cours et frappée de sénilité à sa naissance. Cette constatation faite par les délégués eux-mêmes au Congrès n'est pas le fait du hasard. Elle a ses racines, entre autre, dans la suffisance et la prétention de détenir seule la vérité révolutionnaire, haussant les épaules à la seule idée de pouvoir apprendre quelque chose dans la confrontation d'idées avec d'autres groupes révolutionnaires dans les divers pays.
Deux ans et demi ont suffi pour ne laisser subsister intactes aucune des pages de la Plateforme de Décembre 1945. C'est une leçon sévère mais qui pourrait être salutaire si les camarades de la CCI comprennent et acceptent cette leçon. A cette seule condition l'expérience pourrait ne pas avoir été vaine.
Pour finir, et dans la mesure où il nous est possible et permis de juger de loin et de formuler un avis, nous estimons prématurée la conclusion tirée par le camarade Bernard qui dit" "pour les militants sincèrement révolutionnaires il n'y a pas d'autre voie que la scission et la création d'un nouveau regroupement politique qui ait comme tâche fondamentale la recherche et la formulation des bases idéologiques pour la formation future du vrai parti de classe". Nous ne méconnaissons pas les immenses difficultés auxquelles peuvent se heurter ces camarades dans l'atmosphère qui règne dans le PCI. Mais il est incontestable que le PCI d'Italie reste à ce jour la principale organisation révolutionnaire prolétarienne et probablement la plus avancée en Italie. Tout comme après la Conférence de 1945 nous estimons qu'en son sein sont rassemblés un grand nombre de militants révolutionnaires sains, et de ce fait cette organisation ne peut être considérée comme perdue d'avance pour le prolétariat.
En 1945 nous écrivions que derrière le patriotisme et l'apparence d'unité existent des divergences réelles qui ne manqueront pas de se manifester et de se cristalliser en tendances opportunistes et révolutionnaires. Aider à cette cristallisation, contribuer à dégager les énergies révolutionnaires afin qu'elles puissent trouver leur maturation et leur expression la plus avancée, tel nous paraît être encore aujourd'hui la tâche la plus urgente du révolutionnaire sincère.
(Bulletin de Mai 1948 sur le Congrès du P.C.I. d'Italie).
[1] [17] Faute de place, nous ne pouvons pas publier toujours des articles in extenso. Nous savons combien cela est insatisfaisant, souvent gênant, comportant le risque de la déformation et nous sommes les premiers à le déplorer. Nous nous efforcerons autant que possible de 1'éviter, la meilleure solution étant certainement la publication d'un recueil des principaux articles de cette revue. Un souhait à réaliser.
[2] [18] Voir cette "théorisation" chez les dissidents bordiguistes et situationnistes comme le"Mouvement Communiste", "Négation", et tout particulièrement dans "Invariance" n°2 nouvelle série.
[3] [19] Il est peut-être nécessaire d'insister sur une autre erreur couramment commise et qui consiste à lier l'existence du Parti à la période révolutionnaire et insurrectionnelle. Cette "idée" qui ne conçoit 1 'existence du Parti qu'uniquement en période de révolution est source de bien des confusions.
a) Elle confond le Parti avec les Conseils. Ces derniers parce qu'ils sont 1'organisation spécifique de la classe pour la conduite de la révolution et la prise du pouvoir - ce qui n'est pas la fonction du Parti - ne peuvent apparaître et exister qu'uniquement dans la révolution.
b) Une telle idée reviendrait à dire qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de Parti de la classe ouvrière. Ce qui est une pure absurdité.
c) C'est ignorer les raisons du surgissement du Parti dans la classe et ses fonctions, dont une principale est d'être un facteur actif dans le processus de prise de conscience de la classe.
d) "L'organisation des ouvriers en classe donc en Parti" (Marx) signifie un caractère constant, de 1'existence du Parti, que seule une période de défaite et de réaction profonde vient à mettre en question.
Une période de reprise et de développement des luttes de classe du prolétariat ouvre le processus de la reconstruction du Parti. Ne pas le comprendre c'est maintenir les pieds sur les freins au moment où la route amorce une longue montée.
[4] [20] Voir notamment nos thèses sur les problèmes actuels du mouvement ouvrier. INTERNATIONALISME n°31, Février 1948.
[5] [21] Voir par exemple l'article "LÀ NATURE DU PARTI" publié par Bordiga en 1924.
[6] [22] Pour qu'on ne nous accuse pas de déformation intentionnelle de la pensée du PCI, nous citerons l'explication donnée par la Fraction Belge sur ce point : "s'il y a des ouvriers qui ne veulent pas adhérer au Parti, encadrer ceux-ci dans les fractions syndicales du Parti, qui seront peut-être aussi demain les bases pour la création de nouveaux syndicats".
Conscience et organisation:
- La Gauche Italienne [23]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [10]
Revue Internationale no 37 - 2e trimestre 1984
- 2528 lectures
La reprise de la lutte de classe
- 2646 lectures
Avec les années 80, l’économie capitaliste s’enfonce dans une impasse de plus en plus complète, l’histoire s'accélère. Les caractéristiques profondes et fondamentales de la décadence capitaliste sont mises à nu. En ce sens, les années 80 sont bien des "années de vérité" où les véritables enjeux de la vie de la société apparaissent de plus en plus au grand jour : guerre généralisée et destruction de l'humanité, ou révolution communiste internationale.
Les deux termes de cette alternative existent de façon constante dans la vie de la société depuis l'aube de la décadence : "l'ère des guerres et des révolutions prolétariennes" qu'avait défini l'Internationale Communiste. Mais ils ne se posent pas de façon symétrique et ne pèsent pas du même poids à tout moment sur l'avenir qui se profile. Depuis 68, le prolétariat, seule classe porteuse d'une solution historique à la décadence du capitalisme, a ressurgi sur la scène de l'histoire, ouvrant un cours à des affrontements de classe. Cela ne signifie pas que les conflits inter impérialistes se sont tus. Au contraire, ils n'ont jamais cessé,et, avec les années 80, c'est à 1'exacerbation de ces antagonismes qu'on assiste, à une inféodation croissante de toute la vie économique aux nécessités militaires, à la poursuite et à l'accentuation de la barbarie capitaliste avec ses monceaux de cadavres et de destruction que viennent encore une fois d'illustrer dernièrement la poursuite de la guerre au Liban et les hideux massacres perpétrés dans le renouveau de la guerre Irak Iran. Mais cela signifie que le prolétariat, par sa combativité, par sa non adhésion à l'idéologie dominante, par sa non soumission à la classe capitaliste, barre la route à la généralisation de ces conflits en une troisième conflagration mondiale. ([1] [24])
Cette affirmation du caractère déterminant de la lutte du prolétariat dans la situation actuelle peut paraître gratuite quand on regarde le tableau désolé et sans perspectives que nous offrent les médias bourgeois. Mais la compréhension des grandes tendances qui caractérisent une situation et sa dynamique, ne peut se suffire de l'apparence superficielle et mystifiée des choses présentée par la classe dominante. C'est que la lutte du prolétariat, en tant que lutte d'une classe exploitée,ne peut suivre un cours linéaire, ne peut développer graduellement sa force. Expression du rapport de forces entre deux classes antagoniques, la lutte de classe suit un cours sinueux, en dents de scie, fait d'avancées, de reculs durant lesquels la classe dominante s'efforce d'effacer et de détruire toute trace des avancées précédentes. Cette tendance est exacerbée dans la période de décadence où la forme de domination politico-économique de la bourgeoisie qu'est le capitalisme d'Etat tend en permanence à absorber toute manifestation de la vie sociale. Pour autant, la lutte de classe subsiste comme moteur de 1'histoire et 1'on ne peut comprendre pourquoi la situation de décomposition accélérée dans laquelle la crise historique du système a jeté la société, perdure sans déboucher dans une boucherie généralisée, si l'on ne saisit pas que le prolétariat a constitué et continue d'être l'entrave déterminante à l'aboutissement des tendances guerrières du capitalisme.
LA LUTTE REPREND DANS TOUS LES PAYS
Depuis 1968, nous avons assisté à deux avancées du prolétariat international : de 68 à 74 où la bourgeoisie a été surprise par la réémergence de cette force sociale qu'elle croyait définitivement enterrée, et de 78 à 80 où le mouvement a culminé en Pologne avec une grève de masse développant toutes les caractéristiques de la lutte de classe en période de décadence ([2] [25]). Depuis la mi-83, la tendance à la reprise des luttes du prolétariat dont nous avions annoncé la perspective après deux années de déboussolement et de paralysie à la suite de la défaite partielle du prolétariat mondial en Pologne ([3] [26]), s'est réaffirmée : en BELGIQUE, en HOLLANDE, en ALLEMAGNE, en GRANDE BRETAGNE, en FRANCE, aux ETATS-UNIS, en SUEDE, en ESPAGNE, en ITALIE etc., des grèves ont éclaté contre les mesures d ' austérité draconiennes imposées par la bourgeoisie, touchant tous les pays du coeur du monde industriel où se joue la perspective historique pour l'humanité ([4] [27]). Dans les pays secondaires carme la Tunisie, le Maroc, la Roumanie, des émeutes et des grèves ont explosé. C'est une tendance internationale de résistance à la logique infernale de la crise du capital qui se dessine à nouveau.
Les "Thèses sur la reprise de la lutte de classe" que nous publions plus loin, mettent en évidence les grandes lignes qui ont présidé à l'avancée du prolétariat durant les deux vagues de lut te précédentes et tracent les caractéristiques de celle qui ne fait que commencer.
Si prises séparément, une à une, aucune des luttes qui ont eu lieu dans les pays mentionnés plus haut n'est en soi profondément significative d'un grand pas en avant du prolétariat international, le contexte de crise exacerbée, de décomposition sociale, d'usure des mystifications, de fossé grandissant entre l'Etat et la société civile, le phénomène d'accélération de l'histoire constituent le terrain propice au développement de la conscience du prolétariat révolutionnaire. Ce sont le caractère international et historique de ces réactions, la compréhension du processus de prise de conscience au travers de l'accumulation de ses expériences, de l'évolution de ses luttes et de leur dynamique qui nous donnent la clé des perspectives qui s'ouvrent au prolétariat et existent en germe dans ce renouveau de la combativité.
EN GERME, LES TRAITS DE L'AVENIR
Aucune des luttes que nous avons vu se développer depuis l'importante grève du secteur public en Belgique en septembre 83 n'a permis réellement de faire reculer la bourgeoisie sur les mesures qu'elle voulait imposer à la classe ouvrière. Que ce soit les luttes du secteur public en Hollande ou celle des employés de la compagnie de bus Greyhound aux Etats-Unis contre la baisse des salaires, que ce soit celle des sidérurgistes de Sagunto en Espagne ou des ouvriers de l'usine automobile Talbot-Poissy en France contre les licenciements, ou encore celle des postes en France contre l'augmentation des heures de travail, etc., aucune n'a obtenu de résultat, même momentanément. Cependant, le fa^t que le prolétariat résiste, qu'il ne se laisse pas imposer quasiment passivement ces mesures, comme ça a pu être le cas par exemple aux USA où, pendant 4 ans, de nombreux secteurs ont accepté sans réaction des baisses de salaire, est un signe très positif de sa non soumission aux intérêts de l'économie nationale, de sa combativité. Et la première victoire de la lutte, c'est la lutte elle-même.
Alors que les nécessites d'un développement de la perspective historique de lutte de classe vont imposer à la classe ouvrière, conformément aux caractéristiques des luttes dans la période de décadence, une extension et une auto organisation de ses combats, une confrontation radicale à l'appareil syndical et à toutes les mystifications démocratiques et syndicalistes de la bourgeoisie, une politisation de son mouvement, aucune des luttes qui ont eu lieu n'a réellement réussi à développer pleinement ne serait-ce qu'une seule de ces caractéristiques. Cependant, examinons de plus près, à la lumière de ces nécessités, quelques aspects de ces divers mouvements :
- par rapport à la nécessité de l'extension de la lutte, c'est-à-dire la prise de conscience que le prolétariat ne peut pas se battre de façon isolée, minoritaire, qu'il ne peut pas imposer un rapport de forces en sa faveur sans s'impliquer massivement dans le combat, nous ..avons assisté en Belgique à une tentative spontanée d'extension du mouvement par les cheminots de Charleroi, dépassant dès le départ l'éternelle division communautaire et linguistique Flandres/Wallonie largement usée dans le passé par la bourgeoisie pour dévoyer le prolétariat. Les syndicats se sont trouvés dans l'obligation d'"étendre" la grève à tout le secteur public, visant par là à noyer le mouvement dans des parties moins combatives des travailleurs et à imposer la division catégorielle "secteur public"-"secteur privé". Ce n'est pourtant qu'au bout de trois semaines, après avoir impliqué plusieurs centaines de milliers de travailleurs dans un pays de 9 millions d'habitants, que la grève s'est terminée. A peine celle-ci finie que démarrait dans le paradis du Welfare State" qu'est la Hollande, une grève du secteur public également, la première depuis 1903, qui allait durer 6 semaines. Celle-ci a commencé sous la poussée de la combativité des cheminots et des chauffeurs de bus, et si, grâce à la collaboration étroite entre syndicats belges et syndicats hollandais, et entre toutes les fractions de droite, de gauche et syndicales de la bourgeoisie nationale, plus l'organisation d'une campagne "pacifiste" en plein milieu du mouvement, celui-ci a abouti dans une impasse, ce n'est pas sans mal que la situation est rentrée "dans l'ordre".
Aux USA, des ouvriers d'autres secteurs ont soutenu la grève des employés du Greyhound en participant aux piquets ; les syndicats ont du organiser leur éternelle "aide financière" sous forme de "cadeaux de Noël" aux employés du Greyhound pour répondre au sentiment de solidarité qui se manifestait dans la population et empêcher la réelle et seule solidarité de classe possible, celle de la lutte, de s’exprimer
- par rapport à la nécessité de l'auto organisation de la lutte, des assemblées générales ont eu lieu dans la plupart des mouvements. Mais la question de l'auto organisation pose et contient le problème de la confrontation aux syndicats, c'est-à-dire un pas que le prolétariat n'a pas encore franchi et qui implique un niveau de confiance en lui-même et de conscience qui n'est encore qu'en germe aujourd'hui. Cependant, la question syndicale a été posée dans de multiples cas, dans ces tous premiers mouvements de la reprise. La plupart de ces grèves ont été déclenchées spontanément, sans attendre les consignes syndicales, ou si les syndicats ont su prendre dès le départ le mouvement sous leur responsabilité, comme en Hollande ou dans les grèves en Italie, c'est bien parce qu'ils comprenaient que les mouvements auraient lieu de toutes façons. En Belgique, c'est en dehors des syndicats qu'a démarré le mouvement qu'ils n'ont pu reprendre en main qu'au bout de trois jours ; en Hollande à de nombreuses reprises dans des assemblées générales çà et là, les consignes syndicales n'ont pas été suivies. En Grande Bretagne, 1200 ouvriers ont manifesté contre des manoeuvres syndicales. Même en Suède où la grève des mineurs de Kiruna qui n'a duré qu'une journée, avait été appelée par le syndicat, la consigne de celui-ci qu'une partie seulement des mineurs fasse grève, a été débordée, et tous les mineurs s'y sont mis. Partout, en Italie, en France, en Espagne, en Hollande, en Belgique, c'est au syndicalisme de base, avec son langage radical qu'ont été laissées les choses en main, les appareils étant de moins en moins suivis, sinon pas du tout. L'usure de la mystification syndicale commence d'ores et déjà à se faire sentir, posant les jalons de la future capacité de la classe à prendre en main son propre destin, de son auto organisation.
- par rapport à la question de la politisation du mouvement, c'est-à-dire l'établissement d'un rapport de forces du prolétariat face à l'Etat comme on a pu le voir pleinement développé en août 80 en Pologne, cette question contient la capacité du prolétariat à s'organiser et à étendre lui-même sa lutte. On n'en est pas encore là. Mais d'ores et déjà la question de l'Etat est posée dans les grèves des fonctionnaires qui sont de moins en moins mystifiés par le caractère soi -disant "social" de l'Etat, dans la résistance aux mesures d'austérité que la crise impose à chaque Etat de prendre contre les ouvriers. Elle est par exemple clairement posée dans la confrontation à Sagunto en Espagne entre sidérurgistes et forces de l'ordre, des forces de l'ordre "socialistes". La démystification du caractère réactionnaire des syndicats en tant que rouages de l'Etat fait aussi partie des jalons de cette prise de conscience politique.
Ce qu'on peut conclure de ces quelques éléments, c'est qu'au tout début de cette reprise, la classe ouvrière se heurte aux obstacles sur lesquels elle avait échoué lors de la vague de 78-80 : face à la nécessité de l'extension, les syndicats proposent une fausse extension catégorielle ; face à la nécessité de l'auto organisation, les syndicalistes de base proposent des comités de grève syndicaux "à la base" ; face à la nécessite de la solidarité active, les syndicats proposent le soutien "matériel" inefficace aujourd'hui ; face au problème de la politisation, les syndicats proposent la fausse radicalisation verbale du syndicalisme "de combat" dont les gauchistes se font les fervents porteurs. Ainsi, tous les ingrédients de la précédente vague sont déjà présents.
En réalité, la mise en place de la gauche dans l'opposition face à la précédente vague de luttes en 78-80, la "radicalisation" soudaine des partis de gauche et des syndicats après des années de langage "responsable" en vue d'accéder au pouvoir, la réapparition du syndicalisme de base et des gauchistes en son sein ont été les anti-corps sécrétés par la bourgeoisie contre le prolétariat et qui l'ont momentanément déboussolé. Aujourd'hui, ces anti-corps existent dès le début des luttes, tentant d'en saboter la dynamique dès l'origine, mais, en même temps, dédorant leur blason.
En ce sens, ce troisième mouvement de reprise ne peut être que plus difficile au départ, le prolétariat occidental se heurtant à la bourgeoisie la plus forte et la plus expérimentée du monde, contrairement à ce qui se présentait en Pologne en 80. Il se fera de façon relativement lente, mais cette difficulté même est porteuse de leçons plus profondes.
Lorsqu'une vague de luttes reprend à l'échelle internationale, on ne peut s'attendre automatiquement à ce qu'un pas qualitatif s'opère à son début. Avant que la progression ne se marque, le prolétariat doit souvent revivre dans la pratique les difficultés auxquelles il a été confronté, et c'est la dynamique même de la lutte combinée à l'accumulation des expériences favorisée justement par l’accélération de la crise qui permettra à la conscience de s'épanouir plus largement.
Les conditions de la révolution communiste ont été définies par Marx et Engels, dès l'origine .du mouvement ouvrier : crise économique internationale, internationalisation des luttes. Aujourd'hui, les conditions de la généralisation des combats de la classe ouvrière qui contient la perspective révolutionnaire, se réunissent. Il y aura encore des avancées et des reculs. Les enjeux de l'histoire ne sont pas joués d'avance, mais ils sont en train de se jouer. Les organisations révolutionnaires doivent être à même de reconnaître la dynamique de la perspective historique, afin d'assumer dans leur classe la fonction déterminante pour laquelle elle les a sécrétées.
CN.
[1] [28] Voir l’article"conflits inter-impérialistes et lutte~de classe":"l’histoire s'accélère", in Revue Internationale n° 36, 1er trimestre 84.
[2] [29] Voir tous les articles sur la lutte de classe en Pologne, ses enseignements et ses implications, in Revue Internationale n° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
[3] [30] Voir l'article "Où va la lutte de classe ? Vers la fin du repli de 1'après-Pologne", in Revue Internationale n° 33, 2e trimestre 83.
[4] [31] Voir l'article "Le prolétariat d'Europe de l'ouest au coeur de la généralisation de la lutte de classe" in Revue Internationale n° 31,.4e trimestre 82.
Géographique:
- Europe [32]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe
- 2454 lectures
1 - Le 5e Congrès du CCI constatait, dans sa ré solution sur la situation internationale ([1] [33]) que "la crise qui maintenant atteint de -plein fouet les métropoles du capitalisme, obligera le prolétariat de ces métropoles à exprimer ses réserves de combativité qui n’ont pas été jusqu'à présent entamées de façon décisive". "La crise se révèle la meilleure alliée du prolétariat mondial". Ce qui n'était qu'annoncé au moment du Congrès, sans qu'il n'en soit prévu l'imminence, est devenu aujourd'hui une réalité. Depuis le milieu de 1983,- la classe ouvrière est sortie du recul marqué du sceau de la défaite en Pologne en 81 et s'est engagée dans une nouvelle vague de combats contre le capitalisme. En moins de 6 mois, ce sont des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la France, les Etats-Unis, l'Espagne et dans une moindre mesure, l'Allemagne, la Grande Bretagne et l'Italie qui ont connu des mouvements importants et significatifs de la classe.
2 - La reprise actuelle des luttes exprime le fait que, dans la période présente d'aggravation inexorable et catastrophique de la crise du capitalisme située dans un contexte général de cours historique aux affrontements de classe, les moments de recul du prolétariat sont et seront de plus en plus de courte durée. Ce qui se révèle dans cette reprise, c'est qu'aujourd'hui, les défaites partielles et la désorientation momentanée qui les permet ou qu'elles provoquent, ne sauraient entraver de façon décisive la capacité du prolétariat à riposter de façon croissante aux attaques économiques de plus en plus violences que lui assène le capital. Elle illustre une nouvelle fois le fait que, depuis 1968, c'est la classe ouvrière mondiale qui détient l'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à une bourgeoisie qui, malgré une défense pas à pas et un déploiement massif et impressionnant de son arsenal anti-ouvrier, n'a pas les mains libres pour apporter sa réponse propre à sa crise : la guerre impérialiste généralisée.
3 - La vague présente de lutte s'annonce d'ores et déjà comme devant dépasser en ampleur et en importance les deux vagues qui l'ont précédée depuis la reprise historique de la fin des années 60 : celle de 1968-74, et celle de 1978-80.
La première vague a eu comme caractéristiques majeures :
- d'annoncer avec fracas et de façon spectaculaire (notamment avec Mai 68 en France, le Mai rampant italien, les affrontements de Pologne) la fin de la période de contre-révolution, l'entrée du capitalisme dans une période nouvelle dominée par la confrontation entre les deux classes décisives de la société,
- de surprendre la classe bourgeoise qui avait perdu l'habitude de voir le prolétariat comme acteur de premier plan dans la vie de la société,
- de se développer à partir d'une situation économique encore relativement peu dégradée, ce qui laissait la place pour de nombreuses illusions au sein du prolétariat et notamment celle de l'existence d'une "alternative de gauche".
La deuxième vague se distingue par les éléments suivants :
- elle se base sur une dégradation beaucoup plus avancée de l'économie capitaliste, des attaques beaucoup plus sévères contre les conditions de vie de la classe,
- elle se situe à une période charnière entre deux moments du développement de la situation historique : les "années d'illusion" et les "années de vérité",
- elle voit la bourgeoisie des pays avancés réorienter sa stratégie face au prolétariat, remplacer la carte de "la gauche au pouvoir" par celle de "la gauche dans l'opposition",
- elle fait pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, avec les combats de Pologne 80, l'expérience de cette arme décisive de la classe dans la période de décadence:1a grève de masse,
- elle culmine dans un pays de la périphérie appartenant au bloc le plus "arriéré", ce qui met en évidence l'aptitude retrouvée de la bourgeoisie des métropoles du capital à opposer des lignes de défense encore considérables aux luttes ouvrières.
La vague de luttes actuelles tire sa source de l'épuisement' de ce\qui avait permis le recul de 1'après-Pologne :
- reste des illusions propres aux années 70 qui ont été définitivement balayées par la très forte récession de 1980-82,
- désarroi momentané provoqué tant par le passage de la gauche dans l'opposition que par la défaite en Pologne.
Elle démarre :
- à partir d'une longue période d'austérité et de montée du chômage, d'une intensification des attaques économiques contre la classe ouvrière dans les pays centraux,
- à la suite de plusieurs années d'utilisation de la carte de la gauche dans l'opposition et de l'ensemble des mystifications qui y sont associées.
Pour ces raisons, elle va se poursuivre par des engagements de plus en plus puissants et déterminés du prolétariat des métropoles contre le capitalisme dont le point culminant se situera de ce fait à un niveau supérieur à celui de chacune des vagues précédentes.
4 - Les caractéristiques de la vague présente, tel les qu'elles se sont déjà manifestées et qui vont se préciser de plus en plus, sont les suivantes :
- tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes, tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leur début, un certain débordement des syndicats,
- simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes,
- développement progressif, au sein de l'ensemble du prolétariat,de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité de s'opposer comme classe aux attaques capitalistes,
- rythme lent du développement des luttes dans les pays centraux et notamment de l'aptitude à leur auto organisation, phénomène qui résulte du déploiement par la bourgeoisie de ces pays de tout son arsenal de pièges et mystifications et qui s'est réalisé une nouvelle fois dans les affrontements de ces derniers mois.
5 - Contrairement à 1968, et en continuité avec ce qui s'était passé en 1978, la reprise actuel le ne trouve nullement devant elle une bourgeoisie sans préparation. Elle va se heurter à l'éventail complet des dispositifs que cette classe a déjà opposé à la combativité et à la prise de conscience du prolétariat, et qu'elle n'aura de cesse de perfectionner :
- mise en oeuvre de sa solidarité à l'échelle internationale qui se manifeste notamment par le black-out sur les luttes ou leur dénaturation par les médias,
- organisation de campagnes de diversions de toutes sortes (pacifisme, exploitation de scandales, etc.)
- mise en avant dans les luttes de revendications bourgeoises (défense de "l'économie nationale" ou de tel secteur économique ou encore des syndicats "menacés par la bourgeoisie"),
- faux appels à "l'extension" ou à la "généralisation" par les syndicats destinés à prévenir la menace d'une réelle extension,
- utilisation sélective et "intelligente" de la répression ayant pour but tant de démoraliser les ouvriers que de créer des "abcès de fixation" destinés à détourner la combativité de ses objectifs initiaux.
6 - La prise en considération et la dénonciation des moyens considérables et des obstacles mis en oeuvre par la bourgeoisie ne doit pas cependant conduire à un manque de confiance envers la capacité du prolétariat à les affronter et les surmonter. Cet arsenal sera responsable du développement lent, progressif des luttes dans les métropoles du capital (ce qui n'exclut pas la possibilité de brusques accélérations à certains moments, notamment là où la bourgeoisie n'a pas pu placer ses forces de gauche dans l'opposition comme en Espagne et surtout en France). En cela, les pays centraux continueront à se distinguer des pays de la périphérie (Europe de l'Est et surtout Tiers Monde) qui pourront connaître des explosions de colère et de désespoir, des "révoltes de la faim" violentes et massives mais sans perspectives propres et condamnées à une répression féroce. Cependant, l'utilisation permanente et de plus en plus intensive et simultanée par la bourgeoisie des pays avancés de tous ses moyens de sabotage des luttes, va nécessairement provoquer leur usure :
- les black-out et falsifications conduiront à une perte de confiance absolue envers les médias bourgeois,
- les campagnes de diversion montreront de plus en plus leur vrai visage face à la réalité des luttes sociales,
- les contorsions, même radicales, de la gauche, des gauchistes, des syndicats et du syndicalisme de base à force de conduire dans des impasses et à la défaite, provoqueront une méfiance croissante envers ces forces du capital comme cela se révèle déjà dans la période actuelle, notamment par une tendance nette à la désyndicalisation (en termes d'effectifs ou d'implication des ouvriers dans la vie syndicale),
- l'emploi de la répression, même s'il sera "modéré" dans les pays avancés dans la période qui vient, conduira en fin de compte à une prise de conscience de la nécessité de s'affronter directement et massivement à l'Etat.
En fin de compte, l'impasse économique totale du capitalisme, la misère croissante dans laquelle ce système va plonger la classe ouvrière, vont épuiser progressivement l'ensemble des mystifications qui ont permis jusqu'à présent à la bourgeoisie de maintenir son contrôle sur la société et, notamment, celles du "Welfare State". S'il est donc vain de s'attendre dans les pays centraux du capitalisme pour la période qui vient à des "sauts qualitatifs" brusques, à de soudains surgissements de la grève de masse, il est par contre nécessaire de souligner la tendance des affrontements qui ont d'ores et déjà commencé, à prendre un caractère de plus en plus massif, puissant, et simultané.
En ce sens, comme il l'a déjà été dit, "la crise reste la meilleure alliée du prolétariat mondial".
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Où en est la crise ? : Le mythe de la reprise économique
- 2602 lectures
La bourgeoisie fait grand cas d'une soi-disant "reprise" économique qui marquerait la victoire des politiques d'austérité à la Reagan. L'OCDE, dans ses PERSPECTIVES ECONOMIQUES de décembre 83, commence son rapport par une affirmation presque triomphante : "La reprise de l'activité concerne désormais presque tous les pays de l'OCDE". Et de relever une série de points positifs : croissance du PNB et de la production industrielle, ralentissement de l'inflation, réduction des déficits budgétaires, augmentation des profits. Deux pages plus loin, l'OCDE écrit : "Si cette appréciation se révélait fausse, il faudrait revoir les prévisions quant à la vigueur et à la persistance de la reprise. " ... Ce genre de phrase montre à quel point la bourgeoisie elle-même a confiance en ce qu'elle annonce à grand fracas.
Il est un fait indéniable que plusieurs indicateurs économiques sont devenus positifs en 83 alors qu'ils étaient négatifs en 82, ce qui signifie que l'année 83 est moins pire que la précédente, du moins pour la bourgeoisie. De là à parler de reprise économique réelle il y a plus qu'un pas, il y a un fossé. Avant d'en analyser les causes et les perspectives, examinons brièvement la réalité de cette "reprise".
LA CROISSANCE DU PNB ET DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Cette croissance est pratiquement limitée aux Etats-Unis, et atteint des chiffres plutôt miserables. Le PNB a progressé de 3.5% en 83 aux Etats-Unis, mais n'atteint péniblement que 1% en Europe. La croissance de la production industrielle atteint 6% aux Etats-Unis, mais ne parvient même pas à compenser la chute de 82 (-8.1%) : au total des deux années le bilan reste à une baisse de -2.6% ! Quant aux pays européens, ils connaissent une croissance de leur production industrielle magnifique, puisqu'elle varie de ... -4.3% en Italie à 1% en Grande-Bretagne !
L'UTILISATION DES FORCES PRODUCTIVES
La sous-utilisation des forces productives est une des manifestations les plus claires de la surproduction. Malgré une augmentation de 10% par rapport à 82, le taux d'utilisation des capacités industrielles n'a pas dépassé 80% aux Etats-Unis. Quant au chômage, contrairement aux miracles annoncés, il n'a baissé, à l'échelle annuelle, que de 0.2% aux Etats-Unis, tandis qu'il a poursuivi sa progression hallucinante dans TOUS les pays Européens.
En pourcentage de la population active chiffres corrigés des variations saisonnières
LES INVESTISSEMENTS
Les investissements des entreprises ont continué à décliner, malgré la "reprise". Comme ces investissements sont la base d'une reprise à long terme, la bourgeoisie montre par là qu'elle ne croit pas elle-même en une telle reprise.
LE COMMERCE MONDIAL
Celui-ci a stagné en 83, après une baisse globale de 2% en 1982.
L'ensemble de ces chiffres (tirés pourtant des statistiques officielles de la bourgeoisie : OCDE) prouve sans conteste que, si le capitalisme connaît un pallier momentané dans l’approfondissement. de la crise, il ne s'agit nullement d'une reprise économique réelle. La seule évolution positive dont peut se targuer la bourgeoisie est la réduction effective de l'inflation, mais nous verrons plus loin ce que signifie cette réduction. L'existence d'un léger mieux temporaire dans un cours général vers l'effondrement ne fait que traduire le profil en dents de scie qui a toujours caractérisé l'évolution de l'économie capitaliste. L'important est de voir dans quel sens est orientée la scie : les dents sont aujourd'hui inclinées vers le bas, sans aucune perspective d'inversion de la tendance.
Après la récession profonde de 1975, la bourgeoisie occidentale a réagi en recourant massivement à l'usage de sa drogue classique : le crédit, l'impression de papier monnaie sans contrepartie économique. Les Etats-Unis ont joué à ce niveau un rôle de premier plan, la multiplication des dollars et le déficit de leur balance de paiements ayant un effet de locomotive sur l'ensemble de l'économie mondiale. C'est la faillite de cette politique au travers d'une inflation mondiale démesurée qui a poussé la bourgeoisie à renverser la tendance et à développer les conceptions monétaristes. L'histoire ne se répète pas, et aujourd'hui la bourgeoisie n'a plus les moyens de reproduire le même scénario, car le spectre d'un effondrement du système financier international, reste présent de façon constante, même sans inflation, ne fut-ce qu'à cause de l'endettement colossal de la plupart des Etats qui n'a fait que s'aggraver avec la hausse du dollar. C'est ainsi que, malgré la fameuse "reprise", les Etats-Unis ont enregistré un record de faillites bancaires en 83.
Le "truc" inventé par la bourgeoisie américaine pour stimuler l'économie sans engendrer d'inflation consiste essentiellement à provoquer un transfert de capitaux entre ses mains. D'une part, grâce à des taux d'intérêts exceptionnellement élevés, les Etats-Unis attirent les capitaux du monde entier et rapatrient la masse des dollars dispersés à l'étranger. D'autre part, la réduction générale des salaires dans le monde et la forte augmentation de la productivité du travail permettent d'accroître sensiblement le capital revenant à la bourgeoisie sous forme de plus-value. Ce double mouvement d'appauvrissement du prolétariat et des autres pays relativement aux Etats-Unis, fournit à ceux-ci les ressources nécessaires pour financer leurs déficits budgétaire, commercial et des opérations courantes. Ces derniers se sont considérablement accrus au cours de la dernière année, montrant que les discours monétaristes de Reagan ne sont en définitive que du bluff. Le déficit du budget fédéral a triplé en deux ans passant de 70 milliards de dollars en 1981 à 179 milliards en 1983 ; celui de la balance commerciale a doublé en un an passant de 36 milliards de dollars en 82 à 63 milliards de dollars en 83 ; celui des opérations courantes a quadruplé en un an, passant de 11 à 42 milliards de dollars.
Ces chiffres astronomiques, qui cependant se sont accompagnés d'une diminution de l'inflation et d'une appréciation du dollar contrairement à la logique économique apparente, traduisent bien l'énorme drainage de capitaux vers les Etats-Unis qui s'opère aujourd'hui. Il dévoile par la même occasion toutes les limites de la "reprise" actuelle. Contrairement à ce qui s'était passé à la fin des années 70, les Etats-Unis ne sont plus aujourd'hui à même de jouer un rôle de "locomotive" pour l'économie mondiale. Bien qu'ils recommencent à importer une grande quantité de marchandises, l'effet d'entraînement que pourrait constituer la poursuite de cette politique est partiellement annulé par le transfert de capitaux dans le même sens et par le renchérissement des matières premières libellées en dollars (exemple : pétrole). L'amélioration de la situation économique aux Etats-Unis, qui - comme nous l'avons vu - n'a pourtant rien de spectaculaire, s'accompagne aussi d'une stagnation des économies européennes, qui n'est pas destinée à se modifier qualitativement.
A plus long terme, le mécanisme actuel de la "reprise" aux Etats-Unis annonce un avenir catastrophique pour l'économie mondiale. La surévaluation actuelle du dollar, conséquence des hauts taux d'intérêt américains, permet aux Etats-Unis d'importer à bon marché, mais détériore la compétitivité de leurs secteurs exportateurs, ce qui aggrave encore le déficit commercial. Sous la pression de la loi de la valeur, le dollar est condamné à dévaluer et toute la belle mécanique à l'oeuvre aujourd'hui éclatera comme une baudruche. A ce moment, les déficits budgétaire et commercial américains, que l'on laisse gonfler de façon spectaculaire, ne seront plus compensés, et l'inflation masquée par les hauts taux d'intérêt et les mouvements de capitaux apparaîtra au grand jour.
Le capitalisme se trouvera alors dans une situation dix fois empirée et sera précipité dans des gouffres de plus en plus profonds.
M.L.
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Les communistes et la question nationale (1900-1920) 2ème partie
- 3113 lectures
Le débat pendant la guerre impérialiste
Dans le premier article de cette série, paru dans le numéro 34 de la Revue Internationale , nous avons examiné l'attitude des communistes sur la question nationale à l'aube de la décadence du capitalisme et notamment le débat entre Lénine et Rosa Luxemburg sur la question du soutien de la classe ouvrière au "droit des nations à 1'auto-détermination". Nous avons conclu que, même lorsque certaines luttes de libération nationale pouvaient encore être considérées comme progressistes du point de vue des intérêts de la classe ouvrière, un tel mot d'ordre devait être rejeté.
Avec l'éclatement de la guerre en 1914, toute une série de questions nouvelles se sont posées au mouvement ouvrier. Dans cet article, nous nous proposons d'examiner les premières tentatives des communistes pour en débattre et leurs implications quant à la question du soutien à toutes les luttes nationalistes.
Une des fonctions propres aux révolutionnaires consiste à faire de leur mieux pour analyser la réalité à laquelle la classe se trouve confrontée. Au cours de la première guerre mondiale, le débat au sein des fractions de la "Gauche de Zimmerwald" sur les luttes de libérations nationales, tentait de répondre, pour une bonne part, à ce souci, afin de mettre en évidence les conditions auxquelles la lutte de classe se trouvait confrontée, conditions nouvelles, sans précédent de la guerre capitaliste mondiale, de l'impérialisme déchaîné et du contrôle massif de l'Etat-
Soixante ans plus tard, le débat n'est plus le même; les révolutionnaires se doivent de ne pas répéter ses inadéquations et erreurs. L'expérience de la classe a apporté des réponses, de même qu'elle a soulevé de nouveaux problèmes. Et si les minorités politiques n'adoptent plus le même esprit de critique impitoyable et d'investigation pratique, en restant attachées aux mots d'ordre propres à la période ascendante du capitalisme, elles faillissent à leurs devoirs fondamentaux et rejettent toute la méthodologie de Lénine, Luxemburg et des fractions de gauche. C'est cette méthodologie qui a amené le CCI à rejeter les positions de Lénine sur la question nationale et à développer la contribution faite par Rosa Luxemburg
La question nationale dans la gauche de Zimmerwald
Les révolutionnaires qui sont restés fidèles à l'esprit du Manifeste Communiste et à son cri de ralliement - "Les prolétaires n'ont pas de patrie. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se sont regroupés dans le mouvement de Zimmerwald composé des opposants à la guerre mais ils ont été rapidement contraints de s'organiser en aile gauche au sein de ce mouvement afin de défendre une position de classe claire contre les tendances réformistes et pacifistes de la majorité. La gauche de Zimmerwald fut fondée en 1915 sur la base de rassemblement suivante :
- reconnaissance de la nature impérialiste de la guerre, contre le mensonge de « la défense de la patrie »;
- reconnaissance de la nécessité de la lutte pour le pouvoir politique et de la révolution prolétarienne comme unique réponse à l'impérialisme;
- reconnaissance du fait que le début de cette lutte serait une lutte active contre la guerre.
Tout en ne rejetant ni le vieux programme minimum de la social-démocratie ni la lutte pour des réformes au sein du capitalisme, cette lutte devait désormais être menée "en vue d'aiguiser toute crise sociale et politique du capitalisme en général, de même que la crise causée par la guerre et de transformer cette lutte en une attaque contre la forteresse fondamentale du capitalisme .. Sous le mot d'ordre de socialisme, cette lutte rendra les, masses laborieuses imperméables au mot d'ordre de l'asservissement d'un peuple par un autre..."
(Projet de Résolution de la Gauche de Zimmerwald, 1915).
Malgré un attachement persistant au programme minimum, qui était approprié à la période ascendante du capitalisme, les positions de la Gauche de Zimmerwald reflétaient le constat d'une rupture dans la période historique et dans le mouvement ouvrier lui-même. Désormais, il ne pouvait plus être question pour le prolétariat de soutenir les mouvements nationalistes bourgeois en vue de faire avancer la lutte pour la démocratie dans le cadre d'un capitalisme encore en pleine expansion. L'attitude du prolétariat envers la question nationale était maintenant inséparable de la nécessité de lutter contre la guerre impérialiste et, plus généralement, contre le capitalisme impérialiste lui-même, avec comme objectif de créer les conditions pour la prise de pouvoir révolutionnaire du prolétariat.
Dans la Gauche de Zimmerwald, le Parti Bolchevik exprimait déjà clairement l'attitude générale, historique des révolutionnaires face aux luttes de libération nationale :
"Les guerres réellement nationales qui ont eu lieu, notamment dans la période de 1789-1871, étaient 1'expression de mouvements nationaux de masse, d'une lutte contre l'absolutisme et le système féodal, pour 1'abolition de l'oppression nationale et la création d'Etats sur une base nationale, condition préalable du développement capitaliste.
L'idéologie nationale engendrée par cette époque a laissé des traces profondes dans la masse de la petite bourgeoisie et dans une partie du prolétariat. C'est ce dont profitent actuellement, à une époque toute différente, celle de l'impérialisme, les sophistes de la bourgeoisie et les traîtres au socialisme qui rampent à leur suite, afin de diviser les ouvriers et de les détourner de leurs tâches de classe et de la lutte révolutionnaire contre la bourgeoisie.
Les paroles du Manifeste Communiste : "Les ouvriers n'ont pas de patrie", sont aujourd'hui plus justes que jamais. Seule la lutte internationale du prolétariat contre la bourgeoisie peut sauvegarder ses conquêtes et ouvrir aux masses opprimées la voie d'un avenir meilleur. "
(Résolution de la Conférence de Berne des sections à l'étranger du POSDR, mars 1915 - Lénine, Oeuvres T.21, p. 158-159)
C'est dans ce cadre que prit place le débat entre les différentes fractions de la Gauche de Zimmerwald sur la question nationale. Ce débat, mené essentiellement entre les communistes d'Europe occidentale et Lénine s'était focalisé à l'origine sur la question : est-il encore possible pour le prolétariat d'apporter son soutien au "droit des nations à 1'auto-détermination" ? Il reprenait en grande partie les grandes lignes de la polémique d'avant-guerre entre Lénine et Rosa Luxemburg; mais il devait s'élargir et s'ouvrir sur deux questions fondamentales posées par l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste, sa décadence :
1 - Etait-il encore possible pour le prolétariat de lutter au sein du capitalisme pour un "programme minimum" de revendications démocratiques (y compris le "droit à l'autodétermination") ?
2 - Des guerres nationales progressistes étaient-elles encore possibles qui auraient justifié le soutien du prolétariat à la bourgeoisie ?
Alors qu'à ces deux questions Lénine répondit "oui", d'autres telles que les gauches Allemande, Hollandaise et Polonaise, de concert avec le groupe Kommunist autour de Boukharine et Piatakov au sein du Parti Bolchevik, commencèrent timidement à répondre "non", rejetant définitivement le mot d'ordre de l'autodétermination et tentant de définir les taches du prolétariat face aux conditions nouvelles du capitalisme décadent. Ce furent ces fractions, tendant vers des positions cohérentes autour de la théorie de l'impérialisme défendue par Rosa Luxemburg, qui ont le mieux réussi à s'affronter à la question nationale dans la décadence, et non pas les combats d'arrière-garde de Lénine qui répugnait à apporter des éléments quant à 1' obsolescence du programme minimum soi-disant encore apte à jouer un rôle vital dans la révolution prolétarienne en Russie et dans les pays arriérés d'Europe de l'Est et d'Asie.
Est-il encore possible de lutter pour la "démocratie" ?
Quand, à la Conférence de Berne du Parti Bolchevik en 1915, Boukharine s'opposa au droit des nations à l'autodétermination en tant que tactique prolétarienne, Lénine fut le premier à insister sur le fait qu'on ne peut rejeter un seul aspect de la lutte du prolétariat pour la démocratie sans remettre en question cette lutte elle-même dans son ensemble : si la revendication de l'autodétermination était impossible à l'époque de l'impérialisme, pourquoi ne pas rejeter toutes les autres revendications démocratiques ?
Lénine posait le problème de la façon suivante : comment relier l'avènement de l'impérialisme à la lutte pour des reformes et pour la démocratie ? Pourtant, il dénonça la position de Boukharine qu’il qualifia d'"économisme impérialiste", c'est-à-dire un rejet de la nécessité de la lutte politique et, par conséquent, une capitulation devant l'impérialisme.
Mais Boukharine ne rejetait nullement la nécessité de la lutte politique, mais son identification à la lutte pour le programme minimum.
Boukharine et le groupe "Komminist" posaient le problème en termes de nécessité pour le prolétariat de rompre de façon décisive avec les méthodes du passe et d'adopter une nouvelle tactique et des mots d'ordre répondant à la nécessité de détruire le capitalisme par la révolution prolétarienne. Alors que les communistes avaient défendu fermement la lutte pour la démocratie, ils y étaient désormais opposés.
Comme l'exprima de façon plus complète Boukharine dans un développement ultérieur de cette position :
"... il est parfaitement clair, a priori, que les mots d'ordre et buts spécifiques du mouvement dépendent entièrement du caractère de l'époque dans laquelle le prolétariat en lutte doit agir. La période passée était celle d'un rassemblement des forces et d'une préparation pour la révolution. La période présente est celle de la révolution elle-même, et cette distinction fondamentale implique également des différences profondes dans les mots d'ordre et buts concrets du mouvement. Dans le passé, le prolétariat avait besoin de la démocratie parce qu'il n'était pas encore en mesure d'envisager l'établissement de sa propre dictature. La démocratie était précieuse pour autant qu'elle aidait le prolétariat à élever d'un pas sa conscience, mais le prolétariat était obligé de présenter ses revendications de classe dans une forme "démocratique"... Cependant, il n'est pas besoin de faire nécessité vertu... L'heure est venue d'un assaut direct de la forteresse capitaliste et de l'élimination des exploiteurs..."
(La théorie de la Dictature du Prolétariat, 1919)
Puisque l'époque de la démocratie bourgeoise progressiste était désormais révolue et que l'impérialisme était inhérent à la survie du capitalisme, les revendications anti-impérialistes maintenant intacts les rapports de production capitalistes étaient devenus utopiques et réactionnaires.
L'unique réponse à l'impérialisme ne pouvait être que la révolution prolétarienne :
"La social-démocratie ne doit pas avancer de revendications 'minimum' dans les conditions présentes de la politique internationale... Toute mise en avant de tâches 'partielles', de 'libération des nations' dans le cadre du système capitaliste, signifie un détournement des forces prolétariennes de la véritable solution du problème, et leur fusion avec les forces des groupes bourgeois nationaux correspondants.. . Le mot d'ordre d''autodétermination' des nations est avant tout utopique (il ne peut être réalisé dans les limites du capitalisme) et nuisible comme mot d'ordre qui sème des illusions. En ce sens, il ne diffère nullement des mots d'ordre sur les "cours d'arbitrage", sur le "désarmement", etc., qui présupposent la possibilité d'un soi-disant capitalisme pacifique",
(Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915)
Mais Boukharine allait plus loin dans son rejet du programme minimum à l'ère de l'impérialisme, en montrant la nécessité d'utiliser une tactique et des mots d'ordre exprimant la nécessité pour le prolétariat de détruire l'Etat capitaliste.
Alors que dans la période ascendante du capitalisme l'Etat avait assuré les conditions générales de l'exploitation par des capitalistes individuels, l'époque de l'impérialisme a donné naissance à un appareil d'Etat militariste exploitant directement le prolétariat avec le passage de la propriété individuelle du capital à la propriété collective à travers une unification des structures capitalistes (en trusts, syndicats, etc.), et la fusion de ces structures avec l'Etat. Cette tendance au capitalisme d'Etat s'étend de la sphère économique à toutes les sphères de la vie sociale :
"Toutes ces organisations ont tendance à fusionner entre elles, et à se transformer en une seule organisation des exploiteurs. Telle est l'étape la plus récente du développement, étape qui est devenue particulièrement évidente pendant la guerre... Ainsi surgit une organisation unique, absorbant toutes les autres : 1'Etat impérialiste pirate moderne, organisation omnipotente de la domination bourgeoise.. . et si seuls les Etats les plus avancés ont jusque là atteint cette étape, chaque jour, et en particulier chaque jour de guerre, tend à généraliser cet état de fait."
(L'Etat Pirate Impérialiste, 1915).
La seule force capable d'affronter cette unité des forces de toute la bourgeoisie ne pouvait être que 1 'action de masse du prolétariat. Dans ces conditions nouvelles, le mouvement révolutionnaire avait besoin, par dessus tout, de manifester son opposition à l'Etat, ce qui impliquait le rejet de tout soutien à quelque pays capitaliste que ce soit ([1] [35]).
Ce fut contre cette attaque impitoyable du programme minimum et contre le rejet de l'autodétermination exprimés par la majorité des Gauches d'Europe occidentale que Lénine écrivit ses Thèses sur la révolution socialiste et le droit des nations à l'autodétermination au début de 1916.
Dès le début, la nécessité d'éviter tout soutien objectif à la démocratie bourgeoise réactionnaire et à l'Etat démocratique le contraignit à adopter une position défensive. Il devait ainsi tomber d'accord avec Boukharine sur le fait que :
- "La domination du capital financier, comme celle du capital en général, ne saurait être éliminée par quelque transformation que ce soit dans le domaine de la démocratie politique; or, l'autodétermination se rapporte entièrement et exclusivement à ce domaine." (Thèse n°2, Oeuvres, T.22)
- "... toutes les revendications fondamentales de la démocratie politique, qui à l'époque de l'impérialisme, ne sont 'réalisables' qu'incomplètement, sous un aspect tronqué et à titre tout à fait exceptionnel (par exemple, la séparation de la Norvège d'avec la Suède, en 1905). " (Ibid. ) ([2] [36]) .
- La formation de nouvelles nations (Pologne, Inde, etc..) dans le futur, serait le produit de "quelque changement insignifiant" dans la politique et les rapports stratégiques entre les principales puissances impérialistes.
La position de Lénine était également basée sur la reconnaissance du fait que la nature de la nouvelle période exigeait une rupture avec les anciennes méthodes réformistes de lutte :
"... il est nécessaire de formuler toutes ces revendications et de les faire aboutir non pas en réformistes, mais en révolutionnaires ; non pas en restant dans le cadre de la légalité bourgeoise, mais en le brisant, en entraînant les masses à l'action, en élargissant et en attisant la lutte autour de chaque revendication démocratique fondamentale jusqu'à l'assaut direct du prolétariat contre la bourgeoisie, c'est-à-dire jusqu'à la révolution socialiste, qui exproprie la bourgeoisie." (Ibid.)
Le capitalisme et l'impérialisme ne pourraient être renversés qu'à travers une révolution économique. Néanmoins :
"Ce serait une erreur capitale de croire que la lutte pour la démocratie est susceptible de détourner le prolétariat de la révolution socialiste ou d'éclipser celle-ci, de 1'estomper, etc. Au contraire, de même qu'il est impossible de concevoir un socialisme victorieux qui ne réaliserait pas la démocratie intégrale, de même le prolétariat ne peut se préparer à la victoire sur la bourgeoisie s'il ne mène pas une lutte générale, systématique et révolutionnaire pour la démocratie." (Ibid.)
Telle était, dans les grandes lignes, toute l'argumentation de Lénine, mais, si l'on tient compte des arguments avancés contre lui à la même époque, deux questions étaient restées sans réponse :
- à l'époque de l'impérialisme, alors que la démocratie bourgeoise était devenue réactionnaire, quel était le contenu de cette lutte pour la démocratie ?
- comment le prolétariat pourrait-il, dans la pratique, éviter tout soutien à l'appareil militariste et impérialiste de l'Etat ?
Lénine était indéniablement au fait de ces problèmes, mais il ne pouvait pas les résoudre.
Il était d'accord avec le fait que l'impérialisme avait fait de la démocratie une illusion, mais, par ailleurs, il continuait d'encourager les « aspirations démocratiques » des masses; de ce fait, il existait un antagonisme entre l'impérialisme en tant que négation de la démocratie et la "lutte" des masses pour la démocratie. Ce qui était condensé dans la position de Lénine c'était la poursuite de la nécessité, pour la classe ouvrière, de lutter non pas pour détruire l'Etat capitaliste
- du moins, pas dans l'immédiat - mais au sein de celui-ci, d'utiliser ses institutions afin d'obtenir des réformes démocratiques :
"La solution marxiste au problème de la démocratie consiste en l'utilisation par le prolétariat de toutes les institutions démocratiques dans sa lutte de classe contre la bourgeoisie afin de se préparer à leur renversement et d'assurer sa propre victoire."
(Lénine, Réponse à Kiewsky (Y. Piatakov), 1916)
Avant la révolution de Février, Lénine défendait, en compagnie de Kautsky, l'idée suivant laquelle l'attitude marxiste envers l'Etat consistait à pousser le prolétariat à s'emparer du pouvoir d'Etat et à l'utiliser pour construire le socialisme.
Il critiquait la position de Boukharine comme non marxiste et semi- anarchiste, affirmant de nouveau que les socialistes étaient pour l'utilisation des institutions étatiques existantes.
Mais dans l'élaboration de sa propre réponse à Boukharine en 1916, il revint sur sa position et retourna aux écrits originaux de Marx sur la nécessité de détruire l'appareil d'Etat bourgeois, insistant sur la signification réelle de l'apparition des soviets en 1905 : en tant que forme spécifique de la dictature du prolétariat, alternative au pouvoir de l'Etat bourgeois. Sa réfutation de Boukharine fut remplacée par la brochure mieux connue sous le titre de L'Etat et la Révolution, qui appelle clairement à la destruction de l'Etat bourgeois.
Cependant, malgré cette clarification essentielle dans son attitude envers l'Etat, malgré sa lutte acharnée pour la réalisation du mot d'ordre "Tout le pouvoir aux soviets" en octobre 17, Lénine n'a jamais renoncé à sa conception théorique de la "révolution démocratique". Ainsi, par exemple, alors que dans ses Thèses d'Avril il concluait que, dans la mesure ou le pouvoir d'Etat était maintenant passé aux mains de la bourgeoisie, "la révolution démocratique bourgeoise en Russie est complète" , il incluait encore dans son programme la nécessité pour le prolétariat d'accomplir des tâches bourgeoises, démocratiques, y compris la défense de l'autodétermination, dans la lutte pour le pouvoir des soviets.
Suivant l'expression de Boukharine, sa position sur la question nationale restait "pro-étatique", encore largement influencée par les conditions auxquelles se trouvait confronté le prolétariat des pays capitalistes sous-développés, et fondée sur des conceptions obsolètes plus appropriées à la période ascendante du capitalisme qu'à la période de décadence impérialiste.
Les guerres nationales sont-elles encore progressistes ?
Puisque la période des guerres nationales correspondait à une période historique déterminée - en gros comprise entre 1789 et 1871 - la question qui était posée était de savoir, premièrement, si cette période était définitivement révolue avec l'éclatement de la guerre en 1914, et deuxièmement, étant donnée la nature incontestablement impérialiste et réactionnaire de cette guerre, si cette nature était devenue une caractéristique générale et irréversible des guerres dans la nouvelle période. De nouveau, alors que les Gauches européennes commençaient timidement à répondre par l'affirmative à ces deux questions, Lénine hésitait à admettre ces réponses, malgré un degré d'accord assez important.
Cette question dans son ensemble était évidemment essentielle pour la Gauche à Zimmerwald, qui dénonça, au milieu de la guerre impérialiste, les mensonges de la bourgeoisie sur la défense de la patrie et la nécessité de mourir pour son pays; si certaines guerres pouvaient encore être qualifiées de progressistes et révolutionnaires, alors les internationalistes pouvaient, dans ce cas particulier, appeler les ouvriers à défendre leur patrie.
Comme Boukharine l'avait mis en avant avec la guerre, cette question était devenue une frontière de classe :
" Le problème de tactique le plus important à notre époque est celui de la prétendue défense nationale. Cette question montre exactement où se trouve tracée la ligne de démarcation entre l'ensemble du monde bourgeois et l'ensemble du monde prolétarien. Ce mot lui-même contient une supercherie car il ne concerne pas réellement le pays en tant que tel, c'est-à-dire sa population, mais son organisation étatique."
(L'Etat Pirate Impérialiste).
Par conséquent : "La tâche de la social-démocratie à l'heure actuelle consiste à mener une propagande pour l'indifférence en ce qui concerne la 'patrie', la 'nation' etc., ce qui présuppose de poser la question non pas d'un point de vue 'pro-étatique'... (protestation contre une 'desintégration' de l'Etat) mais au contraire, d'un point de vue clairement révolutionnaire à l'égard du pouvoir d'Etat et du système capitaliste dans son ensemble,"
(Thèse 7, Thèses sur le droit à l'autodétermination, 1915T
Boukharine démontrait que si le mot d'ordre de l'autodétermination était concrètement appliqué (c'est-à-dire en garantissant l'indépendance et le droit à la sécession) dans les conditions de la guerre impérialiste, il ne deviendrait rien d'autre qu une variante du mot d'ordre de la "défense de la patrie", puisqu'il faudrait défendre concrètement les frontières du nouvel Etat indépendant dans l'arène impérialiste; sinon, que pouvait recouvrir en réalité une telle revendication ? Dans une telle situation, les forces internationalistes du prolétariat seraient éclatées et sa lutte de classe canalisée sur un terrain nationaliste :
" Il découle de là qu'en aucun cas et sous aucun prétexte nous ne soutiendrons le gouvernement d'une grande puissance qui réprime le soulèvement d'une nation opprimée; pas plus que nous ne mobiliserons les forces prolétariennes derrière le mot d'ordre du « droit des nations à l'autodétermination ». Dans une telle situation, notre tâche consiste à mobiliser les forces du prolétariat des deux nations (unies aux autres) derrière le mot d'ordre de la guerre civile, de la guerre de classe pour le socialisme, et à mener campagne contre la mobilisation derrière le mot d'ordre du 'droit des nations'...» (Thèse 8, Ibid. )
La Gauche Allemande, dont les fondements résident dans la théorie de Rosa Luxemburg, qui, dans la Brochure de Junius avait affirmé qu'aujourd'hui "la phrase nationale... ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisée comme cri de guerre dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes", s'éleva elle aussi clairement contre l'idée des guerres nationales progressistes à l'époque de l'impérialisme :
"A l'époque de cet impérialisme déchaîné, il ne peut plus y avoir de guerres nationales. Les intérêts nationaux ne sont qu'une mystification qui a pour but de mettre les masses populaires laborieuses au service de leur ennemi mortel : 1'impérialisme. "
(Thèse 5, Thèses sur les taches de la social-démocratie internationale, complément à la Brochure de Junius, 1916).
Dans sa riposte vigoureuse, Lénine revint en arrière en faisant cette conclusion générale sur la nature de la nouvelle période :
- le caractère incontestablement impérialiste de la guerre mondiale n'impliquait pas que les guerres nationales n'étaient plus possibles. Au contraire, elles étaient à la fois inévitables et progressistes;
- alors que la défense de la patrie était réactionnaire pour ce qui concerne une guerre entre des puissances impérialistes rivales, dans une guerre nationale "authentique" les socialistes n'étaient pas opposés au fait d'appeler à la défense nationale.
Lénine ne pouvait pas concevoir que l'entrée du capitalisme dans sa phase impérialiste dictait la nature réactionnaire de toute guerre, insistant sur la nécessité d'une évaluation concrète de chaque guerre prise séparément; il refusa également de voir que la nature impérialiste évidente des pays avancés d'Europe et d'Amérique signifiait qu'un changement s'était opéré dans l'ensemble du système capitaliste, changement auquel même les1 pays arriérés d'Asie et d'Afrique ne pouvaient échapper. Dans les pays capitalistes avancés, la période des guerres nationales était révolue depuis longtemps, mais en Europe de l'Est et dans les pays semi-coloniaux et coloniaux les révolutions bourgeoises étaient encore à l'ordre du jour; dans ces pays, les luttes de libération nationales contre les plus grandes puissances impérialistes n'étaient pas encore lettre morte, et par conséquent, la défense de l'Etat national était encore progressiste. En outre, même en Europe, on ne pouvait considérer les guerres nationales des petites nations annexées ou opprimées par les grandes puissances comme impossibles (bien qu'il sous-entendait qu'elles étaient improbables).
Il citait l'exemple hypothétique de la Belgique annexée par l'Allemagne au cours de la guerre pour illustrer la nécessité pour les socialistes de soutenir même le "droit" de la bourgeoisie belge "opprimée" à l'autodétermination.
L'hésitation de Lénine à adhérer aux arguments, de loin les plus cohérents, de la Gauche Allemande, sur l'impossibilité des guerres nationales résultait principalement de son souci pratique de ne pas rejeter tout mouvement ou événement qui pourrait accélérer une crise dans le système capitaliste, crise que le prolétariat pourrait mettre à profit :
"La dialectique de l'histoire fait que les petites nations, impuissantes en tant que facteur indépendant dans la lutte contre l'impérialisme, jouent le rôle d'un des ferments,d'un des bacilles qui favorisent 1'entrée en scène de la force véritablement capable de lutter contre 1'impérialisme, à savoir : le prolétariat socialiste.
Nous serions de piètres révolutionnaires si, dans la grande guerre libératrice du prolétariat pour le socialisme, nous ne savions pas tirer profit de tout mouvement populaire dirigé contre tel ou tel fléau de l'impérialisme, afin d'aggraver et d'approfondir la crise."
(Bilan d'une discussion sur le droit des nations à |disposer d' elles-mêmes, chap.10. Oeuvres, T. 22 ).
Ce n'était pas le sort des mouvements nationalistes en eux-mêmes qui l'intéressait mais uniquement leur capacité à affaiblir l'emprise des grandes puissances impérialistes au milieu de la guerre mondiale; et par conséquent, il mettait le soulèvement irlandais de 1916 sur le même plan que les révoltes coloniales en Afrique et les mutineries dans les troupes coloniales en Inde, à Singapour etc. , comme autant de signes annonciateurs de l'approfondissement de la crise de l'impérialisme.
Prenons comme exemple concret celui du soulèvement nationaliste irlandais de 1916 pour illustrer certains dangers d'une telle approche. Pour Lénine, cette rébellion était la preuve de la validité de sa position suivant laquelle l'encouragement aux aspirations nationalistes des nations opprimées ne pouvait être qu'un facteur actif et positif dans la lutte contre l'impérialisme; et ceci contre la position de certains autres tels que Radek et Trotsky qui affirmaient qu'il s'agissait d'un putsch désespéré sans appui sérieux montrant, au contraire, que la période des luttes de libération nationale était terminée. Lénine ne soutenait pas qu'il existait un mouvement de masse prolétarien derrière cette rébellion, qui se présentait elle-même comme un "combat de rue menée par un secteur de la petite bourgeoisie urbaine et un secteur de la classe ouvrière" : le problème réel résidait dans la nature de classe de ces révoltes nationalistes ou, en d'autres termes : de tels mouvements participent-ils au renforcement de la "seule force anti-impérialiste, le prolétariat socialiste" (Lénine) ou de la bourgeoisie impérialiste ?
Lénine attribuait de façon dangereuse un potentiel anti-capitaliste à ces actions nationalistes, il disait que, malgré leurs lubies réactionnaires, "elles attaqueront objectivement le capital" (ibid.), et que le prolétariat devait seulement s'y associer et les diriger pour faire avancer le processus de la révolution sociale. Cependant, sans entrer dans toute l'histoire de la "question irlandaise", nous pouvons dire brièvement qu'elle contient des faits contredisant cette idée.
La révolte irlandaise de 1916 marqua du sceau du nationalisme la lutte de classe du prolétariat en Irlande - déjà affaibli par la défaite partielle de ses luttes d'avant-guerre - en mobilisant activement les ouvriers dans la lutte armée du nationalisme catholique de l'Irlande du sud. Malgré le manque de sympathie existant au sein des masses ouvrières pour ce putsch militaire désespéré, les campagnes massives de terreur de l'Etat britannique qui s'ensuivirent n'ont fait qu'achever la désorientation des ouvriers et que les conduire dans le giron des nationalistes réactionnaires; cela s'est traduit par un massacre et le sabotage systématique des dernières manifestations de la lutte autonome de la classe contre le capital, sabotage mené tant par les Anglais "noirs et jaunes" que par l'IRA républicaine. La défaite de cette fraction relativement faible et isolée du prolétariat mondial, défaite imposée par l'unification des forces de la bourgeoisie irlandaise et britannique, ne faisait que traduire un renforcement de l'impérialisme mondial dont l'intérêt majeur est toujours la défaite de son ennemi mortel. La rébellion irlandaise prouvait uniquement que toutes les fractions bourgeoises, y compris les nations soi-disant opprimées, se rangent du côté de l'impérialisme lorsqu'elles se trouvent confrontées à la menace de destruction du système d'exploitation, condition du maintien de leurs privilèges.
A condition d'être clairvoyants, les révolutionnaires, aujourd'hui, ne peuvent que conclure que l'histoire a donné tort à Lénine, et que les Gauches, malgré leurs confusions, avaient vu juste pour l'essentiel. La leçon qu'il s'agit de tirer de la révolte irlandaise réside dans la compréhension que tout soutien au nationalisme conduit directement à subordonner la lutte de classe aux guerres impérialistes de la période de décadence du capitalisme.
LENINE CONTRE LES "LENINISTES"
L'exhortation de Lénine au soutien à toute révolte nationaliste a été inévitablement utilisée par la bourgeoisie comme prétexte pour plonger les ouvriers et les paysans dans d'innombrables bains de sang derrière le drapeau du nationalisme et de 1'"anti-impérialisme". Cependant, une rivière de sang sépare encore les pires erreurs de Lénine des "meilleures" positions défendues par ceux qui prétendent être ses véritables héritiers : les bourreaux du prolétariat, qu'ils soient staliniens, trotskystes ou maoïstes.
Il est également nécessaire de sauver le véritable contenu critique des écrits de Lénine de certaines déformations comme celles du PCI (Programme Communiste) entre autres, qui, bien que celui-ci appartienne au milieu révolutionnaire, préfèrent également rester attachées à toutes les erreurs du passé, même lorsqu'elles mènent dangereusement à la défense des fractions capitalistes les plus réactionnaires sous couvert de "libération nationale" (cf. Revue Internationale n°32, pour une analyse plus développée des erreurs du PCI et de sa récente décomposition).
Lénine a toujours été conscient des dangers pour les révolutionnaires de soutenir le nationalisme; il insistait constamment sur la nécessité pour le prolétariat de préserver son unité et son autonomie face à toutes les forces bourgeoises même si cela devait rendre sa position encore plus inapplicable et contradictoire dans la pratique.
Et même lorsqu'il appelait les révolutionnaires à soutenir chaque révolte contre l'impérialisme, il ajoutait « à condition qu'il ne s'agisse pas de la révolte d'une classe réactionnaire. »
Ce que les Gauches, comme celle â laquelle appartenait R. Luxemburg, ont défendu de façon beaucoup plus cohérente, c'était le fait que les éléments nationalistes dans toutes les révoltes contre la répression sanglante des grandes puissances impérialistes étaient toujours introduits par la classe la plus réactionnaire - la bourgeoisie - pour endiguer la menace d'un réel soulèvement de la classe ouvrière; les révolutionnaires devaient établir une ligne de démarcation très claire entre le nationalisme et la lutte de classe, puisque seule celle-ci représente, dans la période de l'impérialisme, la voie progressiste pour l'humanité.
Au fil de ses écrits, Lénine modéra sa position afin d'éviter le danger toujours présent de subordonner la lutte de classe à la lutte nationale, que ce soit par la capitulation devant l'appareil d'Etat démocratique ou devant la bourgeoisie des nations "opprimées". L'attitude marxiste face à la question nationale devait toujours reconnaître la primauté de la lutte de classe :
"A l'opposé des démocrates petit -bourgeois, Marx voyait dans toutes les revendications démocratiques sans exception non pas un absolu, mais l'expression historique de la lutte des masses populaires, dirigées par la bourgeoisie, contre le régime féodal. Il n'est pas une seule de ces revendications qui, dans certaines circonstances, ne puisse servir et n'ait servi à la bourgeoisie à tromper les ouvriers. Il est radicalement faux, du point de vue théorique, de monter en épingle, à cet égard, l'une des revendications de la démocratie politique, à savoir le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, et de l'opposer à toutes les autres. Dans la pratique, le prolétariat ne peut conserver son indépendance qu'en subordonnant sa lutte pour toutes les revendications démocratiques, sans en excepter la république, à sa lutte révolutionnaire pour le renversement de la bourgeoisie."
(La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, Thèse 5, Oeuvres, T.22, avril 1916).
Par conséquent, Lénine devait rectifier concrètement sa position sur l'autodétermination afin de défendre la nécessité de l'unité internationale de la classe ouvrière et de résoudre cette préoccupation cruciale pour les révolutionnaires de sa division théorique du prolétariat en deux camps : celui des nations "opprimées" et celui des nations "qui oppriment". Ceci constituait pour Lénine, "la tâche la plus difficile et la plus importante".
Ainsi, alors que le prolétariat des pays "oppresseurs" devait revendiquer l'indépendance des colonies et des petites nations opprimées par leur "propre" impérialisme,
". . . les socialistes des nations opprimées doivent s'attacher à promouvoir et réaliser l'unité complète et absolue, y compris sur le plan de 1'organisation, des ouvriers de la nation opprimée avec ceux de la nation oppressive. Sans cela, il est impossible de sauvegarder une politique indépendante du prolétariat et sa solidarité dé classe avec le prolétariat des autres pays, devant les manoeuvres de toutes sortes, les trahisons et les tripotages de la bourgeoisie."
(Ibid., Thèse 4, souligné par nous).
Que de fois entendons-nous les "léninistes" d'aujourd'hui s'enthousiasmer pour les luttes de libération nationale en citant Lénine ! Lénine était bien explicite : en l'absence de l'unité de classe du prolétariat, y compris de ses expressions organisationnelles concrètes, la classe ouvrière était incapable de défendre son autonomie face à son ennemi de classe. La lutte de classe ne pouvait ainsi qu'être subordonnée à la lutte nationale, c'est-à-dire, en réalité, à la lutte de l'impérialisme pour une partie du marché mondial; dans cette lutte, les ouvriers ne pouvaient que servir de chair à canon à leur propre bourgeoisie, les mots d'ordre du Manifeste Communiste -"les prolétaires n'ont pas de patrie" prolétaires de tous les pays, unissez-vous!" - se retournant en leur contraire : "prolétaires des nations opprimées, défendez votre patrie !".
Dans la position de Lénine, c'est cet élément de réponse, au soutien à l'autodétermination que les gauchistes d'aujourd'hui ignorent ou dissimulent; c'est pourtant un élément central pour la défense de l'internationalisme prolétarien puisqu'il contient encore, malgré une certaine déformation, une vision des intérêts généraux de la classe ouvrière.
Ailleurs, dans ses écrits, Lénine rejette fermement toute approche abstraite et non critique " du soutien aux mouvements nationalistes :
"aucune revendication démocratique ne doit conduire à favoriser des abus; nous ne sommes pas tenus d'appuyer ni 'n'importe quelle' lutte pour l'indépendance ni 'n'importe quel mouvement républicain ou anti-clérical'".
(Bilan d'une discussion...)
Les intérêts généraux de la lutte de classe pouvaient être en contradiction avec le soutien à tel ou tel mouvement nationaliste :
"Il peut arriver que le mouvement républicain d'un pays ne soit que l'instrument d'intrigues cléricales, financières ou monarchiques d'autres pays : nous avons alors le devoir de ne pas soutenir ce mouvement concret donné."
(Ibid., chap.7, Oeuvres, T.22)
Et, suivant l'exemple de Marx qui refusait de soutenir le nationalisme tchèque au 19ème siècle, Lénine tirait cette conclusion : si la révolution prolétarienne éclatait dans un certain nombre de pays européens les plus importants, les révolutionnaires seraient favorables à une "guerre révolutionnaire" contre les autres nations capitalistes qui agiraient comme remparts de la réaction : c'est-à-dire favorables à l'écrasement de celles-ci, quelles que soient les luttes de libération nationale qui surgissent en leur sein.
Donc, pour Lénine, il était possible que des mouvements nationalistes agissent comme autant d'armes des puissances impérialistes contre la lutte de classe; pour Luxemburg et Boukharine, c'était un phénomène général et inévitable de la phase impérialiste du capitalisme. Bien qu'il n'ait pas l'avantage de la cohérence du point de départ théorique de ces derniers, Lénine était contraint par le poids des arguments du moins de s'orienter vers leur position. De façon significative, il était désormais contraint d'admettre que le mot d'ordre de l'indépendance de la Pologne était utopique et réactionnaire dans les conditions contemporaines, allant jusqu'à dire que "... même une révolution en Pologne même ne changerait rien et ne ferait que détourner l'attention des masses en Pologne de la tâche principale le lien entre leur lutte et celle du prolétariat de Russie et d'Allemagne." (Bilan de discussion) . Mais il se refusait encore à tirer une conclusion générale de cet exemple spécifique.
Quelques conclusions sur le débat dans la gauche de Zimmerwald
En plus de leur méthode fondamentale, il est une chose avec laquelle tous les membres de la Gauche de Zimmerwald étaient d'accord, une chose bien souvent ignorée dans les débats où l'on se paie de paroles quant à la possibilité de soutenir les mouvements nationaux : seule la lutte de la classe ouvrière est porteuse d'avenir pour les masses opprimées et pour l'humanité. Nulle part dans les affirmations les plus confuses de Lénine, il n'est sous-entendu que le capitalisme décadent m pourrait être détruit par un autre moyen que la violence de la révolution prolétarienne. Le souci qui animait Lénine, Boukharine, Luxemburg et les autres était de savoir si, et jusqu'où, les luttes nationales pouvaient contribuer à accélérer la crise finale du capitalisme et oeuvrer, ainsi, en faveur de la lutte révolutionnaire en participant à l'affaiblissement de tout l'édifice pourrissant de l'impérialisme.
Malgré son incontestable accord avec le cadre de base du débat, une importante partie du mouvement ouvrier pensait encore qu'une rupture complète avec la théorie et la pratique du passé sur cette question n'était pas déjà justifiée; Lénine pensait que les ouvriers n'avaient rien à perdre à soutenir les mouvements nationalistes parce que ceux-ci allaient tous dans le sens de la destruction du capitalisme.
Aujourd'hui, les innombrables massacres d'ouvriers par les fractions nationalistes nous fournissent suffisamment de preuves pour nous permettre d'apporter notre propre contribution à ce débat en concluant que la lutte de classe et le nationalisme sous toutes ses formes n'ont aucun point de convergence : celui-ci reste toujours une arme entre les mains de l'ennemi contre celle-là.
Les révolutionnaires qui, de façon hésitante, ont eu le courage d’affirmer que le moment était en effet venu de rompre clairement avec le passé, étaient à l'avant-garde des tentatives du prolétariat, pour comprendre le monde dans lequel il vivait et luttait. Leur contribution, et notamment la théorie de R. Luxemburg sur la question de l'impérialisme dans son ensemble et de la crise mortelle du capitalisme, est encore une pierre angulaire essentielle du travail des révolutionnaires dans la période de décadence.
Quant à la position de Lénine sur la question nationale, comme nous le savons tous, elle a été saccagée par la bourgeoisie pour justifier toutes sortes de guerres réactionnaires de "libération nationale". Ce n'est pas non plus par accident que la gauche du capital, en quête de références marxistes pour sa participation aux guerres impérialistes, choisit de régurgiter les écrits de Lénine, qui contiennent suffisamment de dangereuses faiblesses pour laisser la porte ouverte à ce qui est devenu aujourd'hui une des pierres angulaires de l'idéologie bourgeoise.
En vérité, on ne peut faire porter à Lénine la responsabilité de la façon dont la bourgeoisie a déformé sa pensée, dans le sillage de la défaite de la révolution prolétarienne pour laquelle il avait combattu avec acharnement. Contre les anarchistes et les libertaires, pour lesquels Lénine a toujours été un politicien bourgeois n'utilisant le marxisme que pour justifier sa propre lutte pour le pouvoir, nous pouvons insister sur la manière dont la contre-révolution bourgeoise a été contrainte de pervertir tout le cadre du débat auquel Lénine a participé, et de masquer ou de supprimer certains principes fondamentaux qu'il défendait, ceci afin de vider sa contribution de son contenu marxiste révolutionnaire.
Mais ceci dit, à la différence des bordiguistes, il n'est pas nécessaire que nous restions aveugles face aux erreurs du passé. Compte tenu des points que nous venons de mentionner, nous pouvons voir que de dangereuses faiblesses et ambiguïtés étaient présentes dans les écrits de Lénine dès le début, faiblesses qu'il nous faut rejeter définitivement aujourd'hui pour rester sur la défense des positions de classe.
Nous traiterons dans un article à venir des tragiques conséquences pratiques des incompréhensions des bolcheviks sur la question nationale après octobre 1917 à travers la politique de l'Etat soviétique.
S. FAY.
[1] [37] La position de Boukharine sur la nécessité de détruire le pouvoir d'Etat bourgeois et son insistance sur l'action de masse des ouvriers était, en partie assimilée par celui-ci, à partir des travaux de Pannekoek et de la Gauche Allemande avec lesquels le groupe Kommunist en exil avait collaboré pendant la guerre. Dans sa polémique avec Kautsky, dans la période d'avant-guerre, Pannekoek avait insisté sur le fait que :
"La bataille prolétarienne n'est pas seulement une bataille contrée la bourgeoisie pour le pouvoir d'Etat; elle est également une lutte CONTRE LE pouvoir DE L'ETAT" (L'action de masse et la révolution, 1911).
La réponse prolétarienne à la répression sanglante de l'Etat bourgeois était LA GREVE DE MASSE.
[2] [38] On pourrait insister sur le fait que la séparation de la Norvège de la Suède en 1905 était le SEUL exemple concret que Lénine pouvait mettre en avant comme support à sa politique sur l'autodétermination, raison pour laquelle il s'est gardé d'y faire allusion dans tous ses écrits sur ce sujet. Sans chercher trop loin, nous pouvons dire que cet exemple possède suffisamment de spécificités pour rendre fragiles les bases d'une théorie générale : cela s'est passé à l'aube de la décadence capitaliste, dans une région du monde excentrée par rapport aux plus grands pays situés au coeur du capitalisme, dans un pays ayant un prolétariat relativement faible. De plus, la bourgeoisie norvégienne a toujours bénéficié d'une certaine autonomie politique et son indépendance formelle a pu, par la suite, être achevée parce que la bourgeoisie suédoise était entièrement prête à L'accepter. C'est la raison pour laquelle elles ont organisé, d'abord, un référendum...
Courants politiques:
- Gauche Communiste [10]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Impérialisme [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
La conception de l'organisation dans les gauches allemande et hollandaise
- 3532 lectures
Pour les groupes de discussion et les individus qui surgissent aujourd'hui sur des bases révolutionnaires, il est nécessaire que leur travail de clarification se fasse par une réappropriation des positions de la Gauche communiste,y compris celles de la Gauche allemande et de la Gauche hollandaise. Ces dernières, en particulier, ont défendu politiquement et théoriquement les premières, toute une série de positions de classe essentielles : rejet du syndicalisme et du parlementarisme, rejet de la conception substitutionniste du parti, dénonciation du frontisme, définition de tous les prétendus Etats socialistes comme capitalistes d'Etat.
Néanmoins, la réappropriation seulement sous un angle théorique des positions de classe ne suffit pas. Sans une conception claire de l'organisation révolutionnaire, tous ces groupes et individus sont condamnés au néant ... Il ne suffit pas de se proclamer révolutionnaire en paroles et de façon individuelle, il faut encore défendre -collectivement- les positions de classe dans un cadre organisé. La reconnaissance de la nécessité d'une organisation ayant une fonction indispensable dans la classe et fonctionnant comme un corps collectif, centralisé est la condition première de tout travail militant. Toute hésitation ou incompréhension sur la nécessité d'une organisation est sanctionnée terriblement par la désagrégation. Cela vaut en particulier pour les groupes "conseillistes" aujourd'hui.
Tirer les leçons de l'histoire de la Gauche allemande et de la Gauche hollandaise, c'est montrer la nécessité vitale d'une organisation pour que la théorie ne soit pas une pure spéculation mais une arme qui s'empare des masses prolétariennes dans la révolution future.
L'apport de la Gauche allemande - et principalement du KAPD - n'est pas d'avoir reconnu la nécessité du parti dans la révolution. Pour le KAPD, qui se formait en parti en 1920, cela allait de soi. Son apport fondamental est d'avoir compris que la fonction du parti n'était plus la même dans la période de décadence. Non plus parti de masse - organisant et rassemblant la classe -mais parti noyau rassemblant les combattants les plus actifs et les plus conscients du prolétariat. Partie sélectionnée de la classe, le parti intervient dans la lutte de classe et dans les organismes que la classe fait surgir : les conseils ouvriers et les comités de grève. Le parti est un parti combattant pour la révolution et non plus pour des réformes graduelles dans des organismes
où le prolétariat n'a plus rien à faire (syndicats) ou à dire (parlement) sinon d'oeuvrer à leur destruction. Enfin parce que le parti est une partie de la classe et non son représentant, ou son chef, il ne peut se substituer à elle dans sa lutte ou l'exercice du pouvoir. La dictature de la classe est celle des conseils et non celle du parti. Contrairement à la vision bordiguiste ce n'est pas le parti qui crée la classe mais la classe qui crée le parti. (1[1] [41]) Ce qui ne signifie pas - comme dans la vision populiste ou menchevik - que le parti est au service de la classe. Il n'est pas un serviteur qui passivement s'adapte à chaque hésitation ou errements de la classe. Au contraire, il doit "développer la conscience de classe du prolétariat même au prix d'une contradiction extérieure apparente avec les larges masses"([2] [42]).
Le KAPD en Allemagne et le KAPN de Gorter en Hollande n'avaient rien à voir avec la vision de Ruhle, dont se réclament aujourd'hui les "conseillistes". Ruhle et sa tendance à Dresde furent expulsés du KAPD à la fin de l'année 1920. Le KAPD n'avait rien à voir avec les tendances anarchisantes qui proclamaient que tout parti est par essence contre-révolutionnaire ; que la révolution n'est pas une question de parti mais d'éducation. Les conceptions du pédagogue Ruhle n'avaient rien à voir avec celles du KAPD. Pour ce dernier le parti n'est pas la volonté individuelle de chacun ; il est "une totalité élaborée programmatiquement, fondue en une volonté unitaire, organisée et disciplinée de la base au sommet. Il doit être la tête et l'arme de la révolution". (Thèses sur le rôle du parti). Le parti joue en effet un rôle décisif dans la révolution prolétarienne. Parce qu'il cristallise et concentre dans son programme et son action la volonté consciente de la classe, il est une arme indispensable de la classe. Parce que la révolution est fondamentalement politique, qu'elle implique un combat sans merci contre les tendances bourgeoises et les partis qui travaillent contre le prolétariat au sein de ses organismes, le parti est un instrument politique de lutte et de clarification. Cette conception n'a rien à voir avec toutes les visions substitutionnistes du parti. Le parti est sécrété par la classe et par conséquent est un facteur actif dans le développement de la conscience générale de la classe.
Néanmoins, avec la défaite de la révolution en Allemagne, la dégénérescence de la révolution en Russie, certaines faiblesses du KAPD vont paraître au grand jour.
LE VOLONTARISME ET LA DOUBLE ORGANISATION
Constitué au moment où la révolution reflue en Allemagne après la défaite de 1919, le KAPD se mit à défendre l'idée que l'on pouvait se substituer au déclin de l'esprit révolutionnaire dans le prolétariat par une tactique putschiste. Lors de l'action de Mars 1921 en Allemagne centrale, il poussa les ouvriers des usines Leuna (près de Halle) à l'insurrection contre leur volonté. Il manifestait là une profonde incompréhension de la fonction du parti qui contribua à sa désagrégation. Le KAPD gardait encore l'idée d'un parti "état-major" militaire" du prolétariat, alors que le parti est avant tout une avant-garde politique de l'ensemble de la classe ouvrière.
De même, confronté à la désagrégation des conseils ouvriers, prisonnier de son volontarisme, le KAPD s'entêta à défendre l'idée d'une double organisation permanente du prolétariat, ajoutant ainsi à la confusion entre organisme unitaire de classe surgissant dans la lutte et pour la lutte (assemblées, comités de grève, conseils ouvriers) et organisation de la minorité révolutionnaire intervenant dans ces organisations unitaires pour féconder leur action et leur réflexion. Ainsi, en laissant subsister et en poussant au maintien des unions - organisations d'usines nées dans la révolution allemande et se rattachant au parti - tout en étant à côté du parti, il se trouva lui-même incapable de déterminer ses tâches : soit devenir une ligue de propagande ([3] [43]) , un simple appendice politique, d'organisation d'usines aux fortes tendances économistes; soit devenir un parti de type léniniste ayant des courroies de transmission sur le terrain économique au sein de la classe. C'est-à-dire dans les deux cas ne plus savoir qui est qui et qui fait quoi ([4] [44]).
Que les conceptions erronées du KAPD aient largement contribué à sa disparition à la fin des années 20 est indubitable. C'est une leçon pour les révolutionnaires d'aujourd'hui qui, par démangeaison activiste et immédiatiste croient suppléer leur faible existence numérique par la création de"groupes ouvriers" artificiels liés au parti. Telle est par exemple la conception de Battaglia Comunista et de la C.W.O. La différence historique est cependant de taille : autant le KAPD se trouvait confronté à des organismes (unions) qui étaient des tentatives artificielles de maintenir en vie des conseils ouvriers qui venaient de disparaître, autant, la conception actuelle des organisations révolutionnaires aux penchants opportunistes reposent sur du bluff.
LA GENESE DU PARTI
Derrière les erreurs du KAPD sur le plan organisationnel, il y avait une difficulté à reconnaître, après l'échec de l'Action de Mars en 1921,1'arrêt momentané de la vague révolutionnaire et donc de tirer les conclusions pour son action dans une telle situation.
Le parti révolutionnaire en effet, comme organisation ayant une influence directe sur l'action et la réflexion des masses ouvrières, ne peut se constituer que dans un cours montant à la lutte de classe. Et en particulier, la défaite et le reflux de la révolution ne permet pas de maintenir en vie une organisation révolutionnaire assumant pleinement la fonction de parti. Si se prolonge un tel recul de la lutte ouvrière, si la voie se dégage pour une reprise en main de la situation par la bourgeoisie, alors soit le parti dégénère sous la pression de la contre-révolution montante et en son sein surgissent des fractions qui poursuivent l'activité théorique et politique du parti (cas de la Fraction Italienne) , soit le parti voit son influence et son assise militante se réduire et devient une organisation plus restreinte qui ne peut que se fixer pour tâche essentielle de préparer le cadre théorique et politique en vue de la prochaine vague révolutionnaire. Le KAPD ne comprenait pas qu'un arrêt de la montée révolutionnaire s'était produit. D'où la difficulté à faire le bilan de la période précédente et à s'adapter à la nouvelle période.
Ces difficultés ont donné jour à deux réponses fausses et incohérentes au sein de la gauche germano-hollandaise :
- proclamer de façon volontariste la naissance d'une nouvelle Internationale, tel est le cas de la KAI([5] [45]) de Gorter en 1922;
- de ne pas se constituer en fraction mais de s'autoproclamer le parti, au fil des scissions ; le terme "parti" devenant une simple étiquette pour chaque organisation scissionniste, réduite à quelques centaines de membres, quand ce n'est pas moins ([6] [46]).
Qui sait qu'il existe 4 "partis" en Italie se réclamant de la Gauche italienne. Cette mégalomanie de petits groupes se prenant pour le "Parti" ne contribue pas peu aujourd'hui à ridiculiser la notion de parti et à entraver le difficile regroupement des révolutionnaires, qui est la première condition subjective pour que surgisse demain un véritable parti mondial du prolétariat.
Toutes ces incompréhensions allaient être dramatiques. Dans la Gauche allemande allaient coexister trois courants, au fur et à mesure que le KAPD de Berlin s'affaiblissait :
- les uns se ralliaient aux thèses de Ruhle que toute organisation politique est mauvaise en soi ; tombant dans l'individualisme, ils disparurent de la scène politique ;
- d'autres - en particulier dans le KAPD de Berlin en lutte contre les tendances anarchisantes développées dans les Unions - avaient tendance à nier les conseils ouvriers pour ne plus voir que le parti. Ils développaient une vision "bordiguiste" avant la lettre ([7] [47]) ;
- les derniers, enfin, considéraient que l'organisation en parti était impossible. La KAU ([8] [48]), née de la fusion d'une scission du KAPD et des Unions (AAU et AAU-E), ne se considérait pas vraiment comme une organisation, mais comme une union lâche de tendances éparses, décentralisée. Le centralisme organisationnel du KAPD était abandonné.
C'est ce dernier courant, appuyé par le GIC hollandais ([9] [49]) né en 1927, qui allait triompher dans la Gauche hollandaise.
LA GAUCHE HOLLANDAISE : LE GIC, PANNEKOEK ET LE SPARTACUSBOND
Le traumatisme de la dégénérescence de la révolution russe et du parti bolchevik a laissé de lourdes séquelles. La Gauche hollandaise qui reprenait l'héritage théorique de la Gauche allemande,^ en a pas repris les apports positifs dans la question du parti et de l'organisation des révolutionnaires .
Elle rejetait la vision substitutionniste du parti Etat-major de la classe, pour ne plus voir que l'organisation générale de la classe : les conseils ouvriers. L'organisation révolutionnaire n'était plus considérée que comme une "ligue de propagande" des conseils ouvriers.
Le concept de parti était ou bien rejeté, ou bien vidé de son contenu. C'est ainsi que Pannekoek considérait tantôt que "un parti ne peut être qu'une organisation visant à diriger et à dominer le prolétariat" ([10] [50]), tantôt que "les partis - ou groupes de discussion, ou ligues de propagande, peu importe le nom par lequel on les désigne -ont un caractère tout à fait différent de cette organisation en partis politiques que nous avons connue dans le passé"([11] [51]).
D'une idée juste - que l'organisation et le parti changeaient de fonction dans la décadence - on aboutissait à des conclusions fausser. Non seulement on ne voyait plus ce qui différencie l'organisation d'un parti dans la période du capitalisme ascendant de celle d'un parti dans une période révolutionnaire, dans une période de pleine maturation de la conscience de classe, mais on abandonnait la vision marxiste de l'organisation politique comme facteur actif de la lutte de classe.
1. Les fonctions indissociables de l'organisation : théorie et praxis étaient séparées. Le GIC se concevait non corme un corps politique avec un programme, mais comme une somme de consciences individuelles et une somme d'activités séparées. Ainsi le GIC préconisait la formation de "groupes de travail" fédérés, par peur de voir naître une organisation unie par son programme et imposant des règles d'organisation : "Il est préférable que des ouvriers révolutionnaires travaillent à la prise de conscience en milliers de petits groupes plutôt que leur activité soit soumise dans une grande organisation aux tentatives de la dominer et diriger" (Canne-Mejer, Le devenir d'un nouveau mouvement ouvrier, 1935).
Plus grave était la définition de l'organisation comme "groupe d'opinion"qui laissait la porte ouverte à l'éclectisme théorique. Selon Pannekoek, le travail théorique visait à l'auto éducation personnelle, à "1'activité intensive de chaque cerveau". De chaque cerveau surgissait une pensée, un jugement personnel "et dans chacune de ces pensées diverses se trouvait en fait une parcelle de la vérité plus ou moins grande" (Pannekoek, Les Conseils Ouvriers). A la vision marxiste d'un travail collectif d'organisation, réel point de départ "d'une activité intensive de chaque cerveau" était substituée une vision idéaliste. Le point de départ était la conscience individuelle, comme dans la philosophie cartésienne, au point que Pannekoek affirmait que le but était non la clarification dans la classe mais "la connaissance par soi-même de la méthode pour distinguer ce qui est vrai et bon", (ibid.)
Si l'organisation n'était qu'un groupe de travail où se forgeait l'opinion de chacun, elle ne pouvait être qu'un "groupe de discussion" ou "un groupe d' études" se "donnant pour tâche 1'analyse des événements sociaux" (Canne-Mejer : Le devenir d'un nouveau mouvement ouvrier, 1935). La nécessité des "groupes de discussion" dont la fonction était la clarification politique et théorique a certes existé. Mais elle correspondait au stade primaire du développement du mouvement révolutionnaire au siècle dernier. Cette phase où pullulaient-les sectes et les groupes séparés était une phase transitoire. Le sectarisme et le fédéralisme qui existaient dans de tels groupes surgis de la classe, étaient des maladies infantiles. Ces maladies disparaissaient avec l'apparition d'organisations prolétariennes centralisées. Comme le notait Mattick en 1935, cette vision du GIC et de Pannekoek était une régression : "Une organisation fédéraliste ne peut pas se maintenir parce que dans la phase du capital monopoliste où se trouve le prolétariat, elle ne correspond finalement à rien...Elle constituerait un pas en arrière par rapport au vieux mouvement au lieu d'être un pas en avant". (Rate-Korrespondenz n° 10-11, Septembre 1935).
2. Dans les faits, le fonctionnement du GIC a été celui d'une fédération d'"unités indépendantes", incapables de jouer un rôle politique actif. Il vaut la peine de citer un article de Canne-Mejer de 1938 (Radencommunisme n° 3) :
"Le groupe des communistes internationaux n'avait pas de statuts, pas de cotisations obligatoires et ses réunions "internes" étaient ouvertes à tous les autres camarades des autres groupes. Il s'ensuit qu'on ne connut jamais le nombre exact de membres que comptait le groupe. Il n'y avait jamais de vote, cette opération n'étant pas nécessaire, car il ne s'agissait jamais de faire une politique de parti. On discutait un problème et quand il y avait une différence d'opinion importante, les divers points de vue étaient imprimés, sans plus. Une décision à la majorité était sans signification. C'était à la classe ouvrière de décider".
En quelque sorte, le GIC s'auto castrait de peur de violer la classe. Par peur de violer la conscience de chacun par des règles d'organisation ou de violer la classe en lui "imposant" une prise de position, le GIC se niait comme partie militante de la classe. En effet, sans moyens financiers réguliers, pas de possibilité de sortir une revue et des tracts en temps de guerre. Sans statuts, pas de règles permettant à l'organisation de fonctionner en toutes circonstances. Sans centralisation avec des organes exécutifs élus, pas de possibilité de maintenir une vie et une activité en toute période et particulièrement en période d'illégalité où le cloisonnement face au déchaînement de la répression impose la centralisation la plus stricte. Et en période de montée de la lutte de classe, comme aujourd'hui, pas de possibilité d'intervenir de façon centralisée et mondiale dans le prolétariat.
Ces errements du courant conseilliste, hier avec le GIC, aujourd'hui dans des groupes informels se réclamant du communisme des conseils reposent sur l'idée que l'organisation n'est pas un facteur actif, mais un facteur négatif dans la classe. En "laissant la classe ouvrière décider", on laisse entendre que l'organisation révolutionnaire est "au service de la classe" ; en quelque sorte une ronéo et non un groupe politique amené - parfois même dans la révolution- à travailler à contre-courant des idées et actions de la classe. L'organisation n'est pas un reflet de ce que "pensent les ouvriers"([12] [52]), elle est un corps collectif portant la vision historique du prolétariat mondial, qui n'est pas ce qu'il pense à tel ou tel moment mais ce qu'il est contraint de faire : la réalisation des buts communistes.
Il n'est donc point étonnant si le GIC disparut en 1940. Tout le travail théorique du GIC fut transmis par le Spartacusbond né d'une scission du parti de Sneevliet en 1942 (cf. article de la Revue Internationale n° 9, "Rupture avec le Spartacusbondy 1977). Malgré une vision plus saine de la fonction le Bond reconnaissait le rôle indispensable d'un parti dans la révolution comme facteur actif de la conscience - et du fonctionnement -le Bond avait des statuts et des organes centraux -, le Spartacusbond finit par être dominé par les anciennes idées du GIC sur l'organisation.
Aujourd'hui, le Spartacusbond est agonisant, et Daad en Gedachte -qui est sorti du Bond en 1965 -est un bulletin météorologique des grèves ouvrières. Aujourd'hui, la Gauche hollandaise agonise comme courant révolutionnaire. Ce n'est donc pas par elle que peut être transmis tout son héritage théorique aux éléments révolutionnaires qui surgissent dans la classe. La compréhension et le dépassement de cet héritage est l'oeuvre d'organisations révolutionnaires et non d'individus ou de groupes de discussion.
Les idées"conseillistes" sur l'organisation n'ont cependant pas disparu, comme on peut le constater dans différents pays. Faire un bilan critique de la conception de l'organisation dans la Gauche allemande et hollandaise, c'est prouver non la faillite des organisations révolutionnaires, mais au contraire leur rôle indispensable pour tirer les leçons du passé et se préparer aux combats de demain.
Sans théorie révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, mais sans organisation révolutionnaire, il n'y a pas non plus de théorie révolutionnaire. Ne pas le comprendre, c'est emprunter la voie qui mène au néant pour toute organisation informelle, et pour les individus. C'est la voie qui mène à être désabusé sur la possibilité d'une révolution. (Cf. dans cette revue, le texte de Canne-Mejer).
CH.
[1] [53] "...il n'est même pas possible de parler de classe tant qu 'il n 'existe pas dans celle-ci une minorité tendant à s 'organiser en un parti politique ." (Bordiga : "Parti et classe").
[2] [54] "Thèses sur le rôle du parti dans la révolution prolétarienne", KAPD, 1920.
[3] [55] Comme l'affirmait Franz Pfemfert, l'ami de Ruhle, directeur de la revue "Die aktion", membre du KAPD.
[4] [56] Michaelis, ex-dirigeant du KAPD et membre de la KAU en 1931, déclarait : "Dans la pratique, l'union devint elle-même un second parti...le KAP regroupait même, plus tard, les mêmes éléments que l'union".
[5] [57] KAI : Internationale Communiste Ouvrière.
[6] [58] En 1925, en Allemagne il y avait 3 KAPD : un pour la tendance de Berlin et 2 pour la tendance d'Essen. Cette erreur, qui était une tragédie dans le camp prolétarien à l'époque, s'est répétée sous forme de farce en 1943 en Italie, avec la proclamation - en pleine contre-révolution - du Parti Communiste Internationaliste de Damen et Maffi.
[7] [59] Le même Michaelis avoue en 1931 : "Les choses allèrent même si loin que pour maints camarades, les conseils n'étaient considérés comme possibles que dans la mesure où ils acceptaient la ligne du KAP."
[8] [60] KAU : Union Communiste Ouvrière
[9] [61] GIC : Groupe des Communistes Internationaux.
[10] [62] Parti et classe ouvrière, 1936.
[11] [63] Les Conseils Ouvriers, 1946.
[12] [64] On peut lire dans le même n° cité de Radencommunisme : "Quand il y avait une grève sauvage, les grévistes faisaient souvent faire des tracts par les groupes ; ceux-ci les réalisaient même s'ils n'étaient pas absolument d'accord avec leur contenu" (souligné par nous).
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [10]
Heritage de la Gauche Communiste:
La faillite du conseillisme
- 2693 lectures
En complément de l'article "La conception de l'organisation dans Les Gauches allemande et hollandaise", dans ce numéro, nous publions ci-dessous des extraits d'un texte de CANNE-MEJER qui fut un des militants les plus actifs et un des théoriciens de ce courant politique, notamment dans le GIC dans les années 30. Ce texte écrit à la fin des années 50, intitulé LE SOCIALISME PERDU, illustre un des aboutissements des erreurs contenues dans la conception théorique et politique du "communisme de conseils" : la mise en question du marxisme et de la signification historique de la lutte prolétarienne; la croyance en la pérennité du capitalisme avec la capitulation à la pression de l'idéologie bourgeoise, dans ce cas celle de la période de reconstruction d'après-guerre sur la "société de consommation et de loisirs" qui fit fureur dans les années 60.
Nous faisons précéder ce texte de quelques commentaires introductifs de notre part
UN SOCIALISTE PERDU
A l'époque où le texte est écrit, les quelques rescapés de la Gauche communiste sont pour la plupart isolés et dispersés. La longue période de contre-révolution a épuisé les énergies. La deuxième guerre mondiale n’a pas fait surgir de mouvement révolutionnaire du prolétariat carme en 1917. Ce qui reste des Gauches communistes italienne et germano-hollandaise qui avaient résisté pendant près de 20 ans dans de petites minorités organisées est disloqué et extrêmement réduit ou se trouve dans une terrible confusion politique. Dans cette situation, les erreurs politiques qui n'ont pas été dépassées vont donner le jour à des aberrations grandissantes sur les bases mêmes de la théorie révolutionnaire, sur la compréhension de ce qu'est le marxisme.
Dans la Gauche italienne, le Parti communiste internationaliste se forme dans la confusion en Italie en pleine deuxième guerre mondiale avec le resurgissement des luttes ouvrières en 43.(1) Il rejette l'héritage de la Gauche communiste internationale qui est le seul groupe vraiment conséquent des années 30 (BILAN). Les critiques et les appels répétés de la Gauche communiste de France (INTERNATIONALISME) à reprendre à fond les questions politiques restent sans réponse. Un peu plus tard Bordiga, dans le Parti communiste international, scission du Parti communiste internationaliste va théoriser de plus en plus, par une fidélité dogmatique et bornée à la révolution russe et à Lénine, un monolithisme du marxisme.
Dans la Gauche germano-hollandaise, dont la dislocation et l'incapacité à tirer les leçons de la révolution russe dés les années 30 ont déjà accéléré la dégénérescence, Canne-Mejer va aboutir dans les années 50, à force de rejeter la révolution russe, à une remise en question complète du marxisme et de la lutte de classe.
Le processus qui mène à ces incompréhensions du marxisme n'est donc pas identique et n'a pas la même origine pour ces deux courants politiques. L'origine de l'échec des groupes qui se réclament de la Gauche italienne se trouve dans l'incapacité à assurer la continuité du travail d'élaboration théorique et politique effectué par la GCI avant la guerre D'une part la pression de la guerre et de l'après-guerre va faire céder le travail politique organisé sur les bases de cette continuité par la GCF qui se ra dissoute en 1953. D'autre part, les autres tendances de ce même courant vont, de concession politique en considération tactique, se maintenir en régressai sur les positions politiques et se fossiliser avec des conséquences dont on peut encore voir les résultats aujourd'hui avec la désagrégation du PCI (Programme Communiste) et les dérapages politiques du PCI (Battaglia Comunista) ([1] [67]). Par contre, l'échec de la Gauche germano-hollandaise trouve ses racines antérieurement. Dans les années 20 c'est dans les Gauches allemande et hollandaise qu'on trouve les tentatives de compréhension les plus avancées sur les apports fondamentaux de la nouvelle période ouverte avec la Guerre mondiale et la vague révolutionnaire : l'impossibilité du parlementarisme révolutionnaire ; la nature contre-révolutionnaire des syndicats ; le rejet des luttes de libération nationale; le rejet du parti de masses" et toute tentative de rapprochement et d'unification avec la social-démocratie et ses courants de "gauche" et la tactique dite de "front unique". -Mais dans les années 30, parce qu'il rejette le parti bolchevik et de plus en plus la nature de classe de la révolution d'octobre, l'héritier de cette Gauche, le courant des "communistes de conseil", va saper toute possibilité d'intégrer les nouvelles positions politiques dans une cohérence théorique et organisationnelle. Il se maintiendra sur un terrain de classe, mais sans pouvoir avancer réellement au-delà d'une répétition des positions sans élaboration.
En fait, seul BILAN est capable à cette époque, bien qu'il n'aille pas jusqu'au bout de cette élaboration, de reprendre les leçons de la révolution et de fournir des bases pour une compréhension actuelle de ces questions. BILAN peut apparaître peu clair sur la formulation théorique, de certaines positions et notamment sur le rapport parti/classe, mais, en s'attachant à l'histoire, il comprend la dynamique de la révolution et du reflux beaucoup plus clairement et ce que sont les taches des révolutionnaires qui en découlent. BILAN fournit ainsi un cadre plus global, plus cohérent, en continuité avec le mouvement ouvrier. Au contraire, on trouve dans les bases du "conseillisme" un rejet de ce cadre historique global. La non reconnaissance du parti bolchevik comme un parti du prolétariat empêche ce courant d'aborder une critique méthodique des positions politiques qui se sont exprimées dans la révolution russe. Au plan théorique, ce courant, d'une sous-estimation d'abord, aboutira ensuite à une négation de la fonction active et indispensable de l'organisation politique révolutionnaire dans la révolution prolétarienne. Ce qu'exprime en fait cette conception c'est une incompréhension du processus de prise de conscience de la classe elle même, contrairement à l'insistance constante mais finalement purement formelle de ce courant sur cette question.
C'est cette conception que développe le "communisme de conseils", et sur cette base, dans la période de reconstruction, au cours de laquelle il semble que le capitalisme a retrouvé un second souffle et que le prolétariat n'a plus les moyens et n'exprime plus les buts de sa lutte, Canne-Mejer, qui fut pourtant toute sa vie un militant dévoué à la cause du prolétariat, finira par divaguer sur les "loisirs" et "l'amélioration possible des conditions de vie sur la base de la collaboration de classe" !
Nous reviendrons de façon plus élaborée dans d'autres articles sur cette question de conception qui se pose toujours aujourd'hui.
Le danger n'est certes plus de prendre les feux de la reconstruction pour un nouveau regain du capitalisme, mais l'abandon du combat de classe, face aux difficultés de la période, existe. La sous-estimation des taches des révolutionnaires dans la lutte de la classe - comme partie prenante active et organisée, capable de fournir des orientations claires - l'irresponsabilité et le sectarisme qui règnent parmi les groupes qui se réclament de la révolution dans la mouvance "anti-léniniste" est tout aussi néfaste que la mégalomanie ridicule des groupes qui se réclament du "léninisme". Elle peut parfois l'être plus. La faillite de la conception du marxisme monolithique et du parti injectant la conscience à la classe apparaît évidente dans les échecs spectaculaires des avatars des diverses "tactiques" des groupes qui s'en réclament. La conception "conseilliste" est plus diffuse, mais dans une période où la bourgeoisie tente de profiter des hésitations de la classe ouvrière, et vise à son déboussolement et à son immobilisation, c'est une idéologie qui, dans sa logique, va dans le même sens, tout comme Canne-Mejer finit par entonner les chants de la bourgeoisie dans une autre période. Le texte que nous publions n'a que peu d'intérêt en lui-même, mais il révèle l'aboutissement d'une méthode et d'une conception profondément erronée de la lutte de classe qui mène, en rejetant le marxisme, à rejeter toute perspective de lutte de la classe ouvrière.
Il ne s'agit pas de reprendre du marxisme "tout" à la manière des bordiguistes, c'est-à-dire mot pour mot, à la lettre, mais de comprendre que le marxisme est un matérialisme historique, et si on relègue au rang de "vieillerie à la rigueur valable pour le siècle dernier" la dimension historique et politique du marxisme pour n'en garder que l'analyse des phénomènes, on quitte le terrain de la lutte de classe et de la révolution communiste pour se jeter dans les bras de la bourgeoisie.
Dans ce texte, Canne-Mejer ne voit dans la classe ouvrière qu'une catégorie économique de la société. Il n'aborde les taches du prolétariat que sur la question de la prise en mains des moyens de production et de consommation ; la lutte de classe est évoquée comme une simple "rébellion", rébellion liée non à une nécessité objective historique de l'impasse où les contradictions internes du mode de production capitaliste l'ont amenée : son entrée dans la décadence, ni aux conditions générales et au devenir de la classe, mais au seul "travail lui-même". Canne-Mejer a encore quelques souvenirs : il fait référence à la critique qu'ont toujours faite les marxistes selon laquelle il n'y a pas un "automatisme" de la lutte de classe seulement lié aux mécanismes du capitalisme ; mais il est nécessaire encore que se développe un des facteurs déterminants de cette lutte, la conscience de la classe de son action. Mais ce rappel devient chez Canne-Mejer une question de "psychologie sociale" ou d'"éthique", tout aussi mécanique, parallèle ou alternant avec la "rébellion". Rien n'est plus étranger au marxisme. Il n'est question nulle part chez Canne-Mejer de poser les vraies questions : quelles sont les taches politiques de la classe ouvrière ? Quels sont la nature et le rôle des communistes au sein de la classe ouvrière ? etc. La conception marxiste de la lutte de classe est réduite à la lutte pour des réformes dans les syndicats et les parlements du 19e siècle, sans référence à l'étude des conditions historiques dans lesquelles le marxisme a toujours situé ses luttes en indiquant toujours leurs limites par rapport au but général du combat de la classe, le communisme par la destruction de l'Etat capitaliste. Tout cet aspect est réduit à une vague notion de "lutte acharnée" hors de tout contexte historique des conditions matérielles de la révolution. Et puisque selon la vision "conseilliste", la révolution russe n’est pas ouvrière pour Canne-Mejer, cette "lutte acharnée" n'a donc pas eu lieu au 20ème siècle. Même les conseils ouvriers sont oubliés. Puisqu'il n'y a pas eu "lutte acharnée", Marx s'est trompé. Le massacre de générations de prolétaires dans la contre-révolution et dans les guerres est ignoré, et bien qu'on prétende "attirer l'attention sur deux phénomènes primordiaux de la vie économique durant ce siècle", l'économie de guerre est également ignorée.
LE SOCIALISME PERDU ESPERANCES DU MOUVEMENT MARXISTE D'AUTREFOIS
EXTRAITS D'UN TEXTE DE H.CANNE-MEYER
On rejoint la bourgeoisie dans l'étude de "l'augmentation des capitaux investis" et de "l'immense croissance de la productivité du travail". La classe ouvrière est assimilée aux syndicats et ses conditions de vie actuelle, ce sont principalement les "loisirs". Et c'est ce qui montre les "mécomptes de Marx" selon Canne-Mejer... Tel est le triste aboutissement du conseillisme.
MS.
CERTITUDE DE L'AVENEMENT DU COMMUNISME
Marx n'a jamais donné de description de la société communiste. Il ne faisait que montrer que la production, organisée sur la base de la propriété privée des moyens de produire, finirait par devenir un fardeau insupportable à la grande masse de la population, de sorte que celle-ci mettrait en commun ces moyens, et supprimerait l'exploitation due aux classes sociales. Dans l'esprit de Marx, décrire la société future c'était retomber dans l'Utopisme. Selon lui, une société nouvelle émerge du giron de la vieille sous l'action des forces réelles qui gouvernent le processus du travail social. Marx remarquait que la possession privée des moyens de production développait un processus de travail collectif en rassemblant des milliers et des milliers d'ouvriers. Ces ouvriers deviendraient les fossoyeurs de la possession privée des moyens de production. Car, pendant que croissent misère, oppression, esclavage, dégénérescence et exploitation, augmente également la rébellion de la classe ouvrière, unifiée et organisée par le processus de travail lui-même ([2] [68]).
"La centralisation des moyens de production et le caractère social atteignent un point où ils sont incompatibles avec 1'enveloppe capitaliste. Cette enveloppe éclate. La dernière heure de la propriété privée a sonné." ([3] [69]).Selon Marx, le mode de production capitaliste produit sa propre négation "avec l'inéluctabilité d'une loi de la nature". ([4] [70]).
Cette formulation de Marx, avec l'allusion à "1'inéluctabilité des lois de la nature" a causé beaucoup de malentendus. Souvent elle menait beaucoup de marxistes à une interprétation mécaniste du développement social. On croyait souvent à un écroulement automatique du système capitaliste, soit à cause des crises, soit à cause de l'abaissement du taux de profit, soit par manque de débouchés pour réaliser la plus-value. Lors d'un tel écroulement, la classe ouvrière pourrait, pour ainsi dire, prendre les moyens de production à son compte. Il suffirait plus ou moins à la classe ouvrière d'observer ce que Marx appelait "la décomposition - inévitable et de plus en plus visible -..."([5] [71]) du système. Les modifications, que subissent les capacités intellectuelles de la classe ouvrière pendant une lutte continue et qui la conduisent à pouvoir maîtriser politiquement et économiquement la vie sociale, apparaissent superflues.
Pourtant cette conception d'un écroulement définitif est en contradiction avec la méthode de penser de Marx... Pour lui, cette "inéluctabilité" n'est pas une nécessité extérieure à l'homme, une nécessité immanente qui s'exécute en dépit des hommes, au sens où, par exemple, certains penseurs bourgeois parlent souvent de développement immanent de l'esprit comme de la force motrice du monde. Pour Marx, il s'agit d'une inévitabilité imposée par les hommes eux-mêmes en conséquence de leur expérience de la vie sociale. Marx était persuadé crue les ouvriers devraient constamment s'opposer violemment aux tendances opprimantes du capitalisme, et que cette lutte se poursuivrait jusqu'à ce qu'ils aient vaincu le capitalisme. Ainsi, 1'"inéluctabilité" dont parlait Marx se trouvait découler de la nécessité naturelle de lutter contre le capitalisme.
LE MARXISME EN TANT QUE PSYCHOLOGIE SOCIALE
Donc Marx n'énonçait pas seulement une théorie qui mettait à jour les forces matérielles motrices du système capitaliste, mais, en plus, fournissait une théorie de la psychologie sociale qui prédisait le changement dans les pensées, la volonté, les sentiments et les actions des ouvriers. La pression de l'exploitation du capital concentré serait contrecarrée par la lutte organisée où se serait forgées la solidarité, la promptitude de chacun et de tous au sacrifice, formant ainsi une unité solide de pensée, de volonté, d'action. Le développement de l'individualité d'un ouvrier ne serait possible que comme partie d'un tout actif plus vaste, comme partie de son organisation de lutte. Les idées sur le bien et le mal dans la vie sociale seraient de nouveau remodelées par cette lutte et en accord avec les nécessités de cette lutte. Ces idées nouvelles que l'on peut appeler "valeurs éthiques", serviraient à leur tour de forces motrices pour commencer de nouvelles luttes. Chaque lutte se convertirait en valeurs éthiques et ces nouvelles valeurs éthiques pousseraient à de nouvelles luttes. La nouvelle éthique serait à la fois fille et mère de la lutte.
LA NAISSANCE DE LA NOUVELLE SOCIETE
Marx puisait sa certitude de l'avènement d'une société sans exploitation et sans classes dans sa certitude d'une lutte acharnée contre le capitalisme. Par cette lutte, la nouvelle société naîtrait du giron de la vieille. Cette lutte se ferait au moyen des syndicats qui amélioreraient les conditions de travail et au moyen des partis socialistes qui développeraient la conscience de classe. Pratiquement pour s'attaquer à ce développement il fallait s'attacher à lutter pour le perfectionnement du système parlementaire bourgeois (du suffrage universel) et pour des réformes sociales.
Ce n'est pas que Marx attendait de grands succès pratiques de la lutte parlementaire et syndicale. Pour lui, le mouvement des salaires n'était à prime abord fonction que de l'accumulation du capital. Dans une période de prospérité où la vie économique se développait, le besoin de main-d'oeuvre croissait et les syndicats pouvaient obtenir un salaire plus haut. Mais si les salaires montaient au point où la production cesserait d'être profitable l'accumulation devrait décroître, avec comme résultat chômage, "surpopulation", et baisse des salaires. Ainsi la base de profit s'élargirait à nouveau ([6] [72]).
"Donc l'augmentation du prix du travail ne reste pas seulement restreinte entre des limites qui ne touchent pas aux fondations du capitalisme, mais ces limites donnent également une certitude d'un élargissement à une plus grande échelle"([7] [73]).
Le sens de la lutte de classe se trouvait, pour Marx surtout dans le développement des caractéristiques intellectuelles qui mèneraient à la chute du capitalisme.
Marx pensait que les syndicats, par eux-mêmes, ne pourraient jamais vaincre le capitalisme aussi longtemps que la classe capitaliste disposerait de l'Etat. Le point cardinal de la lutte politique devait être recherché dans la conquête du pouvoir de l'Etat, soit par les voies parlementaires, (Marx les considérait comme possibles pour l'Angleterre et la Hollande), soit par des méthodes révolutionnaires. Après la Commune de Paris il fut convaincu que l'Etat ne devait pas être conquis mais brisé. En tout cas la tache du gouvernement révolutionnaire ne serait pas d' "établir" le communisme, par exemple en étatisant les moyens de production (quoique la nationalisation de quelques branches ne doive pas être exclue). Marx ne prescrivit pas ce que les révolutionnaires devaient faire en cas de révolution, mais il pensait que le développement devait être confié aux forces révolutionnaires à l'oeuvre dans la société, " quand une véritable révolution éclatera" - dit-il - "on verra également apparaître les conditions ( sans doute pas idylliques ) dans lesquelles elle réalisera ses mesures immédiates les plus urgentes".([8] [74])
Beaucoup de marxistes de cette époque soutenaient l'opinion que la tâche d'un gouvernement révolutionnaire consistait surtout à ne pas entraver les luttes des ouvriers contre les entrepreneurs, il était même de son devoir de les étayer. Les syndicats auraient ainsi les mains libres pour aménager la vie sociale selon leurs besoins, les capitalistes seraient dépossédés, non par le truchement des nationalisations, mais parce que les profits cesseraient d'être payés. Ainsi le capital perdrait toute valeur et pendant ce temps la gestion de la vie sociale tomberait entre les mains de l'association des producteurs libres et égaux. D'un côté la naissance de la nouvelle société au sein de l'ancienne se trouvait liée à l'épanouissement de la conscience politique qui devait mener au pouvoir politique, sous quelque forme que ce soit, de l'autre elle était reliée au processus de déploiement des forces s'opposant aux entrepreneurs, préparant ou bâtissant tout en même temps, les nouveaux organes de gestion sociale.
En illustration de ce qui précède nous pouvons citer un fait historique rapporté par le marxiste bien connu A. Pannekoek. En 1911, il y avait, en Allemagne, une grève et les grévistes tentaient d'empêcher les jaunes de travailler. La presse bourgeoise qualifiait cette action de "terrorisme". Les tribunaux intervinrent et tentèrent d'accuser quelques grévistes de séquestration. Selon les tribunaux, les grévistes avaient contraint les jaunes de les suivre devant le comité de grève, où ils étaient interrogés comme par un tribunal, puis, après quelques mises en garde, relâchés. Lors de leur interrogatoire par la "justice officielle", les jaunes déclarèrent, cependant, qu'il n'était pas question de séquestration; ils avaient suivi les grévistes de leur plein gré. Et le juge, très surpris, de dire : "Ainsi, vous admettez que cette organisation, qui vous est hostile, est une instance si compétente que vous n'osez pas vous soustraire à 1'ordre de les suivre que vous adressèrent les grévistes ?"
Pour Pannekoek, à cette époque, cette anecdote était un exemple de la manière dont les organisations ouvrières travailleraient ensuite comme organes indépendants opposés aux vieux organes de l'Etat. Il suffisait de briser le pouvoir de l'Etat pour permettre l'essor des organisations ouvrières autonomes.
LE MECOMPTE
Ce que Marx attendait du développement du capital, s'est, en général, réalisé. Mais ses prédictions, au sujet de la lutte de classes, sont, jusqu'à présent, apparues fausses. La concentration des capitaux et la centralisation de la vie économique (et politique) se sont effectuées. La classe des salariés devint prépondérante; des milliers d'ouvriers furent rassemblés dans des usines, des millions d'entre eux s'organisèrent en syndicats. Les crises économiques se succédèrent toujours, de plus en plus vite jusqu'en 1939, se montrant de plus en plus destructrices, la première, puis la seconde guerre mondiale, venues de la concurrence des capitaux, causaient le massacre de milliers d'ouvriers et épuisaient l'appareil de production européen. Mais si ces prédictions des vieux marxistes se réalisèrent, il n'en est pas de même de celle concernant l'appauvrissement de la classe laborieuse, au moins si on la considère sous l'angle de la consommation et de la garantie de subsistance. Quantité et diversité des biens de consommation se sont accrues au cours des années; les assurances sociales qui portent sur le chômage, les invalidités, les maladies, la vieillesse etc... sont devenues un appui non négligeable dans l'existence , la réduction du temps de travail, les vacances, la radio, le cinéma, la télévision et les possibilités de voyager assurent des loisirs certains auxquels les vieux marxistes n'avaient sûrement pas rêvé.
Pourtant cette augmentation du niveau de la vie matérielle et cette sécurité plus grande de subsister ne sont pas en soi responsables de l'anéantissement des perspectives ouvrières de société sans classes et sans exploitation. Cette responsabilité incombe plutôt à la façon dont cette amélioration a été obtenue. Si cette amélioration a-vait été conquise au cours des années par des luttes de masse des ouvriers face à une résistance acharnée des entrepreneurs, le processus de développement de nouveaux caractères psychiques, mentionné ci-dessus, serait entré en ligne de compte. La certitude du communisme, son inéluctabilité, se trouvait dans la nécessité d'une lutte permanente et acharnée pour réaliser le prix du travail au niveau de la valeur du travail, avec comme conséquence psychologique la volonté de réaliser le communisme. Les conceptions des ouvriers de la solidarité et d'une solide discipline de classe, l'expression de nouvelles valeurs sociales, d'une nouvelle conscience morale, tout cela est lié à une lutte active des ouvriers eux-mêmes, comme c'était réellement le cas au temps de Marx.
Ici se trouve l'erreur de Marx. Il a sous-estimé les conséquences de l'augmentation prodigieuse de la productivité, qui ouvrait un chemin plus facile à l'augmentation du niveau de vie. Surtout à partir de la première guerre mondiale, le caractère de la lutte de classe devait changer, la collaboration entre le capital et le travail par le truchement des parlements et des syndicats devenait possible sur la base de la productivité accrue du travail, et fournissait une issue à la situation sans que les masses mêmes soient obligées d'intervenir. La lutte acharnée des masses elles-mêmes n'a, jusqu'à présent, pas été absolument nécessaire et il s'ensuit que les prédictions de caractère psychologico-social n'ont pas été réalisées.
TRAVAIL MANUEL ET TRAVAIL INTELLECTUEL
Avant de terminer ce chapitre, nous voulons signaler que l'augmentation du niveau de vie n'est pas en contradiction avec la loi de la valeur de la force de travail formulée par Marx. A première vue cette augmentation, incarnée en radios, cinémas, télévisions, possibilités de voyages etc., semble en contradiction avec cette loi. Mais ce n'est qu'en apparence. Cette loi dit que la valeur du travail est déterminée par les frais de reproduction de la force de travail y compris la reproduction dans la nouvelle génération. Autrefois, ces frais se limitaient en frais d'une méchante habitation, de l'habillement et de la nourriture, le bistrot et l'Eglise assurant une détente suffisante. De nos jours, cette reproduction, exige beaucoup plus, et cela vient du changement de caractère du travail.
C'est la machine qui a modifié ce caractère. Tout le temps où l'on a travaillé avec des machines peu compliquées ou sans machines du tout, le travail avait surtout un caractère manuel, physique. C'étaient surtout les muscles qui comptaient, l'effort intellectuel ou nerveux jouant un rôle secondaire. Ainsi les frais de reproduction de la force de travail se limitaient au rétablissement des facultés physiques et à l'éducation corporelle des enfants. Avec l'extension généralisée du travail mécanisé, aux machines toujours plus compliquées, l'effort intellectuel, une attention constamment soutenue, amenaient une modification du caractère du travail (chauffeurs, chemins de fer, ateliers de confection, travail à la chaîne, emplois de bureaux,). Au lieu du travail musculaire apparaissait l'épuisement corporel et intellectuel. La régénération des facultés physiques cessait d'être suffisante. L'ensemble aboutissait à un raccourcissement du temps de travail et concurremment à une extension des moyens de distraction : cinéma, radio, vacances etc.. Autrement dit : l'épuisement corporel et mental avait pour résultat une augmentation du coût de la valeur du travail qui s'exprimait par une augmentation des frais de reproduction de celle-ci. L’élévation du niveau de vie, loin d'être en désaccord avec la loi de la valeur de la force de travail, en est au contraire une confirmation.
Mais il est sûr que, de nos jours, la classe ouvrière n'a pas réussi à réaliser la nouvelle valeur de sa force de travail malgré le soi-disant pouvoir des syndicats et des partis socialistes parlementaires. Du point de vue du rythme de la vie économique, on doit constater une régression qui ne s'exprime pas en biens de consommation mais en nervosité générale et en maladies nerveuses. Ce n'est pas là ce que Marx attendait.
[1] [75] Voir en particulier les articles consacrés aux premières années des PCI (Internationaliste et International) dans les numéros 32 et 36 de la REVUE INTERNATIONALE.
[2] [76] Voir le Capital 1 chap.24
[3] [77] Voir note 1.
[4] [78] Idem.
[5] [79] Marx, lettre à Domela Neuwenhuis 22-2-1880. p. 317. éd. Institut Marx-Engels-Lénine.
[6] [80] "Le Capital" 1 chap.23 n°1.
[7] [81] "Le Capital" 1 chap.23 n°2.
[8] [82] Voir note 4.
Conscience et organisation:
Débat : à propos de la critique de la théorie du "maillon le plus faible"
- 3122 lectures
A la suite de la défaite et de la répression subies par la classe ouvrière en Pologne, en décembre 81, une discussion s'est engagée dans le CCI en vue de tirer un maximum d'enseignements de cette expérience. Les principales questions étaient :
- Pourquoi et comment la bourgeoisie mondiale a-t-elle réussi à isoler les ouvriers en Pologne de leurs frères de classe des autres pays ?
- Pourquoi leur lutte n'a-t-elle pas donné le signal d'un développement des combats dans le reste du monde ?
- Pourquoi, en Pologne même, les travailleurs qui avaient, en août 80, fait preuve d'une telle combativité, d'une telle capacité d'auto organisation, qui avaient utilisé avec autant d'intelligence l'arme de la grève de masse contre la bourgeoisie, ont-ils par la suite été piégés aussi facilement par le syndicat "Solidarnosc" qui les a livrés pieds et poings liés à la répression ?
- Quelle est, pour le prolétariat mondial, l'ampleur réelle de la défaite subie en Pologne? S'agit-il d'une défaite partielle, de portée relativement limitée, ou d'une défaite décisive qui signifie que la bourgeoisie a d'ores et déjà les mains libres pour donner sa propre réponse à 1'aggravation inexorable de la crise économique : la guerre impérialiste généralisée ?
A ces questions, la Revue Internationale du CCI (n°29, 2ème trimestre 82) apportait une réponse dans l'article "Après la répression en Pologne : perspectives des luttes de classe mondiales". Cependant, la réflexion du CCI ne s'était pas arrêtée aux éléments contenus dans ce texte. Elle l'a conduit à préciser sa critique de la thèse, ébauchée par Lénine et développée par ses épigones, suivant laquelle la révolution communiste débuterait, non dans les grands bastions du monde bourgeois, mais dans des pays moins développés : la "chaîne capitaliste" devait se briser à son "maillon le plus faible". Cette démarche a abouti à la publication dans la Revue Internationale n°31 (4ème trimestre 82) d'un texte dont le titre résume bien la thèse qui y est défendue : "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe, critique de la théorie du maillon le plus faible'".
Elle a conduit également en juillet 83 à l'adoption par le 5ème congrès du CCI d'une résolution sur la situation internationale qui précise que :
"L'autre enseignement majeur de ces combats (en Pologne 80-81) et de leur défaite est que cette généralisation mondiale des luttes ne pourra partir que des pays qui constituent le coeur économique du capitalisme : les pays avancés d'Occident et parmi eux, ceux où la classe ouvrière a acquis 1'expérience la plus ancienne et la plus complète :1'Europe occidentale..,
Si 1'acte décisif de la révolution se jouera lorsque la classe ouvrière aura terrassé les deux monstres militaires de l'Est et de l'Ouest, son premier acte se jouera nécessairement au coeur historique du capitalisme et du prolétariat L'Europe occidentale." (Revue Internationale n°35, page. 21).
L'ensemble du CCI s'est trouvé d'accord sur la nécessité de critiquer la thèse du "maillon le plus faible" dont l'Internationale Communiste dégénérescente a fait un dogme et qui a servi à justifier les pires aberrations bourgeoises, notamment celle du "socialisme dans un seul pays".
Cependant, une minorité de camarades a rejeté l'idée que "le prolétariat d'Europe occidentale serait au centre de la généralisation mondiale de la lutte de classe", que "l'épicentre du séisme révolutionnaire à venir se trouve placé" dans cette région du monde.
"Dans la mesure où les débats qui traversent 1'organisation concernent en général 1'ensemble du prolétariat, il convient que celle-ci les porte à l'extérieur". (Revue Internationale n°33, "Rapport sur la structure et le fonctionnement de l'organisation des révolutionnaires").
Nous publions donc ci-dessous- un texte de discussion émanant d'un camarade de la minorité et qui synthétise d'une certaine façon les désaccords apparus au cours des débats sur cette question précise.
Dans la mesure où ce texte se réfère à une "Résolution sur la critique de la théorie du maillon faible", adoptée en janvier 83 par l'organe central du CCI, nous avons estimé utile de faire précéder ce texte par celle-ci bien qu'elle n'ait pas été écrite aux fins de publication à l'extérieur mais de prise de position dans le débat interne. C'est pour cela que la langue en est difficile à comprendre pour le lecteur non familiarisé avec nos analyses et que nous incitons à lire au préalable les textes de la Revue Internationale n°29 et 31 déjà cités.
Enfin, outre la résolution et le texte de discussion, nous publions la réponse du CCI aux arguments donnés dans celui-ci.
RESOLUTION DU CCI
1) Le CCI réaffirme l'unité des conditions de la révolution prolétarienne au niveau mondial. L'unification du monde capitaliste dans la période de décadence implique que c'est le monde entier, quel que soit le degré de développement des pays qui le compose, qui est mûr pour la révolution communiste, dont les conditions sont données depuis 1914 mondialement. Il rejette la théorie bordiguiste des révolutions bourgeoises dans certaines aires géographiques du tiers-monde, comme étape première de la révolution prolétarienne. Celle-ci n'est pas seulement nécessaire mais possible pour chaque secteur du prolétariat mondial pour lequel elle constitue la seule perspective à la crise générale du système.
2) De même que l'unité des conditions de la révolution n'est pas la somme de conditions nationales particulières, de même le prolétariat mondial n'est pas la somme de ses parties.
La conception marxiste de la révolution n'est pas une conception matérialiste vulgaire. La révolution est un processus dynamique, et non statique, dont la marche est le dépassement des conditions géo historiques particulières. C'est pourquoi le CCI rejette aussi bien la théorie du "maillon le plus faible du capitalisme" que celle de la "Révolution ouest-européenne".
La première, élaborée par l'Internationale Communiste lors de son déclin, affirmait implicitement que le prolétariat des pays arriérés pourrait jouer un rôle plus révolutionnaire que celui des pays développés (absence d'"aristocratie ouvrière" ; inexistence du poison de la "démocratie"; faiblesse de la bourgeoisie nationale).
La seconde, développée dans la "Réponse à Lénine" de Gorter, soutenait que seuls les prolétaires d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord seraient en mesure de réaliser la révolution mondiale, réduite dans les faits à l'ouest européen, étant données des conditions objectives plus favorables (fortes concentrations ouvrières, tradition de lutte). L'erreur symétrique de ces deux conceptions trouve son origine aussi bien dans les conditions de l'époque (la révolution naît en 17 de la guerre, à la périphérie de l'Europe industrielle, dans un monde capitaliste encore divisé en une constellation d'impérialismes et de capitaux privés) que dans la confusion entre champ d'extension et dynamique de la révolution. En cherchant à déterminer les conditions objectives les plus favorables à l'éclatement de la révolution, les révolutionnaires de l'époque eurent tendance à confondre point de départ et point d'arrivée de tout le processus dynamique d'extension de la révolution. Bien que ces deux théories ne fussent pas des conceptions bourgeoises et expriment la vie du mouvement révolutionnaire de l'époque à la recherche d'une cohérence, elles ont mené aux pires aberrations : la théorie des "maillons faibles" aboutissant au tiers-mondisme ; celle de la "révolution ouest-européenne"à un néo-menchevisme.
3) La grève de masse d'août 80 limitée à la Pologne ne remet pas en cause le schéma classique de la généralisation internationale de la lutte de classe, comme bond qualitatif nécessaire à l'ouverture d'un cours révolutionnaire.
La Pologne a reposé avec acuité la question des conditions objectives les plus favorables au développement de la dynamique internationale de la grève de masse :
- à la différence de 1917-18, la bourgeoisie est beaucoup mieux préparée et plus unie internationalement pour étouffer toute menace de généralisation par-delà les frontières d'un pays ;
- un processus révolutionnaire ne peut naître dans un seul pays en l'absence d'une dynamique brisant le cadre national dans lequel la grève de masse ne peut être qu'étouffée.
4) Déterminer le point de départ de cette dynamique, et donc les conditions optimales de la naissance du séisme révolutionnaire, n'est pas nier l'unité du prolétariat mondial. Elle est le processus même par lequel l'unité potentielle devient unité réelle.
Cependant, unité n'est pas identité des parties qui restent soumises à des conditions matérielles différentes. Il n'y a pas d'égalité naturelle entre les divers organes et le coeur ou le cerveau d'un corps vivant, qui remplissent les fonctions vitales complémentaires.
Comme lors de la première vague révolutionnaire, le prolétariat des pays développés se trouve au coeur même du processus d'internationalisation de la grève de masse. Il est le noyau même de la prise de conscience mondiale par le prolétariat de ses taches révolutionnaires.
5) Le CCI rejette la conception naïvement égalitariste suivant laquelle n'importe quel pays pourrait être le point de départ de la dynamique révolutionnaire. Cette conception repose sur la croyance anarchiste que tous les pays - à l'exemple de la grève générale révolutionnaire - pourraient simultanément initier un processus révolutionnaire.
En réalité, le développement inégal du capitalisme, en creusant un fossé toujours plus grand entre grands pays industrialisés concentrant la majorité du prolétariat d'industrie moderne et pays du tiers- monde, a pour conséquence que les conditions les plus favorables à la naissance du bouleversement, révolutionnaire sont étroitement déterminées par le cadre historique et social.
6) Le point de départ de la révolution mondiale se trouve nécessairement en Europe occidentale, où à la force du nombre, s'ajoute celle de la tradition et de l'expérience révolutionnaire du prolétariat de 1848 à la première vague révolutionnaire, où la classe ouvrière a affronté le plus directement la contre-révolution, où se trouve le champ de batail le ultime de la guerre impérialiste généralisée entre Etats capitalistes. Parce que l'Europe occidentale est :
- la première puissance économique et concentration ouvrière, où l'existence de plusieurs nations contiguës pose plus immédiatement la question du dépassement des frontières nationales ;
- au coeur même des contradictions du capitalisme en crise qui le pousse vers la guerre mondiale ;
- le noeud gordien des mystifications bourgeoises les plus puissantes (démocratiques, parlementaires et syndicales) que le prolétariat devra trancher pour faire le saut libérateur de l'ensemble du prolétariat mondial ;
- elle est au coeur même du cours vers la révolution.
La fin de la période de contre-révolution marquée par la grève de mai 68, la maturation de la conscience prolétarienne en Europe dans les années 70, l’existence d'un milieu politique prolétarien plus développé dans cette partie du monde que partout ailleurs, tous ces facteurs n'ont fait que le confirmer.
7) Ni les pays du tiers-monde, ni les pays de l'Est, ni l'Amérique du Nord, ni le Japon, ne peu vent être le point de départ du processus menant à la révolution :
- les pays du tiers-monde en raison de la faiblesse numérique du prolétariat et du poids des illusions nationalistes ;
- le Japon, et les USA surtout, pour n'avoir pas affronté aussi directement la contre-révolution et avoir subi moins directement la guerre mondiale, et en l'absence d'une profonde tradition révolutionnaire ;
- les pays de l'Est, en raison de leur arriération économique relative, de la forme spécifique (pénurie) qu'y prend la crise mondiale entravant une prise de conscience globale et directe des causes de celle-ci (surproduction), de la contre-révolution stalinienne qui a transformé dans la tête des ouvriers l'idéal du socialisme en son contraire et a permis un nouvel impact des mystifications démocratiques, syndicalistes et nationalistes.
8) Cependant, si le point de départ de la révolution mondiale se trouve nécessairement en Europe de l'Ouest, le triomphe de la révolution mondiale dépend en dernière instance de son extension victorieuse rapide aux USA et en URSS, têtes des deux blocs impérialistes où se jouera le dernier grand acte de la révolution.
Pendant la première vague révolutionnaire, les pays où se trouvait le prolétariat le plus avancé et le plus concentré, étaient en même temps les pays capitalistes militairement les plus puissants et les plus décisifs, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, bien que ce soit encore en Europe de l'Ouest que se trouvent les bataillons les plus avancés et concentrés du prolétariat, les centres de la puissance militaire du capital mondial se sont déplacés vers les USA et l'URSS, ce qui a des conséquences pour le développement d'un mouvement prolétarien révolutionnaire.
Aujourd'hui, une nouvelle Sainte Alliance anti ouvrière du capital russe et américain par dessus leurs rivalités impérialistes, imposera une intervention militaire directe contre l'Europe révolutionnaire, c'est-à-dire une mondialisation de la guerre civile dont l'issue dépendra de l'aptitude du prolétariat des deux têtes de bloc, et notamment des USA, à paralyser et renverser l'Etat bourgeois.
9) Le CCI met en garde contre un certain nombre de confusions dangereuses :
- l'idée que "tout est possible à tout moment, en tout lieu", dès que surgissent à la périphérie du capitalisme des affrontements de classe aigus, laquelle idée repose sur l'identification entre combativité et maturation de la conscience de classe.
- l'assimilation inconsciente entre grève de masse internationale et révolution, alors que la généralisation internationale de la grève de masse est un pas qualitatif qui annonce la révolution -naissance d'une situation pré-révolutionnaire -mais ne peut être confondue avec elle. Celle-ci se traduit nécessairement par la dualité des pouvoirs qui pose l'alternative : dictature des conseils ouvriers ou contre-révolution sanglante, ouvrant un cours vers la guerre.
- la conception d'un développement linéaire de l'internationalisation de la grève de masse, alors que celle-ci suit nécessairement un cours sinueux, avec des avancées et des reculs, à l'exemple de la Pologne.
Il appartient aux révolutionnaires de garder la tête froide et de ne pas céder à l'exaltation immédiatiste qui mène à l'aventurisme, ou aux "coups de cafard", à chaque recul, qui se traduisent par la démoralisation.
Si l'histoire s'accélère depuis août 80 et donne une perspective exaltante pour les révolutionnaires, il appartient de comprendre que notre travail est et reste à long terme.
CRITIQUE DE QUELQUES POSITIONS DU CCI. SUR LA THEORIE DES MAILLONS FAIBLES"
Ces deux dernières années ont mis à l'épreuve les capacités des minorités révolutionnaires. L'approfondissement soudain de la crise dans le monde entier, la brutalité des mesures d'austérité que la bourgeoisie a prises, les préparatifs de guerre massifs et évidents, tout cela semblait exiger une réponse foudroyante du prolétariat mondial. Et pourtant, la classe ouvrière a subi une importante défaite en Pologne cependant que partout ailleurs la lutte stagnait. Les organisations révolutionnaires sont restées minuscules et sans écho significatif. Cette situation a mis â nu les nombreuses faiblesses qui existaient dans le milieu révolutionnaire. La confusion est considérable et compréhensible. Les révolutionnaires ne peuvent plus se limiter à la réaffirmation des leçons du passé. Ils doivent évaluer et expliquer la défaite en Pologne et les difficultés présentes. Ils doivent clarifier les perspectives de la lutte ouvrière, expliquer comment parvenir à une étape supérieure.
Dans ce contexte, le CCI a formulé sa critique de la "théorie du maillon le plus faible" (Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe, Revue Internationale n° 31 ; Résolution sur la critique de la "théorie du maillon faible"). Ces textes rejettent à juste titre la position de Lénine qui considère que le renversement du capitalisme démarrera dans les pays les plus faibles et, à partir de là, s'étendra vers le reste du système. Cette théorie a été un instrument pour ceux qui cherchent le fossoyeur du capitalisme en dehors du prolétariat. Le problème, avec les"léninistes" qui défendent cette position aujourd'hui, n'est pas qu'ils ont des illusions sur la force des ouvriers dans les pays faibles , mais qu'ils ont des illusions sur ces pays faibles eux-mêmes. Pour eux, le prolétariat n'est que de la chair à canon du "mouvement anti-impérialiste".
Mais les textes du CCI vent plus loin que le rejet de cette théorie désastreuse. Ils expliquent la défaite en Pologne par ce fait même que la Pologne est un pays et un Etat faibles. Ils affirment également que "ce n'est donc qu'en Europe occidentale ... qu'il (le prolétariat) pourra développer pleinement sa conscience politique indispensable à sa lutte pour la révolution" (Revue Internationale n° 31, p.9). Ici, la bourgeoisie ne pourrait pas isoler une grève de masse parce que "la mise en place d'un cordon sanitaire économique deviendra impossible" et "qu'un cordon sanitaire politique n'aura plus d'effets" (ibid.).
Cette vision offre certainement les moyens de digérer la défaite en Pologne et de voir plus clairement cannent avancer. Mais en mené temps :
- elle obscurcit certaines leçons de la Pologne et d'autres luttes qui ont pris place et qui vont se produire en dehors de l'Europe occidentale. Elle voit leurs implications comme nécessairement limitées du fait qu'elles se passent - aux yeux du CCI - en dehors de la zone géographique où les mystifications capitalistes les plus importantes peuvent être dépassées ;
- elle créé la fausse impression que la capacité de la bourgeoisie d'isoler une grève de masse dépendrait du lieu où elle se déroule, de sorte qu'elle ne s'y heurterait pas aux mêmes problèmes qu'en Pologne ou qu'elle pourrait les vaincre plus facilement ;
- elle donne le faux espoir que la conscience révolutionnaire peut se développer pleinement dans la seule Europe occidentale et faire tomber ensuite, par la force de l'exemple, les mystifications capitalistes dans les autres zones industrialisées.
"Ce n'est qu'au moment où le prolétariat de ces pays aura déjoué les pièges les plus sophistiqués tendus par la bourgeoisie (...) qu'aura sonné l'heure de la généralisation mondiale des luttes prolétariennes,1'heure des affrontements révolutionnaires", (ibid., p. 10) .
FORCES DE CLASSE ET CONSCIENCE DE CLASSE.
La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience. Les mystifications ne peuvent être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse. Les luttes se développent en dépit du poids de nombreuses illusions, qui ont toutes corme dénominateur commun la croyance en la possibilité d'obtenir une amélioration des conditions de vie, une victoire, dans le cadre du capitalisme. Ce cadre a beaucoup de nems et il est coloré par des "spécificités" locales, mais c'est toujours le cadre de l’Etat-Nation.
Cette illusion entrave encore la lutte ouvrière dans tous les pays. Mais elle a un effet très différent dans les pays où le prolétariat n'est qu'une petite minorité, éclipsée par les autres classes, à l'opposé des pays où le prolétariat a la force potentielle de paralyser l'économie entière et de détruire l'Etat bourgeois (à condition qu'il n'ait à affronter que sa "propre " bourgeoisie! . Dans le premier cas, cette illusion tend à dévoyer les travailleurs de leur terrain de classe pour les rallier à une fraction de la bourgeoisie (l'Eglise, la gauche, la guérilla, les militaires "progressistes" etc..) tant leurs propres forces potentielles sont réduites dans le cadre de la nation. C'est pourquoi les ouvriers dans ces pays ont besoin des démonstrations de force de la classe dans les pays industrialisées, pour trouver la voie de la lutte autonome, pour que cette voie ne se présente pas comme désespérée.
Ce n'est que dans le deuxième cas que cette illusion d'une possibilité de changement dans le cadre de la nation, fondement de toutes les mystifications capitalistes, est incapable d'empêcher le développement de la lutte de la classe ouvrière sur son propre terrain. Ici, les ouvriers sont assez forts pour ne compter que sur eux-mêmes, même si, pour le moment, ils ne se voient que comme une catégorie sociale qui exerce sa pression dans le cadre de la nation, et pas encore canne une classe mondiale qui détient entre ses mains le sort de l'humanité. C'est donc le développement de la lutte ouvrière dans ces pays qui est la clé de la prise de conscience croissante par l'ensemble du prolétariat de sa propre force. Et c'est cette prise de conscience croissante qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes. Par conséquent, les concentrations majeures du prolétariat dans les pays industrialisés situés au coeur des deux blocs jouent le rôle décisif dans le développement de la conscience de classe révolutionnaire. Ce n'est que là qu'en dépit du poids de l'idéologie bourgeoise, la lutte peut se développer et devenir le levier avec lequel la conscience prolétarienne sera libérée du poids de l'idéologie de la classe dominante.
Mais l'existence de la lutte ne suffit pas en elle-même. Comme le disait Marx, de mène qu'un homme ne se débarrasse de son outil de travail qu ' une fois qu'il lui est devenu inutile et qu'il en ait trouvé un autre pour le remplacer, le prolétariat ne détruira pas le système social existant avant que la nécessité et la possibilité de cette tâche historique ne soient gravées dans sa conscience. Et ce processus n'est pas possible dans les limites de la seule Europe occidentale.
PRENDRE CONSCIENCE DE LA NECESSITE DE LA GENERALISATION.
Pour comprendre la nécessité de la révolution, la classe ouvrière doit être à même de percevoir la destruction des bases objectives des mystifications capitalistes. Toutes ces mystifications sont fondées sur la croyance en la possibilité d'une économie prospère dans le cadre de la nation. Pour que cet espoir s'effondre aux yeux de tous les ouvriers sa fausseté doit être démontrée clairement partout dans le monde, non pas dans les économies les plus faibles, mais dans les nations capitalistes les plus fortes.
Tant que subsiste l'illusion d'une possibilité de reprise significative pour les économies les plus fortes, la croyance que la nation capitaliste peut offrir un cadre pour leur survie subsistera parmi les ouvriers de tous les pays, faibles et forts. Cela implique que la révolution n'est pas pour l'an prochain. Concevoir un assaut révolutionnaire à court terme, tel que certains l'ont fait pendant la grève de masse en Pologne, ne peut mener qu'à la démoralisation. Mais cela signifie également que, pour la première fois dans l'histoire, cette condition essentielle pour la révolution mondiale va être pleinement remplie. Toutes les tentatives révolutionnaires du passé se sont heurtées à ce problème. La mobilisation des ouvriers pour la première guerre mondiale, et plus tard la défaite de la première vague révolutionnaire, ont été rendues possibles, pour une bonne part, par la promesse d'une reprise dans les pays les plus développés. La mobilisation des ouvriers pour la deuxième guerre mondiale, leur défaite dans les pays comme l'Espagne, ont été possibles en raison du poids de la défaite de la première vague révolutionnaire, mais également de la capacité du capitalisme à offrir un nouvel espoir de redressement en développant le capitalisme d'Etat à un niveau sans précédent (en Allemagne, par exemple, entre 1933 et 38, la production industrielle avait augmenté de 90% et le chômage avait diminué de 3,7 millions à 200 000). Aujourd'hui, pour la première fois, le capitalisme s'approche du moment où il n'aura plus aucun moyen économique objectif de maintenir en vie quelque espoir de redressement, pour pouvoir encore apporter une amélioration temporaire à la situation de "ses" ouvriers, même pas de façon limitée ou sur une partie de la planète. Le capitalisme d'Etat a déjà été développé non pas jusqu'à son maximum théorique, mais jusqu'à son maximum d'efficacité. Le développement du capitalisme d'Etat à l'échelle internationale, et la redistribution de la plus-value grâce aux aides gouvernementales , du FMI, de la Banque Mondiale, etc. ne pourraient pas être poussés suffisamment loin pour que les fondements mêmes du capitalisme - la concurrence- puissent imposer une limite de fer à ce développement. Ce développement du capitalisme d'Etat a déjà été utilisé pleinement pendant l'après-guerre, pour créer les marchés requis par le haut degré de développement des forces productives dans les pays les plus industrialisés, ce qui a conduit à une interdépendance sans précédent entre tous les éléments de la machine capitaliste. Il en résulte qu'aucun pays n'a aujourd'hui les moyens de se protéger de la crise. En tentant d'y échapper, ils ne feraient qu'aggraver leur situation.
Pour la première fois, un déclin brusque, sans espoir crédible de redressement devient inévitable pour tous les pays. Cela ne veut pas dire que la situation soit devenue la même dans tous les pays, que partout les ouvriers vont être jetés dans la famine. Cela signifie que certains vont être jetés dans la famine et les autres dans une exploitation barbare, dans la militarisation, la terreur, la concurrence entre eux et, finalement, dans la guerre et la destruction globale s'ils ne savent pas s'y opposer. La situation spécifiques de tous les ouvriers ne deviendra pas la même. Une multitude de différences continuera à exister. Ce qui sera pareil partout, c'est l'attaque totale de la bourgeoisie, les intérêts des ouvriers et les perspectives qu'ils auront.
PRENDRE CONSCIENCE DE LA POSSIBILITE DE LA GENERALISATION.
Mais, pour que la révolution devienne le but conscient de la lutte, il faut non seulement que les ouvriers en voient la nécessité, mais également la possibilité comme étant à la portée de leurs forces. Le niveau de conscience politique est nécessairement limité par les forces dont ils disposent. Une lutte qui se déclenche à partir d'une plateforme de revendications économiques limitées ne peut élargir ses objectifs, ne peut devenir politique que par la croissance des forces dont la classe dispose, par l'extension et l'auto-organisation. Mais les possibilités dépendent aussi de l'opposition que les ouvriers ont à vaincre. Et à ce niveau également, nous voyons d'importantes différences entre la situation de 17 et celle d'aujourd'hui. En 17, la bourgeoisie était divisée et désorganisée par la guerre, désorientée par son manque d'expérience. Dans ces circonstances, il y avait effectivement des "maillons faibles" dans sa ligne de défense, que le prolétariat pouvait mettre à profit. Suivant la logique de la résolution du CCI, les ouvriers en Russie auraient dû rêver de la démocratie bourgeoise puisqu'ils n'avaient pas été directement confrontés aux mystifications les plus sophistiquées de la bourgeoisie occidentale. Mais, malgré les plaidoyers des menchéviks, ils n'ont pas perdu leur temps avec celle-ci parce que le degré atteint dans l'auto-organisation, l'extension de la lutte à travers la Russie, l'agitation ouvrière dans les pays voisins et la faiblesse de la bourgeoisie qu'ils devaient affronter leur permettaient de dépasser largement cette perspective et rendaient possible l'objectif d'une victoire révolutionnaire en Russie, avec l'espoir raisonnable que les autres pays suivraient rapidement.
Aujourd'hui, par contre, chaque fraction prolétarienne en lutte affronte une bourgeoisie mondiale unifiée. Il n'y a plus de "maillon faible" dans la ligne de défense du capitalisme. Ce qui était alors possible ne l'est plus, et puisque la conscience de classe est liée aux possibilités objectives, ceci implique que la maturation de la conscience révolutionnaire prendra plus de temps, pour que les forces de la classe soient supérieures à celles requises en 17. Si ces forces ne sont pas développées à une échelle internationale, au-delà d'une zone limitée telle que l'Europe occidentale, si les mystifications capitalistes parviennent à isoler les luttes entre elles, à empêcher le prolétariat de prendre conscience de ses intérêts et perspectives communs, alors aucune grève de masse, où qu'elle se produise, ne lui permettra de "développer pleinement sa conscience politique indispensable à sa lutte pour la révolution" (Revue Internationale n°31), parce qu'il sera impossible aux ouvriers de voir quelles sont les forces nécessaires à la tâche du renversement d'une bourgeoisie mondiale unifiée.
En de telles circonstances, une grève de masse ne peut que stagner, ce qui signifie qu'elle dépérira rapidement. Faute d'une perception claire de la possibilité d'un objectif prolétarien plus large qui puisse se graver dans la conscience des prolétaires, le niveau d'auto organisation ne pourra être maintenu et il régressera. Alors, une perspective basée sur des mystifications bourgeoises s'imposera inévitablement. Le CCI ne se rendait pas compte de cela quand il écrivait, plus de trois mois après le démantèlement de l'organisation autonome de la classe en Pologne : "Loin de s'essouffler, le mouvement s'est durci" (Revue Internationale n°24, p.4) , ni quand , par la suite, il attribuait le succès des mystifications capitalistes en Pologne au poids des "spécificités" du bloc de l'Est et, en particulier, de la Pologne.
LE POIDS DES SPECIFICITES.
Comme l'écrivait le CCI, "L'idée qu'il existe des 'spécificités nationales ou de bloc' (...) sera de plus en plus battue en brèche par le nivellement par le bas de la situation économique de tous les pays, ainsi que des conditions de vie de tous les travailleurs" (Revue Internationale n°29, p.51. Ceci ne signifie pas que les révolutionnaires doivent nier l'existence de toutes sortes de différences, entre ouvriers de différents pays, secteurs et régions, utilisés par le capital pour les diviser. Mais sa capacité de division ne résulte pas des "spécificités" elles-mêmes, mais de la capacité globale du capitalisme à maintenir des illusions sur son propre système. Sans la démystification progressive de ces illusions par la crise et la lutte de classe, les ouvriers resteront isolés dans leurs situations "spécifiques", dans les pays "forts" aussi bien que dans les pays "faibles". S'il est possible que la puissance de l'Eglise en Pologne soit spécifique à ce pays, il n'y a rien de spécifique dans les mystifications que cette institution emploie contre la classe ouvrière : nationalisme, pacifisme, légalisme, etc... En d'autres termes, ces mystifications ne sont pas puissantes parce que l'Eglise est puissante, c'est le contraire qui est vrai. L'Eglise joue le rôle d'une gauche dans l'opposition parce que le manque de profondeur de la crise - non pas en Pologne mais à l'échelle internationale - et l'immaturité du développement de la lutte des ouvriers, également au niveau international, permet au capital d'employer ces mystifications avec succès. Cela signifie que les révolutionnaires doivent insister sans cesse sur l'unité mondiale de la lutte du prolétariat et démasquer les mystifications que recouvrent ces spécificités. Cela signifie qu'il faut combattre la peur que l'extension et la généralisation de la lutte ne soient impossibles à cause des différences spécifiques et son corollaire, l'illusion de la possibilité d'une victoire, d'un plein développement de la conscience révolutionnaire dans un seul pays, ou dans une seule partie du continent.
Voyons donc de plus près les spécificités principales que le CCI croient être responsables du fait que les ouvriers en Occident soient seuls sur le chemin vers la conscience révolutionnaire.
La"pénurie" dans le bloc de l'Est.
"La forme spécifique (pénurie) qu'y prend la crise mondiale entravant une prise de conscience globale et directe des causes de celle-ci (surproduction) " .. (Résolution sur la critique de la théorie du maillon faible)...
Pour les ouvriers à l'Est, de même que pour ceux de l'Ouest, la surproduction et la pénurie ne peuvent être comprises que s'ils quittent le point de vue "spécifique" pour voir le système capitaliste comme un tout. Sans cette vision globale, les manifestations de la surproduction à l'Ouest se présentent comme le fait d'une distribution injuste, un manque de protection contre la concurrence étrangère, etc... La surproduction ne peut être localisée uniquement en Occident. En vérité, les pays faibles sont les premiers à la ressentir: à cause de la composition organique plus faible de leurs capitaux, ils se heurtent plus tôt aux limites du marché mondial. Même R. Luxemburg, sur les théories économiques de laquelle se base le CCI, était claire sur le fait que la surproduction n'est pas un phénomène auquel seulement quelques pays sont confrontés, tandis que les autres n'en subiraient que les conséquences : elle la voit comme le résultat d'une disproportion inhérente au processus de production qui est donc présente dans chaque pays. Même dans les pays les plus faibles, les ouvriers peuvent voir comment la surproduction sur le marché mondial abaisse les prix des marchandises qu'ils produisent, provoquant et leur infligeant famine et chômage, tandis qu'en même temps elle pousse "leur" bourgeoisie à détourner une masse croissante de plus-value vers le secteur des moyens de destruction. Même dans un pays sous-développé typique comme le Ghana, l'industrie ne fonctionne qu'à moins de 15% de sa capacité (New York Times, 4/2/83). De la même manière, la pénurie ne peut être comprise que d'un point de vue global.
Si on se place au-delà du point de vue d'un pays particulier, il faut conclure que la pénurie existe dans chaque pays (à divers degré, mais à un taux croissant partout) :
- pénurie de biens de consommation pour les ouvriers et les chômeurs pour qui les produits dont ils ont besoin sont de plus en plus inaccessibles, tandis que la classe dominante en dispose en abondance ;
- pénurie de capital pour la classe dominante qui fait des tentatives désespérées pour augmenter la plu6-value extorquée aux ouvriers afin de protéger sa place sur un marché mondial rétréci.
Ce point de vue global, nécessaire pour percevoir les racines du système et la possibilité de la révolution socialiste, le prolétariat en Occident ne le possède pas de naissance. Il ne peut résulter que de la tendance de la lutte de classe elle-même à se globaliser et à avoir une portée internationale.
L'insuffisance de tradition révolutionnaire, de culture, d'âge.
La vision selon laquelle il n'y a jamais eu de mouvement ouvrier fort en dehors de l'Europe est un préjugé coloré par l'influence d'historiens bourgeois qui ont de bonnes raisons de minimiser le mouvement révolutionnaire. Mais, ce qui est plus important, c'est que ces leçons du passé sont encore latentes dans la mémoire du prolétariat et, qu'elles ne peuvent être réappropriées que par la lutte, avec l'aide de la minorité communiste qui, elle-même est sécrétée par la lutte. La longue contre-révolution a coupé, en Europe, autant qu'ailleurs, les ouvriers des traditions du passé. C'est une aberration de dire, comme la résolution du CCI, que les ouvriers aux USA et au Japon ne se sont pas trouvés confrontés assez directement à la contre-révolution, alors que ceux du bloc de l'Est y ont été trop confrontés, et que, par conséquent, I'"idéal" du socialisme s'est transformé, dans leurs têtes, en son contraire. Partout dans le monde, la vaste majorité des ouvriers identifie le "communisme" au stalinisme ou à ses variantes "eurocommunisme " ou "trotskyste". Ce n'est pas par l'éducation et la culture bourgeoises mais par le développement de la lutte que les ouvriers s'ouvrent aux leçons des expériences de leurs frères de classe dans les autres parties du monde, de même qu'aux leçons du passé. Tous les arguments sur la "tradition", la "culture" et l'"âge" volent en éclat si l'on considère le fait historique que les pays où le prolétariat a réussi le mieux à homogénéiser sa conscience révolutionnaire étaient la Russie et la Hongrie où la classe ouvrière était relativement jeune, privée d'une tradition de longue date, et avec un niveau relativement bas d'éducation bourgeoise. Ceci ne signifie pas que l'expérience ne serait pas importante, que toutes les leçons seraient oubliées au moment où il n'y a pas de luttes ouvertes. Pour les ouvriers en Russie, 1'expérience était très importante, mais elle était directement liée à leur lutte. Ce n'était pas leur situation géographique, ni une confrontation directe avec la démocratie, mais uniquement leur lutte autonome, qui les rendaient capables d'assimiler les expériences de leurs luttes et de celles du reste de la classe, et de les incorporer dans la phase suivante de leur combat.
L'absence d'une confrontation directe avec les mystifications les plus puissantes.
Quand les ouvriers d'Europe occidentale rompront avec les mystifications démocratiques et syndicales ce ne sera pas le résultat de leur confrontation quotidienne à ces pièges. Cela ne se fera que dans et par la lutte, parce que la généralisation de la crise et la lutte simultanée des ouvriers dans les autres pays créent les conditions pour le dépassement de l'isolement que ces mystifications tentent d'imposer. Il en est de même pour les ouvriers de l'Est. En dehors de la lutte, les "syndicats libres" et l'Etat démocratique peuvent être vus comme des produits d'importation de l'Ouest exotiques et attrayants. Mais, dans la lutte, ils deviennent "l'institutionnalisation du mouvement", suivant les termes d'A. Kolodziej, le délégué du MKS de Gdynia qui a refusé de poser_sa candidature aux élections des comités de "Solidarnosc".
Des luttes à l'étranger auraient offert d'autres perspectives aux ouvriers. Elles auraient pu rendre majoritaire la position de Kolodziej, ou du moins, elles auraient ouvert plus de possibilités de succès aux ouvriers dans leurs affrontements avec les syndicats après la mort du MKS. Le fait que cela ne se soit pas passé ne résultait pas de l'absence de confrontation directe à ces mystifications. Sinon, la lutte du prolétariat eût été désespérée. Le capital peut toujours donner une nouvelle enveloppe à ses vieux mensonges, à moins que la base matérielle de toutes les mystifications ne soit dé-. truite par la crise internationale et par la lutte de classe. Si les syndicats en Europe occidentale perdent toute crédibilité par leur pratique quotidienne, il reste toujours les syndicalistes de base pour avancer la mystification d'un nouveau syndicat unitaire, il reste toujours la possibilité d'institutionnaliser des "Conseils Ouvriers" et l'autogestion dans le cadre de l'Etat, il reste la possibilité de gouvernements de gauche radicaux pour préparer la répression, etc.
La conscience de classe révolutionnaire ne peut se développer que par l'assimilation des expériences de la classe dans le monde entier. C'est vrai pour les ouvriers de l'Est aussi bien que pour ceux de l'Ouest."Dans le domaine de la dénonciation du rôle des syndicats, les ouvriers en Pologne ont accompli en quelques mois le chemin que le prolétariat des autres pays a mis plusieurs générations à parcourir" (Revue Internationale n°24, p.3). Ceci s'est fait malgré le manque d'une longue expérience des "syndicats libres". Mais la conscience qu'ils ont acquise ainsi n'est pas un acquis permanent qui subsiste en dehors de la lutte. Elle devra être réappropriée dans les luttes à venir, aussi bien en Pologne qu'ailleurs.
Nous considérons comme limitée la défaite en Pologne. Ceci est correct, non parce que la Pologne n'est qu'un pays secondaire, mais parce que les acquis pour l'ensemble du prolétariat, les leçons de la Pologne, ont plus de poids à long terme que la défaite elle-même. Bien sûr, ce n'était pas une belle retraite. Mais le prolétariat n'est pas une armée, avec un Etat-major et des bataillons, faibles et forts, engagés dans une guerre tactique. Sa lutte n'est pas de nature militaire, mais elle est une lutte pour sa propre conscience révolutionnaire et sa propre organisation. Jamais aucune armée ne connut de telles avancées et de tels reculs suivant le degré d'extension de la conscience de classe. Dans cette bataille, il n'y a pas de belles retraites. Tout arrêt, tout pas en arrière résulte de l'encadrement bourgeois. L'expérience du MKS devra être répétée et améliorée dans plusieurs pays avant que le renversement du rapport de forces entre les classes à l'échelle internationale (le processus d'internationalisation) ne paralyse la classe dominante. Mais les luttes futures pourront tirer profit des leçons de la Pologne. Il est crucial que ces leçons - non seulement celles de la phase ascendante de la lutte, mais, plus encore, celles de sa retombée - ne soient pas obscurcies en attribuant à sa force (tel que le fait la bourgeoisie) ou à ses faiblesses (tel que le fait le CCI) des "spécificités" polonaises. Dans ses luttes prochaines, le prolétariat devra se souvenir de la puissance de l'auto organisation qui a fait ses preuves en Pologne. Il devra se rappeler comment la bourgeoisie lorsqu'elle ne peut empêcher l'auto organisation, tente de contrôler ses organes unitaires pour en faire des instruments destinés à empêcher l'action spontanée de la classe, propager le nationalisme, le légalisme, et d'autres poisons et se transformer finalement en institutions bourgeoises- Il devra se souvenir des affrontements entre "Solidarnosc" et les ouvriers, qui montrent comment chaque syndicat, même nouvellement formé, devient immédiatement l'ennemi mortel de la lutte. Il devra se souvenir comment l'isolement de la lutte la plus radicale depuis des décennies a montré la nécessité de rompre avec toutes les divisions sectorielles ou nationales.
La destruction des principales mystifications capitalistes nécessite une attaque clés deux côtés. D'une part, de l'intérieur, par une lutte qui, grâce à son auto organisation et à sa radicalisation, se tourne activement vers la solidarité des ouvriers des autres pays ; d'autre part, et en lien dialectique avec cela, elle nécessite une attaque de l'extérieur , par l'agitation explosive du reste de la classe qui, en assimilant les expériences des luttes partout dans le monde, prend conscience de l'unité de ses intérêts, permettant ainsi la solidarité.
Pour faire la révolution le prolétariat n'a d'autre arme que celle de sa conscience révolutionnaire et donc internationale. Par conséquent, cette conscience doit se développer dans les luttes qui précèdent la révolution. La généralisation ne débutera pas au moment de l'assaut révolutionnaire en Europe occidentale pour s'étendre par un effet "de domino" touchant pays après pays, parce que le "maillon le plus fort" du capitalisme serait brisé ou, suivant l'expression du CCI, parce que son "coeur et son cerveau" seraient détruits.
La généralisation est un processus qui fait partie de la maturation de la conscience du prolétariat, qui se développe de façon internationale dans ses luttes précédant l'assaut révolutionnaire, assaut rendu possible par l'existence même de ce processus. Le seul "maillon faible" (futur) du capitalisme, c'est l'unité mondiale du prolétariat.
Sander. (5/4/83)
REPONSE AUX CRITIQUES
Une des particularités du texte du camarade Sander, c'est qu'il comporte côte à côte d'excellents passages où il développe très clairement les analyses du CCI et des affirmations également très claires, mais qui malheureusement sont en contradiction avec la vision qui sous-tend les passages précédents.
Ainsi, le camarade Sander reconnaît à la fois qu'il est nécessaire de rejeter fermement la théorie du "maillon le plus faible" et qu'il faut établir une différence nette entre le prolétariat des pays développés et celui du Tiers Monde quant à leur capacité respective de constituer des bataillons décisifs de l'affrontement révolutionnaire futur. Il considère que dans les pays arriérés, "les ouvriers ont besoin de la démonstration de force de la classe dans les pays industrialisés, pour trouver la voie de la lutte autonome, pour que cette voie ne se présente pas comme désespérée". Nous le suivons parfaitement dans ces affirmations. Cependant, là où surgit le désaccord, c'est lorsque :
- il considère que les ouvriers des pays autres que ceux du Tiers Monde (c'est à dire d'Amérique du Nord, du Japon, d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est) se trouvent sur un pied d'égalité quant à leur aptitude à déjouer les mystifications bourgeoises, à constituer en quelque sorte une avant-garde du prolétariat mondial lors des combats révolutionnaires ;
- il estime que "la capacité de la bourgeoisie d'isoler une grève de masse" ne dépend pas "du lieu où elle se déroule" ;
- il rejette l'idée que la généralisation mondiale des luttes se produira par un "effet de dominos" (suivant ses propres termes), qu'il s'agit d'un processus prenant son essor en un point donné de la planète pour se propager ensuite dans le reste du monde,
- il combat l'idée qu'il existe une sorte de "coeur et de cerveau" du prolétariat mondial là où il est à la fois, le plus concentré, le plus développé et le plus riche en expérience.
En fin de compte, le défaut principal du texte de Sander, et qui est à la base de tous les autres, c'est qu'il adopte, pour démontrer sa thèse, toute une démarche qui se veut marxiste mais qui, à certains moments s'écarte en fait complètement d'une réelle vision marxiste.
UNE DEMARCHE QUI S'ECARTE DU MARXISME
Le raisonnement de base du camarade Sander est le suivant :
1°- "La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience";
2°- "C'est le développement de la lutte ouvrière qui est la clé de la prise de conscience croissante par l'ensemble du prolétariat de sa propre force" ;
3 - "C'est cette prise de conscience croissante (de sa force) qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes" ;
4°- "les mystifications ne peuvent (donc) être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe ouvrière de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse" ;
5°- Le capitalisme est dans une impasse économique complète. Partout dans le monde, il dévoile sa faillite et passe à une attaque totale contre les intérêts des travailleurs ;
6°- Partout dans le monde se développe donc la "nécessité" qui est à la base de la lutte ouvrière.
Conclusion : Partout où le prolétariat n'est pas une "petite minorité éclipsée par les autres classes" (pays du Tiers Monde) sont en cours d'apparition, et de façon égale, les conditions d'une prise de conscience révolutionnaire.
Le raisonnement a l'apparente rigueur d'un syllogisme. Malheureusement il est faux. Il s'appuie certes sur des vérités générales admises par le marxisme mais qui, dans ce cas particulier, sont affirmées en dehors de leur champs d'application réel. Elles deviennent des demi vérités et aboutissent à des contrevérités.
Si on peut souscrire à l'étape 5 du raisonnement et (avec des réserves) à l'étape 6, prises en elles-mêmes, on se doit par contre de critiquer et de remettre en cause les autres étapes et donc de remettre en cause l'ensemble du raisonnement.
1 - "La lutte prolétarienne se développe à partir de la nécessité et non à partir de la conscience" Oui si c'est pour dire que "1'existant précède le conscient" (Marx), que ce sont des intérêts maté riels qui mettent,en dernière instance, les classes en mouvement. Mais le marxisme n'est pas un matérialisme vulgaire. Il est dialectique. C'est pour cela que Marx a pu écrire "quand la théorie s'empare des masses, elle devient force matérielle".
C'est parce que le CCI est fidèle à cette vision dialectique qu'il a pu comprendre que nous étions aujourd'hui dans un cours à l'affrontement de classes et non dans un cours à la guerre. Dès 1968, nous écrivions (Révolution Internationale n°2, ancienne série) :
"Le capitalisme dispose de moins en moins de thèmes de mystifications capables de mobiliser les masses et les jeter dans le massacre. Le mythe russe s'écroule, le faux dilemme démocratie bourgeoise contre totalitarisme est bien usé. Dans ces conditions, la crise apparaît dès ses premières manifestations pour ce qu'elle est. Dès ses premiers symptômes, elle verra surgir, dans tous les pays, des réactions de plus en plus violentes des masses."
Donc, si le CCI affirme que, dans la période actuelle, l'aggravation de la crise provoquera un développement des luttes de classe, et non une démoralisation croissante ouvrant la voie à l'holocauste impérialiste comme dans les années 30, c'est parce qu'il prend en compte les facteurs subjectifs qui agissent sur la situation : le fait que le prolétariat ne sorte pas d'un écrasement récent (comme dans les années 20), l'usure des mystifications utilisées dans le passé. C'est parce qu'elle avait cette approche, dont nous nous revendiquons, que la Gauche Communiste Italienne a su analyser correctement la nature de la guerre d'Espagne et qu'elle n'est pas tombée dans les absurdités d'un Trotski fondant -parce que les conditions objectives étaient mûres- une nouvelle Internationale un an avant... la guerre.
Tout cela, le camarade Sander le sait et il l'affirme dans un autre passage de son texte. Le problème, c'est qu'il l'oublie dans son raisonnement.
2 - "C'est le développement de la lutte ouvrière . . . qui est la clé de la prise de conscience croissante par 1'ensemble du prolétariat de sa propre force" : nous renvoyons à ce qui vient d'être dit.
3 - "C'est cette prise de conscience croissante (de sa force) qui permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes". Là encore, Sander énonce une idée juste mais partielle et unilatérale. La conscience du prolétariat est avant tout conscience "de soi" (comme le mot l'indique). Partant, elle comporte la conscience de sa propre force. Mais elle ne se résume pas à cela. Si le sentiment d'être fort "permet au prolétariat de déchirer le filet des mystifications capitalistes", alors on ne comprend absolu ment pas ce qui s'est passé en 1914, lorsqu'un prolétariat qui se sentait plus fort que jamais a été précipité du jour au lendemain dans le massacre impérialiste. Avant 14, la classe ouvrière semblait voler de succès en succès. En réalité, elle reculait pied à pied devant l'idéologie bourgeoise C'est d'ailleurs là une méthode employée abondamment par la bourgeoisie contre le prolétariat tout au long du 20° siècle : lui présenter ses pires défaites (socialisme dans un seul pays? front populaire, "Libération" de 45) comme des victoires, des éléments de sa force. La phrase de Sander doit donc être complétée par "c'est dans son aptitude à déchirer le filet des mystifications capitalistes que le prolétariat témoigne de sa force, qu'il l'accroît et qu'il accroît la conscience de celle-ci". Cet oubli permet au camarade Sander de poursuivre tranquillement son raisonnement. Mais c'est malheureuse ment sur une faussé piste, dans une voie de garage.
4 - "Les mystifications ne peuvent (donc) être dépassées que par la lutte et dans la lutte. C'est la potentialité de croissance de la lutte qui permet à la classe ouvrière de briser les mystifications capitalistes, plutôt que l'inverse."Pour la première fois, Sander fait une petite concession à la méthode dialectique ("plutôt que l'inverse"). Cependant, il ne se défait pas de sa méthode unilatérale et partielle, ce qui le conduit à énoncer une idée en total désaccord avec toute l'expérience du mouvement ouvrier. Par exemple, au cours de la première guerre mondiale, ce n'est pas la lutte en soi qui a été le seul, ni même le premier facteur de démystification des ouvriers en Russie ou en Allemagne. En 1914, embrigadés derrière les drapeaux bourgeois par les partis socialistes, les ouvriers des principaux pays d'Europe sont partis "la fleur au fusil" se massacrer mutuellement au nom de la "défense de la civilisation" et de la "lutte contre le militarisme" ou le "tsarisme". Comme l'écrivait Rosa Luxemburg, "la guerre est un meurtre méthodique, organisé, gigantesque". En vue d'un meurtre systématique, chez des hommes normalement constitués, il faut cependant d'abord produire une ivresse appropriée" (Brochure de Junius). Tant que dura cette ivresse, les ouvriers adhérèrent au mot d'ordre stupide de la social démocratie (notamment celle d'Allemagne) expliquant que"la lutte de classe n'est valable qu'en temps de paix". Ce ne sont pas les luttes qui ont dessoûlé le prolétariat; ce sont plusieurs années de barbarie de la guerre impérialiste qui lui ont fait comprendre que, dans les tranchées, il ne se battait pas pour "la civilisation". Ce n'est qu'en prenant conscience qu'il se faisait massacrer et massacrait ses frères de classe pour des intérêts qui n'étaient pas les siens, qu'il a développé ses luttes qui allaient aboutir aux révolutions de 1917 en Russie et 1918 en Allemagne.
La méthode de Sander, faite de juxtapositions de demi vérités partielles le conduit à énoncer une autre contre-vérité totale : "la conscience qu'ils (les ouvriers polonais) ont acquise ainsi n est pas un acquis permanent qui subsiste en dehors de la lutte".
D'abord, nous constatons que cette affirmation contredit ce que dit, par ailleurs, Sander lui-même: "... les luttes futures (de l'ensemble du prolétariat) pourront tirer profit des leçons de Pologne... Il (le prolétariat) devra se souvenir des affrontements entre "Solidarnosc" et les ouvriers, qui montrent comment chaque syndicat,même nouvellement créé, devient immédiatement l'ennemi mortel de la lutte". Ainsi Sander refuse-t-il aux protagonistes directs dés combats de Pologne une "mémoire" de leur expérience que pourraient conserver les ouvriers d'autres pays malgré toutes les déformations des médias bourgeoises. Peut-être considère-t-il que cela résulte du fait qu'en Pologne (et pourquoi pas dans tous les pays de l'Est) les conditions spécifiques dans lesquelles lutte le prolétariat sont moins favorables à une prise de conscience que dans d'autres pays (pourquoi pas ceux d'Europe occidentale). C'est justement la thèse que combat Sander.
Nous découvrons ainsi un élément supplémentaire de la méthode du camarade Sander : le rejet de la cohérence.
Mais revenons sur cette idée que "la conscience n'est pas un acquis permanent". Nous épargnerons à Sander et au lecteur des développements sur le processus de la prise de conscience du prolétariat; c'est une question qui a déjà été traitée dans cette revue et qui le sera à nouveau. Nous nous contenterons ici de poser les questions suivantes :
- pourquoi en Pologne même, les combats de 1980 sont-ils allés bien plus loin que ceux de 70 et de 76 ?
- n'est-ce pas la preuve "qu'il subsiste un acquis des luttes" ?
- ce niveau supérieur des luttes en 80, est-il le seul résultat de l'aggravation de la crise économique ?
- ne faut-il pas y voir aussi le produit de tout un processus de maturation de la conscience du prolétariat qui s'est poursuivi après les luttes de 70 et 76 ?
- plus généralement, quel sens revêt l'idée marxiste de base suivant laquelle le prolétariat tire les leçons de ses expériences passées, qu'il met à profit l'accumulation de ses expériences ? '
- enfin, quelle est la fonction des organisations révolutionnaires elles-mêmes, si ce n'est justement de systématiser ces enseignements, les employer à développer la théorie révolutionnaire afin qu'elle puisse féconder, les combats futurs de la classe qui secrète justement ces organisations à cet effet ?
A toutes ces questions, le camarade Sander sait donner des réponses correctes. Il connaît le marxisme ainsi que les positions du CCI, mais brusquement, il les "oublie". Faut-il croire qu'il a tendance à attribuer au développement de la conscience du prolétariat sa propre démarche de pensée aux accès fréquents d'amnésie ?
Se voulant "matérialiste", la vision de Sander sombre en fin de compte dans le positivisme, elle tend à rejeter le marxisme pour se noyer dans les sophismes du conseillisme le plus plat, celui qui refuse à l'organisation des révolutionnaires toute fonction dans la lutte de classe.
UN CONSEILLISME «HORIZONTAL»
Le propre de la conception conseilliste (nous parlons de la conception conseilliste dégénérée, développée notamment par Otto Rhule, et non de la conception de Pannekoek qui ne tombait pas dans les mêmes aberrations) est de nier le fait qu'il y ait une hétérogénéité dans la classe dans son processus de prise de conscience. Elle se refuse à admettre que certains éléments de la classe parviennent avant les autres à "comprendre les conditions, la marche et les buts généraux du mouvement ouvrier" (Manifeste Communiste). C'est pour cela que, selon elle, il ne peut exister pour le prolétariat d'autre organisation que son organisation unitaire, les conseils ouvriers, au sein de laquelle tous les ouvriers avancent d'un même pas sur le chemin de la conscience. Nous ne ferons évidemment pas à Sander l'injure de lui attribuer une telle conception. Son texte prouve par ailleurs qu'elle n'est pas sienne et si c'était le cas on ne voit pas ce qu'il ferait à militer dans le CCI.
Cependant, la même démarche unilatérale et non dialectique qui conduit Sander à ouvrir involontairement la porte au conseillisme classique, l'amène à entrer de plein pied, et volontairement cette fois, dans une autre variété de conseillisme. Si on peut qualifier de "vertical" le conseillisme de Otto Rhule qui nie que, dans le chemin vers la révolution, certains éléments de la classe puissent se hisser à un niveau plus élevé de conscience que les autres, on peut considérer que le conseillisme de Sander est "horizontal" puisqu'il met un signe d'égalité entre les niveaux de conscience des prolétariats des différents pays ou zones du globe (le Tiers Monde excepté). Sander admet, avec tout le CCI, que même au moment de la révolution, il subsistera une grande hétérogénéité dans la conscience du prolétariat, ce qui se traduira notamment par le fait que,lors de la prise de pouvoir par la classe, les communistes seront encore une minorité. Mais pourquoi cette hétérogénéité ne pourrait-elle pas exister entre des secteurs du prolétariat diversement constitués, ayant des histoires et des expériences différentes, subissant, certes, une même crise, mais sous des formes et avec des degrés divers.
Sander tente de repousser les éléments donnés par le CCI pour expliquer le rôle central du prolétariat Ouest européen dans le futur mouvement de généralisation des luttes, dans la révolution de demain. En fait, ce n'était pas la peine qu'il se donne le mal d'examiner un par un les différents éléments puisque l'unité et l'homogénéité du prolétariat mondial sont posées à priori. Significative de cela est la façon dont il réfute l'idée que les ouvriers d'Occident peuvent plus facilement comprendre que ceux de l'Est la crise du capitalisme comme crise de surproduction :
"Pour les ouvriers à 1'Est, de même que pour ceux de 1'Ouest, la surproduction et la pénurie ne peuvent être comprises que s'ils quittent le point de vue "spécifique" pour voir le système capitaliste comme un tout... Ce point de vie global, nécessaire pour percevoir les racines du système et la possibilité de la révolution socialiste, le prolétariat en Occident ne le possède pas de naissance. Il ne peut résulter que de la tendance de la lutte de classe elle-même à se globaliser et à avoir une portée internationale".
Le "point de vue global" du camarade Sander est sans aucun doute l'analyse que font les révolutionnaires de la nature du capitalisme et de ses contradictions. Ce point de vue global", les révolutionnaires peuvent l'appréhender qu'ils se trouvent dans des pays avancés comme l'Angleterre où vivaient Marx et Engels où qu'ils viennent de pays arriérés comme Posa Luxemburg ou Lénine. Cela provient du fait que les positions politiques et analyses des organisations révolutionnaires ne sont pas une expression des conditions immédiates dans lesquelles se trouvent leurs militants où des circonstances particulières de la lutte de classe dans tel ou tel pays mais une sécrétion, une manifestation de la prise de conscience du prolétariat comme être historique, comme classe mondiale au devenir révolutionnaire.
Disposant d'un cadre théorique qui leur permet, beaucoup mieux que le reste de leur classe/d'aller plus rapidement au-delà des apparences pour appréhender l'essence des phénomènes, ils sont beaucoup plus en mesure de reconnaître dans n'importe quelle manifestation de la vie du capitalisme les résultats des lois profondes qui gouvernent ce système.
Par contre, ce qui est vrai de la minorité révolutionnaire de la classe ne l'est pas en général de ses grandes masses. Dans la société, "les idées dominantes sont les idées de la classe dominante" (Marx). La grande majorité des travailleurs est soumise à l'influence de l'idéologie bourgeoise. Et si elle s'amoindrira progressivement, cette influence se maintiendra néanmoins jusqu'à la révolution. Cependant, la bourgeoisie aura d'autant plus de mal à maintenir cette influence que l'image que donnera d'elle-même sa société trahira plus ouvertement la nature profonde de celle-ci. C'est pour cela que la crise ouverte du capitalisme est la condition de la révolution. Non seulement parce qu’elle obligera le prolétariat à développer ses luttes, mais parce qu'elle permettra que se révèle à ses yeux l'impasse totale dans laquelle se trouve ce système. Il en sera de même pour l'idée que le communisme est possible, que le capitalisme peut céder la place à une société basée sur l'abondance, permettant une pleine satisfaction des besoins humains, "dans laquelle le libre développement de ' chacun est la condition du libre développement de tous". Une telle idée pourra s'imposer d'autant plus facilement parmi les ouvriers que se révélera clairement la cause de la crise : la surproduction généralisée. A l'Est comme à l'Ouest les ouvriers seront plongés dans une misère croissante et contraint à des luttes de plus en plus puissantes. Mais la prise de conscience que cette misère résulte - de façon absurde - d'une surproduction de marchandises se fraiera un chemin bien plus facilement là où des millions de chômeurs côtoieront des magasins pleins à craquer que là où les queues devant des magasins vides pourront être présentées comme résultant d'une production insuffisante ou de la mauvaise gestion de bureaucrates irresponsables.
De même qu'il se refuse à reconnaître le poids des spécificités économiques sur le processus de prise de conscience de la classe, le camarade Sander est très choqué par ce que nous écrivons sur l'importance de toute une série de facteurs historiques ou sociaux sur ce processus :
"Tous les arguments sur la tradition, la culture et l'âge volent en éclat si l'on considère le fait historique que les pays où le prolétariat a réussi le mieux à homogénéiser sa conscience révolutionnaire étaient la Russie et la Hongrie où la classe ouvrière était relativement jeune, privée d'une tradition de longue date et avec un niveau relativement bas d'éducation bourgeoise. "
Cependant, Sander, fâché qu'il semble être avec la cohérence, nous avait déjà donné la réponse avant : "Mais les possibilités (de la lutte et de la prise de conscience politique) dépendent aussi de 1'opposition que les ouvriers ont à vaincre. Et à ce niveau également, nous voyons d'importantes différences entre la situation de 17 et celle d'aujourd'hui. En 17, la bourgeoisie était divisée et désorganisée par la guerre, désorientée par son manque d'expérience. Dans ces circonstances, il y avait effectivement des "maillons faibles" dans sa ligne de défense, que le prolétariat pouvait mettre à profit."
C'est justement une des grandes différences entre la situation actuelle et celle qui prévalait lorsqu’a surgi la révolution en 1917. Aujourd'hui, instruite par son expérience, la bourgeoisie est capable, malgré ses rivalités impérialistes, d'opposer un front uni contre la lutte de classe. C'est ce qu'elle a montré en de multiples reprises et notamment lors des grands combats de Pologne en 80-81 où l'Est et l'Ouest se sont remarquablement partagés le travail pour défaire le prolétariat comme nous l'avons souvent souligné dans notre presse.
Face aux luttes de Pologne, la tâche spécifique de l'occident a été de cultiver , via sa propagande dans les radios en langue polonaise et ses envois de syndicalistes, les illusions sur les syndicats libres et la démocratie. Cette propagande pourra avoir un impact tant que les ouvriers de l'Ouest, et notamment ceux d'Europe occidentale, n'auront pas dénoncé, dans leur propre lutte, le syndicalisme comme agent de l'ennemi de classe et la démocratie comme dictature du capital. Par contre, le seul fait que, dans les pays de l'Est et comme expression de la terrible contre-révolution qui s'est abattue sur cette zone (cf. Revue Internationale n°34, l'article : "Europe de l'Est : les armes de la bourgeoisie contre le prolétariat"), le système ne soit pas en mesure de tolérer l1existence durable de "syndicats libres", permet régulièrement à ceux-ci, en se couvrant de l'auréole du martyr, de redorer leur blason aux yeux des ouvriers. Si les luttes des ouvriers de Pologne ont porté un coup décisif aux illusions qui subsistaient en occident sur le "socialisme" à l'Est, par contre, elles ont maintenu presque intactes les illusions syndicalistes et démocratiques tant à l’Est qu'à l'Ouest.
Dans l'aide réciproque que s'apportent, face à la classe ouvrière, les bourgeoisies des deux blocs, c'est la bourgeoisie la plus forte qui peut donner le plus. C'est pour cela que la capacité du prolétariat mondial à généraliser ses luttes et à engager le combat révolutionnaire est bien plus déterminé par les coups directs qu'il pourra porter à cette dernière qu'à la première.
C'est également pour cela que, plus que jamais seront déterminants dans la période qui vient les éléments qui sont, dans la vision marxiste, à la base de la force du prolétariat, de sa capacité à développer sa conscience :
- son nombre, sa concentration, le caractère associé du travail des prolétaires;
- la culture qu'est obligée de lui dispenser la bourgeoisie pour augmenter la productivité de leur travail;([1] [83])
- sa confrontation quotidienne avec les formes les plus élaborées des pièges bourgeois.
- son expérience historique;
toutes choses qui existent à plus ou moins grande échelle partout où travaillent des prolétaires mais qui sont le plus pleinement développées là où le capitalisme a surgi historiquement : l'Europe occidentale.
L’UNITE DU PROLETARIAT
Pour le camarade Sander, le maître mot est "l'unité du prolétariat" : "le seul 'maillon faible' (futur) du capitalisme, c'est l'unité mondiale du prolétariat". Nous sommes parfaitement d'accord avec lui. Le problème c'est qu'il n'en est pas entièrement convaincu. Parce que nous constatons une évidence : les différences qui existent entre les différents secteurs de la classe ouvrière et que nous en déduisons certaines des caractéristiques du processus de généralisation mondiale des luttes ouvrières, il s'imagine que nous ignorons l'unité du prolétariat mondial. Comme le dit la résolution de janvier 83:
"Unité n'est pas identité des parties qui restent soumises à des conditions matérielles différentes. Il n'y a pas d'égalité naturelle entre les divers organes et le coeur ou le cerveau d'un corps vivant, qui remplissent des fonctions vitales complémentaires. . .
Déterminer le point de départ de cette dynamique (de 1'internationalisation de la grève de masse), et donc les conditions optimales de la naissance du séisme révolutionnaire, n'est pas nier l'unité du prolétariat mondial. Elle est le processus même par lequel l'unité potentielle devient unité réelle."
Cette vision s'appuie sur une démarche dialectique, dynamique qui, comme le disait Marx, "pose l'abstrait (l'unité potentielle du prolétariat mondial) pour s'élever ensuite au concret (le processus réel de développement de cette unité) ". Sander passe bien par cette étape mais, fidèle à sa démarche unilatérale et partielle, il oublie par contre la seconde. Ce faisant, il reste à terre, au ras de ses abstractions ce qui l'empêche de découvrir l'horizon et d'apercevoir ce que sera le processus véritable du développement mondial de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
F.M.
[1] [84] Pour le camarade Sander le blanc et le noir existent et ce sont deux couleurs bien distinctes. Cependant pour lui, apparemment, le gris et les différentes variantes de cette couleur, comprises entre le noir et le blanc, n'existent pas. Il admet facilement qu'il existe une différence considérable entre la force du prolétariat des pays avancés et celle du prolétariat du Tiers Monde, différence liée à des facteurs objectifs matériels. Par contre, qu'il puisse exister des situations intermédiaires, cela lui échappe complètement. Ainsi, lorsqu'on prend en considération un certain nombre d'éléments qui peuvent caractériser le degré de développement économique d'un pays et la force du prolétariat qui s'y trouve (voir tableau), on est frappé de constater que l'URSS et l'ensemble des pays de l'Est accusent une arriération très notable par rapport aux Etats Unis, au Japon et à l'Europe Occidentale.
Que l'on prenne des facteurs comme :
- le Produit National Brut par habitant, qui rend compte de la productivité moyenne du travail, et par suite notamment de son degré d'association ;
- la proportion de la population vivant dans les villes qui est une des composantes du degré de concentration de la classe ouvrière ;
- la proportion de la population active occupée dans le secteur agricole, qui illustre le poids de l'arriération campagnarde et est en rapport inverse du niveau de dépendance du travail agricole à l'égard du secteur industriel ;
- la proportion de la population ayant suivi des études du 3° degré qui est un indice du degré de technicité introduite dans la production ;
- la mortalité infantile qui est une des manifestations nettes de l'arriération économique et sociale ; l'URSS et les pays d'Europe de l'Est se trouvent à peu près sur le même plan qu'un pays comme la Grèce, bien loin de la situation qui est le lot commun des pays les plus avancés.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 38 - 3e trimestre 1984
- 2530 lectures
Lutte de classe internationale : simultanéité des grèves ouvrières : quelles perspectives ?
- 2436 lectures
LE RENOUVEAU INTERNATIONAL DES LUTTES
Dans notre Revue Internationale n°37, la précédente, nous titrions sur la reprise internationale de la lutte de classe. Après la défaite du prolétariat en Pologne, et le recul des luttes qui l'avait suivie en 1981 et 82, nous avons assisté ces derniers temps au resurgissement de luttes massives dans le monde entier, et principalement en Europe occidentale.
Ce resurgissement confirme que la classe ouvrière refuse de se serrer encore plus la ceinture ; qu'elle n'accepte pas de se sacrifier pour "sauver les économies nationales" ; que la bourgeoisie ne réussit pas à obtenir la paix sociale, la discipline sociale, ni une quelconque adhésion à ses projets économiques immédiats : baisse des salaires, licenciements massifs, la misère généralisée. Cette indiscipline sociale du prolétariat signifie que la bourgeoisie n'a pas les moyens politiques pour déclencher sa 3ème guerre mondiale, malgré l'intensification des rivalités et des conflits inter impérialistes. Incapable de faire accepter l'accentuation de la misère, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne réussit pas à l'imposer en grande partie, la bourgeoisie est d'autant plus -incapable d'imposer de plus grands sacrifices, jusqu'au dernier, celui de nos vies qu'impliquerait l'ouverture de la voie à l'issue capitaliste à la crise : la guerre généralisée.
Nous continuons donc d'affirmer que le cours historique de la période ouverte à la fin des années 60 est aux affrontements de classe et non à la guerre.
Dans les années 80, "années de vérité", la bourgeoisie ne peut plus retarder l'attaque économique contre la classe ouvrière. Cette attaque n'est pas improvisée, cela fait plusieurs années que la classe dominante la prépare, et ce au niveau international : __
- au niveau politique, c'est la mise en place de la tactique de la "gauche dans l'opposition", c'est-à-dire en dehors de toute responsabilité gouvernementale ;
- au niveau économique, c'est la planification par des organismes tels que le FMI ou l'OCDE, ou par des accords entre Etats, de l'attaque économique contre la classe ouvrière.
Nous avons maintes fois développé dans cette Revue (notamment dans la Revue Internationale n° 31, sur "le machiavélisme de la bourgeoisie") et dans nos différentes presses territoriales cette question. Inutile d'y revenir ici.
C'est bien à une attaque concertée, planifiée et organisée au niveau international, contre laquelle se défend la classe ouvrière depuis la fin 83 ([1] [87]).
Le silence de la presse.
Le silence, les mensonges déversés par les médias de la bourgeoisie ne doivent pas empêcher les groupes révolutionnaires de reconnaître cette reprise. Depuis septembre dernier, c'est l'ensemble des pays européens qui sont touchés par des grèves, des réactions massives et déterminées du prolétariat. Sans négliger les révoltes de la faim en Tunisie, au Maroc, dernièrement à Saint Domingue, il est nécessaire de constater que les mouvements qui secouent les USA, fait nouveau, le Japon (22 000 dockers en grève), et surtout la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Espagne, l'Italie, etc.. se situent dans le centre historique, économique et politique du capitalisme, et à ce titre revêtent une importance particulière.
Malgré le black-out de la presse, nous savons, et une des tâches des révolutionnaires, c'est aussi de faire savoir que :
- en Espagne "les ouvriers désabusés se sont mis à se défendre contre les plans du gouvernement. Il n'y a pas un jour sans qu'une nouvelle grève ne se déclenche..." (Der Spiegel, 20/2/84) ; touchés par les grèves : SEAT, la General Motors, les secteurs du textile, Iberia (aviation), les chemins de fer, les services publics, la sidérurgie (Sagunto) et les chantiers navals ;
- le 24 mars, 700 000 ouvriers manifestaient à Rome contre la remise en cause de "l'échelle mobile" ;
- les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs se mettent en grève en Grande-Bretagne, grève qui se poursuit depuis ;
- en France, après Talbot, les Postes, c'est la sidérurgie, les chantiers navals, les mines et l'automobile qui sont touchés par les réactions ouvrières ;
- en mai, au paradis de la paix sociale en Allemagne de l'Ouest, la grève lancée par le syndicat sur les 35 heures est la réponse de la bourgeoisie à la combativité des ouvriers qui commençait à s'exprimer dans plusieurs grèves sauvages et spontanées.
Du mouvement de grève générale dans les services publics en Belgique de septembre à la grève actuelle des métallos en Allemagne, c'est l'ensemble du prolétariat international qui reprend le chemin du combat de classe, du refus de la logique de sacrifice que nous offre le capitalisme.
LES ARMES DE LA BOURGEOISIE
1- Les campagnes de diversion.
Le silence et les mensonges des journaux ne sont pas la seule arme utilisée par la bourgeoisie. L'organisation de campagnes de diversion permet de déboussoler, de démobiliser les ouvriers : essentiellement ceux qui ne sont pas encore en lutte. C'est tout le sens de la manifestation pacifiste organisée par la gauche et les gauchistes en pleine grève de la fonction publique aux Pays-Bas, l'automne dernier. L'utilisation du scandale des "avions-renifleurs de pétrole" - il fallait l'inventer - durant la grève à Talbot en France, le bruit fait autour du scandale sur le financement de partis politiques en Allemagne - quelle soudaine honnêteté ! - au moment où débutait la grève des métallos, ne visent qu'à passer sous silence les grèves ouvrières.
Toutes ces campagnes, et il y en a bien d'autres, produisent un écran de fumée derrière lequel il est difficile d'entrevoir les réactions ouvrières, ce qui renforce ainsi leur isolement.
2- Les faux appels à l'extension.
Face aux secteurs de la classe qui, eux, sont en lutte, ces écrans de fumée ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, la bourgeoisie n'a peur que d'une chose : l'extension, la coordination réelles des grèves. Elle ne peut plus empêcher les réactions prolétariennes ; elle n'en est plus capable. Non, alors elle cherche à les étouffer dans la dispersion et l'isolement. Le prolétariat n'étant pas une masse amorphe sans réflexion, la bourgeoisie se doit d'employer des thèmes qui permettent cet isolement et cette division. Cette tâche revient en premier lieu à ses bons serviteurs du capital que sont les syndicats : enfermer les ouvriers dans des impasses, dans la défense de l'économie nationale, "produisons français, consommons français" crie la CGT, le syndicat du PCF, en opposant les ouvriers d'une région à l'autre comme en Belgique, d'un secteur à l'autre comme aux Pays-Bas où les syndicats lors de la grève du secteur public proposaient une... réduction des salaires dans le privé !
Il est de plus en plus clair pour les ouvriers qu'isolés, dispersés par région, par secteur industriel, ils courent à l'échec. Ce sentiment envers la nécessité de l'extension est chaque fois plus affirmée. Pour parer à cette volonté, pour la vider de son contenu prolétarien, la bourgeoisie n'hésite pas à prendre les devants. Elle propose de fausses extensions, de fausses généralisations, de fausses solidarités.
Nous avons déjà vu comment les syndicats avaient "généralisé" la lutte des cheminots et des postiers en Belgique aux secteurs les moins combatifs, les plus encadrés des services publics. Ainsi, ils noyaient le coeur militant de la lutte et lui étaient toute initiative d'extension réelle pour s'assurer du contrôle complet de la grève.
C'est à la recherche du même but que la CGT a organisé, appelé et fait défiler, "protégés" par son service d'ordre, les ouvriers de la sidérurgie lors de la "Marche sur Paris" du 13 avril. A la recherche du même but aussi, l'organisation de la "Marche sur Rome" du 24 mars ; de même le syndicat du PC espagnol, les "commissions ouvrières" ainsi que les gauchistes en voulant appeler pour le 6 mars à une "Marche sur Madrid" avaient la même volonté d'isolement et de dispersion que la FGT belge.
3- Le syndicalisme de base.
L'accumulation de toutes ces manoeuvres déconsidère encore plus les syndicats parmi les ouvriers. Et malgré la radicalisation de leur langage, ils ne réussissent pas à enrayer la baisse du nombre de syndiqués, à empêcher que les dirigeants se fassent de plus en plus huer et chahuter lors de leur apparition et surtout à garder le contrôle complet sur les réactions ouvrières.
C'est là qu'intervient le syndicalisme critique, à la base, "radical" qui tente de ramener dans le giron du syndicalisme, et non plus tant des syndicats eux-mêmes trop démasqués, les ouvriers qui s'en détournent. C'est le syndicalisme? De base, le Collectif 79/84 qui, à Longwy, enferme les ouvriers dans des "actions-commandos" qui no servent qu'à les isoler encore plus dans "leur" région, "leur" ville, "leur" usine. Ce sont les"coordinations de forces syndicales", les "comités de lutte et de solidarité" qui, avec le leader Camacho des "commissions ouvrières" espagnoles, promettent une "grève générale" hypothétique, à une date indéfinie que... seuls les syndicalistes décideront.
Le meilleur exemple du sale travail qu'accomplit le syndicalisme de base se trouve en Italie. Il y avait bien longtemps que les syndicats officiels n'avaient pu mobiliser tant de monde : 700 000 ouvriers sont venus à la "Marche sur Rome?" à l'appel des "assemblées nationales des conseils d'usine". Nous devons d'abord dire que ces "conseils d'usine" n'ont de conseil que le nom. Ce n'est pas la première fois que la bourgeoisie usurpe des mots et noms au prolétariat afin d'en dénaturer la signification réelle, leur contenu de classe. Ces "conseils" ne sont qu'une structure syndicaliste à la base qui existe de façon permanente depuis 69. Ils sont tout le contraire d'un organe de lutte produit, contrôlé, dirigé par les ouvriers réunis en assemblées générales. Créés à la fin du mouvement de 69 pour maintenir les luttes dans l'enceinte des usines et des ateliers, ils reviennent en scène aujourd'hui afin de constituer une organisation syndicaliste de base crédible pour les ouvriers au niveau national, et ce dès le début du mouvement ; ils suppléent ainsi à la carence des syndicats officiels. Le mot d'ordre des "conseils d'usine" gauchistes d'Italie est : "nous ne sommes pas contre le syndicat, le syndicat c'est nous". La bourgeoisie utilise le syndicalisme de base pour vider la lutte de son contenu et en prendre le contrôle en appliquant la tactique du "laisser-faire à la base", de "reconnaître toutes les actions". Un des arguments du syndicalisme de base est d'essayer de faire croire aux ouvriers que par leur lutte, leur détermination, leur combativité, ils peuvent exercer une pression sur les syndicats afin de pousser ceux-ci ou leur direction à reconnaître ou à prendre en main les luttes. Cela, c'est toujours ramener les ouvriers dans le giron du syndicalisme, en prenant argument de la radicalisation de son langage.
Ces changements de langage syndical trouvent leur véritable sens dans toutes ces grèves, telles Talbot ou Citroën en France, où l'annonce par le patronat d'un nombre de licenciements plus élevé que celui dont il a vraiment besoin permet d'abord au syndicat de se montrer très radical en refusant tout renvoi et lui permet ensuite de faire croire à sa victoire, à son efficacité, en faisant "reculer" la bourgeoisie jusqu'au nombre de licenciements... qu'elle avait planifié. Ainsi, à Talbot, on annonce d'abord 3000 licenciés, puis, "grâce" à l'action énergique du syndicat c'est "seulement" 2000 ouvriers qui sont renvoyés.
Même si elle n'est pas nouvelle, cette tactique, cette concertation préalable entre patrons et syndicats est aujourd'hui de plus en plus employée.
4- L'utilisation de la répression.
L'Etat ne peut se permettre une répression aveugle et frontale contre les luttes ouvrières qui se développent actuellement. Celle-ci aurait l'effet inverse à celui recherché : accélérer la prise de conscience chez les ouvriers que c'est à l'ensemble de la bourgeoisie, à l'Etat qu'ils doivent s'affronter. Néanmoins, l'Etat doit montrer sa présence et sa force. C'est ainsi qu'il sélectionne l'utilisation de sa répression. Il tente de créer des abcès de fixation qui puissent détourner la combativité des luttes.
C'est le sens des procès faits au syndicat des mineurs en Grande-Bretagne contre l'organisation des piquets de grève. En outre, cela crédibilise le syndicat en lui donnant une "auréole" de réprimé. La bourgeoisie anglaise n'a pas hésité à arrêter plus de 500 mineurs à ce jour. C'était le même but qui était visé en France à Talbot, en faisant intervenir la milice patronale sous les yeux de la police contre les ouvriers en grève. De même, à Longwy, avec les opérations "coup de poing", "commandos". C'est aussi ce qui s'est passé à Sagunto en Espagne avec la violente répression contre une manifestation des ouvriers.
C'est un terrain propice au syndicalisme de base, aux gauchistes, qui peuvent ainsi à l'aide de la violence étatique, au besoin avec des "victimes", crédibiliser leurs actions violentes. L'utilisation de la répression "sélective" et celle du gauchisme sont parfaitement complémentaires et forment un tout.
5- Le maintien de la gauche dans l'opposition.
Tous ces obstacles opposés par la bourgeoisie au prolétariat nécessitent, pour avoir un maximum d'efficacité, le relais, l'existence d'un semblant d'opposition aux gouvernements en place chargés d'attaquer la classe ouvrière. Le maintien de partis de gauche importants, au langage ouvrier, ayant eu la confiance des ouvriers et s'appuyant sur les illusions et les faiblesses que ces derniers conservent, permet une mise en place crédible, efficace des obstacles cités précédemment.
Le renvoi du PS dans l'opposition en Allemagne a permis l'année dernière l'organisation de puissantes manifestations pacifistes ; il permet aujourd'hui au syndicat DGB d'organiser préventivement un mouvement de grève sur les 35 heures. Celui-ci a pour but d'épuiser, de dévoyer, de déboussoler la combativité ouvrière qui commençait à s'exprimer spontanément. De même, l'appel à des manifestations pacifistes en Italie correspond à une opposition plus prononcée du PC envers le gouvernement et à une radicalisation de son langage ; tout comme pour la CGIL d'ailleurs qui, en appuyant le syndicalisme de base style "conseils d'usine", tente d'occuper le terrain social. Bien que participant au gouvernement, le PCF essaie de suivre l'exemple des PC italien et espagnol, des PS allemand ou belge afin de paraître s'opposer à l'attaque qui est faite à la classe ouvrière ; c'est le sens des critiques de plus en plus fortes que porte son syndicat, la CGT, contre Mitterrand.
Pour la bourgeoisie, l'heure n'est pas à changer le dispositif de son appareil politique face au prolétariat. Bien au contraire, il s'agit de renforcer la politique de la "gauche dans l'opposition" afin d'affronter le prolétariat.
LES CARACTERISTIQUES DES LUTTES ACTUELLES
La reprise des luttes actuelles signifie que le prolétariat - attaqué économiquement par la bourgeoisie d'une part, ayant mûri et réfléchi sa défaite en Pologne, perdant de plus en plus, et ses illusions sur une issue à la crise du capitalisme, et sa confiance dans les partis de gauche et les syndicats d'autre part - reprend le chemin du combat de classe qui passe par la défense de ses conditions de vie, par la lutte contre le capital.
La nécessité du maintien de la gauche dans l'opposition, la nécessité d'une force politique de la bourgeoisie qui soit présente dans les luttes pour les contrôler, les saboter, les dévoyer, est une tactique employée maintenant depuis les années 79-80. La reprise actuelle des luttes ouvrières manifeste l'usure progressive de cette tactique. Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, l'existence de grands partis de gauche en "opposition" ne suffit plus à empêcher le surgissement des grèves.
En même temps que l'usure progressive de la carte de la gauche dans l'opposition, les luttes ouvrières actuelles manifestent également la fin des illusions sur un renouveau économique du capitalisme. Ces illusions entretenues par la gauche et ses syndicats sur des solutions nationales, protectionnistes, "anti-capitalistes" du style "faire payer les riches", tendent à tomber de plus en plus. C'est ce qu'exprime le refus des ouvriers de la sidérurgie tant en Espagne qu'en France, de se laisser berner par les "plans de reconversion" et de "formation". C'est ce qu'exprime encore plus le retour au combat de classe des ouvriers des USA et d'Allemagne de l'Ouest qui, il y a deux ans, acceptaient les réductions de salaire pour "sauver" leur entreprise.
Cette maturation de la conscience dans la classe ouvrière passe aujourd'hui par la reconnaissance du caractère bourgeois de la gauche dans son ensemble, de 1'inéluctabilité de l'approfondissement de la crise du capitalisme, et que seule la lutte ouvrière déterminée, massive et généralisée peut ouvrir une autre perspective à la dégradation continuelle des conditions d'existence. Cette maturation progressive s'exprime dans les caractéristiques mêmes des luttes qui se déroulent sous nos yeux aujourd'hui :
- tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant un certain débordement des syndicats ;
- tendance à des mouvements de grande ampleur ;
- simultanéité croissante des luttes au niveau international ;
- rythme lent du développement de ces luttes.
1- La tendance au surgissement de mouvements spontanés.
Que ce soit la grève du secteur public en Belgique partie sans les syndicats en septembre 83, que ce soit, en octobre 83 en Grande-Bretagne, le rejet par 65 000 ouvriers des chantiers navals de l'accord passé entre le syndicat et la direction, et le même mois, dans le même pays, la grève de 15 000 mineurs sans l'accord syndical, que ce soit les critiques et le dégoût des ouvriers envers les syndicats à Talbot en décembre 83, ou les violentes manifestations, spontanées, des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals en France en mars 84, que ce soit en Espagne à la General Motors, en Allemagne où des grèves "sauvages" ont éclaté à Duisburg (Thyssen) et à Brème (Klokner), que ce soit même les "révoltes de la faim" en Tunisie, au Maroc, en République Dominicaine le 20 avril, au Brésil etc., toutes ces réactions ouvrières manifestent une tendance générale à déborder spontanément les syndicats.
Ces derniers ne réussissent plus à empêcher les réactions ouvrières, même s'ils arrivent encore à en garder en grande partie le contrôle. La prise de conscience du rôle anti-ouvrier des syndicats grandit. Les mensonges sur leur caractère ouvrier, sur la possibilité et la nécessité d'en passer par eux, sur leur indispensabilité, sont de plus en plus démasqués.
2- La tendance à des mouvements de grande ampleur.
Ce sont des millions d'ouvriers qui, dans le monde entier, et particulièrement dans les grands centres capitalistes, ont participé, et continuent de participer aux luttes actuelles. Nous l'avons vu précédemment : des mouvements d'une très grande ampleur ont touché, et touchent présentement 1'ensemble de l'Europe occidentale, les USA, l'Amérique du Sud, les pays d'Afrique du Nord tout comme l'Afrique du Sud, l'Inde etc.. De plus, ce sont tous les secteurs qui sont touchés par les réactions ouvrières : services publics, automobile, sidérurgie, chantiers navals, mines etc..
Inévitablement, les ouvriers connaissent l'existence de ces mouvements, et ce malgré le silence et les mensonges de la presse. Inévitablement, pour rompre avec leur isolement, la question de l'extension et de la coordination des luttes se pose. Un début de réponse a été donné par les cheminots à Liège et à Charleroi (Belgique) quand ils sont allés chercher les ouvriers des postes et ont réussi à les entraîner dans la grève en septembre dernier. Contre les licenciements massifs, les mineurs de Grande-Bretagne se mettent en grève. 10 000 piquets de grève appellent à l'extension et les 12 et 13 mars, 135 000 mineurs ont arrêté le travail. C'est là aussi un début de réponse à ce problème de l'extension.
L'extension d'ailleurs ne se fait pas uniquement vers les ouvriers qui ont un travail. Ceux qui sont chômeurs sont tout autant concernés par les luttes de leur classe. Nous avons vu comment les ouvriers sans travail se sont joints aux manifestations ouvrières à Longwy et à Sagunto. En République Dominicaine, les chômeurs, 40% de la population, ont participé à la révolte ouvrière contre les augmentations de 40 à 80% des produits alimentaires de base. Même chose en Tunisie et au Maroc l'hiver dernier.
3- La simultanéité des luttes.
Ni durant la première vague de luttes ouvrières de 68-74, ni durant la seconde de 78-80, une telle simultanéité n'avait existé. Et chacun d'entre nous sait le prix qu'en a payé le prolétariat en Pologne : l'incapacité à rompre avec les filets de la propagande bourgeoise sur la spécificité "de l'Est" de la grève de masse d'août 80, l'incapacité des luttes ouvrières à rompre l'isolement international du prolétariat. Aujourd'hui, cette simultanéité n'est que la juxtaposition des luttes ouvrières et non la généralisation internationale de la lutte de classe. Néanmoins l'idée de la généralisation fait déjà son chemin : en assemblées générales, les ouvriers de Charleroi, face au syndicat, au plus fort des affrontements entre les ouvriers de Longwy et la police française scandaient "à Longwy ! A Longwy !" Il ne faut pas s'y tromper, les grèves en Europe, et principalement et pour des raisons différentes, en Allemagne et en France, suscitent une grande attention et un grand intérêt parmi les ouvriers.
4- L'auto organisation.
Jusqu'à présent, le prolétariat n'a pu étendre, coordonner et encore moins généraliser son combat. Tant que les ouvriers n'arriveront pas à disputer le contrôle de leurs luttes aux syndicats, tant qu'ils ne réussiront pas à les prendre en main eux mêmes, tant qu'ils ne s'affronteront pas aux syndicats sur les buts et le contrôle des luttes, ils ne pourront organiser l'extension. C'est dire l'importance de l'auto organisation pour répondre aux besoins immédiats, premiers de chaque lutte aujourd'hui. C'est aux assemblées générales de décider et d'organiser l'extension et la coordination. Ce sont elles qui se déplacent si elles le peuvent, qui. envoient des délégations massives ou des délégués appeler à la grève dans les autres usines, ce sont elles qui nomment et révoquent à tout moment, si besoin est, les délégués. Or, jusqu'à présent, la bourgeoisie a réussi à vider de leur contenu toutes les assemblées qui ont existé.
Sans auto organisation, sans assemblées générales, il ne peut y avoir de véritable extension, et encore moins de généralisation internationale du combat de classe. Mais sans cette extension, les rares exemples d'auto organisation, d'assemblées générales en Belgique, en France, en Espagne, perdent leur fonction et leur contenu prolétariens, et laissent ainsi la bourgeoisie et ses syndicats occuper le terrain. Les ouvriers sont en train de comprendre que l'organisation de l'extension ne se fera qu'au prix du combat contre le syndicalisme.
5- Le rythme lent du développement des luttes.
La difficulté présente d'auto organisation de la classe ouvrière n'est que l'effet le plus visible du rythme lent du développement des luttes actuelles. L'attaque économique est pourtant très forte. Certains pourraient voir dans ces difficultés et la lenteur de la reprise, dans l'absence d' "un saut qualitatif" dans la grève de masse du jour au lendemain, une faiblesse extrême du prolétariat. Ce serait confondre les conditions de lutte dans lesquelles se trouve le prolétariat dans les grands pays industriels et historiques du capitalisme, avec les conditions qu'il rencontre dans les pays du "tiers-monde" et du bloc russe comme en Pologne. Avant de pouvoir déboucher sur la grève de masse et sur la généralisation internationale, le prolétariat doit affronter et dépasser les obstacles disposés par la bourgeoisie : la gauche dans l'opposition et les syndicats, et en même temps organiser le contrôle et l'extension de ses luttes. Ce processus nécessite une prise de conscience et une réflexion collective de la classe tirant les leçons du passé, et celles des luttes actuelles. Le rythme lent de la reprise des luttes, loin de constituer une faiblesse insurmontable, est le produit de la maturation lente, mais profonde de la conscience dans la classe ouvrière. Nous affirmons donc que nous n'en sommes qu'au débat de cette vague de lutte.
La raison de cette lenteur est due à la nécessité de reprendre les questions qui avaient été posées durant la vague précédente, mais qui n'avaient pas été résolues : le manque d'extension dans la grève du port de Rotterdam en 79 ; l'abscence d'assemblées générales à Longwy Denain la même année ; le sabotage du syndicalisme de base dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne; la nécessité de la généralisation internationale après la grève de masse en Pologne ; le rôle de la "gauche dans l'opposition" dans le reflux et la fin de cette vague de lutte.
Mais contrairement à 78-80, c'est à l'ensemble de ces questions que les ouvriers dans toutes les luttes d'aujourd'hui, se trouvent confrontés. Ce n'est pas une question qui est abordée dans chaque lutte, mais toutes à la fois. D'où la lenteur du rythme actuel des luttes ; d'où la difficulté mais aussi la profondeur de la maturation de la conscience dans la classe ouvrière.
6- Le rôle particulier actuellement du prolétariat en France.
Dans la prise de conscience du prolétariat international, la partie de celui-ci en France a une responsabilité particulière, temporaire et limitée. Du fait de l'arrivée accidentelle de la gauche au pouvoir suite aux élections de mai et juin 81, ce pays constitue à l'heure actuelle une brèche dans le dispositif politique international des forces de la bourgeoisie. La participation au gouvernement des partis de gauche, PS et PC, est lourde d'affaiblissement pour la bourgeoisie internationale.
Si la grève de masse d'août 80 en Pologne n'a pas peu contribué à la destruction de la mystification sur le caractère "socialiste" des pays capitalistes du bloc de l'Est, le développement des grèves actuelles en France ne peut que contribuer à démasquer les mystifications et les mensonges colportés par les partis de gauche dans les autres pays et à l'affaiblissement de ces mêmes partis en milieu ouvrier.
Le licenciement de milliers d'ouvriers par ce gouvernement, le soutien qu'il reçoit des syndicats, les grèves, tant dans les services publics (Postes, Chemins de Fer) que dans l'automobile (Talbot, Citroën), les affrontements violents avec la police de "gauche" des ouvriers de la sidérurgie et des chantiers navals (Longwy, Marseille, Dunkerque) ne peuvent qu'accélérer la reconnaissance dans l'ensemble de la classe ouvrière internationale du caractère bourgeois des partis de gauche du capital. De cette prise de conscience par le prolétariat dépend en grande partie le développement de la lutte de classe jusqu'à la révolution prolétarienne.
LE ROLE DES COMMUNISTES
Il existe une autre partie du prolétariat qui tient un rôle particulier, sans commune mesure avec la précédente. Cette partie exerce une responsabilité historique, permanente et universelle. Elle est constituée des minorités communistes, des révolutionnaires.
"Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire" écrit Lénine dans Que Faire ? Sans programme communiste, sans prise de position claire dans la lutte de classe, pas de révolution prolétarienne possible ; sans organisation politique, pas de programme, pas de position claire et donc, pas de révolution.
Les luttes de la classe ouvrière ne peuvent se développer qu'en affirmant et maintenant leur autonomie et leur indépendance face à la bourgeoisie. Cette autonomie ouvrière dépend de la clarté politique du mouvement de lutte lui-même. Partie intégrante de la classe ouvrière, ses minorités politiques ont un rôle indispensable et irremplaçable dans cette nécessaire clarification politique. Les groupes politiques du prolétariat ont pour responsabilité de participer et d'intervenir dans le processus de prise de conscience de la classe ouvrière. Ils accélèrent et poussent le plus loin possible cette réflexion collective de leur classe. C'est dans ce sens qu'il importe :
- qu'ils reconnaissent la reprise actuelle des luttes ouvrières après la défaite en Pologne ;
- qu'ils dénoncent la "gauche dans l'opposition" comme obstacle majeur opposé par la bourgeoisie aux luttes ouvrières ;
- qu'ils comprennent que l'Europe occidentale est la clef, l'épicentre du renouveau des luttes aujourd'hui et du développement de celles-ci ;
- qu'ils sachent reconnaître que le cours historique est, depuis la fin des années 60, aux affrontements de classe et non à la guerre impérialiste. Seule cette compréhension générale peut leur permettre une intervention claire :
- la dénonciation du syndicalisme sous toutes ses formes. Nous avons pu voir les effets désastreux du syndicat Solidarité en Pologne après la grève da masse d'août 80. C'est non seulement une très grande partie d'ouvriers qui fut aveuglée et abusée sur le caractère profondément syndicaliste et capitaliste de Solidarnosc, mais aussi nombre d'éléments et de groupes révolutionnaires. Le rejet et le dépassement du syndicalisme dans l'organisation de l'extension par les ouvriers eux-mêmes nécessitent la dénonciation sans concession et sans faille des syndicats, du syndicalisme de base et de ses agissements par les minorités communistes organisées pour cela. Celle-ci est indispensable et déterminante pour dépasser les pièges de la bourgeoisie ;
- la mise en avant des perspectives de lutte qui passent par l'organisation de l'extension et de la généralisation dans les assemblées générales. C'est un combat permanent que doivent livrer les ouvriers les plus combatifs, les plus avancés et, parmi eux, les petits groupes communistes dans les luttes, dans les assemblées pour l'organisation de l'extension et de la coordination contre le syndicalisme qui s'y oppose.
L'intervention, la propagande, le combat politique des révolutionnaires détermineront de plus en plus la capacité du prolétariat dans son ensemble à rejeter les pièges tendus par la bourgeoisie et ses syndicats dans les luttes. La bourgeoisie, elle, n'hésite pas à "intervenir", à être présente, à occuper le terrain afin d'enrayer le développement de la prise de conscience des ouvriers, d'obscurcir les questions politiques, de dévoyer les luttes dans des impasses. D'où la nécessité de "minorités communistes combattant en leur sein (les assemblées), exposant les manoeuvres de la bourgeoisie et de tous ses agents, et traçant une perspective claire pour le mouvement. L'organisation révolutionnaire est le meilleur défenseur de 1’autonomie ouvrière'.' ( Revue Internationale n°24, p. 12, "sur le rôle des révolutionnaires").
Ces minorités communistes, organisées théoriquement, politiquement, matériellement "sont donc la fraction la plus résolue du prolétariat" de tous les pays, la fraction qui entraîne les autres (suivant 1'idée du Manifeste Communiste). Les groupes révolutionnaires doivent marcher au premier rang du combat prolétarien. Ils doivent montrer la voie du combat de classe. Ils "dirigent", au sens où ils orientent la classe ouvrière vers le développement de ses luttes, sur le chemin de la révolution prolétarienne. Ce développement passe aujourd'hui par les nécessaires et inséparables auto organisation et extension des luttes contre les syndicats.
C'est la tâche que le CCI s'est assignée. C'est tout le sens de notre combat dans le mouvement des luttes actuelles.
R.L.
[1] [88] A ce sujet, nous voudrions corriger une formulation que nous avons souvent utilisée, en particulier dans "les thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" parues dans la dernière Revue Internationale ; à la page 4, dans le point 2, il est dit que "c'est la classe ouvrière mondiale qui détient 1'initiative historique, qui est passée globalement à l'offensive face à la bourgeoisie..." S'il est vrai que la classe ouvrière détient la clef de la situation historique au sens où de son combat dépend l'issue dans la barbarie capitaliste ou dans la révolution prolétarienne et le communisme, par contre, il est faux de dire que la classe ouvrière est passée à l'offensive face au capitalisme. Passer à 1'offensive signifie pour le prolétariat qu'il se trouve à la veille de la révolution, dans une période de double pouvoir, organisé en conseils ouvriers, qu'il se prépare consciemment à attaquer l'Etat bourgeois et à le détruire. Nous en sommes encore loin.
Géographique:
- Europe [32]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Où en est la crise ? La crise transforme l'Europe occidentale en une poudrière sociale
- 2754 lectures
Il existe une "mémoire collective" historique au sein de la classe ouvrière. Les organisations politiques révolutionnaires en sont une manifestation importante. Mais elle n'est pas unique. Dans 1'ensemble de la classe, les luttes passées, les attaques de la bourgeoisie, on en a tiré les leçons pendant des années, souvent sous forme plus ou moins consciente, souvent sous forme purement négative, sachant plus ce qu'il ne faut pas faire que dégageant une perspective concrète positive précise. La puissance et la profondeur du mouvement ouvrier en Pologne en 1980 étaient en grande partie le fruit direct du souvenir des expériences successives de 1956, 1970 et 1976.
C'est pour cela que dans l'unité du prolétariat mondial, toutes les parties de la classe ne sont pas identiques : il y a des secteurs qui ont une plus grande tradition, une plus grande expérience de la lutte de classe. La vieille Europe occidentale regroupe le prolétariat qui possède le plus important coeur industriel (il y a dans la CEE 41 millions de salariés dans 1’industrie, contre 30 millions aux USA et 20 au Japon) et la plus longue expérience historique : à travers les luttes qui vont de 1848 et la Commune de Paris à la vague révolutionnaire de la fin de la 1ère guerre, à travers la confrontation avec la contre-révolution sous toutes ses formes, stalinienne, fasciste, "démocratique" (parlementarisme, syndicalisme), à travers des centaines de milliers de grèves de toutes sorte et ampleur, s'est forgée une classe plus aguerrie qu'ailleurs [1] [89]().
L 'Europe occidentale est actuellement non seulement la zone concentrant les principaux bataillons du prolétariat mondial, mais aussi, au sein de la partie industrialisée du bloc US, celle où, à court et moyen terme, la classe révolutionnaire est appelée à connaître la plus violente attaque économique. Les capitaux d'Europe occidentale s'effondrent lentement, incapables d'affronter sur le marché mondial et sur leur propre marché la concurrence économique de leurs propres "partenaires", américains et japonais, concurrence devenue d'autant plus agressive et impitoyable que ces derniers sont eux-mêmes plongés dans la plus violente crise depuis les années 30.
Les conditions objectives s'ajoutent aux conditions subjectives pour faire de l'Europe de l'Ouest le formidable détonateur révolutionnaire que Marx a annoncé.
LE DECLIN ECONOMIQUE DE L'EUROPE
LA LOI DU PLUS FORT
Dans la décennie qui va de 1963 à 1973, les économies des Etats de la CEE croissaient en moyenne à un rythme de 4,6 I (PIB). Ce taux tombe à 2 % dans la décennie suivante. Au début des années 80, il est tout simplement nul et recule dans plusieurs pays. A la fin des années 60, le taux de chômage dans la CEE était de 2,3 % ; aujourd'hui, il dépasse 10 % et atteint 17 % dans des pays aussi divers que l'Espagne et les Pays-Bas. Entre 1975 et 1982, "la part de marché" de la CEE (mesurée par sa part dans le total des exportations de produits manufacturés de l'ensemble de l'OCDE) est tombée de57%à53% tandis que celle des USA se maintenait à 18 % et celle du Japon augmentait de 13 à 16 %.
Dans la deuxième moitié des années 70, l'économie d'Europe occidentale a commencé à perdre de plus en plus de terrain par rapport aux USA et au Japon. Cette tendance s'est accélérée avec l'entrée dans les années 80. Simultanément, la dépendance du capital en Europe à l'égard de celui de " la puissance chef de bloc - dépendance qui ne s'est jamais démentie depuis la 2ème guerre -s'est fortement aggravée.
Le déclin économique de l'Europe occidentale au sein de son bloc trouve en partie son explication dans les caractéristiques des rapports entre nations dans le capitalisme décadent et militarisé.
Les lois qui régissent les rapports entre capitaux nationaux - fussent-ils ceux d'un même bloc militaire - sont les mêmes que celles du milieu de la pègre. Lorsque la crise frappe le monde capitaliste, la concurrence économique qui lui sert de mode de vie s'exacerbe jusqu'à son paroxysme, tout comme les gangsters s'entretuent lorsque les butins à conquérir se font plus rares et difficiles à obtenir.
Dans l'époque actuelle, cela se traduit au niveau de la planète par l'aggravation des tensions entre les deux blocs militaires. Au niveau de chaque bloc, en son sein, chaque nation est militairement sous le contrôle absolu de la puissance dominante (Le Japon corn ire la Pologne ne disposent que d'un strict minimum de munitions dans leurs armées ; ce sont les chefs de bloc qui en ont la possession et les leur fournissent). Mais les antagonismes économiques n'en subsistent pas moins.
Dans le bloc le plus riche, l'occidental, une certaine liberté de concurrence - beaucoup moindre que ce que les propagandes officielles prétendent- permet à ces antagonismes économiques d'apparaître au grand jour : c'est la guerre à coup de coûts de production moindres, à coup de subventions d'Etat aux exportations, à coup de mesures protectionnistes et de marchandages de "parts de marché", etc.
Dans le bloc de l'Est, le plus pauvre, le plus ruiné par le gigantesque effort de guerre et de militarisation, les tensions économiques entre capitaux nationaux apparaissent plus difficilement tant elles sont soumises aux impératifs militaires (la PDA est proportionnellement plus industrialisée que l'URSS ; elle n'en est pas moins obligée d'acheter le pétrole de celle-ci à un cours arbitrairement fixé, toujours supérieur au cours mondial et elle doit généralement le payer en devises occidentales).
Cependant, avec l'accélération de la crise et de la décadence capitaliste mondiale, c'est le mode de vie du bloc le plus ruiné qui montre l'avenir au mieux nanti. Comme nous le disions lors de notre second Congrès International (1977) : "Les Etats-Unis vont mettre l'Europe au rationnement". Depuis le début des années 70, l'évolution en occident ne s'est pas faite vers un plus grand libéralisme dans les échanges et la vie économique, mais au contraire vers la multiplication des mesures protectionnistes et un pouvoir de plus en plus impitoyable des USA sur leurs vassaux. Le GATT, organisation chargée de défendre et stimuler le libre-échange entre nations, ne cesse dans ses derniers rapports annuels de s'arracher les cheveux et de crier au sacrilège suicidaire devant la multiplication des barrières douanières et autres mesures qui entravent le "libre-échange" entre nations.
Quant aux relations économiques des USA avec leurs partenaires industrialisés, elles se caractérisent, surtout depuis la dite crise du pétrole (1974-75), par une série de manoeuvres économiques dont le résultat concret est un "pillage". Un pillage dont les fruits sont employés par la puissance dominante essentiellement à financer ses dépenses militaires.
Tout comme l'URSS, les USA portent la plus lourde part des dépenses militaires du bloc ([2] [90]). Depuis Nixon, les USA ont mené au niveau de leur bloc des politiques économico militaires qui leur ont permis d'imposer par la force à leurs vassaux le financement d'une partie de leur politique militaire.
Les violentes augmentations du prix du pétrole (1974-75, 1979-80) dont les USA contrôlent directement ou indirectement l'essentiel de la production et de la commercialisation ont fourni :
1 - à travers le flot de Dollars qui a été déversé sur le Moyen-Orient en provenance du Japon et de l'Europe, les moyens de financer, essentiellement à travers l'Arabie Saoudite la "Pax Americana" ;
2 - à travers l'énorme demande de Dollars provoquée (le pétrole se paie en Dollars) une surévaluation du billet vert qui permettait aux USA d'acheter n'importe quoi, n'importe où, en payant d'autant moins ; c'est une sorte de réévaluation forcée du Dollar.
La politique de taux d'intérêts élevés pratiquée par les USA depuis le début des années 80 se traduit par un résultat analogue. La crise économique fait apparaître une masse de capitaux "oisifs" sous forme argent, qui ne trouvent pas de secteurs productifs rentables où s'investir, le secteur productif se réduisant comme peau de chagrin. Ces capitaux sont contraints, sous peine de disparaître au moins partiellement, de se placer dans des secteurs spéculatifs, de se transformer en capitaux fictifs. Ils se placent là où les taux d'intérêts réels sont les plus élevés. Avec leur politique, les USA attirent chez eux ainsi une masse énorme de capitaux du monde entier et qui doivent, pour se placer, commencer par être transformés en Dollars. Celui-ci devient plus demandé, plus recherché, plus cher : il est surévalué (en janvier 84, certains estimaient la surestimation du prix du Dollar à 40 %). Achetant à bas prix (il faudrait dire : à prix forcé), les USA se paient le luxe du plus grand déficit commercial de leur histoire... sans que pour cela leur monnaie, au moins pour le moment ne soit dévaluée, au contraire. Simultanément, et tout aussi impunément, ils connaissent un déficit des administrations publiques sans précédent (200 milliards de Dollars), soit l'équivalent de leurs dépenses militaires officielles ([3] [91]).
Comme nous l'avons à plusieurs reprises démontré dans des numéros précédents de cette Revue, cette politique ne peut pas être éternelle. Elle constitue une fuite en avant qui prépare de gigantesques explosions financières.
Mener une politique de taux d'intérêt réels élevés veut dire être capable de payer des revenus réels élevés aux capitaux que l'on emprunte. Or, la crise économique, qui dévaste aussi les USA, interdit à ceux-ci de trouver les moyens réels de payer ces intérêts. Quant à la production militaire, la seule qui connaît un véritable développement, elle détruit ces moyens de paiement plutôt qu'elle n'en crée. Les USA paient ces revenus en réalité avec du papier, des Dollars surévalués, qui à leur tour se placent de nouveau aux USA. Au bout c'est la banqueroute du système financier mondial ([4] [92]). Mais les USA n'ont pas véritablement le choix et ils n'en laissent aucun à leurs "alliés". L'économie américaine "soutient" celle de l'Europe occidentale comme la corde soutient le pendu. Tout comme dans le bloc rival, et comme dans l'ensemble de la vie sociale du capitalisme décadent, les rapports économiques sont de plus en plus calqués et soumis aux rapports militaires. Parlant des rapports de l'Europe avec son chef de bloc, Helmut Schmidt - représentant expérimenté du capital allemand - déclarait récemment que Washington avait tendance à "remplacer ou supplanter son leadership politique par un commandement militaire strict, exigeant de ses alliés qu'ils exécutent les ordres sans discuter et dans les deux jours qui suivent" (Newsweek, 9 avril 84).
Dans le bloc de l'Est, l'URSS pille ses vassaux directement, par la pression militaire et policière. Dans le bloc occidental, les USA pillent surtout à travers le jeu des mécanismes économiques du "marché" militairement dominé par eux. Mais le résultat est le même. Le chef de bloc se fait payer sa politique militaire par des prélèvements directs ou indirects sur ses "alliés".
Le retard croissant de l'Europe est en grande partie le résultat de la loi du monde capitaliste, celle du plus fort.
Les faiblesses intrinsèques de l'économie européenne sont celles d'un continent divisé en une multitude de nations, concurrentes entre elles, incapables de dépasser leurs divisions, de concentrer leurs forces pour tenter de résister à la concurrence économique de puissances comme les USA et le Japon.
LE MYTHE DU MARCHE COMMUN
Une des manifestations les plus classiques de la crise économique est la multiplication du nombre de faillites d'entreprises. Celles-ci frappent depuis quelques années les principaux pays du bloc US comme une épidémie qui s'étend de plus en plus rapidement, atteignant des rythmes inégalés depuis la grande dépression des années 30.
Mais les faillites ne sont qu'un aspect d'un phénomène tout aussi significatif : l'accélération des concentrations de capitaux.
Dans la jungle capitaliste en proie à une pénurie croissante de marchés solvables, seules les entreprises les plus modernes, celles capables de produire à meilleur marché peuvent survivre. Mais moderniser l'appareil de production dans la période actuelle nécessite des concentrations de capitaux de plus en plus énormes. Face aux géants américains ou même japonais, les européens divisés, incapables de se mettre d'accord sur autre chose que sur la façon d'attaquer ou de combattre le prolétariat, parviennent de moins en moins à suivre la course technologique. Il est plus facile et plus rentable pour une entreprise européenne en difficulté de s'allier avec des capitaux américains ou japonais qu'avec d'autres européens. Et c'est ce qui se produit dans la réalité, malgré les déclarations ampoulées des prêtres de "l'Europe Unie".
Le "Marché Commun" a été un marché unifié essentiellement pour les capitaux américains et japonais qui ont la puissance et les moyens militaires de contrôler des marchés de cette taille.
La CEE, après des années d'efforts, ne parvient aujourd'hui à planifier et organiser que... la destruction et le démantèlement de l'appareil productif (la sidérurgie n'étant que l'exemple le plus spectaculaire).
Du point de vue des conditions objectives, l'Europe occidentale devient une poudrière sociale parce que la crise économique s'y accélère. Mais pas uniquement à cause de cela. Deux caractéristiques du capitalisme en Europe occidentale rendent plus explosive et profonde la lutte de classe dans cette partie du monde : le poids de l'Etat dans la vie sociale ; la juxtaposition d'une somme de petits Etats-nations.
LE POIDS DE L'ETAT DANS LA VIE SOCIALE REND LA LUTTE OUVRIERE PLUS IMMEDIATEMENT POLITIQUE
Plus l'Etat est présent dans la vie économique, et plus la vie de chacun est directement dépendante de "la politique" de l'Etat. La sécurité sociale, les retraites, les allocations familiales, les indemnités de chômage, l'éducation publique, etc. constituent une part importante du salaire des ouvriers en Europe. C'est une partie directement gérée par l'Etat. Plus ces institutions étatiques sont présentes et plus l'Etat est le patron de tout travailleur. Dans ces conditions, "l'austérité", l'attaque contre les salaires prend une forme directement politique et contraint le prolétariat, lorsqu'il combat, à s'affronter plus directement au coeur politique du pouvoir du capital.
La crise se traduit ainsi, plus en Europe qu'au Japon ou aux USA, par une ouverture plus immédiate du terrain politique pour le combat de classes. Plus qu'ailleurs, ce sont les gouvernements et non les entreprises qui prennent les décisions qui modulent les conditions d'existence des travailleurs. L'austérité en Europe, c'est le gouvernement allemand qui réduit les bourses d'études et les allocations familiales, c'est le gouvernement français qui réduit les indemnités de chômage, c'est le gouvernement espagnol qui propose la réduction du taux des retraites de 90 à 65 %, c'est le gouvernement anglais qui élimine plus d'un demi million de postes de fonctionnaires, c'est le gouvernement italien qui décide de détruire l'échelle mobile des salaires.
Le poids de l'Etat a régulièrement augmenté dans tous les pays du bloc occidental, y compris le Japon et les USA. Si on mesure ce poids par les dépenses totales des administrations publiques en pourcentage du produit intérieur brut, celui-ci est passé au Japon entre 1960 et 1981 de 18 % à 34 % et aux USA de 28 % à 35 %. Mais pendant ce temps, en 1981, ce pourcentage atteignait :
47 % en Grande-Bretagne,
49 % en Allemagne et en France,
51 % en Italie,
56 % en Belgique,
62 % en Hollande,
65 % en Suède.
C'est une des raisons pour lesquelles les luttes ouvrières en Europe occidentale ont et auront tendance à assumer plus immédiatement leur contenu politique.
LA JUXTAPOSITION D'UNE SOMME D'ETATS REND PLUS EVIDENT LE CARACTERE INTERNATIONAL DE LA LUTTE PROLETARIENNE
La nation constitue une institution de base caractéristique du mode de production capitaliste, tout comme le salariat. Elle fut un important progrès historique marquant la fin de 1'endettement féodal. Mais, comme l'ensemble des rapports sociaux capitalistes, elle est devenue une entrave majeure à tout développement ultérieur. Une des contradictions fondamentales qui condamnent historiquement le capitalisme est celle entre la production qui est matériellement réalisée à échelle mondiale et l'appropriation et orientation de celle-ci de façon nationale.
Or, nulle part au monde cette contradiction ne se manifeste de façon aussi criante que dans la vieille Europe occidentale. Nulle part, l'identité d'intérêts des prolétaires de tous les pays, la possibilité et la nécessité de l'internationalisation du combat de classe face à l'absurdité de la crise économique capitaliste, n'apparaissent de façon aussi immédiate.
Cette généralisation de la lutte ouvrière à travers les frontières ne se produira pas du jour au lendemain. Elle ne peut pas être une réponse mécanique aux conditions objectives. Il faudra certainement une longue période de luttes qui se déroulent simultanément dans l'ensemble des petits Etats européens pour qu'au milieu d'une effervescence prérévolutionnaire se forge dans la classe ouvrière la conscience et la volonté d'assumer son être international et révolutionnaire.
La classe ouvrière en Europe possède pour cela l'avantage déterminant d'être la fraction historiquement la plus expérimentée, celle dont les traditions révolutionnaires sont les plus importantes. Ce n'est pas par hasard si c'est en Europe occidentale que se concentrent les principales organisations politiques révolutionnaires du prolétariat, forces qui, pour faibles qu'elles puissent être encore aujourd'hui, ont et auront un rôle déterminant à jouer dans le processus révolutionnaire.
L'effondrement de l'économie capitaliste est un phénomène mondial qui touche tous les pays, créant à l'échelle de la planète les conditions de la révolution communiste. Mais l'Europe occidentale du fait de sa place dans le processus mondial de production, du fait de sa place particulière au sein du bloc militaire américain, du fait de sa structure politique (importance de l'Etat, multiplicité de nations), ainsi que du fait des conditions subjectives d'existence du prolétariat, constitue nécessairement l'épicentre de la révolution mondiale.
RV
[1] [93] Voir "Le prolétariat d'Europe de l'Ouest au coeur de la lutte de classe" Revue Internationale n°31, 4ème trimestre 1982, ainsi que "Critique de la théorie du 'maillon le plus faible'" Revue Internationale n°37, 3ème trimestre 1984.
[2] [94] La relative arriération de 1'URSS par rapport à certains des pays de son glacis, telle la RDA, est le reflet du fardeau de ses dépenses militaires. Les seuls secteurs où l'URSS est en tête dans son bloc sont ceux directement militaires.
[3] [95] Les difficultés croissantes que connaissent actuellement les banques américaines et la multiplication des faillites dans ce secteur sont les premières manifestations du gouffre auquel doit aboutir cette politique.
[4] [96] Idem.
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Belgique-Hollande:crise et lutte de classe : Rapport du 5ème Congrès d'Internationalisme
- 4077 lectures
Si nous avons décidé de publier dans la Revue Internationale un rapport consacré à la situation économique, politique et sociale dans ces deux pays d'Europe, c'est que justement celle-ci n'a rien de particulier ou de spécifique, mais exprime de façon exemplaire ce que subissent de façon croissante les prolétaires dans tous les pays industrialisés.
L'austérité draconienne dans ces deux pays qui, il y a quelques années encore, étaient vantés pour leur niveau de vie parmi les plus élevés d'Europe et pour leur niveau de"protection sociale" enviable, est un indice de l'évolution de la crise économique au coeur du capitalisme mondial, de la force de l'attaque des conditions de vie des ouvriers. De même, la capacité de riposte ouvrière à cette attaque et les efforts d'adaptation politique de la bourgeoisie nous fournissent des indications précieuses concernant le développement du rapport de force entre les classes,
Nous estimons donc que ce texte est une excellente illustration de notre démarche générale appliquée à des situations concrètes et qu'il démontre clairement combien l'approfondissement de notre cadre d'analyse par rapport au rôle de la gauche dans l'opposition, le syndicalisme de base, le cours historique ou le processus de généralisation de la lutte de classe, basé sur les leçons de la vague de lutte précédente, se révèle indispensable pour appréhender la situation sociale actuelle.
Le 4ème Congrès de la section du CCI en Belgique (février 1982) se déroula deux mois après le putsch de Jaruzelski en Pologne, en pleine contre-offensive de la bourgeoisie internationale, au nouent où la classe ouvrière, déboussolée, marquait le coup.
Dans ce cadre, ce n'était nullement un hasard si la bourgeoisie belge, après des années de tergiversations et sous la pression directe du bloc, venait d'aligner sa politique sur celle du bloc et engageait l'attaque directe contre la classe ouvrière. La résolution sur la situation nationale, adoptée lors du Congrès, décrivait adéquatement la stratégie mise en place par la bourgeoisie :
"Les élections du 8 novembre 81 légaliseront ce nouvel ordre de bataille de la bourgeoisie face à la lutte de classe, le pas qualitatif dans l'attaque frontale du prolétariat est franchi :
a) une droite dure et arrogante au pouvoir, bien ancrée au pouvoir dans une perspective à long terme et parlant le langage de la vérité,
b) un partage essentiel des tâches au sein de l'appareil politique de la bourgeoisie entre une droite dure au gouvernement et une gauche dans l'opposition face à la lutte de classe, ainsi que diverses sous divisions au sein du gouvernement et dans l'opposition, permettant plus de souplesse dans le développement des mystifications,
c) une gauche dans l'opposition aux accents radicaux dont les thèmes actuels ne sont plus ceux d'une, équipe responsable développant un langage d'illusions dans la perspective d'un retour au gouvernement, mais dont la seule fonction aujourd'hui est de faire dérailler les luttes, face aux réactions engendrées par l'austérité draconienne" (Résolution sur la situation en Belgique et aux Pays-Bas, février 82).
Ainsi, la résolution indiquait clairement dès février 82 les axes fondamentaux de la politique de la bourgeoisie en Belgique pour les deux années à venir. En Hollande, la situation paraissait encore moins tranchée et la gauche venait de revenir au pouvoir. Toutefois, dans le rapport sur la situation aux Pays-Bas, nous soulignions que "L'adhésion du PVDA (SD) au gouvernement n'était rien d'autre qu'une solution de secours temporaire" (Idem), ce qui se confirma bien vite dès la fin de 82. Globalement donc, pour les deux pays, la stratégie de la bourgeoisie dans la période écoulée se caractérisa par une austérité draconienne et le travail de sape de la gauche dans l'opposition.
Sous la pression inexorable de la crise et de l'austérité, l'affrontement entre les classes reprit de plus belle au sein même des pays industrialisés. La Belgique et la Hollande se retrouvèrent au premier rang dans la reprise de la lutte de classe. C'est dans cette perspective que nous évaluerons les résultats de la stratégie de la bourgeoisie, autant sur le plan économique que politique, et son impact sur le développement de la lutte prolétarienne.
BELGIQUE DEUX ANS D'AUSTERITE ET DE "SACRIFICES"
"L'économie belge connaît depuis plusieurs années une situation caractérisée par des déséquilibres multiples et accusés. Ceux-ci trouvent leur origine dans les effets de la crise internationale à laquelle la Belgique est particulièrement sensible en raison de son degré exceptionnel d'ouverture sur l'extérieur. Ils ont également des causes internes, parmi lesquelles les plus importantes tiennent d'une part, à une adaptation insuffisante de la production à l'évolution de la demande intérieure et extérieure et, d'autre part, à un système rigide de formation des revenus qui a conduit à une modification importante dans le partage du revenu national au cours des années 70," (Etudes économiques de l'OCDE, Belgique Luxembourg, mai 83, p.9).
En clair, depuis la fin des années 70, la Belgique se trouve dans une situation économique particulièrement difficile causée :
a) par l'approfondissement de la crise mondiale du capitalisme que la Belgique ressent plus directement et plus brutalement que d1autres à cause de sa dépendance des marchés internationaux, vu l'exiguïté de son marché intérieur.
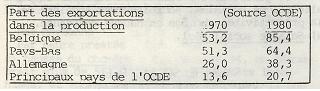
b) par les hésitations de la bourgeoisie belge à mettre en place une politique économique et sociale rigoureuse visant à rationaliser l'économie et « à réduire considérablement les salaires et les allocations sociales.
Aussi, dos son installation, l'action du gouvernement Martens-Gol sera centrée sur :
- le "transfert du revenu des ménages vers les entreprises" (sic !), réalisé par une politique des revenus avec un blocage partiel de l'indexation associé à une dévaluation de 8,5% du franc au sein du SME, et une politique budgétaire restrictive
(l'objectif étant de réduire le déficit public en 82 et 83 chaque fois d'un montant équivalent à 1,5% du PNB, de façon à diminuer le prélèvement des administrations sur les disponibilités de financement de l'économie (Etudes économiques de l'OCDE, p.9).
- Une rationalisation des secteurs non adaptés à "l'évolution de la demande intérieure et extérieure" : sidérurgie (Cockerill-Sambre), chantiers navals (Cockerill-Hoboken, Boel), mines du Limbourg, textile (Fabelta, Motte), métallurgie (Nobels-Peelman, Boomse Metaalwerken, Brugeoise et Nivelles). Comme le reconnaissait cyniquement Gardois, le "conseiller spécial" du gouvernement pour la sidérurgie, il ne s'agit, à travers des fusions, des fermetures partielles, des aides de l'Etat conditionnées par des baisses conséquentes des salaires, que d'une "liquidation socialement camouflée".
Quels sont, après deux ans d'application, les résultats de cette politique d'austérité draconienne ? Une telle observation est importante dans la mesure où, de par sa situation au début des années de vérité, la Belgique a servi de "laboratoire" à la bourgeoisie occidentale pour tester la façon d'imposer une austérité généralisée et une attaque globale contre le niveau de vie de la classe ouvrière.
La situation de l'économie belge
Malgré les deux années de restriction et de "sacrifices", les indicateurs économiques montrent clairement que la situation économique est loin d'être brillante, comme l'illustre bien la croissance du produit intérieur brut :
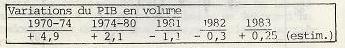
Plus explicite encore est le graphique de la production industrielle qui révèle pratiquement une stagnation permanente de celle-ci depuis 1974.
Même par rapport à l'ensemble des autres pays industrialisés, on ne peut guère dire que l'économie belge a rattrapé le terrain perdu. On pourrait tout au plus parler d'une stabilisation dans la récession.
Cette constatation générale sera étayée en examinant de plus près quatre facteurs permettant de juger plus en profondeur de la santé de l'économie belge :
a) la compétitivité : pour le gouvernement, c'est a ce niveau que se trouve la clé du problème et la solution de la crise : en rendant à l'industrie sa compétitivité, la production pourra reprendre et le chômage se résorber. Et à première vue, en effet, les résultats de la politique gouvernementale semblent spectaculaires.
Toutefois, trois constatations atténuent fortement les conséquences de ce redressement de la compétitivité :
- le redressement de la compétitivité est avant tout lié à la réduction des coûts salariaux et, d'une manière générale, à la diminution des heures travaillées, suite à l'extension du chômage et non pas vraiment au développement de la production ou des exportations (cf. infra);
- comme les autres pays industrialisés ont pris depuis lors des mesures similaires (cf. Rapport sur la Hollande), l'amélioration de la compétitivité sera rapidement annulée.
- la restauration de la position concurrentielle et de la rentabilité des entreprises n'a aucunement conduit à une reprise des investissements productifs. La chute des livraisons de biens d'équipement au marché intérieur ainsi que celle du volume de la formation brute de capital fixe le confirment : la chute des investissements continue.
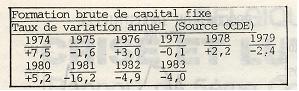
Face à l'impossibilité de vendre sur un marché sursaturé et au sous-emploi de l'appareil productif, la bourgeoisie préfère utiliser ses capitaux pour la spéculation (or, monnaies, matières premières). Les investissements industriels qui se font malgré tout visent alors surtout à la rationalisation : "En moyenne, les entreprises semblent avoir été surtout soucieuses, face à la faiblesse persistante de la demande et au coût toujours élevé du crédit, de restructurer leurs bilans et d’accroître leurs taux d’auto financement. " (Etudes économiques de l'OCDE, p. 31).
b) les exportations : ici aussi, on constate une hausse de 2% des exportations en 1983.
Mais la balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) est toujours déficitaire. De plus, l'amélioration s'explique :
- par la baisse des importations, causée par la dévaluation et la politique d'austérité
- par la dévaluation qui a rendu les produits belges moins chers à l'exportation.
Toutefois, dans la mesure où la Belgique exporte essentiellement vers d'autres pays industrialisés (83 % vers l'OCDE dont 70 % vers la CEE contre 2 % vers le COMECON et 5 % vers l'OPEP) et que ceux-ci subissent de plus en plus l'austérité et limitent en conséquence leurs importations, les conséquences pour les exportations belges risquent d'être désastreuses.
c) 1'inflation : malgré la stagnation de la production industrielle et la diminution des salaires et de la consommation (cf. infra), l'inflation, après un net recul à la fin des années 70, reprend nettement.
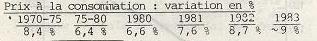
d) déficit et finances publiques : le déficit de l'Etat belge reste catastrophique : 16,2 % du PNB en 1981, 15,8 % en 1982 et,"d'après les estimations gouvernementales, 15,5 % en 1983, alors que la moyenne européenne est de 7 %. Le déficit courant de la Belgique se chiffrait en 1982 à 190 milliards de FB, tandis que la charge des intérêts de la dette représente aujourd'hui déjà 3 % du PNB et 20 % des recettes courantes des administrations.
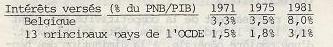
En outre, comme une grande partie de la dette (dette extérieure) est calculée en dollar, la hausse récente de la monnaie US aura des conséquences catastrophiques sur la charge des intérêts.
La "réduction de la charge sociale"
S'il fallait définir succinctement les deux années écoulées, on retiendrait sans nul doute l'attaque brutale du niveau de vie de la classe ouvrière. Certes, dés les années 70, le niveau de vie de la classe ouvrière avait été entamé, mais cela s'était fait de manière détournée, par une hausse des impôts directs et indirects, par un accroissement de la productivité (cf. tableau sur la productivité) et par l'inflation galopante. Mais depuis les "années de vérité", et plus particulièrement depuis la mise en place de la stratégie actuelle de la bourgeoisie (droite au pouvoir, gauche dans l'opposition), l'attaque est brutale, massive et généralisée : baisse des salaires et des allocations sociales, accroissement accéléré de la productivité, chômage en hausse constante, a) Salaire social réel,
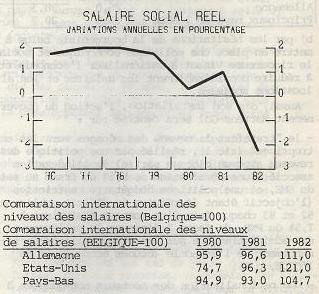
" Au total, les experts belges estiment que, sous l'hypothèse d'une augmentation des prix à la consommation de 7,5 % en 1983 (8,7 % en 1982), l'incidence des mesures de freinage des salaires serait de l'ordre de 7,5 % entre décembre 1981 et décembre 1983, dont 4,5 % au cours de 1982". (Etudes économiques de l'OCDE, p. 16).
Comme l'inflation pour 1983 se chiffrerait, non à 7,5 % mais à plus ou moins 9 %, la baisse des salaires "officielle" devrait s'établir au-delà de 8 %. Pour juger de l'importance de l'attaque, on peut encore relever que, dans l'industrie manufacturière et calculé par rapport aux 15 principaux pays de l'OCDE, l'indice des coûts unitaires relatifs de main d'oeuvre s'est situé en 1982 très en deçà de son niveau en 1970. Parallèlement on assiste à une baisse de la consommation privée, bien illustrée par l'effondrement du volume des ventes au détail :
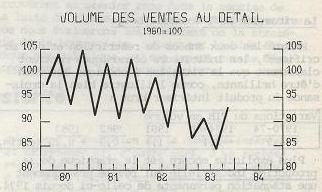
b) 1'augmentation de la productivité : l'amélioration de la compétitivité par la dévaluation et la baisse des salaires n’a nullement débouché sur une baisse du chômage, qui a continué à monter (cf. infra), mais sur une forte augmentation de la productivité à travers une rationalisation (meilleur taux d'utilisation de l'appareil productif) (cf. tableau n° 7) et une mécanisation et une automatisation intensive.
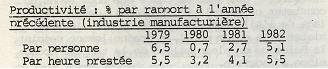
c) hausse du chômage : fin janvier 84, on dénombrait plus de 523.000 chômeurs complets indemnisés, et encore ce chiffre nous donne-t-il une idée fausse de la situation réelle. En vérité, d'après l'OCDE, le nombre de personnes sans emploi (chômeurs indemnisés et autres) s'élevait en mars 83 à environ 600.00, le rythme de progression du chômage s'étant à peine infléchi, dépassant 16 % en mars 83 (contre 20 % pour les 12 mois précédents).
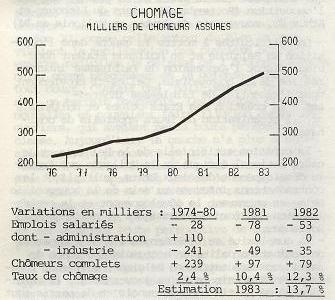
En outre, environ 180.000 personnes bénéficiaient d'un programme public d'aide à l'emploi (chômeurs mis au travail, cadre spécial temporaire, etc.) ou d'une pré pension de sorte crue, au total, près de 19 % de la population active se trouvait en dehors du circuit normal de 1'emploi.
En conclusion, l'austérité draconienne imposée par le gouvernement Martens V a représenté la première attaque directe généralisée contre l'ensemble de la classe ouvrière en Belgique sans qu'elle n'ouvre la voie à une reprise de l'économie qui "ne peut reposer que sur la demande extérieure" (OCDE, p. 46). L'amélioration relative de la compétitivité de l'industrie belge n'est qu'une donnée temporaire et passagère que les programmes d'austérité et de réduction de salaires dans les autres pays industrialisés réduira rapidement à néant. La crise générale du capitalisme ne laisse aucun répit à la bourgeoisie belge en dehors d'un redoublement des attaques contre la classe ouvrière.
HOLLANDE LE CARACTERE INELUCTABLE DE L'PIPASSE ECONOMIQUE
Il y a deux ans, dans le sillage de la locomotive allemande, les Pays-Bas passaient encore pour une des économies les plus fortes, alors qu'aujourd'hui, ils connaissent le chômage le plus étendu et, après la Belgique, le déficit le plus important des pays industrialisés. Les économistes n'y voient plus le bout du tunnel, mais prévoient un long chemin passant par plusieurs législatures qui aboutiraient peut-être à long terme, et ils avancent alors prudemment la date de ... 2005 !
En effet, au cours de 82 et 83, les indicateurs se sont brusquement détériorés :
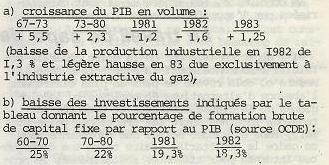
De plus, le taux d'utilisation de l'appareil productif est tombé en 83 à 77 % de la capacité totale de production, le même niveau qu'en 75.
Le taux d'utilisation était en 82 inférieur de 8 % à celui de 73 et de 6,5 % à celui de 79. Le déficit budgétaire qui augmentait de 6,7 % en 81 a augmenté de 9,4 % en 82 et en 83, on prévoit une hausse de 12,5 %. Le graphique n° 9 montre dès lors l'accroissement fulgurant de la dette de l'Etat hollandais, augmentant de 19 % en 81, de 22 % en 82, et atteignant la somme impressionnante de 144,7 milliards de florins.
Les chiffres du commerce extérieur semblent infirmer les données précédentes, puisque l'excédent de la balance des paiements courants a augmenté de 9,8 % en 82 et de 12 % en 83. Ces chiffres n'ont pourtant qu'une signification limitée parce qu'ils s'expliquent surtout par le développement des ventes de gaz naturel et par le recul des importations qui résulte de la chute de la consommation nationale. En vérité, l'industrie hollandaise est en moins bonne posture. " Quelques multinationales puissantes : Philips, Royal Dutch Schell, Unilever ont fait sa réputation. Mais sa structure est faible, peu présente dans les créneaux les plus porteurs. Le déclin est complet dans le textile, la confection, les chantiers navals. Au fil des ans, ce tissu industriel s1est effiloché. Le florin fort et la forte propension à investir à l’étranger y ont contribué." (Le Monde du 5.2.84, p. 9). En conséquence, dès la fin de 82, l'attaque directe contre la classe ouvrière s'accentua en Hollande, après la réorganisation par la bourgeoisie de ses forces politiques avec le passage de la gauche dans l'opposition et la venue de la droite au pouvoir (gouvernement Lubbers). Si la stagnation et le léger recul des salaires était déjà un fait dès le début des années 80 (1972 : 100 - 1980 : 103,9 -1981 : 101,2 - 1982 : 100,1) grâce à un premier gouvernement de droite (Van Agt et Wiegel) et aux mesures plus indirectes du gouvernement de centre-gauche (Van Agt et Den Uyl) en 82, les attaques contre le niveau de vie du prolétariat vont pleuvoir à partir de la fin 82 :
- baisse des salaires de 3,5 % pour la classe ouvrière en 83 et même de 5 % pour les fonctionnaires
- baisse de 3,5 % des salaires des fonctionnaires et des allocations en 84
- diminution des salaires et des allocations de 15 % prévue entre 84 et 86.
En parallèle, on assiste à une véritable explosion du chômage :
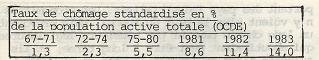
En quelques années, les Pays-Bas ont largement dépassé la moyenne de l'OCDE qui est de 10 %.
En conclusion, les années 82-84 sont caractérisées par l'approfondissement inéluctable de la crise économique qui n'épargne plus aucun pays et par le déclenchement d'une attaque sans précédent contre le niveau de vie de la classe ouvrière. C'est dans ce cadre que nous avons pu constater comment la Hollande qui, dans le sillage de l'Allemagne, semblait encore mieux résister à la crise en 81, a graduellement rejoint la Belgique en plein milieu de la tempête économique et sociale.
Si l'approfondissement de la crise générale affaiblit fondamentalement la bourgeoisie dans la mesure où cela révèle de plus en plus clairement l'absence d'alternatives économiques ou idéologiques de la classe dominante et exacerbe les tensions internes entre ses fractions, celle-ci sait face au danger mortel crue représente dans ce cadre le prolétariat, faire taire ses divergences internes pour affronter solidairement le prolétariat.
Les solutions gui lui font défaut sur le plan économique sont dès lors compensées par une remarquable habileté sur le plan politique. Chaque jour, la bourgeoisie démontre qu'elle est capable de défendre avec beaucoup de hargne et d'intelligence ses privilèges et sa domination. Dans les principaux pays industrialisés, la carte maîtresse du dispositif bourgeois visant à imposer l'austérité généralisée et à faire accepter les préparatifs de guerre est la mise en place de la gauche dans l'opposition. Cela s'est parfaitement illustré en Belgique et en Hollande.
LA NECESSITE DE IA GAUCHE DANS L'OPPOSITION EN BELGIQUE ET EN HOLLANDE
Depuis la reprise des luttes ouvrières en 1978, le CCI avait mis en avant la nécessité de la gauche dans l'opposition pour briser les luttes de l'intérieur, mais l'expérience nous a appris qu'il y a, entre la nécessité objective pour la bourgeoisie et sa capacité à faire tout ce qui est nécessaire pour la satisfaire, un monde de difficultés à franchir. Si en Belgique et en Hollande, la bourgeoisie a réussi adéquatement à adapter son dispositif de défense aux nécessités de la période, le passage de la gauche dans l'opposition s'est toutefois caractérisé par une grande difficulté à le réaliser concrètement :
- en Belgique, dès 1980, une série de gouvernements "de transition" ont essayé de réaliser les conditions nécessaires au passage de la gauche dans l'opposition (cf. Rapport au 50 Congrès), mais ce n'est qu'à la fin 81 qu'elle pourra avoir lieu;
- en Hollande, la droite était venue au pouvoir dès 78 pour mener une politique d'austérité (gouvernement chrétien-libéral Van Agt et Wiegel). Pourtant, de la mi-8I à la mi-82, la gauche revient au pouvoir, et ceci nettement à contre-courant des nécessités nationales (les socialistes ont perdu les élections, une austérité draconienne doit être imposée) et internationales (crise et austérité se généralisent à tous les pays). Ce n'est qu'après environ un an de paralysie gouvernementale accrue et de dé crédibilisation croissante de la gauche que la bourgeoisie trouva le moyen d'en revenir à la situation du début 81.
Ces atermoiements et ces hésitations n'étaient pas l'expression d'une meilleure résistance à la crise, comme certains l'affirmaient.
- Il s'agit des deux pays les plus axés sur l'exportation. Ils ressentent dès lors plus vite et plus fortement que d'autres la crise mondiale de surproduction.
- Malgré les ressources énergétiques propres (gaz naturel), la Hollande a un tissu industriel en dé clin, ce qui amène dès 78 le gouvernement à prendre des mesures d'austérité et de rationalisation (automobiles DAF, textile, chantiers navals).
- La crise provoque dès 79 des réactions ouvrières qui indiquent que la place de la gauche est dans l'opposition (Rotterdam 79, mines du Ljmbourg et Athus 80, mouvements de luttes en Wallonie en 81).
Les difficultés à mettre la gauche dans l'opposition en Belgique et en Hollande étaient donc bien plutôt l'expression de faiblesses internes réelles de la bourgeoisie. Celles-ci proviennent pour l'essentiel de faiblesses inhérentes à la création des Etats belges et hollandais et à l'organisation de leurs appareils de domination.
- La création artificielle de la Belgique et le cadre national étriqué de la Hollande ont freiné le développement des deux Etats, multipliant les contradictions internes au sein de la bourgeoisie belge et entravant le développement et la centralisation des forces économiques et politiques en Hollande.
- La complexité et l'hétérogénéité de l'appareil de domination politique bourgeois (présence de partis communautaires en Belgique, obligeant longtemps à maintenir le PS au gouvernement, la multiplicité de partis confessionnels et de partis tout court en Hollande, séquelles du développement historique de ces pays, rendait toute manoeuvre de la bourgeoisie fort délicate) a retardé ou empêché pendant un certain temps que la bourgeoisie mette la gauche là où elle pouvait lui rendre les meilleurs services.
Toutefois, malgré ces difficultés internes, les bourgeoisies belge et hollandaise ont montré qu'elles avaient une assise suffisamment solide et une expérience assez riche pour développer, sous la pression économique et face au danger de la lutte de classe, un dispositif redoutable afin d'encadrer et de mystifier les luttes.
LE ROLE DE LA CAUCHE ET LA REPRISE DES LUTTES
Alors que le développement de la crise amène souvent à identifier notre période aux années 30, la comparaison entre le travail de la gauche dans ces deux périodes en Belgique révèle le caractère fondamentalement différent des deux périodes historiques.
Dans les années 30, face à la crise et aux luttes ouvrières (grèves insurrectionnelles de 1932), la gauche (Parti Ouvrier Belge) avance le plan de travail (ou Plan De Man) pour "sortir la Belgique de la crise". De cette façon, la classe ouvrière est massivement mobilisée derrière des perspectives de capitalisme d'Etat (programmes de nationalisations) et est amenée à soutenir l'action parlementaire du P0B et du PCB "pour combattre le fascisme".
Aujourd'hui, la tactique et le travail de la gauche sont fondamentalement différents :
- son langage n'est pas celui du réalisme, de la conciliation nationale, de l'union sacrée. Au contraire, elle se veut critique, radicale, ouvriériste même. Les personnalités équivoques sont éliminées (Cools, Simonet), tandis qu'elle ne fait aucun effort pour retourner au gouvernement;
- sa tactique n'est pas offensive, mais défensive. Loin de tenter de mobiliser les ouvriers derrière la capital national, la gauche essaye aujourd'hui d'empêcher par tous les moyens que la lutte se développe.
Alors que dans les années 30, l'encadrement de la classe ouvrière était pris directement en charge par le POB lui-même, la commission syndicale n'étant qu'un appendice du parti, ce sont aujourd'hui les syndicats qui sont aux avant-postes, dans la lutte même, pour tenter de la dévoyer. Les campagnes de la gauche dans les années 30, comme celle autour du Plan De Man, visaient la mobilisation des ouvriers pour des mesures radicales de défense de l'économie nationale, comme précurseur de la défense nationale tout court. C'était une "politisation" des luttes sur un terrain bourgeois. Les mesures étaient nouvelles et pouvaient faire illusion auprès des ouvriers, qui avaient perdu toute perspective de classe. Aujourd'hui, la gauche n'a plus d'autre alternative à proposer, qu'une austérité mieux "emballée", plus "équitable". Ses plans ne font plus illusion après des années de crise, de ministres socialistes et d'austérité "raisonnable". C'est pourquoi ses efforts se concentrent sur le terrain syndical, pour diviser la classe ouvrière en lui enlevant toute perspective de lutte et pour casser ainsi sa combativité.
Ce comportement différent de la gauche trouve son explication dans la dynamique diamétralement opposée qui caractérise le rapport de force entre les classes en 1930 et aujourd'hui. A la fin des années 20, la classe ouvrière était battue au niveau international et la gauche avait pour but, dans les pays où les prolétaires n'avaient pas été écrasés physiquement, d'embrigader la classe ouvrière pour une nouvelle guerre mondiale derrière le drapeau de 1'anti-fascisme. Aujourd'hui, la lutte contre l'austérité d'un prolétariat non défait tend à l'unification sur le plan national comme sur le plan international, et la gauche essaye d'empêcher son développement et de déboussoler la classe ouvrière.
LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION FACE AUX LUTTES
Tout au long de ces deux dernières années, la classe ouvrière, en Belgique comme en Hollande, s'est constamment heurtée à la gauche dans l'opposition et a fait souvent l'amère expérience de ses techniques raffinées de sabotage au sein des luttes. Ces dernières sont axées sur trois axes centraux :
- Occuper le terrain : la force de la gauche et des syndicats ne résulte pas de perspectives originales ou de solutions nouvelles avancées face à l'approfondissement de la crise. Leur force, c'est leur organisation au sein de la classe, leur appareil d'encadrement des ouvriers, le poids des idées reçues pesant sur le prolétariat,' en parti culier la conviction encore répandue qu'une lutte ne peut se développer, s'organiser, être gagnée qu'à travers l'organisation syndicale. C'est à travers cette occupation du terrain social qu'ils peuvent peser lourdement sur le développement et l'orientation des luttes.
- Isoler ou fractionner la réponse de la classe ouvrière : face à la généralisation de l'austérité et des attaques contre le niveau de vie de la classe ouvrière, la gauche peut désamorcer la puissance du mouvement en empêchant l'extension quantitative de la lutte (limiter à l'usine, au secteur, à la région). A ce propos, il faut constater que la gauche utilise avec beaucoup de raffinement les contradictions internes au système, de fausses oppositions ou diverses campagnes idéologiques de la .bourgeoisie pour diviser ou noyer les luttes prolétariennes :
. Les oppositions régionales (Flandres, Wallonie) sont systématiquement mises en avant pour entraver l'extension des luttes à la Belgique entière
. Le féminisme est exploité en Hollande pour diviser et opposer les travailleurs de sexes différents, tandis que le pacifisme a été directement utilisé pour briser la grève des fonctionnaires..
Toutefois, l'isolement et l'encadrement de la lutte peuvent aussi être réalisés en désamorçant la dynamique même du combat. Ainsi, pendant l'automne 83 en Belgique, c'est par le biais d'une "généralisation" formelle mais vide de la grève que les syndicats parvinrent à prendre le contrôle du mouvement et à le vider de sa substance. En réalité, le travail d'éparpillement tend avant tout à séparer l'extension du mouvement de son auto organisation, qui sont deux composantes indispensables de son développement. Pour ce faire, on peut agir sur différentes facettes de la lutte :
. Au niveau des moyens de lutte : grèves passives, occupations, autogestion, "nouveaux moyens de lutte" (grève de l'épargne, etc.);
. Au niveau de la préparation des luttes : mettre l'accent sur les préparatifs techniques (tracts, piquets de grève, etc.) et financiers;
. Au niveau de l'organisation des luttes, placées sous le contrôle des syndicats ou de comités de grève syndicaux dirigés par des permanents syndicaux et des syndicalistes de base;
. Au niveau des perspectives de la lutte : placer la lutte dans la logique du système et de sa crise : se battre "pour une véritable concertation", le sauvetage de son usine, sa région, pour des "sacrifices équitables", pour "faire payer les riches", pour la nationalisation, ...
- Enfermer le mécontentement ouvrier dans le cadre du syndicalisme : les syndicats, comme nous l'avons vu, jouent un rôle central dans la stratégie de la gauche dans l'opposition et ce rôle est encore accentué en Belgique et en Hollande par la dé crédibilisation subie par les partis socialistes à cause des difficultés internes de la bourgeoisie. Ceci provoque une "usure" accélérée des directions syndicales et explique, avec la combativité ouvrière persistante l'importance croissante du syndicalisme de base qui a joué, en Belgique comme en Hollande, pendant les deux années passées, un rôle central dans les luttes importantes qui ont éclaté (Rotterdam 79, vagues de luttes de 81 et 82 en Belgique, grève des fonctionnaires en Belgique et en Hollande en 83). La fonction essentielle du syndicalisme de base a été confirmée dans la période écoulée:
. Par la concentration de toutes les forces gauchistes sur ce travail syndical à la base,
. Par des tentatives de coordination des forces et des conceptions syndicalistes de base sur un plan national ("Vakbond en Demokratie" en Belgique, "Solidariteit" en Hollande).
Dans les luttes actuelles, le rôle du syndicalisme de base est double :
. Prendre le contrôle des luttes radicales pour empêcher quelles aillent trop loin, donc pour saboter, derrière un vocabulaire radical, derrière des actions spectaculaires (affrontements avec la police : sidérurgie en 82), leur extension et leur radicalisation;
. Ramener les "brebis galeuses" dans le giron syndical en leur faisant croire que "les syndicats, c'est nous", tandis que par leurs discours radicaux, leurs actions dures, leurs conflits continuels avec les directions syndicales, ils gagnent la confiance des ouvriers combatifs (Rotterdam, 79 et 82, lutte dans la fonction publique en Belgique et en Hollande, 83).
Dès à présent, le syndicalisme de base s'impose comme une des armes les plus pernicieuses de la bourgeoisie, maintenant que les syndicats traditionnels seront de plus en plus souvent contestés et dépassés par la lutte ouvrière. De par sa flexibilité qui peut même s'accommoder d'un antisyndicalisme de façade, il sera utilisé par la bourgeoisie jusque dans la période révolutionnaire au sein des conseils pour dévoyer le prolétariat de son combat révolutionnaire vers la logique syndicaliste et gestionnaire. Son utilisation, fréquente dès à présent, si elle permet à la bourgeoisie pour le moment de contrôler les mouvements, d'étouffer toute perspective de lutte révolutionnaire et d'entraver l'auto organisation de la classe, marque l'affaiblissement historique de la bourgeoisie et annonce, à long terme, la dé crédibilisation de ses armes mystificatrices les plus radicales.
Le prolétariat face à la gauche dans l'opposition
Les tergiversations de la bourgeoisie et le retard accumulé dans la prise de mesures draconiennes qui ont nécessité un rattrapage brutal, le rôle de "laboratoire" que la Belgique a joué durant ces années en étant la pointe la plus avancée dans l1attaque de la bourgeoisie mondiale contre les conditions de vie des ouvriers dans les pays occidentaux, ont profondément marqué les conditions de la lutte de classe. Attaquée durement et presque continuellement, la classe ouvrière a été obligée de réagir et l'a fait régulièrement (hiver 81, février-mars 82, septembre-octobre 83). De ce fait, les luttes ouvrières en Belgique et plus tard en Hollande ont exprimé d'une façon particulièrement édifiante les obstacles et les problèmes auxquels la classe ouvrière mondiale est confrontée, surtout dans les pays industrialisés, et qu'elle devra surmonter, mais aussi la dynamique et la force du mouvement.
Dès février 1981, des grèves massives éclatent dans toute une série d'usines (Caterpillar, British Leyland, FN) dans la sidérurgie et les transports publics, aussi bien en Flandres qu'en Wallonie, contre les mesures d'austérité prises par un gouvernement où des ministres socialistes occupent des postes-clés (économie, travail). Elles montrent à la bourgeoisie combien le temps presse, combien les nécessités de l'heure (austérité, attaque directe de la classe ouvrière) exigent une stratégie appropriée. En novembre 81, après des élections anticipées, la droite est au pouvoir, et la gauche dans l'opposition démontrera déjà quelques semaines plus tard sa redoutable efficacité.
LES LUTTES DE FEVRIER-MARS 1982 : LE DESARROI FACE AU REPLI DES LUTTES
Le mouvement de février-mars 82 qui mobilise plusieurs dizaines de milliers de travailleurs autour des sidérurgistes à Liège, à Charleroi et dans le Hainaut contre la réduction draconienne des salaires accompagnant la dévaluation, est sans conteste le mouvement le plus important en Belgique depuis la grève générale de 60-61.
Eclatant quelques semaines après le putsch en Pologne, il démontre, par la grande combativité, par la tendance à une lutte générale, dépassant les secteurs ou les revendications particulières face à l'attaque générale que subit le prolétariat, par la tendance à exprimer la spontanéité de la classe et à remettre en cause l'encadrement syndical, par l'affrontement avec l'Etat et en particulier avec les forces de l'ordre, que la défaite en Pologne n'a pas fondamentalement entamé le potentiel de combativité du prolétariat mondial et que le désarroi de la classe ouvrière face à la contre-offensive idéologique de la bourgeoisie n'est pas éternel et ne traduit pas de recul profond et de longue durée de la lutte de classe.
Toutefois, le désarroi général du prolétariat après la défaite en Pologne, l'inexpérience face aux manoeuvres de la gauche dans l'opposition, vont profondément- marquer les luttes de 82 et ne favorisent pas le développement des luttes et la clarté de leurs perspectives. Ainsi, il faut relever :
- tout d'abord l'isolement de la lutte en Belgique, face à un calme social plat dans les autres pays industrialisés, plongés en plein dans les campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur la Pologne
- la limitation du mouvement qui s'est développé, autour des actions des sidérurgistes, à la Wallonie, tandis que les syndicats avaient réussi à désamorcer toute velléité de résistance en Flandres (cf. la longue lutte à Boel et Tamise)
- la facilité relative avec laquelle les syndicats entravent l'extension du mouvement par leurs tentatives de division ouvertes : entre syndicats, entre secteurs, entre régions (Liège contre Charleroi) , permettant à la bourgeoisie de contrôler fermement le mouvement et de conserver un discours particulièrement arrogant sans céder sur quoi que ce soit.
LES LUTTES DE SEPTEMBRE-NOVEMBRE 1983 : AU COEUR DE LA REPRISE DES LUTTES
La longue lutte des services publics en Belgique (septembre octobre), puis en Hollande (octobre-novembre) constitue le mouvement de luttes ouvrières le plus important depuis les combats de Pologne en 1980. Elle reprend les caractéristiques positives du mouvement précédent, mais elle profite de l'accumulation des conditions objectives permettant une reprise internationale de la lutte de classe. :
- longue période d'austérité, de chômage et d'attaques contre la classe ouvrière, qui se sont généralisés à tous les pays industrialisés sans que cela n'amène une amélioration des conditions économiques
- la classe ouvrière en Belgique a fait l'expérience de deux ans de gauche dans l'opposition et de ses mystifications tandis que cette expérience s'est étendue aux pays environnants (la gauche dans l'opposition aux Pays-Bas et en Allemagne)
- les luttes en Belgique et en Hollande s'inscrivent dans une nouvelle vague internationale de combats contre le capitalisme.
Cette maturation des conditions objectives de la reprise de la lutte de classe est confirmée par le développement des caractéristiques suivantes au sein même des combats en Belgique et en Hollande :
- Une tendance vers des mouvements unitaires et massifs impliquant un grand nombre d'ouvriers et touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays. En 1983, aussi bien en Belgique qu'en Hollande, c'est l'ensemble des services publics, soit 1/5 de la population active, qui lutte. Les travailleurs de toutes les centrales syndicales sont impliqués. En Hollande, jamais dans l'histoire de la classe ouvrière, les services publics n'avaient combattu à cette échelle, tandis qu'en Belgique, le mouvement dépassait la division entre la Flandre et la Wallonie et a même failli s'étendre au privé.
- Une tendance à un surgissement spontané des luttes exprimant, surtout à leur début, un certain débordement des syndicats. C'est spontanément et contre les directives syndicales que les conducteurs de trains en Belgique, les conducteurs de bus et de trains en Hollande, lancent la grève. C'est toujours spontanément que d'autres secteurs (postes, transports communaux) rejoignent le combat en Belgique. La puissance de l'extension peut être mesurée au fait que :
. Les syndicats sont obligés d'entériner et en même temps d'élargir la grève d'une façon formelle et d'adopter une attitude de "laisser faire" à la base pour reprendre le contrôle du mouvement;
. Les syndicats ont eu toutes les peines du monde pour arrêter le mouvement en Hollande.
- Une tendance vers une simultanéité croissante des luttes au niveau international. Les mouvements en Belgique et en Hollande éclatent dans les mêmes secteurs et environ au même moment, tandis que simultanément il y a en France la grève des postes, et ceci dans deux pays voisins à forte concentration ouvrière avec une grande expérience de la lutte, fort tournés vers l'extérieur, et au centre des pays industrialisés. Il n'en faut guère plus pour expliquer la crainte de la bourgeoisie qui s'est manifestée à travers le black-out sur ces mouvements sur le plan international et par une attitude conciliante du gouvernement en Belgique même.
Ces caractéristiques ont été confirmées par les grèves d'avril 84 qui, si elles n'ont pas eu l'ampleur des mouvements de l'automne précédent, ont incontestablement mis en évidence le renforcement des tendances suivantes :
- la simultanéité de plus en plus manifeste des luttes dans un grand nombre de pays industrialisés (luttes en Belgique, en France, en Angleterre et en Espagne en avril) et la confrontation à la fois avec les mystifications de la gauche dans l'opposition (Belgique, Angleterre) et l'austérité de la gauche au pouvoir (France, Espagne)
- l'accélération du rythme de confrontations entre les deux classes (les grèves d'avril viennent seulement cinq mois après les mouvements dans le secteur public),
- la confrontation continuelle avec la gauche dans l'opposition renforçant une tendance à la remise en cause de la stratégie syndicale et la prise en main des luttes par les travailleurs eux-mêmes.
La faiblesse centrale, commune à l'ensemble de ces luttes, est l'incapacité de la classe ouvrière à faire front aux manoeuvres de la gauche dans l'opposition -en particulier des syndicats- au sein même des luttes et d'autre part d'affirmer ses propres perspectives de classe. Si les travailleurs prennent de plus en plus conscience du rôle des syndicats dans leur attitude quotidienne de défenseurs de "l'austérité raisonnable", ils restent désarmés lorsque ces mêmes syndicats déploient toute leur astuce au sein des luttes. Cette faiblesse est liée à un manque d'expérience et de confiance en soi de la part du prolétariat, et à une capacité d'adaptation impressionnante de la bourgeoisie à travers le syndicalisme.
La principale forme que prend la gauche dans l'opposition dans la lutte est celle du syndicalisme de base qui a constitué le fer de lance de la réponse bourgeoise aux luttes. Profitant de luttes ponctuelles ou isolées dans les usines, les syndicalistes de base par leur discours combatif et dans leurs actions pseudo radicales gagnent la confiance de secteurs combatifs de la classe ouvrière et répandent l'idée qu'un type de syndicalisme différent de celui des "directions syndicales" est possible (à l'intérieur de la structure traditionnelle si possible, à l'extérieur si nécessaire). Ainsi, en Belgique, les "syndicalistes de combat" se sont mis aux avant-postes de toute une série de luttes isolées et se sont heurtés parfois durement aux leaders syndicaux (Boel et Tamise, Fabelta, Motte, ACEC, Valfil, FN, Brugeoise et Nivelles, etc.). En Hollande, une grève comme celle du port de Rotterdam en 82 a été entièrement menée par la "base syndicale" sous le slogan "Le syndicat, c'est nous !".
C'est à partir de telles luttes que le syndicalisme de base a tiré les expériences et a gagné l'autorité nécessaire pour dévoyer et saboter des luttes de plus grande envergure : en 82 par exemple, les syndicalistes de base prenaient l'initiative de constituer un comité de grève intersectoriel régional dans la province du Hainaut pour enfermer et épuiser la combativité ouvrière dans le cadre de la région. C'est encore eux qui entraînent les sidérurgistes vers l'affrontement préparé et provoqué par la bourgeoisie pour liquider le mouvement. En 83, aussi bien en Belgique qu'en Hollande, c'est aux syndicalistes de base que revient la tâche, dans le cadre de la généralisation formelle décrétée par la bourgeoisie, d'épuiser le mouvement dans des actions radicales mais dispersées, isolées et sans perspectives.
Ces éléments confirment et expliquent que le développement de la lutte dans les pays industrialisés sera lent. Toutefois, avec l'impasse économique totale du système, l'attaque croissante des conditions de vie du prolétariat et les réactions ouvrières, l'ensemble des mystifications de la bourgeoisie, même les plus radicales, tendront à s'épuiser progressivement tandis que les affrontements de classe prendront un caractère de plus en plus massif, puissant et simultané.
INTERNATIONALISME, SECTION EN BELGIQUE DU CCI, MARS 1984
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Questions théoriques:
- L'économie [99]
Organisation des revolutionnaires - Sur les conditions du surgissement du parti
- 3086 lectures
Les conditions générales de la remontée ouvrière depuis 68 et ses implications sur le processus de regroupement pour le parti.
1- Ce n'est pas comme produit d'une réaction contre la guerre, mais d'un développement lent et en dents de scie de la lutte de classe, face à une crise internationale se développant relativement lentement, que surgira le futur parti. Ceci implique
- la possibilité d'une beaucoup plus grande maturation de la conscience ouvrière avant l'assaut final, maturation s'exprimant en particulier au sein des minorités révolutionnaires ;
- qu'une lutte se développant à l'échelle mondiale jette les bases pour un processus de regroupement des forces révolutionnaires se posant directement au niveau international.
2- Le caractère "original" de la période 17-23 n'est pas tant dans la rapidité des événements à partir de 17 (nous devons nous attendre à une rapidité encore plus grande, face à une bourgeoisie beaucoup mieux avertie, une fois le processus révolutionnaire engagé) mais dans le caractère "charnière" de la période.
Aujourd'hui, 70 ans de décadence capitaliste font qu'une série de questions se pose en des termes beaucoup plus clairs qu'à l'époque : nature des syndicats, de la démocratie et du parlementarisme, question nationale. Alors que nous sommes encore loin de la période insurrectionnelle, chaque lutte ouvrière est contrainte de s'affronter aux forces de mystification et d'encadrement de la bourgeoisie. Même dans la confusion, le milieu prolétarien actuel est contraint de prendre position face aux enseignements de ces 70 ans de décadence. La tâche de clarification des conditions qu'ouvre pour la lutte de classe l'entrée en décadence du système est d'ores et déjà beaucoup plus avancée qu’en 1919.
3- Si la période présente reste caractérisée par l'absence de continuité organique avec le mouvement du passé, et si cela pèse lourdement sur l'état des forces révolutionnaires et les rapports qu'elles entretiennent entre elles aujourd'hui, nous ne devons pas oublier que la continuité organique avec la 2ème Internationale,-même si elle a fourni les forces vives de l'IC- a aussi conditionné beaucoup de ses faiblesses. C'est non seulement sur le plan programmatique que l'avant-garde ne put mener de façon suffisamment approfondie la critique des traditions social-démocrate et cerner l'ensemble des conditions nouvelles qui s'ouvraient. Sur le plan organisationnel, les différentes fractions de gauche ont eu d'énormes difficultés à comprendre ce qu'elles étaient et à dépasser le stade d'exister comme opposition chargée de redresser l'organisation SD dégénérescente. Le processus même de confrontation et de regroupement sera marqué par le modèle de la 2ème Internationale, fonctionnant comme une somme de partis nationaux, et même, à l'intérieur d'une nation comme l'Allemagne par des habitudes de fédéralisme. Ainsi :
- même sans"rupture organique", la mise en place d'un cadre de discussion fut non seulement insuffisamment international, mais fut même très difficile dans la seule Allemagne ;
- l'élaboration de la rupture avec la 2ème Internationale restera une série de processus nationaux, impliquant des décalages dans le temps, une hétérogénéité sur le plan politique.
La longue période de défaite qu'a traversée le prolétariat après l'échec de la révolution a été en même temps le creuset dans lequel la classe a mené le plus loin possible son effort pour tirer les enseignements de la vague révolutionnaire. Nous avons derrière nous, non seulement l'expérience vivante d'Octobre, mais l'effort des fractions, Bilan et Internationalisme, pour en tirer le maximum de leçons en vue de la prochaine vague.
4- Aujourd'hui la rupture organique avec le mouvement du passé fait que les groupes révolutionnaires ne sont plus confrontés à la nécessaire rupture avec les organisations passées à l'ennemi. Ils ne sont pas non plus ce qu'était Bilan, la fraction ayant la tâche essentielle, dans la contre-révolution triomphante, de faire le pont avec la prochaine ouverture d'un cours révolutionnaire, en tirant tous les enseignements de la défaite. Leur existence et leur développement aujourd'hui est avant tout conditionné par la reprise des luttes ouverte en 68.
5- Les conditions sont réunies plus que jamais pour que se réalise ce que le texte du CCI met en avant : dans la période de décadence "le parti politique peut parfaitement surgir avant ce point culminant que sont les conseils ouvriers" ([1] [100]).
Le schéma simpliste qui fait des bolcheviks un "exemple de parti", comparé à l'Allemagne où le regroupement s'avéra beaucoup plus difficile, ne voit pas que l'absence dès 1917 d'un parti international fut une grande faiblesse qui allait peser sur toute la vague révolutionnaire. C'est au niveau international et non au niveau de la seule Allemagne, qu'allait peser le retard avec lequel s'est fait le regroupement pour le parti mondial. Le pôle de clarification que fut l'IC eut lieu trop tard, trop peu de temps et. connaît aujourd'hui des conditions bien meilleures pour se constituer préalablement aux moments décisifs. De même c'est sur une base programmatique beaucoup plus claire qu'il pourra et devra se constituer, englobant comme base minimum l'ensemble des leçons de la première vague révolutionnaire.
6- Aujourd'hui, si les conditions générales montrent la possibilité pour un parti plus clair, plus mûr et plus directement international, elles rendent aussi ces caractéristiques plus nécessaires que jamais. Si la bourgeoisie n'a plus cette arme contre-révolutionnaire essentielle que furent les organisations de masses qui venaient de passer à l'ennemi, elle a par contre appris à développer les moyens d'encadrement les plus subtils et il faut s'attendre à toutes les tentatives de sa part pour tenter de récupérer les organes dont se dotera 1a classe. Et surtout, c'est une bourgeoisie beaucoup plus capable de s'unifier extrêmement rapidement au niveau international que le prolétariat trouvera en face de lui. Dans une telle situation, la clarté de l'avant-garde prolétarienne, son unité et sa capacité à développer une influence internationale seront VITALES.
Le milieu prolétarien et l'effort de regroupement aujourd’hui
1- L'échec du cycle de conférences internationales annonçant la crise que traverse le milieu révolutionnaire, et ce alors que s'ouvre une accélération qualitative de l'histoire, donne la mesure du retard et de la faiblesse des minorités communistes face à leurs responsabilités. Ainsi il ne suffit pas que les conditions objectives telles qu'elles existent aujourd'hui oeuvrent dans un sens favorable à une clarification et un processus d'unification au sein des forces révolutionnaires, pour que le processus de regroupement pour le parti s'engage automatiquement.
2- La rupture organique avec 1e mouvement du passé et les 50 années de contre-révolution impliquent des tâches qualitativement différentes aux minorités communistes. La question ne se pose plus en termes d'assurer la continuité du programme en opérant une rupture claire avec les anciennes organisations dégénérées. Cependant la tâche n'en est pas moins lourde. C'est un long travail de décantation qui incombe aux minorités communistes depuis que le prolétariat a ressurgi en 68. Décantation dans le sens, tant d'une réappropriation des leçons du passé que d'une clarification des conditions nouvelles qui s'ouvrent. Cette décantation implique une compréhension de ce qu'elles sont, ne sont pas, en lien avec l'analyse de la période actuelle. La mégalomanie -le mythe d'être aujourd'hui LE parti en rejetant toute confrontation avec le milieu-, le sectarisme, l'idée que l'histoire commence "avec soi" ou celle que le parti et son programme est une donnée invariante depuis 1848, et les confusions ambiantes sur le processus du regroupement, sont autant d'expressions des difficultés du milieu à prendre conscience de ce qu'il est et de ce que sont ses responsabilités aujourd'hui.
3- En disant que les conditions existent aujourd'hui pour que le parti surgisse avant le momment crucial, nous ne disons pas que toutes les condiions sont réunies pour que le parti se constitue demain matin. Son lien avec le développement de la lutte de classe signifie que le surgissement du parti implique que 1a classe ouvrière réponde à l'appel de l'histoire et développe sa conscience dans une dynamique d'internationalisation de sa lutte.
L'apparition de partis du prolétariat exige une telle dynamique, non seulement pour qu'il soit "entendu", non seulement parce que ce n'est que dans cette phase que les idées révolutionnaires peuvent "devenir forces matérielles", mais aussi parce que seule une telle dynamique peut apporter des éléments indispensables au regroupement des forces révolutionnaires à l'échelle mondiale, en clarifiant pratiquement des questions aussi essenielles que le problème de la généralisation internationale, l'organisation générale de la classe contre les multiples formes syndicales, le rôle de la violence ...et surtout la question du parti, de son rapport avec les conseils ouvriers.
4- Rejetant donc l'idée d'un parti créé artificiellement autour d'un regroupement "PCI + CCI +CWO" et le caractère absurde d'une telle hypothèse, le CCI ne considère pas pour autant le futur parti comme un produit mécanique de la période prérévolutionnaire. Celui-ci exige dès aujourd'hui un effort volontaire de la part des minorités communistes, mais cela sans illusion immédiatiste ou prématurée. Notre volonté de participer aux conférences initiées par le PCI (BC) s'appuyait :
- sur le rejet de toutes les pratiques de sectarisme, de refus du débat ;
- sur 1a compréhension qu'il ne pouvait être question de créer un regroupement prématuré;
- sur le besoin de mettre en place un lieu de confrontation et de décantation le plus large possible, dans le cadre des frontières de classe;
- sur la nécessité d'avoir des critères de participation suffisamment précis, rejetant entre autres les courants"anti-parti" modernistes ou conseillistes, afin que soit clair en particulier l'objet de telles conférences ;
- sur l'objectif que ces conférences constituent, face à l'extérieur, face à la classe, un pôle actif de référence, en étant capable de prendre position sur des questions essentielles;
- sur la nécessité d'ordres du jour allant dans le sens de l'approfondissement de ce qu'est l'effort d'unification des révolutionnaires aujourd'hui : l'analyse de la période actuelle et de la crise d'une part, la question du rôle des révolutionnaires d'autre part, comme une des questions les moins avancées aujourd'hui, qui rend urgente une confrontation.
Nous devions nous rendre compte que le sectarisme et le refus du débat pesaient y compris sur les groupes qui avaient participé activement aux conférences. L'immaturité du milieu s'est aussi traduite par l'idée qu'avaient finalement BC et la CWO de conférences beaucoup plus immédiates, cherchant un regroupement rapide avant que le débat n'ait eu lieu, et finalement n'attendant des premières conférences que les moyens matériels de chasser le CCI... au nom d'un désaccord qui n'a même pas été débattu.
5- Cette expérience nous montre l'étendue du chemin qui reste à parcourir. Si nous avons mis la question du parti à l'ordre du jour dans le CCI, c'est bien parce que nous pensons que cette question cristallise la compréhension des tâches des minorités révolutionnaires aujourd'hui, ainsi que l'attitude qu'elles ont les unes envers les autres. Au coeur du processus de décantation qui, de gré ou de force -et même sous la forme d'une crise ouverte se traduisant par la disparition de groupes tout entiers- est engagé au sein du milieu, se trouve la question du parti et du processus de développement de la conscience de classe.
La crise qui traverse le milieu et qui n'a pas épargné le CCI est une grave alerte. Elle montre en effet que ce sont les confusions sur le rôle des organisations politiques de la classe, la recherche d'un résultat immédiat et l'impatience vis à vis de la lutte de classe qui constituent le meilleur terrain à la destruction des organisations communistes par la pression matérielle et idéologique de la bourgeoisie.
Nous ne pouvons nous réjouir de voir un PCI décimé donner naissance à une organisation bourgeoise, de voir la CWO flirter avec des groupes nationalistes. Cela montre que, sans une claire réaction sur le plan programmatique à la pression de la bourgeoisie, sans non plus développer une capacité à intégrer les nouvelles leçons de la lutte de classe, tout l'effort de décantation au sein du milieu peut se trouver détruit du jour au lendemain.
6- Notre compréhension sur la question du parti est aujourd'hui celle qui va le plus loin dans le bilan de la 1ère vague révolutionnaire. C'est la question sur laquelle règne le plus de confusions dans le milieu, dans la mesure où l'expérience de 17-23 n'a pu l'éclairer complètement. Nous disons souvent que notre position s'inscrit plus en négatif qu'en positif, nous devons cependant comprendre que c'est seulement les prochains mouvements de la grève de masse qui pourront clarifier pleinement cette question au niveau international.
Les événements de Pologne, avec toutes leurs limites, ont constitué pour nous une confirmation éclatante de nos positions sur le développement de la conscience de classe, le rôle des minorités révolutionnaires et les formes d'organisation unitaire de la classe. Ils nous ont aussi contraints à pousser plus loin notre compréhension sur le problème de l'internationalisation, sur le rejet du "maillon faible". C'est en fait tout le milieu qui a été mis à l'épreuve devant ces événements. Devant un tel mouvement dans un pays plus central, le CWO aurait-il pu longtemps appeler à l'insurrection tout de suite ? Le PCI aurait-il pu continuer à prétendre qu'il n'y a pas de mouvement de classe sans organisation préalable des ouvriers par le parti ?
Les prochains mouvements mettront, plus encore que la phase de recul du début des années 80, les groupes révolutionnaires à l'épreuve. I1 y aura sans doute d'autres bouleversements au sein du milieu, on verra aussi surgir de nouveaux groupes. Ceux-ci ne seront pas pour autant à l'abri des confusions du passé. Pour englober les enseignements des prochaines expériences de la classe, pour constituer un point de référence afin que les nouvelles avant-gardes communistes ne refassent pas les mêmes erreurs, l'effort de clarification doit être poursuivi au sein du milieu actuel.
L'ossature du prochain parti n'est pas donnée une fois pour toutes par les courants et groupes existant aujourd'hui, pourtant c'est à eux de poursuivre l'effort de décantation indispensable au regroupement de demain, car c'est pour cela que la classe les a fait naître dès qu'elle a repris le chemin de la lutte.
JU mai 1983
[1] [101] Texte adopté comme résolution au 5ème Congrès du CCI. Cf. Revue Internationale n° 35 sur le parti et ses rapports avec la classe, P.27, point 17d.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [10]
Heritage de la Gauche Communiste:
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : le Communistenbond Spartacus et le courant conseilliste 1942-1948, I
- 4421 lectures
Le Communistenbond Spartacus (Union communiste "Spartacus") est né en 1942 d'une scission du "Marx-Lenin-Luxemburg front" lui-même issu du RSAP. Ce dernier dont la figure dominante était Henk Sneevliet, était une organisation qui avant son interdiction en 1940 par le gouvernement hollandais, oscillait entre le trotskisme et le POUM, avec des positions antifascistes, syndicalistes, de défense des "libérations nationales" et de l'Etat russe. Le MLL Front qui lui succéda dans 1'illégalité s'engagea dans un travail internationaliste de dénonciation de tous les fronts de guerre capitaliste ; et en 1941, sa direction à l'unanimité moins une voix trotskyste, décida de ne pas soutenir l'URSS, dénonçant la guerre germano-soviétique comme un déplacement du front de la guerre impérialiste. L'arrestation de la direction du MLL Front - dont Sneevliet - et leur exécution par l'armée allemande, décapitèrent le MLL Front en 1942. Quelques mois plus tard les restes du Front se scindaient en deux : d'un côté, la petite minorité trotskyste qui choisissait le camp capitaliste ; de 1'autre côté, les militants internationalistes qui allaient former, au départ dans une grande confusion, le Communistenbond. Cette organisation évolua progressivement vers le communisme des conseils. Après avoir représenté à partir de 1945 et dans les années 50 le courant révolutionnaire internationaliste en Hollande, elle finit par dégénérer complètement dans 1'idéologie conseilliste. Elle disparut à la fin des années 70 comme groupe, pour ne laisser que des épigones, dont le groupe "Daad en Gedachte".
Si nous présentons cette histoire du"Communistenbond Spartacus" c'est d'abord que son histoire est mal connue, d'autant plus que le Bond en dégénérant considérait que cette histoire "c'est des vieilleries". Pour les révolutionnaires internationalistes, 1'histoire d'un groupe communiste n'est pas une "vieillerie", c'est notre histoire, 1 'histoire d'une fraction politique que le prolétariat a fait surgir. Faire le bilan de ce groupe et du courant conseilliste aujourd'hui, c'est tirer les leçons positives et négatives qui nous permettent de forger les armes de demain. Comme le courant conseilliste est organisationnellement un courant en décomposition en Hollande, qui n 'est plus un corps vivant pouvant tirer les leçons vivantes pour la lutte révolutionnaire, il appartient au CCI de tirer les enseignements de 1'histoire du Communistenbond Spartacus : pour montrer aux éléments qui surgissent sur la base du conseillisme que la logique de ce dernier les mène au néant.
Deux leçons fondamentales sont à tirer :
1) Le rejet d'octobre 17 comme révolution "bourgeoise" mène inévitablement au rejet de toute 1'histoire du mouvement ouvrier depuis 1848. Il s'accompagne nécessairement d'un refus de reconnaître le changement de période historique depuis 1914 : la décadence du capitalisme, et mène logiquement au soutien des "luttes de libération nationale" comme "révolutions bourgeoises progressistes". C'est cette logique qu'avait choisie le groupe suédois "Arbetarmakt" qui devait le plonger jusqu'au cou dans le magma gauchiste.
2) L'incompréhension de la nécessité de la fonction et du fonctionnement centralisé de l'organisation révolutionnaire mène inévitablement au néant ou à des conceptions anarchistes. L'anti-centralisme et l'individualisme dans la conception de l'organisation ouvrent d'abord la porte à 1'ouvriérisme et à l'immédiatisme qui coexistent joyeusement avec l'académisme et l'opportunisme. Le résultat? L'histoire du Communistenbond nous le montre : 1'abdication devant les tendances anarchistes et petites-bourgeoises. Finalement la dislocation ou la capitulation devant 1'idéologie bourgeoise (syndicalisme, luttes de libération nationale).
Puisse cette histoire du Communistenbond Spartacus contribuer à ce que les éléments qui se réclament du "communisme des conseils" comprennent la nécessité d'une activité organisée sur la base de la conception marxiste de la décadence du capitalisme. L'organisation politique des révolutionnaires sur une base internationale et centralisée est une arme indispensable que la classe fait surgir pour le triomphe de la révolution communiste mondiale.
L'évolution du MLL Front vers des positions internationalistes de non défense de l'URSS et de combat des deux blocs impérialistes, sans distinction d'étiquette - "démocratie, fascisme, communisme" - est une évolution atypique. Issu du RSAP, orienté vers le socialisme de gauche, le MLL Front évoluait vers des positions communistes de conseils. Cette orientation s'explique avant tout par la forte personnalité de Sneevliet qui - malgré son âge déjà avancé - était encore capable d'évoluer politiquement, et qui sur le plan personnel n ' avait plus rien à perdre ( [1] [102]). Une transformation politique aussi profonde ne peut être mise en parallèle qu'avec celle - tout aussi atypique - du groupe de Munis et des RKD ([2] [103]).
Cette évolution n'avait pas, cependant, été jusqu'à ses ultimes conséquences. La disparition de Sneevliet et de ses camarades -en particulier Ab Menlst - décapitait totalement la direction du Front. Celui -ci avait dû en partie sa cohésion au poids politique de Sneevliet, qui était plus un militant guidé par sa conviction révolutionnaire et son intuition qu'un théoricien.
La mort de Sneevliet et de la quasi-totalité des membres de la Centrale réduisit à néant pendant plusieurs mois l'organisation. De mars jusqu'à l'été 1942, tous les militants se cachaient et évitaient de reprendre contact, par peur de la Gestapo, dont ils soupçonnaient qu'elle avait démantelé le Front par un indicateur, exerçant son oeuvre au sein même de l'organisation. Les archives de police et du procès de Sneevliet ne laissent pourtant pas d'indice qu'il y eut un agent de la Gestapo à l'intérieur. ([3] [104])
De la direction du Front, seul Stan Poppe avait survécu. C'est sous son influence que fut fondé, au cours de l'été, le "Revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging" (Mouvement ouvrier socialiste-révolutionnaire). Le terme de "mouvement ouvrier" laissait comprendre que l'organisation, qui poursuivait formellement le MLL Front, ne se concevait ni comme un front, ni comme un parti.
A la suite de la formation du groupe de Stan Poppe, les derniers partisans de Dolleman formaient le 22 août 1942 à La Haye leur propre groupe, avec une orientation trotskyste. Ainsi, naissait le "Comité van Revolutionaire Marxisten" (Comité de marxistes révolutionnaires), sur la base de la défense de l'URSS ([4] [105]). Ce groupe était numériquement beaucoup plus réduit que le Mouvement ouvrier socialiste-révolutionnaire. Il publiait un journal : "De Rode October" (L'Octobre rouge), tiré mensuellement à 2.000 exemplaires. Parmi les dirigeants du CRM, on retrouvait Max Perthus, qui avait été libéré de prison. L'ancienne fraction trotskyste du MLL Front se trouvait donc reconstituée. Les éléments les plus jeunes du Front, plus activistes, rejoignaient en majorité le CRM. Logiquement ce dernier se rattachait à la IV° Internationale, dont il se proclamait section aux Pays Bas en juin 1944. ([5] [106])
Cette ultime scission était la conséquence de l'affrontement entre deux positions inconciliables: l'une qui défendait les positions internationalistes prises en juillet 1941 par Sneevliet et ses camarades ; l'autre qui marchait dans la guerre en soutenant la Russie, et par conséquent le bloc militaire des Alliés.
D'autres raisons ont pu jouer dans la scission, à la fois organisationnelles et personnelles. Lors de l'été 1942, Poppe avait pris soin de former une nouvelle direction en éliminant tous les partisans de la défense de l'URSS. D'autre part Poppe, ayant été la dernière personne à voir Sneevliet avant son arrestation, apparaissait pour certains peu sûr sinon suspect ([6] [107]).
Dans les faits, l'organisation constituée autour de Stan Poppe était parfaitement préparée à la clandestinité, et put poursuivre son travail politique jusqu’à la fin de la guerre, sans arrestations. Elle trouvait en Leen Molenaar l'un des plus habiles confectionneurs de faux papiers et de cartes de ravitaillement pour les militants clandestins ([7] [108]).
A la fin de l'été, le groupe qui comptait une cinquantaine de militants commença à éditer un bulletin ronéoté, avec plus ou moins de régularité :"Spartacus". Ce dernier était l'organe du "Communistenbond Spartacus" (Union communiste Spartacus). Plusieurs brochures étaient éditées qui montraient un niveau théorique plus élevé que dans le MLL Front. Vers la fin de l'année 1944, "Spartacus" devenait un organe théorique mensuel. A côté, à partir d'octobre 1944 et jusqu'à mai 1945, était diffusée sous forme de pamphlet une feuille hebdomadaire sur l'actualité immédiate : "Spartacus - actueleberichten" (Nouvelles actuelles).
Politiquement, les membres du Bond étaient plus aguerris car plus anciens que les éléments trotskystes, et plus formés théoriquement. Beaucoup d'entre eux avaient milité dans le NAS, dont ils avaient gardé tout un esprit syndicaliste-révolutionnaire. Ainsi Anton (Toon) van den Berg, militant de l'OSP puis du RSAP, avait dirigé le NAS à Rotterdam jusqu'en 1940. Autour de lui se formait le groupe de Rotterdam du Communistenbond, qui se caractérisa toujours jusqu'au lendemain de la guerre par un esprit activiste. D'autres militants, enfin, avaient tout un passé politique, marqué moins par le syndicalisme que par le socialisme de gauche et même du MLL Eront. Tel était le cas de Stan Poppe.
Stan Poppe avait joué un rôle important dans l'OSP. Il se trouvait à la direction de ce parti, dans la fonction de secrétaire. Lors de la fusion avec le RSP, il était devenu membre du Bureau politique du RSAP. Nommé en 1936 secrétaire trésorier de ce parti, il avait été délégué -avec Menlst - en décembre à la conférence du Centre pour la IV° Internationale. Membre du Bureau politique en 1938, il était en 1940 l'un des responsables du MLL Front. Dans le Front, ccmme plus tard dans le Communistenbond Spartacus, il se faisait connaître sous le pseudonyme de Fjeerd Woudstra. Très orienté vers l'étude économique, son orientation politique était encore un mélange de léninisme et de conseillisme.
La plupart des militants venaient de l'ancien RSAP, sans être passés par le mouvement trotskyste, d'ailleurs très faible aux Pays Bas. Nombre d'entre eux continuèrent - après la guerre - à militer dans le Bond, la plupart jusqu'à la fin de leur vie : Bertus Nansink, Jaap van Otterloo, Jaap Meulenkamp, Cees van der Kull, Wlebe van der Wal, Jan Vastenhouw étaient ce type de militants.
Cependant, pendant deux ans encore, l'évolution de "Spartacus" se signala par des ambiguïtés politiques qui prouvaient que l'esprit du RSAP n'avait pas totalement disparu. Les réflexes socialistes de gauche se manifestèrent encore lors de prises de contact avec un groupe social-démocrate qui avait quitté le SDAP au début de la guerre et dont la personnalité marquante était W. Romljn. Ce dernier -à la fin de l'année 1943- avait écrit, sous le pseudonyme Soc lus, une brochure où il se prononçait pour un soutien "tactique" de la lutte militaire des Alliés. "Spartacus" attaque durement cette position ([8] [109]) et renonça aux négociations de fusion avec Romljn. Le fait moue qu'il y eut des propositions de fusion avec ce groupe montrait que le Bond n'avait aucune caractérisation de classe de la social-démocratie. En cela "Spartacus" était très éloigné des communistes de conseils qui avaient toujours dénoncé comme contre révolutionnaire et bourgeois les groupes socialistes de droite comme de gauche. Cette persistance à chercher des contacts avec des socialistes de gauche se retrouve encore en novembre 1944, lorsque pendant quelque temps un travail commun est mené avec le groupe "De Vonk" (cf. chapitre précédent), travail qui finalement échoue, compte tenu des divergences politiques.
Avec le courant trotskyste, si la rupture organisationnelle était consommée, il n'en était pas de mené idéologiquement avec ses tendances de gauche. Poppe eut au cours de l'année 1944 deux réunions avec le groupe "Contre le courant" (Tegen de Stroom de Vereekenl. Bien que celui-ci refusa la défense de l'URSS en juin 1941, il restait lié au Comité communiste Internationaliste français d'Henri Molinier ; il devait d'ailleurs s'intégrer dans la IV° Internationale, après la guerre ([9] [110]). Plus significatif était le fait que même au sein du Bond "Spartacus" les dernières hésitations sur la défense de l'URSS n'avaient pas été totalement levées. Une petite partie de l'organisation - contre la défense du camp russe dans la présente guerre - se prononçait pour cette défense en cas d'une troisième guerre mondiale entre les Alliés occidentaux et l'URSS ([10] [111]),
Aussi, pendant deux ans - jusqu'à ce que l'apport théorique de l'ex-GIC devint prépondérant - le Bond essaya de clarifier ses positions politiques. Son activité consista en grande partie à réaliser un travail théorique, sous forme de brochures, lequel reposait en grande partie sur les épaules de Bertus Nansink et surtout de Stan Poppe.
La brochure de Stan Poppe sux "Les perspectives de l'impérialisme après la guerre en Europe et la tâche des socialistes -révolutionnaires" fut écrite en décembre 1943 et parut en janvier 1944 ([11] [112]). Le texte, très influencé par le livre de Lénine L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, se réclamait du "socialisme scientifique de Marx, Engels, Lénine" et non de Rosa Luxembourg. Il essayait de définir le cours suivi par le capitalisme et les perspectives révolutionnaires pour le prolétariat.
La cause de la guerre mondiale était "la crise générale du capitalisme" depuis 1914. Dans un sens léniniste, Poppe définissait la nouvelle période de crise comme impérialiste monopoliste :
"Cette phase ultime, la plus haute, Lénine la définissait cpmme impérialiste. L'impérialisme est le côté politique de la société produisant selon un mode capitaliste-monopoliste."
Cette référence à Lénine est particulièrement intéressante, quand on sait que par la suite les "conseillistes" de "Spartacus" se définiront comme anti-léninistes.
On peut voir déjà, pourtant, une certaine réflexion théorique percer sous la référence quasi scolaire à Lénine. Poppe comprend la crise comme une crise de surproduction. Celle-ci se traduit par le capitalisme d'Etat, aboutissement de la phase du monopole, dont l'expression est l'économie d'armements. Celle-ci envahit la production et "le système (capitaliste) ne peut être secouru que par la guerre et par la production pour la guerre".Il ne parle pas, dans sa contribution,de la Russie comme capitaliste d'Etat. Au contraire, il affirme que l'URSS "est soustraite à l'emprise du monopole - production capitaliste - et à la demi-nation du marché" ; qu'elle est "le seul adversaire étatiquement organisé de l'impérialisme". Une telle position était d'autant plus surprenante que Poppe avait été l'un de ceux qui -dans le MLL Front - avait caractérisé l'URSS comme capitaliste d'Etat. Contradictoire était donc la dénonciation dans ce texte des mesures de capitalisme d'Etat dans tous les pays,"qu'ils soient démocratiques ou autocratiques, républicains ou monarchistes", sauf en URSS.
Plus lucide était l'analyse du conflit en Europe :"La guerre touche à sa fin. La défaite militaire de l'Allemagne et de ses alliés n'est pas une spéculation mais un fait..." Poppe, par un paradoxe de style, considérait que la Deuxième guerre mondiale se prolongeait par une Troisième guerre mondiale en Asie, mettant aux prises le Japon et le camp anglo-américain pour la domination des colonies.
Un peu comme Bordiga après 1945 ([12] [113]) Poppe considérait que la guerre menait à la fascisation des démocraties occidentales, sur le plan politique :
"La guerre impérialiste est - sur le plan de la politique extérieure- l'autre face de l'exploitation monopolistique de la force de travail "- tandis que - en politique intérieure - la démocratie bourgeoise, forme de vie du même ordre social, est comme le fascisme."
Les démocraties trouveront - en cas de crise révolutionnaire - dans le fascisme "leur propre futur", sinon s'imposera en économie une forme de néo-fascisme :
"Sous l'apparence de la terminologie, il n'y aura plus de fascisme, mais dans les faits nous vivrons son deuxième âge d'or. Au coeur de la politique sociale néo-fasciste il y aura la dégradation du revenu ouvrier, conséquence nécessaire de la politique de déflation."
Ayant en tête l'exemple des années 30, Poppe pensait que la crise ouverte du capitalisme se poursuivrait après la guerre : en effet, il n'y aurait pas de "conjoncture de reconstruction, sinon très courte et extrêmement modeste."
L'alternative pour le prolétariat était "entre le socialisme ou la chute dans la barbarie", c'est à dire entre la révolution prolétarienne ou la guerre. Faisant cette constatation, le texte se garde de faire des pronostics. Il souligne que la guerre "pour la reconquête et la sauvegarde de l'Indonésie et de l'Extrême-Orient" implique "la perspective d'une guerre inévitable contre l'Union soviétique elle-même", soit au cours de la "troisième" guerre en Orient soit à l'occasion d'une "quatrième" guerre mondiale.
Néanmoins, "la crise générale du capitalisme fait mûrir la crise révolutionnaire du système". Cela n'implique pas que la "révolution surgisse automatiquement" : Elle dépend de l'intervention consciente de la classe révolutionnaire au cours du processus (révolutionnaire) "
Théoriquement, Poppe définit la révolution comme la mise en place de la dictature du prolétariat et la dissolution "de cette dictature et de l'Etat lui-même". Cette dictature sera celle des conseils d'usine qui formeront "les conseils centraux du pouvoir". Il est intéressant de noter que sont exclus ici les soviets de paysans. Dans "la lutte pour le pouvoir" qui n'est autre que "la lutte pour et avec les conseils" le prolétariat d'usine est le coeur de la révolution. Il est symptomatique d'une vision usiniste gramscienne que Poppe prenne comme exemple l'occupation des usines, à l'exemple de l'Italie en 1920 ([13] [114]).
Symptomatique est la séparation faite entre la révolution des conseils dans les pays industrialisés et l'appel lancé au soutien des "luttes de libération nationale" :
"Il ne peut point y avoir de politique socialiste en Europe et en Anérique sans la proclamation de la pleine indépendance des anciens peuples coloniaux."
Dans la question coloniale, Poppe reprend à son compte les positions de Lénine sur le "droit des peuples à l'auto-détermination". Il ne semble pas que ces positions de Poppe reflétassent l'opinion de tous les militants : en 1940, Jan Vastenhouw -membre alors du MLL Front - avait fermement attaqué la conception de Lénine dans un bulletin interne.
Poppe va cependant très loin dans son analyse ; non seulement il considère que "la tâche (des révolutionnaires socialistes) est naturellement d'appeler les ouvriers de tous les pays à chasser les Japonais des territoires occupes par ceux-ci en Chine et en Indonésie", mais il proclame la nécessité de cette "libération" sous la bannière de l'URSS. Mais Poppe ne parle pas d'une URSS stalinienne, mais d'une URSS libérée -grâce à l'instauration du pouvoir des conseils en Europe - par les ouvriers et les paysans du stalinisme. Dans cette optique - mélange de fantasme et de croyance- il y aurait guerre de "libération nationale" révolutionnaire :
"Si les socialistes ne se trompent pas dans leur prévision, alors cela signifie que l'Union soviétique devient le facteur le plus important aussi dans la lutte contre l'impérialisme japonais. Une Union soviétique qui peut s'appuyer sur l'alliance du pouvoir des conseils des autres peuples au lieu des traités douteux avec les gouvernements capitalistes ; une union soviétique qui se sait soutenue sur ses arrières par un système d'Unions des conseils européens . et par la solidarité du prolétariat guidé par le socialisme révolutionnaire doit aussi - sans le secours des armes anglaises et américaines- être capable de chasser les impérialismes japonais du Mandchukuo et des autres parties de territoire de la République chinoise, de même que de l'Indonésie."
Cette idée d'une guerre de "libération révolutionnaire" s'apparentait à la théorie de la guerre révolutionnaire lancée en 1920 par le Komintern. On ne peut manquer de constater ici, cependant, que la "libération" préconisée par Poppe à la pointe des baïonnettes est plus nationale sinon nationaliste- puisqu'elle se propose de restaurer l'intégrité territoriale de la "République de Chine"- que révolutionnaire. Elle apparaît comme une guerre nationale bourgeoise, à l'image des guerres de la Révolution française, qui instaure et non détruit le cadre national. La théorie de Poppe des conseils ouvriers est une théorie nationale des conseils fédérés en Unions. Ici, la conception de la "lutte de libération nationale" est le corollaire d'une conception où la révolution ouvrière qui fait surgir les conseils ouvriers est nationale.
Les positions de Poppe et du Communistenbond sont donc encore très éloignées de celles du communisme des conseils. Elles sont encore un mélange syncrétique de léninisme, de trotskisme, voire de gramscisme. Et cela d'autant plus que jusqu'à l'été 1944, le Bond sera incapable d'avoir une position théorique sur la nature de l'URSS.
C'est finalement par des discussions menées au cours de l'été 1944 avec d'anciens membres du GIC que l'Union communiste Spartacus s'oriente définitivement vers le communisme des conseils. Quelques membres du Bond prirent contact avec Canne Meijer, B.A. Sijes, Jan Appel et Théo Massen, Bruun van Albada pour leur demander de travailler dans leur organisation. Ils acceptèrent de contribuer théoriquement par la discussion et par écrit ([14] [115]) ; mais ils ne voulaient en aucun cas ni dissoudre le propre groupement ni adhérer immédiatement au Bond Ils étaient encore très méfiants vis-à-vis de la nouvelle organisation marquée par une tradition léniniste ; ils voulaient auparavant voir dans quelle mesure le Bond s'orienterait vers le communisme des conseils. Peu à peu ils participèrent aux activités rédactionnelles et d'intervention, en avant un statut hybride d'"hôtes" ([15] [116]). Ils évitaient de prendre partie dans les questions organisationnelles du Bond et ne participaient pas aux réunions lorsque de telles questions étaient soulevées. C'est peu avant mai 1945, qu'ils devinrent membres à part entière de l'organisation, une fois constaté l'accord théorique et politique de part et d'autre.
Le fruit d'une maturation politique du Bond fut la brochure, publiée en août 1944 : "De Strijd cm de macht" (La lutte pour le pouvoir). Cette brochure se prononçait contre toute activité de type parlementaire et syndical, et préconisait la formation de nouveaux organes prolétariens, antisyndicaux, nés de la lutte spontanée : les conseils d'usine, base de la formation de conseils ouvrier La brochure constatait, en effet, .que les changements dans le mode de production capitaliste entraînaient des modifications structurelles au sein de la classe ouvrière et donc mettaient à l'ordre du jour de nouvelles formes d'organisations ouvrières correspondant au surgissement d'u "nouveau mouvement ouvrier". ([16] [117])
A la différence de l'ancien GIC, le Bond - dans cette brochure - préconisait la formation d'un parti révolutionnaire et d'une Internationale. Cependant, à la différence du trotskisme, il était souligné qu'un tel parti ne pourrait surgir qu'à la fin de la guerre, et de lui-même, lorsque seraient formés les organes de lutte du prolétariat.
Lorsque en mai 1945, le Communistenbond "Spartacus" publie légalement la revue mensuelle, Spartacus, il ne peut plus être considéré comme une continuation du MLL Front. Avec l'apport militant des membres du GIC il est devenu une organisation communiste des conseils. Comme devait le noter en 1946, Canne Meijer : "Le Spartacusbond actuel ne peut être considéré comme une continuation directe du RSAP. Sa composition est différente et dans beaucoup de questions, la prise de positions est autre... Beaucoup qui auparavant appartenaient au RSAP ne se sont pas joints à "Spartacus", alors que quelques-uns purent être attirés par les trotskystes. Mais ils ne sont pas nombreux, car les trotskystes de toute façon ne sont pas nombreux." ([17] [118])
En importance, "Spartacus" était la première organisation révolutionnaire en Hollande, et portait donc une lourde responsabilité politique au niveau international dans le regroupement des révolutionnaires en Europe, cloisonnés par l1 Occupation et de nouveau à la recherche de liens internationaux. Cette possibilité de devenir un pôle de regroupement dépendait autant de la solidité de l'organisation, de son homogénéité politique et théorique, que d'une claire volonté de sortir des frontières linguistiques de la petite Hollande.
Numériquement le Bond était relativement fort pour une organisation révolutionnaire, surtout dans un petit pays. En 1945, il comptait une centaine de militants ; il avait à la fois une revue théorique mensuelle et un journal hebdomadaire, dont le tirage était de 6.000 exemplaires ([18] [119]). Il était présent dans la plupart des grandes villes, et en particulier dans les centres ouvriers d'Amsterdam et de Rotterdam, où la tradition communiste des conseils était réelle.
Cependant, l'organisation était loin d'être homogène. Elle rassemblait d'anciens membres du MLL Front, du GIC, mais aussi d'anciens syndicalistes du NAS d'avant guerre. Au Bond s'étaient aussi adjoints des anarchistes de l'ancien "Mouvement socialiste libertaire". Beaucoup de jeunes enfin avaient rejoint "Spartacus", mais sans expérience politique ni formation théorique. Il y avait donc une union de différentes origines mais pas véritablement une fusion, condition même de la création d'un tissu organisationnel homogène. Les tendances centrifuges - comme on le verra plus loin - étaient donc fortes. Les éléments libertaires véhiculaient des conceptions anti-organisation. Les ex-syndicalistes, particulièrement actifs autour de Tbon van den Berg à Rotterdam, étaient très activistes et ouvriéristes. Leur conception était plus syndicaliste que politique. D'autre part, les jeunes avaient une propension - découlant de leur immaturité politique - à suivre l'une de ces deux tendances, et particulièrement la première.
Organisationnellement, le Bond n'avait rien à voir avec l'ancien GIC qui se concevait comme une fédération de groupes de travail. Le Bond était une organisation centralisée et le restera jusqu'en 1947. Son organisation était composée de noyaux (Kerne) ou sections locales de 6 membres, coiffées par des sections territoriales ou urbaines. Le comité exécutif de 5 membres représentait l'organisation à l'extérieur et était responsable devant le congrès du Bond, qui était l'instance suprême. Comme dans toute organisation révolutionnaire digne de ce nom, elle avait des organes de travail élus : une commission politique regroupant la rédaction et chargée des questions politiques ; une commission d'organisation pour les taches courantes ; une commission de contrôle chargée de vérifier que les décisions prises étaient appliquées ; une 'commission de contrôle financier. En tout, en 1945 il y avait entre 21 et 27 personnes dans les organes centraux.
L'adhésion à l'organisation était clairement définie par les statuts adoptés en octobre 1945 ([19] [120]). Le Bond qui avait alors une conception très haute de l'organisation ne voulait accepter de nouveaux membres qu'avec la plus grande prudence et exigeait d'eux "la discipline d'un parti centraliste démocratique" ([20] [121]). Le Bond, en effet, renouait avec la tradition du KAPD.
De cette tradition, cependant, le Communistenbond reprenait certains aspects les moins favorables à l'accomplissement de son travail. Centralisé par ses organes, le Bond était décentralisé au niveau local. Il considérait que chaque "noyau est autonome dans sa propre région" ([21] [122]). Visant à une "décentralisation du travail", il était inévitable que celle-ci entre en contradiction avec le centralisme de l'organisation.
D'autre part, le Bond véhiculait certaines conceptions de l'organisation qui s'étaient épanouies dans les grandes organisations politiques de masses du passé. L'organisation était encore conçue comme une organisation de "cadres" ; d'où la formation, décidée lors de la Conférence des 21 et 22 juillet 1945, d'une "école de cadres marxistes". Elle n'était pas totalement unitaire ; à la périphérie gravitaient les "Associations des amis de Spartacus" (V.S.V.). Le Bond trouvait dans le VSV son organisation de jeunesse autonome. Composée de jeunes entre 20 et 25 ans, cette organisation parallèle était en fait une organisation de jeunes sympathisants. Bien que n'ayant pas de devoirs vis-à-vis du Bond, ils devaient participer à la propagande et contribuer financièrement. Un tel flou entre militants et sympathisants ne contribua pas peu à renforcer les tendances centrifuges au sein de l'organisation.
Un autre exemple du poids du passé est à trouver dans la création en août 1945 d'une "Aide ouvrière" (Arbeidershulp). Il s'agissait de créer dans les entreprises un organisme, ou plutôt une caisse de secours, pour aider financièrement les ouvriers en grève. En filigrane, il y avait l'idée que le Communistenbond devait diriger la lutte des ouvriers et se substituer à leurs efforts spontanés de s'organiser. Néanmoins, l'"Aide ouvrière" n'eut qu'une brève existence. La discussion sur le parti, générale dans le Bond, permit de préciser quelle était la nature et la fonction de l'organisation politique des révolutionnaires.
"Spartacus" pensait en effet que les luttes ouvrières qui éclataient à la sortie de la guerre auguraient d'une période révolutionnaire, sinon dans l'immédiat, du moins dans le futur. Eh avril 1945 la conférence du Spartacusbond proclamait la nécessité d'un parti et le caractère provisoire de son existence comme organisation nationale :
"Le Bond est une organisation provisoire de marxistes, orientée vers la formation d'un véritable parti communiste international, lequel doit surgir de la lutte de la classe ouvrière". ([22] [123])
Il est remarquable que cette déclaration posait la question de la naissance d'un parti en période révolutionnaire. Une telle conception était à l'inverse de celle des trotskystes des années 30, puis des bordiguistes après 1945 qui faisaient du moment de ce surgissement une question secondaire et considéraient que le parti était le produit d'une simple volonté. Il suffisait de le "proclamer" pour qu'il existât. Non moins remarquable était 1'"Adresse inaugurale" - votée à la conférence de juillet- adressée aux groupes révolutionnaires internationalistes. Elle excluait le CRM trotskyste de Hollande, avec lequel la conférence rompit tout contact, en raison de leur position de "défense de l'URSS" ([23] [124]). Enfin elle était un appel au regroupement des différents groupes de la Gauche communiste, qui rejetaient la vision de la prise du pouvoir par un parti :
"C'est dans et par le mouvement même que peut naître une nouvelle Internationale communiste, à laquelle les communistes de tous les pays -débarrassés de la domination bureaucratique mais aussi de toute prétention à briguer le pouvoir pour leur propre compte - peuvent participer". ([24] [125])
On doit cependant constater que cet appel au regroupement des révolutionnaires internationalistes ne se traduisit que par des mesures limitées. La conférence décida d'établir un Secrétariat d'information à Bruxelles dont la tâche était de prendre contact avec divers groupes et d'éditer un Bulletin d'information. En même temps, le contact était repris pour un temps très bref avec le groupe de Vereeken. Il était évident que les positions de son groupe "Centre le courant" (Tegen de stroem) ([25] [126]) étaient incompatibles avec celles du Bond. Mais le fait même de reprendre contact notait une absence de critères politiques dans la délimitation des groupes cemmunistes internationalistes d'autres groupes confus ou anarchistes. Cette même absence de critères se retrouvera en 1947, lors d'une conférence internationale tenue à Bruxelles (cf. infra).
La préparation du Bond au surgissement d'un parti impliquait que la plus grande homogénéité se fasse dans l'organisation sur la conception théorique du parti. C'est pourquoi furent écrites et discutées pour le congrès des 24-26 décembre 1945 des "Thèses sur la tâche et la nature du parti" ([26] [127]). Elles furent adoptées par le congrès et publiées en brochure en janvier 1946 ([27] [128]). Il est très significatif qu'elles furent rédigées par un ancien membre du GIC : Bruun van Albada. Ce fait même montrait l'unanimité qui existait alors dans le Bond sur la question, et surtout traduisait le rejet explicite des conceptions qui avaient régné dans le GIC au cours des années 30.
La tenue de réunions publiques sur le thème du parti, au cours de l'année 1946, montre l'importance que les thèses revêtaient pour l'organisation.
Les Thèses sont centrées sur le changement de fonction du parti entre la période d'ascendance du capitalisme - appelée période du"capitalisme libéral"- et la période de décadence qui suit la première guerre mondiale - période de domination du capitalisme d'Etat. Bien que les concepts d1ascendance et de décadence du capitalisme ne soient pas utilisés, le texte souligne avec force le changement de période historique qui implique une remise en cause des vieilles conceptions du parti :
"La critique actuelle des vieux partis n’est pas seulement une critique de leur pratique politique ou des procédés des chefs, mais une critique de toute la vieille conception du parti. Elle est une conséquence directe des changements dans la structure et dans les objectifs du mouvement de masse. La tâche du parti (révolutionnaire) est dans son activité au sein du mouvement de masse du prolétariat."
Les Thèses, de façon historique, montrent que la conception d’un parti ouvrier agissant sur le modèle des partis bourgeois de la Révolution française et non distinct des autres couches sociales est devenue caduque avec la Commune de Paris. Le parti ne vise pas la conquête de l’Etat mais sa destruction :
"Dans cette période de développement de l'action de masse, le parti politique de la classe ouvrière allait jouer un rôle beaucoup plus grand. Parce que les ouvriers n’étaient pas encore devenus la majorité écrasante de la population, le parti politique apparaissait encore comme l'organisation nécessaire, qui doit oeuvrer à entraîner la majorité de la population dans l'action des ouvriers, tout à fait de la même façon que le parti de la bourgeoisie a agi dans la révolution bourgeoise ; parce que le parti prolétarien devait être à la tête de l'Etat, le prolétariat devait conquérir le pouvoir d'Etat".
Montrant l'évolution du capitalisme après 1900, "période de prospérité croissante du capitalisme", les Thèses montrent le développement du réformisme dans la social-démocratie. Elles ont tendance à rejeter les partis de la II° Internationale après 1900, étant donné leur évolution vers l'opportunisme parlementaire et syndical. Et elles ignorent la réaction des gauches communistes (Lénine, Luxembourg/ Pannekoek) en leur sein. Montrant très bien le "semblant de pleine démocratie" de la social-démocratie classique et la "complète scission entre la masse des membres et la direction du parti", les Thèses concluent négativement et ne montrent pas l'apport positif de l'organisation pour le mouvement ouvrier de l'époque :
"Le parti politique cesse d'être une formation de pouvoir de la classe ouvrière. Il devient la représentation diplomatique des ouvriers dans la société capitaliste. En opposition loyale, il participe au Parlement, participe à l'organisation de la société capitaliste." La Première guerre mondiale ouvrait une nouvelle période, celle de la Révolution prolétarienne. Les Thèses considèrent que c'est la paupérisation absolue du prolétariat et non le changement de période qui est à l'origine de la révolution. De ce fait, on voit mal en quoi la période révolutionnaire de 1917-1923 se distinguait de 1848, période de "paupérisation absolue" caractéristique de la situation du prolétariat naissant :
"L'éclatement de la guerre mondiale signifia qu'à la phase de paupérisation relative succédait celle de la paupérisation absolue. Cette nouvelle évolution doit par la force des choses pousser les ouvriers dans une opposition révolutionnaire au capital. Aussi, en même temps, les ouvriers entraient en conflit avec la social-démocratie".
Les Thèses ne manquent pas de souligner les apports positifs de la vague révolutionnaire de l'après-guerre : naissance spontanée "d'organisations d'entreprise et de conseils ouvriers comme organes de la démocratie ouvrière à l'intérieur des entreprises et organes de la démocratie politique locale". Les Thèses, cependant, minimisent la portée révolutionnaire de 1917 en Russie ; elles ne semblent retenir de 17 que la suite : la contre-révolution et le capitalisme d'Etat. Elles voient même dans la révolution l'origine la contre révolution stalinienne. Le processus de dégénérescence est nié et les ouvriers russes sont ainsi rendus responsables de l'échec de la révolution russe. Ainsi, le développement du "socialisme d'Etat" (c'est-à-dire le capitalisme d'Etat) est considéré "comme résultat de la lutte révolutionnaire des paysans et des ouvriers."
Cependant, c'est avec lucidité que les Thèses notent l'effet pernicieux de la confusion entre socialisme et capitalisme d'Etat dans les rangs ouvriers de l'époque. Cette confusion empêcha la pleine maturation de la conscience révolutionnaire:
"... par la Révolution russe, la conception socialiste d'Etat se para d'une auréole révolutionnaire et cela ne contribua pas peu à entraver la réelle prise de conscience révolutionnaire des ouvriers." ([28] [129])
Le rejet implicite de la Révolution russe et de l'apport du parti bolchevik en 1917 amène le rédacteur des Thèses à établir une identité entre le bolchevisme révolutionnaire des débuts et le stalinisme. Pour lui, il n'y a pas de différence entre bolchevisme et social-démocratie, "sinon de méthode" pour établir une"économie planifiée par l'Etat".
Plus originale est la définition du rôle du parti et des révolutionnaires dans leur intervention. Reprenant la conception du KAPD des années 1920, le Bond souligne que le rôle du parti n'est ni de guider, ni d'éduquer, ni de se substituer à la classe ouvrière :
"Le rôle du parti est maintenant restreint à celui d'une organisation de clarification et de propagande. Il n'aspire pas davantage à instaurer une domination sur la classe".
La genèse du parti dépend étroitement des changements dans le capitalisme - où la période "de capitalisme libéral est définitivement close" -et de la transformation de la conscience de classe des ouvriers. La lutte révolutionnaire qui fait surgir le parti, est avant tout une lutte contre l'Etat produite par l'action de masses, et une lutte consciente pour l'organisation :
"L'Etat est devenu clairement l'ennemi mortel de la classe ouvrière... Dans tous les cas, la lutte des ouvriers se déroule en opposition inconciliable avec cet Etat, non seulement contre les gouvernements mais contre l'ensemble de l'appareil (d'Etat), vieux partis et syndicats inclus. Il y a un lien indestructible entre les trois éléments de la lutte d'émancipation des ouvriers : l'essor de l'action de masse, l'essor de l'organisation et de la conscience."
Les Thèses établissent une interaction dialectique entre le développement de l'organisation révolutionnaire et la lutte révolutionnaire :
"Ainsi se développe dans la lutte l'organisation matériellement et spirituellement ; et avec l'organisation se développe la lutte."
L'aspect le plus significatif des Thèses est de montrer le rôle positif du parti révolutionnaire dans les mouvements de masses et de définir le type de militant révolutionnaire correspondant à la nouvelle période.
Son champ d'action est clairement défini :
a) nécessité du parti : prise de conscience
Les Thèses montrent que le parti est nécessaire, car il est un produit dialectique du développement de la conscience de classe et par conséquent un facteur actif dans ce processus de développement. On est ici très loin de la vision "conseilliste"-qui sera développée par la suite - où les révolutionnaires inorganisés se dissolvent dans la classe ([29] [130]). Est rejetée aussi la conception bordiguiste qui fait du parti un véritable état-major auquel les ouvriers sont subordonnés aveuglément. La nécessité du parti découle non d'un rapport de forces entre cette organisation et la classe, mais d'un rapport organique entre parti et classe, né du développement de la conscience de classe :
"Dans le processus de prise de conscience par la lutte, où la lutte devient consciente d'elle-même, le parti a un rôle important et nécessaire à jouer. En premier lieu il soutient cette prise de conscience. Les leçons qu'on doit tirer autant des victoires que des défaites - et dont les ouvriers, séparément, ont une conscience plus ou moins claire - sont formulées par le parti et diffusées parmi les masses par le moyen de sa propagande. C'est "l'idée", qui, dès qu'elle s'empare des masses, devient une force matérielle".
"Le parti n'est ni un état-major détaché de la classe ni le "cerveau pensant" des ouvriers ; il est le foyer où se focalise et s'exprime la conscience grandissante des ouvriers".
Si le parti et la classe sont dans un rapport organique de complémentarité dans une même unité de conscience, ils ne sont pas identiques ni confondus. Le parti est l'expression la plus élevée de la conscience de classe du prolétariat, comme conscience politique et historique, et non comme conscience reflet de la lutte immédiate (conscience immédiate dans la classe). Le parti est donc une partie de la classe.
"Partie de la classe, la plus consciente dans la lutte et la plus formée, le parti a la capacité de comprendre le premier les dangers qui menacent (la lutte des ouvriers) , de discerner le premier les potentialités des nouvelles organisations de pouvoir : il doit y lutter de façon telle que son opinion soit utilisée à fond par les ouvriers ; il doit la propager par la parole, et s'il le faut par une intervention en acte, afin que son exemple fasse avancer la classe dans sa lutte".
On notera que cette conception du parti dans sa fonction propagandiste "par les mots et par les faits" est identique à celle du KAPD dans les années 20. Le Bond a ici une conception presque volontariste du parti, où l'exemple de l'action du parti est un combat et même une incitation au combat. Cette définition du parti rejoint aussi celle de Bordiga pour lequel un parti c'est un programme plus une volonté d'action. Mais dans la Gauche hollandaise, le programme est moins un ensemble de principes théoriques et politiques que la formulation de la conscience de classe, voire d'une somme de consciences ouvrières :
"Ce que ressent chaque ouvrier, à savoir que la situation est intenable et qu'il est absolument nécessaire de détruire le capitalisme, doit être synthétisé par le parti dans des formules claires".
b) les tâches du parti : théorie et praxis Pour le Communistenbond, il est clair qu'il ne peut être fait une séparation entre travail théorique et intervention pratique. La théorie n'est pas définie comme une somme d'opinions individuelles mais comme une science. Comme le soulignait déjà le Bond en janvier 1945 ; "Le matérialisme dialectique n'est pas seulement la seule méthode exacte mais aussi la seule méthode universelle de recherche " ([30] [131]). Paradoxalement, c'est le scientifique Pannekoek qui rejette dans ses "Conseils ouvriers" l'idée de théorie matérialiste scientifique considérant qu'une organisation exprime des opinions variées sans résultat scientifique et sans méthode. Contrairement au Bond de la période 45-46, Pannekoek défend une méthode éclectique, c'est à dire rejette toute méthode d'investigation théorique, selon le principe qu'une somme d'unités donne une totalité. Il écrit en effet que " dans chacune de ces pensées diverses se trouve en fait une parcelle de la vérité, plus ou moins grande" ([31] [132]). Au contraire, les Thèses affirment :
"Les questions doivent être examinées dans leur cohérence ; les résultats doivent être exposés dans leur clarté et leur déterminisme scientifiques . "
De cette méthode découlent les tâches du parti dans le prolétariat :
- tache"d'éclaircissement" et non d'organisation, cette tâche étant celle des ouvriers dans leur lutte. La fonction d'organisation de la classe disparaît au profit d'une tâche de clarification de la lutte. Cette clarification est définie négativement comme une lutte idéologique et pratique contre "toutes les tentations fourbes de la bourgeoisie et de ses complices de contaminer par leur propre influence les organisations ouvrières".
- tâche"d'intervention pratique dans la lutte de classe". Sa réalisation découle de la compréhension par le parti qu'il ne peut"soustraire aux ouvriers leurs fonctions" :
"(Le parti) ne peut intervenir que comme partie de la classe et non en contradiction avec celle-ci. Sa position dans l'intervention est uniquement de contribuer à 1'approfondissement et à l'extension de la domination du pouvoir de la démocratie des conseils..."
Cette fonction du parti n'implique pas la passivité. A la différence des "conseillistes" des années 50 et 60 (cf. infra), le Spartacusbond n'a pas peur de s'affirmer comme un "moteur" de la lutte de classe qui prend des initiatives qui compensent les hésitations des ouvriers :
"Quand les ouvriers hésitent à prendre certaines mesures, les membres du parti peuvent, comme ouvriers d'industrie révolutionnaires, prendre l'initiative et ils sont même tenus de le faire quand l'accomplissement de ces mesures est possible et nécessaire. Quand les ouvriers veulent remettre à une instance syndicale la décision de déclencher une action, les communistes conscients doivent prendre l'initiative pour une intervention propre des ouvriers. Quand, dans une phase plus développée de la lutte, les organisations d'entreprise et les conseils ouvriers hésitent devant un problème d'organisation de l'économie les communistes conscients ne doivent pas seulement leur montrer la nécessité de cette organisation ; ils doivent aussi étudier eux-mêmes ces questions et convoquer des assemblées d'entreprise pour les discuter. Ainsi, leur activité se déroule dans la lutte et comme le moteur de la lutte, quand celle-ci stagne ou risque de s'égarer sur les voies de garage.
Qui ne manquera pas de relever, dans ce passage, une certaine interprétation ouvriériste de l'intervention dans les conseils ouvriers. Que les membres du parti interviennent comme "ouvriers d'industrie "semble exclure que des "communistes conscients" - d'extraction intellectuelle- puissent défendre comme membres du parti devant les ouvriers leur point de vue. A ce compte là, Marx, Lénine Engels seraient exclus. On sait qu'en 1918, Rosa Luxembourg fut privée du "droit" d'expression dans le Grand Conseil de Berlin sous le prétexte qu'elle était une "intellectuelle". Les défenseurs de la motion d'exclusion étaient les membres du SPD conscients du poids politique de Luxembourg. Ici, les Thèses semblent concevoir que les "intellectuels" membres du parti seraient "étrangers" au prolétariat, bien que le Parti soit défini comme "une partie de la classe".
D'autre part, il est caractéristique que l'intervention du Parti dans les conseils soit centrée d'emblée sur les problèmes économiques de la période de transition : gestion de la production et "organisation de l'économie par la démocratie des conseils ouvriers, dont la base est le calcul du temps de travail". En affirmant que "la nécessité de l'organisation d'une économie communiste planifiée doit être démontrée clairement", le Spartacusbond manifeste une tendance à sous-estimer les problèmes politiques qui se posent en premier dans la révolution prolétarienne, à savoir la prise du pouvoir par les conseils, comme préalable d'une période de transition vers le communisme.
c) le fonctionnement du parti
Les Thèses passent sous silence la question de la centralisation du Parti. Ne sont abordées ni la question des fractions et des tendances, ni la question de la démocratie interne. Le Bond manifeste une tendance à idéaliser l'homogénéité du Parti. Tout comme le PCint bordiguiste de l'après-guerre ([32] [133]), il ne conçoit pas que des divergences puissent surgir dans l'organisation. Mais alors que le parti"bordiguiste" trouve des "garanties" contre les divergences dans un idéal de "programme" immuable, le Spartacusbond croit les trouver dans l'existence de militants idéaux. Le militant, selon le Bond est celui qui est toujours capable d'autonomie de compréhension et de jugement :
"(Les membres du Parti) doivent être des travailleurs autonomes, ayant leur propre faculté de comprendre et de juger..."
Cette définition du militant apparaît comme un "impératif catégorique" et une éthique individuelle à l'intérieur du Parti. Il est à souligner que le Bond pense qu'une composition professionnelle entièrement prolétarienne et que la haute qualité de chaque militant mettent le Parti à l'abri des risques d'une dégénérescence bureaucratique. Cependant on ne peut manquer de relever que les partis composes totalement d'ouvriers, comme les PC dans les années 20 et 30 ne les a pas mis à l'abri de la bureaucratisation stalinienne et que l'organisation du Parti en cellules d'ouvriers d'usine a étouffé la capacité politique de "compréhension et de jugement" des militants ([33] [134]), fussent-ils les meilleurs. D'autre part, dans un parti révolutionnaire, il n'y a pas d'égalité formelle de capacités de tous ; l'égalité réelle est politique par le fait que le Parti est un corps politique avant tout dont la cohésion se reflète dans chacun de ses membres. C'est ce corps qui permet aux militants de tendre individuellement vers une homogénéité politique et théorique.
Plus profond est le rejet par le Bond d'une discipline jésuitique de cadavre - le fameux "perinde ac cadaver" de la Société de Jésus - qui brise les convictions profondes de chaque militant :
"Liés aux conceptions générales et principiel-les du Parti, qui sont en même temps leurs, propres conceptions, (les militants) doivent défendre et appliquer celles-ci dans toutes les circonstances. Ils ne connaissent pas la discipline de cadavre de la soumission sans volonté aux décisions ; ils ne connaissent que l'obéissance par conviction intime, issue d'une conception fondamentale et, dans un conflit au sein de l'organisation, c'est cette conviction qui tranche."
Ainsi est acceptée une discipline de l'organisation librement consentie, qui découle de la défense des positions principielles du Parti. C'est cette notion de discipline qui fut par la suite rejetée quelques années plus tard (cf. infra) par le Bond sous le prétexte qu'elle s'opposait à la libre activité de chacun comme "homme libre pensant par lui-même".
Une idée très importante se trouve exposée dans les Thèses. Le parti n'est pas seulement un programme, mais il est composé d'hommes aminés par la passion révolutionnaire. C'est cette passion, que le Bond appelle "conviction", qui prémunirait le Parti contre toute tendance dégénérescente :
"Cette auto activité des membres, cette éducation générale et cette participation consciente à la lutte des ouvriers rend impossible tout surgissement d'une bureaucratie de parti. Sur le plan organisationnel, on ne saurait trouver des mesures efficaces contre ce (danger) au cas où cette auto activité et cette éducation viendraient à manquer ; dans ce cas-là le parti ne pourrait plus être considéré comme un parti communiste : le parti vraiment communiste, pour lequel l'auto activité de la classe est l'idée de base, le parti dans lequel cette idée s'est incarnée, chair et os, jusque dans ses membres. Un parti avec un programme communiste peut finir par dégénérer, peut-être ; un parti composé de communistes, jamais."
Traumatisé par l'expérience russe, le Bond pensait que la volonté militante et la formation théorique constituaient suffisamment de garde-fous contre la menace de dégénérescence. Il tendait ainsi à édifier l'image d'un militant pur, non soumis individuellement à la pression de l'idéologie bourgeoise. Concevant que le parti est une somme d'individus ayant "les exigences les plus hautes", les Thèses traduisaient un certain volontarisme, voire un idéalisme naïf. La séparation entre programme, fruit d'une constante recherche théorique, et volonté militante aboutissaient à rejeter l'idée d1 un parti, comme corps et programmatique et organique. Si le parti était une somme de volontés militantes, il n'y avait plus d'organe irrigant l'ensemble des cellules militantes. Par la suite, le Bond allait pousser cette séparation à l'extrême, deux ans après (cf .infra).
d) le lien avec la classe
Issu de l'action de masse du prolétariat, le Parti ne trouve finalement d'ultime "garantie" qu'à travers ses liens avec le prolétariat :
"Quand ce lien est inexistant, quand le parti est un organe qui se situe en dehors de la classe, il n'a d'autre choix que de se placer - de façon défaitiste - en dehors de la classe, ou de soumettre les ouvriers à sa direction par la contrainte. Aussi, le Parti ne peut être véritablement révolutionnaire que s'il est ancré dans les masses de telle sorte que son activité n'est, en général, pas distincte de celle du prolétariat, si ce n'est dans le sens que la volonté, les aspirations et la compréhension conscientes de la classe ouvrière sont cristallisées dans le Parti".
Le lien avec la classe apparaît ici -dans sa définition - contradictoire. Le parti catalyse la conscience de la classe en lutte et simultanément fusionne avec le prolétariat. Le Bond ne voit de contradiction entre le Parti et la classe que dans un processus dégénérescent, où se perd le "lien". La cause réside dans la hantise que partageaient les révolutionnaires de cette époque de voir se répéter les horreurs de la contre-révolution en Russie On ne peut, cependant, s'abstenir de remarquer que l'adéquation des buts historiques du prolétariat avec ceux du Parti, n'est point une fusion. L'histoire du mouvement ouvrier, en particulier les révolutions russe et allemande, est l'histoire tourmentée des rapports entre le Parti et la classe. En période révolutionnaire, le Parti peut être en désaccord avec des actions de la classe ; ainsi les bolcheviks étaient en désaccord en juillet 1917 avec les masses ouvrières de Petrograd qui voulaient prendre prématurément le pouvoir. Il peut aussi, comme le Spartakus Bund de Luxembourg, être en accord avec la "volonté des masses" impatientes de prendre le pouvoir à Berlin et se faire décapiter. Dans les faits, la "fusion" entre Parti et masses est rarement accomplie. Le Parti se dirige plus même en période révolutionnaire et totalement dans une phase contre-révolutionnaire - à "contre courant" que "dans le courant". Etant "une partie de la classe" - comme le montrent les Thèses - il est distinct de la totalité de la classe lorsque ses principes et son activité ne sont pas totalement acceptés par la masse des ouvriers ou même rencontrent l'hostilité.
e)Parti et Etat dans la révolution Les Thèses de décembre 1945 n'abordaient pas les rapports entre Parti et Etat, lors de la prise du pouvoir. La question ([34] [135]) fut soulevée au sein du Bond et en mars 1946 parut une brochure consacrée -dans un de ses chapitres - à ce problème : "Van slavenmaatschappij tôt arbeidersmacht" (De la société esclavagiste au pouvoir ouvrier). Il en ressortait que le parti ne pouvait ni prendre le pouvoir ni"gouverner" les ouvriers. En effet, "quel que soit le parti qui forme le gouvernement, il doit gouverner contre les hommes, pour le capital et par une bureaucratie" ([35] [136]). C'est pourquoi le Parti, parti et partie des conseils ouvriers, est distinct de l'Etat :
"C'est un tout autre parti que ceux de la société bourgeoise. Il ne participe lui-même sous aucune forme au pouvoir...la prise du pouvoir prolétarienne n'est ni la conquête du gouvernement de l'Etat par un "parti ouvrier" ni la participation d'un tel parti à un gouvernement d'Etat... l'Etat en tant que tel est complètement étranger par essence au pouvoir des ouvriers ; ainsi les formes d'organisation du pouvoir ouvrier n'ont aucune des caractéristiques de l'exercice du pouvoir par l'Etat." ([36] [137])
Mais en 1946, à l'inverse de ce qui se produira plus tard, c'est Pannekoék qui est influencé par le Ccmmunistenbond ! Dans ces "Cinq thèses sur la lutte de classe" ([37] [138]) il affirme - en contradiction avec ses thèses antérieures- que le travail des partis (révolutionnaires) "est une partie indispensable de l'auto émancipation de la classe ouvrière". Il est vrai qu'il réduit la fonction de ces partis à une fonction uniquement théorique et propagandiste :"Aux partis incombe la deuxième fonction (la première étant "la conquête du pouvoir politique", NDR), c'est à dire diffuser les idées et les connaissance; d'étudier, discuter, formuler les idées sociales et, par la propagande éclairer l'esprit des masses ".
Les oppositions qui naquirent dans le Bond sur la conception du Parti - lors de la préparation du congrès de Noël 1945- apportaient plus des nuances aux Thèses qu'elles ne le critiquaient. Elles étaient en tout cas, un rejet de la théorie éducationniste de Pannekoek. Dans un projet de Thèses - accepté par 2 membres sur 5 de la Commission politique- il était souligné que "le nouveau parti n'est pas l'éducateur de la classe". Ce projet tenait surtout à préciser certains points qui restaient flous dans "Taak en Wszen van de nieuwe Parti ". En premier lieu- pour mieux marquer la rupture avec l'ancien RSAP de Sneevliet - la participation "tactique" aux élections était nettement rejetée :"Le parti naturellement ne participe à aucune activité parlementaire". En second lieu, le rédacteur du projet croyait voir dans les Thèses un retour aux conceptions activistes du KAPD, ou plutôt des tendances "dirigistes" dans la lutte de masses:
"Le parti ne mène aucune action et, comme parti, ne conduit aucune action de la classe. Il combat précisément toute subordination de la classe et de ses mouvements à la direction d'un groupe politique."
Dans cet esprit, le nouveau parti "ne reconnaît point de 'chefs1; il ne fait qu'exécuter les décisions de ses membres... Aussi longtemps qu'une décision subsiste, elle vaut pour tous les membres."
Chardin. (à suivre)
[1] [139] Des deux fils de Sneevliet, l'un s'était suicidé, l'autre était mort en Espagne dans les milices du POUM, sous la bannière de l'antifascisme, victime des positions propagées par le RSAP.
[2] [140] Le groupe de Munis, exilé au Mexique pendant la guerre, prit des positions internationalistes de non-défense de l'URSS. Les RKD, issus eux aussi du trotskisme, et composés de militants français et autrichiens travaillèrent à la fin de la guerre en collaboration avec la Fraction française de la Gauche communiste. Ils s'orientèrent peu à peu vers l'anarchisme pour disparaître en 1948-1949.
[3] [141] Les études de Max Perthus et de Wim Bot sur le MLL Front, qui s'appuient sur les archives allemandes en Hollande, ne donnent aucun fondement à cette hypothèse.
[4] [142] Winkel dans son livre : "De ondergrondse pers 1940-1945" (la Haye, 1954) affirme que l'ex-chef du KAPN et ami de Gorter, Barend Luteraan était rédacteur du CRM ; il semble que Luteraan ait créé pendant la guerre son propre groupe, sur des positions trotskystes. Après la guerre, il devint membre de la social-démocratie hollandaise (Parti du Travail).
[5] [143] Le "Groupe bolchevik-léniniste" constitué sur les positions de la IV° Internationale en 1938 disparut pendant la guerre, après l'arrestation de ses dirigeants. Le CRM se proclama parti en décembre 1945, bien que très faible numériquement, sous l'étiquette de "Parti communiste révolutionnaire" (RCP). Il publiait l'hebdomadaire " De Tribune" qui n'avait rien à voir avec le tribunisme du SPD de Gorter.
[6] [144] Après la guerre, les soupçons se portèrent sur Stan Poppe. Sneevliet avait été arrêté après une visite à Poppe. Dans le dossier du procès de Sneevliet il était affirmé que ce dernier avait été capturé "avec l'aide de Poppe". En décembre 1950 fut constituée une Commission d'enquête composée du RCP, du Ccrmunistenbond et du petit syndicat indépendant 0VB. Elle arriva unanimement à la conclusion que l'attitude de Poppe était irréprochable et qu'aucun blâme ne pouvait être porté contre lui.
[7] [145] 300.000 personnes sur une population de 6 millions d'habitants vivaient dans la clandestinité, avec de faux papiers et de fausses cartes de ravitaillement.
[8] [146] cf. "Spartacus, bulletin van de revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging in Nederland", janvier 1944.
[9] [147] cf. Vereeken :"Le Guépéou dans le mouvement trotskyste", Paris, 1975, chapitre premier.
[10] [148] cf. "Spartacus n°4, octobre 1942 ; et dans la même revue de février 1944 l'article :"De Scwiet-Uhie en Wij" ("L'Union soviétique et nous").
[11] [149] "De perspectiven van het impérialisme na de oorlog in Europa en de taak van de revolutio-naire socialisten", décembre 1943. Il est remarquable que cette brochure, dont les thèses étaient très éloignées du communisme des conseils, soit donnée comme base politique du Bond en 1945, sans qu'aucune critique soit portée sur le contenu de ces thèses. Cf ; "Spartacus, maans-chrift voor de revolutionair-socialistische Arbeidersbeweging", mai 1945 : Beschouwingen over de situatie : de balans".
[12] [150] cf. "ETOrcéteo", n°3, octobre 19^6 : "Le prespettive del dopoguerra in relazione alla piatta-forma del Fartito" (Tes nerspectives de l'après-guerre en relation avec la plateforme du Parti). Bordiga , auteur de l'article, y affirme que "les démocraties occidentales évoluent progressivement vers les formes totalitaires et fascistes". Sous ces termes, Bordiga, comme la Gauche hollandaise, voulaient souligner la tendance vers le capitalisme d'Etat dans les pays d'Europe occidentale.
[13] [151] Le Bond publia dans sa revue théorique "Maandblad Spartacus"en 1945 (N°9 et 12) une étude sur les occupations d'usines en Italie :"Een bedrijfsbezetting" (Une occupation d'usines). L'article affirme que en 1920 "les usines formaient une unité qui n'était rattachée ni à un parti ni à un syndicat". "... le mouvement finit par un compromis entre les syndicats et les patrons". Il montre que l'occupation d'usines ne suffit pas et que doivent surgir des conseils ouvriers dont la "tâche première n'est pas l'ordonnancement de l'industrie mais l'organisation de la lutte. C'est alors une période de guerre : la guerre civile". Cette vision critique de l'occupation des usines en Italie est bien différente de la vision usiniste défendue par la suite dans le Bond par Pannekoek d'une "gestion de la production" par les conseils.
[14] [152] Pour l'historique de la fusion entre les ex-GIC et le Communistenbond, une lettre de Canne Meijer du 30 juin 1946 au journal "Le prolétaire" (RKD-CR) donne d'utiles précisions. Canne Meijer écrivit en 1944 pour la discussion un texte sur la démocratie ouvrière : "Arbeiders-democratie in de bedrijven". Bruun van Albada publia dans "Spartacus" n°1 de janvier 1945, une étude sur la méthode marxiste : Het marxisme als méthode van onderzoek", comme méthode dialectique scientifique d'investigation.
[15] [153] Ils étaient seulement des "hôtes" - note Canne Meijer dans la même lettre -, faisaient tout le travail… en commun avec les camarades du Bond, mais ils se gardaient de toute ingérence organisation
[16] [154] Cependant en 1943 et 1944, des membres du Bond participaient à la création du petit syndicat clandestin "Eenheidsvakbewweging" (Syndicat unitaire). Pour l'histoire de ce syndicat, cf. "De Eenheidsvakcentra-le (EVC) 1943-1948", Groningen, 1976 par P. Coomans, T. de Jonge et E. Nijhof.
[17] [155] Lettre du 30 juin 1946, déjà citée, Canne Meijer considère que le Bond s'inscrit dans le développement d'un "nouveau mouvement ouvrier qui n'est pas une 'opposition' à l'ancien ni sa 'gauche' ou son 'ultra-gauche', mais un mouvement avec d'autres fondements".
[18] [156] Lettre de Canne Meijer du 27 juin 1946 au journal "Le Prolétaire". En 1946 le tirage de "Spartacus" hebdomadaire était tombé à 4.000 exemplaires.
[19] [157] Décision de la conférence des 21-22 juillet 1945, où étaient présents 21 militants des "Kerne" de Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum-Bussum. Cf "Uit eigen Kring" (UEK) n°2, août 1945.
[20] [158] Décision de la conférence des 21-22 juillet 1945, où étaient présents 21 militants des "Kerne" de Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum-Bussum. Cf "Uit eigen Kring" (UEK) n°2, août 1945.
[21] [159] "Le noyau est autonome dans son propre cercle. Il décide de l'admission et de l'exclusion des membres. Le Comité exécutif central est d'abord consulté pour l'admission et l'exclusion des membres. Par ce point de statut, l'autonomie des noyaux restait limitée en théorie, d'autant plus qu était affirmée la discipline organisative : "Les noyaux (noyaux principaux) sont tenus d'observer les décisions prises par la Conférence du Bond et de diffuser les principes du Bond, tels que ceux-ci étaient et sont établis aux conférences du Bond."
[22] [160] "Uit eigen kring", n°1, avril 1945.
[23] [161] "Uit eigen kring", n°2 août 1945 : "La conférence se met d'accord de rejeter toute collaboration avec le CRM. Décision est prise de ne pas s'engager dans une discussion avec le CRM".
[24] [162] "Uit eigen kring", n°4 août 1945, Projet d'adresse inaugurale "aux travailleurs manuels et intellectuels de tous les pays "
[25] [163] La proposition d'établir un "Secrétariat d'informations" à Bruxelles venait de "Contre le courant" et de la Centrale du Communistenbond. La conférence donna son accord. Cf. "Vit eigen king"n°2, août 1945, point 8 de la résolution.
[26] [164] Les Thèses,-qui étaient l'un des trois projets de thèses, parurent dans "Uit eiqen kring" n°8 décembre 1945, puis sous forme brochure en janvier 1946. Les deux autres projets, sans être rejetés étaient soumis à la discussion.
[27] [165] Les Thèses ne furent remises en question qu'en 1951. Des projets d'amendements furent soumis à l'organisation par le groupe d'Amsterdam. Cf. "Uit eigen kring", 20 octobre 1951.
[28] [166] En 1943, Pannekoek lui-même, en dépit de son analyse de la révolution russe comme "bourgeoise" , montrait qu'Octobre 1917 a eu un effet positif sur la conscience de classe : "Puis, comme une étoile brillante dans un ciel sombre, la Révolution russe illumina toute la Terre. Partout les masses se remirent à espérer ; elles devinrent plus rétives aux ordres de leurs maîtres, car elles entendaient les appels venus de Russie : appels à mettre fin à la guerre, appels à la fraternité entre les travailleurs de tous les pays, appels à la Révolution mondiale contre le capitalisme." ("Les conseils ouvriers", p. 184, Balibaste)
[29] [167] Cf. Bordiga, in "Parti et classe", 1921 (republié dans Le fil du temps, n°8, octobre 1971) : "Un parti vit quand vivent une doctrine et une méthode d'action. Un parti c'est une école de pensée politique et, par conséquent, une organisation de lutte. Tout d'abord, il y a un fait de conscience ; ensuite un fait de volonté, soit plus exactement une tendance vers une finalité."
[30] [168] Cf "Spartacus, maandschrift vcor de revolutionaire-socialistische arbeidersbeweging",n°1 : "Het marxisme als méthode van onderzoek", article écrit par Van Albada, qui était astronome.
[31] [169] Cf. "Les conseils ouvriers", p. 493, Bélibaste.
[32] [170] Le PC internationaliste de Bordiga se concevait comme un parti "monolithique" où ne pouvait exister une "liberté de théorie". Les débats internes étaient rendus impossibles par le "centralisme organique" d'une direction concevant le marxisme comme une "conservation de la doctrine". Dans le Bond, existaient des débats internes, mais sans qu'il définisse dans ses statuts dans quel cadre ils devaient surgir.
[33] [171] Cf . Bordiga, l’Unita n°172, 26 juillet 1925 : « …les chefs d’origine ouvrière ce sont révélés au moins aussi capable que les intellectuels d’opportunisme et de trahison en général, plus susceptibles d’être absorbés par les influences bourgeoises… Nous affirmons que l’ouvrier, dans la cellule, aura tendance à ne discuter que les questions particulières intéressant les travailleurs de son entreprise » .
[34] [172] Un deuxième projet de thèses sur le parti abordait cette question. Il rejetait explicitement la conception que le parti prend et exerce le pouvoir. Cf ."Stellingen,taak en wezen van de Partij", thèse 9,in "Uit eigen kring",n°7, décembre 1945.
[35] [173] La brochure était l'un des fondements programmatiques du Bond. Elle examinait la question du voir à travers l'évolution des sociétés de classe de l'Antiquité jusqu'à la société capitaliste.
[36] [174] Les "Cinq thèses" de Pannékoek ont été republiées par "Informations et correspondance ouvrières" (ICO) dans le brochure : "La grève généralisée en France, mai-juin 1968", supplément à ICO, n°72.
[37] [175] Uit eigen kring", n°7, décembre 1945 : "Stellingen over begrip en wezen van de parti j" (Thèses sur le concept et l'essence du parti). Ces Thèses forment le troisième projet soumis à la discussion et non accepta par le Congrès du Bond.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [10]
Revue Internationale no 39 - 4e trimestre 1984
- 2697 lectures
Quelle méthode pour comprendre : la reprise des luttes ouvrières
- 2419 lectures
Le développement, dans le contexte général de la reprise historique des combats de classe depuis 68, d'une troisième vague de luttes ouvrières après celles de 68-74 et de 78-80, est maintenant évident. La succession de combats ouvriers qui, depuis le milieu de 1983, a affecté la presque totalité des pays avancés - et notamment ceux d'Europe occidentale - et qui trouve, avec la présente grève des mineurs de Grande Bretagne, son expression la plus élevée, est venue démontrer clairement que la classe ouvrière mondiale est maintenant sortie de l'apathie qui avait permis et suivi sa défaite cuisante en Pologne en décembre 81. C'est ce que nous mettons une nouvelle fois en évidence (après nos articles de la Revue Internationale n°37 et n°38) dans la première partie de cet article. Cette reprise, même avec du retard, tous les groupes révolutionnaires l'ont maintenant reconnue. Cependant, ce retard, manifesté par beaucoup de 'révolutionnaires dans la compréhension de la situation présente, pose le problème de la méthode avec laquelle il faut analyser cette situation. C'est cette méthode, condition de la capacité des communistes d'être un facteur actif dans le développement des luttes de classe, que nous examinons dans la deuxième partie de cet article.
OU EN EST LA REPRISE ACTUELLE DE LA LUTTE DE CLASSE ?
Le prolétariat a mis deux ans pour tirer les leçons et se remettre de la fin de la vague de lutte des années 78-81 marquée notamment par les mouvements dans la sidérurgie en France et en Grande Bretagne, les grèves des mineurs aux USA, celle du port de Rotterdam avec son comité de grève, et surtout la grève de masse en Pologne d'août 80. Le prolétariat international' a mis deux ans pour encaisser, digérer et comprendre la défaite qu'il a subie en Pologne, défaite dont l'aboutissement fut le coup de force du 13 décembre 81 et la terrible répression qui s'en est suivie.
La durée du recul des luttes que cette défaite a provoquée au niveau international ne pouvait qu'être courte. Avant même de pouvoir reconnaître clairement le renouveau de combativité du prolétariat qui allait s'exprimer d'abord aux USA en juillet 83 (grève du téléphone) puis surtout en Belgique en septembre (grève du secteur public), nous affirmions lors du 5ème congrès du CCI, en juillet 83, que .- "Si jusqu'à présent le prolétariat des pays centraux avait subi moins brutalement que ses frères de classe de la périphérie les rigueurs de l'austérité, l'enfoncement du capitalisme dans la crise contraint la bourgeoisie à une attaque de plus en plus sévère du niveau de vie de la classe ouvrière au sein de la plus importante concentrât ion industriel le mondiale, celle d'Europe occidentale"."Cette crise, que le prolétariat vit comme une contrainte, le pousse à généraliser ses luttes et sa conscience, à mettre pratiquement en avant la perspective révolutionnaire. " (Revue Internationale n°35, "Rapport sur la situation internationale, p.14).
L'année 83-84 a largement confirmé cette analyse. Sans revenir dans le détail (cf. Revue Internationale n°37, 38 et les différentes presses territoriales du CCI), nous pouvons rappeler rapidement que cette vague de luttes a touché tous les continents, le Japon et l'Inde, la Tunisie et le Maroc lors des émeutes de la faim de l'hiver dernier, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la République Dominicaine, les USA et l'Europe occidentale. Dans cette dernière, ce sont tous les pays qui ont été touchés et sont encore touchés par les révoltes ouvrières. Aucun n'a été épargné : Espagne, Italie, Grèce, Suède, Hollande, Belgique, France, Grande Bretagne, Allemagne. Là se trouve le coeur économique et surtout historique du capitalisme. Là se trouve la concentration ouvrière la plus grande, la plus vieille et la plus expérimentée du monde.
Après un été où la combativité ouvrière ne s'est démentie ni même ralentie (Angleterre), nous nous trouvons à l'aube d'une année au cours de laquelle les événements vont s'accélérer. Face à l'accentuation de la crise du capitalisme et à la nécessité pour la bourgeoisie d'attaquer encore plus la classe ouvrière, l'heure est toujours au maintien et au renforcement de la tactique bourgeoise de la "gauche dans l'opposition". Cette dernière "opposée" à des équipes gouvernementales de droite, est spécialement chargée maintenant de saboter les réactions ouvrières aux mesures d'austérité et de licenciements prises dans tous les pays. Deux événements sont particulièrement significatifs de cette tactique de la bourgeoisie : l'élection présidentielle aux USA. Pour celle-ci, qui a lieu en novembre, la bourgeoisie américaine possède en Reagan le "ticket" gagnant apte à remplir le rôle dévolu aux gouvernements de droite en place aujourd'hui. Il a déjà largement fait ses preuves. Pour ceux qui douteraient encore du "machiavélisme" de la bourgeoisie (cf. Revue Internationale n°31), de la mise en place réfléchie de sa "gauche dans l'opposition", de la volonté de la bourgeoisie américaine d'éviter toute mauvaise surprise, la publicité des médias sur la feuille d'impôts de la candidate démocrate à la vice-présidence n'est que le dernier, à ce jour, des "scandales" et des manipulations dans lesquels les bourgeoisie occidentales sont passées maîtres pour organiser les élections et... leur résultat. Le maintien dans l'opposition du parti démocrate doit permettre à celui-ci de prendre un langage de plus en plus "populaire", de "gauche", et de renforcer les liens traditionnels avec la grande centrale syndicale américaine, l'AFL-CIO ; - d'autre part, le départ du PC français du gouvernement. Cette décision du PCF, et son opposition croissante et ouverte à Mitterrand le socialiste, visent à regarnir le front social qui était dangereusement découvert. En 81, l'arrivée accidentelle au gouvernement de la France du PS et du PC, ce dernier étant traditionnellement la force principale d'encadrement et de contrôle de la classe ouvrière dans ce pays, avait mis l'appareil politique de la bourgeoisie en état d'extrême faiblesse face au prolétariat. C'était le seul pays a'Europe occidentale sans parti de gauche important dans l'opposition pour saboter les luttes ouvrières "de l'intérieur". La bourgeoisie n'a pas fini de payer son dérapage de mai 81, de trois ans de gouvernement de "l'union de la gauche", gouvernement qui a asséné l'attaque la plus violente contre la classe ouvrière en France depuis la seconde guerre mondiale et la période de "reconstruction" qui l'a suivie. Cependant, le départ du PCF du gouvernement et son passage dans une opposition de plus en plus ouverte et "radicale", constitue une première disposition de la bourgeoisie française tendant à surmonter cette situation de faiblesse.
Ces deux événements, le passage du PCF dans l'opposition, et surtout l'élection présidentielle à venir aux USA, prennent place dans le cadre du renforcement et de la préparation de l'appareil politique de la bourgeoisie pour affronter le prolétariat, et ce au niveau international. Ces deux événements signifient que la bourgeoisie sait que la crise économique du capital va encore s'accentuer et qu'elle, la bourgeoisie, va devoir attaquer encore plus la classe ouvrière ; ils signifient qu'elle a su reconnaître à sa manière la reprise internationale des luttes ouvrières.
A- Les ouvriers en Grande Bretagne au premier rang de la reprise internationale des luttes.
C'est dans cette situation générale que se situe le mouvement de luttes ouvrières en Grande Bretagne. Avec, à sa tête, la grève des mineurs longue maintenant de sept mois (!), ce mouvement de lutte est devenu le fer de lance de la lutte du prolétariat mondial. Il a atteint le niveau le plus haut de lutte depuis la grève de masse d'août 80 en Pologne.
Pourtant, le prolétariat se trouve confronté, dans ce pays, à une bourgeoisie particulièrement forte politiquement et qui s’était préparée de longue date à des affrontements avec la classe ouvrière. La Grande Bretagne est le plus vieux pays capitaliste. La bourgeoisie britannique domine le monde tout au long du siècle dernier. Elle a une expérience de domination politique que ses consoeurs des autres nations capitalistes lui en vient ; en particulier à travers son jeu démocratique et parlementaire. C'est cette expérience politique sans égale qui lui a permis d'être la première à vouloir et à pouvoir mettre en place la tactique de "la gauche dans l'opposition-. Consciente du danger des réactions ouvrières que ne manquaient pas de provoquer les attaques économiques dues à la crise et à l'usure du parti travailliste au pouvoir, elle sut, en mai 79, renvoyer celui-ci dans l'opposition, et trouver en Thatcher la "Dame de fer" qui lui convenait. Elle sut diviser (création du parti social-démocrate) et affaiblir électoralement le parti travailliste, mais aussi le garder suffisamment fort pour empêcher - avec son organisation syndicale, le TUC - le surgissement de luttes ouvrières et les saboter.
La grève des mineurs, tout comme la reprise internationale des luttes, nous enseigne que cette carte bourgeoise de "la gauche dans l'opposition" n'arrive plus à empêcher ni à étouffer le surgissement des réactions ouvrières, même si elle arrive encore assez bien à les saboter. Dans ce sabotage, la bourgeoisie britannique dispose, là encore, d'une arme que lui envient toutes les autres bourgeoisies : ses syndicats. Tout comme dans le jeu parlementaire et électoral, la classe dominante anglaise est passée maître dans l'art de présenter au prolétariat de fausses oppositions : entre la direction nationale du TUC d'un côté et, de l'autre, Scargill (le chef du syndicat des mineurs) et les shop stewards, institutions vieilles de plus de 60 ans et qui jouent le rôle du syndicalisme de base, de dernière barrière du syndicalisme, la plus "radicale" contre la lutte des ouvriers. Mais si la bourgeoisie est ancienne et expérimentée, le prolétariat est aussi ancien, expérimenté et très concentré. C'est dans ce sens que le mouvement de grèves actuel prend une signification particulière.
La lutte des mineurs, dont la renommée et l'expérience ont déjà traversé la Manche pour atteindre le continent européen, a déjà contribué à détruire une mystification importante tant en Grande-Bretagne que dans les autres pays : le mythe de la démocratie britannique et du policier anglais sans arme. La violente répression qu'ont subie les mineurs a peu à envier à celle de n'importe quelle dictature sud-américaine : 5000 arrestations, 2000 blessés et 2 morts ! Les villes et les villages des mineurs occupés par la police anti-émeute, les ouvriers attaqués dans la rue, dans les pubs, chez eux, les stocks de nourriture destinés aux familles saisis, etc. La dictature de l'Etat bourgeois a vite tombé son masque démocratique.
Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle employée une telle violence ? Pour démoraliser les mineurs ; pour décourager les autres secteurs de la classe ouvrière tentés de les rejoindre. Certes. Mais c'est surtout pour empêcher les piquets de grève d'étendre la grève aux autres puits de mine, aux autres usines, pour empêcher une extension générale du mouvement. Car la bourgeoisie a peur. Elle a peur des débrayages spontanés qui ont eu lieu dans les chemins de fer (à Paddington), à British Leyland, des occupations de chantiers navals comme à Birkenhead, ou à l'Aerospace à côté de Bristol.
Et c'est cette peur de l'extension qui l'a retenue d'utiliser cette même violence étatique, une fois les dockers entrés en grève de solidarité au mois de juillet. L'utilisation de la répression aurait risqué en cette circonstance de mettre le feu aux poudres, d'accélérer l'extension de la grève à toute la classe ouvrière. Grâce aux manoeuvres des syndicats (lire World Révolution No 75) et aux médias, cette première grève s'est terminée au bout de 10 jours.
Le mouvement de luttes en Grande-Bretagne reprend toutes les caractéristiques des luttes internationales actuelles que nous avons mises en évidence dans nos "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe" dans le No 37 de cette Revue : nous n'y reviendrons pas dans cet article. Mais il nous faut souligner l'extraordinaire combativité qu'exprime le prolétariat en Grande-Bretagne : après 7 mois, malgré une violente répression, des pressions de toutes parts, les mineurs sont toujours en grève. A l'heure où nous écrivons, les travailleurs des docks sont en grande partie de nouveau en grève en solidarité avec les mineurs malgré l'échec de la première tentative du mois de juillet ; ils sont conscients que leur intérêt de classe immédiat est le même que celui des mineurs, et des autres secteurs de la classe ouvrière.
C'est l'ensemble de la classe ouvrière qui, peu à peu, prend conscience de son intérêt de classe exprimé dans les mines. A travers cette lutte, la question ouvertement posée, est celle de l'extension réelle des luttes. Il faut souligner, qu'outre les dockers, les chômeurs et les femmes des ouvriers luttent avec les mineurs et se battent avec eux contre la police. Avec la question de la solidarité, c'est la perspective de l'extension consciente qui s'affirme aujourd'hui ouvertement en Grande-Bretagne pour le prolétariat mondial, et surtout européen. Et à travers cette extension, et l'affrontement avec les syndicats et les partis de gauche, ce sont les conditions de la grève de masse dans les métropoles du capitalisme que développe le mouvement de luttes ouvrières.
B- La signification des grèves en Allemagne de l'Ouest
Après les combats en Grande-Bretagne, l'un des aspects les plus probants de cette reprise internationale de la lutte de classe a été le retour du prolétariat allemand sur le terrain des affrontements de classe, comme en témoignent les occupations des chantiers navals à Hambourg et à Brème en septembre 83, la grève des métallurgistes et des imprimeurs au printemps 84. C'est la fraction la plus nombreuse, la plus concentrée et aussi la plus centrale de la classe ouvrière d'Europe de l'Ouest. Ce renouveau des luttes ouvrières au coeur de l'Europe industrielle a une signification historique qui va bien au delà de 1'importance immédiate des grèves elles-mêmes. C'est la fin de 1'importante marge de manoeuvre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière en Europe que lui assurait le relatif calme social maintenu en RFA dans les années 70.
Ce développement des luttes en Allemagne confirme deux aspects importants de l'analyse marxiste de la situation mondiale développée par le CCI :
- la crise économique dans le contexte historique d'une classe ouvrière non battue, agit comme le principal allié des ouvriers, en poussant progressivement les principaux bataillons du prolétariat mondial dans le combat de classe, et au premier rang de celui-ci ;
- le resurgissement historique de la lutte de classe depuis 1968 a permis au prolétariat de se débarrasser de plus en plus des effets terribles de la contre-révolution la plus longue et la plus sauvage qui se soit jamais abattue sur le prolétariat ; or, l'Allemagne, tout comme la Russie, fut le principal centre de la contre-révolution qui a suivi la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-
Quelle est la signification de la reprise des affrontements de classe en Allemagne, signification que la propagande bourgeoise voudrait cacher? Ces luttes montrent la banqueroute du "miracle économique" de l'après-guerre, la banqueroute de l'affirmation selon laquelle le travail dur, la discipline et la "collaboration capital-travail", la "paix" sociale peuvent éviter la crise économique. Plus important encore : ces luttes montrent que le prolétariat n'a jamais été "intégré" au capitalisme (souvenons-nous des théories de 1968 à la Marcuse), que toutes les attaques de la Social-Démocratie et du nazisme n'ont pas réussi à détruire le coeur du prolétariat européen. Nous affirmons, qu'à l'image du reste du prolétariat international, les ouvriers allemands n'en sont qu'au début de leur retour dans le combat de classe.
Tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue que le retour du prolétariat allemand à sa vraie place, à la tête de la lutte de classe internationale, ne fait que commencer, et que ce processus sera long et difficile. En particulier, il faut nous rappeler que :
- le degré de combativité des ouvriers allemands a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau déjà atteint en Grande-Bretagne, où les conditions matérielles des ouvriers sont bien pires qu'en Allemagne, et où la classe ouvrière a déjà développé une tradition de luttes et de combativité tout au long des années 70 ;
- les potentialités à court terme de la situation en Allemagne ne sont en aucun cas aussi riches qu'en France, le voisin, car la bourgeoisie de l'Est du Rhin est bien plus puissante et mieux organisée que celle de l'Ouest (elle a en particulier depuis déjà un certain temps réalisé sa tactique de la mise en place de ses fractions de gauche -syndicats et parti Social-démocrate- dans "l'opposition", mise en place juste entamée en France). De plus, la génération présente des ouvriers allemands manque de l'expérience politique de ses camarades en France ;
- dans les luttes jusqu'aujourd'hui, la proportion des ouvriers directement en grève a été bien plus faible qu'en Belgique, et a touché moins de secteurs qu'en Espagne par exemple.
Loin d'être à la tête du mouvement, les ouvriers d'Allemagne en sont en fait encore à rattraper leur retard sur le reste des ouvriers d'Europe. Ceci est vrai au niveau de la combativité, de l'étendue des mouvements, du degré de politisation et de la confrontation avec la stratégie de la gauche dans l'opposition, en particulier avec le syndicalisme de base, l'arme que la bourgeoisie allemande n'a pas eu encore à employer beaucoup jusqu'à présent. Ce "rattrapage" en Allemagne est devenu un des aspects les plus importants du processus d'homogénéisation de la conscience de classe dans le prolétariat européen et des conditions de la lutte en Europe de l'Ouest.
La présente reprise des luttes ouvrières, le nouveau pas qu'elle représente dans le développement historique des combats de classe depuis 68, assignent aux organisations révolutionnaires des responsabilités accrues, et en particulier celle d'intervenir activement dans le processus de prise de conscience qui s'opère actuellement dans la classe. Une telle intervention s'appuie nécessairement sur la plus grande clarté sur la compréhension des véritables enjeux de la situation présente. C'est dire toute l'importance que revêt pour les révolutionnaires - et pour la classe dans son ensemble - la méthode avec laquelle ils analysent la réalité sociale.
LA METHODE D'ANALYSE DE LA REALITE SOCIALE
La reconnaissance et la compréhension de la reprise internationale des luttes ouvrières ne peut s'acquérir qu'en s'appropriant la méthode marxiste d'analyse de la réalité sociale.
Cette méthode rejette la démarche phénoménologique. Aucun phénomène social ne peut être compris et expliqué à partir de lui-même, par lui-même et pour lui-même. C'est seulement en le situant dans le mouvement social général en développement que le phénomène social, la lutte de classe, peut être saisi. Le mouvement social n'est pas une somme de phénomènes, mais un tout les contenant tous et chacun.
Le mouvement de la lutte prolétarienne est à la fois international et historique. C'est de ces deux points de vue, mondial et historique, que les révolutionnaires peuvent appréhender la réalité sociale, la situation de la lutte de classe.
D'autre part, le travail théorique et d'analyse des révolutionnaires n'est pas une réflexion passive, un simple reflet de la réalité sociale, mais tient un rôle actif, indispensable dans le développement de la lutte prolétarienne. Il n'est pas quelque chose d'extérieur au mouvement de la lutte de classe, mais en est une partie intégrante. Tout comme les révolutionnaires sont une partie, bien précise et particulière, de la classe ouvrière, de même leur activité théorique et politique est un aspect de la lutte révolutionnaire du prolétariat.
Les communistes ne peuvent s'approprier la méthode marxiste qu'en se situant comme facteur actif dans le mouvement de la lutte de classe, et d'un point de vue mondial et historique.
En prenant chaque lutte en soi, en l'examinant de manière statique, immédiate, photographique, on s'ôte toute possibilité d'appréhender la signification des luttes et,en particulier, de la reprise actuelle de la lutte de classe. Si nous reprenons parmi les principales caractéristiques des luttes d'aujourd'hui (cf. Revue Internationale No 37, "Thèses sur l'actuelle reprise de la lutte de classe"), la tendance au surgissement de mouvements spontanés, à des mouvements de grande ampleur touchant des secteurs entiers dans un même pays, leur tendance à l'extension et à l'auto organisation, si nous reprenons donc toutes ces caractéristiques en soi, de manière statique, mécanique, et si nous les comparons avec la révolte ouvrière d'août 80 en Pologne, il est effectivement difficile de voir une reprise du combat de classe du prolétariat international. Les mouvements spontanés de solidarité des dockers et d'autres secteurs ouvriers avec les 135 000 mineurs en grève en Grande-Bretagne, les manifestations violentes et spontanées débordant les syndicats en mars dernier en France, les 700 000 manifestants ouvriers à Rome le 24 mars, même la grève des services publics en septembre 83 en Belgique, paraissent bien en deçà du niveau de lutte atteint par la vague précédente ; et surtout bien loin de la grève de masse en Pologne. Et pourtant...
Et pourtant, la méthode marxiste ne peut se contenter de comparer deux photos prises à quelques années de distance. Elle ne peut se contenter de rester à la surface des choses. Pour les révolutionnaires conséquents, il s'agit d'essayer de saisir la dynamique profonde, le mouvement des luttes ouvrières.
La reprise de la lutte de classe se situe principalement, mais pas uniquement, dans les principaux centres industriels du monde, en Europe occidentale, et aux USA. Ce n'est donc plus dans un pays du bloc de l'Est, ni seulement en Afrique du Nord, à Saint-Domingue et au Brésil que ces mouvements spontanés et de grande ampleur surgissent. C'est dans les principaux, les plus vieux pays capitalistes, dans les pays "les plus prospères", dans le bastion industriel de l'Europe. C'est le prolétariat le plus ancien, le plus expérimenté et le plus concentré qui réagit aux attaques de la bourgeoisie.
C'est dire que deux des principales armes employées avec succès contre le prolétariat dans la vague de luttes précédente, et particulièrement en Pologne, n'ont plus assez d'efficacité aujourd'hui pour maintenir les ouvriers dans les illusions et la démoralisation :
- l'arme de la spécificité nationale des pays du bloc de l'Est qui avait permis l'isolement en Pologne en présentant la crise économique qui sévissait dans ce pays comme le résultat de la*mauvaise gestion des bureaucrates" locaux. Les luttes actuelles en Europe occidentale mettent à bas les illusions sur des issues nationales, pacifiques à la crise économique. La révolte ouvrière ne frappe plus seulement les pays de l'Est et du Tiers-monde mais aussi les pays "démocratiques" et "riches". C'est la fin des illusions sur la nécessité de sacrifices momentanés pour sauver l'économie nationale. Avec l'apparition de soupes populaires dans les grandes villes d'occident et qui éclairent d'un autre jour les queues et les privations supportées par les ouvriers d'Europe de l'Est, la reprise actuelle des luttes dans les métropoles industrielles de l'Ouest signifie donc la compréhension progressive par le prolétariat international du caractère irréversible, catastrophique et international de la crise du capital.
- l'arme de "la gauche dans l'opposition" qui avait si bien fonctionné, et en Europe de l'Ouest, et à travers le syndicat Solidarité en Pologne. La reprise internationale actuelle nous enseigne que cette arme n'arrive plus à empêcher directement l'éclatement de grèves ouvrières (même si elle est encore très efficace dans leur sabotage). Ce sont donc les illusions sur la "Démocratie de l'Ouest" et sur les partis de gauche et les syndicats qui tendent à tomber.
Cette prise de conscience du caractère inévitable et irréversible de la crise du capital dans le monde entier, et du caractère bourgeois des partis de gauche même sans responsabilités gouvernementales, ne pouvait -et ne peut- se développer qu'à partir des luttes ouvrières dans les pays industriels les plus développés et les plus vieux, dans les pays où la bourgeoisie dispose d'un appareil d'Etat rodé au jeu démocratique et parlementaire, dans les pays où les illusions sur "la société de consommation", sur la "prospérité éternelle", prenaient leur source et avaient été les plus fortes.
C'est en répondant à ces deux obstacles et en les dépassant, que le prolétariat reprend le combat aujourd'hui là où il l'avait laissé en Pologne.
Saisir la signification de la période actuelle de luttes, c'est saisir le mouvement et la dynamique qui les animent ; c'est saisir et comprendre que c'est la maturation de la conscience de classe dans la classe ouvrière, le développement de la prise de conscience chez les ouvriers qui produit et détermine la reprise internationale des luttes ouvrières. C'est cette maturation et ce développement de la conscience qui donnent tout leur sens, toute leur signification aux luttes ouvrières.
En effet, condition indispensable du développement de la lutte de classe, l'approfondissement de la crise ne suffit pas à expliquer le développement de la lutte de classe. L'exemple de la crise de 1929 et des années qui ont précédé la seconde guerre mondiale nous le prouve. Dans les années 30 les attaques terribles de la crise économique n'avaient provoqué qu'une plus grande démoralisation et qu'un plus grand déboussolement dans un prolétariat qui venait d'essuyer la plus grande défaite de son histoire et qui subissait à plein le poids des mystifications "antifascistes" et sur la "défense de la patrie socialiste" visant à l'enchaîner au char de l'Etat bourgeois derrière les partis de gauche et les syndicats. La situation est bien différente à l'heure actuelle. Le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas battu et nous avons vu précédemment que c'est sa capacité à digérer, à mûrir ses défaites partielles, à donner une réponse aux armes idéologiques que lui oppose la bourgeoisie qui détermine la reprise présente de la lutte de classe. Les conditions objectives, la crise économique, la misère qui se généralise, ne sont pas seules ; s'y ajoutent des conditions subjectives favorables : la volonté consciente des ouvriers de ne plus accepter de sacrifices pour la sauvegarde de l'économie nationale, la non adhésion du prolétariat aux projets bourgeois (économique et politique), la compréhension de plus en plus grande du caractère anti-ouvrier de la gauche et des syndicats.
Et plus le facteur subjectif devient important dans le développement des luttes ouvrières, et plus devient crucial le rôle des révolutionnaires dans celles-ci. En effet, expression la plus haute de la conscience de classe, les communistes sont indispensables, non seulement par leur travail théorique, politique, leur propagande ; non seulement ils seront indispensables demain dans la période révolutionnaire, mais déjà, dès aujourd'hui, ils sont indispensables dans le processus actuel de la reprise de la lutte de classe, de maturation de la grève de masse. En dénonçant les pièges et les impasses que le capitalisme oppose au prolétariat, ils stimulent, catalysent, accélèrent le développement dans la classe d'une claire conscience de la nature de ces pièges et impasses, du rôle véritable de la gauche et des syndicats. De plus, même s'ils ne se font pas d'illusion sur l'importance de leur impact immédiat, ils contribuent à orienter les luttes dans le sens de l'autonomie la plus grande de la classe ouvrière face à la bourgeoisie, dans le sens de l'extension et de la coordination des luttes par l'envoi 02 délégations massives, de piquets de grève, de manifestations, dans le sens de l'organisation par les ouvriers eux-mêmes dans les assemblées générales, de cette extension ; dans le sens du développement le plus larg3 de la lutte de classe.
La non reconnaissance ou la sous-estimation de la reprise actuelle, la vision mécanique du développement de la lutte de classe, l'incompréhension du rôle actif de la conscience de classe dans le processus de développement de cette lutte de classe,, mènent au rejet -au moins implicite- de la nécessité de l'intervention des révolutionnaires et, partant, du parti communiste mondial de demain.
En effet, il ne suffit pas de clamer à cors et à cris la nécessité du parti, comme le font certains groupes, pour contribuer efficacement au processus qui mène à sa future constitution. C'est, dès aujourd'hui, dans les luttes présentes que se préparent les conditions de son édification, que se forgent les organisations qui en seront des parties constitutives, que- les communistes font la preuve de leur capacité à se trouver à l'avant-garde des combats révolutionnaires à venir. Et ils ne feront une telle preuve que s'ils se montrent capables de défendre avec rigueur la méthode marxiste dont l'ignorance et l'oubli désarment politiquement le prolétariat, le mènent à l'impuissance et à la défaite.
R.L. 9/9/84
Géographique:
- Europe [32]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [1]
Où en est la crise économique ? : Crise historique de l'économie
- 2563 lectures
Le rapport sur la situation internationale adopté au 6ème Congrès de Révolution Internationale (juillet 1984), comportait trois parties : crise historique de l'économie, conflits inter impérialistes et développement de la lutte de classe. Dans la rubrique régulière sur la crise économique de cette Revue, nous publions la première partie de ce rapport ([1] [177]) qui fait le point sur les manifestations actuelles et les perspectives de la crise dans le bloc de l'Ouest vers une nouvelle grande vague de récession.
Nous pouvons aujourd'hui contempler les conséquences désastreuses de la première vague de récession des années 80 sur l'ensemble de la planète, le spectacle désolant des conséquences catastrophiques du choc violent des forces productives contre les rapports sociaux.
On dirait que des populations entières ont subi un cataclysme ou sortent d'un conflit extrêmement violent et meurtrier. Famines, disettes, émeutes de la faim sont aujourd'hui chose courante sur des continents entiers (la seule année 84 a connu des émeutes au Brésil, en Inde, en Tunisie, au Maroc... ou encore des expulsions, l'exode forcé de dizaines de millions de personnes). Dans les pays développés, que ce soit dans les métropoles de la vieille Europe ou dans les Etats Unis d'Amérique, des régions entières, des villes prennent de plus en plus les allures des pays sous-développés. Et pourtant ce ne sont là que les conséquences limitées de la première vague de récession des années 80, qui a culminé en 81-82.
C'est sur ces plaies encore vives qu'une nouvelle grande vague de récession s'annonce aujourd'hui.
UNE NOUVELLE GRANDE VAGUE DE RECESSION
Le grand tournant des politiques économiques mondiales de la fin des années 70 a en quatre années joué un formidable rôle d'accélérateur et bouleversé profondément la situation mondiale à un niveau autrement plus profond que ne l'avaient fait la crise monétaire de 70-71 et la récession de 1974.
Les conséquences des coups portés ces dernières années contre les politiques que nous appelons par commodité "keynésiennes" et qui avaient prévalu avec plus ou moins de force depuis la seconde guerre mondiale ont provoqué la plus grande récession mondiale depuis l'avant-guerre, aux conséquences sociales et humaines que personne n'ignore. Bien que des Etats, comme l'Etat français, ou l'Etat anglais, aient été des précurseurs en la matière, c'est encore l'Etat américain qui a mené la danse. Comme après la seconde guerre, pendant toute la période de reconstruction et depuis la crise ouverte à la fin des années 60, l'économie mondiale a été dépendante de la situation du capitalisme aux USA. Pendant les années de reconstruction, il procurait à l'Europe les moyens de sa reconstruction, de même que dans les années 70, il jouait le rôle de locomotive de l'économie mondiale, par le crédit facile et bon marché, les déficits publics et la planche à billets.
En deux ans, le Tiers-monde s'est effondré, et on se demande vraiment jusqu'où le capitalisme peut enfoncer l'humanité ; les pays sous-développés ou "en voie de développement" sont à genoux, écroulés sous le poids de leurs dettes, leur économie prête à rendre l'âme. Les "miraculés" d'hier deviennent en un espace de temps très réduit les agonisants d'aujourd'hui. Les pays producteurs de pétrole croulent sous la surproduction : Venezuela, Mexique pour l'Amérique latine sont en faillite potentielle (en un an le niveau de vie au Mexique ainsi qu'au Venezuela a chuté de 50%). Le Moyen-Orient est dans un état lamentable : un des principaux financiers international et producteur de pétrole, l'Arabie Saoudite, est en déficit commercial, surproduction aussi, alors que deux autres producteurs très importants, l'Irak et l'Iran ont, à cause de la guerre, fait chuter leur production de 75%. En Afrique, 1e Nigeria, "pays du soleil", exception économique au milieu d'un continent où la misère est indescriptible, à cause aussi de la surproduction de pétrole, expulse un million et demi de personnes en deux semaines (en janvier83). Partout éclatent des émeutes de la faim : Brésil, Colombie, Inde, Maroc, Tunisie, et dernièrement encore aux Caraïbes. Telles sont les conséquences de la surproduction mondiale dans les pays peu ou pas développés. Le bilan historique est rapide à tirer, d'une netteté extrême. Ces pays sont passés de la forme coloniale à la décolonisation pour aboutir aujourd'hui dans l'effondrement. Cela est une manifestation de l'incapacité du capital à assurer son processus d'accumulation et donc d'extension de son mode de production, d'intégration à celui-ci d'autres secteurs de la société.
Dans les pays industrialisés, le choc a là aussi été très rude. Les mesures en vue de mettre fin à la politique d'endettement et de déficit public, le coup de frein brutal à la politique de locomotive mondiale de la part des USA ont brutalement bouleversé le paysage et les habitudes économiques des pays de la métropole, en particulier en Europe. Les pourcentages d'expansion, dans lesquels s'expriment les taux d'accumulation du capital, sont brutalement tombes à zéro ou en dessous.
En 1'esnace de trois ans, 1'évolution du chômage a subi une accélération considérable alors que les salaires continuaient à baisser-. La fraction de salaire versée par l'Etat a elle, sous toutes ses formes, été réduite énormément. En résumé tout ce que la classe ouvrière considérait comme des acquis inaltérables a été brutalement balayé ou est en voie de l'être.
Nous avons toujours mis en avant dans nos analyses que plus nous irions en avant dans la crise, plus les périodes de "reprise" seraient courtes et limitées, alors que les périodes de récession, elles, seraient de plus en plus longues, étendues et profondes. Les faits semblent particulièrement nous donner raison. Mais pour caractériser la situation actuelle, nous devons ajouter que contrairement aux périodes de récession précédentes, la récession de 81-82 n'a pas été suivie d'une nouvelle relance de style keynésien. Au contraire, les conséquences inflationnistes de ces politiques, qui, "à côté" d'une surproduction profonde avaient conduit l'économie mondiale à la limite du krach financier menaçant de faire exploser le système monétaire, ne pouvaient, être poursuivies. C'est ainsi que c'est une politique de "purge" générale qui a suivi la première récession des années 80 et qui se poursuit aujourd'hui. (Les USA constituent sous certains aspects un cas à part mais nous y reviendrons plus loin).
La surproduction ne pouvant plus être épongée par les déficits, nous la voyons ainsi gagner tous les secteurs de la production et les bloquer en partie. Cette caractéristique des crises de la période de décadence, LA CRISE GENERALISEE A TOUS LES SECTEURS DE LA PRODUCTION, ressort aujourd'hui avec une clarté éblouissante :
-secteur de production des moyens de production, de la machine outil à l'industrie lourde (tel l'acier) ;
-secteur des matières premières et de l'énergie;
-secteur de production des moyens de consommation, avec une prime pour l'agriculture et le logement ;
-secteur de production des moyens de transports, de l'aéronautique à l'industrie navale en passant par l'automobile ;
-secteur dit "tertiaire", celui de la circulation du capital (les banques en particulier, principales bénéficiaires de la période "inflationniste" et qui se présentaient comme les institutions les plus assises et les plus solides, ont particulièrement été secouées durant les deux premières années de cette décennie ) ([2] [178]);
-et enfin le secteur appelé "service public", largement gonflé lors des périodes précédentes a particulièrement été visé par la politique générale de purge.
Nous pouvons déjà voir ici l'importance du caractère généralisé de la crise à tous les secteurs pour le développement et l'unification de la lutte de classe. Il nous faut maintenant considérer les années 83 et 84 et plus particulièrement ce qu'on appelle "la reprise" aux USA pour être capables de tirer un bilan de la première moitié des années 80, mais surtout pour dégager une perspective pour les mois et les années à venir.
LA REPRISE AUX USA
Tous les commentateurs de la situation économique s'accordent pour dire que l'ensemble des pays industrialisés (la France mise à part) semblent avoir amorcé une "reprise économique", en particulier les USA. Pour le début de l'année 84, des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne peuvent inscrire à leur actif une baisse assez nette de l'inflation, une stabilisation du chômage et une évolution de la production (PNB) de 2 ou 3% (ce qui correspond d'ailleurs tout juste à l'évolution de la population) . Nous ne nous attarderons pas sur la situation des pays européens dans la mesure où leur évolution est totalement dépendante de la situation économique aux USA. En effet le réajustement des balances commerciales des pays européens ou du Japon n'a pu se faire qu'au prix d'un déficit commercial gigantesque de l'économie américaine.
Seuls les USA peuvent inscrire pour l'année 84 une augmentation de leur PNB d'une moyenne de 5%, mais à quel prix et dans quelle perspective ?
Au delà des aspects de manipulations monétaires, nous pouvons déjà donner un aperçu de la réalité de la "reprise" de l'économie aux USA et de ce qu1 elle contient. Ainsi, fin 83, à un des plus forts moments de ce qui est appelé "reprise", on pouvait apprendre :
"Les commandes de biens durables aux entreprises américaines ont augmenté de 4% en novembre, s'établissant à 37,1 milliards de dollars, annonce le département du commerce. Cette progression, la plus forte depuis le mois de juin dernier (+7,6%) est due en grande partie à la hausse des commandes militaires (+46%) et des commandes d'automobiles et de camions (+17,7%). Les commandes d'appareils domestiques, elles, n'ont progressé que de 3% et les commandes d'équipements de production ont baissé de 4,4%'.' (Le Monde du 24-12-83, nous soulignons).
Ce financement qui pour 50% a été destiné à l'effort de guerre nécessité par l'offensive des USA n'a été rendu possible que par les manipulations sur le dollar, monnaie sur laquelle repose le commerce mondial. La hausse vertigineuse des taux d'intérêts (jusqu'à 18%) a permis de rapatrier vers les USA des millions de dollars qui pendant des années ont été répandus dans le monde entier. Et cela était encore largement insuffisant. Malgré les économies réalisées sur lés dépenses sociales aux USA même, le déficit budgétaire américain passe de 30 milliards de dollars en 79 à 60 milliards en 80 pour atteindre les 200 milliards en 84. Il n'est pas étonnant que dans une telle situation,P. Volcker, président de la Réserve, compare l'immense déficit budgétaire américain à "un pistolet chargé, pointé sur le coeur de l'économie des USA, et dont nul ne peut prévoir quand le coup partira." (Le Monde du 3-3-84).
Voilà les bases de la reprise aux USA :
-hausse des taux d'intérêts, du dollar, du déficit commercial (-28,1 milliards de dollars en 81, -36,4 milliards de dollars en 82, -63,2 milliards en 83, -80 estimés pour 84);
-déficit de la balance des paiements courants (de 4,6, donc positive en 81, elle passe à -11,2 milliards de dollars en 82 et à -42,5 milliards en 83);
-augmentation de la masse monétaire par l'utilisation de la planche à billets (entre juillet 82 et juillet 83, l'expansion monétaire est de 13,5%, LA PLUS PORTE CROISSANCE DEPUIS LA SECONDE GUERRE MONDIALE).
On voit ici, en considérant ces chiffres pharamineux, l'immense baudruche que constitue la reprise aux USA et comment derrière une baisse en chiffres absolus de l'inflation de la monnaie américaine (13,5% en 80, 10,4% en 81, 6,1% en 82, 3,5% en 83) DUE ESSENTIELLEMENT A LA HAUSSE DU DOLLAR (la hausse du dollar a réduit de 10% le prix des marchandises importées), se cache une HYPER INFLATION (la surestimation du prix du dollar étant évaluée en janvier 84 à 40%).
Cette situation économique explosive, telle une bombe atomique amorcée, nous invite à jeter un rapide regard en arrière pour dégager quel peut être l'avenir de la situation.
En 1979, la fuite généralisée devant le dollar, monnaie de référence pour le commerce international, menace de krach le système monétaire international. Face à cette situation qui signe la faillite de plusieurs années de fuite en avant, les autorités américaines portent à 18% le taux d'intérêt de la monnaie américaine pour soutenir leur monnaie et éponger la dette internationale immense que représentent les millions de dollars répandus dans le monde. Résultat : en 81-82, on assiste à la plus forte récession depuis la veille de la seconde guerre mondiale, dans les pays industrialisés (en particulier aux USA), les industries s'écroulent comme des châteaux de cartes, les pays "en développement" ne peuvent plus rembourser leur dette et au delà de leur faillite c'est la faillite de tout le système bancaire des pays développés qui se profile.
En 1982, l'asphyxie générale de l'économie, par les mêmes moyens volontaristes, pousse les autorités américaines à ramener leurs taux d'intérêts à 11%. Taux suffisamment hauts pour continuer à ramener vers les USA des masses de dollars et les capitaux qui dans le reste du monde fuient les investissements et pour permettre aux entreprises américaines d'emprunter à nouveau.
En 83-84, la dégringolade semble marquer une pause, mais comme on l'a vu plus haut, ce n'est qu'au prix de déficits pharamineux. De nouveau, une nouvelle fuite internationale devant le dollar fait trembler le système monétaire international ; en un moi s, le prix du dollar perd en volume (nominal, bien sûr) ce qu'il avait mis six mois à gagner, l'inflation double presque (de 3,5% à 5,5%). Seule solution, les autorités américaines sont obligées à nouveau de hausser les taux d'intérêts et la récession menace à nouveau.
Cette menace ou plutôt cette réalité d'une nouvelle vague de récession aux conséquences encore difficilement calculables (mais que nous laissent imaginer le début# des années 80) et les conditions dans lesquelles elle s'annonce va venir mordre encore plus profondément dans la chair de l'humanité alors que partout dans le monde le champ d'activité du capital se rétrécit de plus en plus.
D'ailleurs la bourgeoisie ne se fait pas d'illusion sur la perspective des mois à venir et c'est à un nouveau choc extrêmement violent qu'elle se prépare. L'attitude du capital aux USA est, à cet égard extrêmement significative. Ces deux dernières années, et ces derniers mois en particulier, on a pu assister aux USA à une considérable accélération de la concentration du capital, financée en grande partie par l'afflux des capitaux étrangers. Mais cette concentration n'a rien à voir avec la concentration du capital qui correspond à une extension de l'activité du capital telle qu1 elle se développe dans les phases d'expansion. Cette concentration, nourrie par un empirisme comme seul le capital peut se le permettre, est l'expression d'une bête blessée à mort qui concentre ses dernières forces en un seul point. La meilleure preuve que nous puissions mettre en avant pour démontrer ce que nous avançons, c'est que la plus grande concentration d'entreprises a eu lieu aux USA dans les industries les plus touchées par la crise de surproduction mondiale : l'industrie du pétrole et celle du bâtiment.
"Quatre ans plus tard, (que 1977), les opérations de fusion sont près de quatorze fois plus importantes et représentent 82.000 millions de dollars. Cette année là, le seul rachat de Conoco (9ème compagnie pétrolière américaine) par Dupont de Nemours (première société chimique) met en jeu 73 milliards de dollars, soit une somme supérieure à la valeur totale des fusions effectuées en 1977V (bilan économique et social 83 "Le Monde").
Ainsi, pour faire face à une chute vertigineuse des taux de profit, et surtout en préparation des prochains chocs, les industries américaines rassemblent leurs dernières forces et rien que cela laisse exsangue le reste du monde qui ressemble de plus en plus à un pantin disloqué, à un corps dont le sang reflue et quitte peu à peu tous les membres pour les laisser engourdis et glacés.
Le déficit commercial américain permet encore pour quelques mois à l'Europe et au Japon de maintenir un certain niveau d'activité. Mais là aussi à quel prix : non seulement celui du déficit commercial américain, mais aussi le prix du dollar, qui est colossal, et, malgré cela, la bagarre pour maintenir un niveau suffisant d'exportation nécessite pour l'Europe déjà à genoux d'asséner des coups de hache et un sabrage des conditions ouvrières sans précédents.
C'est dans ces conditions qu'un nouvel assaut de la récession mondiale qui dégonflera, cette fois -ci, complètement la baudruche de la "reprise" aux USA, se prépare. Quand et comment ? Cela est difficile à dire, mais on peut raisonnablement penser que celle-ci se développera au lendemain des élections aux USA (novembre 84).
Mais qu'importe la date du nouvel assaut, ce qui est certain c'est son proche avenir, et surtout les caractéristiques de la situation mondiale qu' il impliquera et dont les premières années 80, les mois que nous vivons aujourd'hui, nous ont donné un avant-goût.
La dynamite de l'inflation accumulée dans les déficits, concentrée au sein de la puissance économique sur laquelle repose l'économie mondiale donne la mesure de la puissance de la nouvelle vague de récession à venir. La dernière vague de récession a propulsé les taux de chômage à des niveaux record, atteignant dans certains pays des taux sans précédents depuis la veille de la seconde guerre mondiale, (en moyenne pour les pays développés, 12% de la population active). Pour les mois et les années à venir, le taux de chômage qui a presque doublé en seulement trois ans, est encore appelé à doubler, voire tripler, c'est à dire atteindre 20 ou 30% de la population active.
Les chiffres donnés en perspective par l'OCDE en 83 étaient déjà très pessimistes et encore tablaient sur la "reprise internationale" :
"On y apprenait notamment que, pour maintenir le chômage à son niveau actuel, en fonction de l'augmentation prévisible de la population active, il faudrait créer de dix huit à vingt millions d'emplois d'ici la fin de la décennie. De plus les experts de l'OCDE estimaient qu'il faudrait encore quinze millions d'emplois supplémentaires si on voulait revenir au niveau de chômage de 1979, soit dix-neuf millions de personnes sans travail.
Au total, ajoutaient-ils, cela reviendrait à créer 20.000 emplois par jour entre 84 et 89, alors que, après le premier choc pétrolier, entre 1975 et 1980, les 24 pays membres n'en avaient dégagé que 11.500 quotidiennement. S'ensuivaient des prévisions très pessimistes, tablant sur 34,75 millions de chômeurs en 1984, dont 19,75 pour l'Europe et 2,45 pour la France." (Rapport de l'OCDE 1983).
Mais plus encore que le nombre absolu de chômeurs, les caractéristiques et les conditions dans lesquelles le chômage se développe de façon accélérée sont significatifs de l'ampleur de la crise. Les allocations sont réduites aux portions les plus congrues, quand elles ne sont pas tout simplement supprimées. Le chômage touche les plus larges fractions de la classe ouvrière, bien que les "jeunes" et les immigrés en subissent encore la plus forte pression ; d'autre part sa durée est de plus en plus longue et sans issue pour des milliers de personnes.
A la suite de son rapport, l'OCDE ne manquait d'ailleurs pas de mentionner certains de ces aspects, et d'en tirer des conclusions :
"Au delà du tollé que provoqua cette projection, l'OCDE mettait en lumière les caractéristiques profondes du chômage...Un premier élément concerne l'allongement de la durée du chômage, qui prive d'activité une part de plus en plus importante de la population. On constate, un peu partout, le découragement des chômeurs de longue durée. Ceux-ci en viennent à prendre des "petits boulots" ou des emplois d'attente, ou pis, à ne même plus se déclarer comme demandeurs d'emplois. Cette situation, à tous égards est lourde de risques sociaux." (idem) .
Le chômage est à la pointe de l'attaque du capitalisme contre la classe ouvrière. En lui, il résume toute la condition ouvrière, il est l'expression au niveau humain de la surproduction, de la surproduction de la force de travail, de la condition de marchandise, chair à travail et à canon. D'autre part, si la crise historique du capitalisme conduit à une paupérisation absolue ([3] [179]) de la 'classe ouvrière, elle opère aussi, et cet aspect est fondamental, une modification des structures de classe de la société telles qu'elles ont pu être modelées dans les périodes de croissance et d'expansion du capital.
Stratification de la classe ouvrière entre plusieurs couches d'ouvriers qualifiés et non qualifiés, entre cols bleus et cols blancs, entre immigrés et non-immigrés. Possibilité pour certaines fractions, couches d'ouvriers les plus qualifiés d'atteindre après des années "d'efforts" une situation qui les rapproche par leurs conditions de couches moyennes, par l'accession aux emplois d'encadrement ou de maîtrise pour eux-mêmes, par l'accession aux emplois de cols blancs, le plus souvent ceux de techniciens pour eux ou leurs enfants. Avec la crise, telle qu'elle se déroule sous nos yeux, tout cela est fini. Ce n'est plus vers le haut que le regard de la classe ouvrière se tourne, mais effrayé, vers le bas, où tout ce qui hier apparaissait encore comme distinction disparaît. Dans ce processus qui se déroule sous nos yeux de façon accélérée, le chômage joue un puissant rôle, et en particulier quand il menace d'atteindre 20 à 30% de la population active. De plus au travers du chômage, les couches moyennes sont déchirées, et rejoignent les rangs de la classe ouvrière dans ce que sa condition a de plus misérable.
Ce n'est pas là une simple projection que nous faisons, mais la description d'un processus qui se déroule concrètement, sous nos yeux, processus qui non seulement met face à face les classes sociales, mais distingue nettement leurs intérêts irréductibles. Cette réalité balaie radicalement l'écran de fumée constitué par la formation de couches moyennes particulièrement gonflée dans l'époque "keynésienne" ainsi que toutes les théories sur l'aristocratie ouvrière.
CONCLUSIONS
1- Le rapide tableau, encore limité et imprécis, du bilan économique des premières années de la décennie 80 et des perspectives pour les années à venir, établit en partie les conditions dans lesquelles la lutte de classe, et sa nouvelle impulsion qui se manifeste aujourd'hui dans tous les pays va s'affronter à la classe dominante. Rosa Luxembourg déclarait à juste raison que "pour que la révolution ait lieu, il faut que le champ social soit labouré de fond en comble, il faut que ce qui était enfoui profondément monte à la surface, que ce qui était à la surface soit enfoui profondément." (Grèves de masses, parti et syndicats).
Cette tâche là, l'unité de la lutte de classe, de l'expérience de la classe ouvrière et d'une crise économique sans précédents est en train de l'accomplir... La paupérisation rapide et absolue qu'opère la crise économique pousse la classe ouvrière avant de pouvoir plonger son regard dans l'avenir,à se plonger dans son passé, et là, c'est soixante dix ans de décadence qu'elle peut contempler.
2-Nous avons consacré une longue partie à l'ana lyse de la situation du capital aux USA dans la me sure où,comme nous l'avons dit, cette économie qui représente 45% de la production des pays occidentaux et un quart de la production mondiale détermine l'évolution du reste de l'économie mondiale. Mais ce n'est pas tout ; il est un autre aspect dans la profonde crise que traversent les USA qui est extrêmement important du point de vue historique : ce n'est que grâce au capitalisme aux USA, qui s'est développé en pleine période de décadence, avec toutes ses caractéristiques (capitalisme d'Etat, militarisme) , au début grâce à un marché extra-capitaliste intérieur immense, ensuite grâce à la guerre mondiale qui a éliminé ses rivaux, que l'Europe en pleine décrépitude, totalement épuisée par deux guerres mondiales, a pu se maintenir depuis les années du milieu de ce siècle : par sa reconstruction capitaliste de 45 aux années 60, pendant la décennie des années 70 où les USA ont joué un rôle de locomotive mondiale, et d'une certaine manière en 83-84 où seul l'immense déficit commercial américain lui permet de ne pas s'effondrer complètement.
Aujourd'hui, cette période est complètement révolue, du point de vue tant idéologique qu'économique. Les USA ne peuvent plus jouer un rôle d'appui matériel, ni celui, idéologique, de faire croire à un développement infini et prospère du capitalisme au travers du "rêve américain", lequel est devenu un véritable cauchemar.
3-La dernière conclusion de cette partie consacrée à la crise de 1'économie nous amène à critiquer un point de vue que nous avons été amenés à mettre en avant en particulier dans le rapport dout le 5ème Congrès de RI ([4] [180]) selon lequel la fin des années 70 signait la fin des politiques d'endettement. Le CCI avait tout à fait raison de dire que les années 80 marquaient la faillite de toutes les politiques keynésiennes de fuite en avant qui avaient marqué les années précédentes, mais de là à en tirer la conclusion que c'était la fin de l'endettement pour le capitalisme, il y avait un pas à ne pas franchir.
La réalité s'est d'ailleurs chargée elle-même de rectifier cette vision erronée. En l'espace de deux ans, tant dans les pays les plus développés (USA) que dans les pays sous-développés, l'endettement sous les forme:; diverses que nous avons décrites plus haut n'a pas seulement "augmenté" mais il a été multiplié par 2,3 ou 4 par rapport à celui accumulé durant une période de dix ou vingt ans.
Cette situation est liée à la nature more de la crise du capitalisme, la crise de surproduction et à l'incapacité d'assumer un processus d'accumulation sans lequel le capital n'existe pas et ne peut exister.
Nous devons distinguer, et c'est cela qui était la préoccupation du CCI au début des années 80, l'endettement tel qu'il s'est développé par exemple dans les années 70 et celui de la situation actuelle. Dans la première période, malgré une large part de déficit dû à l'armement, l'endettement mondial a permis un certain niveau d'accumulation et d'expansion. Mais les années 80 ont largement illustré comment cette tendance générale du capitalisme décadent à substituer à son processus d'accumulation de capital une accumulation d'armement s'amplifie. C'est ainsi que les déficits colossaux, bien supérieurs à ceux des années 70 ont pour l'essentiel eu pour terrain d'investissement l'armement.
Ce n'est un secret pour personne que le déficit du budget américain est en rapport exact avec l'accroissement pharamineux des armements. Les capitaux fuient l'Europe pour participer à l'effort de guerre du bloc occidental, les missiles les remplacent. Partout ailleurs, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique du Sud, les "aides" au développement sont remplacées par une accumulation d'armes gigantesques. Aux USA même, à la caution de la force économique, se substitue la caution de la force militaire. C'est ce que Reagan appelle "retrouver la force, la puissance de l'Amérique". Pantin stupide !
Aujourd'hui se manifeste clairement et avec une acuité sans précédent comment la crise du capitalisme, la crise de surproduction, l'impossibilité de continuer un processus d'accumulation entraîne impitoyablement et immanquablement un processus d'autodestruction du capital. Autodestruction non pas du capitalisme, mais du capital et de l'existence de centaines de millions d'êtres humains qu'il a attachés au char de son esclavage.
Cette question de l'autodestruction du capital n'est pas une simple question d'"intérêt théorique'. C'est une question fondamentale, pour plusieurs raisons :
-parce qu'elle illustre et explicite les rapports entre la crise historique du capitalisme et la guerre;
-parce qu'elle montre qu'il ne suffit pas de dire que la crise"joue en faveur du prolétariat". En effet, nous avons eu à combattre pendant des années les conceptions qui ne voyaient la révolution prolétarienne que comme une affaire de volonté, bref, toutes les conceptions idéalistes. Aujourd'hui que la crise est manifeste et se livre sans fard, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur inverse et penser que, de toutes façons la crise est là et qu'elle se transformera nécessairement en révolution sociale. Cette conception est aussi fausse que la première. Nous devons combattre, en nous appuyant sur les faits historiques et présents, 1'idée que la crise du capitalisme, la crise de surproduction se présenterait comme une simple accumulation de biens, invendus et invendables, que cette surproduction liée à une baisse profonde des taux de profit mènerait le capitalisme à s'effondrer de lui-même et qu'ainsi le prolétariat n'aurait qu'à cueillir la révolution comme on cueille une fleur.
Cette vision est fausse et les années 80 que nous avons déjà vécues l'illustrent amplement.
RI.juillet 1984
[1] [181] Pour les orientations du rapport sur les autres points, adoptées à ce Congrès, se reporter à la Résolution sur la situation internationale publiée dans Révolution Internationale n°123, août 1984.
[2] [182] "Le nombre des faillites continue d'être très élevé et jamais les banques américaines n'ont enregistré des pertes aussi importantes que celles qu'elles essuyaient encore pendant la deuxième partie de 1983. Plusieurs d'entre elles ont dû, en conséquence, déposer leur bilan".("Le Monde de l'année économique et sociale-bilan 83", p.11).
[3] [183] Où sont-ils aujourd'hui ces fervents critiques de Marx, qui soumettaient à la critique la plus virulente la notion de paupérisation. Cela, sans jamais d'ailleurs distinguer ce qui était, dans la notion de paupérisation, paupérisation absolue ou paupérisation relative. Non seulement aujourd'hui la paupérisation relative de la classe ouvrière s'est développée de manière accrue par le développement de la productivité, mais de plus celle-ci s'ajoute et se confond par ailleurs à une paupérisation absolue qui chaque jour s'accroît sans cesse. Jamais l'histoire n'a autant donné raison à ce Marx qu'on prétend dépassé et qui déclarait : " le capitalisme est né dans le sang, la boue et les larmes, il finira dans la boue, le sang et les larmes."
[4] [184] Revue Internationale n°31,
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Polémique avec la CWO : comment se réapproprier les apports de la gauche communiste internationale
- 3289 lectures
L'histoire du mouvement ouvrier n'est pas seulement l'histoire des grandes batailles révolutionnaires. Lorsque des millions de prolétaires se lancent "à l'assaut du ciel", elle n'est pas seulement deux siècles de résistance permanente, de grèves, de combats inégaux et incessants pour limiter la brutalité de l'oppression du capital. L'histoire du mouvement ouvrier c'est aussi celle de ses organisations politiques, les organisations communistes. La façon dont celles-ci se sont constituées, divisées, regroupées, les débats théoriques-politiques qui les ont toujours traversées comme un sang qui nourrit la passion révolutionnaire, tout cela appartient non pas aux individus particuliers qui les constituent mais à la vie de l'ensemble de la classe. Les organisations politiques prolétariennes ne sont qu'une partie du prolétariat. Leur vie est partie de celle du prolétariat.
Comprendre la vie de la classe révolutionnaire, son histoire, son devenir historique, c'est aussi comprendre la vie des organisations communistes, leur histoire.
L'article que nous publions ci-dessous -une polémique avec la Communist Workers Organisation (CWO) a propos de l'histoire des organisations communistes entre les années 20 et les années 50 - ne répond pas à des soucis académistes d'historiens universitaires, mais à la nécessité pour les révolutionnaires de notre époque de fonder leurs orientations politiques sur le solide granit de l'expérience historique de leur classe.
Pour différentes que soient les années 80 des années 20, l'essentiel des problèmes auxquels se trouvent confrontés les combats prolétariens d'aujourd’hui est le même que pendant les années 20. La compréhension des tendances historiques du capitalisme (décadence, impérialisme), la validité pour le prolétariat des formes de combat syndicalistes ou parlementaires, des luttes de libération nationale, la dynamique de la grève de masse, le rôle des organisations révolutionnaires, toutes ces questions sont au coeur des analyses et prises de position des organisations communistes aussi bien pendant les années 20 (marquées par les révolutions russe et allemande), que pendant les années 30 (marquées par le triomphe de la contre-révolution et l'embrigadement du prolétariat), les années 40 (années de la guerre impérialiste mondiale), que pendant les années 50, au temps du début de la reconstruction.
Pour une organisation politique, ignorer les apports successifs des différents courants du mouvement ouvrier pendant ces années, ou pire, en falsifier la réalité, en déformer le contenu, en altérer l'histoire avec le dérisoire objectif de se dessiner un plus bel arbre généalogique, c'est non seulement tourner le dos à toute rigueur méthodologique -instrument indispensable de la pensée marxiste- mais c'est en outre désarmer la classe ouvrière, entraver le processus qui la conduit à se réapproprier sa propre expérience historique.
C'est à un exercice de ce style que s'est livrée la CWO dans le No 21 de sa publication théorique 9 Revolutionary Perspectives (R.P).
On y trouve un article qui se veut une critique de notre brochure consacrée à l'histoire de La Gauche Communiste d'Italie. La CWO nous avait déjà habitués à des manifestations de son manque de sérieux : pendant des années, elle dénonçait le CCI comme force contre-révolutionnaire parce que nous avons toujours affirmé qu'il y avait encore une vie prolétarienne au sein de l'Internationale Communiste au delà de 1921 (Kronstadt), jusqu'en 1926 (adoption du "socialisme dans un seul pays"). Encore dans le No 21 de R.P., la CWO accuse, avec toujours aussi peu de sérieux, le CCI de défendre des positions "euro-chauvines", ce qui, s'il y avait la moindre rigueur dans la pensée de la CWO, devrait nous exclure ipso facto du camp révolutionnaire.
C'est avec cette même légèreté irresponsable que la CWO a fait de notre brochure une lecture selon une méthode d'échantillonnage de type Gallup : on lit une page sur dix. La critique que cette lecture prétend fonder a en réalité un objectif à peine caché : minimiser sinon effacer de l'histoire du mouvement ouvrier l'apport spécifique -et irremplaçable- des groupes qui ont publié Bilan puis Internationalisme ; c'est-à-dire, éliminer de l'histoire du mouvement ouvrier les courants de la gauche communiste autres que ceux dont se réclament spécifiquement la CWO et son organisation soeur, le Parti Communiste Internationaliste (Battaglia Comunista).
L'article qui suit, en répondant, s'attache non seulement à rétablir certaines vérités historiques, mais encore à montrer comment les organisations révolutionnaires doivent envisager, comprendre, intégrer et dépasse critiquement les apports successifs de l'ensemble du mouvement communiste et plus particulièrement ceux de la Gauche Communiste Internationale.
- "Le CCI aime se présenter comme la fusion des meilleurs éléments de la gauche allemande (KAPD) et de la gauche italienne, regrettant que l'attitude sectaire de Bordiga les ait empêchés de s'unir contre l'opportunisme du Komintern (...l'idée du CCI selon laquelle seul le sectarisme empêcha la fusion entre la gauche italienne et la gauche allemande contre le Komintern et qu'une fusion similaire est nécessaire aujourd'hui pour la formation d'un nouveau parti, est sapée par leur propre dire) " (R.P. n°21).
Ces extraits montrent clairement dans quelles confusions de départ la CWO s'attache à embrouiller la motivation des différents parcours à travers lesquels s'est historiquement exprimée la Gauche communiste. D'après la CWO le CCI aurait voulu une fusion politique et organisationnelle entre la Gauche italienne et la Gauche allemande dans un front unique contre l'I.C. On ne sait vraiment pas d'où les camarades peuvent tirer une telle bêtise. Même un enfant comprendrait que proposer une telle fusion à une telle époque aurait été une folie. Ceci non seulement parce que la Gauche italienne n'aurait de son côté jamais accepté de s'unir avec une tendance qui condamnait les syndicats et le travail dans les syndicats (même si par ailleurs cette dernière préconisait un néo-syndicalisme "révolutionnaire" sous la forme des "unions") et arrivait par ailleurs sur quelques autres points à remettre parfois en cause l'importance du rôle du parti de classe. Mais aussi parce que la Gauche allemande n'aurait jamais, de son côté, accepté de s'unir à une tendance qui ne comprenait pas l'intégration des syndicats dans l'appareil d'Etat et acceptait les yeux fermés le soutien de Lénine aux luttes de libération nationale. Ce qui était à l'ordre du jour, ce n'était pas une fusion aussi impossible qu'inutile mais une bataille commune contre la dégénérescence dénoncée par les deux tendances. Pour porter en avant avec clarté cette bataille commune, les différentes forces de gauche auraient été obligées de clarifier en premier lieu leurs divergences sur des questions cruciales comme les syndicats, les luttes de libération nationale, le parti. De cette façon, ces débats fondamentaux auraient pu se faire au sein de l'I.C. et non contre l'I.C. En l'absence de ce débat l'I.C. est passée à côté des questions essentielles, proposant des réponses qui n'allaient pas au fond des problèmes et qui ne permettaient pas de se défendre contre la dégénérescence.
Avec le reflux des luttes, la Gauche allemande -qui était plus l'expression d'une profonde poussée de luttes ouvrières que d'une clarté programmatique complète- fut ultérieurement incapable de contribuer à la clarification du programme prolétarien et se transforma rapidement en une myriade de petites sectes. Ce fut la Gauche d'Italie (GI), mieux armée du point de vue théorique, essentiellement sur la nécessité et la fonction de l'organisation des révolutionnaires, qui comprit les caractéristiques de la nouvelle période et qui porta en avant ce débat en terme de bilan que l'I.C. de Lénine n'avait pas réussi à faire et qui était nécessaire pour intégrer dans une solide perspective marxiste la profonde bien qu'incomplète intuition de la Gauche allemande (GA) :
- "Le programme international du prolétariat résultera du croisement idéologique -donc de l'expérience de classe de la révolution russe et des batailles des autres pays, particulièrement de l'Allemagne et de l'Italie (...). Car il est probable, que si dans certains domaines Lénine domine Luxemburg, il est évident que dans d'autres Rosa voit plus clair que celui-ci. Le prolétariat ne s'est pas trouvé dans des conditions permettant, comme en Russie, une clarification absolue des tâches révolutionnaires, mais par contre, évoluant face au capitalisme le plus avancé d'Europe, il ne pouvait pas ne pas percevoir certains problèmes mieux et plus profondément que les bolcheviks (...). Comprendre veut dire compléter des fondements trop étroits, non traversés par l'idéologie résultant des batailles de classe dans tous les pays,les compléter par des notions liées au cours historique dans son ensemble jusqu'à la révolution mondiale. Cela, l'Internationale de Lénine ne pouvait le faire. C'est à nous qu'incombe ce travail. " ("Deux époques : en marge d'un anniversaire" Bilan n°15, janvier 1935).
Quand la CWO se rappelle que le "Réveil Communiste", petit groupe de militants italiens qui avaient rejoint les positions du KAPD, finit dans le conseillisme puis dans le néant, elle ne fait que confirmer notre thèse centrale : qu'il n'était pas possible de fondre mécaniquement 50 % de Gauche italienne et 50 % de Gauche allemande. Il s'agissait au contraire d'ancrer dans un cadre marxiste conséquent "les problèmes que le prolétariat allemand a perçus mieux et de façon plus profonde que les bolcheviks". C'est cela que Bilan s'est donné comme tâche à accomplir.
L'histoire ne se fait pas avec des si. L'incapacité des Gauches Communistes d'imposer au centre du débat de l'I.C. les différents problèmes posés par la classe ouvrière à l'entrée du capitalisme dans la phase décadente, ne peut être imputée ni à Bordiga ni à Pannekoek. Cette incapacité est plutôt le fruit de l'immaturité avec laquelle le prolétariat mondial a affronte ce premier combat décisif, immaturité dont les "erreurs" de l'avant-garde révolutionnaire sont un reflet. Une fois l'occasion passée, le travail fut fait dans de terribles conditions de reflux de la lutte, par la GI et par elle seule parce qu'elle avait une position théorique adéquate pour remplir un tel rôle. Et c'est sur cette voie, la voie de Bilan, que la GI a intégré les contributions et expériences des différentes Gauches Communistes pour parvenir à "l'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale" ("Lettre de Bordiga à Korsch", , 1926). C'est grâce à ce travail de synthèse historique que la GI a réussi à "compléter des fondements trop étroits" et à tracer les grandes lignes du programme de la Gauche Communiste Internationale (GCI), valables encore aujourd'hui pour le prolétariat de tous les pays. L'accusation que la CWO nous porte (de vouloir aujourd'hui fusionner les différentes gauches) ne montre pas seulement son incapacité à distinguer une "gauche historique" d'une union mécanique, mais montre surtout son incapacité congénitale à comprendre que ce travail a déjà été fait et que ne pas en tenir compte signifie retourner en arrière de 60 ans. La conséquence est qu'hier la CWO ne réussissait pas à aller au delà des positions de la Gauche allemande des années 30 et qu'aujourd'hui elle retourne aux positions de la GI des années 20 et plus en arrière encore à celles de Lénine. Les positions changent, la régression reste.
Des années 30 aux années 40 : maintenir la barque dans la tempête
- "En fait pour le CCI,la GI est assimilée à une période d'exil, et c'est dans cette période que les vraies leçons de la vague révolutionnaire auraient été tirées. Quel point de vue pessimiste ! On rejette les périodes pendant lesquelles les idées communistes s'emparent des masses alors que l'on idéalise la période de défaite. Mais cette idéalisation de Bilan est déplacée. Il est certain que ces camarades ont fait des contributions importantes au programme communiste (...) mais ce serait stupide de nier les faiblesses de Bilan (...) sur la question des perspectives, le manque de bases économiques marxistes claires (Bilan était luxemburgiste) les a conduits à des visions erratiques et erronées sur le cours historique. Soutenant que la production d'armes était une solution à la crise capitaliste, ils n'ont pas compris le besoin d'une autre guerre impérialiste. (...) Bilan s'est dissout dans la revue Octobre en 1939 et la Fraction a formé un Bureau International pensant que la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour ; ainsi, ils furent totalement bouleversés quand la guerre éclata en 1939, conduisant à la dissolution de la Fraction dans son ensemble. Le CCI essaie de nier que tel était le point de vue de Bilan." (R.P n°21, p.30-31).
Ces extraits posent trois types de problèmes :
- 1) notre "idéalisation" de Bilan ;
- 2) le rôle des révolutionnaires dans les périodes de contre-révolution ;
- 3) la "faillite" finale de la Fraction Italienne à l'étranger.
Procédons par ordre. Premièrement, liquidons cette idée selon laquelle nous idéalisons Bilan : "Bilan n'avait pas la prétention stupide d'avoir apporté une réponse définitive à tous les problèmes de la révolution. Il avait conscience de balbutier souvent, il savait que les réponses définitives ne peuvent être que le résultat de l'expérience vivante de la lutte de classe, de la confrontation et de la discussion Sur bien des questions, la réponse donnée par Bilan restait insuffisante... Il ne s'agit pas de rendre hommage à ce petit groupe..., mais encore d'assimiler ce qu'il nous a légué en faisant nôtre son enseignement et son exemple, et de poursuivre cet effort avec une continuité qui n'est pas une stagnation, mais un dépassement." (Introduction aux textes de Bilan sur la Guerre d'Espagne, Revue Internationale n° 4 1976).
Telle a toujours été notre position. Il est vrai que dans ces années-là la CWO nous définissait comme contre-révolutionnaires justement parce que nous défendions la Gauche italienne aussi au-delà de 1921, année choisie par eux comme date magique au-delà de laquelle l'I.C. devenait réactionnaire. Ceci peut expliquer le peu d'attention avec laquelle la CWO lit aussi bien les textes de Bilan que nous avons republiés que nos introductions.
Passons au second point. Nous ne préférons pas les périodes de défaite à celles de lutte ouverte du prolétariat, mais nous ne nous réfugions pas derrière une telle banalité pour occulter le fait historique essentiel, à savoir que dans les années de la vague révolutionnaire, l'I.C. n'a pas réussi à faire tout le travail de clarification des nouvelles frontières de classe du programme prolétarien. Ce travail, pour l'essentiel, est revenu aux minorités révolutionnaires qui ont survécu à la dégénérescence. Il est sûr que nous aurions aimé aussi que cette synthèse fût faite quand les prolétaires allemands descendaient en armes dans les rues de Berlin, ceci non seulement parce qu'elle aurait été mieux faite, mais parce que cela aurait probablement donné une issue tout autre à la première vague révolutionnaire du prolétariat mondial. Malheureusement, l'histoire ne se fait pas avec des si et ce travail revint principalement à Bilan.
Si nous insistons tant sur le travail de la Fraction Italienne à l'étranger, ce n'est pas parce que nous préférons les années 30 aux années 20, mais parce que les groupes qui devraient en être les "continuateurs" (le PCInt artificiellement constitué à la fin de la guerre) l'ont recouverte d'un mur de silence, permettant ainsi qu'elle soit rayée de la mémoire historique du mouvement ouvrier. Si on regarde la presse de tous les groupes qui se réclament de la Gauche italienne (y compris Battaglia) on ne peut que rester stupéfait du fait qu'au cours de quarante années "le nombre d'articles repris de Bilan peut se compter sur les doigts d'une seule main" (Revue Internationale No 4). Encore aujourd'hui, après que le CCI en ait publié des centaines de pages en différentes langues auxquelles s'ajoute une étude critique de plus de deux cents pages, quelques uns de ces groupes continuent à faire semblant d'ignorer l'existence même de Bilan. Il faut donc a juste titre dire qu'il s'agit de la "politique de l'autruche" et que nous avions pleinement raison d'insister sur cela. Une fois clarifiés ces détails, il reste une question de fond, que la CWO dans son article n'a pas saisie : comment expliquer qu'une telle contribution au programme prolétarien ait été élaborée dans les années de défaite et de recul général et profond du mouvement autonome de classe ?
Dans la logique de la CWO il ne peut y avoir que deux réponses :
- soit nier ou minimiser la contribution théorique de la Fraction italienne de la Gauche communiste du fait que son travail s'est fait dans une période de défaite et dans un cours vers la guerre, c'est ce que font couramment la CWO et Battaglia, ainsi que le PCInt (Programme communiste) ;
- soit reconnaître cette contribution comme illustration de l'idée que la conscience communiste ne naît pas des luttes, mais de l'organisation révolutionnaire qui, nécessairement, doit l'introduire de l'extérieur au sein de la classe ouvrière.
De telles réponses n'expliquent rien et montrent seulement une conception mécanique de l'influence de la lutte de classe sur la réflexion des minorités révolutionnaires. Avec une telle conception, l'unique expérience sur laquelle Bilan aurait pu compter ce sont les défaites des années 30. Mais les origines de Bilan ne se trouvent pas dans les années 30. Elles se trouvent "à l'époque où les idées communistes s'emparaient des masses". Ses militants ne se sont pas formés à la queue des Fronts Populaires, mais à la tête des mouvements révolutionnaires de masse des années 20. Ce qui permet à Bilan de continuer à contre-courant l'approfondissement des positions révolutionnaires, c'est la confiance inébranlable dans la capacité révolutionnaire de la classe ouvrière, confiance acquise non à travers quelques lectures mais dans la participation de militants à la plus grande tentative de cette classe d'instaurer une société sans classes. De ce point de vue, le travail théorique des fractions de gauche n'est absolument pas indépendant ou séparé des expériences historiques des masses prolétariennes. Non seulement le travail de Bilan se fait sous la poussée de la vague révolutionnaire précédente, mais il n'aurait aucun sens en dehors de la perspective d'une nouvelle vague. La preuve a contrario de l'influence très étroite mais non immédiatiste que le mouvement de classe exerce sur la réflexion des révolutionnaires nous est donnée par le fait que la plus grande stagnation des minorités révolutionnaires n'a pas lieu dans les années 30, mais dans les années 50, parce que la bourgeoisie avait réussi à terminer la seconde guerre mondiale sans qu'il y ait eu surgissement d'une nouvelle vague révolutionnaire et que la poussée de la vague précédente était érodée par trente années de contre-révolution.
Nous nous rendons compte qu'une telle conception de l'approfondissement de la conscience de classe, à travers un parcours complexe, non rectiligne, parfois hésitant, est dur à digérer ; mais c'est la seule conception fidèle à la méthode marxiste qui la sous-tend. Il est sans doute plus simple d'imaginer que le parti élabore par lui-même, de son côté, un beau programme tout propre et que, quand le moment arrive, il l'envoie à la classe ouvrière comme une lettre à la poste. Rêver ne coûte rien.
Il reste la dernière question, celle de la faillite de la Fraction du fait de la théorie de Vercesi sur l'économie de guerre qui rendait inutile une nouvelle guerre impérialiste. En premier lieu, nous notons qu'il s'agit d'une nouvelle orientation développée de 1937 à 1939 et qui contredisait toute la perspective affirmée depuis 1928 d'un rapport de force défavorable au prolétariat et s'orientant vers un nouveau conflit mondial. En second lieu, cette position n'était pas la seule existante dans la Gauche Communiste Internationale. Cette analyse fut violemment critiquée par une majorité de la Fraction belge et par une importante minorité de la Fraction italienne. Le résultat de cette bataille fut qu'avec l'éclatement de la guerre la Fraction ne s'est pas dissoute définitivement, comme cherche a le faire croire la CWO, mais fut reconstituée par la minorité regroupée à Marseille, dans le sud de la France non occupé par les Allemands. Le travail s'est poursuivi régulièrement pendant toute la guerre avec une systématisation et un approfondissement remarquables des positions programmatiques. A partir de 1941, se tinrent des conférences annuelles dont sortit entre autres, la condamnation des théories révisionnistes de Vercesi sur l'économie de guerre ("Déclaration politique", mai 1944). Quand la Fraction apprit que le déboussolement de Vercesi avait fini par le conduire à participer à un comité anti-fasciste à Bruxelles, elle réagit immédiatement en l'expulsant pour indignité politique ("Résolution sur le cas Vercesi", janvier 1945). Comme on le voit, la Fraction n'a pas cessé le travail en suivant Vercesi mais l'a poursuivi en expulsant celui-ci.
Notons au passage que la CWO fait la nième pathétique tentative de soutenir une de ses idées fixes, à savoir que ceux qui, comme le CCI, défendent la théorie économique de Luxemburg sur la saturation des marchés ne peuvent maintenir une ligne politique révolutionnaire. Mettons alors au clair que Bilan n'était pas luxemburgiste, au sens strict, mais se limitait surtout à accepter les conséquences politiques des analyses économiques de Rosa (rejet des luttes de libération nationale, etc.). Ce n'est pas un hasard si la défense de ces analyses économiques revient pour une grande part à des camarades provenant d'autres groupes révolutionnaires, comme Mitchell (ex-Ligue des Communistes Internationalistes) ou Marco (ex-Union Communiste). Le luxemburgiste Mitchell sera le chef de file de la critique aux théories révisionnistes de Vercesi avant la guerre, et ce sera le luxemburgiste Marco qui, pendant la guerre, corrigera les points les plus faibles de l'analyse économique de Rosa. Que démontre cela ? Que seuls des luxemburgistes peuvent être des marxistes cohérents? Non, comme le prouve la présence de camarades non luxemburgistes à côté de Mitchell et de Marco. Alors ? Alors, cela montre que la CWO doit arrêter de cacher des faits essentiels derrière des questions secondaires.
Et ceci nous amène au fait essentiel, à savoir que la CWO dans son compte-rendu a carrément fait disparaître six années d'existence de la Fraction (et quelles années : celles de la guerre impérialiste). De façon significative, la même opération désinvolte fut faite par Programma Comunista quand il fut finalement contraint de parler de la Fraction, provoquant de notre part la réponse qu'aujourd'hui nous adressons à la CWO :
- "L'article parle de l'activité de la Fraction de 30 à 40. Passant complètement sous silence son existence et activité entre 1940 et 1945, date de sa dissolution. Est-ce par simple ignorance ou pour s'éviter d'être obligé de faire une comparaison entre les positions défendues par la Fraction pendant la guerre et celles du PCInt constitué en 1943-44 ?" (Revue Internationale No 32, 1983).
Etant donné que notre étude sur la GI consacre pour le moins 17 pages à l'activité de la Fraction entre 1939 et 45, ce n'est pas d'ignorance qu'il faut accuser la CWO, mais de cécité. Pour la CWO aussi, il s'agit de la politique de l'autruche.
Des années 40 aux années 50 :
UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIERE.
"Le CCI présente la formation du PCInt comme une régression par rapport à Bilan, idéalisé dans leur presse. Mais pourquoi était-ce un pas en arrière? Selon le rédacteur, 'la gauche italienne avait dégénéré profondément après 1945, jusqu'à se fossiliser complètement', (p. 186). Mais était-ce réellement une fossilisation que d'engager des milliers de travailleurs dans la politique révolutionnaire après les grandes grèves de 1943 ? Et que dire de la plateforme du Parti, publiée en 52? Représentait-elle un pas en arrière ? (...) Et sur la guerre après les confusions et prévarications de Bilan, les positions (du PCInt) constituaient sans aucun doute un pas en avant, (...) en avance sur les théories sur la disparition du prolétariat durant la guerre impérialiste". (Revolutionary Perspectives, n°21, p.31).
- "Quand le 'PCInt fut formé en 1943, les ancêtres du CCI (Internationalisme) refusaient de s'y joindre non seulement parce qu'ils pensaient que les bases théoriques du nouveau Parti étaient peu solides mais aussi parce qu'ils (.. .) croyaient qu'une nouvelle guerre allait éclater à cette époque et concluaient qu'il n'y avait rien à faire '.Quand le capitalisme 'termine' une guerre impérialiste qui a duré 6 ans sans qu'explose aucun surgissement révolutionnaire, cela signifie la défaite du prolétariat". (Internationalisme 1946) (R.P n°20, p.35). "En fait, la Fraction française, qui publiait Internationalisme, fut exclue de la Gauche Communiste pour avoir publié un tract commun avec deux groupes trotskystes français pour le 1er mai 1945.. .." {R.P., No 21, p.31).
Au lieu de procéder par argumentation politique, la CWO semble adopter la technique des spots publicitaires, dans lesquels la propreté des draps lavés avec une super lessive se démontre en les plaçant à côté de draps sales lavés avec une lessive ordinaire. Que prend-on comme point de référence pour déterminer si le PCInt représente un pas en avant ou un pas en arrière ? La théorie révisionniste de Vercesi qui en arrivait à nier toute activité révolutionnaire pendant la guerre, étant donnée "l'inexistence sociale" du prolétariat ! Qu'offre-t-on comme seule alternative ? Un petit groupe qui flirte avec les trotskystes, qui déclare inutile toute activité révolutionnaire et, dans les faits, suspend ses publications en 52 ! Face à ce désolant tableau de "nuit noire", il est trop facile de faire paraître les positions du PCInt brillantes de clarté.
Mais combien de falsifications et d'omissions ont été nécessaires pour faire ce spot publicitaire ? Pour mettre en avant l'activité du PCInt à partir du milieu de la guerre, ils font disparaître 6 années d'activité de la Fraction italienne à partir du début de la guerre et jusqu'à sa conclusion. On identifie la Gauche italienne avec les dernières positions de Vercesi, alors qu'au cours de la guerre, la tendance Vercesi fut d'abord combattue, puis condamnée, enfin expulsée. Toujours dans le but d'effacer toute l'activité de la Gauche Communiste Internationale durant la guerre, on porte ensuite l'attaque la plus féroce contre la Gauche Communiste de France (constituée à partir de 1942) qui fut la plus ardente à soutenir cette activité et la lutte contre Vercesi. Ici, la CWO n'a pas honte d'utiliser les mêmes falsifications que Vercesi, responsable du travail international du PCInt à partir de 1945, pour exclure cette tendance combative de la Gauche Communiste Internationale.
En réalité le RKD allemand et les CR français ([1] [185]), les deux groupes prolétariens avec lesquels Internationalisme diffuse un appel à la fraternisation prolétarienne, rédigé en plusieurs langues, avaient déjà rompu en 1941 avec le trotskysme et maintenu une attitude internationaliste pendant la guerre, comme le prouve totalement la documentation dans la brochure aux pages 153 et 154. Quant au soi-disant refus de toute activité de la part d'Internationalisme après 1945, la CWO devrait nous expliquer comment est-ce possible que la seule force de la gauche communiste présente dans la fameuse grève sauvage de 1947 à Renault et dans son comité de grève, ce fut précisément la Gauche Communiste de France, tandis que la fraction française "bis", liée au PCInt, brillait par son total désintérêt envers le seul mouvement significatif du prolétariat dans le second après-guerre. Même sans se faire d'illusions sur une quelconque possibilité de révolution, les camarades d'Internationalisme n'ont jamais manqué à leurs tâches de militants communistes. C'est ainsi que la GCF a participé activement à la Conférence Internationale de 1947 convoquée par la gauche hollandaise, a publié 12 numéros du journal mensuel "L'Etincelle" et 48 numéros de sa revue "Internationalisme". Sa dissolution en 1952 avait pour raison la dispersion extrême de ses membres (La Réunion, Amérique du Sud, Etats-Unis, Paris où très peu de membres étaient restés), ce qui rendit matériellement impossible la continuation de son existence et la poursuite de son activité.
En vérité, il n'est ni intéressant, ni utile de suivre la CWO dans toutes ses contorsions. Dans R.P n°20, on cite la reconnaissance de "positions claires envers les partisans" du PCInt, faite par nous à la page 170 de la brochure, pour démontrer que, quand nous parlons de déboussolement du PCInt vis-à-vis des partisans, nous mentons en sachant que nous mentons. Mais pourquoi la CWO ne cite-t-elle pas aussi la page 171, où nous montrons le changement de ligne opéré en 1944 et la page 177 ou un dirigeant du PCInt reconnaît à quels désastreux résultats a abouti, en 1945, ce changement ? La CWO ne lit-elle qu'une page sur 10 ? Il est en tout cas certain qu'elle choisit soigneusement chaque page à lire et à citer... Mais cela ne suffit pas. Dans R.P n°21, on cite les discussions d'Internationalisme avec "Socialisme ou Barbarie" comme preuve de son caractère opportuniste. Dans le numéro précédent de R.P, on présentait par contre les discussions de Battaglia Comunista avec Socialisme ou Barbarie comme une preuve du caractère "vivant et non sectaire" de B.C. La même action est utilisée comme preuve d'esprit révolutionnaire lorsqu'elle est le fait de B.C, et comme preuve d'esprit éclectique lorsqu'elle est le fait d'Internationalisme ! Comment répondre sérieusement à de tels arguments ?
Nous n'idéalisons pas plus Internationalisme que Bilan. Nous savons bien combien il a "balbutié" dans son effort permanent de clarification des positions de classe. C'est pour cela que nous ne nous limitons pas à nous les remémorer, mais essayons de les approfondir, sans avoir peur de les dépasser de façon critique, quand c'est nécessaire. Cela ne nous embarrasse nullement de reconnaître que certaines de ces erreurs, qui ont conduit à la dispersion géographique des militants ont contribué à rendre impossible le maintien d'une presse régulière, ce qui fut un grave coup pour l'ensemble du milieu révolutionnaire. La CWO pense au contraire que l'arrêt des publications en 1952 était simplement la démonstration définitive du manque de sérieux d'Internationalisme. En procédant ainsi, la CWO donne le bâton pour se faire battre. La CWO devrait en fait nous expliquer comment et pourquoi la fraction belge et la fraction 'française-Bis’, liée au PCInt, ont suspendu leurs publications dès 1949 (et donc 3 ans avant Internationalisme) sans que le parti italien "fort de milliers de militants" ait remué le petit doigt pour l'empêcher? Comment est-il possible qu'un petit groupe, qui ne pensait à autre chose qu'à s'échapper en Amérique du Sud, ait réussi à résister à contre courant pendant des années, alors que les représentants du PCInt à l'étranger avaient déjà jeté l'éponge ? A la CWO de répondre... En attendant que la CWO s'interroge sur ces "mystérieux" événements, revenons au problème essentiel: le PCInt est-il, oui ou non, une régression par rapport à la Fraction à l'étranger ? Nous avons déjà vu que la Fraction à l'étranger est restée active jusqu'en 1945, clarifiant ultérieurement de nombreux problèmes laissés en suspens par Bilan (par exemple, la nature contre révolutionnaire, capitaliste et impérialiste de l'Etat russe). Nous avons aussi vu comment la Gauche Communiste de France s'est constituée dans la poussée du dernier grand effort de la Fraction italienne, comment elle en a été partie active et le prolongement après la dissolution de la Fraction italienne. Passons maintenant à l'examen de l'autre élément de la comparaison : le PCInt fondé en Italie en 1943.
A première vue, on ne peut que rester abasourdi par la présentation qu'en fait la CWO : non seulement les positions du PCInt étaient parfaitement claires - voir la plateforme de 1952 - mais, en outre, il disposait de milliers d'adhérents ouvriers. Cela apparaît évidemment comme un beau pas en avant par rapport aux "balbutiements" de quelques dizaines d'émigrés à l'étranger ! Mais pour peu qu'on examine ce "pas" avec attention, on remarque immédiatement les premières notes discordantes : pourquoi écrire une plateforme seulement en 1952 alors que le PCInt avait été fondé 10 ans auparavant et que dès 1949 il avait perdu tout suivi de masse ? Cette plateforme n’arrive-t-elle pas un peu en retard ? Qui plus est, la plateforme de 1952 n'existait évidemment pas en 1943 : sur quelle base ont donc adhéré ces "milliers d'ouvriers" ? La réponse est simple. Sur la base de la plateforme du PC Internationaliste écrite par Bordiga en 1945 et diffusée en 1946 par le parti à l'étranger dans une édition française avec une introduction politique de Vercesi ([2] [186]). Cette plateforme n'était claire ni sur la nature capitaliste de l'Etat russe, ni sur les "mouvements partisans" ; elle affirmait, par contre, très clairement que "la politique programmatique du Parti est celle développée... dans les textes constitutifs de l'Internationale de Moscou" et que "le Parti aspire à la reconstitution de la confédération syndicale unitaire". C'est sur la base de ces positions qui constituaient un retour pur et simple à l'Internationale Communiste des années 20, qu'il a été possible d'enrôler "des milliers d'ouvriers", puis plus tard, de les perdre dans la nature. Il s'agissait d'un double pas en arrière, non seulement par rapport aux conclusions tirées par la Fraction dans sa période finale (1939-45), mais même par rapport aux positions de la Fraction dans sa première période (1928-30). Le poids de milliers de nouveaux adhérents, enthousiastes, certes, mais très peu formés, entrava puissamment les efforts de vieux militants qui n'avaient pas oublié le travail de la Fraction. Ainsi, Stefanini, qui, à la Conférence Nationale de décembre 1945 défendit une position anti-syndicale analogue à celle d'Internationalisme ; ainsi, Danielis qui, au Congrès de 1948 devait amèrement reconnaître : "On peut se demander s'il y a vraiment eu une soudure idéologique entre le Parti et la Fraction à l'étranger ; au Congrès de Bruxelles de la Fraction, on nous avait assuré que les matériaux théoriques étaient régulièrement envoyés en Italie" (compte-rendu du 1er Congrès du PCInt, p.20). A travers ces paroles de désillusion d'un dirigeant du Parti même, on peut mesurer l'ampleur du pas en arrière fait pas le PCInt, au regard des apports théoriques de la Fraction.
Il reste une dernière question, à savoir comment situer la plateforme sur laquelle, en 1952, la tendance Damen (Battaglia Comunista) se sépare définitivement de celle de Bordiga, qui devait constituer Programme Communiste aujourd'hui en déroute ?
Il suffit d'un coup d'oeil pour comprendre que les positions centrales de cette plateforme (dictature de la classe et non du Parti, impossibilité de récupération des syndicats, rejet des luttes nationales) représentent un évident pas en avant par rapport à la plateforme de 1945. Nous avons toujours affirmé ceci avec le maximum de clarté, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. LE PROBLEME, C'EST QU’UN PAS EN AVANT NE SUFFIT PAS APRES DEUX PAS EN ARRIERE. De plus, après 7 ans d'affrontements de tendance à l'intérieur du PCInt, on pouvait s'attendre à des progrès substantiels dans la clarté des termes puisque les formulations encore "ouvertes" en 42 ne l'étaient plus 10 ans après. Au lieu de ces pas en avant, sur tous les terrains abordés, B.C fait des petits pas en avant, et puis s'arrête à mi-chemin sans conclure réellement (dictature exercée par la classe et non par le Parti, MAIS c'est le Parti qui organise et dirige la classe comme un état-major ; les syndicats ne sont pas récupérables, MAIS on peut travailler dedans ; le parlementarisme révolutionnaire est impossible, MAIS le Parti ne peut exclure l'utilisation tactique des élections, et ainsi de suite)
Sa plateforme de 1952 fait davantage penser à une vision ultra-extrêmiste des thèses dé l'Internanationale qu'à une synthèse effective du travail effectué jusqu'alors par la GCI. Certes, elle constituait une bonne base de départ pour rattraper le retard accumulé du fait de l'incohérence des bases théoriques de 1943-45. Cependant, le poids du cycle contre-révolutionnaire, qui atteignait en ces années son maximum, empêcha BC de faire des pas substantiels en avant, même si quelques unes des naïvetés les plus grandes ont été récemment éliminées (cf. par exemple, la transformation des "Groupes syndicaux internationalistes" en "Groupes d'usines internationalistes"). S'il suffisait d'éliminer le terme "syndical" pour éliminer les ambiguïtés sur le syndicat, tout serait réglé... Ce qui constituait en 1952 des obstacles inachevés à la pénétration opportuniste, risque aujourd'hui de devenir une espèce de passoire à travers laquelle tout peut se glisser, comme l'a montré la récente mésaventure de BC avec les nationalistes de l'UCI iranien.
Les années 80 ne sont pas les années 30.
- "Le CCI aimait à se présenter comme la fusion des meilleurs éléments des gauches allemande et italienne (...). Bien que le CCI y voie une vertu, la nature a horreur du déséquilibre. Il ne peut y avoir de fusion éclectique entre des traditions politiques dissemblables. Aujourd'hui, les révolutionnaires doivent se placer fermement sur le terrain de la gauche italienne, corrigeant ses erreurs avec ses propres armes, la dialectique marxiste." (Revolutionary Perspectives n°21, p.30).
Dans un article récent, nous avons cherché à montrer comment B.C et la CWO, avec leur vision d'une contre-révolution encore active, n'arrivaient pas à comprendre la différence entre aujourd'hui et les années 30 du point de vue des rapports de force entre les classes. Dans cette conclusion, nous chercherons à montrer comment ce n'est pas seulement "sur ce terrain que B.C et la CWO se présentent avec plus de 40 années de retard" (Revue Internationale n°36, p.19). La CWO nous accuse de faire de l'éclectisme entre gauche allemande et italienne, soutenant qu'elles ne peuvent pas "fusionner". Mais nous sommes parfaitement d'accord sur ce point. L'involution théorique de "Réveil Communiste" dans les années 30 [et du Groupe Communiste Internationaliste (GCI) plus récemment] le démontre de manière irrévocable. Ce qui était, par contre, possible, c'était de passer ensemble "au crible de la critique la plus intense" (Bilan n°1) l'expérience accumulée par le prolétariat de tous les pays dans la première vague révolutionnaire, pour arriver, à travers des années de travail à une "synthèse historique" (Bilan n°15).
La DONNEE DE FAIT qui ne peut être niée, c'est que cette synthèse historique a été faite, principalement sous l'impulsion et par le travail de la gauche italienne, et qu'elle constitue le point de référence de toute prise de position aujourd'hui. Choisir entre la gauche italienne, la gauche allemande ou un cocktail des deux, c'est dans tous les cas un choix privé de sens parce que ces deux tendances, du point de vue du mouvement historique de la classe, n'existent plus. Le travail de synthèse historique accompli par la Fraction a permis "l'élaboration d'une idéologie politique de gauche internationale" réclamée par Bordiga en 1926. En conséquence, l'unique gauche communiste dont nous pouvons nous sentir partie prenante est la Gauche Communiste Internationale, constituée sur la base de ce travail. Cette acceptation constitue l'unique paramètre acceptable de nos jours. Le CCI, qui s'est constitué sur la base de ce travail et qui a largement contribué à le faire connaître, a clairement choisi. Avec autant d'esprit de décision mais avec une clarté moindre, Programme Communiste a rejeté ce travail, revenant aux positions de base des années 20. Comme nous l'avons vu, B.C (et la CWO) n'arrive pas à se déterminer clairement. Face au choix d'aujourd'hui : se baser sur les pas faits en avant par la Fraction italienne, belge et française ou se baser sur la régression du PCInt, ces camarades restent à mi-chemin de façon éclectique. "Le problème avec B.C, c'est que sa réponse à notre Adresse, comme ses positions politiques, est insaisissable. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. (. . ) Si Programma a une cohérence dans ses erreurs, Battaglia a ses erreurs dans l'incohérence " (Revue Internationale n°36).
La CWO soutient que tout groupe pratiquant l'éclectisme sur les questions fondamentales finit par se déséquilibrer définitivement et mettre ainsi en cause également les pas en avant déjà faits. Nous acceptons sans réserve ce jugement qui est d'autre part confirmé par les faits : le CCI, à une dizaine d'années de sa fondation, n'a altéré aucun de ses points programmatiques de départ ; la CWO, à partir du moment où elle s'est approchée des positions éclectiques de B.C, a retourné comme un gant sa propre plateforme, abandonnant une par une les avancées de la gauche internationale en se retournant vers le léninisme des années 20 sur toutes les questions fondamentales. Avant que ce processus ne devienne irréversible, il serait bon que les camarades de la CWO se rappellent qu'à l'époque actuelle le soi-disant "léninisme", n'ayant plus rien à voir avec l'oeuvre révolutionnaire de Lénine, est seulement une des idéologies contre-révolutionnaires de la gauche du capital.
BEYLE.
[1] [187] Les RKD (Communistes Révolutionnaires d'Allemagne) les CR (Communistes Révolutionnaires) cf. Revue Internationale No 32, p.24, notes
[2] [188] CWO nous reproche amèrement et longuement d’avoir employé dans un article n°32 de la Revue Internationale, le terme de « Bordiguiste » pour qualifier Battaglia Communista et la CWO. Nous voulons bien reconnaître qu’il y avait de notre part un manque de précision qui peut introduire des confusions. Cependant, CWO ne fait que se servir d’une virgule mal placée pour escamoter le débat de fond. Car, premièrement, jusqu’en 1952,la tendance qui allait devenir B.C. se réclame de cette plate-forme de Bordiga. Deuxièmement, parce que les critiques de B.C. à Bordiga, dont CWO se réclame, restent toujours ambiguë, à mi-chemin.
Courants politiques:
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Contribution à une histoire du mouvement révolutionnaire : le Communistenbond Spartacus et le courant conseilliste 1942-1948, II
- 4973 lectures
Dans la première partie de cet article (cf. Revue Internationale n°38) consacré à l'histoire de la gauche hollandaise, nous avons montré l'évolution du Communistenbond Spartacus, issu d'un mouvement situé à la droite du trotskisme dans les années 30, vers des positions révolutionnaires, lui conférant entre 1942 et 1945 - malgré de nombreuses confusions théoriques tant sur la période historique du second après-guerre que sur la nature de l'URSS, les luttes de libération nationale etc..- une lourde responsabilité politique au niveau international dans le regroupement des révolutionnaires en Europe occidentale.
Première organisation révolutionnaire en Hollande, et consciente de cette responsabilité, le Communistenbond, en proclamant en décembre 45 la nécessité du parti international du prolétariat comme facteur actif dans le processus d'homogénéisation de la conscience de classe, était, alors, encore loin des conceptions ouvertement conseillistes qu'il va développer à partir de 1947. Conceptions qui, de régression théorique en régression théorique, vont progressivement 1'acheminer vers le conseillisme achevé : rejet de 1'expérience prolétarienne du passé - notamment de 1'expérience de la révolution russe -, abandon de toute idée d'organisation politique, négation de toute distinction entre communistes et prolétaires, tendance à1'ouvriérisme et à 1'immédiatisme, chaque grève étant considérée comme "une révolution en petit".
Cette 2ème partie s'attachera à analyser les différentes étapes de la dégénérescence du courant conseilliste (dont les germes étaient déjà contenus dans les positions du Communistenbond en 45) qui conduira à sa disparition dans les années 70, pour ne laisser aujourd'hui que des épigones, dont le groupe Daad en Gedach se rattachant au courant libertaire anti-parti.
Il était inévitable que l'orientation du Bond vers une organisation centralisée et que l'importance accordée à la réflexion théorique - sous forme de débats et de cours de formation - ne satisfassent pas les éléments les plus activistes du Bond. Ceux-ci, autour de Toon van den Berg, gardaient le vieil esprit syndicaliste-révolutionnaire du NAS. Très présents dans le milieu prolétarien de Rotterdam, lors des grèves du port, ils avaient contribué à la construction d'un petit syndicat, l'EVB (Union syndicale unitaire), né de la lutte. Il est symptomatique que le Bond - lors de son congrès des 24-26 décembre 1945 - acceptât de travailler dans l'EVB. Condamnant l'activité de l'organisation dans les syndicats, appendices de l'Etat, sa position sur les syndicats restait théorique. En quittant le Bond, Toon van den Berg et ceux qui le soutenaient allaient jusqu'au bout dans la logique d'une participation "tactique" à de petits syndicats indépendants. ([1] [191])
Le Bond se trouvait dans une phase de réappropriation des positions politiques du GIC. Et à tâtonnements, il dégageait peu à peu, de façon plus ou moins claire, ses positions politiques et théoriques propres.
D'autre part, la centralisation que requérait ce travail politique heurtait les éléments anarchisants du Bond. C'est à propos du journal hebdomadaire "Spartacus" que se développa un grave conflit dans l'organisation. Certains - soutenus par une partie de la rédaction finale (Eind-redactie) - qui était la Commission de rédaction -trouvaient que le style du journal était "un style journalistique" ([2] [192]). Ils voulaient que le journal soit le produit de tous les membres et non d'un organe politique. Le conflit connut son point le plus haut en mars 1946, lorsqu'un clivage se fit entre la Commission politique, dont Stan Poppe était le secrétaire, et la Commission de Rédaction finale. Il en ressortit que "la Rédaction finale est soumise à la commission politique" ([3] [193]) dans le choix politique des articles, mais non dans le style laissé à l'appréciation de la Rédaction. La commission politique défendait le principe du centralisme par un travail commun entre les deux organes. La Rédaction finale pensait que son mandat était valable uniquement devant l'assemblée des membres du Bond. Elle s'appuyait sur les jeunes qui voulaient que le journal soit l'expression de tous alors que la majorité de la Commission politique et en particulier Stan Poppe, défendait le principe d'un contrôle politique des articles par un organe ; en conséquence, la Rédaction ne pouvait être qu'une "subdivision" de la Commission politique. La participation des membres à la rédaction se faisait selon le principe de la "démocratie ouvrière" qui prévalait dans les organisations de "vieux style" ([4] [194]). Il ne s'agissait pas d'une"politique de compromis", comme l'en accusaient la majorité de la rédaction et des membres à Amsterdam, mais d'une question pratique de travail commun entre les deux organismes, s'appuyant sur le contrôle et la participation de tous les membres du Bond.
Ce débat confus, où se mêlaient des antagonismes personnels et des particularismes de commissions, ne faisait que porter au grand jour la question de la centralisation. La non-distinction au départ entre Rédaction intégrée dans la commission politique et cette dernière n'avait fait qu'envenimer les choses. Cette grave crise du Bond se traduisait par le départ de plusieurs militants, et loin de triompher la centralisation du Bond devint de plus en plus vague au cours de l'année 1946.
Mais dans les faits, le départ des éléments les moins clairs du Bond, ou les plus activistes, renforçait la clarté politique du Bond qui se démarquait plus nettement du milieu politique ambiant. Ainsi -à l'été 1946 - des membres du Bond qui votaient dans les élections pour le PC le quittèrent. Il en fut de même des membres de la section de Deventer qui avaient pris contact avec les trotskystes du CRM pour faire un travail "entriste" dans le Parti communiste néerlandais. ([5] [195])
Ces crises et ces départs étaient en fait une crise de croissance du Communistenbond, qui en"s'épurant" gagnait en clarté politique.
En 1945-1946, sont examinées plusieurs questions théoriques, sur lesquelles le Bond était resté flou pendant sa période de clandestinité : les questions russe, nationale, syndicale. Celles des conseils ouvriers, de la lutte de classe dans l'après-guerre, de la barbarie et de la science, de la caractérisation de la période suivant la Deuxième Guerre mondiale étaient abordées à la lumière de l'apport de Pannekoek.
1) La question russe
La nature de l'Etat russe n'avait pas été vraiment abordée par le Bond, à sa naissance. Les conférences tenues en 1945 et la publication d'un, article théorique sur la question permirent une prise de position sans ambiguïté ([6] [196]). Cet article, tout en rendant hommage à la position de défaitisme révolutionnaire du MLL Front lors de la guerre germano-russe en 1941, notait que "seulement à l'égard de l'Union soviétique, leur attitude était encore hésitante". Cette hésitation était en fait celle du Bond en 1942-1944. Ce n'était plus le cas en 1945.
Les révolutionnaires, notait le rédacteur de l'article, ont eu des difficultés énormes à reconnaître la transformation de la Russie soviétique en un Etat impérialiste comme les autres :
"On ne pouvait et on ne voulait pas croire que la Russie révolutionnaire de 1917 s'était transformée en une puissance semblable aux autres pays capitalistes."
Il est intéressant de noter ici que le Bond, à la différence du GIC des années 30, ne définit pas la Révolution russe comme une "révolution bourgeoise". Il essaye de comprendre les étapes de la transformation de la révolution en contre-révolution. Comme la Gauche Italienne "Bilan"), il voit le processus contre-révolutionnaire surtout dans la politique extérieure de l'Etat russe, qui marque son intégration dans le monde capitaliste. Ce processus se développe par étapes : Rapallo en 1922 ; l'alliance du Komintern avec le Kuomintang en Chine; l'entrée de l'URSS dans la SDN en 1929. Cependant, le Bond estime que c'est en 1939 seulement que la Russie est vraiment devenue impérialiste. La définition qui est donnée ici de l'impérialisme est purement militaire, et non économique : "Depuis 1939, il est devenu clair que aussi la Russie est entrée dans une phase d'expansion impérialiste".
Cependant, le Bond montre que le processus contre-révolutionnaire est aussi interne, dans la politique intérieure, où "sous la direction de Staline naquit une bureaucratie d'Etat". La nature de classe de la bureaucratie russe est bourgeoise :
"La bureaucratie dominante remplit la fonction d'une classe dominante qui, dans ses buts essentiels, correspond au rôle que remplit la bourgeoisie dans les pays capitalistes modernes".
Il est à noter ici que la "bureaucratie" russe est la bourgeoisie par sa fonction plus que par sa nature. Elle est un agent du capital étatisé. Bien qu'il soit clair dans le reste de l'article que cette "bureaucratie" est la forme que revêt la bourgeoisie d'Etat en URSS, l'impression donnée est qu'il s'agit d'une "nouvelle classe". En effet, il est affirmé que "la bureaucratie est devenue la classe dominante". Cette "classe dominante" deviendra - quelques années plus tard, sous l'influence de "Socialisme ou Barbarie" - pour le Bond "une nouvelle classe".
Le Bond montre qu'il existe deux classes dans la société russe, dans les rapports d'exploitation capitaliste basés sur "l'accumulation de plus-value" : la classe ouvrière et lardasse dominante". L'existence du capitalisme d'Etat - comme capital collectif - explique la politique impérialiste de l'Etat russe :
"L'Etat lui-même est ici l'unique capitaliste, en excluant tous les autres agents autonomes du capital ; il est l'organisation monstrueuse du capital global. Ainsi, il y a d'un côté les travailleurs salariés qui constituent la classe des opprimés ; de l'autre côté l'Etat qui exploite la classe opprimée et dont l'assise s'élargit par l'appropriation du surproduit créé par la classe ouvrière. C'est le fondement de la société russe ; c'est aussi la source de sa politique impérialiste".
La distinction faite ici -implicitement, et non explicitement - entre "dominés" et "dominants" n'est pas sans annoncer la future théorie du groupe "Socialisme ou Barbarie" ([7] [197]). Mais à la différence de ce dernier, le Communistenbond "Spartacus" n'abandonna jamais la vision marxiste d'antagonismes au sein de la société capitaliste.
Malgré les hésitations dans son analyse théorique, le Bond était très clair dans les conséquences politiques qui découlaient de son analyse théorique. La non défense de l'URSS capitaliste était une frontière de classe entre bourgeoisie et prolétariat :
"Prendre parti pour la Russie signifie que l'on a abandonné le front de classe entre ouvriers et capitalisme".
La non-défense de l'URSS ne pouvait être révolutionnaire que si elle s'accompagnait d'un appel au renversement de l'Etat capitaliste en Russie par la lutte de classe et la formation des conseils ouvriers :
"Seuls les soviets, les conseils ouvriers -"comme pouvoir ouvrier autonome - peuvent prendre en main la production, dans le but de produire pour les besoins de la population travailleuse. Les ouvriers doivent, en Russie aussi, former le Troisième front. De ce point de vue la Russie ne se distingue pas des autres pays."
2) La question coloniale et nationale
En 1945, la position du Bond sur la question coloniale n'est guère différente de celle du MLL Front. Alors que débutait une longue guerre coloniale en Indonésie qui allait durer jusqu'en 1949, date de l'indépendance, le Bond se prononce pour la"séparation" entre les Indes néerlandaises et la Hollande. Sa position reste "léniniste" dans la question coloniale, et il participe même - pendant quelques mois - à un "Comité de lutte anti-impérialiste" (Anti-imperialistisch Strijd Comité) . Ce comité regroupait les trotskystes du CRM, le groupe socialiste de gauche "De Vonk" et le Com-munistenbond, jusqu'à ce que ce dernier le quitta en décembre 1945. Le Bond avouait ([8] [198]) que ce comité n'était rien d'autre qu'un "cartel d'organisations".
Le Bond, en fait, n'avait pas de position théorique sur la question nationale et coloniale. Il reprenait implicitement les positions du 2° Congrès de l'IC. Il affirmait ainsi que "la libération de l'Indonésie est subordonnée à et constitue une sous-partie de la lutte de classe du prolétariat mondial". ([9] [199]) En même temps il montrait que 1 ' indépendance de 1'Indonésie était une voie sans issue pour le prolétariat local : "Il n'y a aucune possibilité présente d'une révolution prolétarienne (en Indonésie)".
Peu à peu triomphait la conception de Pannekoek. Ce dernier - dans les conseils ouvriers - sans prendre position vraiment contre les mouvements nationalistes de "libération nationale", considérait qu'ils se feraient sous la férule du capital américain et entraîneraient une industrialisation des pays "libérés". Telle était la position officielle du Bond en septembre 1945, à propos de l'Indonésie ([10] [200]). Il considérait que "la seule voie qui reste ne peut être autre qu'une future industrialisation de l'Indonésie et une ultérieure intensification du travail". Le mouvement de décolonisation se ferait avec le"soutien du capital américain". Il se traduirait par l'instauration d'un appareil d'Etat"tourné contre la population pauvre".
Le Bond avait encore beaucoup de mal à se déterminer théoriquement vis-à-vis de la "question nationale". Issu de deux courants, dont l'un acceptait les Thèses de Bakou, l'autre se revendiquait de la conception de Luxembourg, il était amené à se prononcer pour 1'une de ces deux conceptions de façon claire. C'est ce qu'il fit en 1946 dans un numéro de "Spartacus - Weekblad" (N° 12, 23 mars. Dans un article consacré à l'indépendance nationale ("Nationale onafhankelijkheid"), il attaquait la position trotskyste du RCP qui propageait le mot d'ordre : "Indonésie los van Holland, nu!" (Séparation de l'Indonésie d'avec la Hollande maintenant!). Un tel mot d'ordre ne pouvait être qu'un appel à l'exploitation des prolétaires indonésiens par d'autres impérialismes :
"Indonésie los van Holland. Nu! " veut dire : exploitation des prolétaires indonésiens par 1'Amérique-Angleterre, l'Australie et/ou leurs propres dirigeants ; et cela en réalité ne peut être! 'Contre toute exploitation' la lutte des masses indonésiennes doit surgir".
Plus profondément, le Bond se réclamait sans ambiguïté de la conception de Rosa Luxemburg et rejetait tout mot d'ordre 'léniniste' d'un 'droit à 1'autodétermination nationale'. Ce dernier ne pouvait être qu'un abandon de l'internationalisme au profit d'un camp impérialiste :
"Avoir de la sympathie pour ce mot d'ordre c'est mettre la classe ouvrière du côté d'un des deux colosses impérialistes rivaux, tout comme le mot d'ordre pour le ‘droit à l'autodétermination des nations' en 1914 et celui (de lutte) contre le fascisme allemand' au cours de la 2°guerre mondiale. '''
Ainsi, le Bond abandonnait définitivement la position qui avait été la sienne en 1942. Par la suite lors de 1'indépendance de pays comme la Chine ou l'Inde, il se préoccupe surtout de voir dans quelle mesure "l'indépendance" pouvait amener un développement des forces productives, et donc objectivement favoriser le surgissement d'un puissant prolétariat d'industrie. Implicitement, le Bond posait la question des 'révolutions bourgeoises' dans le tiers monde (cf. Infra).
3) La question syndicale
Bien que débarrassée de la tendance syndicaliste de Toon van den Berg, l'Union communiste Spartacus reste marquée jusqu'en 1949-1950 par le vieil esprit syndicaliste révolutionnaire du NAS.
Pendant la guerre, le Bond avait participé - avec des membres du PC hollandais - à la construction du petit syndicat clandestin EVC (Centrale syndicale unitaire). Rejetant tout travail" syndical depuis son congrès de Noël 1945, il avait néanmoins envoyé des délégués au congrès de l'EVC le 29 juillet 1946 ([11] [201]). Mais, par"tactique", le Bond travaillait dans les petits syndicats "Indépendants" nés de certaines luttes ouvrières. Après avoir travaillé dans le syndicat EVB - dont l'origine était la transformation d'un organisme de lutte des ouvriers de Rotterdam en structure permanente - le Bond défendait l'idée d'"organisations d'usine" créées par les ouvriers. Ces organisations étaient des "noyaux" (Kerne) qui devaient regrouper les"ouvriers conscients" par "localité et entreprise". ([12] [202])
Il est évident que le Bond ne faisait que reprendre ici la vieille conception du KAPD sur les Unions et les organisations d'entreprise (Betrieb-organisation). Mais à la différence du KAPD, il menait parallèlement un travail de type syndicaliste, sous la pression des ouvriers qui nourrissaient des illusions sur la formation de véritables syndicats"révolutionnaires". Il en fut ainsi en 1948-1949, lorsque naquit l'OVB (Union indépendante d'organisations d'entreprise). L'OVB était en fait une scission - provoquée en mars 1948 par Van den Berg - de l'EVC à Rotterdam, dont l'origine était la main mise du PC sur l'EVC. Croyant que l'OVB serait la base d'"organisations d'entreprise autonomes", le Bond devait reconnaître tardivement qu'il n'était rien d'autre qu'une"petite centrale syndicale". ([13] [203])
Cette 'tactique' du Bond était en contradiction avec sa position théorique sur le rôle et la fonction des syndicats dans la "société semi-totalitaire" des pays occidentaux. Les syndicats sont devenus des organes de l'Etat capitaliste :
"... Il ne peut être question de lutte pour les conditions de travail par le biais des syndicats. Les syndicats sont devenus une partie intégrante de l'ordre social capitaliste. Leur existence et leur disparition sont irrévocablement liées au maintien et à la chute du capitalisme. Dans l'avenir, il ne peut plus être question que la classe ouvrière puisse encore trouver des avantages dans les syndicats. Ils sont devenus des organes briseurs de grèves, là où les ouvriers passent spontanément à la grève et la dirigent." ([14] [204])
La propagande du Bond était donc une dénonciation sans équivoque des syndicats. Les ouvriers devaient non seulement mener leur lutte contre les syndicats par la"grève sauvage", mais comprendre que toute lutte dirigée par les syndicats était une défaite :
"La propagande révolutionnaire n'est pas d'appeler à la transformation des syndicats ; elle consiste à montrer clairement que dans la lutte les ouvriers doivent écarter toute direction syndicale, comme la vermine de leur corps. Il faudra dire clairement que toute lutte est perdue d'avance, dès que les syndicats parviennent à la prendre en charge".
La"grève sauvage" menée contre les syndicats était la condition même de la formation d'organismes prolétariens dans la lutte.
4) Le mouvement de la lutte de classe et les conseils
La publication des "Conseils ouvriers" en janvier 1946 a été déterminante pour l'orientation du Bond vers des positions typiquement "conseillistes". Alors qu'auparavant l'Union communiste Spartacus avait une vision essentiellement politique de la lutte de classe, elle développe des positions de plus en plus économistes. La lutte de classe était conçue plus comme un mouvement économique que comme un processus d'organisation croissante du prolétariat.
La vision de Pannekoek de la lutte de classe insistait d'avantage sur la nécessité d'une organisation générale de la classe que sur le processus de la lutte. Il affirmait, en effet, que "l'organisation est le principe vital de la classe ouvrière, la condition de son émancipation" ([15] [205]). Cette nette affirmation montrait que la conception du communisme des conseils de cette période n'était pas celle de 1'anarchisme. A la différence de ce courant, Pannekoek soulignait que la lutte de classe est moins une "action directe" qu'une prise de conscience des buts de la lutte, et que la conscience précède l'action.
"Le développement spirituel est le facteur le plus important dans la prise du pouvoir par le prolétariat. La révolution prolétarienne n'est pas le produit d'une force brutale, physique ; c'est une victoire de 1'esprit... au commencement était l'action. Mais l'action n'est rien de plus que le commencement...Toute inconscience, toute illusion sur l'essence, sur le but, sur la force de l'adversaire se traduit par le malheur et la défaite instaure un nouvel esclavage" ([16] [206]).
C'est cette conscience se développant dans la classe qui permettait l'éclatement spontané de grèves "sauvages (illégales ou non officielles) par opposition aux grèves déclenchées par les syndicats en respectant les règlements et les lois"." La spontanéité n'est pas la négation de l'organisation ; au contraire "l'organisation naît spontanément, immédiatement".
Mais ni la conscience ni l'organisation de la lutte ne sont un but en soi. Elles expriment une praxis où conscience et organisation s'inscrivent dans un processus pratique d'extension de la lutte qui conduit à l'unification du prolétariat :
"...la grève sauvage, tel le feu dans la prai rie, gagne les autres entreprises et englobe des masses toujours plus importantes. La première tâche à remplir, la plus importante, c'est faire de la propagande pour essayer d'étendre la grève".
Cette idée de l'extension de la grève sauvage était néanmoins en contradiction avec celle d'occupation des usines propagée par Pannekoek. Pannekoek, comme les militants du Bond, avaient été très marqués par le phénomène d'occupation d'usines dans les années 30. L'action d'occupation des entreprises était passée dans l'histoire sous le nom de "grève polonaise", depuis que les mineurs polonais en 1931 avaient été les premiers à appliquer, cette tactique. Celle-ci s'était ensuite étendue en Roumanie et en Hongrie, puis en Belgique en 1935, et enfin en France en 1936.
A l'époque, la Gauche communiste italienne, autour de"Bilan", tout en saluant ces explosions de lutte ouvrière ([17] [207]), avait montré que ces occupations étaient un enfermement des ouvriers dans les usines, qui correspondait à un cours contre-révolutionnaire menant à la guerre. D'autre part, un cours révolutionnaire se traduisait essentiellement par un mouvement d'extension de la lutte culminant avec le surgissement des conseils ouvriers. L'apparition des conseils n'entraînait pas nécessairement un arrêt de la production et l'occupation des usines. Au contraire, dans la Révolution russe, les usines continuaient à fonctionner, sous le contrôle des conseils d'usine ; le mouvement n'était pas une occupation d'usines mais la domination politique et économique de la production par les conseils sous la forme d'assemblées générales quotidiennes. C'est pourquoi, la transformation des usines du Nord de l'Italie en "forteresses" par les ouvriers en 1920, qui occupaient l'entreprise, traduisait un cours révolutionnaire déclinant. C'est la raison pour laquelle Bordiga avait vivement critiqué Gramsci qui s'était fait le théoricien du pouvoir dans l'usine occupée.
Pour la Gauche communiste italienne il était nécessaire que les ouvriers brisent les liens les rattachant à leur usine, pour créer une unité de classe dépassant le cadre étroit du lieu de travail. Sur cette question, Pannekoek et le Spartacusbond se rattachaient aux conceptions usinistes de Gramsci en 1920. Ils considéraient la lutte dans l'usine comme une fin en soi, considérant que la tâche des ouvriers était la gestion de l'appareil productif, comme première étape avant la conquête du pouvoir :
" dans les occupations d'usines se dessine cet avenir qui repose sur la conscience plus claire que les usines appartiennent aux ouvriers, qu'ensemble ils forment une unité harmonieuse et que la lutte pour la liberté sera menée jusqu'au bout dans et par les usines ... ici les travailleurs prennent conscience de leurs liens étroits avec 1'usine... c'est un appareil productif qu'ils font marcher, un organe qui ne devient une partie vivante de la société que par leur travail." ([18] [208])
A la différence de Pannekoek, le Bond avait tendance à passer sous silence les différentes phases de la lutte de classe, et à confondre lutte immédiate (grève sauvage) et lutte révolutionnaire (grève de masses donnant naissance aux conseils) . Tout comité de grève - quelle que soit la période historique et la phase de la lutte de classe -était assimile à un conseil ouvrier :
"Le comité de grève comprend des délégués de diverses entreprises. On l'appelle alors "comité général de grève" ; mais on peut l'appeler "conseil ouvrier". ([19] [209])
Au contraire, Pannekoek soulignait dans ses "5 Thèses sur la lutte de classe" (1946) que la grève sauvage ne devient révolutionnaire que dans la mesure où elle est "une lutte contre le pouvoir d'Etat ; dans ce cas "les comités de grève doivent alors remplir des fonctions générales, politiques et sociales, c'est-à-dire remplir le rôle des conseils ouvriers".
Dans sa conception des conseils, Pannekoek était loin de se rapprocher des positions anarchistes, qui allaient par la suite triompher dans le mouvement "conseilliste" hollandais. Fidèle au marxisme, il ne rejetait pas la violence de classe contre 1' Etat ni la notion de dictature du prolétariat. Mais celles-ci en aucun cas ne pouvaient être une fin en soi ; elles étaient étroitement subordonnées au but communiste : l'émancipation du prolétariat rendu conscient par sa lutte et dont le principe d'action était la démocratie ouvrière. La révolution par les conseils n'était pas"une force brutale et imbécile (qui) ne peut que détruire". "Les révolutions, au contraire, sont des constructions nouvelles résultant de nouvelles formes d'organisation et de pensée. Les révolutions sont des périodes constructives de 1'évolution de 1'humanité." C'est pourquoi "si l'action armée (jouait) aussi un grand rôle dans la lutte de classe", elle était au service d'un but : non pas briser les crânes, mais ouvrir les cervelles". Dans ce sens, la dictature du prolétariat était la liberté même du prolétariat dans la réalisation de la véritable démocratie ouvrière :
"La conception de Marx de la dictature du prolétariat apparaît comme identique à la démocratie ouvrière de l'organisation des conseils."
Cependant, chez Pannekoek, cette conception de la démocratie des conseils évacuait la question de son pouvoir face aux autres classes et face à l'Etat. Les conseils apparaissaient comme le reflet des différentes opinions des ouvriers. Ils étaient un parlement où coexistaient différents groupes de travail, mais sans pouvoirs ni exécutif ni législatif. Ils n'étaient pas un instrument de pouvoir du prolétariat, mais une assemblée informelle :
"Les conseils ne gouvernent pas; ils transmettent les opinions, les intentions, la volonté des groupes de travail".
Comme très souvent, dans les "Conseils ouvriers", une affirmation est suivie de son antithèse, de telle sorte qu'il est difficile de dégager une pensée cohérente. Autant dans le passage cité, les conseils ouvriers apparaissent comme impuissants, autant plus loin ils sont définis comme un puissant organe "devant remplir des fonctions politiques", où "ce qui est décidé... est mis en pratique par les travailleurs". Ce qui implique que les conseils "établissent" le nouveau droit, la nouvelle loi."
Par contre, nulle part il n'est question d'antagonisme entre les conseils et le nouvel Etat surgi de la révolution. Bien que la question se fût posée dans la Révolution russe, Pannekoek semble implicitement concevoir les conseils comme un Etat, dont les tâches seront de plus en plus économiques, une fois que les ouvriers "se sont rendus maîtres des usines". Du coup, les conseils cessent d'être des organes politiques et "sont transformés...en organes de production". ([20] [210]). Sous cet angle, il est difficile de voir en quoi la théorie des conseils de Pannekoek se différencie de celle des bolcheviks après 1918.
Ainsi, en l'espace de deux ans -de 1945 à 1947 -la conception théorique du Communistenbond Sparta-cus se rapprochait de plus en plus des théories "conseillistes" du GIC et de Pannekoek, bien que ce dernier ne fut en aucune façon militant du Bond. ([21] [211])
Bien des facteurs entraient en jeu qui expliquaient le contraste brutal entre le Bond de 1945 et le Bond de 1947. Dans un premier temps, l'afflux de militants après mai 1945 avait donné l'impression que s'ouvrait une période de cours révolutionnaire ; inévitablement, croyait le Bond, de la guerre surgirait la révolution. L'éclatement de grèves sauvages à Rotterdam, en juin 1945, dirigées contre les syndicats confortait le Bond dans ses espérances. Plus profondément, l'organisation ne croyait pas à une possibilité de reconstruction de l'économie mondiale ; elle pensait en août 1945 que "la période capitaliste de l'histoire de l'humanité touche à sa fin" ([22] [212]). Elle était confortée par Pannekoek qui écrivait : "Nous sommes aujourd'hui témoins du début de l'effondrement du capitalisme en tant que système économique." ([23] [213]).
Bientôt le Bond dut reconnaître que ni la révolution ni l'effondrement économique n'étaient à attendre, avec le début de la période de reconstruction. Cependant le Bond et Pannekoek restèrent toujours convaincus de la perspective historique du communisme : certes "toute une grande partie du chemin vers la barbarie (avait été) parcourue, mais l'autre chemin, le chemin vers le socialisme, restait) ouvert". ([24] [214])
Le début de la "guerre froide" laissait le Bond indécis sur le cours historique de 1'après -guerre. D'un côté il pensait -avec Pannekoek - que l'après-guerre ouvrait de nouveaux marchés pour le capital américain, avec la reconstruction et la décolonisation, voire l'économie d'armements ; de l'autre côté, il lui semblait que chaque grève était une "révolution en petit". Bien que les grèves se déroulassent de plus en plus dans le contexte de l'affrontement des blocs,"Spartacus" pensait - dans cette période - que "c'est la lutte de classe qui freine les préparatifs d'une 3° guerre mondiale" ([25] [215]).
. La révolution escomptée ne venait pas, dans un cours profondément dépressif pour les révolutionnaires de l'époque. L'autorité morale de Pannekoek et de Canne Meijer pesait de plus en plus dans le sens d'un retour au mode de fonctionnement qui prévalait dans l'ex-GIC. Au printemps 1947, les critiques commencèrent à se faire jour sur la conception du Parti. Les anciens membres du GIC préconisaient un retour à la structure des "groupes d'études" et des "groupes de travail". Ce retour avait été en fait préparé dès 1946, lorsque le Bond avait demandé à Canne Meijer ([26] [216]) de prendre la responsabilité d'éditer une revue en espéranto et donc de former un groupe espérantiste. De fait, se créaient des groupes à l'intérieur du Bond. Dans leur intervention, les militants du Bond avaient de plus en plus tendance à se concevoir comme une somme d'individus au service des luttes ouvrières.
Cependant, le Communistenbond n'était pas isolé malgré le cours non révolutionnaire qu'il devait finalement reconnaître ([27] [217]) plus tard. En Hollande, s'était constitué le groupe "Socialisme von onderop" (Socialisme par en bas), de tendance "conseilliste" . Mais c'est surtout avec la Belgique néerlandophone que le Bond avait les contacts les plus étroits. En 1945, s'était constitué un groupe très proche du Bond qui éditait la revue "Arbeiderswil" (Volonté ouvrière). Il avait pris par la suite la dénomination de "Vereniging van Radensocialisten" (Association de socialistes des conseils). Le groupe se déclarait partisan du "pouvoir des conseils" et "antimilitariste". Par son principe d'organisation fédératif, il se rapprochait beaucoup de l'anarchisme.([28] [218]) Un tel environnement politique de groupes localistes n'était pas sans pousser le Bond à se replier sur la Hollande. Cependant, en 1946, le Bond avait pris soin de faire connaître à ses membres les positions du courant bordiguiste, en traduisant la déclaration de principes de la Fraction belge de la Gauche communiste ([29] [219]). En juillet 1946, Canne Meijer s'était déplacé à Paris pour prendre contact avec différents groupes, en particulier "Internationalisme". Théo Maassen avait par la suite renouvelée cet effort de prendre contact avec le milieu internationaliste en France. Il est notable que les contacts étaient pris par d'anciens membres du GIC, et non par les ex-RSAP qui n'avaient eu de contact politique qu'avec le groupe de Vereeken. Issus du mouvement communiste des conseils des années 20 et 30, ils avaient déjà discuté avec le courant "bordiguiste" regroupé autour de la revue "Bilan"»
Le Bond en 1947 restait très ouvert à la discussion internationale et souhaitait briser les frontières nationales et linguistiques où il était enfermé :
"Le Bond ne veut point être une organisation spécifiquement néerlandaise. Les frontières é-tatiques ne sont pour lui - à cause de l'histoire et du capitalisme - que des obstacles à l'unité de la classe ouvrière internationale." ([30] [220])
C'est dans cet esprit que le Communistenbond prit l'initiative de convoquer une conférence internationale des groupes révolutionnaires existant en Europe. La conférence devait se tenir les 25 et 26 mai 1947 à Bruxelles. Comme document de discussion le Bond avait écrit une brochure : "De nieuwe wereld" (Le nouveau monde) qu'il avait traduite par ses soins en français.
La tenue de la première conférence de l'après-guerre des groupes internationalistes devait se fonder sur des critères de sélection. Sans l'affirmer explicitement, le Bond éliminait les groupes trotskystes pour leur soutien à l'URSS et leur participation à la Résistance. Il avait cependant choisi des critères d'adhésion à la conférence très larges, voire vagues :
"Nous considérons comme essentiel : le rejet de toute forme de parlementarisme ; la conception que les masses doivent s'organiser elles-mêmes dans l'action, en dirigeant ainsi elles-mêmes leurs propres luttes. Au centre de la discussion, il y a aussi la question du mouvement de masse, tandis que les questions de la nouvelle économie communiste (ou communautaire), de la formation de partis ou groupes, de la dictature du prolétariat, etc. ne peuvent être considérées que comme conséquences du point précédent. Car le communisme n'est pas une question de parti, mais celle de la création du mouvement de masses autonome". ([31] [221])
En conséquence, le Bond éliminait le PC internationaliste bordiguiste italien qui participait aux élections. Etaient par contre invités la Fédération autonome de Turin, qui avait quitté le PCint en raison de ses divergences sur la question parlementaire et le groupe français "Internationalisme", qui s'était détaché du bordiguisme. Etaient par contre invités les groupes bordiguistes belges et français qui étaient en divergence avec le PCint sur les questions parlementaire et coloniale.
En dehors de ces groupes, issus du bordiguisme ou en opposition, le Communistenbond avait invité des groupes informels, voire des individus ne représentant qu'eux-mêmes, de tendance anarcho-conseilliste : de Hollande, "Socialisme van onderop"; de Belgique, le "Vereniging van Radensocialisten" ; de Suisse, le groupe conseilliste "Klassenkampf" ; de France, les ccmmunistes-révolutionnaires du "Prolétaire". ([32] [222])
L'invitation faite à la Fédération anarchiste française fut vivement critiquée par "Internationalisme" qui tenait à ce que les critères de la conférence soient rigoureux. Pour marquer la nature internationaliste de la conférence, les mouvements anarchistes officiels qui avaient participé à la guerre en Espagne, puis aux maquis de la Résistance devaient être éliminés. "Internationalisme", déterminait quatre critères de sélection des groupes participant à une conférence internationaliste :
- le rejet du courant anarchiste officiel "pour la participation de leurs camarades espagnols au gouvernement capitaliste de 1936-1938"; leur participation "sous l'étiquette de 1'antifascisme à la guerre impérialiste en Espagne", puis "aux maquis de la Résistance en France" faisaient que ce courant "n'avait pas de place dans un rassemblement du prolétariat" ;
- le rejet du trotskisme "comme corps politique se situant hors du prolétariat";
- de façon générale rejet de tous les groupes qui "ont effectivement participé d'une façon ou d'une autre à la guerre impérialiste de 1939-1945".
- la reconnaissance de la signification historique d'Octobre 1917 comme "critère fondamental de toute organisation se réclamant du prolétariat".
Ces quatre critères "ne faisaient que marquer les frontières de classe séparant le prolétariat du capitalisme". Cependant le Bond ne retira pas son invitation au "Libertaire" (Fédération anarchiste), qui annonça sa participation et ne vint pas. Le Bond dut reconnaître de fait que 1'antiparlementarisme et la reconnaissance de l'organisation autonome par les masses étaient des critères flous de sélection.
A ce titre la conférence internationale ne pouvait qu'être une conférence de prise de contact entre groupes nouveaux surgis après 1945 et les organisations internationalistes de l'avant-guerre que le conflit mondial avait condamne à rester isolées dans leur pays respectif. Elle ne pouvait aucunement être un nouveau Zimmerwald, comme le proposait le groupe "Le Prolétaire", mais un lieu de confrontation politique et théorique permettant leur "existence organique" et "leur développement idéologique".
Comme le notait "Internationalisme" qui participa très activement à la conférence, le contexte international n'ouvrait pas la possibilité d'un cours révolutionnaire. La conférence se situait dans une période où "le prolétariat a essuyé une désastreuse défaite, ouvrant un cours réactionnaire dans le monde". Il s'agissait donc de resserrer les rangs et d'oeuvrer à la création d'un lieu politique de discussion permettant aux faibles groupes d'échapper aux effets dévastateurs de ce cours réactionnaire.
Tel était aussi l'avis des membres de l'ex-GIC du Bond. Et ce ne fut pas l'effet du hasard si deux anciens du GIC (Canne Meijer et Willem)- et aucun membre de la direction du Bond - participèrent à la conférence. Les anciens RSAP restaient en effet très localistes, en dépit du fait que le Bond avait crée une "Commission internationale de contact".
De façon générale régnait une grande méfiance entre les différents groupes invités dont beaucoup avaient peur d'une confrontation politique. Ainsi ni la Fraction française ni "Socialisme van onderop" ne participèrent à la conférence. Lucain, de la Fraction belge, ne se laissa convaincre d'assister aux débats que sur la demande expresse de Marco d'Internationalisme. Seuls finalement, 1!Internationalisme" et la Fédération autonome avaient envoyé une délégation officielle. Quant aux éléments de l'ex-GIC, déjà en désaccord au sein du Spartacusbond ils ne représentaient qu'eux-mêmes. Ils nourrissaient une certaine méfiance vis à vis d'"Internationalisme" qu'ils accusaient de "se perdre dans d'interminables discussions sur la révolution russe". ([33] [223])
Présidée par Willem du Spartacusbond, Marco et un vieil anarcho-communiste qui militait depuis les années 1890, la conférence révéla une plus grande communauté d'idées qu'on aurait pu le soupçonner.
- la majorité des groupes rejetèrent les théories de Burnham sur la "société de managers" et le développement indéfini du système capitaliste. La période historique était celle "du capitalisme décadent, de la crise permanente, trouvant dans le capitalisme d'Etat son expression structurelle et politique".
- sauf les éléments anarchisants présents, les communistes de conseils avec les groupes issus du"bordiguisme" étaient d'accord sur la nécessité d'une organisation des révolutionnaires. Cependant, à la différence de leur conception de 1945, ils voyaient dans les partis un rassemblement d'individus porteurs d'une science prolétarienne : "Les 'partis' révolutionnaires nouveaux sont ainsi les porteurs ou les laboratoires de la connaissance prolétarienne". Reprenant la conception de Pannekoek sur le rôle des individus, ils affirmaient que "ce sont d'abord des individus qui ont conscience de ces vérités nouvelles".
- une majorité de participants soutient l'intervention de Marco, d1"Internationalisme", que ni le courant trotskyste ni le courant anarchiste n'avaient leur place dans une conférence de groupes révolutionnaires" ([34] [224]). Seul le représentant du "Prolétaire" - groupe qui devait par la suite évoluer vers l'anarchisme - se fit l'avocat de l'invitation de tendances non officielles ou "de gauche" de ces courants.
- les groupes présents rejetaient toute "tactique" syndicale ou parlementeriste. Le silence des groupes "bordiguistes" en opposition signifiait leur désaccord avec les positions du Parti bordiguiste italien.
Il est significatif que cette conférence - la plus importante de l'immédiat après-guerre - de groupes internationalistes ait réuni des organisations issues des deux courants "bordiguiste" et communiste des conseils. Ce fut la première et dernière tentative de confrontation politique de l'après-guerre. Dans les années 30, une telle tentative avait été impossible, principalement en raison du plus grand isolement de ces courants et des divergences sur la question espagnole. La conférence de 1947 permettait essentiellement d'opérer une délimitation - sur les questions de la guerre et de 1'antifascisme - d'avec les courants trotskyste et anarchiste. Elle traduisait de façon confuse le sentiment commun que le contexte de la guerre froide clôturait une période très brève de deux années qui avait vu se développer de nouvelles organisations, et ouvrait un cours de désagrégation des forces militantes si, consciemment, celles-ci ne maintenaient pas un minimum de contacts politiques.
Cette conscience générale manquait à la conférence qui se termina sans décisions pratiques ni résolutions communes. Seuls, les ex-membres du GIC et "Internationalisme" se prononçaient pour la tenue d'autres conférences. Ce projet ne put se réaliser en raison de la sortie -le 3 août 1947 ([35] [225]) - du Bond de la plupart des anciens du GIC : sauf Théo Maassen qui jugeait la scission injustifiée, ils pensaient que leurs divergences étaient trop importantes pour rester dans le Communistenbond. En fait ce dernier avait décidé de créer - artificiellement une"Fédération internationale de noyaux d'entreprise" (IFBK) à l'image des "Betriebsorganisationen" du KAPD. Mais la cause profonde de la scission était la poursuite d'une activité militante et organisée dans les luttes ouvrières. Les anciens du GIC é-taient accusés par les miltants du Bond de vouloir transformer l'organisation en un"club d'études théoriques" et de nier les luttes ouvrières immédiates :
" Le point de vue de ces anciens camarades (du GIC-NDR), c'était que - tout en poursuivant la propagande pour 'la production dans les mains des organisations d'usine', 'tout le pouvoir aux conseils ouvriers' et pour une production communiste sur la base d'un calcul des prix en fonction du temps de travail moyen'- le Spartacusbond n'avait pas à intervenir dans la lutte des ouvriers telle qu'elle se présente aujourd’hui. La propagande du Spartacusbond doit être pure dans ses principes et, si les masses ne sont pas intéressées aujourd'hui, cela changera quand les mouvements de masses redeviendront révolutionnaires". ([36] [226])
Par une ironie de l'histoire, les anciens du GIC reprenaient les mêmes arguments que la tendance de Gorter -dite d'Essen - dans les années 20, alors que précisément le GIC s'était constitué en 1927 contre elle. Parce qu'il défendait l'intervention active dans les luttes économiques - position de la tendance de Berlin du KAPD - il avait pu échapper au rapide processus de désagrégation des partisans de Gorter. Ceux-ci avaient soit disparu politiquement soit évolué - comme organisation - vers des positions trotskystes et socialistes de gauche "antifascistes" pour finalement participer à la résistance néerlandaise : Frits Kief, Bram Korper, et Barend Luteraan - chefs de la tendance "gortérienne"- suivirent cette trajectoire ([37] [227]).
Constitués à l'automne 1947 en "Groep van Raden communisten" (Groupe de communistes des conseils), Canne Meijer, B.A. Sijes et leurs partisans eurent quelque temps une activité politique. Ils voulaient malgré tout, maintenir les contacts internationaux en particulier avec "Internationalisme". En vue d'une conférence - qui n'eut jamais lieu - ils éditèrent un "Bulletin d'information et de discussion internationales" en novembre 1947, qui n'eut qu'un seul numéro. ([38] [228]) Après avoir édité deux numéros de "Radencommunisme", en 1948, le groupe disparut. Canne Meijer versa dans le plus grand pessimisme sur la nature révolutionnaire du prolétariat et commença à douter de la valeur théorique du marxisme. ([39] [229]) B.A. Sijes se consacra entièrement à son travail d'historien de la "Grève de février 1941" pour finalement adhérer à un "Comité international de recherche des criminels de guerre nazis" qui le mena à témoigner au procès contre Eichmann, à Jérusalem. ([40] [230]) Bruun van Albada, qui n'avait pas suivi les anciens du GIC dans la scission, cessait bientôt de militer en 1948, alors qu'il était nommé directeur de l'observatoire astronomique de Ban-doeng, en Indonésie. Inorganisé, il ne tarda pas à exprimer qu'il n'avait"plus aucune confiance dans la classe ouvrière" ([41] [231]).
Ainsi, en dehors de toute activité militante organisée, la plupart des militants du GIC finissaient par rejeter tout engagement marxiste révolutionnaire. Seul Théo Maasen, demeuré dans le Bond, maintint cet engagement.
Que la scission fut injustifiée - de l'avis de Théo Maasen - c'est ce que devait montrer l'évolution du Bond dès la fin de 1947, lors de sa conférence de Noël. Cette conférence marquait une étape décisive dans l'histoire du Communistenbond "Spartacus". La conception de l'organisation du GIC triomphait complètement et marquait un abandon des positions de 1945 sur le Parti. C'était le début d'une évolution vers un conseillisme achevé, qui allait mener finalement à la quasi-disparition du Spartacusbond aux Pays-Bas.
L'affirmation d'une participation du Bond à toutes les luttes économiques du prolétariat l'amenait à une dissolution de l'organisation dans la lutte. Le Bond n'était plus une partie critique du prolétariat mais un organisme au service des luttes ouvrières : "Le Bond et les membres du Bond veulent servir la classe ouvrière en lutte". ([42] [232]) La théorie ouvriériste triomphait, et les communistes du Bond étaient confondus avec la masse des ouvriers en lutte. La distinction faite par Marx entre communistes et prolétaires, distinction reprise par les "Thèses sur le parti" de 1945, disparaissait :
"Le Bond doit être une organisation d'ouvriers qui pensent par eux-mêmes, font de la propagande par eux-mêmes, font grève par eux-mêmes, s'organisent par eux-mêmes, et s'administrent par eux-mêmes."
Cependant cette évolution vers l'ouvriérisme n'était pas totale et le Bond n'avait pas encore peur de s'affirmer comme une organisation à la fonction indispensable dans la classe : "Le Bond fournit une contribution indispensable à la lutte. Il est une organisation de communistes devenus conscients
que l'histoire de toute société jusqu'à maintenant est l'histoire de la lutte de classe, basée sur le développement des forces productives". Sans utiliser le terme de parti, le Bond se prononçait pour un regroupement des forces révolutionnaires au niveau international : "Le Bond estime... souhaitable que l'avant-garde ayant la mène orientation dans le monde entier se regroupe dans une organisation internationale".
Les mesures organisatives prises à la conférence étaient en opposition avec ce principe de regroupement, qui ne pouvait se réaliser que si le centralisme politique et organisationnel du Bond était maintenu. Or, le Bond cessait d'être une organisation centralisée avec des statuts et des organes éxécutifs. Il devenait une fédération de groupes de travail, d'étude et de propagande. Les sections locales (ou "noyaux") étaient autonomes, sans autre lien qu'un "groupe de travail" spécialisé dans les rapports inter-groupes locaux, et le Bulletin interne "Uit eigen Kring" (Dans notre cercle). Il y avait autant de groupes de travail autonomes qu'il y avait de fonctions à remplir : rédaction ; correspondance ; administration ; maison d'édition "De Vlam" du Bond ; contacts internationaux ; "activités économiques" liées à la fondation de l'Internationale des noyaux d'entreprise (IFBK) .
Ce retour au principe fédéraliste du GIC amenait en retour une évolution politique de plus en plus "conseilliste" sur le terrain théorique. Le "conseillisme" a deux caractéristiques : la caractérisation de la période historique depuis 1914 comme une ère de "révolutions bourgeoises" dans les pays sous-développés ; le rejet de toute organisation politique révolutionnaire. Cette évolution fut particulièrement rapide dans les années 50. L'affirmation d'une continuité théorique avec le GIC - marquée par la réédition en 1950 des "Principes fondamentaux de la production et de la répartition communiste" ([43] [233]) - signifiait la rupture avec les principes originels du Bond de 1945.
Dans les années 1950, le Bond fit un grand effort théorique en publiant la revue "Daad en Gedachte" {Pote et pensée), dont la responsabilité rédactionnelle incombait avant tout à Cajo Brendel, entré dans l'organisation depuis 1952. Avec Théo Maasen, il contribuait grandement à la publication des brochures : sur l'insurrection des ouvriers est-allemands en 1953, sur les grèves du personnel communal d'Amsterdam en 1955, sur les grèves de Belgique en 1961. A côté de brochures d'actualité, le Bond publiait des essais théoriques qui montraient une influence croissante des théories de "Socialisme ou Barbarie". ([44] [234])
Cette influence de ce dernier groupe - avec lequel des contacts politiques avaient été pris dès 1953 et dont les textes étaient publiés dans "Daad en Gedachte" - n'était pas l'effet d'un hasard. Le Bond avait été le précurseur inconscient de la théorie de Castoriadis sur le "capitalisme moderne" et l'opposition "dominant s /dominés". Mais autant le Bond restait fidèle au marxisme en réaffirmant l'opposition entre prolétariat et bourgeoisie, autant il faisait des concessions théoriques à S.O.B." en définissant la "bureaucratie" russe comme une "nouvelle classe". Mais pour le Bond, cette classe était "nouvelle" surtout par ses origines ; elle prenait la forme d'une "bureaucratie" qui "(faisait) partie de la bourgeoisie" ([45] [235]). Néanmoins, en l'assimilant à une couche de "managers", non propriétaire collectif des moyens de production, le Bond faisait sienne la théorie de Burnham, qu'il avait rejetée à la conférence de 1947. Derechef, le Bond avait été en 1945 le précurseur inconscient de cette théorie, qu'il n'avait jusqu'alors jamais pleinement développée. Le maître devenait le propre "élève" de son disciple : "Socialisme ou Barbarie". Comme ce dernier, il glissait progressivement sur une pente qui devait le mener à sa dislocation.
Cette dislocation a deux causes profondes : -le rejet de toute expérience prolétarienne du passé, en particulier l'expérience russe ; - l'abandon par la tendance du GIC - au sein du Bond- de toute idée d'organisation politique.
Le rejet de l'expérience russe
Après avoir essayé de comprendre les causes de la dégénérescence de la Révolution russe, le Bond cessait de la considérer comme une révolution prolétarienne pour n'y voir - comme le GIC - qu'une révolution "bourgeoise". Dans une lettre à Castoriadis-Chaulieu du 8 novembre 1953 - qui fut publiée par le Bond -([46] [236]) Pannekoek considérait que cette "dernière révolution bourgeoise" avait été "l'oeuvre de la classe ouvrière" russe. Ainsi était niée la nature prolétarienne de la révolution (conseils ouvriers, prise de pouvoir en octobre 1917). Ne voulant pas voir le processus de la contre-révolution en Russie (soumission des conseils à l'Etat, Kronstadt) Pannekoek et le Bond aboutissaient à 1'idée que les ouvriers russes avaient lutté pour la révolution "bourgeoise" et donc pour leur auto exploitation. Si octobre 17 n'était rien pour le mouvement révolutionnaire, il était logique que Pannekoek affirmât que "la révolution prolétarienne appartient au futur". De ce fait, toute l'histoire du mouvement ouvrier cessait d'apparaître comme une source d'expériences du prolétariat et le point de départ de toute réflexion théorique. L'ensemble du mouvement ouvrier, dès le I9ème siècle devenait"bourgeois" et ne se situait que sur le terrain de la "révolution bourgeoise".
Cette évolution théorique s'accompagnait d'un immédiatisme de plus en plus grand vis-à-vis de toutes les grèves ouvrières. Le Bond considérait que sa tache était de se faire l'écho de toutes les grèves. La lutte de classe devenait un éternel présent, sans passé car il n'y avait plus d'histoire du mouvement ouvrier, et sans futur car le Bond se refusait d'apparaître comme un facteur actif pouvant influencer positivement la maturation de la conscience ouvrière.
L'autodissolution de l'organisation Lors de la discussion avec "Socialisme ou Barbarie", le Bond n'avait pas renoncé au concept d'organisation et de parti. Comme l'écrivait Théo Maasen, "l'avant-garde est une partie de la classe militante, se composant des ouvriers les plus militants de toutes les directions politiques". L'organisation était conçue comme l'ensemble des groupes du milieu révolutionnaire. Cette définition floue de l'avant-garde qui dissolvait le Bond dans l'ensemble des groupes était néanmoins un dernier sursaut de vie des principes originels de 1945.Bien que le Parti lui apparut comme dangereux, car ayant "une vie propre" et se développant "selon ses propres lois", le Bond en reconnaissait encore le rôle nécessaire ; il devait "être une force de la classe". ([47] [237])
Mais "cette force de la classe" devait disparaître dans la lutte des ouvriers pour ne pas rompre "leur unité". Ce qui revenait à dire que le parti - et l'organisation du Bond en particulier - était un organisme invertébré, qui devait se "dissoudre dans la lutte".
Cette conception était la conséquence de la vision ouvriériste et immédiatiste du conseillisme hollandais. Le prolétariat lui apparaissait dans son ensemble comme la seule avant-garde politique, "l'instituteur" des militants "conseillistes", qui de ce fait se définissaient comme une "arrière-garde". L'identification entre communiste conscient et ouvrier combatif amenait une identification avec la conscience immédiate des ouvriers. Le militant ouvrier d'une organisation politique ne devait plus élever le niveau de conscience des ouvriers en lutte mais se nier en se mettant au niveau d'une conscience immédiate et encore confuse dans la masse des ouvriers :
"Il en découle que le socialiste ou communiste de notre époque devrait se conformer et s'identifier à l'ouvrier en lutte" ([48] [238]).
Cette conception était particulièrement défendue par Théo Maasen, Cajo Brendel et Jaap Meulenkamp. Elle menait à la scission de décembre 1964 dans le Bond. La tendance qui défendait jusqu'au bout la conception anti-organisation du GIC devenait une revue : "Daad en Gedachte". Cette dislocation ([49] [239]) du Bond avait été en fait préparée par l'abandon de tout ce qui pouvait symboliser l'existence d'une organisation politique. A la fin des années 50, le Cbmmunistenbond Spartacus était devenu le "Spartacusbond". Le rejet du terme "communiste" signifiait un abandon d'une continuité politique avec l'ancien mouvement "communiste des conseils". L'atmosphère de plus en plus familiale du Bond, où avait été banni le mot "camarade" pour celui d'"ami", n'était plus celle d'un corps politique rassemblant les individus sur la base d'une acceptation commune d'une même vision et d'une même discipline collectives.
Désormais, il y avait deux 'organisations'"conseillistes" en Hollande. L'une - le Spartacusbond- après avoir connu un certain souffle de vie après mai 1968 et s'être ouvert à la confrontation internationale avec d'autres groupes finissait par disparaître à la fin des années 1970. S'ouvrant à des éléments plus jeunes et impatients, plongés dans la lutte des "kraakers (squatters) d'Amsterdam, elle se dissolvait dans un populisme gauchiste, pour finalement cesser de publier la revue "Spartacus".([50] [240])
"Daad en Gedachte", par contre, subsiste sous la forme d'une revue mensuelle. Dominée par la personnalité de Cajo Brendel, après la mort de Théo Maassen, la revue est le point de convergence d'éléments anarchisants. La tendance"Daad en Gedachte" a été jusqu'au bout de la logique "conseilliste" en rejetant le mouvement ouvrier du XIX° siècle comme "bourgeois" et en se coupant de toute tradition révolutionnaire, en particulier celle du KAPD, tradition qui lui apparaît comme marquée trop par "1'esprit de parti".
Mais surtout "Daad en Gedachte" s'est progressivement détaché de la tradition véritable du GIC, sur le plan théorique. Elle est avant tout un Bulletin d'information sur les grèves, alors que les revues du GIC étaient de véritables revues théoriques et politiques.
Cette rupture avec la véritable tradition du communisme des conseils l'ont amené progressivement sur le terrain du tiers-mondisme, propre aux groupes gauchistes :
"... Les luttes des peuples coloniaux ont apporté quelque chose au mouvement révolutionnaire. Le fait que des populations paysannes mal armées aient pu faire face aux forces énormes de l'impérialisme moderne a ébranlé le mythe de l'invincibilité du pouvoir militaire, technologique et scientifique de l'Occident. Leur lutte a aussi révélé à des millions de gens la brutalité et le racisme du capitalisme et a conduit beaucoup de gens - surtout parmi les jeunes et les étudiants - à entrer en lutte contre leurs propres régimes." ([51] [241])
Il est frappant de remarquer ici que, comme pour la PV° Internationale trotskyste et le bordiguisme, les luttes qui ont jailli du prolétariat industriel d'Europe sont comprises comme un produit des "luttes de libération nationale". Elles apparaissent comme un sous-produit des révoltes étudiantes, voire sont niées en tant que telles.
Une telle évolution n'est pas surprenante. En reprenant la théorie de "Socialisme ou Barbarie" d'une société traversée non par les antagonismes de classes mais par les révoltes des "dominés" contre les "dominants", le courant "conseilliste" ne peut concevoir l'histoire que comme une suite de révoltes de catégories sociales et de classes d'âge. L'histoire cesse d'être celle de la lutte de classe.
La théorie marxiste du communisme des conseils des années 30 puis du communistenbond des années 40 cède le terrain à la conception anarchiste. ([52] [242])
Aujourd'hui aux Pays-Bas, le communisme des conseils a disparu en tant que courant véritable. Il a laissé subsister des tendances "conseillistes" très faibles numériquement - comme "Daad en Gedachte" - qui se sont rattachées progressivement au courant libertaire anti-parti.
Au niveau international, après la deuxième guerre mondiale, le courant "communiste des conseils" ne s'est maintenu qu'au travers de personnalités comme Mattick, qui sont restées fidèles au marxisme révolutionnaire. Si des groupes - se revendiquant du "Rate-Kommunismus" - ont surgi dans d'autres pays, comme en Allemagne et en France, ce fut des bases bien différentes de celles du "Communistenbond Spartacus",
Chardin
[1] [243] Sur Toon van den Berg (1904-1977), cf. article du Spartacusbond : "Spartacus", n°2, février-mars 1978.
[2] [244] "Uit eigen kring", n°2, mars 1946 : "Nota van de politike commissie" (Notes de la Commission politique)
[3] [245] Cf. UEK n°2 mars 1946, Idem
[4] [246] En même temps que surgissait la question du centralisme se créait un clivage entre éléments "académistes" et militants qui souhaitaient plus de propagande. Ces derniers comme Johan van Dïnkel, dénonçaient le risque pour le Bond de devenir "un club d'études théoriques" Cf. UEK, n°2, mars 1946, "Waar staat de Communistenbond ? Théoretisch studieclub of wordende Party" (Où va le Communistenbond ? Club d'étude théorique ou parti en devenir ?) .
[5] [247] Cf. Circulaire du 17 août 1946 contenant le procès-verbal de la réunion de la commission politique nationale le 14 juillet. Interventions de Stan Poppe, Bertus Nansink, Van Albada, Jan Vastenhouw et Théo MajBsen sur l'état de l'organisation.
(42) "Maandlad Spartacus", n°12, décembre 1945 : "Het russische impérialisme en de revolutionaire arbei-ders".(L'impérialisme russe et les ouvriers révolutionnaires)
[6] [248] Maandlad Spartacus", n°12, décembre 1945 : "Het russische impérialisme en de revolutionaire arbeiders".(L'impérialisme russe et les ouvriers révolutionnaires)
[7] [249] Le groupe "Socialisme ou Barbarie", scission du trotskysme, publia son premier numéro en 1949 Son élément moteur était C. Castoriadis (Chaulieu ou cardan). Ce sont surtout les sous-produits de "Socialisme ou Barbarie : ICO et "Liaisons" d'Henri Simon qui pousseront jusqu'au bout la théorie "dominants/dominos , dirigeants /diriges .
[8] [250] Conférence du Bond des 27 et 28 octobre 1945, Cf UEK n°6, décembre 1945.
[9] [251] Rapport d'un membre de la Commission politique sur la question indonésienne, in UEK, n°6décembre 1945.
[10] [252] "Maandlad Spartacus", n°9 septembre 1945 : "Nederland- Indonésie".
[11] [253] Décision de la Commission politique, le 14 juillet 1946. Cf. Circulaire du 27 août avec le procès-verbal de la réunion de l'organe central.
[12] [254] "Spartacus" (Weekblad) n°23, 7 juin 1947 : "Het wezen der revolutionaire bedrijfsorganisatie" (ia nature de l'organisation révolutionnaire d'entreprise).
[13] [255] En 1951, quelques membres du Bond pensaient que l'OVB n'était rien d'autre qu'un "vieux syndicat", dans lequel ils n'avaient rien à faire. C'était le point de vue de Spartacus en 1978 qui définit l'OVB comme "une petite centrale syndicale", Cf. article "Toon van den Berg (n°2, février-mars) . Le débat sur la nature de l'OVB se trouve dans "Uit eigen kring", n°17, 22 juillet 1951.
[14] [256] "De nieuwe wereld", avril 1947, traduit dans un français maladroit pour la conférence de 1947 et publié en brochure :"Le monde nouveau".
[15] [257] "Les conseils ouvriers" chapitre "l'Action directe".
[16] [258] "Les conseils ouvriers", chapitre "Pensée et action".
[17] [259] Cf."La Gauche communiste d'Italie", chapitre 4.
[18] [260] "Les conseils ouvriers", chapitre 3 :"L'occupation d'usine".
[19] [261] Cf. "Le nouveau monde", 1947, p. 12. Chez le Bond, comme chez Pannekoek, il y a une tendance à considérer les comités de grève comme des organismes permanents, qui subsistent après la lutte. D'où chez Pannekoek l'appel à former - après la grève - de petits syndicats indépendants, "formes intermédiaires., regroupant, après une grande grève, le noyau des meilleurs militants en un syndicat unique. Partout où une grève éclaterait spontanément, ce syndicat serait présent avec ses organisateurs et ses propagandistes expérimentés". ("Les conseils ouvriers", p.157.)
[20] [262] "Les conseils ouvriers", chapitre "La révolution des travailleurs".
[21] [263] Pannekoek n'avait de contacts qu'individuels avec les anciens membres du GIC : Canne Meijer, B.A. Sijes .
[22] [264] "Maandblad Spartacus", n°8, août 1945 : "Het zieke Kapitalisme" (Le capitalisme malade).
[23] [265] "Les conseils ouvriers", p. 419. Cette affirmation d'un effondrement du capitalisme était en contradiction avec l'autre thèse des "Conseils ouvriers" que le capitalisme connaissait avec la décolonisation un nouvel essor : "Une fois qu'il aura fait entrer dans son domaine les centaines de millions de personnes qui s'entassent dans les terres fertiles de Chine et d'Inde, le travail essentiel du capitalisme sera accompli." p.194). Cette dernière idée n'est pas sans rappeler les thèses de Bordiga sur le capitalisme juvénile".
[24] [266] "Maandblad Spartacus", n°8 août 1945, op. cit.
[25] [267] "Spartacus" (Weekblad) n°22, 31 mai 1947 :"Nog twe jaren" (Encore deux ans)
[26] [268] Le Bond avait demandé à Canne Meijer d'assurer la sortie d'une revue espérantiste : "Klasbatalo". Il y eut encore une tentative en 1951 d'éditer "Spartacus" en espéranto. Cette fixation sur cette langue, pratiquée par des intellectuels, explique le peu d'efforts que fit le Bond d'éditer ses textes en anglais, allemand et français.
[27] [269] La préface de 1950 aux "Grondbeginselen der communistische productie en distributie" parle d'une "situation certainement non révolutionnaire" ; elle n'utilise pas le concept de contre-révolution pour définir la période. Cette préface présente un double intérêt : a) examiner la tendance mondiale au capitalisme d'Etat et ses différences : en Russie l'Etat dirige l'économie ; aux USA les monopoles s'emparent de l'Etat ; b) affirmer la nécessité de la lutte économique immédiate comme base de "nouvelles expériences" portant les germes d'une"nouvelle période".
[28] [270] Le Statut provisoire du*Vereniging van Raden-socialisten" a été publié en avril 1947 dans "Uit ei-gen kring" n°5
[29] [271] La traduction et les commentaires du noyau de Leiden sur le "Projet de programme de la Fraction belge" se trouvent dans le bulletin-circulaire du 27 août 1946.
[30] [272] "Uit eigen kring", bulletin de la Conférence de Noël, décembre 1947.
[31] [273] Cité par "Spartakus", n°1, octobre 1947 :"Die internationale Versammlung in Brussel, Pfingsten 1947". "Spartakus" était l'organe des RKD liés au groupe français "Le Prolétaire" (Communistes-Révolutionnaires).
[32] [274] Comptes-rendus de la conférence dans le numéro de "Spartakus", déjà cité, et dans "Internationalisme n°23, 15 juin 1947 : "Lettre de la GCF au Communistenbond 'Spartacus'" ; "Une conférence internationale des groupements révolutionnaires"; "Rectificatif" dans le n°24, 15 juillet 1947.
[33] [275] Compte -rendu d'un voyage de contact avec les groupes français RKD et "Internationalisme" en août 1946. Cf. "Uit eigen kring", n°4, avril 1947.
[34] [276] Citations du compte-rendu du congrès, "Internationalisme", n° 23.
[35] [277] Lettre-circulaire du 10 août 1947 : "De splijting in de Communistenbond 'Spartacus' op zontag 3 augus-tus 1947". Citée par Frits Kool, in "Die Linke gegen die Parteiherrschaft", p. 626.
[36] [278] "Uit eigen kring" numéro spécial, décembre 1947 : "De plaats van Spartacus in de klassenstrijd" (La place de Spartacus dans la lutte de classe).
[37] [279] Frits Kief, après avoir été secrétaire du KAPN de 1930 à 1932, avait fondé avec les Korper le groupe "De Arbeidersraad", qui évolua progressivement vers des positions trotskysantes et antifascistes. Pendant la guerre, Frits Kief participa à la Résistance hollandaise, devint après la guerre membre du "Parti du travail", pour finir par se faire le chantre du "socialisme yougoslave". Bram Korper et son neveu retournèrent au PC. Quant à Barend Luteraan (1878-1970) qui - plus que Gorter déjà malade - avait été le fondateur_du KAPN, il suivit le même itinéraire que_Fris Kief.
[38] [280] La préparation technique de cette conférence (bulletins) devait être prise en charge par le "Groep van Raden-Communisten". Dans une lettre écrite en octobre 1947, "Internationalisme" précisait qu'une future1 conférence ne pouvait se faire sur une"simple base affective" et devait rejeter le dilletantisme dans la discussion.
[39] [281] Sur l'évolution de Canne Meijer, cf, son texte des années 50 : "Le socialisme perdu", publié dans la "Revue internationale" du Courant communiste international, n°37, 1984.
[40] [282] B.A. Sijes (1908-1981) cependant, contribua dans les années 60 et 70 au mouvement communiste des conseils en rédigeant des préfaces à la réédition des oeuvres de Pannekoek. L'édition des "Mémoires" de ce dernier fut son dernier travail.
[41] [283] B. van Albada (1912-1972) , bien que cessant de militer traduisit en hollandais - avec sa femme-"Lénine philosophe" de Pannekoek.
[42] [284] Cette citation et les suivantes sont extraites de "Uit eigen kring", numéro spécial, décembre 1947 : "Spartacus:Eigen werk, organisatie en propaganda".
[43] [285] Les "Principes" ont été écrits en prison, dans les années 20, par Jan Appel. Ils ont été revus, remaniés par Canne Msijer. Jan Appel écrivit - selon le Spartacusbond dans sa préface de 1972 - avec Sijes et Canne Meijer en 1946 l'étude : "De economische grondslagen van de radenmaatqchappij" (Les fondements économiques de la société des conseils) . Or il ne semble pas que Jan Appel devînt en 1945 membre du Bond. Il était en désaccord avec les ex-membres du GIC et avec le Bond qui refusaient de faire un travail révolutionnaire en direction de l'armée allemande. D'autres raisons (tensions personnelles) l'ont tenu à l'écart d'un travail politique militant qu'il aurait souhaité réaliser.
[44] [286] Les brochures citées et la revue "Daad en Gedachte" sont disponibles à l'adresse suivante : Schouw 48-11, Lelystad (Pays-Bas)
[45] [287] Brochure écrite par Théo Maasen en 1961 : Van Beria tôt Zjoekof - Sociaal-economische achter grond van destalinisatie". Traduction en français :"L'arrière-fond de la déstalinisation", in "Cahiers du communisme des conseils", n°5, mars 1970.
[46] [288] Cf. "une correspondance entre A.Pannekoek et P. Chaulieu", avec une introduction de Cajo Brendel, in "Cahiers du communisme des conseils" n°8, mai 1971.
[47] [289] Citations d'une lettre de Théo Maasen à "Socialisme ou Barbarie", publiée dans le n°18, janvier-mars 1956, sous le titre : "Encore sur la question du parti".
[48] [290] Citations de la brochure "Van Beria tôt Zjoekof", déjà mentionnée.
[49] [291] Meulenkamp quitta le Bond en septembre 1964. Cajo' Brendel et Théo Maassen, avec deux de leurs ca-rades, furent exclus en décembre. La scission ne se fit pas en "douceur" : le Bond récupéra les machines et les brochures qui lui appartenaient, bien que ces dernières aient été écrites par Brendel et Maassen. Cf. témoignage de Jaap Meulenkamp, qui parle de "méthodes staliniennes" :"Brief van Jaap aan Radencommunisme", in Initiatief tôt een bijeenkomst van revolutionaire groepen", bulletin du 20 janvier 1981. Par la suite "Daad en Gedachte", malgré les invitations du Bond, refusa de s'asseoir "à la même table" lors de conférences et de rencontres, comme celle de janvier 1981.
[50] [292] Cf. articles du Courant communiste international, dans la "REVUE INTERNATIONALE" :n°2, 1975 : "Les épigones du conseillisme à l'oeuvre 1) "Spartacusbond" hanté par les fantômes bolcheviks, 2) Le conseillisme au secours du tiers-mondisme" ; n°9, 1977 : "Rupture avec Spartacusbond","Spartacusbond : seul au monde ?"; n°16 et 17, 1979 :"La gauche hollandaise".
[51] [293] Cajo Brendel : Thèses sur la révolution chinoise", in "Liaisons" n° 27, Liège (Belgique), février 1975. La citation est extraite de l'introduction à la traduction anglaise, éditée en 1971 par le groupe "Solidarity" d'Aberdeen.
[52] [294] Un résumé des conceptions anarchisantes de "Daad en Gedachte" se trouve dans le Bulletin du 20 janvier 1981 en vue d'une conférence de divers groupes, à laquelle participèrent le CCI et plusieurs individus qui ne représentaient qu'eux-mêmes : Kanttekeningen van 'Daad en Gedachte'" (Notes margina les de 'Daad en Gedachte1). "Daad en Gedachte" participa à la conférence, non comme groupe mais à titre individuel.
Géographique:
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [10]
Correspondance internationale : conscience et stratégie de la bourgeoisie
- 2679 lectures
Dans la Revue Internationale n°34 nous avons publié un texte d'un camarade de Hong Kong, LLM, sur la question de la gauche dans l'opposition, constituant un effort sérieux - hors de notre Courant - pour comprendre les bases des manoeuvres politiques actuelles de la classe dominante, puisque, à la différence des "critiques empiristes" qui n'ont fait que tourner notre analyse en dérision, le texte de LLM, dans la mesure où il va au fond de la question, perçoit l'organisation et la conscience de la bourgeoisie. Le texte soutenait que notre méthode d'analyse était valable, même s'il ne partageait pas toutes les conclusions que nous en avons tirées.
Diverses réactions au sein du milieu révolutionnaire ont poussé LLM à écrire une "élaboration" du texte originel. Dans 1'article ci-dessous, nous répondons aux argumentations développées dans ce second texte que nous ne publions pas et qui, loin d'être une élaboration ou un développement du texte précédent, ne fait qu'exprimer la déroute affolée de LLM retournant dans le camp des empiristes - ce qui montre que, sur cette question comme sur toutes les autres, il n'y a pas de place pour un arbitre impartial distribuant 1es bons et les mauvais points aux diverses parties du mouvement révolutionnaire. La régression dans la pensée de LLM est évidente, tant dans la forme que dans le contenu du texte : dans la forme, de par son attitude condescendante, son argumentation zigzagante et son fréquent recours à des ouï-dire ; mais surtout dans le contenu, puisque ça n'est ni plus ni moins qu'un abandon de tous les aperçus que le camarade avait pu avoir auparavant sur le machiavélisme de la bourgeoisie.
Le texte adopte, par la même occasion, une théorie erronée du cours parallèle vers la guerre et vers la révolution, et de fait, ne se distinguant pas des idées couramment répandues par d ' autres groupes tels que Battaglia Comunista et la Communist Workers' Organisation.
Dans la Revue Internationale n°34, dans son argumentation contre les empiristes qui nient la capacité de la bourgeoisie à s'unifier contre le prolétariat, LLM pouvait écrire :
"Je suis sûr que personne ne niera que les différents Etats sont capables de conspirer pour atteindre des buts communs. Pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, la conspiration entre les USA et la Grande-Bretagne dans la guerre des Falkland, la conspiration entre les USA et Israël lors de la dernière invasion du Liban, etc... sont claires comme la lumière du jour. Ou, si nous remontons un peu dans 1'histoire, les leçons de la Commune de Paris et de la révolution russe ne sont-elles pas suffisantes pour enfoncer à fond la leçon que, menacée par le prolétariat, la bourgeoisie est capable de mettre de côté ses antagonismes, même les plus forts, pour s'unir contre lui, comme l'a montré correctement le CCI ? Pourquo , alors, lorsqu'il se produit une conspiration entre la droite et la gauche de la bourgeoisie à 1'intérieur des frontières nationales, cela devient-il inimaginable ? Est-ce que Noske assassina le prolétariat allemand inconsciemment ou consciemment ?".
Aujourd'hui, à la suite d'un voyage en Europe - évidence empirique, s'il en fut jamais - LLM a décidé que le CCI avait bien, après tout, une théorie idéaliste conspirative de l'histoire. C'est maintenant à son tour de trouver "inimaginable" que le mouvement pacifiste soit organisé par la bourgeoisie, que le conflit au Salvador ait été exacerbé pour alimenter les mystifications anti prolétariennes à d'autres endroits, de même que les sandinistes soient venus au pouvoir au Nicaragua avec l'approbation de l'impérialisme US ([1] [295]). Dans ce texte, la bourgeoisie de LLM est identique à celle des empiristes.
Par exemple, lorsque le CCI affirme que les campagnes pacifistes font partie de la stratégie de la bourgeoisie pour dévoyer la lutte de classe, LLM chante le vieux refrain de tous ceux qui ne peuvent simplement comprendre ce que signifie le fait de dire que la bourgeoisie agit en tant que classe : "Qui est-elle? La bourgeoisie comme un tout ? Dans ce cas, la bourgeoisie dans son ensemble est marxiste", etc.. Il est certain qu' "elle" est effectivement incompréhensible du point de vue de l'empirisme bourgeois qui, désorienté par l'apparente désunion du monde, a toujours châtié le marxisme pour sa vision conspirative de la vie sociale, tout simplement parce qu'il parle des classes et de leur activité consciente.
Il est vrai que LLM affirme reconnaître qu' "il ne fait aucun doute que la bourgeoisie soit consciente de ses propres besoins" ; mais quand il en vient à l'épreuve consistant à appliquer son observation générale à la réalité concrète telles que les campagnes actuelles, LLM réduit cette conscience à la réaction complètement déterminée, "instinctive" d'une classe incapable d'élaborer quelque stratégie que ce soit :
"Quant aux soi-disant campagnes que la bourgeoisie est supposée mener consciemment contre le prolétariat, il est nécessaire d'ajouter seulement...que le nationalisme (un des fondements principaux de ces 'campagnes ') est 'naturel' pour la bourgeoisie. la bourgeoisie sait 'instinctivement' que le nationalisme fait partie de ses intérêts et elle le stimule à tout moment (match international de football, lancement d'un vaisseau spatial...). Même si on ne tient pas compte du problème de la 'conscience' de la bourgeoisie, on n'a pas besoin de cela pour savoir que la stimulation du nationalisme l'aide à démobiliser le prolétariat ; elle en connaît le revers ' instinctivement ' "
Et parce que le CCI rejette cette vision de la bourgeoisie et toutes les conclusions qui en découlent, on nous dit que "le CCI voit la bourgeoisie comme une classe consciente de ses propres besoins au point d'atteindre une compréhension matérialiste marxiste de l'histoire..."
LA COMPREHENSION BOURGEOISE DE L'HISTOIRE.
Bien entendu, la bourgeoisie ne possède pas une "compréhension matérialiste marxiste de l'histoire". Mais il existe effectivement une vision matérialiste bourgeoise de l'histoire, et il y a une bien grande coupure historique entre cette vision et le niveau de conscience réellement instinctif que les êtres humains ont dépassé quand ils sont sortis du reste du monde animal. Comme l'expliquait Marx dans sa petite parabole à propos de l'abeille et l'architecte, la capacité de réfléchir avant, de planifier à l'avance (et par conséquent, la conscience d'un mouvement temporel, historique entre le passé et le futur) constitue la distinction fondamentale entre l'activité animale et l'activité humaine.
Mais tandis que cette conscience "historique" est caractéristique de l'activité humaine, antérieurement à la société capitaliste, l'homme restait au sein de l'économie naturelle, qui engendrait des visions statiques ou circulaires du mouvement historique. Ces visions cycliques étaient également, par définition, des projections mythico-religieuses. En brisant les limites des économies naturelles, la bourgeoisie a également sapé ces conceptions traditionnelles, et s'est constituée en une classe à l'esprit le plus historique et le plus scientifique de toutes les classes dominantes précédentes.
Certes, toutes ces avancées prennent place aux confins de l'aliénation, et donc de l'idéologie. En fait, la vision du monde "rationnelle", "scientifique" de la bourgeoisie coïncide avec le véritable sommet de l'aliénation (question jamais comprise par ces "marxistes" qui voient le marxisme et la conscience communiste comme une simple continuation ou un simple raffinement du rationalisme et de la science bourgeoise). Sous le règne de l'aliénation, l'activité consciente de l'homme est implacablement subordonnée aux forces qui sont à peine comprises ou contrôlées ; la conscience, bien qu'étant par essence un produit collectif et social, est éparpillée en d'innombrables fragments par la division du travail, surtout dans les conditions d'extrême atomisation qui caractérisent une société dominée par des rapports marchands.
Mais, de même que Rosa Luxemburg a démontré que le capital global est une réalité qui existe malgré et même comme résultat des capitaux individuels antagoniques, le marxisme affirme qu'il existe, malgré toutes ses divisions internes, une bourgeoisie "globale" qui a une conscience "globale", une classe réelle qui s'engage dans une activité vitale- consciente. Le fait que celle-ci reste une activité fragmentée, aliénée, hiérarchique, dominée par des mobiles inconscients, ne l'empêche pas de fonctionner comme facteur actif dans la vie sociale, comme force déterminante et non pas simplement déterminée.
Cela signifie que la bourgeoisie est capable d'élaborer par dessus tout, des stratégies pour la défense de ses intérêts les plus essentiels, même si 1'ensemble de la bourgeoisie ne peut jamais participer à ces plans, et même si chaque bourgeois ne peut embrasser la stratégie comme un tout.
"Stratégie" signifie planification à l'avance, avoir une sérieuse capacité à évaluer les forces en présence et à prévoir les potentialités futures. Dans une grande mesure, et particulièrement à l'époque de la décadence, la bourgeoisie a compris (encore une fois, de son propre point de vue mystifié - bien que nous puissions supposer de façon empirique que la bourgeoisie en dit toujours moins qu'elle n'en sait) que la défense de ses besoins les plus fondamentaux ne peut être confiée à quelque "fraction" du capital ; c'est pourquoi elle a développé d'énormes structures étatiques, et à l'échelle du bloc, pour s'assurer de l'accomplissement de cette tâche quels que soient les caprices de telle ou telle fraction ou parti.
Si nous considérons l'ensemble de la guerre des Falklands, que LLM citait auparavant comme un bon exemple de la capacité de la bourgeoisie à conspirer, nous pouvons avoir quelque idée de la manière dont cette division du travail s'effectue. Il ne fait aucun doute que les différents protagonistes sont entrés dans ce conflit avec différents objectifs immédiats. Galtieri, par exemple, était certainement "aspiré" par les gesticulations des USA et de la Grande-Bretagne. D'autre part, il est évident qu'il existe un fond de vérité dans l'argument des gauchistes suivant lequel la guerre des Falkland était la "guerre à l'image de Maggie", reflétant les ambitions politiques "sectorielles" de Thatcher et du parti Tory. Mais la fonction du gauchisme consiste précisément à se fixer sur ces aspects secondaires de l'activité de la bourgeoisie et donc de détourner l'attention du véritable pouvoir dans ce système social - l'Etat capitaliste, et au-dessus de celui-ci, le bloc impérialiste. En dernière analyse, les Thatcher, Reagan ou Galtieri ne sont que des figures de proue,des acteurs destinés à jouer un rôle particulier à un moment particulier. Les véritables stratégies de la bourgeoisie sont le produit des organismes d'Etat et de bloc qui représentent la véritable "communauté" du capital ; et elles sont élaborées suivant une évaluation des besoins de l'ensemble du système. Ainsi, la guerre des Falkland, malgré toutes les motivations les plus opportunistes et particulières, qui ont participé à son déclenchement, ne peut être véritablement comprise que dans le contexte des plans de guerre du bloc impérialiste occidental dans son ensemble.
Quoi que puissent penser certains révolutionnaires, la classe dominante, en élaborant ces plans, mobilise certainement ses techniques et ses découvertes les plus sophistiquées ; il est vraiment "inimaginable" que la classe dominante puisse élaborer ces plans sans prendre en compte la question la plus brûlante de notre époque - la question sociale, la nécessité de préparer la population, et surtout la classe ouvrière, à accepter la marche à la guerre. Le conflit des Falkland n'était pas simplement un match de football de plus, mais faisait partie d'une stratégie à long terme visant à liquider toute véritable résistance à la marche du capital vers un nouveau bain de sang impérialiste généralisé.
DE FAUST A MEPHISTOPHELES.
LLM nous accuse également de faire de plus en plus usage de notre analyse "machiavélique", de la prendre comme point de départ pour analyser chaque action de la classe dominante. Nous ne faisons ici aucune apologie parce que nous ne faisons que reconnaître une réalité historique - celle qui, puisque nous nous dirigeons vers la plus importante confrontation de classe de l'histoire, nous fait attester que la bourgeoisie devient plus unifiée, plus intelligente qu'à n'importe quel autre moment dans le passé.
Certes, cette intelligence de la bourgeoisie constitue une dégénérescence totale de ses grandes visions historiques, des philosophies optimistes qu'elle a élaborées dans les jours héroïques de sa jeunesse. Si, à l'époque de Goethe, Beethoven et Hegel, la bourgeoisie pouvait être personnifiée par Faust, point culminant dans les fiévreux efforts ascendants de l'humanité; dans la décadence, le côté obscur de la bourgeoisie est entré en possession de son bien - et le côté obscur de Faust c'est Méphistophélès, dont l'intelligence et le savoir immenses sont une mince couverture au-dessus d'un puits de désespoir. Le caractère méphistophélien de la conscience bourgeoise à cette époque est déterminé par les nécessités fondamentales de la période : c'est l'époque où la possibilité et la nécessité sont enfin réunies pour réaliser l'émancipation de l'humanité de la division historique de la société en classes antagoniques, de l'exploitation de l'homme par l'homme; et néanmoins, toute la science de la bourgeoisie, toute sa technologie, tous les vestiges de sa propre sagesse sont dirigés vers la préservation et la conservation du même système de l'exploitation et de l'oppression de l'homme au prix des pires monstruosités. De là le cynisme fondamental et le nihilisme de la bourgeoisie à cette époque. Mais précisément parce que c'est la période de l'histoire qui exige "de l'homme une conscience de soi positive", la maîtrise consciente de l'activité productive et des forces productives, la bourgeoisie, elle, est uniquement capable de survivre en son sein en gérant son système anarchique comme s'il était sous le contrôle conscient de l'homme. Ainsi, le capitalisme, dans la décadence, avec sa planification centralisée, son organisation internationale, et bien sûr son idéologie "socialiste" que l'on trouve partout, tend à se présenter lui-même comme une caricature grotesque du communisme. La bourgeoisie ne peut plus tolérer le libre jeu des "forces du marché" (c'est-à-dire de la loi de la valeur) ni au sein des Etats nationaux, ni entre Etats nationaux : elle a été contrainte de s'organiser et de se centraliser d'abord à l'échelle nationale, ensuite à l'échelle des blocs impérialistes uniquement pour prévenir la tendance accélérée du capital vers l'effondrement économique. Mais cette organisation nationale et internationale de la bourgeoisie atteint son point culminant lorsque la bourgeoisie se sent menacée par le réveil prolétarien - un fait qui, comme le remarque LLM lui-même, a été démontré par la réponse à tous les plus grands soulèvements prolétariens de l'histoire (cf. 1871, 1918). Comparée à ces mouvements, la grève de masse en Pologne 1980 n'était qu'un événement précurseur des événements à venir; néanmoins, la réponse unifiée de la bourgeoisie, basée sur des structures mises en place depuis des décennies, a fonctionné, d'un certain point de vue, à une échelle bien plus grande que toute collaboration antérieure entre les puissances impérialistes. Cela suppose que, dans les luttes révolutionnaires à venir, nous nous trouverons face à un ennemi qui manifestera un degré d'unité sans précédent. Nous nous dirigeons, en somme, vers la concrétisation finale du scénario envisagé par Marx et Engels dans le Manifeste Communiste : "La société dans son ensemble est de plus en plus divisée en deux grands camps ennemis, en deux grandes classes s'affrontant directement : bourgeoisie et prolétariat."
En termes plus immédiats, cela veut dire qu'aujourd'hui, alors que se préparent déjà ces immenses confrontations, nous pouvons discerner une tendance de la bourgeoisie à agir de façon de plus en plus concertée, à tenter de réduire autant que possible les effets regrettables des aspects les plus imprévisibles du système. Ainsi, par exemple, si on compare la manière dont les récentes élections en Grande-Bretagne et en RFA ont été organisées par la bourgeoisie ([2] [296]), la part du hasard a été beaucoup plus réduite qu'il y a une ou deux décennies. Nous pouvons également comparer la manière dont les campagnes pacifistes sont maintenant coordonnées dans tout le bloc occidental (et imitées dans le bloc de l'Est) avec la manière dispersée avec laquelle elles ont été menées dans les années 50 et 60. Même si ces stratégies sont souvent pleines de contradictions, même si elles ne représentent pas encore le point culminant de la conscience et de l'unité bourgeoises, elles expriment une tendance déterminée vers la création d'un unique "parti de l'ordre" pour affronter le danger prolétarien.
Nous le répétons, pour les"durs d'oreilles": cela ne signifie en rien que la bourgeoisie puisse avoir une compréhension marxiste de l'histoire ; elle ne peut surtout pas saisir le postulat marxiste suivant lequel son système peut être remplacé à travers l'action révolutionnaire de la classe ouvrière. Mais, comme nous l'expliquions il y a quelques années en réponse à certains arguments typiques des gauchistes contre notre vision de la complémentarité entre fascisme et anti-fascisme, la bourgeoisie est capable de voir que le prolétariat constitue la principale menace pour la simple préservation de son système :
"S'il est vrai qu'ils ne peuvent croire en la possibilité d'une nouvelle société édifiée par les ouvriers, ils comprennent cependant que, afin d'assurer le fonctionnement de la société, il doit y avoir de 1 'ordre, les ouvriers doivent aller travailler régulièrement, en acceptant leur misère sans broncher, en respectant humblement leurs patrons et leur Etat. L'exploiteur le plus crétin le sait parfaitement, même s'il ne sait ni lire ni écrire.
Lorsque tous ces illettrés de l'histoire commencent a sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur règne, lorsqu'ils sont contraints de fermer les usines, d 'augmenter les prix et de baisser les salaires, lorsque les germes de la révolte commencent à pousser dans les usines.... 1'histoire a mille fois montré que, après une période plus ou moins longue d'affolement, la bourgeoisie finit toujours par mettre sa confiance en une solution politique qui permet le rétablissement de 1'ordre.
Sous la pression de ses intérêts de classe, des événements en général, de façon empirique, pragmatique, telle est la manière dont la bourgeoisie en arrive finalement à accepter des solutions qu'elle avait jusqu'ici considérées comme "subversives" ou "communistes"."
("L'anti-fascisme : une arme du capital", in World Révolution n°5 et Révolution Internationale n"14).
Non, la bourgeoisie ne pourrait jamais devenir marxiste, mais au 20ème siècle, surtout depuis 1917, la bourgeoisie a appris à se draper du manteau du marxisme afin de dénaturer et de dévier les buts véritables de la lutte de classe. Dans la période particulière que nous traversons, le modèle "socialiste" de la bourgeoisie, dans les pays avancés d'occident, est contraint de prendre la forme de la gauche dans l'opposition ; demain, face à la révolution elle-même, elle pourrait bien représenter une nouvelle version, plus extrême, de la gauche au pouvoir. En aucun cas la bourgeoisie ne pourra devenir marxiste, mais elle peut et pourra imaginer des poisons idéologiques suffisamment puissants pour paralyser le mouvement vers la révolution prolétarienne ; c'est ce qui constitue; pour nous le problème essentiel. Aucune faiblesse ne pourrait être plus fatale pour la révolution que le manque de lucidité du prolétariat et de ses minorités politiques en ce qui concerne l'ensemble de toutes les armes dont dispose notre ennemi de classe.
SUR LE COURS HISTORIQUE.
A partir de ce qui vient d’être dit, nous sommes évidemment d'accord avec LLM lorsqu'il signale le lien entre notre vision des stratégies de la bourgeoisie et la question du cours historique. L'argument selon lequel la bourgeoisie tend à unifier ses forces est fondé sur l'idée suivant laquelle la classe dominante s'y trouve contrainte par un mouvement inexorable vers des confrontations de classe majeures.
Mais la régression de LLM dans sa compréhension du mode de vie de la bourgeoisie s'accompagne d'une autre régression celle du cours "parallèle", théorie de Battaglia Comunista et de la CWO, théorie adoptée également maintenant par le Communist Bulletin Group qui prétend même que telle était leur vision dès le début. L'influence du CBG sur la pensée de LLM apparaît sur de nombreuses questions, notamment celle de l'organisation -cf. son texte dans le No 5 de The Communist Bulletin. Dans un numéro antérieur de cette Revue, nous avons consacré un article à la vision de Battaglia sur cette question et nous n'avons pas l'intention ici de nous étendre sur ce point. Nous nous limiterons donc à répondre uniquement à l'une des assertions de LLM, celle qui affirme que le CCI "suspend l'histoire" lorsqu'il prétend que le prolétariat constitue un obstacle à la marche vers la guerre de la bourgeoisie.
Sur ce point, il n'y a personne d'autre que LLM qui "suspend l'histoire". Ainsi, il signale les grèves combatives en Russie avant la guerre de 14 et dit : "Vous voyez, ces grèves n'ont pas arrêté la guerre ; aussi, comment pouvez-vous prétendre qu'aujourd'hui la combativité est un obstacle à la guerre ?". Cette méthode fige l'histoire à 1914 et prend à son compte le fait que la bourgeoisie -limitée, après tout, par l'idéologie, n'est ce pas ?- n'a tiré aucune leçon de son expérience où elle est entrée dans une guerre mondiale avec un prolétariat dont la combativité n'avait pas été complètement écrasée. En fait, l'horrible exemple de 1917 a donné à la bourgeoisie une leçon qu'elle n'oubliera jamais. C'est pourquoi elle consacre toute la période des années 30 à s'assurer que la dernière goutte de la résistance prolétarienne a été effectivement asséchée et c'est précisément ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui à nouveau.
On doit également dire que l'exemple des grèves en Russie, prises hors du contexte, ne prouve rien quant à 1914. Il nous est nécessaire de rappeler ici la citation d'Internationalisme 1945 que nous avons mentionnée dans notre article sur Battaglia:
"Ainsi la reprise partielle, la recrudescence de luttes et de mouvements de grèves constatés en 1913 en Russie ne diminue en rien notre affirmation. A regarder les choses de plus près, nous verrons que la puissance du prolétariat international à la veille de 1914, les victoires électorales, les grands partis sociaux-démocrates et les organisations syndicales de masse, gloire et fierté de la 2ème Internationale, n'étaient qu'une apparence, une façade cachant sous son vernis le profond délabrement idéologique. Le mouvement ouvrier miné et fourré par 1'opportunisme régnant en maître, devait s'écrouler comme un château de cartes devant le premier souffle de la guerre."(Rapport à la conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France).
Et si l'exemple de la Russie 1913 ne tient aucun compte du véritable rapport de forces entre les classes de l'époque, la "preuve" avancée par LLM affirmant que les ouvriers du monde sont prêts à aller à la guerre parce que les ouvriers en Grande-Bretagne ont eu tendance à manifester leur "indifférence" devant le spectacle des Falkland, montre que LLM est lui-même privé de toute méthode sérieuse pour appréhender ces questions.
Il est plutôt amusant de voir le CCI accusé de suspendre l'histoire par quelqu'un qui ne prend pas en considération la force motrice réelle de l'évolution historique -la lutte de classes. Pour LLM le lien entre la crise et la guerre (de même que le lien entre la crise et la conscience de la bourgeoisie de celle-ci) est entièrement mécanique et automatique : "si la dynamique profonde du capital (l'accumulation) requiert la guerre, la guerre éclatera... quelle que soit la situation de la lutte de classe". Donc, les contradictions inhérentes au capital sont réduites à leur aspect le plus réifié -les lois économiques objectives de l'accumulation- tandis que la contradiction entre le capital et le travail, la principale contradiction sociale, est évoquée hors de l'existence. Au lieu d'un combat dynamique entre deux forces sociales, on nous donne un tableau complètement statique : soit le prolétariat fait la révolution, soit il "reste sous l'emprise de l'idéologie dominante" et est "déjà défait idéologiquement" (Battaglia défend la même idée quand il nous dit que nous vivons sous le "joug de la contre-révolution jusqu'au surgissement de la révolution). C'est comme si les deux classes se dressaient telles des statues, l'une face à l'autre, dans leur position de combat, au lieu d'engager une lutte qui monte et descend, qui avance et recule, et sans laquelle le renforcement de l'agression d'un côté exige une réaction correspondante de l'autre. Une véritable suspension du mouvement de l'histoire...
Il est une chose que LLM pouvait reconnaître : c'est le fait que la vision de Battaglia et de la CWO du cours historique est conditionnée par leur incapacité à voir le prolétariat comme une force sociale même quand il n'a pas encore fait surgir le parti mondial. Un tel aveuglement peut conduire les libertaires et conseillistes d'aujourd'hui (voir l'article essentiellement anti-centraliste de LLM dans le Communist Bulletin) à commencer à caresser l'idée que tout est une question de "direction" et que le surgissement du parti est le seul facteur actif dans la situation. Mais pour nous, la possibilité réelle de reconstitution du parti est fondée sur le fait que nous allons vers des affrontements de classe massifs au coeur du système. Ces affrontements, non seulement clarifieront la question du cours historique, mais nous permettront également de faire un gigantesque pas en avant dans notre compréhension du problème de la conscience -non seulement celle de la bourgeoisie, mais plus encore, celle du prolétariat et de la société humaine qui émergera de la révolution. Un saut qualitatif dans la lutte de classe exigera un saut correspondant sur le plan théorique ; mais en cherchant refuge dans les abris des empiristes et des sceptiques du mouvement révolutionnaire, le camarade LLM laisse passer la possibilité de faire une contribution réelle sur cette question fondamental .
CDW
[1] [297] LLM recourt ici à une subtile déformation des mots, laissant supposer que, pour le CCI, les campagnes pacifistes, et même le conflit au Salvador, ont été créés ex nihilo, tels quels, par une bourgeoisie omnipotente. Il laisse même supposer dans une note (que nous n'avons pas mentionnée, faute de place) que cette vision était implicitement contenue dans notre résolution sur la situation internationale au Sème Congrès du CCI, malgré la concurrence interne. Que dit, en réalité, la résolution ? Le texte parle des "grandes campagnes pacifistes qui touchent - avec un certain succès - la plupart des pays occidentaux" et qui "s'appuient sur une réelle inquiétude suscitée par les préparatifs guerriers". En d'autres termes, les campagnes pacifistes existent parce que la bourgeoisie a besoin de récupérer cette inquiétude et de 1'utiliser à des fins anti-ouvrières ; il ne s'agit pas d'une création ex nihilo mais d'un subtil travail de transformation de la combativité. Mais LLM prétend-t-il que ces campagnes ne sont pas organisées par la bourgeoisie ? Peut-être a-t-il momentanément oublié que la gauche, le CND (Campagne pour le Désarmement Nucléaire), etc. font partie de la bourgeoisie ?
Nous aurions pu faire une remarque semblable à propos du Salvador : de tels conflits dans des régions sous-développées ont évidemment leurs bases objectives. La question pour nous est de savoir quel usage la bourgeoisie mondiale fait de ces conflits qui peut inclure, bien sûr, leur exacerbation pour des raisons de propagande et de mystification. Enfin, en ce qui concerne 1'approbation des USA à la prise de pouvoir des sandinistes, voir WR n°27 "Les sandinistes, agents de1'impérialismeUS".
[2] [298] L'organisation des dernières élections en RFA pour mettre en place l'orientation classique droite au pouvoir / gauche dans l'opposition était si évidente que la CWO, qui se situe habituellement sur la ligne de front de la critique empirique, pouvait écrire un article dans Workers'Voice n° 11 prenant clairement comme point de départ l'idée suivant laquelle le gouvernement a été mis en place non pas par la libre décision du "peuple allemand", mais par 1'ensemble du bloc occidental.
Questions théoriques:
- Décadence [299]
- Le cours historique [7]