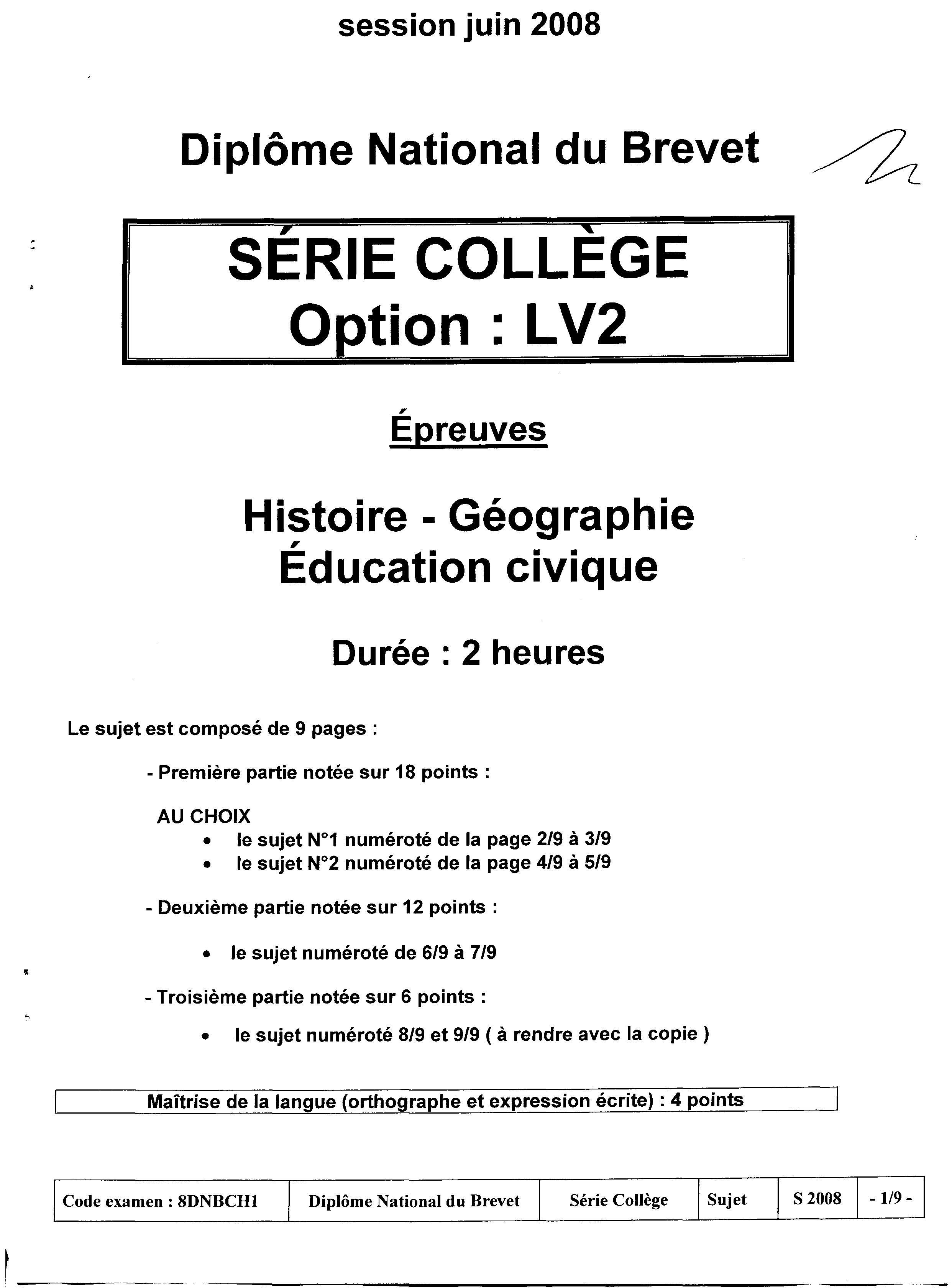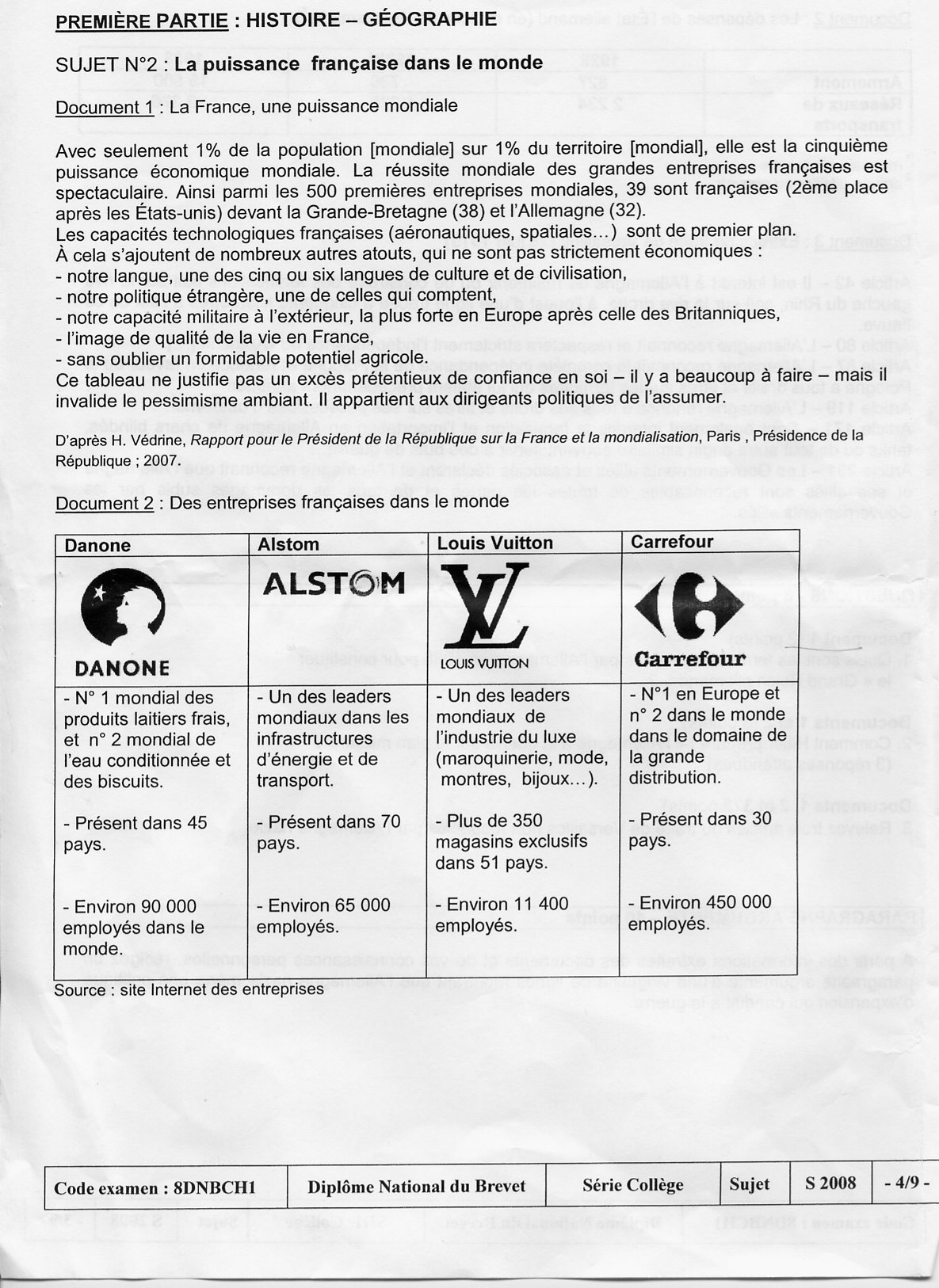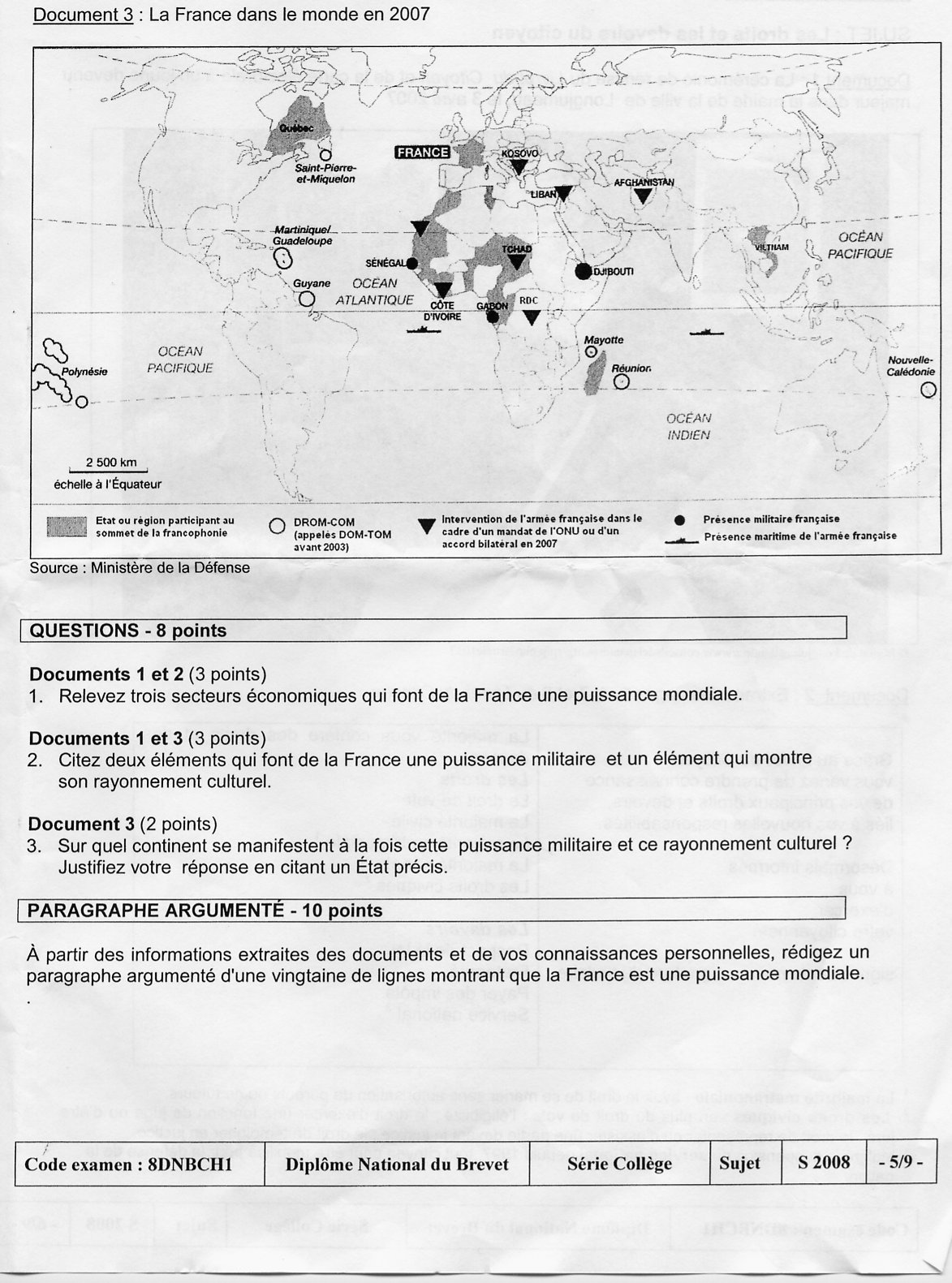ICConline - 2008
- 4742 reads
1968 au Japon : le mouvement étudiant et les luttes ouvrières
- 7670 reads
Introduction du CCI
Comme nous l'avons déjà relevé dans plusieurs articles de la Revue Internationale et dans notre presse territoriale, les événements de mai 1968 en France n'étaient qu'une partie d'un mouvement plus vaste dans le monde.
Nous publions ici un article d'un camarade au Japon qui démontre clairement que ce mouvement plus vaste a aussi compris un épisode dans ce pays malgré les difficultés et les particularités historiques du Japon.
La future révolution prolétarienne sera internationaliste et internationale ou ne sera pas. C'est une des grandes responsabilités des internationalistes du monde entier d'inscrire résolument aujourd'hui leur expérience locale dans le cadre des événements mondiaux, de comprendre le mouvement de la classe ouvrière dans n'importe quel lieu comme n'étant qu'une partie, une expression d'un ensemble plus vaste et de contribuer à un débat international au sein de la classe ouvrière sur les leçons des événements passés, pour l'avenir de la lutte contre un capitalisme moribond. Nous saluons donc l'effort du camarade Ken pour replacer les événements de 1968 au Japon dans un contexte historique et global. Nous soutenons de tout cœur sa conclusion : « Nous serions satisfaits si ce bref résumé de la réflexion sur le « 68 » japonais pouvait contribuer de quelque façon à la coordination internationale de la classe ouvrière dans son ensemble (ce qui était la chose la plus importante et qui est la chose la plus importante maintenant. »
Il y a plusieurs points dans l'article qui sont ambigus pour nous soit à cause des difficultés de traduction soit du fait de notre ignorance de l'histoire du Japon. Nous n'allons en souligner que quelques-uns ici, parce que nous pensons que ce sont des éléments importants pour le débat au sein des internationalistes japonais et plus généralement :
-
Il est clair que les luttes ouvrières ont revêtu plusieurs formes pendant cette période : tentatives d'auto-organisation, et même d'autogestion, beaucoup d'entre elles ayant eu leurs semblables en Europe par exemple. Il était inévitable à cette époque que les ouvriers aient été influencés par les idées des partis « socialistes » et « communistes » (c'est-à-dire staliniens) et des idées trade-unionistes ; il semble que cela ait donné une certaine importance au syndicat SOHYO. Cependant, ce qui n'est pas clair pour nous, c'est à quel niveau SOHYO était une expression d'un réel mouvement ouvrier sous la forme de grève sauvage par exemple, qui aurait été dévoyé vers une tentative impossible de créer un nouveau syndicat ou si c'était une tentative des fractions de gauche de la classe dominante de créer une structure plus « radicale » qui pouvait canaliser le mécontentement et la lutte des ouvriers. Quelles sont les leçons à tirer de l'expérience de SOHYO en termes d'organisation des luttes ouvrières aujourd'hui ? Quelle comparaison pouvons-nous faire avec d'autres luttes ouvrières dans le monde, en particulier avec la grève massive en Pologne en 1980 ?
-
Il nous apparaît clairement, d'après les discussions avec les camarades au Japon, que la dégénérescence des luttes politiques internes entre les principaux groupes gauchistes et les sectes (qui apparemment ont fait au moins 100 morts et plus de 1000 blessés graves au cours des années) a profondément traumatisé le milieu politique en général. Quelles leçons doivent en être tirées ? Pourquoi la « Nouvelle Gauche » a-t-elle été « condamnée à la stagnation » comme le dit le camarade ? Il nous semble que la nouvelle génération au Japon en 1968 a souffert de deux handicaps : d'un côté, une tendance au nationalisme anti-américain, résultat de la situation du Japon, pays occupé militairement, et d'un autre côté, le manque de toute tradition communiste de gauche qui aurait pu servir de point de référence : les travaux de Luxembourg, Pannekoek, Görter, sont pratiquement inconnus et la tradition de la Gauche communiste représentée par la Gauche italienne n'a eu aucun écho.
-
Dans une partie du texte, le camarade parle de « la guerre révolutionnaire indochinoise-vietnamienne » et de la « solidarité révolutionnaire avec les peuples du Vietnam et d'Asie ». Pour nous, la guerre au Vietnam était une confrontation impérialiste entre les États-Unis et le Viêt-Cong qui était soutenu soit par la Chine soit par la Russie. Il n'y a eu que très peu de jeunes gens qui s'opposaient à la guerre au Vietnam et argumentaient leur rejet de la guerre avec une réelle position internationaliste contre la participation à toute guerre impérialiste et un appel à la lutte de classe contre les deux camps dans un conflit impérialiste. C'est une vraie tragédie de l'histoire, qu'à travers le monde, une grande partie de la jeune génération ait été entraînée sur le terrain du soutien aux luttes de libération nationale, en pensant que cela renforcerait la lutte contre « l'impérialisme ». Maintenant, 40 ans après, il est vital d'en arriver à une vision plus profonde de la nature de ces guerres à l'époque. Quel bilan pouvons-nous tirer de ces prétendues luttes de libération nationale ?
Nous avons voulu que cette introduction soit aussi brève que possible de façon à limiter les problèmes de traduction. Il y a clairement d'autres questions soulevées dans cet article qu'il serait nécessaire de discuter ; cependant, nous pensons que les trois mentionnées ci-dessus sont probablement les plus importantes. Nous espérons que la publication de cet article, avec nos commentaires, en anglais, français et japonais, encouragera le débat international qui contribuera à une meilleure compréhension du « Mai 68 japonais » et à un renforcement du milieu internationaliste au Japon même. En ce sens, « le monde devient plus grand, mais aussi plus petit » !
Le soubassement historique
Ce sont les organisations auto-gouvernées d'étudiants qui s'étaient répandues dans les universités de tout le pays, qui ont servi de base massive au mouvement dissident, qui a eu une signification extraordinaire dans l'histoire d'après-guerre pendant la lutte contre le traité de l'AMPO (Coopération mutuelle et Sécurité) entre les États-Unis et le Japon, et qui a cependant semblé stagner dans la période qui a suivi immédiatement. En 1965, après une lutte similaire contre le traité pour la normalisation des relations entre le Japon et la République de Corée (ROK), surgit rapidement la période politique du mouvement anti-guerre, caractérisée par les luttes du Zengakuren et du Zenkyoto dans les luttes anti-AMPO et à propos des luttes des années 1970 contre la présence de bases militaires américaines à Okinawa.
Au sein du mouvement ouvrier, le SOHYO (Conseil Général des Syndicats du Japon) prit de l'importance lorsqu'il mena la grève des mines de charbon Mitsui Miike en 1950-60, le plus grand mouvement de travailleurs dans la période après guerre, ainsi qu'avec sa participation à la lutte contre l'AMPO en 1960, avec des revendications pour la paix, contre la guerre, et toutes sortes de revendications démocratiques.
A côté des partis parlementaires existants, c'est-à-dire le Parti Communiste Japonais (JCP) et le Parti Socialiste Japonais (JSP), les organisations étudiantes/ouvrières sous leur influence, et les syndicats sous celle de SOHYO, il y avait différentes sectes et organisations telles que la Ligue Communiste Japonaise (BUND, la principale section du Zengakuren pendant la lutte contre l'AMPO en 1960) et la Ligue Communiste Révolutionnaire Japonaise « sous l'influence de la Fédération Trotskiste Japonaise » qui organisaient et participaient aux luttes.
Ces groupes étaient des organisations qui se retrouvaient sur une critique de l'URSS et du stalinisme au moment de la répression du soulèvement en Hongrie en 1956 et des critiques à la ligne du Parti Communiste Japonais.
Les luttes dans l'université nationale, Zenkyoto
Alors que l'opposition à la guerre du Vietnam grandit à l'échelle mondiale, la lutte dans les universités s'accélère au Japon.
Des luttes sont menées contre l'augmentation des droits aux universités de Keio en 1964, de Waseda en 1965 et Chuo en 1966.
En 1968, le département de médecine de l'université de Tokyo entre en grève illimitée contre la « loi d'enregistrement des docteurs » (qui aurait augmenté la période d'internat des diplômés de deux ans et introduisait une stricte hiérarchie dans les postes). Un Comité de Lutte de l'ensemble des Étudiants (Zenkyoto) est constitué, une grève illimitée est déclarée et des barricades sont élevées par dix départements académiques. L'année suivante, en 1969, 8500 policiers anti-émeutes attaquent les étudiants en grève et les barricades dans la salle de lecture Yasuda, entre autres, sont évacuées par la force. Plus de 600 personnes sont arrêtées dans l'université de Tokyo. Les examens d'entrée à l'université de Tokyo la même année sont annulés en conséquence.
A la plus grande université privée du Japon à cette époque, l'université Nippon (Nichidai), une grève est déclenchée par une évasion fiscale en lien avec des politiques injustes d'entrée pour les étudiants, tout autant que par la découverte d'environ deux milliards de yens (100 millions de dollars environ) de droits d'inscription non enregistrés. Plus de 35 000 personnes et étudiants assistent à une session massive de négociation à laquelle le directeur de l'université est obligé d'assister.
Ces deux luttes aux universités Todai et Nichidai allaient être les symboles du mouvement étudiant et du Zenkyoto ; le mouvement se répand dans plus de 300 universités et grandes écoles dans le pays. Les blocages, avec des barricades, et les grèves étudiantes continuent jusqu'au début des années 1970, en liaison avec le mouvement anti-guerre, le mouvement anti-AMPO et les luttes concernant Okinawa qui culminent pendant cette période. Ces mouvements occupent les rues.
La différence définitive entre le Zengakuren et le Zenkyoto pendant les luttes anti-AMPO des années 1960 porte sur la question d'organisation.
Le Zengakuren est organisé comme son nom abrégé le reflète : « Fédération de l'ensemble du Japon des associations étudiantes auto-organisées », en organisation verticale qui commence au niveau de l'université, pour concerner ensuite le département, les classes, et les individus (l'adhésion est automatique pour tous les étudiants). En ce sens, le Zengakuren avait été créé selon les « associations auto-dirigées de Postdam », c'est-à-dire la démocratisation du haut vers le bas introduite par les forces américaines d'occupation.
Le Zenkyoto est quant à lui bâti sur une participation extrêmement large et libre, exactement l'opposé des associations auto-dirigées, le Zengakuren ou les partis sectaires, et s'efforce d'être un mouvement de masse basé sur la démocratie directe. Dès le début, le Zenkyoto était une organisation pluraliste, à caractère profondément parlementaire, centré sur les luttes particulières. La majorité de ses membres étaient considérés comme des « radicaux non sectaires », c'est-à-dire ceux qui ne sont affiliés à aucune secte politique particulière.
Le mouvement contre la guerre au Vietnam
Faisant fructifier les luttes des années 1960 anti-AMPO, anti-guerre, et anti-bases militaires américaines, aussi bien que celles contre le traité de normalisation ROK, un mouvement contre la guerre du Vietnam commence à se développer aussi au Japon.
En 1965, une organisation appelée Beheiren (ce qui veut dire « Union des citoyens pour la paix au Vietnam ») se constituait. Il n'y avait ni plate-forme ni adhésion d'aucune sorte, le mouvement dépendait des initiatives indépendantes de ses membres. Beheiren s'étendit à l'échelle nationale, arrivant à constituer jusqu'à 300 groupes.
Le gros du mouvement était constitué du mouvement étudiant dans son ensemble, du Zengakuren, du Parti Socialiste, des syndicats tels que SOHYO et des organisations de la jeunesse contre la guerre. Toutes sortes de luttes contre la guerre étaient menées.
Octobre 1967 voit la première phase de la lutte à l'aéroport de Haneda et une lutte pour empêcher le premier ministre d'alors, Eisaku Sato, de visiter le Sud-Vietnam. Un étudiant de l'université de Kyoto meurt dans une manifestation.
Le même mois : journée internationale contre la guerre. Des manifestations et des meetings se tiennent dans tout le pays, regroupant 1, 4 million de personnes.
Novembre : deuxième phase de la lutte à l'aéroport de Haneda (lutte pour empêcher le premier ministre de visiter les États-Unis). De violents combats entre le Zengakuren et les brigades anti-émeutes durent 10 heures. Plus de 300 arrestations ont lieu dans tout le pays en un seul jour.
Janvier 1968 : lutte pour empêcher le sous-marin nucléaire américain Enterprise d'accoster au port de Sasebo.
Février : meetings massifs pour empêcher la construction d'un nouvel aéroport à Sanrizuka (connu maintenant comme l'aéroport international de Narita). Les fermiers à proximité du site de l'aéroport et les étudiants se battent ensemble pour la première fois. 3000 personnes affrontent la police anti-émeutes.
De février à mars, lutte contre l'ouverture de l'hôpital de guerre d'Ojino. Les luttes violentes débordent dans la ville de Tokyo.
Avril : journée de lutte à propos d'Okinawa. 250 000 personnes participent à l'échelle nationale. Une « loi pour la prévention de l'activisme destructif » est votée contre la Ligue Communiste Révolutionnaire (Chukaku-ha) et la Ligue Communiste.
(Mai : grève générale à Paris et dans toute la France)
Octobre : action internationale unifiée contre la guerre. 4,5 millions de personnes participent à l'échelle nationale, avec les slogans « contre la guerre au Vietnam, pour le retour d'Okinawa, stop à l'accord AMPO ». La Ligue Communiste et la Ligue des Étudiants Socialistes attaquent le Département de la défense ; le Parti socialiste, la Fraction Socialiste de la Libération de la Jeunesse attaquent le parlement et l'ambassade américaine dans laquelle ils se précipitent. La Ligue des étudiants socialistes Chukaku-ha (IVe Internationale) et d'autres gens occupent la station de Shinjuku qui est le point d'approvisionnement crucial pour les tankers américains. Des dizaines de milliers de personnes tiennent un meeting de masse autour de la station. Les deux syndicats nationaux de cheminots partent en grève illimitée. Le gouvernement japonais inculpe les participants pour incitation à l'émeute.
Avril 1969 : journée de lutte sur Okinawa.
Septembre : un meeting de masse constitue un rassemblement national Zenkyoto. 26 000 étudiants dans 178 organisations de 46 universités du Japon se rencontrent à Tokyo.
Octobre : journée internationale contre la guerre. 860 000 personnes marchent avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste et SOHYO. Dans des conditions très dures de répression, les différents partis de la Nouvelle Gauche s'engagent dans la lutte armée autour de Tokyo. Les départements de la police et les locaux de la police sont attaqués. La tactique connaît une escalade avec l'emploi de cocktails Molotov et d'explosifs. 1500 personnes environ sont arrêtées.
Le même mois, les cheminots, suivis par 4 millions de travailleurs de l'industrie dans 67 syndicats, planifient une grève de 24 heures en novembre.
Ces luttes se prolongent dans celles dirigées contre l'AMPO et la base d'Okinawa dans les années 1970.
Le mouvement ouvrier et les autres luttes
Au milieu de l'expansion économique des années 1960, le mouvement ouvrier japonais se trouvait dans une période de croissance continue, centrée sur le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le syndicat SOHYO, et traitait tout un tas de problèmes politiques tels que la place de l'Union Soviétique et du « Bloc socialiste », le progrès de la lutte anti-impérialiste (anti-américaine) et à l'échelle nationale, des luttes contre l'AMPO, Okinawa et la guerre. Les conflits sociaux et les grèves ont culminé après 1968 (en termes de conflits et de participants), avec un pic en 1974. Dans cette période, ont lieu l'offensive sociale nationale du printemps de 1974 (2 270 000 travailleurs dans 71 syndicats, qui ont gagné une augmentation de salaire de 32,9 %), la grève de 1975 pour le droit de grève (menée principalement par le KORYOKO - Fédération des Syndicats des Entreprises gouvernementales et des corporations publiques- et les syndicats nationaux de cheminots), décrite comme la deuxième plus grande grève d'après-guerre, ainsi que d'autres grèves.
Les sectes de la Nouvelle Gauche mettaient en avant des objectifs tels que « créer un mouvement ouvrier sur une base de classe » et intervenaient dans les avant-gardes ouvrières existantes, créant des factions de gauche en leur sein. Ces sectes avaient aussi pour but une direction indépendante incluant l'organisation des ouvriers déshérités inorganisés et celle de ceux qui travaillaient dans des corporations plus petites, en créant des syndicats régionaux et en faisant des tentatives de production autonome et d'auto organisation.
En 1965, le Comité de Coordination anti-guerre affilié au Parti socialiste (mis en place pour s'opposer à la guerre au Vietnam et mettre fin au traité de normalisation des relations Japon-Corée) arriva à s'étendre à une grande échelle avec les slogans « autonomie, originalité et unité », sans impliquer les syndicats de travailleurs ou les organisations verticales ; cependant cette expansion fut déchirée par les luttes hégémoniques des sectes, de la même façon que le sera le mouvement Zenkyoto quelques temps après.
Alors que les luttes anti-AMPO, anti-guerre/anti-bases, la lutte d'Okinawa et de Sanrizuka continuaient sans interruption, les sectes de la Nouvelle Gauche commencèrent à consacrer leur énergie à des luttes plus parcellaires, comme les luttes pour l'immigration (et aussi pour une loi qui reconnaisse les réfugiés), en solidarité avec les Coréens et les Chinois vivant au Japon, en solidarité avec les peuples des pays de l'ASEAN, comme également le mouvement de libération des femmes, le mouvement de libération Buraku et celui des handicapés.
Il y avait en même temps des luttes régionales, des luttes contre la pollution comme le combat contre la maladie de Minamata (du mercure provenant d'une usine locale avait empoisonné des milliers de personnes), le mouvement anti-nucléaire, des mouvements pour la défense de l'environnement, des luttes de journaliers (à Sanya, Kamagasaki, etc.) et la lutte en cours contre le système impérial.
Les fruits de « 68 »
Aujourd'hui, la structure d'après guerre, le soi-disant « système de 1955 », s'est « écroulé ». Nous sommes passés d'une dictature de parti unique, le Parti Démocrate Libéral (LDP) à un système bipartite qui comprend aussi le Parti Démocratique du Japon (DPJ). Le Parti socialiste, qui agissait en tant que pied gauche de la domination politique de la bourgeoisie est démantelé, les sièges du Parti Communiste Japonais au parlement sont nettement moins nombreux et l'influence des organisations de gauche existantes s'est notablement affaiblie.
Le système américano-nippon est très puissant et les bases ou les institutions américaines sont présentes dans 135 endroits de la nation (20 % de la principale île d'Okinawa sont occupés par l'armée américaine). Les envois de troupes en Irak et les « menaces » de la République Démocratique Populaire de Corée ont servi de prétexte à une réforme accélérée de la constitution de la paix centrée sur « l'article 9 ».
En ce qui concerne l'avant-garde ouvrière, SOHYO a été démantelé et aggloméré avec RENGO (la Confédération syndicale japonaise). Les sectes de la Nouvelle Gauche qui avaient œuvré pour la création de « partis révolutionnaires ouvriers pour remplacer les partis socialistes/communistes » et « un mouvement ouvrier sur une base de classe » ont été contraintes à la stagnation.
En prenant cela en compte, il est important de déchiffrer la signification de 1968, qui a été un point de jonction dans l'histoire du monde. Pour nous, la classe ouvrière japonaise, il est particulièrement important de tirer un bilan du « 68 » japonais du point de vue du mouvement communiste international.
-
Les réalisations et les limites du Parti Communiste Japonais (JCP) qui, pendant les deux périodes, quand la branche japonaise du COMINTERN était active et dans la période d'après-guerre pendant laquelle il a été légalisé, avait en vue « l'indépendance souveraine en défense du socialisme scientifique » et a pris le chemin du parlementarisme.
-
La critique du stalinisme et du JPC et ses résultats, la Nouvelle Gauche, la naissance et la stagnation du trotskisme japonais.
Avec ces questions au premier plan, à quel degré le « 68 » japonais, qui a vu surtout se battre les étudiants et les jeunes ouvriers, se connecte-t-il avec les « 68 » américains et français, le « printemps de Prague », « l'automne chaud italien », la grève de masse en Pologne qui s'est déroulée pendant l'hiver 1970-71 et qui a donné naissance à au syndicat Solidarité 1, la guerre révolutionnaire indochinoise-vietnamienne ?
Ce sont des questions que nous devons continuer à examiner.
Le « 68 » japonais a été une lutte qui mit en question la réelle signification de la « démocratie d'après-guerre », qui incluait des luttes faites par les étudiants et les ouvriers eux-mêmes, qui refusaient le futur proposé par la gauche existante, les staliniens et les socialistes. C'était une nouvelle lutte dans laquelle la classe ouvrière japonaise essayait de donner forme au futur en exerçant son hégémonie. Ce « 68 » a été une collection de luttes à la recherche de l'internationalisme prolétarien, en particulier de la solidarité avec les peuples du Vietnam et d'Asie, qui tentaient de réaliser un vrai monde de paix dans lequel les préjugés, la répression et l'exclusion sous toute ses formes seraient éradiqués.
En définitive, dans sa période ascendante il a été incapable de sortir du cadre de la démocratisation rapide et des parties du mouvement se sont orientées vers du simple terrorisme. Incapables de gagner le soutien de plus de 50 millions de travailleurs, les buts des luttes n'ont en grande partie pas été réalisés et restent encore à atteindre aujourd'hui.
Cependant, nous sommes conscients de changements dans le système japonais politique, économique et social après « 68 ».
L'abolition de l'enregistrement des étrangers et de la loi sur les empreintes digitales (obligation pour tous les étrangers sur le sol japonais) ; la promulgation de « la loi sur l'égalité des chances entre les sexes » ; un soutien lent mais croissant à l'élimination des barrages pour les handicapés et à la normalisation (ce pays n'a fait une loi contre la discrimination vis-à-vis des handicapés en matière de droits qu'en 2004 avec la « loi des handicapés ». Cette loi établit que « personne ne peut avoir une conduite qui lèse les droits et le bien-être d'une personne handicapée parce que cette personne est handicapée »). contrairement à la période pendant laquelle la lutte contre la maladie de Minamata avait été menée, aujourd'hui, les officiels et les compagnies font de la surenchère pour promouvoir les thèmes de l'écologie, des économies d'énergie et des dépollutions. Les mouvements pour les droits de l'homme, la préservation de l'environnement et les luttes pour les régions se sont transformés en ONG et organisations à but non lucratifs qui s'organisent à ces fins. Et ainsi de suite !
Des choses qui paraissaient irréalisables à l'époque se sont réalisées à un certain niveau (sans prendre en compte dans quel but cela a été fait). Évidemment, la plupart de ces acquis avaient été des revendications « démocratiques » et ne représentaient rien d'autre que des compromis et l'harmonie avec l'ennemi de classe. Savoir que la collaboration de classe prévaut dans la situation du capitalisme japonais à présent peut nous aider à nous mettre en mouvement pour des victoires réelles sans baisser la garde.
Cependant, « 68 » en tant que mouvement social a encore un poids même aujourd'hui. Les semences de « 68 » qui sont allées au-delà du cadre de la culture du contre-pouvoir et de la résistance à étendre à toute la société contribueront certainement à la germination de changements dans le futur.
Trente après la croisée des chemins de 68, nous serions satisfaits si ce bref résumé de la réflexion sur le « 68 » japonais pouvait contribuer de quelque façon à la coordination internationale de la classe ouvrière dans son ensemble (ce qui était la chose la plus importante et qui est la chose la plus importante maintenant).
A tous nos camarades qui luttent en Europe.
Le monde devient plus grand, mais aussi plus petit. Nous espérons avoir de réelles occasions de nous organiser à vos côtés.
Ken (23 mars 2008)
1 Le camarade fait ici une confusion avec la grève de masse en Pologne de 1980/81 (NDLR).
Géographique:
- Japon [1]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [2]
1968 en Allemagne : au delà du mouvement de protestation, la quête d'une société nouvelle (1ère partie)
- 11298 reads
Comme nous l'avons montré dans d'autres articles de notre presse, vers le milieu des années 1960, un mouvement international s'est développé contre la guerre au Vietnam et contre les premiers signes d'une aggravation de la situation économique. Dans de nombreux pays, ce mouvement portait le germe d'une remise en question de l'ordre existant. Le mouvement en Allemagne a commencé assez tôt, et il devait avoir un impact international majeur.
L'opposition hors du parlement bourgeois
Alors que de plus en plus de manifestations s'organisaient à partir du milieu des années 1960, principalement contre la guerre au Vietnam, ces manifestations prirent une autre dimension quand le 1er décembre 1966 une large coalition gouvernementale formée par le CDU/CSU et le SPD se mit en place à Bonn et qu'à peine une semaine plus tard, le 10 décembre, Rudi Dutschke appela à la formation d'une "opposition extra parlementaire" (APO). Le ralliement et l'entrée du plus grand parti "de gauche" au gouvernement entraîna une grande déception et les gens se détournèrent du SPD. Alors même que le SPD s'activait à faire campagne pour la participation aux élections, des manifestations se multipliaient dans les rues. Au début de ce mouvement, il existait un nombre considérable d'illusions sur la démocratie bourgeoise en général et sur la social-démocratie en particulier. L'idée était que, puisque le SPD avait rejoint le gouvernement, il n'existait plus de force d'opposition majeure au parlement et donc que c'était de la rue qu'il fallait organiser cette opposition. Puisque le rôle de plus en plus évident de la social-démocratie était de constituer une force de soutien au système au sein de la Grande Coalition, "l'opposition extra parlementaire" était davantage dirigée contre la récupération par le biais de la démocratie bourgeoise, contre la participation aux élections parlementaires et en faveur de l'action directe. Cette orientation fut un élément essentiel du lent processus qui mit fin à la paix sociale.
La résistance d'une nouvelle génération
La classe dirigeante se vit dans l'obligation de faire entrer le SPD au gouvernement, en réaction à la réapparition de la crise économique après le boom qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Après le long miracle économique, la croissance s'est brusquement effondrée en 1965. Même si cet effondrement a démarré alors que la croissance était à un taux très élevé, et que les taux de l'époque passeraient maintenant pour des utopies, quelque chose de capital sur le plan historique s'est produit alors. Le miracle économique de l'après-guerre était révolu. Il y eut une première vague de suppressions d'emplois et on supprima toutes les primes et les avantages pour ne garder que les salaires de base tels qu'ils avaient été négociés. Même si toutes ces mesures apparaissent extrêmement "douces", si on les compare aux mesures d'austérité actuelles, elles provoquèrent un véritable choc dans la classe ouvrière. Le cauchemar de la crise était réapparu. Mais même si cette réapparition fut soudaine, la classe ouvrière ne réagit pas et ne déclencha alors aucune importante vague de grèves. Cependant, entre 1965 et 1967, quelques 300 000 ouvriers participèrent à diverses luttes. Une vague de manifestations démarra dans l'ensemble du pays avec une grève sauvage en décembre 1966 à l'usine de machines d'imprimerie Faber et Schleicher d'Offenbach. Les ouvriers exigeaient le renvoi d'un contremaître qui faisait preuve de brutalité. De plus, des conflits concernant le temps de travail surgirent dans les ateliers ILO à Pinneberg, près de Hambourg, en septembre 1967. Presque toutes ces luttes menèrent à des grèves sauvages. Elles contribuèrent de façon significative à un changement d'attitude, particulièrement chez les jeunes ouvriers et spécialement chez ceux en formation (à l'époque, il n'y avait pas de chômage important des jeunes, la plupart d'entre eux accédaient à un emploi). Alors que pendant des années, l'idéologie du "partenariat social" et l'image d'un Etat paternaliste bienveillant s'étaient largement répandues, les premières fissures de la "paix sociale" apparaissaient maintenant Avec le recul, ces petites grèves étaient les signes annonciateurs d'une rupture plus importante qui devait se produire en Allemagne en 1969.
Avec ces actions peu spectaculaires et hésitantes, la classe ouvrière allemande avait envoyé un message important, ce qui avait également donné une impulsion au mouvement de manifestation des étudiants. Même si, du point de vue international, leurs luttes défensives n'avaient pas placé les ouvriers allemands au premier plan, ils firent partie intégrante du mouvement à son tout début.
Ce ne fut pas principalement la dureté immédiate des premières mesures d'austérité qui déclencha le mouvement. On pouvait aussi deviner l'agitation d'une génération nouvelle. Après les privations de la crise économique des années 1930 et les années de famine pendant et après la guerre, après l'épuisement brutal de la force de travail pendant la période de reconstruction et les longues journées de travail aux salaires très bas, un niveau de consommation plus élevé était en train de se mettre en place. Mais, parallèlement, ces nouvelles conditions de travail forcé eurent un effet répulsif, particulièrement chez les jeunes ouvriers. Un sentiment mal défini mais généralisé se mettait en place : "Nous ne pouvons pas croire que c'est comme ça et pas autrement. Nous avons besoin de quelque chose d'autre que juste des biens de consommation. Nous ne voulons pas faire comme nos parents : nous épuiser à la tâche, être lessivés, usés jusqu'à la corde." Très lentement, une nouvelle classe ouvrière non défaite surgissait, une génération d'ouvriers qui n'avaient pas connu la guerre et qui n'étaient pas prêts à accepter l'ennuyeuse routine capitaliste sans résister. La recherche d'une alternative, encore mal définie et confuse, était en route.
Ce qui se cachait derrière le mouvement de protestation : la recherche d'une société nouvelle
La formation d'une opposition "extra parlementaire" à la fin de 1966 n'a été qu'un pas au milieu d'un mouvement plus grand qui se développait au sein de la jeune génération, en particulier des étudiants. A partir de 1965, avant même que la crise économique n'éclate, de plus en plus d'assemblées générales dans les universités étaient le lieu de débats passionnés sur les façons et les moyens de contester.
Suivant l'exemple des Etats-Unis, dans beaucoup d'universités, on formait des groupes pour contrecarrer les universités bourgeoises "établies" ; une "université critique" se mettait en place. Dans ces forums, il n'y avait pas que des membres de la SDS (Ligue Allemande des Etudiants Socialistes) qui décidaient de toutes sortes de formes spectaculaires de contestation de l'autorité. Au cours de cette première phase du mouvement, la vieille tradition du débat, de la discussion dans les assemblées générales publiques, s'est partiellement ranimée. Même si beaucoup se sentaient attirés par l'envie pressante d'actions spectaculaires, l'intérêt pour la théorie, pour l'histoire des mouvements révolutionnaires a refait surface, avec en même temps le courage d'envisager la victoire sur le capitalisme. Beaucoup ont exprimé l'espoir d'une autre société. Rudi Dutschke l'a résumé en juin 1967 de la façon suivante : "Le développement des forces de production a atteint un point tel que l'abolition de la faim, de la guerre et de la domination est devenue matériellement envisageable. Tout dépend de la conscience des gens et de leur volonté de faire l'histoire, ce qu'ils ont toujours fait, mais maintenant il faut que ce soit fait d'une façon consciente et contrôlée." Un certain nombre de textes politiques du mouvement ouvrier, en particulier de la mouvance conseilliste, ont été réimprimés. L'intérêt pour les conseils ouvriers s'est très fortement accru. A l'échelle internationale, le mouvement de protestation en Allemagne était considéré comme l'un des plus actifs sur le plan de la théorie, le plus passionné de discussions, le plus politique.
Au même moment une grande partie des contestataires, tel Rudi Dutschke, ont tout de suite critiqué le stalinisme d'un point de vue théorique, ou au moins d'un point de vue émotionnel. Dutschke a considéré le stalinisme comme une déformation doctrinaire du vrai marxisme qui s'était transformé en une nouvelle idéologie "bureaucratique" de domination. Il a exigé une révolution profonde et une lutte pour le renouveau du socialisme dans le bloc de l'Est.
La répression étatique crée l'indignation
Pour protester contre la visite du Shah d'Iran à Berlin Ouest, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues le 2 juin 1967. Le gouvernement démocratique bourgeois allemand, qui soutenait inconditionnellement la dictature sanglante du Shah, était fermement déterminé à maintenir les manifestations sous contrôle en faisant usage de la violence policière (utilisation de matraques et arrestations violentes de manifestants par des brigades). Au cours de ces manifestations violentes, l'étudiant Benno Ohnesorg fut assassiné d'une balle dans le dos par un policier en civil (qui fut par la suite acquitté). Ce meurtre d'un étudiant a provoqué une immense indignation chez la jeunesse politisée et a donné au mouvement une dynamique supplémentaire. A la suite de cette répression d'Etat, des discussions lors d'un congrès, qui se tenait une semaine après la mort de Benno le 9 juin 1967, sur le thème "Université et Démocratie", ont révélé l'existence d'un gouffre croissant entre l'Etat et la société. Au même moment, une autre composante du mouvement de contestation prenait de plus en plus d'importance.
Le mouvement contre la guerre
Suivant la même dynamique qu'aux Etats-Unis, les manifestations et les congrès contre la guerre du Vietnam avaient commencé en 1965 et 1966. Les 17 et 18 février 1968, un Congrès International contre la guerre au Vietnam se tînt à Berlin Ouest, suivi d'une manifestation de quelques 12 000 participants. L'escalade de la guerre au Moyen-Orient autour de la "Guerre des Six Jours" en juin 1967 et surtout la guerre du Vietnam ramenaient des images de guerre dans les foyers. A peine 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle génération, dont la majorité n'avait pas connu la guerre ou qui étaient tout petits alors, s'est trouvée confrontée à une guerre qui mettait à nu toute la barbarie du système (bombardement permanent, surtout de la population civile, utilisation d'armes chimiques telles que l'Agent Orange (napalm), massacre de My Lai : davantage de bombes avaient été lâchées sur le Vietnam qu'au cours de toute la Seconde Guerre mondiale). La nouvelle génération n'était plus prête à sacrifier sa vie dans une nouvelle guerre mondiale - et donc dans le monde entier, surtout aux Etats-Unis et en Allemagne, de plus en plus de gens manifestaient contre la guerre au Vietnam.
Cependant, on peut constater le caractère contradictoire et confus du mouvement à travers l'idée de base très largement répandue alors et que Dutschke a clairement exprimée. Lui et beaucoup d'autres au SDS pensaient que la guerre américaine au Vietnam, les lois d'urgence en Allemagne et la bureaucratie stalinienne du bloc de l'Est, en dépit de toutes les différences, avaient une chose en commun : elles constituaient les éléments d'une chaîne mondiale d'un pouvoir autoritaire sur des citoyens impuissants. Les conditions pour vaincre le capital dans les riches pays industrialisés et dans le "tiers-monde" étaient différentes selon eux. La révolution ne serait pas faite par la classe ouvrière en Europe et aux Etats-Unis mais par les peuples pauvres et opprimés de la "périphérie" du marché mondial. C'est pour cela que beaucoup de gens politisés se sentaient attirés par les théories "anti-impérialistes", qui vantaient les luttes de libération nationale comme étant une nouvelle force révolutionnaire, alors qu'en réalité elles n'étaient rien d'autre que des conflits impérialistes, souvent sous la forme de guerres par procuration au cours desquelles des paysans étaient sacrifiés sur l'autel de l'impérialisme.
Même si beaucoup de jeunes étaient fascinés par les prétendues luttes de libération nationales dans le "tiers-monde" et soutenaient le Vietcong, la Russie ou la Chine lors de manifestations contre la guerre, ce qui signifie qu'ils ne défendaient pas une position fondamentalement internationaliste, il devenait quand même clair que le malaise de base par rapport à la guerre grandissait et surtout que la nouvelle génération ne pouvait pas être mobilisée pour une nouvelle confrontation entre les deux blocs. Le fait que la classe dirigeante de l'Etat allemand, qui se trouvait en ligne de front, rencontre des difficultés croissantes pour mobiliser les jeune gens pour un massacre impérialiste était particulièrement significatif.
La spirale de la violence s'installe
Dès 1965, on a assisté à des manifestations contre les projets des lois d'urgence qui donnaient à l'Etat de nombreux droits pour intensifier la militarisation et la répression. Le SPD, qui avait rejoint la coalition avec le CDU en 1966, est resté fidèle aux politiques qu'il avait d'abord pratiquées en 1918/1919 (1). Après l'assassinat de Benno Ohnesorg en juin 1967, les campagnes de diffamation à l'encontre des protestataires, en particulier à l'encontre de leurs leaders se sont intensifiées. Le tabloïd populaire allemand Bild Zeitung exigeait : « arrêtez tout de suite le terrorisme des jeunes Rouges ! ». Lors d'une manifestation pro-américaine organisée par l'Etat berlinois le 21 février 1968, des participants portaient des slogans déclarants: « Ennemi n°1 du peuple : Rudi Dutschke ». Au cours de cette manifestation, un homme qui regardait passer la manifestation fut pris par erreur pour Rudi Dutschke ; des manifestants l'ont menacé de le passer à tabac et de le tuer. Une semaine après l'assassinat de Martin Luther King aux Etats-Unis, la campagne de diffamation a finalement atteint un sommet avec la tentative d'assassinat de Rudi Dutschke le 11 avril, le jeudi avant Pâques. Entre le 11 et le 18 Avril, il y eut des émeutes, principalement dirigées contre Springer, le magnat de la presse (les manifestants criaient : "Bild Zeitung a participé à l'assassinat "). Deux personnes furent tuées, des centaines d'autres blessées. Une spirale de violence s'installa. A Berlin, les premiers cocktails Molotov furent lancés : un agent de police les mettait à la disposition des manifestants qui étaient prêts à utiliser la violence. A Francfort, on mit pour la première fois le feu à un grand magasin.
Malgré une marche sur Bonn le 11 mai 1968 comprenant plus de 60 000 participants, la coalition gouvernementale CDU-SPD s'est empressée d'adopter les lois d'urgence.
Alors qu'en France en mai 68, les manifestations étudiantes étaient repoussées à l'arrière-plan par les grèves ouvrières et que la classe ouvrière remontait sur le devant de la scène de l'histoire, les manifestations en Allemagne se trouvaient déjà dans un cul-de-sac.
Une vague de grèves ouvrières ne se déclencha que plus d'un an plus tard, en septembre 1969, surtout parce que les manifestants prolétariens en 1968 manquaient de points de repère.
Alors que certains contestataires se tournaient vers des actes de violence et que d'autres, essentiellement des activistes étudiants, se jetaient à corps perdu dans la construction d'organisations gauchistes pour « mieux toucher les ouvriers dans les usines », beaucoup de contestataires prolétariens rejetèrent ces options et commencèrent à se replier.
Nous
continuerons la deuxième partie de cet article avec les
événements qui ont suivi mai 1968.
Weltrevolution, mai 2008.
1 On peut constater dans le livre de Uwe Soukup, Comment Benno Ohnesorg est mort, comment la bourgeoisie allemande avait utilisé avec succès en 1918/1919 des campagnes de diffamation dans les journaux et des provocations pour présenter les radicaux comme de violents terroristes et les isoler.
Géographique:
- Allemagne [3]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [2]
Chronique d'un débat sur la crise économique (réunion publique du CCI en Espagne)
- 3773 reads
Nous
nous contenterons dans ce bref article de souligner son aspect vivant
en mettant en avant prioritairement les différentes
interventions des participants. Des questions seront donc soulevées
sans que toutes les réponses soient forcément
apportées. Pour connaître plus en profondeur notre
vision tant de la crise économique actuelle que de la crise
historique du capitalisme, nous conseillons à nos lecteurs de
se reporter à notre tout dernier article sur la question :
« Existe-t-il
une issue à la crise économique ? »1.
Quelle est la situation actuelle du capitalisme ?
Réagissant à notre exposé introductif, un camarade a tout d'abord affirmé qu'il ne voyait pas en quoi le capitalisme pouvait être en crise : « Vous exagérez sur la question de la crise. Je vois plutôt de la prospérité. Le capitalisme a de la ressource pour un bon bout de temps. La classe dominante peut offrir des reformes pour satisfaire les besoins du plus grand nombre et ceux d'en bas peuvent accéder aux richesses et aux charges publiques ».
D'autres camarades lui répondirent de différentes façons :
-
« Je ne vois pas comment les besoins de la majorité sont satisfaits. On dit que les gens sont repus par tant de consommation. Mais je ne vois du ‘consumérisme' nulle part. Les gens sont obligés de se serrer la ceinture. Payer les crédits immobiliers est devenu une charge qui oblige à réduire la consommation jusqu'au minimum vital. Les familles, pour arriver à la fin du mois, doivent renoncer à plein de choses. Payer la voiture et le logement oblige à dépenser moins en nourriture, en vêtements et bien d'autres choses de base. Si les familles veulent maintenir une consommation minimale, elles sont obligées de s'endetter et de s'enchaîner à une série de crédits qui finit par les obliger à aller demander un reéchelonnement de leurs dettes, avec les intérêts usuriers que cela implique, c'est-à-dire une dette de plus en plus importante. Voilà la réalité et non pas tout ce tintamarre sur la sur-consommation ».
-
« Je ne vois pas une classe dominante qui réponde aux besoins de la majorité, je vois une classe dominante soumise à la logique de la concurrence, ce qui les amène à réduire les salaires, à jeter des gens au chômage, à ce que les besoins de la majorité des gens soient de moins en moins satisfaits. Le capitalisme va vers la barbarie et il ne faut rien attendre de lui ».
-
« Il y a une crise très forte. En plus, la crise n'est pas seulement une crise économique, mais c'est aussi une crise des idéologies. Les idéologies de la bourgeoisie pour rendre attractif le capitalisme s'usent de plus en plus. Jusqu'à maintenant, les crises du capitalisme trouvaient une issue. Je ne pense pas qu'on doive l'appeler tout simplement ‘crise', parce c'est quelque chose de bien pire. »
Entre ces deux positions est apparue au fil de la discussion un troisième point de vue exprimant une série de nuances : « Il y a une crise économique, mais le capitalisme a des issues. La crise économique aiguise les contradictions politiques et sociales, mais la vérité c'est qu'il y a de la prospérité et on le voit dans le fait que les riches le sont de plus en plus. Le capitalisme se trouve actuellement dans un processus de restructuration. Il y a de nouveaux blocs qui vont se constituer (le bloc européen, le bloc nord-américain, le bloc autour de Chavez, etc.) et ceux qui seront les têtes de chaque bloc auront beaucoup plus de marge de manœuvre que les autres. La hausse de la productivité permet au capitalisme d'augmenter les profits et de sortir ainsi de la crise. »
Le débat a donc exprimé une grande hétérogénéité. Alors qu'il y avait des camarades qui partageaient clairement notre position, d'autres estimaient que le capitalisme « en a encore pour longtemps ». Ce débat est très important : si le capitalisme en a vraiment pour longtemps, s'il peut satisfaire ne serait-ce qu'un peu les besoins de la majorité, la lutte devrait alors se placer sur un terrain favorable aux reformes et aux améliorations du système. Nous pensons, par conséquent, que le débat devrait se poursuivre sur la base d'une série de questions :
-
Nous trouvons-nous face à une « crise de restructuration » comme le pense un des intervenants ? Serions-nous dans un processus où, face à aux vieilles puissances en déclin, vont émerger de nouvelles puissances ? La Chine, peut-être ? Ou bien, au contraire, serions-nous dans une nouvelle phase de la descente progressive vers l'abîme, une descente qui a caractérisé les 40 dernières années ? La croissance actuelle de la Chine ne serait-elle pas la conséquence des tentatives pour pallier à cette crise et qui pourrait finir par aggraver encore plus les problèmes de l'économie mondiale ? Ne serions-nous pas face à ce que l'un des participants a qualifié de « quelque chose de pire qu'une crise » ?
-
On peut se poser une autre question : le fait que « les riches soient de plus en plus riches », est-ce vraiment l'expression de la prospérité du système ? Ne serait-ce pas plutôt l'évidence de son échec, la réalité d'une tendance à une fracture irrémédiable dans la société entre une minorité de plus en plus minoritaire et de plus en plus riche et une majorité de plus en plus grande et pauvre ?
-
Et, enfin, la hausse de la productivité, est-ce une issue à la crise ? Ne représente-elle pas plutôt une aggravation de celle-ci ? N'est-ce pas la saturation des marchés le problème principal du capitalisme que la hausse de la productivité ne fait qu'aggraver au-delà de quelques soulagements momentanés qu'elle peut apporter ? 2
La suite du débat (sur Internet ou avec de nouvelles rencontres) permettrait de développer des réponses plus élaborées à ces questions pour ainsi comprendre la politique que la classe ouvrière devrait suivre : ce n'est pas la même chose si le capitalisme a des possibilités d'« octroyer des reformes pour satisfaire les nécessités d'une majorité » - tel qu'un participant l'a affirmé - ou s'il va « vers la barbarie et on ne peut rien attendre de lui », tel qu'une camarade lui a répondu.
Est-ce qu'il y a une réponse de la classe ouvrière ? Comment pouvons nous la développer ?
Cette question est celle qui a pris le plus de temps lors de cette réunion. Il y a eu un débat très animé où une série d'idées ont émergé.
Une position ne voyait pas de capacité de lutte au sein de la classe ouvrière : « Le prolétariat des pays riches se fout de tout, accepte tout. Je n'ai pas confiance dans le prolétariat, parce qu'il est embourgeoisé. Qui plus est, si, comme vous dites, la crise va s'aggraver, ce qui arrivera alors c'est le fascisme, comme ce qui est arrivé dans les années 30. Écoutez le discours de la droite sur l'immigration, il va vers le fascisme et aucunement vers la moindre prise de conscience ».
Nous avons traité ce sujet du fascisme, présenté comme le « mal absolu » face auquel il faudrait choisir le « moindre mal » de la démocratie, dans de nombreux articles auxquels nous renvoyons3 nos lecteurs. Lors de cette réunion, ce sujet n'a pas été abordé par les autres participants, qui se sont surtout attachés à argumenter contre la thèse comme quoi « le prolétariat se serait embourgeoisé ». Pour un participant « Ce truc sur l'embourgeoisement du prolétariat, on nous le raconte depuis 50 ans. Ça n'a aucune base objective. En vérité, si on parle d'embourgeoisement, c'est parce qu'on voit les syndicats qui se disent représentants des ouvriers et tout ce qu'il font est embourgeoisé. Mais c'est un fait que syndicats et classe ouvrière ne sont pas identiques, ils sont même opposés ». Une participante ajouta : « Là où je vois de l'embourgeoisement et de l'aliénation, c'est dans la lutte syndicale, mais dans la lutte ouvrière, au contraire, ce que je vois, ce sont des essais de rupture avec cette aliénation. »
Un autre participant n'arrivait pas à voir la capacité de riposte au sein de la classe ouvrière : « Les ouvriers restent passifs ; tout au plus sont-ils capables de développer des luttes partielles ». Et il attribuait cette difficulté de la classe ouvrière au fait que « la bourgeoisie met en oeuvre toute une stratégie face aux luttes ouvrières, contre la prise de conscience de la classe ouvrière. La bourgeoisie dépense des millions d'euros pour mystifier les ouvriers : la mystification électorale, la mystification politique, la mystification idéologique. La bourgeoisie se coordonne internationalement contre la classe ouvrière».
D'autres interventions ont essayé d'aller plus loin qu'une simple photographie de la situation de la classe ouvrière, au niveau immédiat, et ont essayé de considérer ses luttes, même avec leurs confusions et leurs défauts, dans une dynamique sociale et historique : « Du monde bourgeois, il n'y a rien à attendre. L'espoir se trouve dans le développement des luttes des ouvriers où l'on voit apparaître des éléments de prise de conscience » ou encore « il y a des luttes ouvrières, bien plus que nous ne le pensons. Ce qui arrive, c'est qu'on n'en parle pratiquement pas. Les grèves, ça ne fait pas de l'info. Elles n'existent que pour ceux qui les vivent. Mais elles sont une école. Le meilleur apport des luttes n'est pas tellement les gains économiques, souvent des victoires à la Pyrrhus, mais les leçons sur la conscience, l'unité et la solidarité, l'apprentissage que ces luttes apportent dans la lutte pour le communisme. Il n'y a pas de raccourcis pour arriver à une révolution. C'est le cumul des expériences, la conscience qui grandit peu à peu, qui conduit vers la révolution. Je crois que toutes ces ‘radicalités' de façade font très mal : brûler des pneus par désespoir, faire des grèves qui emmerdent les usagers, avoir des affrontements violents et stériles avec la police... Ce n'est pas ça la ‘radicalité'. Etre radical, c'est aller à la racine des choses. La lutte ouvrière est radicale quand elle s'affronte de façon déterminée à l'exploitation capitaliste, lorsque face à la concurrence et à la division semées par les rapports de production, elle réussit à unifier la majorité des ouvriers, lorsqu'elle arrive à isoler politiquement l'État et les capitalistes ».
Dans ce cadre, un autre participant a posé des questions concrètes sur comment le prolétariat peut avancer, comment peut-il dépasser la faiblesse et le caractère encore embryonnaire de sa lutte présente : « Ce qui est le plus important pour moi c'est la nécessité de riposte du prolétariat. La question que nous devons nous poser c'est : est-ce que les conditions objectives [la crise économique du capitalisme4] entraînent automatiquement la réponse subjective du prolétariat [le développement du combat du prolétariat vers le communisme5] ? Je crois que non, je pense que pour développer sa réponse subjective, le prolétariat a besoin d'une prise de conscience plus globale, ce qui vient se joindre aux conditions économiques ». La réponse du prolétariat n'est pas - comme ce camarade l'a très bien dit - un simple reflet passif de l'exacerbation de la crise (les fameuses « conditions objectives »), ce n'est pas non plus le résultat immédiat et mécanique des luttes, mais elle nécessite que tout cela soit fertilisé et guidé par un processus de prise de conscience - qui est à son tour un puissant facteur pour impulser les luttes elles-mêmes. Dans ce sens, le camarade a poursuivi : «Est-ce que le prolétariat est conscient des traces de l'idéologie qu'il porte dans sa tête ? Le prolétariat a des difficultés pour développer sa conscience uniquement dans ses luttes, il a besoin de la réflexion, de prendre des distances, de regarder ce qui se passe dans le monde, de regarder les choses avec la perspective de l'histoire. »
La discussion doit continuer : c'est un outil pour transformer le sentiment d'indignation et de révolte qui nous anime tous face à la barbarie de ce monde en sentiment de solidarité et en volonté de lutte contre le capitalisme. Comme l'a dit un participant : « Nous sommes venus ici parce que quelque chose nous rassemble tous : la lutte contre le capitalisme. »
Acción Proletaria, organe du CCI en Espagne (5 mars)
1 La première partie de cet article est d'ores et déjà disponible ici [4] ou dans notre journal du mois de mai (Révolution Internationale n°390). La seconde partie est à paraitre début juin (sur le web et dans RI n°391).
2 Pour une réflexion plus générale sur la situation actuelle du capitalisme et de ses perspectives, on peut lire, entre autres « Décadence du capitalisme : la révolution est nécessaire et possible depuis un siècle [5]. »
3 Voir, entre autres, « Les causes économiques, politiques et sociales du fascisme [6] » dans la Revue internationale nº 3 (1975) et aussi « Crime fasciste à Madrid: l'alternative n'est pas fascisme ou antifascisme, mais barbarie capitaliste ou révolution prolétarienne [7] » (Révolution internationale nº 386, 12/2007).
4 Note de la rédaction.
5 Idem.
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Crise économique [9]
Comme en France, il y a 40 ans, un mai 68 se produisait en Afrique, au Sénégal
- 4441 reads
C'est donc dans ce contexte que Dakar a connu lui aussi un « mai 68 rampant » qui dura une douzaine de jours, entre le 18 mai et le 2 juin, qui a failli ébranler définitivement le régime profrançais de Senghor, avec grèves générales illimitées du monde scolaire puis du monde du travail avant que le pouvoir en place n'arrivât à bout du mouvement par une féroce répression policière et militaire tout en bénéficiant de l'appui décisif de l'impérialisme français.
Le « Mai sénégalais » fut précédé par plusieurs heurts avec le gouvernement Senghor, notamment entre 66 et 68 où les étudiants organisaient des manifestations de soutien aux luttes de « libération nationale » et contre le « néo-colonialisme » et « l'impérialisme ».
De même qu'avant le déclenchement du mouvement de mai, il y a eu en milieu scolaire des « grèves d'avertissement », par exemple, une grève des cours a été déclenchée le 26 mars 1968 par les élèves du lycée de Rufisque (banlieue de Dakar), suite aux sanctions disciplinaires infligées à certains de leurs camarades de classe, mouvement qui dura 3 semaines. Cela avait fini par installer dans les établissements scolaires de la région un climat d'agitation et de contestation du gouvernement.
Le détonateur du mouvement
Le déclenchement du mouvement de mai 68 a eu pour origine immédiate la décision du gouvernement du président Senghor de réduire les mensualités des bourses d'études de 12 à 10 mois tout en diminuant fortement le montant alloué, sous prétexte de « la situation économique difficile que traversait le pays ».
« La nouvelle de la décision du gouvernement se répandit comme une traînée de poudre à la cité universitaire, causant partout l'inquiétude et suscitant un sentiment général de révolte. C'était le seul objet de conversations partout sur le campus. Dès son élection, le nouveau comité exécutif de l'UDES (syndicat étudiant) s'employa à développer l'agitation autour de la question des bourses en milieu étudiant, parmi les élèves des lycées et auprès des syndicats. » (ibid.)
En effet, dès cette annonce gouvernementale, l'agitation s'installe et la contestation du gouvernement s'intensifie, notamment à la veille des élections que les étudiants dénoncent, comme le montre le titre d'un de leurs tracts : « De la situation économique et sociale du Sénégal à la veille de la mascarade électorale du 25 février... ». L'agitation continue : le18 mai, les étudiants décident d'une « grève générale d'avertissement » suite à l'échec des négociations avec le gouvernement sur les conditions d'études, grève massivement suivie dans toutes les facultés.
Galvanisés par le franc succès de la grève et chauffés à bloc par le refus du gouvernement de satisfaire leurs revendications, les étudiants lancent un mot d'ordre de grève générale illimitée des cours et de boycott des examens à partir du 27 mai. Déjà, à la veille de cette date, les meetings se succèdent dans le campus et en milieu scolaire en général, bref, c'est l'épreuve de force avec le pouvoir. De son côté, le gouvernement se saisit de tous les médias officiels pour annoncer une série de mesures d'intimidation contre les grévistes, tout en visant à opposer les étudiants, qualifiés de « privilégiés », aux travailleurs et aux paysans. Et l'UPS (parti de Senghor) dénonce la « position antinationale » du mouvement des étudiants, mais sans rencontrer aucun écho. Au contraire, les campagnes du gouvernement ne font qu'aggraver la colère des étudiants et susciter la solidarité des salariés et de la population.
« Les meetings de l'UED (Union des étudiants de Dakar) constituaient des temps forts de l'agitation dans le campus. Ils enregistraient une influence considérable d'étudiants, d'élèves, d'enseignants, de jeunes chômeurs, d'opposants et, bien entendu, de nombreux agents de renseignement. Au fil du temps, ils constituaient le baromètre qui indiquait les mouvements de la contestation politique et sociale. Chaque meeting était une sorte de messe de l'opposition sénégalaise et de celles des autres pays présents dans le campus. Les interventions étaient ponctuées des morceaux de musique révolutionnaire du monde entier ». (ibid.)
Effectivement, on assiste là à une véritable veillée d'armes. Dès minuit le 27 mai, les étudiants en éveil entendent le bruit des bottes et voient l'arrivée massive d'un cordon policier autour de la cité universitaire. Dès lors, une foule d'étudiants et d'élèves se rassemblent et convergent vers les résidences en vue de monter des piquets de grève.
En fait, par cette intervention, le pouvoir, en encerclant le campus universitaire par les forces de l'ordre, cherche à empêcher tout mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et inversement.
« Ainsi, des camardes se virent privés de leurs repas et d'autres de leur lit car, comme l'UDE a eu souvent à le dire, les conditions sociales sont telles que nombre de camarades mangent en ville (non boursiers) ou y dorment faute de logement à la cité universitaire. Même les étudiants en médecine qui soignaient leurs malades à l'hôpital restaient bloqués à la Cité en même temps que d'autres étudiants en urgence médicale. C'était l'exemple type de violation des franchises universitaires. » (ibid.)
Le 28 mai, lors d'une entrevue avec le recteur et les doyens de l'université, l'UDE demande la levée du cordon policier, tandis que les autorités universitaires exigent que les étudiants fassent une déclaration sous 24 heures « certifiant que la grève n'a pas pour but de renverser le gouvernement Senghor ». Les organisations étudiantes répondent qu'elles n'étaient pas liées à un régime donné et que le temps qui leur est imparti ne permet pas de consulter leur base. Dès lors, le président du gouvernement ordonne la fermeture totale des établissements universitaires.
« Le groupe mobile d'intervention, renforcé par la police, sonna une nouvelle charge et investit les pavillons les uns après les autres. Il avait reçu l'ordre de dégager les étudiants par tous les moyens. Ainsi à coups de matraque, de crosses de fusils, baïonnettes, de grenades lacrymogènes et quelquefois offensives, défonçant portes et fenêtres, les sbires allèrent chercher les étudiants jusque dans leurs chambres. Les gardes et les policiers se comportèrent en véritables pillards. Ils volèrent tout et brisèrent ce qui leur paraissait encombrant, déchirèrent les vêtements, les livres et les cahiers. Des femmes enceintes furent maltraitées et des travailleurs malmenés. Au pavillon des mariés, femmes et enfants furent frappés. Il y a eut sur le champ un mort et beaucoup de blessés (une centaine) selon les chiffres officiels. » (ibid.)
L'implosion
La brutalité de la réaction du pouvoir se traduit par un élan de solidarité et renforce la sympathie envers le mouvement des étudiants. Dans tous les milieux de la capitale s'exprime une forte réprobation du comportement brutal du régime, contre les sévices policiers et l'internement d'un grand nombre d'étudiants. Au soir du 29 mai, tous les ingrédients sont réunis pour un embrasement social car l'effervescence est à son comble parmi les élèves et les salariés. Ce sont les lycéens (qui étaient déjà massivement présents lors des « grèves d'avertissement » du 26 mars et du 18 mai) qui se mettent les premiers en grève illimitée. Dès lors, la jonction est faite entre le mouvement universitaire et le mouvement dans le secondaire. Les uns après les autres, tous les établissements de l'enseignement secondaire se déclarent en grève totale et illimitée tout en formant des comités de lutte qui appellent à manifester avec les étudiants.
Inquiet de l'ampleur de la mobilisation de la jeunesse, le même jour, le 29 mai, le président Senghor fait diffuser un communiqué dans les médias annonçant le fermeture sine die de tous les établissements scolaires (facultés, lycées, collèges) de la région de Dakar et de Saint- Louis et appelant les parents d'élèves à retenir leurs enfants à la maison. Mais sans le succès escompté.
« La fermeture de l'université et des écoles ne fit qu'augmenter la tension sociale. Les étudiants, qui avaient échappé aux mesures d'internement, les élèves et les jeunes se mirent à ériger des barricades dans les quartiers populaires comme la Médina, Grand Dakar, Nimzat, Baay Gainde, Kip Koko, Usine Ben Talli, Usine Nyari Talli, etc. Dans la journée des 29 et 30 notamment, des cortèges imposants composés de jeunes occupaient les principales artères de la ville de Dakar. Les véhicules de l'administration et des personnalités du régime étaient particulièrement recherchés. Selon la rumeur, de nombreux ministres furent ainsi contraints de renoncer à utiliser leurs voitures de fonction, les fameuses voitures de marque Citroën appelées DS 21. En effet, ce type de véhicule officiel symbolisait, aux yeux de la population et des étudiants et élèves en particulier, le « train de vie insolent de la bourgeoisie politico- bureaucratique et ‘ compradore' ». » (ibid.)
Face à la combativité montante et à la dynamique du mouvement, le gouvernement décide de renforcer ses mesures répressives en les étendant à toute la population. Ainsi dès le 30 mai, un décret gouvernemental indique, d'une part, que jusqu'à nouvel ordre, tous les établissements recevant du public (cinéma, théâtres, cabarets, restaurants, bars) sont appelés à fermer nuit et jour. Et, d'autre part, les réunions, manifestations et attroupements de plus de 5 personnes sont interdits.
Grève générale des travailleurs
Face à ces mesures et à la poursuite des brutalités policières contre la jeunesse en lutte, tout le pays s'agite et la révolte s'intensifie partout, cette fois-ci, plus amplement chez les salariés. C'est à alors que les appareils syndicaux traditionnels, notamment l'UNTS (un regroupement de plusieurs syndicats) décident d'entrer en scène pour ne pas se faire déborder par la base.
« La base des syndicats pressait les directions à l'action. Le 30 mai, à 18 heures, l'union régionale UNTS du Cap-Vert (région de Dakar), à la suite d'une réunion conjointe avec le bureau national de l'UNTS, lança un mot d'ordre de grève illimitée à partir du 30 mai à minuit. »
Face à la situation explosive pour son régime, le président Senghor décide de s'adresser au pays, en tenant un discours menaçant envers les travailleurs en les exhortant de désobéir au mot d'ordre de grève générale, tout en accusant les étudiants d'être « téléguidés de l'étranger ». Mais en dépit des menaces réelles du pouvoir allant jusqu'à donner des ordres de réquisition de certaines catégories de travailleurs, le mouvement de grève s'avère très suivi dans le public comme dans le privé.
Le 31 mai à 10 heures, des AG sont organisées à la bourse du travail auxquelles sont invités les délégations des secteurs en grève afin de décider de la suite à donner au mouvement.
« Mais les forces de l'ordre avaient déjà bouclé le quartier. A 10 heures, l'ordre fut donné de charger les travailleurs à l'intérieur de la Bourse. Les portes et fenêtres furent défoncées, les armoires éventrés, les archives détruites. Les bombes lacrymogènes et les coups de matraque eurent raison des travailleurs les plus téméraires. En réponse aux brutalités policières, les travailleurs auxquels se mêlèrent les élèves et le lumpenprolétariat, s'attaquèrent aux véhicules et magasins dont plusieurs furent incendiés. Le lendemain Abdoulaye Diack, secrétaire d'Etat à l'information, révélait devant la presse que 900 personnes avaient été interpellées dans la Bourse du Travail et ses environs. Parmi celles-ci, on comptait 36 responsables syndicaux dont 5 femmes. En réalité, au cours de la semaine de crise, pas moins de 3.000 personnes avaient été interpellées. Certains dirigeants syndicaux furent déportés (...). Ces actes ne firent qu'accentuer l'indignation des populations et la mobilisation des travailleurs. » (ibid.)
En effet, aussitôt après cette conférence de presse au cours de laquelle le porte-parole du gouvernement donne ses chiffres sur les victimes, grèves, manifestations et émeutes ne font que s'intensifier jusqu'à ce que la bourgeoisie décide d'arrêter les dégâts.
« Les syndicats alliés du gouvernement et le patronat sentaient la nécessité de lâcher du lest pour éviter un durcissement au sein des travailleurs, qui au cours des manifestations, avaient pu prendre conscience de leur poids. »
Dès lors, après une série de réunions entre le gouvernement et les syndicats, le 12 juin, le président Senghor annonce un accord de fin de grève basé sur 18 points dont un qui préconise une augmentation de 15% des salaires. En conséquence, le mouvement prend fin officiellement à cette date-là, ce qui n'empêche pas la poursuite du mécontentement et le resurgissement d'autres mouvements sociaux, car la méfiance est de mise chez les grévistes par rapport aux promesses du pouvoir de Senghor. Et, de fait, quelques semaines après la signature de l'accord mettant fin aux grèves, des mouvements sociaux repartent de plus belle et vont se poursuivre avec une certaine vigueur jusqu'au début des années 1970.
En fin de compte, il convient de souligner l'état de désarroi dans lequel s'est trouvé le pouvoir sénégalais au plus fort de sa confrontation au « mouvement de mai de Dakar », à l'instar du chercheur (Abdoulaye Bathily), l'auteur largement cité :
« Du 1e au 3 juin, on avait l'impression que le pouvoir était vacant. L'isolement du gouvernement était démontré par l'inaction du Pari au pouvoir. Devant l'ampleur de l'explosion sociale, les structures de l'UPS n'ont pas réagi. La fédération des étudiants UPS s'est contentée de la distribution furtive de quelques tracts contre l'UDES au début des événements. Cette situation était d'autant plus frappant que l'UPS s'était vantée, trois mois plus tôt, d'avoir été plébiscitée à Dakar lors des élections législatives et présidentielles du 25 février 1968. Or, voilà qu'elle était incapable de trouver une riposte populaire face à ce qui se passait.
Selon la rumeur, les ministres avaient été consignés au building administratif, siège du gouvernement, et de hauts responsables du pari et de l'Etat s'étaient cachés dans leurs maisons. C'était là un bien curieux comportement pour des dirigeants d'un parti qui se disait majoritaire dans le pays. En un moment, le bruit avait couru que le président Senghor se serait réfugié à la base militaire française de Ouakam. Ces rumeurs étaient d'autant plus vraisemblables que les informations concernant la « fuite » du général De Gaulle en Allemagne, le 29 mai, étaient connues à Dakar. » (ibid.)
Le gouvernement de Senghor a donc fortement tremblé devant la vague de luttes menée par la jeunesse et la classe ouvrière qui lui a apportée son soutien décisif. Par ailleurs, Abdoulaye Bathily semble trop prudent dans l'évocation des « rumeurs », sans doute à cause même de ses fonctions (professeur d'université à Dakar) au moment de la publication de son ouvrage. En effet, à l'époque, d'autres rumeurs plus insistantes indiquaient clairement que ce fut l'armée française sur place qui arrêta brutalement les manifestants qui marchaient sur le palais présidentiel en causant plusieurs victimes, y compris des morts.
Rappelons aussi que le pouvoir sénégalais, pour venir à bout du mouvement social, n'a pas seulement utilisé ses chiens de gardes habituels, à savoir ses forces policières, mais il a aussi eu recours aux forces les plus réactionnaires que sont les chefs religieux et les paysans des campagnes reculées. Au plus fort du mouvement (le 30 et le 31 mai), les chefs de cliques religieuses avaient été invités par Senghor à occuper les médias nuit et jour pour faire des déclarations condamnant la grève et exhortant les travailleurs à reprendre le travail.
Quant aux paysans, le gouvernement a essayé de les dresser contre les grévistes en les faisant venir en ville pour soutenir les manifestations progouvernementales. Comme Bathily l'indique, cette tentative fut un fiasco : « Les recruteurs avaient fait croire à ces paysans que le Sénégal avait été envahi à partir de Dakar par une nation appelée « Tudian » (étudiant) et qu'on faisant appel à eux pour défendre le pays. Par groupes, ces paysans furent déposés aux allées du Centenaire (actuel boulevard du général De Gaulle) avec leurs armes blanches (haches, coupe-coupe, lances, arcs et flèches). Mais ils se rendirent bien vite compte qu'ils avaient été menés en bateau. (...) Les jeunes les dispersèrent à coups de pierres et se partagèrent les victuailles. (...) D'autres furent lapidés lors de leur passage à Rufisque. En tout état de cause, l'émeute révéla la fragilité des bases politiques de l'UPS et du régime en milieu urbain, à Dakar en particulier. » (ibid.)
Décidemment, le pouvoir de Senghor aura utilisé tous les moyens y compris les plus barbares pour venir à bout du soulèvement social contre son régime. Cependant, pour éteindre définitivement le feu, l'arme la plus efficace pour le pouvoir fut sans doute le rôle joué par le chef du principal syndicat de l'époque (UNTS), Doudou Ngom (l'équivalent de Séguy, dirigeant CGT en France en 68) qui « négocia » les conditions de l'étouffement de la grève générale. D'ailleurs, en guise de remerciement, le président Senghor le nomma ministre quelques années plus tard.
Amina ( 4 mai 2008)
1 Abdoulaye Bathily, Mai 1968 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie, Edit. Chaka, Paris 1992.
Géographique:
- Afrique [10]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [2]
Conférence de Moscou sur octobre 17 : le bolchévisme et la révolution prolétarienne n'ont rien à voir avec le stalinisme
- 3143 reads
Depuis plusieurs années, le CCI intervient régulièrement parmi le milieu politique qui émerge en Russie. L'article suivant a d'abord été publié sur notre site en langue russe. Il propose un aperçu et un bilan des discussions récentes qui ont impliqué les principales organisations internationalistes actives dans cette partie du monde.
C'est à la révolution d'Octobre 1917 que la conférence du Centre d'Etudes et de Recherche Praxis1 a consacré ses travaux à Moscou en juillet dernier. Ce faisant, elle a fait bien plus que célébrer l'anniversaire d'un simple événement de l'histoire nationale russe. En offrant un cadre sérieux de discussion et de confrontation entre courants venus de divers horizons, en permettant à des groupes révolutionnaires d'y présenter et d'y défendre leurs positions et analyses, cette conférence a contribué à la rappropriation de la plus riche et de la plus grandiose expérience historique du prolétariat au plan international. Faisant la preuve de son aptitude révolutionnaire, le prolétariat détruisait l'Etat capitaliste et, unifié à travers ses conseils ouvriers, assumait l'exercice du pouvoir politique à l'échelle d'un immense territoire.
Un état d'esprit favorable au débat
Il existe bien sûr de nombreuses divergences entre Praxis et notre organisation. Pour autant, celui-ci a encore fait la preuve qu'il est tout à fait capable d'offrir un forum pour un débat ouvert pour tous ceux qui sont en recherche d'une cohérence politique en phase avec leur volonté de transformer la société, qui surgissent et se développent en Russie depuis le début des années 1990.
Le rejet de tout anathème et l'appel plusieurs fois lancé au cours de la conférence par différents participants à s'écouter mutuellement et réellement afin de se répondre avec sérieux, tout comme la volonté exprimée par l'ensemble des participants de séparer les mythes, entretenus par différentes chapelles intéressées, de la réalité et de la vérité historiques, dépassent largement le simple partage de valeurs communes au prolétariat.
C'est une attitude qui contribue directement au renforcement de son combat révolutionnaire. En tant que classe exploitée qui ne dispose d'aucun appui matériel au sein de la société présente, le prolétariat n'a pas d'autres armes à sa disposition que son organisation et sa conscience. Il doit, pour orienter son combat politique, acquérir une conscience démystifiée de la réalité pour agir. Pour forger celle-ci, la confrontation politiques par le débat et la démarche fondée sur l'honnêteté intellectuelle, la recherche de la vérité, l'examen impartial des idées lui sont indispensables.
L'esprit d'ouverture, la rigueur morale qui hait le mensonge, indiscutablement présents au cours de la conférence, ont permis des débats fraternels, l'examen des désaccords et des divergences basé sur un véritable échange d'arguments, où ce sont les idées et les positions politiques qui sont discutées. Du fait que chacun pouvait se prononcer en toute connaissance des arguments présentés, une dynamique de clarification s'est enclenchée conduisant à la remise en cause des préjugés les plus généralement admis.
La première révolution massive et consciente de l'histoire
Au cours de la conférence, on a entendu beaucoup des arguments répétés depuis 90 ans à propos des bolcheviks ou de l'échec final de la révolution démarrée en Russie. Mais l'un des résultats les plus importants obtenu par la discussion, c'est de s'être attaqué au plus grand mensonge du 20e siècle et de l'Histoire, entretenu pendant des décennies par la classe dominante du monde entier et de tous les bords, fasciste, stalinienne ou démocratique, celui qui assimile le régime stalinien au communisme et les bolcheviks à la nomenklatura barbare qui a régné si longtemps en Russie. Mensonge qui a été puissamment réactivé au moment de l'effondrement du bloc de l'Est après 1989 et des campagnes bourgeoises mondiales proclamant la fin de la lutte des classes, la victoire définitive du système bourgeois démocratique, l'inexistence d'alternative à celui-ci.
D'emblée, un participant a affirmé que « la révolution en Russie est née de la crise globale de la guerre mondiale et avait pour enjeu le changement de la société et des bases de la vie sociale. » Le CCI a développé qu'Octobre 1917 avait été la réponse de la classe ouvrière à la plongée du capitalisme dans sa décadence inaugurée par l'éclatement de la première guerre mondiale et le point de départ de la révolution prolétarienne mondiale. Elle n'a pas été le reflet passif de circonstances historiques particulières mais le produit de la prise de conscience collective au sein des masses. C'est avec la création des conseils ouvriers (soviets de députés ouvriers et des soldats), organes grâce auxquels le prolétariat forge son unité et approfondit sa conscience, que le prolétariat s'affirme comme force politique prééminente. La période de février à octobre 1917 montre le processus par lequel les masses ouvrières, initialement soumises et divisées, se transforment en une classe qui agit comme un seul homme et se rendent aptes à se lancer dans la révolution et la prise du pouvoir politique. L'insurrection prolétarienne d'Octobre 17 n'avait rien d'un putsch : elle était le produit de la volonté de l'immense majorité de la classe ouvrière.
La
discussion a trouvé un point de convergence pour rétablir
le rôle et la nature réels des bolcheviks. Un des
participants a souligné que « les
bolcheviks et certains anarchistes à leurs côtés
étaient les seuls à avoir incarné et défendu
en toute conséquence au plan politique la perspective du
changement des bases de la vie sociale et de la société. »
Plusieurs intervenants ont souligné la profonde différence
entre l'internationalisme des bolcheviks qui se sont ardemment
battus pour l'extension de la révolution prolétarienne
dans le monde et le nationalisme du stalinisme, massacreur
d'ouvriers, pas seulement en Russie mais aussi, par exemple, en
Chine en 1927-28. Sous l'angle original de l'écologie, un
participant a évoqué l'aspect méconnu des
préoccupations pour l'environnement et les expériences
écologiques encouragées par Lénine après
l'avènement du bolchevisme.
« Toutes les tendances qui les incarnaient ont péri
dans la terreur stalinienne. »
En montrant que « le
‘productivisme' destructeur développé en URSS à
partir des années 30 n'avait rien à voir avec les
conceptions du marxisme des rapports entre l'homme et la nature ni
avec le bolchevisme, mais avait été une monstruosité
inventée par le stalinisme »,
il a conclu que « sur
ce plan-là aussi, il est nécessaire de faire une
distinction entre le bolchevisme et le stalinisme. »
Face à l'expression de méfiance par rapport au concept de dictature du prolétariat, au nom de laquelle pendant des décennies le stalinisme a justifié ses crimes, l'ouverture de la conférence à la discussion a permis que les organisations révolutionnaires présentent leurs principaux arguments sur la forme du pouvoir de la classe ouvrière.
Si les camarades du KRAS2 ont affirmé récuser le terme de dictature du prolétariat, ils ont souligné qu'ils poursuivaient le but d'une révolution qui établisse le principe de « chacun selon ses moyens ». Le délégué de l'IUPRC3 a développé que « face à l'appareil de coercition de l'Etat, la classe ouvrière doit développer sa violence ; la dictature du prolétariat, c'est la dictature des conseils ouvriers, des assemblées générales des travailleurs. Il est impossible de s'en passer. » Pour le CCI, la révolution russe a permis justement au mouvement ouvrier international de tirer les leçons essentielles que le pouvoir politique du prolétariat ne s'incarne ni dans le pouvoir de l'Etat, ni dans celui d'un Parti. L'organe de la révolution et de l'exercice du pouvoir de l'immense majorité laborieuse contre la minorité bourgeoise, ce sont les conseils ouvriers.
Les conditions de la défaite finale et de la nature de l'URSS à partir de la fin des années 1920 ont naturellement été abordées. Là, il a été possible à un certain nombre de participants de s'approprier et même de reprendre la méthode proposée par le CCI pour qui la révolution prolétarienne est par nature internationale et se développe au plan universel. Contrairement aux mensonges bourgeois, la révolution russe n'a pas dégénéré, puis péri, en premier lieu pour des raisons intérieures, mais du fait de son isolement, de l'échec de la révolution prolétarienne à s'étendre internationalement. Son sort était suspendu avant tout au succès des insurrections ouvrières dans les autres pays du monde. Un participant a ainsi affirmé ensuite « reconnaître que le destin du bolchevisme aurait été différent en cas d'extension de la révolution. » L'un des militants du KRAS a appuyé dans le même sens qu'« il y a eu des moments où les potentialités de la révolution dans le monde pouvaient se réaliser, mais la révolution mondiale a été vaincue » et que si « on peut admettre le fait que par certains de leurs actes les Bolcheviks aient produit certaines conditions de l'apparition du stalinisme, le stalinisme ne procède pas du bolchevisme. » Le stalinisme n'est pas le continuateur du bolchevisme et de la révolution d'octobre : il en a été le fossoyeur et le bourreau.
La conférence a repoussé certaines conceptions de la nature de l'URSS après les années 1920 (comme celle qui en fait un exemple de despotisme asiatique ou celle qui exprime une nostalgie pour « le ‘socialisme de caserne' qui garantissait au moins un minimum pour tous » comme « produit du désarroi dans lequel la crise économique et la dislocation de la société capitaliste en Russie plongent la plus grande partie de la population frappée par la misère. » Très clairement, un militant du KRAS a argumenté que « c'est la bourgeoisie qui a gouverné l'URSS ; elle n'a fait que se révéler en 1992. Les constitutions de 1936 sont complètement bourgeoises. Ce qui fonde cette nature bourgeoise c'est l'existence du travail salarié et de la vente de la main d'œuvre en URSS. La nomenklatura, c'était la bourgeoisie. »
Quelles voies pour la lutte des classes aujourd'hui ?
Les travaux de la conférence ont aussi naturellement fait le pont avec la situation actuelle du prolétariat et abordé, à propos des grèves récentes qui se sont déroulées en Russie, les perspectives que doit se donner aujourd'hui la lutte des classes tout comme les responsabilités qui incombent à ses minorités organisées. Une contribution du KRAS a constitué l'un des points forts de la conférence. La prise de position de ces camarades s'est attachée à dénoncer l'action anti-ouvrière des syndicats dans le mouvement des ouvriers de Ford à Saint-Pétersbourg contre l'allongement du temps de travail. Il est apparu clairement une ligne de clivage entre ceux pour qui la source de la force de la classe ouvrière et la condition de son émancipation sont constituées par la marche vers la révolution prolétarienne, et donc par l'auto-activité des masses, la prise en main de la lutte par les assemblées générales, le développement de la solidarité active entre différents secteurs, et ceux qui veulent faire croire que l'action syndicale est une voie possible pour la lutte, qu'il y aurait quelque chose de bénéfique pour les ouvriers dans une politique de réforme comme « premier pas en avant ». La contribution du KRAS a, à juste raison et avec le plein soutien du CCI, mis en avant que « la politique de réforme et de partenariat social est un leurre et un mensonge et qu'il y a danger pour les ouvriers que de les pousser dans ce mensonge. La lutte pour l'amélioration de ses conditions et pour le changement de la société ne passe pas par le trade-unionisme. Partout, les syndicats sont des organes de la concertation sociale qui font accepter l'augmentation du temps de travail et la baisse des salaires. Anciens ou nouveaux syndicats mènent la même politique. »
Le CCI a soutenu que « les syndicats mènent une stratégie de défaite » (KRAS), que toutes les luttes, laissées à la direction des syndicats, ont, depuis des décennies et dans tous les pays, été vouées à l'échec et ont constitué des défaites cuisantes pour la classe ouvrière. Il en est ainsi parce qu'« il y a eu dans l'histoire un changement dans la fonction des syndicats, un processus de dégénérescence qui a conduit à leur intégration dans l'Etat. » (KRAS)
La contribution du KRAS a fortement défendu que « la lutte des classes est imposée au prolétariat par la bourgeoisie et que face à la classe dominante, le seul choix, c'est ou la résignation ou la lutte. La résignation pose le problème de la dignité humaine. » Pour lutter, la classe ouvrière est placée devant l'alternative : ou bien confier la direction de la lutte à des organes syndicaux saboteurs du mouvement qui dépossèdent les ouvriers de leur action, la détournent de son but dans des impasses ; ou bien « l'action directe dans les assemblées générales qui constituent l'école du communisme, où les ouvriers font l'apprentissage de l'action et de la pensée par eux-mêmes, comme le défendait Lénine. » (KRAS)
Effectivement, la classe ouvrière n'est jamais aussi forte que lorsque qu'elle s'organise elle-même, prend en main ses luttes et développe sa solidarité. Seules les luttes qui, comme le mouvement des jeunes prolétaires encore étudiants en France au printemps 2006 l'atteste, utilisent les assemblées générales et organisent l'extension de la lutte à d'autres secteurs, en dehors et contre la volonté des syndicats, sont capables de faire reculer les gouvernements et la bourgeoisie.
Aujourd'hui, près d'un siècle après le début de la vague révolutionnaire mondiale des années 1920, les expressions de la lutte des classes au plan international nous prouvent que non seulement le prolétariat conserve son caractère de classe révolutionnaire, mais qu'à travers la lente maturation qui le traverse, c'est l'esprit de 1917 qui fermente à nouveau en son sein.
Svetlana, décembre 07
1 Praxis organise des réunions publiques, des conférences et a démarré un programme d'édition et de publication de textes afin de faire connaître « la grande richesse des idées radicales et alternatives (...) qui se rattachent au socialisme démocratique et libertaire et qui s'opposent au totalitarisme. » Voir leur site web : victorserge.ru
2 Confédération anarcho-syndicaliste révolutionnaire de Moscou, section de l'AIT qui a pris une position internationaliste face aux guerres en Tchétchénie. Site web : KRAS.FATAL.ru ; contact : [email protected] [11]
3 Groupe International des Collectivistes Prolétariens Révolutionnaires. Groupe internationaliste actif en Russie et en Ukraine. Voir sur leur site web iuprc.250free.com leurs thèses de présentation (en anglais) « Who we are ». Contact : [email protected] [12]. Le KRAS et l'IUPRC animent depuis juillet 2004 un forum de discussion internationaliste russe. Voir sur le site du CCI.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [13]
Courants politiques:
- Stalinisme [14]
Heritage de la Gauche Communiste:
Crise du néolibéralisme ou crise du capitalisme ?
- 3661 reads
Le texte ci-dessous est une traduction d'un article réalisé par la section du CCI en Espagne.
Sarkozy proclame aujourd'hui que « le capitalisme doit se refondre sur des bases éthiques ». Madame Merkel insulte les spéculateurs. Zapatero pointe d'un doigt accusateur les "fondamentalistes du marché" qui prétendent que celui-ci se régule tout seul sans intervention de l'État. Tous nous disent que cette crise implique la mort du capitalisme « néolibéral » et que l'espoir aujourd'hui se tourne vers un « autre capitalisme ». Ce nouveau capitalisme reposerait sur la production et non sur la finance, se dégageant de cette couche parasitaire des requins financiers et spéculateurs qui auraient poussé comme des champignons sous prétexte de « dérégulation », « d'inhibition de l'État », de primauté de l'intérêt privé sur « l'intérêt public », etc. À les entendre, ce n'est pas le capitalisme qui s'effondrerait, mais une forme particulière de capitalisme. Les groupes de la gauche (staliniens, trotskistes, altermondialistes...) exultent en proclamant : « Les faits nous donnent raison. Les dérives néolibérales ont provoqué ces désastres ! » Ils rappellent leur opposition à la « globalisation » et au « libéralisme déchaîné », exigeant l'adoption de mesures étatiques pour faire entendre raison aux multinationales, aux spéculateurs et autres crapules qui auraient provoqué ce désastre par leur soif démesurée de profits. Ils proclament que la solution passe par « le socialisme », un socialisme qui consisterait en ce que l'État remette à leur place « les capitalistes » au bénéfice du « peuple » et des « petites gens ».
Ces explications sont-elles valables ? Un « autre capitalisme » est-il possible ? L'intervention bienfaitrice de l'État pourrait-elle porter remède au capitalisme en crise ? Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions d'une actualité brûlante. Il faut cependant au préalable éclaircir une question fondamentale : le socialisme est-il l'État ?
Socialisme = État ?
Chavez, l'illustre paladin du « socialisme du xxie siècle », vient de faire quelques déclarations surprenantes : « Le camarade Bush est en train de prendre certaines mesures propres au camarade Lénine. Les États-Unis deviendront un jour socialistes, parce que les peuples ne se suicident pas ». Pour une fois, et sans que cela ne constitue pour autant un précédent, nous sommes d'accord avec Chavez. D'abord sur le fait que Bush est son camarade. En effet, même s'ils sont opposés par une lutte concurrentielle acharnée sur le terrain impérialiste, ils n'en sont pas moins camarades dans la défense du capitalisme et dans l'utilisation de l'État pour sauver le système. Et nous sommes aussi d'accord pour dire que « les États-Unis deviendront un jour socialistes », même si ce socialisme n'aura rien à voir avec celui que préconise Chavez.
Le socialisme véritable défendu par le marxisme et les révolutionnaires tout au long de l'histoire du mouvement ouvrier n'a rien à voir avec l'État. Le socialisme est même la négation de l'État. L'édification d'une société socialiste exige en premier lieu la destruction de l'État dans tous les pays. S'ouvre alors une période de transition du capitalisme au communisme, la transition du jour au lendemain étant impossible. Cette période de transition doit encore subir la loi de la valeur typiquement capitaliste, la bourgeoisie n'est pas totalement éteinte et, aux côtés du prolétariat, coexistent encore des classes non exploiteuses : paysans, marginaux, petite-bourgeoisie (1). Comme produit de cette situation de transition, l'État continue à être nécessaire mais n'a plus rien à voir avec les autres États dans l'histoire, il devient un semi-État, pour reprendre la formulation d'Engels, un État en voie d'extinction. Pour avancer vers le communisme dans une situation historique de transition, à la fois complexe et instable, pleine de dangers et de contradictions, le prolétariat ne doit pas cesser de porter des attaques à ce semi-État, il doit le démanteler pièce par pièce. Le processus révolutionnaire doit en passer par là sous peine de se bloquer et de voir s'éloigner, sinon se perdre définitivement, la perspective du communisme.
Un des auteurs au sein du mouvement ouvrier qui a le plus abordé cette question, Friedrich Engels, est très clair sur cet aspect : « Il conviendrait d'abandonner tout ce bavardage sur l'État, surtout après la Commune, qui n'était plus un État, au sens propre. Les anarchistes nous ont assez jeté à la tête l'État populaire, bien que déjà le livre de Marx contre Proudhon, et puis le Manifeste communiste, disent explicitement qu'avec l'instauration du régime social socialiste, l'État se dissout de lui-même et disparaît. L'État n'étant qu'une institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour réprimer par la force ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d'un État populaire libre: tant que le prolétariat a encore besoin de l'État, ce n'est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l'État cesse d'exister comme tel » (2).
L'intervention de l'État pour réguler l'économie, pour la mettre au « service des citoyens », etc., n'a rien à voir avec le socialisme. L'État ne sera jamais « au service de tous les citoyens ». L'État est un organe de la classe dominante et est structuré, organisé et configuré pour défendre la classe dominante et maintenir le système de production qui la maintient. L'État le « plus démocratique du monde » n'en sera pas moins un État au service de la bourgeoisie, qui défendra, bec et ongles, le système de production capitaliste. En outre, l'intervention spécifique de l'État sur le terrain économique n'a pas d'autre objectif que celui de préserver les intérêts généraux de la reproduction du capitalisme et de la classe capitaliste. Engels, dans son livre l'Anti-Dühring, affirme clairement : « l'État moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiètements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'État moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'État des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble ».
Tout au long du xxe siècle, avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence (3), l'État a été son principal rempart face à l'exacerbation de ses contradictions sociales, guerrières et économiques. Les xxe et xxie siècles se caractérisent par la tendance universelle au capitalisme d'État. Cette tendance existe dans tous les pays, quels que soient leurs régimes politiques. On trouve essentiellement deux voies de réalisation du capitalisme d'État :
-
L'étatisation plus ou moins complète de l'économie (c'est celle qui existait en Russie et existe encore en Chine, à Cuba, en Corée du Nord...) ;
-
La combinaison entre la bureaucratie étatique et la grande bourgeoisie privée (comme aux États-Unis ou en Espagne, par exemple).
Dans les deux cas, c'est toujours l'État qui contrôle l'économie. Le premier affiche ouvertement sa propriété d'une grande partie des moyens de production et services. Le second intervient dans l'économie à travers une série de mécanismes indirects : impôts, fiscalité, achats aux entreprises (4), fixation des taux d'intérêt interbancaires, régulation des prix, normes de comptabilité, agences étatiques de concertation, d'inspection, d'investissements (5), etc.
On nous gave avec un matraquage idéologique qui repose sur deux mensonges jumeaux : le premier est l'identification du socialisme avec l'État, le second est l'identification du néolibéralisme avec la dérégulation et le marché libre. Pendant sa période historique de décadence (xxe et xxie siècles), le capitalisme n'aurait pu subsister sans les béquilles omniprésentes de l'État. Le marché « libre » est guidé, contrôlé, soutenu par la main de fer de l'État. Adam Smith (6) disait que le marché était régulé par une « main invisible ». Cette main invisible, c'est l'État (7) ! Lorsque Bush se précipite pour sauver les banques et les compagnies d'assurances, il ne fait là rien d'exceptionnel, pas plus qu'il ne prend des mesures « que prendrait le camarade Lénine ». Il ne fait que poursuivre le travail de contrôle et de régulation de l'économie dont se charge quotidiennement l'État8.
Le « néolibéralisme » a-t-il échoué
Nous avons déjà exposé notre position sur les causes de la crise dans d'autres textes (9). Après une relative période de prospérité de 1945 à 1967, le capitalisme mondial est retombé dans des crises récurrentes, les épisodes convulsifs se sont succédés comme des séismes qui mettaient l'économie mondiale au bord de l'abîme. Rappelons la crise de 1971 qui obligea à désindexer le dollar de l'étalon or ; celle de 1974-75 qui aboutit à une inflation incontrôlable de plus de 10% ; la crise de la dette de 1982, quand le Mexique et l'Argentine se déclarèrent en suspension de paiement ; la chute de Wall Street en 1987 ; la crise de 1992-93 qui entraîna l'effondrement de nombreuses monnaies européennes ; celle de 1997-98 qui mit à mal le mythe des tigres et des dragons asiatiques ; celle de l'éclatement de la bulle Internet en 2001...
« Ce qui caractérise globalement les xxe et xxie siècles, c'est que la tendance à la surproduction - qui était temporaire au xixe siècle et pouvait être résolue relativement facilement - devient chronique, soumettant ainsi l'économie mondiale à des risques plus ou moins permanents d'instabilité et de destruction. Par ailleurs, la concurrence - trait congénital du capitalisme - atteint son paroxysme dans un marché mondial qui tend en permanence à être saturé et perd ainsi son caractère stimulateur de l'expansion pour ne plus développer que le caractère négatif et destructeur du chaos et de l'affrontement » (10). Les différentes étapes de la crise qui se sont succédées tout au long des dernières quarante années sont le produit de cette surproduction chronique et de la concurrence exacerbée. Les États ont tenté de combattre ses effets en usant de palliatifs, le principal d'entre eux étant bien sûr l'endettement. Les États les plus forts ont aussi repoussé les conséquences les plus néfastes en "exportant" les pires effets sur les pays les plus faibles (11).
La politique adoptée dans les années 1970 fut celle, classique, de l'endettement étatique renforcé par une intervention ouverte de l'État dans l'économie : nationalisations, prises de contrôle d'entreprises, supervisions rigides du commerce extérieur, etc. C'était une politique « keynésienne » (12). Il faut rappeler aux amnésiques qui veulent nous imposer le faux dilemme néolibéralisme/intervention étatique que tous les partis, de droite comme de gauche, étaient alors « keynésiens » et péroraient sur les bienfaits d'un « socialisme en liberté » (comme par exemple le modèle social-démocrate suédois), etc. Cette politique eut comme conséquences désastreuses l'emballement de l'inflation et donc la déstabilisation de l'économie et la tendance à la paralysie du commerce international. Pour y remédier, fut alors mise en place pendant les années 1980 ce qui fut rhétoriquement baptisé « la révolution néolibérale », dont les figures de proue étaient alors La Dame de fer » Madame Thatcher en Grande-Bretagne et le cowboy Reagan aux États-Unis. Cette politique étatique avait deux objectifs :
-
Lâcher du lest en liquidant une importante partie de l'appareil productif non rentable, ce qui entraîna une vague sans précédents de licenciements organisée et planifiée par l'État, ouvrant un processus de dégradation irréversible des conditions de vie des travailleurs : début de la précarité, démantèlement des prestations sociales, etc. (13) ;
-
Soulager l'endettement qui étranglait l'État par des politiques de privatisation, de sous-traitance des services et des fonctions ("l'externalisation") comme le report (« la titrisation ») systématique de la dette publique vers les particuliers, les banques, les spéculateurs, etc. Cette seconde étape de la politique « néolibérale » étendit ainsi particulièrement l'endettement de l'État au secteur financier. Le marché se retrouva inondé de toutes sortes de titres, bons, etc., qui prirent des proportions monstrueuses, la spéculation se déchaîna. L'économie mondiale ressembla dès lors à un immense casino dans lequel gouvernants, banquiers et experts « brokers » (les courtiers) se livrent à des opérations compliquées pour obtenir des profits spectaculaires immédiats ... au prix de terribles séquelles de faillites et d'instabilité.
Il ne faut pas nous raconter d'histoires sur « l'initiative privée » qu'encouragerait le « néolibéralisme » : ses mécanismes ne sont pas nés spontanément du marché mais ont été le fruit et la conséquence d'une politique économique étatique dans le but de juguler l'inflation. Elle n'a fait que la reporter mais en payant le prix fort : par d'obscurs mécanismes financiers, les dettes se sont transformées en créances spéculatives à haut niveau d'intérêt, rapportant dans un premier temps de juteux bénéfices mais dont il fallait se débarrasser le plus tôt possible car, tôt ou tard, personne ne pourrait plus les payer... Ces créances furent dans un premier temps les « stars » les plus attractives du marché que se disputaient les banques, les spéculateurs, les gouvernements... mais elles se transformèrent très rapidement en créances douteuses totalement dévalorisées qu'il fallait fuir comme la peste.
L'échec de cette politique se révéla avec le « krach » brutal de Wall Street en 1987 et l'effondrement des caisses d'épargne américaines en 1989. Cette politique « néolibérale » se poursuivit au cours des années 90 mais, étant donné les montagnes de dettes qui pesaient sur l'économie, il a fallu soulager les coûts de production par des politiques de développement de la productivité et... par les délocalisations, consistant à exporter des pans entiers de la production vers des pays comme la Chine, avec ses salaires de misère et ses conditions de travail impitoyables, ce qui a eu comme conséquence une aggravation générale considérable des conditions de vie de tout le prolétariat mondial. Le concept de « globalisation » s'est développé à ce moment-là : les grands États ont imposé aux petits la suppression des barrières protectionnistes, les inondant alors de marchandises pour soulager leur surproduction chronique.
Une fois de plus, ces "médecines" ne firent qu'aggraver le mal et la crise des dragons et des tigres asiatiques de 1997-98 démontra autant l'inefficacité de ces politiques que les dangers qu'elle contenait. Mais le capitalisme sortit alors un lapin de son chapeau, le nouveau siècle apporta avec lui ce qui s'appela la « net-économie », c'est-à-dire une spéculation à outrance sur les entreprises d'informatique et d'Internet. Ce fut rapidement, dès 2001, un échec fracassant. Le capitalisme tenta encore un nouveau tour de magie dès 2003 en se livrant à une spéculation immobilière déchaînée, remplissant la planète de buildings et d'immeubles (accélérant en passant les problèmes environnementaux), provoquant une terrible flambée du prix immobilier et débouchant sur... le terrible fiasco actuel !
... ou est-ce le capitalisme ?
La crise actuelle peut être assimilée à un gigantesque champ de mines. La première à exploser fut la crise des subprimes durant l'été 2007 et on aurait pu croire à première vue que les choses allaient rentrer dans l'ordre, moyennant le versement de quelques milliards. N'en avait-il pas toujours été ainsi ? Mais l'effondrement des institutions bancaires depuis fin décembre a été la nouvelle mine qui a fait exploser toutes ces illusions. L'été 2008 a été vertigineux avec une succession de faillites de banques aux États-Unis et en Grande- Bretagne. Nous en arrivons au mois d'octobre 2008 et une autre des illusions avec lesquelles les bourgeoisies comptaient apaiser nos préoccupations vient de partir en fumée : ils disaient que les problèmes étaient immenses aux États-Unis mais que l'économie européenne n'avait rien à craindre. Soit. Mais les mines commencent à présent à exploser aussi dans l'économie européenne en commençant par son État le plus puissant, l'Allemagne, qui contemple sans réagir l'effondrement de sa principale banque hypothécaire.
D'où viennent ces explosions brutales de mines alors que tout semble « tranquille et serein » ? Elles sont le résultat de 40 années d'accompagnement de la crise, de palliatifs, qui sont parvenus à masquer les problèmes et maintenir plus ou moins debout un système aux prises avec des problèmes insolubles, mais qui, non seulement n'ont rien résolu, mais au contraire, ont aggravé les contradictions du capitalisme jusqu'à ses limites extrêmes et c'est maintenant, avec cette crise, que l'on voit apparaître les conséquences les unes après les autres.
Le capitalisme s'en sortira-t-il « comme il s'en est toujours sorti » ?
Cet aphorisme est une fausse consolation :
-
Les épisodes précédents de la crise avaient pu être « résolus » par les banques centrales en déboursant quelques milliards de dollars (une centaine lors de la crise des Tigres asiatiques en 1998). Les États ont aujourd'hui investi 3 000 milliards de dollars depuis un an et demi et ils ne voient toujours pas d'issue (14).
-
Les pires effets de la crise avaient jusqu'ici été circonscrits à quelques pays (Sud-Est asiatique, Mexique et Argentine, Russie), alors qu'aujourd'hui l'épicentre où se concentrent les pires effets se trouve précisément dans les pays centraux : États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne... et irradient forcément le reste du monde.
-
Les épisodes précédents, en général et à l'exception de celui de la fin des années 1970, étaient de courte durée et il suffisait de 6 mois à un an pour apercevoir le « bout du tunnel ». Cela fait un an et demi que nous sommes dans cette crise et on n'aperçoit pas la moindre lueur. Au contraire, chaque jour, la crise est plus grave et la débâcle plus profonde !
-
Par ailleurs, cette crise va laisser le système bancaire mondial très affaibli. Le mécanisme du crédit se retrouve paralysé à cause de la méfiance généralisée, personne ne sachant vraiment si les « actifs » présentés par les banques (et les entreprises) dans leurs bilans ne sont pas de l'esbroufe. Les immeubles, les propriétés, les installations sont dévalorisés. Quant aux actifs financiers, ils ne sont, selon l'expression-même de Bush que des « actifs toxiques », du papier représentant d'incroyables dettes irrécupérables. Le capitalisme d'État « libéral » ne peut fonctionner s'il n'a pas des banques fortes et solides, l'économie capitaliste s'est à présent tellement accrochée à la drogue de l'endettement que si le système du crédit s'avère incapable d'apporter un flux d'argent abondant, la production sera paralysée. Le robinet du crédit est fermé malgré les sommes énormes allouées aux banques centrales par les gouvernements. Personne ne voit clairement comment va pouvoir se rétablir un système percé de toutes parts et qui perd ces organes vitaux - les banques - les uns après les autres. La course folle entre les États européens pour voir lequel pouvait donner le plus de garanties aux dépôts bancaires est une sinistre augure qui ne révèle que la recherche désespérée de fonds. Cette surenchère de « garanties » révèle précisément que rien n'est garanti !
Les choses sont donc claires : le capitalisme connaît aujourd'hui sa crise économique la plus grave. L'histoire vient de s'accélérer brutalement. Après 40 années d'un développement de la crise lent et heurté, ce système est en train de plonger dans une récession épouvantable et extrêmement profonde dont il ne se relèvera pas indemne. Mais surtout, dès maintenant, les conditions de vie de milliards de personnes se trouvent durement et durablement affectées. Le chômage frappe de nombreux foyers, 600 000 en moins d'un an en Espagne, 180 000 au mois d'août 2008 aux États-Unis. L'inflation frappe les produits alimentaires de base et la faim ravage le monde à une vitesse vertigineuse depuis un an. Les coupes salariales, les arrêts partiels de production avec les attaques qui en découlent, les risques qui pèsent sur les pensions de retraite... Il ne fait pas le moindre doute que cette crise va avoir des répercussions d'une brutalité inouïe. Nous ne savons pas si le capitalisme s'en sortira, mais nous sommes convaincus que des millions d'êtres humains ne s'en sortiront pas. Le « nouveau » capitalisme qui « sortira » de cette crise sera une société bien plus pauvre, avec énormément de prolétaires plongeant dans la précarité, dans un contexte de désordre et de chaos. Chacune des convulsions antérieures tout au long des 40 dernières années s'est soldée par une détérioration des conditions de vie de la classe ouvrière et par une amputation plus ou moins grande de l'appareil productif ; la nouvelle période qui s'ouvre portera cette tendance à un niveau bien supérieur.
Seule la lutte du prolétariat peut permettre à l'humanité de sortir de l'impasse
Le capitalisme ne va pas jeter l'éponge. Jamais une classe exploiteuse n'a reconnu la réalité de son échec et n'a cédé son pouvoir de son plein gré. Mais nous constatons qu'après plus de cent ans de catastrophes et de convulsions, toutes les politiques économiques avec lesquelles l'État capitaliste a tenté de résoudre ses problèmes non seulement ont échoué, mais elles ont en plus aggravé les problèmes. Nous n'avons rien à attendre des prétendues « nouvelles solutions » que va trouver le capitalisme pour « sortir de la crise ». Nous pouvons être certains qu'elles nous coûteront surtout toujours davantage de souffrances, de misère et nous devons nous préparer à connaître de nouvelles convulsions encore plus violentes.
C'est pourquoi il est utopique de se fier à ce qu'on nous présentera comme une « sortie » de la crise du capitalisme. Il n'y en a pas. Et c'est le système entier qui est incapable de masquer sa faillite. Etre réaliste, c'est participer à ce que le prolétariat reprenne confiance en lui, reprenne confiance en la force que peut lui donner sa lutte comme classe et construise patiemment par ses luttes, par ses débats, par son effort d'auto-organisation, la force sociale qui lui permettra de s'ériger en alternative révolutionnaire face à la société actuelle capable de renverser ce système pourrissant.
CCI (8 octobre)
1 Nous ne pouvons ici aborder en détails toutes ces questions. Pour cela, lire sur notre site : « La perspective du communisme [16] », « Le communisme n'est pas un bel idéal, il est à l'ordre du jour de l'histoire [17] », « Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle [18] ».
2 Engels, Lettre à August Bebel, 1875.
3 La Première Guerre mondiale (1914) met un point final au caractère progressiste du capitalisme et détermine sa transformation en système qui ne charrie plus que des guerres, des crises et la barbarie sans fin. Voir la Revue internationale no 134 [19].
4 Pour s'en faire une idée, aux États-Unis, présentés comme La Mecque du néolibéralisme, l'État est le principal client des entreprises et les entreprises d'informatique sont obligées d'envoyer au Pentagone une copie des programmes qu'elles créent et des composants de hardware qu'elles fabriquent.
5 C'est un conte de fées que de dire que l'économie américaine est dérégulée, que son État est inhibé, etc. : la Bourse est contrôlée par une agence fédérale spécifique, la banque est régulée par le SEC, la Réserve fédérale détermine la politique économique à travers des mécanismes comme les taux d'intérêt.
6 « Adam Smith (5 juin 1723 - 17 juillet 1790) est un philosophe et économiste écossais des Lumières. Il reste dans l'histoire comme le père de la science économique moderne, et son œuvre principale, de la richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique. Professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow, il consacra dix années de sa vie à ce texte qui inspira les grands économistes suivants, ceux que Karl Marx appellera les « classiques » et qui poseront les grands principes du libéralisme économique ». (wikipedia.org).
7 Le fléau de la corruption n'est rien d'autre que la preuve évidente de l'omniprésence de l'État. Aux États-Unis comme en Espagne ou en Chine, l'abc de la culture d'entreprise est que les affaires ne peuvent prospérer qu'en passant par les bureaux de la bureaucratie étatique, et en engraissant les hommes politiques du moment.
8 Si les interventions actuelles de Bush semblent écrites par Chavez, celles de Sarkozy sur la nécessité de moraliser le capitalisme semblent sortir tout droit d'un discours de Besancenot, le porte-parole emblématique du tout Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et de la LCR. Contrairement aux apparences, il n'y a ici rien d'étonnant. Ce que proposent le NPA (ex-LCR) et tous les gauchistes n'a rien de révolutionnaire : il s'agit juste d'une forme particulière de capitalisme où l'État ne manipule pas l'économie dans l'ombre (comme dans le ‘néo-libéralisme') mais de façon directe et ouverte. Et c'est justement, pour la bourgeoisie, cette dernière qui est la mieux adaptée au moment présent de crise. Dans la bouche de Sarkozy, toutes ces recettes étatistes apparaissent directement pour ce qu'elles sont : des changements structurels faits par la bourgeoisie pour la bourgeoisie. Mais ces mêmes recettes, déjà d'une efficacité douteuse pour la bourgeoisie, deviennent carrément frelatées et mensongères quand elles sont frauduleusement présentées dans la pure tradition stalinienne par Besancenot, Laguiller et consorts comme étant « des pas vers le socialiisme » accomplis «dans l'intérêt de la classe ouvrière et des couches populaires ». (Note ajoutée par Révolution Internationale, organe du CCI en France).
9 Voir la Revue internationale no 133, « États-Unis, locomotive de l'économie mondiale... vers l'abîme [20] ».
10 in « Existe-t-il une issue à la crise ? [4] ».
11 Dans la série d'articles "30 ans de crise capitaliste" publiée dans les nos 96 [21], 97 [22] et 98 [23] de la Revue internationale, nous analysons les techniques et méthodes avec lesquelles le capitalisme d'État a accompagné cette chute dans l'abîme pour la ralentir, parvenant à ce qu'elle évolue par paliers successifs.
12 Keynes est particulièrement célèbre pour ses encouragements à une politique d'interventionnisme étatique, dans lequel l'État emploierait des mesures fiscales et monétaires avec pour objectif d'enrayer les effets défavorables des périodes de récession cycliques de l'activité économique. Les économistes considèrent qu'il est un des principaux fondateurs de la macroéconomie moderne.
13 Il faut rappeler ici que, contrairement à ce qu'affirment les menteurs de tout poil, cette politique n'était pas une caractéristique des gouvernements « néolibéraux » mais était approuvée à cent pour cent par les gouvernements « socialistes » ou « progressistes ». En France, le gouvernement Mitterrand, soutenu par les communistes jusqu'en 1984, avait adopté des mesures aussi dures que celles qu'appliquaient Reagan ou Thatcher. En Espagne, le gouvernement « socialiste » de Monsieur Gonzalez organisa une reconversion qui impliqua la disparition d'un million d'emplois.
14 Il est en outre stupide de penser que ce déluge de milliards n'aurait pas de conséquences, que ce serait pour ainsi dire une opération "blanche". Il prépare en fait un avenir encore plus sombre. Tôt ou tard, cette folie devra être payée. Le scepticisme généralisé avec lequel a été accueilli le plan de sauvetage financier le plus gigantesque de l'histoire (700 milliards de dollars !) à travers le « plan Paulson » démontre que le remède est en train d'installer de nouveaux champs de mines encore plus puissantes et dévastatrices, dans les sous-sols de l'économie capitaliste malmenée et dont l'effondrement sera, au bout du compte, inévitable.
Récent et en cours:
- Crise économique [9]
Cyclones en Louisiane : l'incurie de la bourgeoisie américaine
- 2884 reads
On se souvient très bien de la panique qui avait envahi la bourgeoisie américaine devant le délabrement du sud des Etats-Unis après Katrina. Face à une incurie que chacun pouvait aisément constater, les quelques démissions de circonstance avaient laissé la place aux discours bien rodés, larme à l'œil et mine préoccupée, du style "plus-jamais". Georges Bush le premier, la main sur le cœur, avait promis que tout serait fait pour que la Louisiane sinistrée soit reconstruite, que les digues soient renforcées 2, que les plans d'urgence soient révisés, etc. Bref, plus jamais pareille tragédie ne devait se reproduire sur les terres américaines.
Trois ans après, la seule réponse de la bourgeoisie face à l'arrivée d'Ike sur ses côtes fut... l'évacuation ! Car depuis Katrina, rien n'a été fait pour prévenir de nouvelles catastrophes. Les médias s'empressent d'accuser l'accélération de la fréquence des catastrophes naturelles et leur force destructrice sans cesse accrue, mais tout ce vacarme pseudo-scientifique ne peut cacher une réalité bien palpable : que ce soit dans les pays du tiers-monde (voir la prise de position de nos camarades de République dominicaine - RI n°394) ou dans les plus grandes puissances mondiales, la classe dominante ne se donne aucun moyen de faire face aux menaces climatiques. Les bourgeoisies des pays centraux du capitalisme ne peuvent plus accuser tel ou tel dictateur de laisser mourir sa population, protégé derrière les ors de ses palais. Elle-même, dans les mêmes circonstances, pare au plus pressé, consolide ce qu'elle peut, évacue les populations et déblaie ensuite les gravats et les morts. Cette pitoyable impuissance ne doit rien aux hasards météorologiques ou aux effets de surprise. Déjà en 1948, Humprey Bogart et Lauren Bacall se barricadaient dans Key Largo sous la menace d'un puissant ouragan. Aujourd'hui il ne reste plus de planches, plus de clous ; il ne reste que la "solution" de la fuite en croisant les doigts pour que, quand on reviendra, il reste encore quelques murs debout.
Il ne s'agit nullement d'un calcul économique, serait-il même cynique, qui aboutirait à préférer guérir que prévenir. Katrina aura coûté quelques 12 milliards de dollars aux Etats-Unis 3, et Ike pourrait coûter entre 7 et 14 milliards de dollars 4. Des coûts colossaux tout juste suffisants à répondre à l'urgence, mais qui ne sont pas mis en œuvre dans des politiques en amont. Ce capitalisme en faillite est de plus en plus incapable de mettre en œuvre des moyens pour la prévention, il n'a plus que les moyens de panser tout juste quelques plaies.
Ce n'est pas en réduisant l'effet de serre ou en améliorant la prévision météorologique que, fondamentalement, il sera possible de réduire les dégâts occasionnés par les catastrophes climatiques, mais bien en mettant au centre des préoccupations la protection des vies humaines et de ses équipements essentiels dans un seul souci d'efficacité. Mais tout cela est absolument impossible dans le capitalisme.
GD (23 septembre)
1 Source Wikipedia.
2 La Nouvelle-Orléans est construite jusqu'à 6 mètres au-dessous du niveau de la mer, et protégée par des digues de 4 mètres.
3 Source Wikipedia.
4 Estimations établies par la société de réassurance Swiss Re, et relatées par le site tsr.ch.
Récent et en cours:
- Catastrophes [24]
Journée de discussion à Marseille : un débat ouvert et fraternel sur "un autre monde est-il possible ?"
- 3801 reads
Fort du succès des expériences belge et anglaise 1, le CCI a renouvelé en France l'organisation d'une journée de discussion rassemblant sympathisants, contacts et lecteurs de Révolution Internationale, tous animés par la même préoccupation : quel avenir pour ce monde ? Trente et un participants venus de Toulouse, Lyon, Grenoble, Marseille et Milan, se sont donc réunis début décembre à Marseille et ont choisi de débattre autour du thème : « quelle société voulons-nous ? »
L'exposé introductif a été réalisé par l'un des participants. D'origine nord-africaine, ce dernier a tout d'abord expliqué brièvement son parcours politique : avant de venir en France « je voyais la société occidentale, comme un espoir. On sollicitait l'opinion internationale, l'ONU, Amnesty, le parlement européen etc... On espérait gagner comme ça ! Mais quand je suis arrivé en France, toutes mes illusions se sont effondrées ; alors j'ai commencé à me poser des questions. »
Des questions... tout le monde s'en pose mais peu osent venir en débattre ouvertement ou trouvent les moyens et les lieux pour le faire. Et pourtant, les préoccupations sont identiques de Toulouse à Grenoble, de la France à la l'Angleterre. C'est pourquoi nous saluons l'esprit fraternel dans lequel s'est déroulée cette journée, une journée révélatrice de la lente maturation de la conscience de toute la classe ouvrière depuis quelques années.
Une autre société est-elle possible ?
D'emblée, plusieurs interventions ont affirmé que le système capitaliste nous menait « droit dans le mur » et que l'avenir ne tenait qu'en trois mots : « Socialisme ou barbarie » 2.
« Ça va de mal en pis, affirme ainsi une participante, on dit redistribuer les richesses, mais on sait que ce n'est pas possible, ce n'est pas admis par le système. Voter, faire des pétitions ça ne suffira pas à obtenir ce que je veux, un système équitable, humain où l'on puisse vivre en harmonie avec les autres. Le contraire de ce que l'on voit aujourd'hui. Je veux une société différente et je sais que pour cela il faut détruire le système. L'utopie, c'est de croire que ceux qui arriveront après nous pourront vivre dans ce système. » Le développement au niveau mondial des conflits guerriers, de la misère, de la pollution... signe en effet sans aucun doute possible la faillite du capitalisme. Seule la société communiste présente une alternative pour l'ensemble de l'humanité.
Cependant, beaucoup ont exprimé des doutes quant à la possibilité de construire cette nouvelle société, des doutes qui ne sont pas propres à ces camarades mais qui sont au contraire très répandus dans les rangs ouvriers :
-
« Nous ne sommes pas des anges. Je me pose des questions sur la nature de l'homme toujours fauteur de guerre comme nous le répète la bourgeoisie. Dans le film "Sa Majesté des mouches", des enfants isolés sur une île finissent par se massacrer. Ça fait peur... une autre société est-elle vraiment possible ? » Cette intervention résume parfaitement la question qui revient sur toutes les lèvres : comment améliorer ce monde barbare alors que l'homme serait naturellement mauvais ? « L'homme est un animal social », lui répond un autre participant, « Il ressemble à la société dans laquelle il vit. En fonction des conditions données, l'homme se construit. L'homme peut être soumis au capital mais il peut aussi s'y soustraire ».
Cette nature foncièrement mauvaise de l'homme est l'un des principaux arguments avancés par la bourgeoisie pour justifier la barbarie engendrée par le capitalisme et empêcher la classe ouvrière de rêver d'un autre monde : « Ce que l'on nous renvoie toujours dans les médias, les bouquins, c'est que la nature humaine est terrible, que l'homme est un loup pour l'homme, mais c'est surtout pour nous empêcher de réfléchir collectivement. »
Cette question de la nature humaine est éminemment complexe. Il est impossible d'y répondre ici, dans le cadre de ce court compte-rendu. Simplement, nous pouvons réaffirmer que l'homme est en réalité un être profondément social. L'entraide, la solidarité, la générosité..., toutes ces valeurs sont donc ancrées en lui viscéralement 3.
-
Des doutes se sont aussi exprimés sur la capacité de la classe ouvrière à déjouer les pièges de la bourgeoisie, notamment ceux tendus par les syndicats. Leur rôle : diviser pour mieux régner, encadrer sur le terrain les ouvriers pour mieux faire passer les « réformes » (en clair, les attaques). Ainsi, tout en dénonçant ce sale boulot des syndicats, plusieurs camarades ont aussi exprimé leurs craintes face à la force idéologique de la bourgeoisie et de ses chiens de garde : « Le capital trouve toujours des moyens de réformes, comment arriver à démasquer ces palliatifs ? », « Les revendications ont tendance à se rassembler mais on a toujours les syndicats qui offrent des solutions. ».
Cette puissance de la classe dominante est tout à fait réelle. Pour assurer la défense de ses intérêts de classe et la perpétuation de son système d'exploitation, la bourgeoisie est capable de déployer un machiavélisme consommé et les syndicats représentent un véritable danger pour diviser le prolétariat et saboter sa mobilisation. Jusqu'ici, ils ont réussi à endiguer la combativité et la réflexion de notre classe. Néanmoins, depuis quelques années, le vent semble tourner ; partout dans le monde, la classe ouvrière retrouve progressivement le chemin de la lutte. La confrontation au sabotage syndical et la prise en main des luttes par la classe ouvrière elle-même sera justement l'un des grands enjeux des combats à venir.
-
Enfin, dernière crainte exprimée (mais non des moindres), un camarade a fait part de sa peur qu'il ne soit déjà trop tard : « J'ai peur que si on a une révolution, elle ne puisse arriver avant que capitalisme n'ait provoque des dégâts irréversibles et engendré des effets dramatiques. Guerres, famines, réchauffement climatique... On a du mal à imaginer une révolution dans une même échelle de temps que l'aggravation de la crise. » Cette crainte d'un camarade face à l'état d'urgence de la situation actuelle est entièrement justifiée. Effectivement, plus la révolution tardera, plus l'humanité se retrouvera avec un monde dévasté et difficile à reconstruire. Cependant, aujourd'hui, notre seule chance d'avenir est le prolétariat et la révolution. Et là aussi, il faut tenir compte de la dynamique actuelle de notre classe. Nous pouvons avoir confiance dans le prolétariat ; quand il rentre en lutte, ses capacités sont immenses, l'effervescence et la créativité dont il est alors capable sont souvent insoupçonnées. L'avenir est donc en réalité riche de promesses.
Comment construite une nouvelle société ?
Ces interrogations légitimes quant à la possibilité de la révolution se sont aussi révélés par la recherche de solutions « douces » et « progressives », certains participants s'interrogeant sur « comment construire une société communiste sans passer forcément par la lutte et la révolution » :
-
Ainsi, pour un camarade, « Il faudrait peut-être passer par des expérimentations, par des laboratoires qui permettraient d'affiner notre critique du système. »
Rapidement, deux participants lui ont répondu : « Le capitalisme peut-il permettre à un groupe d'individus un système qui lui soit étranger ? Je pense que non, sinon on l'aurait déjà fait. Après 68, il y a eu les illusions sur le retour à la terre qui s'est transformé en petits commerces, car il fallait faire du profit. Il y a eu aussi une association ‘Le sel' qui prônait l'échange de services, mais l'Etat a vite mis le holà ! », « Sur la question des ‘laboratoires', ce n'est pas possible car on ne peut pas préfigurer ce que l'on va vivre dans 15 ans. Mais on a déjà des expériences, il y a eu une vague révolutionnaire de 1917 à 1923 qui a été un moment très riche. Il ne faut pas l'oublier et tirer des leçons. Par exemple les conseils ouvriers avec délégués révocables, aujourd'hui nous devons nous battre pour que les Assemblées générales soient ouvertes et qu'il y ait de véritables débats. »
Dans les années 70 et 80, il y a régulièrement eu des tentatives pour vivre différemment : retour à la terre, communautés, auto-gestion, etc. Toutes exprimaient une illusion sur la possibilité de créer des îlots de communisme sans avoir à supprimer le capitalisme. Et toutes ont échoué, à l'image des expériences d'autogestion qui ont abouti à ce que les ouvriers acceptent d'eux mêmes des licenciements pour que leur entreprise reste compétitive 4 !
En fait, la société future ne sera possible qu'à l'échelle internationale, unifiant ainsi toute l'humanité, abolissant toutes les divisions de classes et de nations. Le communisme n'a pas sa place au sein du capitalisme. C'est une des leçons de la révolution de 1917 qui fut vaincue parce qu'elle n'avait pu s'étendre (et pourtant, nous étions loin ici de « l'expérimentation » à petite échelle, la classe ouvrière s'étant mise en branle sur toute une partie de la surface du globe !).
-
Ce même intervenant a précisé ensuite quel type « d'expérimentations » il avait en tête, présentant la décroissance comme une alternative : « Pour moi, la plate-forme du CCI et les thèses sur la décroissance visent le même but mais la manière d'y parvenir n'est pas la même. »
La question de la décroissance revient aujourd'hui souvent dans les discussions. Elle s'appuie sur un constat tout à fait juste : la production, dans le système capitaliste, n'est pas réalisée pour répondre aux besoins de l'humanité mais pour le profit, ce faisant elle non seulement elle n'engendre pas le bien-être (loin de là) mais en plus la production capitaliste détruit la planète. La solution, pour les tenants de la décroissance, est donc de mieux et de moins consommer. Ce serait à chacun, à chaque « citoyen du monde », individuellement, que reviendrait la tâche de réagir et de tenter dès maintenant de « vivre autrement » : en limitant les déplacements qui polluent, en ne chauffant pas trop sa maison, en choisissant méticuleusement ce que l'on achète, etc., comportements présentés comme moyens « radicaux » de la transformation des consciences. L'une des actions phares prônée par ce modèle est « la journée sans achat ».
Voilà comment les autres intervenants ont répondu au camarade : « Ce n'est pas la théorie de la décroissance qui va se poser mais la question de l'utilité de tels ou tels produits. Aujourd'hui nous sommes obligés d'acheter une voiture, d'avoir un portable. Mais dans l'avenir, quelle utilité ? » ou encore « En parlant de décroissance, on se met dans la logique de la survie du système et donc du problème de la ‘marchandisation' de tout ! Le système repose sur l'accumulation des moyens de production, s'ils cessent d'accumuler, il s'effondre. Le système capitaliste doit toujours aller de l'avant... C'est parce que la croissance n'est plus possible que la révolution est nécessaire ».
Surtout, cette théorie de la décroissance ne touche qu'une partie du problème et de façon superficielle ; elle ne va pas au fond des choses. Le capitalisme ne peut pas être aménagé, il est un système d'exploitation moribond et il emporte l'humanité dans l'abîme avec lui. A la production anarchique et destructrice du capital, s'ajoute par exemple la guerre ou la paupérisation. Pour sauver l'humanité et la planète, il faut détruire ce système barbare et la seule force capable de le faire, ce n'est pas une somme d'individus (animés des meilleures intentions du monde soient-ils), mais une classe : le prolétariat 5.
La révolution ne sera-t-elle pas trop violente ?
Derrière cette recherche « d'alternatives plus douces », se cache en réalité la peur de la violence de la révolution : « S'il faut une révolution, elle devrait se passer en douceur. Il faut réfléchir, changer tout doucement sinon ça fait peur » affirme ainsi une participante.
En réponse, plusieurs interventions ont réaffirmé qu'en effet la révolution sera forcement violente puisque la bourgeoisie ne se laissera pas déposséder sans réagir, mais qu'elle était aussi et surtout nécessaire : « La révolution ça fait peur, c'est vrai qu'elle sera forcément violente car l'internationalisation ne se fera pas en un clin d'œil. Ça ne fait pas plaisir de souffrir, mais c'est un mal nécessaire car la société capitaliste ne peut pas se réformer. » ; « Sur la peur de la révolution, quand je dis qu'elle sera sans péridurale, cela veut dire que tout le monde a peur du pas à franchir, mais l'usage de la violence ne se pose pas en soi mais c'est le seul moyen possible pour s'affranchir du système capitaliste, pour accoucher d'une autre société sans exploitation . Ce rapport de force ne peut pas être sans violence. » ; ou encore « Pour moi, la question, c'est vivre ou mourir. Ce n'est pas de l'utopie ; c'est du réalisme. Ce n'est pas vrai seulement pour moi mais c'est déjà vrai pour une grosse partie de la planète. Il n'y a pas d'autres solutions, sinon c'est le système qui crève et nous avec. »
La violence sera effectivement nécessaire pour sortir l'humanité de ce système moribond. Mais de quelle violence parle t-on ? Le capitalisme est un système où une minorité impose sa domination à l'écrasante majorité de l'humanité par la terreur ; il impose à des millions d'êtres humains les ravages de la famine, de la guerre et des épidémies. Comme l'a dit l'un des participants « Mais à coté de la violence de tous les jours, la violence de la révolution, il faut la relativiser. Nous subissons aujourd'hui la violence du système et nous n'en sommes pas responsables ». La violence de la classe ouvrière et de sa lutte n'a strictement rien à voir avec la terreur bourgeoise. Au contraire, elle en est à la fois l'antithèse et l'antidote. Comme nous l'affirmons dans notre article « Terreur, terrorisme et violence de classe » : la force invincible de la classe ouvrière « ne réside pas tant dans sa force physique et militaire et encore moins dans la répression, que dans sa capacité de mobiliser ses larges masses, d'associer la majorité des couches et classes non-exploiteuses et non-prolétariennes à la lutte contre la barbarie capitaliste. Elle réside dans le développement de sa conscience et dans sa capacité à s'organiser de façon unitaire en tant que classe autonome, dans la défense intransigeante de ses principes et dans la justesse de ses décisions prises collectivement à travers le débat le plus large et "démocratique" possible (notamment dans ses organes de prise du pouvoir appelés "soviets" en Russie dès 1905 ou "Conseils Ouvriers" en Allemagne en 1918). Telles sont les armes fondamentales de la pratique et de la violence de classe du prolétariat. »
Un des participants a eu cette phrase qui révèle à elle-seule l'une des grandes angoisses des ouvriers : « Si on doit faire la révolution, moi, j'ai besoin de certitude ». Nous avons certainement devant nous la plus haute marche à franchir de l'histoire. Il ne s'agit rien de moins que de sortir de la préhistoire de l'humanité. Aucune ‘mesurette', aucune solution locale n'est possible. La seule perspective est de détruire le capitalisme à l'échelle internationale avant qu'il ne détruise l'humanité, avec une lutte internationale et par une classe internationale, le prolétariat. C'est à la fois grandiose et effrayant. Comme Marx l'a écrit dans son 18 Brumaire : « Les révolutions prolétariennes [...] paraissent [...] reculer constamment à nouveau devant l'immensité infinie de leurs propres buts, jusqu'à ce que soit créée la situation qui rende impossible tout retour en arrière et que les circonstances elles-mêmes crient : ‘Hic Rhodus, hic salta' 6 ».
Lors de cette journée de discussion à Marseille, toutes les interrogations, toutes les craintes et tous les doutes ont pu être posés. C'est pour cela que de telles journées de discussion sont si importantes car elles permettent de rompre l'isolement, de s'apercevoir que nous ne sommes pas seuls à vouloir que ce monde change. Cela a été tout l'esprit de cette journée : débattre fraternellement pour comprendre et avancer collectivement. La classe ouvrière peut et doit avoir confiance en sa force.
CCI, le 28 février
1 Lire nos articles sur notre site web (www.internationalism.org [25]) : « Journée de rencontre et de discussion avec le CCI d'août 2007 : chercher ensemble une alternative pour cette société agonisante » et « Journée d'étude du CCI en Grande-Bretagne : un débat vivant et fraternel »
2 1er congrès de la 3ème Internationale en 1919.
3 Le CCI débat depuis quelques années, en son sein, de cette question de la « nature humaine ». Ce débat est en parti publie dans l'article « Marxisme et éthique (débat interne au CCI) » publié sur notre site web (www.internationalism.org [26]). En voici un extrait : « La morale est un guide indispensable de comportement dans le monde culturel de l'humanité. Elle permet d'identifier les principes et les règles de vie commune des membres de la société. La solidarité, la sensibilité, la générosité, le soutien aux nécessiteux, l'honnêteté, l'attitude amicale et la bienveillance, la modestie, la solidarité entre générations sont des trésors qui appartiennent à l'héritage moral de l'humanité. Ce sont des qualités sans lesquelles la vie en société devient impossible. C'est pourquoi les êtres humains ont toujours reconnu leur valeur, tout comme l'indifférence envers les autres, la brutalité, l'avidité, l'envie, l'arrogance et la vanité, la malhonnêteté et le mensonge ont toujours provoqué la désapprobation et l'indignation. »
4 Lire nos articles sur Lip, par exemple, où les ouvriers au nom de l'autogestion se sont mis à s'auto-exploiter !
5 Toute une partie de la discussion a d'ailleurs porté sur « qu'est-ce que la classe ouvrière ? ». Cette question est aujourd'hui très présente ; avec le développement des luttes se pose en effet le problème « Avec qui s'unir ? Où chercher la solidarité dans la lutte ?... » Le débat qui s'est développé à Marseille sur ce point fut très proche de ceux menés à Toulouse, Paris, Lyon... lors de nos Réunions Publiques de février dont l'intitulé était justement « qu'est-ce que la classe ouvrière ? » et dont le texte de présentation était « Cet automne, certains étudiants luttant contre la loi "LRU" ont manifesté leur solidarité avec les cheminots grévistes, tentant même parfois de réaliser des AG communes. Par contre, ils n'ont jamais essayé d'entraîner, par exemple, les infirmiers des hôpitaux ou les enseignants, en allant les voir et discuter. Pourquoi ? L'image d'Epinal fait paraître l'ouvrier en bleu de travail et aux mains calleuses. Mais qu'en est-il des million de chômeurs, des retraités, des salariés de bureaux, des fonctionnaires, des travailleurs précaires...? Qui fait partie de la classe ouvrière ? Répondre à ces questions est primordial pour continuer dans l'avenir à développer, dans la lutte, l'unité et la solidarité. » Nous renvoyons donc le lecteur à l'exposé de cette réunion publique publié sur notre site web : www.internationalism.org [26]
6 "Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter". Proverbe latin inspiré d'une fable d'Esope qui signifie : c'est l'épreuve de vérité, c'est le moment de montrer ce dont on est capable.
Vie du CCI:
Journée de rencontre et de discussion avec le CCI d’août 2007: chercher ensemble une alternative pour cette société agonisante
- 2762 reads
En août 2007, nous avons organisé une ‘journée de rencontre et de discussion avec le CCI', pendant laquelle les participants ont eu l'occasion de poser ‘librement' des questions et de développer leur argumentation sur les thèmes qui leur tenaient le plus à cœur. Ce n'était pas une journée de spécialistes pour spécialistes mais un moment de débat libre entre participants et de recherche de réponses aux questions suscitées par la période actuelle. Ce fut donc une occasion rêvée de discuter plus à fond de certains sujets ou simplement de mieux se connaître.
L'initiative d'organiser cette journée n'est pas tombée du ciel. Les nombreuses réactions positives et la participation active, pleine d'enthousiasme, des présents ont constitué la preuve qu'une telle réunion répond à un besoin qui vit chez beaucoup : réfléchir ensemble sur le futur, chercher ensemble, et pas chacun dans son coin, une alternative pour cette société agonisante, dans laquelle les catastrophes écologiques, la crise économique, le chômage, la guerre et la famine, avec leurs masses de réfugiés, constituent une réalité quotidienne, qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais aussi, tirer des leçons des expériences du passé, des nombreux efforts et des contributions théoriques, et ceci surtout dans la perspective d'appréhender la dynamique, les mécanismes, les forces qui peuvent constituer cette alternative. Qu'est-ce qui fait changer une société ? Qui peut réaliser les changements nécessaires ? Qui peut imposer un rapport de force et pourquoi ?
La discussion politique et le débat ont toujours constitué un souffle vital pour le mouvement ouvrier car c'est de cette manière que sont clarifiées les questions posées par la lutte de classe et par le combat pour l'alternative historique, le communisme. Toutefois, cette discussion peut prendre des formes fort diverses. Ainsi, nous encourageons toujours à nous écrire et il y a aussi les forums internet. Mais il y a bien sûr surtout des réunions, comme celle de l'été passé, où une discussion directe est possible, où les questions, réponses et réflexions se succèdent dans un vrai débat. C'est là que les positions des présents et les vraies questions suscitées par la lutte de classe sont le mieux valorisées.
Pour arriver à coller le mieux possible aux questions que nos lecteurs et contacts se posent, nous avons fait circuler en préparation de la journée de discussion un questionnaire avec une vingtaine de sujets possibles afin que chacun désigne trois sujets qui lui paraissaient les plus urgents à traiter. Les questionnements ci-dessous ont émergé comme étant prioritaires :
-
Où se situe la frontière entre les classes sociales ? Qui fait partie de quelle classe ? Existe-t-il une frontière et comment la détermine-t-on ? Qu'est-ce que la classe ouvrière et qui en fait partie ? Qu'est-ce qu'elle représente ?
-
Qu'est-ce que le communisme et pourquoi est-il plus que jamais actuel ? Qu'est-ce que la perspective du communisme ?
Nous avons ensuite demandé à quelques participants de préparer une introduction à ces deux discussions et ceux-ci ont réalisé un travail magnifique en introduisant pour les participants quelques principes fondamentaux pour la discussion de ces sujets.
Première discussion : qu'est-ce que la classe ouvrière et qui en fait partie ?
La courte introduction est partie de l'affirmation, souvent entendue, que la classe ouvrière n'existe plus et que, même si elle existait, elle n'arriverait plus à imposer une autre société. La lutte pour le changement de la société serait dès lors devenue vaine. Un des arguments avancés est que le capitalisme a connu de grands changements et que nous connaissons aujourd'hui un modèle économique nouveau avec de grands changements sociaux. Il en découlerait la fin de la nature révolutionnaire de la classe ouvrière. Pourtant, un capitalisme sans classe ouvrière n'existe pas, il n'y a pas de capitalisme sans exploitation et pas d'extraction de plus-value sans travail salarié. Pour terminer, l'introduction a mis l'accent sur la nature particulière de la classe ouvrière, à la fois classe exploitée et classe révolutionnaire.
La discussion a démarré sur les chapeaux de roues, surtout grâce aux jeunes qui étaient présents. D'abord, il y a eu des questions générales sur l'existence et la réalité actuelle de la classe ouvrière, ainsi que différentes tentatives pour donner une définition de cette dernière. Depuis le début du mouvement révolutionnaire, en particulier chez Marx, la nécessité d'une définition claire de la classe ouvrière a été ressentie. Si au 19ème siècle, personne ne mettait en doute l'existence de classes, au 20ème siècle, il est devenu plus difficile de les reconnaître. Dans la discussion, un consensus s'est développé qu'il fallait donner une définition à partir d'un processus de croissance historique, celle d'une société capitaliste qui succède à une série d'autres sociétés, de l'Antiquité jusqu'à la période présente. Dans la recherche d'une définition, différents critères ont été avancés, comme la place qu'occupent les travailleurs dans le processus de production. La classe ouvrière n'a pas la propriété des moyens de production et ne décide pas non plus ce qui doit être produit, mais elle vend sa force de production et produit de façon collective la plus-value. Mais si la classe ouvrière est caractérisée en tant que classe exploitée, il y a aussi une classe exploiteuse, la bourgeoisie. C'est alors que la question s'est posée de savoir qui fait partie de la classe ouvrière et qui de la bourgeoisie. Ainsi, à travers des exemples, s'est constituée une image de la méthode qu'il faut utiliser pour trouver des réponses. Où faut-il situer les managers d'entreprises, et toute une série de professions libérales ? Un travailleur a un salaire, un manager aussi mais celui-ci est déduit des bénéfices de l'entreprise pour laquelle il travaille. Quant aux paysans, aux instituteurs ou au personnel hospitalier, ils ne produisent pas directement de plus-value mais participent néanmoins indirectement à la production en permettant la reproduction de la force de travail, ils participent donc au processus de travail comme un tout. La conclusion a été qu'il n'existe pas de frontière claire et définitive entre les classes et qu'on ne peut se satisfaire d'une définition purement sociologique et économique ; la conscience de classe joue aussi un rôle important. Ce qui est décisif est de quel côté l'on se trouve au moment de la lutte de classe et cela fait partie d'une dynamique historique. La discussion a fait référence à des exemples dans l'actualité et dans l'histoire du mouvement ouvrier, ce qui lui a donné un aspect vivant et concret.
L'atmosphère était enthousiasmante. Les participants s'écoutaient et se répondaient, chacun se sentait concerné et, à la demande générale, la discussion s'est un peu poursuivie dans l'après-midi, pour se terminer par une synthèse des points abordés.
Deuxième discussion : nécessité et possibilité du communisme
La deuxième partie de la discussion s'est engagée avec une introduction détaillée dans laquelle a été précisé ce que le communisme est et n'est pas. Les présents ont souligné après coup qu'ils avaient rarement entendu un exposé reprenant une esquisse aussi complète des caractéristiques de la société future. L'exposé a été placé sur notre site web (internationalism.org).
La discussion a mis l'accent sur le fait que le communisme est le produit de toute une évolution de l'humanité et n'est pas fixé à l'avance. Les marxistes ne s'intéressent pas uniquement à la question des luttes immédiates des travailleurs mais surtout aussi à la question de comment obtenir la victoire et quelles sont les tâches principales après la révolution. Le communisme ne naît pas spontanément mais est le produit de la lutte et des orientations pour cette lutte. Si le prolétariat n'engage pas massivement la lutte, la société pourrira et la perspective du communisme s'évanouira. Après toutes les campagnes sur la mort du communisme, la disparition de la classe ouvrière et la faillite du marxisme, on assiste cependant aujourd'hui à une résurgence de la lutte. Peu de questions ont porté sur la nécessité même du communisme. Par contre, il y en a eu d'autant plus sur la possibilité de le réaliser. Cela souligne qu'il y a une certaine prise de conscience de la nécessité d'une autre société mais qu'il subsiste beaucoup de doutes sur les circonstances qui peuvent entraîner la réussite de la lutte prolétarienne. La possibilité de l'instauration du communisme a aussi été liée à la question de la nature humaine. Un participant a estimé que le communisme est la réalisation de la nature humaine mais que ce n'est pas la même chose que ce qui est propre à l'homme, ce qui a mené à des considérations intéressantes. Une autre question qui a été avancée par les présents était : comment la classe ouvrière peut-elle mener le combat contre la bourgeoisie, compte tenu de tous les moyens que cette dernière a à sa disposition ? Cela peut susciter chez les travailleurs un sentiment d'impuissance. Un mouvement de milliers de grévistes paraît dérisoire face à l'ampleur immense de la tâche. Cela pose à son tour la question des obstacles que la bourgeoisie érige et du rapport de force à imposer. Est-ce que la classe ouvrière doit chercher des alliés, comme, par exemple, les masses paysannes dans les pays périphériques ? Bien d'autres points n'ont pu être abordés : la question de la culture, des relations humaines, le rapport homme - femme, la dictature du prolétariat et d'autres points plus pratiques concernant la période de transition du capitalisme vers le communisme.
Prolonger l'enthousiasme. Aidez-nous à préparer la journée de rencontre et de discussion de l'été 2008.
Comme nous l'avons déjà dit, les présents à cette journée ne sont pas les seuls à se poser de telles questions. Dans un article concernant notre dernier Congrès International, nous constatons qu'une nouvelle génération de révolutionnaires surgit (lire Internationalisme 333). Relevons simplement les nombreux débats au sein de petits groupes ou sur internet, les courriers que nous recevons de personnes qui nous contactent pour la première fois, les discussions avec toute une série de nouveaux groupes ou avec des gens que nous rencontrons lors de réunions ou de manifestations. Tout cela témoigne du fait qu'un nombre croissant d'éléments, partout dans le monde, se posent des questions fondamentales à propos de la nature de la société capitaliste et veulent débattre à propos de la manière de mettre en avant une alternative. En tant qu'organisation, nous voulons contribuer autant que possible et partout où c'est possible à ce processus, avec tous les moyens dont nous disposons. Ainsi que nous l'avons souligné dans la conclusion de la journée, un tel débat est une expression de la lutte de classe. La lutte de classe n'est pas seulement une lutte sur un plan immédiat mais c'est aussi une lutte politique pour clarifier.
Le résultat de cette journée de discussion est encourageant : des personnes qui ne se connaissaient pas ont engagé le débat avec un esprit ouvert, se sont écoutées et se sont répondu. Des participants venant de trois pays et de diverses générations se sont réunis et ont discuté en trois langues, une expression concrète de l'internationalisme que nous défendons ardemment, bien éloignée des principes de division et d'inégalité que la bourgeoisie promeut. Ce qui est réalisé ici à une échelle restreinte témoigne de l'énorme puissance que l'ensemble de la classe ouvrière peut générer. La lutte dégage en effet une énergie et une puissance créatrice insoupçonnables. Cette réunion de rencontre et de discussion a donné un avant-goût de ce que le prolétariat représente et est capable de faire.
A la fin de la journée, nous avons demandé une évaluation spontanée aux participants - ils étaient tous enthousiastes. Un des participants l'a exprimé de la façon suivante : « beaucoup de jeunes n'en sont sans doute pas conscients, mais cela fait des années que j'ai participé à une discussion sur le communisme et cela fait vraiment du bien ! Nulle part ailleurs, on débat encore du communisme. Cela demande une suite ! ». Dans une série de discussions informelles après la réunion, une série de sujets ont déjà été avancés pour une nouvelle réunion. A présent, le moment est venu de recueillir le feedback des participants afin de préparer la réunion suivante, dans le courant de l'été 2008. Vu le succès de la formule, nous voulons la répéter et si possible l'étendre à plus de participants encore. C'est pourquoi nous appelons les camarades qui aimeraient contribuer à prendre contact avec nous. Les introductions et synthèses des débats de la journée de 2007 seront également publiées sur notre site web.
CCI / 16.01.08
La CGT encore en flagrant délit de nationalisme
- 3495 reads
Dans ce tract fumeux protestant contre « la casse de la SNCF 1 », la CGT a réussi le tour de force de ne pas mentionner une seule fois la grève menée par les cheminots l'automne dernier 2. Pas un mot non plus sur les autres secteurs de la classe ouvrière : la « casse » de l'hôpital, des écoles, des administrations, des usines est tout simplement passée sous silence, comme si la SNCF était un cas à part et isolé. D'ailleurs, les termes d'ouvriers ou de travailleurs sont introuvables ! Plus fort encore, pas un seul appel à la lutte ! La CGT préfère parler d'union des « USAGERS - CHEMINOTS » et appeler de ses vœux « le gouvernement [à] créer les conditions d'un large débat public sur le financement du service public SNCF ». Exit les « ouvriers » et « la lutte de classe » donc, place aux « usagers » et au « débat public ».
Pourquoi un discours aussi caricatural ? Pourquoi la CGT ne se couvre-t-elle pas d'un peu du verbiage prolétarien dissimulant d'habitude ses manœuvres ? Pourquoi n'y a-t-il même pas la moindre menace de grève, fusse-t-elle hypothétique et encore plus lointaine ? La raison en est simple. Toute la classe ouvrière subit de plein fouet la crise, tous les secteurs sont touchés. La colère gronde et monte peu à peu. La CGT, comme tous les syndicats, craint qu'un mouvement ne se crée en-dehors de son contrôle et ne fasse tâche d'huile. La CGT joue la "paix sociale" "pas de vague, surtout pas de vagues", pensent aujourd'hui secrètement tous les dirigeants syndicaux.
Et, pour mieux couvrir le grondement de la classe ouvrière, la CGT n'hésite pas à marteler une nouvelle fois "La SNCF appartient à la Nation. La Nation doit pouvoir s'exprimer sur l'avenir de la SNCF !...". Sonnez clairons et trompettes nationalistes !
Depuis des décennies, la CGT applique les slogans nationalistes de son parti de tutelle, le PCF (parti communiste FRANCAIS). Quand en 1945, au nom de la reconstruction, Maurice Thorez (alors secrétaire national du PCF) lance : "Retroussez vos manches pour l'économie nationale", la CGT relaie le message au sein des usines en affirmant que "produire est un devoir". Cela se traduit par la condamnation de chaque grève et la culpabilisation des ouvriers : Benoît Frachon (alors secrétaire général de la CGT 3) appellera ainsi les mineurs du Nord, alors engagés dans une grève dure, à reprendre le travail parce que "Le charbon est le pain de notre industrie". A la fin des années 1970 et tout au long des années 1980, le PCF et la CGT auront pour slogan commun le célèbre "Produisons français 4" ! Au nom de la défense de l'industrie française, les ouvriers seront appelés à défendre "leur" entreprise, quitte parfois à accepter de se "sacrifier" en acceptant les licenciements afin de "sauver l'entreprise" (comme l'avaient demandé en cœur la CGT et le maire PCF de Saint-Etienne lors de la restructuration de la manufacture d'arme Manufrance 5). Surtout, ce slogan puant du "Produisons français" permettra de diviser les ouvriers selon le découpage des frontières nationales, les commandos CGT entraînant par exemple les ouvriers de France à détruire le charbon arrivant d'Espagne.
Ce n'est pas l'intérêt des travailleurs que la CGT défend, mais celui de la nation. Parmi les chiens de garde du capital, la CGT est en tête de meute.
Le nationalisme est un poison !
Les prolétaires n'ont pas de patrie !
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Pawel (25 avril)
1 Le budget 2008 prévoit la suppression de 2000 cheminots s'ajoutant aux 16 000 suppressions des cinq dernières années.
2 Et pour cause, on se souvient tous à quel point la CGT a tout fait pour casser ce mouvement et comment Thibault, le secrétaire général, avait été hué dans les différentes manifestations.
3 Il a aussi été membre du bureau politique du PCF.
4 Ce slogan sera d'ailleurs repris ensuite par Le Pen et son Front National avec un petit plus spécifique : « Produisons français avec des français » !
5 Cette usine finira évidemment par fermer, malgré tous ces « sacrifices ».
Situations territoriales:
La guerre des "chefs" au PS est un problème pour la bourgeoisie, pas pour la classe ouvrière
- 2619 reads
Le Congrès du parti socialiste, qui s’est tenu à Reims à la mi-novembre, vient confirmer la réalité de la crise politique profonde qui affecte ce parti. Alors que la déroute économique plonge avec une violence et une rapidité inouïes des milliers d’ouvriers dans une misère noire, la principale force d’opposition institutionnalisée censée proposer une “ alternative politique ”, en réalité de la poudre aux yeux destinée à endormir la classe ouvrière, est en proie à une guerre digne des règlements de comptes de la mafia.
Les politiciens de gauche, qui se sont toujours vantés de “ débattre pour des projets au service des citoyens ”, viennent d’exhiber au grand jour le spectacle grand’guignolesque de leurs mesquines rivalités et de leurs haineux règlements de comptes. Alors qu’il y a peu de temps, ils stigmatisaient hypocritement avec une feinte indignation le fait que la droite puisse afficher ses rivalités de cliques et étaler sur la place publique ses intérêts particuliers sordides, ils démontrent aujourd’hui que la gauche possède sur le fond les mêmes mœurs de gangsters et les mêmes méthodes de voyous. Les masques tombent lamentablement. Du coup, les médias ne peuvent couvrir ce sinistre spectacle sans pouvoir empêcher de lever un coin du voile sur ce qu’on peut qualifier de véritable panier de crabes. Manœuvres électorales de couloir, fraude des urnes, chantage, crocs en jambes, coups bas, dénigrements, les accusations réciproques de “ tricheries ” et les “ noms d’oiseaux ” vociférés par les différents clans opposés, débouchent sur une intronisation brutale, aux forceps, de la nouvelle secrétaire générale Aubry. Ses tentatives pour faire bonne figure, soit en parlant de “ rassemblement ”, soit en prétendant qu’il existe “ deux lignes politiques ”, n’atténuent en rien l’image d’une guerre intestine au sein d’un PS devenu une véritable “ pétaudière ” ayant perdu toute crédibilité de “ parti responsable ”1. Même le plus abruti des supporters de l’un ou l’autre camp ne peut croire à une “ confrontation des idées ” ! Comme le dit si bien Julien Dray à propos des textes politiques livrés au congrès : on ne “ voit pas d’énormes différences, à moins de vouloir cultiver les virgules et nuances ”. Seules les rivalités de personnes et de clans sont à l’œuvre !
Est-ce, comme tendent à le marteler les médias aux ordres, un simple problème “ d’ego boursouflé ” ? Est-ce, comme ils veulent le faire croire encore, un “ drame ” pour l’ensemble des exploités ?
En réalité, ce chaos dans le parti socialiste, s’il se nourrit bien “ d’un choc d’ego boursouflés ”, trouve surtout ses origines dans sa nature bourgeoise, dans l’impasse, la faillite du système capitaliste, dans les miasmes de sa phase historique de décomposition. Le capitalisme ne peut plus rien offrir d’autre que les fléaux qui s’abattent sur le monde. Et les vernis idéologiques du PS sont usés jusqu’à la trame, incapables de susciter le moindre élan d’adhésion des populations. La réalité dément tous les beaux discours ! Ils ne font pas rêver du tout les “ petites gens ”, selon l’expression de Ségolène Royal. L’état lamentable du PS en France n’est d’ailleurs un cas ni unique, ni isolé. Ses difficultés, sous formes diverses, se rencontrent aussi dans d’autres partis d’opposition et dans d’autres pays, comme on le voit par exemple avec la gauche émiettée en Italie.
De plus en plus, le “ chacun pour soi ” tend à exacerber la concurrence au sein même des différentes fractions et cliques bourgeoises. Le gâteau se rétrécit ; même le sens de l’intérêt de l’Etat, qui était un certain apanage des partis de gauche, et en particulier du PS, et qui faisait sa force, est perdu de vue ! Chacun se lance dans une course éperdue pour défendre bec et ongles sa carrière, mêlant par exemple au PS le siège convoité de premier secrétaire à des ambitions pour les présidentielles de 2012. Chacun voulant sa place réservée au soleil, joue des coudes, fait jouer ses réseaux, soigne sa carrière et avance ses pions. Un Kouchner n’a d’ailleurs jamais trahi les siens en entrant au gouvernement : il est allé “ à la soupe ”, vers ce qu’il a jugé le meilleur “ créneau ” pour sa carrière ! La leçon est claire : les bourgeois n’ont pas de conviction, ils n’ont que des intérêts carriéristes assujettis non seulement à la logique concurrentielle et individualiste du système qu’ils défendent mais aussi à ses mœurs corrompues et cyniques de gangsters.
La classe ouvrière n’a donc rien à déplorer ou à regretter par rapport au délabrement actuel du PS, comme organe de la classe dominante. C’est au contraire la bourgeoisie qui s’inquiète du fait qu’elle se trouve dans une situation plus délicate pour encadrer la classe ouvrière, sans opposition vraiment crédible. La classe ouvrière n’est pas affaiblie par le sort minable de ceux qui sont en réalité ses ennemis. Elle ne doit pas compter sur les politiciens bourgeois, sur les faux amis que sont les partis de gauche qui n’ont fait qu’attaquer ses conditions de vie avant l’arrivée au pouvoir de Sarkozy.
Ce n’est que sur sa conscience et sa force collective, dans les luttes massives et unies, par la solidarité de classe à l’échelle internationale, que le prolétariat devra puiser son énergie, montrer qu’il est la seule véritable force d’avenir pour changer le monde.
WH (17 décembre)
1 On a parlé aussi de “ guerre des deux roses ”, allusion à un terrible conflit meurtrier (à la fin du XVe siècle), opposant les maisons royales rivales d’York et de Lancastre, toutes deux revendiquant l’accession légitime au trône d’Angleterre et ayant quasiment mené à l’autodestruction de l’aristocratie anglaise.
Situations territoriales:
La montée en puissance de l'impérialisme chinois
- 6748 reads
Profitant de la dislocation des anciens blocs impérialistes de l'après-« Guerre froide » et, notamment, de la perte d'influence des États-Unis, la Chine avance de plus en plus ouvertement ses propres pions de grande puissance.
« La montée en puissance de la Chine et la poursuite de ses intérêts sont indissociables du sentiment d'avoir retrouvé une place historique légitime et d'un besoin psychologique profondément enraciné, que le pouvoir en place n'est que trop heureux d'exploiter. Les ambitions chinoises sont attisées par un nationalisme nourri de blessures de l'histoire et de grandeur avortée, un nationalisme étrange et incompris dans un occident par trop complaisant. (...) La Chine s'est fixée des buts contraires aux intérêts américains, à savoir supplanter la suprématie américaine en Asie, empêcher les États-Unis et le Japon d'établir un front d'endiguement à l'encontre de la Chine et, enfin, déployer son armée dans les mers de Chine méridionale et orientale afin d'acquérir la maîtrise des principales voies maritimes de la région. La Chine a des visées hégémoniques. Son objectif principal, c'est qu'aucun État - qu'il s'agisse du Japon exploitant ses droits de prospection pétrolière dans la mer de Chine orientale ou de la Thaïlande autorisant l'accès de ses ports aux navires de la flotte américaine- ne puisse rien entreprendre sans tenir compte au préalable des intérêts chinois. Ce scénario s'inscrit dans une ambition autrement plus vaste : le défi à la suprématie mondiale de l'Occident, des États-Unis au premier chef.
(...) A ce titre, d'alliée stratégique des États-Unis, elle deviendra son adversaire durable. Une comparaison qui n'augure rien de bon s'impose ici. De 1941 à 1945, les États-Unis nouèrent une alliance stratégique avec l'Union soviétique, l'une des pires dictatures de tous les temps, afin de venir à bout de l'Allemagne nazie. A la fin de la guerre, à cause de la rivalité naturelle entre ces deux superpuissances, l'alliance se défit. Les relations amicales qu'entretinrent les États-Unis et la Chine dans les années 1970 et 1980 ne sont pas sans rappeler l'alliance américano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Véritables alliances de contraires, leur nécessité provenait d'une menace immédiate, l'Allemagne nazie dans un cas et l'expansionnisme soviétique dans l'autre. Une fois la menace écartée, les alliances ne résistèrent pas longtemps aux divergences de valeurs et d'intérêts. »1
Bien qu'un peu daté, l'ouvrage dont cette citation est tirée donne un éclairage particulier sur la réalité de la montée inexorable de la puissance chinoise qui revendique et assume clairement ses ambitions impérialistes planétaires. En effet, l'essentiel des éléments avancés par les auteurs en décrivant les perspectives des relations entre la Chine et les États- Unis correspondent largement à ce que nous voyons aujourd'hui. Par exemple, sous le titre « Rivalités militaires en Asie : La Chine affirme ses ambitions navales », un article du Monde diplomatique de septembre 2008, en fait très clairement la démonstration : « (...) Toutefois, Taiwan n'est que l'une des pièces d'un vaste jeu de go maritime. La Chine s'oppose ainsi au Japon à propos des îles Diaoyu (Sankaku en japonais), à proximité de l'île d'Okinawa, qui abrite une base américaine. Tokyo martèle que sa ZEE s'étend à 450 kilomètres à l'ouest de l'Archipel, ce que Pékin conteste en revendiquant l'ensemble du plateau continental prolongeant son propre territoire en mer de Chine orientale. Enjeu annexe du conflit : un gisement qui pourrait abriter jusqu'à 200 milliards de mètres cubes de gaz. La Chine dispute aussi à Taiwan, au Vietnam, aux Philippines, à la Malaisie, à Brunei et à l'Indonésie les îles Spratleys (Nansha en Chinois) et l'archipel des Pratas (Dongsha). Elle s'écharpe avec le Vietnam et Taiwan pour l'archipel des Pracels (Xisha).
(...) Une fois ces verrous ouverts, la Marine Chinoise pourra se consacrer plus librement au deuxième enjeu : la sécurisation des couloirs d'approvisionnement en hydrocarbures en Asie du Sud. Le premier de ceux-ci conduit les pétroliers de moins de 100 000 tonnes, depuis l'Afrique et le Proche-Orient jusqu'à la mer de Chine méridionale via le détroit de Malacca. Des mêmes zones de production, le deuxième couloir mène les pétroliers géants à travers les détroits de la Sonde et de Gaspar. Le troisième, depuis l'Amérique latine, passe par les eaux philippines. Le quatrième, trajet de rechange depuis le Proche-Orient et l'Afrique, serpente entre les détroits indonésiens de Lombok et de Macassar, les Philippines et le Pacifique ouest avant de rallier les ports chinois. »
Quelles ambitions impériales !Manifestement, la Chine ne veut pas être un simple « atelier du monde » capitaliste, mais entend, plus que jamais, appuyer sa croissance économique et son développement pour protéger ses propres intérêts impérialistes partout dans le monde, en se préparant ainsi à affronter toute puissance qui voudrait lui résister, y compris au plan militaire. Dans le même sens, Pékin construit et développe de vastes manœuvres diplomatiques et géostratégiques auprès de nombreux pays pouvant lui servir de ponts. En effet, si l'Inde et le Japon sont historiquement depuis longtemps dans son collimateur, la Chine se sert du Pakistan comme tête de pont, à la fois pour contrer l'alliance entre Washington et New-Delhi et pour accroître son influence dans le golfe arabo-persique et en Asie centrale. Mais, le plus frappant encore, c'est la volonté de Pékin de lutter pour préserver ses approvisionnements énergétiques jusqu'au cœur du Golfe persique et du Moyen-Orient, la zone la plus explosive et la plus convoitée au monde par tous les brigands en chef, à leur tête les États-Unis. Cela veut dire que Pékin n'hésite plus à venir chasser sur le même terrain que Washington considère, depuis des décennies, comme relevant de « son intérêt national ». Cela en dit long sur l'aggravation des risques de confrontations majeures entre la Chine et les États-Unis dans cette zone et ailleurs. Mais d'ores et déjà, la confrontation entre Pékin et Washington est très vigoureuse sur le plan diplomatique, en particulier à l'ONU.
Des
manœuvres navales aux manœuvres diplomatiques
Mieux que quiconque, la Chine sait utiliser la diplomatie pour défendre ses intérêts, en particulier au sein de l'ONU, le bastion suprême des manœuvriers impérialistes. Par exemple, lorsque le Japon manifeste en 2005 son intention de devenir membre permanent du Conseil de sécurité, avec accès au sacré « droit de veto », la Chine décrète aussitôt la mobilisation générale de l'ensemble de son corps diplomatique pour contrer à tout prix l'initiative de Tokyo soutenue par Washington. Ainsi, lors de ce bras de fer, on a vu la Chine se rappeler soudain de sa prétendue appartenance à l'ex- Groupe des 77 dit des « non alignés », en se mettant à « séduire » et « arroser» certains de ces derniers de toutes sortes de promesses et de crédits et, au bout du compte, le gang chinois a pu effectivement barrer la route à son rival japonais (ce qui signifie aussi une claque pour le parrain américain). De même, la Chine joue régulièrement les empêcheurs de tourner en rond en s'appuyant sur son droit de veto pour bloquer systématiquement les initiatives américaines visant, par exemple, à sanctionner Téhéran sur la question nucléaire ou d'autres clients de Pékin (à l'instar du Zimbabwe, de la Corée du Nord, du Myanmar, etc.). En clair, le temps est révolu où les États-Unis pouvaient prétendre faire seuls la pluie et le beau temps à l'ONU et à son Conseil de sécurité. Désormais, Pékin dispute ouvertement ce rôle à Washington. Cette rivalité s'est particulièrement concrétisée au Soudan où Pékin, qui arme le pouvoir soudanais et achète son pétrole, a fermé obstinément les yeux durant des années sur les atrocités que commet le gouvernement de Khartoum au Darfour. Egalement, optant pour la même hypocrisie et le même cynisme que les puissances occidentales agissant au nom des « droits de l'homme », la Chine explique son attitude au nom du respect « de la souveraineté des États (amis) ».
La
Chine fait « un grand bond » en Afrique
Si tout le monde est convaincu que la Chine cherche à étendre son influence sur tous les continents, c'est cependant en Afrique que son offensive est plus massive notamment au plan économique. Mais pour Pékin, il n'y a pas que le domaine économique, il y a aussi le militaire et le géostratégique pour asseoir et préserver ses intérêts impérialistes globaux. En effet, la Chine arme des régimes et vend des armes à de nombreux clients du continent. Dès le début des années 1990/2000, fortement marquées par les massacres en masse et le chaos sanglant dans les principales régions du continent, on savait que Pékin était le fournisseur militaire (souvent masqué) de nombreux pays, notamment dans les Grands Lacs. Ainsi par exemple, les armes chinoises ont servi à commettre les horribles atrocités débouchant sur des millions de victimes en RDC.
En effet, étant devenue pratiquement une grande puissance comme les autres, la Chine brigue désormais le rôle de gangster n°1 en Afrique et, de fait, l'impérialisme chinois est en train de repousser certains de ses concurrents hors de leurs positions traditionnelles. Dans cette optique, il va de soi que la France est pleinement dans le collimateur de la Chine.
La
« Chinafrique » tend à supplanter la « Françafrique »
La Chine a investi dans presque tous les pays du continent africain en mobilisant tous les moyens pour y garder des positions fortes au point d'évincer de fait la France dans un bon nombre de pays appartenant à l'ancien pré-carré de Paris. Comment la Chine s'y prend-elle, avec quelles méthodes ? Prenons un seul exemple qui résume et illustre la force de frappe de la Chine : dans le BTP, les Chinois défient tous leurs concurrents en affichant des prix de 30 à 50 % inférieurs à ceux proposés par les Français. Cela veut dire que certains grands groupes français, comme Bouygues, sont directement menacés par le rapace chinois partout où ils sont implantés ou cherchent à le faire. Du coup, certaines entreprises françaises tentent désespérément de se replier dans d'autres pays africains se situant en dehors de l'ancien bastion colonial de la France (comme l'Afrique du Sud ou l'Angola), où évidemment la concurrence n'est pas moins rude pour autant. De toutes les façons, la Chine utilise grosso modo la même arme des « prix bas » dans tous les autres domaines commerciaux, armement compris. Pour tout dire, la menace chinoise à l'encontre de la France est globale.
L'impérialisme français perd du terrain quasiment partout dans son ancien bastion colonial, aussi bien économiquement que politiquement. D'ailleurs, symboliquement, il est hautement significatif de voir la Chine « draguer » ouvertement la Côte d'Ivoire, ancienne « vitrine », ou « fleuron économique » d'antan de la France en Afrique. En effet, non seulement les grands groupes français sont menacés par l‘offensive chinoise, mais au niveau de l'État, le président ivoirien Gbagbo lui-même est très courtisé par Pékin qui le « protège » à l'ONU contre des sanctions et qui, un moment, a pu lui assurer ses fins de mois afin de payer les salaires des fonctionnaires, chose que Paris ne fait plus. L'autre acte symbolique fort, c'est quand Pékin se met à organiser, lui aussi, ses propres « sommets Chine-Afrique ». Voilà une autre réplique chinoise qui a tout son sens à destination de l'ancienne puissance gaullienne.
Par ailleurs, si la France devait évacuer ses bases militaires en Afrique (son principal atout), comme l'a annoncé le président Sarkozy, la Chine serait, sans aucun doute, très heureuse de l'évincer définitivement du continent.
Les manifestations concrètes de la volonté de la Chine de jouer les premiers rôles dans l'arène impérialiste ne font que débuter et ses principaux rivaux ne manqueront pas une occasion de réagir à la hauteur des enjeux posés par les ambitions chinoises. Autant dire qu'aucun discours de paix et d'entente entre les nations ne pourra suffire à masquer cette réalité, synonyme de désolation et de destructions matérielles et humaines.
Amigos (20 décembre)
1 Bernstein/Munro, Chine- Etats-Unis : danger, Editions Bleu de Chine, 1998
Géographique:
- Chine [29]
La violence des jeunes émeutiers est-elle plus "radicale" que celle des étudiants contre le CPE ? (courrier de lecteur)
- 3451 reads
Le retentissement international des événements survenus en France, les émeutes de fin 2005 et le mouvement anti-CPE du printemps 2006, ont polarisé la réflexion de ceux qui sont à la recherche d'une perspective et des moyens à employer pour en finir avec ce système de misère qu'est le capitalisme. Quels sont les points communs et les différences entre ces deux événements ? Entre les émeutes et les assemblées générales massives, laquelle de ces formes porte la promesse de l'émergence d'une lutte véritablement révolutionnaire ? Quel est le rôle de la violence de classe ? Telles sont les questions essentielles abordées dans l'échange de correspondance entre le CCI et un camarade en Russie à propos d'un article de Révolution Internationale de décembre 2006 (RI n° 374) :« Emeutes des banlieues ou mouvement anti-CPE : quelles méthodes de luttes pour l'avenir ? » 1. Cet échange de correspondance, initialement publié sur notre site en langue russe (https://ru.internationalism.org/ [30]) et traduit ici, montre parfaitement que les mêmes questions essentielles se posent partout à la classe ouvrière et que dans tous les pays est en train de se développer progressivement une réflexion sur « comment lutter ? ». A ces questions de dimensions internationales posées à la classe ouvrière, les minorités doivent répondre par un débat vivant et fraternel animé lui aussi inévitablement à l'échelle internationale.
Le
courrier de notre lecteur
Il est difficile de se faire une image complète des événements qui se sont produits en France quand on vit en Russie et, qui plus est, en province. Dans l'article du CCI contre l'OCL, il est évident qu'il y a deux approches diamétralement opposées concernant ces événements. Mais il y a beaucoup de points communs entre ces deux positions. Ni l'une ni l'autre ne font un effort pour analyser les événements, et si l'OCL tente de diffamer et de traîner dans la boue le mouvement des étudiants, le CCI fait la même chose en ce qui concerne les participants aux émeutes de l'automne 2005.
Pour tout marxiste, il ne peut pas y avoir de prolétariat pauvre, puisque ce sont là les conditions objectives qui le constituent (le prolétariat). C'est pourquoi ni l'un ni l'autre ne se tient sur des positions marxistes, bien que tous les deux se considèrent eux-mêmes comme des communistes. Même Noske2 se considérait lui-même comme l'expression des intérêts de la classe ouvrière, mais ceci ne l'a pas dérangé pour supprimer la révolution.
Le CCI écrit que les participants aux émeutes n'ont aucun rapport avec la classe ouvrière. Vous vous trompez, Messieurs ; ceci est la plus authentique lutte de classe. La bourgeoisie dénigre par tous les moyens ce mouvement des ouvriers de banlieue, pour présenter ceux qui y ont participé comme des bandits et des criminels. Et même le CCI rejoint cette analyse, en se faisant ainsi le défenseur des intérêts de la bourgeoisie.
En réalité, c'était un soulèvement d'ouvriers, provoqué par le chômage, la pauvreté et l'arbitraire des autorités, par les conditions dans lesquelles se trouvent les ouvriers. Et si quelqu'un est coupable de ces événements, ce sont les autorités elles-mêmes. Ceci est la conséquence de l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Est-ce que ceci indique que je défends le point de vue de l'OCL ? Naturellement non !
La première différence évidente est que le mouvement des étudiants a été plus ou moins organisé contrairement aux émeutes, qui se sont produites spontanément et confusément. Le CCI, comme la bourgeoisie, essaie de dénigrer le mouvement dans les banlieues au lieu de poser la question : de quel terreau social ce mouvement est-il le produit et pourquoi a-t-il eu un caractère si spontané ? Pourquoi cette lutte de classe a-t-elle pris, pour dire honnêtement la vérité, des formes négatives ? Peut-être parce qu'elle n'a pas été organisée ?
Ce n'est pas de leur faute si les ouvriers ne sont pas organisés, mais c'est bien leur malheur. Et, ici, je veux demander où étaient les organisations communistes quand la crise s'est produite ? Pourquoi le travail envers les banlieues ouvrières n'a-t-il pas été conduit pour organiser leur combat ? Et disons-le franchement, dans les événements passés, il y a une part de responsabilité des organisations communistes qui se sont avérées incapables de coordonner les actions de la classe ouvrière, et ceci a fini dans un grand fiasco. Si le visage reflété dans le miroir ne vous plaît pas, n'en rendez pas le miroir responsable.
Dans l'article, l'importante question de la violence révolutionnaire est soulevée. Le CCI écrit que « l'Etat a multiplié les provocations lors du mouvement anti-CPE, espérant entraîner à leur tour les étudiants dans l'impasse de la violence des émeutes ». Dans la mesure où je sais que le CCI veut établir le socialisme, mais qu'il est contre la violence, la construction du socialisme selon une voie pacifique est un programme social-démocrate. Comme chacun sait, l'ensemble de la social-démocratie occidentale a condamné Lénine en octobre 1917 pour avoir engagé la classe ouvrière en Russie dans l'impasse de la violence stupide !
Mais en même temps, la tactique de l'aventurisme de gauche ne convient pas pour le prolétariat. Il est connu qu'en juillet 1917, Lénine tint sous contrôle des aventuriers du même type que l'OCL, qui tentaient de donner un caractère plus radical au mouvement de la classe ouvrière. Certainement pas parce qu'il avait peur de la violence comme le CCI, mais parce qu'il voulait préserver les forces de la classe ouvrière pour l'offensive décisive.
De l'ensemble des choses dites ci-dessus, il est évident que le CCI s'embourbe dans le marais de l'opportunisme et de la social-démocratie. Ce n'est pas un problème de la classe ouvrière mais du CCI lui-même. (6 avril 2007)
Notre réponse
Cher camarade,
Nous voulons saluer ta volonté de prendre position sur des questions aussi cruciales que celles des émeutes en France en novembre 2005, et plus encore sur le mouvement anti-CPE des jeunes prolétaires au printemps 2006 et sa signification, ainsi que sur les questions que posent ces mouvements, notamment celle de la violence.
Engager la réflexion sur ce que représente et annonce le mouvement contre le CPE est de la plus haute importance pour l'avenir de la lutte des classes.
Les émeutes de 2005 et le mouvement des étudiants du printemps 2006 ont tous les deux les mêmes racines, l'impasse de la société capitaliste, sa crise économique, qui provoque l'inexorable dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière, et qui n'offre comme perspective que la précarité et l'accroissement de la misère, la marginalisation pour une partie sans cesse plus grande des prolétaires condamnés à subir le fléau du chômage. Dans les deux cas, ces mouvements ont impliqué des jeunes prolétaires, révoltés par les conditions qu'on leur impose et que la bourgeoisie leur promet encore d'aggraver.
Mais au-delà de ces points de convergence, de profondes différences distinguent les deux mouvements.t.
Les émeutes ont impliqué une minorité infime des jeunes des quartiers populaires des banlieues ; elles ont représenté une explosion de colère aveugle, sans perspective. Dans leur rage désespérée, ils ne s'en sont pas pris aux symboles de leur oppression (les postes de police, les édifices officiels de l'Etat capitaliste, etc...) mais aux voitures de leurs voisins, aux équipements sociaux de leur quartier... De tels mouvements de violence, le recours à l'émeute, ont déjà existé dans le passé, mais ils ont toujours été la manifestation d'un prolétariat encore peu conscient du but final de son mouvement et de ce qui fait sa force réelle. Au-delà d'affirmer sa solidarité avec eux, le CCI pouvait-il encourager les jeunes émeutiers à continuer à s'engager dans ce genre d'action ?
A l'inverse, le mouvement des étudiants, dans leur grande majorité jeunes prolétaires encore en formation, au printemps 2006, a constitué l'émergence d'une perspective produite par la classe ouvrière. Il a été un grand mouvement de masse rassemblant autour de lui des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers. Il s'est clairement déroulé en réaction aux attaques économiques de la bourgeoisie. Il s'est doté d'assemblées générales massives, forme d'organisation spécifique du prolétariat.. Il s'est caractérisé par la forte volonté d'étendre cette lutte au reste de la classe ouvrière pour la faire entrer en action à ses cotés. Justement, alors que la police française manipulait les jeunes des banlieues en les poussant à s'affronter aux manifestants étudiants, présentés comme des « nantis », des « bourgeois », ceux-ci ont envoyé de larges délégations dans les quartiers ouvriers et se sont adressés aux jeunes des banlieues pour leur expliquer que cette lutte était aussi la leur, pour les intégrer à la lutte, ce qu'ils ont fait finalement, en se rendant massivement aux manifestations suivantes.
Contrairement à ce que tu sembles affirmer, le CCI ne condamne pas en soi l'usage de la violence. Le mouvement ouvrier devra savoir l'employer pour le renversement de l'Etat capitaliste. Mais le prolétariat ne peut pas utiliser n'importe quel type de violence, ni l'employer n'importe comment ou dans n'importe quelles conditions. Notamment, l'emploi de la violence doit être au service du renforcement du mouvement ; elle doit exprimer la force collective du prolétariat et être utilisée de façon consciente, appropriée à son but final qui est de construire une société vraiment humaine3.
Tu sembles par ailleurs penser que le refus des affrontements avec la police constituait à ce moment-là une erreur, un manque de radicalité du mouvement. Mais de quoi s'agissait-il en réalité ?
Il est important de rappeler que les étudiants ont en réalité refusé de tomber dans le panneau d'un véritable traquenard de la bourgeoisie et de l'Etat, associant ses organes que sont les forces de police et les syndicats, consistant à pousser aux affrontements avec les forces de police. L'objectif était de diviser le mouvement, de le discréditer aux yeux du reste de la classe ouvrière et, en focalisant son attention sur l'usage de la violence stérile contre les flics, de le détourner de l'objectif de consacrer le maximum de ses forces à contribuer à élargir le mouvement. Ce faisant, la bourgeoisie cherchait clairement la débandade et le défaite précipitée du mouvement.
Dans ces conditions, les étudiants n'ont-ils pas eu raison de refuser ce piège tendu par l'ensemble des forces bourgeoises, de ne pas compromettre et préserver toutes les potentialités que recelait le mouvement pour gagner à lui d'autres catégories d'ouvriers ?
Bien fraternellement.
Cette lettre envoyée au camarade en réponse à son courrier, conçue comme un moment de cet échange épistolaire, était volontairement concise et ne traitait donc pas de l'ensemble des questions soulevées. En particulier, un aspect important fut momentanément laissé de côté, celui du rôle des organisations révolutionnaires dans la lutte. Le camarade nous écrit en effet « La première différence évidente est que le mouvement des étudiants a été plus ou moins organisé, contrairement aux émeutes, qui se sont produites spontanément et confusément. [...] Pourquoi cette lutte de classe a-t-elle pris, pour dire honnêtement la vérité, des formes négatives ? Peut-être parce qu'elle n'a pas été organisée ? Ce n'est pas de leur faute si les ouvriers ne sont pas organisés, mais c'est bien leur malheur. Et, ici, je veux demander où étaient les organisations communistes quand la crise s'est produite ? Pourquoi le travail envers les banlieues ouvrières n'a-t-il pas été conduit pour organiser leur combat ? ».
Notre lecteur semble donc penser que si les émeutiers en 2005 avaient été "organisés" comme les étudiants en 2006, ils auraient pu être le détonateur des luttes ouvrières. Ce faisant, il reproche au CCI de n'avoir pas rempli son rôle d'"organisateur" de la lutte.
La première chose que l'on doit dire c'est que ce n'est pas le CCI qui a organisé le mouvement des étudiants en 2006. Aucune organisation politique (même celles qui ont les moyens les plus puissants) ne peut mobiliser les masses. Nous savons pertinemment que les minorités révolutionnaires n'ont pas le pouvoir de déclencher les luttes du prolétariat avec une baguette magique. C'est la "vieille taupe de l'histoire" qui a fait ce travail de maturation souterraine de la conscience et a permis que ressurgissent dans les jeunes générations les vieilles méthodes de lutte du prolétariat : les assemblées générales souveraines, les comités de grève, les délégations mandatées et révocables, etc. En 2006, nos militants sont intervenus dans certaines AG, de façon très ponctuelle et en fonction des forces dont nous disposions. Si nos interventions ont été applaudies avec enthousiasme, ce n'est pas parce que nous étions nombreux, mais tout simplement parce que les orientations que le CCI a toujours mises en avant (et qui sont très minoritaires dans la société) coïncidaient avec les besoins ressentis par la grande majorité des étudiants en lutte.
Quant aux adolescents qui se sont laissé embarqués dans la révolte désespérée des émeutes en 2005, il était bien difficile de leur donner une orientation puisqu'ils ne faisaient pas d'assemblées générales et ne faisaient aucun débat politique. Les "actions" minoritaires et violentes des émeutiers n'ont évidemment pas été discutées et votées à la majorité. Et il eut été totalement stérile d'aller au milieu des affrontements entre eux et les forces de répression pour leur dire qu'en brûlant les voitures, les bus, les écoles, ils ne s'en prenaient pas à la bourgeoisie mais aux ouvriers.
La seule chose que les révolutionnaires pouvaient faire, c'est d'abord essayer de comprendre ces événements pour mettre en avant que la seule réponse au désespoir des émeutiers, la seule riposte au renforcement de la répression de l'État capitaliste, se trouve dans la lutte du prolétariat pour le renversement du capitalisme. Ce n'est pas en s'adressant aux émeutiers pendant les échauffourées que le CCI pouvait exprimer sa solidarité envers cette jeunesse désœuvrée mais en s'adressant à toute la classe ouvrière pour œuvrer au développement de sa conscience en mettant en avant les moyens dont se dote le prolétariat pour réaliser son projet révolutionnaire : les grèves, les manifestations, les assemblées générales massives dans lesquelles la passion du débat est fondamentale... C'est bien là qu'est la véritable solidarité envers toute la classe ouvrière, jeunesse des banlieues comprise, car tant que le prolétariat n'aura pas la force d'engager des luttes massives sur son propre terrain de classe et fait surgir ses formes d'organisation unitaire, tant qu'il sera prisonnier des manœuvres syndicales et du syndicalisme, tant qu'il n'aura pas développé sa conscience,... des émeutes sporadiques de plus en plus violentes seront contenues dans la situation historique actuelle (comme on l'a vu en France deux ans après celles de 2005, à Villiers-Le-Bel en novembre 20074).
Nous ne pouvons pas répondre, dans le cadre de cet article, à tous les arguments de notre lecteur. Nous espérons avoir répondu à ses principales critiques. Bien évidemment, nous restons ouverts à d'autres critiques, d'autres arguments, et sommes tout à fait disposés à y répondre publiquement dans notre presse.
Leïla, le 9 mars 2008
1 Cet article fut publié en réponse à l'Organisation Communiste Libertaire (OCL) suite à l'apparition dans son mensuel Courant Alternatif de l'été 2006 d'un long dossier intitulé : "Les émeutes de banlieues au regard du mouvement anti-CPE".
2 Noske, social-démocrate membre du SPD et de la IIe Internationale, fut à la tête de la répression d'une extrême brutalité qui écrasa les masses ouvrières lors de la révolution allemande en 1919-1920 et fit assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, en proclamant : « Il faut un chien sanglant,, je ne recule pas devant cette responsabilité » (NDLR).
3 Voir notre article sur notre site Web (internatiopnalism.org) « Terreur, terrorisme et violence de class ».
4 Lire notre article sur notre site Web (internationalism.org) : « Emeutes à Villiers-le-Bel : face à la violence économique et policière du capital, seule la lutte ouvrière est porteuse d'avenir ».
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Banlieues [32]
- Mouvement étudiant [33]
Le plan de lutte contre la cybercriminalité, un prétexte pour renforcer l'État policier
- 2925 reads
-
Passage de 8 policiers et gendarmes affectés à l'Office central contre la cybercriminalité à une cinquantaine et création de 150 "cyberenquêteurs" régionaux à la police judiciaire (PJ).
-
Surveillance accrue des fournisseurs d'accès à internet qui devront fournir les données d'accès des "connexions suspectes" avec le blocage des sites "à caractère douteux".
-
Mise en place de systèmes de mouchards (équivalents des écoutes téléphoniques pour le net) dans le cadre d'enquête pour "délinquance aggravée" avec captage à distance des données d'un ordinateur.
-
Et enfin, ouverture d'un cybercommissariat recevant des plaintes comme la délation de particuliers.
La police, la surveillance et la répression deviennent des éléments permanents de notre quotidien. Contre la menace terroriste, davantage de flics. Contre l'insécurité routière, davantage de flics. Contre la cybercriminalité, davantage de flics. La prochaine Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (Lopsi2) doit prolonger pour quatre ans encore les mesures «d'exception» prises suite à l'attentat de Londres en 2005 : les soldats, mitraillettes en bandoulière vont rester encore longtemps sur les quais de gare et de métro, et les caméras de surveillance vont continuer de fleurir un peu partout, à chaque coin de rue.
Toutes ces mesures n'ont qu'un seul véritable but : faire en sorte que la "population", c'est-à-dire la classe ouvrière, s'habitue peu à peu au quadrillage par l'Etat français. La classe ouvrière doit se savoir «protégée» mais aussi, et surtout, surveillé en permanence. Il y a ici une dimension de menace latente, une volonté d'impressionner la classe ouvrière pour l'inhiber. "Faites attention, on vous surveille". Le Figaro, en date du 4 juillet, nous donne par exemple un aperçu de l'utilisation possible de la vidéosurveillance : "Lors du mouvement contre le CPE, la police a (...) expérimenté le renvoi des images par satellite considéré comme une solution d'avenir. "
Si cette pression peut être perçue plus intensément par les ouvriers qui commencent à réfléchir sur ce monde et à vouloir lutter, tant mieux, se dit la classe dominante. C'est pourquoi MAM n'a hésité à rappeler, lors de la présentation de son plan de lutte contre la cybercriminalité, les groupes comme "Action directe, la Fraction Armée Rouge ou les Brigades rouges" et leurs liens avec les "partis politiques extrêmes", autant de menaces terroristes à venir. L'assimilation de ces dérives gauchistes et activistes au mouvement ouvrier est du pain béni pour l'Etat policier. Face à la montée actuelle des luttes ouvrières à travers le monde, la bourgeoisie s'empresse de parler de "résurgence violente de l'extrême gauche radicale". Ce n'est pas par hasard si un groupe de jeunes «d'extrême gauche», se définissant eux-mêmes comme "anarcho-autonomes", a récemment fait les frais d'une interpellation de la cybersurveillance policière pour "visées terroristes". Lesquelles ? On n'en sait rien. Mais Michèle Alliot-Marie rappelle elle-même "les risques d'une résurgence violente de l'extrême gauche radicale". En réalité, dans un contexte où les luttes ouvrières sont appelées à se développer de plus en plus massivement, il s'agit de pointer du doigt et d'avertir que tout discours anti-étatique ou anti-bourgeois sera considéré comme "terroriste".
Il ne faut pas se leurrer, l'Etat français et sa police n'ont pas attendu ce plan d'action pour surveiller et infiltrer ordinateurs et correspondances internet de façon ciblée. Mais "Big Mother" permet à la répression de faire encore un pas en avant dans le flicage de la population.
Mulan (19 février)
Géographique:
- France [34]
Mobilisation massive contre la réforme de l'enseignement en Italie : "nous ne voulons pas payer pour leur crise !"
- 2544 reads
- « Nous ne voulons pas payer pour leur crise ! » est le slogan qui a été adopté par le mouvement des étudiants dans toutes les villes italiennes.
Les attaques de la bourgeoisie
Le monde de l'école et des universités est retourné massivement dans la rue en Italie le 14 novembre, après les gigantesques manifestations du 25 octobre rassemblant des centaines de milliers de personnes en opposition au décret Gelmini et quarante ans après les formidables mouvements qui ont ébranlé le monde entier à partir de mai 1968 en France - et des luttes de 1969 en Italie. Au niveau de l'enseignement, le décret Gelmini est surtout contesté à cause des coupes budgétaires qu'il impose dans l'Education nationale et des conséquences de ces restrictions sur la baisse de qualité de l'enseignement. De fait, la nécessité de faire des économies sur les dépenses scolaires implique en général :
-
la réduction du temps passé dans les crèches et les écoles primaires ;
-
la réduction drastique de personnel (touchant à la fois les postes enseignants, administratifs et techniques), le non-renouvellement des contrats et la réduction des horaires de travail : 87 000 enseignants précaires et 45 000 travailleurs de l'ABA (équivalent des ATOS en France) ne seront plus réembauchés ;
-
l'augmentation du nombre d'élèves par classe ainsi qu'une disparition des enseignements techniques et de la deuxième langue étrangère dans les écoles secondaires ;
-
la réduction des horaires dans les lycées techniques et autres établissements de formation professionnelle.
Au niveau universitaire, à côté de toutes les fariboles que raconte le gouvernement pour détourner l'attention des questions de fond, il faudrait subir :
-
des réductions des fonds de financement de l'université dans le budget de l'Etat. Ces coupes s'élèvent à plus de 500 millions d'Euros dans le prochain plan triennal ;
-
une réduction du renouvellement du personnel universitaire pour les années 2010 et 2011 - qui se traduit par une économie de 20% des dépenses relatives au personnel partant en retraite (une seule embauche pour 5 départs à la retraite) ;
-
des mesures préparatoires à la transformation de l'université publique en Fondations alimentés par des fonds privés.
Ce sont les éléments essentiels de la manœuvre du gouvernement qui suffisent à démolir tout l'édifice de l'instruction publique en Italie ; car il ne s'agit pas tant de lois qui se limitent, comme par le passé, à restructurer ce secteur, mais qui font purement et simplement disparaître une partie de ces structures en réduisant à néant le personnel et les ressources. C'est justement contre cela que s'insurgent aussi bien les personnels qui y travaillent (surtout les jeunes travailleurs précarisés) que l'ensemble des étudiants qui voient justement dans la réforme Gelmini et dans toute la manœuvre financière du gouvernement Berlusconi une attaque contre leur avenir. De fait, avec la baisse de qualification qui s'en suivra dans le monde de l'éducation, il ne pourra y avoir d'avenir que pour ceux qui auront les moyens de se l'acheter en allant dans les écoles et les universités privées. Par exemple, la transformation possible des universités en fondations, au-delà de la querelle sur le choix entre le privé et le public, « constitue un signal sans équivoque du désengagement progressif de l'Etat dans son rôle de financement du système universitaire public qui est la garantie de la possibilité pour tous d'accéder aux niveaux de formation les plus élevés »2.
Ce sentiment d'absence d'avenir est d'autant plus présent dans le mouvement actuel des étudiants et des précaires qu'il se déroule sur toile de fond d'une crise économique qui se manifeste dans cette période avec des aspects inédits et tout à fait préoccupants.
De ce point de vue, il faut reconnaître que ce mouvement des étudiants et des précaires tire sa plus grande force de la reconnaissance que l'attaque actuelle du gouvernement est due à la crise économique qui frappe actuellement l'Italie et le monde entier. En ce sens, le mouvement actuel en Italie se situe dans la continuité du mouvement des étudiants français qui se sont mobilisés en 2006 contre la loi qui voulait introduire le CPE (contrat première embauche) qui, si elle avait été approuvée, aurait permis d'imposer aux jeunes des conditions de travail bien pires que les conditions actuelles. Ce n'est pas par hasard si le mot d'ordre qui unifie tout le mouvement des étudiants et des précaires aujourd'hui en Italie est : « Nous ne voulons pas payer pour la crise ! », expression de la volonté d'aller de l'avant sans se faire berner par tous les discours trompeurs du style : « Il faut donner un coup de main à la nation dans ces moments difficiles » ou : « Il faut que chacun contribue à aider l'Etat en acceptant les sacrifices », etc.
Cette volonté de se battre globalement pour un avenir meilleur se traduit aussi dans d'autres aspects. Par exemple, dans le fait que, contrairement à d'autres luttes par le passé, en particulier, celles de 1968, il n'y a pas d'antagonisme ni de conflit de générations entre étudiants et enseignants, mais plutôt une tendance à lutter tous ensemble.
Les pièges tendus au mouvement
Cependant, le mouvement qui s'est exprimé dans la rue présente une série de faiblesses que la bourgeoisie utilise consciemment pour le faire échouer. Un des problèmes est un certain flou dans les buts et les perspectives que s'est donnée cette mobilisation. Alors que la maturité qu'a montrée le mouvement des étudiants en France avait été favorisée par l'attaque frontale portée par le gouvernement, en Italie, le caractère plus indirect et sectoriel de l'attaque a été un obstacle à une prise de conscience plus prononcée. C'est vrai, comme on l'a dit plus haut, qu'un élément qui favorise le mouvement est la crise dans laquelle s'enfonce l'économie nationale et mondiale. Mais quelle lecture fait-on de cette crise aujourd'hui ? Une crise financière due à des spéculateurs sans scrupule ? Une crise liée à une consommation excessive ou à une population mondiale en excès ? Une crise liée à l'invasion du marché mondial par la Chine ? Ou n'est ce pas plutôt une crise insoluble du système dans lequel nous vivons ?
Il est clair que selon l'interprétation qu'on en a, on peut alimenter l'illusion que les gouvernements du monde passent aux mains des Obama, Veltroni, des partis de gauche en général qu'on nous présente comme « le bon camp » pour gérer le capitalisme et la société, comme des gouvernants justes et équitables. Sur cette question, il y a toute une propagande médiatique sur les infamies de la loi Gelmini, « ministre suppôt du détestable Berlusconi », « responsable de vouloir détruire l'école publique » et de « vouloir la remettre dans les mains du privé ». Il ne fait aucun doute que les mesures du gouvernement Berlusconi sont draconiennes et que l'école et l'université sont durement frappées. Mais il faut sortir de la logique selon laquelle le gouvernement de droite aurait fait cela pour affaiblir un secteur politiquement contestataire, dangereux et camoufler la transformation de l'école publique en école du régime, alors qu'au contraire un gouvernement de gauche n'aurait jamais touché ce secteur1.
A part l'illusion que sème ce discours sur le fait qu'il pourrait réellement exister au sein de cette société un enseignement impartial, apolitique, avec une culture indépendante de la transmission des valeurs de l'idéologie dominante, la réalité est que quel que soit le parti au gouvernement, il ne peut que venir au secours de l'économie capitaliste en crise et ne peut que porter des attaques féroces contre la population exploitée. Il est vrai que le gouvernement Berlusconi, avec sa grossièreté, a eu la main lourde, mais il ne faut pas se laisser bercer par l'illusion de croire que tout cela ne serait qu'une basse manœuvre politique et ne correspondrait pas à une nécessité absolue pour l'Etat bourgeois d'obliger les prolétaires à se serrer la ceinture.2
Mais les pièges ne s ‘arrêtent pas là ! Parce que la dynamique de lutte qui se développe dans le mouvement des écoles et de l'université commence justement à inquiéter la bourgeoisie, celle-ci a commencé à développer d'autres moyens de défense. D'abord, Berlusconi a commencé à parler de la nécessité d'empêcher les étudiants d'occuper les établissements scolaires et les universités, disant qu'il aurait donné des instructions précises au ministre de l'intérieur pour le faire.
Ainsi, le 29 octobre sur la place Navona, où un groupe de militants de droite néo-fasciste a provoqué un affrontement avec les étudiants qui participaient à la manifestation. Derrière cela, il y a la marque provocatrice de l'Etat qui tente de faire resurgir un climat de confrontation sur le terrain fascisme-antifascisme et de faire renaître la même terreur que dans les années 1980 à travers une série d'infiltrations et de provocations policières Avant et après l'épisode de la place Navona, on ne compte plus les épisodes de provocations faites par des bandes de néo-fascistes qui essaient de déplacer la confrontation sur le plan physique, de façon à ce qu'on puisse ensuite retomber au niveau de la défense de simples revendications démocratiques et de respect de la légalité et de l'ordre, tout à fait dans la logique manipulatrice préconisée par l'ancien président Cossiga (voir son interview dans l'article «Sabotage des lignes SNCF : des actes stériles instrumentalisés par la bourgeoisie contre la classe ouvrière » sur notre site www.internationalism.org.fr [35]).
Heureusement, le mouvement a réagi sainement face à ce piège, et cela en de nombreuses occasions ; en témoignent aussi les différentes vidéos qui sont apparues récemment et publiées sur les blogs ; les participants au mouvement ont pris conscience du danger de se laisser entraîner dans ce faux affrontement avec les fascistes et qu'il fallait rester fermement enraciné dans la lutte sur le fond que développe le mouvement.
Les perspectives du mouvement
Le mouvement, qui reste actif et vivant, même après l'approbation définitive au Sénat de la loi qui avait été l'élément déclencheur de sa lutte, fait preuve d'une volonté de lutter qui n'est pas éphémère mais est l'expression d'une profonde souffrance provoquée par une misère sociale grandissante.
Même si pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de prévoir ce que sera l'issue de ce mouvement, nous pensons que des mouvements de ce genre ont un rôle important parce que la situation économique, politique et sociale en est arrivée à un seuil intolérable de dégradation des conditions de vie.
Si le mouvement actuel n'a pas atteint la maturité du mouvement français contre le CPE puisque n'ont pas émergé des assemblées générales massives avec des délégués élus et révocables à tout moment en leur sein, s'il n'y a pas une conscience claire de la nécessité de se relier aux autres secteurs en lutte, ce mouvement a cependant exprimé :
-
une nette indépendance vis-à-vis des partis et syndicats, tout en ne tombant pas dans l'illusion mensongère de l'apolitisme ;
-
une préoccupation explicite de faire comprendre à l'ensemble des prolétaires le sens de la lutte qui s'exprime non seulement à travers des manifestations, des slogans ou des pancartes, mais aussi à travers les « leçons dans la rue » faites par des enseignants avec la participation de nombreux groupes d'étudiants, les « nuits blanches » et autres.
Tout cela n'est qu'un début. La partie n'est pas finie. Les manifestations qui ont eu lieu le jour où le décret Gelmini a été approuvé (29 octobre) dans toute l'Italie, la grève de l'école qui a eu lieu le 30 octobre avec un million de manifestants et toute l'élaboration et le pullulement d'initiatives qui se sont développées au niveau de l'école et de l'université, ont été des expressions d'une vitalité essentielle au niveau de la lutte et des initiatives, qui a permis de prendre conscience de la nécessité de mettre en avant des revendications unitaires et d'en appeler aux autres secteurs sociaux à rentrer en lutte.
Ezechiele (4 novembre 2008)
1En réalité, le premier plan de rationalisation du système scolaire a été fait par feu le gouvernement de centre gauche Prodi avec des réductions du nombre de classes et donc d'enseignants et de personnel ATOS.
2 Sur ce plan, une autre mystification politique est à l'œuvre qui tend à focaliser toute l'attaque sur les restrictions budgétaires dans le secteur de la recherche et à se lamenter parce que « nos cerveaux » sont obligés de s'expatrier, comme on l'a vu dans l'émission « Année Zéro » de Michele Santoro, finissant ainsi par réduire la perspective d'un mouvement qui concerne toute la jeune génération actuelle en une attaque qui ne concernerait qu'un secteur particulier et un nombre très limité de personnes.
Géographique:
- Chine [29]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [36]
Mouvement de lutte à la Sécurité Sociale, à Marseille
- 2928 reads
En novembre 2007, nous avions publié un courrier de lecteur signé Sébastien, décrivant de « l'intérieur » la montée de la colère dans les différents services de la Sécurité Sociale de Marseille, sous le titre « Un témoignage de la combativité ouvrière face à l'aggravation des conditions de travail »[1].
Aujourd'hui, seulement quelques mois après ces premières manifestations de mécontentement, les conditions de travail n'ayant fait qu'empirer, la colère éclate à nouveau. Mais à travers ce second courrier de notre camarade Sébastien, nous pouvons voir qu'un véritable processus de réflexion s'est effectué durant ce laps de temps : sur les syndicats, sur la nécessité de se battre de façon unie et solidaire, sur la façon de mener la lutte pour ne pas rester isolé mais au contraire pour parvenir à l'étendre à d'autres services... Toutes ces questions ont commencé à trouver des débuts de réponses, collectivement, dans ce dernier mouvement.
Courrier du lecteur: Une expérience de lutte riche d'enseignements
Dans de nombreux secteurs du service public, le laminage des effectifs a atteint un tel niveau qu'il est souvent impossible aujourd'hui de faire face à la quantité de tâches à effectuer, entraînant une dégradation accélérée des conditions de travail. Le mécontentement que génère une telle situation pousse les travailleurs à réagir.
Dans un grand centre de la Sécurité Sociale, à Marseille, la colère des employés s'est transformée en un mouvement de lutte qui a duré plus d'un mois. Déjà, à la fin de l'été 2007, ces mêmes employés avaient réagi pour les mêmes raisons, la direction ayant à l'époque fait mine de reculer. Aujourd'hui, après des départs à la retraite et autre mutations non remplacés, les effectifs fondent à nouveau à vue d'œil. L'exaspération gagne de plus en plus de services. Un nombre croissant de travailleurs veulent aujourd'hui se battre pour revendiquer plus d'effectifs. Et il ne s'agit plus de mener des actions chacun dans son coin, mais de s'unir, de chercher la solidarité des autres services, de chercher également la solidarité la plus large auprès des « usagers » en les considérant en tant que travailleurs qui viennent régler leurs problèmes de remboursement des frais médicaux, eux aussi confrontés à des problèmes identiques de dégradation accélérée des conditions de travail. Sans demander l'intervention des syndicats qui aurait eu comme effet de les diviser et de les démobiliser, les employés se sont organisés en assemblées générales pour discuter des actions à mener, assemblées qui parfois réunissaient des employés d'autres branches de la Sécurité Sociale confrontés aux mêmes problèmes.
Le déroulement du mouvement
Dès mi-avril, les employés du service prestation envoient une lettre à la direction demandant, pour faire face à l'accumulation de dossiers en retard, une augmentation des effectifs. Suite à une réponse insatisfaisante, les employés décident d'une deuxième lettre fin avril précisant exactement les besoins du service, la direction répond encore par la négative. L'entrée dans le mouvement, mi-mai, du service accueil - confronté à un afflux d'assurés mécontents - en solidarité avec le service prestation, fait sortir la direction de ses bureaux qui envoie ses sbires pour réunir séparément les employés des deux services en leur promettant de prendre des mesures pour diminuer le retard. En fait, elle misait sur le pourrissement du mouvement. Mauvais calcul. Fin mai, des incidents éclatent dans la file d'attente des assurés, les employés arrêtent le travail, se réunissent en assemblée générale et décident l'unité d'action des deux services. La direction réagit en décrétant qu'en dehors des syndicats, toute action est illégale. Les employés décident alors l'envoi d'une délégation pour consulter les syndicats. Pour FO, il ne faut pas déranger la direction qui est en train de réorganiser le travail ! Pour la CGT, par contre, il faut faire grève de suite. Un débat s'enclenche : faire grève d'accord mais pas de suite, il faut tout d'abord construire un rapport de force. Pour éviter des sanctions de la direction, les employés décident de tenir une assemblée générale des deux services pendant les heures de repas. Début juin, les employés réunis décident le dépôt d'un préavis de grève avec envoi d'une lettre commune pour réitérer les revendications sur l'augmentation des effectifs. Quelques jours après, une délégation des employés rencontre la direction qui annonce des premières mesures : mise en place d'heures supplémentaires, aide « inter centre », report des jours RTT. Quant aux effectifs, le résultat est maigre, en deçà de ce qui a été demandé. Les employés rejettent ces propositions comme ne répondant pas au problème de fond. Le préavis de grève est maintenu. Pour l'assemblée générale, la journée de grève doit être conçue comme une journée de mobilisation envers les autres services pour les entraîner dans le mouvement, envers les assurés pour les appeler à la solidarité. La décision de tirer un premier bilan pour tous les employés et services de la Sécurité Sociale est votée. Mais la question de demander ou pas l'aide des syndicats a été l'objet d'un débat. Pour un certain nombre d'employés, il est possible de se servir des syndicats dans les négociations (avec à leurs cotés, une délégation des employés en lutte) et dans la diffusion des informations, sans perdre la maîtrise du mouvement. Pour d'autres, majoritaires, des expériences récentes ou plus anciennes ont démontré concrètement comment ces organismes faisaient tout pour déposséder les travailleurs de leur lutte en ne diffusant pas les informations et en négociant souvent dans le dos des travailleurs. La décision a été prise de ne pas faire appel aux organisations syndicales. C'était l'expression d'une méfiance envers les syndicats s'appuyant sur l'expérience mais pas encore d'une compréhension de ce qu'ils sont, c'est-à-dire, à mon avis, une force d'encadrement des travailleurs pour saboter tout mouvement de lutte.
Comment syndicats et direction vont agir main dans la main pour saboter le mouvement
Cette grande combativité était donc étayée par une véritable réflexion sur « comment mener la lutte collectivement ». Pourtant, tout ce mouvement de lutte n'a finalement pas abouti, la grève n'a finalement pas éclaté. Pourquoi ?
En proposant ces mesures, la direction savait très bien qu'elle agissait dans le sens de la division du mouvement et de l'affaiblissement de la combativité, notamment chez de jeunes employés qui voyaient dans ces heures supplémentaires un moyen d'augmenter leur faible salaire. La direction savait aussi que l'approche des congés d'été allait être un facteur de démobilisation. Mais, en définitive, ce qui a été le plus démobilisateur fut l'action des syndicats et en particulier la CGT. Pour ce qui est de FO, la situation est claire, c'est carrément un syndicat aux ordres de la direction qui a fait ouvertement pression pour que le mouvement cesse. Plus subtil a été le jeu de la CGT : appeler à faire grève quand le mouvement n'était pas mûr début juin, puis proposer d'aller rencontrer la direction qui se trouve de l'autre coté de la ville alors que la force du mouvement a permis que ce soit la direction qui se déplace pour rencontrer les employés en lutte. Et, cerise sur le gâteau, dans le but de diviser les employés, la CGT a mis en avant la participation à la grande journée de « mobilisation nationale » du 17 juin, démonstration de « force syndicale » où chacun était relégué derrière sa banderole d'entreprise et son syndicat. La manœuvre a réussi puisque finalement la journée de grève prévue par les employés eux-mêmes a avorté et n'a pas eu lieu.
Direction et syndicats ont gagné une bataille, mais il est clair pour tout le monde que le mouvement reprendra après les congés d'été. Au cours de cette lutte, un petit noyau plus combatif a décidé de maintenir les liens afin de poursuivre la réflexion sur le bilan de ce mouvement, comment développer la mobilisation, comment l'étendre, s'échanger des informations sur ce qui se passe dans les autres centres et services, quels contacts avoir. C'est une expérience très riche qui a été vécue, comme le dit le bilan : « Ce qui a été important, c'est que nous avons su réellement nous mobiliser, agir de manière unitaire et solidaire, en prenant nous mêmes les décisions, sur la base de réunions communes et en déléguant un certain nombre d'agents pour l'écriture de lettres ou pour rencontrer la direction, délégations qui ont soumis à l'ensemble le travail effectué. C'est une expérience très positive car cela nous a permis de dépasser des divisions entre services, les uns reprochant aux autres la baisse de la qualité du service rendus alors que cela est une conséquence de la dégradation de nos conditions de travail ».
La question de l'unité et de la solidarité, de la prise en charge des luttes non seulement dans un seul secteur mais dans tous les secteurs de la classe ouvrière, a clairement germé dans cette mobilisation.
Sébastien, Marseille (3 juillet)
[1] Ce courrier paru dans Révolution Internationale n° 384 est également disponible sur notre site Internet www.internationalism.org [26].
Vie du CCI:
Géographique:
- France [34]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [36]
Prise de position du KRASS (Russie) sur la guerre en Géorgie
- 3957 reads
-
dénonciation des visées uniquement capitalistes et impérialistes des différents gouvernements nationaux et stigmatisation de leur rapacité, notamment celle des grandes puissances ;
-
aucun soutien à l'un ou l'autre des camps en présence dans la guerre capitaliste et impérialiste ;
-
appel des travailleurs de tous les pays belligérants à manifester leur solidarité de classe par dessus les frontières et à mener le combat contre leurs exploiteurs respectifs.
C'est pour cela que nous apportons notre plein soutien à l'essentiel de cette prise de position.
Nous voulons toutefois préciser que les mots d'ordre adressés aux soldats qui figurent à la fin du document (désobéir aux ordres des commandants, retourner les armes contre eux, etc.), s'ils sont parfaitement justes du point de vue d'une perspective historique (et ils ont été mis en pratique lors des révolutions russe en 1917 et allemande en 1918) ne sauraient être immédiatement d'actualité, alors qu'il n'existe pas, tant dans la région qu'à l'échelle internationale, ni une puissance ni une maturité suffisantes des combats de la classe ouvrière. Dans le contexte actuel, une attitude de ce type de la part des soldats les expose à la pire des répressions sans qu'ils puissent compter sur la solidarité de leurs frères de classe.
Cela dit, nous tenons ici à saluer les camarades du KRASS pour leur défense intransigeante de l'internationalisme et pour le courage politique dont ils font preuve depuis des années dans des conditions particulièrement difficiles, tant du point de vue de la répression policière que du poids des mystifications, notamment nationalistes, qui continuent à s'exercer sur la conscience des prolétaires du fait de la chape de plomb de la contre-révolution stalinienne qui a régné dans leur pays pendant des décennies.
NON À LA NOUVELLE GUERRE CAUCASIENNE !
L'éruption de nouvelles actions militaires entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud menace de se développer en une guerre plus large entre la Géorgie soutenue par l'OTAN d'un côté et l'État russe de l'autre. Des milliers de personnes ont déjà été tuées ou blessées, principalement des civils paisibles. Des villes entières et de nombreuses infrastructures ont été rayées de la carte. La société a été emportée par le torrent boueux du nationalisme et de l'hystérie chauvine.
Comme toujours et partout dans les conflits entre états, il n'y a pas et il ne peut y avoir quoi que ce soit de juste dans cette nouvelle guerre caucasienne ; tous sont coupables. Les braises sur lesquelles on a soufflé pendant des années ont finalement entraîné un embrasement militaire. Le régime de Saakashvili a plongé deux tiers de la population géorgienne dans une misère profonde, et plus montait dan le pays la colère contre cette situation, plus ce régime cherchait une échappatoire à cette impasse sous la forme d'une « petite guerre victorieuse » dans l'espoir que cela pourrait tout effacer. Le gouvernement russe est totalement déterminé à conserver son hégémonie dans le Caucase. Aujourd'hui il prétend défendre les faibles, mais son hypocrisie est tout à fait claire : en fait, Saakashvili ne fait que refaire ce que la soldatesque poutinienne a fait en Tchétchénie depuis neuf ans. Les cercles dirigeants d'Ossétie et d'Abkhazie aspirent à renforcer leur rôle d'alliés exclusifs de la Russie dans la région, et en même temps à rallier les populations paupérisées autour de la flamme de l'« idée nationale » et du « secours au peuple ». Les dirigeants des États-Unis, des États européens et de l'OTAN, au contraire, cherchent à affaiblir autant que possible l'influence de leur rival russe dans le Caucase afin de leur permettre de prendre le contrôle des ressources pétrolières et de leur acheminement. Ainsi sommes-nous témoins et victimes du nouveau point de fixation de l'antagonisme mondial dans la lutte pour l'énergie, le pétrole et le gaz.
Ces combats n'apporteront rien aux travailleurs, qu'ils soient Géorgiens, Ossètes, Abkhazes ou Russes, rien d'autre que du sang et des larmes, d'incalculables désastres et privations. Nous exprimons notre profonde sympathie à tous les amis et parents des victimes, à ceux qui n'ont plus de toit sur leur tête ni de moyens de subsistance à cause de cette guerre.
Nous ne devons pas tomber sous l'influence de la démagogie nationaliste qui nous demande l'unité avec « notre » gouvernement et déploie le drapeau de la « défense de la patrie ». L'ennemi principal des gens simples n'est pas le frère ou la sœur de l'autre côté de la frontière ou d'une autre nationalité. L'ennemi, c'est les dirigeants, les patrons de tout poil, les présidents et ministres, les hommes d'affaire et les généraux, tous ceux qui provoquent les guerres pour sauvegarder leur pouvoir et leurs richesses. Nous appelons les travailleurs en Russie, Ossétie, Abkhazie et Géorgie à rejeter le joug du nationalisme et du patriotisme pour retourner leur colère contre les dirigeants et les riches, de quelque côté de la frontière qu'ils se trouvent.
Soldats russes, géorgiens, ossètes et abkhazes ! N'obéissez pas aux ordres de vos commandants ! Retournez vos armes contre tous ceux qui vous envoient à la guerre ! Ne tirez pas sur les soldats « ennemis », fraternisez avec eux ! Plantez les baïonnettes en terre !
Travailleurs de l'arrière ! Sabotez l'effort militaire, quittez le travail pour aller aux réunions et manifestations contre la guerre, organisez-vous et mettez-vous en grève !
Non à la guerre et à ses organisateurs - dirigeants et riches ! Oui à la solidarité des ouvriers au-delà des frontières et des lignes de front !
Fédération pour l'Éducation, la Science et les ouvriers techniques, CRAS-IWA
Géographique:
Récent et en cours:
- Guerre en Géorgie [38]
Courants politiques:
Propagande nationaliste aux épreuves du brevet des collèges (courrier d'une lectrice)
- 3971 reads
Nous publions ci-dessous le courrier d'une lectrice auquel nous apportons notre soutien. Cette camarade y dénonce la pourriture idéologique de la bourgeoisie qui « n’hésite pas […] à bourrer le crâne de gamins de 14-15 ans de sa propagande nationaliste la plus grossière » lors des épreuves du brevet des collèges.
Courrier de la lectrice
Chers camarades,
En 2005, je vous avais écrit une petite lettre pour vous exprimer mon indignation devant toute la propagande déversée lors de l’épreuve d’histoire – géographie – éducation-civique du brevet des collèges. « Tout le sujet puait l’hypocrisie et la manipulation. L’Etat prétend développer à travers son école la réflexion, l’esprit critique et la compréhension du monde, mais c’est une belle mascarade. » 1 Tous les ans, c’est à peu près la même chose, la bourgeoisie profite de cet examen officiel pour présenter ses mensonges comme des vérités officielles. Elle n’hésite pas ainsi à bourrer le crâne de gamins de 14-15 ans de sa propagande chauvine la plus grossière ! Mais cette année, elle a battu un nouveau record… j’en suis presque tombée de ma chaise.
Le résumé de l’épreuve de géographie peut tenir en une seule phrase : « La France est belle et forte, Vive la France ! ». Je n’exagère pas du tout, sans rire. Le titre de l’épreuve annonce d’ailleurs la couleur (ou, plutôt, les trois couleurs… le bleu, le blanc et le rouge) : « La puissance française dans le monde ». Tout un programme !
Le premier document à étudier est sans nuance. En voici quelques extraits en forme de pot-pourri (mais vraiment pourri) :
-
« La réussite mondiale des grandes entreprises française est spectaculaire ».
-
« Les capacités technologiques françaises (aéronautiques, spatiales…) sont de premier plan ».
-
« A cela s’ajoutent de nombreux autres atouts (…) : notre langue (…), notre politique étrangère, une de celles qui comptent, notre capacité militaire à l’extérieur (…), l’image de qualité de la vie en France (…).
-
Et pour finir en beauté : « Ce tableau ne justifie pas un excès prétentieux de confiance en soi – il y a beaucoup à faire – mais il invalide le pessimisme ambiant » !
J’accorde, en tant qu’enseignante, une mention spéciale à l’Etat pour ce passage va-t-en-guerre qui résonne aujourd’hui de manière si sinistre avec l’actualité : « A cela s’ajoutent de nombreux autres atouts (…) : notre capacité militaire à l’extérieur ». Ces dix militaires, des gosses d’à peine 20 ans, morts en Afghanistan, leurs familles en deuil, ces villages ravagés par la guerre… voici en effet un bel « atout », une belle « capacité ».
Le deuxième document vient illustrer ces affirmations chauvines. Il vante les mérites économiques de quatre grandes entreprises françaises : Danone (« N°1 mondial des produits laitiers (…). Présents dans 45 pays »), Alstom (« Un des leaders mondiaux dans les infrastructures d’énergie et de transport. Présent dans 70 pays »), Louis Vuitton (« Un des leaders mondiaux de l’industrie du luxe ») et Carrefour (« N°1 en Europe et n°2 dans le monde dans le domaine de la grande distribution »). Ce document n’est rien d’autre qu’un encart de pub, une affiche que l’on pourrait retrouver dans le métro ou sur un bus… sauf qu’il est là, planté en plein milieu des copies officielles du brevet distribuées à des collégiens.
Toute cette épreuve de géographie est de la vraie propagande en boîte !
A partir de l’étude de ces documents, les élèves doivent répondre à des questions en en appelant, normalement, à leurs capacités d’observation et de réflexion, et à leur sens critique. Voyez-vous même :
-
Question 1 : « Relevez trois secteurs économiques qui font de la France une puissance mondiale. »
-
Question 2 : « Citez deux éléments qui font de la France une puissance militaire et un élément qui montre son rayonnement culturel. »
-
Question 3 : « Sur quel continent se manifestent à la fois cette puissance militaire et ce rayonnement culturel ? »
-
Et enfin, la question à 10 points, le fameux « paragraphe argumenté » qui en appelle aux connaissances individuelles de l’élève : « A partir des informations extraites des documents et de vos connaissances personnelles, rédigez un paragraphe argumenté d’une vingtaine de lignes montrant que la France est une puissance mondiale. »
Ça frise le ridicule, hein ? Tout ce qui est demandé aux élèves, finalement, c’est de répéter sous tous les angles possibles que « oui, la France est une puissance mondiale ». « Répète après moi : ‘Vive la France !’ et tu auras ton diplôme, mon enfant ». A quand chanter La Marseillaise comme épreuve obligatoire ? Mes collègues non plus n’en sont pas revenus. En salle des professeurs, à l’issue de cette épreuve, quelques commentaires ont fusé : « C’est de la pure propagande », « il n’y a aucun argument à retenir dans le premier document de géo, juste des affirmations… et on nous dit qu’il faut apprendre aux élèves à réfléchir !? ». Le nationalisme, la glorification de la puissance guerrière,… toutes ces notions ne cessent d’être martelées de plus en plus brutalement dès le collège (et sûrement dès l’école primaire, j’essayerais de me renseigner), comme s’il fallait convaincre de plus en plus jeune et à tous prix. Pourquoi ce discours aussi caricatural et récurent ?
Je ne suis pas sûre de moi mais je pense que ce n’est pas un hasard si une telle propagande arrive après le mouvement des étudiants contre le CPE en 2006 et le mouvement des lycéens contre la loi LRU en 2007. Il s’agit d’empêcher les jeunes de réfléchir par eux-mêmes, d’occuper le terrain de la réflexion dès le plus jeune âge. La conclusion édifiante du « document 1 » révèle parfaitement cette préoccupation de la classe dominante : « Ce tableau ne justifie pas un excès prétentieux de confiance en soi – il y a beaucoup à faire – mais il invalide le pessimisme ambiant ». Invalider « le pessimisme ambiant », c’est-à-dire nier la dégradation des conditions de vie, les attaques, la noirceur de l’avenir…, voilà à quoi s’attache cette épreuve du brevet en particulier et tous les discours des politiques en général. Si la bourgeoisie le pouvait, elle conditionnerait nos enfants à la mode ‘pavlovienne’ dès le berceau ! Mais elle peut bien faire ce qu’elle veut, elle ne parviendra pas à empêcher les nouvelles générations de prendre conscience de la barbarie de ce système et de développer leur volonté de se battre pour l’avenir… à mon avis.
Fraternellement, le 22 août, Li.
PS : Je vous transmets les documents officiels pour mieux illustrer mon propos. Ça vaut le coup d’œil !
Documents de l’épreuve d’histoire-géographie-éducation civique du brevet 2008
envoyés par la camarade :
1 Nous avions à l’époque publié cette lettre dans notre journal Révolution Internationale n°360 de septembre 2005 sous le titre « Brevet des collèges : la pourriture de l'idéologie bourgeoise [43] ».
Vie du CCI:
Qu'est-ce que la classe ouvrière ? (exposé de réunion publique)
- 3879 reads
Nous publions ci-dessous l'exposé qui a été présenté à nos dernières réunions publiques sur le thème "Qu'est-ce que la classe ouvrière ?"
Pourquoi cette
question se pose-t-elle aujourd'hui ?
En premier lieu, il y a des éléments liés à l'actualité qui mettent en évidence la difficulté à comprendre clairement en quoi consiste la classe ouvrière :
Cet automne, certains étudiants luttant contre la loi "LRU" ont manifesté leur solidarité avec les cheminots grévistes, tentant même parfois de réaliser des AG communes. Par contre, ils n'ont jamais essayé d'entraîner, par exemple, les infirmiers des hôpitaux ou les enseignants, en allant les voir pour discuter. Pourquoi ?
L'image d'Épinal, chère à la bourgeoisie et ses médias, présente l'ouvrier en bleu de travail et aux mains calleuses. Mais qu'en est-il des millions de chômeurs, des retraités, des employés de bureaux, des fonctionnaires, des travailleurs précaires... ?
Qui fait partie de la classe ouvrière ?
Répondre à ces questions est primordial pour continuer dans l'avenir à développer, dans la lutte, l'unité et la solidarité.
Une question similaire
s'est posée lors de la lutte de la jeunesse scolarisée
contre le CPE, au printemps 2006 : la nécessité
d'une solidarité entre les étudiants et les
travailleurs était évidente, cependant les étudiants
ne parlaient pas de la « classe ouvrière »
mais des « salariés », ce qui signifiait
que même lorsqu'ils comprenaient clairement que ce qui les
attendait pour la plupart était une vie de chômage, de
précarité et d'exploitation, ils ne se considéraient
pas eux-mêmes comme de futurs membres de la classe ouvrière.
En second lieu, et plus
généralement, les confusions sur la nature de la classe
ouvrière ont été particulièrement
répandues lors de l'effondrement des régimes
soi-disant « socialistes » en 1989 :
campagnes sur la « mort du communisme », sur la
« fin de la lutte de classe », voire la
« disparition de la classe ouvrière ».
Pourquoi cette
question est-elle importante ?
Parce que ces idées
fausses, qui sont amplement alimentées par les campagnes et
les mystifications de la classe dominante, affectent les deux forces
principales de la classe ouvrière : son unité et
sa conscience.
- L'unité de la classe ouvrière
Toutes les forces de la bourgeoisie sont intéressées et participent à la division de la classe ouvrière :
- Les secteurs de droite : ils ne parlent que de « citoyens tous égaux devant la loi ». Pour eux, il n'y a pas de division ni antagonisme entre les classes sociales, entre exploiteurs et exploités. Il faut manifester une « solidarité » entre « tous les partenaires d'une même entreprise », entre « tous les citoyens du pays ». Conclusions : l'ennemi des salariés de telle entreprise, ce n'est pas leur patron mais les salariés des entreprises concurrentes ; l'ennemi des exploités d'un pays, ce n'est pas leur bourgeoisie nationale mais les exploités des autres pays qui travaillent pour des salaires plus bas (et contre qui il faut prendre les armes en cas de guerre).
- Les sociologues : ils sont spécialistes dans la recherche de toutes sortes de catégories qui aboutissent à masquer les vrais divisions sociales entre exploiteurs et exploités. Ils vont faire un tas d'études, avec eu tas de statistiques à l'appui, sur les différences hommes/femmes, jeunes/vieux, français/immigrés, croyants/non croyants, diplômés/non diplômés, etc. (alors qu'il y a des femmes, des jeunes, des immigrés, des non croyants ou des non diplômés qui appartiennent à la classe des exploiteurs et réciproquement).
- La gauche et
surtout les syndicats : ils admettent qu'il y a des
exploiteurs et des exploités mais ils ont l'habitude de
diviser ces derniers entre entreprises (ils parlent des « Renault »,
des « PSA », etc.), entre branches
professionnelles (fédérations syndicales des
transports, de la fonction publique, de l'enseignement, etc.) et
aussi entre pays (langage chauvin sur « produisons
français » lorsque le problème de
délocalisation se pose).
- La conscience de la classe ouvrière
Elle se compose notamment de sa confiance en soi et de la conscience de sa nature historique, de son futur.
- La confiance en soi de la classe ouvrière : les différents secteurs de la bourgeoisie veulent « montrer » que la classe ouvrière n'est plus une force dans la société car elle est de plus en plus réduite en nombre puisque :-
dans les pays développés, il y a de moins en moins de « cols bleus », de travailleurs « manuels » (les seuls appartenant à la classe ouvrière dans les définitions officielles) ;
-
là où le nombre de « cols bleus » augmente (Chine, Inde, etc.), ils ne représentent qu'une petite minorité de la population.
- La conscience historique : on veut montrer qu'il n'y a rien à tirer de l'expérience historique de la classe ouvrière puisque les salariés ne sont plus les mêmes qu'au 19e siècle ou dans la première partie du 20e siècle.
Voilà la
conclusion que la bourgeoisie et tous ceux qui sont à son
service veulent faire tirer aux exploités : les idées
socialistes, l'idée d'un renversement possible de la
société capitaliste pouvaient se justifier au 19e
siècle ou au début du 20e siècle,
mais aujourd'hui ce sont des idées absurdes, une rêverie
impuissante.
Qui appartient à
la classe ouvrière ?
- Est-ce que tous les
travailleurs manuels appartiennent à la classe ouvrière ?
NON : le
boulanger ou le boucher propriétaire de son commerce travaille
de ses mains, mais il n'appartient pas à la classe ouvrière
car celle-ci est une classe exploitée, qui n'est pas
propriétaire de ses moyens de production. D'ailleurs, les
petits commerçants ne sont en général pas très
amis des ouvriers qu'ils considèrent souvent comme des
« fainéants ». En France, les artisans
et les commerçants constituent les troupes de choc de Le Pen.
Par contre, le garçon boucher ou le boulanger salarié
appartiennent à la classe ouvrière.
- Est-ce que tous les
exploités appartiennent à la classe ouvrière ?
Non : il
existe par exemple (et ils sont nombreux dans les pays
sous-développés) des paysans pauvres, non-propriétaires
de leurs terres, qui sont exploités par les propriétaires
fonciers à qui ils doivent verser un pourcentage de leurs
revenus ou un loyer annuel. Ils peuvent connaître une
exploitation effroyable, mais ils n'appartiennent pas à la
classe ouvrière comme telle. D'ailleurs, les luttes qu'ils
mènent visent surtout à obtenir un partage des terres,
à se transformer en petits propriétaires exploitants
(comme on en a pas mal encore en France et qui ne sont pas exactement
du côté des ouvriers : ils constituent plutôt
la clientèle de Le Pen). En fait, ce type d'exploitation est
un vestige de la société féodale, il appartient
essentiellement au passé.
Quels sont les
critères d'appartenance à la classe ouvrière ?
La
classe ouvrière est la classe exploitée spécifique
du mode de production capitaliste qui est basé sur le
salariat. La spécificité du capitalisme réside
dans la séparation entre producteurs et moyens de production.
Les travailleurs qui mettent en œuvre les moyens de production n'en
sont pas les propriétaires, ils louent leur force de travail à
ceux qui les possèdent. Appartenir à la classe ouvrière
suppose :
-
Être salarié : on ne vend pas le produit de son travail comme le fait un boulanger mais on loue sa force de travail à celui qui possède les moyens de production.
-
Être exploité : c'est-à-dire que le montant que reçoit chaque jour le salarié est inférieur à la valeur de ce qu'il a produit. S'il travaille pendant 8 heures, il reçoit l'équivalent de 4 heures et les 4 autres heures sont appropriées par le patron (Marx a appelé « plus-value » ce montant qui n'est pas payé au salarié). Tous les salariés ne sont pas exploités : les dirigeants des grandes entreprises sont souvent des salariés mais avec leurs salaires de plusieurs millions d'Euros par an, il est clair qu'ils ne sont pas exploités. C'est la même chose pour les hauts fonctionnaires.
Cela suppose également ne pas avoir une fonction dans la défense du capitalisme contre la classe ouvrière : les curés ou les flics ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production (l'église où le panier à salade), ils sont salariés. Cependant, ils n'ont pas un rôle de producteurs de richesses mais de défenseurs des privilèges des exploiteurs et de maintien en place de l'ordre existant.
C'est la même
chose pour le petit chef dans un atelier qui joue un rôle de
flic au service du patron.
Faut-il être un travailleur manuel pour
appartenir à la classe ouvrière ?
Absolument pas ! Pour plusieurs raisons :
-
Il n'y a pas de séparation nette entre travailleur manuel et intellectuel : c'est le cerveau qui commande à la main. Certains métiers « manuels » demandent un très long apprentissage et mobilisent activement la pensée : un ébéniste ou un chirurgien est un « manuel ».
-
D'ailleurs, dans le mouvement ouvrier, on n'a jamais fait cette séparation : traditionnellement, les correcteurs d'imprimerie se considéraient comme des ouvriers à côté des typographes ou des rotativistes. Souvent, ils étaient à l'avant-garde des combats ouvriers. De même, pas il n'y a pas d'opposition entre les conducteurs de train et les « employés aux écritures ». Il n'y a pas de séparation entre « ouvriers aux mains calleuses » et employés.
-
De plus, au niveau des mots, ouvrier veut dire qui « œuvre », qui travaille. En Anglais, ouvrier se dit « worker », travailleur.
Faut-il faut enrichir directement un patron pour
appartenir à la classe ouvrière ?
NON ! C'est clair qu'un ouvrier travaillant à l'entretien d'un hôpital appartient à la classe ouvrière. Mais c'est aussi le cas d'une infirmière qui soigne des malades. En fait, elle participe à l'entretien de la force de travail qui sert à enrichir le capitalisme.
C'est la même chose pour une institutrice qui participe à la formation de la force de travail qui, plus tard, va entrer dans le processus de la production.
De même, un
chômeur (qui momentanément ne travaille pas) ou un
retraité (ancien producteur salarié et exploité)
appartient à la classe ouvrière non pas au jour le
jour, mais du fait de sa place dans la société.
Conclusion
Les luttes que peuvent mener contre l'exploitation les ouvriers de l'industrie, les cheminots, les enseignants, les infirmières, les employés de banque, les fonctionnaires mal payés, les chômeurs, etc. mais aussi les étudiants qui vont entrer dans ces professions appartiennent toutes au combat général contre le capitalisme. Ce sont des luttes de résistance contre les attaques toujours plus brutales que ce système porte contre ceux qu'il exploite. Ce sont aussi des luttes qui préparent l'affrontement général et international contre ce système en vue de son renversement.
Vie du CCI:
Réponse à des attaques sur le prétendu sionisme du CCI
- 3412 reads
Le CCI fait actuellement l'objet d'attaques graves et répétées sur les sites Indymedia concernant notre prétendu sionisme. Ces attaques prennent deux formes : d'une part un communiqué 1 provenant "d'amis du CCI" qui sont sans le moindre rapport avec nous et usurpent l'adresse de notre site, et d'autre part des articles 2 martelant des positions du CCI qui prouveraient soit-disant son sionisme.
En réponse à ces attaques, nous publions ci-dessous deux communiqués, cette fois-ci émanant véritablement du CCI et rétablissant la vérité sur nos positions. Nous invitons nos lecteurs et sympathisants à renvoyer à cette page dès qu'ils sont témoins ou destinataires de telles attaques.
COMMUNIQUÉ DU CCI SUR LES ACCUSATIONS DE SIONISME CONTRE LE CCI
Depuis un certain temps, des posts signés DO et renvoyant à un site nommé Mai68 accusent le CCI de sionisme.
Nous publions ce communiqué pour affirmer de la manière la plus catégorique qu'aucun texte publié par le CCI depuis le début de son existence en 1975, nulle phrase, nulle expression ne permet d'accréditer une telle accusation. Pour en avoir la preuve, on peut consulter notre site www.internationalism.org [26]
En conséquence, il apparaît que ceux qui formulent de tels mensonges éhontés sont au moins des escrocs sinon des provocateurs.
Nous faisons confiance à tous ceux qui se posent honnêtement la question d'en finir avec la misère et la barbarie du système capitaliste pour refuser tout crédit à ce type d'accusations. Nous les appelons à continuer les débats avec le CCI et avec les autres organisations qui défendent authentiquement les positions du prolétariat.
Le CCI
COMMUNIQUÉ DU CCI SUR UN FAUX APPEL A SOUSCRIPTION
On peut trouver sur des forums du réseau Indymedia (et peut-être sur d'autres) un "Appel à souscription pour la réédition d'ouvrages du CCI 'D'Auschwitz à Gaza, en passant par le ghetto de Varsovie'".
Le CCI n'a jamais lancé un appel à souscription de ce type. Ses appels à souscription se trouvent uniquement sur son propre site ou dans sa presse papier.
Il est clair qu'un tel appel n'est pas autre chose qu'une tentative de discréditer notre organisation. La méthode utilisée est significative du manque de scrupules et de la démarche politique de son auteur, une démarche qui n'a rien à voir avec celle du prolétariat.
Plus généralement, nous mettons en garde contre toute une série de "posts" signés "CCI", "un sympathisant du CCI" ou "Les amis du CCI" qui, prétendant défendre nos positions, ne sont en réalité que des tentatives de jeter le discrédit sur notre organisation. Le CCI, ses militants et ses véritables sympathisants interviennent sur différents forums et comme il ne nous est pas possible de certifier l'authenticité de tous les messages qui sont envoyés, nous engageons les lecteurs qui peuvent trouver surprenants certains des messages signés "CCI" ou "sympathisant du CCI" de vérifier sur notre propre site s'ils sont bien cohérents avec les positions que nous défendons.
Le Courant Communiste International.
1 Voici le texte de ce communiqué :
Appel à souscription pour la réédition d'ouvrages du CCI : "D'Auschwitz à Gaza, en passant par le ghetto de Varsovie"
Le CCI y analyse magistralement les grandes défaites du mouvement ouvrier international. Il montre comment, en se créant des ennemis imaginaires, les prolétaires ont fermé les yeux sur leurs véritables ennemis : leurs bourgeoisies locales. A travers des exemples historiques, nous voyons comment, par exemple, en refusant de lutter contre leur bourgeoisie avec l'aide du prolétariat allemand, les habitants d'Auschwitz ont signé leur perte. De même dans le ghetto de Varsovie, où les armes auraient dû être tournées contre les exploiteurs, non contre les Allemands.
Et à Gaza, n'aurait-il pas été plus simple de creuser des tunnels pour prendre contact avec le prolétariat israélien au lieu d'attaquer l'Etat juif ?
Passez vos commandes aux Amis du CCI : www.internationalism.org [25]
AuteurE : Les Amis du CCI
2 Un certain Do (qui a son propre site Web: https://mai68.org [44]) commente presque systématiquement nos articles par l'accusation de sionisme. Il a même fait tout un article à ce sujet, en voici des extraits:
titre: Le CCI, un groupuscule ''communiste'' qui cache mal son sionisme
Extrait de l'introduction : " Le CCI est un groupuscule qui se prétend "communiste", mais qui camoufle mal son sionisme. Refusant (officiellement) de choisir son camp entre Palestiniens et sionistes, le CCI est donc dans le camp du plus fort : le CCI n'est qu'un attrape-mouche pour juifs de gauche afin d'éviter qu'ils deviennent antisionistes."
Vie du CCI:
Répression contre la grève des employés de banque au Brésil (Tract)
- 2724 reads
La bourgeoisie brésilienne, confrontée à des mouvements échappant à son contrôle (en fait au contrôle des syndicats), utilise de manière grotesque son appareil répressif, la police, en vue d´intimider les travailleurs. C´est ainsi qu´à Porto Alegre (RS), dans le sud du Brésil, elle a réprimé violemment une manifestation d´employés de banque, le 16 octobre dernier, en faisant usage de gaz lacrymogènes, de balles en caoutchouc et blessant ainsi environ 10 personnes. Comme si la répression intervenue dans la matinée n´y suffisait pas, la "13e marche des Sans" [1] réunissant le même jour et dans la même ville, une dizaine de milliers de personnes fut, elle aussi, la cible de la répression policière dont il a résulté de nombreux blessés.
Avant cela, les dirigeants des banques et, parmi eux, le propre gouvernement, avaient déjà entrepris de prendre des mesures contre la grève actuelle des employés de banque en persécutant et licenciant des leaders, en vue de contenir le développement du mouvement.
La solidarité de classe : une nécessité
Il est nécessaire de souligner que la lutte des employés de banque va actuellement au delà des revendications économiques classiques puisque sa revendication essentielle est celle de l´homogénéisation du traitement des employés. Les banques, et surtout les banques fédérales, ont créé un abîme entre la situation des employés de longue date et celle de ceux qui ont été embauchés depuis 1998, lorsqu´ont été supprimés certains «avantages» qui avaient été arrachés à travers la lutte même. Bien plus que la revendication d´une simple compensation économique, il s´agit donc d´un geste important de solidarité entre travailleurs, car il n´est pas possible d´accepter que nous soyons traités différemment, comme si certains d´entre nous étaient inférieurs, alors que nous effectuons tous le même travail, dans le mêmes locaux, en étant soumis aux mêmes pressions.
Il est également nécessaire qu'il soit bien clair que, tous nos «avantages» étant le fruit de la lutte, si certains d'entre nous en bénéficient, alors tous doivent en bénéficier, quel que soit le moment où ils ont été embauchés. De la même manière, cette grève cherche à récupérer ce qui nous a été supprimé, à tous cette fois-ci, comme les primes annuelles, etc. Toutes ces conquêtes économiques ont été le produit de nos luttes de résistance mais elles ont été annulées par la suite par les patrons avec la complicité de leurs « partenaires syndicaux ».
Nous voulons également de meilleures conditions de travail, la fin du harcèlement moral, la fin des objectifs de vente de produits et services imposées par les banques ; tout ceci a occasionné tellement de maladies parmi les travailleurs du secteur bancaire. Nous le répétons, nous ne voulons pas être traités différemment les uns des autres. Nous ne pouvons pas être d´accord avec l´amputation de nos « avantages » qui sont le produit de nos luttes et non pas des cadeaux de la part des patrons du secteur privé ou public.
La revendication des mêmes conditions de travail et rémunération pour ceux qui sont actuellement embauchés constitue un acte de solidarité entre les différentes générations de travailleurs de ce secteur. C´est cette même solidarité dont nous devons faire la preuve en actes avec ceux qui ont été victimes de la répression de l´État. Nous ne pouvons pas renoncer à nous joindre et nous solidariser avec tous ceux qui luttent pour ne pas se laisser écraser par les nécessités du capitalisme en crise, avec tous ceux que la bourgeoisie a réprimé ou va vouloir réprimer du fait de leur implication dans les luttes.
Ces luttes et la répression de l´État ne constituent pas une question qui ne concerne que les employés de banques, mais bien l´ensemble des travailleurs, avec ou sans travail.
Tract
commun du CCI et du groupe Opposition Ouvrière
distribué au Brésil le 20 octobre
dans les assemblées générales de lutte des employés de banque
[1] Mouvement qui réunit différentes catégories d´exclus sociaux, le Mouvement des Sans Terre, le Mouvement des Sans Toit, le Mouvement des Sans Travail. Comme son nom l´indique, ce dernier est essentiellement constitué de prolétaires san travail. Le mouvement des Sans toît regroupe des éléments de différentes couches non exploiteuses de la société, qui s´organisent notemment pour occuper des squats. Le mouvement des Sans Terre est constitué lui aussi de différentes couches non exploiteuses de la société en provenance de la ville, sans travail et qui sont organisés au sein de cette structure pour l´occupation de terres à la campagne en vue de les cultiver. Cette structure est solidement contrôlée par l´État, en particulier depuis le premier mandat de Lula à la tête de l'Etat.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [36]
Réunion publique du CCI au Pérou sur la crise : un débat prolétarien passionnant et passionné
- 3444 reads
Lors de cette deuxième réunion publique1, qui s'est déroulée le 24 octobre 2008, beaucoup de monde était présent (la salle était pleine à craquer). Mais bien plus important que cet aspect quantitatif, c'est l'aspect qualitatif du débat qui est à retenir : il y avait des camarades des différentes générations de la classe ouvrière (dont beaucoup de jeunes) ; il y avait des travailleurs, des étudiants, des femmes, des employés ; la discussion a été très vivante, avec de nombreuses interventions qui se répondaient les unes aux autres, chacun pouvant exprimer librement ses opinions. L'écoute a été attentive et respectueuse, les arguments se sont succédé sans jamais tomber dans l'insulte et le dénigrement. L'intérêt de l'assistance était tel que le débat a été prolongé d'une heure. Vers la fin de la réunion, les participants ont orienté le débat sur la question de comment lutter et comment contribuer au développement de la conscience et de la lutte ouvrière, ce qui a amené à se poser la question de la nécessité de continuer ces réunions, comme nous le verrons plus loin.
Ce fut une démonstration vivante de ce qu'est la culture du débat, de ce qu'est un débat prolétarien.
La crise actuelle conduit à une des pires récessions de l'histoire
Après une brève présentation2, la discussion s'est centrée sur la nature de la crise actuelle, ses causes et ses perspectives3. Un des participants a clairement affirmé : « La Grande-Bretagne est entrée en récession, les Pays-Bas ont des sérieux problèmes, le monde entier va subir la récession. »4
Les interventions ont insisté sur le caractère mondial de la crise. Des éléments et des données ont été apportés sur la situation au Pérou, mais l'axe central des interventions a été la situation mondiale et ses conséquences. Tout cela est l'expression même de la vision internationaliste et prolétarienne qui a été celle de la majorité des participants.
La discussion a insisté sur les fait suivants : la crise actuelle est pire que celle de 1929 et le pire de cette crise est encore devant nous.
Une intervention a mis en avant les conséquences de la crise pour l'économie péruvienne, mais la plupart de ces interventions ont porté sur la question de ses conséquences pour la classe ouvrière. En effet, face à la crise, la préoccupation des travailleurs ne doit pas être : « Que va devenir l'économie nationale ? », mais « Comment la crise affecte-t-elle tous les travailleurs et tous les exploités du monde entier ?" et « Comment pouvons-nous y répondre en tant que classe mondiale ? »
Une des personnes présentes affirma que la crise était la conséquence de la toute-puissance de l'impérialisme yankee, des erreurs de Greenspan qui auraient causé le désastre actuel. Mais la majorité des interventions y ont répondu en disant qu'il ne faut pas chercher les causes de la crise dans la politique économique d'un État et encore moins dans les maladresses de tel ou tel personnage, « Le fond de la question n'est pas de savoir si la faute incombe à quelques banquiers pourris, mais le fait que nous nous trouvions face à la pire des crises du capitalisme en tant que système. Le capitalisme, à cause de ses contradictions, finit par éclater dans la crise et ce sont les travailleurs qui en payent le prix le plus élevé », répondit l'un des présents, un autre ajoutant : « le capitalisme a une limite historique, il arrive un moment où cette limite devient patente. La surproduction et l'endettement ont atteint leurs limites ».
Les moyens de lutte de la classe ouvrière
Comme on pouvait s'y attendre, une bonne partie de la discussion a porté sur la question : quels sont les moyens de lutte dont dispose la classe ouvrière pour s'opposer à cette situation insupportable ?
Une polémique respectueuse entre deux personnes présentes, d'un coté, et de l'autre une majorité des présents, surtout des jeunes, s'est alors ouverte. Alors que les deux premiers étaient favorables à des alternatives nationalistes, d'une intervention de l'Etat pour sauver l'économie nationale, les autres ont mis l'accent sur la lutte autonome des travailleurs dans la perspective de la révolution mondiale.
Alors que les premiers disaient : « Il faut faire pression pour que la demande augmente et sortir ainsi de la crise ; lutter pour que les entreprises augmentent leur productivité et le développement technologique, demander que les crédits à la consommation augmentent », les autres répondaient : « Il ne faut pas demander aux capitalistes de faire quelque chose en faveur des travailleurs, il faut lutter pour les besoins des travailleurs de manière autonome sans faire confiance à ce que peuvent faire l'Etat et les capitalistes ».
Tandis que les premiers insistaient sur la nécessité de trouver une issue pour l'économie péruvienne, d'autres interventions considéraient que cela était un piège, une utopie réactionnaire. Aucun pays ne peut sortir tout seul de la crise. Il n'existe pas de solutions nationales à la crise. Il n'y a qu'une issue mondiale à cette crise et celle-ci ne peut être trouvée que par la lutte révolutionnaire des travailleurs.
Un des éléments présents a, cependant, exprimé sa confiance dans la capacité du capitalisme à trouver une solution mondiale à la crise : « Le 15 novembre vont se réunir des leaders du monde entier pour établir une coopération internationale qui permettra de sortir de la crise. » Est-ce qu'un nouveau Bretton Woods5 est possible, comme l'a affirmé cet intervenant ? Est-il possible, ainsi que l'a demandé un autre intervenant, d'assister à une « refondation du capitalisme sur des bases progressistes et favorables aux travailleurs ? ». Plusieurs interventions ont répondu par la négative à ces questionnements : le capitalisme ne porte pas en lui la moindre dynamique de progrès, bien au contraire, sa dynamique va dans l'autre sens, il ne peut apporter que toujours davantage de barbarie et de destruction ; aux sommets des dirigeants du monde, on prendra des mesures pour sauver les banques, les entreprises et les Etats en faillite aux dépens des travailleurs et de la grande majorité de la population mondiale6.
Deux autres intervenants ont insisté dans leur revendication pour que l'État intervienne davantage, pour que celui-ci ne se consacre pas à sauver des banques mais à prendre des mesures pour l'augmentation de la demande et des crédits pour les ménages. En réponse à cela, un débat sur le rôle de l'Etat s'est engagé. Un des présents a dit : « L'État, c'est les gens qui détiennent la richesse et il va prendre des mesures pour protéger cette classe en faisant toujours plus de coupes dans les subventions et les pensions », un autre affirma : « On nous dit de faire confiance à l'État, mais celui-ci n'est pas là pour nous défendre mais pour défendre les capitalistes. Luttons par nous-mêmes pour faire tomber cet État. Il ne faut pas sauver l'État ni demander à l'État de nous sauver. »
À l'appel d'un élément à la mobilisation « pour sauver la patrie péruvienne menacée par l'invasion des produits chiliens », un autre lui a répondu que l'enjeu « n'est pas de sauver la patrie mais de sauver l'humanité ».
L'autogestion est-elle une solution ?
Un des présents a mis en avant qu'« une bonne réponse à la crise, c'est la prise en mains des entreprises pour que les travailleurs les fassent fonctionner, montrant ainsi que le capitaliste ne sert à rien. En Argentine, il y a 185 entreprises autogérées coordonnées en un réseau solidaire ».
La réponse venue d'autres participants, surtout des jeunes, fut très claire : « L'exploitation est mondiale, prendre le contrôle d'une usine pour la gérer, c'est se soumettre à l'exploitation. Rappelons-nous de ce qui est arrivé en Russie, qui est restée isolée et fut happée par le marché mondial, comment une entreprise seule pourrait-elle sortir du marché mondial ? » Un autre participant a dit : « autogestion veut dire auto-exploitation des travailleurs », « les travailleurs ne peuvent pas gérer leur propre exploitation ».
D'une manière simple et claire, les intervenants ont montré que l'autogestion est une mesure pour sauver les entreprises capitalistes mais non pas pour sauver les travailleurs. Les travailleurs tirent les marrons du feu pour le compte du capital et celui-ci récupère l'entreprise pour l'intérêt de l'économie nationale. Ce que la crise actuelle démontre, ce n'est pas que les capitalistes ne serviraient à rien, mais c'est que non seulement on ne peut pas utiliser le système capitaliste au profit des travailleurs, mais que ce dernier représente un danger pour l'humanité et qu'il ne s'agit pas d'autogérer l'exploitation mais de lutter contre elle dans la perspective de l'abolir à échelle mondiale7.
Poursuivre les réunions
Un des présents a dit : « Il est nécessaire de lutter contre le capitalisme, il est nécessaire de lutter en tant que classe ouvrière, mais j'ai beaucoup de doutes, j'ai dans ma tête tellement de questions que parfois j'ai l'impression qu'elle va exploser. »
Cette intervention si spontanée et sincère a donné lieu à une discussion. La lutte ouvrière est loin d'être facile, elle doit surmonter de nombreux obstacles, elle doit faire face à des problèmes gigantesques, elle se pose une foule de questions pour lesquelles il n'existe pas de manuel pour y répondre. Il n'y a qu'à travers les expériences vivantes des luttes, mais, surtout, grâce aux débats les plus larges possibles où l'on discute avec sincérité, dans un effort de réflexion, avec confiance et solidarité, qu'on pourra commencer à répondre aux problèmes énormes que confronte aujourd'hui l'humanité.
Deux des présents proposèrent de poursuivre les réunions, que l'on fixe une date pour une prochaine rencontre où l'on puisse continuer une discussion méthodique et systématique orientée vers la compréhension des expériences de lutte de la classe ouvrière, et à partir de celles-ci, considérer quels sont les meilleurs moyens de lutte de la classe ouvrière.
Cette décision, qui a eu le soutien du responsable du local mis à disposition pour une nouvelle rencontre, est vraiment un grand pas. Il arrive souvent qu'une réunion aboutisse aux meilleures conclusions, les gens en sortent contents, mais qu'est qu'on fait par la suite ? Eh bien, chacun repart de son coté, tombe dans l'atomisation du quotidien, perd peu à peu de vue la chaleur du débat collectif et la vitalité de la discussion qui l'avaient animé. C'est pour cela qu'il faut se donner les moyens de se réunir régulièrement, de sentir le climat chaleureux de la rencontre et de la discussion collective. Il est nécessaire de continuer les éclaircissements, de se donner des perspectives pour contribuer à la lutte et à la conscience de la classe ouvrière.
Les camarades du Pérou qui ont mis en œuvre cette initiative ne sont pas seuls. Dans d'autres pays, des initiatives similaires se concrétisent. Il y a un milieu internationaliste qui, progressivement, est en train de se former en s'orientant vers une discussion et une collaboration internationales pour continuer à forger la meilleure arme que le prolétariat puisse posséder : son unité et sa conscience à l'échelle mondiale.
D'ici, nous vous envoyons, camarades, notre soutien le plus enthousiaste.
Courant Communiste International (30-10-2008)
oOo
PRESENTATION SUR LA CRISE ACTUELLE
Chers participants :
Nous vous remercions de votre présence8. Il ne s'agit pas ici pour nous de faire un meeting ni une conférence. Ce que nous cherchons c'est d'animer un débat où nous puissions tous participer.
Nous allons donc faire une présentation brève.
Nous tous ici présents sommes plus ou moins au courant des convulsions qui secouent actuellement l'économie mondiale. Personne ne cache aujourd'hui que cette crise est très grave, même plus grave, nous dit-on, que celle de 1929.
La crise ne se limite pas à la finance ; c'est bien une crise qui touche surtout l'industrie et le commerce. Ses conséquences sont très cruelles pour l'immense majorité des travailleurs et de toute l'humanité opprimée et exploitée : poussée du chômage, salaires qui tombent en vrille, des cadences de travail de plus en plus fortes sur les lieux de production, des accidents de travail qui se multiplient, des problèmes de logement en augmentation, et aussi, et de plus en plus, le spectre de la famine qui menace de plus en plus de gens.
Ces problèmes touchent tous les travailleurs du monde. Il est très difficile de trouver un pays qui puisse se sauver des dévastations actuelles. Ouvriers des métropoles industrielles, comme ouvriers des pays les plus pauvres, nous sommes tous frappés par la crise.
Mais, pourquoi il y a des crises ?
Nous ne pouvons nous étendre ici. Nous allons seulement rappeler quelques idées de base. Le capitalisme est le premier système social dans lequel la faim, la misère et le manque ne sont pas le produit de la sous-production ou de la pénurie en général, mais à cause de la surproduction, autrement dit de « l'excès » général des marchandises produites que le capitalisme ne parvient plus à vendre.
Dans les régimes féodaux, les famines étaient la conséquence des mauvaises récoltes, de la rareté dramatique de nourriture,, etc. Sous la domination du capitalisme, les famines sont le résultat de la surproduction, de la surabondance générale de nourriture et de marchandises.
Pour quoi une telle chose ?
Répondre à une telle question nous amène à analyser les contradictions qui conduisent le capitalisme à la crise et à la ruine.
Il existe différentes contradictions, mais nous voudrions simplement en souligner deux.
La première c'est que le capitalisme ne produit pas pour satisfaire les besoins humains mais pour en tirer de la plus-value, du profit. Ceci amène au fait que le capitalisme tend à produire au-delà des limites que le marché peut absorber. La capacité de consommation de la société se trouvé limitée par le système de travail salarié qui impose que ce qu'on paye à l'ouvrier ne doit pas aller beaucoup plus loin que ce dont il a besoin pour la reproduction de sa force de travail. Cette situation conduit le capitalisme à la surproduction.
La deuxième contradiction se trouve dans le fait que la production a tendance à prendre un caractère social et mondial, mais son organisation et son appropriation a un caractère privé et national. Ceci entraîne la concurrence féroce entre capitalistes particuliers et surtout entre capitaux nationaux qui se bagarrent à mort pour le partage des marchés existants.
Cette analyse peut nous servir pour répondre aux idées avec lesquelles nous abreuvent les médias, propagées par les gouvernants, les dirigeants syndicaux, les experts économiques, etc.
Ils nous disent qu'il ne faut pas s'en faire, que les crises sont cycliques. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des moments de prospérité et des moments de crise. Par conséquent, « on se tirera encore de celle-ci » comme on a pu se sortir des précédentes.
Nous pensons que ce n'est pas du tout la réalité. Pendant le 19ème siècle et le début du 20ème il y a avait effectivement des crises cycliques, mais, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même époque historique. À cette époque-là, le capitalisme pouvait s'étendre, conquérir de nouveaux marchés et chaque crise se résolvait par un élargissement du champ de la production, par l'avancée vers la formation du marché mondial.
Par contre, depuis le début du 20ème siècle, avec la formation du marché mondial, le capitalisme tend à la saturation, les marchés ne sont pas suffisants pour garantir la réalisation de la plus-value de toute la multitude des concurrents. Le résultat en est une tendance, d'un coté, à la crise pratiquement chronique et, d'un autre coté, à la concurrence impitoyable et de plus en plus destructrice entre les capitalistes du monde entier.
La crise actuelle est inscrite dans ce processus historique et son seul débouché ce sera l'appauvrissement bien plus grave, des convulsions de plus en plus grandes, une misère bien plus forte et étendue.
Encore une autre chose qu'on nous raconte, c'est que la crise actuelle est la crise du néo-libéralisme, mais qu'elle ne serait pas celle du capitalisme en tant que tel.
Les politiques libérales de « laisser faire le marché », « d'éliminer les régulations », « d'inhibition de l'État » auraient conduit au désastre actuel. La solution serait l'intervention de l'État dans l'économie, on trouverait alors une issue à la crise, une issue qui serait « socialiste » puisqu'elle serait trouvée au « bénéfice » de la grande majorité exploitée et appauvrie.
Voilà le sermon du « socialisme du 21ème siècle » de Chávez, de Correa, et d'autres dirigeants de gauche en Amérique latine.
Nous pensons, en premier lieu, que la dichotomie « libéralisme ou étatisme » est fausse. En réalité, le capitalisme fonctionne selon une tendance générale orientée vers le capitalisme d'Etat, qui est opérationnelle dans tous les pays et qui a fondamentalement deux formes :
- l'intervention indirecte de l'État, ce qu'on appelle le « néolibéralisme » ;
- l'intervention directe et ouverte de l'État qu'on appelle faussement « socialisme »
L'État est intervenu dans les économies capitalistes depuis de nombreuses années. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est aussi à l'échec de toutes les politiques étatiques. C'est l'échec des politiques néolibérales, mais c'est parce que préalablement, ce fut également l'échec des politiques keynésiennes et « socialistes ».
Aucune politique capitaliste ne nous sortira de l'impasse. Toute politique économique ne peut que s'appuyer sur encore plus de chômage, encore plus de misère, encore plus de famine.
L'alternative n'est pas : néolibéralisme ou interventionnisme étatique « socialiste », mais poursuite du capitalisme avec son corollaire d'enfoncement dans la barbarie ou lutte massive du prolétariat international pour la révolution mondiale, pour la construction d'une nouvelle société basée sur la communauté humaine mondiale.
Nous vous remercions de votre écoute attentive et nous vous encourageons à poser toutes les questions que vous considérez nécessaires. Il serait aussi très bien que des réponses soient faites ailleurs que de la tribune, par d'autres personnes présentes dans la salle.
1 Une première réunion avait eu lieu en octobre 2007. Voir, en espagnol, Reunión Pública en Perú : hacia la construcción de un medio de debate y clarificación [46]. [46]
2 Voir annexe ci-dessous.
3 Dans ce qui suit ce n'est pas notre position (CCI) que nous transcrivons, mais celle qui a été exprimée par les participants. Pour connaître notre position sur la crise actuelle, nous invitons le lecteur à lire les documents suivants : « Le capitalisme est un système en faillite, mais un autre monde est possible : le communisme [47] », (RI novembre 2008) ; « Crise du néolibéralisme ou crise du capitalisme ? [48] » ; « Va-t-on revivre un krach comme en 1929 [49] ? »(RI Octobre 2008)
4 Nous reprenons ici les notes manuscrites prises lors du débat. Nous pensons rester fidèles à ce qui a été dit. Si l'un des présents considère que son intervention n'a pas été correctement retranscrite, nous l'invitons à nous écrire pour corriger ce qui doit l'être.
5 Les Accords de Bretton Woods sont les résolutions de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies, qui s'est tenue dans le complexe hôtelier de Bretton Woods, (dans le New Hampshire, aux Etats-Unis), entre le 1er et le 22 juillet 1944, où se sont établies les règles des relations commerciales et financières entre les pays le plus industrialisés du monde. On y a décidé aussi la création de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International et l'utilisation du dollar en tant que monnaie d'échange de référence internationale. Ces organismes sont devenus opérationnels en 1946 (source Wikipedia).
6 L'Islande est un pays en faillite et le FMI est allé lui apporter son aide mais en exigeant des mesures d'austérité draconiennes qui affectent les 300.000 habitants de l'île. La Hongrie se trouve aussi en difficulté. Elle va recevoir un crédit de 20 milliards de € du FMI, mais, en échange, celui-ci exige la mise en place de mesures qui vont se concrétiser en licenciements, nouvelles coupes dans les budgets sociaux, élimination de subventions, augmentation des taxes, etc.
7 Les lecteurs intéressés par notre position sur l'autogestion peuvent consulter notre débat (en espagnol) [50] avec le groupe argentin Nuevo Proyecto Histórico.
8 Nous tenons à remercier l'aide fournie par le responsable de la salle qui, par ailleurs, a participé activement à la discussion.
Vie du CCI:
Géographique:
- Pérou [51]
Récent et en cours:
- Crise économique [9]
Réunions publiques : Les révoltes de la jeunesse en Europe confirment le développement de la lutte de classe
- 2961 reads
A la fin de l'année 2008, quarante ans après l'année 1968, plusieurs pays d'Europe ont été touchés simultanément par des mouvements massifs de la jeunesse scolarisée (étudiants et lycéens). En Grèce, les assemblées générales massives d'étudiants ont même évoqué un nouveau "Mai 68". En effet, ce ne sont pas seulement des jeunes qui se sont mobilisés contre les attaques du gouvernement et contre la répression de l'État policier, mais aussi plusieurs secteurs de la classe ouvrière en solidarité avec les jeunes générations.
L'aggravation de la crise économique
mondiale révèle de plus en plus la faillite d'un système qui n'a
plus d'avenir à offrir aux enfants de la classe ouvrière. Mais ces
mouvements sociaux ne sont pas seulement des mouvements de la jeunesse.
Ils s'intègrent dans les luttes ouvrières qui se développent à l'échelle
mondiale. La dynamique actuelle de la lutte de classe internationale,
marquée par l'entrée des jeunes générations sur la scène de l'histoire,
confirme que l'avenir est bien entre les mains de la classe ouvrière.
Face au chômage, à la précarité, à la misère et à l'exploitation,
le vieux slogan du mouvement ouvrier "Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous" est plus que jamais d'actualité.
Nous invitons nos lecteurs à venir discuter de ces questions lors de nos prochaines réunions publiques.
- A Lyon, le 10 janvier à 17 h
- A Paris, le 24 janvier à 15 h (et non 17 h comme indiqué par erreur dans notre presse)
- A Toulouse, le 24 janvier à 15h
- A Nantes, le 24 janvier à 16 h
- A Marseille, le 31 janvier à 17 h
- A Caen, le 31 janvier à 17 h
- A Tours, le 7 février à 16 h
- A Lille, le 14 février à 14h30
Pour plus de précisions, reportez-vous à l'encadré "réunions publiques" ci-contre à gauche.
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [36]
Réunions publiques au Brésil : débats sur mai 68 et la perspective révolutionnaire
- 3135 reads
Le CCI a tenu récemment deux réunions publiques au Brésil sur Mai 68. La première a eu lieu dans une université (UESB) de l'État de Bahia1 sur l'initiative d'un cercle de discussions et la seconde, assumée conjointement avec deux autres organisations prolétariennes, Opposition Ouvrière2 (OPOP) et le Groupe Anarres3, a eu lieu à São Paulo. Le Brésil ne fait en rien exception pour ce qui concerne la campagne idéologique de toutes les fractions de la bourgeoisie dans le monde, visant à dénaturer Mai 68 et faire en sorte que "ceux qui ont de la sympathie pour ces évènements en retirent des fausses leçons, qu'ils n'en comprennent pas la signification 4." Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de vivre ces évènements ni de pouvoir accéder à des documents permettant une vision plus objective de ce qui est réellement arrivé, les médias ont un discours tout prêt qui résume Mai 68 aux confrontations de rue avec la police et cantonnent l'action de la classe ouvrière à un rôle de figurant, loin à l'arrière plan par rapport au mouvement étudiant. Cependant, au Brésil comme dans beaucoup d'autres pays, il existe des éléments, en particulier parmi les jeunes générations, qui sont intéressés à comprendre ce qui s'est réellement passé en Mai 68. C'est ce qu'a illustré l'assistance significative à l'université, dépassant la quarantaine de personnes.
Le
réel changement historique qu'a représenté Mai 68
La mise en évidence de la signification profonde et historique de Mai 68, qui a marqué la fin d'une période de contre-révolution de 40 années, a été parfaitement prise en charge par certaines interventions :
-
"Il est important de se réapproprier la mémoire historique du prolétariat. Mai 68 est présenté au Brésil comme une lutte contre la dictature alors qu'elle a été l'expression de la crise mondiale du capitalisme. Mai 68 a mis fin à une période de contre-révolution (...) la jeunesse n'en pouvait plus de la contre-révolution. On parlait alors du communisme mais la lutte de classe n'a pas permis le dépassement du capitalisme. (...) Les conditions objectives pour la révolution existaient mais il n'y avait pas de parti révolutionnaire. De nos jours, les conditions sont plus favorables qu'en 68." (Groupe Anarres dans la réunion de São Paulo)
-
"Suite à la défaite de la vague révolutionnaire mondiale, le prolétariat a été dévoyé du chemin de la révolution. (...) On disait alors que le prolétariat s'était accommodé au capitalisme et que la lutte de classe avait disparu. Le rôle de la jeunesse a été central dans le retour du prolétariat sur la scène sociale. En plus de démentir toute cette propagande bourgeoise, le ressurgissement de la lutte de classe a démontré le rôle central des pays industrialisés, contrairement à ce qui se pensait généralement suite à la révolution russe." (OPOP dans la réunion à l'université)
"Pourquoi la révolution n'a-t-elle pas eu lieu en 68 et comment faire pour qu'elle puisse se produire dans le futur ?" On peut dire que cette question a constitué une préoccupation explicite ou implicite ayant traversé le débat dans les deux réunions et à laquelle il a été répondu à travers la discussion de différents questionnements : Qu'est-ce qui a réellement changé en 68 relativement à la période précédente de contre-révolution ? Quelles ont été les limitations de Mai 68 ?
Comprendre
ce qu'a réellement été la période de contre-révolution
Pour comprendre l'importance du changement que les événements de Mai 68 ont apporté, il était nécessaire préalablement d'illustrer ce qu'avaient signifié ces 40 années de contre-révolution subies par le prolétariat. Durant cette période, celui-ci n'a jamais cessé de lutter mais toutes ses luttes, loin de participer à le dégager de l'influence de l'idéologie dominante - qui s'exprimait notamment sous la forme du nationalisme et des illusions démocratiques - et de l'emprise des syndicats, ne faisaient que les renforcer.
Par exemple, dans les luttes massives de mai-juin 1936 en France, le prolétariat, suivant les consignes du Parti "Communiste" Français, manifestait en agitant pêle-mêle les drapeaux rouges et tricolores. Le venin idéologique stalinien avait ainsi pour fonction de faire croire qu'il existait une possibilité de concilier l'intérêt national (nécessairement l'intérêt du capital) et l'intérêt du prolétariat. C'est ainsi que ces luttes, loin de participer à favoriser l'autonomie du prolétariat, ne firent que le soumettre à l'intérêt national jusqu'à son embrigadement dans un camp impérialiste lors de la Seconde Guerre mondiale. Quant à l'action des syndicats pour maintenir la lutte dans le cadre social de l'ordre bourgeois, loin de susciter la méfiance des ouvriers, elle s'était traduite par l'augmentation du nombre des syndiqués.
La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été le théâtre d'un nouveau surgissement révolutionnaire, comme cela avait le cas après la Première, mais a constitué au contraire un facteur supplémentaire de désorientation du prolétariat, notamment grâce à la victoire du camp des Alliés, célébrée comme la victoire de la démocratie sur le fascisme, alors que les deux camps étaient tout autant barbares et capitalistes l'un que l'autre.
Le poids de la contre-révolution s'est exprimé jusque dans les limitations qu'il a imprimées à une lutte réellement prolétarienne comme celle des prolétaires hongrois en 1956 qui avaient fait surgir des conseils ouvriers et participés de mettre clairement en évidence la nature anti-ouvrière du stalinisme. Cependant, contrairement à ce qui s'était passé lors de la première vague révolutionnaire, cette lutte n'a non seulement pas mis en question le pouvoir de l'État mais s'est également prononcée en faveur d'un gouvernement s'appuyant sur la police "ordinaire" (à condition qu'elle ne soit pas au service du stalinisme) et sur l'armée nationale.
En d'autres termes, les luttes du prolétariat dans cette période ne parvenaient pas à dégager une perspective de remise en question de l'ordre dominant, de son idéologie, de ses organes d'encadrement du prolétariat.
La rupture de 68
Le mouvement de 68 a apporté deux contributions inestimables :
-
faire une nouvelle fois la preuve dans la pratique de la capacité de la classe ouvrière à développer spontanément une lutte massive, non seulement sans que les partis et organisations dits ouvriers aient fait quoi que ce soit en faveur de son surgissement mais alors qu'ils avaient tout fait pour que rien ne se produise ;
-
remettre en question des "vérités" qui semblaient éternelles et qui enfermaient la classe ouvrière dans la prison idéologique de la contre-révolution. C'est ainsi que furent remis en question, par des fractions de la classe ouvrière, la nature communiste de l'Union soviétique, la nature ouvrière des partis de gauche, le rôle "ouvrier" des syndicats, etc.
En réalisant cette analyse critique de son passé, le prolétariat se réappropriait sa propre histoire : il redécouvrait qu'avaient existé les conseils ouvriers, organes de sa lutte unitaire et révolutionnaire ; qu'il y avait eu la révolution en Allemagne en 1919, après la révolution russe ; que celle-ci avait été le théâtre de confrontations entre syndicats et ouvriers et qu'elle avait finalement été défaite par l'action de la social-démocratie (traître depuis 1914) au pouvoir. Ce fut alors cette nécessité de comprendre le monde, de vouloir le changer qui animait de nombreuses discussions dans la rue, dans certaines universités transformées en forums permanents et dans certaines entreprises. Toute cette effervescence fut réellement la grande caractéristique de Mai 68.
Cela a constitué une contribution énorme à la reprise de la lutte de classe à l'échelle internationale, mais on ne pouvait exiger de cette nouvelle génération, qui avait grandement contribué à faire de Mai 68 une rupture avec la domination écrasante de la contre-révolution, qu'elle soit également capable d'imprimer une dynamique révolutionnaire, et cela d'autant plus que les conditions de celle-ci n'existaient pas encore.
Les limitations de Mai 68
En effet, en voulant défendre le caractère authentiquement prolétarien de ces événements, notamment face aux campagnes idéologiques ignominieuses de la bourgeoisie visant à défigurer Mai 68, il existe une tendance, de la part d'éléments authentiquement prolétariens et sincères, à sous-estimer certaines limitations de ces épisodes, souvent par manque d'information.
Le poids des manœuvres syndicales
Comme cela a été dit dans la présentation, un million de travailleurs sont entrés en grève avant que les consignes de la CGT appelant à la grève ne soient connues. Ce fut généralement dans les entreprises où la grève a été spontanée, occupées par l'action des ouvriers prenant leurs luttes en mains, que s'est exprimée la vie politique la plus riche et intense. Mais cela ne peut faire oublier que les autres entreprises, c'est-à-dire une majorité d'entre elles, ont été occupées à l'initiative des syndicats qui ont ainsi réussi à établir leur contrôle sur la lutte et se sont empressés de la fragmenter, mettant en place des cordons sanitaires syndicaux pour empêcher l'entrée aux éléments politisés. Les syndicats ont alors organisé des parties de ping-pong dans les usines occupées pour distraire les ouvriers et éviter ainsi qu'ils ne s'intéressent trop à la lutte et à la politique. L'ambiance n'était pas alors à l'effervescence politique mais souvent sinistre. Le contraste était énorme avec les forums permanents de certaines universités ou d'une petite minorité d'autres entreprises.
Ceci signifie qu'il existait des disparités importantes concernant ce que la classe ouvrière était en train de vivre en ces instants.
Le fait que les syndicats aient réussi à prendre le train en marche a eu pour effet d'affaiblir le mouvement spontané de développement de la lutte. Le meilleur, quant à la participation active à la lutte, se rencontrait dans certaines assemblées générales, dans les divers comités qui firent leur apparition. Mais, contrairement à ce que supposaient certaines interrogations qui se sont exprimées dans les discussions, ce processus ne parvint en aucune manière à donner naissance à des conseils ouvriers et encore moins à une situation de double pouvoir, entre bourgeoisie et prolétariat. On en était alors très loin.
Les difficultés propres aux conditions de l'époque
Beaucoup d'étudiants de cette époque qui se considéraient révolutionnaires subissaient encore pleinement des mystifications de la période de contre-révolution. C'est ainsi qu'ils considéraient également comme révolutionnaires des personnages comme Che Guevara, Ho Chi Minh ou Mao, sans percevoir que ces derniers, qui avaient été ou étaient encore protagonistes de la contre-révolution, ne se différenciaient des staliniens classiques du Kremlin que par des choix impérialistes opposés (cas de Mao), voire uniquement au niveau des apparences (Che Guevara ou Ho Chi Minh).
Une difficulté de la situation d'alors fut également la rupture très importante entre la nouvelle génération et celle de ses parents qui étaient critiqués par leurs enfants. En particulier, pour avoir dû travailler dur afin de sortir de la situation de misère, voire de faim, qui avait résulté de la Seconde Guerre mondiale, il était reproché à cette génération de ne se préoccuper que de bien-être matériel. Ceci explique le succès de fantaisies sur la "société de consommation" ou de slogans du type "ne travaillez jamais", favorisés par le faible niveau de la crise économique ouverte qui venait de faire sa réapparition.
Mai 68 n'était qu'un début
Bien que s'étant éveillée à la conscience de nombreuses réalités sociales, la classe ouvrière était loin, en 68, de pouvoir faire la révolution. A cette époque, on parlait beaucoup de révolution, mais les conditions subjectives étaient loin d'être réunies pour cela. La révolution était alors conçue comme une possibilité proche, sans que soit prise en compte la difficulté réelle du processus qui conduit à une situation révolutionnaire. A la différence de la Première Guerre mondiale, et à la différence également des confrontations qui se produiront dans le futur entre prolétariat et bourgeoisie en réaction au désastre de l'actuelle crise économique mondiale, la classe ouvrière de 1968 avait de nombreuses illusions quant aux possibilités du capitalisme de se perpétuer sans être secoué par des crises toujours plus profondes. En d'autres termes, la révolution n'était pas conçue comme une nécessité.
Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on passe d'une situation contre-révolutionnaire à une situation révolutionnaire. Il était nécessaire que s'opère une maturation générale de la conscience au sein du prolétariat en tant que conséquence de l'aggravation de la crise économique. La faillite de ce système devait rendre évidente l'impossibilité de toute amélioration en son sein mais également que lui-même représentait un danger croissant pour l'humanité. A travers tout un processus d'expériences de luttes répétées et d'illusions perdues, le prolétariat devait renforcer sa conscience de la nature des syndicats en tant qu'organes d'encadrement de ses luttes par le capital, de l'impasse électorale, du rôle contre-révolutionnaire de la gauche du capital (PS, PC) et également de l'extrême gauche (trotskistes en particulier) qui ne diffère de la première que par le radicalisme du discours. Actuellement, notre classe a déjà parcouru un long chemin dans cette direction, mais ce chemin est encore loin d'être terminé.
Des luttes significatives après Mai 68 sont venues confirmer que les événements en France n'avaient constitué que le premier pas d'une dynamique nouvelle de développement de la lutte de classe. Ainsi par exemple, les luttes de l'automne 1969 en Italie ont assumé plus explicitement la confrontation aux syndicats. La lutte des ouvriers en Pologne en 1980 a constitué la tentative la plus importante, depuis la vague révolutionnaire mondiale, de la classe ouvrière de s'organiser par elle-même.
Les
limitations de 68 sont-elles imputables à l'absence d'un
parti révolutionnaire?
Déjà implicitement présente dans de nombreux débats, cette question a été posée explicitement à São Paulo. C'est une évidence qu'il n'y avait pas de parti révolutionnaire en 68. Les petits groupes internationalistes et révolutionnaires qui existaient à cette époque et intervenaient dans le mouvement étaient ultra minoritaires (bien que leur audience les dépassait alors largement), dispersés, hétérogènes et généralement très immatures.
En réalité, la question n'est pas "qu'il manquait un parti révolutionnaire pour que la situation soit révolutionnaire" mais l'absence d'un parti révolutionnaire était l'expression de l'immaturité des conditions subjectives pour donner naissance à un tel parti et créer les conditions d'une situation pré-révolutionnaire. En effet, la dimension historique du parti révolutionnaire (qui lui permet de synthétiser l'expérience historique du prolétariat) s'appuie sur la continuité politique des organisations révolutionnaires restées fidèles à la défense des intérêts du prolétariat international. Mais le parti est également le produit de la lutte de classe ouvrière au travers de laquelle il se développe jusqu'à obtenir une influence directe sur celle-ci. En d'autres termes, sans développement de la lutte de classe capable de sécréter une avant-garde révolutionnaire conséquente, il n'y a pas de possibilité qu'existe un parti révolutionnaire. Or, comme nous l'avons vu, la période de contre-révolution n'était en rien propice à l'apparition de l'avant-garde nécessaire. Et les événements de 68 qui ont clos cette période ne pouvaient pas non plus avoir cette capacité immédiate de faire surgir un parti révolutionnaire.
Néanmoins, l'effervescence politique de 68 a constitué une ambiance propice à la cristallisation de groupes politique prolétariens cherchant à rétablir le lien avec les véritables positions révolutionnaires, à intervenir dans la lutte de classe et à oeuvrer au regroupement international des révolutionnaires. Cet acquis de 68 constitue un maillon essentiel du travail de préparation en vue de la formation du futur parti lorsque le permettra le développement de la lutte de classe au niveau international.
Comment
le prolétariat va-t-il parvenir à dépasser le poids de l'idéologie
bourgeoise ?
"Combien de temps encore le prolétariat va-t-il continuer à se manifester comme classe exploitée soumise aux intérêts du capital, avant d'exprimer son être révolutionnaire ? Va-t-il parvenir à se débarrasser de toutes les barrières idéologiques qui constituent autant d'obstacles à la lutte, comme l'individualisme, le corporatisme, etc. ?" Cette question, qui a été explicitement posée à l'université, exprime une certaine anxiété plus générale ressentie par de nombreux éléments lorsqu'ils font le constat que, 40 ans après Mai 68, la révolution n'a pas encore eu lieu.
Comme nous l'avons vu, les conditions objectives et subjectives ont beaucoup évolué depuis 1968, du fait de l'aggravation considérable de la crise économique, de la barbarie (dont la manifestation la plus explicite est la prolifération des conflits impérialistes à travers le monde), mais aussi du renforcement de la conscience de la faillite du système capitaliste, du développement de la lutte de classe, avec des hauts et des bas. Cette dynamique a connu un reflux important au niveau de la conscience du prolétariat au moment de l'effondrement du bloc de l'Est, dont le régime était mensongèrement présenté comme "communiste", ce qui a permis à la bourgeoisie de développer des campagnes sur "la mort du communisme et de la lutte de classe". Mais, depuis 2003, la maturation des conditions subjectives de la révolution a repris son cours. Non seulement il existe actuellement une simultanéité des luttes au niveau international comme il n'en avait jamais existé auparavant, affectant de nombreux pays, développés ou de la périphérie du capitalisme, mais au sein de ces luttes s'expriment aussi des caractéristiques essentielles pour le renforcement du combat de classe : solidarité active entre secteurs de la classe ouvrière, mobilisations massives, tendance à ne pas attendre, voire à ignorer, les consignes syndicales pour entrer en lutte...
Une différence importante avec Mai 68 concerne également les mobilisations étudiantes. Les étudiants qui travaillent pour pouvoir payer leurs études n'ont pas beaucoup d'illusions quant à la situation sociale qui sera la leur à la fin de leurs cursus universitaires. Par-dessus tout, ils savent que leurs diplômes leur donneront à peine le "droit" de se retrouver dans la condition ouvrière sous ses formes les plus dramatiques : le chômage et la précarité. La solidarité qu'ont exprimé les étudiants en lutte en 2006 en France contre le CPE5 envers les travailleurs est en premier la conséquence de la conscience qu'ils avaient en majorité d'appartenir au même monde, celui des exploités en lutte contre un même ennemi, les exploiteurs. Cette solidarité est très éloignée de la démarche d'origine petite-bourgeoise des étudiants de 1968 et dont témoignent entre autres certains slogans de l'époque.
Lorsqu'on évalue le niveau actuel de la lutte de classe et son évolution depuis des décennies, on ne peut se limiter à une vision photographique, dans un pays et à un instant (hors période de lutte) donnés. Il faut une vision internationale, dynamique, capable de prendre en compte le cheminement souterrain de la conscience (la vielle taupe dont parlait Marx) et qui s'exprimera ouvertement et explicitement seulement à des moments particuliers mais significatifs du futur.
Pour évaluer les perspectives, il faut également prendre en compte un facteur important : l'impact de l'idéologie bourgeoise sur le prolétariat qui détermine, d'une certaine façon, la capacité de ce dernier à se libérer ou non de tous les préjugés qui entravent le développement de sa vision historique du futur et des moyens pour assumer son être révolutionnaire. Au sein d'une période historique comme la décadence du capitalisme, depuis le début de laquelle - Première Guerre mondiale - est posée l'alternative Révolution ou barbarie, mais les conditions d'une dynamique vers des confrontations de classe n'existent cependant pas en permanence. En effet, il faut une crise ouverte du système (crise économique comme maintenant ou dans les années 1930) et le refus du prolétariat de se sacrifier au bénéfice du capital national, c'est-à-dire pour les intérêts de la bourgeoisie. La conjonction de ces deux facteurs, crise ouverte et refus de la logique capitaliste de la part du prolétariat, affaiblit l'impact de l'idéologie de la classe dominante. En effet, la base matérielle de l'idéologie bourgeoise, c'est la domination politique et économique de cette classe sur la société. Or, lorsque la crise économique vient remettre en question l'idée selon laquelle le capitalisme est un système universel et éternel, et ouvrir ainsi les yeux des exploités sur la catastrophe que représente sa domination sur le monde, alors tout ce qui peut être dit par la bourgeoisie pour défendre cette société de misère ne peut évidemment être pris pour argent comptant. Au contraire, cela ne peut que susciter l'indignation, la remise en question et la recherche d'une issue politique.
Comment le prolétariat va-t-il parvenir se débarrasser des syndicats ?
Quarante ans après 1968, cette question demeure à l'ordre du jour, comme l'a illustré le fait qu'elle ait été posée explicitement dans la réunion à l'université. Comment expliquer qu'il en soit encore ainsi alors que justement Mai 68 avait constitué une concrétisation explicite du rôle des syndicats, contre la lutte de classe et en faveur de l'ordre dominant ? Mai 68 a surpris la bourgeoisie et la première réponse de son appareil politique est venue de "la gauche", des syndicats. Si les syndicats n'avaient pas eu la capacité de prendre le train en marche, alors la situation aurait probablement connu un niveau supérieur de confrontation entre les classes. Le contrôle qu'ils ont réussi à prendre sur le mouvement a permis à la bourgeoisie de finalement faire en sorte que le travail reprenne, sans que les ouvriers aient arraché des concessions importantes (relativement à l'ampleur de la mobilisation), et que la classe ouvrière subisse ainsi une défaite. Mais ce fut une défaite riche d'enseignements, notamment concernant le rôle anti-ouvrier des syndicats, ce qui s'est traduit à l'époque par le fait que des milliers d'ouvriers aient déchiré leur carte syndicale.
Le problème est que la bourgeoisie a su tirer les enseignements de ces événements pour éviter que se reproduise une situation contraignant les syndicats à se discréditer de façon aussi importante face à la lutte de classe. De façon générale, l'ensemble de l'appareil politique de la bourgeoisie a su s'adapter, notamment ses fractions de gauche et d'extrême-gauche à travers l'adoption d'un langage plus radical, à même de tromper les ouvriers. Les syndicats aussi ont opéré une telle modification de leur attitude face à la lutte, essayant d'anticiper les mobilisations spontanées de la classe ouvrière. En plus de cela, une division du travail entre syndicats modérés et syndicats dits de "lutte de classe" a été systématiquement développée afin de mieux diviser les rangs ouvriers (une telle division s'opérant parfois au sein d'un même syndicat à travers l'opposition base/sommet). Une telle division ne correspond en rien au caractère plus ou moins "ouvrier" de certains syndicats mais uniquement aux nécessités de la stratégie anti-ouvrière de ces organes.
En réalité, la capacité des syndicats de saboter efficacement la lutte de classe dépend de leur capacité à mystifier les ouvriers. Ceci a été illustré par des expériences importantes de lutte de classe dans des pays où les syndicats ne disposent pas d'une telle capacité de mystification et apparaissent directement pour ce qu'ils sont : la police de l'État chargée d'affronter la lutte de classe. L'exemple le plus célèbre demeure à ce jour celui de la Pologne en 1970, 1976 et surtout 1980 où les luttes ont atteint un niveau tel que la bourgeoisie stalinienne s'est trouvée dans l'obligation d'autoriser la création d'un "syndicat indépendant" (Solidarnosc) ayant pour mission de faire reprendre le travail aux ouvriers.
Plus récemment, ces deux dernières années, des luttes de grande envergure se sont développées en Egypte, notamment dans l'industrie textile où les ouvriers ont dû s'organiser au-delà du secteur pour faire face à l'ennemi (aussi bien contre les syndicats que contre l'armée et la police de l'Etat dans la lutte revendicative.
En plus de limiter les possibilités de développement des luttes, en bloquant leur auto-organisation et leur extension, l'action permanente des syndicats contribue pour beaucoup à empêcher que la classe ouvrière prenne confiance dans sa capacité à prendre en charge ses propres luttes, et plus généralement dans sa capacité à acquérir la conscience qu'elle représente une force énorme dans la société. Tout ceci explique en quoi l'obstacle syndical est essentiel sur le chemin du développement de la lutte de classe.
Cependant, il n'est pas insurmontable et l'accélération de la crise économique, une fois de plus, joue en faveur de la lutte de classe, obligeant les syndicats à s'impliquer toujours davantage dans des manœuvres de sabotage des luttes. Or, plus la classe ouvrière est déterminée à assumer les nécessités de la lutte unie au-delà des secteurs et contrôlée par les ouvriers eux-mêmes, et plus les syndicats tendront à être démasqués. La base ouvrière sur laquelle s'appuie le syndicalisme des pays industrialisés démocratiques et qui lui permet de mystifier le prolétariat se trouve chaque fois plus dans l'obligation de devoir choisir son camp. Une partie de cette base renouera alors avec le processus des années 1970 et 1980 de sortie des syndicats et de leur influence.
Des mouvements de classe de grande ampleur étaient contenus dans la perspective ouverte par Mai 68 mais, à cette époque, ils n'étaient pas encore à l'ordre du jour.
Les questions et préoccupations mises en avant durant les débats6 que nous venons de relater expriment, selon nous, la maturation des conditions subjectives qui prépare ces mouvements futurs. Nous ne pouvons qu'encourager nos lecteurs à prendre en charge de tels débats autours d'eux. Quant à nous, nous saurons toujours nous montrer disponibles pour y participer sous une forme ou une autre.
(5 mai 2008)
1 A Vitória da Conquista.
2 Organisation dont nous avons déjà indiqué l'existence dans certains articles de notre presse, notamment Salut à la création d'un noyau du CCI au Brésil ! [53] ; Révolution Internationale n°38.
3 Organisation dont nous avons déjà indiqué l'existence sous le nom "Groupe de Santos" dans l'article cité dans la note précédente.
4 Extrait du document en portugais à partir duquel a été introduit le débat: Mai 68 et la perspective révolutionnaire [54].
5 Lire notre article Thèses sur le mouvement des étudiants du printemps 2006 en France [55], Revue Internationale n° 125.
6 Toutes n'ont pu être répercutées au sein de cet article notamment lorsqu'elles tendaient à s'écartaient du thème initial. Nous voulons cependant signaler une préoccupation qui s'est exprimée à propos de la Chine concernant les perspectives de développement de la lutte de classe dans ce pays et une autre relative à la situation actuelle en Amérique latine.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Mai 1968 [2]
Sabotage des lignes SNCF : des actes stériles instrumentalisés par la bourgeoisie contre la classe ouvrière
- 7952 reads
De nombreux commentaires ont paru sur nos sites en français et en espagnol suite à la publication de cet article. Nous avons publié un texte de réponse [56] à une partie des questions qui nous sont posées.
En six mois, les lignes ferroviaires de la SNCF ont été touchées à une douzaine de reprises par des actes de sabotage. Chaque fois s'en est suivie la même galère pour les passagers : des heures d'attente en gare ou en pleine voie, suite à la paralysie du trafic.
Début novembre, l'état français prévient : il va frapper fort ! Il exige de la police une enquête rapide et de la justice la plus grande sévérité. Ainsi, le 8 novembre, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, demande que "tous les moyens, notamment de police technique et scientifique, soient mobilisés au service des investigations" et la ministre de la Justice Rachida Dati donne des "instructions de fermeté aux procureurs généraux". Hasard incroyable, à peine 48 heures après ces injonctions ministérielles, la police parvient à mettre la main sur les "coupables", un groupe de dix personnes se réclamant de la mouvance "anarcho-autonome"1 et installé à Tarnac, en Corrèze, au fin fond de la campagne française ! Tout cela pue la manipulation à plein nez ! D'ailleurs, en réalité, ce groupe était sous étroite surveillance depuis des mois. Le journal Le Monde du 11 novembre avoue ainsi : "Ce groupe faisait l'objet d'une surveillance de la sous-direction de la lutte anti-terroriste de la police judiciaire depuis plusieurs mois, sur instructions de Michèle Alliot-Marie. Une enquête préliminaire avait même été ouverte par le parquet de Paris depuis avril." Tout le cirque médiatico-judicaire actuel autour de ces présumés "terroristes" est donc le fruit d'une longue préparation opérée en amont par la bourgeoisie. A la lumière de ces derniers événements, les propos de Michèle Alliot-Marie (encore elle) de février 2008 prennent ainsi tout leur sens : "Depuis plusieurs mois, j'étais encore ministre de la Défense, j'ai souligné les risques d'une résurgence violente de l'extrême gauche radicale".
Il n'y a donc aucun doute à avoir, qu'ils soient réellement coupables ou non des actes dont l'État français les accuse, ces "autonomes" n'ont été en réalité que des marionnettes dans les mains de la bourgeoisie. La vraie question est donc pourquoi ? Pourquoi les avoir laissé faire pendant des mois ? Et pourquoi les arrêter en grande pompe aujourd'hui en les traitant comme les pires des criminels ?
Des actes impuissants contre la domination de la bourgeoisie
Ce petit groupe "d'autonomes" est en train d'être broyé par la machine judiciaire. La bourgeoisie qui cyniquement leur a tendu un piège pendant des mois se jette sur ces proies faciles aujourd'hui comme des hyènes enragées avec tout son arsenal répressif. Ainsi, pour avoir (peut-être) bloqué des trains et mis une belle pagaille, cette poignée d'éléments déclassés (bien que provenant d'un milieu familial aisé, insiste lourdement la propagande pour mieux les discréditer) se retrouvent accusés aujourd'hui "d'actes de terrorisme" et "de recours organisé à la lutte armée" contre l'État, encourant des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ! Rien de moins !
Il est possible que ceux qui ont commis ces sabotages pensaient, par ces actes spectaculaires et symboliques, réveiller les consciences et démontrer que le système est finalement vulnérable, etc. Dans une certaine mesure, il y a chez ces éléments l'expression d'un sentiment de révolte brute et désespérée contre l'inhumanité de ce système. Mais en se fourvoyant dans de tels actes stériles qui ne représentent pas plus qu'une piqûre de moustique sur une peau d'éléphant, ces éléments n'ont fait, surtout, que révéler leur propre impuissance. Il s'agit d'éléments déboussolés mus par une révolte avant tout individualiste et qui se livrent à des actions absurdes. Commettre de tels actes ne relève pas seulement de la naïveté mais aussi et surtout de la stupidité. En réalité, de telles actions n'ont aucune chance de réveiller la moindre conscience au sein de la classe ouvrière. Elles ne font que souligner le désespoir impuissant et l'isolement de leurs auteurs. En fait, s'imaginer que de tels actes, émanant par nature d'une infime minorité, pourraient participer de la lutte contre le système d'exploitation relève d'une bonne dose de mégalomanie. De tels actes de sabotage n'ont rien à voir avec les méthodes de lutte de la classe ouvrière. Ces méthodes désespérées sont complètement étrangères et totalement aux antipodes des luttes collectives et solidaires de cette dernière.
Ainsi, si nous dénonçons la répression de l'État bourgeois qui s'abat aujourd'hui sur ces déclassés surveillés et manipulés, nous rejetons aussi sans ambiguïté leurs hypothétiques actes de sabotage.
Des actes toujours utilisés contre la classe ouvrière
En fait, ces éléments n'ont fait que servir ceux-là même contre qui ils croyaient lutter. Quels qu'ils soient, les acteurs de ce sabotage servent effectivement parfaitement les intérêts de la bourgeoisie. C'est pourquoi il y a eu une telle publicité médiatique autour de cette affaire, c'est pourquoi aussi la police a laissé s'enferrer ces éléments durant des mois. La bourgeoisie a manipulé ce petit groupe "d'autonomes" afin de lancer une vaste campagne idéologique cette fois dirigée contre toute la classe ouvrière.
En assimilant aujourd'hui la lutte ouvrière au terrorisme, et en justifiant ainsi que s'abatte sur ceux qui prétendent lutter contre le système capitaliste la plus impitoyable des répressions, elle prépare les esprits à la répression des combats ouvriers futurs. En s'appuyant sur ce bourrage de crâne actuel, elle espère pouvoir réprimer en toute liberté d'éventuelles luttes à venir, au moindre dérapage, au nom du maintien de l'ordre public. Et s'il n'y a pas de dérapages, elle les créera elle-même. Il s'agira ici de la répétition d'un autre grand classique de la bourgeoisie : infiltrer ses agents dans les manifestations pour jouer aux casseurs et justifier l'envoi des forces de l'ordre. Il faut d'ailleurs prêter l'oreille aux propos d'un "expert", vieux maître en coups fourrés de la bourgeoisie italienne qui, au moment où se développent aujourd'hui des luttes en Italie notamment dans les universités2, a livré cette clé dans une interview :
"Président Cossiga, pensez-vous qu'en menaçant d'utiliser la force publique contre les étudiants, Berlusconi ait exagéré ?
Cela dépend, si on pense être le président du conseil d'un État fort, non, il a très bien fait. Mais puisque l'Italie est un État faible et qu'il n'y a pas dans l'opposition le parti de granit qu'est le PCI mais l'évanescent PD, je crains que les faits ne suivent pas les paroles et qu'en conséquence Berlusconi fasse d'autant plus triste figure.
Quels sont les faits qui devraient suivre ?
Maintenant, Maroni (actuel ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Berlusconi, NDLR), devrait faire ce que j'ai fait quand j'étais moi-même ministre de l'intérieur".
C'est-à-dire ?
Laisser faire. Retirer les forces de police de la rue et de l'université, infiltrer le mouvement avec des agents provocateurs prêts à tout, et faire que pendant une dizaine de jours les manifestants dévastent les magasins, incendient des voitures et mettent les villes à feu et à sang".
Et après ?
Après quoi, fort du consensus populaire, le bruit des sirènes des ambulances devrait couvrir celui des autos de la police et des carabiniers".
Dans le sens où... ?
Dans le sens où les forces de l'ordre devraient massacrer les manifestants sans pitié et tous les envoyer à l'hôpital. Ne pas les arrêter pour qu'ensuite les magistrats les remettent tout de suite en liberté, mais les blesser jusqu'au sang et blesser aussi ces enseignants qui les agitent".
Même les enseignants ?
Surtout les enseignants. Pas les vieux, bien sûr, mais les tout jeunes maîtres oui. Se rend-on compte de la gravité de ce qui se passe ? Ce sont les enseignants qui endoctrinent les enfants et les font descendre dans la rue : c'est un comportement criminel !"3.
Tout cela ne fait-il pas étrangement penser aux faux casseurs et vrais provocateurs qui, en novembre 2007, au moment de la lutte des cheminots contre la réforme de leur système de retraite, se sont livrés à des actes similaires de sabotage des voies ferrées permettant de faire passer les cheminots pour des "terroristes" assoiffés de sang et de meurtre alors même qu'une sympathie était née dans les rangs ouvriers pour cette grève4 ?
La bourgeoisie est parfaitement consciente que la perspective est au développement des luttes, que face à la crise économique, la classe ouvrière ne va pas subir les attaques et la paupérisation sans réagir. Cette tendance au retour et au développement de la lutte de classe inquiète tous les gouvernements qui s'y préparent en modernisant et en renforçant particulièrement les appareils de surveillance policière et de répression, en France, en Italie comme partout ailleurs.
Une campagne amalgamant terroristes et révolutionnaires
Mais la perfidie de ce battage orchestré va plus loin encore : elle sert aussi à la bourgeoisie à faire l'amalgame entre les terroristes et les révolutionnaires. Elle vise à assimiler aux "actes terroristes", les paroles et les organisations de tous ceux qui rejettent l'État capitaliste, le parlementarisme bourgeois, l'action syndicale. Terroristes et révolutionnaires sont tous mis dans un même sac baptisé "ultragauche" : "SNCF : le retour de l'ultragauche activiste", "L'ultragauche déraille", "Sabotages SNCF : dix arrestations dans l'ultragauche",... 5 De tels titres se trouvent par dizaines dans la presse ou dans les journaux télévisés6. Et pour couronner le tout, la bourgeoisie insiste lourdement dans cette campagne de calomnies sur les liens internationaux qu'entretiendraient des "terroristes d'ultragauche". En suggérant ainsi la thèse "d'un complot terroriste international", la bourgeoisie cherche à dresser des barrières idéologiques contre le caractère international de la lutte de classe et à distiller la pire défiance envers le caractère tout aussi nécessairement internationaliste des organisations révolutionnaires.
Là aussi, elle justifie ainsi d'éventuelles répressions dans l'avenir. Mais surtout, elle tente de créer dès maintenant une espèce de cordon sanitaire idéologique autour des positions révolutionnaires. Elle agite le terrorisme comme un épouvantail pour décourager les ouvriers de s'approcher de tout individu brandissant dans la rue un journal dont les titres évoquent la révolution (comme c'est le cas, par exemple, de notre journal mensuel Révolution Internationale).7
Voilà l'intérêt de l'amalgame dans une même nébuleuse qualifiée d'"ultra-gauche" entre les positions des révolutionnaires internationalistes soutenant le développement de la solidarité et des luttes ouvrières afin de renverser, à terme, le capitalisme et une "mouvance anarcho-autonome" constituée de révoltés prônant le sabotage et l'action directe individualiste. La bourgeoisie essaye de faire passer pour des terroristes, à criminaliser préventivement, tous ceux qui cherchent à critiquer la domination du capitalisme et à développer le combat contre lui. On instille la défiance envers eux dans le reste de la population et dans la classe ouvrière en particulier. Il est d'ailleurs ici intéressant de voir comment le pouvoir en place, la droite pure et dure de Sarkozy, a à cœur de démarquer par contre cette ultra-gauche honnie de l'extrême gauche, démocratique et respectable. Dans une dépêche du 16 novembre, Michèle Alliot-Marie (toujours elle), tout en estimant l'ultra-gauche en France à 300 personnes, n'oublie pas d'ajouter qu'Olivier Besancenot (le leader actuel de l'extrême gauche) n'est pas de cette espèce, en insistant bien sur le fait que LUI accepte le "débat démocratique". Le message est clair et nous pourrions le sous-titrer ainsi : "Ouvriers, vous qui voulez lutter pour vos conditions de vie, faites attention de ne pas tomber entre les griffes des terroristes de l'ultra-gauche, dirigez-vous plutôt vers des partis responsables comme le NPA". Au passage, ce soutien de la droite révèle la vraie nature de classe (bourgeoise) des organisations d'extrême gauche, ces "premiers opposants à la politique de Sarkozy" !
Le terrorisme ne fait pas partie des méthodes de lutte de la classe ouvrière8. Il est toujours un jouet dans les mains de la classe dominante pour alimenter ses propagandes mensongères et justifier la mise en avant de son arsenal répressif contre son véritable ennemi : le prolétariat.
Non au terrorisme !
A bas la terreur de l'État bourgeois !
Vive la lutte unie et solidaire de toute la classe ouvrière !
CCI, le 17 novembre 2008
1 Cette "mouvance autonome" est extrêmement floue : elle a connu un certain succès d'abord en Italie où plusieurs "groupes autonomes" se sont formés au cours des luttes au printemps et à l'automne 1977, souvent sur les débris des groupes staliniens pro-maoïstes ou en rupture avec le "compromis historique" prôné par le PCI et les centrales syndicales. En France, elle s'est également développée à la même époque s'illustrant notamment lors de la lutte "anti-nucléaire" contre la construction de la centrale de Creys-Malville ou lors de l'occupation du quotidien Libération. Cependant, c'est dans le milieu anarchiste que cette mouvance activiste a connu le plus de succès ; non seulement elle prône l'affrontement violent avec la police dans les manifestations de rue mais elle met en avant la théorisation anarchisante des actions de sabotage destinées à servir symboliquement d'exemple et à défier ou perturber les rouages de l'État. Beaucoup dans cette nébuleuse "autonome" n'ont pas clarifié l'ambiguïté de leurs rapports avec les véritables groupes terroristes paramilitaires des années 1970 marqués par le gauchisme et le stalinisme, que ce soit la RAF en Allemagne, les Brigades Rouges en Italie, les GARI en Espagne, les NAPAP ou Action Directe en France, même s'ils rejettent aujourd'hui catégoriquement le recours au meurtre.
2 Pour le contexte de cette interview, voir notre article sur les manifestations actuelles contre les réformes de l'Instruction publique en Italie.
3 Interview de Cossiga par Andrea Cangini du jeudi 23 octobre 2008 : "Il faut les arrêter, le terrorisme part aussi des universités" publié dans Quotidiano Nazionale.
4 Cette campagne est d'ailleurs internationale comme en témoigne la propagande actuelle des médias envers le film allemand récent sur la "Bande à Baader".
5 Respectivement dans Le Figaro du 14 novembre, sur M6 (chaîne de télévision) le 11 novembre, dans Le Parisien du 11 novembre.
6 En France, le livre de référence définissant "l'ultragauche" est celui de Christophe Bourseiller nommé Histoire générale de l'ultragauche Et en bonne place, dans ce fourre-tout infâme, se trouve la Gauche communiste et donc évidemment le Courant Communiste International. D'ailleurs sur un plateau de télévision sur la 5, un autre "spécialiste de l'ultragauche" a affirmé que le terrorisme actuel des autonomes trouvait ses racines dans le "bordiguisme" des années 1920, qui en tant que Gauche d'Italie constitue une des fractions qui se sont dégagées de la 3e Internationale gangrenée par la contre-révolution stalinienne et dont le CCI revendique l'héritage révolutionnaire. Pour comprendre pourquoi nous ne faisons absolument pas partie de cette pseudo-"mouvance ultragauche", lire notre article "A propos du livre de Bourseiller [57]'Histoire générale de l'ultragauche' [57]".
7 A plusieurs reprises, lors d'actions "terroristes" médiatisées, des membres de notre organisation ont eu à répondre à la question (posée par des passants ou des collègues de travail ayant une vague idée de leurs convictions révolutionnaires) : "Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec ces attentats ?".
8 Cette position de base, nous l'affichons au dos de chaque numéro de la presse du CCI et nous la rappelons ici : "Le terrorisme n'est en rien un moyen de lutte de la classe ouvrière. Expression de couches sociales sans avenir historique et de la décomposition de la petite bourgeoisie, quand il n'est pas directement l'émanation de la guerre que se livrent en permanence les États, il constitue toujours un terrain privilégié de manipulation de la bourgeoisie. Prônant l'action secrète de petites minorités, il se situe en complète opposition à la violence de classe qui relève de l'action de masse consciente et organisée du prolétariat."
Géographique:
- France [34]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Terrorisme [58]
Un débat à EKS sur la grève à Türk Telekom en Turquie
- 3611 reads
Nous publions ici une série de quatre articles traduits du turc par les camarades de Enternasyonalist Komünist Sol (EKS), concernant la grève qui a eu lieu à Türk Telekom fin 2007.
Le premier a été écrit au début de la grève. Il analyse brièvement les forces en jeu dans le conflit.
Le second couvre la fin de la grève considérée ici comme une victoire pour les travailleurs (cette grève de 44 jours s'est achevée avec une augmentation de salaire de 10%).
Les deux articles suivants ont été publiés comme faisant partie d'un débat au sein du EKS quant à la vraie nature de la fin de la grève : le camarade Temel avance qu'en dépit des apparences, la grève a en fait été une défaite, alors que la réponse du camarade Devrim revient à l'analyse originelle de cette grève et sur les critiques du camarade Temel pour conclure que, quelles qu'en aient été ses faiblesses, la grève fut au contraire une victoire tant sur le plan économique que politique. Nous considérons que le débat exprimé dans ces deux articles est un débat important pour la classe ouvrière dans son ensemble.
Non seulement la question de ce qui constitue ou pas une victoire pour les travailleurs est posée, mais elle l'est dans un contexte général qui devrait attirer l'attention des travailleurs et des communistes du monde entier. Pour la majorité des travailleurs dans les grands centres industriels à travers le monde, la guerre impérialiste sert de toile de fond tendue en permanence sur le théâtre de nos vies, comme un rappel permanent de cet énorme mensonge, la promesse " d'un monde de paix et de prospérité " faite après l'effondrement du bloc de l'Est, mais elle n'est pas un enjeu immédiat dans nos vies quotidiennes. Et pourtant la question de la guerre et l'attitude à adopter par rapport à la guerre est pour les travailleurs turcs un enjeu immédiat et brûlant : la classe dirigeante turque mène une guerre plus ou moins permanente contre sa population kurde depuis les années 1980 et les opérations militaires autorisées fin 2007 n'ont été en aucun cas les premières incursions que l'armée turque a effectuées dans le nord de l'Irak (Kurdistan). De plus, à la différence des armées américaine et britannique combattant en Irak, l'armée turque est constituée essentiellement de conscrits. L'horreur et la brutalité de la guerre est un traumatisme quotidien pour les travailleurs dont les fils, frères, pères et maris se battent et meurent dans ce conflit sanglant mais dont on ne parle que très peu (voir le rapport de EKS sur l'invasion de l'Irak sur notre site web ou dans notre journal Révolution Internationale n° 392 de juillet-août 2008). L'attitude des travailleurs turcs revêt ainsi la plus grande importance pour les travailleurs et les communistes du monde entier et nous voulons commenter ici certains des arguments avancés dans les différents articles, afin de contribuer au débat.
Temel se demande tout d'abord " si les conditions nécessaires pour qu'une grève soit déclenchée étaient réunies ", et il est tout à fait vrai que les révolutionnaires ont besoin de se faire une idée précise de l'équilibre des forces (les ouvriers sont-ils plus ou moins dans une position de force face au patronat, par exemple) quand ils entrent en lutte. Cependant les critères qui permettent de juger de la force de cette grève restent certainement à définir.
-
La grève " n'avait pas été suffisamment préparée ". Mais comme la réponse à l'article de Temel le précise, comment est-il possible de le faire dans un contexte de capitalisme en décadence, quand les syndicats- les seules organisations permanentes à exister au sein de la classe ouvrière - sont du côté du patronat ? Temel ne pose pas la question de comment procéder pour préparer une grève. Alors que d'une façon générale nous sommes d'accord avec la réponse de Devrim sur ce point, nous pourrions dire qu'il y a peut-être une sous-estimation de certaines potentialités en ce domaine dans la situation actuelle. Dans les conditions actuelles qui voient s'accroître la méfiance de la classe ouvrière à l'égard des syndicats - phénomène que nous pensons, de manière générale, être mondial - de petits groupes de travailleurs mécontents des syndicats émergent à la fin de nombreuses grèves, décidés à se préparer plus efficacement pour la grève suivante. Au cours des années 1980, cela a conduit (du moins en Europe occidentale) à la création de comités de lutte dans certaines entreprises, dans lesquels les travailleurs les plus avancés, les plus conscients politiquement, pouvaient se rencontrer afin de tirer les leçons des grèves précédentes et préparer l'intervention d'un noyau ouvrier radical dans les assemblées générales des grèves à venir. En fait, cette sorte de " préparation " est possible aujourd'hui, et pousser à la création de tels groupes, voire même en faire partie, constitue une part importante de l'intervention révolutionnaire dans de tels contextes.
-
Les ouvriers " n'ont obtenu que 10% ". Il est vrai qu'avec l'inflation qui est montée à 9,8% en 2007 (selon les chiffres de la CIA), une augmentation de 10% ne représente pas grand-chose. Mais c'est certainement mieux que rien, ce qui aurait été le cas sans la grève, ou que les 4% proposés à l'origine, surtout dans une période d'approfondissement de la crise économique. Ces questions sont communes à la plupart des grèves dans les pays industrialisés aujourd'hui. Mais le point que nous considérons comme le plus important est la réaction des travailleurs de Türk Telekom par rapport à la guerre. Il faut tout d'abord éviter un faux débat : les ouvriers de Türk Telekom ne se sont pas mis en grève pour protester directement contre la guerre ; de même que cela n'aurait été possible, à notre avis, qu'avec un bien plus haut degré de militantisme et de conscience de classe que celui qui existe en cette période. Nous devons seulement nous imaginer ce que représente pour des masses de travailleurs de se mettre en grève consciemment contre des opérations militaires de l'état bourgeois : en effet, cela signifie que la classe ouvrière remet en question le pouvoir et le droit de diriger de la bourgeoisie, et ceci ne peut se produire que dans un contexte révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, précisément parce qu'est posée la question du pouvoir. Dans le contexte de la Turquie d'aujourd'hui, la vraie question est de savoir si les travailleurs sont prêts à renoncer à la lutte pour la défense de leurs propres intérêts afin de ne pas nuire aux intérêts de la machine de guerre de la bourgeoisie. Nous sommes entièrement d'accord avec la réponse à Temel quand nous lisons que : " S'il y avait eu une reprise spontanée du travail afin de maintenir le bon fonctionnement du système Telecom en temps de guerre, cela aurait été un désastre absolu. Et cela ne s'est pas produit. En fait, les travailleurs ont maintenu la grève alors même que les médias et divers membres de la classe politique leur répétaient qu'ils agissaient contre l'intérêt national. Il faut applaudir cela. " Que les travailleurs continuent à défendre leurs droits, en dépit de l'agitation des médias bourgeois en faveur de la guerre, ne suffit pas en soi à empêcher la guerre impérialiste - l'armée turque a quand même envahi le Kurdistan - mais cela met un frein à l'éclatement généralisé de la guerre. C'est le soubassement indispensable au développement d'une plus forte conscience au sein de la classe de l'antagonisme qui existe entre les intérêts de la nation bourgeoise et les leurs.
Pour finir, nous tenons à exprimer chaleureusement notre entier accord avec l'esprit qui a régi et continue de régir ce débat mené par les camarades d'EKS : " Débattre des vraies questions auxquelles les travailleurs doivent faire face ne peut qu'aider au développement des organisations communistes ", et nous pourrions ajouter, plus largement, au développement de la conscience et de la réflexion du prolétariat dans son ensemble.
CCI
Grève à Türk Telekom
La vraie question politique en Turquie aujourd'hui
La grève actuelle menée par 26 000 travailleurs des télécommunications chez Türk Telekom démontre clairement ce que sont pour la classe ouvrière les vraies questions politiques en Turquie aujourd'hui. Alors que le gouvernement tente d'attirer l'intérêt de la population sur le référendum et les guerres permanentes au Sud-Est de la Turquie, la classe ouvrière a posé le problème sans ambiguïté : pour nous la vraie question est celle du salaire des ouvriers.
Les représentants de la bourgeoisie sont très clairs sur ce point. Si certains ne l'ont pas compris, Paul Doany, PDG de Türk Telekom, l'énonce sans détour : " Aucun employé ne doit compter sur une augmentation au-dessus du taux d'inflation ". Ce qui signifie qu'ils aimeraient que chaque employé ne reçoive qu'une augmentation inférieure au taux de l'inflation, c'est-à-dire que chaque employé ait une diminution de revenus.
La vraie question est de savoir si des travailleurs organisés peuvent essayer d'arrêter les attaques continuelles contre les conditions de vie qui ont eu lieu ces dix dernières années. Pour les communistes et pour tous les travailleurs, c'est la question essentielle aujourd'hui.
Calomnies de tous bords contre les travailleurs
Bien sûr, chacun s'attend à ce que la presse capitaliste attaque les travailleurs. Elle continuera à publier des histoires comme celle du regrettable décès de Aysel Tosun1. L'une des choses que nous trouvons pourtant vraiment étranges, c'est le fait que ce décès unique bouleverse autant les commentateurs politiques alors qu'ils soutiennent avec grand enthousiasme les préparatifs de guerre meurtriers dans le Sud-Est.
Ce à quoi beaucoup ne s'attendaient vraiment pas, c'était au discours de "leurs" dirigeants syndicaux. Ali Akçan, dirigeant d'Haber-İs2, a été prompt à rejoindre les possédants pour condamner les actes de sabotage des ouvriers: " C'est de la calomnie. Notre syndicat n'a rien à voir avec aucun de ces incidents. Trouvons les coupables et punissons les ensemble. " La grève ne date que de quelques jours et déjà les syndicats se proposent de travailler avec la police pour attaquer les travailleurs militants. Pour nous, la question est claire : nous soutenons les luttes de la classe ouvrière pour défendre ses conditions de vie, et si cela veut dire couper quelques câbles téléphoniques, eh bien, qu'ils soient coupés ! Ceux qui s'empressent de rejoindre la direction pour condamner les ouvriers prouvent à quel bord ils appartiennent.
A quel côté appartiennent les syndicats ?
Devrions-nous être surpris par la réaction de "nos" leaders syndicaux. Après tout le discours militant de l'an passé, la seule action proposée par le KESK3 a été une journée "sans travailler". Les syndicats considèrent que leur rôle est de faire la promotion de la paix sociale et de se soumettre aux patrons. A la fin de la grève de THU4, Salih Kılıç a déclaré : " Je considère comme un honneur d'apposer ma signature sous ce contrat ". Oğuz Satıcı, président de l'Assemblée des Exportateurs Turcs, a parfaitement exprimé la position des capitalistes : " La sagesse et la conscience ont gagné, la Turquie a eu ce qu'il y a de meilleur ". Nous disons, nous, qu'après une décennie de défaites, il est temps pour les travailleurs de ce pays d'arrêter de faire passer la Turquie en premier, il est temps de commencer à privilégier leurs conditions de vie. Quand les patrons déclarent que " la Turquie a eu ce qu'il y a de meilleur ", ils veulent dire que les travailleurs se sont fait avoir. Quiconque trouve " un grand honneur " à contresigner des documents qui confirme cet état de fait est un ennemi de classe.
Aller de l'avant
Si les travailleurs ne peuvent placer leur confiance dans "leurs propres" syndicats, en qui peuvent-ils avoir confiance ? La réponse est : le seul ami d'un travailleur est un autre travailleur. Les travailleurs des Télécoms doivent former des comités pour contrôler leur propre grève et ne pas la laisser aux mains des syndicats qui ressentiront "un grand honneur" à les vendre aux patrons. Beaucoup de travailleurs à travers la Turquie veulent se battre. THY et les fonctionnaires ont prouvé cette volonté en début d'année. Aujourd'hui les ouvriers de Telekom se dressent fièrement à la tête de la classe ouvrière turque. Il ne revient pas qu'à eux, mais aussi à tous les travailleurs, de faire en sorte qu'ils n'y restent pas seuls. Nous affirmons que pour soutenir les grévistes de Telekom, tous les travailleurs doivent lutter contre les réductions de salaire de façon concrète dans leurs entreprises.
Devrim
Victoire pour les grévistes de Türk Telekom
L'article des camarades de Enternasyonalist Komünist Sol [59] qui suit dresse le bilan de la grève très importante qui a eu lieu chez Türk Telekom fin 2007. Au-delà de l'importance de cette grève par elle-même et des leçons que l'on peut en tirer, les camarades d'EKS ont raison d'insister sur son importance dans le contexte actuel de nationalisme guerrier rampant et de la ligne de classe nette qui sépare la direction du syndicat Haber-İş des travailleurs, déterminés à défendre leurs propres conditions de vie. La défense nationale et l'intérêt des travailleurs ne sont pas compatibles !
La grève massive menée par plus de 26 000 ouvriers de Türk Telekom est terminée. Au bout de 44 jours, les grévistes sont retournés au travail. Une perte de 1 100 000 journées de travail en fait la plus grande grève de l'histoire de la Turquie depuis la grève des mineurs de 1991. Il est temps de dresser le bilan des événements.
La première leçon, et la plus importante, que l'on peut en tirer est que les travailleurs sont capables de protéger leurs conditions de vie par la lutte. L'offre de 4% faite à l'origine par Türk Telekom était bien inférieure aux prévisions du taux d'inflation de 7,7% pour la fin de l'année. En fait, ce que Türk Telekom offrait était une réduction de salaire.
L'accord de 10% cette année et de 6,5% plus l'inflation l'an prochain est certainement une énorme victoire. Arrivant peu de temps après que les travailleurs de THY aient obtenu une augmentation de 10%, cela envoie un message clair à tous les travailleurs de Turquie. L'unité et l'action collective sont les seuls moyens de protéger les salaires de l'inflation.
Cela montre clairement à tous les travailleurs le chemin à suivre et particulièrement aux employés du secteur public à qui le gouvernement a fait l'insulte de proposer une augmentation de 2%. Toute augmentation inférieure à l'inflation est une réduction de salaire. Dans beaucoup de domaines, le secteur public est prédominant en Turquie. De nombreuses familles ouvrières ont au moins un de leurs membres qui travaille pour l'Etat. Une victoire dans ce secteur serait une victoire pour tous les travailleurs du pays.
La seconde leçon à tirer concerne ceux qui ont été accusés d'actes de sabotage. C'est un point positif que tous les employés qui avaient été renvoyés pendant la grève aient été réembauchés. Cependant ces travailleurs sur qui pèsent des charges de sabotage ne pourront reprendre définitivement leur poste que s'ils sont reconnus innocents. Contrairement à la classe dirigeante, aux médias des patrons et aux syndicats, nous refusons de condamner des ouvriers qui se sont battus pour défendre leurs conditions de vie. Il est essentiel que tous les travailleurs de Telekom débattent de comment réagir si ces travailleurs sont jugés coupables d'actes de sabotage et sont renvoyés.
La leçon suivante concerne les allégations de traîtrise. Le dirigeant de Haber-İş, Ali Akcan, s'est empressé de prétendre que les ouvriers en grève n'étaient pas des "traîtres" et que si le pays l'exigeait, dans l'éventualité d'une guerre, les grévistes feraient "leur devoir". Pour nous, il est tout à fait évident que la classe ouvrière de ce pays a placé les intérêts de la nation avant les siens propres depuis bien trop longtemps. La classe ouvrière a payé la guerre nationale du Sud-Est non seulement par des années d'inflation et d'austérité, mais aussi par le sang et la vie de ses enfants. Le temps est venu, en tant qu'ouvriers, de placer nos intérêts en premier.
La leçon finale concerne la classe ouvrière dans son ensemble. Les ouvriers de Telekom se sont battus seuls. Même quand il y avait des piquets de grève sur les lieux de travail, les employés de bureau des Postes travaillaient. Et pourtant, ce pourquoi les travailleurs de Telekom luttaient, la défense des salaires contre l'inflation, concernait la classe ouvrière toute entière. Les syndicats enferment les travailleurs dans leurs secteurs respectifs. Si à eux seuls les travailleurs de Telekom ont obtenu 10%, combien auraient-ils pu gagner s'ils s'étaient battus avec les ouvriers des Postes ? Et aussi si les autres travailleurs du secteur public s'étaient joints à la lutte? Les travailleurs doivent éviter de rester isolés dans leur propre secteur ; ils doivent appeler d'autres secteurs à les rejoindre. Si les grévistes étaient allés chercher les ouvriers des Postes et les avaient convaincus de les rejoindre dans la grève, la victoire aurait été à la fois plus grande et plus rapide.
L'inflation ne va pas disparaître ; la banque centrale a de nouveau révisé ses prévisions à la hausse. Non seulement les travailleurs du secteur public devront se battre pour défendre leurs salaires contre les réductions, mais les ouvriers de Telekom devront se remettre en lutte dans un futur plus ou moins proche pour défendre leur victoire d'aujourd'hui. Et le meilleur moyen pour cela est de se battre tous ensemble.
EKS
Telekom : Autopsie d'une grève
Il s'agit ici de l'article de Temel qui a suscité un débat à l'intérieur d'EKS et auquel Devrim répondra dans le quatrième article de cette série.
Quand le patronat turc s'est réveillé le matin du 28 novembre, il a compris que les choses ne fonctionnaient pas comme d'habitude. Les lignes de la bourse d'Istanbul étaient coupées à cause d'un accident sur un chantier de construction, et comme il y avait une grève à ce moment là chez Türk Telekom, aucun technicien n'a pu être envoyé dans l'entreprise de construction et ainsi la première session de la bourse n'a pas pu ouvrir. Cela a amené Ali Bahçucav, président de la société des investisseurs en bourse, un représentant du capital financier, à élever très haut le ton et d'une façon tout à fait convaincante. Selon Bahçucav, soit l'administration de Telekom devait " résoudre le problème, soit Telekom devait à nouveau être nationalisée ". Si le groupe Oger5 n'était même pas capable de régler des problèmes comme ceux d'aujourd'hui, que feraient-ils demain dans l'éventualité de ‘problèmes sérieux' dans le domaine de la "défense" ? Ainsi les autres fractions de la bourgeoisie ont commencé à harceler les capitalistes de Telekom à cause de leur rôle clef. En conséquence, les " désaccords irréconciliables" et les "demandes inadmissibles" des syndicats ont été réglés lors d'une réunion pendant laquelle il n'y a eu "ni perdants ni gagnants" (ainsi que l'a déclaré le dirigeant syndical), tout cela avec bien sûr la médiation et l'intervention du Ministère de la Communication. Après de longues négociations, les dirigeants de Telekom ont présenté leurs revendications au ministre qui, de son côté, a envoyé une chiquenaude aux bureaucrates syndicaux.
Et ensuite ? Hurriyet6 rapporte le 30 novembre : " Après l'accord mis au point pendant les négociations, Binali Yildirim, Ministre des Communications, Salih Kilic, dirigeant de Turk-Is (la principale confédération syndicale), Ali Akcan, dirigeant de l'union des travailleurs de l'information de Turquie , et Paul Doany, président du comité administratif et directorial de Türk Telekom, sont allés dîner ensemble au ‘Beykoz Trautters and Tripes Saloon'.
Quel était l'enjeu ?
Il ne faut jamais oublier qu'à chaque fois que la presse, les syndicats, ou la bureaucratie du capital, ont des problèmes, ils essaient de tout réduire à une question de chiffres et de pourcentages en sortant des statistiques compliquées auxquelles ils espèrent que les travailleurs ne comprendront rien. Le problème a commencé de cette façon dans le cas de la grève de Telekom. Au cours de la septième séance des négociations, le syndicat et le groupe Oger s'étaient mis d'accord sur une vingtaine de points et ne l'étaient pas sur environ quatre-vingt-dix autres. Selon le syndicat, la flexibilité, les sous-contrats, les différences entre les salaires des travailleurs syndiqués et non-syndiqués constituaient les problèmes principaux. Le syndicat décrivait ces problèmes comme étant une "attaque" du capital international, étranger. Cependant, en y regardant de plus près, il est facile de voir que le problème est beaucoup plus simple. Turk-Is7 a depuis toujours été un syndicat modelé par les divisions au sein de la classe dirigeante, c'est-à-dire pris entre le bloc au pouvoir et entre le principal courant d'opposition de la bourgeoisie. Si on examine le changement de pouvoir à l'intérieur de Turk-Is, le fait que la majorité de la confédération ait pris une direction pro-AKP, alors que la minorité se soit rapprochée de l'opposition nationaliste, vient renforcer cet état de fait. Juste avant ce changement de pouvoir à la conférence générale de la confédération syndicale, "l'opposition", composée de Haber-Is, Petrol-Is et de quelques autres syndicats, a commencé à reprocher au syndicat pro-AKP sa "soumission" au gouvernement. Bien sûr, le marchandage dans les coulisses pouvait être interprété comme la négociation qui montrerait jusqu'à quel point les bureaucrates nationalistes syndicaux seraient liquidés.
Aussi, il n'est pas surprenant que l'aile pro-AKP se soit chargée de l'administration juste avant la grève de Telekom. En fait, tous les syndicats de l'opposition (Haber-Is, Petrol-Is, Gida-Is8) sont implantés soit dans des entreprises privatisées, soit dans des entreprises en voie de privatisation. Quand ce n'est pas le cas, ces syndicats essaient de s'implanter dans des secteurs de développement récent, tels que Novamed. Dans le premier cas, les syndicats sont en danger de perdre la position représentative qu'ils ont auprès de l'Etat. Comme on le constate à Telekom, les patrons des entreprises privatisées donnent aux ouvriers qui quittent les syndicats certains privilèges et liquident ainsi le syndicalisme d'Etat traditionnel. Dans le deuxième cas, nous constatons les efforts des syndicats liés à Turk-Is pour s'implanter, et cela entre partiellement en conflit avec la politique du gouvernement de main d'œuvre bon marché dans les zones franches.
Ainsi, quand certains syndicats au sein de Turk-Is sont confrontés à l'éventualité d'être liquidés par l'Etat, ils répliquent en agaçant et en menaçant l'Etat avec des grèves. Il serait utile d'examiner l'histoire de Turk-Is afin de comprendre cette tendance dans son fonctionnement interne.
Turk-Is : une abomination créée par le capitalisme d'Etat et l'impérialisme américain
Dès sa création en tant que confédération syndicale, Turk-Is est devenue le résultat d'une lutte politique entre le Parti Démocratique9 et le Parti Populaire Républicain et de leur bataille pour instaurer leur loi sur la classe ouvrière. C'est ainsi que la fraction bourgeoise qui détenait la majorité au parlement s'est toujours retrouvée à la tête de Turk-Is. C'est également ainsi que Turk-Is a assuré le rôle du plus solide cheval de Troie de l'idéologie bourgeoise dominante au sein de la classe ouvrière. Qui plus est, Turk-Is a été créée dans ce seul et unique but. Inspirée de l'exemple de l'AFL-CIO aux Etats-Unis, Turk-Is a été formée, financée et modelée directement par l'impérialisme américain. Même les nationalistes "anti-impérialistes" qui se retrouvent aujourd'hui dans l'aile nationaliste de Turk-Is l'ont dit autrefois, même si la situation est, de toute évidence, différente aujourd'hui (!).
Tous ces faits montrent que Turk-Is a été formée pour manipuler le mouvement ouvrier qui se développait dans les années 1950 en Turquie après la première longue période de contre-révolution commencée à la fin des années 1920. La lutte impérialiste bi-polaire, baptisée Guerre Froide après la fin de la Seconde Guerre mondiale, exigeait que des pays satellites soient modelés de façon étatique.
Tandis que cela était fait au nom du "socialisme" en Russie et dans les pays satellisés de son bloc, cela l'était au nom de la "démocratie" dans les Etats sous contrôle américain. Cette transformation, après les années 1950, qui a poussé l'Etat turc à porter un masque "démocratique et occidentalisé" pour s'opposer à l'URSS, s'est reflétée dans les syndicats. Et les fortes tensions au milieu des années 1950 ont rendu nécessaire la création d'un organe tel que Turk-Is pour défendre les intérêts de l'Etat et de la bourgeoisie. Pour remplacer l'ancienne vision idéologique qui était une vision corporatiste pratiquement fasciste et stipulait que l'Etat représentait toutes les classes, et même que les classes n'existaient pas en Turquie, par un modèle idéologique occidental incluant "la liberté d'expression et d'organisation", des lois commencèrent à être mises en place pour réglementer les syndicats et les grèves. L'ironie, pourtant, a fait qu'en cette période, alors que les droits des syndicats s'étendaient rapidement, le droit de grève s'est trouvé restreint et la structure des règles "d'arbitrage" a été modifiée pour accroître la légitimité de l'Etat aux yeux des ouvriers.
Tous ces changements ont donné naissance à Turk-Is et aux syndicats qui en font partie ; la confédération syndicale est née comme l'arme principale de la nouvelle Turquie "démocratique" et "anti-communiste" au sein du bloc impérialiste américain. Par la suite, Turk-Is est devenue le chien de garde loyal contre la gauche stalinienne et les syndicats qui en étaient proches dans la lutte impérialiste et a été l'instrument principal pour absorber les luttes ouvrières. Bien que ce ne soit pas le seul exemple, le coup d'Etat de 1980 en est une illustration frappante. Pendant le coup d'Etat, Turk-Is a, dans sa pratique, soutenu la junte militaire, et le président de la confédération a même été récompensé en étant nommé ministre du Travail dans le gouvernement provisoire mis en place par l'armée ! Cette situation a changé avec la "normalisation" de la fin des années 1980 et la réapparition de désaccords entre différentes fractions de la bourgeoisie. Par la suite, Turk-Is a rapidement commencé à perdre sa position privilégiée. Tout comme les maîtres ingrats qui font entrer le chien de garde dans la maison quand ils ont peur mais qui le flanquent dehors à coups de pied quand le danger est passé, l'Etat turc a largement oublié Turk-Is dans ses projets. Parce qu'après tout, la classe ouvrière ayant été écrasée dans un bain de sang, et avec l'affaiblissement mondial des tendances politiques staliniennes dites "socialistes" comme de l'impérialisme russe, ajouté à ses pratiques sanglantes, le tout avait complètement achevé sa marginalisation.
Ainsi, il avait fallu, pour Turk-Is, d'un côté, trouver un moyen de faire taire la classe ouvrière pour la défense des intérêts du gouvernement et, de l'autre, essayer de retrouver sa place et reprendre un rôle significatif à l'intérieur de l'Etat et sa légitimité au sein de la bourgeoisie. Dans ce but, elle a commencé à mener une opposition "démocratique" pour tenter de montrer sa force à l'Etat en menaçant de prendre certaines mesures tout en essayant, entre-temps, de démobiliser la classe ouvrière. Les tactiques de Turk-Is pendant la grève chez Telekom peuvent s'expliquer ainsi. Bien sûr, ces tactiques étaient devenues inopérantes avec l'offensive ouvrière de la fin des années 1980 quand Turk-Is s'était massivement décrédibilisée aux yeux de la bourgeoisie, mais cette question dépasse de loin les limites du sujet de ces articles. Le point essentiel sur lequel nous voulons insister est que dans les situations où Turk-Is est écartée de tout rôle significatif, sa façon de mettre en scène des menaces en direction de certaines fractions de la bourgeoisie, tout en conduisant à un épuisement de la combativité ouvrière, montre la pratique d'une très ancienne tactique.
Et qu'en est-il de la classe ouvrière ?
Nous ne pouvons, bien sûr, aboutir à une conclusion saine si nous jugeons une grève du point de vue de la bourgeoisie et de ses instruments au sein de la classe ouvrière. Cependant, l'importance de la grève chez Telekom n'a pas concerné que les travailleurs de Telekom, mais aussi la classe ouvrière toute entière. Cette grève a, à la fois, renforcé l'illusion que les syndicats soutiennent les travailleurs et a aussi enfermé les exigences de classe des travailleurs dans un seul secteur et les a empêchés d'élargir leur lutte au reste de la classe. En fait, la question que nous devons poser est la suivante : quand peut-on considérer qu'une grève est une victoire ? Il faut se demander si les conditions nécessaires étaient réunies pour une grève à Telekom. Il est clair que, même à l'intérieur de Telekom, les syndicats et la direction avaient monté les travailleurs les uns contre les autres. Quand les travailleurs syndiqués ont accusé d'égoïsme les ouvriers non-syndiqués, ou ceux qui avaient quitté les syndicats avant, ils subissaient clairement l'influence des syndicats et les conditions de discussion n'étaient pas réunies avant la grève pour permettre aux deux bords "différents" d'agir ensemble de façon solidaire. Le résultat a été que le syndicat a désigné ceux qui en étaient partis pour une raison concrète, comme celle de gagner un meilleur salaire, comme cibles à leurs propres frères et sœurs de classe.
De plus, le syndicat a élevé le niveau de chauvinisme et de démagogie nationaliste à chaque attaque des médias bourgeois, trompant à nouveau de la sorte la classe ouvrière. En décrivant la vente de Telekom à un groupe étranger comme un acte de "trahison envers la mère patrie", le syndicat a fait passer la nationalisation avant les intérêts des travailleurs. De même que l'acceptation des 10 % offerts par le patronat avant la grève a été justifiée au nom de cette même "mère-patrie". Quand le dirigeant du syndicat Haber-Is a déclaré sans vergogne que " la grève a été une défaite économique mais une victoire politique " en parlant à l'Université Technique du Moyen-Orient, c'est cette situation qu'il admettait de fait, et il a vite pris la fuite devant les questions critiques de quelques étudiants.
Et c'est bel et bien la situation de la classe ouvrière. Une grève qui a duré plus d'un mois... et qui n'a apporté aucune amélioration au niveau de vie et n'a servi qu'à aggraver les divisions au sein de la classe. Quand le gouvernement AKP a annoncé 10% d'augmentation de salaire à la fin de l'année, la situation a été poussée à son comble et, cette fois, les syndicats de l'opposition ont hypocritement accusé la présidence de la confédération d'être des "vendus".
Le bilan
De même que les révolutionnaires communistes doivent tirer les leçons des victoires de la classe ouvrière, il leur faut tirer les leçons des défaites et ils doivent défendre ces leçons dans d'autres secteurs de la lutte de classe. Pour cela, il est nécessaire que les communistes soient clairs sur chacune des erreurs qu'ils font et qu'ils utilisent la critique comme une arme dans chaque situation. Le débat est l'un des instruments les plus importants pour les communistes, tout comme il l'est pour la classe ouvrière en général. Nous devons accepter le fait que la grève chez Telekom ne s'est en aucune façon terminée comme une victoire. Les raisons intrinsèques qui expliquent cela sont les suivantes :
-
Cette grève a creusé des divisions au sein de la classe ouvrière et a engendré de la méfiance entre ouvriers syndiqués et non-syndiqués.
-
La grève à Telekom, en forçant les travailleurs à placer des intérêts "nationaux" inexistants avant leurs intérêts de classe, a servi les intérêts politiques du syndicat.
-
Comme la grève avait été insuffisamment préparée auparavant et qu'il n'y a pas eu suffisamment de solidarité mise en place avec d'autres secteurs de la classe ouvrière, cela a conduit au gaspillage partiel de la volonté naissante de lutter en tant que classe et cela a renforcé les illusions syndicales parmi les travailleurs.
Tout cela ne veut pas dire que nous ne soutiendrons pas des grèves comme celles-là jusqu'au bout. Cela montre seulement que nous devons intégrer le fait que la première tâche des communistes, dans des grèves manipulées par les syndicats à des fins politiques, est de prôner une solidarité active auprès d'autres travailleurs avec les travailleurs qui sont en lutte afin de briser les entraves syndicales et de défendre leurs propres intérêts. C'est seulement ainsi que les travailleurs pourront commencer à voir le vide des illusions qu'ils se font sur les syndicats et qu'ils verront où sont les vraies victoires. Pour nous, communistes, nous devons défendre et protéger cette leçon avec détermination. Dans cet esprit, il ne fait aucun doute que la discussion engendrée par la grève à Telekom au sein de EKS aura un résultat positif.
Temel
Débat dans EKS
Réponse au camarade Temel
Cet article est une contribution au débat au sein d'EKS à propos de la grève à Telekom. C'est une réponse à l'article " Telekom : Autopsie d'une grève ", publié dans le numéro de Gece Notları du mois dernier, qui était lui-même une réponse à un précédent article " Victoire pour les grévistes de Türk Telekom ".
Dans le numéro de Gece Notları du mois dernier, Temel a écrit que la grève chez Türk Telekom " ne s'est en aucune façon terminée comme une victoire. " Ceci était une réponse au titre de première page du numéro de février qui proclamait : " Victoire chez Türk Telekom. " Gece Notları avait déclaré à ce moment-là que la grève était une victoire, et maintient cette position aujourd'hui. Toutefois, nous sommes ouverts à une discussion sur ce sujet et nous encourageons nos lecteurs à nous envoyer leurs contributions à ce débat.
Temel définit la grève comme un échec d'abord, mais pas essentiellement, sur une base économique. Il déclare que 10% avaient été offerts par le patronat avant la grève. Ceci n'est cependant pas exact. L'offre de la direction était de 4%. L'accord final a été de 10% pour cette année et de 6,5% plus l'inflation l'an prochain. Ce sont des chiffres bien différents. Ce à quoi Temel fait référence, ce sont des articles de presse qui indiquaient que Türk Telekom était prêt à aller jusqu'à 10%. Cela est peut-être vrai, mais ne doit pas faire oublier que l'offre était de 4%. Des entreprises comme Türk Telekom font des plans économiques. Ils font des budgets pour ce qu'ils pensent être possible. Cela ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas souhaité que l'accord soit inférieur à ce qu'il a été. Bien évidemment, les patrons veulent toujours que les ouvriers obtiennent l'augmentation de salaire la plus petite possible. S'ils s'en étaient tirés avec 4%, ils en auraient été très heureux. Ils n'ont pas pu et, à notre avis, c'est la grève qui les en a empêchés. Bien sûr, personne ne sait ce qui s'est exactement passé pendant les négociations entre Paul Doany et Salih Kiliç, mais notre perspective va dans le sens de ce qui a été publié. Temel continue en invoquant trois "raisons intrinsèques" pour lesquelles il ressent que la grève a été un échec. La première est que la " grève a creusé des divisions au sein de la classe ouvrière et a engendré de la méfiance entre ouvriers syndiqués et non-syndiqués. " Comme Temel le dit lui-même, ce sont des divisions créées par la classe dirigeante. Aussi absurde que cela puisse paraître, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce pays à ce qu'au sein d'une même entreprise des ouvriers travaillent pendant que d'autres sont en grève. La principale façon pour des ouvriers de développer une lutte est de la généraliser pour y inclure d'autres ouvriers. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que les syndicats n'ont aucun intérêt à cela, et la grève chez Telekom le prouve. Cependant, briser les barrières entre différents groupes de travailleurs n'est en aucun cas chose aisée. On peut le faire en faisant directement appel auprès des autres travailleurs à être solidaires dans l'action. Bien sûr, beaucoup nous dirons qu'il faut faire agir les leaders syndicaux. Nous avons vu récemment ce que signifie leur "action", une grève de deux heures dans laquelle peu de gens ont pris part. Si les ouvriers rentrent dans ce genre d'actions, il faut qu'ils en prennent l'initiative dans leur propre intérêt. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les travailleurs sont liés aux syndicats non seulement de façon organisationnelle, mais aussi idéologiquement. La Gauche communiste a toujours défendu les assemblées générales ouvertes pour les syndiqués de tous bords et les non syndiqués dans lesquelles les ouvriers peuvent discuter de la façon de prendre le contrôle de leur lutte. Cependant, cela n'a en soi pas beaucoup de poids si l'assemblée décide de faire exactement ce que les dirigeants syndicaux disent de faire. Le capitalisme crée des divisions entre les travailleurs pour ses propres besoins. Le rôle des syndicats est de maintenir cet ordre des choses. Au cours de cette grève, les ouvriers n'ont pas réussi à briser la sectorisation et à étendre leur grève à d'autres travailleurs. Mais fallait-il nous attendre à autre chose ? Bien sûr que non. La plupart des grèves sont isolées dans leurs propres secteurs. Cela ne veut pas dire que c'est la grève qui renforce les divisions entre les grévistes et les non-grévistes. Cela veut dire que la classe ouvrière n'est pas assez forte pour dépasser ces divisions.
Le second point dans sa liste est que la grève à Telekom a obligé les travailleurs à faire passer les intérêts nationaux avant les leurs propres. Je pense que c'est une étrange lecture de la situation. Au milieu du déchaînement de l'hystérie collective sur les combattants héros et martyrs en Irak, qui était en arrière-plan de la grève, les travailleurs de Telekom ne se sont nullement fait particulièrement remarquer dans le sens de cette propagande nationaliste. Personnellement, je me rappelle que ce sont les écoliers qui ont fait le plus entendre leurs voix pour la défense des intérêts nationaux. Les ouvriers de Telekom n'ont été ni plus ni moins nationalistes que la grande majorité de la classe ouvrière de ce pays. Oui, des commentaires nationalistes ont été faits par des ouvriers de Telekom, mais les mêmes commentaires étaient faits par la majorité des ouvriers à ce moment là. S'il y avait eu un retour spontané au travail pour faire fonctionner le système de Telekom, cela aurait été un désastre absolu. Cela ne s'est pas produit. En fait, les ouvriers sont restés en grève en dépit du fait que les médias et divers membres de la classe politique leur répétaient qu'ils agissaient contre les intérêts nationaux. Cela, il faut le saluer. Oui, des travailleurs ont proclamé leur patriotisme. Oui, des travailleurs ont manifesté contre le capital étranger. Est-ce différent d'autres secteurs de travail en Turquie ? Existe-t-il des secteurs où les travailleurs rejettent à la fois le patronat étranger et le patronat turc et qui prônent l'internationalisme ? Malheureusement, non. La grève ne s'est pas dissoute dans une vague de sentiment patriotique. Cela aurait été une lourde défaite. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec ça.
Le troisième point de Temel est que la grève n'a pas été suffisamment bien préparée. Bien sûr qu'elle ne l'a pas été, mais c'est généralement le cas des grèves. Pour renforcer ce point, il ajoute que cela a fait disparaître dans la classe ouvrière l'envie de lutter, et que cela a renforcé les illusions syndicalistes. C'est une chose difficile à prouver. En ce qui concerne la préparation, cependant, la classe ouvrière n'est pas suffisamment forte pour se préparer réellement aux grèves. La plupart des secteurs militants de la classe ouvrière sont dominés par les "illusions syndicales". A notre avis, la seule chose qui séparera la masse des travailleurs des syndicats est le fait d'entrer en conflit avec eux au cours de la lutte. Des militants isolés ou des petits groupes de militants peuvent être gagnés à l'avance, mais dans la situation actuelle, au début de chaque lutte, la majorité des travailleurs sont dans l'illusion syndicale. Comment est-on alors supposé préparer la grève à l'avance ? Les seuls qui peuvent le faire sont les syndicats. Et nous sommes d'accord ici avec Temel que les syndicats n'agissent pas pour défendre les intérêts de la classe ouvrière. La classe ouvrière n'est actuellement pas assez forte pour affirmer clairement ses propres intérêts de classe. Elle peut, par l'intermédiaire de la lutte, se couper de l'idéologie des autres classes et commencer à agir par elle-même. Elle n'est pas encore assez forte pour le faire et par conséquent ne peut pas se préparer suffisamment pour les grèves. Quant à la suggestion que cette grève a conduit au gaspillage potentiel de la volonté de la classe ouvrière de se battre, nous verrons ce qu'il en adviendra. S'il y a un grand mouvement contre la réforme des retraites, cela renforcera notre conviction que la grève à Telekom a accru la volonté de la classe de se battre. L'illusion syndicale est forte en ce moment. Nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit brisée du jour au lendemain, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit brisée sans lutte. Si cela encourage les travailleurs à lutter, alors cela les mènera finalement à entrer en conflit avec les syndicats. Cela reste à voir.
Nous sommes toutefois entièrement d'accord avec le paragraphe final de Temel. Nous soutenons toutes les grèves que la classe ouvrière mène pour défendre ses intérêts. Nous devons être vigilants sur la façon dont les syndicats manipulent les grèves. Nous devons convaincre de rechercher la solidarité entre les différents secteurs de la classe ouvrière. Et débattre des vraies questions auxquelles les travailleurs doivent faire face dans un conflit ne peut qu'accroître le développement des organisations communistes. C'est ce qui, d'une façon très concrète, nous unit et nous tenons à continuer ce débat, ainsi que d'autres débats qui se développeront à partir d'autres luttes de la classe ouvrière, telles que celle, actuelle, sur les pensions de retraite.
Devrim
1 Une femme qui serait morte à cause de la grève.
2 Le principal syndicat des travailleurs des télécoms.
3 Le syndicat gauchiste des fonctionnaires
4 Compagnie aérienne turque
5 Propriétaire de Türk Telekom
6 ‘Liberté', un important journal bourgeois
7 Littéralement ‘Travail Turc', principale confédération syndicale en Turquie.
8 Petrol-Is et Gida-Is, littéralement ‘Travail du Pétrole' et ‘Travail de l'Alimentation' sont les syndicats des travailleurs du pétrole et de l'alimentation à l'intérieur de Turk-Is.
9 Le vieux Parti Démocrate était au pouvoir dans les années 1950 après avoir battu le Parti Populaire Républicain aux élections. Ils ont été éjectés du pouvoir par un coup d'état qui a abouti à l'exécution du Premier ministre et chef du Parti Adnan Menderes. Le parti fut ensuite interdit. Tous les partis de centre droit et les partis islamiques de droite ont un lien historique avec ce parti.
Récent et en cours:
- Luttes de classe [36]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [60]
Élection d'Obama : les nouveaux habits de l'État américain
- 2684 reads
Voici un article repris d'Internationalism, section du CCI aux Etats-Unis, dénonçant la propagande mensongère entourant l'élection d'Obama.
La tempête propagandiste autour de la campagne électorale a enfin cessé au bout de presque deux ans. Les médias aux ordres de la classe dominante nous disent qu'il s'agit de l'élection la plus importante de l'histoire des États-Unis, démontrant une fois de plus la puissance et la supériorité de la " démocratie ". Cette propagande crie haut et fort que non seulement nous avons pour la première fois de l'histoire américaine un président afro-américain, mais aussi que, par-dessus tout, la victoire d'Obama porte avec elle un profond désir de changement. On nous dit encore que le " peuple a parlé ", et que " Washington a écouté ", grâce à l'œuvre miraculeuse des urnes. On nous dit même que l'Amérique a dès à présent dépassé le racisme et est devenue une véritable terre de fraternité. Ainsi, aujourd'hui, Obama est devenu président. Mais qu'est-ce cela signifie en réalité ? Obama a promis le changement, mais cette promesse n'est rien d'autre qu'une illusion. Toute cette campagne n'a été qu'un mensonge hypocrite, qui s'est servi des espoirs d'une population, et surtout d'une classe ouvrière terriblement épuisée par la misère et la guerre.
Les véritables gagnants de ces élections ne sont pas plus " Joe le plombier ", symbole de " l'Américain moyen ", que les Afro-américains qui font partie de la classe ouvrière américaine, mais bien plutôt la bourgeoisie américaine et ses représentants. Il est clair que les mêmes attaques incessantes vont continuer de s'abattre sur les ouvriers. La misère va ainsi continuer de s'aggraver inexorablement. Obama n'a pas davantage été un candidat de la " paix ". Sa critique essentielle envers Bush porte sur l'enlisement en Irak et sur sa politique qui a laissé l'impérialisme américain incapable de répondre de façon appropriée aux défis posés à sa domination. Obama prévoit d'envoyer plus de troupes en Afghanistan et a clairement déclaré que les États-Unis devaient être prêts à répondre militairement à toute menace contre ses intérêts impérialistes. Il a été en outre très fortement critique par rapport à l'incapacité de l'administration Bush de répondre au niveau requis à l'invasion de la Géorgie par la Russie l'été dernier. Voilà quel champion de la paix il est !
Pendant les débats présidentiels, Obama a expliqué qu'il soutenait le renforcement de l'éducation aux États-Unis, parce qu'une force de travail bien éduquée était vitale pour une économie forte et qu'aucun pays ne peut rester une puissance dominante sans une économie forte. En d'autres mots, il voit les dépenses d'éducation comme une pré-condition à la domination impérialiste. Quel idéalisme !
Il n'y a donc rien à attendre pour la classe ouvrière de cette venue au pouvoir d'Obama. Pour la classe dominante par contre, cette élection représente un succès presqu'au-delà de ses rêves les plus fous.
Elle a permis de ravaler la vieille façade de l'électoralisme et du mythe démocratique, qui avaient été mis à mal depuis 2000 et avaient conduit à un sentiment de désenchantement par rapport au "système" chez beaucoup de monde. L'euphorie post-électorale - comme les danses dans les rues pour saluer la victoire d'Obama - est un témoignage de l'étendue de la victoire politique de la bourgeoisie. L'impact de cette élection est comparable à la victoire idéologique qui est apparue immédiatement après le 11 septembre 2001. Tout de suite après, la bourgeoisie profitait d'une poussée d'hystérie nationaliste, lançant la classe ouvrière dans les bras de l'État bourgeois. Aujourd'hui, l'espoir dans la démocratie et dans la magie du leader charismatique, fait plonger de larges secteurs de la population vers l'illusion de l'État protecteur. Au sein de la population noire, le poids de cette euphorie est particulièrement lourd ; il existe à présent une croyance largement répandue que la minorité opprimée a pris le pouvoir. Les médias bourgeois célèbrent même le dépassement par l'Amérique du racisme, ce qui est parfaitement faux et tout aussi ridicule. La population noire des États-Unis fait partie des secteurs les plus exploités et les plus désenchantés de la population.
Au niveau international, la bourgeoisie a bénéficié presque immédiatement d'une prise de distance de la nouvelle administration par rapport aux erreurs du régime de Bush sur la politique impérialiste et d'une ouverture opportune vers le rétablissement de l'autorité politique, de la crédibilité et du leadership de l'Amérique dans l'arène internationale.
Au niveau de la politique économique, les efforts de la nouvelle administration Obama pour mettre en oeuvre les nécessaires mesures capitalistes d'État afin de consolider le système d'oppression et d'exploitation vont se déployer à une échelle inégalée. Si dès aujourd'hui les gouverneurs de chaque État, comme de l'État fédéral, sont en train d'attaquer les services et les programmes sociaux à cause de la crise économique, Obama ne promet rien de mieux pour demain. Il est au contraire le premier avocat de la nécessité de soutenir ou renflouer... les plus grandes entreprises, les banques et les compagnies d'assurance, et de les faire financer par de plus grands sacrifices de... la classe ouvrière !
Malgré la griserie de son succès, consciente qu'elle ne pourra pas mettre en oeuvre les changements promis durant la campagne, la bourgeoisie développe déjà une campagne de façon à "temprérer l'enthousisasme". On a ainsi pu entendre des propos soulignant que "Obama ne peut que remettre de l'ordre dans la politique catastrophique et malhonnête de Bush", et que "Il y a un héritage des erreurs du passé", "le changement ne viendra pas immédiatement", "les sacrifices seront nécessaires".
Face à tout cela, nous devons rappeler les positions historiques de notre classe :
-
la démocratie, c'est la dictature de la classe dominante ;
-
la classe ouvrière doit se battre et s'organiser elle-même pour défendre ses propres intérêts ;
-
seule la révolution communiste mondiale peut mettre fin à l'exploitation capitaliste et à son oppression.
L'euphorie actuelle ne peut être que de courte durée. Les programmes d'austérité que chaque État comme le gouvernement central vont devoir mettre en place appelent à un nécessaire développement de la lutte de classe. La faillite prévisible de l'administration Obama pour réaliser les "changements promis", une amélioration des conditions de vie et un "programme plus social", conduira inévitablement au désenchantement et à alimenter l'expression d'un mécontentement de classe plus fort.
Internationalism, organe du CCI aux États-Unis (11 novembre 2008)
Géographique:
- Etats-Unis [61]
Personnages:
- Barack Obama [62]