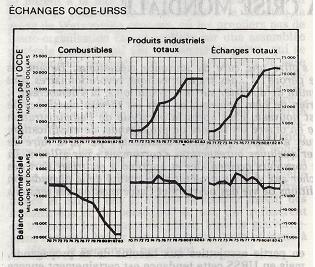Revue Int. 1987 - 48 à 51
- 3709 reads
Revue Internationale no 48 - 1e trimestre 1987
- 2897 reads
Situation internationale : face à l'enfoncement dans la barbarie, la nécessite et la possibilité de la révolution
- 2544 reads
La misère se généralise, le chômage s'intensifie, la barbarie s'approfondit, la révolution communiste est une nécessite absolue
Depuis plus de quinze ans, la bourgeoisie de tous les pays tient régulièrement des discours lénifiants sur la proximité et la possibilité de sortir de la crise économique. Chaque jour qui passe dément formellement ces pronostics mensongers. A l'encontre des discours bourgeois, la situation présente est à la plongée dans la récession de l'économie mondiale, à une contraction violente du marché, à l'exacerbation sans précédent d'une guerre commerciale acharnée. Le niveau actuel de la crise économique capitaliste laisse clairement apparaître les causes profondes de celle-ci : la surproduction généralisée. Inexorablement cela se traduit par le développement de la misère la plus profonde, une misère sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Epidémies, malnutrition, famines, sont le lot quotidien de milliards d'être humains. C'est ce véritable enfer que vivent, dans les pays à capitalisme moins développé, des populations entières : 40 000 personnes y trouvent chaque jour la mort. Cette réalité barbare tend également à envahir progressivement les pays les plus industrialisés. Nations où des pans entiers, considérables, de l'appareil de production sont démantelés et disparaissent, laissant ainsi la rue des millions d'ouvriers. Ce sont actuellement plus de 32 millions d'entre eux qui se retrouvent dans cette situation, avec des allocations qui ne cessent de se réduire dramatiquement. La bourgeoisie de chaque pays y est contrainte d'attaquer toujours plus massivement et frontalement les populations et particulièrement la classe ouvrière par la réduction des salaires réels, des allocations sociales, des retraites, des dépenses de santé, etc. Mais la généralisation de l'austérité, de la misère n'est qu'une des expressions de la barbarie croissante du capitalisme en voie de putréfaction. Tout aussi parlants sont les derniers événements de Tchernobyl, la fuite de gaz radioactif à la centrale de Minkley-Point (Grande-Bretagne), les 200 000 blessés de Bhopal en Inde suite à 1’explosion d'une usine de gaz toxique. Aussi sophistiquée soit-elle, la production capitaliste devient une arme de destruction dans les mains d'une bourgeoisie acculée, par une guerre économique exacerbée, à tirer un maximum de profit au détriment croissant de toute règle sérieuse de sécurité, en exploitant au maximum des sources d'énergie que personne ne sait réellement contrôler.
Depuis toujours, et tout particulièrement depuis le début de ce siècle, le capitalisme a vécu les armes à la main : deux guerres mondiales sont là pour le rappeler si nécessaire. Mais jamais auparavant nous n'avions connu un tel degré d'armement généralisé de la planète, une telle constance et permanence dans l'utilisation systématique des forces armées, dans la fermentation incessante de conflits locaux. L'enlisement dans la guerre au Liban, entre l'Iran et l'Irak, en Ethiopie, au Mozambique, en Angola, n'est que la partie visible de cet énorme iceberg véritable gangrène qui ronge cette société pourrissante. Dans le cadre historique du capitalisme décadent, il n'existe aucune limite à l'enfoncement dans la barbarie. L'utilisation d'un terrorisme aveugle visant- des populations entières, comme le bombardement aérien de Tripoli par les USA, en plein centre urbain, ou encore comme les derniers attentats d'octobre à Paris, devient un mode courant de règlement de comptes entre les différentes cliques impérialistes, défendant chacune ses propres intérêts sordides, son capital national, son bloc impérialiste de tutelle.
Toute cette misère, cette boue et ce sang révèlent la décomposition avancée du capitalisme. Tout cela marque l'enfoncement continu de ce système barbare dans l'abîme de la décadence. Poussé par ses propres contradictions, incapable de surmonter sa crise économique de surproduction, le capitalisme fait peser sur la tête de toute l'Humanité un danger bien pire encore : une nouvelle guerre impérialiste généralisée.
De tout cela découle la nécessité de le détruire de fond en comble. La révolution communiste s'impose comme un besoin vital à l'humanité afin de balayer définitivement toute cette pourriture et de créer un monde sans exploitation, sans misère et sans guerre. Ainsi s'achèvera la « préhistoire de l'humanité ».
Un scepticisme largement partage
Dans l'ensemble du milieu politique prolétarien, il n'existe aucune sorte de difficulté pour reconnaître et dénoncer la barbarie généralisée du capitalisme. Même les groupes de la mouvance « moderniste » n'y font pas exception. C'est même en général leur terrain de prédilection. Tous mettent en avant la nécessité historique de la révolution communiste, certains groupes modernistes ont même pris des noms fort évocateurs sur ce plan : « Le Communisme », « Les Fossoyeurs du vieux monde », etc. Par contre, c'est une tout autre affaire lorsqu'il s'agit de savoir si le communisme a réellement une chance de voir le jour. Quelle est la force dans la société capable de réaliser la révolution communiste ? Quelles sont les conditions nécessaires à son éclosion ? Quel est le chemin à parcourir ? Dès ce moment-là, les difficultés commencent, le scepticisme gagne.
Pour ce qui concerne le « marais moderniste », en dehors dudit milieu, aussi informel que possible, c'est le doute permanent qui fait force de loi. On se réunit en colloques pour discuter d'activités alternatives (on se demande lesquelles !), on se proclame « les Amis du doute » ou encore « Ecologie et lutte de classes ». On se propose de discuter de la réalisation du communisme « par la lutte écologique », « féministe » et autres fadaises. On fait en ce domaine pire encore que par le passé, l'«Internationale situationniste » est bel et bien enterrée. On doute de tout, mais surtout de la seule force capable de renverser le capitalisme : la classe ouvrière. En s'enlisant ainsi dans des mouvements interclassistes, on signifie que l’on se trouve en dehors du marxisme, en dehors de la lutte de classes. Marx affirmait dans la « Contribution à la critique du Droit de Hegel », oeuvre dite « de jeunesse » de Marx et plat préféré des modernistes :
«La possibilité d'une révolution radicale existe dans le fait de la formation d'une classe dans la société civile, qui ne soit pas une classe de la société civile, d'un groupe social qui soit la dissolution de tous les groupes. Une sphère qui possède un caractère d'universalité, par l'universalité de ses souffrances et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on lui a fait subir non une injustice particulière mais l'injustice en soi, qui ne puisse plus se targuer d'un titre historique, mais seulement d'un titre humain. Qui ne soit pas en contradiction exclusive avec les conséquences, mais en contradiction systématique avec les conditions préalables du régime politique allemand. D'une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper sans émanciper toutes les autres sphères de la société, qui soit en un mot la perte totale de l'homme et ne puisse donc se reconquérir elle-même sans une reconquête totale de l'homme. Cette dissolution de la société réalisée dans une classe particulière, c'est le prolétariat ». C'est le prolétariat à l'exclusion de tout autre, faudrait-il sans doute préciser ici.
Il n'y a donc rien d'étonnant qu'en rejetant ainsi la seule force capable de renverser la société capitaliste, on en arrive à n'être que des sceptiques permanents, incapables de voir l'activité de la classe ouvrière et donc totalement inaptes à comprendre le développement du processus de la lutte de classes. A n'envisager en fin de compte le présent, comme le fait « La Banquise », que sous la forme d'une glaciation, d'une époque de congélation de la révolution. Les classes petites-bourgeoises, qui sont hétérogènes par excellence, ont, comme nous l'avons dit, la caractéristique de méconnaître le sujet historique révolutionnaire de la société moderne : le prolétariat.
Ecrasées dans leur vie quotidienne et matérielle par les effets de la crise économique, tout en étant incapables de mettre en avant une perspective propre, elles sont par conséquent particulièrement réceptives à toutes les mystifications bourgeoises : poussés à la révolte par les conditions de vie que leur fait le capital, un certain nombre d'individus qui les composent s'engluent dans le marais moderniste. Mais étant donné que ce qui les marques fondamentalement c'est l'individualisme, la démoralisation et l'impatience, d'autres ne peuvent éviter de tomber dans le piège du terrorisme. C'est seulement comme cela que peut être expliquée l'existence de groupes terroristes tels qu'« Action directe », la « Bande à Baader » ou encore les « Brigades rouges » en Italie...
Utilisant le terrorisme pour tenter d'« ébranler » le capitalisme et de « réveiller le prolétariat » vu comme une masse amorphe et apathique, ils ne font alors rien d'autre que la preuve de leur propre impuissance. Contrairement à ce que peuvent penser ces quelques individus mystifiés, ces actions purement spectaculaires ne poussent en rien la classe ouvrière à lutter. Par contre elles favorisent grandement le travail permanent qu'effectue la bourgeoisie contre le prolétariat. Celle-ci a beau jeu, après chaque attentat terroriste et au nom de la sécurité des citoyens de développer et déployer tout son arsenal de répression : armée et police. Cela lui permet de préparer d'autant plus efficacement la répression directe de la classe ouvrière et de ses organisations révolutionnaires. C'est même pour ces raisons que tous ces groupes se retrouvent infiltrés et manipulés par les services compétents de l'Etat bourgeois.
Si le scepticisme et le manque de confiance à l'égard du prolétariat — et même les aventures désespérées du terrorisme — s'expliquent pour ces éléments et courants de la petite-bourgeoise, beaucoup plus surprenant par contre est le fait qu'un tel scepticisme puisse exister également, avec autant de force, au sein du milieu politique prolétarien. Cette réalité s'exprime de façon différente suivant les groupes qui le composent, mais il s'agit d'une faiblesse constante qui sévit dans l'ensemble de ce milieu.
Pour le FOR ([1] [1]), la question est en apparence fort simple : le prolétariat est révolutionnaire ou il n'est pas et c'est le mépris qui domine à l'égard des ouvriers. Dans « Alarme » n° 33, il est écrit sur la lutte des chantiers navals en France : « Qu'est-ce que cela signifie, une nouvelle fois, si ce n'est que les syndicats prennent la classe ouvrière pour un tas d'abrutis ? Et le pire, malgré quelques débordements sans contenu, c'est que ça marche comme en témoigne le remue-ménage syndical sur les chantiers ».
Dans le n° 30 de sa revue, niant totalement le lien existant entre la crise économique et la lutte de classe, le FOR déclare: « Notre principale base économique pour estimer la situation politique mondiale, ce ne sont ni les difficultés du capitalisme, ni le chômage, ni les perspectives d'une reconversion industrielle et encore moins la prétendue crise de surproduction ». Tout ceci ne serait que pur économisme et donc « de fait une manière de se plier à la logique et à la contamination cérébrale que veut nous imposer le capitalisme. » Rien de moins ! La lutte contre le chômage est ainsi assimilée à une « contamination cérébrale ». Sur sa lancée, le FOR peut ensuite écrire : « Le seul problème réel aujourd'hui est l'énorme décalage entre ce qui est possible objectivement et la misérable condition subjective. » Etre plus méprisant à l'égard du prolétariat relèverait du tour de force. Contrairement à ce que pense le FOR, la lutte contre le chômage dans la période actuelle est un des principaux facteurs d'unification des luttes ouvrières. Les luttes économiques de la classe ouvrière ne peuvent être ainsi rejetées, sous peine de tomber dans l'impuissance la plus complète.
A propos des grèves dans le Caucase en 1902, Rosa Luxembourg écrit ceci : « La crise engendra un chômage énorme alimentant le mécontentement dans les masses des prolétaires. Aussi le gouvernement entreprit-il, pour apaiser la classe ouvrière, de ramener progressivement la 'main d'oeuvre inutile' dans son pays d'origine. Cette mesure qui devait toucher environ quatre cents ouvriers du pétrole provoqua précisément à Batoum une protestation massive. Il y eut des manifestations, des arrestations, une répression sanglante et finalement un procès politique au cours duquel la lutte pour des revendications partielles et purement économiques prit le caractère d'un événement politique et révolutionnaire. » (Grève de masses, parti et syndicats).
En fin de compte, lorsqu'on ne comprend pas les conditions générales nécessaires au développement de la lutte ouvrière, on ne peut que tomber dans le doute sur le présent et la fuite dans un avenir hypothétique. La révolution communiste devient une chimère.
" Ce scepticisme profond, nous le retrouvons au sein du BIPR ([2] [2]) dans la « Revue Communiste » n° 4 (article « Crise du capitalisme et perspectives du BIPR »), il est écrit: « Partout où ils sont les révolutionnaires doivent développer la conscience politique révolutionnaire dans la classe ouvrière et construire une organisation révolutionnaire. Une telle tâche ne peut attendre l’explosion généralisée des luttes ouvrières et elle demeure y compris au cas où la guerre viendrait à éclater, car il est vital que le prolétariat s'organise contre sa propre bourgeoisie en cas de guerre comme en temps de paix. » Cela revient à dire que tout est possible dans la situation historique actuelle : le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale comme la révolution communiste. Mais quelle signification aurait pour toute l'humanité l'éclatement d'un nouveau conflit impérialiste généralisé ?
Le marxisme a toujours rejeté la vision consistant à comprendre les guerres dans l'histoire comme le simple résultat d'une nature humaine par trop belliqueuse, permettant ainsi de tracer un trait d'égalité entre toutes les guerres.
Sans remonter bien loin dans l'histoire, il faut souligner que les guerres du 19e siècle au sein de la société capitaliste elle-même étaient bien différentes dans leurs causes, dans leurs déroulement et implications, que les deux guerres impérialistes généralisées du 20e siècle. Le sens profond des guerres du 19e siècle résidait dans la nécessité pour le capitalisme ascendant de s'ouvrir de nouveaux marchés, de les unifier sur une échelle plus grande. Ce processus s'accompagne de la constitution de nouveaux Etats capitalistes concurrents. Les guerres avaient alors immédiatement une rationalité économique. Mais ce processus d'expansion du capitalisme n'est pas sans limites. Celles-ci s'imposeront dans la réalité par la constitution du marché mondial. Dès lors, l'impérialisme, la lutte à mort entre les différents Etats capitalistes pour étendre leur zone d'influence va régner en maître. La guerre et le militarisme vont être soumis aux exigences de cette nouvelle réalité. Le capitalisme décadent, de par ses propres contradictions internes, se voit alors poussé inexorablement dans la guerre généralisée.
Rosa Luxembourg en 1919 dans le « Discours sur le Programme » au congrès de constitution du PC d'Allemagne, affirmait : « Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l’humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie ou salut par le socialisme. Il est impossible que la guerre mondiale procure aux classes dirigeantes une nouvelle issue, car il n'en existe plus sur le terrain de la domination de classe du capitalisme(...) Le socialisme est devenu une nécessité non seulement parce que le prolétariat ne veut plus vivre dans les conditions matérielles que lui préparent les classes capitalistes, mais aussi parce que, si le prolétariat ne remplit pas son devoir de classe en réalisant le socialisme, l'abîme nous attend tous,autant que nous sommes. » Paroles particulièrement prophétiques si l'on envisage le déclenchement d'une troisième guerre mondiale.
S'il est vrai que les deux guerres mondiales furent suivies de périodes (de durée très courte) de reconstruction permettant au capitalisme de relancer momentanément son économie, cela ne signifie nullement que ces deux conflits impérialistes généralisés aient constitué des « solutions » à la crise capitaliste délibérément mises en place par la bourgeoisie. En réalité l'un et l'autre résultèrent d'un engrenage incontrôlable entraînant sans rémission l'ensemble de la bourgeoisie vers le gouffre. Si c'est l'effondrement économique qui pousse le capitalisme vers la guerre mondiale, celle-ci constitue l'expression la plus développée, absurde et barbare de la crise historique de ce système. Et la bourgeoisie ne peut pas plus arrêter définitivement le processus qui pousse l'économie mondiale dans une crise généralisée que l'engrenage la conduisant vers une guerre impérialiste totale, tout comme elle ne peut contrôler l'utilisation des moyens de destruction mis à sa disposition.
Déjà durant la deuxième guerre mondiale, la bourgeoisie s'est servie de tous les moyens existant à l'époque. Le résultat en a été le bombardement de Londres par les V1 (ancêtres des missiles) de l'armée allemande ou les bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima. Si dans la période actuelle la bourgeoisie est inexorablement poussée vers une troisième guerre mondiale, il ne faut pas se faire d'illusions : cela voudra dire très certainement la quasi destruction de l'humanité dans son ensemble, ce qui met particulièrement en évidence l'absurdité de la thèse sur la rationalité économique pour la bourgeoisie des guerres impérialistes généralisées en période de décadence !
L'utilisation massive de tous les moyens de destruction est alors inévitable : bombes thermonucléaires, bombes à neutrons, etc. La bourgeoisie dispose aujourd'hui de l'arsenal nécessaire et amplement suffisant pour éliminer toute vie de la surface de la planète, en renvoyant alors vraiment cette dernière à l'époque de la glaciation, comme le pense sinistrement « la Banquise ». Le fait d'envisager la possibilité de « la transformation de la 3e guerre mondiale en guerre civile », comme le fait le BIPR dès aujourd'hui, revient à dire dans cette hypothèse que la révolution communiste tient du miracle, que la réalisation du socialisme relève de l'utopie.
Le prolétariat seul frein a la guerre impérialiste : le cours historique aux affrontements de classe généralises
Lorsqu'on se rend compte du scepticisme général qui règne actuellement dans le milieu politique prolétarien — ainsi que dans le marais moderniste — indépendamment des différentes façons dont il s'exprime et de la nature des groupes qui l'affichent, ce qui surprend en premier lieu, c'est qu'aucun des groupes concernés ne s'aperçoive de la contradiction apparente existant actuellement entre le niveau atteint par la crise économique, le développement gigantesque de l'armement, la constitution de deux blocs impérialistes mondiaux et le fait que malgré tout la 3e guerre impérialiste généralisée ne se déclenche pas. On ne peut aller au-delà de cette contradiction apparente qu'en prenant en compte que le déclenchement de la guerre mondiale n'est possible que si la bourgeoisie peut absolument compter non seulement sur la neutralité du prolétariat, mais encore sur son adhésion, sur son embrigadement derrière les idéaux bellicistes et nationalistes de la classe dominante. C'est tout un processus de dégénérescence et de trahisons des partis ouvriers sociaux-démocrates qui a permis la mobilisation du prolétariat en 1914-18.
Pourtant, dès 1917, des mouvements de masse vont surgir contre la guerre. La révolution prolétarienne d'Octobre en Russie, les mouvements révolutionnaires en Allemagne et Autriche-Hongrie en 18-19 vont venir rappeler à la bourgeoisie que l'on ne déclenche pas une guerre mondiale simplement « en s'assurant la neutralité du prolétariat ». C'est pour cela qu'avant la deuxième guerre mondiale, ce sont dix années qui seront nécessaires à la bourgeoisie pour achever l'écrasement physique et le désarmement idéologique de la classe ouvrière, dix années de travail acharné des partis staliniens encore tout auréolés de leur appartenance récente au mouvement ouvrier, dix années de massacres sanglants perpétrés par la soldatesque à la solde de la bourgeoisie. Le résultat a été l'embrigadement de la classe ouvrière sous la bannière de l'anti-fascisme ou dans les rangs du fascisme. La guerre mondiale ne peut éclater sans l'écrasement préalable de toute résistance ouvrière, idéologique et physique.
Dans la période historique actuelle, toute organisation qui n'a pas une vision au jour le jour, qui ne pose pas d'ultimatum aussi absurde à la classe ouvrière, qui ne se pare pas d'un scepticisme grandiloquent, devrait percevoir que la situation est radicalement différente. En effet, depuis l'irruption d'un nouveau cycle de crise ouverte du capitalisme à la fin des années 60, le prolétariat, développe sa lutte et sa conscience préparant ainsi la réalisation de sa propre perspective historique : la révolution communiste, qui sans être inéluctable, devient une réelle possibilité et la seule chance de survie de l'humanité.
C'est donc, dès la fin des années 60 que le prolétariat mondial reprend à une échelle historique le chemin de sa lutte. En premier lieu, pendant toute la période qui va de 1968 à 1974 — avec Mai 68 en France, le Mai rampant en Italie, les affrontements en Pologne en 1970 — le prolétariat marquait alors la fin de plusieurs dizaines d'années de contre-révolution particulièrement noires et sanglantes ayant conduit à la liquidation physique de toute une partie d'une génération de prolétaires. Le fait que cette première vague de luttes se soit déroulée à partir d'une situation économique encore peu dégradée, laissait beaucoup de place pour les illusions au sein de la classe ouvrière, des illusions du type « Programme commun » en France, « Compromis historique » en Italie. La croyance en la possibilité de se sortir de la crise capitaliste, vue comme passagère, comme crise de restructuration, était profondément enracinée dans la classe. L'expérience pratique dans la lutte de l'affrontement aux syndicats restait en très grande partie à faire pour les jeunes générations de prolétaires impliquées dans ces luttes. Les illusions sur la capacité des syndicats de mener le combat de classe avaient une très forte emprise sur le prolétariat.
Mais déjà, malgré toutes ces limites, les quelques minorités révolutionnaires de l'époque se devaient de relever le changement profond dans la situation historique qui était en train de s'opérer.
Après quatre années d'accalmie relative, les années 1978-80 verront à nouveau un développement significatif de la lutte ouvrière qui culminera dans la grève de masse en 1980 en Pologne. Cette deuxième vague de lutte qui se développera à partir d'attaques déjà beaucoup plus fortes de la condition de vie ouvrière démontre l'évolution survenue dans le prolétariat. La combativité y sera plus forte et plus répandue que lors de la première vague de luttes, les illusions sur la possibilité de sortir rapidement de la crise capitaliste moins grandes et moins fortes. Les mystifications bourgeoises du type « Programme commun » ou « Compromis historique », tout en gardant une forte emprise sur la classe ouvrière, ne seront plus suffisantes pour empêcher le développement des luttes de résistance du prolétariat.
C'est pour faire face à cette situation de renforcement du combat de classe que la bourgeoisie sera alors contrainte de réorganiser l'ensemble de son appareil politique et d'enclencher un processus de renvoi de ses forces de gauche dans l'opposition.
Débutant par les luttes en Belgique en 1983, l'actuelle 3° vague de luttes marque un pas en avant important dans le développement de la combativité et de la conscience ouvrières. Elle prend sa source face à des attaques économiques massives et à la suite de plusieurs années de sabotage des luttes mené par la gauche et les syndicats dans l'opposition. Elle se traduit au coeur du capitalisme mondial, dans les pays les plus industrialisés et à haute concentration ouvrière, par l'existence de mouvements de grande ampleur impliquant des centaines de milliers d'ouvriers simultanément (Danemark en 1985, Belgique en 1986, Suède en 1986). Dans tous ces mouvements se sont développées des tendances concrètes à l'unification des luttes par-delà les secteurs, privé, public, chômeurs, etc. : par l'envoi de délégations ouvrières vers différents secteurs, par des manifestations centrales autour de mots d ordre communs, etc. Une grande partie de ces luttes ont débuté de façon spontanée en dehors de toute consigne syndicale, marquant ainsi concrètement dans la lutte l'usure croissante des forces d'encadrement bourgeoises. La vague de luttes actuelle marque toute l'évolution survenue dans le prolétariat depuis la fin des années 60 et notamment le dégagement progressif de l'emprise de l'idéologie bourgeoise et de l'Etat sur la classe ouvrière. Il est caractéristique que les appels de la bourgeoisie à accepter des sacrifices immédiats en vue d'une hypothétique amélioration future rencontrent un écho toujours plus restreint dans les rangs ouvriers. Les campagnes idéologiques sur les luttes de libération nationale (Nicaragua, Angola, etc.), le « pacifisme », l'« anti-totalitarisme » font de moins en moins recette dans la classe ouvrière et n'amoindrissent en rien sa volonté de lutte.
La vague présente de luttes de classe montre la détermination croissante du prolétariat à refuser toujours plus consciemment les conditions de vie qui lui sont faites par le capitalisme décadent ; elle prépare ainsi dès aujourd'hui la future généralisation des luttes dans la grève de masse. Face à la menace du prolétariat, dans l'incapacité de répondre aux exploités par une réelle amélioration de leurs conditions de vie, mais au contraire, contrainte d'exiger l'exploitation toujours plus féroce, la bourgeoise développe à outrance ses appareils de répression (armée, police, etc.), radicalise davantage ses appareils d'encadrement de la lutte ouvrière. Cet état de choses exprime l'affaiblissement historique de la bourgeoisie amenée s à faire face à des mouvements de lutte qui gagnent en ampleur. Il indique que sa priorité absolue est de tenter de battre idéologiquement et d'écraser dans le sang le prolétariat. Si la lutte est suffisamment forte, si elle continue à se développer, alors l'aboutissement de la logique du capitalisme en crise généralisée : la guerre impérialiste mondiale, n'est pas possible.
Aujourd'hui, le cours est vers la montée des luttes : la généralisation de la crise capitaliste reste la principale alliée du prolétariat r Dans le passé, jamais les conditions ne lui ont été aussi favorables. La division de la classe ouvrière dans la vague révolutionnaire commencée en 1917, entre ouvriers des pays vainqueurs et ouvriers des pays vaincus de la première guerre mondiale, n'existe plus. Dans la situation historique présente, le milieu politique prolétarien doit avoir résolument confiance dans les réelles possibilités présentes de la classe ouvrière.
LE SCEPTICISME, UNE ATTITUDE QUI DETOURNE LES ORGANISATIONS REVOLUTIONNAIRES DE LEURS TACHES ACTUELLES
Il est une évidence : le développement de la lutte de classe n'est pas un processus linéaire. Il est fait d'avancées et de reculs, de moments d'accélération et de défaites partielles : « Elles (les grèves de masse) prirent les dimensions d’un mouvement de grande ampleur, elles ne se terminaient pas par une retraite ordonnée, mais elles se transformaient, tantôt en luttes économiques, tantôt en combats de rue, et tantôt s'effondraient d'elles-mêmes. » (Rosa Luxembourg, Grève de masse, partis et syndicats).
Il n'y aurait pas de pire chose que se laisser ballotter au gré des événements, perdre confiance à chaque pause de la lutte de classe car on se rend alors incapable de saisir la dynamique générale du mouvement.
Le chemin qui reste à parcourir est encore long et difficile : sur ce plan, le plus dur est encore devant pour la classe ouvrière. La vague de luttes présente va continuer de se heurter à une bourgeoisie parfaitement organisée et unifiée face au prolétariat. Elle devra s'affronter à des syndicats de plus en plus actifs au sein des luttes ouvrières, à un syndicalisme de base toujours plus « radical » et virulent.
C'est parce que les révolutionnaires connaissent cette réalité, mais aussi parce que jamais les possibilités n'ont été aussi fortes et favorables au mouvement ouvrier, qu'ils doivent éviter à tout prix de tomber dans le scepticisme. Celui-ci ne peut que les détourner des tâches à l'ordre du jour.
C'est dès aujourd'hui dans sa lutte présente que la classe ouvrière a besoin d'une intervention adaptée et décidée des révolutionnaires. Quiconque manque actuellement de confiance dans la classe ouvrière démontre ainsi sa profonde sous-estimation du développement de la lutte de classe. Avec une telle vision on est conduit, comme le font les modernistes, à chercher en dehors du marxisme, en dehors de la lutte de classe, sur le terrain interclassiste des consolations à moindre prix. Dans le meilleur des cas, comme peut le faire une organisation révolutionnaire telle que le FOR, on développe un antisyndicalisme abstrait en dehors de l'activité réelle de la classe.
Etre à l'écoute permanente des mouvements actuels de la lutte de classe, répondre aux besoins du combat par des propositions adaptées à la situation, assumer dans les faits le rôle d'avant-garde de la classe, voilà le devoir présent des révolutionnaires.
C'est la seule façon de vérifier dans la pratique la validité des positions communistes : « Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres ; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat /'avantage d'une intelligence claire des conditions de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. » (Manifeste Communiste, Marx et Engels).
pa
Questions théoriques:
- Décadence [5]
- Le cours historique [6]
Où en est la crise économique ? : Récession, chômage, inflation : la grande plongée de la fin des années 80
- 7037 reads
La « reprise » de l'économie américaine, amorcée en 1983 et qui a culminé en 1984, est définitivement terminée. Les cris de victoire de l’administration Reagan qui prétendait avoir terrassé la crise, scandés au rythme de la baisse de l'inflation et galvanisés par la croissance record de l'économie américaine en 1984 (6,6%) se sont tus. Le bel optimisme du gouvernement américain, après les doutes de 1985, a sombré, au vu des mauvais résultats de 1986 qui ont amené tous les principaux pays industrialisés à réviser en baisse leurs prévisions de croissance.
A priori, le taux de croissance de l'économie américaine ne sera pas pire en 1986 qu'il ne l'a été en 1985 : après avoir plafonné à 2,2 % en 1985, les premières estimations pour 1986 ont été de 4 %, puis revues à 3 % ; finalement, il devrait se situer plus près des 2 %. Cependant, le taux de croissance de 1986 est resté faible, malgré un déficit budgétaire record qui a servi à faire tourner la production, essentiellement grâce aux commandes d'armement, et surtout malgré une baisse du dollar de plus de 40 % par rapport au yen et au mark allemand qui aurait dû doper les exportations, et donc la production. Cette dernière espérance ne s'est pas réalisée malgré toutes les mesures prises, et c'est avec une inquiétude croissante que les dirigeants politiques et les responsables économiques du monde entier voient l'économie américaine s'engager sur le chemin de la récession, entraînant derrière elle l'ensemble de l'économie mondiale.
Les remèdes de la bourgeoisie face à la crise économique mondiale n'en sont pas, et ne font que répercuter les contradictions de l'économie capitaliste à un niveau toujours plus élevé. Les fameuses « Reaganomics », dont la seule nouveauté était le nom, n'échappent pas à la règle. Cela est vrai tant sur le plan de la croissance du chômage que de l'inflation, plans sur lesquels la bourgeoisie prétendait encore, il y a peu, avoir vaincu la crise.
UN NOUVEAU PAS DANS LA RECESSION
La croissance américaine s'est faite à crédit. En cinq ans, les USA, qui étaient le principal créditeur de la planète, sont devenus le principal débiteur, le pays le plus endetté du monde. La dette cumulée des USA, interne et externe, atteint aujourd'hui la somme pharamineuse de 8000 milliards de dollars, alors qu'elle n'était que de 4600 milliards en 1980, et 1600 en 1970. C'est-à-dire que pour parvenir à jouer son rôle de locomotive, en l'espace de cinq ans, le capital américain s'est endetté autant que durant les dix années qui ont précédé. Et pour quels résultats ! Cette politique n'a pas permis une relance mondiale ; elle a tout au plus permis de bons scores pour les pôles les plus développés (USA, Japon, Allemagne), tandis que pour le reste des pays industrialisés de l'OCDE, l'économie est plutôt restée stagnante, et que pour les pays capitalistes les moins développés, cette politique d'endettement s'est traduite par une fuite des capitaux, un recul dramatique des investissements, et une plongée depuis le début des années 80 dans une récession tragique dont ils ne sont pas sortis. La locomotive américaine n'a pas été suffisante pour entraîner une réelle reprise mondiale ; tout cet endettement n'a permis que de gagner du temps. Et cette politique menée par les USA à coups de déficits budgétaires et commerciaux n'est plus possible aujourd'hui. La dette du gouvernement américain depuis le début de la décennie a crû à un rythme de 16,6 % par an en moyenne ; les seuls remboursements des intérêts pour l'année 1986 s'élèvent à 20 milliards de dollars. Il devient urgent pour les USA de réduire leur déficit budgétaire (210 milliards de dollars en 1986) et commercial (170 milliards de dollars en 1986). Ils doivent rétablir leur balance commerciale et ne peuvent le faire qu'aux dépens de tous leurs concurrents commerciaux (notamment l'Europe et le Japon) qui avaient vu leur croissance stimulée par les exportations vers les USA. Le marché américain, principal marché capitaliste de la planète, est en train de se fermer comme débouché pour les autres pays. La chute de 40 % du dollar vis-à-vis du mark et du yen a constitué le premier pas de cette politique, mais comme celle-ci s'est révélée insuffisante, des mesures encore plus drastiques sont à prévoir de la part de la première puissance mondiale : nouvelle baisse du dollar, protectionnisme renforcé, etc. Les conséquences prévisibles et qui commencent à faire sentir leurs effets sont dramatiques : concurrence exacerbée, déstabilisation du marché mondial et, surtout, nouvelle accélération de la plongée dans la récession dont nul économiste n'ose aujourd'hui prévoir les terribles effets à venir.
VERS UN ACCROISSEMENT DRAMATIQUE DU CHOMAGE
La diminution du chômage aux USA — qui est passé de 9,5 % de la population active en 1983 à 7,1 % en 1985 — a constitué un des axes de la propagande reaganienne pour justifier sa politique économique. Mais ce « succès » est une fausse victoire, car pour l'ensemble des pays européens de l'OCDE, dans le même temps, le chômage a continué sa croissance : 10 % en 1983 et 11 % en 1985. Le chômage n'a pas été vaincu ; au contraire, il s'est développé en dépit de toutes les rodomontades de la propagande bourgeoise. Même là où les résultats ont été les meilleurs, en Amérique du Nord, ceux-ci sont à relativiser, car les chiffres fournis par la bourgeoisie sur cette question sont une tricherie permanente, du fait qu'ils sont soumis aux besoins de la propagande sur ce sujet particulièrement brûlant.
Par rapport aux résultats des USA, il faut d'abord noter que même avec la baisse du chômage, les chiffres restent supérieurs à tous ceux enregistrés avant 1981.
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
USA 6,9 6,0 5,8 7,0 7,5 9,5 9,5 7,4 7,1
Europe 5,7 6,0 6,2 6,8 8,4 9,5 10,0 10,8 11,0
De plus, si la politique de Reagan a permis de créer des centaines de milliers d'emplois, c est essentiellement dans le secteur des services où l'emploi est moins stable, et surtout moins bien payé (d'environ 25 %) que dans l'industrie où 1 million d'emplois ont été perdus.
Avec la chute de la croissance et la concurrence renforcée qui en découle, une nouvelle vague de licenciements massifs est en cours, et il est tout à fait significatif de voir aujourd'hui une firme comme General Motors annoncer la fermeture de 11 usines et plusieurs dizaines milliers de licenciements. Le mythe de la diminution possible du chômage a vécu, alors qu'il y a déjà 32 millions de sans emploi (officiellement) dans les pays de l'OCDE, que les taux de chômage sont déjà en 1985 de 13,2 % en Belgique, 13 % en Grande-Bretagne, 13 % en Hollande, 21,4 % en Espagne ; ce sont des taux comparables à ceux qui ont suivi la grande crise de 1929 qui se profilent à l'horizon.
A aucun moment, la « reprise » américaine n'a permis au chômage de revenir à son niveau des années 70, et maintenant que celle-ci est terminée, c'est une perspective dramatique qui se profile pour la fin des années 80.
LE RETOUR DE L'INFLATION GALOPANTE
S'il est un plan sur lequel la classe dominante croyait bien avoir gagné la partie, c'est bien celui de l'inflation passée pour les pays de l'OCDE de 12,9 % en 1980 à 2,4 %, pour les 12 mois qui ont précédé août 86. Cependant, l'inflation n'a pas disparu, loin de là. Pour l'ensemble du monde, selon le FMI, elle a continué à croître : 12,6 % en 1983, 13,8 % en 1984, 14,2 % en 1985. En fait, seuls les pays les plus industrialisés ont bénéficié de la baisse de l'inflation, tandis que celle-ci continuait ses ravages dans le reste du monde, et tous les plans d'austérité draconiens mis en place au Mexique, en Argentine et au Brésil ne sont pas parvenus à la juguler. L'inflation est présente aux frontières des centres les plus industrialisés, prête à déferler de nouveau : au Mexique, aux portes des USA, 66 % en 1986 ; en Yougoslavie, aux frontières de l'Europe industrielle, 100 % prévus en 1986!
La politique anti-inflationniste menée par les USA et le reste des pays industrialisés n'a pu se faire que par :
— une attaque sévère contre le niveau de vie de la classe ouvrière, afin de diminuer les coûts de production : licenciements massifs, attaques en règle contre les salaires, diminution de la protection sociale, cadences accélérées, etc.,
— et surtout une chute dramatique du cours des matières premières, imposée et orchestrée par les puissances économiques dominantes qui ont mis à profit la situation de surproduction généralisée, ce qui a eu pour résultat de plonger les pays les plus pauvres, essentiellement producteurs de matières de base, dans une misère encore plus effroyable.
Cette politique a eu pour conséquence d'engendrer un rétrécissement du marché mondial et un^ concurrence exacerbée. Elle est fondamentalement à l'origine de la récession comme expression de la surproduction généralisée. Cependant, dans le même temps, la politique d'endettement des USA en vue de maintenir l'activité dans les plus importantes concentrations du monde capitaliste, a été, elle, une politique fondamentalement inflationniste qui tirait des traites sur l'avenir et dont les effets étaient seulement reportés. En procédant ainsi, la classe dominante n'a fait que gagner du temps, et le spectre de l'inflation, chassé par la porte de la baisse des coûts de production et du coût des matières premières, ne peut que faire un retour en force par la fenêtre de l'endettement.
Ainsi, ce n'est pas par hasard si, au même moment, les principaux pays industrialisés sont amenés à réviser en baisse les prévisions de croissance, présentant ainsi la perspective d'une nouvelle accélération de la plongée dans la récession, et à réviser en hausse les indices d'inflation. Toutes les mesures prises pour freiner la récession qui s'impose inéluctablement, ne peuvent que contribuer à une relance de l'inflation dans une situation où l'accumulation d'un endettement gigantesque a créé les conditions d'un développement rapide de celle-ci. Le double infléchissement : croissance en chute, inflation en hausse de l'année 1986, est caractéristique de la dégradation profonde de l'économie mondiale ces dernières années.
LE JAPON ET L'ALLEMAGNE DANS LA TOURMENTE DE LA CRISE
Finalement, les résultats de la « reprise » américaine sont bien faibles :
— l'économie mondiale n'est pas sortie de la récession amorcée à l'aube des années 80 ; celle-ci a tout au plus été freinée essentiellement dans les pays les plus industrialisés;
— le chômage a continué de se développer, et là où il a pu diminuer d'une année sur l'autre, il n'est cependant jamais revenu au niveau d'avant le début de cette décennie;
— l'inflation n'a pas disparu, et les conditions de son redéveloppement se sont renforcées.
Ce piètre résultat a cependant été obtenu au prix fort d'un endettement gigantesque, nous l'avons vu pour les USA, mais aussi pour l'ensemble du monde : la dette des pays au capitalisme sous-développé est passée, de 1980 à aujourd'hui, de 800 à plus de 1000 milliards de dollars, au prix d'une paupérisation dramatique de la population, avec pour conséquence des famines comme jamais l'humanité n'en avait connues dans son histoire, au prix d'un déséquilibre renforcé entre les pays capitalistes les plus pauvres et les pays les plus riches, au prix d'une instabilité croissante du marché mondial qui a vu sa principale monnaie, le dollar, jouer au yoyo, doublant son cours en trois ans, pour reperdre la moitié de sa valeur en un an. Tout cela signifie une fragilisation très importante de l'économie capitaliste mondiale.
Mais aujourd'hui, même cette politique aux conséquences catastrophiques n'est plus possible pour maintenir l'activité des centres industriels; l'économie américaine, locomotive de l'économie mondiale, a entamé son irrésistible plongée dans la récession.
A la lumière de la catastrophe prévisible à venir, c'est avec une inquiétude croissante que les dirigeants du monde entier sont à la recherche désespérée de nouvelles solutions qui permettraient de prolonger l’« atterrissage en douceur » de l'économie mondiale. L'administration Reagan prétend avoir trouvé la réponse avec ses demandes répétées au Japon et à l'Allemagne de contribuer à la « relance » de l'économie mondiale. Mais cette « solution », pas plus que les précédentes, n'en est une. Ce que n'a pas réussi à faire l'économie américaine, relancer l'économie mondiale, les économies japonaise et allemande en ont encore moins les moyens.
A eux deux, le Japon et la RFA ne représentent que la moitié du PNB des USA (en 1985 : 612 milliards de dollars pour la RFA, 1233 pour le Japon, contre 3865 pour les USA) ; tout au plus peuvent-ils, par une politique de relance interne, contribuer à freiner la plongée dans la récession. Mais à quel prix ? Les fameux pays du miracle économique japonais et allemand ne sont plus que des miraculés en sursis. L'Allemagne et le Japon sont ceux qui ont le mieux profité de la reprise américaine ; la fermeture du marché américain frappe aujourd'hui leur économie de plein fouet.
L'exemple du Japon est particulièrement significatif. Initialement estimée à 4 % en 1986 (après avoir été de 5,1 % en 1984 et de 4,8 % en 1985), la croissance ne cesse tout au long de l'année 1986, d'être revue en baisse. Officiellement, elle devrait être finalement de 2,8 %, mais au vu des résultats, elle pourrait n'atteindre que 2,3 %. Durant le premier semestre 1986, la production industrielle a baissé de 0,2 % par rapport à la même période de 1985 ; les résultats de l'automne risquent d'être encore plus alarmants. La récession est déjà une réalité tangible au Japon, la 2e puissance économique du monde.
En conséquence, on assiste à une flambée du chômage, le chiffre de 6 % annoncé par les journaux japonais est certainement plus réaliste que les 3 % officiels (qui ne considèrent pas comme chômeur tout ouvrier qui a travaillé ne serait-ce qu'une heure dans le mois). Tous les grands groupes industriels annoncent des licenciements. D'ici à 1988, les cinq grands groupes sidérurgiques annoncent 22 500 suppressions d'emploi. A la fin de 1986, 6 000 emplois auront été supprimés dans la construction navale. Le gouvernement, de son côté, a décidé de licencier dans les chemins de fer, et surtout dans les mines de charbon : 8 mines sur 11 vont être fermées, entraînant 14 000 suppressions d'emploi. Le mythe du Japon qui ne connaît pas le chômage a définitivement sombré.
Et pourtant, ces résultats négatifs se sont produits malgré la politique de relance interne du gouvernement japonais qui a fait baisser son taux d'escompte tout au long de l'année 1986 jusqu'à 3 % aujourd'hui. Un record ! Mais cela n'est pas suffisant pour compenser la baisse des exportations vers les USA.
Les chiffres record des excédents de la balance commerciale japonaise ne doivent pas semer l'illusion. Ils sont essentiellement dus à la chute des importations, liée à la chute des cours des matières premières et notamment du pétrole. Mais cette situation est tout à fait provisoire. Ce n'est qu'à grand peine que le Japon a maintenu ses exportations en rognant sur ses marges bénéficiaires face à un dollar en baisse qui a diminué d'autant la compétitivité de ses exportations. Ce qui a pour la première fois conduit les grandes entreprises japonaises exportatrices à enregistrer des pertes.
L'économie allemande ne sauve guère mieux les apparences, la situation n'est pas florissante. Le chômage persistant se maintient à 8,5 % de la population active, la croissance industrielle a stagné à 1,6 % d'août 1985 à août 1986 et les mauvais résultats de l'automne ont amené les autorités germaniques à réviser à la baisse toutes leurs prévisions de croissance (pour 1987, on ne s'attend plus qu'à une croissance de 2 %, ce qui est peut-être encore optimiste). La croissance de la masse monétaire, pourtant de 7,9 % d'août 85 à août 86, ne parvient pas à stimuler la croissance. Malgré les résultats exceptionnels obtenus sur le plan de l'inflation, et qui sont dus essentiellement à la revalorisation du mark. Cette croissance de la masse monétaire annonce l'inflation à brève échéance.
Le Japon et la RFA ont commencé une politique de croissance interne, mais celle-ci se révèle déjà insuffisante pour leur économie nationale. Alors, quant à relancer l'économie mondiale, il n'en est pas question. Les recettes reaganiennes appliquées à ces pays ne peuvent qu'avoir des résultats encore plus aléatoires que pour les USA. Le Japon et l'Allemagne sombrent eux aussi de plus en plus nettement dans l'abîme de la récession mondiale.
DE PLAIN-PIED DANS LA CATASTROPHE ECONOMIQUE
Les perspectives sont donc on ne peut plus sombres pour l'économie mondiale. Toutes les « solutions » mises en avant et appliquées par la bourgeoisie se révèlent impuissantes à juguler la crise qui poursuit son long travail de dégradation de l'économie capitaliste. La classe dominante est en train de brûler ses dernières cartouches pour freiner autant que possible la plongée dans la récession. Les dernières années ont montré que la relance mondiale était devenue impossible, la crise a mis en échec toutes les mesures apprises par les économistes de la bourgeoisie depuis la crise de 1929, et même la relance par l'économie de guerre vient d'échouer avec la fin de la « reprise » américaine. La surproduction est générale, y compris pour l'industrie d'armements, où l'on voit une entreprise comme Dassault en France être aujourd'hui obligée de licencier.
La seule question qui se pose maintenant, ce n'est pas de savoir si la perspective est catastrophique, elle l'est, mais à quelle vitesse l'économie mondiale s'enfonce dans cette catastrophe. Plus la bourgeoisie va vouloir freiner les effets de la récession, plus l'inflation se développe. Plus la bourgeoisie veut freiner le développement de l'inflation, plus la récession s'accélère, et finalement les deux tendent à se développer ensemble.
Avec l'effondrement de l'économie mondiale, ce sont les dernières illusions sur le capitalisme qui vont être sapées à la base. La misère et la barbarie qui se développent plus que jamais imposent la nécessité de la perspective communiste. La crise balaie le terrain pour que cette perspective puisse s'imposer comme la seule issue. La crise, malgré les misères qu'elle impose, en détruisant les bases d'existence et de mystification de la classe dominante est la meilleure alliée du prolétariat.
JJ. 26/11/86
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (1)
- 4811 reads
A travers la polémique avec un groupe, le GCI[1] [8] qui se dit marxiste mais rejette violemment l'idée de la décadence», voici une réaffirmation des fondements de l'analyse de la décadence du capitalisme et de sa brûlante actualité au milieu des années 80, lorsque le prolétariat mondial relève la tête et se prépare à livrer des combats décisifs pour son émancipation.
Pourquoi l'humanité en est-elle à se poser la question de savoir si elle n'est pas en train de s'autodétruire dans une barbarie croissante, alors qu'elle a atteint un degré de développement des forces productives qui lui permettrait de s'engager dans la voie de la réalisation d'un monde sans pénurie matérielle, une société unifiée capable de modeler sa vie suivant ses besoins, sa conscience, ses désirs, pour la première fois de son histoire ?
Le prolétariat, la classe ouvrière mondiale, constitue-t-elle la force révolutionnaire capable de sortir l'humanité de l'impasse dans laquelle le capitalisme l'a enfermée, et pourquoi les formes de lutte du prolétariat à notre époque ne peuvent-elles plus être celles de la fin du siècle dernier (syndicalisme, parlementarisme, lutte pour des réformes, etc.) ? Il est impossible de prétendre se repérer dans la situation historique actuelle, encore moins de jouer un rôle d'avant-garde, d'orientation pour les luttes ouvrières, sans avoir une vision globale, cohérente, permettant de répondre à ces questions aussi élémentaires que cruciales.
Le marxisme -le matérialisme historique- est la seule conception du monde qui permette de le faire. Sa réponse claire et simple peut être résumée en peu de mots : pas plus que les autres modes de production qui l'ont précédé (communisme primitif, despotisme oriental, esclavagisme, féodalisme), le capitalisme n'est un système éternel.
L'apparition puis la domination mondiale du capitalisme furent le produit de toute une évolution de l'humanité et du développement de ses forces productives : au moulin à bras correspondait l'esclavagisme, au moulin à eau le féodalisme, au moulin à vapeur le capitalisme, écrivait Marx. Mais au-delà d'un certain degré de développement, les rapports de production capitalistes se sont transformés à leur tour en obstacle au développement des forces productives. Dès lors, l'humanité vit prisonnière d'un ensemble de rapports sociaux devenus inadaptés, obsolètes, qui la condamnent à une «barbarie» croissante dans tous les domaines de la vie sociale. La succession de crises, guerres mondiales, reconstructions, crises, depuis quatre-vingts ans n'en est que la plus claire manifestation. C'est la décadence du capitalisme. La seule issue est dès lors la destruction de fond en comble de ces rapports sociaux par une révolution dont seul le prolétariat peut assumer la direction, car il est la seule classe véritablement antagoniste au capital ; une révolution qui peut aboutir à une société communiste parce que le capitalisme, pour la première fois dans l'histoire, a permis la création des moyens matériels d'entreprendre une telle réalisation.
Tant que le capitalisme remplissait une fonction historiquement progressiste de développement des forces productives, les luttes prolétariennes ne pouvaient aboutir à une révolution mondiale triomphante mais pouvaient, à travers le syndicalisme et le parlementarisme, obtenir de véritables réformes et améliorations durables des conditions d'existence de la classe exploitée. A partir du moment où le système capitaliste entre en décadence, la révolution communiste mondiale devient une nécessité et une possibilité à l'ordre du jour, ce qui bouleverse entièrement les formes de combat du prolétariat, même sur le plan immédiat revendicatif (grève de masses).
Depuis l'Internationale communiste, constituée sous la poussée de la vague révolutionnaire internationale qui mit fin à la première guerre mondiale, cette analyse de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence est devenue patrimoine commun des courants communistes qui ont su, grâce à cette « boussole historique», se maintenir sur un terrain de classe intransigeant et cohérent. Le CCI n'a fait que reprendre et développer ce patrimoine tel qu'il fut transmis et enrichi par le travail des courants des gauches communistes allemande, italienne ("Bilan"), dans les années 30, puis du groupe de la gauche communiste de France ("Internationalisme") dans les années 40[2] [9]
Aujourd'hui, alors que sous la pression d'une crise économique sans précédent qui, depuis plus de quinze ans, accélère les manifestations de la décadence et exacerbe les antagonismes de classes, le prolétariat mondial a repris le chemin de la lutte, lentement, se heurtant à mille difficultés et aux mille armes de la classe dominante, mais avec une simultanéité internationale inconnue auparavant, il est crucial que les organisations révolutionnaires sachent être à la hauteur de leur fonction.
En vue des combats décisifs qui se préparent, plus que jamais il est indispensable que le prolétariat se réapproprie sa propre conception du monde, telle qu'elle s'est élaborée à travers près de deux siècles de luttes ouvrières et d'élaboration théorique de ses organisations politiques.
Plus que jamais, il est indispensable que le prolétariat comprenne que l'actuelle accélération de la barbarie, l'exacerbation ininterrompue de son exploitation ne sont pas des fatalités "naturelles", mais les conséquences des lois économiques et sociales capitalistes qui continuent à régir le monde alors qu'elles sont devenues historiquement dépassées depuis le début du siècle.
Plus que jamais, il est indispensable que la classe ouvrière comprenne que les formes de lutte qu'elle avait apprises au siècle dernier (luttes pour les réformes, appui à la constitution de grands Etats nationaux - pôles d'accumulation du capitalisme en développement), si elles avaient un sens lorsque la bourgeoisie était encore en plein développement historique et pouvait accepter l'existence du prolétariat organisé au sein de la société, ces mêmes formes ne peuvent le conduire, à l'heure du capitalisme décadent, qu'à des impasses et à l'inefficacité.
Plus que jamais il est crucial que le prolétariat comprenne que la révolution communiste - dont il est le porteur - n'est pas un rêve chimérique, une utopie, mais une nécessité et une possibilité qui trouve ses fondements scientifiques dans la compréhension de la décadence même du mode de production dominant, décadence qui s'accélère sous ses yeux.
“Il n'y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire”, disait Lénine. Cette idée est d'autant plus à réaffirmer aujourd'hui que la classe dominante ne se défend plus idéologiquement par l'élaboration de théories nouvelles ayant un minimum de consistance, mais par une sorte de “nihilisme” de la conscience, le rejet de toute théorie comme “fanatisme idéologique”. S'appuyant sur la méfiance justifiée de la classe exploitée à l'égard des théories “de gauche” qui, de la social-démocratie au stalinisme, ont été utilisées pendant des décennies comme instruments de la contrerévolution, incapable de trouver dans la réalité sociale en décomposition un quelconque avenir à offrir, la classe dominante n'a rien d'autre à proposer que “la politique de l'autruche” : ne pas réfléchir, se résigner, le fatalisme.
Lorsque la bourgeoisie était une classe historiquement révolutionnaire elle a donné des Hegel qui ont ouvert des portes essentielles pour la compréhension de l'évolution de l'humanité ; lorsqu'elle stabilise son pouvoir dans la seconde moitié du 19e siècle, elle revient en arrière à travers les conceptions positivistes d'un Auguste Conte. Aujourd'hui, elle ne produit même plus de philosophes pouvant revendiquer une compréhension de l'histoire. L'idéologie dominante, c'est le néant, le vide, la négation de la conscience.
Mais autant cette négation de la conscience est la manifestation d'une décadence qui devient à son tour instrument de défense de la classe dominante, autant pour la classe révolutionnaire la conscience de son être historique est un instrument vital pour sa lutte.
LES «ANTI-DECADENTISTES»
Ce qui nous préoccupe ici, c'est que cette tendance au nihilisme de la conscience se manifeste aussi dans des groupes politiques prolétariens ...paradoxalement à prétentions théoriques.
C'est ainsi que l'on a pu voir, fin 1985, un groupe comme le GCI publier un article dans le n° 23 de son organe “Le Communiste” qui, par son contenu, illustre parfaitement la deuxième partie de son titre : “Théories de la décadence : décadence de la théorie”. Ce texte, écrit dans un langage prétentieux, à “sonorité marxiste”, citant à tort et à travers Marx et Engels, prétend détruire ce qu'il appelle les “théories décadentistes”, dont il situe les défenseurs à côté de : “Tous les chacals réactionnaires hurlant à la 'décadence de l'Occident' depuis les témoins de Jéhovah, jusqu'aux «nouveaux philosophes», en passant par les néo-nazis européo-centristes, jusqu'aux adorateurs de Moon !” Rien que ça!
Ce texte réussit le chef-d'oeuvre de concentrer en quinze pages les principales incompréhensions de base que l'on peut trouver dans l'histoire du mouvement ouvrier en ce qui concerne l'évolution historique du capitalisme et les bases objectives pour l'avènement d'une société communiste. Le résultat est une bouillie aussi pédante qu'informe, qui mélange les théories tant combattues par Marx des socialistes utopiques, celles des anarchistes ...et, pour les temps modernes, la théorie bordiguiste des années 50 sur l'“invariance” du marxisme et sur le développement continu du capitalisme depuis 1848 !
Nous nous attacherons ici à mettre en lumière les principales aberrations de ce document, pas tant pour le GCI en lui-même dont l'involution vers l'incohérence est d'un intérêt fort restreint, mais parce que sa défense de certaines positions politiques de classe, son langage radical et ses prétentions théoriques, peuvent faire illusion chez des éléments nouveaux à la recherche d'une cohérence - entre autres, parmi ceux qui viennent de l'anarchisme[3] [10]
Cela permettra de rappeler quelques éléments de base de l'analyse marxiste de l'évolution des sociétés et donc de ce qu'on entend par décadence du capitalisme.
Y-A-T-IL UNE EVOLUTION HISTORIQUE ?
Y-A-T-IL UNE PHASE ASCENDANTE DU CAPITALISME?
Le GCI n'est pas modeste. A la manière de Dühring qui prétendait bouleverser la Science, le GCI bouleverse le Marxisme. Il se veut marxiste, mais à condition de rejeter dans le camp des «chacals réactionnaires» tous ceux qui depuis la 2e Internationale ont enrichi le marxisme en analysant les causes et l'évolution de la décadence du capitalisme... et comme on le verra, en ignorant ou altérant totalement l'oeuvre de Marx lui-même.
La grande découverte du GCI, celle qui réduit au rang d'«adorateurs de Moon» les Bolcheviks, les Spartakistes, la gauche allemande du KAPD, la gauche italienne de «Bilan» - qui ont tous élaboré et partagé l'analyse de la décadence du capitalisme -, sa grande vérité, consiste en ceci : il n'y a pas de décadence du capitalisme parce qu'il n'y a jamais eu de phase ascendante «progressiste» du capitalisme. Il n'y a pas de barbarie de la décadence parce que le capitalisme a toujours été barbare.
Il suffisait d'y penser !... Si ce n'était que les courants socialistes pré-marxistes et leurs héritiers anarchistes, qui n'ont jamais compris à quoi bon cela pouvait servir de passer du temps à réfléchir sur les lois de l'évolution historique - puisqu'il suffit d'être révolté et que le communisme a toujours été à l'ordre du jour de l'histoire - n'ont jamais dit autre chose ...contre le marxisme.
Mais regardons de plus près les principaux arguments du GCI: «Presque tous les groupes se prévalant aujourd'hui de défendre la perspective communiste se réclament d'une vision décadentiste non seulement du mode de production capitaliste mais de l'ensemble de la succession de sociétés de classes (cycle de la valeur) et cela grâce à de multiples 'théories' allant de la 'saturation des marchés' à 'l'impérialisme : stade supérieur du capitalisme', du 'troisième âge du capitalisme' à la 'domination réelle', de 'l'arrêt du développement des forces productives' à '1a baisse tendancielle du taux de profit'... Ce qui nous intéresse dans un premier temps est le contenu commun à toutes ces théories : la vision moralisatrice et civilisatrice qu'elles induisent.» (“Théories de la décadence : décadence de la théorie”, “Le Communiste” n° 23, p. 7, novembre 1985)
En quoi constater que les rapports de production capitalistes sont devenus à un moment donné une entrave au- développement des forces productives, traduirait-il une conception «moralisatrice et civilisatrice» ? Parce que cela implique qu'il y aurait eu un temps où tel n'était pas le cas et où ces rapports auraient constitué un progrès, un pas en avant dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase ascendante du capitalisme. Or, dit le GCI, ce “progrès” n'était qu'un renforcement de l'exploitation :
“(...) il s'agit de voir en quoi la marche forcée du progrès et de la civilisation a signifié chaque fois plus d'exploitation, 1a production de surtravail (et pour le capitalisme uniquement la transformation de ce surtravail en survaleur) en fait 1a réelle affirmation de la barbarie par la domination de plus en plus totalitaire de la valeur...” (op. cit. p. 8, le GCI emploie ici le terme de “barbarie” sans savoir de quoi il s'agit ; nous y reviendrons plus loin). Que le capitalisme ait toujours été depuis sa naissance un système d'exploitation -le plus achevé, le plus impitoyable- n'est ni faux ni nouveau, mais, à moins de partager la vision idéaliste –“morale” au sens propre du terme- suivant laquelle n'est progrès dans l'histoire que ce qui avance de façon immédiate dans le sens de la “justice sociale”, cela n'explique pas encore pourquoi affirmer que l'instauration de ce mode d'exploitation représenta un progrès historique, constitue une preuve de “vision moralisatrice et civilisatrice”. Le GCI nous explique alors que : “La bourgeoisie présenta (...) tous les modes de production qui l'ont précédée comme 'barbares' et 'sauvages' et, à mesure de 'l'évolution' historique, progressivement 'civilisés'. Le mode de production capitaliste étant bien entendu l'incarnation de l'aboutissement final de la Civilisation et du Progrès. La vision évolutionniste correspond donc bien à l'être social capitaliste et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle fut appliquée à toutes les sciences (c'est-à-dire à toutes les interprétations partielles de la réalité du point de vue bourgeois) : science de la nature (Darwin), démographie (Malthus), histoire logique, philosophie (Hege1)...” (Ibid.p.8).
Le GCI a placé au début de son texte, en grosses lettres, en encadré, ce titre “ambitieux” : “Première contribution : la méthodologie”. Le morceau que nous venons de citer est un échantillon de ce qu'il a à nous offrir dans ce domaine.
“La bourgeoisie, constate le GCI, présente le mode de production capitaliste comme étant l'aboutissement final de la civilisation et du “progrès”. “Donc, conclut-il la vision évolutionniste correspond à l'être social capitaliste”.
C'est en-deçà du plus stupide syllogisme ! Avec une telle “méthodologie”, pourquoi ne pas penser que les théories “fixistes” (“rien de nouveau sous le soleil”) correspondent à l'“être social du prolétariat” ? La bourgeoisie disait que le monde bouge et que l'histoire évolue. Le GCI en déduit que puisque c'est la bourgeoisie qui l'a dit, ce doit être certainement faux ; donc, le monde n'évolue pas. Si aberrant que cela paraisse, c'est à cela qu'aboutit “la méthode” du GCI, comme on le verra plus loin à propos de son adhésion à la vision de «l'invariance».
Le marxisme rejette évidemment l'idée que le capitalisme représente l'aboutissement de l'évolution humaine. Mais il ne rejette pas pour autant l'idée que l'histoire humaine a suivi une évolution qui peut être rationnellement expliquée et dont il s'agit de trouver les lois. Marx et Engels en leur temps reconnurent les mérites scientifiques de Darwin et se sont toujours réclamés du noyau rationnel de la dialectique hégélienne (Malthus, que le GCI ramène ici, n'a rien à faire dans cette histoire). Ils ont su voir dans ces efforts pour définir une évolution, une vision dynamique de l'histoire, la manifestation du combat que devait livrer la bourgeoisie pour asseoir son pouvoir contre la réaction féodale, avec ses avancées et ses limites. Voici comment Engels parle de Darwin dans l'“Anti-Dühring” : “Il faut citer ici Darwin, qui a porté le coup 1e plus puissant à la conception méthaphysique de la nature en démontrant que toute la nature organique actuelle, les plantes, les animaux et, par conséquent, l'homme aussi, est le produit d'un processus d'évolution qui s'est poursuivi pendant des millions d'années” (chap. I).
De Hegel, il dit ceci: “De ce point de vue, l'histoire de l'humanité n'apparaissait plus comme un enchevêtrement chaotique de violences absurdes, toutes également condamnables devant le tribunal de la raison philosophique arrivé à maturité et qu'il est préférable d'oublier aussi rapidement que possible, mais comme le processus évolutif de l'humanité lui-même” (chap. I).
Ce que le marxisme rejette de la vision de Hegel c'est son caractère encore idéaliste (l'histoire ne serait que la réalisation de l'Idée de l'histoire) et bourgeois (l'Etat capitaliste serait l'incarnation de la raison achevée) et, évidemment pas l'idée qu'il existe une évolution historique qui traverse des étapes nécessaires. Au contraire, il revient à Marx le mérite d'avoir découvert ce qui constituait le fil conducteur de l'évolution des sociétés humaines et d'avoir fondé sur cela la nécessité et la possibilité du communisme :
“Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. (...) Réduits à leurs grandes lignes, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne apparaissent comme des époques progressives de la formation économique de 1a société. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme antagonique du procès social de production (...) Avec ce système social, c'est donc la préhistoire de la société humaine qui se clôt.” (Avant-propos à la Critique de l'Economie politique).
LE COMMUNISME A-T-IL TOUJOURS ÉTÉ A L'ORDRE DU JOUR DANS L'HISTOIRE ?
Dans son délire “anti-décadentiste” le GCI considère que ceux qui défendent aujourd'hui l'analyse de la décadence du capitalisme ne parlent de déclin du capitalisme à notre époque que pour mieux être “pro-capitalistes”... il y a un siècle (!) : “Les décadentistes sont donc pro-esclavagistes jusqu'à telle date, pro-féodaux jusqu'à telle autre... pro-capitalistes jusqu'en 1914 ! Ils sont donc chaque fois, du fait de leur culte du progrès, opposés à la guerre de classe que mènent les exploités opposés aux mouvements communistes qui ont le malheur de se déclencher dans la «mauvaise phase” (GCI, op. cit., p. 19)
Avec de grands airs de radicalisme, le GCI ne fait que reprendre la vision idéaliste d'après laquelle le communisme a été à l'ordre du jour à n'importe quel moment de l'histoire.
Nous n'entrerons pas ici dans la question des spécificités du combat prolétarien au cours de la phase ascendante du capitalisme, mais pourquoi le “Manifeste communiste” dit-il : “Au début (...) les prolétaires ne combattent pas encore leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis, les résidus de la monarchie absolue, les propriétaires fonciers, les bourgeois non-industriels, les petits-bourgeois” (Manifeste communiste, “Bourgeois et prolétaires”) ? Pourquoi et comment les luttes ouvrières de la phase suivante se donnent-elles pour objectif la conquête de réformes et l'“union de plus en plus étendue des travailleurs” ? Pourquoi le syndicalisme, les partis de masse, la social-démocratie de la fin du XIXe siècle furent-ils des instruments prolétariens...? Toutes ces formes de lutte que le GCI est incapable de comprendre et rejette un siècle après comme bourgeoises, nous les aborderons dans un prochain article consacré spécifiquement à la question de la nature prolétarienne de la social-démocratie.
Pour le moment, ce qui nous importe ici et ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est la conception marxiste de l'histoire et des conditions de la révolution communiste.
Marx, les marxistes, ne se sont jamais cantonnés à dire simplement : le capitalisme est un système d'exploitation qu'il faut détruire et qui n'aurait jamais dû exister, le communisme étant possible à tout moment. C'est sur cette question que le marxisme constitue une rupture avec le socialisme “utopique” ou “sentimental” ; c'est sur cette question que se fera la rupture entre anarchisme et marxisme. Tel fut l'objet du débat entre Marx et Weitling en 1846, qui devait aboutir à la constitution de la première organisation politique marxiste: la Ligue des Communistes. Pour Weitling : “Ou bien l'humanité est, nécessairement, toujours mûre pour 1a révolution, ou bien elle ne le sera jamais” (cité par Nicolaïevski, La Vie de Karl Marx, chap. X).
C'est encore ce même problème qui est la base des divergences entre Marx-Engels et la tendance de Willich et Schapper au sein de la Ligue des Communistes en 1850, et qui fera dire à Marx : “A la conception critique, la minorité substitue une conception dogmatique, à la conception matérialiste, elle substitue une conception idéaliste. Au lieu des conditions réelles, elle considère la simple volonté comme le moteur de la révolution.” (Procès-verbal de la séance du Comité central du 15 septembre 1850, cité par Nicolaïevski, op.cit., chap XV).
C'est la conception du matérialisme historique, du socialisme scientifique que rejette le GCI. Voici comment Engels dans l'“Anti-Dühring” abordait un aspect fondamental des conditions du communisme : “La scission de la société en une classe exploiteuse et une classe exploitée, en une classe dominante et une classe opprimée était une conséquence nécessaire du faible développement de la production dans le passé. Tant que le travail total de la société ne fournit qu'un rendement excédant à peine ce qui est nécessaire pour assurer strictement l'existence de tous, tant que le travail réclame donc tout ou presque tout le temps de la grande majorité des membres de la société, celle-ci se divise nécessairement en classes. (...) Mais si, d'après cela, la division en classes a une certaine légitimité historique, elle ne l'a pourtant que pour un temps donné, pour des conditions sociales données. Elle se fondait sur l'insuffisance de la production ; elle sera balayée par 1e plein déploiement des forces productives modernes” (partie III, chap. II).
C'est en ce sens que Marx parla des “merveilles” accomplies par la bourgeoisie et de “la grande influence civilisatrice du capital”. “C'est elle (1a bourgeoisie) qui a montré ce que l'activité humaine est capable de réaliser. Elle a accompli des merveilles qui sont autre chose que les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques ; les expéditions qu'elle a menées à bien sont très différentes des invasions et des croisades.” (Marx/Engels : Le Manifeste communiste, “Bourgeois et Prolétaires”).
“C'est ici, écrit ailleurs Marx, la grande influence civilisatrice du capital : il hausse la société à un niveau en regard duquel tous les stades antérieurs font figure d'évolutions locales de l'humanité et d'idolâtrie de la nature. La nature devient enfin un pur objet pour l'homme, une simple affaire d'utilité ; elle n'est plus tenue pour une puissance -en soi” (Grundrisse, Chap. II : Le capital; marché mondial et système de besoins - 1857-58).
Si le GCI était conséquent, s'il avait un quelconque souci de cohérence théorique, il ne devrait pas hésiter à rejeter aux poubelles de la bourgeoisie -après les gauches communistes, après Trotsky, Lénine, Luxembourg et toute la 2e Internationale- les vieux Marx et Engels, en tant que farouches défenseurs de ce qu'il appelle des conceptions “évolutionnistes” et “civilisatrices”.
Peut-être qu'alors le groupe RAIA, ayant pour sa part achevé son approfondissement de “la question Marx-Bakounine”, pourra lui faire comprendre que ce qu'il défend n'est rien d'autre que la vieille et insipide rengaine utopiste et anarchiste, maquillée -pour on ne sait quelle raison- d'un verbiage marxiste.
LA DÉCADENCE DU CAPITALISME : “UNE ÈRE DE RÉVOLUTION SOCIALE”
A partir de quel moment la révolution communiste devient-elle une possibilité historique ? Marx répond : “A un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de 1a société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale.” (Avant-propos à la Critique de l'Economie politique, 1859).
Le marxisme ne définit pas un jour, une heure, à partir de laquelle la révolution communiste est objectivement à l'ordre du jour. Il détermine les conditions générales -au niveau de ce qui constitue le squelette de la vie sociale, l'économie- qui caractérisent une “ère”, une période historique dans laquelle le capitalisme se heurte d'une façon qualitativement différente à ses propres contradictions, et se transforme en frein au développement des forces productives.
Les principales manifestations de cette nouvelle situation historique se situent au niveau économique (crises économiques, ralentissement de la croissance des forces productives). Mais aussi au niveau de l'ensemble des aspects de la vie sociale qui, en dernière instance, sont influencés par la vie économique de la société. Marx parle des “formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit (entre rapports de production et forces productives, ndlr) et le poussent jusqu'au bout.” (Avant-propos...).
Marx et Engels crurent à plusieurs reprises au cours de la deuxième moitié du 19e siècle que le capitalisme était parvenu à ce point, en particulier à l'occasion des différentes crises économiques cycliques qui secouèrent le système à cette époque. Ils surent reconnaître à chaque occasion qu'il n'en était rien.
Ainsi, en 1850, après que la crise économique et sociale de 1848 fut dépassée, Marx écrivait :
“Avec cette prospérité générale, au sein de laquelle les forces productives de la société bourgeoise se développent avec toute l'exubérance que permettent les conditions bourgeoises, il ne peut être question d'une véritable révolution. Une telle révolution n'est possible que dans une période où deux facteurs se trouvent en opposition : les forces productives modernes et les formes bourgeoises de production (...) Une nouvelle révolution n'est possible qu'à la suite d'une nouvelle crise. Mais celle-là est aussi certaine que celle-ci.” (Les luttes de classes en France, 1850).
En réalité jusqu'au début du 20e siècle, les crises du capitalisme furent encore des crises de croissance rapidement surmontées par le système. C'est seulement avec la Ire guerre mondiale que se sont manifestés de façon éclatante et in-équivoque les symptômes de l'arrivée du capitalisme à un point où le développement de ses contradictions internes avait atteint un degré qualitativement différent.
Les marxistes révolutionnaires, la gauche de la 2e Internationale, ceux-là même qui venaient de combattre pendant des années les courants révisionnistes (Bernstein) qui avaient théorisé l'idée que le capitalisme ne connaîtrait plus de crises et que l'on pourrait aller au socialisme par une évolution graduelle et pacifique, reconnurent sans hésitations la création de cette nouvelle situation historique : l'entrée du capitalisme dans sa phase de déclin.
L'éclatement de la révolution russe, puis la vague révolutionnaire internationale qui la suivit, confirmaient avec éclat la perspective marxiste.
C'est de cette analyse que nous nous réclamons aujourd'hui ; une analyse que 70 ans marqués par deux guerres mondiales, deux phases de reconstruction et deux périodes de crise économique mondiale : 1929-1939 et 1967-1987, sont venus confirmer par un développement sans précédent de la barbarie sur l'ensemble de la planète.
UNE CRITIQUE DÉNUÉE DE SENS
Pour rejeter cette analyse, le GCI commence par attribuer aux “décadentistes” une idée absurde qu'il invente de toutes pièces et qu'il se plait par la suite à critiquer longuement. Avant de passer à leur argument de “l'invariance”, réglons donc rapidement cette manoeuvre pitoyable.
Le GCI prétend que l'analyse de la décadence affirmerait que pendant la phase ascendante du capitalisme, celui-ci ne connaît aucune contradiction, ces contradictions n'apparaissant que pendant la phase de décadence. Ainsi répond-il:
“Il n'y a donc pas deux phases : l'une où la contradiction de classe (autrement dit la contradiction entre force productive sociale et rapport de production) n'existerait pas : phase progressive où le 'nouveau' mode de production développerait sans antagonismes ses bienfaits civilisateurs..., et une phase où, après le développement 'progressiste de ses bienfaits', il deviendrait obsolescent et commencerait à décliner, induisant donc seulement à ce moment, l'émergence d'un antagonisme de classe.”
Voici ce que nous écrivions sur cette question dans notre brochure : La décadence du capitalisme :
“Marx et Engels ont eu la géniale perspicacité de dégager dans les crises de croissance du capitalisme l'essence de toutes ses crises et d'annoncer ainsi à l'histoire future les fondements de ses convulsions les plus profondes. S'ils ont pu le faire, c'est parce que, dès sa naissance, une forme sociale porte en germe toutes les contradictions qui l'amèneront à sa mort. Mais tant que ces contradictions ne sont pas développées au point d'entraver de façon permanente sa croissance, elles constituent le moteur même de cette croissance.” (La décadence du capitalisme, p.68).
Le GCI ne sait pas de quoi il parle.
“L'INVARIANCE”
Ayant rejeté avec l'analyse de la décadence du capitalisme tous les courants marxistes conséquents depuis plus d'un demi-siècle, mais craignant certainement de se reconnaître comme anarchiste, le GCI est allé chercher dans les théories de Bordiga des années 50 une “caution” marxiste à ses délires libertaires : c'est la théorie de “l'invariance du programme communiste depuis 1848”.
Le paradoxe n'est qu'apparent. L'anarchisme qui ignore tout de l'évolution historique en général peut s'accommoder de la vision bordiguiste, qui, sous prétexte d'“invariance”, ignore les changements fondamentaux qui ont marqué l'évolution du capitalisme depuis ses origines.
Cependant, pour aberrante que soit la théorie de Bordiga, elle a au moins le mérite d'une certaine cohérence avec les positions politiques qu'elle soutient : le bordiguisme considère que les formes de lutte du 19° siècle, telles que le syndicalisme ou l'appui à la constitution de nouveaux Etats, demeurent valables à notre époque. Par contre, pour le GCI, qui rejette ces formes de lutte, cela devient une source d'incohérence. Il est alors contraint de rejeter dans le camp de la bourgeoisie la social-démocratie du 19e siècle, et de s'inventer un Marx anti-syndicaliste, antiparlementariste, anti-social-démocrate, un peu comme le stalinisme réinventait l'histoire de la révolution russe en fonction des besoins de sa politique immédiate.
Mais regardons de plus près la critique de la théorie de la décadence et l'analyse de l'évolution du capitalisme de Bordiga, derrière laquelle le GCI prétend dissimuler son involution anarchisante. Bordiga, que le GCI cite dans l'article mentionné, dit en effet :
“La théorie de la courbe descendante compare 1e développement historique à une sinusoïde : tout régime, 1e régime bourgeois par exemple, débute par une phase de montée, atteint un maximum, commence à décliner ensuite jusqu'à un minimum, après un autre régime entreprend son ascension. Cette vision est celle du réformisme gradualiste : pas de secousse, pas de saut, pas de bond. La vision marxiste peut se représenter (dans un but de clarté et de concision) en autant de branches de courbes toutes ascendantes jusqu'à leur sommet (en géométrie : point singulier ou cuspides) auxquelles succède une violente chute brusque, presque verticale, et au fond, un nouveau régime social surgit ; on a une autre branche historique d'ascension (...) L'affirmation courante que le capitalisme est dans sa branche descendante et ne peut remonter contient deux erreurs : l'une fataliste, l'autre gradualiste.” (Réunion de Rome, 1951). Ailleurs Bordiga écrit encore : “Pour Marx, 1e capitalisme croît sans arrêt au-dela de toute limite…” (Dialogue avec les morts).
Avant de répondre aux accusations fantaisistes de «gradualisme» et de “fatalisme”, confrontons, ne fût-ce que rapidement, la vision de Bordiga avec la réalité.
Tout d'abord une remarque importante : Bordiga parle de “courbe” ascendante ou descendante d'un régime. Précisons que ce dont il est question pour les marxistes lorsqu'ils parlent de «phase ascendante» ou «décadente» n'est pas une série statistique mesurant la production en soi. Si l'on veut envisager l'évolution de la production comme un élément pour déterminer si un mode de production connaît ou non sa phase de décadence -c'est-à-dire savoir si les rapports de production sont devenus un frein ou non au développement des forces productives- il faut d'abord savoir de quelle production on parle : la production d'armes ou d'autres biens et services improductifs n'est pas un signe de développement des forces productives, mais au contraire un signe de leur destruction ; ensuite, ce n'est pas le niveau de production en soi qui est significatif, mais son rythme de développement, et cela non pas en absolu, mais évidemment eu égard aux possibilités matérielles acquises par la société.
Ce point étant précisé, lorsque Bordiga affirme que “1a ‘vision marxiste’ (dont il prétend être 'l'invariable' défenseur) peut se représenter en autant de branches de courbes toutes ascendantes jusqu'à leur sommet auxquelles succède une violente chute brusque”, il dit deux contre-vérités.
C'est une contre-vérité d'affirmer que telle est la vision marxiste. Marx s'est exprimé très clairement sur la fin du féodalisme et la naissance du capitalisme, et cela dans un texte suffisamment connu, Le Manifeste Communiste :
“Les moyens de production et d'échange, sur la base desquels s'est édifiée la bourgeoisie, furent créés à l'intérieur de la société féodale. A un certain degré du développement de ses moyens de production et d'échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, l'organisation féodale de l'agriculture ou de la manufacture, en un mot le régime féodal de 1a propriété, cessèrent de correspondre aux forces productives en plein développement. Ils entravaient la production au lieu de la faire progresser. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Il fallait les briser. Et on les brisa.” (‘Bourgeois et prolétaires’, souligné par nous).
Il s'agit ici pourtant d'une situation fort différente de celle qui se produit pour la fin du capitalisme, puisque le communisme ne peut pas commencer à s'édifier au sein de l'ancienne société. Mais dans le cas du féodalisme comme dans celui du capitalisme, la mise à l'ordre du jour du bouleversement des rapports sociaux existants est provoquée par la nature de frein, de chaîne de ceux-ci, par le fait que ceux-ci entravent au lieu de faire progresser le développement économique.
C'est tout autant une contre-vérité d'affirmer que l'histoire s'est déroulée suivant le schéma d'une série de branches toujours ascendantes. En particulier pour le cas qui nous intéresse le plus, le capitalisme.
Il faut être aveugle ou ébloui par la propagande en trompe-l'oeil, immédiatiste de la bourgeoisie décadente pour ne pas voir la différence entre le capitalisme depuis la première guerre mondiale et le capitalisme du 19e siècle, pour affirmer que les rapports de production, capitalistes ne sont pas plus une entrave au développement des forces productives au 20e qu'au 19e siècle.
Les crises économiques, les guerres, le poids des frais improductifs, existent aussi bien au 19e qu'au 20e siècle, mais la différence entre les deux époques est quantitativement si importante qu'elle en devient qualitative.
(Le GCI, qui emploie si souvent à tort et à travers le mot “dialectique” dans son texte, a dû au moins entendre parler de la transformation du quantitatif en qualitatif).
L'effet de frein au développement des forces productives exercé par les destructions et le gaspillage de forces matérielles et humaines des deux guerres mondiales est qualitativement différent de celui qu'ont pu exercer par exemple la guerre de Crimée (1853-56) ou la guerre franco-prussienne (1870-71). Pour ce qui est des crises économiques, celles de 1929-39 et de 1967-87 sont à peine comparables aux crises cycliques de la deuxième moitié du 19e siècle, et cela aussi bien sur le plan de leur intensité, que sur celui de leur étendue internationale ou de leur durée (Voir à ce propos l'article La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent, Revue Internationale n° 23, 4e trimestre 1980, où cette question est spécifiquement traitée). Quant au poids des frais improductifs, son effet stérilisateur sur la production est lui aussi qualitativement différent de tout ce qui pouvait exister au 19e siècle :
- production permanente d'armement, recherche scientifique orientée vers le militaire, entretien d'armées (pour 1985, les chiffres officiels des gouvernements reconnaissent plus de 1,5 millions de dollars dépensés en frais militaires par minute dans le monde !) ;
- les services improductifs (banques, assurances, la plupart des administrations étatiques, publicité, etc.).
Le GCI cite quelques chiffres sur la croissance de la production au 19e et au 20e siècle qui prétendent démontrer l'inverse. Nous ne pouvons entrer ici dans les détails (Voir la brochure La décadence du capitalisme). Mais quelques remarques s'imposent.
Les chiffres du GCI comparent la croissance de la production de 1950 à 1972 à celle de 1870 à 1914. C'est une mystification assez grossière. Il suffit de comparer ce qui peut être comparé pour que l'argument s'effondre. Si au lieu de considérer les dates cidessus qui excluent de la phase de décadence la période de 1914 à 1949 (deux guerres mondiales et la crise des années 30 !), on compare la période 1840-1914 avec celle de 1914-1983, la différence s'annule... Mais qui plus est, la production du 19e siècle est essentiellement celle de moyens de production et de biens de consommation, alors que celle du 20e siècle inclut une part toujours croissante de moyens de destruction ou improductifs (aujourd'hui, on compte une puissance destructrice cumulée équivalente à 4 tonnes de dynamite par être humain, et par ailleurs, dans la comptabilité nationale, un fonctionnaire d'Etat est considéré «produire» l'équivalent de son salaire). Enfin et surtout, la comparaison entre la production réalisée et ce qu'elle pourrait être eu égard au degré de développement atteint par les techniques de production est totalement ignorée.
Mais outre les contre-vérités contenues dans l'affirmation “pour Marx, le capitalisme croît sans arrêt au delà de toute limite”, la vision de Bordiga tourne le dos aux fondements matérialistes, marxistes de la possibilité de la révolution.
Si “le capitalisme croît sans arrêt au delà de toute limite”, pourquoi des centaines de millions d'hommes décideraient un jour de risquer leur vie dans une guerre civile pour remplacer ce système par un autre? Comme le dit Engels :
“Tant qu'un mode de production se trouve sur la branche ascendante de son évolution, ü est acclamé même de ceux qui sont désavantagés par le mode de répartition correspondant.” (Engels, Anti-Dühring, partie II, “Objet et méthode”).
GRADUALISME ET FATALISME ?
Le gradualisme est la théorie qui prétend que les bouleversements sociaux ne peuvent et ne doivent être faits que lentement par une succession de petits changements : “pas de secousse, pas de saut, pas de bond”, comme dit Bordiga. L'analyse de la décadence dit que celle-ci se traduit par l'ouverture d'une “ère de guerres et de révolutions” (Manifeste de l'Internationale communiste). A moins d'assimiler les guerres et les révolutions à des évolutions en douceur, Bordiga et le GCI ne font que se payer de mots.
Quant à l'accusation de fatalisme, elle n'est pas plus sérieuse que la précédente[4] [11]
Le marxisme ne dit pas que la révolution est inévitable. Il ne nie pas la volonté comme facteur de l'histoire, mais il démontre qu'elle ne suffit pas, qu'elle se réalise dans un cadre matériel produit d'une évolution, d'une dynamique historique dont elle doit tenir compte pour être efficace. L'importance donnée par le marxisme à la compréhension des «conditions réelles», des «conditions objectives» n'est pas la négation de la conscience et de la volonté, mais au contraire la seule affirmation conséquente de celles-ci. L'importance attribuée à la propagande et à l'agitation communistes en est une preuve évidente.
Il n'y a pas d'évolution inévitable de la conscience dans la classe. La révolution communiste est la première révolution de l'histoire où la conscience joue véritablement un rôle déterminant, et elle n'est pas plus inévitable que cette conscience.
Par contre l'évolution économique suit des lois objectives qui, tant que l'humanité vit dans la pénurie matérielle, s'imposent aux hommes indépendamment de leur volonté.
Dans le combat que livra la gauche de la 2e Internationale contre les théories révisionnistes, la question de l'effondrement inévitable de l'économie capitaliste était au centre du débat, comme le montre l'importance donnée à cette question par Rosa Luxemburg dans Réforme ou révolution, cet ouvrage salué par toute la gauche aussi bien en Allemagne qu'en Russie (Lénine en particulier).
L'orthodoxie “marxiste” religieuse de Bordiga ignore Marx et Engels qui écrivaient sans crainte :
“L'universalité vers quoi tend sans cesse 1e capital rencontre des limites immanentes à sa nature, lesquelles, à un certain degré de son développement, 1e font apparaître comme le plus grand obstacle à cette tendance, et le poussent à son auto-destruction.” (Marx, Grundrisse, “Le capital : marché mondial et système des besoins”), et encore :
“Le mode de production capitaliste (...) par son évolution propre, tend vers le point où il se rend lui même impossible.” (Engels, Anti-Dühring, partie II, “Objet et méthode”).
Ce qu'affirme le marxisme, ce n'est pas que le triomphe de la révolution communiste est inévitable, mais que, si le prolétariat n'est pas à la hauteur de sa mission historique, l'avenir n'est pas à un capitalisme qui “croît sans arrêt au delà de toute limite” comme le prétend Bordiga, mais au contraire à la barbarie, la vraie. Celle qui ne cesse de se développer depuis 1914. Celle dont Verdun, Hiroshima, le Biafra, la guerre Irak-Iran, les dernières vingt années d'augmentation ininterrompue du chômage dans les pays industrialisés, la menace d'une guerre nucléaire qui mettrait fin à l'espèce humaine, ne sont que des images parmi tant d'autres.
Socialisme ou barbarie, comprendre que telle est l'alternative pour l'humanité, c'est cela comprendre la décadence du capitalisme.
RV.
[1] [12] Groupe Communiste Internationaliste: BP 54, BXL 31, 1060 Bruxelles
[2] [13] Pour une histoire de l'élaboration théorique de l'analyse de la décadence du capitalisme, voir l'introduction à la brochure du CCI La décadence du capitalisme.
[3] [14] C'est ainsi qu'on a pu voir un petit groupe en Belgique, en rupture avec l'anarchisme et qui en est encore à “approfondir la question Marx-Bakounine” comme ils disent, juger du haut de son ignorance et de sa lecture admirative du GCI, la théorie de la décadence du capitalisme en ces termes : “La théorie de la décadence du capitalisme! Mais que diable est-ce donc que cette théorie ?
En quelques mots on pourrait qualifier celle-ci de la plus merveilleuse, la plus fantastique histoire jamais écrite depuis l'Ancien Testament !
D'après les prophètes du CCI, la ligne de vie du capitalisme serait divisée en DEUX tronçons distincts. A. la date fatidique du 8 août 1914 (sic!) (pour l'heure exacte, prière de s'adresser au bureau de renseignements !), le système capitaliste 'aurait' cessé d'être dans sa 'phase ascendante' pour entrer dorénavant dans de terribles convulsions mortelles que le CCI baptise du nom de 'phase décadente du capitalisme'! Décidemment, nous nageons en pleine psychopapouille !” (RAIA n° 3, BP 1724, 1000 Bruxelles).
[4] [15] Le GCI n'en est pas à une contradiction près, qui, reprenant une formulation de Bordiga, affirme qu'il faut y “considérer le communisme comme un fait advenu” !
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [5]
Correspondance internationale (Norvège, Danemark)
- 4839 reads
LE DEVELOPPEMENT DE LA LUTTE DE CLASSE ET LA NECESSITE DE L'ORGANISATION ET DE L'INTERVENTION DES REVOLUTIONNAIRES
Critique du « conseillisme »
Nous publions ci-dessous
des extraits de deux lettres qui émanent du courant politique « conseilliste », l’une d'un élément
venant du KPL, cercle politique en Norvège aujourd'hui dissout, l'autre d'un
membre du GIK du Danemark. Ces textes traitent essentiellement de deux
questions particulièrement importantes pour les révolutionnaires dans la
période actuelle: le rôle et les taches de l'organisation révolutionnaire,
l'intervention dans les luttes ouvrières. Le premier texte fait un bilan de
l'échec du KPL à maintenir une activité révolutionnaire organisée. Il a été adressé
« aux anciens membres du KPL et aussi aux autres camarades en Scandinavie », et
à ce titre a été envoyé à la section du CCI en Suède, IR, L'auteur se propose
de « reprendre une activité politique organisée », de « prendre contact et
prendre part à la discussion et à l'activité qui malgré tout existe », Nous
répondons sur la nécessité de clarifier et débattre de la question de la
fonction et du fonctionnement d'une organisation révolutionnaire qui est la
question-clé abordée par ce bilan et posée par la proposition qui est faite. Le
texte du GIK est une critique de l'intervention du CCI dans les luttes
ouvrières actuelles.
SUR L'ORGANISATION
Lettre de Norvège (ex-KPL)
Camarades,
Ca commence à faire un moment que le KPL s'est complètement dissout. On trouve un petit réconfort au malheur des autres, mais pendant ces dernières années ce n'est pas seulement le KPL qui a disparu. Dans le monde entier, une série de groupes révolutionnaires soit ont disparu complètement, soit ont été fortement réduits.
Si nous regardons dans le « milieu Scandinave », les groupes avec lesquels, pendant plusieurs années, nous avons été plus ou moins en contact, c'est le même développement. Le GIK semble engagé dans un processus similaire à celui qu'a connu le KPL. La section du CCI, IR, et Arbetarpress existent encore, mais ils se sont réduits par rapport à avant.
Nous, qui avons été parmi ces groupes, avons pris des voies différentes. Mais elles ont une chose en commun : elles mènent à l'abandon de l'activité révolutionnaire organisée. Nous nous sommes dans une large mesure éloignés de toute activité politique ; et ce qui existe est au mieux individuel et limité.
Nous avons vu un processus de déclin qui ne peut donner aucun résultat positif. Nous voyons des camarades abandonner l'activité révolutionnaire, et nous voyons des camarades abandonner les positions révolutionnaires.
Le capitalisme poursuit continuellement sa crise que nous ne pouvons concevoir que d'une seule façon, comme crise mortelle du capitalisme. Nous savons que cette crise ne peut qu'avoir une solution violente, ou la révolution prolétarienne mondiale, ou une destruction du capital, une nouvelle guerre mondiale.
La classe ouvrière mène une lutte qui est grosse de possibilités pour le développement d'une révolution mondiale. Cette lutte a un long chemin devant elle, mais il n'y a aucun signe évident qu'elle ne pourrait pas se développer. Dernièrement au Danemark, au printemps 1985, nous avons vu comment la lutte de classe peut se développer ; presque sans signe avant-coureur, elle a surgi dans des formes similaires à la grève de masse.
Qu'ont fait alors les communistes ? Rien. Ou même pire, ils ont cessé d'être communistes. Dans une période où les idées révolutionnaires et l'activité révolutionnaire peuvent commencer à devenir autre chose qu'un hobby pour de petits cercles, beaucoup de communistes cessent leur activité.
Je pense qu'il est grand temps d'essayer de faire quelque chose dans le processus dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous l'avons laissé se développer faussement assez longtemps.
Pourquoi sommes-nous arrivés dans l'impasse où nous nous trouvons maintenant ? Il serait trop facile et immédiatiste de se contenter de voir le développement du KPL comme le résultat de l'évolution individuelle de personnes. Nous sommes passés par une évolution où nous étions nettement moins intéressés par ce que nous faisions, dans un environnement qui ne nous fournissait pas d'impulsion particulière dans une autre direction. Le niveau de la lutte de classe était bas ; et l'intérêt politique et l'activité au sein de la « gauche en général » ont fortement régressé. Il y a un faible intérêt pour la politique en général, et pour la politique révolutionnaire en particulier. Je crois que c'est important car c'est la lutte ouvrière locale qui, malgré tout, nous influence tous, d'abord et avant tout.
Mais de telles explications ne peuvent être suffisantes pour comprendre ce qui est arrivé. Nous avons vu le même processus ailleurs et dans d'autres groupes. Il doit y avoir des raisons plus générales.
Au mieux, le KPL a été capable de produire des choses comme Extremisten n° 2, les bulletins en anglais, la brochure sur la Pologne. Qui plus est, de les avoir faits et distribués nous a donné des résultats notables. Nous avions fait des progrès politiques avec de nouveaux membres et contacts. Extremisten n° 2 a donné, relativement, de grands succès au KPL, à la fois dans le recrutement et l'influence de nos positions politiques. Les bulletins en anglais nous ont donné un certain écho international.
En même temps, ceci montre aussi partiellement nos faiblesses. Nous n'avons pas été capables de nous maintenir en vie et de développer les progrès que nous avions faits. Nous avions une organisation misérable, ou plus exactement nous n'avions pas d'organisation. Ceci nous a fortement gênés et a empêché que le KPL comme groupe fonctionne vraiment bien. Nous n'avons probablement jamais été capables de maintenir une activité continue et responsable, ni interne ni externe. Au sein du groupe, cela a pu subsister pendant un moment ; à l'extérieur, c'était une catastrophe. L'activité était occasionnelle et mauvaise.
Nous avions eu des difficultés à définir quelle sorte de groupe devait être le KPL. Le KPL devait-il être une organisation avec une base politique et une structure fermes ? ou le KPL devait-il être un groupe plus souplement coordonné à la fois politiquement et organisationnellement ? Nous avons essayé d'être les deux, mais ce fut de plus en plus la seconde position qui a dominé. Nous avions en partie défini des critères d'appartenance, mais nous ne les avons pas beaucoup pris en compte. Nous n'avions pas décidé quelles tâches le KPL devait avoir. Nous n'avions pas de structure organisationnelle.
C'est une des choses aujourd'hui que les communistes doivent apprendre : comment être organisés et comment les organisations doivent fonctionner. Pour être capables de répondre à ces questions, on doit être clairs sur quelle sorte d'organisation on essaye de créer. Le KPL n'a jamais donné de réponse claire à cette question, nous l'avions à peine posée.
Nous n'avons jamais été particulièrement « militants ». La question de l'activité politique, nous ne l'avons jamais vue comme une question de « nécessité ». Nous ne nous sommes pas, jusqu'à présent, sentis obligés de faire quelque chose de nos positions politiques. C'était plus une question de savoir si nous voulions ou si nous ne voulions pas faire quelque chose de nos positions politiques. Dans la période que nous laissons maintenant derrière nous, une période de faible niveau de la lutte de classe, il était possible de vivre ainsi. Quand la lutte de classe s'aiguise, ce n'est plus possible. Dans les périodes de lutte de classe ouverte, les révolutionnaires ne peuvent plus choisir, ils doivent alors agir en fonction de leurs positions politiques. Alors la question n'est plus s'ils feront quelque chose, mais ce qu'ils feront. Nous entrons dans une telle période maintenant, une période où l'activité révolutionnaire sera nécessaire. S'il n'y a rien, nous serons comme ouvriers, comme participants individuels dans un processus social, face à une lutte qui nous forcera à prendre position et à y participer. Comme communistes, nous ne serons pas capables de contribuer beaucoup à la lutte de classe sur une base individuelle. Les contributions des communistes à la lutte de classe sont d'abord les analyses, les perspectives et les expériences historiques. La lutte des ouvriers combatifs et les revendications ne sont pas notre contribution la plus importante.
Le fait que nous sommes à un tournant est, je crois, une partie de la racine de la crise que les révolutionnaires ont traversée et traversent encore. Ca commence à devenir sérieux, nos positions commencent à avoir des conséquences. Nous risquons quelque chose quand nous agissons en conséquence. Notre vie quotidienne et nos positions politiques ne peuvent plus être séparées de la même façon qu'auparavant.
Ce qui est exigé des révolutionnaires est aussi quelque chose d'autre que ce dont nous étions préoccupés antérieurement. Nous devons prendre part à la lutte que la classe ouvrière est en train de mener, et nous devons être capables de mettre en avant notre vision du chemin à parcourir. Pas seulement le développement général, mais la critique concrète de la lutte qui est menée et des pas qui sont faits.
Nous, qui sommes révolutionnaires aujourd'hui, avons une mauvaise connaissance et une mauvaise expérience de la réalité de la lutte de classe. La période de paix sociale dans laquelle nous avons vécu ne nous a donné que peu de possibilités d'apprendre de nos propres expériences.
Il serait tentant d'essayer de se retirer de la lutte de classe. Se maintenir hors de l'activité risque de nous exposer. Et naturellement on pourrait se mettre en sécurité du mieux possible ; mais ceci ne veut pas dire qu'on devrait abandonner la conviction et l'activité révolutionnaires, capituler. Je pense que c'est une illusion de croire qu'on pourrait se retirer dans une existence « sûre ». Tôt ou tard, cette « sécurité » n'existe plus. La seule voie pour que l'existence soit « sûre » est la révolution prolétarienne mondiale. C'est seulement si la révolution prolétarienne a réussi que l'individu peut compter sur une existence « sûre et en sécurité ».
La situation d'aujourd'hui est déprimante. Pas seulement pour nous qui étions dans le KPL, mais aussi pour d'autres révolutionnaires. La tendance à la dissolution continue, même si nous voyons quelques signes de nouvelles organisations.
La plate-forme du KPL disait, en 1981 : « Nous ne croyons pas que nous allons jouer le rôle décisif dans la lutte pour le socialisme. Nous allons participer où nous sommes, comme courant révolutionnaire dans la classe ouvrière. Quelles expressions politiques la lutte de classe va prendre dans les années qui viennent, nous le verrons. Peut-être serons-nous présents dans celle-ci comme groupe, peut-être rejoindrons-nous d'autres groupes ou serons-nous avec d'autres groupes. Le plus important n'est pas seulement l'organisation avec un grand 0, mais que la discussion dans la classe ouvrière existe et se développe, malgré les partis et les syndicats qui voudraient maintenir le monopole de leurs positions. Au cours des dernières années, nous avons vu à nouveau la croissance de groupes et tendances communistes dans une série de pays dans le monde. Nous nous considérons comme une partie de cette tendance internationale. Nous voyons comme notre tâche de mettre en avant que toute autre solution que la révolution prolétarienne est seulement expression du rapport de forces permanent entre le prolétariat et la bourgeoisie. »
Sur cette base, je souhaite reprendre une sorte d'activité politique. C'est pour nous, révolutionnaires, partiellement un acte de volonté. Nous avons vu quelques-unes des conditions fondamentales : on peut naturellement choisir de les « oublier », si on peut le supporter. Pour nous qui ne pouvons pas le supporter, nous devons choisir de faire quelque chose avec notre clarté et nos positions politiques.
Dans la situation d'aujourd'hui, il n'y a pas de grands pas à faire pour améliorer la situation. Et c'est d'abord avec de petits pas que nous devons commencer. Les camarades qui veulent continuer une activité révolutionnaire doivent se regrouper : à présent, c'est le seul progrès qui peut être fait.
Cette lettre est d'abord écrite aux anciens membres du KPL, et aussi aux autres camarades en Scandinavie. Ceci ne signifie pas qu'il y a un souhait de nous limiter à cette région géographique. C'est hors de Scandinavie que la plupart des révolutionnaires existent. Cependant, nous qui vivons ici en Scandinavie, nous devons commencer par un endroit, là où nous sommes nous-mêmes.
Le fait que nous soyons inactifs est cependant le résultat de ce que la plupart des camarades ne sont plus intéressés par l'activité révolutionnaire. Nous devons voir qui est intéressé à prendre part à une activité organisée, et commencer avec ce point de départ.
Les bases politiques n'ont pas changé. Je reste encore sur les vieilles positions politiques du KPL. Ceci ne signifie pas que toutes les positions politiques sont décidées une fois pour toutes ; mais jusqu'à présent, il n'y a aucune base pour réviser les positions fondamentales.
Lorsqu'on passe à la pratique, c'est autre chose. Il serait sans signification de poursuivre à partir de là où nous nous sommes arrêtés. Il ne s agit pas d'une nouvelle édition du vieux groupe, mais de quelque chose qui permette de tirer les leçons de ce que nous avons fait avant.
Ce n'est pas une tentative de former une nouvelle organisation politique. C'est un souhait de trouver une base pour l'activité révolutionnaire organisée. La situation d'aujourd'hui n'est pas tenable, et nous devons faire quelque chose.
Il n'y a pas une organisation communiste aujourd'hui. C'est pourquoi les camarades ont tort s'ils croient que leur propre organisation est la seule avec une politique et une pratique correctes.
Ont également tort ceux qui croient que parce qu'on ne peut pas créer une organisation « parfaite », on devrait laisser faire et plutôt rejoindre un groupe existant.
Tous les camarades devront réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Ceux qui arrivent à la conclusion qu'ils désirent continuer à prendre part à une activité révolutionnaire doivent faire eux-mêmes les pas pour sortir des « eaux stagnantes » où ils sont. Ceux d'entre nous qui souhaitent continuer une activité que nous avons cessée pendant trop longtemps, peuvent reprendre cette activité. En premier, ceci signifie reprendre contact et prendre part à la discussion et à l'activité qui malgré tout existent.
Salutations fraternelles. WP, février 1986.
Réponse du CCI
Cet appel adressé « aux anciens membres du KPL et aux autres camarades en Scandinavie » est une initiative très positive. Elle manifeste une volonté de réagir et de ne pas céder à la démoralisation, à la dispersion des énergies militantes, qui conduisent nombre de groupes politiques prolétariens à végéter, à se disloquer jusqu'à l'abandon de toute activité révolutionnaire, comme le décrit très clairement la lettre à propos de la dissolution du KPL en Norvège.
Actuellement les luttes ouvrières se développent dans le monde entier, en particulier en Europe occidentale, et dans les pays « nordiques » également, la classe ouvrière est engagée dans cette vague de résistance aux mêmes attaques toujours plus fortes des plans d'austérité de la bourgeoisie dans tous les pays. Tour à tour et simultanément, en Scandinavie, figurant au nombre des luttes les plus importantes de la vague mondiale, des mouvements se sont développés, comme la grève générale au Danemark au printemps 85, les mouvements de grève en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède, contre le démantèlement de l'« Etat social » particulièrement développé dans ces pays, la multiplication de grèves et débrayages hors des consignes syndicales, surtout en Suède depuis deux ans, et tout dernièrement encore, le mouvement autour des grèves dans le secteur public dans ce pays en octobre 86.
Dans cette situation, il est vital que les minorités révolutionnaires sachent reconnaître la combativité de ces mouvements, la prise de conscience qu'ils manifestent de la nécessité de lutter, de ne pas rester passifs, de ne pas se laisser enfermer par les manoeuvres des syndicats. Or les groupes du milieu politique prolétarien se caractérisent pour la plupart aujourd'hui par un scepticisme sur la réalité du développement de la lutte de classe sinon par une négation complète de celui-ci, ce qui contribue à renforcer le déboussolement et la dispersion des énergies révolutionnaires. Au contraire, la lettre pose clairement les enjeux de la période actuelle et leurs implications pour les révolutionnaires :
— la crise actuelle est une «r crise mortelle du capitalisme »,
— la seule alternative historique est « ou la révolution prolétarienne mondiale, ou une destruction du capital, une nouvelle guerre mondiale » ;
— la lutte présente de la classe ouvrière est « grosse de possibilités pour le développement d'une révolution sociale », ayant « un long chemin devant elle », mais avec « aucun signe évident qu'elle ne pourrait pas se développer »;
— les révolutionnaires doivent « prendre part à la lutte que la classe ouvrière est en train de mener », être « capables de mettre en avant notre vision du chemin à parcourir. Pas seulement le développement général, mais la critique concrète de la lutte qui est menée et des pas qui sont faits ».
Nous soutenons pleinement ces positions qui sont à la base de cet appel à rouvrir des discussions et des contacts, et à un regroupement de ceux qui veulent « sortir des 'eaux stagnantes' où ils sont ».
En plus de ces points nous soutenons également l'affirmation de la nécessité de l'organisation des révolutionnaires et ne pouvons qu'appuyer le souhait de « reprendre une activité organisée ».
C'est dans cet esprit que nous ferons les remarques qui suivent sur la question centrale soulevée dans la lettre, celle de la conception de l'organisation des révolutionnaires et de l'engagement militant, sur laquelle il nous semble nécessaire de poursuivre et approfondir la discussion, en plus du suivi de la situation et de l'intervention dans la lutte de classe.
Il est vrai, comme le mentionne le texte, que tous les groupes ont connu et connaissent des difficultés. Le début des années 80 en particulier a été marqué par une « crise » du milieu politique prolétarien que le CCI a amplement analysée ([1] [17]). Pour cette raison, il est juste de relier le processus de dissolution du KPL à cette crise d'ensemble. Cependant, si la crise a touché tous les groupes, elle ne les a pas tous amenés à « l'abandon de l'activité révolutionnaire », et de plus de nouveaux groupes surgissent ([2] [18]), produits de la poussée de la lutte de classe, de la lente clarification qui est en train de s'opérer sur les enjeux de la période, la nature capitaliste de la gauche du capital, les perspectives des combats ouvriers.
L'évolution des groupes n'est pas seulement liée à des facteurs objectifs tels que le fait que nous vivons une période totalement nouvelle dans toute l'histoire du capitalisme, l'accélération brutale de sa crise catastrophique avec l'entrée dans les années 80, ou le poids des cinquante années de la contre-révolution qui a dominé jusqu'à la fin des années 60 et qui pèse sur l'expérience des générations ouvrières actuelles.
La capacité ou l'incapacité à faire face aux difficultés, à tirer des leçons de l'expérience, qui font qu'un groupe politique maintienne les positions révolutionnaires et son activité ou qu'il les abandonne pour aller vers le gauchisme ou le néant, relèvent aussi de la conception qu'il défend de la fonction et du fonctionnement d'une organisation révolutionnaire du prolétariat.
La lettre illustre particulièrement clairement cela en décrivant comment la dissolution du KPL a été directement liée au flou régnant en son sein sur la question de l'organisation : le groupe a été incapable de « maintenir une activité continue et responsable » (« nous n'avions pas d'organisation », « l'activité était occasionnelle et mauvaise », etc.), le dilettantisme dominait une activité conçue comme « hobby » et « non comme une nécessité ». De même la lettre montre comment le groupe n'avait jamais tranché entre deux conceptions diamétralement opposées, celle d'« une organisation avec une base politique et une structure ferme » ou celle d'« un groupe plus souplement coordonné ».
Le texte se prononce sans ambiguïté dans sa condamnation de la deuxième position et affirme l'impossibilité de maintenir le flou, et particulièrement combien, « quand la lutte de classe s'aiguise, ce n'est plus possible ». Il rejette le repli dans l'individualisme en quête d'une « sécurité » tout à fait illusoire. Il reconnaît que les positions des révolutionnaires « peuvent avoir des conséquences». Ainsi, implicitement, il rejette les conceptions conseillistes d'une organisation de type fédéraliste ou de groupes « souplement coordonnés », qui n'ont pas fondamentalement un rôle actif à jouer dans la lutte de classe.
Mais pour tirer véritablement les leçons de l'expérience, trouver les moyens politiques de « reprendre une activité organisée », c'est explicitement qu'il est nécessaire de relier le bilan du KPL à sa conception ou plutôt son absence de conception de l'organisation, influencée par le « conseillisme » sinon
Le KPL a surgi de la mouvance conseilliste influencée par Mattick, formée de quelques groupes et cercles qui avaient tenu des « Conférences » à la fin des années 70 ([3] [19]). Si ces conférences destinées à regrouper les révolutionnaires « en Scandinavie », et auxquelles le CCI a participé en partie, ont échoué dans l'académisme d'études économiques qui n'ont jamais abouti, ce n'est pas en soi à cause des théories économiques de Mattick ou de Grossmann que défendaient la plupart des participants ([4] [20]). C'est essentiellement en raison des conceptions conseillistes des tâches des révolutionnaires qui prévalaient.
Pour l'anecdote, on peut rappeler que les propositions du CCI de ne pas se cantonner à ces seules questions économiques furent rejetées. Et ce n'est pas en fait pour ses positions « luxemburgistes » sur les questions économiques que le CCI était ressenti comme indésirable c'est fondamentalement pour sa conception de l'organisation et des tâches des révolutionnaires jugée par trop « léniniste » (ceci alors que par ailleurs le CCI était exclu des Conférences Internationales de la Gauche Communiste parce que jugé... « conseilliste » par la CWO et Battaglia Comunista).
Si nous faisons ce bref rappel, ce n'est pas pour revenir sur la « petite histoire » des débats de l'époque, mais parce que dans la mesure où l'appel de Norvège nous a été adressé, nous pensons qu'il est nécessaire de reprendre clairement ces questions là où elles ont été laissées. Il n'est pas suffisant, comme la proposition finale le fait, de simplement réaffirmer la validité des bases politiques d'origine du KPL (« les bases politiques n'ont pas changé »), alors que le bilan est tout à fait lucide sur le fiasco du groupe quant à la question de l'organisation, que la lettre se termine par « le souhait de trouver une base pour l'activité révolutionnaire », affirmant qu'«r il ne s'agit pas d'une nouvelle édition du vieux groupe ».
Pour que la proposition ne reste pas lettre morte, et soit une réelle impulsion à « trouver les bases d'une activité organisée », ce que le camarade appelle de ses voeux, si le bilan entrepris de l'expérience du KPL est poursuivi, cela doit se faire en discutant des conceptions théoriques erronées qui l'ont influencé, en comprenant les origines et l'évolution de telles conceptions dans le mouvement ouvrier, au sein des gauches qui se sont dégagées de la 3e Internationale.
Sans développer dans cette courte réponse, on peut schématiquement rappeler cette évolution : au départ des critiques souvent justes de la dégénérescence du parti bolchevik, essentiellement de la part de la gauche germano-hollandaise ; ces critiques, au fil des années de contre-révolution, emporteront « l'enfant avec l'eau du bain » ; elles finiront par mener le courant politique du « communisme de conseils » au rejet du parti bolchevik, de la révolution russe, de la nécessité d'organisations politiques centralisées, dotées d'« une base politique et d'une structure ferme » ; enfin, elles aboutiront au rejet de toute organisation politique quelle qu'elle soit, jusqu'à l'abandon du marxisme et du militantisme pour beaucoup de groupes et éléments révolutionnaires.
Ces conceptions qui amènent à ranger au placard des accessoires inutiles les organisations politiques du prolétariat, ce sont celles qui se trouvaient à la base de la constitution de nombre de groupes du type KPL qui ont aujourd'hui disparu. Elles sont l'explication première de cet « abandon de l'activité organisée ».
«Reprendre un travail organisé» passe par des débats sur l'analyse de la situation actuelle et de ses perspectives et sur l'intervention des révolutionnaires, et nécessite une réelle clarification de la question de l'organisation.
SUR L'INTERVENTION DANS LES LUTTES OUVRIERES ACTUELLES
La conception de l'organisation, c'est aussi celle des tâches concrètes des révolutionnaires dans les luttes, en particulier dans la période actuelle, avec le développement international d'une vague de mobilisation ouvrière, dans toute l'Europe. Et l’année 1986 a encore confirmé cette reprise de la lutte de classe, avec les grèves massives du printemps en Belgique, puis les grèves de l'automne autour du secteur public en Suède, qui ont montré une plus grande tendance à V unité et une plus forte contestation des syndicats dans la classe ouvrière.
Quelle doit être l'intervention au sein de tels mouvements ? La lettre de Norvège aborde aussi cette question à plusieurs reprises, à un niveau général, et appelle justement à « prendre part à la lutte que la classe ouvrière est en train de mener ». Cependant, tout comme sur la question de l'organisation en général, la vision « conseilliste » de l'intervention n'est pas explicitement remise en cause, alors qu'elle est aussi à la base de cette absence d'intervention communiste que déplore le texte, de la part des groupes qui partagent cette conception de l'organisation et de ses tâches dans la lutte de classe.
En Scandinavie, un des exemples en est le cercle GIK du Danemark, à qui l'appel de Norvège a aussi été adressé. Ce groupe, s'il maintient quelques contacts et correspondances épisodiques dans le milieu politique prolétarien, en particulier avec le CCI, n'a en fait publié depuis sa constitution il y a quatre ans, qu'un seul numéro de sa publication Mod Strommen (« Contre le courant ») ; il n'est intervenu à aucun moment dans les mouvements de grève du printemps 1985 au Danemark, malgré l'aide que certains des éléments du groupe ont fournie à l'intervention du CCI au moment des événements ; il n'a pas pris position publiquement sur ce mouvement le plus important de la classe ouvrière dans ce pays depuis dix ans au moins, sinon plus. Par contre, le GIK nous a adressé en 1985 une critique de l'intervention du CCI, contre une « orientation très activiste » et « le ton et la tendance à l'exagération empirique des luttes ouvrières » dans la presse du CCI, affirmant que « ce n'est pas seulement notre impression, mais aussi celle du KPL en Norvège et d'autres groupes ». Voici quelques extraits de cette lettre à laquelle nous avons répondu largement dans Internationell Révolution, la publication du CCI en Suède, et sur laquelle nous faisons ici quelques remarques au sujet de la vision « conseilliste » de l’intervention qui sous-tend la critique qui nous est adressée.
Extraits de lettre du Danemark (GIK)
(...) Nous sommes principiellement tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de chose comme une « pure lutte de classe », qu'on doit attendre un long et douloureux processus avant que les travailleurs ne se libèrent des vieilles illusions et traditions, et que par conséquent, il est nécessaire pour les révolutionnaires communistes d'être présents dans la vie courante de l'ouvrier, entre autres les assemblées convoquées par les syndicats pour y faire de la propagande (...)
Le CCI a pris ces dernières années une orientation très activiste (...) Vous divisez plutôt l'activité des révolutionnaires en trois domaines : travail théorique, propagande et agitation. Cette addition d'agitation, avec des « perspectives pratiques pour chaque phase de la lutte », les « prochains pas pour la lutte de classe », constitue, à notre avis, un phénomène concomitant du tournant activiste du CCI.
Je ne veux pas rejeter ici catégoriquement et par principe l'adjonction de l'agitation. Lorsqu'on fait de la propagande, il est nécessaire, cela va de soi, d'être en état d'indiquer aussi des pas tout à fait concrets. Et c'est un point particulièrement difficile. Mais on doit précisément s'attacher aux principes généraux et expliquer franchement par une propagande et une agitation inséparablement liées qu'il appartient à la classe ouvrière elle-même de se décider à lutter, et dans cette lutte de se déterminer à des pas concrets. Ce n'est pas la tâche des communistes de penser pour la classe ouvrière et de lui proposer toute espèce de direction, conduite, etc. Ce n'est pas la tâche des communistes de formuler pour les luttes quotidiennes les mots d'ordre concrets. Cela surgit de soi-même chez les ouvriers qui entrent en lutte. Notre tâche consiste plutôt à critiquer les mots d'ordre concrets, à critiquer les pas concrets en éclaircissant les expériences récentes, à renvoyer à des luttes et défaites analogues, à analyser et estimer les conditions de la lutte et à propager le « programme maximum », c'est-à-dire le but final et les développements nécessaires, généraux, de la lutte de classe y conduisant. A supposer que cela réussisse et que les ouvriers peut-être, pour un moment, écoutent les communistes au milieu de la lutte ou en dehors (c'est-à-dire qu'ils ne nous ignorent pas simplement, ou ne nous contraignent pas au silence comme « provocateurs indésirables »), ils nous demanderont peut-être : oui, peut-être, mais que faire ? Que veulent proposer ici les communistes ? A cette question, on ne peut pas répondre autrement, dans une situation tout à fait concrète, que par des généralités : prenez la lutte dans vos propres mains ! Ne remettez pas la direction et le déroulement de la lutte dans les mains des syndicats, des partis politiques et autres « pros » qui d'ordinaire pensent et agissent à votre place ! Choisissez votre propre comité directement par vous-mêmes et contrôlez constamment ses décisions ! Allez directement vers les autres ouvriers pour les entraîner dans la lutte et former directement avec eux leur propre coordination !
Ou bien la situation concrète peut voir le surgissement de luttes, alors on peut seulement dire qu on doit exhorter les ouvriers à plus se préoccuper de leurs propres affaires, qu'ils doivent se préparer à mieux diriger les prochaines luttes, qu'ils doivent lire, discuter la presse révolutionnaire, qu'ils ne doivent pas se laisser enfermer par les barrières syndicales, les portes d'usines ou les frontières locales, etc. Mais quels seront dans un sens tout à fait concret précisément les « prochains pas », on ne peut le dire. On doit précisément s'en remettre aux ouvriers eux-mêmes. Ils le savent le mieux (...).
Ceci conduit à la question de l'agitation. Précisément en raison de notre estimation de votre presse, nous craignons beaucoup que votre récente orientation vers des interventions pratiques dans les luttes ouvrières soit portée par le même sensationnalisme empirique. S'il en est ainsi, nous ne pouvons rien y voir d'autre qu'un mauvais activisme.
Et je veux expliciter cela sur la base de l'expérience des combats de 1921 en Allemagne centrale. Cela ne signifie pas naturellement que je considère cette situation valable pour opérer une comparaison avec notre situation actuelle. Surtout pas. Mais pour la question de l'agitation, de la presse et de l'intervention des révolutionnaires, c'est un bon enseignement. Ce n'est pas seulement le VKPD, mais aussi le KAPD et l'AAU qui étaient dans cette situation très activistes ; les exagérations dans leurs organes de presse constituaient, dans cette situation très tendue, une très dangereuse agitation pour l'insurrection qui reposait sur une information fausse. La presse du KAPD et de l'AAU donnait l'impression mensongère que dans presque toutes les grandes villes et centres industriels d'Allemagne était arrivé le premier signe de l'insurrection armée. C'était un mensonge. Et dans une situation aussi critique, c'était une tentative très dangereuse des organisations révolutionnaires de pousser les ouvriers à la confrontation armée avec l'Etat. La clarification de cette question d'une agitation dangereuse par la surestimation et l'interprétation erronée, de même que celle de la question de la lutte armée et de la lutte de classe prolétarienne, nous la devons à Otto Ruhle, Franz Pfemfert et à l'AAU-E en 1921. On peut beaucoup reprocher à ces gens, mais on doit en tirer un grand profit critique. Le KAPD et l'AAU ont commis ici de très graves erreurs dont nous avons tous à apprendre.
Cette question fut aussi abordée dans la première moitié des années 30 par le GIK (Hollande) de façon semblable à Ruhle et Pfemfert en 1921. Parmi les différentes tendances du mouvement communiste de gauche germano-hollandais, le GIK se prononça contre l'agitation excitatoire qui partout cherchait à entraîner les ouvriers dans la lutte. Comme le GIK le soulignait, ce n'était pas la tâche des minorités révolutionnaires d'appeler le plus souvent possible et à chaque instant les ouvriers à la lutte directe, mais plus de contribuer à long terme à la clarification et à la conscience de classe de l'ouvrier. Et cela ne se fait pas par un activisme impatient et une agitation à sensation, mais au contraire par des analyses froides et une claire propagande (...).
Avec toute notre camaraderie, salutations.
Un membre du GIK. Octobre 1985.
Quelques remarques en réponse au GIK
En premier lieu, le GIK, à la différence de la lettre de Norvège, ne voit dans la lutte de classe actuelle « rien d'autre qu'un essor purement quantitatif des luttes. Par leur contenu et leur qualité, la plupart des luttes sont encore profondément rattachées à la vieille tradition économiste et réformiste.(...) les masses restent encore profondément prisonnières des schémas syndicaux et des illusions réformistes. (...). » Et lorsque le GIK nous met en garde, au fond le débat n'est pas si la presse du CCI fait du « gonflement sensationnaliste qui s'exprime par des mots d'ordre et la routine d'analyse simplistes », mais quelle appréciation nous avons des luttes actuelles. L'analyse de la combativité et de la prise de conscience dans la classe ouvrière des enjeux de la période, des caractéristiques des luttes dans cette période nouvelle dans l'histoire du mouvement ouvrier, du rôle de division des syndicats et de la gauche, etc., n'a rien de « simpliste » et le CCI ne se fonde pas sur le dénombrement empirique des luttes pour défendre cette analyse comme en témoignent nombre d'études, rapports et articles publiés sur cette question. Nous n'y reviendrons pas dans le cadre de ces remarques ; le GIK ne fait que reprendre l'idée qui domine dans la quasi-totalité des groupes politiques prolétariens aujourd'hui qu'il ne se passe rien ou peu de chose sur le front des luttes ouvrières, idée à laquelle nous avons déjà répondu à plusieurs reprises et à laquelle nous répondons encore dans le premier article de ce numéro.
En second lieu, il existe un profond désaccord de la part du GIK avec certaines des positions de base du CCI. Parmi elles, le GIK ne pense pas que la crise économique soit irréversible, mais qu'il existe toujours pour le capitalisme des possibilités de « restructuration » ; le GIK ne conçoit pas que la gauche de l'appareil politique et syndical de la bourgeoisie soit une composante à part entière de l'Etat capitaliste, tout comme la droite, etc. De ce fait, c'est toute la base pour comprendre la période historique actuelle qui diverge d'avec celle du CCI. Et avec sa vision, le GIK ne peut effectivement voir dans la presse du CCI que du « sensationnalisme » sur les grèves ouvrières actuelles puisque lui ne voit qu'une classe ouvrière « prisonnière des schémas syndicaux et des illusions réformistes ». Il faut savoir voir au-delà de l'apparence des événements, du black-out et de la propagande de la bourgeoisie sur les luttes ouvrières, tout comme Marx a pu reconnaître dans la Commune de Paris la première tentative de dictature du prolétariat, alors que tout concourait à n'y faire voir qu'une guerre patriotique.
Pour ces raisons, il est « logique » que le GIK voie de l'« activisme » dans l'agitation que le CCI s'efforce d'entreprendre dans les luttes concrètes des ouvriers, en cohérence avec sa propagande sur l'analyse et les perspectives de la période. L'« activisme » étant en effet l'agitation alors que le cours de la période n'est pas au développement de la lutte de classe, le GIK nous met donc en garde contre l'« activisme », avec l'exemple historique de la gauche germano-hollandaise dans les années 20 à l'appui. Mais précisément, pour le CCI, ce que montre un tel exemple n'est pas le « danger » que constitue en soi l’« agitation excitatoire » des organisations révolutionnaires, mais bien le danger pour les communistes de se tromper sur l'analyse de la période.
Mais la critique du GIK ne relève pas seulement des divergences de méthode et d'analyse, mais aussi de la conception des tâches des communistes. Il est tout à fait vrai que « ce n'est pas la tâche des révolutionnaires de penser pour la classe ouvrière », mais il est tout à fait faux de dire : « on ne peut pas répondre autrement dans une situation tout à fait concrète que par des généralités ». Les organisations révolutionnaires font partie intégrante de la classe ouvrière et de ses combats ; elles ne sont pas seulement la voix de la lutte historique du prolétariat défendant le but communiste et le « critique » de la lutte immédiate, et le GIK l'affirme par ailleurs : « il est nécessaire, cela va de soi, d'être en état d'indiquer aussi des pas tout à fait concrets ». La seule chose, c'est que cela ne va pas de soi. C'est une tâche difficile qui doit être prise en charge consciemment par les organisations révolutionnaires pour appliquer les « généralités » dans chaque situation concrète, pas seulement pour indiquer les perspectives lointaines, mais aussi les objectifs et les moyens immédiats de la lutte, dans les grèves, les assemblées, les manifestations, les piquets. Cela, la conception « conseilliste » de l'organisation le rejette ou, pour le moins, le minimise complètement. C'est ce qui est aussi à la base de l'incapacité des éléments et groupes de ce courant politique à s'organiser et à être actifs dans le combat prolétarien.
MG.
[1] [21] Revue Internationale n° 32, 1er trimestre 1983.
[2] [22] Revue Internationale n° 42 et 45 sur l'Inde, n° 44 sur le Mexique, n° 46 sur l'Argentine et l'Uruguay par l’anarchisme, et qui explique la manière dont le KPL, qui était d'ailleurs plus un « collectif » qu'un groupe, s'est disloqué.
[3] [23] P. Mattick était un membre du KAPD dans les années 20 ; il fut un des chefs de file du « communisme de conseils » dans les années 30 avec la publication International Council Correspondance aux Etats-Unis. Dans les années 70, professeur au Danemark, il eut une forte influence sur l'orientation des groupes politiques en Scandinavie.
Sur les conférences en Scandinavie, voir la Revue Internationale n° 12, 1er trimestre 1978 ; sur les « conseillistes » au Danemark, voir le n° 25, 2e trimestre 1981.
[4] [24] Ce ne sont pas les explications théoriques de la crise du capitalisme, sur lesquelles peuvent exister des divergences au sein même des groupes politiques, qui constituent des critères de délimitation des discussions dans le camp révolutionnaire.
Géographique:
- Europe [25]
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 : du tribunisme au communisme (1914-1916)
- 2960 reads
DU TRIBUNISME AU COMMUNISME (1914-1916)
Nous publions la suite de l'histoire de la Gauche hollandaise dont plusieurs chapitres sont parus dans de précédents numéros de la Revue Internationale. La période traitée dans cette nouvelle série d'articles va de 1914 au début des années 20 : le déclenchement de la 1° guerre mondiale, la révolution russe et la vague révolutionnaire en Europe occidentale. Cette 1° partie concerne l'attitude du courant « tribuniste » pendant la première guerre mondiale.
Bien que les Pays-Bas aient préservé pendant la première guerre mondiale leur neutralité et se soient épargné les destructions matérielles et les terribles saignées en hommes, la guerre a été une hantise constante de la population. L'invasion de la Belgique portait les combats aux frontières mêmes de la Hollande. La prolongation du conflit mondial semblait rendre inévitable l'engagement de la bourgeoisie hollandaise dans le camp de l'Allemagne ou dans celui des Alliés. Le mouvement socialiste, comme dans les autres pays, devait donc se déterminer clairement sur le soutien ou la lutte contre son propre gouvernement.
En fait, bien souvent, les gouvernements de pays comme la Suisse, la Suède, le Danemark et la Norvège avaient une « neutralité » de façade : leur orientation était discrètement pro-allemande. Mais cette orientation se manifestait avec d'autant plus de discrétion qu'ils en tiraient des avantages commerciaux dans les deux camps. A cela s'ajoutait, facteur décisif, la profonde division des bourgeoisies de ces pays en deux fractions souvent de poids égal : l'une pro-Entente, l'autre pro-allemande (Triplice).
La bourgeoisie néerlandaise décréta très tôt la mobilisation en prévision de son engagement militaire. Ce fut surtout pour elle un moyen de tester à la fois l'adhésion des ouvriers à une éventuelle guerre et de mesurer l'intégration de la social-démocratie à l'Etat national.
La social-démocratie officielle, comme la plupart des partis des pays belligérants, adhéra au nationalisme. Le SDAP franchissait le Rubicon en reniant l'internationalisme encore affiché dans son programme. Dès le début de la guerre, Troelstra s'affirmait « principiellement au côté du gouvernement ». Le 3 août 1914, avant même la social-démocratie allemande, le SDAP votait les crédits de guerre. Il affirmait nettement sa volonté d'« Union sacrée » avec la bourgeoisie néerlandaise : « l'idée nationale domine les différends nationaux », affirmait Troelstra au Parlement.
Cependant, tout en s'engageant au côté du gouvernement dans l'Union sacrée, le SDAP mena une politique internationale qui le fit apparaître, apparemment, « neutre ». Le SDAP ne se prononça pas ouvertement pour le camp allemand, bien que la majorité du parti, et Troelstra en particulier, inclinât vers la Triplice. Il est vrai qu'une minorité significative, autour de Vliegen et Van der Goes, était ouvertement pro-Entente....
La tactique du SDAP consistait à faire ressurgir la 2e Internationale, une Internationale disloquée en partis nationaux, une Internationale qui s'était volatilisée en août 1914 avec le vote des crédits de guerre par ses principaux partis adhérents. Troelstra fit en sorte que le Bureau socialiste international, auquel refusaient d'adhérer les socialistes français, fût transporté à La Haye, pour passer sous le contrôle du SDAP et... de la social-démocratie allemande. Quant à convoquer une conférence des partis des pays neutres, comme le proposaient dans un premier temps les socialistes suisses et italiens, le parti de Troelstra ne voulait pas en entendre parler.
Néanmoins, cette pseudo-neutralité du SDAP en politique internationale lui permit d'éviter le choc de multiples scissions. L'attitude du prolétariat néerlandais resta pendant toute la durée du conflit mondial résolument anti-guerre. Celle-ci, même si elle se tenait aux frontières des Pays-Bas, se traduisait par une chute dramatique du niveau de vie de la classe ouvrière de ce pays : l'étouffement économique du pays se concrétisait rapidement par une augmentation considérable du chômage. A la fin de 1914, il y avait plus de 40000 chômeurs à Amsterdam. Rapidement, les produits de première nécessité étaient rationnés. Pour la majorité des ouvriers, la guerre mondiale était une réalité qui se traduisait par plus de misère, plus de chômage. Le risque d'extension du carnage aux Pays-Bas était aussi bien présent et permanent : en décrétant en août 1914 la mobilisation, le gouvernement plaçait sous les drapeaux des milliers d'ouvriers et laissait planer en permanence l'engagement militaire de l'armée dans le conflit mondial. Pour cela, une propagande constante était menée pour l'Union sacrée et l'arrêt des grèves ouvrières.
Menacé des horreurs des champs de bataille, soumis à une misère grandissante, le prolétariat hollandais se montrait très combatif. Des grèves éclataient, comme celle de 10000 diamantaires à Amsterdam. Dès 1915, et pendant toute la durée de la guerre, des manifestations contre la vie chère se déroulaient dans la rue. Les meetings dirigés contre la guerre et ses effets trouvaient des auditeurs de plus en plus attentifs et combatifs.
Il faut noter d'ailleurs que, dès le départ, les idées antimilitaristes et internationalistes rencontrèrent un très vif écho dans le prolétariat. Sous l'influence de Nieuwenhuis, un fort antimilitarisme organisé s'était développé aux Pays-Bas depuis le début du siècle. L'Association internationale antimilitariste (IAMV) avait été fondée en 1904 à Amsterdam. Sa section néerlandaise, qui publiait la revue « De Wapens neder » (A bas les armes !), était la plus active de cette association. Sous l'autorité de Nieuwenhuis, qui restait un révolutionnaire, elle ne prit jamais une coloration pacifiste. Restant libertaire, elle était liée aussi bien au SDP qu'au mouvement libertaire de Nieuwenhuis. Pour un petit pays de la taille des Pays-Bas, le tirage de la revue devint considérable pendant la guerre : plus de 950000 exemplaires. De façon générale, à côté du mouvement antimilitariste, le courant syndicaliste révolutionnaire connut un nouvel essor et le NAS passa de 10000 à 30000 adhérents pendant la période de la guerre.
Le SDP, de son côté, ne resta pas passif. Dès le 1° août 1914, « De Tribune » proclamait « la guerre à la guerre ». Un manifeste publié en décembre 1914 pour la démobilisation de l'armée hollandaise montrait la volonté du parti de mener une propagande vigoureuse contre la guerre.
Cependant, la politique du SDP était loin d'être claire et montrait même un éloignement des positions marxistes intransigeantes. Le SDP avait choisi en août 1914 de participer avec d'autres organisations — NAS, IAMV — à la formation d'un cartel d'organisations, dénommé « Unions ouvrières agissantes » (SAV). Ce cartel, dans lequel se fondait le SDP, apparaissait finalement moins comme une organisation de lutte révolutionnaire contre la guerre que comme une nébuleuse antimilitariste à connotation inévitablement pacifiste, faute de se prononcer clairement pour la révolution.
D'autre part, au sein du SDP, une partie de la direction véhiculait des conceptions étrangères à l'intransigeance première du tribunisme. C'est ainsi que Van Ravesteyn, entre autres, se prononçait pour « l'armement populaire » en cas d'invasion des Pays-Bas. Cette position était déjà ancienne dans la 2° Internationale ; elle essayait de concilier l'inconciliable : le patriotisme, que l'armement « populaire » transformerait en « patriotisme ouvrier » et l'internationalisme. Même les révolutionnaires les plus intransigeants, comme Rosa Luxemburg, n'échappèrent pas pendant la guerre à cette conception, héritée de l'époque des révolutions bourgeoises, qui menait directement au soutien d'un camp impérialiste. Mais chez Rosa Luxemburg, une ambiguïté passagère était vite surmontée par un rejet de toute guerre nationale à l'époque de l'impérialisme. Rejet sans ambiguïté aucune.
En fait, derrière la conception de Van Revestayn, il y avait l'idée d'une défense nationale des petits pays menacés par les « grands » pays. Cette conception menait inévitablement à la défense du camp impérialiste soutenant les petits pays en question. C'est cette idée implicite d'une « guerre juste » que les socialistes serbes avaient rejetée avec force en août 1914, en refusant de voter les crédits de guerre et en se prononçant pour l'internationalisme et la révolution internationale.
Il fallut une bataille acharnée de Gorter pour que la conception d'une défense nationale des petits pays plongés dans le conflit généralisé soit explicitement condamnée. Une résolution écrite par Gorter, dite « Résolution de Bussum », fut proposée et adoptée lors du congrès du parti de juin 1915. Elle marquait le rejet de la position de Van Revesteyn.
Lors du même congrès, Gorter fit adopter dans la même résolution le rejet du pacifisme, qui sans être explicite dans le SDP s'infiltrait derrière un langage radical, mais en fait anarchisant. Gorter s'en prenait particulièrement à la section de Groningue qui par principe, comme les anarchistes, déclarait « combattre et rejeter toute organisation militaire et toute dépense militaire. »
Une telle position, en fait, par son purisme abstrait, ne faisait qu'évacuer la question de la révolution prolétarienne. Celle-ci, finalement, dans cette vision, ne pourrait être que pacifique, sans que se pose la question concrète de l'armement des ouvriers avant la prise du pouvoir, donc celle de l'organisation militaire des ouvriers. De plus, une telle position niait la réalité, après la prise du pouvoir, d'une orientation de la production, en cas de guerre civile, en vue de la fabrication d'armes pour défendre le nouveau pouvoir révolutionnaire face à la contre-révolution.
Finalement, l'acceptation de la position de la section de Groningue par le parti aurait signifié un glissement du SDP vers le pacifisme, danger d'autant plus grand que celui-ci était inséré dans un cartel d'organisations anarchistes à orientation plus pacifiste que révolutionnaire. Pour cette raison, Gorter, par sa résolution acceptée par 432 voix contre 26, faisait condamner sans ambiguïté l'idéologie pacifiste, fût-elle antimilitariste, comme menant à l'abandon de la lutte révolutionnaire pour le pouvoir armé du prolétariat : « Si un jour les ouvriers ont le pouvoir en main, ils doivent le défendre les armes à la main. »
Ces flottements politiques au sein du SDP faisaient contraste avec les positions théoriques sur la guerre mondiale qui s'inscrivaient pleinement dans l'orientation de la gauche révolutionnaire en Russie et en Allemagne. Mais celles-ci étaient plus le produit de l'activité de Gorter que du parti comme un tout. Comme Pannekoek, Gorter avait finalement plus d'écho réel dans le mouvement révolutionnaire international que dans son parti même.
Avec Lénine et Rosa Luxemburg, Gorter fut au début de la guerre le théoricien marxiste qui exprima de la façon la plus cohérente les raisons de la mort de l'Internationale et la nature des guerres à l'ère de l'impérialisme, pour en tirer les implications pratiques pour la lutte révolutionnaire future.
C'est en décembre 1914 que Gorter fit publier par les éditions du SDP sa principale contribution théorique et politique à la lutte contre la guerre, « L'impérialisme, la guerre mondiale et la social-démocratie ». Cette brochure, qui connut plusieurs éditions rapprochées en hollandais, fut immédiatement traduite en allemand pour mener le combat politique contre la social-démocratie au niveau international.
Gorter abordait les questions les plus brûlantes posées par la guerre mondiale et la faillite de l'Internationale :
LA NATURE DE LA GUERRE
Comme les révolutionnaires de l'époque, Gorter situe le conflit mondial dans le cadre de l'évolution du capitalisme. Cette évolution est celle de la mondialisation du capital, à la recherche de nouveaux débouchés. L'analyse de Gorter sur le plan économique reste néammoins très sommaire et constitue plus une description des étapes du développement capitaliste en direction des colonies et semi-colonies qu'une véritable explication théorique du phénomène impérialiste. Par certains côtés, Gorter est plus proche de Lénine que de Rosa Luxemburg. C'est sur le plan politique que l'analyse de Gorter est proche de celle de Rosa Luxemburg, en affirmant fortement que tout Etat est impérialiste et qu'il ne peut y avoir de lutte de libération nationale, comme le soutenait encore Lénine pendant la première guerre mondiale : « sont tous les Etats qui font une politique impérialiste et veulent étendre leur territoire. » (Op. cit.)
En conséquence, le combat du prolétariat ne peut être dirigé seulement contre « sa » propre bourgeoisie. A la différence de Liebknecht, qui proclamait que « l'ennemi principal est dans son propre pays », Gorter proclame qu'il n'y a pas d'ennemis n° 1 et n° 2, mais au contraire qu'il s'agit de combattre tous les impé-rialismes, puisque le combat ne se situe plus sur un terrain national, mais sur un terrain mondial :
« L'impérialisme national menace le prolétariat autant que l'impérialisme des autres nations. Par conséquent, pour le prolétariat dans son ensemble il est nécessaire de combattre de la même façon, c'est-à-dire avec une égale énergie, tous les impérialismes, le sien comme l'impérialisme étranger. » (Ibid.)
LE DECLIN DU SYSTEME CAPITALISTE
Gorter ne voit pas la décadence du système capitaliste en théoricien, en s'appuyant sur une étude historique et économique. Il la saisit dans ses effets à la fois sociaux et culturels. La guerre mondiale signifie une menace directe pour la vie même du prolétariat mondial ; la mondialisation du capitalisme est l'aboutissement d'une évolution historique qui conduit à un combat mortel entre prolétariat et capital mondial: « Les temps ont changé ! Le capitalisme s'est tellement développé qu'il peut continuer son développement ultérieur seulement en massacrant le prolétariat de tous les pays. Un capitalisme mondial est né qui se tourne contre le prolétariat mondial... L'impérialisme mondial menace la classe ouvrière du monde entier. » (Ibid.)
On ne sera pas étonné que le grand poète que fut Gorter soit particulièrement sensible à la crise des valeurs artistiques, signe indubitable du déclin de la civilisation capitaliste. Son jugement est sans doute expéditif, car il fait abstraction des nouvelles formes d art qui surgiront au lendemain de la guerre, fortement inspirées par la vague révolutionnaire (expressionnisme, surréalisme...). Mais Gorter montre surtout l'incapacité de créer de nouveau un grand art à l'image d'un système en expansion, comme ce fut le cas au 19e siècle :
« Le grand art est aujourd'hui mort. La grande poésie dans tous les pays est morte ; sont morts l'impressionnisme, le naturalisme, le grand réalisme bourgeois... Morte la grande architecture. Ce qui subsiste encore d'architecture est sans coeur, sans amour. La musique est l'ombre de ce qu'elle était. La grande peinture est morte. La philosophie est morte ; l'ascension même du prolétariat l'a tuée. » (Ibid.)
Cette vision de la décadence du système capitaliste, sous toutes ses formes, n'est pas propre à Gorter ; elle sera la base même des courants de la gauche communiste après la guerre, en particulier de la gauche allemande, influencée aussi bien par Rosa Luxemburg que par Gorter et Pannekoek.
LA FAILLITE DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE
La guerre a été rendue possible par la trahison des partis qui ont « renié les idées socialistes ». Comme Pannekoek, Gorter montre que le processus d'effondrement de la 2° Internationale a été préparé par des reniements successifs de la lutte contre la guerre et de la lutte immédiate. C'est le facteur subjectif qui a finalement permis à la bourgeoisie mondiale d'avoir les mains libres en 1914 pour se lancer dans la guerre. Nulle mieux que la bourgeoisie, classe qui vit dans sa propre putréfaction comme classe condamnée par l'histoire, ne pouvait saisir avec autant d'intelligence, l'intelligence d'une classe toute orientée vers sa propre survie, la putréfaction de son adversaire, au sein même du prolétariat. Gorter donne l'exemple au congrès de Bâle (1912) :
« La bourgeoisie qui, suite à sa propre putréfaction, a un odorat très fin pour la décomposition morale, sentit immédiatement la marche de ce congrès de l'Internationale. Elle sentit que d'un tel congrès il n'y avait rien à craindre. Elle mit la cathédrale de Bâle à notre disposition...; » (Ibid.)
Ainsi, pour la gauche hollandaise, qui avait d'ailleurs été interdite de parole lors de ce congrès, Bâle n'était que l'ultime aboutissement d'un long déclin. Août 1914 est annoncé par Bâle, qui ne fut qu'une messe contre la guerre.
Cependant, Gorter n'analyse pas la trahison de la 2° Internationale comme simplement la trahison des chefs. Il va plus profondément en analysant les facteurs organisationnels, tactiques qui ont conduit à cette banqueroute. Toutes les causes envisagées mènent à une interrogation brûlante : quel est le réel état de conscience du prolétariat, son degré de maturité révolutionnaire ?
Il est significatif que Gorter hésite dans les explications de la faillite de la 2e Internationale. Il insiste fortement sur le fait que les révisionnistes et les centristes kautskystes sont « coresponsables du nationalisme et du chauvinisme des masses ». D'un autre côté, il préfigure sa théorie, exposée en 1920 dans sa « Réponse à Lénine », sur l'opposition entre « masses » et « chefs ». C'est le phénomène bureaucratique qui aurait privé la masse prolétarienne de sa capacité d'action révolutionnaire :
«Le centre de gravité se déplaça... de la masse aux chefs. Il se forma une bureaucratie ouvrière. La bureaucratie cependant est par nature conservatrice. » (Ibid.)
Mais Gorter, qui est profondément marxiste, ne se contente pas d'une simple analyse sociologique ; la question de l'organisation des partis comme émanation de l'Internationale est la question décisive. Comme plus tard, pour la gauche italienne, c'est l'Internationale qui précède les partis et non les partis nationaux l'Internationale. La faillite de la 2° Internationale s'explique avant tout par son caractère fédéraliste :
«La seconde Internationale alla réellement à la débâcle, parce qu'elle n'était pas internationale. Elle était un conglomérat d'organisations nationales et non un organisme international. » (Ibid.)
Toutes ces causes expliquent finalement le recul de la conscience du prolétariat, dans la guerre. Le prolétariat s'est trouvé « très affaibli » et « spirituellement démoralisé ». Mais pour Gorter, comme pour les révolutionnaires de l'époque, il ne s'agissait que d'un recul et non d'une défaite définitive. De la guerre devait nécessairement surgir la révolution.
L'AVENIR
Les conditions même d'évolution du capitalisme donnent les conditions objectives pour l'unification du prolétariat mondial. La révolution est posée à l'échelle mondiale :
« ...pour la première fois dans l'histoire mondiale, tout le prolétariat international est aujourd'hui uni grâce à l'impérialisme, en temps de paix comme en temps de guerre, comme un tout, dans une lutte qui ne peut être menée sans un commun accord du prolétariat international, face à la bourgeoisie internationale. »
Cependant, Gorter souligne avec force que la révolution est un long processus, « s'étendant sur des décennies et des décennies ». Les « facteurs spirituels » sont décisifs. En particulier, la lutte passe par un changement radical de tactique : lutte non par le moyen du syndicat ou du parlement, mais par la grève de masse. Sans être développé, ce point annonçait toute la conception communiste de gauche pleinement développée en 1919 et 1920.
Tout aussi décisive était la lutte politique du prolétariat. Celui-ci devait combattre aussi bien le révisionnisme que le centrisme. Mais plus encore, pour s'engager dans la voie révolutionnaire, le prolétariat devait rejeter la lutte pour la paix, telle qu'elle était développée par les courants pacifistes. L'ennemi le plus dangereux restait le pacifisme :
« ...autant comme hypocrisie et auto tromperie que comme moyen de mieux asservir et exploiter, le mouvement pacifiste est le revers de la médaille de l'impérialisme (...) Le mouvement pacifiste, c'est la tentative de l'impérialisme de la bourgeoisie contre le socialisme du prolétariat. » (Ibid.)
Enfin, sans Internationale, créée par le prolétariat, il ne pouvait y avoir de véritable mouvement révolutionnaire. De la guerre devait naître une « nouvelle internationale », à la fois nécessaire et possible.
La brochure de Gorter, qui fut saluée comme un modèle par Lénine, posait donc de façon concrète l'attitude du SDP dans la reprise des liens internationaux en vue de poser les bases de la nouvelle Internationale.
LE SDP ET ZIMMERWALD
Il est significatif que la position de Gorter d'oeuvrer énergiquement au regroupement international des socialistes opposés à la guerre et partisans de la fondation d'une nouvelle internationale restât isolée dans le parti. De toutes ses forces, Gorter — appuyé par Pannekoek — souhaitait la participation du SDP aux débats et à la conférence de Zimmerwald en 1915.
En cette année 1915, l'opposition à la guerre commençait à se faire plus vigoureuse. Dans le SPD allemand, l'opposition de Rosa Luxemburg et celle d'éléments à Berlin et Brème s'enhardissait et posait les bases d'une réorganisation des forces révolutionnaires. Dans tous les pays belligérants, et dans les pays neutres, naissait une opposition au social-patriotisme qui dans les faits posait la question de la réorganisation des révolutionnaires dans les anciens partis et même en dehors, au prix de la scission.
Précisément, aux Pays-Bas, au sein même du SDAP, des éléments opposés à la politique nationaliste de leur parti, officialisée par un congrès de janvier 1915, s'étaient constitués en « club révolutionnaire-socialiste » à Amsterdam. Ils décidèrent de constituer une fédération de clubs qui prit le nom de « Revolutionaire Socialistisch Verbond » (RSV), afin de développer une opposition contre la guerre et le nationalisme en dehors du SDAP. Mais à la tête du RSV se trouvaient des éléments qui n'appartenaient pas au SDAP de Troelstra. Roland-Holst, sans parti depuis qu'elle avait quitté le SDAP en 1912, était le porte-parole reconnu du RSV. Celui-ci, composé essentiellement d'intellectuels, avait peu d'influence dans la classe ouvrière. Numériquement très réduit — une centaine de membres au départ — il ressemblait plus à un cartel qu'à une véritable organisation. La confusion organisationnelle de ses adhérents était grande : beaucoup étaient encore dans le SDAP et appartenaient donc à deux organisations. Cela dura encore quelques mois, jusqu'au moment où ils furent expulsés ou quittèrent définitivement le SDAP. Non moins floue était l'attitude des membres du SDP, qui bien que membres d'une organisation révolutionnaire, adhéraient au RSV. Il fallut toute la fermeté du congrès d'Utrecht du SDP (20 juin 1915) pour que soit interdite formellement la double appartenance organisationnelle. Ceux qui avaient adhéré au RSV le 2 mai durent donc le quitter.
Politiquement, le RSV — à l'image de Roland-Holst — pouvait être considéré comme un groupe du centre, entre le SDAP et le SDP. D'un côté, il se prononçait pour « l'action de masse nationale et internationale », pour la reprise des mouvements de lutte de classe ; d'un autre côté, il refusait de condamner explicitement l'attitude du SDAP dans la guerre, au nom de l'unité qui devait se concrétiser par la « concentration de tous les travailleurs révolutionnaires » . Cette position hésitante n'empêcha pas néanmoins une collaboration de plus en plus active entre le RSV et le SDP.
Pourtant, le SDP, plus clair politiquement et théoriquement, allait dans le concret se retrouver derrière le RSV, lorsque en 1915, la reprise des relations internationales entre groupes révolutionnaires en vue d'une conférence s'effectua.
Lénine dès le début de la guerre prit contact avec les Hollandais. Il s'adressa tout naturellement au SDP afin « d'arriver à un contact plus étroit » entre Russes et Hollandais. Il ne pensait certainement pas à s'associer à Roland-Holst, en laquelle il voyait — depuis son attitude face aux tribunistes en 1909 — une version de Trotsky, voire de Kautsky, transplantée aux Pays-Bas ».
Mais le SDP resta divisé pour mener clairement une activité de collaboration étroite avec les révolutionnaires russes et allemands. Une petite minorité de la direction du parti, autour de Gorter, était fermement décidée à mener un travail international contre le social-chauvinisme et le centre kautskyste. Dans ce sens, Gorter proposa le 8 avril 1915 à Lénine de publier une revue marxiste, sous la direction de Pannekoek, qui se substituerait à la « Neue Zeit » de Kautsky. A cette proposition, Lénine s'associa. Dans les faits, l'effort de regroupement mené au sein du SDP avec d'autres groupes révolutionnaires, en Suisse, avant Zimmerwald, fut l'oeuvre de Gorter et de Luteraan, membre de la direction du parti. Luteraan fut délégué à la conférence internationale des jeunes socialistes à Berne, en avril 1915, non comme représentant officiel du SDP, mais comme membre du groupe de jeunes socialistes « De Zaaier », indépendant du parti. C'est là que Luteraan prit contact avec Lénine.
On doit noter qu'au contraire la position des chefs historiques du tribunisme, Wijnkoop, Ravesteyn et Ceton fut plus qu'ambiguë. Lénine souhaitait associer étroitement les Hollandais à la préparation de la conférence de Zimmerwald. Dans une lettre à Wijnkoop, écrite au cours de l'été, Lénine déclarait avec force : « Mais vous et nous nous sommes des partis indépendants ; nous devons faire quelque chose : formuler le programme de la révolution, démasquer et dénoncer les mots d'ordre stupides et hypocrites de paix. » Et un télégramme fut envoyé peu avant Zimmerwald à Wijnkoop : « Venez aussitôt ! ».
Mais le SDP n'envoya aucun délégué à la conférence de Zimmerwald, qui se déroula du 5 au 8 septembre 1915. Wijnkoop et ses amis firent circuler l'information dans le parti — non confirmée — que l'organisateur de la conférence, le Suisse Robert Grimm, député, aurait donné au début de la guerre son vote pour l'approbation des crédits de mobilisation. « De Tribune », l'organe du parti ne donna pas à ses lecteurs communication des résolutions de la conférence. Au lieu de voir dans Zimmerwald «un pas en avant dans la rupture idéologique et pratique avec l'opportunisme et le social-chauvinisme», les chefs du SDP — à l'exception de Gorter, Pannekoek et Luteraan — n'y trouvèrent que pur opportunisme. Pire, ils passèrent à côté de l'importance historique de l'événement, comme première réaction organisée à la guerre et première étape d'un regroupement de révolutionnaires internationalistes ; ils ne virent qu'une « farce historique » dans ce qui devint par la suite le symbole de la lutte contre la guerre, une « sottise » dans le geste de fraternisation par delà les tranchées de socialistes allemands et français :
« Nous devons manifestement remercier Dieu (sic)...qu'il nous ait préservé de la sottise de la conférence de Zimmerwald, ou en termes plus précis, de la nécessité de nous occuper de l'opposition sur les lieux (...) Nous savions déjà à l'avance ce qu'il en adviendrait: rien que de l'opportunisme et aucune lutte de principe ! »
Cette attitude de Wijnkoop, mélange de sectarisme et d'irresponsabilité, ne fut pas sans conséquence pour l'image même de la gauche hollandaise. Elle laissa la place libre au courant de Roland-Holst, à Zimmerwald, qui représenta — par défection du SDP — le mouvement révolutionnaire aux Pays-Bas. Le RSV se situait dans le courant « centriste« de Zimmerwald, qui envisageait comme seule possible la lutte pour la paix, et refusait de s'associer à la gauche zimmerwaldienne, qui posait comme bases la lutte révolutionnaire et la nécessité d'une 3e Internationale. Internationalement, dans le mouvement de la gauche zimmerwaldienne, auquel s'associait le SDP politiquement, le « tribunisme » apparaissait comme un courant sectaire.
Dans le cas de Wijnkoop, Ravesteyn et Ceton, le sectarisme ne faisait que camoufler une politique opportuniste qui se révéla pleinement à partir de 1916-17. Le « sectarisme », dont l'Internationale communiste les accusa en 1920, n'était pas chez Gorter, Pannekoek et leurs partisans, qui oeuvraient de façon décidée pour un regroupement international des révolutionnaires.
QUELQUES LEÇONS
Les leçons que le mouvement révolutionnaire peut tirer de cette période de crise dans le mouvement ouvrier ne sont pas différentes ou spécifiques en comparaison des autres pays. Ce sont des leçons générales :
1) Le vote des crédits de guerre par le SDAP de Troelstra le 3 août 1914 signifie que l'ensemble de l'appareil s'est rangé du côté de la bourgeoisie hollandaise. Cependant, comme dans les autres partis, la crise provoquée dans ce parti se traduira par deux scissions, à gauche. Celles-ci seront numériquement très limitées : 200 militants pour chacune, pour un parti comptant 10000 adhérents. Le SDAP, à la différence du SPD allemand, n'était plus capable de sécréter en son sein de très fortes minorités, voire une majorité, hostile à la guerre, et se rangeant sur des positions prolétariennes. La question de la reconquête du parti ne pouvait plus se poser. C'est autour du SDP « tribuniste » que s'opère le processus de regroupement pendant la guerre. L'existence même du SDP depuis 1909 a en quelque sorte vidé le SDAP de l'essentiel de ses minorités révolutionnaires.
2) L'antimilitarisme et la « lutte pour la paix » en période de guerre sont une source énorme de confusion. Ils rejettent au second plan la lutte de classe et la lutte pour la révolution, seule capable de mettre fin à la guerre. Ces mots d'ordre, qu'on retrouve dans le SDP, traduisent la pénétration — dans le meilleur des cas — de toute l'idéologie petite-bourgeoise véhiculée en priorité par les courants anarchiste, syndicaliste-révolutionnaire et « centriste ». L'alliance conduite par le SDP avec ces courants, pendant la guerre, n'a fait que favoriser la pénétration de l'opportunisme dans le parti révolutionnaire qu'était le SDP.
3) Une scission « étroite » et précoce d'avec l'ancien parti, tombé dans l'opportunisme, n'est pas une garantie en soi contre le retour de l'opportunisme dans le nouveau parti révolutionnaire. La scission à gauche n'est pas un remède miracle. Toute organisation, fut-elle une minorité la plus sélectionnée, la plus armée théoriquement et la plus décidée, n'est pas épargnée par la pénétration constante de l'idéologie bourgeoise et/ou petite-bourgeoise. L'histoire du SDP pendant la guerre le montre amplement. Nécessairement se créent en réaction des minorités qui tendent à devenir fraction dans le parti. Telle fut l'opposition qui se développe autour de Gorter — à partir de 1916 — contre le danger opportuniste représenté par la clique Wijnkoop-Ravesteyn, succédané « radical » de celle de Troelstra.
4) Dans un parti révolutionnaire, l'opportunisme ne se manifeste pas toujours au grand jour. Très souvent, il se cache sous le masque du radicalisme verbal et de la « pureté des principes ». La direction Wijnkoop-Ravesteyn-Ceton en est l'illustration lorsqu'elle refuse de participer à la conférence de Zimmerwald sous prétexte que celle-ci serait dominée par les courants opportunistes. Le sectarisme ici n'est bien souvent que le revers de la médaille de l'opportunisme. Il s'accompagne bien souvent d'un grand esprit de « largesse » avec des courants confus, anarchisants et même carrément opportunistes. L'évolution de la direction du SDP, qui entraîne dans sa suite une grande partie de l'organisation, est typique. En cédant aux sirènes du parlementarisme, en s'alliant avec des courants étrangers au mouvement ouvrier — comme les Chrétiens-sociaux —, en ayant une attitude pro-Entente à la fin de la guerre, en se situant au début de la révolution russe aux côtés de Kerensky, cette direction empruntait le chemin de Troelstra avec un vernis «révolutionnaire» en plus. Les événements cruciaux — guerre et révolution — dissolvent immanquablement un tel vernis.
5) Dans la lutte contre l'opportunisme, l'action des minorités révolutionnaires est décisive. Il n'y a pas de fatalisme. Le fait que la réaction de Gorter, Pannekoek ait été dispersée, et au départ une simple opposition, a beaucoup pesé sur l'évolution ultérieure du SPD, lorsqu'il se transforma en parti communiste en novembre 1918.
Ch.
Géographique:
- Hollande [28]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [30]
Revue Internationale no 49 - 2e trimestre 1987
- 2891 reads
Leçons des grèves ouvrières en Europe de l'ouest
- 2526 reads
Entrer en lutte massivement, prendre en mains les luttes
Débutée en automne 1983, la troisième vague de luttes depuis la reprise historique du prolétariat mondial à la fin des années 1960, confirme aujourd'hui son ampleur et sa profondeur. Si durant 1985 on avait pu constater un certain affaiblissement de cette vague de luttes résultant principalement du fait que la bourgeoisie avait mis en œuvre une stratégie d'éparpillement des attaques en vue de morceler les ripostes ouvrières, l'année 1986, notamment avec la Belgique au printemps, a vu le retour de combats massifs répondant au caractère de plus en plus frontal des attaques anti-ouvrières imposées par la poursuite et l'aggravation de l'effondrement économique du capitalisme.
Ce nouveau souffle de la lutte de classe s'est amplement confirmé durant les mois qui viennent de s'écouler : tour à tour la Suède, le France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, c'est-à-dire des pays parmi les plus avancés et centraux, mais aussi la Grèce, ont été le théâtre de luttes importantes et souvent d'un niveau inconnu depuis des années, voire des décennies. Ces différents combats de classe sont riches d'enseignements qu'il importe que les révolutionnaires soient en mesure de tirer afin d'être un facteur actif dans leur développement
UNE AMBIANCE GENERALE DE COMBATIVITE OUVRIERE
Depuis l'extrême nord de l’Europe occidentale jusqu'à son extrême sud, depuis la Suède « prospère » jusqu'à la Grèce « pauvre » et relativement sous-développée, le prolétariat a engagé le combat de façon déterminée et souvent massive.
En Suède s'est déroulé à partir du début octobre 1986 le troisième mouvement de grèves important en un an et demi, affectant particulièrement les fonctionnaires (près de 30 000 employés de l'Etat et des municipalités), mais s'accompagnant aussi d'une série de grèves sauvages dans d'autres secteurs.
En Grèce, ce sont des mouvements généralisés de grève, impliquant plus de deux millions d'ouvriers qui ont, fin janvier 1987 et surtout courant février, paralysé tout le pays. Industrie, télécommunications, postes, électricité, banques, transports routiers, aériens et maritimes, enseignement et hôpitaux : ce pays n'avait pas connu depuis des décennies un mouvement social d'une telle ampleur.
Cette relative simultanéité des luttes ouvrières dans deux pays aussi éloignés et apparemment aussi différents, met en évidence; l'unité du prolétariat mondial, et notamment celui qui vit et travaille en Europe occidentale, confronté à une morne crise insoluble du capitalisme. Que le niveau de vie des ouvriers dans les pays scandinaves soit de très loin supérieur à celui (les ouvriers en Grèce, que la part de la classe ouvrière dans l'ensemble de la population soit très différente entre ces deux pays n'y change; rien : partout les ouvriers subissent des attaques de plus en plus violentes de la part de la bourgeoisie et de son Etat, partout ils sont contraints d’entrer dans la lutte.
Les attaques extrêmement dures contre lesquelles a réagi la classe ouvrière en Grèce (les plus brutales depuis la chute du régime des colonels en 1974) ne sont pas simplement à l'image de la situation économique catastrophique de ce pays. Elles sont le reflet d'une détérioration considérable de l'économie mondiale depuis près d'une année, qui affecte également ces modèles de « prospérité » que sont les pays Scandinaves, et notamment le plus important d'entre eux, la Suède. Là aussi, les ouvriers subissent des attaques d'une ampleur sans précédent. En 10 ans, les salaires réels ont baissé de 12 %. Ces derniers mois se sont multipliées dans de nombreux secteurs les annonces de licenciements massifs, et pour 1987, le ministre des finances a parlé de 23 000 suppressions d'emplois dans le secteur public (dans un pays comptant moins de 9 millions d'habitants). Comme partout, le mythe de « l'Etat social », particulièrement fort en Suède, s'effondre totalement. Et si dans ce pays, comme dans la plupart des pays les plus avancés (à l'exception de la Belgique au printemps 1986), les luttes n'ont pas encore connu le caractère généralisé qu'elles ont connu en Grèce, c'est principalement parce que sa force industrielle lui a permis jusqu'à présent de s'épargner le niveau de convulsions économiques qui affecte les pays les plus faibles. Mais ce n'est que partie remise. Alors qu au siècle dernier, au moment de la phase ascendante du système capitaliste, c'était le pays le plus développé, la Grande-Bretagne, qui indiquait l'avenir des autres nations, dans la décadence capitaliste, c'est le délabrement total de l'économie des pays les plus faibles qui donne l'image de ce qui attend les pays les plus développés. Et avec l'effondrement économique croissant de ces derniers, avec le déchaînement des attaques anti ouvrières qui en découle, c'est bien le développement de luttes de plus en plus massives et généralisées qui constitue la perspective.
Cette perspective, elle est déjà en germe dans les manifestations de combativité ouvrière qui, au début de 1987, ont pris place dans plusieurs pays centraux d'Europe occidentale.
Ainsi aux Pays-Bas, les ouvriers ont commencé à riposter à un plan d'austérité d'une brutalité sans précédent (voir Revue Internationale n° 47). Et c'est un des secteurs « phares » de la classe ouvrière de ce pays, les dockers de Rotterdam (le plus grand port du monde) qui se trouve directement impliqué. Significatif est le fait que le secteur des containers, qui s'était trouvé en dehors des grèves de 1979 et de 1984, soit cette fois-ci parti en grève sauvage. Par ailleurs, contrairement à la grande grève des dockers de 1979, le mouvement de janvier-février 1987 ne se déroule pas de façon isolée. Des manifestations de solidarité se sont fait jour dans le port d'Amsterdam, et par ailleurs, des grèves ont éclaté simultanément dans diverses entreprises du pays (dans un chantier naval de Rotterdam, à Amsterdam, à Arnhem).
Un autre pays, parmi ceux du cœur de l'Europe occidentale, vient de confirmer les caractéristiques du moment présent de la lutte de classe. Il s'agit d'un des plus significatifs de tous, celui qui concentre les traits les plus marquants de la situation de l'ensemble de cette zone : la Grande-Bretagne.
En effet, ce pays a connu fin janvier et début février, avec la grève de British Telecom, un mouvement d'une grande ampleur affectant jusqu'à 140 000 travailleurs, qui a su associer aussi bien les employés du secteur administratif que les ouvriers du secteur technique, marquant un pas important dans le dépassement du corporatisme du métier traditionnellement très fort au sein de la classe ouvrière en Grande-Bretagne et qui, en particulier, s'est déclenché et développé de façon spontanée en solidarité à l'égard d'ouvriers sanctionnés pour refus d'effectuer des heures supplémentaires. Alors que la grande grève des mineurs de 1984-85 et la grève des ouvriers de l'imprimerie en 1986 étaient restées entièrement, du début jusqu'à la fin, encadrées par les syndicats, le débordement de ces derniers qui s'est exprimé dans ce mouvement récent, le fait qu'ils aient été contraints de courir en permanence après la lutte afin de ne pas se démasquer ouvertement, la reprise du mouvement après que le 11 février, le syndicat ait réussi par ses manœuvres à faire voter la fin de la grève, tous ces traits témoignent d'un processus profond de maturation de la conscience dans la classe ouvrière. De même, cette explosion massive de combativité est le signe que les ouvriers de Grande-Bretagne se sont remis de la relative démoralisation qui avait accompagné la défaite de la grève des mineurs et celle des ouvriers de l'imprimerie. Le fait que cette reprise d'une combativité massive concerne un pays où se trouve la classe ouvrière la plus ancienne du monde, où la bourgeoisie est la plus expérimentée et habile, est un nouveau témoignage de la force du nouveau souffle de la lutte de classe internationale depuis le début 1986.
Mais l'événement le plus significatif de cette situation, après les luttes de Belgique du printemps 1986, est certainement la grève qui a paralysé pendant près d'un mois les transports ferroviaires en France.
Les enseignements de la grève des chemins de fer en France
Alors que depuis l'automne 1983 s'étaient produits des surgissements massifs de la lutte de classe dans pratiquement tous les pays d'Europe occidentale, la classe ouvrière semblait relativement à la traîne en France. Certes les ouvriers de ce pays n'étaient pas restés étrangers au mouvement, et les luttes dans l'automobile fin 1983 et courant 1984, dans la sidérurgie et la construction navale au printemps 1984 constituaient, en compagnie d'autres mouvements de moindre importance, un témoignage du caractère général de la reprise des luttes dans les pays les plus avancés. Cependant on était loin de l'ampleur des mouvements qui avaient affecté des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou le Danemark.
Pour certains groupes révolutionnaires, le fait qu'un des secteurs nationaux de la classe ouvrière dont les luttes passées — et en particulier mai 1968 — avaient témoigné de la capacité à mener des combats massifs, n'ait amené à partir de 1983 que des luttes de portée limitée, était un argument pour conclure à une apathie durable des ouvriers dans ce pays et pour sous-estimer l'importance des combats qui se menaient dans le reste de l'Europe. En réalité, ce type d'analyse est à l'opposé de la démarche qui doit être celle des révolutionnaires marxistes dans l'examen des situations historiques. Loin de regarder celles-ci par le petit bout de la lorgnette, les marxistes se sont toujours distingués par leur capacité à déceler derrière des apparences trompeuses les véritables enjeux des situations auxquelles ils étaient confrontés. Le faible niveau des grèves en France n'était nullement le signe de l'absence ni d'un profond mécontentement, ni d'un important potentiel de combativité. D'ailleurs des indices de ce mécontentement et de cette combativité avaient été donnés par les grèves spontanées et de courte durée qui avaient paralysé durant deux jours le trafic ferroviaire national fin septembre 1985 et pendant une journée les transports parisiens deux mois plus tard.
En réalité, il convenait d'analyser cette relative faiblesse de la lutte ouvrière comme le résultat de deux facteurs assez spécifiques de la situation en France.
Le premier de ces facteurs était la relative timidité des attaques anti-ouvrières portées par le gouvernement de gauche PS-PC. Ce gouvernement, s'il s'était montré un fidèle gestionnaire du capital national en accentuant sous le nom de la « rigueur » une réelle politique d'austérité, se trouvait entravé par la présence de tous les partis de gauche à la tête de l'Etat dégarnissant le terrain social : un niveau d'attaques plus élevé risquait fort d'aboutir à une situation complètement incontrôlable par la totalité des syndicats, lesquels soutenaient ce même gouvernement.
Le second de ces facteurs était la stratégie d'immobilisation menée à partir de 1984 et suite au départ du PC du gouvernement par ces mêmes syndicats, et particulièrement la CGT (proche du Parti Communiste), consistant à utiliser contre les luttes le discrédit qui s'était développé à leur égard parmi les ouvriers : leurs appels répétés et radicaux à « l'action » avaient pour résultat justement de détourner de l'action les ouvriers les plus conscients de leur rôle de saboteurs.
Mais derrière la relative passivité ouvrière résultant de cette situation s'accumulait un énorme mécontentement et mûrissait la capacité à transformer en positif le discrédit des syndicats, pour (et non plus contre) le combat de classe.
C'est justement ce qu'a démontré la grève à la SNCF (Chemins de Fer français) à partir de la deuxième moitié de décembre 86.
La grève est partie le 18 décembre dans le dépôt de conducteurs de la gare du Nord de Paris, de façon spontanée, sans préavis auprès de la direction (obligatoire dans le secteur public en France), ni consigne des syndicats, lesquels attendaient l'ouverture de négociations avec la direction prévues le 6 janvier 1987. Ce premier groupe de grévistes bloquait immédiatement le trafic dans le réseau Nord et appelait les autres conducteurs à rejoindre la lutte. En 48 heures, ce sont tous les dépôts (quatre-vingt treize) qui sont touchés et on compte 98 % de grévistes parmi les conducteurs. C'est le mouvement le plus important dans ce secteur depuis mai 1968. Ce mouvement déborde sur d'autres catégories de travailleurs de la SNCF. Bien qu'avec une participation moindre, les « sédentaires » de pratiquement toutes les gares, de tous les ateliers, sont entrés en lutte.
Pendant plusieurs jours, les syndicats sont complètement débordés et prennent position contre la lutte sous prétexte de ne pas gêner les départs en vacances de la période de fin d'année. Même la CGT, qui est le plus « radical » d'entre eux, s'oppose au démarrage du mouvement, allant dans certains dépôts jusqu'à organiser des « piquets de travail » pour casser la grève. Cette attitude des syndicats, l'énorme méfiance qui s'était développée à leur égard depuis des années et particulièrement au cours de l'année écoulée où ils ont écœuré les ouvriers de la SNCF par quatorze « journées d'action » stériles, tout cela permet d'expliquer que d'emblée une des préoccupations majeures de tous les grévistes a été de prendre eux-mêmes en main leur lutte afin d'empêcher les syndicats de la saboter. Partout se tiennent chaque jour des assemblées générales souveraines qui se veulent le seul lieu de prise de décision sur la façon de conduire la lutte. Partout des comités de grève sont élus par les assemblées et sont responsables devant elles. C'est la première fois qu'en France on assiste à un tel niveau d'auto-organisation des luttes. Les grévistes ressentent le besoin d'unifier cette auto-organisation à l'échelle de tout le pays, ce qui aboutit à la création de deux « coordinations » nationales. La première, celle dite de « Paris-Nord » (lieu de ses réunions) regroupe les délégués de près de la moitié des dépôts de conducteurs. La seconde, dite « d'Ivry » (dépôt de la banlieue sud de Paris) est ouverte à toutes les catégories d'ouvriers de la SNCF mais est en même temps moins représentative et beaucoup de ses participants ne sont pas mandatés par les assemblées. Et c'est là que le mouvement exprime ses limites. La coordination de Paris-Nord décide de se limiter aux seuls conducteurs et celle d'Ivry, si elle est plus ouverte, décide à son tour d'interdire l'entrée de ses réunions aux ouvriers d'autres secteurs.
Dans cet enfermement de la lutte, il faut voir évidemment le résultat du travail des instruments les plus radicaux de l'Etat bourgeois : le syndicalisme « de base » et les groupes gauchistes. En effet, ces derniers, tout en faisant dans leur presse de grandes déclarations en faveur de l'extension de la lutte, sont les premiers, sur le terrain, à combattre une telle extension. Ce n'est pas un hasard si la coordination de Paris-Nord, qui se referme aux seuls conducteurs, a pour porte-parole un militant de la « Ligue Communiste Révolutionnaire » (trotskyste) ; si la coordination d'Ivry a pour figure de proue un militant d'un autre groupe trotskyste, « Lutte Ouvrière ». En réalité, si ces groupes bourgeois sont en fin de compte capables de dévoyer le mouvement dans l'impasse de l'isolement c'est qu'il existait encore au sein de la classe ouvrière un fort poids du corporatisme que les gauchistes ont flatté par des propos radicaux du style : « si nous élargissons le mouvement à d'autres secteurs, nos propres revendications spécifiques seront comme d'habitude noyées dans les autres et d'autre part, nous allons perdre le contrôle du mouvement au bénéfice des syndicats qui eux ont une structure à l'échelle de tout le pays ».
L'isolement dans lequel se sont enfermés au bout d'une semaine les travailleurs de la SNCF s'est révélé extrêmement nocif pour la suite du mouvement. Il était d'autant plus grave qu'il existait tout au cours de la fin décembre d'importants mouvements de grève dans les transports parisiens et dans les ports. Ces mouvements avaient été lancés par les syndicats mais témoignaient d'une très forte combativité et méfiance par rapport à ceux-ci. Alors que l'envoi de délégations massives des assemblées de cheminots vers les autres assemblées et secteurs ouvriers, que l'ouverture de leurs propres assemblées à ces autres secteurs auraient pu constituer autant d'exemples de comment lutter pour l'ensemble de la classe ouvrière, de comment s'organiser en dehors des syndicats, l'isolement des cheminots dont l'attitude des deux coordinations était le témoignage, a déterminé la stagnation puis le déclin de leur mouvement après le 25 décembre. Celui-ci avait cessé d'être un facteur dynamique positif dans l'ensemble de la situation en France. Par contre, son épuisement a été l'occasion pour la bourgeoisie de développer une contre-offensive visant à saboter dans les autres secteurs la combativité ouvrière. Le partage des tâches a été systématiquement organisé. En particulier syndicats et gouverneraient ont fait pendant des semaines de la question de la grille des salaires (la Direction voulait remplacer une grille d'avancement à l'ancienneté par une grille d'avancement « au mérite ») le sujet central de leur battage, alors que la question centrale qui concerne tout le secteur public en France est celle d'une baisse continue du pouvoir d'achat qui va encore s'amplifier en 1987. Après avoir affiché son intransigeance sur la « grille », le gouvernement décide le 31 décembre de la « suspendre », ce qui évidemment est salué comme une « victoire » par les syndicats. Comme les cheminots décident après cette date de poursuivre la grève, on voit alors la CGT, sûre désormais de l'échec du mouvement, adopter (suivie par la CFDT d'obédience PS) un langage « jusqu'au-boutiste » qui va se maintenir jusqu'à la fin de la grève à la mi-janvier. Ce même syndicat lance au début janvier une série de grèves dans le secteur public notamment aux Postes et Télécommunications et surtout dans un de ses bastions, l'Electricité et le Gaz (EDF-GDF). C'est au nom de l'extension de la grève des cheminots à tout le secteur public que la CGT lance ses appels. Le fait qu'elle reprenne à ce moment-là un slogan qui en général est celui des révolutionnaires ne signifie évidemment pas que ce syndicat aurait décidé d'un seul coup de défendre les intérêts ouvriers. Ce qu'il cherche par ses appels ce n'est pas l'extension du combat mais l'extension de sa défaite. Plus important sera le nombre des ouvriers engagés dans la lutte dans un moment défavorable et plus cuisante et étendue sera la démoralisation qui en résultera : tel est le calcul de la bourgeoisie. Et c'est en partie ce qu'elle a obtenu dans des secteurs comme EDF-GDF.
Ainsi, malgré son complet débordement au début du mouvement, la bourgeoisie, avec l'ensemble de ses forces se partageant le travail : droite, gauche et gauchistes (lesquels en particulier ont réussi à convaincre les ouvriers les plus méfiants de s'en remettre aux syndicats pour négocier avec le gouvernement) a réussi encore une fois à reprendre les choses en main. Cependant, cette grève a laissé une marque très importante dans la conscience de toute la classe ouvrière en France. Ainsi, dans chaque petit mouvement qui a pu se dérouler par la suite (instituteurs, hôpitaux, etc.), la nécessité d'assemblées générales souveraines s est exprimée et sont apparues des «coordinations» fomentées en général par les gauchistes pour qu'ils puissent en garder le contrôle. Par ailleurs, on assiste à l'heure actuelle à un profond mouvement de réflexion au sein de la classe dont une des manifestations est l'apparition encore timide de comités de lutte ([1] [31]) se donnant pour objectif d'impulser la réflexion parmi les ouvriers dans la perspective des prochains combats.
Le mouvement qui vient de se produire en France, malgré son échec et ses faiblesses, est extrêmement significatif du moment présent des luttes à l'échelle européenne. L'auto-organisation dont il s'est doté avant que gauchistes et syndicats ne viennent la vider de son contenu, l'extrême méfiance qui s'est exprimée à l'égard de ces derniers montrent l'avenir de la lutte de classe à l'échelle internationale. Ces caractéristiques sont particulièrement accentuées en France du fait de la présence au gouvernement pendant trois ans de tous les partis de gauche. En ce sens, les luttes qui viennent de se dérouler en France constituent une confirmation a contrario de la nécessité pour la bourgeoisie de tous les pays, depuis la fin des années 1970, de placer ses forces de gauche dans l'opposition afin d'occuper le terrain social. Elles sont aussi une confirmation du fait que la venue de la gauche au pouvoir en mai 1981 ne résultait nullement d'une stratégie de la bourgeoisie, mais bien d'un accident lié à l'archaïsme de son appareil politique. Cependant, même dans les pays qui ont pu s'éviter ce genre d'accident (c'est-à-dire la grande majorité), l'usure d'un appareil syndical de plus en plus mis à contribution dans le sabotage des luttes ouvrières débouchera de plus en plus vers l'apparition de tels mouvements spontanés et développant leur auto-organisation.
L’intervention des révolutionnaires
Il est clair qu'un mouvement d'une telle importance requiert de la part des organisations révolutionnaires une intervention active afin d'apporter une contribution réelle au développement de la lutte et à la prise de conscience de l'ensemble de la classe.
C'est dès les premiers jours du mouvement qu'une telle intervention active s'avérait nécessaire pour appeler tous les autres secteurs de la classe ouvrière à rejoindre le mouvement. C'est pour cela que notre section en France a publié le 22 décembre un court tract en ce sens largement diffusé et intitulé : « Pour faire reculer l'attaque du gouvernement, élargissons le mouvement, entrons tous ensemble dans la lutte ».
Ensuite, lorsque après le 25 décembre le mouvement a atteint son apogée et a commencé à piétiner, il s'agissait de souligner aux yeux de tous les ouvriers l'impérieuse nécessité de ne pas laisser isolée la grève des cheminots sous peine d'aboutir à une défaite pour l'ensemble de la classe ouvrière. Il fallait en même temps insister particulièrement pour que se développe dans la classe une réflexion approfondie à partir des événements qu'elle vivait depuis une dizaine de jours. C'était la signification du deuxième tract publié le 28 décembre par la section en France du CCI et intitulé « Appel à tous les ouvriers pour élargir et unifier les lunes ».
Enfin, lorsque la lutte s'est achevée, il convenait que les révolutionnaires participent encore activement au processus de réflexion et de décantation qui s'opérait dans la classe en vue de mieux être armée pour les combats futurs. C'était le but du troisième tract publié le 12 janvier par notre organisation, intitulé « Leçons du premier combat ».
Il est clair que l'intervention des révolutionnaires ne peut se limiter à la diffusion de tracts : la vente de la presse sur les lieux de travail, dans les manifestations, les prises de parole dans les assemblées et meetings, les réunions publiques, constituent aussi des moyens importants de cette intervention au cours d'une telle période, moyens que le CCI a tenté d'utiliser le mieux possible malgré ses faibles forces.
Cependant, ce n'est pas une seule organisation du milieu révolutionnaire mais toutes ses organisations qui étaient confrontées à cette nécessité d'une intervention active. Et malheureusement, pour la majorité de celles-ci, cette intervention s'est trouvée une nouvelle fois bien en deçà de ces nécessités lorsqu'elle n'a pas été carrément inexistante.
De cette carence de l'ensemble du milieu politique prolétarien il est nécessaire de tirer plusieurs enseignements.
En premier lieu, une organisation révolutionnaire ne peut être un facteur actif dans le développement des luttes que si elle s'est dotée d'une analyse claire du moment historique dans lequel elles se situent. Lorsqu'on continue de penser que le cours historique est encore à la guerre, que le prolétariat n'est pas encore sorti de la contre-révolution (alors que c'est tout le contraire qui est vrai depuis la fin des années 1960), il n'est pas étonnant qu'on sous-estime complètement l'importance des mouvements présents, qu'on en soit absent ou qu'on y intervienne après la bataille.
En second lieu, il importe que les révolutionnaires soient capables à chaque moment de situer la signification réelle des différents événements auxquels ils sont confrontés : attribuer au mouvement des étudiants de décembre 1986 en France, une valeur « d'exemple » pour les luttes ouvrières de ce pays c'est non seulement confondre 1986 avec 1968, c'est aussi ne pas comprendre la nature profonde, inter-classiste de ce type de mouvement, c'est enfin apporter sa petite contribution aux discours des gauchistes et de toute la bourgeoisie sur le même thème.
En troisième lieu, il est nécessaire que les révolutionnaires soient à chaque moment en mesure de juger de façon précise des situations afin d'y intervenir suivant les formes les plus appropriées. Cette nécessité d'une analyse au jour le jour de l'évolution des situations est évidemment difficile pour les révolutionnaires. Elle ne découle pas mécaniquement de la validité de leurs principes programmatiques ni de la justesse de leur compréhension de la période historique. En particulier, cette capacité résulte aussi, pour une bonne part, de l'expérience concrète acquise par les révolutionnaires dans la lutte.
Pour pouvoir réunir l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire que les organisations communistes se conçoivent comme partie prenante des combats actuels de la classe ouvrière. Et c'est sûrement ce qui manque le plus dans le milieu politique prolétarien à l'heure actuelle.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous faisons ce constat ; le CCI n'est pas intéressé à dénigrer les autres organisations afin de pouvoir souligner ses propres mérites. Nos critiques, sur lesquelles nous reviendrons plus précisément, nous les concevons -comme un appel à tous les révolutionnaires à prendre à bras le corps la responsabilité que la classe leur à confiée et dont l'importance croît de jour en jour en même temps que se développe le mouvement de celle-ci.
Perspectives du développement des luttes
Dans un contexte européen et même mondial (voir l'article dans ce numéro sur les luttes aux USA) le développement des luttes ouvrières, les combats qui se sont déroulés en France à la fin 1986, constituent, après ceux de Belgique au printemps de la même année, un pas important de ce développement. En particulier bien qu'elles aient beaucoup de caractéristiques communes, ces deux luttes ont mis particulièrement en évidence, chacune pour sa part, une des deux nécessités majeures du combat de classe à l'heure actuelle.
Les luttes de Belgique ont souligné la nécessité et la possibilité de mouvements massifs et généralisés dans les pays capitalistes avancés. Les luttes en France sont venues confirmer la nécessité et la possibilité d'une prise en main par les ouvriers de leurs combats, de l'auto-organisation de ceux-ci en dehors des syndicats, contre eux et leurs manœuvres de sabotage.
Ce sont ces deux aspects inséparables du combat ouvrier qui seront de plus en plus présents dans le mouvement de luttes qui a déjà débuté.
FM. 1/3/87
[1] [32] Voir dans Révolution Internationale n°8153 et 154 deux textes publiés par des comités de ce type.
Géographique:
- Europe [25]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Rapport (Internationalism) : Crise et lutte de classe aux USA (extraits)
- 2741 reads
L'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase de récession n'épargne pas les USA, chef de file du bloc de l'Ouest et principale puissance économique mondiale. Les difficultés s'accroissent inexorablement pour le capital américain. Et les changements qui s'opèrent à la tête de l'exécutif, à travers le montage médiatique autour de «l'Irangate», visant à préparer la relève de Reagan en maintenant le Parti républicain au gouvernement et le Parti démocrate dans l'opposition, témoignent des préoccupations de la bourgeoisie américaine sur la nécessaire application d'une austérité brutale aux USA. Et cette austérité, comme dans le monde entier, comme en Europe occidentale, le prolétariat américain n'est pas prêt à l'accepter sans réagir. Même si du fait de ses caractéristiques historiques, le prolétariat aux USA n'a pas encore développé ses luttes au niveau atteint depuis quelques années en Europe de l'Ouest, il a montré une combativité dans toute une série de grèves ouvrières dans différents secteurs qui s'inscrit dans la vague actuelle de lutte de classe internationale.
Nous publions ci-dessous l'extrait sur la «Lutte de classe » du rapport sur la situation aux USA adopté par la section du CCI aux USA en décembre 1986, traitant de la politique de la bourgeoisie et des luttes ouvrières (pour obtenir le texte complet en anglais, s'adresser à «Internationalism»), Les événements des quelques mois écoulés depuis ce rapport n'ont fait que confirmer la perspective qui y est tracée d'un renforcement des attaques de la bourgeoisie et des réactions ouvrières à ces attaques.
La lutte de classe
La classe ouvrière aux USA participe à part entière à la troisième vague de luttes de classe qui a commencé en septembre 1983. Chaque phase de la vague actuelle a eu un écho très rapide dans les luttes des ouvriers américains. Le retard des ouvriers américains est en profondeur, pas dans le temps. Les luttes n'ont pas atteint la même ampleur qu'en Europe de T Ouest, mais ont montré les mêmes tendances et caractéristiques, prouvant une fois de plus que la lutte de classe est internationale. Les différences de degré qui se manifestent aux USA sont le reflet de la force du capitalisme américain et de sa position de chef du bloc de l'Ouest.
La troisième vague a eu trois phases distinctes :
— Première phase : elle commence en septembre 1983 en Belgique avec la grève du secteur public, et montre une tendance à l'extension — les ouvriers allant chercher d'autres secteurs lorsqu'ils voient la nécessité d'éviter l'isolement — et aussi un haut degré dans la simultanéité des luttes dans différentes industries et différents pays. Cette phase s'est rapidement exprimée aux USA par la grève à Greyhound, dans laquelle les ouvriers se battaient contre des baisses de salaires. Quand la direction a essayé de suivre l'exemple de l'administration Reagan face aux aiguilleurs du ciel, et a voulu employer des jaunes pour remplacer les ouvriers, des ouvriers combatifs d'autres secteurs sont accourus pour montrer leur solidarité dans les manifestations. Ces manifestations, appelées par le conseil syndical central, ville par ville, ont offert souvent la possibilité de rompre le contrôle syndical et ont montré que les ouvriers avaient tiré des leçons de l'expérience des contrôleurs aériens. Des manifestations de masse, des défilés dans les rues, d'abord appelés par les syndicats sous la pression des ouvriers, devinrent bientôt chose courante. Alors que les mois précédents avaient vu les pionniers de la nouvelle vague s'affronter violemment à la police lors des grèves à Iowa Beef, Phels Dodge en Arizona, ATT Continental, et avant Chrysler (en 1983), la grève de Greyhound a marqué un pas qualitatif : pour la première fois des ouvriers, hors d'un conflit spécifique sur un contrat, ont participé directement à la lutte. Cette recherche de la solidarité active n'a pas pris la forme de rejoindre la grève sur leurs propres revendications, comme cela a été le cas dans la grève du secteur public en Belgique en septembre 1983. Mais la grève de Greyhound a clairement exprimé le même processus, et les premiers jalons ont été posés pour briser l'isolement du corporatisme entretenu par les syndicats. Les ouvriers qui n'étaient pas employés à Greyhound se battaient à côté des grévistes, bloquant les autobus, risquant d'être arrêtés par la police, et un ouvrier de la construction est mort en essayant de bloquer un bus à Boston. Cette première phase a continué à faire écho aux événements en Europe, lorsque plusieurs milliers d'ouvriers à Toledo on rejoint les grévistes pour attaquer un atelier de jaunes en mai 1984, et se sont lancés dans une bataille rangée avec la police qui dura toute la nuit. Les confrontations violentes à Phels Dodge, la grève de la LILCO contre les baisses de salaires en dépit de la faillite proche de la compagnie, la grève des hôpitaux à New York et la grève de General Motors, grève sauvage non officielle qui s'est étendue à treize usines dans le pays, et la grève des employés de l'hôtel New York City dans laquelle les grévistes ont pris les rues, marchant d'hôtel en hôtel dans la ville, bloquant le trafic et trouvant un certain écho chez les employés des centres de distribution; tels furent quelques-uns des épisodes marquants de cette première phase de la troisième vague de lutte de classe, qui ont démontré la résistance grandissante aux baisses de salaires et autres concessions, et la tendance à la solidarité.
— La seconde phase a commencé à la fin 1985 - et fut caractérisée par une série de luttes dispersées, la bourgeoisie essayant de contrecarrer la tendance à l'extension et à la solidarité active dans la classe ouvrière en recourant à une stratégie d'attaques dispersées, attaquant les ouvriers d'une compagnie, d'une usine, d'un secteur à la fois. Les syndicats n'attendirent plus la pression ouvrière pour organiser des manifestations de solidarité et des marches, mais agirent préventivement en annonçant leurs plans d action, court-circuitant toute action spontanée. Bien sûr, les syndicats sabotèrent consciemment ces manifestations. Pour combattre le danger, explosif de la tendance à l'extension, les syndicats mirent de plus en plus en avant la fausse stratégie des « batailles d'usure » — la grève de longue durée. La restriction des piquets de masse, des marches de solidarité et autres armes de la classe ouvrière devinrent l'arme de routine utilisée par le syndicat, la direction et le gouvernement pour dévoyer les luttes ouvrières. Là où la situation était si explosive que les tactiques des syndicats traditionnels ne suffisaient plus à contrôler et à défaire les ouvriers, la bourgeoisie commença à s'appuyer de plus en plus sur les syndicalistes de base.
La stratégie d'attaques dispersées et le relais assuré par les syndicalistes de base menèrent à la dispersion de luttes combatives, dans lesquelles les ouvriers affirmèrent une résistance croissante aux attaques, et même une tendance à rompre le contrôle syndical, mais qui sont restées isolées. Les luttes centrales de cette période furent : la grève de Wheeling-Pittsburgh, où les ouvriers partirent en grève contre le plan de restructuration prévu à la suite de la faillite de l'entreprise; la grève d'Hormel, où la bourgeoisie s'appuya sur les syndicalistes de base qui se mirent à la tête de la tendance à l'extension, en prirent le contrôle, et l'amenèrent à la défaite ; la grève de Watsonville Cannery, où les premiers pas de l'auto organisation furent réalisés par une assemblée générale massive qui élit un comité de grève, qui se fit cependant récupérer par les syndicalistes de base qui orientèrent les ouvriers sur une «réforme syndicale » ; la grève des imprimeurs du Chicago Tribune, qui, bien qu'empêtrée dans une « grève d'usure », explosa dans une énorme manifestation de solidarité de classe en janvier 1986 où 17 000 ouvriers débrayèrent quelques heures pour aller à une manifestation appelée par les syndicats, se battirent avec la police, et essayèrent de bloquer le passage des jaunes ; la grève du personnel naviguant de la TWA, dans laquelle les grévistes refusaient les baisses de salaires drastiques et eurent dès le départ le soutien massif des mécaniciens et du personnel au sol, qui refusèrent de traverser les piquets de grève. Mais le gouvernement réussit à briser cette solidarité, isola et mena à la défaite le personnel naviguant.
— La troisième phase commence au printemps 1986. Comme le CCI l'avait prévu, à cause de l'approfondissement de la crise et de la chute dans une nouvelle récession globale, la bourgeoisie de tous les pays a de moins en moins de marge de manœuvre, de moins en moins de possibilité de reporter ses attaques contre la classe ouvrière. Elle déclenche une attaque frontale contre toute la classe ouvrière : un assaut d'austérité général. Internationalement, la troisième phase apparaît en Scandinavie où les ouvriers se battent contre les programmes d'austérité du gouvernement au début du printemps, et atteint son point le plus haut en Belgique au printemps, où la combativité des ouvriers est renforcée par un effort conscient de recherche de l'unité dans la lutte. Aux USA, les premiers signes d'un changement de situation sont apparus à peu près en même temps : au printemps, une grève sauvage de General Electric s'étendit à quatre usines du Massachusetts, et une grève des cheminots du Maine Railroad s'étendit rapidement dans la Nouvelle-Angleterre, les autres cheminots manifestant une solidarité active. Mais ce fut la grève des employés municipaux de Philadelphie et Détroit en juillet qui annonça le plus clairement la troisième phase aux USA, à peine deux mois après les événements de Belgique.
A Philadelphie, les ouvriers utilisèrent des piquets de masses pour fermer l'Hôtel de Ville, refusant de laisser les syndicats utiliser des divisions juridiques pour diviser l'unité de la lutte, ne laissant pas les ordres syndicaux dissoudre les piquets pour faire dérailler le mouvement, et n'obéirent pas à l'injonction de reprendre le travail. Mais les syndicats parvinrent à utiliser la menace de la Ville de licencier tous les ouvriers, et à briser la grève, parce que les ouvriers n'avaient pas encore compris que la seule façon de déjouer de telles tactiques est d'étendre encore plus la lutte, d'entraîner plus d'ouvriers d'autres secteurs dans la bataille.
A Détroit, les efforts conscients de recherche d'unité ont atteint un niveau encore plus haut : les employés dits « cols bleus » comme ceux du sanitaire et du transport, qui n'étaient pas directement impliqués dans le conflit immédiat sur le contrat de salaires, ont maintenu une unité combative, résistant à tous les efforts des syndicats et de la direction pour les diviser. Même si les « cols bleus » n'ont jamais vraiment rejoint la grève sur leurs propres revendications, leur solidarité combative a donné à la grève sa réelle force, et a permis aux ouvriers de repousser l'attaque pour le moment, montrant clairement que la lutte paie. La même tendance s'est manifestée dans la grève des hôtels à Atlantic City où les ouvriers ont affirmé que la manifestation de rue était une arme puissante de la lutte de classe, défilant dans les rues, bloquant les transports de touristes et les bus qui transportaient les jaunes, et s'affrontant à la police pendant près de deux jours, avant qu'un nouveau contrat ne leur soit proposé.
Les mêmes tendances vers la recherche rapide et consciente de l'unité, ignorant les ordres syndicaux, prenant les rues, évitant les « guerres d'usure » se sont manifestées dans la grève des cliniques d'une chaîne privée en Californie, qui voulait baisser le salaire d'entrée de 30 %. Les piquets de masse forcèrent cinq autres syndicats représentants d'autres employés à rejoindre la grève.
En identifiant les nouvelles tendances déterminantes qui ont surgi dans cette troisième phase de la lutte, nous ne voulons pas déduire que toute lutte a nécessairement les mêmes forces et le même développement. Il est clair que la bourgeoisie américaine, avec sa grande force économique, a encore la capacité de disperser ses attaques, à un plus ou moins grand degré, et le fera tant que ce sera possible. Comme le montre l'exemple de la grève à USX (sidérurgie), elle a la capacité d'orchestrer l'isolement des luttes et recourt à l'idéologie de la grève d'usure. Néanmoins, nous devons insister sur le fait que la tendance générale favorise un développement des luttes dans lesquelles les ouvriers cherchent consciemment à unifier leurs luttes et à construire une solidarité active.
Vu les spécificités de l'économie américaine, avec son large secteur privé, et la façon plus indirecte dont les plans d'austérité du gouvernement sont imposés au secteur privé, c'est dans le secteur public que les conditions sont le plus favorables à un mouvement unifié à court terme. Toutefois, comme le montre l'avalanche de nouveaux licenciements, la résistance des ouvriers du secteur privé ne suivra pas de loin.
Avec les contrats pour 1987 qui touchent près de 600 000 ouvriers du secteur public et 400 000 du secteur automobile, les potentialités pour des luttes importantes sont posées. La croissance rapide du chômage pose la condition pour que les chômeurs jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte de classe, comme nous l'avons vu dans certains pays d'Europe. La fermeture d'un nombre croissant d'usines, suivant des années de concessions syndicales, qui étaient censées garantir le futur, et les licenciements dans des compagnies qui réalisent d'énormes profits, attisera la résistance combative des ouvriers. La pression grandissante du gouvernement et des compagnies pour attaquer les ouvriers amènera une plus grande simultanéité des luttes, et créera des circonstances de plus en plus favorables pour la tendance à l'unification des luttes contre des attaques unifiées.
La participation de la classe ouvrière américaine à la troisième phase démontre clairement que le même processus de maturation de la conscience de classe a eu lieu ici et en Europe. Les ouvriers aux USA comprennent de plus en plus le sérieux de ce qui est engagé dans les luttes. Bien que le nombre de grèves en 1986 ait incroyablement augmenté par rapport à 1985 (qui détenait le record du nombre de grèves le plus bas depuis la seconde guerre mondiale), il n'a pas encore rattrapé celui de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Mais, plus important que le nombre de grèves, est la qualité des grèves, qui se traduit dans le sérieux des enjeux des grèves et dans les efforts de la classe ouvrière pour tirer les leçons des grèves passées.
La bourgeoisie utilise ses médias pour démoraliser les ouvriers quant aux perspectives de lutte, insistant sur la défaite des contrôleurs aériens en 1981, sur la grève d'Hormel, sur celle du personnel naviguant de la TWA — tous ceux là ayant perdu leur travail. Mais les ouvriers n'ont pas été détournés de la lutte par ces défaites. Au contraire, ils commencent à tirer les leçons de ces défaites, et cherchent l'unité dans la lutte, qui est leur principale arme. Il devient de plus en plus évident que la meilleure façon de se battre ce n’est pas les longues grèves d'usure, mais les conflits courts, qui s'étendent rapidement. A Hormel, à Watsonville, à la TWA, à USX, les syndicats ont imposé leur stratégie de grève d'usure, et ont mené les ouvriers à la défaite. Mais à Philadelphie, Détroit, Atlantic City et dans les cliniques de Californie, les ouvriers ont très rapidement cherché à étendre leurs luttes.(...)
Internationalism Décembre 1986
Géographique:
- Etats-Unis [34]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Où en est la crise économique ? : Le capitalisme russe s'enfonce dans la crise mondiale
- 3820 reads
Avec Mikhaïl Gorbatchev, la propagande soviétique s'offre une cure de jouvence médiatique. Devant les caméras du monde entier, le nouveau chef de l’Etat russe pérore : « ...des transformations révolutionnaires sont en cours dans notre pays », et les nouveaux princes du Kremlin de disserter sur la « révolution », la « démocratie », la « paix », le « désarmement », etc. Mais dans tout cela, rien de bien nouveau, ce sont les thèmes classiques de la propagande soviétique depuis des décennies. Ce qui est nouveau, c'est après la paralysie de l'administration brejnevienne, le dynamisme de la nouvelle équipe à mettre en œuvre ses thèmes de propagande, de mystification, sa capacité à jouer des ressources de l'arsenal médiatique, à libérer quelques «dissidents» par-ci, à faire de mirifiques propositions de « désarmement » par-là, à arrêter quelques bureaucrates « corrompus » par ailleurs. La bourgeoisie russe est en train de prendre exemple sur ses consœurs occidentales et apprend à maîtriser l'art des campagnes idéologiques de déboussolement destinées à cacher aux yeux du prolétariat la réalité de la dégradation générale de l'économie, l'attaque drastique contre les conditions de vie des ouvriers et l’accentuation des tensions impérialistes.
La dégradation économique de l'URSS
Les données économiques de manière générale sont toujours sujettes à caution, car ce sont d'abord des données fournies par la classe dominante, donc en partie assujetties aux besoins de sa propagande, mais en URSS cette tendance est certainement encore plus forte que pour les autres grandes puissances, quand ce n'est pas que simplement ces données sont classées secret d'Etat. Dans ces conditions, il est bien difficile de se faire une idée exacte de la situation réelle de l'économie russe. Cependant, quelques éléments montrent clairement sa situation de faiblesse sur la scène mondiale et la dégradation qui va en s'accélérant dans le cadre de la crise économique mondiale du capitalisme.
Le statut de 2e puissance économique mondiale de l'URSS est à relativiser. Alors qu'en 1984, les USA caracolent en tête avec un PNB de 3627 milliards de dollars, l'URSS, en 2e position, est talonnée par le Japon : respectivement 1400 et 1307 milliards de dollars.
Cependant, l'estimation du PNB russe, pour être un élément de comparaison valable, doit être relativisée par:
— le fait que le rouble qui sert de base aux calculs en URSS est profondément surévalué par rapport à la monnaie internationale de référence qui est le dollar ;
— une grande part (de 10 à 20 %) de la production manufacturière russe est déficiente et invendable (même sur le marché interne), mais est tout de même comptabilisée, et l'ensemble de la production est de qualité médiocre.
En tenant compte de ces éléments, il est probable que la valeur réelle de la production globale du Japon a dépassé celle de l'URSS et de toute façon, même sur le plan des chiffres officiels, le Japon, sur le strict plan de la production manufacturière, précède l'URSS pour laquelle celle-ci ne représente que 25 % du PNB.
Ce rattrapage de l'URSS par le Japon montre à l'évidence que l'URSS, malgré les taux de croissance records annoncés depuis des années, a vu sa situation se dégrader sur la scène économique mondiale.
Un bon indice du degré de développement est le PNB par habitant. Avec 5500 dollars en 1984, le PNB de l'URSS par habitant se situait à la 49e place mondiale, après Hong-Kong et Singapour. L'URSS présente de graves caractéristiques de sous-développement. Cela est particulièrement net si on considère simplement la situation du commerce extérieur, même si celui-ci ne représente que 6 % du PNB (contre 18 % pour la France par exemple).
Les échanges de l'URSS avec l'OCDE sont caractéristiques de ceux d'un pays sous-développé. L'URSS est essentiellement un exportateur de matières premières : 80 % du total de ses exportations vers l'OCDE en 1985.
Le capital russe est incapable de maintenir sa compétitivité. Ainsi, si les exportations de produits « dérivés de la technologie » représentaient 27 % des exportations russes vers l'OCDE en 1973, ils n'en représentaient plus que 9 % en 1982. C'est de moins en moins sa puissance industrielle et de plus en plus la richesse de son sous-sol qui permet à l'URSS de maintenir une balance commerciale positive et d'acheter à l'occident la technologie qui lui fait défaut. Mais cette situation rend l'URSS particulièrement sensible aux fluctuations du marché mondial.
Sur le plan de ses échanges avec l'occident, l'année 1986 a été une année noire pour l'URSS. La chute des cours des matières premières, et notamment du pétrole, est venue porter un coup très rude aux exportations soviétiques : au cours du 1er semestre 1986, les exportations ont baissé en valeur de 21 %, tandis que pour maintenir le solde de sa balance commerciale, l'URSS a dû réduire ses importations de 17,5 %, et procéder à d'importantes ventes d'or, écornant ainsi ses réserves.
L'URSS, comme tout pays capitaliste, subit de plein fouet la crise de l'économie mondiale. Depuis le début des années 1970, la croissance n'a cessé de chuter. Elle est ainsi passée d'un taux moyen annuel de 5,1 % en 1971-75, à 3,7 % en 1976-80, pour finir à 3,1 % en 1985. Sur 1981-85, ce taux de 3,2 % a été le plus bas de l'après-guerre (ces taux officiels sont surévalués, mais ils donnent une idée de l'évolution générale vers la récession).
Comme on vient de le voir, nous sommes bien loin des rodomontades d'un Khrouchtchev qui prétendait il y a 25 ans rattraper les USA sur le plan économique. Pourtant aujourd'hui, Gorbatchev nous ressort le même type de balivernes. Mais derrière le sourire de l'homme médiatique, s'impose la même poigne de fer qui, dans la logique de la gestion capitaliste, impose au prolétariat toujours plus d'austérité. Le discours et la pratique des dirigeants russes n'a pas changé. Devant la dégradation de son appareil économique, devant la pénurie de capital typique du sous-développement, le « capital humain » comme disait Staline, doit remplacer les machines que l'URSS n'a pas la technique pour construire, ni l'argent pour acheter à l'occident. Alors que le prolétariat russe subit déjà des conditions de misère terribles, derrière tous les beaux discours actuels, c'est encore plus de peine, plus de sueur, plus de sang, plus de larmes qui lui sont imposés.
Une attaque redoublée contre le niveau de vie de la classe ouvrière
La lutte sur le front de la productivité, inclut les méthodes policières mises en place durant l'intermède Andropov, et derrière les campagnes contre l'alcoolisme, ces mesures sont même intensifiées par les nouveaux dirigeants : surveillance renforcée dans les usines, interdiction d'aller faire les courses durant les heures de travail (ce qui était une coutume étant donné les longues heures d'attente pour avoir une chance de disposer des rares produits disponibles dans les magasins d'Etat), vérifications dans la rue et dans les usines de la présence sur les lieux de travail, sanctions accrues contre les récalcitrants à la discipline du travail, etc.
Le but de l'équipe Gorbatchev est d'accroître la production et la compétitivité en renforçant la compétition économique entre les ouvriers. La part des primes de toutes sortes dans les salaires est accrue par les nouvelles réformes : les nouveaux critères de qualité, s'ils peuvent signifier un accroissement du salaire dans les usines les plus modernes, là où ils sont possibles à réaliser (ainsi par exemple une usine-pilote de turbines en Sibérie a fait grimper le salaire mensuel de 320 à 450 roubles) ; par contre, là où l'appareil productif est délabré (ce qui constitue l'essentiel des cas), l'impossibilité de répondre à ces critères va signifier une chute brutale des primes, et donc des salaires. De plus, comme ces primes sont attribuées collectivement, il est nécessaire que l'ensemble des ouvriers participe de l'effort de production. Cela signifie une pression renforcée sur l'ensemble des travailleurs, et vise à renforcer aussi les divisions et oppositions entre ouvriers. Ces nouvelles mesures vont accroître les disparités des salaires et accentuer le fonctionnement à deux vitesses de l'économie russe : d'un côté les secteurs pilotes nécessaires au développement technologique de l'industrie d'armement où les salaires sont plus élevés, de l'autre côté le reste de l'économie où les salaires vont diminuer.
De plus, dans la mesure où les primes, qui représentent 40 % du salaire, sont indexées aux résultats obtenus vis-à-vis des objectifs du plan, la perspective très ambitieuse d'une croissance de 4 % imposée par Gorbatchev, signifie en fait, devant le peu de chances de la réaliser, une baisse des salaires.
Si l'inflation ' n'a jamais officiellement existé en URSS, pour autant c'est un secret de polichinelle que celle-ci a fait comme à l'ouest ses ravages durant les années 1970. Cela s'est notamment manifesté sur le marché kolkhozien et sur le marché noir omniprésents face à la pénurie de produits dans les magasins d'Etat. Cependant, si l'inflation a marqué le pas ces dernières années, les nouvelles mesures prises signifient à terme une relance de celle-ci :
— dans les magasins d'Etat les prix vont tendre à s'aligner sur ceux des marchés parallèles au travers de la diminution des subventions de l'Etat aux produits de base, l'approvisionnement va être « facilité » pour des produits soi-disant de meilleure qualité, mais surtout d'un prix beaucoup plus élevé ;
— la plus grande liberté pour les paysans de cultiver et de vendre leurs propres produits va permettre d'alimenter le marché kolkhozien, mais à des prix prohibitifs (ainsi cet été, un kilo de tomates valait une journée de salaire ouvrier) ;
—-la tendance actuelle à la légalisation de l'économie souterraine, reconnaissance du travail artisanal, mise en place de nouvelles structures semi-privées de production et de distribution, va tendre à aligner les prix officiels sur ceux du marché noir.
Ces mesures sont une attaque directe contre les conditions de vie de la classe ouvrière.
Quelles perspectives ?
Il est tout à fait significatif qu'au même moment où Gorbatchev lance ses appels à la lutte pour la production, pour la compétitivité, ce sont les mêmes discours qui sont prononcés à l'ouest, où Reagan lance une « bataille pour la compétitivité », qu'au même moment où la direction soviétique met en place un vaste plan de réformes économiques, la « refonte », pour donner plus d'autonomie concurrentielle aux entreprises d'Etat ; à l'ouest, la mode est au « libéralisme », à la « privatisation », pour éliminer les « canards boiteux » de la production. La crise est mondiale, et dans la situation de concurrence exacerbée qui en découle, la lutte pour une plus grande compétitivité passe par la mise en place de programmes d'austérité renforcés. Là est le véritable sens de tous les beaux discours qui sont assénés au prolétariat à l'est comme à l'ouest.
Les discours productivistes, pacifistes et démocratiques, de Gorbatchev ne sont que du bluff :
— les mirifiques taux de croissance annoncés pour le futur plan quinquennal de la fin des années 1980 ne seront jamais atteints. L'économie mondiale est en train, lentement mais sûrement, de s'enfoncer dans la récession, et l'URSS, puissance économique secondaire, à l'appareil productif périmé, est bien incapable, même en soumettant l'ensemble de son bloc à un pillage en règle, de redresser la situation. L'URSS, à l'instar des autres pays, s'enfonce inexorablement dans la crise, et ceci, vu la faiblesse économique de ce pays, va prendre des formes brutales :
— Dans ces conditions, étant donné l'incapacité de l'URSS d'asseoir sa puissance sur le plan économique, plus que jamais c'est dans la fuite en avant dans l'économie de guerre, dans le sacrifice de l'économie sur l'autel de la production d'armements, que l'URSS peut parvenir à maintenir sa place de puissance impérialiste dominante. Tous les beaux discours de Gorbatchev sur le désarmement ne sont qu'un leurre, lié à la réorientation de sa stratégie imposée par sa difficulté à faire face à 1 offensive impérialiste du bloc de l'ouest de ces dernières années, et qui vise a resserrer son dispositif militaire sur les frontières de son bloc et à entreprendre un vaste plan de modernisation de son armement technologiquement en retard.
— Après la défaite du prolétariat en Pologne en 1981, et le reflux des luttes qui s'en est suivi, de nouveaux échos de la lutte de classe nous parviennent d'Europe de l'est, qui témoignent que le potentiel de combativité de la classe ouvrière est toujours là, et que face à l'attaque en règle contre ses conditions de vie, celle-ci réagit. Dans le bloc de l'est aussi la perspective est au développement de la lutte de classe.
En URSS, les émeutes de Kazakhstan témoignent d'un mécontentement croissant. Mais plus significatives encore ont été les émeutes, réprimées elles aussi dans le sang, des travailleurs originaires des Etats baltes, réquisitionnés pour circonscrire la catastrophe de Tchernobyl, et les échos de grèves qui ont eu lieu dans la gigantesque usine Kamaz où l'on fabrique des camions (ville de Breschnev, République Tatare) contre les « contrôles de qualité » imposés par Gorbatchev.
Les beaux discours démocratiques de Gorbatchev ont d'abord pour but de faire accepter par une classe ouvrière récalcitrante une austérité accrue, et d'adapter l'appareil d'Etat russe pour faire face à la lutte ouvrière. L'utilisation des mystifications démocratiques par Gorbatchev n'a pas un sens différend de l'utilisation de la « démocratisation » des régimes gouvernementaux en Argentine ou au Brésil : désarmer et encadrer la classe ouvrière pour mieux l'affronter. Le pire danger pour le prolétariat serait de prendre ces belles paroles pour argent comptant. L'expérience kroutchevienne, qui elle aussi, derrière la campagne de « déstalinisation », avait été marquée par une attaque massive contre les conditions de vie des ouvriers, et avait vu en 1961-62-63 se développer une importante vague de lutte de classe, vague qui avait notamment culminé dans la grève des mineurs du Donbass que les troupes du KGB avaient réprimée violemment, n'est pas si éloignée, comme celle plus récente de la Pologne, pour montrer aux ouvriers russes le mensonge des discours démocratiques.
Avec le développement de la crise, Gorbatchev, bien moins encore que Kroutchev il y a 30 ans, n'a les moyens de sa politique.
J.J. 27/2/87
Géographique:
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
Polémique : Comprendre la décadence du capitalisme (2)
- 3547 reads
COMPRENDRE LES CONSÉQUENCES POLITIQUES DE LA DÉCADENCE DU CAPITALISME
-
Le syndicalisme, le parlementarisme, les partis de masse, la lutte pour des réformes sociales, l'appui aux luttes pour la formation de nouveaux Etats... ce ne sont plus là des formes de lutte valables pour la classe ouvrière. La réalité de la crise ouverte qui secoue le capitalisme, l'expérience des luttes sociales que cette crise a engendrées, rendent cela de plus en plus clair pour des centaines de millions de travailleurs dans le monde entier.
-
Mais pourquoi ces formes de lutte qui ont été si importantes au siècle dernier pour le mouvement ouvrier ont-elles pu être transformées en ce qu'elles sont aujourd'hui ?
-
Il ne suffit pas d'être contre. Pour avoir une intervention solide dans la lutte de classe, capable de combattre le déboussolement que distille l'idéologie bourgeoise, encore faut-il savoir pourquoi on est contre.
Aujourd'hui, soit par ignorance, soit par facilité, certains groupes qui sont parvenus à la conclusion de la nature bourgeoise du syndicalisme, parlementarisme, etc., tentent de répondre à ces questions en ayant recours à des conceptions anarchistes ou utopistes, formulées en langage marxiste pour faire « plus sérieux ». Parmi eux, le Groupe Communiste Internationaliste (GCI)[1] [36].
Pour le GCI, le capitalisme n'a pas changé depuis ses origines. Les formes de lutte du prolétariat non plus. Quant au programme formulé par les organisations révolutionnaires, pourquoi aurait-il changé ? C'est la théorie de l'Invariance.
Pour ces chantres de la « révolte éternelle », la lutte de type syndical, parlementaire, la lutte pour des réformes ont toujours été, depuis leur apparition, ce qu'elles sont aujourd'hui, des moyens d'intégrer le prolétariat dans le capitalisme.
L'analyse de l'existence de deux phases dans l'histoire du capitalisme auxquelles correspondent des formes de lutte différentes ne serait qu'une invention des années 30 pour mieux « trahir le programme historique », programme qui lui se résumerait à une vérité quasi-éternelle : « révolution violente et mondiale ».
Voici comment ils formulent tout cela :
-
« Cette théorisation de l'ouverture d'une nouvelle phase capitaliste : celle de son déclin, permit ainsi à posteriori de maintenir une cohérence formelle entre les "acquis du mouvement ouvrier du siècle précédent" (il s'agit bien entendu ici des "acquis" bourgeois de la social-démocratie : le syndicalisme, le parlementarisme, le nationalisme, le pacifisme, la "lutte pour des réformes", la lutte pour la conquête de l'Etat, le rejet de l'action révolutionnaire...) et, du fait du "changement de période" (argumentation classique pour justifier toutes les révisions-trahisons du programme historique), l'apparition de "nouvelles tactiques" propres à cette "nouvelle phase"; cela allant de la défense de la "patrie socialiste" pour les staliniens au "programme de transition" de Trotsky, au rejet de la forme syndicale au profit de celle des conseils "ultra-gauches" » (cf. Pannekoek : Les Conseils Ouvriers). Tous entérinent ainsi, de façon a-critique l'histoire passée et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait "dans la phase ascendante du capitalisme...".
-
(...) « Et, les communistes d'être encore une fois des “iguanodons[2] [37] de l'histoire”, ceux pour qui rien n'a fondamentalement changé, ceux pour qui les “vieilles méthodes” de lutte directe, classe contre classe, la révolution violente et mondiale, l'internationalisme, la dictature du prolétariat... restent toujours -hier, aujourd'hui, demain- valables ». “Le Communiste” n° 23, p. 17-18.
Le GCI précise :
-
« L'origine même des théories décadentistes (théories du "changement de période" et de "l'ouverture d'une nouvelle phase capitaliste" : celle de son "déclin"...) se retrouve bizarrement" dans les années 30, théorisées tant par les staliniens (Varga) que par les trotskystes (Trotsky lui-même) que par certains sociaux démocrates (Hilferding, Sternberg...) et universitaires (Grossmann). C'est donc à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 que certains produits de la victoire de la contre-révolution commencèrent à théoriser une longue période de "stagnation" et de "déclin" ».
Difficile de dire autant d'absurdités en si peu de lignes. Laissons de côté les amalgames auxquels recourt fréquemment le GCI, qui n'apportent rien au débat sinon de démontrer la superficialité de son propre raisonnement. Mettre dans un même sac la gauche communiste internationaliste (Pannekoek) et le stalinisme (Varga) parce qu'ils ont parlé de décadence du capitalisme est aussi stupide que d'identifier révolution et contre-révolution parce que les deux traitent de lutte des classes.
LES ORIGINES DE LA THÉORIE DE LA DÉCADENCE
Commençons par ce qui est un vulgaire mensonge, ou dans le meilleur des cas, l'expression de la plus crasse ignorance de l'histoire du mouvement ouvrier : d'après le GCI, c'est dans les années 30, “a postériori”, qu'aurait été “bizarrement” inventée l'analyse de la décadence du capitalisme. Quiconque connaît un tant soit peu de l'histoire du mouvement ouvrier, et en particulier du combat contre le réformisme que mena la gauche révolutionnaire au sein de la social-démocratie et de la seconde Internationale, sait qu'il n'en est rien.
Dans l'article “Comprendre la décadence du capitalisme” nous avons longuement montré comment l'idée de l'existence de deux phases, l'une “ascendante” où les rapports capitalistes stimulent le développement économique et global de la société, l'autre “décadente” où ces rapports se transforment en « entrave » à ce développement, ouvrant une “ère de révolution”, nous avons indiqué comment cette vision est au coeur de la conception matérialiste de l'histoire, telle qu'elle fut définie par Marx et Engels, dès le Manifeste Communiste de 1847. Nous avons montré le combat que durent mener les fondateurs du socialisme scientifique contre tous les courants utopistes, anarchistes qui ignoraient volontairement une telle distinction de phases historiques et ne voyaient dans la révolution communiste qu'un idéal éternel à réaliser à tout moment et non un bouleversement que seul pouvait rendre possible et historiquement nécessaire l'évolution même des forces productives et leur contradiction avec les rapports sociaux de production capitalistes.
Mais Marx et Engels durent surtout combattre ceux qui ne voyaient pas que le capitalisme était encore dans sa phase ascendante. Dès la fin du siècle, la gauche de la seconde Internationale -en particulier à travers Rosa Luxembourg- dut combattre la tendance inverse, celle des réformistes qui consistait à nier que le capitalisme approchait sa phase de décadence. C'est ainsi qu'en 1898, Rosa Luxembourg écrivait dans Réforme ou Révolution :
-
« Une fois que 1e développement de l'industrie aura atteint son apogée et que sur le marché mondial, commencera pour le capital la phase descendante, la lutte syndicale deviendra doublement difficile : premièrement parce que les conjonctures objectives du marché s'aggraveront pour la force du travail, la demande de force de travail augmentant plus lentement et l'offre plus rapidement que ce n'est maintenant le cas ; deuxièmement, parce que le capital lui-même, pour se, dédommager des pertes subies sur le marché mondial, s'efforcera d'autant plus énergiquement de réduire la part du produit revenant aux ouvriers (...). L'Angleterre nous offre déjà le tableau du début du deuxième stade du mouvement syndical. Ce dernier se réduit nécessairement de plus en plus à la simple défense des conquêtes déjà réalisées, et même celle-ci devient de plus en plus difficile » (souligné par nous), Réforme ou Révolution (1ère partie, point 3).
Ce n'est pas “a posteriori” -comme le prétend le GCI-, ce n'est pas après que la première boucherie impérialiste mondiale eut apporté la preuve irréfutable que le capitalisme était définitivement entré dans sa phase décadente, que ces lignes furent écrites. C'est quinze ans auparavant. Et Rosa Luxembourg commence à voir nettement les conséquences politiques -ici au niveau de la possibilité du syndicalisme- qu'entraîne pour le mouvement ouvrier un tel changement de “phase”.
Le GCI affirme que c'est « à la suite de la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 que certains produits de la victoire de la contre-révolution commencent à théoriser une longue période de stagnation et de déclin ».
Le GCI ignore-t-il que, au cœur même de cette vague révolutionnaire, se fonde la troisième Internationale sur la base de l'analyse de l'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase :
« Une nouvelle époque est née. Epoque de désagrégation du capitalisme, de son effondrement intérieur. Epoque de la révolution communiste du prolétariat » (Plate-forme de l'Internationale Communiste). Et c'est au sein de cette Internationale que la gauche communiste mènera à son tour le combat contre les tendances majoritaires qui ne voient pas toutes les conséquences politiques pour les formes de lutte du prolétariat de cette nouvelle période historique.
Voici, par exemple, comment s'exprimait le KAPD, la gauche communiste allemande en 1921, au troisième congrès de l'IC :
-
« Pousser le prolétariat à prendre part aux élections dans la période de décadence du capitalisme revient à nourrir en son sein l'illusion que la crise peut être surmontée par des moyens parlementaires ».
Enfin dans les années 30, ce ne sont pas seulement les « produits de la victoire de la contre-révolution » mais les avant-gardes prolétariennes qui s'efforcent de tirer les enseignements de la vague révolutionnaire passée et qui « théorisent une longue période de stagnation et de déclin ». Ainsi la revue Bilan, qui regroupait des éléments de la gauche communiste d'Italie, Belgique et France, écrivait:
-
« La société capitaliste, vu le caractère aigu des contradictions inhérentes à son mode de production, ne peut plus remplir sa mission historique : développer les forces productives et la productivité du travail humain de façon continue et progressive. Le choc entre les forces productives et leur appropriation privée, autrefois sporadique, est devenu permanent, le capitalisme est entré dans sa crise générale de décomposition » (Mitchell, Bilan n° 11, septembre 1934)[3] [38].
Le GCI ignore ou falsifie l'histoire du mouvement révolutionnaire. Dans les deux cas ses affirmations sur « l'origine même des théories décadentistes » suffisent à démontrer la vacuité de son argumentation et le peu de sérieux de sa démarche.
L'INVARIANCE DU PROGRAMME OU LE “MARXISME DES DINOSAURES”
Venons en à l'argument du GCI selon lequel parler de changement pour les moyens de lutte du prolétariat serait « trahir le programme historique ».
Le programme d'un mouvement politique est constitué par la définition de l'ensemble des moyens et des buts que se propose ce mouvement. Le programme communiste contient en ce sens des éléments qui sont effectivement permanents depuis le Manifeste Communiste dont la rédaction correspond aux révolutions de 1848 qui virent la première apparition sur la scène de l'histoire du prolétariat comme force politique distincte. Il en est ainsi par exemple de la définition du but général : la révolution communiste mondiale ; ou du moyen fondamental pour atteindre ce but: la lutte de classe et la dictature du prolétariat.
Mais le programme communiste n'est pas que cela. Il contient aussi les buts immédiats et les moyens concrets, les formes d'organisation, les formes de la lutte nécessaires pour atteindre le but final.
Ces éléments concrets sont directement déterminés par la situation historique concrète dans laquelle se déroule la lutte du prolétariat.
-
« Si notre programme formule une bonne fois l'évolution historique de 1a société du capitalisme en socialisme, il doit manifestement aussi formuler, dans leurs traits fondamentaux, toutes les phases transitoires de ce développement, et par conséquent, pouvoir indiquer, à chaque moment, au prolétariat, le comportement correspondant, dans le sens du rapprochement vers le socialisme » dit Rosa Luxemburg dans Réforme ou révolution (2e partie, point sur la conquête du pouvoir politique).
Pour le GCI, le programme communiste ignore tout cela, et se cantonne à un seul cri de guerre : « I1 faut faire la révolution mondiale toujours et partout ». Réduit à cela, le programme pourrait être considéré invariant, mais il ne serait plus alors un programme, mais une déclaration d'intentions.
Quant à son application pratique, si ce « programme » pouvait en avoir une, elle se résumerait à envoyer des prolétaires à l'affrontement final quelles que soient les conditions historiques, les rapports de force. Autant dire c'est la voie au massacre.
Marx avait déjà combattu ce genre de tendances au sein de la Ligue des Communistes :
-
« Tandis que nous disons aux ouvriers : vous avez à traverser quinze, vingt, cinquante ans de guerres civiles et de guerres internationales, non seulement pour transformer les conditions, mais pour vous transformer vous-mêmes, et pour vous rendre aptes au pouvoir politique, vous leur dites au contraire : il faut que nous parvenions tout de suite au pouvoir, ou bien nous pouvons aller nous coucher. » (Marx, contre la tendance de Willich et Schapper au sein de la Ligue des Communistes, procès-verbal de la séance du comité central de septembre 1850, cité par B.Nicolaïevski in « La vie de Karl Marx », chap. XV.).
Un programme qui ne s'attache pas à définir les spécificités de chaque situation historique et des comportements prolétariens qui correspondent, un tel programme ne sert à rien.
Par ailleurs, le Programme communiste trouve une source permanente d'enrichissement dans la pratique de la classe. Des questions aussi cruciales que 1 impossibilité pour le prolétariat de conquérir 1’appareil d'Etat bourgeois à son profit ou les formes de lutte et d'organisation du prolétariat pour la révolution ont entraîné des modifications dans le programme communiste à la suite d'expériences comme celles de la Commune de Paris de 1871 et de la révolution russe de 1905.
Refuser de modifier le programme, de l'enrichir en permanence, en fonction de l'évolution des conditions objectives et de l'expérience pratique de la classe, ce n'est pas « rester fidèle » au programme, mais le détruire en le transformant en des tables de la loi. Les communistes ne sont pas des dinosaures et leur programme n'est pas un fossile.
Savoir modifier, enrichir le programme communiste comme ont toujours su le faire les révolutionnaires les plus conséquents pour qu'il soit capable de répondre à chaque situation historique générale, pour qu'il intègre les résultats de la praxis révolutionnaire, ce n'est pas « trahir le programme », mais c'est la seule attitude conséquente qui fasse de celui ci un véritable outil pour la classe[4] [39].
LE POINT DE VUE IDÉALISTE DE L'ANARCHISME ET LA MÉTHODE MARXISTE
Pour le GCI, le pire crime des “décadentistes” consiste à « théoriser une cohérence formelle avec 'les acquis du mouvement ouvrier du siècle précédent'». Et le GCI de préciser: « Il s'agit bien entendu ici des 'acquis' bourgeois de la social-démocratie ». Le danger fondamental de la théorie de la décadence serait « d'entériner de façon a-critique l'histoire passée et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait 'dans la phase ascendante du capitalisme'».
Pour le GCI, « La fonction historique de 1a Socialdémocratie a été directement, non pas d'organiser la lutte pour la destruction du système (ce qui est le point de vue invariant des communistes), mais d'organiser les masses d'ouvriers atomisés par la contre-révolution afin de les éduquer pour les faire participer au mieux au système d'esclavage salarié ». (Le Communiste n° 23, p. 18).
Nous reviendrons dans un prochain article de façon spécifique sur la nature de classe de la Socialdémocratie-2e Internationale de la période de l'entredeux siècles. Mais pour pouvoir en parler, il faut auparavant répondre au simplisme absurde du GCI selon lequel « rien n'a fondamentalement changé » pour la lutte ouvrière depuis ses origines.
Le GCI reproche à la Social-démocratie en effet de ne pas avoir organisé la lutte « pour la destruction du système (ce qui est le programme invariant des communistes) », mais le combat syndical, parlementaire, pour des réformes qui n'a jamais pu être autre chose qu'un moyen pour faire participer les prolétaires au système.
Mais rejeter le syndicalisme ou le parlementarisme uniquement parce qu'il s'agit là de formes de lutte qui ne se traduisent pas immédiatement par la « destruction du système », c'est les rejeter pour des raisons purement idéalistes, fondées sur le vent des idéaux éternels et non sur la réalité concrète des conditions objectives de la lutte de classe. Cela revient à ne voir la classe ouvrière que comme classe révolutionnaire, oubliant qu'au contraire de toutes les classes révolutionnaires du passé, elle est aussi une classe exploitée.
La lutte revendicative et la lutte révolutionnaire sont deux moments d'un même combat de la classe ouvrière contre le capital ; la lutte pour la destruction du capitalisme n'est autre que la lutte revendicative contre les attaques du capital portée à ses dernières conséquences. Ces deux moments de lutte n'en sont pas pour autant identiques. Et l'on a une vision totalement creuse de la lutte prolétarienne si l'on en ignore ce double caractère.
Ceux qui -tels les réformistes- ne voient dans la classe ouvrière que son caractère de classe exploitée et sa lutte comme seulement revendicative, ont une vision statique, a-historique bornée. Mais ceux qui ne voient la classe ouvrière que comme classe révolutionnaire ignorant sa nature d'exploitée et partant la nature revendicative de toute lutte ouvrière, parlent d'un fantôme.
Lorsque les révolutionnaires marxistes ont rejeté la forme de lutte syndicale ou parlementaire par le passé, ce ne fut jamais au nom du radicalisme creux et a-classiste propre aux anarchistes, et qui faisait écrire à Bakounine en 1869 dans le “Catéchisme révolutionnaire” que l'organisation doit consacrer « toutes ses forces et tous ses moyens à aggraver et à étendre les souffrances et les misères qui doivent finalement pousser le peuple à un soulèvement général ».
L'anarchisme se situe du point de vue d'un idéal de « révolte » abstrait. Pour les luttes revendicatives de la classe ouvrière, il n'éprouve qu'un « mépris transcendantal » comme le dénonce Marx à propos de Proudhon dans Misère de 1a philosophie. Le marxisme se situe du point de vue d'une classe et de ses intérêts, aussi bien historiques qu'immédiats. Lorsque les révolutionnaires marxistes parviennent à la conclusion que le syndicalisme, le parlementarisme, les luttes pour des réformes ne sont plus valables, ce n'est pas parce qu'ils abandonnent la lutte revendicative, mais parce qu'ils savent que celle-ci ne peut plus aboutir, ne peut plus être efficace en se servant des anciennes formes.
Telle est la démarche générale de Rosa Luxemburg lorsqu'elle envisage qu'avec l'entrée du capital dans “la phase descendante”, la lutte syndicale deviendra “doublement difficile”, lorsqu'elle constate à la fin du 19e siècle, que le mouvement syndical, dans le pays le plus avancé de l'époque, l'Angleterre, « se réduit nécessairement de plus en plus à la simple défense des conquêtes déjà réalisées, et même celle-ci devient de plus en plus difficile ».
Telle est la démarche du KAPD quand il rejette la participation aux élections non pas parce que « le vote c'est sale », mais parce que les moyens parlementaires ne servent plus pour faire face aux effets de la crise du capitalisme, c'est-à-dire pour faire face à la misère pour le prolétariat.
Tant que le développement du capitalisme a pu s'accompagner de façon durable d'une véritable amélioration des conditions d'existence de la classe ouvrière, tant que l'Etat n'était pas devenu une puissance totalitaire sur la vie sociale, la lutte revendicative devait et pouvait prendre les formes syndicales, parlementaires. Les conditions objectives où le capitalisme connaît son apogée historique créent une sorte de terrain économique et politique où les intérêts immédiats de la classe ouvrière peuvent coïncider avec les nécessités du développement d'un capital en pleine expansion mondiale, et y trouver un réel profit.
C'est l'illusion de croire qu'une telle situation pourrait se poursuivre indéfiniment qui fut la base du développement du réformisme -cette idéologie bourgeoise selon laquelle la révolution communiste est impossible et seul peut être réalisée une réforme progressiste du capitalisme au profit de la classe ouvrière- au sein du mouvement ouvrier.
Pour les marxistes, le rejet de la lutte pour des réformes dans le capitalisme a toujours reposé -en dernière instance- sur l'impossibilité de celles-ci. Rosa Luxembourg formulait cela dès 1898 en ces termes :
-
« La protection ouvrière, par exemple, est autant dans l'intérêt immédiat des capitalistes en tant que classe, que de la société en général. Mais cette harmonie ne dure que jusqu'à un certain moment du développement capitaliste. Quand ce développement a atteint un certain niveau, les intérêts de la bourgeoisie en tant que classe, et ceux du progrès économique, même dans le sens capitaliste, commencent à se séparer » (Réforme ou Révolution, 1re partie, point 4).
Ce qui change pour la lutte ouvrière au niveau des conditions objectives avec l'entrée du capitalisme dans sa phase décadente c'est l'impossibilité d'obtenir de véritables améliorations durables. Mais cela ne se produit pas isolément. La décadence du capitalisme est aussi synonyme de capitalisme d'Etat, d'hypertrophie de l'appareil d'Etat, et cela bouleverse entièrement les conditions d'existence du prolétariat.
Nous ne pouvons ici développer tous les aspects du bouleversement qu'implique pour la vie sociale en général, et pour la lutte de classe en particulier, l'entrée du capitalisme dans une nouvelle phase historique. Nous renvoyons le lecteur à l'article « La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent » (Revue Internationale, n° 23).
Ce qui nous importe de souligner ici, c'est le fait que pour les marxistes, les formes de lutte du prolétariat dépendent des conditions objectives dans lesquelles celle-ci se déroule et non sur des principes abstraits de révolte éternelle.
C'est seulement en se fondant sur l'analyse objective du rapport de forces entre les classes envisagé dans sa dynamique historique que l'on peut fonder la validité ou non d'une stratégie, d'une forme de combat. En dehors de cette base matérialiste, toute prise de position sur les moyens de la lutte prolétarienne repose sur du sable mouvant ; c'est la porte ouverte au déboussolement dès que les formes superficielles de la « révolte éternelle » -la violence, l'anti-légalité- font leur apparition.
Le GCI en est une manifestation criante. Quand on ne comprend pas pourquoi certaines formes de lutte étaient valables dans le capitalisme ascendant, on ne peut pas comprendre pourquoi elles ne le sont plus dans le capitalisme décadent. A force de ne baser ses critères politiques que sur des “anti-tout-ce-qui ressemble-à-la-social-démocratie”, à force de croire que “l'anti-démocratie” peut être un critère en soi, suffisant, le GCI se retrouve à affirmer en novembre 1986 qu'une organisation comme celle des guérilleros nationaliste staliniens du Pérou, “Sentier Lumineux”, parce qu'elle est armée et a refusé de participer à des élections « apparaît de plus en plus » comme l'unique structure capable de donner une cohérence au nombre toujours croissant d'actions directes du prolétariat, « dans les villes et les campagnes, alors que tous les autres groupes de gauche s'unissent objectivement contre tous les intérêts ouvriers au nom de la condamnation du terrorisme en général et de la défense de la démocratie » (souligné par nous, Le Communiste n° 25, p. 48-49).
Le GCI constate que « tous les documents que 'SL' a rédigés sont basés sur le plus strict stalinomaoïsme », et que celui-ci considère qu'au Pérou la lutte est « dans l'époque actuelle anti-impérialiste et anti-féodale ». Mais cela n'empêche pas le GCI de conclure : « Nous n'avons pas d'éléments pour considérer 'SL' (ou le PCP comme il s'auto-définit) comme une organisation bourgeoise au service de la contre-révolution » (idem).
Ce qui manque au GCI pour apprécier la nature de classe d'une organisation politique, ou toute autre réalité de la lutte de classe, ce ne sont pas des “éléments d'information”, mais la méthode marxiste, la conception matérialiste de l'histoire -dont la notion de phases historiques d'un système (ascendante et décadente) est un élément indispensable.
RV.
[1] [40] Cet article fait suite à celui paru dans le numéro précédent de la Revue Internationale: « Comprendre la décadence du capitalisme ».
[2] [41] Iguanodon : “reptile dinosaurien fossile, qui vivait à l'époque crétacée”.
[3] [42] Le GCI reconnaît dans une petite note de l'article cité qu'effectivement Luxemburg, Lénine, Boukharine ont partagé des «théories décadentistes ». Mais il prétend qu'il ne s'agissait pas pour eux de « définir une phase de plus de 70 années ». C’est encore une falsification: pour la gauche de la 2e Internationale, fondatrice de la 3e, le stade dans lequel était entré le capitalisme n'était pas une phase parmi d'autres à laquelle pourraient succéder de nouvelles phases ascendantes. Pour eux tous, la nouvelle période était « une phase ultime », un « stade suprême » du capitalisme, audelà duquel il n'y aurait plus d'autre issue pour la société que la barbarie ou le socialisme.
[4] [43] Contre toute attitude religieuse à l'égard de ce qui est l'instrument vivant d'une classe vivante, nous nous revendiquons de l'attitude de Marx et Engels déclarant après la Commune de Paris qu'une partie du Manifeste Communiste était devenue périmée ; de celle de Lénine en 1917 dans Les thèses d'avril affirment la nécessité de re-rédiger une partie du programme du Parti.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [5]
Correspondance internationale (Argentine) a propos du regroupement des révolutionnaires
- 3027 reads
L'an dernier, deux groupes en Argentine et en Uruguay ont lancé une «Proposition internationale aux partisans de la révolution mondiale » que nous avons publiée dans le n° 46 de cette Revue.
La
question de la nécessité du regroupement des forces révolutionnaires, dans la
perspective du développement de la lutte de classe, est vitale aujourd'hui. Il
est nécessaire que les groupes confrontent et clarifient leurs positions
politiques et leurs orientations respectives dans la période actuelle, pour
pouvoir envisager un rapprochement et des tâches communes, ce que la situation
présente du milieu politique prolétarien ne permet pas encore. C'est dans ce
sens que nous avions répondu à la « Proposition
». Emancipacion Obrera a commencé à publier dans une brochure les réponses
reçues à sa « Proposition » et
répondu en particulier par un texte aux questions soulevées par le CCI. Nous
publions ci-dessous de larges extraits de ce texte, ainsi qu'à nouveau une
réponse de notre part sur les principales questions posées sur les conditions
et critères d'un regroupement des forces révolutionnaires dans la période
historique actuelle.
Emancipacion obrera au CCI
Argentine, le 20 septembre 1987
Compagnes et Compagnons du CCI,
Avant
tout nous voulons vous remercier du geste que vous avez eu en traduisant notre
proposition en anglais et en français ainsi qu'en la publiant dans vos Revue Internationale de France et
d'Angleterre, et d'y avoir dédié un article dans votre publication en Espagne, Action Proletaria. Ce n'est pas
n'importe qui qui ferait cela et nous n'avons pas de doutes sur le fait que
grâce à votre contribution, nos préoccupations ont eu une divulgation bien
plus grande que celle que nous aurions pu avoir par nos seules forces.
Répondre
à quelques questions et clarifier des positions
(...) Quand nous avons élaboré cette proposition nous avons essayé de trouver les points de discrimination (lignes de séparation, NDT) les plus importants, tout en tenant compte du fait que tout le monde n'a pas suivi les mêmes étapes ni donné des définitions dans le même ordre d'idées. Nous voulions en même temps qu'ils soient un obstacle contre les opportunistes, les réformistes, et contre la gauche (du capital) en général tout en fournissant une base minimum permettant d'établir des rapports, et non un obstacle apportant plus de sectarisme ou de confusion, ou encore, des définitions avec lesquelles nous seuls aurions pu être d'accord.
Par exemple, il y a un sujet que nous considérons fondamental et que la plupart des organisations considèrent comme secondaire ou subsidiaire : la condition de la femme, les rapports d'exploitation et d'oppression qui existent dans le travail domestique, la manipulation permanente du corps et de la vie de la femme pour qu'elle garantisse la production et la reproduction de la force de travail en fonction des besoins et des intérêts généraux et particuliers de la classe dominante. Pour nous, l'élimination de l'exploitation dont souffre la classe ouvrière (hommes et femmes) et celle dont souffre la majorité des femmes à travers le système du travail domestique (perturbant aussi les rôles familiaux et sexuels) sont partie intégrante d'une lutte unique pour la révolution sociale. Et dans la Proposition il n'apparaît pratiquement rien là-dessus parce que nous pensions qu'étant donné que cette question a, en général, été traitée très peu et très mal, elle ne pouvait être un point de départ mais le résultat d'un processus. Nous avons adopté le même critère pour d'autres sujets et il ne nous a pas semblé juste d'établir des priorités sans tenir compte du fait que les points discriminants sont un point de départ. Dans ce sens ils doivent être larges et stricts : larges pour que puissent participer des groupes ou des personnes dont les définitions, de par leurs limitations historiques, ne recouvrent pas la vaste gamme des autres groupes, mais s'inscrivent dans la même tendance ; stricts, pour exclure ceux qui expriment une politique antagonique à celle que nous revendiquons, même si leur langage contient des relents marxistes.
Sur la démocratie
C'est ainsi que nous n'avons pas mis tout ce que nous défendons et nous considérons certaines questions comme contenues implicitement dans les points discriminants ; par exemple, la question de la démocratie. Nous n'avons aucune objection à l'expliciter davantage et il va de soi que nous ne sommes pas d'accord pour faire du parlementarisme, pas plus que nous ne considérons qu'à travers la démocratie ou la participation à ses institutions on puisse apporter quelque chose de révolutionnaire.
Et ces conclusions nous ne les tirons pas d'un principe a priori mais en analysant les situations concrètes, étant donné que nous sommes d'accord avec Marx sur le fait que « des événements historiques sensiblement analogues, mais qui se déroulent dans des milieux différents, conduisent à des résultats totalement différents » ([1] [44]).
Nous n'aboutissons pas à cette conclusion sur la base de la catégorie « capitalisme décadent » car cela pourrait donner lieu à deux types d'erreurs : justifier pour la fin du siècle dernier ou les débuts de celui-ci la participation aux élections pour des postes exécutifs — c'est-à-dire, appuyer le crétinisme parlementaire que Lénine a critiqué si justement — ou définir la tactique sur la base de principes idéaux valables en tout temps et en tout lieu, méconnaissant le fait que la vérité est concrète, et la tactique doit partir des situations réelles, non pour les justifier ou les affirmer, mais pour les modifier.
Il ne nous semble pas que le refus de participer à une campagne électorale soit un critère discriminant ([2] [45]), même si nous ne l'avons jamais fait et n'avons pas l'intention de le faire vu que nous considérons que, dans l'état actuel des choses, c'est complètement réactionnaire et cela ne sert à rien de révolutionnaire. Nous insistons : nous sommes d'accord sur le fait qu'à travers la démocratie ou la participation à ses institutions on ne fait que renforcer les options bourgeoises et nous n'avons pas d'objection à rendre cette idée plus explicite.
Il y a cependant d'autres points sur lesquels il peut y avoir des différences de deux types : l'une, disons « tactique » et l'autre « stratégique ». Voyons la première.
Pourquoi nous nous referons peu au passe ,
Nous ne pensons pas que pour pouvoir participer à la Proposition chaque groupe doive avoir analysé et défini des prises de position sur toute l'histoire du mouvement ouvrier et les différentes organisations et partis qui ont existé. Non pas que nous considérions que ce n'est pas important, mais parce que nous savons que tous les groupes ou personnes n'ont pas ou n'auront pas une longue histoire antérieure ou des possibilités de produire tant de définitions — justes — par eux-mêmes et dans un laps de temps limité.
Prenons un exemple : vous nous demandez, entre autres, une reconnaissance et une revendication des Gauches communistes issues de la Troisième Internationale. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord les connaître et cela n'est pas possible sans des documents les concernant et la possibilité de les étudier. (...)
Revendiquer la continuité avec la social-democratie ?
Mais nous faisons une autre objection, plus « stratégique » : bien que nous n'ayons pas, en tant qu'organisation, de documents et d'analyses stricts sur le sujet, nous ne nous revendiquons pas, par exemple, d'une continuité du Parti Social-démocrate allemand, ni de l'Internationale à laquelle il appartenait (la soi-disant deuxième). Le fait que des secteurs de la bourgeoisie (ou de la petite-bourgeoisie), à quelque moment de leur histoire, aient été révolutionnaires, n'implique pas que nous nous considérions comme leurs continuateurs, et nous aurions du mal à nous considérer comme des continuateurs d'organisations qui n'ont jamais revendiqué dans la pratique la destruction de l'Etat bourgeois et son remplacement par la dictature socialiste du prolétariat, mais, par contre, ont bien dédié leurs efforts à renforcer et élargir la démocratie bourgeoise. On peut ajouter qu'il y a des camarades d'EO qui disent que Lénine s est trompé quand il a traité Kautsky de renégat et qu'il a parlé de la faillite de la IIe Internationale ; pour eux, Kautsky a toujours été cohérent et celui qui renie, qui rompt (et à la bonne heure !) c'est Lénine. Quelles interventions et orientations révolutionnaires ont été produites par la IIe Internationale ? Quelle activité révolutionnaire prolétarienne concrète a-t-elle impulsé ? Ces camarades de notre organisation n'hésiteraient pas à affirmer qu'ils n'auraient pas appartenu à la IIe Internationale et que la IIe Internationale n'« entrerait » pas dans cette Proposition. (...)
Prenons
un autre exemple : parmi les différents groupes, il y en a qui se réclament de
la IIIe Internationale jusqu'en 1928, d'autres des quatre premiers congrès ;
nous, nous n'allons même pas au-delà du deuxième et sûrement que parmi ceux qui
connaissent les Gauches hollandaise, allemande et italienne, il doit exister
différentes interprétations et évaluations. Faut-il incorporer toutes ces
questions parmi les points de discrimination ? Nous ne le pensons pas, au moins
pas en ce moment, mais nous considérons par contre qu'il est nécessaire de
stimuler organiquement ces études et débats pour apprendre à les connaître et
tirer des conclusions de ces expériences. Le fait de se définir et de
s'homogénéiser autour de ces questions reflétera un moment supérieur au moment
présent et doit avoir comme point de départ la prise effective de positions de
classe aujourd'hui face à des situations qui ne requièrent pas seulement des
caractérisations générales mais des indications et des actions politiques
concrètes. (...)
Guerilla tiers-mondiste et terrorisme petit-bourgeois
Vous vous étonnez également de ne rien trouver sur la question du terrorisme, ni un « rejet catégorique de ce genre d'action »(...) C'est peut-être parce que nous vivons depuis de nombreuses années cette expérience et que nous avons souffert dans notre propre chair ce qu'étaient ces groupes, que nous avons une approche quelque peu différente de cette affaire. Le combat fondamental contre eux ne se mène pas en nous en prenant à la méthode mais à la politique qui guide ce fusil et qui préconise la formation d'armées parallèles, de poser des bombes, de séquestrer des patrons pour obtenir une augmentation de salaire, etc.
Quand nous disons dans notre Proposition, au point 2 « à ceux qui n'appuient aucun secteur bourgeois contre un autre, mais qui luttent contre tous... » ou, au point 4 : « à ceux qui luttent contre les politiques de défense de l’économie nationale, de relance économique...», ou au point 11 : «Dans ce sens, dans l’optique bourgeoise fascisme-antifascisme, à ceux qui dénoncent le caractère de classe bourgeois des fronts antifascistes et de la démocratie... », notre condamnation de ces groupes guérilleristes est implicite, en tant que secteurs de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie, qui luttent violemment pour prendre l'Etat bourgeois et se répartir la part de plus-value arrachée à la classe ouvrière. Nous n'entrons même pas dans les considérations de savoir s'ils prétendent atteindre leurs objectifs au moyen des élections ou de l'insurrection, en formant des armées de votants ou des groupes armés, en essayant de conquérir un syndicat ou d'assassiner un de leurs dirigeants.
La lutte pour le communisme est une lutte contre la bourgeoisie dans son ensemble : ce n'est pas juste de choisir un «moindre mal» ou de recommander telle ou telle forme de lutte à l'ennemi de classe. Nous ne rejetons pas l'action de guérilla seulement par « son inefficacité » et sa prétention à « réveiller » — dans le meilleur des cas — ou à se substituer — dans le pire des cas — à la seule violence adéquate, la violence de classe, comme vous semblez le dire dans votre lettre.
Notre combat contre des groupes comme les Montoneros, Tupamaros, ERP, etc. ne découle pas de divergences méthodologiques mais du contenu de classe de la politique qu ils impulsent, qui correspond à celle d'un secteur du capital. Leur pacifisme, bien qu'ils empoignent les armes, s'exprime dans leur politique de collaboration de classes : libération nationale, tiers-mondisme, anti-impérialisme, nationalisations, etc. Centrer la polémique sur une question de méthode empêche de voir clairement le contenu bourgeois et les conséquences politiques, leur caractère contre-révolutionnaire, ce qui n'empêche pas que nous mettions également en question leur messianisme, leur substitutionnisme, leur violence petite-bourgeoise, leurs « méthodes ».
(...) Et dans ce sens nous prenions l'exemple de la torture : pour nous il n'existe pas une torture bourgeoise et une autre révolutionnaire. De même que l'Etat bourgeois ne peut être utilisé à des fins révolutionnaires — et le problème n'est pas « qui le dirige » ; c'est par essence — il y a des questions comme celle-ci qui, par elles-mêmes, renferment un contenu opposé aux rapports sociaux auxquels nous aspirons, raison pour laquelle nous ne la revendiquerons jamais et la condamnerons toujours, quels que soient les justificatifs qu'elle se donne.
Bref, nous ne mentionnons pas les groupes terroristes parce qu'ils sont par eux-mêmes exclus par la majorité des points discriminants, mais nous n'avons pas d'objection à les condamner plus explicitement.
Les conseils ouvriers
C'est vrai qu'il n'y a aucune référence aux conseils ouvriers. Dans ce sens vous avez raison. Nous parlons de la nécessité de détruire l'Etat bourgeois mais nous ne développons pas par quoi on va le « remplacer ». On revendique une dictature du prolétariat générique et rien de plus. Il faudrait élaborer ce point. Dans ce point il faudrait aussi dire clairement que la forme ne garantit pas un contenu et aussi que, sans certaines formes — comme celle dont nous parlons — il ne peut y avoir un réel pouvoir prolétarien avec un contenu révolutionnaire.
Caractérisation de la période actuelle
Nous ne sommes pas si convaincus, par contre, sur la caractérisation que vous faites selon laquelle il y a une génération du prolétariat « qui n'a pas connu de défaite et conserve toute sa potentialité et combativité ». Il est vrai qu'après la grande contre-révolution qui a donné lieu à la 2e guerre mondiale — et la période qui la précédait — avec le massacre de millions de travailleuses et travailleurs, la décennie des années 1960 marque une remontée de la lutte de classes, de la lutte prolétarienne. Dans cette zone du monde nous l'avons bien connue, particulièrement dans les périodes 1967-73, mais cette remontée de la lutte ouvrière, ce ressurgissement de secteurs classistes, révolutionnaires, a été écrasé ou contrôlé, avec plus ou moins de violence, par diverses méthodes. Et ce fut une défaite douloureuse, les minorités les plus radicales et sur des positions de classe ont été démantelées politiquement ou massacrées et la classe ouvrière en général frappée durement. Il reste encore des arrière-goûts de ces coups.
Et nous ne pensons pas que cela ne touche que cette aire en particulier : nous avons fraîche dans notre mémoire la question de la Pologne, la grève des mineurs anglais et d'autres cas. Cest-à-dire, la décennie des années 1960 marque un changement qualitatif: la fin d'une longue période contre-révolutionnaire ; mais de là à affirmer que la génération actuelle ne connaît pas de défaites c est un peu fort : n'a-t-elle pas eu à lutter et été défaite, dans la plupart des cas, ne fût-ce que de manière circonstancielle ? La période 1973-81 est assez noire, au moins dans plusieurs zones de la planète, et nous ne pouvons pas ignorer cela dans nos analyses.([3] [46])
Nous devons signaler que dans cette décennie des années 1980 on assiste à un ressurgissement de la lutte de classes, quoique avec des hauts et des bas. (…)
Nous ne sommes pas aujourd'hui au plus bas de la force et de la lutte de la classe prolétarienne mais, de par un ensemble de facteurs que nous n'analyserons pas ici, il commence à y avoir des luttes et des mouvements qui secouent la classe et la tirent de son repli et de son retrait... et à nous aussi. Mais l'ennemi, malgré ses problèmes économiques, conserve en grande partie sa force politique et l'initiative, c'est pourquoi il ne sera pas rare de trouver des agents à lui, au sein du mouvement ouvrier, préconisant « la lutte » alors qu'en réalité cette « lutte » est la subordination aux projets de secteurs de la classe dominante. C'est pourquoi, bien que nous comprenions ce que vous avez voulu dire quand vous affirmez « c'est un devoir de se mettre dans le courant» au lieu de nager contre le courant comme dans d'autres périodes, nous préférons dire qu'aujourd'hui plus que jamais il faut nager contre le courant bourgeois et petit-bourgeois, particulièrement celui de gauche qui justifie le réformisme et sa politique de subordination à la bourgeoisie par l'affirmation que « le mouvement est tout », défendant dans les faits la démocratie, les syndicats, les fronts, la nation.
Oui, nous devons rentrer pleinement dans le courant internationaliste prolétarien, en combattant tant ceux qui recherchent une pureté utopique que ceux qui, au nom d'un soi-disant réalisme, laissent pour un futur lointain ou pour une autre étape les principes et les objectifs révolutionnaires internationalistes prolétariens (ou ceux qui s'assoient pour étudier et discuter dans l'attente d'une future — et lointaine — vague révolutionnaire au lieu de participer effectivement à la lutte concrète et de résistance et contre le capital que la classe ouvrière livre de manière intermittente). (...)
Quelques conclusions
(...) Pour nous, votre réponse a été un stimulant, et pas seulement la lettre mais l'attitude que vous avez eue de faire circuler nos idées. Et par rapport à la lettre, nous considérons les critiques très importantes — de même que celles de l'OCI/Italie —, non que nous soyons d'accord avec chacune d'elles mais parce qu'elles démontrent une attitude très revendicable de responsabilité, d'essayer d'être un apport — avec votre politique, bien sur — au développement du mouvement révolutionnaire.
Salutations chaleureuses Emancipaciôn Obrera
Réponse
à Emancipaciôn Obrera
Chers camarades,
Avant tout nous voulons que vous compreniez que si nous avons traduit et publié votre « Proposition-appel » dans notre presse internationale et lui avons donné le maximum de diffusion, autant que nos forces limitées nous le permettaient, ce n'était pas par « sentimentalisme révolutionnaire », ni parce que nous sommes des partisans « inconditionnels » du regroupement « à tout prix ». Ce qui détermine notre position dans ce domaine, ce sont des convictions fermes basées sur une analyse approfondie de la période présente.
Quelles perspectives pour le regroupement des révolutionnaires dans la période historique actuelle.
Toute l'histoire de la lutte du prolétariat nous enseigne que la formation et le regroupement des révolutionnaires, donnant lieu à une organisation internationale révolutionnaire, sont étroitement liés au cours suivi par la lutte de la classe. Les périodes de hautes luttes et les périodes de grandes défaites du prolétariat ont inévitablement une répercussion directe sur les organisations révolutionnaires de la classe, sur leur développement ou leur dispersion, et sur leur existence même.
Sans vouloir ici entrer dans de grands développements à ce sujet, il suffit de rappeler le déroulement de l'histoire de la Ligue des Communistes de 1848, des lre, 2e et 3e Internationales pour s'en convaincre. Nous disons que cette relation est évidente et inévitable parce que, pour nous, l'apparition et l'activité des organisations révolutionnaires ne sont pas un produit de la « volonté » de gens intelligents en marge des classes, mais sont le produit des classes elles-mêmes. Une organisation révolutionnaire (dans la société capitaliste) ne peut être que le produit de la classe historiquement révolutionnaire : le prolétariat. Et la vie de cette organisation ne peut donc pas être fondamentalement différente de la vie et l'état de la classe.
L'échec de la première vague révolutionnaire qui a suivi la première guerre mondiale nous enseigne, entre autres, que la gravité et les conséquences de la défaite sont en rapport avec le projet révolutionnaire mis en pratique par la classe. L’échec de la première vague révolutionnaire s'est soldé par un massacre sanglant de grandes masses de prolétaires, dans de nombreux pays, par la ruine de la révolution victorieuse d'octobre 1917, par la dégénérescence rapide de la 3e Internationale, et par la trahison des PC staliniens passés, dans tous les pays, dans le camp de la bourgeoisie ; par une 2e guerre mondiale, par 50 ans de réaction engloutissant deux générations du prolétariat. Une telle situation ne pouvait que disperser les forces révolutionnaires, affaiblissant de plus en plus leurs activités, les réduisant à des îlots de résistance qu'étaient les Fractions de la Gauche Communiste. Et ces groupes ne pouvaient résister à l'avalanche écrasante de la contre-révolution qu'en se maintenant fermement sur les principes programmatiques, comprenant la profondeur réactionnaire de la période, l'impossibilité d'avoir un impact réel sur les masses, et limitant essentiellement leur activité à un travail de réexamen critique, de bilan de l'expérience que la classe venait de vivre, afin de tirer les enseignements politiques indispensables pour assumer leur tâche lors d'une nouvelle reprise de la lutte du prolétariat.
Toute orientation contraire, qui voulait coûte que coûte se lancer, dans une telle situation, à la reconstruction immédiate d'une organisation de masses, à une nouvelle Internationale (la 4e), relevait à la fois d'une incompréhension de la situation, et d'une démarche volontariste nécessairement impuissante, ou pire encore, comme ce fut le cas du courant trotskyste, menait à brader les principes révolutionnaires, et à s'enfoncer de plus en plus dans une évolution opportuniste.
Un autre exemple de l'incompréhension d'une période est celui de la proclamation d'un parti, comme ce fut le cas des bordiguistes, à la fin de la 2e guerre, en pleine réaction. Ces actions « d'impatience révolutionnaire », sont des aventures qui se font toujours au prix d'une politique immédiatiste et opportuniste.
Guerre ou révolution, la crise actuelle.
Nous avons insisté un peu longuement sur ce point, pour mieux faire ressortir ce qui distingue la période antérieure, de celle qui s'est ouverte à la fin de la décennie des années 1960, qui marque la fin de la reconstruction d'après la deuxième guerre mondiale, l'annonce d'une nouvelle crise ouverte du capitalisme mondial avec tout ce que cela impliquait du point de vue de la lutte de classe. Contrairement à la crise des années 1930 qui trouve un prolétariat épuisé par de grandes défaites historiques de sa lutte révolutionnaire, démoralisé par la dégénérescence de la révolution d'octobre et la trahison des PC passés à la bourgeoisie, par la victoire du fascisme en Allemagne, et le massacre du prolétariat espagnol sur l'autel de la défense de la république, qui ouvraient un cours inexorable vers une nouvelle guerre mondiale, la crise qui s'annonce à la fin des années 1960 trouve, elle, une nouvelle génération du prolétariat qui n'avait connu ni de batailles décisives, ni de défaites sanglantes, gardant donc toutes les potentialités et les capacités d'une reprise de la lutte.
Tout en aiguisant les tensions inter-impérialistes, cette crise ouvre avant tout un cours de luttes de la classe ouvrière, et c'est le sort de cette lutte de classe qui conditionne l'issue de l'alternative historique : barbarie ou socialisme, ou une 3e guerre mondiale (et ses conséquences catastrophiques) ou la révolution prolétarienne.
C'est
cette analyse de la période actuelle de reprise et de développement de la lutte
de la classe ouvrière qui détermine la nécessité et la possibilité d'une
renaissance et le renforcement d'une organisation révolutionnaire apte à
assumer pleinement sa fonction dans la classe et sa lutte.
Le cours à des affrontements de classe
Cinquante années de contre-révolution et de réaction ont rompu la continuité organique du mouvement révolutionnaire, ont anéanti les organisations de la Gauche communiste russe, allemande, hollandaise, et sclérosé en grande partie celle d'Italie, et développé un esprit de secte, de chapelle. Mais le ressurgissement du mouvement du prolétariat en lutte ne peut pas ne pas sécréter en son sein de nouvelles organisations révolutionnaires. Ces nouvelles organisations qui ont leurs racines communes dans la situation nouvelle, actuelle, de la lutte des classes, n'ont pas pour autant une même trajectoire et un même développement politique ; elles souffrent souvent d'un manque de formation théorique-politique rigoureux, d'une connaissance sérieuse de l'histoire du mouvement révolutionnaire, de ses expériences et acquis, se débattent souvent dans la confusion, avec le risque, dans leur isolement, de se perdre dans des impasses et de disparaître.
Seule la prise de conscience de la nécessité de rompre l'isolement, de développer des contacts avec d'autres groupes, de la nécessité de l'échange des idées, de la presse, de l'information, de la stimulation de la discussion internationale inter-groupes, des accords éventuels pour des interventions communes, peut permettre un processus de décantation indispensable, et ouvrir la voie vers un regroupement international des forces révolutionnaires, basé sur des principes solides, marxistes, et des positions politiques rigoureuses de classe.
C'est sur ces analyses et ces convictions que repose notre ferme volonté de propulser et soutenir toute proposition qui va dans le sens de resserrer les contacts entre les groupes, de créer un pôle, un lieu de réflexion, de clarification, de décantation et de regroupement des forces révolutionnaires aujourd'hui encore dispersées.
C'est parce que nous sommes convaincus que cette tâche est à l'ordre du jour aujourd'hui, pour la reconstitution du mouvement révolutionnaire, qui ne peut être faite que sur le plan international, que nous ne nous lassons pas de poursuivre notre effort dans ce sens, depuis bien avant la constitution formelle du CCI, et c'est la raison pour laquelle nous avons salué votre Appel.
Par expérience, nous savons que ce n'est pas une tâche facile. Mieux que vous, nous connaissons les différents groupes qui constituent ce que nous appelons le milieu politique prolétarien ; ce milieu que beaucoup de groupes ignorent ou veulent ignorer, se considérant chacun dans son sectarisme, comme le seul et unique groupe révolutionnaire de par le monde. On ne peut certes ignorer qu'il existe des divergences réelles qui ne peuvent être résolues que par la discussion, la clarification approfondie et la décantation politique inévitable et salutaire. Mais on doit savoir distinguer ces divergences réelles de ce qui relève de malentendus, d'incompréhensions, et surtout d'un étroit état d'esprit mégalomane.
Il n'existe pas de recettes contre ces dernières manifestations. Il faut reconnaître leur existence comme autant d'entraves, et leur opposer une ferme volonté de poursuivre inlassablement l'effort pour rompre l'isolement, pour développer les contacts, les discussions sérieuses de clarification et, les événements aidant, parvenir à un rapprochement des groupes, en vue d'une activité révolutionnaire fructueuse.
Pour résumer notre pensée sur ce point, nous pouvons dire : tant que, d’une part, une compréhension de la période actuelle ne se fondera pas sur une analyse juste d'une période de reprise internationale de la lutte du prolétariat, de ses causes et potentialités, et d'autre part persistera l'esprit de secte, le souci prioritaire de conservation de SA chapelle, héritage caricatural d'une période passée, votre proposition d'une revue publique internationale commune à tous les groupes, quel que soit le souci JUSTE qui la sous-tend, ne peut rester qu'un vœu pieux, une illusion sur le plan politique, sans parler déjà des difficultés quasiment insurmontables dans les conditions actuelles sur le plan pratique. En tout état de cause, avec la meilleure volonté du monde, votre proposition d'une telle revue reste pour le moins largement prématurée dans la réalité du moment présent.
Seul
un événement révolutionnaire d'une portée historique extraordinaire pourrait
précipiter la réalisation d'un tel projet. Est-ce à dire que pour le moment il
n'y a rien à faire ? Absolument pas ! Mais il serait erroné et même négatif de
chercher des raccourcis, et de penser qu'on peut contourner les difficultés en
commençant par un regroupement d'actions politiques ou la publication dune
revue commune. Ces raccourcis, loin de mener vers un rapprochement, sur une
base politique claire et solide, risquent au contraire de mener vers la
confusion et l'escamotage des problèmes politiques, terre fertile de tous les
opportunismes.
Les critères minimaux ouvrant la voie d'un rapprochement
Pour éviter tout malentendu concernant les critères devant servir de base de sélection des groupes pouvant positivement participer à des discussions de clarification dans un processus de rapprochement entre les groupes révolutionnaires existants, nous partageons pleinement votre souci que de tels critères doivent être à la fois « larges et stricts : larges pour que puissent participer des groupes ou des personnes dont les définitions, de par leurs limitations historiques, ne recouvrent pas la vaste gamme des autres groupes, mais s'inscrivent dans la même tendance ; stricts pour exclure ceux qui expriment une politique antagonique à celle que nous revendiquons, même si leur langage contient des relents marxistes ». Nous sommes même d'avis, qu'appliquant ce même type de critères, nous devons également tenir compte s'il s'agit de groupes anciens, dans lesquels les positions erronées ou historiquement dépassées sont incrustées au point de les scléroser ; ou de groupes nouveaux qui surgissent, et dont les erreurs relèvent d'une immaturité momentanée, et peuvent être largement surmontées et corrigées au cours d'un processus de clarification.
Cependant, nous divergeons en partie avec vous, sur la question de savoir quels sont « les points de discrimination les plus importants, tout en tenant compte du fait que tout le monde n'a pas suivi les mêmes étapes, ni donné des définitions dans le même ordre d'idées. Nous voulions en même temps qu'ils soient un obstacle contre les opportunistes, les réformistes et contre la gauche en général... (du capital) ». La question est de savoir quels sont ces « points de discrimination les plus importants ».
Tout d'abord, nous ne saurions admettre l'absence de critère politique, et ne retenir pour seul et unique critère l'affirmation qui se trouve dans votre « Proposition Internationale» (Revue Internationale n°46, p. 15) : «Pour nous, ce critère pour nous reconnaître, c'est la pratique ». Qu'est-ce donc que cette « pratique » se suffisant à elle-même, et bonne pour toute discrimination ? Formulé ainsi, c'est en contradiction, ou du moins ça entretient une ambiguïté avec tout le souci exprimé dans le reste de votre « Proposition » et dans les 14 points pour définir à qui celle-ci est adressée.
Une « pratique », séparée de tout fondement politique, de toute orientation, de tout cadre de principes n'est qu'une pratique suspendue en l'air, un immédiatisme borné, mais ne saurait jamais être une activité vraiment révolutionnaire. Toute séparation entre théorie et pratique optant, soit pour la théorie sans pratique, soit pour la pratique sans théorie, détruit l'unité des luttes immédiates et du but historique. Cette fameuse «pratique» en soi ressemble étrangement à une réédition de la non moins fameuse devise révisionniste bernsteinienne de la fin du siècle dernier : « Le mouvement est tout, le but n'est rien».
Cette « pratique pour la pratique », quoi qu'on en dise, est aussi une politique : une politique de cacher, d'escamoter, d'esquiver les vrais problèmes de la lutte de classe concrète, tels qu'ils se présentent dans la réalité aux ouvriers. Incapable de répondre à ces problèmes, cette pratique cache à peine l'indigence de pensée de ses protagonistes, préférant le coup de poing ou le coup de gueule d'une phraséologie révolutionnaire, aussi grandiloquente que creuse, pour s'épargner l'effort, un tant soit peu, de la réflexion et de l'activité cohérente.
Une politique-pratique révolutionnaire découle à la fois du but qu'on se propose d'atteindre, et de l'analyse des conditions concrètes, de la situation réelle, vivante, du rapport de forces donné entre les classes. La « pratique » politique, par contre, tourne complètement le dos à la réflexion, à toute cohérence qui lui apparaît comme un carcan pesant et inutile, dont il faut se débarrasser au plus vite, pour mieux pouvoir, non pas agir mais s'agiter. Cette politique (de la pratique se suffisant à elle-même) a une tradition dans le mouvement ouvrier : elle va de Weitling à Willitch, de Bakounine à Netchaev, et à toutes les variantes de l'anarchisme d'hier et d'aujourd'hui.
Ajouter le mot « commune » à la pratique, et parler de la « pratique commune » pour en faire le seul point de discrimination et pour « se reconnaître » n'arrange pas davantage les choses. Quelle est la pratique commune des groupes qui se disent révolutionnaires ? Elle consiste, avant tout, dans le fait de publier une presse, de sortir des tracts, de les diffuser le plus largement possible. Cette pratique effectivement commune ne permet nullement de distinguer les révolutionnaires des autres organisations politiques au service de l'ennemi de classe. Le problème n'est donc pas la pratique, mais son contenu politique, et seul ce contenu effectivement politique peut nous permettre de juger le terrain de classe sur lequel se situent les différentes organisations. C'est pourquoi ce n'est pas la pratique en soi qui peut servir de critère de discrimination et de regroupement, mais fondamentalement les positions politiques qui la fondent.
C'est pourquoi, nous voudrions rappeler les critères politiques qui ont servi de base aux trois Conférences Internationales des groupes de la Gauche Communiste dans les années 1977 à 80, critères qui pour une première délimitation immédiate demeurent nécessaires. L'invitation s'adressait à tous les groupes qui :
« 1°) Se réclament et défendent les principes fondamentaux qui ont présidé à la Révolution prolétarienne d'octobre 1917 et à la constitution de la 3e Internationale de 1919 et qui, à partir de ces principes, entendent soumettre à la critique constructive les positions politiques et la pratique élaborée et énoncée par l'Internationale Communiste à la lumière de l'expérience.
2°) Rejettent sans la moindre réserve toute prétendue existence dans le monde de pays à régime socialiste ou de gouvernement ouvrier, même avec le qualificatif de "dégénéré". Rejettent toute distinction de classe à établir entre les pays du bloc de l’est ou de la Chine avec les pays du bloc de l’ouest et dénoncent comme contre-révolutionnaire tout appel à la défense de ces pays.
3°) Dénoncent les PS et les PC et leurs acolytes comme des partis du capital
4°) Rejettent catégoriquement l’idéologie de l'anti-fascisme, établissant une frontière de classe entre le fascisme et la démocratie, en appelant les ouvriers à défendre ou à soutenir la démocratie contre le fascisme.
5°) Proclament la nécessité pour les communistes d’œuvrer pour la reconstruction du Parti, arme indispensable pour la victoire de la Révolution prolétarienne.
Un simple énoncé de ces critères fait comprendre à tout ouvrier qu'il ne s'agit pas d'un ramassis de toutes les "bonnes volontés", mais de groupes authentiquement communistes, se démarquant nettement de toute la faune gauchiste : maoïstes, trotskystes, modernistes, et autres conseillistes bêlants "anti-parti".
Ces critères, certes insuffisants pour établir une plate-forme politique pour un regroupement, sont par contre parfaitement suffisants pour savoir avec qui on discute et dans quel cadre, afin que la discussion soit réellement fructueuse et constitue un point positif. »
(Revue Internationale n° 16, 1er trimestre 1979)
Cependant, certains aspects contenus dans ces critères, en particulier dans les points 1 et 5, peuvent et doivent être explicités.
La discrimination fondée sur la séparation historique entre le marxisme et les théories de l'anarchisme (cette expression des couches artisanales en voie de prolétarisation) et du populisme reste d'autant plus importante aujourd'hui avec le réveil de courants tendant à préconiser la conciliation possible avec ces deux courants antagonistes.
Il en est de même pour ce qui concerne ce que nous appelons les modernistes, qui prétendent remettre en cause le marxisme et remettre en question le prolétariat comme l'unique classe révolutionnaire dans la société et le seul sujet de son dépassement.
Il en est aussi de même des académistes-marxologues qui acceptent volontiers de discourir sur la validité de la théorie marxiste, mais oublient et passent sous silence le côté actif du marxisme qui est avant tout la théorie et la pratique de la lutte de classe du prolétariat.
Il en est encore de même de la discrimination avec le conseillisme qui rejette la nécessité d'une organisation politique du prolétariat (le parti) et lui nie toute fonction politique et militante dans la lutte pour la révolution, ou bien les théories bordiguistes qui substituent à la dictature du prolétariat la dictature du parti.
La compréhension et la reconnaissance de la phase de décadence du système capitaliste aujourd'hui, qui explique l'impossibilité de réformes durables et donc du réformisme, qui définit catégoriquement les partis socialistes et « communistes » comme non ouvriers et simple aile gauche du capital, qui rejette de façon tranchante le parlementarisme, le syndicalisme, et les mouvements de libération nationale comme définitivement dépassés, ne servant désormais qu'à mystifier le prolétariat en le détournant sur un terrain de classe de la bourgeoisie.
Nous voulons citer en exemple vos propres expériences qui confirment l'importance de ces critères :
1) Durant la guerre des Malouines, vous vous trouvez être le seul groupe en Argentine à dénoncer la guerre et les appels à la collaboration du prolétariat sous prétexte de la lutte anti-impérialiste. A lui seul cet événement a pu faire un démarquage de principes entre vous et tous les autres groupes qui se sont laissés prendre dans le piège de la lutte soi-disant anti-impérialiste. Nous reviendrons plus loin sur la soi-disant existence des pays impérialistes et non impérialistes. Mais ce que nous voulons mettre en relief dès maintenant, c'est que la question de la soi-disant lutte anti-impérialiste est passée du plan théorique au plan pratique comme critère important de position de classe.
2) Concernant vos discussions avec l'OCI d'Italie, vous écrivez que si l'OCI persiste à défendre ses positions concernant la « libération nationale », vous vous verrez dans l'obligation de constater l'impossibilité et l'inutilité de poursuivre les discussions avec ce groupe. Vous confirmez ainsi que la position sur la libération nationale est devenue un critère de discrimination entre les groupes qui se disent révolutionnaires.
3) Concernant la question du terrorisme révolutionnaire et votre discussion avec le GCI qui « revendique le terrorisme révolutionnaire », votre rejet de cette position anarchiste est nette et catégorique comme le fut et reste la notre. Cette question constituait une des raisons de la rupture du GCI avec le CCI, il y a huit ans. Pour ne pas avoir compris ce qui distingue la violence révolutionnaire de la classe du terrorisme petit-bourgeois, le GCI nous lançait alors le reproche de défendre rien de moins que le pacifisme bourgeois. Aujourd'hui le GCI semble être revenu sur cette position. Nous voudrions espérer que ce retour n'est pas simplement un fait conjoncturel, sans en être pourtant absolument sûrs. Toujours est-il que cette question du terrorisme «révolutionnaire » ne peut pas ne pas être un critère discriminatoire.
Il
va de soi que nous partageons absolument vos remarques sur la torture comme
méthode absolument étrangère au prolétariat et à combattre par les
révolutionnaires. Le prolétariat ne peut pas utiliser ce type de méthode parce
que si la torture correspond à une classe oppressive par nature, elle est dans
son essence antagonique à une classe, le prolétariat, qui représente, pour la
première fois dans l'histoire, la libération de toutes les oppressions et
barbaries.
La continuité historique du mouvement révolutionnaire
Nous comprenons très bien que, partant de la constatation juste que vous faites qu'un bon nombre de groupes authentiquement prolétariens et révolutionnaires qui ont surgi et surgiront encore connaissent mal l'histoire du mouvement révolutionnaire du prolétariat, vous vouliez éviter de faire, des leçons de cette histoire, des critères de discrimination risquant de laisser ces groupes hors du processus de contact et de regroupement qu'il importe aujourd'hui de propulser.
Nous ne sommes pas assez stupides ni sectaires pour l'exiger comme préalable absolu. Ce sur quoi nous voulions insister de toute notre conviction, c est que sans cette connaissance et cette assimilation, aucun regroupement véritable, solide, n'est possible. C'est pourquoi nous mettons tant d'insistance sur la discussion et la clarification, sur l'évolution du mouvement et de ses différents courants, sur leurs positions énoncées, sur leur expérience afin de pouvoir partir de ses acquis indispensables pour avancer aujourd'hui dans notre activité révolutionnaire.
Nous avons déjà rappelé les plus de 50 ans de rupture de la continuité organique qui s'est produite après la défaite de la 1re vague révolutionnaire, et les lourdes conséquences pour le mouvement révolutionnaire. Mais il ne suffit pas de se contenter de le constater, il importe de s'efforcer de rétablir la continuité politique et historique du mouvement. Bien des groupes font cette constatation et font même de cela une vertu. Il leur semble plus avantageux de rester dans l'ignorance et même d'effacer purement et simplement le passé, et de considérer que l'histoire de la lutte de classe commence avec eux. Il importe au plus haut point de combattre cette absurde présomption et apprendre à ces groupes, dans leur volonté d'effacer le passé, se considérant être sortis du néant, qu'ils sont condamnés à n'être que le néant.
De même que la classe ouvrière continue à rester la même classe ouvrière, c'est-à-dire à la fois classe exploitée et historiquement révolutionnaire, quelles que soient les vicissitudes de l'évolution du capitalisme, de même les organismes politiques qu'elle engendre constituent, au travers des hauts et des bas de la lutte de la classe, un mouvement politique historique continu. La notion même du prolétariat comme une classe internationale unie fonde et détermine la réalité de la continuité de son mouvement politique.
Seuls les gens bornés peuvent interpréter la notion de continuité comme identique à immobilité, à une idée statique. La continuité n'a rien à faire avec les idées telles « qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil» ou bien que chaque jour et avec chaque génération commence une histoire totalement nouvelle qui n'a rien à voir avec le passé ni avec le devenir. La continuité, au contraire, est fondamentalement dynamique, mouvement, développement, dépassement, critique et nouveaux acquis. Rien d'étonnant à ce que les groupes politiques ouvriers qui ne comprennent pas ou rejettent la notion de continuité n'ont eux mêmes aucune continuité et traversent le mouvement ouvrier comme phénomènes éphémères et disparaissent sans laisser de trace de leur passage.
C'est le cas de bien des groupes qui se sont agités dans les décennies 1960 et 1970. Il suffit de mentionner les groupes tels que : ICO (ouvriériste anarchiste), les Situationnistes (intellectuels-volontaristes), le GLAT (marxiste-ouvriériste), Pouvoir ouvrier (trots-kysto-conseilliste), le PIC (activiste-conseilliste), l'OCL (libertaire) en France ; Potere Operaio (ouvriériste), Lotta Continua (activiste), Autonomia Operaia (ouvriériste-moderniste) en Italie, Spartacus (conseilliste) en Hollande, et tant d'autres groupes pseudo-marxistes, semi-libertaires, semi-modernistes un peu partout en Europe et aux Amériques. Tous ces groupes, dont l'existence constituait un énorme gaspillage de forces ouvrières, avaient tous cette caractéristique commune de rejeter l'histoire du mouvement ouvrier et plus particulièrement l'idée d'une continuité politique du mouvement révolutionnaire du prolétariat.
Quoi d'étonnant que tous ces éléments et groupes devaient plus ou moins se retrouver et se reconnaître dans la sentence, le verdict sans appel prononcé par l'éminent sociologue universitaire en titre, M.Rubel, lors du débat organisé pour le centenaire de la mort de Marx. Selon Rubel, Marx (et le marxisme) ne sont qu'une utopie du 19e siècle, car Marx annonçait que « le prolétariat sera tout et partout, or aujourd'hui le prolétariat n'est rien et nulle part», prenant ainsi leur propre faillite pour la faillite du prolétariat et de sa théorie : le marxisme révolutionnaire.
Derrière le rejet de la continuité, se cache une négation de toute l'histoire du mouvement ouvrier, ou pour mieux dire, la négation que la classe ouvrière ait eu et peut avoir une histoire. Derrière une phraséologie ultra-radicale en apparence et en fait creuse des modernistes, se cache en réalité la mise en question du prolétariat comme classe révolutionnaire et qui est, pour les marxistes, la seule classe révolutionnaire dans la société capitaliste.
Il est de bon ton aujourd'hui, pour chaque moderniste au nez très délicat de se détourner avec dégoût, à la seule évocation de la 2e Internationale. Avec 80 ans de retard, ces « révolutionnaires » de la phrase, découvrent la faillite de la 2e Internationale sous le poids de l'opportunisme et ne voient que cela. Ils ignorent et veulent ignorer tout le positif que constituait cette Internationale, à un moment donné et précis dans l'histoire du mouvement ouvrier. En le rejetant en bloc, ces farceurs « révolutionnaires » jettent l'enfant avec l'eau sale de la baignoire. Ils ferment les yeux et se bouchent les oreilles pour ne pas entendre et ne pas voir que cette organisation a servi, à un moment de l'histoire du mouvement ouvrier, de pôle de rassemblement des forces ouvrières, une pépinière d'éducation, de formation et de propagation de la prise de conscience des grandes masses du prolétariat. Ils ignorent ou semblent ignorer que c'est en son sein et nulle par ailleurs, que se développait et agissait la gauche marxiste, de Lénine à Luxemburg, de Liebknecht à Bordiga, qui combattait, non en phrases creuses mais théoriquement et pratiquement, la pénétration de l'idéologie bourgeoise et contre la dégénérescence opportuniste. Mais de qui donc ces « révolutionnaires » en peau de lapin d'aujourd'hui, de qui donc ont-ils appris la faillite de la 2e Internationale, sinon de cette gauche marxiste qui a reconstitué, après la faillite de la précédente, et en continuation et dépassement de cette dernière, la nouvelle Internationale : l'Internationale Communiste. Il ne s'agit pas de faire l'apologie et de se réclamer de toute l'œuvre positive et négative, pêle-mêle, de la 2e Internationale, mais de situer celle-ci dans l'histoire, et dans l'histoire du mouvement ouvrier. Nos grands-pères ont peut-être mal fini leur vie, tombant dans l'alcoolisme dévastateur, ils n'en reste pas moins que ce sont eux qui ont donné la vie à la génération de laquelle nous sommes la progéniture. Une nouvelle génération révolutionnaire ne vient pas par la voie de la génération spontanée, mais se hisse, en continuation, sur les épaules des générations révolutionnaires antérieures du prolétariat.
Vos
remarques critiques et objections formulées sur ce point nous paraissent,
franchement, trop évasives et peu satisfaisantes.
Sur le parlementarisme
Pour commencer, nous prenons acte de votre affirmation que sur la question de la participation électorale « nous ne l'avons jamais fait et nous n'avons pas l'intention de le faire». Mais cette affirmation claire est immédiatement rendue ambiguë, dans la mesure où vous confondez participation et dénonciation quand vous écrivez : «si à quelque moment se pose la question d'un boycott actif dans une élection, cela revient dans les faits à participer à une campagne.. » C'est peut-être la faute d une traduction défaillante, mais si nous continuons ainsi, nous n'arriverons pas à nous comprendre. Boycotter, même accompagné de l'adjectif «actif» ne peut, en toute logique, vouloir dire participer, de même que boycotter les syndicats et les dénoncer ne veut pas dire participer. Participer veut dire prendre part positivement à quelque chose, c'est par exemple appeler les ouvriers à voter, en présentant ou non des candidats. Il faut donc distinguer clairement ces deux choses : participation ou abstention. Pour ne pas embrouiller encore plus la question, il vaudrait mieux laisser de côté le crétinisme parlementaire qui s'est développé dans le giron de l'opportunisme dans la 2e Internationale.
Au 19e siècle, Marx et la majorité de la 1ere Internationale défendirent contre les anarchistes et Bakounine la validité politique de la participation aux élections et au Parlement, non pour briguer « des charges exécutives » comme vous semblez le dire, mais dans la mesure où, à l'époque, la lutte pour des réformes politiques et sociales au sein de la société capitaliste comme le suffrage universel, le droit d'association, de réunion, de la presse ouvrière, ou encore la limitation officielle de la journée de travail, etc. avaient un intérêt et un sens évident dans la défense des intérêts de la classe ouvrière. Vous semblez mettre en question ce point, rejoignant ainsi, avec un siècle de retard, la position anarchiste, et en oubliant complètement ce que vous dites par ailleurs, sur la nécessité de prendre en compte « les situations concrètes ».
Cette justification de la participation au parlement fut abandonnée par Lénine et les marxistes à la fondation de l'Internationale communiste qui retenait uniquement l'argument de la possibilité de l'utilisation des campagnes électorales et de la tribune des parlements en vue de l'agitation révolutionnaire, ce qu'ils nommaient le parlementarisme révolutionnaire.
Vous ne semblez pas attacher grande importance à ce changement fondamental, ni chercher les raisons profondes pour lesquelles il a été accompli par des révolutionnaires qui n'entendaient pas faire en cela une quelconque « concession » rétrospective à l'idéologie anarchiste, mais en marxistes, se référaient au changement historique de la situation, aux conditions objectives nouvelles intervenues dans la réalité concrète.
Ce qui est en discussion aujourd'hui dans nos débats, c'est de se prononcer sur la validité ou non de ce que Lénine appelait le parlementarisme révolutionnaire. Cette position, qui a été celle de Lénine dans la 3e Internationale a-t-elle jamais été valable dans la période présente ? Et pourquoi n'est-elle pas valable ? Comme vous ne répondez pas clairement, ni à la première, ni à la seconde question, vous vous contentez d'écrire après maintes tergiversations que cela ne peut être un « critère discriminatoire », laissant ainsi la porte ouverte à tout venant. Même en retenant votre affirmation qu'« il va de soi que nous ne sommes pas d'accord pour faire du parlementarisme», vous l'accompagnez par « nous ne le tirons pas d’un principe a priori », ni « de la catégorie (?) capitalisme décadent », « mais en analysant les situations concrètes ». De quelles situations concrètes s'agit-il ? De situations locales, ou «des aires géographiques » chères aux bordiguistes, ou encore de « situations conjoncturelles », autre argument bordiguiste, ou bien de changement d'une situation historique, de période historique ? Et ce manque de clarté s amplifie encore quand vous vous référez hors contexte à Marx sur le fait que «des événements historiques sensiblement analogues mais qui se déroulent dans des milieux différents (souligné par nous) conduisent à des résultats totalement différents ». Qu'est-ce à dire sinon que vous considérez que le même problème: le parlementarisme, se pose, encore aujourd'hui, dans des milieux différents, selon le pays ou aire géographique, et donc ne peut conduire qu'à des résultats totalement différents, à savoir ; à tel endroit (situation concrète !) le parlementarisme serait toujours praticable, et à tel autre endroit il ne serait plus valable ou que cela dépendrait du moment.
Cette généralité de « situations concrètes » peut servir à n'importe quoi sauf à répondre à la question : pourquoi le parlementarisme, dans le sens révolutionnaire de Lénine, a cessé d'être valable précisément à partir de la 1re guerre mondiale dans tous les pays du monde.
Serait-il trop vous demander de préciser clairement, pour nous et pour le milieu prolétarien en général, votre position là-dessus ? Ceci est d'autant plus nécessaire que la question du parlementarisme révolutionnaire est très étroitement liée à celle du syndicalisme et de la libération nationale.
Il faut se garder de la méthode phénoménologique et ne pas traiter ces questions d'une façon séparée, chacune à part, en soi. Ces questions ne sont que différents aspects d'une même problématique ayant ses racines dans une même réalité « concrète ». A des questionnements qui s'inscrivent dans une même globalité, la réponse ne peut être que globale.
On ne peut que regretter la façon un peu légère avec laquelle vous touchez, comme cela en passant, le problème du capitalisme décadent. Sans vouloir nous étendre ici sur ce problème, nous nous contenterons d'attirer votre attention sur l'article paru dans la Revue Internationale n° 48 qui répond plus à fond aux diverses objections sur cette question, et à la suite de cet article dans ce numéro.
Vous semblez, par ailleurs, accorder une importance particulière à la question de la condition des femmes aujourd'hui. Nous regrettons de ne pas bien vous comprendre et de ne pas pouvoir vous suivre. Les marxistes n'ont jamais ignoré le problème de l'oppression que subissent les femmes dans toute société où existe la division des classes et donc l'exploitation et l'oppression dans tous les domaines et à tous les niveaux. Mais la solution de ce problème relève de la solution générale : mettre fin au capitalisme, dernière société de la division en classes, libérer toute l'humanité de ce fléau qu'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et rétablir, réaliser la communauté humaine. Mais il faut affirmer que le porteur de cette libération totale ne peut être que le prolétariat, parce que LUI SEUL représente l'humanité universelle. Il faut surtout se garder de faire de la question des conditions de la femme un problème séparé, un problème de féminisme supra-classiste, tel qu'il s'est développé dans les décennies 1960-70, avec la campagne et le mouvement dit de «libération de la femme ». Tous ces mouvements de « libération » de la femme, de le jeunesse, des minorités nationales, des homosexuels, etc. tendent à être toujours supra ou inter-classistes, et ont pour vocation de détourner l'attention du problème fondamental, celui de la lutte de classe du prolétariat.
Pour finir, nous voulons clarifier une fois pour toute la question ainsi nommée de tiers-mondisme ([4] [47]) afin de lever tout malentendu à ce sujet. Nous partageons pleinement avec vous que ce terme, autant que celui de « pays sous-développés » sont impropres, ambigus, et se prêtent à toutes sortes de distorsions et de confusions. Nous les employons faute d'un vocable plus approprié à la réalité, et probablement aussi du fait que c'est la terminologie courante dans toute l'Europe, et dans toute la presse du monde. C'est là une explication, mais non une justification.
Qu'il soit clair que pour nous, le capitalisme est depuis longtemps parvenu à créer un marché mondial dans lequel il a intégré tous les pays dans les rapports de production capitalistes. L'impérialisme, pour Rosa Luxemburg, est précisément ce stade atteint de l'intégration de l'ensemble des pays dans le système économique capitaliste, d'où la saturation du marché mondial, la surproduction, la crise permanente et insurmontable du système dans laquelle tous les pays se débattent pour vendre leurs marchandises aux dépens de leurs concurrents. Ainsi le concept d'impérialisme ne se réduit pas au simple fait de la domination d'un pays par un autre, comme le prétendent les trotskystes et autres maoïstes, divisant le monde en pays impérialistes (dominants) et pays non impérialistes (dominés). Il est bien plus que cela. Il est un stade atteint par le capitalisme, et de ce fait, tous les pays, quelle que soit leur puissance, sont marqués du sceau de l'impérialisme.
Il serait pour autant erroné de ne pas reconnaître le décalage existant dans le développement et la puissance des différents capitaux nationaux. L'inégalité du développement est une loi inhérente au capitalisme. Non seulement l'inégalité a pour cause des raisons historiques, mais encore parce que le capitalisme, comme système, ne permet pas un développement vers une égalisation totale de la puissance économique des différents pays. Cela ne sera possible que dans le socialisme. C'est le cas surtout des pays qui se sont intégrés plus tardivement dans le système capitaliste de production. Cette inégalité se répercute forcément et joue un rôle énorme dans le rapport de forces entre les classes dans les pays différents. De cette loi de l'inégalité du développement, Lénine a tiré la théorie du maillon le plus faible, selon laquelle la tension révolutionnaire va produire la rupture de la chaîne dans les pays de moindre puissance du capitalisme. A cette théorie, nous opposons la vision classique de Marx et de Engels, pour qui la révolution communiste est plus certaine de se produire et de se propager, partant des pays les plus avancés, les plus industrialisés, là où les forces productives se heurtent le plus violemment au mode de production, là où le prolétariat est le plus nombreux, le plus concentré, le plus expérimenté, constituant une plus grande force pour vaincre le capitalisme. C'est dans ces pays qu'ils situaient l'épicentre du tremblement et de l'effondrement du capitalisme.
C'est dans ce sens que nous employons parfois, à défaut de termes plus appropriés, 1’image métaphorique et les termes de centre et de périphérie constituant un tout.
Toutefois nous sommes d'accord avec vous qu'il serait souhaitable de trouver des termes plus appropriés. En attendant, il serait peut-être judicieux de les mettre entre guillemets afin d'éviter toute interprétation abusive et déformatrice de notre pensée.
Dans l'espoir que cette lettre, un peu longue, contribuera à dissiper les malentendus et permettra de clarifier les vrais problèmes en discussion, recevez, chers camarades, nos salutations communistes et nos meilleurs vœux pour une nouvelle année de luttes pour la révolution.
CCI
08/01/1987
[1] [48] Marx, 1877, dans «Correspondance».
[2] [49] C'en est un que de se présenter pour des postes exécutifs ou pour défendre qu'à travers la démocratie l'on puisse obtenir des changements révolutionnaires. La phrase «participer à une campagne électorale » est très ambiguë, car, par exemple, si à un moment se pose la question d'un boycottage actif dans une élection, cela revient dans les faits à participer à une campagne et nous ne pensons pas que l'on puisse exclure cette possibilité pour toujours et partout : les questions tactiques ne se déterminent pas par des principes généraux, mais, en se basant sur eux et en analysant les situations concrètes, on détermine quels sont les meilleurs cours pour l'action révolutionnaire.
[3] [50] Un des vieux écrits que vous nous avez envoyés récemment le confirme : vous parlez de la grave défaite qu'a été la Pologne non seulement pour la classe ouvrière polonaise mais pour la classe ouvrière mondiale.
[4] [51] Nous faisons ici référence à un autre des textes publiés dans votre brochure, critiquant la notion de « pays périphériques ».
Courants politiques:
- Gauche Communiste [30]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 « 2° partie»
- 3428 reads
Face a la révolution russe
Le chapitre précédent de l’histoire de la Gauche hollandaise, paru dans
le n° 48 de la Revue Internationale, traitait du passage du SDAP
dirigé par Troelstra, dans le camp de la bourgeoisie, par le vote des crédits
de guerre en 1914, des scissions dans ce parti, du regroupement des minorités
révolutionnaires, essentiellement le courant « tribuniste », autour du SDP créé
depuis 1909. Mais la direction du SDP adopta face à la Conférence de Zimmerwald
contre la guerre en 1915, une attitude sectaire et fermée. Le chapitre publié
dans ce numéro montre comment cette attitude amenait à abandonner
l'internationalisme pour une position pro Entente dans la guerre, et quelles
furent l'attitude et les positions révolutionnaires, autour de Gorter, face à
la révolution russe et contre les concessions opportunistes du SDP. Le fait que
la réaction de Gorter, Pannekoek, ait été dispersée, et au départ une simple
opposition, a beaucoup pesé sur l'évolution ultérieure du SDP, lorsqu'il se
transforma en parti communiste en novembre 1918.
Le développement du SDP entre la révolution et l'opportunisme (1916-1917)
En dépit de la politique de la direction du SPD hollandais, l'écho de Zimmerwald fut, comme dans les pays belligérants, très grand dans la classe ouvrière des Pays-Bas. Une grosse propagande avait été faite dans les grandes villes par Roland-Holst. L'écho rencontré chez les ouvriers était tel que même le SDAP, sous la pression d'oppositionnels, publia le Manifeste de Zimmerwald, dans son quotidien « Het Volk».
Finalement, sous la pression des ouvriers et du RSV — auquel il ne voulait pas donner un label exclusif d'activité révolutionnaire — le SDP se rattacha, en 1916, et à contrecœur ([1] [53]), à la Commission socialiste internationale créée à Zimmerwald. C'était une adhésion tardive au mouvement de Zimmerwald. Finalement, plusieurs raisons avaient entraîné un changement d'attitude de la part du SDP, et un rapprochement avec le RSV.
En premier lieu, le RSV de Roland-Holst s'était rapproché considérablement des « tribunistes ». Il avait même donné des gages tangibles de son glissement vers la gauche : les membres du RSV, qui étaient encore au sein du SDAP, le quittèrent en janvier 1916 ; devant l'attitude de ce parti, qui avait condamné explicitement le mouvement de Zimmerwald, lors de son Congrès, la petite minorité hostile à la 2e Internationale se tournait désormais vers le SDP. Aussitôt, Roland-Holst fit savoir que la fusion avec le parti « tribuniste » était à l'ordre du jour. Après ce départ, le SDAP ne connut guère plus de scission, à l'exception de celle qui se produisit sur sa gauche en février 1917.
En deuxième lieu, et malgré les atermoiements de sa direction, le SDP rencontrait une sympathie croissante en milieu ouvrier. Il avait considérablement développé sa propagande : contre la guerre, le service militaire de 3 ans, contre le chômage et le rationnement. Il était particulièrement actif chez les chômeurs et au sein des comités que ceux-ci faisaient surgir. Politiquement, le parti disposait d'instruments théoriques qui le faisaient apparaître comme le seul parti marxiste conséquent en Hollande. Le mensuel théorique « De Nieuwe Tijd » (« Les temps modernes ») qui appartenait ni au SDAP ni au SDP et comprenait des «théoriciens marxistes» appartenant aux deux partis depuis la scission de 1909, passait entièrement dans les mains du courant marxiste révolutionnaire. Le départ de Wibaut et Van der Goes de la rédaction mettait fin à la présence du courant opportuniste et révisionniste au sein du seul organe théorique en hollandais.
Il est notable que Roland-Holst fut associée à Gorter et Pannekoek pour assurer la rédaction de la revue, qui devenait un organe de combat «pour le socialisme, pour la libération de l'humanité du capitalisme».
En troisième lieu, à travers la personne de Pannekoek, le SDP s'impliquait de plus en plus dans l'effort de rassemblement des forces révolutionnaires qui se prononçaient nettement contre la guerre pour la révolution. A partir de 1915, Pannekoek collabore régulièrement avec les courants internationalistes allemands ; le groupe « Lichstrahlen » de Borchardt (Berlin), puis le groupe de Brème « Arbeiterpolitik », qui publie sa revue en 1916, après être sorti du SPD. Sans ; cesse en contact avec les internationalistes allemands, Pannekoek est désigné tout naturellement pour prendre en charge — avec la collaboration de Roland-Holst — l'édition de la revue « Vorbote » en janvier 1916. Cette revue, éditée en Suisse, était l'organe de la Gauche zimmerwaldienne ([2] [54]), hostile au centrisme du courant pacifiste de Zimmerwald. Elle se plaçait résolument sur le terrain de la « future 3e Internationale ».
Tout cela manifestait une évolution positive du SDP et du groupe de Roland-Holst. Après une période de flottement, le parti « tribuniste » prenait ses responsabilités au niveau international. Roland-Holst, après avoir marché avec le centre du mouvement zimmerwaldien, avec Trotsky particulièrement, avait évolué à gauche.
L'existence de deux groupes révolutionnaires séparés en Hollande n'avait plus de raison d'être. L'heure était au regroupement. Le 19 février 1916, la direction du SDP émit le souhait d'une fusion avec le RSV. Enfin, le 26 mars, l'assemblée générale de ce dernier se prononça pour le regroupement. Seules les sections de La Haye et de Rotterdam manifestèrent une grande confusion, en voulant n'accepter la fusion que si pouvaient s'intégrer des éléments syndicalistes. Ces hésitations montraient que, comme pour le SDP, la délimitation du courant marxiste d'avec le courant syndicaliste-révolutionnaire était loin d'être nette.
Néanmoins, la fusion se réalisa. Le SDP, qui gagnait 200 militants, devenait un parti de 700 membres. Cette croissance, après une longue période de stagnation numérique, permettait au parti de disposer d'un quotidien : « De Tribune » paraissait dorénavant tous les jours. Le développement du SDP devenait même qualitatif. Pour la première fois de son histoire, le 21 juin, le SDP était capable de conduire avec succès une manifestation ouvrière à Amsterdam contre la faim et la guerre. La « secte » devenait véritablement un parti ouvrier par sa capacité d'influencer activement l'action de larges masses prolétariennes.
Il est certain que le développement du courant marxiste en Hollande, en cette année 1916, était le fruit de tout un réveil du prolétariat international après un an et demi d'hécatombes sur les champs de bataille. L'année 1916 est l'année tournant, celle qui préfigure le bouleversement révolutionnaire de 1917 en Russie. La reprise de la lutte de classe, après des mois de torpeur et de stupeur, brise l'Union Sacrée. En Allemagne, commencent les premières grèves politiques contre la guerre, après l'arrestation de Karl Liebknecht.
Les Pays-Bas, bien que « neutres », connaissent la même reprise des luttes ouvrières. Le début de la vague de grèves et de manifestations contre les effets de la guerre au niveau international est une réalité de la « petite Hollande ». Pendant les mois de mai et de juin se déroulèrent à Amsterdam des manifestations spontanées de femmes contre le rationnement. Des comités de femmes ouvrières avaient été constitués à Amsterdam et dans d'autres villes. Une agitation permanente régnait qui se manifestait par des assemblées et des manifestations auxquelles participaient ouvriers et ouvrières. Ces mouvements se prolongèrent par des grèves dans tout le pays au mois de juillet. Ces phénomènes de mécontentement profond étaient incontestablement prérévolutionnaires. Jamais la situation n'avait été aussi favorable pour le courant révolutionnaire aux Pays-Bas.
Pourtant, la direction du SDP allait progressivement révéler une attitude ambiguë et même opportuniste. Non pas sur le terrain de la lutte revendicative, où le parti était très actif, mais sur celui de la lutte politique.
Tout d'abord, le SDP continuait infatigablement sa politique de front avec des organisations de type syndicaliste et anarchiste. L'ancien cartel d'organisations, le SAV s'était sabordé le 25 février ([3] [55]). Ce fut pour être remplacé, en avril 1916, par un comité socialiste-révolutionnaire contre la guerre et ses conséquences, en abrégé RSC. Le SDP, avec Wijnkoop et Louis de Visser — tous deux futurs chefs du PC des Pays-Bas stalinisé — était de fait à la tête du nouveau cartel d'organisations. Celui-ci, bien que très actif dans la lutte contre la guerre et la misère, apparaissait en fait comme un état-major des luttes, se substituant à leur spontanéité. Il n'était ni un conseil ouvrier, en l'absence de révolution, ni un comité central de grève, qui par nature est temporaire et lié à l'étendue de la lutte. Il était un organisme politique hybride, qui loin d'apporter la clarté sur les objectifs de la lutte de classe, apparaissait comme très confus, comme compromis entre différents courants politiques au sein du mouvement ouvrier.
On trouvait au sein du RSC les groupements anarchistes qui avaient déjà travaillé avec le SDP. Le plus révolutionnaire de tous était incontestablement le groupe de Nieuwenhuis.
Ce groupe — « Action social-anarchiste » (SAC) — était incontestablement, bien que de façon confuse, révolutionnaire, en raison surtout de la personnalité intransigeante de Nieuwenhuis. Cela n'était certainement pas le cas des autres groupements. On trouvait pêle-mêle : le « Bond van Christen-Socialisten », fédération des chrétiens socialistes (BCS), dont la couleur politique était pacifiste-chrétienne et parlementariste ; le « Vrije Menschen Verbond » (VMV), « Ligue des hommes libres » se réclamant de Tolstoï. Lorsque le groupement de Nieuwenhuis et aussi l'IAMV quittèrent fin 1916 le cartel, il ne restait plus que ces groupes, bientôt rejoints en février 1917 par le petit parti socialiste (SP), scission de 200 personnes du SDAP. C'était avant tout un groupe syndicaliste et parlementariste.
Ce conglomérat d'organisations pacifistes, la plupart étrangères au marxisme révolutionnaire, eut comme conséquence directe d'entraîner la direction du SDP toujours plus sur le terrain de l'opportunisme pratique. En s'alliant avec les « chrétiens socialistes » et avec le SP, le SDP allait tomber rapidement dans l'aventurisme parlementaire et une politique sans principe qu'il avait naguère dénoncée chez Troelstra. En effet, en 1917, et comme dérivatif à une situation sociale de plus en plus tendue dans le pays, la bourgeoisie néerlandaise avait instauré le suffrage universel. Le SDP forma un cartel électoral avec les deux organisations. Il put obtenir ainsi un net succès, par rapport à l'avant-guerre : 17 000 voix contre 1340 en 1913. Ce résultat, certes, traduisait une désaffection croissante de nombreux ouvriers pour le SDAP. Il était néanmoins, le début d'une politique qui devint rapidement, un an plus tard, parlementariste. Cette politique développa alors progressivement une nette réaction anti-parlementaire dans le parti, à l'origine de l'anti-parlementarisme de la gauche communiste hollandaise.
Mais l'opposition au sein du parti ne se cristallisa pas d'emblée sur l'anti-parlementarisme. Elle se forma dès 1916, pour culminer en 1917, contre la politique étrangère de la direction Wijnkoop. Sous la conduite de Barend Luteraan, membre de cette direction, et de Sieuwertsz van Reesema surgit dans les sections d'Amsterdam et de La Haye une puissante opposition à cette politique.
En effet, de plus en plus ouvertement, Wijnkoop, à la suite de Ravesteyn, mais aussi de la majorité du SDP — ce qui était plus grave — adoptaient une orientation favorable à l'Entente ; cela s'était déjà exprimé, mais de façon indirecte, dès septembre 1914, sous la plume de Ravesteyn. Celui-ci affirmait que la défaite de l'Allemagne serait la condition la plus favorable pour l'éclatement de la révolution dans ce pays. Il n'était certes pas nouveau dans le camp marxiste d'envisager — et cela se répéta lors de la deuxième guerre mondiale ([4] [56]) — quels seraient les différents épicentres du séisme révolutionnaire à venir. Pannekoek répliqua dans « De Tribune », pour mettre fin à cette question purement théorique : même si l'Allemagne est plus développée économiquement que l'Angleterre, il est indifférent pour des marxistes d'envisager lequel des deux camps impérialistes doit remporter la victoire finale ; l'oppression violente par un camp et la tromperie démocratique, plus rusée, sont toutes deux défavorables au mouvement ouvrier. C'est exactement la même réponse que firent les gauches communistes italienne et hollandaise pendant la deuxième guerre mondiale à des courants comme l'anarchisme et le trotskysme.
La discussion en resta là. Ravesteyn, à l'évidence, développait des positions pro Entente. Il resta néanmoins isolé dans le parti ; Wijnkoop lui-même, président du SDP, avait encore la même position que Pannekoek et Gorter. Au cours de l'année 1916, tout commença à changer. Wijnkoop, brusquement, se rangea du côté de Ravesteyn, en mettant au premier plan la lutte contre le militarisme allemand, sous prétexte — ce qui était faux — que la bourgeoisie néerlandaise dans son ensemble se rangeait derrière l'Allemagne. Au cours de l'année 1917, il utilisa cette fois les mêmes arguments que ceux des « social-chauvins » des pays de l'Entente. Dans un article approuvé par la rédaction de « De Tribune », ce qui montrait que le danger de gangrène opportuniste était réel dans le SDP, Wijnkoop dépeignit l'Allemagne comme le rempart « féodal » de la réaction en Europe, contrainte aux pillages et à l'assassinat des peuples vaincus ; par contre, la France, héritière de la Grande Révolution, et l'Angleterre développée seraient incapables de tels actes (sic !). Une telle position était un net abandon des principes internationalistes du SDP ; elle laissait présager que si la neutralité des Pays-Bas était violée par l'Allemagne, la direction du SDP n'appellerait pas à la lutte contre les deux camps impérialistes mais au soutien de l'Entente.
Cette position, qui marquait un tournant dans l'histoire du parti, souleva de violentes protestations à l'intérieur de celui-ci. Une opposition, menée par Barend Luteraan et Van Reesema, engagea la lutte contre le comité de rédaction, qui avait laissé s'exprimer dans « De Tribune » des conceptions totalement étrangères à l'essence révolutionnaire du parti. La chose avait été d'autant plus aisée que Gorter, malade et déprimé ([5] [57]), s'était retiré en 1916 de la rédaction, et se trouvait momentanément dans l'impossibilité de participer aux activités du parti.
Pour désamorcer l'opposition, la direction de Wijnkoop employa une arme qu'elle allait utiliser de plus en plus, par la suite, pour déconsidérer ses adversaires de gauche : la calomnie. Elle prétendit que les opposants, Gorter et Pannekoek inclus, étaient en fait des partisans de l'Allemagne, Ravesteyn ne fut pas le dernier à créer ce bruit.
L'opposition reprenait en fait l'analyse de Gorter, exposée en 1914 dans sa brochure sur 1 impérialisme, et qui avait été officiellement acceptée par le SDP comme base pour sa propagande. Clairement, elle montrait la nécessité de combattre tous les impérialismes, tous les camps en présence :
«Il ne s'agit pas de combattre spécialement l'impérialisme allemand. Tous les impérialismes sont également dommageables pour le prolétariat » ([6] [58]).
Malheureusement pour elle, et signe inquiétant pour l'évolution de l'ensemble du parti, l'opposition se trouva isolée. Elle se trouvait d'ailleurs sans appui. Gorter hésitait encore à mener le combat avec elle. Pannekoek et Roland-Holst étaient plus plongés dans l'activité internationale que dans celle du SDP. C'était un signe de faiblesse organisationnelle qu'on retrouva comme constante chez ces dirigeants marxistes de stature internationale, et qui ne fut pas sans conséquence en 1917 et 1918.
La situation en 1917, et particulièrement la révolution russe et ses répercussions aux Pays-Bas, accentuèrent encore les clivages politiques au sein du SDP.
Le SDP en 1917 face a la révolution
La Révolution russe de 1917 ne fut pas une surprise pour des révolutionnaires comme Gorter, qui étaient convaincus que de la guerre naîtrait la révolution. Dans une lettre à Wijnkoop de mars 1916, Gorter montrait une confiance inébranlable dans l'action révolutionnaire du prolétariat international : «Je m'attends à de très grands mouvements après la guerre»
Les événements révolutionnaires tant attendus venaient pourtant en pleine guerre. L'écho de la révolution russe fut énorme aux Pays-Bas. Il montrait à l'évidence que la révolution prolétarienne était aussi à l'ordre du jour en Europe occidentale ; qu'il s'agissait non d'un phénomène « russe » mais d'une vague internationale de luttes révolutionnaires. De ce point de vue, l'année 1917 est décisive dans l'évolution du SDP confronté aux premiers signes de la révolution internationale, par l'action de masse, qu'il avait appelée de ses vœux dès le début de la guerre.
Premiers signes prérévolutionnaires aux Pays-Bas
L'année 1917 ouvrit une nouvelle période d'agitation contre la guerre, la faim, le chômage. En février, au moment où éclatait la révolution en Russie, les ouvriers d'Amsterdam manifestaient violemment contre l'absence de produits alimentaires et la politique de la municipalité de la ville.
Les manifestations prirent rapidement une tournure politique ; non seulement elles étaient dirigées contre le gouvernement, mais aussi contre la social-démocratie. Celle-ci, en effet, avait plusieurs élus — échevins — dans la municipalité d Amsterdam. Wibaut, l'un des dirigeants du SDAP, était même président de la commission d'approvisionnement de la ville depuis décembre 1916. En tant que tel, il était tenu responsable par les ouvriers de la pénurie alimentaire.
Mais Wibaut, et avec lui Vliegen — autre sommité du SDAP, élu à la mairie — fit appel le 10 février à l'armée, pour « rétablir Tordre », à la suite de pillages de boulangeries. C'était le premier pas concret de l'engagement du SDAP aux côtés de la bourgeoisie pour réprimer toute réaction ouvrière. Cette solidarité du SDAP avec l'ordre établi se manifesta encore plus en juillet, au cours d'une semaine qui est restée gravée dans l'histoire sous le nom de « semaine sanglante ». A la suite de manifestations de femmes contre la pénurie et de pillages de magasins, la municipalité, avec l'appui de tous les échevins social-démocrates, fit interdire toute démonstration. La réaction du prolétariat fut immédiate : une grève de 24 heures — à l'appel du RSC — fut suivie par plus de 20 000 ouvriers d'Amsterdam, grève de masse qui s'étendit comme une traînée de poudre dans la plupart des grandes villes des Pays-Bas. Mais à Amsterdam, comme dans d'autres villes, la troupe et la police tirèrent sur les ouvriers. Cette fois, pour la première fois depuis le début de la guerre, des ouvriers tombèrent sous les balles des forces de la bourgeoisie.
A Amsterdam, Vliegen et surtout Wibaut ([7] [59]) portaient une, lourde responsabilité dans la répression sanglante. Wibaut n'hésita pas à opposer les chômeurs et les manifestants, dans lesquels il ne voulait voir qu'une « jeunesse débauchée », au « mouvement ouvrier moderne», organisé dans les syndicats et le SDAP. Il justifiait même, dans un article de « Het Volk », la répression qui, selon lui, aurait été « limitée » et appelait à « d'autres moyens pour assurer l'ordre ». Un tel langage, non désavoué par la direction du SDAP, était le langage de la classe dirigeante. Ainsi, même si le SDAP, officiellement, hésitait à couvrir totalement Wibaut ([8] [60]), la social-démocratie hollandaise initiait une politique qui fut pleinement développée en Allemagne, en 1919, par Noske et Scheidemann. Le parti de Troelstra, à une petite échelle, ouvrait la voie de la collaboration avec la bourgeoisie face au mouvement révolutionnaire.
La « Semaine Sanglante » rendit plus nette la démarcation entre le SDP révolutionnaire et le SDAP, devenu traître à la classe ouvrière ; le SDP pouvait ainsi appeler les ouvriers à « s'écarter pleinement des traîtres à la classe ouvrière, des judas modernes, des valets du capital, de la direction du SDAP et du NW»
(De Tribune, 23-74917).
De tels événements aux Pays-Bas s'inscrivaient incontestablement dans le sillage de la révolution russe. Celle-ci non seulement entraînait manifestations et grèves dans le prolétariat, mais encourageait l'agitation dans l'armée. Ainsi, et bien que le phénomène fut limité, à partir d'octobre 17 se formèrent des conseils de soldats dans quelques localités, tandis que tout un mouvement se développait contre la discipline militaire.
Le SDP avait incontestablement profité de la situation. En participant pleinement aux grèves et aux manifestations, en subissant la répression — plusieurs de ses militants étaient en prison —, le SDP apparaissait comme un véritable parti révolutionnaire, non un parti de la « phrase » sectaire, mais comme une organisation militante active.
Cette activité tranchait nettement avec l'ambiguïté du SDP en politique extérieure, vis-à-vis de l'Entente et surtout face à là révolution russe. Comme si le développement du parti le poussait, par souci d'une « popularité » fraîchement acquise en milieu ouvrier, à faire des concessions opportunistes pour renforcer une influence qu'il avait témoignée sur le terrain électoral en 1917.
La direction du SDP et la révolution russe
Le parti que Lénine avait considéré avec le parti bolchevik au début de la guerre, comme le plus révolutionnaire et le plus apte à œuvrer à la constitution de la Nouvelle Internationale va se trouver singulièrement éloigné en 1917 du bolchevisme. Du moins la majorité du parti dont la direction était totalement dominée par le trio Wijnkoop-Ravesteyn-Ceton. La minorité, après le départ de Gorter et l'élimination de Luteraan de la direction du SDP, se trouvait isolée. C'est elle du moins, qui mena, avec l'autorité morale de Gorter et Pannekoek, la lutte la plus résolue pour soutenir le bolchevisme et défendre le caractère prolétarien de la révolution russe. Cette attitude est d'ailleurs commune à toutes les gauches qui se formaient soit comme opposition, soit comme fraction dans les différents partis socialistes.
La méfiance qui se fit jour dans la majorité à l'égard des bolcheviks découle directement de ses positions pro Entente en politique internationale. Elle se manifesta en premier lieu lorsque les bolcheviks traversèrent l'Allemagne pour regagner la Russie. Ce voyage fut désapprouvé par « De Tribune », qui y vit une compromission avec l'Allemagne. En fait, cette méfiance dissimulait mal un soutien à la politique de Kerenski, qui en juillet 1917 menait une offensive similaire contre l'Allemagne. Pour justifier cette politique, van Ravesteyn — dans «De Tribune» —n'hésitait pas à comparer la Russie de Kerenski à la France révolutionnaire de 1792. Idéologiquement, la position de Ravesteyn, et aussi de Wijnkoop, était identique à celle des mencheviks : il s'agissait de réaliser la révolution bourgeoise et de l'exporter militairement pour écraser l'Empire allemand, « féodal et réactionnaire ».
Ce soutien implicite au gouvernement Kérenski entraîna de violentes réactions de l'opposition. Celle-ci, par la plume de Pannekoek et de Gorter, se situa résolument au côté des bolcheviks, en dénonçant à la fois la démocratie bourgeoise russe et la conception d'une révolution bourgeoise comparable à 1793 en France. Pour Pannekoek, il ne s’agissait pas d'une révolution « bourgeoise » en marche, mais d'une politique contre-révolutionnaire et impérialiste. Son point de vue était identique à celui des bolcheviks en 1917 :
« Toute guerre (..) menée avec la bourgeoisie contre un autre Etat est un affaiblissement de la lutte de classe, et par conséquent une trahison, un forfait contre la cause du prolétariat» ([9] [61])
Les errements de la direction du SDP s'arrêtèrent là. Lorsque la prise du pouvoir par les conseils fut connue en novembre, celle-ci fut saluée avec enthousiasme par « De Tribune ».
Mais la minorité autour de Gorter, Pannekoek et Luteraan, émettait des doutes justifiés sur le soudain enthousiasme révolutionnaire de la direction. En refusant, une fois de plus, de participer à la troisième (et dernière) conférence du mouvement de Zimmer-wald ([10] [62]), à Stockholm, en septembre, celle-ci montrait un refus de s'engager résolument sur la voie de la troisième internationale. Le radicalisme verbal utilisé une fois de plus pour condamner « l'opportunisme » avait du mal à camoufler la politique étroitement nationale de la direction Wijnkoop. Son internationalisme était purement verbal et le plus souvent déterminé par l'air ambiant.
Il n'est pas surprenant que, lors des débats qui se firent jour autour de Brest-Litovsk, sur la question de la paix ou de la guerre révolutionnaire, la direction se fit le champion d'une guerre révolutionnaire à tout prix. En Russie, • Boukharine, Trotsky, en étaient devenus les partisans pour accélérer, croyaient-ils, l'expansion de la révolution prolétarienne en Europe. Chez eux, nulle ambiguïté : la « guerre révolutionnaire» n'était pas une guerre contre l'Allemagne, insérée dans les plans de l'Entente ; il s'agissait de briser l'encerclement de la Russie révolutionnaire pour étendre la révolution non seulement à l'Allemagne, mais à toute l'Europe, pays de l'Entente inclus.
Contrairement à toute attente, Gorter — pour des raisons identiques à celles des communistes de gauche russes — se rangea du côté de la direction du SDP pour soutenir la position de Trotsky et Boukharine. Gorter attaqua vivement Pannekoek, qui soutenait entièrement la position de Lénine sur la paix rapide avec l'Allemagne.
Pannekoek partait du point de vue, évident, que la « Russie ne peut plus combattre ». En aucun cas, la révolution ne pouvait s'exporter par la force militaire ; son côté fort résidait dans l'éclatement de luttes de classe dans d'autres pays : « la force des armes est le côté faible du prolétariat»
Gorter se trompa de cible. Il laissa pendant plusieurs mois toute critique à la direction du SDP de côté. Il crut voir exprimée dans la prise de position de Pannekoek une version du pacifisme qu'il avait combattu en 1915, une négation de l'armement du prolétariat. Selon lui, une guerre révolutionnaire devait être conduite contre l'Empire allemand, car dorénavant : « la force des armes est le côté fort du prolétariat »
Cependant, Gorter commença à changer sa position. Il se trouvait en Suisse depuis l'été 1917, officiellement pour des raisons de santé. Il voulait en fait s'éloigner du parti hollandais et travailler en collaboration avec les révolutionnaires russes et suisses. Au contact de Platten et de Berzin — tous deux « zimmerwaldiens » et collaborateurs de Lénine — il entra en relation avec les révolutionnaires russes. Une correspondance étroite commença avec Lénine. Il se convainquit de la justesse des positions de Lénine sur la paix avec l'Allemagne. Et c'est lui qui se chargea de traduire en hollandais les thèses « sur la paix malheureuse ».
Gorter se trouvait libre pour combattre avec Pannekoek la direction du SDP, et soutenir sans réserve le caractère révolutionnaire de la Russie, et l'internationalisme bolchevik.
La révolution russe et la révolution mondiale
Contrairement à une légende tenace, la gauche hollandaise dans le SDP défendit pendant trois ans le caractère prolétarien de la révolution russe. Celle-ci était la première étape de la révolution mondiale. Avec acharnement, Gorter et la minorité du parti dénoncèrent l'idée menchevik — exprimée par Ravesteyn — d'une révolution bourgeoise en Russie. Une telle position ne pouvait que renforcer la position favorable à l'Entente et perpétuer la guerre impérialiste, au nom d'une « guerre révolutionnaire ». Lorsque, avec la dégénérescence de la révolution russe et la soumission de la troisième internationale aux intérêts d'Etat russes, la gauche commença à défendre l'idée dune révolution « double » en Russie : en partie bourgeoise, en partie prolétarienne, c'était dans une optique différente du menchevisme. Pour elle une révolution bourgeoise, ne pouvait être que le capitalisme d'Etat et la contre-révolution. Elle ne naissait pas au début mais à la fin de la vague révolutionnaire.
En 1917 et 1918, Gorter et la minorité sont les plus chauds partisans du bolchevisme. Ils sont les véritables introducteurs et propagateurs des conceptions de Lénine. C'est Gorter qui, de son propre chef, se charge de traduire, au cours de l'année 1918, « L'Etat et la Révolution ». De façon naïve, il se fait le propagateur d'un véritable culte de la personne de Lénine, dans sa brochure — parue en 1918 — sur la « Révolution mondiale » ; le futur pourfendeur des « chefs » reconnaît en Lénine le chef de la révolution : « il est le chef de la révolution russe, il doit devenir le chef de la révolution mondiale » ([11] [63])
La brochure de Gorter — qui n'était pas un travail officiel du SDP — est l'une de ses contributions » théoriques et politiques les plus importantes. Elle présente l'avantage de tirer un certain nombre de leçons de la révolution russe, du point de vue de son organisation. Comme Lénine, Gorter proclame que les conseils ouvriers sont la forme enfin trouvée du pouvoir révolutionnaire, forme valable non pour la Russie, mais pour l'ensemble des pays du monde :
« Dans cette organisation de conseils ouvriers, la classe ouvrière du monde a trouvé son organisation, sa centralisation, sa forme et son être » (idem, p. 59)
La conception localiste et fédéraliste des conseils ouvriers, qui fut développée par la suite par le courant unioniste autour de Ruhle, est totalement absente dans la gauche hollandaise ; pas plus que n'est présente 1’idée d'une fédération d'Etats prolétariens, reposant sur des conseils ouvriers nationaux, idée développée plus dans l'I.C. de Zinoviev. La forme du pouvoir mondial du prolétariat sera « dans un avenir proche le conseil ouvrier central du monde » (idem, p. 76)
La révolution prolétarienne ne peut trouver son véritable essor que dans les principaux pays industrialisés, et non dans un seul pays. Elle doit être un phénomène simultané : « (Le socialisme) doit naître simultanément dans plusieurs, dans de nombreux, dans tous les pays et au moins dans les pays principaux» (idem, p. 64) On trouve ici chez Gorter l'idée maintes fois répétée par la suite que l'Europe occidentale est l'épicentre de la véritable révolution ouvrière, compte tenu du poids numérique et historique du prolétariat par rapport à la paysannerie : « La révolution véritable et complètement prolétarienne doit être faite par l'Europe occidentale elle-même» (idem, p.45) La révolution sera bien plus longue et difficile qu'en Russie, face à une bourgeoisie beaucoup mieux armée ; d'autre part, « le prolétariat d'Europe occidentale est seul comme classe révolutionnaire » (idem, p. 67). Nulle impatience « infantile » donc sur le cours révolutionnaire, reproche qui sera fait par la suite à la gauche communiste de la troisième Internationale.
Il est remarquable que la seule critique, indirecte, faite aux bolcheviks dans la brochure « La Révolution mondiale » soit dirigée contre le mot d'ordre du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Celui-ci, selon Gorter, qui reste bien en deçà des positions de Pannekoek et Rosa Luxemburg qui refusent le cadre de la « nation », « ne peut être garanti que par le socialisme ; il ne peut être introduit qu'avec le socialisme, ou qu'après son établissement» ([12] [64]). Il est vrai que Gorter — qui est pour l'indépendance des Indes néerlandaises et soutient donc le mot d'ordre du SDP — fait une distinction explicite entre l'Occident, où seule la révolution est à 1’ordre du jour, et l'Orient, où l'indépendance des colonies doit être revendiquée :
«En traitant de ce droit, il faut bien distinguer entre Europe occidentale et orientale, entre les Etats asiatiques et les colonies » (idem)
Lénine pouvait à juste titre souligner l'inconséquence de la position de Gorter, qui apparaissait moins comme une divergence de principe que comme une question tactique à examiner suivant les zones géo-historiques ([13] [65]).
Cette brochure eut en tout cas un écho considérable tant aux Pays-Bas que dans maints pays, où sa traduction fut immédiate.
Ch.
[1] [66] Le SDP ne participa ni à la conférence de Kienthal ni à celle de Stockholm. Finalement, il ne participa à aucune des conférences tenues de 1915 à 1917.
[2] [67] Elle n'eut que deux numéros. Radek en Suisse en avait la direction effective.
[3] [68] Les courants syndicalistes, représentés par les fédérations d'employés et de marins avaient peur en fait de 1 emprise croissante du SDP au sein du SAV.
[4] [69] La gauche communiste italienne était convaincue que la révolution surgirait en Allemagne en 1945.
[5] [70] Gorter avait perdu sa femme, ce qui l'avait rendu dépressif. D'autre part, sa maladie l'affaiblissait ; il était depuis 1913 dans l'impossibilité de parler dans les meetings ouvriers. Il est certain aussi que son retour à la poésie — il publie son grand poème «Pan» en 1917 — l'a presque complètement absorbé.
[6] [71] Article de Van Reesema, in « De Tribune », 21 mai 1917.
[7] [72] F.M. Wibaut (1859-1936) ; adhéra en 1897 au SDAP. Il devint membre du conseil municipal d'Amsterdam de 1907 à 1931, échevin de 1914 à 1931. Vliegen (1862-1947) était l'un des fondateurs du SDAP en 1894.
[8] [73] Plus tard, Troelstra — dans ses Mémoires parus de 1927 à 1931 — appuya cyniquement la politique de répression menée par Wibaut comme une politique de parti : il la trouvait même trop douce ! : « Wibaut écrivit quelques semaines plus tard dans "Het Volk" un article où il qualifiait cette violence d'inévitable, mais il faisait fortement ressortir le fait déplorable qu'une municipalité démocratique doive ainsi intervenir contre la population. Il exprima dans son article urgemment le souhait que les professionnels de la police dussent imaginer une méthode non violente pour prévenir des pillages. A mon avis, on ne peut se laisser diriger par une telle sensiblerie dans l'argumentation, qu'il fit peser si lourd dans celle-ci. Si nous social-démocrates avons conquis une importante position de force, c'est dans l'intérêt de la classe ouvrière toute entière, et par conséquent cette position de force doit être défendue par tous les moyens, violents si nécessaire» (« Gedenkschriften» t. IV,p. 72-73, Amsterdam, 1931)
[9] [74] « De Nieuwe Tijd», 1917, p. 444-445.
[10] [75] Malgré l'opposition de Lénine, qui voulait fonder immédiatement la troisième Internationale, en avril 17, les bolcheviks déléguèrent leurs représentants à la conférence de Stockholm. Celle-ci ne doit pas être confondue avec celle des partis de la seconde Internationale, qui devait se dérouler dans la même ville au même moment. Elle ne put se tenir, les socialistes patriotes français refusant de siéger avec les social-patriotes allemands.
[11] [76] Cf. traduction française : « La révolution mondiale», Ed. socialistes, Bruxelles 1918, p. 58. Gorter idolâtre l'individu Lénine, qu'il ne voit plus comme l'expression d'un parti : « La force de son esprit et de son âme est égale à celle de Marx. Si Marx le surpasse en connaissances théoriques, en force dialectique, il surpasse Marx par ses actions... Et nous l'aimons comme nous aimons Marx. Comme chez Marx, son esprit, son âme nous inspirent immédiatement de l'amour»
[12] [77] Idem, p. 24, Gorter ajoute : «Il se peut que cette indépendance soit pire que la soumission pour les nations, pour le prolétariat.»
[13] [78] « Gorter est contre l'autodétermination de SON pays, mais POUR celle des Indes néerlandaises, opprimées par sa nation!» (Lénine, « Bilan d'une discussion sur le droit des nations à disposer d'elles-mêmes », 1916).
Géographique:
- Hollande [28]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [79]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [30]
Revue Internationale no 50 - 3e trimestre 1987
- 2928 reads
Lutte de classe internationale : le besoin de l'unification et la confrontation au syndicalisme de base
- 2633 reads
La faillite de plus en plus évidente du capitalisme mondial, qui s'engage aujourd'hui dans une nouvelle récession, commence sérieusement à alarmer même les plus optimistes analystes des «perspectives» de l'économie dans tous les pays. En même temps, le mécontentement, la colère, la combativité ne cessent de monter dans la classe ouvrière contre des attaques de plus en plus généralisées des conditions de vie :
— le chômage de moins en moins indemnisé, de longue durée, sans perspective de retrouver des emplois ; au contraire, de plus en plus de licenciements, au nom de la «restructuration», «reconversion», «privatisation»;
— le démantèlement de toutes les réglementations de l'aide sociale de l'Etat, dans les domaines de la santé, des retraites, du logement, de l'éducation ;
— la baisse des revenus par suppression de primes, augmentation du temps de travail, limitations et blocages des salaires ;
— la déréglementation des conditions de travail : réintroduction du travail pendant les jours de congé, du travail de nuit des femmes, «flexibilisation» des horaires.
— l'augmentation des sanctions sur les lieux de travail, le renforcement des contrôles policiers, notamment dans «l'immigration», au nom de la lutte «pour la sécurité», contre le «terrorisme» ou même «l'alcoolisme», etc.
Sur le plan de l'économie et des conséquences pour la vie des classes sociales exploitées et déshéritées de la société, ce sont les pays au capitalisme moins développé qui montrent l'avenir pour les pays industrialisés. Aujourd'hui, les caractéristiques de la faillite historique du capitalisme se manifestent très violemment dans ces pays (voir article sur le Mexique dans ce numéro). Cependant, ces caractéristiques ne sont pas réservées au «sous-développement» et le capitalisme des centres industriels les plus importants montre des symptômes de plus en plus flagrants de cette faillite au cœur même de son système : aggravation du chômage au Japon, endettement des Etats-Unis supérieur à celui du Brésil, plans de licenciements massifs en Allemagne de l'Ouest, pour ne donner que quelques indices les plus significatifs.
Face à cette tendance à unifier dans la crise du capitalisme les conditions d'exploitation et de misère pour les travailleurs de tous les pays, la classe ouvrière a répondu internationalement. Toute une série de luttes ouvrières se sont développées depuis 1983 et renforcées depuis 1986, parcourant tous les pays et tous les secteurs. La vague actuelle de luttes constitue une simultanéité de riposte ouvrière aux attaques capitalistes inconnue jusque là dans l'histoire. Dans les pays parmi les plus industrialisés d'Europe occidentale — Belgique, France, Angleterre, Espagne, Suède, Italie —, également aux Etats-Unis, dans les pays de capitalisme moins développé — en particulier en Amérique Latine —, en Europe de l'Est où se manifestent des signes récents d'une reprise de la combativité ouvrière, en Yougoslavie où déferle depuis plusieurs mois une vague de grèves ; partout dans le monde, dans tous les secteurs de l'économie, la classe ouvrière a entamé et va poursuivre le combat contre les attaques des conditions d'existence. La tendance à des mouvements touchant de plus en plus d'ouvriers, dans tous les secteurs, actifs et chômeurs, la tendance au surgissement de mouvements spontanés, au développement de la confiance en soi au sein du prolétariat, à la recherche de la solidarité active, sont présentes, à des degrés divers suivant les moments et les pays, dans les luttes ouvrières actuelles. Elles manifestent une recherche de l'unification dans la classe ouvrière, unification qui constitue le besoin central des luttes dans la période présente.
C'est à enrayer cette tendance à l'unification que s'emploie la bourgeoisie, surtout sur le terrain de la lutte classe par l'intervention des syndicats et du syndicalisme de base qui déploient toutes les tactiques possibles division et de détournement des objectifs et des moyens de lutte :
— contre l'extension des luttes: l'isolement corporatiste, régional;
— contre l'auto organisation : la fausse extension par les syndicats ;
— contre les manifestations unitaires, l'utilisation des divisions syndicales et corporatistes, le trucage des convocations et du calendrier, etc.
Le tout est enveloppé d'un verbiage d'autant plus radical que la méfiance envers les syndicats se transforme de plus en plus en hostilité ouverte parmi les ouvriers et que la combativité est stimulée lorsqu'il y a mobilisation en nombre des travailleurs, dans des assemblées, dans des manifestations.,
«Les luttes de Belgique (printemps 1986) ont souligné la nécessité et la possibilité de mouvements massifs et généralisés dans les pays capitalistes avancés. Les luttes en France (hiver 1986-87) sont venues confirmer la nécessité et la possibilité d'une prise en mains par les ouvriers de leurs combats, de l'auto organisation de ceux- ci en dehors des syndicats, contre eux et leurs manœuvres de sabotage.
Ce sont ces deux aspects inséparables du combat ouvrier qui seront de plus en plus présents dans le mouvement de luttes qui a déjà débuté». (Revue Internationale n° 49, 2e trimestre 1987)
Après la grève des chemins de fer en France et la grève des télécommunications en Grande-Bretagne au début de l’année, les luttes ouvrières en Espagne et en Yougoslavie depuis plusieurs mois, et en ce moment même en Italie, confirment à leur tour les caractéristiques générales de la vague de luttes actuelles. La simultanéité des ripostes et les tendances à prendre en main la lutte face à la stratégie de la gauche, de l’extrème-gauche et des syndicats, confirment le développement d'un potentiel d'unification.
Espagne : divisions syndicales contre unité ouvrière
En Espagne, surtout depuis le mois de février, pas un jour ne se passe sans grèves, assemblées, manifestations : des mines à l'aviation, du secteur de la santé à celui de la sidérurgie, des chantiers navals aux transports, de l'enseignement à la construction. Le très sérieux journal Le Monde constate ainsi : «Nombre de travailleurs semblent désormais persuadés, à tort ou à raison, que descendre dans la rue constitue la seule manière de se faire entendre» (8/5/87). C'est évidemment «à raison» que la classe ouvrière ressent le besoin de descendre dans la rue pour tenter de rechercher la solidarité et l'unité face à la bourgeoisie. Ceci est vrai pour toute la classe ouvrière dans tous les pays. En Espagne, c'est une tradition, héritée en particulier de la période franquiste quand la police interdisait aux ouvriers en grève de rester dans les usines, que de manifester d'usine en usine et de rechercher immédiatement la solidarité. C'est ce qui avait déjà caractérisé les luttes massives de 1975-76 dans ce pays.
Dès le début du mouvement de cette année, des premières tentatives d'unification ont surgi dans certains secteurs de la classe ouvrière : les ouvriers agricoles de la région de Castellon ont multiplié les manifestations entraînant d'autres travailleurs et des chômeurs avec eux ; à Bilbao, les ouvriers de deux usines ont imposé contre l'avis des syndicats une manifestation commune, tout comme l'ont fait aux Canaries les travailleurs du port de Tenerife avec les ouvriers du tabac et les camionneurs. Cependant, malgré ces signes d'une poussée à la solidarité active, en février mars les syndicats parviennent à contenir l'extension et en particulier à isoler le mouvement de 20000 mineurs dans les Asturies au nord du pays : il n'y a dans ce mouvement pratiquement aucune assemblée générale qui se tient ni aucune manifestation organisée. Début avril, il semble que les syndicats vont parvenir à arrêter le mouvement grâce à ce déploiement sans précédent des tactiques de division de tous bords. Commissions Ouvrières, syndicat du PCE, UGT, syndicat du PSOE, CNT, syndicat anarchiste, et toute une kyrielle de syndicats de métier, de branche, y compris des syndicats de base comme la «Coordinadora des dockers des ports» (CEP), s'emploient à diviser par revendications, par secteurs, par régions, etc., à disperser par des arrêts de travail tournants, notamment dans les transports.
En fait, si les manœuvres syndicales parviennent à contenir le potentiel d'unification important qui existe, elles ne parviennent à étouffer la combativité à un endroit que pour la voir immédiatement ressurgir ailleurs. Beaucoup d'arrêts de travail, de courtes grèves, d'initiatives de manifestations, ont lieu hors de toute consigne syndicale et il règne dans de nombreux secteurs une ambiance de conflit larvé. La bourgeoisie, qui ne parvient pas à empêcher les travailleurs d'investir la rue, fait tout pour éviter que ceux-ci ne se rejoignent dans les manifestations et mettent en œuvre une solidarité active entre différents secteurs ; ceci par le jeu des divisions syndicales complété par l'intervention systématique des forces de police là où ces divisions ne suffisent pas. Ainsi, à certains endroits, toutes les énergies sont mobilisées dans les affrontements quasi quotidiens : dans le port de Puerto Real à Cadix, les ouvriers et beaucoup d'éléments de la population qui se joignent à eux, affrontent la police depuis plusieurs semaines ; dans les mines d'El Bierzo, près de Léon dans le nord, alors que le mécontentement se manifeste depuis -le début de l'année, depuis début mai, tous les jours il y a des bagarres avec la police auxquelles est mêlée toute la population. La mort d'un travailleur à Reinosa, zone sidérurgique près de Santander, dans des affrontements particulièrement violents, a une fois de plus tragiquement confirmé le véritable rôle de chien de garde du capitalisme qu'est, au même titre que la «droite», la «gauche» du capital, en l'occurrence le PSOE, parti «socialiste» au gouvernement.
L'engagement dans les affrontements avec la police dans les petites villes industrielles relativement isolées telles que Reinosa et Ponferrada dans le nord du pays, Puerto real dans le sud, montre la profondeur du mécontentement ouvrier, de la combativité et des tendances à s'unifier toutes catégories confondues contre le sort qui est fait aux conditions de vie des travailleurs, et contre l'envoi de la force publique. Cependant, ces affrontements systématiques constituent souvent un piège pour les travailleurs. Toutes les énergies sont mobilisées sur les seuls combats de rue, rituellement orchestrés par la police et par ceux qui, dans les rangs ouvriers, réduisent la question des objectifs et des moyens de la lutte à ces seuls affrontements. Syndicats et organismes de base «radicaux» se partagent le travail pour cette orchestration ; c'est ainsi que depuis plusieurs semaines, à Puerto Real, les combats sont «programmés» le mardi au port et le jeudi en ville ! Ce n'est pas pour rien que les médias en Europe commencent seulement à parler maintenant des événements en Espagne, et seulement sur des bagarres avec la police, alors que les luttes ouvrières se développent depuis plusieurs mois. Dans ces combats isolés contre les forces de l'ordre, les ouvriers ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent qu'épuiser leurs forces au détriment d'une recherche de l'extension, de la solidarité, hors de la région, car seules des luttes massives et unies peuvent faire face à l'appareil d'Etat, à sa police et à ses agents en milieu ouvrier.
Les tendances à l'unité des luttes simultanées, dans des luttes massives et par la prise en charge de celles-ci par les travailleurs eux-mêmes, ne trouvent pas encore leur plein épanouissement dans l'unification de la classe ouvrière. Cependant, les conditions qui ont fait surgir ces tendances — attaques massives et frontales contre la classe ouvrière, maturation de la conscience de classe sur la nécessité de lutter ensemble — sont loin d'être épuisées, ni en Espagne, ni dans aucun autre pays.
Italie : le syndicalisme de base contre la prise en mains des luttes
Les tendances à la prise en mains des luttes par les ouvriers se sont manifestées à plusieurs reprises. C'est en particulier en France, dans la grève des cheminots du début de l'année, que la nécessité et la possibilité de l'auto organisation de la lutte ouvrière ont ressurgi au grand jour. Cette expérience a eu un profond écho dans toute la classe ouvrière internationalement.
Aujourd'hui en Italie, c'est à nouveau ce besoin de la prise en mains des luttes, hors du cadre syndical traditionnel, qui est au premier plan du mouvement qui se développe dans le pays dans de nombreux secteurs : chemins de fer, transports aériens, hôpitaux, et surtout dans l'enseignement. Dans ce dernier secteur, le rejet de la convention acceptée par les syndicats a conduit à une auto organisation en comités de base, d'abord dans 120 écoles de Rome, puis à' l'échelon national. En l'espace de quelques mois, le mouvement est devenu majoritaire par rapport aux syndicats et a organisé trois assemblées nationales à Rome, Florence et Naples de délégués élus par des coordinations provinciales. A l'intérieur du mouvement se sont affrontées essentiellement la tendance à stabiliser les comités en un nouveau syndicat (Unione Comitati di Base, Cobas, majoritaire à Rome) et la tendance «assembléiste», majoritaire aux assemblées nationales, manifestant clairement un profond rejet du syndicalisme qui existe dans toute la classe ouvrière. Pour le moment, ceci s'exprime plus par un rejet généralisé de toute notion de délégué — ce qui laisse le champ plus libre au syndicalisme de base — que par une claire conscience de l'impossibilité de bâtir de nouveaux syndicats. Mais le fait que le syndicalisme, pour garder le contrôle de la mobilisation, soit contraint d'accepter les « comités de base », est significatif du lent dégagement des travailleurs de l'idéologie syndicaliste, et du besoin de prise en charge et d'unité des luttes qu'ils ressentent.
Toujours en Italie, dans les chemins de fer, le mouvement est parti d'une assemblée «autoconvoquée» à Naples qui a donné naissance à une coordination régionale, puis des organes semblables se sont constitués dans d'autres régions, pour former une coordination nationale dans une assemblée à Florence. Le besoin de l'unité s'est exprimé dans le fait que lors d'une manifestation nationale des cheminots à Rome, un tract-appel à lutter ensemble a été distribué par la minorité non syndicale du mouvement des comités de base de l'enseignement. Dans les coordinations des cheminots, dès le début, le poids des gauchistes a été très fort. Democrazia Proletaria (DP, gauche radicale du type PSU en France, mais plus important), a tout de suite essayé de canaliser le mouvement en focalisant l'attention sur le double plan «hors/dans» les syndicats, ramenant les syndicats comme préoccupation du mouvement, et poussant ainsi au second plan la question de l'unité.
La profondeur du processus d'accumulation de multiples expériences ponctuelles et de réflexion dans la classe depuis plusieurs années s'exprime de plus en plus ouvertement : par de courtes grèves «sauvages», comme celle de 4000 travailleurs de la municipalité de Palerme en Sicile ; par des regroupements pour discuter ce qu'il faut faire, comme la tenue d'une assemblée de 120 travailleurs de différentes catégories de la Fonction Publique, en mars à Milan, sur comment s'organiser face à la trahison des syndicats. Face à ce bouillonnement se développe un travail préventif de sape de la part des différentes fractions syndicalistes de base et extrême-gauche du capital. Pour la première fois en Italie, les trotskystes ont joué un rôle, dans l'enseignement. Les libertaires sont sortis de leur torpeur pour réchauffer le cadavre de l'anarcho-syndicalisme. DP fait tout un travail pour transformer les comités de base, organismes prolétariens au départ, en syndicats de base, pour contrôler la manifestation de 40000 travailleurs de l'enseignement à Rome fin mai, en polarisant l'attention sur la reconnaissance des Cobas pour «négocier» avec le gouvernement, au détriment de la jonction avec les autres secteurs qui tendent à se mobiliser.
Cependant, si la bourgeoisie, en battant le rappel de toutes les forces politiques susceptibles d'encadrer la classe ouvrière «à la base», garde le contrôle de la situation d'ensemble, la situation présente en Italie est une illustration de l'affaiblissement historique de la gauche de l'appareil politique de la bourgeoisie face à la classe ouvrière. Le Corriere della Serra, journal tout aussi «sérieux» que Le Monde, constate dans un article intitulé «Malaise incontrôlé»: «La crise des syndicats n'est pas épisodique, mais structurelle (...) ». De son point de vue bourgeois qui ne voit la classe ouvrière que dans les syndicats, il considère de ce fait «caducs les intérêts de classe» ! Mais il affirme aussitôt : «ceci ne signifie pas que les syndicats parviennent à contrôler les manifestations spontanées et centrifuges de franges (rebelles ? sauvages ? égoïstes ?) qui n'entendent pas renoncer à la défense de leurs propres intérêts» ! Et c'est bien pourquoi la bourgeoisie essaie de contrôler les mouvements :
— par le jeu de la radicalisation de la gauche, incapable désormais de se contenter du syndicalisme traditionnel complètement discrédité au yeux des ouvriers les plus combatifs de plus en plus nombreux,
— par les tentatives de jeter le discrédit sur les franges les plus combatives de la classe ouvrière, présentées comme « égoïstes ». Tout ceci ne peut néanmoins cacher la réalité de la montée de la mobilisation, ainsi décrite concassement : «les enseignants bloquent les vacances des hospitaliers qui ne soignent pas les cheminots qui ne transportent pas les employés de banque. Etc. » ! (id.).
Alors que l'Italie avait connu relativement moins que dans d'autres pays des manifestations ouvertes de la vague internationale actuelle de la lutte de classe, les luttes de ce printemps 1987 montrent que la période d'émiettement et de dispersion des luttes a aussi tiré à sa fin dans ce pays. Les attaques renforcées contre la classe ouvrière, la méfiance et le ras-le-bol accumulés vis-à-vis des syndicats, une plus grande confiance en soi des travailleurs sur la possibilité d'agir par eux-mêmes, amènent la classe ouvrière à des actions plus massives et plus décidées.
Le développement de la perspective de l'unification
Les caractéristiques générales des luttes ouvrières actuelles ne se manifestent pas seulement dans les pays industrialisés d'Europe de l'Ouest. Dans les pays de capitalisme moins développé, comme au Mexique (voir le communiqué dans ce numéro), mais aussi dans les pays de l'Est (voir également dans ce numéro), la classe ouvrière montre une combativité montante qui confirme la dimension internationale de la lutte.
En Yougoslavie également : depuis février 1987, une vague de grèves contre de nouvelles mesures gouvernementales sur les salaires (qui ont déjà baissé de 40 % en six ans), a déferlé dans le pays. La mesure consistant à faire rembourser par les travailleurs des augmentations versées depuis plusieurs mois a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ! De 20000 travailleurs à Zagreb au départ, dans l'industrie, les hôpitaux, l'enseignement, les grèves se sont ensuite étendues à la province puis à tout le pays, et à d'autres secteurs tels que les ports, les chantiers, la sidérurgie, et le secteur agricole dans la région de Belgrade. Ce mouvement que la bourgeoisie yougoslave ne parvient pas à juguler depuis trois mois, revêt des caractéristiques d'extension, de combativité et d'initiatives prises directement par les ouvriers. Et cela d'autant plus fortement que les syndicats apparaissent ouvertement comme partie de l'appareil d'Etat, comme dans tous les pays de l'Est. De là une dynamique marquée par une ébullition dans toute la classe, des mouvements décidés hors de toute consigne syndicale, des décisions collectives d'ouvriers de quitter publiquement le syndicat officiel — qui dénonce les grévistes comme «antisocialistes» —, des assemblées nombreuses où se discute et se décide l'action. Et face à cette situation les syndicats demandent une autonomie vis-à-vis du gouvernement afin de tenter de reprendre une emprise sur la classe ouvrière.
Dans tous ces événements, c'est la question de l'unification des luttes, de l'unité d'action et de la prise en mains des luttes qui se précise aussi bien en Espagne qu'en Italie, qu'en Yougoslavie. Dans les autres pays d'Europe de l'Ouest également, la classe ouvrière est loin d'être restée passive. En Belgique, les mineurs du Limbourg, qui avaient démarré le mouvement du printemps 1986 marquant le début de la nouvelle accélération dans la vague actuelle de lutte de classe, sont à nouveau repartis en lutte, dans un contexte de regain de combativité marqué par des grèves courtes dans plusieurs secteurs, après l'accalmie relative qui avait suivi le mouvement de l'an dernier. En Hollande, après que les dockers de Rotterdam aient été enfermés dans une «grève surprise» syndicale début mars, les travailleurs de la municipalité d'Amsterdam entamèrent une grève qui s'est étendue en deux jours à toute la capitale. Les syndicats avaient préparé le même scénario que pour le port de Rotterdam, mais les travailleurs ont démarré rapidement et simultanément la grève avec la menace de l'étendre aux postiers et aux chemins de fer, et ont refusé les «actions surprises» des syndicats. Cependant, sans trouver une alternative aux syndicats et avec le retrait rapide par la bourgeoisie de ses plans, les ouvriers ont alors repris le travail. Néanmoins, ce bref mouvement a marqué un changement dans le «climat social» dans le pays et approfondi la perspective du développement de luttes contre les mesures de plus en plus draconiennes que prend la bourgeoisie. En Allemagne également, face aux plans de licenciements de dizaines de milliers de travailleurs, en particulier dans la Ruhr, quelques manifestations dont une conjointe entre ouvriers de l'industrie et travailleurs municipaux, ont déjà montré que même dans ce pays où la mobilisation ouvrière est en retard par rapport à d'autres pays, des luttes ne vont pas manquer de se développer avec la plongée dans la récession de l'économie mondiale qui n'épargnera pas l'Allemagne et ses conséquences pour la classe ouvrière.
Comités de lutte : une tendance générale au regroupement des ouvriers combatifs
Particulièrement significative de la maturation qui s'opère aujourd'hui dans la classe ouvrière est l'apparition encore embryonnaire de comités de lutte, regroupant des ouvriers combatifs autour des problèmes posés par la nécessité de lutter, de préparer la lutte, ceci hors des structures syndicales traditionnelles.
Dès le printemps 1986 en Belgique, un comité s'était constitué dans les mines du Limbourg, prenant l'initiative d'envoyer des délégations pour impulser l'extension (à l'usine Ford de Gand, aux meetings de Bruxelles) ; à Charleroi également, des cheminots s'étaient regroupés pour envoyer des délégations dans d'autres gares et dans d'autres secteurs de la région comme les transports urbains ; à Bruxelles, une coordination d'enseignants (Malibran) s'était également formée, regroupant des non-syndiqués et des syndiqués avec comme perspective de «combattre la division dans les luttes». Ces comités, surgis avec la lutte du printemps 1986, ont finalement disparu avec le recul du mouvement, après avoir été progressivement vidés de leur vie ouvrière et repris en main par les syndicalistes de base.
De tels regroupements n'apparaissent pas seulement comme fruit d'une lutte ouverte. Dans une lutte ouverte ils tendent à grouper un plus grand nombre de participants, à d'autres moments ils regroupent de plus petites minorités d'ouvriers. En Italie, il existe par exemple à Naples depuis plusieurs mois un comité d'éboueurs et un comité d'hospitaliers. Ce dernier, composé d'une petite minorité de travailleurs, se réunit régulièrement et est intervenu par tracts, affiches, prises de parole dans les assemblées convoquées par les syndicats, pour l'extension, contre les propositions syndicales. Il a rencontré un écho important dans le secteur (depuis, les syndicats ne convoquent plus d'assemblées dans l'hôpital !) et même au-delà parmi des cheminots. En France aussi des comités ont surgi. Au début de l'année, les syndicats ont tout fait pour essayer d'entraîner toute la classe ouvrière dans la défaite des cheminots, en organisant une extension bidon sous la houlette de la CGT — qui n'avait cessé de condamner la grève pendant la montée de celle-ci. Face à ce sabotage, des ouvriers du gaz électricité, puis des postes, ont constitué des comités pour tirer les leçons de la lutte des cheminots, établir des contacts entre les différents lieux de travail, se préparer pour les prochaines luttes.
Même si ces premières expériences de comités de lutte en sont à leur début, même si ces comités ne parviennent pas encore à se maintenir longtemps et fluctuent fortement en fonction des événements, ceci ne veut pas dire que ce ne sont que des phénomènes éphémères liés à une situation particulière. Au contraire, ils vont tendre à se multiplier parce qu'ils correspondent à un besoin profond dans la classe ouvrière. Dans le processus vers l'unification des luttes, c'est une nécessité que les travailleurs combatifs, convaincus du besoin de l'unité dans la lutte, se regroupent :
— pour, au sein des luttes, défendre la nécessité de l'extension et de l'unification des combats,
— pour y montrer la nécessité des assemblées générales souveraines et des comités de grève et coordinations élus et révocables par les assemblées,
— pour mener en leur sein, y compris en dehors des moments de lutte ouverte, la discussion et la réflexion la plus large, dans le sens de tirer les leçons des luttes précédentes et préparer les luttes à venir,
— pour être des lieux de regroupements, ouverts à tous les ouvriers désirant y participer, quels que soient leur secteur et leur éventuelle appartenance individuelle à un syndicat.
De tels regroupements n'ont donc pas pour vocation de constituer des groupes politiques, définis par une plateforme de principes, et ils ne sont donc pas non plus des organes unitaires englobant l'ensemble des travailleurs (assemblées générales d'actifs et de chômeurs, comités élus et révocables devant les assemblées) ; ils regroupent des minorités d'ouvriers et ne sont pas des délégations des organes unitaires.
En 1985, avec une relative dispersion des luttes, la méfiance grandissante envers les syndicats avait entraîné beaucoup de travailleurs à rester dans l'expectative, écœurés des manœuvres syndicales, et passifs vis-à-vis de l'action. L'accélération de la lutte de classe en 1986 a été marquée non seulement par les tendances à des luttes plus massives et à la prise en charge de celles-ci par les travailleurs, mais également par des tentatives plus nombreuses de la part de minorités combatives dans la classe, de se regrouper pour agir dans la situation. Les premières expériences de comités de lutte correspondent à cette dynamique : une plus grande détermination et confiance en soi, qui va se développer de plus en plus dans la classe ouvrière, et amener des regroupements de travailleurs sur le terrain de la lutte, hors du cadre syndical. Et ce n'est pas seulement une possibilité, mais une nécessité impérieuse pour développer la capacité de la classe ouvrière à trouver son unité, contre les manœuvres qui visent à enrayer le processus d'unification du prolétariat,
Cela, la bourgeoisie l'a bien compris. Le principal danger qui guette les comités de lutte est celui du syndicalisme. Les syndicalistes et gauchistes se font aujourd'hui les promoteurs de «comités de lutte». En y introduisant critères d'appartenance, plate-forme, voire cartes d'adhésion, ils ne font que tenter de recréer une variante de syndicalisme. En les maintenant dans le cadre corporatiste et les autoproclamant «représentatifs», alors qu'ils ne sont que l'émanation de ceux qui y participent et non d'assemblées de l'ensemble des ouvriers, ils les ramènent également sur le terrain du syndicalisme. Par exemple, dans le Limbourg en Belgique, les maoïstes réussirent à dénaturer la réalité du comité de lutte des mineurs en le proclamant «comité de grève» et le transformant ainsi en obstacle à la tenue d'assemblées générales de tous les travailleurs. En France des militants de la CNT (anarcho-syndicaliste) et des éléments venant de l'ex-PCI-Programme Communiste (aujourd'hui disparu en France), ont tenté une opération de récupération des comités des postiers et du gaz électricité. Ils proposèrent une plate-forme d'adhésion «pour un renouveau du syndicalisme de classe», reproduisant de façon «radicale» les mêmes objectifs et moyens que n'importe quel syndicat. Et contre le principe défendu par le CCI de la nécessaire ouverture à tout ouvrier désirant participer, un élément de la CNT opposa même le «danger de voir dans ces comités trop d'ouvriers "incontrôlés"» !.
Malgré les difficultés qu'il y a à constituer et faire vivre de tels groupes ouvriers, malgré le danger constant qu'ils soient tués dans l'œuf par le syndicalisme de base, les comités de lutte seront partie intégrante du processus de constitution du prolétariat en classe unie, autonome, indépendante de toutes les autres classes de la société. Tout comme l'extension et l'auto organisation de la lutte, le soutien et l'impulsion de tels comités doivent être défendus par les groupes révolutionnaires : leur développement est une condition de l'unification des luttes ouvrières.
MG. 31/5/87
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Heritage de la Gauche Communiste:
Où en est la crise économique ? : Crise et lutte de classe dans les pays de l'est
- 3081 reads
Récession, inflation, endettement, misère accrue pour la classe ouvrière : comme à l’Ouest, la crise se développe en force au sein du bloc de l’Est les vieilles rengaines staliniennes et trotskystes sur la nature «socialiste» des pays ou de certains pays du bloc russe, sur L’absence de crise, succombent sous l’évidence des faits. Non seulement la crise à l’Est, étant donné le relatif sous-développement de l’économie, prend une forme particulièrement brutale, mais le développement de la lutte de classe montre clairement la nature anti-ouvrière, bourgeoise, de ces régimes. La crise économique et sociale qu'ils subissent montrent qu'ils sont partie intégrante du capitalisme mondial
Dans le précédent numéro de la Revue Internationale du CCI (n° 49), la rubrique régulière sur la crise économique a été consacrée à la crise en URSS ; dans ce numéro nous continuons notre état des lieux du bloc de l’Est en traitant des autres pays d'Europe intégrés au COMECON. ([1] [81])
La faiblesse économique du bloc de l'Est
Les six pays européens du bloc de l'Est : RDA, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie constituent après l'URSS les pays les plus puissants économiquement de ce bloc. Cela permet de constater sa faiblesse profonde vis-à-vis de son rival occidental : le PNB global des 6 pays d'Europe de l'Est, égal en 1984 à 507 milliards de dollars, est à peine supérieur à celui de la France la même année : 496 milliards de dollars, et bien inférieur à celui de la RFA : 616 milliards de dollars ?
|
|
PNB 1984 |
PNB/habitant |
|
|
(milliards de dollars) |
(dollars) |
|
RDA |
145 |
8680 |
|
POLOGNE |
160 |
4370 |
|
TCHECOSLOVAQUIE |
100 |
6485 |
|
HONGRIE |
20 |
1902 |
|
BULGARIE |
43 |
4790 |
|
ROUMANIE |
39 |
1750 |
|
URSS |
500 |
5500 |
L'ensemble des pays du COMECON (avec le Vietnam et Cuba) totalise un PNB de 2020 milliards de dollars, ce qui est bien peu en comparaison de l'alliance économique rivale regroupée au sein de l'OCDE qui avec ses 8193,4 milliards de dollars, totalise quatre fois plus. A eux seuls, les pays de la CEE en 1984 représentaient un PNB de 2364 milliards de dollars, encore bien supérieur à celui du COMECON dans son ensemble.
Et encore faut-il relativiser les chiffres en provenance d'Europe de l'Est car ceux-ci selon certaines études ([2] [82]), sont pour les besoins de la propagande et à cause d'un mode de comptabilité bien différent, surestimés de 25 à 30%, à l'exception toutefois de la Hongrie qui appartient au FMI et qui, pour pouvoir accéder aux crédits pour pays pauvres, diminue volontairement de 50 % ses estimations !
Ce n'est donc certainement pas sur le plan économique que le bloc de l'Est peut faire le poids face à son concurrent occidental. La seule issue pour l'URSS, afin de maintenir l'indépendance et l'unité de son bloc impérialiste, est de soumettre de manière draconienne le potentiel économique de celui-ci aux besoins de son économie de guerre. La production d'armements, nécessaire au renforcement de son potentiel militaire, est le seul plan sur lequel il peut concurrencer et s'opposer à la puissance du bloc adverse. Cette réalité détermine profondément la situation économique des pays d'Europe de l'Est depuis qu'à la fin de la seconde guerre mondiale, l'avancée de l'armée rouge et les accords de Yalta ont scellé leur soumission aux besoins de l'impérialisme russe.
Les pays d'Europe de l'Est ont payé très cher dans leur développement leur intégration au bloc russe. La réalité est bien différente de celle que voudraient faire croire les taux de croissance ronflants que nous servent les économistes staliniens depuis des décennies.
Le démantèlement des usines les plus compétitives pour en envoyer les machines en URSS au lendemain de la guerre, la réorientation à 180 degrés vers l'Est de toutes les voies de communication et des circuits d'échange traditionnels , la «collectivisation» forcée, le pillage systématique et l'imposition d'une division internationale de la production au sein du bloc pour les besoins de l'économie de guerre russe ont pesé très lourdement sur la croissance réelle de l'économie des pays d'Europe de l'Est. Sur ce plan, la Tchécoslovaquie est un cas tout à fait exemplaire : en 1963 le niveau de la production agricole était encore inférieur à celui de 1938, mais c'est surtout sur le plan industriel que cette dégradation est la plus nette, pour le pays qui avant la seconde guerre mondiale était connu pour la qualité de ses produits. Ainsi, en 1980, un Institut tchèque a réalisé une étude sur 196 produits portant le label «1re qualité» et destinés à l'exportation ; 113 étaient invendables à l'ouest car ils ne correspondaient pas aux critères de qualité requis. Les dirigeants russes eux-mêmes ont élevé une protestation officielle à propos de la mauvaise qualité des produits que l'URSS importe de Tchécoslovaquie.
|
|
Consommation énergétique (*) |
Consommation d'énergie par unité de PNB |
|
RDA |
86 |
0,61 |
|
POLOGNE |
114 |
0,71 |
|
TCHECOSLOVAQUIE |
69 |
0,69 |
|
HONGRIE |
28 |
1,35 |
|
BULGARIE |
37 |
0,90 |
|
ROUMANIE |
70 |
1,57 |
(*) millions de tonnes équivalent pétrole
La croissance industrielle des pays d'Europe de l'Est s'est faite sur la base d'une perte de qualité des produits, d'un retard technologique croissant qui se caractérise par le fait que l'essentiel des marchandises produites est considéré comme périmé selon les standards du commerce international et donc invendable sur le marché mondial en dehors du COMECON. Ce retard technologique pris par la production dans les pays d'Europe de l'Est ne se manifeste pas seulement par l'obsolescence de l'appareil productif (machines-outils périmées, recours abondant à la main-d'œuvre pour pallier le retard pris dans l'automatisation) et de ce qui est produit, mais aussi dans le gaspillage énergétique nécessaire à cette production.
Si l'on considère l'énergie nécessaire à la production d'une unité de PNB, le pays le plus compétitif d'Europe de l'Est arrive péniblement au niveau du Portugal (0,60), derrière la Grèce (0,54) et loin derrière la RFA (0,38) ou la France (0,36). Et encore faut-il considérer ces chiffres à la lumière de ce que nous avons dit auparavant sur l'estimation du PNB, c'est-à-dire les majorer de 25 à 30%. Cela traduit parfaitement le retard industriel inacceptable accumulé par les pays de l'Est durant les décennies de «croissance» de l'après-guerre par rapport à leurs concurrents ouest européens. Le développement des pays de l'Est depuis la deuxième guerre mondiale s'est fait dans une situation de crise permanente.
Convulsions de la crise du capital et réactions ouvrières
La crise, depuis la fin des années 60, a pris à l'Est des formes moins «dynamiques» et spectaculaires qu'à l'Ouest qui constitue l'épicentre de la surproduction généralisée. Dans les années 70, la crise a été marquée en Europe de l'Est par un ralentissement général de la croissance, et pour les pays les plus faibles (Pologne, Roumanie), par un endettement croissant en vue de tenter de moderniser une économie encore largement marquée par un important secteur agricole arriéré. L'accélération de la crise dans les années 80 va avoir de graves conséquences pour l'ensemble des pays d'Europe de l'Est : la chute des échanges Est-ouest, l'épuisement des sources de crédit, la chute des cours des matières premières, l'effondrement du marché du «Tiers-monde», et la concurrence exacerbée sur le marché mondial, l'intensification de la course aux armements menacent d'étrangler l'économie du COMECON.
Les attaques de la bourgeoisie contre les conditions de vie de la classe ouvrière déjà très difficiles se font chaque jour plus aiguës. Le mécontentement croît et l'écho des luttes ouvrières commence à percer le mur du silence qu'impose la bourgeoisie stalinienne.
Roumanie
Après avoir été en cessation de paiement en 1981, la Roumanie a vécu au rythme du remboursement accéléré de la dette passée de 9,9 milliards de dollars en 1981 à 6,5 fin 1985. Pour aboutir à ce résultat, un rationnement brutal et une intensification violente de l'exploitation ont été imposés à la population.
En deux ans (1984-85), la consommation d'électricité des familles a été diminuée de moitié pour aboutir à ce résultat : limitation du chauffage à 12° dans les maisons et les bureaux, interdiction d'utiliser des ampoules de plus de 15 watts, programmes de télévision ramenés à deux heures par jour. La liste des rassures bureaucratiques imposées par la terreur policière n'a pas de fin : interdiction de circulation des voitures privées à Bucarest pour économiser l'essence, rationnement drastique des produits alimentaires pour diminuer les importations et stimuler les exportations ; fin 86, face à la crise du logement, Ceausescu a demandé aux vieux retraités de Bucarest de déménager à la campagne ; devant la résistance de la population, il a annoncé durant l'été que «certaines catégories» de retraités se verraient refuser leur traitement médical s'ils ne déménageaient pas.
Symptômes soigneusement cachés par la bourgeoisie, la mortalité augmente et la famine gagne. En décembre 85, des paysans affamés du Banat ont tenté de s'emparer des silos à blé, témoignant du mécontentement profond de la population.
Les ouvriers sont soumis à une exploitation forcenée : suppression du salaire garanti en septembre 1983, obligation décrétée en juin 85, pour ceux qui n'auraient pas fait don d'une journée de travail, de dédommager l'Etat en espèces. Les «accidents» du travail se sont multipliés dans les mines et le grand chantier de la canalisation de la Volga a coûté des centaines de vies ouvrières.
Le mécontentement de la classe ouvrière s'est concrétisé dans les grèves qui ont duré plusieurs mois dans les mines de charbon et dans l'industrie pétrochimique en 1983-84. La répression a été brutale et sanglante, la militarisation du travail a été imposée dans ces secteurs ; cette mesure a été étendue en octobre 85 aux ouvriers des centrales qui produisent l'électricité. Des grèves éparses ont éclaté en novembre 1986 dans plusieurs villes de Transylvanie, contre le nouveau système de salaire. Au début de Tannée 1987, des tracts circulaient à Bucarest appelant à la grève générale pour renverser Ceausescu.
Pologne
L'économie polonaise s'enfonce dans l'abîme. Le revenu national a baissé de 30 % entre 1978 et 1982 ; il reste encore officiellement inférieur de 10 % à celui de 1979. Les taux de croissance positifs annoncés depuis 1983 sont à relativiser : par exemple, en 1983, le taux de croissance officiel annoncé est de 5,9 % mais il est estimé à seulement -0,7 % par l'OCDE. L'économie polonaise est en pleine récession.
La chute des cours du charbon (dont la Pologne est le 3e exportateur mondial) de - 25 % en 1986 et l'empoisonnement de la récolte par les retombées radioactives de la catastrophe de Tchernobyl ont de graves conséquences sur les exportations qui ont déjà chuté vis à vis de l'Occident de 3,8 % en 1985. Malgré des dévaluations successives du zloty, la monnaie nationale (plus de 30 % de dévaluation en 1984-85), pour renforcer la compétitivité des exportations, et une diminution drastique des importations, l'excédent commercial dégagé n'est même pas suffisant pour payer le service de la dette et celle-ci s'accroît allègrement : elle est passée de 29,5 milliards de dollars en 1985 à 33,4 en 1986 et vole vers les 35 en 1987.
L'inflation fait rage et les augmentations des prix se succèdent en cascade : en mars 86, les biens alimentaires essentiels sont devenus 8 % plus chers, le prix des autobus et des transports a grimpé de -66 % ; le 7 avril 86, le gaz et l'électricité ont augmenté de -80 % ; en août, c'est au tour de la viande : S %. Entre 1982 et 1986, le prix du pain a explosé de 3 à 28 zlotys.
Dans le même mouvement, les salaires ont été attaqués avec la réforme sur la «nouvelle autonomie des entreprises». Le travail le week-end, annulé par les accords d'août 80, a été rétabli dans les secteurs «vitaux» tels les mines. Avec l'intensification de l’exploitation, les normes de sécurité ne sont plus respectées et les accidents du travail se sont multipliés.
Face au mécontentement qui gronde, le gouvernement Jaruzelski a fait siennes les orientations de Gorbatchev : après la répression, les amnisties se sont succédées et la bourgeoisie essaie de présenter un visage plus libéral, Solidarnosc est toléré ; mais tout cela, c'est pour mieux faire accepter les attaques contre la classe ouvrière.
Bulgarie
La Bulgarie elle aussi est touchée par la récession. Si les estimations officielles de la croissance du PNB se situent à 4 % en 1982 et à 3 % en 1983, l'OCDE quant à elle les estime plus justement, respectivement pour ces deux années là, à : - 0,7 % et -0,2 %. En 1985, la production agricole a reculé de - 10 % et celle d'électricité de - 7 %, au lieu des 4,1 % prévus. La croissance a officiellement été revue à la baisse : 1,8 % finalement, le taux le plus bas depuis la guerre. Les hausses de prix s'accélèrent : en septembre 85, l'électricité a été augmentée de 41 % pour les ménages, l'essence de 35 %...
Pour économiser l'électricité, les coupures de courant se sont multipliées et le rationnement a été imposé : consommation électrique ramenée à 350 KWh par mois et par ménage là où un chauffage collectif existe, à 1100 KWh là où il n'existe pas, toujours dans le même but ; la fermeture des magasins a été avancée de deux heures, l'éclairage limité à des ampoules de 60 W dans les salons et de 45 W dans les autres pièces. En cas de désobéissance, c'est la coupure d'électricité.
Le mécontentement gronde et la bourgeoisie essaie de le dévier sur la question des minorités nationales en réprimant sauvagement la minorité turque pour en faire un bouc émissaire et renforcer le nationalisme. L'écho encore à confirmer de grèves durant l'hiver 86-87 est venu percer le black-out.
Hongrie
Vitrine libérale de l'Europe de l'Est, la Hongrie elle aussi s'enfonce de manière accélérée dans la crise. La croissance officiellement de -0,3 % en 83, de 2,8 % en 1984 a rechuté à 0,6 % en 1985 et il semble bien qu'elle soit inférieure à 1 % en 1986.
En 1986, les exportations vers l'Ouest ont stagné et l'année 1987 s'annonce mal ; alors que la Hongrie est essentiellement un exportateur agricole, les retombées de Tchernobyl ont rendu sa récolte invendable à l'Ouest tandis que l'entrée de l'Espagne dans le Marché Commun vient de lui rétrécir son principal marché occidental : la CEE.
Le taux d'inflation officiel est de 7 %. Les augmentations de prix tombent en cascade ; en 1985 les transports ont augmenté de 100 % ; les tarifs des postes de 85 % et la tendance s'est accélérée en 1986, rognant constamment le niveau de vie des ouvriers et des retraités.
L'attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière se fait de plus en plus vive ; en décembre 86, le conseil des ministres appelle à un gel des salaires de base, de nouveaux critères de qualité et de rendement qui diminuent les primes sont imposés. Les ouvriers ne peuvent maintenir leur niveau de vie qu'en cumulant des emplois et en doublant leur temps de travail.
Le modèle hongrois au niveau de consommation relativement haut a été une exception en Europe de l'Est qui atteint aujourd'hui ses limites, une chimère basée sur un endettement par tête vis à vis de l'Ouest plus élevé que celui de Pologne. Les attaques contre la classe ouvrière ne peuvent aller qu'en s'intensifiant, ce qui va exacerber le mécontentement croissant de la population. Les grèves de mineurs, dans la région de Tababanya, sont significatives de la tendance de la classe ouvrière en Hongrie à reprendre le chemin du combat de classe.
Tchécoslovaquie et RDA
La Tchécoslovaquie et la RDA sont les pays de l'Europe de l'Est les plus développés industriellement et qui ont le mieux résisté aux effets dévastateurs de la crise. Cependant, les signes de la crise qui les secoue, se font de plus en plus nets : la croissance stagne et la récession s'annonce. Pour la RDA la croissance officielle de 2,5 % en 1982 et de 4,4 % en 1983 est revue à la baisse par l'OCDE : respectivement 0,2 % et 0,8 %. le taux officiel de 4,8 % en 1985 est profondément surévalué. De même, en Tchécoslovaquie, les taux officiels de 0 % en 1982 et de 1,5 % en 1983, ce dernier taux revu à la baisse à 0,1 % par l'OCDE, montrent qu'en fait ce pays plus faible que la RDA a entamé la récession.
Si ces deux pays ont jusqu'à présent relativement bien défendu leurs exportations sur le marché mondial, l'avenir est cependant sombre étant donnée la perspective de rétrécissement du marché ouest-européen lui aussi touché par la crise et qui reste le principal domaine d'exportation en Occident pour ces deux pays. La Tchécoslovaquie dont la production de produits manufacturés est de plus en plus périmée et inexportable, n'a pu rétablir sa balance commerciale qu'en vendant de plus en plus de produits semi-finis à moins faible valeur ajoutée.
L'endettement, croissant de la RDA vis à vis de l'Occident : 13 milliards de dollars en 1985, et de la Tchécoslovaquie vis à vis de l'URSS : 15 milliards de couronnes, pèse lourdement sur ces deux pays et le redressement des comptes implique à terme une attaque renforcée contre les conditions de vie des travailleurs.
Le niveau de vie en RDA et en Tchécoslovaquie est le plus élevé d'Europe de l'Est ; le PNB par habitant était respectivement de 8680 dollars et de 6485 dollars en 1984, soit des niveaux comparables à ceux de l'Autriche (8685) ou de l'Italie (6190). Cette situation « privilégiée » sur le plan du bien-être matériel en Europe de l'Est, conjuguée avec un quadrillage militaire et policier, a permis jusqu'à présent de maintenir un relatif calme social.
Cependant, ce constat reste à relativiser :
— sur le plan du niveau de vie, pour comparer réellement avec l'Ouest, il faut diminuer les chiffres du PNB de 25 à 30 %. De plus, le PNB calcule la production et non la consommation, et ne tient pas compte de la cherté et de la mauvaise qualité des produits de consommation, ni du cadre militarisé d'une tristesse qu'aucun indice ne saurait mesurer. 150 allemands de l'Est passent clandestinement à l'Ouest chaque jour, 50 000 par an pour fuir le pays qui a le « meilleur » niveau de vie de toute l'Europe de l'Est.
— la perspective est à la dégradation économique, non seulement pour la Tchécoslovaquie, mais aussi pour la RDA qui a jusqu'à présent le mieux résisté. Les attaques contre la classe ouvrière vont en s'accroissant. Le dernier congrès du parti en RDA a annoncé 1 million de licenciements. Cela ne va pas créer du chômage étant donnée la pénurie chronique de main-d'œuvre et la réembauche obligatoire, mais cela permet d'imposer aux ouvriers des emplois moins bien rémunérés. Là encore, le cumul des emplois, le travail parallèle, est le seul moyen pour les ouvriers de maintenir leur niveau de vie. Le mécontentement croît et même s'il s'exprime encore de manière mystifiée, par les campagnes « d'opposition » démocratique et religieuse, il est significatif des futures luttes de classe à venir.
Comme le reste du capitalisme mondial, l'Europe de l'Est s'enfonce inexorablement dans la crise. Comme à l'Ouest, les attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière se font de plus en plus drastiques ramenant le niveau de vie de la classe ouvrière vers celui des années noires de l'après-guerre et de la guerre.
Le mécontentement partout s'accroît, et peu à peu s'impose à l'Est l'écho de la lutte de classe. Avec retard et difficulté, le prolétariat d’Europe de l'Est tend à s'intégrer dans la reprise internationale de la lutte de classe. C'est pour faire face à cette perspective que la bourgeoisie russe, sous l'impulsion de Gorbatchev, essaie d'imposer une fausse libéralisation afin d'utiliser au mieux les mystifications démocratiques, religieuses et nationalistes en vue de briser l'élan naissant de la lutte de classe. Cependant, l'expérience encore récente de la répression en Pologne est là pour montrer aux ouvriers le mensonge du cours nouveau de la propagande stalinienne à la sauce Gorbatchev. En Pologne, le difficile processus de tirer les leçons est en train de se faire ; cela prend souvent la forme de l'affirmation des luttes défensives sur le terrain de classe contre les «aventures politiques» de Solidarnosc et sa collaboration avec Jaruzelski. Aujourd'hui, Walesa est ouvertement contesté et critiqué. Si la classe ouvrière en Pologne a subi une défaite, pour autant son potentiel de combativité est encore très fort et les expériences répétées de 1970-76-80 sont un gage de la capacité du prolétariat polonais à développer ses luttes dans le futur.
La perspective du développement des luttes en Europe de l'Est, faisant écho à celles qui se mènent à l'Ouest, va poser de plus en plus la question de l'internationalisme prolétarien et de la solidarité ouvrière par-delà la division du monde en deux blocs militaires antagonistes, notamment avec le développement de ces luttes dans les pays plus développés, la Tchécoslovaquie et surtout la RDA, en contact direct avec les grandes concentrations industrielles d'Europe de l'Ouest.
JJ. 29/05/87
[1] [83] Nous ne traitons pas dans ces articles des racines historiques du capitalisme russe et de son histoire qui déterminent les caractéristiques présentes qui sont celles du bloc russe avec ses spécificités ; pour cela, nous renvoyons nos lecteurs à d'autres textes publiés précédemment par le CCI, parmi d'autres la brochure «La décadence du capitalisme», l'article «La crise dans les pays de l'Est» (Revue Internationale n° 23).
[2] [84] «The Soviet Union and Eastern Europe in the World Economy», P. Marer
Récent et en cours:
- Crise économique [7]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : le développement de la vie politique et des luttes ouvrières au Mexique
- 2705 reads
Le capitalisme est un tout. La crise chronique du capitalisme touche tous les pays du monde. Partout les gouvernements aux abois ont recours à la même politique, aux mêmes mesures : attaque forcenée et frontale contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Partout la classe ouvrière riposte en s'engageant dans la lutte pour la défense de ses intérêts vitaux et partout la lutte prend de plus en plus un caractère massif. Et partout aussi les ouvriers se trouvent face à un ennemi qui a raffiné sa stratégie : le gouvernement attaque de front, pendant que la «gauche», les syndicats et les gauchistes se chargent de saboter les luttes de l'intérieur, briser et diviser l'unité ouvrière et s'emploient, avec un langage «radical», à dévoyer les luttes dans des impasses, assurant leurs défaites.
A l’encontre des divagations de tous les pessimistes et les déçus pour ce qui concerne la classe ouvrière et sa combativité, de ceux qui la cherchent sur la «Banquise» où ils se trouvent eux-mêmes (les modernistes) ou encore ceux qui, comme le GCI, passent leur temps à se plaindre de la classe ouvrière qu'ils voient toujours «passive et amorphe», les nouvelles qui nous arrivent du Mexique viennent leur porter un démenti et confirmer pleinement nos analyses sur le développement de la 3e vague de luttes qui atteint aussi bien les pays de l'Amérique Latine que ceux d'Europe.
Nous publions ci-dessous des extraits d'un communiqué adressé à tous les ouvriers et à tous les groupes révolutionnaires du monde par le «Collectif Communiste Alptraum» (CCA) sur les dernières luttes au Mexique. Ce groupe est peu connu en Europe. Aussi estimons-nous nécessaire de donner à nos lecteurs quelques informations à son sujet. Le CCA s'est constitué au début des années 1980 comme un groupe marxiste d'étude et de discussions. Sa trajectoire a été une évolution lente et hésitante à devenir pleinement un groupe d'intervention politique. Cette évolution lente n'est pas seulement due à des «hésitations» devant les difficultés venant de l'ambiance politique pourrie qui règne au Mexique mais est, d'une certaine manière, le témoignage du sérieux, du sens des responsabilités de ces camarades cherchant à s'assurer un fondement théorique politique solide avant de se lancer dans une activité publique. Dans ce sens, c'est une leçon salutaire pour tant de petits groupes qui se laissent enivrer imprudemment par le seul goût de l'«action pratique», courant toujours le risque d'une vie éphémère et se perdant souvent dans la superficialité et la confusion.
Depuis 1986, le CCA — avec lequel nous sommes en étroite relation (voir Revue Internationale n° 40 et 44) — devenu un groupe politique à part entière, publie régulièrement la revue Comunismo avec un contenu aussi intéressant que sérieux. Nous sommes certains que les lecteurs liront avec un grand intérêt ce communiqué sur la situation au Mexique et la lutte ouvrière qui s'y développe. Intégrant la situation au Mexique dans le contexte international, l'analyse que fait le CCA emprunte la même démarche et tire les mêmes conclusions que nous.
Nous saluons le CCA, non seulement pour le contenu juste de ce communiqué mais également pour le souci qui les a guidés en l'adressant pour information aux révolutionnaires et aux ouvriers de tous les pays.
Simultanément au communiqué du CCA nous recevons du Mexique le premier numéro de la revue Revolucion mundial publiée par le Grupo Proletario Internacionalista (GPI). Le GPI a été constitué définitivement en décembre 1986 par un certain nombre d'éléments qui ont parcouru un «pénible et long processus de décantation politique». C'est un groupe d'éléments solidement formés politiquement et foncièrement militants. La place nous manque dans ce numéro pour donner une plus ample information sur ce nouveau groupe et sur ses positions, nous ne manquerons pas dans notre prochain numéro de reproduire de larges extraits de leurs travaux théoriques et prises de positions politiques. Pour le moment nous nous contenterons de donner l'extrait suivant de la présentation de leur revue :
«C'est dans cette situation de "croisée des chemins" historique et sous l'influence politique de la propagande communiste qu'est né le Grupo Proletario Internacionalista. C'est aussi dans ce cadre que voit le jour "Revolucion Mundial". Cette publication est le produit d'un pénible et long processus de décantation politique d'une période dédiée fondamentalement à la discussion, à la clarification, d'effort de rupture avec tout type de pratiques et influences bourgeoises ».
Nous ne pouvons qu'exprimer notre grande satisfaction de voir les rangs révolutionnaires se renforcer avec la venue au jour de ce nouveau groupe communiste. Avec la venue de ce groupe s'ouvre une perspective, après les nécessaires discussions et confrontations des positions, d'un processus de regroupement des forces révolutionnaires au Mexique dont l'importance et l'impact dépasseront largement les frontières de ce pays. Nous en sommes convaincus et ferons tout notre possible pour aider ce processus à se conclure positivement.
Nos chaleureuses salutations communistes au Grupo Proletario Internacionalista.
Le CCI
A TOUTES LES ORGANISATIONS REVOLUTIONNAIRES DANS LE MONDE AU PROLETARIAT INTERNATIONAL
COMUNISMO (MEXICO)
(...) La misère croissante du prolétariat est devenue palpable avec la réduction et la liquidation des «programmes sociaux» de l'Etat, principalement dans les aires centrales du capitalisme ; avec la croissance accélérée de l'armée de réserve industrielle surtout en Europe, avec l'augmentation du taux d'exploitation dans toutes les aires capitalistes qui, dans le cas des pays de la périphérie, se combinent avec de très hauts taux d'inflation et rendent encore plus pénible l'existence du prolétariat.
(...) Le prolétariat mexicain n'a pas fait exception; La fraction mexicaine de la bourgeoisie mondiale a appliqué les mesures nécessaires pour maintenir les intérêts du capital mondial dans son ensemble.
(...) Au cours des trois dernières années, l'Etat a fermé des entreprises dans les secteurs de la sidérurgie, des transports et communications, des docks, des automotrices, des engrais, du sucre, ainsi que du secteur de l'administration centrale. Les subventions d'Etat à l'alimentation de base ont été suspendues et les dépenses pour l'éducation et la santé ont été fortement diminuées.
Une des mesures prises par l'Etat et appliquée de manière générale a été celle de maintenir les augmentations de salaire de tous les travailleurs en dessous du niveau de l'inflation et faire que les salaires accordés dans les contrats collectifs de travail soient toujours plus près du minimum légal. Pour donner une idée générale de la situation du prolétariat au Mexique, nous indiquerons quelques chiffres des statistiques bourgeoises :
— 6 millions de chômeurs, soit 19 % de la population active ;
— 4 millions de «sous-emplois» ;
— le salaire minimum légal est passé de 120 dollars par mois en 1985 à 87 dollars par mois en 1986 ;
— plus de 50 % des salariés recevaient en 1986 le salaire minimum légal.
(...) Pour 1987, étant donné le processus d'accélération de la dévaluation et l'accélération de la croissance du taux d'inflation (115% annuel), la détérioration des salaires est encore plus grande, tandis que le nombre de chômeurs n'arrête pas d'augmenter.
La baisse importante des conditions de vie du prolétariat au Mexique dans les trois dernières années a atteint un point extrême au début de 1987. Ainsi par exemple, la situation salariale des ouvriers du secteur de l'électricité est l'illustration de ce qui arrive dans le secteur public. Après avoir perçu en 1982 des salaires qui allaient jusqu'à 11,5 fois le salaire minimum légal, en 1987 ils ne recevaient plus que 4 fois ce minimum légal.
L'inquiétude parmi les travailleurs du secteur public se faisait déjà sentir l'an dernier. La grande majorité des syndicats a réalisé les révisions du contrat collectif et fixé les salaires professionnels entre janvier et avril. La pression croissante des travailleurs pour demander des salaires plus élevés laissait prévoir aux syndicats du secteur public qu'il y aurait des mobilisations qui risquaient d'échapper à leur contrôle. En février, l'Etat a fait savoir aux travailleurs, à travers les syndicats, qu'«il n'y avait pas de fonds» pour couvrir la demande d'augmentation salariale d'«urgence» que les syndicats avaient fixée à 23 % (au Mexique le taux annuel de l'inflation dépasse les 110%).
En dépit des coups durs portés au prolétariat à DINA, RENAULT et FUNDIDORA de Monterrey (FUMOSA) en 1986, et immédiatement après que se soit terminée la grève des étudiants à Mexico — conflit typique des classes moyennes et avec lequel la bourgeoisie et la petite-bourgeoise ont tenté de donner au prolétariat une «leçon» sur les «bontés» de la démocratie bourgeoise — au milieu de la crise économique la plus aiguë de tous les temps, les électriciens (36000 au total) entamèrent le 28 février une grève dans la zone centrale du pays qui englobe le District Fédéral (Mexico) et les quatre départements qui l'entourent. Cela signifiait toucher un nerf central de l'appareil productif, étant donné que c'est la zone industrielle et concentration ouvrière la plus importante du pays.
(...) La grève n'a duré que cinq jours, et les ouvriers ont été ramenés au travail sans rien obtenir. Mais dans ce bref laps de temps s'est exprimée plus nettement une série de tendances qui sont apparues dans les mobilisations actuelles du prolétariat, en Europe principalement, et dont certaines existaient déjà en germe dans la lutte à FUMOSA. Dans la grève de l'électricité s'est manifestée la tendance ouvrière à lutter massivement, avec de fortes possibilités d'extension à d'autres secteurs du prolétariat, comme cela s'est vu récemment en Belgique, en France et en Espagne. Un autre aspect significatif de cette grève a été sa durée réduite dans le temps, à la différence de celle de FUMOSA qui avait duré près de deux mois. Les particularités de la grève sont les suivantes :
1. A la différence de ce qui est arrivé à DINA, RENAULT et FUMOSA l'année dernière, où les conflits ont duré plus longtemps, la grève des électriciens a pris immédiatement un caractère politique. Deux heures avant l'éclatement de la grève, l'Etat, par ordre présidentiel, a réquisitionné les installations de la Compagnie d'Electricité «pour sauvegarder l'intérêt national». Certaines installations de production d'énergie électrique ont été occupées et gardées par les forces de l'ordre. L'armée était prête à intervenir à tout moment. Devant le caractère clairement politique acquis par la grève, le syndicat, avec l'aide de la gauche du capital, n'a fait que marteler dans la tête des ouvriers que le mouvement «était une affaire nationale de défense du droit, de la légalité, de la Constitution», de la «souveraineté nationale», etc.
(...) En insistant en permanence sur le fait « qu'on ne peut déclarer la grève illégale que si on prouve qu'il y a eu des actes de violence de la part des travailleurs », le syndicat a empêché la mise en place de la plupart des piquets de grève ainsi que l'appel à se joindre à la grève aux travailleurs non syndiqués et des autres agences (transformés par décret en « jaunes ») qui ont été amenés à travailler à leur place.
2. (...) Le syndicat a montré une grande capacité de flexibilité pour s'adapter aux conditions que lui a imposées le mouvement des ouvriers afin de le récupérer, le canaliser et le soumettre.
Les syndicats qui sont plus étroitement et plus ouvertement liés à l'appareil de l'Etat ont plus de possibilité de perdre leur crédibilité aux yeux des ouvriers avec des actes aussi brutaux que celui qu'ils ont commis à FUMOSA (14000 licenciements directs et 40000 indirects) ; c'est à cause de cela que doivent entrer en jeu les tendances de gauche du capital et les gauchistes, afin de maintenir l'ordre et ramener la mobilisation sur les rails de la «paix sociale».
Dans ce cas, et contrairement à ce qui était arrivé à FUMOSA où les ouvriers étaient assujettis à un syndicat , clairement identifié par eux comme faisant partie de la structure étatique, le syndicat mexicain des électriciens (SME) est un syndicat « démocratique » qui en plus fait , le pont entre le syndicalisme officiel et le syndicalisme de base («de classe») animé par la gauche du capital et les gauchistes. Pour cela même, depuis la première minute de la grève, le syndicat n'a pas cessé de marteler aux ouvriers l'idée que « l'organisation syndicale était en péril», raison pour laquelle il était nécessaire de se plier aux décisions du Comité Central du syndicat. Cela a permis au SME de se mouvoir de droite à gauche et vice versa, radicalisant son langage en même temps qu'il manipulait des consignes dans un sens purement idéologique nationaliste.
Les ouvriers se sont laissés littéralement mener par ce que décidait le SME : dans leur grande majorité ils ont quitté les lieux de travail et se sont concentrés autour de l'immeuble du syndicat... immobilisés tout le temps pour «éviter la violence»... et ont laissé le syndicat chercher la «solidarité»... des autres syndicats. Le SME a fait exactement la même chose que les syndicats des automotrices et des mineurs à DINA, RENAULT et FUMOSA enfermant les ouvriers dans le pire corporatisme, les isolant du reste des ouvriers et maintenant le conflit dans les strictes limites locales. De plus le SME, comme un des principaux impulseurs de la «table de concertation syndicale» — véritable concile où se réunit toute la gamme des syndicats «démocratiques» et syndicalistes de base pour fabriquer des caricatures de «journées de solidarité», s'est chargé de remplir les pages de la presse bourgeoise avec une véritable «solidarité»... de papier, pendant que le reste des syndicats maintenait tranquilles -«leurs» ouvriers.
La gauche du capital, à travers ses partis et groupes politiques et syndicalistes s'est chargée de son côté de bombarder les électriciens avec l'idée qu'il fallait défendre ce «bastion de la démocratie» qu'est le SME et surtout qu'il était nécessaire d'engager la mobilisation dans les voies de la «souveraineté nationale» et «contre le paiement de la dette extérieure», etc.
4. (...) La seule marche qu'ont pu réaliser les électriciens avec la participation de centaines de milliers de personnes à Mexico a réussi à concentrer de grands contingents d'électriciens provenant des quatre départements de la zone centrale. A cette marche se sont joints beaucoup de travailleurs du secteur public (métro, banque du commerce extérieur, téléphone, tramways, agences de change, universités, etc. et de l'industrie (confection), ainsi que de petits noyaux d'ouvriers d'entreprises moyennes (brasserie Moctezuma, aciérie Ecatepec). A la marche se sont joints aussi des groupes d'habitants des quartiers marginaux et des lycéens.
Face à la visible possibilité d'extension massive de la grève à d'autres secteurs, le Tribunal du Travail a déclaré, deux jours après la marche, que la grève était «inexistante», appelant les ouvriers à reprendre immédiatement le travail sous la menace de licenciements massifs. Le syndicat a obligé les ouvriers à reprendre le travail, leur disant : «Nous sommes respectueux de la loi». Quand le syndicat en a informé l'assemblée de travailleurs qui était restée dans le local syndical, les grévistes ont manifesté leur mécontentement. Il y a eu des cris de «traîtres» contre les dirigeants syndicaux. Mais toute cette colère s'est diluée dans la frustration puis dans la résignation. Seule une minorité d'ouvriers a été capable de réagir contre le syndicat. (...)
5. Pendant que l'Etat frappait les électriciens, les autres syndicats sabotaient toute tentative de mobilisation dans les autres secteurs. En trois occasions, ils ont empêché qu'éclatent des grèves dans des secteurs clés, comme le téléphone, l'aéronavale et les tramways de la ville. Ils ont aussi démoralisé les ouvriers des universités, du cinéma et les enseignants du primaire. Secteur après secteur, les syndicats ont manipulé et se sont imposés aux travailleurs afin qu'ils acceptent la décision de l'Etat de n'accorder aucune augmentation du salaire général d'urgence. Après avoir arrêté la grève des électriciens, il était visible que les ouvriers du téléphone allaient se mettre en grève. Le syndicat a tenté de contenir jusqu'au bout l'éclatement de la grève, la «remettant» sans cesse à plus tard. Mais dans les assemblées syndicales, la détermination des ouvriers à s'engager dans la grève était ferme. L'Etat a appliqué alors la même tactique qu'il avait employée avec les électriciens : deux heures avant l'éclatement de la grève, il a réquisitionné l'entreprise et le syndicat a tout de suite fait entrer les ouvriers au travail. (...) Finalement, on a pu observer que les syndicats, dans leurs diverses variantes, sont un véritable obstacle pour la lutte revendicative du prolétariat. Loin d'exprimer les intérêts du mouvement revendicatif des ouvriers, ils incarnent les intérêts bourgeois nationaux et de l'Etat. L'Etat bourgeois a imposé sa politique salariale avec l'aide des syndicats, brisant la résistance des ouvriers et retenant les tendances vers la massivité, l'extension et la simultanéité.
6. Le mouvement de résistance aux mesures salariales du capital qu'ont réussi à mener les électriciens, malgré toutes ses limitations comme le corporatisme, la confiance dans les syndicats et le manque de confiance dans ses propres forces, l'isolement et le grand poids de l'idéologie bourgeoise nationaliste qui pesait sur eux, a été très important, car il a montré aux ouvriers que la lutte pour les revendications économiques se transforme inévitablement en un mouvement politique, étant donné qu'inexorablement l'Etat bourgeois la confronte. Il a montré aussi qu'il existe une tendance vers la grève de masse où les possibilités de l'extension du mouvement vers d'autres secteurs sont chaque fois plus évidentes. (...) C'est dans ces mouvements qu'apparaît la nécessité de forger l'instrument politique du prolétariat qui lui donne les éléments de son identité comme classe, c'est-à-dire le Parti Communiste International qui incarne dans chaque moment de sa lutte la perspective du programme communiste. (...)
Comunismo Mexico, avril 1987
Géographique:
- Mexique [86]
Heritage de la Gauche Communiste:
Comprendre la décadence du capitalisme (3) : la nature de la Social-Démocratie
- 3487 reads
La continuité des organisations politiques du prolétariat : la nature de la Social-Démocratie
Comprendre la décadence du capitalisme c'est aussi
comprendre les spécificités des formes de la lutte prolétarienne à notre époque
et donc les différences avec celles d'autres phases historiques. A travers la
compréhension de ces différences se dégage la continuité qui traverse les
organisations politiques du prolétariat.
Ceux
qui, tel le Groupe Communiste Internationaliste (GCI), ignorent la décadence du
capitalisme, rejettent «logiquement y dans le camp de la bourgeoisie la 2e
Internationale (1889-1914) et les partis qui l'ont constituée. Ce faisant ils
ignorent cette continuité réelle qui constitue un élément fondamental de la
conscience de classe.
En défendant cette continuité il ne s'agit pas pour nous de glorifier pour aujourd'hui les partis qui ont constitué la 2e Internationale. Encore moins de considérer comme valable pour notre époque, leur pratique. 11 ne s'agit surtout pas de revendiquer l'héritage de la fraction réformiste qui glissait vers le K social-chauvinisme y et est passée, avec l'éclatement de la guerre, définitiuem?nt dans le camp de la bourgeoisie. Ce dont il s'agit c'est de comprendre que la 2e Internationale et les partis qui l'ont constituée ont été des expressions authentiques du prolétariat durant un moment de l'histoire du mouvement ouvrier.
Un de ses mérites, et non le moindre, consistait à achever la décantation qui avait commencé dans les dernières années de la 1ère Internationale en éliminant l'anarchisme, cette expression idéologique du processus de décomposition de la petite bourgeoisie et de sa prolétarisation, fort mal acceptée par certaines couches de l'artisanat.
La 2e Internationale se situe d'emblée sur les bases du marxisme qu'elle inscrit dans son programme.
11 y a deux façons de juger la 2e Internationale et les partis social-démocrates : l'une avec la méthode marxiste, c'est à dire critique, la situant dans son contexte historique. L'autre c'est celle de l'anarchisme, qui sans méthode cohérente et de façon a-historique se contente simplement de nier ou d'effacer son existence dans le mouvement ouvrier. Et pour cause !
La première est celle qu'ont toujours empruntée les
gauches communistes, et que reprend le CCI. La deuxième est celle des
irresponsables qui, sous une phraséologie « révolutionnaire » aussi creuse
qu'incohérente, cachent mal leur nature et leur démarche semi-anarchiste. Le
GCI appartient à cette dernière.
Un nihilisme apocalyptique
« Avant moi le chaos ». Pour celui qui croit qu'il n'y a pas d'avenir, « no future », l'histoire passée semble inutile, absurde, contradictoire. Tant d'efforts, tant de civilisations, tant de savoir pour n'en arriver qu'à la perspective d'une humanité affamée, malade, et menacée d'être détruite par le feu nucléaire. « Après moi le déluge » ... « Avant moi le chaos ».
Ce genre d'idéologie « punk » suintée par le capitalisme dans cette époque de décadence avancée, pénètre à des degrés divers l'ensemble de la société. Même des éléments révolutionnaires, supposés être convaincus - par définition - de l'existence, sinon de l'imminence d'un avenir révolutionnaire pour la société, subissent parfois, lorsqu'ils sont peu armés politiquement, la pression de ce « nihilisme apocalyptique », où plus rien dans le passé n'a de sens. L'idée même d'une « évolution » historique leur semble saugrenue. Et l'histoire du mouvement ouvrier, l'effort d'un siècle et demi de générations de révolutionnaires organisés, pour accélérer, stimuler, féconder la lutte de leur classe, tout cela est considéré comme peu de chose, voire même comme des éléments de conservation, d'« autorégulation » de l'ordre social existant. C'est une mode qui revient parfois, véhiculée surtout par des éléments en provenance de l'anarchisme ou allant vers celui-ci.
Depuis quelques années, le GCI, Groupe Communiste Internationaliste, joue de plus en plus ce rôle. Le GCI est une scission du CCI (1978), mais les éléments qui l'ont constitué provenaient en partie, avant d'être au CCI, de l'anarchisme. Après un flirt passager avec le bordiguisme, au lendemain de la rupture, le GCI a évolué par la suite vers les amours d'enfance de certains de ses animateurs, l'anarchisme, avec ses élucubrations désespérées a-historiques sur la révolte éternelle ; mais il ne s'agit pas d'un anarchisme déclaré, ouvert, capable d'affirmer par exemple nettement que Bakounine ou Proudhon avaient raison sur le fond contre les marxistes de l'époque ; c'est un anarchisme honteux, qui n'ose pas dire son nom et qui défend ses thèses à coups de citations de Marx et de Bordiga. Le GCI a inventé l'« anarcho-bordiguisme punk ».
Comme un adolescent en mal d'affirmation de son identité et de rupture parentale, le GCI considère qu'avant lui et sa théorie, c'était le néant ou presque. Lénine ? « (Sa) théorie de l'impérialisme - nous dit le GCI - n'est qu'une tentative de justifier sous une autre couleur (antiimpérialiste !) le nationalisme, la guerre, le réformisme... la disparition du prolétariat comme sujet de l'histoire » ([1] [88]). Rosa Luxemburg ? Les Spartakistes allemands? « des sociaux-démocrates de gauche ». Et la social-démocratie elle-même, celle du 19e siècle et du début du 20e siècle, à la fondation de laquelle participèrent Marx et Engels, dans laquelle se formèrent non seulement les bolcheviks et les spartakistes, mais aussi ceux qui allaient constituer la gauche communiste de la 3e Internationale (gauches italienne, allemande, hollandaise, etc.) ? Pour le GCI, la Social-démocratie (ainsi que la 2e Internationale qu'elle a créée) était « de nature essentiellement bourgeoise ». Tous ceux qui, au sein de la 2e Internationale puis de la 3e, ont défendu, contre les réformistes qui la niaient, l'inéluctabilité puis la réalité de la décadence du capitalisme ? « Anti-impérialiste ou luxemburgiste, la théorie de !a décadence n'est qu'une science bourgeoise visant à justifier idéologiquement la faiblesse du prolétariat dans sa lutte pour un monde sans valeur ».
Avant le GCI, il semblerait - au nombre de citations utilisées - qu'il n'y ait eu en fait de révolutionnaire que Marx et peut-être Bordiga... quoiqu'on soit en droit de se demander ce que pouvaient avoir de révolutionnaire - dans la conception du GCI - un fondateur d'organisations « de nature essentiellement bourgeoise » comme Marx, et un élément comme Bordiga qui ne rompt avec la Socialdémocratie italienne qu'en 1921 !
En fait, pour le GCI, c'est la problématique même de
savoir quelles ont été les organisations prolétariennes du passé et quels ont
été leurs apports successifs au mouvement communiste qui est un non-sens. Pour
le GCI, se réclamer d'une continuité politique historique des organisations du
prolétariat, comme l'ont toujours fait les organisations communistes, comme nous
le faisons, c'est tomber dans l'esprit de « famille ». Ce n'est là qu'une des
facettes de sa vision chaotique de l'histoire, une des perles de la bouillie
théorique qui est supposée servir au GCI de cadre pour son intervention. Dans
les deux articles précédents ([2] [89]),
consacrés à l'analyse de la décadence du capitalisme et à la critique qu'en
fait le GCI, nous avons montré d'une part la vacuité anarchiste qui se cache
derrière le verbiage marxisant du GCI avec son rejet de l'analyse de la
décadence du capitalisme et de l'idée même d'évolution historique, d'autre part
des aberrations politiques, des positions nettement bourgeoises - appui aux
guérilleros staliniens du Sentier Lumineux au Pérou, par exemple - auxquelles
conduit cette méthode, ou plutôt cette absence totale de méthode. II s'agit
donc dans cet article de combattre l'autre volet de cette conception
a-historique : le rejet de la nécessité pour toute organisation révolutionnaire
de comprendre et de se situer dans le cadre de la continuité historique des
organisations communistes du passé.
L'importance de la continuité historique dans le mouvement communiste
Dans toutes nos publications, nous écrivons : « Le CCI se réclame des apports successifs de la Ligue des Communistes, des le, 2e et 3e Internationales, des fractions de gauche qui se sont dégagées de cette dernière, en particulier des gauches allemande, hollandaise et italienne ». Voila qui donne la nausée au GCI.
« Les communistes - écrit le GCI - n'ont pas de problème de "paternité", l'attachement à la "famille" révolutionnaire est une manière de nier l'impersonnalité du programme. Le fil historique sur lequel circule le courant communiste n'est pas plus une question de "personne" que d'organisation formelle, c'est une question de pratique, cette pratique étant portée tantôt par tel individu, tantôt par telle organisation. Laissons donc les décadentistes séniles caqueter sur leurs arbres généalogiques, à la recherche de leurs papas. Occupons-nous de la révolution ! »
Obsédé par des problèmes de « révolte contre le père », le GCI ne parle de « fil historique » que pour en faire une abstraction éthérée, vide de chair et de réalité, planant au dessus des « personnes » et des «organisations formelles ». Se réapproprier l'expérience historique du prolétariat et donc les leçons tirées par ses organisations politiques, le GCI appelle cela « rechercher son papa ». « Occupons-nous plutôt de la révolution », oppose-t-il, mais ces mots sont des formules creuses et inconséquentes quand on ignore l'effort et la continuité de l'effort des organisations qui depuis plus d'un siècle et demi... « s'occupent de la révolution ».
Ce n'est pas à partir du passé de l'histoire qu'on s'intéresse au présent, c'est à partir des besoins présents et à venir de la révolution que l'on s'intéresse au passé. Mais sans cette compréhension de l'histoire, on est inévitablement désarmé vis-à-vis de l'avenir.
La lutte pour la révolution communiste n'a pas commencé avec le GCI. Cette lutte a déjà une longue histoire. Et si celle-ci est jalonnée surtout de défaites du prolétariat, elle a fourni à ceux qui aujourd'hui veulent véritablement contribuer au combat révolutionnaire des leçons, des acquis qui sont de précieux et indispensables instruments de combat. Or ce sont justement les organisations politiques du prolétariat qui tout au long de cette histoire se sont efforcées de dégager et de formuler ces leçons. C'est du charlatanisme de révolté à la petite semaine que d'appeler à « s'occuper de la révolution » sans s'occuper des organisations politiques prolétariennes du passé et de la continuité de leur effort. Le prolétariat est une classe historique, c'est-à-dire porteuse d'un avenir à l'échelle de l'histoire. C'est une classe qui, contrairement aux autres classes opprimées qui se décomposent avec l'évolution du capitalisme, se renforce, se développe, se concentre tout en acquérant au travers des générations, à travers des milliers de combats de résistance quotidienne et quelques grandes tentatives révolutionnaires, une conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut et de ce qu'elle veut. L'activité des organisations révolutionnaires, leurs débats, leurs regroupements comme leurs scissions, font partie intégrante de ce combat historique, ininterrompu depuis Babeuf jusqu'à son triomphe définitif.
Ne pas comprendre la continuité qui lie politiquement
celles-ci au travers de l'histoire, c'est ne voir dans le prolétariat qu'une
classe sans histoire ni conscience... tout au plus révoltée. C'est la vision
qu'a la bourgeoisie de la classe ouvrière. Pas celle des communistes ! Le GCI
voit un problème psychologique de « paternité » et d'« attachement à la famille
» là où il s'agit en fait du minimum de conscience qui puisse être exigé d'une
organisation qui prétend s'élever au rôle d'avant-garde du prolétariat.
De quelle continuité nous réclamons-nous ?
Le GCI affirme que se réclamer d'une continuité avec les organisations communistes du passé c'est « nier l'impersonnalité du programme ». Il est évident que le programme communiste n'est ni l'oeuvre ni la propriété d'une personne, d'un génie. Le marxisme porte le nom de Marx en reconnaissance du fait que ce fut lui qui jeta les fondements d'une conception prolétarienne véritablement cohérente du monde. Mais cette conception n'a cessé de s'élaborer à travers la lutte de la classe et ses organisations depuis ses premières formulations. Marx luimême se revendiquait de l'oeuvre des Egaux de Babeuf, des socialistes utopistes, des chartistes anglais,etc. et considérait ses idées comme un produit du développement de la lutte réelle du prolétariat.
Mais pour « impersonnel » qu'il soit, le Programme communiste n'en est pas moins l'oeuvre d'êtres humains en chair et en os, de militants regroupés dans des organisations politiques, et il n'en existe pas moins une continuité dans l'oeuvre de ces organisations. La vraie question n'est pas de savoir s'il existe ou non une continuité, mais de savoir quelle est cette continuité.
Montrant qu'il ne comprend même pas ce qu'il prétend critiquer, le GCI laisse entendre que se revendiquer d'une continuité des organisations politiques prolétariennes reviendrait à se réclamer de ce que tout le monde a pu dire, à n'importe quel moment, dans le mouvement ouvrier.
Un des principaux reproches que fait le GCI à ceux qui défendent l'idée de l'existence d'une décadence du capitalisme, c'est qu'ils « entérinent ainsi, de façon acritique, l'histoire passée, et principalement le réformisme social-démocrate justifié en un tour de main puisqu'il se situait "dans la phase ascendante du capitalisme" ». Dans l'esprit borné du GCI, assumer une continuité historique ne peut signifier qu'« entériner de façon a-critique ». Dans la réalité, pour ce qui est des organisations du passé, l'histoire s'est chargée elle-même d'exercer une critique impitoyable en tranchant dans les faits la question.
Ce ne sont pas des tendances quelconques qui ont pu assumer la continuité entre l'ancienne organisation et la nouvelle. Entre les trois principales organisations politiques internationales du prolétariat, c'est la gauche qui a toujours assumé cette continuité.
Ce fut elle qui assura la continuité entre la 1e et la 2e Internationales à travers le courant marxiste, en opposition aux courants proudhonien, bakouniniste, blanquiste, et autres corporativistes. Entre la 2e et la 3e Internationales c'est encore la gauche, celle qui mena le combat tout d'abord contre les tendances réformistes, ensuite contre les «social -patriotes », qui assura la continuité pendant la lere guerre mondiale en formant l'Internationale communiste. De la 3e Internationale, c'est encore la gauche, la « gauche communiste », et en particulier les gauches italienne et allemande, qui ont repris et développé les acquis révolutionnaires foulés au pied par la contre révolution social-démocrate et stalinienne. Cela s'explique par la difficulté de l'existence des organisations politiques du prolétariat. L'existence même d'une authentique organisation politique prolétarienne constitue un combat permanent contre la pression de la classe dominante, pression qui est d'ordre matériel : manque de moyens financiers, répression policière, mais aussi et surtout d'ordre idéologique. L'idéologie dominante tend toujours à être celle de la classe économiquement dominante. Les communistes sont des hommes et leurs organisations ne sont pas miraculeusement imperméables à la pénétration de l'idéologie qui imprègne toute la vie sociale. Les organisations politiques du prolétariat meurent souvent vaincues, en trahissant, en passant dans le camp de l'ennemi. Seules les fractions de l'organisation qui ont eu la force de ne pas laisser tomber leurs armes devant la pression de la classe dominante - la gauche - ont pu assumer la continuité de ce que ces organisations contenaient de prolétarien.
En ce sens, se réclamer de la continuité qui traverse les organisations politiques prolétariennes c'est se réclamer de l'action des différentes fractions de gauche qui seules ont eu la capacité d'assurer cette continuité. Se revendiquer « des apports successifs de la Ligue des Communistes, des le, 2e et 3e Internationales », ce n'est pas « entériner de façon a-critique » les Willich et Schapper de la Ligue des Communistes, ni les anarchistes de la l" Internationale, ni les réformistes de la 2e, ni les bolcheviks dégénérescents de la 3e. Au contraire, c'est se revendiquer du combat politique mené par les gauches généralement minoritaires contre ces tendances. Mais ce combat n'était pas mené n'importe où. Il se déroulait au sein des organisations qui regroupaient les éléments les plus avancés de la classe ouvrière. Des organisations prolétariennes qui avec toutes leurs faiblesses ont toujours été un défi vivant à l'ordre établi. Elles n'étaient pas l'incarnation d'une vérité invariable éternelle et définie une fois pour toutes -- comme le prétend la théorie de l'Invariance du Programme communiste, empruntée par le GCI aux bordiguistes. Elles ont été « l'avant-garde » concrète du prolétariat comme classe révolutionnaire à un moment donné de l'histoire et à un degré donné du développement de la conscience de classe.
A travers les débats entre la tendance Willich
et celle de Marx au sein de la
Ligue des Communistes, à travers la confrontation entre les
anarchistes et les marxistes au sein de la le Internationale, entre les
réformistes et la gauche internationaliste au sein de la 2e, entre les
bolcheviks dégénérescents et les gauches communistes au sein de la 3e, c'est
l'effort permanent de la classe ouvrière pour se donner les armes politiques de
son combat qui se concrétise. Se revendiquer de la continuité politique des
organisations politiques du prolétariat, c'est se situer en continuité des
tendances qui ont su assumer cette continuité, mais aussi de l'effort en
lui-même que représentent ces organisations.
La nature de classe de la social-démocratie de la fin du 19e siècle, début du 20e.
Pour le GCI, ce qui interdit le plus de parler de continuité des organisations politiques prolétariennes c'est que l'on puisse considérer les partis social-démocrates du 19e siècle et la 2e Internationale comme des organisations ouvrières. Pour lui, la social-démocratie est de nature « essentiellement bourgeoise ».
Comme on l'a vu dans les articles précédents, le GCI reprend la vision anarchiste d'après laquelle la révolution communiste a toujours été à l'ordre du jour depuis les débuts du capitalisme : il n'y a pas différentes périodes du capitalisme. Le programme du prolétariat se réduit à un mot d'ordre éternel : la révolution communiste mondiale tout de suite. Le syndicalisme, le parlementarisme, la lutte pour des réformes, rien de cela n'a jamais été ouvrier. En conséquence, les partis social-démocrates puis la 2e Internationale, qui ont fait de ces formes de lutte l'axe essentiel de leur activité ne pouvaient être que des instruments de la bourgeoisie. La 2e Internationale d'Engels serait la même chose que les ententes entre Mitterrand et Felipe Gonzales. Pour les avoir abordées longuement dans deux articles précédents, nous ne reviendrons pas ici sur des questions telles que l'existence de deux phases historiques fondamentales dans la vie du capitalisme et sur la place centrale de l'analyse de la décadence du capitalisme dans la cohérence marxiste (Revue Internationale n° 48) ; nous ne redévelopperons pas non plus la question des différences qui découlent du changement de période pour la pratique et les formes de lutte du mouvement ouvrier (Revue Internationale n° 49).
Nous situant ici du point de vue de la question de la continuité historique des organisations révolutionnaires, nous voulons mettre en relief ce qui, au delà de ses faiblesses, dues aux formes de lutte de l'époque, et de sa dégénérescence, était prolétarien dans la Socialdémocratie et quels sont les apports dont les révolutionnaires marxistes se sont revendiqués par la suite.
***Quels sont les critères pour juger de la nature de classe d'une organisation. On peut en définir trois importants :
- le programme., c'est-à-dire la définition de l'ensemble des buts et des moyens de son action ;
- la pratique de l'organisation au sein de la lutte de classe ;
- enfin, son origine et sa dynamique historique.
Cependant, ces critères n'ont évidemment de sens que si l'on sait tout d'abord resituer l'organisation en question dans les conditions historiques de son existence. Et cela non seulement parce qu'il est indispensable de tenir compte des conditions historiques objectives pour définir ce que sont et peuvent être les objectifs immédiats et les formes de la lutte prolétarienne. Il est aussi indispensable d'avoir à l'esprit quel était le degré de conscience atteint historiquement par la classe prolétarienne à un moment donné pour juger du degré de conscience d'une organisation spécifique.
Il y a un développement historique de la conscience. Il ne suffit pas de comprendre que le prolétariat existe comme classe autonome politiquement au moins depuis le milieu du 19e siècle. Encore faut-il comprendre que pendant tout ce temps il n'est pas resté une momie, un dinosaure empaillé. Sa conscience de classe, son programme historique ont évolué, s'enrichissant de l'expérience, évoluant avec les conditions historiques murissantes. Pour juger du degré de conscience exprimé par le programme d'une organisation prolétarienne du 19e siècle, il serait absurde d'en exiger la compréhension de ce que seules des décennies d'expérience et l'évolution de la situation pouvaient permettre de comprendre plus tard.
Rappelons donc brièvement quelques éléments sur les
conditions historiques dans lesquelles se forment et vivent les partis
social-démocrates dans le dernier quart du 19e siècle et jusqu'à la période de
la le guerre mondiale, moment où meurt la 2e Internationale et où éclatent les
partis, les uns après les autres, sous le poids de la trahison de leurs
directions opportunistes.
Les conditions de la lutte du prolétariat à l'époque de la social-démocratie
Dans la conception figée et statique du GCI selon laquelle le capitalisme serait « invariable » depuis ses débuts, la fin du 19e siècle apparaît comme identique à l'époque actuelle. Aussi son jugement sur la socialdémocratie de cette époque se résume à une identification de celle-ci avec les partis social-démocrates ou staliniens de notre temps. En réalité, ce genre de projections infantiles selon lequel ce que l'on connaît est la seule chose qui n'ait jamais pu exister n'est autre chose qu'une plate négation de l'analyse historique. Les générations actuelles connaissent un monde qui depuis plus de trois quarts de siècle a vécu au rythme des plus grandes manifestations de barbarie de l'histoire de l'humanité : les guerres mondiales. Quand ce n'est pas la guerre mondiale ouverte, c'est la crise économique qui s'abat sur la société, seules faisant exception deux périodes de « prospérité » fondées sur la « reconstruction » au lendemain des le et 2e guerres mondiales. A cela doit s'ajouter depuis la fin de la 2e guerre, l'existence de guerre locales en permanence dans les zones les moins développées et une orientation de l'économie, au niveau mondial , essentiellement vers des objectifs militaires et destructifs.
L'appareil chargé du maintien de cet ordre décadent n'a cessé de développer son emprise sur la société et la tendance au capitalisme d'Etat, sous toutes ses formes, se concrétise dans tous les pays de façon toujours plus puissante et omniprésente dans tous les secteurs de la vie sociale, au premier rang desquels se trouvent évidemment les rapports entre les classes. Dans tous les pays, l'appareil d'Etat s'est doté de toute une panoplie d'instruments pour contrôler, encadrer, atomiser la classe ouvrière. Les syndicats, les partis de masse sont devenus des rouages de la machine étatique. Le prolétariat ne peut plus affirmer son existence comme classe que sporadiquement. En dehors des moments d'effervescence sociale il est, en tant que corps collectif, atomisé, comme chassé de la société civile.
Tout autre est le capitalisme du dernier quart du 19e siècle. Sur le plan économique, la bourgeoisie connaît la plus longue et puissante période de prospérité de son histoire. Après les crises cycliques de croissance qui, presque tous les 10 ans, avaient frappé le système de 1825 à 1873, le capitalisme connaît jusqu'en 1900, près de 30 ans de prospérité quasi ininterrompue. Sur le plan militaire, c'est aussi une période exceptionnelle : le capitalisme ne connaît aucune guerre importante. Dans ces années de prospérité relativement pacifiques, difficilement concevables pour des gens de notre époque, la lutte du prolétariat se déroule dans un cadre politique qui, s'il demeure - évidemment - celui de l'exploitation et l'oppression capitalistes, n'en possède pas moins des caractéristiques très différentes de celles du 20e siècle.
Les rapports entre prolétaires et capitalistes sont des rapports directs, et d'autant plus éparpillés que la plupart des usines sont encore de taille réduite. L'Etat n'intervient dans ces rapports qu'au niveau des conflits ouverts qui risquent de « troubler l'ordre public ». Les négociations salariales, l'établissement des conditions de travail sont pour l'écrasante majorité des cas une affaire qui dépend des rapports de forces locaux entre les patrons (souvent d'entreprises de type familial) et des ouvriers dont la grande majorité vient directement de l'artisanat et de l'agriculture. L'Etat est à l'écart de ces négociations.
Le capital conquiert le marché mondial et étend sa forme d'organisation sociale aux quatre coins de la planète. La bourgeoisie fait exploser le développement des forces productives. Elle est chaque jour plus riche et trouve même un profit dans l'amélioration des conditions d'existence des prolétaires. Les luttes ouvrières sont fréquemment couronnées de succès. Les grèves longues, dures, même isolées, parviennent à faire céder des patrons qui - outre le fait qu'ils peuvent payer - affrontent souvent les ouvriers en ordre dispersé. Les ouvriers apprennent à s'unifier et à s'organiser de façon permanente (les patrons aussi d'ailleurs). Leurs luttes imposent à la bourgeoisie le droit d'existence d'organisations ouvrières : syndicats, partis politiques, coopératives. Le prolétariat s'affirme comme force sociale dans la société, même en dehors des moments de lutte ouverte. Il y a toute une vie ouvrière au sein de la société : il y a les syndicats (qui sont des « écoles de communisme »), mais il y a aussi des clubs ouvriers où on parle de politique, il y des « universités ouvrières » où l'on apprend aussi bien le marxisme qu'à lire et écrire, (Rosa Luxembourg et Pannekoek furent enseignants dans la social démocratie allemande), il y a des chansons ouvrières, des fêtes ouvrières où l'on chante, danse et parle du communisme.
Le prolétariat impose le suffrage universel et obtient
d'être représenté par ses organisations politiques dans le parlement bourgeois
- les parlements sont encore des lieux où le théâtre mystificateur n'a pas tout
dévoré ; le pouvoir réel n'est pas encore totalement dans le seul exécutif au
gouvernement ; les différentes fractions des classes dominantes s'y affrontent
réellement et le prolétariat parvient parfois à utiliser les divergences entre
partis bourgeois pour imposer ses intérêts. Les conditions d'existence de la
classe ouvrière en Europe connaissent des améliorations réelles : réduction du
temps de travail de 14 ou de 12 à 10 heures ; interdiction du travail des
enfants et des travaux pénibles pour les femmes ; élévation générale du niveau
de vie, élévation du niveau culturel. L'inflation est un phénomène inconnu. Les
prix des biens de consommation baissent au fur et à mesure que les nouvelles
techniques de production sont introduites dans la production. Le
chômage est réduit à celui minimum d'une armée de réserve où le capital en
expansion peut puiser la nouvelle force de travail dont il a en permanence
besoin. Un jeune chômeur peut aujourd'hui avoir du mal à imaginer ce que cela
pouvait être, mais cela devrait être une évidence pour toute organisation qui
se réclame du marxisme.
La social-démocratie ne s'identifie pas avec le réformisme
Les partis ouvriers social-démocrates et « leurs » syndicats étaient le produit et l'instrument des combats de cette époque. Contrairement à ce que peut laisser entendre le GCI, ce n'est pas la social-démocratie qui a « inventé » la lutte syndicale et politique parlementaire au début des années 1870. Dès les premières affirmations du prolétariat comme classe, dans la première moitié du 19e siècle, la lutte pour l'existence de syndicats ou le suffrage universel (Chartistes en Angleterre en particulier) se développait dans la classe ouvrière. La social-démocratie n'a fait que développer, organiser un mouvement réel qui existait bien avant elle et se développait indépendamment d'elle. Pour le prolétariat la question était - comme aujourd'hui - toujours la même : comment combattre la situation d'exploitation qui lui est faite. Or la lutte syndicale et politique parlementaire étaient alors des moyens de résistance véritablement efficaces. Les rejeter au nom de « la Révolution » c'était ignorer, rejeter le mouvement réeel et le seul cheminement possible à l'époque vers la révolution. La classe ouvrière devait s'en servir pour limiter l'exploitation mais aussi pour prendre conscience de soi, de son existence comme force autonome, unie.
- « La grande importance de la lutte syndicale et de la lutte politique réside en ce qu'elles socialisent la connaissance, la conscience du prolétariat, l'organisent en tant que classe », écrit Rosa Luxemburg dans « Réforme ou Révolution » (I,5).
C'était le «programme minimum ». Mais celui-ci s'accompagnait d'un «programme maximum », réalisable par une classe devenue capable de mener son combat contre l'exploitation jusqu'au bout : la révolution. Rosa Luxemburg formulait le lien entre ces deux programmes :
- « Selon la conception courante du Parti, le prolétariat parvient, par l'expérience de la lutte syndicale et politique, à la conviction de l'impossibilité de transformer de fond en comble sa situation au moyen de cette lutte et de l'inéluctabilité d'une conquête du pouvoir. »
Tel était le programme de la social-démocratie.
Le réformisme se définit, par contre par son refus de l'idée de la nécessité de la révolution. Il considère que seule la lutte pour des réformes au sein du système peut avoir un sens. Or la social-démocratie se constitue en opposition directe aussi bien aux anarchistes - qui croient la révolution à l'ordre du jour à toute heure - qu'aux possibilistes et a leur réformisme considérant le capitalisme comme éternel. Voici par exemple comment le Parti ouvrier français présentait son programme électoral en 1880 :
- « .... Considérant,
- Que cette appropriation collective ne peut sortir que de l'action révolutionnaire de la classe productive - ou prolétariat - organisé en parti politique distinct ;
- Qu'une pareille organisation doit être poursuivie par tous les moyens dont dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel, transformé ainsi d'instrument de duperie qu'il a été jusqu'ici en instrument d'émancipation ;
- Les travailleurs socialistes français, en donnant pour but à leurs efforts dans l'ordre économique le retour à la collectivité de tous les moyens de production, ont décidé, comme moyens d'organisation et de lutte, d'entrer dans les élections avec le programme minimum suivant... » ([3] [90]).
Quelque fut le poids de l'opportunisme vis à vis du
réformisme au sein des partis social-démocrates, leur programme rejettait
explicitement le réformisme. Les partis social-démocrates avaient comme
programme maximum la révolution ; la lutte syndicale et électorale était
essentiellement le moyen pratique, adapté aux possibilités et nécessités de
l'époque, pour préparer la réalisation de ce but.
Les acquis de la 2e Internationale
L'adoption du marxisme
Le GCI ne reconnait évidemment aucun apport pour le mouvement ouvrier de toutes ces organisations de nature « essentiellement bourgeoise ». « Entre social-démocratie et communisme, dit-il, il y a la même frontière de classe qu'entre bourgeoisie et prolétariat ».
Le rejet de la social-démocratie et de la 2e Internationale du 19e siècle n'est pas nouveau. II a toujours été le fait des anarchistes. Ce qui est relativement nouveau ([4] [91]) c'est de prétendre faire ce rejet en se réclamant de Marx et Engels... (par souci d'autorité parentale peut-être).
Le problème c'est que l'adoption des conceptions marxistes et le rejet explicite des conceptions anarchistes par des organisations de masses constitue sans aucun doute le principal acquis de la 2e Internationale par rapport à la première.
La 2e Internationale, fondée en 1864, regroupait, surtout à ses débuts, toutes sortes de tendances politiques en son sein : mazzimistes, proudhoniens, bakouninistes, blanquistes, les trade-unionistes anglais, etc. Les marxistes n'y étaient qu'une infime minorité (le poids de la personnalité de Marx au sein du Conseil général de celle qui s'appelait Association ou Internationale des Travailleurs, ne doit pas faire illusion). Pendant la Commune de Paris il y avait un seul marxiste, Frankel, et il était hongrois.
La 2e Internationale par contre se fonde, avec Engels, dès le départ, sur la base des conceptions marxistes. Le congrès d'Erfurt en 1891 le reconnaît explicitement.
En Allemagne, dès 1869, le Parti Ouvrier SocialDémocrate fondé à Eisenach par Wilhelm Liebknecht et August Bebel, proches de Marx, après avoir scissionné de l'organisation de Lassalle (l'Association générale des ouvriers allemands) se fonde sur le marxisme. Lorsqu'en 1875 se réalisera la réunification, les marxistes sont majoritaires, même si le programme qui est adopté est tellement rempli de concessions aux conceptions lassalliennes que Marx écrira dans une lettre d'accompagnement de sa célèbre critique du Programme de Gotha :
- « ... après le congrès de coalition, nous publierons, Engels et moi, une brève déclaration où nous dirons que nous sommes fort éloignés dudit programme de principes, et que nous nous en louons les mains ». Mais il ajoute : « Un seul pas du mouvement réel est plus important qu'une douzaine de programmes ».
Quinze ans plus tard, sa confiance dans le mouvement réel se confirmait par l'adoption des conceptions marxistes par l'ensemble de la 2e Internationale dès ses premiers moments.
C'était là un apport fondamental au renforcement du mouvement ouvrier.
Le GCI rappelle le rejet par Marx et Engels du terme de « social-démocrate » qui en réalité reflétait des faiblesses lassalliennes du parti allemand : dans « tous ces écrits je ne me qualifie jamais de social-démocrate, mais de comrnuniste. Pour Marx comme pour moi il est donc absolument impossible d'employer une expression aussi élastique pour désigner notre conception propre ». (Engels dans la brochure « Internationales aus dem Volkstaat », 1871-1875).
Mais le GCI « oublie » de rappeler que les marxistes n'en déduisent pas pour autant qu'il fallait rompre avec le parti mais s'en faire une raison en menant le combat sur le fond. Ainsi Engels précisait-il : « Il en va autrement aujourd'hui, et ce mot peut passer à la rigueur, bien qu'il ne corresponde pas davantage aujourd'hui à un parti dont le programme économique n'est pas seulement socialiste en général, mais directement communiste, c'est à dire à un parti dont le but final est la suppression de tout Etat et, par conséquent, de la démocratie. »
L'adoption des conceptions de base du marxisme par
l'Internationale ne fut pas un cadeau de la Providence mais un
acquis conquis par le combat des éléments les plus avancés.
La distinction entre organisations unitaires et organisations
politiques du prolétariat
Un autre apport important de la 2e Internationale par rapport à la première fut la distinction entre deux formes distinctes d'organisation. D'une part, les organisations unitaires regroupant les prolétaires sur la base de leur appartenance de classe (syndicats, et plus tard les soviets ou conseils ouvriers) ; d'autre part, les organisations politiques regroupant des militants sur la base d'une plateforme politique précise.
La 1e Internationale, surtout à ses débuts, regroupait aussi bien des individus que des coopératives, des associations de solidarité, des syndicats ou des clubs politiques. Ce qui en faisait un organe qui ne parvint jamais à remplir véritablement ni des tâches d'orientation politique claires, ni des tâches d'unification des prolétaires.
C'est donc tout naturellement que les anarchistes qui rejettent aussi bien le marxisme que la nécessité des organisations politiques, combattent la 2e Internationale dès sa naissance. D'ailleurs, beaucoup de courants anarchistes continuent de se réclamer aujourd'hui de l'AIT.
Ici encore le GCI n'innove pas et demeure
invariablement ... anarchiste.
Le pourquoi et le comment du combat des révolutionnaires dans les partis de la 2e Internationale
Est-ce-à dire que la social-démocratie et la 2e Internationale furent des incarnations parfaites de ce que doit être l'organisation politique d'avant-garde du prolétariat ? Il est évident que non.
Le congrès de Gotha se tient quatre ans après l'écrasement de la Commune ; la 2e Internationale se fonde après près de vingt ans de prospérité capitaliste ininterrompue dans l'élan d'une poussée de grèves provoquée non par l'aggravation de l'exploitation due à une crise économique, mais par la prospérité elle-même qui situe le prolétariat en relative position de force. La séparation des crises cycliques du capitalisme, le progrès de la condition ouvrière par la lutte syndicale et parlementaire, créaient inévitablement des illusions parmi les ouvriers, même dans leur avant-garde.
Dans la vision marxiste, la révolution ne peut être provoquée que par une crise économique violente du capitalisme. L'éventualité d'une telle crise semblait s'éloigner au fur et à mesure que se prolongeait la prospérité. Les succès mêmes de la lutte pour des réformes crédibilisaient l'idée des réformistes de l'inutilité et de l'impossibilité de la révolution. Le fait même que les résultats de la lutte pour des réformes dépendent essentiellement du rapport de forces existant au niveau de chaque Etatnation et non du rapport de forces international - comme c'est le cas pour la lutte révolutionnaire - enfermait de plus en plus l'organisation du combat dans le cadre national, les tâches, les conceptions internationalistes étant souvent réléguées à un second plan ou repoussées aux calendes grecques.
En 1898, sept ans après le congrès d'Erfurt, Bernstein formule dans l'Internationale la remise en question de la théorie marxiste des crises et l'inévitabilité de l'effondrement économique du capitalisme (celle-là même que rejette le GCI) : seule la lutte pour des réformes est viable, « Le but n'est rien, le mouvement est tout ».
Les groupes parlementaires du parti sont souvent facilement englués dans les filets de la logique du jeu démocratique bourgeois et les responsables syndicaux tendent à devenir trop « compréhensifs » à l'égard des impératifs de l'économie capitaliste nationale. L'ampleur du combat que menèrent Marx et Engels contre les tendances conciliatrices avec le réformisme au sein de la social-démocratie naissante, le combat des Luxemburg, Pannekoek, Gorter, Lénine, Trotsky, dans la socialdémocratie dégénérescente sont une preuve de l'importance du poids de cette forme de l'idéologie bourgeoise au sein des organisations prolétariennes... Mais le poids du réformisme dans la 2e Internationale ne fait pas plus de celle-ci un organe bourgeois que celui du réformisme proudhonien ne fit de l'AIT un instrument du capital.
Les organisations politiques du prolétariat n'ont jamais été un bloc monolithique de conceptions identiques. Qui plus est, les éléments les plus avancés s'y sont retrouvés souvent en minorité - comme nous l'avons illustré précédemment. Mais ces minorités qui vont de Marx et Engels aux gauches communistes des années 30 savaient que la vie des organisations politiques du prolétariat dépendait d'un combat non seulement contre l'ennemi dans la rue et les lieux de travail, mais aussi d'un combat permanent contre les influences bourgeoises - toujours présentes - au sein même de ces organisations.
Pour le GCI ce genre de combats était un non-sens, une aide à la contre-révolution.
- « La présence de révolutionnaires marxistes (Pannekoek, Gorter, Lénine...), écrit le GCI, au sein de la 2e Internationale ne signifiait pas que cette dernière défendait les intérêts du prolétariat (tant "immédiats" qu'historiques) mais permettait de cautionner - par manque de rupture - toute la pratique contre-révolutionnaire de la social-démocratie. »
Remarquons en passant que voici Pannekoek, Gorter et Lénine, cette gauche d'une organisation séparée du communisme « ou une frontière de classe » élevés par le GCI soudain au rang de « révolutionnaires marxistes ». Merci pour eux. Mais ce faisant, le GCI nous laisse entendre que des organisations « de nature essentiellement bourgeoise » peuvent avoir une gauche constituée d'authentiques « révolutionnaires marxistes » ... et cela pendant des décennies ! C'est probablement la même « dialectique » qui conduit le GCI à considérer que l'aile gauche du stalinisme latino-américain (les maoïstes du « Sentier Lumineux » au Pérou) peuvent être dans ce pays « l'unique structure capable de donner une cohérence au nombre toujours croissant d'actions directes du prolétariat ».
N'en déplaise à nos dialecticiens punk, le stalinisme maoiste péruvien n'est pas plus « une structure capable de donner une cohérence » aux actions du prolétariat » que les « révolutionnaires marxistes » de la 2e Internationale ne furent des « cautions d'une pratique contre-révolutionnaire ».
Le prolétariat se prépare aujourd'hui à livrer des combats décisifs contre le système capitaliste qui ne parvient plus à se relever de la crise ouverte qui le frappe depuis maintenant près de vingt ans, depuis la fin de la reconstruction à la fin des années 60.
Marx et Engels, Rosa et Lénine, Pannekoek et Gorter n'étaient pas des imbéciles incohérents qui pensaient pouvoir lutter pour la révolution en militant et animant des organisations bourgeoises. C'étaient des révolutionnaires qui, contrairement aux anarchistes - ... et au GCI - avaient une compréhension des conditions concrètes de la lutte ouvrière suivant les époques historiques du système
On peut critiquer le retard avec lequel un Lénine prit conscience de la gravité de la maladie opportuniste qui rongeait la 2e Internationale ; on peut critiquer l'incapacité de Rosa Luxemburg à mener un véritable travail organisationnel de fraction au sein de la social-démocratie dès le début du siècle, mais on ne peut rejeter la nature du combat qu'ils menèrent.
On doit par contre saluer la lucidité de Rosa Luxemburg qui, dès la fin du siècle dernier, fit la critique impitoyable du courant révisionniste qui s'affirmait au sein de la 2e Internationale tout comme la capacité des bolchéviks à s'organiser en fraction indépendante, avec ses propres moyens d'intervention au sein du Parti Ouvrier socialdémocrate de Russie. C'est pour cela qu'ils purent être l'avant-garde du prolétariat dans la vague révolutionnaires de la fin de la première guerre mondiale.
Le GCI croit-il que c'est par hasard que ceux qu'il appelle parfois les « marxistes révolutionnaires » provenaient de la social-démocratie et non de l'anarchisme ou autre courant ? Il est impossible de répondre à cette question élémentaire sans comprendre l'importance de la continuité des organisations politiques du prolétariat. Et ceci ne peut être compris sans comprendre l'analyse de la décadence du capitalisme.
Toute l'histoire de la 2e Internationale ne peut
apparaître que comme un chaos dénué de sens si l'on n'a pas à l'esprit que son
existence se situe dans la période charnière entre la période historique
d'ascendance du capitalisme et celle de sa décadence.
Conclusion
Il part vers ces combats, relativement dégagé des mystifications que la contre-révolution stalinienne a fait peser sur lui pendant près de quarante ans ; ayant perdu dans les pays à vieille tradition de démocratie bourgeoise, ses illusions sur la lutte syndicale ou parlementaire, dans les pays moins développés les illusions sur le nationalisme anti-impérialiste.
Cependant, en se dégageant de ces mystifications, les prolétaires ne sont pas encore parvenus à se réapproprier toutes les leçons des luttes ouvrières du passé.
La tâche des communistes n'est pas d'organiser la classe ouvrière - comme le faisait la social-démocratie au 19e siècle. L'apport des communistes à la lutte ouvrière est essentiellement au niveau de la pratique consciente, de la praxis de la lutte. Et à ce niveau ce n'est pas tant par les réponses qu'ils contribuent, mais par la façon d'envisager, de poser les problèmes. C'est une conception du monde et une attitude pratique qui mettent toujours en avant les dimensions mondiale et historique de chaque question à laquelle est confrontée la lutte.
Ceux qui, tel le GCI, ignorent la dimension historique de la lutte ouvrière, en niant les différentes phases de la réalité du capitalisme, en niant la continuité réelle des organisations politiques du prolétariat, désarment la classe ouvrière au moment où elle a le plus besoin de se réapproprier sa propre conception du monde.
Il ne suffit pas d'être « pour la violence », « contre la démocratie bourgeoise » pour pouvoir se repérer et tracer à chaque moment des perspectives dans la lutte de classe. Loin de là. Entretenir des illusions à cet égard est dangereux et criminel.
RV.
[1] [92]
Voir « Comprendre la décadence
du capitalisme», Revue Internationale
n° 48, 1e trimestre 1987, ainsi que « Comprendre les conséquences politiques de
la décadence du capitalisme », Revue
Internationale n° 49, 2e trimestre 1987.
[2] [93] Sauf indication contraire, toutes les
citations du GCI sont tirées des articles «Théories de la décadence, décadence
de la théorie » parus dans les n° 23 et 25 de Le Communiste, novembre 1985 et novembre 1986.
[3] [94]
Rédigé par Marx, K. Marx,
Oeuvres, La Pleiade,
T. 1.
[4] [95]
En réalité c'est la vieille
rengaine des modernistes ou anarchistes « honteux », surtout depuis 1968.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [5]
Polémique : réponse à « Battaglia Comunista » sur le cours historique
- 3133 reads
Depuis 1968, les groupes révolutionnaires qui ont été amenés à former le CCI défendent le fait que la vague de luttes ouvrières qui a débuté cette année-là en France a marqué une nouvelle période dans le rapport de forces entre bourgeoisie et prolétariat : la fin de la longue période de contre-révolution consécutive au reflux de la vague révolutionnaire de 1917-23 ; l'ouverture d'un cours vers des confrontations de classe généralisées. Alors que l'accélération de l'écroulement de l'économie capitaliste ne pouvait que pousser la bourgeoisie vers une nouvelle guerre mondiale, cette même désintégration économique provoquait une forte résistance de la part d'une nouvelle génération d'ouvriers qui n'a pas connu la défaite. En conséquence, le capitalisme ne peut pas aller à la guerre sans, d'abord, écraser le prolétariat ; d'un autre côté, la combativité et la conscience croissantes du prolétariat conduisent inévitablement vers des combats de classe titanesques dont l'issue déterminera si la crise du capitalisme débouchera sur la guerre ou sur la révolution.
Il n'y a pas beaucoup de groupes du milieu politique prolétarien qui partagent cette vision du cours historique, et c'est le cas en particulier du courant le plus important en dehors du CCI, le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR). Après une longue période pendant laquelle le BIPR montrait peu ou pas d'intérêt à discuter avec le CCI, on ne peut que saluer sa récente contribution sur cette question parue dans « Battaglia Comunista » (BC), publication de l'organisation du BIPR en Italie : le Parti Communiste Internationaliste (article « Le CCI et le cours historique : une méthode erronée », BC n° 83, mars 87, publié en anglais dans la « Communist Review » n° 5). Cela, non seulement parce que le texte contient des passages qui indiquent que BC s'éveille à certaines réalités de la situation mondiale actuelle, en particulier la fin de la contre-révolution et les « signes » — au moins cela — d'une reprise des luttes de classe. Mais aussi parce que, même là où le texte défend des positions fondamentalement erronées, il pose les questions essentielles : le problème de la méthode marxiste dans la compréhension de la dynamique de la réalité ; les conditions qui permettent le déchaînement d'une nouvelle guerre mondiale ; le niveau réel de la lutte de classe aujourd'hui, et l'approche de cette question qu'a faite notre ancêtre commun, la Fraction Italienne de la Gauche Communiste dans les années 1930 et 1940.
La méthode marxiste : indiquer la direction ou agnosticisme ?
Dans la Revue Internationale n° 36 nous avons publié une autre polémique avec BC sur la question du cours historique (« Le cours historique : les années 80 ne sont pas les années 30 »). Un texte émanant du 5e Congrès de BC avait affirmé qu'il n'était pas possible de dire si les tourmentes sociales provoquées par la crise éclateraient avant, pendant ou après une guerre impérialiste mondiale. Dans notre réponse, ainsi que dans un texte de base sur le cours historique émanant de notre 3e Congrès en 1979 (voir Revue Internationale n° 18), nous disions que c'est une tâche cruciale et fondamentale des révolutionnaires que d'indiquer la direction générale dans laquelle évoluent les événements sociaux. C'est dommage que le texte de BC ne réponde pas vraiment à ces arguments. En fait, il ne fait pas grand chose d'autre que citer de nouveau le passage que nous avons longuement critiqué dans la Revue Internationale n° 36 ! Mais dans une autre partie de l'article, BC essaie au moins d'expliquer pourquoi il lui semble nécessaire de maintenir une attitude agnostique, considérant qu'il est impossible de se déterminer au sujet du cours historique ; et, plutôt que de répéter simplement tous les arguments qui sont contenus dans nos deux précédents articles, on va répondre à cette nouvelle « explication ».
Voici comment BC pose le problème :
« En ce qui concerne le problème que le CCI nous pose, de devenir des prophètes exacts du futur, la difficulté est que la subjectivité ne suit pas mécaniquement les mouvements objectifs. Bien qu'on puisse suivre de manière précise les tendances et les probables contre-tendances dans les structures du monde économique, ainsi que leurs rapports réciproques, il n'en va pas de même pour ce qui concerne le monde subjectif, ni pour la bourgeoisie ni pour le prolétariat. Personne ne peut croire que la maturation de la conscience, même de la plus élémentaire conscience de classe, puisse être déterminée de manière rigide à partir de données observables et mises dans un rapport rationnel. »
Il est parfaitement exact que les facteurs subjectifs ne sont pas déterminés mécaniquement par les facteurs objectifs et que, en conséquence, il n'est pas possible de faire des prédictions exactes sur les lieu et place des luttes prolétariennes à venir. Mais cela ne veut pas dire qu'historiquement le marxisme se soit confiné à prédire seulement les tendances de l'économie capitaliste. Au contraire : dans le Manifeste Communiste, Marx et Engels ont défini les communistes comme ceux qui « ont l'avantage d'une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien ». Et durant toute leur vie ils ont essayé de mettre en pratique cette proposition théorique, alignant étroitement leur activité organisationnelle sur les perspectives qu'ils traçaient pour la lutte des classes (soulignant la nécessité de réflexion théorique après les défaites des révolutions de 1848, pour la formation des 1ére et 2e Internationales dans des périodes de reprise des luttes, etc. ). Ils se sont parfois trompés et ont dû réviser leurs prédictions, mais ils n'ont jamais abandonné l'effort qui a fait d'eux les éléments qui ont vu le plus loin dans le mouvement prolétarien. De même, les positions révolutionnaires intransigeantes adoptées par Lénine en 1914 et en 1917 se basaient sur une confiance inébranlable dans le fait que les horreurs « objectives » de la guerre impérialiste faisaient mûrir en profondeur la conscience de classe du prolétariat. Et quand la Fraction italienne dans les années 30 a insisté si fortement sur la nécessité de fonder toute son activité sur une analyse adéquate du cours historique, elle ne faisait que suivre la même tradition. Et ce qui s'applique à la dimension historique plus large s'applique aussi à la lutte immédiate ; afin de pouvoir intervenir concrètement dans un mouvement de grève, les communistes doivent développer leur capacité d'évaluer et réévaluer la dynamique et la direction des luttes. Le fait d'avoir affaire à des facteurs « subjectifs » n'a jamais empêché les marxistes d'accomplir ce travail essentiel.
Les conditions de la guerre généralisée aujourd'hui
Le CCI a toujours soutenu que, pour pouvoir envoyer le prolétariat à une nouvelle guerre, le capitalisme a besoin d'une situation caractérisée par « l'adhésion croissante des ouvriers aux valeurs capitalistes (et à leurs représentants politiques et syndicaux) et une combativité qui soit tend à disparaître, soit apparaît au sein d'une perspective totalement contrôlée par la bourgeoisie » (Revue Internationale n° 36, « Cours historique : les années 80 ne sont pas les années 30 »).
Peut-être parce qu'il ne veut pas continuer à insister (comme il la fait dans le passé) sur le fait que le prolétariat est encore aujourd'hui écrasé par le talon de fer de la contre-révolution, BC fournit une nouvelle réponse :
«...la forme de guerre, ses moyens techniques, son rythme, ses caractéristiques par rapport à l'ensemble de la population, ont beaucoup changé depuis 1939. Plus précisément, la guerre aujourd'hui nécessite moins de consensus ou de passivité de la part de la classe ouvrière que les guerres d'hier. Qu'il soit clair que nous ne sommes pas en train de théoriser la séparation complète du "militaire" et du "civil" qui, particulièrement au niveau de la production, sont de plus en plus interconnectés. Plutôt, nous voulons mettre en relation la rapidité et le haut contenu technique de la guerre, avec son cadre économique, politique et social. Cette relation est telle que l'engagement dans des actions de guerre est possible sans l'accord du prolétariat. Chaque bourgeoisie est capable de compter sur sa victoire pour rétablir un consensus ainsi que sur les autres choses qu'amène la victoire : occupation de territoires, etc. Et il est évident que chaque bourgeoisie entre en guerre en pensant à la victoire. »
En lisant ce passage, il est difficile de comprendre de quelle guerre parle BC. Les conditions mentionnées ci-dessus pourraient s'appliquer à des aventures impérialistes très limitées telles que les divers raids et expéditions que l'Occident a faits au Proche-Orient — quoique même ces actions doivent s'accompagner de campagnes idéologiques intenses pour embobiner le prolétariat sur ce qui est en train de se passer. Mais nous ne parlons pas d'actions limitées ou locales mais de guerre mondiale, une troisième guerre mondiale dans un siècle où les guerres ont été chaque fois plus globales — embrassant la planète entière — et totales, exigeant la coopération active et la mobilisation de toute la population. BC suggérer ait-il sérieusement que la 3e guerre mondiale pourrait se faire avec des armées professionnelles, sur un champ de bataille « distant », et que l'« interconnexion » des secteurs civils et militaires qui s'ensuivrait n'imposerait pas des sacrifices monstrueux à toute la population travailleuse ? Avec une vision si moyenâgeuse de la guerre mondiale, il n'est pas surprenant que BC puisse encore avoir des espoirs sur une révolution prolétarienne victorieuse pendant et même après le prochain conflit mondial ! Ou alors, par « moyens techniques » et « rythme », BC veut dire que la 3e guerre commencera d'emblée par le bouton qu'on appuie et qui déclenche la guerre atomique. Mais, si c'est le cas, cela n'a aucun sens de parler de victoire de la bourgeoisie ou du prolétariat, vu que le monde serait réduit à des décombres.
En fait, il est pratiquement certain que l'escalade d'une troisième guerre mondiale aboutirait à l'holocauste nucléaire, ce qui est une raison suffisante pour ne pas parler à la légère de la révolution prolétarienne émergeant pendant ou après la prochaine guerre. Mais nous sommes d'accord sur le fait que « chaque bourgeoisie va à la guerre en pensant à la victoire ». C'est pourquoi la bourgeoisie ne veut pas plonger tout de suite dans la guerre nucléaire, c’est pourquoi elle dépense des milliards à chercher des moyens de gagner la guerre sans tout annihiler au passage. La classe dominante sait aussi que les enjeux essentiels de la prochaine guerre seraient les cœurs industriels de l'Europe. Et elle est certainement assez intelligente pour reconnaître que pour que l'Occident puisse occuper l'Europe de l'Est ou pour que la Russie s'empare des richesses de l'Europe de l'Ouest, il faudrait l'engagement et la mobilisation totale des masses prolétariennes, soit dans les fronts militaires soit dans les lieux de production, et cela particulièrement en Europe.
Mais pour que cela soit possible, la bourgeoisie doit s'assurer au préalable non seulement de la « passivité » de la classe ouvrière, mais de son adhésion active aux idéologies de guerre de ses exploiteurs. Et c'est précisément de cela que la bourgeoisie ne peut pas s'assurer aujourd'hui.
Le resurgissement historique du prolétariat
En 1982 le texte du congrès de BC disait que « si le prolétariat aujourd'hui, confronté à la gravité de la crise et subissant les coups répétés des attaques bourgeoises, ne s'est pas encore montré capable de riposter, cela signifie simplement que le long travail de la contre-révolution mondiale est encore actif dans les consciences ouvrières » ; que le prolétariat aujourd'hui « est fatigué et déçu, bien que pas définitivement battu ».
Le texte de BC le plus récent sur le sujet dénote un progrès certain sur ce point. Pour la première fois, il constate sans équivoque que « la période contre-révolutionnaire qui a suivi la défaite de la révolution d'octobre a pris fin » et qu'« il ne manque pas de signes d'une reprise de la lutte de classe et on ne manque pas de les signaler ». Et en fait on a déjà signalé que les pages de Battaglia ont montré un suivi conséquent des mouvements de classe massifs en Belgique, France, Yougoslavie, Espagne, etc.
Cependant, l'attitude sous-jacente du BIPR demeure une attitude de profonde sous-estimation de la profondeur réelle de la lutte de classe aujourd'hui et c'est cela pardessus tout qui le rend incapable de voir à quel point le prolétariat représente un obstacle aux plans de guerre de la bourgeoisie ([1] [96]).
Battaglia a peut-être remarqué quelques « signes » de riposte de la classe ouvrière dans les années 86-87. Mais ces « signes » sont en réalité le point le plus avancé d'une succession de vagues internationales qui remontent à mai 68 en France. Mais quand la première de ces vagues s'est manifestée, que ce fût en France en 1968 ou lors de l'« automne chaud » en Italie (1969), Battaglia n'y a pas attaché d'importance, les qualifiant d'éruptions bruyantes des couches petites-bourgeoises étudiantes ; elle a ridiculisé les arguments des prédécesseurs du CCI sur l'ouverture d'une nouvelle période et puis est retournée se coucher. Lors de son 5e congrès, en 1982, elle projetait encore sa propre fatigue sur le prolétariat, malgré le fait qu'il y avait déjà eu une seconde vague de luttes entre 78 et 81, qui a culminé dans les grèves de masses en Pologne. Et, après un court reflux après 1981, une nouvelle vague a débuté en Belgique, en septembre 83 ; mais ce n'est qu'en 86, trois ans après le début de cette vague, que BC a commencé à voir les « signes » d'une reprise des luttes de classe ! Ce n'est donc pas surprenant que BC ait du mal à voir où va le mouvement de la classe, vu l'ignorance qu'il a d'où il vient. Typique de cet aveuglement, même par rapport au passé, est cet extrait de son dernier article selon lequel : « après 74 et 79 la crise a poussé la bourgeoisie à asséner des attaques beaucoup plus sérieuses sur la classe ouvrière, mais la combativité ouvrière qui a été tellement saluée, n'a pas augmenté». La vague de luttes de 78 à 81 se trouve donc effacée de l'histoire...
N'interprétant les luttes actuelles que comme un premier et timide début de reprise des luttes plutôt que de les situer dans une dynamique historique en évolution depuis presque vingt ans, BC est par conséquent incapable de mesurer la réelle maturation de la conscience de classe qui a été à la fois un produit et un facteur actif de ces luttes.
Ainsi, quand le CCI dit que les idéologies que le capitalisme utilisait afin de mobiliser la classe pour la guerre dans les années 30 — fascisme/anti-fascisme, défense de la Russie « socialiste », etc. — sont maintenant usées, discréditées aux yeux des ouvriers, Battaglia affirme que la bourgeoisie peut toujours trouver des alternatives au stalinisme ou aux campagnes sur fascisme/antifascisme des années 30. Mais, assez curieusement, il ne nous dit pas lesquelles. Si, par exemple, quand il parle de trouver d'« autres obstacles » au stalinisme il veut dire des obstacles à la gauche du stalinisme, cela apporte de l'eau à notre moulin : parce que quand la bourgeoisie est obligée de mettre son extrême gauche en première ligne pour faire face à la menace prolétarienne, cela ne fait que traduire un processus réel de radicalisation qui s'opère dans la classe.
La vérité est que le désengagement croissant du prolétariat des principales idéologies et institutions de la société bourgeoise est un problème réel pour la classe dominante, en particulier quand elle affecte les principaux organismes chargés de discipliner les ouvriers : les syndicats. Et, à ce niveau, BC semble particulièrement aveugle à ce qui se passe dans la classe ouvrière :
«Le CCI devrait indiquer ici les termes dans lesquels se présente le cours qu'ils ont adopté : une renaissance de la combativité, la faillite des vieux mythes, la tendance à se débarrasser des entraves syndicales... Comme il n'existe pas de réelles pièces à conviction (de cela)... il lui est nécessaire de tricher avec la réalité, l'exagérer, la distordre, l'inventer. »
Ainsi, la tendance croissante à la désyndicalisation (dont la presse bourgeoise se lamente dans beaucoup de pays), le nombre croissant de grèves qui éclatent spontanément, ignorant ou débordant les directives syndicales (comme en Belgique en 83 et 86, au Danemark en 85, la grève de British Telecom début 86, les cheminots en France, les mineurs et métallurgistes en Espagne, et beaucoup d'autres mouvements), les ouvriers qui de plus en plus souvent huent les discours syndicaux, ignorent les pseudo actions syndicales ou les transforment en vraies actions de classe, l'apparition de formes d'auto organisation ouvrière indépendantes et unitaires (comme à Rotterdam en 1979, en Pologne en 1980, en France fin 86-début 87 avec la grève des cheminots, ou la grève des enseignants en France et en Italie...), le surgissement de noyaux d'ouvriers combatifs en dehors des structures syndicales (Italie, Belgique, France, Grande-Bretagne...) toutes ces « pièces à conviction » sur « la tendance à se débarrasser des entraves syndicales» que la presse du CCI suit et commente depuis des années, tout cela ne serait que « pure invention » de notre part, ou au mieux, une « distorsion » de la réalité.
Est-ce que la lutte de classe affecte la bourgeoisie ?
Si l'idée d'une marée montante de résistance prolétarienne n'est qu'une pure invention du CCI, alors il devrait s'ensuivre que la bourgeoisie n'a pas à prendre la classe ouvrière en considération lorsqu'elle élabore ses stratégies économiques ou politiques. Et BC n'hésite pas à tirer cette conclusion :
«Il n'existe pas une seule politique dans l’économie politique des pays métropolitains (à l'exception peut-être de la Pologne et la Roumanie) qui ait été modifiée par la bourgeoisie par suite de luttes du prolétariat ou de fractions de celui-ci. »
Si ce que Battaglia veut dire est que la bourgeoisie n'élabore pas ses attaques économiques (ou ses campagnes de propagande, ses stratégies électorales, etc.) en anticipant sûr les réactions qu'elles vont provoquer chez les ouvriers alors il prend la bourgeoisie pour une imbécile — erreur que les marxistes peuvent difficilement se permettre. En même temps, BC laisse entendre que les bourgeoisies polonaise et roumaine seraient les plus rusées du monde ! En fait, ce n'est pas un hasard si ces deux exemples sont cités. La forme stalinienne de capitalisme d'Etat met souvent plus en relief des tendances qui sont moins évidentes parce que plus banales dans les variantes occidentales du capitalisme d'Etat. On peut toutefois se demander quelles modifications de la politique de la bourgeoisie BC discerne en Roumanie jusqu'à présent. Quant aux modifications de la politique de la bourgeoisie en Pologne pour mieux attaquer la classe ouvrière, qu'on a vues à l'œuvre face à la lutte de classe en 1980 : fausse libéralisation, utilisation du syndicalisme « rénové » à la sauce Solidarnosc, étalement des attaques dans le temps, etc., ce sont celles employées couramment depuis des décennies en Occident. Ce sont les mêmes que Gorbatchev veut généraliser à l'ensemble de son bloc pour mieux confronter la lutte de classe renaissante. Même les fractions les plus rigides et brutales de la bourgeoisie sont aujourd'hui amenées à modifier et adapter leur politique pour mieux confronter la lutte de classe en plein développement.
Par ailleurs, dire que le prolétariat, malgré toutes les luttes massives de ces dernières années, n'a aucunement réussi à faire reculer les mesures d'austérité de la classe dominante, c'est dénier toute signification aux luttes défensives de la classe. Logiquement cela impliquerait que seule la lutte immédiate pour la révolution peut défendre les intérêts ouvriers. Mais, bien qu'en termes globaux il soit vrai que la révolution est la seule ultime défense du prolétariat, il est aussi vrai que les luttes actuelles de la classe sur le terrain des revendications économiques ont à la fois retenu la bourgeoisie de faire des attaques encore plus sauvages, et, dans bon nombre de circonstances, obligé la bourgeoisie à remettre des attaques qu'elle essayait d'imposer. L'exemple de la Belgique en 86 est particulièrement significatif à ce sujet, parce que c'est la menace réelle d'unification des luttes qui a obligé la bourgeoisie à reculer temporairement.
Mais la signification la plus profonde de la capacité prolétarienne à faire reculer les attaques économiques de la classe dominante c'est qu'elle représente aussi la résistance du prolétariat à la poussée du capitalisme vers la guerre. Parce que si la bourgeoisie ne peut pas obliger les ouvriers à se résigner à faire des sacrifices toujours plus lourds au nom de l'économie nationale, elle ne pourra pas plus mettre en place la militarisation du travail que requiert une guerre impérialiste.
Pour Battaglia, cependant, le prolétariat n'est pas encore à la hauteur. Les preuves que nous donnons d'un désengagement croissant de l'idéologie bourgeoise, d'une combativité et d'une conscience en développement, tout cela en fait, «présenté par le CCI comme une "preuve', est extrêmement faible et insuffisant pour caractériser un cours historique. »
Le fait est que pour Battaglia, la seule chose qui pourrait avoir un effet quelconque sur la poussée à la guerre est la révolution elle-même. Notre texte de 1979 répondait déjà à cet argument : « Certains groupes, tel "Battaglia Comunista", estiment que la riposte prolétarienne à la crise est insuffisante pour constituer un obstacle au cours vers la guerre impérialiste. Ils estiment que les luttes devraient être "de nature révolutionnaire" pour qu'elles puissent contrecarrer réellement ce cours et basent leur argumentation sur le fait qu'en 1917-18, c'est la révolution seule qui a mis fin à la guerre impérialiste. En fait, ils commettent une erreur en essayant de transposer un schéma en soi juste sur une situation qui n'y rentre pas. Effectivement, un surgissement du prolétariat dans et contre la guerre prend d'emblée la forme d'une révolution :
— parce que la société est alors plongée dans la forme la plus extrême de sa crise, celle qui impose aux prolétaires les sacrifices les plus terribles,
— parce que les prolétaires en uniforme sont déjà armés,
— parce que les mesures d'exception (loi martiale, etc.) qui sévissent alors rendent tout affrontement de classe plus violent et frontal,
— parce que la lutte contre la guerre prend immédiatement une forme politique d'affrontement avec l'Etat qui mène la guerre sans passer par l'étape de luttes économiques qui, elles, sont beaucoup moins frontales.
Mais toute autre est la situation quand la guerre ne s'est pas encore déclarée.
Dans ces circonstances, toute tendance, même limitée à la montée des luttes sur un terrain de classe suffit à enrayer l'engrenage dans la mesure où :
— elle traduit un manque d'adhésion des ouvriers aux mystifications capitalistes,
— l'imposition aux travailleurs de sacrifices bien plus grands que ceux qui ont provoqué les premières réactions risque de déclencher de leur part une réplique en proportion. » (« Revue Internationale » n° 18, « Le Cours historique », p. 23.)
Ce à quoi nous ne pouvons qu'ajouter qu'aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, on se dirige vers une confrontation de classes généralisée provoquée non par une guerre mais par une crise économique qui s'étend dans le temps. Le mouvement de luttes qui pose les fondations pour cette confrontation est par conséquent lui-même très long et paraît même très peu spectaculaire en comparaison aux événements de 1917-18. Néanmoins, rester fixé sur les images de la première vague révolutionnaire et mésestimer les luttes actuelles, c'est bien la dernière chose à faire pour se préparer aux explosions sociales massives qui vont venir.
La Fraction Italienne et le cours de l'histoire
La manière dont le CCI pose la question du cours historique se base en grande partie sur la méthode de la Fraction Italienne de la Gauche communiste, dont l'activité politique, dans les années 30 était fondée sur la reconnaissance du fait que la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23 et l'assaut de la crise de 1929 avaient ouvert un cours vers la guerre impérialiste.
Bien que le Parti Communiste Internationaliste revendique aussi une continuité organique avec la Fraction, il n'a pas réellement assimilé beaucoup de ses contributions les plus vitales, et cela est particulièrement vrai par rapport à la question du cours historique. Ainsi, alors que ce que nous voyons dans la clarté avec laquelle la Fraction traite ce problème c'est que cela lui a permis d'apporter une réponse internationaliste aux événements d'Espagne 1936-39 — contrairement à tous les autres courants prolétariens, du trotskysme à Union Communiste et la minorité de la Fraction elle-même, qui ont succombé à des degrés divers à l'idéologie de l'antifascisme — Battaglia est seulement avide de trouver l'« erreur méthodologique » de la Fraction :
«La Fraction (spécialement son CE. et en particulier Vercesi) dans les années 30, ont évalué la perspective comme étant vers la guerre de manière absolue. Avaient-ils raison ? Certes, les faits leur ont donné intégralement raison. Mais même alors le fait de faire du cours quelque chose d'absolu a conduit la Fraction à faire des erreurs politiques...
L'erreur politique était la liquidation de toute possibilité d'intervention politique révolutionnaire en Espagne avant la défaite réelle du prolétariat, avec le consécutif durcissement des divergences entre la minorité et la majorité sur une base où aucune des deux n'était à son avantage. Les "internationalistes" se sont laissés absorber par les milices du POUM dont ils ont vite été déçus et sont retournés à la Fraction. La majorité est restée à regarder et pontifier : "II n'y a rien à faire..." »
Revenant au CCI aujourd'hui, Battaglia poursuit :
« Aujourd'hui l'erreur du CCI est fondamentalement la même, même si l'objet est inversé. On fait un absolu du cours vers les affrontements avant la guerre ; toute l'attention est tournée vers cette ingénieuse et irresponsable sous-évaluation de ce qui est devant les yeux de tout le monde en ce qui concerne la course de la bourgeoisie à la guerre. »
Ce passage est rempli d'erreurs. Pour commencer, BC semble mélanger les notions de cours et celle de tendances produites par la crise. Quand il nous accuse de « faire un absolu » du cours vers les affrontements de classe il semble penser que nous voulons nier la tendance à la guerre. Mais ce que nous voulons dire par cours aux affrontements de classe est que la tendance à la guerre — permanente en décadence et aggravée par la crise — est entravée par la contre tendance aux soulèvements prolétariens. Par ailleurs, ce cours n'est ni absolu ni éternel : il peut être remis en question par une série de défaites de la classe ouvrière. En fait, simplement parce que la bourgeoisie est la classe dominante de la société, un cours vers les affrontements de classe est plus fragile et réversible qu'un cours à la guerre.
Deuxièmement, BC déforme complètement l'histoire de la Fraction ; nous ne développerons pas ici en détail l'histoire complexe des groupes de la Gauche communiste ([2] [97]). Il faut cependant préciser rapidement quelques points.
Ce n'est pas vrai que la position de la majorité était qu'« il n'y avait rien à faire ». Alors qu'elle s'opposait à toute idée d'engagement dans les milices antifascistes, la majorité a envoyé une délégation de camarades en Espagne pour étudier la possibilité de créer un noyau communiste sur place, malgré le danger évident que représentaient les troupes de choc staliniennes : ces camarades ont manqué de peu se faire assassiner à Barcelone. En même temps, en dehors de l'Espagne, les Fractions italienne et belge (et aussi mexicaine : « Groupe ouvrier marxiste ») ont émis un certain nombre d'appels dénonçant le massacre en Espagne et insistant sur le fait que la meilleure solidarité avec les ouvriers espagnols était que les prolétaires des autres pays se mettent en lutte pour leurs propres revendications.
C'est vrai que, devant la 2e guerre mondiale, une tendance s'est cristallisée autour de Vercesi, qui niait « l'existence du prolétariat pendant la guerre » et rejetait toute possibilité d'activité révolutionnaire. C'est aussi vrai que les Fractions de gauche en général ont plongé dans le désarroi et l'inactivité peu avant l'éclatement de la guerre. Mais la source de ces erreurs réside précisément dans l'abandon de leur précédente clarté sur le cours historique. La théorie, formulée surtout par Vercesi, d'une « économie de guerre » qui aurait surmonté les crises de surproduction et par conséquent toutes autres guerres, preuve d'une solidarité inter-impérialiste pour écraser le danger prolétarien, a abouti à la disparition de la revue « Bilan » et la publication d'« Octobre » qui se voulait une anticipation d'une nouvelle reprise révolutionnaire. Les Fractions s'en sont trouvées complètement désarmées à la veille de la guerre : loin de « fixer toute leur attention sur la guerre » comme le dit BC, « Octobre » a interprété l'occupation de la Tchécoslovaquie et les accords de Munich comme des tentatives désespérées de prévenir la révolution ! Il faut dire qu'une minorité significative de l'organisation s'est opposée à cette révision radicale des analyses précédentes de la Fraction. Quelques-uns des porte-parole les plus clairs de cette minorité ont été réduits à silence dans les camps de mort nazis. Mais en France on a continué à défendre cette position même pendant la guerre ; et ce n'est pas par hasard que les mêmes camarades qui ont insisté sur la nécessité de poursuivre l'activité communiste pendant la guerre ont aussi été capables de résister à la fièvre activiste qu'ont provoquée les mouvements prolétariens en Italie en 1943, quand la majorité des camarades de la Gauche Italienne y ont vu un nouveau 1917 décident que le moment de former le parti était venu. Le Parti Communiste Internationaliste est l'héritier direct de cette erreur de méthode ([3] [98]).
Dans ce contexte, cela vaut aussi la peine de signaler que les éléments de la minorité « internationaliste » ne sont pas retournés à la Fraction comme le dit BC. Ils sont revenus à Union Communiste, qui était à mi-chemin entre la gauche communiste et le trotskysme. Et après 1943 ils sont retournés... au Parti Communiste Internationaliste. Ils se sentaient sans doute plus à l'aise dans une organisation dont les ambiguïtés concernant les formations de partisans en Italie étaient sensiblement les mêmes que leurs propres ambiguïtés envers les milices antifascistes en Espagne... ([4] [99]). De même Vercesi, d'abord opposé à la formation prématurée du parti, finit par le rejoindre dans l'activisme et la confusion après avoir participé à un « comité anti-fasciste » à Bruxelles !
Le danger qui guette Battaglia
Comme nous venons de le voir, les origines mêmes de Battaglia reposent sur une analyse erronée du cours historique. La formation précipitée du PCI pendant la 2e guerre mondiale a abouti à un abandon de la clarté qu'avait atteinte Bilan sur beaucoup de points, en particulier sur les questions de « fraction », « parti » ou « cours historique ». Ces erreurs ont atteint leur forme la plus caricaturale dans le courant « bordiguiste » qui a scissionné du courant de Battaglia en 1952 ; mais c'est très difficile pour ce dernier de dépasser les ambiguïtés qui lui restent sans remettre en question ses propres origines.
Dans son récent article BC affirme que les erreurs de méthode du CCI, ses déformations de la réalité, ont entraîné des scissions et en amèneront d'autres. Mais le fait est que les pronostics du CCI se sont avérés fondamentalement justes depuis 1968. Nous avons été les premiers à réaffirmer la réapparition de la crise historique à la fin des années 60. Nos prédictions sur le développement de la lutte de classes se sont confirmées avec les différentes vagues qui ont eu lieu depuis lors. Et, malgré tous les sarcasmes et les incompréhensions du milieu politique, il devient de plus en plus évident que la « gauche dans l'opposition » est bien la stratégie politique essentielle de la bourgeoisie dans la période actuelle. Ceci n'est pas pour dire que nous n'avons pas fait des erreurs ou subi des scissions. Mais avec un cadre d'analyses qui est fondamentalement valable, dans une période pleine de possibilités pour le travail révolutionnaire, les erreurs peuvent se corriger et les scissions peuvent aboutir à un renforcement de l'organisation.
Le danger qui guette Battaglia est d'un ordre différent. Il est tellement attaché à sa fausse analyse du cours historique, tellement lié à un certain nombre de conceptions politiques dépassées, qu'il risque de voir éclater l'« homogénéité » dont il fait montre aujourd'hui en une série d'explosions provoquées par la pression constante de la lutte de classe, la contradiction croissante entre ses analyses et la réalité de la lutte des classes.
Que cela plaise à Battaglia ou pas, nous allons vers des confrontations de classe immenses. Les courants qui n'y seront pas préparés risquent de se faire emporter par le souffle de l'explosion.
MU
[1] [100] On parle ici à un niveau général. A certains moments — et en totale contradiction avec l'article auquel nous répondons ici — Battaglia va même jusqu'à appuyer la thèse selon laquelle le capitalisme doit d'abord réduire à silence le prolétariat avant de pouvoir l'envoyer à la guerre. Ainsi, dans le même numéro de Battaglia où est paru cet article, on peut lire un article « Réaffirmons quelques vérités sur la lutte de classes » qui dit : « réaffirmons pour la nième fois aux ouvriers que ne pas lutter contre les sacrifices qu'impose la bourgeoisie revient à laisser la bourgeoisie consolider la paix sociale requise comme prélude à une troisième guerre impérialiste. » (Souligné par nous).
[2] [101] Voir notre brochure « La Gauche communiste d'Italie ».
[3] [102] On trouvera une documentation plus fournie sur la réponse de la Fraction à la guerre en Espagne et la 2e guerre mondiale dans notre brochure « La Gauche Communiste d'Italie ».
[4] [103] Sur les ambiguïtés du PCI sur la question des partisans, voir la Revue Internationale n° 8 : « Les ambiguïtés sur "les partisans" dans la constitution du PCI en Italie 1943 ».
Courants politiques:
- Gauche Communiste [30]
- Battaglia Comunista [104]
Approfondir:
Questions théoriques:
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise de 1914 au début des années 1920 (3° partie)
- 3061 reads
L'ANNEE 1918 : ENTRE LA REVOLUTION ET L'OPPORTUNISME, LA NAISSANCE DU PARTI COMMUNISTE HOLLANDAIS
L'année 1918 est une année décisive pour le mouvement révolutionnaire hollandais. La minorité du SDP, constituée de différentes fractions, devient une opposition structurée contre l'opportunisme de la direction Wijnkoop-Van Ravesteyn. Cette opposition se développe numériquement au rythme de la croissance du SDP, qui se proclame en novembre Parti communiste, au moment où la révolution frappe aux portes des Pays-Bas.
L'offensive de la minorité dans le SDP: entre la fraction et l'opposition
Au printemps 1918, le SDP connaît une crise sans précédent en son sein. La minorité est directement menacée d'écrasement par la direction autoritaire de Wijnkoop. Celui-ci fait suspendre — phénomène inouï dans l'histoire du SDP — la section de La Haye, Tune des plus combatives dans l'opposition à Wijnkoop. Cette suspension venait après plusieurs exclusions individuelles de militants de l'opposition. Ces mesures, en contradiction avec la démocratie ouvrière, faisaient apparaître la direction comme de dignes émules de Troelstra.
L'opposition ne tarda pas à se regrouper, lors d'une réunion commune tenue le 26 mai 1918. Elle était composée de groupes qui jusqu'ici avaient réagi de façon dispersée à l'opportunisme dans la SDP:
— l'Union de propagande Gauche de Zimmerwald, d'Amsterdam, dirigée par Van Reesema, qui œuvrait pour le rattachement du parti à la gauche bolchevik ;
— le groupe de Luteraan, à Amsterdam, en relation étroite avec Gorter ;
— le groupe de Rotterdam ;
— la section de La Haye.
L'opposition représentait un tiers des militants du parti. Elle se dota d'un organe bimensuel, «De Internationale», dès juin. Une commission de rédaction était mise en place. La commission de presse, qui se réunissait tous les trois mois, et était composée des représentants des 4 groupes ([1] [107]) formait dans les faits un organe exécutif. Cette opposition était bien près de former une fraction à l'intérieur du SDP, avec son journal et sa commission. Il lui manquait, cependant, une plate-forme clairement établie, faute d'homogénéité. Elle souffrait aussi cruellement de l'absence de Gorter, qui de Suisse ne contribuait aux débats que sous forme d'articles, dont la parution était d'ailleurs soumise à la mauvaise volonté de la rédaction de « De Tribune », entièrement contrôlée par Wijnkoop et Van Ravesteyn. ([2] [108])
La cause de ce regroupement des oppositions était l'hostilité croissante à la politique du parti, de plus en plus tournée vers les élections. Celles-ci, qui s'étaient déroulées, le 3 juillet, avaient été un véritable succès pour le SDP. Pour la première fois, il siégeait au Parlement : Wijnkoop et Ravesteyn devenaient députés, cela avait été rendu possible par une alliance avec le petit parti socialiste (S. P.), sorti du SDAP en 1917. Celui-ci dirigé par un chef du NAS — Kolthek ([3] [109]) — était ouvertement pro Entente. Avec les chrétiens sociaux, autre composante de ce «front uni» électoral, il obtenait un siège à l'Assemblée.
L'opposition, par suite de cette alliance, qu'elle dénonçait comme une «union monstrueuse» avec les éléments syndicalistes pro Entente, souligna que le succès électoral était un succès démagogique. Les voix glanées chez les militants syndicalistes du NAS l'avaient été par une campagne qui apparaissait comme un soutien à la politique des USA. Alors que les Etats-Unis retenaient dans ses ports la flotte de commerce hollandaise, pour l'utiliser dans la guerre contre l'Allemagne, en échange de denrées alimentaires pour les Pays-Bas, Wijnkoop affirmait que tous les moyens étaient bons pour obtenir des USA ces denrées. Une telle politique fut vivement dénoncée par Gorter et la section de Bussum, mais beaucoup plus tard, en novembre. Avec Gorter, l'opposition voyait de plus en plus en Wijnkoop un nouveau Troelstra, dont l'amour pour la révolution russe était «purement platonique» et la politique purement parlementaire ([4] [110]).
L'approche de la fin de la guerre, avec les événements révolutionnaires qui l'accompagnèrent, plaça au second plan la lutte de l'opposition contre la politique pro Entente de Wijnkoop. De plus en plus elle souligna ([5] [111]) le danger d'une politique parlementaire. Elle combattit avec force le syndicalisme révolutionnaire, celui du NAS, qui s'était mis à travailler avec le syndicat réformiste NVV, soumis au parti Troelstra. En germe, se trouve la politique antiparlementaire et antisyndicale de la future Gauche Communiste hollandaise. Cette politique signifiait une rupture avec l'ancien «tribunisme».
La révolution avortée de novembre 1918
C'est un parti en pleine croissance numérique, mais menacé d'éclatement, qui subit l'épreuve du feu des événements révolutionnaires de novembre.
Ce sont les événements en Allemagne, où le gouvernement est tombé fin octobre, qui créent une véritable atmosphère révolutionnaire aux Pays-Bas. De véritables mutineries éclatent dans les camps militaires les 25 et 26 octobre 1918. Elles succèdent à une agitation ouvrière permanente contre la faim, durant les mois de septembre et octobre, à Amsterdam et Rotterdam.
Il est symptomatique de voir la social-démocratie officielle de Troelstra se radicaliser. Au grand étonnement des autres chefs du SDAP, le dirigeant du parti tient des discours enflammés pour la révolution, pour la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Il proclame, à la stupéfaction de la bourgeoisie hollandaise, qu'il était son adversaire irréductible :
«Ne sentez-vous pas peu à peu avec les événements que vous êtes assis sur un volcan...L'époque du système gouvernemental bourgeois est révolu. A présent, la classe ouvrière, la nouvelle force montante, doit vous prier de lui laisser la place et une place qu'il revient de lui remettre. Nous ne sommes pas vos amis, nous sommes vos adversaires, nous sommes, pour ainsi dire (sic), vos ennemis les plus résolus »
Troelstra, un «révolutionnaire» de la dernière heure ? Il tenait en fait un double langage. Dans le secret d'une réunion des instances du SDAP, tenue le 2 novembre — soit trois jours avant cette déclaration enflammée à la chambre des députés — Troelstra avouait crûment que sa tactique était de devancer l'action des révolutionnaires, encouragés par la révolution en Allemagne :
«Dans ces circonstances les contrastes s'accentueront dans la classe ouvrière et une partie croissante de celle-ci se placera sous la direction d'éléments irresponsables.»
Jugeant la révolution inévitable et pour neutraliser un éventuel « spartakisme » hollandais, Troelstra proposait d'adopter la même tactique que la social-démocratie allemande dans les conseils ouvriers ; en prendre la direction pour mieux les détruire :
«Nous n'appelons pas maintenant la révolution, mais la révolution nous appelle ... Ce qui s'est passé dans les pays qui font l'épreuve d'une révolution me fait dire : nous devons dès qu'elle arrive jusque là en prendre la direction.»
La tactique adoptée fut d'appeler à la formation de conseils ouvriers et de soldats, le 10 novembre, si l'exemple allemand devait gagner la Hollande. «Wijnkoop ne doit pas être le premier», affirmait Oudegeest, un des chefs du SDAP.
Mais le SDP fut le premier à appeler à la formation de conseils de soldats et à la grève, dès le 10 novembre. Il se prononçait pour l'armement des ouvriers et la formation d'un gouvernement populaire sur la base des conseils. Il exigeait aussi une « démobilisation immédiate » des appelés, mot d'ordre ambigu, puisque sa conséquence était le désarmement des soldats.
C'est ce mot d'ordre que reprit le SDAP, dans cette intention. A cela, il ajoutait le programme de la social-démocratie allemande, pour désamorcer les revendications révolutionnaires : socialisation de l'industrie, assurance chômage complète et travail de huit heures.
Mais les événements montrèrent que la situation aux Pays-bas était loin d'être encore révolutionnaire. Il y eut bien le 13 novembre un début de fraternisation entre ouvriers et soldats d'Amsterdam ; mais le lendemain, la manifestation se heurta aux hussards qui tirèrent sur la foule, laissant plusieurs morts sur le pavé. L'appel à la grève lancé par le SDP pour le lendemain, en protestation contre la répression, resta sans écho chez les ouvriers d'Amsterdam. La révolution était bien écrasée avant d'avoir pu pleinement se développer. L'appel à former des conseils ne rencontra qu'un succès limité ; seuls quelques groupes de soldats, dans des lieux isolés de la capitale — à Alkmaar et en Frise — se constituèrent en conseils. Constitution sans lendemain.
Si la situation n'était pas mûre pour une révolution, on doit constater que l'action du SDAP a été décisive pour empêcher tout mouvement de grève en novembre. Plus de 20 ans après, Vliegen, dirigeant du SDAP, l'avouait sans ambages :
«Les révolutionnaires n'ont pas accusé en vain le SDAP d'avoir en 18 étranglé le mouvement de grève, car la social-démocratie l'a alors consciemment freiné.»
Mais, à côté de la politique du SDAP pour empêcher la révolution, celle pratiquée par les syndicalistes du NAS et par le RSC — auquel adhérait le SDP — ne fut pas sans provoquer un désarroi dans les masses ouvrières. En effet, au cours des événements de novembre, le NAS entreprit de se rapprocher du SDAP et du NVV afin d'établir un éventuel programme d'action commune. Cette politique de « front uni » avant la lettre, vivement critiquée dans les assemblées du RSC, donnait l'impression que le RSC, auquel adhérait le NAS, et le SDAP se situaient sur le même terrain. La politique de sabotage du mouvement de grève n'était pas mise à nu. D'autre part, la direction du SDP n'émit aucune critique véritable du syndicalisme révolutionnaire ; elle estima, lors du congrès de Leiden tenu les 16 et 17 septembre, que «le NAS avait agi correctement » pendant la semaine révolutionnaire du 11 au 16 septembre.
La fondation du Parti communiste en Hollande (CPN)
La transformation du SDP en Parti communiste faisait de celui-ci le deuxième parti du monde, après le parti russe, à avoir abandonné l'étiquette «social-démocrate». Il se formait avant même le parti communiste allemand.
Petit parti, le CPN était en pleine croissance : plus de 1000 membres au moment du congrès ; chiffre qui doubla en l'espace d'un an.
Cette transformation ne mit pas fin à la politique autoritaire et manoeuvrière de Wijnkoop. Trois semaines avant le congrès, lui et Ceton, par un avis paru dans «De Tribune», s'étaient autoproclamés respectivement président et secrétaire du parti. Tous deux, en anticipant les résultats du congrès, donnaient un curieux exemple de démocratie. ([6] [112])
Cependant, le nouveau parti demeurait le seul pôle révolutionnaire aux Pays-Bas. Ce fait explique que le résultat du congrès de fondation fut la désagrégation de l'opposition. «De Internationale», organe de l'opposition, cessait de paraître en janvier 19. La démission des 26 membres de la section de La Haye en décembre 1918 qui refusaient de devenir membres du CPN apparaissait irresponsable. Sa transformation en groupe de « Communistes internationaux » pour se rattacher aux spartakistes et aux bolcheviks, sur une base antiparlementaire et de solidarité avec la révolution russe, fut sans lendemain. Ses membres, pour la plupart, ne tardèrent pas à regagner le parti. Le groupe Gauche de Zimmerwald, au sein du parti, ne tarda pas à se dissoudre lui aussi. Seule restait l'opposition « gortérienne » d'Amsterdam autour de Barend Luteraan. C'est ce groupe qui maintint la continuité avec l'ancienne opposition, en faisant paraître son propre organe, dès l'été 1919 : «De Roode Vaan» (« Le drapeau rouge »).
Contrairement à une légende qui en a fait un fondateur du parti communiste, Gorter était absent du congrès. Il s'était de plus en plus détaché du mouvement hollandais pour se consacrer entièrement au mouvement communiste international. Fin décembre, il était à Berlin, où il eut un entretien avec Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. De là, il rentrait aux Pays-Bas. Il refusait, malgré la demande pressante de Luteraan, de prendre la tête de l'opposition dans le CPN. La direction d'une opposition était pour lui «aussi bonne qu'impossible», en raison de son état de santé dégradé.
Il ne s'agissait pas de sa part d'un refus de toute activité politique. Quelques mois plus tard, il se retirait de toute activité au sein du CPN, pour se consacrer entièrement au mouvement communiste en Allemagne. Il devenait de fait un militant et le théoricien de l'opposition qui allait former le KAPD en avril 1920. Son activité se déployait totalement au sein de l'Internationale communiste, dans l'opposition.
Pannekoek, à la différence de Gorter, ne devint pas membre du KAPD. Il resta dans l'opposition au sein du CPN jusqu'en 1921, pour en démissionner. Ses contributions furent essentiellement théoriques plus qu'organisationnelles. Il s'agissait pour lui de déployer ses activités théoriques au sein du mouvement communiste mondial, principalement en Allemagne.
Ainsi, les têtes théoriques du «tribunisme» se détachaient du CPN. Elles constituaient l'Ecole hollandaise du marxisme, dont le destin était lié désormais théoriquement et organiquement à celui du KAPD en Allemagne. Désormais, la gauche communiste aux Pays-Bas était liée, jusqu'au début des années 30, à la gauche communiste allemande. Celle-ci, étroitement dépendante de l'Ecole hollandaise du marxisme, constituait le centre du communisme de gauche international, sur le terrain pratique de la révolution et sur le plan organisationnel. Quant au CPN, en dehors de l'opposition qui finit par s'en détacher, son histoire devient celle d'une section de plus en plus « orthodoxe » de l'Internationale communiste.
CH. (Fin du chapitre)
[1] [113] De Internationale, n° 1, 15 juin 1918, «Ons Orgaan», p. 1. Les lignes directrices du regroupement étaient : le rattachement politique à la Gauche zimmerwaldienne ; le combat contre l'Etat impérialiste néerlandais ; la lutte la plus aiguë contre toute les tendances réformistes et impérialistes parmi les syndiqués organisés dans le NAS et le NW (syndicat du SDAP).
[2] [114] Depuis août 1917, Wijnkoop et Van Ravesteyn étaient les seuls rédacteurs du quotidien.
[3] [115] Kolthek, qui fut élu député, était collaborateur d'un journal bourgeois « De Telegraaph », qui avait l'orientation la plus vigoureusement pro Entente. Avec son parti, le SP, et le BVSC, le SDP obtenait plus de 50 000 voix, dont 14 000 pour Wijnkoop à Amsterdam — soit la moitié de celles du SDAP. Les trois députés élus formèrent une «fraction parlementaire révolutionnaire» à la chambre.
[4] [116] Gorter rédigea un article assimilant Wijnkoop à Troelstra, publié sous le titre « Troelstra-Wijnkoop », le 18 septembre 1918 dans De Tribune. De Tribune, du 26 octobre 1918 soulignait : «l'amour du comité directeur pour la révolution russe est purement platonique. En réalité toutes les puissances de son amour sont dirigées vers l'extension de la popularité et de la croissance du parti avec l'aide des secours du parlement.»
[5] [117] L'opposition ne rejetait pas encore le parlementarisme ; elle souhaitait une discussion sérieuse dans le mouvement ouvrier pour déterminer la tactique future : « ...d'importants problèmes dans cette phase du mouvement ouvrier ne pouvaient s'éclaircir...Au sujet du parlementarisme, la rédaction soutient le point de vue que chacun doit pouvoir son avis là dessus dans "De Internationale". Cette question pourtant ne doit pas être encore épuisée... La même chose vaut pour la participation ou la non-participation aux élections. » (De Internationale, n° 9, 12 octobre 1918, « Landelijke conferentie van "de Internationale"».
[6] [118] De Tribune, 26 octobre 1918. Cité par WIESSING ; op. cit., p. 86. La nomination anticipée sous forme d'avis était annoncée de la façon suivante : « Attention ! étant donné que Wijnkoop est le seul candidat pour le poste de président du parti, il est par cela même déclaré élu à ce poste. Etant donné que l'unique candidat pour le poste de secrétaire du parti est Ceton, il est en conséquence déclaré élu. Les candidats pour le poste de vice-président sont: A. Lisser et B. Luteraan. »
Géographique:
- Hollande [28]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [30]
La gauche hollandaise en 1919-1920 (1° partie) : la troisième internationale
- 3359 reads
En janvier 1919, était envoyée à différents partis communistes, qui venaient à peine de se constituer, et à des fractions ou oppositions révolutionnaires dans les anciens partis, une lettre d'invitation au congrès de la « nouvelle Internationale révolutionnaire ». A l'origine, il ne s'agissait pas de convoquer un congrès, mais une simple « conférence socialiste internationale », pour préparer la fondation de la 3e Internationale. Elle devait se tenir avant le premier février, soit à Berlin, soit en Hollande, clandestinement. L'écrasement de l'insurrection de janvier à Berlin modifia le plan originel : la conférence dut se tenir à Moscou, du 2 au 6 mars 1919.
Le parti communiste hollandais reçut la convocation. Il avait déjà décidé lors de son congrès de novembre 1918 d'envoyer un délégué lorsque serait connue la convocation au congrès de la troisième Internationale. Pourtant, l'attitude de la direction du CPN fut exactement la même que celle qu'elle avait adoptée pour les trois conférences du mouvement de Zimmerwald. Bien qu'ayant reçu tous les moyens pour faire le voyage vers Moscou, Wijnkoop ne « réussit » pas à se mettre en route. Il s'agissait en fait de sa part d'un refus. Pour expliquer ce refus, toujours camouflé derrière une phrase sectaire, il fit paraître les articles du journaliste bourgeois Ransome qui prétendait que le congrès de la troisième Internationale n'aurait été qu'une « pure opération slave ».
Finalement, le parti communiste des Pays-Bas fut représenté indirectement, et uniquement avec voix consultative, au premier congrès de la nouvelle internationale. Son représentant, Rutgers, ne venait pas directement des Pays-Bas : il avait quitté le pays en 1914 pour les Etats-Unis, où il était devenu membre de la Ligue américaine de propagande socialiste ([1] [119]). Parvenu à Moscou, via le Japon, il ne représentait en fait que ce groupe américain, sans mandat. C'est par son intermédiaire qu'aux USA, la gauche Hollandaise était connue. L'un des chefs du communisme de gauche américain, Fraina ([2] [120]), son ami, était très influencé par Gorter et Pannekoek.
Le parti communiste hollandais finissait par adhérer à la troisième Internationale, en avril 1919. Rutgers fut associé aux travaux du comité exécutif.
Les courants de gauche dans l'Internationale en 1919
La gauche dans la troisième Internationale s'est développée au cours de Tannée 1919 sous l'influence de la révolution allemande. Celle-ci représentait pour tous les courants de gauche l'avenir du mouvement prolétarien dans l'Europe occidentale industrialisée. Malgré la défaite de janvier 1919 à Berlin, où le prolétariat avait été écrasé par la social-démocratie de Noske et Scheidemann, jamais la révolution mondiale n'avait semblé aussi proche. La république des conseils avait été instaurée aussi bien en Hongrie qu'en Bavière. La situation demeurait révolutionnaire en Autriche. De grandes grèves de masses secouaient la Grande-Bretagne et s'ébauchaient en Italie. Le continent américain lui-même était secoué par la vague révolutionnaire de Seattle jusqu'à Buenos-Aires ([3] [121]). Le prolétariat des pays les plus développés se mettait en branle. La question de la tactique à adopter dans les pays centraux du capitalisme, où la révolution serait plus purement prolétarienne qu'en Russie, devait nécessairement être examinée à la lueur d'une prise du pouvoir, que les révolutionnaires pensaient devoir se produire dans un futur très proche.
La vague révolutionnaire, c'est-à-dire l'expérience même des ouvriers confrontés à l'Etat, se traduisait par un changement de tactique avec la fin de l'ère pacifique de croissance du capitalisme. Tous les courants révolutionnaires reconnaissaient la validité des thèses du Premier Congrès de la Troisième Internationale :
« 1) La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste mondial, et ce sera celle de l'effondrement de la civilisation européenne en général, si le capitalisme, avec ses contradictions insurmontables, n'est pas abattu.
2) La tâche du prolétariat consiste maintenant à s'emparer du pouvoir d'Etat. La prise du pouvoir d'Etat signifie la destruction de l'appareil d'Etat de la bourgeoisie et l'organisation d'un nouvel appareil du pouvoir prolétarien. » ([4] [122])
Dans la nouvelle période, c'est la praxis même des ouvriers qui remettait en cause les vieilles tactiques parlementaire et syndicale. Le parlement, le prolétariat russe l'avait dissous après la prise du pouvoir, et en Allemagne une masse significative d'ouvriers s'était prononcée en décembre 1918 pour le boycottage des élections. En Russie comme en Allemagne, la forme conseils était apparue comme la seule forme de lutte révolutionnaire en lieu et place de la structure syndicale. Mais la lutte de classe en Allemagne avait révélé l'antagonisme entre prolétariat et syndicats. Lorsque les syndicats eurent participé à la répression sanglante de janvier 19 et que surgirent des organismes politiques de lutte — les Unions (AAU) — le mot d'ordre fut non la reconquête des vieux syndicats, mais leur destruction ([5] [123]).
En donnant comme base fondamentale de PIC aussi bien le programme du PC allemand que celui du parti bolchevik, l'Internationale acceptait de fait les courants de gauche antiparlementaires et antisyndicaux. Le congrès du Spartakus Bund n'avait-il pas rejeté la participation aux élections ? Même si Rosa Luxembourg en cela n'était pas d'accord avec la majorité, elle défendait une ligne antisyndicale : «(...) (les syndicats) ne sont plus des organisations ouvrières, mais les protecteurs les plus solides de l'Etat et de la société bourgeoise. Par conséquent, il va de soi que la lutte pour la socialisation ne peut pas être menée en avant sans entraîner celle pour la liquidation des syndicats. Nous sommes tous d'accord sur ce point. » ([6] [124])
A ses débuts, l'Internationale communiste acceptait dans ses rangs des éléments syndicalistes révolutionnaires, comme les IWW, qui rejetaient aussi bien le parlementarisme que l'activité dans les anciens syndicats. Mais ces éléments rejetaient par principe l'activité politique et donc la nécessité d'un parti politique du prolétariat. Ce n'était pas le cas des éléments de la gauche communiste qui d'ailleurs étaient le plus souvent hostiles au courant syndicaliste révolutionnaire qu'ils ne souhaitaient pas voir accepter dans l'Internationale, organisme non syndical, mais politique ([7] [125]).
C'est au cours de l'année 1919 qu'apparaît véritablement le courant communiste de gauche sur une base politique et non syndicaliste, dans les pays développés. La question électorale est dans certains pays la question clef pour la gauche. En mars 1918, le parti communiste polonais — issu lui-même du SDKPIL de Rosa Luxembourg et Jogiches — boycotte les élections. En Italie, est publié le 22 décembre 1918 «Il Soviet» de Naples, sous la direction d'Amadeo Bordiga. A la différence de Gramsci, et de son courant syndicaliste, qui défend la participation aux élections, le courant de Bordiga prône l'abstentionnisme communiste en vue d'éliminer les réformistes du parti socialiste italien, pour constituer un « parti purement communiste ». Formellement, la Fraction communiste abstentionniste du PSI est constituée en octobre 1919. En Grande-Bretagne, la Worker's Socialist Fédération de Sylvia Pankhurst se prononce contre le parlementarisme «révolutionnaire» afin d'éviter tout «gaspillage d'énergie» ([8] [126]). En Belgique le groupe «De Internationale» des Flandres et le groupe de War van Overstraeten ([9] [127]) sont contre l'électoralisme. Il en est de même dans les pays plus « périphériques ». Au Congrès du parti communiste bulgare, en mai 1919, une forte minorité s'était prononcée pour la condamnation de l'action parlementaire ([10] [128])
Les Hollandais, par contre, en dépit d'une légende tenace étaient loin d'être aussi radicaux sur la question parlementaire. Si la majorité autour de Wijnkoop était électoraliste... la minorité était hésitante. Gorter lui-même était pour l'activité révolutionnaire au Parlement ([11] [129]).
Pannekoek, par contre, défendait une position antiparlementaire. Comme tous les communistes de gauche il soulignait le changement de période historique et la nécessité de rompre avec le principe démocratique ancré dans les masses ouvrières d'Europe occidentale. Pour le développement de la conscience de classe, il était nécessaire de rompre avec la « démocratie parlementaire » ([12] [130]).
L'Internationale communiste en 1919 ne considérait pas que le rejet de la participation aux parlements bourgeois était un motif d'exclusion de la gauche. Lénine, dans une réponse à Sylvia Pankhurst ([13] [131]) était d'avis que « la question du parlementarisme est actuellement un point particulier, secondaire... Etre indissociablement lié à la masse ouvrière, savoir y faire une propagande constante, participer à chaque grève, faire écho à chaque revendication des masses, voilà ce qui est primordial pour un parti communiste... Les ouvriers révolutionnaires dont les attaques ont pour cible le parlementarisme ont parfaitement raison dans la mesure où elles expriment la négation de principe du parlementarisme bourgeois et de la démocratie bourgeoise. » ([14] [132])
Sur cette question, pourtant, la circulaire du comité exécutif de TIC du 1er septembre 1919, marque un tournant. Si les actions parlementaires et les campagnes électorales sont encore définies comme des «moyens auxiliaires», la conquête du parlement apparaît comme une conquête de l'Etat. L'I.C. revient à la conception social-démocrate du Parlement comme centre de la lutte révolutionnaire: « (les militants)... vont au parlement pour s'emparer de cette machine (souligné par nous) et pour aider les masses, derrière les murs du Parlement, à le faire sauter.»
Beaucoup plus grave, comme point de rupture entre la gauche et l'IC était la question syndicale. Dans une période où les conseils ouvriers n'étaient pas encore apparus, fallait-il militer dans les syndicats, devenus contre-révolutionnaires, ou au contraire les détruire en instaurant de véritables organismes de lutte révolutionnaire ? La gauche était divisée. La fraction de Bordiga penchait pour la constitution de « vrais » syndicats rouges : le parti communiste d'Amérique de Fraina était partisan de travailler avec les syndicalistes révolutionnaires des IWW, rejetant tout « entrisme » dans les syndicats réformistes. La minorité du CPN, avec Gorter et Pannekoek, était hostile de plus en plus à une activité dans le NAS, estimant la rupture inéluctable avec le courant anarcho-syndicaliste.
L'exclusion de la gauche allemande, pour antiparlementarisme et antisyndicalisme, va cristalliser l'opposition de gauche internationale. La minorité hollandaise se trouve de fait, théoriquement, à la tête du «Linkskommunismus» allemand et international.
(A suivre)
Ch.
[1] [133] La Ligue américaine de propagande socialiste naquit en 1916 au sein du Parti socialiste, dans le Massachussetts, contre l'orientation électoraliste de la direction du parti. Elle publia «The Internationalist» qui combattit la majorité orientée vers le pacifisme en 1917. En 1919, elle prit la dénomination d'«Aile gauche du parti socialiste », et publia à Boston — sous la direction de Fraina l'hebdomadaire «Revolutionary Age». Dans ses Thèses, elle se prononçait en 19 pour la sortie de la deuxième Internationale et le rattachement à la troisième Internationale : pour l'élimination des revendications réformistes contenues dans la plate-forme du P. S.
[2] [134] Louis Fraina (1894-1953) : né en Italie du Sud, avait émigré aux USA avec ses parents à l'âge de deux ans. A 15 ans, il devenait membre du SLP deléoniste qu il quitta en 1914. Il devint membre du PS américain et actif, avec J. Reed, dans son aile gauche, qui décida la scission lors d'une conférence en juin 19. De cette scission naquit le Communist Labor Party of America de Fraina le plus avancé théoriquement — en septembre 1919. Après la conférence d'Amsterdam de février 1920, il participa au second congrès de l'I. C., après avoir été lavé du soupçon d'être un « agent provocateur». Il prit alors avec Katayama et un certain Jésus Ramirez la direction du «Bureau panaméricain du Komintern» à Mexico, en 1920-21, sous le pseudonyme de Luis Corey. En 1922, il cessait de militer et se faisait connaître comme journaliste sous ce pseudonyme. Devenu professeur d'université en économie, il se fit par la suite essentiellement valoir pour ses ouvrages d'économie.
[3] [135] Les IWW furent à la tête de la grève de Seattle qui se généralisa à Vancouver et Winnipeg, au Canada. La même année 19, éclatèrent des grèves très dures chez les métallos de Pennsylvanie. Ces grèves furent combattues par les syndicats et durement réprimées par la police patronale et le gouvernement fédéral. En Argentine, la «Semaine sanglante» de Buenos-Aires se solda par des dizaines de morts chez les ouvriers. A l'extrême sud du continent, les ouvriers agricoles de Patagonie furent sauvagement réprimés.
[4] [136] « Lettre d'invitation du Congrès » dans « La révolution allemande » de Broué, p. 40.
[5] [137] La première union (AAU) qui ne soit pas anarcho-syndicaliste > — comme dans la Ruhr — naquit à l'automne 1919 à Bremen. Son organe Kampfruf (Flugzeitung fur die revolutionàre Betrieb-sorganisation) affirmait clairement qu'elle ne voulait pas «devenir un nouveau syndicat » Se prononçant « pour la conquête du pouvoir politique», l'AAU de Bremen dénonçait les syndicalistes comme « des adversaires de la dictature politique du prolétariat ». (In « Kampfruf», n° 1, 15 octobre 1919, « Was ist die AAU ? »).
[6] [138] Cité par Prudhommeaux, « Spartacus et la Commune de Berlin 1918-19 », « Spartacus », p. 55)
[7] [139] Bordiga était le plus ferme partisan de cette séparation entre Internationale politique et Internationale d'organisations économiques. Jusqu'en 1920, l'I.C. acceptait dans ses rangs aussi bien des organisations communistes que des syndicats nationaux, régionaux de métier et d'industrie. Cela dura jusqu'à l'instauration de l'Internationale syndicale rouge (Profintern). Le KAPD voulait instaurer, à côté de l'Internationale communiste, une internationale des organisations d'entreprise sur des bases politiques : antiparlementarisme, destruction des svndicats contre-révolutionnaires, conseils ouvriers, destruction de 1 Etat capitaliste.
[8] [140] S. Pankhurst, « Pensée et action communistes dans la troisième Internationale » publié dans « Il Soviet » de Bordiga le 20 septembre 1919.
[9] [141] War van overstaeten (1891-1981), peintre ; d'abord anarchiste, il devint pendant la guerre le rédacteur en chef du journal des Jeunes Gardes Socialistes : « Le socialisme », zimmerwaldien. Il est à l'origine du groupe communiste de Bruxelles, fondé en 1919, qui devait publier le 1er mars 1920 « L'ouvrier communiste » (« De Kommunistische Arbeider » en Flandre). Il défendit au seond congrès de l'IC les thèses antiparlementaires de Bordiga. Il fut l'un des principaux artisans de la fondation du PC belge en novembre 1920, auquel adhéra la Fédération flamande en décembre (« De Internationale »). Au troisième congrès de l'IC, il se trouvait très proche du KAPD. Sous la pression de l'IC, il dut admettre le groupe « centriste » : « Les amis de l'exploité » de Jacquemotte et Massart, en septembre 1921, lors du congrès d'unification. Contrairement à Bordiga, il continua toujours à défendre les positions antiparlementaires. Hostile aux partis de «masse» et à la «bolchevisation», il fit partie en 1927 du groupe unifié de l'opposition. Il fut exclu avec l'opposition en 1929 et devint proche de la Ligue des communistes internationalistes de Hennaut, fondée en 1931, après la séparation d'avec l'aile trotskyste. En Espagne de 1931 à 1935, en contact avec des groupes de la gauche communiste, il se retira par la suite de tout engagement politique.
[10] [142] Une forte opposition s'était constituée dans le PC bulgare autour d'Ivan Gantchev, journaliste et traducteur de Goethe. C'est lui qui se chargea de traduire en bulgare un certain nombre d'ouvrages de Gorter. En Hongrie, les positions antiparlementaires furent connues grâce au groupe de communistes hongrois exilés à Vienne, après la fin de la « Commune hongroise ». Au sein de ce groupe, Lukacs était antiparlementaire, tandis que Bêla Kun préconisait une tactique curieuse : participation aux élections pour les dénoncer ; aucun envoi de députés au parlement. En Suède, la fédération de la jeunesse social-démocrate (Social-démokratiska ungdomsfôrbundet) de C. J. Bjôrklund, qui avait adhéré à l'IC en mai 1919, était résolument antiparlementaire ; en contact avec le KAPD en 1920, elle dénonçait l'opportunisme de Hôglund au Parlement, ce dernier étant présenté par Lénine comme le «Liebknecht» suédois. L'antiparlementarisme s'étendit jusqu'à l'Amérique latine : au sein du Partido socialista internacional d'Argentine — futur parti communiste d'Argentine, créé en décembre 1920 — se forma en 1919 une forte minorité, se réclamant de Bordiga, préconisant le boycott des élections.
[11] [143] Quelques semaines avant de rédiger sa « Réponse à Lénine », Gorter écrivait le 1ermai 1920 à Lénine ces mots : «Je ne suis pas un adversaire du parlementarisme. Je vous écris cela seulement pour vous montrer — à vous et au comité central — combien il est dangereux de trop parler en faveur des communistes opportunistes. » (cité par Wiessing « Die Hollàndische Schule des Marxismus », p. 91)
[12] [144] A. Pannekoek, « De strijd over de kommunistische taktiek in Duistland », in « De Nieuwe Tijd », 1919, p. 695.
[13] [145] Sylvia Pankhurst (1882-1960) avait milité dans le mouvement des « suffragettes » fondé par sa mère Emma. Elle avait fondé en 1914 l'East London Fédération of Suffragettes qui publiait « The Womens Dreadnaught ». Sous l'effet de la guerre, son mouvement rompit avec le féminisme. Il se transforma en 1917 en Workers Socialist Fédération, dont l'organe était « The Workers Dreadnaught » (« Le cuirassé ouvrier »). Elle se prononce pour les bolcheviks. En 1919, elle est présente au congrès de Bologne du PSI. Elle devient correspondante rémunérée de « l'Internationale Communiste », organe de l'IC. Elle participe activement, de retour en Italie, à la conférence de Frankfurt puis à la conférence d'Amsterdam. Refusant toute tactique parlementaire et toute entrisme dans le Labor Party, elle contribue en juin 1920 à la fondation du Communist Party (British Section of the Third International). Elle défendra la même année, avec le shop steward Gallacher, les positions antiparlementaires et antisyndicales au second congrès de l'IC. Son parti est obligé de fusionner, en janvier 1921 à Leeds, avec le CP of Great Britain (CPGB) qui défend l'orthodoxie de l'IC. « The Workers Dreadnaught » reste l'organe indépendant de sa tendance dans le PC « unifié ». Jetée en prison par le gouvernement britannique, elle sera libérée pour être exclue du CPGB, avec ses partisans, en septembre 1921. En février 1922, elle fondera avec les exclus le Communist Workers Party, section de la KAI de Gorter, qui subsistera jusqu'en juin 1924. Sylvia Pankhurst, à partir de cette date, cesse d'être une communiste de gauche et une militante prolétarienne. Elle revient à ses premières amours féministes et se prend de passion pour l'espéranto. Elle devient même en 1928 l'apôtre d'une croisade « antiraciste ». Elle forme en 1932 un Womens International Matteoti Committee, mouvement féministe antifasciste. Elle soutient le Negus, lors de la guerre de 1935 entre l'Italie et l'Ethiopie. Elle part en Ethiopie pour devenir finalement catholique. Amie du Negus, elle meurt à Addis-Abeba en 1960, où elle est enterrée.
[14] [146] la lettre de Pankhurst et la réponse de Lénine (août 1919) se trouvent dans « Die Kommunistische Internationale », n° 4-5, p. 91-98 (« der Sozialismus in England »).
Géographique:
- Hollande [28]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [30]
Revue Internationale no 51 - 4e trimestre 1987
- 3069 reads
Situation internationale : conflits impérialistes et lutte de classe
- 2645 reads
Simultanément la situation mondiale nous livre d'un côté les événements guerriers du Moyen-Orient, et d'un autre, les luttes ouvrières en Afrique du Sud et en Corée du Sud. Ces deux aspects antagoniques de la situation mondiale, sur fond général d'un approfondissement de la crise du capitalisme, illustrant ce que nous entendons par accélération de l’histoire. Ils montrent que le cours historique, le rapport de forces entre deux perspectives: guerre ou révolution, est l'axe autour duquel s'articule l'histoire présente et à venir. Et si jusqu'à présent la lutte de classe a réussi à prévenir l'humanité d'un engagement sur le chemin sans retour de la guerre, l'accélération de l'histoire souligne la nécessité vitale d'une prise de conscience pour la classe ouvrière des enjeux de la situation mondiale et de sa mission historique pour pousser ses combats plus loin.
Guerre dans le Golfe persique
«Guerre des ambassades» en Europe, événements sanglants de la Mecque pour les pays arabes, scandale de «l'Irangate» aux USA, résolution de l'ONU pour tous. C'est de main de maître que le bloc impérialiste occidental, sous la haute impulsion et direction des USA, a préparé et couvert le plus vaste déploiement militaire depuis la seconde guerre mondiale. L'événement était de taille, il devait être précautionneusement préparé, surtout en direction de ce que l'on appelle «l'opinion publique». Il le fut. Au cœur de cette préparation minutieuse, le scandale de «l'Irangate» et la publicité tapageuse qu'il reçut dont les événements actuels nous révèlent la véritable signification : justifier le tournant majeur de la politique des USA par.rapport à l'Iran.
Comme le scandale du «Watergate» en 1973-74, qui entraîna la démission du président Nixon, correspondait à un changement de politique internationale (retrait des USA du Viêt-Nam, rapprochement avec la Chine), l'Irangate aujourd'hui correspond à un changement dans l'orientation de politique internationale. Que ressort-il de ce «scandale» sinon que la négociation avec les «terroristes», iraniens est impossible, que seule la force, le langage des armes, est capable de leur faire entendre raison ?
Pour ceux qui pensent encore que cette intervention militaire dans le Golfe Persique où sont engagés 40 navires de guerre américains des plus sophistiqués dont deux porte-avions, sans compter les forces aéronavales, la moitié de la marine française dont un porte-avion, les navires les plus perfectionnés de la marine anglaise et plusieurs dizaines de milliers d'hommes, pour une grande part du contingent, n'est somme toute pas si importante et qui, cédant aux roucoulades sur la «volonté de paix», s'endorment en se disant que finalement il ne s'agit là que d'une «aventure lointaine», sans conséquences et implications importantes pour l'Europe, nous rappellerons simplement que la première guerre mondiale qui allait saigner en particulier cette même Europe a commencé par ces mêmes guerres «lointaines», les deux guerres des Balkans, dans une région du monde très proche du Moyen-Orient, jouant un rôle stratégique analogue : hier l'affrontement entre grandes puissances pour l'accès aux «mers chaudes», aujourd'hui haut-lieu de l'affrontement est-ouest depuis qu'il a été déclaré tel symboliquement à Yalta en 1945.
De tous points de vue la classe ouvrière est concernée par l'engagement militaire. Comment en serait-il autrement quand, du seul point de vue économique et social les deux tiers de l'humanité souffrent de la faim, quand le chômage étend son ombre de misère sur une grande partie de la classe ouvrière des pays industrialisés, alors que les frais de l'intervention militaire actuelle dans le Golfe Persique s'élèvent officiellement pour les USA au chiffre astronomique d'un million de dollars par jour pour les* simples frais de convoi. Quant à la France qui est présente sur deux fronts, en Afrique et au Moyen-Orient, aucun chiffre n'est fourni et pour cause.
«Fanatisme et terrorisme» contre «paix et civilisation»
La politique des USA n'est ni «chaotique»,ni «incohérente», ni «au coup par coup» comme l'affirment beaucoup de commentateurs. Malgré ses détours et ses contours pas toujours immédiatement compréhensibles, la stratégie américaine au Moyen-Orient, stratégie d'offensive et d'étranglement du bloc russe, se règle sur une logique de fer.
Si pendant huit années les Etats du monde entier ont pu se satisfaire de la simple poursuite de la guerre entre l'Iran et l'Irak, aujourd'hui la situation a qualitativement changé. Après avoir «réglé» la situation au Liban et parfait l'isolement de l'Iran au Moyen-Orient, les USA ont décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec la question iranienne. Il s'agit aujourd'hui pour les USA de reconstituer la forteresse militaire que fut il y a presque une dizaine d'années l'Iran. Il n'y a pas d'autre pays qui par sa position géographique, l'étendue de son territoire, sa densité démographique, puisse de ce point de vue remplacer l'Iran dans cette région.
En face de ces réalités indéniables que dit-on pour justifier l'intervention dans le Golfe Persique ? Que le fanatisme de la population iranienne, subjuguée par des religieux déments, serait la cause de l'instabilité dans le Golfe Persique et de bien d'autres maux. Toute l'entreprise actuelle des pays occidentaux et du chef d'orchestre américain n'aurait pour but que de contenir, «par la force si nécessaire», cette poussée d'irrédentisme religieux, de ramener la paix entre l'Iran et l'Irak et bien sûr d'assurer l'intérêt des pays occidentaux par la libre circulation des convois pétroliers dans le Golfe Persique.
Ainsi les chancelleries du monde occidental et des pays arabes désignent d'un même geste le fanatisme religieux en Iran comme un dangereux fauteur de trouble, faisant peser une lourde menace sur la paix du Golfe.
Tout d'abord nous ne pensons pas que la population en Iran, qui, comme celle de l’Irak, vient de subir sept années d'une guerre particulièrement meurtrière, quelque chose comme un million de morts, soit d'un grand enthousiasme pour mener la «guerre sainte» contre toutes les puissances du «monde arabe» et plus encore, contre toutes les puissances du monde occidental.
Toutes les guerres sont atroces. Celle-ci particulièrement. A la puissance de feu des armes modernes est venue s'ajouter la guerre chimique. Rien, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, n'a été refusé à la barbarie qui sur les champs de bataille comme dans les agglomérations urbaines a fait une boucherie. •
Comment oublier que durant ces sept années, faute d'un nombre suffisant de combattants que la guerre fauchait par milliers, ce sont des gamins qui dès 10 ans étaient envoyés de force sur le front. Et comment mesurer, quand la guerre ne vous arrache pas votre vie, ou celle de vos enfants, ou encore ne vous laisse infirme, les sacrifices qu'il faut consentir pour payer huit années de guerre ? Dans ces conditions, on ne peut guère se tromper en affirmant qu'il y a dans la population iranienne et dans la population irakienne un large sentiment anti-guerre. On ne subit pas huit ans de guerre sans être guéris de tout fanatisme. Malgré le peu d'information, et pour cause, que la bourgeoisie laisse filtrer sur ces questions nous pouvons savoir qu'aussi bien en Iran qu'en Irak existe une réelle opposition à la guerre :
«L'hostilité de la population au conflit est en relation étroite avec les privations, notamment chez les pauvres (...). L'agitation habituellement provoquée par la situation économique (...) a fait place pour la première fois en 1985 à de véritables manifestations contre la guerre. » ([1] [147]).
Il est déjà hallucinant d'entendre aujourd'hui ce formidable concert de déclarations pacifistes accompagner le déploiement dans le Golfe d'une gigantesque armada de guerre. Mais la duperie est encore plus éclatante quand on considère que cette guerre à laquelle on prétend vouloir mettre un terme, a été commencée, entretenue et nourrie pendant huit ans par ceux qui aujourd'hui crient le plus fort à la «paix». Ce n'est un secret pour personne que la guerre entre l'Iran et l'Irak avait pour objectif essentiel la destruction du pouvoir religieux de Téhéran, le prix en vies humaines comptait peu ou plutôt pas du tout.
Tous les pays qui furent à l'origine de ce conflit, sous l'impulsion des USA, Koweït et Arabie Saoudite en particulier, pensaient que le choc de la guerre dans un pays plongé dans un chaos indescriptible après la chute du Shah d'Iran conduirait rapidement à l'effondrement du pouvoir religieux de Téhéran. Cette perspective ne s'est pas vérifiée, au contraire. Cette guerre, qui était prévue courte, est toujours, et comment, d'actualité aujourd'hui. La fraction derrière Khomeiny loin de s'effondrer dans la guerre, s'en est nourrie et a renforcé son emprise sur la société iranienne par les moyens d'une répression impitoyable. Qu'aucune autre fraction dirigeante plus «adaptée», moins anachronique que le pouvoir des mollahs n'ait pu s'imposer à Téhéran montre la profondeur de la décomposition sociale atteinte dès l'époque du Shah.
Quoi qu'il en soit, l'objectif de renversement des dirigeants de Téhéran ayant momentanément échoué, l'Iran et l'Irak ne pouvaient que s'enliser dans la guerre. Guerre entretenue par toutes les puissances internationales qui, pendant huit ans, ont fourni armes et matériel militaire moderne de toutes sortes aux belligérants. Armement sans lequel la poursuite du conflit aurait été impossible.
Ne pouvant espérer régler rapidement la question iranienne, en particulier tant que la question de la Syrie et du Liban n'était pas «stabilisée», tant que l'isolement de l'Iran n'était pas total, le monde occidental, les pays arabes, Israël s'accomodaient fort bien de la guerre.
Ainsi pendant des années tout le beau monde impérialiste y a trouvé son compte, à commencer par les marchands d'armes de tous bords. En tête de ceux-ci, la France qui a vendu à l'Irak des armements modernes pour un montant de 7 milliards de dollars. L'Etat d'Israël, dont on ne peut mettre en doute les liens qui l'unissent aux USA, a durant toute la guerre été lui-même le principal pourvoyeur d'armes de l'Iran :
«Bien que Téhéran nie tout lien de cette nature, l'Iran a reçu des livraisons israéliennes dès le début de la guerre (...) à l'époque, le montant de ces transactions a pu être évalué à prés de 100 millions de dollars. (...) Pour la seule année 1983, les livraisons d'armes à l'Iran ont atteint 100 millions de dollars.».
Sur d'autres plans, au-delà du commerce des armes qui alimentait le carnage au profit d'un grand nombre de nations, Chine et URSS y compris, cette guerre faisait autour d'elle un large consensus. Les nations arabes qui ne pouvaient voir sans satisfaction, en plus de «l'occupation» que cette guerre fournissait à leur voisin iranien turbulent, deux des principaux producteurs de pétrole du Golfe baisser drastiquement leur production en pleine période de surproduction et de chute des cours. Israël, qui, tant que l'Iran restait un ventre mou de la défense des intérêts occidentaux au Moyen-Orient, pouvait, lui, prétendre occuper ce rôle exclusivement et en tirer tous les avantages. Jusqu'à l'URSS, qui, bien que n'ayant aucune possibilité et aucun espoir d'implanter une quelconque influence en Iran, préférait de loin voir celui-ci en guerre plutôt que comme place forte des USA aux frontières de l'Afghanistan occupé militairement par ses troupes.
Tant que les USA ne pouvaient régler son sort à la clique d'illuminés de Téhéran, ils permettaient et encourageaient la poursuite de la guerre, contrôlant et dosant savamment les livraisons d'armes à Bagdad comme à Téhéran. Il s'agissait de ne permettre, ni de victoires décisives à l'Iran, ce qui aurait renforcé le pouvoir en place, ni non plus, par une défaite cuisante, de pousser à un effondrement et un démantèlement total de ce dernier qui aurait compromis toute possibilité de reconstruction sur place d'une forteresse militaire du bloc occidental.
Dans cette optique, la continuation de la guerre et des tensions dans le Golfe offrait de plus aux USA l'avantage non négligeable d'une dépendance accrue des pays arabes vis-à-vis d'eux :
«Ils (les Etats du Golfe) se sont ainsi condamnés à soutenir financièrement Bagdad et à renforcer leurs propres systèmes de défense civile et militaire contre Téhéran. Leur dépendance implicite vis-à-vis de la garantie américaine, comme le poids politique de cette alliance de fait, s'est accrue brutalement.».
Voilà les réalités de la danse macabre de l'impérialisme dans le Golfe Persique. Et encore n'en avons-nous évoqué que les lignes directrices.
De façon générale cette escalade n'est pas une suite désordonnée d'actions et d'efforts, sans but cohérent et aux conséquences somme toute limitées géographiquement au Moyen-Orient. La situation actuelle dans le Golfe Persique est la continuation d'une stratégie d'ensemble qui, même si elle ne met pas en prise directe l'impérialisme russe et l'impérialisme américain -et heureusement, participe de la logique mondiale de cet affrontement.
Quand les USA seront parvenus a «régler» la question iranienne, c'est-à-dire à faire de nouveau de l'Iran un bastion de leurs positions militaires avancées au Moyen-Orient, ce «règlement» ne marquera en fin de compte qu'un cran de plus dans l'engrenage militariste planétaire. Après avoir établi la paix des tombes, ce n'est guère par la puissance économique, déjà très à mal au sein des métropoles, que le bloc de l'Ouest pourra maintenir son «ordre» dans une région du monde aussi instable, où la décomposition économique s'est particulièrement installée. Obligatoirement, l'ordre militaire s'y installera de façon permanente aux frontières mêmes de la Russie, marquant ainsi un degré supérieur dans les tensions impérialistes mondiales.
Le développement des tensions militaires et les enjeux historiques
Détachons un moment notre attention du Moyen-Orient. Les flammes de la lutte de classe brûlent en Afrique du Sud. En Corée du Sud, un mouvement massif de la classe ouvrière, par sa pugnacité, son intransigeance et son courage, brise en mille morceaux la vitrine tant exposée d'un prolétariat d'esclaves dociles en Asie. Et ce ne sont là que les expressions actuelles d'un puissant flot mondial d'insoumission aux lois du capitalisme en crise.
Toute la situation mondiale est contenue dans cette contradiction, dans l'opposition de deux perspectives issues toutes deux de la décadence du capitalisme, la guerre ou la révolution.
Jusqu'aujourd'hui, il revient à la classe ouvrière internationale, d'avoir, par ses luttes, repoussé la perspective bourgeoise de la guerre mondiale. En refusant de se sacrifier pour la survie de l'économie bourgeoise, il lui revient d'avoir repoussé d'autant la perspective d'un sacrifice suprême sur l'autel de l'impérialisme. Il est tout à son honneur d'avoir dans sa lutte, par sa résistance à l'exploitation, forgé un esprit auquel sont étrangères les molles et serviles conception et mentalité fatalistes.
Mais comme nous le montre la situation mondiale dans sa totalité, l'histoire s'accélère et en s'accélérant devient de plus en plus exigeante. Elle exige du prolétariat qu'il prenne conscience de ce qu'il a déjà fait et, en en prenant pleinement conscience, qu'il le pousse jusqu'au bout. D'internationale de fait, la lutte ouvrière peut et doit devenir internationaliste.
L'histoire sait parfois être ingrate, mais jamais elle n'exige l'impossible. Avec une nécessité historique se développent toujours les conditions de sa réalisation. Par le développement de la crise économique, véritable fléau social, et de la barbarie que celle-ci induit, par le développement international de la lutte prolétarienne même, la classe ouvrière est aujourd'hui contrainte de pousser son combat à un niveau supérieur. L'expérience accumulée de ses assauts répétés contre la forteresse capitaliste lui en donne la force et les moyens.
Le prolétariat, pour prendre conscience de sa mission historique, ne peut attendre d'être submergé dans la barbarie, dans ce cas il serait trop tard. Sur le terrain même de l'économie, la lutte entre le travail et le capital est déjà un barrage à l'orientation vers la troisième guerre mondiale, et aujourd'hui les luttes ouvrières peuvent et doivent ouvrir la perspective propre au prolétariat. Détruire les frontières, l'exploitation et l'économie de profit sont les seules voies pour balayer définitivement la menace du désastre que le capitalisme fait peser sur l'humanité.
Prénat 6/9/87.
Géographique:
- Moyen Orient [149]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Questions théoriques:
- Guerre [150]
Luttes ouvrières en Corée du sud et en Afrique du sud la mobilisation du prolétariat mondial se développe
- 2796 reads
Contrairement à l'insistance de la propagande de la classe dominante, les récentes luttes ouvrières en Corée du Sud et en Afrique du Sud ne sont pas de nature essentiellement différente de celles menées par les ouvriers des autres pays et en particulier dans les pays les plus industrialisés. Malgré leurs spécificités - dictature militaire en Corée, régime de l'« apartheid » en Afrique du Sud- il s'agit de moments d'un seul et même combat, celui mené par la classe ouvrière mondiale contre l'exploitation capitaliste.
La Corée du Sud, ce pays dont les «experts économiques» ont tant vanté les performances exceptionnelles, qu'ils ont donné en modèle aux pays moins développés, vient de connaître, au cours de cet été, sa plus grande secousse sociale depuis la guerre. Les dix millions de prolétaires sur le dos desquels le capital national, mais aussi le capital japonais et américain, ont fait «le miracle coréen» en leur imposant des conditions de travail parmi les pires du monde, ont donné une gifle magistrale au mythe des «ouvriers asiatiques, passifs, résignés, travailleurs, exploités jusqu'à la mort et... contents de l'être». Par un mouvement de grèves sans précédent qui, partant des principales concentrations ouvrières -les mines de charbon, les chantiers navals, l'industrie automobile- s'est étendu comme une traînée de poudre à tous les secteurs de la classe ouvrière, les travailleurs coréens ont démontré que dans la zone d'influence du capital japonais, comme dans le reste du monde, la classe ouvrière apprend à se constituer en force, la seule capable d'affronter le capitalisme décadent en crise et d'ouvrir une perspective. A terme, c'est la mobilisation du prolétariat japonais qu'annoncent ces combats.
L'Afrique du Sud vient aussi de connaître la plus grande mobilisation ouvrière de son histoire. Plus d'un quart de million de mineurs ont fait grève pendant trois semaines. En même temps 10 000 travailleurs des postes partaient en grève; 60 000 ouvriers dans le secteur de la métallurgie poursuivaient des mouvements de grève commencés depuis juillet et 15 000 travailleurs du secteur de la pétrochimie menacent de faire de même.
Nous ne pouvons ici traiter de tous les aspects de ces combats. Nous renvoyons le lecteur aux différents organes de notre presse territoriale qui le font.
Ce qui nous importe ici c'est de dénoncer l'idéologie qui cherche à enfermer ces luttes dans un cadre qui les émascule de leur contenu de classe, qui cache ce qui les unit au combat de tout le reste de la classe ouvrière mondiale.
La bourgeoisie a toujours recours au même stratagème : mettre l'accent sur ce qui diffère dans les conditions spécifiques des travailleurs en lutte dans une entreprise, un secteur ou un pays afin d'isoler, d'étouffer ce combat, tout en le dévoyant sur de faux terrains. L'exemple de la Pologne 1980, où la lutte des ouvriers contre leur exploitation avait été présentée dans le monde entier comme une lutte pour le droit d'aller à la messe, et localement fut enfermée dans le combat pour le droit d'existence du syndicat Solidarnosc, reste un des plus spectaculaires.
La barbarie capitaliste connaît en Corée du Sud la forme d'une dictature militaire particulièrement violente ; en Afrique du Sud celle du racisme de l'«apartheid». La bourgeoisie américaine s'y emploie actuellement à se débarrasser des aspects les plus anachroniques de ces régimes afin, non pas de soulager les conditions d'existence de la classe ouvrière -ce dont elle n'a que faire- mais au contraire d'y créer des institutions capables d'encadrer et de contrôler la lutte de classe qui s'y développe, comme dans tous les pays, sous les effets de la crise économique mondiale.
Les grèves ouvrières en Corée du Sud n'ont pas éclaté avec l'objectif d'instaurer un régime bourgeois «démocratique à l'occidentale», pas plus que celles de travailleurs sud-africains pour l'établissement d'un capitalisme moins cruel envers les prolétaires noirs. Ces luttes se sont manifestées dès le départ comme des réactions directes contre l'exploitation capitaliste, pour des augmentations de salaires, pour des améliorations des conditions de travail et d'existence en général.
S'il en avait été autrement, elles n'auraient pas pris la forme de grèves pour des revendications de classe, mais seraient restées dans le cadre suicidaire, interclassiste des pétitions et manifestations des fractions dites «démocratiques» des partis bourgeois d'«opposition».
Cela ne veut pas dire qu'elles ne s'attaquent pas aux formes dictatoriales et racistes de l'exploitation capitaliste. Au contraire, elles sont les seules luttes qui peuvent imposer des limites à la barbarie de la classe dominante locale.
Toutes les fractions de la bourgeoisie, démocrates et libéraux en tête, s'en disent choquées et réclament aux prolétaires de ces pays de faire attention à ne pas situer leurs intérêts «égoïstes» de classe au-dessus des intérêts de «la nation».
Kim Young Sam, un des principaux leaders de l'opposition démocratique coréenne ne cesse de demander aux ouvriers de «faire preuve de modération dans leur exigences pour ne pas mettre à mal les succès de l'économie Sud-coréenne ». En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le leader du NUM, le nouveau syndicat «démocratique» qui vient de saboter et de vendre la grève des mineurs, expliquait ses appels à la reprise du travail par la nécessité de respecter la légalité de la nation.
Leurs appels, leurs manœuvres ne sont en réalité que des moyens pour désarmer la classe exploitée, pour détruire ses luttes en les dévoyant sur le terrain de leurs exploiteurs.
Non, les luttes des prolétaires de Corée et d'Afrique du Sud ne sont pas des exemples de coopération entre exploités et exploiteurs pour une utopique «humanisation» de la barbarie capitaliste. Elles sont des moments du combat mondial de la classe ouvrière contre le capital et sa barbarie mondiale.
Et cela parce que :
1) les causes qui les provoquent sont les mêmes : la crise économique du capitalisme mondial se traduit à la périphérie comme ailleurs par un renforcement de l'exploitation capitaliste ; s'il y a une différence c'est uniquement parce qu'en général dans ces pays l'aggravation de la crise se fait sentir de façon encore plus violente ;
2) les "formes" mêmes que prennent ces luttes -leur tendance à s'étendre aux différents secteurs de la classe ouvrière, par delà les barrières de profession, de secteur ou de race- sont les mêmes qui se sont manifestées dans toutes les luttes ouvrières importantes de ces dernières années en Europe occidentale ;
3) enfin, parce que comme les luttes des autres prolétaires dans le monde entier, elles doivent se battre sur deux fronts : celui des ennemis déclarés, les gouvernements et leur appareils armés, militaires et policiers ; mais aussi celui des ennemis déguisés en «amis», les syndicats et les partis dits d'«opposition» qui travaillent de l’«intérieur» au sabotage de la lutte.
Le pire danger pour les prolétaires de ces pays c'est de tomber prisonniers de la confusion créée par toute la propagande «démocratique», d'autant plus dangereuse qu'elle s'adresse à un prolétariat qui ne connaît pas encore, ou ne fait que commencer à connaître le rôle de policiers de ces institutions «démocratiques» au sein des rangs prolétariens.
C'est dire toute la responsabilité des prolétaires des pays à longue tradition «démocratique», eux qui savent de plus en plus à quoi s'en tenir, qui désertent par millions ces institutions -partis et surtout syndicats- et qui apprennent de plus en plus à se battre non seulement en dehors d'elles, mais aussi contre elles comme l'ont démontré dans les dernières années les travailleurs de pays comme la Belgique, la France, et plus récemment l'Italie.
5/9/87 RV
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [33]
Le septième congres du CCI
- 2331 reads
Début juillet 1987 s'est tenu le septième congrès du Courant Communiste International. Ce congrès se situait à un moment crucial de la vie de la classe ouvrière mondiale marqué à la fois par une nouvelle aggravation de la crise du capitalisme et des tensions impérialistes qu'elle détermine et par un nouvel essor des luttes ouvrières à l’échelle internationale dont une des conséquences est le surgissement de toute une série de nouveaux groupes plus ou moins formels se situant sur des positions de classe révolutionnaires. C'est l'ensemble de ces questions et la façon dont le CCI y a fait et devra y faire face qui constituaient l'ordre du jour du congrès. Celui-ci devait également se prononcer sur une rectification de la plate-forme de l'organisation dont la nécessité avait été déjà constatée lors du précédent congrès (voir Revue Internationale n° 44). Nous publions dans ce numéro les principales résolutions correspondant aux différents points à l'ordre du jour du congrès. Ces résolutions parlent par elles-mêmes et expriment de façon condensée la position du CCI face aux principaux problèmes qui se posent à la classe et à ses minorités révolutionnaires. Le présent texte de présentation ne se propose pas de répéter ce que disent les textes publiés à la suite, mais essentiellement d'insister sur les enjeux essentiels qui se sont trouvés au centre des préoccupations de ce congrès et qui confèrent à ces différents textes leur unité.
Dans la conclusion de la présentation du 6e congrès en novembre 1985 (Revue Internationale n° 44), nous écrivions : « ...il nous faut donc considérer que le 6e congrès du CCI a globalement atteint les objectifs qu'il s'était fixés, qu'il a valablement armé l'organisation face aux enjeux de la période présente. Les années qui viennent jugeront de la validité d'une telle appréciation, elles montreront en particulier si l'analyse dont s'est doté le CCI sur la situation internationale et notamment sur l'évolution de la lutte de classe est bien conforme à la réalité, ce que contestent la plupart des autres groupes révolutionnaires. Mais dès à présent,les résolutions que nous publions dans ce numéro font la preuve que le CCI s'est engagé dans une direction bien précise, laissant le moins possible la porte ouverte à toute ambiguïté (comme c'est le cas malheureusement de la part de beaucoup de ces groupes), une direction qui, sur la base de l'analyse des énormes potentialités de combat qui mûrissent et se développent dans la classe, exprime la ferme volonté d'être à la hauteur de ces combats, d'en être partie prenante et de contribuer activement à leur orientation vers l'issue révolutionnaire.»
Les vingt mois qui se sont écoulés entre le 6e et le 7e congrès du CCI ont amplement confirmé le bien-fondé de cette position. En effet, cette période a vu se poursuivre et s'amplifier la vague de luttes ouvrières (la troisième depuis la reprise historique des combats de classe à la fin des années 1960) dont les luttes massives du secteur public de septembre 83 en Belgique avaient marqué le début. Au moment du 6e congrès, en novembre 1985, cette vague de luttes connaissait un certain affaiblissement après les mouvements massifs de fin 1983 et de 1984. Mais cela n'avait pas conduit le CCI, contrairement à beaucoup d'autres groupes du milieu révolutionnaire, à en conclure qu'elle était déjà épuisée. Bien au contraire, la résolution sur la situation internationale adoptée à ce congrès (Revue Internationale n° 44) insistait sur le fait que : «la situation présente recèle d'énormes potentialités de surgissements prolétariens de grande envergure»(point 15).
De façon plus générale, cette résolution soulignait que :
«La faillite totale du capitalisme que révèlent les années de vérité, de même qu'elle conduit à une accélération de l'histoire sur le plan des conflits impérialistes, provoque également une telle accélération sur le plan du développement de la lutte de classe, ce qui se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précèdent » (point 15)
C'est pour cela que, contrairement à ce qui s'était en partie passé en 1983 lors du surgissement de la troisième vague de luttes, l'ensemble du CCI n'a été nullement surpris lorsque les formidables combats du printemps 1986 en Belgique ont signé l'entrée de cette vague de luttes dans une nouvelle phase d'affrontements massifs et déterminés qui ne s'est pas démentie depuis comme le relève la résolution adoptée au 7e congrès (point 6).
Ainsi, alors que le 6e congrès marquait une discontinuité avec le précédent, le 7e congrès s'est inscrit en parfaite continuité du 6e.
En effet, une des tâches essentielles du 5e congrès, tenu en juillet 1983, avait consisté à tirer toutes les leçons de la défaite subie par la classe ouvrière mondiale en 1981 et marqué en particulier par le coup de force contre le prolétariat en Pologne en décembre de cette année. S'il avait armé l'organisation de perspectives générales justes, il ne l'avait par contre pas préparée à l'imminence de la reprise des combats ouvriers qui allait intervenir quelques mois après. Et si le CCI a su immédiatement reconnaître l'importance de ces combats, il lui a fallu tout un effort d'adaptation face aux responsabilités nouvelles qu'ils impliquaient pour les révolutionnaires, effort qui a été contrarié par toute une série d'incompréhensions et de résistances dont la manifestation la plus évidente a été l'apparition d'une soi-disant «tendance» qui allait quitter l'organisation justement lors du 6e congrès pour constituer la Fraction externe du Courant Communiste International (FECCI).
Le 6e congrès venait justement ponctuer tout ce processus de réarmement de l'organisation notamment en affirmant clairement la nécessité pour les révolutionnaires d'intervenir activement et systématiquement dans les combats en cours, de se concevoir comme «partie prenante» de ceux-ci.
Le 7e congrès a confirmé intégralement cette orientation. Ses résolutions ici publiées et ses débats ont insisté sur la validité des travaux et perspectives du 6e congrès. Il ne s'agissait donc pas au 7e congrès de tracer de nouvelles perspectives mais de vérifier comment celles du 6e avaient été mises en pratique et, à la lumière de l'expérience, de les préciser pour la période qui vient. C'est ainsi que tous les points à l'ordre du jour partaient de préoccupations déjà affirmées lors du 6e congrès :
- sur la situation internationale ;
- sur notre intervention dans la classe ouvrière ;
- sur notre responsabilité à l'égard du milieu politique ;
- sur la nécessité de renforcer la capacité théorique et programmatique de l'organisation face à ses responsabilités croissantes.
Sur la situation internationale
Outre la lutte de classe dont le développement actuel a donné le ton à l'ensemble des débats, le congrès s'est penché, comme le révèle la résolution, sur la nouvelle aggravation de la crise du capitalisme. Il a mis en évidence la faillite aujourd'hui patente des «Reaganomics» sensées ouvrir une nouvelle ère de prospérité et qui débouche maintenant sur une nouvelle récession mondiale aux effets encore plus dévastateurs que les précédents notamment du point de vue de la brutalité des attaques anti-ouvrières. Le congrès a également souligné que l'enfoncement dans la crise ne pouvait, malgré les discours de paix spectaculaires, que déboucher sur nouvelle aggravation des tensions impérialistes dont l'élément central est l'offensive américaine visant à parachever l'encerclement de l'URSS et qui passe aujourd'hui par une remise au pas de l'Iran. Sur ce plan, l'actualité s'est chargée immédiatement de confirmer notre analyse avec l'envoi d'une formidable armada occidentale dans le golfe Persique et l'aggravation des tensions dans cette région du monde.
Cependant, le point le plus discuté de la situation internationale a été évidemment le développement de la lutte de classe et plus particulièrement :
- les multiples moyens mis en avant par la bourgeoisie pour entraver ce développement, et dont le syndicalisme de base constitue le fer de lance ;
- les différentes manifestations du processus de développement de la conscience dans la classe, en particulier le surgissement de groupes d'ouvriers combatifs, les comités de lutte.
Sur notre intervention
Notre responsabilité face à ce développement des combats de classe a évidemment fait l'objet de débats très animés. Ces débats étaient en particulier alimentés par l'expérience acquise par nos dix sections territoriales dans leurs pays respectifs. Il s'agissait que cette expérience contribue pleinement à l'armement de toute l'organisation face aux tâches qui l'attendent dans la période qui vient. La préoccupation et la tonalité des débats s'expriment notamment dans cet extrait de la résolution d'activités adoptée par le congrès.
«Ces perspectives vont constituer pour le CCI une nouvelle épreuve, la lutte de classe exigeant plus d'unité, de capacité de mobilisation et d'engagement à tous les niveaux, pour faire face aux responsabilités dans l'intervention, pour être un facteur actif dans la tendance à l'unification et la confrontation avec la bourgeoisie sur le terrain des luttes, et assurer ainsi l'apprentissage des implications concrètes de la fonction de l'organisation dans la classe
(...).»
«L'intervention dans les luttes immédiates est un axe des activités pour la période qui vient (...). »
«Dans cette perspective, il est nécessaire de renforcer notre capacité à faire des propositions concrètes de marche, à faire que ces propositions ''passent". Pour cela, en plus de l'intervention de l'organisation par la presse, les tracts et les prises de parole, il est nécessaire lorsque les conditions le permettent :
- de faire des propositions de motions, déclarations, résolutions écrites, autant que possible préparées et discutées dans le cadre de l'organisation pour faire que les assemblées se prononcent ;
- d'intervenir non seulement dans les manifestations, les assemblées, les comités de chômeurs, les réunions politiques, mais également dans les tentatives de regroupement d'ouvriers combatifs, dans les comités de lutte, en dehors des syndicats, qui peuvent surgir et vont surgir, en les impulsant, en participant à leur formation.»
Nous ne pouvons ici répercuter l'ensemble des questions qui ont été abordées dans ce point de l'ordre du jour. Des positions très minoritaires se sont exprimées, principalement sur notre intervention à l'égard des comités de lutte, qui traduisent encore une certaine difficulté à prendre en compte les aspects de ce qu'implique l'axe central de notre orientation à l'égard de l'intervention dans la classe : être «partie prenante des combats ouvriers» afin de contribuer à leur plein épanouissement vers des affrontements de plus en plus massifs, déterminés, unis et conscients contre un capitalisme toujours plus barbare.
Sur notre responsabilité à l'égard du milieu politique révolutionnaire
Comme le signalait une résolution adoptée lors du 6e congrès :
«L'orientation actuelle vers l'accélération et le renforcement de l'intervention du CCI dans la lutte de classe est également valable et doit être appliquée rigoureusement dans notre intervention envers le milieu. »
«Le CCI (...) doit se préoccuper d'utiliser pleinement la dynamique positive de la situation actuelle de lutte afin de pousser le milieu de l'avant et d'insister sur une intervention claire et déterminée des organisations révolutionnaires dans ces luttes (...). »
«Afin de faire le meilleur usage de ces potentialités qui sont à leur tour simplement une concrétisation du fait que la période de lutte pour la formation du parti est ouverte, il est nécessaire de mobiliser les forces de tout le CCI afin d'oeuvrer au mieux à la défense du milieu politique, ce qui passe par (...) une attitude déterminée pour participer au regroupement des révolutionnaires, à leur unité.»
Cette préoccupation s'est de nouveau, et encore plus illustrée lors du 7e congrès. C'est ce qu'exprime l'adoption d'une nouvelle résolution que nous publions ici, accompagnée d'une présentation spécifique et qui souligne tout l'intérêt et toute la préoccupation de notre organisation envers le surgissement de plusieurs nouveaux groupes révolutionnaires. Ce surgissement met en évidence la nécessité d'un nouvel effort de tenue de conférences internationales des groupes de la gauche communiste dont un premier cycle avait été interrompu par le sectarisme d'une partie du milieu politique. Comme le relève la résolution, les conditions pour de telles conférences ne sont pas aujourd'hui réunies, mais le congrès a été pleinement conscient de l'importance de l'effort que doit faire notre organisation pour impulser la création de ces conditions et, plus généralement, pour contribuer résolument au renforcement du milieu révolutionnaire dans son ensemble.
Le renforcement de la capacité théorique et programmatique
Le renforcement du milieu révolutionnaire et de notre capacité à impulser son développement passe par le renforcement de notre propre organisation sur les plans théorique et programmatique. C'est pour cela que tous les congrès du CCI ont eu dans leur ordre du jour une question d'une portée plus générale que l'examen de la situation internationale et la définition de notre intervention en son sein. Le 6e congrès avait en particulier adopté une résolution sur la question de «l'opportunisme et du centrisme dans la période de décadence» (Revue Internationale n° 44) faisant suite à près de deux ans de débats sur cette question. Le présent congrès, en continuité du précédent et en application de sa décision, avait mis à son ordre du jour la rectification de la plate-forme de l'organisation.
Nous publions ici deux documents sur cette question :
- le texte d'orientation de septembre 1986 ouvrant la discussion dans notre organisation,
- la résolution de rectification de la plate-forme contenant la nouvelle version du point 14 de celle-ci qui est touché par cette rectification.
Là aussi les textes parlent par eux-mêmes mais il importe de souligner particulièrement deux idées fondamentales qui y sont exprimées :
- «une telle rectification ne constitue nullement une remise en cause ni des fondements de la plate-forme, ni des acquis de la gauche communiste, ni des acquis du CCI, mais constitue au contraire un affermissement de ces fondements, une meilleure traduction de ces acquis et notamment une mise en adéquation du document programmatique central de l'organisation avec les textes déjà adoptés lors de congrès précédents (Résolution sur les groupes politiques prolétariens du 2e congrès, Rapport sur le cours historique du 3e congrès et Résolution sur le centrisme et l'opportunisme du 6e congrès, «Résolution de rectification»).
- « ...la discussion théorique en vue de la rectification de la plate-forme (...) n'est nullement un débat académique. Il n'est pas académique parce que tout débat sur des questions programmatiques se trouve au cœur de ce qui fonde l'existence de l'organisation, mais, de plus, parce qu'il fait partie de sa capacité à accomplir ses tâches non seulement futures mais aussi immédiates à l'heure où le développement de la lutte de classe confère à notre organisation des responsabilités croissantes » («Texte d'orientation»).
Conclusion
Ainsi, du début à la fin, le 7e congrès du CCI a été traversé par la volonté de hisser l'organisation à la hauteur des responsabilités que la situation internationale, et particulièrement le développement de la lutte de classe, impose aux minorités révolutionnaires. Nous sommes conscients des faiblesses qui sont les nôtres, comme elles sont celles de l'ensemble du milieu révolutionnaire prolétarien. Nous savons en particulier quel tribut celui-ci continue de payer à la rupture organique que près d'un demi-siècle de contre-révolution a provoqué dans les courants révolutionnaires. Mais le constat de ces faiblesses, l'ampleur de la tâche à accomplir, ne sont pas faits pour nous décourager. Ils constituent au contraire, comme pour tous les communistes, pour tous ceux qui misent sur l'avenir révolutionnaire du prolétariat et luttent à cette fin, un stimulant de notre volonté de poursuivre et de renforcer toujours plus notre combat et notre engagement.
FM. Courant Communiste International
RESOLUTION SUR LA SITUATION INTERNATIONALE
1. La résolution sur la situation internationale du 6e Congrès du CCI (Revue Internationale n° 44) avait comme axe la dénonciation de toute une série de mensonges mis en avant par la bourgeoisie pour tenter de masquer la réalité de cette situation :
- «mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les "succès" de l'économie américaine en 1983 et 1984... seraient l'incarnation» ;
- prétendue «atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la "main tendue" aux négociations avec l'URSS qui trouvent leur pendant avec l'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev» ;
- battage sur «l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale».
Huit mois plus tard, la résolution du CCI de juin 1986 (Revue Internationale n° 47) constatait, « suite :
- à la baisse de 30% du dollar US et aux premiers signes d'une nouvelle récession mondiale,
- à un nouveau durcissement des diatribes de Reagan contre "l'empire du mal" et aux bombardements US sur la Libye,
- au formidable mouvement de luttes massives qui s'était développé en Belgique en avril et mai 1986»,
que la «réalité s'est chargée de démentir ouvertement toutes les campagnes précédentes» et que «la rapidité avec laquelle les événements sont venus battre en brèche les mensonges de 1985 illustre une autre caractéristique générale de ces années de vérité : l'accélération croissante de l'histoire. »
Un an après cette dernière résolution, le 7e Congrès du CCI confirme toute la validité des analyses sur la situation internationale développées par l'organisation au cours et à la suite de son 6e congrès. En ce sens, la présente résolution se conçoit essentiellement comme une prolongation, un enrichissement des deux précédentes. Elle ne se donne pas pour but de re-développer leurs analyses, mais de les illustrer et de les compléter par les événements intervenus depuis un an, de tirer les enseignements de ces événements, et principalement au plan des luttes de la classe ouvrière, afin d'armer le mieux possible les révolutionnaires pour leur intervention au sein de ces dernières.
L'évolution de la crise du capitalisme
2. Après les déclarations euphoriques de 1984 et 1985, le temps des lamentations est revenu pour les «experts» bourgeois de l'économie. Il ne se passe pas un mois sans qu'ils ne soient obligés de revoir «à la baisse» les prévisions qu'ils avaient faites auparavant, à l'heure où ils s'étaient eux-mêmes grisés des discours optimistes qu'ils tenaient aux exploités pour leur faire accepter des sacrifices censés permettre enfin un redressement de l'économie. Au centre de cette euphorie, les péroraisons de l'administration Reagan sur le «libéralisme»
et le «désengagement de l'Etat» comme remède miracle à la crise ne faisaient en réalité que cacher le rôle décisif de l'Etat US dans la «reprise» américaine et mondiale des années 1983-85 sous forme de déficits budgétaires et commerciaux colossaux.
Alors que l'endettement des pays de la périphérie du capitalisme dits du «tiers-monde» avait alimenté la «reprise» des années 1976-79, celui de la première puissance mondiale a joué un rôle similaire après la récession de 1981-82. Mais de même que le premier, en se heurtant à la menace d'un effondrement brutal du système financier international, a épuisé ses effets dès 1980, le second, en faisant des USA l'Etat le plus endetté du monde, loin devant le Brésil, ne peut plus aujourd'hui faire office de «locomotive» de l'économie mondiale, ce qui débouche sur une nouvelle récession dont l'ampleur et la profondeur seront bien plus considérables encore que celles de la précédente. Tous les artifices destinés à contourner la maladie mortelle du capitalisme, la surproduction généralisée, ne peuvent en fin de compte que repousser pour un temps limité les échéances tout en aggravant encore cette maladie, en accumulant à un niveau supérieur les contradictions explosives qui minent le système (qui s'expriment notamment aujourd'hui par une reprise importante de l'inflation et les poussées de fièvre spéculative et en réduisant toujours plus la capacité de la bourgeoisie à limiter l'ampleur et les effets de la récession). Et le fait que ces contradictions aboutissent aujourd'hui à l'énorme endettement extérieur du pays le plus puissant du monde, que celui-ci se retrouve dans une situation qui jusqu'à présent caractérisait essentiellement les pays sous-développés, est significatif du niveau présent de ces contradictions et souligne l'urgence pour ce pays de mesures destinées à redresser son commerce extérieur et sa balance des paiements. C'est le sens du déploiement actuel par les USA de tout un arsenal protectionniste, comme la taxation à 100% d'un certain nombre de marchandises japonaises qui, à côté de la baisse considérable du taux de change du dollar caractérise une intensification sans précédent depuis près d'un demi-siècle de la guerre commerciale à l'échelle mondiale que les organismes, tel le GATT, chargés de favoriser les échanges commerciaux ne peuvent empêcher mais seulement permettre qu'elle n'aboutisse, comme au cours des années 1930, à un étranglement brutal du marché mondial.
3. Ainsi, la perspective qui se présente à l'économie capitaliste n'est pas seulement celle d'une nouvelle récession encore plus catastrophique que celle de 1980-82 du fait de l'épuisement de tous les palliatifs utilisés jusqu'à présent, mais aussi celle d'un déchaînement de la concurrence entre capitaux du fait de cette récession et également de la nécessité pour la première puissance économique de rétablir coûte que coûte sa balance commerciale. Et ce sont tous les pays du monde qui feront les frais de cette situation.
Les pays de la périphérie capitaliste dits «sous-développés» seront un nouvelle fois les plus brutalement atteints par la récession qui arrive et par ses conséquences. En particulier, la baisse du prix des matières premières qui constituent dans la plupart des cas l'essentiel des exportations de ces pays, ne pourra aboutir qu'à la poursuite et à l'aggravation de leurs difficultés face à un endettement phénoménal. Non seulement ces pays ne pourront pas réduire leur endettement mais les nouveaux déficits prévisibles de leur commerce extérieur ne pourront aboutir qu'à une augmentation de cet endettement. Pour ces pays, la perspective consiste donc en un resserrement de l'étau de leurs créanciers avec en tête le FMI, soucieux de maintenir le plus longtemps possible le mythe qu'ils rembourseront leurs dettes afin de ne pas provoquer une explosion de faillites parmi les banques prêteuses et un effondrement de tout le système financier international. De plan «d'austérité» en nouveau plan «d'austérité», la barbarie qui règne dans ces pays est appelée à atteindre de nouveaux sommets dans la misère absolue, la famine, les épidémies meurtrières. Si d'ores et déjà ce sont 40. 000 individus qui y meurent pour ces raisons chaque jour, ce chiffre ne peut encore que s'aggraver. Avec la nouvelle plongée de l'économie mondiale, l'enfer permanent que vivent des milliards d'êtres humains ne pourra que s'étendre et prendre des formes plus terrifiantes encore.
Pour leur part, les pays du bloc de l'Est sont appelés à connaître une nouvelle dégradation de leur situation économique. Si plusieurs de ces pays ont pu annoncer pour 1986 des chiffres en augmentation quant à leur taux de croissance, il est nécessaire de prendre en compte les faits que, plus encore qu'en Occident, ces chiffres sont falsifiés et aussi qu'une bonne part de la production annoncée concerne des biens absolument inutilisables à cause de leur qualité défectueuse. En fin de compte, la gravité de la crise qui affecte ces pays, transparaît dans leurs propres déclarations alarmistes lors de la réunion du COMECON en novembre 1986 signalant leur incapacité à atteindre les objectifs de leurs plans quinquennaux. Elle se manifeste aussi dans le nouvel accroissement de la dette extérieure de la Pologne (33,4 milliards de dollars pour 1986 contre 29,5 en 1985), comme dans la stagnation de la production industrielle de la Hongrie pourtant considérée jusqu'ici comme un «modèle» de bonne gestion. Elles se révèlent enfin, pour ce qui concerne la première puissance du bloc, l'URSS :
- par une chute de près d'un tiers des exportations vers les pays occidentaux en 1986, ce qui l'a condamnée à réduire ses propres importations de 17% (ce qui affecte particulièrement sa capacité de moderniser son appareil productif) ;
- par les campagnes de l'équipe Gorbatchev en vue d'intensifier l'effort de productivité avec à la clé des baisses de salaire pour les ouvriers des secteurs peu productifs.
Pour la classe ouvrière des pays dits « socialistes », l'heure est donc à de nouvelles attaques contre ses conditions d'existence déjà particulièrement pénibles : baisse des salaires réels (notamment sous forme d'une inflation baptisée «vérité des prix»), nouvelle dégradation des conditions de travail, de logement, de santé. Et si la grande fragilité des régimes d'Europe de l'Est leur interdit les licenciements massifs et la mise au chômage d'énormes proportions de la force de travail (comme c'est le cas dans les autres régions du monde), les transferts considérables d'ouvriers (un million pour la seule RDA d'ici à 1990) dans des secteurs dits «moins productifs» -donc moins payés- sous couvert de «restructuration technologique», constituent un de moyens par lesquels ils viseront le même objectif qui est atteint par le chômage : une réduction massive du capital variable.
Concernant le Japon, l'évolution de sa situation économique constitue très certainement un des indices les plus significatifs de la gravité présente de la crise mondiale. Alors que ce pays s'était distingué jusqu'à présent par des taux de croissance bien au-dessus de ceux de ses concurrents et qu'il avait réussi à limiter le fléau du chômage, il se retrouve aujourd'hui avec une quasi-stagnation de sa production et une brutale flambée du nombre de chômeurs. Même les «modèles» ne résistent plus au flot croissant de la crise.
L'Europe Occidentale, enfin, se retrouve de nouveau, et bien plus encore que lors des précédentes récessions, aux avant-postes pour ce qui concerne les effets de la nouvelle récession et de la guerre commerciale qui s'avancent. La fermeture du marché des pays « sous-développés » aux abois, celle des pays du bloc de l'Est et surtout la fermeture du marché américain résultent de la forte poussée du protectionnisme des USA et de la baisse du dollar (qui ne peut que stimuler l'agressivité des exportations américaines sur le marché européen), tous ces éléments augurent d'une aggravation considérable des difficultés économiques sur le vieux continent. Ces difficultés seront d'autant plus brutales que l'Europe occidentale va devenir la cible de choix des exportations japonaises privées du marché américain. Alors que ce continent voit déjà pratiquement stagner sa production industrielle (la croissance du PNB étant due essentiellement au secteur tertiaire), que de façon continue sont mis à la casse des pans considérables de son appareil productif non seulement dans les secteurs traditionnels (mines, sidérurgie, chimie, etc.), mais aussi dans les secteurs «de pointe» (électronique, télécommunications, etc.), c'est une nouvelle saignée bien plus brutale encore que les précédentes qui s'y profile. Et cette chute de la production va entraîner une nouvelle poussée du chômage vers des niveaux de plus en plus intolérables alors qu'en chiffres réels, il frappe déjà près de 30 millions d'ouvriers, soit de 10 à 30% de la population active, suivant les pays, c'est-à-dire de 15 à 45% de la classe ouvrière. Chiffre auquel il faut ajouter la masse de plus en plus considérable des chômeurs partiels et des travailleurs précaires. Alors qu'au-delà des statistiques officielles, c'est une baisse de près de 10% de son niveau de vie que la classe ouvrière a subi en 1986, c'est donc une attaque d'une violence inouïe, sans précédent depuis la dernière guerre mondiale qui l'attend. Si l'inflation durant les années 1970 et le chômage dans la première partie des années 1980 furent successivement les axes centraux des attaques capitalistes, dans la période qui s'est ouverte, ce sont tous les aspects de la vie des ouvriers qui, sous l'égide directe et ouverte de l'Etat, sont brutalement attaqués de façon simultanée : emploi, conditions de travail, salaires nominaux, santé, allocations pour les enfants et les personnes âgées, logement, etc. , entraînant de façon massive la paupérisation absolue de la classe ouvrière, une paupérisation absolue dont les « experts » détracteurs du marxisme avaient annoncé des décennies durant l'extinction définitive. Ainsi reviennent déferler au centre historique du capitalisme, dans les concentrations industrielles et ouvrières les plus anciennes et importantes du monde, ces formes extrêmes de la barbarie que la bourgeoisie croyait avoir rejetées une fois pour toutes vers la périphérie après la 2e guerre mondiale.
L'évolution des conflits impérialistes
4. La barbarie qui aujourd'hui revient frapper le cœur du capitalisme, aussi cruelle qu'elle soit, n'est qu'une pâle image de celle vers où ce système entraîne l'humanité s'il est laissé à sa propre logique ; sur le terrain capitaliste, il n'existe qu'un seul aboutissement à la crise économique mondiale : un 3e holocauste impérialiste qui détruirait toute civilisation et probablement l'humanité elle-même.
Cette perspective s'est profilée de façon ouverte à l'entrée des années 1980 lorsque les augmentations astronomiques des dépenses militaires, et particulièrement celles des USA, se sont accompagnées d'une radicalisation des diatribes entre les gouvernements des deux blocs et une détérioration sensible des rapports diplomatiques. Mais si aujourd'hui ce sont des discours de paix qui dominent la vie diplomatique, si fleurissent des initiatives et des discussions en faveur des réductions d'armement, cela ne signifie nullement qu'il se serait produit un réel changement dans l'ensemble de la situation, que nous irions vers une atténuation des tensions impérialistes et une disparition définitive de la menace d'une 3e guerre mondiale.
En réalité, les discours pacifistes, les grandes manœuvres diplomatiques, les Conférences internationales de toutes sortes ont toujours fait partie des préparatifs bourgeois en vue de la guerre impérialiste (cf. les accords de Munich en 1938 par exemple). Ils interviennent en général en alternance avec des discours bellicistes et ont une fonction complémentaire. Alors que ces derniers ont pour objet de faire accepter à la population, et en particulier à la classe ouvrière, les sacrifices économiques commandés par l'explosion des armements, de la préparer à la mobilisation générale, les premiers ont pour objet de permettre à chaque Etat d'apparaître comme «celui qui veut la paix», qui n'est pour rien dans l'aggravation des tensions, afin de pouvoir justifier par la suite la «nécessité» de la guerre contre «l'autre qui en porte toute la responsabilité». C'est bien à une telle alternance entre discours bellicistes et discours pacifistes que nous avons assisté ces dernières années notamment de la part de l'administration Reagan dont le «jusqu'au-boutisme» des premières années de son mandat, destiné à justifier les énormes accroissements des dépenses militaires ainsi que diverses interventions à l'extérieur (Liban, Grenade, etc.), a fait place à «l'ouverture» face aux initiatives soviétiques dès lors qu'était acquise et affermie la nouvelle orientation d'accroissement des préparatifs militaires et qu'il convenait de faire preuve de «bonne volonté». Mais derrière le battage diplomatique actuel et les perspectives d'une réduction des «euromissiles», il n'existe aujourd'hui aucune remise en cause réelle des menaces que le capitalisme fait peser sur l'humanité : même si les négociations actuelles aboutissaient -ce qui est extrêmement improbable- à une réduction importante ou même totale des «euromissiles», cela ne remettrait nullement en cause la capacité des armements actuels à détruire 10 fois la planète. D'ailleurs, c'est en partie aussi le surarmement des deux grandes puissances qui permet d'expliquer leurs discussions actuelles : plutôt que d'épuiser encore plus une économie déjà violemment frappée par la crise (ce qui est particulièrement le cas de l'URSS dont ce n'est pas par hasard qu'elle soit à l'origine des présentes initiatives), par une concurrence du nombre de missiles et des mégatonnes, elles préfèrent soulager quelque peu cette économie et consacrer plus de moyens aux systèmes d'armes les plus sophistiqués.
5. Ainsi, au plan des conflits impérialistes, la situation internationale n'a connu sur le fond aucune modification sensible ces derniers temps où se sont maintenus ou même avivés les multiples foyers d'affrontement entre les grands blocs sous couvert notamment de «libérations nationales» (comme en Angola, en Ethiopie, au Cambodge, en Afghanistan, etc.). En particulier, cette situation reste dominée par l'offensive du bloc occidental destinée à établir un «cordon sanitaire» autour de l'URSS, à parachever l'encerclement de cette puissance et dont l'étape actuelle consiste dans la réinsertion de l'Iran dans le dispositif stratégique du bloc.
Cette offensive a été rendue difficile non pas tant par la résistance que peut lui opposer l'URSS mais principalement par l'instabilité interne d'un grand nombre de régimes des régions concernées par cette offensive, instabilité qui ne fait que s'aggraver avec les coups de boutoir de la crise et la décomposition sociale qui en résulte et qui est un terrain de choix pour toutes sortes de surenchères entre cliques bourgeoises notamment à l'égard des blocs impérialistes. Ces pays bien souvent expriment de façon caricaturale que l'appartenance à un bloc ne signifie nullement qu'une bourgeoisie renonce pour autant à la défense de ses propres intérêts nationaux ni à ses propres ambitions impérialistes particulières. Une telle appartenance a au contraire comme objectif d'assurer la meilleure défense possible de ces intérêts et ambitions dans un monde où la crise tend à exacerber les rivalités économiques et militaires entre tous les pays et où il est impossible à un pays donné de s'affronter à tous les autres. Dans toute une série de pays «sous-développés» de la périphérie plongés dans une situation économique catastrophique et aux ambitions impérialistes perpétuellement frustrées, l'indiscipline et le chantage à l'égard du bloc de tutelle constituent un des moyens pour essayer de se vendre le plus cher possible.
Cependant de telles gesticulations ne sauraient remettre en cause le facteur prépondérant que constitue, dans la situation mondiale, la division en deux grands blocs impérialistes, ni non plus le fait que dans leurs affrontements permanents, c'est le bloc de l'Ouest qui dispose des meilleurs atouts. C'est bien ce que viennent de confirmer les derniers événements au Proche et Moyen-Orient :
- avec son intervention à Beyrouth Ouest de début 1987, la Syrie a fait la preuve qu'elle était désormais prête à jouer pleinement au Liban son rôle de gendarme au profit des intérêts du bloc US : cette intervention fait comme principales victimes les partis de « gauche » (PCL et PSL de W. Joumblatt) et surtout les «hezbollahs» pro-iraniens, preuve que la Syrie a renoncé à son alliance avec l'Iran pour participer à l'offensive occidentale visant à récupérer ce pays ;
- les déboires de la Libye au Tchad, résultant de l'important soutien militaire de la France et des Etats-Unis à ce dernier pays démontrent les limites des velléités d'indépendance des pays qui sont tentés de faire passer leurs intérêts impérialistes locaux devant les intérêts globaux du bloc auquel ils sont rattachés ; plus qu'à la Libye c'est à l'Iran qu'est destiné un tel avertissement ;
- le scandale de «l'Irangate», au-delà des manœuvres de politique interne américaine destinées à préparer en faveur des Républicains la succession de Reagan, fait apparaître la nécessité pour l'Iran, malgré toutes ses campagnes contre les pays du bloc occidental, de composer avec celui-ci afin de faire face au poids grandissant de la guerre contre l'Irak encouragée au départ par ce même bloc.
Ainsi, ces derniers mois ont apporté à celui-ci, après plusieurs années de relatif piétinement, de réels succès dans son offensive. Mais les progrès de celle-ci et l'établissement, vers lequel elle s'achemine, d'un contrôle ferme et sans partage du bloc occidental sur les Proche et Moyen-Orient, n'annoncent aucune perspective réelle de paix dans cette région et encore moins à l'échelle mondiale :
- dans cette région, l'accumulation de problèmes légués par l'histoire du capitalisme -notamment celle de la colonisation (divisions communautaires au Liban, Kurdes et surtout question palestinienne)- et qui ne pourront pas être réglés au sein de ce système (même par une nouvelle «conférence de Genève» si elle arrive à se tenir), ne pourra aboutir dans un contexte général d'aggravation de la crise et des tensions impérialistes qu'à de nouvelles convulsions meurtrières ;
- même s'il établissait dans cette partie spécifique du monde une «pax americana» durable, elle ne pourrait empêcher que la poursuite de l'offensive du bloc US ne fasse surgir d'autres foyers de conflits jusqu'à aboutir à l'embrasement généralisé d'une 3e guerre mondiale au cas où l'URSS serait repoussée dans ses derniers retranchements.
Cet aboutissement monstrueux, ce point culminant de toute la barbarie du capitalisme décadent, supposerait évidemment que la classe ouvrière, par son embrigadement derrière les drapeaux nationaux laisse les mains libres aux grandes puissances pour s'engager dans l'engrenage qui y conduit, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle du fait même du développement des luttes ouvrières.
L'évolution de la lutte de classe
6. Ainsi la lutte du prolétariat, si elle porte dans son devenir, avec le renversement du capitalisme, l'élimination de tous les aspects de la barbarie de ce système, constitue déjà le facteur historiquement décisif de la période actuelle, empêchant le déchaînement de la forme extrême de cette barbarie : le cours historique n'est pas à la guerre impérialiste généralisée, mais aux affrontements de classe généralisés et ce qui caractérise les mois écoulés, c'est que la lutte de classe est revenue de façon de plus en plus insistante au centre de la situation mondiale immédiate.
En moins d'un an, en effet, outre des mouvements importants dans une multitude de pays dans le monde entier, allant des USA (sidérurgie, employés municipaux de Philadelphie et Détroit durant l'été 1986) à la Yougoslavie (vague de grèves sans précédent au printemps 1987), en passant par le Brésil (plus d'un million et demi d'ouvriers de nombreux secteurs en grève en octobre 1986 et nouvelle vague de luttes massives en avril mai 1987), l'Afrique du Sud (grèves dans les mines et les chemins de fer), le Mexique (manifestations massives de plusieurs secteurs en appui aux électriciens en grève), la Suède (des dizaines de milliers de grévistes à l'automne 1986) et la Grèce (près de 2 millions d'ouvriers en grève en janvier 1987) ; on a pu assister à quatre mouvements majeurs très significatifs affectant le cœur du prolétariat mondial : l'Europe occidentale. Il s'agit :
- des grèves massives en Belgique au printemps 1986;
- du très important mouvement des travailleurs des chemins de fer en France en décembre 1986 ;
- de la grève des 140. 000 travailleurs de British Telecom en Grande-Bretagne fin janvier 1987 ;
- de la vague de luttes affectant de nombreux secteurs en Espagne au printemps 1987.
L'ensemble de ces mouvements confirme donc que la 3e vague de luttes ouvrières depuis la reprise historique de la fin des années 1960 et qui avait débuté à l'automne 1983 avec les luttes massives du secteur public en Belgique, a une toute autre durée, ampleur et profondeur que la 2e (1978-80), et que le piétinement qu'elle avait connu en 1985, suite à la politique bourgeoise d'éparpil-lement des attaques en vue d'éparpiller les ripostes ouvrières, ne remettait pas en cause sa dynamique d'ensemble.
Les mouvements démontrent également que c'est au cours de cette 3e phase dans le développement de cette vague de luttes (après les mouvements massifs de 1983-84 et l'éparpillement de 1985) que s'expriment pleinement ses principales caractéristiques telles qu'elles avaient été dégagées par le CCI dès janvier 1984 («Résolution sur la situation internationale», Revue Internationale n° 37, 2e trimestre 1984) et confirmée lors de son 6e congrès de même que dans la résolution de juin 1986 :
1. tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes ;
2. tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant en particulier à leurs débuts, un certain débordement des syndicats ;
3. développement progressif au sein de l'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité à s'opposer comme classe aux attaques capitalistes ;
4. recherche de la solidarité active et de l'unification par-delà les usines, les catégories ou les régions, notamment sous forme de manifestations de rue et en particulier de délégations massives d'un centre ouvrier à l'autre, mouvement qui se fera en confrontation croissante avec tous les obstacles placés par le syndicalisme et au cours duquel s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto organisation de leur combat. »
7. En effet, les luttes qui se sont développées depuis un an, et notamment celles de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d'Espagne, revêtent toutes, à des degrés divers, une ou plusieurs de ces caractéristiques.
C'est ainsi que la tendance à des mouvements de grande ampleur s'est exprimée de façon très nette en Belgique, où c'est près d'un million d'ouvriers qui ont été impliqués dans les luttes (dans un pays qui ne compte que 9 millions d'habitants), de même qu'en Espagne où les luttes se sont déployées sur plusieurs mois dans de multiples secteurs. Mais, dans une moindre mesure, elle s'est exprimée également en Grande-Bretagne avec plus de 130. 000 grévistes de British Telecom, ainsi qu'en France où, malgré un nombre plus limité de grévistes (40.000 à 50.000), la lutte dans les chemins de fer a eu un énorme impact dans toute la classe ouvrière et la vie politique du pays.
Pour sa part, la tendance au surgissement de mouvements spontanés s'est manifestée de manière très claire dans ces deux derniers pays. Et si, dans le cas de la France, la spontanéité du mouvement des cheminots -qui a rencontré au départ l'hostilité de tous les syndicats résultait pour une part du discrédit qui s'était accumulé à l'égard de ces organismes durant les 5 années de gouvernement de gauche qu'ils soutenaient (ce qui constitue une confirmation a contrario de la nécessité pour la bourgeoisie dans la période présente de placer ses forces de gauche dans l'opposition), le cas de la Grande-Bretagne (où la bourgeoisie la plus expérimentée du monde avait mis la gauche dans l'opposition dès la fin des années 1970) illustre le fait que cette tendance est bien un phénomène général qui se développera de plus en plus dans les autres pays.
C'est également dans ces deux pays que le développement de la confiance en soi du prolétariat s'est manifesté de la façon la plus significative. Pour ce qui est de la France, le déploiement de la grève des cheminots confirme la sortie d'une période où la bourgeoisie avec l'aide des syndicats avait mis en œuvre, avec un certain succès, une politique d'immobilisation de la classe, où le discrédit des syndicats était retourné contre les ouvriers pour les convaincre qu'ils ne pouvaient rien faire contre les attaques capitalistes. Le phénomène est encore plus net en Grande-Bretagne où la grève de British Telecom signifie la fin d'une période de démoralisation et de sentiment d'impuissance qui avait suivi la défaite de la longue grève des mineurs de 1984-85 et celle des ouvriers de l'imprimerie en 1986.
Ces différentes caractéristiques des luttes récentes sont appelées à se renforcer dans la période qui vient avec le développement de la résistance ouvrière face à l'intensification et la généralisation des attaques d'une bourgeoisie dont la marge de manoeuvre économique se réduit toujours plus. Cette période sera marquée par :
- une tendance à une mobilisation beaucoup plus massive et simultanée des ouvriers,
- une plus grande fréquence de ces situations de mobilisation de la classe, les moments de répit tendant à être d'une durée de plus en plus courte,
- un renforcement de l'expérience et surtout de la maturation de la prise de conscience dans les rangs ouvriers où la simple méfiance face aux forces bourgeoises d'encadrement cédera de plus en plus la place à une attitude active de débordement de celles-ci, de prise en main directe des luttes posant de façon croissante la question de leur unification.
8. La tendance vers l'unification des luttes est justement celle qui a éprouvé jusqu'à présent le plus de difficultés à s'exprimer de façon positive et claire. Si les bases en ont été posées de façon nette lors des luttes en Belgique au printemps 1986 (avec en particulier la volonté permanente des mineurs d'étendre le combat dans d'autres secteurs), c'est surtout son besoin qui s'est exprimé alors que des centaines de milliers d'ouvriers luttaient simultanément, bien plus que sa réalité. Ce besoin s'est également fait sentir fortement lors des luttes de l'hiver et du printemps 1987 en Espagne, alors que de multiples mouvements affectant de nombreux secteurs dans tout le pays se sont déroulés en ordre dispersé, ce qui a permis la reprise en main de la situation par la bourgeoisie et la dissipation de leur énorme potentialité. Dans le cas de la France, l'isolement corporatiste qui a caractérisé la grève dés cheminots et constitué sa principale faiblesse a d'autant plus mis en évidence le besoin de l'unification que se déroulaient en même temps d'autres mouvements dans les transports urbains à Paris et parmi les marins, et qu'il existait dans tout le secteur public un réel potentiel de combativité qui aurait pu se cristalliser si les cheminots avaient appelé leurs frères de classe à les rejoindre.
Cette difficulté à concrétiser le besoin de l'unification, alors que les autres caractéristiques des combats actuels se sont exprimées déjà de façon beaucoup plus marquée, s'explique aisément par le fait que l'unification constitue justement l'élément central des luttes de la période présente, celui qui, d'une certaine façon, contient tous les autres, qui en constitue la synthèse.
Par ailleurs, les mouvements récents ont montré que l'effort vers l'unification se heurtait à la différence existant entre la situation des ouvriers du secteur privé et ceux du secteur public. Le fait que ces grèves aient touché essentiellement le secteur public illustre cette différence. En effet, dans le secteur privé, l'arme de la grève se révèle d'un emploi beaucoup plus difficile à cause du poids du chômage et de la menace de licenciement. C'est pour cela que les manifestations de rue tendront à devenir, comme la résolution de juin 1986 le mettait en évidence, un des moyens privilégiés du processus d'unification du combat entre tous les secteurs de la classe ouvrière : ouvriers du secteur public, du secteur privé, ouvriers au chômage. Et cela a pu être vérifié négativement dans la lutte des ouvriers des chemins de fer en France, par exemple où un des facteurs indiscutables du maintien de leur isolement favorisant les manœuvres syndicales et les conduisant à la défaite a résidé dans le fait qu'ils n'aient pas pris l'initiative de telles manifestations de rue dès qu'ils se sont mis spontanément en grève et dotés de l'auto organisation de leur combat.
9. Le fait que l'unification du combat de classe face aux attaques de plus en plus frontales du capital -et qui constitue à l'heure actuelle l'axe central du développement de l'affrontement contre celui-ci- contienne tous les autres aspects de la lutte ouvrière -la prise en main des luttes, leur auto organisation, leur extension d'un secteur à l'autre, les manifestations de rue- détermine les caractéristiques de la stratégie employée par la bourgeoisie, sa gauche et en particulier ses syndicats contre ce combat. Dans la période présente où c'est dans l'opposition qu'agissent les forces bourgeoises de gauche, celles-ci n'ont et n'auront pas pour tactique, dans l'accomplissement de leur fonction anti-ouvrière, de s'opposer ouvertement à la combativité qui surgit partout, ni même en général de s'opposer à tel ou tel aspect de la lutte, mais essentiellement de dissocier, d'opposer les différents aspects complémentaires du chemin vers l'unification. C'est ainsi que dans les grèves du printemps 1987 en Espagne, la tactique syndicale a consisté essentiellement à prendre les devants face à un mécontentement et une combativité généralisés, afin d'empêcher les surgissements spontanés de la lutte et sa prise en charge par les ouvriers, et de pouvoir la découper en rondelles à travers des « actions » dispersées dans le temps et l'espace, des manifestations séparées alors que le sens même d'une manifestation est de permettre aux ouvriers de tous les secteurs de se retrouver ensemble. De même, lors de la grève des cheminots en France, la tactique syndicale, une fois qu'il était devenu impossible de faire obstacle au mouvement, a consisté non pas à s'opposer ouvertement à son auto organisation, mais d'abord à en faire un problème «spécifique» des cheminots et même des conducteurs de train, puis de jouer la carte du «jusqu'au-boutisme» quand la preuve a été faite que la lutte était battue, tout en lançant à ce moment-là des appels à «l'extension» visant non pas à l'extension du combat, mais à l'extension de la défaite.
Une des caractéristiques de la période présente et à venir de développement de la combativité et de la conscience de la classe ouvrière consiste dans l'utilisation croissante par le syndicalisme, à côté des grandes centrales officielles, de ses variantes «de base» et «de combat», notamment lorsque les premières sont débordées par les ouvriers. La fonction essentielle du syndicalisme de base, derrière lequel on trouve en général les différentes variétés de groupes gauchistes, consiste à ramener dans les filets du syndicalisme, et en fin de compte des syndicats «officiels», les secteurs ouvriers qui tendent à rompre avec celui-ci. C'est bien ce qui a pu être constaté dans la grève des chemins de fer en France, où les deux «coordinations» constituées en dehors des syndicats, celle des «roulants» et celle «inter catégories», ont décidé, sous l'influence des deux groupes trotskystes qui s'étaient placés à leur tête, de confier aux centrales syndicales officielles le soin de mener les négociations avec la direction («l'audace» la plus «radicale» consistant à demander qu'on lui réserve une petite place sur un strapontin). Mais le mode d'activité du syndicalisme de base ne se limite pas à cela. Il consiste également à promouvoir des actions «dures» (que les centrales peuvent dans certains cas reprendre également à leur compte) telles que des blocages de routes, de voies de chemin de fer, des séquestrations, des affrontements avec la police qui, si elles peuvent faire partie dans certaines circonstances des moyens de lutte de la classe ouvrière, sont ici utilisées pour isoler les éléments les plus combatifs du reste de la classe, ce qui met en évidence une réelle convergence entre syndicalisme de base et répression étatique, un partage des tâches de fait. De même, outre qu'il peut prôner directement un syndicalisme plus « radical » face aux centrales officielles en appelant à la formation de syndicats «révolutionnaires» ou «rouges», le syndicalisme de base peut également agir à travers la mise en place de structures de nature syndicale qui ne disent pas leur nom ou en poussant à la transformation de réels organes de la lutte en de telles structures. C'est ainsi qu'il est amené, comme on l'a vu en Allemagne avec les comités de chômeurs et en France avec les « coordinations », à auto proclamer une fausse centralisation de la lutte, avant que les ouvriers concernés ne soient prêts à pouvoir la réaliser par eux-mêmes, avec comme résultat d'entraver le réel processus d'auto organisation.
Face à cette multitude de facettes de l'action des forces bourgeoises au sein de la classe ouvrière, il importe que les révolutionnaires soient particulièrement vigilants à ne pas leur apporter un concours involontaire en fétichisant ou en employant à contretemps des mots d'ordre justes en général mais qui, dans certaines circonstances particulières, peuvent aller dans le sens des gauchistes et des syndicats cherchant à créer des abcès de fixation ou des diversions. En toutes circonstances, ils se doivent de mettre en avant ce qui contribue réellement au développement de la force essentielle du combat : son unification et la prise de conscience.
10. Cette même vigilance des révolutionnaires doit s'appliquer à l'égard d'un phénomène qui. ne s'est manifesté que de façon embryonnaire jusqu'à présent, mais qui tendra à prendre une importance croissante avec le développement de la lutte elle-même : le surgissement de regroupements des éléments parmi les plus combatifs de la classe, les comités de lutte. Il importe que les révolutionnaires sachent bien faire la différence entre d'une part des manifestations du syndicalisme de base, des tentatives bourgeoises pour ramener dans les nasses du syndicalisme les ouvriers qui tentent de rompre avec lui, et d'autre part de réelles expressions de la vie de la classe, aussi confuses soient-elles. Afin de pouvoir impulser efficacement la création et le développement des comités de lutte, combattre les dangers tendant à les dénaturer et en faire des proies pour les gauchistes et le syndicalisme de base, les révolutionnaires doivent en particulier comprendre leur nature, fonction et caractéristiques réelles :
- ils n'ont pas de plate-forme, ni de conditions d'admission, ni de cotisations régulières, ils sont ouverts à tous les ouvriers ;
- ils ne constituent pas les embryons des futurs comités de grève (dans le cas d'élection de certains de leurs membres dans ces derniers, une claire distinction devrait s'établir entre leur appartenance à un comité et le mandat émanant d'une assemblée générale) ;
- ils ont pour tâche première, à travers la discussion, la réflexion, la propagande, de préparer les combats à venir, leur auto organisation et leur unification ;
- ils se distinguent en ce sens des cercles de discussion (même si de tels cercles peuvent également exister aujourd'hui) tels qu'ils étaient apparus dans les années 1970 et qui constituent une étape vers la formation d'organisations politiques ;
- ils ne sauraient être des «annexes» ou «courroies de transmission» de groupes politiques existants, même si ces derniers interviennent en leur sein ;
- ils ne doivent pas être mis sur le même plan que les comités de chômeurs qui eux ont une vocation d'organisation unitaire de la classe au même titre que les assemblées générales (même si dans certaines circonstances où ils regroupent un nombre réduit d'ouvriers les comités de chômeurs peuvent s'apparenter à des comités de lutte).
11. Si c'est essentiellement dans les grandes concentrations industrielles des pays centraux du capitalisme, et en premier lieu ceux d'Europe occidentale, que se dérouleront dans la période qui vient les combats prolétariens les plus importants et les plus riches d'enseignements pour l'ensemble de la classe ouvrière mondiale, il importe que les révolutionnaires soient vigilants aux manifestations de la combativité ouvrière dans les autres aires de la planète, notamment dans les pays de l'Est et dans les centres les plus industrialisés des pays de la périphérie. Dans ces zones du capitalisme, la perspective pour les luttes est étroitement liée au développement des combats dans les pays avancés du bloc occidental qui sont les seuls à pouvoir réellement démystifier les illusions d'un syndicalisme «libre» et «démocratique» fortement présentes à l'Est et les illusions du type «syndicalisme révolutionnaire» ainsi que le nationalisme «anti-impérialiste» très implantés dans les pays de la périphérie. Cependant, les combats de classe qui se mènent dans les pays dits «socialistes» et ceux des pays dits «sous-développés» apportent et seront appelés à apporter encore plus une contribution appréciable au développement de la prise de conscience des ouvriers des pays centraux du capitalisme. C'est aux premiers, en particulier, qu'on doit principalement l'usure et l'épuisement en cours de la mystification sur l'existence de «pays socialistes». Mais plus généralement, la simultanéité qu'on constate, au cours de cette 3e vague de luttes ouvrières, dans le développement de celles-ci, à l'Ouest, à l'Est et dans les centres névralgiques de la périphérie, constituent déjà un facteur important et significatif dans l'évolution du rapport de forces entre classes en faveur du prolétariat. C'est la seule voie qui pourra préparer et annoncer une généralisation des luttes au niveau mondial, qui posera la question de leur future unification à l'échelle mondiale.
C'est pour cela qu'il importe de comprendre les campagnes «rénovatrices» de Gorbatchev en URSS et dans les autres pays de l'Europe de l'Est. Elles traduisent la crainte de la bourgeoisie que les mesures d'austérité de plus en plus sévères rendues nécessaires par l'intensification de la crise ne provoquent d'importantes réactions de la classe ouvrière. Dans ces pays, où la marge de manœuvre économique et politique de la classe dominante est beaucoup plus restreinte qu'en Occident, les promesses «démocratiques» et la «radicalisation» des syndicats officiels sont un moyen par lequel les autorités essaient de prévenir un débordement trop massif, immédiat et explosif comme ce fut le cas en Pologne en 1980.
De même, pour ce qui concerne les pays dits du «tiers-monde», il convient de réaffirmer que, dans la période à venir, c'est de plus en plus autour de la classe ouvrière que se forgera la résistance de toutes les couches non exploiteuses contre l'attaque brutale de leurs conditions d'existence déjà intenables. Seule en effet, la classe ouvrière, aussi minoritaire qu'elle soit dans ces pays, peut donner une perspective à toutes ces luttes et révoltes. C'est pour cela que dans cette partie du monde également, l'intervention des révolutionnaires est indispensable, notamment dans la dénonciation des campagnes bourgeoises «anti-impérialistes» et en faveur de «l'indépendance nationale», de la «démocratisation» et d'un «syndicalisme de base révolutionnaire».
12. L'accélération de l'histoire qui se produit aujourd'hui, et notamment sur le plan de la lutte de classe, confère d'énormes responsabilités aux organisations révolutionnaires que la classe a fait surgir en son sein. En particulier celles-ci sont appelées à acquérir une influence croissante non pas encore au niveau de l'évolution globale du combat prolétarien, mais sur des moments significatifs de celui-ci. Pour se porter à la hauteur de ces responsabilités, il est indispensable que ces organisations :
- se dotent des positions programmatiques tirant à fond les enseignements de toute l'expérience historique de la classe ouvrière, notamment sur la question syndicale ;
- soient en mesure de développer les analyses les plus claires et précises possibles de la période actuelle : le cours historique aux affrontements de classe, les caractéristiques de la 3e vague de luttes ouvrières depuis le resurgissement historique de la fin des années 1960 ;
- soient capables de concrétiser à tout instant ces analyses par un suivi pas à pas de chacun des mouvements importants de la classe afin de mettre en avant les perspectives et les mots d'ordre appropriés aux différentes situations qu'il traverse ;
- sachent tirer de chacune de leurs interventions dans ces mouvements le maximum d'enseignements afin de pouvoir reconstituer progressivement le potentiel d'expérience que la terrible contre-révolution dont nous sommes sortis a fait perdre aux révolutionnaires.
Pour faire face à ces nécessités, et notamment aux deux dernières, il est indispensable, que les organisations révolutionnaires se conçoivent comme partie prenante des combats qui se mènent dès aujourd'hui. Cela suppose de leur part et de celle de leurs militants une implication résolue, énergique et directe au sein de ces combats. Cela suppose aussi, comme condition indispensable à une telle implication, qu'elles conçoivent leur rôle et leur activité non au jour le jour, mais dans une perspective à long terme, de façon en particulier à ne pas se laisser ballotter, et finalement emporter par les soubresauts de la lutte de classe.
Comme le CCI l'affirmait dans sa résolution de juin 1986:
«C'est le propre des révolutionnaires que d'exprimer au plus haut point ces qualités de la classe porteuse du futur de l'humanité : la patience, la conscience de l'ampleur immense de la tâche à accomplir, une confiance sereine mais indestructible en l'avenir».
Conscience et organisation:
Rectification de la plate-forme du CCI
- 2780 reads
Introduction: quelle démarche pour modifier la plate-forme ?
Le programme d'une organisation révolutionnaire n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le bordiguisme sclérosé, une doctrine figée et invariante. Ce programme est vivant. Certes, ce qu'il exprime avant tout c'est le devenir révolutionnaire de la classe ouvrière lequel est tracé à celle-ci par l'histoire depuis près de deux siècles avec son développement en même temps que celui des rapports de production capitalistes. Mais le programme ne saurait se résumer à la mise en avant de la nécessité et de la possibilité pour la classe d'abolir le capitalisme et d'instaurer, le communisme. Il bénéficie en permanence de l'expérience accumulée par la classe ouvrière et de la clarification qui s'opère en son sein et, en premier lieu, dans ses organisations politiques dont c'est la responsabilité même :
- d'éclaircir et de préciser sans relâche les positions politiques de classe ;
- de rectifier ces positions lorsque l'expérience, la discussion ou la réflexion a démontré leur non validité.
C'est pour cela que les organisations révolutionnaires ont souvent été amenées à rectifier ou modifier leur programme. Les exemples historiques ne manquent pas. On peut citer notamment :
- la préface de l'édition allemande de 1872 du Manifeste Communiste où Marx et Engels signalent la caducité de certains passages de ce document et la nécessité en particulier de prendre en compte l'expérience de la Commune de Paris sur la question de l'Etat ;
- l'adoption par la Social-démocratie allemande à son congrès d'Erfurt en 1891 d'un nouveau programme en remplacement de celui de Gotha adopté en 1875 ;
- la modification du programme du POSDR de 1903 par les bolcheviks au cours même de la révolution de 1917;
- la modification des positions de l'Internationale Communiste par Bilan.
Cependant, lorsqu'une modification s'impose, il faut agir à la fois avec audace et avec prudence comme nous l'a en particulier enseigné Bilan. S'il ne faut pas craindre de remettre en cause ce qui pouvait apparaître comme des dogmes intangibles, « ne supporter aucun interdit non plus qu'aucun ostracisme », comme le dit Bilan (ce que n'ont pas su faire les résidus de la Gauche italienne comme Programma et Battaglia Comunista), il faut se garder encore plus de «jeter l'enfant avec l'eau du bain», de «faire table rase» de l'expérience passée du mouvement ouvrier. Lorsque s'impose une modification du programme :
- il ne s'agit pas d'une «révision» ou d'une «rupture» (à l'image de la démarche des conseillistes ou des modernistes) ;
- il s'agit de s'appuyer fermement sur les acquis pour aller plus loin, il s'agit d'un dépassement au sens marxiste du terme.
C'est bien cette démarche qui a été mise en œuvre par le CCI depuis ses origines : «Les bases sur lesquelles s'est appuyé, dès avant sa constitution formelle, notre Courant dans son travail de regroupement ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours par le passé constitué les piliers de ce type de travail. On peut les résumer ainsi :
- la nécessité de rattacher l'activité révolutionnaire aux acquis passés de la classe, à l'expérience des organisations communistes qui ont précédé (...);
- la nécessité de concevoir les positions et analyses communistes non comme un dogme mort mais comme un programme vivant, en constant enrichissement et approfondissement (...)» («10 ans du CCI, quelques enseignements» ; Revue Internationale n° 40).
C'est aussi la démarche qu'il s'agit d'adopter pour la rectification de la plate-forme du CCI. En particulier, il importe en premier lieu pour cette rectification de se baser sur les acquis de la Gauche communiste concernant les points qui sont aujourd'hui soulevés.
Pourquoi des erreurs ont-elles été commises par le CCI ?
Les questions qui sont ici concernées - la dégénérescence et le passage à la bourgeoisie d'organisations révolutionnaires ; les conditions d'apparition et de développement de nouvelles organisations - ne sont pas nouvelles. Elles sont en fait tranchées depuis longtemps dans le mouvement ouvrier, en grande partie grâce au travail théorique réalisé par Bilan, sur la question de la Fraction, sur les circonstances d'apparition de celle-ci au sein du parti frappé de dégénérescence opportuniste, sur son rôle en vue de la reconquête de celui-ci tant que cela est possible et, lorsque cette tâche devient sans objet par le passage définitif du parti au service de la bourgeoisie nationale, sur sa fonction de préparation du surgissement du nouveau parti de classe lorsque les circonstances historiques le permettront ; travail théorique qui était lui-même une systématisation de l'expérience de la Gauche au sein de la 2e et 3e Internationale. Et si le CCI a commis des erreurs, c'est essentiellement dû à la rupture organique provoquée dans le courant révolutionnaire par la plus longue et profonde contre-révolution de l'histoire et qui a nécessité à ses origines tout un travail de réappropriation des acquis du passé. C'était un travail considérable et si, lors de sa constitution formelle en 1975, notre courant en avait déjà accompli l'essentiel, l'expérience a démontré qu'il n'était pas encore achevé. En particulier notre organisation n'avait pas toujours correctement digéré ces acquis et elle n'a pas échappé à des erreurs de jeunesse assez classiques.
Ainsi, lorsqu'on parvient à un certain degré de clarté et à une certaine cohérence sur certaines questions (comme ce fut le cas au début des années 1970), il peut en découler un sentiment d'euphorie conduisant à considérer que toutes les organisations qui ne partagent pas les mêmes positions, qui véhiculent encore des positions bourgeoises, sont en réalité dans le camp de la bourgeoisie.
C'est typiquement une maladie de la jeunesse : les jugements catégoriques et définitifs qu'on porte sur ceux qui ne partagent pas ses positions sont le pendant du manque d'assurance qu'on a soi-même sur ces positions.
C'est bien cette immaturité qui se révélait dans le texte de la plate-forme adopté lors du premier congrès du CCI et qui, par certaines de ses formulations, rejetait dans la bourgeoisie tous les autres groupes politiques. Pour dépasser cette immaturité, il a fallu que le 2e congrès adopte la résolution sur «Les groupes politiques prolétariens» qui jetait les bases claires sur cette question. C'est sur ces bases que s'est appuyée la modification de la plate-forme du CCI lors du 3? congrès ; mais cette modification, si elle permet à la plate-forme de donner un cadre correct à l'égard des organisations existant aujourd'hui, est encore insuffisante du point de vue même de la clarté auquel nous étions parvenus au 2e congrès. En effet, il subsiste encore une contradiction entre, d'un côté, la plate-forme qui par exemple place en 1914 le passage à la bourgeoisie des partis socialistes tout en considérant à juste titre comme révolutionnaire et à l'avant-garde du mouvement ouvrier les partis communistes sortis de ces partis bien après cette date, et, de l'autre côté, la résolution du 2e congrès qui affirme que : « (les groupes politiques issus de scissions dans des organisations passées définitivement à la .bourgeoisie, scissions basées sur une ^rupture avec certains points de leur programme), se distinguent fondamentalement des fractions communistes qui peuvent apparaître comme réaction à un processus de dégénérescence des organisations prolétariennes. En effet, celles-ci se basent non sur une rupture mais sur une continuité du programme révolutionnaire précisément menacé par le cours opportuniste de l'organisation, même si par la suite elles lui apportent les rectifications et enrichissements imposés par l'expérience. De ce fait, alors que les fractions apparaissent avec un programme révolutionnaire cohérent et élaboré, les courants qui rompent avec la contre-révolution se présentent avec des positions essentiellement négatives opposées, généralement de façon partielle, à celles de leur organisation d'origine, ce qui ne suffit pas à constituer un programme communiste solide. Leur rupture avec une cohérence contre-révolutionnaire ne peut suffire à leur conférer une cohérence révolutionnaire (...) ».
Outre cette immaturité globale, il existe une autre cause plus circonstancielle (mais elle aussi résultant de notre immaturité et de celle du milieu révolutionnaire) • aux erreurs du CCI sur ces questions et plus particulièrement sur le moment précis du passage à la bourgeoisie des PS et des PC. A l'époque où ces erreurs ont été commises, nous sortions d'une longue polémique avec des groupes (tel Revolutionary Perspectives) qui plaçaient en 1921 le passage à la bourgeoisie des PC et la mort de l'IC ou qui estimaient que les partis social-démocrate n'avaient jamais appartenu à la classe ouvrière. Polarisés par la lutte contre des positions ouvertement intenables, nous n'avions pas suffisamment consacré d'efforts à développer pour notre part une analyse tout à fait correcte puisque notre première préoccupation avait été de démontrer pourquoi la Social-démocratie avait été prolétarienne et pourquoi en 1921 les PC étaient des partis ouvriers.
Quelle ampleur pour les modifications de la plate-forme ?
Faut-il considérer que les modifications, dont une première proposition avait été faite au 6e congrès, constituent une remise en cause de nos acquis, une révision du marxisme comme le prétendait la «tendance» (devenue depuis lors la FECCI) ? En d'autres termes, sommes-nous en train de nous écarter de la méthode de Bilan pour rejoindre celle des modernistes ? La réponse est clairement non !
En réalité, ce qu'il s'agit fondamentalement et simplement de réaliser c'est une mise en cohérence (suite à des débats importants qui se sont déjà menés dans l'organisation et que nous pouvons conclure) de l'ensemble de nos positions, telles qu'elles s'expriment dans la plateforme, avec toute une série de textes d'orientation d'ores et déjà adoptés par l'organisation.
La plupart de ces textes sont antérieurs au 6e congres du CCI (et ont été adoptés par les camarades qui ont quitté le CCI à ce congrès). Il s'agit notamment de :
- la résolution du 2e congrès sur «Les groupes politiques prolétariens» ;
- le rapport sur «Le cours historique» adopté par le 3e congrès.
Dans ce deuxième texte sont reprises et qualifiées de «lumineuses» les lignes suivantes provenant du rapport sur la situation internationale à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France :
«On peut distinguer trois étapes nécessaires et se succédant entre les deux guerres impérialistes.
La première s'achève avec l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après 1917 et consiste dans une suite de défaites de la révolution dans plusieurs pays, de la défaite de la gauche exclue de l’IC où triomphe le centrisme et l'engagement de l'URSS dans une évolution vers le capitalisme au travers de la théorie et de la pratique du «socialisme dans un seul pays»
La deuxième étape est celle de l'offensive générale du capitalisme international parvenant à liquider les convulsions sociales dans le centre décisif où se joue l'alternative historique du capitalisme ou socialisme : l'Allemagne, par l'écrasement physique du prolétariat et l'instauration du régime hitlérien jouant le rôle de gendarme en Europe. A cette étape correspond la mort définitive de l’lC et la faillite de l'Opposition de gauche de Trotsky (...)
La troisième étape fut celle du dévotement total du mouvement ouvrier des pays "démocratiques". Sous le masque de défense des libertés" et des "conquêtes" ouvrières menacées par le fascisme, on a en réalité cherché à faire adhérer le prolétariat à la défense de la démocratie, c'est-à-dire de la bourgeoisie nationale, de sa patrie capitaliste. L'antifascisme était la plate-forme, l'idéologie moderne du capitalisme que les partis traîtres au prolétariat employaient pour envelopper la marchandise putréfiée de la défense nationale. Dans cette troisième étape s'opère le passage définitif des partis dits communistes au service de leur capitalisme respectif (...) ».
La relecture de ces lignes nous montre en particulier trois choses :
- les modifications à apporter à la plate-forme ne constituent pas, sur cette question, une remise en cause des positions des groupes dont nous revendiquons la continuité politique, mais bien une réappropriation de ces positions ;
- l'ensemble du CCI a adopté à son 3e congrès un texte important, longuement discuté, sans prendre pleinement en compte toutes les implications de ce texte, ce qui traduit une faiblesse déjà constatée à plusieurs reprises par ailleurs ;
- plus précisément, le CCI (ou une partie de ses militants) a apporté à des acquis de la Gauche communiste une adhésion formelle mais relativement superficielle (ce qui s'était également manifesté à d'autres reprises).
Il faut donc constater, contre nombre d'affirmations malveillantes, que dès avant le 6e congrès (en fait dès 1979) le CCI s'était doté des moyens théoriques lui permettant de corriger sa plate-forme dans le sens où nous nous proposons de le faire. Cependant, le 6e congrès, avec sa résolution sur l'opportunisme et le centrisme qui ramassait presque deux ans de débats particulièrement animés et approfondis, nous dote aujourd'hui des moyens non seulement de donner à notre plate-forme les formulations les plus correctes possibles mais aussi de comprendre pleinement les implications de ces formulations.
Quelles modifications de la plate-forme ?
Comme on a vu plus haut, avant même que l'organisation se penche de façon précise sur les formulations des amendements à apporter à la plate-forme, il importe qu'elle ait une vue claire des questions qui sont concernées par ces amendements. Il importe en premier lieu qu'elle sache se réapproprie les acquis du passé, dégager toutes les implications découlant de ces acquis , de même que des documents qu'elle a déjà adoptés et notamment la résolution du 6e congrès sur le centrisme et l'opportunisme.
Les textes du passé qui explicitent ces acquis sont nombreux. Un des plus significatifs est certainement une résolution adoptée en août 1933 par la Commission exécutive de la Fraction de gauche du PCI publiée dans le N° 1 de Bilan sous le titre «Vers l'Internationale deux et trois quarts... ?» republiée dans le « Bulletin d'Etude et de Discussion » de RI N° 6 et dont on peut extraire les passages suivants :
«(...) La capacité d'action du parti ne précède pas, mais suit la compréhension des situations. Cette compréhension ne dépend pas d'individus qui se réclament du prolétariat, mais du parti lui-même. Celui-ci, parce qu'il est un élément des situations et de leur enchevêtrement, peut être mobilisé et gagné par l'ennemi de classe, et dès lors, il appartiendra au courant marxiste de saisir le cours de l'évolution historique.
Le prolétariat a essuyé en 1927 une défaite terrible en ne parvenant pas à empêcher le succès contre-révolutionnaire du centrisme au sein des PC. S'il avait gagné sa bataille, au sein des partis, il aurait assuré la continuité du parti pour la réalisation de sa mission, car il aurait résolu, dans une direction révolutionnaire, les nouveaux problèmes issus de l'exercice du pouvoir prolétarien en URSS.
Lorsque le parti a perdu sa capacité de guider le prolétariat vers la révolution -et cela arrive par le triomphe de l'opportunisme-, les réactions de classe produites par les antagonismes sociaux n'évoluent plus vers la direction qui permet au parti d'accomplir sa mission. Les réactions sont appelées à chercher les nouvelles bases où se forment désormais les organes de l'entendement et de la vie de la classe ouvrière : la Fraction. L'intelligence des événements ne s'accompagne plus avec l'action directe sur ces derniers, ainsi qu'il arrivait précédemment au sein du parti et la fraction ne peut reconstituer cette unité qu'en délivrant le parti de l'opportunisme. (...)
Au point de vue fondamental, le problème est vu sous deux formes diamétralement opposées : notre fraction conçoit sa transformation en parti, envisage chaque moment de son activité comme un moment de la reconstruction du parti de classe du prolétariat et considère que, seule la fraction à l'intérieur ou en dehors de l'organisation officielle du parti, représente l'organisme pouvant conduire le prolétariat à la victoire. Le camarade Trotsky conçoit, par contre, que la constitution d'un nouveau parti ne dépendra pas directement de la fraction ou de son travail, mais du travail de «l'opposition»en jonction avec d'autres formations politiques et même avec des courants appartenant à des partis de la classe ennemie.
La transformation de la fraction en parti est conditionnée par deux éléments intimement liés :
1. L'élaboration, par la fraction de nouvelles positions politiques permettant d'asseoir la lutte du prolétariat pour la révolution, dans sa nouvelle phase plus avancée. (...)
2. Par l'ébranlement du système des rapports de classe tel qu'il s'est constitué lors de la victoire de l'opportunisme au sein du parti de la classe ouvrière. Cet ébranlement résiderait dans l'éclosion de mouvements révolutionnaires permettant à la fraction de reprendre la direction des luttes vers l'insurrection.
Ces deux données sont dialectiquement liées et nous verrons et comprendrons les nouvelles situations -qui sont en devenir- dans la mesure où se vérifie le passage vers l'ennemi de l'opportunisme qui dirige le parti communiste. Ou bien, dans la perspective opposée, dans la mesure où progresse le travail de la fraction de gauche pour la victoire révolutionnaire. (...)
La notion de l'Internationale est supérieure à celle du parti, non seulement dans l'ordre organisatoire et politique, mais aussi dans l'ordre chronologique. En effet, le parti est un organisme qui se relie directement avec un processus de lutte de classe et qui affirme comme objectif celui de sa lutte contre l'Etat capitaliste. L'Internationale, au contraire, se fonde uniquement sur des notions politiques et n'a pas en face d'elle un Etat capitaliste mondial, mais des Etats qui reproduisent, sur l'échelle internationale, les antagonismes qui opposent, dans le domaine économique, les capitalistes ou les groupes de ceux-ci.
La mort de l'Internationale Communiste dérive de l'extinction de sa fonction (...).
Le parti ne cesse pas d'exister, même après la mort de l'Internationale. Le parti ne meurt pas, il trahit. Le parti, se rattachant directement au processus de la lutte de classe, est appelé à continuer son action même lorsque l'Internationale est morte.
Dans le passé, nous avons défendu la notion fondamentale de la "fraction" contre la position dite "d'opposition". Par fraction nous entendions l'organisme qui construit les cadres devant assurer la continuité de la lutte révolutionnaire, et qui est appelée à devenir le protagoniste de la victoire prolétarienne. Contre nous, la notion dite "d'opposition" a triomphé au sein de l'Opposition Internationale de Gauche. Cette dernière affirmait qu'il ne fallait pas proclamer la nécessité de la formation des cadres : la clé des événements se trouvant entre les mains du centrisme et non entre les mains de la fraction.
Il est préconisé aujourd'hui un travail commun avec les gauches socialistes en vue de la formation de la nouvelle Internationale. (...)
A notre avis, la guerre et la révolution russe ont opéré, dans l'histoire, une rupture définitive. Avant 1914, les partis socialistes pouvaient se trouver au sein de la classe ouvrière ; par après, leur place s'est trouvée être du côté opposé : au sein du capitalisme. Cette transformation de la position de classe de la Social-démocratie comporte, par conséquent, une opposition fondamentale entre les gauches socialistes qui préparèrent les partis communistes et les gauches socialistes d'après-guerre nécessaires à la Social-démocratie pour tromper les masses et pour lui permettre de continuer à remplir ainsi sa fonction dans l'intérêt de l'ennemi. Les gauches socialistes se situent aujourd'hui en deçà de la révolution russe et ne peuvent jamais cohabiter avec les fractions de gauche des partis communistes afin de déterminer le programme devant traduire -pour les révolutions futures- les leçons découlant d'une grandiose expérience de gouvernement prolétarien et de la terrible expérience survenue avec la victoire du centrisme.
(...) Le travail des fractions de gauche pour la formation des nouveaux partis et de la nouvelle Internationale ne peut résulter d'un accouplement d'espèces historiques fondamentalement opposées : les partis ne peuvent résulter que du travail des fractions de gauche et seulement d'elles.».
Concernant les implications de la résolution du 6e congrès sur le centrisme et l'opportunisme et sur les questions concernant directement la rectification de la plate-forme on peut également signaler plus particulièrement les passages suivants :
« 1. Il existe une différence fondamentale entre l'évolution des partis de la bourgeoisie et l'évolution des partis de la classe ouvrière.
Les premiers, du fait qu'ils sont des organes politiques d'une classe dominante, ont la possibilité d'agir dans la classe ouvrière et certains d'entre eux le font effectivement car ceci fait partie d'une division du travail au sein des forces politiques de la bourgeoisie dont une partie a la tâche particulière de mystifier le prolétariat, de mieux le contrôler en le faisant de l'intérieur, et de le détourner de sa lutte de classe. A cette fin, la bourgeoisie utilise de préférence d'anciennes organisations de la classe ouvrière passées dans le camp de la bourgeoisie.
Par contre, la situation inverse d'une organisation prolétarienne agissant dans le camp de la bourgeoisie ne peut jamais exister. Il en est ainsi du prolétariat, comme de toute classe opprimée, parce que la place que lui fait occuper dans l'histoire le fait d'être une classe exploitée ne peut jamais faire de lui une classe exploiteuse.
Cette réalité peut donc être résumée dans l'affirmation lapidaire suivante :
- il peut, il doit exister et il existe toujours des organisations politiques bourgeoises agissant dans le prolétariat.
- il ne peut jamais exister, par contre, comme le démontre toute l'expérience historique, des partis politiques prolétariens agissant dans le camp de la bourgeoisie.
2. Ceci n'est pas seulement vrai pour ce qui concerne des partis politiques structurés. C'est également vrai pour ce qui concerne des courants politiques divergents pouvant naître éventuellement au sein de ces partis. Si des membres des partis politiques existants peuvent passer d'un camp dans l'autre et cela dans les deux sens (du prolétariat à la bourgeoisie et de la bourgeoisie au prolétariat), cela ne peut être qu'un fait individuel. Par contre, le passage collectif d'un organisme politique déjà structuré ou en formation dans les partis existants ne peut obligatoirement se produire que dans un sens unique : des partis du prolétariat à la bourgeoisie et jamais dans le sens contraire : des partis bourgeois au prolétariat. C'est-à-dire qu'en aucun cas un ensemble d'éléments en provenance d'une organisation bourgeoise ne peut évoluer vers des positions de classe sans une rupture consciente avec toute idée de continuité avec son éventuelle activité collective précédente dans le camp contre-révolutionnaire. Autrement dit, s'il peut se former et se développer des tendances dans les organisations du prolétariat, évoluant vers des positions politiques de la bourgeoisie et véhiculant cette idéologie au sein de la classe ouvrière, ceci est absolument exclu concernant les organisations de la bourgeoisie.
(...)
6. Comme l'histoire l'a démontré, le courant opportuniste ouvert, du fait qu'il se situe sur des positions extrêmes et tranchées, aboutit, dans les moments décisifs, à effectuer un passage définitif et sans retour dans le camp de la bourgeoisie. Quant au courant qui se définit comme se situant entre la gauche révolutionnaire et la droite opportuniste -courant le plus hétérogène, en constante mouvance entre les deux et recherche de leur réconciliation au nom d'une unité organisationnelle impossible- il évolue pour sa part selon les circonstances et les vicissitudes de la lutte du prolétariat.
Au moment de la trahison ouverte du courant opportuniste, en même temps que s'effectue une reprise et une montée de la lutte de la classe, le centrisme peut constituer -au début- une position passagère des masses ouvrières vers les positions révolutionnaires. Le centrisme, en tant que courant structuré, organisé sous forme de parti, est appelé, dans ces circonstances favorables, à exploser et passer dans sa majorité, ou pour une grande partie, dans l'organisation de la gauche révolutionnaire nouvellement constituée, comme cela s'est produit pour le Parti Socialiste français, le Parti Socialiste d'Italie et l'USPD en Allemagne dans les années 1920-21, après la première guerre mondiale et la révolution victorieuse en Russie.
Par contre, dans les circonstances d'une série de grandes défaites du prolétariat ouvrant un cours vers la guerre, le centrisme est immanquablement destiné à être happé par l'engrenage de la bourgeoisie et à passer dans son camp tout comme le courant opportuniste ouvert.
Avec toute la fermeté qui doit être la sienne, il est important pour le parti révolutionnaire de savoir comprendre les deux sens opposés de l'évolution possible du centrisme dans des circonstances différentes pour pouvoir prendre une attitude politique adéquate à son égard. Ne pas reconnaître cette réalité mène à la même aberration que la proclamation de l'impossibilité de l'existence de l'opportunisme et du centrisme au sein de la classe ouvrière dans la période de décadence du capitalisme.»
Pour résumer, on peut dégager trois questions essentielles affectant directement les modifications et ajouts à introduire dans la plate-forme.
La première question concernée est la différence existant (et dont la plate-forme ne rend pas compte dans sa forme actuelle) entre la mort d'une internationale et le passage de ses différents partis dans le camp bourgeois :
- la mort d'une internationale est la traduction d'une crise dans le mouvement ouvrier, c'est un événement se déroulant à l'échelle de celui-ci, l'échelle mondiale, et non de tel ou tel pays et qui intervient quand l'internationale perd sa substance, sa raison d'être même (paralysie de la 2e face à la 1ère guerre mondiale en août 1914, adoption de la thèse du « socialisme dans un seul pays » par l'IC en 1928) ;
- le passage à la bourgeoisie des partis composant une internationale qui s'est disloquée ne découle pas mécaniquement ni immédiatement de cette dislocation. D'une part, certains partis de l'Internationale peuvent maintenir après sa mort des positions clairement internationalistes et révolutionnaires. D'autre part, cette intégration à la bourgeoisie d'anciens partis ouvriers ne relève pas seulement d'un phénomène mondial (crise dans le mouvement ouvrier) mais également de circonstances au plan national (puisque cette intégration se fait au sein de chaque capital national dans la mesure où la bourgeoisie ne connaît pas une unité mondiale).
La deuxième question est le caractère heurté d'un tel passage. La mort de l'Internationale ne signifie ni la mort pour le prolétariat de ses partis ni non plus un processus linéaire et irréversible vers cette mort. Ce qui est ouvert, c'est un affrontement acharné au sein de ces partis entre les forces qui essayent de garder l'organisation à la classe et celles qui la poussent à s'intégrer dans l'Etat capitaliste. De plus, cette intégration nécessite l'élimination de toute possibilité de réaction contraire au sein des partis. (C'est ainsi que le soutien de la social-démocratie allemande -dirigée par la droite- à l'effort de guerre de la bourgeoisie nationale a provoqué en son sein, au cours de la guerre, une opposition croissante qui était en passe de devenir majoritaire, donc de renverser la domination de la droite et, par suite, d'empêcher celle-ci d'amener définitivement l'ensemble du parti dans le camp bourgeois qu'elle avait pour sa part rejoint dès 1914. Et c'est pour arrêter un tel processus que la droite décide en 1917, avant qu'elle ne soit elle-même éliminée, d'exclure du parti non seulement la gauche spartakiste mais aussi le centre de Kautsky). C'est pour cela que le critère majeur permettant d'établir qu'une organisation est complètement morte pour le prolétariat, c'est son incapacité définitive à faire surgir en son sein des fractions ou tendances prolétariennes. Or ce n'est en général qu'après coup qu'on peut juger d'une telle situation. C'est pour cela que les révolutionnaires responsables ont toujours été de la plus grande prudence dans ce domaine même si, dans le feu des événements, ils ont pu être conduits à formuler des jugements hâtifs (ainsi Rosa décrétant en 1914 -avec l'approbation de Lénine- que la Social-démocratie est un «cadavre» ce qui a été contredit par la suite par toute l'attitude de ces deux révolutionnaires).
La troisième question concernée (et qui découle de la deuxième) est la question de la fraction, question qui est traitée en termes généraux dans le point 17 de la plate-forme (l'organisation des révolutionnaires dans les différents moments de la lutte de classe), et qu'il s'agit également d'envisager du point de vue de l'attitude que doivent avoir les révolutionnaires face à un processus de dégénérescence pouvant affecter une organisation prolétarienne : non pas abandon précipité du navire en perdition afin de se « sauver soi-même », mais lutte acharnée en vue de le sauver comme un tout, et si l'entreprise s'avère* impossible, d'en sauver le maximum d'occupants. Telle a toujours été la démarche des fractions de gauche responsables.
Plus généralement, une défense intransigeante des principes communistes ne signifie nullement qu'il faille considérer comme définitivement perdus pour la classe les courants centristes. Dans la mesure même où ce qui caractérise ces courants c'est l'instabilité et le manque de cohésion, il est nécessaire de lutter pour les gagner (ou tout au moins la plus grande partie possible) à ces principes communistes tant qu'il existe une telle possibilité, ce qui est particulièrement le cas lorsque la dynamique de ces courants n'est pas des positions de classe vers les positions bourgeoises mais de rupture avec celles-ci vers des positions de classe.
A un niveau plus général encore, et même s'il n'est pas nécessaire que la plate-forme évoque explicitement cette question, il importe qu'il soit clair qu'il est vain d'attendre des partis du prolétariat une parfaite «pureté», une totale compréhension de tous leurs membres de l'intégralité de la pensée marxiste. Une telle vision (qui aujourd'hui est défendue par la FECCI) implique notamment qu'on se refuse à prendre en considération le fait que la pression de l'idéologie bourgeoise qui s'exerce sur l'ensemble de la classe n'épargne pas ses organisations politiques malgré tous les garde-fous qu'elles peuvent établir contre cette menace.
Les enjeux pour aujourd'hui
Ce n'est qu'en apparence que les modifications à apporter à la plate-forme relèvent de problèmes de l'histoire passée du mouvement ouvrier. Ce qui est en jeu ce n'est pas une simple question de date (c'est pour cela que, contrairement à ce qu'affirmaient les camarades qui allaient former la FECCI, il y a place dans l'organisation pour des camarades qui ont des désaccords sur la date précise de passage à la bourgeoisie de tel ou tel parti ouvrier). Ce qui importe c'est que l'organisation comme un tout se renforce le plus possible et renforce sa capacité d'action dans la classe :
- par une meilleure assimilation des acquis de la Gauche communiste ;
- par une meilleure assimilation de la méthode marxiste en général notamment en rejetant les visions simplistes, «blanc ou noir», les démarches mécanistes et non dialectiques ;
- par une meilleure compréhension du rôle des courants révolutionnaires les plus conséquents face aux formations politiques ou tendances qui, sans se situer dans le camp bourgeois, ne défendent pas des positions communistes conséquentes et cohérentes.
Ce dernier point a deux implications :
- la démarche qui doit guider la lutte des tendances et fractions de gauche au sein des .organisations prolétariennes en dégénérescence, qui, si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui pour ce qui concerne le CCI (contrairement aux affirmations de l'ex-« tendance ») doit lui permettre de s'armer face à une telle éventualité pour le futur (éventualité contre laquelle il n'existe pas de vaccin définitif) et doit permettre à ses militants de s'éviter le lamentable parcours de la «tendance» ;
- de façon bien plus immédiate, l'attitude que doit adopter le CCI à l'égard des différents groupes du milieu prolétarien, tant les anciennes organisations que les courants que le développement international de la lutte de classe fait et fera surgir.
Sur cette deuxième question, il importe en particulier que soit établi dans les discussions le lien qui unit le texte sur le milieu politique adopté en juin 86 et l'ensemble des questions et textes rattachés à la rectification de la plateforme.
Ainsi, la discussion théorique en vue de la rectification de la plate-forme n'est nullement un débat académique. Il n'est pas académique parce que tout débat sur des questions programmatiques se trouve au cœur de ce qui. fonde l'existence de l'organisation, mais de plus parce qu'il fait partie de sa capacité à accomplir ses tâches non seulement futures mais aussi immédiates à l'heure où le développement de la lutte de classe confère à notre organisation des responsabilités croissantes.
CCI, septembre 1986.
Résolution de rectification de la plate-forme
1) Le 7e congrès du CCI confirme le constat fait depuis plusieurs années par une majorité de l'organisation de l'existence dans le point 14 de la plate-forme de celle-ci d'un certain nombre de formulations schématiques conduisant à une interprétation erronée du processus de passage des partis ouvriers, PS et PC, dans le camp bourgeois.
En effet, ce que conduisent à considérer les formulations existant jusqu'à présent dans la plate-forme c'est que le vote des crédits de guerre par les fractions parlementaires de la plupart des principaux partis de la 2e Internationale en août 1914 et l'adoption par le 6e congrès de l'Internationale communiste en 1928 de la «théorie» du «socialisme dans un seul pays», sont l'indice de la trahison définitive de l'ensemble des partis constituant ces deux internationales. Il s'agit là d'une analyse erronée.
Outre une simple erreur de dates, et plus important que celle-ci, une telle interprétation de ces événements historiques contient implicitement le rejet d'un certain nombre d'acquis fondamentaux du mouvement ouvrier et notamment de la Gauche communiste d'Italie, acquis que le CCI avait déjà fait siens depuis longtemps.
En premier lieu, cette interprétation tend à éliminer la distinction essentielle établie par le CCI entre le mode de vie d'une Internationale et celui des partis qui la constituent. Elle tourne le dos au fait que l'issue d'un processus de dégénérescence opportuniste au sein d'une internationale se trouve -même si elle se maintient d'une façon formelle- dans la mort de celle-ci, la fin de sa raison d'exister (comme ce fut effectivement le cas en 1914 et en 1928), alors qu'après cette disparition, la vie des partis la composant se poursuit dans un processus plus ou moins long de crise menant soit à leur trahison, c'est-à-dire à leur intégration dans l'appareil politique de chaque capital national (laquelle s'accompagne de l'élimination des courants de gauche continuant à défendre les positions révolutionnaires), soit à un rétablissement du parti par l'exclusion de la droite bourgeoise.
En deuxième lieu, et plus important encore, cette interprétation entre en contradiction (à moins de considérer avec les conseillistes que les partis communistes étaient bourgeois dès leur naissance) avec une position essentielle de la Gauche Communiste d'Italie -notamment contre la position trotskyste- affirmant qu'il ne peut surgir au sein d'un organisme de la bourgeoisie aucune tendance ou fraction prolétarienne, position qui a été clairement acquise par le CCI dès son deuxième congrès avec la résolution sur les groupes politiques prolétariens et qui a été explicitée dans la résolution de son 6e congrès sur l'opportunisme et le centrisme.
Enfin, une telle interprétation remet en cause la validité -proclamée par le CCI depuis ses origines- du combat mené par les fractions de gauche (Bolcheviks, Spartakistes, Gauche du Parti communiste d'Italie, etc.) dans les partis socialistes après 1914 et dans ou en dehors des partis communistes avant et après 1928 en vue de reconquérir ces partis à des positions révolutionnaires. C'est seulement à partir de la reconnaissance de la validité et de l'importance primordiale de cette lutte héroïque, qu'il est nécessaire et possible de rendre compte des hésitations et faiblesses qui ont pu se manifester dans cette lutte afin d'être en mesure de dépasser ce type de faiblesses.
2) Conscient :
- de la nécessité, déjà signalée par une résolution du 6e congrès du CCI, de rectifier les formulations incorrectes contenues dans le point 14 de la plate-forme ;
- du fait qu'une telle rectification ne constitue nullement une remise en cause ni des fondements de la plate-forme, ni des acquis de la Gauche communiste, ni des acquis du CCI, mais constitue au contraire un affermissement de ces fondements, une meilleure traduction de ces acquis et notamment une mise en adéquation du document programmatique central de l'organisation avec les textes déjà adoptés lors de congrès précédents (Résolution sur les groupes politiques prolétariens du 2e congrès, Rapport sur le cours historique du 3e congrès et Résolution sur le centrisme et l'opportunisme du 6e congrès) ;
- du fait que la nouvelle formulation n'enlève rien à la valeur charnière du 4 août 1914, date qui signe effectivement la crise historique ouverte de la Social-démocratie et l'intégration sans retour de son aile droite dans le camp bourgeois, mais au contraire explicite mieux que l'ancienne le clivage et la lutte à mort qui se produisent entre gauche prolétarienne et droite bourgeoise ;
Le 7e congrès du CCI adopte pour le point 14 de la plate-forme la formulation suivante :
L'ensemble des partis ou organisations qui aujourd'hui défendent, même «conditionnellement» ou de façon «critique», certains Etats ou certaines fractions de la bourgeoisie contre d'autres, que ce soit au nom du «socialisme», de la «démocratie», de «l'anti-fascisme», de «l'indépendance nationale», du «front unique» ou du «moindre mal», qui fondent leur politique sur le jeu bourgeois des élections, dans l'activité anti-ouvrière du syndicalisme ou dans les mystifications autogestionnaires sont des organes de l'appareil politique du capital. Il en est ainsi, en particulier, des partis «socialistes» et «communistes».
Ces partis, en effet, après avoir constitué à un certain moment les véritables avant-gardes du prolétariat mondial, ont connu par la suite tout un processus de dégénérescence qui les a conduits dans le camp du capital. Si les internationales auxquelles ils appartenaient (2e Internationale pour les partis socialistes, 3e Internationale pour les partis communistes) sont mortes comme telles malgré la survivance formelle de leur structure dans un moment de défaite historique de la classe ouvrière, ils ont quant à eux survécu pour devenir progressivement, chacun pour sa part, des rouages (souvent majeurs) de l'appareil de l'Etat bourgeois de leurs pays respectifs.
Il en est ainsi des partis socialistes lorsque, dans un processus de gangrène par le réformisme et l'opportunisme, la plupart des principaux d'entre eux ont été conduits, lors de la première guerre mondiale (qui marque la mort de la 2e Internationale) à s'engager, sous la conduite de leur droite, «social chauvine», désormais passée à la bourgeoisie, dans la politique de défense nationale, puis à s'opposer ouvertement à la vague révolutionnaire d'après guerre jusqu'à jouer le rôle de bourreaux du prolétariat comme en Allemagne en 1919. L'intégration finale de chacun de ces partis dans leurs Etats nationaux respectifs a pris place à différents moments dans la période qui a suivi l'éclatement de la 1ère guerre mondiale mais ce processus a été définitivement clos au début des années 1920, quand les derniers courants prolétariens ont été éliminés ou sont sortis de leurs rangs et ont rejoint l'Internationale communiste.
De même, les partis communistes sont à leur tour passés dans le camp du capitalisme après un processus similaire de dégénérescence opportuniste. Ce processus, engagé dès le début des années 1920, s'est poursuivi après la mort de l'Internationale communiste (marquée par l'adoption en 1928 de la théorie du «socialisme en un seul pays») jusqu'à aboutir, malgré la lutte acharnée de leurs fractions de gauche et après l'élimination de celles-ci, à une complète intégration dans l'Etat capitaliste au début des années 1930 avec leur participation aux efforts d'armement de leurs bourgeoisies respectives et leur entrée dans les «fronts populaires». Leur participation active à la «Résistance» durant la seconde guerre mondiale et à la «reconstruction nationale» après celle-ci les a confirmés comme de fidèles serviteurs du capital national et comme la plus pure incarnation de la contre-révolution.
L'ensemble des courants soi-disant «révolutionnaires» tels que le maoïsme -qui est une simple variante de partis définitivement passés à la bourgeoisie-, le trotskysme -qui après avoir constitué une réaction prolétarienne contre la trahison des PC a été happé dans un processus similaire de dégénérescence- ou l'anarchisme traditionnel -qui se situe aujourd'hui dans le cadre d'une même démarche politique en défendant un certain nombre des positions des partis socialistes et des partis communistes (comme par exemple les alliances «anti-fascistes»)- appartiennent au même camp qu'eux : celui du capital. Le fait qu'ils aient moins d'influence ou qu'ils utilisent un langage plus radical n'enlève rien au fond bourgeois de leur programme et de leur nature, mais en fait d'utiles rabatteurs ou suppléants de ces partis.
Conscience et organisation:
Heritage de la Gauche Communiste:
Résolution sur le milieu politique prolétarien
- 3389 reads
Introduction
Le milieu politique prolétarien, avec ses forces et ses faiblesses, est le produit de la classe ouvrière. Dans sa dynamique et dans ses caractéristiques, il tend à exprimer le mouvement de développement de la prise de conscience par le prolétariat de sa nature de classe révolutionnaire et de sa capacité à réaliser la perspective communiste. Cependant, le milieu politique n’est pas un simple reflet de la classe. Elle le sécrète pour qu’il joue un rôle actif dans sons processus de prise de conscience, dans sa lutte. Le dynamisme propre du milieu politique est donc aussi déterminé par la conscience qu’il a de lui-même et par le rôle que jouent en son sein ces fractions les plus claires.
C’est pour cela, que la question du milieu politique, de son état actuel, de ses perspectives de développement et du rôle du CCI au sein de ce processus, a été mise à l’ordre du jour du 7e congrès du CCI.
Le souci du renforcement politique organisé, le travail pour son regroupement, son un axe permanent de l’activité des révolutionnaires et de leur intervention. Le CCI en tant que principal pôle de référence et donc de regroupement au sein du milieu révolutionnaire international porte une responsabilité particulière dans le processus qui mène à la formation du parti prolétarien sans lequel il n’y a pas de révolution communiste possible. Cette responsabilité, le CCI entend pleinement l’assumer ; tel est le sens de la résolution sur le milieu politique que nous publions ci-après et que le 7e congrès du CCI a fait sienne.
Le développement actuel du milieu politique prolétarien caractérisé par le surgissement de nouveaux groupes témoigne de l'écho grandissant des positions révolutionnaires au sein de la classe ouvrière mondiale. Produits par la reprise internationale de la lutte de classe, ces nouveaux groupes politiques posent avec encore plus d'acuité la responsabilité des organisations plus anciennes qui ont survécu à la décantation politique de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le développement actuel du milieu prolétarien ne pourra se traduire dans un renforcement politique et organisationnel de la présence politique révolutionnaire que si les groupes plus anciens sont à même de se dégager du poids du sectarisme pour s'avancer sur le chemin indispensable de la clarification politique nécessaire à tout processus de regroupement.
Sur le milieu politique actuel pèsent encore de tout leur poids, la faillite de la 3e internationale et les décennies de contre-révolution qui ont suivi, durant lesquelles les révolutionnaires ont été réduits à une infime minorité. Malgré le développement réel du milieu politique depuis la reprise historique du prolétariat à la fin des années 60, au-delà des vicissitudes inhérentes à tout processus vivant, celui-ci reste marqué par une grande faiblesse. Celle-ci n'exprime pas seulement le poids de la rupture organique avec les fractions communistes du passé, mais est aussi l'expression d'une difficulté propre au milieu actuel à assumer avec détermination le nécessaire travail de réappropriation critique des acquis politiques du mouvement ouvrier. Cette réappropriation, insuffisante de la continuité politique se manifeste notamment sur le plan organisationnel par la dispersion du milieu, par son éclatement en de multiples organisations, par son incompréhension de la nécessité d’œuvrer avec détermination et clarté au processus de regroupement du milieu révolutionnaire. Ce n'est certainement pas un hasard si c’est la question de l'organisation -et donc celle du regroupement-, qui cristallise le plus clairement la faiblesse du milieu politique, car c'est elle qui concrétise, dans l'activité, l'ensemble des autres positions révolutionnaires. Elle pose la nécessité de la réappropriation des acquis du passe, non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, et c'est sur ce plan de l'expérience pratique que pèse le plus lourdement le poids de la rupture de la continuité organisationnelle. La dispersion du milieu et le sectarisme (à l'opposé des conceptions des organisations communistes du passé) qui l'accompagne, sont un facteur de confusion terrible pour les nouveaux éléments qui surgissent à la recherche d'une cohérence révolutionnaire. Le milieu politique actuel est un véritable labyrinthe qui rend d'autant plus difficile pour les nouveaux groupes le laborieux travail de réappropriation d'une continuité politique nécessaire à leur survie.
Le milieu politique est un tout. La défense de son identité face aux forces de la contre-révolution, comme le rejet de toute pratique étrangère au prolétariat en son sein, sont un aspect essentiel de la vie de toute organisation révolutionnaire. Cependant, ce n'est pas un tout homogène, loin de là, étant donnée la dispersion qui pèse et entrave son renforcement. Toutes les organisations qui l'animent, n'expriment pas la même dynamique vis à vis du nécessaire processus de clarification politique et de regroupement organisationnel qui doit absolument s'opérer pour permettre la formation du parti communiste de demain.
Pour rendre efficace l'intervention des révolutionnaires et œuvrer clairement au processus de clarification et de regroupement, il est important de distinguer :
-
les nouveaux groupes qui surgissent et qui, malgré les confusions inhérentes à leur jeunesse et leur manque de continuité historique d'avec les organisations révolutionnaires du passé, expriment la volonté positive de clarification et d'intégration au sein du milieu révolutionnaire prolétarien, manifestent la réalité du développement de l'écho des révolutionnaires au sein de la classe ;
-
les organisations qui constituent, par leur origine, les pôles historiques et politiques du milieu prolétarien et qui portent en premier lieu la responsabilité d'œuvrer de manière décidée à renforcer la maturité politique des nouveaux groupes qui surgissent et à engager dans la clarté le processus de regroupement indispensable ; ainsi, en dehors du CCI, le BIPR, et notamment Battaglia Comunista ;
-
les organisations qui expriment de manière plus aiguë le poids du sectarisme et qui fondent leur existence sur un repli de secte ou sur des scissions prématurées marquant par là une incompréhension majeure par rapport à la question de l'organisation et du regroupement des révolutionnaires. En se distinguant artificiellement des principaux pôles de cohérence du milieu politique, ces groupes ne peuvent que cristalliser un déboussolement politique qui, que ce soit au travers de l'académisme ou de l'activisme, ouvre les portes à des abandons des positions de classe et constitue en fait une entrave au processus de clarification nécessaire pour le regroupement. Ainsi, la FECCI est une claire expression de ce parasitisme politique qui, tout en se réclamant de la plate-forme du CCI, théorise de manière incohérente son existence séparée.
L'histoire n'attend pas, l'accélération du processus historique impose ses propres besoins : le surgissement de nouveaux groupes, le développement de l'écho des idées révolutionnaires avec le développement de la lutte de classe posent, à terme, la nécessité de nouvelles conférences des groupes de la Gauche communiste afin de lutter contre l'émiettement du milieu révolutionnaire et d'accélérer le processus de clarification et de décantation politiques préalable à tout regroupement. Les organisations incapables de s'intégrer de manière positive dans ce processus absolument nécessaire sont condamnés par l'histoire ; l'itinéraire du PCI bordiguiste qui naguère, refusait obstinément tout contact avec d'autres organisations du milieu prolétarien, qui a refusé de participer aux Conférences des groupes de la Gauche communiste à la fin des années 1970 et, finalement, a payé de son existence son repli sectaire (car celui-ci l'a empêché de s'engager sur la voie du redressement politique), le démontre amplement.
Loin de toute illusion immédiatiste qui pourrait faire croire à une possibilité de regroupement immédiat, le CCI, conscient de ses responsabilités, est décidé à agir de manière déterminée pour préparer la perspective de la tenue de nouvelles Conférences, dans un cadre de rigueur et de clarté politique.
Même si les conditions nécessaires à la tenue de nouvelles Conférences ne sont pas encore réunies, il est extrêmement important que l'ensemble des organisations constitutives du milieu politique prolétarien prenne une claire conscience de l'absolue nécessité d’œuvrer dans le sens de rendre possible dans le futur la concrétisation de cette perspective. Pour cela, il faut que contre tout sectarisme mais avec la rigueur et la fermeté politiques nécessaires à toute clarification , les organisations révolutionnaires et, en premier lieu, celles qui constituent les principaux pôles historiques, développent leurs relations, présentent dans leur presse des polémiques claires qui permettent de souligner les points d'accord et de divergence, aient le souci permanent d'utiliser toutes les opportunités et, notamment, les réunions publiques, pour confronter clairement leurs points de vue.
De la capacité du milieu prolétarien d'assumer cette responsabilité, d'avancer vers la tenue de nouvelles Conférences, de poser la perspective du regroupement, dépend l'avenir de la lutte de classe. L'issue du futur se forge dès aujourd'hui.
JJ
Résolution sur le milieu politique
1- L'évolution du milieu politique prolétarien au cours des deux dernières années a été marquée en particulier par :
-
une sortie de celui-ci, notamment sous la poussée de la 3e vague de luttes depuis la reprise historique de la fin des années 1960, de la crise dans laquelle il avait été plongé au début des années 1980 ;
-
le surgissement, sous cette même poussée, de nouveaux groupes, surtout dans les pays de la périphérie du capitalisme ;
-
la dégénérescence de certains des groupes déjà existants : comme celle du GCI vers l'anarchisme et celle de 1’OCI (Organizzazione Comunista Internazionalista) vers le trotskysme.
2 - Cette évolution a encore plus mis en relief la responsabilité croissante des organisations qui ont su se maintenir sur un terrain marxiste conséquent et qui disposent d'une réelle expérience et présence internationale.
En ce sens, l'effort du CCI vis-à-vis de l'éclaircissement, la décantation, le renforcement et, finalement, le regroupement de ce milieu, ne peut aller qu'en se développant.
3 - Dans cet effort, la méthode du CCI reste fondamentalement la même que par le passé : mettre en avant la priorité de la clarté et de la rigueur politiques contre toutes les aventures de rapprochement entre groupes par des raccourcis activistes qui ne peuvent qu'ouvrir la porte à la superficialité et à l'opportunisme.
4 - Dans le cadre de cette évolution et de cet effort, une nouvelle série de conférences des groupes de la Gauche communiste est une perspective à préparer. L'écho rencontré par l'initiative du groupe Emancipacion Obrera (écho auquel a contribué le CCI en la faisant connaître en sept langues et dans dix pays et au-delà) traduit, malgré l'inconsistance de beaucoup de réponses reçues, l'existence d'un plus grand souci dans le milieu pour combattre l'actuelle situation de dispersion.
Cependant, bien que le besoin de telles conférences se fasse ressentir de façon de plus en plus urgente, les conditions pour l'appel à leur tenue ne sont pas aujourd'hui encore suffisamment mûres :
-
d'une part, parce que beaucoup d'« anciens groupes » ont encore une attitude de repli sectaire (l'enthousiasme pour le contact avec un nouveau groupe à l'autre bout du monde ne doit pas cacher que cela s'accompagne souvent d'un refus -parfois théorisé- de même participer aux réunions publiques tenues dans leur propre pays par d'autres organisations révolutionnaires) ;
-
d'autre part, parce que les « nouveaux » groupes, du fait même de leur jeunesse, ne sont pas en mesure de porter jusqu'au bout avec succès la responsabilité politique d'un tel travail.
5 - Pour l'immédiat, l'intervention du CCI dans le milieu politique prolétarien doit suivre deux axes fondamentaux :
-
vis-à-vis des nouveaux groupes l'organisation doit poursuivre son travail de suivi et de discussion poussant à la décantation par l'éclaircissement politique ; mettant en avant la nécessité pour ceux-ci de s'intégrer dans le milieu international et à se rattacher à la continuité politique de la Gauche communiste sans pour autant négliger les tâches de renforcement de leur propre définition politique et intervention dans la classe ;
-
vis-à-vis des « anciens » groupes, outre la dénonciation de la dégénérescence de certains et de la nature parasitaire1 d'autres, la priorité doit être donnée à un resserrement des rapports avec l'autre pôle de référence historique du milieu : le courant du BIPR (poursuite et amélioration de la qualité du débat public et international, présence à leurs réunions publiques, propositions de réunions publiques communes, contacts directs aussi fréquents que possible).
FF
1 C'est-à-dire en maintenant une existence artificielle de façon séparée, avec une plate-forme politique quasiment identique à celle d'autres groupes, le CCI en particulier.
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [154]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [30]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Débat : syndicats bourgeois, organes ouvriers et intervention des révolutionnaires (réponse à Battaglia Comunista]
- 3832 reads
Après de nombreuses années de silence, Battaglia Comunista ([1] [155]) a repris dans sa presse la polémique avec les positions du CCI. A la vérité, ça n'a pas été une reprise facile. D'abord BC a commencé par discuter et répondre à des groupes qui, à la périphérie du capitalisme (Mexique, Inde), partageaient ou connaissaient les positions du CCI, puis a entrepris de publier ces réponses dans sa presse ; enfin, en prenant appui sur la réponse faite à un groupe de nos sympathisants espagnols, BC a finalement entamé une polémique directe avec le CCI.
Comme nous avons déjà répondu ([2] [156]) sur la question du cours historique et de l'évaluation de la phase actuelle des luttes, dans cet article nous traiterons des «positions abstraites du CCI sur les syndicats et le parlementarisme» (BC, février 1987), en nous concentrant sur la question des syndicats et de l'intervention des révolutionnaires dans les luttes ouvrières. Fidèles à notre méthode, nous essaierons de ne pas nous attacher à telle ou telle phrase qu'on peut trouver dans un article donné, mais d'aller à la racine des divergences, en prenant en compte l'ensemble des textes de BC sur cette question.
L'article de BC part du présupposé que tant qu'il ne s'agit que du «problème théorique général (nature et fonction des syndicats)», il ne faut pas de grands efforts pour donner une réponse de classe. «Tout autre est le problème politique qu'on peut poser ainsi : étant donné cette nature et cette fonction des syndicats, comment peut-on réaliser leur ''dépassement révolutionnaire" ? ». A cette question, selon BC, le CCI ne saurait répondre «du fait de son incapacité organique... à faire de la politique».
Dans notre réponse, nous cherchons avant tout à mettre en évidence que, même au niveau «théorique général», BC devrait éclaircir certains points. Ensuite, nous examinerons les propositions spécifiques que BC avance en ce qui concerne l'organisation des révolutionnaires au sein des luttes : «les groupes internationalistes d'usine». Enfin, nous analyserons en quoi les faiblesses de l'intervention de BC sont liées, en grande partie, à la difficulté de reconnaître la réalité de la lutte de classe, et en particulier les tentatives encore confuses et embryonnaires dans lesquelles la classe elle-même commence à se poser les problèmes de son organisation unitaire de demain.
Ces questions étaient justement au centre des débats du premier cycle de Conférences Internationales de la Gauche Communiste, interrompu par la volonté de BC et de la CWO en 1980. C'est à travers la reprise de ce débat, sur des bases plus larges et plus claires, que l'ensemble du milieu politique prolétarien international pourra contribuer de la meilleure façon à donner des réponses aux problèmes qui se posent à la classe dans la préparation des affrontements décisifs avec le capitalisme.
LES SYNDICATS, ORGANES DE L'ETAT BOURGEOIS
Quels sont pour BC les points de repère fermes sur lesquels se fonder pour comprendre les syndicats aujourd'hui ? Essentiellement trois : 1) «le syndicat n'est pas et n'a jamais été un organe de lutte révolutionnaire pour l'émancipation du prolétariat », 2) «en tant qu'organe de négociation économique, il est amené à s'opposer aux poussées révolutionnaires pour l'abolition du capitalisme » 3) «la révolution passera sur le cadavre des syndicats».
Ces points de repère fermes nous paraissent cependant chancelants, surtout parce qu'ils ne touchent pas à l'essentiel du problème posé par les camarades espagnols. Ces camarades veulent savoir pourquoi BC tient encore aujourd'hui pour possible de travailler dans des organes contre-révolutionnaires comme les syndicats. S'entendre répondre que les syndicats ne sont pas révolutionnaires, cela leur fera certainement plaisir, mais cela ne fait pas avancer la question d'un pouce.
Il ne fait aucun doute que déjà au 19e siècle les syndicats n'étaient pas des organes révolutionnaires et que leur fonction même de négociation a toujours influencé leurs dirigeants dans un sens conformiste et non révolutionnaire. Mais il est tout aussi vrai qu'au 19e siècle les marxistes se sont battus avec toute leur énergie pour renforcer ces syndicats -ce que BC considère comme valable. Comment est-il possible alors que sur cette base identique, les camarades de BC puissent arriver à la conclusion diamétralement opposée, que la révolution devra «passer sur le cadavre des syndicats».
Il est clair que de cette façon, on n'arrive nulle part et qu'il faut encore remettre de l'ordre dans les idées avant d'aller de l'avant. Les axes essentiels de la position communiste sur les syndicats sont à notre avis les suivants : 1) les syndicats ont été l'organisation prolétarienne unitaire typique de la phase ascendante du capitalisme, quand, la révolution prolétarienne mondiale n'étant pas à l'ordre du jour, la classe ouvrière luttait essentiellement pour défendre ses conditions de vie et son unité à l'intérieur du capitalisme ; 2) avec l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, marquée par la 1ère guerre mondiale, le prolétariat ne peut plus conquérir de réforme réelle à son profit ; en conséquence, tous les instruments qu'il s'était donné dans ce but (syndicats, partis parlementaires, etc. ) devenaient inutilisables pour lui ; 3) la tendance dominante du capitalisme décadent est la tendance au capitalisme d'Etat, dont une des caractéristiques est l'intégration dans l'Etat, avec une fonction anti-ouvrière, de tous les organes devenus désormais inutiles pour les ouvriers. Les syndicats sont donc devenus les organes de l'Etat bourgeois chargés du contrôle des ouvriers et c'est en tant que tels qu'ils seront détruits par la révolution.
Comme on le voit l'essentiel est que les syndicats étaient hier des organes de la classe ouvrière, aujourd'hui sont des organes de la classe antagonique ; l'essentiel n'est pas ce qui est resté tel quel, mais ce qui a changé.
Etant donné que la réponse aux camarades espagnols ne parle justement pas de cela, cherchons dans le document que BC a dédié aux syndicats en octobre 1986. Ici effectivement on dit que quelque chose a changé. Mais quoi ? Et quand ?
Selon BC, ce qui a changé c'est qu'à l'époque de Marx, les augmentations de salaires réduisaient effectivement les profits des patrons et que donc la lutte syndicale, bien que limitée, était de toute façon antagonique au capital. Avec le développement de sa forme monopoliste, le capital serait devenu au contraire capable de contrôler de façon monopoliste le marché, et donc de répercuter sur les prix les augmentations de salaires ; en conséquence, «l'irréconciliabilité des intérêts immédiats diminuant, ou mieux s'atténuant, toute une idéologie interclassiste a pu se développer et avoir une résonance au sein même de la classe ouvrière, et avant tout dans le syndicat (...), le syndicat institution constitue l'aboutissement inévitable de ce processus » ([3] [157]).
En une phrase, BC réussit à faire marcher le monde la tête en bas : la décadence du capitalisme ne signifie plus que le capitalisme est devenu historiquement incapable d'accorder des réformes à la classe ouvrière, mais que «le syndicat s'est trouvé face à un patronat qui parfois même le précédait en concédant des augmentations de salaire, rendues possibles justement, par le quota élevé de surprofit que la grande entreprise réalise grâce à sa capacité d'agir sur le processus de formation des prix».
BC prend ici les effets pour les causes : le fait que la bourgeoisie soit contrainte de réglementer toutes les étapes du cycle économique (quota de production, de marché, équilibre monétaire, etc. ) ne démontre pas que le capital monopoliste fait ce qu'il veut, mais démontre au contraire qu'il est obligé de marcher sur la pointe des pieds dans un terrain miné, parce qu'il suffirait de laisser le capitalisme décadent «au libre jeu» de ses lois pendant quelques mois pour le voir s'écrouler dans le chaos. Les syndicats, organes destinés à négocier des améliorations au sein du capitalisme, s'intègrent dans l'Etat, parce qu'obtenir des améliorations durables est devenu impossible, non parce que c'est devenu trop facile.
Par ailleurs, si véritablement la facilité de distribution de miettes de surprofits était la cause de l'intégration à l'Etat, alors la crise, qui, comme le dit BC, a «réduit de façon drastique la possibilité (...) de distribuer les miettes des surprofits», aurait par là même éliminé la raison de l'intégration des syndicats et ouvert la voie à la reconversion des «glorieux syndicats rouges» comme l'attendent classiquement les différents groupes bordiguistes.
C'est le contraire qui est arrivé, et BC est la première à reconnaître qu'avec la crise le syndicat «a progressivement accentué son appartenance à l'appareil d'Etat».
Il n'y a qu'une manière de sortir de ce réseau de contradictions : reconnaître que l'intégration des syndicats dans l'Etat bourgeois n'a rien à voir avec les surprofits, mais est fondée sur deux nécessités historiques complémentaires :
1) la décadence du capitalisme rend impossible la lutte pour des améliorations durables, 2) la décadence du capitalisme rend indispensable un renforcement croissant de cet instrument de cohésion qu'est l'Etat, renforcement qui se réalise en particulier par l'intégration des différentes structures d'origine ouvrière comme les syndicats, et leur transformation en organes destinés à contrôler la classe ouvrière.
A quelle époque les syndicats se sont-ils intégrés à l'Etat bourgeois ?
En dehors de cette cohérence, BC est obligée de se débattre dans des contradictions de plus en plus inextricables, surtout quand elle cherche à répondre à la question : quand est-ce que les syndicats sont passés à la bourgeoisie ?
Ici il ne devrait pas y avoir de doute possible : dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, Lénine décrit le passage à la forme monopoliste du capital comme quelque chose déjà réalisé, et ceci en 1916. Donc l'intégration des syndicats qui, selon BC, dépend de ce passage, se situe autour de la 1re guerre mondiale. Comme le confirmait la voix autorisée du gouvernement impérial allemand pendant la 1re guerre mondiale : «sans les dirigeants syndicaux, et à plus forte raison contre eux, on ne peut arriver à rien ; leur influence se base sur les actions qu'ils ont menées avec succès pendant des décennies pour améliorer les conditions des ouvriers... on ne peut imaginer comment nous ferions pour rester à flot s'il n'en était pas ainsi» ([4] [158]).
Cette intégration définitive ne fait que conclure un processus engagé de nombreuses années auparavant, et ce n'est pas par hasard si, à l'inadéquation progressive de la forme syndicale pour les besoins de la lutte ouvrière, correspond déjà en 1905, le surgissement de nouveaux organes de masse : les conseils ouvriers de la révolution russo-polonaise qui seront ensuite les protagonistes de la vague révolutionnaire qui déferle à partir de l'octobre rouge.
Face à ces données de fait, c'est avec une grande surprise qu'on lit dans la brochure que le syndicat d'aujourd'hui est le même «que celui d'il y a 30 ou 40 ans» (c'est-à-dire 1947-1957) et encore que le «passage définitif, au moins en Italie, s'est produit pendant et après la 2e guerre mondiale». En bref, le passage est transféré vers la fin des années 1940, faisant un bond de plus de 30 ans ! A quoi devons-nous ce véritable séisme historique ? Probablement au fait que dans la discussion qui s'est développée au début des années 1920, la Gauche italienne s'était alignée sur les bolcheviks en faveur de la reconquête des syndicats (Thèses de Rome, 1922), contre la Gauche hollandaise et allemande qui soutenait que l'intégration des syndicats à l'Etat était désormais irréversible ; ce qui est incompréhensible, c'est qu'encore aujourd'hui on cherche à réécrire l'histoire pour nier ce qui est une évidence, à savoir que sur cette question, l'intuition des Allemands et Hollandais a été plus rapide et plus profonde que celle des Russes et des Italiens. ([5] [159])
Cela n'a rien à voir avec ce que fut la méthode que nous a transmis la Gauche italienne ; déjà dans les années 1930, les Fractions de celle-ci à l'étranger, loin de se retrancher dans la défense à outrance des formulations des Thèses de Rome, travaillaient avec ténacité à «souligner les étapes de l'incorporation progressive des syndicats dans l'appareil d'Etat» ([6] [160]). Tandis que quelques-uns insistaient sur le fait que seule une nouvelle situation révolutionnaire aurait permis de clarifier définitivement la question, d'autres la considéraient comme déjà résolue et se battaient pour l'abandon de l'activité au sein des syndicats : «Il ne s'agit pas aujourd'hui de voir si oui ou non il est possible pour des marxistes de développer à l'intérieur des syndicats une activité saine ; il s'agit de comprendre que ces organes sont désormais passés de façon définitive dans le camp ennemi, et qu'il est impossible de les transformer».
En réalité, l'unique raison pour situer le tournant décisif à la fin des années 1940 réside dans le fait que... c'est seulement au début des années 1950, à l'occasion de la scission avec les bordiguistes de Programma Comunista que BC se décide à renoncer définitivement à tout projet de reconquête des syndicats.
Pour tenter de masquer ce fait, la brochure de BC rappelle que déjà dans les Thèses sur la question syndicale présentées au Congrès de Turin du Parti Communiste Internationaliste en décembre 1945 «il y avait toutes les prémisses de notre position ultérieure et d'aujourd'hui». C'est vrai, les Thèses, présentées par Luciano Stefanini, étaient nettement anti-syndicales et, de ce point de vue, assez voisines des positions de la Gauche communiste de France dont nous nous réclamons : et c'est justement pour cela qu'elles ont été refusées par une grande majorité du Congrès qui se donnait comme objectif la «conquête des organes dirigeants du syndicat» ! Si les camarades de BC considèrent utile de citer des épisodes de l'histoire de leur parti, qu'ils cherchent au moins à les citer entièrement.
Comment s'est modifiée la conception de Battaglia Comunista de ses «groupes internationalistes d'usine» ?
Parvenus à ce point, une fois «donnée cette nature et cette fonction des syndicats», nous pouvons enfin considérer quel type d'intervention organisée doit être développée. La lettre aux camarades mexicains et espagnols n'en parle pas directement (pourquoi ?), mais on sait que pour BC l'intervention organisée des révolutionnaires se fait à travers les «groupes d'usine». Voyons donc quelles sont «la nature et la fonction» de ces groupes, et comment cette conception a évolué avec le temps.
1922 : les Thèses de Rome du PC d'Italie attribuent aux Groupes communistes d'usine composés de militants du Parti la tâche de reconquérir et de prendre la direction politique des syndicats, vus comme courroies de transmission entre classe et parti.
1952 : la perspective de reconquérir les syndicats étant abandonnée, pour maintenir le groupe en vie, on leur fait porter «deux casquettes, celle d'organisme intermédiaire entre le parti et la classe, et celle d'organisme politique» (3). Bref, étant donné que la courroie de transmission syndicat n'existe plus, ce sont les groupes eux-mêmes qui doivent assumer la fonction de courroie de transmission, remplaçant en quelque sorte l'organisation unitaire de la classe. Ce n'est pas par hasard qu'au lieu de les définir comme communistes, comme en 1922, on les appelle Groupes syndicaux d'usine, coordonnés dans une Fraction Syndicale, sur la base d'une Plate-forme Syndicale spécifique.
1977-80 : en réaction à la discussion qui se développe à ce sujet dans les Conférences internationales de la Gauche Communiste, BC se limite à modifier leur nom qui devient Groupe internationaliste d'usine, sans changer tout le reste.
1982 : le 5e Congrès de BC laisse tomber toute l'armature de Fraction Syndicale, Plate-forme Syndicale, etc. , mais continue à assigner aux groupes la fonction de «seule réelle courroie de transmission entre le parti et la classe» ([7] [161]).
1986 : la nouvelle brochure sur les syndicats de BC déclare clairement que, si le groupe garde sa fonction d'organisme de parti, «nous ne pouvons cependant plus le considérer comme un organe intermédiaire», «situé à mi-chemin entre le parti et la classe ». Des termes comme «organisme intermédiaire» et «courroie de transmission» sont liquidés car considérés «usés et vieills».
Le plus incroyable, c'est que les camarades de BC ne paraissent pas se rendre compte de l'importance de ces derniers changements. Pour comprendre et surtout pour en faire comprendre l'importance à tous les nouveaux camarades qui aujourd'hui sont présents sur la scène internationale, il est nécessaire de revenir au cycle des Conférences internationales qui a eu lieu entre 1977 et 1980.
L'argument qui était au centre des débats du moment était sans conteste quelle doit être l'intervention des révolutionnaires. Le débat a fini par se polariser entre BC et CWO d'une part, qui défendaient les groupes d'usine, en soutenant que «leur fonction est d'agir comme ''courroie de transmission" ou "intermédiaires" entre le parti et la classe» ([8] [162]), et le CCI d'autre part qui défendait au contraire que les communistes, au lieu de s'illusionner sur le fait de pouvoir créer eux-mêmes les organes dans lesquels s'organisent les secteurs combatifs de la classe, doivent intervenir politiquement dans les organismes que la classe elle-même tend à créer dans son mouvement (aujourd'hui : assemblées, comités, coordinations ; demain : les Conseils ouvriers). BC résume elle-même le débat de la 3e Conférence : «le développement de la discussion a permis de mettre en évidence deux positions opposées : 1) le parti a un rôle secondaire dans la lutte de classe, en niant sa raison d'être dans l'organisation de la lutte elle-même ; 2) sans le parti comme organe dirigeant et organisateur, le prolétariat ne peut accomplir sa tâche historique» ([9] [163]) (souligné par nous). Comme on le voit, pour BC, les organes du parti doivent non seulement être une direction politique, mais être aussi les organisateurs de la classe ; celui qui refuse ce rôle nie «la raison d'être du Parti». Sur cette base, BC et CWO ont saboté les Conférences, en proclamant qu'il était impossible de continuer à discuter avec les «spontanéistes» du CCI, qui affirmaient que seul est juste le terme «d'orientation politique », de « direction politique» ([10] [164]) et qui proposaient une formulation selon laquelle le parti est «l'organe indispensable d'orientation politique, pouvoir qui est pris par l'ensemble de la classe organisée en Conseils» ([11] [165]). BC, qui a déclaré à la Conférence que la formulation était «inacceptable, parce que la Conférence devait éliminer le spontanéisme» ([12] [166]) (c'est-à-dire le CCI), déclare aujourd'hui tranquillement que «l'unité dialectique de la classe et du parti se réalise à travers la direction politique du Parti (stratégie-tactique de la Révolution) dans les organes de masse du Prolétariat (force vive et sujet de la Révolution)» ([13] [167]). Le sujet de la révolution est donc l'ensemble de la classe, organisée dans ses organes de masse (les conseils), et c'est au sein de ces organes que doit s'exercer le rôle de direction politique du parti.
Les camarades de BC seraient bien aimables de nous expliquer pourquoi ces formulations seraient complètement «opposées» à celles «inacceptables» du CCI ? Pendant une dizaine d'années, quand on demandait comment font les groupes pour être en même temps des organes du parti et des intermédiaires entre la classe et le parti, on nous répondait «vous ne comprenez rien à la dialectique». Et aujourd'hui BC, comme si de rien n'était, nous annonce que d'avoir situé les groupes «à mi-chemin entre la classe et le parti» a été clairement «équivoque» et «ambigu» ([14] [168]).
Sur ce point, deux choses doivent être claires. La première, c'est que nous savons bien que, malgré ce changement, les positions de BC restent encore très éloignées des nôtres ; la seconde, c'est que, malgré cela, nous saluons avec enthousiasme le pas en avant qu'a fait Battaglia. Mais une troisième chose doit cependant être claire : quel que soit le pas en avant, pour petit ou grand qu'il soit, il ne peut servir à quelque chose que s'il est fait de manière cohérente. Abandonner une position qui a servi de base à une décision aussi grave que celle d'interrompre les conférences internationales, sans se poser le moins du monde le problème de réfléchir sur la validité ou non de cette décision, à notre avis, n'est ni sérieux ni cohérent.
Les communistes peuvent-ils travailler dans des organes d'Etat comme les syndicats ?
La réponse de BC aux camarades espagnols sur les problèmes d'intervention peut être résumée ainsi :
1) les camarades du CCI, du fait qu'ils restent dans l'abstrait schématique et l'extrémisme verbal, se limitent à faire «les révolutionnaires du bavardage et du beau geste, qui mettent leur conscience en paix, en parlant "sagement" pour eux, faute de toute possibilité de se faire entendre, et, encore moins, de voir leurs ''indications" se concrétiser dans une praxis organisationnelle et de lutte de classe» ;
2) en réalité, ce qui est décisif, ce n'est pas tant où on intervient, mais comment on intervient. En ce sens «le problème d'être en dehors ou à l'intérieur du syndicat est un faux problème, ou mieux, un problème lié aux possibilités concrètes et aux opportunités que présente la situation contingente» ;
3) la confirmation de la validité de la position de BC réside dans le fait que «le CCI depuis quelque temps développe pour sa part une activité intense d'intervention et a corrigé, en les ramollissant, certaines de ses rigidités de type idéaliste».
Essayons de remettre les choses à leur place. Le CCI est si peu «abstrait» dans son anti-syndicalisme de principe, que non seulement il intervient dans toutes les manifestations et assemblées syndicales dans lesquelles il y a une réelle présence ouvrière, mais admet aussi explicitement que ses militants puissent s'inscrire à un syndicat quand c'est rendu légalement obligatoire pour pouvoir travailler dans tel ou tel secteur (pratique de «closed-shop» en usage dans beaucoup de pays anglophones). Mais cette obligation, analogue à celle de payer les impôts, n'a rien à voir avec le choix de s'inscrire au syndicat pour y avoir une activité antisyndicale. Notons, au passage, que déjà dans les années 30, les camarades de la Gauche Italienne excluaient -à la différence des Trotskystes- tout travail à l'intérieur des syndicats fascistes, en Italie et en Allemagne. Puisqu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur le fait que ces syndicats-là étaient des organes d'Etat, il était automatiquement exclu de discuter, puisqu'on tenait pour établi qu'aucune activité communiste n'était possible à l'intérieur d'un organe de l'Etat, les camarades de Battaglia affirment au contraire que les syndicats sont intégrés à l'Etat et qu'il est tout de même possible de travailler dedans : ils sont libres de l'affirmer, mais pas de se réclamer de la Gauche communiste pour soutenir cette affirmation.
Deux hypothèses d'intervention dans la lutte de classe
Face à cette affirmation amusante selon laquelle le CCI aurait changé de position en se jetant dans «une activité intense d'intervention» dans les luttes, il faut retourner encore une fois aux discussions des Conférences Internationales.
Le débat ne se situait pas entre ceux qui étaient en faveur et ceux qui étaient contre la nécessité d'intervenir. Le débat affrontait d'une part le CCI qui soutenait que les révolutionnaires doivent intervenir dans les luttes et dans les tentatives d'auto organisation qui à ce moment- là se développaient (en 1978 : hospitaliers en Italie, en 1979 : les sidérurgistes en Angleterre et en Lorraine, les dockers à Rotterdam, etc. ) et d'autre part Battaglia et la CWO, qui soutenaient que les révolutionnaires devaient se dédier à la construction de groupes d'usine, qui auraient organisé les secteurs combatifs du prolétariat et rendu possible de vrais mouvements de classe. Le CCI proposa une résolution. Celle-ci prenait comme point de départ la reconnaissance du fait que «la reprise historique des luttes ouvrières s'accompagne du développement, au sein de la classe, de groupes, de cercles, de noyaux de prolétaires, qui, bien que n'ayant pas une forme achevée et bien qu'étant menacés par toutes sortes de dangers, d'activisme, d'ouvriérisme, de néo-syndicalisme, sont une manifestation réelle de la vie de la classe» ([15] [169]). Cette résolution soulignait en conséquence la nécessité d'intervenir au sein de ces organismes pour combattre ces dangers et contribuer ainsi au processus de prise de conscience et d'organisation de la classe.
Cette résolution fut rejetée par BC et CWO qui, aveuglés par les faiblesses de ces tentatives, en arrivaient à mettre en discussion leur nature de classe, en les voyant essentiellement comme des «manœuvres de tel ou tel groupe politique». Même dans les thèses du Ve Congrès de 1982 on insiste encore sur cette caractérisation et quand on admet la possibilité lointaine qu'il puisse surgir de véritables «cercles ouvriers», on ne leur donne comme seule possibilité que celle de se transformer en groupe d'usine, courroie de transmission entre Battaglia et la classe.
Aujourd'hui, la brochure sur les syndicats de BC insiste sur le fait que les organismes que se donnera la spontanéité ouvrière (assemblées, coordinations d'assemblées, conseils...) devront trouver «sur les lieux de travail des points de référence bien caractérisés politiquement et capables de représenter la direction politique de ces organes de masse». Lorsque, en 1977-80, nous insistions sur le fait que le rôle des communistes était de se battre pour donner une orientation de classe au sein des organisations que la spontanéité ouvrière fera de plus en plus surgir, nous étions taxés de «spontanéistes» avec lesquels il était impossible de discuter sérieusement. Aujourd'hui, de quoi faut-il taxer Battaglia ?
Les deux hypothèses à l'épreuve de la réalité
Mais avoir abandonné l'idée qu'il incombe aux communistes de créer les organismes appelés à encadrer les secteurs combatifs du prolétariat, ne résout pas tous les problèmes et n'élimine pas toutes les différences entre nous et BC En premier lieu, BC reconnaît aujourd'hui la réalité du processus d'apparition, ça et là, d'organismes autonomes de masse (assemblées, comités de grève...) mais ne se prononce pas sur la tendance à l'apparition d'organismes minoritaires, regroupant de petits noyaux d'ouvriers combatifs, qui se donnent comme objectif de faire aller de l'avant les luttes et d'en tirer ensuite les leçons. Toujours dans les thèses de 82, ces organismes minoritaires sont pratiquement identifiés à des «émanations des organisations politiques de la classe». Aujourd'hui, est-ce que BC reconnaît, oui ou non, que la tendance à former de tels noyaux est une «manifestation réelle de la vie de la classe»?
En second lieu, il ne suffit pas de comprendre qu'il faut assurer une direction politique dans ces organes de masse, encore faut-il être capable de le faire.
Et de ce point de vue, le bilan de Battaglia est tout autre que positif. Si nous examinons les deux épisodes dans lesquels nous avons vu récemment apparaître des organismes prolétariens de masse en dehors des syndicats : la lutte des cheminots en France et la lutte des travailleurs de l'Ecole en Italie, nous voyons que ni la section française du BIPR liée à Battaglia, ni Battaglia même, ne sont intervenus dans ces mouvements. Tout ce qu'ils ont réussi à faire a été d'attendre la fin des luttes pour écrire un texte dans lequel... ils dénonçaient les limites de la lutte ! C'est particulièrement déconcertant dans le cas de Battaglia, qui, dans le secteur de l'enseignement, a un groupe organisé de militants, avec une vieille tradition d'intervention, qui aurait pu et dû jouer un rôle d'aiguillon et de direction politique dans le mouvement. Mais pour diriger un mouvement, il faut au moins intervenir dedans, et ne pas se limiter à dire «sagement» ses opinions. Battaglia préfère, au contraire, nous expliquer que le mouvement des cheminots de 87 a été plus corporatiste que celui des sidérurgistes en 79 et que cela démontre qu'il n'est pas vrai que la classe apprend de ses propres expériences, contrairement à ce que dit le CCI. Des affirmations de ce genre ne font que montrer que BC n'a rien à faire ni du mouvement des cheminots ni du mouvement des sidérurgistes. En 79, la lutte des sidérurgistes français, avec toute sa radicalité et sa combativité, est restée sous le contrôle de l’«Intersyndicale» de Longwy, c'est-à-dire d'un organe de base des syndicats. En 86-87, les cheminots ont déclenché et étendu leur mouvement à l'échelle nationale en dehors et contre les syndicats : ils ont formé des comités de grève, émanation de leurs assemblées, et commencé à créer des coordinations régionales et nationales. Ce qui est un pas en avant non négligeable. Quant aux travailleurs de l'école en Italie, ils se sont organisés au niveau national en dehors et contre les syndicats.
Bien sûr il y avait le corporatisme et surtout les syndicats de base, mais il y avait aussi la maturation de la classe ouvrière, son ouverture par rapport à l'intervention des révolutionnaires qui s'est manifestée par le fait que non seulement le CCI a pu intervenir au sein du mouvement, comme en 78, mais que ses militants ont trouvé un écho plus important et, dans le cas des assemblées nationales des travailleurs des écoles en Italie, ont été délégués dans les coordinations nationales ([16] [170]).
Certes, nous avons fait des erreurs pendant ces années, et certaines nous les avons même payées assez cher. Mais au moins, nous les avons faites en apprenant quelque chose, au cœur même des luttes ouvrières. Est-ce que les fameux groupes d'usine, avec tous leurs virages, permettent à Battaglia de tirer un bilan semblable ?
La reprise de la lutte de classe remet à l’ordre du jour les discussions inachevées
Après avoir saboté les Conférences Internationales, Battaglia Comunista a omis pendant des années de répondre dans sa presse à nos articles de polémique. Quand on en demandait la raison aux camarades, ils nous répondaient que leur journal était lu dans les usines et que les ouvriers ne sont pas intéressés à lire des pages et des pages de polémiques avec le CCI, ce qui revient à dire que le débat entre révolutionnaires n'est que du vent et que les ouvriers «concrets» n'en ont rien à faire.
Aujourd'hui cependant, BC dédie régulièrement des pages et des pages à la polémique avec le CCI, avec l’OCI et même avec un groupe extraparlementaire bourgeois comme Lotta Comunista. Que s'est-il passé ? Les lecteurs ouvriers de BC auraient-ils décidé de se «refaire une culture» ? Ou n'est ce pas plutôt qu'apparaît la vérification de ce que nous répondions quand BC a décidé d'interrompre les Conférences : «il y a une chose qui doit être claire : les questions que vous refusez de discuter aujourd'hui, seront demain à l'ordre du jour dans les luttes » ([17] [171]). C'est effectivement la reprise de la lutte de classe internationale qui pousse aujourd'hui à reprendre le débat et à l'élargir jusqu'au Mexique, à l'Inde, à l'Argentine, alors qu'il s'était engagé seulement en Europe.
Pour reprendre les termes de la Lettre ouverte que nous envoyions alors à Battaglia : «Si la Conférence est morte de votre fait, l'idée des Conférences, elle, n'est pas morte. Au contraire, la reprise de la lutte du prolétariat continuera à pousser les révolutionnaires à sortir de leur isolement et à discuter publiquement et de façon organisée les questions auxquelles se confronte la classe» ([18] [172]).
C'est cela l'objectif que tous les révolutionnaires, compris Battaglia, doivent consciemment se fixer.
Beyle
[1] [173] Parti communiste internationaliste, (Battaglia Comunista, du nom du journal qu'il publie) ; C. P. 1753, 20101 Milan, Italie.
[2] [174] Voir « Le cours historique », Revue internationale n° 18, 1979.
[3] [175] «Les syndicats dans le 3e cycle d'accumulation du Capital». On peut se procurer cette brochure auprès de BC. Les différentes citations se trouvent pp. 9, 8, 11, 13, 3, 10, 15 et 16.
[4] [176] Cité dans « La Sinistra Tedesca » de Barrot, Ed. La Salamandra.
[5] [177] Le fait que cette intuition, par sa précocité même, se soit exprimée avec des formulations encore incomplètes et immatures, qui n'immunisaient pas encore complètement contre des rechutes sous la forme radicale de syndicalisme « révolutionnaire » n'enlève rien au mérite qui revient aux Gauches allemande et hollandaise pour avoir posé les premières le problème de la destruction des syndicats.
[6] [178] Ce travail est exposé de façon détaillée dans le livre «La Gauche Communiste Italienne -1912-1952 », éditions CCI, en particulier dans le chapitre VII.
[7] [179] Les thèses sur le syndicat du Ve Congrès de BC sont reproduites en annexe de la brochure de 86.
[8] [180] Bulletin n° 2 des Textes préparatoires pour la 3e Conférence des groupes de la Gauche Communiste, p. 17.
[9] [181] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[10] [182] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[11] [183] Les thèses sur le syndicat du Ve Congrès de BC sont reproduites en annexe de la brochure de 86.
[12] [184] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[13] [185] «Les syndicats dans le 3e cycle d'accumulation du Capital». On peut se procurer cette brochure auprès de BC. Les différentes citations se trouvent pp. 9, 8, 11, 13, 3, 10, 15 et 16.
[14] [186] «Les syndicats dans le 3e cycle d'accumulation du Capital». On peut se procurer cette brochure auprès de BC. Les différentes citations se trouvent pp. 9, 8, 11, 13, 3, 10, 15 et 16.
[15] [187] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[16] [188] Un article de critique détaillée sur l'absence de BC dans le mouvement des travailleurs de l'école sera publié dans le numéro 31 de l'organe du CCI en Italie : Rivoluzione internazionale.
[17] [189] Procès verbal de la 3e conférence des Groupes de la gauche communiste (mai 1980), qu'on peut se procurer à l'adresse du CCI en France. Les diverses citations annotées 9 se trouvent aux pages 44, 47, 54, 28, 50 du chapitre 7.
[18] [190] « Lettre du CCI au PCInt (BC) à la suite de la 3e conférence » publiée en annexe au procès verbal de la conférence.
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [104]
Heritage de la Gauche Communiste:
Il y a 70 ans la révolution russe : LA PLUS IMPORTANTE EXPERIENCE DU PROLETARIAT MONDIAL
- 3329 reads
- Les dix jours qui ébranlèrent le monde, c'était il y a 70 ans. Les médias du monde entier « célèbrent » l'anniversaire. Une fois de plus ils vont reparler de la Révolution russe. A leur façon. Celle de l'idéologie dominante, avec ses mensonges et déformations, avec sa rengaine défraîchie : « la révolution communiste ne peut conduire qu'au Goulag ou au suicide ».
- En défense de la véritable nature de ce qui reste la plus grande expérience révolutionnaire du prolétariat mondial, le CCI vient de faire paraître une brochure consacrée à la Révolution russe.
En voici la présentation.
« Le trait le plus incontestable de la Révolution, c'est l'intervention directe des masses dans les événements historiques. D'ordinaire l’Etat, monarchique ou démocratique, domine la nation ; l'histoire est faite par des spécialistes de métier : monarques, ministres, bureaucrates, parlementaires, journalistes. Mais aux tournants décisifs, quand un vieux régime devient intolérable pour les masses, celles-ci brisent les palissades qui les séparent de l'arène politique, renversent leurs représentants traditionnels, et, en intervenant ainsi, créent une position de départ pour un nouveau régime. Qu'il en soit bien ou mal, aux moralistes d'en juger. Quant à nous, nous prenons les faits tels qu'ils se présentent dans leur développement objectif. L'histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d'une irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs propres destinées. » (Trotsky, Histoire de la Révolution Russe, Préface).
Le terme même de révolution fait souvent peur. « L'idéologie dominante -disait Marx- est toujours l'idéologie de la classe dominante». Et ce que les classes dominantes, les classes exploiteuses craignent le plus, au fond de leur être, c'est que les masses qu'elles exploitent s'avisent un jour de mettre en question l'ordre des choses existant en faisant une « irruption violente dans le domaine où se règlent leurs propres destinées ».
La Révolution russe de 1917 ce fut d'abord et avant tout cela : une grandiose action des masses exploitées pour tenter de détruire l'ordre qui les réduit à l'état de bêtes de somme de la machine économique et de chair à canon pour les guerres entre puissances capitalistes. Une action où des millions de prolétaires, entraînant derrière eux toutes les autres couches exploitées de la société, sont parvenus à briser leur atomisation, à s'unifier consciemment, à se donner les moyens d'agir collectivement comme une seule force. Une action pour devenir maîtres de leurs propres destinées, pour commencer la construction d'une autre société, une société sans exploitation, sans guerres, sans classes, sans nations, sans misère : une société communiste.
La Révolution russe mourut étouffée, isolée, du fait de la défaite des tentatives révolutionnaires dans le reste de l'Europe, en particulier en Allemagne. La bureaucratie stalinienne en fut l'hypocrite et impitoyable bourreau.
Mais cela ne change rien à la grandeur de l'intrépide « assaut du ciel » que fut la Révolution russe. Octobre 1917 ce ne fut pas une tentative révolutionnaire parmi d'autres. La Révolution russe constitue, et reste jusqu'à présent -et de loin- la plus importante expérience révolutionnaire de la classe ouvrière mondiale.
Par sa durée, par le nombre de travailleurs qui y ont participé, par le degré de conscience de ceux-ci, par le fait qu’elle représentait le point le plus avancé d'un mouvement international de luttes ouvrières, par l'ampleur et la profondeur des bouleversements qu'elle tenta de mettre en place, la Révolution russe constitue la plus transcendante des expériences révolutionnaires de la classe ouvrière. Et en tant que telle elle est la plus riche source d'enseignements pour les luttes révolutionnaires ouvrières à venir.
Mais pour pouvoir tirer des enseignements d'une expérience historique, il faut au départ savoir de quel type d'expérience il s'agit. La Révolution russe a t’elle été une révolution ouvrière ? Ou bien a t’elle été un coup d'Etat, fomenté par un parti bourgeois particulièrement habile dans la manipulation des masses ? Le stalinisme a t’il été le produit normal, « naturel » de cette révolution ou bien en a t’il été le bourreau ? Suivant la réponse que l'on donne à ces questions élémentaires, les enseignements que l'on tirera seront évidemment radicalement opposés.
Or la bourgeoisie ne s'est pas contentée d'écraser militairement ou d'étouffer les révolutions prolétariennes du passé. Elle en a aussi systématiquement déformé le souvenir en en donnant des versions déformées, dénaturées : de même qu'elle a entièrement adultéré l'histoire de la Commune de Paris de 1871 - cette première grande tentative prolétarienne de destruction de l'Etat bourgeois - en la présentant dans ses manuels d'histoire comme un mouvement nationaliste, patriotique anti-prussien, de même elle a totalement défiguré le souvenir de la Révolution russe.
Les idéologies staliniennes «reconnaissent» une nature prolétarienne (ils préfèrent en général parler de «populaire»), à la révolution d'Octobre. Mais la version totalement défigurée qu'ils en donnent n'a d'autre objectif que de faire oublier l'effroyable répression à laquelle le stalinisme s'est livré contre les ouvriers et les bolcheviks qui en avaient été les protagonistes ; de tenter de justifier ce qui restera comme un des plus grands mensonges de l'histoire : l'assimilation du capitalisme d'Etat, cette forme décadente et militarisée de l'exploitation capitaliste, comme synonyme de « communisme ».
Les trotskystes parlent aussi d'« Octobre ouvrier », mais pour eux encore les régimes de type stalinien ont quelque chose de prolétarien qu'il s'agit de défendre au nom de la marche vers le « communisme ».
Les autres formes de l'idéologie bourgeoise, non staliniennes ou assimilées, dénaturent la Révolution russe de façon non moins répugnante. Certaines se contentent de parler de mouvement nationaliste en vue de moderniser le capitalisme russe qui ne parvenait pas, au début de ce siècle, à se débarrasser de ses oripeaux féodaux : en somme une révolution bourgeoise comme celle de 1789 en France, mais avec plus d'un siècle de retard et aboutissant à une dictature de type fasciste. D'autres parlent de « révolution ouvrière » pour Octobre 1917 et s'accordent avec les staliniens pour considérer l'URSS comme un pays « communiste », mais ce n'est que pour mieux décrire les horreurs du stalinisme en en déduisant : « c'est à cela, et seulement à cela que peuvent conduire des mouvements révolutionnaires à notre époque ». Et d'entonner le credo de toutes les classes dominantes : « les révoltes des exploités ne peuvent conduire qu'au suicide ou à des régimes encore pires que ceux qu'elles prétendent combattre ».
Bref, les idéologues bourgeois ont complété l’œuvre des massacreurs de la Révolution russe en s'attachant à détruire le souvenir même de ce qui a été la plus grande tentative révolutionnaire prolétarienne jusqu'à présent.
Malheureusement dans le camp révolutionnaire, parmi les courants politiques prolétariens dont la tâche devrait être de tirer les leçons des expériences du passé pour les transformer en armes pour les combats à venir, l'on retrouve aussi des théories aberrantes sur la nature de la Révolution russe, même si évidemment leur objectif politique est différent. Ainsi les « conseillistes », au sein du courant de la Gauche allemande, en sont arrivés à considérer Octobre et les bolcheviks comme bourgeois. Ainsi, au sein de la Gauche italienne, les « bordiguistes» ont développé la théorie de la « double nature » (bourgeoise et prolétarienne) de la Révolution russe.
Ces théories ont été les produits de la défaite de la vague révolutionnaire des années 1920, de la confusion créée dans les esprits par le fait que la Révolution russe ne mourut pas comme la Commune de Paris, rapidement et ouvertement écrasée par la réaction bourgeoise, mais dégénéra suivant un processus long, douloureux et complexe, subissant le pouvoir d'une bureaucratie qui se prétendait la continuatrice d'Octobre 1917.
Mais si on peut comprendre l'origine de ces aberrations, elles n'en demeurent pas moins un obstacle majeur pour la rappropriation par la classe révolutionnaire des enseignements de sa principale expérience historique. Et elles doivent être combattues comme telles. Tel est l'objectif de cette brochure qui est composée de deux articles parus dans la Revue Internationale du CCI (no 12 et 13, fin 1977 - début 1978) et consacrés l'un à la critique des théories « conseillistes » et l'autre à celle des théories « bordiguistes ».
Il faudra longtemps au prolétariat mondial pour parvenir à se débarrasser de toute la boue idéologique avec laquelle la bourgeoisie a recouvert la plus grande expérience révolutionnaire. Probablement, il ne parviendra à se réapproprier toute la richesse des leçons de cette expérience qu'au cours de la lutte révolutionnaire elle-même, lorsqu'il sera confronté aux mêmes questions pratiques.
C'est lorsqu'ils seront confrontés à la nécessité immédiate de s'organiser comme force unifiée, capable d'abattre l'Etat bourgeois et de proposer une nouvelle forme d'organisation sociale, que les prolétaires réapprendront le véritable sens du mot russe « soviet ». C'est lorsqu'ils se trouveront devant la tâche d'organiser collectivement une insurrection armée qu'ils ressentiront massivement le besoin de posséder les leçons d'Octobre 1917. C'est lorsqu'ils seront confrontés à des questions telles que savoir qui exerce le pouvoir, ou bien quels rapports doit-il y avoir entre le prolétariat en armes et l'institution étatique qui surgira au lendemain des premières insurrections victorieuses, ou bien encore comment réagir face à des divergences entre secteurs importants du prolétariat, qu'ils comprendront les véritables erreurs commises par les bolcheviks (en particulier dans la tragédie de Kronstadt).
Malgré son échec, qui fut en réalité celui de la vague révolutionnaire internationale dont elle n'était que le point le plus avancé - échec qui confirmait que la révolution prolétarienne n'a pas plus de patrie que les prolétaires eux-mêmes - la Révolution russe a posé dans la pratique des problèmes pratiques cruciaux auxquels les mouvements révolutionnaires de l'avenir se trouveront inévitablement confrontés. En ce sens, qu'ils en aient conscience aujourd'hui ou non, les prolétaires des luttes de demain devront s'en réapproprier les enseignements.
Mais pour cela ils devront commencer par reconnaître cette expérience comme leur expérience. Pour affirmer la continuité du mouvement révolutionnaire prolétarien ils devront inévitablement réaliser, sur ce terrain aussi, « la négation de la négation », le rejet des théories qui nient le caractère prolétarien de leur plus grande expérience passée.
Quant aux organisations révolutionnaires, pour elles, c'est dès à présent que la reconnaissance d'Octobre est cruciale : leur capacité à féconder les luttes prolétariennes immédiates dépend en effet tout d'abord de la compréhension de la dynamique historique qui depuis plus de deux siècles a conduit aux luttes présentes. Or cette compréhension serait impossible sans une claire reconnaissance de la véritable nature de la Révolution d'octobre.
C'est à la recherche de cette clarté indispensable que veut contribuer cette brochure.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [79]
Approfondir:
- Russie 1917 [191]