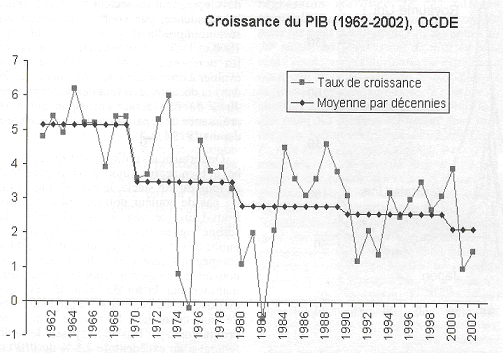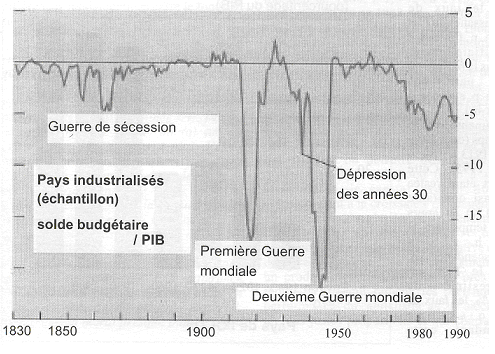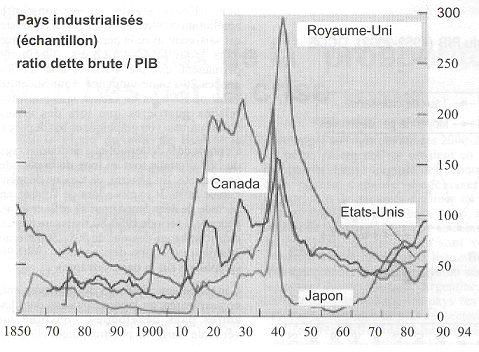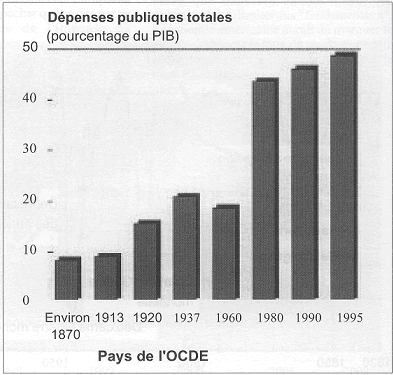Revue Int. 2003 - 112 à 115
- 4557 reads
Revue Internationale no 112 - 1er trimestre 2003
- 3615 reads
Le terrorisme : arme et justification de la guerre
- 4507 reads
Le 28 juin 1914, l’Archiduc François-Ferdinand d’Autriche, neveu de l’empereur François-Joseph et inspecteur général des armées d’Autriche-Hongrie, était assassiné à Sarajévo par Gavrilo Princip, un jeune nationaliste serbe. L’occasion était trop belle pour l’Autriche. Elle avait déjà fait main basse sur la Bosnie-Herzégovine en 1908, exprimant ainsi ses appétits impérialistes attisés par l’effondrement de l’empire ottoman. Cet assassinat fournissait le prétexte rêvé pour s’attaquer à la Serbie soupçonnée d’encourager les velléités d’indépendance des nationalités dominées par l’Autriche. La déclaration de guerre s’est faite sans attendre la moindre négociation. On connaît la suite : la Russie, craignant la prépondérance autrichienne sur les Balkans, vole au secours de la Serbie ; l’Allemagne apporte son plein soutien à l’Autriche-Hongrie, son alliée ; la France apporte le sien à son allié russe ; l’Angleterre lui emboîte le pas ; au total, près de dix millions de morts, six millions d’invalides et une Europe en ruines sans compter toutes les conséquences de la guerre comme l’épidémie de grippe espagnole de 1918 qui fait plus de morts que le conflit lui-même.
Le 11 septembre 2001, les 3000 morts des Twin Towers ont fourni le prétexte permettant aux États-Unis de lancer l’invasion de l’Afghanistan, de s’installer avec des bases militaires dans trois des pays limitrophes, anciennes républiques de l’Union Soviétique. Ils ont permis également de préparer la guerre visant à éliminer le gouvernement de Saddam Hussein avec une probable occupation militaire de longue durée de l’Irak par les troupes US. Si, du fait des conditions historiques actuelles, les suites du 11 septembre sont pour le moment moins meurtrières que la guerre de 1914-18, cette extension de la présence militaire directe des États-Unis est néanmoins lourde de menaces pour le futur.
Malgré la ressemblance entre ces deux événements – dans chaque cas, une grande puissance impérialiste se sert d’un attentat terroriste pour justifier ses propres menées guerrières – le phénomène terroriste de 2001 n’a plus rien à voir avec celui de 1914.
D’un côté, l’acte de Gavrilo Princip plonge ses racines dans les traditions des organisations populistes et terroristes qui ont lutté au cours du 19e siècle contre l’absolutisme tsariste, expression de l’impatience d’une petite bourgeoisie incapable de comprendre que ce sont les classes et non les individus qui font l’histoire. En même temps, cet attentat préfigure ce qui va être une caractéristique du terrorisme pendant le 20e siècle : l’utilisation de ce moyen par des mouvements nationalistes, et la manipulation de ceux-ci par la bourgeoisie des grandes puissances. Dans certains cas, ces mouvements nationalistes étaient trop faibles ou arrivés trop tard sur la scène historique pour se faire une place dans un monde capitaliste déjà partagé entre les grandes nations historiques : l’ETA en Espagne en est un exemple typique puisqu’un État basque indépendant n’aurait aucune viabilité. Dans d’autres cas, ces groupes terroristes font partie d’un mouvement plus ample, qui aboutit à la création d’un nouvel État national : on peut citer ici l’exemple de l’Irgoun, mouvement terroriste juif qui combattait les anglais en Palestine pendant la période d’avant et d’après la deuxième guerre mondiale, et qui avait à son actif non seulement des attaques contre des cibles «militaires», comme le quartier général de l’armée britannique, mais aussi des massacres de civils comme la tuerie perpétrée contre la population arabe de Deir Yassine. Signalons que Menahem Begin, l’ex-premier ministre israélien à qui on accorda le prix Nobel de la paix suite à la signature des accords de Camp David entre Israël et l’Égypte, fut un des dirigeants de l’Irgoun.
L’exemple de l’IRA et du Sinn Fein en Irlande[1] résume d’une certaine façon les caractéristiques de ce que va être le terrorisme pendant le 20e siècle. Suite à l’écrasement de la révolte de Pâques 1916, un des dirigeants irlandais exécutés n’était autre que James Connolly, figure emblématique du mouvement ouvrier irlandais. Sa mort marque la fin d’une époque en réalité déjà révolue avec l’éclatement de la première guerre mondiale, une époque où le mouvement ouvrier pouvait encore soutenir, dans certains cas, des luttes d’indépendance nationale, alors que dans la période de décadence qui s’ouvrait, un tel soutien se retourne inévitablement contre le prolétariat.[2] En fait c’est le sort de Roger Casement qui symbolisera ce que seront les mouvements nationalistes et terroristes de la période de décadence : il fut arrêté par les anglais (et fusillé par la suite) dès son arrivée en Irlande dans un sous-marin allemand alors qu’il devait convoyer une livraison de fusils allemands destinés au soulèvement indépendantiste de 1916.
Les fins de carrière de Menahem Begin – premier ministre d’Israël – et de Gerry Adams l’ex-terroriste et dirigeant du Sinn Fein – pas encore premier ministre, mais néanmoins politicien respectable reçu à Downing Street et à la Maison Blanche – sont significatifs également du fait que, pour la bourgeoisie, il n’y a aucune ligne de démarcation étanche entre le terrorisme et la respectabilité. La différence entre le chef terroriste et l’homme d’État est tout simplement que le premier est encore dans une position de faiblesse, puisque les seules armes dont il dispose sont celles des attentats et des coups de main armés, alors que le second dispose de tous les moyens militaires de l’État bourgeois moderne. Tout au long du 20e siècle, surtout pendant la période de «décolonisation» après la deuxième guerre mondiale, les exemples sont nombreux de groupes terroristes (ou nationalistes se servant des moyens terroristes) qui se transforment en forces armées d’un nouvel État : les membres de l’Irgoun se fondant dans la nouvelle armée israélienne, le FLN en Algérie, le Viêt-minh au Vietnam, l’OLP de Yasser Arafat en Palestine, etc.
Ce genre de lutte armée est également un terrain de prédilection pour l’intervention de l’État bourgeois, dans le cadre des conflits inter-impérialistes. Le phénomène commence à prendre de l’ampleur pendant la deuxième guerre mondiale, avec l’utilisation par les bourgeoisies "démocratiques" des mouvements de résistance contre l’occupant allemand, particulièrement en France, en Grèce et en Yougoslavie, ou par la bourgeoisie allemande nazie – quoique avec beaucoup moins de succès – dans le cas de certains mouvements d’indépendance nationale dans l’empire britannique (notamment en Inde). Là où les confrontations entre les grands blocs américain et russe prennent vraiment de l’ampleur, les formations nationalistes cessent d’être de simples groupes terroristes, pour devenir de véritables armées : c’est le cas au Vietnam, où il y a des centaines de milliers de combattants en présence, et au final des millions de morts, ou en Afghanistan où – rappelons-le – les Talibans et leurs prédécesseurs qui s’étaient distingués dans la lutte contre l’occupation soviétique ont été formés et armés par les États-Unis.
Le terrorisme – lutte armée minoritaire – est donc devenu un champ de manoeuvre pour l’intervention et la manipulation des grandes puissances. Si c’est clairement le cas dans les confrontations armées dans les pays dits du «Tiers-Monde», c’est également vrai dans des manipulations plus ténébreuses à l’intérieur des grands États eux-mêmes. Du fait que le terrorisme est une action qui se prépare dans l’ombre, il offre ainsi «un terrain de prédilection aux manigances des agents de la police et de l’État et en général à toutes sortes de manipulations et d’intrigues les plus insolites».[3] Un exemple frappant de ce type de manipulation, où sont mêlés des individus illuminés (s’imaginant même agir dans l’intérêt de la classe ouvrière), le gangstérisme, les grands États et leurs services secrets, est l’enlèvement, d’une efficacité toute militaire, d’Aldo Moro par un commando des Brigades rouges italiennes et son assassinat le 9 mai 1978 (après que le gouvernement italien ait refusé de négocier sa libération). Cette opération n’était pas l’œuvre de quelques terroristes excités, et encore moins de militants ouvriers. Derrière l’action des Brigades rouges, il y avait des enjeux politiques impliquant non seulement l’État italien lui-même mais aussi les grandes puissances. En effet, Aldo Moro représentait une fraction de la bourgeoisie italienne favorable à l’entrée du Parti communiste italien dans la majorité gouvernementale, option à laquelle s’étaient fermement opposés les États-Unis. Les Brigades rouges partageaient cette opposition à la politique du "compromis historique" entre la Démocratie chrétienne et le PC défendue par Aldo Moro et faisaient ainsi ouvertement le jeu de l’État américain. Par ailleurs, le fait que les Brigades rouges aient été directement infiltrées à la fois par les services secrets italiens et par le réseau Gladio (une création de l’OTAN qui avait pour mission de constituer des réseaux de résistance au cas où l’URSS aurait envahi l’Europe de l’Ouest) révèle que dès la fin des années 1970, le terrorisme est déjà un instrument de manipulation dans les conflits impérialistes.[4]
Le terrorisme: arme et justificationde la guerre impérialiste
Au cours des années 1980, la multiplication des attentats terroristes (comme ceux de 1986 à Paris) exécutés par des groupuscules fanatiques, mais qui étaient commandités par l’Iran, ont fait apparaître un phénomène nouveau dans l’histoire. Ce ne sont plus, comme au début du 20e siècle, des actions armées menées par des groupes minoritaires, visant à la constitution ou à l’indépendance nationale d’un État, mais ce sont des États eux-mêmes qui prennent en charge et utilisent le terrorisme comme arme de la guerre entre États.
Le fait que le terrorisme soit devenu directement un instrument de l’État en vue de mener la guerre marque un changement qualitatif dans l’évolution de l’impérialisme. Le fait que ce soit l’Iran le commanditaire de ces attaques (dans d’autres cas comme l’attentat contre le vol Panam au-dessus de Lockerbie, c’est la Syrie ou la Libye qui sont mises en cause) est significatif également d’un phénomène qui va prendre de l’ampleur seulement avec la fin des blocs après 1989 et la disparition de la discipline imposée par les têtes de bloc : des puissances régionales de troisième ordre comme l’Iran tentent de s’échapper de la tutelle des blocs russe et américain. Le terrorisme devient véritablement la bombe atomique des pauvres.
Dans la dernière période, on a pu constater que ce sont les deux principales puissances militaires, les États-Unis et la Russie, qui ont utilisé le terrorisme comme moyen de manipulation pour justifier leurs interventions militaires. Ainsi, les médias eux-mêmes ont révélé que les attentats à Moscou de l’été 1999 avaient été perpétrés avec des explosifs utilisés exclusivement par les militaires et que Poutine, le chef du FSB (ex-KGB) à l’époque, en était probablement le commanditaire. Ces attentats étaient un prétexte pour justifier l’invasion de la Tchétchénie par les troupes russes. Avec le dernier attentat à Moscou, la prise en otage de 700 spectateurs d’un théâtre, la ficelle est si grosse que la presse elle-même, nationale comme internationale, est amenée à s’interroger ouvertement sur la manipulation, sur comment une cinquantaine de personnes ont pu se rassembler et pénétrer dans un lieu public au coeur de la capitale en transportant un arsenal impressionnant, dans une ville où un Tchétchène peut se faire contrôler et arrêter plusieurs fois par jour dans la rue.
Parmi les hypothèses mises en avant dans le journal Le Monde du 16 novembre, il est évoqué soit une infiltration du commando par les services secrets russes, soit que ces derniers étaient au courant de l’opération et ont laissé faire dans le but de relancer la guerre en Tchétchénie. En effet, selon certaines fuites, des agents des services secrets avaient informé leur hiérarchie des mois à l’avance de la préparation d’actions à Moscou par le groupe de Movsar Baraev, mais l’information «se serait perdue comme toujours dans les méandres des échelons supérieurs». On imagine pourtant mal une information de cette importance passer inaperçue. Le 29 octobre, le quotidien Moskovski Komsomolets a cité un informateur anonyme du FSB (ex-KGB) selon lequel le commando était depuis longtemps «infiltré» par les services russes qui auraient directement contrôlé quatre des preneurs d’otages.
Le commando était dirigé par le clan Baraev dont les hommes de main ont déjà joué un rôle éminent dans la guerre en Tchétchénie. Alors qu’il se présentait comme le défenseur d’un islamisme radical, son ancien chef (assassiné il y a deux ans), et oncle du commandant des preneurs d’otages, entretenait des liens directs avec le Kremlin. Ses troupes ont en effet été les seules à être épargnées au cours des bombardements et des massacres de l’armée russe. C’est lui qui avait par ailleurs permis le massacre des principaux chefs de guerre nationalistes tchétchènes encerclés dans Grozny en les attirant dans un guet-apens, leur donnant le feu vert pour s’enfuir dans un passage où les attendaient les troupes russes.
Concernant les événements du 11 septembre 2001, même si l’État américain n’a pas directement commandité ces attentats, il est inconcevable d’imaginer que les services secrets de la première puissance mondiale aient été pris par surprise, comme dans n’importe quelle république bananière du tiers-monde. De toute évidence, l’État américain a laissé faire, quitte à sacrifier ses Twin Towers et près de 3000 vies humaines.[5] C’était le prix que l’impérialisme américain était prêt à payer pour pouvoir réaffirmer son leadership mondial en déclenchant l’opération «Justice illimitée» en Afghanistan. Cette politique délibérée de la bourgeoisie américaine consistant à laisser faire pour justifier son intervention militaire n’est pas nouvelle.
Elle avait déjà été utilisée en décembre 1941 lors de l’attaque japonaise à Pearl Harbor[6] pour justifier l’entrée des États-Unis dans la seconde guerre mondiale et, plus récemment, lors de l’invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein en août 1990 pour déchaîner la guerre du Golfe sous la houlette de l’oncle Sam.[7]
La méthode qui consiste à utiliser les attentats terroristes déjà prévus, afin de justifier l’extension de son influence impérialiste via l’intervention militaire (ou policière) commence à faire des émules. Les informations disponibles semblent montrer que le gouvernement australien était au courant des menaces d’attentat en Indonésie, et qu’il a laissé faire, encourageant même ses ressortissants à continuer à se rendre à Bali. Ce qui est certain en tout cas, c’est que l’Australie a saisi l’occasion de l’attentat du 12 octobre pour renforcer son influence en Indonésie, à la fois pour son propre compte et pour le compte de son allié américain.[8]
Mais cette politique du «laisser faire» ne consiste plus, comme en 1941 ou en 1990, à laisser l’ennemi attaquer le premier selon les lois classiques de la guerre entre États.
Ce n’est plus la guerre entre États rivaux, avec ses propres règles, ses drapeaux, ses préparatifs, ses troupes en uniforme, ses champs de bataille et ses armements, qui sert de prétexte à l’intervention massive des grandes puissances. Ce sont les attaques terroristes aveugles, avec leurs commandos de kamikazes fanatisés, frappant directement les populations civiles qui sont utilisées par les grandes puissances pour justifier le déchaînement de la barbarie impérialiste.
L’utilisation et la manipulation du terrorisme ne sont plus seulement le lot de petits États, tels la Libye, l’Iran ou d’autres du Moyen-Orient. Elles sont devenues l’apanage des plus grandes puissances de la planète.
L'idéologie de la mort et de la peur
Il est significatif de la désagrégation de plus en plus avancée de tout le tissu idéologique de la société capitaliste que les exécutants des attentats de New York, de Moscou ou de Bali (quelles que soient les motivations de leurs commanditaires) ne sont plus mus par des idéologies ayant au moins une apparence rationnelle et progressive, telle que la lutte pour la création de nouveaux États nationaux. Au contraire, ils font appel à des idéologies qui étaient déjà désuètes et irrémédiablement réactionnaires au 19e siècle : l’obscurantisme religieux et mystique. La décomposition du capitalisme est bien résumée dans ce fait que, pour des franges de la jeunesse d’aujourd’hui, la meilleure perspective que la vie puisse leur offrir n’est plus la vie, ni même la lutte au service d’une grande cause, mais la mort dans les ténèbres de l’obscurantisme féodal et au service de commanditaires cyniques dont souvent ils ne soupçonnent même pas l’existence.
Dans les pays développés, le terrorisme dont ils sont eux-mêmes les premiers responsables sert aux États bourgeois de moyen de propagande auprès de leur propres populations civiles, afin de les convaincre que dans un monde qui s’écroule, où se perpètrent des horreurs comme l’attentat du 11 septembre, la seule solution est de s’en remettre à la protection de l’État lui-même. La situation au Venezuela nous montre la perspective qui nous attend si la classe ouvrière, à travers le soutien à telle ou telle faction de la bourgeoisie, se laisse dévoyer sur un terrain qui n’est pas le sien. Le gouvernement Chavez est venu au pouvoir avec un soutien assez large parmi les populations pauvres et les ouvriers, ayant réussi à leur faire croire que son programme national-populiste et anti-américain pourrait les protéger contre les effets d’une crise de plus en plus insupportable. Aujourd’hui, les masses pauvres et ouvrières se trouvent divisées et encadrées par les forces de la bourgeoisie : soit derrière Chavez et sa clique militaire, soit embrigadées dans les syndicats qui participent à une "grève générale" qui comprend même les juges et qui bénéficie de la bienveillance de l’organisation des patrons ! Et ce danger n’est pas limité à des pays périphériques du capitalisme, comme nous le montre la manifestation monstre du 1er mai 2002 à Paris, où les "citoyens" furent invités à prendre parti pour une clique de la bourgeoisie contre une autre ("l’autre" étant cet épouvantail caricatural appelé Le Pen).
Si la classe ouvrière mondiale ne réussit pas à réaffirmer sa propre indépendance de classe, dans la lutte pour la défense de ses propres intérêts d’abord et pour le renversement révolutionnaire de cette société pourrissante ensuite, alors nous ne pouvons rien attendre d’autre que la généralisation des affrontements entre les cliques bourgeoises et entre les États bourgeois employant tous les moyens, y compris les plus barbares, notamment l’usage quotidien de l’arme de la terreur.
Arthur, 23 déc. 02.
1 IRA, ou Irish Republican Army. Le Sinn Fein (“Nous-mêmes” en gaélique) fut fondé en 1907 par Arthur Griffith, principal dirigeant irlandais à l’époque de l’indépendance de la république irlandaise (Eire) au début des années 20. Il constitue aujourd’hui encore l’aile politique de l’IRA, ayant des rapports avec cette dernière semblables à ceux de Herri Battasuna avec l’ETA.
En quelque sorte, on pourrait dire que la "révolution nationaliste" irlandaise a été caractéristique de l’ouverture de la période de décadence du capitalisme, dans le sens qu’elle n’a jamais réussi a créer autre chose qu’un État amputé (privé des six comtés d’Ulster) essentiellement inféodé à la Grande-Bretagne.
2 Toute l’ambiguïté de l’attitude de Connolly apparaît dans un article publié dans son journal Irish Worker au début de la guerre de 1914, où il déclare d’un côté que tout ouvrier irlandais serait parfaitement en droit de s’engager dans l’armée allemande si ça pouvait hâter la libération irlandaise du joug de l’impérialisme britannique, tout en espérant que "l’Irlande peut cependant mettre le feu à un incendie européen qui ne s’éteindra pas tant que le dernier trône ainsi que les dernières actions ou obligations capitalistes ne se seront pas consumés dans le bûcher funéraire du dernier seigneur de la guerre" (cité dans FSL Lyons, Ireland since the famine).
3 Voir la Revue Internationale n°15, "Résolution sur terrorisme, terreur et violence de classe", point 5.
4 Rappelons aussi que les services secrets de l’État français se sont montrés prêts à utiliser directement les méthodes terroristes avec l’attentat en Nouvelle Zélande contre le Rainbow Warrior, navire de l’organisation Greenpeace.
5 Voir à ce sujet nos articles "La guerre ‘anti-terroriste’ sème terreur et barbarie" et "Pearl Harbor 1941, les ‘Twin Towers’ 2001, le machiavélisme de la bourgeoisie" dans la Revue internationale n°108.
6 Voir l’article "Pearl Harbor..." dans la Revue internationale n°108.
7 Voir nos articles "Golfe persique : le capitalisme c’est la guerre", "Face à la spirale de la barbarie guerrière, une seule solution : développement de la lutte de classe", "Guerre du Golfe : massacres et chaos capitalistes", "Le chaos" publiés respectivement dans les numéros 63 à 66 de la Revue Internationale.
8 Pour une analyse plus détaillée, voir l’article "Comment les massacres de Bali profitent à l’impérialisme australien" publié dans Révolution internationale n°330.
Questions théoriques:
- Guerre [1]
L'élargissement de l'Union européenne
- 3118 reads
L'Europe: alliance économique et champ de manoeuvre des rivalités impérialistes
Cela fait un peu moins d'un demi siècle maintenant que la bourgeoisie nous parle de construction européenne. L'introduction d'une monnaie commune - l'Euro - nous a été présentée comme une étape fondamentale dans ce processus dont l'horizon serait la mise en place des États-Unis d'Europe. Processus qui serait en bonne voie puisqu'il est prévu un premier élargissement de 15 à 25 pays au premier mai 2004 et qu'un projet de Constitution européenne est en cours d'élaboration.
La bourgeoisie serait-elle capable de dépasser le cadre étriqué de la nation ? Serait-elle à même de surmonter la concurrence économique et ses antagonismes impérialistes ? Pourrait-elle mettre fin à la guerre économique et à la guerre tout court qui a tant de fois déchiré le continent? En d'autres termes, la bourgeoisie serait-elle capable de donner un début de solution à la question de la division capitaliste du monde en nations concurrentes, source de dizaines de millions de morts et qui a ensanglanté la planète entière, particulièrement depuis le début du 20e siècle ? Ou encore, la bourgeoisie serait-elle capable de renoncer à l'idéologie nationaliste ferment et base constitutive de sa propre existence en tant que classe et source de toutes ses légitimations économiques, politiques, idéologiques et impérialistes ?
Et si les réponses à toutes ces questions sont négatives, si les États-Unis d'Europe sont une chimère, à quoi correspondrait alors la constitution et le développement de la Communauté Européenne ? La bourgeoisie serait-elle devenue masochiste à ce point pour éternellement courir derrière un mirage et pourquoi déploierait-elle tant d'efforts pour construire un château de cartes sans viabilité réelle ? Pour se donner l'illusion du change par rapport aux États-Unis d'Amérique ? Par pur souci de propagande ?
L'impossible dépassement du cadre national dans la décadence du capitalisme
La vanité d'un tel projet se mesure déjà aux conditions initiales requises pour sa viabilité. Conditions qui sont non seulement totalement absentes dans le projet actuel mais qui relèvent tout simplement de l'utopie dans le contexte historique présent. En effet, comme l'existence des différentes bourgeoisies nationales est intimement liée à la propriété privée et/ou étatique qui s'est historiquement déployée dans un cadre national, toute unification réelle à une échelle supérieure impliquerait des dépossessions de pouvoirs aux échelons inférieurs. Cette perspective est d'autant plus irréaliste que la création d'une réelle Europe unifiée à l'échelle du continent passerait par un inéluctable processus d'expropriation des différentes fractions bourgeoises nationales dans chaque pays. Processus nécessairement violent, comme le furent les révolutions bourgeoises contre la féodalité d'Ancien Régime ou les guerres d'indépendance contre la métropole de tutelle, auquel ne peuvent se substituer la "volonté politique des gouvernements" et/ou "l'aspiration des peuples à faire l'Europe ". Lorsque l'on sait combien, au sein de ce processus de formation des nations au 19° siècle, la guerre a toujours joué un rôle de premier ordre pour éliminer les résistances intérieures émanant des secteurs réactionnaires de la société ou pour délimiter ses frontières face aux autres pays, l'on peut imaginer ce que supposerait et `coûterait' le processus d'unification européenne. Cela souligne à quel point est utopique ou hypocrite et mensongère cette idée de l'union pacifique de différents pays, fussent-ils européens. Penser cette unification comme possible impliquerait qu'un nouveau groupe social, porteur d'intérêts supranationaux émancipateurs, puisse émerger et être capable, au travers d'un véritable processus révolutionnaire, à l'aide de ses propres moyens politiques (partis, etc.) et coercitifs (forces militaires, etc.), d'exproprier les intérêts bourgeois liés aux différents capitaux nationaux et de s'imposer sur ces derniers.
Sans entrer dans de longs développements à propos de la question nationale ([1] [2]), force est de constater que toutes les nations qui ont été créées depuis la guerre de 1914-18 - une petite centaine - sont la conséquence des problèmes nationaux non résolus au cours du 19° et au tout début du 20° siècle. Toutes furent des nations mortnées qui n'ont pu parachever leur révolution bourgeoise et entamer leur révolution industrielle de façon suffisamment affirmée et vigoureuse, alimentant ainsi la dynamique des multiples conflits depuis la Première guerre mondiale. Seuls les pays constitués au cours du 19° siècle ont pu atteindre suffisamment de cohérence, de puissance économique et de stabilité politique. Ainsi, les six plus grandes puissances actuelles l'étaient déjà, bien que dans un ordre quelque peu différent, à la veille de la Première guerre mondiale. Ce constat, que même les historiens bourgeois énoncent, n'est réellement explicable que dans le cadre du matérialisme historique.
En effet, pour qu'une nation puisse se constituer sur des bases politiques solides, elle doit pouvoir plonger ses racines dans une réelle centralisation de sa bourgeoisie, centralisation qui s'est forgée au travers d'une âpre lutte unificatrice contre la féodalité de l'Ancien Régime et pouvoir disposer des bases économiques suffisantes pour le déploiement de sa révolution industrielle qu'elle trouve alors dans un marché mondial en voie de constitution. Ces deux conditions étaient réunies au cours de la période ascendante du capitalisme s'étalant principalement pendant les 18, et 19e siècles jusqu'à la Première guerre mondiale. Ces conditions ayant disparu ensuite, les possibilités d'émergence d'un nouveau projet national viable n'ont plus été réunies. Dès lors, pourquoi ce qui fut impossible à réaliser tout au long du 20e siècle serait-il tout à coup possible aujourd'hui ? Alors qu'aucune des nouvelles nations créées depuis la Première guerre mondiale n'a pu disposer des moyens de son existence, pourquoi l'avènement d'une nouvelle grande puissance - comme le seraient les États-Unis d'Europe - serait-il soudain réalisable ?
La troisième conséquence logique de l'hypothèse européenne impliquerait une atténuation de la tendance à l'exacerbation des antagonismes impérialistes entre nations concurrentes au sein de l'Europe. Or, déjà Marx dans le Manifeste Communiste soulignait à son époque (le milieu du 19e siècle) la permanence des antagonismes existant entre toutes les fractions nationales de la bourgeoisie : "La bourgeoisie vit dans un état de guerre perpétuel ; d'abord contre l'aristocratie, plus tard contre ces fractions de la bourgeoisie même dont les intérêts entrent en contradiction avec les progrès de l'industrie, et toujours contre la bourgeoisie de tous les pays étrangers". Si la contradiction qui l'opposait aux vestiges féodaux a été très largement dépassée par la révolution capitaliste et si la contradiction qui l'opposait aux secteurs rétrogrades de la bourgeoisie a pu l'être également dans les principaux pays développés, par contre, celle concernant l'antagonisme entre les nations n'a fait que s'exacerber tout au long du 20` siècle. Dès lors, pourquoi verrait-on aujourd'hui un processus inverse alors que durant toute la période de décadence les conflits entre fractions de la classe dominante n'ont fait que s'exacerber?
Une caractéristique non équivoque de l'entrée en décadence d'un mode de production est d'ailleurs l'explosion des antagonismes entre fractions de la classe dominante. Cette dernière ne pouvant plus extraire suffisamment de surtravail d'un rapport social de production devenu désormais obsolète, elle tend à l'obtenir par la rapine chez ses pairs. Il en va ainsi lors de la décadence du mode de production féodal (1325-1750) avec la guerre de cent ans (1337-1453) relayée ensuite par les guerres entre les grandes monarchies absolutistes européennes : "La violence, fût sans doute un trait permanent et spécifique des sociétés médiévales. Il n'empêche qu'elle a manifestement pris une dimension particulière au tournant des XIIIe et XIVe siécles. (...) La guerre devient en effet un phénomène endémique, multiforme, nourri par toutes les frustrations sociales. ( ..) La généralisation de la guerre fut avant tout l'expression ultime des dysfonctionnements d'une société aux prises avec des problèmes qu'elle ne peut en aucune manière maîtriser. Sorte de fuite en avant pour échapper aux impasses du moment. " (Guy Bois, La grande dépression médiévale, PUF). Cette période de décadence du mode de production féodal contraste très fortement avec son ascendance (1000-1325) : "Plus nettement encore que les temps féodaux, la période 1150-1300, dates larges, connut à diverses reprise et dans des ensembles géographiques assez vastes des phases de paix quasi complète, à la faveur desquelles l'essor démographique et économique ne put que s’accentuer "(P. Contamine, La guerre au Moyen Âge, PUF-Clio). Il en fut de même lors de la décadence du mode de production esclavagiste avec le démembrement de l'empire romain et la multiplication de conflits sans fin entre Rome et ses provinces.
Tel est également le cas lors de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Afin de restituer le fossé entre les conditions qui prévalaient en ascendance et en décadence du capitalisme, voici ce qu'en dit Eric Hobsbawm, avec le recul de l'historien, dans sa fresque historique L 'âge des extrêmes (1994) qui campe bien, sous forme de bilans respectifs, les différences fondamentales entre le « long 19 » et le « court 20 » siècle : "Comment dégager le sens du Court Vingtième Siècle - du début de la Première Guerre mondiale à 1 'effondrement de l'URSS -, de ces années qui, comme nous le voyons avec le recul, forment une période historique cohérente désormais terminée ? (..) dans le Court Vingtième Siècle on ait tué ou laissé mourir délibérément plus d'êtres humains que jamais auparavant dans l'histoire. (...) il fut sans doute le siècle le plus meurtrier dont nous avons gardé la trace, tant par l'échelle, la fréquence et la longueur des guerres qui l'ont occupé (et qui ont à peine cessé un instant dans les années 1920) mais aussi par l'ampleur des plus grandes famines de l'histoire aux génocides systématiques. A la différence du `long XIXe siècle', qui semblait et fut en effet une période de progrès matériel, intellectuel et moral presque ininterrompu, c'est-àdire de progression des valeurs de la civilisation, on a assisté depuis 1914, à une régression marquée de ces valeurs jusqu'alors considérées comme normales dans les pays développés (..)Tout cela changea en 1914. (..) Bref, 1914 inaugure l'ère des massacres (..) La plupart des guerres non révolutionnaires et non idéologiques du passé n'avaient pas été menées comme des luttes à mort jusqu'à l'épuisement total. (..) Dans ces conditions, pourquoi les puissances dominantes des deux camps menèrent-elles la Première Guerre mondiale comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire comme une guerre qui ne pouvait être que totalement gagnée ou perdue ? La raison en est que cette guerre, à la différence des conflits antérieurs aux objectifs limités et spécifiables, fut menée à des fins illimitées. (..) C'était un objectif absurde et autodestructeur, qui ruina à la fois les vainqueurs et les vaincus. Il entraîna les seconds dans la révolution, et les vainqueurs dans la faillite et l'épuisement physique. (..) la guerre moderne implique tous les citoyens et mobilise la plupart d'entre eux; qu'elle se mène avec des armements qui requièrent un détournement de toute l'économie pour les produire et qui sont employés en quantités inimaginables : qu'elle engendre des destructions inouïes, mais aussi domine et transforme du tout au tout la vie des pays impliqués. Or, tous ces phénomènes sont propres aux guerres du XXe siècle. (..) La guerre a-t-elle servi la croissance économique ? En un sens, il est clair que non. ) ».
L'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence interdit désormais l'émergence de nouvelles nations réellement viables. La saturation relative des marchés solvables - eu égard aux considérables besoins de l'accumulation atteint par le développement des forces productives - qui est à la base de la décadence du capitalisme, empêche toute résolution « pacifique » des contradictions insurmontables de ce dernier. C'est pourquoi la guerre commerciale entre nations et le développement del'impérialiste n'ont fait que s'exacerber depuis lors. Dans un tel contexte, les nations arrivées avec retard sur l'arène mondiale ne peuvent surmonter celui-ci, tout au contraire, l'écart tend irrémédiablement à se creuser.
L'Europe ne s'étant pas constituée en entité nationale avant le début de ce siècle, à une époque pourtant favorable au surgissement de nouvelles nations, parce qu'elle n'en présentait pas les conditions, il était impossible qu'elle le fit ensuite. De plus, dans la phase actuelle et ultime de la décadence, celle de la décomposition de la société capitaliste([2] [3]), non seulement les conditions sont toujours aussi défavorables au surgissement de nouvelles nations, mais de plus elles exercent une pression à l'éclatement de celles d'entre elles présentant le moins de cohésion (URSS, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, etc.) et exacerbent les tensions entre les nations existantes, même les plus fortes et les plus stables (Cf. ci-dessous le paragraphe sur l'Europe dans la période de décomposition).
Un parallèle historique: les monarchies absolues
Doit-on être surpris du processus d'unification européenne en pleine décadence du capitalisme ? Est-ce le signe d'une vigueur retrouvée du mode de production capitaliste ou une expression de résistance à la décadence de ce dernier? Plus généralement, peut-on constater des phénomènes analogues lors de phases décadentes antérieures et que signifient-ils ?
La décadence du mode de production féodal est intéressante à cet égard dans la mesure où nous y avons assisté à la constitution de grandes monarchies absolues qui ont semblé dépasser l'émiettement du fief si caractéristique du mode de production féodal. Ainsi, au cours du XVIe siècle apparaît en Occident l'État absolutiste. Les monarchies centralisées représentaient une rupture décisive avec la souveraineté pyramidale et morcelée des formations sociales médiévales. Cette centralisation du pouvoir monarchique suscita une armée et une bureaucratie permanentes, des impôts nationaux, une législation codifiée et les débuts d'un marché unifié. Et si tous ces éléments peuvent s'apparenter aux caractéristiques du capitalisme, et cela d'autant plus qu'ils coïncidèrent avec la disparition du servage, ils n'en restèrent pas moins une expression du féodalisme en déclin.
En effet, l’« unification nationale » sur divers plans par les monarchies absolues ne représentait pas un dépassement du cadre géo-historique du Moyen Âge - le fief féodal - mais une expression de son caractère devenu trop étroit que pour contenir la poursuite du développement des forces productives. Les États absolutistes représentaient une forme de centralisation de l'aristocratie féodale, un blindage de son pouvoir, pour résister à la décadence du mode féodal de production. C'est d'ailleurs une autre des caractéristiques de toutes les décadences des modes de production que d'engendrer des phénomènes de centralisation du pouvoir - en général au travers du renforcement de l'État représentant les intérêts collectifs de la classe dominante - afin d'offrir un front de résistance plus solide aux forces déstructurantes des crises de leur déclin historique.
De façon analogue, la constitution de l'Union Européenne, et plus généralement la conclusion de tous les accords économiques régionaux dans le monde, est une tentative de dépassement du cadre trop étriqué de la nation pour faire face à l'exacerbation de la concurrence économique dans la décadence du capitalisme... La bourgeoisie est donc coincée entre d'une part la nécessité de dépasser toujours plus le cadre national pour défendre au mieux ses intérêts économiques et d'autre part les bases nationales de son pouvoir et de sa propriété. L'Europe n'est en rien un dépassement de cette contradiction mais une expression de la résistance de la bourgeoisie aux contradictions de la décadence de son mode de production. Si Louis XIV invitait les grands de son Royaume à s'installer à sa cour, ce n'était pas pour leur payer du bon temps à Versailles mais plutôt pour surveiller leurs faits et gestes et éviter qu'un complot ne se trame à partir de la province. A bien des égards, les calculs stratégiques sont quelque peu analogues au sein de la Communauté européenne où la France préfère une Allemagne arrimée à l'Europe et un Deutsche Mark fondu dans l'Euro, qu'une Allemagne libre de ses mouvements, déployant ses penchants historiques vers les pays d'Europe centrale où le Mark faisait déjà office de monnaie de référence ; où la Grande-Bretagne, après avoir essayé de créer un pôle concurrent avec l'AELE, préfère être de la partie pour infléchir, voire saboter les politiques communautaires, plutôt que d'être marginalisée sur son île; et où l'Allemagne préfère avancer masquée derrière la fiction de l'Europe pour développer ses véritables ambitions impérialistes de futur chef de file d'un bloc impérialiste rival à celui des États-Unis.
L'Europe, une création impérialiste pour les besoins de la guerre froide
La constitution de la Communauté Européenne plonge ses racines dans le contexte du développement de la guerre froide dans l'immédiat après-guerre ([3] [4]) . Proie potentielle-pour l'impérialisme russe, car déstabilisée par la crise et la désorganisation sociale, l'Europe sera soutenue par les États-Unis pour constituer un rempart face aux velléités d'avancées du bloc de l'Est. Ceci fut réalisé grâce au plan Marshall proposé à tous les pays européens en juin 1947. De même, la constitution de IaCECA en 1952- la Communautéeuropéenne pour le charbon et l'acier - répondait à la nécessité de renforcer l' Europe dans un contexte d'aggravation dramatique des tensions EstOuest avec l'éclatement de la guerre de Corée. Enfin, la création de la CEE en 1957 venait parachever cette dynamique de renforcement du bloc occidental sur le continent. Un tel développement de l'Europe, essentiellement sur le plan économique et militaire - via la présence des troupes et des armements de l'OTAN -, illustre que loin de personnifier la paix retrouvée, elle restait, comme à travers toute l'histoire du capitalisme, le principal théâtre des enjeux inter-impérialistes.
Contrairement aux mensonges répandus par la bourgeoisie, la paix, qui a régné en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, ne fut pas la conséquence du processus 'd'unification européenne', de la concorde retrouvée entre les frères ennemis de toujours mais de la conjonction de trois facteurs économiques, politiques et sociaux. Dans un premier temps, le contexte de la reconstruction économique, conjuguée à la régulation keynésiano-fordiste d'après-guerre, permit au capitalisme de prolonger sa survie sans être contraint de recourir à un troisième conflit mondial à brève échéance comme ce fut le cas entre la Première et la Seconde guerre mondiale : après seulement dix années de reconstruction entre 1919 et 1929 éclate la plus grave crise de surproduction en 1929 qui va se prolonger jusqu'à la veille de la guerre. Ensuite, le nouveau contexte de la guerre froide met face à face désormais deux blocs impérialistes continentaux (l'OTAN et le Pacte de Varsovie) avec, respectivement, comme tête de bloc, les Etats-Unis et l'URSS, qui ont pu momentanément déplacer leurs affrontements directs à la périphérie. Ces conflits localisés entre 1945 et 1989 ont néanmoins fait autant de victimes que tous les affrontements de la Seconde guerre mondiale !Enfin, le non embrigadement idéologique du prolétariat, suite à son resurgissement sur la scène historique en 1968, a permis de faire barrage aux velléités guerrières des deux blocs impérialistes au moment où la nécessité d'en découdre devenait de plus en plus pressante face au déploiement de la crise économique.
L'Europe, une coquille vide et une foire d'empoigne au niveau politique
Si l'entente européenne a pu se faire autour d'accords à teneur essentiellement économique (l'OECE- l'Organisation Européenne de Coopération Économique -, la CECA - la Communauté Européenne pour le Charbon et l'Acier -, la PAC - la politique agricole commune -, l'Union douanière, la mise en place de la TVA, le Marché commun, le SME - le Serpent Monétaire Européen -, la monnaie unique, etc.), dans un contexte qui le permettait largement, la mésentente politique fut, en revanche, une constante dans la politique communautaire à commencer par la question allemande au lendemain de la défaite. La France réclame une Allemagne faible et désarmée mais les ÉtatsUnis, en raison des impératifs de la guerre froide, imposeront la reconstitution d'une Allemagne forte, capable de se réarmer, conduisant à la création de la RFA en 1949. En 1954, la France rejettera la ratification de la CED - (Communauté Européenne de Défense) pourtant signée en 1952 par ses cinq partenaires européens sous l'impulsion américaine. Le Royaume-Uni, qui a refusé d'entrer dans la CEE créée en 1957, tente de réaliser une vaste zone de libreéchange comprenant tous les pays de l'OECE, ce qui engloberait le Marché Commun et lui ôterait sa spécificité. Devant le refus français, les britanniques créent, avec d'autres pays européens, l'AELE (l'Association Européenne de Libre Échange) par le traité de Stockholm du 20 novembre 1959. Dès lors, à deux reprises, en 1963 et en 1967, la France rejettera la candidature de la Grande-Bretagne à la CEE car ce pays représente le cheval de Troie des américains. En 1967, la France encore avait pendant six mois provoqué une grave crise en pratiquant la politique de la `chaise vide'... qui débouche sur un compromis permettant à l'Europe de survivre mais moyennant l'instauration de la règle de l'unanimité sur tous les grands dossiers ! Après l'entrée effective de la Grande-Bretagne en janvier 1973, cette dernière ne se privera pas de mettre de fréquents bâtons dans les rouages communautaires sur de multiples dossiers à commencer par la renégociation du traité d'adhésion un an après, des modifications de la PAC, une renégociation de sa contribution financière au budget européen (le fameux '! want my moneo back' de Margareth Thatcher), le refus de participer à la monnaie commune, etc. Enfin, tout récemment, les divergences sur la date d'ouverture des négociations pour une adhésion de la Turquie sont très illustratives des divisions européennes sur le plan des rivalités impérialistes : la France marque franchement son hostilité envers un pays qui a été très proche, soit de l'Allemagne, soit des États-Unis. Ces derniers faisant par ailleurs terriblement pression pour que la Turquie soit acceptée comme future candidate, soit directement via des coups de téléphone présidentiel aux dirigeants européens, soit indirectement via le lobbying de l'Angleterre... avec comme stratégie sous-jacente quasi avouée que plus l'Europe s'élargit, moins elle sera capable d'une intégration politique et surtout d'une politique et d'une stratégie commune sur la scène internationale.
L'absence totale d'une politique extérieure commune et des instruments de cette politique (une armée intégrée), l'absence de budget européen conséquent (à peine 1,27% du PIB de la zone Euro !), àl'image de ce que sont les budgets nationaux, et la place totalement disproportionnée de l'agriculture dans celui-ci (près de la moitié du budget communautaire est consacré à un secteur qui ne représente plus que 4 à 5% de la valeur ajoutée annuelle au niveau européen), etc., tous ces éléments illustrent à suffisance que les attributs fondamentaux d'un véritable État européen supranational sont absents et, quand ils existent, ce sont des avortons sans réel pouvoir, sans aucune autonomie. Ainsi, le fonctionnement politique de la Communauté européenne est carrément une caricature typique du mode de fonctionnement de la bourgeoisie en période de décadence : le parlement est totalement court circuité, le centre de gravité de la vie politique est monopolisé par l'exécutif, le Conseil des ministres, à tel point que la bourgeoisie doit régulièrement s'inquiéter de ce "déficit de légitimité démocratique"!
Ceci n'a pas lieu de nous surprendre dans la mesure où la stratégie européenne sur le plan politique était déjà conditionnée et se heurtait nécessairement aux limites imposées par la discipline du bloc à la tête duquel se trouvaient les États-Unis du temps de la guerre froide. Peu consistante à cette époque, cette stratégie le sera encore moins après l'effondrement du mur de Berlin qui consacre dans les faits la disparition des deux blocs. Depuis, l'Europe n'a pu définir de position commune sur à peu près aucun dossier de politique étrangère. Elle s'est déchirée, voire même les uns et les autres se sont opposés sur les enjeux au Moyen-Orient, lors de la guerre du Golfe, du conflit en Yougoslavie et au Kosovo, etc. Il en va ainsi, et surtout, concernant le projet de constitution d'une armée européenne. Les désaccords entre les bourgeoisies nationales européennes sont très illustratifs des enjeux impérialistes des uns et des autres. Les unes (la France etl'Allemagneparexemple) poussant vers plus d'intégration, compris dans le sens d'une plus grande volonté d'indépendance par rapport aux structures militaires subsistantes de l'OTAN, les autres (l'Angleterre et les Pays-Bas, par exemple), poussant à rester au sein de ces dernières.
L'Europe, un accord essentiellement économique
Si la constitution des États-Unis d'Europe est une illusion, si une réelle unification et intégration européenne sur tous les plans est une chimère, si les origines et le renforcement de l'Europe plongent leurs racines dans les besoins de la guerre froide, à quoi correspondent alors les structures actuelles et les volontés politiques de les renforcer ?
Nous l'avons vu, la naissance et le renforcement del'Europe fut d'abord l'expression de la nécessité de faire front face aux velléités d'expansion du bloc soviétique en Europe. Créée pour les besoins impérialistes du bloc américain et même utile à l'expansion économique de ce dernier, l'Europe (comme le Japon et les Nouveaux Pays Industrialisés([4] [5]) ) est cependant devenue petit à petit un concurrent économique sérieux pour les États-Unis jusqu'à lui tailler des croupières dans certains domaines, y compris de haute technologie (Airbus, Arianespace, etc.). Ceci est une des résultantes de la compétition économique menée par les deux blocs au cours de la guerre froide. Dès lors, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin, l'intégration se fait essentiellement sur le plan économique. Débutant comme une zone de libreéchange intérieure pour les marchandises, puis comme une union douanière vis-à-vis de l'extérieure, ensuite comme un marché commun pour les produits, les capitaux et les travailleurs, l'Europe chapeaute finalement cette intégration en mettant en place des politiques régulatrices au sein de l'Union Économique. Au fur et à mesure de son développement, les objectifs de l'intégration économique sont d'emblée envisagés comme un moyen de renforcer les positions européennes sur le marché mondial. La constitution d'un grand marché permettant des économies d'échelle, devient un tremplin pour le renforcement des entreprises européennes face à leurs concurrentes étrangères, principalement américaines et nipponnes. La mise en place de l'Acte Unique en 1985-86 est d'ailleurs directement née d'un constat globalement négatif sur la situation économique européenne : l'Europe a moins bien que le Japon et les États-Unis, traversé les dix années de crise.
L'Europe face à la décomposition et à l'effondrement des blocs
Depuis le début des années 80, le capitalisme se caractérise par une situation où les deux classes fondamentales et antagoniques de la société se font face et s'opposent sans toutefois que l'une d'entre elles parvienne à pleinement imposer son alternative. Or, encore moins que pour les autres modes de production qui l'ont précédé, il ne peut exister pour le capitalisme de `gel', de `stagnation' de la vie sociale. Alors que les contradictions du capitalisme en crise ne font que s'aggraver, l'incapacité de la bourgeoisie à offrir la moindre perspective pour l'ensemble de la société et l'incapacité du prolétariat à affirmer ouvertement la sienne dans l'immédiat ne peuvent que déboucher sur un phénomène de décomposition généralisée, de pourrissementsur pied de la société. Une série de manifestations non équivoques, dont l'effondrement du bloc de l'Est en 1989 en fut la plus spectaculaire, se sont développées au cours des années 80 qui attestent de l'entrée du mode de production capitaliste dans cette phase ultime de son existence.
Il en va ainsi de l'aggravation considérable des convulsions politiques des pays de la périphérie qui interdisait de façon croissante aux grandes puissances de s'appuyer sur eux dans le maintien de l'ordre régional et les contraignait à intervenir de plus en plus directement dans les affrontements militaires. Un tel constat se basait notamment sur la situation au Liban et surtout en Iran. Dans ce dernier pays, en particulier, on relevait déjà une relative nouveauté par rapport aux situations qu'on pouvait rencontrer auparavant : un pays d'un bloc, et important dans son dispositif militaire, échappait pour l'essentiel à son contrôle sans pour autant tomber, ou même avoir la possibilité de tomber, sous la tutelle de l'autre. Cela n'était pas dû à un affaiblissement du bloc dans son ensemble, ni à une option prise parce pays visant une amélioration de la position de son capital national, bien au contraire, puisqu'une telle politique devait conduire à une catastrophe politique et économique. En fait, l'évolution de la situation en Iran ne correspondait à aucune rationalité, même illusoire, du point de vue des intérêts du capital national, la meilleure illustration en étant l'accession au pouvoir d'une couche de la société, le clergé, qui n'a jamais eu de compétence pour gérer les affaires économiques et politiques du capitalisme. Ce phénomène de la montée de l'intégrisme musulman, et de la victoire de celui-ci dans un pays relativement important, était lui-même une des premières manifestations de la phase de décomposition. Manifestation amplement confirmée depuis lors puisque l'on a assisté au développement de ce phénomène dans plusieurs pays.
Il y avait là une apparition de phénomènes attestant d'un changement qualitatif dans la manifestation des caractéristiques classiques de la décadence du capitalisme.
En effet, toutes les classes dominantes devenues historiquement obsolètes développent une série de mécanismes et de structures pour faire face aux forces qui sapent leur pouvoir (crises économiques et conflits guerriers croissants, dislocation du corps social, décomposition de l'idéologie dominante, etc.). Pour la bourgeoisie ces mécanismes sont le capitalisme d'État, un contrôle de plus en plus totalitaire de la société civile, la soumission des différentes fractions de la bourgeoisie aux intérêts supérieurs de la nation, la constitution d'alliances militaires pour affronter la compétition internationale, etc.
Tant que la bourgeoisie parvient à dominer le rapport de force entre les classes, les manifestations de décomposition, caractéristiques de toute période de décadence d'un mode de production, peuvent être contenues dans certaines limites compatibles avec la survie du système. Dans la phase de décomposition par contre, si ces caractéristiques persistent et s'exacerbent face à la crise généralisée qui se développe, l'incapacité de la classe dominante à imposer ses solutions et la faiblesse de la classe ouvrière à dégager sa propre perspective, laisse le champ libre à toutes les forces déstructurantes sur le plan social et politique, à l'explosion du chacun pour soi : « Toutes les sociétés en décadence comportaient des éléments de décomposition : dislocation du corps .social, pourrissement de ses structures économiques, politiques et idéologiques, etc. Il en a été de même pour le capitalisme depuis le début de sa période de décadence (..) dans une situation historique où la classe ouvrière n'est pas encore en mesure d'engager immédiatement le combat pour sa propre perspective, la seule vraiment réaliste, la révolution communiste, mais où la bourgeoisie, elle non plus, ne peut proposer aucune perspective quelle qu 'elle soit, même à court terme, la capacité que cette dernière a témoignée dans le passé, au cours même de la période de décadence, de limiter et contrôler le phénomène de décomposition ne peut que s'effondrer.sous les coups de butoir de la crise. »(Revue Internationale n° 62 ou 107, "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme"). L'histoire montre que lorsqu'une société s'embourbe dans ses propres contradictions sans pouvoir les résoudre, elle se perd dans un chaos croissant, en combats sans fin entre Seigneurs de la guerre. L'image de la décomposition est celle d'un chaos croissant et du chacun pour soi. En effet, une des expressions majeure de la décomposition du capitalisme réside dans l'incapacité croissante de la bourgeoisie à contrôler la situation politique surtout un ensemble de plans : discipliner ses différentes fractions, discipliner les appétits impérialistes, etc. Bref c'est le règne du chacun pour soi : "Cette incapacité du mode de production capitaliste à proposer la moindre perspective à la société (...) débouche inévitablement et nécessairement sur des tendances croissantes à un chaos généralise, vers une débandade des différentes composantes du corps social dans le chacun pour soi " ("La décomposition, phase ultime...").
La fin des années 80 allait venir confirmer ce diagnostic de façon spectaculaire. L'implosion du bloc de l'Est etdel'URSS, la mort du stalinisme, la menace d'éclatement de la Russie elle-même et, peu après, la guerre du Golfe ont exprimé au plus haut point ces caractéristiques inéquivoques d'une phase de décomposition d'un mode de production que sont l'explosion du chacun pour soi, la déstructuration de la cohésion sociale et le chaos croissant.
C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la réorientation de la politique européenne au cours des années 90. La direction essentiellement économique que l'intégration européenne avait prise jusqu'alors opère un tournant nettement plus politique après l'effondrement du mur de Berlin. Dès décembre 1989, le sommet de Strasbourg accélère le processus de mise en place de l'Eure, et invite les pays de l'Est à la table des négociations. Immédiatement, une claire option est prise en direction de futures adhésions et les moyens matériels de celles-ci sont immédiatement mis en place : constitution de la BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) en mai 1990, investissements dans divers domaines, programmes de coopération, etc. Le caractère essentiellement géostratégique de cet élargissement de l'Europe vers l'Est est clairement attesté par le fait que le gain économique de l'opération pourrait s'avérer nul, voire négatif, comme le fut l'intégration de l'Allemagne de l'Est pour la RFA. Ainsi, la moyenne du PIB par habitant des dix pays candidats n'atteint même pas la moitié de celui de l'Europe des quinze. L'intégration commerciale est profondément asymétrique. Alors que 70% des exportations des PECO (Pays d'Europe Centrale et Orientale) sont destinés à l'Union européenne, celle-ci ne compte sur leurs achats que pour 4% de ses exportations. Les pays de l'Est sont donc extrêmement sensibles à la conjoncture des pays d'Europe occidentale, alors que la réciproque n'est pas vraie. Élément de vulnérabilité supplémentaire, ces échanges se soldent par un déficit courant structurel dans tous les PECO, ce qui les rend très dépendants des entrées en capitaux étrangers. L'emploi a baissé de 20% dans la région depuis 1990 et nombre de pays se débattent encore dans de graves difficultés économiques.
En réalité les raisons véritables sont à chercher ailleurs. La première est clairement impérialiste. Elle est constituée par l'enjeu du partage des dépouilles du défunt bloc de l'Est. La seconde découle des conséquences de la décomposition elle-même : il était vital pour l'Europe de recréer un cordon de relative stabilité à ses frontières orientales afin de faire barrage à la contagion du chaos économique et social que représentait l'implosion du bloc de l'Est. Dans cette perspective, il est significatif que les principaux pays adhérents soient économiquement les moins pauvres et géographiquement les plus proches de l'Europe de l'Ouest (Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie) et que les trois pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) ferment un peu plus l'accès de la Russie à la mer Baltique. En effet, il y a superposition de deux enjeux impérialistes. D'une part, l'Europe, avec l'Allemagne en tête, dispute aux États-Unis les dépouilles du défunt bloc de l'Est. Pour la Communauté européenne l'objectif est de ramener le plus possible de pays d'Europe centrale et orientale dans son giron, y compris, à terme, la Russie elle-même, aujourd'hui bien ancrée dans la sphère d'influence américaine mais dont le premier partenaire commercial est l'Allemagne. Mais, d'autre part, la France est aussi intéressée à ce que l'expansion à l'Est soit le fait de l' Europe et non d'une Allemagne autonome qui retrouverait ses vieux réflexes d'entre-deux guerres. Cette dernière acceptant d'autant mieux cette stratégie qu'elle peut de la sorte avancer ses prétentions impérialistes de façon masquée tant qu'elle n'est pas encore prête à ouvertement assumer le rôle de leadership d'un nouveau bloc impérialiste opposé aux États-Unis.
La significationde la mise en place de l'Euro
C'est dans ce contexte de phase de décomposition et d'effondrement des blocs impérialistes qu'il faut comprendre la mise en place de la monnaie unique. Quatre raisons fondamentales en sont à la base :
1) La première est d'ordre géostratégique et impérialiste. Les bourgeoisies française et allemande ont intérêt à sauvegarder l'alliance franco-allemande face à l'éclatement des tendances au chacun pour soi découlant des divergences d'intérêts impérialistes. D'un côté, les français ont peur d'une Allemagne unifiée disposant d'un champ d'expansion à l'est dont la France n'a aucun équivalent. Cette dernière a fait en sorte que la monnaie est-européenne ne soit pas le Deutsche Mark, ce qui aurait eu tendance à l'exclure de cette zone au niveau économique. De l'autre, la politique de l'Allemagne depuis 1989 est d'avancer à l'ombre de l'Europe afin de masquer ses propres intérêts impérialistes. Elle a donc tout intérêt à associer la France et les autres pays européens de second ordre à sa politique d'expansion. Il est devenu maintenant banal d'entendre au sein de la bourgeoisie allemande la réflexion suivante que « l'Allemagne à réussi économiquement ce que Hitler avait voulu faire par la guerre » !
2) La deuxième raison s'explique par la nécessité de résister aux forces déstructurantes de la crise largement amplifiées par les phénomènes propres à la phase de décomposition. En instaurant l' Euro, l'Europe s'évite les déstabilisations spéculatives dont elle a plusieurs fois souffert de par le passé (spéculation sur la Lire, la Livre Sterling qui ont dû quitter le SME, etc.). En créant une assiette monétaire beaucoup plus stable face au dollar et au Yen elle tente de se mettre à l'abri du chacun pour soi monétaire qui exerce dès lors ses ravages essentiellement au sein des pays de la périphérie. La mise en place du SME (Serpent Monétaire Européen) en 1979 allait déjà dans ce sens. Ceci constitue une des différences majeure d'avec la crise de 29 dont les États-Unis d'abord et les pays européens ensuite subirent l'essentiel des conséquences. Alors que lors des années 30 et aujourd'hui la crise de surproduction trouve ses racines au sein des pays capitalistes développés, ces derniers parviennent jusqu'à présent à en reporter les effets majeurs sur la périphérie. Sur ce plan, contrairement à celui des tensions inter-irnpérialistes où les forces centrifuges échappent à toute discipline, la bourgeoisie est encore capable d'un minimum de coopération sur ce qui fait l'essence même de sa domination en tant que classe : l'extorsion du surtravail. Ainsi, dans le domaine économique, la classe dominante a pu se coordonner, contrairement aux années 30, pour tempérer les krachs à répétition et limiter les effets les plus dévastateurs de la crise et de la décomposition.
3) La troisième raison est d'ordre économique et impérialiste à la fois. Toutes les bourgeoisies européennes désirent une Europe forte capable de faire front à la concurrence internationale et particulièrement américano-japonaise. Ce besoin se fait d'autant plus sentir que les pays européens veulent pouvoir ramener les pays d'Europe centrale, y compris même la Russie, dans leur giron, ce qui serait beaucoup plus difficile en cas de dollarisation de la région.
4) La quatrième est d'ordre strictement technique : elle permet d'économiser les coûts de transaction entre devises et de supprimer les incertitudes liées aux changes entre monnaies flottantes (assurances contre les fluctuations monétaires). L'essentiel des échanges commerciaux des pays d'Europe se faisant avec d'autres pays européens, le maintien de monnaies nationales différentes représentait un facteur d'alourdissement des coûts de production face aux États-Unis et au Japon. Le passage à la monnaie unique était en quelque sorte le prolongement naturel de l'intégration économique. Il y avait de moins en moins d'arguments économiques pour maintenir des monnaies nationales différentes dans un marché avec une fiscalité et des réglementations largement unifiées.
L'Europe base d'un nouveau bloc impérialiste ?
Née comme avant poste du bloc impérialiste américain en Europe, la CEE est progressivement devenue une grande entité économiquement concurrente aux ÉtatsUnis mais toujours politiquement dominée et soumise à ceux-ci durant toute la période de la guerre froide jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin. Au lendemain de la disparition des deux blocs impérialistes en 1989, 1'Europe est à nouveau au centre des convoitises des uns et des autres mais, depuis lors, la configuration et les intérêts géostratégiques des différents impérialismes poussent assez paradoxalement non dans le sens d'une dislocation mais d'une plus grande intégration de l'Europe !
Sur le plan économique, toutes les bourgeoisies européennes se retrouvent derrière le projet de constitution d'un grand marché unifié qui puisse tenir tête à la concurrence américano-japonaise.. Au niveau de la défense de ses intérêts impérialistes, nous avons vu que chacune des trois plus grandes puissances en son sein y joue sa propre carte, antagonique à celle des deux autres. Enfin, les américains eux mêmes poussent à l'élargissement de l'Europe, comprenant parfaitement qu'au plus elle s'élargit à des composantes aux intérêts et orientations impérialistes hétérogènes au moins elle sera capable de jouer un rôle quelconque sur la scène internationale !
A bien y regarder nous comprenons, dès lors, que la poursuite de l'actuelle intégration européenne ne peut faire illusion! Chaque composante ne participe au processus qu'en fonction de ses propres intérêts et calculs impérialistes du moment. Le consensus pour un élargissement de l'Union européenne est structurellement fragile car il repose sur des bases très hétérogènes et divergentes qui pourraient céder le pas à la faveur d'un changement de la configuration des rapports de force sur la scène internationale. Aucune des raisons, en tout ou en partie, qui fondent l'existence de l'Europe aujourd'hui ne justifie que l'on puisse conclure qu'elle forme d'ores et déjà un bloc impérialiste rival au bloc américain. Plus fondamentalement, quelles sont les raisons majeures qui ne nous permettent pas de tirer une telle conclusion ?
1) A l'opposé d'une coordination économique basée sur un contrat entre États bourgeois souverains comme l'est l'Europe aujourd'hui, un bloc impérialiste est un corset de fer imposé sur un groupe d'États par la suprématie militaire d'un pays leader et accepté du fait de la volonté commune de résister à la menace adverse ou de détruire l'alliance militaire opposée. Les blocs de la guerre froide n'ont pas surgi à travers de longs accords négociés comme pour l'Union européenne : ils ont été le résultat du rapport de force militaire établi sur le terrain au lendemain de la défaite allemande. Le bloc de l'Ouest est né parce que l'Europe occidentale et le Japon étaient occupés par les États-Unis et le bloc de l'Est est né suite à l'occupation de l'Europe de l'Est par l'armée rouge. De même, le bloc de l'Est ne s'est pas effondré à cause d'une modification de ses intérêts économiques et de ses alliances commerciales, mais parce que le leader, qui en assurait la cohésion par la force et par le sang, n'a plus été en mesure d'envoyer ses chars pour la préserver comme lors des révoltes en Hongrie 1956 ou en Tchécoslovaquie 1968. Le bloc de l'Ouest est mort tout simplement parce que l'ennemi commun avait disparu, et avec lui le ciment qui faisait sa cohésion. Un bloc impérialiste n'est jamais un mariage d'amour mais toujours un mariage de raison. Comme l'a écrit un jour Winston Churchill, les alliances militaires ne sont pas le produit de l'amour mais de la peur : la peur de l'ennemi commun.
2) Plus fondamentalement, l'Europe n'a historiquement jamais constitué un bloc homogène et a toujours été un terrain de convoitise où les uns et les autres se sont entre-déchirés : "L'Europe et l'Amérique du Nord sont les deux centres principaux du capitalisme mondial. Les États-Unis, en tant que puissance dominante de l’Amérique du Nord, étaient destinés par leur dimension continentale, par leur situation à une distance de sécurité des ennemis potentiels en Europe et en Asie et par leur, force économique, à devenir la puissance leader dans le monde.
Au contraire, la position économique et stratégique de l'Europe l’a condamnée à devenir et à rester le principal foyer de tensions impérialistes dans le capitalisme décadent. Champ de bataille principal dans les deux guerres mondiales et continent divisé, par le "rideau de fer " pendant la Guerre froide, 1'Europe n'a jamais constitué une unité et sous le capitalisme elle ne la constituera pas.
A cause de son rôle historique comme berceau du capitalisme et de sa situation géographique comme demi-péninsule de l'Asie s'étendant jusqu'au nord de l 'Afrique, l'Europe au 20e siècle est devenue la clé de la lutte impérialiste pour la domination mondiale. En même temps, entre autres à cause de sa situation géographique, l'Europe est particulièrement difficile à dominer sur le plan militaire. La Grande-Bretagne, même au temps où elle "régnait sur les mers", a dû se débrouiller pour surveiller l'Europe à travers un svstéme compliqué de "rapports de forces ". Quant à l 'Allemagne sous Hitler, même en 1941, sa domination du continent était plus apparente que réelle, dans la mesure oir la Grande-Bretagne, la Russie et l 'Afrique du Nord étaient entre des main ennemies. Même les États-Unis, au plus fort de la Guerre , froide, n 'ont jamais réussi à dominer plus de la moitié du continent. Ironiquement, depuis leur "victoire " sur l'URSS, la position des États-Unis en Europe s'est considérablement affaiiblie, avec la disparition de "l'Empire du Mal ". Bien que la superpuissance mondiale maintienne une présence militaire considérable sur le vieux continent, l'Europe n'est pas une zone sous-développée qui peut être contrôlée par une poignée de baraquements de GI’s : des pays industriels du G7 sont européens (...) si l'Europe est le centre des tensions impérialistes aujourd'hui, c'est surtout parce que les principales puissances européennes ont des intérêts militaires divergents. On ne doit pas oublier que les deux guerres mondiales ont commencé d'abord comme des guerres entre les puissances européennes, tout comme les guerres des Balkans dans les années 1990. " (Revue Internationale n°98, "Rapport sur les conflits impérialistes" pour le 13e congrès du CCI).
3) Le marxisme a déjà mis en évidence que les conflits et intérêts inter-impérialistes ne recoupent pas nécessairement les intérêts économiques. Si les deux guerres mondiales ont bel et bien opposé deux pôles pouvant prétendre à l'hégémonie sur le plan économique, ce ne fut pas le cas lors de la guerre froide puisque le bloc de l'Ouest regroupait l'ensemble des grandes puissances économiques face à un bloc de l'Est qui n'a jamais pu tenir la distance sur ce plan et qui tirait sa force de la seule puissance atomique de l'URSS car sa puissance militaire était elle aussi toute relative. L'Euroland illustre parfaitement que les intérêts stratégiques impérialistes et le commerce mondial des États-nations ne sont pas identiques. La France et l'Allemagne, qui sont les deux nations qui constituent le moteur de l'Europe, se sont fait la guerre par trois fois en 150 ans et, depuis Napoléon, la Grande-Bretagne a toujours cherché à entretenir les divisions au sein de l'Europe continentale : "L'économie des Pays-Bas par exemple est fortement dépendante du marché mondial en général et de l'économie allemande en particulier. C'est la raison pour laquelle ce pays a été l’un des plus chauds partisans au sein de l'Europe de la politique allemande envers une monnaie commune. Au niveau impérialiste au contraire, la bourgeoisie néerlandaise, précisément à cause de sa proximité géographique avec l'Allemagne, s'oppose aux intérêts de son puissant voisin chaque fois qu'elle le peut, et elle constitue un des alliés les plus loyaux des États-Unis sur le continent. Si "l'Euro" était d'abord et avant tout une pierre angulaire d'un futur bloc allemand, La Haye serait la première à s’y opposer. Mais en réalité, la Hollande, la France et d'autres pays qui craignent la résurgence impérialiste de lAllemagne soutiennent la monnaie unique précisément parce qu'elle ne menace pas leur sécurité nationale, c'est-à-dire leur souveraineté militaire."(Revue Internationale n°98, "Rapport sur les conflits impérialistes" pour le 13e congrès du CCI). Compte tenu des rivalités impérialistes qui existent entre les pays européens eux-mêmes et compte tenu du fait que l'Europe aujourd'hui est au coeur même des tensions inter-impérialistes au niveau planétaire, il est peu réaliste de soutenir que le seul intérêt économique puisse souder les uns et les autres. Ceci est d'autant plus vrai que si l'Europe s'est intégrée sur le plan économique, c'est très loin d'être le cas sur le plan politique et ce ne l'est pas du tout sur le terrain militaire et en matière de politique étrangère. Dès lors comment peut-on soutenir que sans les deux attributs majeurs de ce qui constitue un bloc impérialiste, à savoir une armée et une stratégie impérialiste, l'Euroland constituerait déjà le bloc impérialiste rival au bloc américain ? La réalité démontre chaque jour, dans les faits, qu'une Europe unie est une utopie, comme l'attestent en particulier les dissensions qui traversent ces pays et leur incapacité à influencer le règlement des conflits internationaux, même ceux se déroulant aux portes même de l'Europe comme en Yougoslavie.
[1] [6] Lire à ce propos notre brochure Nation ou classe.
[2] [7] Lire nos Thèses sur « La décomposition. phase ullime de In décadence du capitalisme » dans la Revue Internationale n°107.
[3] [8] Lire "l'impossible unité de l'Europe" dans la Revue Internationale n°73.
[4] [9] Lire « Les 'dragons' asiatiques s'essoufflent » dans la Revue Internationale n°89.
Géographique:
- Europe [10]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Correspondance avec l'UCI (Russie) : Comprendre la décadence du capitalisme
- 2813 reads
Nous publions ci-dessous une lettre reçue du groupe UCI (Union Communiste Internationaliste) de Russie[1] Cette lettre est elle-même une réponse à une lettre que nous avons envoyée à ce groupe précédemment ; elle contient de nombreuses citations de notre lettre qui apparaissent en italiques.
chers camarades
Nous nous excusons de ne pas avoir pu répondre plus tôt. Nous sommes un petit groupe et avons énormément de travail, en particulier un grand volume de correspondance, d'autant plus que les étrangers ne nous écrivent pas en russe.
Concernant la plate-forme, il semble qu'il y ait beaucoup de points d'accord sur des positions clefs: la perspective : socialisme ou barbarie, la nature capitaliste des régimes staliniens, la reconnaissance du caractère prolétarien de la Révolution russe de 1917.
Tout n'est pas si simple. En Russie, en 1917, deux crise étaient imbriquées: une crise interne, qui pouvait conduire à une révolution démocratique bourgeoise, et une crise à l'échelle internationale qui avait mis à l'ordre du jour une tentative de révolution socialiste mondiale. D'après Lénine, la tâche du prolétariat de Russie était de prendre l'initiative dans ces deux révolutions: prendre la tête de la révolution bourgeoise en Russie et, simultanément, en s'appuyant sur cette révolution, étendre la révolution socialiste à l'Europe et aux autres pays. C'est pourquoi nous considérons comme incorrect de poser la question de la nature de la révolution russe sans spécifier de laquelle des deux on parle: l'interne ou l'internationale. Mais il est certain qu'en Russie, le prolétariat était à la tête des deux.
Ce dont nous sommes moins sûrs est si vous êtes d'accord avec le CCI sur le cadre historique qui donne substance et cohérence à beaucoup de ces positions: le concept de décadence et de déclin du capitalisme comme système social depuis 1914.
Il est certain que nous ne sommes pas d'accord sur ce point. La transition d'un système économique vers un système de plus haut niveau est le résultat d'un développement du premier et non de sa destruction. Si le vieux système a épuisé ses ressources, il entraîne une crise constante dues aux forces sociales aspirant à un nouveau système. Ce qui n'est pas le cas. De plus, depuis des décennies, le capitalisme est, de façon relativement stable, en développement, ce qui n'a pas entraîné de développement des forces révolutionnaires, mais au contraire leur effondrement. Le capitalisme se développe à un tel point qu'il ne se contente pas de créer qualitativement de nouvelles forces productives, mais aussi de nouvelles formes de capitalisme. L'étude de ce développement et de ces nouvelles formes permet de déterminer quand surviendra une nouvelle crise, comme celle de 1914-1945, et sous quelle forme s'effectuera la transition vers le socialisme. La théorie de la décadence nie le développement du capitalisme et rend donc impossible son étude, nous laissant tels des rêveurs obnubilés par l'avenir radieux de l'humanité.
Quant aux destructions, à la guerre et à la violence, ce ne sont pas que parties intégrantes du capitalisme, mais une nécessité de son 'existence, à la fois à l'époque de Marx et au 20ème siècle.
Pour donner une illustration précise du problème que nous soulevons: dans votre déclaration, vous prenez position contre les "fronts communs" avec la bourgeoisie, sur la base que toutes les fractions de la bourgeoisie sont également réactionnaires. Ce en quoi nous sommes d'accord. Mais cette position n'a pas été toujours valide pour les marxistes. Si, aujourd'hui, le capitalisme est un système décadent, c'est à dire que les relations sociales y sont devenues une entrave au développement des forces productives et donc au progrès de l'humanité, il a connu, comme les autres systèmes d'exploitation de classes, une phase ascendante, où il représentait un progrès par rapport au mode de production précédent. C'est pourquoi Marx soutenait certaines fractions de la bourgeoisie, que ce soit les capitalistes du Nord contre les esclavagistes du Sud, durant la Guerre de Sécession, le mouvement du Risorgimento en Italie, pour l'unité nationale contre les vieilles classes féodales, etc. Ce soutien était basé sur la compréhension que le capitalisme n'avait pas encore accompli sa mission historique et que les conditions pour la révolution communiste mondiale n'étaient pas encore suffisamment mûres.
Historiquement parlant, par rapport à son combat contre la bourgeoisie, le parti prolétarien a considéré toutes les fractions de la bourgeoisie comme étant réactionnaires. Mais ce n'est pas uniquement quand le capitalisme avait encore des possibilités de développement qu'on pouvait dire si telle ou telle fraction de la bourgeoisie était progressiste, encore fallait-il qu'elle fût capable d'accomplir sa tâche historique. C'est pourquoi, par exemple, la bourgeoisie russe, incapable de conduire la révolution bourgeoise, peut être considérée comme réactionnaire en 1917, alors que les transformations démocratiques et bourgeoises que pouvait accomplir la révolution russe pouvaient être considérées comme progressistes. Aujourd'hui, nous confirmons qu'aucune fraction bourgeoise n'est capable d'effectuer de telles transformations sans une guerre mondiale qui entraînerait l'humanité entière. Pour cette raison, soutenir une telle fraction n'a aucun sens. Mais ça ne signifie pas que la bourgeoisie n'a plus de tâche à accomplir. La suppression des frontières et la création du marché mondial sont des tâches bourgeoises, mais on ne peut faire confiance à la bourgeoisie pour les accomplir. Ce sera au prolétariat à les accomplir, en utilisant la crise future et en s'en servant pour construire le socialisme. En clair, savoir si le capitalisme peut encore accomplir des tâches historiques et si les fractions de la bourgeoisie sont réactionnaires, sont deux questions distinctes. C'est pourquoi le prolétariat devrait toujours prendre l'initiative révolutionnaire. Et s'il s'agit de tâches bourgeoises, il peut, par une extension du mouvement (révolutionnaire), les transformer en tâches socialistes. Nous considérons que cette approche est marxiste.
D'après vous, les luttes nationales ont été une source considérable de progrès, et la demande d'autodétermination est toujours valide, ne serait-ce que pour les ouvriers des pays capitalistes les plus puissants, par rapport aux pays opprimés par leur propre impérialisme. Il semble alors que d'après vous, les luttes nationales aient perdu leur caractère progressiste depuis la venue de la "globalisation". Ces affirmations appellent un certain nombre de commentaires de notre part.
La notion de décadence, qui est notre position, n'a pas été inventée par nous. Basée sur les fondements de la méthode matérialiste historique (en particulier quand Marx parle " des époques de révolution sociale" dans sa "Préface à la Critique de l'Economie politique"), elle s'est concrétisée, pour la majorité des révolutionnaires marxistes, par l'éclatement de la 1ère guerre mondiale, qui a montré que le capitalisme était déjà "globalisé", au point qu'il ne pouvait plus surmonter ses contradictions internes que par la guerre impérialiste et l'auto-cannibalisme (1). Ce fut la position de l'Internationale Communiste à son congrès fondateur, bien que celle-ci n'ait pas été capable d'en tirer toutes les conséquences, pour ce qui concernait la question nationale: les thèses du second congrès conféraient toujours un rôle révolutionnaire a certaines bourgeoisies des pays soumis à un régime colonial. Mais les fractions de gauche de l'IC on été capables, plus tard, de tirer les conclusions de cette analyse, en particulier après les résultats désastreux de la politique de l'IC durant la vague révolutionnaire de 1917-1927. Pour la Gauche italienne dans les années 1930, par exemple, l'expérience de la Chine en 1927 a été décisive. Elle a montré que toutes les fractions de la bourgeoisie, même si elles se proclamaient anti-impérialistes, ont été amenées à massacrer le prolétariat quand celui-ci combattait pour ses intérêts propres, comme lors du soulèvement de Shanghai en 1927. Pour la Gauche italienne, cette expérience a prouvé que les thèses du deuxième congrès devaient être rejetées. De plus, ceci fut une confirmation de la justesse des vues de Rosa Luxemburg sur la question nationale contre celles de Lénine: pour Luxemburg, il était devenu clair, durant la 1ère guerre mondiale, que tous les états faisaient inévitablement partie du système impérialiste mondial.
C'est tout un ensemble de différentes questions qui sont mélangées là. D'abord, la politique du Komintern de Staline et de Boukharine durant la révolution chinoise de 1925-27, est complètement différente de celle de Lénine et des Bolcheviks, qui a été déterminante au cours des premières années du Komintern. Pour vous, s'il y a des tâches bourgeoises à accomplir, on est amené à soutenir telle ou telle fraction. C'est comme ça que parlaient Staline et les Mencheviks. La méthode de Marx et de Lénine ne consiste pas à refuser ces tâches du moment, alors que toutes les fractions de la bourgeoisie sont réactionnaires, mais de les accomplir au moyen de la révolution prolétarienne, essayant d'effectuer au maximum ces tâches bourgeoises et de continuer par des tâches socialistes.
La révolution chinoise a prouvé que cette approche était correcte, et non pas celle de la Gauche communiste.
La révolution bourgeoise a triomphé en Chine, en faisant d'innombrables victimes. Cette révolution a permis de créer le prolétariat le plus nombreux au monde et de développer rapidement de puissantes forces productives. Ce même résultat a été atteint par des dizaines d'autres révolutions dans les pays d' Orient. Cela n'a aucun sens de nier leur rôle historiquement progressiste: par là, notre révolution dispose de bases solides dans de nombreux pays du monde, qui, en 1914, étaient essentiellement agricoles.
Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque de ce début de "globalisation"? Les révolutions nationales ne sont plus à l'ordre du jour. D'après vous, voilà bien longtemps que le capitalisme a un caractère global. Oui, nous pouvons dire qu'il a un tel caractère depuis ses origines, depuis l'époque des grandes découvertes. Mais le niveau de cette "globalisation" était qualitativement différent. Jusque vers les années 1980, les révolutions nationales pouvaient assurer une croissance des forces productives, c'est pourquoi il fallait les soutenir et essayer, dans la mesure du possible, de transférer leur direction dans les mains du prolétariat révolutionnaire. Il en était ainsi car il existait une possibilité objective de développement sous l'impulsion de l'état national. Maintenant, ce stade de développement national est finalement dépassé... Et ceci est valable pour tout état, même les plus avancés. C'est pourquoi les réformes entreprises par Reagan ou Thatcher, qui auraient pu conduire à de terribles crises dans les années 1950-1960, ont donné, relativement et temporairement, des résultats positifs. Car ces réformes ont conduit l'économie de leur pays vers plus de "globalisation" (au sens moderne du terme).
Maintenant, le combat national a perdu son caractère progressiste car il a épuisé sa tâche historique: l'état national, qui, même si la révolution triomphe sous la direction du prolétariat, n'offre plus de cadre à un développement futur. Ceci ne signifie pas pour autant que partout les tâches bourgeoises ont disparu. Il y a encore des pays avec des régimes féodaux, il y a encore des nations opprimées. Mais ce n'est pas une révolution nationale qui peut y mettre fin. Pour le prolétariat des pays arriérés, le chapitre des révolutions nationales est clos, elles ne peuvent donner de résultat si elles ne conduisent pas directement ou indirectement à la révolution internationale prolétarienne. C'est pour cette raison que nous disons qu'avec le début de la globalisation, les révolutions nationales ont perdu toute signification progressiste.
De la même manière, le soutien à un mouvement de libération national n'a de sens, à la fois hier et aujourd'hui, qu'en arrachant le combat contre l'oppression nationale des mains de la bourgeoisie et en le transférant au prolétariat. C'est à dire en transformant un mouvement d'indépendance nationale en un moment de la révolution socialiste mondiale. Ceci ne peut se faire en ne reconnaissant pas le droit des nations à l'autodétermination, donc en ne reconnaissant pas la nécessité de mener à leur terme les tâches historiques de la bourgeoisie. Sinon, nous laisseront le prolétariat sous la domination de sa bourgeoisie nationale.
L'approche léniniste de ce problème a entraîné un vaste intérêt pour le marxisme parmi un grand nombre d'habitants des pays arriérés, par la manière correcte dont la question nationale a été posée. Et ce n'est pas la faute des Bolcheviks si la bureaucratie stalinienne s'est emparée de la direction du Komintern. Seule la révolutionr dans les pays occidentaux aurait pu empêcher ça, mais elle n'a pas eu lieu car le capitalisme n'avait pas épuisé ses possibilités historiques. Les deux guerres mondiales lui ont permis d'étouffer ses contradictions.
Maintenant que ses contradictions ont crû, pour bien comprendre pourquoi elles vont conduire à de nouvelles crises, il est nécessaire d'étudier le développement du capitalisme au lieu de se contenter de répéter qu'il est en déclin et en décomposition. En Russie, cette thèse déclenche de méchants sarcasmes, après les décennies au cours de laquelle la bureaucratie stalinienne nous a rebattu les oreilles avec le capitalisme "pourrissant".
Soutenir une nation contre une autre a toujours signifié soutenir un bloc impérialiste contre un autre, et toutes les guerres de libération nationale du 20ème siècle l'ont prouvé. Ce que la Gauche italienne a clairement exprimé, est que ceci s'appliquait aussi aux bourgeoisies coloniales, aux fractions capitalistes cherchant à créer un nouvel état "indépendant": elles ne pouvaient espérer atteindre leur but qu'en se subordonnant à un des pouvoirs impérialistes qui avaient déjà divisé la planète. Comme vous le dites dans votre plate-forme, le 20ème siècle n'a été qu'une suite incessante de guerres impérialistes pour la domination de la planète: pour nous, c'est à la fois la confirmation la plus sûre que le capitalisme est un ordre mondial sénile et réactionnaire, et aussi que toutes les formes de luttes "nationales" sont entièrement intégrées dans le jeu impérialiste global.
Ici encore : 1)"les guerres continuelles": elles ont accompagné le capitalisme à n'importe quel stade de son développement et ne sont pas une preuve de son progrès ni de son déclin; 2) la croissance des forces productives et du nombre de prolétaires dans les pays du Tiers-monde a montré sans équivoque le caractère progressiste des révolutions nationales bourgeoises jusque vers le milieu des années 1970; 3) le but du soutien à ces mouvements n'était pas de "soutenir une nation contre une autre" mais d'attirer vers le parti de la révolution les ouvriers et en premier lieu, de favoriser le développement du prolétariat dans ces pays.
Rosa Luxemburg a fait une critique sans concession du slogan d'"autodétermination nationale" même avant la 1ère guerre mondiale, avançant comme argument que c'était une illusion de la démocratie bourgeoise: dans tout état capitaliste, ce n'est ni le "peuple" qui "s'autodétermine", ni la "nation", mais seulement la classe capitaliste. Pour Marx et Engels, ce n'était pas un secret que quand ils appelaient à l'indépendance nationale, ce n'était que pour soutenir le développement du mode de production capitaliste, dans une période où le capitalisme avait encore un rôle progressiste à jouer.
Pas plus que Marx, nous ne cachons pas le fait que les révolutions nationales n'ont un caractère progressiste que du point de vue du développement du capitalisme (...)
Congratulations fraternelles
ICU
Notre réponse
Dans une série d’articles que nous avons écrits à la fin des années 80 et début 90 pour défendre l’idée que le capitalisme est un système social en déclin, nous remarquions que “plus le capitalisme s’enfonce dans la décadence, plus il montre sa décomposition avancée, plus la bourgeoisie a besoin de nier la réalité et de promettre au monde un futur brillant sous le soleil du capital. C’est l’essence des campagnes actuelles en réponse à l’effondrement bien visible du stalinisme : le seul espoir, le seul futur, c’est le capitalisme. (“ La domination réelle du capital et les confusions réelles du milieu prolétarien ”, Revue Internationale N°60, hiver 90)
Il n’y a rien de surprenant à ce que la bourgeoisie nie la faillite inévitable de son système social ; plus proche est sa mort, plus on s’attend bien sûr à ce qu’elle s’éloigne de la vérité et se replie sur des fantasmes. Après tout, c’est une classe exploiteuse et aucune classe exploiteuse n’a été capable de faire face à la vérité qu’elle est une classe exploiteuse, encore moins quand ses jours sont comptés historiquement. Si quelques-uns de ses représentants finissent par admettre sa fin prochaine, aucun parmi eux n’envisage un monde humain au-delà de la domination du capital sans tomber dans des visions d’un passé mythique ou d’un futur messianique.
On attend mieux, bien sûr, de ceux qui disent parler au nom du prolétariat exploité et attendre une révolution communiste. Cependant, nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir idéologique du système dominant, sa capacité à dévoyer et trafiquer tout effort tendu vers une compréhension claire et lucide de la situation réelle et des perspectives pour l’ordre mondial actuel. Il y a vraiment trop d’exemples de ceux qui ont perdu de vue les prémisses théoriques fondamentales du mouvement communiste telles que Marx et Engels les ont pour la première fois mises dans un cadre en termes scientifiques, de ceux qui ont perdu confiance dans l’affirmation que le capitalisme, comme les autres systèmes qui l’ont précédé, n’est qu’une phase transitoire dans l’évolution historique de l’humanité, voué à disparaître du fait de ses propres contradictions intrinsèques. C’est un phénomène que nous avons observé dans les années 80 et – comme nous l’avons souligné dans la première partie de cet article dans la Revue Internationale n°111 – que nous voyons encore plus explicitement aujourd’hui. Plus le capitalisme pourrit, plus il passe du simple déclin à une désintégration complète, plus nous voyons de ceux qui, dans et autour du mouvement révolutionnaire, vont dans tous les sens, cherchant désespérément quelque “nouvelle” découverte qui cacherait l’horrible vérité. Le capitalisme en décomposition ? Non, non, il se restructure ! Le capitalisme dans une impasse ? Mais alors et Internet, la globalisation, les dragons d’Asie… ?
C’est l’atmosphère générale de confusion dans laquelle surgissent les nouveaux courants prolétariens en Russie et dans l’ex-URSS. Comme nous l’avons souligné dans l’article précédent, malgré leurs différences, tous semblent avoir de la difficulté à accepter la conclusion sur laquelle s’était fondée l’Internationale Communiste et qui constituait le socle du travail de la gauche communiste, la conclusion selon laquelle le capitalisme mondial a été en déclin historique ou décadence, depuis la première guerre mondiale.
Comme nous l’avons dit dans le dernier article, nous allons nous focaliser sur les arguments des camarades de l’Union Communiste Internationale dans cette discussion. Voilà comment ils présentent leurs arguments contre la notion de décadence :
“La transition vers une forme économique supérieure est le résultat du développement de la forme antérieure, pas de sa destruction. Si l’ancienne formation était épuisée, il s’ensuivrait constamment des crises sociales et des forces sociales aspirant à mettre en place la nouvelle forme. Cela ne se produit pas. De plus, pendant plusieurs décennies, le capitalisme a connu une stabilité relative de son développement, pendant lesquelles les forces révolutionnaires non seulement n’ont pas grandi, mais au contraire, se sont émiettées. .. Et (le capitalisme) se développe réellement, non seulement en créant de nouvelles forces productrices qualitativement, mais en créant aussi de nouvelles formes de capitalisme. L’étude de ce développement peut donner la réponse quand viendra une nouvelle crise, telle que la crise de 1914-45, et de là, quelles pourraient être les formes de transition au socialisme. La théorie de la décadence nie le développement du capitalisme et rend impossible son étude, nous laissant comme de simples rêveurs ayant la foi dans le brillant futur de l’humanité ” (Lettre au CCI, février 20, 2002).
Les camarades ont ici sans aucun doute à l’esprit les arguments de Marx dans sa fameuse Préface à la critique de l’économie politique dans laquelle il traite des conditions matérielles de la transition d’un mode de production à un autre, disant que “jamais une société n’expire avant que ne soient développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir ; jamais des rapports supérieurs de production ne se mettent en place avant que les conditions matérielles de leur existence ne soient écloses dans le sein même de la vieille société ”.[2]
Naturellement, nous sommes d’accord ici avec les arguments de Marx, mais nous ne pensons pas qu’il voulait dire que cela impliquait qu’une nouvelle société ne pouvait surgir de l’ancienne tant que les toutes dernières innovations techniques ou économiques n’aient été développées. Une telle vision pourrait sembler compatible avec les modes de production antérieurs dans lesquels les découvertes techniques se faisaient à un rythme très lent ; ce serait difficilement possible dans le capitalisme qui ne peut vivre sans développer constamment, sinon quotidiennement, son infrastructure technologique. Le problème ici est que l’UCI semble se référer à ce passage sans avoir assimilé la partie qui précède, dans laquelle Marx souligne les préconditions de l’ouverture d’une période de révolution sociale, qui est la clef de notre compréhension de la décadence du capitalisme, de son époque de guerre et de révolution, comme l’a dit L’IC. Nous nous référons au passage dans lequel Marx dit que “à un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existant, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles avaient évolué jusqu’alors et qui n’en sont que l’expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. ”.
Les formes de développement deviennent des entraves ; dans la vision dynamique qui est propre au marxisme, cela ne signifie pas que la société en arrive à un arrêt complet mais que la poursuite de son développement devient de plus en plus irrationnelle et catastrophique pour l’humanité. Nous avons d’ailleurs rejeté en de nombreuses occasions la vision selon laquelle la décadence représente un arrêt total du développement des forces productives. La première fois, c’était dans notre brochure La décadence du capitalisme, écrite à l’origine au début des années 70, dans laquelle un chapitre entier est précisément dédié à cette question. En réfutant l’affirmation de Trotski dans les années 30, selon laquelle “les forces productives avaient cessé de croître ”, nous affirmions que “dans la vision marxienne, la période de décadence d’une société ne peut donc être caractérisée par l’arrêt total et permanent de la croissance des forces productives, mais par le ralentissement définitif de cette croissance. Les blocages absolus de la croissance des forces productives apparaissent bien au cours des phases de décadence. Mais (dans le système capitaliste, la vie économique ne pouvant exister sans accumulation croissante et permanente du capital) ils ne surgissent que momentanément. Ils sont les convulsions violentes qui régulièrement marquent le déroulement de la décadence….
… Ce qui caractérise la décadence d’une forme sociale donnée du point de vue économique est donc :
- Un ralentissement effectif de la croissance des forces productives, compte-tenu du rythme qui aurait été techniquement et objectivement possible en l’absence du freinage exercé par la permanence des anciens rapports de production. Ce freinage doit avoir un caractère inévitable, irréversible. Il doit être provoqué spécifiquement par la perpétuation des rapports de production qui soutiennent la société. L ‘écart de vitesse qui en découle au niveau du développement des forces productives ne peut aller qu’en s’accroissant et donc en apparaissant de plus en plus aux classes sociales.
- L’apparition de crises de plus en plus importantes en profondeur et en étendue. Ces crises, ces blocages momentanés fournissent par ailleurs les conditions subjectives nécessaires à l’accomplissement d’une tentative de bouleversement social. C’est au cours de ces crises que le pouvoir de la classe dominante subit de profonds affaiblissements et à travers l’intensification objective de la nécessité de son intervention, la classe révolutionnaire trouve les premiers fondements de son unité et de sa force ”.[3]
Ailleurs, (“l’étude du capital et des fondements du communisme ”, Revue Internationale n°75), nous avons souligné que notre conception n’était pas différente de celle de Marx dans les Grundrisse, quand il écrit : “ D’un point de vue idéel, la dissolution d’une forme de conscience donnée suffirait à tuer une époque entière. D’un point de vue réel, cette limite de la conscience correspond à un degré déterminé de développement des forces productives matérielles et donc de la richesse. A vrai dire, le développement ne s’est pas produit sur l’ancienne base mais il y a eu développement de cette base elle-même. Le développement de cette base elle-même (la floraison en laquelle elle se transforme ; mais c’est toujours cette base, cette même plante en tant que floraison ; c’est pourquoi elle fane après la floraison et à la suite de la floraison) est le point où elle a elle-même été élaborée jusqu’à prendre la forme dans laquelle elle est compatible avec le développement maximum des forces productives et donc aussi avec le développement le plus riche des individus. Dès que ce point est atteint, la suite du développement apparaît comme un déclin et le nouveau développement commence sur une nouvelle base ”.
Plus que tout autre système social antérieur, le capitalisme est synonyme de “croissance économique ”, mais contrairement à ce que racontent les charlatans de la bourgeoisie, croissance et progrès ne sont pas la même chose : la croissance du capitalisme dans sa période de pourrissement est plus semblable à celle d’une tumeur maligne qu’à celle d’un corps sain qui passe progressivement de l’enfance à l’état adulte.
Les conditions matérielles d’un développement “sain” du capitalisme ont disparu au début du vingtième siècle quand le capitalisme a effectivement établi une économie mondiale et posé ainsi les fondations de la transition au communisme. Cela ne signifiait pas que le capitalisme s’était lui-même débarrassé de tous les restes des modes de production et des classes précapitalistes, qu’il avait épuisé le dernier marché précapitaliste, ni même qu’il avait effectué la transition finale de la domination formelle à la domination réelle de la force de travail dans chaque recoin de la planète. Ce que cela signifiait, c’était qu’à partir de ce moment, le capitalisme global pouvait de moins en moins envahir ce que Marx appelait “les domaines périphériques” d’expansion, et était obligé de croître au travers d’un auto-cannibalisme croissant et de la tricherie avec ses propres lois. Nous avons déjà dédié un espace considérable à ces formes de “développement en tant que décadence ” et nous les résumerons simplement ici :
- L’organisation de “trusts capitalistes d’Etat ” gigantesques au niveau national, et même au niveau international à travers la formation de blocs impérialistes, ayant pour fonction de réguler et de contrôler le marché, et donc d’empêcher que les opérations “normales ” de la concurrence capitaliste n’atteignent leur niveau réel et n’explosent dans de gigantesques crises ouvertes de surproduction sur le modèle de celle de 29 ;
- Le recours (en grande partie par l’intervention des grands capitalismes d'Etat ) au crédit et aux dépenses déficitaires, qui n’agit plus comme un stimulus pour le développement de nouveaux marchés mais de plus en plus comme un remplacement du marché réel ; de là, une croissance économique sur une base de plus en plus spéculative et artificielle qui ouvre la voie à des “ajustements ” dévastateurs tels que l’effondrement des tigres et des dragons en Asie, ou d’ailleurs ce qui se passe maintenant aux USA après la croissance “délirante” mais dopée des années 90 ;
- Le militarisme et la guerre comme mode de vie pour le système – pas seulement en tant que nouveau (further) marché artificiel qui devient un fardeau accablant pour l’économie mondiale – mais comme seul moyen pour les Etats de défendre leur économie nationale aux dépens de leurs rivaux. Les camarades de l’UCI pourront répondre que le capitalisme a toujours été un système guerrier, mais comme nous l’avons aussi expliqué dans un article de notre série “comprendre la décadence du capitalisme ” (voir en particulier la partie V dans la Revue Internationale n°54), il y a une différence qualitative entre les guerres de l’ascendance du capitalisme – qui étaient généralement de courte durée, à une échelle locale, impliquant surtout des armées professionnelles et ouvrant naturellement de nouvelles possibilités d’expansion – et les guerres de son déclin, qui ont pris un caractère quasi-permanent, se sont orientées de façon croissante vers le massacre sans discrimination de millions d’appelés et de civils, et qui ont précipité la richesse produite par des siècles de travail dans un abîme sans fond. Les guerres du capitalisme ont jadis fourni la base pour l’établissement d’une économie mondiale et donc pour la transition au communisme ; mais à partir de là, loin de poser les bases du progrès social futur, elles ont de plus en plus menacé la survie même de l’humanité.
- Le gaspillage gigantesque de la force de travail humaine représenté par la guerre et la production de guerre illustre aussi un autre aspect du capitalisme dans sa phase de sénilité : le poids énorme des dépenses et des activités non-productives, pas seulement dans la sphère militaire, mais aussi de par la nécessité d’entretenir de grands appareils dans la bureaucratie, dans le marketing et ailleurs. Dans le livre officiel des records du capitalisme, toutes les sphères sont définies comme des expressions de la “croissance ”, mais en réalité, elles témoignent du degré auquel est parvenu le capitalisme en tant qu’obstacle au développement qualitatif des forces de production humaine, développement qui devient à la fois nécessaire et possible à cette époque ;
- Une autre dimension du “développement dans le sens d'un déclin” qui ne pouvait qu’être entrevu du temps de Marx, est constituée par la menace écologique que la course aveugle à l’accumulation fait peser sur le système à la base de la vie même de la planète. Bien que cette question soit devenue de plus en plus évidente ces dix dernières années, elle est intimement liée à la question de la décadence. C’est le rétrécissement historique du marché mondial qui a de plus en plus contraint chaque Etat au pillage ou à hypothéquer ses ressources naturelles ; ce processus s’est déroulé tout au long du XXème siècle, même s’il n’atteint son paroxysme qu’aujourd’hui ; à l’époque, une révolution prolétarienne triomphante en 1917-23 n’aurait pas eu à faire face à un problème aussi immense que celui posé maintenant par les dégâts dans l’environnement naturel que provoque la croissance maladive du capitalisme. A ce niveau, il est immédiatement évident que le capitalisme est le cancer de la planète.
Quand s'est terminé l'époque des révolutions bourgeoises?
En accord avec les écrits de Marx sur la Commune de Paris, Lénine considérait que 1871 marquait la fin de la période des révolutions bourgeoises dans les principaux centres du capitalisme mondial. Il datait de cette même époque les débuts de la phase d’expansion impérialiste à partir de ces centres.
Pendant le dernier tiers du XIXème siècle, le mouvement marxiste considérait que les révolutions bourgeoises étaient toujours à l’ordre du jour dans les régions dominées par les puissances coloniales. C’était une vision parfaitement valable à l’époque ; cependant, à la fin du siècle, il devenait de plus en plus clair que la dynamique même de l’expansion impérialiste, qui voulait que les colonies ne se développent qu’au niveau où elles servaient de marchés passifs et de sources de matière première, inhibait le surgissement de nouveaux capitalismes nationaux indépendants, et donc d’une bourgeoisie révolutionnaire. Cette question était le sujet de débats particulièrement ardus au sein du mouvement révolutionnaire en Russie ; dans ses écrits sur les communes paysannes russes, Marx avait déjà exprimé l’espoir qu’une révolution mondiale triomphante puisse épargner à la Russie la nécessité de passer par le purgatoire du développement capitaliste. Plus tard, comme il devenait évident que le capital impérialiste n’allait pas abandonner la Russie à son propre destin, le centre de la question se déplaça sur le problème des faiblesses inhérentes de la bourgeoisie russe au berceau. Les Mencheviks, interprétant la méthode marxiste d’une façon très rigide et très mécaniste, affirmaient que le prolétariat devait se préparer à soutenir l’inévitable révolution bourgeoise en Russie ; les Bolcheviks, de l’autre côté, reconnaissaient que la bourgeoisie russe manquait d’envergure pour mener sa révolution et en concluaient que cette tâche devait être prise en main par le prolétariat et la paysannerie (la formule de la “dictature démocratique ”). En fait, c’était la position de Trotsky qui collait le plus à la réalité, car elle n’était pas immédiatement posée en termes “russes ” mais dans un cadre global et historique, et qu’elle avait comme point de départ la reconnaissance que le capitalisme comme un tout était en train de rentrer dans l’époque de la révolution socialiste mondiale. La classe ouvrière au pouvoir ne pourrait pas se limiter aux tâches bourgeoises de la révolution mais serait obligée de faire la “révolution permanente ”, d’étendre la révolution sur la scène mondiale où elle ne pourrait que prendre un caractère socialiste.
Dans les Thèses d’avril de 17, Lénine rejoint effectivement cette position, balayant les objections des Bolcheviks conservateurs (qui avaient en fait flirté avec le Menchevisme et la bourgeoisie) selon lesquelles il abandonnait la perspective de la “dictature démocratique ”. En 1919, l’Internationale communiste s’est formée sur la base que le capitalisme était bien entré dans sa période de déclin, l’époque de la révolution prolétarienne mondiale. Toutefois, alors qu’elle proclamait que l’émancipation des masses colonisées dépendait maintenant du succès de la révolution mondiale, l’IC n’a pas été capable de pousser cette question jusqu’à sa conclusion logique : l’époque des luttes de libération nationale était terminée - bien que Rosa Luxembourg et d’autres l’aient déjà vu. Ce furent par-dessus tout les essais désastreux des Bolcheviks pour forger des alliances avec la bourgeoisie soi-disant “anti-impérialiste ” de régions telles que la Turquie, l’ancien empire tsariste, et surtout la Chine, qui ont amené la gauche communiste (la Fraction Italienne en particulier) à remettre en question les thèses de l’IC sur la question nationale, qui contenaient la possibilité d’alliances temporaires entre la classe ouvrière et la bourgeoisie coloniale. Les fractions de gauche avaient bien vu que chacune de ces “alliances” se terminait par un massacre de la classe ouvrière et des communistes perpétré par la bourgeoisie coloniale, qui en le faisant, n’hésitait pas à se mettre au service de tel ou tel gang impérialiste.
L’UCI, dans sa plate-forme, dit qu’elle existe à l’origine grâce au travail des fractions de la gauche communiste qui ont rompu avec l’IC dégénérescente. (Voir World Revolution n°254). Toutefois, sur cette question, l’UCI a la vision “officielle ” de l’IC contre celle de la gauche : “ la politique du Cominterm de Staline et de Boukharine pendant la révolution chinoise de 1925-27 diffère complètement de celle de Lénine et des Bolcheviks qui prévalait pendant les premières années du Comintern. Vous argumentez encore que s’il y a des tâches bourgeoises, nous devrions soutenir telle ou telle fraction bourgeoise. Les Mencheviks et les staliniens disaient la même chose…. La méthode de Marx et de Lénine ne consiste pas à ne pas refuser les tâches de l’heure quand toutes les fractions de la bourgeoisie sont également réactionnaires, et à accomplir ces tâches avec la méthode de la révolution prolétarienne, en essayant d’exécuter les tâches bourgeoises avec la plus grande profondeur et en accomplissant les tâches socialistes. La révolution chinoise a montré que cette approche était correcte au contraire de celle de la gauche. La révolution a de toute façon gagné en Chine, bien que cela ait laissé un nombre énorme de victimes. Cette révolution a rendu possible la création du prolétariat le plus nombreux du monde, puissant, qui a rapidement développé les forces productives. Le même résultat a été atteint par des dizaines d’autres révolutions dans les pays de l’Est. Nous ne voyons pas de raison pour nier leur rôle progressif historique : grâce à elles, notre révolution a une solide base de classe dans beaucoup de pays du monde qui en 1914 étaient complètement agricoles”.
Nous sommes bien sûr d’accord sur le fait que la position de Lénine, position qui se trouve dans les "Thèses sur la question nationale et coloniale" du deuxième Congrès de l’IC en 1920, n’était en aucune façon la même que celle de Staline en 1927. En particulier, les Thèses de 1920 insistaient sur la nécessité pour le prolétariat de rester strictement indépendant y compris des forces “nationalistes révolutionnaires” ; Staline a appelé les ouvriers insurgés de Shanghai à rendre leurs armes aux bouchers du Kuomintang. Mais comme nous l’avons vu dans notre série d’articles sur les origines du Maoïsme (Revue Internationale n° 81, 84, 94), cette expérience ne confirmait pas seulement que la clique de Staline avait abandonné la révolution prolétarienne au profit des intérêts de l’Etat national russe, elle a aussi annihilé tout espoir de trouver un secteur de la bourgeoisie coloniale qui ne se prosterne pas aux pieds de l’impérialisme et qui ne massacre pas le prolétariat à la première occasion. Les secteurs “nationalistes révolutionnaires ” ou anti-impérialistes ” de la bourgeoisie coloniale n’existaient tout simplement pas. Il ne pouvait en être autrement à une époque historique – la décadence du monde capitaliste – dans laquelle il n’y a plus la moindre coïncidence entre les intérêts des deux principales classes.
L'UCI et la “révolution bourgeoise” en Chine
La position de l’UCI sur la Chine nous semble contenir une profonde ambiguïté. D’un côté, l’UCI dit qu’en Russie en 1917, la bourgeoisie était déjà réactionnaire, ce qui est la raison pour laquelle le prolétariat doit prendre en charge les tâches de la révolution bourgeoise ; de l’autre côté, selon leur vision, en Chine et dans des “dizaines d’autres ” pays de l’Est non spécifiés, il semble que la révolution bourgeoise ait pu se dérouler. Est-ce que cela signifie que la bourgeoisie de ces pays était encore progressiste après 1917 ? Ou cela veut-il dire – dans le cas de la Chine en particulier, que la fraction qui a accompli la “révolution bourgeoise ” - le Maoïsme – avait quelque chose de prolétarien, comme le disent les Trotskistes ? L’UCI a besoin de faire une clarté limpide sur sa vision de cette question.
Quoiqu’il en soit, regardons si ce qui est arrivé en Chine correspond à la compréhension marxiste de ce qu’est une révolution bourgeoise. Du point de vue marxiste, les révolutions bourgeoises étaient un facteur de progrès historique parce qu’elles éliminaient les restes du vieux mode de production féodal et jetaient les bases de la future révolution du prolétariat. Ce processus a deux dimensions fondamentales :
- Au niveau le plus matériel, la révolution bourgeoise a jeté à bas les barrières féodales qui bloquaient le développement des forces productives et l’expansion du marché mondial. La formation de nouveaux Etats était une expression du progrès dans ce sens : c’est à dire qu’elle a fait éclater les limites féodales et créé les fondations de la construction d’une économie mondiale.
- Le développement des forces productives est aussi, bien sûr, le développement matériel du prolétariat, mais ce qui était aussi une clef pour la révolution bourgeoise est qu’il a créé le cadre politique pour le développement “idéologique ” de la classe ouvrière, sa capacité à s’identifier et à s’organiser en tant que classe distincte au sein de la société capitaliste et contre elle à la fin.
La soi-disant révolution chinoise de 1949 ne correspond à aucun de ces aspects. Pour commencer, ce n’était pas un produit d’une économie mondiale en expansion mais celui d’une économie qui est arrivée à une impasse historique. Cela peut se voir directement quand on comprend qu’elle était née non pas d’une lutte contre le féodalisme ou le despotisme asiatique, mais d’une lutte sanglante entre gangs de la bourgeoisie, tous liés à l’une ou l’autre des grandes puissances impérialistes qui dominaient le monde. La “révolution chinoise ” a été le fruit de conflits impérialistes qui ont dévasté la Chine dans les années 30 et surtout de leur point culminant – la deuxième guerre mondiale impérialiste. Le fait qu’à différents moments les factions chinoises en lutte aient eu différents soutiens impérialistes (le maoïsme par exemple était soutenu par les US pendant la deuxième guerre mondiale et ensuite par la Russie au début de la “guerre froide ”) ne change rien à l’affaire. Pas plus que le fait que la Chine ait pris une orientation impérialiste “indépendante ” pendant une brève période dans les années 60 ne prouve qu’il y aurait de “jeunes ” bourgeoisies qui pourraient échapper à l’emprise de l’impérialisme dans cette époque. C’est plutôt le contraire : le fait que même la Chine, avec ses territoires et ses ressources immenses, n’ait été capable de se ménager une marche indépendante que pendant une période aussi brève confirme amplement les arguments de Rosa Luxembourg dans la Brochure de Junius : que dans l’époque ouverte par la première guerre mondiale, aucune nation ne peut se “tenir à l’écart ” de l’impérialisme parce que nous vivons dans une période dans laquelle la domination de l’impérialisme sur la planète toute entière ne peut être dépassée que par la révolution communiste mondiale.
Le développement économique de la Chine comprend aussi toutes les caractéristiques du “développement en tant que décadence” : il ne se produit donc pas comme faisant partie d’un marché mondial en expansion, mais comme une tentative de développement autarcique dans une économie mondiale qui a déjà atteint ses limites fondamentales à sa capacité à s'étendre. De là, comme dans la Russie stalinienne, l’énorme prépondérance du secteur militaire, de l’industrie lourde aux dépens de la production de biens de consommation, d’une bureaucratie étatique horriblement gonflée. De là aussi, les convulsions périodiques telles que “le grand bond en avant ” et la “révolution culturelle ” dans laquelle la classe dominante visait à mobiliser la population derrière des campagnes pour intensifier son exploitation et sa soumission idéologique à l’Etat. Ces campagnes étaient une réponse désespérée à la stagnation et à l’arriération chronique de l’économie : témoin l’exigence de l’Etat pendant le “grand bond en avant ” de mettre en place un haut fourneau dans chaque village, qui utilise la moindre miette de métal qui tomberait sous la main.
Naturellement, la classe ouvrière chinoise est plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était en 1914. Mais pour juger si c’est en soi un facteur de progrès pour l’humanité, nous devons considérer la situation du prolétariat au niveau mondial et non national. Ce que nous voyons à ce niveau, c’est que le capitalisme s’est avéré incapable d’intégrer la majorité de la population du monde dans la classe ouvrière. En pourcentage de la population mondiale, la classe ouvrière reste une minorité.
Le progrès pour le prolétariat chinois au siècle passé aurait été le succès de la révolution mondiale en 1917-27, ce qui aurait permis un développement équilibré et harmonieux de l’industrie et de l’agriculture à l’échelle mondiale, pas ces luttes frénétiques et non nécessaires historiquement de chaque économie nationale pour survivre dans un marché mondial saturé. A la place de cela, la classe ouvrière chinoise a passé la plus grande partie du siècle sous la botte odieuse du stalinisme. Loin d’être le produit d’une révolution bourgeoise tardive, le stalinisme est l’expression classique de la contre-révolution bourgeoise, l’horrible revanche du capital après que le prolétariat ait essayé et manqué de renverser sa domination. Le fait qu’il soit fondé sur un mensonge total – sa prétention de représenter la révolution communiste – est en lui-même une expression typique d’un mode de production décadent : dans son ascendance, dans sa phase de confiance en lui-même, le capitalisme n’avait aucun besoin de se draper dans les vêtements de son ennemi mortel. De plus, ce mensonge a eu l’effet des plus négatifs sur la capacité de la classe ouvrière – à l’échelle mondiale et en particulier dans les pays dominés par le stalinisme – de comprendre la réelle perspective communiste. Quand nous considérons autant le prix terrible de répression et de massacre que le stalinisme a fait payer à la classe ouvrière – le nombre de ceux qui sont morts dans les prisons maoïstes et dans les camps de concentration est encore inconnu, mais se chiffre probablement en millions – il devient évident que la soi disant “révolution bourgeoise ” en Chine a complètement échoué à accomplir ce que les authentiques révolutions bourgeoises avaient réussi à fournir au XVIII et au XIXe siècle : un cadre politique qui permettait au prolétariat de développer sa confiance en lui et sa conscience d’être une classe. Le stalinisme a été un désastre complet pour le prolétariat mondial ; même dans les affres de la mort, il continue à empoisonner sa conscience grâce aux campagnes de la bourgeoisie qui identifie la faillite du stalinisme à la fin du communisme. Comme toutes les soi-disant “révolutions nationales” du XXe siècle, c’est le témoignage du fait que le capitalisme ne pose plus désormais les fondations pour le communisme mais qu’il les sape de plus en plus.
Les communistes et la question nationale : pas de place pour l'ambiguité
Selon l’UCI, les communistes pouvaient en un certain sens soutenir les révolutions nationales jusque dans les années 80 ; maintenant avec l’avènement de la globalisation, ce ne serait plus possible : “ Qu’est ce qui a changé à partir du début de la “globalisation ” ? La possibilité de la révolution nationale a disparu. Jusque dans les années 80, les révolutions nationales pouvaient encore garantir la croissance des forces productives, elles devaient donc être encore soutenues, en essayant si possible de transférer leur gestion dans les mains du prolétariat révolutionnaire… Maintenant, cette étape historique pour le développement national est arrivée à son terme ”.
Le premier point à faire sur cette position, c’est que si la Gauche communiste l’avait défendue jusque dans les années 89, il n’y aurait plus de gauche communiste aujourd’hui. Jusqu’à la mort de l’Internationale communiste à la fin des années 20, la Gauche communiste a été le seul courant politique qui s’est opposé de façon conséquente à la mobilisation du prolétariat dans la guerre impérialiste, surtout quand ces guerres étaient faites au nom d'une quelconque révolution bourgeoise tardive ou de la “lutte contre l’impérialisme ”. A partir de l’Espagne et de la Chine dans les années 30, en passant par la deuxième guerre mondiale, et dans tous les conflits locaux qui ont caractérisé la guerre froide (Corée, Vietnam, Moyen- Orient, etc.), la Gauche communiste, seule, a maintenu l’internationalisme prolétarien, rejetant tout soutien à un quelconque Etat ou fraction nationale, appelant la classe ouvrière à défendre ses propres intérêts de classe contre les appels à se dissoudre dans les fronts guerriers du capital. La conséquence terrible du fait de s’écarter de cette voie a été illustrée de façon très vivante par l'’implosion du courant bordiguiste au début des années 80 : ses ambiguïtés sur la question nationale ont ouvert la porte à la pénétration de fractions nationalistes qui ont cherché à entraîner la principale organisation bordiguiste sur le terrain du soutien à l’OLP et à des Etats tels que la Syrie dans la guerre au Moyen-Orient. Il y a eu des résistances de la part d’éléments prolétariens dans l’organisation, mais elle a payé un prix terrible en perte d’énergies militantes et en éclatement consécutif du courant tout entier. Les nationalistes auraient-ils réussi, ils auraient fini par annexer ce courant historique de la gauche italienne à l’aile gauche du capital aux côtés des trotskistes et des staliniens. Si les ancêtres politiques d’autres groupes tels que le CCI et le BIPR avaient suivi une politique de soutien aux soi-disant “révolutions nationales ”, ils auraient subi un sort analogue et il n’y aurait plus de courant de la gauche communiste avec lequel puissent se mettre en contact les nouveaux groupes qui surgissent en Russie.
En second lieu, il nous semble que, bien que l’UCI conclut que maintenant enfin, c’est le moment pour une position prolétarienne vraiment indépendante sur les mouvements nationaux, les camarades restent attachés à des formulations qui sont au mieux ambiguës et au pire peuvent conduire à une trahison ouverte des principes de classe. Ainsi, ils parlent encore de la possibilité de transférer la lutte nationale de la bourgeoisie au prolétariat, adhèrent encore au mot d’ordre “d’autodétermination nationale ” : “ en ce qui concerne le soutien aux mouvements d’indépendance nationale, la seule orientation ici, à la fois pour hier et pour aujourd’hui, c’est d’arracher la lutte contre l’oppression nationale des mains de la bourgeoisie et de la remettre dans les mains du prolétariat. Cela ne peut être fait si on ne reconnaît pas le droit des nations à l’autodétermination, c’est-à-dire si on ne reconnaît pas la nécessité de mener jusqu’au bout les tâches historiques de la bourgeoisie. Autrement, nous laisserons le prolétariat national sous la direction de la bourgeoisie nationale ”. Mais la classe ouvrière ne peut pas prendre en charge la lutte nationale ; même pour défendre ses intérêts de classe, elle se trouve en opposition avec la bourgeoisie nationale et toutes ses ambitions. La guerre de classe et la guerre nationale sont diamétralement opposées autant dans leur forme que dans leur contenu. En ce qui concerne l’autodétermination, les camarades reconnaissent eux-mêmes qu’elle est impossible dans les conditions actuelles du capitalisme, même s’ils considèrent que ce n’est le cas que depuis les années 80. Ils argumentent donc en faveur du mot d’ordre en des termes semblables à ceux de Lénine – comme un moyen d’éviter de “créer des antagonismes ” ou d’offenser les prolétaires des pays arriérés et de les soustraire à l’influence bourgeoise. Camarades, le communisme ne peut pas s’empêcher d’être offensif par rapport aux sentiments nationalistes mal placés qui existent au sein de la classe ouvrière. A ce compte là, les communistes devraient éviter de critiquer la religion parce que beaucoup d’ouvriers sont influencés par l’idéologie religieuse. Bien sûr, nous ne provoquons pas ou nous n’insultons pas les ouvriers parce qu’ils ont des idées confuses. Mais comme il est dit dans le Manifeste Communiste, les communistes refusent de cacher leur vision. Si la libération nationale et l’autodétermination nationale sont impossibles, alors, nous devons le dire dans les termes les plus clairs possibles.
L’apparition de groupes comme l’UCI est un apport important pour le prolétariat mondial. Mais ses ambiguïtés sur la question nationale sont très graves et mettent en question sa capacité de survie en tant qu’expression du prolétariat. L’histoire a montré que, parce qu’elles se rattachent au profond antagonisme entre le prolétariat et la guerre impérialiste, les ambiguïtés sur la question nationale surtout peuvent facilement amener à trahir les intérêts internationalistes de la classe ouvrière. Nous le poussons donc à réfléchir en profondeur sur tous les textes et toutes les contributions que la gauche communiste a produites sur cette question vitale.
CDW
1 Pour la présentation de ce groupe, nous renvoyons nos lecteurs à la Revue internationale n°111, "Présentation de l'édition russe de la brochure sur la décadence : la décadence, un concept fondamental du marxisme"
2 Les camarades d’un autre groupe russe, le Groupe des Collectivistes Prolétariens Révolutionnaires, paraît avoir la même position quand ils disent que la révolution communiste n’est devenue possible que depuis que le capitalisme a développé les puces. Nous reviendrons plus tard sur cet argument.
3 Nous avons développé ce point après dans la série d’articles “Comprendre la décadence du capitalisme ” ; voir en particulier les Revue internationale 55 et 56.
Courants politiques:
Questions théoriques:
- Décadence [13]
Heritage de la Gauche Communiste:
"Fraction interne" du CCI : Tentative d'escroquerie vis-à-vis de la Gauche Communiste
- 4145 reads
Dans chaque numéro de toute publication du CCI, nous publions nos "Positions de base", où on peut lire la phrase suivante : "Le CCI se réclame des apports successifs de la Ligue des Communistes de Marx et Engels (...), des fractions de gauche qui se sont dégagées dans les années 1920-1930 de la Troisième internationale lors de sa dégénérescence, en particulier les Gauches allemande, hollandaise et italienne." Notre organisation est le fruit du travail acharné des fractions de gauche. Au niveau des principes organisationnels, elle est surtout le fruit du travail de la Gauche italienne pendant les années 20 et 30, regroupée autour de Bilan. On comprendra donc que nous prenions la question des fractions très au sérieux, d'autant plus que nos prédécesseurs de la Gauche italienne ont accompli un travail de fond sur les conditions de surgissement des fractions dans le mouvement ouvrier, et sur le rôle qu'elles sont appelées à remplir. La question de la fraction se trouve au coeur même de notre conception de ce qu'est une organisation révolutionnaire.
Lorsqu'un groupe de militants s'est déclaré "fraction interne du CCI" en octobre 2001, il était donc de notre devoir de revenir sur la question de la fraction au sein du mouvement ouvrier et de ce qu'elle représente historiquement, afin de traiter la question de la manière la plus adéquate.
C'est pourquoi nous avons décidé de publier, dans le numéro 108 de la Revue Internationale un article qui réaffirme notre conception de ce que représente une fraction dans le mouvement ouvrier ("Les fraction de gauche - En défense de la perspective prolétarienne"). Évidemment, nous nous doutions que les membres de la prétendue "fraction interne" ne seraient pas d'accord avec la vision défendue dans ce texte. Il avait alors été proposé à ces militants qu'ils exposent publiquement leur désaccord sur la question de la fraction dans les colonnes de la Revue Internationale. Afin d'esquiver la confrontation franche et ouverte des divergences, ils s'empressèrent d'assortir une éventuelle acceptation de leur part d'exigences que le CCI ne pouvait pas accepter[1] puisqu'il lui était demandé rien de moins que de renoncer à son analyse des mobiles ayant présidé à la constitution de cette prétendue "fraction".[2]
Depuis lors, les fractionnistes ont publié une réponse à notre article.[3] Le but de leur réponse est de montrer "comment le CCI est obligé de déformer ou d'ignorer des pans entiers de l'expérience de l'histoire ouvrière, particulièrement de l'histoire de ses fractions, et donc qu'il tombe inévitablement dans l'oubli et la trahison de ses propres principes organisationnels et des principes du mouvement ouvrier". Qu'en est-il réellement?
Quelles questions posées par la déclaration d'une fraction?
Inévitablement, la création d'une fraction soulève quatre questions fondamentales pour une organisation communiste:
a) Quelle est la nature des divergences politiques qui séparent la fraction de l'organisation dans son ensemble? Et en premier lieu, ces divergences concernent-elles les principes programmatiques justifiant ainsi la création d'une organisation dans l'organisation, selon la conception que le CCI a développée sur la base du legs de la Gauche italienne?
b) Comment l'organisation doit-elle réagir face à la création d'une fraction? Comment doit-elle assumer la responsabilité à la fois de favoriser le débat au sein de l'organisation et de maintenir la cohésion de l'organisation et sa capacité d'action?
c) Quelles sont les responsabilités de la fraction elle-même face à l'organisation? Quelles sont ses tâches, comment mène-t-elle la lutte pour défendre ses positions et notamment, quel est son devoir au niveau du respect des règles de fonctionnement et de la discipline organisationnelle?
d) Quel est le jugement politique de la majorité de l'organisation sur le bien-fondé ou non d'une fraction? Notamment, le refus du CCI de reconnaître le bien-fondé de la fraction actuelle ne serait-il pas qu'une tentative d'esquiver le débat de fond de la part de ses organes centraux actuels ?
Nous avons déjà répondu à la troisième question dans l'article de la Revue Internationale n°108, et dans un article sur "Les fractions face à la question de la discipline organisationnelle" publié dans la Revue Internationale n°110. Notre réponse à la quatrième question – donc notre analyse de la véritable nature de la "fraction interne" qui s'est constituée dans le CCI – a été affirmée unanimement[4] par notre Conférence extraordinaire d'avril 2002, dont un compte-rendu se trouve également dans la Revue Internationale n°110. Notre but donc, dans cet article, est surtout de répondre aux deux premières questions. A cette fin, nous serons conduits à rappeler les conceptions de base du CCI sur la façon de mener le débat à l'intérieur d'une organisation communiste, et sur comment et pourquoi des tendances ou des fractions peuvent apparaître en son sein.
Comment traiter les divergences?
Les statuts du CCI accordent une importance et un soin particuliers à l'explication nos principes organisationnels en ce qui concerne l'attitude à adopter face à l'apparition de divergences en son sein :
"Si les divergences s'approfondissent jusqu'à donner naissance à une forme organisée, il convient de comprendre la situation comme manifestation :
- soit d'une immaturité de l'organisation,
- soit d'une tendance à sa dégénérescence.
Face à une telle situation, seule la discussion peut :
- soit résorber les divergences,
- soit permettre qu'apparaissent clairement des divergences de principe pouvant conduire à une séparation organisationnelle.
En aucune façon, des mesures disciplinaires ne peuvent se substituer à cette discussion pour résoudre les désaccords mais, tant qu'une de ces issues n'a pas été atteinte, la position majoritaire est celle de l'organisation.
De même, il convient qu'un tel processus d'apparition d'une forme organisée de désaccords soit pris en charge de façon responsable, ce qui suppose en particulier :
- que si l'organisation n'a pas à juger quand une telle forme organisée doit se constituer et se dissoudre, celle-ci se base, afin d'être une réelle contribution à la vie de l'organisation, sur des positions positives et cohérentes clairement exprimées et non sur une collection de points d'opposition et de récrimination ;
- que cette forme organisée résulte par conséquent d'un processus de décantation préalable des positions dans la discussion générale au sein de l'organisation, et ne soit donc pas conçue comme la condition d'une telle décantation".
Il est évident que, pour que ces pré-requis statutaires soient opérants, l'organisation doit se doter des moyens de mener des débats dans lesquels participeront l'ensemble des militants au niveau international. Ces moyens sont explicités dans un texte fondamental, adopté par tout le CCI suite à la crise organisationnelle de 1981:[5]
"Si l'existence de divergences au sein de l'organisation est un signe qu'elle est vivante, seul le respect d'un certain nombre de règles dans la discussion de ces divergences permet que celles-ci soient une contribution au renforcement de l'organisation et à l'amélioration des tâches pour lesquelles la classe l'a faite surgir.
On peut ainsi énumérer un certain nombre de ces règles:
- réunions régulières des sections locales et mise à l'ordre du jour de celles-ci des principales questions débattues dans l'ensemble de l'organisation : en aucune façon le débat ne saurait être étouffé,
- circulation la plus ample possible des différentes contributions au sein de l'organisation au moyen des instruments prévus à cet effet (les bulletins internes),
- rejet par conséquent des correspondances secrètes et bilatérales, qui loin de favoriser la clarté du débat, ne peuvent que l'obscurcir en favorisant les malentendus, la méfiance, et la tendance à la constitution d'une organisation dans l'organisation,
- respect par la minorité de l'indispensable discipline organisationnelle,
- rejet de toute mesure disciplinaire ou administrative de la part de l'organisation à l'égard de ses membres qui soulèvent des désaccords (...)".
Les éléments qui allaient fonder la "fraction interne", n'ont respecté ni la forme ni l'esprit des statuts et de nos principes de fonctionnement. Ils n'ont pas assumé la responsabilité qui était la leur de confronter ouvertement, au sein de l'organisation, les divergences qu'ils avaient ou prétendaient avoir avec le reste de l'organisation, alors que les discussions dans les réunions internes de l'organisation et les contributions dans les bulletins internes le leur permettaient sans restriction aucune.[6] Au lieu de cela, ils se sont retrouvés entre eux à comploter contre l'organisation dans des réunions secrètes. En revanche, lors de la découverte de ces réunions secrètes, le CCI a réagi avec le souci de "rejeter toute mesure disciplinaire ou administrative": "Les agissements des membres du 'collectif' constituent une faute organisationnelle extrêmement grave méritant une sanction des plus sévères. Toutefois, dans la mesure où les participants à cette réunion [c'est à dire la réunion du Bureau International de septembre 2001] ont décidé de mettre fin au 'collectif', le BI décide de surseoir à une telle sanction".[7]
Le texte sur le fonctionnement que nous venons de citer explicite également notre compréhension de ce que représente une fraction au sein d'une organisation prolétarienne:
"La fraction est l'expression du fait que l'organisation est en crise de par l'apparition d'un processus de dégénérescence en son sein, de capitulation face au poids de l'idéologie bourgeoise. Contrairement à la tendance qui ne s'applique qu'à des divergences sur l'orientation face à des questions circonstancielles, la fraction s'applique à des divergences programmatiques qui ne peuvent trouver d'aboutissement que dans l'exclusion de la position bourgeoise ou par le départ de l'organisation de la fraction communiste et c'est dans la mesure où la fraction porte en elle la séparation de deux positions devenues incompatibles au sein du même organisme qu'elle tend à prendre une forme organisée avec ses propres organes de propagande.
C'est parce que l'organisation de la classe n'est jamais garantie contre une dégénérescence que le rôle des révolutionnaires est de lutter à chaque moment pour l'élimination des positions bourgeoises pouvant se développer en son sein. Et c'est quand ils se trouvent en minorité dans cette lutte que leur tâche est de s'organiser en fraction soit pour gagner l'ensemble de l'organisation aux positions communistes et exclure la position bourgeoise soit, quand cette lutte est devenue stérile de par l'abandon du terrain prolétarien par l'organisation - généralement lors d'un reflux de la classe - de constituer le pont vers une reconstitution du parti de classe qui ne peut alors surgir que dans une phase de remontée des luttes.
Dans tous les cas, le souci qui doit guider les révolutionnaires est celui qui existe au sein de la classe en général. Celui de ne pas gaspiller les faibles énergies révolutionnaires dont dispose la classe. Celui de veiller sans cesse au maintien et au développement d'un instrument aussi indispensable mais aussi fragile que l'organisation des révolutionnaires".[8]
Les principes du CCI en droite ligne de la Gauche italienne
Cette définition de ce que doit être une fraction nous vient en droite ligne de la Gauche italienne et notamment de Bilan.
Dans le mouvement ouvrier, le terme de "fraction" a été employé indistinctement pour caractériser des courants tels que les bolcheviks, les mencheviks, les spartakistes et différentes minorités sur tel ou tel point de l'orientation du parti, notamment dans le parti russe pendant la révolution, autour de Brest-Litovsk, etc. Les citations de Lénine et de Trotsky, utilisées par la "fraction interne" dans son article, le montrent largement. Cependant, la conception du CCI qui est condensée dans la citation plus haut, est plus précise : elle fait la distinction entre tout ce qui peut être une minorité ou encore une tendance sur tel ou tel point de l'orientation du parti, y compris une orientation aussi cruciale que l'orientation que la révolution doit prendre dans un cas comme Brest-Litovsk, et la minorité qui s'appelle la fraction. Cette définition n'est pas une fantaisie ou un exercice de "style", mais vient de Bilan, de tout le travail d'approfondissement qu'il a fourni dans les années 1930.
Dans cette période, le groupe qui allait se former autour de Bilan, comme toutes les oppositions et les minorités dans ou autour de l'Internationale et des partis communistes, se trouvait confronté à la situation dramatique dans laquelle ces partis, composés de millions d'ouvriers, qui s'étaient constitués au cours de la vague révolutionnaire de 1917-23, étaient en train de dégénérer et de trahir, l'un après l'autre, les principes fondamentaux du prolétariat avec le reflux de la révolution. Dans ces conditions, définir les tâches et le sens de l'activité que devaient mener les oppositionnels et les exclus était une question vitale, de même que définir le cadre de cette activité : "Lorsque le parti a perdu sa capacité de guider le prolétariat vers la révolution - et cela arrive par le triomphe de l'opportunisme - les réactions de classe produites par les antagonismes sociaux, n'évoluent plus vers la direction qui permet au parti d'accomplir sa mission. Les réactions sont appelées à chercher les nouvelles bases où se forment désormais les organes de l'entendement et de la vie de la classe ouvrière : la fraction".(Bilan n°1, "Vers l’Internationale deux et trois-quarts" ?).
Bilan était en désaccord avec l'orientation préconisée par Trotsky de fonder un nouveau parti, une nouvelle Internationale et de faire appel aux gauches socialistes. Pour Bilan, il fallait en premier lieu examiner et tirer les leçons de l'expérience historique récente, de l'échec de la révolution russe, de la trahison de l'Internationale, de la dégénérescence des partis : "Ceux qui opposent à ce travail indispensable d'analyse historique le cliché de la mobilisation immédiate des ouvriers, ne font que jeter de la confusion et empêcher la reprise réelle des luttes prolétariennes". (Bilan n°1, Introduction).
Une donnée essentielle des perspectives pour l'activité de la fraction était l'évolution de la situation et l'évolution du parti. Comme le met en évidence la citation du Bulletin d'information qui a précédé Bilan - donnée dans l'article de la "fraction interne"[9] :"La fraction ainsi comprise, c'est l'instrument nécessaire pour l'éclaircissement politique qui doit définir la solution de la crise communiste. Et l'on doit juger comme arbitraire toute discussion opposant l'issue de la fraction exclusivement dans le redressement du parti, à l'issue de la fraction dans un deuxième parti, et vice-versa. L'une ou l'autre dépendront de l'éclaircissement politique obtenu, et ne peuvent pas dès maintenant caractériser la fraction. Il est possible et souhaitable que cet éclaircissement se concrétise par le triomphe de la fraction dans le parti lequel retrouvera alors son unité. Mais on ne peut pas exclure que cet éclaircissement précise des différences fondamentales qui autorisent la fraction à se déclarer elle-même, contre le vieux parti, le parti du prolétariat; celui-ci, à la suite de tout le processus idéologique et organisatoire de la fraction, relié aux développements de la situation, trouvera les bases effectives pour son activité. Dans un cas, comme dans l'autre, l'existence et le renforcement de la fraction sont les prémisses indispensables pour la solution de la crise communiste." (Bulletin d'information n°3, novembre 1931)
La tâche que se donne la fraction est en premier lieu un travail de clarification politique, d'approfondissement.
La définition de l'activité de la fraction est intimement liée à l'analyse du rapport de forces entre les classes. La dégénérescence du parti est l'expression d'un affaiblissement de la classe. La fraction s'oppose à l'idée de créer à tout moment un nouveau parti : "L'intelligence des événements ne s'accompagne plus avec l'action directe sur ces derniers, ainsi qu'il arrivait précédemment au sein du parti, et la fraction ne peut reconstituer cette unité qu'en délivrant le parti de l'opportunisme." (Bilan n°1, "Vers l’Internationale deux et trois-quarts" ?)
Bilan allait développer sa compréhension de ce qu'est la fraction tout au long de son existence, pour arriver à la résolution de 1935, proposée par Jacobs, et publiée dans Bilan n°17. Cette résolution représente probablement l'expression la plus achevée de la conception qu'a Bilan de la fraction. et son rapport avec le parti de classe. En fait, les deux notions sont intimement liées, la fraction représentant la continuité des intérêts historiques de la classe ouvrière alors que l'existence du parti est déterminée également par les conditions de la lutte de classe elle-même et par la capacité du prolétariat de s'affirmer en tant que classe révolutionnaire:
"Il est évident que la nécessité de la fraction est aussi l'expression de la faiblesse du prolétariat, soit disloqué, soit gagné par l'opportunisme ; comme par contre la création du parti indique un cours de situations ascendantes où continuellement le prolétariat se retrouve, se concentre : au travers de lutte partielles, générales, il taille des brèches et démolit la structure du capitalisme." (Bilan nº17, "Projet de résolution sur les problèmes de la fraction de gauche").
Que représente la fraction ? "La fraction est une étape nécessaire aussi bien pour la constitution de la classe que pour sa reconstitution dans les différentes phases de l'évolution, elle est le lien de continuité par laquelle s'exprime la vie de la classe en même temps qu'elle exprime la tendance de cette dernière de se donner une structure de principe et une méthode d'intervention dans les situations. Précisément parce que le prolétariat ne peut représenter une force économique pouvant se concentrer autour de ses richesses matérielles puisque étant la classe ne disposant que des moyens nécessaires à sa propre production que lui attribue le capitalisme pour sa force de travail, son affirmation en tant que classe indépendante appelée à créer un nouveau type d'organisation sociale, ne peut se manifester en réalité que dans des phases particulières quand se disloquent les rapports entre les classes au point de vue mondial."(idem)
Selon cette définition élaborée par Bilan, il est clair que la fraction ne représente pas une minorité, une tendance ou une opposition sur différents points d'orientation ou même du programme de la classe, mais qu'elle exprime la continuité de l'être historique du prolétariat, de son devenir révolutionnaire. En ce sens, la notion de fraction n'est plus utilisée par Bilan comme elle a pu l'être jusqu'alors dans le mouvement ouvrier pour qualifier différents courants. La fraction n'est pas non plus une forme spécifique à la période historique dans laquelle vit Bilan et face à la dégénérescence du parti. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est non seulement ponctuée par l'existence de partis, dans les phases ascendantes de la lutte, mais elle s'exprime tout autant par l'histoire de ses fractions : "Les "centres de correspondants", créés par Marx avant la fondation de la Ligue des Communistes, son travail théorique après 1848 jusqu'à la fondation de la Première Internationale, le travail de la fraction bolchevique au sein de la Deuxième Internationale, sont les moments essentiels de constitution du prolétariat qui ont permis l'apparition de partis animés d'une doctrine et d'une méthode d'action. Voir les termes de ce processus en niant la fraction sous ses formes historiques particulières, c'est voir l'arbre et non la forêt, c’est consacrer un mot en rejetant la substance." (idem)
La tâche de la fraction n'est pas uniquement de maintenir ou restaurer le programme face aux trahisons opportunistes ou aux échecs de la lutte de classe, c'est aussi d'élaborer sans cesse la théorie du prolétariat : "Pour donner une substance historique à l'œuvre des fractions, il faut démontrer qu'elles sont aujourd'hui la filiation légitime des organisations où le prolétariat s'est retrouvé en tant que classe dans les phases précédentes et aussi qu'elles sont l'expression toujours plus consciente des expériences de l'après-guerre. cela doit servir à prouver que la fraction ne peut vivre, former des cadres, représenter réellement les intérêts finaux du prolétariat qu'à la seule condition de se manifester comme une phase supérieure de l'analyse marxiste des situations, de la perception des forces sociales qui agissent au sein du capitalisme, des positions prolétariennes envers les problèmes de la révolution". (Bilan nº17, "Projet de résolution sur les problèmes de la fraction de gauche", souligné dans l'original).
Nous n'avons pas la place, dans cet article, de développer plus la notion de fraction élaborée par Bilan. Mais c'est de cette conception de la fraction que le CCI se revendique depuis ses origines. Dans ce cadre, le CCI lui-même se considère comme le continuateur de la fraction dont la tâche est de participer à la création des conditions pour le surgissement du parti de demain ; en somme de faire "le pont", selon les termes de Bilan, entre l'ancien parti qu'était l'IC, morte sous le stalinisme, et la future Internationale de la révolution à venir.
Est-ce que le CCI dénature l'expérience de la classe ouvrière?
Maintenant que nous avons posé notre cadre d'analyse, hérité de l'élaboration de la Gauche italienne et qui permet d'appréhender la nature et les tâches d'une véritable fraction, examinons à présent ce qu'en dit notre soi-disant fraction qui prétend représenter fidèlement la continuité des principes du CCI. Lorsqu'elle affirme que c'est le CCI qui les abandonne, on est en droit d'attendre que cela soit démontré.
Avant de considérer le texte sur les fractions publié dans le Bulletin n°9, voyons en quoi la déclaration de formation d'abord du "collectif", ensuite de la "fraction interne", se basent "sur des positions positives et cohérentes clairement exprimées et non sur une collection de points d'opposition et de récrimination".
La déclaration de formation du "collectif" n'était déjà pas prometteuse. En répondant à la question "comment et pourquoi nous nous sommes réunis?", le texte nous explique : "A la suite de la réunion de section Nord consacrée à la discussion du texte d'orientation sur la confiance, chacun de nous a pu faire le constat d'une convergence de points de vue chez la majorité des membres de la section présents à cette réunion, autour d'un commun rejet tant de la démarche que des conclusions du texte d'orientation. Cette convergence venait s'ajouter au précédent constat d'un commun désaccord avec la manière dont est considérée, expliquée et présentée au reste du CCI la récente dégradation des relations au sein de la section Nord". De quoi s'agit-il sinon "une collection de points d'opposition"? Les membres du "collectif" le reconnaissent eux-mêmes, puisque leur perspective est de "Travailler ! Aller au fond des questions. Aller rechercher des réponses, des expériences et des leçons sur les problèmes actuels du CCI dans l'histoire de notre classe, dans l'histoire du mouvement ouvrier". C'est un but louable, et on ne peut que regretter que les membres du "collectif" qui ont formé la "fraction" à peine deux mois plus tard, ne l'ait pas entrepris. Les membres du "collectif" ne sont pas satisfaits de certaines analyses défendues par la majorité, sans pour autant, comme ils l'avouent eux-mêmes, avoir à une orientation alternative à y opposer : "notre opposition, si elle reste minoritaire, devra prendre la forme d'une fraction, luttant au sein de l'organisation pour son redressement. Pour le moment, nous pensons qu'il est encore trop tôt pour la déclarer comme telle, d'abord parce que la politique actuelle n'a pas encore été confirmée ni par le BI plénier ni par un congrès du CCI, ensuite parce qu'il nous faut encore élaborer et rassembler des textes plus développés en tant qu'orientation alternative à la politique actuelle" (souligné par nous). Bravo pour la continuité authentique avec le CCI qui permet à certains d'envisager de se constituer en fraction sans avoir produit de textes fondamentaux à discuter au sein de l'organisation !
Quand la "fraction" se forme, les "textes plus développés" n'ont toujours pas vu le jour. N'empêche, la "fraction" propose comme orientation de :
"- combattre la dérive "révisionniste" actuelle qui ne s'exprime pas seulement sur le plan du fonctionnement, mais aussi sur le plan théorico-politique ;
- développer la réflexion théorique, notamment par un travail approfondi sur l'histoire du mouvement ouvrier, afin d'amener l'organisation à se réapproprier ses propres fondements, ceux du marxisme révolutionnaire, dont s'écarte de plus en plus la politique qui est menée actuellement ;
- remettre l'analyse de la situation internationale au premier plan des discussions[10] et notamment lutter contre une tendance "démoralisatrice" qui tend à marquer notre compréhension de la situation et du rapport de force entre les classes, et cela en vue de renforcer notre intervention dans la classe ouvrière ;
- pousser l'organisation à ne se concevoir que comme une partie du MPP[11] et donc à développer une politique unitaire, plus courageuse et plus déterminée en direction de celui-ci"[12].
Se pose donc à la soi-disant fraction la question de justifier son existence alors que son apparition ne résulte en rien " d'un processus de décantation préalable des positions dans la discussion générale au sein de l'organisation," ni ne peut prétendre qu'elle n'est pas " conçue comme la condition d'une telle décantation"? Est-ce que, sérieusement, "une tendance "démoralisatrice" qui tend à marquer notre compréhension de la situation et du rapport de force entre les classes" correspond de la part du CCI à un abandon programmatique des principes prolétariens? Dans ces conditions, peut-on s'étonner que la majorité de l'organisation ait refusé de reconnaître le bien-fondé de la "fraction"? Après tout, si un fou se prend pour Napoléon, nous sommes bien obligés de constater qu'il se prend pour Napoléon, mais nous ne sommes pas obligés de le suivre dans sa folie en croyant nous-mêmes qu'il l'est vraiment !
C'est donc un véritable tour de force qui échoit à l'article publié dans le Bulletin n°9[13] de la "fraction", puisque son objectif est de donner une caution historique et programmatique à la création de la soi-disant fraction! Nous allons donc essayer d'en faire ressortir la logique, si on peut parler ainsi concernant cette espèce de soupe à prétention historique, afin d'en faire la critique.
La diversion à défaut de divergence, ou comment noyer le poisson
La première partie de l’article veut traiter des fractions dans les moments de lutte de classe ascendante et descendante à travers des exemples tirés des trois Internationales. On apprend donc, que "C'est à travers la fusion de toutes sortes d'organismes et même des sociétés ouvrières que naît la Ière Internationale. (…). Par contre, la période de contre-révolution qui suivit la répression après la Commune de Paris vit que l'apparition des groupements, tendances ou fractions dans l'Internationale prennent un autre tour jusqu'à entraîner sa disparition". Ceci ne nous avance pas beaucoup, puisqu’on ne fait absolument aucune distinction entre "organismes", "groupements", "tendances", ou "fractions". En particulier, on ne fait aucune distinction entre les tendances qui représentaient les premiers courants à l'origine du mouvement ouvrier (Proudhoniens et Blanquistes par exemple) et qui étaient destinés à disparaître, avec le développement de la classe elle-même, et la "forme historique particulière" de la fraction de gauche (pour reprendre les mots de Bilan) représentée par la tendance marxiste.
En ce qui concerne la 2ème Internationale, on nous apprend qu'il y a eu toutes les sortes imaginables de "fractions" : en Allemagne il y avait les Eisenachiens et les Lassalliens, alors qu'en France "le parti constitué après le Congrès de Marseille en 1879, a connu deux fractions : la fraction "collectiviste" de Guesde et de Lafargue et la fraction "possibiliste" de Brousse qui regroupait les réformistes". "Si l'on prend l'exemple du POSDR," continue l'auteur "ce que nous avons développé ci-dessus se vérifie de façon lumineuse: "Après 1905, les 2 fractions : mencheviks et bolcheviks se regroupent une première fois en 1906 et une deuxième fois en 1910 (…) Puis avec la marche à la guerre, nous retrouvons le phénomène de dispersion non seulement dans les 2 fractions principales mais également en leur sein. C'est ainsi que dans le POSDR en 1910, il existe 3 fractions bolcheviques : celle de Lénine, les ozovistes et les conciliateurs, et 3 mencheviques : l'unitaire, celle de Plekhanov contre l'unité et les conciliateurs dont Trotsky". Encore une fois, on ne fait absolument aucune distinction entre les courants réformistes (voire "étatistes" dans le cas des Lassalliens), les courants de gauche (Eisenachiens, Guesdistes, par exemple), et la fraction bolchevique qui avec la Gauche allemande "représentaient [seules] les intérêts du prolétariat alors que droite et centre exprimaient toujours plus la corruption du capitalisme".[14]
Ensuite, l'auteur passe à la période de la révolution russe, fait appel à Trotsky, "le plus digne des révolutionnaires" (sic! on doit supposer que Lénine, Luxemburg, Liebknecht l’étaient moins…), pour raconter l’histoire des différentes "fractions" apparues dans le parti pendant la période révolutionnaire et la guerre civile : l’opposition Kamenev-Zinoviev à la prise de pouvoir en octobre, l’opposition du groupe de Boukharine à la signature de la traité de Brest-Litovsk, ainsi que des oppositions sur la question de l’armée rouge, etc. A l’époque de Brest-Litovsk, "Les partisans de la guerre révolutionnaire constituèrent alors une fraction véritable ayant son organe central". Trotsky souligne, et notre "fraction" saisit l’occasion de nous le rappeler, que "La fraction, le danger de scission furent alors vaincus non par des décisions formelles sur la base des statuts, mais par l'action révolutionnaire".
Rappelons aussi que, si Boukharine et le groupe Kommunist n’ont pas scissionné à l’époque de Brest-Litovsk, ce n’est pas uniquement grâce au développement des faits et de l’argumentation de Lénine en particulier, c’est aussi grâce à leur propre sens des responsabilités, leur compréhension que le parti bolchevique avait un rôle crucial à jouer dans l’éclosion de la révolution au niveau mondial. Surtout, les fractions dont parle Trotsky ici, sont de véritables minorités, formées autour des questions cruciales dont dépend la vie de la révolution. Il est vraiment indécent de venir comparer les minorités au sein du parti bolchevique avec une "fraction" dont le but – où plutôt le but proclamé – est de "remettre l'analyse de la situation internationale au premier plan des discussions".
Le but avoué de toutes ces "démonstrations" est de nous convaincre que "L'histoire du mouvement ouvrier que nous avons retracé à grands traits nous enseigne :
- qu'il a existé et qu'il existera de nombreux types de fractions et groupements ;
- qu'elles n'ont pas toutes connu des programmes achevés pour se constituer en fraction, c'est la raison pour laquelle il existe préalablement un processus de clarification avec le développement de la discussion ;
- que toute fraction ou groupement n'aboutit pas forcément à une scission",
- et que donc "le CCI est obligé de déformer ou d'ignorer des pans entiers de l'expérience de l'histoire ouvrière, particulièrement de l'histoire de ses fractions".
Mais si tous ces courants, oppositions, etc. ont bel et bien existé, que diable cela a-t-il à voir avec la fraction, telle qu'elle est définie depuis toujours par le CCI sur la base des travaux de la Gauche italienne? En réalité, le but de cette partie de l'article est tout simplement de faire diversion en se cachant derrière un étalage de connaissances mal digérées, de faire oublier que pour le CCI la notion de fraction a un sens bien déterminé vis-à-vis duquel l'existence de notre prétendue "fraction interne" n'a absolument aucune justification théorique ni principielle.
Il est donc clair que la "fraction interne" qui se prévaut du maintien des positions fondamentales du CCI, a choisi de jeter aux oubliettes le concept de "fraction" tel que le CCI l'utilise, pour endosser celui de Trotsky et du mouvement ouvrier avant Bilan, c'est-à-dire un nom appliqué aux différents courants, minorités, tendances et fractions qui existent inévitablement dans toute l'histoire du mouvement ouvrier. Rappelons quand même au passage que c'est notamment face et en opposition à la conception qu'avait Trotsky des tâches à mener dans les années 1930, que Bilan a élaboré sa notion de fraction. Mais apparemment, pour notre "fraction interne", Trotsky est devenu source de référence sur la question.
Justifier l'indiscipline
Il vaut la peine de s'attarder sur ce que l'auteur nous dit des fractions issues de la 3e Internationale, en période de "difficultés du mouvement ouvrier" puisque c'est en particulier de celles-ci que se revendique le CCI et que, selon notre conception - et celle de Bilan - c'est justement dans de telles périodes où la classe n'est pas capable de faire surgir le parti et que se justifie le travail des fractions. En fait, le texte a peu à dire sinon que "dans l'IC, la discussion théorique a été rapidement biaisée, empêchée, écourtée et remplacée par la question de la discipline, ce qui a abouti rapidement à l'exclusion des Oppositions". Des immenses problèmes auxquels étaient confrontés le mouvement ouvrier, l'Internationale, les partis, les prémisses des futures fractions, notre "fraction interne" en retient un - et pour cause, c'est celui de la discipline.
En effet, le problème pour la "fraction interne", c'est que non seulement elle doit s'échapper du carcan trop rigoureux et contraignant des analyses et des principes de base du CCI sur la question organisationnelle, mais elle doit aussi justifier les violations les plus flagrantes de la discipline minimale qui seule permet à l'organisation de fonctionner, voire d'exister, violations qui ont marqué l'existence de la "fraction interne" dès avant sa naissance officielle et lui ont valu, dans le CCI, le surnom d'"Infraction". Elle s'y prend d'abord de façon tout à fait originale : "Du fait de la création [dans la Troisième internationale] du nouveau régime intérieur des organisations communistes de la plus grande unité et centralisation internationale, la question de la discipline intérieure prend un autre caractère. C'est la raison pour laquelle dans la phase de dégénérescence de l'IC et des PC, la vie des fractions est tout autre : tout ce qui pousse à l'unité dans la phase de montée des luttes pousse encore plus fortement à la désunion dans la phase de déclin des luttes".[15] Cette phrase "géniale" est précisée de la sorte dans un article sur la "discipline" justement, publié dans le bulletin n°13: "si, au 19ème siècle dans la social-démocratie, c'était la gauche qui défendait avec fermeté la discipline dans le parti contre les opportunistes qui revendiquaient une "liberté d'action", c'est-à-dire d'avoir les mains libres pour… fricoter avec la bourgeoisie, par contre au 20ème siècle, dans le capitalisme décadent, c'est la droite dans les PC qui a été la championne de la discipline interne, comme le sont aujourd'hui nos liquidationnistes, pour pouvoir faire taire toutes les divergences, ce qui signifiait faire taire et même éliminer la gauche, c'est-à-dire la position marxiste". Nous n'avons pas la place ici de dénoncer dans le détail le ridicule de cette position – dont le but est tout simplement d'assimiler le CCI aujourd'hui aux PC stalinisés, tout en étant trop hypocrite pour le dire ouvertement. Il vaut néanmoins la peine de rappeler, et c’est quelque chose que le CCI a toujours considéré comme positif, que l'IC est en effet la première internationale fondée sur un programme explicitement communiste, dédié au renversement immédiat du capitalisme. En tant que telle, elle exige des partis membres, considérés comme de simples sections nationales du parti mondial, une discipline face aux décisions du centre, en particulier l’adoption d’un programme unifié, et l’exclusion du parti des sociaux-chauvins et des centristes. C’est le but même des 21 Conditions, dont la 21ème était proposée par nul autre que Bordiga, chef de file de la Gauche italienne…dans le but notamment de lutter contre l'indiscipline de courants opportunistes tels que le parti français. Tant que l'IC défend le programme du prolétariat, cette plus grande unité et centralisation internationale du parti est une nécessité pour la révolution communiste, elle exprime un développement du programme qui correspond aux besoins de la lutte internationale et révolutionnaire de la classe ouvrière.[16] La "nouveauté" apportée par la "fraction interne" avec l'idée qu' "au 20ème siècle, dans le capitalisme décadent, c'est la droite dans les PC qui a été la championne de la discipline interne" n'est qu'un tour de passe-passe pour faire passer sa propre indiscipline.
La véritable fraction?
Jusqu'ici, nous n'avons pas appris grand chose, sinon qu’il y a eu beaucoup de fractions dans l’histoire du mouvement ouvrier, et que celles-ci peuvent être des tendances, des groupements, des oppositions, qu’elles peuvent contribuer soit à l’unité de l’organisation, soit à son éclatement. Mais dans la deuxième partie de l'article, on nous dit que "ce qui fonde l'existence d'une véritable fraction, c'est l'existence d'une crise communiste" (souligné par nous). Comment ça? Tous ces "groupements, tendances, fractions" dont on vient de parler en long et en large n'étaient donc pas de "véritables fractions"? Notre auteur cite les textes de Bilan – sur lesquels le CCI s'est toujours basé, en effet – afin de démontrer la nécessité et le bien-fondé d'une fraction en lutte contre la dégénérescence d'une organisation communiste. (On remarquera quand même qu'il prend soin de ne pas citer les textes mêmes du CCI en la matière.) Mais, si la "véritable" fraction (dixit les infractionnistes) est la fraction telle qu'elle est définie par la Gauche italienne, c’est à dire un organisme qui surgit face à la dégénérescence du parti, et dont le rôle est soit de redresser l’ancien parti, soit de préparer les futurs cadres suite à la trahison définitive de ce dernier, quid de tous les autres exemples de "fractions" dont le texte est rempli ? Décidément, la "fraction" a inventé quelque chose de nouveau : une fraction à géométrie variable, que l’on peut plier et tordre dans tous les sens pour les besoins de la cause. Mais en réalité, ce n'est pas nouveau dans le mouvement ouvrier, c'est la méthode typique de l'opportunisme qui utilise les principes en fonction des circonstances, et selon l'intérêt qu'il y trouve. Si nos "infractionnistes" font maintenant appel à la Gauche italienne, c'est parce que la gauche de l'IC s'est souvent trouvée contrainte de rompre la discipline de l'Internationale pour assurer sa fidélité au programme du prolétariat et que la référence à la lutte de la gauche contre la dégénérescence de l'Internationale communiste vers le stalinisme leur sert à justifier le mépris flagrant pour nos principes, nos règles communes et pour leurs anciens camarades. Si la situation de notre "fraction" peut être comparée à celle de la Gauche italienne, alors forcément le CCI doit jouer le rôle de l'IC stalinisée.[17]. Le tour est joué !
Malgré tout, la "fraction" aimerait bien trouver une manifestation flagrante de la dégénérescence du CCI, pour pouvoir se justifier de façon un peu plus consistante. Le problème, c'est que l'on peut tourner les choses comme on veut, on ne peut pas nier la place du CCI aujourd'hui parmi les rares organisations à défendre contre vents et marées l'internationalisme prolétarien : nous pouvons être "idéalistes" (dixit le BIPR), "conseillistes/anarchistes" (dixit le PCI) ou "léninistes" (dixunt les anarcho-conseillistes), mais personne jusqu'ici n'a jamais nié que le CCI est, sans ambiguïté et sans concessions, internationaliste. A défaut de pouvoir mettre en évidence une telle trahison du principe qui représente la ligne de démarcation entre prolétariat et bourgeoisie, elle en est réduite à la quête d'indices annonçant une telle perspective. Ainsi, on lit ceci dans la conclusion d'un article sur la crise Inde/Pakistan: "Quelle est la conclusion naturelle, logique, qui découle de toute l'argumentation de l'article de la Revue internationale ? (…)Que seules les grandes puissances, et en premier lieu les Etats-Unis, font des efforts, bien qu'insuffisants, "pour faire tomber la tension" et éviter la guerre (…)Tout cela donc, de manière naturelle, logique, ouvre la porte à ce que - quand l'occasion se présentera - on commence à appeler ou à "exiger" des bourgeoisies des grandes puissances qu'au lieu de "permettre" ou "d'attiser" les haines et les massacres, elles agissent plus résolument "pour faire tomber la tension" et qu'elles arrêtent le chaos...". Le procédé est tout simplement pitoyable car, en toute bonne fois, il n'est possible d'interpréter de la sorte pas plus la forme que le fond de notre analyse. Et la "fraction" termine ainsi son propos : "Il n'y a aucun appel concret, ni à la classe, ni aux révolutionnaires... Ce qui nous renvoie aux belles résolutions de la Seconde internationale à la veille de la guerre", ayant oublié apparemment que ces "belles résolutions" ont été proposées par… Lénine et Luxembourg; et qu'elles ont jeté les bases pour Zimmerwald. Heureusement pour la "fraction" que le ridicule ne tue pas !
De l'opportunisme à l'escroquerie
Il est vrai que le premier expert en étymologie venu vous expliquera que le sens des mots évolue dans le temps. Mais en tant que marxistes, ce qui nous intéresse n'est pas tant l'évolution du mot, que l'évolution des conditions historiques qui la sous-tendent. Par ceci nous voulons dire à la fois l'évolution des conditions historiques globales (ascendance ou décadence), et celle de l'expérience et de la compréhension du mouvement ouvrier. Alors, faire comme la "fraction" et prendre partout où on elle le trouve le mot "fraction", en ignorant complètement l’évolution de son sens historique et surtout le sens qu’il a acquis pour la Gauche communiste d’aujourd’hui, et noyer complètement le poisson en identifiant "fractions, groupements, tendances", "c’est consacrer le mot en rejetant la substance" comme disait Bilan (voir ci-dessus). Ce n’est, en fait, rien d’autre que de piller l’histoire du mouvement ouvrier à la recherche de justifications pour une politique et un comportement injustifiables. D’un côté, on cite un nombre infini de minorités diverses et variées pour démontrer que l’on n’a pas besoin, pour former une "fraction", de programme ni même de positions cohérentes,, ni de lutter contre la dégénérescence d’une organisation, ni de chercher une nouvelle cohérence et, de l’autre, on fait appel à la Gauche italienne (la "véritable" fraction, rappelons-le) pour justifier toutes les infractions commises contre nos principes organisationnels au nom d’une lutte contre la dégénérescence du CCI. C’est à dire, que l’on se réclame du droit de dire et de faire n’importe quoi, du moment que l’on s’arroge l’appellation de "fraction", sur la base de citations prises n’importe comment chez nos prédécesseurs. Si cela est une pratique déjà dénoncée par Marx et Lénine, de transformer les figures du mouvement ouvrier en icônes inoffensifs afin de justifier la politique de l’opportunisme,[18] notre "fraction" a fait un pas de plus : en cherchant à cacher sa pratique opportuniste derrière ce fatras pseudo-théorique, elle se livre à une véritable tentative d'escroquerie envers la notion même de fraction envers le milieu prolétarien.
Plus ça change, plus c'est la même chose, mais en pire
"Le congrès du CCI a marqué l’entrée définitive du CCI dans une phase de dégénérescence (…) Cette dégénérescence s’est manifestée, sur le plan des positions politiques, par la répudiation de certains des principes sur lesquels il s’était constitué (…) mais aussi et de la façon la plus caricaturale sur le plan de son fonctionnement interne par l’interdiction de réunions de discussions entre camarades minoritaires (…) la censure des textes publics de la tendance, la proposition de modifier sa plate-forme et ses statuts sans texte explicatif ni débat, ainsi qu’une multitude de résolutions et de prises de position à l’encontre des camarades minoritaires. La dégénérescence de la vie interne du CCI s’est marquée de façon irrévocable par l’exclusion de la tendance de l’instance suprême de l’organisation – son congrès international – suite au refus principiel de la tendance de prêter serment de fidélité à l’organisation pour après le congrès (…)
Par sa constitution, la Fraction entend :
e) représenter la continuité programmatique et organique avec le pôle de regroupement que fut le CCI, avec sa plate-forme et ses statuts qu’il a cessé de défendre (…)
g) établir un pont entre l’ancien pôle de regroupement que fut le CCI et le nouveau pôle que pourra se développer sur les bases de la Fraction dans le cours futur de la lutte de classe".
Le texte que nous venons de citer constitue la déclaration de la formation d’une "fraction"… non pas en 2001, mais en 1985 lors de la formation de la soi-disant "Fraction Externe du CCI", qui aujourd’hui est arrivée... non pas à défendre la continuité du CCI, mais à en mettre en question les positions les plus fondamentales, telles que celle de la décadence du capitalisme. On comprendra pourquoi nous restons de marbre face aux accusations actuelles de l’Infraction…
Il nous reste quand même à faire remarquer une différence d’attitude de la "fraction" de l’époque avec celle d’aujourd’hui. Si la "fraction" de 1985 s’est empressée par la suite de répandre des mensonges sans fin sur la "dégénérescence" du CCI, elle a tout de même terminé sa déclaration par ces mots : "[La Fraction] demande d’organiser immédiatement des rencontres avec les sections de Belgique, d’Angleterre, et des Etats-Unis afin de procéder à la remise du matériel et des finances appartenant à l’organisation". Alors que "la fraction" actuelle est partie en volant non seulement l’argent mais les documents les plus sensibles de l’organisation : les adresses des camarades et des abonnés.[19]
Ce n'est pas la première fois dans la l'histoire du CCI qu'un regroupement de mécontents traduit ses frustrations, ses rancœurs, bref tous ses griefs à l'encontre de l'organisation et de ses militants, en se constituant en fraction pour défendre le "vrai CCI" (cf. "La question du fonctionnement de l'organisation dans le CCI" dans la Revue Internationale n° 109). Néanmoins, on ne peut que constater une évolution dans les agissements de tels types de regroupement qui portent la marque de leur époque. La dernière "fraction" en date, avec ses mœurs de voyous, exprime pleinement le poids de l'idéologie du capitalisme en décomposition qui s'infiltre jusque dans les organisations révolutionnaires.
Jens, 6/12/2002
1 Pour des raisons de place, nous ne pouvons pas citer ici toute la lettre de refus des "fractionnistes", mais relevons notamment qu'ils exigent "la reconnaissance formelle et écrite de la fraction"(...),"la levée des sanctions en cours à l'égard de tous les membres de la Fraction [on devait donc leur donner le droit de transgresser à leur guise toute règle organisationnelle puisqu'ils étaient une "fraction"] et l'arrêt immédiat de la politique de discrédit, de mesures disciplinaires à leur égard; ce qui implique forcément le rejet de l'explication de 'clanisme' concernant la politique de notre Fraction (...) [les membres de la "fraction" n'ont jamais été sanctionnés pour "clanisme" comme ils le sous-entendent!], une remise en question de l'explication du clanisme comme cause de la crise actuelle...".
2 Voir dans la Revue Internationale n°110 l'article sur la Conférence Extraordinaire et notre analyse de la fraction.
3 Dans le n°9 de leur Bulletin. Le lecteur trouvera les textes cités sur membres.lycos.fr/bulletincommuniste.
4 Ce qui démontre que l'analyse de la nature de "fraction" n'est pas le simple fait d'une prétendue "direction liquidatrice", selon les termes de la fraction, mais de l'ensemble du CCI.
5 Voir la Revue Internationale n°33.
6 Selon les accusations de la "fraction", répétées ad nauseam dans leur Bulletin, il leur aurait été interdit d'écrire dans les Bulletins internes de l'organisation. La réalité, c'est que l'organisation a exigé – dans une résolution votée par les futurs membres de la "Fraction" que ces militants "fassent une critique radicale de leurs agissements" et "s'engagent dans une réflexion de fond sur les raisons qui les ont conduits à se comporter comme des ennemis de l'organisation" [ dans des réunions secrètes] et qu'ils s'en expliquent avant toute chose dans les bulletins internes. Suite à la création de la fraction – qui au contraire se réclame de ces réunions secrètes – nous avons simplement exigé qu'ils prennent position par écrit sur leur contenu. Voilà une drôle de censure, qui exige que la minorité écrive des textes, alors que cette dernière se revendique du droit de se taire! Nous renvoyons à l'article de la Revue internationale n°110 : "le combat pour la défense des principes organisationnels" pour la présentation détaillée du combat qu'a dû mener l'organisation vis-à-vis du comportement des membres de la "fraction".
7 Voir la Revue Internationale n°110 (Cf. note précédente) pour une présentation détaillée des faits qui ont entouré la constitution de ce « collectif ».
8 Op. cit., Revue Internationale n°33
9 Dans son article, la "fraction interne" fait tout un développement sur le fait que le pour le CCI une fraction "aboutit nécessairement à la scission" ; l'auteur de l'article a manifestement lu notre article de la Revue internationale n°108 avec des lunettes spéciales qui lui permettaient d'y voir ce qu'il avait envie.
10 C'est particulièrement culotté comme revendication, étant donné que les membres de la "fraction" ont ensuite refusé d'assister à une réunion de l'organe central, sous prétexte qu'avant de discuter de la situation créée par la "fraction", on allait discuter de... la situation internationale!
11 Etant donné que notre organisation est toujours, malheureusement, la seule à défendre de façon conséquente et sans la moindre ambiguïté que le milieu politique prolétarien existe, c’est fort de café comme raison pour former une fraction destinée à combattre la dégénérescence du CCI!
12 Nous passons ici sur les diverses accusations de "dérives organisationnelles" que contient la déclaration, et notamment sur l'accusation que le CCI aurait sanctionné un camarade qui « défendait courageusement ses positions ». La réalité, c'est que ce militant s'était fait l'écho, en cachette, de la campagne développée dans les couloirs par Jonas, contre un de nos militants accusé d'être un agent de l'Etat.
13 Voir membres.lycos.fr/bulletincommuniste/francais/b9/groupemindex.html.
14 Bilan n°17, "Projet de résolution sur les problèmes des fractions de gauche”.
15 Sans doute cette conclusion se veut un véritable camouflet à la dégénérescence théorique du CCI : "Tout ce qui pousse à l'unité dans la phase de montée des luttes…" - c'est-à-dire le développement de la lutte de classe, et surtout de la conscience du prolétariat des enjeux d’une situation révolutionnaire – ce même "tout" "pousse encore plus fortement à la désunion dans la phase de déclin des luttes".
16 Pour plus de développements, nous renvoyons à l'article de la Revue internationale n°110 sur la discipline. Notons au passage que notre "Infraction" a une idée bien à elle de la discipline, qui peut se résumer ainsi : quand nous sommes la majorité et que nous "tenons les rênes" de l’organisation, alors la discipline est bien ; quand nous sommes la minorité et devons accepter les mêmes règles que les autres, alors la discipline est mauvaise.
17J usqu'à récemment, une chose seulement manquait au tableau: un Staline dans le CCI. Avec "L'ultime" – et nauséabonde – "mise au point" publiée dans le Bulletin n°14, c'est chose faite.
18 "Du vivant des grands révolutionnaires, les classes d'oppresseurs les récompensent par d'incessantes persécutions; elles accueillent leur doctrine par la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les campagnes les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie d'en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une certaine auréole afin de "consoler" les classes opprimées et de les mystifier ; ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de son contenu , on l'avilit et on en émousse le tranchant révolutionnaire. C'est sur cette façon d'"accommoder" le marxisme que se rejoignent aujourd'hui la bourgeoisie et les opportunistes du mouvement ouvrier" (Lénine, L'Etat et la révolution).
19 Il vaut la peine de noter que la dernière publication de l’Infraction sur Internet a rendu publique, pour les polices du monde entier, la date de la conférence générale de notre section au Mexique…Cf. l'article "Les méthodes policières de la FICCI" paru dans Révolution Internationale n° 330.
Vie du CCI:
Courants politiques:
- FICCI - GIGC/IGCL [16]
Texte d'orientation, 2001 : La confiance et la solidarité dans la lutte du prolétariat, 2ème partie
- 4179 reads
Nous publions ci-dessous la seconde partie d'un texte d'orientation mis en discussion au sein du CCI durant l'été 2001 et adopté par la conférence extraordinaire de notre organisation qui s'est tenue en mars 2002 [1] [17]. La première partie de ce texte a été publiée dans la Revue internationale n° 111 et aborde les points suivants :
- Les effets de la contre-révolution sur la confiance en soi et les traditions de solidarité des générations contemporaines du prolétariat
- Les effets au sein du CCI des faiblesses dans la confiance et dans la solidarité
- Le rôle de la confiance et de la solidarité dans l'ascension de l'humanité
4. La dialectique de la confiance en soi de la classe ouvrière : passé, présent, futur
Puisque le prolétariat est la première classe de la société ayant une vision historique consciente, il est compréhensible que les bases de sa confiance dans sa mission soient également historiques, incorporant la totalité du processus qui lui a donné naissance. C'est pourquoi, en particulier, cette confiance se base de façon décisive sur le futur et donc sur une compréhension théorique. Et c'est pourquoi le renforcement de la théorie constitue l'arme privilégiée dans le dépassement des faiblesses congénitales du CCI concernant la question de la confiance. Cette dernière, par définition, est toujours la confiance dans l'avenir. Le passé ne peut être changé, donc il ne peut être question de confiance orientée vers ce dernier.
Toute classe révolutionnaire ascendante base sa confiance dans sa mission historique non seulement sur sa force présente mais aussi sur ses expériences et ses réalisations passées ainsi que sur ses buts futurs. Néanmoins, la confiance des classes révolutionnaires du passé, et de la bourgeoisie en particulier, était principalement enracinée dans le présent - dans le pouvoir économique et politique qu'elles avaient déjà gagné au sein de la société existante. Puisque le prolétariat ne peut jamais posséder un tel pouvoir au sein du capitalisme, il ne peut jamais y avoir une telle prédominance du présent. Sans la capacité d'apprendre de son expérience passée et sans une clarté et une conviction réelles par rapport à son but comme classe, il ne peut jamais gagner la confiance en lui-même pour dépasser la société de classes. En ce sens, le prolétariat est, plus que n'importe quelle classe avant lui, une classe historique dans le plein sens du terme. Le passé, le présent et le futur sont les trois composantes indispensables de sa confiance en lui-même. De ce fait, on n'a pas à se demander pourquoi le marxisme, l'arme scientifique de la révolution prolétarienne, a été appelé par ses fondateurs le matérialisme historique ou dialectique.
a) Cette prééminence du futur n'élimine pas du tout le rôle du présent dans la dialectique de la lutte de classe. Précisément parce que le prolétariat est une classe exploitée, il a besoin de développer sa lutte collective pour que la classe dans son ensemble devienne consciente de sa force réelle et de son futur potentiel. Cette nécessité que la classe dans son ensemble prenne contiance en elle-même constitue un problème complètement nouveau dans l'histoire de la société de classes. La confiance en soi des classes révolutionnaires du passé, lesquelles étaient des classes exploiteuses, se basait toujours sur une claire hiérarchie au sein de chacune de ces classes et au sein de la société dans son ensemble. Elle se basait sur la capacité à commander, à soumettre d'autres parties de la société à sa propre volonté, et donc sur le contrôle de l'appareil productifet de l'appareil d'État. En fait, il est caractéristique de la bourgeoisie que même dans sa phase révolutionnaire elle trouvait d'autres catégories sociales pour se battreà son service, et que, une fois au pouvoir, elle "déléguait" de plus en plus ses tâches à des serviteurs appointés.
Le prolétariat ne peut pas déléguer sa tâche historique à quiconque. C'est pourquoi il revient à la classe de développer sa confianceen elle-même. Et c'est pourquoi la confiance dans le prolétariat est toujours nécessairement une confiance dans la classe dans son ensemble, jamais dans une partie de celle-ci.
C'est le fait pour le prolétariat d'être une classe exploitée qui donne à sa confiance en soi un caractère fluctuant et même erratique, connaissant des hauts et des bas avec le mouvement de la lutte de classe. De plus, les organisations politiques révolutionnaires sont elles-mêmes profondément affectées par ces hauts et ces bas, dans la mesure où la façon dont elles s'organisent, se regroupent et interviennent dans la classe dépend en grande partie de ce mouvement. Et comme nous le savons, dans les périodes de profonde défaite, seules de minuscules minorités sont capables de conserver leur confiance dans la classe.
Mais ces fluctuations dans la confiance ne sont pas seulement liées aux vicissitudes de la lutte de classe. En tant que classe exploitée, le prolétariat peut être victime d'une crise de confiance à tout moment, même dans le feu des luttes révolutionnaires. La révolution prolétarienne "interrompt constamment son propre cours, revenant sur ce qu'elle avait apparamment déjà accompli pour recommencer de nouveau ", etc. En particulier, "elle recule sans cesse devant l'immensité de ses propres buts "comme l'écrivait Marx ([2] [18]).
La révolution russe de 1917 montre clairement que non seulement la classe dans son ensemble mais également le parti révolutionnaire peuvent être affectés par de telles hésitations. En fait, entre février et octobre 1917, les bolcheviks ont traversé plusieurs crises de confiance dans la capacité de la classe à remplir les tâches de l'heure. Des crises qui ont culminé dans la panique qui a étreint le comité central du parti bolchevik face à l'insurrection.
La révolution russe est donc la meilleure illustration du fait que les racines les plus profondes de la confiance dans le prolétariat, contrairement à celle de la bourgeoisie, ne peuvent jamais résider dans le présent. Pendant ces mois dramatiques, c'est avant tout Lénine qui a personnifié la confiance inébranlable dans la classe, confiance sans laquelle aucune victoire n'est possible. Et il l'a fait parce qu'à aucun moment il n'a abandonné la méthode théorique et historique propre au marxisme.
Néanmoins, la lutte massive du prolétariat est un moment indispensable au développementde la confiance révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est une clé de toute la situation historique. En permettant une reconquête de l'identité de classe, c'est une pré-condition pour que la classe dans son ensemble réassimile les leçons du passé et redéveloppe une perspective révolutionnaire,
Ainsi, comme pour la question de la conscience de classe à laquelle elle est intimement liée, nous devons distinguer deux dimensions de cette confiance : d'une part l'accumulation historique, théorique, programmatique et organisationnelle de la confiance, représentée par les organisations révolutionnaires, et, plus largement, par le processus historique de maturation souterraine au sein de la classe, d'autre part le degré et l'extension de la confiance en soi au sein de la classe dans son ensemble à un moment donné.
b) La contribution du passé à cette confiance n'est pas moins indispensable. En premier lieu parce que l'histoire contient des preuves irréfutables du potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière. La bourgeoisie elle-même comprend l'importance de ces exemples passés pour son ennemi de classe, c'est pourquoi elle attaque constamment cet héritage, et, surtout, la révolution d'octobre 1917.
En deuxième lieu, un des facteurs les plus aptes à rassurer le prolétariat après une défaite consiste dans sa capacité à corriger ses erreurs passées et à tirer des leçons de l'histoire. Contrairement à la révolution bourgeoise qui va de victoire en victoire, la victoire finale du prolétariat se prépare à travers une série de défaites. Le prolétariat est donc capable de transformer ses défaites passées en éléments de confiance dans le futur. C'était l'une des bases principales de la confiance que Bilan a maintenue au plus profond de la contre-révolution. En fait, plus la confiance dans la classe est profonde, plus les révolutionnaires ont le courage de critiquer sans merci leurs propres faiblesses et celles de la classe, moins ils ont besoin de se consoler, plus ils se caractérisent par une sobre lucidité et l'absence d'euphorie insensée. Comme Rosa l'a répété maintes fois, la tâches des révolutionnaires est de dire ce qui est.
En troisième lieu, la continuité, en particulier la capacité de transmettre les leçons d'une génération à l'autre, a toujours été fondamentale pour le développement de la confiance en soi de l'humanité. Les effets dévastateurs de la contre-révolution du 20e siècle sur le prolétariat en constituent la preuve en négatif. Il est d'autant plus important pour nous aujourd'hui d'étudier les leçons de l'histoire, afin de transmettre notre propre expérience et celle de toute la classe ouvrière aux générations de révolutionnaires qui nous succéderont.
c) Mais c'est la perspective future qui offre la base la plus profonde pour notre confiance dans le prolétariat. Cela peut paraître paradoxal. Comment est-il possible de fonder la confiance sur quelque chose qui n'existe pas encore ? Mais cette perspective existe bien. Elle existe comme but conscient, comme construction théorique, de la même façon que le bâtiment à construire existe déjà dans la tête de l'architecte. Avant même que de le réaliser pratiquement, le prolétariat est l'architecte du communisme.
Nous avons déjà vu qu'en même temps que le prolétariat comme force indépendante dans l'histoire est apparue la perspective du communisme : la propriété collective non des moyens de consommation mais des moyens de production. Cette idée était le produit de la séparation des producteurs d'avec les moyens de production, à travers le travail salarié et la socialisation du travail. En d'autres termes, elle était le produit du prolétariat, de sa position dans la société capitaliste. Ou, comme Engels l'écrit dans 1'Anti-Dühring, la principale contradiction au coeur du capitalisme est celle entre deux principes sociaux, un principe collectif à la base de la production moderne, représenté par le prolétariat, et un principe individuel, anarchique, basé sur la propriété privée des moyens de production, représenté par la bourgeoisie.
La perspective communiste avait surgi déjà avant que la lutte prolétarienne ait révélé son potentiel révolutionnaire. Ce que ces événements ont donc clarifié, c'est que ce sont les luttes ouvrières qui seules peuvent mener au communisme. Mais la perspective elle-même existait avant. Elle se basait principalement sur les leçons passées et contemporaines du combat prolétarien. Et même dans les années 1840, quand Marx et Engels ont commencé à transformer le socialisme d'utopie en science, la classe n'avait pas donné beaucoup de preuves de sa puissance révolutionnaire.
Cela veut dire que, dès le début, la théorie était elle-même une arme de la lutte de classe. Et jusqu'à la défaite de la vague révolutionnaire, comme nous l'avons dit, cette vision de son rôle historique était cruciale pour donner confiance à la classe pour s'affronter au capital.
Donc, en même temps que la lutte immédiate et les leçons du passé, la théorie révolutionnaire est pour le prolétariat un facteur indispensable de confiance, de son développement en profondeur en particulier, mais à long terme aussi de son extension. Puisque la révolution ne peut être qu'un acte conscient, elle ne peut être victorieuse que si la théorie révolutionnaire s'empare des masses.
Dans la révolution bourgeoise, la perspective n'était guère plus qu'une projection de l'esprit de l'évolution présente et passée : la conquête graduelle du pouvoir au sein de l'ancienne société. Dans la mesure où la bourgeoisie a développé des théories du futur, elles se sont avérées des mystifications grossières ayant pour tâche principale d'enflammer les passions révolutionnaires. Le caractère irréaliste de ces visions ne portait pas préjudice à la cause qu'elles servaient. Pour le prolétariat au contraire, c'est le futur le point de départ. Dans la mesure où il ne peut construire graduellement son pouvoir de classe au sein du capitalisme, la clarté théorique est une de ses armes les plus indispensables :
"La philosophie idéaliste classique a toujours postulé que 1'humauité vit dans deux mondes différents, le monde matériel dans lequel domine la nécessité et celui de l'esprit ou de l'imagination dans lequel règne la liberté.
En dépit de la nécessité de rejeter les deux mondes auxquels appartient, selon Platon ou Kant, l'humanité, il est néanmoins correct que les êtres humains vivent simultanément en deux mondes différents (..) Les deux mondes dans lesquels vit l'humanité sont le passé et le futur. Le présent est la frontière entre les deux. Toute son expérience réside dans le passé (..) Elle ne peut rien y changer, tout ce qu'elle peut faire, c'est accepter sa nécessité. Aussi le monde de l'expérience, le monde de la connaissance est aussi celui de la nécessité. Il en va autrement pour le futur. Je n'en ai pas la moindre expérience. II se présente apparemment libre devant moi, comme un monde que je ne peux explorez sur la base de la connaissance, mais dans lequel je dois m'affirmer par l'action. (...) Agir veut toujours dire choisir entre différentes possibilités, et même si c'est seulement entre agir ou ne pas agir, cela veut dire accepter et rejeter, défendre et attaquer. (..) Mais non seulement le sentiment de liberté est une pré condition de l'action, il est aussi un but donné. Si le monde du passé est gouverné par les rapports entre la cause et l'effet (causalité), celui de l'action, du futur l'est par la détermination (téléologie)".([3] [19])"
Déjà avant Marx, c'est Hegel qui a résolu, de façon théorique, le problème du rapport entre la nécessité et la liberté, entre le passé et le futur. La liberté consiste à faire ce qui est nécessaire, disait Hegel. En d'autres termes, ce n'est pas en se révoltant contre les lois d'évolution du monde mais en les comprenant et en les employant à ses propres fins que l'homme agrandit son espace de liberté. "La nécessité est aveugle seulement dans la mesure où elle n 'est pas comprise "([4] [20]). De même il est nécessaire pour le prolétariat de comprendre les lois d'évolution de l'histoire pour être capable de comprendre et donc de remplir sa mission historique. De ce fait, si la science, et avec elle, la confiance de la bourgeoisie étaient dans une grande mesure basées sur une compréhension croissante des lois de la nature, la science et la confiance de la classe ouvrière sont basées sur la compréhension de la société et de l'histoire.
Comme l'a montré MC dans une contribution de défense classique du marxisme sur cette question([5] [21]), c'est le futur qui doit prédominer sur le passé et le présent dans un mouvement révolutionnaire parce que c'est ce qui détermine sa direction. La prédominance du présent mène invariablement à des hésitations, créant une vulnérabilité énorme envers l'influence de la petite bourgeoisie, personnification de l'hésitation. La prédominance du passé mène à l'opportunisme et donc à l'influence de la bourgeoisie comme bastion de la réaction moderne. Dans les deux cas, c'est la perte de la vision à long terme qui conduit à la perte de la direction révolutionnaire.
Comme le disait Marx, « la révolution sociale du 19e siècle ne peut tirer sa poesie du passé, seulement du futur »([6] [22]).
De cela nous devons conclure que l'immédiatismeest le principal ennemi de la confiance en soi du prolétariat, pas seulement parce que la route vers le communisme est longue et tortueuse, mais également parce que cette confiance s'enracine dans la théorie et dans le futur, tandis que l'immédiatisme est une capitulation face aupréscnt, l'adoration des faits immédiats. A travers l'histoire, l' immédiatisme a constitué le facteur dominant de la désorientation dans le mouvement ouvrier. Il a été à la racine de toutes les tendances à placer "le mouvement avant le but" comme le disait Bernstein, et donc à l'abandon des principes de classe. Qu'il prenne la forme de l'opportunisme comme chez les révisionnistes au tournant du siècle ou chez les trotskistes dans les années 30; ou de l'aventurisme comme chez les Indépendants en 1919 et le KPD en 1921 en Allemagne, cette impatience politique petite-bourgeoise ramène toujours à la trahison du futur pour un plat de lentilles, pour reprendre l'image de la Bible. A la racine de cette attitude absurde, il y a toujours une perte de confiance dans la classe ouvrière.
Dans l'ascension historique du prolétariat, passé, présent et futur forment une unité. En même temps, chacun des ces "mondes" nous avertit d'un danger spécifique. Le danger concernant le passé est celui d'oublier ses leçons. Le danger du présent est d'être victime des apparences immédiates, de la surface des choses. Le danger concernant le futur est de négliger et d'affaiblir les efforts théoriques.
Ceci nous rappelle que la défense et le développement des armes théoriques de la classe ouvrière constituent la tâche spécifique des organisations révolutionnaires, et que ces dernières ont une responsabilité particulière dans la sauvegarde de la confiance historique dans la classe.
5. La confiance, la solidarité et l'esprit de parti ne sont jamais des acquis définitifs.
Comme nous l'avons dit, la clarté et l'unité sont les principales bases de l'action sociale confiante. Dans le cas de la lutte de classe prolétarienne internationale, cette unité n'est évidemment qu'une tendance qui pourra un jour se réaliser à travers un conseil ouvrier à l'échelle mondiale. Mais politiquement, les organisations unitaires qui surgissent dans la lutte sont déjà l'expression de cette tendance. Même en dehors de ces expressions organisées, la solidarité ouvrière - y compris lorsqu'elle s'exprime à un niveau individuel - manifeste aussi cette unité. Le prolétariat est la première classe au sein de laquelle il n'y a pas d'intérêts économiques divergents ; en ce sens, sa solidarité annonce la nature de la société pour laquelle il lutte.
Cependant, l'expression la plus importante et permanente de l'unité de classe est l'organisation révolutionnaire et le programme qu'elle défend. De ce fait, cette dernière est l'incarnation la plus développée de la confiance dans le prolétariat - et aussi la plus complexe.
Comme telle, la confiance est au coeur même de la construction d'une telle organisation. Ici, la confiance dans la mission du prolétariat s'exprime directement dans le programme politique de la classe, dans la méthode marxiste, dans la capacité historique de la classe, dans le rôle de l'organisation envers la classe, dans ses principes de fonctionnement, dans la confiance des militants et des différentes parties de l'organisation en eux-mêmes et les uns envers les autres. En particulier, c'est l'unité des différents principes politiques et organisationnels qu'elle défend et l'unité entre les différentes parties de l'organisation qui sont les expressions les plus directes de la confiance dans la classe : unité de but et d'action, du but de la classe et des moyens d'y parvenir.
Les deux principaux aspects de cette confiance sont la vie politique et organisationnelle. Le premier aspect s'exprime dans la loyauté aux principes politiques, mais aussi dans la capacité à développer la théorie marxiste en réponse à l'évolution de la réalité. Le second aspect s'exprime dans la loyauté aux principes de fonctionnement prolétarien et la capacité à développer une confiance et une solidarité réelles au sein de l'organisation. Le résultat d'un affaiblissement de la confiance à l'un ou l'autre de ces deux niveaux sera toujours une remise en cause de l'unité - et donc de l'existence - de l'organisation.
Au niveau organisationnel, l'expression la plus développée de cette confiance, de cette solidarité et de cette unité est ce que Lénine a appelé l'esprit de parti. Dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a trois exemples célèbres de mise en aeuvre d'un tel esprit de parti : le parti allemand dans les années 1870et 1880, les bolcheviks à partir de 1903 jusqu'à la révolution, le parti italien et la fraction qui en est sortie après la vague révolutionnaire. Ces exemples aideront à nous montrer la nature et la dynamique de cet esprit de parti, et les dangers qui le menacent.
a) Ce qui a caractérisé le parti allemand sur ce plan, c'est qu'il a basé son mode de fonctionnement sur les principes organisationnels établis par la Première internationale dans sa lutte contre le bakouninisme (et le lassallisme), que ces principes on tété ancrés dans tout le parti à travers une série de luttes organisationnelles et que, dans le combat pour la défense de l'organisation contre la répression étatique, une tradition de solidarité entre les militants et les différentes parties de l'organisation s'est forgée. En fait, c'est pendant la période "héroïque" de clandestinité que le parti allemand a développé les traditions de défense sans concession des principes, d'étude théorique et d'unité organisationnelle qui ont fait de lui le dirigeant naturel du mouvement ouvrier international. La solidarité quotidienne dans ses rangs était un puissant catalyseur de toutes ces qualités. Cependant, au tournant du siècle, l'esprit de parti était presque complètement mort au point que Rosa Luxemburg pouvait déclarer qu'il y avait plus d'humanité dans un village sibérien que dans tout le parti allemand([7] [23]). En fait, bien avant sa trahison programmatique, la disparition de la solidarité annonçait la trahison à venir.
b) Mais le drapeau de l'esprit de parti a été repris par les bolcheviks. Là encore on trouve les mêmes caractéristiques. Les bolcheviks ont hérité leurs principes organisationnels du parti allemand, les ont ancrés dans chaque section et chaque membre à travers une série de luttes organisationnelles, ont forgé une solidarité vivante à travers des années de travail illégal. Sans ces qualités, le parti n'aurait jamais pu passer le test de la révolution. Bien qu'entre août 1914 et Octobre 1917,1e parti ait subi une série de crises politiques, et ait même dû répondre, de façon répétée, à la pénétration de positions ouvertement bourgeoises dans ses rangs et sa direction (comme le soutien à la guerre en 1914 et après février 1917), l'unité de l'organisation, sa capacité à clarifier ses divergences, à corriger ses erreurs et à intervenir dans la classe n'ont jamais été mises en question.
c) Comme nous le savons, bien avant le triomphe final du stalinisme, l'esprit de parti avait complètement reflué dans le parti de Lénine. Mais une fois de plus, le drapeau a été repris parle parti italien cette fois, et après, par la Fraction face à la contre-révolution stalinienne. Le parti est devenu l'héritier des principes organisationnels et des traditions du bolchevisme. Il a développé sa vision de la vie de parti dans la lutte contre le stalinisme, l'enrichissant plus tard avec la vision et la méthode de la Fraction. Et cela eut lieu dans les conditions objectives les plus terribles, face auxquelles, une fois de plus, il fallait forger une solidarité vivante.
A la fin de la 2e guerre mondiale, la Gauche italienne à son tour a abandonné les principes organisationnels qui avaient constitué sa marque. En fait, ni la parodie semi-religieuse de vie collective de parti développée par le bordiguisme d'après guerre, ni l'informalisme fédéraliste de Battaglia n'ont à voir avec la vie organisationnelle de la Gauche italienne des années 20 et 30. En particulier, toute la conception de la Fraction a été abandonnée.
C'est la Gauche communiste de France qui a repris à son compte l'héritage de ces principes organisationnels et de la lutte pour l'esprit de parti. Et il appartient aujourd'hui au CCI de perpétueretde faire vivre cet héritage.
d) L'esprit de parti n'estjamais un acquis définitif. Les organisations et les courants du passé qui l'ont le mieux incarné, ont tous fini par le perdre complètement et définitivement. (... )
Dans chacun des exemples donnés, les circonstances dans lesquelles l'esprit de parti a disparu étaient très différentes. L'expérience de la lente dégénérescence d'un parti de masse ou de l'intégration d'un parti dans l'appareil d'État d'un bastion ouvrier isolé ne se répéteront probablement jamais. Néanmoins, il y a des leçons générales à tirer. Dans chaque cas :
- l'esprit de parti a disparu à un moment detournant historique : en Allemagne, entre l'ascendance et la décadence du capitalisme ; en Russie avec le recul de la révolution ; et pour la Gauche italienne, entre la révolution et la contre-révolution. Aujourd'hui, c'est l'entrée dans la phase de décomposition qui menace l'esprit de parti.
- l'illusion que les réalisations passées peuvent être définitives a empêché la vigilance nécessaire. La maladie infantile de Lénine est un parfait exemple de cette illusion. Aujourd'hui, la surestimation de la maturité organisationnelle du CCI contient le même danger.
- ce sont l'immédiatisme et l'impatience qui ont ouvert la porte à l'opportunisme programmatique et organisationnel. L'exemple de la Gauche italienne est particulièrement frappant puisque historiquement le plus proche de nous. C'est le désir de parvenir enfin à étendre son influence et à recruter de nouveaux membres qui a poussé la Gauche italienne en 1943-45 à abandonner les leçons de la Fraction et le PCI bordiguiste en 1980-81 à abandonner certains de ses principes programmatiques. Aujourd'hui, le CCl à son tour est confronté à de similaires tentations liées à l'évolution de la situation historique.
- cet abandon a été l'expression au niveau organisationnel de la perte de confiance dans la classe ouvrière qui s'est exprimée inévitablement au niveau politique aussi (perte de la clarté programmatique). Ceci n'a jamais été le cas pour le CCI comme tel jusqu' à aujourd'hui. Mais cela atoujours été le cas des différentes "tendances" qui ont scissionné du CCI (comme la FECCI ou le "Cercle de Paris" qui ont rejeté l'analyse de la décadence).
Durant les derniers mois, c'est par dessus tout la simultanéité d'un affaiblissement de nos efforts théoriques et de la vigilance, une certaine euphorie quant à la progression de l'organisation et donc un aveuglement vis-à-vis de nos difficultés, et la résurgence du clanisme qui révèlent le danger de la perte de l'esprit de parti, de dégénérescence organisationnelle et de sclérose théorique. Le fait que la confiance dans nos rangs a été sapée et l'incapacité de faire des pas en avant décisifs dans le développement de la solidarité ont constitué les facteurs dominants dans cette tendance qui peut, potentiellement, mener à la trahison programmatique ou à la disparition de l'organisation.
6. Pas d'esprit de parti sans responsabilité individuelle
Après la lutte de 1993-96 contre le clanisme, ont commencé à émerger des attitudes de méfiance envers les rapports politiques et sociaux des camarades en dehors du cadre formel des réunions et des activités mandatées. L'amitié, les rapports amoureux, les liens et les activités sociales, les gestes de solidarité personnelle, les discussions politiques et autres entre les camarades ont parfois été traités, dans la pratique, comme un mal nécessaire, en fait comme le terrain privilégié pour le développement du clanisme. En opposition à cela, les structures formelles de nos activités ont commencé à être considérées comme offrant, en quelque sorte, une garantie contre le retour du clanisme.
De telles réactions contre le clanisme révèlent par elles-mêmes une assimilation insuffisante de notre analyse, et nous désarment face à ce danger. Comme nous l'avons dit, le clanisme a en partie surgi comme une fausse réponse à un réel problème de manque de confiance et de solidarité dans nos rangs. De plus, la destruction des rapports de confiance et de solidarité mutuels entre les camarades qui existaient réellement, est due principalement au travail du clanisme et a constitué une précondition pour un nouveau développement de celui-ci. C'est d'abord et avant tout le clanisme qui a sapé l'esprit d'amitié : la réelle amitié n'est jamais dirigée contre une troisième personne et n'exclut jamais la critique mutuelle. Le clanisme a détruit la tradition indispensable de discussions politiques et de liens sociaux entre les camarades en les convertissant en "discussions informelles" dans le dos de l'organisation. En accroissant l'atomisation et en démolissant la confiance, en intervenant de façon excessive et irresponsable dans la vie personnelle des camarades tout en les isolant socialement de l'organisation, le clanisme a sapé la solidarité naturelle que doit exprimer le « devoir de regard » de l'organisation envers les difficultés personnelles que peuvent rencontrer ses militants.
Il est impossible de combattre le clanisme en utilisant ses propres armes. Ce n'est pas la méfiance envers le plein développement de la vie politique et sociale en dehors du simple cadre formel des réunions de section mais la véritable confiance dans cette tradition du mouvement ouvrier qui nous rend plus résistants au clanisme.
En arrière plan de cette méfiance injustifiée envers la vie "informelle" d'une organisation ouvrière réside l'utopie petite bourgeoise d'une garantie contre l'esprit de cercle qui ne peut que mener au dogme illusoire du catéchisme contre le clanisme. Une telle démarche tend à transformer les statuts en des lois rigides, le "devoir de regard" en surveillance et la solidarité en un rituel vide.
L'une des façons dont la petite bourgeoisie exprime sapeur du futur, c'est dans un dogmatisme morbide qui semble offrir une protection contre le danger de l'imprévisible. C'est ce qui a amené la "vieille garde" du parti russe à constamment accuser Lénine d'abandonner les principes et les traditions du bolchevisme. C'est une sorte de conservatisme qui sape l'esprit révolutionnaire. Personne n'est exempt de ce danger comme le montre le débat dans l'Internationale socialiste sur la question polonaise dans lequel non seulement Wilhem Liebknecht mais partiellement Engels ont adopté une telle attitude lorsque Rosa Luxemburg a affirmé la nécessité de remettre en cause l'ancienne position de soutien de l'indépendance de la Pologne.
En réalité, le clanisme, précisément parce qu'il est une émanation de couches intermédiaires, instables, sans futur, est non seulement capable mais est en réalité condamné à prendre des formes et des caractéristiques toujours changeantes. L'histoire montre que le clanisme ne prend pas seulement la forme de l'informalisme de la bohème et des structures parallèles si appréciées des déclassés, mais qu'il est également capable d'utiliser les structures officielles de l'organisation et l'apparence du formalisme et du routinisme petit-bourgeois pour promouvoir sa politique parallèle. Tandis que, dans une organisation où l'esprit de parti est faible et l'esprit de contestation fort, un clan informel a le plus de chance de succès, dans une atmosphère plus rigoureuse où existe une grande confiance dans les organes centraux, l'apparence formelle et l'adoption des structures officielles peut répondre parfaitement aux besoins du clanisme.
En réalité, le clanisme contient les deux faces de la pièce. Historiquement, il est condamné à vaciller entre ces deux pôles qui apparemment s'excluent mutuellement. Dans le cas de la politique de Bakounine, nous trouvons les deux aspects contenus en une "synthèse supérieure" : la liberté individuelle anarchiste absolue, proclamée par l'Alliance officielle, et la confiance et l'obéissance aveugles demandées par l'Alliance secrète :
"Comme les jésuites, non dans le but de l'asservissement, mais dans celui de l'émancipation populaire, chacun d'eux a renoncé à sa propre volonté. Dans le Comité, comme dans toute l'organisation, ce n'est pas l'individu qui pense, veut et agit, mais la collectivité" écrit Bakounine. Ce qui caractérise cette organisation, continue-t-il, c'est "la confiance aveugle que lui offrent des personnalités connues et respectées"([8] [24]).
Les rapports sociaux qui sont appelés à jouer un rôle dans une telle organisation, sont clairs : "Tous les sentiments d 'affection, les sentiments ramollissants de parenté, d'amitié, d'amour, de reconnaissance doivent être étouffés en lui par la passion unique et, froide de l'oeuvre révolutionnaire".([9] [25])"
Ici on peut clairement voir que le monolithisme n'est pas une invention du stalinisme mais est déjà contenu dans le manque de confiance clanique dans la tâche historique, la vie collective et la solidarité prolétarienne. Pour nous, il n'y a rien de nouveau ni de surprenant à cela. C'est la peur petite-bourgeoise bien connue à l'égard de la responsabilité individuelle qui, de nos jours, amène en grande quantité des personnalités hautement individualistes dans les bras de diverses sectes où elles peuvent cesser de penser et d'agir pour elles-mêmes.
C'est vraiment une illusion de croire qu'on peut combattre le clanisme sans la responsabilisation des membres individuels de l'organisation. Et il serait paranoïaque de penser que la surveillance "collective" pourrait se substituer à la conviction et à la vigilance individuelles dans ce combat. En réalité, le clanisme incorpore le manque de confiance et dans la vie collective réelle et dans la possibilité de la responsabilité individuelle réelle.
Quelle est la différence entre des discussions entre camarades en dehors des réunions et les "discussions informelles" du clanisme ? C'est le fait que les premières et non les secondes seraient rapportées à l'organisation? Oui, bien qu'il ne soit pas possible de rapporter formellement chaque discussion. Plus fondamentalement, c'est l'attitude avec laquelle une telle discussion est menée qui est décisive. C'est l'esprit de parti que nous devons tous développer parce que personne ne le fera pour nous. Cet esprit de parti restera toujours lettre morte si les militants ne peuvent apprendre à avoir confiance les uns dans les autres. De même il ne peut y avoir de solidarité vivante sans un engagement personnel de chaque militant à ce niveau.
Si la lutte contre l'esprit de cercle dépendait uniquement de la santé des structures collectives formelles, il n'y aurait jamais de problème de clanisme dans les organisations prolétariennes. Les clans se développent à cause de l'affaiblissement de la vigilance et du sens des responsabilités au niveau individuel. C'est pourquoi une partie du Texte d'orientation de 1993([10] [26]) est dédiée à l'identification des attitudes contre lesquelles chaque camarade doit s'armer lui même. Cette responsabilisation individuel le est indispensable, non seulement dans la lutte contre le clanisme, mais dans le développement positif d'une vie prolétarienne saine. Dans une telle organisation, les militants ont appris à penser par eux-mêmes, et leur confiance est enracinée dans une compréhension théorique, politique et organisationnelle de la nature de la cause prolétarienne, non dans la loyauté ou la peur vis-à-vis de tel ou tel camarade ou comité central.
"Le `cours nouveau' doit avoir pour premier résultat de faire sentir à tous que personne désormais n 'osera plus terroriser le Parti. Notre jeunesse ne doit pas se borner à répéter nos formules. Elle doit les conquérir, se les assimiler, se former son opinion, sa physionomie à elle et être capable de lutter pour ses vites avec le courage que donnent une conviction profonde et une entière indépendance de caractère. Hors du Parti l'obéissance passive qui fait emboîter mécaniquement le pas après les chefs : hors du Parti 1'impersonnalité, la servilité, !e carriérisme ! Le bolchevik n'est pas seulement un homme discipliné : c’est un homme qui, dans chaque cas et sur chaque question, se forge une opinion frme et la défend courageusement, non seulement contre ses ennemis, mais au sein de son propre parti".([11] [27])"
Et Trotsky ajoute : "L'héroïsme suprème, dans l'art militaire comme dans la révolution, c'est la véracité et le sentiment de la responsabilité".([12] [28])
La responsabilité collective et la responsabilité individuelle, loin de s'exclure mutuellement, dépendent l'une de l'autre et se conditionnent l'une l'autre. Comme l'a développé Plekhanov, l'élimination du rôle de l'individu dans l'histoire est liée à un fatalisme incompatible avec le marxisme. "Si certains subjectivistes, dans leurs effôrts pour attribuer à 'l'individu' le maximum d'importance dans l'histoire, refusaient de tenir- l'évolution historique de l'humanité pour- un processus obéissant à des lois, certains de leurs plus récents adversaires, dans leur effort pour souligner au maximum les lois qui régissent cette évolution, ont paru sur le point d'oublier que l'histoire est faite par les hommes, et que, par suite, l'action des individus ne peut pas y être dépourvue d'importance".([13] [29])
Un tel rejet de la responsabilité des individus est également lié au démocratisme petit-bourgeois, au désir de remplacer notre principe "de chacun selon ses moyens" par l'utopie réactionnaire de l'égalisation des membres d'un corps collectif. Ce projet, déjà condamné dans le Texte d' orientation de 1993 ne constitue ni un but de l'organisation aujourd'hui, ni celui de la future société communiste.
Une des tâches que nous avons tous, c'est d'apprendre de l'exemple de tous les grands révolutionnaires (les célèbres et tous les combattants anonymes de notre classe) qui n'ont pas trahi nos principes programmatiques et organisationnels. Ceci n'a rien à voir avec un quelconque culte de la personnalité. Comme Plckhanov conclut son essai célèbre sur le rôle de l'individu : "Ce n’est pas seulementt pour ceux qui commencent', ce n'est pas seulement pour les `grands' hommes, qu'un large champ d'action se déploie. I1 est ouvert à tous les hommes, à tous ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un coeur pour aimer leur prochain. La notion de grandeur est relative. Dans le sens moral, tout homme est grand qui , pour citer Le nouveau testament, donne sa vie pour ses amis ".
En guise de conclusion
De cela il s'ensuit que l'assimilation et l'approfondissement des questions que nous avons commencé à discuter il y a plus d'un an sont une priorité majeure aujourd'hui.
La tâche de la conscience est de créer le cadre politique et organisationnel qui favorise le mieux le développement de la confiance et de la solidarité. Cette tâche est centrale dans la construction de l'organisation, cet art ou cette science parmi les plus difficiles. A la base de ce travail se trouve le renforcement dc l 'unité de l'organisation, ce principe le plus "sacré" du prolétariat. Et comme pour toute communauté collective, sa précondition est l'existence de règles de comportement communes. Concrètement, les statuts, les textes de 1981 sur la fonction et le fonctionnement, et de 1993 sur le tissu organisationnel donnent déjà des éléments pour un tel cadre. I1 est nécessaire de revenir, de façon répétée, à ces textes, mais avant tout quand l'unité de l'organisation est en danger. Ils doivent être le point de départ d'une vigilance permanente.
A ce niveau, l'incompréhension principale dans nos rangs est l'idée que ces questions sont faciles et simples. Selon cette démarche, il suffit de décréter la confiance pour qu'elle existe. Et puisque la solidarité est une activité pratique, il suffit de "just go and do it" (la mettre en oeuvre). Rien n'est plus loin de la vérité ! La construction de l'organisation est une entreprise extrêmement compliquée et même délicate. Et il n'existe aucun produit de la culture humaine qui soit aussi difficile et fragile que la confiance. Rien d'autre n'est plus difficile à construire et plus facile à détruire. C'est pourquoi, face à tel ou tel manque de confiance par telle ou telle partie de l'organisation, la première question qui doit toujours être posée est ce qui peut être fait, collectivement, pour réduire la méfiance ou même la peur dans nos rangs. Il en est de meme pour la solidarité. Bien qu'elle soit "pratique" et aussi "naturelle" dans la classe ouvrière, dans la mesure où cette classe vit dans la société bourgeoise, elle est entourée de facteurs qui travaillent contre une telle solidarité. De plus, la pénétration d'une idéologie étrangère amène à des conceptions aberrantes sur cette question, comme la récente attitude de considérer le refus de publier les textes de camarades comme une expression de solidarité, ou de trouver comme base valable pour un débat sur la confiance l'explication des origines de certaines divergences politiques dans la vie personnelle des camarades (...) ([14] [30]).
En particulier dans la lutte pour la confiance, notre mot d'ordre doit être prudence et prudence encore.
La théorie marxiste est notre principale arme dans la lutte contre la perte de confiance. En général, c'est le moyen privilégié de résister à l'immédiatisme et de défendre une vision à long terme. C'est la seule base possible pour une confiance réelle, scientifique dans le prolétariat qui est à son tour la base de la confiance de toutes les différentes parties de la classe en elles mêmes et les unes dans les autres. Spécifiquement, seule une démarche théorique nous permet d'aller aux racines les plus profondes des problèmes organisationnels qui doivent être traités comme des questions théoriques et historiques à part entière. De même, en l'absence d'une tradition vivante sur cette question et en l'absence jusqu'à présent de l'épreuve du feu de la répression, le CCI doit se baser sur une étude du mouvement ouvrier du passé dans le développement volontaire et conscient d'une tradition de solidarité active et d'une vie sociale dans ses rangs.
Si l'histoire nous a rendus particulièrement vulnérables vis-à-vis des dangers du clanisme, elle nous a aussi donné les moyens de les surmonter. En particulier, nous ne devons jamais oublier que le caractère international de l'organisation et la création de commissions d'information sont les moyens indispensables de restaurer la confiance mutuelle dans des moments de crise quand cette confiance a été endommagée et perdue.
Le vieux Liebknecht a dit de Marx qu'il traitait la politique comme un sujet d' étude([15] [31]). Comme nous l'avons dit, c'est l'élargissement de la zone de la conscience dans la vie sociale qui libère l'humanité de l'anarchie des forces aveugles, rendant possibles la confiance, la solidarité et la victoire du prolétariat. Afin de surmonter les difficultés présentes et résoudre les questions posées, le C.C.I. doit les étudier car, comme le disait le philosophe (l’ignorantia non est argumentum" (L'ignorance n'est pas un argument). ("L'Ethique", Spinoza)
[1] [32] Pour plus d'éléments sur cette Conférence voir l'article « Le combat pour la défense des principes organisationnels » (Revue internationale n° 110). Les notes en bas de page ont été rajoutées au texte d'origine. Celles qui figuraient dans ce dernier ce trouvent à la fin de l'article.
[2] [33] Le !8 Brumaire
[3] [34] Kautsky, La conception matérialiste de l'histoire
[4] [35] Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques
[5] [36] MC est notre camarade Marc Chirik, mort en 1990. II avait connu directement la Révolution de 1917 dans sa ville de Kichinev cri Moldavie. Il avait été membre dès l'âge de 13 ans du parti communiste de Palestine dont il avait été exclu à cause de son désaccord avec les positions de l'International communiste sur la question nationale. Immigré en France, il était entré au PCF avant que d'en etre exclu en même temps que l'ensemble des oppositionnels de Gauche. II avait été membre de la Ligue communiste (trotskiste) puis de l'Union communiste qu'il avait quittée en 1938 pour rejoindre la Fraction italienne de la Gauche communiste internationale (GCI) dont il partageait la position sur la guerre d'Espagne contre celle de l'UC. Pendant la guerre et l'occupation allemande, il a impulsé la reconstitution de la Fraction italienne autour du noyau de Marseille après que le Bureau international de la GCI, animé par Vercesi, ait considéré que les fractions n'avaient plus de raison de poursuivre leur travail pendant la guerre. En mai 1945, il s'est opposé à I'auto-dissolution de la Fraction italienne dont la conférence a décidé l'intégration individuelle de ses militants dans le Partito comunista internazionalista fondé peu avant. II a rejoint la Fraction française de la Gauche communiste qui s'était constituée en 1944, et qui s'est rebaptisée par la suite Gauche communiste de France (GCF). A partir de 1964 au Venezuela et de 1968 en France, MC a jouer un rôle décisif dans la formation des premiers groupes qui allaient etre a l'origine du CCI auquel il a apporté l'expérience politique et organisationnelle qu'il avait acquise dans les différentes organisations communistes dont il avait été membre auparavant. On trouvera plus d'éléments sur la biographie politique de notre camarade dans notre brochure « La Gauche communiste de France » et dans l'article que la Revue internationale lui a consacré (numéros 65 et 66).
Le texte de MC qui est évoqué ici est une contribution au débat interne du CCI intitulé « Marxisme révolutionnaire et centrisme dans la réalité présente et le débat actuel dans le CCI »
et publié en mars 1984.
[6] [37] Le l8 Brumaire
[7] [38] Correspondance avec K. Zetkin
[8] [39] Bakounine, "Appel aux officiers de l'armée russe" (traduction française dans La première internationale T.11, par Jacques Freymont, Genève 1962).
[9] [40] Bakounine, Le catéchisme révolutionnaire (Ibid.)
[10] [41] I1 s'agit du texte "La question du fonctionnement de l'organisation dans le CCI" publié dans la Revue internationale n° 109.
[11] [42] Trotskv, Cours nouveau
[12] [43] Sur le routinisme dans l'armée et ailleurs
[13] [44] "A propos du rôle de l'individu dans l'histoire", Oeuvres philosophiques, Tome II, Éditions du Progrès
[14] [45] Ce passage fait référence notamment à des faits quc nous avions déjà évoqués dans notre article "Le combat pour la défense des principes organisationnels" (Revue internationale n° 110) relatant notre Conférence extraordinaire de mars 2002 et les difficultés organisationnelles qui avaient motivé sa tenue : "Que des parties de 1’organisation puissent faire des critiques à un texte adapté par l'organe central du CCI n'avait jamais constitué un problème pour ce dernier. Bien au contraire, le CCI et son organe central ont toujours insisté pour que toute divergence, tout doute s'exprime ouvertement au sein de l'organisation afin de faire la plus grande clarté possible. L'attitude de l'organe central, lorsqu'il se heurtait à des désaccords était d'y répondre avec le plus grand sérieux possible. Or à partir dit printemps 2000, la majorité du SI [Secrétariat international, la commission permanente de l'organe central duCCI] a adopté une attitude camplètement opposée. Ait lieu de développer une argumentation sérieuse, il a adopté une attitude totalement contraire à celle qui avait été la sienne par le passé. Dans son esprit, si une toute petite minorité de camarades faisait des critiques à un texte du SI, cela ne pouvait venir que d'un esprit de contestation, ou bien du fait que l'un d'entre eux avait des problèmes familiaux, que l'autre était atteint pur une maladie psychique. (...) La réponse apportée aux arguments des camarades en désaccord n'était donc pas basée sur d'autres arguments, mais sur des dénigrements de ces camarades ou bien carrement sur la tentative de ne pas publier certaines de leurs contributions avec l'argument que celle.s-ci allaient « foutre la merde dans l'organisation », ou encore qu'une des camarades qui était alfectée par la pression qui se développait à son égard ne "supporterait" pas les réponses que les autres mllitants du CCl apporteraient à ses textes. En somme, de façon totalement hypocrite, c'est au nom de la -solidarité- que la majorité du SI développait une politique d'étouffement des débats. "
[15] [46] K Wilhem Liebknecht, Kart Marr
Vie du CCI:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [47]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le mouvement ouvrier au Japon : 1882-1905
- 3613 reads
Les notes suivantes sur l'histoire du mouvement révolutionnaire au Japon illustrent, avec des éléments concrets, la nature même du processus de développement de la classe ouvrière et de son avant-garde révolutionnaire caractérisé par l'unité fondamentale de ses intérêts et de sa lutte à travers le globe pour renverser le capitalisme mondial.
Ce processus, qui se vérifie globalement au niveau international, ne s'exprime pas de manière identique et au même rythme dans chaque pays pris séparément ; il s'y manifeste de façon inégale mais avec une influence mutuelle d'un pays sur l'autre. Pour différentes raisons historiques, l'Europe occidentale se trouve constituer le centre de gravité de la révolution communiste mondiale[1]. L'histoire du mouvement révolutionnaire au Japon met en évidence, à plusieurs occasions, qu'il s'est retrouvé à la traîne des avancées qui se produisaient dans le monde occidental.
Ceci ne constitue cependant pas un jugement moral, le résultat d'un quelconque "Euro-centrisme" pas plus que cela n'exprime la volonté de décerner des bons points au prolétariat des pays où il est le plus avancé. Au contraire, avec ces éléments d'histoire du mouvement révolutionnaire au Japon apparaît clairement le lien indissoluble qui existe entre le mouvement révolutionnaire en Europe occidentale et dans le reste du monde. Un tel cadre d'analyse est le seul à même de permettre de comprendre la dynamique de la future révolution mondiale, de même que le rôle vital, irremplaçable que devra y jouer une fraction mondiale du prolétariat comme la classe ouvrière au Japon.
Quand nous étudions l'histoire du mouvement ouvrier au Japon, nous ne pouvons qu'être frappés par les similitudes profondes entre les questions confrontées, et les réponses données, par le prolétariat dans ce pays et partout ailleurs dans le monde industrialisé. Ces similitudes sont d'autant plus significatives que le Japon s'est trouvé relativement isolé des autres grands pays industrialisés, et qu'il a connu un développement industriel extraordinairement rapide. Ce dernier n'a commencé qu'à partir des années 1860, et l'ouverture du Japon au commerce mondial et à l'influence extérieure par la force militaire des "navires noirs" du commodore américain Perry, rapidement suivi par les puissances européennes. Jusqu'alors, le Japon était resté gelé dans un féodalisme hermétique, entièrement coupé du reste du monde. En trente ans – à peine une génération – il est devenu la dernière grande puissance industrielle à percer dans l'arène impérialiste mondiale. Cette percée s'effectua de la façon la plus retentissante qu'il soit donné d'imaginer, avec la destruction de la flotte russe à Port Arthur en 1905.
Cela signifie que l'expérience et les idées acquises par les ouvriers européens en un siècle ou plus l'ont été en un quart de siècle au Japon. Le prolétariat japonais est né à l'époque où le marxisme avait déjà développé une profonde influence sur le mouvement ouvrier européen (notamment à travers la première internationale), alors que les premières traductions des écrits de Marx ne furent disponibles en japonais qu'en 1904. Comme on va le voir, il était possible que des idées appartenant en propre aux débuts du mouvement ouvrier cohabitent avec les expressions les plus modernes de ce dernier.
Le premier regroupement des révolutionnaires
Jusque dans les dernières décennies du 19e siècle, le mouvement ouvrier au Japon était largement influencé par le Confucianisme traditionnel pour lequel l’harmonie sociale et la participation de l’individu (jin) n’existaient que dans l’intérêt de la communauté.
En mai 1882, le Parti Socialiste d’Orient (Toyo Shakaito) fut fondé. Il s’appuyait sur le socialisme utopique et l’anarchisme. Peu de temps après, il fut dissout.
Les années 1880 furent marquées par l’apparition de cercles qui se donnèrent pour tâche de s’approprier les classiques du socialisme et de se familiariser avec les luttes et les débats du mouvement ouvrier en Europe, notamment avec ‘Les Amis du Peuple’ (Kokumin-no tomo) ou ‘La Société d’exploration des problèmes sociaux’ (Shakai mondai kenkyukai). L'activité de ces cercles ne reposait pas sur une organisation permanente et ils n’avaient pas encore établi des liens avec la IIe Internationale fondée en 1889.
En 1890, pour la première fois, des ouvriers migrants d’origine japonaise se regroupèrent aux États-Unis dans la ‘Société courageuse des ouvriers’ (Shokko gijukai). Ce groupe était plutôt un cercle d’études ayant pour but d’étudier la question ouvrière de différents pays d’Europe de l’Ouest et des États-Unis. Les syndicats américains avaient une forte influence sur ce groupe.
En 1897, ‘La Société pour la préparation de la création de syndicats’ (Rodo kumiai kiseikai) fut créée, revendiquant 5700 membres. Pour la première fois dans l’histoire du mouvement ouvrier au Japon, elle avait son propre journal : Rodo sekai, diffusé tous les deux mois et édité par S. Katayama. Le but de ce mouvement était de créer des syndicats et des coopératives. Deux ans plus tard, cette association syndicale comptait déjà 42 sections et 54 000 membres. Les statuts et les positions de ces syndicats étaient basés sur les modèles européens. Le syndicat des conducteurs de trains développa une campagne pour l’introduction du droit de vote généralisé et déclara en mars 1901 que “le socialisme est la seule réponse définitive à la condition ouvrière”.
Le 18 octobre 1898, un petit groupe d’intellectuels se rencontra dans une Église Unitariste de Tokyo et fonda Shakaishugi Kenkyukai (l’Association pour l’Étude du Socialisme). Ils commencèrent à se réunir une fois par mois. Cinq de ses six fondateurs se considéraient toujours eux-mêmes comme des Socialistes Chrétiens.
Après son voyage en Angleterre et aux États-Unis, Katayama contribua à la fondation en 1900 de l’Association Socialiste (Shakaishugi kyokai) qui comptait quelques 40 membres. Il fut décidé d’envoyer pour la première fois un délégué au Congrès de Paris de la IIe Internationale mais des problèmes financiers empêchèrent la réalisation du projet.
La première phase du mouvement ouvrier ‘de destruction des machines’ (qui correspond d'une certaine manière au "Luddism" du mouvement ouvrier anglais à la charnière du 18e et du 19e siècle) ne fut dépassée qu'à la fin des années 1880, ouvrant ainsi la voie à une vague de grèves qui eurent lieu entre 1897 et 1899. En particulier, les ouvriers métallurgistes, les mécaniciens et les cheminots montrèrent leur combativité. La Guerre Sino-Japonaise (1894-1895) entraîna un nouvel essor industriel de sorte qu’au milieu des années 1890, le Japon comptait 420 000 ouvriers. Quelques 20 000 ouvriers - à savoir 5% de travailleurs industriels modernes - étaient syndiqués, la plupart des syndicats étant de taille réduite, ne dépassant pas 500 membres. Mais la bourgeoisie japonaise réagit dès le début avec une violence terrible contre une main-d’œuvre de plus en plus combative. En 1900, elle adopta une ‘loi sur la protection de l’ordre public’ basée sur le modèle des lois anti-socialistes de Bismark qui avait interdit le SPD en Allemagne en 1878.
Le 20 mai 1901 vit la formation du premier Parti Social-démocrate (Shakai Minshuto). Il mettait en avant les revendications suivantes :
"- l’abolition de l’écart entre les riches et les pauvres et assurer la victoire du pacifisme dans le monde au moyen du socialisme et de la démocratie véritables ;
- fraternité internationale dépassant les différences raciales et politiques ;
- la paix mondiale et l’abolition de toutes les armes ;
- la répartition juste et égalitaire des richesses ;
- l’accès égalitaire au pouvoir politique pour toute la population."
Ces revendications sont tout à fait caractéristiques de la situation dans laquelle le mouvement ouvrier au Japon s'est retrouvé à cette époque combinant à la fois :
- une vision quelque peu naïve "a-classiste", typique des premières phases de la lutte de classe et s'apparentant au courant utopiste en Europe et Etats-Unis ;
- une insistance pour que soient éradiquées les inégalités basées sur la race, et qui reflète certainement l'expérience des travailleurs japonais immigrés aux Etats-Unis ;
- une phraséologie démocratique et pacifique similaire à celle de l'aile révisionniste de la IIe internationale.
Shakai Minshuto (le Parti Social démocrate) proclamait vouloir respecter la loi ; l’anarchisme et la violence étaient explicitement rejetés ; il soutenait la participation aux élections parlementaires. En défendant les intérêts de la population, au-delà des classes, en liquidant l’inégalité économique, en combattant pour le droit de vote généralisé pour tous les ouvriers, le parti espérait apporter sa contribution à l’établissement de la paix mondiale.
Bien qu’il considérait ses activités parlementaires comme une priorité, le parti fut immédiatement interdit. La tentative de construire un parti politique échoua. Le niveau d’organisation ne pouvait dépasser encore celui des cercles de discussion. De plus, la répression provoca un très important revers. La publication des journaux continua à être assurée sans le soutien d'une organisation derrière. C’est ainsi que la tenue de conférences, de meetings et la publication de textes formaient l’essentiel des activités.
La lutte contre la guerre
Les 5 et 6 avril 1903, à la Conférence Socialiste du Japon à Osaka, les participants réclamèrent la transformation socialiste de la société. Tandis que les exigences de ‘liberté, d’égalité et de fraternité’ étaient toujours présentes, la revendication de l’abolition des classes et de toutes les oppressions de même que l’interdiction des guerres d’agression apparurent également. Fin 1903, la Commoners Society (Heiminsha) devint le centre du mouvement anti-guerre, alors que le Japon poursuivait son expansion en Manchourie et en Corée et qu’il était sur le point d’entrer en guerre contre la Russie. Le journal de cette association était publié à 5 000 exemplaires. Là encore, c’était un journal sans structure organisationnelle forte derrière. D. Kotoku était l’un des orateurs les plus connus de ce groupe.
Katayama[2]2, qui quitta le Japon de 1903 à 1907, assista au Congrès d’Amsterdam de la IIe Internationale en 1904. Quand il serra la main de Plékhanov, cela fut considéré comme un geste symbolique important en pleine guerre russo-japonaise qui dura de février 1904 à août 1905.
Au début de la guerre, Heiminsha prit clairement position contre celle-ci ; une prise de position au nom du pacifisme humanitaire. La course au profit du secteur de l’armement était dénoncée.
Le 13 mars 1904, Heimin Shimbun publia une lettre ouverte au Parti Ouvrier Social-démocrate russe, appelant à l’unité avec les socialistes du Japon contre la guerre. L’Iskra n° 37 publia sa réponse. Au même moment, les socialistes japonais diffusaient la littérature socialiste parmi les prisonniers de guerre russes.
En 1904, 39 000 tracts contre la guerre furent diffusés et quelques 20 000 exemplaires de Heimin vendus.
C’est ainsi que les activités impérialistes intensives du Japon (les guerres contre la Chine dans les années 1890, la guerre avec la Russie en 1904-1905) contraignirent le prolétariat à prendre position sur la question de la guerre. Même si le rejet de la guerre impérialiste n’était pas encore solidement ancré sur le marxisme et s’il était toujours fortement marqué par une orientation pacifiste, la classe ouvrière développait la tradition de l’internationalisme.
La première traduction du Manifeste Communiste fut également publiée par Heimin en 1904. Jusqu’à ce moment là, les classiques du Marxisme n’étaient pas disponibles en japonais.
Dès que le gouvernement réprima les révolutionnaires, faisant passer en jugement beaucoup d’entre eux, Heimin cessa de publier et le journal Chokugen (La Libre Parole), qui apparut peu après, était encore imprégné par un très fort pacifisme.
Le capital dut faire porter à la classe ouvrière le coût de la guerre. Les prix doublèrent puis triplèrent. L’état, qui inaugura une politique d’endettement pour financer la guerre, accabla d’impôts la classe ouvrière.
De la même façon qu’en Russie en 1905, l’aggravation dramatique des conditions de vie des ouvriers au Japon mena à l’éclatement de manifestations violentes en 1905 et à une série de grèves dans les chantiers navals et les mines en 1906 et 1907. La bourgeoisie n’hésita jamais un seul instant à envoyer la troupe contre les ouvriers et une fois de plus déclara toute organisation ouvrière illégale.
Alors qu’il n’y avait pas encore d’organisation des révolutionnaires mais uniquement une tribune révolutionnaire contre la guerre, la guerre russo-japonaise suscita en même temps une forte polarisation politique. Une première décantation se produisait entre les Chrétiens Socialistes autour de Kinoshita, Abe et l’aile autour de Kotoko (qui dès 1904-05 avait pris un ferme positionnement antiparlementaire) et celle autour de Katayama Sen et Tetsuji.
DA
1 Voir le texte "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation internationale de la lutte de classe –critique de la théorie du maillon faible" dans la Revue Internationale n°31, 1982. Des aires telles que le Japon ou l'Amérique du Nord, bien qu'elles remplissent la plupart des conditions nécessaires à la révolution, ne constituent néanmoins pas le lieu le plus favorable pour le développement du processus révolutionnaire, à cause du manque d'expérience et du retard dans le développement de la conscience du prolétariat de ces pays.
2 Pendant sa première période d’exil de 1903 à 1907, il fut impliqué au Texas (USA) avec des fermiers japonais dans des expérimentations agricoles suivant le concept socialiste-utopique de Cabet et Robert Owen. Après la répression, il quitta à nouveau le Japon incidemment après l’éclatement de la Première guerre mondiale et partit aux États-Unis. Il devint à nouveau actif dans le milieu immigrant japonais. En 1916, il rencontra Trotsky, Boukharine, Kollontai à New-York. Une fois le contact établi, il commença à rejeter ses idées chrétiennes. En 1919, il rejoignit le Parti Communiste Indépendant d’Amérique et fonda une Association des Socialistes Japonais en Amérique. En 1921, il parti pour Moscou, où il vécu jusqu’en 1933. Il semble n’avoir jamais élevé la voix contre le Stalinisme. Quand il mourut, à Moscou en 1933, il eut des funérailles d’État.
Géographique:
- Japon [50]
Revue Internationale no 113 - 2e trimestre 2003
- 2926 reads
La barbarie de la guerre en Irak : La société bourgeoise telle qu'elle est vraiment
- 2779 reads
La guerre actuelle en Irak dévoile d'emblée toute son horreur et sa barbarie. Quinze jours après le début de cette troisième guerre du Golfe, après celle de 1980-88 entre Irak et Iran et celle de 1991 menée par Bush le père, on ne sait pas encore quand et comment elle se terminera. Mais ce qui se dessine nettement c'est qu'elle durera beaucoup plus de temps que l'avait annoncé le pronostic initial de l’administration du fils
La "guerre propre" annoncée par George W. Bush dévoile sa grimace de mort. Chaque jour de guerre apporte son lot supplémentaire de victimes civiles,de prolétaires tués des deux côtés, d'enfants mutilés dans les hopitaux, des traumatisés par les vagues de bombardements intensifs. Quinze jours après ce nouveau déclenchement d'horreur "la 'guerre propre' est devenue la plus sale des guerres, la plus Sanglante et la plus destructrice. Les 'armes intelligentes' sont soudain atteintes d'une stupidité préméditée, qui tue, detruit aveuglement et abat sa colère histérique sur les marchés populaires" Al-Ahram, quotidien égyptien). Le commandement américain a admis avoir largué des bombes à fragmentation. A Bagdad, une maternité du Croissant-Rouge irakien a été la cible de bombardements. Elle aurait été soufflée en plein jour par des bombes qui visaient le marché de Bagdad. Encore une fois, c'est la population civile de l'Irak qui est massacrée et terrorisée par toutes les armées sur place, y inclus les forces armées de l'Irak. Il n'y a pas seulement les victimes des balles et des missiles, mais aussi tous les malades qui ne reçoivent pas de soins, les enfants qui boivent de l'eau polluée, les exsangues victimes de la famine qui règne déjà depuis la guerre Iran/Irak, aggravée par l'embargo économique qui a succédé à la première guerre du Golfe.
Les troupes de Saddam présentent une infériorité militaire écrasante face aux armes sophistiquées des Américains et des Britanniques. C'est pourquoi, évitant les batailles ouvertes, le régime irakien a de plus en plus recours à une tactique de guérilla, utilisant la population civile comme bouclier humain. Une puissance occupante, même dotée d'une très large suprématie militaire, peut connaître les plus grandes difficultés à maintenir sa domination sur le territoire conquis, comme l'a prouvé le Vietnam pour les Etats-Unis ou l'Afghanistan pour l'URSS. Ainsi, il ne faut pas penser que tout sera terminé avec le renversment ou la mort de Saddam. La guerre en Israël/Palestine ne dépend pas non plus de Sharon ou d'Arafat et dure déjà depuis des décennies, et il n'existe pas de perspective de paix. Ce sont effectivement les attentats-suicides du Hamas qui sont le modèle pour le djihad auquel Saddam a appelé les musulmans. Déjà des volontaires en provenance d'autres pays arabes s'acheminent par centaines vers l'Irak. Contre la guérilla du Vietcong, les Etats-Unis recoururent aux bombardements au napalm sur les villages vietnamiens. Quelle arme encore plus "performante" sera-t-elle, cette fois, utilisée pour anénatir cette nouvelle menace?
En 1915, Rosa Luxemburg exprimait en ces termes son dégoût vis-à-vis de la barbarie guerrière : "Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordr'e, de la paix et du droit, c'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l 'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment " (Brochure de Junius). Malheureusement, c'est toujours ce même capitalisme qui domine le monde, mais décadent depuis 90 ans et aujourd'hui en pleine putréfaction et agonisant.
La spirale infernale
Le 11 septembre et la croisade contre le terrorisme mondial ont constitué une étape importante de l'accélération des tensions impérialistes et la guerre qui vient d'éclater en Irak en illustre toute la gravité.
Face à un monde dominé par le "chacun pour soi", où notamment les anciens alliés du bloc de l'Ouest aspirent à se dégager le plus possible de la tutelle des Etats-Unis qu'ils avaient dû supporter face à la menace du bloc adverse, le seul moyen décisif pour les Etats-Unis d'imposer leur autorité est de s'appuyer sur la force militaire parce que c'est le moyen par lequel ils disposent d'une supériorité écrasante sur tous les autres Etats. Mais, ce faisant, les EtatsUnis sont pris dans un dilemme : plus ils font usage de la force brute, plus les opposants sont poussés à saisir la moindre occasion pour prendre leur revanche et saboter les entreprises de la seule superpuissance ; et à l'inverse, si celle-ci renonce à la mise en œuvre ou à l'étalage de sa supériorité militaire, cela ne peut qu'encourager les contestataires à aller plus loin dans ce sabotage.
Cette contradiction, à l'oeuvre depuis l'effondrement du bloc de l'Est, est à l'origine d'un mouvement de balancier alternant offensive américaine qui fait taire la contestation / retour de la contestation à une plus grande échelle. Néanmoins, par définition, un tel mouvement ne peut pas être seulement répétitif mais il s'auto-alimente et prend à chaque fois plus d'ampleur.
C'est ce que vient illustrer l'escalade des conflits depuis la première guerre du Golfe. Et c'est ce dont témoigne la nouvelle vague de contestation du leadership américain, amorcée au printemps 2002 et qui, depuis lors, a battu des "records historiques". La France a défié les Etats-Unis avec une constance et une détermination qu'on ne lui connaissait pas auparavant, en jouant ouvertement la carte de son droit de veto au conseil de sécurité de l'ONU. L'audace du coq gaulois ne peut être séparée du fait qu'il agissait de concert avec toute une ménagerie contenant notamment l'ours russe, le dragon chinois et surtout l'aigle allemand. Cette fronde a constitué le soubassement d'un `vent de révolte' qui s'est emparé, sous différentes formes. du monde entier. Les attitudes des contestataires sont allées de la provocation ouverte de la Corée du Nord, jusqu'au positionnement de la Turquie et du Mexique qui, l'un en jouant sur un plan militaire, l'autre sur le volet diplomatique, ont tous les deux mis des gros bâtons dans les roues des plans américains.
Sur le plan idéologique aussi, les choses ont changé par rapport à la situation de 1999 lorsque l'OTAN bombardait Belgrade sous couvert "d'intervention humanitaire" Pour "sauver les Kosovars albanais du génocide". Les prétextes humanitaires des gouvernements Bush et Blair ne trouvent guère d'écho. La guerre apparaît sans justification, elle se montre toute nue, avec son souffle pestilentiel.
La guerre en Irak n'est pas la Troisième Guerre mondiale. Mais la seule perspective offerte par le capitalisme en décomposition est toujours plus de guerres, à chaque fois plus dévastatrices. L'alternative classique des internationalistes de la Première Guerre mondiale : "socialisme ou barbarie", doit aujourd'hui être précisé en ces termes "socialisme ou anéantissement de l'humanité".
La responsabilité de la classe ouvrière
La barbarie du monde d'aujourd'hui met en relief l'énorme responsabilité qui repose sur les épaules du prolétariat, lequel doit faire face au déchaînement d'une campagne et de manoeuvres d'une intensité sans précédent destinées à le détourner, non seulement de sa perspective historique, mais aussi de la lutte pour la défense de ses intérêts élémentaires, et ce à un moment où se produit un nouveau plongeon de l'économie mondiale dans la crise.
Les communistes ont le devoir de dénoncer avec autant d'énergie les pacifistes que ceux qui prêchent la guerre. Le pacifisme est un des pires ennemis du prolétariat. Il cultive l'illusion que la `bonne volonté' ou les « néociations internationales », peuvent venir à bout des guerres et entretient ainsi le mensonge qu'il pourrait
exister un 'bon capitalisme', respectueux de la paix et des « droits de l'homme ». La fonction du pacifisme est de détourner les prolétaires de la lutte de classe contre le capitalisme comme un tout (voir l'article de Trotsky "Le pacifisme, suppletif de 1’impérialisme" dans ce numéro de la Revue internationale).
Mais la classe ouvrière n'est pas vaincue et la plongée dans la récession va la contraindre à développer sa combativité. Dans le même temps, la guerre qui dévoile toujours plus le vrai caractère de la société bourgeoise est à même d'alimenter un processus souterrain de maturation de la conscience au sein de minorités de la classe ouvrière (voir pour cet aspect, mais aussi pour les enjeux de la guerre présente, la résolution sur la situation internationale adoptée au 15e congres du CCI et publiée dans ce numéro de la Revue internationale. Le prolétariat, y compris dans la situation actuelle de, grande difficulté qu'il connaît depuis le début des années 1990, constitue un frein à la guerre. Il constitue le seul espoir pour l'humanité puisque lui seul est capable. à travers ses luttes, de s'affirmer dans cette société en décomposition comme une force porteuse d'une alternative à la barbarie capitaliste.
SM (4 avril 2003)
Géographique:
- Irak [51]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [52]
La responsabilité des révolutionnaires face à la guerre
- 2827 reads
La guerre a, de tout temps, constitué une épreuve pour la classe ouvrière et les minorités révolutionnaires.
En effet, les ouvriers sont les premiers à subir les conséquences de la guerre qu’ils paient au prix d’une exploitation accrue ou de leur propre vie. En même temps, le prolétariat constitue la seule force au sein de la société capable de mettre un terme à la barbarie en renversant le capitalisme qui l’engendre.
Cette nouvelle guerre du Golfe et l’aggravation considérable des tensions impérialistes qu’elle traduit viennent justement rappeler au monde la menace que constitue pour l’humanité tout entière la perpétuation d’un système condamné par l’histoire et dont la fuite en avant dans la guerre et le militarisme est la seule réponse qu’il ait à proposer à la crise de son économie.
Bien que la classe ouvrière ne soit pas en mesure actuellement, à travers une lutte révolutionnaire, de répondre à ces enjeux que lui pose l’histoire, il importe que cette nouvelle irruption de la barbarie puisse constituer un facteur de maturation de la conscience en son sein. Or la bourgeoisie fait tout son possible pour que ce conflit, dont elle ne peut plus dissimuler le caractère impérialiste derrière des prétextes humanitaires ou la défense du droit international, ne puisse être bénéfique au développement de la conscience dans la classe. Pour cela, elle peut s'appuyer, dans tous les pays, sur tout un arsenal médiatique et idéologique dédié au bourrage de crâne.
Quels que soient les intérêts impérialistes qui opposent les différentes fractions nationales de la bourgeoisie, leur propagande ont en commun au moins les deux thèmes suivants : ce n’est pas le capitalisme qui, comme un tout, est responsable de la barbarie guerrière mais tel ou tel Etat en particulier, tel ou tel régime à la tête de celui-ci ; la guerre n’est pas une expression inéluctable du capitalisme mais il existe des possibilités de pacifier les relations entre les nations.
Au même titre que la révolution, la guerre constitue un moment de vérité pour les organisations du prolétariat qui les contraint à se positionner clairement dans un camp ou l'autre.
Face à cette guerre, à sa préparation et à son accompagnement par la bourgeoisie à travers un déluge de propagande pacifiste, il appartenait aux organisations révolutionnaires, les seules à même de défendre un clair point de vue de classe, de se mobiliser pour une intervention décidée au sein de leur classe. Ainsi il était de leur responsabilité de dénoncer haut et fort le caractère impérialiste de cette guerre, comme de toutes celles intervenues depuis le début du 20e siècle, de défendre l’internationalisme prolétarien, d'opposer les intérêts généraux du prolétariat à ceux de toutes les fractions de la bourgeoisie, quelles qu’elles soient, de rejeter tout soutien à une quelconque union nationale, de mettre en avant la seule perspective possible pour le prolétariat, le développement de la lutte de classe dans tous les pays, jusqu’à la révolution.
En ce qui le concerne, le CCI a mobilisé ses forces afin d’assumer au mieux de ses possibilités cette responsabilité qui lui incombait.
Il est intervenu à travers la vente de sa presse dans les manifestations pacifistes qui se sont multipliées dans tous les pays depuis le mois de janvier et l’importance des ventes qu’il a réalisées dans celles-ci témoigne au moins de sa détermination à convaincre de ses positions. Dans certains pays, des suppléments de la presse territoriale ont été réalisés ou des appels à des réunions publiques exceptionnelles ont été diffusés. Ces dernières, dans certaines villes, ont permis que des contacts et des discussions aient lieu avec de nouveaux éléments qui jusqu’alors ne connaissaient pas le CCI.
Le jour suivant les premeirs bombardements sur l’Irak, le CCI entreprenait la diffusion massive (relativement à ses modestes forces) d’un tract (publié ci-après) en direction de la classe ouvrière dans les quatorze pays où il a une présence organisée (voir la liste de ces pays au dos de nos publications), soit encore dans cinquante villes sur tous les continents à part l’Afrique. Pour certains de ces pays, comme l’Inde, la diffusion du tract dans deux des principaux centres industriels a nécessité qu’il soit traduit en d’autres langues comme l’Hindi et le Bengali. De nombreux sympathisants se sont joints à notre effort de diffusion permettant ainsi d’en élargir la portée. Ce tract a aussi été diffusé, plus sélectivement, dans les manifestations pacifistes. Il a été traduit en russe, en vue d’en permettre la circulation en Russie, pays où le CCI n’est pas présent. Dès le premier jour des bombardements, il était déjà disponible en anglais et en français sur le site Internet du CCI. Il sera progressivement disponible sur ce site dans toutes les langues dans lesquelles il a été traduit, y inclus certaines, comme le Coréen, le Farsi ou le Portugais, qui sont parlées dans des pays où le CCI n’est pas présent.
Il existe d’autres organisations révolutionnaires de la Gauche communiste qui, elles aussi, sont intervenues notamment par tract dans les manifestations pacifistes. A travers la défense d'un internationalisme intransigeant face à la guerre ne souffrant pas la moindre concession dans le soutien à un camp bourgeois, elles se distinguent de tout le fatras gauchiste.
Conformément à la conception qu’il a de l’existence d’un milieu révolutionnaire constitué justement par ces organisations, et conformément également à la pratique qui est la sienne depuis qu’il existe, le CCI s’est adressé à celles-ci en vue d’une intervention commune face à la guerre. Il a précisé, à travers une lettre adressée à ces groupes en quoi pourrait consister une telle intervention : "la rédaction et la diffusion d’un document commun de dénonciation de la guerre impérialiste et des campagnes bourgeoises qui l’accompagnent" ou "la tenue de réunions publiques communes où chacun des groupes pourra présenter, outres les positions communes qui nous rassemblent, les analyses spécifiques qui le distinguent des autres".
Nous avons déjà publié sur ce site le contenu de notre tract [53] ; on y trouvera également le contenu de notre appel de même qu'une première analyse des réponses reçues, toutes négatives. Une telle situation illustre le fait que le milieu révolutionnaire comme un tout n'a pas été à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes, face à la situation guerrière actuelle mais également, fait plus grave, vis-à-vis de la perspective du nécessaire regroupement des révolutionnaires en vue de la constitution du futur parti de classe du prolétariat international.
Géographique:
- Irak [51]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [52]
Propositions du CCI aux groupes révolutionnaires pour une intervention commune face à la guerre
- 3475 reads
Nous publions ci-dessous deux lettres que nous avons fait parvenir aux organisations de la Gauche communiste, leur proposant des modalités pour une intervention commune face à la guerre. N'ayant reçu aucune réponse écrite à notre première lettre de la part de ces organisations, nous avons décidé d'en envoyer une seconde avec de nouvelles propositions plus modestes et plus facilement acceptables par celles-ci, pensions-nous. Parmi les organisations destinataires de notre appel,
- Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR)
- Partito Comunista Internazionale (Il Comunista, Le Prolétaire)
- Partito Comunista Internazionale (Il Partito Comunista)
- Partito Comunista Internazionale (Il Programma Comunista)
seuls le BIPR et le PCI (Le Prolétaire) ont daigné répondre. Cela en dit long sur l'autosuffisance des deux autres organisations.
Notre lettre du 11 février
Camarades,
Le monde s'achemine vers une nouvelle guerre aux conséquences tragiques : massacres des populations civiles et des prolétaires en uniforme irakiens, intensification de l'exploitation des prolétaires des pays "démocratiques" sur qui va retomber en priorité l'énorme accroissement des dépenses militaires de leurs gouvernements... En fait, cette nouvelle guerre du Golfe, dont les objectifs sont bien plus ambitieux que ceux de la guerre de 1991, risque de la laisser loin derrière tant du point de vue des massacres et des souffrances qu’elle va provoquer que de l’accroissement de l’instabilité qu’elle va entraîner dans toute cette région du Moyen-Orient déjà particulièrement affectée par les conflits impérialistes.
Comme toujours à l’approche des guerres, on assiste aujourd’hui à un déchaînement massif de campagnes de mensonges afin de faire accepter par les exploités les nouveaux crimes que s’apprête à commettre le capitalisme. D’un côté, on justifie la guerre en préparation comme une “nécessité pour empêcher un dictateur sanguinaire de menacer la sécurité du monde avec ses armes de destruction massive”. De l’autre, on prétend que “la guerre n’est pas inévitable et qu’il faut s’appuyer sur l’action des Nations unies”. Les communistes savent pertinemment ce que valent ces discours : les principaux détenteurs d’armes de destruction massive, ce sont les pays qui aujourd’hui prétendent garantir la sécurité de la planète et leurs dirigeants n’ont jamais hésité à les utiliser lorsqu’ils l’estimaient utile à la défense de leurs intérêts impérialistes. Quant aux États qui aujourd’hui en appellent à “la paix”, nous savons bien que c’est pour mieux défendre leurs propres intérêts impérialistes menacés par les ambitions des États-Unis et que demain ils n’hésiteront pas à déchaîner à leur tour les massacres si leurs intérêts le commandent. Les communistes savent aussi qu’il n’y a rien à attendre de ce “repaire de brigands”, suivant les termes de Lénine à propos de la Société des Nations, que constitue l’organisation qui a succédé à cette dernière, l’Organisation des Nations unies.
Parallèlement aux campagnes organisées par les gouvernements et leurs médias aux ordres, on voit aussi se développer des campagnes pacifistes sans précédent, notamment sous la houlette des mouvements anti-mondialisation, bien plus bruyantes et massives que celles de 1990-91 lors de la première guerre du Golfe ou que celles de 1999 lors des bombardements de l’OTAN sur la Yougoslavie.
La guerre a toujours constitué une question centrale pour le prolétariat et pour les organisations qui défendent ses intérêts de classe et sa perspective historique de renversement du capitalisme. Les courants qui dans les conférences de Zimmerwald et de Kienthal avaient pris une position claire sur la guerre, une position véritablement internationaliste, furent ceux qui allaient par la suite se porter à l’avant-garde de la révolution d’Octobre 1917, de la vague révolutionnaire qui l’a suivie et de la fondation de l’Internationale communiste. En outre, l’histoire a également montré au cours de cette période que le prolétariat est la seule force dans la société qui puisse réellement s’opposer à la guerre impérialiste, non pas en s’alignant sur les illusions pacifistes et démocratiques petites bourgeoises, mais en engageant le combat sur son propre terrain de classe contre le capitalisme comme un tout et contre les mensonges pacifistes. En ce sens, l’histoire nous a également appris que la dénonciation par les communistes de la boucherie impérialiste et de toutes les manifestations de chauvinisme devait s’accompagner nécessairement de la dénonciation du pacifisme.
C’est à la Gauche de la 2e Internationale (particulièrement les bolcheviks) qu’il est revenu de défendre avec le plus de clarté la véritable position internationaliste dans la première boucherie impérialiste. Et il est revenu à la Gauche communiste de l’IC (particulièrement à la Gauche italienne) de représenter la position internationaliste face aux trahisons des partis de l’IC et face à la seconde guerre mondiale.
Face à la guerre qui se prépare et à toutes les campagnes de mensonges qui se déchaînent aujourd’hui, il est clair que seules les organisations qui se rattachent au courant historique de la Gauche communiste sont réellement en mesure de défendre une véritable position internationaliste :
1. La guerre impérialiste n’est pas le résultat d’un politique “mauvaise” ou “criminelle” de tel ou tel gouvernement en particulier ou de tel ou tel secteur de la classe dominante ; c’est le capitalisme comme un tout qui est responsable de la guerre impérialiste.
2. En ce sens, face à la guerre impérialiste, la position du prolétariat et des communistes ne saurait être en aucune façon de s’aligner, même de façon “critique”, sur l’un ou l’autre des camps en présence ; concrètement, dénoncer l’offensive américaine contre l’Irak ne signifie nullement apporter le moindre soutien à ce pays et à sa bourgeoisie.
3. La seule position conforme aux intérêts du prolétariat est le combat contre le capitalisme comme un tout et donc contre tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale avec comme perspective non pas celle d’un “capitalisme pacifique” mais pour le renversement de ce système et l’instauration de la dictature du prolétariat.
4. Le pacifisme est au mieux une illusion petite-bourgeoise tendant à détourner le prolétariat de son strict terrain de classe ; le plus souvent, il n’est qu’un instrument utilisé avec cynisme par la bourgeoisie pour entraîner les prolétaires dans la guerre impérialiste en défense des secteurs “pacifistes” et “démocratiques” de la classe dominante. En ce sens, la défense de la position internationaliste prolétarienne est inséparable d’une dénonciation sans concession du pacifisme.
Les groupes actuels de la Gauche communiste partagent tous ces positions fondamentales au delà des divergences pouvant exister entre eux. Le CCI est bien conscient de ces divergences et il n’a jamais tenté de les cacher. Au contraire, il s’est toujours efforcé dans sa presse de signaler les désaccords qu’il avait avec les autres groupes et de combattre les analyses qu’il estime erronées. Cela dit, conformément à l’attitude des bolcheviks en 1915 à Zimmerwald et de la Fraction italienne dans les années 30, le CCI estime qu’il est de la responsabilité des véritables communistes de présenter de la façon la plus ample possible à l’ensemble de la classe, face à la guerre impérialiste et aux campagnes bourgeoises, les positions fondamentales de l’internationalisme. Cela suppose, de notre point de vue, que les groupes de la Gauche communiste ne se contentent pas de leur propre intervention chacun dans son coin mais qu’ils s’associent pour exprimer de façon commune ce qui constitue leur position commune. Pour le CCI, une intervention commune des différents groupes de la Gauche communiste aurait un impact politique au sein de la classe qui irait bien au delà de la somme de leurs forces respectives qui, nous le savons tous, sont bien réduites à l’heure actuelle. C’est pour cette raison que le CCI propose aux groupes qui suivent de se rencontrer pour discuter ensemble de tous les moyens possibles permettant à la Gauche communiste de parler d’une seule voix pour la défense de l’internationalisme prolétarien, sans préjuger ou remettre en cause l’intervention spécifique de chacun des groupes. Concrètement, le CCI fait les propositions suivantes aux groupes cités à la fin du document :
- Rédaction et diffusion d’un document commun de dénonciation de la guerre impérialiste et des campagnes bourgeoises qui l’accompagnent.
- Tenue de réunions publiques communes où chacun des groupes pourra présenter, outre les positions communes qui nous rassemblent, les analyses spécifiques qui le distinguent des autres.
Le CCI est évidemment ouvert à toute autre initiative permettant de faire entendre le plus possible les positions internationalistes.
En mars 1999, le CCI avait déjà envoyé un appel du même type à ces mêmes organisations. Malheureusement, aucune d’entre elles n’avait répondu favorablement et c’est pour cela que notre organisation avait estimé inutile de renouveler un tel appel au moment de la guerre en Afghanistan à la fin 2001. Si nous renouvelons aujourd’hui un tel appel, c’est parce que nous pensons que tous les groupes de la Gauche communiste, conscients de l’extrême gravité de la situation présente et de l’ampleur exceptionnelle des campagnes pacifistes mensongères, auront à cœur de tout faire pour que se fasse entendre le plus possible la position internationaliste.
Nous vous demandons de transmettre le plus rapidement possible votre réponse à cette lettre en l'adressant à la boîte postale donnée en en-tête. Pour que cette réponse nous parvienne au plus vite nous vous proposons d'en adresser une copie à la boîte postale de nos sections territoriales les plus proches de votre organisation ou à des militants du CCI que vous pouvez rencontrer.
Nous vous adressons nos salutations communistes.
Notre lettre du 24 mars
Camarades,
(...) De toute évidence, vous devez considérez que l'adoption par différents groupes de la Gauche communiste d'un document commun dénonçant la guerre impérialiste et les campagnes pacifistes est susceptible de créer la confusion et de masquer les différences entre nos organisations. Vous savez que ce n'est pas notre opinion mais nous n'essaierons pas ici de vous convaincre de celle-ci. Le but essentiel de cette lettre est de vous faire la proposition suivante : organiser en commun des réunions publiques au cours desquelles chacune des organisations de la Gauche communiste représentée ferait, sous sa responsabilité exclusive, sa propre présentation et apporterait ses propres arguments dans la discussion. Il nous semble qu'une telle formule répond à votre préoccupation que nos positions respectives ne soient pas confondues et qu'il n'y ait pas d'amalgame possible entre nos organisations. En même temps, une telle formule permet de faire apparaître avec le maximum d'impact (même s'il est encore très modeste) qu'à côté des différentes positions bourgeoisies qui s'affichent à l'heure actuelle (qu'elles préconisent le soutien à tel ou tel camp militaire au nom de "la démocratie" ou de "l'anti-impérialisme" ou qu'elles se présentent comme "pacifistes" au nom du "respect de la loi internationale" ou autres balivernes) il existe une position internationaliste, prolétarienne et révolutionnaire que seuls les groupes qui se rattachent à la Gauche communiste sont capables de défendre. Enfin, une telle formule doit permettre qu'un maximum d'éléments qui s'intéressent aux positions de la Gauche communiste et à ses positions internationalistes puissent se retrouver et discuter ensemble ainsi qu'avec les organisations qui défendent ces positions, en même temps qu'ils seront en mesure de prendre connaissance de la façon la plus claire possible des désaccords politiques qui existent entre elles.
Pour que les choses soient bien claires : cette proposition ne vise pas à permettre au CCI d'élargir son auditoire en se donnant la possibilité de prendre la parole devant des éléments qui fréquentent habituellement les réunions publiques ou permanences de votre organisation. Comme preuve de cela, nous vous faisons la proposition suivante : les réunions publiques que le CCI a prévues dans la période qui vient, et qui seront consacrées, évidemment, à la question de la guerre et de l'attitude du prolétariat face à elle, pourront être transformées, si vous en êtes d'accord, en réunions publiques du type de celles que nous vous proposons. Une telle formule est particulièrement réalisable dans les villes ou les pays où se trouvent des militants de votre propre organisation. Mais notre proposition englobe aussi d'autres pays ou villes : concrètement, c'est avec une grande satisfaction que nous participerions par exemple à l'organisation à Cologne ou à Zürich d'une réunion publique en commun avec des militants de la Gauche communiste habitant en Angleterre, en France ou en Italie. Nous sommes évidemment disposés à loger les militants de votre organisation qui participeraient à ces réunions publiques de même qu'à traduire dans la langue du pays, si c'était nécessaire, leur présentation et leurs interventions.
Si cette proposition vous convient, nous vous prions de nous en informer le plus rapidement possible, (éventuellement à l'adresse Internet que nous indiquons plus bas) afin que nous puissions prendre toutes les dispositions nécessaires. En tout état de cause, même si vous refusez notre proposition (ce qu'évidemment nous déplorerions), votre organisation et ses militants sont cordialement invités à participer à nos réunions publiques pour y défendre vos positions.
Dans l'attente de votre réponse, nous vous adressons nos meilleures salutations communistes et internationalistes.
° ° °
Réponse du BIPR du 28 mars
Chers camarades,
Nous avons reçu via vos camarades votre "appel" pour l’unité d’action contre la guerre. Nous nous trouvons dans l’obligation de le repousser pour des raisons qui devraient être déjà connues par vous et que nous résumons.
Si presque trente ans après la Première Conférence Internationale de la Gauche Communiste, les divergences entre nous et le CCI, non seulement ne se sont pas amoindries, mais se sont accrues et qu’en même temps, le CCI a subi les scissions que nous connaissons, cela veut dire – et c’est clair pour quiconque observe le phénomène dans son essence – que le CCI ne peut être considéré par nous comme un interlocuteur valable pour définir une forme d’unité d’action.
Il n’est pas possible de "mettre ensemble" ceux qui soutiennent qu’un danger gravissime menace la classe ouvrière qui, après avoir subi presque sans réagir les attaques extrêmement violentes contre les salaires, l’emploi et les conditions de travail, risque maintenant d’être enchaînée au char de la guerre, et ceux qui – comme le CCI – soutiennent que la guerre impérialiste entre les blocs n’a pas encore éclaté parce que… la classe ouvrière n’est pas défaite et empêcherait donc la guerre elle- même. Qu’est ce qu’on aurait à dire, ensemble ? Il est évident que face à l’énormité de ce problème, les principes généraux énoncés dans l’Appel ne suffisent pas.
D’autre part, l’unité d’action – contre la guerre comme sur tout autre problème – peut se vérifier entre interlocuteurs politiques définis et indentifiables de façon non équivoque et qui partagent les positions politiques qu’ils considèrent en commun comme essentielles. Nous avons déjà vu que sur un point que nous considérons comme essentiel il y a des positions antithétiques, mais, indépendamment des possibilités de convergence politique future ou pas, il est essentiel que l’hypothétique unité d’action organisée entre tendances politiques différentes voie la convergence de toutes les composantes dans lesquelles de telles tendances s’entendent ou se divisent. C’est-à-dire que n’a pas de sens l’unité d’action entre des parties des différents courants politiques alors que les autres… parties restent en dehors, avec bien sur une attitude critique et antagoniste.
Et bien, vous (le CCI) vous faites partie d’une tendance politique qui se répartit désormais en plusieurs groupes qui revendiquent chacun l’orthodoxie du CCI du début, comme le font tous les groupes bordiguistes auxquels vous vous adressez, en plus de nous.
Tout ce que vous écrivez dans votre "appel" à propos de resserrer les rangs révolutionnaires face à la guerre devrait être valable avant tout au sein de votre tendance, comme il en irait au sein des tendances bordiguistes.
Franchement, ce serait plus sérieux qu’un appel comme celui-ci soit adressé justement à la FICCI et à l’ex-FECCI, comme il serait sérieux que Programma Comunista ou Il Comunista-Le Prolétaire lancent un appel semblable aux nombreux autres groupes bordiguistes dans le monde. Pourquoi serait-ce plus sérieux ? Parce que cela constituerait une tentative d’inverser la tendance ridicule - si elle n’était pas dramatique – à se diviser toujours plus, au fur et à mesure que s’accroissent les contradictions du capitalisme et les problèmes que cela pose à la classe ouvrière.
Mais il est maintenant évident que dans les deux cas, cette tendance dramatique/ridicule caractérise les deux courants.
Ce n’est pas par hasard, et nous revenons à l’autre question essentielle. La position théorique et la méthode, les positions politiques, la conception de l’organisation du CCI (comme de Programma Comunista du début) ont de toute évidence … des défauts, si sur cette base apparaissent des ruptures et des scissions chaque fois que les problèmes du capitalisme et des rapports de classe s’exacerbent.
Si 60 ans après la constitution du PC Internationaliste en Italie et 58 ans après la fin de la II Guerre mondiale, deux des trois tendances présentes dans la Gauche Communiste entre les deux guerre se sont morcelées, il doit y avoir une raison.
Nous insistons : il ne s’agit pas d’une absence de croissance ou d’un manque d’enracinement dans la classe ouvrière ; ceux ci dépendent de la difficulté extrême de la classe à sortir de la défaite historique de la contre-révolution stalinienne. Nous posons ici, au contraire, le problème de la fragmentation de ces tendances politiques en une constellation de groupes, chacun revendiquant l’orthodoxie. La raison de ceci réside – comme nous l’avons soutenu en plusieurs occasions – dans la faiblesse de … l’orthodoxie, dans son incapacité donc à comprendre et à expliquer la dynamique du capitalisme et à élaborer les orientations politiques nécessaires qui en découlent. En conclusion, il nous semble que l’objectif de recomposer la Gauche Italienne dans un cadre politique unitaire est désormais inatteignable, vu que deux de ses composantes manifestent une impuissance notoire à expliquer les événements en termes cohérents avec la réalité et, à cause de cette impuissance, ne réussissent qu’à se fragmenter encore plus.
Evidemment, cela ne signifie pas, de notre part, une fermeture sur nous mêmes et – de la même manière que nous avions su prendre des initiatives adéquates pour rompre la glace dans les lointaines années 76 et déclencher une nouvelle dynamique dans le débat au sein du camp politique prolétarien – nous chercherons aujourd’hui à prendre les initiatives propres à dépasser le vieux cadre politique, désormais bloqué, et à rénover la tradition révolutionnaire et internationaliste dans un nouveau processus d’enracinement dans la classe.
° ° °
La réponse du PCI du 29 mars
Camarades,
Nous avons bien reçu votre lettre du 24 mars, qui contenait aussi votre lettre précédente du 11 février. Nous avons déjà eu oralement l'occasion de répondre à la proposition contenue dans cette dernière lors d'une réunion de lecteurs et nous y reviendrons publiquement sur les colonnes du Prolétaire. Même s'il semble que vous abandonnez l'idée d'un texte commun, votre nouvelle proposition relève du même frontisme politique et ne peut donc recevoir de notre part que la même réponse négative.
Avec nos salutations communistes,
Notre prise de position sur les réponses
Ce n'est pas la première fois que le CCI lance un appel en direction des groupes du Milieu Politique Prolétarien en vue d'une intervention commune face à l'accélération de la situation mondiale. Comme le rappelle notre courrier, nous avions déjà lancé un tel appel en mars 1999 face au déchaînement de la barbarie guerrière au Kosovo. L'essentiel de l'argumentation alors développée dans les articles que nous avions écrits à l'époque à propos des réponses négatives qu'il avait sucitées[1] est encore à notre sens tout à fait adapté à la situation actuelle. Néanmoins, si nous estimons nécessaire de prendre brièvement position à propos de réponses négatives qui nous sont à nouveau parvenues, c'est pour prendre acte d'une démarche politique que nous considérons préjudiciable aux intérêts historiques du prolétariat, étant entendu que, dans de prochains articles, nous reviendrons de façon plus exhaustive sur le sujet. Le PCI (Le Prolétaire) a d'ailleurs annoncé dans sa lettre qu'il ferait de même dans les colonnes de sa presse.
Nous nous limiterons donc à une considération des arguments donnés par les deux groupes pour rejeter nos deux propositions : la diffusion d’un document contre la guerre sur la base de nos positions internationalistes communes, et l’organisation de réunions destinées à permettre à la fois une dénonciation commune de la guerre et la confrontation des divergences entre nos organisations.
Le PCI et son petit dénominateur commun
La lettre très brève du PCI (Le Prolétaire) considère que notre appel revient à faire du "frontisme". Cette réponse rejoint celle qui nous a été donnée oralement à la permanence du PCI à Aix-en-Provence le 1er mars, où on nous a dit également que la vision du CCI revenait à chercher le "plus petit dénominateur commun" entre les organisations. Par ailleurs, ces arguments très sommaires sont en cohérence avec ceux – plus développés sans être pour autant plus convaincants – mis en avant dans une polémique à notre égard publiée dans Le Prolétaire n°465. Celle-ci nous permet d'aborder brièvement les conceptions organisationnelles du PCI.
Disons tout de suite que cet article représente un pas en avant par rapport à l'attitude du PCI des années 1970/80. Alors que nous avions l'habitude de nous affronter à une organisation qui se considérait déjà comme le "parti compact et puissant" et unique guide de la révolution prolétarienne dont le seul programme devait être celui, "invariant", de… 1848, le PCI d'aujourd'hui nous dit : "Bien loin de nous croire 'seuls au monde', nous défendons au contraire la nécessité de la critique programmatique intransigeante et de la lutte politique contre les positions que nous estimons fausses et les organisations qui les défendent".
Le Prolétaire semble penser que nous voulons attirer des éléments pour aller vers la formation du parti sur la base du plus petit dénominateur commun. A cela, il oppose une méthode qui considère que toutes les autres organisations et leurs positions sont à combattre au même titre, c’est-à-dire qu’il ne fait pas de distinction entre les organisations qui maintiennent une position internationaliste et des organisations trotskystes ou staliniennes qui ont, depuis longtemps, abandonné le terrain de la classe ouvrière par leur soutien plus ou moins explicite à un camp ou à un autre dans la guerre impérialiste. Une telle méthode aboutit nécessairement à penser qu’on est la seule organisation à défendre le programme de la classe ouvrière et qu’en conséquence on constitue la seule base pour la construction du parti et, en dernière analyse à agir comme si on était seul au monde à défendre des positions de classe.
Le PCI constate également que la situation actuelle n'a rien à voir avec celle de Zimmerwald et Kienthal, et considère que notre référence aux principes de Zimmerwald n’est pas de mise parce que basée sur une comparaison abusive. C'est qu'il n'a rien compris – ou ne veut rien comprendre – à notre propos.
Il n’est pas indispensable d’être marxiste pour constater que la situation d'aujourd'hui n’est pas identique à celle de 1917, ni même à celle de 1915, l'année de Zimmerwald. Néanmoins, il existe bien des traits significatifs communs à ces deux périodes : la guerre impérialiste y est présente sur le devant de la scène de l'histoire, impliquant pour les éléments avancés de la classe ouvrière qu’une question prime sur toutes les autres : celle de l'internationalisme contre cette guerre. Il est de la responsabilité de ces éléments de faire entendre leur voix contre le bourbier de la propagande et de l'idéologie bourgeoises. Parler de "frontisme" et de "petit dénominateur commun", non seulement ne permet pas de faire ressortir les divergences entre internationalistes mais est facteur de confusion dans la mesure où la vraie divergence, la frontière de classe qui sépare les internationalistes de toute la bourgeoisie, de la droite à l'extrême gauche, se trouve mise sur le même plan que les divergences entre les internationalistes.
L’accusation de "frontisme" se base en fait sur une erreur profonde quant à la nature réelle du frontisme, tel qu’il a été compris et dénoncé par nos prédécesseurs de la Gauche communiste. Ce terme fait référence aux tactiques adoptées par une 3e Internationale qui essayait – mais de façon erronée et opportuniste – de briser l’isolement de la révolution russe. Par la suite, et dans le processus de sa dégénérescence, l’Internationale communiste est de plus en plus devenue un simple instrument de la politique étrangère de l’Etat russe et s'est servie de la tactique du frontisme comme instrument de cette politique. Le frontisme – tel le "front unique ouvrier à la base" prôné par l’IC, était donc une tentative de créer une unité dans l’action entre les partis de l’Internationale restés fidèles à l’internationalisme prolétarien, et les partis sociaux-démocrates en particulier qui avaient soutenu l’effort de guerre de l’Etat bourgeois en 1914. C’est-à-dire que le frontisme essayait de créer un front unique entre deux classes ennemies, entre les organisations du prolétariat et celles passées irrémédiablement dans le camp de la bourgeoisie.
En se réfugiant derrière les différences de période historique et le rejet du frontisme, le PCI esquive les vraies questions et les responsabilités qui incombent aujourd'hui aux internationalistes. Lorsque nous faisons appel à l'esprit de Lénine à Zimmerwald, c'est au niveau des principes. Quoi que le PCI en pense, nous sommes d'accord avec lui sur la nécessité de la critique programmatique et de la lutte politique. Nous aussi, nous combattons les idées que nous considérons fausses mis à part que, comprenant la différence de nature qui existe entre les organisations de la bourgeoisie et celles du prolétariat, ce sont les positions politiques de ces dernières que nous combattons et non les organisations.
"Le parti unique qui guidera demain le prolétariat dans la révolution et la dictature ne pourra naître de la fusion d'organisations et donc de programmes hétérogènes, mais de la victoire bien précise d'un programme sur les autres (…) il devra avoir un programme lui aussi unique, non équivoque, le programme communiste authentique qui constitue la synthèse de tous les enseignements des batailles passées…".
Nous aussi, nous estimons que le prolétariat ne saura faire la révolution sans avoir été capable de faire surgir un parti communiste mondial basé sur un seul programme,[2] synthèse des enseignements du passé. Mais là où le bât blesse, c'est de savoir comment ce parti pourra surgir. Nous ne croyons pas qu'il pourra jaillir tout prêt au moment révolutionnaire, comme Athéna de la tête de Zeus, mais qu'il doit être préparé dès maintenant. C’est justement ce type de préparation qui a fait cruellement défaut à la 3e Internationale. Pour cette préparation, deux choses sont nécessaires : premièrement, délimiter clairement les positions internationalistes de tout le fatras gauchiste qui revient toujours à défendre telle ou telle fraction bourgeoise dans la guerre impérialiste ; et deuxièmement, permettre que les divergences qui existent au sein de ce camp internationaliste puissent être confrontées dans le feu du débat contradictoire. Mettre aujourd'hui la formation du parti mondial sur le même plan que la défense de l'internationalisme contre la guerre impérialiste, c'est vraiment faire preuve d'idéalisme, en tournant le dos à un besoin urgent de la situation actuelle au nom d'une perspective historique qui ne pourra éclore qu'à partir d'un développement massif de la lutte de classe et du travail préalable de clarification et de décantation chez les minorités révolutionnaires.
Quant au rejet de "la fusion d'organisations" par le Prolétaire, il ne fait qu’exprimer, de la part de cette organisation, un oubli de l'histoire : doit-on lui rappeler que l'appel à la constitution de la 3e Internationale ne s’adressait pas uniquement à des bolcheviks, ni même qu'à des sociaux-démocrates restés fidèles à l'internationalisme comme le groupe Spartacus de Rosa Luxemburg et de Liebknecht. Il s’adressait aussi à des anarcho-syndicalistes notamment la CNT espagnole, à des syndicalistes révolutionnaires comme Rosmer et Monatte en France et comme les IWW américains, à des "industrial unionists" du mouvement des shop-stewards en Grande-Bretagne, ou encore à des De Leonistes comme le SLP écossais de John Maclean. Le parti bolchévique lui-même, à peine quelques mois avant la révolution d'Octobre, intègre en son sein l'organisation inter-rayons de Trotsky qui comprend d'anciens mencheviks internationalistes. Evidemment, il ne s’est pas agi d'une fusion "oecuménique" mais d’un regroupement des organisations prolétariennes restées fidèles à l’internationalisme pendant la guerre autour des conceptions des bolcheviks, dont l’évolution des faits historiques et surtout de l’action ouvrière avaient démontré la validité. Cette autre expérience historique vient illustrer la non validité de l’idée du PCI selon laquelle une fusion d'organisations équivaudrait à une fusion de programmes.
Aujourd'hui, lever bien haut le drapeau de l'internationalisme et créer des aires de débat au sein du camp internationaliste permettrait aux éléments en recherche d'une clarté révolutionnaire d'apprendre à déjouer toute la propagande trompeuse de la bourgeoisie démocratique, pacifiste et gauchiste, d'apprendre à se tremper dans la lutte politique. Le PCI dit vouloir combattre le CCI, son programme, ses analyses, sa politique, et "mener une lutte politique sans compromis contre tous les confusionnistes" (dont le CCI). Fort bien, et nous relevons le défi. Le problème, c'est que pour qu'il y ait un tel combat (nous entendons bien combat politique à l'intérieur du camp prolétarien), les forces opposées doivent se rencontrer dans un cadre – et nous ne pouvons que regretter que le PCI préfère "combattre" à partir de sa chaire professorale et dogmatique plutôt que d'affronter les rigueurs et les réalités d'un débat contradictoire, sous le prétexte que ce dernier serait une "démocratique union oecuménique".[3] Refuser notre proposition, ce n'est pas "combattre" ; au contraire, c'est refuser le combat réel et nécessaire à la faveur d'un combat idéal et irréel.
La réponse du BIPR
Le BIPR donne quatre raisons que nous résumons à l’appui de son refus :
1. Le CCI pense que c’est la classe ouvrière qui empêche l’éclatement de la guerre impérialiste mondiale, on ne peut donc le considérer comme un "interlocuteur valable".
2. La Gauche communiste est morcelée en trois tendances (c’est-à-dire les bordiguistes, le BIPR et le CCI) dont deux (les bordiguistes et le CCI) sont éclatées en différents groupes qui se réclament tous de "l’orthodoxie" d’origine. Pour le BIPR, il n’est pas possible d’envisager une action commune entre ces "tendances" avant que celles-ci ne se soient réunies elles-mêmes (l'ancienne "fraction externe" et l'actuelle "fraction interne" du CCI faisant partie, selon le BIPR, de "notre tendance"): "il est essentiel que l’hypothétique unité d’action organisée entre tendances politiques différentes voie la convergence de toutes les composantes dans lesquelles de telles tendances s’entendent ou se divisent". Dans ce sens, "ce serait plus sérieux qu’un appel comme celui-ci soit adressé justement à la FICCI et à l’ex-FECCI" (ces dernières faisant parti de ce que le BIPR appelle "notre tendance").
3. Le fait que le CCI connaisse des scissions serait le résultat de ses faiblesses théoriques, d’où son "incapacité donc à comprendre et à expliquer la dynamique du capitalisme et à élaborer les orientations politiques nécessaires qui en découlent". De ce fait (et vu que le BIPR nous met dans le même sac que les groupes bordiguistes), le BIPR se trouve aujourd’hui seul survivant valable et valide de la Gauche Italienne.
4. En conséquence de tout cela, il ne resterait plus que le BIPR capable de "prendre les initiatives adéquates" et de "dépasser le vieux cadre politique, désormais bloqué , et à rénover la tradition révolutionnaire et internationaliste dans un nouveau processus d'enracinement dans la classe".
Comment ne pas faire du "travail sérieux"
Avant de répondre sur les questions de fond, il faut déblayer le terrain concernant ces "fractions" qui – selon le BIPR – devraient être les premiers objets de notre sollicitude. En ce qui concerne l’ancienne "Fraction Externe" du CCI nous pensons qu’il serait plus "sérieux" de la part du BIPR de prêter attention aux positions de ce groupe (aujourd’hui connu sous le nom de Perspective Internationaliste) : il s’apercevrait ainsi que, ayant complètement abandonné le fondement même des positions du CCI, l’analyse de la décadence du capitalisme, PI ne se revendique plus de notre plate-forme et ne s'appelle plus "fraction" du CCI. Mais là n’est pas l’essentiel, que ce groupe fasse ou non politiquement partie de notre "tendance" selon le BIPR, si le CCI ne fait pas appel à lui, c'est pour de tout autres raisons que ses analyses politiques. Et le BIPR le sait très bien. Ce groupe s'est fondé sur la base d'une démarche parasitaire, de dénigrement et de calomnie du CCI ; et c'est sur la base de ce jugement politique[4] que le CCI ne le considère pas comme faisant partie de la Gauche communiste. Quant au groupement qui se prétend aujourd’hui "fraction interne" du CCI , c'est encore bien pire. De plus le BIPR, s'il a lu le bulletin n° 14 de la FICCI et notre presse territoriale (voir notre article "les méthodes policères de la FICCI dans RI n° 330) n'est pas sans savoir que les organisations révolutionnaires ne peuvent en aucune façon faire le moindre travail en commun avec des éléments qui se comportent comme des mouchards au bénéfice des forces de répression de l'Etat bourgeois. A moins que le BIPR ne trouve rien à redire à ce type de comportements !
Quelles sont les conditions pour un travail en commun?
Venons-en maintenant à un type d’argumentation méritant de plus amples remarques de notre part : nous serions trop éloignés au niveau des positions politiques pour pouvoir agir ensemble. Nous avons déjà souligné que cette attitude est à mille lieues de celle de Lénine et des bolcheviks à la conférence de Zimmerwald, où ces derniers ont signé un Manifeste commun avec les autres forces internationalistes, malgré le fait que les divisions entre les participants à Zimmerwald étaient assurément bien plus profondes que les divisions entre les groupes internationalistes d’aujourd’hui. Pour donner ne serait-ce qu’un exemple, les socialistes-révolutionnaires qui n’étaient même pas des marxistes et qui ont fini pour la plupart par adopter une position contre-révolutionnaire en 1917, ont participé à la conférence de Zimmerwald.
On voit mal d’ailleurs pourquoi notre analyse du rapport de forces entre les classes au niveau global serait un critère discriminatoire interdisant une intervention commune face à la guerre et, dans ce cadre, un débat contradictoire, sur cette question et d’autres. Nous avons déjà largement et fréquemment expliqué les bases de notre position sur le cours historique dans les pages de cette Revue. La méthode qui sous-tend notre analyse est la même qu’à l’époque des Conférences internationales de la Gauche communiste, initiées par Battaglia Comunista et soutenues par le CCI à la fin des années 1970. Notre position n’est donc pas une découverte pour le BIPR. A propos de ces conférences, BC faisait elle-même explicitement référence à Zimmerwald et à Kienthal : "on ne parvient ni à une politique de classe, ni à la création du parti mondial de la révolution, ni d'autant moins à une stratégie révolutionnaire si l'on ne se décide pas à faire fonctionner, dès à présent, un centre international de liaison et d'information qui soit une anticipation et une synthèse de ce que sera une future Internationale, comme Zimmerwald et encore plus Kienthal, furent l'ébauche de la 3e Internationale" ("Lettre d’appel" de BC à la Première Conférence, 1976).
Qu’est-ce qui a changé depuis cette époque justifiant une moins grande unité entre internationalistes et le refus de notre proposition qui n’a pourtant pas l’ambition de vouloir mettre sur pied un "centre de liaison".
En fait le BIPR devrait prendre davantage de recul sur la situation actuelle et relativiser l’importance qu’il accorde à ce qu’il estime être notre "analyse erroné du rapport de force entre les classes". En effet, ’il y a au moins une chose qui a changé à plusieurs reprises depuis l'époque des conférences, c’est bien l’analyse du BIPR du rapport de forces entre les classes et des facteurs qui ont empêché l’éclatement d’une nouvelle guerre mondiale avant 1989. Nous avons lu vraiment toutes sortes d'explications de sa part à ce sujet : à un moment, la guerre n'aurait pas éclaté parce que les blocs impérialistes étaient insuffisamment consolidés – alors que jamais dans l’histoire on n’a vu deux blocs autant coulés dans le béton que le bloc américain et le bloc russe. À un autre moment, c’était la terreur inspirée à la bourgeoisie par l’idée d'une guerre nucléaire qui aurait retenu celle-ci. Et enfin, l’ultime trouvaille que le BIPR a maintenue jusqu’à l’effondrement du bloc russe sous les coups de boutoir de la crise économique, c’était l’idée que la troisième guerre mondiale n’aurait pas éclaté à cause... du niveau insuffisamment profond de la crise économique !
Rappelons que deux mois avant la chute du mur de Berlin, le CCI a affirmé que la nouvelle période qui s'ouvrait serait marquée par la désagrégation des blocs et, que deux mois après, il écrivait que cette situation allait aboutir à un chaos grandissant, nourri surtout par l'opposition des puissances impérialistes de second et de troisième ordre aux tentatives des Etats-Unis de maintenir et de renforcer leur rôle de gendarme du monde (voir à ce sujet les numéros 60 et 61 de notre Revue). Le BIPR par contre, après avoir évoqué pendant un certain temps l'hypothèse d'une nouvelle expansion de l'économie mondiale grâce à la "reconstruction" des pays de l'Est,[5] s'est mis à défendre la notion d'un nouveau bloc basé sur l'Union européenne et qui rivaliserait avec les Etats-Unis. Aujourd'hui il est évident que la "reconstruction" des pays de l'ancien bloc de l'Est a fait long feu, alors qu'avec l'éclatement de la nouvelle guerre en Irak, l'UE n'a jamais été aussi divisée, aussi incapable d'agir de façon unie au niveau d'une politique étrangère commune, aussi loin de constituer ne serait-ce qu'un semblant de bloc impérialiste. Cette divergence entre le plan économique (l'élargissement et l'unification de l'Europe au niveau économique : mise en place de l'Euro, arrivée de nouveaux pays membres) et le plan impérialiste (l'impuissance totale et évidente de l'Europe dans ce domaine) ne fait que souligner cet aspect fondamental de la dynamique du capitalisme dans sa période de décadence que le BIPR refuse toujours de reconnaître : les conflits impérialistes ne sont pas le fruit direct de la concurrence économique, mais la conséquence d'un blocage économique à un niveau beaucoup plus global de la société capitaliste. Quels que soient les désaccords entre nos organisations, on est en droit de se demander sur quoi le BIPR fonde son jugement que lui-même, contrairement au CCI, serait capable de rendre compte de "la dynamique du capitalisme".
Les choses ne sont pas si claires non plus, quant à l’analyse de la lutte de classe. Le BIPR reproche au CCI de surestimer la force du prolétariat et son analyse du cours historique. Pourtant, c'est bien le BIPR, qui a une tendance regrettable à se laisser emporter par l’enthousiasme du moment à chaque fois qu’il perçoit quelque chose qui ressemblerait à un mouvement "anti-capitaliste". Sans entrer dans les détails, rappelons seulement le salut de Battaglia Comunista aux mouvements en Roumanie dans un article intitulé "Ceaucescu est mort, mais le capitalisme vit encore": "La Roumanie est le premier pays dans les régions industrialisées dans lequel la crise économique mondiale a donné naissance à une réelle et authentique insurrection populaire dont le résultat a été le renversement du gouvernement en place (…) en Roumanie, toutes les conditions objectives et presque toutes les conditions subjectives étaient réunies pour transformer l'insurrection en une réelle et authentique révolution sociale". Lors des évènements en Argentine en 2002, le BIPR est toujours en train de prendre les révoltes interclassistes contre des gouvernements corrompus pour des insurrections classistes et prolétariennes : "[Le prolétariat] est descendu spontanément dans la rue, entraînant derrière lui la jeunesse, les étudiants, et des parties importantes de la petite bourgeoisie prolétarisée et paupérisée comme lui. Tous ensembles, ils ont exercé leur rage contre les sanctuaires du capitalisme, les banques, les bureaux et surtout les supermarchés et autres magasins qui ont été pris d’assaut comme les fours à pain au Moyen-Age (…) la révolte n’a pas cessé, s’étendant à tout le pays, assumant des caractéristiques toujours plus classistes. Jusqu’au siège du Gouvernement, monument symbolique de l’exploitation et de la rapine financière, qui a été pris d’assaut".[6]
En revanche, le CCI, malgré sa "surestimation idéaliste" des forces du prolétariat, n'a cessé de mettre en garde contre les dangers que la situation historique globale fait courir à la capacité du prolétariat à mettre en oeuvre sa perspective, en particulier depuis 1989, et contre les emballements immédiatistes et sans lendemain pour tout ce qui bouge. Alors que le BIPR s’enthousiasmait pour les luttes en Roumanie, nous écrivions: "Face à de telles attaques, le prolétariat [de l’Europe de l’Est] va se battre, va tenter de résister (...) Mais la question est : dans quel contexte, dans quelles conditions vont se dérouler ces grèves? La réponse ne doit souffrir d’aucune ambiguïté: une extrême confusion due à la faiblesse et l’inexpérience politique de la classe ouvrière à l’Est, inexpérience rendant particulièrement vulnérable la classe ouvrière à toutes les mystifications démocratiques, syndicales et au poison nationaliste (...) On ne peut pas exclure la possibilité, pour des fractions importantes de la classe ouvrière, de se faire embrigader et massacrer pour des intérêts qui lui sont totalement opposés, dans des luttes entre cliques nationalistes ou entre cliques ‘démocratiques’ et staliniennes" (on ne peut s’empêcher de penser à Grozny, à la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan...). Quant à la situation en Occident, nous écrivions: "Dans un premier temps, l’ouverture du ‘rideau de fer’ qui séparait en deux le prolétariat mondial ne permettra pas aux ouvriers d’Occident de faire bénéficier leurs frères de classe de leur expérience (...) au contraire, ce sont les illusions démocratiques particulièrement fortes parmi les ouvriers de l’Est (...) qui vont venir se déverser à l’Ouest...".[7] On ne peut guère dire que ces perspectives ont été démenties depuis.
Notre but ici n’est pas d'entrer dans le débat sur cette question – ce qui exigerait un développement bien plus important de notre part[8] – encore moins de prétendre que le BIPR se trompe systématiquement et que le CCI aurait un monopole dans la capacité d'analyse de la situation : nous voulons seulement montrer que la caricature que nous présente le BIPR d’un CCI indécrottablement "idéaliste" à cause de ses analyses erronées parce que non basées sur le matérialisme strictement économique affectionné par le BIPR, et d’un BIPR seul capable de "comprendre et expliquer la dynamique du capitalisme" ne correspond pas vraiment à la réalité. Les camarades du BIPR pensent que le CCI est idéaliste. Soit. Pour notre part nous pensons que le BIPR est trop souvent empêtré dans un matérialisme vulgaire des plus plats. Mais par rapport à ce qui unit les internationalistes face à la guerre impérialiste, par rapport à la responsabilité qu'ils pourraient prendre et à l'impact qu'une intervention en commun pourrait avoir, c'est franchement secondaire, et n'empêcherait en aucune façon de débattre, approfondir et clarifier les divergences théoriques qui les séparent, au contraire. Nous sommes convaincus que faire "la synthèse de toutes les batailles passées" sera un travail indispensable pour la victoire du prolétariat qui permettra que soit tranchée, et pas seulement en théorie, la validité des thèses de ses organisations politiques. Nous sommes tout aussi convaincus que pour le faire, il est nécessaire de délimiter le camp internationaliste et de permettre la confrontation théorique au sein de ce camp. Le Prolétaire refuse cette confrontation pour des raisons principielles, quoique secondaires aujourd’hui. Le BIPR la refuse pour des raisons conjoncturelles et d’analyse. Est-ce "sérieux" ?
Les scissions sont-elles un critère discriminatoire?
La troisième raison que donne le BIPR pour refuser toute collaboration avec nous, c'est le fait que nous avons connu des scissions: "deux des trois tendances présentes dans la Gauche communiste se sont morcelées [et] ne réussissent qu'à se fragmenter encore plus". Le BIPR ne renvoie pas une vision objective de ce qu'il appelle le morcellement de la "tendance CCI", non seulement concernant la démarche responsable politique et militante à laquelle tournent le dos les groupements parasitaires qui gravitent dans l'orbite du CCI, mais également concernant l'importance qu'ils ne représentent pas au niveau d'une présence politique organisée à l'échelle internationale. Par contre, ce qui est une réalité c'est le morcellement entre les organisations qui peuvent légitimement se revendiquer de l'héritage de la gauche italienne. Et concernant l'attitude nécessaire à adopter vis-à-vis de cette situation, Battaglia Comunista a effectué un tournant à 180° par rapport à l'appel que cette organisation avait elle-même lancé avant la première Conférence des groupes de la Gauche communiste: "La conférence devra indiquer aussi comment et quand ouvrir un débat sur des problèmes (…) qui divisent actuellement la Gauche communiste internationale, ceci si nous voulons qu'elle se conclue positivement et ne représente qu'un premier pas vers des objectifs plus vastes et vers la formation d'un front international des groupes de la Gauche communiste qui soit le plus homogène possible, si nous voulons enfin sortir de la tour de Babel idéologique et politique et d'un ultérieur démembrement des groupes existants".[9] A cette époque aussi, Battaglia pouvait considérer que "la gravité de la situation générale (…) impose des prises de positions précises, responsables, et surtout en accord avec une vision unitaire des différents courants au sein desquels se manifeste internationalement la Gauche communiste". Le virage à 180° s'est déjà produit lors des Conférences mêmes : Battaglia a refusé de prendre position, même sur les divergences existant entre nos organisations.[10] Le BIPR refuse de nouveau aujourd'hui. Et pourtant la situation est loin d'être moins grave.
Par ailleurs, le BIPR doit expliquer en quoi le fait de connaître des scissions représenterait une disqualification pour un travail commun entre groupes de la Gauche communiste. Pour aider à remettre les pendules à l'heure, mais sans non plus vouloir faire de comparaisons abusives, on peut faire remarquer qu'à l'époque de la 2e Internationale, parmi tous les partis membres, il y en avait un, en particulier, qui était connu pour ses "luttes internes", ses "conflits d'idées" souvent opaques pour les militants extérieurs, ses scissions, pour une véhémence extrême dans les débats de la part de certaines de ses fractions, et pour des débats menés en son sein autour des statuts. C'était une opinion couramment répandue que, "les russes étaient incorrigibles", et que Lénine, par trop "autoritaire" et disciplinaire" était le premier responsable du "morcellement" du POSDR en 1903. Cela se passait autrement dans le parti allemand qui apparemment avançait d'un pas sûr de succès en succès grâce à la sagesse de ses dirigeants dont le premier n'était autre que le "pape du marxisme", Karl Kautsky. On sait ce qu'il adviendra des uns et des autres…
Quelles initiatives exigées par la situation?
Le BIPR pense qu'il est la seule organisation de la Gauche communiste capable de "prendre les initiatives" et de "dépasser le vieux cadre politique, bloqué désormais".
Nous ne pouvons développer ici en profondeur le désaccord que nous avons à ce sujet avec le BIPR. En tout cas, alors que c'est BC qui a pris la responsabilité d'exclure le CCI des Conférences internationales, puis d'y mettre un terme, alors que c'est le BIPR qui refuse maintenant systématiquement tout effort commun du milieu prolétarien internationaliste, il nous semble particulièrement culotté de venir affirmer aujourd'hui que "le vieux cadre est bloqué".
Pour notre part, malgré la disparition du cadre formel et organisé internationalement des Conférences, notre attitude est toujours restée la même :
- Rechercher, sur la base de positions internationalistes, le travail commun entre les groupes de la Gauche communiste (appel à l'action commune lors des guerres du Golfe en 1991, Kosovo en 1999, réunion publique commune avec la CWO à l'occasion de l'anniversaire d'Octobre en 1997, etc) ;
- Défense du milieu prolétarien (à la mesure de nos moyens très modestes) contre les attaques extérieures et contre l'infiltration de l'idéologie bourgeoise (citons seulement notre défense de la brochure du PCI Auschwitz ou le grand alibi contre les attaques de la presse bourgeoise, notre dénonciation des nationalistes arabes de feu El Oumami qui ont fait éclater le PCI et sont partis avec la caisse, la publicité que nous avons donnée à l'exclusion de nos rangs d'éléments que nous jugeons dangereux pour le mouvement ouvrier, notre rejet des tentatives du LAWV[11] de se faire une respectabilité en galvaudant des éléments de notre plateforme).
Depuis 1980 l'histoire du BIPR est par contre semée de toute une série de tentatives de trouver "un nouveau processus d'enracinement dans la classe". Des tentatives, dans leur écrasante majorité, soldées par un l'échec (liste non-exhaustive) :
- Les forces "sérieusement sélectionnées" par le BIPR et invitées à la 4e "Conférence" de la Gauche communiste se sont limitées dans les faits aux crypto staliniens iraniens de l'UCM ;
- Pendant les années 1980, le BIPR a découvert une nouvelle recette "d'enracinement": les "groupes communistes d'usine" qui sont toujours restés à l'état… de fantasmes ;
- Le BIPR s'est enthousiasmé pour les possibilités grandioses de formation de partis de masses dans les pays de la périphérie du capitalisme ; cela n'a rien donné en dehors de l'éphémère et peu "enraciné" Lal Pataka indien ;
- Avec la chute du mur de Berlin, le BIPR est allé à la pêche dans les anciens partis staliniens des pays de l'Est. Cela n'a rien donné non plus.[12]
Que le BIPR ne s'offusque surtout pas du rappel par nous de cette liste d'illusions déçues. Elle ne nous fait aucunement plaisir, bien au contraire. Mais nous pensons que l'extrême faiblesse des forces communistes dans le monde aujourd'hui constitue une raison supplémentaire pour se serrer les coudes dans l'action et dans la confrontation fraternelle de nos divergences, plutôt que de s'ériger en seuls héritiers de la Gauche communiste.
Nous répondrons présents
Encore une fois, nous sommes obligés de constater la lamentable incapacité des groupes de la Gauche communiste de créer ensemble le pôle de référence internationaliste dont le prolétariat et ses éléments avancés ou en recherche ont un besoin urgent alors que la planète s'enfonce de plus en plus dans le chaos guerrier d'un capitalisme pourrissant.
Ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner nos convictions, et le jour où les autres organisations de la Gauche communiste auront compris la nécessité de l'action commune nous répondrons : présents!
Jens, 7/04/03
1 Voir à ce sujet nos articles "A propos de l'appel lancé par le CCI sur la guerre en Serbie ; "L'offensive guerrière de la bourgeoisie exige une réponse unie des révolutionnaires" dans la Revue Internationale n°98 et "La méthode marxiste et l'appel du CCI sur la guerre en ex-Yougoslavie" Revue Internationale n°99".
2 Nous n'entrons pas ici dans la discussion de la vision bordiguiste du parti "unique" ; si la tendance à l'homogénéisation du prolétariat devra, comme l'histoire l'a montré, amener à la création d'un seul parti, le "décréter" comme un principe intangible, préalable à toute activité entre courants internationalistes comme le font les bordiguistes, c'est tourner le dos à l'histoire et se gargariser de mots.
3 Nous ne revenons pas ici sur la question de nos prétendues "méthodes administratives" que le PCI fustige dans le même article, de façon tout à fait irresponsable d’ailleurs en prenant pour argent comptant la parole de nos détracteurs. La question est la suivante : peut-il exister, oui ou non, des mœurs inacceptables au sein des organisations communistes qui ainsi peuvent être amenées à exclure des militants qui enfreignent gravement les règles de fonctionnement. Les camarades du PCI devraient se réapproprier la méthode de nos prédécesseurs à propos de ce genre de question.
4 Voir les "Thèses sur le parasitisme", dans la Revue internationale n°94.
5 En décembre 1989, Battaglia Comunista publie un article "Effondrement des illusions sur le socialisme réel" où on peut lire notamment: "L'URSS doit s'ouvrir aux technologies occidentales et le COMECON doit faire de même, non – comme le pensent certains [désigne-t-on le CCI?] – dans un processus de désintégration du bloc de l'Est et de désengagement total de l'URSS des pays de l'Europe, mais pour faciliter, en revitalisant les économies du COMECON, la reprise de l'économie soviétique".
6 Article "Ou le parti révolutionnaire et le socialisme, ou la misère généralisée et la guerre !" publié sur www.ibrp.org [54]
7 Voir la Revue Internationale n°60, 1er trimestre 1990.
8 Voir, entre autres, nos articles sur "Le cours historique", Revue internationale n°18, "Le concept de cours historique dans le mouvement révolutionnaire", Revue internationale n°107.
9 Juin 1976, c’est nous qui soulignons. Cette détermination initiale de BC n'a duré que peu de temps pendant les Conférences, et nous avons déjà largement dénoncé son incohérence dans la Revue internationale n°76 entre autres. Les citations sont de la lettre d’appel de Battaglia Comunista à la première Conférence, laquelle est publiée dans la brochure des textes et procès-verbal de celle-ci.
10 Pendant la 2e Conférence, Battaglia Comunista a systématiquement refusé la moindre prise de position commune: "Nous sommes opposés, par principe, à des déclarations communes, car il n'y a pas d'accord politique" (BC, intervention à la 2e Conférence).
11 Los Angeles Workers’ Voice, qui représentait le BIPR jusqu’à récemment aux Etats-Unis.
12 Voir la Revue Internationale n°76 pour une analyse plus détaillée.
Géographique:
- Irak [51]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [52]
Courants politiques:
- TCI / BIPR [55]
- Bordiguisme [56]
Le combat historique des révolutionnaires contre les illusions pacifistes
- 2819 reads
Nous republions ci-aprés un article écrit par Léon Trotsky au milieu de l'année 1917, quelques semaines après son retour des Etats-Unis motivé par le soulèvement révolutionnaire de février en Russie. Ce dernier avait entrainé le remplacement du Tsra par un gouvernement provisoire "démocratique bourgeois". Il existait depuis lors en Russie une situation de double pouvoir, l'un bourgeois et l'autre prolétarien : d'un coté le gouvernemcnt provisoire et de l'autrd la classe ouvriére organisée en conseils ouvriers (soviets). Le gouvernement provisoire, ainsi que les partis alors majoritaires dans les soviets, les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires (SR), s'engagent à continuer la guerre contre la volonté du prolétariat, à poursuivrc le programme impérialiste du capital russe lié par des traités avec les autres puissances de 1'Entente (France et Grande-Bretagne) contre l’Allemagne-Autriche ([1] [57]).
La raison à la republication de ce texte ne tient pas seulement à son intéret historique,mais surtout au fait qu'il est encore tout à fait d'actualité malgré des diffiérences entre la situation présente et celle 1917. En effet, bien que nous ne soyons confrontés actuellement ni à la guerre mondiale ni à une situation révolutionnaire, les questions centrales traitées par l'article "Le pacifisme supplétif de l’impérialisme" sont fondamentalement les mêmes qui se posent ajourd'hui au prolétariat dans tous les pays, quoi qu'en disent les banderolles pacifistes ou les justifications des "va-t’en guerre" dans les différents pays.
Trotsky se situe dès le début de la Première guerre mundiale au côté des internationalistes qui dénoncent tous les camps belligérants et les sociaux-patriotes qui mobilisent le prolétariat pour le carnage. Dés l'automne 1915, avec sa contribution "La guerre et l’Internationale", il est parmi les premiers à attaquer les traîtres de la Sociale-Démocratie qui défendent l' impérialisme de leur Etat national au nom du "progrès" ou de la "défense natianale". Mais les révolutionnaires du passé ne dénonçaient pas seulement les belligérants et les sociaux-chauvins comme Plekhanov et Scheidemann, ils dénonçaient aussi les neutres et les pacifistes, surtout les sociaux-pacifistes comme Turati et Kautsky. Lénine écrivait en janvier 1917 qu’il y a une unité de principe entre les deux catégories et que tous les deux - sociaux-chauvins et sociaux-pacifistes - sont les serviteurs de l'impérialisme : « Les uns le servent en présentant la guerre impérialiste comme ‘la défense de la patrie’, les autres défendent le même impérialiste en le déguisant par des phrases sur la ‘paix démocratique’, la paix impérialiste qui s’annonce aujourd’hui. La bourgeoisie impérialiste a besoin de larbins de l’une et de l’autre sorte, de l’une et de l’autre nuance : elle a besoin des Plékhanov pour encourager les peuples à se massacrer en criant ‘A bas les conquérants’ ; elle a besoin des Kautsky pour consoler te calmer les masses irritées par les hymnes et dithyrambes en l’honneur de la paix ». Les internationalistes ont toujours partagé le rejet de tous ccs slogans pacifistes qu'on entend maintenant.
Actualité des questions
Le pacifisme n'est rien de nouveau. Ses caractéristiques sont toujours et partout les mêmes : ne pas mettre en cause l'ordre social qui produit nécessairement les guerres ; défendre la logique dominante bourgeoise, particulièrement la démocratie ; propager « la doctrine de l’harmonie sociale entre des intérets de classe différents » (comme le dit Trotsky) et son pendant au niveau des rapports entre Etats nationaux : "l’attenuation graduelle et la régulation des conflits nationaux". Son but n'est pas d'empêcher mais de préparer et d'accompagner les guerres impérialiste,.
Le poids énorme de la propagande pacifiste actuelle se mesure à l'ampleur des manifestations "anti-gucrre" qui ont été organisées par la bourgeoisic : pour certaines d'entre elles, jamais la même "cause" n'avait mobilisé autant de manifestants le même jour à l'échelle planétaire. Comme nous l'avons déjà montré dans les articles de la presse territoriale ( World Revolution, Révolution Internationale, Weltrerévolutionld, etc.) une telle propagande a pour fonction d'empêcher la remise en cause du capitalisme, de comprendre que la guerre est l'expression des rivalités interimpérialistes entre tous les Etats, engendrées par la concurrence capitaliste dans la défense de leurs intérêts nationaux respectifs.
C’est carrément une véritable "union sacrée" derrière la bourgeoisie nationale qui est mise en avant par certains Etats, en Allemagne et en France notamment, où la propagande est nettement marquée par une tonalité anti-américaine, encouragée et soutenue par la quasi-totalité des fractions politiques de la bourgeoisie nationale. Il s'agit de nourrir dans les populations un sentiment anti-américain en désignant les Etats-Unis conune les seuls "fauteurs de guerre", l'adversaire impérialiste "numéro1" par exellence, afin de dévoyer l'hostilité envers la guerre sur un terrain bourgeois et même patriotique. A l'opposé de cela, le mot d'ordre de Karl Lieblnecht et des internationalistes pendant la Première guerre mondiale était : "L'ennemi principal se trouve dans notre propre pays !" ([2] [58])
Aujourd'hui, comme dans le passé, le pacifisme est le meilleur complice du boutrrage de crâne belliciste. Cette idéologie bourgeoise est un véritable poison pour la classe ouvrière. Au-delà de la crapulerie de tous ceux qui colportent une telle mystification pour masquer leur idéologie nationaliste, le pacifisme vise un objectif bien particulier : récupérer la crainte et l'aversion des ouvriers devant la menace de guerre pour empoisonner leur conscience et les amener à soutenir un camp bourgeois contre un autre.
C'est pour cela que, à chaque fois que la bourgeoisie a eu besoin de faire accepter aux prolétaires sa logique meurtrière, elle a offert une place de choix au pacifisme au sein d'un vaste partage des tâches entre les différentes fractions impérialistes du capital mondial.
Ce qui définit le pacifisme, ce n'est pas la revendication de la paix. Tout le monde veut la paix. Les va-t-en guerre eux-mêmes ne cessent de clamer qu'ils ne veulent la guerre que pour mieux rétablir la paix. Ce qui distingue le pacitisme, c'est de prétendre qu'on peut lutter pour la paix, en soi, sans toucher aux fondements du monde capitaliste. Les prolétaires qui, par leur lutte révolutionnaire en Russie et en Allemagne, mirent fin à la Première guerre mondiale, voulaient eux aussi la fin de la misère. Mais s'ils ont pu faire aboutir leur combat, c'est parce qu'ils ont su le mener non pas AVEC les "pacifistes" mais malgré et CONTRE eux. A partir du moment où il devint clair que seule la lutte révolutionnaire permettait d'arrêter la boucherie impérialiste, les prolétaires de Russie et d'Allemagne se sont trouvés confrontés non seulement aux "faucons" de la bourgeoisie, mais aussi et surtout à tous ces pacifistes de la première heure (mencheviks, socialistes révolutionnaires, sociaux-patriotes) qui, armes à la main, ont défendu ce dont ils ne pouvaient plus se passer et caqui leur était le plus cher, l’Etat bourgeois. Pour cela, ils devaient rendre inoffensive pour le capital la révolte des exploités contre la guerre.
Entre le pacifisme et les révolutionnaires, il y a une frontière de classe. Les révolutionnaires, les internationalistes comme Lénine, Luxembourg et Trotsky luttaient pour l'action des masses prolétaires sur leur terrain de classe, pour la défense de leurs conditiuns de vie : "Ou bien se sont les gouvernements bourgeois qui font la paix, comme ils font la guerre, , ensuite, comme après chaque guerre l’impérialisme restera la dominante et s’ensuivront fatalement un nouveau réarmement, des guerres, la ruine, la réaction et la barbarie. Ou bien vous rassemblez vos forces pour un soulevement révolutionnaire, pour combattre afin d’obtenir le pouvoir politique et dicter VOTRE paix à l’extérieur et à l’intérieur. " (R. Luxembourg, Spartacusbriefe n° 4, avril 1917).
Malgré la différence de situation, les questions principales qui se posent aujourd'hui avce l'omniprésence de la guerre et l'immense campagne pacifiste sont les mêmes que celles soulevées dans l'article d Trosky "le pacifisme, supplétif de l’impérialisme".
Le lien entre pacifisme et démocratie
Trotsky montre que le pacifisime et la démocratie ont en commun la même lignée historique. C’est la fiction de l'égalité et de la liberté de chaque individu dans la société capitaliste qui est, selon laconception bourgeoise, la condition nécessaire pour le contrat entre le travailleur et son exploiteur. Et selon cette même idéologie, les rapports entre les nations devraient aussi obéir aux mêmes lois de l'égalité et de la "raison". « Mais, sur ce point, elle s’est heurtée à la guerre, c'est-à-dire une façon de régler les problèmes qui représente une négation totale de la ‘raison’. (…) Le réalisme capitaliste joue avec l’iéde d’une paix universelle fondée sur l’harmonie de la raison, et il le fait d’une façon peut-être encore plus cynique qu’avec les idées de liberté, d’égalité, de fraternité. Le capitalisme a développé la technique sur une base rationnelle mais il a échoué à rationnaliser les conditions économiques. »
Trotsky dénonce non seulement les pacifistes officiels à la Wilson et "d'opposition" à la Bryan ([3] [59]), mais aussi la petite bourgeoisie qui "à toujours été le meilleur gardien de l'idéologie democratique, de toutes ses traditions et ses illusions".
Ce qu'il ne pouvait pas prévoir cependant, c'est le poids énorme qu'allait prendre cette idéologie démocratique 80 ans plus tard, dans la phase ultime du capitalisme, celle de la décomposition. Par manque de perspective dans la société, l'idéologie démocratique qui correspond à la production généralisée de marchandises s'impose spontanément. "La démocratie bourgeoise avait absolument besoin de l’égalité juridique pour permettre à la libre concurrence de s’épanouir", disait Trotsky. La concurrence, le "chacun pour soi" sont portés à leurs limites les plus extrêmes dans le capitalisme en décomposition, avec l'atomisation, l'aliénation accentuée et la guerre de tous contre tous. Dans cette phase ultime du capitalisme, l'idéologie démocratique pénètre tous les rapports dans la société, et la démocratie devient la justitication et le prétexte pour tous et chacun : Chirac et Schroder s'opposent à l'intervention en Irak au nom de la démocratie ; Bush et Powell la décident pour soi-disant appapporter la démocratic aux peuples arabes. En d'autres termes, on peut appliquer la torture au nom de la démocratie, la proscrire au nom de la démocratie et torturer démocratiquement, c'està-dire seulement si c'est nécessaire au sens de l'article X de la loi Y qui a été adoptée "démocratiquement".
Et ce n'est pas par hasard si, aujourd'hui encore une fois, le pacifisme est le messager de la logique démocratique. Ce n'est pas par naïveté mais par cynisme que des organisations pacifistes opposent aujourd'hui à la guerre les "droits de l'homme" et "l'aide humanitaire" en escamotant le fait que toutes les guerres, depuis Reagan et surtout depuis l'effondrement du bloc de l'Est, ont été menées par les puissances occidentales au nom des droits de l'homme et sous la bannière "d'interventions humanitaires".
Les pacifistes et les démocrates appellent la "population" en général, les "citoyens" à se mobiliser contre la guerre, tandis que les révolutionnaires ont toujours montré que c'est seulement la lutte du prolétariat sur son propre terrain de classe , pour ses propres objectifs, qui peut mettre fin à la guerre. Avec le pacifisme, le prolétariat ne peut qu'être enchaîné à la défense d'un camp impérialiste contre un autre : il ne petit que perdre sa propre identité de classe en se laissant noyer dans la "population" en général, toutes classes confondues, au milieu d'un gigantesque mouvement "citoyen" dans lequel il lui est totalement impossible d'affirmer ses intérêts propres. Ceux d'une classe qui n'a pas de patrie, pas de frontières et pas d'intérêts nationaux à défendre. Les trotskistes d'aujourd'hui ont depuis longtemps trahi le programme de Lénine, Trotsky, Luxembourg ([4] [60]) et cela s'illustre encore ajourd'hui lorsqu'ils sont tout à fait partie prenante des mobilisations pacifistes où certains d'entre eux s'expriment de la sorte : "Développer le mouvement contre la guerre le plus large, le plus actif, le plus diversifié possible est un éléments nécessiare pour stopper une guerre, pour créer les conditions afin que le peuple d’Irak puisse choisir son avenir"(tract du 05/03/2003 du "Mouvement pour le Socialisme" succursale de la IVe Internationale). Répandrede telles illusions démocratiques et pacifistes, c'est être partie prenante de l'appareil idéologique et politique de son propre impérialisme.
La doctrine de l'harmonie sociale et de la régulation des conflits nationaux
Trotsky raille les illusions des pacifistes qui croient à la possibilité de l'atténuation des conflits entre les Etats impérialistes : "Si l'on croit possible une atténuation graduelle de la lutte des classes, alors on croira aussi à la regulation des conflits nationaux."
Bien que les conflits nationaux se soient multipliés depuis la Première Guerre mondiale, malgré tous les massacres du 20e siècle qui ont prouvé mille fois que le militarisme et la guerre sont devenus le mode de vie permanent du capitalisme décadent, les pacifistes sont toujours là à réclamer l'application du droit international et à exiger l'adoption d'une procédure fonnellede l'ONU.
Les trotskistes d'aujourd'hui font tout pour souiller la mémoire de Trotsky. La LCR en France non seulement prend une position farouchement anti-ainéricaine en parfaite harmonie avec la politique impérialiste de la bourgeoisie française, mais exige en plus "que la France use de son droit de veto à l'ONU contre le déclenchement d'une guerre" afin d'exprimer "notre solidarité aux démocrates d'Irak". Ainsi les trotskistes invoquent l'application des règles de l'ONU, dont la Société des Nations de Wilson était le prédécesseur - et tout cela au nom de la démocratie. On devrait leur demander s'ils ont jamais entendu parler d'un certain Trotsky.
Le pacifisme prépare les guerres
l'article "le pacifisme supplétif de l’impérialisme" montre également avec quelle subtilité les pacifistes mobilisent les masses pour le militarisme et la guerre à travers un raisonnement du type « Tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la guerre, signifie une exutoire à l’opposition des masses sous formes de manifestes inoffensifs. On assure aussi au gouvernement que, l’opposition pacifiste ne créera aucun obstacle à son action ».
Quand Trotsky parle du pacifisme de Wilson et de l'opposition tonitruante de Bryan à la guerre, on ne peut s'empceher de penser à Schröder, l'ancien soixante huitard, et à Fischcr, l'ex-gauchiste "radical", qui sont vraiment les meilleurs représentants dont l'impérialisme allemand pouvait se doter, parce que "si Schrdder peut déclarer la guerre, et Fischer lui-même le soutenir sur ce terrain, alors il s'agit sûrement d'une guerre juste et nécessaire".
Avec la republication de ce texte de Trotsky nous voulons aussi encourager nos lecteurs à se pencher sur l'histoire du mouvement ouvrier et la richesse des enseignements qu'on peu en tirer sur la guerre, mais aussi sur le pacifisme. Une arme essentielle de la classe ouvrière est sa conscience. Celle-ci doit se forger en s'appuyant sur l'histoire du prolétariat, une histoire qui, avec celle de la société de classe, dure déjà depuis trop longtemps. Il faut en finir avec le capitalisme avant qu'il n'en finisse avec l'humanité.
SM (mars 2003)
[1] [61] Pour d’avantage d’éléments sur la situation en Russie lors de l’été 17, lire notre article « 1917 : la révolution russe. Les journées de juillet » dans la Revue internationale n° 90.
[2] [62] Cette formulation est également employée par Lénine dans Le Socialisme ou la guerre, en 1915. Une telle formulation est tout à fait valable dans le contexte de la lutte contre l'opportunismc sous la forme du pacifisme et de la conciliation avec les fractions nationales de la bourgeoisie. Elle ne peut néanmoins pas être généralisée, ses limites tenant au fait que le prolétariat n'a à préférer aucune fraction de la bourgeoisie, pas plus dans les autres pays que dans le sien propre.
[3] [63] William Jennings Bryan, plusieurs fois candidat démocrate aux élections présidentielles aux Etats-Unis de 1913-15, ministre de l’extérieur sous Wilson et défenseur de la neutralité des Etats-Unis lors de la Première Guerre mondiale.
[4] [64] Les trotskistes en général ont trahi l'internationalisme déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale en apportant leur soutien à l'une des puissances impérialistes dans l'un des camps belligérants, l'Union Soviétique
Courants politiques:
- Gauche Communiste [47]
Questions théoriques:
- Guerre [1]
Léon Trotsky 1917 : Le pacifisme, supplétif de l'impérialisme
- 2947 reads
Alors que les hommes s'entretuent dans tous les pays, jamais le monde n'a compté autant de pacifistes. Chaque époque historique a non seulement ses techniques et ses formes politiques propres, mais aussi son hypocrisie spécifique. A une certaine période, les peuples s'exterminaient mutuellement au nom des enseignements du christianisme, de l'amour de l'humanité. Désormais, seuls les gouvernements les plus réactionnaires en appellent au Christ. Les nations progressistes se coupent mutuellement la gorge au nom du pacifisme. Wilson entraîne les États-Unis dans la guerre au nom de la Ligue des Nations et de la paix perpétuelle. Kerensky et Tseretelli plaident pour une nouvelle offensive en prétendant qu'elle rapprochera l'arrivée de la paix.
Aujourd'hui, la verve satirique et l'indignation d'un Juvénal ([1]) nous font cruellement défaut. De toute façon, même les armes satiriques les plus corrosives s'avèrent impuissantes et illusoires face à l'alliance triomphante de l'infamie et de la servilité - deux éléments qui se sont développés sans entraves avec cette guerre.
Le pacifisme possède le même lignage historique que la démocratie. La bourgeoisie a tenté d'accomplir une grande oeuvre historique en essayant de placer toutes les relations humaines sous l'autorité de la raison et de remplacer des traditions aveugles et stupides par les outils de la pensée critique. Les contraintes que les guildes faisaient peser sur la production, les privilèges qui paralysaient les institutions politiques, la monarchie absolue tout cela n'était que des vestiges des traditions du Moyen Age. La démocratie bourgeoise avait absolument besoin de l'égalité juridique pour permettre à la libre concurrence de s'épanouir, et du parlementarisme pour administrer les affaires publiques. Elle a cherché également à réguler les relations entre les nations de la même manière. Mais, sur ce point, elle s'est heurtée à la guerre, c'est-à-dire une façon de régler les problèmes qui représente une négation totale de la "raison". Alors, elle a commencé à dire aux poètes, aux philosophes, aux moralistes et aux hommes d'affaires qu'il serait bien plus productif pour eux d'arriver à la "paix perpétuelle". Et c'est cet argument logique qui se trouve à la base du pacifisme.
La tare originelle du pacifisme, cependant, est fondamentalement la même que celle de la démocratie bourgeoise. Sa critique n'aborde que la surface des phénomènes sociaux, elle n'ose pas tailler dans le vif et aller jusqu'aux relations économiques qui les sous-tendent. Le réalisme capitaliste joue avec l'idée d'une paix universelle fondée sur l'harmonie de la raison, et il le fait d'une façon peut-être encore plus cynique qu'avec les idées de liberté, d'égalité et fraternité. Le capitalisme a développé la technique sur une base rationnelle mais il a échoué à rationaliser les conditions économiques. Il a mis au point des armes d'extermination massive dont n'auraient jamais pu rêver les "barbares" de l'époque médiévale.
L'internationalisation rapide des relations économiques et la croissance constante du militarisme ont ôté tout fondement solide au pacifisme. Mais en même temps, ces mêmes forces lui ont procuré une nouvelle aura, qui contraste autant avec son ancienne apparence qu'un coucher de soleil flamboyant diffère d'une aube rosâtre.
Les dix années qui ont précédé la guerre mondiale sont généralement qualifiées de "paix armée", alors qu'il s'est agi en fait d'une période de guerre ininterrompue dans les territoires coloniaux.
La guerre a sévi dans des zones peuplées par des peuples faibles et arriérés; elle a abouti à la participation de l'Afrique, de la Polynésie et de l'Asie, et ouvert la voie à la guerre actuelle. Mais, comme aucune guerre n'a éclaté en Europe depuis 1871, quoiqu'il y ait eu des conflits limités mais aigus, les petits bourgeois se sont bercés d'une douce illusion : l'existence et le renforcement continuel d'une armée nationale garantissaient la paix et permettraient un jour l'adoption d'un nouveau droit international. Les gouvernements capitalistes et le grand capital ne se sont évidemment pas opposés à cette interprétation "pacifiste" du militarisme. Pendant ce temps-là, les préparatifs du conflit mondial battaient leur plein, et bientôt la catastrophe se produirait.
Théoriquement et politiquement, le pacifisme repose exactement sur la même base que la doctrine de l'harmonie sociale entre des intérêts de classe différents.
L'opposition entre États capitalistes nationaux a exactement la même base économique que la lutte des classes. Si l'on croit possible une atténuation graduelle de la lutte des classes, alors on croira aussi à l'atténuation graduelle et à la régulation des conflits nationaux.
La petite bourgeoisie a toujours été le meilleur gardien de l'idéologie démocratique, de toutes ses traditions et ses illusions. Durant la seconde moitié du XIX siècle, elle avait subi de profondes transformations internes, mais n'avait pas encore disparu de la scène au moment même où le développement de la technique capitaliste minait en permanence son rôle économique, le suffrage universel et la conscription obligatoire lui donnèrent, grâce à sa force numérique, l'illusion de jouer un rôle politique. Lorsqu'un petit patron réussissait à ne pas être écrasé par le grand capital, le système de crédit se chargeait de le soumettre. Il ne restait plus aux représentants du grand capital qu'à se subordonner la petite bourgeoisie sur le terrain politique, en se servant de ses théories et de ses préjugés et en leur donnant une valeur fictive. Telle est l'explication du phénomène que l'on a pu observer durant la décennie précédant la guerre : alors que le champ d'influence de l'impérialisme réactionnaire s'étendait et atteignait un niveau terrifiant, en même temps fleurissaient les illusions réformistes et pacifistes dans la démocratie bourgeoise. Le grand capital avait domestiqué la petite bourgeoisie pour servir ses fins impérialistes en s'appuyant sur les préjugés spécifiques de cette classe.
La France est l'exemple classique de ce double processus. Dans ce pays dominé par le capital financier, il existe une petite bourgeoisie nombreuse et généralement conservatrice. Grâce aux prêts à l'étranger, aux colonies, à l'alliance avec la Russie et l'Angleterre, la couche supérieure de la population a été impliquée dans tous les intérêts et les conflits du capitalisme mondial. En même temps, la petite bourgeoisie française demeurait provinciale jusqu'à la moelle. Le petit bourgeois éprouve une peur instinctive devant les affaires mondiales et, toute sa vie, il a eu horreur de la guerre, essentiellement parce qu'il n'a en général qu'un fils, à qui il laissera son affaire et ses meubles. Ce petit bourgeois envoie un radical bourgeois le représenter à l'Assemblée, parce que ce monsieur promet qu'il préservera la paix grâce, d'une part, à la Ligue des Nations et, de l'autre, aux cosaques russes qui trancheront la tête du Kaiser à sa place. Lorsque le député radical, issu de son petit milieu d'avocats de province, arrive à Paris, il est animé par une solide foi en la paix. Cependant, il n'a qu'une très vague idée de la localisation du Golfe persique, et ne sait pas si le chemin de fer de Bagdad est nécessaire ni à qui il pourrait être utile. C'est dans ce milieu de députés "pacifistes" que l'on pioche pour former les gouvernements radicaux. Et ceux-ci se trouvent immédiateruent empêtrés dans les ramifications de toutes les précédentes obligations diplomatiques et militaires souscrites en Russie, en Afrique, en Asie au nom des divers groupes d'intérêts financiers de la Bourse française. Le gouvernement et l'Assemblée n'ont jamais abandonné leur phraséologie pacifiste, mais en même temps, ils ont poursuivi une politique extérieure qui a finalement mené la France à la guerre.
Les pacifismes anglais et américain bien que les conditions sociales et l'idéologie de ces pays diffèrent considérablement de celles de la France (et malgré l'absence de toute idéologie en Amérique) -- remplissent essentiellement la même tâche : ils fournissent un exutoire à la peur des citoyens petits bourgeois face aux secousses mondiales, qui, aprés tout, ne peuvent que les priver des derniers vestiges de leur indépendance ; ils bercent et endorment la vigilance de la petite bourgeoisie grâce à des notions comme le désarmement, le droit international ou les tribunaux d'arbitrage. Puis, à un moment donné, les pacifistes incitent la petite bourgeoisie à se donner corps et âme à l'impérialisme capitaliste qui a déjà mobilisé tous les moyens nécessaires à cet effet : connaissances techniques, art, religion, pacifisme bourgeois et "socialisme" patriotique.
"Nous étions contre la guerre, nos députés, nos ministres étaient tous opposés à la guerre", se lamente le petit bourgeois français : "Il s'ensuit donc que nous avons donc été forcés de faire la guerre et que, pour réaliser notre idéal pacifiste, nous devons mener cette guerre jusqu'à la victoire". "Jusqu'au bout ! ([2])" s'écrie le représentant du pacifisme français, le baron d'Estournel de Constant pour consacrer solennellement la philosophie pacifiste.
Pour mener la guerre jusqu'à la victoire, la Bourse de Londres avait absolument besoin de la caution de pacifistes ayant la trempe du libéral Asquith ou du démagogue radical Lloyd George. "Si ces hommes conduisent la guerre, se sont dit les Anglais, alors nous devons avoir le droit pour nous."
Tout comme les gaz de combat, ou les emprunts de guerre qui ne cessent d'augmenter, le pacifisme a donc son rôle à jouer dans le déroulement du conflit mondial.
Aux Etats-Unis, le pacifisme de la petite bourgeoisie a montré son vrai rôle, celui de serviteur de l'impérialisme, de façon encore moins dissimulée. Là-bas. comme partout ailleurs, ce sont les banques et les trusts qui font la politique. Même avant 1914, grâce au développement extraordinaire de l'industrie et des exportations, les États-Unis avaient déjà commencé à s'engager de plus en plus sur l'arène mondiale pour défendre leurs intérêts et ceux de l'impérialisme. Mais la guerre européenne a accéléré cette évolution impérialiste jusqu'à ce qu'elle atteigne un rythme fébrile. Au moment où de nombreuses personnes vertueuses (y compris Kautsky) espéraient que les horreurs de la boucherie européenne inspireraient à la bourgeoisie américaine une sainte horreur du militarisme, l'influence réelle du conflit en Europe se faisait sentir non sur le plan psychologique mais sur le plan matériel et aboutissait au résultat exactement inverse. Les exportations des États-Unis, qui s'élevaient en 1913 à 2 466 millions de dollars, ont progressé en 1916 jusqu'au montant incroyable de 5 481 millions. Naturellement l'industrie des munitions s'est taillée la part du lion. Puis a surgi tout à coup la menace de l'interruption du commerce avec les pays de l'Entente, lorsqu'a commencé la guerre sous-marine à outrance. En 1915, l'Entente avait importé 35 milliards de biens américains, alors que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie n'avaient importéque 15 milliards. Des profits gigantesques étaient donc enjeu, mais aussi une grave crise de l'ensemble de l'industrie américaine qui repose sur l'industrie de guerre. C'est ces chiffres que nous devons avoir en tête si nous voulons comprendre la répartition des "sympathies" pour chaque camp en Amérique. Et les capitalistes en ont donc appelé à l' État : "Vous avez constitué l'industrie militaire sous le drapeau du pacifisme, c'est donc à vous de nous trouver de nouveaux marchés." Si l'État n'était pas en mesure de promettre la "libre circulation sur les mers" (autrement dit, la liberté d'extraire du capital à partir du sang humain), il devait dégager de nouveaux marchés pour les industries de guerre menacées - en Amérique même. Et les besoins de la boucherie européenne ont donc abouti à une militarisation soudaine et catastrophique des États-Unis.
Il était prévisible que ces mesures allaient susciter l'opposition d'une grande partie de la population. Calmer ce mécontentement aux contours indéfinis et le transformer en coopération patriotique constituait un défi capital en matière de politique intérieure. Et par une étrange ironie de l'Histoire, le pacifisme officiel de Wilson, tout autant que le pacifisme "d'opposition" de Bryan, a fourni les armes les plus aptes à réaliser ce dessein : contrôler les masses par le militarisme.
Bryan a exprimé haut et fort l'aversion naturelle des paysans et de tous les petits bourgeois envers l'impérialisme, le militarisme et l'augmentation des impôts. Mais tandis qu'il multipliait pétitions et délégations en direction de ses collègues pacifistes qui occupaient les plus hautes charges gouvernementales, Bryan faisait tout pour rompre avec la tendance révolutionnaire de ce mouvement.
"Si on en vient à la guerre", télégraphia par exemple Bryan à un meeting anti-guerre qui avait lieu à Chicago en février, "alors, bien sûr, nous soutiendrons le gouvernement, mais jusqu’à ce moment, notre devoir le plus sacré est de faire ce qui est en notre pouvoir pour éviter les horreurs de la guerre". Ces quelques mots contiennent tout le programme du pacifisme petit bourgeois. "Tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter la guerre" signifie offrir un exutoire à l'opposition des masses sous forme de manifestes inoffensifs. On assure ainsi au gouvernement que, si la guerre a lieu, l'opposition pacifiste ne créera aucun obstacle à son action.
En vérité, c'est tout ce dont avait besoin le pacifisme officiel : un Wilson qui avait déjà donné aux capitalistes qui font la guerre nombre de preuves de sa "disposition à combattre". Et Mr Bryan lui-même trouva qu'il suffisait d’avoir fait ces déclarations, après quoi il fut satisfait de mettre de côté son opposition tonitruante à la guerre dans un seul but : déclarer la guerre. Comme Wilson, Bryan se précipita au secours du gouvernement. Et les grandes masses, pas seulement la petite bourgeoisie, se dirent : "Si notre gouvernement, dirigé par un pacifiste de réputation mondiale comme Wilson peut déclarer la guerre, et que Bryan lui-même peut le soutenir sur la question de la guerre, alors il s'agit sûrement d'une guerre juste et nécessaire". Ceci explique pourquoi le pacifisme vertueux, à la mode quaker, soutenu par les démagogues qui dirigent gouvernement, était tenu en si haute estime par la Bourse et les dirigeants de l'industrie de guerre.
Notre propre pacifisme menchevik, socialiste-révolutionnaire, malgré les différences des conditions locales, a joué exactement le même rôle, à sa façon. La résolution sur la guierre, adoptée par la majorité du Congrés panrusse des Conseils d'ouvriers et de soldats, se fonde non seulement sur les mêmes prejugés pacifstes en ce qui concerne la guerre, mais aussi sur les caractéristiques de la guerre impérialiste. Le Congrès a affirmé que "la première et plus importante des tâches de la démocratie révolutionnaire" était d'en fïnir rapidement avec la guerre. Mais ces déclarations n'avaient qu'un but : tant que les efforts internationaux de la démocratie bourgeoise n'arrivent pas à en finir avec la guerre, la démocratie révolutionnaire russe exige avec force que l'armée russe soit préparée au combat, à la défensive comme à l'offensive.
La révision des anciens traités internationaux oblige le congrès panrusse à se soumettre au bon vouloir des diplomates de l'Entente, et ce n'est pas dans leur nature de liquider le caractère impérialiste de la guerre même s'ils le pouvaient. Les "efforts internationaux des démocraties" abandonnent le Congrés panrusse et ses dirigeants entre les mains des patriotes social-démocrates, qui sont pieds et poil ligs liés à leurs gouvernements impérialistes. Et cette même majorité du Congrès panrusse, après s'être engagée dans une voie sans issue ("la fin la plus rapide possible de la guerre"), a maintenant abouti, en ce qui concerne la politique pratique, à une conclusion précise : l'offensive. Un "pacifisme" qui se soumet à la petite bourgeoisie et nous amène à soutenir l'offensive sera bien sûr accueilli très chaleureusement par le gouvernement russe mais aussi par les puissances impérialistes de l'Entente.
Milioukov déclare par exemple : "Notre loyauté envers nos alliès et envers les anciens traités (impérialistes) signés nous oblige à entamer l’offensive."
Kerensky et Tsérételli affirment : "Bien que les anciens traités n’aiient pas encore été révisés, l'offensive est inévitable."
Les arguments varient mais la politique est la même. Et il ne peut en être autrement, puisque Kerensky et Tsérételli sont étroitement liés au parti de Milioukov qui se trouve au gouvernement.
Le pacifisme social-démocrate et patriotique de Dan, tout comme le pacifisme à mode quaker de Bryan, sert, dans les faits, l'intérêt des puissances impérialistes.
C’est pourquoi la tache la plus importante de la diplomatie russe ne consiste pas à persuader la diplomatie de l' Entente de réviser tel ou tel traité, ou d'abroger telle disposition, mais de la convaincre que la révolution russe est absolument fiable, qu'on peut lui faire confiance en toute sécurité.
L'ambassadeur russe, Bachmatiev, dans son discours devant le Congrès américain du l0 juin, a aussi caractérisé l'activité du gouvernement provisoire de ce point de vue :
"Tous ces événements, a-t-il dit, montrent que le pouvoir et la représentativité du gouvernement provisoire augmentent chaque jour. Plus ils augmenteront, plusle gouvernement sera en mesure d’éliminer les éléments désintégrateurs, qu’ils viennent de la réaction ou de l’extrême gauche. Le gouvernement provisoire vient juste de décider de prendre toutes les mesures nécessaires pour y arriver, même s'il doit utiliser la force, et bien qu'il ne cesse de rechercher une solution pacifique à ces problèmes."
On ne peut douter un instant que « 1’honneur national » de nos Patriotes sociaux-démocrates reste intact lorsque l'ambassadeur de la "démocratie révolutionnaire" s'empresse de démontrer à la ploutocratie américaine que le gouvernement russe est prêt à faire couler le sang du prolétariat russe au nom de la loi et l'ordre. L 'élément le plus important du maintien de l'ordre étant le soutien loyal aux capitalistes de l'Entente.
Et tandis qu’Herr Bachmatief, chapeau à la main, s'adressait humblement aux hyènes de la Bourse américaine, Messieurs ([3]) Tsérételli et Kérensky endormaient la "démocratie révolutionnaire", en lui assurant qu'il était impossible de combattre l'"anarchie de la gauche" sans utiliser la force et menaçaient de désarmer les ouvriers de Pétrograd et les régiments qui les sontenaient. Nous pouvons voir maintenant que ces menaces étaient proférées au bon moment : elles étaient la meilleure garantie pour les prêts américains à la Russie.
"Vous pouvez maintenant voir, aurait pu dire Herr Bachmatiev à Mr.Wilson, que notre pacifisme révolutionnaire ne diffère pas d'un cheveu du pacifisme de votre Bourse. Et s'ils peuvent croire en Mr. Bryan, pourquoi ne pourraient-ils croire Herr Tsérételli ?"
[1] Poète latin (vers 60 - 140) auteur de satires stigmatisant avec une mordante ironie les moeurs décadentes des dignitaire, de l'Empire romain.
[2] En français dans le texte. (N.d.T.)
[3] En français dans le texte (N.d.T.)
Questions théoriques:
- Guerre [1]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rubrique:
15e Congrès du CCI : Résolution sur la situation internationale
- 2805 reads
Nous publions ci-après deux documents d'analyse de la situation internationale adoptés par le XVe congrès du CCI qui vient de se tenir : la résolution sur la situation internationale et des notes sur l'histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous reviendrons, dans la prochain numéro de la Revue Internationale, sur les travaux de ce congrès.
1. Avec l'offensive massive des ÉtatsUnis contre l'Irak, nous entrons dans une nouvellc phase de la chute du capitalisme dans la barbarie militaire, ce qui va agrraver tous les conflits ouverts ou les tensions latentes dans le monde. En plus des terribles dévastations qui vont s'abattre sur la malheureuse population irakienne, cette guerre n'aura pour effet que d'attiser les tensions impérialistes et le chaos militaire partout ailleurs. La préparation de la guerre a déjà provoqué la première déchirure ouverte entre l'Amérique d'une part, et la seule autre puissance qui pourrait poser sa candidature pour diriger un nouveau bloc anti-américain, l’Allemagne. Les divisions entre grandes Puissances au sujet de l'Irak ont sonné le glas de l'OTAN, tout en révélant que l’Europe, loin de constituer déjà un tel bloc, est déchirée par de profondes divergences sur les questions clé des relations internationales. L'offensive américaine a poussé un autre pôle de "l'axe du Mal", la Corée du Nord, a jouer son propre jeu dans la crise, avec pour danger à moyen terme l'extension des hostilités à l'Extrême Orient. Pendant ce temps, le troisième pôle de l'axe, l'Iran, joue aussi sa carte nucléaire. EN Afrique, les prétentions de la France à passer pour une puissance 'pacifique' sont démenties par l'implication croissante de ses trottpes dans la guerre sanglante en Côte d'Ivoire. Les retombées de la guerre en Irak, loin de créer une nouvelle "Allemagne de l'Ouest" au Moyen-Orient. comme l'ont prédit les commentateurs bourgeois les plus inconsistants, ne peu servir qu'à créer unie gigantcsque zone d'instabilité qui aura pour conséquence immédiate l'aggravation du conflit Israël/Palestine, et provoquera de nouvellcs attaques terroristes de par le monde. La guerre contre le terrorisme répand la terreur sur toute la planète, non seulement par les massacres qu'elle perpcetue sur ses victimes immédiates sur les fronts des rivalités impérialistes, Mais plus largement par le développement dans les populations de l'angoisse sur l'avenir qui attend l'ensemble de l'humanité.
2. Ce n'est pas un hasard si l'aggravation des tensions militaires "coïncide" avec un nouveau plongeon dans la crise économique mondiale. Cela s'est manifesté non seulement dans l'effondrement ouvert des économies plus faibles (mais èconomiquemcnt significatives) comme l'Argentine, mais par dessus tout, dans le retour en récession ouverte de l'économie US, dont la croissance artificiellement par le crédit dans les années 90 (et qu'on nous présentait comme le triomphe de la "nouvelle économie") avait représenté la grande espérance de tout le système économique mondial, en particulier des pays d'Europe. Ces années glorieuses sont maintenant définitivement terminées alors que l'économie américaine est touchée par une augmentation spectaculaire du chômage, une chute de la production industrielle, un déclin de la consommation, l'instabilité boursière, des scandales et des banqueroutes et le retour du déficit du budget fédéral.
Une mesure de la gravité de la situation économique actuelle est donnée par l'état de l'économie britannique, qui parmi celles de tous les principaux pays européens, était présentée comme la mieux armée pour faire face aux tempêtes en provenance des États-Unis. En fait, quasiment tout de suite après que le chancelier Brown ait déclaré que "la Grande Bretagne est mieux placée que par le passé pour affronté le recul économique mondial", les statistiques offïcielles étaient publiées, montrant que l'industrie britannique, dans les secteurs hight tech comme dans les secteurs plus traditionnels, était à son plus bas niveau depuis la récession de 1991, et que 10000 emplois disparaissent chaque mois dans ce secteur. Combiné aux sacrifices exigés par l'augmentation vertigineuse des budgets militaires, le glissement dans la récession ouverte génère d'ores et déjà tout une nouvelle vague d'attaques contre les conditions de vie de la classe ouvrière dicenciements, "modernisation", réduction des allocations, et tout spécialement des pensions de retraite, etc.).
3. La situation à laquelle fait face la classe ouvrière est donc d'une gravité sans précédent. Depuis plus d'une décennie, la classe ouvrière a subi le recul de ses luttes le plus prolongé depuis la sortie de la période de contre-révolution à la fin des années 60. Confrontée au double assaut de la guerre et de la crise économique, la classe ouvrière a rencontré des difficultés considérables dans le développement de ses luttes, même au niveau le plus élémentaire de son autodéfense économique. Sur le plan politique, ses difficultés sont encore plus prononcées, sa conscience générale des énormes responsabilités qui pèsent sur ses épaules ayant subi un coup après l'autre depuis plus d'une décennie. De plus, les forces dont la première tâche est de combattre les faiblesses politiques du prolétariat, les forces de la Gauche communiste sont dans un état de désarroi plus dangereux que jamais depuis la réémergence des forces révolutionnaires à la fin des années 60. Les énormes pressions d'un ordre capitaliste en décomposition ont tendu à renforcer les vieilles faiblesses opportunistes et sectaires dans le milieu politique prolétarien, ont entraîné d'importantes régressions politiques et théoriques, menant à sous-estimer la gravité de la situation à laquelle le prolétariat et ses minorités révolutionnaires Sont confrontés et en fait, à obscurcir toute réelle compréhension de la nature et de la dynamique de l'ensemble de l'époque historique.
La crise du leadership américain
4. Confronté à l'effondrement du bloc rival russe à la fin des années 80, et à la rapide désagrégation de son propre bloc occidental, l'impérialisme US a élaboré un plan stratégique qui, au cours de la décennie qui a suivi, s'est révélé de plus en plus ouvertement. Confïrmés comme la seule super-puissance subsistante, les EtatsUnis feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter qu'aucune autre super-puissance -en réalité, aucun autre bloc impérialiste - ne vienne défier leur "nouvel ordre mondial". Les principales méthodes de cette stratégie ont été pleinement mises en évidence par la première guerre du Golfe en 1991:
- une démonstration massive de la supériorité militaire US, avec Saddam Hussein dans le rôle du bouc émissaire ;
- l'enrôlement de force des autres puissances dans une coalition destinée à donner des airs de légitimité à l'opération US, tout autant qu'à fournir une partie importante des énormes fonds nécessaires. L'Allemagne en particulier, le seul réel candidat au leadership d'un nouveau bloc anti-américain, a dû payer le plus.
5. Si le premier objectif de la guerre du Golfe était d'adresser un avertissement efficace à tous ceux qui voudraient défier l'hégémonie US, il faut considérer qu'elle a été un échec. Dans l'année qui a suivi, l'Allemagne a provoqué la guerre dans les Balkans, dans le but d'étendre son influence au carrefour stratégique entre l'Europe et le Moyen-Orient. Cela a presque pris toute la décennie aux États-Unis avant qu'ils puissent, à travers la guerre au Kosovo, imposer leur autorité sur la région en rencontrant l'opposition non seulement de l'Allemagne (qui soutenait la Croatie en sous main), mais aussi de la France et l'allié supposé des américains, la Grande-Bretagne, qui soutenaient secrètement la Serbie. Le chaos dans les Balkans était une expression claire des contradictions auxquelles les États-Unis faisaient face : plus ils cherehaient à discipliner leurs anciens alliés, plus ils provoquaient résistance et hostilité, et moins ils réussissaient à les enrôler dans des opérations militaires dont ils savaient qu'elles étaient dirigées contre eux. D'où le phénoméne qui a vu les États-Unis, de plus en plus obligés de faire cavalier seul dans leurs aventures, s'en remettre de moins en moins aux structures internationales "légales" comme l'ONU et l'OTAN, lesquelles devenaient de façon croissante des obstacles aux plans américains.
6. Après le 11 septembre 2001, presque certainement organisé avec la complicité de l'État US, la stratégie globale des EtatsUnis est passée à un stade supérieur. La "guerre contre le terrorisme" a immédiatement été annoncée comme une offensive militaire permanente et à l'échelle de la planète. Confrontés au défi croissant de leurs principaux rivaux impérialistes (exprimé successivement à propos des accords clé Kyoto, de la force militaire européenne, des manoeuvres autour du maintien de l'ordre au Kosovo, etc.). les ÉtatsUnis ont opté pour une politique d'intervention militaire beaucoup plus massive et directe, avec pour but stratégique l'encerclement de l'Europe et de la Russie en prenant le contrôle de l'Asie centrale et du Moyen-Orient. En Extrême-Orient, en incluant la Corée du Nord dans "l'Axe du mal" et en renouvelant son intérêt pour "la lutte contre le terrorisme" en Indonésie à la suite de l'attentat de Bali, l'impérialisme américain a aussi déclaré son intention d'intervenir dans les plates-bandes de la Chine et du Japon.
7. Les objectifs de cette intervention ne se limitent certainement pas à la question du pétrole considéré uniquement comme source de profit capitaliste. Le contrôle de ces régions pour des raisons géostratégiques était un sujet d'intenses rivalités impérialistes bien avant que le pétrole ne devienne un élément vital de l'économie capitaliste. Et bien qu'il existe une claire nécessité de contrôler les énormes capacités de production pétrolière du Moyen-Orient et du Caucase, l'action militaire US dans cette région n'est pas mise en oeuvre au service des compagnies pétrolières : celles-ci ne sont autorisées à encaisser leurs profits que si elles s'insèrent dans les plans stratégiques généraux, qui incluent la capacité d'interrompre les livraisons de pétrole aux ennemis potentiels de l'Amérique, et donc d'étrangler toute menace militaire avant qu'elle ne débute. L'Allemagne et le Japon en particulier sont beaucoup plus dépendants du pétrole du Moyen-Orient que les Etats-Unis.
8. L'audacieux projet américain de bâtir un cercle d'acier autour de ses principaux rivaux impérialistes est donc la véritable explication de la guerre d'Afghanistan, de l'assaut contre l'Irak, et de l'intention déclarée de s'occuper de l'Iran. Cependant, les agissements des États-Unis ont appelé une réponse en proportion de la part de leurs principaux rivaux. La résistance aux plans US a été conduite par la France, qui a menacé de faire usage de son droit de veto au Conseil de Sécurité ; mais encore plus significatif est le défi lancé par l'Al lemagne, qui jusqu'à présent a eu tendance à travailler dans l'ombre, permettant à la France de jouer le rôle d'opposant déclaré aux ambitions américaines. Aujourd'hui cependant l'Allemagne perçoit l'aventure américaine en Irak comme une réelle menace contre ses intérêts dans une zone qui a été centrale pour ses ambitions impérialistes depuis la Première guerre mondiale. Elle a donc lancé un défi plus explicite que jamais auparavant vis-à-vis des Etats-Unis. De plus, sa position résolument "anti guerre" a encouragé la France qui quasiment jusqu'à la veille de la guerre a laissé entendre qu'elle pourrait changer de position et prendre part à l'action américaine. Avec l'éclatement de la guerre, ces puissances ont adopté un profil plutôt bas, mais au niveau historique, c'est un réel tournant qui a été pris. Cette crise met en évidence la fin non seulement de l'OTAN (dont l'inadéquation s'est vue à travers son incapacité à s'accorder sur la "défense" de la Turquie juste avant la guerre) mais aussi des Nations Unies. La bourgeoisie américaine considère de plus en plus cette institution comme un instrument de ses principaux rivaux et dit ouvertement qu'elle ne jouera aucun rôle dans la "reconstruction" de l'Irak. L'abandon de ces institutions de "droit international" représente une avancée significative dans le développement du chaos dans les rapports internationaux.
9. La résistance aux plans américains de la part de l'alliance entre la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine montre que, confrontés à la supériorité massive des Etats-Unis, ses principaux rivaux n'ont d'autre choix que de se regrouper contre eux. Cela confirme que la tendance à la constitution de nouveaux blocs impérialistes reste un facteur réel dans la situation actuelle. Mais ce serait une erreur de confondre une tendance et un fait accompli, surtout parce que dans la période de la décomposition capitaliste, le mouvement vers la formation de nouveaux blocs est constamment contrarié par la contre-tendance de chaque pays à défendre ses intérêts nationaux immédiats avant tout, par la tendance au chacun pour soi. Les profondes divisions entre pays européens sur la guerre en Irak ont montré que "l'Europe" est loin de former un bloc cohérent comme certains éléments du mouvement révolutionnaire ont tendance a l'affirmer. De plus de tels arguments se basent sur une confusion entre alliances économiques et véritables blocs impérialistes, qui sont avant tout des formations militaires en vue de la guerre mondiale. Ici, deux autres facteurs importants entrent en jeu : premièrement, la domination militaire indéniable des EtatsUnis qui empêche leurs principaux rivaux de leur lancer ouvertement un défi guerrier ; deuxièmement, le fait que la classe ouvrière n'est pas battue signifie qu'il n'est pas encore possible de créer les conditions sociales et idéologiques pour de nouveaux blocs guerriers. Ainsi la guerre contre l'Irak, tout en ayant révélé ouvertement les rivalités entre les grandes puissances, conserve fondamentalement la même forme que les autres grandes guerres de cette période : une guerre "détournée" dont le véritable but est caché derrière le choix d'un "bouc émissaire" représenté par une puissance de troisième ou quatrième ordre et dans laquelle les principales puissances prennent soin de n'envoyer que des armées professionnelles.
10. La crise du leadership US a placé l'impérialisme britannique dans une position de plus en plus contradictoire. Avec la fin de la "relation spéciale", la défense des intérêts clé la Grande-Bretagne exige que celle-ci joue un rôle de "médiateur" entre l'Amérique et les principales puissances européennes, ainsi qu'entre ces dernières. Bien que présenté comme le caniche des États-Unis, le gouvernement Blair lui-même a joué un rôle significatif dans l'éclatement de la crise actuelle, en insistant sur le fait que l'Amérique ne pouvait pas aller seule en Irak, mais devait suivre la voie de l'ONU. La Grande-Bretagne a aussi été le théâtre des plus grandes manifestations "pour la paix", lesquelles ont été organisées par des fractions importantes de la classe dominante - et pas seulement ses appendices gauchistes. Le fort sentiment "anti-guerre" dans des parties de la bourgeoisie britannique est l'expression d'un réel dilemme pour la classe dominante en Angleterre, alors que le déchirement grandissant entre l'Amérique et les autres grandes puissances rend son rôle "centriste" de plus en plus inconfortable. En particulier, les arguments de la Grande-Bretagne selon lesquels les Nations Unies doivent jouer un rôle central dans la période post-Saddam et que cela doit s'accompagner de concessions significatives aux palestiniens, sont poliment ignorés par les Etats-Unis. Bien qu'il n'y ait pas encore de claire alternative, au sein de la bourgeoisie britannique, à la ligne Blairen ce qui concerne les relations internationales, il y a un malaise grandissant d'être associé de manière trop étroite à l'aventurisme US. le bourbier qui se développe maintenant en Irak ne peut que renforcer ce malaise.
11. Bien que les Etats-Unis continuent à démontrer leur supériorité militaire écrasante par rapport aux autres grandes puissances, le caractère de plus en plus ouvert de leurs ambitions impérialistes tend à affaiblir leur autorité politique. Dans les deux guerres mondiales et dans le conflit avec le bloc russe, les États-Unis ont été capables de se poser en tant que principal rempart de la démocratie et des droits des nations, en défenseur du monde libre contre le totalitarisme et les agressions militaires. Mais depuis l'effondrement dit bloc de l'Est les États-Unis ont été obligés de jouer eux mêmes le rôle de l'agresseur ; et tandis que dans l'immédiat après 11 septembre, ils étaient encore capables dans une certaine mesure de présenter leur action en Afghanistan comme un acte de légitime défense, les justifications pour la guerre actuelle en Irak se sont révélées complètement inconsistantes tandis que leurs rivaux se sont présentés comme les meilleurs défenseurs des valeurs démocratiques face aux intimidations américaines. Les premières semaines de l'action militaire ont principalement servi à créer de nouvelles difficuités à l'autorité politique américaine. Initialement présentée comme une guerre qui serait à la fois rapide et propre, il apparaît que le plan de guerre établi par l'administration actuelle a sérieusement sous estimé le degré auquel l'invasion provoquerait des sentiments de défense nationale dans la population irakienne. Bien que l'omniprésence des unités Spéciales de Saddam ait certainement joué un rôle dans l'étouffement de la résistance de l'armée régulière à travers leur méthode habituelle de coercition et de terreur, il y a eu une réaction bien plus générale d'hostilité envers l'invasion américaine, même si elle ne s'est pas accompagnée d'un grand enthousiasme envers le régime de Saddam. Même les organisations chiites sur lesquelles on comptait pour se "soulever" contre Saddam ont déclaré que le premier devoir de tous les irakiens était de résister à l'envahisseur. La prolongation de la guerre ne va faire qu'aggraver la misère de la population par la faim et la soif ou par l'intensification des bombardements ; et tout indique que cela ne fera qu'accroitre l'hostilité populaire envers les Etats-Unis.
De plus la guerre exacerbe les divisions dans la société irakienne, en particulier entre ceux qui se sont alliés aux Etats-Unis (comme les régions kurdes) et ceux qui se battent contre l'invasion. Ces divisions ne peuvent servir qu'à créer du désordre et de l'instabilité dans l'Irak d'après Saddam, sapant encore plus les proclamations américaines selon lesquelles ils apporteraient la paix et la prospérité dans la région. Au contraire, la guerre accumule déjà les tensions dans cette partie du monde, comme le démontre l'incursion turque dans le nord de l'Irak, la position anti-américaine adoptée par la Syrie et le renouveau de bruits de bottes entre l'Inde et le Pakistan.
Aussi, loin de résoudre la crise du leadership américain, la guerre actuelle ne peut que la porter à un niveau supérieur.
Décadence et décomposition
12. La plongée dans le militarisme est par excellence l'expression de l'impasse à laquelle est confronté le système capitaliste, sa décadence en tant que mode de production. Comme les deux guerres mondiales, et la guerre froide entre 1945 et 1989, les guerres de la période inaugurée depuis 1989 sont la manifestation la plus flagrante du fait que les rapports de production capitalistes sont devenus un obstacle au progrès de l'humanité. Non seulement ce terrifiant record de destructions (et de production des moyens de destruction) représente un gaspillage consternant de force de travail humain dans une période où les forces productives sont objectivement capables de libérer l'Homme de toutes les formes de travail pénible et de pénurie, c'est aussi le produit d'un facteur actif dans une dynamique qui menace la survie même de l'humanité. Cette dynamique s'est aggravée tout au long de la période de décadence : il suffit de comparer les niveaux de mort et de destructions occasionnés par la première et la deuxième guerres mondiales, aussi bien que l'étendue globale de chaque conflit pour le comprendre. De plus, bien que la troisième guerre mondiale entre les blocs russe et américain une guerre qui aurait presque certainement mené à la destruction de l'humanité - n'ait jamais éclaté, les guerres par procuration entre eux pendant plus de quatre décennies ont fait autant de morts que les deux guerres mondiales réunies. Ce ne sont pas seulement des faits mathématiques ou technologiques ; ils témoignent d'un approfondissement qualitatif de la tendance du capitalisme à l'autodestruction.
13. Il est évident pour tout observateur de la scène internationale que 1989 a marqué le commencement d'une phase radicalement nouvelle dans la vie du capitalisme. En 1990, Bush senior promettait un Nouvel Ordre mondial de paix et de prospérité. Et pour les apologistes intellectuels de la classe dominante, la fin de "l'expérience communiste" a signifie un renforeement du capitalisme, devenu enfin un système réellement "global", et armé des merveilleuses technologies nouvelles qui feraient de ses crises économiques un vieux souvenir. De même le capitalisme ne serait plus troublé par la contradiction entre bourgeoisie et prolétariat, Puisque dans la "nouvelle économie", la classe ouvrière et ses luttes ont cessé d'exister. L'éclosion de la nouvelle ère de globalisation était si évidente que ses opposants les plus connus, le mouvement global anti-capitaliste, partageait pratiquement tous les postulats de base de ses apologistes. Pour le marxisme, cependant, l'effondrement du bloc stalinien n'était que l'effondrement d'une partie d'un système capitaliste déjà globalisé ; et la période inaugurée par ce séisme n'a représenté aucune fleuraison, aucun rajeunissement du capitalisme ; au contraire, il ne peut être compris que comme la phase terminale de la décadence capitaliste, la phase que nous appelons la décomposition, la "floraison" de toutes les contradictions accumulées d'un ordre social déjà sénile.
14. Le retour de la crise économique ouverte à la tin des années 1900 avait en effet déjà ouvert un chapitre final dans le cycle classique du capitalisme, crise, guerre, reconstruction, nouvelle crise. Dorénavant, il devenait virtuellement impossible au capitalisme de reconstruire après une troisème guerre mondiale qui signitierait probablement l'anéantissement de l'humanité, ou au mieux une régression aux proportions incalculables. Le choix historique auquel est aujourd'hui confrontée l'humanité n'est plus seulement révolution ou guerre, mais révolution ou destruction de l'humanité.
15. 1968 a vu la résurgence historique des luttes prolétariennes en réponse à l'émergence de la crise, ouvrant un cours vers des confrontations de classe massives. Sans défaire le prolétariat renaissant, la classe dominante ne serait pas capable de conduire la société à la guerre, qui même si elle aurait certainement signifié l'autodestruction du capitalisme, demeurait l'issue "logique" des contradictions fondamentales du système. Cette nouvelle période de luttes ouvrières s'est manifestée au travers les trois vagues internationales(1968-74, 1978-81, 1983-89) ; mais l'effondrement du bloc de l'Est en 1989, et les campagnes simultanées sur la faillite du communisme et la fin de la lutte de classe, ont représenté une rupture importante avec l'ensemble de cette période. La classe ouvrière n'a pas subi de défaite historique majeure et la menace d'une troisième guerre mondiale, qui avait déjà été tenue en échec par la recrudescence de la lutte de classe, a encore été repoussée plus loin dans l'ordre du jour de l'histoire par les nouvelles barrières objectives à la reconstitution de blocs impérialistes, en particulier la vigueur de la tendance au "chacun pour soi" dans la nouvelle période. Néanmoins, la classe ouvrière, dont les luttes dans la période de 1968 à 1989 avaient empêché la bourgeoisie d'imposer sa "solution" à la crise économique, était de plus en plus confrontée aux conséquences de son propre échec à élever ses luttes à un niveau politique plus haut et à offrir une alternative à l'humanité. La période de décomposition, résultat de cette "impasse" entre les deux classes principales, n'apporte rien de positif à la classe exploitée. Bien que la combativité de la classe n'ait pas été anéantie dans cette période, et qu'un processus de maturation souterraine de la conscience y était encore sensible, en particulier sous la forme "d'éléments en recherche" et de petites minorités politisées, la lutte de classe partout dans le monde a subi un recul qui n'est toujours pas terminé. La classe ouvrière dans cette période a été confrontée non seulement à ses faiblesses politiques, mais aussi au danger de perdre son identité de classe sous le poids d'un système social en pleine désintégration.
16. Ce danger n'est pas fondamentalement le résultat des réorganisations de la production et du partage du travail exigées par la crise économique (par exemple le déplacement des industries secondaires vers le secteur tertiaire dans la plupart des pays avancés, l'informatisation, etc.) ; il résulte d'abord et avant tout des tendances les plus omniprésentes de la décomposition, l'atomisation accélérée des relations sociales, la gangstérisation et, plus important que tout, l'attaque systématique contre la mémoire de l'expérience historique et de la perspective propre du prolétariat que la bourgeoisie a développée dans le sillage de "l'effondrement du communisme". Le capitalisme ne peut pas fonctionner sans l'existence d'une classe ouvrière, mais cette dernière peut perdre, à terme, toute conscience de son existence comme classe. Ce processus est tous les jours renforcé par la décomposition aux niveaux spontané et objectif; mais il n'empêche pas la classe dominante d'utiliser consciemment toutes les manifestations de la décomposition pour accentuer l'atomisation de la classe. La récente montée de l'extrême droite, capitalisant les craintes populaires en jouant sur les flux de réfugiés désespérés provenant des pays les plus touchés par la crise et la guerre, en est un exemple, tout comme l'utilisation des peurs devant le terrorisme pour renforeer l'arsenal répressif de l'État.
17. Bien que la décomposition du capitalisme soit le résultat de cet écart historique entre les classes, cette situation ne peut pas demeurer statique. La crise économique, qui est aux racines tant de la tendance vers la guerre que de la réponse du prolétariat, continue à s'approfondir, mais contrairement à la période de 1968 à 1989, alors que l'issue de ces contradictions de classe ne pouvait être que la guerre ou la révolution, la nouvelle période ouvre la voie à une troisième possibilité : la destruction de l'humanité, non au travers d'une guerre apocalyptique, mais au travers d'une avance graduelle de la décomposition,qui pourrait à terme saper la capacité du prolétariat à répondre comme classe, et pourrait également rendre la planète inhabitable dans une spirale de guerres régionales et de catastrophes écologiques. Pour mener une guerre mondiale, la bourgeoisie devrait commencer par affronter directement et défaire les principaux bataillons de la classe ouvrière, et ensuite les mobiliser pour qu'ils marchent avec enthousiasme derrière les bannières et l'idéologie de nouveaux blocs impérialistes , dans le nouveau scénario, la classe ouvrière pourrait être battue d'une manière moins ouverte et moins directe, simplement en n'arrivant pas à répondre à la crise du système et en se laissant de plus en plus entraîner dans la spirale de la décadence. En bref, une perspective beaucoup plus dangereuse et difficile attend la classe et ses minorités révolutionnaires.
18. La nécessité pour les marxistes de comprendre ces changements majeurs dans la situation à laquelle est confrontée l'humanité est soulignée par la menace croissante que fait peser la simple continuation de la production capitaliste sur l'environnement. De plus en plus de scientifiques tirent la sonnette d'alarme à propos des possibilités de "réaction positive" dans le processus de réchauffement global -par exemple, dans la cas de l'Amazonie, où les effets combinés du déboisement et d'autres empiètements, ainsi que les températures en hausse, en accélèrent dramatiquement la destruction. Si cette destruction se poursuit à ce rythme, elle libérera dans l'atmosphère des quantités énormes de dioxyde de carbone, et donc fera augmenter de façon importante la vitesse du réchauffement. En plus de cela, l'intensification des dangers écologiques ne peut avoir que des effets déstabilisants massifs sur la structure de la société, l'économie, et les rapports inter-impérialistes. Dans ce domaine, la classe ouvrière ne peut pas faire grand-chose pour mettre un terme à ce glissement avant d'avoir remporté la victoire politique à l'échelle mondiale, et pire, plus sa révolution est retardée, et plus le prolétariat risque d'être englouti, et les bases mêmes d'une reconstruction sociale d'être minées.
19. Malgré les dangers croissants de la décomposition capitaliste, la plupart des groupes de la Gauche communiste n'acceptent pas le concept de décomposition, même s'ils peuvent en voir les manifestations extérieures dans le chaos croissant aux niveaux international et social. En fait, loin de leur donner une vision claire de la situation où se trouve la classe ouvrière, la période de décomposition, nouvelle et sans précédent, a produit chez eux un réel désarroi théorique. Les groupes bordiguistes n'ont jamais eu une théorie solide sur la décadence, même s'ils reconnaissent le cours à la guerre impérialiste dans cette période et sont encore capables d'y répondre sur un terrain internationaliste. Ils n'ont pas été capables non plus d'intégrer le concept de cours historique élaboré par la Fraction italienne dans les années 1930, notion suivant laquelle la guerre impérialiste exige la défaite préalable et la mobilisation active du prolétariat. Il leur manque donc les deux fondements théoriques de la décomposition. Le BIPR, bien qu'acceptant la notion de décadence, a aussi rejeté le concept de cours historique élaboré par la Gauche italienne. De plus, de récentes déclarations de ce courant montrent que sa compréhension du concept de décadence aussi est en recul. Une polémique avec la conception du CCI à propos de la décomposition révèle très clairement l'incohérence des positions qu'il tend actuellement à adopter : "La tendance à la décomposition, que la vision apocalyptique du CCI voit partout, impliquerait en effet que le capitalisme soit au bord de l’effondrement si elle était réelle. Cependant, ce n'est le cas, et si le CCI examinait les phénomènes de la société contemporaine de manière plus didactique, ce serait évident. Aloirs que d'une part, de vieilles structures s’effondrent, de nouvelles apparaissent. Par exemple, l'Allemagne n'aurait pas pu se réunifier sans l’effondrement de la RDA et celui du bloc russe. Les pays du Comecon n’auraient pu rejoindre la CEE sans la dissolution du Comecon, etc. Le processus d'écroulement est en même un processus de reconstruction, la décomposition fait partie d’un processus de recomposition. Alors que le CCI reconnait qu'il y à une tendance à la recomposition, i1 la considère comme insignifiante en comparaison avec la tendance prédominante à la décomposition et au chaos... Le CCI à échoué à délmontrer comment cette tendance à surgi de l’infrastructure capitaliste. La difficulté qu'il rencontre en voulant le faire vient du fait que c'est la tendance à la recomposition qui provient des forces de l’infrastructure capitaliste. En particulier, la crise économique permanente, conséquence de la baisse du taux de profit, oblige les capitaux les plus faibles à former des blocs commerciaux, ,et ces blocs commerciaux constituent les squelettes sur base desquels les futurs blocs impérialistes seront batis" (Revolutionary Perspectives 27).
Confrontés à cette hypothèse, nous devons faire les points suivants :
- le marxisme a toujours insisté sur le fait que l'ouverture de la décadence du capitalisme posait l'alternative historique entre socialisme et barbarie. Avant de déverser leur ironie sur les visions "apocalyptiques" du CCI, les camarades du BIPR feraient bien de se rendre compte qu'ils sous estiment la gravité de la situation mondiale, et la dynamique destructrice imposée au capital par son impasse historique ;
- la question n'est pas de fixer le moment d'un effondrement immédiat et final ; la tendance à l'effondrement est inhérente à toute la période de décadence, dans laquelle l'ancien cadre pour la croissance économique fait défaut, et l'effondrement complet du système n'est repoussé que par les réponses de la classe dominante, le contrôle étatique sur l'économie et la fuite vers la guerre, qui elle-même contient la menace d'un effondrement à un niveau bien plus dévastateur que le simple grippage de la machine économique. De plus, la phase de décomposition signifie une réelle accélération de ce mouvement descendant. C’est peut-étre plus évident au niveau des rapports impérialistes, où la concurrence internationale est la plus impitoyable et anarchique ; au niveau économique, la classe dominante est plus capable d'atténuer le danger de la concurrence débridée entre capitaux nationaux (voir la reconnaissance par la bourgeoisie US de la nécessité d’épauler son principal rival économique le Japon) ;
- dans la période de décadence, il n'y a pas d'harmonie "dialectique" entre décomposition et recomposition. La décomposition n'est que la phase finale d'une tendance vers le chaos et les catastrophes, déjà identifiée au premier congrès de la Troisième Internationale. Dans l'époque décadente, la guerre de chacun contre tous (non l'invention de Hobbes, mais la réalité fondamentale d'une société basée sur la production généralisée de marchandises) n'est en aucun cas écartée par la formation d'énormes cartels d'Etats capitalistes et de blocs impérialistes ; comme le notait déjà Boukharine en 1915, ces formations ne faisaient que hausser l'anarchie fondamentale du capital à un niveau supérieur et plus destructeur. Voilà la tendance qui découle de "l'infrastructure capitaliste" quand elle ne petit plus croître en harmonie avec ses propres lois. D'autre part, il n'y a dans cette période aucune tendance spontanée à la recomposition. Si par là, les camarades veulent dire reconstruction c'est au prix de gigantesques destructions physiques au travers de guerres impérialistes, et dans tous les cas, ce n'est plus une possibilité réelle pour le capitalisme aujourd'hui. Par ailleurs, s'ils pensent que cette "recomposition" exprime une évolution naturelle et pacifique du capitalisme "moderne", cela semblerait montrer l'influence des théories "autonomistes" qui rejettent la vision catastrophiste au coeur du marxisme ; d'ailleurs, leur acceptation partielle de l'idéologie de la globalisation, de la révolution technologique, etc., révèle une réelle concession aux campagnes actuelles de la bourgeoisie à propos de la nouvelle ascendance du capitalisme ;
- enfin, si la recomposition signifie que les nouveaux blocs impérialistes sont déjà en cours de formation, ceci se base sur une identification erronée entre alliances commerciales et blocs impérialistes, ces derniers ayant un caractère fondamentalement militaire. La crise irakienne en particulier a montré que "l'Europe" est totalement
divisée à propos clé ses relations avec les États-Unis. Les facteurs qui empêchent la formation de nouveaux blocs restent aussi présents que jamais : profondes divisions parmi les membres potentiels d'un bloc allemand ; supériorité militaire massive des États-Unis ; manque de fondements idéologiques pour le nouveau bloc, en soi c'est une expression supplémentaire du fait que le prolétariat n'est pas battu.
L'irrationalité de la guerre dans la période de décadence
20. La période de décomposition montre plus clairement que jamais l'irrationalité de la guerre en période de décadence, la tendance de sa dynamique destructrice à devenir autonome et de plus en plus en contradiction avec la logique du profit. Elle est pleinement à contre sens des conditions de base de l'accumulation dans la période de décadence. L'incapacité du capital à s'étendre dans les "zones de production périphériques" paralyse de plus en plus le fonctionnement "naturel" des lois du marché qui, laissées à elles-mêmes, déboucheraient dans un blocage économique catastrophique. Les guerres de la décadence, contrairement à celles de la période ascendante, n'ont pas de logique économique. Contrairement à la vision selon laquelle la guerre serait "bonne" pour la santé de l'économie, la guerre aujourd'hui exprime autant qu'elle aggrave sa maladie incurable. De plus, l'irrationalité de la guerre du point de vue des propres lois au capital s'est intensifiée dans la période de décadence. La première guerre mondiale avait un but "économique" clair, la mainmise sur les marchés coloniaux des puissances rivales. Jusqu'à un certain point, cet élément était aussi présent dans la seconde guerre mondiale, bien qu'il ait déjà été démontré qu'il n'existe pas de lien mécanique entre rivalité économique et confrontation militaire ; en ce sens, au début des années 1920, la Troisième Internationale se trompait en prévoyant que le prochain conflit impérialiste mondial opposerait les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Ce qui est à l'origine de l'impression que la seconde guerre mondiale avait une fonction rationnelle pour le capitalisme, c'est la longue période de reconstruction qui l'a suivie, conduisant beaucoup de révolutionnaires à conclure que la motivation principale du capitalisme à faire la guerre était de détruire du capital pour le reconstruire par la suite. En réalité, la guerre n'était pas le résultat d'une intention consciente de reconstruction après la guerre, mais a été imposée aux puissances capitalistes par la logique impitoyable de la concurrence impérialiste, exigeant la destruction totale de l'ennemi pour des raisons principalement stratégiques.
Cela n'enlève rien au fait que la marche vers la guerre est fondamentalement le résultat de l'impasse économique du capitalisme. Mais le lien entre crise et guerre n'est pas purement mécanique. Les difficultés économiques du capitalisme au moment de la première guerre mondiale n'étaient encore qu'embryonnaires ; la seconde guerre mondiale a éclaté alors que le choc initial de la dépression avait commencé à être absorbé. L'exacerbation de la crise économique crée plutôt les conditions générales de l'exacerbation des rivalités militaires ; mais l'histoire de la décadence montre que les rivalités et les objectifs purement économiques se sont de plus en plus subordonnés aux rivalités et objectifs stratégiques. Cela illustre la profonde impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Après la seconde guerre mondiale, le conflit global entre les blocs américain et russe était presque totalement dominé par des préoccupations stratégiques, puisque sur aucun plan, la Russie ne pouvait prétendre représenter une quelconque rivalité économique sérieuse pour les Etats-Unis. Et il était désormais clair que la guerre mondiale ne résoudrait pas les problèmes économiques du capitalisme puisque. Cette fois, elle aurait mené à l'autodestruction définitive de tout le système.
De plus, la façon dont la période des blocs s'est terminée démontre aussi les coûts ruineux pour l'économie du militarisme : le bloc russe, le plus faible, s'est effondré parce qu'il n'était plus capable de supporter les coûts faramineux de la course aux armements (et était également incapable de mobiliser son prolétariat dans une guerre pour rompre l'étranglement stratégique et économique que lui imposait le bloc US, plus fort). Et malgré toutes les prédictions sur la façon dont la "chute du communisme" allait créer un avenir radieux pour l'entreprise capitaliste la crise économique a poursuivi ses ravages, aussi bien à l'Ouest que dans les pays de l'ex-bloc de l'Est.
Aujourd'hui, la "guerre contre le terrorisme" des États-Unis contient effectivement la défense de leurs intérêts économiques immédiats chez eux et sur toute la planète, et leur agressivité ne peut qu'être exacerbée par l'épuisement des options utilisables par l'économie américaine. Mais cette guerre est fondamentalement dictée par le besoin stratégique des États-Unis de maintenir et de renforeer son leadership global. Le coût énorme des opérations internationales montées dans la première guerre du Golfe en 1991, en Serbie en 1999, en Afghanistan en 2001 et dans le Golfe en 2003 réfute les allégations selon lesquelles ces conflits seraient menés au service des compagnies pétrolières multinationales ou pour les contrats juteux signés lors des reconstructions d'après-guerre. Les reconstructions qui interviendront probablement en Irak après la guerre seront fondamentalement motivées par une nécessité politique et idéologique en tant que condition indispensable, même si pas suffisante, à une domination américaine de ce pays. Bien sûr, des capitalistes individuels peuvent toujours tirer profit d'une guerre, mais le bilan économique général est négatif. La guerre contre le terrorisme ne sera pas suivie d'une reconstruction réelle, ni de nouveaux marchés importants pour l'expansion des États-Unis ou de tout autre économie. La guerre est la ruine du capital à la fois produit de son déclin et facteur d'accélération de celui-ci. Le développement d'une économie de guerre hypertrophiée n'offre pas de solution à la crise du capitalisme, comme le pensaient certains éléments de la Fraction italienne dans les années 1930. L'économie de guerre n'existe pas pour elle-même mais parce que le capitalisme en décadence est contraint de mener guerre après guerre, et soumet de plus en plus l'ensemble de l'économie aux nécessités de la guerre. Cela mine considérablement l'économie car les dépenses d'armements sont fondamentalement stériles. En ce sens, l'effondrement du bloc russe nous donne un avant-goût de l'avenir du capital, puisque l'incapacité de ce dernier à soutenir l'accélération de la course aux armements a constitué l'un des facteurs clés de sa chute. Et bien que le bloc américain ait délibérément cherché ce résultat, aujourd'hui, ce sont les Etats-Unis eux mêmes qui vont vers une situation comparable, même si c'est à un rythme plus lent. La guerre du Golfe actuelle, et plus généralement toute "la guerre contre le terrorisme", sont liées a un énorme accroissemcnt des dépenses militaires conçu pour éclipser tous les budgets militaires du resté du monde mis ensemble. Mais les dommages que ce projet dément va infliger à l'économie américaine sont incalculables.
21. La nature profondément irrationnelle de la guerre dans la période de décadence est aussi démontrée par ses justifications idéologiques, une réalité déjà révélée par la montée du nazisme dans la période menant à la seconde guerre mondiale. En Afrique, quasiment tous les pays, l'un après l'autre, subissent des "guerres civiles" dans lesquelles des gangs de maraudeurs mutilent et massacrent sans aucun semblant de but idéologique, détruisant les infrastructures déjà fragiles sans aucune perspective de relèvement après la guerre. Le recours au terrorisme par un nombre croissant d'Etats, et en particulier le succès grandissant du terrorisme islamique, avec ses idéaux déments de suicide et de mort, sont des expressions supplémentaires d'une société en pleine putréfaction, happée dans une spirale mortelle d'autodestruction. Selon les camarades de la CWO, AI Qaïda « représente une tentative d’ériger un impérialisme moyen-oriental indépendant basé sur l’Islam et les territoires de l’empire Omayyade du 8e siècle. Ce n’est pas simplement un mouvementexprimant la décomposition et le chaos ». (Révolutionary Perspective n°27). En tait, un but aussi réactionnaire et irréaliste n'est pas plus rationnel que l'autre espoir secret de Ben Laden : que ces actions nous rapprochent du Jugement Dernier. Le terrorisme islamique est une pure culture de décomposition.
En revanche, la justification de la guerre de la part des grandes puissances économiques se présente généralement sous les apparences humanitaires, démocrates et autres buts rationnels et progressistes. En fait, si on laisse de côté l'énorme fossé entre les justifications affichées par les Etats impérialistes et les véritables motifs et actions sordides qui s'abritent derrière ces justifications, l'irrationalité de la grande entreprise des États-Unis commence aussi à émerger du brouillard idéologique : un nouvel Empire dans lequel une puissance seule règne sans partage et pour toujours. L'histoire, et en particulier l'histoire du capitalisme, a déjà montré la vanité de tels rêves. Mais cela n'a pas empêché le développement d'une nouvelle idéologie profondément rétrograde pour justifier tout ce projet : le concept d'un colonialisme nouveau et humain, pris au sérieux aujourd'hui par nombre d'idéologues américains et britanniques.
La lutte de classe
22. Il est vital de comprendre la distinction entre le poids historique de la classe ouvrière et son influence immédiate sur la situation. Dans l'immédiat, la classe ne peut pas empêcher les guerres actuelles et elle se trouve dans un sérieux recul, mais ce n'est pas la même chose qu'une défaite historique. Le fait que la bourgeoisie ne soit pas capable de mobiliser le prolétariat pour un conflit impérialiste direct entre grandes puissances, et soit obligée de "dévier" le conflit sur des puissances de deuxième et troisième ordre, en n'utilisant pas des appelés mais des armées professionnelles, est une expression de ce poids historique de la classe.
Même dans le contexte de ces guerres "détournées" la bourgeoisie est contrainte, avec l'aggravation des enjeux, de prendre des mesures préventives contre la classe ouvrière. L'organisation de campagnes pacifistes à une échelle sans précédent (tant en termes de taille des manifestations que de leur coordination internationale) témoigne du malaise de la classe dominante concernant l'hostilité montante envers sa guerre, parmi la population en général, et dans la classe ouvrière en particulier. Pour le moment, la caractéristique essentiel le des campagnes pacifistes a été de montrer leur nature interclassiste et démocratique, leur appel à l'ONU et aux intentions pacifiques des rivaux des Etats-Unis. Mais déjà, dans les discours prononcés depuis les tribunes de ces manifestations, il y a une forte poussée vers la démagogie ouvriériste. On a même vu des mobilisations de la puissance du mouvement syndical, y compris des actions de grève illégales lorsque la guerre a éclaté. Cela va jusqu'à la récupération de slogans internationalistes classiques comme "l'ennemi principal est dans notre propre pays". Derrière cette rhétorique, il y a la compréhension de la part de la bourgeoisie que la marche vers la guerre ne petit faire l'économie d'une confrontation avec la résistance de sa victime principale, la classe ouvrière, même si l'opposition de classe est en fait réduite actuellement à des réponses isolées de la part des ouvriers ou à l'activité d'une petite minorité internationaliste.
23. Tout cela démontre clairement que le cours historique n'a pas été inversé, même si, dans la période de décomposition, les conditions dans lesquelles il s'exprime ont été profondément modifiées. Ce qui a changé avec la décomposition, c'est la possible nature d'une défaite historique. qui peut lie pas venir d'un heurt frontal entre les classes principales, mais d'un lent reflux des capacités du prolétariat à se constituer en classe, auquel cas le point de non retour serait plus difficile à discerner, comme ce serait le cas avant toute catastrophe définitive. C'est le danger mortel auquel la classe est confrontée ayjourd'hui. Mais nous sommes convaincus que ce point n'a pas encore été atteint, et que le prolétariat conserve la capacité de redécouvrir sa mission historique. Pour être à même de prendre en compte les potentialités réelles que conserve le prolétariat, et d'assumer les responsabilités qui en découlent pour les révolutionnaires, encore est-il nécessaire que ces dernières se départissent d'une approche immédiatiste de l'analyse des situations.
24. Sans un cadre historique clair pour comprendre la situation actuelle clé la classe, il est très facile de tomber dans une attitude immédiatiste, qui peut balancer de l'euphorie au pessimisme le plus noir. Dans la période récente, la tendance majeure dans le milieu politique prolétarien a été de se laisser emporter par de faux espoirs de mouvements massifs de la classe : ainsi, certains groupes ont vu dans les émeutes de 2001 en Argentine le commencement d'un mouvement tendant à l'insurrection prolétarienne, alors que le mouvement n'était même pas basé principalement sur un terrain de classe : de même, la grève des pompiers en Grande-Bretagne a été interprétée comme le foyer d'une résistance de classe massive contre la marehe à la guerre. Ou encore, en l'absence de mouvements sociaux ouverts, il y a eu une tendance à voir le syndicalisme de base comme le point de départ pour préparer la résurgence de la classe dans le futur.
25. Dans le contexte du cours historique actuel, la perspective pour la lutte de classe reste le retour de luttes massives en réponse à l'approfondissement de la crise économique. Ces luttes suivront la dynamique de la grève de masse, qui est caractéristique du mouvement réel de la classe à l'époque de la décadence : elles ne sont pas organisées d'avance par un organe préexistant. C’est à travers la tendance à des luttes massives que la classe va recouvrer son identité de classe qui est une précondition indispensable à la politisation finale de sa lutte. Mais nous devons garder à l'esprit que de tels mouvements seront inévitablement précédés par une série d'escarmouches qui resteront sous le contrôle syndical, et même lorsqu'elles prendront un caractère plus massif, elles n'apparaîtront pas directement sous une "forme pure", c'est-à-dire ouvertement en dehors des syndicats et contre eux, et organisées et centralisées par des assemblées autonomes et des comités de grève. En fait, il sera plus important que jamais que les minorités révolutionnaires et les groupes d'ouvriers avancés défendent la perspective de formation de tels organismes au sein des mouvements qui surgiront.
26. Il y a eu beaucoup de telles escarmouches tout au long, des années 1990 et elles expriment la contre tendance au reflux général. Mais leur manque de toute dimension politique claire a été appréhendé par la bourgeoisie pour aggraver le désarroi dans la classe. Une carte particulièrement importante dans les années 1990 a été la venue au pouvoir de gouvernements de gauche, à même de donner une énorme impulsion à l'arsenal bourgeois d'idéologies démocratiques et réformistes ; en plus de cela, les syndicats ont organisé de nombreuses actions préventives pour endiguer le mécontentement croissant dans la classe. Les plus spectaculaires ont été les grèves de décembre 1995 en France, qui avaient même l'apparence de dépasser les syndicats et de s'unifier à la base, en fait pour empecher que cela se passe vraiment. Depuis lors, les campagnes syndicales ont été plus limitées, en concordance avec la désorientation de la classe, mais un retour à des réponses plus combatives peut être discerné aujourd'hui dans des exemples comme les grèves dans le secteur public annoncées ou menaçantes en GrandeBretagne, en France, en Espagne, en Allemagne et ailleurs.
27. Lc marxisme a toujours insisté sur le fait qu'il ne suffisait pas d'observer la lutte de classe seulement sous l'angle de ce que fait le prolétariat : puisque la bourgeoisie aussi mène une lutte de clase contre le prolétariat et sa prise de conscience, un élément clé de l'activité marxiste a toujours été d'examiner la stratégie et la tactique de la classe dominante pour devancer son ennemi mortel. Une part importante de cette activité est d'analyser quelles équipes gouvernementales la bourgeoisie tend à mettre en avant en réponse à différents moments de l'évolution de la lutte de classe et de la crise générale de la société.
28. Comme le CCI l'avait noté dans la première phase de son existence, la réponse initiale de la classe dominante au ressurgissement historique de la lutte de classe à la fin des années 1960 a été de placer des gouvernements de gauche au pouvoir ou de dévoyer les luttes ouvrières en leur présentant la perspective mystificatrice de gouvernements de gauche. Ensuite, à la fin des années 1970, nous avons vu qu'en réponse à la seconde vague internationale de luttes, la bourgeoisie avait adopté une nouvelle stratégie dans laquelle la droite revenait au gouvernement et la gauche entrait dans l'opposition afin de saboter de l'intérieur la résistance des ouvriers. Bien qu'elle n'ait jamais été appliquée de façon mécanique dans tous les pays, cette stratégie était néanmoins très claire dans les pays capitalistes les plus importants.
Après l'effondrement du bloc de l'Est, cependant, étant donné le recul de la conscience dans la classe ouvrière, il n'y avait plus le même besoin d'adopter cette ligne, et dans un certain nombre de pays, des gouvernements de centre-gauche, personnifiés par le régime de BLair en GrandeBretagne, furent favorisés comme étant la meilleure formule, par rapport à la fois à la crise économique et à la nécessité de présenter la fuite actuelle du capitalisme dans le militarisme comme une nouvelle forme d"'humanitaire".
La récente accession de partis de droite aux responsabilités gouvernementales ne signifie cependant pas que la classe dominante serait en train d'adopter une stratégie concertée de gauche dans l'opposition. L'arrivée de gouvernements de droite dans un certain nombre de pays capitalistes centraux est plus l'expression du manque de cohérence au sein des bourgeoisies nationales et entre bourgeoisies nationales, laquelle est une des conséquences de la décomposition. Il faudrait une grande avancée dans la lutte de classe pour que la bourgeoisie surmonte ces divisions et impose une réponse plus unifiée : retourner à la stratégie de la gauche dans l'opposition pour faire face à une sérieuse résurgence du mouvement de classe, et, comme carte ultime, la mise en place d'une "extreme-gauche" au pouvoir dans le cas d'une menace directement révolutionnaire de la part de la classe ouvrière.
29. Même si le développement essentiel des luttes ouvrières ne sera pas une réponse directe à la guerre, les révolutionnaires se doivent d'être attentifs aux réponses de classe qui surgissent, gardant à l'esprit le fait que la question de la guerre deviendra de plus en plus un facteur du développement de la conscience politique sur les véritables enjeux de la lutte de classe, en particulier du fait que le développement de l'économie de guerre requerra de plus en plus de sacrifices dans les conditions de vie de la classe ouvrière. Ce lien grandissant entre la crise et la guerre s'exprimera en premier lieu par la formation de minorités visant à apporter une réponse internationaliste à la guerre, mais cela s'étendra aussi au mouvement plus général à mesure que la classe retrouvera sa confiance en elle et ne verra plus les guerres organisées par la classe dominante comme une preuve de sa seule impuissance.
30. La nouvelle génération "d'éléments en recherehe", la minorité s'approchant des positions de classe, aura un rôle d'une importance sans précédent dans les futurs combats de la classe, qui seront confrontées à leurs implications politiques beaucoup plus vite et profondément que les luttes de 1968-1989. Ces éléments, qui expriment déjà un développement lent mais significatif de la conscience en profondeur, seront mis à contribution pour aider à l'extension massive de la conscience dans toute la classe. Ce processus culminera dans la formation du parti communiste mondial. Mais cela ne deviendra réalité que si les groupes de la Gauche conununiste se montrent à la hauteur de leurs responsabilités historiques. Aujourd'hui en particulier, cela signifie affronter les dangers qui les guettent. De même que pour la classe toute démission face à la logique de la décomposition ne peut que la priver de sa capacité à répondre à la crise à laquelle l'humanité est confrontée, de la même manière, la minorité révolutionnaire elle-même risque d'être terrassée et détruite par l'ambiance putride qui l'entoure, et qui pénètre dans ses rangs sous la forme du parasitisme, de l'opportunisme, du sectarisme et de la confusion théorique. Les révolutionnaires aujourd'hui peuvent avoir confiance dans les capacités intactes de leur classe et aussi dans la capacité du milieu révolutionnaire à répondre aux exigences que l'histoire place sur ses épaules. Ils savent qu'ils doivent conserver une vision à long terme de leur travail et éviter tous les pièges immédiatistes. Mais en même temps, ils doivent comprendre que nous n'avons pas un temps illimité devant nous, et que les erreurs graves commises aujourd'hui constituent déjà un obstacle à la future formation du parti de classe.
Vie du CCI:
Notes sur l'histoire de la politique étrangère des Etats-Unis depuis la deuxième guerre mondiale
- 7668 reads
Le monde a fait du chemin depuis la disparition de la division du monde en deux pôles qui a caractérisé la Guerre froide pendant 45 ans. L’ère de paix, de prospérité et de démocratie que la bourgeoisie mondiale avait promise, au lendemain de l’effondrement du bloc de l’Est en 1989, n’a évidemment jamais vu le jour. Au contraire, la décomposition de la société capitaliste qui était la conséquence du blocage du rapport de force entre la bourgeoisie et le prolétariat après deux décennies de crise économique ouverte et qui a déclenché l’effondrement du stalinisme, s’est implacablement aggravée entraînant l’humanité dans une spirale infernale d’enfoncement dans le chaos, la violence et la destruction, vers un avenir de barbarie de plus en plus proche. Au moment où nous écrivons cet article, le président George W. Bush vient d’annoncer que les Etats-Unis étaient prêts à envahir l’Irak, avec ou sans soutien international et même sans l’accord du Conseil de sécurité. La brèche qui existe entre Washington et les capitales des principaux pays européens, et même avec la Chine, sur la question de cette guerre imminente est palpable. Dans ce contexte, il est tout à fait approprié d’examiner les racines de la politique impérialiste américaine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, afin de mieux comprendre la situation actuelle.
Lorsque la Deuxième Guerre impérialiste mondiale s'achève en 1945, l’ensemble de la configuration impérialiste s’est profondément transformée. "Avant la Deuxième Guerre mondiale, il existait 6 grandes puissances : la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Union soviétique, le Japon et les Etats-Unis. A la fin de la guerre, les Etats-Unis restaient la seule grande nation de loin la plus puissante du monde ; sa puissance s’était énormément accrue grâce à sa mobilisation dans l’effort de guerre, à la défaite de ses rivaux et à l’épuisement de ses alliés" (D.S. Painter, Encyclopedia of US Foreign Policy). La guerre impérialiste "avait détruit l’ancien équilibre entre les puissances, laissant l’Allemagne et le Japon anéantis et impuissants, la Grande Bretagne et la France réduites au rang de puissances de second et même de troisième ordre" (George C. Herring, Encyclopedia of American Foreign Policy).
Pendant la guerre, les Etats-Unis, avec plus de 12 millions d’hommes sous les drapeaux, ont doublé leur produit national brut (PNB) et à la fin de la guerre, ils détenaient "la moitié de la capacité manufacturière du monde, la plus grande partie de ses surplus en nourriture et la quasi-totalité de ses réserves financières. Les Etats-Unis occupaient la première place dans toute une série de technologies essentielles à la guerre moderne et à la prospérité économique. La possession de grandes réserves intérieures de pétrole et le contrôle sur les vastes ressources de pétrole de l’Amérique Latine et du Moyen-Orient contribuaient à la position dominante globale des Etats-Unis" (Painter, op. cit.). L’Amérique possédait la plus grande puissance militaire du monde. Sa force navale dominait les mers, ses forces aériennes le ciel, son armée occupait le Japon et une partie de l’Allemagne, et elle bénéficiait du monopole des armes atomiques dont elle avait montré, à Hiroshima et Nagasaki, qu’elle n’hésiterait pas à se servir pour la défense de ses intérêts impérialistes. La puissance de l’Amérique était favorisée par les avantages dus à sa position géographique d’isolement relatif. Eloigné de l’épicentre des deux guerres mondiales, le territoire américain n’a subi aucune destruction massive de ses moyens de production, contrairement aux nations européennes, et sa population civile a été épargnée de la terreur des raids aériens, des bombardements, des déportations et des camps de concentration qui ont provoqué la mort de millions de civils en Europe (plus de 20 millions rien qu’en Russie).
La Russie dévastée par la guerre a compté peut-être jusqu’à 27 millions de morts, civils et militaires, subi une destruction massive de sa capacité industrielle, de son agriculture, de ses ressources minières, et de l'infrastructure de son réseau de transports. Son niveau de développement économique atteignait à peine le quart de celui des Etats-Unis. Mais elle a grandement bénéficié de la destruction totale de l’Allemagne et du Japon, deux pays qui avaient historiquement freiné l’expansion russe, respectivement vers l’Ouest et vers l’Est. La Grande-Bretagne était saignée à blanc après six années de mobilisation dans la guerre. Elle avait perdu un quart de ses richesses d’avant-guerre, était profondément endettée et "courait le risque de perdre son rang de grande puissance" (ibid). La France, vaincue avec facilité au début de la guerre, affaiblie par l’occupation allemande et divisée par la collaboration avec les forces d’occupation allemandes, "ne comptait plus désormais comme grande puissance" (Painter, op. cit.).
Avant même la fin de la guerre, la bourgeoisie américaine s’apprêtait déjà à former un bloc militaire en prévision de la future confrontation avec la Russie stalinienne. Par exemple, des commentateurs bourgeois ont estimé que la guerre civile en Grèce en 1944 (Painter, Herring) annonçait déjà la future confrontation entre les Etats-Unis et la Russie. On peut voir cette préoccupation envers une future confrontation à l’impérialisme russe dans les chamailleries et les retards qui se sont produits sur la question de l’invasion de l’Europe par les Alliés, en vue de soulager la pression exercée sur la Russie par l’ouverture d’un second front à l’Ouest. Au départ, Roosevelt avait promis un débarquement en 1942 ou début 1943, mais il n’a pas eu lieu avant 1944. Les russes se sont plaints du fait que les Alliés "ont délibérément retenu leurs secours afin d’affaiblir l’Union soviétique ce qui leur permettrait ainsi de dicter les termes de la paix" (Herring, op.cit). C’est la même préoccupation qui explique également l’utilisation des armes atomiques contre le Japon en août 1945, alors même que ce pays avait donné des signes de sa volonté de capitulation négociée ; cela avait pour but d'abord de gagner la guerre avant que l’impérialisme russe ne puisse entrer en guerre à l’Est et revendiquer des territoires et de l’influence dans la région et ensuite de servir d’avertissement aux russes sur la véritable force de la puissance militaire américaine au moment où se profilait le début de l’après-guerre.
Cependant, si les Etats-Unis prévoyaient une confrontation avec Moscou dans l’après-guerre, il serait faux de prétendre qu’ils avaient une compréhension complète ou précise des contours exacts de cette compétition ainsi que des desseins impérialistes de Moscou. Roosevelt notamment semblait conserver encore des conceptions dépassées du 19e siècle concernant les sphères d’influence impérialistes et comptait sur une coopération de la Russie pour construire un nouvel ordre mondial dans la période d’après-guerre dans lequel Moscou aurait un rôle de subordonné (Painter, op cit.). En ce sens, Roosevelt pensait apparemment que l’attribution à Staline d'une zone tampon en Europe de l’Est servant de protection contre l’adversaire historique de la Russie, l’Allemagne, satisferait les appétits impérialistes russes. Cependant, même à Yalta où la plus grande partie de ce cadre fut établi, il y eut des conflits sur la participation des britanniques et des américains à l’avenir des nations d’Europe de l’Est, de la Pologne en particulier.
Dans les 18 mois qui ont suivi la fin de la guerre, le président américain Truman s’est trouvé face à une image bien plus alarmante de l’expansionisme russe. L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie avaient déjà été absorbées par la Russie dès la fin de la guerre, des gouvernements fantoches avaient été établis en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie et dans la partie de l’Allemagne contrôlée par les forces russes. En 1946, la Russie retarda son retrait de l’Iran, y soutint les forces dissidentes et chercha à arracher des concessions pétrolières. Des pressions furent exercées sur la Turquie pour obtenir un plus grand accès de la Russie à la Mer Noire et, après son échec aux élections, le parti stalinien grec, sous l'influence directe du Kremlin, adopta une stratégie qui fit repartir la guerre civile en Grèce. Aux Nations Unies, Moscou rejeta un plan américain sur le contrôle des armes atomiques qui aurait donné aux Etats-Unis le droit de maintenir son monopole nucléaire, révélant ainsi ses propres projets de s’engager dans la course aux armements nucléaires.
En février 1946, George Keenan, jeune expert du département d’Etat en poste à Moscou, rédiga son fameux "long télégramme" qui présentait la Russie comme un ennemi "irréductible", enclin à une politique expansionniste pour étendre son influence et sa puissance, qui est devenu la base de la politique de Guerre froide américaine. L’alarme sonnée par Keenan semblait se confirmer par l’influence croissante de Moscou dans le monde. Les partis staliniens en France, en Italie, en Grèce et au Vietnam semblaient avoir des prétentions à prendre le pouvoir. Les nations européennes subissaient une énorme pression pour décoloniser leurs empires d’avant-guerre, en particulier au Proche-Orient et en Asie. L’administration Truman adopta une stratégie d’endiguement pour bloquer toute nouvelle avancée de la puissance russe.
L’endiguement du ‘communisme’
Dans l’immédiat après-guerre, le principal objectif stratégique de l’impérialisme américain était la défense de l’Europe, afin d’éviter que des nations autres que celles déjà affidées à l’impérialisme russe à Yalta, ne tombent aux mains du stalinisme. Cette doctrine fut appelée "containment" (endiguement) et avait pour objectif de résister à l’extension des tentacules de l’impérialisme russe en Europe et au Proche-Orient. Cette doctrine apparut comme une contre-mesure à l’offensive d’après-guerre de l’impérialisme russe. En 1945/46, l’impérialisme russe commença à revendiquer agressivement deux théâtres d’intérêt traditionnels de la Russie, l’Europe de l’Est et le Proche-Orient, ce qui alarma Washington. En Pologne, Moscou ne respecta pas les garanties d’élections "libres" établies à Yalta et imposa un régime fantoche ; la guerre civile en Grèce se ranima, les pressions s’exacerbèrent en Turquie et Moscou refusa de retirer ses troupes du nord de l’Iran. En même temps, l’Allemagne et l’Europe de l’Ouest étaient toujours dans une confusion économique totale, faisaient des efforts pour entreprendre la reconstruction et pour négocier le règlement formel de la guerre, ce règlement étant paralysé en raison de chamailleries entre les grandes puissances, et les partis staliniens conquéraient une formidable influence dans les pays dévastés de l’Europe de l’Ouest, en particulier en France et en Italie. L’Allemagne vaincue constituait un autre point majeur de confrontation. L’impérialisme russe demanda des réparations et des garanties afin qu’une Allemagne reconstruite ne constitue jamais à nouveau une menace.
Afin de contenir l’expansion du "communisme" russe, l’administration Truman répondit en 1946 en soutenant le régime iranien contre la Russie, en assumant les responsabilités prises en charge auparavant par les britanniques dans l’Est méditerranéen, en fournissant une aide militaire massive à la Turquie et à la Grèce début 1947, en mettant en place le Plan Marshall en juin 1947 pour avoir la mainmise politique sur la reconstruction de l’Europe de l’Ouest. Bien qu’il ne s’agisse pas dans cet article d’entrer dans les détails sur la nature et les mécanismes qu’impliquait la revitalisation de l’Europe occidentale, il est important de comprendre que l’aide économique constituait un facteur essentiel pour combattre l’influence russe et un rempart contre celle-ci. L’aide économique était complétée par une politique d’encouragement à la constitution d’organisations et d’institutions pro-occidentales (pro-Washington),de création de syndicats et d’organisations politiques anti-communistes, les exécutants de l’AFL travaillant main dans la main avec la CIA pour faire de l’Europe de l’Ouest un terrain sûr pour le capitalisme américain. Le syndicat Force Ouvrière en France et la revue de gauche New statesman en Grande Bretagne sont deux exemples connus de la façon dont l’Amérique arrosait d’argent les non-communistes dans l’Europe d’après guerre. "L’assistance américaine a permis à des gouvernements modérés de dédier des ressources énormes à la reconstruction et à l’expansion des exportations de leurs pays sans imposer les programmes d’austérité politiquement inacceptables et socialement explosifs qui auraient été nécessaires sans l’aide américaine. L’aide américaine a également contribué à contrecarrer ce que les dirigeants américains considéraient comme un éloignement dangereux de la libre entreprise vers le collectivisme. En favorisant certaines politiques et en s’opposant à d’autres, les Etats-Unis non seulement influençaient la façon dont les élites européennes et japonaises définissaient leurs propres intérêts, mais changeaient également le rapport de forces dans les groupes de décisions. La politiques américaine d’aide facilitait la montée des partis centristes comme les Chrétiens-Démocrates en Italie et en Allemagne de l’Ouest et le Parti Libéral Démocratique plus conservateur au Japon" (Painter, op.cit).
3. La revitalisation économique de l’Europe de l’Ouest fut rapidement suivie de la fondation de l’OTAN qui, à son tour, poussa le rival impérialiste russe à cristalliser la dépendance de ses vassaux européens dans une autre alliance militaire: le Pacte de Varsovie. C’est à partir de là que fut établie la confrontation stratégique qui allait prévaloir en Europe jusqu’à l’effondrement du stalinisme à la fin des années 1980. Malgré le fait que les deux pactes militaires fussent supposés être des alliances de sécurité mutuelle, ils étaient tous deux en réalité totalement dominés par le leader du bloc.
La création d’un ordre mondial bipolaire
Malgré les affrontements décrits ci-dessus, la création d’un monde impérialiste bipolaire qui caractérisa la Guerre froide n’apparut pas instantanément à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien que les Etats-Unis fussent clairement le leader dominant, la France, la Grande-Bretagne et d’autres puissances européennes avaient encore des illusions d’indépendance et de puissance. Tout en parlant en privé de créer un nouvel empire sous leur contrôle, les dirigeants politiques américains maintenaient en public la fiction d’une coopération mutuelle et d’un partenariat avec l’Europe de l’Ouest. Par exemple, quatre sommets avec les chefs d’Etats des Etats-Unis, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la France se sont tenus durant les années 1950, pour finalement tomber dans le néant au fur et à mesure que l’impérialisme américain consolidait sa domination. A partir des années 1960 jusqu’à la fin de la Guerre froide, les sommets se limitèrent uniquement aux Etats-Unis et à la Russie, les "partenaires" européens étant souvent exclus même des consultations préparatoires aux rencontres.
Après la guerre, la Grande-Bretagne était la troisième puissance mondiale – troisième assez loin des premières – mais dans les premiers jours de la Guerre froide, il existait une tendance à surestimer nettement les capacités britanniques. Il subsistait des restes de rivalités impérialistes entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne, et peut-être même une tendance à vouloir utiliser la Russie pour contrebalancer les Britanniques et, en même temps, la croyance qu’on pouvait compter sur la Grande-Bretagne pour défendre la ligne de front européenne contre l’expansionnisme russe. En ce sens, c’est à la Grande Bretagne que fut dévolue la responsabilité de bloquer les russes en Grèce, en tant que puissance européenne dominante en Méditerrannée orientale. Cependant, ce fut un rude réveil en 1947, lorsque les britanniques durent appeler les Etats-Unis à la rescousse. Il fallut donc un certain temps aux Etats-Unis pour voir plus clairement le rôle précis qu’ils allaient devoir jouer en Europe et pour que la division bipolaire du monde apparaisse.
Malgré leur énorme importance économique et militaire, les pays européens furent amenés de force et malgré leurs protestations à se soumettre à la volonté de leur maître impérialiste. La pression fut mise sur les puissance européennes, peu empressées d’abandonner leurs colonies en Afrique et en Asie, en partie pour les afaiblir et les dépouiller des vestiges de leur glorieux passé impérialiste, en partie pour contrer les avancées russes en Afrique et en Asie, mais aussi pour permettre à l’impérialisme américain d’exercer davantage d’influence dans ces anciennes colonies. Ceci n’empêcha évidemment pas les Européens de tenter de convaincre les Américains de suivre des orientations politiques mutuellement acceptables comme dans le cas, par exemple, où les britanniques cherchèrent à mettre les américains de leur côté dans leur politique envers l’Egypte de Nasser en 1956. Les impérialismes français et britannique, agissant de concert avec Israël, tentèrent le dernier acte ouvert d’impérialisme indépendant en jouant leur propre carte dans la crise de Suez de 1956, mais les Etats-Unis montrèrent aux Britanniques qu’ils ne se laisseraient pas intimider. La Grande-Bretagne comprit qu’elle ne pouvait pas se permettre de négocier face à une position de force américaine en s’exposant à une action disciplinaire rapide de la part des Etats-Unis. La France en revanche chercha obstinément à maintenir l’illusion de son indépendance vis-à-vis de la domination américaine en retirant ses troupes du commandement de l’OTAN en 1966 et en insistant pour que toute représentation de l’OTAN soient retirée du territoire français dès 1967.
L’unité et la continuité de la politique impérialiste américainependant la Guerre Froide
L’isolationnisme, en tant que courant politique sérieux au sein de la classe dominante américaine, fut complètement neutralisé par les événements de Pearl Harbor, en 1941, utilisés et même provoqués par Roosevelt pour forcer les isolationnistes, ainsi que les éléments pro-allemands au sein de la bourgeoisie américaine à abandonner leurs positions. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les points de vue isolationnistes au sein de la bourgeoisie ont été essentiellement confinés à l’extrême-droite et ne constituent plus une force sérieuse dans la définition de la politique étrangère. Il est clair que la Guerre froide contre la Russie fut une politique unie de la bourgeoisie. Les divergences qui apparurent étaient en grande partie pour la galerie du jeu démocratique, à l’exception des divergences autour de la guerre du Vietnam après 1968 qui seront abordées plus loin. La Guerre froide débuta sous Truman, le démocrate qui arriva au pouvoir à la mort de Roosevelt en 1945. Ce fut Truman qui décida de lancer la bombe atomique, qui entreprit les efforts pour bloquer l’impérialisme russe en Europe et au Moyen-Orient, qui promut le Plan Marshall, qui décida le pont aérien de Berlin, qui créa l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et qui engagea les troupes américaines dans la guerre deCorée.
Lors de la campagne électorale de 1952, il est vrai que les républicains conservateurs critiquèrent la politique d’endiguement de Truman comme une concession au "communisme", une forme d’apaisement qui, implicitement ou explicitement, acceptait la domination russe sur des pays déjà sous leur influence ou leur contrôle et s’opposait seulement à l’expansion de la Russie à de nouveaux pays. A la place de cette politique, ces conservateurs revendiquaient le "rollback", une politique consistant à repousser de façon active l’impérialisme russe à l’intérieur de ses propres frontières. Mais malgré le fait que le conservateur Eisenhower soit arrivé au pouvoir en 1952 et y soit resté pendant le point culminant de la Guerre froide en Europe, dans les années 1950, jamais aucune tentative de "rollback" ne fut entreprise par l’impérialisme américain. Il mena toujours une politique d’endiguement. Ainsi, en 1956, lors du soulèvement de la Hongrie, l’impérialisme américain n’intervint pas, sauf à titre de propagande, reconnaissant de facto les prérogatives de la Russie d'écraser la rébellion dans sa propre sphère d’influence. D’un autre côté, sous Eisenhower, l’impérialisme américain poursuivit clairement la stratégie d’endiguement, se glissant dans la brèche en Indochine à la suite de la défaite de l’impérialisme français dans la région en sapant les accords de Genève afin de prévenir une éventuelle unification du Vietnam par le soutien du régime du sud ; maintenant la division de la Corée en faisant de la Corée du Sud une vitrine pour le capitalisme occidental en Extrême-Orient ; et en s’opposant au régime de Fidel Castro et à son ouverture vers Moscou. On peut constater la continuité de cette politique dans le fait que c’est l’Administration du républicain conservateur Eisenhower qui prépara l’invasion de la Baie des Cochons, mais que c'est l’administration du démocrate libéral Kennedy qui la mit en œuvre..
C'est le démocrate libéral Johnson qui fut le premier en 1966 à développer la notion de "détente" - il appelait cela "jeter des ponts" et "s’engager pacifiquement", mais ce fut le conservateur Nixon, un républicain, avec Henry Kissinger à ses côtés, qui présida à l’éclosion de la détente dans les années 1970. Et ce fut le démocrate Carter et non Reagan qui engagea le processus de démantèlement de la détente et de réactivation de la Guerre froide. Carter fit des droits de l’homme lapierre angulaire de sa politique étrangère ce qui, tout en imposant certains changements dans les dictatures militaires dépassées qui dominaient l’Amérique latine, refroidit aussi les rapports avec Moscou et relança la propagande anti-russe. En 1977, l’OTAN adopta les propositions de Carter : 1) la détente avec Moscou devait reposer sur une position de force (sur la base du rapport Harmel adopté en 1967) ; 2) un accord de standardisation de l’équipement militaire au sein de l’OTAN, et une plus grande intégration des forces de l’OTAN au niveau opérationnel ; 3) la réactivation de la course aux armements qui allait être connue sous le nom de Programme de Défense à Long Terme (LTDP) et débuta par un appel à renforcer l’armement conventionnel dans les pays de l’OTAN. En réponse à l’invasion russe de l’Afghanistan en 1979, Carter adopta une nouvelle orientation de Guerre froide qui fondamentalement mettait fin à la détente, refusant de soumettre le traité SALT II au Sénat pour ratification et organisant le boycott des Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. En décembre 1979, sous l'autorité de Carter, l’OTAN adopta une stratégie de réarmement à "double piste" - négocier avec Moscou pour réduire ou éliminer les missiles nucléaires SS20 de portée intermédiaire dirigés vers l’Europe occidentale avant 1983 mais, dans le même temps, préparer le déploiement de missiles américains équivalents (464 missiles de croisière en Grande Bretagne, en Hollande, en Belgique et en Italie et 108 Pershing en Allemagne de l’Ouest) dans l’éventualité où l’accord avec Moscou ne serait pas obtenu.
En ce sens, le soutien de Reagan aux Moudjahidin en Afghanistan, l’accélération de la course aux armements et le déploiement de missiles de portée intermédiaire en Europe en 1983-84 qui provoqua tant de protestations sur ce continent, n'étaient nullement en rupture mais en totale continuité avec les initiatives politiques américaines entreprises sous Carter. L’objectif stratégique d’empêcher l’apparition d’une puissance rivale en Asie ou en Europe capable de défier les Etats-Unis fut développé à la fin de la première administration Bush, continua sous Clinton et est maintenant au cœur de la politique de Bush fils. Même la guerre tant vantée contre Oussama Ben Laden et Al Qaïda lancée par l’Administration Bush après le 11 septembre 2001, est en continuité avec la politique commencée sous l’administration Clinton, même si elle s’élève à un degré supérieur dans la guerre ouverte, ayant comme but prioritaire d’établir et de solidifier la présence américaine en Asie centrale. De même, la nécessité pour l’impérialisme américain d’être prêt à une action unilatérale militaire fut développée sous Clinton et mise en œuvre par le gouvernement Bush actuel. La continuité fondamentale dans la politique impérialiste américaine est un reflet de la caractéristique centrale du capitalisme d’Etat dans le capitalisme décadent, où c’est la bureaucratie permanente, et non le pouvoir législatif, qui est le lieu du pouvoir politique. Il ne s’agit pas bien sûr de nier qu’il y a parfois des divergences au sein de la bourgeoisie américaine qui se trouvent en contraste tranchant avec l’unité générale. Les deux exemples les plus flagrants sont le Vietnam, et la politique chinoise à la fin des années 90 qui conduisit à l’impeachment de Clinton, deux exemples qui seront examinés plus loin.
La Guerre de Corée: la stratégie d’endiguement en action en Extrême Orient
Alors que les tensions Est-Ouest en Europe de l’Ouest, particulièrement en Allemagne et à Berlin, et au Proche-Orient, avaient préoccupé les stratèges de la politique impérialiste américaine dans l’immédiat après-guerre, les événements en Extrême-Orient ne tardèrent pas à tirer le signal d’alarme. Avec un gouvernement militaire américain en place au Japon et un régime nationaliste ami en Chine qui était aussi membre permanent du Conseil de Sécurité, les Etats-Unis avaient prévu d’avoir un rôle dominant en Extrême-Orient. La chute du régime nationaliste en Chine en 1949 vit se dresser le spectre d’un expansionnisme russe en Extrême-Orient. Même si Moscou avait pourtant fait de son mieux pour contre carrer le leadership de Mao durant les années de guerre, et avait une relation active avec les nationalistes, Washington craignait un rapprochement entre Moscou et Pékin, véritable défi aux intérêts américains dans la région. Le blocage de la tentative de Moscou d’imposer la reconnaissance par l’ONU de la Chine rouge en son sein, amena Moscou à quitter le Conseil de Sécurité et à le boycotter pendant sept mois, jusqu’en août 1950.
Le boycott du Conseil de Sécurité par Moscou allait avoir un profond impact en juin 1950, quand les forces nord-coréennes envahirent la Corée du Sud. Truman ordonna immédiatement la mobilisation des forces américaines pour défendre le régime pro-occidental de Corée du Sud, une semaine avant qu’ait lieu un vote du Conseil de Sécurité autorisant une action militaire sous le commandement des Etats-Unis - ce qui montre que la prédisposition à l’action unilatérale de la part de la bourgeoisie américaine n’est pas une invention récente. Non seulement les troupes américaines s’engagèrent dans la bataille avant que l’ONU ne donne son autorisation, mais même après que cela fut devenu une opération sous l’égide de l’ONU et que 16 autres nations envoient des forces pour participer à "l’action de police", le commandement américain rendit des comptes directement à Washington, et non à l’ONU. Si Moscou avait été présent au Conseil de Sécurité, il aurait pu exercer son droit de veto pour bloquer une intervention militaire de l’ONU, jouant ainsi une avant-première de la pièce à laquelle nous avons assisté ces derniers mois montrant à quel point la bourgeoisie américain est prête à s’engager seule pour défendre ses intérêts impérialistes.
Certains analystes bourgeois suggèrent que le boycott russe était en fait motivé par le souhait d’éviter la possibilité que le régime de Mao ne soit accepté prématurément par les Nations Unies à travers un nouveau vote et de gagner du temps pour cimenter les relations entre Moscou et Pékin. Zbigniew Brzezinski a même affirmé qu’il s’agissait d’"un calcul délibéré en vue de stimuler l’hostilité entre l’Amérique et la Chine… l’orientation américaine prédominante avant la guerre de Corée était de chercher un accord avec le nouveau gouvernement du territoire chinois. De toutes façons, Staline ne pouvait que bien accueillir toute occasion de stimuler un conflit entre l’Amérique et la Chine et à juste titre. Les 20 années d’hostilité entre l’Amérique et la Chine qui ont suivi, ont certainement constitué un bénéfice net pour l’Union soviétique" ("How the Cold War was Played", Foreign Affairs, 1972).
La crise des missiles cubains: au bord de la guerre nucléaire
Le renversement par Fidel Castro, en 1959, du dictateur soutenu par les Américains a posé un sérieux dilemme dans la confrontation bipolaire de la Guerre froide et a amené les superpuissances au bord de la guerre nucléaire pendant la crise des missiles cubains, en octobre 1962. Au départ, le caractère de la révolution castriste n’était pas clair. Drapé dans une idéologie de populisme démocratique, à la sauce romantique des guérillas, Castro n’était pas membre du parti stalinien et ses liens avec ce dernier étaient très ténus. Cependant, sa politique de nationalisation des biens américains dès le début de sa prise du pouvoir lui aliénèrent rapidement Washington. L’animosité de Washington ne fit que pousser Castro, à la recherche d’une aide étrangère et d’une assistance militaire, dans les bras de Moscou. L’invasion de la Baie des Cochons en avril 1961, soutenue par la CIA – prévue par Eisenhower au départ et mise en œuvre par Kennedy – a montré queWashington était prêt à renverser le régime soutenu par les Russes. Pour les Etats-Unis, l’existence de ce régime lié à Moscou dans son pré carré était intolérable. Depuis la Doctrine Monroe formulée en 1823, les Etats-Unis avaient toujours maintenu la position selon laquelle les pays d’Amérique étaient hors de portée des impérialismes européens. Voir l’impérialisme adverse de la Guerre froide établir une tête de pont à 150 km du territoire américain de Floride, était totalement inacceptable pour Washington.
Fin 1962, Castro et l'impérialisme russe s’attendaient à une invasion imminente des américains et, en fait, à l’instigation de Robert Kennedy, Washington avait engagé en novembre 1961 l’opération Mongoose qui prévoyait des opérations militaires contre Cubà la mi-octobre1962, inspirées par les Américains et menées au nom de l’Organisation des Etats américains pour en exclure Cuba et interdire la vente d’armes à Castro. "le 1er octobre, le secrétaire à la Défense, Robert Mc Namara ordonne des préparatifs militaires pour un blocus, des attaques aériennes, une invasion ‘avec le maximum de préparation’ afin que ces deux dernières actions soient achevées le 20 octobre". (B.J. Bernstein, Encyclopedia of US Foreign relations). Au même moment, les Etats-Unis avaient installé 15 missiles Jupiter en Turquie, près de la frontière sud de la Russie, ciblant des objectifs en Russie, ce que Moscou estimait inacceptable.
Moscou chercha à contrecarrer ces deux menaces à travers une mesure : le déploiement de missiles nucléaires à Cuba pointés sur les Etats-Unis. L’administration Kennedy fit une estimation erronée des intentions de Moscou et considéra le déploiement de missiles comme une action offensive et non défensive ; elle réclama le démantèlement immédiat et le retrait des missiles déjà déployés et que les autres missiles en route pour Cuba retournent en Russie. Comme le blocus des eaux cubaines aurait été un acte de guerre selon la loi internationale, l’administration Kennedy annonça la "mise en quarantaine" des eaux cubaines et se prépara à arrêter sur les hautes mers et les eaux internationales les bateaux russes soupçonnés de transporter des missiles. Toute la crise se déroula en plein milieu des élections au Congrès de novembre 1962 où apparemment Kennedy avait peur que la droite républicaine ne remporte un triomphe s’il apparaissait en position de faiblesse dans sa confrontation avec Khrouchtchev, bien qu’il soit difficile de croire, comme le proclament certains historiens, que Kennedy ait plus été motivé par des considérations de politique intérieure que par la stratégie de défense et la politique extérieure. Après tout, à cause de la proximité des Etats-Unis, les missiles russes de Cuba accroissaient de 50% la capacité de Moscou de frapper le continent américain avec des têtes nucléaires, ce qui constituait un changement majeur dans l’équilibre de la terreur de la Guerre froide. Dans ce contexte, l’Administration alla très loin et amena le monde au bord d’une confrontation nucléaire directe, en particulier lorsque les Russes abattirent un avion espion U2 en plein milieu de la crise, déclenchant la demande par les chefs d’Etat major d’attaquer immédiatement Cuba. A un moment, Robert Kennedy "suggéra qu’il fallait chercher un prétexte ‘Couler Le Maine ou quelque chose comme ça’ et entrer en guerre contre les Soviétiques"[i] (1). Mieux vaut maintenant que plus tard, conclut-il" (Bernstein). Finalement on parvint à un accord secret avec Khrouchtchev, les Américains offrant de retirer en secret les missiles Jupiter de Turquie contre le retrait des missiles russes de Cuba. Comme la concession faite par les américains fut gardée secrète, Kennedy put revendiquer une victoire totale pour avoir forcé Khrouchtchev à reculer. Il se peut que l’énorme coup de propagande des Américains ait sévèrement sapé l’autorité de Khrouchtchev dans les cercles dirigeants russes et contribué à son retrait peu de temps après. Les membres du cercle le plus proche de Kennedy ont maintenu cette histoire pendant presque deux décennies ; on la trouve dans leurs divers Mémoires. Ce n’est que dans les années 1980 que les faits concernant la crise des missiles cubains et l’accord secret qui y avait mis un terme, furent révélés (Bernstein, op. cit.). Dégrisés d’être arrivés si près d’une guerre nucléaire, Moscou et Washington se mirent d’accord pour établir une "ligne rouge" de communication entre la Maison Blanche et le Kremlin et sur un traité d’interdiction des essais nucléaires, et se concentrèrent plus sur les confrontations par procuration pendant la suite de la Guerre froide.
Les guerres par procuration pendant la Guerre Froide
Pendant toute la Guerre froide, les bourgeoisies américaines et russes ne se sont jamais affrontées directement dans des conflits armés, mais à travers une série de conflits par procuration, confinés aux pays périphériques, n’impliquant jamais les métropoles du monde capitaliste, ne constituant jamais un danger de spirale incontrôlée dans une guerre nucléaire mondiale, à l’exception de la crise des missiles à Cuba en 1962. Le plus souvent, ces conflits par procuration impliquaient deux puissances intermédiaires, habituellement un gouvernement épaulé par Washington contre un mouvement de libération nationale soutenu par Moscou. Moins fréquemment ces conflits impliquaient soit la Russie soit les Etats-Unis contre un pays intermédiaire soutenu par l’autre, comme les Etats-Unis en Corée ou au Vietnam, ou la Russie contre les Moudjahïdins soutenus et armés par les Etats-Unis en Afghanistan. En général,les insurgés étaient soutenus par le bloc le plus faible (par exemple, les prétendues guerres de libération nationale soutenues par les staliniens pendant la Guerre froide). L’Angola ou l’Afghanistan où les rebelles étaient soutenus par les Etats-Unis, furent de notables exceptions. En général, les avancées obtenues dans ce jeu d’échec macabre de l’impérialisme, par les éléments appuyés par Moscou, entraînaient une réponse plus grande et plus dévastatrice des éléments appuyés par les Etats-Unis, comme par exemple la guerre au Moyen-Orient où Israël repoussa les offensives arabes appuyées par l'impérialisme russe de manière répétée et massive. Malgré les nombreuses luttes de libération qu’elle soutint pendant quatre décennies, la bourgeoisie russe réussit rarement à établir une tête de pont stable au delà de son glacis européen. Différents Etats dans le Tiers monde montèrent les deux blocs l’un contre l’autre, courtisèrent Moscou, en acceptant son soutien militaire, mais n’intégrèrent jamais complètement ou définitivement son orbite. Nulle part l’incapacité des Russes à étendre de manière permanente leur influence ne fut plus flagrante qu’en Amérique Latine où ils ne furent jamais capables d’aller au delà de Cuba. En fait incapable d’étendre le stalinisme en Amérique latine, Cuba fut obligé de répondre à l’aide apportée par les Russes en envoyant des troupes de choc en Angola au service de Moscou.
(A suivre)
JG, février 2003
i En 1898, le USS Maine explosa dans le port de La Havane. Sans chercher à en savoir les raisons, le gouvernement des EU saisit le prétexte pour entrer en guerre contre l’Espagne pour la ‘libération’ du Cuba. Aujourd’hui, la plupart des historiens considère que l’explosion fut accidentelle, le résultat de la mauvaise conception du navire. C’est encore un autre exemple du machiavélisme de la bourgeoisie qui cherche tout le temps des prétextes qu’elle invente même, pour fournir une couverture à ses manoeuvres impérialistes. Voir l’article "Les Tours jumelles et le machiavélisme de la bourgeoisie" dans la Revue internationale n°108.
Géographique:
- Etats-Unis [66]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [52]
A propos du film "Le Pianiste" de Polanski. Nazisme et démocratie : tous coupables du massacre des juifs
- 11090 reads
Il y a 60 ans avait lieu la révolte du ghetto de Varsovie ; et, ironie de l'histoire, exactement 100 ans auparavant, en 1843, Karl Marx publiait La question juive, texte qui marquait de façon significative l'évolution de Marx de la démocratie radicale vers le communisme. Nous reviendrons sur ce texte dans un autre article ; il suffit de dire ici que tout en soutenant l'abolition de toutes les contraintes féodales imposées aux juifs dans leur participation à la société civile, Marx soulignait les limites inhérentes à une émancipation uniquement "politique" fondée sur le citoyen atomisé, et montrait que la véritable liberté ne pouvait s'accomplir qu'au niveau social, par la création d'une communauté unifiée qui ait dépassé les rapports marchands, source sous-jacente de la division des hommes en différentes unités en concurrence.
A cette époque, en 1843, le capitalisme ascendant posait de façon immédiate la question d’en finir avec toutes les formes de discrimination féodales contre les juifs, y compris leur enfermement dans le ghetto. En 1943, le peu qui restait des juifs de Varsovie s’est soulevé non seulement contre la restauration du ghetto, mais aussi contre leur extermination physique - tragique expression du passage du capitalisme de sa phase d'ascendance à celle de sa décadence.
En 2003, alors que son déclin arrive à sa phase la plus avancée, il semble que le capitalisme n'ait toujours pas résolu la question juive ; les conflits impérialistes au Moyen-Orient et le resurgissement d'un Islam radical ont redonné vie aux anciens mythes antisémites, et le sionisme qui se présentait comme le libérateur des juifs, non seulement n'a fait qu'enfermer des millions d'entre eux dans un nouveau piège mortel, mais est devenu lui-même une force d'oppression raciale, aujourd'hui dirigée contre la population arabe d'Israël et de Palestine. Nous reviendrons sur ces questions dans d'autres articles.
Mais ici nous voulons examiner une façon de traiter de l'Holocauste, sur le plan artistique, avec le film de Polanski, Le pianiste, qui a récemment reçu beaucoup de louanges, la Palme d'or au Festival de Cannes de 2002, la récompense du meilleur film lors des cérémonies artistiques (BAFTA) de Londres et plusieurs Oscars à Hollywood.
Un holocauste capitaliste
Polanski est lui-même un réfugié du ghetto de Cracovie et il est clair que ce film constitue un prise de position qui a une dimension personnelle. Le pianiste constitue une adaptation remarquablement fidèle des Mémoires d'un survivant du ghetto de Varsovie, le pianiste Vladislav Szpilman, qu'il a écrits immédiatement après la guerre et que Victor Gollanz a récemment republiés en 1999, puis qui sont parus en livre de poche en 2002. Malgré quelques broderies, le scénario se tient très près de la présentation simple et non sentimentale qu’a faite Szpilman des horribles événements qu'il a vécus, parfois jusqu'au plus petit détail. Il nous raconte l'histoire d'une famille juive cultivée qui a décidé de rester vivre à Varsovie au début de la guerre et s'est donc trouvée soumise à la marche forcée, graduelle mais inexorable, vers les chambres à gaz. Commençant par de petites humiliations telles que le décret sur le port de l'Etoile de David, le processus de cette chute traverse toutes les étapes, depuis le moment où toute la population juive de la ville est concentrée dans un ghetto reconstitué dans lequel la majorité connaît des conditions sanitaires et de travail atroces, jusqu'à la mort lente par la faim. Cependant, l'éclosion d'une classe de profiteurs et la formation d'une force de police juive et d'un Conseil juif entièrement soumis à l'armée d'occupation montrent que, même dans le ghetto, les divisions de classe continuaient d'exister parmi les juifs eux-mêmes. Le film comme le livre montrent comment, durant cette période, des actes apparemment aléatoires d'une cruauté incroyable de la part des SS [1] et d'autres organes de la domination nazie, avaient une "rationalité" - celle d'inculquer la terreur et de détruire toute volonté de résistance. En même temps, le côté plus "doux" de la propagande nazie encourage toutes sortes de faux espoirs et sert également à empêcher toute pensée de résistance. C'est illustré de façon aiguë lorsque commence le processus final des déportations et que des milliers de gens sont parqués dans des camions à bétail qui doivent les emmener dans les camps de la mort : pendant qu'ils attendent l'arrivée des trains, ils discutent encore pour savoir s'ils seront exterminés ou utilisés pour travailler ; on dit que de telles discussions eurent lieu aux portes mêmes des chambres à gaz.
Il est certain que l'Holocauste fut un des événements les plus terribles de toute l'histoire de l'humanité. En fait, toute une idéologie ayant avant tout pour but de défendre la Seconde Guerre impérialiste mondiale comme ayant été une guerre "juste", s'est développée à partir du caractère prétendument unique de la Shoah : selon celle-ci, face à une telle monstruosité sans égal, il était certainement nécessaire de soutenir le moindre mal que constituait la démocratie. Des apologistes de gauche de la guerre prétendent même que le nazisme, ayant introduit l'esclavage et étant revenu à des idéologies païennes pré-capitalistes, constituait une sorte de régression par rapport au capitalisme et que, en comparaison, le capitalisme était donc progressiste. Mais ce qui ressort clairement de toute cette période, c'est que l'holocauste nazi contre les juifs n'était pas du tout unique. Non seulement les nazis ont massacré des millions de "sous-hommes", slaves, tziganes, etc. ainsi que des opposants politiques de toutes sortes, bourgeois ou prolétares ; mais leur Holocauste a eu lieu en même temps que l'holocauste stalinien qui ne fut pas moins dévastateur, et que l'holocauste démocratique sous la forme de la terreur des bombardements des villes allemandes, des attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki et de la famine délibérée imposée à la population allemande après la guerre. Le travail esclavagiste non plus n'a pas été caractéristique du nazisme ; le stalinisme en particulier en a fait un usage énorme dans la construction de sa machine de guerre. Il est sûr que tout cela était l'expression d'une dégénérescence extrême du capitalisme, en particulier dans une phase où il avait vaincu la classe ouvrière et avait les mains libres pour se laisser aller à ses pulsions les plus profondes à l'auto-destruction. Mais il existait toujours une logique capitaliste derrière cela, comme le démontre la brochure Auschwitz ou le grand alibi, publiée par le Parti communiste international.
Ayant démasqué la raison matérielle la plus élémentaire derrière le "choix" des juifs par les nazis - la nécessité de sacrifier une partie de la petite-bourgeoisie ruinée pour mobiliser la partie "aryenne" de celle-ci derrière le capital et la guerre - la description par cette brochure de l'économie de l'Holocauste reflète fidèlement les événements du ghetto de Varsovie :
"En temps "normal", et lorsqu'il s'agit d'un petit nombre, le capitalisme peut laisser crever tout seuls les hommes qu'il rejette du processus de production. Mais il lui était impossible de le faire en pleine guerre et pour des millions d'hommes : un tel "désordre" aurait tout paralysé. Il fallait que le capitalisme organise leur mort.
Il ne les a d'ailleurs pas tués tout de suite. Pour commencer, il les a retirés de la circulation, il les a regroupés, concentrés. Et il les a fait travailler en les sous-alimentant, c'est-à-dire en les surexploitant à mort. Tuer l'homme au travail est une vieille méthode du capital. Marx écrivait en 1844 : « Pour être menée avec succès, la lutte industrielle exige de nombreuses armées qu'on peut concentrer en un point et décimer copieusement ». Il fallait bien que ces gens subviennent aux frais de leur vie, tant qu'ils vivaient, et à ceux de leur mort ensuite. Et qu'ils produisent de la plus-value aussi longtemps qu'ils en étaient capables. Car le capitalisme ne peut exécuter les hommes qu'il a condamnés, s'il ne retire du profit de cette mise-à-mort elle-même".
Le soulèvement de Varsovie et l'indifférence des grandes démocraties
Tôt dans le film - on est en septembre 1939 - nous voyons la famille Szpilman écouter la radio annoncer que la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Ils fêtent l'événement car ils pensent que leur délivrance est à portée de main. Au long du film, l'abandon total et complet des juifs de Varsovie et en fait, de la Pologne elle-même, devient de plus en plus évident et les espoirs placés dans les puissances démocratiques s'avèrent totalement sans fondement.
En avril 1943, la population du ghetto est passée de pratiquement un demi million à 30 000, beaucoup de ceux qui restent étant des jeunes gens sélectionnés pour accomplir des tâches pénibles. A ce moment-là, il n'y a plus aucun doute depuis longtemps sur la "solution" nazie au problème juif. Le film montre les contacts pris par Szpilman avec certaines figures clandestines ; l'un d'entre eux, Jehuda Zyskind, est décrit dans le livre comme un "socialiste idéaliste" qui, à plusieurs reprises, a presque convaincu Szpilman de la possibilité d'un monde meilleur (le livre révèle que Zyskind et toute sa famille furent tués chez eux après avoir été découverts en train de trier de la littérature clandestine autour d'une table). Szpilman est un artiste et non un personnage profondément politique ; on le montre en train de transporter clandestinement des armes dans des sacs de pommes de terre, mais il s'échappe du ghetto avant le soulèvement. Ni lui, ni le film n'entrent beaucoup en détail sur les courants politiques qui agissent dans le ghetto. Il semble qu'ils étaient principalement composés d'anciennes organisations prolétariennes se situant maintenant essentiellement sur un terrain nationaliste radical, sous une forme ou une autre - l'aile d'extrême-gauche du sionisme et de la social-démocratie, les bundistes et le Parti communiste officiel. Ce sont ces groupes qui ont organisé les liens avec la résistance "nationale" polonaise et sont parvenus à livrer clandestinement des armes au ghetto, préparant le soulèvement final d'avril 1943 sous les auspices de l'organisation juive de combat. Malgré le nombre dérisoire d'armes et de munitions à leur disposition, les insurgés ont réussi à tenir l'armée allemande en échec pendant un mois. Ce ne fut possible que parce qu'une grande proportion de la population affamée s'est jointe à la révolte d'une façon ou d'une autre. En ce sens le soulèvement a eu un caractère populaire et ne peut être réduit aux forces bourgeoises qui l'ont organisé ; mais ce n'était pas non plus une action ayant un caractère prolétarien et il ne pouvait en aucune façon remettre en cause la société qui génère ce type d’oppression et d’horreurs. En fait il était très consciemment une révolte sans perspective, la motivation prépondérante des rebelles étant de mourir debout plutôt qu'être emmenés comme du bétail dans les camps de la mort. Des soulèvements similaires ont eu lieu à Vilno et dans d'autres villes. Même dans les camps, il y eut des actes de sabotage et des éruptions armées. De telles révoltes sans espoir sont le produit classique d'une situation où le prolétariat a perdu la capacité d'agir sur son terrain propre. Toute la tragédie se répéta l'année suivante à plus grande échelle, pendant la révolte générale de Varsovie qui s'est terminée par la destruction de la ville, tout comme le ghetto avait été totalement rasé à la suite de la révolte des juifs.
Dans les deux cas, la duplicité des forces de la démocratie et de la "patrie du socialisme" qui proclamaient ne mener la guerre que dans le but de libérer ceux qui étaient opprimés par la domination nazie, peut être démontrée sans détour.
Dans son livre While Six million Died (Secker and Warburg, Londres 1968), Arthur Morse cite l'une des dernières proclamations des révoltés du ghetto : "Seule la puissance des nations alliées peut apporter une aide immédiate et active maintenant. Au nom des millions de juifs brûlés, assassinés et brûlés vivants. Au nom de ceux qui luttent et de tous ceux qui sont condamnés à mourir, nous appelons le monde entier... Nos plus proches alliés doivent au moins comprendre le degré de responsabilité produit d'une telle apathie face au crime sans précédent commis par les Nazis contre toute une nation, dont l'épilogue tragique est maintenant en train de se jouer. Le soulèvement héroïque, sans précédent dans l'histoire, des fils condamnés du ghetto doit au moins réveiller le monde pour agir d'une façon qui soit en rapport avec la gravité de l'heure". Ce passage illustre très clairement à la fois la compréhension par les révoltés qu'ils étaient condamnés et leurs illusions sur les bonnes intentions des puissances alliées.
Que faisaient en réalité les Alliés contre les crimes nazis quand le ghetto de Varsovie brûlait ? Au même moment - le 19 avril 1943 - la Grande-Bretagne et l'Amérique avaient organisé aux Bermudes une conférence sur le problème des réfugiés. Comme Morse le montre dans son livre, les puissances démocratiques avaient été directement informées du mémorandum d'Hitler d'août 1942 qui formalisait le plan d'extermination de toute la population juive européenne. Pourtant leurs représentants vinrent à la Conférence des Bermudes avec un mandat qui devait assurer que rien ne serait fait à ce sujet :
"Le Département d'Etat a établi un mémorandum pour l'orientation des délégués à la Conférence des Bermudes. Les américains furent instruits de ne pas limiter la question à celle des réfugiés juifs, de ne pas soulever les questions de foi religieuse ou de race en appelant au soutien public, ni en promettant des fonds américains ; de ne pas s'engager concernant le transport par bateaux de réfugiés ; de ne pas retarder le programme maritime militaire proposant que des transports de retour vides prennent des réfugiés en route ; de ne pas transporter de réfugiés de l'autre côté de l'océan si on trouvait des emplacements pour des camps en Europe ; de ne pas s'attendre à un seul changement dans les lois d'immigration américaines ; de ne pas ignorer les nécessités de l'effort de guerre et les besoins de la population américaine en argent et en nourriture ; de ne pas établir de nouvelles agences pour soutenir les réfugiés, puisque le Comité intergouvernemental était déjà là pour ça".
"Le délégué britannique, Richard Kidston Law, ajouta quelques ‘ne pas’ à la longue liste apportée par ses amis américains. Les Britanniques ne prendraient en considération aucun appel direct aux Allemands, n'échangeraient pas de prisonniers contre des réfugiés et ne lèveraient pas le blocus de l'Europe pour envoyer de l'approvisionnement de secours. Mr Law y ajouta le danger d'un "déchargement" d'un grand nombre de réfugiés sur les alliés, dont certains pourraient s’avérer des sympathisants de l'Axe, cachés sous le masque de personnes opprimées".
A la fin de la Conférence, la "poursuite" de son activité fut mise entre les mains d'un Comité intergouvernemental - le précurseur de l'ONU - qui était déjà bien connu pour... ne rien faire.
Ceci n'était pas une expression isolée d'inertie bureaucratique. Morse raconte d'autres épisodes comme l'offre faite par la Suède de recueillir 20 000 enfants juifs d'Europe, offre qui passa de bureau en bureau en Grande-Bretagne et en Amérique et fut finalement enterrée. Et la brochure d'Auschwitz raconte l'histoire encore plus frappante de Joel Brandt, le leader de l'organisation juive hongroise, qui négocia avec Adolf Eichman la libération d'un million de juifs en échange de 10 000 camions. Mais comme le dit la brochure : "Non seulement les juifs, mais les SS aussi s'étaient laissé prendre à la propagande humanitaire des Alliés ! Les Alliés n'en voulaient pas de ce million de juifs ! Pas pour 10 000 camions, pas pour 5 000, même pas pour rien." Le même genre d'offres de la part de la Roumanie et de la Bulgarie fut également rejeté. Selon les paroles de Roosevelt, "transporter autant de gens désorganiserait l'effort de guerre".
Ce bref survol du cynisme total des Alliés serait incomplet si on ne mentionnait pas comment l'Armée rouge, qui avait appelé les Polonais à se soulever contre les nazis, a maintenu ses troupes aux abords de Varsovie pendant le soulèvement d'août 1944, laissant aux nazis le soin de massacrer les insurgés. Nous en avons expliqué les raisons dans notre article "Les massacres et les crimes des grandes démocraties" dans la Revue internationale n°66 : « En fait, Staline, devant l’ampleur de l’insurrection, décide (…) de "laisser Varsovie mijoter dans son jus", dans le but évident d’avaler la Pologne sans rencontrer d’obstacle sérieux du côté de la population polonaise. En cas de succès de l’insurrection de Varsovie, le nationalisme se serait trouvé considérablement renforcé et aurait pu dès lors mettre de sérieux bâtons dans les roues des visées de l’impérialisme russe. Il inaugurait en même temps le rôle de gendarme anti-prolétarien, face à une menace ouvrière potentielle à Varsovie". Et de peur qu'on pense qu'une telle cruauté ait été spécifique au méchant dictateur Staline, l'article souligne que cette tactique de "les laisser mijoter dans leur jus" fut d'abord adoptée par Churchill en réponse aux grèves ouvrières massives qui eurent lieu dans le nord de l'Italie la même année ; une fois encore les Alliés permirent aux bouchers nazis de faire le sale travail à leur place. Ecrit en 1991, l'article montre ensuite qu'une tactique tout à fait identique fut utilisée par "l'Occident" à la suite de la guerre du Golfe par rapport aux soulèvements kurdes et chiites contre Saddam.
La survivance de la solidarité humaine
Le fait que Szpilman ait survécu à ce cauchemar est tout à fait remarquable ; il est dû en grande partie à la combinaison d'une chance extraordinaire et au respect qu’avaient les gens envers son art musical. Il fut involontairement éloigné des camions à bétail par un policier juif compatissant, tandis que ses parents, son frère et ses deux sœurs y étaient jetés et emportés vers leur destin. Après être sorti clandestinement du ghetto, il fut recueilli par des musiciens polonais en relation avec la résistance. Cependant, à la fin, il resta totalement seul et dut la vie à un officier allemand, Wilm Hosenfeld, qui le nourrit tout en le cachant dans un grenier dans le quartier général même des forces d'occupation allemandes qui étaient maintenant en train de se désintégrer. Le livre contient un appendice constitué d'extraits du journal d'Hosenfeld. Nous apprenons que c'était un catholique idéaliste dégoûté par le régime nazi et qu'il sauva un certain nombre d'autres juifs et de victimes de la terreur.
Il y eut beaucoup de petits actes de bravoure et d'humanité de ce genre pendant la guerre. Les Polonais, par exemple, ont une épouvantable réputation d'antisémites, notamment parce que les combattants juifs qui s'échappaient du ghetto furent aussi tués par des partisans de la résistance nationale polonaise. Mais le livre souligne que les Polonais sauvèrent plus de juifs qu'aucune autre nation.
Ce furent des actes individuels, non des expressions d'un mouvement prolétarien collectif tel que la grève contre les mesures anti-juives et les déportations qui se déclencha dans les chantiers navals d'Amsterdam en février 1941 (cf. notre livre sur La gauche hollandaise). Cependant ils nous donnent un aperçu du fait que, même en plein milieu des plus terribles orgies de haine nationaliste, il existe une solidarité humaine qui peut s'élever au dessus.
A la fin du film, après la défaite de l'armée allemande, on voit l'un des amis musiciens de Szpilman passer devant un groupe de prisonniers de guerre allemands. Il va à la barrière pour les insulter ; mais il est décontenancé quand l'un d'entre eux court vers lui et lui demande s'il connaît Szpilman, et appelle à l'aide. C'est Hosenfeld. Mais le musicien est repoussé par les gardes avant qu'il puisse apprendre le nom et les détails concernant Hosenfeld. Honteux de son attitude initiale, le musicien dit à Szpilman - qui a maintenant retrouvé son travail de pianiste à la radio de Varsovie - ce qui est arrivé. Szpilman passa des années à chercher la trace de son sauveur, sans succès, bien qu'il soit venu en aide à des membres de sa famille. Et nous apprenons qu'Hosenfeld mourut dans un camp de travail russe au début des années 50 - un dernier rappel du fait que la barbarie ne se restreignait pas à l'impérialisme perdant.
Il ne fait pas de doute que l'Holocauste continuera d'être exploité par la bourgeoisie pour renforcer le mythe de la démocratie et justifier la guerre. Et dans la situation actuelle, si les meilleures expressions artistiques peuvent donner un aperçu profond sur des vérités sociales et historiques, elles sont rarement armées d'un clair point de vue prolétarien qui leur permette de résister aux tentatives de récupération. Le résultat, c'est que la bourgeoisie cherchera à utiliser des tentatives honnêtes de décrire de tels événements pour servir ses fins malhonnêtes. Il est certain que nous assistons aujourd'hui à des tentatives écoeurantes de présenter la nouvelle offensive impérialiste dans le Golfe comme une bataille pour nous sauver tous des atrocités que prépare le "nouvel Hitler", Saddam Hussein. Mais les préparatifs de guerre actuels révèlent avec une clarté croissante que c'est le capital comme un tout qui prépare un nouvel holocauste pour l'humanité, et que ce sont les grandes puissances démocratiques qui mènent la charge vers le gouffre. Un tel holocauste dépasserait certainement de loin tout ce qui a été déchaîné dans les années 1940 puisqu'il impliquerait certainement la destruction de l'humanité. Mais, contrairement aux années 1940, le prolétariat mondial n'a pas été pulvérisé et empêché d'agir sur son propre terrain de classe ; c'est pourquoi il n'est pas trop tard pour empêcher le capitalisme d'imposer sa "solution finale" et pour remplacer son système pourrissant par une société authentiquement humaine.
Amos (février 2003)
1 Le livre comme le film montrent Szpilman et sa famille être témoins d'un raid dans l'appartement opposé au leur. Une autre famille est assise à dîner quand les SS surgissent et demandent à chacun de se lever. Un vieil homme paralysé est incapable de le faire assez vite et deux SS l'empoignent avec sa chaise et le jettent par la fenêtre. Les enfants n'étaient pas mieux traités, comme cet extrait du livre le souligne froidement : "Nous sortîmes, escortés de deux policiers, en direction de la porte du ghetto. Elle était gardée habituellement par des officiers de police juifs, mais aujourd'hui toute une unité de la police allemande vérifiait avec soin les papiers de tous ceux qui quittaient le ghetto pour aller au travail. Un garçon de dix ans arriva en courant sur le trottoir. Il était très pâle et si effrayé qu'il oublia d'ôter sa casquette devant un policier allemand qui venait dans sa direction. L'allemand s'arrêta, sortit sans un mot son revolver, le pointa sur la tempe du garçon et tira. Le garçon tomba à terre, battit des bras, devint raide et mourut. Le policier rangea calmement son revolver dans son étui et poursuivit son chemin. Je le regardai : il ne présentait même pas des caractéristiques particulières de brutalité et ne paraissait pas en colère. C'était un homme normal, placide qui venait d'accomplir l'un de ses nombreux petits devoirs quotidiens et l'avait ensuite chassé de sa tête pour d'autres affaires plus importantes qui l'attendaient"
Géographique:
- Allemagne [67]
Revue Internationale no 114 - 3e trimestre 2003
- 4322 reads
Face aux attaques massives du capital, le besoin d'une riposte massive de la classe ouvrière
- 2586 reads
Face à l’attaque frontale sur les retraites en France comme en Autriche, des secteurs entiers de la classe ouvrière se sont mis en lutte avec une détermination comme il n’y en avait pas eu depuis la fin des années 1980. En France, pendant plusieurs semaines, des manifestations à répétition ont rassemblé plusieurs centaines de milliers d’ouvriers du public mais aussi du privé : un million et demi de prolétaires étaient dans les rues des principales villes du pays le 13 mai, près d’un million lors de la seule manifestation parisienne du 25 mai et, le 3 juin, il y avait encore 750 000 personnes mobilisées. Le secteur de l’Education nationale s’est retrouvé à la pointe de la combativité du mouvement social dans ce pays, en particulier du fait qu’il était le plus brutalement attaqué. En Autriche, face à des attaques similaires concernant les retraites, on a assisté aux manifestations les plus massives depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 100 000 personnes le 13 mai, près d’un million (sur un pays comptant moins de 10 millions d’habitants) le 3 juin. A Brasilia, capitale administrative du Brésil, une manifestation a rassemblé 30 000 employés du service public le 11 juin, mobilisés contre une réforme de l’impôt, de la sécurité sociale mais, là encore, surtout des retraites, imposée par le nouveau "gouvernement de gauche" de Lula. En Suède, 9000 employés municipaux et des services publics se sont mis en grève contre les coupes claires dans les budgets sociaux.
La bourgeoise fait payer la crise du capitalisme à la classe ouvrière
Jusqu'ici, la bourgeoisie était parvenue à relativement étaler ses attaques anti-ouvrières dans le temps et à les mener paquets par paquets, par secteurs, par régions, par pays. Le fait majeur de l’évolution de la situation actuelle, c’est que, depuis la fin des années 1990, elle a entrepris de les porter de façon plus brutale, plus violente, plus massive. C’est un indice de l’accélération de la crise mondiale qui se traduit par deux phénomènes majeurs et concomitants à l’échelle internationale : le retour de la récession ouverte et un nouveau bond en avant dans l'endettement.
La plongée dans une nouvelle récession touche aujourd’hui de plein fouet les pays centraux, les pays du coeur du capitalisme : le Japon depuis plusieurs années et maintenant l’Allemagne. Officiellement, l’Allemagne est entrée dans une nouvelle période de récession (pour la deuxième fois en 2 ans). D’autres Etats européens, notamment les Pays-Bas, sont dans la même situation. Cette récession menace sérieusement les Etats-Unis depuis deux ans où les taux de chômage remontent et où les déficits de la balance commerciale comme les déficits budgétaires de l’Etat fédéral se creusent à nouveau. Le journal français Le Monde du 16 mai sonne l’alerte sur le risque de déflation qui fait resurgir le spectre des années 1930 : "Non seulement l’espoir d’une reprise au lendemain de la guerre contre l’Irak s’amenuise de jour en jour, mais, à la place, la crainte grandit de voir l’économie américaine s’enfoncer dans une spirale de baisse des tarifs (…) Un scénario catastrophe où les prix des actifs et des biens de consommation ne cessent de baisser, les profits s’effondrent, les entreprises diminuent les salaires et licencient, entraînant un nouveau recul de la consommation et des prix. Les ménages et les entreprises, trop endettés, ne peuvent plus faire face à leurs engagements, les banques exsangues restreignent le crédit sous l’œil impuissant de la Réserve fédérale. Il ne s’agit pas seulement d’hypothèses d’experts en mal de sensations fortes. C’est ce que le Japon vit depuis plus de dix ans avec, de temps à autre, de courtes périodes de rémission". Ce que la bourgeoisie appelle déflation n’est autre qu’un enfoncement durable dans la récession où le "scénario" décrit ci-dessus devient une réalité, où la bourgeoisie ne parvient pas à utiliser le crédit comme facteur de relance. Cela apporte un démenti à tous ceux qui pensaient que la guerre en Irak allait permettre de relancer l’économie mondiale alors qu'elle a représenté un gouffre pour celle-ci. En réalité, la guerre et l'occupation qui perdure, représentent en premier lieu une ponction importante pour l'économie américaine (1 milliard de dollars par semaine pour l'armée d'occupation) et britannique. De plus, tous les prolétaires sont mis à contribution dans la course aux armements qui s’accélère partout dans le monde (entre autres, à travers les nouveaux programmes militaires européens).
La seconde caractéristique de la situation économique, c’est la fuite en avant dans un endettement d’une ampleur colossale qui représente une véritable bombe dans la période à venir et qui affecte toutes les économies, depuis les entreprises jusqu’aux gouvernements nationaux en passant par les ménages, dont le taux d’endettement n’a jamais été aussi élevé (voir l'article sur la crise dans ce numéro de la Revue).
Comme chaque fois qu’il est confronté ouvertement à la crise et à ses contradictions, le capitalisme tente de la surmonter avec les deux seuls moyens dont il dispose :
- d’une part, il intensifie la productivité du travail en soumettant de plus en plus les ouvriers, producteurs de plus-value, à des cadences infernales ;
- d'autre part, il s'attaque directement au coût du capital variable, autrement dit la part du paiement de la force de travail, en le réduisant toujours plus. Il dispose de plusieurs moyens pour cela : la multiplication des plans de licenciements ; la baisse des salaires dont la variante la plus utilisée pour faire face à la concurrence est de recourir à la "délocalisation" ou aux travailleurs immigrés pour se procurer la main d’œuvre la moins chère possible ; la réduction du coût du salaire social en taillant dans tous les budgets sociaux (retraites, santé, indemnisation du chômage).
Le capitalisme est contraint d’agir de plus en plus simultanément sur l’ensemble de ces plans, c’est-à-dire que partout les Etats sont poussés à s’attaquer en même temps à TOUTES les conditions de vie de la classe ouvrière. La bourgeoisie n’a pas d’autre choix, dans sa logique de profit, que de mener des attaques massives et frontales. Elle prend évidemment soin de planifier et de coordonner le rythme de ces attaques selon les pays pour éviter toutefois une simultanéité des conflits sociaux sur la même question.
Depuis les années 1970, avec la généralisation du chômage massif et le sacrifice de milliers d’entreprises et des secteurs les moins rentables de l’économie, des millions d’emplois ont disparu et la bourgeoisie dévoile son incapacité d’intégrer de nouvelles générations d’ouvriers dans la production. Mais, à l’heure actuelle, un autre cap a été franchi : tout en continuant à licencier à tour de bras, ce sont tous les budgets sociaux qui sont dans la ligne de mire de la bourgeoisie. Dans certains pays centraux, comme les Etats-Unis, la "protection sociale" a toujours été quasiment inexistante. Mais, dans ce pays en particulier, les entreprises finançaient la plupart du temps la retraite de leurs salariés. La base des "scandales financiers" de ces dernières années, dont l'exemple le plus spectaculaire est celui d’Enron, c’est qu’elles ont profité de ces placements pour les investir dans des actions en bourse et que cet argent est parti en fumée dans des spéculations hasardeuses, sans que les entreprises puissent payer la moindre pension et sans qu’elles aient les moyens de rembourser les salariés spoliés, c’est-à-dire réduits à la misère noire. Dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, la protection sociale a été déjà largement démantelée. Le cas de la Grande-Bretagne est particulièrement édifiant sur ce qui attend l’ensemble de la classe ouvrière : depuis les "années Thatcher", il y a vingt ans, les retraités sont payés sur des fonds de pensions. Mais la situation s’est encore dégradée fortement depuis. En transformant les retraites en fonds de pension, on avait fait croire que les actions de ces fonds allaient rapporter beaucoup d’argent. C’est l’inverse qui s’est produit. Ces dernières années, la chute vertigineuse de leur cotation a entraîné des centaines de milliers d’ouvriers dans la misère (la retraite de base garantie par l’Etat est d’environ 120 Euros par semaine) et plus de 20 % d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, condamnant un grand nombre d’entre eux… à ne pas prendre de retraite et à travailler jusqu’à plus de 70 ans ou jusqu’à leur mort pour survivre, généralement avec de petits boulots très mal rémunérés. Beaucoup d’ouvriers connaissent une situation angoissante dans laquelle ils se trouvent incapables de payer leur logement ou leurs frais médicaux. L’hospitalisation des personnes âgées devant recourir à des traitements lourds pour assurer leur survie n’est même plus prise en charge. Ainsi, les hôpitaux comme les cliniques anglaises refusent les dialyses aux patients âgés qui n’ont pas les moyens de payer, les condamnant directement à la mort. Ceux qui n’ont pas les revenus suffisants pour se faire soigner peuvent crever. Plus généralement, les reventes de maisons ou d’appartements dont les ouvriers ne peuvent plus honorer les traites ont été multipliées par quatre en deux ans alors que 5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (ce chiffre a doublé depuis les années 1970) et que le chômage connaît aujourd’hui la plus forte augmentation depuis 1992. Le premier pays capitaliste a avoir mis en place le Welfare State (l'Etat providence) au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu le premier laboratoire d’essai pour son démantèlement.
Un tournant dans l'aggravation des attaques
Aujourd’hui, ces attaques se généralisent, se "mondialisent", faisant voler en éclats le mythe des "acquis sociaux". La nature de ces nouvelles attaques est significative. Elles portent sur les retraites, les indemnisations des chômeurs et les dépenses de santé. Ce qu'elles font apparaître partout de plus en plus clairement, c'est l’incapacité croissante de la bourgeoisie de financer les budgets sociaux. Le fléau du chômage et la fin du Welfare State sont deux expressions majeures de la faillite globale du capitalisme. C'est ce que viennent illustrer des attaques récentes dans un certain nombre de pays :
· En France, concernant les retraites, il ne s’agit pas seulement d’aligner le public sur le privé en portant de 37,5 à 40 ans la durée de cotisation pour avoir droit à une retraite à "taux plein". Le gouvernement a aussi annoncé l’augmentation progressive de cette durée à 42 ans qui sera ensuite allongée au-delà, en fonction du niveau de l'emploi. Les cotisations seront augmentées pour tous les salariés afin de renflouer les caisses de retraite, sans compter l’obligation de recourir à des fonds de pensions ou à des retraites complémentaires payantes. Suivant le discours officiel, c'est un facteur purement démographique, le "vieillissement" de la population, qui serait responsable du déficit des caisses de retraite et deviendrait un "fardeau" insupportable pour l’économie. Il n'y aurait pas assez de "jeunes" pour payer les retraites d'un nombre croissant de "vieux". En réalité, les jeunes entrent de plus en plus tard dans la vie active, non seulement à cause de l'allongement de la scolarité rendue nécessaire par les progrès techniques de la production mais surtout parce qu'ils trouvent de plus en plus difficilement un emploi (l'allongement de la scolarité étant d'ailleurs un moyen de masquer le chômage des jeunes). C'est en réalité la montée inexorable du chômage (qui représente au moins 10 % de la population en âge de travailler) et de la précarité qui est la cause principale de la baisse des cotisations et des déficits des régimes de retraite. En fait, beaucoup de patrons ne sont pas intéressés à conserver dans leur effectif les travailleurs âgés, qui sont en général mieux payés que les jeunes alors qu'ils ont moins de forces et sont moins "adaptables". Derrière le discours sur la nécessité de travailler plus longtemps, il y a surtout la réalité d'une chute massive du niveau des pensions de retraite. D’ores et déjà, dès leur mise en oeuvre, les mesures prévues vont se traduire par une chute du pouvoir d’achat des retraités allant de 15 à 50%, y compris pour les salariés les plus mal payés. Une autre "réforme", celle de la sécurité sociale, dont les mesures doivent être arrêtées à l’automne prochain, a déjà commencé avec une liste de 600 médicaments qui ne sont plus remboursés alors qu’une liste de 650 autres va être rendue publique et immédiatement applicable par décret en juillet.
· En Autriche, une attaque comparable à celle de la France vise principalement les retraites. Mais là, la durée des cotisations qui était déjà de 40 ans, doit passer à 42 ans et pour une majorité de salariés à 45 ans avec une amputation de leur montant pouvant atteindre jusqu’à 40 % pour certaines catégories. Le chancelier conservateur Schlüssel a profité des élections anticipées en février pour former un nouveau gouvernement de droite classique et homogène suite à la "crise" de septembre 2002 qui avait mis fin à l’encombrante coalition avec le parti populiste de Haider et a permis à la bourgeoisie d’avoir les mains plus libres pour porter ces nouvelles attaques.
· En Allemagne, le gouvernement rouge-vert a mis en œuvre un programme d’austérité baptisé "agenda 2010" qui s’attaque simultanément à plusieurs "volets sociaux". Il s’agit en premier lieu d’une réduction drastique des allocations chômage. La durée de l’indemnisation qui était de 36 mois sera réduite à 18 mois pour les plus de 55 ans et à 12 mois pour les autres. Après cela, les ouvriers licenciés n’ont pas d’autre ressource que "l’aide sociale" (qui représente environ 600 Euros pas mois). Ce qui équivaut à diviser par deux le montant des pensions de retraite pour 1 million et demi de travailleurs réduits au chômage alors même que l’Allemagne est en train de franchir le cap des 5 millions de chômeurs. Concernant les dépenses de santé, il est prévu une baisse des prestations de l’assurance maladie (diminution des taux de remboursement comme des visites médicales, restriction des arrêts maladie). A titre d’exemple, à partir de la sixième semaine d’arrêt maladie par an, la Sécurité sociale n’indemnisera plus et les assurés devront cotiser à une assurance privée pour prétendre à un remboursement. Ces restrictions sur les dépenses de santé sont cumulées avec une hausse des cotisations maladie à l’œuvre depuis début 2003 pour tous les salariés. Parallèlement, le régime des retraites sera aussi attaqué à terme en Allemagne : élévation de l’âge de départ à la retraite qui est déjà de 65 ans en moyenne, augmentation des cotisations des salariés, suppression de la revalorisation annuelle automatique des pensions. Depuis le début de l’année sont appliqués des hausses d’impôts (retenus à la source sur les salaires), des mesures d’encouragement pour les travaux intérimaires, un développement de la précarité du travail, des contrats à temps partiel ou à durée limitée.
· Aux Pays-Bas, après s’être débarrassé comme en Autriche de son aile populiste, le nouveau gouvernement de coalition (chrétiens-démocrates, libéraux, réformateurs) s’est empressé d’annoncer un plan d’austérité basé sur les restrictions budgétaires dans le domaine social (plan qui prévoit une économie de 15 milliards d’Euros) avec notamment une réforme radicale de l’indemnité chômage et des critères de l’incapacité de travail ainsi qu’une révision générale de la politique salariale.
· En Pologne, les dépenses de santé sont aussi attaquées. En dehors des soins pour les maladies très graves encore remboursés à 100 %, la plupart des soins ne sont remboursés qu’à 60 ou 30 %. Des maladies "bénignes" comme une grippe ou une angine ne le sont pas du tout. Le statut des fonctionnaires ne les protège pas des licenciements.
· Au Brésil, nous avons également vu plus haut que le Parti des Travailleurs de "Lula" est à la pointe des coupes dans les budgets sociaux en Amérique latine.
· Dans le cadre de l’élargissement de l’Union européenne, la directive donnée le 9 juin par le Bureau International du Travail pour les années qui viennent est de faire passer le financement des caisses de retraite pour 5 des 10 pays concernés (la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Lituanie et l’Estonie) à la charge des seuls ouvriers, alors qu'il était jusqu'à présent pris en charge par l’employeur, l’Etat et le salarié.
Il s’avère donc que, quel que soit le gouvernement en place, de droite ou de gauche, ce sont les mêmes attaques qui sont mises en œuvre.
Pendant ce temps, les plans de licenciements massifs s’accumulent de plus belle : 30 000 suppressions d’emploi chez Deutsche Telekom, 13 000 à France Télécom, 40 000 à la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands), 2000 supplémentaires à la SNCF (chemins de fer français). Fiat vient d’annoncer la suppression de 10 000 emplois sur le continent européen, après les licenciements de 8100 ouvriers fin 2002 dans la péninsule italienne, Alstom 5000. La compagnie aérienne Swissair a prévu d’éliminer 3000 emplois supplémentaires dans un secteur particulièrement affecté par la crise depuis deux ans. La banque d’affaires américaine Merrill Lynch a licencié 8000 salariés depuis l’an dernier. 42 000 emplois ont été perdus au cours du premier trimestre 2003 en Grande-Bretagne. Aucun pays, aucun secteur n’est épargné. Par exemple, d’ici 2006, il est prévu des fermetures d’entreprises sur le sol britannique au rythme de 400 par semaine. Partout, la précarité des emplois est en train de devenir la règle.
C'est donc face à cette aggravation qualitative de la crise et des attaques contre ses conditions de vie qu'elle entraîne, que la classe ouvrière s'est mobilisée dans les récentes luttes.
Le rapport de forces entre les classes
La première chose qu’il faut souligner à propos de ces luttes, c’est qu’elles constituent un démenti cinglant à toutes les campagnes idéologiques qui nous avaient été assénées suite à l’effondrement du bloc de l’Est et des régimes staliniens. Non, la classe ouvrière n’a pas disparu ! Non, ses luttes n’appartiennent pas à un passé révolu ! Elles démontrent que la perspective est toujours orientée vers des affrontements de classe, malgré le déboussolement et l’énorme recul de la conscience de classe que les bouleversements de l’après-1989 avaient provoqués. Un recul encore accentué par tous les autres ravages d’une décomposition sociale avancée, tendant à faire perdre aux prolétaires leurs points de repère et leur identité de classe, et par les campagnes de la bourgeoisie, antifascistes, pacifistes en passant par les mobilisations "citoyennes". Face à cette situation, les attaques de la bourgeoisie et de l’Etat les poussent à nouveau à s’affirmer sur un terrain de classe et à renouer, à terme, avec les expériences passées et les besoins vitaux de la lutte. Ainsi, les ouvriers sont amenés à faire à nouveau l'expérience du sabotage de la lutte par les organes d’encadrement de la bourgeoisie que sont les syndicats et les gauchistes. De façon plus significative encore, au sein de la classe ouvrière, commencent à émerger, malgré l’amertume de la défaite immédiate, des questions plus profondes sur le fonctionnement de la société qui, à terme, tendent à mettre en cause les illusions semées par la bourgeoisie.
Pour comprendre quelle est la portée de ces attaques et ce que représentent ces événements par rapport à l’évolution du rapport de forces dans la lutte de classe, la méthode marxiste n’a jamais consisté à rester le nez collé aux luttes ouvrières elles-mêmes mais à cerner quel est l’objectif majeur poursuivi par la classe ennemie, quelle stratégie elle développe, à quels problèmes elle est confrontée à un moment donné. Car pour lutter contre la classe dominante, la classe ouvrière doit toujours non seulement identifier qui sont ses ennemis, mais comprendre ce qu’ils font et manigancent contre elle. En effet, l’étude de la politique de la bourgeoisie est habituellement la clé la plus importante pour comprendre le rapport de forces global entre les classes. Ainsi, Marx a consacré énormément plus de temps, de pages et d’énergie à examiner, disséquer les moeurs et à démonter l’idéologie de la bourgeoisie pour mettre en évidence la logique, les failles et les contradictions du capitalisme qu’à décrire et examiner en soi les luttes ouvrières. C’est pourquoi, face à un événement d’une toute autre portée, dans sa brochure sur Les luttes de classe en France en 1848, il analysait ainsi essentiellement les ressorts de la politique bourgeoise. Lénine, proclamait lui aussi en 1902 dans Que faire ?: "La conscience des masses ouvrières ne peut être une conscience de classe authentique si les ouvriers n’apprennent pas, à partir de faits et d’événements concrets et par-dessus tout politiques, d’actualité, à observer l’autre classe dans toute sa vie intellectuelle, morale et politique. (...) Ceux qui concentrent l’attention, l’observation et la conscience de la classe ouvrière exclusivement, ou même principalement sur elle-même ne sont pas des sociaux-démocrates", autrement dit pas de vrais révolutionnaires. Récemment, dans sa résolution sur la situation internationale adoptée à son 15e congrès, le CCI réaffirmait encore "Le marxisme a toujours insisté sur le fait qu’il ne suffisait pas d’observer la lutte de classe seulement sous l’angle de ce que fait le prolétariat : puisque la bourgeoisie aussi mène une lutte de classe contre le prolétariat et sa prise de conscience, un élément clé de l’activité marxiste, a toujours été d’examiner la stratégie et la tactique de la classe dominante pour devancer son ennemi mortel" (Revue Internationale n°113). La négligence de l’étude de l’ennemi de classe a toujours été typique de tendances ouvriéristes, économistes et conseillistes au sein du mouvement ouvrier. Cette vision oublie une donnée élémentaire qui doit servir de boussole fondamentale dans l’analyse d’une situation donnée, c’est qu’en dehors de situations directement pré-révolutionnaires, ce n’est jamais le prolétariat qui est à l’offensive. Dans les autres cas, c’est toujours la bourgeoisie en tant que classe dominante qui attaque et oblige le prolétariat à répondre et qui, de façon permanente et organisée, s’adapte non seulement à ce que font les ouvriers mais s’attache à prévoir leurs réactions car la classe exploiteuse, elle, ne cesse de surveiller son adversaire irréductible. Elle dispose d’ailleurs pour cela d’instruments spécifiques qui lui servent en permanence d’espions pour prendre la température sociale, les syndicats.
Aussi, face à la situation actuelle, la première question à se poser, c’est pourquoi la bourgeoisie mène ces attaques de cette façon.
La stratégie de la bourgeoisie pour faire passer ses attaques économiques
Les médias ont largement évoqué la comparaison du mouvement en France avec les grèves de novembre-décembre 1995 dans le secteur public contre le gouvernement Juppé qui avait donné lieu à des rassemblements comparables. En 1995, l’objectif essentiel du gouvernement était de profiter de la campagne idéologique de toute la bourgeoisie sur la pseudo-faillite du marxisme et du communisme, consécutive à l’effondrement des régimes staliniens, d’exploiter le recul de la conscience de classe pour renforcer et recrédibiliser l’appareil d’encadrement syndical, en gommant toute l’expérience accumulée des luttes ouvrières entre 1968 et les années 1980, notamment sur la question syndicale. Même si une partie économique du plan Juppé (consacré à la réforme du financement de la sécurité sociale et à l’institution d’un nouvel impôt appliqué à tous les revenus) est passée en catimini sous le gouvernement Jospin dans les mois qui ont suivi, le volet consacré précisément à la retraite (suppression des régimes spéciaux les plus "favorables" du secteur public) n’avait pu aboutir et avait même été délibérément sacrifié par la bourgeoisie pour faire passer cela comme une "victoire des syndicats". Ainsi, la bourgeoisie avait voulu montrer cette grève comme "une "victoire ouvrière" grâce aux syndicats qui avaient fait reculer le gouvernement, comme une lutte exemplaire en lui assurant une publicité médiatique phénoménale à l’échelle internationale. La classe ouvrière dans tous les pays était ainsi invitée à faire du "décembre 95 français" la référence incontournable de tous ses combats à venir, et surtout à voir dans les syndicats, qui avaient été si "combatifs", si "unitaires" et si "déterminés" tout au long des événements, leurs meilleurs alliés pour se défendre contre les attaques du capital. Ce mouvement a d’ailleurs servi de référence essentielle aux luttes syndicales en Belgique tout de suite après et en Allemagne six mois plus tard pour redorer le blason de la combativité syndicale passablement terni dans le passé. Aujourd’hui, le niveau de la crise économique n’est plus le même. La gravité de la crise capitaliste oblige la bourgeoisie nationale à s’attaquer de front au problème. La remise en cause du régime des retraites n’est qu’une des premières mesures d’une longue série de nouvelles attaques massives et frontales en préparation.
Ce n’est jamais de manière improvisée que la bourgeoisie affronte la classe ouvrière. Toujours elle tente de l’affaiblir le plus possible. Pour ce faire, elle a souvent employé la tactique qui consiste à prendre les devants, à susciter le déclenchement de mouvements sociaux avant que de larges masses ouvrières ne soient prêtes à les assumer, en provoquant certains secteurs plus disposés à se lancer immédiatement dans le mouvement. L’exemple historique le plus marquant est l’écrasement, en janvier 1919, des ouvriers berlinois qui s’étaient soulevés suite à une provocation du gouvernement social-démocrate, mais qui restèrent isolés de leur classe, pas encore prête à se lancer dans la confrontation générale avec la bourgeoisie. L’actuelle attaque sur les retraites en France a elle aussi été accompagnée de toute une stratégie visant à limiter les réactions ouvrières qui devaient, tôt ou tard, résulter de cette attaque. A défaut de pouvoir éviter la lutte, la bourgeoisie devait faire en sorte que celle-ci se termine par une défaite ouvrière douloureuse, afin que le prolétariat doute à nouveau de sa capacité à réagir en tant que classe aux attaques. Elle a donc choisi de faire crever l’abcès avant terme et de provoquer un secteur, celui du personnel de l’Education nationale au moyen d’attaques supplémentaires et particulièrement lourdes, afin qu’il parte le premier en lutte, qu’il s’épuise le plus possible, et essuie la défaite la plus cinglante. Ce n’est pas la première fois que la bourgeoisie française ou ses consœurs européennes provoquent un secteur au sein d'une manœuvre contre la classe ouvrière. Avant l’Education nationale aujourd’hui, elle l’avait déjà fait par exemple en 1995 avec les cheminots de la SNCF.
Déjà sous le gouvernement Jospin, par la voix du ministre Allègre, la bourgeoisie avait annoncé son intention de "dégraisser le mammouth" de l’Education nationale qui représentait de loin le plus fort contingent de fonctionnaires. Comme la plupart des fonctionnaires (sauf la défense, l’intérieur et la justice, c’est-à-dire les corps chargés de la répression étatique), il a été soumis à des coupes budgétaires prévoyant le non-remplacement de fait de 3 postes sur 4, hormis les enseignants. De plus, fin 2002, a été annoncée, avec un début de mise en œuvre, la suppression de milliers "d’auxiliaires d’enseignement", sous la forme d’emplois jeunes dans les écoles primaires et de surveillants pour les établissements du secondaire (lycées, collèges). Ces suppressions de poste, en plus de priver d’emploi de nombreux jeunes, représentent une aggravation insupportable des charges de travail pour les enseignants et les laissent isolés en première ligne face à des élèves de plus en plus difficiles avec le poids grandissant de la décomposition sociale (drogue, violence, délinquance, problèmes sociaux et familiaux, etc.).
Ainsi, ce secteur déjà lourdement affecté, non seulement devait subir l’attaque générale sur les retraites mais on lui en a infligé encore une autre supplémentaire, spécifique, le projet de décentralisation des personnels non enseignants. Pour ces derniers, cela revient à se trouver placés sous une autre autorité administrative, non plus nationale mais régionale, avec un contrat de travail moins avantageux et à terme plus précaire. C’était donc une véritable provocation pour que le conflit se focalise sur ce secteur. La bourgeoisie a également choisi le moment de l’attaque lui permettant de bénéficier de deux butoirs à la mobilisation : la période des examens pour les enseignants et celle des congés d’été concernant la classe ouvrière dans son ensemble. De même, afin de "casser" la combativité, diviser et démoraliser le mouvement, particulièrement dans l’Education nationale, le gouvernement avait prévu d’avance de lâcher un peu de lest, qui ne lui coûtait pas grand-chose, sur son projet de "décentralisation". Elle a retiré, pour pouvoir en préserver l’essentiel, un tout petit morceau de cette attaque spécifique, la décentralisation pour les personnels les plus proches des enseignants (les psychologues, les conseillers d’orientation, les assistantes sociales). En favorisant une minorité du personnel concerné, (représentant 10 000 salariés), au détriment des techniciens et ouvriers de service (100 000 salariés), elle savait aussi pouvoir diviser l’unité du mouvement et désamorcer la colère des enseignants. Pour parachever la défaite, le gouvernement a mis le paquet en se refusant à négocier le paiement des jours de grève avec les "consignes de rigueur" (retrait intégral et étalement des retenues sur salaire limité à deux mois) mises en avant par le premier ministre Raffarin : "La loi prévoit des retenues de salaire pour les grévistes. Le gouvernement applique la loi". La bourgeoisie savait aussi pouvoir compter sur une collaboration sans faille des syndicats et des gauchistes pour se partager le travail et pour diviser et désorienter le mouvement en freinant les uns pour les dissuader de se mettre en lutte, en poussant au contraire les autres résolument dans la lutte, exhortant ensuite les uns à se montrer "responsables", "raisonnables" et les autres "à tenir" et à "étendre" la lutte dans une attitude "jusqu’au boutiste" avec des appels à la "grève générale" en plein reflux pour étendre la défaite, notamment chez les enseignants.
On en revient donc aujourd’hui à un schéma beaucoup plus classique dans l’histoire de la lutte de classes : le gouvernement cogne, les syndicats s’y opposent et prônent l’union syndicale dans un premier temps pour embarquer massivement des ouvriers derrière eux et sous leur contrôle. Puis le gouvernement ouvre des négociations et les syndicats se désunissent pour mieux porter la division et la désorientation dans les rangs ouvriers. Cette méthode, qui joue sur la division syndicale face à la montée de la lutte de classe, est la plus éprouvée par la bourgeoisie pour préserver globalement l’encadrement syndical en concentrant autant que possible le discrédit et la perte de quelques plumes sur l’un ou l’autre appareil désigné d’avance. Cela signifie aussi que les syndicats sont à nouveau soumis à l’épreuve du feu et que le développement inévitable des luttes à venir va poser à nouveau le problème pour la classe ouvrière de la confrontation avec ses ennemis pour pouvoir affirmer ses intérêts de classe et les besoins de son combat.
Chaque bourgeoisie nationale s’adapte au niveau de combativité ouvrière pour imposer ses mesures. Alors que les 35 heures sont partout présentées comme une conquête sociale, elles ont constitué en fait une attaque de premier ordre contre le prolétariat en Allemagne et en France où les lois sur les 35 heures ont pu servir de modèle à d’autres Etats, puisqu'elles permettent à la bourgeoisie de généraliser la "flexibilité" des salariés adaptée en fonction des besoins de l’entreprise (intensification de la productivité, diminution ou suppression des pauses, travail le week-end, non paiement des heures supplémentaires, etc.) Les ouvriers travaillant dans les "Länder" de l’ex-Allemagne de l’Est viennent "d'obtenir" la promesse de passer aux "35 heures" en 2009 comme ceux de l’Ouest, alors que cette mesure leur était refusée jusque là sous le prétexte du niveau inférieur de leur productivité. Le syndicat des métallos IG-Metall n’a cessé de chercher à détourner les ouvriers de leurs revendications (notamment pour des hausses de salaire) en organisant toute une série de grèves et de manifestations sur ce thème. Aujourd’hui encore, cette perspective, jugée trop lointaine par les syndicats, sert à IG-Metall pour pousser les ouvriers de l’Est à réclamer les 35 heures pour tout de suite, autrement dit les encourager à se faire exploiter davantage le plus rapidement possible… Alors que pour les mesures d’austérité de "l’agenda 2010", en dehors de manifestations dans quelques villes (comme à Stuttgart le 21 mai), le même syndicat des métallos s’est contenté de faire circuler des pétitions (tandis que le syndicat des services organisait une manifestation nationale réservée aux ouvriers de ce secteur à Berlin le 17 mai).
Les perspectives pour l’avenir de la lutte de classe
Pendant des années, face à l’aggravation de la crise dont les premières conséquences pour la classe ouvrière ont été la brutale montée du chômage, les charrettes de licenciements, entraînant une paupérisation considérable au sein de la classe ouvrière, la bourgeoisie a mené toute une politique visant à masquer en priorité l’ampleur du phénomène du chômage. Pour cela, elle a recouru à la manipulation constante des statistiques officielles, aux radiations massives des chômeurs dans les agences pour l’emploi, au travail à temps partiel, aux contrats précaires, à l’encouragement au retour des "femmes au foyer", aux stages et aux emplois jeunes sous-payés ou non payés. En outre, elle n’a cessé d’encourager, favoriser, multiplier pour les salariés les plus âgés, les mises en pré-retraite, les départs à la retraite anticipés, les cessations progressives d’activité en faisant miroiter la perspective d’un raccourcissement de la durée du travail en même temps qu'on montait en épingle l'allongement de l'espérance de vie de la population (dans laquelle les ouvriers sont d'ailleurs les plus mal lotis). Parallèlement, pour les ouvriers en activité, cette propagande visait à leur faire accepter une détérioration dramatique de leurs conditions de vie et de travail liée aux suppressions de postes au nom de la nécessité de moderniser les modes de gestion, de faire face à la concurrence. On leur a demandé de se soumettre à la hiérarchie, aux impératifs de la productivité pour sauvegarder leur emploi. Pour contenir la montée du mécontentement social, face à cette détérioration accélérée de leurs conditions d’existence, l’abaissement de l’âge de la retraite a été mis en avant comme un exutoire orchestré par la bourgeoisie et même instrumentalisé en abaissant légalement l’âge du droit à la retraite dans certains pays. En France notamment, la légalisation de la retraite à 60 ans, adoptée sous la gauche, a pu être présentée sous un jour particulièrement social alors qu’elle ne faisait qu’officialiser une réalité de fait.
Aujourd’hui, l’aggravation de la crise ne permet plus comme avant à la bourgeoisie de payer les ouvriers à la retraite, de rembourser les frais médicaux. Avec le développement parallèle du chômage, un nombre croissant de travailleurs peuvent de moins en moins et, demain, ne pourront plus justifier du nombre d’années requis pour "bénéficier" d’une retraite décente. A partir du moment où les prolétaires cessent de produire de la plus-value, ils deviennent un fardeau, une charge pour le capitalisme si bien que pour ce système, la meilleure solution, et celle vers laquelle il s’oriente cyniquement, est qu’ils meurent le plus vite possible.
C’est pourquoi l’attaque brutale et ouverte portée sur les retraites se traduit par une très vive inquiétude qui s’exprime par un réveil de la combativité mais aussi par le fait qu'elle ouvre la porte à un questionnement en profondeur sur les perspectives d’avenir réelles pour la société qu’offre le capitalisme.
En 1968, un des facteurs majeurs du ressurgissement de la classe ouvrière et de ses luttes sur la scène de l’histoire à l’échelle internationale, avait été constitué par la fin brutale des illusions portées par la période de reconstruction qui avait permis, le temps d’une génération, une situation euphorisante de plein emploi durant laquelle les conditions de vie de la classe ouvrière avaient connu une nette amélioration, après le chômage des années 1930, le rationnement et les famines de la guerre et de l’après-guerre. La bourgeoisie s’était elle-même persuadée que cette période de prospérité n’aurait pas de fin, qu’elle avait résolu le problème de la crise économique et que le spectre des années 1930 avait disparu définitivement. Dès les premières manifestations de la crise ouverte, la classe ouvrière avait ressenti non seulement les atteintes à ses conditions de vie et de travail, mais aussi que l'avenir se bouchait, qu’une nouvelle période de stagnation économique et sociale croissante s’installait sous l’effet de la crise mondiale. L’ampleur des luttes ouvrières à partir de mai 68 et la réapparition de la perspective révolutionnaire ont pleinement révélé que les mystifications bourgeoises sur la "société de consommation" et "l'embourgeoisement du prolétariat" se trouvaient mises à mal. Toutes proportions gardées, la nature des attaques actuelles contient des similitudes avec la situation de l'époque. Il ne s’agit évidemment pas d’identifier les deux périodes. 1968 a constitué un événement historique majeur, marquant la sortie de plus de quatre décennies de contre-révolution ; il a eu une portée et une signification considérables pour le prolétariat international auxquelles la situation actuelle ne saurait être comparée.
Mais aujourd’hui, on assiste à l’effondrement de ce qui apparaissait en quelque sorte comme une consolation après des années de bagne salarié et qui a constitué un des piliers permettant au système de "tenir" pendant vingt ans : la retraite à 60 ans, avec la possibilité, à partir de cet âge-là, de goûter une vie tranquille, dégagée de nombreuses contraintes matérielles. Aujourd'hui, les prolétaires se voient contraints d'abandonner cette illusion de pouvoir échapper pendant les dernières années de leur vie à ce qui est vécu de plus en plus comme un calvaire : la dégradation des conditions de travail dans un environnement où sévissent les pénuries d’effectifs, l’augmentation constante des charges de travail, l’accélération des cadences. Soit ils devront travailler plus longtemps ce qui veut dire une amputation de la durée de cette période où ils pouvaient enfin échapper à l'esclavage salarié, soit, pour ne pas avoir cotisé assez longtemps, ils seront réduits à une misère noire, le tourment des privations se substituant à celui des cadences infernales. Cette situation nouvelle pose pour tous les ouvriers la question du futur.
De plus, l’attaque sur les retraites concerne et touche tous les ouvriers, jette un pont sur le fossé qui s’était creusé entre les générations d’ouvriers alors que le poids du chômage reposait surtout sur les épaules des jeunes générations et tendait à les isoler dans le "no future". C’est pour cela que toutes les générations d’ouvriers jusqu’aux plus jeunes se sont senti impliquées, alertées par cette attaque sur les retraites dont la nature même est susceptible de créer un sentiment d’unité dans la classe et de faire germer une réflexion en profondeur sur l’avenir que réserve la société capitaliste.
Avec cette nouvelle étape dans l’aggravation de la crise, apparaissent les ingrédients et mûrissent les germes pour la remise en cause de certains garde-fous idéologiques édifiés par la bourgeoisie au cours des années précédentes : la classe ouvrière n’existe plus, il est possible d’améliorer ses conditions de vie et de réformer le système ne serait-ce que pour profiter d'une fin de vie paisible ; tout ce qui poussait les ouvriers à la résignation envers leur sort. Cela entraîne une maturation des conditions pour que la classe ouvrière retrouve la conscience de sa perspective révolutionnaire. Les attaques unifient les conditions pour une riposte ouvrière à une échelle de plus en plus large, au-delà des frontières nationales. Elles tissent une même toile de fond pour des luttes plus massives, plus unitaires et plus radicales.
Elles constituent le ferment d'un lent mûrissement des conditions pour l’émergence de luttes massives qui sont nécessaires à la reconquête de l’identité de classe prolétarienne et pour faire tomber peu à peu les illusions, notamment sur la possibilité de réformer le système. Ce sont les actions des masses elles-mêmes qui permettront la réémergence de la conscience d’être une classe exploitée porteuse d’une autre perspective historique pour la société. Pour cela, la crise est l’alliée du prolétariat. Pour autant, le chemin que doit se frayer la classe ouvrière pour affirmer sa propre perspective révolutionnaire n’a rien d’une autoroute, il va être terriblement long, tortueux, difficile, semé d’embûches, de chausse-trapes que son ennemi ne peut manquer de dresser contre elle.
C’est une défaite que viennent de subir les prolétaires dans leurs luttes contre les attaques de l’Etat sur les retraites, en France et en Autriche notamment. Néanmoins, cette lutte a constitué une expérience positive pour la classe ouvrière en premier lieu parce qu'elle a réaffirmé son existence et sa mobilisation sur son terrain de classe.
Face aux autres attaques que la bourgeoisie prépare contre elle, la classe ouvrière n’a pas d’autre choix que de développer son combat. Elle connaîtra inévitablement d’autres échecs avant de pouvoir affirmer sa perspective révolutionnaire. Comme Rosa Luxemburg le soulignait avec force dans son dernier article, L’ordre règne à Berlin, rédigé à la veille de son assassinat par la soldatesque aux ordres du gouvernement social-démocrate : "Les luttes partielles de la révolution finissent toutes par une ‘défaite’. La révolution est la seule forme de ‘guerre’ – c'est encore une des lois de son développement - où la victoire finale ne peut être préparée que par une série de ‘défaites’". Mais Rosa Luxemburg ajoutait : "A une condition il est vrai ! Car il faut étudier dans quelles conditions la défaite s'est chaque fois produite." (Die Rote Fahne, 14 janvier 1919) Effectivement, pour que ses "défaites" participent de la victoire finale, il faut que le prolétariat soit capable d'en tirer des enseignements. En particulier, il va devoir comprendre que les syndicats sont partout des organes de défense des intérêts de l'Etat contre les siens propres. Mais plus généralement, il doit prendre conscience qu'il doit affronter un adversaire, la bourgeoisie, qui sait manœuvrer pour défendre ses intérêts de classe, qui peut compter sur toute une panoplie d'instruments pour protéger sa domination, depuis ses flics et ses prisons jusqu'à ses partis de gauche et même ses "révolutionnaires" estampillés (les groupes gauchistes, notamment trotskistes) et qui surtout dispose de tous les moyens (y compris ses "universitaires") pour tirer ses propres enseignements des affrontements passés. Comme le disait encore Rosa Luxemburg : "La révolution n'agit pas à sa guise, elle n'opère pas en rase campagne, selon un plan bien mis au point par d'habiles "stratèges". Ses adversaires aussi font preuve d'initiative, et même en règle générale, bien plus que la révolution." (Ibid.) Dans son combat titanesque contre son ennemi capitaliste, le prolétariat ne pourra compter que sur ses propres forces, sur son auto-organisation et surtout sur sa conscience..
Wim (22 juin)
Géographique:
- France [68]
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [70]
Après la guerre en Irak : Le "nouvel ordre mondial" signifie toujours plus de chaos
- 3963 reads
Les trois semaines de guerre éclair en Irak ont largement confirmé la validité de l'expression selon laquelle, avant même que la première balle soit tirée, "la première victime de la guerre, c'est la vérité". En fait, jamais auparavant une guerre n'a été autant médiatisée, "vendue", surtout à la population américaine, avec toute la technique et la sophistication de l'industrie cinématographique hollywoodienne.
D'abord, la mise en scène, avec l'épouvantable dictateur menaçant toute l'humanité avec ses armes de destruction massive, comme dans un film de James Bond. Heureusement, il y a le président Bush, déterminé et courageux, qui vient prendre les choses en main ! Il se veut rassurant : la guerre sera courte et peu coûteuse ; les GIs libérateurs seront accueillis les bras ouverts par une population en liesse.
Seulement, les commanditaires du film savent pertinemment qu'il n'en sera pas ainsi et qu'une fois la guerre engagée, il faudra vendre l'idée d'une longue occupation. Alors, ils ont recours aux techniques du film d'action, où le héros doit toujours se trouver en mauvaise posture au milieu du film, sans quoi le dénouement perdrait tout intérêt - en mauvaise posture, de surcroît, parce que notre héros refuse de se servir des méthodes criminelles de son adversaire. On nous a donc servi, pendant une semaine, le piétinement de l'avancée américaine confrontée à une résistance plus importante que prévue de "terroristes fanatisés". Tout semble tourner mal, et voilà qu'on nous remonte le moral avec un "remake" du "Il faut sauver le soldat Ryan"([1] [71]) : l'opération montée pour arracher le soldat Jessica Lynch des mains de ses tortionnaires arabes. Surfant sur la vague de ce nouvel élan, les "boys" surgissent d'un coup du désert, fondent sur Bagdad comme la cavalerie sur un campement sioux, l'affreux tyran est évincé du pouvoir et le soleil peut se coucher sur Old Glory([2] [72]) flottant au-dessus d'un Irak enfin libre, heureux et prospère.
Le problème est que le film est très loin de la réalité.
Nous ne savons pas quels étaient les calculs de l'Etat-major américain, ni pourquoi l'offensive américaine a semblé piétiner pendant sa deuxième semaine. Par contre, on peut affirmer que le sauvetage de Jessica Lynch était une pure falsification([3] [73]), et que l'avancée de l'armée américaine a eu lieu sous le couvert d'un déluge de feu, y compris des bombes à fragmentation, larguées sur les populations civiles. Si les "armes de destruction massive" que la guerre devait arracher des mains du tyran Saddam restent désespérément introuvables, on a vu en revanche à l'œuvre celles des croisés de la "coalition". Et aujourd'hui, la "liberté" et "l'ordre" que les forces d'occupation devaient apporter, se sont révélés être la "liberté" pour les bandes armées de tous bords d'imposer leur "ordre" à une population démunie de tout. Les seuls cadavres qu'on nous montre, sont ceux des victimes de l'ancien régime vieux de 12 ans, non pas ceux bien plus récents, et qui doivent se compter aussi par milliers, des soldats et des civils ensevelis sous la puissance de feu terrifiante de la plus grande machine de guerre de la planète, une armée qui à elle seule engloutit plus de la moitié des dépenses mondiales d'armement. On ne peut faire absolument aucune confiance aux médias, qu'ils soient américains essayant de nous convaincre du bien fondé de la guerre, ou européens en train de soutenir les exigences de leurs gouvernements (parmi lesquels l'Etat français n'est pas le moindre) cherchant à se réintroduire dans la région par le biais des Nations Unies. Il n'y a qu'un point de repère fiable dans ce monde de mensonges, c'est le point de vue de classe.
Il faut donc commencer par placer la situation en Irak, et plus généralement au Moyen Orient, dans son contexte international, celui des rivalités qui opposent les Etats-Unis aux autres grandes puissances, puisque c'est le jeu stratégique entre ces puissances, et surtout la volonté américaine d'encercler l'Europe et de freiner l'expansion de l'Allemagne, qui a engendré la guerre.
Comme nous l'avions écrit en 1990, l'effondrement du bloc russe et la désagrégation du bloc américain qui devait inévitablement s'ensuivre, "ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales (...) du fait de la disparition de la discipline imposée par la préseuce des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus fréquents en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est plus faible" (Revue Internationale n°61). "Dans la nouvelle période historique où nous somntes rentrés (...) le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au 'chacun pour soi', où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment. Un monde de désordre meurtrier, de chaos sanglant dans lequel le gendarme américain tentera de faire régner un minimum d'ordre par l'emploi de plus en plus massif et brutal de sa puissance militaire" ("Militarisme et décomposition", Revue Internationale n°64).
Les années qui ont suivi la première guerre du Golfe, celle de 1991, ont vu une contestation grandissante de l'autorité américaine par les puissances rivales (poussée allemande et positionnement des forces françaises et britanniques dans les Balkans en particulier), ainsi qu'une indiscipline permanente de la part d'Etats qui devaient lui être parfaitement inféodés (faillite totale du "processus de paix" d'Oslo en Israël, ainsi que des efforts de Clinton pour stabiliser la situation entre Israël et la Palestine). Le fait qu'après le 11 septembre 2001, les Etats-Unis aient frappé un grand coup, sans précédent, pour montrer leur force et rétablir leur autorité, est donc déjà largement inscrit dans la réalité de 1989 telle que nous l'avions analysée à l'époque.
A ce niveau-là, la guerre a clairement affirmé la puissance de feu écrasante des forces armées américaines et l'incapacité totale de "l'Europe" de s'y opposer. Jamais les bourgeoisies française et allemande n'étaient montées autant au créneau qu'avant la guerre. Jamais non plus, elles ne se sont trouvées aussi seules. La France a été abandonnée par ses alliés latins "naturels" - l'Italie et l'Espagne. L'Allemagne a pu voir la plupart des pays de l'Europe de l'Est où son influence économique est pourtant largement dominante non seulement prendre position en faveur des Etats-Unis, mais, pire encore, participer activement dans la guerre : la Hongrie a fourni des camps d'entraînement aux forces d'opposition irakiennes embarquées avec l'armée américaine, alors que la Pologne a envoyé des troupes en Irak. Le fait que ces troupes (environ 2000 hommes) se voient octroyer aujourd'hui une zone d'occupation en Irak n'est certainement pas en raison de leurs qualités militaires, mais un moyen de plus pour les Etats-Unis de pousser à la division en Europe entre l'Allemagne et ses voisins. II est probable que, dans un proche avenir, les Etats-Unis vont encore plus étendre leur emprise sur la zone d'influence traditionnelle allemande, puisque la Bulgarie et la Roumanie, avec leurs ports sur la Mer noire, devront accueillir une partie des 80 000 hommes des troupes américaines actuellement basées en Allemagne.([4] [74])
Face à la surpuissance si brutalement affichée par les Etats-Unis, les efforts actuels de la France et de l'Allemagne de monter une force militaire européenne risquent presque de les ridiculiser plus qu'autre chose : cette force, basée sur les commandos belges et les services secrets luxembourgeois, vient de prendre position en Macédoine avec un effectif total de 350 hommes. Mais ce n'est pas pour autant que les deux alliés vont désarmer, bien au contraire. La détermination franco allemande de continuer à revendiquer des "droits" face aux Etats-Unis et surtout de se donner les moyens de les défendre est néanmoins clairement affirmée par le lancement de deux programmes de haute technologie de grande envergure: le système européen de GPS([5] [75]) et le gros porteur militaire d'Airbus.
L'extrême faiblesse de la coalition franco-allemande sur le plan militaire est encore plus évidente face à la victoire rapide et spectaculaire des Etats-Unis en Irak, qui a démontré on ne peut plus clairement que non seulement les Américains détiennent une puissance écrasante - ce que tout le monde savait mais surtout qu'ils sont prêts à s'en servir. Dans un premier temps après la guerre, le "camp de la paix" (la France, l'Allemagne et la Russie) a essayé d'imposer un retour de son influence en s'opposant à la levée des sanctions des Nations Unies contre l'Irak, et en insistant sur le fait que la recherche, infructueuse à ce jour, des ADM devrait être entre les mains de l'équipe onusienne des inspecteurs de Hans Blix. Ces Etats espéraient ainsi maintenir en vie le programme de l'ONU dit "pétrole contre nourriture" qui en fait plaçait les profits tirés des ressources pétrolières irakiennes sous le contrôle de l'ONU. En effet c'est à travers l'ONU qu'ils peuvent, jusqu'à un certain point, contrer les visées américaines. Le but était de décourager la mise en vente du pétrole irakien par les forces d'occupation en lui enlevant tout cadre légal dans le système du commerce mondial. Mais cette tentative a fait long feu face à la détermination américaine d'imposer sa volonté selon le principe "possession vaut loi". De surcroît, si les gouvernements du "camp de la paix" ont pu s'attribuer le beau rôle en opposant le "droit international" aux menées guerrières des Etats-Unis et en se servant de cette mystification pacifiste pour encourager les énormes manifestations "anti-guerre", aujourd'hui les rôles sont inversés. Ce sont les forces d'occupation qui se présentent comme investies d'une oeuvre humanitaire en remettant en état de marche l'infrastructure et l'économie irakienne pour les "rendre à leur peuple", alors que le "camp de la paix" risque au contraire de donner l'impression (tout à fait justiftée) qu'il met en avant ses propres intérêts sordides au détriment de la remise sur pied dès que possible de l'économie dont dépend la population nouvellement "libérée" de l'Irak.
Face au refus brutal du gouvernement américain d'envisager un quelconque rôle pour l'ONU dans la reconstruction de l'Irak, le "camp de la paix" s'est trouvé obligé de faire marche arrière et de lever ses objections. Le 9 mai, à la suite d'une réunion au sommet avec le président polonais Aleksander Kwasniewski, Schrôder déclare : "Nous sommes prêts à trouver des solutions pragmatiques (...) Je pense que nous pouvons arriver à une conclusion satisfaisante", alors que Chirac affirme "l'esprit constructif et d'ouverture" de la France en ajoutant que "la guerre c'est une chose, la gestion de da paix en est une autre".([6] [76]) Une fois que leurs rivaux ont battu en retraite, les Etats-Unis ont beau jeu de se montrer bon prince et d'accepter la prolongation du mandat onusien sur la vente du pétrole irakien des quatre mois qu'ils avaient proposés à... six mois, et de demander la désignation d'un "représentant spécial" de l'ONU plutôt qu'un simple "coordinateur". Peu importent les mots, l'essentiel c'est que le "camp de la paix" a été obligé de donner son aval à la présence en Irak des troupes américaines pour une période indéterminée. La force armée fera le reste.
Cela dit, ce n'est pas pour autant que les gouvernements français et allemand vont abandonner leurs tentatives de se réintroduire sur le terrain. La France d'abord, a organisé récemment un grand exercice de séduction auprès de l'Algérie, y compris par la visite du Président Chirac lui-même. De même, la nouvelle présence de forces françaises en Côte d'Ivoire et maintenant au Congo montre clairement une tentative de retour en force de la France dans son pré-carré africain traditionnel. Du côté allemand, la visite en Algérie de Joschka Fischer, accompagné d'une équipe des services secrets, semble indiquer que l'Allemagne et la France ont décidé momentanément de mettre de côté leur rivalité dans la région afin de faire face aux menées des Etats-Unis et de défendre les positions françaises au Maghreb. .
La France et l'Allemagne n'ont pas désarmé non plus au niveau plus global. Battue en brèche à l'ONU, la France a ainsi décidé de se servir de la conférence du G8 à Evian([7] [77]) pour faire de nouveau contrepoids aux Etats-Unis, en y invitant 22 pays "en voie de développement" dont aucun n'a soutenu la guerre américaine.
Un autre grand perdant de la guerre, c'est la Grande-Bretagne qui s'était rangée du côté américain, non pas par une amitié indéfectible mais pour défendre ses propres intérêts impérialistes dans la région et aussi pour tenter de retenir les Etats-Unis dans le cadre de l'ONU et du "droit international". En réalité, la bourgeoisie britannique sait aussi bien que la française qu'elle a besoin de lier les Etats-Unis à l'ONU afin de préserver au maximum sa propre influence sur son "allié" surpuissant. Ainsi, dès la fin de la guerre, le gouvernement de Tony Blair insistait auprès des Américains pour que l'ONU retrouve un rôle prépondérant en Irak. Ces derniers ont refusé aux Anglais plus poliment qu'aux Français, mais non moins nettement, et les Anglais n'ont pas eu d'autre choix que de se résigner avec l'espoir (pour le moment déçu) de pouvoir ramasser quelques miettes parmi les juteux contrats de reconstruction. Cette incapacité de faire prévaloir les intérêts britanniques, et le sentiment d'avoir sacrifié son influence en Europe pour rien, trouve son expression aujourd'hui en Grande Bretagne dans une intense campagne anti-Blair autour des ADM introuvables.
"Pax americana" au Moyen-Orient?
Bien que la situation soit actuellement très mouvante, de sorte qu'il est difficile de faire des prévisions précises à court terme, trois éléments principaux ressortent de la stratégie américaine actuelle au Moyen Orient.
Premièrement, l'intention affichée clairement et de façon répétée par les dirigeants américains de maintenir une force d'occupation massive en Irak dans le moyen terme, malgré son coût faramineux ( 1 milliard de dollars par semaine). Les Etats-Unis vont ainsi maintenir une ligne d'occupation, allant du sud de la péninsule arabique jusqu'en Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan) en passant par l'Irak et l'Afghanistan. En même temps, ils essaient d'associer d'autres pays à la force d'occupation (l'Inde en est l'exemple le plus récent, avec qui des pourparlers se poursuivent actuellement), et donc d'utiliser encore l'Irak comme un moyen de diviser leurs rivaux. Par contre, il est clair qu'ils n'admettront aucun "partenaire" dans leur gestion de la région, c'est pourquoi la "feuille de route" pour la Palestine - qui était parrainée par les Etats-Unis, l'ONU, l'Union européenne et la Russie - sera mise en oeuvrc par les Etats-Unis seuls.
Deuxièmement, les Etats-Unis semblent vouloir associer l'Iran à leur dispositif diplomatico-militaire dans la région. Déjà, pendant la guerre en Afghanistan, ils ont pu bénéficier de la coopération et de renseignements apportés par les forces spéciales iraniennes. Plus significatif encore est le marchandage avec l'Iran autour du sort réservé au Moudjahidines du peuple, le groupe d'opposition iranien, soutenu et armé par Saddam, ayant des bases en Irak, près de la frontière iranienne. Washington, en effet, aurait obtenu la bienveillance iranienne pendant la guerre en promettant de bombarder les bases des Moudjahidines. Seulement les forces américaines - qui n'ont rien à apprendre en matière de perfidie de leurs prédécesseurs britanniques - n'ont pas joué franc jeu et n'ont bombardé qu' une base vide, laissant intacte la capacité de combat des Moudjahidines. La fin de la guerre venue, ces derniers pouvaient servir de pion dans un marchandage avec l'Iran. C'est effectivement ce qui semble s'être passé : aux dernières informations (10/05/2003, Associated Press), l'année américaine a entouré la zone contrôlée par les Moudjahidines en exigeant leur reddition immédiate et sans condition - ouvrant ainsi la voie pour un futur massacre par les forces pro-iraniennes. Pourquoi une telle volte-face? Elle n'est certainement pas étrangère à la visite du président iranien Muhammad Khatami au Liban, pendant laquelle il aurait fortement fait pression sur le Hezbollah pour qu'il mette fin à son activité militaire contre les Israéliens dans le sud du Liban sur la frontière avec Israël.
En Irak même, c'est pratiquement dès son arrivée, que le nouveau chef civil de l'occupation, Jerry Bremer, a annoncé qu'il n'accepterait pas le retour des hauts fonctionnaires du régime baasiste et a accordé ses actes à ses paroles en en congédiant plusieurs de leurs postes. En même temps, il a intégré les hommes du SCIRI([8] [78]) au comité consultatif de l'administration d'occupation.
C'est le "gros lot" en perspective pour Washington qui peut envisager non seulement d'utiliser l'Iran dans son jeu autour d'Israël et de la Palestine, mais en plus d'y éclipser l'influence européenne, allemande en particulier. Va-t-on voir bientôt des expressions ouvertes d'amitié entre le pilier iranien de "l'Axe du mal" et le "Grand Satan"?
On peut, de toute façon, s'attendre à voir les marchandages, les tentatives de séduction et la pression s'accroître autour de l'Iran dans la période qui vient, alors qu'Américains et Européens essaient d'y renforcer leur influence. Si les Etats-Unis jouent plus sur le registre de la pression (avec l'encouragement ouvert des récentes manifestations anti-gouvernementales à Téhéran et les menaces à peine voilées à propos du programme nucléaire iranien([9] [79]), la France essaie apparemment de jouer la séduction avec la récente opération contre le centre politique des Moudjahidines du peuple dans la banlieue parisienne.'([10] [80])
La question palestinienne
Cela dit, pour le moment, la question palestinienne reste la plus sensible parmi les trois éléments. S'il y a une chose sur laquelle tous les commentateurs des médias bourgeois sont d'accord, c'est que pour imposer durablement leur ordre au Moyen Orient, les Etats-Unis doivent se donner les moyens de régler le conflit israélo-palestinien. L'Intifada, avec son lot quotidien de tueries dont la population palestinienne est la principale victime, est devenue un véritable point de fixation pour les pays arabes. Pour les classes dirigeantes, elles-mêmes déstabilisées par l'exaspération ressentie par les classes exploitées, c'est la preuve quotidienne que le parrain américain se moque royalement de leurs intérêts, ce qui limite l'avantage qu'ils trouvent à soutenir l'ordre de l'impérialisme des Etats-Unis.
George Bush est donc revenu à la charge sur la question palestinienne en essayant d'imposer une "feuille de route" pour la paix, aux israéliens et à l'Autorité palestinienne de Yasser Arafat. Pour ce faire, il a mis en jeu son autorité et celle des Etats-Unis comme jamais un président ne l'avait fait auparavant sur la question palestinienne. II a non seulement insisté pour qu'Israël accepte un Etat palestinien "viable" avec une continuité de territoire, mais il a désigné un émissaire - John Wolf - qui doit rester sur place pour veiller à la "pax americana", alors que Condoleeza Rice devient conseillère du président avec la responsabilité particulière de cette question.
Face à une telle pression, les premiers ministres d'Israël et de Palestine n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter le 'déal". Mahmoud Abbas s'est engagé à mettre fin aux attaques terroristes. Sharon à son tour doit commencer à démanteler certaines des colonies les plus récentes ou les moins bien installées. La viabilité de l'accord reste pourtant extrêmement incertaine. Rien que le temps d'écrire cet article, nous avons assisté à des revirements à répétition de la situation. Dans un premier temps, le Jihad islamique a accepté l'accord, et même le Hamas s'est dit prêt à mettre fin à ses attaques contre les civils. Mais Tsahal n'a pas arrêté ses attaques contre les palestiniens, et c'est à peine quelques jours après le sommet d'Aqaba ou Sharon et Mahmoud Abbas se sont serré la main autour de l'accord que le Hamas, le Jihad Islamique et les Brigades al-Aqsa ont lancé une nouvelle attaque armée contre un poste de l'armée israélienne, tuant quatre soldats et indiquant très clairement qu'ils n'ont pas l'intention de respecter les engagements d'Abbas. C'est d'autant plus inquiétant pour ce dernier que les Brigades al-Aqsa font partie de son propre mouvement et de celui d' Arafat, E1-Fatah.
A l'heure où nous écrivons, l'armée israélienne continue de cibler les responsables du Hamas, et le gouvernement égyptien essaie de venir en aide au processus en rafistolant un accord entre le Hamas et Mahmoud Abbas.
II est quasiment impossible de prévoir comment les choses vont évoluer dans le court terme. Par contre, il est clair que la situation d'ensemble de la région reste complètement dominée par ce phénomène caractéristique de la décomposition de la société capitaliste : la guerre de tous contre tous et l'incapacité même des Etats-Unis d'imposer leur disciplne sur les puissances de troisième ordre comme l'Iran, encore moins sur les diverses bandes armées qui se battent chacune pour leurs intérêts particuliers. Un autre aspect caractéristique du conflit, c'est la nature profondément réactionnaire et même irrationnelle de ces mêmes bandes, que ce soit celles des colons israéliens qui rêvent de recréer l'Eretz Israel de David et Salomon ou les bandes non moins brutales du Hamas qui veulent revenir à l'Etat islamique mythique de l'époque de Mahomet. Que ces groupements puissent mettre en cause les intérêts et les désirs des Etats-Unis montre à quel point la désagrégation de la discipline autrefois imposée par "l'ordre" des deux blocs impérialistes est complète.
Au milieu de la confusion qui caractérise la situation
au Moyen-Orient, une chose est néanmoins parfaitement claire : l'intervention
des Etats-Unis en Irak n'a absolument rien réglé dans la région. Toutes les
rivalités locales en Irak restent entières. Plus encore, la disparition de
Saddam Hussein fait sauter un verrou qui leur avait jusque là imposé une certaine
stabilité. Le vide du pouvoir laissé par l'effondrement de l'Etat irakien
introduit, en plus, un nouvel élément d'instabilité dans la région qui va
offrir un point d'appui pour que les puissances rivales sèment le désordre dans
la pax americana.
II n'y aura pas de "super-impérialisme"
Au début du 20e siècle, le courant réformiste de la social-démocratie allemande - et notamment Karl Kautsky - qui allait trahir le prolétariat pendant la guerre, a défendu l'idée que la concentration progressive du pouvoir dans la société capitaliste allait aboutir dans l'émergence d'un "super-impérialisme" et que celui-ci mettrait fin aux conflits impérialistes en imposant sa volonté sur le monde entier.
Cette idée est aujourd'hiu reprise dans une version plus moderne et "de droite" par certains "penseurs" des "think-tanks" américains. Ceux-ci commencent à prôner ouvertement un "nouveau colonialisme", où les Etats-Unis imposeraient leur ordre sur les "Etats en faillite" afin de les refaire sur le modèle de la "démocratie libérale" américaine.''([11] [81])
Mais loin d'apporter de l'ordre, les efforts de la super-puissance américaine d'imposer son autorité attisent les rivalités entre les puissances de deuxième et troisième ordre - jusqu'au gangstérisme local des milices religieuses, nationalistes, et autres - et poussent ces dernières à chercher les moyens de défendre leurs propres intérêts.
Avant 1989, la confrontation entre les deux super-puissances (russe et américaine) contenait les conflits dans un certain cadre. Aujourd'hui, aucune puissance ne peut s'opposer frontalement aux EtatsUnis. Elles ne peuvent qu'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues en soutenant en sous-main d'autres velléités d'opposition. De surcroît, pour les Etats plus démunis, la guerre contre l'Irak est loin de constituer un avertissement préventif efficace contre la détention des armes de destruction massive. Bien au contraire, la victoire écrasante des Etats-Unis en Irak - un pays qui très visiblement ne possédait pas d'ADM - ne peut que pousser des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, l'Inde ou le Pakistan, à développer ou à maintenir leur propre armement nucléaire. Ils y seront aidés par des Etats de deuxième ordre qui chercheront ainsi (comme la Russie en Iran) à fidéliser des clients prêts à s'opposer aux ambitions américaines.
L'épouvantable boucherie de la première guerre mondiale a démontré la vacuité de la théorie de Kautsky sur le "super-impérialisme". La guerre, et la révolution d'Octobre qui y a mis fin, ont confirmé que seule la révolution prolétarienne est capable, en renversant la barbarie du capitalisme, de libérer l'humanité de la guerre et de la misère.
Jens, 17 juin 2003
[1] [82] Film récent sur la Deuxième guerre mondiale, qui raconte une opération de sauvetage montée par l'armée américaine afin de récupérer un GI perdu derrière les lignes allemandes-la coïncidence est vraimanttrop frappante.
[2] [83] Le drapeau américain
[3] [84] Un reportage de la BBC a révélé que les troupes irakiennes avaient abandonné le terrain bien avant l'opération, que Jessica Lynch n'avait pas été torturée mais au contraire soignée du mieux possible par l'équipe de l'hôpital qui avait même tenté de la ramener aux avant-postes américains mais qui s'est fait tirer dessus et a dû abandonner.
[4] [85] Financial Times, 08/05/03. Toutes les informations sont tirées du site www.ft.corn [86].
[5] [87] Un système qui est d'une futilité totale sur le plan commercial, puisqu'il va faire double emploi avce celui des américains.
[6] [88] Financial Times, 09/05/03.
[7] [89] Sous présidence fran4ai,cpar le hasard de la rotation.
[8] [90] Supreme Council for Islamic Revolution in Irak, inféodé à l'Iran
[9] [91] Voir The: Economist du 14 juin 2003
[10] [92] Ce centre était installé depuis 20ans, sans jamais le moindre ennui de la part des autorités françaises - il était au contraire protégé par les gendarmes jusqu'à il y a quelques jours, avant cette opération quasi-militaire que le gouvernement de Raffarin a eu l'incroyable culot de placer sous l'enseigne "anti-terroriste".
[11] [93] Un exemple parmi d'autres de cette tendance est la suggestion par Max Singer du très sérieux Hudson Institutc que les EU devraient occuper les provinces orientales (et pétrolifères) de l'Arabie Saoudite, et les transformer en Etat chiite d'obédience américaine.
Géographique:
- Irak [51]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [52]
Questions théoriques:
- Décomposition [94]
XVe Congrès du CCI : Renforcer l'organisation face aux enjeux de la période
- 3608 reads
Fin mars, le CCI a tenu son 15e congrès. La vie des organisations révolutionnaires est partie prenante du combat du prolétariat. Il appartient donc à celles-ci de faire connaître à leur classe, notamment à leurs sympathisants et aux autres groupes du camp prolétarien, le contenu des travaux de ce moment de la plus haute importance que constitue leur congrès. C'est l'objet du présent article.
Le 15e congrès revêtait pour notre organisation une importance toute particulière ; pour deux raisons essentielles.
D'une part, nous avons connu depuis le précédent congrès, qui s'est tenu au printemps 2001, une aggravation très importante de la situation internationale, sur le plan de la crise économique et surtout sur le plan des tensions impérialistes. Plus précisément, le congrès s'est déroulé alors que la guerre faisait rage en Irak et il était de la responsabilité de notre organisation de préciser ses analyses afin d'être en mesure d'intervenir de la façon la plus appropriée possible face à cette situation et aux enjeux que représente pour la classe ouvrière cette nouvelle plongée du capitalisme dans la barbarie guerrière.
D'autre part, ce congrès se tenait alors que le CCI avait traversé la crise la plus dangereuse de son histoire. Même si cette crise avait été surmontée, il appartenait à notre organisation de tirer le maximum d'enseignements des difficultés qu'elle avait rencontrées, sur leur origine et les moyens de les affronter.
L'ensemble des discussions et travaux du congrès a été traversé par la conscience de l'importance de ces deux questions, lesquelles s'inscrivaient dans les deux grandes responsabilités de tout congrès : l'analyse de la situation historique et l'examen des activités qui en découlent pour l'organisation. Tous ces travaux se sont basés sur des rapports discutés au préalable dans l’ensemble du CCI et ils ont débouché sur l’adoption de résolutions donnant le cadre de référence pour la poursuite du travail au niveau international.
Dans le précédent numéro de la Revue internationale, nous avons publié la résolution sur la situation internationale qui a été adoptée par le congrès. Comme chaque lecteur de cette résolution peut le constater, le CCI analyse la période historique actuelle comme la phase ultime de la décadence du capitalisme, la phase de décomposition de la société bourgeoise, celle de son pourrissement sur pied. Comme nous l'avons mis en avant à de nombreuses reprises, cette décomposition provient du fait que, face à l'effondrement historique irrémédiable de l’économie capitaliste, aucune des deux classes antagoniques de la société, bourgeoisie et prolétariat, ne parvient à imposer sa propre réponse : la guerre mondiale pour la première, la révolution communiste pour la seconde. Ces conditions historiques, comme nous le verrons plus loin, déterminent les caractéristiques essentielles de la vie de la bourgeoisie aujourd'hui ; mais pas seulement : elles pèsent aussi lourdement sur le prolétariat ainsi que sur ses organisations révolutionnaires.
C'est donc dans ce cadre qu'ont été examinés, non seulement l'aggravation des tensions impérialistes que l'on connaît à l'heure actuelle, mais aussi les obstacles que rencontre le prolétariat sur son chemin vers les affrontements décisifs contre le capitalisme de même que les difficultés auxquelles a été confrontée notre organisation.
L'analyse de la situation internationale
Pour certaines organisations du camp prolétarien, notamment le BIPR, les difficultés organisationnelles rencontrées par le CCI dernièrement, comme celles qu'il avait connues en 1981 et au début des années 1990, proviennent de son incapacité à fournir une analyse appropriée de la période historique actuelle. En particulier, notre analyse de la décomposition est considérée comme une manifestation de notre "idéalisme".
Nous pensons que l'appréciation du BIPR concernant les origines de nos difficultés organisationnelles révèle en réalité une sous-estimation des questions d'organisation et des leçons tirées par le mouvement ouvrier à ce sujet. Cependant, il est vrai que la clarté théorique et politique est une arme essentielle pour une organisation qui prétend être révolutionnaire. En particulier, si elle n'est pas en mesure de comprendre les véritables enjeux de la période historique dans laquelle elle mène son combat, elle risque d'être ballottée par les événements, de sombrer dans le désarroi et finalement d'être balayée par l'histoire. Il est vrai aussi que la clarté ne se décrète pas. Elle est le fruit d’une volonté, d’un combat pour forger de telles armes. Elle exige d’affronter les questions nouvelles que pose l’évolution des conditions historiques avec méthode, la méthode marxiste.
Il s'agit là d'une tâche et d'une responsabilité permanentes dans les organisations du mouvement ouvrier. Cette tâche a revêtu une importance plus aiguë à certaines périodes, comme à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le développement de l’impérialisme annonçait l’entrée prochaine du capitalisme dans sa phase de décadence. Engels, se projetant dans cette analyse, avait été capable d’annoncer, dès les années 1880, l’alternative historique qui se dessinait : Socialisme ou Barbarie. Rosa Luxemburg, au congrès de l’Internationale socialiste à Paris, en 1900, prévoyant l’entrée en décadence du capitalisme, envisageait comme possible que cette nouvelle période soit inaugurée par la guerre : "Il est possible que la première grande manifestation de la faillite du capitalisme qui est devant nous, ne soit pas la crise mais l’explosion de la guerre". Franz Mehring, un des porte-parole de la gauche au sein de la social-démocratie, mesurait dès 1899, dans la Neue Zeit, toute la responsabilité historique qui désormais allait plus fortement reposer sur la classe ouvrière : "L’époque de l’impérialisme est l’époque de la faillite du capitalisme. Si la classe ouvrière n’est pas à la hauteur, c’est l’ensemble de l’humanité qui est menacée." Mais cette détermination à vouloir analyser et comprendre la période, afin de forger les armes de la lutte, n’était pas le fait de tous et de chacun dans la social-démocratie. Sans parler du révisionnisme de Bernstein ni des discours des adorateurs de la "bonne vieille tactique éprouvée", on a vu un Kautsky, la référence théorique de toute l'Internationale socialiste, défendre l’orthodoxie des positions marxistes mais refuser de les utiliser pour analyser la nouvelle période qui s’ouvrait. Le renégat Kautsky (comme l'a qualifié par la suite Lénine) pointait déjà chez le Kautsky qui ne voulait pas regarder en face la nouvelle période et qui, notamment, se refusait à considérer comme inéluctable la guerre entre les grandes puissances impérialistes.
En pleine contre-révolution, dans les années1930 et 40, la Fraction italienne de la Gauche communiste, puis la Gauche communiste de France ont poursuivi cet effort pour analyser, "sans ostracisme" (comme l'écrivait Bilan, la revue de la Fraction italienne), autant l'expérience passée que les nouvelles conditions historiques qui se présentaient. Cette attitude est celle du combat qu’a toujours mené l’aile marxiste dans le mouvement ouvrier pour faire face à l’évolution de l’histoire. Elle est aux antipodes de la vision religieuse de "l’invariance", chère au courant bordiguiste, qui voit le programme non comme le produit d’une lutte théorique permanente pour analyser la réalité, tirer des leçons, mais comme un dogme révélé depuis 1848 auquel "il ne faut pas changer une virgule". La tâche d’actualiser et d'enrichir, en permanence, les analyses et le programme, dans le cadre du marxisme, est une responsabilité essentielle pour le combat.
C'est la préoccupation qui animait les rapports préparés pour le congrès et qui a traversé ses débats. Le congrès a eu le souci d'inscrire ses travaux dans le cadre de la vision marxiste de la décadence du capitalisme et de sa phase actuelle de décomposition. Il a rappelé que la vision de la décadence non seulement était celle de la Troisième Internationale, mais qu’elle est une base même de la vision marxiste. C’est ce cadre et cet éclairage historique qui ont permis au CCI de mesurer la gravité de la situation dans laquelle la guerre devient un facteur de plus en plus permanent dans la vie de la société.
Plus précisément, le congrès se devait d'examiner dans quelle mesure le cadre d'analyse que s'est donné le CCI a été capable de rendre compte de la situation présente. Suite à la discussion, le congrès a conclu qu'il n'était pas utile de remettre en cause ce cadre, bien au contraire. La situation actuelle et son évolution constituent en fait une pleine confirmation des analyses que le CCI s'était données dès la fin de 1989, au moment même de l’effondrement du bloc de l’Est. Les événements actuels, comme l'antagonisme croissant entre les États-Unis et leurs anciens alliés qui s'est manifesté ouvertement dans la crise récente, la multiplication des conflits guerriers avec l'implication directe de la première puissance mondiale faisant chaque fois plus l'étalage de sa force militaire étaient déjà prévus dans les Thèses que le CCI a élaborées en 1989-90.[1] Le CCI, dans son congrès, a réaffirmé aussi que l’actuelle guerre en Irak ne se réduit pas, comme certains secteurs de la bourgeoisie voudraient le faire croire, pour en minimiser la gravité, à une "guerre pour le pétrole". Dans cette guerre, le contrôle du pétrole représente un enjeu stratégique pour la bourgeoisie américaine et non pas d’abord économique. C'est un des moyens de chantage et de pression que les Etats-Unis veulent se donner pour contrer les tentatives d'autres puissances, comme les grands Etats d'Europe et le Japon, de jouer leur propre carte sur l'échiquier impérialiste mondial. En fait, derrière l'idée que les guerres actuelles auraient une certaine "rationalité économique", il y a un refus de prendre en compte l'extrême gravité de la situation dans laquelle se trouve le système capitaliste aujourd'hui. En soulignant cette gravité, le CCI s'est délibérément placé dans la démarche du marxisme qui ne donne pas aux révolutionnaires pour tâche de consoler la classe ouvrière, mais au contraire de lui faire mesurer l'importance des dangers qui menacent l'humanité et donc de souligner l'ampleur de sa propre responsabilité.
Et, dans la vision du CCI, la nécessité pour les révolutionnaires de faire ressortir face au prolétariat toute la gravité des enjeux actuels est d'autant plus importante que celui-ci éprouve à l'heure actuelle les plus grandes difficultés à retrouver le chemin des luttes massives et conscientes contre le capitalisme. C'était donc un autre point essentiel de la discussion sur la situation internationale : sur quoi peut on aujourd'hui fonder la confiance que le marxisme a toujours affirmée dans la capacité de la classe exploitée de renverser le capitalisme et de libérer l'humanité des calamités qui l'assaillent de façon croissante.
Quelle confiance peut-on avoir dans la classe ouvrière pour faire face à ces enjeux historiques ?
Le CCI a déjà, et à de nombreuses reprises, mis en évidence que la décomposition de la société capitaliste pèse d'un poids négatif sur la conscience du prolétariat[2]. De même, dès l'automne 1989, il a souligné que l'effondrement des régimes staliniens allait provoquer des "difficultés accrues pour le prolétariat" (titre d'un article de la Revue internationale n°60). Depuis, l'évolution de la lutte de classe n'a fait que confirmer cette prévision.
Face à cette situation, le congrès a réaffirmé que la classe conserve toutes ses potentialités pour parvenir à assumer sa responsabilité historique. Il est vrai qu’elle est encore aujourd’hui dans une situation de recul important de sa conscience, suite aux campagnes bourgeoises assimilant marxisme et communisme à stalinisme et établissant une continuité entre Lénine et Staline. De même, la situation présente se caractérise par une perte de confiance marquée des prolétaires en leur propre force et dans leur capacité de mener même des luttes défensives contre les attaques de leurs exploiteurs, pouvant les conduire à perdre de vue leur identité de classe. Et il faut noter que cette tendance à une perte de confiance dans la classe s'exprime même dans les organisations révolutionnaires, notamment sous la forme de poussées subites d'euphorie face à des mouvements comme celui en Argentine à la fin 2001 (présenté comme une formidable poussée prolétarienne alors qu'il était englué dans l'interclassisme). Mais une vision matérialiste, historique, à long terme, nous enseigne, comme le disent Marx et Engels qu'il ne s'agit pas de considérer "ce que tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe ce qu'il est et ce qu'il sera historiquement contraint de faire conformément à cet être." (La Sainte Famille). Une telle vision nous montre notamment que, face aux coups très forts de la crise du capitalisme, qui se traduisent par des attaques de plus en plus féroces, la classe réagit et réagira nécessairement en développant son combat.
Ce combat, à ses débuts, sera fait d’une série d’escarmouches, lesquelles annonceront un effort pour aller vers des luttes de plus en plus massives. C’est dans ce processus que la classe se comprendra à nouveau comme une classe distincte, ayant ses propres intérêts et tendra à retrouver son identité, aspect essentiel qui en retour stimulera sa lutte. De même, la guerre qui tend à devenir un phénomène permanent, qui dévoile chaque jour plus les tensions très fortes qui existent entre les grandes puissances et surtout le fait que le capitalisme est incapable d'éradiquer ce fléau, qu'il ne peut qu'en accabler toujours plus l'humanité, favorisera une réflexion en profondeur de la classe. Toutes ces potentialités sont contenues dans la situation actuelle. Elles imposent aux organisations révolutionnaires d’en être conscientes et de développer une intervention pour les faire fructifier. Intervention essentielle, notamment en direction des minorités et des éléments en recherche au niveau international.
Mais pour être à la hauteur de leur responsabilité, il faut encore que les organisations révolutionnaires soient en mesure de faire face, non seulement aux attaques directes que la classe dominante tente de leur porter, mais aussi à toute la pénétration en leur sein du poison idéologique que celle-ci diffuse dans l'ensemble de la société. En particulier, il est de leur devoir de combattre les effets les plus délétères de la décomposition qui, de la même façon qu'ils affectent la conscience de l'ensemble du prolétariat, pèsent également sur les cerveaux de leurs militants, détruisant leurs convictions et leur volonté d'œuvrer à la tâche révolutionnaire. C'est justement une telle attaque de l'idéologie bourgeoise favorisée par la décomposition que le CCI a dû affronter au cours de la dernière période et c'est la volonté de défendre la capacité de l'organisation à assumer ses responsabilités qui a été au centre des discussions du congrès sur les activités du CCI.
Les activités et la vie du CCI
Le congrès a tiré un bilan positif des activités de notre organisation depuis le précédent congrès, en 2001. Au cours des deux dernières années, le CCI a montré qu’il était capable de se défendre face aux effets les plus dangereux de la décomposition, notamment les tendances nihilistes qui ont saisi un certain nombre de militants qui se sont constitués en "fraction interne". Il a su combattre les attaques de ces éléments dont l’objectif était, clairement, de le détruire. Dès le début de ses travaux, avec une totale unanimité, le congrès, après la conférence extraordinaire tenue en avril 2002,[3] a une fois de plus ratifié tout le combat mené contre cette camarilla et stigmatisé ses comportements de provocateurs. C’est avec une totale conviction qu’il a dénoncé la nature anti-prolétarienne de ce regroupement. Et c'est de façon unanime qu'il a prononcé l'exclusion des éléments de la "fraction" qui avaient mis un point d'orgue à leurs agissements contre le CCI en publiant (et en se revendiquant de cette publication) sur leur site Internet des informations faisant directement le jeu des services de police de l'État bourgeois.[4] Ces éléments, bien qu'ayant refusé de venir au congrès (comme ils y étaient invités) et ensuite de présenter leur défense face à une commission spéciale nommée par celui-ci, n'ont trouvé d'autre chose à faire, dans leur bulletin n° 18, qu'à poursuivre leurs campagnes de calomnies contre notre organisation, faisant la preuve que leur souci n'était nullement de convaincre l'ensemble des militants de celle-ci des dangers dont la menace une prétendue "faction liquidationniste", suivant leurs propres termes, mais de la discréditer le plus possible, faute d'avoir réussi à la détruire.[5]
Comment ces éléments avaient-ils pu développer au sein de l’organisation une action qui la menaçait à ce point de destruction ?
Par rapport à cette question, le congrès a mis en évidence un certain nombre de faiblesses qui se développaient au niveau de son fonctionnement, faiblesses qui sont essentiellement en lien avec un esprit de cercle qui revenait en force, favorisé par le poids négatif de la décomposition de la société capitaliste. Un aspect de ce poids négatif est le doute et la perte de confiance dans la classe, ne voyant que sa faiblesse immédiate. Loin de favoriser l’esprit de parti, cela favorise la tendance à ce que les liens affinitaires et donc la confiance dans des individus se substituent à la confiance dans les principes de fonctionnement. Les éléments qui vont former la "fraction interne" étaient une expression caricaturale de ces déviations et de cette perte de confiance dans la classe. Leur dynamique de dégénérescence s’est servie de ces faiblesses, qui pèsent sur toutes les organisations prolétariennes aujourd’hui, et qui pèsent d’autant plus dangereusement que la plupart n’en ont aucune conscience. C’est avec une violence jamais connue à ce jour dans l’histoire du CCI, que ces éléments ont développé leurs menées destructrices. La perte de confiance dans la classe, l’affaiblissement de la conviction militante, se sont accompagnées d’une perte de confiance dans l’organisation, dans ses principes et d’un mépris total pour ses statuts. Cette gangrène pouvait contaminer toute l’organisation et saper la confiance et la solidarité dans ses rangs et donc ses fondements mêmes.
Le congrès a abordé sans crainte la mise en évidence des faiblesses de type opportuniste qui avaient permis que le clan autoproclamé "fraction interne" menace autant la vie même de l’organisation. Il a pu le faire parce que le CCI sort renforcé du combat qu’il vient de mener.
Par ailleurs, c’est parce que le CCI lutte contre toute pénétration de l’opportunisme qu’il apparaît comme ayant une vie mouvementée, faite de crises qui se répètent. C’est notamment parce qu’il a défendu sans concession ses statuts et l’esprit prolétarien qu’ils expriment qu’il a suscité la rage d’une minorité gagnée par un opportunisme débridé, c'est-à-dire un abandon total des principes, en matière d'organisation. Sur ce plan, le CCI a poursuivi le combat du mouvement ouvrier, de Lénine et du parti bolchevique en particulier, dont les détracteurs stigmatisaient les crises à répétition et les multiples combats sur le plan organisationnel. A la même époque, la vie du parti social démocrate-allemand était beaucoup moins agitée mais le calme opportuniste qui le caractérisait (altéré seulement par des "troublions" de gauche comme Rosa Luxemburg) annonçait sa trahison de 1914. Les crises du parti bolchevique construisaient la force qui a permis la révolution de 1917.
Mais la discussion sur les activités ne s'est pas contentée de traiter de la défense directe de l'organisation contre les attaques qu'elle subit. Elle a particulièrement insisté sur la nécessité de poursuivre l'effort de développement de la capacité théorique du CCI tout en constatant que le combat contre ces attaques a profondément stimulé cet effort. Le bilan de ces deux dernières années met en évidence un enrichissement théorique : sur les questions d’une vision plus historique de la confiance et de la solidarité dans le prolétariat, éléments essentiels de la lutte de classe ; sur le danger d’opportunisme qui guette les organisations incapables d’analyser un changement de période ; sur le danger du démocratisme. Et cette préoccupation de la lutte sur le terrain théorique est partie prenante, comme nous l'ont enseigné Marx, Rosa Luxemburg, Lénine, les militants de la Fraction italienne et bien d'autres révolutionnaires, de la lutte contre l'opportunisme, menace mortelle pour les organisations communistes.
Enfin, le congrès a fait un premier bilan de notre intervention dans la classe ouvrière à propos de la guerre en Irak. Il a constaté la très bonne capacité de mobilisation du CCI à cette occasion puisque, dès avant le début des opérations militaires, nos sections ont réalisé une diffusion très significative de notre presse dans de nombreuses manifestations, produisant quand nécessaire des suppléments à la presse régulière et engageant des discussions politiques avec de nombreux éléments qui ne connaissaient pas notre organisation auparavant. Dès que la guerre a éclaté, le CCI a immédiatement publié un tract international traduit en 13 langues[6] qui a été distribué dans 14 pays et plus de 50 villes, particulièrement devant les usines, et placé sur notre site Internet.
Ainsi, ce congrès a été un moment qui a exprimé le renforcement de notre organisation. Le CCI se revendique hautement du combat qu’il a mené et qu’il poursuit pour sa défense, pour la construction des bases du futur parti et afin de développer sa capacité pour intervenir dans le combat historique de la classe. Il est convaincu d’être, dans ce combat, un maillon dans la chaîne des organisations du mouvement ouvrier.
Le CCI, avril 2003
1 Voir notamment à ce sujet les "Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est" (Revue internationale 60) rédigées deux mois avant la chute du mur de Berlin et "Militarisme et décomposition" (daté du 4 octobre 1990 et publié dans la Revue internationale n° 64).
2 Voir notamment : "La décomposition, phase ultime de la décadence du capitalisme", points 13 et 14 (Revue internationale n°62, republié sans le n°107)
3 Voir notre article "Conférence extraordinaire du CCI : le combat pour la défense des principes organisationnels" dans la Revue internationale n°110.
4 Voir à ce sujet notre article "Les méthodes policières de la 'FICCI'", dans Révolution internationale n°330.
5 Une des calomnies permanentes de la "FICCI" est que la "faction liquidationniste" qui dirige le CCI emploie à l'égard des minoritaires des méthodes "staliniennes" afin de faire régner la terreur et d'empêcher toute possibilité d'exprimer des divergences au sein de l'organisation. En particulier, la "FICCI" n'a eu de cesse d'affirmer que de nombreux membres du CCI désapprouvaient en réalité la politique menée actuellement contre les agissements des membres de cette prétendue "fraction". La résolution adoptée par le 15e congrès à propos des agissements des membres de la "FICCI" fixait ainsi le mandat de la Commission spéciale chargée de recevoir la défense des éléments concernés :
"Les modalités de constitution et de fonctionnement de cette commission sont les suivantes :
- elle est composée de 5 membres du CCI appartenant à 5 sections différentes, 3 du continent européen et 2 du continent américain ;
- elle est composée majoritairement de militants non membres de l’organe central du CCI ;
- elle devra examiner avec la plus grande attention les explications et les arguments fournis par chacun des éléments concernés.
Par ailleurs, ces derniers auront toute latitude de se présenter individuellement ou ensemble devant la Commission, de même que de se faire représenter par l'un ou plusieurs d'entre eux. Chacun d’eux aura également la possibilité de demander le remplacement de 1 à 3 des 5 membres de la Commission désignés par le Congrès par des militants du CCI de son choix, sachant évidemment que la Commission définitive ne pourra pas être à géométrie variable. Elle comportera 5 membres et elle sera composée au moins par deux membres désignés par le congrès et au plus par 3 militants du CCI correspondant aux souhaits exprimés majoritairement par les éléments concernés.
La décision de rendre exécutoire l’exclusion de chacun de ces éléments ne pourra être prise qu’à la majorité des 4/5 des membres de la Commission."
Avec de telles modalités, il suffisait que les membres de la FICCI trouvent dans tout le CCI deux militants qui auraient pu être opposés à leur exclusion pour que la décision de celle-ci ne devienne pas exécutoire. Ils ont préféré ironiser sur les modalités de recours que nous leur proposions en continuant à vociférer contre nos méthodes "staliniennes" et "iniques". Ils savaient parfaitement qu'ils ne trouveraient personne au sein du CCI pour prendre leur défense tant est grande l'indignation et le dégoût que leurs comportements ont provoqué chez TOUS les militants de notre organisation.
6 Les langues de nos publications territoriales plus le portugais, le russe, l'hindi, le bengali, le farsi et le coréen
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Crise économique : Les oripeaux de la "prospérité économique" arrachés par la crise
- 2702 reads
- Après la chute du mur de Berlin, la multiplication des guerres et génocides est rapidement venu infirmer tous les discours sur le prétendu nouvel ordre mondial qui en résulterait. Par contre, force est de constater que toutes les campagnes idéologiques sur la "démocratie" et la "prospérité" capitaliste ont rencontré un certain écho et pèsent fortement sur la conscience de classe des exploités.
L'effondrement du bloc de l'Est devait ouvrir de gigantesques "nouveaux marchés" et préluder à un développement économique dans un nouvel "ordre mondial" de paix et de démocratie. Au cours des années 1990, les prévisions concernant ce prétendu développement économique ont été soutenues par un battage médiatique sur les pays "émergents", comme le Brésil ou les pays du Sud-Est asiatique. La "nouvelle économie" prenait le relais dès la fin des années 1990 et était censé ouvrir une nouvelle phase d'expansion fondée sur une révolution technologique. Qu'en est-il en réalité? Autant de prophéties mensongères ! Après les pays les plus pauvres du Tiers Monde, qui connaissent des reculs nets de leur PIB par habitant depuis deux à trois décennies, ce fut la chute du " second monde " avec l'effondrement économique des pays du bloc de l'Est, et la banqueroute de la Russie et du Brésil en 1998 ; le Japon est tombé en panne au début des années 90 et, huit années plus tard, l'ensemble de la zone du Sud-Est asiatique a été sérieusement mis à mal. Cette dernière, qui fut longtemps considérée par les idéologues du capitalisme comme le nouveau pôle de développement du 21ème siècle, rentrait dans le rang, et pendant ce laps de temps, les économies dites "intermédiaires" ou "émergentes" se sont toutes, l'une après l'autre, plus ou moins effondrées. Pendant que l'e-économic se transformait en e-krach dans les pays développés au cours des années 2000-2001, les pays "émergents" se muaient en pays plongeants. Là, la fragilité des économies n'est guère capable d'encaisser un endettement de quelques dizaines de pour cent du Produit Intérieur Brut. Ainsi, après la crise de la dette du Mexique au début des années 1980, d'autres pays sont venus progressivement rallonger la liste : Brésil, Mexique encore en 1994, pays du sud-est asiatique, Russie, Turquie, Argentine, etc. La récession qui frappe les pays les plus développés ne concerne plus des secteurs de vieilles technologies (charbonnages, sidérurgie, etc.) ou déjà arrivées à maturité (chantiers navals, automobile, etc.), mais carrément des secteurs de pointe, ceux-là même qui étaient appelés à être les fleurons de la " nouvelle économie ", le creuset de la prétendue "nouvelle révolution industrielle" : l'informatique, Internet, les télécommunications, l'aéronautique, etc. Dans ces branches, c'est par centaines que se comptent les faillites, les restructurations, les fusions-acquisitions et par centaines de milliers les licenciements, les baisses de salaire avec la dégradation des conditions de travail.
Aujourd'hui, avec le krach des valeurs boursières du secteur censé être à l'origine de cette nouvelle prospérité et avec la récession qui exerce déjà ses ravages, les mystifications idéologiques de la bourgeoisie par rapport à la crise ont commencé à s'éroder sérieusement. C'est pourquoi la bourgeoisie multiplie les fausses explications sur les difficultés économiques actuelles. I1 s'agit pour elle de cacher au maximum la gravité de la maladie de son système économique au prolétariat afin d'empêcher que ce dernierne prenne conscience de l'impasse du capitalisme.
Le capitalisme s'enfonce inexorablement dans la crise
Contrairement à ce que nous raconte la classe dominante, la dégradation économique n'est pas le produit de l'effondrement des Twin Towers aux Etats-Unis, même si cela a pu constituer un facteur aggravant, en particulier pour certains secteurs économiques tels que le transport aérien ou le tourisme. Le ralentissement brutal de la croissance américaine date de l'éclatement de la bulle Internet en mars 2000 et le niveau d'activité économique était déjà faible à la fin de l'été 2001 (voir le graphique ci-dessous).
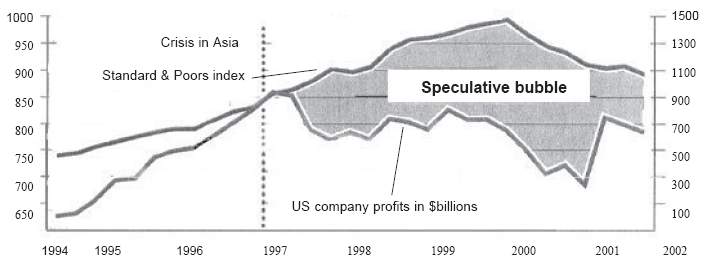
Comme le soulignent les experts de l'OCDE : "Le ralentissement éconornique qui a débuté aux Etats-Unis en 2000 et a gagné d'autres pays, s'est transformé en un recul mondial de l'activité économique auquel peu de pays ou de régions ont échappé". (Le Monde, 21/11/2001). La crise économique actuelle n'a donc rien de spécifiquement américain.
Le capitalisme est entré dans sa sixième phase de récession ouverte depuis le resurgissement de la crise sur la scène de l'histoire à la fin des années 60 : 1967, 1970-71, 1974-75, 1980-82, 1991-93, 2001-?, sans compter l'effondrement des pays du Sud-Est asiatique, du Brésil, etc., dans les années 1997-1998. Depuis, chaque décennie se solde par un taux de croissance inférieur à la précédente : 1962-69 : 5,2% ; 1970-79 : 3,5`% ; 1980-89 : 2,8% ; 1990-99 : 2,6% ; 2000-2002 : 2,2'%. En 2002, la croissance de la zone Euro atteint péniblement + 0,7% alors qu'elle se maintenait encore à 2,4% aux Etats-Unis, chiffre néanmoins moins élevé que dans les années 1990. Au demeurant, à se limiter aux "fondamentaux", l'économie américaine aurait dû marquer le pas dès 1997, car le taux de profit avait déjà cessé de progresser (voir le graphique ci-dessous).
Ce qui caractérise la récession actuelle, aux dires des commentateurs bourgeois eux mêmes, c'est la rapidité et l'intensité de son développement. Les Etats-Unis, la première économie du monde, ont très rapidement plongé dans la récession. Le repli du PIB américain est plus rapide que lors de la récession précédente et l'aggravation du chômage atteint un record inégalé depuis la crise de 1974. Le Japon, la deuxième économie du monde, ne se porte pas mieux. Ainsi même avec des taux d'intérêt réels négatifs (au Japon, les ménages et les entreprises gagnent de l'argent en empruntant !), la consommation et l'investissement ne redémarrent pas. Malgré des plans de relance massifs, l'économie nippone vient de replonger dans la récession pour la troisième fois. C'est la plus forte crise depuis 20 ans et, selon le FMI, le Japon pourrait connaître, pour la première fois depuis l'après-guerre, deux années consécutives de contraction de l'activité économique. Avec ces multiples plans de relance successifs, le Japon rajoute à son endettement bancaire astronomique, un endettement public qui est devenu le plus élevé de tous les pays industrialisés. Ce dernier représente aujourd'hui 130 % du PIB et devrait atteindre 153 % en 2003.
L'intensification des contradictions du capitalisme décadent
Au 19e siècle, dans la période ascendante du capitalisme, le solde budgétaire des finances publiques (différence entre les recettes et les dépenses) de six grands pays (Etats-Unis, Japon, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie) n'est que ponctuellement en déficit, essentiellement pour cause de guerres. Il est par ailleurs stable et en constante amélioration entre 1870 et 1910. Le contraste est saisissant avec la période de décadence dans laquelle le déficit est quasiment permanent, excepté 4 années à la fin des années 20 et une vingtaine d'années entre 1950 et 1970, et se creuse tant pour des raisons guerrières que lors des crises économiques (voir le graphique ci-dessous).
Le poids de la dette publique en pourcentage du PIB diminue tout au long de la période ascendante. En général, ce taux ne dépasse jamais 50%. Il explose lors de l'entrée en période de décadence pour ne refluer qu'au cours de la période 1950-80, mais sans jamais redescendre au-dessous de 50%,. Il remonte ensuite au cours des années 1980-90 (voir le graphique ci-dessous).
Cette montagne de dettes qui s'accumulent, non seulement au Japon mais aussi dans les autres pays développés, constitue un véritable baril de poudre potentiellement déstabilisateur à terme. Ainsi, une grossière estimation de l'endettement mondial pour l'ensemble des agents économiques (Etats, entreprises, ménages et banques) oscille entre 200 et 300`% du produit mondial. Concrètement, cela signifie deux choses : d'une part, que le système a avancé l'équivalent monétaire de la valeur de deux à trois fois le produit mondial pour pallier à la crise de surproduction rampante et, d'autre part, qu'il faudrait travailler deux à trois années pour rien si cette dette devait être remboursée du jour au lendemain. Si un endettement massif peut aujourd'hui encore être supporté par les économies développées, il est par contre en train d'étouffer un à un les pays dits "émergents". Cet endettement phénoménal au niveau mondial est historiquement sans précédent et exprime à la fois le niveau d'impasse dans lequel le système capitaliste s'est enfoncé mais aussi sa capacité à manipuler la loi de la valeur afin d'assurer sa pérennité. Si, dans la dernière période, "en tant que puissance dominante, les Etats-Unis ont pu s'arroger le droit de faire financer leur effort d'investissernent et de soutenir une croissance de la consommation très vigoureuse" ("Après l'euphorie, la gueule de bois", Revue Internationale n° 111), aucun autre pays n'aurait pu se permettre le déficit commercial qui a accompagné la croissance des Etats-Unis. "Il en est résulté une crise classique de surproduction se matérialisant par un retournement de la courbe du profit et un ralentissement de l'activité aux USA, quelques mois avant le 11 septembre" (idem). I1 n'y a donc là rien d'extraordinaire ni de quoi spéculer sur un nouveau retour de la croissance basé sur une soi-disant nouvelle révolution technologique. Les discours théoriques autour de la "nouvelle économie", le bluff de cette dernière et les récentes fraudes comptables mettent sérieusement à mal la fiabilité des données de la comptabilité nationale - américaine en particulier - à la base des calculs du PIB. Depuis l'éclatement des affaires Enron, Andersen, etc., on a vu qu'une bonne partie de la nouvelle économie était fictive. Des centaines de milliards de dollars, qui avaient été imputés dans la comptabilité des entreprises, n'étaient que des subterfuges et se sont volatilisés. Ce cycle s'est d'ailleurs clos sur un krach boursier qui fut particulièrement sévère dans le secteur qui était justement appelé à porter le nouveau capitalisme sur les fonts baptismaux.
La fable du "moins d'Etat"
"Les causes directes dit renforcement de l'Etat capitaliste à notre époque traduisent toutes les difficultés dues à l'inadaptation définitive du cadre des rapports capitalistes au développement atteint par les forces productive." (La décadence du capitalisme, brochure du CCI).
On essaie de nous faire croire qu'avec la libéralisation et la mondialisation, les Etats n'ont pratiquement plus rien à dire, qu'ils ont perdu leur autonomie face aux marchés et aux organismes supranationaux comme le FMI, l'OMC, etc., mais lorsqu'on consulte les statistiques, force est de constater que malgré vingt années de "néolibéralisme", le poids économique global de l'Etat (plus précisément du secteur dit"non marchand" : dépenses de toutes les administrations publiques, y compris les dépenses de sécurité sociale) n'a guère reculé. Il continue de croître, même si c'est à un rythme moins soutenu, pour atteindre une fourchette de + 45 à 50% pour les 32 pays de l'OCDE avec une valeur basse autour de 351% pour les Etats-Unis et le Japon et une valeur haute de 60 à 70% pour les pays nordiques (voir graphique ci-après).
Oscillant autour de 10% tout au long de la phase ascendante du capitalisme, la part de l'Etat (secteur non marchand) dans la création de valeur ajoutée grimpe progressivement au cours de la phase de décadence pour avoisiner 50% en 1995 dans les pays de l'OCDE (source : Banque Mondiale, rapport sur le développement dans le monde, 1997).
Cette statistique est révélatrice du gonflement artificiel des taux de croissance dans l'époque de la décadence du capitalisme dans la mesure où la comptabilité nationale prend partiellement en compte deux fois la même chose. En effet, le prix de vente des produits marchands incorpore les impôts dont le montant sert à payer les dépenses de l'Etat, à savoir le coût des services non marchands (enseignement, sécurité sociale, personnel des services publics). L'économie bourgeoise évalue la valeur de ces services non marchands comme étant égale à la somme des salaires versés au personnel qui est chargé de les produire. Or, dans la comptabilité nationale, cette somme est rajoutée à la valeur ajoutée produite dans le secteur marchand (le seul secteur productif) alors qu'elle est déjà incluse dans le prix de vente des produits marchands (répercussion des impôts et des cotisations sociales dans le prix des produits).
Dés lors, dans la période de décadence, le PIB et le taux de croissance du PIB gonflent artificiellement dans la mesure où la part des dépenses publiques augmente avec le temps (de + 10% en 1913 à + 50% en 1995). Cette part étant restée quasi constante (10%) au cours du temps dans la phase d'ascendance. Là, si le PIB est surestimé de 10 %, les taux de croissance pendant cette période reflètent correctement la réalité du développement du secteur productif. Dans la décadence, par contre, l'explosion du secteur improductif- particulièrement entre 1960 et 1980 - vient artificiellement doper les performances du capitalisme. Pour évaluer correctement la croissance réelle dans la décadence, il faut défalquer près de 40 % du PIB actuel correspondant à la croissance de la part du secteur improductif depuis 1913 !
Quant au poids politique des Etats, il s'est bel et bien accru. Aujourd'hui, comme tout au long du 20e siècle, le capitalisme d'Etat n'a pas de couleur politique précise. Aux Etats-Unis, ce sont les républicains (la "droite") qui prennent l'initiative d'un soutien public à la relance et qui subventionnent les compagnies aériennes et les assureurs. Le pouvoir encourage d'ailleurs directement leur maintien par la loi du "chapitre II" qui autorise les sociétés à se protéger facilement de leurs créanciers. La relance budgétaire programmée par Bush a fait passer le solde fédéral d'un excédent de 2,5% du PIB en 2000 à un déficit estimé par le FMI à 1,5 % du PIB en 2002, soit une relance d'une ampleur comparable à celle des plus dispendieux Etats européens. La Banque Centrale (la Fédéral Réserve) pour sa part, très étroitement liée au pouvoir, a baissé ses taux d'intérêt au fur et à mesure que la récession se précisait afin d'aider à la relance de la machine économique : de 6,5 % à 1,75%, -2 % entre le début et la fin 2001. Cela permet, entre autres, aux ménages surendettés de souscrire davantage de prêts ou de les renégocier à la baisse. Enfin, la cohérence de cette nouvelle orientation implique une baisse du dollar permettant de rétablir la compétitivité des produits américains et de regagner ainsi des parts de marché. Au Japon, les banques ont été renflouées à deux reprises par l'Etat et certaines ont même été nationalisées. En Suisse, c'est l'Etat qui a organisé la gigantesque opération de renflouement de la compagnie aérienne nationale Swissair, etc. Même en Argentine, avec la bénédiction du FMI et de la Banque Mondiale, le gouvernement a recours a un vaste programme de travaux publics pour essayer de recréer des emplois. Si, au 19° siècle, les partis politiques instrumentalisaient l'Etat pour faire passer prioritairemcnt leurs intérêts, dans la période de décadence, ce sont les impératifs économiques et impérialistes globaux qui dictent la politique à suivre, quelle que soit la couleur du gouvernement en place. Cette analyse fondamentale, dégagée par la Gauche communiste, a été amplement confirmée tout au long du 20° siècle et est plus que jamais d'actualité aujourd'hui que les enjeux sont encore plus exacerbés.
Le développement des dépenses militaires
C'est à Engels que revient d'avoir énoncé, à la fin du 19° siècle, ce qui sera l'alternative historique de la phase de décadence du capitalisme : "socialisme ou barbarie". Rosa Luxemburg en dégagera nombre d'implications politiques et théoriques et l'Internationale communiste en fera sa formule caractérisant la nouvelle période : "l'ère des guerres et des révolutions". Enfin, ce sont les Gauches communistes, en particulier la Gauche communiste de France, qui systématiseront et approfondiront la place et la signification de la guerre dans la phase ascendante et dans la décadence du capitalisme.
On peut affirmer sans conteste que, contrastant avec la phase ascendante, la décadence du capitalisme a été caractérisée par la guerre sous toutes ses formes : guerres mondiales, guerres locales permanentes, etc. A ce propos, comme petit complément historique très utile, nous ne résistons pas à la tentation de citer des extraits de la fresque de l'historien Eric Flobsbawm (1994) dans son livre L'âge des extrêmes, qui campe sous forme de bilans respectifs, les différences fondamentales entre le long 19, siècle et le "court 20' siècle" :
"Comment dégager le sens du court vingtième siècle du début de la première guerre mondiale à l'effondrement de l'URSS -de ces années qui, comme nous le vovons avec le recul, forme une période historique cohérente désormais terminée ? (...) Dans le court vingtième siècle, on (a) tué ou laissé mourir délibérément plus d'êtres humains que jamais auparavant dans l'histoire. (...) Il fut sans doute le siècle le plus meurtrier dont nous avons gardé la trace, tant pur l'échelle, la fréquence et la longueur des guerres qui l'ont occupé (et qui ont à peine cessé un instant depuis les années 1920) mais aussi par l'ampleur des plus grandes famines de l'histoire aux génocides systématiques. A la différence du "long 19' siècle" qui semblait et fut en effet une période de progrès matériel, intellectuel et moral presque ininterrompu (...) on a assisté depuis 1914 à une régression marquée de ces valeurs jusqu'alors considérées comme normales dans les pays développés. (...) Au cours du 20° siècle, les guerres ont de plus en plus visé l'économie et 1’infrastructure des Etats ainsi que leurs populations civiles. Depuis la première guerre mondiale, le nombre de victimes civiles a été bien plus important que celui des victimes militaires dans tous les pays belligérants, sauf aux Etats-Unis. (... ) En 1914, cela faisait un siècle qu'il n’y avait plus eu de grande guerre (..). La plupart des guerres mettant aux prises des grandes puissances avaient été relativement rapides. (...) la durée de la guerre se comptait en mois ou même (comme dans la guerre de 1886 entre la Prusse et l'Autriche) en semaines. Entre l871 et 1914, l'Europe n'avait pas connu de conflit amenant les armées de grandes puissances à franchir les frontières ennemies. (...) Il n'y eut aucune guerre mondiale. (...) Tout cela changea en 1914 (...) 1914 inaugure "l'ère des massacres" (...) la guerre moderne implique tous les citoyens el mobilise la plupart d'entre eux (..), elle se mene avec des armements qui requièrent un détournement de toute l'économie pour les produire et sont employés en quantités ininmaginables ; elle engendre des destructions inouïes, mais aussi domine et transforme du tout au tout la vie des pays impliqués. Or, tous ces phénomènes sont propres aux guerres du 20° siècle. (..) La guerre a-t-elle servi la croissance économique ? En lui sens, il est clair que non (...) Sur cette montée de la barbarie après 1914, il n’y a malheureusement aucun doute".
Cette "ère des massacres", inaugurée par la première guerre mondiale et contrastant avec un long 19° siècle nettement moins meurtrier, est attestée par l'importance relativement faible des dépenses militaires dans le produit mondial et sa quasi-constance tout au long de la phase ascendante du capitalisme, alors qu'elles augmentent fortement par la suite. De 2% du produit mondial en 1860, à 2,5 % en 1913, elles atteignent 7,2% en 1938 pour se situer aux environs de 8,4% dans les années 1960 et plafonner aux environs de 10% au moment du sommet de la guerre froide à la fin des années 1980. (Sources : Paul Baïroch pour le produit mondial et le SIPRI pour les dépenses militaires). L'armement a ceci de particulier que, contrairement à une machine ou à un bien de consommation, il ne peut être consommé de façon productive (il ne peut que rouiller ou détruire des forces de production). Il correspond donc à une stérilisation de capital. Aux +40 % correspondant à la croissance des dépenses improductives dans la période de décadence, il faut donc encore rajouter +6 % correspondant à l'augmentation relative des dépenses militaires... ce qui nous amène à un produit mondial surévalué de près de moitié. Voilà qui ramène les prétendues performances du capitalisme au 20° siècle à de plus justes proportions et qui contraste fortement avec cette ère de "progrès matériel, intellectuel et moral presque ininterrompu" du long 19° siècle.
L'avenir reste dans les mains de la classe ouvrière
Ce qui est absolument certain, c'est qu'avce le développement de la récession au niveau international, la bourgeoisie imposera une nouvelle et violente dégradation du niveau de vie de la classe ouvrière. Sous prétexte d'état de guerre et au nom des intérêts supérieurs de la nation, la bourgeoisie américaine en profite pour faire passer ses mesures d'austérité déjà prévues depuis longtemps, car rendues nécessaires par une récession qui se développait : licenciements massifs, efforts productifs accrus, mesures d'exception au nom de l'anti-terrorisme mais qui servent fondamentalement comme terrain d'essai pour le maintien de l'ordre social. Après l'effondrement du bloc de l'Est, la course aux armements s'était ralentie pendant quelques années mais très rapidement, vers le milieu des années 1990, elle est repartie. Le 11 septembre a permis de justifier le développement encore plus considérable des armements. Les dépenses militaires des Etats-Unis représentent 37 % des dépenses militaires mondiales qui sont en hausse dans tous les pays. Partout dans le monde, les taux de chômage sont de nouveau fortement orientés à la hausse alors que la bourgeoisie avait réussi à camoufler une partie de l'ampleur réelle de ce phénomène par des politiques de traitement social - c'est-à-dire la gestion de la précarité - et par des manipulations grossières des statistiques. Partout en Europe, les budgets sont révisés à la baisse et de nouvelles mesures d'austérité sont programmées. Au nom de la stabilité budgétaire, dont le prolétariat n'a que faire, la bourgeoisie européenne est en train de revoir la question des retraites (abaissement des taux et allongement de la vie active) et de nouvelles mesures sont envisagées pour faire sauter "les freins au développement de la croissance" comme disent pudiquement les experts de l'OCDE, à savoir "atténuer les rigidités" et "favoriser l'offre de travail" via une précarisation accrue et une réduction de toutes les indemnisations sociales (chômage, soins de santé, allocations diverses, etc.). Avec le krach boursier, les systèmes de retraite par capitalisation apparaissent aujourd'hui pour ce qu'ils sont : une duperie pour encore plus spolier les revenus de la classe ouvrière. Au Japon, l'Etat a planifié une restructuration dans 40% des organismes publics : 17 vont fermer et 45 autres seront privatisés. Enfin, pendant que ces nouvelles attaques viennent frapper le prolétariat au coeur du capitalisme mondial, la pauvreté se développe de façon vertigineuse à la périphérie du capitalisme. La situation des pays dits "émergents" est significative à cet égard avec la situation dans des pays comme l'Argentine, le Venezuela, le Brésil. En Argentine, le revenu moyen par habitant a été divisé par trois en trois ans. C'est une débâcle qui dépasse en ampleur celle des Etats-Unis dans les années 1930. La Turquie et la Russie sont toujours sous perfusion et suivies à la loupe.
A cette situation d'impasse économique, de chaos social et de misère croissante pour la classe ouvrière, celle-ci n'a qu'une réponse à apporter : développer massivement ses luttes sur son propre terrain de classe dans tous les pays. Aucune "alternance démocratique", aucun changement de gouvernement, aucune autre politique ne peut apporter un quelconque remède à la maladie mortelle du capitalisme. La généralisation et l'unification des combats du prolétariat mondial qui ne peuvent aller que vers le renversement du capitalisme, sont la seule alternative capable de sortir la société de cette impasse. Rarement dans l'histoire, la réalité objective n'avait aussi clairement mis en évidence que l'on ne peut plus combattre les effets de la crise capitaliste sans détruire le capitalisme lui-même. Le degré de décomposition atteint par le système, la gravité des conséquences de son existence sont tels que la question de son dépassement par un bouleversement révolutionnaire apparaît et apparaîtra de plus en plus comme la seule issue "réaliste" pour les exploités. L'avenir reste dans les mains de la classe ouvrière.
(Décembre 2002 ; Extraits du rapport sur la crise économique adopté par le XVe congrès du CCI)
Sources: Croissance du PIB (1962-2001): OCDE
Ratio solde budgétaire/PlB (en % du PIB) Paul Masson et Michael Muss : "Long term tendencies in budget déficits and Debts", document de travail du FMI 95/l28 (décembre 1995)
Alternatives Economique (Hors série) : "L'état de l'économie 2003".
Maddison : "L'économie mondiale 1820-1992, OCDE et Deux siècles de révolution industrielle", Pluriel H 8413
Récent et en cours:
- Crise économique [96]
Notes sur l'histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale, 2e partie
- 3851 reads
Nous continuons ici les "Notes sur l'histoire de la politique impérialiste des Etats-Unis depuis la seconde guerre mondiale", que nous avons commencé à publier dans le précédent numéro de la Revue internationale. La Guerre du Vietnam : des divergences sur la politique impérialiste secouent la bourgeoisie américaine
L’engagement des Etats-Unis au Vietnam suit immédiatement la défaite française en Indochine où ils vont tenter de récupérer les régions perdues pour l’Occident. La stratégie, nouvelle manifestation de l’endiguement,[1] consiste à empêcher les pays de tomber les uns après les autres sous l'influence de l’impérialisme russe, ce que le secrétaire d’Etat d’Eisenhower, Dulles, avait appelé la "théorie des dominos".[2] Le but est de transformer la séparation temporaire du Vietnam en une zone Nord et une zone Sud, créée par les accords de Genève, en une division permanente comme dans la péninsule coréenne. C’est dans ce sens que la politique américaine de détournement des accords de Genève, initiée sous le régime républicain d’Eisenhower, continue sous Kennedy qui envoie les premiers conseillers militaires au Vietnam au début des années 60. L’administration Kennedy joue un rôle capital dans la gestion du pays, autorisant même un coup d’Etat militaire et l’assassinat du président Diem en 1963. L'impatience manifestée par la Maison Blanche à l'égard du général qui reporte l'assassinat de Diem a été amplement documentée. A la suite de l'assassinat de Kennedy en 1963, Johnson poursuit l’intervention militaire américaine au Vietnam, intervention qui va devenir la plus longue guerre menée par l’Amérique.
La bourgeoisie américaine reste unie derrière cette entreprise, alors même qu’un bruyant mouvement anti-guerre, sous la houlette des gauchistes et des pacifistes, s’amplifie. Le mouvement anti-guerre, très marginal dans la politique américaine, sert de soupape de sécurité vis-à-vis des étudiants radicaux et des activistes noirs. L’offensive du Têt, lancée en janvier 1968 par le Vietnam du Nord et le FNL dans le Sud, comportant des attaques suicides contre l’ambassade américaine et le palais présidentiel à Saïgon, aboutit de fait à une défaite sanglante pour les staliniens. Cependant, sa tentative même vient démentir la propagande de longue date des militaires américains selon laquelle la guerre se déroulait très bien et que la victoire n'était qu'une question de mois. Des membres importants de la bourgeoisie commencent alors à mettre la guerre en question puisqu’il apparaît clairement qu’elle sera longue, contrairement à la recommandation faite par Eisenhower quand il a quitté ses fonctions, sur la nécessité d’éviter de s’embourber dans une guerre prolongée en Asie.
Simultanément, se profile une autre orientation stratégique pour l’impérialisme américain, contraint de s’occuper aussi du Moyen-Orient - stratégiquement important et riche en pétrole - où l'impérialisme russe progresse dans le monde arabe.
Une commission d’anciens membres éminents du parti démocrate presse alors Johnson de renoncer à ses plans de réélection et de se concentrer sur la façon de mettre fin à la guerre ; fondamentalement, c'est un coup d'Etat interne dans la bourgeoisie américaine. En mars, Johnson déclare à la télévision qu’il ne cherchera, ni n’acceptera d'être présenté par son parti pour être réélu, et qu’il consacrera toute son énergie à mettre fin à la guerre. Au même moment, reflet de divergences croissantes au sein de la bourgeoisie sur la politique impérialiste à mener, les médias américains prennent le train du mouvement anti-guerre, et celui-ci passe de phénomène marginal gauchiste au centre de la politique américaine. Par exemple, Walter Cronkite, présentateur des informations sur une des plus grandes chaînes de télévision, qui termine chacune de ses émissions par le slogan "and that's the way it is" ("et il en est ainsi"), va au Vietnam et revient en annonçant qu'il faut arrêter la guerre. La chaîne NBC démarre un programme du dimanche soir, appelé "Vietnam This Week", qui diffuse à la fin de chaque émission une séquence présentant des photos de jeunes américains de 18 et 19 ans tués cette semaine-là au Vietnam – une manouvre de propagande anti-guerre qui vise à donner un caractère "personnel" aux conséquences de la guerre.
Les difficultés de Johnson sont exacerbées par l'émergence de la crise économique ouverte et le fait que le prolétariat n'est pas idéologiquement battu ; alors qu’il avait tenté une politique de "guns and butter" (des fusils et du beurre) – faire la guerre sans qu'il soit nécessaire de faire des sacrifices matériels à l'arrière – la guerre se révèle alors trop coûteuse pour soutenir cette politique. En réponse au retour de la crise ouverte aux Etats Unis, une vague grandissante de grèves sauvages se développe de 1968 à 1971, dans lesquelles s’impliquent souvent des vétérans du Vietnam mécontents et en colère. Ces grèves causent de sérieuses difficultés politiques à la classe dominante américaine. 1968 est en fait le signal de bouleversements aux Etats-Unis avec le développement simultané de désaccords internes au sein de la bourgeoisie et du mécontentement grandissant dans le pays. Deux semaines après que Johnson ait annoncé son retrait de la course aux présidentielles, le leader des droits civiques, le pasteur Martin Luther King, qui avait rejoint le mouvement anti-guerre en 1967 et dont on disait qu'il était prêt à renoncer à la protestation non-violente, est assassiné, ce qui provoque de violentes émeutes dans 132 villes américaines. Début juin, Robert Kennedy, le plus jeune frère de John F. Kennedy, qui avait participé au cabinet de son frère comme procureur général et qui était présent à la Maison Blanche en 1963 lorsque l’administration Kennedy attendait impatiemment le résultat de la mission de l’exécution de Diem, mais qui était désormais devenu un candidat anti-guerre aux élections primaires démocrates pour la présidence, est également assassiné après avoir gagné la primaire de Californie. Il y a de violents affrontements dans les rues lors de la Convention du parti démocrate en juillet, où la gauche du parti lutte âprement contre les forces de Humphrey forcées de continuer la guerre. Nixon, le républicain conservateur, gagne les élections, en promettant qu’il a un plan secret pour mettre fin à la guerre.
Pendant ce temps, à partir d’octobre 1969, le New York Times publie le planning des manifestations pour un moratoire au Vietnam, en page 2 du quotidien, afin d'y assurer une participation massive. Les politiciens des grands courants politiques et les célébrités commencent à s’exprimer lors des rassemblements. L’administration Nixon négocie avec les staliniens vietnamiens, mais elle ne parvient pas à mettre fin à la guerre. Cependant, malgré la continuation de la guerre, des pressions s'exercent sur Nixon pour qu’il fasse des progrès rapides dans la mise en place de la détente prévue par Johnson, y compris par des visites diplomatiques à Moscou et la négociation des traités de contrôle des armements. Il y a même des analystes bourgeois, bien qu'ils n'aient évidemment pas une compréhension marxiste de la globalité de la crise du capitalisme, qui font observer que l’intérêt porté par les Américains à la détente avec Moscou et à l’apaisement temporaire de la Guerre froide est dicté par les difficultés économiques liées au début de la crise ouverte et à la réémergence du prolétariat dans la lutte de classe. Par exemple David Painter note qu’aux Etats-Unis, "la guerre avait exacerbé les difficultés économiques de longue date (...) qui nourrissaient l'inflation et sapaient de plus en plus l’équilibre de la balance des paiements américaine" (Encyclopedia of US Foreign Policy). Brzezinski parle des "difficultés économiques américaines" (op cit.) et George C. Herring observe : "En 1969, [la guerre] avait accru les problèmes économiques et politiques de façon critique et contraint à revoir des politiques qui n'avaient pas été remises en cause depuis plus de 20 ans. Les dépenses militaires massives avaient provoqué une inflation galopante qui rompait avec la prospérité d'après-guerre et suscitait un mécontentement croissant", tout cela "poussait l'administration de Richard M. Nixon à rechercher la détente avec l'Union soviétique" (Encyclopedia of American Foreign Policy).
En 1971, Nixon abandonne le système économique de Bretton Woods,[3] mis en place depuis 1944, en suspendant la convertibilité du dollar en or, ce qui amène immédiatement la libre cotation des devises internationales et, de facto, la dévaluation du dollar. En même temps, Nixon crée un impôt protectionniste de 10% sur les importations et un contrôle des prix et des salaires au niveau intérieur. Certains analystes et des journalistes bourgeois commencent même à parler d’un déclin permanent de l’impérialisme américain et de la fin du "siècle américain".
Les divisions au sein de la bourgeoisie, centrées sur le désengagement du Vietnam et la réorientation vers le Moyen-Orient, sont renforcées par les troubles continus et les difficultés au Moyen-Orient, notamment le boycott du pétrole arabe. Kissinger s’engage simultanément et sans succès dans des négociations avec les Vietnamiens et joue personnellement la "navette diplomatique" au Moyen-Orient. En matière de détente, Nixon prend l’initiative d’une ouverture vers la Chine qui a rompu idéologiquement avec Moscou, ce qui ouvre alors de nouvelles perspectives pour l’impérialisme américain. L’attitude qui avait prévalu pendant la Guerre froide consistant à refuser de reconnaître le régime de Mao et à considérer Taïwan comme le gouvernement légitime de toute la Chine, avait été maintenue grâce à toute une rhétorique idéologique anti-communiste et "en défense de la liberté" pendant les années 50 et 60 ; elle est abandonnée afin de courtiser la Chine pour qu'elle rejoigne le camp américain dans la Guerre froide, ce qui devrait permettre d'encercler militairement la Russie non seulement à l’ouest, en Europe, au sud avec la Turquie, au nord (avec les bases de missiles américains et canadiens autour du pôle), mais aussi à l’est.[4] Cette nouvelle option impérialiste ne fait que renforcer l’exigence de la classe dominante de mettre fin à la guerre au Vietnam, puisque la liquidation de cette guerre constitue une condition préalable à l’alliance de la Chine avec les Etats-Unis. En tant que puissance régionale, la Chine a de grands intérêts en jeu dans un conflit en Asie du Sud-Est et soutient, à l’époque, le Vietnam du Nord. C’est l'incapacité à accomplir ce changement d’orientation de la politique étrangère vers le Moyen-Orient et à mettre fin à la guerre afin d’amener la Chine dans le bloc de l’Ouest, qui conduit à l’incroyable bouleversement politique de la période du Watergate et au départ de Nixon (le belliqueux vice-président Agnew, l’homme de main de Nixon pour ses basses œuvres, avait déjà été contraint de démissionner sur des accusations de corruption) pour préparer une transition en bon ordre vers un président intérimaire acceptable : Gerald R. Ford.
Huit mois après la démission de Nixon, avec Ford à la Maison Blanche, Saïgon tombe aux mains des staliniens, et l’impérialisme américain se retire de l’imbroglio vietnamien. La guerre avait coûté la vie à 55 000 Américains et à au moins 3 millions de Vietnamiens. Carter entre à la Maison Blanche en 1977 et, en 1979, les Etats-Unis reconnaissent officiellement la Chine continentale qui va désormais occuper le siège de la Chine (jusqu'alors occupé par le Taiwan) au Conseil de Sécurité de l’ONU.
La période 1968-76 illustre l’incroyable instabilité politique allant de pair avec de sérieuses divergences au sein de la bourgeoisie américaine sur la politique impérialiste. En huit ans, il y eut :
- quatre présidents (Johnson, Nixon, Ford, Carter) : deux furent contraints de démissionner (Johnson et Nixon) ;
- les assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy, et une tentative d’assassinat de George Wallace, le candidat du parti populiste de droite en 1972 ;
- l’implication du FBI et de la CIA dans l’espionnage des adversaires politiques à l'intérieur du pays qui fit tomber le discrédit sur ces deux institutions et amena une législation de "réforme" pour réduire formellement leurs pouvoirs. Le fait que, sous Nixon, la clique dirigeante ait utilisé des agences de l’Etat (FBI et CIA) pour s’assurer un avantage décisif sur les autres fractions de la classe dominante, fut intolérable pour ces dernières qui se sont senties directement menacées. Ce qu’on a appelé la crise de la sécurité nationale, à la suite du 11 septembre 2001, a permis à ces agences de fonctionner une fois encore sans entrave.
Après la Guerre froide, les ajustements de la politique impérialiste américaine à la disparition d’un monde bipolaire
L’effondrement du bloc russe à la fin des années 1980 constitue une situation sans précédent. Un bloc impérialiste disparaît, non pas à la suite de sa défaite dans la guerre impérialiste, mais de son implosion sous la pression de l’impasse historique dans la lutte de classe, des pressions économiques et de l’incapacité à continuer de participer à la course aux armements avec le bloc rival. Alors que la propagande américaine célèbre sa victoire sur l’impérialisme russe et glorifie le triomphe du capitalisme démocratique, 1989 se révèle être une victoire à la Pyrrhus pour l'impérialisme américain qui voit rapidement son hégémonie remise en cause au sein même de son ancienne coalition, du fait de la disparition de la discipline qui permettait la cohésion des deux blocs. La disparition soudaine de l’affrontement entre deux pôles qui avait caractérisé l’arène impérialiste pendant 45 ans, lève la contrainte d’adhérer à une discipline de bloc à laquelle étaient auparavant soumises les puissances de deuxième et de troisième ordre : la tendance au "chacun pour soi" au sein de la décomposition du capitalisme s’impose rapidement au niveau international. Les impérialismes plus faibles, nouvellement enhardis, commencent à jouer leur propre carte, refusant désormais de soumettre leurs intérêts à ceux des Etats-Unis. La première expression de cette décomposition était déjà apparue une décennie avant, en Iran, où la révolution menée par Khomeini a été le premier exemple dans lequel un pays parvenait à rompre avec le bloc américain sans que les Etats-Unis ne parviennent à le ramener dans leur giron et sans être, en même temps, gagné par le bloc russe. Auparavant, les pays de la périphérie du capitalisme mondial avaient pu jouer un bloc contre l’autre et avaient même pu changer de camp, mais aucun n’était parvenu à se maintenir en dehors du système bipolaire. En 1989, cette tendance devient dominante sur le terrain inter-impérialiste.
Les responsables politiques américains doivent soudainement s'adapter à une nouvelle disposition des forces sur le terrain international. Les activités expansionnistes de l’Allemagne sont particulièrement alarmantes pour les Etats-Unis. La guerre du Golfe contre l’Irak qui prend comme prétexte l’invasion du Koweït par l’Irak, "agression" que les Etats-Unis ont eux-mêmes suscitée, quand l’ambassadeur américain avait dit aux irakiens que son pays n'interférerait pas dans un conflit Irak-Koweït, est le moyen utilisé par les Etats-Unis pour réaffirmer leur domination et rappeler aux nations tentées par le "chacun-pour-soi" que les Etats-Unis restent la seule superpuissance au monde et qu’ils sont prêts à user de leur puissance militaire en qualité de gendarme du monde. Contre leur volonté et sans enthousiasme, les puissances européennes, y compris celles qui avaient entretenu des relations économiques et politiques avec l’Irak, se voient obligées non seulement d’approuver formellement les projets de guerre des Etats-Unis, mais même de rallier la "coalition internationale". La guerre est un formidable succès pour l’impérialisme américain qui démontre sa supériorité militaire, son armement moderne et sa volonté d’exercer son pouvoir. Aux Etats-Unis, Bush père bénéficie d’une incroyable popularité politique, au point d’obtenir 90% d’opinions favorables dans les sondages après la guerre.
Cependant, Bush s'avère incapable de consolider le succès américain dans le Golfe. La contrainte exercée sur les puissances qui veulent jouer leur propre carte au niveau international, se révèle être un phénomène très temporaire. Les avancées de l’Allemagne dans les Balkans reprennent et s'accélèrent avec l’éclatement de la Yougoslavie et "l’épuration ethnique". L’incapacité de l’administration Bush à consolider les acquis de la guerre du Golfe et à formuler une réponse stratégique efficace dans les Balkans constitue un facteur central dans son échec aux élections en 1992. Pendant la campagne présidentielle, Clinton rencontre les dirigeants du Pentagone et leur assure qu’il autorisera les raids aériens dans les Balkans et poursuivra une politique déterminée pour établir une présence américaine sur le terrain dans cette région, politique qui avait constitué un aspect de plus en plus important de la politique impérialiste américaine au cours de la précédente décennie. Malgré les critiques des républicains, durant la campagne électorale de 2000, vis-à-vis de la politique de Clinton consistant à impliquer des troupes dans des interventions militaires sans en avoir planifié l’issue, l’invasion de l’Afghanistan effectuée par l’administration G.W. Bush, les projets d’invasion de l'Irak et l’envoi de troupes dans plusieurs pays du monde (les troupes américaines sont actuellement stationnées dans 33 pays) sont en continuité de la politique de Clinton.
Pendant le mandat de Clinton, une divergence politique significative se développe au sein de la bourgeoisie américaine au sujet de la politique asiatique, l’extrême-droite s’opposant à la stratégie de partenariat en Extrême-Orient avec la Chine plutôt qu’avec le Japon. La droite considère la Chine comme un régime communiste anachronique, risquant d’imploser, et un allié peu fiable – un ennemi potentiel, en fait. C'est ce désaccord qui constitue la toile de fond des différents scandales de la fin des années 90 et de l’impeachment de Clinton. Cependant, tous les anciens présidents encore vivants des deux partis (à l’exception de Reagan atteint de la maladie d’Alzheimer) approuvent la stratégie politique adoptée par rapport à la Chine et s’opposent à l’impeachment. La droite paye un fort tribut pour avoir échoué dans son attaque contre Clinton. Newt Gingrich[5] est rejeté de la vie politique et d’autres leaders qui avaient soutenu l’impeachment sont démis de leurs fonctions. Dans ce contexte, il est important de noter que, quand il y a des divergences importantes au sein de la bourgeoisie sur la politique impérialiste et que les enjeux sont élevés, les combattants n'hésitent pas à déstabiliser l’ordre politique.
Les récentes divergences au sein de la classe dominante américaine au sujet de l’action unilatérale en Irak
En 1992, Washington adopte consciemment une orientation très claire pour sa politique impérialiste dans la période d’après Guerre froide, à savoir une politique basée sur "l'engagement fondamental de maintenir un monde unipolaire dans lequel les Etats-Unis n'aient pas d'égal. Il ne sera permis à aucune coalition de grandes puissances d'atteindre une hégémonie sans les Etats-Unis" (prof. G. J. Ikenberry, Foreign Affairs, sept-oct. 2002). Cette politique vise à empêcher l’émergence de toute puissance en Europe ou en Asie qui puisse remettre en cause la suprématie américaine et jouer le rôle de pôle de regroupement pour la formation d’un nouveau bloc impérialiste. Cette orientation, initialement formulée dans un document de 1992 (1992 Defense Planning Guidance Policy Statement) rédigé par Rumsfeld, durant la dernière année du premier mandat Bush, établit clairement cette nouvelle grande stratégie : "Empêcher la réémergence d'un nouveau rival, sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou ailleurs, qui représenterait une menace du type de celle exercée auparavant par l'Union soviétique (...) Ces régions incluent l'Europe occidentale, l’Asie orientale, le territoire de l'ex-Union soviétique et l'Asie du Sud-Est (...) Les Etats-Unis doivent montrer la direction nécessaire pour établir et protéger un nouvel ordre qui tienne la promesse de convaincre ses rivaux potentiels qu'ils n'ont pas besoin d'aspirer à un rôle plus important ni d'avoir une attitude agressive pour protéger leurs intérêts légitimes. (...) Sur les questions autres que militaires, nous devons tenir suffisamment compte des intérêts des nations industrielles avancées afin de les décourager de mettre en cause notre leadership ou de chercher à renverser l'ordre économique et politique établi... Nous devons maintenir les mécanismes de dissuasion des rivaux potentiels de ne serait-ce qu'aspirer à un rôle régional ou global plus grand".
Cette politique continue sous l'administration Clinton qui entreprend un formidable programme de développement de l'armement visant à décourager les ambitions de tout rival potentiel ; c’est l’annonce de la politique de stratégie militaire nationale de 1997 (1997 National Military Strategy) : "Les Etats-Unis resteront la seule puissance globale du monde à court terme, mais opéreront dans un environnement stratégique caractérisé par la montée de puissances régionales, de défis asymétriques comprenant les armes de destruction massive, des dangers transnationaux et la probabilité d'événements incontrôlés qu'on ne peut prévoir exactement". Cette politique, reprise et poursuivie par l’actuelle administration Bush et exprimée dans le Quadrennial Defense Review Report, paru le 30 septembre 2001, moins de trois semaines après l'attaque du World Trade Center, considère comme un "intérêt national à long terme" le but "d’empêcher toute domination hostile de régions critiques, en particulier en Europe, dans le nord-est asiatique, le littoral asiatique oriental,[6] et le Moyen-Orient et le Sud-Ouest asiatique". Le Quadriennal Report défend l'idée que "une stratégie et une politique bien ciblées peuvent (...) dissuader les autres pays de se lancer dans des compétitions militaires à l'avenir". Et dans le National Security Strategy 2002, l'administration Bush affirme : "Nous serons assez forts pour dissuader des adversaires potentiels de poursuivre un effort militaire dans l'espoir de dépasser ou d'égaler la puissance des Etats-Unis". En juin 2002, dans son discours lors de la cérémonie de remise des diplômes de West Point, le président Bush a affirmé encore que "l'Amérique détient et a l'intention de garder une puissance militaire impossible à défier - rendant ainsi vaine toute course aux armements déstabilisatrice d'autres zones et limitant les rivalités au commerce et à d'autres occupations pacifiques". Tout ceci se combine pour démontrer la continuité essentielle de la politique impérialiste américaine, au-delà des divergences entre partis, depuis bien plus d'une décennie, depuis la fin de la Guerre froide. Par "continuité", nous ne voulons pas dire évidemment que la mise en œuvre de ces orientations ait été identique à tous les niveaux. Il y a eu, bien sûr, des ajustements, en particulier au niveau pratique, de cette orientation, liés aux changements du monde pendant la dernière décennie. Par exemple, la capacité de l’impérialisme américain à organiser une "coalition" internationale pour soutenir ses aventures militaires s'est trouvée confrontée à des difficultés croissantes au cours du temps, et la tendance des Etats-Unis à intervenir de plus en plus seuls, à agir unilatéralement, dans leurs efforts stratégiques pour prévenir le risque d’apparition d’un rival asiatique ou européen, a atteint des niveaux qui provoquent de sérieux débats au sein même de la classe dominante.
Ces débats sont l’expression de la reconnaissance des difficultés auxquelles est confronté l’impérialisme américain. Bien qu’elle soit incapable d’avoir une conscience "complète" du développement des forces économiques et sociales dans le monde au sens marxiste, il est clair que la bourgeoisie, et la bourgeoisie américaine en particulier, est tout à fait capable de reconnaître certains éléments clés dans l’évolution de la situation internationale. Par exemple, un article intitulé "L'impérialiste hésitant : Terrorisme, Etats en faillite et le cas de l'empire américain", de Sebastian Mallaby, note que les hommes politiques américains reconnaissent l’existence d’un "chaos" croissant sur l’arène internationale, le phénomène d’Etats "en faillite" qui sont incapables de maintenir un minimum de stabilité dans leur société et les dangers qui en découlent d’une émigration massive et incontrôlée et d’un flux de réfugiés des pays de la périphérie vers les pays centraux du capitalisme mondial. Dans ce contexte, Mallaby écrit : "La logique du néo-impérialisme contraint aussi l'administration Bush à résister. Le chaos dans le monde est trop menaçant pour qu'on l'ignore et les méthodes existantes pour traiter ce chaos qui ont été essayées, se sont avérées insuffisantes". (Foreign Affairs, mars-avril 2002). Mallaby et d'autres bourgeois américains, théoriciens de politique étrangère, mettent en avant la nécessité pour les Etats-Unis, en tant que superpuissance mondiale, d’agir pour stopper l'avancée de ce chaos, même s’ils doivent le faire seuls. Ils parlent même ouvertement d’un "nouvel impérialisme" que les Etats-Unis doivent instaurer pour bloquer les forces centrifuges qui tendent à déchirer la société dans son ensemble. Dans la situation internationale actuelle, ils reconnaissent aussi que la possibilité de faire pression sur les anciens alliés des Etats-Unis au sein d’une "coalition internationale" comme au temps de la guerre du Golfe de 1990-91, est quasiment nulle. D'où le fait que la pression, déjà identifiée dans la presse du CCI, poussant les Etats-Unis à agir unilatéralement au niveau militaire, grandit incommensurablement. La prise de conscience de la nécessité de se préparer à agir unilatéralement remonte au gouvernement Clinton, quand des membres de celui-ci ont commencé à discuter ouvertement de cette option et ont préparé le terrain à des actions unilatérales de l'impérialisme américain. (Voir par exemple le document de Madeleine Albright, "The testing of American Foreign Policy", dans Foreign Affairs, nov-déc 1998). Ainsi donc, le gouvernement Bush agit en continuité avec la politique mise en place sous Clinton : les Etats-Unis obtiennent en Afghanistan la "bénédiction" de la communauté internationale pour leurs opérations militaires, sur la base de manipulations idéologique et politique à la suite du 11 septembre, et mènent alors seuls les opérations au sol, empêchant même leur proche allié, la Grande-Bretagne, de prendre une part du gâteau. Même si la bourgeoisie est consciente de la nécessité pour les Etats-Unis d’agir unilatéralement en définitive, la question de savoir quand et jusqu’où aller dans l’action unilatérale est une question tactique sérieuse pour l’impérialisme américain. La réponse n’est pas guidée par les précédents de la Guerre froide, quand les Etats-Unis intervenaient souvent sans la consultation de l’OTAN et des autres alliés, mais pouvaient compter sur leur puissance et leur influence en tant que tête de bloc pour obtenir l’assentiment des autres (comme ce fut le cas en Corée, dans la crise des missiles de Cuba, au Vietnam, pour les missiles Pershing et Cruise au début des années 1980, etc.). La réponse à cette question aura aussi un impact important sur l’évolution ultérieure de la situation internationale. Il faut remarquer en particulier que le débat qui a eu lieu pendant l’été 2002, a d'abord commencé chez les dirigeants du parti républicain, en fait entre les spécialistes traditionnels des affaires étrangères du parti républicain. Kissinger, Baker, Eagleburger, et même Colin Powell étaient d’avis d’être prudents et ne pas agir unilatéralement trop tôt en argumentant qu’il était encore possible, et préférable, d’obtenir l’approbation de l’ONU pour déclencher les hostilités américaines contre l’Irak. Des commentateurs bourgeois aux Etats-Unis ont même évoqué la possibilité que les anciens spécialistes républicains de la politique étrangère aient parlé au nom de George Bush père quand ils ont pris position pour une répétition de la démarche employée lors de la précédente Guerre de Golfe. Les démocrates, même la gauche du parti, ont été remarquablement silencieux dans cette controverse au sein du parti au pouvoir, à l’unique exception de la brève incursion de Gore sous les projecteurs, lorsqu'il a essayé de gagner des points auprès de la gauche des démocrates en émettant l'avis selon lequel la guerre contre l’Irak serait une erreur, du fait qu'elle détournerait l’attention de la préoccupation centrale, à savoir la guerre contre le terrorisme.
La question pour nous est de savoir quelle est la signification de ces divergences au sein de la bourgeoisie de l’unique superpuissance mondiale.
D’abord, il est important de ne pas exagérer l’importance du récent débat. Les précédents historiques démontrent largement que, quand il y a des divergences sérieuses sur la politique impérialiste au sein de la bourgeoisie américaine et que les protagonistes du débat mesurent l’ampleur des enjeux, ils n'ont pas peur de poursuivre leur orientation politique, même au risque de provoquer un bouleversement politique. Il est clair que le récent débat n’a pas abouti à des conséquences politiques semblables à celles observées par exemple pendant le conflit du Vietnam. En aucun cas, ce débat n’a menacé l’unité fondamentale de la bourgeoisie américaine sur sa politique impérialiste. De plus, le désaccord ne portait pas sur la question de la guerre en Irak, sur laquelle l’accord était presque complet au sein de la classe dominante américaine. Toutes les parties étaient d’accord avec cet objectif politique, non pas en raison de ce qu’aurait fait, ou menacé de faire, Saddam Hussein, ni par désir de se venger de la défaite de Bush père, ni pour stimuler les profits pétroliers d'Exxon au sens matérialiste vulgaire, mais à cause de la nécessité de lancer à nouveau un avertissement aux puissances européennes qui voudraient jouer leur propre carte au Moyen-Orient, à l’Allemagne en particulier, avertissement ayant pour but de signifier que les Etats-Unis n’ont pas peur d’utiliser la force militaire pour maintenir leur hégémonie. Par conséquent, il n'est ni surprenant ni accidentel que ce soit l’Allemagne qui ait été la plus véhémente à s’opposer aux préparatifs de guerre américains, puisque ce sont ses intérêts impérialistes qui sont en premier lieu pris pour cible par l’offensive américaine.
Le débat au sein des cercles dirigeants américains s’est centré sur quand et sur quelles bases déchaîner la guerre et, peut-être de manière plus critique, sur le niveau jusqu'où les Américains devaient agir seuls dans la situation actuelle. La bourgeoisie américaine sait parfaitement qu’elle doit être prête à agir unilatéralement, et qu’agir unilatéralement aura des conséquences significatives pour elle sur le terrain international. Cela contribue indubitablement à isoler davantage l'impérialisme américain, à provoquer de plus grandes résistances et de plus grands antagonismes au niveau international et pousse les autres puissances à rechercher des alliances possibles pour faire face à l’agressivité américaine, tout ceci ayant un plus grand impact sur les difficultés que va rencontrer l’impérialisme américain dans la période à venir. Le moment précis que choisissent les Etats-Unis pour abandonner tout semblant de recherche de soutien international à leurs actions militaires et pour agir unilatéralement, constitue donc une décision tactique qui a des implications stratégiques importantes. En mars 2002, Kenneth M. Pollack, actuellement directeur adjoint du Conseil des Affaires étrangères et, auparavant, directeur des Affaires du Golfe au Conseil National de Sécurité pendant l'Administration Clinton, parlait ouvertement de la nécessité pour le gouvernement de déclencher rapidement la guerre contre l’Irak avant que ne disparaissent la fièvre guerrière, attisée avec un tel succès aux Etats-Unis après le 11 septembre, et la sympathie internationale créée par les attaques terroristes qui avait facilité l’accord d’autres nations avec les actions militaires américaines. Comme le dit Pollack : "Trop tarder poserait autant de problème que trop peu, parce que l'élan gagné par la victoire en Afghanistan pourrait être brisé. Aujourd'hui, le choc des attaques du 11 septembre est encore frais et le gouvernement américain comme le public sont prêts à faire des sacrifices - en même temps que le reste du monde reconnaît la colère américaine et hésiterait à se mettre du mauvais côté. Plus longtemps nous attendons pour envahir, plus difficile ce sera d'avoir un soutien international et intérieur, même si la raison de l'invasion a peu, sinon rien, à voir avec les relations de l'Irak avec le terrorisme. (...) Les Etats-Unis peuvent, en d'autres termes, se permettre d'attendre un peu avant de s'en prendre à Saddam, mais pas indéfiniment." (Foreign Affairs, mars-avril 2002). L’opposition à l’intervention militaire américaine en Irak, aussi bien dans la classe ouvrière américaine qui ne s’est pas entièrement rangée derrière cette guerre, que dans le monde chez des puissances de deuxième et troisième ordre, laisse en fait supposer que les Etats-Unis ont peut-être trop attendu avant d’attaquer l’Irak.
Il est clair que les éléments les plus prudents de l’équipe dirigeante, notamment Colin Powell qui a défendu une politique de pression diplomatique pour gagner l’approbation du Conseil de Sécurité de l’ONU sur une action militaire en Irak, étaient majoritaires dans l’administration à l'automne dernier et, comme les événements l’ont montré, leur tactique s’est avérée efficace pour obtenir un vote unanime qui a fourni aux Etats-Unis le prétexte pour entrer en guerre contre l’Irak quand ils le souhaitaient. Mais il est clair qu'en février, le résultat obtenu à l'automne s'était largement amoindri du fait que la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine s’opposaient ouvertement aux plans de guerre américains, trois d'entre eux ayant le droit de veto au Conseil de Sécurité. Les critiques au sein de la bourgeoisie américaine exprimaient des préoccupations concernant le manque d'habileté de l'administration Bush pour manœuvrer et gagner un soutien international à la guerre (voir par exemple les récents commentaires du Sénateur Joseph Biden, le haut responsable démocrate au Comité des relations extérieures du sénat).
Les contradictions inhérentes à la situation actuelle soulèvent de très sérieux problèmes aux Etats-Unis. La décomposition et le chaos au niveau mondial rendent impossible la création de nouvelles "coalitions" au niveau international. Par conséquent, Rumsfeld et Cheney ont raison d'insister sur le fait qu’il ne sera plus jamais possible de constituer une coalition internationale à l’image de celle de 1990-91. Cependant, il est impossible d’imaginer que l’impérialisme américain permette qu’une telle situation l’entrave dans ses actions militaires pour défendre ses propres intérêts impérialistes. D’un autre côté, si les Etats-Unis mènent effectivement une intervention militaire unilatérale, quel que soit le succès obtenu à court terme, cela ne fera que les isoler un peu plus sur le plan international, leur aliénera les plus petits pays, rendra ces derniers contestataires et enclins à résister de plus en plus à la tyrannie de la superpuissance. Mais, par ailleurs, si les Etats-Unis reculent et ne mènent pas seuls la guerre dans le cadre actuel, ce sera une sérieuse démonstration de faiblesse de la part de la superpuissance qui ne fera qu’inciter les puissances plus petites à jouer leur propre carte et remettre en cause directement la domination américaine.
La question pour les révolutionnaires n’est pas de tomber dans le piège de prédire à quel moment précis la bourgeoisie américaine engagera une guerre unilatérale, en Irak dans un futur proche ou sur une autre scène plus tard, mais de comprendre clairement quelles sont les forces à l’oeuvre, la nature du débat au sein des cercles dirigeants américains, et les sérieuses implications de cette situation pour la poursuite du chaos et de l’instabilité à l'échelle internationale dans la période à venir.
JG, février 2003
1 "Endiguement", en anglais "containment", était la politique adoptée par l'impérialisme américain après la deuxième guerre mondiale d'endiguer toute extension de la zone d'influence russe.
2 La "théorie des dominos" voulait que la chute sous influence russe d'un pays dans une région disputée par les deux grands impérialismes (à l'occurrence, le sud-est asiatique) serait suivie inéluctablement par la chute des pays voisins.
3 La conférence de Bretton Woods établit le nouvel ordre monétaire et économique d'après-guerre, dominé par les Etats-Unis. Il mit en place, entre autres, le Fond Monétaire International, et le système d'échange basé sur le dollar à la place de l'étalon-or.
4 Cette politique d’encerclement de l’URSS ressemble remarquablement à l’actuelle politique envers l’Europe.
5A l'époque, le dirigeant du parti républicain dans la Chambre des représentants du Congrès américain, aujourd'hui totalement discredité.
6Selon le Pentagone, "le littoral asiatique oriental est une région qui s'étend du sud du Japon, passe par l'Australie et comprend le Golfe du Bengale".
Géographique:
- Etats-Unis [66]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
160 ans après la publication de La question juive
- 4201 reads
Marx et la question juive
Dans le dernier numéro de la Revue internationale, nous avons publié un article sur le film de Polanski, Le pianiste, qui porte sur le soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943 et sur le génocide nazi des juifs d'Europe. Soixante ans après l'horreur indicible de cette campagne d'extermination, on aurait pu s'attendre à ce que l'antisémitisme soit définitivement relégué au passé - les conséquences du racisme antisémite étant si claires qu'il aurait dû être discrédité une fois pour toutes. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. En fait toutes les vieilles idéologies antisémites sont aussi toxiques et aussi répandues que jamais même si leur cible principale s'est déplacée de l'Europe au monde "musulman", et en particulier, au "radicalisme islamique" personnifié par Ousama Ben Laden qui, dans toutes ses prises de position, n'a jamais manqué de s'attaquer "aux croisés et aux juifs" en tant qu'ennemis de l'islam et comme cibles appropriées pour les attaques terroristes. Un exemple typique de cette version "islamique" de l'antisémitisme nous est fourni par le site Internet "Radio Islam" dont le slogan est "Race ? Une seule race humaine". Le site se dit opposé à toute forme de racisme, mais à y regarder de plus prés, il est clair que sa préoccupation principale, c'est "le racisme juif envers les non-juifs" ; en fait, il s'agit d'une archive de textes antisémites classiques, depuis les protocoles des sages du Sion, une contre façon tsariste de la fin du 19e Siècle, qui se prétend être le procès-verbal d'une réunion de la conspiration juive internationale et constituait une des bibles du parti nazi, jusqu'à Mein Kampf de Hitler et autres invectives plus récentes du leader de "Nation of Islam" aux Etats-Unis. Louis Farrakhan.
Ce genre de publications -qui prennent à l'heure actuelle de très grandes proportions- montrent que la religion est devenue aujourd'hui l'un des principaux véhicules du racisme et de la xénophobie, qui encourage les attitudes de pogrom et divise la classe ouvrière et les couches opprimées de façon générale. Et nous ne parlons pas seulement d'idées, mais de justifications idéologiques pour de vrais massacres, qu'ils impliquent les serbes orthodoxes. les catholiques croates ou les musulmans bosniaques en ex Yougoslavie, les protestants et les catholiques en Irlande du Nord, les musulmans et les chrétiens en Afrique et en Indonésie, les hindous et les musulmans en Inde, ou les juifs et les musulmans en Israël/ Palestine.
Dans deux précédents articles de cette Revue -"La résurgence de l'Islam, un symptôme de la décomposition des relations sociales capitalistes" dans la Revue n109 et "Le combat du marxisme contre la religion, la source fondamentale de la mystification religieuse est l'esclavage économique" dans la Revue n°110- nous avons montré que ce phénomène était une véritable expression de l'enfoncement dans la décomposition de la société capitaliste. Dans cet article, nous voulons nous centrer sur le problème des juifs, non seulement parce que le fameux article de Karl Marx "A propos de la question juive" a été publié il y a 160 ans, en 1843, mais aussi parce que Marx dont toute la vie a été dédiée à la cause de l'internationalisme prolétarien, est cité aujourd'hui par un théoricien de l'antisémitisme -en général de façon désapprobatrice, mais pas toujours. Le site Radio Islam est instructif à ce sujet : l'article de Marx y apparaît sur la même page que les Protocoles des Sages de Sion, même si le site publie aussi des dessins humoristiques du genre de ceux de Der Sturmer qui insultent Marx pour être juif lui-même.
Cette accusation contre Marx n'est pas nouvelle. En 1960, Dagobert Runes publiait l'article de Marx en y mettant un titre à lui : Un monde sans juifs et qui sous-entendait que Marx était le premier représentant de la "solution finale" du problème juif. Dans une histoire dcs juifs plus récente, l'intellectuel anglais d'extrême-droite, Paul Johnson, a porté des accusations similaires et n'a pas hésité à trouver une composante antisémite à l'idée même de vouloir abolir l'échange comme base de la vie sociale. Au minimum, Marx serait un juif "qui se hait lui-même" (ce qui est aujourd'hui la plupart du temps un qualificatif donné par l'ordre établi sioniste envers tous ceux d'origine juive qui portent des critiques à l'Etat d'Israël).
Contre toutes ces distorsions grotesques, le but de cet article est non seulement de défendre Marx contre ceux qui cherchent à l'utiliser contre ses propres principes, mais aussi de montrer que le travail de Marx fournit le seul point de départ pour comprendre et dépasser le problème de l'antisémitisme.
Le contexte historique de l'article de Marx sur La question juive
II est inutile de présenter ou de citer l'article de Marx en dehors de son contexte historique. Cet article, "A propos de la question juive"([1] [97]), fait partie de la lutte générale menée pour le changement politique en Allemagne semi-féodale. La question de savoir s'il fallait ou non accorder aux juifs les mêmes droits civiques qu'aux autres habitants de l'Allemagne constituait un débat spécifique dans cette lutte. En tant que rédacteur de la Rheinische Zeitung, Marx avait eu au départ l'intention de faire une réponse aux écrits antisémites et ouvertement réactionnaires d'un certain Hernies qui défendait l'idée qu'il fallait maintenir les juifs dans le ghetto et voulait préserver à l'Etat sa base chrétienne. Mais après que l'hégélien de gauche Bruno Bauer fut entré dans la bagarre avec deux articles : "La question juive" et "La capacité des juifs et des chrétiens d'aujourd'hui de se libérer", Marx estima qu'il était plus important de polémiquer avec le point de vue de Bauer qu'il considérait comme faussement radical.
Nous devons aussi rappeler que dans cette période de sa vie, Marx était en train d'accomplir une transformation politique et de passer du point de vue de la démocratie radicale au communisme. Il était en exil à Paris et était influencé par les artisans communistes français (Cf. "Comment le prolétariat a gagné Marx au conununisme", dans la Revue internationale n°69) ; c'est à la fin de 1843, dans sa Critique de la philosophie du droit de Hegel, que Marx reconnut dans le prolétariat la classe porteuse d'une nouvelle société. En 1844, il rencontra Engels qui l'aida à comprendre l'importance des fondements économiques de la vie sociale; les manuscrits économiques et philosopiques, écrits la même année. constituent sa première tentative de compréhension de toute cette évolution dans sa véritable profondeur. En 1845, il écrivait les Thèses sur Feuerbach qui expriment sa rupture définitive avec le matérialisme unilatéral de ce dernier.
La polémique avec Bauer sur la question des droits civiques et de la démocratie, publiée dans les : Annales francos-allemandes, constitue sans aucune équivoque un moment de cette évolution.
A l'époque, Bruno Bauer était le porte parole de la "gauche" en Allemagne, bien que les germes de son évolution ultérieure vers la droite puissent déjà se percevoir dans l'attitude qu'il adopte envers la question juive sur laquelle il prend une position apparemment radicale mais qui, en fin de compte, aboutit à préconiser de ne rien faire pour changer l'état des choses existant. Selon Bauer, il était inutile de revendiquer l'émancipation politique des juifs dans un Etat chrétien : pour pouvoir réaliser une véritable émancipation, il était avant tout nécessaire, pour les juifs comme pour les chrétiens, d'abandonner leurs croyances et leur identité religieuses ; dans un Etat vraiment démocratique, il n'y aurait pas d'idéologie religieuse. En fait, s'il y avait quelque chose à faire, cela incombait beaucoup plus aux juifs qu'aux chrétiens : du point de vue des hégéliens de gauche, le christianisme constituait la dernière enveloppe religieuse au sein de laquelle s'était exprimée historiquement la lutte pour l'émancipation humaine. Ayant rejeté le message universel du christianisme, les juifs avaient encore deux degrés à franchir tandis que les chrétiens n'en avaient plus qu'un.
La transition entre ce point de vue et la position ultérieure ouvertement antisémite de Bauer n'est pas difficile à voir. Marx peut très bien l'avoir pressentie mais dans sa polémique, il commence par défendre la position selon laquelle accorder des droits civiques "normaux" aux juifs - qu'il appelle "l'émancipation politique", constituerait "un grand pas en avant" ; en fait, cela avait déjà caractérisé les précédentes révolutions bourgeoises (Cromwell avait permis aux juifs de rentrer en Angleterre et le code Napoléon accordait les droits civiques aux juifs). Cela devait faire partie de la lutte plus générale pour se débarrasser des barrières féodales et créer un Etat démocratique moderne qui n'avait que trop tardé, notamment en Allemagne.
Mais Marx était déjà conscient que la lutte pour la démocratie politique ne constituait pas le but final. L'article Sur "La question juive" semble marquer une avancée significative par rapport au texte qu'il avait écrit peu de temps auparavant, la Critique de la philosophie politique de Hegel. Dans ce dernier, Marx pousse sa pensée démocrate radicale à l'extrême, et y défend l'idée que la démocratie réelle - le suffrage universel - signifie la dissolution de l'Etat et de la société civile. Dans "La question juive", au contraire, Marx affirme qu'une émancipation purement politique - il utilisé même l'expression de "démocratie accomplie" -est loin de répondre à une véritable émancipation humaine.
C'est dans ce texte que Marx reconnaît clairement que la société civile est la société bourgeoise - une société d'individus isolés en concurrence sur le marché. C'est une société de séparation et d'aliénation (c'est le premier texte dans lequel Marx utilise ces termes) dans laquelle les puissances mises en oeuvre par les hommes eux-mêmes - pas seulement le pouvoir de l'argent mais aussi celui de l'Etat lui-même - deviennent inévitablement des forces étrangères dominant la vie humaine. Ce problème n'est pas résolu par la réalisation de la démocratie politique et des droits de l'homme. Celle-ci reste fondée sur la notion du citoyen atomisé et non sur une véritable Communauté. "Ainsi, aucun des prétendus droits de l’homme ne s'étend au-delà de l'homme égoïste, au delà de l'homme comme membre de la société civile, savoir un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé st son caprice prive, l'individu sépare de la communauté. Bien loin que l'homme ait été considéré, dans ces droits-là, comme un être générique, c'est au contraire la vie générique elle même, la société, qui apparait comme un cadre extérieur aux individus, une entrave à leur indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leur propriété et de leur personne égoïste ".
Une preuve supplémentaire du fait que l'aliénation ne disparaît pas avec la démocratie politique, soulignait Marx, était fournie par l'exemple de l'Amérique du Nord : formellement, la religion et l'Etat y étaient séparés ; pourtant c'était par excellence le pays de l'observance religieuse et des sectes.
Aussi, tandis que Bauer défend l'idée que la lutte pour l'émancipation politique des juifs comme tels est une perte de temps, Marxd éfend et soutient cette revendication : "Aussi ne disons-nous pas aux juifs, avec Baller : vous ne pouvez être politiquement émancipés, sans vous émanciper radicalement du judaïsme. Nous leur disons plutôt : c'est parce que vous pouvez être émancipés politiquement, sans vous détacher complétement et définitivement du judaisme, que l'émancipation politique elle-même n'est pas l'émancipation humaine. Si vous, juifs, vous désirez votre émancipution politiques sans vous émanciper vous-mêmes humainement, c'est que l'imperfection et la contradiction ne sont pas seulement en vous, mais ils sont inhérentes à l'essence et à la catégorie de l’émancipation politique". Concrètement, cela voulait dire que Marx acceptait la demande faite par la communauté juive locale de rédiger une pétition en faveur des libertés civiques pour les juifs. Cette démarche vis-à-vis des réformes politiques devait constituer une attitude caractéristique du mouvement ouvrier pendant la phase ascendante du capitalisme. Mais Marx regardait déjà plus loin sur le chemin de l'histoire - vers la société communiste future - même s'il ne la nomme pas encore ainsi dans "La question juive". C'est la conclusion de la première partie de sa réponse à Bauer : "C'est seulement lorsque l'homme individuel, réel, aura recouvré en lui-même le citoyen abstrait et qu'il sera devenu, lui, homme individuel, un être générique dans sa vie empirique, dans son travail individuel, dans ses rapports individuels ; lorsque l'homme aura reconnu et organisé ses forces propres comme forces sociales et ne retranchera donc plus de lui la force sociale sous l'aspect de la force politique : c'est alors seulement que l'émancipation humaine sera accomplie".
Le prétendu antisémitisme de Marx
C'est la deuxième partie du texte, en réponse au deuxième article de Baller, qui a attiré contre Marx les foudres de toutes parts et dont la nouvelle vague d'antisémitisme islamique aujourd'hui fait un emploi abusif au service de sa vision obscurantiste du monde. « Quel est le culte profane du juif ? Le trafic. Quel est son dieu ? L'argent.(...) L'argent est le dieu jaloux d’Israël, devant qui nl autre dieu ne doit exister. L'argent avilit tous les dieux (les hommes : il les transforme en une marchandise. L'argent est la valeur universelle de toutes choses. constituée pour soi-même. C'est pourquoi il a dépouillé le monde entier, le monde des hommes ainsi que la nature, de leur valeur originelle. L'argent, c'est l'essence aliénée du travail et de la vie de l'homme, et cette essence étrangère le domine, et il l'adore. Le dieu des juifs . s'est mondanise, il s'est changé en dieu du monde,. La lettre de change est le vrai dieu du juil… » C'est de ce passage et d'autres, dans "La question juive", dont on s'est emparé pour prouver que Marx serait un des pères fondateurs de l'antisémitisme moderne ; son article aurait donné une respectabilité au mythe raciste du parasite juif assoiffé de sang.
II est vrai que bien des formulations utilisées par Marx dans cette partie, ne pourraient pas l'être de la même façon aujourd'hui. I1 est également vrai que ni Marx ni Engels n'étaient totalement affranchis de tout préjugé bourgeois et que certaines de leurs prises de position, en particulier sur les nationalités, le reflètent. Mais en conclure que Marx et le marxisme lui-même sont indélébilement marqués par le racisme est une contre façon de sa pensée.
Toutes ces formules doivent être placées dans leur contexte historique approprié. Comme l'explique Hal Draper dans l'appendice de son livre Karl Marx’s Theorie of Revolution (Vol. 1, Monthly Review Press, 1977), l'identification entre le judaïsme et le commerce ou le capitalisme faisait partie du langage de l'époque et était reprise par nombre de penseurs radicaux et de socialistes, y compris des juifs radicaux comme Moses Hess qui influençait Marx à l'époque (et a eu en fait une influcnce sur cet article même).
Trevor Ling, historien des religions, critique l'article de Marx sous un autre angle : "Marx avait un style journalistique mordant et agrémentait ses pages de nombreuses tournures de phrases intelligentes et satiriques. La sorte d’écrits dont on vient de donner des exempIes, est vigoureusement pamphlétaire, excite les passions, mais n'a pas grand chose à offrir en terme d’analyse sociologique utile. De grandes entités superflicielles comme le « judaisme » ou le « christianisme », quand elles sont utilisées dans ce genre de contexte, ne correspondent pas à des réalités historiques : ce sont des étiquettes apposées par Marx à ses propres constructions, artificielles et mal conçuees". (Ling, Karl Marx and Religion, Macmillan Press, 1980). Pourtant quelques phrases mordantes de Marx fournissent des outils bien plus tranchants pour examiner une question en profondeur que tous les ouvrages savants des académiciens. De toutes façons, Marx n'essaie pas ici de faire une histoire de la religion juive qui ne peut être réduite à une simple justification du mercantilisme, ne serait-ce que parce qu'elle puise ses origines dans une société où les rapports marchands avaient un rôle très secondaire et que sa substance reflète aussi l'existence de divisions de classe entre les juifs eux-mêmes (par exemple, dans les diatribes des prophètes contre la corruption de la classe dominante dans l'Israël antique). Comme nous l'avons vu, ayant défendu la nécessité que la population juive ait les mêmes "droits civiques" que les autres citoyens, Marx n'utilise l'analogie verbale entre le judaïsme et les rapports marchands que pour aspirer à une société libérée des rapports marchands, ce qui est le véritable sens de sa phrase de conclusion : "L’émancipation sociale du juif, c'est l'émancipation de la société libérée du judaisme". Cela n'a rien à voir avec un quelconque plan d'élimination des juifs, malgré les insinuations répugnantes de Dagobert Rune ; cela signifie que tant que la société sera dominée par les rapports marchands, les êtres humains ne pourront pas contrôler leur propre puissance sociale et resteront étrangers les uns aux autres.
En même temps, Marx fournit une vraie base pour analyser la question juive d'un point de vue matérialiste - tâche qui a été menée à bien par d'autres marxistes plus tard, comme Kautsky et notamment, Abraham Leon[2 [98]]). Contrairement à l'interprétation idéaliste qui cherchait à expliquer la survie opiniàtre des juifs par leur conviction religieuse, Marx souligne que la survie de leur identité séparée et de leurs convictions religieuses s'expliquait par le rôle qu'ils avaient rempli dans l'histoire : "Le judaïsme s'est conservé non pas en dépit d l'histoire, mais grâce à l’histoire". Et c'est en fait profondément lié aux relations qu'ont entretenus les juifs avec le commerce : "Ne cherchons pas le secret du juif dans sa religion, mais cherchons le secret de la religion dans le juif réel". Et c'est ici que Marx utilise lejeu de mot entre le judaïsme en tant que religion et le judaïsme comme synonyme de marchandage et de pouvoir financier, cc qui se basait sur un fond de réalité : le rôle économique et social particulier joué par lesjuifs dans l'ancien système féodal.
Leon, dans son livre The Jewish Question, a Marxist Interpretation, fonde son étude sur ces quelques phrases limpides de "La question juive" et sur une autre, dans Le Capital, qui parle des "juifs [vivant] dans les pores de la société polonaise"([3] [99]) de façon comparable à d'autres "peuples marchands" dans l'histoire. A partir de ces quelques éléments, il développe l'idée que les juifs dans l'antiquité et dans le féodalisme, ont fonctionné comme un "peuple-classe", en grande partie attaché à des rapports de commerce et d'argent dans des sociétés qui étaient fondées, de façon prédominante, sur une économie naturelle. Dans le féodalisme en particulier, cette situation était codifiée dans les lois religieuses qui interdisaient aux chrétiens de faire de l'usure. Mais Leon a aussi montré que le lien des juifs avec l'argent n'a pas toujours été limité à l'usure. Dans les sociétés antique et féodale, les juifs étaient un peuple marchand, personnifiant les rapports de commerce qui ne dominaient pas encore l'économie mais reliaient des communautés dispersées dont la production était principalement tournée vers l'usage, tandis que la classe dominante s'appropriait et consommait directement la plus grande part du surplus. C'est cette fonction socio économique particulière (qui était évidemment une tendance générale et non une loi absolue chez tous les juifs) qui a fourni la base matérielle à la survie de la "corporation" juive au sein de la société féodale ; a contrario, là où les juifs ont développé d'autres activités comme l'agriculture, ils ont en général été très rapidement assimilés.
Mais ceci ne veut pas dire que les juifs ont été les premiers capitalistes (question qui n'est pas complètement claire dans le texte de Marx parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore complètement saisi la nature du capital) ; au contraire, c'est la montée du capitalisme qui a coïncidé avec une des pires phases de persécution des juifs. Contrairement au mythe sioniste selon lequel la persécution des juifs a constitué une constante de toute l'histoire - et que les juifs ne cesseront d'être persécutés que lorsqu'ils seront tous réunis dans un seul pays ([4] [100]) -Leon montre quctant qu'ils ontjoué un rôle "utile" dans les sociétés pré-capitalistes, les juifs étaient la plupart du temps tolérés et, souvent, spécifiquement protégés par les monarques qui avaient besoin de leurs qualifications et de leurs services. C'est l'émergence d'une classe marchande "autochtone" qui s'est mise à utiliser ses profits pour les investir dans la production (par exemple, le commerce de la laine anglaise, clé pour comprendre les origines de la bourgeoisie anglaise) qui a sonné l'heure du désastre pour les juifs ; ceux-ci incarnaient une forme d'économie marchande désormais dépassée et étaient considérés comme un obstacle au développement de ces nouvelles formes. C'est ce qui a poussé un nombre croissant de commerçants juifs à se consacrer à la seule forme de commerce qui leur était accessible - l'usure. Mais cette pratique a amené les juifs à entrer en conflit direct avec les principaux débiteurs de la société - d'une part les nobles, et les petits artisans et les paysans de l'autre. Il est significatif, par exemple, que les pogroms contre les juifs cri Europe occidentale eurent lieu dans la période où le féodalisme avait commencé son déclin et le capitalisme sa montée. En Angleterre, en 1189-90, les juifs d'York et d'autres villes furent massacrés et la totalité de la population juive expulsée. Les pogroms étaient souvent provoqués par les nobles qui avaient de grosses dettes envers les juifs et qui trouvaient des partisans tout prêts parmi les petits producteurs qui étaient également souvent endettés vis-à-vis des prêteurs juifs les uns et les autres espéraient bénéficier d'une annulation de leurs dettes crâce au meurtre et à l'expulsion des usuricrs, et Se saisir de leurs propriétés. L'émigration juive d'Europe occidentale vers l'Europe orientale à l'aube du développement capitaliste permettait un retour vers des régions plus traditionnelles et encore féodales où les juifs pouvaient retrouver leur propre rôle plus traditionnel ; en revanche, les juifs qui sont restés ont tendu à s'assimiler dans la société bourgeoise environnante. Notamment, une fraction juive de la classe capitaliste (personnifiée par la famille Rothschild) est le produit de cette époque : parallèlement s'est développé un prolétariat juif, bien que les ouvriers juifs, à l'Ouest comme à l'Est, aient été concentrés essentiellement dans la sphère artisanale et non dans l'industrie lourde, et que la majorité des juifs ait continué à appartenir de façon disproportionnée à la petite-bourgeoisie, souvent en tant que petits commerçants.
Ces couches -petits commerçants, artisans, prolétaires- sont jetées dans la misère la plus abjecte avec le déclin du féodalisme à l'est et l'émergence d'une infrastructure capitaliste qui contenait déjà bien des signes de son déclin. A la fin du 19° siècle, ont lieu de nouvelles vagues de persécution dans l'Empire russe, provoquant un nouvel exode des juifs vers l'ouest ce qui, de nouveau, "exporte" le problème juif dans le reste du monde, en particulier en Allemagne et en Autriche. Cette période voit se développer le mouvement sioniste qui, de la droite à la gauche, met en avant l'idée que le peuple juif ne pourra jamais être normalisé tant qu'il n'aura pas de patrie - argument dont la futilité fut, selon Léon, confirmée par l'Holocauste lui-même, puisque l'apparition d'une petite "patrie juive" en Palestine n'a en rien pu l'empêcher([5] [101]).
Leon, écrivant en plein milieu de l'Holocauste nazi, montre comment le paroxysme d'antisémitisme atteint en Europe nazie est l'expression de la décadence du capitalisme. Fuyant la persécution tsariste en Europe de l'Est et en Russie, les masses juives immigrées n'ont pas trouvé, en Europe occidentale, un havre de paix et de tranquillité mais une société capitalistc qui devait bientôt être déchirée par d'insolubles contradictions, ravagée par la guerre et la crise économique mondiale. La défaite de la révolution prolétarienne après la Première Guerre mondiale avait non seulement ouvcrt le cours à une secondc boucherie impérialiste, mais aussi à une forme de contre-révolution qui exploita à fond les vieux préjugés antisémites, utilisant le racisme anti-juif, à la fois pratiquement et idéologiquemcnt, comme base pour concourir à la liquidation de la menace prolétarienne et adapter la société à une nouvelle guerre. Comme le Parti Communiste International dans la brochure Auschwitz et le grand alibi, Léon se concentre particulièrement sur l'utilisation faite par le nazisme des convulsions de la Petite-bourgcoisie, ruinée par la crise capitaliste et proie facile pour une idéologie qui lui promettait non seulement de la libérer de ses concurrents juifs, mais encore lui permettait officiellement de faire main basse sur leurs propriétés (méme si l'Etat nazi n'a pas vraiment permis à la petite-bourgeoisie allemande d'en bénéficier et s'est approprié la part du lion pour développer et maintenir sa vaste économie de guerre).
En même temps, comme le montre Léon, une nouvelle fois, l'utilisation dc l'antisémitisme comme un socialisme d'imbécile,,,, une fausse critique du capitalisme, permit à la classe dominante d'entraîner certains secteurs de la classe ouvrière, en particulier les couches les plus marginales ou celles qui étaient écrasées par le chômage. En fait, la notion de "national"socialisme était en partie une réponse directe de la classe dominante au lien étroit qui avait été établi entre l'authentique mouvement révolutionnairc et une couche d'intellectuels ct d'ouvriers juifs qui, comme Lénine l'a souligné, gravitait naturellement vers le socialisme international en tant que seule solution à leur situation d'éléments persécutés et sans abri de la société bourgeoise. Le socialisme international était qualifié de machination de la conspiration juive mondiale et les prolétaires étaient enjoints d'agrémenter leur socialisme de patriotisme. Il faut aussi souligner que cette idéologie s'est reflétée dans l'URSS stalinienne où la campagne d'insinuations contre "les cosmopolites sans racines" servait de couverture à des sous-entendus antisémites contre l'opposition internationaliste à l'idéologie et à la pratique du "socialisme en un seul pays".
Cela montre que la persécution des juifs fonctionne aussi au niveau idéologique et a besoin d'une idéologie qui la justifie. Au Moyen Age, c'était le mythe chrétien des assassins du Christ, des empoisonneurs de puits, des meurtres rituels d'enfants chrétiens : Shylock et sa livre de chair([6] [102]). Dans la décadence du capitalisme, c'est le mythe d'une conspiration juive mondiale qui aurait fait apparaître le capitalisme comme le communisme pour imposer sa domination sur les peuples aryens.
Dans les années 1930, Trotsky notait que le déclin du capitalisme engendrait une terrible régression sur le plan idéologique :"Le fascisrne a amené à la politique les basfonds de la société. Non seulement dans les maisons paysannes, mais aussi dans les gratte-ciel des villes vivent encore aujourd’hui, à côté du XXe siécle, le Xe et le XIIe siècles. Des centaines de millions de gens utilisent le courant électique, sans cesser de croire à la force magique des gestes et des incantations. Le pape à Rome prêche à la radio sur le miracle de la transmutation de l'eau en vin. Les étoiles de cinéma se font dire la bonne aventure. Les aviateurs qui dirigent de merveilleuses mécaniques, créées par le génie de l'homme, portent des amulettes sous leur combinaison. Quelles réserves inépuisables d'obscurantisme, d'ignorance et de barbarie ! Le désespoir les a fait se dresser, le fascisme leur a donné un drapeau. Tout ce qu'un développement sans obstacle de la société aurait dû rejeter de l'organisme national, sous la forme d'excréments de la culture, est maintenant vomi : la civilisaition capitaliste vomit une barbarie non digérée. Telle est la physiologie du national socialisme". ("Qu'est-ce que le nationalsocialisme ?" 10 mai 1933)
On retrouve tous ces éléments dans les fantasmes nazis à propos des juifs. Le nazisme n'a pas fait de secret sur sa régression idéologique - il est revenu ouvertement aux dieux pré-chrétiens. Le nazisme en fait était un mouvement occultiste qui s'est emparé du contrôle direct des moyens de gouvernement ; et comme les autres occultismes, il considérait qu'il menait une bataille contre une autre puissance satanique secrète - en l'occurrence, les juifs. Et ces mythologies qu'on peut certainement examiner en elles-mêmes, sous tous leurs aspects psychologiques, développent leur propre logique et nourrissent le monstre qui a mené aux camps de la mort.
Néanmoins, on ne peut jamais séparer cette irrationalité idéologique des contradictions du système capitaliste - ce n'est pas, comme ont tenté de le démontrer de nombreux penseurs bourgeois, l'expression d'une sorte de principe métaphysique du mal, un mystère insondable. Dans l'article sur le film de Polanski "Le pianiste" dans la Revue internationale n°113, nous avons cité la brochure du PCI (Auschwitz ou le grans alibi) à propos du froid calcul "raisonné" qui se tenait derrière l'holocauste - l'industrialisation du meurtre et l'utilisation des cadavres pour en tirer le maximum de profit. Mais il existe une autre dimension que cette brochure n'aborde pas : l'irrationalité de la guerre capitaliste elle même. Ainsi la "solution finale", sous la forme de la guerre mondiale qui lui a fourni son contexte, est provoquée par les contradictions économiques et ne renonce pas à la course au profit, mais en même temps, elle devient un facteur supplémentaire dans l'exacerbation de la ruine économique. Et si l'économie de guerre requérait l'utilisation du travail forcé, toute la machinerie des camps de concentration est aussi devenue un immense fardeau pour l'effort de guerre allemand.
La solution de la question juive
160 ans plus tard, l'essence de ce que Marx a mis en avant conune solution de la question juive, reste valable : l'abolition des rapports capitalistes et la création d'une réelle communauté humaine. Evidenunent, c'est aussi la seule solution possible à tous les problèmes nationaux qui subsistent : le capitalisme s'est avéré incapable de les résoudre. La manifestation actuelle du problème juif qui est spécifiquement liée au conflit impérialiste au Moycn-Orient, en constitue la meilleure preuve.
La "solution" mise en avant par le « mouvementde libération nationale juif », le sionisme, est devenue le nœud dit problème. La source principale du regain actuel d'antisémitisme n'est plus directement liée à la fonction particulière des juifs dans les Etats capitalistes avancés, ni au problème de l'immigration juive dans ces régions. Dans ces pays, depuis la Seconde Guerre mondiale, la cible du racisme a porté sur les vagues d'immigration en provenance des anciennes colonies ; dernièrement, dans les protestations contre les "demandeurs d'asile", c'est aux victimes des dévastations économiques, écologiques et militaires que le capitalisme en décomposition inflige à la planète, que s'adresse le racisme. L'antisémitisme "moderne" est d'abord et avant tout lié au conflit du Moyen-Orient. La politique crûment impérialiste d'Israël dans la région et le soutien sans faille que lui ont apporté les Etats-Unis ont revitalisé tous les vieux mythes sur le complot juif international. Des millions de musulmans sont convaincus par le mythe urbain selon lequel "40 000 Juifs se sont tenus éloignés des Tours jumelles le 11 septembre parce qu'on les avait avertis à l'avance de l'attaque" - "les juifs en sont les auteurs". Et cela en dépit du fait que ceux qui le proclament, sont des gens qui défendent Ben Laden et applaudissent les attaques terroristes ! ([7] [103]) Le fait que plusieurs membres dirigeants de la clique qui entoure Bush, les "néoconservateurs" qui sont aujourd'hui les avocats les plus résolus et les plus explicites du "nouveau siècle américain", soient juifs (Wollbwitz, Perle, etc.) a apporté de l’eau à ce moulin, en lui donnant parfois une tournure de gauche. En Grande Bretagne récemment, il y a eu une controverse sur le fait que Tain Dalyell, figure "anti-guerre" de la gauche du Labour Party, a ouvertement parlé de l'influence du "lobby juif" sur la politique étrangère américaine et même sur Blair, et il a été défendu contre les accusations d'antisémitisme par Paul Foot du Socialist Workers Party qui a seulement regretté qu'il ait parlé de juifs et non de sionistes. Dans la pratique réelle, la distinction entre les deux est de plus en plus obscurcie dans les discours des nationalistes et du Jihad qui dirigent la lutte armée contre Israël. Dans les années 1960 et 70, l'OLP et les gauchistes qui la soutenaient, disaient qu'ils voulaient vivre en paix avec les juifs dans une Palestine détnocratique et laïque ; mais aujourd'hui, l'idéologie de l'Intifada submerge celle du radicalisme islamique et ne cache pas qu'elle veut expulser les juifs de la région ou les exterminer complètement. Quant au trotskisme, il a depuis longtemps rejoint les rangs du pogrom nationaliste. Nous avons déjà mentionné qu'Abraham Leon avait dit que le sionisme ne pouvait rien faire pour sauver les juifs de l'Europe dévastée par la guerre ; aujourd'hui, on peut ajouter que les juifs les plus menacés de destruction physique sont ceux qui se trouvent précisément sur la terre promise du sionisme. Non seulement le sionisme a bâti une immense prison pour les Arabes palestiniens qui vivent sous le régime humiliant de l'occupation militaire et de la violence brutale ; il a aussi emprisonné les juifs d'Israël eux-mêmes dans une horrible spirale de terrorisme et de contre-terreur qu'aucun "processus de paix" impérialiste ne semble capable d'arrêter.
Le capitalisme dans sa décadence a ranimé tous les démons de haine et de destruction qui ont toujours hanté l'humanité, et il les a armés avec les armes les plus dévastatrices qu'on n'ait jamais connues. Il a permis le génocide à une échelle sans précédent dans l'histoire et il ne montre aucun signe d'apaisement ;malgré l'holocauste des juifs, malgré les cris de "Plus jamais", nous assistons non ouvertement à un virulent renouveau d'antisémitisme, mais à des carnages ethniques à une échelle comparable à celle de l'Holocauste, comme le massacre de centaines de milliers de Tutsis au Rwanda en l'espace de quelques semaines, ou les séries continuelles de nettoyage ethnique qui ont ravagé les Balkans pendant lesa nnées 1990. Ce retour du génocide est une caractéristique du capitalisme décadent dans sa phase finale - celle de sa décomposition. Ces terribles événements nous donnent un aperçu de l'avenir que l'aboutissement ultime de la décomposition nous réserve : l'autodestruction de l'humanité. Et comme pour le nazisme dans les années 1930, ces massacres s'accompagnent des idéologies les plus réactionnaires et apocalyptiques sur toute la planète - le fondamentalisme islamique, fondé sur la haine raciale et le mysticisme du suicide, en est l'expression la plus évidente, mais pas la seule : nous pouvons également parlé du fondamentalisme chrétien qui commence à avoir de l'influence aux plus hauts échelons du pouvoir dans la nation la plus puissante du monde, de l'emprise croissante de l'orthodoxie juive sur l'Etat d'Israël, du fondamentalisme hindou en Inde qui, comme son jumeau musulman au Pakistan, détient des armes nucléaires, jusqu'au renouveau "fasciste" en Europe. Et nous ne devons pas non plus ôter de la liste la religion de la démocratie ; tout comme elle l'a fait pendant l'Holocauste, la démocratie aujourd'hui, cette bannière déployée sur les tanks américains et britanniques en Afghanistan et en Irak, s'est montrée être une face de la pièce dont les religions sont l'autre, plus ouvertement irrationnelles : une feuille de vigne pour la répression totalitaire et la guerre impérialiste. Toutes ces idéologies sont l'expression d'un système social qui a atteint une impasse totale et n'offre rien d'autre à l'humanité que la destruction.
Le capitalisme dans son déclin a créé une myriade d'antagonismes nationaux qu'il s'est montré incapable de résoudre ; il n'a fait que les utiliser pour poursuivre sa route dans la guerre impérialiste. Le sionisme qui n'a su poursuivre son but en Palestine qu'en se subordonnant d'abord aux besoins de l'impérialisme britannique, puis à ceux de l'impérialisme américain, est un clair exemple de cette règle. Mais contrairement à ce que proclame l'idéologie anti-sioniste, ce n'est absolument pas un cas particulier. Tous les mouvements nationalistes ont opéré exactement de la même façon, y compris le nationalisme palestinien qui a été l'agent de différentes puissances impérialistes, petites ou grandes, depuis l'Allemagne nazie jusqu'à l'URSS, en passant par l'Irak de Saddam, sans oublier certaines puissances modernes d'Europe. Le racisme et l'oppression nationale sont des réalités de la société capitaliste, mais aucun schéma d'autodétermination nationale ni de regroupement des opprimés en une foule de mouvements "parcellaires" (les noirs, les gays, les femmes, les-juifs, les musulmans, etc.) ne constitue une réponse au racisme et à l'oppression. Tous ces mouvements se sont avérés des moyens supplémentaires pour diviser la classe ouvrière et l'empêcher de voir sa véritable identité. Ce n'est qu'en développant cette identité, à travers des luttes pratiques et théoriques, que la classe ouvrière peut surmonter toutes les divisions dans ses rangs et se constituer en une puissance capable de prendre le pouvoir au capitalisme.
Cela ne signifie pas que toutes les questions nationales, religieuses, culturelles disparaîtront automatiquement dès que la lutte de classe aura atteint un certain degré. La classe ouvrière fera la révolution bien avant de s'être débarrassée du bagage des siècles, ou plutôt au cours même du processus où elle s'en défera ; et dans la période de transition au communisme, elle devra s'affronter à une foule de problèmes ayant trait à la croyance religieuse et à l'identité ethnique et culturelle au fur et à mesure qu'elle cherchera à unir l'humanité en une communauté globale. Il est vrai que le prolétariat victorieux ne supprimera jamais par la force les expressions culturelles particulières pas plus qu'il ne mettra la religion hors la loi ; l'expérience de la révolution russe a démontré que de telles tentatives ne font que renforcer l'emprise d'idéologies dépassées. La mission de la révolution prolétarienne, comme l'argumente avec force Trotsky, c'est de jeter les fondements matériels pour faire la synthèse de tout ce qu'il y a de mieux dans les différentes traditions culturelles de l'histoire humaine - pour créer la première culture vraiment humaine. Et ainsi nous revenons à Marx de 1843 : la solution de la question juive, c'est la réelle émancipation humaine qui permettra enfin à l'homme d'abandonner la religion en extirpant les racines sociales de l'aliénation religieuse.
Amos
[1] [104] Karl Marx, (Oeuvres, Editions Gallimard, Collection "Bibliotheque de la Pléiade", Tome III "Philosophie", page 347 et suivantes.
[2] [105] Abraham Léon était un juif né en Pologne qui a grandi en Belgique dans les années 1920-30. II a commencé sa vie politique comme membre du groupe précurseur "Socialiste Sioniste" Hashomair Hatzair, mais il a rompu avec le sionisme après les procès de Moscou qui l'ont poussé vers l'Opposition trotskiste. La profondeur et la clarté de son livre montrent que pendant cette période, le trotskisme étaittoujours un courant du mouvement ouvrier ; et meme si le livre a été écrit au montent où il était en train de cesser de l'être (au début des années 1940, pendant l'occupation allemande de la Belgique), les bases marxistes continuent d'y briller. Leon fut arrêté en 1944 et mourut à Auschwitz
[3] [106] Livre III, chapitrc XIII - Karl Marx, Oeuvres, Editions Gallimard, Collection "Bibliothèque de la Pléiade". Tome II "Economie".
[4] [107] Comme Leon le met en évidence, l'idée que les problèmes des juifs remontent tous à la destruction du temple par les romains et au fait qu'il s'en serait suivi une diaspora, constitue également un mythe ; en fait il existait déjà une importante diaspora juive dans l'antiquité, avant les événements qui ont présidé à la disparition finale de l'antique "patrie", juive.
[5] [108] En réalité, le sionisme était l'une des nombreuses forces bourgeoises à s'opposer au "sauvetage" des juifs d'Europe en Ieur permettant de fuir Amérique ou ailleurs, sinon en Palestine. Le héros sioniste David Ben Gourion l'a exprimé très clairement dans une lettre à l'Exécutif sioniste datée du 17 décembre 1938 : « le destin des juifs en Allemgne n’est pas une fin mais un début. D’autres Etats antisémites apprndront d’Hitler. Des millions de juifs sont confrontés à l’annihilation, le problème des réfugiés a pris des proportions planétaires et urgentes. La Grande-Bretagne tente de distinguer la question des réfugiés de celle de la Palestine… Si les juifs ont à choisir entre les réfugiés – sauver les juifs des camps de concentration – et aider un musée national en Palestine, la pitié aura le dessus et toute l’énergie du peuple sera canalisée dans le sauvetage des juifs de différents pays. Le sioniqme sera balayé, pas seulemnt dans l’opinion publuque mondiale, en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, mais aussi dans l’opinion publique juive. Si nous permettons de faire une séparation entre le problème des réfugiés et celui de la Palestine, nous mettons en jeu l’existence du sionisme. » En 1943 qunad l’holocuste battait son plein, Itzhak Greenbaum, directeur de l’agence juive du Comité de secours, écrivait à l’executif sioniste que : « Si on me demande de donner de l’argent de l’Appel juif uni (United Jewish Appeal) pour secourir les juifs ? Je réponds « Non et je rediis non ». A mon avis, nous devons resister à cette vague qui met les activités sionistes au second plan ». De telles attitudes - qui sont parfois arrivées jusqu'à la collaboration ouverte entre le nazisme et le sionisme - démontrent la "convergence" théorique entre le sionisme ct l'antisémitisme puisque tous deux ont en commun l'idée que la haine des juifs, est une vérité éternelle.
[6] [109] Shylock est un personnage dans la pièce de Shakespeare Le marchand de Venise. Il est représenté comme l'archétype du juif usurier, qui prête de l'argent au protagoniste de la pièce en exigeantd de son client "une livre de sa chair" comme garantie.
[7] [110] Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de conspiration autour du 11 septembre ; mais faire porter la faute à la catégorie fictive "Les juifs" ne sert qu'à couvrir la culpabilité d'une catégorie réelle, la bourgeoisie, et en particulier l'appareil d’Etat de la bourgeoisie américaine. Voir notre article sur cette question dans la Revue internationale n°108 : "les Tours jumelles, Pearl Harbour et le machiavelisme de la bourgeoisie".
Questions théoriques:
- Religion [111]
Heritage de la Gauche Communiste:
Notes pour une histoire du mouvement ouvrier au Japon, 2e partie
- 3371 reads
Nous poursuivons ici la publication d’une courte étude sur l’histoire du mouvement révolutionnaire au Japon dont une première partie est parue dans la Revue internationale n°112. Le débat sur les moyens de la lutte
Les événements révolutionnaires de 1905 en Russie provoquèrent comme un tremblement de terre dans tout le mouvement ouvrier. Dès que les conseils ouvriers furent formés, dès que les ouvriers lancèrent les grèves de masse, l’aile gauche de la Social-Démocratie (avec Rosa Luxemburg dans son texte Grève de masses, Parti et syndicats, Trotsky dans son ouvrage sur 1905, Pannekoek dans plusieurs textes, notamment sur le parlementarisme) commença à tirer les leçons de ces luttes. L’insistance sur l’auto-organisation de la classe ouvrière dans les conseils, la critique du parlementarisme qui étaient mises en avant en particulier par Rosa Luxemburg et Pannekoek, n’étaient pas le résultat de lubies anarchistes mais une première tentative pour comprendre les leçons de la nouvelle situation à l’aube de la décadence du mode de production capitaliste et pour essayer d’interpréter les nouvelles formes des luttes.
En dépit de l’isolement international relatif des révolutionnaires au Japon, le débat sur les conditions et les moyens de la lutte qui se déroula aussi parmi eux, reflétait l'effervescence qui existait à l'échelle internationale dans la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires. De façon beaucoup plus claire qu’auparavant, deux tendances s’affrontèrent. D’un côté, la tendance autour de Kotoku qui exprimait de forts glissements anarchistes, puisque toute son insistance tournait autour de "l’action directe" : la grève générale et le syndicalisme révolutionnaire. Kotoku alla aux Etats-Unis en 1905/1906, prit connaissance des positions des IWW syndicalistes et établit des contacts avec les anarchistes russes. Le courant anarcho-syndicaliste publia le journal Hikari (La Lumière) à partir de 1905. De l’autre côté, Katayama défendait inconditionnellement la voie parlementaire au socialisme dans Shinkigen (Les Temps nouveaux). En dépit des divergences entre les deux ailes, elles fusionnèrent en 1906 pour former le Parti socialiste du Japon (Nippon Shakaito) qui, comme le proposait Katayama, devait lutter pour le socialisme "dans les limites de la Constitution". Le Parti Socialiste du Japon exista du 24 juin 1906 au 22 juillet 1907 et publia Hikari jusqu’en décembre1906.[1]
En février 1907, se tint le 1er Congrès du nouveau Parti socialiste au cours duquel plusieurs points de vues s’affrontèrent. Après avoir élu un délégué au Congrès de Stuttgart de la Deuxième Internationale, la discussion commença. Kotoku ne mâcha pas ses mots contre le travail parlementaire et revendiqua des méthodes d'action directe (chokusetsu kodo) : "Ce n’est pas par le suffrage universel et la politique parlementaire, absolument pas, que s’accomplira une vraie révolution ; pour atteindre les objectifs du socialisme, il n’y a pas d’autres moyens que l’action directe des travailleurs unis... Trois millions d’hommes qui se préparent pour les élections, cela ne sert à rien pour la révolution (car cela) ne représente pas trois millions d’hommes conscients et organisés..." Tazoe défendit la lutte sur le terrain strictement parlementaire, la majorité se prononça pour une résolution intermédiaire présentée par T.Sakai. Elle se contentait de retirer des statuts les termes "dans les limite de la Constitution". Dans le même temps, les membres avaient le libre choix de participer à des mouvements pour le droit de vote généralisé ou à des mouvements antimilitaristes et antireligieux. Les positions de Kotoku dégénérèrent vers l'anarchisme et il ne parvint pas à s'approprier la critique qui commençait à être développée par l’aile gauche de la Deuxième Internationale vis-à-vis de l’opportunisme de la Social-Démocratie, contre le parlementarisme et le syndicalisme.
Après ce débat, Kotoku qui se revendiqua de l'anarchisme à partir de 1905, agit de plus en plus comme un obstacle à la construction d’une organisation ; son point de vue empêchait surtout les éléments en recherche d'approfondir leur connaissance et leur compréhension du marxisme. Il voulait proposer la perspective de "l’action directe". Au lieu d'encourager l'approfondissement théorique des positions politiques, contribuant de la sorte à la construction de l’organisation, il était poussé vers un activisme frénétique. Dès que le Congrès fut terminé, le Parti socialiste fut interdit par la police.
Après un renouveau de grèves en 1907, il y eut un autre recul de la lutte de classe entre 1909 et 1910. Pendant ce temps, la police faisait la chasse aux révolutionnaires. Le simple fait d’être muni de drapeaux rouges était déjà considéré comme un délit. En 1910, Kotoku fut arrêté. Beaucoup de socialistes de gauche le furentégalement. En janvier 1911, Kotoku et onze autres socialistes furent condamnés à mort, sous le prétexte d’avoir voulu assassiner l’empereur. La presse socialiste fut interdite de même que les meetings, et les livres socialistes qu'on put trouver dans les librairies et bibliothèques furent brûlés. Confrontés à cette répression, beaucoup de révolutionnaires s’exilèrent ou se retirèrent de toute activité politique. La longue période de "l’hiver japonais" (fuyu) commença. Les révolutionnaires qui ne s’exilèrent pas et les intellectuels utilisèrent dorénavant une maison d’édition - Baishunsha - pour publier leurs textes mais dans des conditions d’illégalité. Afin d’échapper à la censure, les articles étaient écrits de façon ambiguë.
En Europe, la répression et l’imposition des lois anti-socialistes n’avaient pu empêcher la croissance de la Social-Démocratie (Cf. le cas du SPD ou même, avec une répression encore plus sévère, le cas du POSDR en Russie et du SdKPIL, en Pologne et Lituanie). Le mouvement ouvrier au Japon eut beaucoup de mal à se développer dans des conditions de répression et à se renforcer, de même qu’à être en mesure de former des organisations révolutionnaires fonctionnant avec un esprit de parti, c'est à dire dépassant les pratiques de cercles et le rôle prépondérant des individus qui avaient toujours un poids dominant dans le mouvement au Japon. L’anarchisme, le pacifisme et l’humanitarisme avaient toujours une grande influence. Ni au niveau programmatique, ni au niveau organisationnel, le mouvement ne put se hisser à un stade lui permettant de sécréter une aile marxiste significative. En dépit de premiers contacts avec la Deuxième internationale, il restait encore à établir des liens étroits avec elle.
Malgré ces spécificités, on doit cependant reconnaître que la classe ouvrière au Japon s’était intégrée à la classe ouvrière internationale et bien que n'ayant pas une longue expérience de lutte de classe ni les acquis programmatiques et organisationnels du mouvement révolutionnaire en Europe, elle s’affrontait quasiment aux mêmes questions et faisait montre de tendances similaires. En ce sens, l’histoire de la classe ouvrière au Japon s'apparente plus à celle de la classe aux Etats-Unis ou d’autres pays plus périphériques où une aile marxiste n’a pas réussi à s’imposer et où l’anarcho-syndicalisme jouait toujours un rôle majeur.
La classe ouvrière et la Première Guerre mondiale
Bien que le Japon ait déclaré la guerre à l’Allemagne en 1914 afin de s’emparer de ses positions coloniales (en quelques mois, le Japon conquit les avant-postes coloniaux allemands dans l’Océan pacifique et à Tsningtao (Chine), le territoire japonais ne fut jamais touché par les combats. Du fait que le centre de la guerre se situait en Europe, le Japon ne participa directement à celle-ci que lors de sa première phase. Après ses premiers succès militaires contre l’Allemagne, il s’abstint de toute nouvelle activité militaire et, d’une certaine façon, adopta une attitude de neutralité. Tandis que la classe ouvrière en Europe était confrontée à la question de la guerre de façon de plus en plus dramatique, celle du Japon était, elle, confrontée à un "boom" économique résultant de la guerre. En effet, le Japon étant devenu un grand fournisseur d’armes, il y avait une énorme demande de main-d’œuvre. Le nombre d’ouvriers d’usine doubla entre 1914 et 1919. En 1914, quelques 850 000 salariés travaillaient dans 17 000 entreprises, en 1919, 1 820 000 travaillaient dans 44 000 entreprises. Alors que les salariés masculins représentaient jusque là une faible part de la main-d’œuvre, en 1919, ils en représentaient 50%. A la fin de la guerre, il existait 450 000 mineurs. Ainsi la bourgeoisie japonaise tira de grands bénéfices de la guerre. Grâce aux débouchés gigantesques du secteur de l’armement pendant la guerre, le Japon put évoluer d’une société principalement dominée par le secteur agricole vers une société industrielle. La croissance de la production entre 1914 et 1919 fut de 78%.
De même, du fait de cette implication limitée dans la guerre du Japon, la classe ouvrière japonaise n’a pas eu à faire face à la même situation que celle d'Europe. La bourgeoisie n’eut pas à mobiliser en masse et à militariser la société comme cela fut le cas pour les puissances européennes. Cela permit aux syndicats japonais d'éviter d'avoir à créer une "union sacrée" avec le capital, comme ce fut le cas en Europe et d’être démasqués comme étant des piliers de l’ordre capitaliste. Tandis que les ouvriers en Europe étaient confrontés à la fois à la sous-alimentation et aux gigantesques massacres impérialistes causant 20 millions de morts, à la guerre de tranchées et à un terrible carnage dans les rangs de la classe ouvrière, tout cela fut épargné aux ouvriers japonais. C’est la raison pour laquelle il manqua au Japon cette impulsion constituée par la lutte contre la guerre qui radicalise le combat ouvrier, comme ce fut le cas en Europe, en Allemagne et en Russie plus particulièrement. Il n’y eut aucune fraternisation comme cela se produisit entre les soldats russes et allemands.
Un tel contraste dans la situation de différents secteurs du prolétariat mondial durant la Première guerre mondiale constitue une expression du fait que, contrairement à ce que les révolutionnaires pensaient à cette époque, les conditions de la guerre impérialiste ne sont pas les plus favorables pour le développement et la généralisation de la révolution mondiale
Les révolutionnaires en Europe qui mirent en avant une position internationaliste et des perspectives internationales peu après le début de la guerre et qui se rencontrèrent pendant l’été 1915 à Zimmerwald et plus tard à Kienthal, pouvaient se référer à la tradition révolutionnaire de la période d’avant la Première Guerre mondiale (la position des marxistes du 19e siècle, les résolutions de la Deuxième internationale aux Congrès de Stuttgart et de Bâle). A l'inverse, les socialistes du Japon devaient payer le prix de l’isolement et leur résistance internationaliste ne pouvait s’appuyer sur une tradition profonde, solidement ancrée sur le marxisme. Tout comme en 1904/1905, ce sont principalement les voix pacifistes et humanitaires contre la guerre qui se firent entendre. En effet, les révolutionnaires au Japon n'étaient pas en mesure de reprendre la perspective popularisée par l’avant-garde révolutionnaire à Zimmerwald s'appuyant sur l'analyse du fait que la Seconde internationale était morte, qu’une nouvelle Internationale devait être formée et que la guerre ne pouvait être stoppée qu’en transformant la guerre impérialiste en guerre civile.
Néanmoins, les révolutionnaires au Japon, qui étaient peu nombreux, surent prendre conscience de la responsabilité qui leur incombait. Ils firent entendre leur voix internationaliste dans les journaux qui étaient interdits,[2] ils se réunissaient secrètement et ils firent de leur mieux, malgré leurs forces limitées, pour diffuser les positions internationalistes. Si Lénine et les activités des Bolcheviks étaient à peine connus, par contre la position internationaliste des Spartakistes allemands et le combat courageux de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg reçurent beaucoup d’attention.[3]
Emeutes de la faim en août 1918
Même si le Japon avait connu un certain "boom" économique pendant et grâce à la guerre, l'entrée dans la période de décadence en 1914 était fondamentalement un phénomène à l'échelle mondiale avec des répercussions dans tous les pays, y compris ceux qui avaient été épargnés par les ravages de la Première guerre mondiale. Le capital japonais ne pouvait pas rester à l'écart de la crise permanente de surproduction, résultant de la saturation relative du marché mondial. De même, la classe ouvrière au Japon allait devoir confronter le même changement des conditions et des perspectives qui s'imposaient au prolétariat à l'échelle internationale.
Bien que les salaires aient augmenté dans tous les secteurs industriels de 20 à 30 %, à cause d'une pénurie de main d'œuvre, les prix grimpèrent entre 1914 et 1919 de 100%. Les salaires réels chutèrent globalement d’une base de 100 en 1914 à 61 en 1918. Ces augmentations des prix très importantes obligèrent la classe ouvrière à mener une série de luttes défensives.
Entre 1917 et 1918, le prix du riz doubla. Durant l’été 1918, les ouvriers commencèrent à manifester contre cette augmentation. Nous n’avons pas d’informations sur des grèves dans les usines ni sur l’extension de revendications à d’autres domaines. Apparemment des milliers d’ouvriers descendirent dans la rue. Cependant, ces manifestations ne débouchèrent pas sur une forme organisée plus marquée, ni sur aucune revendication ou objectif spécifiques. Des magasins semblent avoir été pillés. En particulier, les ouvriers agricoles et la main d’œuvre récemment prolétarisée, de même que les Burakumin (les exclus sociaux) semblent avoir joué un rôle très actif dans ces pillages. Beaucoup des maisons et d’entreprises furent mises à sac. Il semble n’y avoir eu aucune unification entre des revendications économiques et des revendications politiques. Contrairement au développement des luttes en Europe, il n’y eut aucune assemblée générale ni aucun conseil ouvrier. Après la répression du mouvement, quelques 8 000 ouvriers furent arrêtés. Plus de 100 personnes furent tuées. Le gouvernement démissionna pour des raisons tactiques. La classe ouvrière s’était soulevée spontanément mais, en même temps, le manque de maturation politique en son sein était d’une évidence dramatique.
Bien que les luttes ouvrières puissent surgir spontanément, le mouvement ne peut développer sa pleine force que s’il peut s’appuyer sur une maturation politique et organisationnelle. Sans cette maturation plus profonde, un mouvement s’effondre rapidement. Ce fut le cas au Japon : ces mouvements s’effondrèrent aussi vite qu’ils avaient surgi. Il ne semble pas non plus y avoir eu d’intervention organisée de la part d’une organisation politique. Sans l’activité obstinée des Bolcheviks et des Spartakistes, les mouvements en Russie et en Allemagne auraient capoté très vite. Au Japon, une telle intervention organisée a fait défaut de façon irrémédiable. Mais, malgré la différence des conditions en Europe et au Japon, la classe ouvrière dans ce pays allait faire un grand pas en avant.
L’écho de la Révolution russe au Japon
Lorsque, en février 1917, la classe ouvrière en Russie amorça le processus révolutionnaire et, en octobre, prit le pouvoir, ce premier soulèvement prolétarien réussi trouva également un écho au Japon. La bourgeoisie japonaise comprit immédiatement le danger que représentait la révolution en Russie. Dès avril 1918, elle fut une des premières à participer de la façon la plus déterminée à la mise sur pied d’une armée contre-révolutionnaire. Le Japon fut le dernier pays à retirer ses troupes de Sibérie en novembre 1922.
Mais alors que la nouvelle de la Révolution russe se propageait très vite de Russie vers l’Ouest, que le développement révolutionnaire en Russie avait un grand impact - en particulier en Allemagne - et menait à la déstabilisation des armées d’Europe centrale, cet écho fut très limité au Japon. Non seulement les facteurs géographiques contribuèrent à cet état de fait (plusieurs milliers de kilomètres séparaient le Japon du centre de la révolution, Pétrograd et Moscou) mais, surtout, la classe ouvrière au Japon avait été moins radicalisée pendant la guerre. Cependant, elle devait prendre part, à travers ses éléments les plus avancés, à la vague révolutionnaire de luttes internationales qui se déroula entre 1917 et 1923.
La réaction des révolutionnaires
Au début, les nouvelles de la Révolution russe se propagèrent très lentement et par fragments au Japon. Les premiers articles sur cet événement n’apparurent dans la presse socialiste qu’en mai et juin 1917. Sakai envoya un message de félicitations dans des conditions d’illégalité, message qui fut imprimé par Katayama aux Etats-Unis dans le journal des ouvriers immigrés Heimin (Commoners), dans le journal des IWW, Internationalist Socialist Review et, également; dans des journaux russes. Au Japon, Takabatake fut le premier à faire un compte rendu du rôle des soviets dans Baibunsha, mettant l’accent sur le rôle décisif des révolutionnaires. Cependant, le rôle que jouèrent les différents partis pendant la révolution n’était pas encore connu.
Le niveau d’ignorance sur les événements en Russie et sur le rôle des Bolcheviks peut être perçu à travers les premières déclarations des révolutionnaires les plus en vue. Ainsi, Arahata écrivait en février 1917 : "Aucun d’entre nous ne connaissait les noms de Kerensky, Lénine et Trotsky". Et pendant l’été 1917, Sakai parlait de Lénine comme d’un anarchiste et même encore en avril 1920, il affirmait que "le bolchevisme est en quelque sorte similaire au syndicalisme". Même l’anarchiste Osogui Sakae écrivait en 1918 que "la tactique bolchevique était celle de l’anarchisme."
Enthousiasmés par ce qui se passait en Russie, Takabatake et Yakamawa écrivirent un Manifeste (ketsugibun) en mai 1917 à Tokyo qu’ils envoyèrent au POSDR. Cependant, à cause du chaos dans les transports, il n’arriva jamais aux révolutionnaires de Russie. Comme il n’y avait pratiquement pas de contacts directs entre le milieu de révolutionnaires en exil (la plupart des éléments révolutionnaires émigrés à l’étranger vivaient, comme Katayama, aux Etats-Unis) et le centre de la révolution, le Manifeste ne fut publié que deux ans plus tard, au Congrès de fondation de l’Internationale communiste en mars 1919.
Ce message des socialistes japonais affirmait : "Depuis le début de la Révolution russe, nous avons suivi vos actions courageuses avec enthousiasme et une profonde admiration. Votre travail a eu une grande influence sur la conscience de notre peuple. Aujourd’hui, nous sommes indignés que notre gouvernement ait envoyé des troupes en Sibérie sous toutes sortes de prétextes. Cela est, sans aucun doute, un obstacle au libre développement de votre révolution. Nous regrettons profondément d’être aussi faibles pour contrer le péril qui vous menace à cause de notre gouvernement impérialiste. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit du fait de la persécution du gouvernement qui nous accable. Cependant, vous pouvez être assurés que le drapeau rouge flottera bientôt sur tout le Japon dans le proche avenir.
Parallèlement à cette lettre, nous vous joignons une copie de la résolution approuvée à notre réunion du 1e mai 1917.
Salutations révolutionnaires, le Comité Exécutif des Groupes Socialistes de Tokyo et Yokohama".
Résolution des socialistes japonais :
"Nous, socialistes du Japon, réunis à Tokyo le 1e mai 1917, exprimons notre profonde sympathie pour la Révolution russe que nous suivons avec admiration. Nous reconnaissons que la Révolution russe est à la fois une révolution politique de la bourgeoisie contre l’absolutisme médiéval et une révolution du prolétariat contre le capitalisme contemporain. Transformer la Révolution russe en une révolution mondiale n’est pas l’affaire des seuls socialistes russes ; c’est la responsabilité des socialistes du monde entier.
Le système capitaliste a d’ores et déjà atteint son stade de développement le plus élevé dans tous les pays et nous sommes entrés dans l’époque de l’impérialisme capitaliste pleinement développé. Afin de ne pas être trompés par les idéologues de l’impérialisme, les socialistes de tous les pays doivent défendre inébranlablement les positions de l’Internationale et toutes les forces du prolétariat international doivent être dirigées contre notre ennemi commun, le capitalisme mondial. C’est seulement ainsi que le prolétariat sera en mesure de remplir sa mission historique.
Les socialistes de Russie et de tous les autres pays doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la guerre et soutenir le prolétariat des pays en guerre pour retourner leurs armes, aujourd’hui dirigées vers leurs frères de l’autre côté des tranchées, contre les classes dominantes de leur propre pays.
Nous avons confiance dans le courage des socialistes russes et de nos camarades du monde entier. Nous sommes fermement convaincus que l’esprit révolutionnaire se propagera et imprégnera tous les pays.
Le Comité Exécutif du Groupe socialiste de Tokyo." (publié dans "Premier Congrès de l’Internationale communiste", mars 1919)
Résolution du 5 mai 1917 des socialistes de Tokyo-Yokohamma
"En même temps que la Révolution russe est, pour une part, une révolution politique effectuée par la classe montante commerciale et industrielle contre la politique du despotisme médiéval, elle est également, pour une autre part, une révolution sociale menée par la classe des gens du peuple (heimin) contre le capitalisme.
C’est pourquoi, en l’occurrence, il est de la responsabilité de la Révolution russe - et au même moment, de tous les socialistes du monde entier - d’exiger résolument la fin immédiate de la guerre. La classe des gens du peuple (zheimin) de tous les pays en guerre doit être rassemblée et sa puissance de lutte réorientée de sorte à être dirigée contre la classe dominante de son propre pays. Nous avons confiance dans la lutte héroïque du Parti socialiste russe et dans les camarades de tous les pays et nous attendons avec impatience le succès de la révolution socialiste".
Ces mêmes socialistes de Tokyo envoyèrent un télégramme à Lénine et une copie à l’USPD et au SPD d’Allemagne.
"Le moment de la réorganisation sociale du monde, quand notre mouvement sera reconstitué et quand, avec les camarades de tous les pays, nous travaillerons ensemble du mieux que nous pourrons, ce moment n’est probablement pas très éloigné. Nous espérons que dans cette phase critique de trêve et dans ces moments importants, nous pourrons vous contacter. En ce qui concerne la fondation d’une Internationale des socialistes qui est prévue prochainement, si nous le pouvons, nous vous enverrons une délégation et nous sommes en train de nous y préparer. Espérant la reconnaissance de notre organisation (Baibunsha), votre soutien et beaucoup de conseils...les représentants des socialistes de Tokyo vous saluent."
Ce message montre les orientations internationalistes, les efforts vers le regroupement et le soutien à la fondation d’une nouvelle Internationale. Cependant, il est difficile de dire quelles furent les préparations précises entreprises par Baibunsha à cette époque. Tandis que ce message fut intercepté par la police secrète et ne fut probablement jamais reçu par les Bolcheviks, le SPD et l’USPD le gardèrent secret et ne le publièrent jamais.
Comme en témoignent ces déclarations, la révolution agit comme une étincelle puissante sur les révolutionnaires. En même temps, l’impact de la révolution sur l’ensemble de la classe ouvrière du pays fut certainement plus faible. Contrairement à beaucoup de pays à l’ouest de la Russie (la Finlande, l’Autriche, la Hongrie, l’Allemagne etc..) où la nouvelle du renversement du Tsar et de la prise du pouvoir par les Conseils ouvriers avait provoqué un enthousiasme énorme et une vague de solidarité irrépressible, entraînant l’intensification des luttes des ouvriers "dans leur propres pays", il n’y eut pas de réaction directe parmi les masses ouvrières du Japon. A la fin de la Première Guerre mondiale, la combativité était en augmentation - cependant pas parce que la révolution avait débuté en Russie. La raison résidait plus dans un contexte économique : le boom des exportations pendant la guerre s’était rapidement tari après l'arrêt de celle-ci. La colère des ouvriers était dirigée contre l’augmentation des prix et une vague de licenciements. En 1919, 2 400 "conflits du travail", impliquant quelques 350 000 ouvriers, furent dénombrés, avec un léger déclin du mouvement en 1920, avec 1000 conflits impliquant 130 000 ouvriers. Ce mouvement subit un recul après 1920. Les luttes ouvrières restèrent plus ou moins cantonnées au terrain économique, il n’y eut pratiquement pas de revendications politiques. C’est la raison pour laquelle il n’y eut aucun conseil ouvrier, contrairement à l’Europe, ou même aux Etats-Unis et à l’Argentine où la Révolution russe avait inspiré les ouvriers de la Côte Ouest et de Buenos Aires en radicalisant leur mouvement.
Entre 1919 et 1920, quelques 150 syndicats furent créés et tous agirent comme un obstacle à la radicalisation des ouvriers. Les syndicats ont été le fer de lance et l’arme la plus pernicieuse de la classe dominante pour contrer la combativité montante. C’est ainsi qu’en 1920, la Labour Union League, Rodo Kumiai Domei, la Fédération nationale des syndicats, fut créée. Jusqu’alors, le mouvement syndical était divisé en plus de 100 syndicats.
Au même moment, un large "mouvement de la démocratie" fut lancé avec le soutien de la bourgeoisie en 1919, mettant en avant la revendication du droit de vote généralisé et une réforme électorale. Comme dans d’autres pays européens, le parlementarisme servit de bouclier contre les luttes révolutionnaires. Ce sont surtout les étudiants japonais qui furent les principaux protagonistes de cette revendication.
Le débat sur les nouvelles méthodes de lutte
Sous l’impulsion de la Révolution russe et de la vague de luttes internationale, un processus de réflexion se produisit également parmi les révolutionnaires au Japon. Inévitablement, ce processus de réflexion fut marqué par des contradictions. D’un côté les anarcho-syndicalistes (ou ceux qui se déclaraient tels) apportèrent leur adhésion aux positions des Bolcheviks puisqu’ils étaient les seuls qui avaient accompli avec succès une révolution visant à la destruction de l’Etat. Ce courant maintenait que la politique des Bolcheviks prouvait le bien fondé de leur rejet d’une orientation purement parlementaire (Gikau-sei-saku contre Chokusetsu-kodo line)
Lors de ce débat de Février 1918, Takabatake défendit l'idée que la question des luttes économiques et politiques était très complexe. La lutte pouvait inclure les deux dimensions - l’action directe et la lutte parlementaire. Le parlementarisme et le syndicalisme n’étaient pas les seuls éléments composant le mouvement socialiste. Takabatake s’opposa aussi bien au rejet par l’anarcho-syndicalisme de la "lutte économique" qu’à l’attitude individualiste d’Osugi. Alors que Takabatake, de façon très confuse, mettait sur le même plan "l’action directe" et le mouvement de masse, son texte faisait partie d’un processus général de clarification des moyens de la lutte à l’époque. Yamakawa soulignait que l’identification d’un mouvement politique avec le parlementarisme n’était pas valable. De plus il déclara : "je pense que le syndicalisme a dégénéré à cause de raisons que je ne comprends pas suffisamment."
Malgré l’expérience limitée et le niveau de clarification théorético-programmatique également limité de ces questions, il est important de reconnaître que ces voix au Japon étaient en train de remettre en cause les vieilles méthodes syndicales et la lutte parlementaire et qu’elles étaient à la recherche de réponses à la nouvelle situation. Cela démontre que la classe ouvrière était confrontée aux mêmes questions et que les révolutionnaires au Japon étaient aussi englobés dans le même processus, tentant de se confronter à la nouvelle situation.
Au Congrès de fondation du KPD allemand, les leçons de la nouvelle époque par rapport à la question syndicale et parlementaire commencèrent à être tirées bien que de manière tâtonnante. La discussion sur les conditions de la lutte dans la nouvelle époque était d’une importance historique mondiale. De telles questions ne pouvaient être clarifiées qu'à la condition qu'existent une organisation et un cadre de discussion. Isolé internationalement, sans organisation, le milieu révolutionnaire japonais ne pouvait qu'éprouver de grandes difficultés pour pousser plus avant la clarification. C’est pourquoi, il est d’autant plus important d’être conscient de ces efforts pendant cette phase de mise en cause des anciennes méthodes syndicales et parlementaires sans tomber dans le piège de l’anarchisme.
Les tentatives de clarification et de construction d’une organisation
La Révolution en Russie, les nouvelles conditions historiques de la décadence du capitalisme, le déploiement de la vague de luttes internationales mirent au défi les révolutionnaires au Japon. Il est évident que la clarification et la recherche de réponses à ces questions ne pouvaient avancer que s’il y avait un pôle de référence marxiste. La formation d’un tel pôle se heurta à de gros obstacles parce que sa pré-condition résidait dans une claire décantation entre une aile anarchiste, hostile à toute organisation révolutionnaire et une aile qui affirmait la nécessité d’une organisation révolutionnaire mais qui, cependant, était encore incapable d’entreprendre sa construction de façon déterminée.
Le milieu politique au Japon mit longtemps à se porter à la hauteur de la tâche du moment car il était entravé dans ses avancées par une tendance à se focaliser sur le pays lui-même. Il était également marqué par la prédominance de l'esprit de cercle et de personnalités en vue qui ne s'étaient approchées du marxisme que tout récemment et qui n'étaient que faiblement déterminées à construire une organisation de combat du prolétariat.
Ainsi, parmi les personnalités les plus connues (Yamakawa, Arahata et Sakai), Yamakawa était encore convaincu en 1918 qu’il devait écrire une "critique du marxisme". Cependant, lors de l’édition de mai de la New Society, Sakai, Arahata et Yamakawa affirmèrent leur soutien au Bolchevisme. En février 1920, ils firent un compte rendu de la fondation de l'Internationale communiste dans leur journal, la New Social Review (Shin Shakai Hyoron) - qui, en septembre 1920, changea son nom en Shakaishugi - Socialisme. Au même moment, ces révolutionnaires étaient très actifs dans les cercles d’études tels que la Friday Society (Shakai shugi kenkyu - Etudes socialiste) et la Wednesday Society (Shakai mondai kenkyu - études des problèmes sociaux). Leurs activités étaient moins orientées vers la construction de l’organisation que vers la publication de journaux qui furent pour la plupart éphémères et qui n’étaient pas structurellement rattachés à une organisation. Avec cet arrière-plan de confusions et d’hésitations sur la question organisationnelle chez les révolutionnaires au Japon, l'Internationale communiste elle-même allait jouer un rôle important dans les tentatives de construction d’une organisation.
(A suivre)
DA
1) En tout, 194 membres furent déclarés ; parmi eux, 18 commerçants, 11 artisans, 8 paysans, 7 journalistes, 5 employés de bureau, 5 docteurs, 1 officier de l’Armée du salut. Il y avait peu d’ouvriers. Les femmes n’étaient pas admises puisque l’interdiction pour elles de s’organiser était encore en vigueur. De plus, la majorité des membres avait moins de 40 ans. En janvier 1907, le quotidien Nikkan Heimin Shibun fut créé. Il réussit à se vendre en dehors de la région. Il fut d’abord diffusé à 30 000 exemplaires. Contrairement à Hikari qui servait d'organe central, il n’était pas considéré comme l’organe du Parti. En avril 1907, il cessa de paraître. Alors que de premières tentatives de présenter l’histoire de la Deuxième internationale dans le journal théorique furent entreprises, journal qui diffusait à quelques 2 000 exemplaires, le journal lui-même devint rapidement le porte-parole de l’anarchisme. A la différence des grands pays industriels européens, où le poids de l’anarcho-syndicalisme allait en décroissant avec le développement de l’industrialisation et de l’organisation des ouvriers dans la social-démocratie, l’influence de l’anarchisme était dans une dynamique ascendante au Japon de même qu’aux Etats-Unis.
2) Arahata et Ogusi publièrent, d’octobre 1914 jusqu'à mars 1915, le mensuel Heimin Shinbun ; d’octobre 1915 à janvier 1916, Kindai shiso, qui étaient des voix internationalistes.
3) Dans le journal Shinshakai, une page spéciale intitulée Bankoku jiji (Notes Internationales) était dédiée à la situation internationale. Même si le nombre d’exemplaires restait faible, beaucoup de nouvelles sur la trahison du SPD et les activités des internationalistes étaient données. La publication était imprimée avec des photos de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht en tant que représentants les plus prestigieux de l’internationalisme en Allemagne. Par exemple, les articles étaient intitulés : "Clara Zetkin arrêtée - La situation dans le Parti Socialiste français après l’assassinat de Jaurès - L’attitude de Kautsky et de Liebknecht au Reichstag par rapport au 4 août 1914 sur les crédits de guerre - La division du SPD - L’attitude du va-t-en-guerre Scheidemann et le neutre Kautsky - Les grèves et les soulèvements en Italie pendant la guerre - La libération de prison de Rosa Luxemburg - Sur la situation des prisonniers en Russie - Explications sur le Manifeste de Zimmerwald - Liebknecht arrêté - La 2e Conférence Internationale des Partis Socialistes à Kienthal et l’opportunité pour la Gauche de fonder une nouvelle Internationale - La minorité anti-guerre social-démocrate arrêtée à cause de sa propagande du "Manifeste de Zimmerwald" - La situation à la Conférence de Parti du SPD - La menace de grèves des cheminots américains."
Géographique:
- Japon [50]
Revue Internationale no 115 - 4e trimestre 2003
- 3800 reads
Le prolétariat face à l'aggravation dramatique de toutes les contradictions du capitalisme
- 2587 reads
La canicule de l'été 2003 a tragiquement révélé à la face du monde comment, en Europe aussi, le développement de la pauvreté et de la précarité exposaient les populations aux ravages de catastrophes dites naturelles inconnues jusqu'à récemment dans ces régions. En effet, dans de nombreux pays européens, le taux de mortalité a fait un bond en ce mois d'août, avec un record pour la France où près de 15 000 décès sont directement imputables à la vague de chaleur. Les victimes se comptent en majorité parmi les personnes âgées, mais aussi les handicapés, les SDF morts de soif dans les rues, c'est-à-dire parmi ceux que le capitalisme condamne à une marginalisation et à une misère toujours plus grandes. Pour la bourgeoisie, il s'agit de bouches improductives, devenues inutiles à ses yeux, et qui constituent un fardeau toujours trop lourd pour elle, si bien qu'elle cherche en permanence à rogner sur les dépenses affectées à leur entretien. Loin de constituer un accident de l'histoire, un tel drame illustre crûment la situation que nous façonne le capitalisme puisque, aussi bien la dégradation des conditions de vie de la classe ouvrière que les dérèglements climatiques ne peuvent qu'empirer. Encore ne s'agit-il ici que d'une partie du paysage social qu'envahissent toutes les manifestations de la putréfaction du monde capitaliste transformant la vie sur terre en un enfer pour le plus grand nombre : violence, délinquance, drogue, regain du mysticisme, de l'irrationalité, de l'intolérance, du nationalisme. En dehors des deux conflits mondiaux du 20e siècle, la guerre elle-même n'a jamais été aussi omniprésente sur le globe. L'intensification des tensions entre grandes puissances qui, depuis deux ans, ne peuvent même plus être dissimulées, se trouve être le principal facteur d'un chaos mondial qui ne pourra que devenir de plus en plus sanglant.
Toutes les calamités qui accablent aujourd'hui l'humanité expriment la faillite du système qui régit la vie de la société, le système capitaliste. Mais la simultanéité croissante avec laquelle leurs manifestations se conjuguent sont à l'image de la rapidité avec laquelle le capitalisme, dans la phase ultime de sa décadence, celle de sa décomposition, entraîne l'humanité vers sa destruction.
La crise économique au coeur des contradictions du capitalisme
Pour entraver la prise de conscience de la faillite de son système, la bourgeoisie livre à une publicité abrutissante et décervelante tout ce qui constitue des expressions patentes de cette faillite. Ainsi, elle banalise toutes les calamités qui accablent la société, elle habitue les populations à accepter l'inacceptable, poussant chacun, face à des images souvent insoutenables servies par les actualités télévisées aux heures des repas, à se détourner du problème. Le drame de l'été a donné lieu, en France, à de multiples "expressions d'opinion" à travers les médias, souvent très critiques à l'encontre du gouvernement, mais toutes plus partielles ou fausses les unes que les autres, afin d'empêcher que ne se dévoile le fond du problème. Celui-ci réside dans le fait que, depuis les années 1980, la bourgeoisie de tous les pays industrialisés, de gauche comme de droite, prise à la gorge par la crise économique et contrainte de maintenir la compétitivité du capital national sur l'arène mondiale, s'est employée à effectuer, à un rythme de plus en plus soutenu, des coupes sombres dans tous les budgets sociaux, de santé en particulier. Il en a résulté un appauvrissement et une précarisation générale dont l'ampleur a été révélée brutalement par la vague de chaleur de l'été. De la même manière mais à une tout autre échelle, l'épidémie de grippe espagnole après la Première Guerre mondiale avait révélé, en fauchant plus de 20 millions de vies humaines, la profondeur d'un mal social constitué par des conditions épouvantables d'insalubrité et l'affaiblissement extrême des populations suite aux ravages de la guerre. Ainsi ces morts sont, elles aussi, imputables à la folie meurtrière du capital, au même titre que les 10 millions de tués sur les champs de bataille.
Dans ses discours, la bourgeoisie présente les calamités qui accablent l'humanité comme étant sans lien entre elles et surtout sans rapport avec le système qui régit la vie des hommes sur la planète, le capitalisme. Pour la classe dominante et les défenseurs de son système, les événements historiques sont soit le fruit du pur hasard, soit l'expression de la volonté divine, soit le simple résultat des passions ou des pensées des hommes, voire de la "nature humaine".
Pour le marxisme, c'est au contraire l'économie qui, en dernière instance, détermine les autres sphères de la société : les rapports juridiques, les formes de gouvernement, les modes de pensée. C'est cette vision matérialiste que vérifie avec éclat la situation du capitalisme depuis son entrée en décadence au début du 20e siècle sous l'effet de contradictions économiques insurmontables. Depuis cette époque et en dehors des périodes de reconstruction ayant succédé aux deux guerres mondiales, il vit en situation de crise permanente. Pendant la période de décadence du capitalisme, la guerre et le militarisme expriment, avant tout, la fuite en avant des différents pays face à l'impasse économique dans un marché mondial saturé. Ils sont devenus le mode de vie permanent du capitalisme comme en attestent les deux guerres mondiales et la chaîne ininterrompue des conflits locaux, de plus en plus destructeurs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces deux conflits mondiaux ainsi que la phase actuelle de décomposition de la société illustrent à quel point ce système devenu caduc menace l'existence même de l'humanité. Dans sa fuite en avant, le capitalisme imprime sa marque à toutes les sphères de l'activité humaine, y inclus ses rapports avec la nature. C'est ainsi que, pour maintenir ses profits, il se livre massivement, depuis plus d'un siècle, au saccage et au pillage à grande échelle de l'environnement. Si bien qu'aujourd'hui, sous l'effet de l'accumulation de pollutions de tous ordres, le désastre écologique constitue une menace tangible pour l'écosystème de la planète lui-même. Le capitalisme étant par nature un système concurrentiel qui met en compétition au plus haut niveau les différentes nations, l'approfondissement de la crise économique signifie donc aussi l'intensification de la guerre économique entre celles-ci. Après la disparition des blocs impérialistes constitués depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le maintien d'une coordination des politiques économiques entre les différents Etats, pour encadrer la guerre commerciale, a permis d'éviter une détérioration plus importante du système des relations économiques internationales, des échanges en particulier. En agissant de la sorte, les fractions de la bourgeoisie mondiale des pays les plus développés avaient conscience de devoir éviter la répétition du scénario des années 1930. En effet, pour essayer de se protéger face à la dépression, la bourgeoisie avait alors réagi en élevant des barrières douanières qui eurent pour conséquence de réduire massivement le commerce mondial et d'aggraver la crise. Tout au long des années 1990, les décisions de l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) ont éliminé des barrières douanières et des mesures protectionnistes, mais essentiellement celles des pays les plus faibles au bénéfice des pays les plus forts. Lorsque des accords sont conclus entre les membres de cette organisation, ils viennent sanctifier un rapport de forces entre eux et, sur cette base, définissent les règles pour la poursuite de la guerre économique. Qu'un tel accord ne puisse être obtenu, comme cela vient d'arriver à la conférence ministérielle de Cancun (10 au 14 septembre), cela ne change strictement rien aux relations ni au rapport de forces entre les pays les plus riches et les autres, contrairement à ce qu'en dit la propagande mensongère des alter-mondialistes. En effet, cette dernière présente comme une victoire remportée par les pays du Tiers-Monde le fait qu'aucun accord ne soit sorti de Cancun (1). Ce type d'argument rejoint parfaitement la mystification tiers-mondiste selon laquelle l'issue aux problèmes tragiques que pose l'agonie du capitalisme ne réside pas dans le renversement de ce système mais dans la lutte entre le Nord, les pays développés, et le Sud, les pays sous-développés. Au moment où cette propagande nauséabonde est à nouveau développée, il faut se souvenir que c'est elle qui, dans les années 1960 à 80, a servi de justification à l'enrôlement de masses paysannes dans les conflits et guérillas, en général pour le compte du bloc russe, tout aussi impérialiste que le bloc adverse américain. Un tel positionnement ne doit pas nous étonner de la part du courant altermondialiste. Depuis quelques années, son slogan, "un autre monde est possible" et ses thèses dénonçant le libéralisme et soutenant la nécessité d'un Etat plus fort se sont trouvés propulsés sur le devant de la scène, grâce aux bons offices de la bourgeoisie, afin de faire obstacle au développement de la prise de conscience par le prolétariat de la faillite du capitalisme. Ce prétendu "autre monde" n'a rien de neuf ni de social, c'est celui dans lequel nous vivons actuellement où l'Etat, quoi qu'en en dise, est et restera le pilier de la défense des intérêts de la bourgeoisie et du capitalisme.
L'Etat, fer de lance des attaques
Si la bourgeoisie ne peut pas nier ce qui constitue une évidence criante, à savoir que la crise économique constitue le fondement des attaques contre la classe ouvrière, elle essaie cependant de brouiller cette réalité en incriminant le "manque de civisme de certains patrons immoraux", la "mauvaise gestion" de certains autres... bref, en faisant tout pour que la vraie question, une fois de plus, ne soit pas posée, à savoir l'inéluctabilité de la crise économique en tant qu'expression des contradictions insurmontables du capitalisme. Néanmoins, lorsque c'est l'Etat lui-même, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, qui est amené à assumer, au nom de toute la bourgeoisie, des attaques profondes, massives et générales comme celle sur les retraites, cela ne peut signifier qu'une chose : le capitalisme est de moins en moins capable d'assurer les nécessités vitales d'entretien de la classe qu'il exploite. Dans notre précédent numéro de la Revue internationale, nous mettions en évidence comment l'Etat dans différents pays avait pris en charge une telle politique d'attaque contre les retraites (France, Autriche, Brésil) et contre la sécurité sociale ou l'indemnisation du chômage (Allemagne, Hollande, Pologne). A présent c'est le gouvernement italien qui prévoit à son tour de s'engager dans une réforme du système des retraites, accusé pour l'occasion d'être "parmi les plus coûteux de l'Union européenne". Depuis le printemps, les réductions d'effectifs dans la fonction publique et les plans de licenciements sur tous les continents, dans tous les pays, dans tous les secteurs n'ont pas cessé. Pour l'illustrer nous pouvons citer les plus récents : - En cinq ans Philips a déjà fermé ou vendu 120 sites de production dans le monde et supprimé 50 000 emplois depuis mai 2001. Il va fermer ou vendre 50 de ses 150 sites sur lesquels se répartissent 170 000 personnes ; - Schneider Electric, qui emploie 75 000 salariés dans 130 pays va supprimer 1000 emplois en France ; - ST Microélectronics annonce la fermeture de son site de Rennes en France qui compte 600 salariés ; - 10% des employés de Cadence Design System (Californie), soit 500 personnes, sont licenciés ; - Volkswagen annonce un plan de 3 933 licenciements à Sao Bernardo do Campo (Etat de Sao Paulo, Brésil). Face aux risques de mobilisation ouvrière, le président de la firme menace de licencier sur le champ quiconque se mettra en grève ; - Matra automobiles ferme une usine en France en licenciant près de mille employés ; - Giat Industries (armement en France) annonce un plan de 3750 licenciements d'ici 2006 ; - L'entreprise manufacturière de tabac Altadis supprime près de 1700 emplois en Espagne et en France ; - La société métallurgique Eramet supprime 2000 emplois en Europe.
Face à la contraction du marché mondial, artificiellement entretenu par une montagne de dettes, les entreprises publiques ou privées se débarrassent d'une partie de leur main d'oeuvre pour maintenir leur compétitivité sur l'arène internationale. C'est l'Etat qui, en dernière instance, approuve les modalités des plans de licenciements et, dans le même temps, prend les dispositions permettant que ces dégraissages n'occasionnent pas par ailleurs de dépenses supplémentaires pour l'Etat lui-même. Ainsi, partout, des mesures sont prises pour revoir à la baisse les conditions d'indemnisation du chômage. Après les mesures prises au printemps dernier par l'Etat allemand, c'est au tour de l'Etat français de radier par milliers des ouvriers des listes du chômage, en application d'une loi adoptée quelques mois auparavant. Afin d'éviter que l'aggravation de la crise et des attaques ne favorise au sein de la classe ouvrière une remise en cause en profondeur du système, la fonction des fractions de gauche et d'extrême-gauche de la bourgeoisie est d'intoxiquer la conscience des prolétaires en proclamant que des solutions sont possibles au sein du système, notamment en redonnant à l'Etat le rôle plus central que le libéralisme lui aurait confisqué. Mais, comme on vient de le voir, c'est l'Etat lui-même, avec à sa tête des gouvernements de gauche comme de droite qui orchestre les attaques les plus massives depuis la fin des années soixante. Contrairement à la thèse d'une diminution du rôle de l'Etat dans la vie de la société et quelles que soient les apparences, celui-ci occupe une place de plus en plus prépondérante, au service de la défense des intérêts du capital national, comme l'illustrent sur un autre plan les exemples suivants : - en 1998, l'Etat japonais volait au secours d'institutions bancaires pour leur éviter la faillite ; - le 23 septembre de la même année, la Réserve fédérale américaine faisait de même en organisant le sauvetage du fonds d'arbitrage "Long Term Capital Management", au bord du dépôt de bilan ; - aujourd'hui, en France, l'Etat français n'agit pas différemment lorsqu'il se porte au secours d'Alstom (fabrication de TGV) pour le sauver. Dans tous les cas, ce sont des mesures de capitalisme d'Etat qui sont prises dans le but de maintenir à flot des entreprises, soit parce que celles-ci sont jugées stratégiques sur le plan industriel, soit parce que c'est le seul moyen d'éviter des catastrophes financières plus importantes encore. Il ne s'agit nullement de mesures sociales comme en témoigne la prévision de près de 5000 licenciements à Alstom et de 10 500 dans 15 banques au Japon qui perçoivent des fonds publics. En effet, dans ce dernier cas, si ces banques veulent continuer à bénéficier du soutien de l'Etat sans lequel elles couleraient, elles n'ont d'autre choix que d'appliquer ses directives : améliorer, par des "dégraissages", leur bilan financier menacé et fragilisé par 50 milliards de dollars de créances douteuses qui risquent de ne jamais être récupérées. Et encore, de telles estimations qui émanent de l'Etat sont, d'après des analystes indépendants, bien en deçà de la réalité (d'après BBC News du 19 septembre).
Un retour vers les conditions de vie de la classe ouvrière au 19e siècle
Pour rendre plus acceptables aux yeux des prolétaires leurs conditions de vie actuelles, il arrive que la bourgeoisie se plaise à rappeler ce qu'elles étaient aux 18e et 19e siècle. Ils s'entassaient dans de véritables taudis insalubres ; hommes, femmes, enfants subissaient des conditions de travail inhumaines, avec en particulier des journées de travail pouvant atteindre 18 heures dans certains cas. L'affaiblissement de la force de travail qui en résultait risquait de constituer une entrave à l'exploitation et donc à l'accumulation capitaliste. De même, les poches de misère qui se développaient dans les villes industrielles devenaient une source croissante d'épidémies meurtrières en premier lieu pour la classe ouvrière elle-même, mais menaçant également toute la population, petite-bourgeoisie et bourgeoisie incluses. C'est la raison pour laquelle le développement de la lutte ouvrière pour obtenir des réformes permettant une amélioration des conditions de vie coïncidait avec les intérêts généraux du capitalisme dès lors que le développement de celui-ci n'avait pas encore atteint ses limites historiques. C'est cette situation qu'illustre la citation suivante de Marx extraite de Salaires, prix et profits à propos de la lutte pour la diminution de la journée de travail : "[les économistes officiels] nous annoncèrent de grands maux (au cas où la loi des dix heures serait obtenue par les travailleurs) : l'accumulation diminuée, les prix en hausse, les marchés perdus, la production ralentie, avec réaction inévitable sur les salaires, enfin la ruine (...) Le résultat ? Une hausse des salaires en argent pour les ouvriers des fabriques, en dépit du raccourcissement de la journée de travail, une augmentation importante des bras employés, une chute continue du prix des produits, un développement merveilleux des forces productives de leur travail, une expansion inouïe des marchés pour leurs marchandises". En revanche, dès lors que, ayant cessé d'être un système progressiste, le capitalisme est entré dans une période de déclin, il a été poussé par ses propres contradictions à attaquer toujours plus profondément les conditions de vie de la classe ouvrière. Toutes les luttes de résistance que la classe ouvrière a développées au cours du 20eme siècle, bien qu'ayant effectivement freiné la violence des attaques, ont cependant été impuissantes à inverser la tendance globale à la dégradation de ses conditions de vie. Cela, seul le renversement du capitalisme sera en mesure de le permettre.
Des situations de plus en plus catastrophiques dues à la détérioration de l'environnement
Des torrents de boue qui engloutissent des habitations de fortune, des cyclones qui les démantèlent, des tremblements de terre qui disloquent des immeubles construits à bon marché, avec plus de sable que de ciment, la perte par milliers de vies humaines, complètement démunies face aux éléments naturels déchaînés du fait de la misère qui les étreint, tout cela constitue, depuis des décennies, le lot commun des contrées du Tiers-Monde à la dérive. Mais, désormais, de telles catastrophes n'épargnent plus le coeur du monde industrialisé qui, lui aussi, compte de plus en plus de démunis et où commencent nettement à se faire sentir, depuis quelques années, les effets du dérèglement climatique de la planète. Même si les différences demeurent considérables, il apparait de plus en plus clairement que c'est bien la situation du Tiers-Monde qui indique le futur des grands pays industrialisés et non pas l'inverse. Alors que l'humanité n'avait jamais été aussi près de pouvoir dominer la nature pour vivre en harmonie avec elle, grâce à l'énorme pas en avant dans le développement des forces productives qu'avait permis le capitalisme, l'Europe, le berceau du développement de ce système, est de plus en plus impuissante face aux éléments naturels, comme en témoigne la courte rétrospective suivante sur un an seulement : - Eté 2003 : la canicule a aussi été à l'origine des incendies de forêts les plus importants jamais recensés dans ces contrées et faisant de nombreux morts. Près de 20% des surfaces boisées d'un pays comme le Portugal sont parties en fumée. - Janvier 2003 : la vague de froid qui s'est abattue sur l'Europe s'est soldée par de nombreux morts, comme c'est désormais régulièrement le cas chaque fois que le thermomètre affiche moins de zéro degré en hiver : un millier en Russie, quelques dizaines en Europe de l'Ouest. Ce dernier chiffre peut sembler dérisoire au regard de certains autres, mais il mérite néanmoins d'être relevé dans la mesure où il correspond à un phénomène tout à fait nouveau. - Septembre 2002 : une gigantesque montagne d'eau descend des Cévennes (Sud-Est de la France) en dévastant tout ce qui se trouve sur son passage, transformant en marécage toute une région couvrant trois départements. Bilan : une quarantaine de morts, ponts effondrés, chemins de fer, autoroutes, lignes téléphoniques coupés. - Août 2002 : depuis les rives de la Mer Noire jusqu'aux régions de l'Allemagne de l'Est, la Bavière, la République tchèque, l'Autriche se trouvent noyées par les eaux débordées de l'Elbe, du Danube et de leurs affluents. Les inondations, conséquence de pluies interminables, ont touché les campagnes, les villes, petites et grandes : 100 000 personnes évacuées à Dresde, des quartiers entiers dévastés à Prague, à Vienne, ponts de chemins de fer détruits, complexes chimiques menacés, pertes financières pharamineuses et surtout, des morts qui se comptent par dizaines un peu partout. Tout comme les autres aspects de la décomposition de la société capitaliste, la menace qui pèse sur l'environnement souligne le fait que, plus le prolétariat tarde à faire sa révolution, plus grand est le danger que le cours vers la destruction et le chaos n'atteigne le point de non retour qui rendrait impossible la lutte pour la révolution et la construction d'une société nouvelle (cf. Revue Internationale n° 63 ; "Mensonges et vérités de l'écologie ; c'est le capitalisme qui pollue la terre").
Le chaos et la guerre sont les seules perspectives offertes par le capitalisme
Comme nous l'avons exposé à différentes reprises dans nos colonnes, la première puissance mondiale est en permanence contrainte de prendre l'initiative sur le plan militaire, là où s'exprime son écrasante supériorité par rapport à tous ses rivaux, afin de défendre face à ceux-ci un leadership mondial qui lui est de plus en plus contesté. Depuis la première guerre du Golfe, les conflits majeurs ont été le produit d'une fuite en avant de la part des Etats-Unis talonnés par cette contradiction insurmontable : chaque nouvelle offensive, tout en faisant taire momentanément la contestation du leadership américain, crée en même temps les conditions pour une relance de celle-ci en favorisant les frustrations et le développement d'un sentiment anti-américain. L'escalade qui, depuis septembre 2001, a amené les Etats-Unis (sous prétexte de guerre contre le terrorisme et les "dictateurs dangereux") à occuper militairement, sans se soucier de l'ONU et l'OTAN, l'Afghanistan et l'Irak, n'échappe pas à cette logique. Néanmoins, aucun des conflits précédents n'avait comme l'Afghanistan, mais surtout l'Irak, engendré une situation aussi difficile à gérer pour les Etats-Unis. Forte de la facilité de sa victoire militaire sur l'Irak de Saddam Hussein, la bourgeoisie américaine ne s'attendait certainement pas à des problèmes aussi importants que ceux que lui posent actuellement l'occupation et le contrôle du pays. L'enlisement militaire des Etats-Unis en Irak renvoie à un avenir pour le moins hypothétique les belles promesses de l'administration Bush sur la reconstruction et la démocratie en Irak. Les implications d'une telle situation sont multiples. Pour tenter de maintenir l'ordre et contrôler la situation, les Etats-Unis sont contraints d'augmenter les effectifs de leurs troupes d'occupation. Signe de l'impopularité de cette mission, les professionnels volontaires deviennent plus difficiles à trouver et les troupes sur place expriment ouvertement leurs états d'âme, quand ce n'est pas leur nervosité en tirant sur tout ce qui bouge, de peur de recevoir la première balle.
Avant de lancer les Etats-Unis dans cette nouvelle offensive militaire, Bush avait annoncé que la libération de ce pays allait bouleverser le paysage géopolitique de la région. C'était effectivement un objectif, non avoué évidemment, que la domination américaine sur l'Irak permette un renforcement de son influence sur toute la région, notamment en tant que moyen d'encerclement de l'Europe. Un tel scénario incluait nécessairement que les Etats-Unis soient en mesure d'imposer la "pax americana" sur tous les foyers de tensions, en particulier sur le plus explosif d'entre eux, le conflit israélo-palestinien. Bush avait d'ailleurs annoncé le règlement prochain de celui-ci. Il était tout à fait exact, comme l'a fait Bush, de considérer que l'évolution de la situation en Irak aurait une incidence sur celle des territoires occupés par Jérusalem. C'est ce que démontre aujourd'hui, à contrario des espérances de Bush, l'aggravation des affrontements dans ces territoires. L'échec actuel de la bourgeoisie américaine en Irak constitue en effet un handicap vis-à-vis de la politique de mise au pas de son turbulent allié israélien pour lui faire respecter une "feuille de route" qu'il n'a de cesse de saboter. De telles difficultés de la bourgeoisie américaine pour imposer ses exigences à Israël ne sont pas nouvelles et expliquent en partie l'échec des différents plans de paix tentés depuis 10 ans. Néanmoins, elles n'ont jamais été aussi lourdes de conséquences qu'aujourd'hui. C'est ce qu'illustre la politique à courte vue qu'un Sharon est capable d'imposer au Moyen-Orient, basée exclusivement sur la recherche de l'escalade dans la confrontation avec les palestiniens en vue de les chasser des territoires occupés. Même si, à l'image du reste du monde, il n'y a pas de paix possible dans cette région, la carte jouée par Sharon, le boucher de Sabra et Chatila (2), ne pourra qu'aboutir à des bains de sang qui ne régleront pas pour autant, pour Israël, le problème palestinien. Au contraire, celui-ci reviendra, tel un boomerang, notamment à travers une recrudescence du terrorisme encore plus incontrôlable qu'actuellement. Une telle issue ne pourra que rejaillir négativement sur les Etats-Unis qui, évidemment, ne pourront pas pour autant lâcher leur meilleur allié dans la région. Les déboires des Etats-Unis en Irak affectent leur crédit et leur autorité sur le plan international, ce dont tous leurs rivaux ne peuvent que se réjouir et qu'ils vont tenter d'exploiter. A la faveur de ces circonstances, le plus bruyant d'entre eux, la France s'est permis l'outrecuidance, par la voix de Chirac à l'assemblée générale de l'ONU, sous prétexte d'exprimer sa différence par rapport à son "grand allié de toujours", de signifier à Bush qu'il a commis une erreur en intervenant en Irak, malgré les réserves que ce projet avait suscité de la part de nombreux pays, dont la France. Plus préoccupant pour les Etats-Unis, ils n'ont pas jusqu'à aujourd'hui pu obtenir, malgré leurs appels renouvelés, qu'une autre grande puissance, en dehors de la Grande-Bretagne qui a participé dés le début à l'opération militaire, vienne renforcer à leurs côtés le contingent des troupes d'occupation en Irak. L'Espagne, qui n'est pas une grande puissance, a expédié un détachement militaire tout à fait symbolique. Seule la Pologne, qui est une puissance encore moins grande, a répondu positivement aux avances américaines l'invitant à parader au soleil dans la cour des grands. Il sera également difficile pour les Etats-Unis de trouver beaucoup de volontaires pour financer avec eux le coût de la stabilisation et de la reconstruction de l'Irak. En fait la bourgeoisie américaine se trouve dans une impasse résultant elle-même de l'impasse de la situation mondiale qui ne peut se résoudre, du fait des circonstances historiques actuelles, à travers la marche vers une nouvelle guerre mondiale. En l'absence de cette issue bourgeoise radicale à la crise mondiale actuelle, qui signifierait à coup sûr la disparition de l'humanité, cette dernière s'enfonce progressivement dans le chaos et la barbarie qui caractérisent la phase ultime actuelle de décomposition du capitalisme. La situation présente de faiblesse relative des Etats-Unis a suscité une ardeur renouvelée de ses rivaux à reprendre l'offensive. Ainsi le 20 septembre avait lieu à Berlin une rencontre entre G. Schröder, J. Chirac et T. Blair où s'est dégagé un accord des trois dirigeants sur l'idée de doter l'Europe d'un état-major opérationnel autonome, modalité qui se heurtait jusqu'alors à l'hostilité de la bourgeoisie britannique. Les quelques pas de cette dernière en direction de rivaux avérés des Etats-Unis ne sont pas étrangers au fait que la Grande-Bretagne fait aussi les frais de la mésaventure irakienne et qu'il est plus que nécessaire pour elle d'équilibrer ses alliances, à travers différents contrepoids à l'influence américaine. La déclaration de Blair au terme de cette rencontre est tout à fait éloquente : "Nous avons sur la défense européenne une position de plus en plus commune" (cité par le journal Le Monde du 23 septembre). De même, à l'occasion de l'assemblée plénière de l'ONU qui vient de se tenir au mois de septembre, les 25 membres de l'Europe Elargie ont tous voté, vraisemblablement sous l'initiative de l'Allemagne et de la France, en faveur d'un texte qui ne peut qu'accentuer l'embarras des Etats-Unis face à la politique de son allié Israël, puisqu'il condamne la décision de Sharon d'expatrier Arafat (3). A travers ce vote symbolique, ce qui est visé c'est l'image des Etats-Unis pour la ternir davantage encore. Parmi les vingt-cinq membres de l'Europe Elargie qui ont ainsi implicitement critiqué les Etats-Unis, une majorité avait, avant le déclenchement de la guerre en Irak, peu ou prou soutenu l'option américaine contre le trio France, Allemagne, Russie. Ce fait, de même que l'évolution récente de la position de la Grande-Bretagne à propos de l'état-major opérationnel autonome européen, viennent illustrer une caractéristique de la période ouverte par la disparition des blocs impérialistes, mise en évidence par le CCI suite à la guerre du Golfe : "Dans la nouvelle période historique où nous sommes entrés, et les évènements du Golfe viennent de le confirmer, le monde se présente comme une immense foire d'empoigne, où jouera à fond la tendance au "chacun pour soi", où les alliances entre Etats n'auront pas, loin de là, le caractère de stabilité qui caractérisait les blocs, mais seront dictées par les nécessités du moment." (cf. Revue Internationale n°64 ; "Militarisme et décomposition"). C'est à juste titre que les révolutionnaires ont comparé les moeurs de la bourgeoisie à celles des gangsters. Mais, alors que par le passé il existait des règles chez les uns et les autres destinées à "encadrer" leurs forfaits, celles-ci volent aujourd'hui en éclat laissant la place à des comportements sans foi ni loi. Schröder en a récemment donné une brillante illustration en déclarant être entièrement d'accord avec G. Bush suite à la rencontre qu'il venait d'avoir avec lui en marge des travaux de l'assemblée de l'ONU, alors que jusqu'à présent il était avec la France, le porte drapeau de l'anti-américanisme.
Les responsabilités de la classe ouvrière
Avec l'effondrement du bloc de l'Est et la désintégration du bloc occidental disparaissait, au début des années 1990, la menace d'un conflit nucléaire mondial qui, en anéantissant l'humanité, aurait mis un terme brutal aux contradictions du capitalisme. C'est dans un contexte différent, éliminant pour toute une période la possibilité d'un conflit mondial, que ces contradictions ont continué à s'exprimer depuis lors sous la forme d'un phénomène de plus en plus accentué de décomposition du capitalisme, imprimant sa marque à tous les aspects de la vie de la société. Cela ne peut pas constituer un motif de consolation puisque : "La décomposition mène, comme son nom l'indique, à la dislocation et à la putréfaction de la société, au néant. Laissée à sa propre logique, à ses conséquences ultimes, elle conduit l'humanité au même résultat que la guerre mondiale. Etre anéanti brutalement par une pluie de bombes thermonucléaires dans une guerre généralisée ou bien par la pollution, la radioactivité des centrales nucléaires, la famine, les épidémies et les massacres de multiples conflits guerriers (où l'arme atomique pourrait aussi être utilisée), tout cela revient, à terme, au même" (cf. Revue Internationale n°107 ; "La décomposition phase ultime de la décadence du capitalisme"). Tant que la menace de destruction de la société était représentée uniquement par la guerre impérialiste, le fait que les luttes du prolétariat soient en mesure de se maintenir comme obstacle décisif à un tel aboutissement, suffisait à barrer la route à cette destruction. En revanche, contrairement à la guerre impérialiste généralisée qui, pour pouvoir se déchaîner, requiert l'adhésion du prolétariat aux idéaux de la bourgeoisie, la décomposition n'a nul besoin de l'embrigadement de la classe ouvrière pour détruire l'humanité. En effet, de même qu'elles ne peuvent s'opposer à l'effondrement économique, les luttes du prolétariat dans ce système ne sont pas non plus en mesure de constituer un frein à la décomposition. Pour mettre fin à la menace que constitue la décomposition, les luttes ouvrières de résistance aux effets de la crise ne suffisent plus : seule la révolution communiste peut venir à bout d'une telle menace. Malgré le coup porté par l'effondrement du bloc de l'Est à la prise de conscience du prolétariat, dont les répercussions sur le niveau de la lutte de classe sont encore loin d'être dépassées, celui-ci n'a subi aucune défaite majeure et sa combativité reste pratiquement intacte. Si l'aggravation inexorable de la crise du capitalisme est à l'origine de la progression de la décomposition, elle constitue en même temps le stimulant essentiel de la lutte et de la prise de conscience de la classe ouvrière, lesquelles sont la condition même de sa capacité à résister au poison idéologique du pourrissement de la société. En effet, la crise met à nu les causes ultimes de l'ensemble de la barbarie qui s'abat sur la société, permettant ainsi au prolétariat de prendre conscience de la nécessité de changer radicalement de système, et de l'impossibilité d'en améliorer certains aspects. Néanmoins, si la lutte défensive est nécessaire, elle est en elle-même insuffisante pour jalonner le chemin qui mène à la révolution. La compréhension des moyens et des buts de son combat par le prolétariat ne peut être que le produit d'un effort conscient de sa part, au sein duquel les organisations révolutionnaires ont un rôle primordial, pour comprendre les enjeux de sa lutte, la tactique et les pièges tendus par la classe ennemie, et pour tendre vers toujours plus d'unité.
LC (3 octobre)
(1) José Bové, porte-parole de la Confédération paysanne et un des leaders français les plus en vue de l'alter-mondialisation, archi-médiatisé par la bourgeoisie française et entretenant de bonnes relations avec toutes les composantes de la gauche et de l'extrême gauche dans ce pays, déclarait le 10 septembre à la fête de l'Humanité (quotidien du Parti communiste français) qu'il fallait " faire capoter Cancun".
(2) Sharon avait conduit avec une barbarie toute particulière l'expédition punitive israélienne dans ces deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth Ouest, en septembre 1982, laquelle avait fait des milliers de morts et de blessés, hommes, femmes et enfants.
(3) Les principaux rivaux européens des Etats-Unis ont su exploiter la position très inconfortable dans laquelle se trouvent les Etats-Unis dans cette affaire. En effet, bien qu'ayant critiqué publiquement cette position d'Israël, ceux-ci ne pouvaient néanmoins pas se permettre de lâcher leur allié, ce qui les a conduit à faire usage de leur droit de veto à l'ONU pour éviter à Israël d'être condamné par une résolution.
Récent et en cours:
- Crise économique [96]
Questions théoriques:
- Le cours historique [112]
- L'économie [113]
La crise économique signe la faillite historique des rapports de production capitalistes
- 5492 reads
Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que la bourgeoisie annonce la reprise et qu'elle est obligée à chaque trimestre d'en reporter l'échéance. Cela fait aussi plus de deux ans et demi que les performances économiques sont systématiquement en deçà des prévisions forçant la classe dominante à les revoir constamment à la baisse. Commencée au second semestre 2000, la récession actuelle est d'ores et déjà l'une des plus longues depuis la fin des années 60 et, si des signes de reprise se font jour outre-atlantique, c'est encore loin d'être le cas pour l'Europe et le Japon. Encore faut-il rappeler que, si les États-Unis remontent la pente, c'est essentiellement le produit d'un interventionnisme étatique parmi les plus vigoureux de ces 40 dernières années et d'une fuite en avant dans un endettement sans précédent qui fait craindre l'éclatement d'une nouvelle bulle spéculative, immobilière cette fois. Concernant l'interventionnisme étatique visant à soutenir l'activité économique, il faut noter que le gouvernement américain a laissé filer sans retenue le déficit budgétaire. De positif qu'il était en 2001, à hauteur de 130 milliards de dollars, le solde budgétaire en est arrivé à un déficit estimé à 300 milliards en 2003 (3,6% du PNB). Aujourd'hui, l'ampleur de ce déficit ainsi que ses prévisions en augmentation, compte tenu du conflit irakien et de la diminution des recettes fiscales consécutives à la baisse des impôts, inquiètent de plus en plus la classe politique et les milieux d'affaire des États-Unis. Concernant l'endettement, la baisse drastique des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale a non seulement eu pour objectif de soutenir l'activité mais a surtout visé au maintien de la demande des ménages grâce à la renégociation de leurs prêts hypothécaires. L'allégement du poids des remboursements des emprunts immobiliers a ainsi permis un surcroît d'endettement octroyé par les banques. La dette hypothécaire des ménages américains s'est ainsi accrue de 700 milliards de dollars (plus de deux fois le déficit public !). L'accroissement de la triple dette américaine, de l'État, des ménages et extérieure explique que les États-Unis ont pu rebondir plus rapidement que les autres pays. Cependant, le rebond de ce pays ne pourra se maintenir que si son activité économique reste soutenue à moyen terme sous peine de se retrouver comme le Japon, il y a plus d'une dizaine d'années, face à l'éclatement d'une bulle spéculative immobilière et d'être en cessation de paiements face à toutes une série de créances non recouvrables. L'Europe ne peut guère se payer un tel luxe puisque ses déficits étaient déjà imposants au moment de l'éclatement de la récession et que les conséquences de cette dernière n'ont fait que les creuser un peu plus. Ainsi, l'Allemagne et la France qui représentent le coeur économique de l'Europe sont aujourd'hui désignées comme les plus mauvaises élèves de la classe avec des déficits publics s'élevant à 3,8% pour la première et 4% pour la seconde. Ces niveaux sont déjà bien au-delà du plafond fixé par le traité de Maastricht (3%) et menacent ainsi ces pays de subir les foudres de la Commission européenne et les amendes prévues à l'égard des contrevenants. Ceci restreint d'autant les capacités de l'Europe à mener une politique conséquente de relance à la mesure des enjeux. De plus, en organisant la baisse du Dollar face à l'Euro pour réduire leur déficit commercial, les États-Unis vont peser sur la relance dans une Europe qui a de plus en plus de peine à dégager des excédents à l'exportation. Il n'est pas étonnant dès lors que les pays de l'axe centre européen comme l'Allemagne, la France, la Hollande et l'Italie soient en récession et que les autres n'en soient pas loin.
Ceux qui, lors de la chute du mur de Berlin, ont cru aux discours de la bourgeoisie sur l'avènement d'une nouvelle ère de prospérité et l'ouverture du 'marché des pays de l'Est' en sont pour leurs frais. Ainsi la réunification de l'Allemagne, loin de représenter un tremplin pour la 'domination allemande', constitua et constitue toujours un lourd fardeau pour ce pays. L'Allemagne, qui était la locomotive de l'Europe, est devenue depuis la réunification le wagon de queue qui peine à suivre le rythme du train. L'inflation est basse et frise la déflation, les taux d'intérêts réels élevés dépriment encore plus l'activité et l'existence de l'Euro interdit désormais de mener des politiques de dévaluation compétitive de la monnaie nationale. Le chômage, la modération salariale et la récession ont pour effet une stagnation du marché intérieur encore jamais observée lors des précédents replis de la conjoncture dans ce pays. De même, la future intégration des pays de l'Est au sein de l'Europe pèsera encore plus sur la conjoncture économique. Tout ceci a pour conséquence inéluctable un accroissement drastique des attaques contre les conditions de travail et le niveau de vie de la classe ouvrière. Mesures d'austérité, licenciements massifs et aggravation sans précédent de l'exploitation au travail sont sur tous les agendas de la bourgeoisie partout dans le monde. Selon les statistiques officielles largement sous-estimées, le chômage est en route pour atteindre les 5 millions en Allemagne, 6,1% aux États-Unis et les 10% en France à la fin de cette année. En Europe, l'axe franco-allemand, avec le plan Raffarin et l'Agenda 2010 de Schröder, donne le ton de la politique qui est menée un peu partout : creusement du déficit budgétaire, réduction des impôts pour les hauts revenus, assouplissement du droit de licenciement, réduction des indemnités de chômage et allocations diverses, diminution du remboursement des soins de santé et recul de l'âge de la retraite. Les pensionnés font aujourd'hui particulièrement les frais de l'austérité laquelle détruit définitivement l'idée de la possible existence d'un 'repos bien mérité' après une vie de dur labeur. Ainsi, aux États-Unis, avec la faillite ou les pertes de nombreux fonds de pension suite au krach boursier, l'on assiste à une entrée massive de retraités sur le marché de l'emploi, contraints qu'ils sont de se remettre au travail pour survivre. La classe ouvrière doit faire face à une vaste offensive d'austérité à tout crin qui n'aura d'ailleurs d'autre conséquence sur le plan économique que de prolonger encore plus la récession et d'engendrer de nouvelles attaques.
La crise, une expression de l'obsolescence des rapports de production capitalistes
Le déclin ininterrompu du taux de croissance depuis la fin des années 60 (Cf. Notre article "Les oripeaux de la 'prospérité économique' arrachés par la crise" dans la Revue internationale n°114 ainsi que le graphique ci-dessous) démasque bien l'immense bluff savamment entretenu par la bourgeoisie tout au long des années 90 sur la prétendue prospérité économique retrouvée du capitalisme grâce à la 'nouvelle' économie, la mondialisation et les recettes néo-libérales. Et pour cause, la crise n'est en rien une affaire de politique économique : si les recettes keynésiennes des années 50-60 puis néo-keynésiennes des années 70 sont arrivées à épuisement et si les recettes néo-libérales des années 80 et 90 n'ont rien pu résoudre c'est bien parce que la crise mondiale ne résulte pas fondamentalement d'une "mauvaise gestion de l'économie" mais qu'elle relève des contradictions de fond qui traversent la mécanique du capitalisme. Si la crise n'est pas une affaire de politique économique, c'est encore moins une affaire d'équipe gouvernementale. Qu'ils soient de gauche ou de droite, les gouvernements ont utilisé tour à tour toutes les recettes disponibles. Ainsi, les gouvernements américain et anglais actuels, identifiés comme les plus néo-libéraux et pro-mondialisation sur le plan économique, sont de couleurs politiques différentes et utilisent aujourd'hui les recettes les plus vigoureusement néo-keynésiennes qui soient en laissant filer leurs déficits publics. De même, à regarder de plus près les programmes d'austérité du gouvernement Schröder (social-démocrate - écologiste) et Raffarin (droite libérale), force est de constater qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et mettent en application les mêmes mesures.
Face à cette spirale de crise et d'austérité ininterrompue depuis plus de 35 ans, l'une des responsabilités majeures des révolutionnaires est de démontrer qu'elle trouve ses racines dans l'impasse historique du capitalisme, dans l'obsolescence de ce qui est au coeur de son rapport de production fondamental, le salariat (1). En effet, le salariat concentre en lui à la fois toutes les limites sociales, économiques et politiques à la production du profit capitaliste et, de par son mécanisme même, pose également les obstacles à la réalisation pleine et entière de ce dernier (2). La généralisation du salariat fut à la base de l'expansion du capitalisme au 19e siècle et, à partir de la première guerre mondiale, de l'insuffisance relative des marchés solvables eu égard aux besoins de l'accumulation. Contre toutes les fausses explications mystificatrices de la crise, il y va de la responsabilité des révolutionnaires de souligner cette impasse, de montrer en quoi le capitalisme, s'il a été un mode de production nécessaire et progressif, est aujourd'hui historiquement dépassé et mène l'humanité à sa perte. Comme pour toutes les phases de décadence des modes antérieurs de production (féodal, antique, etc.) cette impasse réside dans le fait que le rapport social de production fondamental est devenu trop étroit et ne permet plus d'impulser comme auparavant le développement des forces productives (3). Pour la société d'aujourd'hui, le salariat constitue désormais ce frein au plein développement des besoins de l'humanité. Seules l'abolition de ce rapport social et l'instauration du communisme permettront à l'humanité de se libérer des contradictions qui l'assaillent.
Or, depuis la chute du mur de Berlin, la bourgeoisie n'a eu de cesse de mener des campagnes sur 'l'inanité du communisme', 'l'utopie de la révolution' et la 'dilution de la classe ouvrière' en une masse de citoyens dont la seule forme d'action légitime serait la réforme 'démocratique' d'un capitalisme présenté désormais comme le seul horizon indépassable de l'humanité. Dans cette vaste escroquerie idéologique, c'est aux altermondialistes qu'est dévolu le monopole de la contestation. La bourgeoisie ne ménage pas sa peine pour leur donner un rôle de premier plan comme interlocuteurs privilégiés de sa propre critique : une large place est laissée dans les médias aux analyses et actions de ce courant, des invitations occasionnelles sont faites lors de sommets et autres rencontres officielles à leur plus éminents représentants, etc. Et pour cause, le fond de commerce des altermondialistes est le complément parfait à la campagne idéologique de la bourgeoisie sur 'l'utopie du communisme' puisqu'ils partent des mêmes postulats : le capitalisme serait le seul système possible et sa réforme la seule alternative. Pour ce mouvement, avec l'organisation ATTAC en tête et son conseil 'd'experts en économie', le capitalisme pourrait être humanisé pour autant que le 'bon capitalisme régulé' chasse le 'mauvais capitalisme financier'. La crise serait la conséquence de la dérégulation néo-libérale et de la mainmise du capitalisme financier imposant sa dictature des 15% comme rendement obligé au capitalisme industriel... le tout ayant été décidé dans une obscure réunion tenue en 1979 appelé 'le consensus de Washington'. L'austérité, l'instabilité financière, les récessions, etc. ne seraient que les conséquences de ce nouveau rapport de forces qui se serait établi au sein de la bourgeoisie au profit du capital usuraire. D'où les idées de 'réguler la finance', la 'faire reculer' et de 'réorienter les investissements vers la sphère productive', etc.
Dans cette ambiance de confusion générale sur les origines et les causes de la crise, il s'agit pour les révolutionnaires de rétablir une compréhension claire des bases de celle-ci et, surtout, de montrer qu'elle est le produit de la faillite historique du capitalisme. En d'autres termes, il s'agit pour eux de réaffirmer la validité du marxisme dans ce domaine. Malheureusement, à regarder les analyses de la crise proposées par les groupes du milieu politique prolétarien comme le PCInt - Programme Communiste ou le BIPR, force est de constater qu'ils sont loin d'une telle réaffirmation et notamment d'être capables de se démarquer de l'idéologie ambiante véhiculée par l'altermondialisme. Certes, ces deux groupes appartiennent incontestablement au camp prolétarien et se distinguent fondamentalement de la mouvance altermondialiste par leurs dénonciations des illusions réformistes et par la défense de la perspective de la révolution communiste. Cependant, leur propre analyse de la crise est largement empruntée au gauchisme défroqué de cette mouvance. Morceaux choisis : "Les gains issus de la spéculation sont si importants qu'ils ne sont pas seulement attractifs pour les entreprises 'classiques' mais aussi pour bien d'autres, citons entre autres, les compagnies d'assurance ou les fonds de pension dont Enron est un excellent exemple (...) La spéculation représente le moyen complémentaire, pour ne pas dire principal, pour la bourgeoisie, de s'approprier la plus-value (...) Une règle s'est imposée, fixant à 15% l'objectif minimum de rendement pour les capitaux investis dans les entreprises. Pour atteindre ou dépasser ce taux de croissance des actions, la bourgeoisie a dû accroître les conditions d'exploitation de la classe ouvrière : les rythmes de travail ont été intensifiés, les salaires réels baissés. Les licenciements collectifs ont touché des centaines de milliers de travailleurs." (BIPR in Bilan et Perspectives n°4, p. 6). On peut déjà relever que c'est une curieuse façon de poser le problème pour un groupe qui se proclame "matérialiste" et qui considère même que le CCI est "idéaliste". "Une règle s'est imposée" nous dit le BIPR. S'est-elle imposée toute seule ? Nous ne ferons pas l'injure au BIPR de lui attribuer une telle idée. C'est une classe, un gouvernement ou une organisation humaine donnée qui a imposé cette nouvelle règle ; mais pourquoi ? Parce que certains puissants de ce monde sont brusquement devenus plus rapaces et méchants que d'habitude ? Parce que les "méchants" l'on emporté sur les "bons" (ou les "moins méchants"). Ou tout simplement, comme le considère le marxisme, parce les conditions objectives de l'économie mondiale ont obligé la classe dominante à intensifier l'exploitation des prolétaires. Ce n'est malheureusement pas ainsi que ce passage pose le problème. De plus, et c'est encore plus grave, c'est un discours que l'on pourrait lire dans n'importe quel opuscule altermondialiste : c'est la spéculation financière qui est devenue la principale source du profit capitaliste (!), c'est la spéculation financière qui impose sa règle des 15% aux entreprises, c'est la spéculation financière qui est responsable de l'aggravation de l'exploitation, des licenciements massifs et de la baisse des salaires et c'est même la spéculation financière qui est à la source d'un processus de désindustrialisation et de la misère sur l'ensemble de la planète "L'accumulation des profits financiers et spéculatifs alimente un processus de désindustrialisation entraînant chômage et misère sur l'ensemble de la planète" (idem p. 7). Quant au PCInt - Programme Communiste, ce n'est guère mieux même si c'est dit en termes plus généraux et qu'il se couvre de l'autorité de Lénine : "Le capital financier, les banques deviennent en vertu du développement capitaliste les véritables acteurs de la centralisation du capital, accroissant la puissance de gigantesques monopoles. Au stade impérialiste du capitalisme, c'est le capital financier qui domine les marchés, les entreprises, toute la société, et cette domination conduit elle-même à la concentration financière jusqu'au point où "le capital financier, concentré en quelques mains et exerçant un monopole de fait, prélève des bénéfices énormes toujours croissants sur la constitution de firmes, les émissions de valeurs, les emprunts d'État, etc., affermissant la domination des oligarchies financières et frappant la société tout entière d'un tribut au profit des monopolistes" (Lénine, in L'impérialisme stade suprême du capitalisme). Le capitalisme qui naquit du minuscule capital usuraire, termine son évolution sous la forme d'un gigantesque capital usuraire" (Programme Communiste n°98, p.1). Voici à nouveau une dénonciation sans appel du capital financier parasitaire qui pourrait plaire au plus radical des altermondialistes (4). On chercherait en vain dans ces quelques extraits une quelconque démonstration que c'est bien le capitalisme comme mode de production qui a fait son temps, que c'est le capitalisme comme un tout qui est responsable des crises, des guerres et de la misère du monde. On chercherait en vain la dénonciation de l'idée centrale des altermondialistes selon laquelle ce serait le capital financier qui serait la cause des crises alors que c'est le capitalisme comme système qui est au coeur du problème. En reprenant des pans entiers de l'argumentation altermondialiste, ces deux groupes de la Gauche Communiste laissent la porte grande ouverte à l'opportunisme théorique envers les analyses gauchistes. Celles-ci présentent la crise comme la conséquence de l'instauration d'un nouveau rapport de forces qui se serait instauré au sein de la bourgeoisie entre l'oligarchie financière et le capital industriel. Les oligopoles financiers auraient pris le dessus sur le capital des entreprises au moment de la décision prise à Washington de brusquement relever les taux d'intérêt.
En réalité, il n'y a guère eu de 'triomphe des banquiers sur les industriels', c'est la bourgeoisie comme un tout qui est passée à la vitesse supérieure dans son offensive contre la classe ouvrière.
Les 'profits financiers' comme bases d'un capitalisme usuraire ?
La dénonciation de la financiarisation est aujourd'hui un thème commun à tous les économistes dit 'critiques'. L'explication en vogue à l'heure actuelle parmi ces 'critiques du capitalisme' est de prétendre que le taux de profit a effectivement augmenté mais qu'il a été confisqué par l'oligarchie financière de sorte que le taux de profit industriel ne s'est pas rétabli significativement, expliquant par là l'absence de redémarrage de la croissance (cf. graphique ci-dessous).
Il est exact que depuis le début des années 80, suite à la décision prise en 1979 de faire remonter les taux d'intérêt, une part importante de la plus-value extraite n'est plus accumulée via l'autofinancement des entreprises mais est distribuée sous forme de revenus financiers. La réponse dominante à ce constat est de présenter cette croissance de la financiarisation comme une ponction sur le profit global qui l'empêcherait ainsi de s'investir productivement. La faiblesse de la croissance économique s'expliquerait donc par le parasitisme de la sphère financière, par l'hypertrophie du 'capital usuraire'. De là les 'explications' pseudo marxistes s'appuyant sur les maladresses de Lénine "le capital financier, concentré en quelques mains et exerçant un monopole de fait, prélève des bénéfices énormes toujours croissants sur la constitution de firmes, les émissions de valeurs, les emprunts d'État, etc. affermissant la domination des oligarchies financières et frappant la société tout entière d'un tribut au profit des monopolistes" selon lesquelles les profits financiers exerceraient une véritable 'ponction' sur les entreprises (le fameux return de 15%). Cette analyse est un retour à l'économie vulgaire où le capital pourrait choisir entre l'investissement productif et les placements financiers en fonction de la hauteur relative du taux de profit d'entreprise et du taux d'intérêt. Sur un plan plus théorique, ces approches de la finance comme élément parasitaire renvoient à deux théories de la valeur et du profit. L'une, marxiste, dit que la valeur existe préalablement à sa répartition et est exclusivement produite dans le procès de production à travers l'exploitation de la force de travail. Dans le Livre III du Capital, Marx précise que le taux d'intérêt est "...une partie du profit que le capitaliste actif doit payer au propriétaire du capital, au lieu de la mettre dans sa poche". En cela Marx se distingue radicalement de l'économie bourgeoise qui présente le profit comme l'addition des revenus des facteurs (revenus du facteur travail, revenus du facteur capital, revenus du facteur foncier, etc.). L'exploitation disparaît puisque chacun des facteurs est rémunéré selon sa propre contribution à la production : "pour les économistes vulgaires qui essaient de présenter le capital comme source indépendante de la valeur et de la création de valeur, cette forme est évidemment une aubaine, puisqu'elle rend méconnaissable l'origine du profit" (Marx). Le fétichisme de la finance consiste dans l'illusion que la détention d'une part de capital (une action, un Bon du Trésor, une obligation, etc.) vont, au sens propre du terme, 'produire' des intérêts. Détenir un titre c'est s'acheter un droit à recevoir une fraction de la valeur créée mais cela ne crée en soi aucune valeur. C'est le travail et exclusivement lui qui confère de la valeur à ce qui est produit. Le capital, la propriété, une action, un livret d'épargne, un stock de machines ne produisent quoi que ce soit par eux-mêmes. Ce sont les hommes qui produisent (5). Le capital 'rapporte', au sens où un chien de chasse rapporte le gibier. Il ne crée rien, mais il donne à son propriétaire le droit à une part de ce qu'à créé celui qui s'en est servi. En ce sens le capital désigne moins un objet qu'un rapport social : une partie du fruit du labeur de certains aboutit entre les mains de qui possède le capital. L'idéologie altermondialiste inverse l'ordre des choses en confondant l'extraction de la plus-value d'avec sa répartition. Le profit capitaliste tire exclusivement sa source de l'exploitation du travail, il n'existe pas de profits spéculatifs pour l'ensemble de la bourgeoisie (même si tel ou tel secteur particulier peut gagner à la spéculation) ; la Bourse ne crée pas de valeur. L'autre théorie, flirtant avec l'économie vulgaire, conçoit le profit global comme la somme d'un profit industriel d'un côté et d'un profit financier de l'autre. Le taux d'accumulation serait faible parce que le profit financier serait supérieur au profit industriel. C'est une vision héritée en droite ligne des défunts partis staliniens qui ont répandu une critique 'populaire' du capitalisme vu comme la confiscation d'un profit 'légitime' par une oligarchie parasitaire (les 200 familles, etc.). L'idée est ici la même ; elle repose sur un véritable fétichisme de la finance selon laquelle la Bourse serait un moyen de créer de la valeur au même titre que l'exploitation du travail. C'est en cela que réside toute la mystification sur la taxe Tobin, la régulation et l'humanisation du capitalisme répandue par les altermondialistes. Tout ce qui transforme une contradiction subséquente (la financiarisation) en contradiction principale porte en soi le danger d'un glissement typiquement gauchiste consistant à séparer le bon grain de l'ivraie : d'un côté le capitalisme qui investit, de l'autre celui qui spécule. Cela mène à voir la financiarisation comme une espèce de parasite sur un corps capitaliste sain. La crise ne disparaîtra pas, même après l'abolition du 'gigantesque capital usuraire' si cher à Programme Communiste. D'une certaine manière, insister sur la financiarisation du capitalisme conduit à sous-estimer la profondeur de la crise en laissant entendre qu'elle proviendrait du rôle parasite de la finance qui exigerait des taux de profit trop élevés aux entreprises les empêchant ainsi de réaliser leurs investissements productifs. Si telle était bien la racine de la crise, alors une "euthanasie des rentiers" (Keynes) suffirait à la résoudre.
Ces glissements gauchistes au niveau de l'analyse mènent à présenter un certain nombre de données économiques qui cherchent à démontrer, en citant des chiffres qui donnent le vertige, cette domination absolue de la finance, et l'énormité des ponctions qu'elle opère : "... les grandes entreprises virent leurs investissements s'orienter vers les marchés financiers, supposés plus 'porteurs' (...) Ce marché phénoménal se développe à une vitesse bien supérieure à celui de la production (...) En ce qui concerne la spéculation monétaire sur les 1300 milliards de dollars qui se déplaçaient en 1996, chaque jour entre les différentes monnaies, 5 à 8% au maximum correspondaient au paiement de marchandises ou de services vendus d'un pays à l'autre (il convient d'y ajouter les opérations de change non spéculatives). 85% de ces 1300 milliards correspondaient donc à des opérations quotidiennes purement spéculatives ! Les chiffres sont à réactualiser, gageons que les 85% sont aujourd'hui dépassés" (BIPR, Bilan et Perspectives n°4, p.6). Oui ils ont été dépassés et les montants ont atteints les 1500 milliards de dollars, soit presque la totalité de la dette du Tiers-Monde... mais ces chiffres ne font peur qu'aux ignorants car ils n'ont aucun sens ! En réalité cet argent ne fait que tourner et les sommes annoncées sont d'autant plus importantes que le carrousel va vite. Il suffit de s'imaginer une personne convertissant 100 chaque demi-heure pour spéculer entre les monnaies ; au bout de 24 heures les transactions totales se seront élevées à 4800, et si elle spéculait chaque quart d'heure les transactions totales auront doublé... mais cette somme est purement virtuelle car la personne ne possède toujours que 100 plus 5 ou moins 10 suivant son talent dans l'art de la spéculation. Malheureusement cette présentation médiatique des faits, reprise par le BIPR, crédibilise les interprétations de la crise comme un produit de l'action parasitaire de la finance. En réalité, c'est l'augmentation de la sphère financière qui s'explique par celle de la plus-value non-accumulée. C'est la crise de surproduction et donc la raréfaction des lieux d'accumulation rentables qui engendrent la rétribution de plus-value sous forme de revenus financiers, et non la finance qui s'oppose ou se substitue à l'investissement productif. La financiarisation correspond à l'augmentation d'une fraction de la plus-value qui ne trouve plus à être réinvestie avec profit (6). La distribution de revenus financiers n'est pas automatiquement incompatible avec l'accumulation basée sur l'autofinancement des entreprises. Lorsque les profits tirés de l'activité économique sont attractifs, les revenus financiers sont réinvestis et participent de manière externe à l'accumulation des entreprises. Ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas que les profits sortent par la porte sous forme de distribution de revenus financiers, mais que ces derniers ne reviennent pas par la fenêtre pour se réinvestir productivement dans le circuit économique. Si une partie significative de ces sommes était réinvestie, cela devrait se traduire par une élévation du taux d'accumulation. Si cela ne se produit pas c'est parce qu'il y a crise de surproduction et donc raréfaction des lieux d'accumulation rentables. Le parasitisme financier est un symptôme, une conséquence des difficultés du capitalisme et non la cause à la racine de ces difficultés. La sphère financière est la vitrine de la crise parce que c'est là que surgissent les bulles boursières, les effondrements monétaires et les turbulences bancaires. Mais ces bouleversements sont la conséquence de contradictions qui ont leur origine dans la sphère productive.
Le salariat au coeur de la crise de surproduction
Que s'est-il passé depuis une vingtaine d'années ? L'austérité et la baisse des salaires (7) ont permis de rétablir le taux de profit des entreprises mais ces profits accrus n'ont pas conduit à un relèvement du taux d'accumulation (l'investissement) et donc de la productivité du travail. La croissance est ainsi restée dépressive (Cf. graphique ci-dessous).
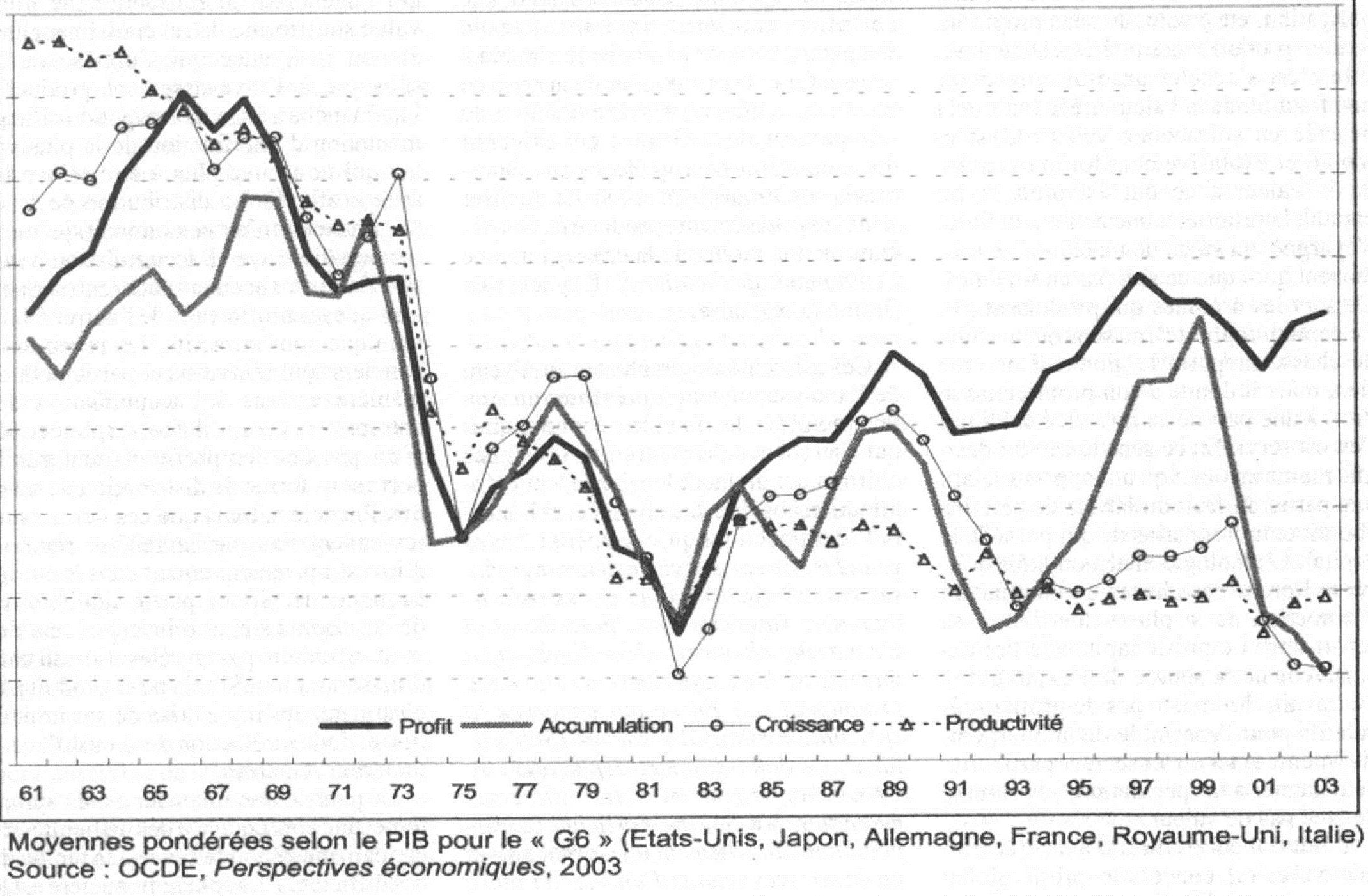
En bref, le freinage du coût salarial a restreint les marchés, nourri les revenus financiers et non le réinvestissement des profits. Mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il un si faible réinvestissement alors que les profits des entreprises ont été rétablis ? Pourquoi l'accumulation ne redémarre-t-elle pas suite à la remontée du taux de profit depuis plus de vingt ans ? Marx, et Rosa Luxemburg à sa suite, nous ont enseigné que les conditions de la production (l'extraction de la plus-value) sont une chose et que les conditions de réalisation de ce surtravail cristallisé dans les marchandises produites en sont une autre. Le surtravail cristallisé dans la production ne devient de la plus-value sonnante et trébuchante, de la plus-value accumulable, que si les marchandises produites ont été vendues sur le marché. C'est cette différence fondamentale entre les conditions de la production et celles de la réalisation qui nous permet de comprendre pourquoi il n'y a pas de lien d'automatique entre le taux de profit et la croissance.
Le graphique ci-dessus résume bien l'évolution du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. L'exceptionnelle phase de prospérité après la reconstruction voit toutes les variables fondamentales du profit, de l'accumulation, de la croissance et de la productivité du travail augmenter ou fluctuer à des niveaux élevés jusqu'à la réapparition de la crise ouverte au tournant des années 1960-70. L'épuisement des gains de productivité qui commence dès les années 60 entraîne les autres variables dans une chute de concert jusqu'au début des années 80. Depuis, le capitalisme est dans une situation tout à fait inédite sur le plan économique marquée par une configuration qui associe un taux de profit élevé avec une productivité du travail, un taux d'accumulation et donc un taux de croissance médiocres. Cette divergence entre l'évolution du taux de profit et les autres variables depuis plus de 20 ans ne peut se comprendre que dans le cadre de la décadence du capitalisme. Il n'en va pas ainsi pour le BIPR qui estime aujourd'hui que le concept de décadence est à reléguer aux poubelles de l'histoire : "Quel rôle joue donc le concept de décadence sur le terrain de la critique de l'économie politique militante, c'est-à-dire de l'analyse approfondie des phénomènes et des dynamiques du capitalisme dans la période que nous vivons ? Aucun. (...) Ce n'est pas avec le concept de décadence que l'on peut expliquer les mécanismes de la crise, ni dénoncer le rapport entre la crise et la financiarisation, le rapport entre celle-ci et les politiques des super-puissances pour le contrôle de la rente financière et de ses sources" (BIPR, "Éléments de réflexion sur les crises du CCI"). Ainsi, le BIPR préfère abandonner le concept clef de décadence qui fondait ses propres positions (8) pour lui substituer les concepts en vogue dans le milieu altermondialiste de 'financiarisation' et de 'rente financière' pour 'comprendre la crise et les politiques des super-puissances'. Il en arrive même à affirmer que "...ces concepts [notamment de décadence] sont étrangers à la méthode et à l'arsenal de la critique de l'économie politique" (idem). Pourquoi le cadre de la décadence est-il indispensable pour comprendre la crise aujourd'hui ? Parce que le déclin ininterrompu des taux de croissance depuis la fin des années 60 au sein des pays de l'OCDE, avec respectivement 5,2%, 3,5%, 2,8%, 2,6% et 2,2% pour les décennies 60, 70, 80, 90 et 2000-02, confirme le retour progressif du capitalisme à sa tendance historique ouverte par la Première Guerre mondiale. La parenthèse de l'exceptionnelle phase de croissance (1950-75) est définitivement close (9). Tel un ressort cassé qui, après un ultime sursaut, retrouve sa position d'origine, le capitalisme en revient inexorablement aux rythmes de croissance qui prévalaient en 1914-50. Contrairement à ce que crient sur tous les toits nos censeurs, la théorie de la décadence du capitalisme n'est en rien un produit spécifique de la stagnation des années trente (10). Elle constitue l'essence même du matérialisme historique, le secret enfin trouvé de la succession des modes de production dans l'histoire et, à ce titre, elle donne le cadre de compréhension pour analyser l'évolution du capitalisme et, en particulier, de la période qui s'est ouverte au moment de la Première Guerre mondiale. Elle a une portée générale ; elle est valable pour toute une ère historique et ne dépend aucunement d'une période particulière ou d'une conjoncture économique momentanée. D'ailleurs, même en intégrant l'exceptionnelle phase de croissance entre 1950 et 1975, deux guerres mondiales, la dépression des années 30 et plus de trente-cinq années de crise et d'austérité présentent un bilan sans appel de la décadence du capitalisme : à peine 30 à 35 années (en comptant large) de 'prospérité' pour 55 à 60 années de guerre et/ou de crise économique (et le pire est encore à venir !). La tendance historique au frein de la croissance des forces productives par des rapports capitalistes de production devenus obsolètes constitue la règle, le cadre qui permet de comprendre l'évolution du capitalisme, y compris l'exception de la phase de prospérité d'après la seconde guerre mondiale (nous y reviendrons dans de prochains articles). Par contre, à l'image du courant réformiste qui s'est laissé berner par les performances du capitalisme de la Belle Époque, c'est l'abandon de la théorie de la décadence qui est un pur produit des années de prospérité. Par ailleurs le graphique ci-dessus nous montre clairement que le mécanisme qui est à la base de la remontée du taux de profit n'est ni un regain de la productivité du travail, ni un allégement en capital. Ceci nous permet aussi de tordre définitivement le cou aux bavardages sur la prétendue 'nouvelle révolution technologique'. Certains universitaires, émerveillés qu'ils sont par l'informatique et tombant dans le panneau des campagnes de la bourgeoisie sur la 'nouvelle économie'... confondent la fréquence de leur ordinateur avec la productivité du travail : ce n'est pas parce que le Pentium 4 tourne deux cent fois plus rapidement que la première génération de ce processeur que l'employé de bureau tapera deux cent fois plus vite à sa machine et pourra accroître sa productivité d'autant. Le graphique ci-dessus montre clairement que la productivité du travail continue sa décroissance depuis les années 60. Et pour cause, malgré des profits restaurés, le taux d'accumulation (les investissements à la base de possibles gains de productivité) n'a pas repris. La 'révolution technologique' n'existe que dans les discours des campagnes bourgeoises et dans l'imagination de ceux qui les gobent. Plus sérieusement, ce constat empirique du ralentissement de la productivité (du progrès technique et de l'organisation du travail), ininterrompu depuis les années 60, contredit l'image médiatique, bien ancrée dans les esprits, d'un changement technologique croissant, d'une nouvelle révolution industrielle qui serait aujourd'hui portée par l'informatique, les télécommunications, Internet et le multimédia. Comment expliquer la force de cette mystification qui inverse la réalité dans la tête de chacun d'entre nous ? Tout d'abord, il faut rappeler que les progrès de productivité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale étaient bien plus spectaculaires que ce qui nous est présenté à l'heure actuelle comme 'nouvelle économie'. La diffusion de l'organisation du travail en trois équipes de 8 heures, la généralisation de la chaîne mobile dans l'industrie, les rapides progrès dans le développement et la généralisation des transports de tous types (camion, train, avion, voiture, bateau), la substitution du charbon par un pétrole meilleur marché, l'invention des matières plastiques et le remplacement de matériaux coûteux par ces dernières, l'industrialisation de l'agriculture, la généralisation du raccordement à l'électricité, au gaz naturel, à l'eau courante, à la radio et au téléphone, la mécanisation de la vie domestique via le développement de l'électroménager, etc. sont bien plus spectaculaires en termes de progrès de productivité que tout ce qu'apportent les développements dans l'informatique et les télécommunications. Dès lors, les progrès de productivité du travail n'ont fait que décroître depuis les Golden Sixties. Ensuite, parce qu'une confusion est entretenue en permanence entre l'apparition de nouveaux biens de consommation et les progrès de productivité. Le flux d'innovations, la multiplication de nouveautés aussi extraordinaires soient-elles (DVD, GSM, Internet, etc.) au niveau des biens de consommation ne recouvre pas le phénomène du progrès de la productivité. Ce dernier signifie la capacité à économiser sur les ressources requises pour la production d'un bien ou d'un service. L'expression progrès technique doit toujours être entendue dans le sens de progrès des techniques de production et/ou d'organisation, du strict point de vue de la capacité à économiser sur les ressources utilisées dans la fabrication d'un bien ou la prestation d'un service. Aussi formidables soient-ils, les progrès du numérique ne se traduisent pas dans des progrès significatifs de productivité au sein du processus de production. Là est tout le bluff de la 'nouvelle économie'. Enfin, contrairement aux affirmations de nos censeurs qui nient la réalité de la décadence et la validité des apports théoriques de Rosa Luxemburg - et qui font de la baisse tendancielle du taux de profit l'alpha et l'oméga de l'évolution du capitalisme -, le cours de l'économie depuis le début des années 80 nous montre clairement que ce n'est pas parce que ce taux remonte que la croissance repart. Il y a certes un lien fort entre le taux de profit et le taux d'accumulation mais il n'est ni mécanique, ni univoque : ce sont deux variables partiellement indépendantes. Ceci contredit formellement les affirmations de ceux qui font obligatoirement dépendre la crise de surproduction de la chute du taux de profit et le retour de la croissance de sa remontée : "Cette contradiction, la production de la plus-value et sa réalisation, apparaît comme une surproduction de marchandises et donc comme cause de la saturation du marché, qui à son tour s'oppose au processus d'accumulation, ce qui met le système dans son ensemble dans l'impossibilité de contrebalancer la chute du taux de profit. En réalité, le processus est inverse. (...) C'est le cycle économique et le processus de valorisation qui rendent 'solvable' ou 'insolvable' le marché. C'est partant des lois contradictoires qui règlent le processus d'accumulation que l'on peut arriver à expliquer la 'crise' du marché" (Texte de présentation de Battaglia Comunista à la première conférence des groupes de la Gauche communiste, mai 1977). Aujourd'hui nous pouvons clairement constater que le taux de profit remonte depuis près d'une vingtaine d'années alors que la croissance reste déprimée et que la bourgeoisie n'a jamais autant parlé de déflation qu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que le capitalisme parvient à produire avec suffisamment de profit qu'il crée automatiquement, par ce mécanisme même, le marché solvable où il sera capable de transformer le surtravail cristallisé dans ses produits en plus-value sonnante et trébuchante lui permettant de réinvestir ses profits. L'importance du marché ne dépend pas automatiquement de l'évolution du taux de profit ; tout comme les autres paramètres conditionnant l'évolution du capitalisme, c'est une variable partiellement indépendante. C'est la compréhension de cette différence fondamentale entre les conditions de la production et celles de la réalisation, déjà bien mise en évidence par Marx et magistralement approfondie par Rosa Luxemburg, qui nous permet de comprendre pourquoi il n'y a pas d'automatisme entre le taux de profit et la croissance.
Décadence et orientations pour les luttes de résistance
Rejetant la décadence comme cadre de compréhension de la période actuelle et de la crise, pointant la spéculation financière comme la cause de tous les malheurs du monde, sous-estimant le développement du capitalisme d'État sur tous les plans, les deux plus importants groupes de la Gauche communiste en dehors du CCI - Programme Communiste et le BIPR - ne peuvent offrir une orientation claire et cohérente aux luttes de résistance de la classe ouvrière. Il suffit de lire les analyses qu'ils font de la politique de la bourgeoisie en matière d'austérité et les conclusions qu'ils tirent de leur analyse de la crise pour s'en rendre compte : "Courant des années 50 les économies capitalistes se remirent en route et la bourgeoisie vit enfin refleurir de manière durable ses profits. Cette expansion, qui s'est poursuivie la décennie suivante, s'est donc appuyée sur un essor du crédit et s'est faite avec l'appui des États. Elle s'est traduite indéniablement par une amélioration des conditions de vie des travailleurs (sécurité sociale, conventions collectives, relèvement des salaires...). Ces concessions faites, par la bourgeoisie, sous la pression de la classe ouvrière, se traduisirent par une baisse du taux de profit, phénomène en lui-même inéluctable, lié à la dynamique interne du capital. (...) Si au début du stade de l'impérialisme, les profits engrangés grâce à l'exploitation des colonies et de leurs peuples avaient permis aux bourgeoisies dominantes de garantir une certaine paix sociale en faisant bénéficier la classe ouvrière d'une fraction de l'extorsion de la plus-value, il n'en est plus de même aujourd'hui, la logique spéculative impliquant une remise en cause de tous les acquis sociaux arrachés lors des décennies précédentes par les travailleurs des 'pays centraux' à leur bourgeoisie" (BIPR, in Bilan et perspectives n°4, p. 5 à 7). Ici aussi, nous pouvons constater que l'abandon du cadre de la décadence ouvre toutes grandes les portes aux concessions envers les analyses gauchistes. Le BIPR préfère recopier les fables gauchistes sur les 'acquis sociaux (sécurité sociale, conventions collectives, relèvement des salaires,...)' qui auraient été des 'concessions faites par la bourgeoisie sous la pression de la classe ouvrière' et que 'la logique spéculative' actuelle remet en cause, plutôt que de s'appuyer sur les contributions théoriques léguées par les groupes de la Gauche communiste internationale (Bilan, Communisme, etc.), qui analysaient ces mesures comme des moyens mis en place par la bourgeoisie pour faire dépendre et rattacher la classe ouvrière à l'État ! En effet, dans la phase ascendante du capitalisme, le développement des forces productives et du prolétariat était insuffisant pour menacer la domination bourgeoise et permettre une révolution victorieuse à l'échelle internationale. C'est pourquoi, même si la bourgeoisie a tout fait pour saboter l'organisation du prolétariat, ce dernier a pu, au fur et à mesure de ses combats acharnés, se constituer en tant que 'classe pour soi' au sein du capitalisme au travers de ses propres organes qu'étaient les partis ouvriers et les syndicats. L'unification du prolétariat s'est réalisée au travers des luttes pour arracher au capitalisme des réformes se traduisant par des améliorations des conditions d'existence de la classe : réformes sur le terrain économique et réformes dans le domaine politique. Le prolétariat a acquis, en tant que classe, le droit de cité dans la vie politique de la société, ou, pour reprendre les termes de Marx dans la Misère de la philosophie : la classe ouvrière a conquis le droit d'exister et de s'affirmer de façon permanente dans la vie sociale en tant que 'classe pour soi', c'est-à-dire en tant que classe organisée avec ses propres lieux de rencontre quotidiens, ses idées et son programme social, ses traditions et même ses chants. Lors de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence en 1914, la classe ouvrière a démontré sa capacité à renverser la domination de la bourgeoisie en forçant celle-ci à arrêter la guerre et en développant une vague internationale de luttes révolutionnaires. Depuis ce moment, le prolétariat constitue un danger potentiel permanent pour la bourgeoisie. C'est pourquoi elle ne peut plus tolérer que sa classe ennemie puisse s'organiser de façon permanente sur son propre terrain, puisse vivre et croître au sein de ses propres organisations. L'État étend sa domination totalitaire sur tous les aspects de la vie de la société. Tout est enserré par ses tentacules omniprésents. Tout ce qui vit dans la société doit se soumettre inconditionnellement à l'État ou affronter ce dernier dans un combat à mort. Le temps où le capital pouvait tolérer l'existence d'organes prolétariens permanents est révolu. L'État chasse de la vie sociale le prolétariat organisé comme force permanente. De même, "Depuis la Première Guerre mondiale, parallèlement au développement du rôle de l'État dans l'économie, les lois régissant les rapports entre capital et travail se sont multipliées, créant un cadre strict de 'légalité' au sein duquel la lutte prolétarienne est circonscrite et réduite à l'impuissance." (extrait de notre brochure Les syndicats contre la classe ouvrière). Ce capitalisme d'État sur le plan social signifie la transformation de toute vie de la classe en ersatz sur le terrain bourgeois. L'État s'est saisi, par le biais des syndicats dans certains pays, directement dans d'autres, des différentes caisses de grèves ou d'organisations de secours et mutuelles en cas de maladie ou de licenciement qui avaient été mis en place par la classe ouvrière tout au long de la seconde moitié du 19e siècle. La bourgeoisie a retiré la solidarité politique des mains du prolétariat pour la transférer en solidarité économique aux mains de l'État. En subdivisant le salaire en une rétribution directe par le patron et une rétribution indirecte par l'État, la bourgeoisie a puissamment consolidé la mystification consistant à présenter l'État comme un organe au dessus des classes, garant de l'intérêt commun et garant de la sécurité sociale de la classe ouvrière. La bourgeoisie est parvenue à lier matériellement et idéologiquement la classe ouvrière à l'État. Tel était l'analyse de la Gauche italienne et de la Fraction belge de la Gauche communiste internationale à propos des premières caisses d'assurances chômage et de secours mutuel mis en place par l'État pendant les années 30 (11). Que dit le BIPR à la classe ouvrière ? Tout d'abord que la 'logique spéculative' serait responsable de la "remise en cause de tous les acquis sociaux" ... et revoilà le mal absolu de la 'financiarisation' ! Le BIPR oublie au passage que la crise et les attaques contre la classe ouvrière n'ont pas attendu l'apparition de 'la logique spéculative' pour pleuvoir sur le prolétariat. Le BIPR croit-il réellement, comme sa prose le sous-tend, que les lendemains chanteront pour la classe ouvrière une fois la 'logique spéculative' éradiquée ? Au contraire, cette mystification gauchiste qui prétend que la lutte contre l'austérité dépendrait de la lutte contre la logique spéculative est à combattre le plus vigoureusement possible ! Mais il y a plus grave ! C'est une grossière mystification que de faire croire au prolétariat que la sécurité sociale, les conventions collectives et même le mécanisme de relèvement des salaires via l'indexation ou l'échelle mobile seraient des 'acquis sociaux arrachés de haute lutte'. Oui, la réduction horaire de la journée de travail, l'interdiction de l'exploitation des enfants, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, etc. ont constitué de véritables concessions arrachées de haute lutte par la classe ouvrière en phase ascendante du capitalisme. Par contre, les prétendus 'acquis sociaux' comme la sécurité sociale ou les conventions collectives consignées dans les Pactes Sociaux pour la Reconstruction n'ont rien à voir avec la lutte de la classe ouvrière. Classe défaite, épuisée par la guerre, enivrée et mystifiée par le nationalisme, saoulée d'euphorie à la Libération, ce n'est pas elle qui, par ses luttes, aurait arraché ces 'acquis'. C'est à l'initiative même de la bourgeoisie au sein des gouvernements en exil que des Pactes Sociaux pour la Reconstruction ont été élaborés mettant en place tous ces mécanismes de capitalisme d'État. C'est la bourgeoisie qui a pris l'initiative, entre 1943 et 1945, en pleine guerre (!), de réunir toutes 'les forces vives de la nation', tous les 'partenaires sociaux', au travers de réunions tripartites composées de représentants du patronat, du gouvernement et des différents partis et syndicats, c'est-à-dire dans la plus parfaite des concordes nationales du mouvement de la Résistance, pour planifier la reconstruction des économies détruites et négocier socialement la difficile phase de reconstruction. Il n'y a pas eu de 'concessions faites par la bourgeoisie sous la pression de la classe ouvrière' dans le sens d'une bourgeoisie contrainte d'accepter un compromis face à une classe ouvrière mobilisée sur son terrain et développant une stratégie en rupture avec le capitalisme, mais des moyens mis en place de concert par toutes les composantes de la bourgeoisie (patronat, syndicat, gouvernement) pour contrôler socialement la classe ouvrière afin de réussir la reconstruction nationale (12). Faut-il rappeler que c'est aussi la bourgeoisie qui, dans l'immédiat après-guerre, a carrément créé de toutes pièces des syndicats comme la CFTC en France ou la CSC en Belgique ? Il est évident que les révolutionnaires dénoncent tout empiétement tant sur le salaire direct que sur le salaire indirect, il est évident que les révolutionnaires dénoncent les atteintes au niveau de vie lorsque la bourgeoisie réduit la sécurité sociale à une peau de chagrin, mais jamais les révolutionnaires ne peuvent défendre le principe même du mécanisme mis en place par la bourgeoisie pour relier la classe ouvrière à l'État (13) ! Les révolutionnaires doivent au contraire dénoncer les logiques idéologiques et matérielles qui sous-tendent ces mécanismes comme la prétendue 'neutralité de l'État', la 'solidarité sociale organisée par l'État', etc. Face aux enjeux posés par l'aggravation générale des contradictions du mode de production capitaliste et face aux difficultés que rencontre la classe ouvrière pour faire face à ces enjeux, il appartient aux révolutionnaires de développer l'approfondissement nécessaire pour répondre aux nouvelles questions posées par l'histoire. Mais cet approfondissement ne saurait se baser sur les analyses frelatées colportées par les secteurs d'extrême gauche de l'appareil politique de la bourgeoisie. C'est uniquement en s'appuyant sur le marxisme et sur les acquis de la Gauche communiste, notamment sur l'analyse de la décadence du capitalisme, que les révolutionnaires seront à la hauteur de leur responsabilité.
C. Mcl
(1) Puisque, comme l'écrit Marx, "Le capital suppose donc le travail salarié, le travail salarié suppose le capital. Ils sont la condition l'un de l'autre; ils se créent mutuellement." (Travail salarié et capital)
(2) Nous ne pouvons, dans le cadre de cet article, revenir sur ce que Marx et les théoriciens marxistes ont écrit sur les contradictions qu'engendre la généralisation du travail salarié, c'est-à-dire de la transformation de la force de travail en marchandise. Pour plus de précisions sur ces travaux des marxistes, nous renvoyons le lecteur notamment à notre brochure "La décadence du capitalisme" ainsi qu'à nos articles de la Revue internationale.
(3) "À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient ces rapports en deviennent des entraves." (Karl Marx, Préface de "Introduction à la critique de l'économie politique")
(4) Malheureusement, Lénine n'est pas ici d'un grand secours car son étude sur l'impérialisme, pour décisive qu'elle soit sur certains aspects de l'évolution du capitalisme et des enjeux inter-impérialistes au tournant du 19e au 20e siècle, accorde une importance démesurée au rôle du capital financier et passe à côté de processus bien plus fondamentaux à l'époque comme le développement du capitalisme d'État (cf. Revue internationale n°19 "Sur l'impérialisme" et Révolution Internationale n°3 et 4 "Capitalisme d'État et loi de la valeur"). Capitalisme d'État qui, contrairement à l'analyse de Hilferding-Lénine, restreindra drastiquement le pouvoir de la finance à partir de l'expérience de la crise de 29 pour ensuite lui réouvrir progressivement les portes d'une certaine liberté à partir des années 80. Ce qui est décisif ici, c'est que ce sont les États nations qui ont commandé le mouvement et non l'internationale fantôme de l'oligarchie financière qui aurait imposé son diktat un soir de 1979 à Washington.
(5) Il suffit, pour bien s'en convaincre, d'imaginer deux situations limites : dans l'une toutes les machines ont été détruites et seuls les hommes subsistent et dans l'autre toute l'humanité est décimée et seules les machines restent !
(6) D'ailleurs, le fait que les taux d'autofinancement des entreprises sont supérieures à 100% depuis un bon moment réduit cette thèse à néant puisque cela veut dire que les entreprises n'ont pas besoin de la finance pour financer leurs investissements.
(7) La part des salaires dans la valeur ajoutée en Europe est passée de 76% à 68% entre 1980 et 1998 et, comme les inégalités salariales se sont notablement accrues au cours de la même période, cela signifie que la diminution du salaire moyen des travailleurs est bien plus conséquente que ne le laisse entrevoir cette statistique.
(8) Citons, entre autre, le texte du BIPR présenté à la première conférence des groupes de la Gauche communiste ; extrait du paragraphe intitulé "Crise et décadence" : "Quand ceci a commencé à se manifester le système capitaliste a cessé d'être un système progressif, c'est-à-dire nécessaire au développement des forces productives, pour entrer dans une phase de décadence caractérisée par des essais de résoudre ses propres contradictions insolubles, se donnant de nouvelles formes organisatives d'un point de vie productif (...) En effet, l'intervention progressive de l'État dans l'économie doit être considérée comme le signe de l'impossibilité de résoudre les contradictions qui s'accumulent à l'intérieur des rapports de production et est donc le signe de sa décadence".
(9) Nous renvoyons le lecteur à la publication du rapport de notre 15e congrès international sur la crise économique dans le numéro précédent de cette revue qui, sans que cela n'enlève rien au caractère exceptionnel de la période 1950-75, démystifie tout d'abord les taux de croissance calculés dans la période de décadence et ensuite démystifie ceux concernant en particulier la période d'après la Seconde Guerre mondiale qui sont très nettement surestimés.
(10) * "... la théorie de la décadence, telle qu'elle découle des conceptions de Trotski, de Bilan, de la GCF et du CCI, n'est plus adaptée aujourd'hui à la compréhension du développement réel du capitalisme tout au long du 20e siècle, et notamment à compter de 1945 (...) En ce qui concerne les communistes de la première moitié du siècle, cela peut s'expliquer assez facilement : les événements qui se succèdent sur trois décennies, entre 1914 et 1945, sont tels (...) qu'ils paraissent donner du crédit à la thèse du déclin historique du capitalisme et confirmer les prévisions faites ; il était logique de ne voir dans le capitalisme qu'un système en putréfaction, à bout de souffle et décadent" (Cercle de Paris, in "Que ne pas faire ?", p.31). * "Le concept de décadence du capitalisme a surgi dans la 3e Internationale, où il a été développé en particulier par Trotsky (...) Trotsky précisa sa conception en assimilant la décadence du capitalisme à un arrêt pur et simple de la croissance des forces productives de la société (...) Cette vision semblait assez bien correspondre à la réalité de la première moitié de ce siècle (...) La vision de Trotsky fut reprise pour l'essentiel par la Gauche italienne regroupée dans Bilan avant la 2ème guerre mondiale, puis par la Gauche Communiste de France (GCF) après celle-ci." (Perspective Internationaliste, "Vers une nouvelle théorie de la décadence du capitalisme"). * "L'hypothèse d'un 'frein irréversible' des forces productives n'est que la déduction, sur le plan théorique, d'une impression générale léguée par la période qui marque l'entre deux guerres où l'accumulation capitaliste a, de manière conjoncturelle, du mal à redémarrer." (Communisme ou Civilisation, 'Dialectique des forces productives et des rapports de production dans la théorie communiste'). * "Après la Deuxième Guerre mondiale, tant les trotskistes que les communistes de gauche ré-émergèrent avec la conviction raffermie que le capitalisme était décadent et au bord de l'effondrement. Considérant la période qui venait tout juste de s'écouler, la théorie ne paraissait pas si irréaliste, le krach de 1929 avait été suivi par la dépression durant la majeure partie des années 30 et ensuite par une autre guerre catastrophique (...) Maintenant, de même que nous pouvons dire que les communistes de gauche ont défendu les vérités importantes de l'expérience de 1917-21 contre la version léniniste des trotskistes, leur objectivisme économique et la théorie mécanique des crises et de l'effondrement, qu'ils partagent avec les léninistes, les rendirent incapables de répondre à la nouvelle situation caractérisée par un 'boom' de longue durée (...) Après la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme entra dans une de ses périodes d'expansion les plus soutenues, avec des taux de croissance non seulement plus hauts que ceux de l'entre-deux-guerres mais même plus hauts que ceux du grand 'boom' du capitalisme classique..." (Aufheben, "Sur la décadence, théorie du déclin ou déclin de la théorie").
(11) Lire "Une autre victoire du capitalisme : l'assurance chômage obligatoire" dans Communisme n°15, juin 1938 ; ainsi que "Les syndicats ouvriers et l'État" dans le n°5 de la même revue.
(12) Des luttes sociales il y en eut pendant la guerre, mais aussi et surtout dans l'immédiat après-guerre, compte tenu des conditions de vie catastrophiques. Mais en général, à quelques exceptions notables près comme dans le Nord de l'Italie ou dans la vallée de la Ruhr, elles ne présentaient aucune menace réelle pour le capitalisme. Ces luttes étaient toutes bien encadrées, contrôlées et souvent brisées par les partis de gauche et les syndicats au nom de la nécessaire concorde nationale en vue de la reconstruction.
(13) Ce qui est proprement incroyable c'est que le BIPR range également dans la catégorie des 'acquis sociaux' les 'conventions collectives' qui sont, on ne peut plus clairement, la codification et l'imposition de la paix sociale par la bourgeoisie dans les entreprises !
Récent et en cours:
- Crise économique [96]
Questions théoriques:
- L'économie [113]
Réponse au MLP (Russie) : Révolution socialiste du prolétariat contre 'Droit des nations a l'autodétermination'
- 4498 reads
Dans de précédents numéros de la Revue Internationale (1) nous avons publié un nombre important de courriers échangés avec le Marxist Labour Party en Russie. L'axe principal de cet échange portait sur nos désaccords à propos du problème de la décadence du capitalisme et de ses implications pour certaines questions-clés, en particulier celles de la nature de classe de la révolution d'Octobre et du problème de la "libération nationale".
Nous avons reçu des nouvelles d'une scission au sein du groupe ; il y aurait maintenant deux MLP, l'un se faisant appeler le MLP (Bolchevik) et l'autre - celui avec lequel nous avons mené le débat jusqu'à présent- le MLP (Bureau Sud). Dans le but de clarifier une situation plutôt confuse et de mieux comprendre la position du MLP (Bureau Sud) concernant des questions fondamentales de l'internationalisme prolétarien, nous lui avons envoyé une série de questions (pour le reste de cet article, MLP signifie MLP Bureau Sud, sauf indication contraire). Nous publions une partie de la réponse du MLP et la nôtre, une fois de plus centrées sur nos divergences sur la question nationale. Entre temps, nous avons reçu une nouvelle réponse du MLP sur cette question ; nous y reviendrons ultérieurement ainsi que sur d'autres questions, en particulier l'anti-fascisme et la nature de la Seconde guerre mondiale.
LETTRE du MLP
Camarades !
Bien que votre lettre soit adressée au "Bureau Sud du MLP", nous avons également transmis son contenu à nos camarades de l'organisation qui ne vivent pas seulement dans le Sud de la Russie. Voici notre réponse collective :
1. Considérez-vous le soutien aux luttes de libération nationale possible au 20ème siècle ?
Nous pensons qu'avant de se prononcer pour ou contre le soutien aux luttes de libération nationale au 20ème siècle, il faut bien comprendre ce qu'est une lutte de libération en tant que telle. Mais en retour, c'est difficile à faire si on n'a pas au préalable déterminé plus ou moins clairement ce qu'est une "nation".
De plus, selon nous, on devrait clarifier ce qu'était l'attitude de Marx et Engels par rapport à cette question à leur époque, ainsi que la position des bolcheviks-léninistes, aussi bien avant qu'après la révolution d'Octobre 1917. Finalement, il faudrait considérer l'évolution du point de vue de l'Internationale communiste sur ces problèmes.
2. Reconnaissez-vous un "droit à l'autodétermination des nations", ou rejetez-vous une telle formule ?
Le mouvement de libération nationale est quelque chose d'objectif. Il indique qu'un peuple ou un autre a pris le chemin de son propre développement capitaliste et que le groupe ethnique correspondant est soit sur le point de devenir une nation BOURGEOISE, soit a déjà franchi ce pas. Contrairement à ce que veut la tradition de l'Internationale communiste bolchevique qui non seulement apportait son soutien aux mouvements de libération nationale comme étant bourgeois progressifs, mais en plus s'orientait vers la création de partis communistes (!) dans des pays arriérés, partis constitués de la paysannerie sous la direction de l'intelligentsia nationale progressive/révolutionnaire, et s'engageait à lutter pour l'établissement d'un pouvoir soviétique sans la présence minimale d'un prolétariat industriel sur place (la fameuse théorie du "développement non capitaliste" ou de "l'orientation socialiste dans les pays en développement"), le MLP (à ne pas confondre avec le MLP (B) !) considère que le soutien à des mouvements de libération nationale ne fait que créer l'illusion qu'on peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur de frontières nationales. En particulier, cette illusion trouve son expression dans le slogan "marxiste-léniniste" : "de la libération nationale à la libération sociale ! ".
Seule la révolution sociale mondiale est capable de résoudre les problèmes nationaux, entre autres. La participation à quelque mouvement de libération nationale que ce soit, par exemple pour la séparation étatique d'une nouvelle nation bourgeoise, n'est pas une tâche spécifique des marxistes. En même temps, nous ne sommes pas des opposants aux mouvements de libération nationale. Comme, par exemple, pour ce qui est du mouvement politique qui a surgi en faveur de la séparation de la Tchétchénie d'avec la Russie, auquel certains membres du MLP(B) participent activement. Si la majorité de la population d'une certaine nationalité, sur un territoire historique déterminé, a décidé de faire usage du "droit des nations à l'autodétermination" contre "l'expansion impérialiste", nous ne nous opposerons pas à une telle position, à deux conditions: a) si la séparation territoriale est à même de mettre fin au massacre sanglant de nombreuses victimes dans les rangs de la population travailleuse des deux bords; b) si l'indépendance étatique d'une nouvelle nation bourgeoise mène plus vite à la situation dans laquelle cette nation verra émerger et se renforcer son propre prolétariat industriel, qui lancera alors sa lutte de classe contre la bourgeoisie nationale locale, ne se faisant plus d'illusion sur toute autre "libération" que la libération sociale. Avant que les prolétaires de tous les pays puissent s'unifier, il faut tout simplement qu'il existe des prolétaires dans ces pays !
3. Considérez-vous toutes les fractions de la bourgeoisie également réactionnaires au 20ème siècle - depuis le début de la Première guerre mondiale- et si ce n'est pas le cas, quels sont vos critères ?
Ici aussi, il est nécessaire de définir d'abord ce qu'il faut entendre par "réactionnaire". Le mot "réactionnaire" signifie dans son premier sens "agissant contre le progrès" ou, plus exactement, "contrecarrant les pas en avant". Il est clair, cependant, que cette définition est très générale. Etant marxistes, nous pouvons et devons parler de cette sorte de réaction qui s'oppose au désir d'en finir avec le mode de production bourgeois-capitaliste et la société de classe (propriété privée et exploitation) comme un tout, qui empêche le genre humain d'avancer vers le communisme. En même temps, les classiques du marxisme nous ont appris à comprendre le caractère progressif du mode de production bourgeois-capitaliste en regard des modes de production le précédant et des structures socio-économiques arriérées coexistant avec lui dans le cadre de la société de classe. Ils nous ont aussi appris à distinguer les étapes progressives du développement de ce mode de production lui-même. Selon nous, toute autre démarche serait scolastique et dogmatique, mais ni historique ni dialectique ! Au 20ème siècle, la production petite-bourgeoise et paysanne faisait place à la production capitaliste à grande échelle. Du point de vue marxiste, les forces productives changent la structure sociale de la société au cours de leur développement. Ceci est objectivement progressif. Selon nous, quand on se réfère au 20ème siècle, on devrait parler non de décadence du capitalisme en soi, mais seulement du processus par lequel la forme d'Etat national du capitalisme survit à sa nécessité, c'est à dire qu'une étape bien définie de son développement est épuisée. Et on ne peut pas dire qu'avec le début de la Première Guerre mondiale, le capitalisme a sans équivoque épuisé son caractère progressif. Selon nous, ce processus ne prend cours que vers le milieu du vingtième siècle. Une manifestation évidente en est l'actuelle mondialisation et l'unification économique de l'Europe, par exemple. C'est à notre époque que le capitalisme a commencé à épuiser son caractère progressif. Le moment approche de le liquider à l'échelle internationale par la révolution sociale mondiale. (...)
REPONSE DU CCI
Les Communistes et la question nationale
Parmi les différentes questions posées par ce courrier, nous avons choisi de répondre en premier lieu à celle que nous estimons particulièrement importante à clarifier. C'est une question qui est aussi présente parmi les éléments et les groupes politiques émergents en Russie. C'est la question nationale et, en particulier, la position communiste par rapport aux luttes de libération nationale et le fameux slogan de Lénine sur le "droit des nations à l'autodétermination". Bien que dans sa réponse à notre lettre, le MLP souligne qu'il ne soutient pas les mouvements de libération nationale, parce que ceux-ci "créent l'illusion qu'on peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur de frontières nationales", en même temps, il trouve certaines occasions où il ne s'y opposerait pas. C'est quand "la majorité de la population d'une certaine nationalité, sur un territoire historique déterminé, a décidé de faire usage du "droit des nations à l'autodétermination" contre "l'expansion impérialiste"�" Ces occasions sont les suivantes : dans le cas où la séparation peut mettre fin à un massacre sanglant, ou dans le cas où la création d'un nouvel Etat indépendant pourrait conduire au renforcement du prolétariat dans cette nouvelle nation et plus tard, à une lutte de classe contre la bourgeoisie nationale locale.
Ce que cela signifie concrètement pour le MLP, c'est qu'il ne "[s'oppose pas] aux mouvements de libération nationale. Comme, par exemple, pour ce qui est du mouvement politique qui a surgi en faveur de la séparation de la Tchétchénie d'avec la Russie, auquel certains membres du MLP(B) participent activement". Tout d'abord, nous trouvons très étrange que le MLP dise qu'il n'est pas contre le mouvement de libération nationale et, en même temps, qu'il n'est pas pour. Le MLP est-il indifférent ou simplement ne combat-il pas activement l'idéologie de la libération nationale qui pourtant, comme il le dit, "crée l'illusion qu'on peut résoudre les problèmes sociaux à l'intérieur de frontières nationales" ? Que veut dire le MLP quand il écrit que la participation aux mouvements de libération nationale "n'est pas une tâche spécifique des marxistes"? Et pourtant, le MLP ne s'oppose pas aux activités de membres du MLP(B) qui "participent activement" à un mouvement séparatiste tchétchène. Comment interpréter tout cela?
Selon nous, cela exprime une position hautement opportuniste sur la question des mouvements de libération nationale. Nous avons l'impression que ce flou dans les prises de position n'est rien d'autre qu'une ouverture de certains membres du MLP à la participation à de tels mouvements. En fait, la position du MLP ouvre la porte au soutien à n'importe quelle lutte de libération nationale, parce qu'il sera toujours possible de trouver un critère d'application. Il y a beaucoup d'occasions où le MLP pourrait prétendre qu'une séparation nationale pourrait mettre fin à un massacre sanglant. Par exemple, en 1947, cette position aurait logiquement poussé le MLP à soutenir la séparation de l'Inde et du Pakistan pour faire cesser les massacres entre musulmans et hindous. La querelle qui s'en est suivie à propos du Jammu-et-Cachemire entre l'Inde et le Pakistan est sans doute aussi un bon exemple de comment le "droit des nations à l'autodétermination" (à ce moment-là au nom de l'Independence Act britannique) ne peut conduire qu'à des bains de sang plus nombreux encore. Aujourd'hui, nous voyons comment les dangereux conflits et les tensions constantes entre Pakistan et Inde menacent de morts par millions cette zone très densément peuplée au travers d'un conflit nucléaire entre les deux pays - qui se rajouteraient à tous les morts du conflit autour du Cachemire (2). Cet exemple montre à quel point le critère mis en avant par le MLP pour "ne pas s'opposer" à la séparation d'un nouvel Etat est absurde et non marxiste. L'autre critère utilisé par le MLP est l'hypothèse qu'une séparation pourrait mener à un développement de l'industrie et par conséquent à un développement du prolétariat et, à terme, à l'augmentation de la lutte de classe contre la "bourgeoisie nationale locale".
Le MLP ne partage pas l'analyse d'un "déclin du capitalisme" (le passage du capitalisme d'une phase progressiste à une phase de décadence) avant le milieu du 20ème siècle. Pour ce qui est de la seconde moitié de ce siècle, il devrait alors tirer les conséquences du changement de période. Ce que ne furent pas capable de faire, dans les années 1970 en Europe, plusieurs groupes qui, bien que proches des positions prolétariennes, apportaient leur soutien "critique" au FLN vietnamien parce que, disaient-ils, celui-ci devait instaurer un nouvel Etat bourgeois qui ferait avancer l'industrialisation et développerait le prolétariat. Dès que la bourgeoisie nationale serait victorieuse, disaient-ils, le prolétariat devrait immédiatement se retourner contre celle-ci. Cette fausse application du marxisme était et est encore aujourd'hui (dans le meilleur des cas) une couverture vis-à-vis de concessions opportunistes à l'idéologie bourgeoise. Cette position est très proche de celle du trotskisme qui trouve toujours une excuse pour soutenir les prétendues luttes de libération nationale, alors qu'en fait, elles ne sont rien d'autre à notre époque qu'une couverture des conflits impérialistes qui déchirent le monde. Ces remarques préliminaires mettent en évidence la nécessité de recourir à un cadre marxiste à travers la question suivante (et qui est aussi posée par le MLP au début de sa réponse à nos questions) : quelle a été l'attitude de Marx et Engels envers les luttes de libération nationale et quelle était la position des communistes sur cette question, depuis la gauche de Zimmerwald jusqu'à l'Internationale communiste ? Finalement, quelle doit être la position des communistes sur cette question aujourd'hui?
L'Etat national
Le MLP dit fort judicieusement qu'avant de prendre position pour ou contre les luttes de libération nationale, il faut comprendre le point de vue marxiste sur la nature de ces luttes et aussi sur le concept de nation. Le concept de nation n'est pas un concept abstrait et absolu, mais peut seulement être compris dans un contexte historique. Rosa Luxemburg donne une définition de ce concept dans sa Brochure de Junius: "L'Etat national, l'unité et l'indépendance nationales, tels étaient les drapeaux idéologiques sous lesquels se sont constitués les grands Etats bourgeois du c�ur de l'Europe au siècle dernier. Le capitalisme est incompatible avec le particularisme des petits Etats, avec un émiettement politique et économique ; pour s'épanouir, il lui faut un territoire cohérent aussi grand que possible, d'un même niveau de civilisation ; sans quoi on ne pourrait élever les besoins de la société au niveau requis pour la production marchande capitaliste, ni faire fonctionner le mécanisme de la domination bourgeoise moderne. Avant d'étendre son réseau sur le globe tout entier, l'économie capitaliste a cherché à se créer un territoire d'un seul tenant dans les limites nationales d'un Etat."". C'est dans ce sens que Marx et Engels, à différentes occasions, ont défendu le soutien à certaines luttes de libération nationale. Ils n'ont jamais fait cela par principe, mais seulement dans les cas où ils pensaient que la création de nouveaux Etats pouvait conduire à un réel développement du capitalisme contre les forces féodales. La création de nouveaux Etats nationaux pouvait, à cette époque en Europe, être accomplie uniquement par des mesures révolutionnaires et jouer un rôle historiquement progressif dans la lutte de classe de la bourgeoisie contre le pouvoir féodal: "Le programme national n'a joué un rôle historique en tant qu'expression idéologique de la bourgeoisie montante, aspirant au pouvoir dans l'Etat, que jusqu'au moment où la société bourgeoise s'est tant bien que mal installée dans les grands Etats du centre de l'Europe et y a créé les instruments et les conditions indispensables de sa politique." (Rosa Luxemburg, Brochure de Junius).
La méthode qu'utilisaient Marx et Engels n'était pas basée sur un slogan abstrait mais toujours sur l'analyse de chaque cas, sur une analyse du développement politique et économique de la société. "Marx, cependant, qui n'accordait pas le moindre crédit à cette formule abstraite [au droit des nations à l'autodétermination],condamna alors les Tchèques et leurs aspirations à la liberté, car il les considérait comme une complication nuisible de la situation révolutionnaire, et sa condamnation vigoureuse était d'autant plus justifiée que, selon Marx, les Tchèques étaient une nationalité en déclin, vouée à disparaître rapidement". (Rosa Luxemburg, La question nationale et l'autonomie)
Marx et Engels n'ont pas toujours eu raison dans leurs analyses, comme Rosa Luxemburg a pu le montrer par exemple dans le cas de la Pologne. La définition d'une nation n'est pas basée sur quelque critère abstrait comme une langue et une culture communes, mais sur un contexte historique précis. Dans une société de classe, une nation n'est pas quelque chose d'homogène, mais est divisée en classes dont les intérêts, les points de vue, la culture, l'éthique, etc. sont antagoniques. La notion abstraite de "droits" des nations ne peut recouvrir que les "droits" de la bourgeoisie.
De tout ceci découle qu'il ne peut pas exister quelque chose comme la volonté uniforme d'une nation, la volonté d'autodétermination. Derrière ce slogan, il y a une concession à l'idée que, pour atteindre le socialisme, il est indispensable de passer par le stade démocratique. Derrière cela, il y a aussi l'idée qu'il doit y avoir un moyen de déterminer la "volonté" du peuple. Le MLP utilise l'expression "la majorité de la population d'une certaine nationalité". Dans cette expression, il y a deux concepts abstraits. D'abord la "volonté de la population" suppose qu'il y aurait une voie pacifique, par-dessus les réels antagonismes de classe, permettant de décider (peut-être par un référendum -comme c'était proposé par les bolcheviks) du sort des nations. Deuxièmement, l'utilisation du terme "nationalité" est très vague. S'il signifie un groupe ethnique ou culturel spécifique, la relation à l'autodétermination est très incertaine. La nation est une catégorie historique et la création de l'Etat national joue un certain rôle historique pour la bourgeoisie. L'Etat national n'est pas seulement un cadre dans lequel la bourgeoisie peut développer et défendre son économie et son système d'exploitation, c'est aussi en même temps un outil offensif contre d'autres Etats nationaux pour la conquête et la domination politiques, pour la suppression d'autres nations. Ainsi, le "droit des nations à l'autodétermination" est dans la vie réelle, un "droit" de toute bourgeoisie de supprimer les "droits" des autres nations, des autres groupes ethniques, des autres langues et des autres cultures. Le "droit des nations à l'autodétermination" n'est rien d'autre qu'une utopie abstraite qui ne fait que laisser entrer par la porte de derrière le nationalisme de la bourgeoisie.
Le débat dans la Gauche de Zimmerwald
Au sein de la Gauche de Zimmerwald - courant internationaliste qui s'est opposé le plus fermement à la Première Guerre mondiale - une discussion a vu le jour sur la question du slogan du "droit des nations à l'autodétermination". Ce slogan émanait de la Seconde Internationale : "Dans la Seconde Internationale, il jouait un rôle double : d'une part, il était supposé exprimer une protestation contre toute oppression nationale et, d'autre part, il montrait l'empressement de la social-démocratie à 'défendre la patrie'. Le slogan n'était appliqué à des questions nationales spécifiques que pour mieux éviter l'investigation de son contenu concret et des tendances de son développement". (Impérialisme et oppression nationale) (3).
Les adhérents néerlandais et polonais de la Gauche de Zimmerwald ont rejeté le slogan des bolcheviks hérité de la social-démocratie. Très tôt - déjà en 1896 à l'occasion du Congrès de Londres de la Seconde Internationale et plus tard, avec Radek et d'autres, dans le SDKPiL- Rosa Luxemburg avait critiqué ce slogan qui, pensait-elle, était une concession opportuniste. Egalement dans le Parti bolchevique, représentée par Piatakov, Bosh et Boukharine, il existait une position critique envers le slogan du "droit des nations à l'autodétermination". Ceux-ci basaient leur critique sur le fait qu'à l'époque de l'impérialisme, "la réponse à la politique impérialiste de la bourgeoisie doit être la révolution socialiste du prolétariat ; la social-démocratie ne doit pas avancer de revendications minimales dans le domaine de la politique étrangère actuelle.
1.Il est par conséquent impossible de lutter contre l'asservissement de nations autrement que par une lutte contre l'impérialisme. Donc une lutte contre l'impérialisme; donc une lutte contre le capital financier, donc une lutte contre le capitalisme en général. Contourner ce chemin de quelque façon que ce soit et avancer des tâches "partielles" de "libération des nations" dans les limites de la société capitaliste détourne les forces prolétariennes de la réelle solution au problème et les enchaîne aux forces de la bourgeoisie des groupes nationaux correspondants" (Thèses sur le droit à l'autodétermination des nations, Piatakov, Bosh, Boukharine, extrait du livre Lenin's struggle for a revolutionary International).
Lénine avait une autre réponse à cette question qui étayait toute la question de la mise en avant de revendications minimales et le lien entre la question nationale et celle de la démocratie : "Ce serait une erreur radicale de penser que le combat pour la démocratie pourrait détourner le prolétariat du chemin de la révolution socialiste, ou le lui cacher, l'éclipser, etc. Au contraire, de la même façon qu'aucune victoire du socialisme n'est possible sans pratiquer la pleine démocratie, le prolétariat ne peut se préparer à sa victoire sur la bourgeoisie sans une lutte totale, cohérente et révolutionnaire pour la démocratie" (4) Il y a dans ce passage une certaine tendance à confondre la "démocratie" avec la dictature du prolétariat, et plus particulièrement, à voir la future dictature prolétarienne sous les formes de la démocratie bourgeoise. Ceci est faux à plusieurs niveaux, en particulier la domination prolétarienne ne peut se maintenir qu'à une échelle mondiale, alors que la démocratie capitaliste adopte nécessairement une forme nationale, inséparablement liée à l'Etat national. De façon plus immédiate, il y a une confusion entre la lutte pour des revendications démocratiques -y compris les "droits des nations"- et le combat pour le pouvoir prolétarien et la destruction de l'Etat bourgeois. C'était une erreur de Lénine de reprendre le vieux slogan social-démocrate sur "le droit des nations à l'autodétermination" -qui exprimait vraiment la vision opportuniste selon laquelle le socialisme ne pouvait être atteint que par la démocratie, par la conquête pacifique du pouvoir au travers du parlement- et d'essayer de le greffer sur un programme révolutionnaire. Indirectement, cette vision apportait aussi un soutien aux arguments des Mencheviks pour qui la révolution en Russie devait passer par une période de démocratie bourgeoise avant d'être prête pour le socialisme. Lénine et les Bolcheviks tiraient des conclusions totalement différentes de cette idée, dans ce sens qu'ils soutenaient la lutte révolutionnaire et y travaillaient, alors que les Mencheviks s'opposaient à toute lutte qui, selon leur théorie, dépasserait "la réalité objective" du capitalisme. Cette idée réformiste avait encore une grande influence parmi les Bolcheviks comme le révèlent les premières réactions de la majorité des "vieux Bolcheviks" en Russie face à la révolution de février. Cette position (qui n'était pas soutenue par les couches les plus radicales du parti) était dominante dans les organes dirigeants avant que Lénine ne soit de retour à Petrograd et attaque immédiatement cet opportunisme, et elle impliquait un soutien au gouvernement de Kerensky et à son effort de guerre. Lénine a combattu plus tard ce point de vue dans ses fameuses "Thèses d'avril". Maintenant Lénine comprenait que la révolution en Russie n'était pas une révolution bourgeoise, mais le premier pas de la révolution mondiale. C'est la pratique révolutionnaire de Lénine et des Bolcheviks qui allait réfuter le dogme menchevique d'une nécessaire étape démocratique avant que la révolution socialiste soit possible. En fait, l'histoire montre (contrairement à ce que croyait Lénine en 1916, quand il défendait le "droit à l'autodétermination") que ce n'est pas seulement en Russie que les illusions dans la démocratie se sont avérées le poison le plus dangereux contre la révolution : dans presque tous les pays secoués par la révolution russe, la question de la démocratie a été l'arme principale utilisée par la bourgeoisie pour s'opposer au mouvement révolutionnaire.
Contre l'idée que tous les pays devaient nécessairement passer par un certain stade de leur mode de production pour arriver à un nouveau mode de production, Rosa Luxemburg a écrit : "C'est pourquoi, historiquement parlant, l'idée selon laquelle le prolétariat moderne en tant que classe séparée et consciente ne peut rien faire sans commencer par créer un nouvel Etat-nation équivaut à demander à la bourgeoisie de chaque pays de restaurer l'ordre féodal là où ce processus n'a pas eu lieu normalement ou pris des formes particulières comme, par exemple, en Russie. La mission historique de la bourgeoisie est la création d'un Etat "national" moderne ; mais la tâche historique du prolétariat est d'abolir cet Etat en ce qu'il est une forme politique du capitalisme dans laquelle lui-même émerge en tant que classe consciente, afin d'établir le système socialiste" (La question nationale et l'autonomie, Rosa Luxemburg, souligné par nous). Voilà ce que Rosa Luxemburg a dit de la décision du Congrès de Londres de 1896 d'adopter le "droit des nations à l'autodétermination": "on propose de passer en fraude la position nationaliste sous la bannière internationale" (5). Bien que la position de Lénine n'ait rien à voir avec le social-chauvinisme des vieux partis sociaux-démocrates qui ont fini par "défendre la patrie", ses tentatives d'intégrer le "droit à l'autodétermination" au programme révolutionnaire n'en restaient pas moins une erreur. La question nationale dans la révolution russe Il faut envisager la révolution en Russie dans un cadre mondial historique, en même temps partie et signal d'une révolution mondiale. La révolution de Février n'était pas la révolution bourgeoise nécessaire avant que puisse avoir lieu la révolution socialiste, mais la première phase de la révolution prolétarienne en Russie, où s'est établie une situation de double pouvoir pour préparer l'étape suivante, la prise du pouvoir en Octobre. C'est à peu de choses près la vision défendue par Lénine dans ses "Thèses d'avril" qui sont de fait une attaque contre la vision mécanique, nationale, opportuniste de la révolution prolétarienne. Dans la Préface de Lénine à la première édition (août 1917) de son livre L'Etat et la révolution, il développe clairement sa vision de la révolution russe en écrivant: "Enfin, nous tirerons les principaux enseignements de l'expérience des révolutions russes de 1905 et surtout de 1917. A l'heure présente (début d'août 1917) cette dernière touche visiblement au terme de la première phase de son développement ; mais, d'une façon générale, toute cette révolution ne peut être comprise que si on la considère comme un des maillons de la chaîne des révolutions prolétariennes socialistes provoquées par la guerre impérialiste". Et c'est aussi en partant de cette vision de la révolution russe comme n'exprimant rien d'autre que la dynamique d'une révolution prolétarienne mondiale que Rosa Luxemburg répétait avec une intransigeance accrue sa critique du slogan du "droit à l'autodétermination" et de son utilisation par le parti bolchevique au pouvoir : "Au lieu de viser, selon l'esprit même de la nouvelle politique internationale de classe, qu'ils représentaient par ailleurs, à grouper en une masse la plus compacte possible les forces révolutionnaires sur tout le territoire de l'empire russe, en tant que territoire de la révolution, d'opposer, en tant que commandement suprême de leur politique, la solidarité des prolétaires de toutes les nationalités à l'intérieur de l'empire russe à toutes les séparations nationalistes, les bolcheviks ont, par leur mot d'ordre nationaliste retentissant du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, jusque et y compris la séparation complète", fourni à la bourgeoisie, dans tous les pays limitrophes, le prétexte le plus commode, on pourrait même dire la bannière, pour leur politique contre-révolutionnaire. Au lieu de mettre en garde les prolétaires dans les pays limitrophes contre tout séparatisme, comme piège de la bourgeoisie, ils ont, au contraire, par leur mot d'ordre, égaré les masses, les livrant ainsi à la démagogie des classes possédantes. Ils ont, par cette revendication nationaliste, provoqué, préparé eux-mêmes, le dépècement de la Russie, et mis ainsi aux mains de leurs propres ennemis le poignard qu'ils devaient plonger au c�ur de la Révolution russe" (La révolution russe, Rosa Luxemburg).
Dans tous les cas où le slogan des Bolcheviks du "droit à l'autodétermination" a été appliqué, il a ouvert la porte à des illusions sur la démocratie et le nationalisme -mythes sacrés que la bourgeoisie elle-même a toujours foulés au pied dès qu'elle devait défendre sa survie contre la révolution prolétarienne. Face à cette dernière, les bourgeoisies nationales ont toujours bien vite mis en poche l'idée d'indépendance nationale et abandonné leurs rêves nationaux pour appeler les puissances bourgeoises étrangères rivales à les soutenir et les aider à défaire "leur propre" classe prolétarienne. En même temps, et précisément pour la même raison, toute l'histoire de "l'ère des guerres et des révolutions" (termes employés par l'Internationale communiste pour l'époque du déclin capitaliste) montre que partout où le prolétariat a eu des illusions sur la possibilité de mener une lutte commune avec la bourgeoisie, cela n'a mené qu'à des massacres du prolétariat. La Finlande et la Géorgie sont des exemples criants de la façon dont la bourgeoisie, dès qu'elle eut accédé à son "indépendance", a demandé de l'aide pour écraser le bastion prolétarien en Russie - le tout sous la bannière de l'indépendance nationale. En Finlande, des troupes allemandes ont été envoyées pour réprimer la Garde rouge finlandaise, et la révolution en Finlande s'est transformée en une terrible défaite pour le prolétariat. L'Armée rouge était obligée de rester "neutre" en vertu du traité de Brest-Litovsk et n'est pas intervenue officiellement (bien que beaucoup de Bolcheviks dans l'Armée Rouge aient aidé la Garde rouge finlandaise). La bourgeoisie finlandaise a mobilisé des paysans pauvres pour combattre "l'ennemi russe" ; beaucoup des recrues de la "Garde blanche" finlandaise étaient convaincues qu'elles affrontaient des troupes russes. En Géorgie, les Mencheviks (maintenant passés à la bourgeoisie nationale, défendant le "droit à l'autodétermination nationale") ont également appelé à l'aide l'impérialisme allemand.
Il y a eu certains changements de la part des Bolcheviks sur la question nationale au début de la révolution russe : ils voyaient plus le slogan comme une nécessité purement tactique que comme un principe politique. Cela s'est exprimé dans le fait que non seulement le slogan de "l'autodétermination" a été atténué à l'intérieur du Parti bolchevique lui-même mais aussi que le Premier Congrès de la Troisième Internationale a adopté à son égard une démarche beaucoup plus claire et s'est beaucoup plus centré sur la lutte internationale du prolétariat, sur l'indépendance de celui-ci vis-à-vis de tout mouvement national, ne le laissant jamais se subordonner à la bourgeoisie nationale. Mais avec le développement d'un l'opportunisme grandissant dans l'Internationale communiste, qui était lié à la confusion croissante entre la politique de l'IC et la politique étrangère de l'Etat soviétique dégénérant, il y a eu une véritable rechute sur la question nationale, une tendance à perdre de vue la relative clarté du Premier Congrès. Une expression de ceci a été la politique de soutien aux alliances, en Turquie et en Chine, entre les partis communistes et les bourgeoisies nationalistes, qui a conduit dans les deux cas à un massacre du prolétariat et à la décimation des communistes par leurs anciens alliés "nationaux-révolutionnaires". Au bout du compte, les erreurs de Lénine et des Bolcheviks sur ces questions se sont transformées en idéologie de défense de la guerre impérialiste, en particulier par le trotskisme. Ce qui était une erreur opportuniste de la part des Bolcheviks permet aujourd'hui à la gauche du capital d'utiliser le nom de Lénine pour défendre les guerres impérialistes. Au lieu de répéter ces erreurs, les communistes doivent fonder leurs positions sur la critique internationaliste la plus cohérente qui a été développée par la gauche marxiste, de Luxemburg à Piatakov et du KAPD à la Gauche italienne.
Olof, 15.6.03
(1) Nous renvoyons le lecteur aux autres articles de la Revue Internationale sur le MLP, en particulier les numéros 101, 104 & 111. Les camarades du MLP nous ont fait savoir que la traduction correcte du nom russe de leur groupe est Marxist Workers Party (Parti marxiste ouvrier) et non Marxist Labour Party (Parti marxiste du travail). Nous avons cependant gardé le sigle MLP, pour assurer la continuité avec nos précédentes publications.
(2) Le Pakistan réclame un référendum pour déterminer à quel pays doit revenir cette région, alors que pour l'Inde, la question est réglée.
(3) Imperialism and National Oppression, thèses présentées en 1916 par Radek, Stein-Krajewski et M. Bronski, qui appartenaient à une fraction du SDKPiL et avaient des positions similaires à celles de Luxemburg.
(4) The discussion on self-determination summed up, Lénine, 1916
(5) The Polish Question at the International Congress in London,, Rosa Luxemburg, 1896
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
- La question nationale [114]
Notes sur l'histoire des conflits impérialistes au Moyen-Orient, 1e partie
- 3885 reads
Au cours de la plupart des cent dernières années, le Moyen-Orient a été le théâtre de guerres impérialistes.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce sont succédées trois guerres « ouvertes » entre Israël et ses voisins rivaux (1949, 1967, 1973), un état de guerre permanent entre Israël et les combattants armés palestiniens (avec les groupes terroristes organisés et les attentats suicide d'un côté, et la terreur d'Etat israélienne de l'autre), une guerre longue de huit ans entre l'Irak et l'Iran, des combats incessants entre les nationalistes kurdes et l'Etat turc, vingt ans de guerre en Afghanistan, la guerre du Golfe en 1991, et l'invasion de l'Irak en 2003, qui n'a eu comme conséquence qu'une aggravation de l'état de guerre.
Aucune autre partie du monde n'illustre plus clairement que le capitalisme ne petit survivre qu'à travers la guerre et la destruction, que tous les pays sont impérialistes (qu'ils soient petits ou grands), qu'il n'existe pas de solution à l'intérieur du système capitaliste à ses contradictions, que la guerre a développé sa propre dynamique et que les ouvriers doivent s'unir sur le terrain internationaliste et combattre tous les nationalismes.
Le but de cette brève histoire du Moyen-Orient est de montrer que la multitude de conflits régionaux et locaux qui ont affecté cette région ne peuvent être compris que dans le contexte global de l'impérialisme.
Le Moyen-Orient, point de convergence des intérêts impérialistes de toutes les puissances capitalistes
Situé entre l'Océan indien et la Méditerranée, au carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, le Moyen-Orient a toujours représenté nue pomme de discorde, bien avant que ses ressources pétrolières soient découvertent.
Dès le début de l'expansion de l'Europe capitaliste dans cette région, les préoccupations stratégiques globales ont dominé la politique des différentes puissances qui ne se sont jamais affrontées uniquement pour la recherche de telle ou telle matière première.
Déjà, dans sa phase préliminaire d'expansion, bien avant que la révolution industrielle ait atteint son plein essor, le capitalisme britannique s'est empress de prendre pied en Inde, d'où il a pu évincer son rival français. C'est dès le début du 19e siècle que la Grande-Bretagne est devenue la principale force, en s’employant à occuper les points d'importance stratégique sur la route des Indes. En 1839, Aden d'actuel Yémen a été occupé, et les Britanniques y ont joué le rôle de police de la côte du Golfe, où les pirates entravaient le développement du commerce.
Mais le Moyen-Orient devint également vite une cible de l'expansion du capitalisme russe. Après les heurts avec la Perse (1828) et ses guerres à répétition contre l'Empire ottoman (1828, 1855, 1877) au cours du seul 19e siècle, la Russie et la Turquie sont entrées en guerre trois fois, durant la guerre de Crimée en 1853-56, ainsi qu'à l'occasion des affrontements avec la Turquie, l'Angleterre, la France et l'Italie en Mer Noire -la Russie a cherché à se déplacer vers le Caucase, la Mer Caspienne et vers les régions appelées maintenant Kazakhstan et Tadjikistan. Son objectif global était d'avoir accès à l'Océan indien via l'Afghanistan et l'Inde.
Dans le but de parer à l'expansion russe vers cette zone, la Grande-Bretagne envahit par deux fois l'Afghanistan (1839-42 et 1878-80). Après sa victoire dans la deuxième guerre afghane, la Grande-Bretagne mit en place un régime fantoche dans ce pays ([1] [115]).
A la fin du 19e siècle, l'Angleterre et la Russie décidèrent de résoudre leur conflit sur la domination en Asie, car l'impérialisme allemand commençait à s'étendre vers les Balkans et le MoyenOrient. Ils tombèrent d'accord pour se partager la zone autour de l'Afghanistan afin d'y contenir la pénétration allemande. En même temps, la GrandeBretagne établit la "ligne Durand" en Afghanistan en 1893, qui fut conçue pour empêcher la Russie d'avoir une frontière commune avec l'Inde (Durand prit soin, malgré les objections du roi d'Afghanistan, de prolonger cette frontière vers l'Est par une étroite bande de terre, le Wakhan, qui s'étend jusqu'à la Chine à travers le massif du Pamir, de façon à bien séparer l'empire russe de l'empire des Indes, Lacoste, Dictionnaire de géopolitique, p.53). En 1907, l'Angleterre et la Russie signèrent un traité de partage des zones autour de l'Iran.
Par dessus tout, la Grande-Bretagne a remporté une importante victoire stratégique en occupant militairement l'Egypte en 1882 et en en évinçant son rival français qui avait construit le canal de Suez ouvert en 1809. Le canal de Suez devint la pierre angulaire de l'implantation britannique au Moyen-Orient et d'importance vitale pour sa domination en Inde et dans d'autres parties de l'Asie et de l'Afrique. Et c'est jusqu'en 1950 que la Grande-Bretagne (de concert avec la France) envoya des troupes pour défendre le contrôle sur le canal, en s'opposant aux Etats-Unis.
Depuis le début du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a pu jouer un rôle prépondérant au Moyen-Orient, mettant à l'écart ses rivaux européens, la Russie et la France.
Comme on l'a dit plus haut, en s'appropriant leurs colonies et en définissant leurs visées impérialistes, les puissances coloniales européennes ne considéraient pas comme primordiales les questions de matières premières, que ce soit le pétrole ou d'autres. Au début du 20e siècle, les ressources pétrolières du Moyen-Orient étaient de moindre un importance et les autres matières premières ne jouaient pas de rôle décisif ([2] [116]). Déjà, les considérations stratégiques et militaires jouaient un rôle dominant.
Cependant, la nature des conflits impérialistcs prit un caractère qualitativement nouveau une fois que le globe fut divisé entre les principales puissances européennes, au début du 20e siècle.
Dès que celles-ci commencèrent à s'affronter dans différentes parties du monde, après qu'elles se le furent partagé (entre la France et l'Italie en Afrique du Nord, entre la France et l'Angleterre en Egypte et à Fachoda au Soudan, entre l'Angleterre et la Russie en Asie centrale, entre la Russie et le Japon en Extrême-Orient, entre le Japon et l'Angleterre en Chine, entre les Etats-Unis et le Japon dans le Pacifique. entre l'Allemagne et la France au sujet du Maroc, etc. ), les tensions au Moyen-Orient allèrent crescendo.
Déjà au début du 20e siècle, l'Allemagne, pays arrivé trop tard sur le marché mondial et tentant désespérément de s'approprier des colonies, ne pouvait que les arracher à un autre pays déjà "installé". Ce qui signifiait que l'Allemagne pouvait essentiellement tenter d'affaiblir les positions de la seule puissance mondiale
: l'Angleterre. L'effort allemand de ce constituer une puissance militaire datait déjà de la fin du 19e siècle. Cependant, comme nous le verrons, même si l'impérialisme allemand a pu menacer et ébranler les intérêts an(Ilais dans la région, jamais il ne fut capable d'en renverser la domination. Bien que constituant un challenger et un fauteur de troubles préjudiciable aux intérêts anglais, Contrairement à l'impérialisme britannique, il n'avait pas les moyens d'imposer sa présence dans la région.
L'Allemagne essaya alors de s'étendre vers l'Est en direction des Balkans (ce n'est pas par hasard si la Première Guerre mondiale fut déclenchée, après une accélération des antagonismcs impérialistes lors de deux guerres balkaniques, en 1912-1913, à l'issue desquelles l'Empire ottoman perdit ses territoires en Europe, en faveur de la Bulgarie, de la Serbie, de la Grèce et de l'Albanie). L'Empire ottoman en décomposition devint le point de convergence des appétits impérialiates allemands au MoyenOrient.
Alors que Marx appuyait encore la revendication d'intégrité territoriale de la Turquie comme une barrière aux ambitions russes vers le Moyen-Orient, Rosa Luxemburg avait déjà compris, au début du 20e siècle, que la situation globale avait changé et que cet appui à la Turquie était réactionnaire. "Etant donnée la multitude de revendication nartionales qui déchirent l'Etat turc : arméniennes, kurdes, syriennes, arabes, grecques (et jusqu'à récemment albanaises et macédoniennes), étant donnée la pléthore de problèmes socioéconomiques dans les différentes parties de l'Empire otoman… il est clair pour tout un chacun, et en particulier depuis longtemps pour la social-démocratie allemande qu'une véritable régénération de l’Etat turc relève de la plus complète utopie et que tous les efforts déployés pour maintenir debout ces ruines pourries et en pleine décomposition ne peuvent que constituer une entreprise réactionnaire. "(Rosa Luxemburg, Brochure de Junius, chapitre 4),
Pour l'impérialisme allemand, la Turquie représentait un atout maître dans le jeu de ses ambitions ([3] [117]).
L'Allemagne appuyait la Turquie militairement (elle entraînait l'état-major turc, fournissait des armes et signa, en 1914, un traité d'alliance et de soutien mutuel en cas de guerre) ; elle devint aussi son principal fournisseur d'aide financière et technique. C'est pourquoi "la position de l'impérialisme allemand le mit en situation de conflit avec les autres Etats européens au Moyen-Orient, en particulier avec la Grande-Bretagne. La construction de lignes de chemin de fer stratégiques et le soutien de l’Allemagne au militarisme turc heurta les intérêts' les plus sensibles de la Grande-Bretagne : ils intervinrent au carrefour de l'Asie centrale, de la Perse, de l'Inde et de l'Egypte." (Ibid.) ([4] [118])
L'ambition principale de l'impérialisme allemand au moment de la construction de la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad était de créer un support logistique aux troupes allemandes ([5] [119]). L'effondrement de l’empire ottoman allait être d'une importance décisive pour l'éclatement des conflits impérialistes, aussi bien dans les Balkans qu'au MoyenOrient.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la plus grande partie du Moyen-Orient était sous le contrôle de l'Empire ottoman. Sur le continent asiatique, la Turquie contrôlait la Syrie (qui incluait la Palestine), une partie de la péninsule arabique (qui n'avait, à cette époque, pas de frontières fixées), une partie du Caucase et de la Mésopotamie (allant aussi loin que Bassorah).
L'effondrement de l'Empire ottoman n'offrit pas d'opportunité pour la création d'une grande nation industrielle ni dans les Balkans, ni au Moyen-Orient, nation qui aurait été capable d'entrer en compétition sur le marché mondial. Au contraire, la pression de l'impérialisme conduisit à sa fragmentation et au développement d'Etats embryonnaires. De la même manière que ces mini-Etats dans les Balkans sont restés l'objet des rivalités impérialistes entre les grandes puissances tout au long du 20e siècle jusqu'à nos jours, la partie asiatique des ruines de l'Empire ottoman, le Moyen-Orient, a été et reste le théâtre de conflits impérialistes permanents.
Contrairement à l'Extrême-Orient qui, mis à part quelques conflits de moindre importance, est resté à l'écart de la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient, était depuis toujours un champ de bataille des affrontements entre les puissances belligérantes ([6] [120]). Déjà, à l'époque de la Première Guerre mondiale, bien avant que fussent posées les questions Palestiniennes et d'un Etat hébreu, la région était devenue un véritable champ de mines impérialiste. Comme nous le verrons, les conflits autour de la Palestine et du sionisme ont constitué des facteurs aggravants dans cette zone de conflits impérialistes entre puissances rivales.
La chute de l'Empire ottoman et les conditions de l'impérialisme à la fin de la Première Guerre mondiale
Durant la Première Guerre mondiale, les puissances européennes essayèrent de mobiliser leurs "alliés" dans la région en vue de leurs efforts de guerre.
L'Angleterre, qui combattait l'Allemagne et la Turquie aux côtés de la Russie, essaya d'attirer la bourgeoisie arabe dans son camp, contre les dirigcants ottomans. Les Anglais encouragèrent les tentatives des tribus du Hedjaz (partie orientale de la péninsule arabique) à lutter pour leur autonomie visà-vis des Turcs et appuyèrent Shérif Hussein de La Mecque.
Déjà durant la guerre, les chefs locaux servirent de pions dans la lutte pour la domination de la région que se livrèrent les puissances europènnes. Les Anglais, dont Laurence d'Arabie qui joua un rôle important en tant qu'agent de liaison avec les rebelles arabes, utilisèrent leur soulèvement contre les Turcs. Les immigrants juifs furent aussi recrutés pour servir de chair à canon à l'impérialisme anglais. Après que l'Allemagne eut poussé la Turquie à lancer une offensive contre les positions anglaises en Egypte en février 1915, essayant par là de se saisir du canal de Suez (offensive qui s'écroula après quelques jours seulement à cause du manque de soutien logistique et de fournitures d'armement), la Turquie apparut alors comme le grand perdant de cette guerre.
Ceci eut pour conséquence d'augmenter les appétits impérialistes des puissances européennes et des dirigeants arabes locaux. Espérant profiter de l'occasion, les troupes arabes, commandées par Shérif Hussein de La Mecque livrèrent une véritable course contre l'armée anglaise en été 1917 afin de se saisir de portions de territoire turc. En octobre 1918, ces mêmes troupes entrèrent dans Damas et proclamèrent la création d'un Royaume arabe. Ainsi, après avoir jouè le rôle de chair à canon pour les intérêts impérialistes anglais en Turquie, les dirigeants arabes affichèrent leurs propres ambitions impérialistes en voulant créer un "empire pan-arabe" avec Damas comme capitale. Mais ces ambitions se heurtèrent immédiatement aux intérêts anglais et français : il n'y avait pas de place pour les appétits impérialistes arabes.
Au fur et à mesure que l'Empire ottoman s'effondrait et que la défaite germano-turque devenait évidente, la France et l'Angleterre élaboraient des plans pour se partager le Moyen-Orient, tout en cherchant à s'en évincer mutuellement.
Les Etats arabes allaient être exclus du partage du butin. Historiquement, la formation d'une grande nation arabe qui aurait regroupé les morceaux de l'Empire ottoman, était devenue impossible. Les espoirs des classes dirigeantes arabes de voir se créer une grande nation arabe étaient voués à l'échec car les requins impérialistes européens ne pouvaient tolérer de rival local.
Au printemps 1915, par un accord tenu secret, les puissances européennes, Angleterre, France, Russie, Italie et Grèce se partagèrent le Moyen-Orient. Mais un autre accord signé par l'Angleterre et la France en mai 1916 et ignoré des autres pays, stipulait que :
- l'Angleterre contrôlerait Haïfa, Acca, le désert du Néguev, le Sud de la Palestine, l'Irak, l'Arabie et la Transjordanie d'actuelle Jordanie),
- la France recevrait le Liban et la Syrie.
Après la guerre, en avril 1920, l'Angleterre reçut un mandat de la Société des Nations sur la Palestine, la Transjordanie, l'Iran, l'Irak ; la France en reçut un sur la Syrie et le Liban, et dut rendre le contrôle de Mossoul (avec ses riches puits de pétrole) à l'Angletere contre des concessions anglaises sur l'Alsace-Lorraine et la Syrie.
A cette époque, l'Allemagne, pays vaincu, et la Russie, après la Révolution d'Octobre 1917, n'allaient plus être présents sur la scène impérialiste au Moyen-Orient pour une longue période. Le nombre de rivaux dans la région baissa considérablement et l'Angleterre et la France devinrent les deux forces dominantes, l'Angleterre ayant clairement la plus forte position.
Durant la guerre et jusque dans les années 1930, les forces en présence étaient européennes, les Etats-Unis ne jouant pas encore de rôle significatif.
Pour défendre son empire colonial, qui était convoité par d'autres puissances, la Grande-Bretagne devait s'appuyer sur la Palestine, région vitale stratégiquement.
Pour l'Angleterre, la Palestine représentait le lien entre le Canal de Suez et la future Mésopotamie britannique. Aucune autre puissance, fût elle européenne ou arabe, ne pouvait s'y installer et, dès 1916, l'Angleterre avait Clairement déclaré que le contrôle de la Palestine était le but de sa politique.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, tant qu'existait l'Empire ottoman, la Palestine avait toujours été considérée comme faisant partie de la Syrie. Mais maintenant que l'Angleterre avait reçu un mandat sur la Palestine, les puissances impérialistes avaient créé une nouvelle "unité". Comme toutes ces nouvelles "unités" créées au cours de la décadence du capitalisme, elle était destinée à devenir un théâtre permanent de conflits et de guerres.
Les dirigeants palestiniens étaient encore plus faibles que les autres dirigeants arabes. Ne disposant ni de base industrielle ni de capitaux financiers, à cause de leur retard économique, ils n'avaient aucun potentiel économique et ne pouvaient compter que sur les moyens militaires pour défendre leurs intérêts.
En 1919 fut convoquè le premier congrès national palestinien et Amin al Hussein fut nommé mufti de Jérusalem. Les nationalistes palestiniens prirent contact avec la France afin d'ébranler la domination anglaise sur la Palestine. Un soulèvement militaire fut organisé avec le soutien de la Syrie et l'aide des forces françaises qui l'occupaient. Cependant, ce soulèvement fut rapidement écrasé par l’armée britannique.
En même temps les dirigeants palestiniens qui proclamaient leur autonomie dans un monde où il n'y avait plus de place pour un nouvel Etat-nation, étaient confrontés avec un nouveau "rival" venu de l'extérieur.
Comme l'Angleterre avait promis. dans la Déclaration Balfour en novembre 1917, un soutien à l'installation d'un foyer juif en Palestine, le nombre d'immigrants juifs ne cessait de croître. Les colons juifs entamèrent une lutte sanglante contre les dirigeants palestiniens pour assurer leur survie.
La Grande-Bretagne utilisa les colons juifs sur deux fronts. Après avoir incorporé dans les rangs de son armée le "Zion Mule Corps" en vue de combats contre son rival turc durant la guerre. l'Angleterre utilisait maintenant les nationalistes juifs à la fois contre son rival principal, la France et contre les nationalistes arabes. C'est pourquoi l'Angleterre incita les sionistes à proclamer à la Société des Nations qu'ils ne désiraient en Palestine ni protection française, ni protection internationale, mais la protection britannique.
Bien qu'étant rivales la France et l'Angleterre agirent de concert contre les nationalistes arabes quand ceux-ci réclamèrent leur indépendance. Après les avoir poussés contre les Turcs durant la guerre, ils utilisaient maintenant des moyens militaires pour écraser leurs ambitions indépendantistes. Après la proclamation par Fayçal, en octobre 1918 à Damas, d'un Empire arabe indépendant, qui devait inclure la Palestine, les troupes françaises le renversèrent en Juillet 1920, utilisant des bombardiers contre les nationalistes.
En Egypte, en mars 1918, au cours de nombreuses manifestations, des nationalistes égyptiens, des ouvriers et des paysans réclamèrent des réformes sociales. Elles furent réprimées à la fois par l'armée britannique et par l'armée Egyptienne, tuant plus de 3000 manifestants. En 1920, l'Angleterre écrasa un mouvement de protestation à Mossoul en Irak. Dans aucun des pays ou des protectorats arabes la bourgeoisie locale n'avait les moyens d'installer des Etats indépendants, libérés de l'emprise coloniale et des puissances "protectrices".
La revendication de libération nationale n'était rien d'autre qu'une demande réactionnaire. Alors que Marx et Engels avaient pu soutenir certains mouvements nationaux, à la seule condition que la formation d'Etat-nations pût accélérer la croissance de la classe ouvrière et la renforcer, celle-ci pouvant agir comme fossoyeur du capitalisme, ce que les développements guerriers de la situation au Moyen-Orient avaient montré était qu'il n'y avait pas de place pour la formation d'une nouvelle nation arabe ni palestinienne.
Comme partout ailleurs dans le monde, une fois le capitalisme entré dans sa phase de déclin, plus aucune fraction nationale du capital ne pouvait jouer de rôle progressiste.
Incapables de conquérir de nouveaux débouchés capitalistes, les rivaux ne pouvaient que réagir militairement : au Moyen-Orient, les puissances coloniales empêchèrent la formation d'une nouvelle nation arabe et les bourgeoisies arabes locales empêchèrent la création d'un nouvel Etat-nation palestinien.
Pour résumer la situation au Moyen-Orient, après l'effondrement de l'Empire ottoman et la fin de la Première Guerre mondiale, nous pouvons souligner les points suivants :
- les deux puissances européennes, la France et l'Angleterre, rivales entre elles et qui avaient choisi leurs "protégés", dominaient la région ;
- l'Allemagne et la Russie, qui avaient de grandes ambitions impérialistes dans la région, en avaient été rejetées ;
- la bourgeoisie arabe était incapable de créer un Etat-nation panarabe stable ;
- unité nouvellement formée, le protectorat de Palestine, avec à sa tête une classe dirigeante faible et retardataire, entrait dans un conflit contre son "protecteur", l'Angleterre, tout en étant incapable de représenter une véritable menace, et contre son nouveau rival sioniste venu de l'extérieur ;
- la bourgeoisie arabe, qui s'affrontait aux puissances coloniales qui voulaient l'empêcher de créer un nouvel Etat viable, s'opposait à son tour à la formation d'une nouvelle "unité" palestinienne ;
- les Etats-Unis, grands bénéficiaires de la guerre, n'étaient pas encore réellement présents dans la région ;
- le coeur des rivalités impérialistes n'était pas la conquête d'une matière première particulière, mais plutôt la conquête de positions stratégiques.
Nous pouvons voir que la situation au Moyen-Orient confirme totalement l'analyse faite par Rosa Luxemburg au cours de la Première Guerre mondiale : "L'Etat national, l'unité et l'indépendance nationales, tels étaient les drapeaux idéologiques sous lesquels ce sont cortstitués les grands Etats bourgeois du coeur de l'Europe au siècle dernier. Le capitalisme est incompatible avec le particularisme des petits Etats, avec un émiettement politique et économique ; pour s’épanouir il faut un territoire cohérent aussi grand que possible, d’un même niveau de civilisation : sans quoi on ne pourrait élever les besoins de la société au niveau requis pour la production marchande capitaliste, ni faire fonctionner le mécanisme de la domination bourgeoise moderne. Avant d'étendre son réseau sur le globe tout entier, l’économie capitaliste à cherché à se créer un territoire d’un seul tenant dans les limites nationales d’un Etat (...) Aujourd'hui, (la phrase nationale) ne sert qu'à masquer tant bien que mal les aspirations impérialistes, à moins qu'elle ne soit utilisées comme cri de guerre, dans les conflits impérialistes, seul et ultime moyen idéologique de capter l’attention des masses populaires et de leur faire jouer le rôle de chair à canon dans les guerres impérialistes" (Brochure de Junius).
DE
[1] [121] Engels, 10.08.1857.
[2] [122] En 1900, la consommation de pétrole sélevait à environ 20 millions de tonnes et cette demande était satisfaite par les puits américains et russes (à cette époque la principale région de production était le Golfe du Mexique). La militarisation accrue et le fait que les moteurs industriels et les locomotives n'étaient plus mus par le charbon mais par le pétrole entraîna une forte demande de celui-ci. Entre 1900 et 1910, la production de pétrole brut a plus que doublé pour atteindre 43,8 millions de tonnes. L'invention du moteur Diesel pour entrainer les locomotives et les paquebots en constitua la base technique, mais les besoins d’une économie militarisée entraina le doublement de la production de brut. Cependant, avant la guerre, cette région ne jouait qu'un rôle secondaire dans l’approvisionnement mondial en pétrole. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale avec la demande importante induite par le développement de l'industrie automobile, que la production pétrolière s'accrut considérablement au Moyen-Orient.
[3] [123] L'impérialisme allemand balançait entre le soutien à la Turquie ou aux colons nationalistes juifs. Si les sionistes établissaient un foyer juif en Palestine, avec le soutien allemand, cela aurait provoqué un conflit avec l'Empire ottoman. Mais l'Allemagne ne voulait pas prendre le risque de briser son alliance avec la Turquie, car elle représentait son allié le plus important dans son antagonisme global avec la Grande-Brelagne.
[4] [124] Rosa Luxemburg fut l'une des premieres à saisir les implications historiques des conditions nouvelles qu'entraînait le début de la décadence. Déjà dans son livre sur Le développement industriel de la Pologne en 1898, elle montrait que les commnistes ne pouvaient plus soutenir la formation d'une nation polonaise. Dans le texte Les 1uttes nationales en Turquie et la sociale-démocratie, en 1896 et dans La question nationale et l'autonomie de 1908, elle a montré le changement historique intervenu entre l'ascendance et la décadence, qui rendait impossible tout soutien à la Turquie.
[5] [125] Rohrbach écrivait dans son livre Le chemin fer de Bagdad : « l’Angleterre ne peut attaquer depuis l'Europe, par la terre ferme, et touchée brutalement qu'en Egypte… Mais la Turquie ne peut envisager de conquérir l’Egypte que si elle dispose d’un réseau ferré en Asie Mineure et en Syrie. Dés le début, le ligne de chemin de fer de Bagdad a été prévue comme une loigne directe entre Constantinople et les positions militaires clés de la Turquie en Asie Mineure, avec la Syrie et les provinces du Tigre et de l’Euphrate . Bien sûr, dans ce plan était inclus le projet de transport de troupe turcs vers l’Egypte »
( Paul Rohrbach, cite par Rosa Luxembourg dans La Guerre et la politique germanique).
[6] [126] Bien que le Moyen-Orient fût un théatre périphérique de la Première Guerre mondiale, sur ses 20 millions de morts, quelque 350 000 provenaient du Moyen-Orient. La Turquie. ainsi que le blocus des ports arabes par les alliés et les épidémies et la famine furent responsables de nombre de morts. 30% des Egyptiens furent enrôlés par les Anglais et les Australiens pour servir de main d'euvre.
Géographique:
- Moyen Orient [127]
Questions théoriques:
- Impérialisme [11]
Il y a 30 ans, la chute d'Allende au Chili : Dictature et démocratie sont les deux visages de la barbarie capitaliste
- 5779 reads
Le 11 septembre 1973 un coup d'État militaire dirigé par le général Pinochet renversait dans un bain de sang le gouvernement de l'Unité Populaire de Salvador Allende au Chili. La répression qui s'est abattue sur la classe ouvrière fut terrible : des milliers de personnes (1), pour la plupart des ouvriers, furent systématiquement massacrés, des dizaines de milliers furent emprisonnés et torturés. A cette barbarie effroyable se sont encore ajoutées plusieurs centaines de milliers de licenciements (un ouvrier sur dix au cours de la première année de la dictature militaire). L'ordre qui régnait à Santiago (et qui s'est installé avec le soutien de la CIA) (2) n'était rien d'autre que l'ordre de la terreur capitaliste dans sa forme la plus caricaturale. A l'occasion du trentième anniversaire du renversement du gouvernement "socialiste" d'Allende toute la bourgeoisie "démocratique" a mis à profit la commémoration de cet événement pour tenter une fois encore de dévoyer la classe ouvrière de son propre terrain de lutte. Une fois encore, la classe dominante cherche à faire croire aux ouvriers que le seul combat dans lequel ils doivent s'engager, c'est celui de la défense de l'Etat démocratique contre les régimes dictatoriaux dirigés par des voyous sanguinaires. C'est bien le sens de la campagne orchestrée par les médias consistant à faire le parallèle entre le coup d'État de Pinochet le 11 septembre 1973 et l'attentat contre les Tours jumelles à New York (voir le titre du journal Le Monde du 12 septembre : "Chili 1973 : l'autre 11 septembre").
Et dans ce choeur unanime de toutes les forces démocratiques bourgeoises, on trouve au premier plan les partis de gauche et les officines gauchistes qui avaient pleinement participé, aux côtés du MIR (3) chilien, à embrigader la classe ouvrière derrière la clique d'Allende, les livrant ainsi pieds et poings liés au massacre (voir notre article dans RI nouvelle série n° 5 : "Le Chili révèle la nature profonde de la gauche et des gauchistes"). Face à cette gigantesque mystification consistant à présenter Allende comme un pionnier du "socialisme" en Amérique Latine, il appartient aux révolutionnaires de rétablir la vérité en rappelant les faits d'armes de la démocratie chilienne. Car les prolétaires ne doivent jamais oublier que c'est le "socialiste" Allende qui a envoyé son armée "populaire" pour réprimer les luttes ouvrières et a permis ensuite à la junte militaire de Pinochet de parachever le travail. Nous publions ci-dessous un article adapté du tract diffusé début novembre 1973 par "World Revolution" ainsi que le tract diffusé peu après le coup d'État par "Révolution Internationale", c'est-à-dire les groupes qui allaient constituer les sections du CCI en Grande-Bretagne et en France.
TRACT DE WORLD REVOLUTION (organe du CCI en Grande-Bretagne)
Au Chili comme au Moyen Orient, le capitalisme a montré une fois de plus que ses crises se paient du sang de la classe ouvrière. Tandis que la Junte massacrait les travailleurs et tous ceux qui se sont opposé à la loi du capital, la "gauche" du monde entier s'unissait dans un même ch�ur hystérique et mystificateur. Les résolutions parlementaires, les glapissements de "Cassandre" des partis de gauche, la fureur des trotskistes criant : "Je vous l'avais bien dit", les grandes manifestations, tout cela n'était qu'un rabâchage soigneusement préparé par la gauche officielle et les gauchistes. Leur partenaire chilien, le défunt gouvernement de l'Unité Populaire d'Allende a préparé le massacre après avoir désarmé, matériellement et idéologiquement les travailleurs chiliens pendant trois ans. En considérant la coalition d'Allende comme celle de la classe ouvrière, en l'appelant "socialiste", toute la "gauche" a essayé de cacher ou de minimiser le rôle réel d'Allende et aidé à perpétuer les mythes créés par le capitalisme d'État au Chili. La nature capitaliste du régime d'Allende Toute la politique de l'Unité Populaire consistait à renforcer le capitalisme au Chili. Cette large fraction du capitalisme d'État, qui s'est appuyée sur les syndicats (aujourd'hui devenus partout des organes capitalistes) et sur les secteurs de la petite bourgeoisie et de la technocratie s'est scindée pendant quinze ans dans les partis communiste et socialiste. Sous le nom de Front des Travailleurs, FRAP ou Unité Populaire, cette fraction voulait rendre le capital chilien arriéré compétitif sur le marché mondial. Une telle politique, appuyée sur un fort secteur d'État, était purement et simplement capitaliste. Recouvrir les rapports de production capitalistes d'un vernis de nationalisations sous "contrôle" ouvrier n'aurait rien changé à la base : les rapports de production capitalistes sont restés intacts sous Allende, et ont même été renforcés au maximum. Sur les lieux de production des secteurs public et privé, les travailleurs devaient toujours suer pour un patron, toujours vendre leur force de travail. Il fallait satisfaire les appétits insatiables de l'accumulation du capital, exacerbés par le sous-développement chronique de l'économie chilienne et une insurmontable dette extérieure, surtout dans le secteur minier (cuivre) dont l'État chilien tirait 83% de ses revenus dans l'exportation. Une fois nationalisées, les mines de cuivre devaient devenir rentables. Dès le début, la résistance des mineurs contribua à détruire ce plan capitaliste. Au lieu d'accorder crédit aux slogans réactionnaires de l'Unité Populaire :"Le travail volontaire est un devoir révolutionnaire", la classe ouvrière industrielle du Chili, particulièrement les mineurs, a continué à lutter pour l'augmentation des salaires, et a brisé les cadences par l'absentéisme et les débrayages. C'était la seule façon de compenser la chute du pouvoir d'achat pendant les années précédentes, et l'inflation galopante sous le nouveau régime qui avait atteint 300% par an à la veille du coup d'État. La résistance de la classe ouvrière à Allende a débuté en 1970. En décembre 1970, 4000 mineurs de Chuquicamata se mirent en grève réclamant des augmentations de salaires. En juillet 1971, 10 000 mineurs du charbon se mirent en grève à la mine de Lota Schwager. Dans les mines d'El Salvador, El Teniente, Chuquicamata, La Exotica, et Rio Blanco, de nouvelles grèves s'étendirent à la même époque, réclamant des augmentations de salaire. Allende déchaîne la répression contre les ouvriers La réponse d'Allende fut typiquement capitaliste : alternativement, il calomnia puis cajola les travailleurs. En novembre 1971 Castro vint au Chili pour renforcer les mesures anti-ouvrières d'Allende. Castro tempêta contre les mineurs, et les traita d'agitateurs "démagogues" ; à la mine de Chuquicamata, il déclara que "cent tonnes de moins par jour signifiait une perte de 36 millions de dollars par an". Alors que le cuivre est la principale source de devises du Chili, les mines représentent seulement 11% du produit national brut, et emploient seulement 4% de la force de travail, c'est-à-dire environ 60 000 mineurs du cuivre. Quoi qu'il en soit, l'importance numérique de ce secteur de la classe est tout à fait hors de proportion avec le poids que les mineurs représentent dans 1'économie nationale. Peu nombreux mais très puissants et conscients de l'être, les mineurs obtinrent de l'État l'échelle mobile des salaires et donnèrent le signal de l'offensive sur les salaires qui surgit dans toute la classe ouvrière chilienne en 1971. Toute la presse bourgeoise était d'accord pour affirmer que "la voie chilienne au socialisme" était une forme de "socialisme" qui a échoué. Les staliniens et les trotskistes bien sûr ont acquiescé, en conservant leurs différences talmudiques. De ces derniers, le capitalisme d'Allende a reçu un "soutien critique". Les anarchistes n'ont pas été en reste : "La seule porte de sortie pour Allende aurait été d'appeler la classe ouvrière à prendre le pouvoir pour elle-même et de devancer le coup d'État inévitable" écrivait le Libertarian Struggle (octobre 1973). Ainsi Allende n'était pas seulement "marxiste". C'était aussi un Bakounine raté. Mais ce qui est vraiment risible, c'est d'imaginer qu'un gouvernement capitaliste puisse jamais appeler les travailleurs à détruire le capitalisme ! En mai-juin 1972, les mineurs ont recommencé à se mobiliser : 20 000 se mirent en grève dans les mines d'El Teniente et Chuquicamata. Les mineurs d'El Teniente revendiquèrent une hausse des salaires de 40%. Allende plaça les provinces d'O' Higgins et de Santiago sous contrôle militaire, parce que la paralysie d'El Teniente "menaçait sérieusement l'économie". Les managers "marxistes", membres de l'Unité Populaire ont vidé des travailleurs et envoyé des briseurs de grève. 500 carabiniers attaquèrent les ouvriers avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. 4000 mineurs firent une marche sur Santiago pour manifester le 14 juin, la police les chargea sauvagement. Le gouvernement traita les travailleurs d'"agents du fascisme". Le PC organisa des défilés à Santiago contre les mineurs, appelant le gouvernement à faire preuve de fermeté. Le MIR, "opposition loyale" extraparlementaire à Allende, critiqua l'utilisation de la force et prit parti pour la "persuasion". Allende nomma un nouveau ministre des mines en août 1973 : le général Ronaldo Gonzalez, le directeur des munitions de l'armée. Le même mois, Allende alerta les unités armées dans les 25 provinces du Chili. C'était une mesure contre la grève des camionneurs, mais aussi contre quelques secteurs ouvriers qui étaient en grève, dans les travaux publics et les transports urbains. Pendant les derniers mois du régime d'Allende, la politique à l'ordre du jour fut celle des attaques généralisées et des meurtres contre les travailleurs et les habitants des bidonvilles, par la police, l'armée et les fascistes. A partir de ce moment, le cheval de Troie du capitalisme, l'Unité Populaire avait tenté de renforcer son électorat dans toutes sortes de "comités populaires" hiérarchisés, comme les 20 000 environ qui existaient en 1970, dans ces "comités de soutien au peuple" (JAPS) et finalement dans ces cordons industriels si vantés, que les anarchistes et trotskistes présentaient à l'époque comme des types de "soviets" ou de comités d'usine. Il est vrai que les cordons étaient dans la majorité des cas, l'�uvre spontanée des travailleurs, de même que beaucoup d'occupations d'usine, mais ils finirent par être récupérés par l'appareil politique de l'Unité Populaire. Comme un journal trotskiste l'admettait lui-même : "en septembre 1973 de tels cordons avaient surgi dans tous les faubourgs industriels de Santiago et les partis politiques de gauche poussaient à leur instauration dans tout le pays" ("Red Weekly", 5 octobre 1973). Les cordons n'étaient pas armés et n'avaient aucune indépendance par rapport au réseau des syndicats de l'Unité Populaire, des comités locaux de la police secrète etc. Leur indépendance n'aurait pu s'affirmer que si les travailleurs avaient commencé à s'organiser séparément et contre l'appareil d'Allende. Cela aurait signifié ouvrir la lutte de classe contre l'Unité Populaire, l'armée et le reste de la bourgeoisie. En décembre 1971, Allende avait déjà laissé Pinochet l'un des nouveaux dictateurs du Chili, se déchaîner dans les rues de Santiago. L'armée avait imposé des couvre-feux, la censure de la presse, et des arrestations sans mandat. En octobre 1972, l'armée (la chère "armée populaire" d'Allende) fut appelée à participer au gouvernement. Allende avouait par là l'incapacité de la coalition gouvernementale à mater et écraser la classe ouvrière. Il avait durement essayé mais avait échoué. Le travail dut être continué par l'armée sans fioritures parlementaires. Mais au moins l'Unité Populaire avait permis de désarmer les travailleurs idéologiquement : cela facilita la tâche des massacreurs le 11 septembre 1973. La gauche et l'extrême-gauche mystifient les ouvriers En réalité, Allende a pris le pouvoir en 1970 pour sauver la démocratie bourgeoise dans un Chili en crise. Après avoir renforcé le secteur d'État de façon à rentabiliser la totalité de l'économie chilienne en crise, après avoir mystifié une grande partie de la classe ouvrière avec une phraséologie "socialiste" (ce qui était impossible aux autres partis bourgeois) son rôle était terminé. Exit the King. L'aboutissement logique de cette évolution, un capitalisme totalement contrôlé par l'État, n'était pas possible au Chili qui restait dans la sphère d'influence de l'impérialisme américain et devait commercer avec un marché mondial hostile dominé par cet impérialisme. La "gauche" et tous les libéraux, humanistes, charlatans et technocrates se lamentèrent sur la chute d'Allende. Ils encouragèrent le mensonge du "socialisme" d'Allende pour tenter de mystifier la classe ouvrière. Déjà en septembre 1973, à Helsinki, les sociaux-démocrates de tous bords qui représentaient 50 nations s'étaient réunis pour "chasser" la junte chilienne. On a ressorti le slogan pourri de l'anti-fascisme, pour détourner la lutte de classe, pour cacher que les prolétaires n'ont rien à gagner en luttant et mourant pour une quelconque cause bourgeoise ou "démocratique". En France, Mitterrand et le "Programme Commun de la Gauche", tous les curés progressistes et les canailles bourgeoises ont entonné le ch�ur antifasciste. Sous couvert de l'"antifascisme" et de soutien à l'Unité Populaire, les divers secteurs de la classe dirigeante tentèrent de mobiliser les travailleurs pour leur replâtrage parlementaire. Face à cette nouvelle "brigade internationale" de la bourgeoisie, la classe ouvrière ne peut que montrer du mépris et de l'hostilité. Les fractions de l'"extrême gauche" du capitalisme d'État ont joué (évidemment !) le même rôle dans ce concert que le MIR dans celui d'Allende. Mais (quel subtil mais !) leur soutien était "critique". La question n'est pas "parlement contre lutte armée", mais capitalisme contre communisme, antagonisme entre la bourgeoisie du monde entier et les travailleurs du monde entier. Les prolétaires n'ont qu'un seul programme : l'abolition des frontières, l'abolition de l'État et du parlement, l'élimination du travail salarié et de 1a production marchande par les producteurs eux-mêmes, la libération de l'humanité tout entière amorcée par la victoire des conseils ouvriers révolutionnaires. Tout autre programme est celui de la barbarie, la barbarie et la duperie de la "voie chilienne au socialisme".
TRACT DE REVOLUTION INTERNATIONALE (organe du CCI en France)
A BAS LA "VOIE CHILIENNE" AU MASSACRE !
C'est par milliers que la racaille militaire massacre les ouvriers au Chili, Maison par maison, usine par usine on traque les prolétaires, on les arrête, on les humilie, on les tue. L'ordre règne. Et l'ordre du capital, c'est la BARBARIE. Plus horrible, plus révoltant encore, c'est que les travailleurs sont acculés, qu'ils le veuillent ou non à se battre dans un combat, où ils sont vaincus d'avance sans aucune perspective, sans qu'à aucun moment ils puissent avoir la conviction de mourir pour leurs propres intérêts. La "gauche" crie au massacre. Mais cette pègre armée, c'est le gouvernement d'Union Populaire qui l'a appelée au pouvoir. Ce que la "gauche" tait soigneusement, c'est qu'il y a dix jours, elle gouvernait encore avec ces mêmes assassins, qu'elle qualifiait "d'Armée Populaire". A ces criminels, ces tortionnaires, elle donnait l'accolade au même moment où DEJA ils commençaient à arrêter des ouvriers, perquisitionner dans les usines. Une chose doit être claire. Depuis trois ans de gouvernement de gauche, JAMAIS les ouvriers n'avaient cessé d'être trompés, exploités, réprimés. C'est la "gauche" qui a organisé l'exploitation. C'est elle qui a réprimé les mineurs en grève, les ouvriers agricoles, les affamés et sans-logis des bidonvilles. C'est elle qui a dénoncé les travailleurs en lutte comme des "provocateurs", c'est elle qui a appelé les militaires au gouvernement, Jamais l'Union Populaire n'a été autre chose qu'une façon particulière de maintenir l'ordre en trompant les travailleurs. Face à la crise qui s'approfondit à l'échelle mondiale, le capital chilien particulièrement en difficulté, devait d'abord avant de la régler à sa manière, mater le prolétariat écraser sa capacité de résistance. Et pour cela, il fallait procéder en deux temps. En premier lieu le mystifier. Cette mystification accomplie, on a amené les travail1eurs embrigadés derrière les drapeaux bourgeois de la "démocratie", pieds et poings liés au peloton d'exécution.
La gauche et 1a droite au Chili comme ailleurs, ne représentent que les deux aspects d'une même politique du Capital : écraser la classe ouvrière. On utilise les cadavres des ouvriers chiliens pour mystifier les ouvriers français La gauche et les gauchistes ne se contentent pas d'avoir amené les travailleurs au massacre. Mais de plus, ici en France, ils ont le culot d'utiliser les cadavres des prolétaires chiliens pour entamer une opération de DUPERIE à grande échelle : ils n'attendent même pas que le sang qui coule à Santiago ait séché pour appeler les ouvriers à manifester, à débrayer pour défendre la "démocratie" contre les militaires. Ce faisant, les Marchais, Mitterrand, Krivine et Cie se préparent déjà à jouer en France le même rôle que les Allende, le P.C. et le MIR gauchiste au Chili. Car en France, comme dans le monde entier, avec l'approfondissement de la crise, se posera le problème de briser le prolétariat.
En organisant la tromperie "démocratique" sur le Chili, la gauche se prépare déjà à prendre en main l'opération qui consistera a embrigader les ouvriers derrière les drapeaux des "nationalisations", de la république" et autres niaiseries, pour les clouer sur un terrain qui n'est pas le leur et les livrer à l'écrasement. Et en refusant de dénoncer la gauche, pour ce qu'elle est, les gauchistes se placent, eux aussi dans le camp du capital. La leçon Au Chili, la crise a frappé plus tôt et plus vite qu'ailleurs. Et avant même que le prolétariat ait vraiment engagé le combat, son propre combat, toutes les forces de la gauche, ce cheval de Troie de la bourgeoisie parmi les travailleurs, se sont employées à le museler pour l'empêcher d'apparaître comme force indépendante sur son propre terrain, avec son programme, qui n'est pas une quelconque réforme "démocratique", ou étatique du capital, mais la révolution sociale. Et tous ceux qui, comme les trotskistes, ont apporté la moindre caution à cette castration de la classe ouvrière, en soutenant ne serait ce que du bout des lèvres et de façon "critique" ces forces, portent aussi la responsabilité du massacre. Ces mêmes trotskistes en France prouvent qu'ils sont du même coté de la barricade que la fraction de gauche du capital, puisqu'ils polémiquent avec elle sur les moyens "tactiques" et militaires d'arriver au pouvoir et reprochent a Allende de ne pas avoir mieux embrigadé les ouvriers derrière lui !
Depuis la France en 1936 jusqu'au Chili en passant par la guerre d'Espagne, la Bolivie, l'Argentine, la même leçon s'y est dégagée des dizaines et des dizaines de fois.
Le prolétariat ne peut passer aucune alliance, ne faire aucun front avec les forces du capital, même si celles-ci se parent du drapeau de la "liberté" ou du socialisme. Toute force qui contribue à lier aussi faiblement que ce soit les ouvriers à une quelconque fraction de la classe capitaliste se situe de l'autre côté. Toute force qui entretient la moindre illusion sur la gauche du capital est un maillon d'une chaîne unique dont l'aboutissement est le carnage des ouvriers. Une seule "unité" : celle de tous les prolétaires du monde. Une seule ligne de conduite : l'autonomie totale des forces ouvrières. Un seul drapeau : la destruction de l'État bourgeois et l'extension internationale de la révolution. Un seul programme : l'abolition de l'esclavage salarié.
Quant à ceux qui seraient tentés de se laisser duper par les belles paroles, les discours creux sur la "république", les rengaines éc�urantes de l'"Unité Populaire", qu'ils regardent bien l'image horrible du Chili. Avec l'approfondissement de la crise, une seule alternative : reprise révolutionnaire ou écrasement du prolétariat !
Révolution Internationale, 18 septembre 1973
(1) Les chiffres officiels sont de 3000 morts mais les associations d'aide aux victimes parlent de plus de 10 000 morts et disparus.
(2) Il faut noter que les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir apporté un soutien aux "gorilles" sud-américains. Ainsi, la junte qui a pris le pouvoir en Argentine quelques temps après, qui a fait pour sa part 30 000 morts et qui a coopéré activement avec celle du Chili dans le cadre de l'Opération "Condor" pour assassiner des opposants, a reçu un soutien "technique" précieux d'experts militaires français qui lui ont enseigné leur "savoir-faire" acquis pendant la Guerre d'Algérie dans le domaine de la lutte contre la "subversion".
(3) MIR : "Mouvement de la Gauche Révolutionnaire"
Géographique:
Histoire du mouvement ouvrier : Notes pour une histoire du mouvement ouvrier au Japon, 3e partie
- 3460 reads
Nous publions ci-dessous la dernière partie d'une étude sur l'histoire du mouvement révolutionnaire au Japon dont les deux premiers volets sont parus dans les Revue internationale n°112 et 114.
L'Internationale communiste et le Japon
Bien que la classe ouvrière ait conquis le pouvoir en Russie en Octobre 1917, il a fallu beaucoup de temps avant que les révolutionnaires du Japon n'établissent un contact direct avec le centre de la révolution et le mouvement international. C'est ainsi qu'il n'y eut aucun contact entre les révolutionnaires japonais et russes en 1917 et 1918. En outre, au Congrès de fondation de l'Internationale Communiste en mars 1919, aucune délégation venant du japon n'était présente, et même si S. Katayama - établi aux Etats-Unis - avait été mandaté comme délégué de Tokyo et Yokohama, il ne put assister au Congrès. Les premier et second Congrès des Organisations Cornmunistes d'Orient eurent lieu en novembre 1918 et 1919 à Moscou, des délégués du Japon y étaient invités mais ils ne purent non plus y assister. Par contre, à la Conférence de Bakou en septembre 1920, un participant japonais provenant des Etats-Unis était présent ; il était membre des Industrial Workers of thc World (IWW) mais il n'avait aucun mandat d'aucune organisation du Japon et était venu de son propre chef.
Cet isolement prolongé vis-à-vis du reste du monde des révolutionnaires du Japon s'explique d'abord par le fait que les communications entre la Russie et le Japon étaient en grande partie interrompues à cause de la guerre civile durant laquelle l'armée japonaise - opposante des plus féroces à la révolution prolétarienne - fut impliquée jusqu'cn 1922 cri Sibérie et, ensuite, du fait de la faiblesse politique des révolutionnaires eux-mêmes. Il n'y avait aucun groupe parmi eux pouvant agir comme élément moteur en vue de la construction d'une organisation et de son intégration dans le mouvement révolutionnaire international. Ainsi l'Internationale Communiste n'avait aucun pôle de référence au Japon bien qu'elle ait toujours cherché à établir le contact.
L'absence d'une fraction capable de jeter les bases d'une nouvelle organisation, se révéla une grande faiblesse et le travail de préparation qu'accomplit une fraction pour la construction d'un parti ne peut être lui-même que le résultat d'un long processus de maturation, d'un combat difficile pour la compréhension marxiste de la question organisationnelle.
Ce n'est qu'après le début du reflux du mouvement révolutionnaire que l'Internationale Communiste, en s'appuyant sur une politique totalement opportuniste, s'est mise à oeuvrer de façon précipitée à la construction d'une organisation.
Après que la Troisième Internationale eut créé en 1920 à Shanghai un secrétariat pour l'Extrême-Orient auxquels participaient des révolutionnaires de Corée et de Chine, un contact fut établi en octobre de la même année avec l'anarchiste japonais Osugi. Le secrétariat de l'IC pour l'Extrême-Orient lui fit parvenir 2000 yens en vue de fonder une organisation au Japon.
Mais quelle crédibilité programmatique et organisationnelle pouvait avoir un anarchiste dans la construction d'un parti communiste ? Osugi lui-même demandait l'autonomie pour chaque "section nationale" et n'était d'accord que sur la fondation d'un bureau de coordination internationale. De plus, il n'avait aucun mandat de quelque groupe que ce soit mais lorsqu'il revint de Shanghai, il fonda le journal Rodo Undo deabour Movement). Les autres révolutionnaires toujours très dispersés ne montrèrent que peu de détermination dans ces années 1920-1921 pour mener à bien un tel projet. Quant à Osugi, il resta fidèle à ses principes anarchistes tout au long des événements qui se développaient en Russie et appela au renversement du gouvernement soviétique après la tragédie de Kronstadt en 1921. L'Internationale Communiste mit alors fin à tout contact avec lui et les efforts pour créer une organisation furent de ce fait un échec.
Au Japon même, à partir de la fin 1920, Yamakawa, Sakai et Arahata s'efforcèrent de regrouper des forces. C'est ainsi que Hachigatsu Domei dea Ligue d'Août) fut fondée en août 1920 ; en décembre 1920, elle se transforma en Nippon Shakai-shugi Domei (Japanese Socialist League). Différents courants venant d'horizons programmatiques et théoriques divers se regroupèrent et quelques 1000 membres s'y affilièrent. Son journal officiel s'appela Shakaishugi (Socialisme).
Dès le début, la police s'employa à réprimer l'organisation : entre août et novembre 1920, des réunions de préparation du travail furent dispersées et, le 9 décembre de la même année, la conférence de fondation prévue à Tokyo fut également dispersée par la police. Là encore, la tentative d'édifier une organisation échoua sous la forte pression policière. La dispersion et la fragmentation l'emportèrent, le processus de clarification et de regroupement ne purent faire une percée et, par contrecoup, les différents groupes continuèrent à publier différents journaux tels les Studics in Socialism - édité par Sakai et Yamakawa - Japan Labour News d'Arahata et Labour Movement d'Osugi. En mai 1921, la Socialist League fut officiellement interdite.
Le groupe Socialist League qui aurait dû jouer le rôle de pôle de regroupement, ne fut jamais en mesure d'établir une claire démarcation, d'entraîner une sélection à travers la clarification ni de poser les bases de la création d'une organisation révolutionnaire unie. Au lieu de cela, l'existence de différentes personnalités qui avaient regroupé des éléments autour d'elles et qui avaient chacune son journal, continua à dominer la scène révolutionnaire.
Le fiasco rencontré avec Osugi amena les délégués du bureau de l'IC de Shanghai à proposer à Yamakawa en avril 1921 de s'atteler à la tâche de créer un parti. Jusqu'alors, Yamakawa et Sakai qui était très proche de lui, avaient eu une attitude attentiste mais dorénavant, Yamakawa, Kondo et Sakai se tinrent à travailler à l'élaboration d'une plate forme et élaborèrent les statuts d'un "Comité Communiste provisoire". Mais ces camarades, même au printemps 1921, n'avaient pas encore l'intention de fonder un parti communiste. Le concept d’une organisation communiste comme organisation de combat qui aurait à jouer un rôle d'avant-garde dans la lutte révolutionnaire, n'était pas encore ancré dans les esprits. L'accent était seulement mis sur la diffusion des idées et sur la propagande communiste. Cependant, la volonté de ces camarades allait dans le sens d'intensifier les contacts avec ]'Internationale Communiste.
Kondo fut envoyé à Shan-liai en mai 1921 afin d'accélérer le rapprochement avec l'Internationale Communiste. Sa trajectoire politique avait été influencée par les IWW quand il était aux Etats-Unis et il avait participé au journal d'Osugi auparavant, Rondo Undo. Il exagéra les progrès effectués quand il s'entretint avec les délégués de l'IC parce qu'en réalité, très peu d'évolution était intervenue en vue de la création de l'organisation. Impressionnés par Kondo, les délégués lui promirent une aide fïnanciere et Kondo revint au Japon avec 6 500 yens mais n'utilisa pas l'argent pour construire l'organisation ([1] [129]).
A son retour à Tokyo, contrairement aux accords établis avec l'Internationale, Kondo fonda son propre groupe "Gyomin Kysanto" (Enlightened People's Communist Party) dont il devint le président en août 1921. Yakamawa et Sakai rejetèrent sa proposition de transformer le "Groupe de propaande communiste" en parti car ils n'avaient toujours pas digéré le revers de la dissolution de la Socialist League En mai 1921. Après une descente de police en décembre 1921, le groupe de Kondo fut mis hors-la-loi et dissous. Un délégué de l'IC, Grey, qui était également porteur de fonds de l’IC ainsi que d'une liste de contacts fut arrêté en même temps et les documents tombèrent aux mains de la Police : un autre revers pour l’IC dans ses efforts pour aider à la construction d'un parti.
Au moment du 3e Congrès de la Troisième Internationale durant l'été 1921, il n'y avait toujours pas de délégué du Japon ; les seuls camarades présents venaient des Etats-Unis (Gentaro était membre du Japonese Socialist Group et Unzo, des IWW). Une fois de plus, les révolutionnaires au Japon étaient coupés du débat central à Moscou concernant la situation et les méthodes de l'!C. A ce Congrès, les délégués des courants qui, plus tard, allaient se faire connaïtre comme la Gauche Communiste combattirent la tendance à l'opportunismc croissant dans l'IC.
Entre-temps, l'Internationale Communiste elle-même avait crée des comités pour le Japon, avec Radek pour coordinateur. Elle décida une campagna pour l'introduction du droit de vote généralisé, campagne qui survenait alors que le 1e Congrès de l'IC avait dénoncé le rôle dangereux de la démocratie bourgeoise et du parlementarisme et qu'aux 2e et 3e Congrès, les camarades de la Gauche italienne et de la Gauche germano-hollandaise mettaient en garde contre la tentation d'utiliser le parlementarisme. Au 3e Congrès, Taguchi Unzo, membre des IWW, s'opposa aussi à cette campagne.
L'Internationale Communiste appela à une Conférence des Peuples d'ExtrêmeOrient a l'automne 1921 ; elle fut organisée directement comme conférence alternative face au sommet des puissances impérialistes réunies à Washington en novembre 1921 où ces dernières avaient projeté de se partager les zones d'influence en Extrême-Orient.
Différents groupes du Japon furent invités à assister à cette Conférence d'Extrême-Orient. Le groupe de Yamakawa et celui de Kondo, Enlightened People's Communist Party, envoyèrent des délégués : s'y joignirent deux anarchistes ainsi que d'autres éléments. A la Conférence, qui se tint finalement en janvier 1922 à Petrograd, Takase, qui s'exprimait au nom du Enlightened People's Communist Party de Kondo, déclara qu'un parti communiste avait déjà été formé. De façon patente, c'était du bluff. Par ailleurs, l'anarchiste Yoshida, impressionné par le Congrès, annonça qu'il avait été `converti' au communisme : cependant, sur le chemin même du retour au Japon, il revint sur sa déclaration et réaffirma son allégeance aux positions anarchistes.
Boukharine, à cette même Conférence, demanda que la prochaine phase des luttes ouvrières au Japon se concentre sur la construction d'un régime entièrement démocratique à la place du projet d'établissentent immédiat de la dictature du prolétariat. De plus, l'objectif principal devrait être d'abolir le système impérial. En janvier 1922, Zinoviev parlait encore du Japon comme d'une puissance impérialiste mais quelques mois plus tard, quand le Parti communiste allait être fondé, le Japon n'allait plus être considéré comme impérialiste.
Malgré les efforts des forces révolutionnaires rassemblées à Petrograd enjanvicr 1922, les révolutionnaires du Japon continuèrent à rester dispersés ([2] [130]).
Les difficultés à accomplir des progrès décisifs dans la construction d'une organisation provenaient du fait que, à cause de l'isolement et des efforts insuffisants pour établir des liens au-delà du Japon, l'Internationale Communiste connaissait à peine les différentes composantes du milieu révolutionnaires au Japon, sans compter les raisons plus sérieuses : la sous-estimation de la question organisationnelle parmi les éléments les plus responsables, leur manque d'initiative pour établir le contact dans des circonstances difficiles, tous ces facteurs ont pesé dans les échecs répétés de l'IC.
Si l'IC choisit l'anarchiste Osugi et le très individualiste et imprévisible Kondo comme "hommes deconfiance", c'est parce que les éléments les plus sérieux au lapon n'avaient pas compris la nécessité de prendre directement contact avec l'Internationale communiste. Ils laissèrent cette initiative aux anarchistes et aux éléments les moins sérieux.
Même si l'Internationale a tenté d'offrir toutes sortes d'aide aux forces révolutionnaires du Japon, elle ne pouvait pallier au manque de conviction des révolutionnaires envers la nécessité d'un parti mondial dans le pays même. La responsabilité des révolutionnaires envers leur classe n'est jamais unie responsabilité "nationale", limitée à une zone géographique où les révolutionnaires vivent mais elle doit se baser sur une démarche internationaliste.
Ainsi, l'absence de tentatives critiques pour tirer les leçons de la décadence sur la question du parlementarisme d'un point de vue marxiste fui d'autant plus dramatique que les révolutionnaires au Japon n'avaient aucun contact avec les forces de la Gauche communiste qui émergeaient au même moment. Ces difficultés à rompre l'isolement ont contribué à la confusion politique et programmatique.
Quand, à partir de 1920. la vague révolutionnaire reflua, la classe ouvriére japonaise avait combattu sans qu'ait lieu en son sein une véritable intervention des révolutionnaires. Alorsq ue l'Internationale Communiste était déjà embarquée dans un cours opportuniste, celle-ci s'employa à regrouper les révolutionnaires du Japon désireux de participer à la construction du parti. C'est dans ce contexte qu'eut lieu la fondation du Parti communiste japonais ( PCJ) le l5 juillct 1922.
La fondation du Parti communiste japonais (PCJ)
Le parti était formé de dirigeants et de membres de différents groupes qui avaient peu d'expérience organisationnelle et il ne comportait aucune aile marxiste véritable et, notamment, aucune aile marxiste sur la question organisationnelle. D'anciens dirigeants, contactés et formés par I'IC, comme Sakai, Yamakawa, Arahata le rejoignirent et avec eux les groupes qu'ils avaient dirigés jusqu'alors tel e "Wednesday Society Group" de Yamakawa et la publication Vanguard, le cercle autour du Prolétariat de Sakai, "The Enlightened People's Communist Party", des membres des syndicats formés en 1921. En 1923, il était constitué de quelques 50 membres mais le concept même d'adhésion était un problème du fait que le parti ne comptabilisait aucun membre individuel, ces derniers appartenant à l'un des différents groupes qui s'étaient réunis pour former le parti. De plus, il n'y avait ni plate-forme ni statuts, aucun organe central élu. Les membres du parti étaient surtout actifs au sein de leur groupe d'origine, les groupes autour de Yamakawa et Sakai représentant le plus grand nombre de membres.
Au lieu de s'atteler à la tâche de colismiction d'un seul corps unifié, la vic du Parti allait être "fragmentée" et très fortement influencée par ces groupes et par le poids des anciennes personnalités dirigeantes. Du fait que la clarification programmatique n'avait pas été suffisamment effectuée, aucun programme n'avait été réellement élaboré.
De plus le parti ne possédait aucune presse autonome car du fait de sa situation d'illégalité, il ne pouvait publier aucune déclaration publique. C’est pourquoi, les membres prenaient position individuellement dans différentes publications politiques. C'est seulement en avril 1923 que 3 Journaux - Vanguard The Prolétariat, Studices in Socialism - fusionnèrent en un seul journal Sekki (Red Flag) qui devait représenter l'organe du parti.
Au même moment, le parti chercha à devenir un parti de masse et Yaniakima, suivant les orientations de l'Internationale, s'orienta dans ce sens. Ce parti de masse devait englober tous "les ouvriers organisés ou non-organisés ainsi que les paysans, les couches subalternes des classes moyenness et tous les mouvements et organisations anti-capitalites ". Le PCJ reprenait donc l'orientation de l'Internationale C'ommuniste mais c'était l’expression de sa politique opportuniste. En effet, la période des partis de masse était revolue commc cela avait été explicitement analysé par le KAfD allemand à l'époque.
Un programme pour le Japon fut élaboré en novembre 1922 par une commission de l'Internationale à la tête de laquelle se trouvait Boukharine. Le projct traitait du développement économique rapide du Japon pendant la Première Guerre mondiale mais surtout, il mettait l'accent sur le fait que « le capitalisme japonais montre encore des restes de rapports féodaux du passé, le plus importnat vestige étant l’empereur (mikado) à la tête du gouvernement (…) Les résidus du féodalisme joue également un rôle dominant dans toute la structure étatique actuelle. Les organes de l’Etat sont toujours aux mains d’un bloc composé de différentes parties de al bourgeoisie commerciale et industrielle et des grands propriétaires fonciers. Cette nature semi-féodale particulière de l’Etat est surtout illustrée par le rôle prédominant de la genro (noblesse, propriétaires féodaux) dans la constitution. A partir de cet arrière plan, les forces qui s’opposent à l’Etat, proviennent non seulement de la classe ouvrière, de la paysannerie et de la petite bourgeoisie mais émergent égaelment de couches plus larges de la soit disant bourgeoisie libérale – dont les intérêts sont aussi en opposition au gouvernement actuel (…) L’achèvement de la révolution bourgeoise peut devenir le prologue, le prélude à la révolution prolétarienne, visant à la domination de la bourgeoisie et l’établissement de la dictature du prolétariat (…) La lutte entre les seigneurs féodaux et la bourgeoisie prendra très certainement un caractère révolutionnaire."(Cité dans Houston, p.60, notre traduction.)
Alors qu'à son Congrès de fondation, l'Internationale Communiste dans son Manifeste avait mis la révolution à l'ordre du jour partout, l'IC dégénérescente commençait en 1922 à assigner des tâches historiques différentes au prolétariat selon les différentes zones du le monde.
Plaçant le Japon, la Chine et l'Inde sur le même plan car il y avait toujours une forte proportion de paysans au Japon et surtout parce qu'il y avait encore un empereur et des restes féodaux, l'IC proposa que la classe ouvrière du Japon fasse alliance avec des groupes bourgeois. L'Internationale communiste mais aussi le PCJ sous-estimaient le réel développement du capitalisme d'Etat qui s'était déjà profondément implanté au Japon.
Bien que l'empereur jouât encore un rôle en que représentant politique, cela ne changeait en rien la composition de classe de la société japonaise, ni les tâches historiques auxquelles la classe ouvrière était confrontée. L'industrie privée était certainement moins développée au Japon que dans d'autres pays industriels, du fait de l'histoire du développement du capitalisme dans ce pays. Mais depuis l'expansion du mode de production capitaliste, cette spécificité du capital japonais, la proportion relativement faible de capital privé par rapport au capital étatique, était "compensée" par la croissance rapide de l'Etat. Très tôt, l'Etat a joué un rôle actif et interventionniste pour défendre les intérêts nationaux japonais. A l'arrière-plan de cette position du PCJ et de l'Internationale Communiste, il y avait une sérieuse sous-estimation du niveau de capitalisme d'Etat qui avait pris des proportions bien plus énormes et qui, jusqu'à un certain point, était plus développé au Japon que dans la plupart des autres pays occidentaux.
Même si, du fait du faible développement du secteur capitaliste privé pendant la phase ascendante du capitalisme, il n'y avait pas autant de partis bourgeois qu'en Europe et si, globalement, le parlementarisme avait moins de poids et d'influence que dans les autres pays, cela ne voulait pas dire que la classe ouvrière du Japon avait des tâches historiques différentes et qu'elle devait combattre pour un parlementarisme démocratique bourgeois.
Cette orientation du PCJ devait rencontrer une résistance en son sein. Ainsi, Yamakawa affirmait que s'il n'y avait aucune démocratie bourgeoise et que le Japon était dirigé par des cliques militaires et bureaucratiques, contrairement à l'analyse de l'Internationale, il n'y avait aucune utilité de passer par une révolution bourgeoise. En conséquence, il prit position contre la mobilisation du parti sur le terrain électoral.
La thèse fut discutée à Lille conférence du parti en mars 1923, mais aucune décision ne fut arrêtée. Sano Manabu proposa une plate-forme alternative dont l'idée principale était que la révolution Prolétarienne était également à l'ordre du jour au Japon. Il existait aussi des divergences par rapport à la revendication du droit de vote généralisé et le même Sano Manabu rejeta la participation au parlement. Yamakawa se prononça aussi contre la participation aux élections.
Etant donné que la voix de la Gauche communiste d'Europe ne pouvait être entendue au Japon, ce qui aurait pu aider à l'approfondissement de cette critique cette dernière ne put être poussée plus avant et s'enraciner sur une base programmatique.
Du fait que les luttes de la vague révolutionnaire étaient sur le déclin à la fois internationalement et au Japon lui-même, le PC fut privé du test de l'intervention dans le feu du combat. En considérant son expérience organisationnelle limitée et ses positions politiquement confuses et opportunistes, on peu présumer que le parti aurait eu les plus grandes difficultés pour agir comme une organisation de combat et jouer son rôle d'avant-garde.
La stratégie de la bourgoisie japonnaise fut semblable à celle de n'importe quelle autre classe dominante - utilisation de la répression et infiltration du PC.J. Le 5 juin 1923 le parti fut interdit, quelques 100 à 200 membres furent arrêtés, tous les membres du parti connus de la police furent jetés en prison.
Le 24 mars 1924, le parti fut totalement dissous : Arahata s'opposa à la dissolution, défendant le besoin de lutter pour maintenir son existence et Sakai soutinrent la dissolution, déclarant qu'un parti d'avant-garde illégal n'était plus nécessaire ni désirable. Selon Yamakawa, un tel parti serait séparé des ouvriers et la proie de la répression bourgeoise, les révolutionnaires marxistes se devaient de rejoindre les organisations de masse telles les syndicats et les organisations paysannes et préparer le parti prolétarien légal du futur. C’est ainsi que le premier PC, qui ne fut jamais un corps solide mais plutôt un regroupement de diverses personnalités, n'ayant aucun tissu organisationnel, ne travaillant pas avec un esprit de parti ne fut jamais en mesure d'accomplir ses taches.
Après le reflux des luttes au niveau mondial, les révolutionnaires furent confrontés à la même tache : alors que l'IC dégénérescente avait mis en avant le mot d'ordre de construction de partis de masse et la politique du front unique, augmentant de la sorte la confusion parmi les ouvriers de plus en plus épuisés et désorientés, les révolutionnaires devaient, en conséquence, s'atteler à la tâche de développer le travail de fraction.
Mais une fois de plus, les révolutionnaires au Japon eurent à faire face à de grandes difficultés Pour remplir cette tâche. Aucune fraction ne surgit de leurs rangs pour combattre la dégénérescence de l'Internationale et pour poser les bases d'un futur parti.
La contre-révolution montante au Japon.
La bourgeoisie utilisa le rapport de forces qui penchait en sa faveur pour accroitre ses attaques contre la classe ouvriére au Japon. Alors que la classe ouvrière, pendant la Première Guerre mondiale et la vague révolutionnaire qui s'ensuivit, ne s'était pas autant radicalisée qu'ailleurs et qu'elle ne prit part à ces luttes que de manière périphérique, cette dernière allait être frappée durement à son tour pendant les années 1920 par la contre-révolution montante. Après l'interdiction du parti en 1923, le gouvernement saisit l'opportunité des effets d'un tremblement de terre dévastateur qui secoua Tokyo le 1er septembre 1923, où plus de 100 000 personnes périrent et où de larges parties de la ville furent détruites, pour accroître la répression contre lu classe ouvrière. Une "police de la pensée" spéciale (Tokko) fut créée procédant dans les années qui suivirent à des arrestations massives : 4000 ouvriers arrêtés en 1928, 5000 en 1929, 14 000 en 1932. 14 000 encore en 1933.
Tandis qu'en Europe il y eut une faible et courte reprise economique au cours des années 1920, le Japon fut frappé plus tôt par la crise économique mondiale provoquant des attaques accrues contre la classe ouvrière de ce pays. Jusqu'à l'éclatement de la grande crise au Japon qui débuta en 1927, deux ans avant le krach de 1929, la production avait déjà chuté de 40% dans les principales zones industrielles. La vaIeur des exportations japonaises se réduisit de 50%a entre 1929 et 1931 .
Le capital japonais se dirigeait à nouveau vers des conquétes militaires. Le budget pour l'armement. qui aux environs de 1921 - moment le plus fort de l'intervention contre la Russie - atteignait quasiment 50% du budget de l'Etat, ne fut jamais réellement réduit après la Premiére Guerre mondiale. Contrairement à l'Europe et aux Etats-Unis, il n'y eut pas véritablement de démilitarisation. Quelque diminution qu'il y ait pu avoir dans les budgets militaires, l'argcnt sorti de là fut immédiatcmcnt réinjecté dans la modernisation de l'armement. La classe ouvrière du Japon ne put offrir qu'une faible résistance aux attaques capitalistes et au cours vers la guerre. Dans ce contexte, I'Etat se trouva en position dominante dans l'économie beaucoup plus tôt que les Etats en Europe et commença à développer un régime capitaliste d'Etat très étendu, s'engageant de façon déterminée dans un cours à des conquètes militaires.
Le niveau de vie des ouvriers qui était beaucoup plus bas qu'en Europe chuta d'autant plus : leur revenu réel baissa d'une base de 100 en 1926 à 81 en 1930 jusqu'à 69 en 1931. La famine se répandit dans les campagnes ([3] [131]). Dans cet environnement d'une classe ouvrière affaiblie, avec un capital à l'offensive, il existait que les révolutionnaires tentent de dépasser à tout prix le rapport de forces défavorable en provoquant artificiellement des luttes et en essayant de construire un parti de masse.
Le P.C.J. devient un laquais du stalinisme
A la fin de la vague révolutionnaire en 1923 et alors que le stalinisme en Russie et au sein de l'IC se renforçait, de plus en plus de partis communistes se soumirent à la domination de Moscou, devenant son instrument. Le développement du PCJ illustre de façon aveuglante cet état de fait.
L'IC tenta de construire un nouveau parti à tout prix pour défendre les intérêts russes. Après la dissolution du parti en mars 1924, l'Internationale Communiste fonda un nouveau groupe communiste en août 1925 qui se proclama nouveau parti le 4 décembre 1926 mais qui n'était rien d'autre que le perroquet de Moscou. Déjà, en 1925, l'Internationale communiste avait commencé à critiquer dans les Thèses de Shanghai les positions et le travail du précédent parti. Les orientations de l'Internationale étaient que la révolution démocratique bourgeoise, qui avait été inaugurée avcc la restauration des Meiji, devait être achevée puisque des vestiges féodaux (surtout les propriétaires terriens féodaux) et la bourgeoisie subsistaient encore. L'internationale conlmuniste mettait donc l'accent sur les vestiges féodaux tout en admettant que : « l'Etat japonnais lui-même est un élement puissant du capitalisme japonnis. Aucun pays européen n 'est encore allé aussi loin dans l'introduction du capitalisme d’Etat que le Japon où 30% de tous Les investissements dans l'industrie et dans le secteur financier sont finances par l 'Etat ».
Cependant, selon l'Internationale, l'Etat japonais devait devenir réellement démocratiquebourgeois. Yamakawa s'opposa â cette analyse, mettant en exergue l'amalgame effectué entre l' Etat et le grand capital financier. Il affirma que la bourgeoisie détenait le pouvoir au Japon depuis longtemps et que le prolétariat devait établir une alliance anti-bourgeoise avec la paysannerie, rejetant la "révolution en deux temps" comme le défendait Moscou. Yamakawa soutenait l'idée qu'une aile gauche au sein du mouvement ouvrier ou un parti paysan-ouvrier pouvait prendre la place du PCJ interdit. Yamakawa se mit à publier un journal Rono (Paysan-Ouvrier) en décembre 1927.
L'Internationale communiste poursuivit sa politique "de noyautage et de conquête des syndicats". obtenant une grande influence dans le "Nippon Rodo Hyogikai" ("Labor Union Council of Japan")- fondé en mai 1925.
Aux élections parlementaires de 1928, le PC.I défendit "un front unique" avec les autres partis « capitalistes dee gauche », dont le nombre avaient autgmenté et dont sept d'entre eux avaient fusionné pour former le "Musan taishuto" ("Parti des Masses prolétariennes").
Après une autre vague de répression en mars 1928, tous les partis de gauche furent interdits et leurs dirigeants envoyés en prison. ils furent menacés de peine de mort s'ils poursuivaient des activités politiques clandestines. Cependant. une fois que la police emprisonné les leaders de l'ancien PC, Moscou put reconstituer à nouveau le parti en novembre 1921; et mettre en place un autre comité central qui pourrait suivre à la lettre les instructions de Moscou. Le comité central et le bureau politique du PCJ furent remplacés les années suivantes en fonction des changements de politique de l'Internationale. Après chaque nouvelle vaguc de répression et arrestations, une nouvelle direction était toujours envoyée par Moscou si bien que le parti était maintenu « artificiellement » en vie ; mais en dépit de tous les efforts déployés, Moscou ne réussit jamais à accroître de façon significative les adhésions. Le PCJ était devenu un simple laquais de Moscou.
Quand. en 1928. l'Internationale communiste déclara "le socialisme en seul pays" comme étant sa politique officielle et qu'il expulsa tous les militants dee la Gauche communistc qui restaient ainsi que les forces d'opposition trotskistes, le PCJ ne fit aucune objection. Il ne considéra pas cela comme une trahison des intérêts de la classe ouvrière par l' Internationale Communiste. Le PC,I. "alimenté" depuis 5 ans par Moscou a tous les niveaux, organisationnellement et programmatiquement, défenseur totalement loyal de Moscou, ne put opposer la moindre résistance à cette situation. Déjà en 1927, un groupe arrêté du PCJ mené par Mizino Shigeo, rejeta l'internationalisme et se mit à défendre l'idée du "socialisme national".
Des problèmes de langue et la difficulté d'accès aux textes de cette période, requierent de notre part de la prudence dans l'évaluation définitive de l'attitude du PCJ, mais au moment de l'écriture de ce texte, nous n’avons pas connaissance de groupes exclus ou de scissions du PCJ comme conséquence de leur opposition à la stalinisation ou a l'idée du "socialisme dans un seul pays". C’est pourquoi on petit présumer que le PCJ ne fit aucune critique et n'opposa aucune résistance à la stalinisation. En tout état de cause, s'il y eut des voix oppositionnelles, elles n'eurent aucun contact avec l'opposition en Russie, ni avec les courants de la Gauche communiste en dehors de la Russie. Même à propos des événements qui eurent lieu en 1927 en Chine voisine et qui furent durement débattus au sein de l'Internationale et internationalement, autant que l'on sache, il n'y eut aucune voix critique provenant du Japon dénonçant la politique désastreuse de l'Internationale.
Même si le parti n'avait pas encore trahi après l'annonce du "socialisme en un seul pays" par l'Internationale Communiste, il ne fut pas en mesure de donner naissance à une quelconque résistance prolétarienne, luttant pour une position internationaliste.
Le chemin vers la guerre de l'impérialisme japonais : l'élimination des voix internationalistes par le stalinisme.
Du fait que le capital japonais avait affronté une classe ouvrière offrant moins de résistance que le prolétariat en Europe, cela lui permit de s'engager dans un cours à la guerre systematique plus tôt que ses rivaux européens. En septembre 1931, l'armée japonaise cnvahissait la Mandchourie et installait un Etat mandchou fantoche.
Tandis que le cours à la guerre s’accélérait internationalement et alors que la guerre en Espagne milieu des années 1930 représentait la répétition générale en vue des confrontations en Europe et de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre entre le .lapon et la Chine se déroula de 1937 à 1945.
L'impérialisme japonais enclencha la spirale de la barbarie à un haut niveau avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 200 000 chinois furent massacrés en quelques jours à Nankin en 1937 et au total 7 millions de personnes furent tuées lors de cette guerre.
Le groupe de la Gauche communiste qui a publié Bilan était un des rares à défendre une position internationaliste (même au prix d'une scission) pendant la guerre d' Espagne : il représente le pôle de référence pour toutes les forces révolutionnaires. Au Japon, cependant, la précieuse tradition de l'internationalisme qui avait existé lors de la guerre de 1905 entre le Japon et la Russie et pendant la Première Guerre mondiale, avait été réduite au silence par le stalinisme. Le "Nippon Kukka Shakaito" ("Japonese State Socialist Party") - qu'on peut comparer au NSDAP de Hitler en Allemagne - qui fut fondé en 1931 et le Social Démocratie Party du Japon soutinrent ouvertement le cours impérialiste à la guerre du capital japonais. Le "Shakai Taishuto" ("Social Masses Party") se rallia également aux "efforts de défense" de l'armée japonaise en octobre 1934 dans la mesure où "l'armée combattait à la fois le capitalisme et le fascisme". La direction du "Shakai Taishuto" ("Socialist Party") qualifia la guerre contre la Chine de "guerre sacrée de la nation japonaise". Le congrès des syndicats japonais, Zenso, mit les grèves ouvrières hors-la-loi en 1937.
D'un autre côté, alors que les forces de la Gauche communiste défendaient seules l'internationalisme, le PCJ stalinien et Trotsky lui-même appelèrent à la défense de la Chine contre le Japon.
En septembre 1932, le PCJ déclarait : « La guerre de l’impérialisme japonais en Mandchourie marque le début d'une nouvelle série de guerres imperialistes dirigées en priorité contre la révolution chinoise et l'URSS (...) Si les imperialistes du monde entiers s’avisaient de lencer un défi à notre patrie, l'URSS, nous leur montrerions que le prolétariat mondial se souléverait par les armes contre eux (...) Vive l'Armée rouge d'Union soviétique et vive l 'Armée rouge de la Chine soviétique ! » (Langer. Red Flag in Japan, 1968, notre traduction). Avec les mots d'ordre de "A bas la guerre impérialiste" "Bas les pattes en Chince" "Défendons la Chine révolutionnaire et l'union soviétique !", le PC.J. appela à soutenir la Russie et la Chine contre le capital japonais. Le PC.J était devenu le meilleur laquais de Moscou.
Mais Trotsky jeta aussi par-dessus bord sa propre position qu'il avait maintenue pendant la Première Guerre mondiale. Partant d'une vision totalement erronée selon laquelle "L’aventure japonaise actuelle en Mandchourie peut mener le Japon à la révolution " (1931), (Le fascisme peut-il réellement triompher ? l’Allemagne clé de la situation internationale, 26/11/1931, notre traduction) - il appela l'Union soviétique à armer la Chine : "Dans la gigantesque lutte historique entre la Chine el le Japon, le gouvernement des soviet ne peut rester neutre, il ne peut prendre la même position par rapport à la Chiite et par rapport au Japon. Il se doit de soutenir pleinement le peuple chinois.". Considérant qu'il existait encore "des guerres progressistes possibles" il déclara : "S'il y a une guerre juste en ce monde, alors c'est celle du peuple chinois contre ses oppresseurs. Toutes les organisations de la classe ouvrière, toutes les forces rpgressistes de Chine, rempliront leur devoir dans celle guerre de libération, sans abandonlier le programme et leur indépendance politique. "(30/07/1937, notre traduction)
"Dans ma déclaration à la presse bourgeoise, j'ai parlé du devoir de toutes les organisationts ouvrières de Chine de participer activement et en première ligne à la guerre contre le Japon, sans renoncer le moins du monde à leur programme et à leurs activités autonomes. Mais les Eiffelistes ([4] [132]) appellent cela du socialpatriotisme'. Cela signifie la capitulation devant Tchang-Kaï-Chek ! Cela veut dire tourner le clos aux principe de la lutte de classe (...) Dans la guerre impérialiste, le Bolchevisme militait pour le défaitisme révolutionnaire. La guerre civile espagnole et la guerre sino-japonaise sont toutes deux desguerres impérialistes. (...) Nous prenons la même position par rapport à la guerre en Chine. Le seul salut pour les ouvriers et paysans de Chine est d'agir en tant que force autonome contre les deux armées, à la fois contre la chinoise et la japonnaise. (...) C'es quatre lignes du document des Eiffelistes du 1e septembre 1937 révèlent qu 'ils sont soit des traitres soit de parfaits idiots. Mais quand la stupidité atteint de telles proportions, cela revient à de la trahison.(...) Parler de défaitisme révolutionnaire en général sans faire la distinction entre les pays opprimés et les pays oppresseurs, c'est défigurer le Bolchevisme en une lamentable caricature et mettre cette caricature au service de l’impérialisme. La Chine est un pays semi-colonial qui va être transformer sous nos yeux en pays colonial par le Japon. En ce qui concerne ce dernier, il mène unc guerre impérialiste réactionnaire. Pour ce qui est de lar Chine, elle mène une guierre de libération progressiste. (...) Le patriotisme japonais à le visage hideux et abject du banditisme international. Le patriotisme chinois est lui légitime e progressiste. Placer ces deux patriotisme sur le même plan et parler de ‘social-patriotisme’montre que vous n’avait rien lu de Lénine, que vous n’avait rien compris à l'attitude des Bolcheviks dans la guerre impérialiste et défendre cela est tout simplemet faire insulte au marxisme. (...) Nous devons insister fortement sur le fait que la 4e Internationale est aux côtés de la Chine contre le Japon." ("Sur la guerre sinojaponaise", Lettre à Diego
Toute la tradition d'une lutte impitoyable contre les deux camps impérialistes était abandonnée par Trotsky. Seuls les groupes de la Gauche communiste défendirent clairement une position internationaliste lors de cette confrontation impérialiste. Le groupe de Bilan prit la position suivante à propos de cette guerre : "L'experience a prouvé que le proletariat international, lorsqu'il fut amené par l’Internationale communiste et pur la Russie soviétique, à envisager la possibilité de révolutions bourgeoises et anti-impérialistes en Chine (en 1927), s'est, en fait, sacrifie sur l’autel du capitalisme mondial" ("Résolution de la C.E. de la fraction italienne de la Gauche communistc internationale sur le Conflit sinojaponais", nov.-déc. 1937)
« Et c'est dans cette phase historique, où les guerres nationales sont reléguées au musée des antiquités, que l'on voudrait mobiliser les ouvriers autour de 'guerre d’émancipatin nationale ' du peuple chinois »
"Qui donc soutient aujourd'hui la 'guerre d’indépendance' de la Chine (...) : La Russie, l'Angleterre, les Etats-Unis, la France. Tous les impérialismes la soutiennent (...) Et jusqu'à Trotsky qui se laisse emporter à nouveau par le courant de la guerre impérialiste et qui préconise le soutien de la ‘guerre juste’ du peuple chinois" (... )
"Des deux côtés des fronts il y a une bourgeoisie rapace, dominatrice et qui ne vise qu’à faire massacrer les prolétaires. Il est faux, archi faut de croire qu 'il existe une bourgeoisie avec laquelle es ouvriers chinois peuvent, même provisoirement, faire un ‘bout de chemin ensemble' et que seul l'impérialisme japonais doit être abattu pour permettre aux ouvriers chinois de lutter victorieusement pour la revolution. Partout l’imparialisme mène ladanse et la Chine n’est que le jouet des autres impérialistes. Pour entrevoir le chemin des batailles révolutionnaires il faut que les ouvriers chinois et japonnais trouvent le chemin de classe qui les conduira les uns vers les autres : la fraternisation devant cimenter leur assauts simultanés contre leurs propres exploiteurs (...)"
« Seules, les fractions de la Gauche communiste internationale seront oppsoées à tous les courants traîtres et opportunistes et brandiront hardiment le drapeau de la lutte pour la révolution. Seules, elles lutteront pour la transformation de la guerre impérialiste qui ensanglante l'Asie en une guerre civile des ouviers contre leurs exploiteurs : fraternisation des ouvriers chinois et japonnais ; destruction des fronts de la 'guerre nationale' ; lutte contre le Kuomintang, lte contre l’impérialisme japonnais, luute contre tous les courants qui agissent parmis les ouvriers pour la guerre impérialiste »
"Le prolétaiat international doit trouver dans cette nouvelle guerre la force d 'échapper à ses bourreaux, aux traîtres et de manifester sa solidatité avec ses frères d'Asie en déclenchant des batailles contre sa propre bourgeoisie.
A bas la guerre impérialiste de Chine Vive la guerrc civile de tous les exploité contre la bourgeoisie chinoise et l'imperialisme japonnais !"(Bilan, "A bas le carnage impérialiste en Chine ! : Contre tous les bourreaux, pour la transformation immédiate de la guerre en guerre civile oct.-nov. 1937).
Ceci représentait la tradition internationaliste de la Gauche communiste la seule véritable continuité avec les positions des révolutionnaires de la Première Guerre mondiale. Cependant, aucune force révolutionnaire au Japon ne reprit, semble-t-il, cet étendard internationaliste.
En Europe, la bourgeoisie inaugura la politique des "fronts populaires" afin d'enrôler la classe ouvrière dans la bataille impérialiste de la défense des "Etats démocratiques" contre l'Allemagne fasciste de Hitler. Afin de mobiliser les ouvriers dans la guerre, la bourgeoisie avait besoin de tromper les ouvriers par la défense de la "démocratie". Cependant, au Japon, la classe ouvrière avait en grande partie déjà été défaite.
Les appels initiaux du PCJ en vue de l'établissement d'un front unique des partis de gauche afin de défendre l'Union soviétique, furent rejetés par ces mêmes partis qui s'étaient rangés derrière les intérêts de l'Etat japonais. Le PC.J. de son côté avait choisi son camp.
Les résidus du PCJ qui, une fois de plus, avait été interdit avant même le déclenchement de la guerre sino-japonaise, appela à la défense de l'Union soviétique contre le Japon.
Pendant la guerre, ce qui restait du PCJ appela à "la destruction de 1'ordre militaro-féodal du Japon par ‘une révolution démocratique-bourgeoise’, déclarant "qu’au sein de ce processu une active coopération avec les nations capitalistes serait nécessaire. " Sur la base de tels arguments, le P.C.J. soutint les Etats-Unis et la Russie dans leur conflit contre le « Japon impérial ! »
Durant l'hiver 1945-1946, le P.C.J. se réforma pendant l'occupation américaine. Un programme fut élaboré qui, à l'instar des thèses de 1927 et 1932, prévoyait un projet de "révolution en deux temps". La tâche immédiate consistait à "dépasser le système impérial, réaliser la démocratie du Japon, une réforme agraire ".
Cette stratégie offrit la base à une coopération avec les Etats-Unis pour la démilitarisation et la démobilisation du Japon. Le commandement suprême des forces alliées et des Etats-Unis était considéré comme une partie de la bourgeoisie progressiste dont la fonction historique était d'accomplir la révolution démocratiquebourgeoise.
Comme partout ailleurs dans le monde, la classe ouvrière au sortir de la guerre était plus faible que jamais.
La reconstruction eut lieu avec une classe fortement défaite et démoralisée. Pendant des décennies, la classe dominante se fit le plaisir de présenter la classe ouvrière au Japon comme l’exemple même d'une classe docile, servile, défaite et humiliée, travaillant pendant de longues heures et recevant de très bas salaires.
Quand en 1968, après les grèves massives en Europe et particulièrement en France, la classe ouvrière mondiale réapparut sur la scène de l'histoire, mettant fn à plus de cinquante ans de contre-révolution, la classe redonna naissance à une série de petits groupes révolutionnaires dont certains purent retrouver la tradition de la Gauche Communiste. Mais au Japon, les groupes de la gauche capitaliste dominaient totalement la scène politique. De ce que nous savons aucune force ne put établir des contacts avec le milieu politique prolétarien historique, c'est-à-dire les groupes se réclamant de la tradition de la Gauche communiste.
Après la période de reconstruction, avec l'entrée en crise et la récession ouverte au Japon depuis pratiquement une décennie, ce n'est qu'une question de temps pour que la classe ouvrière au Japon ne se trouve contrainte de se défendre contre les attaques de la crise à un niveau qualitativement plus élevé. Ces confrontations de classe nécessiteront l'intervention la plus déterminée des révolutionnaires. Néanmoins, pourque les révolutionnaires puissent remplir leur tâche, les éléments politiques prolétariens qui surgiront, devront établir un lien avec le milieu politique prolétarien international et se concevoir eux-mêmes comme une partie de cette entité internationale.
Plus de cent années d'isolement politique quasi complet doivent être surmontées. Les conditions pour entreprendre cette tâche n'ont jamais été aussi favorables.
DA
[1] [133] Après son arrivée dans le port japonais de Shimonoscki, il rata son train pour Tokyo. II dut pasaer la nuit en ville - où il dépensa une partie des fonds de l’IC en se payant les services d'une prostituée et en boissons alcoolisées. pendant la nuit il tomba, ivre, aux mains de la police qui lui contisqua le reste de l'argent que la prostituée ne lui avait pas arnaqué. Parlant à un espion de la police dans sa cellule de prison, il avoua sa mission en Chine, mais il fut néanmoins relâché.
[2] [134] Au moment même où la Conférence s’ouvrait à Petrograd, le groupe autour de Yamakawa conunençait à publier un journal, Zenei de’avant-garde). A partir d'avril 1922, le groupe autour de Sakai publia Musankaikyu dee Prolétariat) et à partir de juin 1922, Rodo Kumiai deabour Union) parut également. Entre-temps, à partir de janvier 1922, l'anarchiste Osugi avait aussi fait paraître Labour Movement.
[3] [135] La famine parmi la population à la campagne était un phénomène très répandu. La journée dee travail dans l'industrie du textile tournait autour de l2 heures et plus. Dans les annécs 1930, il y avait encore une proportion de 44% de femmes travaillant dans les usines et dans les industrie, textiles, 91% de la force de travail féminine vivait dans des dortoirs, afin qu'elle soit toujours plus disponible pour l'exploitation.
[4] [136] Eiffel, nom de guerre de Paul Kirchoff (1900-1972), membre du KAPD (Parti Communiste ouvrier allemand). Après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, il émigra en France, travailla pour la direction trotskiste allemande en exil, mais s'opposa à la politique trotskiste d'entrisme. Pendant son séjour au Mexique entre 1930 et 1940, il coopéra à la publication de Communismo, journal du "Grupo de trabajadores marxistas", cf. Revue Interrnationale n° 10. juin-août 1977.
Géographique:
- Japon [50]