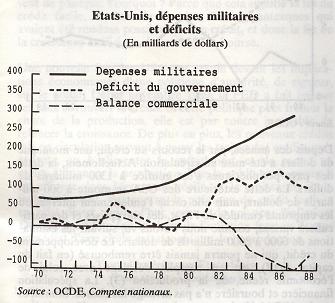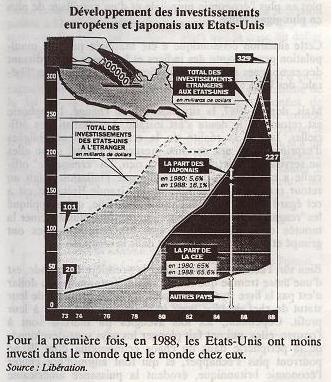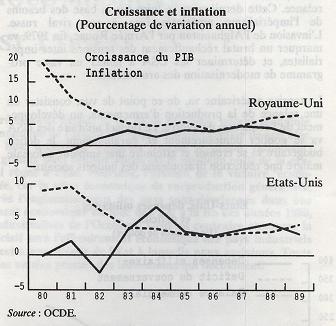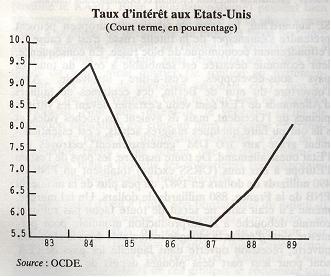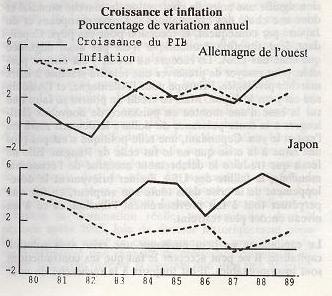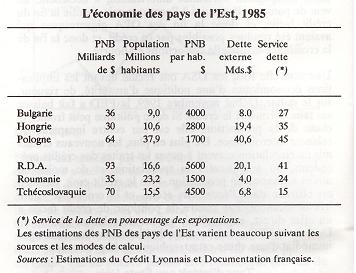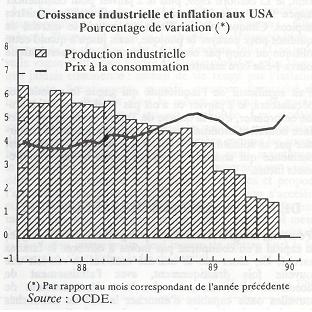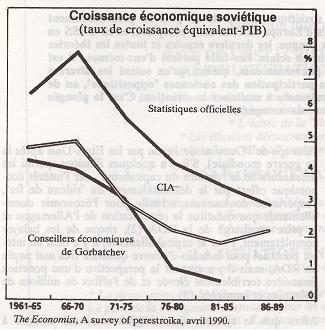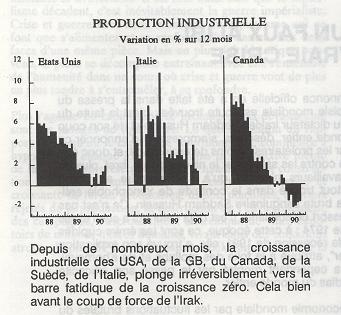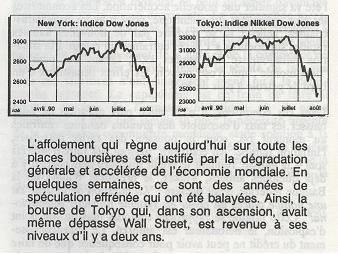Revue Int. 1990 - 60 à 63
- 4758 reads
Revue Internationale no 60 - 1e trimestre 1990
- 3325 reads
Ecroulement du bloc de l'est la faillite définitive du stalinisme
- 5008 reads
Présentation des 'Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est"
Les "Thèses"publiées dans ce numéro, ont été adoptées début octobre 1989. Depuis, les événements à l'Est se sont précipités, se télescopant les uns les autres, semaine après semaine, provoquant des situations qui, il y a encore 6 mois, eussent semblé inconcevables. A peine assistions-nous en août 1989 à cette incongruité que Solidarnosc hier encore clandestin - et qui plus est un "syndicat" - accède au gouvernement en Pologne, que d'autres événements, d'une portée historique considérable, secouaient tour à tour tous les pays de l'Est.
La Hongrie, où le parti "communiste" change de nom et proclame sa volonté de devenir social-démocrate, devient elle-même une simple république sans adjectif, renvoyant ainsi aux oubliettes de l'histoire son habit de démocratie populaire" et son appartenance au camp "socialiste". En RDA, l'élément "sage" du bloc de l'Est, son maillon apparemment le plus solide, alors que plus de 100 000 personnes, parmi la force de travail la plus qualifiée, ont déjà quitté, depuis le début de l'année ce pays du "socialisme réel" pour rejoindre la RFA, des manifestations de plus en plus importantes se développent dans toutes les villes, réclamant pêle-mêle des élections libres, la légalisation de l'opposition, la liberté de voyager. Honecker démissionne pour être écarté définitivement quelques semaines plus tard d'un parti contraint de renoncer à son rôle dirigeant exclusif et d'ouvrir le "mur de Berlin", symbole du renforcement en 1961 du partage du monde de la 2e guerre mondiale décidé à Yalta en 1944. En Bulgarie, puis en Tchécoslovaquie, les régimes hérités du stalinisme s'effondrent à leur tour.
Cette accélération de la situation, des convulsions qui se généralisent à tous les pays de l'Est, confirme le cadre tracé par les "thèses" quant à la crise historique du stalinisme et à ses racines. De plus, le rythme auquel les événements se succèdent fait que ce qui n'était encore qu'une perspective, se trouve aujourd'hui déjà totalement réalisé, à savoir l'effondrement définitif du stalinisme et la totale implosion du bloc de l'Est, réduisant dès aujourd'hui celui-ci à une simple fiction, fiction qui va rejoindre rapidement les poubelles de l'Histoire.
Cette situation, qui voit d'ores et déjà l'URSS et les pays de l'Est cesser de constituer un bloc impérialiste, a une importance historique considérable et marque le tournant le plus important depuis la fin de la seconde guerre mondiale et la reprise historique du combat prolétarien à la fin des années 1960, et ce tant sur le plan de l'impérialisme (l'ensemble des constellations impérialistes issues des accords de Yalta va être profondément déstabilisé), que sur le plan de ce qui reste plus que jamais la seule réelle alternative à la décomposition, à la barbarie, au chaos croissant provoqué par la crise historique du système capitaliste à un niveau mondial: la lutte prolétarienne ».
Crise et faillite du stalinisme sont celles du capitalisme, non du communisme
Les "thèses" développent longuement ce qui est à la racine de cette faillite :
- la crise généralisée du mode de production capitaliste à l'échelle mondiale ;
- l’échec de cette forme extrême, caricaturale, du capitalisme d'Etat que représente le stalinisme, produit et facteur de la contre-révolution en Russie.
Ce caractère aberrant du stalinisme n'a fait que renforcer considérablement les difficultés de capitalismes déjà faibles et arriérés face à la crise, et à l'exacerbation de la concurrence qu'elle provoque sur un marché mondial déjà sursaturé. Nous ne reviendrons donc pas ici sur les racines de l'effondrement définitif du stalinisme et du bloc de l'Est, mais nous nous attacherons à en actualiser l'évolution.
Il y a aujourd'hui un déchaînement de mensonges à cette occasion, et en premier lieu, le principal et le plus crapuleux d'entre eux : celui prétendant que cette crise, cette faillite c'est celle du communisme, celle du marxisme ! Démocrates et staliniens se sont toujours retrouvés, au-delà de leurs oppositions, dans une sainte-alliance, dont le premier fondement est de dire aux ouvriers que c'est le socialisme qui, au-delà de ses travers et déformations, règne à l'Est. Pour Marx, Engels, Lénine, Luxemburg, et pour l'ensemble du mouvement marxiste, le communisme a toujours signifié la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, la fin des classes, la fin des frontières, cela n'étant possible qu'à l'échelle mondiale, dans une société où règne l'abondance, "à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités", où "le règne du gouvernement des hommes cède la place à celui de l'administration des choses". Prétendre qu'il y aurait quelque chose de "communiste" ou d'engagé sur la voie du "communisme" en URSS et dans les pays de l'Est, alors que régnent en maître exploitation, misère, pénurie généralisée, représente le plus grand mensonge de toute l'histoire de l'humanité, mensonge aussi énorme que prétendre que les rapports entre serfs et seigneurs au Moyen Age avaient quelque chose de socialiste !
A l'Est les staliniens n'ont pu imposer ce mensonge que grâce à la terreur la plus brutale. L'instauration et la défense du "socialisme en un seul pays" se sont faites au prix de la plus sanglante et de la plus terrible contre-révolution, où tout ce qui pouvait subsister d'octobre 1917, et en premier lieu du parti bolchevique, a été férocement et systématiquement décimé, anéanti sous les coups et dans les geôles du stalinisme, avant de livrer à la déportation et à la mort, des dizaines de millions d'êtres humains. Cette féroce dictature, concentré hideux de tout ce que le capitalisme décadent contient de barbarie, n'a eu sans cesse que deux armes pour assurer sa domination: la terreur et le mensonge.
Ce mensonge représente un atout considérable pour toutes les fractions de la bourgeoisie face au cauchemar que représente pour celle-ci "le spectre du communisme", la menace que fait peser sur sa domination la révolution prolétarienne. Or, la révolution d'octobre 1917 en Russie et la vague révolutionnaire mondiale qui l'a suivie jusqu'au début des années 1920, restent jusqu'à présent le seul moment de l'histoire où la domination bourgeoise a été ou renversée par le prolétariat (en Russie en 1917) ou réellement menacée par celui-ci (en Allemagne en 1919). Dès lors, identifier Octobre, identifier la révolution prolétarienne avec son bourreau et son fossoyeur : la contre-révolution stalinienne, représente pour tous nos bons "démocrates" un atout majeur dans la défense de l’ordre bourgeois. Pendant plusieurs décennies, le fait qu'une majorité de la classe ouvrière identifiait positivement, grâce à l'immense prestige d'Octobre 1917, révolution et stalinisme, communisme et régimes de l'Est, a été le facteur idéologique le plus puissant responsable de l'impuissance du prolétariat. Il a été l'instrument de sa soumission jusqu'à accepter de se faire massacrer dans la deuxième boucherie mondiale, justement au nom de la défense du camp "socialiste", allié pour l'occasion au camp de la "démocratie", contre le fascisme, après avoir été l'allié de Hitler au début de la guerre. Le prolétariat n'a jamais été aussi faible, aussi soumis à l'idéologie dominante que lorsque les partis staliniens ont été forts, auréolés qu'ils étaient encore du prestige de l'Octobre rouge. Mais, lorsque cette croyance dans le caractère prétendument socialiste de l'URSS s'est effritée, sous les coups de la reprise historique des combats de la classe ouvrière à l'Est comme à l'Ouest depuis 1968, jusqu'à provoquer un profond rejet du stalinisme dans l'ensemble du prolétariat, il était encore plus vital pour les "démocraties" de maintenir en vie cette monstrueuse fiction du "socialisme" à l'Est. A l'heure où l'aiguillon de la crise à nouveau ouverte du système capitaliste, à l'échelle mondiale, poussait, et pousse de plus en plus les prolétaires à élargir et renforcer leur combat contre la bourgeoisie et son système ; à l'heure où se posait, et se pose de plus en plus à la classe ouvrière la question de donner une perspective à son combat ; il ne fallait surtout pas que la mise à nu de ce plus grand mensonge de l'Histoire : l'identification entre stalinisme et communisme, ne favorise le développement dans le prolétariat de la perspective de la révolution.
C'est pourquoi le maintien de cette fiction représente plus que jamais un enjeu considérable pour la bourgeoisie. Le maintien de ce monstrueux accouplement entre "révolution" et "stalinisme", après avoir servi en "positif", sert aujourd'hui en "négatif", en tant que repoussoir à toute idée de perspective de révolution. Au moment où, pour l'ensemble de l'humanité, est posée de plus en plus crûment l'alternative historique, socialisme ou barbarie sans fin, jusqu'à l'holocauste final, il est vital pour la bourgeoisie de discréditer et de salir le plus possible la perspective du communisme aux yeux des ouvriers.
C'est pourquoi, avec l'effondrement définitif du stalinisme, les "démocrates" redoublent d'effort pour maintenir en vie ce répugnant mensonge : "Octobre 1917 = stalinisme", "marxisme = stalinisme", "URSS = communisme". Avec tout le cynisme dont est capable la classe dominante, on étale partout l'image de ces dizaines de milliers d'ouvriers fuyant le "socialisme" pour rejoindre les pays "d'abondance et de liberté" que sont censées être les "démocraties" capitalistes occidentales. Ce faisant, on essaye de discréditer, aux yeux des prolétaires, toute perspective d'une autre société que celle basée sur le profit et l'exploitation de l'homme par l'homme. Et plus encore on assène la mystification selon laquelle la "démocratie" serait sinon le meilleur, du moins "le moins pire" des systèmes. Enfin, et c'est là un danger bien réel, on tente également d'entraîner les ouvriers à l'Est à lutter pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, à épouser la lutte que se livrent les cliques "réformatrices" et staliniennes - Gorbatchev ou Eltsine contre Ligatchev en URSS, "Nouveau Forum" contre SED en RDA, etc. -, et sans compter les différentes "nationalités".
La classe ouvrière, chaque fois qu'elle est tombée dans un tel piège au cours de son histoire, non seulement n'a rien obtenu, mais s'est en fin de compte toujours fait massacrer, comme dans la guerre d'Espagne en 1936-39, au nom du mirage de la "république" bourgeoise. Staliniens et "démocrates", staliniens et "anti-staliniens" ne sont, en réalité, que deux facettes d'un même visage, celui de la dictature bourgeoise. Il faut se rappeler qu'au cours de la seconde boucherie mondiale, les "démocraties" anglaise et nord-américaine n'ont pas hésité à s'allier avec Staline pour mener à bien la guerre contre l'Allemagne. Leur opposition d'alors, qui aboutit au partage du monde en deux zones d'influence antagoniques, ne relève pas d'une opposition idéologique, entre un bloc qui serait "socialiste" et un bloc capitaliste. Elle est bel et bien l'expression de deux blocs, également capitalistes et impérialistes, devenus rivaux.
C'est seulement lorsque l'URSS, profitant de l'écroulement de l'impérialisme allemand, a pu constituer en bloc impérialiste la zone d'influence dont elle a hérité en Europe, que les "démocraties" ont soudainement redécouvert qu'on ne pouvait que s'opposer à un système "communiste" et "totalitaire". Avant la guerre, l'URSS était isolée et une puissance de second ordre, et on pouvait s'allier avec ce même système "communiste et totalitaire". Ce n'est plus le cas lorsque celui-ci, dans les années 50, est une puissance impérialiste de premier plan, et donc un rival impérialiste sérieux!
C'est pourquoi, si le prolétariat ne peut que vomir le stalinisme et les staliniens, il doit tout autant rejeter le camp de la "démocratie" et des "anti-staliniens". Il n'a pas à choisir, sous peine d'abandonner le terrain de classe, de servir alors d'otage et d'être la victime impuissante, dans une lutte qui n'est pas la sienne, entre ces deux bourreaux capitalistes de la révolution prolétarienne que furent le stalinisme et la "démocratie" qui redore son blason aujourd'hui.
C'est la "social-démocratie" qui, ne l'oublions jamais, en écrasant la révolution en Allemagne de 1919 à 1923, condamnant ainsi la révolution russe à un terrible isolement, a ouvert la route au stalinisme et au fascisme.
Fin du bloc impérialiste russe fin de "Yalta" vers le chaos mondial
L'effondrement de ce pur produit de la contre-révolution qu'est le stalinisme, ne peut s'effectuer qu'à travers des convulsions toujours plus profondes, plus généralisées jusqu'à créer une situation de véritable chaos dans ce qui était jusqu'à présent la seconde puissance impérialiste mondiale et le deuxième "bloc".
On assiste, jour après jour, à la généralisation de ces convulsions, à la perte croissante de contrôle de la bourgeoisie sur les événements.
Le syndicat Solidarnosc entre au gouvernement en Pologne, avec comme objectif la "libéralisation de l'économie" et la volonté ouvertement déclarée de se "rapprocher" de l'Ouest, sans que Moscou ne puisse s'y opposer, feignant de l'encourager.
Le parti stalinien au pouvoir en Hongrie change de nom, se proclame social-démocrate, revendique un statut de neutralité pour ce pays, demande son adhésion à l'un des plus importants organismes du bloc de l'Ouest, le Conseil de l'Europe, ce qui équivaut à quitter le Pacte de Varsovie : Gorbatchev envoie un télégramme de félicitations.
En Bulgarie, en RDA, en Tchécoslovaquie, les vieux staliniens sont écartés. La RDA ouvre ses frontières où s'engouffrent des centaines de milliers de personnes.
Partout (sauf en Roumanie au moment de la rédaction de cet article), se produisent quotidiennement des changements dont un seul d'entre eux aurait entraîné l'envoi immédiat des chars russes il y a quelques années. Ce n'est pas là l'expression d'une politique délibérément choisie de la part de Gorbatchev, comme on le présente en général, mais la manifestation de la crise dans l'ensemble du bloc, et en même temps de la faillite historique du stalinisme. La rapidité de ces événements, et le fait que ceux-ci touchent désormais de plein fouet le pilier central sur lequel reposait le bloc de l'Est, la RDA, est le plus sûr symptôme que le deuxième bloc impérialiste mondial a totalement implosé.
Ce changement est désormais irréversible et touche non seulement le bloc, mais son coeur, sa tête, l'URSS elle-même, dont la manifestation la plus claire d'écroulement est le développement du nationalisme sous la forme de revendications d'"autonomie" et d'"indépendance" dans les régions périphériques d'Asie centrale, de la côte de la mer Baltique, et également d'une région aussi importante pour l'économie nationale soviétique que l'Ukraine.
Or, pour un bloc impérialiste, dès qu'un chef de file n'est plus capable de maintenir un tant soit peu la cohésion d'ensemble, et plus encore, dès qu'il n'est plus capable de maintenir l'ordre à l'intérieur même de ses frontières, il ne peut que perdre son statut de puissance mondiale. L'URSS et son bloc ne sont plus au centre des antagonismes interimpérialistes entre deux camps capitalistes, qui est la polarisation ultime que peut atteindre l'impérialisme au niveau mondial dans la période de décadence du capitalisme.
L'implosion du bloc de l'Est, sa disparition en tant qu'enjeu dominant des conflits inter-impérialistes, implique la remise en cause radicale des accords de Yalta, et la généralisation d'une instabilité de l'ensemble des constellations impérialistes constituées sur la base de ces accords, y compris du bloc de l'Ouest dominé depuis 40 ans par les USA. A son tour ce dernier ne peut que connaître, à terme, une remise en cause de ses propres fondements. Si, au cours des années 1980, c'est la cohésion de tous les pays occidentaux contre le bloc russe, qui a constitué un facteur supplémentaire de l'effondrement de ce dernier, le ciment de cette cohésion n'existe plus aujourd'hui. S'il n'est pas possible de prévoir le rythme et les formes que prendra l'évolution de la situation, la perspective est à des tensions entre les grandes puissances au sein du bloc occidental actuel, à la reconstitution à terme de deux nouveaux blocs impérialistes à l'échelle internationale, pour, en l'absence d'une réponse prolétarienne, une nouvelle boucherie mondiale. L'effondrement définitif du stalinisme et son corollaire, l'implosion du bloc impérialiste de l'Est, sont donc porteurs dès à présent d'une déstabilisation de l'ensemble des constellations impérialistes issues de Yalta.
La remise en cause de l'ordre impérialiste hérité de la 2e guerre mondiale, et le fait que la reconstitution de deux nouveaux camps impérialistes majeurs prendra inévitablement un certain temps, ne signifient en aucune façon la disparition des tensions impérialistes. La crise généralisée du mode de production capitaliste ne peut que pousser toujours plus tous les pays, du plus grand au plus petit, et au sein de chaque pays les différentes fractions de la bourgeoisie, à tenter de régler sur le terrain militaire les conflits et la concurrence qui les opposent. Aujourd'hui, la guerre déchire toujours le Liban, l'Afghanistan, le Cambodge, le Salvador, etc. Loin de signifier la paix, l'implosion des blocs issus de Yalta est porteuse, comme la décomposition du système capitaliste qui en est à l'origine, de toujours plus de tensions et de conflits. Les appétits de sous-impérialismes, jusque là déterminés surtout par la division mondiale entre deux camps principaux, que les têtes de bloc ne dominent plus aujourd'hui comme auparavant, vont se développer.
Le stalinisme ne meurt pas pacifiquement en cédant tranquillement sa place à des formes "démocratiques" de la dictature bourgeoise. Il n'y aura pas de transition "en douceur" mais au contraire le chaos. L'agonie de la charogne stalinienne va se faire dans une "libanisation" de l'ensemble du bloc de l'Est. Les affrontements entre cliques bourgeoises rivales nationalistes en URSS même, les tensions entre Hongrie et Roumanie, RDA et Tchécoslovaquie, Roumanie et URSS, RDA et Pologne, etc., les débuts de pogroms auxquels on assiste actuellement en Moldavie, en Arménie, en Azerbaïdjan, indiquent et montrent la perspective de la décomposition généralisée, concentré de toute la barbarie du capitalisme décadent.
Conséquences pour le prolétariat de la décomposition généralisée du bloc de l'est
Derrière les réformes, la "démocratisation", les tentatives de libéraliser l'économie, derrière tous les beaux discours sur "les lendemains qui chantent", la réalité que vivent les ouvriers, c'est d'ores et déjà une dégradation considérable de leurs conditions de vie pourtant déjà très dures. On manque de tout en Pologne et en URSS, on ne trouve presque plus de savon et de sucre à Moscou et Leningrad pourtant traditionnellement mieux approvisionnées. Partout le rationnement se généralise et devient de plus en plus drastique. L'hiver va être terrible car les mesures de libéralisation décidées en Pologne, Hongrie et amorcées en URSS, cela veut dire qu'il y aura toujours pénurie et que le marché noir va devenir de plus en plus inaccessible pour les ouvriers, car le taux d'inflation va bientôt atteindre trois chiffres comme en Pologne, et la vérité des prix va toucher en premier lieu les produits de première nécessité. La libéralisation de l'économie, et son corollaire l'autonomie des entreprises, cela veut dire l'apparition et le développement d'un chômage massif. On mesure l'ampleur de ce chômage, lorsque l'on sait qu'en Pologne, plus d'un tiers des ouvriers devrait être licencié en cas de fermeture des usines non rentables (dixit les experts économiques du gouvernement de Solidarité). En URSS, alors que déjà plusieurs millions d'ouvriers sont de fait au chômage, c'est 11 à 12 millions d'ouvriers qu'il faudrait réduire au chômage d'ici cinq ans. En Hongrie, c'est la majorité des usines que l’on devrait fermer pour cause d'obsolescence et de non-compétitivité ! C'est donc une misère terrible, digne des pays du "tiers-monde", qui attend et tend déjà à toucher le prolétariat de l'Est.
Face à de telles attaques, ce prolétariat va se battre, va tenter de résister, comme le font par exemple les mineurs sibériens qui ont repris leurs grèves de l'été pour réclamer le respect des accords passés avec le gouvernement. Il y a et il y aura des grèves. Mais la question est : dans quel contexte, dans quelles conditions vont se dérouler ces grèves ? La réponse ne doit souffrir d'aucune ambiguïté : une extrême confusion due à la faiblesse et l'inexpérience politique de la classe ouvrière à l'Est, inexpérience rendant particulièrement vulnérable la classe ouvrière à toutes les mystifications démocratiques, syndicales et au poison nationaliste. On le voit en Pologne, en Hongrie, en URSS, où des ouvriers russophones font grève contre des ouvriers baltes et vice versa, ou encore Azéris et Arméniens. Le symbole, sans aucun doute le plus tragique de cette arriération politique du prolétariat de l'Est, c'est ce qui se passe en RDA. Le prolétariat de ce pays hautement industrialisé, situé en plein coeur de l'Europe, ce prolétariat, qui avait été au coeur de la révolution allemande en 1919 (en Saxe et Thuringe), qui avait le premier exprimé son rejet du stalinisme en 1953, manifeste aujourd'hui massivement, mais manifeste en étant totalement dilué dans la population. On crie "Gorby ! Gorby !" en revendiquant pêle-mêle la démocratie, la légalisation des partis d'opposition, sans jamais que ne s'affirment, ne serait-ce qu'embryonnairement, de revendications en tant que classe ouvrière. C'est une image terrible que de voir cette classe ouvrière allemande "s'organiser" à partir des églises luthériennes et se noyer dans le "peuple" en général !
La haine du stalinisme est si forte, si viscérale, que le mot même de prolétariat paraît "maudit", contaminé par la charogne du stalinisme. Ce faisant, en crevant le stalinisme empuantit encore l'atmosphère, et rend un dernier et précieux service à la bourgeoisie, en paraissant condamner aux yeux des prolétaires de l'Est jusqu'à toute revendication de l'identité et des intérêts de la classe ouvrière, en transformant en un terrifiant repoussoir, en cauchemar, toute idée de révolution.
Cet héritage de la contre-révolution stalinienne pèse terriblement. Même si, sans nul doute, la combativité ouvrière à l'Est ne pourra que se manifester face à des attaques de plus en plus insupportables, la conscience de classe, elle, connaîtra d'immenses difficultés pour se frayer un chemin. On ne peut pas exclure la possibilité, pour des fractions importantes de la classe ouvrière, de se faire embrigader et massacrer pour des intérêts qui lui sont totalement opposés, dans des luttes entre cliques nationalistes ou entre cliques "démocratiques" et staliniennes.
Le prolétariat dans son ensemble, internationalement, se trouve face à un surcroît de difficultés, pour le développement de la prise de conscience de la classe, provoquées par cette nouvelle situation (Voir l'article Des difficultés accrues pour le prolétariat dans ce numéro).
Perspectives
Nous entrons dans une période totalement nouvelle qui va profondément modifier aussi bien la configuration des constellations impérialistes (le bloc de l'Ouest va lui aussi être touché, même si c'est à un degré moindre et à un rythme moins frénétique, par les convulsions et l'instabilité, cela est inévitable dans la mesure où son fondement, sa raison d'être principale, l'autre bloc, a cessé d'exister) que les conditions dans lesquelles se déroulaient jusqu'à présent les combats de classe.
Dans un premier temps, cette période nouvelle va être une période difficile pour le prolétariat, car en dehors du poids accru de la mystification démocratique, et ce y compris à l’Ouest, il va être confronté à la nécessité de comprendre les nouvelles conditions dans lesquelles son combat va se dérouler. Cela prendra inévitablement du temps, d'où la profondeur du recul dont parlent les "thèses". Il va devoir en particulier s'affronter de façon frontale à la mystification démocratique et notamment ses deux piliers les plus pernicieux, la social-démocratie et les syndicats.
La classe ouvrière du coeur du capitalisme, en particulier celle d'Europe occidentale, est la seule en mesure de véritablement confronter et combattre cette mystification, et a de ce fait une responsabilité historique considérablement accrue, à la mesure de la fantastique accélération de l'histoire qui se produit depuis quelques mois. Elle seule peut véritablement aider par le développement de ses luttes les ouvriers de l'Est à surmonter le piège mortel des illusions démocratiques dans lesquelles ils ont tous les risques de s'embourber.
Plus que jamais, la crise économique reste le meilleur allié du prolétariat, le stimulateur de cette confrontation indispensable à la "démocratie". La perspective d'une nouvelle récession ouverte, dont les symptômes avant-coureurs sont en train aujourd'hui de rapidement se développer (Voir l'article Crise économique mondiale : après l'Est, l'Ouest, dans ce numéro), en accélérant le rythme de l'effondrement du coeur du capitalisme, le capitalisme occidental, "en balayant les illusions sur la reprise de l'économie mondiale (...) et en dévoilant la faillite historique de l'ensemble du mode de production capitaliste et non seulement de ses avatars staliniens", va aider le prolétariat à comprendre, d'une part que la crise, l'effondrement à l'Est, n'est qu'une expression de la crise du système capitaliste en général, et d'autre part que lui seul détient la solution à la crise historique, à la décomposition généralisée du capitalisme.
Non seulement les attaques redoublées des conditions de vie du prolétariat vont contraindre la classe ouvrière à reprendre et à élargir ses luttes, mais elles vont, plus encore, face à la faillite évidente du capitalisme "libéral" et "démocratique" le contraindre à inscrire ses luttes dans ce qui reste plus que jamais la seule perspective : la révolution communiste mondiale. Plus que jamais, dans ce chaos, l'avenir appartient au prolétariat.
RN. 19/11/89
Géographique:
Questions théoriques:
- Décomposition [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
Effondrement du bloc de l'Est : des difficultés accrues pour le prolétariat
- 6490 reads
Le stalinisme a constitué le fer de lance de la plus terrible contre-révolution subie par le prolétariat au cours de son histoire. Une contre-révolution qui a permis en particulier la plus grande boucherie de tous les temps, la deuxième guerre mondiale, et l'enfoncement de toute la société dans une barbarie sans exemple par le passé. Aujourd'hui, avec l'effondrement économique et politique des pays dits "socialistes", avec la disparition de fait du bloc impérialiste dominé par l'URSS, le stalinisme, comme forme d'organisation politico-économique du capital et comme idéologie, est en train d'agoniser. C'est donc un des plus grands ennemis de la classe ouvrière qui disparaît. Mais la disparition de cet ennemi ne facilite pas pour autant la tâche de celle-ci. Au contraire, dans sa mort elle-même, le stalinisme vient rendre un dernier service au capitalisme. C'est ce que se propose de mettre en évidence le présent article.
Dans toute l'histoire humaine le stalinisme constitue le phénomène certainement le plus tragique et haïssable qui n’ait jamais existé. Il en est ainsi non seulement parce qu'il porte la responsabilité directe du massacre de dizaines de millions d'êtres humains, parce qu'il a instauré pendant des décennies une terreur implacable sur près d'un tiers de l'humanité, mais aussi, et surtout, parce qu'il s'est illustré comme le pire ennemi de la révolution communiste, c'est-à-dire de la condition de l'émancipation de l'espèce humaine des chaînes de l'exploitation et de l'oppression, au nom justement de cette même révolution communiste. Parce que, ce faisant, il a été le principal artisan de la destruction de la conscience de classe au sein du prolétariat mondial lors de la plus terrible période de contre-révolution de son histoire.
Le rôle du stalinisme dans la contre-révolution
Depuis qu'elle a établi sa domination politique sur la société, la bourgeoisie a toujours vu dans le prolétariat son pire ennemi. Par exemple, au cours même de la révolution bourgeoise de la fin du 18eme siècle, dont on vient de célébrer en grandes pompes le Bicentenaire, la classe capitaliste a tout de suite compris le caractère subversif des idées d'un Babeuf. C'est pour cela qu'elle l'a envoyé sur l'échafaud, même si, à l'époque, son mouvement ne pouvait constituer une réelle menace pour l'Etat capitaliste ([1] [4]). Toute l'histoire de la domination bourgeoise est marquée par les massacres d'ouvriers perpétrés dans le but de protéger cette domination : massacre des canuts de Lyon en 1831, des tisserands de Silésie en 1844, des ouvriers parisiens de juin 1848, des communards en 1871, des insurgés de 1905 dans tout l'empire russe. Pour ce type de besogne la bourgeoisie a toujours pu trouver dans ses formations politiques classiques les hommes de main dont elle avait besoin. Mais lorsque la révolution prolétarienne a été inscrite à l'ordre du jour de l'histoire, elle ne s'est pas contentée de faire appel à ces seules formations pour préserver son pouvoir. Il est revenu à des partis traîtres, à des organisations que le prolétariat s'était données en d'autres temps, la responsabilité d'épauler les partis bourgeois traditionnels, ou même de prendre leur tête. Le rôle spécifique de ces nouvelles recrues de la bourgeoisie, la fonction pour laquelle ils étaient indispensables et irremplaçables, consistait en leur capacité, du fait même de leur origine et de leur appellation, à exercer un contrôle idéologique sur le prolétariat afin de saper sa prise de conscience et de l'embrigader sur le terrain de la classe ennemie. Ainsi l'honneur insigne de la Social-Démocratie en tant que parti bourgeois, son plus grand fait d'armes, ne réside pas tellement dans son rôle de responsable direct des massacres du prolétariat à partir de janvier 1919 à Berlin (où, comme ministre des armées, le social-démocrate Noske a parfaitement assumé sa responsabilité de "chien sanglant", suivant le terme dont il s'est lui même qualifié), mais bien déjà comme sergent-recruteur de la première guerre mondiale, et, par la suite, comme agent de mystification de la classe ouvrière, de division et de dispersion de ses forces, face à la vague révolutionnaire qui a mis fin et succédé à l'holocauste impérialiste. En effet, seule la trahison de l'aile opportuniste qui dominait la plupart des partis de la 2e Internationale, seul son passage avec armes et bagages dans le camp bourgeois a rendu possible l'embrigadement, au nom de la "défense de la civilisation", du prolétariat européen derrière la "défense nationale" et le déchaînement de ce carnage. De même, la politique de ces partis, qui continuaient à se prétendre "socialistes" et avaient conservé de ce fait une influence importante sur ce même prolétariat, a joué un rôle essentiel dans le maintien en son sein des illusions réformistes et démocratiques qui l'ont désarmé et lui ont interdit de suivre l'exemple donné par les ouvriers de Russie en octobre 17.
Au cours de cette période, les éléments et fractions qui s'étaient dressés contre une telle trahison, qui avaient maintenu debout, contre vents et marées, le drapeau de l'internationalisme et de la révolution prolétarienne, s'étaient regroupés au sein des partis communistes, sections de la 3e Internationale. Mais il revenait à ces mêmes partis de jouer, dans la période suivante, un rôle semblable à celui des partis socialistes. Rongés par l'opportunisme dont l'échec de la révolution mondiale avait ouvert en grand les portes, fidèles exécutants de la direction d'une "internationale" qui après avoir impulsé de façon vigoureuse cette révolution, se transformait toujours plus en simple instrument de la diplomatie de l'Etat russe à la recherche de son intégration dans le monde bourgeois, les partis communistes ont suivi le même chemin que leurs prédécesseurs. A l'image des partis socialistes, ils ont fini par s'intégrer complètement dans l'appareil politique du capital national de leurs pays respectifs. Mais, au passage, ils ont participé à la défaite des derniers soubresauts de la vague révolutionnaire de l'après-guerre, comme en Chine en 1927-28, et surtout ils ont contribué de façon décisive à la transformation de la défaite de la révolution mondiale en une terrible contre-révolution.
En effet, après cette défaite, la contre-révolution, la démoralisation et le déboussolement du prolétariat étaient inévitables. Cependant, la forme qu'a prise la contre-révolution en URSS même - non pas le renversement du pouvoir qui était sorti de la révolution d'octobre 1917, mais une dégénérescence de ce pouvoir et du parti qui le détenait - a conféré à celle-ci une étendue et une profondeur incomparablement plus importantes que si la révolution avait succombé sous les coups des armées blanches. Le parti communiste d'union soviétique (PCUS), qui avait constitué l'avant-garde incontestable du prolétariat mondial, aussi bien dans la révolution de 1917 que dans la fondation de l'Internationale communiste en 1919, s'est converti, suite à son intégration dans l'Etat post-révolutionnaire et sa confusion avec lui, en principal agent de la contre-révolution en URSS, en véritable bourreau de la classe ouvrière ([2] [5]). Mais auréolé du prestige de ses hauts faits d'armes passés, il a continué de faire illusion auprès de la majorité des autres partis communistes et de leurs militants, de même que dans les grandes masses du prolétariat mondial. C'est grâce à ce prestige, dont les partis communistes des autres pays récupèrent une part, que pourront être tolérées par ces militants et ces masses toutes les trahisons que le stalinisme va accomplir dans cette période. En particulier, l'abandon de l'internationalisme prolétarien sous couvert de la "construction du socialisme en un seul pays", l'identification au "socialisme" du capitalisme qui s'est reconstitué en URSS sous ses formes les plus barbares, la soumission des luttes du prolétariat mondial aux impératifs de la défense de la "patrie socialiste" et, en fin de compte, à la défense de la "démocratie" contre le fascisme, tous ces mensonges et toutes ces mystifications n'ont, pour une grande part, pu abuser les masses ouvrières que parce qu'ils étaient véhiculés par les partis qui continuaient à se présenter comme les héritiers "légitimes" de la révolution d'Octobre, alors qu'ils en étaient les assassins. C'est ce mensonge - l'identification entre stalinisme et communisme - probablement le plus grand de l'histoire, et en tout cas le plus répugnant, auquel tous les secteurs de la bourgeoisie mondiale ont prêté leur concours ([3] [6]), qui a permis que la contre-révolution atteigne l'ampleur qu'on lui a connue, paralysant plusieurs générations d'ouvriers, les livrant pieds et poings liés à la deuxième boucherie impérialiste, venant à bout des fractions communistes qui avaient lutté contre la dégénérescence de l'Internationale communiste et de ses partis, ou bien les réduisant à l'état de petits noyaux complètement isolés.
En particulier, au cours des années 1930, c'est aux partis staliniens qu'on doit une part considérable du travail consistant à dévoyer sur un terrain bourgeois la colère et la combativité des ouvriers brutalement frappés par la crise économique mondiale. Cette crise, par l'ampleur et l'acuité qu'elle a revêtues, était le signe indiscutable de la faillite historique du mode de production capitaliste et aurait pu, à ce titre et dans d'autres circonstances, constituer le levier d'une nouvelle vague révolutionnaire. Mais la majorité des ouvriers qui voulaient se tourner vers une telle perspective sont restés prisonniers des nasses du stalinisme qui prétendait représenter la tradition de la révolution mondiale. Au nom de la défense de la "patrie socialiste" et au nom de l’antifascisme, les partis staliniens ont systématiquement vidé de tout contenu de classe les combats prolétariens de cette période et les ont convertis en forces d'appoint de la démocratie bourgeoise, quand ce n'était pas en préparatifs de la guerre impérialiste. Tel fut le cas, en particulier, des épisodes des "fronts populaires" en France et en Espagne, où une énorme combativité ouvrière fut dévoyée et anéantie par l'anti-fascisme qui se prétendait "ouvrier", colporté principalement par les staliniens. Dans ce dernier cas les partis staliniens ont fait la preuve que, en dehors même de l'URSS, où depuis des années déjà ils jouaient le rôle du bourreau, ils valaient bien, et dépassaient même de loin, leurs maîtres social-démocrates dans la tâche de massacreurs du prolétariat (voir en particulier leur rôle dans la répression du soulèvement du prolétariat de Barcelone en mai 1937 ; cf. l'article "Plomb, mitraille, prison..." dans la Revue Internationale n° 7). Au nombre des victimes dont il porte directement la responsabilité à l'échelle mondiale, le stalinisme vaut bien le fascisme, cette autre manifestation de la contre-révolution. Mais son rôle anti-ouvrier aura été bien plus considérable puisqu'il aura assumé ses crimes au nom même de la révolution communiste et du prolétariat, provoquant au sein de celui-ci un recul de sa conscience de classe sans égal dans l'histoire.
En fait, alors qu'à la fin et à la suite de la première guerre impérialiste, au moment où se développait la vague révolutionnaire mondiale, l'impact des partis communistes était directement en rapport avec la combativité et surtout la conscience dans l'ensemble du prolétariat, l'évolution de leur influence, à partir des années 1930, est en proportion inverse de la conscience dans la classe. Au moment de leur fondation, la force des partis communistes constituait, en quelque sorte, un thermomètre de la puissance de la révolution ; après qu'ils aient été vendus à la bourgeoisie par le stalinisme, la force des partis qui continuaient à se dénommer "communistes" ne faisait que mesurer la profondeur de la contre-révolution.
C'est pour cela que le stalinisme n'a jamais été aussi puissant qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cette période, en effet, constitue le point culminant de la contre-révolution. Grâce en particulier aux partis staliniens, auxquels la bourgeoisie devait d'avoir pu déchaîner une nouvelle fois le carnage impérialiste et qui s'en sont faits les meilleurs sergents-recruteurs avec les mouvements de "résistance", cette boucherie, contrairement à la première, n'a pas abouti à un surgissement révolutionnaire du prolétariat. L'occupation d'une bonne partie de l'Europe par l'"Armée rouge" ([4] [7]), d'une part, la participation des partis staliniens aux gouvernements de la "Libération", d'autre part, ont permis de faire taire toute velléité de combat du prolétariat sur son terrain de classe, par la terreur ou par la mystification, ce qui l'a plongé dans un désarroi encore plus profond que celui qu'il subissait à la veille de la guerre. Dans celle-ci, la victoire des alliés, à laquelle le stalinisme a apporté toute sa contribution, loin de déblayer le terrain pour la classe ouvrière (comme le prétendaient les trotskystes pour justifier leur participation à la "Résistance"), n'a fait que l'enfoncer encore plus dans la soumission absolue à l'idéologie bourgeoise. Cette victoire, présentée comme celle de la "Démocratie" et de la "Civilisation" sur la barbarie fasciste, a permis à la bourgeoisie de redorer de façon considérable le blason des illusions démocratiques et de la croyance en un capitalisme "humain" et "civilisé". Elle a ainsi prolongé de plusieurs décennies la nuit de la contre-révolution.
Ce n'est d'ailleurs nullement le fait du hasard si la fin de cette contre-révolution, la reprise historique des combats de classe à partir de 1968, coïncide avec un affaiblissement important, dans l'ensemble du prolétariat mondial, de l'emprise du stalinisme, du poids des illusions sur la nature de l'URSS et des mystifications antifascistes. Ce fait est particulièrement parlant dans les deux pays occidentaux où existaient les partis "communistes" les plus puissants et où se déroulent les combats les plus significatifs de cette reprise : la France en 1968 et l'Italie en 1969.
L'utilisation par la bourgeoisie de l'effondrement du stalinisme
Cet affaiblissement de l'emprise idéologique du stalinisme sur la classe ouvrière résulte pour une bonne part de la découverte par les ouvriers de la réalité des régimes qui se prétendaient "socialistes". Dans les pays dominés par ces régimes, c'est évidemment de façon très rapide que la classe ouvrière a pu constater que le stalinisme comptait parmi ses pires ennemis. Dès 1953 en Allemagne de l'Est, 1956 en Pologne et en Hongrie, les révoltes ouvrières, et leur répression sanglante, ont apporté la preuve que, dans ces pays, les ouvriers ne se faisaient pas d'illusions sur le stalinisme. Ces événements (de même aussi que l'intervention armée du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968) ont contribué également à ouvrir les yeux d'un certain nombre d'ouvriers en Occident sur la nature du stalinisme ([5] [8]), mais bien moins que les luttes de 1970, 76 et dans la place occupée par la guerre impérialiste dans leurs origines respectives. La nature ouvrière de la révolution d'Octobre est illustrée par le fait qu'elle surgit CONTRE la guerre impérialiste. La nature anti ouvrière et capitaliste des "démocraties populaires" est contresignée par le fait qu'elles sont instaurées GRACE à la guerre impérialiste. (5) Ce n'est évidemment pas le seul facteur permettant d'expliquer l'usure de l'impact du stalinisme dans la classe ouvrière, de même que de l'ensemble des mystifications bourgeoises, entre la fin de la guerre et le resurgisse ment historique du prolétariat, à la fin des années 60. D'ailleurs, dans beaucoup de pays (notamment ceux d'Europe du Nord), le stalinisme ne jouait plus, depuis la seconde guerre mondiale, qu'un rôle très secondaire par rapport à celui de la Social-démocratie dans l'encadrement des ouvriers. L'affaiblissement des mystifications antifascistes, faute de l'existence dans la majorité des pays d'un épouvantait "fasciste", de même que l'usure de l'influence des syndicats (qu'ils soient staliniens ou socio-démocrates) déjà mis fortement à contribution au cours des années 60 pour saboter les luttes, permet également d'expliquer l'amoindrissement de l'impact du stalinisme, comme de la Social-démocratie, sur le prolétariat, ce qui a permis à ce dernier, dès les premières attaques de la crise ouverte, de ressurgir sur la scène historique.
Un autre élément qui a contribué à l'usure des mystifications staliniennes est constitué par la mise en évidence, par ces luttes ouvrières, de la faillite de l'économie "socialiste". Cependant, au fur et à mesure que se confirmait cette faillite, et que reculaient d'autant les mystifications staliniennes, la bourgeoisie occidentale en profitait pour développer ses campagnes sur le thème de la "supériorité du capitalisme sur le socialisme". De même, les illusions démocratiques et syndicalistes que les ouvriers de Pologne subissaient de plein fouet ont été pleinement exploitées, notamment à partir de 1980 avec la formation du syndicat "Solidarnosc", pour redorer leur blason auprès des ouvriers d'Occident. C'est en particulier le renforcement de ces illusions, accentué encore par la répression de décembre 1981 et la mise hors-la-loi de "Solidarnosc", qui permet de comprendre le désarroi et le recul de la classe ouvrière du début des années 1980.
Le surgissement, à partir de l'automne 1983, d'une nouvelle vague de luttes massives dans la plupart des pays occidentaux développés, et particulièrement en Europe de l'Ouest, la simultanéité même de ces combats à l'échelle internationale, faisaient la preuve que la classe ouvrière était en train de se dégager de l'emprise des illusions et des mystifications qui l'avaient paralysée dans la période précédente. En particulier, le débordement des syndicats, et même leur rejet, qui s'étaient manifestés notamment lors de la grève dans les chemins de fer en France, fin 1986, et lors de la grève dans l'enseignement en Italie, en 1987, la mise en place par les gauchistes, dans ces mêmes pays et dans certains autres, de structures d'encadrement se présentant comme "non syndicales", les "coordinations", révélaient l'affaiblissement des mystifications syndicalistes. Dans la même période, cet affaiblissement s'accompagnait de celui des mystifications électorales, de plus en plus évidentes à travers la croissance des taux d'abstention lors des diverses élections, notamment dans les circonscriptions ouvrières. Mais aujourd'hui, grâce à l'effondrement des régimes staliniens, et au déchaînement des campagnes médiatiques qu'il permet, la bourgeoisie a réussi à renverser la tendance qui s'était manifestée dans tout le milieu des années 1980.
En effet, si les événements de Pologne de 1980-81, non pas les luttes ouvrières, bien sûr mais le pièce syndicaliste et démocratique qui s'était refermé sur elles (ainsi que la répression à laquelle ce piège avait ouvert le chemin), avaient permis à la bourgeoisie de provoquer une très sensible désorientation au sein du prolétariat des pays les plus avancés, l'effondrement général et historique du stalinisme qui se déroule aujourd'hui ne peut conduire qu'à un désarroi encore plus important.
Il en est ainsi parce que les événements actuels se situent à une toute autre échelle que ceux de Pologne en 1980. Ce n'est pas un seul pays qui en est le théâtre. Ce sont tous les pays d'un bloc impérialiste, à commencer par le plus important d'entre eux, l'URSS, qui sont aujourd'hui concernés. La propagande stalinienne pouvait présenter les difficultés du régime en Pologne comme le résultat des "erreurs" de Gierek. Aujourd'hui, personne, à commencer par les nouveaux dirigeants de ces pays, ne songe à faire porter aux politiques menées ces dernières années par les dirigeants déchus la responsabilité totale des difficultés de leurs régimes. Ce qui est en cause, aux dires mêmes de beaucoup de ces dirigeants, notamment ceux de Hongrie, c'est l'ensemble de la structure de l'économie et des pratiques politiques aberrantes qui ont marqué les régimes staliniens depuis leur origine. Une telle reconnaissance de la faillite de ces derniers par ceux qui se trouvent à leur tête est évidemment pain béni pour les campagnes médiatiques de la bourgeoisie occidentale.
La deuxième raison pour laquelle la bourgeoisie est en mesure d'utiliser à fond, et de façon efficace, l'effondrement du stalinisme et du bloc qu'il dominait, réside dans le fait que cet effondrement ne résulte pas de l'action de la lutte de classe mais d'une faillite complète de l'économie de ces pays. Dans les événements considérables qui se produisent à l'heure actuelle dans les pays de l'Est, le prolétariat, en tant que classe, en tant que porteur d'une politique antagonique au capitalisme, est douloureusement absent. En particulier, les grèves ouvrières qui se sont produites l'été dernier dans les mines en URSS, font plutôt figure d'exception et révèlent, par le poids des mystifications qui ont pesé sur elles, la faiblesse politique du prolétariat dans ce pays. Elles étaient essentiellement une conséquence de l'effondrement du stalinisme, et non un facteur actif dans cet effondrement. D'ailleurs, la plupart des grèves qui se sont déroulées ces derniers temps dans ce pays n'ont pas, contrairement à celles des mineurs, comme objet la défense d'intérêts ouvriers, mais se situent sur un terrain nationaliste (pays baltes, Arménie, Azerbaïdjan, etc.), et donc complètement bourgeois. D'autre part, dans les nombreuses manifestations massives qui secouent à l'heure actuelle les pays d'Europe de l'Est, notamment en RDA, en Tchécoslovaquie et en Bulgarie, et qui ont contraint certains gouvernements, à procéder d'urgence à un ravalement, on ne peut percevoir l'ombre d'une seule revendication ouvrière. Ces manifestations sont complètement dominées par des revendications typiquement et exclusivement démocratiques bourgeoises : "élections libres", "liberté", "démission des PC au pouvoir", etc. En ce sens, si l'impact des campagnes démocratiques qui s'étaient développées lors des événements de Pologne en 1980-81 avait été quelque peu limité par le fait qu'ils prenaient leur source dans des combats de classe, l'absence d'une lutte de classe significative dans les pays de l'Est, aujourd'hui, ne peut que renforcer les effets dévastateurs des campagnes actuelles de la bourgeoisie.
A une échelle plus générale, celle de l'effondrement de tout un bloc impérialiste, dont les répercussions seront énormes, le fait que cet événement historique considérable se soit produit indépendamment de la présence du prolétariat ne peut engendrer au sein de celui-ci qu'un sentiment d'impuissance, même si cet événement n'a pu advenir, comme le montrent les thèses publiées dans ce numéro, qu'à cause de l'incapacité pour la bourgeoisie d'embrigader au niveau mondial, jusqu'à présent, la classe ouvrière dans un troisième holocauste impérialiste. C'est la lutte de classe qui, après avoir renversé le tsarisme, puis la bourgeoisie, en Russie, avait mis fin à la première guerre mondiale en provoquant l'effondrement de l'Allemagne impériale. C'est pour cette raison, en grande partie, qu'a pu se développer à l'échelle mondiale la première vague révolutionnaire. En revanche, le fait que la lutte de classe n'ait été qu'un facteur de deuxième ordre dans l'effondrement des pays de "l'Axe" et dans la fin de la seconde guerre mondiale a joué un rôle important dans la paralysie et le déboussolement du prolétariat au lendemain de celle-ci. Aujourd'hui, il n'est pas indifférent que le bloc de l'Est se soit effondré sous les coups de la crise économique et non sous les coups de la lutte de classe. Si cette deuxième alternative avait prévalu, cela n'aurait pu que renforcer la confiance en soi du prolétariat, et non l'affaiblir comme c'est le cas à l'heure actuelle. En outre, dans la mesure ou l'effondrement du bloc de l'Est fait suite à une période de "guerre froide" avec le bloc de l'Ouest, où ce dernier apparaît comme le "vainqueur", sans coup férir, d'une telle "guerre", cela va engendrer dans les populations d'Occident, et aussi parmi les ouvriers, un sentiment d'euphorie et de confiance envers leurs gouvernements similaire (toutes proportions gardées) à celui qui avait pesé sur le prolétariat des pays "vainqueurs" lors des deux guerres mondiales et qui avait même constitué une des causes de l'échec de la vague révolutionnaire qui avait suivi la première.
Une telle euphorie, catastrophique pour la conscience du prolétariat, sera évidemment beaucoup plus limitée du fait même que le monde ne sort pas aujourd'hui d'un carnage impérialiste. Cependant, les conséquences néfastes de la situation actuelle seront renforcées par l'euphorie qui est celle des populations d'un certain nombre de pays de l'Est, et qui n'est pas sans impact à l'Ouest. Ainsi, lors de l'ouverture du mur de Berlin, symbole par excellence de la terreur que le stalinisme à imposée aux populations des pays qu'il dirigeait, la presse et certains hommes politiques ont comparé l'ambiance qui régnait dans cette ville à celle de la "Libération". Ce n'est nullement un hasard : les sentiments éprouvés par les populations d'Allemagne de l'Est lors du renversement de ce symbole étaient comparables à ceux des populations qui avaient subi pendant des années l'occupation et la terreur de l'Allemagne nazie. Mais comme l'histoire nous l'a montré, ce type de sentiments et d'émotions comptent parmi les pires obstacles pour la prise de conscience par le prolétariat. La satisfaction éprouvée par les habitants des pays de l'Est devant l'effondrement du stalinisme, et surtout le renforcement des illusions démocratiques qu'elle va permettre, se répercutera, et se répercute déjà, fortement sur le prolétariat des pays d'Occident, et tout particulièrement sur celui d'Allemagne dont le poids est particulièrement important au sein du prolétariat mondial dans la perspective de la révolution prolétarienne. En outre le prolétariat de ce pays devra, dans la période qui vient, affronter le poids des mystifications nationalistes que la perspective d'une réunification de l'Allemagne, même si elle n'est pas encore, pratiquement, à l'ordre du jour, ne pourra que renforcer.
Ces mystifications nationalistes sont, d'ores et déjà, particulièrement fortes parmi les ouvriers de la plupart des pays de l'Est. Elles n'existent pas uniquement au sein des différentes républiques qui constituent l'URSS. Elles pèsent aussi lourdement sur les ouvriers des "démocraties populaires", du fait, notamment, de la façon particulièrement brutale dont s'est exercée sur elles la domination impérialiste du "Grand Frère". Les interventions sanglantes des tanks russes en RDA en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, de même que le pillage en règle qu'ont subi les économies des pays "satellites" durant des décennies n'ont pu qu'alimenter de telles mystifications. A côté des illusions démocratiques et syndicales, elles ont contribué pour beaucoup, en 1980-81, au déboussolement des ouvriers de Pologne qui a ouvert la porte à l'écrasement de décembre 1981. Avec la dislocation du bloc de l'Est à laquelle on assiste aujourd'hui, elles connaîtront un nouveau souffle rendant encore plus difficile la prise de conscience des ouvriers de ces pays. Ces mystifications nationalistes vont peser également sur les ouvriers d'Occident, non pas nécessairement (à part le cas de l'Allemagne) par un renforcement direct du nationalisme dans leurs rangs, mais par le discrédit et l'altération que va subir dans leur conscience l'idée même d'internationalisme prolétarien. En effet, cette notion a été dénaturée complètement par le stalinisme, et dans sa foulée par l'ensemble des forces bourgeoises, qui l'ont identifié avec la domination impérialiste de l'URSS sur son bloc. C'est ainsi que, en 1968, l'intervention des tanks du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie a été menée au nom de "l’internationalisme prolétarien". L'effondrement et le rejet par les populations des pays de l'Est de "l’internationalisme" à la mode stalinienne, ne pourra que peser négativement sur la conscience des ouvriers de l'Ouest, et cela d'autant plus que la bourgeoisie occidentale ne manquera pas une occasion d'opposer à l'internationalisme prolétarien véritable, sa propre "solidarité internationale", comprise comme soutien aux économies de l'Est en détresse (quand ce ne sera pas d'appels à la charité) ou aux "revendications démocratiques" de leurs populations lorsque celles-ci se heurteront à des répressions brutales (on se souvient des campagnes à propos de la Pologne en 1981, à propos de la Chine encore récemment).
En fait, et nous touchons là le coeur des campagnes que la bourgeoisie déchaîne à l'heure actuelle, leur objectif ultime et fondamental, c'est la perspective même de la révolution communiste mondiale qui est affectée par l'effondrement du stalinisme. L'internationalisme n'est qu'un des éléments de cette perspective. La rengaine que nous assènent à en vomir les médias : "le communisme est mort, il a fait faillite", résume le message fondamental dont les bourgeois de tous les pays veulent bourrer le crâne des ouvriers qu'ils exploitent. Et le mensonge sur lequel s'était déjà faite l'unanimité de toutes les forces bourgeoises par le passé, aux pires moments de la contre-révolution, l'identification entre le communisme et le stalinisme, est repris encore avec la même unanimité à l'heure actuelle. Cette identification avait permis dans les années 1930 à la bourgeoisie d'embrigader la classe ouvrière derrière ce dernier afin de parachever sa défaite. Aujourd'hui, au moment où le stalinisme est complètement déconsidéré aux yeux de tous les ouvriers, ce même mensonge lui sert pour les détourner de la perspective du communisme.
Dans les pays de l'Est, il y a déjà longtemps que la classe ouvrière subit un tel désarroi : lorsque le terme de "dictature" du prolétariat recouvre la terreur policière, que "pouvoir de la classe ouvrière" signifie pouvoir cynique des bureaucrates, que "socialisme" désigne exploitation brutale, misère, pénuries et gabegie, lorsqu'à l'école on doit apprendre par coeur des citations de Marx ou de Lénine, on ne peut que se détourner de telles notions, c'est-à-dire rejeter ce qui constitue le fondement même de la perspective historique du prolétariat, refuser catégoriquement d'étudier les textes de base du mouvement ouvrier, les termes mêmes de "mouvement ouvrier" et de "classe ouvrière" étant perçus comme des obscénités. Dans un tel contexte, l'idée même d'une révolution du prolétariat est complètement discréditée. "A quoi bon vouloir recommencer comme en Octobre 1917, si c'est pour parvenir, en fin de compte, à la barbarie stalinienne". Tel est le sentiment qui domine aujourd'hui chez pratiquement tous les ouvriers des pays de l'Est. Ce que vise à l'heure actuelle la bourgeoisie des pays occidentaux, grâce à l'effondrement et l'agonie du stalinisme, c'est de développer un déboussolement similaire parmi les ouvriers d'Occident. Et la faillite de ce système est tellement évidente et spectaculaire qu'elle y parvient pour une bonne part.
Ainsi, l'ensemble des événements qui secouent les pays de l'Est, et qui se répercutent sur le monde entier, vont peser pendant toute une période de façon négative sur la prise de conscience de la classe ouvrière. Dans un premier temps, l'ouverture du "rideau de fer" qui séparait en deux le prolétariat mondial ne permettra pas aux ouvriers d’Occident de faire bénéficier leurs frères de classe des pays de l'Est de leur expérience acquise dans les luttes face aux pièges et mystifications déployés par la bourgeoisie la plus forte du monde. Au contraire, ce sont les illusions démocratiques particulièrement fortes parmi les ouvriers de l'Est, ce sont leurs croyances à propos de la "supériorité du capitalisme sur le socialisme", qui vont venir se déverser à l'Ouest, affaiblissant dans l'immédiat, et pour un moment, les acquis de l'expérience du prolétariat de cette partie du monde. C'est pour cela que l'agonie de cet instrument par excellence de la contre-révolution que fut le stalinisme est aujourd'hui retournée par la bourgeoisie contre la classe ouvrière.
Les perspectives pour la lutte de classe
L'effondrement des régimes staliniens, résultant, pour l'essentiel, de la faillite totale de leur économie, ne pourra, dans un contexte mondial d'approfondissement de la crise capitaliste, qu'aggraver cette faillite. Cela signifie pour la classe ouvrière de ces pays des attaques et une misère sans précédent, même des famines. Une telle situation provoquera nécessairement des explosions de colère. Mais le contexte politique et idéologique est tel dans les pays de l'Est, que la combativité ouvrière ne pourra, durant toute une période, déboucher sur un réel développement de la conscience (voir l'editorial de ce numéro de la Revue). Le chaos et les convulsions qui s'y développent sur le plan économique et politique, la barbarie et le pourrissement sur pieds de l'ensemble de la société capitaliste qu'ils expriment de façon concentrée et caricaturale, ne pourront pas déboucher sur la compréhension de la nécessité de renverser ce système, tant qu'une telle compréhension ne se sera pas développée parmi les bataillons décisifs du prolétariat dans les grandes concentrations ouvrières d'Occident, et particulièrement en Europe de l'Ouest ([6] [9]).
A l'heure actuelle, comme on l'a vu, ces secteurs eux-mêmes du prolétariat mondial subissent de plein fouet le déchaînement des campagnes bourgeoises et sont affectés par un recul de leur conscience. Cela ne veut pas dire qu'ils seront dans l'incapacité de mener le combat contre les attaques économiques du capitalisme dont la crise mondiale est irréversible. Cela signifie avant tout que, durant un certain temps, ces luttes seront, beaucoup plus qu'au cours de ces dernières années, prisonnières des organes d'encadrement de la classe ouvrière, et en premier lieu des syndicats, comme on peut déjà le constater dans les combats les plus récents. En particulier, les syndicats vont encaisser les bénéfices du renforcement général des illusions démocratiques. Ils vont également trouver un terrain bien plus propice à leurs manoeuvres avec le développement de l'idéologie réformiste résultant du renforcement des illusions sur le thème de la "supériorité du capitalisme" vis-à-vis de toute autre forme de société.
Cependant, le prolétariat d'aujourd'hui n'est pas celui des années 1930. Il ne sort pas d'une défaite comme celle qu'il a subie après la vague révolutionnaire du premier après-guerre. La crise mondiale du capitalisme est insoluble. Elle ne pourra aller qu'en s'aggravant (voir l'article sur la crise économique dans ce même numéro de la Revue) : après l'effondrement du "Tiers monde" à la fin des années 1970, après l'implosion actuelle des économies dites "socialistes", le prochain secteur du capital mondial à se trouver sur la liste est celui des pays les plus développés qui avaient pu, en partie, donner le change jusqu'à présent en reportant le plus gros des convulsions du système vers sa périphérie. La mise en évidence inévitable de la faillite complète, non d'un secteur particulier du capitalisme, mais de l'ensemble de ce mode de production ne pourra que saper les bases mêmes des campagnes de la bourgeoisie occidentale sur la "supériorité du capitalisme". A terme, le développement de sa combativité devra déboucher sur un nouveau développement de sa conscience, développement interrompu et contrecarré aujourd'hui par l'effondrement du stalinisme. Il appartient aux organisations révolutionnaires de contribuer de façon déterminée à ce développement, non pas en essayant aujourd'hui de consoler les ouvriers, mais en mettant clairement en évidence que, malgré la difficulté du chemin, il n'en existe pas d'autre pour le prolétariat que celui qui conduit à la révolution communiste.
F.M. 25/11/89
[1] [10] Il est significatif que la bourgeoisie française, "révolutionnaire" et "démocratique", n'ait pas hésité à bafouer la "Déclaration des droits de l'Homme" qu'elle venait à peine d'adopter (et dont on fait grand cas aujourd'hui) en interdisant toute association ouvrière (loi Le Chapelier du 14 juin 1791). Cette interdiction ne sera abrogée que près d'un siècle plus tard, en 1884.
[2] [11] Ce n'est pas sans résistance, dans la classe ouvrière et au sein même du parti bolchevik, que s'est produite la dégénérescence et la trahison de celui-ci. En particulier, une grande proportion des militants et la presque totalité des dirigeants du parti d'Octobre 1917 ont été exterminés par le stalinisme. Sur cette question voir en particulier les articles "La dégénérescence de la révolution russe" et "La gauche communiste en Russie" dans la Revue Internationale, n° 3 et n° 8 et 9.
[3] [12] Dans la seconde moitié des années 20 et tout au long des années 30, la bourgeoisie "démocratique" d'Occident a été loin de manifester la même répugnance vis-à-vis du stalinisme "barbare" et "totalitaire" qu'elle a affichée à partir de la "guerre froide", et qu'elle continue d'exhiber aujourd'hui dans ses campagnes. Elle a en particulier apporté à Staline un soutien sans faille dans les persécutions qu'il a déchaînées contre l'"Opposition de gauche" et son principal dirigeant, Trotsky. Pour ce dernier, après son expulsion d'URSS en 28, le monde est devenu une "planète sans visa". A son égard, tous les "démocrates" du monde, et en première ligne les socio-démocrates qui étaient au gouvernement en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Suède, en Belgique ou en France, ont fait une nouvelle fois la preuve de leur hypocrisie répugnante en s'asseyant sur leurs "vertueux principes" tels que le "Droit d'asile". Ce beau monde n'a pas trouvé grand chose à redire lors des procès de Moscou où Staline a liquidé la vieille garde du parti bolchevik en l'accusant d'"hitléro-trotskysme". Ces "belles âmes" ont même poussé l'abjection jusqu'à laisser entendre qu'"il n'y avait pas de fumée sans feu".
[4] [13] Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, du fait que les régimes qui s'installent dans les pays d'Europe de l'Est au lendemain de la seconde guerre mondiale (de même, évidemment que le régime qui existe alors en URSS) n'ont rien à voir avec le régime instauré en Russie en 1917, réside
[5] [14] en Pologne, qui, parce qu'elles se situaient beaucoup plus directement sur un terrain de classe et qu'elles prenaient place à un moment de reprise mondiale des combats ouvriers, ont pu dévoiler de façon beaucoup plus claire au prolétariat des pays occidentaux, la nature anti-ouvrière des régimes staliniens. C'est d'ailleurs pour cette raison que les partis staliniens d'Occident ont pris quelque distance, lors de ces combats, avec la répression dont ces derniers ont fait l'objet de la part des Etats "socialistes".
[6] [15] Voir notre analyse sur cette question dans l'article "Le prolétariat d'Europe occidentale au centre de la généralisation de la lutte de classe" de la Revue Internationale, n° 31.
Géographique:
Questions théoriques:
- Le cours historique [16]
Heritage de la Gauche Communiste:
Crise économique mondiale : après l'est, l'ouest
- 6497 reads
L’"équilibre" sur lequel les impérialismes planétaires reposaient depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, depuis Yalta, vient de basculer avec l'effondrement économique de l'URSS et l'implosion consécutive de son bloc. Face à la débandade économique de son rival, le bloc occidental apparaît comme le grand vainqueur; l'abondance exubérante des vitrines des magasins des grands pays industrialisés est le meilleur outil de la propagande occidentale face à la pénurie dramatique qui règne à l'Est. Pourtant, l'illusion de la victoire "économique" de l'Occident risque bien d'être de courte durée, car la crise économique de surproduction généralisée, qui dure depuis plus de vingt ans, est mondiale. Après l'engloutissement des pays sous-développés dans une misère insondable à la fin des années 1970, l'effondrement économique du bloc de l'Est à la fin des années 1980, loin de démontrer la vitalité de l'économie des pays industrialisés de l'Occident, vient au contraire annoncer la catastrophe mondiale à venir, dont le prochain pas décisif sera l'effondrement économique des pays industriels les plus développés. Plus qu'une victoire de l'Ouest, c'est à une défaite de l'Est à laquelle nous assistons. Toute l'évolution de l'économie des pays occidentaux depuis des années promet des lendemains qui déchantent.
Que s'est-il passé le vendredi 13 octobre 1989 ? En une seule séance, Wall Street perdait 7 %, et ce malgré toutes les mesures mises en place au lendemain de l'effondrement de l’automne 1987 pour éviter que celui-ci ne se renouvelle, malgré l'intervention massive des investisseurs dits "institutionnels", à qui l’Etat américain avait ouvert immédiatement de nouvelles lignes de crédit pour leur permettre de racheter les actions et soutenir ainsi les cours.
Dans la foulée, après un week-end de concertations intensives des grandes banques centrales des principales économies du bloc occidental, ce sont, le lundi 15 octobre, Francfort qui perd 13 %, Paris 6,9 %, Londres 4,6 %, tandis que Tokyo résiste. Les mesures conjuguées mises en place par les grandes puissances économiques commencent cependant à faire leur effet : ce même, jour Wall Street tient bon et se redresse à +3,4 %. La semaine qui suit va permettre de stabiliser les cours.
L'alerte a été chaude. 200 milliards de dollars se sont envolés en fumée. Une nouvelle purge a été imposée à la spéculation boursière, mais finalement, malgré l'addition salée, les banques centrales peuvent se réjouir de leur "maîtrise technique", elles ont limité les dégâts. Pourtant, l'euphorie ne règne pas, bien au contraire. Ce nouvel accroc à la spéculation boursière vient raviver les inquiétudes. 1987 n'était pas un accident. Les marchés ont été stabilisés, oui, mais jusqu'à quand ?
Les capitalistes ne sont pas des gens particulièrement superstitieux, mais ils vont finir par le devenir. Le mois d'octobre est décidément propice aux effondrements boursiers : en 1929, déjà, et, plus récemment, en 1987. Pourtant, au-delà de l'aspect répétitif, les conditions qui ont présidé à ces effondrements boursiers ne sont pas identiques. Evidemment, la situation de l'économie mondiale est bien différente dans les années 1980 de ce qu'elle était en 1929, nous ne reviendrons pas sur cet aspect qui a déjà été amplement traité dans la Revue internationale ([1] [17]).
Mais si les mêmes causes, la hausse des taux d'escompte des grandes banques centrales, ont produit les mêmes effets - la raréfaction du crédit ravive la peur de la récession et provoque une panique boursière -, le contexte international entre octobre 1987 et octobre 1989 a bien changé. La dégradation de l'économie américaine s'est accélérée et les déséquilibres mondiaux se sont accentués.
Face a la récession, la fuite en avant dans l'endettement
Durant les années 1970, les crédits largement octroyés aux pays sous-développés de la périphérie ont permis de résorber dans une large mesure la surproduction des pays industrialisés. Cependant, cette politique a trouvé sa limite dans la crise du dollar. Les 900 milliards de dollars empruntés par les pays pauvres d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie ne seront jamais remboursés. L'inflation explose, ravage les économies fragiles écrasées par la dette, leur fait perdre toute solvabilité, les fermant définitivement comme débouchés aux marchandises massivement produites par le monde industriel. Le marché mondial se rétrécit brutalement et, à la suite de l'économie américaine, l'économie de la planète plonge dans la récession au début des années 1980.
La récession est le pire des fléaux pour le capitalisme. Elle signifie la chute de la production, la fermeture des usines, le développement du chômage et une montée vertigineuse des dettes impayées. Elle exprime de manière brutale l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. Une telle situation met en danger la stabilité du dollar, la monnaie reine du marché mondial, symbole de la puissance américaine. Une telle situation est intenable pour le capitalisme américain, car non seulement elle met en cause sa domination économique, mais aussi sa suprématie impérialiste.
En effet, les USA ne sont pas simplement la première puissance économique du globe, ils sont aussi la force impérialiste dominante du bloc dominant, celui de l'Ouest. Maintenir l'activité économique, la croissance, est une priorité pour l'économie américaine, pour sa propre sauvegarde et celle de ses intérêts économiques et impérialistes. Après deux ans de purge imposée par la politique d'austérité au début de la présidence reaganienne, pour sauver son économie, l'Etat américain va pratiquer une politique de relance. Cette dernière va se faire sur la base des besoins de l'impérialisme américain face à son rival russe. L'invasion de l'Afghanistan par l'Armée Rouge, fin 1979, va marquer un brutal réchauffement des tensions inter-impérialistes, et déterminer les USA à lancer un vaste programme de modernisation des armements.
La reprise américaine va, de ce point de vue, consister en une relance de la production d'armements, un développement de l'économie de guerre. Le budget militaire des USA va se gonfler démesurément et, parallèlement, le déficit budgétaire va se creuser et atteindre une ampleur colossale malgré une réduction draconienne des budgets sociaux.
Cependant, la production d'armement a ceci de particulier qu'elle est une pure destruction de capital qui entrave l'ensemble du développement économique ([2] [18]). En effet, les armes ne sont ni un bien de consommation qui fournit l'entretien et la reproduction de la force de travail, ni un bien de production qui permet une accumulation de capital. La catastrophe économique des pays de l'Est traduit bien cette réalité où la priorité absolue donnée à l'économie de guerre durant des décennies a abouti à l'asphyxie de l'ensemble de l'économie.
Dans une moindre mesure, mais de manière tout aussi tangible, cette réalité s'est également imposée aux USA. Les Etats-Unis ont vu depuis les années 1950 s'éroder leur compétitivité dans la concurrence économique mondiale. Ce n'est certainement pas le moindre des paradoxes que de voir aujourd'hui les pays vaincus de la 2e guerre mondiale, le Japon et l'Allemagne, battre des records de compétitivité. Cette situation est due au fait que ces pays, à l'issue de la guerre qu'ils ont perdue, ont reconstruit leur économie détruite sur une base plus moderne, utilisant les technologies alors les plus avancées, alors que l'appareil productif des USA, au lendemain de la guerre, n'a pas été détruit, mais est usé par l'effort d'armement et se retrouve de fait grandement obsolète, en retard. Cette situation de perte de compétitivité relative après 1945 va encore s'accroître dans les années qui suivent, car les vaincus se sont vu interdire par les traités une politique de réarmement, et ont donc pu investir dans la production sans sacrifier celle-ci aux besoins de l'économie de guerre, tandis que les USA ont entretenu un secteur militaire imposant, qui correspondait à leur rôle et à leur besoin comme chef de bloc impérialiste, grevant ainsi constamment leur compétitivité sur le plan économique.
La politique de la présidence Reagan de relance par l'économie de guerre a donc eu pour principale conséquence d'affaiblir encore plus la compétitivité de l'économie américaine. Les déficits budgétaires destinés à financer l'effort militaire se sont en conséquence doublés de déficits commerciaux qui, eux aussi, ont battu des records tout au long des années 1980. Pour financer ces déficits pharamineux, les USA ont du s'endetter et ils ont pulvérisé les records atteints par les pays les plus endettés jusque-là. Aujourd'hui, l'endettement de pays comme le Brésil ou le Mexique (une centaine de milliards de dollars chacun en 1980), qui avait fait frémir les financiers au début des années 1980, pourrait presque paraître ridicule comparé à la fin des années 1980 : plus de 500 milliards de dollars de dette extérieure et une dette interne dont les estimations oscillent entre 6000 et 8000 milliards de dollars, pour les USA. Le budget annuel américain a été écorné de 170 milliards de dollars pour le paiement de la dette. Cette situation ne peut aller qu'en empirant et la dette en grossissant.
Tout à fait significatif de l'affaiblissement de l'économie américaine est le fait que, durant les années 1980, les investissements étrangers aux USA ont largement dépassé les investissements américains dans les autres pays du monde. Des pans entiers de l'économie des Etats-Unis sont aujourd'hui la propriété d'entreprises japonaises et européennes.
Développement des investissements européens et japonais aux Etats-Unis
Pour la première fois, en 1988, les Etats-Unis ont moins investi dans le monde que le monde chez eux. Source : Libération.
Le capitalisme américain à la recherche d'argent frais va utiliser toutes les ressources que lui autorise son statut de première puissance économique mondiale et de chef du bloc impérialiste le plus puissant ; le roi dollar impose sa suprématie :
- la banque fédérale des Etats-Unis (FED), au nom du libéralisme, va guider de manière très étatique l'économie mondiale par sa politique des taux ;
- une politique de soutien du dollar est imposée aux principaux pays industrialisés devenus les bailleurs de fonds des USA.
Cette politique va permettre de freiner momentanément la plongée dans la récession et de maintenir à flot l'économie des pays les plus industrialisés. Elle va se doubler d'une campagne idéologique intensive à la gloire de l'économie capitaliste. En 1987, c'est encore l'euphorie, la "croissance" officielle bat des records tandis que l'inflation est à son plancher. L'effondrement des places boursières est rapidement surmonté, la spéculation repart de plus belle.
La crise du crédit : les limites d'une politique
La pseudo-croissance officielle de la deuxième présidence de Reagan a été une vraie récession larvée de l'économie mondiale ([3] [19]). On a en fait assisté à une croissance de l'économie de guerre, c'est-à-dire à une croissance de la destruction de capital et à une progression artificielle des secteurs improductifs. L'activité économique a été maintenue de manière factice, la production n'est pas réellement payée, les marchandises sont échangées contre des dettes. Dans ces conditions, la production n'est pas directement production de valeur. Le capitalisme ne peut maintenir un semblant d'activité économique qu'au travers d'une immense tricherie avec les lois du marché qui déstabilise de plus en plus l'économie mondiale et d'un gaspillage de plus en plus gigantesque.
Cette situation économique a été masquée par une manipulation grandissante des indices et le tapage assourdissant des campagnes menées sur l'efficacité de la politique "libérale" des USA : lés fameuses reaganomics.
Mais, depuis 1987, la situation a bien changé. L'euphorie est retombée, le doute s'est installé. Les statistiques officielles, face à la réalité de la crise, se voient obligées d'exprimer dans une certaine mesure la réalité, sinon elles ne serviraient strictement plus à rien. La "croissance" officielle a entamé son déclin tandis que l'inflation a fait un retour remarqué. L'exemple de la Grande-Bretagne est à cet égard particulièrement significatif. Elle, qui a appliqué les "reaganomics" avant l'heure, ne parvient plus à freiner la montée de l'inflation alors que les taux bancaires ont grimpé et plongé son économie dans la récession.
Bien sûr, l'économie américaine, la première du monde, est d'une autre trempe que l'économie britannique, et le dollar n'est pas la livre sterling. De plus, les USA profitent de leur statut de chef de bloc pour imposer une discipline à leur profit. Cependant, les lois aveugles du marché sont à l'oeuvre, elles, qui ont fait plonger les pays sous-développés de la périphérie dans un chaos économique dont ils ne pourront plus s'échapper, et qui font aujourd'hui chuter l'économie britannique, érodent la puissance américaine placée au centre des contradictions économiques du capitalisme mondial.
Depuis des années, par le recours au crédit, une montagne de dollars a été mise en circulation. Actuellement, la dette des pays périphériques s'est gonflée à 1300 milliards de dollars. La dette extérieure des USA se monte à 500 milliards de dollars, mais elle cache l'endettement interne, où les emprunts cumulés de l'Etat, des entreprises et des particuliers varient, comme nous l'avons vu, suivant les estimations de 6000 à 8000 milliards de dollars. Le développement du crédit, qui ne pourra jamais être remboursé (en fait du capital fictif), est en complet décalage avec celui de l'économie réelle, de la production ([4] [20]). La spéculation financière et boursière n'a pas arrangé les choses. Stimulées par les "OPA" ([5] [21]), les entreprises ont vu cette décennie leur valeur boursière multipliée par 5, voire par 10, sans que le développement de la production justifie cette explosion des cours.
Dans ces conditions, les lois du marché capitaliste poussent à une ré adéquation de la valeur du dollar à la richesse réellement produite. Les pressions inflationnistes se font de plus en plus fortes. Face à celles-ci, la politique de la FED est, en relevant son taux d'escompte, de rendre le crédit plus cher, donc plus rare. Cependant, par deux fois, cette politique s'est conclue avec une panique boursière, car elle signifie à terme une plongée de l'économie américaine dans la récession, qui ne peut qu'entraîner l'économie mondiale à sa suite. Et, par deux fois, la FED a dû céder, et relâcher les taux, rouvrir les vannes du crédit, pour éviter une plongée accélérée de la croissance qui aurait des conséquences catastrophiques pour sur le plan mondial.
Avant le mini effondrement boursier d'octobre 1989, les managers des cent plus grandes entreprises des USA avaient sonné le tocsin, inquiétés par le ralentissement de l'activité qui s'était concrétisé dans une chute brutale des bénéfices des entreprises américaines (ainsi, les fleurons tels que General Motors, Ford, IBM, ont vu au 3e trimestre 1989 leurs bénéfices chuter de 30 % à 40 %), pour demander à la FED de relâcher ses taux, de maintenir la croissance.
Au regard de l'inquiétude croissante qui ronge les financiers du monde entier à la lecture quotidienne des différents indices économiques, l'événement singulier qui a été, de manière toute phénoménologique, à l'origine de la panique boursière d'octobre 1989 pourrait presque paraître anodin. Pourtant, il est tout à fait significatif des difficultés présentes de l'économie mondiale. Dans la guerre internationale des OPA que se livrent les capitalistes, l'incapacité d'un groupe de spéculateurs de réunir par le recours au crédit sur la place boursière de quoi financer une OPA qu'ils avaient lancée sur United Airlines, une des principales compagnies aériennes américaines, a déclenché un vent de panique. Pourquoi ? Parce que cela signifie la fin du crédit facile, et donc la fin des OPA gigantesques qui avaient été rendues possibles par ce crédit, et donc la fin de la croissance artificielle des actions en bourse.
Une nouvelle fois, les USA ont reculé devant les implications économiques d'une politique d'austérité, de rigueur, sur le dollar. Début novembre 1989, la FED a fait baisser ses taux et rouvert le crédit. Si cette politique peut freiner la chute de la production, elle est par contre incapable de relancer la croissance. De plus en plus, les nouveaux crédits mis en circulation servent à payer les traites des crédits précédents, ou à alimenter la spéculation, et de moins en moins à financer la production. Plus le crédit croît, moins il est efficace dans l'économie réelle, et la croissance chute irrésistiblement. Par contre, la politique de crédit facile a un effet direct, aujourd'hui, qui est de relancer l'inflation. De fait, la FED a fait le choix de l'inflation face au danger immédiat d'une chute catastrophique de la production.
Depuis des années, les économistes et les dirigeants politiques américains parlent de l’"atterrissage en douceur" de leur économie, et de fait la politique des USA est parvenue à limiter les dégâts ; l'avion américain a réussi à effectuer une descente en douceur. Mais où va-t-il atterrir ? Toutes les manoeuvres difficiles qu'on lui impose l'ont usé, ne risque-t-il pas de tomber en panne ? Le carburant du crédit ne va-t-il pas lui faire défaut ?
A partir du moment où l'économie américaine arrête son envol, cela signifie une nouvelle plongée brutale de l'économie mondiale dans la récession, le marché américain qui se ferme aux exportations européennes et japonaises, une incapacité de rembourser la dette et une envolée de l'inflation, c'est-à-dire une crise financière majeure centrée autour du dollar. Ces perspectives sont contenues en filigrane de l'économie mondiale depuis le début des années 1980, et toute la politique des USA a visé à reculer l'échéance, à la reporter dans le temps en manipulant les lois de la valeur sur le marché mondial.
Cette politique de fuite en avant n'a été rendue possible que par le statut particulier des USA, non seulement comme première puissance économique et premier marché du monde, mais aussi comme chef du bloc impérialiste le plus puissant qui impose sa loi aux économies les plus développées de la planète : les pays d'Europe, notamment l'Allemagne de l'Ouest, et le Japon. Le groupe des "sept plus grands pays industrialisés" du bloc occidental - le fameux G7 - a symbolisé la loi américaine exercée au plan économique dans son bloc. La discipline imposée au sein du bloc, notamment à l'Allemagne et au Japon, a été la condition sine qua non de la stabilisation économique durant les années 1980. Malgré la catastrophe du "tiers-monde", la descente de l'économie mondiale, l'enfoncement des pays industrialisés dans le marasme d'une récession larvée, s'est faite en "douceur", pour ce qui est du point de vue des économistes, bien sûr.
Les conditions qui ont permis une telle politique économique de la part des USA ont changé :
- Le délabrement de l'économie américaine contraste fortement avec la bonne santé affichée par ses principaux concurrents que sont le Japon et l'Allemagne. Alors que les USA accumulent les déficits commerciaux, le Japon et l'Allemagne battent des records à l'exportation. A l'inverse de la période de reconstruction de l'après-guerre, ce sont aujourd'hui des capitaux européens et japonais qui rachètent des pans entiers de l'économie américaine. La locomotive s'essouffle et, alors que l'inflation repart, la récession pointe à l'horizon américain. La position de leadership économique des USA est vacillante alors que la crise du dollar menace.
- L'effondrement du bloc russe, en même temps qu'il vient rappeler la réalité incontournable au sein du capitalisme de la loi de la valeur, vient bouleverser les données de l'équilibre mondial des blocs, qui a "organisé" le monde depuis Yalta. La discipline que les USA ont pu imposer à leurs principaux concurrents d'Europe et du Japon, n'a pu se maintenir que grâce au ciment constitué par la menace impérialiste de l'ours russe. Un verrou vient de sauter à l'Est qui implique un bouleversement des relations entre les principales puissances économiques du bloc occidental.
L'effondrement du bloc de l'est et la déstabilisation de l'économie mondiale
Dans ces conditions, la prochaine décennie s'ouvre sous les auspices :
- d'une plongée dramatique dans la crise économique de surproduction généralisée par rapport aux marchés existants qui vont en se rétrécissant ;
- d'une déstabilisation grandissante des équilibres qui dominent le monde depuis la seconde guerre mondiale.
L'effondrement du bloc russe implique la déstabilisation du bloc occidental, et cela a des implications particulièrement importantes sur le plan économique (entre autres). Face à la banqueroute qui menace l'économie américaine et qui signifie, à terme, une fermeture du marché des Etats-Unis aux exportations européennes et japonaises, les tendances centrifuges au sein du bloc vont se faire plus fortes. La menace impérialiste russe n'est plus suffisamment crédible, et, du même coup, le parapluie protecteur américain perd sa justification. Les velléités d'indépendance, qu'une telle situation implique de la part de la RFA et du Japon, vont se concrétiser dans une tendance renforcée au chacun pour soi, chacun essayant de protéger ses propres marchés privilégiés face à la récession ouverte qui, irrésistiblement, s'impose.
Les deux pôles qui garantissaient la suprématie du dollar, la puissance économique et impérialiste américaine, sont en train de s'éroder. La solvabilité du dollar était plus garantie par le rôle impérialiste dominant des USA que comme contrepartie de la puissance économique américaine. La valeur du dollar est en fait largement fictive, liée à la "confiance" qu'inspirent les Etats-Unis, et cette "confiance" va de plus en plus se trouver ébranlée par les bouleversements mondiaux. Dans la perspective du développement de la crise, ce qui est en jeu, c'est le rôle hégémonique du dollar sur la scène internationale, et donc la question de sa solvabilité future. Le système financier international, centré sur la devise américaine, est comme un château de cartes, il menace de s'effondrer au moindre souffle de vent, et ce sont les prémices d'une tempête qui s'accumulent.
Tant que ce le reste de "croissance" aux USA permet à l'Europe et au Japon de continuer à écouler leur production, l'ensemble des pays industrialisés a intérêt au statu quo présent, mais cette situation est provisoire. La perspective de l'effondrement du marché américain dans la récession signifie une nouvelle contraction du marché mondial et donc une chute des exportations des pays européens et du Japon : par conséquent, la récession pour ces pays. Cependant, leur situation économique n'est pas aussi dégradée que celle des USA. Le recours au crédit y est encore possible, pour essayer de préserver une relative stabilité à leurs marchés privilégiés, l'Europe pour l’Allemagne, et l'Asie du sud-est pour le Japon. Mais ce crédit ne pourra se faire que sur la base d'une montée en puissance de nouveaux challengers à la toute puissance du dollar : le deutschmark ou l'ecu et le yen. Cependant, une telle politique n'est pas plus une issue à la crise que ne le fut celle de Reagan. Elle ne ferait que traduire le délabrement accentué de l'économie mondiale, la faillite des USA, freiner brièvement le développement de la crise dans toute son ampleur, en fait que perpétuer tout à fait provisoirement l'illusion, et ce à un niveau encore plus restreint.
Le capitalisme ne peut envisager une crise sans solution capitaliste. Il ne peut accepter le fait que ses contradictions sont insurmontables. Il est toujours à la recherche de nouvelles illusions, de nouveaux mirages, qui puissent le faire rêver. Les bouleversements à l'Est avec la perspective de l'ouverture économique des pays d'Europe orientale vers l'Occident créent l’espoir de nouveaux débouchés pour les marchandises occidentales, donc d'un nouveau ballon d'oxygène permettant de maintenir la "croissance". Cet espoir sera de courte durée. Il y a dix ans, la Chine avait suscité les mêmes espérances, mais les capitalistes occidentaux avaient vite déchanté. Même si la Chine, avec son milliard d'habitants, a des besoins économiques énormes, ceux-ci, dans la logique du capital, ne pourront jamais être un marché solvable. Géante par sa population, la Chine est un nain économique.
Si, aujourd'hui, les pays du glacis est-européen peuvent prétendre s'émanciper de la tutelle russe, c'est à cause de l'effondrement économique du bloc russe. En conséquence, leur économie dévastée est semblable à celle de tous les pays sous-développés, c'est-à-dire insolvable. Avec l'ouverture du mur de Berlin, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est sont venus s'extasier devant les vitrines pleines de l'Occident, mais ils avaient les poches vides, et s'ils ont pu faire quelques maigres achats, c'est essentiellement grâce aux 100 DM "généreusement" octroyés par l'Etat ouest-allemand. De toute manière, les pays de l'est de l'Europe à eux tous (URSS exclue) totalisent un PNB de 490 milliards de dollars en 1987, un peu plus de la moitié du PNB de la France, 880 milliards de dollars. Un tel marché, même s'il était sain, ne serait de toute façon pas suffisant comme débouché à la surproduction mondiale pour permettre ainsi d'éviter la plongée inéluctable dans la récession ouverte, récession ouverte dans laquelle les pays de l'Est sont pour leur part déjà plongés depuis de nombreuses années.
La solution du crédit, la manne occidentale à laquelle les dirigeants de l'Est font appel, Walesa en tête, qui s'est fait le représentant des intérêts de l'économie polonaise, ne constitue pas une solution. Vu la ruine d'une économie ravagée par des décennies de gestion stalinienne aberrante, les crédits nécessaires à la "reconstruction" des pays de l'Est ne sont pas à la portée des capitalismes occidentaux. Ils seraient investis en pure perte : l'exemple de la Pologne est là, avec ses 40 milliards de dollars de dette, et la banqueroute persistante de son économie. Ce sont des milliers de milliards de dollars qui seraient en fait indispensables. A une époque où le monde entier ploie sous la dette, où, face à la restriction des marchés, la concurrence fait rage, un nouveau "plan Marshall" n'est plus possible, et les prêts de l'Ouest, plus que de permettre un développement industriel de ces pays, ont pour rôle de stabiliser au jour le jour la situation. Dans ces conditions, les crédits occidentaux resteront tout à fait symboliques.
Au début des années 1980, les pays sous-développés de la périphérie du capitalisme - le "tiers-monde" - ont irrémédiablement sombré économiquement. A la fin des années 1980, c'est au tour du bloc de l'Est - le "deuxième monde" - de s'effondrer. Le "premier monde", celui des grands pays industrialisés occidentaux, apparaît encore, par rapport à la banqueroute générale, comme un îlot de santé et de richesse relatives. Cette situation ne peut que renforcer l'illusion sur le capitalisme "démocratique" et "libéral", et constitue la base sur laquelle s'appuient les campagnes idéologiques intensives du bloc occidental. Cependant, toutes les conditions sont réunies pour qu'éclate au grand jour la faillite économique de l'ensemble du monde capitaliste, et notamment de ses pôles les plus développés. Depuis le milieu des années 1980, à coup de tricherie économique et de statistiques trompeuses, la bourgeoisie des pays industrialisés a entretenu l'illusion de la croissance. Ce mensonge officiel auquel la classe dominante elle-même avait besoin de croire touche à sa fin. Malgré toutes les manipulations dont ils sont l'objet, irrésistiblement, les indices économiques tendent à traduire l'approfondissement de la faillite économique du capitalisme. Les illusions sur la croissance, sur le développement économique, vont tomber brutalement avec les indicateurs officiels eux-mêmes, qui vont être obligés de traduire la réalité de la plongée accentuée dans la récession et du développement accéléré de l'inflation. C'est toute la base de la domination du capital qui se trouve sapée par la crise économique mondiale qui, avec une relative lenteur, mais inéluctablement, se développe.
JJ. 27/11/89.
[1] [22] Voir "Le crédit n'est pas une solution éternelle", Revue internationale n° 56, 1er trimestre 1989.
[2] [23] Voir "Guerre et militarisme dans la décadence", Revue internationale n° 52 et n° 53, 1er et 2e trimestres 1988
[3] [24] Voir présentation et extraits du "Rapport sur la situation internationale du 8 Congrès du CCI", Revue internationale n°59, 4 trimestre 1989.
[4] [25] Voir "L'agonie barbare du capitalisme décadent", Revue internationale n° 57, 2 trimestre 1989.
[5] [26] "Offre Publique d'Achat" : enchère boursière officielle pour racheter une entreprise, le plus souvent par un recours massif au crédit ou à des manipulations comptables acrobatiques.
Récent et en cours:
- Crise économique [27]
Comprendre la décadence du capitalisme (8) : La domination réelle du capital, ou...
- 5702 reads
-
LA DOMINATION RÉELLE[1] [28] DU CAPITAL,
ou les réelles confusions du milieu politique prolétarien
Il y a une nouvelle vogue dans le milieu politique prolétarien, une petite théorie dernier cri, que ses colporteurs présentent comme un secret depuis longtemps perdu du marxisme. Un secret qui permet d'expliquer l'évolution historique de la société capitaliste sans avoir à tomber -et c'est là toute sa beauté !- dans ce lieu commun, cette théorie désuète de la décadence, dont le CCI, en particulier, parle depuis si longtemps.
Selon cette vogue, le CCI et autres courants philistins (comme le KAPD, Bilan, Internationalisme) peuvent bien argumenter que le capitalisme est passé de sa phase ascendante à sa phase de décadence au moment de la première guerre mondiale, mettant la révolution prolétarienne à l'ordre du jour et rendant ainsi obsolètes les vieilles tactiques du mouvement ouvrier (le soutien au parlementarisme, aux luttes de libération nationale, etc.) ; rien n'y fait, ceux qui sont vraiment dans le coup font les dégoûtés et ricanent. Non, non, disent-ils, le véritable secret de l'évolution capitaliste est contenu dans la notion de transition entre sa phase de "domination formelle" à celle de sa "domination réelle", une notion que Marx lui-même a développée, mais à laquelle ses colporteurs contemporains ont donné une signification toute nouvelle.
Jetons un coup d'oeil à l'aile "néo-bordiguiste" du milieu il y a la Revue internationale du Mouvement communiste - au titre impressionnant ! - qui est publiée en commun par Communisme ou Civilisation (France), Union Prolétarienne (France), Comunismo (Mexique) et Kamunist Kranti (Inde). Les trois premiers de ces groupes se réclament tous du cadre de la "domination réelle-formelle". Communisme ou Civilisation (C. ou C.) a écrit trois longs volumes expliquant les tenants et les aboutissants de cette théorie. Et puis, il y a un groupe nouvellement formé, et encore plus grandiosement intitulé Mouvement communiste pour la formation du Parti Communiste Mondial, produit d'un regroupement entre les Cahiers Communistes (France) et À Contre-Courant (Belgique). Le numéro 0 de leur revue contient une déclaration de "points de référence programmatique", qui, à son tour, souligne l'importance de comprendre cette notion.
Et il n'y a pas que les « néo-bordiguistes ». Les crypto-conseillistes qui se sont donnés le nom de "Fraction Externe du CCI" ne veulent pas non plus avoir l'air démodés. Selon un long article de Perspective Internationaliste n° 7 (écrit par le camarade Mc Intosh comme contribution au débat, mais auquel aucun autre membre de la FECCI n'a répondu publiquement), "le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital" n'est pas seulement un élément décisif dans le développement du capitalisme d'Etat, mais également "c'est ce passage qui pousse le mode de production capitaliste vers sa crise permanente, qui rend insolubles les contradictions du procès de production capitaliste". Selon la FECCI, le CCI reste totalement aveugle face à cette percée scientifique saisissante parce qu'il a perdu tout intérêt pour l'approfondissement théorique.
Pour être honnête, cette "théorie", comme beaucoup d'autres modes des années 1980, n'est pas entièrement nouvelle. En fait, tout comme la mode punk était en grande partie une resucée du style des années 1950, les propriétés magiques de la "domination formelle-réelle" furent d'abord rendues publiques à la fin des années 1960, par le groupe Invariance autour de Jacques Camatte. Invariance était un groupe qui avait rompu avec le bordiguisme "officiel" du "Parti Communiste International" (PCI-Programma), et commencé à évoluer sur certaines questions (comme la contribution historique de la Gauche Communiste d'Allemagne). Mais l'adoption de la domination formelle réelle comme pierre de touche de son édifice théorique, ne l'a pas empêché d'abandonner rapidement le marxisme et de s'évanouir dans le néant du modernisme. En fait, le mauvais usage de ce concept a certainement participé à le pousser sur cette voie. Pour Invariance, le capitalisme, en achevant sa domination réelle, en particulier dans la période après 1945, loin de devenir historiquement obsolète, décadent, entré en crise permanente, avait non seulement démontré une capacité de croissance quasiment illimitée, mais était devenu si puissant que plus rien ne pourrait lui résister. Pour le moderniste Camatte, la "domination réelle" signifiait le triomphe total, omniprésent du capital, l'intégration du prolétariat, la fin de la perspective de la révolution prolétarienne. Désormais, l'espoir du communisme résidait autant dans les animaux, les végétaux et les minéraux, que dans le prolétariat.
Les nouveaux promoteurs du concept ne s'identifient pas avec la moderniste Invariance qui a rejoint depuis longtemps son nirvana final avec d'autres sectes modernistes qui, elles aussi, avaient repris l'idée de la domination formelle-réelle (Négation, Union Ouvrière, etc.). Mais ce qu'ils partagent avec Invariance, c'est une inflation et un abus éhonté de l'usage de la notion de Marx de domination formelle et réelle du capital.
Pour esquisser une réponse à ces éléments (ce à quoi nous nous limiterons ici), et arriver ainsi à la défense de la théorie de la décadence, comme l'ont fait d'autres articles de cette série, il faut en premier lieu revenir à ce que Marx a dit lui-même de ce concept.
-
Marx et la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital
Le fait que la formulation la plus développée de cette notion soit contenue dans un chapitre du Capital qui ne fut pas publié avant les années 1930, et ne fut donc pratiquement connu que dans les années 1960, a, dans une certaine mesure, permis aux théoriciens de dernière heure d'entourer ce concept d'un air de mystère, de donner l'impression d'un secret longtemps enterré et finalement porté à la lumière. La FECCI ajoute du piment à ce mystère quand Mc Intosh déclare que "leurs concepts fondamentaux auraient été intégrés aux derniers volumes du Capital prévus par Marx s'il avait vécu pour les achever" (Perspective Internationaliste n° 7) - ce qui est peut-être vrai, mais minimise le fait que les concepts fondamentaux sont déjà là, dans le seul volume du Capital que Marx a vraiment achevé, le volume I. Les arguments contenus dans le chapitre inédit sont essentiellement une élaboration de ce qui est déjà contenu dans le volume achevé.
Dans le volume I, Marx introduit le concept de "soumission formelle" et "réelle du travail au capital", dans le chapitre "Plus-value absolue et plus-value relative" :
- "Prolonger la joumée de travail au-delà du temps nécessaire à l'ouvrier pour fournir un équivalent de son entretien, et allouer ce surtravail au capital : voilà la production de la plus-value absolue. Elle forme la base générale du système capitaliste et le point de départ de la production de la plus value relative. Là, la journée est déjà divisée en deux parties, travail nécessaire et surtravail. Afin de prolonger le surtravail, le travail nécessaire est raccourci par des méthodes qui font produire l'équivalent du salaire en moins de temps. La production de la plus-value absolue n'affecte que la durée du travail, la production de la plus-value relative en transforme entièrement les procédés techniques et les combinaisons sociales. Elle se développe donc avec le mode de production capitaliste proprement dit." (Le Capital, Livre I, Ed La pléiade, p. 1002.)
- "Cela requiert, par conséquent, un mode de production spécifiquement capitaliste, un mode de production qui, avec ses méthodes, ses moyens et ses conditions, naît et se développe spontanément sur les bases de la subordination formelle du travail au capital. La subordination formelle est alors remplacée par une subordination réelle." (Le Capital Livre I. Marx n'a pas repris ces lignes dans la version française. Nous le traduisons de la version anglaise, Penguin ed., 1976, p. 645.)
En peu de mots : la subordination formelle implique l'extraction de plus-value absolue, la subordination réelle implique l'extraction de plus-value relative.
Historiquement, l'avènement de cette subordination formelle correspond au passage de l'industrie domestique à la manufacture :
- "Une simple subordination formelle du travail au capital suffit pour la production de plus value absolue. Il suffit, par exemple, que des artisans qui travaillaient auparavant pour leur propre compte, ou comme apprentis d'un maître, deviennent des travailleurs salariés sous le contrôle d'un capitaliste." (id.)
Dans le "Chapitre inédit" du Capital, nous trouvons exactement les mêmes concepts, si ce n'est qu'ils s'y trouvent plus longuement expliqués :
- "J'appelle subordination formelle du travail au capital la forme qui repose sur la plus-value absolue, parce qu'elle ne se distingue que formellement des modes de production anciens (...)" ("Matériaux pour 1"Economie"', ed. La pléiade, T. II, p 369).
- "La subordination réelle du travail au capital s'opère dans toutes les formes qui développent la plus-value relative par opposition à la plus-value absolue. Avec elle, une révolution totale (et sans cesse renouvelée) s'accomplit dans le mode de production lui même, dans la productivité du travail et dans les rapports entre les capitalistes et le travailleur." (id., p.379.)
Dans un autre passage, Marx affirme clairement que le passage de la domination formelle du travail à sa domination réelle correspond à la transition de la manufacture (lorsque les capitalistes rassemblaient des artisans et en extrayaient de la plus-value sans modifier fondamentalement leurs méthodes de production) à la grande industrie :
- "(...) la subordination du processus du travail au capital s'opère sur une base antérieure à cette subordination et différente des anciens modes de production. Dés lors, le capital s'empare d'un processus de travail préexistant, par exemple du travail artisanal ou du mode d'agriculture de la petite économie paysanne autonome. Lorsque des transformations se produisent dans le processus du travail traditionnel passé sous le contrôle du capital, il ne peut s'agir que de conséquences graduelles d'une subordination au capital déjà accomplie. En soi et pour soi, le caractère du processus et du mode réel du travail ne change pas parce que le travail se fait plus intensif, ou que sa durée augmente, et qu'il devient plus continu et plus ordonné sous l'oeil intéressé du capitaliste. Tout cela contraste beaucoup avec le mode de production spécifiquement capitaliste (travail sur une grande échelle, etc.) qui révolutionne la nature et le mode réel du travail en même temps que les rapports des divers agents de production. Ce mode de travail, que nous appelons subordination formelle du travail au capital, s'oppose au mode qui s'est développé avant même que surgisse le rapport capitaliste. " (id., p. 366.)
Pour résumer : le changement d"'époque" entraîné par le passage de la domination formelle du capital à sa domination réelle avait déjà eu lieu au moment où Marx écrivait, puisqu'il était la même chose que le passage de la manufacture à l'industrie moderne, réalisé à la fin du 18e et début du 19e siècle. Et, comme l'explique Marx dans le chapitre "Machinisme et grande industrie" du Livre I du Capital, ce passage a constitué un facteur décisif pour l'expansion rapide et sans précédent du mode de production capitaliste dans la période qui a suivi. En d'autres termes : la phase la plus dynamique de l'ascendance de la société bourgeoise reposait sur les bases de la domination réelle du capital.
-
Comment les épigones déforment Marx
1. Les divagations d'Invariance et des néo-bordiguistes
Telle est la définition que donne Marx des concepts de domination formelle et réelle. Mais qu'est-ce qu'en font les épigones ?
Commençons par les néo-bordiguistes. Parmi ceux-ci, CouC est celui qui a consacré le plus de temps et d'énergie à développer la thèse suivant laquelle domination "formelle" et domination "réelle" représentent les deux phases principales dans la vie du capital. Et il faut dire qu'ils ont au moins le mérite d'une certaine consistance avec la pensée de Marx. Tout comme Marx ils situent la transition de la domination formelle à celle réelle à la fin du 18e et début du 19e siècle :
- "La phase de soumission formelle du travail au capital (XVI°-XVIII° siècles) ... et la phase de soumission réelle du travail au capital (XIX°-XX°)" ("Les deux phases historiques de la production capitaliste", I, in CouC, n° 5 p. 3.)
Ou encore
- "Dans le dernier tiers du 18e siècle s'affirme la phase de la soumission réelle, dont le mode d'extorsion de la plus-value repose sur la plus-value relative. " (id., p. 33.)
Le problème se situe au niveau des conclusions que CouC tire de ceci : il s'en sert pour fournir un autre argument contre la notion de décadence et en faveur de 1"'invariance" du marxisme depuis 1848, car pour lui le communisme devient possible dès que débute la phase de domination réelle. Voici comment est présenté son long travail sur les "Deux phases historiques" :
- "Nous espérons ainsi pouvoir déblayer un peu le terrain de toutes les confusions et mystifications dont la périodisation du capital fait l'objet. Enfin, le pseudo-concept d'une 'décadence' du mode de production capitaliste vole en éclats qu'on ouvre au moins le chapitre inédit du Capital de Marx (...) Si l'on estime décadent le mode de production capitaliste parce qu'il a cessé de jouer un rôle progressiste et révolutionnaire, alors nous sommes en pleine décadence depuis 1848, car à cette époque déjà le capital était suffisamment développé pour poser en son sein les bases matérielles du communisme. Qualitativement cette date est celle qui a sonné pour nous, une fois pour toutes, le glas du capital. C'est la compréhension juste de la périodisation du capital qui permet, entre autres d'affirmer ceci : à partir de 1848 le communisme est devenu possible." (id. p. 4.)
A première vue, Mouvement communiste défend la même position :
- "Le marxisme à déclaré le mode de production capitaliste 'en décadence' depuis 1848, en posant, dès cette date, la nécessité et la possibilité de la révolution communiste." (Mouvement communiste, n° 0, p. 21.)
Mais que l'on creuse un peu et l'on découvrira que MC ce n'est en fait que du néo-néo-bordiguisme. Prenons un exemple important: alors que CouC, tout comme son prédécesseur reconnu, la pré-moderniste Invariance, n'a aucune honte à proclamer le caractère "révolutionnaire", "anti-impérialiste" des luttes de libération nationale, qui seraient supposées accélérer le passage de la domination formelle à la domination réelle (cf. CouC n°9, p. 47.), Mouvement communiste ne peut supporter quoi que ce soit qui touche aux luttes de libération nationale. Aussi doit-il forcer la théorie de la domination formelle-réelle pour l'adapter à ses propos :
- "Avec le passage du mode de production capitaliste dans sa phase de subsomption réelle (...) qui est globalement et mondialement effectué au début du 20e siècle - le rapport historique de forces entre les classes antagoniques fondamentales a entraîné la liquidation des tactiques de soutien aux bourgeoises progressistes en lutte contre le féodalisme, de soutien dans l'intérêt de la révolution en pennanence de certaines luttes de constitution d'Etats-nations (...) ainsi que des tactiques spécifiques à la révolution double. Seul reste a l'ordre du jour et mondialement, l'élaboration de la tactique 'directe et/ou indirecte' en parfaite conformité avec la révolution purement prolétarienne et communiste." (MC, n° 0, p. 20-21)
Il en est de même pour les tactiques de parlementarisme et d'organisation en syndicats. On s'aperçoit donc maintenant que pour MC, le véritable changement d"'époque", celui qui requiert un changement global du programme du mouvement ouvrier, ce n'est pas en réalité la transition de la domination formelle à celle réelle, mais le moment où cette transition est achevée à une échelle globale, ce qui, par une remarquable coïncidence, correspond justement à la période que certains philistins définissent comme le début de la phase de décadence du capitalisme.
En réalité cette sournoiserie, cette subtile distorsion de la périodisation en domination formelle et réelle en vue de l'adapter aux vues particulières de tel ou tel groupe, n'est pas le propre du seul MC. On retrouve le même procédé chez ceux qui ont lancé la mode à l'origine, Invariance, pour qui le réel changement se produit tantôt en 1914, tantôt avant, tantôt entre 1914 et 1945 et tantôt seulement après 1945. Et nous trouvons ce même flou chez la FECCI, comme nous le verrons.
Mais pour le moment, penchons-nous sur les vrais invariantistes, CouC, et leur idée que le communisme a été possible depuis 1848. Nous avons déjà traité de cette question longuement, dans un article précédent de cette série (voir Revue internationale, n° 48) à propos des arguments du GCI, qui affirme que le communisme est à l'ordre du jour depuis le début du capitalisme. A ce propos, tout ce qu'on peut dire ici c'est que, bien qu'il se revendique de l'orthodoxie marxiste, CouC n'est pas moins que le GCI en contradiction totale avec le matérialisme historique sur cette question cruciale.
Au coeur de la définition donnée par Marx du matérialisme historique, dans l'Avant propos à la critique de l'économie politique, se trouve la notion selon laquelle une nouvelle société ne devient possible qu'à partir du moment où l'ancienne est devenue une entrave permanente au développement des forces productives. Il est certain que 1848 a constitué un moment décisif historiquement, puisque cette date correspond en même temps à la première apparition du prolétariat comme force sociale autonome (journées de juillet à Paris, Chartisme, etc.), et à la première affirmation scientifique des principes généraux du communisme. Mais, en 1848, les rapports de production capitaliste n'étaient pas du tout une entrave pour les forces productives; au contraire, étant parvenus au niveau de la grande industrie ("domination réelle"), ils connaissaient un processus de conquête de l'ensemble de la planète. En 1848, Marx et Engels ont pu momentanément croire à l'imminence de la révolution communiste. Mais au cours des années 1850 ils ont non seulement révisé leur point de vue, mais aussi considéré que leur tâche la plus importante consistait à comprendre la dynamique historique du capital et à déterminer le point à partir duquel les contradictions internes du système se transformeraient en une barrière permanente pour le capital lui même. Ils ont entièrement reconnu qu'il s'agissait de quelque chose pour l'avenir, car le capitalisme était en train de vivre, sous leurs yeux, sa plus "héroïque" période d'expansion et de croissance. Das Kapital est lui même un produit de cette nécessaire période de réflexion et de clarification.
Le problème avec les bordiguistes, c'est qu'ils ont tendance à confondre les conditions matérielles objectives avec les conditions subjectives de la conscience de l'avant-garde du prolétariat : bref, ils pensent que le parti est tout-puissant. En 1848, la minorité communiste était en mesure d'affirmer la perspective du communisme comme le but final du mouvement ouvrier ; pour les néo-bordiguistes de CouC, cette prévision des marxistes est transformée en possibilité immédiate, comme s'il suffisait que les communistes la veuillent pour qu'elle fût réalité. Le marxisme a un nom pour cette déviation idéologique : idéalisme.
2. La FECCI : centriste comme toujours
Avec la découverte par la FECCI de la domination formelle-réelle, son habituel centrisme vis-à-vis du conseillisme se transforme, sur cette question particulière, en centrisme vis-à-vis du bordiguisme. Alors que CouC et les autres ont explicitement développé leur théorie comme une attaque contre la notion de décadence, la FECCI veut garder le beurre (la notion de décadence, de capitalisme d'Etat) et l'argent du beurre (domination formelle-réelle).
Par la plume du camarade Mc Intosh, ils affirment que la transition de la domination formelle à la domination réelle fournit un "lien causal" dans la chaîne qui conduit en même temps à la décadence du capitalisme et à son mode spécifique d'organisation : le capitalisme d'Etat. Malheureusement, sur la question de savoir comment l'avènement de la domination réelle est "cause" de la décadence du capitalisme, nous n'avons que le petit morceau cité ci-dessus, qui n'est en fait qu'une note dans l'article de Mc Intosh. Nous attendons avec impatience la prochaine livraison. Mais, notons que, pour le moment, Mc Intosh n'a virtuellement rien à dire sur un des maillons de la chaîne causale dont il parlait si aisément lorsqu'il était dans le CCI - à savoir la théorie de Rosa Luxemburg sur l'épuisement des marchés pré-capitalistes comme un déterminant fondamental du commencement de la décadence. On se demande si la FECCI ne va pas laisser tomber la théorie de Rosa ; toujours à la recherche de raisons pour justifier leur existence ils s'éloignent toujours plus des analyses de base du CCI. Mais pour le moment, nous ne pouvons poursuivre ici cette question.
Quoi qu'il en soit, l'essentiel de l'article de Mc Intosh est consacré à démontrer que la transition de la domination formelle à la domination réelle oblige le capitalisme à adopter sa forme étatisée. C'est un très long article, qui contient quelques contributions intéressantes sur le rôle de l'Etat dans la théorie marxiste. Mais l'argumentation mise en avant pour montrer en quoi la transition domination formelle-réelle justifie le capitalisme d'Etat, est en réalité bien mince.
Pour justifier sa thèse, Mc Intosh cite certains passages du "Chapitre inédit" ("Résultats du processus immédiat de production"), où Marx dit que sous la domination réelle du capital "le véritable agent du procès de travail total n'est plus le travailleur individuel, mais une force de travail se combinant toujours plus socialement", et que ce changement exige "l'application au processus de production immédiat de la science" (Cité in PI. n° 7, p. 25.)
A partir de ces brefs passages, Mc Intosh fait un bond jusqu'à la conclusion que seul l'Etat peut organiser, scientifiquement, l'extraction de la plus-value relative du travailleur collectif : d'où le capitalisme d'Etat et l'organisation totalitaire de la vie sociale moderne.
Les défauts de cette argumentation ne sont pas difficiles à trouver. Premièrement, alors que la socialisation du travail est un produit "organique" du développement capitaliste, tout comme la concentration de capital, le capitalisme d'Etat constitue une réponse à l'effondrement de ce développement organique, un produit de l'épuisement des possibilités d'extension "pacifique" de la production capitaliste. Pour trouver les véritables causes du capitalisme d'Etat, il faut expliquer pourquoi la croissance organique du capital dans sa phase ascendante a été violemment interrompue. La théorie de Luxemburg fournit une réponse cohérente et consistante.
Deuxièmement, la périodisation faite par Mc Intosh est confuse, comme nous l'avons argumenté dans la Revue internationale n° 54. L'apparition du travailleur collectif, l'application de la science au processus de production, cela se développait du temps de Marx - dans la phase ascendante du capitalisme, au 19e siècle. Le développement du capitalisme d'Etat se produit au cours du 20e siècle, dans l'époque de décadence : il constitue en réalité une réponse aux conditions économiques, sociales et politiques de la décadence capitaliste. Ce qu'a fait ici Mc Intosh, c'est identifier l'époque d'ascendance avec la phase de domination formelle, et l'époque de décadence avec la phase de domination réelle. Comme nous l'avons déjà dit, CouC a au moins le mérite d'une certaine consistance avec Marx en situant la transition de domination formelle à réelle au sein de la période ascendante ; ils maintiennent une certaine cohérence logique lorsqu'ils utilisent ce fait pour argumenter contre la notion de décadence et affirmer que le communisme a été possible depuis 1848. Mais la FECCI baigne en pleine confusion.
-
Les frontières changeantes de la domination réelle
Dans Perspective internationaliste n° 12, la FECCI prétend répondre à nos critiques précédentes sur leur périodisation du capital :
- "(...) le CCI choisit d'interpréter la catégorie de la domination réelle du capital non comme la généralisation de l'extraction de la plus-value relative à l'ensemble du mode de production capitaliste, non comme la dépendance du capitalisme de l'extraction de la plus-value relative, mais comme la simple apparition de cette catégorie dans le paysage capitaliste, comme sa naissance même, la situant par là au commencement même du capitalisme. (...) En réalité, loin de se situer au 18e siècle, voire en 1848, le passage de la domination formelle à la domination réelle du capital ne s'est achevé qu'après 1914, son triomphe final s'étendant jusqu'aux dernières décennies avec l'extension de la domination réelle du capital à pratiquement l'ensemble du secteur agraire." (Perspective Internationaliste, n° 12.)
Nous avons déjà signalé la tendance chez les colporteurs de cette théorie à changer les frontières de la domination réelle en fonction des besoins de leur version particulière de l'histoire. Invariance, par exemple, s'intéressa de plus en plus à relever les progrès de la domination réelle au cours du 20e siècle, avec l'objectif précis d'étayer sa vision de la toute puissante, omniprésente "communauté du capital". MC et la FECCI sont plutôt trop attachés aux positions de classe qu'ils ont apprises du CCI et veulent ainsi souligner que le changement crucial se produit au début du 20e siècle, lorsque les vieilles tactiques du mouvement ouvrier devaient être abandonnées.
Tout ceci nous éloigne beaucoup de Marx, pour qui les catégories de domination formelle et réelle avaient une signification bien plus précise. Elles ne furent jamais mises en avant comme le secret ultime de l'évolution du capital, comme la clé des crises du système, etc. Ce n'est pas par hasard si Marx développe ces concepts dans le volume I du Capital, où il traite non pas des crises, mais des relations "internes" entre travail et capital, du mode d'exploitation directe au niveau de la production. Le concept était certes important pour expliquer l'énorme expansion du capital à cette époque, mais il n'avait pas d'autre prétention.
Cela peut difficilement satisfaire nos théoriciens de la dernière heure, qui veulent y trouver un concept capable de rivaliser avec la théorie de la décadence (ou, dans le cas de la FECCI, une nouvelle explication de la décadence). Pour eux ce concept doit être enflé jusqu'à englober tous les changements majeurs qui ont pu se produire dans la vie économique, sociale et politique du capital. Mais en faisant cela, le concept perd toute la précision qu'il possède chez Marx et devient outrancièrement flou et vague. Mais cela convient tout aussi bien à nos théoriciens de la domination "formelle-réelle", puisque cela leur permet de mouler la notion suivant leurs propres besoins. Prenons la FECCI, par exemple : ils ont commencé par parler du changement d"'époque" entre domination formelle et domination réelle comme un facteur déterminant dans la crise historique du capital et son évolution vers une forme étatisée. Le CCI avait répondu : si ce changement doit être situé dans une "époque" particulière, c'est au sein de la période ascendante ; aussi en quoi cela serait-il une explication de la décadence du capitalisme ? La FECCI répond par une esquive en argumentant que le "changement d'époque" peut avoir commencé au 18e siècle mais qu'il est toujours en marche aujourd'hui...
Évidemment, ici ils n'ont pas tout à fait tort : il reste, en particulier, dans le "tiers monde", des zones entières de production qui ne sont encore dominées que formellement par le capital. Qui plus est, il demeure des régions entières qui ne sont pas encore parvenues à ce stade. On peut affirmer, sans risque de se tromper, que la domination réelle finale, achevée et universellement triomphante, n'arrivera jamais. Mais si la transition effective est en cours depuis 200 ans, comment diable allons nous mesurer les changements spécifiques que ce processus a entraînés dans la vie du capital ? Parvenu à ce point, tout cela devient si vague qu'on ne peut plus rien distinguer.
Le seul moyen d'éviter ce flou est de reconnaître, avec Marx, que le changement décisif dans le mode d'exploitation capitaliste a eu lieu au cours de la période ascendante et que depuis lors le développement et l'expansion capitalistes ne se sont pas déroulés à travers une répétition mécanique de ce changement dans chaque pays ou région mais sur la base de la domination réelle, de la grande industrie avec son exploitation scientifique du travail social.
Il y a une autre erreur importante dans la vision de ceux qui voient la "véritable" période de domination réelle dans le 20e siècle, et plus spécialement dans la période après 1945. Puisque le passage à la domination réelle fut un facteur décisif dans la phénoménale croissance du 19e siècle, pourquoi n'en serait-il pas de même pour le 20e siècle ? Ou, plutôt, si le véritable changement de la domination formelle se produit au 20e siècle, cela n'implique-t-il pas que le capitalisme du 20e siècle, loin d'être décadent, connaît sa période de plus grande croissance et développement ?
Telle est précisément la conclusion à laquelle était parvenue Invariance ; elle facilita énormément son effondrement dans le modernisme. On retrouve l'écho de cette même idée chez les néo-bordiguistes qui aiment tant ridiculiser la théorie de la décadence en citant les énormes taux de croissance de la période post-1945. Pour la FECCI, qui se cramponne encore à la notion de décadence, il importe d'éviter à tout prix de parvenir à une telle conclusion, mais la logique n'est certainement pas de son côté.
C'est quelque chose de remarquable : plus le capitalisme sombre dans sa décadence, plus il montre sa décomposition avancée, et plus la bourgeoisie se voit obligée de nier la réalité et de promettre un brillant avenir sous le soleil du capitalisme. Telle est l'essence des campagnes actuelles en réponse à l'effondrement du stalinisme : le seul espoir, le seul avenir c'est le capitalisme !
La mode de dénigrer la théorie de la décadence au sein du milieu prolétarien ne peut être comprise que sous cet éclairage : c'est un reflet de la pénétration de l'idéologie bourgeoise au sein du mouvement ouvrier, et cela doit être combattu comme tel. En même temps, la tâche qui consiste à chercher une "alternative" à la théorie de la décadence pour fonder les positions révolutionnaires maintient artificiellement en vie un ensemble de sectes et de groupes parasites qui auraient du mal à justifier autrement leur existence ; les fausses théorisations sur domination formelle et domination réelle tendent à sous-estimer la nature catastrophique de l'actuelle crise, qui est une authentique expression de l'agonie mortelle du système capitaliste ; elles sont un prétexte parfait pour cet académisme stérile qui regarde avec mépris les révolutionnaires qui se sont engagés dans une intervention militante au sein de la lutte de classe. Malheureusement pour nos professeurs et experts en marxisme, l'histoire s'accélère si rapidement aujourd'hui qu'elle va bientôt troubler la sérénité de leurs études avec le bruit vulgaire de ses bottes dans les rues.
CDW. Novembre 1989.
[1] [29] Les termes de "domination" ou "subordination" sont employés pour traduire le terme "subsumption" utilisé par Marx.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [31]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 61 - 2e trimestre 1990
- 3014 reads
Après l'effondrement du bloc de l'est, déstabilisation et chaos
- 8678 reads
Après l'effondrement du bloc de l'est, déstabilisation et chaos ([1] [33])
L'effondrement du bloc de l'Est, auquel nous venons d'assister, constitue, avec la reprise historique du prolétariat à la fin des années 1960, le fait le plus important depuis le dernière guerre mondiale. En effet, ce qui s'est passé dans la seconde moitié de l'année 1989 met fin à la configuration du monde telle qu'elle s'était maintenue durant des décennies. Les Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est" (voir Revue Internationale n°60), rédigées en septembre 89, donnent le cadre de compréhension des causes et des enjeux de ces événements. Pour l'essentiel, cette analyse a été amplement confirmée par les faits advenus au cours de ces derniers mois. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir longuement ici, sinon pour rendre compte des principaux événements qui se sont produits depuis la parution du précédent numéro de notre revue. En revanche, il est essentiel pour les révolutionnaires d'examiner les implications de cette nouvelle situation historique, du fait notamment de l'importance considérable des différences qu'elle comporte avec la période précédente. C'est ce que se propose principalement de faire le présent article.
Pendant plusieurs mois, l'évolution de la situation dans les pays de l'Est a semblé combler les voeux de la bourgeoisie en faveur d'une "démocratisation pacifique". Cependant, dès la fin décembre 89, la perspective d'affrontements meurtriers annoncée dans les "thèses" trouvait une confirmation tragique. Les convulsions brutales et les bains de sang que viennent de connaître la Roumanie et l'Azerbaïdjan soviétique ne sont en effet pas destinés à rester une exception. La "démocratisation" de la Roumanie constituait la fin d'une période dans l'effondrement du stalinisme : celle de la disparition des "Démocraties populaires" ({C}[2]{C} [34]). En même temps, elle inaugurait une nouvelle période : celle des convulsions sanglantes qui vont affecter cette partie du monde, et tout particulièrement le pays d'Europe où le parti stalinien conserve encore son pouvoir (mise à part la minuscule Albanie) : l'URSS elle-même. En effet, les événements des dernières semaines dans ce pays confirment la perte totale de contrôle de la situation par les autorités, même si, pour le moment, Gorbatchev semble être en mesure de maintenir sa position à la tête du Parti. Les chars russes dans Bakou ne constituent nullement une démonstration de force du pouvoir qui dirige l'URSS ; ils sont au contraire un terrible aveu de faiblesse. Gorbatchev avait promis que, désormais, les autorités n'emploieraient plus la force armée contre la population : le bain de sang du Caucase a signé l'échec total de sa politique de "restructuration". Car ce qui se passe dans cette région n'est que le signe annonciateur des convulsions bien plus considérables encore qui vont secouer et finalement terrasser l'URSS.
L’URSS s'enfonce dans le chaos
En quelques mois, ce pays vient de perdre le bloc impérialiste qu'il dominait jusqu'à l'été dernier. Désormais il n'existe plus de "bloc de l'Est", il est parti en lambeaux en même temps que s'effondraient comme des châteaux de cartes les régimes staliniens qui dirigeaient les "Démocraties populaires". Mais une telle déconfiture ne pouvait s'arrêter là : dans la mesure même où la cause première de la décomposition de ce bloc est constituée par la faillite économique et politique totale, sous les coups de l'aggravation inexorable de la crise mondiale du capitalisme, du régime de sa puissance dominante, c'est dans cette dernière qu'une telle faillite devait nécessairement s'exprimer avec le plus de brutalité. L'explosion du nationalisme dans le Caucase, les affrontements armés entre azéris et arméniens, les pogroms de Bakou, toutes ces convulsions qui furent à l'origine de l'intervention massive et sanglante de l'Armée "rouge", constituent un pas de plus dans l'effondrement, dans l'éclatement de ce qui constituait, il y a encore moins d'un an, la deuxième puissance mondiale. La sécession ouverte de l'Azerbaïdjan (où même le Soviet suprême local s'est dressé contre Moscou), mais aussi celle de l'Arménie où la rue est tenue par des forces armées qui n'ont rien à voir avec les autorités officielles, ne font que précéder la sécession de l'ensemble des régions qui entourent la Russie. Par l'emploi de la force armée, les autorités de Moscou ont essayé de mettre un terme à un tel processus dont la sécession "en douceur" de la Lituanie, et les manifestations nationalistes en Ukraine du début janvier, annoncent les prochaines étapes. Mais une telle répression ne peut, au plus, qu'en retarder quelque peu les échéances. A Bakou, déjà, sans parler des autres villes et de la campagne, la situation est loin d'être sous contrôle des autorités centrales. Le silence qu'observent désormais les médias ne signifie nullement que les choses soient "rentrées dans l’ordre". En URSS, comme en Occident, la "glasnost" est sélective. Il s'agit de ne pas encourager d'autres nationalités de suivre l'exemple des arméniens et des azéris. Et même si, pour le moment, les tanks ont réussi à rétablir une chappe de plomb sur les manifestations nationalistes, rien n'est réglé pour le pouvoir de Moscou. Jusqu'à présent, ce n'était qu'une partie de la population qui s'était mobilisée activement contre la tutelle de la Russie, l'arrivée des chars et les massacres ont soudé l'ensemble des azéris contre l’"occupant". Les arméniens ne sont plus les seuls à craindre pour leur vie : les populations russes d'Azerbaïdjan risquent maintenant de payer pour cette opération militaire. De plus, les autorités de Moscou n'ont pas les moyens d'employer partout la même méthode de "maintien de l'ordre". D'une part, les azéris ne représentent qu'un vingtième de la totalité des populations non russes qui peuplent l'URSS. On se demande avec quels moyens, par exemple, le gouvernement de ce pays pourrait mettre au pas les 40 millions d'ukrainiens. D’autre part, les autorités ne peuvent compter sur l'obéissance de l'Armée "rouge" elle-même. Dans celle-ci, les soldats appartenant aux différentes minorités qui aujourd'hui réclament leur indépendance sont de moins en moins disposés à se faire tuer pour garantir la tutelle russe sur ces minorités. En outre, les russes eux-mêmes rechignent de plus en plus à assumer ce genre de travail. C'est ce qu'ont démontré des manifestations comme celle du 19 janvier à Krasnodar, dans le Sud de la Russie, dont les slogans montraient clairement que la population n'est pas prête à accepter un nouvel Afghanistan, manifestations qui ont contraint les autorités à libérer les réservistes mobilisés quelques jours auparavant.
Ainsi, le même phénomène qui a conduit il y a quelques mois à l'explosion de l'ancien bloc russe, se poursuit aujourd'hui avec l'explosion de son chef de file. De même que les régimes staliniens eux-mêmes, le bloc de l'Est ne tenait en place que par la terreur, par la menace, plusieurs fois mise à exécution, d'une brutale répression armée. Dès lors que l'URSS, du fait de son effondrement économique et de la paralysie qui en résultait pour son appareil politique et militaire, n'a plus eu les moyens d'une telle répression, son empire s'est immédiatement disloqué. Mais cette dislocation portait dans son sillage celle de l'URSS elle-même puisque ce pays est, lui aussi, constitué par une mosaïque de nationalités sous la tutelle de la Russie. Le nationalisme de ces minorités, dont l'impitoyable répression stalinienne n'avait fait qu'empêcher les manifestations ouvertes, mais qui s'était encore accru du fait même de cette répression et du silence auquel il était condamné, s'est déchaîné dès qu'il est apparu, avec la "perestroïka" gorbatchévienne, que s'éloignait la menace de la répression. Aujourd'hui, cette répression est à nouveau à l'ordre du jour, mais il est désormais trop tard pour faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. De même que la situation économique, la situation politique échappe complètement au contrôle de Gorbatchev et de son parti. La seule chose que sa "perestroïka" ait permise, c'est encore moins de biens sur les étalages des magasins, encore plus de misère et, en outre, la libération des pires sentiments chauvins et xénophobes, les pogroms et les massacres de tous ordres.
Et ce n'est qu'un début, le chaos qui règne dès à présent en URSS ne peut que s'aggraver car le régime qui gouverne encore ce pays, de même que l'état de son économie, n'offrent aucune perspective. La "perestroïka", c'est-à-dire la tentative d'adapter "à petits pas" un appareil économique et politique paralysé face à l'aggravation de la crise mondiale, démontre chaque jour plus sa faillite. Le retour à la situation passée, le rétablissement de la centralisation complète de l'appareil économique et de la terreur de la période stalinienne ou brejnévienne, même s'il est tenté par un sursaut des secteurs "conservateurs" de l'appareil, ne pourra rien résoudre. Ces méthodes ont déjà fait faillite puisque la perestroïka partait justement du constat de cette faillite. Depuis, la situation n'a fait que s'aggraver sur tous ces plans à une échelle considérable. La résistance encore très forte d'un appareil bureaucratique qui voit s'écrouler sous ses pieds les bases mêmes de son pouvoir et de ses privilèges ne pourrait aboutir qu'à de nouveaux bains de sang sans permettre pour autant de surmonter le chaos. Enfin, l'établissement de formes plus classiques de la domination capitaliste - autonomie de gestion des entreprises, introduction de critères de compétitivité liés au marché - même s'il constitue de toutes façons la seule "perspective", ne peut, dans l'immédiat, qu'aggraver encore plus le chaos de l'économie. On peut voir à l'heure actuelle en Pologne les conséquences d'une telle politique : 900 % d'inflation, montée irrépressible du chômage et paralysie croissante des entreprises (au 4e trimestre 89, la production des biens alimentaires traités par l'industrie a chuté de 41 %, celle des vêtements, de 28 %). Et dans un tel contexte de chaos économique, une "démocratisation en douceur", la stabilité politique, n'ont pas de place.
Ainsi, quelle que soit la politique qui sortira des instances dirigeantes du parti communiste de l'URSS, quel que soit le successeur éventuel de Gorbatchev, le résultat ne saurait être très différent, la perspective pour ce pays est celle de convulsions croissantes dont celles des dernières semaines ne nous donnent qu'une petite idée : famines, massacres, règlements de compte armés entre fractions de la "Nomenklatura" et entre populations saoulées par le nationalisme. C'est avec une épouvantable barbarie que le stalinisme avait établi son pouvoir sur le cadavre de la Révolution communiste d'octobre 1917, victime de son isolement international. C'est dans la barbarie, le chaos, le sang et la boue que ce système agonise aujourd'hui.
De plus en plus, la situation de l'URSS et de la plupart des pays d'Europe de l'Est va ressembler à celle des pays du "Tiers-monde". La barbarie complète qui depuis des décennies a transformé ces derniers pays en un véritable enfer, la décomposition totale de toute vie sociale, la loi des gangs armés, tel que le Liban, par exemple, nous en offre aujourd'hui le tableau, seront de moins en moins réservées à des zones éloignées du coeur du capitalisme. Désormais, c'est toute la partie du monde jusqu'à présent dominée par la seconde puissance mondiale qui est menacée de "urbanisation". Et cela, en Europe même, à quelques centaines de kilomètres des concentrations industrielles les plus anciennes et importantes du monde.
C'est pour cette raison que l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, non seulement constitue un bouleversement pour les pays de cette zone et pour les constellations impérialistes telles qu'elles étaient sorties de la seconde guerre mondiale, mais porte avec lui une instabilité générale qui ne manquera pas d'affecter tous les pays du monde, y compris les plus solides. En ce sens, il importe que les révolutionnaires soient capables de prendre la mesure de ces bouleversements et en particulier d'actualiser le cadre d'analyse qui était valable jusqu'à l'été dernier, au moment où s'est tenu notre dernier congrès international (voir Revue Internationale n°59), mais que les événements de la seconde partie de 1989 se sont chargés de rendre en partie caduc. C'est ce que nous nous proposons de faire sur les trois points "classiques" de l'analyse de la situation internationale :
{C}- {C}la crise du capitalisme,
{C}- {C}les conflits impérialistes,
{C}- {C}la lutte de classe.
La crise du capitalisme
C'est le point sur lequel les analyses du dernier congrès du CCI restent le plus d'actualité. En effet, l'évolution de la situation de l'économie mondiale au cours des 6 derniers mois a pleinement confirmé l'analyse du congrès sur l'aggravation de la crise du capitalisme. Les illusions que les "spécialistes" bourgeois avaient essayé d'entretenir sur la "croissance" et sur la "sortie de la crise" - illusions basées sur les chiffres de 1988 et début 1989 concernant les principaux pays avancés - sont, d'ores et déjà, rudement battues en brèche (voir les articles à ce sujet dans ce numéro de la Revue Internationale et dans le précédent).
Pour ce qui concerne les pays de l’ex-bloc de l'Est, la "Glasnost", qui aujourd'hui permet de se faire une idée plus réaliste de leur situation véritable, permet en même temps de mesurer l'étendue du désastre. Les chiffres officiels antérieurs, qui déjà rendaient compte d'un sinistre de première grandeur, étaient encore bien en deçà de la réalité. L'économie des pays de l'Est se présente comme un véritable champ de ruines. L'agriculture (qui pourtant emploie une proportion bien plus élevée de la force de travail que dans les pays occidentaux) se trouve, dans la plupart des pays, absolument incapable de nourrir la population. Le secteur industriel est non seulement totalement anachronique et obsolète, mais, de plus, complètement grippé, incapable de fonctionner, du fait des carences des transports et de l'approvisionnement en pièces détachées, de l'usure des machines, etc., et surtout de la désimplication générale de tous ses acteurs, depuis les manoeuvres jusqu'aux directeurs des usines. Près d'un demi-siècle après la seconde guerre mondiale, l'économie qui devait, aux dires de Kroutchev au début des années 60, rattraper et dépasser celle des pays occidentaux et "faire la preuve de la supériorité du 'socialisme' sur le capitalisme", semble tout droit sortie de la guerre. Et la situation, comme on l'a vu, n'est pas prêt de s'améliorer. Si c'est bien la faillite totale de l'économie stalinienne, enregistrée depuis déjà des années face à l'aggravation de la crise mondiale, qui se trouve à l'origine de l'effondrement du bloc de l'Est, cette faillite n'a pas encore atteint son point le plus extrême, loin de là. Et cela d'autant plus qu'au niveau mondial, la crise économique, non seulement ne peut que s'aggraver encore, mais sera encore amplifiée par les conséquences de la catastrophe qui touche les pays de l'Est.
En effet, il importe de souligner la totale ineptie (propagée par certains secteurs de la bourgeoisie, mais aussi par certains groupes révolutionnaires) suivant laquelle l'ouverture de l'économie des pays de l'Est sur le marché mondial pourrait constituer un "ballon d'oxygène" pour l'ensemble de l'économie capitaliste. La réalité est toute autre.
En premier lieu, pour que les pays de l'Est puissent contribuer à une amélioration de la situation de l'économie mondiale, il faudrait qu'ils constituent un marché réel. Ce ne sont pas les besoins qui font défaut, comme ils ne font pas défaut aux pays sous-développés, d'ailleurs. La question est : avec quoi peuvent-ils acheter tout ce qui leur manque ? Et c'est là qu'on mesure immédiatement l'absurdité d'une telle analyse. Ces pays N'ONT RIEN pour payer leurs achats. Ils ne disposent d'absolument aucune ressource financière : en fait, il y a déjà longtemps qu'ils ont rejoint le lot des pays gravement endettés (ainsi la dette extérieure de l'ensemble des ex-démocraties populaires se montait en 89 à 100 milliards de dollars ([3] [35]), soit un chiffre proche de celui du Brésil pour une population et un PNB également comparables). Pour qu'ils puissent acheter, il faudrait qu'ils puissent vendre. Mais que peuvent-ils vendre sur le marché mondial alors que la cause première de l'effondrement des régimes staliniens (dans le cadre, évidemment de la crise générale du capitalisme) est justement le manque complet de compétitivité sur ce même marché des économies qu'ils dirigeaient ?
A cette objection, certains secteurs de la bourgeoisie répondent qu'il faudrait un nouveau "Plan Marshall" qui permettrait de reconstituer le potentiel économique de ces pays. En réalité, même si l'économie des pays de l'Est comporte des points communs avec celle de l'ensemble de l'Europe au lendemain de la seconde guerre mondiale, un nouveau "Plan Marshall" est totalement impossible aujourd'hui. Ce plan (dont la vocation essentielle, d'ailleurs, n'était pas en soi de reconstruire l'Europe, mais de soustraire celle-ci à la menace d'un contrôle par l'URSS), a pu réussir dans la mesure où le monde entier (à l'exception des Etats-Unis) était à reconstruire. A cette époque ne se posait pas un problème de surproduction généralisée de marchandises ; et c'est justement la fin de la reconstruction de l'Europe occidentale et du Japon qui se trouve à l'origine de la crise ouverte que nous connaissons depuis le milieu des années 60. C'est pour cela qu'aujourd'hui, une injection massive de capitaux vers les pays de l’Est visant à développer leur potentiel économique, et particulièrement industriel, ne peut être à l'ordre du jour. Même en supposant qu'on puisse remettre sur pieds un tel potentiel productif, les marchandises produites ne feraient qu'encombrer encore plus un marché mondial déjà sursaturé. Il en est des pays qui aujourd'hui sortent du stalinisme comme des pays sous-développés: toute la politique de crédits massifs injectés dans ces derniers au cours des années 70 et 80 n'a pu aboutir qu'à la situation catastrophique que l'on connaît bien (une dette de 1400 milliards de dollars et des économies encore plus ravagées qu'auparavant). Les pays de l'Est (dont l'économie s'apparente d'ailleurs à celle des pays sous-développés par bien des côtés) ne peuvent connaître de sort différent. D'ailleurs, les financiers des grandes puissances occidentales ne s'y trompent pas : ils ne se bousculent pas pour apporter des capitaux aux pays qui, comme la Pologne fraîchement "déstalinisée", les réclament à cors et à cris (il faudrait à ce pays au minimum 10 milliards de dollars en trois ans), y compris en leur envoyant l'"ouvrier" prix Nobel Walesa. Et comme ces responsables financiers sont tout sauf des philanthropes, il n'y aura ni crédits ni ventes massives des pays les plus développés en direction des pays qui viennent de "découvrir" les "vertus" du libéralisme et de la "Démocratie". La seule chose à laquelle on puisse s'attendre, c'est l'envoi de crédits ou d'aides d'urgence permettant à ces pays de s'éviter une banqueroute financière ouverte et des famines qui ne feraient encore qu'aggraver les convulsions qui les secouent. Et ce n'est pas cela qui pourra constituer un "ballon d'oxygène" pour l'économie mondiale.
Parmi les pays de l'ex-bloc de l'Est, la RDA constitue évidemment un cas à part. En effet, ce pays n'est pas destiné à se maintenir comme tel. La perspective de son absorption par la RFA est d'ores et déjà admise, à contre-coeur, non seulement par l'ensemble des grandes puissances, mais y compris par son gouvernement actuel. Cependant, l'intégration économique, première étape de cette "réunification", et qui constitue le seul moyen de mettre fin à l'exode massif de la population de RDA vers la RFA, pose dès à présent des problèmes considérables, tant à ce dernier pays qu'à l'ensemble de ses partenaires occidentaux. Le "sauvetage" de l'économie d'Allemagne de l'Est constitue un fardeau énorme du point de vue financier. Si, d'un côté, les investissements qui ne manqueront pas d'être réalisés dans cette partie de l'Allemagne peuvent constituer un "débouché" momentané pour certains secteurs industriels de la RFA et de quelques autres pays d'Europe, de l'autre côté, ces investissements ne pourront qu'accentuer l'aggravation de l'endettement généralisé de l'économie capitaliste tout en contribuant à engorger encore plus le marché mondial. C'est pour cela que l'annonce récente de la création d'une union monétaire entre la RFA et la RDA, décision qui avait des motivations plus politiques qu'économiques (comme en témoignent les réticences du président de la Banque fédérale), n'a pas soulevé l'enthousiasme, loin de là, dans l'ensemble des pays occidentaux. En fait, la RDA constitue, sur le plan économique, un cadeau empoisonné pour la RFA. Dans la corbeille de mariage, l'Allemagne de l'Est n'apporte qu'une industrie délabrée, une économie essoufflée et poussive, une montagne de dettes et des wagons de marks-Est qui valent à peine le papier dont ils sont faits, mais que la RFA devra racheter au prix fort lorsque le Deutsch-Mark deviendra la monnaie commune aux deux parties de l’Allemagne. En RFA, la "planche à billets" a de beaux jours devant elle, l'inflation aussi.
Ainsi, ce que, fondamentalement, l'économie capitaliste peut attendre de l'effondrement du bloc de l'Est, ce n'est certainement pas une atténuation de sa crise mais des difficultés accrues. D'une part, comme on l'a vu, la crise financière (la montagne des dettes non solvables) ne peut que s'aggraver, mais, en outre, l'affaiblissement de la cohésion du bloc occidental et, à terme sa disparition (comme nous le verrons plus loin), portent avec eux la perspective d'un surcroît de difficultés pour l'économie mondiale. Comme nous l'avons mis en évidence depuis longtemps, une des raisons pour lesquelles le capitalisme a pu ralentir jusqu'à présent le rythme de son effondrement, c'est la mise en oeuvre d'une politique de capitalisme d'Etat à l'échelle de tout le bloc occidental (c'est-à-dire de la sphère dominante du monde capitaliste). Une telle politique supposait une discipline très sérieuse de la part des afférents pays qui composent ce bloc. Cette discipline était obtenue principalement grâce à l'autorité qu'exerçaient les Etats-Unis sur leurs alliés du fait de leur puissance économique mais aussi militaire. Le "parapluie militaire" des Etats-Unis face à la "menace soviétique" (de même, évidemment, que la place prépondérante de ce pays, et de sa monnaie, dans le système financier international) appelait, en contrepartie, une soumission aux volontés américaines dans le domaine économique. Aujourd'hui, avec la disparition de toute menace militaire de l'URSS sur les Etats du bloc occidental (notamment ceux d'Europe occidentale et le Japon), les moyens de pression des Etats-Unis sur leurs "alliés" se sont sensiblement réduits, et cela d'autant plus que l'économie américaine, avec ses énormes déficits et le recul continu de sa compétitivité sur le marché mondial, est en très nette perte de vitesse vis-à-vis de ses principaux concurrents. La tendance qui va donc s'affirmer de plus en plus est celle d'une tentative des économies les plus performantes, en premier lieu celles du Japon et de la RFA, de se dégager de la tutelle américaine pour jouer leur propre carte sur l'arène économique internationale, ce qui conduira à une accentuation de la guerre commerciale et à une aggravation de l'instabilité générale de l'économie capitaliste.
En fin de compte, il faut affirmer clairement que l'effondrement du bloc de l'Est et les convulsions économiques et politiques des pays qui le constituaient, n'augurent nullement une quelconque amélioration de la situation économique de la société capitaliste. La faillite économique des régimes staliniens, conséquence de la crise générale de l'économie mondiale, ne fait qu'annoncer et précéder l'effondrement des secteurs les plus développés de cette économie.
Les antagonismes impérialistes
La configuration géopolitique sur laquelle a vécu le monde depuis la seconde guerre mondiale est désormais complètement remise en cause par les événements qui se sont déroulés au cours de la seconde moitié de l’année 1989. Il n'existe plus aujourd'hui deux blocs impérialistes se partageant la mainmise sur la planète.
Le bloc de l'Est, c'est devenu une évidence (y compris pour les secteurs de la bourgeoisie qui, pendant des années avaient jeté des cris d'alarme contre le danger présenté par "l'Empire du Mal" et sa "formidable puissance militaire"), a cessé d'exister. Cette réalité a été confirmée par toute une série d'événements récents tels que :
- le soutien que les principaux dirigeants occidentaux (Bush, Thatcher, Mitterrand, notamment) apportent à Gorbatchev (soutien qui s'accompagne même d'éloges dithyrambiques à son égard) ;
- les résultats des différentes rencontres au sommet récentes (Bush-Gorbatchev, Mitterrand-Gorbatchev, Kohl-Gorbatchev, etc.) qui tous font apparaître la réelle disparition des antagonismes qui ont opposé pendant quatre décennies l'Est et l'Ouest ;
- l'annonce par l'URSS du retrait de l'ensemble de ses troupes basées à l'étranger ;
- la réduction des dépenses militaires des Etats-Unis qui est planifiée dès à présent ;
- la décision conjointe de réduire rapidement à 195 000 les effectifs des armées soviétique et américaine basées en Europe centrale (essentiellement dans les deux Allemagnes), et qui correspond en fait à un retrait de 405 000 hommes pour l'URSS contre 90 000 pour les Etats-Unis ;
{C}- {C}l'attitude des principaux dirigeants occidentaux, lors des événements de Roumanie, demandant à l'URSS d'intervenir militairement pour apporter un soutien aux forces "démocratique" face aux résistances qu'elles rencontraient de la part des derniers "fidèles" de Ceaucescu ;
{C}- {C}le soutien apporté par les mêmes à l'intervention des chars russes à Bakou, en janvier.
Dix ans après le tollé général provoqué dans les rangs des pays occidentaux par l'arrivée des mêmes chars à Kaboul, cette différence d'attitude est on ne peut plus significative du bouleversement complet de la géographie impérialiste de la planète. Ce bouleversement est d'ailleurs confirmé par la tenue, à Ottawa, début février, d'une conférence (co-présidée par le Canada et la Tchécoslovaquie) entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie et au cours de laquelle l'URSS a accepté pratiquement toutes les exigences des occidentaux.
Cette disparition du bloc de l'Est signifie-t-elle que, désormais, le monde sera dominé par un seul bloc impérialiste ou que le capitalisme ne connaîtra plus d'affrontements impérialistes ? De telles hypothèses seraient tout à fait étrangères au marxisme.
Ainsi, la thèse du "super-impérialisme", développée par Kautsky avant la première guerre mondiale a été combattue autant par les révolutionnaires (notamment Lénine) que par les faits eux-mêmes. Elle est restée tout autant mensongère lorsqu'elle a été reprise et adaptée par les staliniens et les trotskystes pour affirmer que le bloc dominé par l'URSS n'était pas impérialiste. Aujourd'hui, l'effondrement de ce bloc ne saurait remettre en selle ce genre d'analyses : cet effondrement porte avec lui, à terme, celui du bloc occidental. De plus, ce ne sont pas seulement les grandes puissances à la tête des blocs qui sont impérialistes, contrairement à la thèse défendue par le CWO. Dans la période de décadence du capitalisme, TOUS les Etats sont impérialistes et prennent les dispositions pour assumer cette réalité : économie de guerre, armements, etc. C'est pour cela que l'aggravation des convulsions de l'économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre ces différents Etats, y compris, et de plus en plus, sur le plan militaire. La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux "partenaires" d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s'y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible.
Jusqu'à présent, dans la période de décadence, une telle situation d'éparpillement des antagonismes impérialistes, d'absence d'un partage du monde (ou de ses zones décisives) entre deux blocs, ne s'est jamais prolongée. La disparition des deux constellations impérialistes qui étaient sorties de la seconde guerre mondiale porte, avec elle, la tendance à la recomposition de deux nouveaux blocs. Cependant, une telle situation n'est pas encore à l'ordre du jour du fait :
- de la permanence d'un certain nombre de structures issues de la configuration passée (par exemple, l'existence formelle des deux grandes alliances militaires, l'OTAN et le Pacte de Varsovie, avec le déploiement des dispositifs militaires qui y correspondent) ;
{C}- {C}de l'absence d'une grande puissance capable de prendre, dans l'immédiat, le rôle - perdu définitivement par l'URSS - de chef de file du bloc qui devrait faire face à celui qui serait dominé par les Etats-Unis.
Pour tenir ce rôle, un pays comme l'Allemagne, notamment après sa réunification, serait évidemment le mieux placé, du fait de sa puissance économique et de sa situation géographique. C'est pour cette raison que, dès à présent, il existe une unité d'intérêts entre les pays occidentaux et l'URSS pour ralentir (ou tout au moins tenter de contrôler) le processus de cette réunification. Cependant, si, d'un côté, il faut constater l'affaiblissement considérable de la cohésion du bloc américain, affaiblissement qui ne fera que s'accentuer, il faut prendre garde également, comme on vient de le faire ressortir, de ne pas annoncer de façon prématurée la reconstitution d'un nouveau bloc dirigé par l'Allemagne. Sur le plan militaire, ce pays est loin d'être prêt à assumer un tel rôle. Du fait de sa situation de "vaincu" de la seconde guerre mondiale, la puissance de son armée est loin d'être à la hauteur de sa puissance économique. En particulier, la RFA n'a pas été autorisée, jusqu'à présent, à se doter de l'arme atomique, l'énorme quantité d'engins nucléaires qui se trouvent sur son sol étant entièrement contrôlée par l’Otan. En outre, et plus important encore à long terme, la tendance à un nouveau partage du monde entre deux blocs militaires est contrecarrée, et pourra peut-être même être définitivement compromise, par le phénomène de plus en plus profond et généralisé de décomposition de la société capitaliste tel que nous l'avons déjà mis en évidence (voir Revue Internationale n° 57).
Ce phénomène, qui s'est développé tout au long des années 1980, résulte de l'incapacité pour les deux classes fondamentales de la société à apporter leur propre réponse historique à la crise sans issue dans laquelle s'enfonce le mode de production capitaliste. Si la classe ouvrière, en refusant de se laisser embrigader derrière les drapeaux bourgeois, contrairement à ce qu'elle fit dans les années 30, a pu jusqu'à présent empêcher le capitalisme de déchaîner une troisième guerre mondiale, elle n'a pas, en revanche, trouvé la force d'affirmer clairement sa propre perspective : la révolution communiste. Dans une telle situation où la société se trouve momentanément "bloquée", privée de toute perspective, alors que la crise capitaliste ne cesse de s'aggraver, l'histoire ne s'arrête pas. Son "cours" se traduit par une putréfaction croissante de toute la vie sociale dont nous avons déjà analysé dans cette Revue les manifestations multiples : depuis le fléau de la drogue jusqu'à la corruption généralisée des hommes politiques, en passant par les menaces sur l'environnement, la multiplication de catastrophes dites "naturelles" ou "accidentelles", le développement de la criminalité, du nihilisme et du désespoir des jeunes (le "no future"). Une des expressions de cette décomposition réside dans l'incapacité croissante de la classe bourgeoise à contrôler, non seulement la situation économique, mais aussi la situation politique. Un tel phénomène est évidemment particulièrement avancé dans les pays de la périphérie du capitalisme, ceux qui, pour être arrivés trop tard dans le développement industriel, ont été les premiers et les plus gravement frappés par la crise de ce système. Aujourd'hui, le chaos économique et politique qui se développe dans les pays de l'Est, la perte complète de contrôle de la situation par les bourgeoisies locales, constitue une nouvelle manifestation de ce phénomène général. Et la bourgeoisie la plus forte, c'est-à-dire celle des pays avancés d'Europe et d'Amérique du Nord, est elle-même consciente de ne pas être à l'abri de ce type de convulsions. C'est pour cela qu'elle apporte tout son soutien à Gorbatchev dans sa tentative de "remettre de l'ordre" dans son empire, même quand c'est fait de façon sanglante comme à Bakou. Elle a trop peur que le chaos qui est en train de se développer à l'Est ne franchisse, tel le nuage radioactif de Tchernobyl, les frontières et ne vienne se répercuter à l'Ouest.
A cet égard, l'évolution de la situation en Allemagne est significative. La rapidité incroyable avec laquelle se sont enchaînés les événements depuis l'automne dernier ne signifie nullement que la bourgeoisie soit saisie d'une frénésie de "démocratisation". En réalité, si la situation en RDA a cessé depuis longtemps de répondre à une quelconque politique délibérée de la bourgeoisie locale, il en est de même, de plus en plus, pour la bourgeoisie de RFA, et aussi pour î'ensemble de la bourgeoisie mondiale. La réunification des deux Allemagnes, dont aucun des "vainqueurs" de 1945 ne voulait il y a quelques semaines (il y a 3 mois, Gorbatchev l'envisageait pour "dans un siècle") de peur que la reconstitution d'une "Grande Allemagne" hégémonique en Europe n'aiguise ses appétits impérialistes, s'impose de plus en plus à tous comme le seul moyen de combattre le chaos en RDA, et par contagion, dans tous les pays voisins. Même la bourgeoisie d'Allemagne de l'Ouest trouve que les choses vont "trop vite". Dans les conditions où elle se présente, cette réunification, qui était pourtant appelée de ses voeux depuis des décennies, ne pourra lui apporter que des difficultés. Mais plus elle retarde son moment, et plus ces difficultés seront considérables. Que la bourgeoisie de RFA, une des plus solides du monde, en soit aujourd'hui réduite à courir après les événements en dit long sur ce qui attend l'ensemble de la classe bourgeoise.
Dans un tel contexte de perte de contrôle de la situation par la bourgeoisie mondiale, il n'est pas dit que les secteurs dominants de celle-ci soient aujourd'hui en mesure de mettre en oeuvre l'organisation et la discipline nécessaires à la reconstitution de blocs militaires. Une bourgeoisie qui ne maîtrise plus la politique de son propre pays est bien mal armée pour s'imposer à d'autres bourgeoisies (comme on vient de le voir avec l'effondrement du bloc de l'Est dont la cause première réside dans l'implosion économique et politique de sa puissance dominante).
C'est pour cela qu'il est fondamental de mettre en évidence que, si la solution du prolétariat -la révolution communiste - est la seule qui puisse s'opposer à la destruction de l'humanité (qui constitue la seule "réponse" que la bourgeoisie puisse apporter à sa crise), cette destruction ne résulterait pas nécessairement d'une troisième guerre mondiale. Elle pourrait également résulter de la poursuite, jusqu'à ses conséquences extrêmes (catastrophes écologiques, épidémies, famines, guerres locales déchaînées, etc.) de cette décomposition.
L'alternative historique "Socialisme où Barbarie", telle qu'elle a été mise en évidence par le marxisme, après s'être concrétisée sous la forme de "Socialisme ou Guerre impérialiste mondiale" au cours de la plus grande partie du 20e siècle, s'était précisée sous la forme terrifiante de "Socialisme ou Destruction de l'humanité" au cours des dernières décennies du fait du développement des armements atomiques. Aujourd'hui, après l'effondrement du bloc de l'Est, cette perspective reste tout à fait valable. Mais il convient de mettre en avant qu'une telle destruction peut provenir de la guerre impérialiste généralisée OU de la décomposition de la société.
Le recul de la conscience dans la classe ouvrière
Les "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est" (Revue Internationale 60) mettent en évidence que l'effondrement du bloc de l'Est et l'agonie du stalinisme vont se répercuter sur la conscience du prolétariat par un recul de celle-ci. Les causes d'un tel recul sont analysées dans l'article "Des difficultés accrues pour le prolétariat" (Ibid). On peut les résumer ainsi :
{C}-{C}au même titre que le surgissement, en 1980, d'un syndicat "indépendant" en Pologne, mais à une échelle beaucoup plus vaste, compte tenu de l'ampleur considérable des événements actuels, l'effondrement du bloc de l'Est et l'agonie du stalinisme vont permettre une poussée très importante des illusions démocratiques, non seulement au sein du prolétariat des pays de l'Est, mais également dans celui des pays occidentaux ;
{C}-{C}"le fait que cet événement historique considérable se soit produit indépendamment de la présence du prolétariat ne peut engendrer au sein de celui-ci qu'un sentiment d'impuissance" (Ibid) ;
{C}-{C}"dans la mesure ou l'effondrement du bloc de l'Est fait suite à une période de 'guerre froide’ avec le bloc de l'Ouest, où ce dernier apparaît comme le 'vainqueur', sans coup férir, d'une telle 'guerre', cela va engendrer dans les populations d'Occident, et aussi parmi les ouvriers, un sentiment d'euphorie et de confiance envers leurs gouvernements similaire (toutes proportions gardées) à celui qui avait pesé sur le prolétariat des pays 'vainqueurs' lors des deux guerres mondiales";
{C}-{C}la dislocation du bloc de l'Est ne peut qu'exacerber le poids du nationalisme, dans les républiques périphériques de l'URSS et dans les anciennes "Démocraties populaires", mais également dans un certain nombre de pays d'Occident et, en particulier, dans un pays aussi important que l'Allemagne du fait de la réunification des deux parties de ce pays ;
-"ces mystifications nationalistes vont peser également sur les ouvriers d'Occident... par le discrédit et l'altération que va subir dans leur conscience l'idée même d'internationalisme prolétarien..., notion dénaturée complètement par le stalinisme, et dans sa foulée par l'ensemble des forces bourgeoises, qui l'ont identifié avec la domination impérialiste de l'URSS sur son bloc" ;
-"en fait,... c'est la perspective-même de la révolution communiste mondiale qui est affectée par l'effondrement du stalinisme (...) ; l'identification entre le communisme et le stalinisme avait permis, dans les années 1930, à la bourgeoisie d'embrigader la classe ouvrière derrière ce dernier afin de parachever sa défaite (...) ; au moment où le stalinisme est complètement déconsidéré aux yeux de tous les ouvriers, ce même mensonge lui sert pour les détourner de la perspective du communisme."
On peut compléter ces éléments en considérant l'évolution de ce qui reste des partis staliniens des pays occidentaux.
L'effondrement du bloc de l'Est implique, à terme, la disparition des partis staliniens, non seulement dans les pays où ils dirigeaient l'Etat, mais aussi dans ceux où ils avaient pour fonction d'encadrer la classe ouvrière. Soit ces partis se transformeront radicalement - comme est en train de le faire le PC d'Italie - en abandonnant complètement ce qui faisait leur spécificité (y compris leur nom), soit ils seront réduits à l'état de petites sectes (comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis et dans la plupart des pays d'Europe du Nord). Ils pourront encore intéresser les ethnologues, ou les archéologues, mais ne joueront plus aucun rôle sérieux comme organes d'encadrement et de sabotage des luttes ouvrières. La place qu'ils tenaient dans ce domaine, jusqu'à présent, dans un certain nombre de pays, sera prise par la social-démocratie ou par des secteurs de gauche de celle-ci. De ce fait, le prolétariat aura de moins en moins l'occasion, dans le développement de sa lutte, de s'affronter au stalinisme, ce qui ne pourra que favoriser encore l'impact du mensonge qui identifie celui-ci au communisme.
Les perspectives pour la lutte de classe
Ainsi, l'effondrement du bloc de l'Est et la mort du stalinisme créent de nouvelles difficultés pour la prise de conscience dans le prolétariat. Est-ce à dire que ces événements vont également déterminer un ralentissement sensible des combats de classe ? Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que les "Thèses" parlent d'un "recul de la conscience" et non d'un recul de la combativité du prolétariat. Elles précisent même que "les attaques incessantes et de plus en plus brutales que le capitalisme ne manquera pas d'asséner contre les ouvriers vont les contraindre à mener le combat", car il serait faux de considérer que le recul de la conscience s'accompagnera d'un recul de la combativité. En de nombreuses reprises, déjà, nous avons mis en évidence la non-identité entre conscience et combativité. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir ici en tant que question générale. Dans le cas précis de la situation actuelle, il faut souligner que le présent recul de la conscience ne découle pas d'une défaite directe de la classe ouvrière suite à un combat qu'elle aurait engagé. C'est complètement en dehors d'elle et de ses luttes que se sont produits les événements qui, aujourd'hui, sèment le désarroi dans ses rangs. De ce fait, ce n'est pas la démoralisation qui pèse sur elle à l'heure actuelle. Si sa conscience est affectée, son potentiel de combativité, en revanche, n'est pas fondamentalement atteint. Et ce potentiel, avec les attaques de plus en plus brutales qui vont se déchaîner, peut se révéler à tout moment. Il importe donc de ne pas être surpris face aux explosions prévisibles de cette combativité. Elles ne pourraient pas être interprétées comme une remise en cause de notre analyse sur le recul de la conscience ni "oublier" que la responsabilité des révolutionnaires est d'intervenir en leur sein. .
En deuxième lieu, il serait faux d'établir une continuité dans l'évolution des luttes et de la conscience du prolétariat entre la période qui précède l'effondrement du bloc de l'Est et la période présente. Dans la période passée, le CCI a critiqué la tendance dominante, au sein du milieu politique prolétarien, à sous-estimer l'importance des luttes de la classe et des pas accomplis par celle-ci dans sa prise de conscience. La mise en évidence du recul actuel de cette prise de conscience ne signifie nullement une remise en cause de nos analyses pour la période passée, et notamment celles qui avaient été dégagées par le 8e Congrès du CCI (Revue Internationale n°59).
C'est vrai que l'année 1988 et la première moitié de 1989 ont été marquées par un certain nombre de difficultés dans le développement de la lutte et de la conscience de la classe, et notamment par un certain retour au premier plan des syndicats. Ce fait avait d'ailleurs été relevé dès avant le 8e congrès, notamment dans l’éditorial de la Revue Internationale n°58 qui notait que "cette stratégie (de la bourgeoisie) a réussi pour le moment à désorienter la classe ouvrière et à entraver sa marche vers l'unification de ses combats". Cependant, en s'appuyant sur les données de la situation internationale qui étaient celles de l'époque, notre analyse relevait les limites d'un tel moment de difficultés. En fait, les difficultés que rencontrait la classe ouvrière en 1988 et début 1989 se situaient sur un même plan (même si elles étaient plus sérieuses) que celles qu'elle avait pu rencontrer au cours de l'année 1985 (et relevées lors du 6e congrès du CCI : voir dans la Revue Internationale n° 44 la "Résolution sur la situation internationale" adoptée par ce congrès). Elles n'excluaient nullement la possibilité "de nouveaux surgissements massifs, de plus en plus déterminés et conscients de la lutte prolétarienne" (Revue Internationale n°58), de la même façon que le ralentissement de 1985 avait débouché en 1986 sur des mouvements aussi importants et significatifs que les grèves massives du printemps en Belgique et la grève des chemins de fer en France. En revanche, les difficultés que rencontre le prolétariat aujourd'hui se situent à un tout autre niveau. L'effondrement du bloc de l'Est et du stalinisme est un événement historique considérable dont les répercutions sur tous les aspects de la situation mondiale sont-elles mêmes extrêmement importantes. Ainsi, cet événement ne saurait être placé, du point de vue de son impact sur la classe, sur le même plan que telle ou telle série de manoeuvres de la bourgeoisie comme on les a connues depuis 20 ans, y compris la mise en avant de la carte de la gauche dans l'opposition, à la fin des années 1970.
En fait, c'est une autre période qui s'est ouverte aujourd'hui, distincte de celle que nous avons vécue pendant 20 ans. Depuis 1968, en effet, le mouvement général de la classe, malgré certains moments de ralentissement ou de courts reculs, s'est développé dans le sens de luttes de plus en plus conscientes, se libérant notamment de façon croissante de l'emprise des syndicats. En revanche, les conditions mêmes dans lesquelles s'est effondré le bloc de l'Est, le fait que le stalinisme n'ait pas été abattu par la lutte de classe mais par une implosion interne, économique et politique, déterminent le développement d'un voile idéologique (indépendamment même des campagnes médiatiques qui se déchaînent aujourd'hui), d'un désarroi pour la classe sans commune mesure avec tout ce qu'elle avait dû affronter jusqu'à présent, y compris la défaite de 1981 en Pologne. En fait, il nous faut considérer que, même si l'effondrement du bloc de l'Est s'était produit au moment où les luttes du prolétariat étaient en plein essor (par exemple fin 1983-début 1984, ou en 1986), cela n'aurait changé strictement rien à la profondeur du recul que cet événement aurait provoqué dans la classe (même si ce recul aurait pu éventuellement tarder un peu plus à faire sentir ses effets).
C'est pour cette raison, en particulier, qu'il convient aujourd'hui de mettre à jour l'analyse développée par le CCI sur la "gauche dans l'opposition". Cette carte était nécessaire à la bourgeoisie depuis la fin des années 1970 et tout au long des années 1980 du fait de la dynamique générale de la classe vers des combats de plus en plus déterminés et conscients, de son rejet croissant des mystifications démocratiques, électorales et syndicales. Les difficultés rencontrées dans certain pays (par exemple la France) pour la mettre en place dans les meilleures conditions, ne retirait rien au fait qu'elle constituait l'axe central de la stratégie de la bourgeoisie contre la classe ouvrière, ce qui était illustré par la permanence de gouvernements de droite dans des pays aussi importants que les Etats-Unis, la RFA et la Grande-Bretagne. En revanche, le recul actuel de la classe n'impose plus à la bourgeoisie, pour un certain temps, l'utilisation prioritaire de cette stratégie. Cela ne veut pas dire que dans ces derniers pays on verra nécessairement la gauche retourner au gouvernement : nous avons, à plusieurs reprises (voir, en particulier, la Revue Internationale n° 18), mis en évidence qu'une telle formule n'est indispensable que dans les périodes révolutionnaires ou de guerre impérialiste. Par contre, il ne faudra pas être surpris s'il advient un tel événement, ou bien considérer qu'il s'agit d'un "accident" ou l'expression d'une "faiblesse particulière" de la bourgeoisie de ces pays. La décomposition générale de la société se traduit pour la classe dominante par des difficultés accrues à maîtriser son jeu politique, mais nous n'en sommes pas au point où les bourgeoisies les plus fortes du monde pourraient laisser se dégarnir le terrain social face à une menace du prolétariat.
Ainsi, la situation mondiale, sur le plan de la lutte de classe, se présente avec des caractéristiques très sensiblement différentes de celles qui prévalaient avant l'effondrement du bloc de l'Est. Cependant, la mise en évidence de l'importance du recul présent de la conscience dans la classe ne saurait conduire à une remise en cause du cours historique tel qu'il a été analysé par le CCI depuis plus de 20 ans (même s'il convient de préciser cette notion comme on l'a vu plus haut).
En premier lieu, à l'heure actuelle, un cours vers la guerre mondiale est exclu du fait de l'inexistence de deux blocs impérialistes.
En second lieu, il importe de souligner les limites du recul actuel de la classe. En particulier, même si on peut comparer la nature des mystifications démocratiques qui aujourd'hui se renforcent dans le prolétariat avec celles qui se sont déchaînées au moment de la "Libération", il convient aussi de marquer les différences entre les deux situations. D'une part, ce sont les principaux pays industrialisés, et donc le coeur du prolétariat mondial, qui ont été directement impliqués dans la seconde guerre mondiale. De ce fait, c'est également de façon directe que l'euphorie démocratique a pu peser sur ce prolétariat. En revanche, les secteurs de la classe qui se trouvent aujourd'hui en première ligne de ces mystifications, ceux des pays de l'Est, sont relativement périphériques. C'est principalement à cause du "vent d'Est" qui souffle aujourd'hui, et non parce qu'il serait dans "l'oeil du cyclone", que le prolétariat de l'Ouest doit affronter ces difficultés. D'autre part, les mystifications démocratiques du lendemain de la guerre ont trouvé un relais puissant dans la "prospérité" qui a accompagné la reconstruction. La croyance en la "Démocratie" comme le "meilleur des mondes" a pu s'appuyer pendant deux décennies sur une amélioration réelle des conditions de vie de la classe dans les pays avancés et sur le sentiment que donnait le capitalisme d'avoir réussi à surmonter ses contradictions (sentiment qui a même pénétré certains groupes révolutionnaires). La situation est toute autre à l'heure actuelle où les bavardages bourgeois sur la "supériorité" du capitalisme "démocratique" vont se heurter aux faits têtus d'une crise économique insurmontable et de plus en plus profonde.
Ceci dit, il importe aussi de ne pas se laisser bercer et endormir par des illusions. Même si la guerre mondiale ne saurait, à l'heure actuelle, et peut-être de façon définitive, constituer une menace pour la vie de l'humanité, cette menace peut très bien provenir, comme on l'a vu, de la décomposition de la société. Et cela d'autant plus que si le déchaînement de la guerre mondiale requiert l'adhésion du prolétariat aux idéaux de la bourgeoisie, phénomène qui n'est nullement à l'ordre du jour à l'heure actuelle pour ses bataillons décisifs, la décomposition n'a nul besoin d'une telle adhésion pour détruire l'humanité. En effet, la décomposition de la société ne constitue pas, à proprement parler, une "réponse" de la bourgeoisie à la crise ouverte de l'économie mondiale. En réalité, ce phénomène peut se développer justement parce que la classe dominante n'est pas en mesure, du fait du non embrigadement du prolétariat, d'apporter SA réponse spécifique à cette crise, la guerre mondiale et la mobilisation en vue de celle-ci. La classe ouvrière, en développant ses luttes (comme elle l'a fait depuis la fin des années 1960), en ne se laissant pas embrigader derrière les drapeaux bourgeois, peut empêcher la bourgeoisie de déchaîner la guerre mondiale. En revanche, seul le renversement du capitalisme est en mesure de mettre fin à la décomposition de la société. De même qu'elles ne peuvent en aucune façon s'opposer à l'effondrement économique du capitalisme, les luttes du prolétariat dans ce système ne peuvent constituer un frein à sa décomposition.
En ce sens, si jusqu'à présent nous avions pu considérer que "le temps travaillait pour le prolétariat", que la lenteur du développement des combats de la classe permettait à celle-ci, de même qu'aux organisations révolutionnaires, de se reconstituer une expérience que la contre-révolution avait engloutie, cette analyse est devenue désormais caduque. Il ne "s'agit pas pour les révolutionnaires de s'impatienter et de 1 vouloir "forcer la main de l'histoire", mais ils doivent être conscients de la gravité croissante de la situation s'ils veuillent être à la hauteur de leurs responsabilités.
C'est pour cela que, dans leur intervention, s'ils doivent mettre en évidence que la situation historique reste encore entre les mains du prolétariat, qu'il est tout à fait capable, /par et dans ses combats, de surmonter les obstacles que la bourgeoisie a semés sur son chemin, ils doivent également insister sur l'importance des enjeux de la situation présente, et donc de sa propre responsabilité.
Pour la classe ouvrière, la perspective actuelle est donc celle de la poursuite de ses combats en réponse aux attaques économiques croissantes. Ces luttes vont se dérouler, durant toute une période, dans un contexte politique et idéologique difficile. C'est particulièrement vrai, évidemment, pour le prolétariat des pays où s'instaure aujourd'hui la "Démocratie". Dans ces pays, la classe ouvrière se retrouve dans une situation d'extrême faiblesse, comme le confirment, jour après jour, les événements qui s'y déroulent (incapacité d'exprimer la moindre revendication indépendante de classe dans les différents "mouvements populaires", enrôlement dans des conflits nationalistes - notamment en URSS -, participation même à des grèves typiquement xénophobes contre telle ou telle minorité ethnique, comme récemment en Bulgarie). Ces événements nous donnent un exemple de comment se présente une classe ouvrière prête à se laisser enrôler dans la guerre impérialiste.
Pour le prolétariat des pays occidentaux, la situation est, évidemment, très différente. Ce prolétariat est très loin de subir les mêmes difficultés que celui de l'Est. Le recul de sa conscience se traduira notamment par un retour en force des syndicats dont le travail sera facilité par l'accroissement des mystifications démocratiques et des illusions réformistes : "le patronat peut payer", "partage des bénéfices", "intéressement à la croissance", mystifications facilitant l'identification par les ouvriers de leurs intérêts avec ceux du capital national.
En outre, la poursuite et l'aggravation du phénomène de pourrissement de la société capitaliste exerceront, encore plus qu'au cours des années 1980, ses effets nocifs sur la conscience de la classe. Par l'ambiance générale de désespoir qui pèse sur toute la société, par la décomposition même de l'idéologie bourgeoise dont les émanations putrides viennent empoisonner l'atmosphère que respire le prolétariat, ce phénomène va constituer pour lui, jusqu'à la période prérévolutionnaire, une difficulté supplémentaire sur le chemin de sa prise de conscience.
Pour le prolétariat, il n'y a pas d'autre chemin que de rejeter l'embrigadement interclassiste derrière la lutte contre certains aspects particuliers de la société capitaliste moribonde (l'écologie, par exemple). Le seul terrain sur lequel il peut à l'heure actuelle se mobiliser comme classe indépendante (et c'est une question encore plus cruciale au moment du déferlement de la mystification démocratique qui ne connaît que des "citoyens", ou le "peuple") est celui où ses intérêts spécifiques ne peuvent être confondus avec les autres couches de la société et qui, plus globalement, détermine l'ensemble des autres aspects de la société : le terrain économique. Et c'est justement en ce sens que, comme nous l'avons affirmé depuis longtemps, la crise constitue "le meilleur allié du prolétariat". C'est l'aggravation de la crise qui va obliger celui-ci à se rassembler sur son terrain, à développer ses luttes qui constituent la condition du dépassement des entraves actuelles à sa prise de conscience, qui va lui ouvrir les yeux sur les mensonges à propos de la "supériorité" du capitalisme, qui va le contraindre à perdre ses illusions sur la possibilité pour le capitalisme de se sortir de sa crise et donc sur ceux, les syndicats et les partis de gauche, qui veulent l'attacher à ï'"intérêt national" en lui parlant de "partage des profits" et autres foutaises.
Aujourd'hui, alors que la classe ouvrière se débat contre tous les rideaux de fumée que la bourgeoisie a réussi momentanément à jeter devant ses yeux, restent toujours valables les mots de Marx :
"Il ne s'agit pas de ce que tel ou tel prolétaire ou même le prolétariat entier se représente à un moment comme le but. Il s'agit de ce qu'est le prolétariat et de ce que, conformément à son être, il sera historiquement contraint défaire."
Il appartient aux révolutionnaires de contribuer pleinement à la prise de conscience dans la classe de ce but que lui assigne l'histoire afin qu'elle puisse enfin transformer en réalité la nécessité historique de la révolution qui n'a jamais été aussi pressante.
CCI, 10 février 1990.
{C}
{C}[1]{C} [36] Ce texte est basé sur un rapport adopté par le CCI lors d'une réunion internationale tenue à la fin janvier 1990.
{C}[2]{C} [37] La très faible résistance opposée par la presque totalité des anciens dirigeants des "Démocraties populaires", et qui a permis des "transitions en douceur" dans ces pays, n'exprime nullement le fait que ces dirigeants, de même que l'appareil des partis staliniens, auraient volontairement sacrifié leur pouvoir et leurs privilèges. En fait, ce phénomène illustre, outre la faillite économique totale de ces régimes, leur extrême fragilité politique, fragilité que nous avions signalée depuis longtemps mais qui s'est révélée bien plus considérable encore que tout ce qui avait pu être imaginé.
{C}[3]{C} [38] Parmi ces pays, la Pologne et la Hongrie font figure de "champions" avec respectivement 40,6 et 20,1 milliards de dollars de dettes, soit 63,4 et 64,6% de leur PNB annuel. A côte d'eux, le Brésil, avec un endettement équivalent à "seulement" 39,2% de son PNB, apparaît comme un "bon élève".
Géographique:
Questions théoriques:
- Décadence [31]
- Décomposition [2]
La crise du capitalisme d'Etat : l'économie mondiale s'enfonce dans le chaos
- 4312 reads
"Victoire ! Victoire ! Le capitalisme a vaincu le communisme ! Regardez à l'Est, c'est la ruine, la pauvreté, plus rien ne fonctionne, la population ne veut plus du socialisme ! Regardez à l'Ouest, c'est l'opulence, l'inflation a été terrassée, la croissance économique dure depuis 7 ans, la démocratie libérale et pluraliste est le meilleur des systèmes ! Le marché a gagné ! Les capitales du monde occidental résonnent des cris euphoriques des chantres de l'économie capitaliste. L'effondrement économique du bloc de l'Est est le prétexte au déchaînement d'une campagne idéologique intense à la gloire du capitalisme libéral. Dans tout cela, deux vérités - l'économie du bloc de l'Est est en ruine et la loi du marché s'est imposée. Pour le reste ce ne sont que mensonges que la classe dominante entretien pour mener sa guerre idéologique contre le prolétariat et parce qu'elle-même s'illusionne sur son propre système.
Le plus grand des mensonges réside dans l'affirmation selon laquelle dans les pays du bloc de l'Est, et notamment en URSS, se serait incarné le communisme. De ce fait, le soi-disant "socialisme réel", selon le terme à la mode, serait l'enfer réel où mènerait la théorie marxiste. Ainsi, le prolétariat continue de payer les dividendes de l'échec tragique de la révolution prolétarienne qui avait commencé en Russie en 1917 : l'identification entre la contre-révolution stalinienne et la victoire du communisme est la pire mystification qu'il ait subie dans toute son histoire.
Une classe ouvrière affamée, exploitée de manière forcenée, massacrée au moindre signe de révolte. Une classe dominante arrogante - la nomenklatura -, cramponnée à ses privilèges. Un Etat tentaculaire, bureaucratique et militarisé. Une économie totalement orientée vers la production et l'entretien d'armements. Un impérialisme russe d'une brutalité extrême, imposant le pillage et le rationnement à son bloc. Tous ces traits caractéristiques des pays de l'Est n'ont pourtant rien à voir avec l'abolition des classes, le dépérissement et l'extinction de l'Etat, ni l'internationalisme prolétarien prônés par Marx.
Pourtant, même si la dictature stalinienne des pays de l'Est marque ces traits jusqu'à la caricature, ceux-ci ne sont certainement pas propres au stalinisme. Ils se retrouvent de manière de plus en plus accentuée dans le monde entier. Malgré ses spécificités - liées à son histoire - l'économie des pays de l'Est est capitaliste.
L'éclatement des blocs et la crise du capitalisme d'Etat
La Nomenklatura stalinienne parasitaire et représentant 15 % de la population se retrouve au lendemain de la deuxième guerre mondiale à la tête d'un bloc dont l'économie était soit détruite, soit sous-développée. Elle n'a pu affirmer sa puissance qu'en détournant la loi de la valeur, en trichant avec elle par l'imposition de mesures de capitalisme d'Etat extrêmes du fait de l'absence de l'ancienne bourgeoisie des propriétaires individuels des moyens de production qui a été expropriée par la révolution prolétarienne d'octobre 1917 : étatisation totale des moyens de productions, marché intérieur contrôlé et rationné, développement massif de l'économie de guerre et sacrifice de toute l'économie aux besoins de l'armée, seule garantie en dernière instance de la soumission de son bloc et de sa crédibilité impérialiste internationale. Incapable de recourir à la seule carte qui lui restait : la guerre, son armée entravée par le dysfonctionnement économique et devant faire face à une population dont la terreur policière ne parvenait plus à faire taire le mécontentement grandissant, la nouvelle bourgeoisie russe ne peut plus aujourd'hui que constater le délabrement de son économie et de son impuissance à faire face à la catastrophe.
L'effondrement économique du modèle stalinien ne signifie pas l'effondrement du socialisme mais un nouveau pas du capitalisme dans la crise mondiale qui dure depuis plus de 20 ans. Effectivement, la fameuse loi du marché, dont les vertus sont tant chantées, s'est imposée aujourd'hui, comme elle s'est imposée il y a 10 ans aux pays dits du "tiers-monde", les plongeant définitivement dans une misère et une barbarie - bien capitaliste celle-là, personne n'en doute - qui n'a rien à envier à celle qui règne dans les pays de l'Est.
On ne triche pas impunément avec la loi de la valeur, base du système économique capitaliste. Mais cette vérité, dont aujourd'hui les idéologues occidentaux se gargarisent, répétant à satiété : "Vive le marché ! Vive le marché !", s'impose aussi à l'ensemble de l'économie dite "libérale", en dehors du bloc de l'Est. Alors que la propagande occidentale, face à l'évidence de la faillite économique du bloc de l'Est, entonne le refrain connu : "A l'Ouest tout va bien !", la crise n'en continue pas moins son travail de sape, la fameuse loi du marché est toujours à l'oeuvre. Irrésistiblement, malgré toutes les manipulations dont ils sont l'objet, les taux de croissance continuent partout leur baisse, annonçant une plongée encore plus profonde de l'économie mondiale dans la récession.
Loin d'annoncer des lendemains qui chantent pour le capitalisme, la banqueroute du bloc de l'Est, après celle du "tiers-monde", annonce les banqueroutes futures du capitalisme dans ses pôles les plus développés. La première puissance mondiale : les USA, est en ligne de mire.
La première puissance mondiale, qui se pose comme le champion du libéralisme économique sur le plan idéologique, n'a pas sur le plan pratique concrétisé son discours. Bien au contraire, l'intervention de l'Etat dans l'économie n'a cessé de s'intensifier depuis des décennies.
La tendance au capitalisme d'Etat ne se résume pas à sa caricature stalinienne, aux nationalisations et à l'abolition de la concurrence sur le marché intérieur. Le capitalisme d'Etat à l'américaine, intégrant le capital privé dans une structure étatique et sous son contrôle, le fameux modèle bien improprement appelé "libéral", est bien plus efficace, plus souple, plus adapté, avec un sens plus développé de la responsabilité de la gestion de l'économie nationale, plus mystificateur parce que plus masqué. Surtout, il contrôle une économie et un marché autrement plus puissants : le PNB global des pays de l'OCDE, avec environ 12 000 milliards de dollars, représente six fois le revenu national des pays du COMECON en 1987.
Avocats farouches du libéralisme à tout crin, du moins d'Etat, devant les tribunes médiatiques, Reagan et son équipe, dans les antichambres obscures du pouvoir d'Etat, vont faire mener une politique économique à l'inverse de leurs professions de foi. Mais ces politiques étatiques sont autant de distorsions de la loi de la valeur, de tricheries par rapport à la sacro-sainte loi du marché.
Par la très étatique politique des taux de la très étatique Banque Fédérale, les Etats-Unis vont imposer la loi du dollar - dans lequel sont libellés les trois-quarts des échanges mondiaux - au marché mondial. Pour la défense du roi dollar, la discipline est imposée aux grands pays industrialisés - concurrents économiques mais aussi vassaux du bloc occidental - au sein du groupe G7 qui réuni les pays les plus industrialisés. Des parts de marché sont négociées, réparties, échangées dans les discussions du GATT au mépris de toutes les règles de la concurrence. La fameuse dérégulation des marchés n'a été que l'expression de la volonté très étatique des USA d'imposer les normes de leur marché intérieur au monde entier. Des subventions de plusieurs centaines de milliards de dollars sont directement versées par l'Etat fédéral pour protéger l'agriculture en déroute et renflouer les banques et les caisses d'épargne en faillite, tandis que les commandes d'armement du Pentagone sont une subvention déguisée à toute l'industrie américaine qui en est devenue de plus en plus dépendante.
La relance américaine, après la récession brutale du début de la décennie 1980 (qui a définitivement laissé les pays sous-développés sur le carreau), va se faire par un déficit budgétaire massif qui va servir à financer un effort de guerre sans précédent en période de paix et un déficit commercial record. Une telle politique n'a pu être permise que par un endettement pharamineux.
Ces politiques capitalistes d'Etat ont imposé des distorsions croissantes aux mécanismes du marché, le rendant de plus en plus artificiel, instable, volatil. L'économie américaine flotte sur une montagne de dettes que, pas plus que n'importe quel pays sous-développé, elle ne pourra rembourser. La dette américaine globale (interne et externe) correspond à environ deux années de PNB, la dette externe du Mexique et du Brésil, dont aujourd'hui les banquiers du monde entier font tant cas (la dette interne n'a pas grand sens alors que les monnaies nationales se sont effondrées), correspond à respectivement neuf et six mois d'activité. La super-puissance américaine a des pieds d'argile et sa dette pèse de plus en plus lourd sur ses épaules. Même avec des formes différentes, le soi-disant marché libre du monde occidental - en fait l'essentiel du marché mondial - est tout aussi artificiel que celui du monde de l'Est, car artificiellement maintenu à flot par un recours aux planches à billets et à un endettement croissant, qui ne pourra jamais être remboursé.
Si elles ont permis de renforcer la suprématie impérialiste des USA, les commandes d'armement n'ont pas dopé l'industrie américaine. Bien au contraire. De 1980 à 1987, les parts du marché mondial dans trois secteurs clés de l'industrie : machines-outils, automobiles, informatique-bureautique ont régressé respectivement de : 12,7 à 9 %, 11,5 à 9,4%, 31 à 22%.
La production d'armements ne sert à reproduire ni la force de travail ni de nouvelles machines. C'est de la richesse, du capital détruit, c'est une ponction improductive qui pèse sur la compétitivité de l'économie nationale. Les deux têtes de bloc surgies du partage de Yalta ont toutes deux vu leur économie s'affaiblir, perdre de sa compétitivité par rapport à leurs propres alliés. C'est là le résultat des dépenses consenties au renforcement de leur puissance militaire, garante de leur position de leader impérialiste, condition ultime de leur puissance économique.
Avec l'effondrement économique des pays du COMECON, l’épouvantail de l'impérialisme russe perd sa crédibilité et, du même coup, le bloc de l'Ouest perd son ciment essentiel.
Après des décennies de politique de capitalisme d'Etat menée sous la houlette des blocs impérialistes, le processus actuel de dissolution des alliances, qui avaient partagé la planète, constitue effectivement, d'un certain point de vue, une victoire du marché, une ré adéquation brutale des rivalités impérialistes aux réalités économiques. Et, symboliquement, s'affirme l'impuissance des mesures de capitalisme d'Etat à court-circuiter ad eternam les lois incontournable du marché capitaliste. Cet échec, au-delà même des limites étroites de l’ex-bloc russe, marque l'impuissance de la bourgeoisie mondiale à faire face à la crise de surproduction chronique, à la crise catastrophique du capital. Il montre l'inefficacité grandissante des mesures étatiques employées de manière de plus en plus massives, à l'échelle des blocs, depuis des décennies, et présentées depuis les années 1930 comme la panacée aux contradictions insurmontables du capitalisme, telles qu'elles s'expriment dans son marché.
La plongée des États-Unis dans la récession...
Alors que les idéologues rémunérés du capital s'extasient encore sur la victoire du "capitalisme de marché", et croient voir, à l'Est, le signe d'une nouvelle aurore pour un capitalisme revigoré et triomphant, l'ouragan qui s'approche des rives de l'économie américaine va leur faire rentrer dans la gorge leurs phrases creuses sur le marché.
Le symbole du capitalisme triomphant, la terre sainte des croisés du libéralisme : l'économie américaine, bat de l'aile et entame les dernières manoeuvres improvisées d'un atterrissage qui ne se fera pas en douceur.
Les USA perdent de leur crédibilité sur le marché financier, les prêteurs se font de plus en plus réticents. Le simple paiement des intérêts de la dette fédérale prévu pour 1991, 180 milliards de dollars, équivaut à plus de six mois d'exportations. Les capitalistes européens et japonais, qui ont financé l'essentiel de la dette, commencent à bouder les émissions du Trésor américain dont les cours dégringolent. Ainsi, les emprunts à trente ans du Trésor américain se négocient-ils aujourd'hui 5 % au dessous de leur valeur nominale.
Privée de liquidités, l'économie américaine est en fait à court de carburant, et son industrie artificiellement protégée a perdu sa compétitivité sur le marché mondial. Le dernier trimestre 1989 est marqué par une plongée brutale dans la récession, la croissance officielle chute à 0,5 % en rythme annuel. Les fleurons de l'industrie américaine annoncent des bénéfices en chute libre et des pertes. Dans l'informatique, IBM annonce pour le 4e trimestre 1989 des bénéfices en baisse de 74 %, et pour toute l’année en baisse de 40 %, pour Digital Equipment c'est une baisse de 44 % pour l'année, Control Data annonce pour 1989 des pertes de 680 millions de dollars, 196 millions pour le dernier trimestre. Dans l'automobile il en va de même : Ford, Chrysler, General Motors annoncent des dizaines de milliers de licenciements. La production de pétrole est à son plus bas niveau depuis 26 ans. La sidérurgie est au plus mal. Les entreprises les plus faibles accumulent les pertes et font faillite.
Wall Street est de plus en plus instable et, depuis octobre, a perdu 300 points accumulant les alertes. Les ténors de la bourse américaine suivent leurs collègues industriels et licencient à tour de bras : Merryl Lynch, Drexel-Burnham, Shearson-Lehman, etc. La perspective de réduction du déficit budgétaire angoisse les industriels confrontés à la baisse des commande de l'Etat : 1 milliard de dollars de réduction du budget d'armement équivaut à 30 000 licenciements. Avec le développement du chômage massif se rétrécit toujours plus le marché solvable.
Faute d'acheteurs, le marché immobilier s'effondre après des années de spéculation effrénée. La dévalorisation brutale du parc immobilier dévalorise tout l'avoir du capital américain. De même que les centaines de caisses d'épargne qui font faillite ont vu la valeur de leurs placements fondre comme neige au soleil avec l'effondrement de la spéculation immobilière, les spéculateurs internationaux qui, à coups d'OPA financées à crédit, ont constitué des empires industriels, voient la valeur de leur patrimoine se volatiliser et se retrouvent incapables de faire face aux échéances de leur dette.
La panique commence à gagner les grandes banques. Alors que la question de la dette impayée des pays pauvres ne peut être résolue, elles sont aujourd'hui confrontées à la solvabilité déclinante de l'économie américaine. Le pourcentage des crédits immobiliers à problèmes, par rapport aux fonds propres des banques, a progressé de 8 % à 15 % en un an dans le Nord-Est industriel. Les prêts, qui ont financé les OPA et la spéculation boursière, deviennent inconsistants avec les péripéties de Wall Street. Ainsi la faillite d'un seul spéculateur, Robert Campeau, laisse une ardoise dont l'estimation varie de 2 à 7 milliards de dollars. La banque d'affaire Drexel-Burnham annonce des pertes de 40 millions de dollars et se déclare en faillite. Les industriels confrontés au marasme du marché ont de plus en plus de mal à rembourser leurs emprunts et les 200 milliards de dollars de "junk-bonds" (littéralement "obligations pourries", en fait des obligations à risque mais au fort taux rémunérateur... tant que tout va bien) en circulation voient leur cours s'effondrer.
Les grandes banques, porte-drapeaux du capitalisme américain, accumulent en conséquence les pertes : 1,2 milliards de dollars pour J.P. Morgan, 665 millions de dollars pour la Chase Manhattan, 518 pour Manufacturers Hanover. Et le pire reste à venir : l'accélération de la dégradation s'étant produite au dernier trimestre 89, ses effets vont aller en s'accentuant. Avec cette nouvelle plongée dans la récession, le marché américain est en train de perdre sa solvabilité, non seulement sur le plan national, mais aussi et surtout sur le plan international. Le dollar est gagé sur la puissance de l'économie américaine et la dynamique d'effondrement du marché américain contient la perspective d'effondrement du dollar. Le système financier international est devenu un immense château de cartes qui tremble de plus en plus fortement sous le souffle asthmatique de l'économie US. La fameuse politique des taux se révèle impuissante à entraver la progression de l'inflation et à empêcher renfoncement dans la récession.
...annonce un nouvel effondrement de l'économie mondiale
Avec le ralentissement de l'économie américaine s'annonce un enfoncement encore plus profond de l'économie mondiale dans la récession. Si l'effondrement économique des pays de l'Est n'a eu qu'un très faible impact sur le marché mondial - depuis des décennies ces marchés étaient fermés et les échanges avec le reste du monde très faibles - il ne peut en être de même avec l'économie américaine. Même si depuis la fin de la seconde guerre mondiale, sa part de marché a chuté de 30 % à 16 %, et même si sa compétitivité n'a cessé de se dégrader, l'économie américaine reste la première du monde et son marché de loin le plus important.
Les exportations du Japon et des pays industrialisés d'Europe dépendent du marché américain. L"'empire du Soleil levant" écoule 34 % de ses exportations aux USA. Il est le plus dépendant du marché américain. En 1989 son excédent commercial, en contrecoup des difficultés américaines, a chuté de 17 %. Par conséquent la récession aux USA, l'insolvabilité grandissante de l'économie américaine, signifient une fermeture aux importations en provenance des autres pays et, par conséquent, une chute parallèle de la production mondiale. Dans cette spirale de la catastrophe capitaliste, c'est l'ensemble de l'économie planétaire qui est en train de sombrer dans le chaos. La pagaille invraisemblable qui est en train de submerger le monde, et qui rend difficile et délicat tout pronostic détaillé quant à la forme exacte à travers laquelle l'accélération de la crise va se manifester, montre au moins une chose : l'illusion de relative stabilité, que le capital avait réussi à maintenir sur le plan économique dans ses métropoles les plus développées durant les années 1980, a vécue.
L'ensemble des mécanismes dits de régulation du marche commence à se gripper. Les Etats tentent de huiler les rouages mais les remèdes sont de plus en plus inefficaces.
Les banquiers voient avec effroi leurs bilans s'incliner vers des gouffres sans fond, tandis que les "goldens boys" de Wall-Street, héros du libéralisme reaganien, se retrouvent aujourd'hui en prison ou au chômage. Les grandes places boursières sont inquiètes, elles ont eu des malaises à répétition, le 13 octobre 1989, puis le 2 janvier pour commencer l'année 1990, et le 24 janvier pour confirmer ces sinistres auspices. Chaque fois, les Etats ont inondé le marché de liquidités pour enrayer la panique, mais jusqu'à quand cette politique du coup par coup, de l'improvisation acrobatique pourra-t-elle être maintenue ?
Fait significatif de l'inquiétude qui gagne le monde des spéculateurs, le 2 janvier ce n'est pas Wall-Street qui a craqué en premier, c'est la bourse de Tokyo, devenue première place boursière mondiale et qui s'était fait jusque là remarquer par sa solidité et sa stabilité. Le compte-à-rebours est commencé qui annonce les craquements et les effondrements futurs.
De nouveaux marches illusoires
Pourtant, malgré ces sombres perspectives, les idéologues du capital n'en continuent pas moins à célébrer le fameux marché. Et, alors que le marché mondial se rétrécit une nouvelle fois drastiquement, avec l'affaissement de l'économie américaine, ils cherchent désespérément de nouvelles oasis capables d'étancher la soif de débouchés d'une industrie dont les moyens de production se sont énormément développés, avec les investissements de ces dernières années. Ils ne trouvent que de nouveaux mirages pour perpétuer l'illusion :
- le marché japonais qui, depuis des années, doit s'ouvrir, mais qui reste désespérément fermé car sa propre industrie l'occupe pleinement et ne laisse guère de place aux exportateurs étranger ;
- le marché des pays de l'Est qui vient de s'ouvrir plus largement à l'Occident, mais qui est ruiné par des décennies de pillages et d'aberration bureaucratique staliniennes et qui, pour importer, devra faire massivement appel aux crédits des pays occidentaux ;
- la future "unification" européenne qui en 1992 doit instituer le plus grand marché unique du monde, perspective hypothétique rendue encore plus lointaine par l'instabilité mondiale qui se développe et qui, de toutes façons, est déjà un marché occupé, même s'il est morcelé.
Pour tous ces marchés le problème reste le même : par rapport à leur capacité solvable, ils sont déjà amplement saturés. Une relance dans ces régions ne pourrait se faire qu'à crédit, en faisant marcher la planche à billets. C'est exactement la politique économique menée par les USA depuis des années. On voit où elle mène !
La situation financière mondiale n'incite pas les investisseurs à octroyer de nouveaux crédits qui, pour l'essentiel, ne pourront pas plus être remboursés que les anciens. Il est significatif qu'au-delà des déclarations d'intention d'aide aux pays de l'Est, les crédits occidentaux se soient faits plus que parcimonieux. L'économie mondiale a atteint un seuil. La politique qui consistait, pour forcer les exportations, à prêter en même temps l'argent destiné à les financer, se révèle de moins en moins possible et de plus en plus dangereuse. Les remèdes de cheval de l'économie libérale appliqués aux pays de l'Est, avec l'ouverture de leur marché, signifie d'abord :
- une inflation galopante, 900 % en Pologne ; des prix de denrées de première nécessité qui doublent en Hongrie ;
- la fermeture des usines insuffisamment compétitives, la majorité, et par conséquent, le développement d'un chômage massif, inconnu jusque là dans ces pays.
L'Eldorado mythique du capitalisme occidental qui a fait rêver des générations de prolétaires à l'Est, est devenu le cauchemar quotidien d'une dégradation insupportable des conditions de vie. Pas plus que les pays sous-développés n'ont pu se défaire de la misère ou ils se sont effondrés à la fin des années 1970, les pays de l’ex-bloc de l'Est ne sortiront demain de la catastrophe économique dans laquelle ils s'enfoncent toujours plus. Pas plus que les recettes du capitalisme d'Etat stalinien, les recettes du capitalisme d'Etat libéral ne pourront être efficaces.
Qui pourrait financer une relance destinée à atténuer le contrecoup de l'enlisement de l'économie américaine ? Toujours optimiste, la bourgeoisie mondiale répond : "Mais l'Allemagne et le Japon ! Voyons !". Ces pays ont en effet montré ces dernières années une santé insolente, battant des records à l'exportation, hyper compétitifs sur les marchés déchirés par la concurrence, menant une politique monétaire plus rigoureuse que leur mentor américain.
Cependant, toutes les économies de ces pays ne peuvent suffire à maintenir à flot l'économie mondiale. A eux deux, en 1987, ils ne représentaient que les trois-quarts du PNB américain. L'essentiel de leurs avoirs est immobilisé en bons du Trésor américain, en actions et en réserves libellées en dollars, qui ne peuvent être réalisés sans semer la panique sur les marchés. La "relance" au Japon sur un marché national surprotégé ne peut servir qu'à l'industrie japonaise, mais aura une incidence négligeable sur le marché mondial. Quant à la "relance" allemande, on a un avant-goût de ce qu'elle signifie avec le projet d'unification monétaire, prélude à la réunification des deux Allemagnes. D'abord nul ne peut estimer son coût : les différentes hypothèses varient de quelques dizaines de milliards de deutschemark à plusieurs centaines. L'incertitude règne, mais l'attrait d'une "Grande Allemagne" a poussé la RFA à desserrer le cordon de sa bourse, à mettre en fait à profit une politique de relance pour financer sa réunification. Comme pour le Japon, charité bien ordonnée commence par soi-même.
L'impact d'une telle relance ne peut, en conséquence, qu'être limité sur le plan international. L'abandon de la politique de rigueur monétaire de l'Allemagne, tant citée comme exemple jusqu'alors, sème l'inquiétude dans le monde de la finance effrayé par ce saut vers l'inconnu. Par contrecoup, les marchés européens sont déstabilisés, les taux d'intérêt, face à la peur qu'une telle politique ait pour résultat premier de relancer l'inflation, flambent à Francfort et à Paris, mettant à mal les marchés spéculatifs: bourses, MATIF. Les investisseurs japonais hésitent, le "Serpent monétaire" européen est mis à mal. Le choix allemand de l'Allemagne de l'Ouest mécontente les autres pays de l'Occident, notamment européens qui voient leur échapper l'escarcelle sur laquelle ils comptaient pour sauver leur propre économie.
La RFA n'a pas les moyens de financer à la fois l'absorption de la RDA et une mini relance en Europe de l'Ouest. La Communauté européenne est mal en point et le marché unique de 1992 de plus en plus lointain, improbable, à un moment où les effets conjugués de l'accélération de la crise et de la désagrégation de la discipline des blocs pousse chaque puissance capitaliste dans une concurrence acharnée où domine le "chacun pour soi" et où les tentations protectionnistes se font chaque jour plus fortes.
Loin d'être, comme l'affirmaient les propagandistes médiatisés du capital, une victoire du capitalisme et l'aurore d'un nouveau développement, l'effondrement économique du bloc de l'Est a été le signe annonciateur d'un nouvel enfoncement de l'économie mondiale dans la crise. Liées par leur destin paradoxal, les deux grandes puissances dominantes, qui se sont partagées le monde à Yalta, sombrent aujourd'hui sous les coups de boutoir de la crise capitaliste. De l'est à l'Ouest, du Nord au Sud, la crise économique est mondiale et si l'effondrement du bloc de l'Est a été plus un facteur de déboussolement que de clarification pour le prolétariat mondial, l'enfoncement significatif de l'économie mondiale, à la suite de la récession américaine, dans une crise toujours plus aiguë et dramatique, va donner l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Le franchissement du fatidique degré 0 de la croissance aux USA vient inéluctablement affaiblir les axes de la propagande occidentale.
Les prévisions marxistes sur la crise catastrophique du capitalisme trouvent aujourd'hui une concrétisation qui ne va cesser de prendre de l'ampleur. Catastrophe de l'économie planétaire qui plonge des fractions de plus en plus larges de la population mondiale dans une misère insondable. Anarchie croissante des marchés capitalistes qui traduit l'impuissance de toutes les mesures capitalistes d'Etat. Les métropoles développées sont à leur tour en train de sombrer : inflation, récession, chômage qui se redéploie massivement, paralysie du fonctionnement de l'Etat bureaucratique, décomposition des rapports sociaux.
Les lois aveugles du marché, celles des contradictions insurmontables du capitalisme, sont à l'oeuvre.- Elles mènent l'humanité dans la barbarie, la décomposition à l'image de la machine capitaliste devenue folle. Une nouvelle vague d'attaques contre la classe ouvrière, plus sévère que jamais commence : niveau de vie rongé par l'inflation galopante, licenciements massifs, mesures d'austérité de toutes sortes. Partout c'est la même politique de misère pour la classe ouvrière qui est appliquée. Les modèles s'écroulent devant la réalité des faits, ceux qui prétendaient défendre les intérêts de la classe ouvrière comme les autres. Non seulement le modèle stalinien, mais aussi, maintenant, le "socialisme à la suédoise" avec le gouvernement social-démocrate qui annonce le blocage des salaires et propose l'interdiction du droit de grève. La dégradation s'accélère et, plus que jamais, le capitalisme, sous toutes ses formes, montre l'impasse et la destruction dans lesquelles il mène l'espèce humaine. Plus que jamais est posée la nécessité de la révolution communiste, seul moyen de mettre fin à la loi du marché, c'est-à-dire la loi du capital.
JJ. 15 février 1990.
Récent et en cours:
- Crise économique [27]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [39]
Polémique : le vent d'est et la réponse des révolutionnaires
- 2675 reads
L'effondrement du bloc impérialiste russe est un événement de dimension historique, mettant fin à l'ordre mondial établi par les grandes puissances depuis 1945. Il va sans dire qu'un événement d'une telle échelle est un vrai test pour les organisations politiques de la classe ouvrière, sorte d'épreuve du feu qui montrera si celles-ci possèdent ou pas l'armement théorique et organisationnel que réclame la situation.
Ce test opère à deux niveaux étroitement liés de l'activité révolutionnaire. En premier lieu, les événements à l'Est ont inauguré toute une nouvelle phase dans la vie du capitalisme mondial, une période de bouleversement et d'incertitude, de chaos grandissant, qui rend absolument indispensable pour les révolutionnaires le développement d'une analyse de l'origine et de l'orientation des événements, leurs implications pour les principales classes de la société. Une telle analyse doit être basée sur des fondements théoriques solides, capables de résister aux tempêtes et doutes du moment, et doit cependant aussi rejeter tout attachement conservateur aux hypothèses et schémas qui sont devenus obsolètes.
En second lieu, l'effondrement du bloc de l'Est a ouvert une période difficile pour la classe ouvrière, dans laquelle nous avons vu les ouvriers à l'Est être engloutis par une marée d'illusions démocratiques et nationalistes, et dans laquelle la bourgeoisie mondiale toute entière a saisi l'opportunité d'assaillir les ouvriers avec une campagne assourdissante sur "la faillite du communisme" et le "triomphe de la démocratie". Face à ce torrent idéologique, les révolutionnaires sont dans l'obligation d'intervenir à contre-courant, de s'attacher aux principes de classe fondamentaux en réponse à une cacophonie de mensonges qui a un réel impact sur la classe ouvrière.
Pour ce qui concerne le CCI, nous renvoyons aux articles de cette Revue Internationale et du numéro précédent, ainsi qu'à la presse territoriale sur les événements. Comment les autres groupes du milieu révolutionnaire ont répondu à cette épreuve, tel est l'objet du présent article. ([1] [40])
Le BIPR : un pas en avant, mais combien en arrière
Les composantes du BIPR sont le Parti communiste internationaliste Battaglia Comunista en Italie, et la Communist Workers organisation en Grande-Bretagne. Ce sont des groupes sérieux, avec une presse régulière, et il est normal que leurs numéros récents se soient axés sur les événements à l'Est. C'est en soi important puisque, comme nous le verrons, une des principales caractéristiques de la réponse du milieu politique aux événements a été... pas de réponse du tout, ou au mieux, un retard lamentable dans la réponse. Mais comme nous prenons le BIPR au sérieux, notre souci principal est ici celui du contenu ou de la qualité de leur réponse. Et bien qu'il soit trop tôt pour tracer un bilan définitif, nous pouvons dire que jusqu'à présent, bien que quelques points clairs soient contenus dans les articles écrits par le BIPR, ces éléments positifs sont affaiblis sinon sapés par une série d'incompréhensions et de franches confusions.
La CWO (Workers’Voice)
L'impression première est que des deux composantes du BIPR, c'est la CWO qui a répondu de la manière la plus adéquate. L'effondrement du bloc de l'Est n'est pas seule ment un événement d'une importance historique considérable : il n'a aussi aucun précédent dans l'histoire. Jamais auparavant un bloc impérialiste s'était écroulé non pas sous la pression d'une défaite militaire ou d'une insurrection .prolétarienne, mais d'abord et avant tout par sa totale incapacité à faire face à la crise économique mondiale. Dans ce sens, la manière avec laquelle ces événements se sont déroulés, sans parler de leur extraordinaire rapidité, ne pouvait être prévue. Le résultat a été, non seulement que la bourgeoisie a été prise par surprise, mais que les minorités révolutionnaires l'ont été tout autant, y compris le CCI. Sur ce plan, il faut porter au crédit de la CWO d'avoir vu dès avril-mai de l'an dernier que la Russie perdait le contrôle sur ses satellites est-européens, position critiquée à tort dans World Révolution comme concession aux campagnes pacifistes de la bourgeoisie, ceci résultant du retard à voir la désintégration véritable du système stalinien.,
Le numéro de Workers'Voice de janvier 1990. le premier à être publié depuis l'effondrement effectif du bloc, commence par un article qui dénonce correctement le mensonge que le "communisme est en crise", et, dans d'autres articles, montre un niveau de clarté sur les trois points centraux suivants : - la désintégration des régimes staliniens est le produit de la crise économique mondiale, qui touche ces régimes avec une sévérité particulière :
- la crise n'est pas le résultat du "pouvoir du peuple", encore moins de la classe ouvrière ; les manifestations massives en RDA et Tchécoslovaquie ne sont pas sur un terrain prolétarien ;
- ce sont des "événements d'une importance historique mondiale", signifiant "l’amorce d'un effondrement de l'ordre mondial créé vers la fin de la 2e guerre mondiale", et ouvrant une période de "reformation de blocs impérialistes."
Cependant, ces intuitions, pour importantes qu'elles soient, ne sont pas menées à leur conclusion. Ainsi, bien que la fin du montage impérialiste post-1945 soit vu comme "amorce", il n'est pas clairement dit si le bloc russe est réellement fini ou non. Les événements sont présentés comme "d'une importance historique mondiale", mais ceci est à peine suggéré du fait de la tonalité assez frivole de deux des articles de première page, et par le fait que cette position est repoussée en page cinq du journal.
Plus important, les intuitions de la CWO sont plus basées sur une observation empirique des événements que sur un cadre analytique clair, ce qui signifie qu'elles peuvent être aisément éclipsées avec l'évolution des événements. Dans nos "Thèses sur la crise économique et politique en URSS et dans les pays de l'Est" en septembre 1989 {Revue Internationale n° 60), nous avons tenté de fournir un tel cadre : en particulier, nous avons expliqué pourquoi l'effondrement a été si soudain et achevé par la mise en évidence de la rigidité particulière et l'immobilité de la forme politico-économique stalinienne, forme prise par le fait que ce régime a été l'expression même de la contre-révolution ^accomplissant en Russie. En l'absence d'un tel cadre, ce que dit la CWO est équivoque sur la profondeur réelle de l'effondrement du stalinisme. Aussi, bien qu'un article dise que la politique de Gorbatchev de non-intervention -signifiant en fait qu'il n'y avait rien qui eût pu maintenir les gouvernements staliniens en Europe de l'Est - était "très peu volontaire mais imposée au Kremlin par l'état épouvantable de l'économie soviétique", ailleurs on a l'impression qu'au fond la non-intervention est une stratégie de Gorbatchev pour intégrer la Russie dans une nouvel impérialisme basé en Europe, et pour améliorer l'économie par l'importation de technologie occidentale. Ceci sous-estime le degré de perte de contrôle de la situation auquel en est la bourgeoisie soviétique, qui est simplement entrain de combattre pour survivre au jour le jour, sans aucune stratégie sérieuse à long terme.
Une fois encore, la position de la CWO sur les manifestations massives en Europe de l'Est, et l'exode énorme de réfugiés de RDA, ne saisit pas la gravité de la situation. Ces phénomènes sont écartés de façon désinvolte comme faisant partie de "la révolte de la classe moyenne contre le capitalisme d'Etat", et motivés par un désir des belles marchandises occidentales : "ils veulent des BMW (...) Les écouter parler d'attendre 10 ans pour une nouvelle voiture fait saigner le coeur démocratique de certains !" Cette attitude contemplative manque un point crucial : les ouvriers de RDA et Tchécoslovaquie ont participé en masse dans ces manifestations, non pas comme classe, mais comme individus atomisés dans le "peuple". C'est une question sérieuse pour les révolutionnaires, parce que cela signifie que la classe ouvrière a été mobilisée derrière les drapeaux de son ennemi de classe. La CWO a eu une attitude assez stupide vis-à-vis du CCI, parce que la répression que nous avions vue comme une possibilité pour la bourgeoisie d'Allemagne de l'Est n'avait pas eu lieu. Mais, les conséquences tragiques et sanglantes de l'enrôlement d'ouvriers sur le faux terrain de la démocratie ont été très clairement illustrées par les événements en Roumanie, un mois plus tard, et ensuite par le développement d'affrontements violents en Azerbaïdjan et dans d'autres républiques de l'URSS.
De plus, WV de décembre 1989 ne répond pas vraiment aux campagnes sur la "démocratie" à l'Ouest, ni ne prend position sur les conséquences négatives que ces événements ont pour la lutte de classe, à l'Est et à l'Ouest.
Le PCInt (Battaglia Comunista)
Bien que la CWO et le PCInt fassent partie du même regroupement international, il y a toujours eu une hétérogénéité considérable entre les deux groupes, sur le niveau programmatique et dans leur réponse aux développements immédiats de la situation mondiale. Avec les événements de l'Est, cette hétérogénéité ressort très clairement. Et dans ce cas, il semble que le PCInt - bien que ce soit le groupe qui ait la plus grande expérience politique - ait été envahi par de pires confusions que la CWO. C'est évident lorsqu'on examine les quelques derniers numéros de Battaglia Comunista.
En octobre 1989, BC publie un article "La bourgeoisie occidentale applaudit l'ouverture des pays de l'Est", qui affirme que les régimes staliniens sont capitalistes et que la source de leurs troubles est la crise économique mondiale. Mais là se termine le bon point ([2] [41]), et le reste du texte montre une sous-estimation extraordinaire du niveau de l'effondrement économique et politique à l'Est. Alors que nos "Thèses", adoptées à peu près au même moment, c'est-à-dire avant les événements spectaculaires en Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, reconnaissaient la désintégration effective du bloc russe, BC voit "l'empire oriental encore solidement sous la botte russe." Et, encore une fois en comparaison avec nos "Thèses", il semble dans cet article que BC pense que la formation de régimes "démocratiques" (c'est-à-dire multipartis) en Europe de l'Est est parfaitement compatible avec la cohésion du bloc. En même temps, pour BC, la crise économique qui est derrière ces événements peut avoir touché les pays occidentaux dans les années 1970, mais touche seulement les régimes staliniens "plus récemment" - alors qu'en fait, ces pays ont sombré dans un bourbier économique depuis les vingt dernières années. Peut-être que cette étrange illusion sur la santé relative des économies staliniennes explique leur croyance touchante que l'ouverture du "marché" de l'Est représente un véritable espoir pour l'économie capitaliste mondiale :
"L'effondrement des marchés de la périphérie du capitalisme, par exemple l'Amérique Latine, a créé de nouveaux problèmes d'insolvabilité pour la rémunération du capital... Les nouvelles opportunités ouvertes en Europe de l’Est pourraient représenter une soupape de sécurité par rapport au besoin d'investissement... Si ce large processus de collaboration est-ouest se concrétise, ce serait une bouffée d'oxygène pour le capital international."
Nous avons déjà publié une réponse aux affirmations de la bourgeoisie sur les "nouvelles opportunités" ouvertes à l'Est (voir la Revue Internationale n° 60 et dans ce n°), nous n'y reviendrons pas ici : les économies de l'Est sont pas dans un état de ruines moins sévères que les économies d'Amérique latine. Marquées par l'endettement, l'inflation, le gaspillage et la pollution, elles n'offrent pas grand chose à l'ouest en termes d'occasions d'investissement et d'expansion. L'idée que l'Est est un "nouveau marché" est purement de la propagande bourgeoise, et il faut conclure que BC est tombé tout droit dans le piège.
En novembre, au moment des manifestations massives en RDA et Tchécoslovaquie, dans lesquelles des millions d'ouvriers ont marché derrière les drapeaux de la "démocratie" sans une seule revendication de classe, BC titre malheureusement un éditorial "Résurgence de la lutte de classe à l'Est". Cet article fait référence non pas aux événements en Europe de l'Est, mais principalement à la lutte des mineurs en URSS qui, bien qu'elle se soit développée sur une échelle massive au cours de l'été 89, avait ensuite été complètement éclipsée par la "révolution" démocratique et nationaliste parcourant tout le bloc. De plus, l'article contient quelques ambiguïtés sur les revendications démocratiques soulevées par les ouvriers en même temps que les revendications exprimant leurs véritables intérêts comme classe. Bien que BC admette que les premières peuvent aisément être utilisées par l'aile "radicale" de la classe dominante, on trouve aussi le passage suivant :
"... Pour ces masses imprégnées d'anti-stalinisme et de l'idéologie du capitalisme occidental, les premières revendications possibles et nécessaire sont celles pour le renversement du régime 'communiste', pour une libéralisation de l'appareil productif, et pour la conquête de libertés démocratiques."
Sans aucun doute, les ouvriers dans les régimes staliniens ont, au cours de leurs luttes, avancé des revendications politiques bourgeoises (même lorsqu'ils ne sont pas infiltrés de l'extérieur par des agents de l'ennemi de classe). Mais ces revendications ne sont pas "nécessaires" à la lutte prolétarienne ; au contraire, elles sont toujours utilisées pour amener les luttes dans des impasses, et les révolutionnaires ne peuvent que s'y opposer. Mais l'utilisation de BC du terme "nécessaire" n'est pas du tout due à un écart de plume. Elle est dans la droite ligne des théorisations sur la "nécessité" de revendications démocratiques contenue dans leurs "Thèses sur les tâches des communistes dans les pays de la périphérie" ([3] [42]) ; il est clair que la même logique est maintenant appliquée au pays de l'ancien bloc de l'Est.
Au total, ce numéro de BC constitue une réponse très inadéquate au flot des mystifications "démocratiques" qui a été déchaîné sur le prolétariat mondial. Après avoir refusé de reconnaître la vraie reprise de la lutte de classe depuis plus de 20 ans, BC commence brusquement à la voir et la proclame au moment précis où l'offensive "démocratique" de la bourgeoisie l'a faite temporairement refluer !
En décembre 1989, même après les événements en RDA, Tchécoslovaquie et Bulgarie, BC publie un article "Effondrement des illusions sur le socialisme réel", qui contient beaucoup d'idées différentes, mais qui semble être dirigé contre les thèses du CCI de l'effondrement du bloc :
"La perestroïka russe entraîne un abandon de l'ancienne politique vis-à-vis des pays satellites, et a pour objectif de transformer ces derniers. L'URSS doit s'ouvrir aux technologies occidentales et le COMECON doit faire de même, non - comme le pensent certains - dans un processus de désintégration du bloc de l'Est et de désengagement total de l'URSS des pays d'Europe, mais pour faciliter, en revitalisant les économies du COMECON, la reprise de l'économie soviétique. "
Une fois encore, comme la CWO, on nous donne une description d'un processus qui correspondrait à un plan bien établi de Gorbatchev destiné à intégrer la Russie dans une nouvelle prospérité économique européenne. Mais, quelles que soient les fantaisies auxquelles Gorbatchev, ou BC, peut se livrer, les politiques actuelles de la classe dominante russe lui sont imposées par un processus de désintégration interne sur lequel elle n'a aucun contrôle, et dont elle ne peut attendre aucune issue dans l'avenir.
En janvier, le numéro contient un long article "La dérive du continent soviétique" qui développe des idées similaires sur les buts de la politique étrangère de Gorbatchev, mais, qui en même temps, semble admettre qu'il peut en réalité y avoir une "dislocation" du bloc de l'Est. Peut-être que BC a fait là quelques progrès. Mais si ceci est un pas en avant, l'article sur les événements en Roumanie constitue plusieurs pas en arrière, vers l'abîme gauchiste.
La propagande bourgeoise, de la droite à la gauche, dresse le portrait des événements en Roumanie en décembre dernier, comme une authentique "révolution populaire", un soulèvement spontané de toute la population contre le haï Ceaucescu. C'est vrai qu'à Timisoara, à Bucarest et dans beaucoup d'autres villes, des centaines de milliers de personnes, entraînées par une répugnance légitime pour le régime, ont pris la rue en défiant la Securitate et l'armée, prêts à donner leurs vies pour le renversement de ce monstrueux appareil de terreur. Mais il est aussi vrai que ces masses, ce "peuple" amorphe au sein duquel la classe ouvrière n'a jamais été présente comme force autonome, étaient simplement trop facilement utilisées comme chair à canon par les opposants bourgeois de Ceaucescu, ceux qui conduisent aujourd'hui la machine plus ou moins inchangée de répression étatique. Les politiciens staliniens réformistes, les généraux de l'armée, et les anciens patrons de la Securitate qui constituent le "Front de Salut National", avaient dans une large mesure préparé leurs plans bien à l'avance : le FSN lui-même avait été formé, en secret, six mois avant les événements de décembre. Ils attendaient simplement que le moment arrive, et il est arrivé avec les massacres de Timisoara et les manifestations massives qui ont suivi. Une minute avant, les généraux de l'armée donnaient l'ordre à leurs soldats de tirer sur les manifestants, la minute suivante, ils ralliaient le peuple, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le peuple comme marchepied pour s'asseoir dans le siège du gouvernement. Ce n'était pas une révolution, qui, dans notre période, ne peut avoir lieu que lorsque le prolétariat s'organise lui-même comme classe et dissout l'appareil d'Etat bourgeois, en particulier la police et l'armée. Au mieux, c'était une révolte désespérée qui a été immédiatement canalisée sur le terrain politique capitaliste par les forces encore très intactes de l'opposition bourgeoise. Face à cette tragédie, dans laquelle des milliers de travailleurs ont donné leur sang pour une cause qui n'était pas la leur, les révolutionnaires ont le devoir clair de parler contre la marée de la propagande bourgeoise qui la décrit comme une révolution.
Mais comment BC répond ? En tombant la tête la première dans le piège : "La Roumanie est le premier pays dans les régions industrialisées dans lequel la crise économique mondiale a donné naissance à une réelle et authentique insurrection populaire dont le résultat a été le renversement du gouvernement en place." ("Ceaucescu est mort, mais le capitalisme vit encore"). En réalité, "en Roumanie, toutes les conditions objectives et presque toutes les conditions subjectives étaient réunies pour transformer l’insurrection en une réelle et authentique révolution sociale." (ibid.). Et il n'est pas difficile de deviner quel "facteur subjectif particulier manquait : "L'absence d'une force politique de classe véritable laissait le terrain ouvert aux forces qui travaillaient au maintien des rapports de production bourgeois." (ibid.)
"Une réelle et authentique insurrection populaire", quel genre de créature est-ce ? Stricto sensu, insurrection signifie la prise armée du pouvoir par une classe ouvrière consciente, organisée, comme en octobre 1917. Une "insurrection populaire" est une contradiction dans les termes, parce que le "peuple" comme tel, qui pour le marxisme ne peut signifier qu'un conglomérat amorphe de classes (quand ce n'est pas un mot codé pour désigner des forces de la bourgeoisie), ne peut pas prendre le pouvoir. Ce qui arrive ici est, une fois encore, qu'on ouvre largement la porte aux campagnes de la bourgeoisie sur la "révolution populaire", campagnes dans lesquelles les gauchistes ont joué un rôle particulièrement important.
Ces passages révèlent aussi l'idéalisme profond de BC sur la question du parti. Comment peuvent-ils affirmer que le seul élément "subjectif manquant en Roumanie était l'organisation politique ? Un élément subjectif indispensable pour la révolution est aussi une classe ouvrière qui s'organise elle-même dans ses organes autonomes, unitaires, les conseils ouvriers. En Roumanie, non seulement ce n'était pas le cas, mais la classe ouvrière n'était même pas en train de combattre sur son plus élémentaire terrain de classe ; au cours des événements de décembre, il n'y a eu aucun signe de quelques revendications de classe mises en avant par les ouvriers. Toute grève était immédiatement canalisée dans la "guerre civile" bourgeoise qui ravageait le pays.
L'organisation politique de la classe n'est pas un deus ex machina. Elle peut seulement gagner une influence significative dans la classe, elle peut seulement peser dans le sens de la révolution, lorsque les ouvriers s'engagent dans des confrontations massives et ouvertes avec la bourgeoisie, mais en Roumanie, les ouvriers ne luttaient même pas pour leurs plus élémentaires intérêts de classe : tout leur courage et toute la combativité ont été mobilisés au service de la bourgeoisie. Dans ce sens, ils étaient plus loin de la révolution que toutes les luttes défensive en Europe de l'Ouest au cours de la dernière décennie, luttes que BC a eu tellement de difficulté à voir.
Si on considère que le BIPR est le second principal pôle du milieu politique international, le désarroi de BC face au "vent de l'Est" est une triste indication des faiblesses plus générales du milieu. Et étant donné le poids de BC au sein du BIPR lui-même, il y a de fortes possibilités que la CWO soit poussée vers les confusions de BC, plutôt que poussée vers une plus grande clarté. (En particulier, nous devons attendre de voir ce que dit CWO sur la "révolution" en Roumanie). Quoi qu'il en soit, l'incapacité du BIPR à parler d'une seule voix sur ces événements historiques est révélatrice d'une faiblesse qui se paiera très cher dans la période à venir.
Bordiguisme, neo-bordiguisme, conseillisme, neo-conseillisme, etc.
Comme nous l'avons dit, en dehors du CCI et du BIPR, la réponse la plus caractéristique a été soit le silence, soit un refus de laisser de côté la routine de publications irrégulières et peu fréquentes, et de faire un effort particulier pour répondre à ces changements mondiaux historiques. Bien que sur ce plan aussi, il y ait différents degrés.
Ainsi, après un long silence, le Ferment Ouvrier Révolutionnaire en France a publié un numéro d'Alarme en réponse aux événements. L'éditorial est une réponse relativement claire aux campagnes de la bourgeoisie sur "la faillite du communisme". Mais lorsque dans un second article, le FOR descend de ce niveau général aux événements concrets de Roumanie, il en arrive à des positions proches de BC : ça n'a peut-être pas été une révolution, mais c'était une "insurrection". Et "bien que probablement personne en Roumanie n'eût songé à parler alors de communisme, des mesures comme l'armement des ouvriers, le maintien des comités de vigilance et leur prise en main de l'organisation de la lutte, de la production (nécessités alimentaires et médicales, à définir dans leurs natures, leurs qualités et quantités), l'exigence de dissolution des corps armés étatiques (armée, milice, polices...), et la jonction avec par exemple le comité occupant le palais présidentiel, eussent constitué les premiers pas d'une révolution communiste. "
Comme BC, le FOR a longtemps été déprimé par "l'absence" de lutte de classe ; maintenant, il voit les "premiers pas d'une révolution communiste" au moment où la classe ouvrière a été dévoyée sur le terrain de la bourgeoisie. C'est la même chose lorsqu'il considère les effets "positifs" de l'effondrement du bloc russe (qu'il semble reconnaître, puisqu'il écrit "on peut considérer que le bloc stalinien est vaincu (...)" Selon le FOR, ceci va aider les ouvriers à voir l'identité de leur condition internationalement. Ceci peut être éventuellement vrai, mais insister sur ce point en ce moment est ignorer l'impact essentiellement négatif que l'offensive idéologique actuelle de la bourgeoisie a sur le prolétariat.
Le courant bordiguiste "orthodoxe" possède encore une certaine solidité politique, du fait qu'il est le produit d'une tradition historique dans le mouvement révolutionnaire. Nous pouvons voir les "restes" de cette solidité par exemple dans le dernier Le Prolétaire, publication en France du Parti communiste international (Programme Communiste). Au contraire de l'enthousiasme déplacé pour les événements en Roumanie manifesté par BC et le FOR, le numéro de décembre 89-février 90 du Prolétaire prend position clairement contre l'idée qu'une révolution, ou tout au moins les "premiers pas" vers une révolution, ont surgi dans les manifestations de masse en Europe de l'Est :
"En plus des aspirations à la liberté et à la démocratie, le trait commun aux manifestants de Berlin, de Prague et de Bucarest, c'est le nationalisme. Le nationalisme et l'idéologie démocratiques qui prétendent englober 'tout le peuple', sont des idéologies de classe, des idéologies bourgeoises. Et en fait, ce sont des couches bourgeoises et petites-bourgeoises, frustrées d'être tenues à l'écart du pouvoir, qui ont été les véritables acteurs de ces mouvements et qui ont finalement réussi à placer leurs représentants au sein des nouveaux gouvernements. La classe ouvrière ne s'est pas manifestée en tant que classe, pour ses intérêts propres. Lorsqu'elle a fait grève, comme en Roumanie et en Tchécoslovaquie, c'est à l'appel des étudiants, en tant que simple composante indifférenciée du 'peuple'. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu la force de refuser les appels au maintien de l'union du peuple, de l'union nationale entre les classes. "
Même si ces mobilisations ont pris un caractère violent, elles ne parviennent pas au stade d'une "insurrection populaire" : "Et en Roumanie, les combats meurtriers qui ont décidé de l'issue ont opposé l'armée régulière à des éléments des corps spéciaux ‘Securitate') ; c'est-à-dire que les combats se sont déroulés entre fractions de l'appareil d'Etat, non contre cet appareil lui-même."
Concernant les causes historiques et les résultats de ces événements, Le Prolétaire semble reconnaître le rôle-clé de la crise économique, et il affirme également que la désintégration du bloc occidental est la conséquence nécessaire de la désintégration du bloc de l'Est. Il est aussi conscient que le soi-disant effondrement du "socialisme" est utilisé pour embourber la conscience des ouvriers partout, et dénonce ainsi correctement le mensonge selon lequel les régimes du bloc de l'Est n'avaient rien à voir avec le capitalisme.
Côté négatif, Le Prolétaire semble encore sous-estimer la véritable dimension de l'effondrement à l'Est, puisqu'il défend que "l’URSS est peut-être affaiblie, mais elle est encore, pour le capitalisme mondial, comptable du maintien de l'ordre dans sa zone d'influence", alors qu'en fait, le capitalisme mondial est bien conscient qu'on ne peut même plus s'appuyer sur l'URSS pour maintenir l'ordre à l'intérieur de ses propres frontières. En même temps, il surestime la capacité des ouvriers à l'Est de surmonter les illusions sur la démocratie par leurs propres luttes. En effet, il semble penser qu'il y aura des luttes contre les nouvelles "démocraties" à l'Est qui aideront les ouvriers à l'Ouest à rejeter leurs illusions, alors que c'est le contraire qui est vrai.
Ceci étant, ce PCI Programme Communiste a, au cours des deux dernières décennies, été de plus en plus poussé vers des positions ouvertement bourgeoises, sur des questions aussi critiques que la "libération nationale" et la question syndicale. La réponse relativement saine du Prolétaire aux événements de l'Est prouve qu'il y a encore une vie prolétarienne dans cet organisme. Mais nous ne pensons pas que ceci représente réellement un nouveau regain de vie : c'est l'antipathie "classique" des bordiguistes vis-à-vis des illusions démocratiques, plus qu'un réexamen critique des bases opportunistes de leur politique, qui leur a permis de défendre une position de classe sur cette question.
On pourrait en dire de même pour "l'autre" PCI, qui publie Il Partito Comunista en Italie et La Gauche Communiste en France. Par rapport à la fois aux événements du printemps en Chine et de l'automne en Allemagne de l'Est, il est capable d'affirmer clairement que la classe ouvrière n'a pas surgi sur son propre terrain. Dans l'article "En Chine, l'Etat défend la liberté du capital contre les ouvriers", il arrive à la difficile mais nécessaire conclusion que "même si les mitraillettes qui ont balayé les rues furent aussi tournées vers lui (le prolétariat chinois), il a eu la force et la volonté de ne pas se laisser attirer par un exemple sûrement héroïque, mais qui ne le concerne pas. "
En ce qui concerne l'Allemagne de l'Est, il écrit "pour le moment il s'agit de mouvements interclassistes qui se situent sur un terrain démocratique et national. Le prolétariat se trouve noyé dans la masse petite-bourgeoise et ne se différencie guère sur le plan des revendications politiques. "
Bon. Mais comment ce PCI peut-il réconcilier cette sobre réalité avec l'article qu'il a publié sur les grèves des mineurs en Russie, dans lequel il clame que le prolétariat dans les régimes staliniens est moins perméable à l'idéologie démocratique que les ouvriers à l'Ouest ? ([4] [43])
En dehors du courant bordiguiste "orthodoxe" il existe nombre de sectes qui aiment leur "Gauche italienne" épicée d'un trait de modernisme, ou d'anarchisme, mais surtout, d'académisme. Et ainsi, tout au long de mois où se sont déroulés ces événements qui font l'histoire actuelle, rien n'a dérangé la tranquillité de groupes comme Communisme ou Civilisation ou Mouvement Communiste ("pour le Parti communiste mondial", bien sûr !), qui continuent avec leurs recherches dans la critique de l'économie politique, convaincus de marcher dans les traces de Marx quand ils se retirent du "parti formel" pour se concentrer sur Das Kapital. Comme si Marx serait un moment resté silencieux face à des développements historiques d'une telle dimension ! Mais aujourd'hui, même les éléments les plus activistes de ce courant, comme le Groupe communiste internationaliste, semblent être repliés dans la chaleur de leurs bibliothèques. Il fait froid et il y a du vent dehors après tout...
Qu'en est-il des conseillistes ? Peu à rapporter. En Grande-Bretagne, silence de Wildcat et de Subversion. Un groupe de Londres, The Red Menace, s'est excusé pour n'avoir rien publié sur l'Europe de l'Est dans le numéro de janvier 1990 de son bulletin. Ses énergies ont été concentrées sur la nécessité bien plus pressante de dénoncer... l'Islam, puisque c'est le contenu principal d'un tract qu'il a sorti récemment. Toutefois, comme ce tract trace aussi un trait d'égalité entre bolchevisme et stalinisme, entre la révolution d'octobre 1917 et la contre-révolution bourgeoise, il fournit ainsi un rappel utile sur comment le conseillisme se fait l'écho des campagnes de la bourgeoisie, qui sont aussi extrêmement ardentes à montrer qu'il y a un trait de continuité entre 1917 et les camps de travail staliniens.
Pour les néo-conseillistes de la Fraction externe du CCI, nous ne pouvons pas en dire beaucoup jusqu'à présent, puisque leur numéro actuel date de l'été dernier et qu'ils n'ont pas jugé bon de publier un quelconque numéro spécial en réponse à la situation. Mais le numéro en cours n'inspire pas beaucoup confiance, pour le moins. Pour la FECCI, l'installation de Solidarnosc au gouvernement en Pologne n'a impliqué aucune perte de contrôle par les staliniens : au contraire, elle a révélé leur capacité à utiliser la carte démocratique pour tromper les ouvriers. De même, on ne peut attendre aucune réponse de classe claire au bain de sang en Roumanie, puisqu'ils ont vu, derrière les massacres en Chine, non pas une bataille sauvage entre fractions bourgeoises, mais une grève de masse embryonnaire, et qu'ils ont dénoncé le CCI pour ne pas le voir. Et pour autant qu'on puisse se référer à des prises de position récentes dans des réunions publiques en Belgique, la FECCI continuera à être guidée par ce vieux principe du mouvement ouvrier : dire le contraire de ce que dit le CCI ! Ils semblent être particulièrement zélés pour nier que le bloc de l'Est s'est effondré : un bloc impérialiste ne peut s'effondrer que par la défaite militaire ou la lutte de classe, parce que ça s'est passé comme ça dans le passé. Pour un groupe qui prétend être le rempart contre toute version dogmatique, ossifiée, du marxisme, ceci ressemble à une tentative pathétique de se raccrocher à des schémas éprouvés et sûrs. Nous n'en dirons pas plus avant d'avoir pris connaissance de leurs positions clairement exprimées.
La nouvelle période et la responsabilité des révolutionnaires
Bien que nous traitions d'une situation encore en évolution, nous avons déjà assez d'éléments pour conclure que les événements à l'Est ont violemment mis en évidence les faiblesses du milieu prolétarien existant. En dehors du CCI, qui, malgré quelques retards et erreurs, a été capable de prendre ses responsabilités face à ces développements, et à part quelques éléments de clarté montrés par les groupes politiques les plus sérieux, nous avons vu des degrés variés de confusion ou une complète incapacité à dire quoi que ce soit. Pour nous, une telle situation ne provoque aucun sentiment victorieux de "supériorité", mais elle met en évidence l'énorme responsabilité qui pèse sur le CCI. Etant donné que nous entrons dans une période de reflux dans la conscience de la classe, les difficultés du milieu ne vont pas s'atténuer. Au contraire. Mais ceci n'est pas un argument pour tomber dans la passivité ou le pessimisme. D'un côté, l'accélération de l'histoire va accélérer le processus de décantation que nous avions déjà observé dans le milieu. Les groupes éphémères et parasitaires qui se sont montrés complètement incapables de répondre à la nouvelle période vont être emportés par la roue implacable de l'histoire, mais même les courants les plus importants vont être secoués jusque dans leurs fondements s'ils ne sont pas capables de surmonter leurs erreurs et équivoques. Ce processus sera certainement douloureux, mais il n'est pas nécessairement négatif, à condition que les éléments les plus avancés dans le milieu, et le CCI en particulier, soient capables de mettre en avant une orientation claire qui puisse servir dans un moment difficile de l'histoire.
Une fois encore, un reflux général de la conscience de la classe, c'est-à-dire au niveau de l'extension de la conscience dans la classe, ne signifie pas la "disparition" de la conscience de classe, une fin de son développement en profondeur. Nous avons déjà vu, en fait, que les événements à l'Est ont fourni un stimulant considérable pour une minorité d'éléments qui cherchent à comprendre ce qui se passe, et qui ont repris contact avec l’avant-garde politique. Même ce développement sera sujet à fluctuations, mais le processus sous-jacent continuera. Notre classe n'a pas souffert de défaite historique, et il y a de réelles possibilités qu'elle ressorte de ce présent repli pour défier le capitalisme de façon plus profonde que jamais.
Pour la minorité révolutionnaire, c'est indubitablement un moment où les tâches de clarification politique et de propagande générale vont tendre à prendre le pas sur une manière plus agitationnelle d'intervention. Mais ceci ne signifie pas que les révolutionnaires devraient se retirer dans leurs études. Notre tâche est de rester dans et avec notre classe, même si notre intervention se mène dans de plus difficiles conditions et sera souvent appelée à être "à contre-courant". Plus que jamais, les voix des révolutionnaires doivent se faire entendre aujourd'hui ; c'est en effet une des pré conditions pour que la classe surmonte ses difficultés présentes et reprenne le chemin du coeur de la scène historique.
CDW, Février 1990.
[1] [44] Au moment du bouclage de ce numéro, nous avons reçu de nouvelles publications : Workers'Voice, Battaglia Comunista, Supplément à Perspectives Internationaliste, dont nous ne pouvons intégrer la critique dans cet article. Globalement, WV maintient la même analyse de la période, tout en dénonçant plus clairement les dangers pour le prolétariat. BC semble revenir en partie de ses délires lors de "l'insurrection populaire" en Roumanie. PI louvoie et minimise l'effondrement du bloc, et, tout en faisant silence sur leur grande trouvaille "théorique" sur "la transition de la domination formelle à la domination réelle du capital" comme explication de la situation en URSS, voit la situation assez bien contrôlée par Gorbatchev. La position minoritaire du même PI admet plus clairement l'effondrement du bloc russe et ses racines dans la crise économique.
Les évolutions des positions montrent que les événements poussent à une clarification, mais le problème du cadre général d'analyse reste toujours posé tel que nous l'envisageons dans ce présent article, avant ces dernières parutions.
[2] [45] Voir Révolution internationale n° 187.
[3] [46] Voir notre critique de ce texte dans la Revue Internationale n° 46, 3e trimestre 1986.
[4] [47] Voir l'article "La responsabilité des révolutionnaires" dans Rivoluzione Internazionale n° 62.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [48]
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique avec Battaglia Comunista : le rapport fraction-parti dans la tradition marxiste (2° partie)
- 2880 reads
Deuxième partie : la Gauche communiste internationale, 1937-1952
La polémique dont nous poursuivons ici la publication n'est pas un débat d'histoire académique. Le prolétariat ne possède comme arme que sa capacité d'organisation et sa conscience. Cette conscience est historique parce qu'elle est l'instrument de l'avenir, mais aussi parce qu'elle se nourrit de l'expérience historique de deux siècles de luttes prolétariennes. Il s'agit ici de transformer en armes, pour le présent et l'avenir, la terrible expérience des révolutionnaires dans les années qui ont précédé et suivi la 2e guerre mondiale, en particulier comment et dans quelles conditions les groupes révolutionnaires peuvent se transformer en véritables partis politiques du prolétariat Mais pour faire cela, il faut rétablir certains faits historiques dans leur vérité, et combattre les falsifications qui ont malheureusement été développées, même au sein du milieu révolutionnaire.
Dans la première partie de cet article [1] [49], nous avons montré comment, dans les années cruciales de 1935 à 1937, la Fraction de la Gauche italienne à l'étranger a été capable, au prix d'un terrible isolement politique, de sauvegarder le fil rouge de la continuité marxiste, face au naufrage dans l'antifascisme démocratique des autres courants de gauche, et du premier parmi eux, le courant trotskiste [2] [50]. C'est cette démarcation historique dramatique qui a jeté les bases politiques et programmatiques sur lesquelles se fondent encore aujourd'hui les forces de la Gauche communiste internationale. Nous y avons aussi montré que pour les camarades de BC, (Battaglia Comunista, organe du Partito Comunista Internazionalista) tout ceci n'est valable que jusqu'à un certain point, étant donné que pour eux, en 1935, la question centrale était de répondre au passage des vieux partis dans la contre-révolution par la transformation de la Fraction en un nouveau parti communiste. Cette position, défendue en 1935 par une minorité activiste (qui rompt l'année suivante avec la Gauche communiste pour donner son adhésion à la guerre "antifasciste" d'Espagne) a été rejetée par la majorité de la fraction qui, fidèle à la position de toujours de la Gauche, liait la transformation en parti à la reprise de la lutte de classe. Selon les camarades de Battaglia, la majorité "attentiste" qui en 1935 avait défendu cette position, erronée selon eux, l'aurait corrigée en 1936, pour ensuite la reprendre en 1937, avec des conséquences désastreuses.
En particulier, son porte-parole le plus prestigieux, Vercesi, "en 1936, pour trancher la controverse entre l’attentiste Bianco et Piero-Tito (partidiste), penchait plus pour ces derniers : 'il faut considérer que, dans la situation actuelle, bien que nous n'ayons pas et ne pouvons pas avoir encore une influence sur les masses, nous nous trouvons devant la nécessité d'agir non plus comme fraction d'un parti qui a trahi, mais comme parti en miniature'. (Bilan n° 28). En pratique, dans cette phase, Vercesi paraît se rapprocher d'une vision plus dialectique, selon laquelle à la trahison des partis centristes on devait répondre en faisant naître de nouveaux partis, non pour guider de façon velléitaire des masses (qu'il n'y avait pas encore) vers la conquête du pouvoir, (...) mais pour représenter la continuité de classe qui s'était interrompue, pour combler ce vide politique qui s'était produit, pour redonner à la classe ce point de référence politique indispensable même dans les phases de reflux qui fut en mesure, même si c'était de façon minuscule, de grandir au fur et à mesure des événements au lieu de les attendre comme le messie. Mais, en 1937, il revient en arrière, pour reproposer dans son 'rapport sur la situation internationale' les fractions comme unique expression politique possible du moment renonçant implicitement à quelque transformation que ce soit. (...) Au delà des retournements personnels de Vercesi, avec l'éclatement de la guerre, la fraction devient pratiquement inopérante. C'est la fin de toutes les publications (bulletins internes, Prometeo, Bilan et Octobre), c'est l'espacement, sinon l’arrêt, des contacts entre les sections française et belge. En 1945, la Fraction se dissout sans avoir résolu sur le terrain de la pratique un des problèmes les plus importants qui avait provoqué sa création à Pantin en 1928. Le parti naît quand même à la fin de 1942 sous l'impulsion de camarades restés en Italie (Partito Comunista Intemazionalista), parti que rejoindront à la fin de la guerre beaucoup d'éléments de la Fraction dissoute." [3] [51]
Comme d'habitude, les camarades de BC réécrivent notre histoire à leur façon. D'abord, Vercesi n'était pas le porte-parole de la majorité "attentiste" (comme l'appelle Battaglia) mais le porteur d'une tentative de compromis entre les deux positions qui s'affirmaient, même si c'était de façon ambiguë, à la fin du congrès de 1935. Au début de 1936, Vercesi recourt encore à une expression qui contient effectivement toute l'ambiguïté combattue par la majorité et qui est citée dans les extraits ci-dessus. C'est vrai que la citation exacte parle de la nécessité d'agir "non plus comme fraction d'un parti qui a trahi, mais comme -si on peut s'exprimer ainsi - un parti en miniature". Mais même avec la forme conditionnelle, que les camarades de BC ont fait disparaître avec une certaine fourberie, l'expression conserve toute l'ambiguïté qui consiste à présenter la fraction comme un parti qui aurait peu de militants, alors qu'il s'agit d'une forme d'organisation propre aux phases de lutte de classe qui ne permettent pas l'existence d'un parti, qu'il soit petit ou grand. Les véritables porte-parole de la majorité avaient toutes les raisons de protester contre ces formulations contradictoires qui introduisaient en catimini l'idée qu'on aurait pu s'orienter vers une activité de parti, quand il n'en existait absolument pas les conditions. Ce n'est pas par hasard que l'article de Bianco, dans Bilan n° 28, qui s'oppose à celui de Vercesi s'intitule "Un peu de clarté, s'il vous plaît". La clarté sur le fait que seule pouvait exister une fraction, dans de telles conditions est effectivement ré établie, mais pas en 1937, comme l'affirme l'article de Battaglia. Ce qui a rendu les choses claires, c'est la minorité qui face aux événements d'Espagne, largue définitivement les amarres, en sombrant dans l'antifascisme et clarifiant dans la pratique où mènent les discours sur la nécessité de "rompre avec l'attentisme". Confronté à cette culbute, Vercesi reprend pied et abandonne momentanément au placard (seulement momentanément, hélas !) les discours "sur les nouvelles phases". En se maintenant fermement sur ses positions, dans la période cruciale qui va de juillet 1936 à mai 1937 (massacre des travailleurs de Barcelone), la fraction a été capable de jeter les bases de l'actuelle Gauche communiste internationale, au prix toutefois d'un isolement total vis-à-vis du milieu politique en pleine décomposition démocratique. Cette terrible pression ambiante ne pouvait pas ne pas laisser de traces au sein même de la Fraction italienne et de la toute nouvelle Fraction belge. Chez quelques camarades, on commence à voir ressortir l'idée que, tout compte fait, le fait même qu'on aille à la guerre rapproche le moment de la riposte prolétarienne de la guerre elle même et que pour être prêt pour ces futures réactions, il fallait immédiatement commencer à avoir une activité "différente". Vers la fin de 1937, Vercesi commence à théoriser le fait qu'à la place de la guerre mondiale il y aura nombres de "guerres locales" dont la nature véritable serait d'être des massacres préventifs contre la menace prolétarienne, qui planerait on ne sait comment. Pour se préparer à ces convulsions, il faut "faire plus", et voilà que ressort, sous d'autres mots, la théorie selon laquelle la fraction doit agir - en un certain sens - comme un parti en miniature. Pour avoir une "activité" de parti, en septembre 1937, les fractions s'embarquent dans une entreprise absurde de collecte de fonds pour les victimes de la guerre d'Espagne, pour faire concurrence sur le plan du travail "de masse" aux organismes socio-staliniens comme le Secours Rouge, en descendant sur leur terrain. Si en décembre 1936, Bilan n° 38 republiait le projet de 1933 d'un Bureau International des Informations, en constatant amèrement qu'il n'existait encore aucune possibilité d'accepter cette proposition minimum, en septembre 1937, dans Bilan n° 43, Vercesi déclare qu'un simple Bureau des informations serait désormais "dépassé et que nous devons entrer dans une autre phase de travail" avec la constitution du Bureau International des fractions de gauche. En elle même, l'exigence de constituer un organe de coordination entre les deux seules fractions existantes était tout à fait juste. Le problème, c'est que ce bureau au lieu de coordonner l'action de clarification et de formation des cadres, seul travail possible pour les fractions dans ces conditions, était toujours plus conçu comme l'organe qu'on devait trouver prêt dès la reprise de classe pour coordonner "la construction des nouveaux partis et de la nouvelle Internationale". Toujours en mettant la charrue avant les boeufs, en janvier 1938, on arrête la publication de Bilan, en la remplaçant par une revue dont le nom, Octobre, anticipe sur les convulsions révolutionnaires qu'on ne pouvait entrevoir nulle part et dont auraient du sortir des éditions française, anglaise et allemande ! Le résultat de cette folie de vouloir agir "comme un parti en miniature" était prévisible : la revue qui devait sortir en trois langues n'arrive même pas à sortir régulièrement en français, le Bureau cesse pratiquement de fonctionner et, - ce qui est pire - la démoralisation et les démissions se multiplient chez les militants complètement déboussolés.
Avec l'éclatement de la guerre, en août 1939, la débandade atteint son comble, aggravée par le passage à la clandestinité, l'assassinat de quelques uns des meilleurs cadres et l'arrestation de beaucoup d'autres ; ainsi, les fractions se trouvent-elles désorganisées de fait. A cela contribue fortement le fait que Vercesi, qui jusqu'alors avait soutenu que le travail de fraction ne servait à rien, mais qu'il fallait celui d'un mini-parti, avec l'éclatement de la guerre, commence à théoriser que - vu que le prolétariat ne réagit pas - il est "socialement inexistant" et que dans ces conditions, le travail de fraction ne sert plus à rien.
Comme on le voit, ce qui revient constamment, c'est la remise en discussion de la fraction comme organe de l'activité révolutionnaire dans les phases historiquement défavorables. De tout cela, BC tente de tirer la conclusion que ceux qui pendant la guerre ont fait un travail de fraction n'en ont rien conclu. Mais ceux qui pendant la guerre n'en ont rien conclu - comme Vercesi - étaient précisément ceux qui ont refusé le travail de fraction. Contrairement à ce que Battaglia essaie de faire croire, la fraction ne cesse pas toute activité, mais - à l'initiative de la section de Marseille qui était le chef de file de l'opposition à Vercesi - se réorganise déjà début 1940, tient des conférences annuelles clandestines, rétablit des sections à Lyon, Toulouse, Paris, reprend les contacts avec les camarades restés en Belgique. Malgré des difficultés matérielles inimaginables, la publication régulière d'un bulletin de discussion reprend, outil de formation des militants et de circulation des textes d'orientation de la Commission Executive, qui servaient de base aux discussions avec les autres groupes avec lesquels on prenait contact. Ce travail clandestin conduisit à la constitution (de 1942 à 1944) d'une nouvelle fraction, la Fraction française, et au rapprochement des positions de la Gauche italienne de la part d'un bon nombre de communistes allemands et autrichiens qui avaient rompu avec le trotskisme, désormais passé dans le camp de la contre-révolution.
En vérité, on ne comprend pas comment auraient réussi à faire tout cela, dans des conditions extrêmement difficiles, des éléments qui, selon Battaglia, restaient "au chaud", en se réfugiant dans leurs "théorisations", dans l'attente "messianique" que les masses deviennent capables par elles mêmes de les reconnaître comme la juste direction.
Ici, on touche à un des points fondamentaux de la question. Battaglia présente la fraction comme un organe (on ferait mieux de dire un cercle culturel) qui, dans les périodes où le prolétariat n'est pas à l'offensive, se limite à des études théoriques, puisque intervenir dans la classe ne sert à rien. La fraction est, au contraire, l'organe qui permet de maintenir la continuité de l'intervention communiste dans la classe, même dans les périodes noires, dans lesquelles cette intervention ne trouve pas d'écho immédiat. Et toute l'histoire des fractions de la Gauche communiste est là pour le démontrer. A côté de la revue théorique Bilan, la Fraction italienne publiait un journal en italien, Prometeo, qui avait en France une diffusion supérieure à celle du journal des trotskistes français, ces maîtres de l'activisme. Les militants de la fraction étaient tellement connus pour leur engagement dans la lutte de classe qu'il fallait nécessairement des interventions brutales des directions nationales des syndicats pour les expulser des structures de base qui les défendaient. Ces camarades diffusaient la presse, malgré la chasse qui leur était faite conjointement par la police et les syndicats tricolores ; frappés jusqu'au sang, ils retournaient diffuser des tracts, le pistolet bien en vue à la ceinture, pour signifier leur volonté de se faire massacrer sur place plutôt que de renoncer à leur intervention dans la classe. Un ouvrier comme Piccino, attrapé par les staliniens alors qu'il diffusait la presse et livré à la police française, fut tellement battu qu'il en resta handicapé pendant toute sa vie, mais n'en retourna pas moins diffuser la presse. Dans une lettre d'avril 1929, Togliatti demandait l'aide de l'appareil répressif de Staline contre les "débris bordiguistes" avouant que leur acharnement lui créait plus que des petits problèmes partout où il y avait des ouvriers italiens. Venant de l'ennemi de classe, c'était la meilleure des reconnaissances.
Il faut vraiment du courage pour présenter comme des théoriciens en pantoufles des militants qui ont été liquidés dans les camps de concentration, ceux qui sont tombés aux mains de la Gestapo pendant qu'ils traversaient clandestinement la frontière pour maintenir les contacts avec les camarades en Belgique, ceux qui, recherchés par la police et sans papiers, participaient aux grèves illégales, ceux qui à la sortie de l'usine passaient au milieu des "killers" staliniens chargés de les tuer et qui ne s'en sortaient qu'en sautant par dessus le mur d'enceinte. Battaglia écrit que les camarades à l'étranger auraient du se battre pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile et que "renseignement de Lénine (...) aurait dû avoir un plus grand crédit" surtout chez "des camarades qui avaient grandi dans la tradition léniniste". Mais les camarades des fractions italienne et française, ont-ils fait autre chose quand ils diffusaient des appels au défaitisme révolutionnaire rédigés en français et en allemand jusque dans les trains militaires allemands, quand, en plein milieu de l'orgie patriotique de la "libération" de Paris, ils risquaient leur vie pour appeler les ouvriers à déserter l'encadrement des partisans ?
Comme on le voit, il est complètement faux d'écrire que l’unique possibilité d'organiser une quelconque opposition aux tentatives de l'impérialisme de résoudre ses l contradictions dans la guerre passait par la constitution de nouveaux partis". S'il n'y a pas eu de transformation en guerre civile, ce n'est pas du fait de l'absence d'une "quelconque opposition" de la part des fractions, mais du fait que le capitalisme mondial avait réussi à briser les premières tentatives faites dans ce sens, d'abord en Italie, puis en Allemagne, faisant reculer ainsi toute perspective révolutionnaire. Selon Battaglia, cependant, si la Fraction s'était malgré tout transformée en parti, la présence de ce parti aurait changé les choses. Mais dans quel sens auraient-elles changé ?
Pour répondre à cette question, considérons l'action du Parti Communiste Internationaliste fondé en Italie à la fin de 1942 par des camarades rassemblés autour d'Onorato Damen. Ce camarade, à la différence de la fraction qui rompt tous les liens avec le PCI en 1928, reste dans le parti jusqu'à la moitié des années 1930, en dirigeant encore en 1933 la révolte des détenus inscrits au parti dans les prisons de Civitavecchia. Battaglia Comunista (dont Damen a été un des dirigeants jusqu'à sa mort) dans l'article que nous avons cité, ironise sur l'appel à sortir des partis communistes passés à la contre-révolution, appel lancé par le Congrès de la Fraction en 1935. BC se demande : s'il ne pouvait y avoir de transformation en parti parce que les masses restaient sourdes à ce moment là aux appels de la fraction, alors, à qui diable pouvait bien s'adresser cet appel ? "On ne peut s'empêcher de se demander si le mot d'ordre en question n'a pas été lancé avec le dernier espoir que le prolétariat ne l'entende point de façon à ne pas créer de problèmes qui mettraient en question le schéma abstrait du rapporteur". L'ironie de Battaglia tombe particulièrement mal à propos : l'appel s'adressait à ces camarades qui, comme Damen, se trouvaient encore dans les rangs du PC avec l'espoir d'y défendre des positions de classe, et aurait concerné personnellement Damen lui même, si les staliniens n'avaient déjà veillé à résoudre le problème en l'expulsant du parti à la fin de 1934. Ou alors est-ce que Battaglia pense que Bilan n'aurait pas du faire appel à ces camarades pour qu'ils sortent des partis passés à la bourgeoisie et s'intègrent à la fraction, seul lieu où on continuait la bataille pour la reconstitution du parti de classe ?
En fait, Battaglia affirme qu'en 1935, pour n'importe quel marxiste, il était clair que la sortie définitive du PCI impliquait automatiquement la fondation du nouveau parti. Mais si c'était si clair, pourquoi Damen n'a-t-il pas fondé ce nouveau parti en 1935 ? Pourquoi s'est-il consacré à un patient travail clandestin de sélection et de formation des cadres, exactement comme la Fraction à l'étranger ? S'il est vrai que c'est par la fondation de nouveaux partis que passait l’unique possibilité d'organiser une opposition quelconque " à la guerre, pourquoi n'a-t-on pas fondé ce parti au moins en 1939, quand la guerre a éclaté, alors qu'on a attendu la fin de 1942, après trois années et demie de massacre impérialiste ? Selon les analyses de BC, ces sept années de retard devraient être considérées comme une folie ou une trahison. Selon nos analyses, c'est la meilleure démonstration de la fausseté de la thèse qui veut que pour fonder un nouveau parti, il suffit que le vieux ait trahi.
Si la naissance du PC Internationaliste a eu lieu fin 1942, c'est parce qu'il se développait alors une forte tendance à la reprise de la lutte de classe contre le fascisme et la guerre impérialiste, tendance qui conduit en quelques mois aux grèves de mars 1943, à la chute du fascisme et à la demande de la bourgeoisie italienne d'une paix séparée. Même si la bourgeoisie mondiale a rapidement réussi à dévoyer cette réaction de classe du prolétariat italien, c'est un fait que ce n'est que sur la base de cette réaction que les camarades en Italie ont estimé que le temps était venu de se constituer en parti. Ce n'est pas par hasard que la même évaluation est faite - tout à fait indépendamment - par les camarades à l'étranger, aussitôt qu'ils prirent connaissance des grèves de mars 1943 : la Conférence de la Fraction en août de la même année déclare que s'est ouverte "la phase de la rentrée de la fraction en Italie et de sa transformation en parti". Cependant, cette rentrée organisée n'a pas été possible, en partie à cause de difficultés matérielles quasi insurmontables (rappelons nous que le PC Internationaliste lui même fondé en Italie ne put faire connaître qu'en 1945 son existence à l'étranger), difficulté aggravée par l'assassinat et l'arrestation de nombreux camarades.
Mais la faiblesse fondamentale était d'ordre politique : la minorité de la Fraction italienne liée à Vercesi et forte de la Fraction belge déniait tout caractère de classe aux grèves de 1943, s'opposant à toute activité organisée parce que "volontariste". La conférence annuelle de 1944 condamna les positions de la tendance Vercesi et, au début de 1945, Vercesi fut exclu de la Fraction pour avoir participé au Comité de coalition antifasciste de Bruxelles. Cette longue lutte avait cependant contribué à réduire les énergies pour la rentrée de la Fraction en Italie, à laquelle fut substituée dans les faits, une politique de rentrée individuelle d'un grand nombre de ses militants qui, une fois en Italie, découvraient l'existence du parti, y rentraient, toujours à titre individuel. Cette politique allait être durement critiquée par une partie de la Fraction et surtout par la Fraction reconstituée en France qui développait de façon croissante un travail clandestin contre la guerre et critiquait le manque de décision de la Fraction italienne pour la réalisation d'un retour organisé en Italie. C'est alors, au printemps 1945, qu'arrive comme une bombe la nouvelle qu'il existe depuis des années en Italie un parti qui compte déjà "des milliers de membres" et auquel participent des camarades comme Damen et Bordiga. La majorité de la Fraction fut transportée d'enthousiasme et décide, dans une conférence précipitée en mai 1945, de sa propre dissolution et de l'adhésion de ses militants à un parti dont elle ignorait complètement les positions programmatiques. Comme la Fraction en France appuyait la minorité qui s'opposait à ce suicide politique, la majorité de la Conférence rompit tout lien organisationnel avec le groupe français, en prenant comme prétexte le travail que les camarades français avaient mené sur le défaitisme révolutionnaire avec des internationalistes allemands et autrichiens qui n'appartenaient pas aux fractions de la Gauche communiste.
La décision de s'auto dissoudre a eu des conséquences très graves sur le développement ultérieur de la Gauche communiste. La Fraction était le dépositaire des leçons politiques fondamentales qui avaient été tirées par la sélection des forces communistes opérée entre 1935 et 1937, et elle avait le devoir historique de garantir que le nouveau parti se forme sur la base de ces leçons, qui ont été résumées de la façon suivante dans l'article précédent :
1) le parti se formera par adhésion individuelle aux positions programmatiques de la Gauche, élaborées par les fractions, en excluant toute intégration de groupes de camarades se situant à mi-chemin entre la Gauche et le Trotskisme ;
2) la garantie du défaitisme révolutionnaire du parti sera la dénonciation frontale de toute forme de "milice partisane", destinée à enrôler les ouvriers dans la guerre, comme les "milices ouvrières" espagnoles de 1936. Comme l'absence de rentrée organisée et la dissolution de 1945 n'ont pas permis à la Fraction de remplir cette fonction, nous devons maintenant regarder si le parti fondé en Italie a été capable de se constituer tout de même sur ces bases. Et ceci, non pour décider de quelle appréciation devrions nous avoir de ce parti en particulier, mais pour comprendre s'il est vrai ou non que le travail de fraction est une condition indispensable de la constitution du parti de classe.
Procédons par ordre, en partant des positions politiques et de la méthode de recrutement. Le premier Congrès du PC Internationaliste (28 décembre 1945 - 1 janvier 1946), qui se tient après l'intégration des militants de la Fraction dans le parti, déclare que le PC Internationaliste a été fondé en 1942, "Sur la base de cette tradition politique précise" ([4] [52]) représentée par la Fraction à l'étranger à partir de 1927. Les premiers noyaux se référaient à "une plate-forme constituée par un bref document dans lequel étaient fixées les directives que devait suivre le parti et que pour l'essentiel, il suit encore maintenant". Il est difficile de dire jusqu'à quel point ce document était sur les positions de la Fraction, pour la simple raison que - pour autant que nous le sachions - Battaglia n'a jamais veillé à le republier (et pourtant il était "bref "!) et dans sa brochure de 1974 sur les plate-formes du PC Internationaliste, elle ne mentionne même pas son existence. Quel sort étrange pour la plateforme de constitution du Parti... Nous sommes donc obligés de nous référer à la Plate-forme rédigée par Bordiga en 1945 et approuvée par le premier Congrès au début de 1946.
Sans entrer dans une analyse détaillée, il suffira de souligner que ce texte admet la possibilité de participer aux élections (position rejetée par la Gauche dès l'époque de la Fraction Abstentionniste du PSI), que, comme bases doctrinales du parti, on prend "les textes constitutifs de "l’Intemationale de Moscou" (en rejetant donc les critiques qu'en avait fait la Fraction à partir de 1927), qu'on ne parle pas vraiment de dénoncer les luttes de libération nationale (position acquise par la Gauche dès 1935), et que, pour terminer en beauté, on exalte comme "fait historique de premier ordre" l'enrôlement des prolétaires dans les bandes armées des partisans. La Plate-forme est aussi inacceptable sur d'autres questions (syndicale, en premier lieu), mais nous nous sommes limités à ne considérer que ces points sur lesquels la Plate-forme se situe en dehors de frontières de classe déjà tracées grâce à l’élaboration programmatique de la Gauche communiste.
La méthode de recrutement du parti est en harmonie avec ce fatras idéologique, bien plus, le fatras idéologique est le résultat obligé de la méthode de recrutement suivie, basée sur l'absorption successive de groupes de camarades aux positions les plus disparates, sinon complètement contraires. On pouvait ainsi trouver à la fin dans le Comité central les premiers camarades de 1942, les dirigeants de la Fraction qui avaient exclu Vercesi en 1944 et Vercesi lui-même qui a été admis en même temps que les membres de la minorité expulsés en 1936 du fait de leur participation à la guerre antifasciste en Espagne. Sont admis des groupes comme la "Fraction des communistes et socialistes de gauche" du sud, qui en 1944 croyaient encore à la possibilité de "redresser" le parti stalinien et dans la foulée le parti socialiste (!), et qui, en 1945, se dissout pour rejoindre directement le parti. En revanche, le principal théoricien et rédacteur de la Plate-forme de 1945, Amedeo Bordiga, lui n'est même pas inscrit (il semblerait qu'il ne se soit inscrit qu'en 1949).
Sur la seconde question clarifiée dans les années 1935-37, celle du danger représenté par les milices partisanes, la dégénérescence du PC Internationaliste va de pair avec son élargissement numérique aux dépens des principes. En 1943, le PC Internationaliste s'aligne sur une courageuse position qui dénonce sans équivoque le rôle impérialiste du mouvement partisan. En 1944, on est déjà obligé de faire des concessions aux illusions sur la guerre "Démocratique" :
"Les éléments communistes croient sincèrement à la nécessité de la lutte contre le nazi-fascisme et pensent qu'une fois cet obstacle abattu, ils pourront marcher vers la conquête du pouvoir, en battant le capitalisme", (Prometeo, n° 15, août 1944).
En 1945 le cercle se referme avec la participation de fédérations entières (comme celle de Turin) à l'insurrection patriotique du 25 avril et l'adoption d'une Plate-forme qui définit le mouvement partisan comme une "tendance de groupes locaux prolétariens à s'organiser et à s'armer pour conquérir et conserver le contrôle des situations locales" en déplorant seulement que ces mouvements n'aient pas "une orientation politique suffisante" (!). Il s'agit de la même position que celle défendue par la minorité en 1936 sur la guerre d'Espagne et qui lui avait valu d'être expulsée de la Gauche communiste.
Jusque là, il est assez clair que les positions globalement exprimées par le PC Internationaliste se situaient en deçà du niveau de clarification déjà atteint par la Fraction et des bases considérées comme intangibles pour la constitution du nouveau parti. Les camarades de Battaglia, au contraire, considèrent le parti "né à la fin de 1942" comme le summum de la clarté existant à l'époque. Comment peuvent-ils concilier cette affirmation avec l'existence de confusions et d'ambiguïtés que nous venons à peine d'évoquer ? Très simplement : en niant que ces confusions étaient celles du parti et en les attribuant exclusivement aux adeptes de Bordiga qui en sortiront ensuite en 1952 pour fonder Programme Communiste. On leur répondait déjà dans la Revue internationale : " en d'autres termes : eux et nous avons participé à la constitution du parti : ce qu'il y avait de bon, c'était nous, le mauvais, c'était eux. En admettant qu'il en ait été ainsi, il reste le fait qu'il y avait ce 'mauvais' qui constituait un élément fondamental et unitaire au moment de la constitution du parti et que personne n'a rien trouvé à redire."
Ce que nous voulons montrer maintenant, c'est que les faiblesses étaient celles du parti dans son ensemble et pas celles d'une fraction particulière qui serait passée par là. La première chose que BC a toujours niée, c'est que les portes du parti étaient ouvertes à quiconque avait la bonne volonté d'adhérer. Mais c'est ensuite BC même qui affirme que la présence de Vercesi, qui venait du Comité de coalition antifasciste, s'explique par le fait que ce dernier "estimait devoir adhérer au parti" ([5] [53]). Mais qu'est ce que c'est que ce parti, un club de golf ? (encore que même dans les clubs, on doive être accepté par les autres membres pour pouvoir rentrer...). En plus, il faut se rappeler que Vercesi "estimait devoir adhérer" directement au Comité central du PC Internationaliste, devenant un des principaux dirigeants. BC nous informe que Vercesi était dans le CC, mais que le parti n'était pas responsable de ce qu'il faisait ou disait :
"Les positions exprimées par le camarade Perrone (Vercesi) à la Conférence de Turin (1946) (...) étaient de libres manifestations d'une expérience toute personnelle et avec une perspective politique fantaisiste à laquelle il n'est pas licite de se référer pour formuler des critiques à la formation du PC Internationaliste". ([6] [54])
Bien dit. Dommage cependant qu'en lisant le compte-rendu de cette première Conférence nationale du PC Internationaliste, on découvre à la page 13, que ces "libres* affirmations "de politique fantaisiste" n'étaient rien d'autre que le rapport sur "Le parti et les problèmes internationaux" présenté par le CC à la Conférence, dont Vercesi était le rapporteur officiel. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, parce que page 16, à la fin du rapport de Vercesi, pour tirer les conclusions, c'est Damen lui-même qui prend la parole et qui affirme que jusque là, "il n'y a pas de divergences, mais des sensibilités particulières qui permettent une clarification organique des problèmes". Si Damen pensait que le rapport de Vercesi relevait de la politique fantaisie, pourquoi a-t-il nié qu'il y avait des divergences ? Peut-être parce que l'alliance sans principe avec Vercesi était alors utile ?
Mais ne nous attardons pas et passons directement à la Plate-forme, écrite en 1945 par Bordiga. Battaglia l'a republiée en 1974 en même temps qu'un projet de Programme diffusé en 1944 par les camarades groupés autour de Damen, avec une introduction dans laquelle il est affirmé que le projet de 1944 est beaucoup plus clair que la Plate-forme de 1945. Effectivement, c'est tout à fait vrai pour quelques points (bilan de la révolution russe par exemple), mais sur d'autres points, les glissements sont beaucoup plus importants que dans le document de 1945. En particulier, sur le point de la tactique, on dit que : "notre parti, qui ne sous-estime pas l'influence des autres partis de masse, se fait le défenseur du front unique'". Or, si on retourne au compte-rendu de la Conférence de Turin, on y trouve le rapport de Lecci (Tullio) qui fait le bilan du travail de la fraction à l'étranger et de sa délimitation par rapport au trotskisme : "cette démarcation présupposait en premier lieu la liquidation de la tactique de front unique des blocs politiques" (p 8). A la Conférence de 1946 donc, quelques points clés du projet étaient déjà considérés comme incompatibles avec les positions de la Gauche communiste. Mais venons en maintenant à ce que dit l'introduction de 1974 à la Plate-forme de 1945 :
"En 1945, le CC reçoit un projet de Plate-forme politique du camarade Bordiga qui, nous le soulignons, n’était pas inscrit au parti. Le document dont l’acceptation fut demandée en termes d'ultimatum, est reconnu comme incompatible avec les fermes prises de position adoptées désormais par le parti sur des problèmes plus importants, et, malgré les modifications apportées, le document a toujours été considéré comme une contribution au débat et pas comme une plate-forme de fait.(...) Le CC ne pouvait, comme on l'a vu, qu'accepter le document comme une contribution tout à fait personnelle pour le débat du congrès futur, qui, reporté à 1948, mettra en évidence des positions très différentes (cf. Compte-rendu du Congrès de Florence)." ([7] [55])
Telle est la reconstitution des faits présentée par les camarades de Battaglia en 1974. Pour voir si elle correspond à la réalité, retournons à la Conférence de janvier 1946 qui aurait dû se prononcer sur la "demande en termes d'ultimatum de l'acceptation " de la plate-forme faite par Bordiga. A la page 17 du Compte-rendu, on lit : "A la fin du débat, puisque aucune divergence substantielle ne s'est manifestée, la 'Plate-forme du Parti' est acceptée et on renvoie au prochain congrès la discussion sur le 'Schéma de Programme' et sur d'autres documents en voie d'élaboration". Comme on le voit, il est arrivé exactement le contraire de ce que Battaglia raconte aujourd'hui : à la conférence de 1946, les camarades de Battaglia eux-mêmes ont voté à l'unanimité pour l'acceptation de la Plate-forme écrite par Bordiga et qui est devenue la base officielle d'adhésion au parti depuis ce moment-là (et qui a été publiée comme telle à l'extérieur). Les délégués français eux-mêmes donnent leur adhésion à la Conférence sur la base de la reconnaissance de l'adéquation de la plate-forme (p.6) et la résolution de constitution d'un Bureau International de la Gauche communiste commence par ces mots : "le CC, tenant compte du fait que la Plate-forme du PC Internationaliste est le seul document qui donne une réponse marxiste aux problèmes rencontrés avec la défaite de la révolution russe et la deuxième guerre mondiale, affirme que c'est sur cette base et sur le patrimoine de la Gauche italienne que peut et doit être constitué le Bureau International de la Gauche communiste". Pour conclure, remarquons qu'il y a effectivement eu un document considéré comme une simple contribution au débat et dont la discussion fut renvoyée au congrès suivant, sauf que ce ne fut pas la plate-forme de Bordiga mais... le Schéma de programme élaboré en 1944 par le groupe de Damen et qu'aujourd'hui Battaglia cherche à faire passer pour la plate-forme effective du PC Internationaliste de années 1940.
On n'a pas assez de mots pour condamner la falsification totale de l'histoire du PC Int. effectuée toutes ces années par les camarades de Battaglia. On en est au niveau des falsifications staliniennes qui réécrivent l'histoire du parti bolchevik en faisant disparaître les noms des camarades de Lénine fusillés ou en attribuant à Trotsky les erreurs commises par Staline. Battaglia, pour faire que les choses aient l'air de se tenir, a été capable de faire disparaître de l'histoire du parti sa propre plate-forme et dans d'autres documents ([8] [56]), n'a pas hésité à attribuer aux "pères du CCI", les camarades de la Gauche communiste de France, les pirouettes de Vercesi, avec qui ses pères avaient noué une alliance opportuniste en 1945, en l'admettant dans le CC du Parti. Nous savons bien qu'il s'agit d'un jugement très dur, mais nous le fondons sur les documents officiels de PC Int., comme le Compte-rendu de la Conférence de janvier 1946, que Battaglia a bien pris soin de cacher, alors qu'elle a republié le compte-rendu du congrès de 1948, parce qu'à cette date, l'alliance opportuniste avec Vercesi était désormais rompue. Nous soumettons nos conclusions et nos jugements à la volonté critique de tous les camarades du milieu international de la Gauche communiste. Si les documents que nous avons cités n'existent pas, que Battaglia le dise et le démontre. Dans le cas contraire, on saura une fois de plus d'où viennent les falsifications.
Il reste de toute façon un problème à clarifier : comment est-il possible que des camarades de valeur comme Onorato Damen, des camarades qui ont tenu le flambeau de l'internationalisme dans les moments les plus durs pour notre classe, aient pu s'abaisser à un tel niveau de falsification de cette période de leur histoire ? Comment est-il possible que les camarades de Programme Communiste (qui s'était séparé en 1952 de Battaglia Comunista) aient pu en arriver à faire disparaître dans le néant leur histoire depuis 1926 jusqu'en 1952 ? Sur la base de tout ce qui a été re parcouru dans cet article, la réponse est claire : ni les uns ni les autres, dans les années cruciales autour de la deuxième guerre mondiale, n'ont été capables d'assurer fondamentalement la continuité historique de la Fraction de Gauche, seule base possible pour le parti de demain. On ne peut certainement pas leur reprocher d'avoir cru en 1943 que les conditions de la renaissance du parti avait mûri, étant donné que même les Fractions à l'étranger partageaient cette illusion, fondée sur le début d'une riposte prolétarienne à la guerre qui s'était manifestée avec les grèves de 1943 en Italie. Mais en janvier 1946, quand le congrès de Turin se tient, il était clair alors que le capitalisme avait réussi à briser toute réaction prolétarienne et à la transformer en un moment de la guerre impérialiste, à travers l'encadrement dans les bandes partisanes. Dans cette situation il était nécessaire de reconnaître que les conditions indispensables à la constitution du parti n'existaient absolument pas et de dédier ses forces à un travail de fraction, un travail de bilan et de formation de cadres sur la base de ce bilan. Ni les uns ni les autres n'ont été capables de s'engager jusqu'au bout sur cette voie et cela explique leurs contorsions par la suite. La tendance Damen commença à théoriser que la formation du parti n'avait rien à voir avec la reprise de la lutte de classe, démentant ainsi sa propre expérience de 1943. La tendance Vercesi (proche de Bordiga) recommença à louvoyer entre quelque chose qui n'était pas encore le parti mais qui n'était plus la fraction (le vieux "parti-miniature" de 1936 est recyclé en 1948 en "fraction élargie",), anticipant sur les futurs tours d'équilibre de Programme Communiste sur "parti historique/parti formel". Seule la Gauche communiste de France (Internationalisme), dont le CCI se réclame aujourd'hui, a été capable de reconnaître ouvertement les erreurs qui avaient été faites en croyant qu'en 1943 les conditions de la transformation de la fraction en parti existaient, et de se dédier au travail de bilan historique que les temps exigeaient. Pour aussi partiel qu'il soit, ce bilan reste la base indispensable sur laquelle on doit partir pour la reconstitution du parti de demain.
Dans la suite de ce travail, nous analyserons la contribution que ce bilan représente et doit représenter dans le processus de regroupement des révolutionnaires qui est en cours au niveau mondial.
Beyle
[1] [57] Revue internationale n° 59, 4c trimestre 1989.
[2] [58] Voir la brochure "La Gauche communiste d'Italie, 1917-1952", et le supplément sur les rapports de la Gauche italienne et de l'Opposition de gauche internationale, publiés par le CCI.
[3] [59] « Frazione-Partito nell » esperenza della Simstra Italiana", Prometeo n°2. mars 79.
[4] [60] "Compte-rendu de la première conférence nationale du Parti Communiste Internationaliste d'Italie". Publications de la Gauche communiste internationale, 1946.
[5] [61] 'Lettre de BC au CCI’, reproduite dans la Revue internationale n° 5 décembre 1976, avec notre réponse.
[6] [62] Prometeo n° 18, ancienne série, 1972.
[7] [63] Documents de la Gauche italienne n° 1, Cd. Prometco, janvier 1974.
[8] [64] Battaglia Comunista n° 3, février 1983, article reproduit dans la Revue Internationale n° 34, 3e trimestre 1983, avec notre réponse.
Courants politiques:
- Battaglia Comunista [65]
Questions théoriques:
- Parti et Fraction [66]
Revue Internationale no 62 - 3e trimestre 1990
- 2676 reads
Editorial : pays de l'est : crise irréversible, restructuration impossible
- 4376 reads
Les événements de ces derniers mois dans l’ex-bloc soviétique ont révélé de plus en plus clairement l'énorme délabrement de l'économie, dans tous les pays d'Europe de l'Est sans exception, et en URSS en particulier. Au fur et à mesure que la réalité est mieux connue, les derniers espoirs et toutes les théories sur une possibilité d'amélioration de la situation volent en éclats. Les faits parlent d'eux-mêmes : il est impossible de relever l'économie de ces pays ; leurs gouvernements, quelles qu'en soient les diverses composantes, l'ancien appareil "réformé" avec ou sans participation des anciennes "oppositions", ou de "nouvelles" formations politiques, sont totalement impuissants à maîtriser la situation. C'est la plongée dans un chaos sans précédent qui se confirme chaque jour davantage. ([1] [67])
Les pays occidentaux ne renfloueront ni les pays de l'Est, ni l'URSS
Partout c'est la débandade et les pays de PEst aimeraient bien voir les grands pays industrialisés venir au secours de leur économie complètement sinistrée. Walesa ne cesse de quémander pour la Pologne de l'aide à l’"Occident". Gorbatchev plaide auprès de Bush la "clause de la nation la plus favorisée", accord préférentiel en matière contractuelle que les Etats-Unis ont toujours refusé à l'URSS, qui fut souvent conclu avec la Roumanie, pays le plus pauvre de l'ancien bloc de l'Est. La RDA attend de la réunification avec la RFA des subsides pour sauver les quelques rares secteurs de son appareil productif qui ne sont pas dévastés.
Mais les pays occidentaux ne sont pas prêts à engager le dixième des dépenses qui seraient nécessaires, dans une entreprise qui est, non seulement des plus hasardeuses, mais dès à présent vouée à un échec certain. Il n'y a plus guère d'illusions sur une perspective de redressement économique des pays de l'Est. Il n'y a aucun profit tangible à retirer d'un appareil productif à l'infrastructure et aux moyens de production totalement obsolètes, et à la main-d'oeuvre non rompue aux normes de productivité draconiennes imposées par la guerre commerciale sur le marché mondial que se livrent les principales puissances industrielles occidentales, essentiellement Etats-Unis, Japon, Allemagne de l'Ouest, et les autres pays d'Europe occidentale.
Et même si le FMI octroyait plus de crédits, il se trouverait confronté à une situation semblable à celle des pays du "tiers-monde" insolvables, avec des dettes de milliards de dollars qui n'ont aucune chance d'être jamais remboursés.
Il est symptomatique que la rencontre Bush-Gorbatchev, en cours au moment de sortir ce numéro, ne donne lieu à aucun accord économique particulier, sinon la reconduction timide d'anciens accords existants. Personne ne mise plus sur une quelconque réussite de la fameuse "perestroïka". Les considérations qui entrent en ligne de compte, dans l'entretien des relations occidentales avec les pays de l'Est, relèvent de préoccupations générales sur les moyens de contenir la généralisation d'un désordre en Europe de l'Est qu'aucune puissance occidentale ne voit d'un bon oeil. Il n'est pas question d'accords commerciaux ou industriels susceptibles d'apporter un véritable ballon d'oxygène à l'économie complètement asphyxiée de ces pays.
Les pays de l'Est ne peuvent compter sur aucun "plan Marshall" (le financement de la "reconstruction" de l'Europe de l'Ouest et du Japon par les Etats-Unis après la 2e guerre mondiale). S'il y a quelques illusions, parmi les défenseurs de la "victoire du capitalisme", sur l'intérêt économique offert par le démantèlement du "rideau de fer", l'expérience douloureuse actuelle pour l'économie ouest-allemande que constitue la réunification de l'Allemagne et la prise en charge de la RDA ([2] [68]), risque de les balayer complètement. Pour le capital allemand, il y a bien un intérêt ponctuel pour la main-d'oeuvre qualifiée très mal payée en RDA, mais il y a surtout la perspective d'une ponction financière terriblement élevée et de l'afflux de millions de chômeurs et immigrés. ([3] [69])
Alors que le système financier international menace à chaque instant de s'écrouler sous le poids de la dette mondiale, alors que des licenciements massifs ont déjà commencé, aux Etats-Unis notamment, et ne vont faire qu'augmenter partout dans les grands pays capitalistes développés, ces derniers n'ont aucun intérêt strictement économique, aucun "marché" dans les pays de l'Est, à quelques très rares exceptions près. Seuls des "théoriciens" attardés, et il en existe malheureusement encore quelques-uns y compris dans le camp prolétarien ([4] [70]), croient encore au mirage de la restructuration de l'économie des pays de l'Est.
Le délabrement complet de l'économie
Les chiffres officiels avoués aujourd'hui en URSS sur l'état exsangue de l'économie, à tous les niveaux, pulvérisent à la baisse les anciennes estimations officieuses, que les spécialistes occidentaux opposaient déjà depuis plusieurs années au mensonge institutionnel des "statistiques" soviétiques.
Les nouvelles statistiques qui font le constat d'un taux de croissance de l'économie qui s'approche inexorablement de zéro rendent plus compte de la réalité que celles d'avant la "Glasnost". Cependant, en incluant dans son calcul le secteur militaire, seul secteur où l'économie russe a connu une croissance réelle depuis le milieu des années 1970, il donne une indication qui sous-estime encore l'ampleur de la crise de l'économie soviétique.
C'est, au mieux, au niveau économique d'un pays comme le Portugal que se trouve actuellement l'URSS, disposant, selon les estimations, de 30 000 F de revenu par tête et par an, revenu pouvant aller de 9 000 à 54 000 F. Ce qui signifie, pour une majorité de la population, un "niveau de vie" en fait certainement plus près de celui de pays tels que l’Algérie que de celui des régions les plus pauvres de l'Europe du sud.
De plus les caractéristiques "classiques" de la crise à l'occidentale, l'inflation et le chômage, commencent déjà à ravager les pays de l’Est, à des taux dignes des pays du "tiers-monde" les plus touchés. Et ces fléaux "classiques" du capitalisme viennent s'ajouter à ceux, tout aussi capitalistes, hérités du stalinisme : rationnement et pénurie permanents des biens de consommation courante. Même les plus violents pourfendeurs du stalinisme et glorificateurs zélés du capitalisme à l'occidentale sont stupéfaits de l'état de délabrement de l'économie de l'URSS : "La réalité soviétique n'est pas une économie développée nécessitant diverses rectifications, c'est un gigantesque bric-à-brac inutilisable et imperfectible." ([5] [71]).
La "perestroïka" est une coquille vide et la popularité de Gorbatchev est désormais au plus bas en URSS, les récentes "mesures" du gouvernement consistant à entériner la catastrophe : une reconnaissance officielle d'augmentation des prix à la consommation jusqu'à 100 %, et la promesse de 15 % d'augmentation des salaires comme... "compensation financière" ! A brève échéance, dans cinq ans pour les "optimistes", dans un an pour d'autres, c'est le chômage massif pour des millions de travailleurs, les prévisions faisant état du chiffre de 40 ou 45 ou 50 millions de chômeurs, ou même "peut-être plus", soit plus d'une personne sur cinq, et sans allocation d'un quelconque "minimum vital" !
Et si la situation en URSS est une des plus catastrophiques, celle dans les autres pays de l'Est n'est guère plus brillante. Dans l'ex-RDA, avec la mise en place de l’"union monétaire" allemande de juillet 1990, ce sont 600 000 chômeurs qui se retrouvent immédiatement sur le pavé, et ce chiffre atteindra quatre millions dans les années qui viennent, soit une personne sur quatre ! ([6] [72]) En Pologne, après que les prix aient augmenté de 300 % en moyenne en 1989, jusqu'à des flambées à 2000 % sur certains produits, le gouvernement a bloqué les salaires "pour enrayer l'inflation". En fait, officiellement, l'inflation est aujourd'hui de 40 % et le nombre de chômeurs devrait atteindre cette année les deux millions. Partout, le bilan des "mesures de libéralisation" est clair : elles ne font qu'ajouter au désastre.
La forme stalinienne du capitalisme d'Etat héritée, non de la révolution d'octobre 1917, mais de la contre-révolution qui l'a tuée dans le sang, a sombré avec la ruine complète et la désorganisation totale des formes de l'économie capitaliste qu'elle a engendrées dans les ex-pays soi-disant "socialistes". Mais la forme "libérale" du capitalisme occidental, qui n'est pas moins du capitalisme d'Etat, mais sous une forme beaucoup plus sophistiquée, ne peut pas constituer une solution de rechange. C'est le système capitaliste comme un tout au niveau mondial qui est en crise, et les pays "démocratiques" développés doivent y faire face pour défendre leurs propres intérêts. Le manque de marchés n'est pas l'apanage des pays de l'Est ruinés, il frappe au coeur du capitalisme le plus développé.
L'échec de la "libéralisation"
L'accélération de la crise a mis à nu la totale absurdité des .méthodes du capitalisme d'Etat à la façon du stalinisme sur le plan de la gestion économique : l'irresponsabilité complète de plusieurs générations de fonctionnaires dont la seule préoccupation était de s'en mettre plein les poches en respectant, sur le papier, des directives de "plans" complètement déconnectés du fonctionnement normal du marché. Le constat, au sein même de la classe dominante, de l'obligation d'en finir avec cette irresponsabilité, d'abandonner la tricherie permanente avec les "lois du marché" que constitue la totale prise en main de la vie économique par l'appareil d'Etat, ne signifie pas que la classe dominante puisse opérer un rétablissement de l'économie par une "libéralisation", et une reprise en main de la situation par une "démocratisation". Ce constat n'est que la reconnaissance de la pagaille généralisée qui existe à tous les niveaux. Mais comme c'est de cette tricherie permanente que cette même classe dominante tient ses privilèges depuis des décennies, ce constat ne peut en rester qu'à l'état d'un constat, ce que l'expérience de la "perestroïka" et de la "glasnost" depuis cinq ans illustre largement. Comme nous le disions dès septembre 1989 :
"(...) De même que la 'réforme économique' s'est donné des tâches pratiquement irréalisables, la 'réforme politique' comporte de bien faibles chances de succès. Ainsi, l'introduction effective du 'pluripartisme' et d'élections 'libres', qui est la conséquence logique d'un processus de 'démocratisation', constitue une menace véritable pour le parti au pouvoir. Comme on l'a vu récemment en Pologne, et dans une certaine mesure également en URSS l'an passé, de telles élections ne peuvent conduire qu'à la mise en évidence du complet discrédit, de la véritable haine, qui s'attachent au Parti au sein de la population. Dans la logique de telles élections, la seule chose que le Parti puisse en attendre est donc la perte de son pouvoir. Or c'est quelque chose que le Parti, à la différence des partis 'démocratiques' d'Occident, ne peut pas tolérer du fait que :
- s'il perdait le pouvoir par les élections, il ne pourrait jamais, contrairement à ces autres partis, le reconquérir par ce moyen;
- la perte de son pouvoir politique signifierait concrètement l'expropriation de la classe dominante puisque son appareil est justement la classe dominante.
Alors que dans les pays à économie 'libérale' ou 'mixte', où se maintient une classe bourgeoise classique, directement propriétaire des moyens de production, le changement du parti au pouvoir (à moins justement qu'il ne se traduise par l'arrivée d'un parti stalinien) n'a qu'un faible impact sur ses privilèges et sa place dans la société, un tel événement dans un pays de l'Est signifie, pour la grande majorité des bureaucrates, petits et grands, la perte de leurs privilèges, la mise au chômage, et même des persécutions de la part de leurs vainqueurs. La bourgeoisie allemande a pu s'accommoder du 'kaiser', de la république social-démocrate, de la république conservatrice, du totalitarisme nazi, de la république 'démocratique' sans que soit remis en cause l'essentiel de ses privilèges. En revanche, un changement de régime en URSS signifierait dans ce pays la disparition de la bourgeoisie sous sa forme actuelle en même temps que celle du parti. Et si un parti politique peut se suicider, prononcer son autodissolution, une classe dominante et privilégiée, elle, ne se suicide pas" ([7] [73])
En URSS, le stalinisme est, par les circonstances historiques de son apparition, une organisation particulière de l’Etat capitaliste. Avec la dégénérescence de la révolution russe, l'Etat qui avait surgi après l'expropriation de l'ancienne bourgeoisie par la révolution prolétarienne de 1917, est devenu l'instrument de la reconstitution d'une nouvelle classe capitaliste, sur les cadavres de dizaines de millions de prolétaires, ouvriers et révolutionnaires, dans la contre-révolution depuis la fin des années 1920 jusque dans les années 1930, puis dans l'embrigadement meurtrier dans la 2e guerre mondiale. La forme prise par cet Etat est le produit direct de la contre-révolution dans laquelle la classe dominante s'est totalement identifiée à l’Etat-Parti unique. Avec la faillite définitive du système, la classe dominante a perdu tout contrôle de la situation, non seulement sur les anciens Etats "socialistes", mais aussi au sein même de l'URSS, et n'a pas de marge de manoeuvre pour enrayer cet engrenage.
La situation dans les pays de l'Est est un peu différente. C'est à la fin de la 2e guerre mondiale que l'URSS, avec la bénédiction des "Alliés", a imposé, dans les gouvernements des pays passés dans sa zone d'influence, la prépondérance des Partis Communistes qui lui étaient inféodés. Dans ces pays, l'ancien appareil d'Etat n'a pas été détruit par une révolution prolétarienne. Il a été adapté, plié à l'impérialisme russe, laissant subsister, plus ou moins selon les pays, des formes classiques de la domination de la bourgeoisie, à l'ombre du stalinisme. C'est pourquoi, avec la mort du stalinisme et l'incapacité de l'URSS à maintenir son emprise impérialiste, la classe dominante dans ces pays, pour la plupart moins sous-développés que l'URSS économiquement, s'est empressée de tenter de se débarrasser du stalinisme en essayant de réactiver les résidus de ces formes antérieures.
Cependant, si les pays de l'Est disposent théoriquement de plus de possibilités que l'URSS pour essayer de faire face à la situation, les derniers mois montrent que l'héritage des quarante dernières années de stalinisme et le contexte de la crise mondiale du capitalisme posent des problèmes énormes à une véritable "démocratie" bourgeoise. En Pologne par exemple, la classe dominante s'est montrée incapable de maîtriser cette "démocratisation". Elle s'est retrouvée dans la situation aberrante d'avoir au gouvernement le syndicat Solidarnosc. En RDA, c'est la "démocratie chrétienne", la CDU, qui a gouverné avec le SED (Parti communiste) pendant quarante ans, qui est le principal protagoniste de la "démocratisation" pour la réunification avec la RFA. Mais loin de constituer une force politique responsable capable d'assurer une quelconque réorganisation dans le pays, cette formation politique n'a pour seule dynamique que l'appât du gain de son personnel, et ne fait rien d'autre qu'attendre les subsides de RFA, au grand dam de la CDU ouest-allemande, principal bailleur de fonds de l'opération.
L'évolution inexorable commencée l'été dernier depuis l'accession de Solidarnosc au gouvernement de Pologne, le virage à l'Ouest de la Hongrie, l'ouverture du mur de Berlin, le séparatisme des "républiques asiatiques", jusqu'à la sécession des "républiques baltes", et l'investiture récente d'Eltsine en Russie même, n'est pas le fruit d'une politique voulue et choisie délibérément par la bourgeoisie. Elle est l'expression jour après jour de la perte de contrôle de la classe dominante, et indique la plongée dans une dislocation et un chaos jusque là inconnus dans toutes ces régions du monde. Il n'y a pas "libéralisation", mais impuissance de la classe dominante face à la décomposition du système.
Les illusions démocratiques et les nationalismes
La "libéralisation" n'est qu'un discours vide, un rideau de fumée idéologique, qui utilise les illusions sur la "démocratie" très fortes dans la population qui a vécu quarante années d'encasernement du stalinisme, pour essayer de faire accepter la dégradation continue des conditions d'existence. Déjà, la "libéralisation" de Gorbatchev a fait long feu avec cinq années de discours qui n'ont aucun résultat concret sinon une situation de plus en plus pénible pour la population. Et ce n'est pas seulement le fait des hommes de l'appareil à la Gorbatchev. Les anciens opposants, même les plus "radicaux", champions de la "démocratisation", se démasquent et montrent leur vrai visage dès que leur échoit une responsabilité gouvernementale. En Pologne par exemple, on voit un Kuron, emprisonné par Jaruzelsky il y a quelques années, autrefois "trotskiste" ([8] [74]), après s'être vanté, lorsqu'il prit ses fonctions de Ministre du Travail, de pouvoir "éteindre des milliers" (de grèves) pour avoir été capable d'en "organiser cent", menacer aujourd'hui de répression directe les grévistes des transports, et ne se distinguer en rien de l'attitude classique du stalinisme contre la classe ouvrière. Quelles que soient les fractions et cliques politiques qui occupent à un moment ou à un autre le pouvoir, il n'y a pas de véritable "démocratie" possible sous la forme de la démocratie bourgeoise des pays les plus développés, et encore moins une démocratie "socialiste".
Cette idée de démocratie "socialiste", selon laquelle il suffirait d'écarter la bureaucratie du pouvoir pour permettre aux "rapports de production socialistes" soi-disant existant dans les pays de l'Est, de s'épanouir, idée chère à nombre de sectes trotskistes, n'est qu'une invention de dernier rabatteur du stalinisme que constitue ce courant politique, et tous les événements récents en apportent chaque jour un peu plus la confirmation.
Tous les "oppositionnels", pour la plupart issus de l'appareil, ou tout l'ancien appareil repenti, ou encore des personnalités converties par les circonstances à se mettre "au service de leur pays", tous candidats à la défense du maigre capital national en danger, utilisent les illusions démocratiques nourries par la plus grande majorité dans les pays de l'Est, pour se chercher des masses de manoeuvre pour leurs desseins et aspirations au pouvoir. Mais seuls les grands pays développés peuvent se permettre de véritables formes "démocratiques" de domination de la classe capitaliste. La force relative de l'économie et l'expérience politique leur permettent d'entretenir tout l'appareil, des médias à la police, et toutes les institutions nécessaires à une emprise sur la société qui cache son totalitarisme sous l'apparence de "libertés". Le stalinisme, capitalisme d'Etat poussé à l'absurdité jusqu'à tenter de nier la loi de la valeur, a forgé une classe dominante totalement inapte, ignorante du BA. BA de cette même loi sur laquelle elle fonde pourtant sa domination de classe. Jamais une classe dominante n'a été aussi faible.
Et cette faiblesse entraîne aussi, avec la dislocation du bloc de l'Est et de l'URSS, l'éclatement des multiples nationalismes qui n'étaient attachés à l'URSS que par la répression militaire, et qui se réveillent automatiquement avec l'impuissance de leur chef de file à exercer cette suprématie par la force des armes.
Gorbatchev a pu donner un moment l'impression qu'il favorisait l'expression des "nationalités" en URSS. En réalité, le pouvoir central soviétique ne peut pas utiliser les nationalismes au profit du renforcement de sa puissance. Au contraire, les flambées de nationalismes, régionalismes, particularismes à tous les niveaux, sont une manifestation de l'incapacité du régime russe et de la perte définitive de sa puissance, de son statut de tête de bloc impérialiste, de sa place parmi les "grandes puissances" ([9] [75]). Ce sont les conditions de la situation qui alimentent le nationalisme : sans Moscou et l'Armée rouge, les cliques au pouvoir se retrouvent "nues", et la voie est libre pour les débordements de tous les particularismes qui n'étaient tenus que par la terreur militaire. Les conséquences de cet effondrement n'en sont qu'au début de leurs pires manifestations. A terme, par sa logique propre, c'est au mieux une "démocratisation" comme en connaissent des pays tels que la Colombie ou le Pérou, ou plus vraisemblablement une "libanisation" de tout l'ancien bloc de l'Est et de l'URSS elle-même, qui est inscrite dans la situation actuelle, avec aucune politique de rechange de la bourgeoisie, et le chacun pour soi.
Le capitalisme "libéral" occidental a son tour dans la crise
Fondamentalement la crise en URSS est en dernier ressort l'expression de la crise économique généralisée du capitalisme, une des manifestations de la crise historique de ce dernier, de sa décomposition. Il ne peut y avoir de restructuration du capitalisme possible à l'Est, de la même manière qu'aucun "pays en voie de développement" n'a pu s'arracher du "sous-développement" depuis que la terminologie de "tiers-monde" a été inventée. Au contraire, la crise amène la perspective d'un effondrement mondial irréversible.
Depuis son ouverture à la fin des années 1960, la crise économique ouverte a entraîné :
- dans les années 1970-80 la chute inexorable des pays du "tiers-monde" dans le sous-développement et la misère la plus noire pour d'immenses masses de la population mondiale,
- à la fin des années 1980, la mort définitive du stalinisme, régime capitaliste hérité de la contre-révolution du "socialisme en un seul pays", plongeant à grande vitesse la majorité de la population des pays soi-disant "communistes" dans une aussi grande sinon pire situation de paupérisation absolue.
Au cours des années 1990 la crise va entraîner cette même paupérisation absolue au coeur du "premier-monde", dans les métropoles industrielles déjà rongées par vingt ans de croissance du chômage massif et de longue durée, d'augmentation de l'insécurité et de la précarité, à tous les niveaux de la vie sociale. Il n'y aura pas de "restructuration" du capitalisme, ni à l'Est, ni à l'Ouest.
MG, 3 juin 1990.
[1] [76] Voir les analyses développées sur l'analyse de l'effondrement du bloc russe et ses implications pour la situation mondiale dans la Revue internationale, n°60 et 61.
[2] [77] Voir le "La situation en Allemagne", dans ce numéro.
[3] [78] Certains milieux gouvernementaux russes ont envisagé un "moyen" pour renflouer les caisses de l'URSS : envoyer 16 millions d'immigrés soviétiques en Europe de l'ouest dans les années qui viennent, pour rapporter des devises...
[4] [79] Voir l'article "Face aux bouleversements de l'Est, une avant-garde en retard", dans ce numéro.
[5] [80] Le Point, 9-10 juin 1990.
[6] [81] Voir le "La situation en Allemagne", dans ce numéro.
[7] [82] Revue internationale, n°60, "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est", thèse 16.
[8] [83] Cf. "Lettre ouverte au Parti Ouvrier Polonais", K.Modzelewski et J.Kuron, 1968, supplément à Quatrième Internationale, mars 1968.
[9] [84] Voir l'article "La barbarie nationaliste", dans ce numéro.
Questions théoriques:
- L'économie [85]
Heritage de la Gauche Communiste:
Pays de l'Est : la barbarie nationaliste
- 3147 reads
Nous assistons dans toute l'Europe orientale et en URSS, à une violente explosion de nationalisme.
La Yougoslavie est en voie de désintégration. La "civilisée" et "européenne" Slovénie demande son indépendance et, en même temps, soumet les républiques "soeurs" de Serbie et de Croatie à un blocage économique rigoureux. En Serbie, le nationalisme encensé par le stalinien Milosevic a donné lieu à des pogroms, à l'empoisonnement des eaux, à la répression la plus brutale contre les minorités albanaises. En Croatie, les premières élections "démocratiques" donnent la victoire au CDC, groupe violemment revanchard et nationaliste. Un match de football du Dynamo de Zagreb contre un club de Belgrade (en Serbie) dégénère en affrontements violents.
Toute l'Europe de l'Est est secouée par des tensions nationalistes. En Roumanie une organisation para fasciste, Cuna Rumana, composée essentiellement d'éléments de l'ancienne Securitate et qui peut compter sur l'appui indirect des "libérateurs " du FSN, persécute les Hongrois et les passe à tabac. Ceux-ci, à leur tour, ont profité de la chute de Ceaucescu pour perpétrer des pogroms anti-Roumains. Pour sa part, le gouvernement central de Bucarest, enfant chéri des gouvernements "démocratiques", poursuit avec acharnement les minorités gitanes et d'origine allemande. La Hongrie, pionnier des changements "démocratiques", pratique une politique discriminatoire à l'égard des gitans, et encourage les revendications de la minorité hongroise en Transylvanie roumaine. En Bulgarie, le régime "démocratique" flambant neuf, cautionne grèves et manifestations massives contre les minorités turques. Dans la Tchécoslovaquie de la "révolution de velours", le gouvernement du "rêveur" Havel poursuit "démocratiquement" les gitans et une violente polémique, assaisonnée de manifestations et d'affrontements, s'est déclenchée entre Tchèques et Slovaques autour de la question transcendantale de savoir si le nom de la "nouvelle" République "libre" serait "Tchécoslovaquie" ou "Tchéco-Slovaquie"...
Mais c'est surtout en URSS que l'explosion nationaliste atteint des proportions qui mettent en question l'existence même de cet Etat, seconde puissance mondiale il y a encore six mois. Cette explosion y est particulièrement sanglante et chaotique.
Massacres d'Azéris par des Arméniens et d'Arméniens par des Azéris, Abkhazes victimes de Géorgiens, Turkmènes lynchés par des Ouzbéks, Russes passés à tabac par des Kazakhs... Entre temps, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Géorgie, l'Arménie, l’Azerbaïdjan, l'Ukraine, demandent l'indépendance.
L’explosion nationaliste : la décomposition capitaliste a vif
Pour les propagandistes de la bourgeoisie, ces mouvements seraient une "libération", produit de la "révolution démocratique" grâce à laquelle les peuples de l'Est se sont débarrassés du joug "communiste".
Si une "libération" a eu lieu c'est celle de la boîte de Pandore. L'effondrement du stalinisme a libéré les violentes tensions nationalistes, les fortes tendances centrifuges qui, avec la décadence du capitalisme, ont couvé, se sont radicalisées, approfondies dans ces pays, renforcées par leur arriération insurmontable et par la domination du stalinisme, expression et facteur actif de cette arriération ([1] [86]).
Le dénommé "ordre de Yalta", qui a dominé le monde pendant quarante-cinq ans, contenait ces énormes tensions et contradictions que la décadence du capitalisme faisait mûrir inexorablement vers l'holocauste total d'une troisième guerre impérialiste mondiale. La renaissance de la lutte prolétarienne depuis 1968 a bloqué ce cours "naturel" du capitalisme décadent. Mais étant donné que la lutte prolétarienne n'a pas été capable d'aller jusqu'à ses ultimes conséquences -l'offensive révolutionnaire internationale- les tendances centrifuges, les aberrations toujours plus destructrices propres à la décadence capitaliste, continuent de se manifester et de s'aggraver, donnant naissance à un pourrissement sur pied de l'ordre capitaliste, qui est ce que nous appelons, sa décomposition généralisée ([2] [87]).
Dans les anciens domaines de l'Ours Russe cette décomposition a "libéré" les pires sentiments de racisme, de revanchisme nationaliste, de chauvinisme, d'anti-sémitisme, de fanatisme patriotique et religieux... qui ont fini par s'exprimer avec toute leur fureur destructrice.
"Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est Ce n'est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit, c'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment" (Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie, Chap 1, p. 55).
D'habitude la bourgeoisie fait une distinction entre le nationalisme "sauvage", "fanatique", "agressif, et le nationalisme "démocratique", "civilisé", "respectueux des autres". Cette distinction est une pure supercherie, fruit de l'hypocrisie des grands Etats "démocratiques" occidentaux, dont la position de force permet d'utiliser avec plus d'intelligence et d'astuce la barbarie, la violence et la destruction inhérentes par principe à toute nation et à tout nationalisme dans le capitalisme décadent.
Le nationalisme "démocratique", "civilisé" et "pacifique" de la France, des USA et compagnie, est celui des massacres et des tortures au Viet-Nam, en Algérie, au Panama, en Centrafrique, au Tchad, c'est le nationalisme "démocratique" de l'appui non-dissimulé à l'Irak dans la guerre du Golfe. C'est celui des deux guerres mondiales qui ont fait plus de 70 millions de morts et dans lesquelles l'exaltation du patriotisme, de la xénophobie, du racisme, ont été la couverture idéologique d'actes de barbarie qui n'ont tien à envier à ceux des nazis : les bombardements américains de Dresde ou de Hiroshima et Nagasaki, ou les atrocités de la France à l'égard des populations allemandes dans sa zone d'occupation, tant après la première guerre mondiale qu'après la deuxième.
C'est la "civilisation" et le "pacifisme" de la "libération" française lors de la défaite des nazis : les forces "républicaines" de De Gaulle et le P "C" F encourageant conjointement à la délation, aux pogroms contre les Allemands : "A chacun son boche", était la consigne "civilisée" de la "France éternelle" incarnée par ces surenchérisseurs du nationalisme le plus hystérique et agressif qu'ont toujours été les staliniens.
C'est le cynisme hypocrite qui consiste à favoriser l'immigration illégale d'ouvriers africains pour avoir une main d'œuvre bon marché, soumise en permanence à l'intimidation et au chantage de la répression policière (qui suit les besoins de l'économie nationale, n'hésitant pas à renvoyer dans des conditions atroces des milliers de travailleurs immigrés dans leur pays d'origine) et qui exhibe en même temps, avec des larmes de crocodile, un "antiracisme" attendrissant.
C'est le pharisaïsme éhonté de Thatcher qui, tout en se disant "désolée et horrifiée" par la barbarie en Roumanie, renvoie au Viet-Nam 40 000 émigrants illégaux capturés brutalement par la police de Sa Majesté à Hong Kong.
Toute forme, toute expression de nationalisme, fût-il grand ou petit, porte obligatoirement et fatalement la marque de l'agression, de la guerre, du "tous contre tous", de l'exclusivisme et de la discrimination.
Dans la période ascendante du capitalisme, la formation de nouvelles nations constituait un progrès pour le développement des forces productives, en tant qu'étapes nécessaires à la constitution d'un marché mondial permettant leur extension et leur développement. Au 20e siècle, avec la décadence du capitalisme, éclate brutalement la contradiction entre le caractère mondial de la production et la nature inévitablement privée-nationale des rapports capitalistes. Dans cette contradiction, la nation, base de regroupement des bandes capitalistes dans la guerre à mort qu'elles se livrent pour le repartage d'un marché sursaturé, révèle son caractère réactionnaire, sa nature congénitale de force de division, d'entrave au développement des forces productives de l'humanité.
"D'un côté, la formation d'un marché mondial internationalise la vie économique, marquant profondément la vie des peuples ; mais d'un autre côté, cela produit la nationalisation, toujours plus accentuée, des intérêts capitalistes, ce qui traduit de la façon la plus manifeste l’anarchie de la concurrence capitaliste dans le cadre de l'économie mondiale et conduit à de violentes commotions et catastrophes, à une immense perte d'énergies, posant de façon impérieuse le problème de l'organisation de nouvelles formes de vie sociale. " (Boukharine, L'économie mondiale et l'impérialisme, 1916).
Tout nationalisme est impérialiste
Les trotskistes, extrême-gauche du capital, appuis "critiques" permanents de l'impérialisme russe, font une analyse "positive" de l'explosion nationaliste à l'Est ; ils y voient la mise en pratique du "droit à l'autodétermination des peuples", ce qui supposerait un coup porté contre l'impérialisme, une déstabilisation des blocs impérialistes.
Nous avons déjà argumenté amplement pour démontrer la supercherie du mot d'ordre d'"autodétermination des peuples", y compris dans la période d'ascendance du capitalisme ([3] [88]). Ici nous voulons démontrer que l'explosion nationaliste, si elle est une conséquence de l'effondrement du bloc impérialiste russe et s'inscrit dans un processus de déstabilisation des constellations impérialistes qui ont dominé le monde ces quarante dernières années ("l'ordre" de Yalta), elle n'implique aucune remise en cause de l'impérialisme et, ce qui de loin est le plus important, qu'un tel processus de décomposition n'apporte rien de favorable au prolétariat.
Toute mystification s'appuie, pour être efficace, sur des fausses vérités ou fies apparences de vérité. Ainsi, il est évident que le bloc impérialiste occidental voit avec embarras et préoccupation le processus actuel d'éclatement de l'URSS en mille morceaux. Mis à part les bravades propagandistes du genre "ne touchez pas à la Lituanie !" et les tapes sur l'épaule à Landsbergis et sa clique, son attitude face à l'indépendance de la Lituanie a été d'offrir un appui très peu dissimulé à Gorbatchev.
Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux n'ont, pour l'instant, aucun intérêt à l'éclatement de l'URSS. Ils savent qu'un tel éclatement donnera naissance à une énorme déstabilisation, avec des guerres civiles et nationalistes sauvages, où les arsenaux nucléaires accumulés par la Russie pourraient entrer en jeu. Par ailleurs, une déstabilisation des frontières actuelles de l'URSS aurait inévitablement des répercussions au Moyen-Orient et en Asie, libérant les tensions nationalistes, religieuses, ethniques, tout aussi énormes, qui y sont accumulées et contenues à grand peine.
Néanmoins, cette attitude, pour le moment unanime, des grandes puissances impérialistes de l'Occident est circonstancielle. Inévitablement, à mesure que s'aiguise le processus, déjà en cours, de dislocation du bloc occidental -dont le principal facteur de cohésion, l'unité contre le danger de l'Ours Russe, a disparu- chaque puissance commencera à jouer ses propres cartes impérialistes, attisant le feu de telle ou telle bande nationaliste, appuyant telle ou telle nation contre telle autre, soutenant telle ou telle indépendance nationale.
Dans ce sens, la spéculation grossière sur la déstabilisation de l'impérialisme est clairement démentie, mettant en évidence ce que les révolutionnaires défendent depuis la première guerre mondiale :
"Les 'luttes de libération nationale' sont des moments de la lutte à mort entre les puissances impérialistes, grandes et petites, pour acquérir un contrôle sur le marché mondial. Le slogan de 'soutien aux peuples en lutte' n'est en fait qu'un appel à défendre une puissance impérialiste contre une autre, tous un verbiage nationaliste ou 'socialiste’ ". (Principes de base du CCI).
Cependant, même en admettant que la phase actuelle de décomposition du capitalisme accentue l'expression anarchique et chaotique des appétits impérialistes de chaque nation aussi petite soit-elle, et qu'une telle "libre expression" tende à échapper toujours plus au contrôle des grandes puissances, cette réalité n'élimine pas l'impérialisme, ni les guerres impérialistes localisées, de même qu'elle ne les rend pas moins meurtrières. Bien au contraire, cette réalité avive les tensions impérialistes, les radicalise et aggrave leurs capacités de destruction.
Ce que tout cela démontre, c'est une autre position de classe des révolutionnaires : tout capital national, aussi petit soit-il, est impérialiste, et ne peut survivre sans recourir à une politique impérialiste. Cette position, nous l'avons défendue avec le maximum de fermeté face aux spéculations dans le milieu révolutionnaire, exprimées particulièrement par la CWO, selon laquelle les capitaux nationaux ne seraient pas tous impérialistes, ce qui donne prise à toutes sortes d'ambiguïtés dangereuses ; entre autres celle 4e réduire l'impérialisme, en dernière instance, à une "superstructure" propre à un groupe restreint de superpuissances, ce qui entraîne, qu'on le veuille ou non, que "l'indépendance nationale" des autres nations pourrait avoir quelque chose de "positif ([4] [89]).
Ce que l'époque actuelle de décomposition du capitalisme rend manifeste, c'est que toute nation, toute petite nationalité, tout groupe de gangsters capitalistes, qu'il ait pour domaine privé le territoire gigantesque des USA ou un minuscule quartier de Beyrouth, est nécessairement impérialiste ; son objectif, son mode de vie, c'est la rapine et la destruction.
Si la décomposition du capitalisme et, en conséquence, l'expression chaotique et incontrôlée de la barbarie impérialiste, résulte de la difficulté du prolétariat à hisser sa lutte au niveau requis par son propre être -l'être d'une classe internationale et par conséquent révolutionnaire-, logiquement, tout appui au nationalisme, même déguisé en "tactique marxiste" (le fameux "appui aux petites nations pour déstabiliser l'impérialisme" des trotskistes), éloigne le prolétariat de sa voie révolutionnaire et alimente le pourrissement du capitalisme, sa décomposition jusqu'à la destruction de l'humanité.
La seule attaque réelle, radicale, contre l’impérialisme, c'est la lutte révolutionnaire internationale du prolétariat, sa lutte autonome comme classe, dégagée et clairement opposée à tout terrain nationaliste, interclassiste.
La fausse communauté nationale
L'actuel "printemps des peuples" est perçu par les anarchistes comme une "confirmation" de leurs positions. Cela correspond à leur idée de la "fédération" des peuples regroupés librement en petites communautés selon des affinités de langue, de territoire, etc., ainsi qu'à leur autre idée, "l'autogestion", c'est-à-dire la décomposition de l'appareil économique en petites unités, supposées être ainsi plus accessibles au peuple.
La barbarie anarchique et chaotique de l'explosion nationaliste à l'Est confirme le caractère radicalement réactionnaire des positions anarchistes.
La décomposition en cours de vastes parties du monde, plongées dans un chaos terrible, confirme que "l'autogestion" est une façon pseudo-radicale, "assembléiste", de s'adapter à cette décomposition, et donc de la nourrir.
Si le capitalisme a apporté quelque chose à l'humanité c'est la tendance à la centralisation des forces productives à l'échelle de la planète, avec la formation d'un marché mondial. Ce que révèle la décadence du capitalisme, c'est une incapacité à aller plus loin dans un tel processus de centralisation et sa tendance inévitable à la destruction, à la dislocation.
"La réalité du capitalisme décadent, malgré les antagonismes impérialistes qui le font apparaître momentanément comme deux unités monolithiques opposées, c'est la tendance à la dislocation et à la désintégration de ses composantes. La tendance du capitalisme décadent c'est le schisme, le chaos, d'où la nécessité essentielle du socialisme qui veut réaliser l'unité du monde." (Internationalisme : "Rapport sur la situation internationale", 1945)
Ce que la décomposition du capitalisme met en évidence avec acuité c'est le développement de tendances croissantes à la dislocation, au chaos, à l'anarchie toujours plus incontrôlable dans des segments entiers du marché mondial.
Si les grandes nations constituaient au siècle dernier des unités économiques cohérentes, elles sont aujourd'hui un cadre trop étroit, un obstacle réactionnaire pour tout développement réel des forces productives, une source de concurrence destructive et de guerres ; la dislocation en petites nations accentue encore plus fortement ces tendances vers la distorsion et le chaos de l'économie mondiale.
D'autre part, dans cette époque de décomposition du capitalisme, l'absence de perspective pour la société, l'évidence du caractère destructeur et réactionnaire de l'ordre social régnant, entraînent une terrible absence de valeurs, de points de repère, d'objectifs crédibles pouvant soutenir la vie des individus. Cela augmente encore les tendances, que l'anarchisme stimule avec son mot d'ordre de "petites communes fédérées", à rester attaché à toute sorte de fausses communautés -comme la communauté nationale-, qui procurent une sensation illusoire de sécurité, de "soutien collectif".
Bien entendu, la clientèle privilégiée de telles manipulations sont les classes moyennes, petites-bourgeoises, marginalisées qui, faute de perspective et de cohésion comme classe, ont besoin de la fausse garantie de la "communauté nationale".
"Ecrasées matériellement, sans aucun avenir devant elles, végétant dans un présent aux horizons complètement bouchés, piétinant dans une médiocrité quotidienne sans bornes, elles sont dans leur désespoir la proie facile à toutes les mystifications, des plus pacifiques (sectes religieuses, naturistes, anti-violence, anti-bombe atomique, hippies, écologistes, antinucléaire, etc.) aux plus sanglantes (Cent-noirs, pogromistes, racistes, Ku-Klux-Klan, bandes fascistes, gangsters et mercenaires de tout acabit, etc.). C'est surtout dans ces dernières, les plus sanglantes, qu'elles trouvent la compensation d'une dignité illusoire à leur déchéance réelle que le développement du capitalisme accroît de jour en jour. C'est l'héroïsme de la lâcheté, le courage des poltrons, la gloire de la médiocrité sordide."
(Revue Internationale n° 14 : "Terreur, terrorisme et violence de classe", p. 7).
Dans les tueries nationalistes, dans les affrontements interethniques qui secouent l'Est, on voit la marque de ces masses petites-bourgeoises, désespérées par une situation qu'elles ne peuvent améliorer, avilies par la barbarie de l'ancien régime dans lequel elles ont souvent assumé les tâches les plus basses, prenant le parti de forces politiques bourgeoises, ouvertement réactionnaires.
Mais ce poids de la "communauté nationale" comme fausse communauté, comme racine illusoire, pèse aussi sur le prolétariat. Dans les pays de l'Est, la faiblesse du prolétariat, sa terrible arriération politique, produit de la barbarie stalinienne, ont déterminé son absence comme classe autonome dans les événements qui ont entraîné la chute des régimes du "socialisme réel", et cette absence a donné encore plus de force à l'action irrationnelle et réactionnaire des couches petites-bourgeoises ce qui a à son tour augmenté la vulnérabilité du prolétariat.
Ce que la classe ouvrière doit affirmer contre les illusions réactionnaires du nationalisme, propagées par la petite-bourgeoisie, c'est que la "communauté nationale" est le masque qui recouvre la domination de chaque Etat capitaliste.
La nation n'est pas le domaine souverain de tous ceux qui sont "nés sur la même terre", mais la propriété privée de l'ensemble des capitalistes qui organisent à partir de là, et à travers l'Etat national, l'exploitation des travailleurs et la défense de leurs intérêts face à la concurrence sans merci des autres Etats capitalistes.
"Etat capitaliste et nation sont deux concepts indissociables subordonnés l'un à l'autre. La nation sans l'Etat est aussi impossible que l'Etat sans la nation. En effet, cette dernière est le milieu social nécessaire pour mobiliser toutes les classes autour des intérêts de la bourgeoisie luttant pour la conquête du monde, mais comme expression des positions de la classe dominante, la nation ne peut avoir d'autre axe que l'appareil d'oppression de celle-ci : l'Etat." (Bilan, n° 14 : "Le problème des minorités nationales", p. 474).
La culture, la langue, l'histoire, le territoire communs, que les intellectuels et les plumitifs à la solde de l'Etat national présentent comme "le fondement" de la "communauté nationale", sont le produit de siècles d'exploitation, le sceau marqué du sang et du feu grâce auquel la bourgeoisie est parvenue à se doter d'une zone privée sur le marché mondial. "Pour les marxistes il n'existe véritablement aucun critère suffisant pour indiquer où commence et où finit une nation, un peuple et le droit, pour des minorités nationales, à s'ériger en nations... Ni du point de vue de la raison, ni de l'histoire, le conglomérat que représentent les Etats nationaux bourgeois ou les groupes nationaux, ne se justifient. Deux faits seulement animent la charlatanerie académique sur le nationalisme : la langue et le territoire communs, et ces deux éléments ont varié continuellement à travers des guerres et des conquêtes. (Bilan, idem p. 473).
La fausse communauté nationale est le masque de l'exploitation capitaliste, l'alibi de tout capital national pour embarquer ses "citoyens" dans les crimes que sont les guerres impérialistes, la justification pour demander aux ouvriers d'accepter les licenciements, les coupes dans les salaires, etc., "parce que l'économie nationale ne peut pas faire autrement", le prétexte pour les embarquer dans la bataille de la "compétitivité" avec les autres capitalismes nationaux ce qui, avec la même force, les sépare et les monte contre leurs frères de classe des autres pays, les condamne à de nouveaux sacrifices encore plus durs, à la misère et au chômage.
La seule communauté qui soit progressiste aujourd'hui est l'unification autonome de toute la classe ouvrière. 'Tour que les peuples puissent réellement s'unifier, leurs intérêts doivent être communs. Pour que leurs intérêts soient réellement communs, il est nécessaire d'abolir les rapports de propriété actuels, car ceux-ci conditionnent l'exploitation des peuples entre eux; l'abolition des rapports de propriété actuels est de l'intérêt exclusif de la classe ouvrière. Elle est aussi la seule qui possède les moyens de le faire. La victoire de la classe ouvrière sur la bourgeoisie c'est, en même temps, la victoire sur les conflits nationaux et industriels qui opposent aujourd'hui les divers peuples entre eux." (Karl Marx: "Discours sur la Pologne", 1847).
La lutte du prolétariat contient en germe la suppression des divisions d'ordre national, ethnique, religieux, linguistique, avec lesquelles le capitalisme -continuant l'oeuvre oppressive des modes de production antérieurs-, a tourmenté l'humanité. Dans le corps commun de la lutte unie pour les intérêts de classe, ces divisions disparaissent de manière naturelle et logique. La base commune ce sont les conditions d'exploitation qui tendent à empirer partout avec la crise mondiale ; l'intérêt commun c'est l'affirmation de ses besoins en tant qu'êtres humains contre les besoins inhumains, toujours plus despotiques, de la marchandise et de l'intérêt national.
Le but du prolétariat, le communisme, c'est-à-dire la communauté humaine mondiale, représente une centralisation et une unité nouvelles de l'humanité, à la hauteur du niveau atteint par les forces productives, capables de leur donner le cadre qui permettra leur vrai développement et leur pleine expansion. C'est l'unité de la centralisation consciente, basée sur les intérêts communs, permise par l'abolition des classes, de l'exploitation salariée et des frontières nationales.
"La communauté apparente que les individus avaient jusqu'alors constituée, prit toujours une existence indépendante vis-à-vis d'eux et, en même temps, du fait qu'elle représentait l'union d'une classe face à une autre, elle représentait non seulement une communauté tout à fait illusoire pour la classe dominée, mais aussi une nouvelle chaîne. Dans la communauté réelle, les individus acquièrent leur liberté simultanément à leur association, grâce à cette association et en elle."
(Marx, Engels, L'idéologie allemande, lre partie, "Communisme", Editions Sociales).
Adalen, 16 mai 1990
[1] [90] Voir dans la Revue Internationale, n° 60, "Thèses sur la crise économique et politique dans les pays de l'Est".
[2] [91] Voir "La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste", dans ce numéro.
[3] [92] Voir "Les révolutionnaires face à la question nationale", Revue Internationale, n° 34 et 42.
[4] [93] Voir "Sur l’impérialisme", Revue Internationale, n° 19
Géographique:
- Europe [94]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [1]
Questions théoriques:
- Décomposition [2]
Heritage de la Gauche Communiste:
La situation en Allemagne : Rapport sur la situation nationale de la section du CCI en Allemagne (mai 1990)
- 2705 reads
L'évolution des contradictions qui aujourd'hui se concentrent en Allemagne constitue une clé fondamentale de l'évolution de la situation mondiale. Nous publions ici un rapport de notre section dans ce pays qui en dégage la dynamique globale et les différentes hypothèses qu'elle ouvre.
Le
développement de l'économie allemande avant
l'union économique et monétaire
Alors qu'à la fin des années 1980, début des années 1990, l'économie mondiale rencontre des problèmes toujours plus grands, l'économie allemande est encore en plein boom. De nombreux records de production, en particulier dans le secteur automobile, ont été battus plusieurs années de suite. Un nouveau record a été atteint dans le surplus commercial en 1989. Le taux d'utilisation des capacités industrielles a atteint son plus haut point depuis le début des années 1970. Dans beaucoup de secteurs, le manque de main-d'oeuvre qualifiée a été le principal facteur empêchant l'expansion de la production, dans les derniers mois. De nombreuses entreprises ont dû refuser de nouvelles commandes à cause de cela.
Ce boom n'est pas l'expression de la santé de l'économie mondiale, mais de l'écrasante compétitivité du capital ouest-allemand, la loi de la survie du plus adapté. L'Allemagne s'est développée brutalement au détriment de ses concurrents, comme le montrent amplement ses excédents à l'exportation.
La position de l'Allemagne dans la compétition s'est notablement renforcée tout au long des années 1980. Au niveau économique, la tâche principale du gouvernement Kohl-Genscher a été de permettre une énorme augmentation des capitaux propres pour les grandes entreprises, afin de mettre en place une modernisation et une automatisation gigantesques du processus de production. Le résultat en a été une vague de "rationalisation" incroyable, comparable dans son étendue à celle qui a eu lieu en Allemagne dans les années 1920. Les axes principaux de cette politique étaient :
- plus de 100 milliards de marks économisés grâce à des réductions des dépenses sociales, et à peu près directement transférés dans les mains des capitalistes, via des réductions massives d'impôts ;
- une série de nouvelles lois qui ont été adoptées, autorisant les entreprises à accumuler d'énormes réserves complètement exonérées d'impôt - par exemple la création de compagnies d'assurance privées, à travers lesquelles les fonds d'investissement, en grande partie produit de gigantesques spéculations, s'accumulent.
Le résultat est qu'aujourd'hui, le grand capital "baigne dans l'argent". Tandis qu'au début des années 1980, environ 2/3 des investissements des plus grandes entreprises étaient financés par des emprunts bancaires, aujourd'hui, les 40 affaires les plus importantes sont capables de financer leurs investissements presque entièrement par leurs fonds propres - situation tout à fait unique en Europe.
En plus de ces moyens financiers, le gouvernement a considérablement accru le pouvoir des dirigeants d'entreprises sur leur force de travail : flexibilité, dérégulation, journée continue en échange d'une réduction minimum de la semaine de travail.
Il ne fait aucun doute que l'industrie allemande est profondément satisfaite du travail du gouvernement Kohl pendant les années 1980, à ce niveau. Au début de 1990, le porte-parole libéral des industriels, Lambsdorff, annonçait fièrement : "L'Allemagne de l'Ouest est aujourd'hui le leader mondial des pays industriels, et celle qui a le moins besoin de mesures protectionnistes ".
Par exemple, alors que tous les autres pays de la CEE ont pris des mesures protectionnistes radicales contre les importations de voitures japonaises, l'Allemagne a été capable de limiter le pourcentage japonais sur le marché allemand de l'automobile un peu au-dessus de 20 %, et en terme de valeur, elle exporte plus de voitures au Japon que le Japon n'en exporte en Allemagne.
Le plan de la bourgeoisie allemande pour les années 1990 avant l'effondrement de l'est
Malgré cette relative force, la vague de rationalisations des années 1980 était supposée n'être que le commencement. Face à une surproduction massive, à la perspective de la récession, à la banqueroute du tiers-monde et de l'Europe de l'est, il était clair que les années 1990 allaient être celles de la lutte pour la survie, et cela même pour les pays les plus industrialisés. Et cette survie ne pourrait se faire qu'aux dépens des autres rivaux industrialisés.
Face à ce défi, l'Allemagne de l'ouest est loin d'être aussi bien préparée qu'il peut paraître de prime abord.
- Le secteur de la production des moyens de production (machines, électronique, chimie) est terriblement fort. Dans la mesure ou l'Allemagne n'a jamais eu de marché colonial fermé, et où elle est un producteur classique de moyens de production, créant constamment sa propre concurrence, ce secteur a appris historiquement que la survie n'est possible qu'à la condition d'être toujours un pas en avance sur les autres.
- L'Allemagne a été, initialement, beaucoup plus lente que les USA, la Grande-Bretagne ou la France pour développer la production de masse de biens de consommation, et en particulier l'industrie automobile. Cela s'est fait essentiellement après la seconde guerre mondiale, avec l'ouverture du marché mondial aux exportations allemandes, tandis qu'en même temps l'Allemagne, tout comme le Japon, était exclue en grande partie du secteur militaire, ce qui lui a permis de rattraper son retard et de devenir un des leaders mondiaux dans l'automobile. Aujourd'hui, face à la surproduction absolue (on estime que l'industrie occidentale a, pour l'année 1990, une capacité de production excédentaire de 8 millions de voitures !) et, avec une concurrence internationale devenant de plus en plus intense dans ce domaine, la très grande dépendance de l'Allemagne vis-à-vis de l'industrie automobile (environ 1/3 des emplois industriels dépendent directement ou indirectement d'elle) ouvre aujourd'hui des perspectives réellement catastrophiques pour l'économie allemande.
- Le principal domaine dans lequel l'Allemagne a souffert de la défaite dans la deuxième guerre mondiale, c'est le secteur de la haute technologie, qui a été développé historiquement en lien avec le secteur militaire, et dont l'Allemagne a été largement exclue. Le résultat c'est qu'aujourd'hui, malgré son appareil productif hautement moderne, l'Allemagne a un retard massif vis-à-vis des USA mais aussi du Japon dans ce domaine.
La perspective des années 1990 était, par conséquent, de réduire radicalement la dépendance de l'économie allemande à l'égard de l'industrie automobile, non pas en abandonnant volontairement des parts de marché, bien sûr, mais en développant fortement le secteur de la haute technologie. En fait la bourgeoisie allemande est convaincue que dans les années 1990, soit elle fera une percée parmi les nations leaders de la haute technologie aux côtés des USA et du Japon, soit elle disparaîtra complètement comme puissance industrielle majeure indépendante. Cette lutte à mort a été préparée pendant les années 1980, non seulement par la rationalisation et l'accumulation d'énormes investissements, mais aussi par la constitution symbolique de la plus grande entreprise européenne de haute technologie, sous la direction de Daimler- Benz et de la Deutsche Bank. Daimler et Siemens sont supposés être les fers de lance de cette offensive. Cette tentative de l'industrie allemande vers l'hégémonie mondiale dans les années 1990 requiert :
- des investissements absolument gigantesques, laissant ceux des années 1980 loin derrière, et impliquant un transfert encore plus massif de revenus de la classe ouvrière vers la bourgeoisie ;
- l'existence d'une stabilité politique à la fois internationale ment (discipline du bloc US) et à l'intérieur, en particulier vis-à-vis de la classe ouvrière.
Effondrement de l'Est : les buts de guerre allemands finalement atteints.
Après la chute du mur de Berlin, le monde impérialiste a tremblé à la pensée d'une Allemagne unifiée plus grande. Non seulement à l'étranger, mais en Allemagne même, le SPD (social-démocratie), les syndicats, l'église, les médias, tous ont mis en garde contre un nouveau revanchisme allemand, danger apparemment présent avec les ambiguïtés de Kohl sur la frontière Oder-Neisse. De telles visions d'une nouvelle Allemagne mettant en cause les frontières de ses voisins, dans les traces d'Adolf Hitler, n'inquiètent pas vraiment la bourgeoisie allemande. En fait, ces mises en garde ne servent qu'à masquer l'état réel des affaires : à savoir qu'avec la course à l'Europe 92 et l'effondrement du bloc de l'Est, la bourgeoisie allemande a déjà atteint les objectifs qui ont été la cause de deux guerres mondiales. Aujourd'hui, la bourgeoisie allemande triomphante n'a absolument pas besoin de remettre en question une frontière quelconque pour être la puissance dominante en Europe. L'établissement d'une "Grossraumwirtschaft" (zone étendue d'économie et d'échange) dominée par l'Allemagne, en Europe de l'Ouest, et d'un réservoir de main-d'oeuvre bon marché et de matières premières en Europe de l'Est, lui aussi dominé par l'Allemagne, objectifs de l'impérialisme allemand, déjà formulés avant 1914, sont aujourd'hui pratiquement une réalité. C'est pourquoi tout le tapage autour de la frontière Oder-Neisse, ne sert en fait qu'à cacher la réelle victoire de l'impérialisme allemand aujourd'hui en Europe.
Mais une chose doit être claire: cette victoire de l'impérialisme allemand, dont le ministre libéral des affaires étrangères Genscher (et non les extrémistes de droite) est le meilleur représentant, n'implique pas que l'Allemagne puisse aujourd'hui dominer l'Europe de la façon dont Hitler envisageait de le faire. Il n'y a pas actuellement, de bloc européen constitué, et dirigé par l'Allemagne. Alors que dans les lre et 2e guerres mondiales, l'Allemagne se croyait assez forte pour dominer l'Europe de façon dictatoriale, cette illusion est impossible aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, l'Allemagne était le seul pays industriel important sur le contiennent européen (sans compter la Grande-Bretagne), ce n'est plus le cas aujourd'hui (France, Italie). L'unification allemande ne fera passer que de 21 % à 24 % le pourcentage de l'Allemagne dans la production de la CEE. Qui plus est, alors que la tentative allemande de domination de l'Europe, dans les lre et 2e guerres mondiales, n'était possible qu'avec l'isolationnisme des USA, aujourd'hui l'impérialisme US est massivement et immédiatement présent sur le vieux continent et sera très attentif à prévenir l'émergence de telles ambitions. Enfin, l'Allemagne est aujourd'hui trop faible militairement et ne possède pas d'armes de destruction massive. Pour toutes ces raisons, la formation d'un bloc européen n'est possible, dans les conditions présentes, que s'il y a une puissance assez forte pour soumettre toutes les autres. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
La victoire de l'Allemagne : victoire a la Pyrrhus
A la différence des années 1930, l'Allemagne d'aujourd'hui n'est pas la "nation prolétarienne" (formulation du KPD dans les années 1920 !), exclue du marché mondial et poussée à renverser les frontières tout autour d'elle. Aussi longtemps qu'elle n'est pas coupée du marché mondial et des fournitures de matières premières, la bourgeoisie allemande n'a absolument aucune ambition ni aucun intérêt à former un bloc militaire en opposition aux USA. En fait l'Allemagne aujourd'hui est, dans un certain sens, plutôt une puissance "conservatrice" qui a "obtenu ce qu'elle voulait" et qui est plus préoccupée de ne pas "perdre ce qu'elle a". Et c'est vrai : l'Allemagne est une puissance qui a tout à perdre dans le chaos et la décomposition actuels. Son souci principal aujourd'hui est d'éviter que sa victoire ne se transforme en catastrophe - une catastrophe qui est très probable.
Les coûts de l'unification
Ces coûts sont si gigantesques qu'ils mettent en danger la santé des finances de l'Etat, et la position immédiate de l'Allemagne dans la concurrence internationale. Il est plus que probable que les capitaux, qui vont être utilisés pour l'unification, sont ceux-là mêmes qui étaient prévus pour financer la fameuse percée sur le marché de la haute technologie, pour rejoindre les USA et le Japon. En d'autres termes, l'unification, loin d'être un renforcement à ce niveau, pourrait être, pour la bourgeoisie allemande, le facteur même de la destruction de ses espoirs de rester une des puissances industrielles dominantes dans le monde.
Les coûts de l'Europe de l'Est
De la même manière qu'elle essaiera d'ériger un nouveau "mur de Berlin" le long de la ligne "Oder-Neisse" pour contenir le chaos de l'Est, il est certain que l'Allemagne sera obligée d'investir dans les pays limitrophes afin de créer une sorte de "cordon sanitaire" contre la totale anarchie se développant plus à l'Est. Bien sûr, l'Allemagne va dominer et domine déjà les marchés de l'Europe de l'Est. Cependant, il est intéressant de noter que la bourgeoisie allemande, loin d'être triomphante à ce propos, lance aujourd'hui un cri d'alarme à propos des dangers que cela implique :
- danger que l'obligation d'investir à l'Est n'entraîne en permanence des pertes de marchés à l'Ouest, alors que ceux-ci sont beaucoup plus importants dans la mesure où ils paient comptant et sont beaucoup plus solvables ;
- danger d'une baisse de niveau technique de l'industrie allemande, dans la mesure où les marchandises que l'Europe de l'Est commandera seront plus simples et rudimentaires que celles exigées par le marché mondial.
Les coûts de la rupture du bloc US
Cela présente le danger, à long terme, de la désagrégation du marché mondial, jusqu'alors tenu par la discipline du bloc et surveillé militairement par les USA. Une telle éventualité serait un désastre pour l'Allemagne de l'ouest, en tant que nation leader à l'exportation, et en tant que puissance ayant été, avec le Japon la principale bénéficiaire industrielle de l'ordre d'après-guerre.
Les coûts de tout affaiblissement du Marché commun européen
Le marché européen, et surtout le projet de l'Europe 92, sont menacés aujourd'hui par la montée du "chacun pour soi", par la volonté d'éviter le partage des coûts liés à l'Europe de l'Est, par les réactions françaises à la perte du leadership conjoint avec l'Allemagne de l'ouest en Europe occidentale, leadership qui sera maintenant assuré par la seule Allemagne.
Si l'Europe de 92 (ce par quoi nous entendons l'établissement de normes pour la "libéralisation" des échanges, de règles pour régir la bataille de tous contre tous, favorisant toujours les plus forts, et non les irréalisables "Etats-Unis d'Europe") devait échouer, et si le marché européen devait se rompre, ce serait une catastrophe totale pour l'Allemagne de l'Ouest, dans la mesure où c'est là que se trouvent ses principaux marchés d'exportation. C'est donc une formulation incorrecte, souvent utilisée par la presse bourgeoise, de dire que Bonn, en menant la réunification rapidement, a mis en avant ses propres intérêts contre ceux de la CEE'. L'intérêt particulier de Bonn, c'est la CEE. Elle a été obligée de faire l'unification immédiatement du fait de l'incroyable accélération du chaos.
L'effondrement de l'Union Soviétique
Aussi longtemps que l'URSS tenait encore debout, l'Europe de l'Est était, d'une part, un territoire ennemi et une menace militaire pour l'Allemagne de l'ouest, mais d'autre part une garantie de voisinage stable à la frontière est de l'Allemagne. Le terrible chaos qui se développe aujourd'hui en URSS est une préoccupation majeure pour les USA, et extrêmement inquiétant pour la France et la Grande-Bretagne. Mais pour la bourgeoisie allemande, qui est juste à côté, c'est une vision de cauchemar absolu. Dans la nouvelle Allemagne unifiée, il n'y aura que la Pologne pour la séparer de l'URSS. Le Ministère des affaires étrangères de Genscher est hanté par la vision d'horreur de guerres civiles sanglantes, de monceaux d'armements et de centrales nucléaires explosant, de millions de réfugiés d'Union Soviétique déferlant à l'Ouest, menaçant de détruire complètement la stabilité politique de l'Allemagne. Mais si ce "scénario du pire" doit être évité, la bourgeoisie allemande devra accepter une responsabilité importante dans la tentative de limiter l'anarchie en Union Soviétique, ce qui représentera aussi une énorme charge économique. Par exemple : le gouvernement ouest-allemand s'est engagé à respecter et honorer tous les engagements de livraison passés entre l'Allemagne de l'est et l'Union Soviétique, promesse qui est d'inspiration politique et qui ne sera tenue qu'à contre-coeur. De la même manière que la rupture de la CEE signifierait l'annulation de la victoire des buts de guerre de l'impérialisme allemand (Grossraumwirtschaft), le déclenchement d'une totale anarchie en Union Soviétique détruirait le second plan, celui d'une Europe de l'est fournisseuse de matières premières bon marché. Ce serait pour le moins tragique pour le capitalisme allemand, dans la mesure où l'Union Soviétique est le seul réservoir disponible de matières premières qui ne viennent pas d'outre-mer, et ne dépend donc pas du bon vouloir des USA. Un exemple des effets de l'anarchie de l'Est sur les ambitions de l'impérialisme allemand : un des projets favoris de Gorbatchev est la création d'une zone industrielle exonérée d'impôts à Kaliningrad, qui est supposée devenir la nouvelle fenêtre de la Russie sur l'Ouest. Il a l'intention de transférer des Allemands de la Volga dans cette zone de l’ex-ville allemande de Königsberg, comme mesure incitatrice supplémentaire pour drainer les capitaux allemands. Kaliningrad est ainsi censée être une fenêtre allemande sur l'Est, c'est-à-dire sur une "voie sûre" pour les matières premières sibériennes, évitant les républiques asiatiques d'Union Soviétique. Aujourd'hui, le séparatisme et le mini-impérialisme des républiques de la Baltique sèment la pagaille dans ces plans. Landbergis a déjà laissé les Lituaniens revendiquer Kaliningrad.
Les mesures de la bourgeoisie allemande contre le chaos et la décomposition
Au vu de l'effrayante accélération de la crise, des guerres économiques, de la décomposition, de l'effondrement de l'Est, il y a un réel danger :
- que le combat de la bourgeoisie allemande en vue de se frayer un passage dans la lutte pour l'hégémonie sur le marché mondial contre les USA et le Japon, ait lieu dans des conditions beaucoup moins favorables ;
- que l'Allemagne perde complètement sa place privilégiée de "surfer" sur la vague de la crise au détriment de ses rivaux. Au contraire, le danger est réel que la position de l'Allemagne devienne même particulièrement fragile, comme c'était le cas dans les années 1930, mais cette fois face à une classe ouvrière non défaite ;
- que la fameuse stabilité politique allemande puisse être ruinée par la décomposition et le chaos mondiaux.
La tendance à la ruine économique totale et au chaos complet est historiquement irréversible. Néanmoins, toute tendance a des contre-tendances, qui dans ce cas n'arrêteront pas, mais pourront ralentir ou de toute façon influencer, le cours de ce mouvement à certains moments, ce qui fait qu'il ne se développera pas de la même manière dans tous les pays. En particulier, il est nécessaire d'examiner les mesures que la bourgeoisie allemande est en train de prendre pour se protéger. La bourgeoisie allemande n'est pas seulement la plus puissante en Europe au plan économique, et l'une des plus riches d'amères expériences, mais elle a aussi les structures politiques et étatiques les plus modernes (par exemple, la modernité politique de l'Etat allemand en comparaison du britannique est aussi marquée que leur différence au niveau économique). La bourgeoisie allemande a été capable de combiner ses "qualités traditionnelles" et tout ce qu'elle a appris de son mentor américain à la fin des années 1940 (l'Allemagne de l'ouest est dans beaucoup de domaines, sans aucun doute, le plus "américanisé" des pays européens).
Faire l'unification au meilleur coût
A travers l'union monétaire, Bonn envisage de donner aux Allemands de l'est de l'argent de l'Ouest, mais aussi peu que possible, et par là d'avoir la justification politique pour arrêter leur venue à l'Ouest. Le but est de faire porter, le plus possible, la charge de l'unification à la RDA elle-même, à la CEE, et surtout (nous reviendrons sur ce point), à la classe ouvrière de l'Est et de l'Ouest. Par ailleurs, la bourgeoisie ouest-allemande s'efforce de conserver exclusivement pour elle les aspects bénéfiques de cette unification, c'est-à-dire, des sources de force de travail incroyablement bon marché grâce auxquelles elle pourra aussi exercer des pressions sur les salaires de l'Ouest, ou l'accès aux matières premières soviétiques et à la technologie spatiale par les liens historiques avec les entreprises est-allemandes.
Eviter la désagrégation de la CEE
S'il y a une tendance dans cette direction, il y a aussi d'importantes contre-tendances. Parmi ces contre-tendances :
- l'intérêt impérieux de l'Allemagne elle-même d'éviter cela ;
- l'intérêt des autres pays européens qui sont terrifiés par le risque d'être dépassés par le Japon. Même s'il est vrai que la tendance est aujourd'hui au "chacun pour soi", les gangsters tendent malgré tout à se regrouper pour affronter d'autres gangsters.
L'Europe 92 n'est pas un nouveau bloc contre les USA. Et elle n'a probablement aucune chance de le devenir si les Américains décident de la saboter. Bonn est actuellement en train d'essayer de convaincre Washington que l'Europe 92 est essentiellement dirigée contre le Japon, et non contre les USA. La bourgeoisie ouest-allemande est convaincue que l'une des bases principales de la terrible compétitivité japonaise sur le marché mondial, est la fermeture complète du marché intérieur japonais, et que les prix élevés à l'intérieur du Japon financent leur dumping sur le marché mondial. Bonn proclame que si le Japon est contraint, par des mesures protectionnistes, de construire des usines en Europe, celles-ci ne sont pas plus compétitives que les européennes, ou au moins que les allemandes. Le message est clair : si l'Europe 92 peut servir à obliger le Japon à ouvrir son marché intérieur, il est possible de vaincre le géant asiatique. De plus, Bonn souligne sans cesse que le marché européen, qui sera alors le plus grand marché unifié du monde, est le seul moyen grâce auquel les USA peuvent combler leur gigantesque déficit commercial, c'est-à-dire que Bonn propose un partage germano-américain du marché européen.
Avant les 1e et 2e guerres mondiales, les marxistes ont alerté la classe ouvrière à propos des massacres à venir, et ont exprimé quelle attitude le prolétariat devrait prendre à ce propos. Aujourd'hui, notre tâche est d'alerter les ouvriers contre la guerre mondiale commerciale qui vient de se déclencher à une échelle sans précédent dans l'histoire, et de les armer contre le danger mortel du nationalisme économique, c'est-à-dire de prendre partie pour leur propre bourgeoisie. Le coût de cette guerre pour la classe ouvrière sera réellement horrible.
L’unification allemande et la possibilité d'une brutale récession
Jusqu'à maintenant nous avons montré les énormes implications du chaos et de la décomposition actuels pour le capital allemand dans la perspective des années 1990. Mais il y a aussi une perspective immédiate, celle des effets de l'union économique et monétaire notamment. Ces effets vont être catastrophiques en particulier pour la classe ouvrière, et spécialement celle de RDA.
Il est difficile de prédire l'issue immédiate de cette affaire, dans la mesure ou c'est une situation inédite dans l'histoire. Mais il y a une possibilité que cela puisse freiner temporairement la tendance de l'économie mondiale à la récession ouverte, au prix de la ruine des finances d'Etat de l'Allemagne, et en aiguisant encore plus les contradictions globales. L'autre possibilité que nous ne devons pas exclure, au vu de la grande fragilité de la conjoncture économique mondiale actuelle, est que les désordres monétaires et des taux d'intérêt, la panique de l'investissement et des bourses qui pourraient survenir soient la goutte d'eau qui fait déborder le vase, plongeant l'économie mondiale dans la récession ouverte.
Ce qu'on peut avancer avec certitude, c'est que l'arrivée du Deutsche Mark en Allemagne de l'est va provoquer des millions de licenciements et une explosion de paupérisation de masse qui, dans leur soudaineté et leur brutalité, seront, peut-être, sans précédent dans un pays industrialisé dans l'histoire du capitalisme, en dehors d'une période de guerre. Il est vrai également que le coût incalculable de ces mesures drastiques ne peut être assuré sans pressurer les ouvriers d'Allemagne de l'ouest... Les systèmes de chômage et de sécurité sociale de l'Ouest, par exemple, vont être amenés au bord de l'insolvabilité, dans la mesure où il leur faudra financer ce qui se passe à l'Est. Qui plus est, il n'y a absolument aucune garantie que le principal but politique immédiat de l'union monétaire - éviter la venue des Allemands de l'Est à l'Ouest - soit un succès. Et encore, le dilemme de la bourgeoisie ouest-allemande face à un monde capitaliste qui s'effondre est mis en évidence par le fait que les effets économiques de la non-réalisation immédiate de l'unification seraient certainement encore plus désastreux. Lambsdorff ne plaisantait pas quand il déclarait récemment que si des élections ne se tenaient pas rapidement dans toute l'Allemagne, non seulement l'Allemagne de l'est mais aussi celle de l'ouest se trouveraient bientôt en faillite. (Il faisait référence à la survivance de la bourgeoisie stalinienne d'Allemagne de l'est, qui rêve maintenant de continuer ses 40 ans de mauvaise gestion, mais cette fois directement financée par l'Ouest).
Le désarroi de la bourgeoisie après la chute du mur
Quand le mur est tombé, la bourgeoisie s'est trouvée déroutée, surprise et divisée. Il y a eu un enchaînement de crises politiques :
- Genscher appuyait, de façon originale, l'appartenance rapide mais séparée de la RDA à la CEE, avec seulement des liens fédératifs avec l'Allemagne de l'ouest ;
- Brandt devait se battre en coulisses pour amener le SPD sur la position de la réunification ;
- une coalition régionale et communale SPD-CDU a été nécessaire pour obliger Kohl à mettre un terme aux lois incitant l'émigration de l'Est, lois utiles pendant la guerre froide, mais conduisant aujourd'hui au désastre ;
- Bonn a été obligé de supporter à la fois les gouvernements de Krenz et de Modrow, aussi longtemps que le vide du pouvoir ne pouvait être comblé ;
- Bonn a dû changer sa politique initiale d'aide économique hésitante, pour celle de l'union monétaire immédiate et de l'unification accélérée ;
- la lutte de l'appareil d'Etat stalinien de RDA pour une place dans la nouvelle Allemagne a causé une série de crises, depuis l'aggravation de l'immigration vers l'Ouest, jusqu'aux chantages sur des leaders politiques (pas seulement de l'Est) exercés par la Stasi (police d'Etat-Staatssicherheit) ;
- les manoeuvres de Kohl sur la frontière Oder-Neisse ont causé des crises internes et des scandales internationaux.
Offensive de stabilisation vers l'unité nationale
Le premier axe de l'offensive de restabilisation a été le rétablissement de l'unité des courants bourgeois dominants. En dépit de tous les conflits et du chaos, très rapidement le sentiment s'est développé que cette sorte de crise historique nécessitait un certain type d'unité nationale. Aujourd'hui il y a un réel accord entre la CDU, le FDP et le SPD sur les problèmes fondamentaux soulevés par l'ouverture du mur : unification rapide, union monétaire immédiate (soutenue politiquement, même par la Bundesbank, bien qu'elle la considère comme suicidaire au plan économique), politique anti-immigration à l'égard de l'Est, maintien au sein de POTAN (qui sera étendue par étapes à la RDA), reconnaissance de la frontière Oder-Neisse.
Deuxième phase d'instabilité : la digestion de la RDA
L'autre axe de la "stabilisation" ne fait que déplacer le chaos d'un niveau à un autre. L'unification précipitée n'est pas possible sans un certain niveau de chaos. Elle provoque des conflits avec les grandes puissances et menace de déstabiliser encore plus l'URSS. Et l'union monétaire est une des politiques les plus aventuristes de l'histoire humaine, peut-être comparable à l'offensive "Barberousse" de Hitler contre la Russie. Le massacre économique de l'industrie de la RDA va être si sanglant, le chômage massif si élevé (certains parlent de 4 millions de chômeurs), que cela pourrait même manquer totalement son but immédiat - celui de stopper l'immigration massive vers l'Ouest. Le remède contre le chaos mènera probablement... au chaos.
Malgré l'opposition directe, en particulier des "grandes puissances" européennes, à la perspective de l'unification immédiate de l'Allemagne après l'ouverture du mur de Berlin, ce processus a aussi été accéléré dans le même temps, en particulier avec le soutien des Etats-Unis (dont la formule de l'appartenance d'une Allemagne unie à l'OTAN sert surtout à maintenir la présence américaine en Allemagne et en Europe, aux dépens non seulement de l'Allemagne, mais aussi de la Grande-Bretagne, de la France, et de l'URSS), et même au risque d'une plus grande déstabilisation du régime de Gorbatchev et de l'URSS. Deux raisons à cela :
- toutes les puissances majeures sont effrayées par le vide créé en Europe centrale, vide que seule l'Allemagne peut combler ;
- c'est l'effondrement de l'URSS qui fait automatiquement de l'Allemagne la puissance dirigeante de l'Europe, qui amène la disparition de l'impératif, pour Bonn, de partager la direction de l'Europe de l'ouest avec Paris, etc. Au contraire, il est peu probable, et pas prouvé, que l'actuelle unification allemande conduise au renforcement de l'Allemagne comme puissance majeure. Economiquement, l'unification est à coup sûr un affaiblissement, et tous les avantages stratégico-militaires seront probablement plus que contrebalancés par les effets du chaos de l'Est. C'est la compréhension du fait que l'unification ne signifie pas du tout automatiquement un renforcement de l'Allemagne qui a permis de la rendre acceptable pour ses "alliés".
Chronologiquement parlant :
- Après l'ouverture du mur, il y a eu une explosion nationaliste au sein de la bourgeoisie allemande, de Kohl à Brandt. "Nous autres, Allemands, sommes les meilleurs" etc., en dépit des mises en garde immédiates des plus modérées (par exemple Lafontaine). La panique, l'effroi et la jalousie parmi les "alliés" a été symbolisée par l'opposition ouverte à l'unification, et la visite-éclair de Mitterrand à Berlin-Est et Budapest, pour s'assurer que la France aurait un morceau de ce gâteau, était typique.
- La bourgeoisie s'est réveillée de ses stupides illusions. Plus Bonn réalise clairement que "le gâteau est empoisonné", plus la bourgeoisie allemande est obligée de le manger rapidement, du fait du développement du chaos. Maintenant c'est Bonn qui panique et qui est rendue furieuse par la nouvelle attitude des alliés, qui laissent l'Allemagne de l'ouest seule avec les problèmes et surtout avec le coût de cette pagaille.
- Bonn a réussi à convaincre les autres qu'elle ne peut pas se charger seule du problème et que s'ils ne participent pas activement, le résultat pourrait être la déstabilisation de toute l'Europe de l'ouest.
Les élections à venir ; une tentative de mettre en place des structures de stabilisation
En novembre 1989, nous avions noté que dans la nouvelle situation, la présence du SPD dans l'opposition, afin de mieux contrôler la classe ouvrière, n'est plus une obligation pour la bourgeoisie, du fait du recul de la conscience de classe provoquée par les événements à l'Est, et que la continuation du gouvernement Kohl-Genscher dépend du dépassement de leurs divergences. A présent, il semble que de telles divergences ne seront plus au coeur des élections (hormis l'extension de la stabilité, c'est-à-dire l'application des structures politiques de l'Allemagne de l'ouest à la RDA). La CDU reste légèrement plus forte que le SPD dans une Allemagne unie, le FDP reste le "faiseur de coalition", les "Républicains" sont maintenus hors du Parlement. Il n'y a pas de raison de penser qu'un gouvernement dirigé par Lafontaine serait fondamentalement différent de l'actuel.
Un problème qui se pose est celui des tensions et des confusions au sein de l'appareil politique :
- rivalités entre CDU et CSU concernant l'influence en RDA;
- rivalités entre le SPD et les staliniens pour le contrôle des syndicats en RDA ;
- divergences aiguës au sein des Verts sur l'unification ;
- désorientation chez les gauchistes, dont la plupart s'accrochent à l'Etat de RDA et au PDS (ex-SED) dont personne ne veut plus, ni à l'Est (à part les principaux fonctionnaires staliniens), ni à l'Ouest.
Aussi importantes que soient les tentatives de stabilisation, de nouvelles vagues d'anarchie sont déjà à l'horizon :
- l'effondrement définitif de l'URSS ;
- la crise économique mondiale (après l'URSS, les USA sont probablement le prochain gros bateau qui va faire naufrage) ;
- les tensions au sein de l'OTAN.
Lutte de classes : la combativité de la classe reste intacte
Il est évident que l'Allemagne n'est pas une exception dans le reflux, en particulier de la conscience, au sein de la classe ouvrière. Au contraire :
- le reflux a commencé en Allemagne plus tôt qu'ailleurs, dès 1988-89, et déjà, essentiellement, du fait de la situation à l'Est:
- les propositions de réductions d'armement par Moscou ont provoqué des illusions réformistes à propos d'un capitalisme plus pacifique ;
- l'afflux, en provenance de l'Est, de près d'un million de personnes par an ;
- l'énorme battage à propos de la "faillite du communisme", dès les massacres de Pékin ;
- un impact plus profond, du fait de la proximité de l'Est, des illusions démocratiques, réformistes, pacifistes, et inter-classistes qui y sont encore plus importantes que partout ailleurs. Les questions de l'unification des luttes et de la contestation des syndicats, bien qu'elles aient déjà été posées par les luttes à Krupp en décembre 1987, étaient par avance posées moins fortement qu'ailleurs, et elles sont donc aujourd'hui plus affaiblies.
D'autre part, la combativité, après avoir souffert d'une paralysie momentanée sous l'impact de l'immigration de l'Est, au lieu de reculer encore, après l'ouverture du mur, comme on aurait pu s'y attendre, a réellement commencé à reprendre (comme l'ont montré récemment les débrayages symboliques pendant les négociations syndicales). L'absence du moindre indice, pour le moment, indiquant que les ouvriers d'Allemagne de l'ouest soient prêts à de quelconques sacrifices matériels pour l'unification, est le problème central de la bourgeoisie. Cette idée même semble chasser les derniers vestiges de patriotisme de la tête de nombreux ouvriers
Crise et unification : bilan des années 1980
La crise joue un rôle essentiel pour l'unification, même quand la bourgeoisie parvient à éviter la concrétisation de cette dernière dans les luttes. L'apparition, au début des années 1980, du chômage de masse, de la "nouvelle pauvreté" au milieu de ces années, et de la dramatique crise du logement datant de l'après-guerre, et se révélant à la fin de ces années, tout cela a puissamment accru le potentiel de l'unification. Mais ce développement est contradictoire et non-linéaire.
L'offensive de modernisation des années 1980, l'attaque la plus forte en Allemagne depuis les années 1920, a partiellement transformé le monde du travail. L'ouvrier industriel moderne, contrôlant souvent plusieurs machines à la fois, est confronté à de telles exigences meurtrières, en énergie, en concentration, en qualification et requalification permanente, etc., qu'une part croissante de la population est automatiquement exclue du processus de production (trop vieux, trop malade, pas assez fort mentalement pour supporter la pression, pas assez qualifié, etc.).
Cela explique en grande partie le paradoxe d'avoir, d'un côté, le chômage de masse, et simultanément des centaines et des milliers d'emplois vacants dans les secteurs qualifiés. L'anarchie est totale. Des millions d'ouvriers sont au chômage, pas seulement parce qu'il n'y a pas d'emplois, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux incroyables exigences actuelles. Cette masse toujours croissante n'est plus utile au capital comme moyen de pression sur les salaires et sur ceux qui ont encore un emploi, il n'y a donc pas de raison économique de les garder en vie. Aussi, les mesures les plus radicales ont été appliquées dans ce secteur ; c'est pourquoi, dans les années 1980, Bonn a arrêté la construction de logements sociaux.
Les effets immédiats de l'offensive de rationalisation-modernisation du capital allemand n'ont pas eu que des effets positifs sur l'unification des luttes. Ils ont aussi impliqué une certaine tendance à diviser les ouvriers entre :
- ceux qui peuvent encore répondre aux impératifs actuels de la production, et qui, malgré le contrôle des salaires, ont plus de revenus aujourd'hui qu'il y a cinq ans, du fait des heures supplémentaires innombrables (cela vaut probablement pour la majorité des ouvriers). Ceux-là pensent que, du fait du manque actuel de main-d'oeuvre qualifiée, le capital a besoin d'eux: ce qui favorise les illusions individualistes et corporatistes ("nous sommes assez forts tous seuls" ;
- ceux qui ne peuvent pas répondre à ces impératifs, qui sont sans cesse plus marginalisés et exclus de la production, qui tombent dans une pauvreté croissante, et sont souvent les premières victimes de la décomposition sociale (désespoir, drogues, explosions de violence aveugle ; par exemple Kreuzberg à Berlin), et qui se sentent isolés du reste de leur classe. En rapport avec cela (mais non identique), nous devons voir l'échec des luttes de chômeurs, et de leur lien avec les ouvriers actifs.
La crise et l'unification en perspective
Parmi les effets les plus immédiats du changement historique, il y a :
- les illusions sur un boom durant des années, du fait de :
. l'Europe de l'est,
. l'Europe 92,
. une "prime de paix", liée à une réduction radicale des dépenses militaires.
- la peur d'un nouvel appauvrissement, à cause de l'unification, cela n'ayant pas seulement des effets de radicalisation, mais aussi des tendances à la division de la classe (Ouest contre Est) ; ([1] [95])
- l'union monétaire doublera en fin de compte le nombre des chômeurs en Allemagne ;
- un véritable massacre d'emplois semble inévitable dans les secteurs où la surproduction est la plus importante, en particulier dans l'automobile ;
- le coût des années 1990, les énormes programmes d'investissement, l'annulation des dettes impayables de pays de la périphérie, etc., tout cela exigera des transferts de richesse encore plus importants du prolétariat vers le capital ;
- si la "rationalisation" continue au rythme actuel, vers le milieu des années 1990, des millions d'ouvriers seront confrontés à l'épuisement total et à une usure complète avant l'âge de 40 ans. Des forces essentielles de la classe seraient menacées.
Les principales difficultés pour l'unification politique de la classe
Le renforcement de la social-démocratie, des syndicats, de l'idéologie réformiste, du pacifisme, de l'inter-classisme, cela ne peut être dépassé facilement, ni rapidement ou automatiquement, mais requiert :
- l'engagement dans des luttes répétées ;
- la mobilisation et la discussion collectives ;
- l'intervention communiste.
Les leçons des 20 dernières années de crise et de luttes n'ont pas disparu, mais ont été rendues moins accessibles, enfouies sous un amas de confusions. Il n'y a pas de place pour la complaisance, le trésor doit être ramené à la surface, sinon la classe échouera dans sa tâche historique.
LE RETARD DU PROLETARIAT DE RDA
Bien que la RDA ait fait partie de l'Allemagne jusqu'en 1945, les effets du stalinisme ont été profondément catastrophiques pour la classe ouvrière. Il y a un retard fondamental qui va plus loin encore que le manque d'expérience sur la démocratie, les syndicats "libres", la haine virulente du "communisme". L'isolement derrière le mur a conduit les ouvriers à une véritable provincialisation. L'"économie de pénurie" les a amenés à voir les étrangers comme des ennemis qui "achètent tout et nous laissent sans rien". L'"internationalisme" soviétique et l'isolement du marché mondial ont encouragé un puissant nationalisme. Alors qu'en Allemagne de l'ouest un ouvrier sur dix, peut-être, est raciste, en RDA un sur dix n'est pas raciste. L'économie de commandement a conduit à une perte de dynamisme et d'initiative, à l'apathie et à la passivité, à l'incessante "attente des ordres", à une certaine servilité (pas même atténuée par un marché noir florissant, comme en Pologne). Et le retard technique : la plupart des ouvriers n'ont même pas l'habitude d'utiliser le téléphone. Le stalinisme laisse la classe profondément divisée par le nationalisme, les questions ethniques, les conflits religieux, la délation (probablement un ouvrier sur cinq informait régulièrement la Stasi sur ses collègues).
Nous pouvons nous réjouir de ce que, quand l'Allemagne a été divisée après la guerre, 63 millions de personnes se soient trouvées à l'Ouest et seulement 17 millions à l'Est, et pas l'inverse.
Le rôle crucial des ouvriers de l'Ouest ; l'alternative historique est encore ouverte
L'immense vague nationaliste réactionnaire venue de l'Est s'est brisée, jusqu'à maintenant, sur le rocher du prolétariat d'Allemagne de l'ouest. Nous n'entendons pas dire par là, que la contre-révolution a obtenu, à l'Est, une victoire irréversible. Mais s'il est encore possible qu'ils participent à des mouvements révolutionnaires dans le futur, c'est parce que les ouvriers de l'Ouest n'ont pas été entraînés sur le même terrain bourgeois qui, à l'Est, est aujourd'hui aussi efficace qu'il l'était en Espagne pendant la guerre civile. La classe ouvrière d'Allemagne de l'ouest a montré qu'elle n'a pas, pour le moment, les mêmes penchants au nationalisme.
L'ouvrier ouest-allemand typique associe aujourd'hui le nationalisme avec les défaites dans les guerres mondiales et avec la plus terrible pauvreté, et, au contraire, assimile une certaine prospérité à la CEE, au marché mondial, etc. Un emploi industriel sur deux en Allemagne, dépend du marché mondial. Et même l'immigration massive venant de l'Est n'a eu des effets de division importants que sur les secteurs faibles, et non sur les "bataillons" principaux de la classe. Le prolétariat reste une force décisive dans la situation mondiale. Par exemple, si la bourgeoisie allemande, malgré le coût incroyable de l'unification, la lutte sur le marché mondial, etc., devait s'engager dans une course pour le réarmement pour devenir une superpuissance militaire, le prix en serait tellement élevé, que cela conduirait probablement à la guerre civile. La classe ouvrière dans les pays industriels de l'Ouest reste invaincue, elle demeure une force avec laquelle la bourgeoisie doit compter en permanence
Nous ne savons pas avec certitude si la classe peut sortir des difficultés présentes et rétablir sa propre perspective de classe. Et nous ne pouvons pas même nous consoler avec l'illusion déterministe selon laquelle "le communisme est inévitable". Cependant nous savons que le prolétariat, aujourd'hui, n'a pas que ses chaînes à perdre, mais son existence-même. Par contre il a toujours un monde à gagner, et pour ce faire, Il n'est pas encore trop tard.
Weltrevolution, 8 mai 1990
[1] [96] L'économie ne constitue pas automatiquement et immédiatement un antidote au reflux sur la question de l'unification des luttes. Mais à long terme, la récession est une force puissante pour l'unification. Cependant la situation du capital mondial est désastreuse même sans récession ouverte.
Géographique:
- Allemagne [97]
Questions théoriques:
- L'économie [85]
- Décadence [31]
Polémique : Face aux bouleversements à l'Est, une avant-garde en retard
- 2915 reads
L'effondrement du bloc de l'Est est l'événement historique le plus important :
- depuis les accords de Yalta en 1945, qui établissaient la division et le partage du monde entre deux blocs impérialistes antagonistes dominés respectivement par les USA et l'URSS ;
- depuis la reprise de la lutte de classe à partir de 1968, mettant fin aux noires années de la contre-révolution qui régnait depuis la fin des années 1920.
Un événement d'une telle importance est une épreuve, un test déterminant, pour les organisations révolutionnaires et le milieu prolétarien dans son ensemble. Il n'est pas un simple révélateur de la clarté ou de la confusion des organisations politiques, il a des implications extrêmement concrètes. De leur capacité à y répondre clairement dépend non seulement leur propre avenir politique mais aussi la capacité de la classe à s'orienter dans la tempête de l'histoire.
L'activité des révolutionnaires n'est pas gratuite, elle a des conséquences pratiques pour la vie de la classe. La capacité de développer une intervention claire contribue au renforcement de la conscience dans la classe, et l'inverse aussi est vrai, l'impuissance à intervenir, la confusion des organisations prolétariennes, constituent des entraves à la dynamique révolutionnaire dont la classe est porteuse.
Face au séisme économique, politique et social qui ravage les pays du pacte de Varsovie depuis l'été 1989, comment le milieu politique prolétarien et les organisations révolutionnaires qui le constituent ont réagi ? Comment les événements ont été compris ? Quelle intervention a été faite ? Ce ne sont pas là des questions secondaires et des prétextes à des polémiques stériles, ce sont des questions essentielles qui influencent très concrètement les perspectives du futur.
Le retard du milieu politique face à de l'importance des événements [1] [98]
Le PCI, Battaglia Comunista commence une prise de position évolutive durant l'automne 1989, mais il faut attendre la nouvelle année pour que paraissent les premières prises de position de la CWO, du PCI-Programme Communiste, Le prolétaire, et du FOR, fin février 1990, paraissent deux textes de débat interne de la FECCI sur la situation dans les pays de l'Est, mais il faudra attendre avril pour voir paraître sa publication : Perspective internationaliste, n° 16, datée de l'hiver ! Avec le printemps, les petites sectes retrouvent un peu de vigueur et publient enfin des prises de position. Communisme ou civilisation, Union prolétarienne, le GCI, Mouvement communiste pour la formation du parti mondial, sortent de leur léthargie. De longs mois se sont écoulés jusqu'à la fin de l'année 1989 durant lesquels, en dehors des prises de position du CCI, les prolétaires désireux de se clarifier et de connaître le point de vue des groupes révolutionnaires n'avaient à se mettre sous la dent qu'un maigre numéro de BC et du Prolétaire. Lorsque le CCI publie dans la Revue internationale n° 61, une polémique écrite fin février [2] [99], celle-ci ne peut traiter que des positions de trois organisations: le BIPR qui regroupe la CWO et BC, le PCI Le prolétaire et le FOR, pourtant, six mois se sont écoulés depuis les premiers événements marquants et significatifs.
Certes, l'effondrement d'un bloc impérialiste sous les coups de la crise économique mondiale n'a pas de précédent dans l'histoire du capitalisme, la situation est historiquement nouvelle, et donc difficile à analyser. Cependant, indépendamment même du contenu des positions développées, ce retard traduit avant tout une incroyable sous-estimation de l'importance des événements et du rôle des révolutionnaires. La passivité des organisations politiques qui environnent le CCI face à l'implosion du bloc de l'Est et aux interrogations nécessaires qu'un tel fait soulève au sein de la classe ouvrière en dit long sur l'état de décrépitude politique dans lequel elles s'enfoncent.
Ce n'est certes pas un hasard si les organisations qui ont réagi le plus rapidement sont celles qui se rattachent par leur histoire le plus clairement aux traditions communistes des Gauches, et particulièrement de la Gauche italienne, celles qui, dans la durée, ont déjà montré une relative solidité. Elles constituent les pôles politiques et historiques du milieu prolétarien. Les petites sectes qui gravitent autour, produits des multiples scissions, fondamentalement, n'expriment pas de points de vue si originaux ou nouveaux qu'ils puissent justifier leur existence séparée. Pour se distinguer, elles ne peuvent que, soit de "découverte" en "découverte", s'enfoncer dans la confusion et le néant, soit singer de manière caricaturale et stérile les positions classiquement en débat au sein du milieu révolutionnaire.
Dans cet article polémique, nous privilégions donc d'abord le BIPR, qui, en dehors du CCI, reste le principal pôle de regroupement, et les groupes bordiguistes, car même si ce courant s'est effondré en tant que pôle de regroupement, il n'en reste pas moins un pôle politique important des débats au sein du milieu révolutionnaire. Pour autant, nous essayerons de ne pas négliger les prises de position des groupes "parasites" tels la FECCI, Communisme pu Civilisation, et même celles du GCI, dont on peut raisonnablement se demander s'il a encore le bout d'un doigt de pied au sein du camp prolétarien. La liste, évidemment, n'est pas exhaustive. Ces derniers groupes traduisent, le plus souvent de manière outrancière, les faiblesses qui s'expriment au sein du milieu prolétarien et sont un révélateur de la logique où mènent les confusions véhiculées par les groupes les plus sérieux.
Face aux bouleversements intervenus dans les pays de l'Est, dans l'ensemble, toutes les organisations révolutionnaires ont su afficher clairement à un niveau théorique général deux positions de base qui, le plus souvent, à défaut même d'analyse de la situation, ont fait office de première prise de position :
- l'affirmation de la nature capitaliste de l'URSS et des pays satellites ;
- la dénonciation du danger que constituent pour la classe ouvrière les illusions démocratiques.
La clarté sur ces deux principes de base qui fondent l'existence et l'unité du milieu politique prolétarien est bien le moins qu'on pouvait attendre de la part d'organisations révolutionnaires. Mais, sorti de là, c'est une confusion cacophonique qui règne quant à l'analyse des événements. Le retard dans la prise de position de la plupart des groupes du camp révolutionnaire n'est pas un simple retard pratique, une incapacité à bouleverser le rythme douillet des échéances des publications pour faire face aux événements historiques qui le nécessitent, c'est un retard à reconnaître l'évidence de la réalité, à simplement constater les faits et en premier lieu l'effondrement et l'éclatement du bloc de l'Est.
En octobre 1989, "BC voit l’empire oriental encore solidement sous la botte russe", en décembre 1989, elle écrit : "L'URSS doit s'ouvrir aux technologies occidentales et le Comecon doit faire de même, non -comme le pensent certains- dans un processus de désintégration du bloc de l'Est et de désengagement total de l'URSS des pays d'Europe, mais pour faciliter, en revitalisait les économies du Comecon, la reprise de l'économie soviétique". Ce n'est qu'en janvier 1990 qu'apparaît une première prise de position claire du BIPR dans Workers'Voice, la publication de la CWO : ces "événements d'une importance historique mondiale" signifient "l’amorce d’un effondrement de l'ordre mondial créé vers la fin de la 1e guerre mondiale" et ouvrent une période de "reformation de blocs impérialistes".
Les deux principaux groupes de la diaspora bordiguiste vont montrer plus de rapidité de réflexe que le BIPR. Dans son numéro de septembre 1989, 77 Programma comunista envisage la désagrégation du pacte de Varsovie et la possibilité de nouvelles alliances, comme le fait au même moment Il Partito comunista. Cependant, ces prises de position posées comme hypothèses né sont pas dépourvues d'ambiguïtés. Ainsi, en France Le Prolétaire peut encore écrire que "l'URSS est peut-être affaiblie, mais elle est encore comptable du maintien de l'ordre dans sa zone d'influence".
En janvier, le FOR annonce timidement, sans autre développement, qu"'on peut considérer que le bloc stalinien est vaincu".
La FECCI, au printemps 1990, nous offre deux positions. Celle majoritaire, position officielle de cette organisation, ne voit dans les événements de l'Est qu'"une tentative de l'équipe Gorbatchev de réunir progressivement toutes les conditions qui permettraient à l'Etat russe de mener une réelle contre-offensive dirigée contre l'Ouest". La minorité, plus lucide, note que la situation échappe au contrôle de la direction soviétique et que les réformes ne font qu'aggraver la débâcle du bloc russe.
Pour Communisme ou Civilisation, qui publie sur le sujet un texte dans le n° 5 de la Revue internationale du Mouvement communiste, "l'importance historique des événements en cours tient en premier lieu à leur situation géographique" ! Et après un long pensum académique où une multitude d'hypothèses de toutes sortes sont envisagées, aucune prise de position claire ne se dégage : en fait, en Europe de l'Est, c'est à une simple crise de restructuration à laquelle nous assisterions.
Quant au GCI et à son avatar le Mouvement communiste pour la formation du Parti communiste mondial dont les publications nous parviennent au printemps, l'effondrement du bloc de l'Est n'est même pas envisagé ; il s'agirait pour eux de simples manoeuvres de restructuration pour faire face à la crise et surtout à la lutte de classe.
On le voit, les organisations du milieu prolétarien ont mis des mois à mesurer la signification des événements et le plus souvent, l'ambiguïté subsiste, la porte reste ouverte à l'illusion d'une possible reprise en main par l'URSS de son ex-bloc. Six mois après le début des événements, le BIPR ne voit que l’"amorce" d'un processus alors que l'URSS a fondamentalement déjà perdu tout contrôle sur son glacis est-européen. Quant aux sectes parasites, elles n'ont pour ainsi dire rien vu. Solidarnosc a gagné les élections en Pologne durant l'été, avec l'automne, le mur de Berlin est tombé, les partis staliniens ont été jetés hors du pouvoir en Tchécoslovaquie et en Hongrie, Ceaucescu a été mis à bas en Roumanie tandis qu'en URSS même, l'agitation du Caucase et des pays baltes ont montré la perte de maîtrise du pouvoir central et la dynamique d'éclatement qu'implique le "réveil des nationalités", mais, face à tout cela, le milieu politique révolutionnaire a été comme frappé de léthargie. Cela manifeste un incroyable aveuglement face à la simple réalité des faits. Ce qu'un simple pisse-copie de la presse bourgeoise ne pouvait que constater : l'effondrement du bloc russe, nos docteurs en théorie marxiste engoncés dans un conservatisme peureux refusaient de le voir. Le manque de réflexe politique qui a sévi dans le milieu prolétarien ces derniers mois est la manifestation des faiblesses profondes qui le marquent. Incapable ces dernières années d'intervenir avec détermination dans les luttes de la classe ouvrière, qu'elle ne reconnaissait pas, une grande partie du milieu prolétarien s'est avérée impuissante à faire face à la brutale accélération de l'histoire de ces derniers mois. Enfermée dans un repli frileux tout au long de la décennie 80, elle est restée sourde, aveugle et muette. Une telle situation ne peut s'éterniser. Même si elles se réclament de la classe ouvrière, des organisations qui sont incapables d'assumer leur rôle ne sont d'aucune utilité pour celle-ci et deviennent au contraire des entraves. Elles perdent leur raison d'être.
Quand on voit avec quelle difficulté les organisations du milieu politique ont ouvert les yeux à la réalité, pourtant de plus en plus aveuglante au fur et à mesure des mois qui s'écoulaient, de l'effondrement du bloc russe, on peut déjà avoir une idée de la confusion des analyses qui vont être développées et du déboussolement politique qui règne. Il ne s'agit pas ici de reprendre en détail tous les avatars théoriques que les groupes politiques révolutionnaires ont pu élaborer, plusieurs numéros de la Revue internationale du CCI n'y suffiraient pas. Nous nous attacherons avant tout à cerner les implications des prises de position du milieu sur deux plans : la crise économique et la lutte de classe. Nous verrons ensuite quelles ont été les implications de tout cela, sur la vie même du milieu prolétarien.
La crise économique a l'origine de l'effondrement du bloc de l'est : une sous-estimation générale
Toutes les organisations du milieu prolétarien voient bien la crise économique à l'origine des bouleversements qui secouent l'Europe de l'Est, à l'exception du FOR, qui n'y fait aucune référence conformément à sa position surréaliste selon laquelle il n'y a pas de crise économique du capitalisme aujourd'hui. Cependant, au-delà de cette pétition de principe, l'appréciation même de la profondeur de la crise et de sa nature détermine la compréhension des événements actuels et cette appréciation varie profondément d'un groupe à l'autre.
BC, en octobre, écrit: "Dans les pays à capitalisme avancé d'Occident, la crise s'est surtout manifestée dans les années 70. Plus récemment, la même crise du processus d'accumulation du capital a explosé dans les pays 'communistes' moins avancés." C'est-à-dire que BC ne voit pas la crise ouverte du capital dans les pays de l'Est avant les années 1980. Et dans la période antérieure, il n'y avait donc pas de "crise du processus d'accumulation du capital" en Europe de l'Est ? Le capital russe était-il en pleine expansion comme le prétendait la propagande stalinienne ? En fait, BC sous-estimait profondément la crise chronique et congénitale qui durait depuis des décennies. Dans ce même article, BC continue :
"L'effondrement des marchés de la périphérie du capitalisme, par exemple l'Amérique latine, a créé de nouveaux problèmes d'insolvabilité à la rémunération du capital (...). Les nouvelles opportunités qui s'ouvrent à l'est de l'Europe peuvent représenter une soupape de sécurité par Rapport à ce besoin d'investissement (...) Si ce large processus de collaboration Est-Ouest vient à se concrétiser, ce sera une bouffée d'oxygène pour le capitalisme international." On le voit, ce n'est pas seulement la crise à l'Est que BC sous-estime, c'est aussi la crise en Occident. Où ce dernier trouvera-t-il ces nouveaux crédits nécessaires à la reconstruction des économies ravagées des pays de l'Est ? Simplement pour remettre à niveau l'économie de l'Allemagne de l'Est, la RFA se prépare à investir plusieurs milliers de milliards de marks sans être sûre du résultat et, pour se les procurer, elle devra se transformer de principal prêteur sur le marché mondial après le Japon qu'elle était jusque là, en gros emprunteur, accélérant encore la crise du crédit de l'Occident. On peut imaginer les sommes colossales qu'il faudrait pour sortir l'ensemble de l’ex-bloc de l'Est de la catastrophe économique dans laquelle il n'a cessé de s'enfoncer depuis sa naissance : l'économie mondiale à bout de souffle n'a pas les moyens de cette politique, un nouveau plan Marshall n'est pas à l'ordre du jour. Mais surtout, en quoi les économies sinistrées d'Europe de l'Est seraient-elles plus solvables que celles d'Amérique latine alors qu'elles sont déjà comme la Pologne et la Hongrie incapables de rembourser les emprunts qu'elles ont contractés depuis des années ? En fait, BC ne voit pas que l'effondrement du bloc de l'Est, une décennie après l'effondrement économique des pays du "tiers-monde", vient marquer un nouveau pas en avant de l'économie capitaliste mondiale dans sa crise mortelle. L'analyse du BIPR va à l'envers de la réalité. Et là où il y a un enfoncement dramatique dans la crise, il y voit une perspective pour le capitalisme de trouver une nouvelle "bouffée d'oxygène", un moyen de freiner la dégradation économique ! Il est logique qu'avec une telle vision, BC surestime la capacité de manoeuvre de la bourgeoisie russe et puisse envisager une restructuration possible de l'économie du bloc de l'Est, sous la houlette de Gorbatchev et avec l'appui de l'Occident.
Le PCI-Programme communiste reconnaît la crise économique comme étant à l'origine de l'effondrement du pacte de Varsovie. Cependant, dans une polémique avec le CCI publiée dans Le Prolétaire d'avril 1989, il trahit sa sous-estimation profonde et traditionnelle de la gravité de la crise économique : "L'extralucide CCI développe en effet une analyse effarante selon laquelle les événements actuels seraient rien moins qu'un 'effondrement du capitalisme' à l'Est ! D'ailleurs, pour faire bonne mesure, le numéro de mars de RI nous apprend que c'est toute l'économie mondiale qui s'effondre." Bien évidemment, le CCI ne prétend pas, comme voudrait le faire croire le PCI, qu'en Europe de l'Est, les rapports de production capitalistes auraient disparu mais, avec cette mauvaise polémique, le PCI montre sa propre sous-estimation de la crise économique et nie d'une phrase la réalité de la catastrophe qui submerge le monde et qui plonge la majorité de la population mondiale dans une misère économique sans fond. Le PCI-Programme Communiste croit-il vraiment que nous sommes encore dans les crises cycliques du 19e siècle ou reconnaît-il que la crise économique présente, qu'il a mis des années à voir, est une crise mortelle qui ne peut se traduire que par une catastrophe mondiale toujours plus large avec des pans entiers de l'économie capitaliste qui s'effondrent effectivement. Le PCI, qui, autrefois nous accusait d'indifférentisme, est toujours myope face à la crise économique ; fondamentalement, il la voit à peine et surtout il ne la comprend toujours pas.
Les petites sectes académistes se sont souvent fait une spécialité de longues analyses économiques ennuyeuses et d'innovations théoriques pseudo-marxistes.
Il faut un long pensum insipide à Communisme ou Civilisation pour rester aveugle à l'évidence de la crise économique ouverte : il en est toujours à attendre "l'éclatement d'une nouvelle crise cyclique du MPC (on suppose qu'il doit s'agir du mode de production capitaliste) dans les années 1990 à l'échelle mondiale". Pour lui, les bouleversements actuels en Europe de l'Est sont l'expression du fait que "le plein passage de la société soviétique au stade du capitalisme le plus développé ne pouvait se faire sans une crise profonde, comme c'est le cas". Autrement dit, la présente crise est une simple, crise de restructuration, de croissance, d'un capitalisme en plein développement !
La FECCI, qui, depuis des années, glose sur une "nouvelle" théorie du développement du capitalisme d'Etat comme produit du passage du capital de la domination formelle à la domination réelle, est tout d'un coup devenue muette sur cette élucubration de ses têtes savantes. Ce point, il y a peu si fondamental qu'il justifiait une diatribe enflammée de la FECCI contre le CCI, accusé de "stérilité théorique", de "dogmatisme", tout d'un coup n'est plus d'actualité face à la crise dans les pays de l'Est. Comprenne qui pourra ![3] [100]
La sous-estimation de la profondeur de la crise et les incompréhensions sur sa nature sont une constante des organisations prolétariennes. De là résultent des incompréhensions majeures sur la nature des événements qui se développent aujourd'hui. Ce n'est que devant la pression insistante des faits que certains groupes commencent seulement à se résigner à l'évidence de l'effondrement du bloc impérialiste de rEst sous le poids de la crise économique. Mais la signification profonde d'un tel événement, la situation qui l'a rendu possible, la dynamique qui l'a déterminé échappent totalement à leur entendement. Alors qu'il y a un blocage de la situation historique, que le rapport de forces entre les classes ne permet ni à la bourgeoisie de fuir en avant dans la guerre impérialiste généralisée, ni au prolétariat d'imposer à court terme la solution de la révolution prolétarienne, la société capitaliste est entrée dans une phase de pourrissement sur pied, de décomposition. Les effets de la crise économique prennent une dimension qualitative nouvelle. L'effondrement du bloc russe est la manifestation éclatante de la réalité du développement de ce processus de décomposition qui se manifeste à des degrés et sous des formes diverses sur l'ensemble de la planète [4] [101].
Mais la myopie politique qui rend déjà bien difficile à ces groupes le discernement de l'évidence pourtant criante des bouleversements dans l'Est, les laisse au surplus bien incapables d'en comprendre la raison et d'en saisir toute la dimension. Les errements sur la crise et ses implications, qui ont grandement contribué à paralyser le milieu face aux récents événements, annoncent des incompréhensions encore plus grandes par rapport aux bouleversements importants encore à venir.
Des organisations révolutionnaires incapables d'identifier la lutte de classe
Face aux luttes ouvrières qui se sont développées depuis 1983 au coeur des pays capitalistes les plus avancés, dans son ensemble, en dehors du CCI, le milieu prolétarien a fait la fine bouche. Le CCI a alors été accusé de surestimer la lutte de classe. Dans son numéro d'avril, BC accuse encore le CCI de se fier "plus à ses désirs qu'à la réalité" car, dit-elle, ces mouvements "n'ont rien produit d'autre que des luttes revendicatives qui n'ont jamais été capables de se généraliser". Il est vrai que, pour BC, ces luttes revendicatives n'ont pas grande signification puisque, selon elle, nous sommes toujours dans une période de contre-révolution, suivant en cela la position de tous les groupes bordiguistes issus des diverses scissions du PCI depuis son origine à la fin de la guerre.
BC qui est incapable de reconnaître la lutte de classe quand il l'a devant les yeux et par conséquent encore plus incapable d'y intervenir concrètement, par contre va s'empresser de l'imaginer là où elle n'est pas. Dans les événements de Roumanie en décembre 1989, BC voit une "authentique insurrection populaire" et précise :
"Toutes les conditions objectives et presque toutes les conditions subjectives étaient réunies pour que l'insurrection puisse se transformer en véritable révolution sociale, mais l'absence d'une force politique authentiquement de classe a laissé le champ libre justement aux forces qui étaient pour le maintien des rapports de production de classe. "
Cette position a déjà été critiquée dans notre polémique publiée dans la Revue internationale, n° 61, et a provoqué une réponse de BC qui persiste et signe dans son numéro d'avril 1990, mais précise en même temps :
"Nous ne pensions pas qu'il pouvait surgir des doutes sur le fait que l'insurrection est comprise comme conséquence de la crise et qu'elle est qualifiée de populaire et pas de socialiste ou de prolétarienne. "
Visiblement BC ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre le débat. Le simple usage du terme "insurrection" dans un tel contexte ne peut que semer la confusion et le fait d'y adjoindre "populaire" en rajoute encore. Dans le monde capitaliste présent, seul le prolétariat est la classe capable de mener une insurrection, c'est-à-dire la destruction de l'Etat bourgeois en place. Pour cela, la première condition est son existence en tant que classe qui se bat et s'organise sur son terrain. Ce n'est évidemment pas le cas en Roumanie. Les ouvriers sont atomisés, dilués dans le mécontentement de toutes les couches de la population qui a été utilisé par une fraction de l'appareil d'Etat pour renverser Ceausescu. La mise en scène médiatique de la "révolution" roumaine a été un vulgaire coup d'État. Dans cette situation où les ouvriers ont été dilués dans le mouvement "populaire", c'est-à-dire où le prolétariat comme classe a été absent, BC voit "presque toutes les conditions subjectives pour que l'insurrection puisse se transformer en révolution sociale" ! Dans cette situation d'extrême faiblesse de la classe ouvrière, BC aperçoit au contraire une force grandiose.
Toutes les dénonciations du poison démocratique que le BIPR peut faire à longueur de page deviennent lettre morte si cette organisation est incapable d'en voir les effets dévastateurs comme élément diluant de la conscience de classe dans le concret, et croit discerner le mécontentement ouvrier dans le triomphe de la mystification démocratique.
Dans cette ornière que BC a commencé à creuser, la FECCI est déjà bien engagée. Elle qui, comme le BIPR, avait il y a un an des visions du côté de la Chine et croyait voir la colère ouvrière prête à se manifester, aujourd'hui affirme que : "Les illusions actuelles, l'entrée du prolétariat roumain dans la danse macabre de la lutte pour la démocratie, ne doivent pas éclipser le potentiel de combativité pour des revendications de classe qui est pourtant celui du prolétariat roumain." La FECCI se console comme elle peut, mais elle manifeste ainsi ses propres illusions quant aux potentialités ouvrières qui subsistent dans l'immédiat après un tel débauchage démocratique.
Le FOR dans un article intitulé : "Une insurrection pas une révolution" distingue en Roumanie "la présence des ouvriers en armes" et précise que "les prolétaires y ont rapidement abandonné la direction aux 'spécialistes' de la confiscation du pouvoir". Pour le FOR, le prolétariat a "largement contribué à mettre en oeuvre" les changements à l'Est. Evidemment, le FOR qui ne voit rien de la crise économique doit bien aller chercher ailleurs son explication.
La porte que BC ouvre à la confusion, le Mouvement communiste et le GCI vont s'empresser de la franchir. Le premier va intituler sa longue brochure entièrement consacrée à la Roumanie, alors que rien n'est dit sur la situation globale du bloc de l'Est : "Roumanie : entre restructuration de l'Etat et poussées insurrectionnelles prolétariennes" ; et le second va publier un "Appel à la solidarité avec la révolution roumaine" ! Cela se passe de commentaire.
Il faut signaler et porter au crédit du PCI-Programme communiste que celui-ci n'est pas tombé dans le piège roumain, notant clairement que, dans les pays de l'Est, "la classe ouvrière ne s'est pas manifestée en tant que classe, pour ses intérêts propres" et qu'en Roumanie, "les combats se sont déroulés entre fractions de l'appareil d'Etat, et non contre cet appareil lui-même". De même, le PCI-Il Partito comunista de Florence pose clairement que la lutte de classe dans les pays de l'Est a été, pour le moment, submergée par l'orgie populiste, nationaliste et démocratique et que "le mouvement roumain a été tout sauf une révolution populaire". Cependant, ces défenseurs du bordiguisme, s'ils sont encore capables de dénoncer et d'identifier le mensonge démocratique, s'ils n'ont pas encore complètement dilapidé leur héritage politique de la Gauche italienne, comme le prouvent leurs prises de position sur la situation en Europe de l'Est, sont toujours incapables de reconnaître la lutte de classe quand eue se développe réellement au coeur des pays industrialisés. Comme BC, les groupes issus du bordiguisme analysent la période actuelle comme étant celle de la contre-révolution.
Le tableau est éloquent. Une des caractéristiques majeures de ces organisations politiques est leur incapacité à reconnaître la lutte de classe, à l'identifier. Ne la voyant pas là où elle se développe et l'imaginant là où elle n'est pas. Ce déboussolement profond prive évidemment tous ces groupes de la capacité de mener une intervention claire au sein de la classe. Alors que la classe dominante met à profit l'effondrement du bloc de l'Est pour lancer une offensive idéologique massive pour la défense de la démocratie, offensive devant laquelle succombe le prolétariat des pays est-européens, de nombreux groupes voient dans cette situation le développement de potentialités ouvrières. Une telle inversion de la réalité traduit une très grave incompréhension non seulement de la situation mondiale, mais aussi de la nature même de la lutte ouvrière. Tous ces groupes, après avoir fait durant les années 1980 la fine bouche devant les luttes dans les pays développés (qui, malgré toutes les difficultés et les pièges auxquels elles furent exposées, n'en sont pas moins restées ancrées sur leur terrain de classe), préfèrent aujourd'hui chercher la preuve de la combativité du prolétariat dans des expressions du mécontentement général où le prolétariat en tant que classe est absent et qui se mènent, pour des objectifs qui ne sont pas les siens, derrière le drapeau de la "démocratie", comme en Chine ou en Roumanie.
Dans de telles conditions, il est bien difficile de demander à ces organisations du milieu prolétarien qui, pour la plupart, n'ont rien vu du développement de la lutte de classe ces dernières années ou, du moins, l'ont toujours profondément sous-estimé, de comprendre quelque chose aux effets de l'effondrement du bloc russe et de l'intense campagne démocratique actuelle sur le prolétariat. Le déboussolement présent de celui-ci face à ces grands bouleversements historiques se traduit dans un recul de la conscience dans la classe [5] [102]. Mais comment comprendre un recul quand on n'a pas vu d'avancée ? Comment comprendre le développement en dents de scie de la lutte de classe quand on pose que nous sommes toujours dans une période de contre-révolution ?
La faiblesse politique du milieu trouve sa concrétisation dans le poids renforceé du sectarisme
Dans le numéro précédent de la Revue internationale, nous notions : "Si on considère que le BIPR est le second principal pôle du milieu politique international, le désarroi de BC face au 'vent de l'Est' est une triste indication des faiblesses plus générales du milieu." Malheureusement, le développement des prises de position, ces derniers mois, ne font que confirmer ce constat qui n'est pas pour nous surprendre. Depuis des années, le CCI met en garde au travers de ses polémiques les groupes du milieu contre les confusions dangereuses qui les traversent, mais comme ces groupes sont restés aveugles à la lutte de classe, à l'effondrement du bloc de l'Est, au recul présent, à l'évidence des faits qui se déroulent pourtant devant leur nez, ils sont aussi restés sourds à nos appels [6] [103]. En conséquence, ils sont restés muets sur le plan de l'intervention, s'enfonçant toujours plus dans une impuissance inquiétante, mise on ne peut plus clairement en relief ces derniers mois.
Mais ce n'est pas seulement sur le plan de leurs analyses que ces organisations ont échoué à être, par rapport aux éléments avancés de la classe à la recherche d'un cadre cohérent de compréhension de la situation présente, un facteur de clarification. Leur attitude, traditionnellement marquée par le poids du sectarisme, parallèlement au développement de la confusion, a été marquée ces derniers mois par une dégradation.
Là encore, Battaglia comunista, qui nous avait habitués à beaucoup mieux, s'illustre tristement. L'intervention d'un camarade du CCI à une réunion publique de BC, dans laquelle celui-ci met en lumière la gaffe monumentale du BIPR face aux événements en Roumanie, en affirmant simplement que ce qui a eu lieu est un vulgaire "coup d'Etat", est le prétexte à un raidissement de camarades de BC qui, en colère, menacent dans ces conditions de refuser dorénavant la vente habituelle de nos publications dans le cadre de ses réunions ouvertes. Le fait que dans la publication en France du CCI -Révolution internationale n° 151- nous ayons fait référence à cette poussée de sectarisme va provoquer l'ire de BC qui a adressé une "circulaire" incendiaire "à tous les groupes et contacts à l'échelle internationale'' pour dénoncer "les mensonges du CCI" et "la nature désormais objectivement de brigand de l'activité du CCI" et conclure : "Tandis que nous défions le CCI de continuer au-delà cette campagne diffamatoire basée sur le mensonge et sur la calomnie, afin d'éviter des réactions plus graves, nous invitons tous ceux au courant des faits à en tirer les conclusions politiques nécessaires dans l'évaluation de cette organisation." Une telle réaction, hors de toute proportion, puisque le prétexte officiel en est une intervention d'un de nos militants dans une discussion à une réunion de BC, traduit en fait l'embarras grandissant de ce groupe face à nos critiques.
Le sectarisme qui pèse lourdement dans le milieu politique est l'expression de l'incapacité à débattre, à confronter les analyses et les positions. La réaction de BC est dans la continuité de son attitude sectaire et opportuniste, lorsqu'elle avait mis fin aux Conférences des groupes de la Gauche communiste, en 1980. Le sectarisme a toujours fait bon ménage avec l'opportunisme. Au même moment où BC envoie cette circulaire ridicule dans tout le milieu, le BIPR, dont elle constitue le groupe principal, signe une adresse commune sur la situation dans les pays de l'Est avec des petits groupes comme le Gruppe Internationalistische Komunismen (Autriche) ou Comunismo (Mexique) dont le contenu traduit plus des concessions opportunistes que la recherche de la clarté. BC est pour le regroupement des révolutionnaires, mais sans le CCI. Cette attitude de concurrence ridicule mène tout droit au pire des opportunismes et accroît la confusion des débats dans le milieu.
L'ostracisme qui frappe le CCI de la part des anciens groupes du milieu politique, et des multiples sectes qui le parasitent, n'est pas, comme on l'a vu, contradictoire avec l'opportunisme le plus plat sur la question du regroupement des forces révolutionnaires. La FECCI, ces dernières années a été une parfaite illustration de ce fait : dans le même temps où eue abreuvait le CCI d'insanités, elle se lançait dans une dynamique de pseudo-conférences avec des groupes aussi hétérogènes que Communisme ou Civilisation, Union prolétarienne, Jalons, A Contre-Courant et des individus isolés. Les sectes se payaient leur conférence, on peut imaginer ce que cela a pu donner, pas grand chose, tout aux plus de nouvelles sectes. Aujourd'hui, la FECCI a entamé un nouveau flirt avec le Communist Bulletin Group, groupe dont la naissance s'était déroulée sous les auspices d'un acte de brigandage envers le CCI un vrai, cette fois, pas comme ceux, imaginaires, que BC prête au CCI. La FECCI tourne en ridicule l'idée même de regroupement mais, malheureusement, cette organisation s'est aussi singularisée par la bêtise méchante, la mauvaise foi et l'aveuglement haineux de ses polémiques et, ce faisant, c'est toute l'activité révolutionnaire qui est dénaturée.
Les événements dans les pays de l'Est se sont traduits pour la FECCI par une aggravation de son déboussolement et de son irresponsabilité. La FECCI, la vision obscurcie par son aigreur, a vu dans nos prises de position sur l'effondrement du bloc russe une négation de l’"impérialisme" et "un abandon du cadre marxiste de la décadence." La FECCI n'en est pas à un faux débat près, c'est ce qui lui sert de raison d'existence. Combien de temps lui faudra-t-il pour simplement reconnaître la réalité de l'effondrement du bloc de l'Est ? A ce moment-là, la FECCI pourra-t-elle reconnaître la validité des positions du CCI ? En tirera-t-elle les conclusions par rapport à son attitude présente ?
Les organisations bordiguistes ne reconnaissent pas l'existence d'un milieu politique et pour chacune d'entre elles, il n'y a qu'un seul parti, elle-même: Le sectarisme est là théorisé et justifié. Cependant, le PCI-Programme communiste, semble quelque peu tirer les leçons de sa crise passée et commence à publier des polémiques avec d'autres groupes du milieu politique. Ainsi, le CCI a eu droit à une réponse polémique dans Le Prolétaire, sa publication en France. A quoi réagit le PCI ? Au fait que nous ayons salué sa prise de position correcte ! Et il précise : "Ce qui nous importe dans cette note c'est de réfuter le plus clairement possible l’idée que notre position serait analogue à celle du CCI" Que cette organisation se rassure, le fait que nous reconnaissons la relative clarté de sa prise de position par rapport aux événements de l'Est ne nous fait pas oublier ce qui nous sépare d'elle, mais le PCI a-t-il atteint un tel niveau de gangrène sectaire que même la reconnaissance sur un point de la validité de ses positions lui soit si complètement insupportable ? Peut-être le rappel de ce que nous concluions à son propos dans l'article de la précédente Revue internationale, consacré au milieu politique, le rassurera dans ce cas : "La réponse relativement saine du Prolétaire aux événements de l'Est prouve qu'il y a encore une vie prolétarienne dans cet organisme. Mais nous ne pensons pas que ceci représente réellement un nouveau regain de vie : c'est l'antipathie 'classique' des bordiguistes vis-à-vis des illusions démocratiques, plus qu'un réexamen critique des bases opportunistes de leur politique, qui leur a permis de défendre une position de classe sur cette question. "
Un des constats des plus inquiétants qu'il faut tirer, c'est l'incapacité de ces organisations, face à des faits nouveaux, de reconsidérer leur cadre de compréhension, de l'enrichir pour s'élever à la compréhension de ce qui a changé. En fait, l'accélération historique a mis en lumière l'incroyable conservatisme qui sévit dans le milieu. Le sectarisme qui s'est développé à l'occasion des polémiques à propos du "vent d'Est" est le corollaire de ce conservatisme. Incapables de reconnaître l'actuel processus de décomposition sociale, considéré comme un "gadget" du CCI, ces organisations sont évidemment bien incapables d'en identifier les manifestations dans la vie du milieu prolétarien, dans leur propre vie et donc de s'en défendre. La dégradation des relations entre les principales organisations ces dernières années en est pourtant une expression très claire.
Dans ces conditions il n'est pas même question de développer dans cet article à propos de l'intervention qu'ont menée ces groupes par rapport au séisme qui secoue l'Europe de l'Est. Aucun autre groupe que le CCI n'a su briser la routine pour simplement accélérer ses publications ou publier des suppléments. Le déboussolement politique et la sclérose sectaire ont rendu ces organisations impuissantes à intervenir. Dabs la situation présente de désarroi où l'a plongée le "vent d'Est", accentuée par l'offensive de la propagande bourgeoise, la classe ouvrière subit un recul dans sa conscience, et ce ne sont pas les lumières apportées par la majorité des groupes révolutionnaires qui lui auront été d'une grande utilité pour sortir de cette passe difficile.
Le développement du cours historique impose au milieu un irrésistible processus de décantation. La clarification que ce processus implique, dans la situation présente de dégradation des relations entre les groupes prolétariens, n'arrive pas à se faire par la confrontation claire et volontaire des positions. Elle doit néanmoins se faire, et dans ces conditions elle ne peut que tendre à prendre la forme d'une crise de plus en plus forte des organisations qui, à l'accélération de l'histoire répondent par le développement de la confusion, posant ainsi la question de leur survie politique. La clarification qui ne parvient pas à se faire par le débat risque de s'imposer par le vide. Tels sont les enjeux du débat présent pour les organisations politiques révolutionnaires.
JJ, 31mai l990
[1] [104] Dans cet article seront souvent utilisés les sigles des organisations, ce qui donne:
- Parti communiste internationaliste (PCint) et ses publications Battaglia Comunista (BC) et Prometeo
- Comunist workers' organisation (CWO) et sa publication Workers Voice - Bureau international pour le parti révolutionnaire (BIPR), publication Communist Review, regroupement des deux précédentes organisations.
- Parti communiste international (PCI), publications Programme communiste et Le Prolétaire
- Ferment ouvrier révolutionnaire (FOR), publications Alarme et l’Arme de la critique
- Fraction externe du Courant communiste international (FECCI), publication Perspective internationaliste
-Groupe communiste internationaliste (GCI)
[2] [105] Revue Internationale n°61. « Le vent d’Est et la réponse des révolutionnaires ».
[3] [106] Voir sur cette question : "La domination réelle" du capital et les réelles confusions du milieu politique", Revue internationale, n° 60.
[4] [107] Voir sur cette question : "La décomposition du capitalisme", Revue internationale n° 57, et l'article de ce numéro.
[5] [108] Voir "Des difficultés accrues pour le prolétariat", Revue internationale, n°60.
[6] [109] Voir "Le milieu politique depuis 1968", Revue internationale, n° 53-54-56.
Courants politiques:
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 63 - 4e trimestre 1990
- 2683 reads
Golfe persique : le capitalisme, c'est la guerre
- 3259 reads
Au moment où nous écrivons, les forces armées américaines encerclent et asphyxient l'Irak. De toute évidence, nous allons vers un affrontement meurtrier dont les populations de la région vont faire les frais, victimes des privations, victimes des bombardements, des gaz, de la terreur. Victimes de la guerre. Victimes du capitalisme.
L'invasion du Koweït par l'Irak résulte fondamentalement de la nouvelle situation historique ouverte par l'effondrement du bloc de l'Est. Elle est aussi une manifestation de la décomposition croissante qui touche le système capitaliste. Et le gigantesque déploiement de forces armées des grandes puissances, essentiellement des USA à vrai dire, révèle, pour sa part, la préoccupation croissante de ces dernières à l'égard du désordre qui s'étend de plus en plus. Mais, à terme, les réactions des grandes puissances ne pourront donner que le résultat inverse de celui attendu, se transformant en un facteur supplémentaire de déstabilisation et de désordre. A terme, elles ne peuvent qu'accélérer encore la chute dans le chaos et y entraîner l'humanité entière. Il n'est qu'une seule force qui puisse offrir une alternative, c'est le prolétariat mondial. Et cette alternative a pour nom : le communisme.
Que n'a-t-on entendu depuis la disparition du bloc de l’Est ? Une ère nouvelle de paix et de prospérité s'ouvrait. En collaborant, les USA et PURSS allaient permettre d'en terminer avec les conflits qui n'ont cessé de ravager le monde depuis 1945. Perpétuant le mensonge stalinien sur le caractère socialiste de l'URSS et des pays de l'Est, la bourgeoisie occidentale proclamait la victoire du capitalisme sur "le communisme", sur "le marxisme". Les pays de l'Est allaient connaître les délices du capitalisme sous sa forme occidentale et leur marché relancer l'économie mondiale. Le meilleur des mondes enfin s'offrait à nous. Marx était rangé au rayon des vieilleries, au mieux une curiosité. Lénine était triomphalement sacré "le mort de l'année" dans la presse. Certains idéologues bourgeois, enthousiastes, allaient même jusqu'à proclamer la fin de l'histoire !
Six mois. Six mois auront suffi pour mettre à bas toutes ces chimères, tous ces mensonges. Comme l'affirmaient et continuent d'affirmer les groupes communistes, les organisations qui sont réellement fidèles au marxisme, le capitalisme s'enfonce inexorablement dans la catastrophe économique ([1] [111]). Les pays de la périphérie, dits du "tiers-monde", sont un enfer quotidien pour l'immense majorité de leurs habitants ; un enfer qui ne cesse d'empirer. Les pays de l'ex-bloc de l'Est plongent du marasme économique propre au capitalisme d'Etat stalinien, dans le désastre le plus complet et le plus dramatique pour des millions d'êtres humains. Sans espoir aucun d'amélioration, ni même d'arrêt dans la détérioration. Les USA entrent dans la récession ouverte, et ouvertement reconnue par la bourgeoisie elle-même. C'est la première puissance économique qui chute, entraînant déjà, telle la Grande-Bretagne, les principaux pays industriels du monde.
Six mois plus tard, les grandes proclamations sur la paix sont réduites à néant par le conflit au Moyen-Orient. Et, "le mort de l'année", Lénine, revient affirmer avec force qu"'e/2 régime capitaliste, et particulièrement à son stade impérialiste, les guerres sont inévitables". ([2] [112])
L'illusion n'aura duré que six mois. Les masques tombent et la réalité du capitalisme en décomposition s'impose à tous, barbare, implacable, faite de misère, de faim, de catastrophes, de chantages et de prises d'otages, d'assassinats et de répressions, de massacres, de guerres, réalité de sang et de boue comme disait déjà K. Marx en son temps à propos d'un capitalisme encore en plein développement, et qui se révèle bien pire dans sa période actuelle de sénilité.
Les mensonges s'effondrent et la nouvelle situation historique, ouverte par l'effondrement des pays capitalistes d'Etat staliniens et la disparition des deux blocs impérialistes Ouest et Est, loin d'ouvrir une période de paix, nous apparaît dans toute son horreur. La fin de la "Guerre froide" ne signifie pas la fin des conflits impérialistes.
"Dans la période de décadence du capitalisme, TOUS les Etats sont impérialistes et prennent les dispositions pour assumer cette réalité: économie de guerre, armements, etc. C'est pour cela que l’aggravation des convulsions de l’économie mondiale ne pourra qu'attiser les déchirements entre ces différents Etats, y compris, et de plus en plus, sur le plan militaire. La différence avec la période qui vient de se terminer, c'est que ces déchirements et antagonismes, qui auparavant étaient contenus et utilisés par les deux grands blocs impérialistes, vont maintenant passer au premier plan. La disparition du gendarme impérialiste russe, et celle qui va en découler pour le gendarme américain vis-à-vis de ses principaux 'partenaires' d'hier, ouvrent la porte au déchaînement de toute une série de rivalités plus locales. Ces rivalités et affrontements ne peuvent pas, à l'heure actuelle, dégénérer en un conflit mondial (même en supposant que le prolétariat ne soit plus en mesure de s'y opposer). En revanche, du fait de la disparition de la discipline imposée par la présence des blocs, ces conflits risquent d'être plus violents et plus nombreux, en particulier, évidemment, dans les zones où le prolétariat est le plus faible." {Revue Internationale n°61, 10 février 1990).
Six mois plus tard, la réalité de la société capitaliste, réalité d'un système pourrissant, se décomposant et s'enfonçant chaque jour plus dans le chaos, est venue avec éclat confirmer nos propos d'alors.
L’invasion du Koweït par l'Irak est un moment de la chute dans le chaos.
La prospérité et la paix, nous disait-on après la chute du mur de Berlin. La crise et la guerre, oui ! Voilà ce que signifie le conflit au Moyen-Orient. La guerre avec l'Irak n'est pas simplement le fait d'un nouvel "Hitler". Après les événements d'Europe de l'Est, elle est une autre manifestation d'ampleur de la période de décomposition que vit le capitalisme. Elle est le produit de la nouvelle situation historique ouverte avec l'effondrement du bloc de l'Est, le produit de la tendance croissante à la perte de contrôle de la situation par la bourgeoisie mondiale, du développement du chacun pour soi, de la guerre de tous contre tous, de l'instabilité et de l'anarchie croissante du monde capitaliste.
Contrairement à ce qu'on nous rabâche, l'aspect marquant dans la crise du Golfe n'est pas tant l'unanimité des grandes puissances pour condamner et contrer l'Irak - nous y reviendrons - mais bel et bien, le fait nouveau qu'un pays comme l'Irak s'aventure à défier l'ordre établi dans la région par la première puissance mondiale, sans l'assentiment, le soutien, d'une autre grande puissance. Hier, c'est-à-dire il y a encore un an, Saddam Hussein eut été vite ramené à la raison par la logique supérieure de l'opposition des deux blocs impérialistes. Aujourd'hui, son aventure a déjà irrémédiablement changé et déstabilisé tout le Moyen-Orient. Ce sont maintenant tous les pays de la région, ceux de la péninsule arabe, la Jordanie, la Syrie même, qui entrent dans une ère d'instabilité. C'est toute la région qui tend à se "libaniser" à son tour.
Inévitablement, les conflits de ce type, de plus en plus nombreux, de plus en plus incontrôlés par les grandes puissances, vont se multiplier dans le monde à cause de la catastrophe économique qui touche tous les pays, petits ou grands et d'une situation mondiale où a cessé d'exister la discipline de chacun des deux blocs. De ce fait, les petits Etats dans l'impasse sont de plus en plus poussés dans des aventures militaires.
Après la guerre contre l'Iran, horrible boucherie qui a fait un million de morts, l'Irak s'est retrouvé avec une dette de plus de 70 milliards de dollars pour une population de 17 millions d'habitants (4 000 dollars de dette par personne, femmes, enfants et vieillards compris !) et une armée... d'un million de soldats.
Le pays est incapable de rembourser quoi que ce soit. Complètement asphyxié, il n'avait pas d'autre alternative que de jouer son va-tout avec la seule carte à sa disposition : la plus grande armée de la région. Non seulement, il a essayé de réaliser un hold-up sur le trésor du Koweït, mais aussi de s'affirmer comme la puissance dominante de toute cette partie du monde, si importante du point de vue économique et stratégique. C'est là l'inéluctable voie, impérialiste, que la situation de crise économique croissante et la décadence de la société capitaliste imposent de suivre à tous les Etats. Et qui, de manière encore plus exacerbée dans la période de décomposition, mènent de la guerre commerciale à la guerre impérialiste.
Hussein n'est pas qu'un fou. Il est aussi l'homme de la situation, le produit du capitalisme, du capitalisme actuel. Il est la créature même de ceux qui le combattent aujourd'hui. Hier, les grandes puissances occidentales n'avaient pas assez de mots pour louer sa clairvoyance, son courage, son mérite, sa grandeur, quand l'Irak se faisait l'instrument de leur politique visant à remettre au pas l'Iran de Khomeiny. Hier, les grandes démocraties occidentales ont elles-mêmes armé l'Irak des engins de morts les plus modernes. Et elles ont continué à le faire sans retenue, ni le moindre état d'âme, alors même qu'il utilisait ces moyens pour bombarder et terroriser les populations civiles des grandes villes d'Iran, et gazer, en Irak même, des villes kurdes.
Elles n'ont arrêté, ou limité les livraisons militaires, que lorsque l'Irak n'a pu payer plus longtemps, et les fournitures, et ses dettes. Voilà ce qu'entend la bourgeoisie mondiale par la défense du "droit international" et des "Droits de l'homme".
Particulièrement répugnante est l'utilisation cynique des milliers d'otages par l'Irak et par... les puissances occidentales. Il est vrai que la prise d'otages par Saddam Hussein est particulièrement odieuse. Elle est le fait d'une bête traquée, encerclée, qui ne sait comment se sortir d'affaire.
Mais elle est surtout utilisée sciemment par la bourgeoisie occidentale pour développer une campagne propagandiste terrible afin de justifier et d'essayer d'enrôler les populations derrière ses objectifs guerriers. Si nécessaire, elle n'hésitera pas à sacrifier les otages, reportant sur le "boucher de Bagdad", comme on le présente aujourd'hui dans la presse bourgeoise, ses propres responsabilités. Est-il besoin de rappeler l'utilisation éhontée des otages de l'ambassade américaine en Iran en 1979 dont on vient de révéler qu'elle 1a permise à la CIA - dont le directeur à l'époque était G. Bush ! - de faire élire Reagan et d'augmenter les crédits militaires. ([3] [113])
N'ayons aucune illusion : tous les moyens, et les plus ignobles, et les plus barbares, la terreur et le terrorisme tout particulièrement, vont être de plus en plus utilisés dans les conflits à venir par les différents Etats. Car, inévitablement d'autres conflits vont surgir, d'autres Hussein armés par les grandes puissances, soutenus par elles, produits par le capitalisme, vont se lancer dans des guerres du même type. Les conflits impérialistes locaux, produits du chaos croissant dans lequel s'enfonce le capitalisme mondial, vont devenir facteur aggravant et accélérateur de ce chaos.
LES USA S'IMPOSENT COMME SEULS CAPABLES DE JOUER LE ROLE DE GENDARME AU NIVEAU MONDIAL
Face à cette tendance irréversible au chaos, les grandes puissances mondiales essayent de réagir. Tout comme les pays occidentaux continuent d'apporter leur soutien à Gorbatchev face à l'explosion et à l'anarchie en URSS, de 1 même, face à l'aventure irakienne, aux dangers de déstabilisations qu'elle contient, ils ne pouvaient rester passifs. L'unanimité des grandes puissances pour condamner l'Irak exprime la conscience du danger et la volonté de limiter et de s'opposer à l'éclatement de ce type de conflits. Non pour la paix universelle évidemment, ni même pour le bien-être des populations, mais pour assurer leur puissance et leur main-mise sur le monde. Ce qu'elles appellent la "paix" et la "civilisation", et qui n'est que l'impérialisme brutal et barbare, le pouvoir du plus fort sur le plus faible. Bien sûr, ce sont les Etats-Unis, la première puissance mondiale, qui ont réagi avec le plus de détermination et d'ampleur. Les mesures de blocus adoptées à PONU ont été imposées avant tout par les USA. L'intervention des forces militaires occidentales s'est faite sous le leadership inflexible de cette puissance.
Ces derniers ne pouvaient laisser, sans réaction, la péninsule arabe plonger dans la guerre, et laisser à l'Irak d'Hussein le contrôle des principales réserves mondiales de pétrole. Surtout, ils veulent mettre le holà aux aspirations impérialistes, aventuristes et guerrières de tous ceux, de plus en plus nombreux de par le monde, qui seraient tentés d'imiter Saddam Hussein.
Le parrain de la mafia toute puissante n'aime pas que des petits truands de quartier se croient tout permis, et gênent la bonne marche des affaires en provoquant des braquages intempestifs qu'il n'a pas autorisés. De plus, il ne peut accepter que son autorité, et la peur qu'il inspire, soient mises en question. De là vient le formidable déploiement militaire américain, non seulement pour laver l'affront dans le sang, pour punir l'Irak, et probablement même se débarrasser d'Hussein, mais aussi pour faire un exemple aux yeux du monde et tenter de porter un coup d'arrêt au développement du chaos.
L'engagement américain est le plus important depuis la guerre du Vietnam et s'appuie sur la plus grosse opération logistique depuis la seconde Guerre mondiale, selon les généraux US. Plus de 100 000 hommes se trouvent déjà sur le terrain en Arabie Saoudite. Deux porte-avions dans la mer d'Oman, et deux autres en Méditerranée. Les bombardiers les plus sophistiqués, les F-lll et les F-117, dits "furtifs" car indétectables, sont basés en Turquie et en Arabie. Jusqu'à 700 avions, dont 500 de chasse, sont présents du côté américain. D'innombrables missiles sont braqués sur l'Irak. Bien que cette information soit supposée secrète, les journalistes bourgeois admiratifs et va-t-en guerre, tout excités à l'approche de la guerre franche et joyeuse, nous révèlent que des sous-marins nucléaires d'attaque sont présents autour des porte-avions. De la mer d'Oman, ou de l'Ouest de Chypre, ils pourraient bombarder Bagdad avec une précision de 500 mètres nous dit-on. Mais, ce n'est rien à côté des missiles de croisière que peuvent lancer les cuirassés américains également présents qui peuvent, eux, frapper une cible à Bagdad à quelques mètres près. Fantastique, non ? Pour les journalistes : une merveille d'efficacité. A vrai dire, un cauchemar.
Un cauchemar parce que nous savons très bien que la bourgeoisie, quelle que soit sa nationalité, est tout à fait capable de bombardements massifs de civils. Parce que nous savons très bien que la bourgeoisie américaine, saluée par ses alliées de l'époque, n'avait pas hésité à balancer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 alors que le Japon demandait l'armistice depuis un mois, simplement # pour arrêter l'avancée de... l'URSS en Extrême-Orient ([4] [114]). Parce que l'aviation US a montré son savoir-faire sur cible réelle et humaine en bombardant Panama (décembre 1989), les quartiers pauvres de préférence, faisant 10 000 morts, tout comme Tripoli (mars 1986). Parce que nous savons très bien que Bush et ses alliés peuvent décider de raser Bagdad - avec ou sans otages - pour faire un exemple, tout comme Saddam Hussein avait gazé la population kurde. C'est le capitalisme, le meilleur des mondes, qui prend des millions d'êtres humains en otages et n’hésite pas à les sacrifier quand nécessaire.
Les armes déployées sont en quantités énormes et incroyablement meurtrières. Bush a menacé de riposter à l'utilisation de gaz par l'Irak par d'autres gaz, et même par des moyens atomiques. L'horreur se banalise et la menace de l'emploi de l'arme nucléaire devient naturelle, dans l'ordre des choses. Plus personne ne s'en offusque. Pas même les pacifistes bourgeois qui ne sont pacifistes en général qu'en temps de paix, et d'autant plus violemment bellicistes lorsque éclatent les conflits.
Mais l'hypocrisie et le cynisme ne s'arrêtent pas là. Certes, discrètement, il apparaît que les USA auraient délibérément laissé l'Irak s'engager dans l'aventure guerrière. La presse bourgeoise internationale a fait part d'informations dans ce sens. Par exemple, les services de renseignement français "ne s'interdisent pas dépenser que les services américains disposaient d'informations précises tendant à prouver les préparatifs irakiens d'invasion du Koweït (...) Auraient-ils profité de cette 'circonstance attendue', selon le mot d'un haut fonctionnaire, pour justifier un face à face militaire depuis plusieurs mois ? Les arrière-pensées américaines n'auraient-elles pas consisté à attendre que M. Saddam Hussein aille 'à la faute', provoquant de lui-même l'occasion pour les Etats-Unis sinon de le renverser, du moins de détruire, 'en toute légitimité', des infrastructures militaires irakiennes stratégiques susceptibles de doter le régime de Bagdad de l'arme nucléaire ?" ([5] [115]). Vrai ou faux, et c'est sans doute vrai ([6] [116]), cela nous éclaire sur les moeurs et les pratiques de la bourgeoisie, sur ses mensonges, ses manipulations, sur l'utilisation qu'elle fait des événements. Si c'est vrai, et c'est sans doute vrai, on mesure encore mieux l'utilisation cynique qu'elle fait des milliers d'otages retenus par l'Irak pour préparer les "opinions publiques" à l'intervention militaire directe.
Mais vrai ou faux, il n'empêche que l'Irak n'avait pas le choix comme nous l'avons vu précédemment. Ce pays était acculé à une telle politique. Et les USA ont laissé faire, favorisé et exploité l'aventure guerrière de Saddam Hussein, conscients qu'ils étaient de la situation de chaos croissant, conscients de la nécessité de faire un exemple.
L'URSS : une puissance impérialiste de second ordre
Chaque jour il se confirme que l'URSS est tombée au niveau d'une puissance de deuxième ordre. Dans ce conflit, en dépit de la perte du marché irakien pour ses armements, elle n'avait pas d'autre issue que de se ranger derrière la politique et la puissance américaines. C'est ce qu'elle a fait depuis le début, tout particulièrement à l'ONU. De ce point de vue, l'attitude des Etats-Unis envers Gorbatchev est significative : Bush n'hésite pas à le convoquer quand il l'estime nécessaire. Certes à Helsinki, il y met des formes. Mais celles-ci doivent être comprises comme une aide visant à renforcer le pouvoir fragile de Gorbatchev en URSS même, en échange, évidemment, de son soutien dans le conflit avec l'Irak.
L'économie de l'URSS, dont le délabrement atteint des niveaux hallucinants, dépend de façon croissante du soutien des pays occidentaux. Les émeutes se multiplient contre les pénuries. L'absence de tabac et de vodka ont donné lieu à des violentes émeutes faisant de nombreux blessés. Même les biens de première nécessité, comme le pain, commencent à manquer ! De véritables famines ne sont plus très loin.
La situation de guerre civile dans laquelle se trouve un grand nombre de Républiques - dont presque toutes se sont déclarées souveraines ou indépendantes -, les pogroms et les massacres entre nationalités, les affrontements au sein même des communautés entre milices rivales (Arménie), en disent long sur l'état d'éclatement et de désordre dans lequel se trouve l'URSS. Sa principale préoccupation : que le chaos externe, et particulièrement au Moyen-Orient, si proche de ses frontières et de ses républiques musulmanes, se développe sans retenue et vienne à son tour aggraver encore le chaos, déjà dramatique, interne à l'URSS. Voilà pourquoi, elle se range derrière les USA dans le conflit. On est loin de la situation où l'URSS, à la tête du bloc de l'Est, tentait de verser de l'huile sur le feu du moindre conflit local afin de remettre en cause un statu quo favorable au bloc occidental.
Sa faible participation à l'opération de police du Golfe, dont, pourtant, elle partage pleinement les objectifs, révèle l'état d'affaiblissement de sa puissance militaire, qui ne peut pas se mesurer en nombre de navires, avions, missiles, tanks et soldats, mais en niveau de désagrégation d'une "Armée rouge" déjà incapable de maîtriser la situation interne (comme par exemple de désarmer les milices arméniennes). Les arguments donnés par un officiel russe pour justifier cette faible participation ("contrairement à Vannée américaine, l’armée rouge n'a pas pour vocation d'intervenir en dehors des frontières et ne Va jamais fait") - quel culot !-en dit long sur l'impuissance de l'URSS.
La guerre au Moyen-Orient confirme que l’URSS ne peut plus jouer le rôle de tête d'un bloc impérialiste, qu'elle ne peut avoir la moindre politique étrangère propre. En moins d'un an, l’ex-deuxième puissance mondiale a été ramenée à un statut inférieur à celui de l'Allemagne, du Japon et même de la Grande-Bretagne ou de la France.
Le nouvel ordre impérialiste : la guerre de tous contre tous
L'ampleur des moyens militaires mis en oeuvre par les USA et l'intransigeance dont ils font preuve, témoignent de leur volonté de mettre à profit la situation créée par l'aventure irakienne pour affirmer clairement leur "leadership" sur l'ensemble du monde. Alors que le Japon ou les pays européens (en particulier l'Allemagne) pourraient être tentés, à la faveur de la disparition de toute menace provenant de l'URSS, de rompre quelque peu la discipline qu'ils avaient observée jusqu'à présent, et de pousser leurs avantages économiques face à une économie américaine de moins en moins compétitive, la démonstration de force des Etats-Unis permet fort opportunément à ce pays de faire la preuve qu'il est le principal "gendarme" du monde.
D'ores et déjà, les USA vont sortir renforcés de cette guerre locale vis-à-vis des autres grands pays avancés qui auront fait la preuve de leur impuissance pour assurer la stabilité du monde par eux-mêmes. Avec la tendance croissante à une dislocation de tout le système de relations internationales, il revient bien aux seuls Etats-Unis de ne plus compter sur aucun autre pays pour faire la police dans une zone aussi cruciale, et dont l'instabilité ne disparaîtra pas après la punition infligée à l'Irak. Les Etats-Unis sont décidés à maintenir une présence militaire massive au Moyen-Orient. Les premières déclarations d'officiels parlent déjà de rester au moins jusqu'en 1992.
De plus, le contrôle américain sur cette région du monde, éminemment stratégique, première réserve de pétrole de la planète, va se trouver accentué. Or, ce contrôle va se révéler précieux dans le cadre de l'accentuation de la guerre commerciale avec l'Europe et Je Japon.
Et afin de lever tout malentendu éventuel, la presse américaine met les points sur les "i", profitant du marchandage sur la participation aux frais de l'opération US "Bouclier du désert" : "ni l'Allemagne, ni le Japon n'ont commencé à contribuer à un niveau équivalent à leur besoin d'un approvisionnement sûr en pétrole. Bien sûr, Bonn est occupée par la réunification. Cependant, l'Allemagne aurait tort de sous-estimer sa dette face au sacrifice américain. C'est encore plus vrai pour Tokyo." ([7] [117])
Nous le voyons, l’unanimité des grands pays industrialisés pour condamner et contrer l'Irak n'est pas le produit d'une bonne volonté pacifique, comme l'a présentée la presse bourgeoise, mais le fruit d'un rapport de forces entre elles, dans lequel les USA imposent leur domination militaire, et dans lequel aucune autre puissance ne se dégage pour jouer le rôle, tenu par l'URSS auparavant, de chef d'un bloc impérialiste antagonique. Dans ce sens, l'unanimité entre les grandes puissances pour condamner l'Irak, n'est pas le produit de la paix, ni un facteur de paix, mais le produit des rivalités d'intérêts impérialistes et facteur d'aggravation de celles-ci.
Cette unanimité, imposée, a mis en évidence aux yeux des bourgeoisies allemande et japonaise leur impuissance politique, alors qu'elles sont des "géants économiques". D'où des déclarations croissantes en leur sein, pour changer leurs Constitutions héritées de la défaite de 1945, qui limitent leurs forces armées et leur champ d'intervention. On ne peut être plus clair sur ce que signifie, pour la bourgeoisie, la diplomatie et la politique internationale : c'est la diplomatie et la politique des armes, de la force militaire. Mais même si des changements sont adoptés dans ces Constitutions, il en coûtera de l'argent, et surtout du temps, avant que ces deux pays puissent se doter d'une force militaire adaptée à leurs ambitions impérialistes, c'est-à-dire capable de rivaliser avec les USA sur ce terrain.
Le capitalisme précipite l'humanité dans le gouffre de la barbarie.
Au moment où nous écrivons, depuis le 2 Août, jour de l'invasion du Koweït, aucun élément n'est venu contredire, ou ralentir, la dynamique vers une action militaire US contre l'Irak. Toutes les démarches diplomatiques apparaissent clairement pour ce qu'elles sont : une préparation à la guerre. D'ailleurs, toutes les offres de négociation proposées par Hussein ont été rejetées par Bush qui exige que l'armée irakienne se retire du Koweït. C'est à ce prix, et encore ce n'est même pas sûr, que la guerre pourrait être évitée. Ce retrait constituerait pour Saddam Hussein un suicide politique et, sans doute aussi, un suicide tout court. On le voit mal, maintenant, se plier au diktat des grandes puissances. Il ne peut qu'aller de l'avant dans son aventure.
Dans un premier temps, l'intervention US va marquer un coup d'arrêt à la déstabilisation au Moyen-Orient. Mais juste un coup d'arrêt, et non un renversement de la tendance croissante à la "libanisation" de la région. De même, elle va tendre à marquer un coup d'arrêt à l'éclatement de ce genre de conflit dans le monde, mais, là aussi, sans réussir à inverser la tendance. Car la remise en ordre, leur ordre, que les USA vont imposer, sera basé sur la force militaire. Et uniquement sur celle-ci. Or un ordre basé sur la terreur n'est jamais tout à fait stable, et encore moins aujourd'hui, dans une période de crise économique mondiale catastrophique, de tensions locales croissantes. Le futur est à l'explosion des guerres locales et civiles. Et ce futur est proche. A vrai dire, il est même déjà, en grande partie, le présent.
Tant de conflits existent. Les affrontements militaires sont réguliers à la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Et ces deux pays, eux, sont déjà dotés de la bombe atomique... La guerre en Afghanistan se poursuit sans discontinuer, meurtrière. Au Cambodge. Au Liban. La liste est longue. C'est ça, le capitalisme.
Au Libéria, la population est livrée à la terreur depuis des mois (2 000 Ghanéens pris en otages), aux viols, aux exactions et massacres de bandes armées, essentiellement tribales, ivres de sang et de tueries. Et cela, d'ailleurs, sous l'oeil impavide des médias occidentaux et d'une flottille militaire US ancrée au large de Monrovia. Mais le Libéria ne présente pas d'intérêts économiques et stratégiques comme le Moyen-Orient.
En fait, c'est une grande partie de l'Afrique que les bourgeoisies occidentales abandonnent à sa détresse. Le désintérêt croissant des grandes puissances pour la situation de chaos qui prévaut en Afrique en dit long, à la fois sur leur cynisme et leur impuissance à contrecarrer la chute dans la décomposition.
Car l'Afrique est particulièrement exemplaire de ce que nous prépare le capitalisme pourrissant sur pied. Les émeutes, les massacres, les guerres, de plus en plus nombreuses, et de plus en plus meurtrières, presque toujours d'ordre tribal, se multiplient : au Libéria, nous l'avons vu, mais aussi au Soudan, en Ethiopie, dans les anciennes colonies françaises, en Afrique du Sud même, opposant les partisans de Mandela aux partisans de Buthelezi, etc. Est-il besoin de rappeler ici les famines, les épidémies de maladies qui avaient pratiquement disparu (comme le paludisme), du Sida, etc., tout cela au milieu d'une corruption effrénée. Mais n'est-ce pas là ce qui se passe aussi déjà dans nombre de pays d'Asie, voire en URSS ? Et c'est la seule perspective que peut nous offrir aujourd'hui le capitalisme.
Cette plongée dans le gouffre de la misère la plus noire s'accompagne d'une décomposition de toutes les valeurs d'ordre moral que pouvait avoir le capitalisme. On le voit très bien avec le conflit au Moyen-Orient. L'impudence, l'hypocrisie, le mensonge et la corruption à tous les niveaux, le gangstérisme et le chantage à échelle planétaire sur la vie de millions d'êtres humains, le terrorisme aveugle, le meurtre et l'assassinat, sont érigés en principes de gouvernement. Ils sont même la marque de l'homme d'Etat accompli : est un grand stratège celui qui prend eh otage des milliers d'hommes. Est encore plus grand et respecté celui qui n'hésitera pas à sacrifier ces mêmes otages sur l'autel des principes et du droit bourgeois.
Que ce soit au niveau économique, social, politique, idéologique, au niveau même de sa morale et de ses principes, ce système a fait faillite et entraîne de plus en plus vite l'humanité entière dans la catastrophe économique et guerrière.
La classe ouvrière mondiale est la seule force qui puisse présenter une autre perspective
"Historiquement, le dilemme devant lequel se trouve l'humanité d'aujourd'hui se pose de la façon suivante : chute dans la barbarie, ou salut par le socialisme. (...) Ainsi nous vivons aujourd'hui la vérité que justement Marx et Engels ont formulée pour la première fois, comme base scientifique du socialisme dans le grand document qu'est le Manifeste Communiste : le socialisme est devenu une nécessité historique (...) non seulement parce que le prolétariat ne veut plus vivre dans les conditions matérielles que lui préparent les classes capitalistes, mais aussi parce que, si le prolétariat ne remplit pas son devoir de classe en réalisant le socialisme, l'abîme nous attend tous, tant que nous sommes. " ([8] [118])
Soixante-douze ans plus tard, ces paroles sont toujours d'actualité. Elles pourraient avoir été écrites aujourd'hui. Seule la classe ouvrière mondiale, le prolétariat, peut offrir l'unique perspective alternative à l'effroyable cataclysme du capitalisme en putréfaction : le communisme.
La terrible récession ouverte qui commence aux USA, et par contrecoup sur l'économie mondiale, va représenter pour l'ensemble du prolétariat mondial, et tout particulièrement des pays industrialisés d'Europe, des attaques encore exacerbées sur leurs conditions de vie : licenciements par millions, salaires en baisse, conditions de travail aggravées comme jamais, etc. alors qu'il subit déjà depuis longtemps une détérioration drastique de sa situation, détérioration qui s'est déjà énormément accélérée ces derniers mois. Et qui plus est, la bourgeoisie mondiale profite, sans attendre, du conflit au Moyen-Orient, pour faire passer les sacrifices au nom de l'unité nationale et du... choc pétrolier. On nous l'a déjà fait deux fois ce coup-là ! C'est clair : ce sont les ouvriers qui vont payer la note de l'intervention militaire, les ouvriers en uniforme enrôlés dans l'armée irakienne, mais aussi ceux des pays occidentaux.
La classe ouvrière ne doit pas céder aux sirènes de l'unité nationale et de la défense de l'économie capitaliste. Elle ne doit pas suivre la bourgeoisie et prendre part au conflit contre l'Irak. Ce conflit n'est pas le sien. Elle a tout à y perdre et rien à y gagner. Son combat, le seul terrain sur lequel elle puisse se battre, c'est celui de la lutte contre le capitalisme comme un tout, c'est la lutte pour la défense de ses conditions de vie, contre les attaques économiques, contre l'austérité et les sacrifices, contre la logique du capital qui ne conduit qu'à la misère et à la guerre, partout dans le monde, mais aussi contre l'unité nationale, contre la défense de la nation et de la démocratie bourgeoise dans tous les pays.
Aujourd'hui, un an après la dislocation du stalinisme et l'effondrement du bloc de l'Est, après l'énorme propagande sur la victoire du capitalisme et la paix, il est clair pour tout ouvrier que le capitalisme mondial est dans une faillite insoluble et irréversible. Il est tout aussi clair que le capitalisme décadent, c'est inévitablement la guerre impérialiste. Crise et guerre sont deux moments du capitalisme qui ne font que s'alimenter et se renforcer l’un l'autre. Les deux faces d'une même pièce. Mais en plus, fait historique nouveau, la pièce se décompose entraînant avec elle l'ensemble de l'humanité dans un cours où crise et guerre vont de plus en plus tendre à s'entremêler, à se confondre.
Plus l'agonie du capitalisme se prolonge, plus dévastateurs sont ses ravages de tout ordre. La décomposition du rapport social qu'est le capital, en se prolongeant, commence à hypothéquer chaque fois un peu plus la perspective même de la révolution prolétarienne, et à handicaper la construction future du communisme. La destruction massive et croissante de forces productives, usines, machines, ouvriers rejetés de la production, la destruction de l'environnement, des campagnes, l'accroissement anarchique de villes-dépotoirs de millions d'êtres humains, vivant dans des conditions atroces, la plupart du temps sans travail, l’atomisation et la destruction des rapports sociaux, les dégâts causés par les nouvelles épidémies, la drogue, la faim, les guerres - et nous en oublions -, autant de drames et de catastrophes qui rendront plus difficile la construction de la société communiste.
Les enjeux deviennent de plus en plus dramatiques. Le prolétariat ne dispose pas d'un temps illimité pour accomplir sa tâche historique. Révolution prolétarienne triomphante ou destruction de l'humanité, telle est l'alternative. Pour le prolétariat, il n'est d'autre voie que la destruction du capitalisme et la construction d'une autre société, où la faim, la guerre et l'exploitation auront disparu.
Le chemin jusqu'à la société communiste sera long et ardu. Mais il n'en est pas d'autre.
RL. 4/9/90
"Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse ; voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit, c'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment...
"Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix : ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquences, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien, victoire du socialisme, c'est à dire de la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un ou bien-ou bien encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive de son combat révolutionnaire : l'avenir de la civilisation est de l'humanité en dépendent."
Rosa Luxembourg, Brochure de Junius.
[1] [119] Voir l'article sur la crise dans ce numéro.
[2] [120] Lénine, Résolution sur "Le pacifisme et la consigne de la
paix" de la Conférence des sections du POSDR à l'étranger, mars 1915.
[3] [121] Un ancien membre de la CIA a récemment fait des déclarations (reproduites par divers journaux dans différents pays : Libération en France, Cambio 16 en Espagne), rendant compte d'accords secrets établis entre la CIA et les autorités iraniennes de l'époque, pour faire durer suffisamment longtemps la prise d'otages afin d'assurer la défaite de Carter aux élections...
[4] [122] Comme le rappellent le New-York Times et Le Monde Diplomatique, août 1990.
[5] [123] "Le Monde", 29/8/90.
[6] [124] Ce ne serait pas la première fois que la bourgeoisie américaine procède de cette façon. Ainsi, à une échelle bien plus vaste, cette bourgeoisie a eu l'occasion de tendre la perche à son futur ennemi pour que celui-ci fasse le premier pas dans une guerre devenue inévitable et se présente de la sorte comme l'"agresseur". Il s'agit de l'attaque japonaise du 8 décembre 1941 contre la flotte américaine du Pacifique basée à Pearl Harbour (Hawaii), qui provoqua l'entrée officielle des USA dans la seconde guerre mondiale. Il a été clairement démontré, à posteriori, que c'est le président américain Roosevelt qui a tout fait pour inciter le Japon à prendre une telle initiative, notamment en réduisant au minimum les moyens de défense de la base (la presque totalité des soldats US étaient en permission) alors qu'il savait pertinemment que ce pays s'apprêtait à entrer dans la guerre. L'attaque japonaise de Pearl Harbour allait ainsi permettre de constituer, autour de Roosevelt, l'"union nationale" pour la guerre et faire taire les résistances, tant dans la population que dans certains secteurs de la bourgeoisie US, contre cette politique.
[7] [125] "As for Germany and Japon, neither has begun to contribute at a level equal to its need for secure oil suppty. To be sure, Bonn is preoccupied with reunification. Yet Germany would be shortsighted to underestimate its debt to America's sacrifice. That is even more true for Tokyo", The New-York Times for the International Herald Tribune, 31/8/90.
[8] [126] Rosa Luxembourg, Discours sur le Programme du Parti Communiste Allemand, dec. 1918, édition Spartacus.
Géographique:
- Irak [127]
Questions théoriques:
- Décomposition [2]
- Guerre [128]
Crise économique : le pétrole : un faux alibi pour une vrais crise
- 6283 reads
La récession de l'économie américaine est là. L'annonce officielle en a été faite dans la presse du monde entier. L'explication qu'en donne la bourgeoisie mondiale est toute trouvée : c'est la faute du renchérissement du cours du pétrole, c'est la faute du dictateur irakien Saddam Hussein et de son coup de force au Koweït. Et les classes dirigeantes du monde entier, désolées, s'empressent d'annoncer ce que tout cela va signifier, dans un proche avenir, pour les prolétaires : moins de croissance, et donc des licenciements, une inflation en hausse et une attaque contre les salaires et le niveau de vie, bref, plus de misère et de pauvreté. Mais évidemment, les travailleurs n'auront qu'à s'en prendre au grand responsable de cette situation, au bouc émissaire tout trouvé dans le contexte de xénophobie antiarabe et anti-islamique cultivé depuis des années : la brute sanguinaire Saddam Hussein. Ce n'est pas la première fois que la bourgeoisie mondiale nous ressort ce scénario, c'est déjà celui qui a servi après le choc pétrolier de 1973 pour justifier la récession de 1974 ; à cette époque, ce sont les émirs cupides de la péninsule arabe qui étaient montrés du doigt ; la récession de 1981, elle, a trouvé son explication avec ce qui a été appelé le "deuxième choc pétrolier", attribué à la folie des mollahs et de Khomeiny. Aujourd'hui, le même mensonge éculé, mais qui a cependant montré par le passé son efficacité idéologique, nous est servi sur un plateau par les médias du monde entier.
Cette explication de la crise et de la récession de l'économie mondiale par les fluctuations brutales du cours du pétrole, liées à l'instabilité politico-militaire de la principale région productrice de l'or noir, le Moyen-Orient, est un pur mensonge de la propagande capitaliste destiné à cacher la véritable nature de la crise économique, son origine, ce qui la détermine réellement. La crise ouverte de l'économie mondiale, qui s'aggrave constamment depuis plus de vingt ans, est le produit des contradictions insolubles du mode de production capitaliste, lequel est en train d'entraîner l'ensemble de l'humanité dans sa banqueroute catastrophique.
Cette vérité de la tragédie historique où mène la domination du capital, la classe dominante, la bourgeoisie, qui contrôle la destinée du monde, s'efforce évidemment par tous les moyens de la cacher, car elle porte en germe la nécessité de sa propre disparition et celle du système capitaliste qui l'a fait naître.
Quelle récession ?
Depuis la récession de 1981-1982, la bourgeoisie occidentale, à l’unisson des rodomontades d'un Ronald Reagan, n'a cessé tout au long des années 1980 de célébrer la santé retrouvée de l'économie mondiale et d'aligner les chiffres montrant la croissance record et l'inflation enfin vaincue. Cependant, cette fameuse croissance et la chute de l'inflation tant saluées relevaient plus d'un trucage grandissant des statistiques économiques et d'une politique artificielle de fuite en avant dans l'endettement et l'économie de guerre que d'une réelle prospérité. Loin des indices officiels trompeusement optimistes des officines étatiques, le prolétariat, avec l'immense majorité de la population mondiale, a subi dans sa chair la dégradation dramatique de la situation économique mondiale durant toutes ces années. Les années 1980 se sont ouvertes avec l'effondrement économique des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'une partie de l'Asie, mettant définitivement fin à leurs rêves de développement, et se sont terminées par l'effondrement de l'économie des pays de l'Est, entraînant la dislocation du bloc russe. Des centaines de millions d'habitants des pays les plus pauvres ont sombré dans la misère absolue, selon un rapport de la Banque mondiale plus d'un milliard d'hommes vivent avec moins de 370 $ par an. La famine s'est étendue (100 000 morts rien qu'au Soudan en 1989), les épidémies se sont développées, non seulement le SIDA mais encore les anciennes maladies sont en pleine recrudescence, tel le paludisme, qui tue deux millions de personnes par an. Dans les pays développés, là où dit-on a régné la prospérité, les conditions de vie se sont profondément dégradées sous les coupes claires des programmes d'austérité permanents, le chômage massif s'est maintenu, tandis que le travail précaire et mal rémunéré s'est développé, la pauvreté a gagné du terrain et une misère inconnue depuis les années noires de la guerre s'est étendue au coeur des métropoles du capitalisme "avancé". Sinistre bilan, bien éloigné de l'euphorie intéressée des chantres de l'économie capitaliste.
Loin de l'enthousiasme de la propagande bourgeoise, les années 1980 ont été en fait des années de récession de l'économie mondiale marquées par un enfoncement dramatique de la planète dans la misère. A l'évidence, il y a deux manières de considérer la situation économique : celle de la bourgeoisie, qui truque ses indices, qui a besoin de faire croire, et dans une certaine mesure de croire elle-même, à la prospérité de son système, et celle des exploités du monde entier, qui, dans le concret des souffrances quotidiennes, ont subi durement la dégradation générale de leurs conditions de vie.
Etat des lieux avant les événements du golfe
Cependant, les chiffres officiels de la classe dominante, s'ils sont un travestissement optimiste de la réalité, n'en expriment pas moins, dans leur évolution, les fluctuations de la situation économique mondiale. En effet, pour les besoins de sa gestion, la classe dominante éprouve aussi la nécessité d'une certaine vérité de ses statistiques. De fait, même si, toutes ces dernières années, les taux de croissance positifs des principales puissances industrielles ont perpétué le mensonge d'une bonne santé de l'économie mondiale, le lent déclin, année après année, mois après mois, traduit l'enfoncement tout à fait réel dans une récession toujours plus profonde.
Depuis de nombreux mois, la croissance industrielle des USA, de la GB, du Canada, de la Suède, de l'Italie, plonge irréversiblement vers la barre fatidique de la croissance zéro. Cela bien avant le coup de force de l'Irak.
Les résultats inquiétants qui sont annoncés aujourd'hui, et qui affolent les bourses du monde entier, sont antérieurs à ce que les journalistes nomment déjà le "troisième choc pétrolier".
Le moteur qui a permis de maintenir l’économie des pays les plus industrialisés à flot est en panne. L'économie américaine est au plus mal. Après la récession du début des années 1980, c'est au travers d'une politique d'endettement faramineuse que les USA ont entamé une relance de leur économie, accumulant des déficits budgétaires et commerciaux inimaginables jusque-là, permettant ainsi au Japon et aux pays industrialisés d'Europe de développer leurs exportations et de faire tourner leur appareil productif.
Les estimations de la dette globale des USA, interne et externe, varient aujourd'hui de 8 000 à 10 000 milliards de dollars, à comparer avec l'évaluation de la dette de l'ensemble des pays sous-développés à 1 300 milliards de dollars en 1989. Au début de l'année 1990, la dette fédérale a atteint le chiffre de 3 120 milliards de dollars, et une nouvelle loi a dû être votée pour autoriser le dépassement de ce seuil. L'endettement extérieur net, c'est-à-dire en défalquant les créances des USA à l'étranger, atteint, fin 1989, 663 milliards de dollars, en croissance de 25 % sur l'année précédente. A ce niveau, les chiffres deviennent surréalistes, et pas plus que n'importe quel pays sous-développé, les Etats-Unis ne sont capables de rembourser leur dette.
Et pourtant, ces injections massives de liquidités n'ont pas permis à la principale puissance économique du globe d'empêcher l'enfoncement irrésistible de son économie dans une nouvelle récession ouverte, tout au plus ont-elles permis de freiner le mouvement. Au dernier trimestre 1989, la croissance était de 0,5 %, au deuxième trimestre 1990, de 1,2 %. Les taux de croissance record du milieu des années 1980 sont définitivement oubliés.
Avec le marasme qui s'approfondit, les bénéfices des sociétés américaines sont en chute libre. Ainsi, pour le premier semestre de 1990, Chrysler et General Motors voient leurs profits se réduire respectivement de 45 % et 39 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi les géants de l'informatique, en 1989, Unisys a annoncé des pertes de 640 millions de dollars et Wang de 425 millions. En conséquence, les faillites se sont multipliées, et tout à fait significatives ont été les banqueroutes en chaîne de centaines de caisses d'épargne, laissant une ardoise officielle de plus de 500 milliards de dollars (alors que certaines estimations parlent de 1000 milliards) à l'Etat fédéral.
Après avoir été officiellement déclaré vaincu, le chômage, aux USA, recommence à augmenter brutalement, même dans les statistiques officielles truquées : durant le seul mois de juillet 1990, il passe de 5,2 % à 5,5 % de la population active. Et le pire est à venir, pas un jour ne s'écoule sans que de nouvelles réductions d'effectifs ne soient annoncées. Les fleurons de l'industrie technologique américaine, censés être le secteur le plus compétitif, licencient massivement : General Electric, McDonnell-Douglas, Pratt & Whitney, Lockheed, NAS, etc. La liste n'est évidemment pas exhaustive, tous les secteurs sont touchés.
La déroute de l'économie américaine et son enfoncement dans la récession ne peuvent qu'entraîner l'ensemble de l'économie mondiale dans un cours catastrophique. Malgré la persistance d'énormes déficits commerciaux américains, les exportations des pays industrialisés baissent avec le ralentissement de l'économie US. Même les puissances industrielles les plus compétitives sur le marché mondial voient leurs exportations dégringoler : l'excédent commercial du Japon a plongé de 19 % en 1989 et de 22,8 % sur les six premiers mois de 1990, celui- de la RFA sur le premier semestre de 1990 de 8 %, alors que la balance des paiements de ce dernier pays chutait de 18 % d'une année sur l'autre. Quant aux pays industrialisés moins bien lotis, ils commencent déjà à subir la contagion de la récession américaine (selon les statistiques officielles). Il en est ainsi du Canada, dont l'économie est étroitement imbriquée dans celle des USA, qui a vu son PIB diminuer de 0,1 % en avril, de 0,2 % en mai et juin, et de l'Italie dont la croissance industrielle retombe à zéro à la fin du printemps.
A la suite de celle des USA, l'ensemble de l'économie mondiale est en train de plonger. Partout, les mêmes symptômes se manifestent. Les bénéfices des grandes compagnies sont en chute libre, les pertes s'accumulent. Ainsi, dans le secteur informatique européen, Bull (France) annonce 1,8 milliards de francs de pertes sur six mois, et Nixdorf (RFA) a subi 3,3 milliards de francs de pertes en 1989, avant de se faire racheter par Siemens. Les faillites se multiplient, elles sont par exemple en augmentation de 31 % en Suède pour le premier semestre de 1990 et, sur les six premiers mois de 1990, de 30 % en GB par rapport au semestre correspondant de l'année précédente. Quant au chômage, comme conséquence du ralentissement de l'économie, il connaît aussi une nouvelle poussée en Europe : en RFA, il est passé significativement de 6,4 % à 6,6 % de la population active en juillet 1990, et pas un jour ne s'écoule sans que, dans tous les pays d'Europe de l'ouest, ne soient annoncés de nouveaux licenciements, qui préfigurent la future croissance fulgurante de la masse des ouvriers sans emploi, laquelle, selon les chiffres officiels, comptant déjà 25 millions de travailleurs au sein de l'OCDE.
Avec l'effondrement du bloc russe, la bourgeoisie avait cru trouver dans l'ouverture des marchés est-européens un palliatif au ralentissement de l'économie américaine, un nouvel eldorado pour réaliser ses profits. Avec l'accélération de la crise ces derniers mois, le mythe a fait long feu. Sur le plan économique, l'unification de l'Allemagne se révèle être une catastrophe. La production industrielle de la RDA a chuté de 7,3 % en juin tandis que la liste des chômeurs s'allonge vertigineusement au point que l'on envisage pour la période qui vient des taux de chômage de 25 % à 30 % de la population active. La réunification est un puits sans fond pour toute l'économie ouest-allemande, qui prévoit pour l'année 1991 une augmentation de sa dette de 30 %, de 1 000 milliards à 1300 milliards de marks, sans compter le fond spécial prévu de plus de 100 milliards de marks. La réalité sera pourtant, selon toute vraisemblance, encore bien plus désastreuse. La situation des autres pays d'Europe de l'Est est encore pire. Ils n'ont pas, eux, une grande puissance occidentale pour les soutenir, leur dette croît de manière accélérée, la production chute brutalement : pour les six pays anciennement satellites de l'URSS, la production industrielle a plongé de 13,4 % durant le premier semestre de 1990, comparé à la même période de l'année 1989 et les exportations de 14,2 %. Les travailleurs subissent de plein fouet les charmes de l'économie libérale à coups de programmes d'austérité draconiens : durant le seul mois de juin dernier, 125 000 chômeurs de plus se sont retrouvés sur le pavé en Pologne ; en Tchécoslovaquie, début juillet, les prix de 3 000 produits ont augmenté de plus de 25 %.
Voilà l'état des lieux de l'économie mondiale avant le 2 août, jour de l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes. La "récession" était déjà là, l'accélération de la plongée dans la crise avait déjà grandement commencé à faire sentir ses effets depuis de longs mois. Les événements du golfe Persique n'ont fait qu'accentuer et accélérer une tendance déjà fortement affirmée de l'économie mondiale vers une plongée dramatique dans un ralentissement toujours plus fort de l'économie.
Ce ne sont pas les menaces de guerre qui sont à l'origine de la crise économique, mais c'est exactement l'inverse, c'est l'approfondissement de la crise économique qui pousse vers les tensions guerrières. La situation de l'Irak à cet égard est parfaitement claire : incapable de rembourser une dette écrasante de 70 milliards de dollars, mais bénéficiant d'une puissance militaire surclassant celle de ses voisins, l'Irak a utilisé son armée pour s'emparer des richesses tentantes du Koweït, et essayer ainsi de surmonter ses difficultés économiques. Les USA aussi, qui constituent pourtant la puissance économique majeure, et de loin, sont poussés, pour défendre leurs intérêts économiques et leur situation de puissance mondiale dominante, à utiliser de plus en plus le gigantesque arsenal militaire qu'ils ont constitué depuis des années. Là où leur puissance économique ne suffit pas à faire prévaloir leurs intérêts, la force des armes est employée de plus en plus pour imposer la discipline.
Bien sûr, le renchérissement du prix du pétrole, qui a été catapulté brutalement de 14 $ le baril à plus de 30, va être un facteur accélérateur, aggravant, de la crise, mais il n'en est pas la cause. En fait, toute la propagande actuelle de la bourgeoisie sert à minimiser l'accélération dramatique de la crise et ses conséquences.
La panique boursière actuelle trouve bien plus son origine dans les résultats catastrophiques des économies des pays développés que dans l'évolution des cours pétroliers. Même si ce dernier élément a été un facteur accélérateur de l'effondrement boursier, il faut à l'évidence constater que depuis l'effondrement des bourses en 1987, les alertes se sont succédées, malgré tous les dispositifs de contrôle mis progressivement en place. Encore récemment, dans une longue glissade au début de cette année, la bourse de Tokyo, devenue le haut heu de la spéculation mondiale, avait déjà perdu 28 %. Le 23 août, cette perte se chiffrait à 39% depuis janvier 1990. D'ailleurs, la chute catastrophique des cours boursiers de l'été 1990 n'a pas commencé avec les hostilités du 2 août mais dès la mi-juillet.
Quelles perspectives ?
La tourmente, qui souffle aujourd'hui sur toutes les places boursières de la planète, annonce l'ouragan qui va secouer l'économie mondiale. Les places boursières, à notre époque, n'ont plus le même rôle central que lors de la crise de 1929. Même si, durant les années 1980, elles étaient devenues un haut lieu de la spéculation où grenouillaient les affairistes de tout poil, elles ne constituaient pas pour autant le coeur de l'économie. Le développement du capitalisme d'Etat, depuis des décennies, a déplacé le centre de gravité du capital vers les officines discrètes des bureaux ministériels. Cependant, l'effondrement boursier actuel est lourd de signification, relativement à l'instabilité grandissante qui menace l'ensemble du système économique mondial dans ses différents aspects : productif, monétaire, financier. Il traduit la perte de confiance de la bourgeoisie dans sa propre économie et manifeste l'impasse où elle se trouve.
La politique menée au lendemain de l'effondrement des valeurs boursières d'octobre 1987 et qui avait permis, en relançant la spéculation, de sauver les apparences d'une santé maintenue de l'économie mondiale n'est plus possible. Cette politique avait été celle de la baisse des taux d'intérêt, celle du crédit facile. Elle a eu pour premier résultat de développer l'inflation sans pour autant permettre une croissance de l'économie réelle : la production, qui a continué a décliner irrésistiblement.
L'inflation, que les chantres de l'économie capitaliste prétendaient avoir vaincue au milieu des années 1980 (et elle avait effectivement, au moins au vu des indices officiels, rejoint un niveau relativement bas) n'a cessé de se développer régulièrement depuis plusieurs années dans les pays industrialisés. Elle est passée ainsi, entre 1987 et 1989, de 3,7 % à 4,8 % aux USA, de 4,2 % à 7,8 % en GB, et globalement, pour les sept grands pays industrialisés de 2,9 % à 4,5 %. Même si ces chiffres paraissent encore faibles par rapport aux records des années 1970, la progression n'en est pas moins très importante sur les deux dernières années : respectivement, selon les exemples cités, les indices ont progressé de 29 %, 85 % et 55 %. Les premiers mois de l'année 1990 ont été marqués par une accélération brutale. D'après les indices de juillet 1990, la progression en rythme annuel a été de 5,6 % aux Etats-Unis et de 9,8 % en GB. Dans les pays de la périphérie, l'inflation, durant les années 1980, a continué sur sa lancée des années 1970, atteignant des sommets inconnus jusqu'alors et des indices à quatre chiffres. L'augmentation brusque des cours du pétrole de l'été va signifier une nouvelle accélération. Les économistes les plus optimistes prévoient que, pour tous les pays industrialisés, celle-ci va se traduire par de nouvelles hausses rapides supérieures à 1 %, et entraîner un retour à la situation inflationniste des années 1970. Quant aux pays du "tiers-monde", nul n'ose prévoir les effets désastreux d'un baril de pétrole à plus de 30 $.
Dans ces conditions, il n'est nulle part question de faire baisser les taux d'escompte des grandes banques centrales au moment où, sous la poussée des tarifs pétroliers, l'inflation flambe. Au contraire, partout, les taux d'intérêts sont à la hausse, rendant le crédit toujours plus cher. Il y a déjà quelques années, Volker, le président d'alors de la Banque fédérale, avait déclaré : "La question de la dette est une bombe placée au coeur du système financier international". Cette bombe se rapproche toujours plus de son point d'explosion, le détonateur est amorcé. Le surenchérissement du crédit ne peut avoir pour conséquence que de faire peser encore plus lourdement le poids de la dette, et de rendre encore moins possible son remboursement, même de la part des pays les plus développés qui étaient, jusqu'à présent, les garants de la stabilité du système financier international. La situation est particulièrement grave à un moment où les besoins en capitaux se font plus importants.
Durant les années 1980, l'endettement de la plupart des pays industrialisés n'a cessé de croître. De 1981 à 1989 la dette publique nette en pourcentage du PNB est passée de 37,2 % à 51,4 % pour les USA, de 57,1 % à 68 % pour le Japon, de 61 % à 97 % pour l'Italie par exemple. La pseudo croissance des années 1980, qui a permis de maintenir l'illusion de la prospérité des économies développées de l'Occident, s'est faite à crédit. Alors que les marchés, les débouchés pour la production se fermaient pour manque de solvabilité, le recours au crédit permettait d'écouler des marchandises qui, autrement, n'auraient jamais trouvé preneur sur un marché sursaturé en rétrécissement permanent.
Cependant, cette politique artificielle trouve ses limites dans l'incapacité de la classe capitaliste à créer de nouveaux crédits alors que les anciens ne sont pas remboursés, et ne pourront jamais l'être. On assiste ainsi à des phénomènes aberrants depuis des années : les pays endettés payent leurs traites en contractant de nouveaux crédits qui alourdissent encore le poids de leur dette et des traites à payer ; les pays industriels, pour exporter leur production, prêtent de l'argent qui ne sera Jamais remboursé, et par cela, ils s'endettent eux-mêmes. Un tel système ne peut perdurer longtemps, il se fonde sur une tricherie constante avec la loi de la valeur, et ne repose que sur une illusion, celle de la croissance infinie du capital. C'est cette illusion qui est en train de s'écrouler avec l'entrée de l'économie mondiale dans une nouvelle phase de récession.
Aujourd'hui, la nécessité de payer la facture pétrolière ne peut qu'aggraver les déficits commerciaux et les balances des paiements, c'est-à-dire renforcer les besoins de liquidités, de financement, donc de crédits des différents Etats. Mais là n'est pas le pire : le recours de plus en plus massif à l'endettement s'est révélé incapable de suffire à créer les débouchés artificiels nécessaires pour maintenir la croissance de la production qui décline depuis des années. La chute de l'économie mondiale, et notamment celle des pays industrialisés, dans la récession ouverte signifie une moins grande rentrée des impôts dans les caisses de l'Etat et une aggravation des déficits budgétaires. Sur ce point, l'exemple le plus significatif reste les USA ; lors de la récession de 1973-1975, le déficit budgétaire avait grimpé de 2 à 8 milliards de dollars, lors de la récession de 1979-1982, de 50 à 200 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il avait chaque fois quadruplé. Avec la récession actuelle, cela signifierait que le déficit budgétaire actuel de plus de 190 milliards de dollars serait propulsé à près de 800 milliards de dollars. On peut imaginer les besoins de crédits américains dans cette hypothèse. Mais alors où trouver des prêteurs ? L'un des principaux bailleurs de fonds de ces dernières années, la RFA, étant en train de se transformer lui-même, pour financer la réunification de l'Allemagne, en un des plus gros emprunteurs sur le marché mondial, reste le Japon, qui, avec la récession, voit ses marchés se rétrécir, sa balance commerciale positive se réduire et ses capacités de financement s'amoindrir. Une nouvelle relance par le crédit n'est donc plus possible.
Même une relance par l'économie de guerre, dans la mesure où celle-ci, pour son financement, a aussi besoin de crédit, ne peut constituer une solution. D'ailleurs, il suffit de constater que le premier effet de l'intervention US au Moyen-Orient est, sur le plan économique, d'aggraver le déficit budgétaire américain ; la relance des programmes d'armement que la situation peut impliquer, de toute façon, devrait être financée sur le budget, ce qui ne contribuerait qu'à en détériorer encore plus le déficit.
Une des solutions pour le gouvernement américain, pour réduire son déficit, est de lever de nouveaux impôts, mais cela signifie un ralentissement encore plus fort de l’économie et une plongée plus dramatique dans la récession. La quadrature du cercle ! Tous les spécialistes de la conjoncture économique sont dans le cirage ; depuis de nombreux mois, la panique montait et la guerre dans le Golfe a été le détonateur pour qu'elle s'exprime ouvertement. Les maigres espoirs d'une relance ont définitivement sombré avec l'explosion des cours du pétrole, qui signifie une perte rapide de plus d'un point de croissance pour les pays industrialisés. Les événements du Golfe, tout en n'étant pas directement à l'origine de la crise, se sont produits à un moment où l'économie mondiale se trouvait extrêmement fragilisée, précipitant et aggravant grandement les effets dévastateurs de la crise.
Les perspectives sont on ne peut plus sombres pour les capitalistes du monde entier : chute de la production, faillites en chaîne des entreprises industrielles et des banques, crise du crédit et donc du système financier international avec, au coeur de la tourmente, le dollar, qui, au mois d'août, a rejoint ses niveaux historiques les plus bas, inflation galopante, concurrence exacerbée pour les maigres marchés encore solvables, déstabilisation grandissante du marché mondial. La catastrophe est là. La perspective, après l'effondrement économique des pays sous-développés de la périphérie et des pays d'Europe de l'Est est maintenant à l'écroulement de l'économie des pays les plus développés. Même si on ne peut prévoir précisément les formes que prendra cette nouvelle phase de la crise catastrophique du capital, ni l'enchaînement des événements qui vont la caractériser, ses principales caractéristiques, elles, ne font aucun doute.
Les travailleurs des pays du monde entier vont payer le prix fort de la banqueroute du capital. Le chômage va grimper à des niveaux jamais atteints jusqu'alors. L'inflation et les politiques d'austérité vont dégrader le niveau de vie de la classe ouvrière des pays développés à un point qui, jusque là, était l'apanage malheureux des pays les plus pauvres. Partout dans le monde, la crise va exercer ses effets désastreux, accélérant encore le processus de décomposition général, à l'oeuvre depuis des années ; les famines, les épidémies vont connaître un nouveau bond en avant.
Avec une économie qui descend sous le seuil fatidique de la croissance zéro des indices officiels, c'est un seuil psychologique fondamental que la classe dominante est en train de franchir. La panique présente des spéculateurs sur les marchés boursiers en est une expression frappante.
Dans un premier temps, le bain de sang qui se prépare dans le golfe Persique constitue un facteur de déboussolement du prolétariat mondial. Le martelage incessant des organes de propagande de la bourgeoisie que celui-ci subit lui masque provisoirement la réalité de la profondeur de la crise qui s'annonce et entrave sa capacité à se situer sur son terrain de classe.
Cependant, les effets des attaques brutales contre ses conditions de vie que la situation implique nécessairement, signifient que la combativité toujours présente de la classe ouvrière va, à court terme, tendre à s'exprimer dans des luttes revendicatives d'ampleur. La perspective de luttes sociales massives face à la paupérisation brutale qui va frapper le prolétariat mondial ne peut qu'aviver davantage les frayeurs de la classe dominante. La propagande incessante des années 1980 sur les indispensables sacrifices à consentir pour maintenir la prospérité, qui a été une réelle entrave au développement de la lutte et de la conscience de classe, va se trouver balayée devant la réalité du fait que tous ces sacrifices n'ont finalement mené qu'à la catastrophe présente. Le capitalisme est en train de faire la preuve absolue de l'impasse historique où il mène l'humanité, et plus que jamais se pose la nécessité urgente de la révolution communiste mondiale, seule solution à la barbarie présente. L'enfoncement accéléré dans la misère qui est en train de se produire déblaie le terrain pour que la compréhension de cette nécessité se développe dans la classe ouvrière.
JJ, 4/9/1990.
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [129]
- Crise économique [27]
Résolution sur la situation internationale (juin 1990)
- 3324 reads
Lors de son adoption, cette résolution ne pouvait intégrer la "crise du Golfe" déclenchée depuis le 2 août 1990. Elle traite des perspectives générales de la situation internationale sous ses principaux aspects et conserve une pleine validité aujourd'hui. Et en particulier, les événements au Moyen-Orient survenus depuis la rédaction de ce document illustrent de façon immédiate et complète ce qui y était tracé : le futur que nous offre le capitalisme n'est pas seulement celui d'une crise insoluble aux effets économiques de plus en plus dévastateurs (famines dans les pays arriérés, paupérisation absolue dans les pays avancés, misère généralisée pour l'ensemble de la classe ouvrière), il est aussi celui d'affrontements militaires de plus en plus brutaux là où le prolétariat n'aura pas la force de les empêcher, il est enfin celui d'un chaos grandissant, d'une perte de contrôle croissante par la classe dominante de l'ensemble de la société, d'une barbarie de plus en plus extrême et déchaînée..."
La situation mondiale est dominée aujourd'hui, et pour un moment encore, par l'événement historique considérable que constitue l’effondrement brutal et définitif du bloc impérialiste de l'Est. Il en est ainsi parce que cet effondrement :
- constitue une illustration de la profondeur, de la gravité et du caractère insoluble de la crise de l'économie capitaliste ;
- vient confirmer l'entrée, au cours des années 1980, du capitalisme décadent dans une nouvelle phase - la phase ultime- de son existence, celle de la décomposition générale de la société ;
- débouche sur une déstabilisation générale de toute l'organisation géopolitique du monde instaurée à la fin de la seconde guerre mondiale ;
- exerce un impact de première importance sur la conscience et la lutte du prolétariat dans la mesure où ce bloc a été présenté depuis ses origines, par tous les secteurs de la bourgeoisie, comme le "bloc socialiste", l'héritier de la révolution prolétarienne d'octobre 1917.
1) L'effondrement du bloc de l'Est trouve ses origines fondamentales dans :
- la faiblesse et l'arriération congénitales de l'économie de sa puissance dominante, l'URSS, résultant de l'arrivée tardive de ce pays dans le développement historique du capitalisme et l'empêchant, de ce fait, de constituer une tête de bloc viable (l'accession de l'URSS à une place qu'elle ne pouvait pas tenir provenant des conditions politiques et militaires particulières qui se présentaient à la fin de la seconde guerre mondiale) ;
- la faillite complète de l'économie des pays qui constituaient ce bloc et, en premier lieu évidemment, de l'URSS elle-même.
Cette faillite résulte de l'incapacité de la forme du capitalisme d'Etat existant dans ces pays (et qui avait été instaurée en URSS sur les ruines de la révolution prolétarienne victime de son isolement international) à affronter l'aggravation inexorable de la crise mondiale du capitalisme. Cette forme de capitalisme d'Etat, si elle avait pu se montrer capable d'affronter victorieusement une situation de guerre impérialiste généralisée, s'est, en revanche, révélée inapte à faire face à la situation de concurrence exacerbée provoquée sur le marché mondial par une crise de surproduction du fait :
- du handicap considérable que représente pour la compétitivité de chaque capital national l'économie de guerre qui avait trouvé en URSS une de ses manifestations les plus extrêmes et caricaturales ;
- et, surtout, de la totale déresponsabilisation de l'ensemble des acteurs de la production (depuis les directeurs d'usine jusqu'aux manoeuvres et aux kolkhoziens) qui découle d'une centralisation complète de l'économie, de la fusion, sous l'égide du Parti-Etat, de l'appareil politique et de l'appareil productif, de l'élimination de toute sanction du marché.
En fait, l'effondrement économique spectaculaire de l'ensemble de l'économie dite "socialiste" traduit la revanche, sous les coups de boutoir de la crise mondiale, de la loi de la valeur avec laquelle cette forme particulière de l'économie capitaliste avait, pendant des décennies, tenté de tricher à grande échelle.
2) En ce sens, la disparition de l'économie de type stalinien, la réintroduction en catastrophe des mécanismes du marché dans les pays de l'Est, n'ouvre aucune perspective réelle de relance de l'économie mondiale dont le maintien à flot depuis deux décennies repose également sur une tricherie avec cette même loi de la valeur. En effet, à part quelques exceptions et situations spécifiques (comme l'Allemagne de l'Est), l'ensemble des pays de l'Est, et particulièrement l'URSS, ne saurait constituer un nouveau marché pour la production des pays industrialisés. Les besoins y sont immenses, mais les moyens de paiement totalement absents et les conditions historiques actuelles interdisent toute mise en place d'un quelconque nouveau "plan Marshall". En effet, celui-ci a pu relever l'économie d'Europe occidentale de ses ruines parce qu'il intervenait dans une période de reconstruction faisant suite à la guerre mondiale. Aujourd'hui, en revanche, le développement dans les pays de l'Est d'une industrie compétitive se heurte de façon insurmontable à la saturation générale du marché mondial. Comme ce fut déjà le cas durant les années 70 dans les pays du "tiers-monde", les crédits occidentaux destinés à financer un tel développement dans les pays de l'Est ne pourraient aboutir à d'autre résultat que d'accroître encore leur endettement déjà considérable et alourdir, de ce fait, le fardeau de la dette qui pèse sur l'ensemble de l'économie mondiale.
3) En fait, le mythe de la "sortie de la crise" par le "libéralisme" et les "reaganomics", et qui a connu son heure de gloire au milieu des années 1980, est aujourd'hui en train de crever comme une bulle de savon. Les prétendus "succès" des économies occidentales étaient en réalité basés sur une fuite en avant à corps perdu constituée principalement par un endettement gigantesque, notamment de la part de la première puissance mondiale, les Etats-Unis. Par d'énormes déficits de sa balance commerciale et de son budget, par une course effrénée aux dépenses d'armements, ce pays a permis de repousser pendant des années l'échéance d'une nouvelle récession ouverte, laquelle constitue, pour la bourgeoisie, la hantise majeure dans la mesure où c'est la manifestation de la crise qui met le mieux en évidence la faillite complète du mode de production capitaliste. Mais une telle politique, forme "occidentale" de la tricherie avec la loi de la valeur, ne pouvait qu'exacerber encore plus les contradictions de fond de l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'entrée des Etats-Unis, de même que de la Grande-Bretagne, dans une nouvelle récession ouverte constitue une illustration de cette réalité. Cette nouvelle récession de la première économie mondiale, au même titre que les précédentes, ne peut, à terme, qu'entraîner celle des autres économies occidentales.
4) En effet, la fermeture du marché américain, qui se profile, va se répercuter (et a déjà commencé à se répercuter pour un pays comme le Japon) sur l'ensemble du marché mondial, faisant notamment plonger la production des pays d'Europe de l'Ouest (même si, dans l'immédiat, cette production se trouve soutenue en RFA par l'unification des deux Allemagnes). De plus, le facteur d'atténuation des effets et du rythme de la crise que pouvait constituer la politique de capitalisme d'Etat à l'échelle du bloc occidental pourra de moins en moins jouer son rôle avec la désagrégation de ce dernier, désagrégation qu'entraîne nécessairement la disparition du bloc adverse. Ainsi la perspective de l'économie mondiale est, plus que jamais, celle de la poursuite et de l'aggravation de son effondrement. Pendant toute une période, les pays du centre du capitalisme ont pu repousser les manifestations les plus brutales de la crise, dont l'origine se situe pourtant en ce même centre, vers la périphérie. De plus en plus, comme un choc en retour, ces formes les plus extrêmes de la crise vont revenir frapper de plein fouet ces pays centraux. Ainsi, après le "tiers-monde", après les pays du bloc de l'Est, et même si elles disposent de plus d'atouts pour en atténuer quelque peu les dégâts, les métropoles capitalistes d'Occident sont inscrites sur la liste noire de la catastrophe économique.
5) L'aggravation de la crise mondiale de l'économie capitaliste va nécessairement provoquer une nouvelle exacerbation des contradictions internes de la classe bourgeoise. Ces contradictions, comme par le passé, vont se manifester sur le plan des antagonismes guerriers : dans le capitalisme décadent, la guerre commerciale ne peut déboucher que sur la fuite en avant de la guerre des armes. En ce sens, les illusions pacifistes qui pourraient se développer à la suite du "réchauffement" des relations entre l'URSS et les Etats-Unis doivent être résolument combattues : les affrontements militaires entre Etats, même s'ils ne sont plus manipulés et utilisés par les grandes puissances, ne sont pas près de disparaître. Bien au contraire, comme on l'a vu dans le passé, le militarisme et la guerre constituent le mode même de vie du capitalisme décadent que l'approfondissement de la crise ne peut que confirmer. Cependant, ce qui change avec la période passée, c'est que ces antagonismes militaires ne prennent plus à l'heure actuelle la forme d'une confrontation entre deux grands blocs impérialistes :
- d'une part, le bloc de l'Est a cessé d'exister comme l'illustre le fait que, dès maintenant, sa puissance dominante en soit réduite à lutter pour sa simple survie comme Etat ; la perspective de la situation en URSS est celle d'une réduction de ce pays à la seule Russie qui ne sera plus qu'une puissance de deuxième ordre, bien plus faible que les grands Etats d'Europe de l'Ouest ;
- d'autre part, avec la disparition de sa principale raison d'existence, c'est-à-dire la menace militaire du bloc russe, le bloc occidental lui-même est entré dans un processus de désagrégation qui ne peut aller qu'en s'amplifiant dans la mesure où, comme l'a démontré depuis longtemps le marxisme, U ne peut exister de "super-impérialisme" dominant le monde entier.
6) C'est aussi pour cette dernière raison que la
disparition des deux constellations impérialistes qui se sont partagées
le monde depuis plus de quarante ans porte avec elle la tendance à la
reconstitution de deux nouveaux blocs : un bloc dominé par les Etats-Unis et
l'autre dominé par un nouveau leader, rôle pour lequel l'Allemagne (du fait de
sa puissance économique et de sa place géographique) serait la mieux placée.
Mais une telle perspective n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour du fait :
- de la relative faiblesse militaire de l'Allemagne actuelle (qui ne dispose même pas de l'arme atomique), faiblesse qui ne peut être surmontée du jour au lendemain ;
- de la persistance formelle des structures d'organisation du bloc de l'Ouest (OTAN, CEE, OCDE, etc.) et, surtout, de l'importance de la puissance économique des Etats-Unis qui tendent à limiter la marge de manoeuvre des différents "alliés" (et qui vont freiner des quatre fers tout processus de renforcement de la puissance militaire de l'Allemagne) ;
- du frein majeur que constitue le phénomène de décomposition qui affecte l'ensemble de la société et dont le chaos croissant qu'il provoque au sein de la classe dominante limite les capacités de celle-ci à se donner la discipline nécessaire à l'organisation de nouveaux blocs impérialistes.
7) En fait, si les structures héritées de l'ancienne organisation du bloc occidental ont désormais perdu leur fonction première, elles sont utilisées, à l'heure actuelle, pour limiter la tendance croissante à la désorganisation, au "chacun pour soi", qui se développe au sein de la classe bourgeoise. En particulier, le chaos politique qui, d'ores et déjà, s'est instauré en URSS (notamment sous la forme de l'exacerbation des multiples revendications nationalistes), et qui ne fera que s'accroître, contient une menace réelle de contamination vers l'Europe centrale et occidentale. C'est bien là une des raisons majeures du soutien unanime dont bénéficie Gorbatchev de la part de toutes les fractions de la bourgeoisie occidentale. C'est aussi pour cette raison que la RFA, qui, avec la périlleuse opération d'absorption de la RDA, se trouve en première ligne de cette menace de chaos venue de l'Est, s'est convertie pour le moment en "fidèle" allié au sein de l'OTAN. Cependant, le fait même qu'un pays comme l'Allemagne, qui constituait un "modèle" de stabilité tant économique que politique, soit aujourd'hui durement secoué par le cyclone venu de l'Est en dit long sur la menace générale de déstabilisation qui pèse sur l'ensemble de la bourgeoisie européenne et mondiale. Ainsi, le futur que nous offre le capitalisme n'est pas seulement celui d'une crise insoluble aux effets économiques de plus en plus dévastateurs (famines dans les pays arriérés, paupérisation absolue dans les pays avancés, misère généralisée pour l'ensemble de la classe ouvrière), il est aussi celui d'affrontements militaires de plus en plus brutaux là où le prolétariat n'aura pas la force de les empêcher, il est enfin celui d'un chaos grandissant, d'une perte de contrôle croissante par la classe dominante de l'ensemble de la société, d'une barbarie de plus en plus extrême et déchaînée qui, au même titre que la guerre mondiale, ne peut avoir d'autre aboutissement que la destruction de l'humanité.
8) Le chaos grandissant au sein de la classe bourgeoise, l'affaiblissement qu'il représente pour elle, ne constituent pas en soi, à l'heure actuelle, une condition favorisant la lutte et la prise de conscience du prolétariat. En effet, en de nombreuses reprises, l'histoire a démontré que, face à une menace de la classe ouvrière, la bourgeoisie est parfaite ment capable de surmonter ses contradictions et antagonismes internes pour lui opposer un front uni et redoutable. Plus généralement, la classe ouvrière ne saurait compter, pour combattre et renverser la bourgeoisie, sur la faiblesse de celle-ci mais avant tout et fondamentalement sur sa propre force. En outre, les années 1980 qui marquent l'entrée de la société capitaliste décadente dans sa phase de décomposition, ont mis en relief la capacité de la classe dominante à retourner contre le prolétariat les différentes manifestations de cette décomposition :
- campagnes aclassistes sur des thèmes écologiques, humanitaires ou anti-fascistes contre les menaces sur l'environnement, les famines, les massacres et les manifestations de xénophobie ;
- utilisation du désespoir, du nihilisme, du "chacun pour soi" découlant de la décomposition de l'idéologie bourgeoise pour attaquer la confiance en l'avenir de la classe, saper sa solidarité et l'enfermer dans les pièges corporatistes.
9) Ce poids négatif de la décomposition sur la classe ouvrière s'est fait notamment sentir autour de la question du chômage. Si ce dernier peut constituer un facteur de prise de conscience de l'impasse historique dans laquelle se trouve le mode de production capitaliste, il a plutôt contribué, tout au long des années 1980, à rejeter dans le désespoir, le "chacun pour soi" et même la lumpénisation des secteurs non négligeables de la classe ouvrière, particulièrement parmi les jeunes générations qui n'ont jamais eu l'occasion de s'intégrer dans une collectivité de travail et de lutte. Plus concrètement, alors que dans les années 1930, dans des circonstances historiques bien plus défavorables qu'aujourd'hui (puisque dominées par la contre-révolution), les chômeurs avaient pu s'organiser et mener des luttes significatives, il n'en a rien été ces dernières années. En fait, il s'avère que, pour l'essentiel, seuls les combats massifs des ouvriers au travail pourront entraîner dans la lutte les secteurs au chômage de la classe ouvrière.
10) La capacité de la bourgeoisie à retourner
contre la classe ouvrière la décomposition de sa société s'est particulièrement
illustrée au cours de la dernière période avec l'effondrement du bloc de l'Est
et du stalinisme. Alors que ce dernier avait constitué le fer de lance de la
terrible contre-révolution qui s'était abattue sur le prolétariat entre
les années 1920 et les années 1960, sa crise historique et sa disparition, loin
de déblayer le terrain politique pour le combat et la prise de conscience de la
classe, ont au contraire provoqué au sein de celle-ci un recul très sensible dans
la dynamique de cette prise de conscience. Le fait que le bloc
"socialiste" ait péri de ses propres contradictions internes
(exacerbées par la crise mondiale et le développe ment de la décomposition) et
non de la main du prolétariat a, en effet, permis à la bourgeoisie d'accentuer
la difficulté de ce dernier à dégager les perspectives de son combat, ainsi que
le poids des illusions réformistes, syndicalistes et démocratiques.
Ce recul de la classe ouvrière est à la hauteur de l'importance de l'événement
qui l'a provoqué : il est le plus important qu'elle ait subi depuis la reprise
historique de ses combats à la fin des années 1960 ; en particulier, il se
situe à un niveau bien plus élevé que le recul qui avait accompagné sa défaite
de 1981 en Pologne.
11) La profondeur indiscutable du recul actuel dans le processus de prise de conscience du prolétariat ne remet nullement en cause, cependant, le cours historique aux affrontements de classe tel qu'il s'était développé pendant plus de deux décennies. En effet, l'ampleur de ce recul est limitée par le fait que :
- contrairement aux années 1930 et au lendemain de la seconde guerre mondiale, ce n'est pas le prolétariat des pays centraux qui se trouve aujourd'hui en première ligne des campagnes démocratiques ; ce que la bourgeoisie utilise, c'est le "vent d'Est" provenant de régions où vivent des secteurs secondaires du prolétariat mondial ;
- ce "vent d'Est", lui-même, a grandement perdu de son souffle avec les premiers résultats des politiques de "libération du marché" vantées comme remède enfin trouvé aux maux de l'économie de type stalinien ; l'aggravation irrémédiable de la situation économique, la perte du minimum de sécurité existant pour l'emploi et la consommation, ne peuvent que saper les illusions, à l'Est et à l'Ouest, sur les "bienfaits" du capitalisme "libéral" appliqué aux pays de l'Est ;
- en dépit du désarroi qui pèse sur lui, le prolétariat n'a pas subi de défaite directe, d'écrasement de ses luttes ; de ce fait, sa combativité n'a pas été réellement entamée ;
- cette combativité ne pourra qu'être stimulée par les attaques de plus en plus vives que la bourgeoisie sera contrainte de déchaîner contre lui et qui lui permettront de se rassembler sur son propre terrain de classe en dehors de toutes les campagnes aclassistes.
De façon plus fondamentale, le tableau de la faillite croissante de l'économie capitaliste sous toutes ses formes, et particulièrement celles qui dominent dans les pays avancés, va constituer un facteur essentiel de mise à nu des mensonges sur le thème du "capitalisme victorieux du socialisme" qui sont au coeur de la campagne idéologique déchaînée par la bourgeoisie contre le prolétariat.
12) C'est un chemin difficile et encore long qui attend la classe ouvrière pour parvenir à son émancipation. Il est d'autant plus difficile que, désormais, et à l'opposé des années 1970, le temps ne travaille plus pour elle du fait de l'enfoncement irréversible et croissant de l'ensemble de la société dans la décomposition. Mais pour elle, la classe ouvrière a le fait que son combat représente la seule perspective de sortie de la barbarie, le seul espoir de survie de l'humanité. Avec l'aggravation inéluctable de la crise du capitalisme, avec les luttes qu'elle devra nécessairement développer, la porte lui reste entièrement ouverte à la prise de conscience de sa tâche historique. Le rôle des révolutionnaires est de participer pleinement aux combats présents de la classe afin de planter des jalons lui permettant de sortir la mieux armée possible de la situation difficile d'aujourd'hui et de mettre en avant avec assurance sa perspective révolutionnaire.
CCI, juin 1990.Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [130]
Géographique:
- Moyen Orient [131]
Heritage de la Gauche Communiste:
Ecologie : c'est le capitalisme qui pollue la Terre
- 6343 reads
Plus la civilisation capitaliste dure, plus elle nous rapproche d'une catastrophe écologique aux proportions planétaires, une catastrophe qui ne peut être évitée sans la destruction du système capitaliste.
Les faits eux-mêmes sont bien connus et on peut les trouver dans un nombre croissant de publications spécialisées ou de vulgarisation scientifique, aussi ne les décrirons-nous pas en détail ici. Une simple liste suffit à montrer l'étendue et la profondeur du danger : le frelatage croissant de la nourriture par les différents additifs ou les maladies du bétail ; la contamination des réserves d'eau par l'utilisation incontrôlée de fertilisants et les décharges de déchets toxiques ; la pollution de l’air, en particulier dans les grandes villes, du fait des effets combinés des fumées industrielles et des gaz d'échappement des automobiles ; la menace de contamination radioactive à partir des réacteurs nucléaires et des décharges de produits irradiés éparpillés dans tous les pays industrialisés, y compris ceux de l'ex-bloc russe, menace qui est déjà devenue une réalité de cauchemar avec les désastres de Windscale, de Three Miles Island et surtout de Tchernobyl ; l'empoisonnement des rivières, des lacs et des mers utilisés, depuis des décennies, comme les dépotoirs du monde, ce qui aboutit maintenant à la rupture de la chaîne alimentaire et à la destruction d'organismes dont le rôle est important dans la régulation du climat mondial ; la destruction accélérée des forêts, en particulier les forêts tropicales, ce qui, outre des effets qui modifient aussi le climat de la planète, implique l'érosion des terres, qui entraîne à sont tour d'autres calamités, comme l'avancée du désert en Afrique et les raz-de-marée au Bengladesh.
Qui plus est, il apparaît maintenant que la quantité se change en qualité et que les effets de la pollution deviennent à la fois plus globaux et plus incalculables. Ils sont globaux au sens où chaque pays du monde est affecté ; non seulement les pays hautement industrialisés de l'Ouest, mais aussi les pays sous-développés du "tiers-monde" et les pays staliniens ou ex-staliniens, qui sont dans une telle banqueroute qu'ils ne peuvent même pas s'offrir les contrôles minimaux qui ont été introduits en Occident. Les anciens pays "socialistes" comme la Pologne, l'Allemagne de l'Est et la Roumanie sont peut-être les Etats les plus pollués du monde; virtuellement, chaque ville de l'Europe de l'Est a ses histoires d'horreur/à propos d'usines locales qui vomissent des toxiques mortels provoquant des cancers, des maladies respiratoires et autres, ou bien à propos de rivières qui s'enflamment dès qu'on y jette une allumette, etc. Mais des villes du "tiers-monde" comme Mexico ou Cubatao (au Brésil), ne sont sûrement pas loin derrière.
Mais il y a un autre sens, et plus terrifiant encore, au mot "global" dans ce contexte ; à savoir que le désastre écologique est maintenant une menace tangible pour l'écosystème de la planète lui-même. L'amincissement de la couche d'ozone, qui semble résulter principalement de l'émission de gaz CFC, en est une claire illustration, dans la mesure où la couche d'ozone protège toutes les formes de vie sur la terre des rayons ultraviolets mortels ; et il est impossible de dire, à ce stade, ce que seront les conséquences à long terme de ce processus. Il en va de même avec le problème de l'effet de serre, qui est maintenant reconnu comme une menace réelle par un nombre croissant d'experts scientifiques, le dernier en date étant la Commission Intergouvernementale sur les changements climatiques (CICC) de l'ONU. Cet organisme et d'autres n'ont pas seulement alerté sur les inondations massives, les sécheresses et les famines qui pourraient en résulter s'il n'y a pas une diminution significative du niveau actuel d'émission de gaz favorisant l'effet de serre, en particulier le gaz carbonique, ils ont aussi souligné le risque d'un processus "rétroactif-actif", dans lequel chaque aspect de pollution et de destruction de l'environnement agit sur les autres pour produire une spirale irréversible de désastres.
Il est évident aussi que la classe dont le système a provoqué cette pagaille est incapable d'y rien changer. Bien sûr, dans les dernières années presque toutes les lumières de la bourgeoisie se sont miraculeusement converties à la cause de la sauvegarde de l'environnement. Les supermarchés sont remplis de produits proclamant l'absence d'additifs artificiels ; les étiquettes des cosmétiques, des détergents, des couches pour bébés, rivalisent pour prouver à quel point ils respectent la couche d'ozone, l'air et les rivières. Et les dirigeants politiques, de Thatcher à Gorbatchev, parlent de plus en plus du fait que nous devons tous agir ensemble pour protéger notre planète en danger.
Comme d'habitude, l'hypocrisie de cette classe de gangsters ne connaît pas de limite. La préoccupation réelle qu'a la bourgeoisie de sauver la planète peut se mesurer en regardant ce qu'elle se prépare à faire. Par exemple, elle a mené un grand tapage à propos de la récente conférence sur l'ozone à Londres, où les principaux pays du monde, y compris les géants du "tiers-monde", l'Inde et la Chine, qui y étaient autrefois récalcitrants, se sont mis d'accord pour supprimer progressivement les CFC d'ici à l'an 2000. Mais cela signifie encore que 20 % de plus de la couche d'ozone pourrait être détruit durant la prochaine décennie ; pendant cette période, la diminution du volume d'ozone qui s'opérerait représenterait la moitié du volume total qui a été supprimé depuis que les CFC ont été inventés.
La situation est encore pire en ce qui concerne l'effet de serre. L'administration US a banni la phrase "réchauffement global" de ses communiqués officiels. Et les pays qui acceptent sur le papier les prévisions de la CICC se sont seulement engagés à stabiliser les émissions de gaz carbonique à leur niveau actuel, pas d'avantage. Et surtout, ils n'ont pas de stratégie sérieuse pour réduire la dépendance de leurs économies vis-à-vis du pétrole et des automobiles privées, qui sont les causes principales de l'effet de serre. Rien n'est fait pour arrêter la destruction des forêts, ravage qui, tout à la fois, ajoute à l'accumulation des gaz favorisant l'effet de serre et a réduit la capacité de la planète de les absorber : le Plan d'action de l'ONU pour la forêt tropicale est lui-même entièrement dominé par les entreprises forestières. En outre, la destruction de la forêt par les coupes, par le bétail, et par les intérêts industriels de même que par les paysans affamés, avides de terres cultivables et de bois de chauffage, cette destruction ne pourrait être arrêtée que si le "tiers monde" était tout à coup libéré de la masse écrasante de la dette et de la pauvreté. Quant aux plans pour construire des défenses contre les inondations ou pour prévoir les famines, les populations des régions les plus menacées, telles que le Bengladesh, peuvent espérer le même genre d'aide que celle accordée aux habitants des régions sujettes aux tremblements de terre, ou aux victimes de la sécheresse en Afrique.
Les réponses de la bourgeoisie à tous ces problèmes mettent en lumière le fait que la structure même de son système la rend incapable de régler les problèmes écologiques qu'elle a créés. Les problèmes écologiques globaux demandent une solution globale. Mais en dépit de toutes les conférences internationales, en dépit de tous les voeux pieux sur la coopération internationale, le capitalisme est irréductiblement fondé sur la compétition entre des économies nationales. Son incapacité à réaliser le moindre degré de coopération globale ne fait que s'exacerber aujourd'hui du fait que les vieilles structures de bloc s'effondrent et que le système s'enfonce dans la guerre de tous contre tous. L'approfondissement de la crise économique mondiale qui a mis le bloc russe à genoux va aggraver la compétition et les rivalités nationales; cela signifie que chaque entreprise, chaque pays, agira avec encore plus d'irresponsabilité dans la folle bousculade pour la survie économique. Même si de petites concessions sont faites aux considérations d'environnement, la tendance dominante sera de jeter par la fenêtre les contrôles de santé, de sécurité et de pollution. Cela a déjà été le cas dans la décennie passée, au cours de laquelle on a vu une nette augmentation du nombre de catastrophes dans l'industrie, les transports et autres secteurs, résultat des coupes claires dues à la crise économique. Dans la mesure où la guerre commerciale entre les nations s'exacerbe, les choses ne pourront qu'empirer rapidement.
Qui plus est, ce chacun pour soi va accroître le danger de conflits militaires localisés dans les régions où la classe ouvrière est trop faible pour y faire obstacle. Maintenant que ces conflits ne sont plus contenus par la discipline des anciens blocs impérialistes, le risque est très grand de voir se développer les horreurs de la guerre chimique ou même nucléaire à une échelle locale, avec le massacre de millions d'êtres humains et un empoisonnement encore pire de l'atmosphère de la planète. Qui peut croire que, prises dans une spirale montante de chaos et de confusion, les bourgeoisies du monde vont travailler harmonieusement ensemble pour s'occuper des menaces pesant sur l'environnement? Si les difficultés écologiques - la baisse des ressources en eau, les inondations, les conflits à propos des réfugiés, etc. - ont un effet, ce sera celui d'accroître encore les tensions impérialistes locales. La bourgeoisie le sait déjà. Comme le ministre des affaires étrangères d'Egypte, Boutros Ghali, l'a dit récemment : "La prochaine guerre dans notre région portera sur les eaux du Nil, pas sur des questions politiques."
Dans la phase actuelle de décomposition avancée, la classe dominante perd de plus en plus le contrôle de son système social. L'humanité ne peut plus se permettre de laisser le sort de la planète entre les mains des bourgeois. La "crise écologique" est une preuve de plus que le capitalisme doit être détruit avant qu'il n'entraîne l'ensemble du monde à l'abîme.
La pollution idéologique
Mais si la bourgeoisie est incapable de réparer les dommages qu'elle a causés à la planète, elle n'hésite certainement pas à utiliser les thèmes écologiques pour alimenter ses campagnes de mystification dirigées contre la seule force dans la société en mesure d'apporter une solution au problème : le prolétariat mondial.
La question écologique est idéale de ce point de vue, c'est pourquoi la bourgeoisie ne cache guère la gravité du problème (et peut même donner libre cours à quelque exagération quand ça la sert). Sans arrêt, on nous dit que des problèmes comme le trou dans la couche d'ozone, le réchauffement du globe, "nous affectent tous", qu'ils ne font pas de "distinction" de couleur, de classe ou de pays. Et c'est vrai que la pollution, comme d'autres aspects de la décomposition de la société capitaliste, (drogue, crimes, etc.), affecte toutes les classes de la société (même si c'est généralement les plus exploitées et opprimées qui en souffrent le plus). Aussi, quelle meilleure base pourrait-il y avoir pour diluer le prolétariat, lui faire oublier ses propres intérêts de classe, le noyer dans une masse amorphe où il n'y aurait plus de distinction d'intérêts entre les ouvriers, les boutiquiers... ou la classe dominante elle-même ? Le bourrage de crâne relatif à l'environnement complète donc toutes les campagnes idéologiques au sujet de la démocratie et du "pouvoir au peuple" déchaînées après l'écroulement du bloc de l'Est.
Regardons comment ils déforment les solutions écologiques pour les adapter à leurs besoins. Ces problèmes si terrifiants, si urgents, ne sont-ils pas, disent-ils, sûrement plus importants que votre lutte égoïste pour des augmentations salariales ou contre les licenciements ? En effet, la plupart de ces problèmes ne sont-ils pas dus au fait que les ouvriers, dans les pays avancés "consomment trop" ? Ne devraient-ils pas se préparer à manger moins de viande, à utiliser moins d'énergie, à accepter aussi la fermeture de telle ou telle usine "pour le bien de la planète" ? Quelle meilleure excuse pourrait avancer la bourgeoisie pour les sacrifices demandés par la crise de l'économie capitaliste ?
Et on trouve donc ici tous les arguments soutenant le mythe des "réformes" ou du "changement réaliste". Quelque chose peut certainement être fait maintenant, disent-ils. Aussi, ne devrions-nous pas chercher à voir quel candidat aux élections offre la meilleure politique écologique ? Quel parti promet de faire le plus pour l'environnement ? Les préoccupations exprimées par Gorbatchev, Mitterrand ou Thatcher ne prouvent-elles pas que les politiciens peuvent effectivement répondre à la pression populaire ? Est-ce que les expériences sur la conservation de l'énergie, l'énergie solaire ou éolienne qui sont effectuées aujourd'hui par des gouvernements "éclairés" comme ceux de la Suède ou des Pays-Bas, ne démontrent pas que les changements sont juste une question de volonté et d'initiative de la part des politiciens, combinée avec la pression à la base des citoyens ? Le changement pour des produits respectant l'environnement n'atteste-t-il pas que les grosses compagnies peuvent être réellement touchées par "l'action des consommateurs" ?
Et si toutes ces approches "pleines d'espoir" et "positives" ne réussissent pas à convaincre, la bourgeoisie peut toujours profiter des sentiments d'impuissance et de désespoir qui ne peuvent qu'être renforcés quand le citoyen isolé met la tête à sa fenêtre et voit un monde entier en train d'être empoisonné. Si la bourgeoisie n'arrive pas à convaincre les exploités que ses mensonges sont la vérité, au moins, une classe ouvrière atomisée et démoralisée ne menace-t-elle pas la survie de son système.
Les fausses alternatives des "verts"
Mais, au cours de la dernière décennie, une nouvelle force politique a fait son apparition sur la scène, un courant qui revendique avoir une approche radicale pour mettre la défense de l'environnement au-dessus de toutes autres considérations : les "verts". En Allemagne, ils sont devenus une force estimée dans la vie politique nationale. En Europe de l'Est, des groupes écologiques ont figuré fortement dans les oppositions démocratiques qui ont colmaté la brèche ouverte par l'effondrement des régimes staliniens. Des partis "verts" et des groupes de pression naissent dans les pays les plus industrialisés, et même dans le "tiers-monde".
Mais les "verts" sont aussi une partie du capitalisme pourrissant. Constat d'évidence quand on observe leur jeu en Allemagne de l'Ouest : ils sont devenus un parti parlementaire respectable, avec de nombreux sièges au Bundestag (organe confédéral) et différents postes de responsabilité dans les Lander (instances régionales). L'intégration déclarée des "verts" dans la normalité capitaliste a été symbolisée, il y a quelques années, par l'"extra-parlementaire", le rebelle anarchiste de 1968, Daniel Cohn-Bendit lui-même (rappelez-vous le slogan : "Elections, piège à cons") devenu mais oui, un député et qui a même exprimé son désir de devenir ministre. Au Bundestag, les "verts" s'engagent dans toutes les manoeuvres sordides typiques des partis bourgeois -tantôt agissant comme un "frein" pour garder le SPD dans l'opposition, tantôt formant une alliance avec les sociaux-démocrates contre la CDU au pouvoir. C'est vrai que les "verts" sont divisés en une aile "réaliste", qui se contente de se focaliser sur le terrain parlementaire et une aile "puriste", qui est pour des formes d'action plus radicales, extraparlementaires. Et beaucoup de l'attrait des partis "verts" et des groupes de pression tient de ce qu'ils profitent du dégoût des gens envers les gouvernements centralisés bureaucratiques et la corruption parlementaire. Comme solution de rechange, ils proposent des campagnes contre les cas locaux de pollution, des actions de protestation à l'éclat spectaculaire du type Greenpeace, des marches et des manifestations, tout en appelant à la décentralisation du pouvoir politique et à toutes sortes d'"initiatives de citoyens". Mais aucune de ces activités ne s'écarte d'un pouce des campagnes générales de la bourgeoisie. Au contraire, elles servent à garantir que ces campagnes prennent profondément racine dans le sol de la société.
Les "verts" radicaux sont champions de l’interclassisme, Ils s'adressent eux-mêmes à l'individu responsable", à la "communauté locale", à la bonne conscience de l'humanité en général. Les actions qu'ils entreprennent tentent de mobiliser tous les citoyens, sans considération de classe, dans la lutte contre la pollution. Et quand ils critiquent la bureaucratie et l'éloignement du gouvernement central, c'est seulement pour mettre en avant une vision de "démocratie locale" tout aussi bourgeoise dans son contenu.
Ils ne sont pas moins zélés dans leur soutien à l'illusion réformiste. Les actions qu'ils organisent ont invariablement pour but de rendre les compagnies industrielles, les gouvernements, plus responsables, plus propres, plus "verts". Juste un exemple : un tract des Amis de la Terre ("Eliminer la dette, pas les forêts équatoriales") expliquait que la dette du "tiers monde" conduisait à la destruction des forêts équatoriales. Quelle était donc la solution ? Les grandes banques occidentales, répondait ce groupe de pression, "devraient annuler toutes les dettes des pays les plus pauvres du monde, et réduire les dettes des autres pays les plus endettés d'au moins la moitié". Elles pouvaient maintenant s'offrir ce luxe". Et comment convaincrait-on les banques ? "Les banques ne bougeront pas, à moins que les consommateurs leur montrent fortement leur sentiment sur cette question. Tamponner vos chèques avec 'éliminer la dette, pas les forêts équatoriale et prendre le 'Gage de dette' sont deux moyens puissants pour leur montrer ce que vous en pensez. "
Les "verts" nous invitent donc à croire en l'efficacité du "pouvoir du consommateur", et en la possibilité d'appeler à de meilleurs sentiments les riches qui n'ont cure de condamner des millions de gens à la famine rien qu'en passant leur capital d'un pays à l'autre. C'est la même chose quand les "verts" peignent leur tableau d'un futur possible : un monde où de petites entreprises, bonnes écologiquement, ne se transforment jamais en géants capitalistes rapaces, une vision pacifiste de* l'entente entre les nations, bref, un capitalisme gentil, charitable, pacifique, impossible.
Mais il y a aussi des courants à l'intérieur et autour du mouvement "vert" qui se parent d'une radicalité plus poussée, qui critiquent le capitalisme et vont jusqu'à parler de révolution. Certains d'entre eux sont à ce point radicaux qu'ils proclament que le marxisme lui-même n'est rien de plus que l'autre face de la "mégamachine" capitaliste. Ils disent : regardez les régimes à l'Est, c'est le résultat logique du culte du marxisme pour le "progrès" technologique, l'industrie. Inspirés par des "penseurs" comme Baudrillard, ils se risquent même à expliquer dans un langage très recherché que le marxisme est simplement une autre idéologie "productiviste" (en cela, ils rejoignent les staliniens défroqués tel que Martin Jacques, qui, à une récente conférence du PC britannique en ruines, disait : "On ne peut ignorer le fait que la tradition marxiste est productionniste au fond : conquête de la nature, forces de production, engagement à la croissance économique." Des anarcho-primitivistes comme le journal Fifth Estate à Détroit appellent à rien de moins que l'éradication de la société technologique industrielle et à un retour au communisme primitif. Les "écologistes profonds" de Earth First vont même plus loin : pour leurs idéologues, le problème n'est pas simplement la société industrielle, ou la civilisation, mais l'homme lui-même...
Le marxisme contre les mystifications des "verts"
La notion qu'une entité abstraite appelée "homme" est responsable de la pagaille écologique présente n'est pas restreinte à quelques idéologues "verts" ésotériques ; c'est en fait un poncif courant. Mais, de toute façon, cette idée ne peut mener qu'au désespoir, car si le problème vient des êtres humains, comment pourront-ils trouver une solution ? Ce n'est pas un hasard si quelques "écologistes profonds" ont accueilli le SIDA comme un facteur nécessaire pour élaguer le monde des hommes en trop...
La position des anarcho-primitivistes conduit aux mêmes sombres conclusions. Etre "contre la technologie" c'est aussi être contre le genre humain ; l'homme s'est créé lui-même à travers le travail, et "le travail commence avec la fabrication des outils" (Engels, "Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme", in "La dialectique de la nature"). La logique de la position anti technologique est d'essayer de revenir à un passé pré humain, quand la nature n'était pas dérangée par les bouleversements de l'activité humaine : "L'animal utilise seulement son environnement et y apporte des changements par sa simple présence ; l'homme par ses changements l'adapte à ses fins, le maîtrise. C'est la distinction finale, essentielle entre l'homme et les autres animaux. " (ibid.)
Mais même si les anti technologistes pouvaient se contenter d'un retour à une culture humaine à l'étape de la cueillette et de la chasse, le résultat serait identique puisque les conditions matérielles d'une telle société présupposent une population mondiale inférieure à quelques millions. Ces conditions ne pourraient être instaurées que par une "élimination sélective" massive des êtres humains, quelque chose que le capitalisme, dans son agonie, nous prépare dès à présent. Donc ces écologistes "radicaux", produits de la désintégration de la petite-bourgeoisie, classe qui n'a pas de futur historique et qui ne peut que se retourner sur un passé qu'elle idéalise, deviennent les théoriciens et apologistes d'une descente dans la barbarie qui est déjà bien en marche.
Contre ces idéologies nihilistes, le marxisme, exprimant le point de vue de la seule classe qui possède un futur aujourd'hui, insiste sur le fait que le cauchemar écologique actuel ne peut pas être expliqué en invoquant des catégories comme l'homme, la technologie ou l'industrie d'une façon totalement vague et a-historique. L'homme n'existe pas en dehors de l'histoire, et la technologie ne peut pas être séparée des relations sociales dans lesquelles elle s'est développée. L'interaction de l'homme et de la nature peut seulement être comprise dans son véritable contexte social et historique.
L'humanité existe sur la planète depuis environ trois millions d'années. Jusqu'à il y a très peu de temps, à cette échelle géologique, elle vécut au stade du communisme primitif, formant des sociétés qui vivaient de la chasse et de la cueillette et dans lesquelles régnait un équilibre relativement stable entre l'homme et la nature (fait reflété dans les mythes et les rituels des peuplades anciennes). La dissolution de cette communauté archaïque et le surgissement d'une société de classes, si elle représente un saut qualitatif dans l'aliénation de l'humanité, a déterminé aussi de nouvelles aliénations de l'homme à la nature. Les premiers cas de destruction écologique intensive coïncident avec les premières villes-Etats. Il ne fait pas de doute que le tout début du processus de déforestation, en même temps qu'il permettait à des civilisations telles que la Sumérienne, la Babylonienne, l'Egyptienne ou autres de développer ainsi une base agricole de large échelle, constituait également un élément qui, à terme, jouera un rôle considérable dans leur déclin et leur disparition.
Mais c'étaient des phénomènes locaux, limités. Avant le capitalisme, toutes les civilisations étaient basées sur une "économie naturelle" : la plus grande partie de la production était encore orientée vers la consommation immédiate des valeurs d'usage, même si, à la différence du communisme primitif, une large partie était accaparée par la classe dominante. Le capitalisme, par contre, est un système où toute la production est orientée vers le marché, en fonction de la reproduction élargie de la valeur d'échange ; c'est une formation sociale de loin plus dynamique que tout système antérieur, et cette dynamique l'a contraint à marcher inexorablement vers la création d'une économie mondiale. Mais le profond dynamisme et la globalité du capital ont fait que le problème de la destruction écologique a maintenant atteint un niveau planétaire. Parce que ce n'est pas le marxisme, mais le capitalisme, qui est "productionniste dans le fond". Aiguillonné par la compétition, par la rivalité anarchique des unités capitalistes luttant pour le contrôle des marchés, il obéit à une force interne pour s'étendre aux limites les plus lointaines possibles, et dans sa marche sans trêve vers son auto expansion, il ne peut pas s'arrêter pour prendre en considération la santé ou le bien-être de ses producteurs, ou les conséquences écologiques de ce qu'il produit et comment il le produit. Le secret de la destruction écologique, aujourd'hui, se trouve dans le secret profond de la production capitaliste : "Accumulez, accumulez ! C'est Moïse et les prophètes... L'accumulation pour l'intérêt de l’accumulation, la production pour l’intérêt de la production..." (Marx, Le Capital, Livre I, chap. 24, "La transformation de la plus-value en capital").
Le problème, donc, derrière la catastrophe écologique, n'est pas la "société industrielle" dans l'abstrait, comme tant d'écologistes le proclament : jusqu'ici, la seule société industrielle qui ait jamais existé est le capitalisme. Celui-ci inclut bien sûr les régimes staliniens, qui sont une véritable caricature de la subordination capitaliste de la consommation à l'accumulation. Ceux qui blâment le marxisme pour les ravages écologiques dans les pays de l'Est accordent simplement leur voix à la clameur sur la "faillite du communisme" que la bourgeoisie occidentale pousse depuis l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est. Le problème ne réside pas dans telle ou telle forme du capitalisme, mais dans les mécanismes essentiels d'une société qui ne se développe pas en harmonie consciente avec les besoins de l'homme et avec ce que Marx appelait le "corps inorganique" de l'homme, la nature, mais une société qui se développe "pour se développer".
Toutefois, le problème écologique a également une histoire spécifique dans le capitalisme. Déjà, dans la période ascendante du capitalisme, Marx et Engels avaient, à de nombreuses occasions, dénoncé la façon dont la soif de profit de ce système empoisonnait les conditions de travail et d'existence de la classe ouvrière. Ils considéraient même que les grandes cités industrielles étaient dès cette époque devenues trop grandes pour fournir les bases de communautés humaines viables, et ils considéraient "l'abolition de la séparation entre les villes et la campagne" comme une composante à part entière du programme communiste (on imagine ce qu'ils auraient dit au sujet des mégalopoles de la fin du 20e siècle...).
Mais c'est essentiellement dans la période présente du capitalisme, époque qui depuis 1914, a été définie par les marxistes comme celle de la décadence de ce mode de production, que la destruction impitoyable de l'environnement par le capital prend une autre dimension et une autre qualité, tout en perdant la moindre justification historique. C'est l'époque dans laquelle toutes les nations capitalistes sont obligées de se concurrencer dans un marché mondial sursaturé ; une époque, par conséquent, d'économie de guerre permanente, avec une croissance disproportionnée de l'industrie lourde ; une époque caractérisée par l'irrationnel, le dédoublement inutile de complexes industriels dans chaque unité nationale, le pillage désespéré des ressources naturelles par chaque nation essayant de survivre dans un combat de rats sans merci pour le marché mondial. Les conséquences de tout ça pour l'environnement sont claires comme le cristal ; l'intensification des problèmes écologiques peut être mesurée selon les différentes phases de la décadence capitaliste. Le premier développement des émissions de dioxyde de carbone s'est effectué durant ce siècle avec un accroissement considérable depuis les années 1960. Les CFC ont été inventés au cours des années 1930 et ont été utilisés massivement seulement lors de ces dernières décennies. Le surgissement des "mégalopoles" est surtout un phénomène d'après la seconde guerre mondiale, de même que le développement des types d'agriculture qui n'ont pas été moins dommageables écologiquement que la plupart des types d'industrie. La destruction effrénée des forêts amazoniennes s'est opérée dans la même période, et particulièrement entre 1980 et 1990 : son taux a alors probablement doublé.
Ce que nous voyons aujourd'hui est la culmination de décennies d'activité militaire et économique anarchique, de gaspillage et d'exploitation irrationnelle de la part du capitalisme décadent ; l'accélération qualitative de la crise écologique au cours des années 1980 "coïncide" avec l'ouverture de la phase finale de la décadence capitaliste - la phase de décomposition. Par cela nous voulons dire qu'après vingt ans de crise économique profonde et toujours pire, pendant lesquelles aucune des forces sociales déterminantes de la société n'a été capable d'imposer sa propre perspective historique de guerre ou de révolution mondiale, tout l'ordre social commence à s'effriter, à descendre dans une spirale incontrôlée de chaos et de destruction (voir dans Revue Internationale, n° 62, "La décomposition, phase finale de la décadence capitaliste").
Le système capitaliste a depuis longtemps cessé de représenter un quelconque progrès pour l'humanité. Les conséquences écologiques désastreuses de sa "croissance" depuis 1945 sont une démonstration de plus que son développement a pris place sur une base malade, destructive, et constitue un camouflet pour tous les "experts" - dont malheureusement certains figurent dans le mouvement politique prolétarien - qui mettaient en avant ce développement afin de combattre la notion marxiste de la décadence du capitalisme.
Mais cela ne signifie pas que les marxistes -à la différence de la bourgeoisie aujourd'hui, et de tous ses parasites petits-bourgeois- abandonnent la notion de progrès ou font de quelconques concessions aux préjugés anti technologie des "verts" radicaux.
Le concept marxiste de progrès n'a jamais été le même que celui, unilatéral, de la bourgeoisie, la notion linéaire d'une ascension stable des ténèbres primitives et de la superstition à la clarté de la raison moderne et de la démocratie. Le concept marxiste est une vision dialectique qui reconnaît que le progrès historique s'est fait à travers le choc des contradictions, qu'il a entraîné des catastrophes et même des régressions, que l'avancée de la "civilisation" a aussi signifié raffinement de l'exploitation et l'aggravation de l'aliénation de l'homme par rapport à lui-même et du divorce de l'homme d'avec la nature. Mais il admet aussi que la capacité croissante de l'homme à transformer la nature à travers le développement de ses forces productives, à soumettre les processus inconscients de la nature à son propre contrôle conscient, fournit les seules bases pour dépasser cette aliénation et arriver à une forme plus élevée de la communauté que le communisme limité des temps primitifs, c'est-à-dire à un monde élargi, une communauté unifiée qui sera fondée non pas sur la pénurie et la submersion de l'individu dans le collectif, mais sur un niveau d'abondance sans précédant qui fournira "les conditions matérielles pour le développement total, universel des forces productives de l'individu" (Marx, Grundrisse). En créant les bases pour la communauté humaine totale, le capitalisme a représenté un pas immense pour dépasser les économies naturelles qui l'ont précédé.
Aujourd'hui, la notion de "contrôle" de la nature a été vilement déformée par l'expérience du capitalisme, qui a traité toute la nature simplement comme une autre marchandise, comme un sujet mort, comme quelque chose d'essentiellement externe à l'homme. A l'opposé de cette vision -mais aussi contre le culte passif de la nature qui prévaut parmi beaucoup de "verts" aujourd'hui-, Engels a défini la position communiste quand il écrivait :
- "A chaque pas il nous est rappelé, qu'en aucune façon, nous ne régnons pas sur la nature comme un conquérant sur un peuple étranger, comme quelqu'un étant en dehors de la nature, mais que nous, avec notre chair, notre sang et notre cerveau, appartenons à la nature, existons en son sein, et que toute notre supériorité consiste dans le fait que nous avons l'avantage sur toutes les autres créatures d'être capables d'apprendre ses lois et de les appliquer correctement." (Ibid.)
En vérité, en dépit de toutes ses prétendues conquêtes, le capitalisme dévoile aujourd'hui que son contrôle sur la nature est le "contrôle" des apprentis sorciers, pas du sorcier lui-même. Il a jeté les bases pour une maîtrise réellement consciente de la nature, mais sa pratique profonde transforme toutes ses réussites en catastrophe. Comme disait Marx :
- "Au fur et à mesure que l'humanité maîtrise la nature, l'homme semble être de plus en plus soumis aux autres hommes ou à sa propre infamie. Même la clarté pure de la science semble incapable de briller si ce n'est sur un fond d'ignorance noire. Toutes nos inventions et tous nos progrès semblent aboutir à doter les forces matérielles d'une vie intellectuelle et à déshumaniser la vie humaine en la réduisant à une force matérielle". (Discours à l'anniversaire de Peoples Paper, avril 1856). Aujourd'hui, cette contradiction a atteint un tel degré que l'humanité se trouve à un moment fatidique de son histoire, devant le choix entre, d'un coté, le contrôle conscient de ses propres forces sociales et productives, et donc une "application correcte" des lois de la nature, et de l'autre, la destruction aux mains des forces mêmes qu'elle a mises en marche. Autrement dit, le choix entre le communisme ou la barbarie.
Seule la révolution prolétarienne peut sauver la planète
Si le communisme est la seule réponse à la crise écologique, la seule force capable de créer une société communiste, c'est la classe ouvrière.
Tout comme les autres aspects de la décomposition de la société capitaliste, la menace qui pèse sur l'environnement souligne le fait que, plus le prolétariat tarde à faire sa révolution, plus grand est le danger que la classe révolutionnaire soit minée et épuisée, que le cours vers la destruction et le chaos n'atteigne le point de non-retour qui rendrait la lutte pour la révolution et la construction d'une société nouvelle une tâche impossible. Dans la mesure où elle souligne l'urgence grandissante de la révolution communiste, la conscience de la profondeur des problèmes écologiques actuels jouera un rôle dans la transition entre les luttes prolétariennes défensives au niveau économique et un combat conscient et politique contre le capital dans son ensemble.
Mais il serait faux de croire qu'aujourd'hui, la question de l'écologie puisse en soi être un axe pour la mobilisation du prolétariat sur son propre terrain de classe. Bien que certains aspects limités du problème (par exemple, la santé, la sécurité dans le travail) puissent s'intégrer dans des revendications de classe véritables, la question en tant que telle ne permet pas au prolétariat de s'affirmer comme force sociale distincte. Au contraire, comme nous l'avons vu, elle fournit à la bourgeoisie un prétexte idéal pour ses campagnes interclassistes, et les ouvriers vont devoir résister activement aux tentatives de la bourgeoisie, et particulièrement de ses éléments "verts" et gauchistes, de se servir de la question pour les dévoyer de leur propre terrain de classe. Il reste donc vrai que c'est surtout en se battant contre les effets de la crise économique - contre les baisses de salaire, le chômage, l'appauvrissement à tous les niveaux - que les ouvriers vont pouvoir se constituer en force capable d'affronter l'ensemble de l'ordre bourgeois.
La classe ouvrière ne pourra prendre en charge la question écologique dans sa totalité qu'après avoir pris le pouvoir politique au niveau mondial. Il doit même être évident que cela constituera une des tâches les plus urgentes de la période de transition, intimement liée qu'elle est de toute façon avec d'autres problèmes pressants tels que la faim et la réorganisation de l'agriculture.
Nous ne pouvons pas, faute de place, entrer ici dans une discussion détaillée des mesures que devra prendre le prolétariat afin de redresser la situation désastreuse que nous lègue le capitalisme, et aller vers un rapport qualitativement nouveau entre l'homme et la nature. Ici, nous voulons seulement souligner un point : les problèmes auxquels sera confronté un prolétariat victorieux seront fondamentalement d'ordre non pas technique mais politique et social.
L'infrastructure technique et industrielle est profondément déformée par l'irrationalité du développement capitaliste dans l'époque présente, et il faudra certainement en démolir une bonne partie avant de pouvoir créer une base de production qui ne nuise pas à l'environnement naturel. Cependant, au niveau purement technique, de nombreuses alternatives ont déjà été développées, ou pourraient l'être si on y consacrait des ressources suffisantes. Il est dès maintenant possible, par exemple, dans les centrales électriques brûlant des hydrocarbures, d'éliminer la plupart des émissions de dioxyde de carbone et autres substances nuisibles, tout en réutilisant 100 % des déchets ou presque. De la même façon, il est déjà possible de développer d'autres sources d'énergie - solaire, éolienne, marine, etc.- qui sont à la fois renouvelables et non polluantes; des possibilités énormes existent également dans la fusion nucléaire, qui pourrait résoudre beaucoup des difficultés rencontrées avec la fission.
Le capitalisme a déjà développé ses capacités techniques au point de pouvoir résoudre le problème de la pollution. Mais le fait que la véritable question est de nature sociale est souligné par les nombreux cas où les intérêts capitalistes économiques ou militaires à court terme n'ont pas permis à la bourgeoisie de développer des technologies non polluantes. Nous savons par exemple qu'après la seconde guerre mondiale, les industries américaines du pétrole, du gaz, et de l'électricité ont monté toute une campagne pour étouffer l'énergie solaire; nous avons récemment appris que le gouvernement britannique a collaboré à l'élaboration d'un rapport dont les chiffres étaient falsifiés afin de démontrer que les centrales nucléaires coûteraient moins cher que les centrales maritimes ; l'industrie automobile, de même, a longtemps résisté au développement de moyens de transport moins polluants, etc.
Mais la question est plus profonde que la politique consciente de tel ou tel gouvernement ou industrie. Comme nous l'avons vu, le problème se trouve à la base même du mode de production capitaliste, et ne peut être résolu qu'en s'attaquant aux racines de ce mode de production.
Le capital détruit l'environnement sans s'en soucier, parce qu'il doit croître pour croître ; la seule réponse est donc de supprimer le principe même de l'accumulation capitaliste, de produire non pas pour le profit, mais pour satisfaire les besoins humains. Le capital ravage les ressources du monde parce qu'il est divisé en unités nationales concurrentes, parce qu'il est fondamentalement anarchique et produit en ne pensant pas au futur ; la seule solution consiste par conséquent dans l'abolition de l'Etat national, la mise en commun de toutes les ressources naturelles et humaines de la terre, et l'établissement de ce que Bordiga appelait "un plan de vie pour l'espèce humaine". Bref, le problème ne eut être résolu que par une classe ouvrière consciente du besoin de révolutionner les bases mêmes de la vie sociale, et qui détienne les instruments politiques pour assurer une telle transition à la société communiste.
Organisé à l'échelle mondiale, amenant dans son sillage toutes les masses opprimées du monde, le prolétariat international peut et doit mettre en oeuvre la création d'un univers où une abondance matérielle sans précédent ne compromettra pas l'équilibre de l'environnement naturel, ou plutôt, où l'une sera la condition de l'autre ; un monde où l'homme, enfin libéré de la domination du travail et de la pénurie, pourra commencer à jouir de la planète. C'est cela sûrement le monde que Marx a entrevu, à travers l'épais brouillard d'exploitation et de pollution dans lequel la civilisation capitaliste a plongé la terre, quand il prévoyait, dans les Manuscrits de 1844, une société qui exprimerait l’unité de l'être de l'homme avec la nature - la véritable résurrection de la nature -, la naturalisation de l'homme et l'humanisation de la nature enfin accomplies"
CDW.
Questions théoriques:
- Décadence [31]
- L'économie [85]
POLEMIQUE : Les révolutionnaires face aux émeutes de la faim
- 3108 reads
-
Quelle signification revêtent, pour la classe ouvrière, les “émeutes de la faim”, ces révoltes des populations les plus misérables et marginalisées des pays sous-développés et qui ont vu leur nombre augmenter au cours des dernières années : Algérie (1988); Venezuela, Argentine, Nigeria, Jordanie (1989) ; Côte d’ivoire, Gabon (1990) pour ne citer que les plus Importantes ? Quelle doit être l’attitude de l’avant-garde révolutionnaire à leur égard ?
La réponse que les organisations révolutionnaires apportent à ces questions relève de leur analyse globale de la situation internationale actuelle et des perspectives à long terme qu’elles envisagent pour le prolétariat dans le chemin qu’il aura encore à parcourir pour aller vers la révolution, des formes de lutte et d’organisation qu’il adoptera et de la fonction qu’elles attribuent au parti de classe. Dans la mesure où les émeutes tendent à gagner du terrain, à devenir chaque fois plus fréquentes, elles posent aux révolutionnaires la nécessité d’y intervenir directement, avec des orientations claires pour la classe ouvrière, ce qui souligne l’importance pratique et immédiate d’avoir une position claire à leur égard.
Devant la confusion des différents groupes du milieu politique prolétarien qui ont salué les émeutes de la faim comme des pas en avant de la lutte de classe du prolétariat, leur attribuant même une importance plus grande qu’aux grèves dans les usines, seul le CCI a souligné que ces actions contiennent le danger d’éloigner le prolétariat de son terrain de classe.
Une expression de la décomposition du capitalisme
Plusieurs organisations du milieu politique prolétarien ont abordé dans leurs publications la question des émeutes de la faim[1] [132], mettant en relief que leur cause profonde est l’approfondissement de la crise du système capitaliste et l’augmentation de l’exploitation et de la misère qui en découle pour la classe ouvrière et les autres couches déshéritées. Elles ont démontré comment les “plans” et les “mesures économiques” que la classe capitaliste applique pour essayer d’éviter la ruine des pays sous-développés -c’est-à-dire, pour essayer de sauver leurs profits-, entraînent des attaques renouvelées et brutales aux conditions de vie de millions de personnes ; et que les révoltes de la faim, les pillages massifs de magasins, sont la réponse la plus élémentaire à une situation insupportable et désespérée. Nous-mêmes avons écrit, par exemple, que “Les émeutes sont tout d’abord la réponse des masses marginalisées aux attaques de plus en plus barbares du capitalisme mondial en crise. Elles font partie des secousses qui ébranlent de plus en plus fortement les fondements mêmes de la société capitaliste en décomposition” (Revue Internationale n° 57, p. 14, 2e trimestre 1989).
D’autres groupes y font référence en ces termes :
- “La révolte se manifeste (...) comme réponse aux coups de la crise. Si l’on considère le fait que les masses prolétariennes et semi-prolétariennes de ces pays [la périphérie] ont participé dans le mouvement (...) on doit nécessairement conclure qu’un tel mouvement constitue primordialement une action de la classe exploitée contre les effets de sa condition”. (Prometeo n° 13, nov. 1989 p. 33).
- “La crise du capitalisme argentin, qui enfonce jour après jour dans la misère la plus absolue des masses toujours plus grandes de prolétaires et de salariés, de la même façon qu’au Venezuela ou en Algérie, a lancé les affamés dans une lutte pour la survie”. (Le Prolétaire, n° 403, oct-nov. 1989)
Le fait que l’on partage ce point de vue général sur les causes des émeutes de la faim indique l’existence d’une frontière de classe qui sépare les organisations politiques prolétariennes des organisations de la bourgeoisie. Car, bien que ces dernières ne puissent pas nier l’augmentation de la misère qui est à l’origine de ces actions, elles ne pourront jamais admettre que c’est le système capitaliste comme un tout qui en est la cause (et pas seulement la “mauvaise politique économique” de tel ou tel gouvernement, ou “les mesures du FMI contre les pays pauvres”), car cela remettrait en question leur propre existence.
Cependant, ce point de vue commun aux organisations du milieu politique prolétarien est en fait très général. Au-delà de celui-ci il existe de grandes divergences par rapport à l’analyse de la crise (sur ses racines: baisse tendancielle du taux de profit ou saturation des marchés, sur sa nature : cyclique ou permanente...), divergences qui ne cessent de s’approfondir. C’est ainsi que seul le CCI a relevé la signification du fait que la crise dure déjà depuis vingt ans sans trouver d’issue. Le cours aux affrontements de classe signifie que la bourgeoisie n’a pas réussi à assener au prolétariat une défaite historique telle qu’elle lui permette de l’entraîner vers une guerre mondiale ; cependant, le prolétariat n’a pas non plus été capable encore d’imposer son alternative historique : la révolution communiste. Ce blocage historique entre les classes a rendu possible que la crise continue de s’approfondir. Cependant tous les aspects de la société ne demeurent pas stables, mais sont entrés dans ce que nous avons appelé “la période de décomposition du capitalisme” (voir “La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste” Revue Interna4onale n° 62).
Pour le CCI il est clair que le capitalisme peut mener à la destruction de l’humanité, pas seulement par la guerre atomique entre les grandes puissances impérialistes (danger momentanément écarté à cause de l’effondrement dans le chaos du bloc de l’URSS), mais que cette destruction peut aussi provenir de la multiplication de plus en plus incontrôlable des expressions de ladite décomposition : famines, épidémies, drogues, catastrophes nucléaires... Les autres organisations révolutionnaires feraient mieux d’analyser sérieusement le contenu de toutes ces données, qui semblent à première vue sans rapport les unes avec les autres, et les tendances actuelles de la société capitaliste qui en découlent, plutôt que de taxer simplement le CCI de “catastrophiste”.
Pour ce qui concerne les pays sous-développés, nous disions que la crise capitaliste y impose une misère telle qu’elle est à l’origine des émeutes massives de la faim. Cependant, cette misère acquiert aussi un contenu différent en tant que produit de la décomposition du capitalisme.
Les pays sous-développés ont été moins résistants aux coups de la crise et, l’un après l’autre, ils se voient précipités dans la ruine la plus complète et irréversible. Dans la décennie des années 80, avec l’arrivée à échéance des délais de paiement des dettes contractées dans la décennie précédente, et devant l’impossibilité de les honorer, le flux de capitaux vers ces pays s’est tari, provoquant la récession mondiale de 1980-82, que seuls les pays les plus industrialisés ont pu surmonter.
Les pays sous-développés n’ont jamais pu s’en remettre. Dans les années 80, la croissance de leur production a été pratiquement égale à zéro. La faiblesse de leur industrie les rend incapables d’être concurrentiels sur le marché mondial et leurs marchés internes sont occupés par les produits en provenance de pays plus développés, ce qui les conduit à la faillite. La production de matières premières (minerais, agriculture, pétrole), leur principale source de revenus, s’est aussi écroulée, par suite de la chute des prix due à la saturation du marché mondial. Ils sont maintenant entrés dans une phase de décapitalisation et de désindustrialisation ; les champs cultivés sont laissés à l’abandon ou consacrés à la culture de produits destinés à la fabrication de drogues à la place de produits alimentaires ; on ferme les mines qui ne sont pas assez rentables ; des réserves de pétrole restent inexploitées parce que les capitaux sont investis dans la spéculation en bourse, placés dans les banques des pays riches ou bien partent dans le remboursement de l’intérêt des dettes.
Dans ces pays le capital et les bourgeoisies “locales” -avec l’appui des grandes puissances- tiennent grâce à une exploitation extrême de la classe ouvrière : les salaires réels ont été réduits de moitié au cours des dernières dix années, principalement par le biais de la formule infernale “inflation-plans de choc”, et rien n’arrête cette tendance à la baisse. En même temps, le chômage croissant a créé une situation sans précédent dans l’histoire, qui doit être sérieusement analysée.
Avec la stagnation et la chute de la production capitaliste, des millions d’ouvriers ont été expulsés des industries. S’y ajoutent les millions de jeunes qui arrivent à l’âge de travailler sans que le capitalisme soit capable de les intégrer à un travail productif ; autant de millions de paysans ruinés émigrent sans arrêt vers les villes. D’après les chiffres très partiels publiés par la bourgeoisie, 50 % de la population de ces pays est au chômage et le pourcentage atteint même 70 à 80 % dans certains endroits. S’il est vrai que l’expulsion de la paysannerie, l’existence d’une armée industrielle de réserve et le chômage massif sont tous des aspects inhérents au capitalisme en période de crise, l’ampleur qu’ils atteignent à l’époque actuelle leur confère un nouveau contenu et démontre la tendance du capitalisme à la décomposition, à la désagrégation complète.
Comment ces masses ont-elles pu survivre jusqu’à mainte nant ? Au moyen de ce qu’on appelle l’“économie immergée”. Cette “économie immergée” est constituée par un dense réseau de relations à la tête duquel se trouvent de puissants trafiquants capitalistes (trafiquants de n’importe quoi, depuis les drogues jusqu’aux appareils électroménagers) qui concurrencent avantageusement l’“économie officielle”, au point d’obtenir dans certains pays des profits équivalents ou même supérieurs à ceux de cette dernière. Cette “économie immergée” fournit des “emplois” à ces millions de personnes, essentiellement en tant que vendeurs à la sauvette dans les rues. Ces masses de “sous-employés”, chômeurs en réalité, constituent l’élément central des émeutes de la faim. Marginalisées par le capitalisme, elles sont proches du prolétariat du fait qu’elles ne possèdent que leur force de travail et qu’en ce sens elles constituent potentiellement une force anticapitaliste ; cependant, l’analyse ne peut pas les assimiler sans plus à l’ensemble de la classe ouvrière, comme l’ont fait les différents groupes du milieu révolutionnaire. Car le fait de se trouver exclus d’un processus de travail collectif est un obstacle qui empêche leur réflexion et leur lutte comme partie de la classe ouvrière. Il faut noter que tout au long des dernières vingt années, on n’a pas assisté à des mouvements de sans-travail, luttant et s’organisant comme tels. Cela traduit, en même temps que la perte des traditions de la classe ouvrière, produit de la contre-révolution entre les années 20 et la fin des années 60, l’influence croissante du “sauve qui peut” propre à l’idéologie capitaliste en décomposition. Mais en outre, comme nous le disions plus haut, à ces chômeurs viennent s’ajouter les paysans ruinés qui abandonnent les campagnes et qui conservent leur point de vue individuel de petit propriétaire, et les jeunes toujours plus nombreux qui n’ont jamais pu travailler. Même si ceux-ci restent en rapport avec la classe ouvrière, car beaucoup sont des fils d’ouvriers et habitent les mêmes quartiers, cette masse n’échappe pas à l’influence du lumpenprolétariat, car d’elle proviennent aussi les vendeurs de drogue, les criminels, les mouchards, les hommes de main...
Ainsi, la compréhension du fait que la cause des pillages est la crise capitaliste, et qu’ils constituent la seule réponse que peut donner une masse désespérément affamée, ne doit pas nous voiler les yeux sur le caractère dénué de perspective de classe de ces émeutes et sur le danger que la classe ouvrière soit diluée dans cette masse de marginalisés, si elle ne réussit pas à affirmer son terrain de classe.
La classe ouvrière face aux émeutes
Une nouvelle divergence s’ouvre entre le CCI et les autres groupes du milieu politique prolétarien avec la prise de position sur les émeutes de la faim. Pour eux :
-
“La nature prolétarienne de ces événements” réfute “ceux qui voient dans les émeutes de la faim et de la misère une sorte de déviation de la lutte de classe” (Le Prolétaire n° 403).
-
"On affirme -sans démontrer- que ce genre d’émeutes ne relève pas directement de la lutte des classes, on les présente comme un processus de décomposition sociale (et non également de lutte contre ce processus), comme une révolte sans profil de classe qui accentue la “lumpen-prolétarisation de la société” (Emancipacién Obrera - “Rapport sur l’explosion sociale en Argentine”).
-
“Dire, comme certains, que ces mouvements illustrent seulement l’état de décomposition de la société comme aspect générique de la décadence du capitalisme impérialiste, c’est du bavardage complètement inutile si ce n’est pour cacher son propre aveuglement politique et sa propre absence de méthode marxiste (...) Mais la signification principale et plus importante de ces luttes est qu’en leur sein s’exprime un fort mouvement matériel de larges couches de notre classe contre les effets de la crise capitaliste. Et c’est le mouvement matériel des classes que les marxistes considèrent comme condition indispensable à un développement du mouvement subjectif politique.” (“Prometeo” n° 13).
Pour ces groupes donc, contrairement au CCI, les pillages massifs de magasins ont un caractère prolétarien, ils sont partie intégrante de la lutte de classe du prolétariat. Nous devons revenir sur ce que nous entendons par “luttes de la classe ouvrière”.
Bien entendu, et c’est une lapalissade, la première condition de la lutte de classe du prolétariat est... que des prolétaires y participent. Et effectivement, nous ne nions pas que des ouvriers participent dans ces émeutes. Bien au contraire, nous n’avons pas cessé de souligner cette réalité, mais en signalant que cela constitue un danger pour la lutte de la classe. S’il est vrai que dans toute lutte de classe prolétarienne participent forcément des ouvriers, l’inverse n’est pas toujours vrai ; toute action à laquelle participent des ouvriers n’est pas forcément un mouvement de la classe. Par exemple : les mouvements nationalistes, ethniques, dans lesquels sont entraînées des masses d’ouvriers, qui peuvent aussi se trouver dans une situation désespérée, ont un caractère bourgeois.
Dans ces émeutes les ouvriers participent, effectivement, mais non pas regroupés comme classe, mais en tant qu’individus dispersés dans les masses affamées, désoeuvrées, dont nous parlions plus haut.
D’autres groupes, tels que le PCI/Le Prolétaire ou la CWO, ne font simplement pas de différence dans ce sens, et voient dans les révoltes uniquement le prolétariat en action. Il faut noter cependant que BC remarque une différence, puisqu’il nous demande : “Les masses misérables et marginalisées [d’autres endroits il parle de “semi-prolétaires”] sont-elles du côté du prolétariat ou du côté de la bourgeoisie ? (Cette question implique déjà que ces masses marginalisées ne sont pas exactement identiques au prolétariat). “Leur potentialité de lutte est-elle en faveur de la révolution prolétarienne ou de la conservation bourgeoise ?” Et il répond tout de suite à cette question, mais par la tangente : “C’est avec les masses pauvres et marginalisées que le prolétariat des pays périphériques pourra vaincre lors de son attaque décisive contre l’Etat capitaliste”.
Certainement. C’est avec les masses marginalisées que le prolétariat peut et doit mener son combat révolutionnaire. Mais il ne suffit pas de dire “avec les masses marginalisées”. La question est que le prolétariat doit guider ces masses, les attirer à sa lutte, s’efforcer de faire qu’elles adoptent son point de vue de classe et sa perspective historique ; et non pas le contraire, comme cela arrive dans les émeutes de la faim, où c’est le prolétariat qui se laisse entraîner derrière la réponse désespérée de ces masses marginalisées.
BC poursuit : “Mais surtout la lutte de ces masses est, tout compte fait, une révolte contre l’ordre capitaliste et non contre le prolétariat et ses revendications immédiates et historiques.” Que les émeutes sont “contre l’ordre capitaliste”, nous l’avons déjà dit aussi : “Réveillée brusquement de ses rêves par une explosion de violence sociale qu’elle n’avait jamais imaginée, la bourgeoisie a assisté au dramatique écroulement de sa “paix sociale” (Section du CCI au Venezuela, “Communiqué sur la révolte”).
Mais, ici encore, on doit faire attention aux termes. Car si la lutte de la classe ouvrière brise nécessairement l’ordre bourgeois, la réciprocité n’est pas vraie : toute déstabilisation de l’ordre bourgeois n’implique pas en soi une lutte prolétarienne anticapitaliste. “Emancipacion Obrera” exprime la même confusion que BC de manière encore plus crue, quand il fait référence au “triomphe récupérable” de la révolte en Argentine: “Et ce n’est pas n’importe quelle lutte qui a eu lieu, mais une lutte qui brisait non seulement l’encadrement syndical et politique-démocratique, mais aussi le cadre légal.” (“Communiqué sur l’explosion sociale en Argentine”)
On trouve ici dans E.O. des relents de gauchisme, pour qui l’“illégalité” est synonyme de révolutionnaire. Les actions terroristes, les attaques de lumpenprolétaires troublent aussi l’ordre et sont aussi “illégales”, et pourtant on ne les considère pas comme faisant partie de la lutte prolétarienne. Est-ce que nous voulons dire par là que les émeutes sont le fait de lumpenprolétaires, ou de terroristes ? Non. Mais il faut voir que ces deux excroissances sociales -tant les lumpenprolétaires que les “guérilleros”- se trouvent dans ces émeutes comme des poissons dans l’eau, dans leur élément (“expropriations”, “exécutions”, actions violentes sans lendemain...), et c’est pour cela qu’ils les encouragent avec tant d’ardeur -ce sur quoi nous devons également mettre en garde le prolétariat.
Ce que nous voulons dire est que, s’il est vrai que la lutte ouvrière brise nécessairement la légalité bourgeoise -puisque toute grève de résistance s’affronte à l’appareil juridico-politique du capital et doit le surmonter pour réussir à s’étendre-, par contre, toute action “illégale” n’est pas en soi une lutte de la classe ouvrière.
Mais alors, si la participation d’ouvriers et le fait de briser l’ordre bourgeois ne sont pas des facteurs suffisants, qu’est- ce qui caractérise une action qui fait partie de la lutte de la classe ouvrière ? Les revendications immédiates et les objectifs historiques qui leur sont indissociables. C’est-à-dire, l’orientation, la perspective de ces luttes. Ce que nous appelons toujours : “le terrain de classe”.
A ce sujet, voyons la position des différents groupes. A notre connaissance, seul E.O. est arrivé à affirmer que les émeutes de la faim obtiennent la satisfaction de revendications immédiates, ce qui serait -avec la rupture de la légalité-, le deuxième volet du “triomphe récupérable” de la révolte en Argentine.
“Pour commencer, face à une situation concrète de faim et de très bas salaires, le mouvement de lutte [c’est-à-dire la révolte] a impliqué une amélioration réelle du “salaire” des participants [sic]. En outre, il leur a démontré à eux-mêmes qu’on peut faire des choses, [?] qu’on peut lutter et que cette lutte porte des fruits.” (p. 12).
Cette affirmation à la légère qui tend à identifier la lutte pour les salaires avec les pillages, est tout simplement démentie dans le même document d’E.O., quand il rapporte comment, pendant la répression sauvage de la révolte, les forces de police ont perquisitionné les maisons des quartiers pauvres en confisquant tout sur leur passage. Mais pour la classe ouvrière, le plus grand danger est précisément qu’elle abandonne ses mouvements de grèves et ses manifestations de rue sur son terrain de classe, pour ses propres revendications et dans la perspective révolutionnaire, et qu’elle commence à penser que les pillages sont la seule solution à la misère de sa situation. Et les affirmations d’E.O. poussent dans ce sens quand elle dit que la révolte “porte des fruits”. D’autres groupes n’ont pas affirmé cela, mais autant BC que le PCI ont salué le document d’E.O. sans critiquer cette position, soucieux surtout d’utiliser ce document pour s’en prendre au CCI.
Quant à la perspective que contiennent les émeutes, voyons ce qu’en disent certains groupes.
- CWO : “Pour les révolutionnaires le problème se pose en ces termes : comment la classe ouvrière vénézuélienne peut-elle transformer cette résistance, combative mais désespérée, en quelque chose qui n’aboutisse pas à une brutale répression.” (Workers’Voice, n° 46, avril-mai 1989)
- PCI : “Nul doute que dans cette situation, le prolétariat continuera à occuper le devant de la scène sociale, et ce que nous pouvons espérer [?], c’est qu’à la spontanéité des révoltes des quartiers, se substitue une lutte plus organisée, en dehors du giron des appareils réformistes, unifiant l’action de la lutte du prolétariat et la protégeant plus efficacement contre les coups de la répression.” (Le prolétaire, n° 406)
- E.O. : “Sa limite réside dans l’absence de perspective révolutionnaire, le manque d’objectifs, ne fût-ce qu’à moyen terme et, évidemment, l’absence d’une organisation prolétarienne révolutionnaire, ce qui rend le mouvement totalement vulnérable.”
Cette dernière et franche affirmation d’E.O., sur l’absence de perspective révolutionnaire, n’a été démentie par personne dans le milieu politique prolétarien. Les groupes se contentent d’esquiver le problème. Posons-nous alors la question : si ces révoltes font partie de la lutte de classe du prolétariat, pourquoi faudrait-il que les révolutionnaires se battent pour faire que ces luttes “deviennent autre chose” (CWO), ou pour qu’il s’y “substitue une lutte plus organisée” (PCI), au lieu de, par exemple, lutter pour que ces émeutes s’organisent, s’étendent et s’élèvent à un niveau supérieur ?
La réponse semble évidente : parce que, suivant leur propre dynamique, la poursuite de ces émeutes de la faim ne peut conduire qu’à une impasse sans issue. En tant que réaction désespérée, désorganisée, incapable d’affronter sérieusement la répression, elles ne peuvent conduire qu’à l’écrasement des masses aux mains des forces de répression, et à une situation encore pire que celle qui les a engendrées, dans tous les domaines : matériel, organisationnel, conscience.
C’est justement cela que nous avons souligné. C’est pour cela que nous avons mis en garde la classe ouvrière contre toute tendance à se laisser entraîner dans ces émeutes, l’appelant à se maintenir sur son propre terrain de lutte, au lieu de l’inviter -explicitement ou implicitement- de façon irresponsable, à se plonger dans ce type d’actions, à coups de saluts aux “luttes de la classe ouvrière”.
BC se hasarde cependant à affirmer que ces émeutes de la faim possèdent une perspective :
- “...au-delà de la question de leur nombre, il existe une différence qualitative entre les luttes qui se sont toujours déroulées dans les pays de la périphérie et les émeutes des dernières années.., on ne peut que noter la différence qui existe entre une grève ordinaire [?], revendicative.., et une révolte, accompagnée d’affrontements dans la rue, comme réponse à une attaque extraordinaire et générale... L’intensité de l’affrontement détermine non seulement l’intensité de la répression qui en découle de la part de la bourgeoisie, mais aussi, dans certaines limites, sa politique...”
- “Si la paix sociale permettait l’acceptation sans conditions des diktats du FMI, ou, plus généralement, de la situation de crise au niveau international, la rupture de la paix sociale oppose à ceux-ci des limites, ou, du moins, de sérieux obstacles... Le changement d’attitude... de la part des gouvernements des pays de la périphérie, s’il parvenait à avoir une influence sur la part de plus-value qui est drainée de la périphérie vers le centre, déterminerait une détérioration des conditions qui ont rendu possible la gestion de la crise et le maintien de la paix sociale dans les métropoles... Nous tenons à souligner que nous parlons de possibilité.., car il n’est pas du tout certain que cela se produise...”
BC ne reconnaît pas la continuité qui lie les grèves ouvrières des dernières années dans un même mouvement. Dans une autre partie du document cité, il ne voit, dans les grèves en Europe, que des “épisodes” sans conséquences, “les luttes ordinaires de toujours qui ne troublent en rien la paix sociale”. Les vagues de grèves au niveau international de ces dernières vingt années, ne sont, pour BC, que pure imagination du CCI. Mais il n’y a ici rien de nouveau chez ce groupe, qui nous a habitués à ne pas voir de luttes ouvrières là où il y en a, et à les voir là où il n’y en a pas.
Ce qui est nouveau c’est que BC, en partant de l’idée que les émeutes de la faim sont “qualitativement différentes” des grèves ouvrières, considère les premières comme les plus fortes et les plus importantes, et cela non pas à cause des “fruits” immédiats auxquels pense E.O., mais à cause des grandes perspectives qu’elles ouvrent. Car, d’après BC, les pillages de magasins :
- opposent des limites, créent des obstacles à la politique économique des gouvernements de la périphérie ;
- peuvent faire changer d’opinion ces gouvernements quant à l’application des plans dictés par le FMI ;
- peuvent, en conséquence, provoquer un affaiblissement de la fragile stabilité économique des métropoles ;
- et pourraient de ce fait rompre la paix sociale au sein de celles-ci.
En résumé, d’après BC, les pillages de magasins font plier le capitalisme mondial. A cette affirmation, pour le moins légère, nous pouvons répondre tout simplement qu’aucune de ces émeutes n’a “limité” ni “créé des obstacles” à l’application des plans du capital à moins de croire naïvement aux larmes de crocodiles des banquiers et des gouvernements. La seule chose qui change c’est la plus grande brutalité avec laquelle ces plans sont appliqués. Et tout le reste des spéculations de BC perd son sens. Il est vrai que l’économie des pays centraux s’oriente vers la récession ouverte, mais ceci n’est pas dû aux émeutes qui auraient empêché la “gestion de la crise”. Au contraire, c’est parce que la “gestion de la crise” a déjà donné tout ce qu’elle pouvait donner, parce que tous les plans ont déjà été appliqués, que la récession ouverte vient frapper de nouveau le capitalisme des pays centraux.
BC parle aussi d’“intenses émeutes avec des affrontements de rue”, donnant l’impression qu’il s’agit de combats entres forces comparables. A ce propos, nous préférons laisser la parole à la CWO qui, avec BC, fait partie du BIPR, mais qui a cependant une opinion très différente au sujet de ces “affrontements de rue” :
-
“Dans les rues de Caracas et d’autres villes, en particulier dans les quartiers pauvres, il y a eu une résistance armée aux forces de l’Etat. Mais d’où est venue cette résistance ? S’agissait-il d’une provocation de la droite... ? S’agissait-il d’un nouveau réveil de la guérilla urbaine... ? Ou était-ce les habitants de ces zones qui essayaient désespérément de venger les victimes de la terreur ? Ce qui est certain c’est qu’il ne s’agissait pas de l’expression armée d’un nouveau mouvement prolétarien. Les mouvements prolétariens n’ont pas besoin de sacrifier les ouvriers qu’ils défendent ni de les faire agir en dehors d’un mouvement de masses politiquement préparé pour faire avancer la lutte.”
Ce qui est vrai, c’est que ce n’est pas seulement dans sa phase de “résistance”, mais dès son départ, que la révolte “n’est pas une expression du mouvement prolétarien”.
Où en est-on après tout cela? Qu’en est-il des émeutes de la faim ? En fait, il s’agit d’actions désespérées dans lesquelles les ouvriers, dans la mesure où ils y participent, n’agissent pas comme classe ; des actions qui n’ont comme résultat immédiat que la répression féroce du capital et qui ne contiennent aucune perspective révolutionnaire. Il s’agit d’actions qui devraient “devenir autre chose”
Cependant, les groupes du milieu politique prolétarien que nous avons mentionnés peuvent continuer à saluer ces révoltes de la faim comme des “luttes de la classe ouvrière”, car, pour eux, le manque de perspectives de classe de ces actions a une explication : elles ne sont pas dirigées par le parti.
“Si le parti existait...”
-
PCI : “Ces actions spontanées, si elles montrent bien la faiblesse de la classe… et l’absence de l’organisation révolutionnaire… laissent voir cependant une lueur d’espoir, parce qu’elles témoignent que la classe n’est pas disposée à laisser, les bras croisés, ses enfants mourir de faim. La tâche des révolutionnaires consiste à constituer et à développer l’organisation révolutionnaire, le parti de classe capable de recueillir cette volonté de lutte et de diriger cette énergie révolutionnaires vers des objectifs de classe.” (Le prolétaire, n° 403, oct-nov 1989)
-
E.O. “Sa limite réside dans l’absence de perspective révolutionnaire et, évidemment, l’absence d’une organisation prolétarienne révolutionnaire, ce qui rend le mouvement totalement vulnérable”.
-
BC : “Y avait-t-il, dans cette révolte, plus de semi-prolétaires ou de sous prolétaires que de prolétaires d’usine ? La question porte à rire… Si le prolétariat n’était pas encore suffisamment présent dans le mouvement, il s’agissait d’une limite du prolétariat et de son organisation politique (encore virtuellement inexistante) et non de la révolte elle même.” (Prometeo n° 13)
Ainsi, suivant la voie “bordiguiste” qui fait du parti le démiurge du mouvement révolutionnaire, ces groupes croient avoir résolu tout questionnement sur la nature des émeutes. Mais cette position, qui se veut très ferme, cache, en réalité, leur incapacité à offrir actuellement au prolétariat une orientation face aux émeutes
Rappelons ici que le CCI considère que le parti est un organe indispensable pour le prolétariat dont il oriente le combat révolutionnaire. Mais ce dont il s’agit ici ce n’est pas de savoir ce qu’il adviendra de ces émeutes lorsque le parti existera, mais de l’attitude que doivent avoir les révolutionnaires aujourd’hui, lorsque les conditions existantes engendrent la multiplication de ces révoltes.
Si les émeutes de la faim constituent des luttes prolétariennes d’une importance égale ou même supérieure à celle des mouvements de grèves “ordinaires”, alors ces groupes révolutionnaires devraient agir en conséquence.
Par exemple, face aux grèves, les révolutionnaires tirent des leçons des expériences et les font connaître à l’ensemble de la classe, afin que les prochaines grèves soient plus fortes, affrontent en de meilleures conditions l’appareil étatique. Face à une grève qui éclate, les révolutionnaires bandent leurs forces, interviennent activement en son sein, appellent à son extension, demandent à d’autres secteurs de se joindre au combat, dénoncent les manoeuvres des syndicats et des autres ennemis, ils font des propositions de marche et d’organisation, ils réalisent, enfin, tout un travail d’agitation et de propagande en vue de l’extension de la conscience révolutionnaire parmi les travailleurs...
Quelle devrait donc être l’attitude des révolutionnaires face à cette autre forme de la “lutte de classe” que seraient ces émeutes ? Faut il encourager celles-ci ? Faut-il y participer ? Faut-il appeler les ouvriers à participer aux pillages ? Faut-il faire de la propagande expliquant que ces révoltes permettent d’arracher des “fruits” et qu’elles déstabilisent le système capitaliste ?
Ce que nous disons semble faire rire certains. Mais il n’y a pas de quoi. Tous ces groupes ne font que tourner autour d’un très grave problème : ils appellent “lutte de classe” des actions dans lesquelles ils ne sont pas prêts à s’engager eux mêmes. Tout ce qu’ils parviennent à dire c’est des formules du genre :
- “Nous espérons qu’à ces révoltes se substituera une lutte plus organisée.” (PCI) ;
- “Les mouvements prolétariens n’ont pas besoin de sacrifier les ouvriers qu’ils défendent.” (CWO) ;
- “Il est évident qu’un mouvement similaire ne pourra pas se reproduire au cours des prochains mois car la bourgeoisie provoquerait un terrifiant bain de sang et une très grave défaite, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui [?]. Et tous ceux qui y ont participé le savent.” (E.O.) ;
- “Nous tenons à souligner que [à propos des spéculations sur les perspectives des émeutes] nous parlons de possibilité et que nous employons le mode conditionnel, car il n’est pas du tout certain qu’il en adviendra ainsi.” (Prometeo)
Telle est l’attitude de ces groupes face aux émeutes de la faim :
- Ils les saluent aux quatre vents comme des jalons importants de la lutte de classe.., mais ils sont incapables de leur offrir la moindre alternative de marche concrète. Cette tâche ils la laissent... au futur parti.
- Du bout des lèvres, ils admettent que les émeutes n’ont d’autre destin que celui de s’écraser contre le mur de la répression ; qu’elles ne portent pas en elles une alternative prolétarienne révolutionnaire et que l’énergie gaspillée dans ces combats devrait être utilisée d’une façon différente, dans un autre type d’actions, dans une véritable lutte de classe.
- Cela ne les empêche pas, cependant, de continuer à “critiquer” le CCI parce qu’il est la seule organisation qui a ouvertement dénoncé le danger que constituent ces émeutes pour le prolétariat, et qui distingue clairement ce type d’actions de la lutte sur le terrain de la classe ouvrière.
L’attitude de ces groupes peut être synthétisée en deux phrases :
- incapacité à comprendre les bouleversements accélérés de la vie du capitalisme que nous sommes en train de vivre ;
- irresponsabilité face à la fonction que leur a désignée la classe à laquelle ils appartiennent.
Ldo.
[1] [133] Dans cet article nous ferons référence aux organisations suivantes :
- le PCI (Parti Communiste Internationaliste), qui publie “Battaglia Comunista” et “Prometeo”, en Italie, auquel il sera fait référence sous le sigle “BC” ;
- le PCI (Parti Communiste International), qui publie “Le Prolétaire” et “Programme Communiste” en France, auquel il sera fait référence sous le sigle “PCI” ;
- la Communist Workers’Organisation, qui publie “Workers’Voice” en Grande-Bretagne, à laquelle il sera fait référence sous le sigle “CWO”;
- “Emancipaciôn Obrera” en Argentine, à laquelle il sera fait référence sous le sigle “EO”.
Situations territoriales:
Récent et en cours:
- Banlieues [135]
Courants politiques:
- TCI / BIPR [136]
- Battaglia Comunista [65]
- Communist Workers Organisation [137]