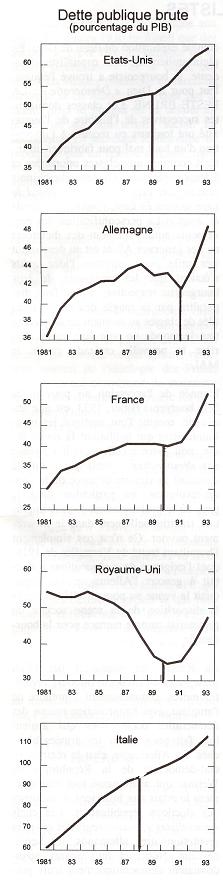Revue Int. 1994 - 76 à 79
- 4276 lectures
Revue Internationale no 76 - 1e trimestre 1994
- 2850 lectures
Editorial : La difficile reprise de la lutte de classe
- 2618 lectures
Au Moyen-Orient la <r paix » Israel-OLP se révèle pour ce qu'elle est : un nouveau prolongement de la guerre qui n'a jamais cessé dans cette région du monde. Champ de bataille des grands intérêts impérialistes depuis la première guerre mondiale, le Moyen-Orient le restera tant que le capitalisme mondial vivra, tout comme toutes les autres régions où n'ont jamais cessés les guerres ouvertes ou larvées.
En Yougoslavie, la guerre se poursuit. Des combats se mènent désormais au sein même de chacun des camps, entre Serbes, entre Croates, et entre Musulmans. L'alibi « ethnique » fourni pour justifier cette guerre est tragiquement dénoncé par les nouveaux combats autour desquels les médias font désormais taire leur publicité ! C'est sous couvert du « droit à l'indépendance » des « peuples » que la Yougoslavie est devenue le sinistre champ d'expérience des nouveaux affrontements entre grandes puissances provoqués par la disparition des anciens blocs impérialistes. Là aussi, il n'y aura pas de retour en arrière possible tant que le capitalisme aura les mains libres pour mener sa politique diplomatico-guerrière au nom de l'aide « humanitaire ».
En Russie, la situation ne fait qu'empirer. Le naufrage économique est décuplé, et l'instabilité politique qui a déjà entraîné des pans entiers de l'ex-URSS dans des guerres sanglantes, touche de plus en plus au coeur même de la Russie. Le risque de l'extension d'un chaos « à la yougoslave » y est bien réel. Là encore, le capitalisme n'a d'autre perspective que les guerres.
Guerres et crise, décomposition sociale, tel est /'« avenir » que le capitalisme offre à l'humanité en cette dernière décennie du millénaire
Dans les pays « développés », qui constituent le centre névralgique de ce système de terreur, de mort et de misère qu'est le capitalisme mondial, les luttes ouvrières ont resurgi depuis plusieurs mois après quatre ans de recul et de passivité. Début de mobilisation ouvrière contre des plans d'austérité d'une brutalité inconnue depuis la deuxième guerre mondiale, ces luttes contiennent aussi en germe la seule possibilité de réponse à la décadence et la décomposition du mode de production capitaliste. Avec toutes leurs limites, elles constituent déjà un pas dans le sens d'un combat de classe, une lutte massive et internationale du prolétariat, seule perspective pour enrayer les attaques contre les conditions d'existence, la misère et les guerres qui ravagent aujourd'hui la planète.
Le développement de la lutte de classe
Depuis plusieurs mois maintenant, mouvements de grèves et manifestations se sont multipliés dans les principaux pays d'Europe de l'ouest. Le calme social qui régnait depuis près de quatre ans est définitivement rompu.
La brutalité des licenciements et des baisses de salaires, et toutes les autres mesures d'austérité qui les accompagnent, ont partout provoqué la montée d'un mécontentement qui, à plusieurs reprises, a débouché sur une combativité retrouvée, une volonté manifeste de se battre, de ne pas se résigner face aux menaces que font peser les attaques contre toutes les conditions de vie de la classe ouvrière.
Et si partout les mouvements restent bien encadrés par les syndicats, ils n'en signifient pas moins un développement important de la lutte de classe. Le fait que, dans tous les pays, les syndicats appellent à des journées de manifestation et à des grèves, est symptomatique de la montée de la combativité dans les rangs ouvriers. C'est bien parce que les syndicats, par la place qu'ils occupent dans l'Etat capitaliste comme gardiens de l'ordre social pour le compte du capital national, perçoivent clairement que la classe ouvrière n'est pas prête à accepter passivement ces attaques contre ses conditions d'existence, qu'ils prennent les devants. En enfermant et en canalisant les revendications dans le corporatisme et le nationalisme, en dévoyant la volonté de lutter dans des impasses, les syndicats déploient une stratégie visant à empêcher le développement de la lutte de classe. Et cette stratégie est, a contrario, le signe qu'une véritable reprise de la lutte de classe est désormais en cours, à l'échelle internationale.
La reprise de la combativité ouvrière
La fin de l'année 1993 a ainsi été marquée par des grèves et manifestations en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne.
Ce sont les grèves et manifestations en Allemagne ([1] [1]) au début de l'automne qui ont donné le « la ». Tous les secteurs ont été touchés par une forte vague de mécontentement, obligeant les syndicats à orchestrer des manoeuvres de grande envergure, dans les principaux secteurs industriels, avec notamment une manifestation de 120 000 ouvriers du bâtiment le 28 octobre à Bonn, et avec également, dans l'industrie automobile, la « négociation » sur la semaine de 4 jours de travail avec diminution des salaires chez Volkswagen.
En Italie, où les premiers signes de la reprise de la lutte de classe internationale s'étaient manifestés dès septembre 1992, avec une importante mobilisation contre le plan du gouvernement Amato et contre les syndicats officiels signataires du plan, se sont multipliées grèves et manifestations depuis septembre 1993. Les grandes centrales syndicales étant fortement discréditées auprès des ouvriers, ce sont des organismes du syndicalisme de base qui prennent le relais. Le 25 septembre, 200 000 personnes manifestent à l'appel des « coordinations des conseils de fabrique ». Le 28 octobre, 700 000 personnes participent aux manifestations organisées dans le pays, et la grève de 4 heures est suivie ce jour-là par 14 millions de salariés. Le 16 novembre, c'est une manifestation de 500 000 salariés du secteur du bâtiment. Le 10 décembre, des manifestations de métallos de Fiat se déroulent à Turin, Milan et Rome.
En Belgique, le 29 octobre, 60 000 manifestants défilent à Bruxelles à l'appel de la FGTB, syndicat socialiste. Le 15 novembre sont organisées des grèves tournantes dans les transports publics. Le 26 novembre, qualifié de « Vendredi rouge » par la presse bourgeoise, la grève générale contre le « plan global » du premier ministre, la plus importante depuis 1936, appelée par les deux grands syndicats, la FGTB et le syndicat chrétien, la CSC, paralyse tout le pays.
En France, en octobre, c'est la grève des personnels au sol de la compagnie Air France, puis toute une série de manifestations et grèves localisées, notamment dans les transports publics, le 26 novembre. En Grande-Bretagne, 250 000 fonctionnaires sont en grève le 5 novembre. En Espagne, le 17 novembre, c'est le rassemblement de 30 000 métallos à Barcelone, contre le plan de licenciements de l'usine d'automobiles SEAT. Le 25 novembre est organisée une grande journée de manifestations syndicales dans tout le pays, contre le « pacte social » du gouvernement, la baisse des salaires, retraites, allocation chômage à laquelle participent plusieurs dizaines de milliers de personnes à Madrid, Barcelone et dans tout le pays.
Le blackout
Dans chaque pays, la propagande médiatique de la presse, de la radio et de la télévision, s'efforce autant que possible de taire les événements qui touchent à la classe ouvrière. C'est particulièrement le cas des mouvements dans les autres pays qui ne sont pratiquement jamais « couverts ». Et lorsque certains journaux mentionnent parfois très brièvement grèves et manifestations, dans la presse « populaire » et à la télévision, c'est quasiment partout le black out. Par exemple, pratiquement rien n'a filtré des grèves et manifestations en Allemagne dans les médias des autres pays. Et quand la réalité de « l'agitation sociale » ne peut pas être cachée, lorsqu'il s'agit d'événements nationaux, lorsqu'il s'agit des manoeuvres de la bourgeoisie qui servent sa propagande, ou lorsque l'importance de ce qui se passe s'impose à 1' « information », cette dernière présente systématiquement les aspects particuliers de chaque situation : c'est le problème de telle ou telle entreprise, c'est le problème de tel ou tel secteur, c'est le problème de tel ou tel pays. Ce sont toujours les revendications les plus corporatistes et nationalistes des syndicats qui sont présentées. Ou encore, ce sont les aspects spectaculaires stériles, comme les affrontements minoritaires avec les forces de l'ordre (en France lors du conflit d'Air France, en Belgique lors du « Vendredi rouge »), qui sont mis en avant.
Mais derrière le black out et la déformation de la réalité, c'est fondamentalement la même situation dans tous les pays développés, en Europe de l'ouest en particulier, qui est à la base de la reprise de la lutte de classe. La multiplication des grèves et manifestations est en elle-même déjà la marque de la reprise de la combativité ouvrière, d'une montée du mécontentement contre la baisse du « niveau de vie » qui s'élargit de jour en jour à toutes les couches de la population au travail, et contre le chômage massif.
Ce développement de la lutte de classe n'est qu'un début. Il se heurte aux difficultés créées par les conditions de la période historique actuelle.
Les difficultés de la classe ouvrière face à la stratégie syndicale et politique
C'est après toute une période d'un important reflux des combats ouvriers, qui a duré près de quatre ans, que la classe ouvrière commence à retrouver le chemin de la lutte.
Le mensonge stalinisme=communisme pèse toujours
Le prolétariat a d'abord été déboussolé par les campagnes idéologiques sur la « fin du communisme » et la « fin de la lutte de classe » qui ont été martelées à profusion depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Ces campagnes, en présentant la mort du stalinisme comme la « fin du communisme », ont attaqué directement la conscience latente dans la classe ouvrière de la nécessité et de la possibilité de se battre pour une autre société. En usant et abusant du plus grand mensonge de ce siècle, l'assimilation de la forme stalinienne de capitalisme d'Etat au « communisme », la propagande de la bourgeoisie a largement déboussolé la classe ouvrière. Dans sa grande majorité, celle-ci a perçu l'effondrement du stalinisme comme la manifestation de l'impossibilité de l'instauration d'un autre système que le capitalisme. Au lieu d'une clarification dans la conscience de la classe sur la nature capitaliste du stalinisme, la fin de ce dernier a en quelque sorte permis de renforcer la crédibilité du mensonge de la nature « socialiste » de l’URSS et des pays de l'Est. Un reflux profond dans la conscience de la classe ouvrière, qui se dégageait lentement de l'emprise de ce mensonge, dans ses luttes depuis la fin des années 1960, s'est ouvert à partir de là, expliquant en grande partie le plus bas niveau de grèves et manifestations ouvrières jamais enregistré en Europe de l'ouest depuis la seconde guerre mondiale.
La confusion, qui depuis plusieurs décennies a régné dans la classe ouvrière sur sa propre perspective, celle du communisme, mensongèrement assimilée à la contre-révolution capitaliste sanglante du stalinisme, perdure. Elle continue d'être entretenue par la propagande, aussi bien celle des fractions de la bourgeoisie qui dénoncent le « communisme » pour vanter les mérites de la « démocratie » libérale ou socialiste, que par celle des fractions qui en défendent les «acquis socialistes» comme les Partis communistes et les organisations trotskistes. ([2] [2])
Toutes les occasions sont bonnes pour entretenir cette confusion. Lors des affrontements à Moscou en octobre 1993 entre le gouvernement d'Eltsine et les « insurgés du Parlement », la propagande n'a cessé de présenter les députés « conservateurs » comme les « vrais communistes » (en insistant qu'ils ne peuvent bien sûr s'entendre qu'avec les « fascistes »), renforçant à nouveau le rideau de fumée idéologique sur le « communisme », utilisant une fois encore le cadavre du stalinisme pour marteler son message contre la classe ouvrière. Quant aux Partis communistes et aux organisations trotskistes, avec la désillusion qu'entraînent les ravages de la crise en URSS et dans les ex-pays « socialistes », ils retrouvent de la voix de plus en plus souvent pour défendre combien finalement les « acquis socialistes » ([3] [3]) avaient du bon... avant le «retour du capitalisme ».
Le mensonge de l'assimilation du stalinisme au communisme, qui occulte la véritable perspective du communisme, va continuer à être entretenu par la bourgeoisie. La classe ouvrière ne pourra véritablement se débarrasser de cet obstacle à sa prise de conscience qu'avec la mise à nu, dans la pratique de ses luttes, du rôle contre-révolutionnaire des organisations de la gauche du capital social-démocratie, stalinisme et ses variantes « déstalinisées » et du syndicalisme.
Le poids du syndicalisme
Les promesses d'un « nouvel ordre mondial » qui devait ouvrir une « nouvelle ère de paix et de prospérité » sous l'égide du capitalisme « démocratique » ont également contribué à un reflux de la lutte de classe, de la capacité de la classe ouvrière à riposter aux remises en cause de ses conditions d'existence.
La guerre du Golfe en 1991 avait mis à mal les promesses de « paix », et constitué un facteur de clarification dans la conscience sur la nature de cette « paix » selon le capitalisme « triomphant », mais elle avait en même temps généré un sentiment d'impuissance annihilant la combativité.
Aujourd'hui, la crise économique et la généralisation des attaques des conditions de vie qu'elle entraîne, pousse le prolétariat à émerger lentement de la passivité qui dominait dans ses rangs. Le regain de combativité est un signe que les promesses de « prospérité » ne font plus recette. Les faits sont là. Le capitalisme ne peut offrir que la misère. Les sacrifices consentis appellent d'autres sacrifices. L'économie capitaliste est malade et ce sont les travailleurs qui en font les frais.
La reprise actuelle de la lutte de classe est donc marquée à la fois par une confusion qui persiste dans la classe ouvrière sur la perspective générale de ses luttes, à l'échelle historique, la perspective du communisme, le vrai, dont elle est porteuse, et à la fois par un réveil de la conscience de la nécessité de se battre contre le capitalisme.
C'est pourquoi, la caractéristique principale de cette reprise est l'emprise des syndicats sur les luttes actuelles, la quasi absence d'initiatives autonomes de la part des ouvriers, le faible niveau de rejet du syndicalisme. En effet, en l'absence de développement d'une conscience, même diffuse, de la possibilité d'un renversement du capitalisme, la combativité est piégée. Cantonnée à poser des revendications dans le cadre du capitalisme, elle se retrouve sur le terrain privilégié du syndicalisme. C'est pourquoi, actuellement, les syndicats parviennent à entraîner les ouvriers hors de leur terrain de classe:
- en formulant les revendications dans un cadre corporatiste, dans celui de la défense de l'économie nationale, au détriment de revendications communes à tous les ouvriers ;
- en « organisant » des « actions » qui servent à défouler le mécontentement, à faire croire à la classe ouvrière qu'elle lutte ainsi pour ses revendications, alors qu'en réalité elle est entraînée dans des impasses, fourvoyée dans des actions isolées, quand elle n'est pas simplement baladée dans des processions inoffensives pour l'Etat.
Une bourgeoisie qui se prépare à l'affrontement...
A quelques rares exceptions près, comme lors du début du mouvement des mineurs dans la Ruhr en Allemagne en septembre, tous les mouvements qui se sont développés ont été encadrés et «organisés» par les syndicats. Y compris certaines actions de syndicalisme de base, plus radicales, se sont déroulées sous l'oeil bienveillant des grandes centrales, quand ces dernières ne les ont pas directement suscitées ([4] [4]). Cette capacité de manoeuvre est rendue possible à la fois par le faible niveau de conscience dans la classe ouvrière du rôle véritable que jouent les syndicats dans le sabotage de leurs luttes et à la fois par la préparation de la stratégie de la bourgeoisie sur les « conséquences sociales de l'austérité », en clair le danger de la lutte de classe.
Car si le prolétariat a des difficultés à se reconnaître comme classe, à prendre conscience de son être, la bourgeoisie n'a aucune difficulté à voir le danger que représentent des luttes ouvrières, les grèves, les manifestations. Par expérience, la classe dominante connaît le danger de la lutte de classe pour le capitalisme, tout au long de son histoire en général et avec les vagues de luttes qu'elle a dû contenir, encadrer et affronter au cours des dernières vingt-cinq années ([5] [5]). Avec les mesures particulièrement brutales qu'elle est amenée à prendre dans la tourmente économique actuelle, elle s'efforce de planifier ses attaques, y compris les réactions de colère, de mécontentement, et la combativité que celles-ci ne manquent pas de susciter.
Il n'est donc pas étonnant que, tout comme le moment du déclenchement des luttes ouvrières en Italie, en septembre 1992, avait été choisi par la bourgeoisie pour défouler prématurément le prolétariat dans ce pays, et éviter ainsi la contagion dans d'autres pays européens ([6] [6]), la plupart des mouvements aujourd'hui dépendent peu ou prou d'un calendrier syndical. D'un côté les «journées d'action », de l'autre le battage sur quelques « exemples », comme Air France ou le « Vendredi rouge » en Belgique, tout cela est en grande partie programmé par l'appareil politique et syndical de la classe dominante, pour « lâcher la vapeur » dans la classe ouvrière. Et ceci en concertation avec les « partenaires » des autres pays.
Avec le coup de massue des mesures anti ouvrières, dans un contexte de déboussolement politique et idéologique, le poids des illusions syndicalistes et le soin apporté par la bourgeoisie dans sa stratégie expliquent pourquoi la combativité n'a nulle part réellement fait échec aux attaques anti-ouvrières. Qui plus est, le prolétariat subit aussi la pression de la décomposition sociale. Le « chacun pour soi » ambiant pèse sur le besoin de développer la lutte collective et la solidarité, et favorise les manoeuvre de division du syndicalisme. De plus, la bourgeoisie utilise sa propre décomposition pour en retourner les effets contre la prise de conscience du prolétariat.
...et utilise la décomposition
La décomposition qui gangrène la société bourgeoise où règnent en maître les mensonges et les magouilles pour les profits d'un gâteau qui se rétrécit à vue d'oeil, pousse effectivement la classe bourgeoise au chacun pour soi.
Les scandales et les diverses affaires du monde politique, financier, industriel, sportif, princier, suivant les pays, ne sont pas seulement une mascarade. Ils correspondent à l'aiguisement des rivalités au sein de la classe dominante. Néanmoins, il y a une chose qui met d'accord tout ce beau monde autour des « affaires », c'est la publicité maximum qui en est faite pour occuper le terrain de 1'« information ».
En Italie par exemple, c'est l'« opération mains propres». Publiquement il s'agit de moraliser et d'assainir les comportements des hommes politiques. En fait, c'est le règlement de comptes entre les différentes fractions de la bourgeoisie, les divers clans dans l'appareil politique, essentiellement entre les tendances pro-Etats-Unis, dont le Parti démocrate-chrétien a été le zélé serviteur pendant quarante ans, et les tendances pro-alliance franco-allemande ([7] [7]). De même en France, le scandale Tapie et autres feuilletons politico-médiatiques, sont les sujets systématiquement traités au premier plan de 1' « actualité ». A vrai dire, tout le monde s'en fout. Mais c'est précisément un des buts recherché : le moins d'information possible, et le message en filigrane, « surtout, pas de politique, c'est sale », est bien utile pour le cas où les ouvriers s'aviseraient précisément de s'occuper de politique. En Grande-Bretagne, c'est le feuilleton permanent autour de la famille royale qui remplit le même rôle d'occupation du terrain de 1'« information ».
Les campagnes «humanitaires» pour « héberger un étranger» en Allemagne ou « recueillir un enfant de Sarajevo » en Grande-Bretagne, tout comme le matraquage autour d'assassinats commis par des enfants en Grande-Bretagne ou en France, constituent également de claires illustrations de l'utilisation de la décomposition par l'idéologie bourgeoise pour entretenir un sentiment d'impuissance et de peur, et détourner l'attention des véritables problèmes économiques, politiques et sociaux.
Il en va de même de l'utilisation systématiques des images de guerre, comme au Moyen-Orient ou en Yougoslavie, dans lesquelles les intérêts impérialistes sont masqués, qui servent à créer un sentiment de culpabilité, et justifier ainsi l'acceptation des conditions d'exploitation dans les pays en « paix ».
Les perspectives de la lutte de classe
Toutes les difficultés de la lutte de classe ne signifient pas que les combats soient perdus d'avance et que les ouvriers n'ont rien à en attendre. Au contraire. Le déploiement actuel de la stratégie concertée de la bourgeoisie internationale contre la classe ouvrière, s'il constitue un obstacle de taille au déploiement des luttes, est aussi la marque d'une réelle tendance à la mobilisation et à la combativité, ainsi que d'une tendance à la réflexion sur les enjeux d'aujourd'hui.
C'est plus « par défaut » que par adhésion profonde que les ouvriers s'en remettent aux syndicats, contrairement à ce qui se passait dans les années 1930 où c'est par dizaines de millions que les ouvriers entraient dans ces organisations, signe de défaite historique de la classe ouvrière. C'est également plus « par défaut » que par adhésion à la politique de la bourgeoisie que le prolétariat tend encore à suivre les partis de la gauche du capital qui se prétendent « ouvriers », contrairement aux années 1930 où c'était l'enthousiasme pour les « fronts populaires » (avec son pendant dans la soumission au « national-socialisme » et au « stalinisme »).
Si la décomposition et son utilisation par la bourgeoisie se conjuguent avec les manoeuvres sur le terrain social des syndicats et de leurs prolongements « à la base » pour empoisonner la combativité et brouiller la prise de conscience de la classe ouvrière, la crise économique et les attaques des conditions d'existence en constituent un puissant antidote. C'est sur ce terrain que le prolétariat a commencé à riposter. Ce n'est qu'un début d'une longue période de luttes. La répétition de défaites sur les revendications économiques, si elle est douloureuse, est aussi porteuse d'une réflexion en profondeur sur les buts et les moyens de la lutte. La mobilisation ouvrière porte déjà en elle cette réflexion. La bourgeoisie ne s'y trompe pas : une « critique du capitalisme », de la part... du pape, est publiée à grand renfort de publicité ; des intellectuels publient soudain des articles en « défense du marxisme ». C'est au danger du début de réflexion qui s'opère dans la classe que s'attaque ce genre d'entreprise.
Malgré les difficultés, les conditions historiques actuelles tracent un chemin vers des affrontements de classe entre le prolétariat et la bourgeoisie, dont la reprise de la combativité aujourd'hui ne constitue qu'un premier pas.
Il revient aux organisations révolutionnaires de participer activement à cette réflexion et au développement de l'action de la classe ouvrière. Dans les luttes, ils doivent mettre en avant la dénonciation sans relâche de la stratégie de la bourgeoisie de division et de dispersion, rejeter les revendications corporatistes, catégorielles, sectorielles et nationalistes, s'opposer aux méthodes de « lutte » des syndicats qui ne sont que des manoeuvres destinées à « mouiller la poudre ». Ils doivent défendre la perspective d'une lutte générale de la classe ouvrière, la perspective du communisme. Ils doivent rappeler les expériences des luttes passées, l'apprentissage de la prise en mains de son combat par la classe ouvrière, dans ses assemblées générales, avec des délégués élus et révocables par ces mêmes assemblées. Ils doivent défendre, lorsque c'est possible, l'extension des luttes au-delà des barrières catégorielles. Ils doivent impulser et animer des cercles de discussion et comités de lutte où tous les travailleurs peuvent discuter des enjeux, des objectifs et des moyens de la lutte de classe, développer leur compréhension du rapport de forces entre prolétariat et bourgeoisie, de la nature de ce combat qui ouvre la perspective du développement d'affrontements de classe de grande ampleur dans les années qui viennent.
OF, 12 décembre 1993.
[1] [8] Voir Revue Internationale n° 75.
[2] [9] Quant à l'anarchisme, qui fait du stalinisme le résultat du « marxisme », il est condamné, en dépit de son « radicalisme » à se rallier à la bourgeoisie. Dans sa variante anarcho-syndicaliste, il se rattache directement à l'Etat bourgeois, en tant que syndicalisme. Dans sa variante politique, il est l'expression de la petite-bourgeoisie, et se range dans un camp de la bourgeoisie, comme en 1936 en Espagne, au même titre que les couches sociales qu'il représente.
[3] [10] En France, le groupe trotskiste Lutte Ouvrière a mené une énorme campagne d'affichage dans toute la France pour dénoncer le « retour au capitalisme » en URSS et appeler à défendre ces fameux « acquis ouvriers.»
[4] [11] Aussi bien la manifestation en Italie à l'appel des « coordinations... » que les bagarres sur les pistes des aéroports de Paris lors de la grève d'Air France.
[5] [12] Qui plus est aujourd'hui, c'est la génération d'hommes qui avaient vingt ans en 1968 qui est aux commandes de l'Etat capitaliste. C'est une génération particulièrement expérimentée dans le domaine « social » : faut-il rappeler qu'un Mitterrand en France est entouré d'anciens gauchistes de Mai 68, et que le premier grand service rendu par Chirac à sa classe a été l'organisation, en plein mai 68, des réunions secrètes du gouvernement Pompidou (dont faisait partie Balladur...) avec le syndicat stalinien CGT, pour préparer les accords qui devaient enterrer le mouvement.
[6] [13] Sur les luttes en Italie en 1992, voir Revue Internationale n° 72 et 71 (supplément).
[7] [14] Sur l'Italie, voir la Revue Internationale n° 73.
Géographique:
- Europe [15]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [16]
« Reprise » économique, accords du GATT : Les mystifications d'une solution capitaliste a la crise
- 3002 lectures
Depuis le début de la décennie, l'économie mondiale a plongé dans la récession. La multiplication des licenciements, la croissance brutale du chômage qui atteint des niveaux inconnus depuis les années 1930, une précarisation grandissante de l'emploi pour ceux qui ont la chance d'en conserver un, une baisse généralisée du niveau de vie amputé par les plans d'austérité à répétition, une paupérisation grandissante qui se concrétise brutalement par la marginalisation d'une fraction de plus en plus importante de la population qui se retrouve sans revenu et même sans domicile. Autant de phénomènes que la classe ouvrière au coeur des grandes métropoles développées subit de plein fouet. Aujourd'hui, les exploités sont confrontés à la plus importante attaque jamais menée contre leurs conditions de vie. Au-delà de tous les indices abscons, de tous les chiffres abstraits, cette réalité montre de manière terriblement concrète la vérité de la crise économique du système capitaliste dans son ensemble. C'est une évidence tellement criante qu'aujourd'hui, plus aucun économiste ne songe à la nier. Et pourtant, inlassablement, les thuriféraires du capitalisme ne cessent de nous annoncer que la reprise est là... pour l'année prochaine. Jusqu'à présent, ces espoirs ont été chaque fois déçus. Cela n'empêche pas qu'en cette fin d'année 1993, une fois de plus, et peut-être plus fort que jamais, les médias nous chantent sur tous les tons le refrain de la « reprise » annoncée.
Sur quoi se base ce regain d'optimisme? Essentiellement sur le fait qu'on assiste aux USA, après plusieurs années de récession, à un retour à des taux de croissance positifs du PNB. Ces chiffres sont-ils pour autant significatifs et annoncent-ils le retour à des lendemains capitalistes qui chantent? Croire cela serait la pire des illusions pour la classe ouvrière.
Le niveau assourdissant qu'atteint aujourd'hui le tapage médiatique sur la question de la fin de la récession exprime au contraire le besoin pour la classe dominante de contrecarrer le sentiment de plus en plus aigu qui se développe au sein du prolétariat, confronté à la réalité de ses difficultés quotidiennes qui vont en s'aggravant depuis de nombreuses années, que, face à la crise de leur système, les gestionnaires du capital n'ont pas de réponse adéquate, pas de solution. Depuis des années, les thèmes et les discours idéologiques mis en avant par la classe dominante ont pu varier, du « moins d'Etat » de Reagan et Thatcher à la revalorisation du rôle social et régulateur de l'Etat par Clinton, les gouvernements de « gauche » et de « droite » se sont succédés, mais la réalité a continué d'avancer toujours dans le même sens : celui de l'approfondissement de la crise mondiale et de la dégradation généralisée des conditions de vie des exploités. Constamment de nouvelles recettes au goût de potion amère ont été essayées. Continuellement de nouveaux espoirs ont été soulevés. En vain.
Ces derniers mois, la propagande capitaliste a trouvé un nouveau thème mystificateur: les négociations du GATT. Ce serait le protectionnisme qui entraverait le développement de la reprise économique. Par conséquent, l'ouverture des marchés, le respect des règles de la libre concurrence serait la panacée qui permettrait de sortir l'économie mondiale de l'ornière dans laquelle elle s'est embourbée. Les USA se font le porte-drapeau d'une telle vision. Mais tout cela n'est que baratin idéologique, un écran de fumée qui parvient de plus en plus mal à cacher la férocité de la foire d'empoigne qui oppose les principales puissances économiques du monde pour la conservation de leur part d'un marché mondial qui va en se rétrécissant. Sous prétexte des négociations du GATT, chaque fraction de la bourgeoisie essaye de mobiliser le prolétariat derrière l'étendard de la défense de l'économie nationale. Les accords du GATT ne sont qu'un moment de la guerre commerciale qui s'exacerbe sur le marché mondial et la classe ouvrière n'a fondamentalement rien à en attendre. L'issue de ces négociations ne change rien à la dynamique de concurrence effrénée qui se développe depuis des années et qui se traduit par des licenciements massifs et des plans sociaux draconiens pour restaurer la compétitivité des entreprises et redresser les bilans en imposant des économies drastiques dont la classe ouvrière va continuer à faire les frais. Dans le futur, les responsables capitalistes auront tout au plus un nouvel argument à faire valoir pour licencier, pour amputer les salaires, pour imposer plus de misère : « c'est la faute du GATT », comme on entend déjà « c'est à cause de la CEE » ou de la « NAFTA » ([1] [17]). Tous ces faux arguments n'ont qu'une raison d'être : masquer la réalité que toute cette misère qui se développe est le produit d'un système économique qui s'empêtre dans ses contradictions insolubles, le capitalisme.
Une récession sans fin
Au moindre petit frémissement des indices de croissance, les dirigeants du capitalisme sont prompts à s'enthousiasmer pour y voir le signe de la reprise et donc la validation de la politique économique d'austérité qu'ils ont menée. Tel a notamment été le cas en France et en Allemagne récemment. Pourtant, les chiffres de la croissance de ces derniers mois pour les principales puissances économiques montrent qu'il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser.
Ainsi pour l'ensemble de l’Union Européenne (suivant la nouvelle dénomination de l'ex-CEE), la « croissance » était encore d'un petit + 1 % en 1992 avant qu'elle ne chute à -0,6% en 1993. Elle passe ainsi, pour ces deux années, de + 1,6% à -2,2% pour l'Allemagne (hors Allemagne orientale), de + 1,4 % à - 0,9 % pour la France, de + 0,9 % à - 0,3 % pour l'Italie. Tous les pays de l’Union Européenne voient uniformément leur PIB plonger à une seule exception près : la Grande-Bretagne dont le PIB grimpe durant la même période de - 0,5 % à + 1,9 % (nous y reviendrons) ([2] [18]).
Par-delà le nécessaire optimisme de façade dont font preuve les hommes politiques lorsqu'ils annoncent la reprise pour 1994, les divers instituts spécialisés de conjoncture, à l'audience plus discrète, réservés à l'usage des «décideurs» économiques, sont autrement plus prudents. Ainsi le Nomura Research Institute (Institut de recherche Nomura), après avoir estimé le recul du PIB du Japon pour l'année fiscale qui va d'avril 1993 à avril 1994 à -1,1 %, envisage un nouveau recul de -0,4 % pour la période suivante, c'est-à-dire jusqu'en avril 1995. Dans son rapport, il précise même : «L'actuelle récession risque d'être la pire depuis les années 1930 », et ajoute : « Il est important de noter que le Japon est en train de passer d'une vraie récession à une déflation (...) en bonne et due forme ». Après une baisse du PIB estimée à -0,5 % en 1993 ([3] [19]), la seconde puissance économique de la planète ne voit guère la reprise se profiler à l'horizon.
Le climat est apparemment bien différent aux USA. Avec une croissance du PIB estimée à 2,8 % en 1993 ([4] [20]), les Etats-Unis (avec la Grande-Bretagne et le Canada) font, aujourd'hui, figure d'exception parmi les grandes puissances. Eux qui ont toujours prétendu symboliser le capitalisme libéral, qui s'en sont faits les champions sur le plan idéologique trouvent, là encore, une occasion de hisser haut le drapeau arrogant du capitalisme triomphant. Dans la situation de pessimisme ambiant, les USA se veulent les fers de lance de la foi dans les vertus du capitalisme et dans sa capacité à surmonter toutes les crises qu'il peut traverser, incarnation du modèle achevé de la « Démocratie », idéal indépassable, point le plus achevé auquel peut prétendre l'humanité. Malheureusement pour nos chantres d'un capitalisme éternel, ce verbiage idéologique inlassablement répété n'a pas grand chose à voir avec la sinistre réalité qui se développe sur la scène mondiale, y compris aux USA. Ce discours est surtout destiné à entraver la prise de conscience de la classe ouvrière en suscitant de vains espoirs et à servir de vecteur idéologique des intérêts impérialistes américains face aux rivaux européens et japonais. La farce médiatisée du GATT en témoigne clairement.
Le mythe de la baisse du chômage aux Etats-Unis
Pour asseoir leur propagande sur la « reprise », les USA s'appuient aussi sur un indice qui a un écho autrement plus important pour la classe ouvrière que celui, abstrait, de la croissance du PIB : le taux de chômage. Là encore, les USA et le Canada, font figure d'exception. Parmi les pays développés, ils sont les seuls à pouvoir prétendre à une diminution du nombre de chômeurs, alors que partout ailleurs celui-ci progresse de manière accélérée.
Progression du chômage
Taux de chômage (pourcentage) ([5] [21])
|
|
|
USA |
7,4 |
6,8 |
|
Canada |
11,3 |
11,2 |
|
Japon |
2,2 |
2,5 |
|
Allemagne |
7,7 |
8,9 |
|
France |
10,4 |
11,7 |
|
Italie |
10,4 |
11,7 |
|
GB |
10,0 |
10,3 |
|
Union européenne |
10,3 |
11,3 |
|
Total OCDE |
7,8 |
8,2 |
Aux USA, la situation des travailleurs est-elle à ce point différente de celle des autres pays développés ? Pas un jour ne passe sans qu'une des grandes entreprises qui occupe le devant de la scène économique mondiale n'annonce une nouvelle charrette de licenciement. Nous ne reprendrons pas ici la lugubre litanie des licenciements annoncés ces derniers mois, il y faudrait des pages et des pages. Partout dans le monde la situation est la même et les USA ne font pas exception. Ainsi, 550 000 emplois ont été supprimés en 1991, 400 000 en 1992 et 600 000 en 1993. De 1987 à 1992, les entreprises de plus de 500 employés ont « dégraissé » leurs effectifs de 2,3 millions de travailleurs. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui ont créé des emplois aux USA, mais les petites. Ainsi durant la période considérée, les entreprises de moins de 20 salariés ont vu leurs effectifs croître de 12 %, celles de 20 à 100 salariés de 4,6 % ([6] [22]). Qu'est-ce que cela signifie pour la classe ouvrière ? Tout simplement que des millions d'emplois stables et bien rémunérés ont été détruits et que les nouveaux emplois sont précaires, instables et le plus souvent très mal payés. Derrière les chiffres triomphalistes de l'administration américaine sur l'emploi, se cache toute la sauvagerie de l'attaque brutale contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Une telle situation a été rendue possible par le simple fait qu'aux USA, au nom du « libéralisme » et de la sacro-sainte loi du marché, les règles régissant le marché du travail sont quasiment inexistantes, contrairement à la situation qui prévaut en Europe.
C'est vers ce « modèle » que lorgnent avec envie les dirigeants européens et japonais, pressés de démanteler ce qu'ils appellent les « rigidités » du marché de l'emploi, c'est-à-dire tout le système de « protection sociale » mis en place depuis des décennies et qui, suivant les pays, est concrétisé par un salaire minimum, l'assurance de ne pas être licencié dans certains secteurs (fonction publique en Europe, grandes entreprises au Japon), des réglementations précises concernant les licenciements, des systèmes d'allocation chômage, etc. En fait, derrière le mot d'ordre, généralisé aujourd'hui dans tous les pays industrialisés, de la recherche d'une plus grande «mobilité» des travailleurs, d'un «assouplissement» du marché de l'emploi se profile une des plus importantes attaques jamais menées contre les conditions de vie de la classe ouvrière. Voila le « modèle » proposé par les USA. Au-delà de l'apparence des chiffres, la diminution du chômage aux Etats-Unis n'est pas en soi une bonne nouvelle. Il correspond à une énorme dégradation des conditions de vie du prolétariat.
Ce qui est vrai pour les chiffres du chômage l'est aussi pour ceux de la croissance. Ils n'ont en fait qu'un lointain rapport avec la réalité. Le retour de la prospérité est un rêve définitivement révolu pour une économie capitaliste en crise ouverte depuis 25 ans. Un seul exemple qui permet de relativiser grandement les proclamations euphoriques du capitalisme américain : durant les années 1980, sous la présidence Reagan, nous avons déjà connu, de manière intensive, les affirmations mille fois répétées sur la « reprise » qui renvoyaient définitivement le spectre de la crise du capitalisme aux oubliettes de l'histoire. Finalement, l'histoire a pris sa revanche, et la récession ouverte qui a suivi a fait oublier ces rodomontades. Les années 1980 ont été, en fait, des années de crise et la « reprise », pas autre chose qu'une récession larvée durant laquelle, loin des discours idéologiques, les conditions de vie de la classe ouvrière se sont continuellement dégradées. La situation présente est encore pire. Le moins que l'on puisse dire est que la «reprise» américaine est particulièrement poussive et guère significative. Elle relève pour l'instant plus d'une propagande qui se veut rassurante que de la réalité.
Une fuite en avant dans le crédit
Dans réchauffement des débats du GATT, un chiffre a été publié dans la presse : les USA, l'Union européenne, le Japon et le Canada à eux quatre représentent 80 % des exportations mondiales. Cela donne une idée du poids prépondérant de ces pays sur le marché mondial. Mais cela montre aussi que l'économie de la planète repose sur trois pôles : l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon en Asie. Et deux de ces pôles, qui représentent près de 60 % de la production totale de ces pays, sont toujours plongés dans la récession. Malgré les rodomontades de l'équipe Clinton qui, sur ce plan, est dans la continuité de ses prédécesseurs, Reagan et Bush, la reprise de l'économie mondiale n'est pas au coin de la rue, loin de là. Dans ces conditions, quelle est donc la signification de la « reprise » américaine ? Les USA, le Canada et la GB qui ont les premiers plongés officiellement dans la récession vont-ils être les premiers à en sortir et les indices en progression qu'ils annoncent aujourd'hui sont-ils le signe annonciateur d'une reprise générale de l'économie mondiale?
Regardons d'un peu plus près cette fameuse «reprise» américaine. Que se passe-t-il ? D'un coup de baguette magique, Clinton a-t-il fait disparaître tous les maux qui minaient l'économie américaine? A-t-il enrayé le manque de compétitivité à l'exportation et en conséquence un déficit commercial abyssal, des déficits budgétaires colossaux se traduisant par un endettement écrasant de l'Etat américain, un endettement généralisé qui a atteint un tel niveau que le problème de son remboursement et de la solvabilité de l'économie américaine menace l'édifice financier international ? Rien de tout cela n'a disparu, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Sur tous ces plans la situation s'est aggravée.
La déficit annuel de la balance commerciale des USA qui avait atteint en 1987 le niveau record de 159 milliards de dollars s'était quelque peu résorbé par la suite pour atteindre « seulement » 73,8 milliards de dollars en 1991. Mais depuis, il ne cesse de s'approfondir et, pour 1993, il est estimé à 131 milliards de dollars ([7] [23]). Quant au déficit budgétaire, il est estimé, pour 1993, entre 260 et 280 milliards de dollars. Bref, Clinton n'innove pas, il continue sur la même lancée que ses prédécesseurs, celle de la fuite en avant dans l'endettement. Les problèmes sont repoussés à demain et leur aggravation réelle est masquée dans le présent. La baisse des taux qui a abouti à ce qu'aujourd'hui la Banque fédérale prête à un taux de 3 %, c'est-à-dire un taux équivalent à l'inflation officielle (et donc inférieur à l'inflation réelle) n'avait pas d'autre but que de permettre aux entreprises, aux particuliers et à l'Etat d'alléger le poids de la dette et de fournir à une économie défaillante un débouché intérieur artificiellement entretenu par le crédit « gratuit ». Un exemple : après deux ans de quasi-stagnation, la consommation des ménages a recommencé à croître depuis quelque mois, elle a fait un bond de 4,4 % au troisième trimestre 1993. La raison essentielle en est que les particuliers ont pu renégocier tous leurs prêts hypothécaires à un taux de 6,5 % au lieu de 9,5 %, 10 % ou plus, ce qui augmente d'autant le revenu disponible et leur redonne le goût pour la vie à crédit. Ainsi, les crédits à la consommation ont fait un bond en rythme annuel de 8 % en août, de 9,7 % en septembre, de 12,7% en octobre ([8] [24]). La confiance retrouvée de l'économie américaine c'est avant tout une nouvelle fuite en avant dans le crédit.
Les USA ne sont certainement pas les seuls à recourir massivement au crédit, à fuir dans l'endettement. C'est une situation généralisée.
Evolution de la dette publique nette
En pourcentage du PIB nominal ([9] [25])
|
|
1991 |
1992 |
1993 |
|
USA |
34,7 |
38,0 |
39,9 |
|
Allemagne |
23,2 |
24,4 |
27,8 |
|
France |
27,1 |
30,1 |
35,2 |
|
Italie |
101,2 |
105,3 |
111,6 |
|
GB |
30,2 |
35,8 |
42,6 |
|
Canada |
49,2 |
54,7 |
57,8 |
A l'exception du Japon, qui utilise son bas de laine pour maintenir son économie à flot et en est déjà à son cinquième plan de relance sans grands résultats, tous les pays ont eu recours à la drogue du crédit pour éviter une récession plus dramatique. Cependant, bien que l'endettement de l'Etat américain ne soit pas le plus excessif selon l'OCDE, les USA n'en demeurent pas moins le pays qui y a recouru le plus massivement sur tous les plans de son activité économique, Etat, entreprises et particuliers. Ainsi selon d'autres sources, l'endettement brut de l'Etat représente 130 % du PNB, celui des entreprises et des particuliers 170%. L'importance de l'endettement global des USA - plus de 12 000 milliards de dollars, mais l'estimation pourrait être bien supérieure selon certaines sources -, pèse lourdement sur la situation économique mondiale. Cette situation signifie qu'à terme, la dynamique de reprise annoncée peut faire illusion quelque temps et trouver provisoirement une confirmation ailleurs qu'aux USA, mais surtout qu'elle est destinée à faire long feu.
La contre-offensive américaine
Ce qui pour n'importe quel autre pays serait considéré comme une situation catastrophique et susciterait la colère du FMI est pourtant, dans le cas des USA, constamment minimisé par les dirigeants du monde entier. La « reprise » présente, comme celle de la deuxième moitié des années 1980, sous Reagan, activée de façon totalement artificielle par la drogue du crédit, est présentée comme la preuve du dynamisme du capitalisme américain et par extension du capitalisme en général. La raison de cette situation paradoxale : non seulement toutes les économies du monde sont étroitement dépendante du marché américain où elles exportent et sont donc intéressées au maintien de celui-ci, mais la crédibilité des USA ne se résume pas à la puissance de leur économie. Les Etats-Unis ont d'autres atouts à faire valoir. En particulier, leur statut de première puissance impérialiste mondiale durant des décennies, leur maintien à la tête du bloc occidental de la fin de la deuxième guerre mondiale à la chute du bloc de l'Est, leur ont permis d'organiser le marché mondial suivant leurs besoins. Un exemple de cette situation parmi d'autres : le dollar est la monnaie-reine du marché mondial, avec laquelle sont effectués les trois-quarts des échanges internationaux. Même si le bloc occidental s'est aujourd'hui délité avec la perte du ciment que constituait la menace de l'«ogre» russe et, qu'en conséquence, les principaux concurrents économiques des USA - l'Europe et le Japon, qui auparavant se soumettaient à la discipline du bloc, y compris sur le plan économique - tentent maintenant de voler de leurs propres ailes - , il n'en demeure pas moins que toute l'organisation actuelle du marché mondial est héritée de la période passée. En conséquence, les USA vont tenter de toutes leurs forces, d'en tirer le bénéfice dans la situation présente de concurrence et de guerre commerciale exacerbée. La foire d'empoigne à propos des négociations du GATT est une illustration frappante de cette situation.
Les USA ont annoncé la couleur. Leur président affiche dans son programme la perspective de faire passer de 638 à 1000 milliards de dollars les exportations annuelles américaines. Ce qui signifie en clair que les Etats-Unis comptent redresser leur situation économique en restaurant une balance commerciale bénéficiaire. Ambitieux objectif qui mobilise aujourd'hui l'Amérique et qui ne peut être atteint qu’aux dépens des autres puissances économiques. Premier volet de cette politique, la relance des investissements, Clinton prônant un rôle accru de l'Etat sur ce plan. Il est tout à fait significatif de constater qu'aux USA la formation brute de capital fixe (l'investissement) a progressé de + 6,2 % en 1992 et de + 9,8 % en 1993, alors qu'elle a baissé en 1993 de 2,3 % au Japon, de 3,3 % en Allemagne, de 5,5 % en France, de 7,7 % en Italie et n'a progressé que de + 1,8 % en GB. Les USA sont en train de muscler leur économie pour restaurer leur compétitivité et repartir à l'assaut du marché mondial. Mais dans les conditions de concurrence exacerbée qui prédominent actuellement, cette seule politique économique ne saurait suffire. Un deuxième volet y a été adjoint qui consiste à utiliser toutes les ressources de la puissance américaine pour ouvrir aux exportations US les marchés protégés par des barrières protectionnistes.
C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre aussi bien les accords NAFTA, la récente conférence qui vient de réunir les pays riverains du Pacifique à Seattle, comme les disputes qui ont dominé les négociations des accords du GATT. Les arrières pensées impérialistes ne sont évidemment pas absentes de ces négociations économiques. Après la disparition de leur bloc, les Etats-Unis se doivent de reconstituer et de restructurer leur zone d'influence. De la même manière qu'ils font bénéficier leur économie des atouts que constitue leur puissance impérialiste, ils utilisent aussi leur puissance économique au profit de leurs objectifs impérialistes. Cela n'est pas nouveau, mais auparavant, tenus par la nécessaire discipline du bloc, les principaux compétiteurs économiques des USA faisaient contre mauvaise fortune bon coeur, et avalaient les couleuvres. En fait ils payaient la note au nom de la solidarité occidentale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
L'attitude en flèche de la France face a l'Amérique n'a pas été aussi isolée que la propagande médiatique a pu le faire croire. Elle a pu compter sur le soutien de la majeure partie des pays européens, notamment de l'Allemagne, tandis que le Japon, visiblement, n'en pensait pas moins en comptant les points. Les négociations ont été aussi dures et ont pris une telle allure de psychodrame parce que, face aux exigences américaines, l'Europe et le Japon ont, bien sûr, défendu leurs propres intérêts économiques avec une détermination qu'ils n'avaient jamais montrée auparavant. Mais cela n'est pas la seule raison. Toutes les grandes puissances, qui sont aussi les principaux pays exportateurs, ont intérêt à un accord qui limite le développement du protectionnisme. Même si la France est le 2e exportateur agricole mondial, l'argument français à propos du préaccord de Blair House qui n'affectait qu'une très petite part de ses exportations a été essentiellement un prétexte médiatisé, tandis que se négociaient, difficilement et discrètement, d'autres aspects autrement plus importants sur le plan économique. La dramatisation de ces négociations avait aussi pour fondement la rivalité impérialiste qui se développe de manière de plus en plus intense entre, d'une part, les USA et d'autre part l'alliance franco-allemande au coeur de l'Europe, et le Japon. La France et la plupart des pays d'Europe devaient marquer leur différence parce que derrière ces négociations économiques se joue aussi la mise en place des thèmes idéologiques qui serviront aux alignements impérialistes futurs. Il est ainsi particulièrement significatif qu'aucun accord n'ait pu se faire sur le volet des produits audio-visuels. La fameuse « exception culturelle », mise en avant notamment par la France, masque en fait la nécessité pour les challengers de la domination américaine de ne pas laisser les USA contrôler un secteur, celui des médias, indispensable à toute politique impérialiste indépendante.
L'argument selon lequel le GATT va favoriser la relance de l'économie mondiale a été abondamment utilisé. Cette affirmation s'est essentiellement appuyée sur une étude produite par une équipe de chercheurs de l'OCDE qui a prédit que le GATT permettrait un accroissement de 213 milliards de dollars du revenu annuel mondial, sans insister exagérément sur le fait que cette perspective était définie pour le siècle prochain ! D'ici là, quand on sait combien les spécialistes de la conjoncture ont pu se tromper par le passé, ces prévisions opportunes seront bien oubliées. Car la véritable signification de ces accords est d'abord l'exacerbation de la guerre commerciale, une concurrence qui va aller en s'aggravant et donc, à court terme, une dégradation de l'économie mondiale. Ils ne changent rien à la dynamique de la crise. Ils en sont au contraire un moment aigu où se sont manifestés les tensions et griefs entre les principales puissances du monde.
Par delà les illusions que tente aujourd'hui de véhiculer la classe dominante, les nuages annonciateurs de tempête continuent de s'accumuler sur l'économie mondiale. Crise financière, plongée plus profonde dans la récession, retour de l'inflation sont autant de spectres qui se profilent à l'horizon. Autant de menaces qui signifient pour la classe ouvrière une dégradation toujours plus tragique de ses conditions d'existence. Mais elles annoncent aussi une difficulté toujours plus grande pour la classe dominante à crédibiliser son système. La crise détermine le prolétariat à lutter pour la défense de ses conditions de vie, en même temps qu'elle lui ouvre les yeux sur la réalité du mensonge capitaliste. Malgré les souffrances qu'elle lui inflige, la crise reste le principal allié de la classe révolutionnaire.
JJ, 16/12/1993
[1] [26] NAFTA (North american free trade agreement) ou ALENA : Association de libre-échange nord-américaine englobant les pays d'Amérique du Nord (Canada, Mexique, USA).
[2] [27] Source : Commission Européenne
[3] [28] Déflation : référence à la crise de 1929 durant laquelle la chute de la production et de l'emploi s'est conjuguée avec une baisse des prix.
[4] [29] Source : OCDE
[5] [30] Source : OCDE (sauf Italie qui entre temps a modifié son mode de calcul et pour laquelle la référence est la Commission européenne).
[8] [33] Source : Réserve fédérale
[9] [34] Source : OCDE
Questions théoriques:
- L'économie [35]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [36]
Comment est organisée la bourgeoisie ? : Le mensonge de l'Etat « démocratique »
- 3182 lectures
Le bloc de l'Est s'est effondré et, du coup, les thèmes de la propagande idéologique déchaînée par son vieux rival occidental s'en sont trouvés automatiquement revalorisés. Durant des décennies, le monde a vécu sous le poids d'un double mensonge : celui de l'existence du communisme à l'Est, identifié à la dictature impitoyable du stalinisme, opposé à celui du règne de la liberté démocratique à l'Ouest. De ce combat idéologique, traduction, sur le plan de la propagande, des rivalités impérialistes, l'illusion en la « démocratie » est sortie gagnante. Ce n'est pas sa première victoire. Déjà, lors des deux guerres mondiales qui ont ravagé la planète depuis le début du siècle, le camp des « démocraties libérales » a gagné, et à chaque fois, en conséquence, l'idéologie démocratique s'en est trouvée renforcée.
Ce n'est pas là un phénomène du hasard. Les pays qui ont pu le mieux prétendre incarner l'idéal démocratique sont ceux qui, les premiers, sont parvenus à réaliser la révolution démocratique bourgeoise et à instaurer le règne d'Etats purement capitalistes : le Royaume-Uni, la France, les Etats-Unis notamment. Par conséquent, parce qu'ils sont arrivés les premiers, ils ont été les mieux lotis sur le plan économique. Cette supériorité économique s'est concrétisée sur le plan militaire et sur le plan de la guerre idéologique. Durant les conflits impérialistes qui ont ravagé la planète depuis le début du siècle, la force des « démocraties libérales » a constamment été de faire croire aux prolétaires qui servaient de chair à canon, qu'en se battant pour la «c démocratie », ce n'était pas les intérêts d'une fraction capitaliste qu'ils défendaient, mais un idéal de liberté face à la barbarie de systèmes dictatoriaux. Ainsi, durant la 1e guerre mondiale, les prolétaires français, anglais et américains sont envoyés à la boucherie au nom de la lutte contre le militarisme prussien. Durant la seconde, les dictatures nazies et fascistes servent, par leur brutalité, de justification au militarisme démocratique. Par la suite, le combat idéologique entre les deux blocs a été assimilé à la lutte de la « démocratie » contre la dictature « communiste ». Chaque fois, les démocraties occidentales ont prétendu mener le combat contre un système fondamentalement différent du leur, contre des « dictatures ». Il n'en est rien.
Aujourd'hui, le modèle démocratique occidental est présenté comme un idéal de progrès qui transcende les systèmes économiques et les classes. Tous les citoyens sont « égaux » et « libres » de choisir par le vote les représentants politiques, et donc le système économique qu'ils désirent. Chacun est «libre» en «démocratie» d'exprimer ses opinions. Si les électeurs veulent le socialisme, ou même le communisme, ils n'ont qu'à voter pour les représentants des partis qui prétendent défendre ces objectifs. Le parlement est le reflet de la « volonté populaire ». Chaque citoyen a un recours devant l'Etat. Les « Droits de l'homme sont respectés », etc.
Cette vision idyllique et naïve de la «démocratie» est un mythe. La «démocratie» est le paravent idéologique qui sert à masquer la dictature du capital dans ses pôles les plus développés. Il n'y a pas de différence fondamentale de nature entre les divers modèles que la propagande capitaliste oppose les uns aux autres pour les besoins de ses campagnes idéologiques de mystification. Tous les systèmes soi-disant différents par leur nature, qui ont servi de faire-valoir à la propagande démocratique depuis le début du siècle, sont des expressions de la dictature de la bourgeoisie, du capitalisme. La forme, l'apparence peuvent varier, pas le fond. Le totalitarisme sans fard du nazisme ou du stalinisme n’est pas l'expression de systèmes économiques différents, mais le résultat du développement du totalitarisme étatique, caractéristique du capitalisme décadent, et du développement universel de la tendance au capitalisme d'Etat qui marque le 20e siècle. En fait, la supériorité des vieilles démocraties occidentales qui, elles aussi, ont été marquées tout au long de ce siècle par les stigmates du totalitarisme étatique, a été d'avoir su bien mieux masquer ce phénomène.
Les mythes ont la vie dure. Mais la crise économique ; qui s'approfondit chaque jour de façon plus dramatique; met à nu la réalité du capitalisme décadent, dévoile ses mensonges. Ainsi l'illusion de la prospérité à l'Ouest, présentée comme éternelle au lendemain de l'effondrement économique de l'ex-bloc de l'Est, a fait long feu. Le mensonge démocratique est d'un autre acabit, car il repose sur d'autres prémisses moins sujettes aux fluctuations immédiates. Cependant, des dizaines d'années de crise ont imposé à la classe dominante un niveau croissant de tensions tant sur le plan international que sur le plan intérieur pour chacune de ses fractions nationales. En conséquence, elle a dû développer des manoeuvres sur tous les plans de son activité comme jamais elle n'en avait connu auparavant la nécessité. Les occasions où elle a montré, en gros et en détail, le peu de cas qu'elle pouvait faire de l'idéal démocratique qu'elle prétend incarner, se sont multipliées. Dans le monde entier, les partis politiques «responsables», de droite comme de gauche, qui tous ont suivi la même politique d'austérité contre la classe ouvrière lorsqu'ils se sont approchés des responsabilités gouvernementales, souffrent aujourd'hui d'un discrédit général. Ce discrédit qui touche l'ensemble du fonctionnement de l'appareil d'Etat est le produit du divorce croissant entre l'Etat qui impose la misère et la société civile qui la subit. Mais cet état de fait a encore été renforcé, ces dernières années, par le processus de décomposition qui affecte l'ensemble du monde capitaliste.
Dans tous les pays, les rivalités sourdes qui s'exacerbent entre les divers clans qui grenouillent au sein de l'appareil d'Etat, se traduisent par des scandales à répétition qui mettent en évidence la pourriture de la classe dominante, la corruption, la prévarication qui gangrènent l'ensemble de l'appareil politique et qui lèvent le voile sur le fonctionnement réel de l'Etat où les politiciens cohabitent étroitement avec des barbouzes de tout acabit et des représentants de toutes sortes de maffias gangstéristes et affairistes, au sein d'officines de pouvoir occulte, inconnues du grand public. Peu à peu cette réalité sordide de l'Etat totalitaire du capitalisme décadent commence à percer l'écran des apparences démocratiques. Cela ne signifie pas pour autant que le poids de la mystification s'est évanoui. La classe dominante sait utiliser sa propre pourriture pour renforcer sa propagande en utilisant les exemples édifiants de ses scandales comme justification de sa lutte pour la pureté démocratique. Même si la crise sape continuellement les bases de la domination bourgeoise et mine son emprise idéologique sur les exploités, met à nu les mensonges continuellement martelés, la classe dominante n'en devient que plus déterminée, plus acharnée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour conserver son pouvoir. Le mensonge démocratique s'est installé avec le capitalisme, il ne pourra disparaître qu'avec lui.
Au 19e siècle : une démocratie bourgeoise à l'usage exclusif des bourgeois
Si les fractions dominantes de la bourgeoisie mondiale peuvent se réclamer de la « démocratie », c'est parce que cela correspond à leur propre histoire. La bourgeoisie a fait sa révolution et mis à bas le féodalisme au nom de la démocratie, des libertés. La bourgeoisie organise son système politique en correspondance avec ses besoins économiques. Il lui faut abolir le servage au nom de la liberté individuelle, pour permettre la création d'un prolétariat massif composé de salariés prêts à vendre individuellement leur force de travail. Le parlement est l'arène où les différents partis, représentants des intérêts multiples qui existent au sein de la bourgeoisie, les différents secteurs du capital, s'affrontent pour décider de la composition et des orientations du gouvernement en charge de l'exécutif. Le parlement est alors, pour la classe dominante, un véritable lieu de débat et de décision. Voilà le modèle historique duquel se réclament nos « démocrates » d'aujourd'hui, la forme d'organisation politique que prend la dictature du capital dans sa période juvénile, la forme qu'a prise la révolution bourgeoise en Angleterre, en France, aux Etats-Unis.
Mais il faut noter que déjà, ce modèle classique n'était pas absolument universel. Souvent ces règles démocratiques ont dû subir d'importantes entorses pour permettre à la bourgeoisie de faire sa révolution et d'accélérer le bouleversement social nécessaire à l'affermissement de son système. Il suffit, pour constater cela, de considérer, entre autres, la Révolution française, la terreur jacobine et l'épopée napoléonienne ensuite, et voir le peu de cas que la bourgeoisie pouvait déjà faire de son idéal démocratique lorsque les circonstances l'imposaient. La démocratie bourgeoise était, d'une certaine manière, comme la démocratie athénienne, au sein de laquelle seuls les citoyens pouvaient participer aux décisions, c'est-à-dire ni les femmes, ni les métèques (étrangers), ni les esclaves qui constituaient évidemment la grande majorité de la population.
Dans le système démocratique parlementaire mis en place par la bourgeoisie, seuls les notables sont électeurs : les prolétaires n'ont pas le droit à la parole, ni le droit de s'organiser. Il faudra des années de luttes acharnées de la classe ouvrière, pour arracher le droit d'association, le droit de s'organiser en syndicat, pour imposer le suffrage universel. Que les ouvriers veuillent participer activement à la démocratie bourgeoise pour arracher des réformes ou soutenir les fractions les plus progressistes de la classe dominante, cela n'était pas prévu au programme de la révolution bourgeoise. D'ailleurs, chaque fois que la classe ouvrière est parvenue, par ses luttes, à gagner de nouveaux droits démocratiques, la bourgeoisie s'est employée à en limiter les effets. Ainsi, en Italie, en 1882, lorsqu'une nouvelle loi électorale est promulguée, un des amis du chef du gouvernement d'alors, Depretis, décrivait ainsi l'attitude de ce dernier : « Il craignait que la participation de nouvelles couches sociales à la vie publique n'eut comme conséquence logique des bouleversements profonds dans les institutions de l'Etat. Dès lors, il employa tous les moyens pour se mettre à l'abri, pour opposer des digues solides aux inondations redoutées. » ([1] [37]). Voilà qui résume parfaitement l'attitude de la classe dominante, la conception de celle-ci de la démocratie et du parlement au 19e siècle. Fondamentalement, les travailleurs en sont exclus. Elle n'est pas faite pour eux, mais pour les besoins de la bonne gestion du capitalisme. Lorsque des fractions plus éclairées de la bourgeoisie soutiennent certaines réformes et se proclament favorables à une plus grande participation des travailleurs au fonctionnement de la « démocratie », par le suffrage universel ou le droit d'organisation syndical, ce sera toujours en vue de permettre un meilleur contrôle de la classe ouvrière, et d'éviter des remous sociaux préjudiciables à la production. Ce n'est pas par hasard si les premiers patrons qui s'organisent et se regroupent en comité, face à la pression des luttes ouvrières, sont ceux de la grande industrie qui sont, en même temps, les plus favorables à des réformes. Dans la grande industrie, les capitalistes, confrontés à la force massive des nombreux prolétaires qu'ils emploient, prennent plus pleinement conscience d'une part de la nécessité de contrôler le potentiel explosif de la classe ouvrière, en lui permettant une expression parlementaire et syndicale et, d'autre part, de la nécessité de réformes (limitation de la journée de travail, interdiction du travail des enfants) qui permettent d'entretenir une force de travail en meilleure santé, et donc plus productive.
Cependant, malgré le fait que les exploités en soient fondamentalement exclus, la démocratie parlementaire au 19e siècle constitue la réalité du fonctionnement de la bourgeoisie. Le législatif domine l'exécutif, le système parlementaire et la démocratie représentative sont une réalité.
Au 20e siècle : un fonctionnement « démocratique » vidé de son contenu
Avec l'entrée dans le 20e siècle, le capitalisme a conquis le monde et, en se heurtant aux limites de son expansion géographique, il rencontre aussi la limitation objective des marchés et donc des débouchés à sa production. Les rapports de production capitalistes se transforment en entraves au développement des forces productives. Le capitalisme comme un tout est entré dans une période de crises et de guerres de dimension mondiale.
Ce bouleversement, déterminant dans la vie du capital a eu pour conséquence une modification profonde du mode d'existence politique de la bourgeoisie et du fonctionnement de son appareil d'Etat.
L'Etat bourgeois est, par essence, le représentant des intérêts globaux du capital national. Tout ce qui concerne les difficultés économiques globales, les menaces de crise et les moyens de s'en dégager, l'organisation de la guerre impérialiste, est affaire d'Etat. Avec l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence, le rôle de l'Etat devient donc prépondérant car il est le seul à même de maintenir un minimum d'« ordre » dans une société capitaliste déchirée par ses contradictions et qui tend à l'éclatement. « L'Etat est l'aveu que la société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même » disait Engels. Le développement d'un Etat tentaculaire qui contrôle tous les aspects de la vie économique, politique et sociale est la caractéristique fondamentale du mode d'organisation du capital dans sa phase de décadence, il est la réponse totalitaire de la société capitaliste à sa crise. « Le capitalisme d'Etat est la forme que tend à prendre le capitalisme dans sa phase de déclin » ([2] [38]).
En conséquence, dans la société bourgeoise, le pouvoir se concentre dans les mains de l'exécutif au détriment du pouvoir législatif. Ce phénomène est particulièrement évident durant la première guerre mondiale où les impératifs de la guerre et l'intérêt national n'autorisent pas le débat démocratique au parlement et imposent une discipline absolue à toutes les fractions de la bourgeoisie nationale. Mais, par la suite, cet état de fait va se maintenir et se renforcer. Le parlement bourgeois devient une coquille vide qui ne possède plus aucun rôle décisionnel.
Cette réalité, la 3e internationale la constate à son deuxième congrès. Elle proclame que « le centre de gravité de la vie politique actuelle est complètement et définitivement sorti du parlement », que « le parlement ne peut être en aucun cas, à l'heure actuelle, le théâtre d'une lutte pour des réformes et pour l'amélioration de la situation de la classe ouvrière, comme il arriva à certains moments à l'époque antérieure ». En effet, non seulement, le capitalisme en crise ne peut plus accorder de réformes durables, mais la classe bourgeoise a définitivement perdu son rôle historique de classe du progrès économique et social, toutes ses fractions deviennent également réactionnaires.
De fait, dans ce processus, les partis politiques de la bourgeoisie perdent leur fonction première, celle de représenter, au sein de la vie « démocratique » bourgeoise qui s'exprimait au parlement, les divers groupes d'intérêts, les différents secteurs économiques du capital. Ils deviennent des instruments de l'Etat chargés de faire accepter la politique de celui-ci aux divers secteurs de la société auxquels ils s'adressent. De représentants de la société civile dans l'Etat, les partis deviennent des instruments de l'Etat pour contrôler la société civile. L'unité de l'intérêt global du capital national que représente l'Etat tend à se traduire par le fait qu'en un certain sens, les partis politiques de la bourgeoisie sont devenus des fractions du parti totalitaire étatique. Cette tendance au parti unique va s'exprimer clairement dans les régimes fascistes, nazis ou staliniens. Mais, même là où la fiction du pluralisme se maintient, dans des situations de crise aiguë telle que la guerre impérialiste, la réalité d'un parti hégémonique ou la domination d'un parti unique s'imposent de fait. Ainsi, à la fin des années 1930 et durant la guerre qui suivit, Roosevelt et le parti démocrate aux Etats-Unis, ou en Grande-Bretagne, pendant la deuxième guerre mondiale avec l'« état d'exception », Churchill et la création du Cabinet de guerre. « Dans le contexte du capitalisme d'Etat, les différences qui séparent les partis bourgeois ne sont rien en comparaison de ce qu'ils ont en commun. Tous partent d'une prémisse générale selon laquelle les intérêts du capital national sont supérieurs à tous les autres. Cette prémisse fait que les différentes fractions du capital national sont capables de travailler très étroitement ensemble, surtout derrière les portes fermées des commissions parlementaires et aux plus hauts échelons de l'appareil d'Etat ». ([3] [39]) Les dirigeants des partis et les membres du parlement sont en réalité devenus des fonctionnaires d'Etat.
Ainsi, toute l'activité parlementaire, le jeu des partis perdent leur sens du point de vue des décisions que prend l'Etat au nom de l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire du capital national. Ils ne sont plus qu'un paravent destiné à masquer le développement de l'emprise totalitaire de l'Etat sur l'ensemble de la société. Le fonctionnement «démocratique» de la classe dominante, même avec les limites qu'il connaissait au 19e siècle, a cessé d'exister, il est devenu une pure mystification, un mensonge.
Le totalitarisme « démocratique » contre la classe ouvrière
Dans ce cas pourquoi maintenir un tel appareil «démocratique» coûteux et délicat à faire fonctionner, s'il ne correspond plus aux besoins du capital? En fait, toute cette organisation conserve une fonction essentielle à un moment où la crise permanente pousse la classe ouvrière vers des luttes pour la défense de ses conditions de vie et vers une prise de conscience révolutionnaire. Celle de dévoyer le prolétariat de son terrain de classe, de le piéger et de l'empêtrer sur le terrain « démocratique ». Dans cette tâche, l'Etat va bénéficier de l'apport des partis dits « socialistes » après 1914, et «communistes» à partir des années 1930. Partis qui, en trahissant la classe qui les a fait naître, en s'intégrant dans l'appareil de contrôle et de mystification de la bourgeoisie, vont crédibiliser le mensonge «démocratique» aux yeux de la classe ouvrière. Alors qu'au 19e siècle le prolétariat doit lutter pour arracher le droit de voter, au 20e siècle dans les métropoles développées, c'est au contraire une propagande intensive qui est menée par l'Etat «démocratique» pour ramener le prolétariat sur le terrain électoral. Il est même des pays, par exemple la Belgique et l'Italie, où le vote devient obligatoire.
De même, sur le plan des syndicats, alors que la lutte pour des réformes a perdu son sens, les syndicats, qui correspondaient au besoin du prolétariat pour améliorer sa situation dans le cadre de la société capitaliste, perdent leur utilité pour la lutte ouvrière. Mais ils ne vont pas disparaître pour autant. L'Etat va s'en emparer et s'en servir pour mieux contrôler la classe exploitée. Ils vont compléter l'appareil de coercition « démocratique » de la classe dominante.
Mais alors, on peut légitimement se poser la question suivante : si l'appareil de mystification démocratique est si utile à la classe dominante, à son Etat, comment se fait-il que ce mode de contrôle de la société ne se soit pas imposé partout, dans tous les pays ? Il est intéressant de noter à cet égard que les deux régimes qui ont symbolisé le plus clairement le totalitarisme étatique au cours du 20e siècle, ceux de l'Allemagne nazie et de l'URSS stalinienne sont ceux qui se sont bâtis sur l'écrasement le plus profond du prolétariat à la suite de l'échec des tentatives révolutionnaires qui ont marqué l'entrée du capitalisme dans sa décadence. Face à un prolétariat profondément affaibli par la défaite, décimé dans ses forces vives par la répression, la question de son encadrement se pose différemment pour la bourgeoisie. La mystification « démocratique » dans ces conditions n'est guère utile et le capitalisme d'Etat totalitaire peut apparaître sans fard, sans masque. De plus, précisément parce que du strict point de vue du fonctionnement de la machine d'Etat, au début du siècle, l'appareil « démocratique » hérité du 19e siècle est devenu superflu, certains secteurs de la bourgeoisie, reconnaissant cet état de fait, théorisent son inutilité. Le fascisme est une expression de cette tendance. Il faut aussi noter que l'entretien d'une lourde machinerie «démocratique» est non seulement dispendieux, mais réclame aussi un fonctionnement économique adéquat pour le crédibiliser et une classe dominante suffisamment expérimentée pour le manier subtilement. Dans les pays sous-développés, la plupart du temps, ces facteurs ne sont pas réunis et la faiblesse du prolétariat local n'encourage pas la bourgeoisie à mettre en place un tel système ; de fait, les dictatures militaires y abondent. Ceci est la traduction du fait que dans ces pays, la faiblesse de l'économie trouve son expression dans la faiblesse de la bourgeoisie locale et que, dans ce cas, l'armée constitue la structure de l'Etat bourgeois la plus à même de représenter l'intérêt global du capital national et va donc constituer l'ossature de l'appareil d'Etat. Ce rôle a aussi pu être joué par des partis uniques militarisés qui s'inspiraient du modèle stalinien comme en Chine par exemple.
Loin d'être l'expression d'une sorte de perversion face à la pureté « démocratique » du capitalisme, les différentes dictatures et Etats ouvertement totalitaires dont l'existence marque toute l'histoire du 20e siècle sont au contraire la manifestation de la tendance générale à l'emprise totalitaire sur tous les aspects de la vie économique, sociale et politique par le capitalisme d'Etat. En fait, ils montrent la réalité du totalitarisme de l'Etat du capitalisme décadent et permettent de comprendre ce qui se cache derrière le vernis démocratique qui recouvre les agissements de la classe dominante dans les pays développés. Il n'y a pas de différence de nature, ni même une bien grande différence dans le fonctionnement de l'Etat qui se prétend « démocratique » ; simplement cette réalité est bien mieux cachée, occultée.
Lorsqu'en France, dans les années 1930, la même assemblée parlementaire qui a été élue avec le Front populaire, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il ne s'agit pas d'une aberration mais, au contraire, de l'expression limpide de la réalité de l'inanité des prétentions «démocratiques» du jeu parlementaire dans le capitalisme décadent. De même, une fois la guerre finie, l'Etat qui se met en place à la « Libération » est fondamentalement dans la continuité de celui de la collaboration avec l'Allemagne nazie. La police, la magistrature, les oligarchies économiques et même politiques qui s'étaient distinguées par leur zèle collaborationniste, à part quelques rares exceptions utilisées comme victimes expiatoires, restent en place. Il en a été de même en Italie où, comme en France, on estime à 90 % le nombre de responsables de l'Etat qui conservent leur fonction après la chute du régime fasciste.
D'ailleurs, il est aisé de constater que nos « démocraties » ne se sont jamais gênées pour soutenir ou utiliser telle ou telle «dictature» lorsque cela correspondait à leurs besoins stratégiques, ni même d'ailleurs à mettre en place de telles «dictatures». Les exemples ne manquent pas : ainsi les USA en Amérique latine ou bien la France dans la plupart de ses ex-colonies africaines.
L'habileté des vieilles « démocraties » occidentales consiste à utiliser la barbarie et la brutalité des formes les plus caricaturales du capitalisme d'Etat pour masquer le fait qu'elles-mêmes ne font pas exception à cette règle absolue du capitalisme décadent qui est celle du développement du totalitarisme étatique. En fait, seuls les pays capitalistes les plus développés ont les moyens d'entretenir la crédibilité et de manoeuvrer un appareil « démocratique » sophistiqué de mystification et d'encadrement de la classe ouvrière. Dans le monde capitaliste sous-développé, les régimes à apparence « démocratique » sont l'exception et, en général, sont plus le produit d'un soutien efficace d'une puissance impérialiste « démocratique » que l'expression de la bourgeoisie locale. De plus, leur existence est le plus souvent provisoire, soumise aux aléas des fluctuations de la situation internationale. Il faut toute la puissance et l'expérience des fractions les plus anciennes et les plus développées de la bourgeoisie mondiale pour entretenir le grand mensonge du fonctionnement démocratique de l'Etat bourgeois.
Dans sa forme la plus sophistiquée de la dictature du capital qu'est la « démocratie », le capitalisme d'Etat doit parvenir à la gageure de faire croire que règne la plus grande liberté. Pour cela, à la coercition brutale, à la répression féroce doit le plus souvent, lorsque c'est possible, se substituer la manipulation en douceur qui permet d'aboutir au même résultat sans que la victime ne s'en aperçoive. Ce n'est pas là une tâche facile et seules les fractions les plus expérimentées de la bourgeoisie mondiale y parviennent efficacement. Mais pour y parvenir, l'Etat a dû soumettre étroitement à son contrôle l'ensemble des institutions de la société civile. Il a dû développer tout un système tentaculaire, totalitaire.
L'Etat «démocratique» a non seulement organisé tout un système visible et officiel de contrôle et de surveillance de la société, mais il a dédoublé son fonctionnement en tissant une toile de fils occultes qui lui permettent de contrôler et de surveiller les espaces de la société qu'il prétend en dehors de sa compétence. Cela est vrai pour tous les secteurs de la société. Un exemple caricatural est celui de l'information. Un des grands principes dont se vante l'Etat « démocratique » est la liberté de la presse. Il se pose même en garant de la pluralité de l'information. Il est vrai que dans les pays «démocratiques», il existe une presse abondante et le plus souvent une multitude de chaînes de télévision. Mais, à y regarder de plus près, les choses ne sont pas si idylliques. Tout un système administrativo-juridique permet à l'Etat de borner cette « liberté » et de fait, les grands médias sont complètement dépendants de la bonne volonté de l'Etat qui a parfaitement les moyens juridiques et économiques d'étrangler et de faire disparaître un titre de presse. Quant aux grandes chaînes de télévision, leur autorisation d'émettre est directement subordonnée à l'accord de l'Etat. On peut aussi noter que presque partout, l'essentiel des moyens d'« information » sont aux mains de quelques magnats qui, le plus souvent, ont leur fauteuil réservé dans l'antichambre des ministères. On peut même supposer que s'ils bénéficient de cette situation enviable, c'est parce qu'ils ont été mandatés par l'Etat, comme agents d'influence, pour jouer ce rôle. Les grandes agences de presse sont le plus souvent des émanations directes de l'Etat au service de sa politique. Il est parfaitement significatif de constater comment, durant la guerre du Golfe, l'ensemble de la presse «libre» occidentale s'est mise au garde-à-vous pour raconter les gros mensonges de la propagande guerrière, filtrer les nouvelles et manoeuvrer l'opinion au mieux des besoins de « son » impérialisme. A ce moment-là, il n'y avait guère de différence entre la conception « démocratique » de l'information et celle tant vilipendée de la « dictature » stalinienne, ou de celle que, de son côté, imposait Saddam Hussein. Elle ne faisait qu'un avec la plus vile propagande, et les fiers journalistes occidentaux, ces remparts des «libertés», étaient servilement aux ordres, le doigt sur la couture du pantalon, faisant docilement vérifier leurs informations par l'armée avant de les publier. Par souci d'objectivité, sans doute !
Ce gigantesque appareil étatique «démocratique» trouve sa justification, dans les pays développés, dans le besoin vital pour la classe dominante de contrôler les plus grandes concentrations prolétariennes de la planète. Même si la mystification démocratique est un aspect essentiel de la propagande impérialiste des grandes puissances occidentales, il n'en reste pas moins que c'est sur le plan social, du contrôle du prolétariat et de la population en général, qu'elle trouve sa principale justification. C'est d'ailleurs dans ce but d'encadrement social que sont menées les grandes manoeuvres pour lesquelles l'Etat « démocratique » utilise toutes ses ressources de propagande et de manipulation. Une des occasions où l'Etat fait manoeuvrer le plus pleinement son lourd appareil « démocratique » est la grand messe électorale dans laquelle, périodiquement, les «citoyens» sont invités à communier. Les élections, alors qu'elles ont perdu tout sens du point de vue du fonctionnement de l'Etat totalitaire, restent une arme de choix pour atomiser la classe ouvrière dans le vote individualisé, pour dévoyer son mécontentement sur un terrain stérile et crédibiliser l'existence de la « démocratie ». Ce n'est pas par hasard si les Etats « démocratiques » mènent aujourd'hui une lutte acharnée contre l'abstentionnisme et la désaffection des partis, car la participation des ouvriers aux élections est essentielle à la perpétuation de l'illusion démocratique. Cependant, même si la représentation parlementaire n'est plus d'aucune importance pour le fonctionnement de l'Etat, il n'en reste pas moins essentiel que le résultat des élections soit conforme aux besoins de la classe dominante afin d'utiliser au mieux le jeu trompeur des partis et d'éviter leur usure prématurée. Notamment, les partis dits « de gauche » ont un rôle spécifique d'encadrement de la classe ouvrière et leur place vis-à-vis des responsabilités gouvernementales est déterminante dans leur capacité à jouer leur rôle mystificateur et donc à encadrer efficacement la classe ouvrière. Par exemple, il est évident qu'à un moment où ce qui est à l'ordre du jour, quand la crise s'accélère, c'est l'austérité, la gauche au pouvoir perd énormément de sa crédibilité pour prétendre défendre les intérêts de la classe ouvrière et est fort mal placée pour encadrer le prolétariat sur le terrain des luttes. Manipuler les élections pour obtenir le résultat souhaité est donc extrêmement important pour l'Etat. Pour réussir cela, l'Etat a mis en place tout un système de sélection des candidatures, au travers de règles, de lois qui permettent d'éviter des candidats surprises. Mais là, ce n'est pas dans cet aspect officiel qu'est l'essentiel. La presse aux ordres oriente les choix par un martelage idéologique intense. Le jeu subtil des alliances entre partis, les candidatures manipulées pour les besoins de la cause permettent, le plus souvent, d'obtenir finalement le résultat souhaité et la majorité gouvernementale désirée. C'est un constat banal aujourd'hui que, quels que soient les résultats électoraux, c'est finalement toujours la même politique anti-ouvrière qui est menée. L'Etat « démocratique » parvient à conduire sa politique indépendamment des élections qui sont organisées à cadence accélérée. Les élections sont une pure mascarade.
En dehors des élections qui sont la pierre de touche de l'auto-justification «démocratique» de l'Etat, il est beaucoup d'occasions où celui-ci manoeuvre son appareil pour assurer son emprise. Face aux grèves par exemple : dans chaque lutte qu'elle mène sur son terrain, la classe ouvrière voit se dresser face à elle l'ensemble des forces de l'Etat : presse, syndicats, partis politiques, forces de répression, parfois provocations du fait de la police ou d'autres organismes moins officiels, etc.
Ce qui distingue fondamentalement l'Etat « démocratique » des « dictatures », ce ne sont donc pas finalement les moyens employés qui tous sont basés sur l'emprise totalitaire de l'Etat sur la société civile, mais la subtilité et l'efficacité avec lesquels ils sont employés. Cela est particulièrement net sur le plan électoral. Souvent, les « dictatures », elles aussi, cherchent dans des élections ou des référendum une légitimité, mais la pauvreté de leurs moyens fait qu'elles ne sont qu'une caricature de ce que sont capables d'organiser les riches pays industrialisés. Mais il n'y a pas de différence de fond. La caricature ne fait que montrer, à traits forcés, la vérité du modèle. La « démocratie » bourgeoise n'est que la dictature « démocratique » du capital.
L'envers du décor de l'Etat « démocratique »
Alors que la bourgeoisie durant la période ascendante du capitalisme pouvait appuyer sa domination de classe sur la réalité du progrès dont son système était porteur pour l'humanité, dans la période de décadence, cette base non seulement a disparu, mais le capitalisme ne peut plus apporter que la misère d'une crise économique permanente et la barbarie meurtrière du déchaînement de conflits impérialistes à répétition. La classe dominante ne peut plus assurer sa domination de classe et la perpétuation de son système obsolète que par la terreur et le mensonge. Cette réalité va déterminer une évolution en profondeur de la vie interne de la classe dominante et se concrétiser dans l'activité de l'appareil d'Etat.
La capacité de l'Etat, d'une part, à imposer sa force militaire et répressive, et d'autre part, à rendre ses mensonges crédibles, et corollairement à conserver ses secrets, devient l'un des facteurs déterminants de sa capacité à gérer la situation.
Dans cette situation, les secteurs de la bourgeoisie qui vont se hisser dans la hiérarchie de l'Etat sont naturellement ceux qui sont spécialisés dans l'emploi de la force, de la propagande mensongère, de l'activité secrète et dans les manoeuvres tordues de toutes sortes. En clair cela donne l'armée, la police, les services secrets, les clans et sociétés secrètes et les maffias gangsteristes.
Les deux premiers secteurs ont, de tout temps, joué un rôle important dans l'Etat dont ils étaient des piliers indispensables. Nombre de généraux ont ainsi marqué la vie politique de la bourgeoisie au 19e siècle Mais à cette époque, il faut déjà noter que leur arrivée près du centre ou au centre même du pouvoir d'Etat, était le plus souvent le produit de situations d'exception, de difficultés particulières dans la vie du capital national, comme avec la guerre de Sécession aux USA. Cette tendance militariste n'exprimait pas le moins du monde la tendance démocratique de la vie politique bourgeoise, comme sous Napoléon ni en France. Aujourd'hui, il est tout à fait caractéristique qu'une très grande proportion des chefs d'Etat des pays sous-développés soit des militaires et même dans les «démocraties» occidentales, il y ait eu des Eisenhower et des Haig aux USA, ou un De Gaulle en France.
L'accession de responsables de services secrets au pouvoir est par contre un phénomène typique de la période de décadence qui traduit bien les préoccupations présentes de la bourgeoisie et le fonctionnement interne des plus hautes sphères de l'Etat. Ce fait est particulièrement visible, encore une fois, à la périphérie du capitalisme, dans le monde sous-développé. Le plus souvent les généraux qui s'y emparent des présidences, sont les chefs des services secrets de l'armée et, très fréquemment, lorsqu'une personnalité civile accède à la tête de l'Etat, il est intéressant de constater, qu'auparavant, elle a fait sa carrière à la direction des services secrets « civils » ou de la police politique.
Mais cet état de fait n'est pas l'exclusivité des pays sous-développés d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. En URSS, Andropov était le patron du KGB, Gorbatchev en avait été un responsable et l'actuel président de Géorgie, Chevardnadze en est un ancien général. Particulièrement significatif est l'exemple de Bush aux USA, « le pays le plus "démocratique" du monde ». Il était un ancien directeur de la CIA. Et ce ne sont là que les exemples les plus connus. Il n'est pas de notre ressort, ni de nos moyens -d'ailleurs tel n'est pas notre but - de dresser une liste exhaustive, mais il serait cependant intéressant de noter la quantité impressionnante de responsables politiques, de ministres, de parlementaires qui, avant d'occuper ces «honorables» fonctions, ont fait leurs classes dans un service secret d'une sorte ou d'une autre.
La multiplication de polices parallèles, de services tous plus secrets les uns que les autres, d'officines occultes de toutes sortes est un aspect particulièrement saillant de la vie sociale dans les pseudo-démocraties d'aujourd'hui. Cela trahit les besoins et la nature des activités de l'Etat. Sur le plan impérialiste bien sur : espionnage, provocation, chantage, assassinats, manipulations de toutes sortes sur le plan international, pour la défense des intérêts impérialistes nationaux, sont devenus monnaie courante. Mais cela n'est que l'aspect « patriotique » le plus «avouable» de l'activité des services secrets. C'est sur le plan intérieur que cette activité occulte de l'Etat s'est certainement le plus développée. Fichage systématique de la population, surveillance des individus, développement des écoutes téléphoniques «officielles» et clandestines, provocations de toutes sortes destinées à manoeuvrer l'opinion publique, infiltration de tous les secteurs de la société civile, financements occultes, etc., la liste est longue des activités pour lesquelles l'Etat a recruté une main-d'oeuvre abondante et qui sont menées dans le secret afin de ne pas entacher le mythe de la « démocratie » Pour exécuter ces tâches délicates l'Etat a recruté le ban et l'arrière-ban de la société, les services des diverses maffias ont été appréciés et la distinction entre gangster et agent secret s'est faite de plus en plus floue car ces spécialistes du crime ont su, à l'occasion, vendre au mieux leurs compétences et rendre d'appréciables services. Depuis de nombreuses années, l'Etat a investi les divers réseaux d'influence qui existaient dans la société, sociétés secrètes, maffia, sectes, pour les mettre au service de sa politique internationale et nationale, permettant du même coup leur ascension au sein des sphères dirigeantes. De fait l'Etat «démocratique» fait exactement la même chose que les « dictatures » qu'il dénonce, mais plus discrètement. Les services secrets sont non seulement au coeur de l'Etat, mais ils sont aussi ses antennes au sein de la société civile.
Parallèlement à ce processus qui a permis la progression, au sein de l'Etat, de fractions de la bourgeoisie dont le mode d'existence était basé sur le secret, l'ensemble du fonctionnement de l'Etat s'est occulté. Derrière l'apparence gouvernementale, les centres de décisions sont devenus invisibles. Nombre de ministres n'ont pas de pouvoir réel et sont là pour amuser la galerie. Cette tendance a trouvé une expression cynique avec le président Reagan dont les piètres talents d'acteur lui ont permis de parader sur la scène médiatique, mais dont le rôle n'était certainement pas de définir des orientations politiques. Pour cela d'autres centres de décision existent qui sont, la plupart du temps, ignorés du grand public. Dans un monde où les médias de propagande idéologique ont pris une importance grandissante, la qualité qui est devenue de plus en plus essentielle pour un homme politique est de bien savoir parler, de bien « passer » à la télévision. Parfois cela seul suffit pour faire carrière. Mais derrière les «bêtes de scène» politiques chargées de donner figure humaine à l'Etat, se cachent une multitude de comités, officines, lobbies animés par des éminences grises couleur muraille, le plus souvent inconnus du public et qui, par-delà les fluctuations gouvernementales, assurent la continuité de la politique étatique et donc la réalité du pouvoir.
Ce fonctionnement de plus en plus dissimulé de l'Etat ne signifie pas pour autant que les divergences, les antagonismes d'intérêts ont disparu au sein de la classe dominante. Au contraire, avec la crise mondiale qui s'approfondit, les divisions s'exacerbent au sein même de chaque bourgeoisie nationale. De manière évidente, des fractions se cristallisent sur le choix des alliances impérialistes. Mais là n'est pas le seul facteur de division au sein de la classe bourgeoise. Les choix économiques, l'attitude à adopter face à la classe ouvrière sont autant de motifs qui cristallisent des débats et des désaccords, et aussi, bien sûr, le sordide intérêt pour la puissance et le pouvoir, source de richesse, au-delà de réelles divergences d'orientation, est une source permanente de conflits entre les différents clans de la classe dominante. Ces divergences au sein de celle- ci ne trouvent plus tant leur expression sur le plan de la division en partis politiques, c'est-à-dire à un niveau visible, qu'au travers de la formation de cliques qui cohabitent à tous les échelons de l'Etat et dont l'existence est cachée au commun des mortels. La guerre que se mènent ces clans pour gagner une influence au sein de l'appareil d'Etat est sévère et pourtant, le plus souvent, elle n'apparaît pas au grand jour. De ce point de vue, là encore, rien ne distingue les « dictatures » des « démocraties ». Fondamentalement, la guerre pour le pouvoir se mène en dehors de la connaissance du plus grand nombre.
La situation actuelle de crise économique exacerbée, de bouleversement des alliances à la suite de l'effondrement du bloc de l'Est pousse à l'exacerbation des rivalités et de la guerre que se mènent les clans capitalistes au sein de l'Etat. Les divers scandales, les « suicides » à répétition d'hommes politiques et d'hommes d'affaires qui émaillent de plus en plus l'actualité depuis quelques années sont la manifestation visible de cette guerre de l'ombre qui s'exacerbe entre les divers clans de la bourgeoisie. La multiplication des « affaires » est une occasion qui permet d'avoir un aperçu de la réalité du fonctionnement réel de l'Etat par-delà l'écran de fumée « démocratique ». La situation en Italie est à cet égard particulièrement révélatrice. L'affaire de la Loge P2, l'affaire Gladio, les scandales maffieux et les scandales de la corruption des hommes politiques illustrent de manière exemplaire la réalité du cadre de compréhension de la réalité totalitaire du fonctionnement de l'Etat «démocratique» que nous avons abordé dans cet article. L'exemple concret de l'Italie constituera l'ossature de la seconde partie de cet article.
JJ.
Articles de référence : Brochure : « La décadence du capitalisme », Revue Internationale n° 31 : « Machiavélisme, conscience, unité de la bourgeoisie », Revue Internationale n° 66 : « Les massacres et les crimes des 'Grandes Démocraties' ».
Questions théoriques:
- Décomposition [43]
Polémique avec le BIPR : tirer les leçons des expériences négatives
- 3705 lectures
Quelle méthode ? Quelles perspectives pour le rapprochement des organisations révolutionnaires ?
Au moment où une nouvelle reprise de la combativité prolétarienne se développe internationalement, posant avec encore plus d'acuité la question d'une plus grande unité au sein du milieu révolutionnaire, il est important que les organisation révolutionnaires sachent tirer un bilan de ce qui a été fait dans ce domaine au cours des dernières années, et qu'elles en tirent des leçons pour le futur.
L'objet de cet article est de contribuer à cet effort. Il s'attache plus particulièrement à la critique de l'expérience du BIPR. Nous le faisons non pas dans un esprit de « concurrence » mais de sincère et fraternelle confrontation. Notre objectif n'est pas de critiquer des pratiques et habitudes du BIPR en soi, mais d'illustrer, à travers les difficultés de cette organisation, les erreurs à ne pas commettre.
Au cours des deux dernières années, quelque chose a commencé à bouger au sein du milieu politique prolétarien : une certaine conscience a commencé à émerger - même si c'est de façon très sporadique et hésitante - du fait que les révolutionnaires doivent se rassembler s'ils veulent être à la hauteur de leurs responsabilités.
L'Appel du CCI
En 1991, le 9e congrès du CCI publiait un Appel au milieu politique prolétarien. Il s'agissait d'un appel au combat contre le sectarisme qui pèse au sein de ce milieu et un encouragement à voir dans ce combat une question vitale pour la classe ouvrière.
Il traduisait lui même les frémissements d'un premier changement d'ambiance dans le milieu politique prolétarien.
«A la place du total isolement sectaire, nous trouvons aujourd'hui dans les différents groupes une plus grande disposition à exposer leurs critiques réciproques dans la presse ou dans les réunions publiques. Il existe en plus un appel explicite des camarades de Battaglia Comunista à surmonter la dispersion actuelle, appel dont nous partageons en grande partie les arguments et les buts. Il existe enfin - et ce doit être encouragé au maximum - une poussée contre l'isolement sectaire, qui vient d'une nouvelle génération d'éléments que le tremblement de terre de ces deux dernières années pousse vers les positions de la gauche communiste et qui restent pantois devant l'extrême dispersion dont ils n'arrivent pas à comprendre les raisons politiques. »
(...)
«Aujourd'hui, l'hypothèque que le capitalisme en décomposition fait peser sur la classe ouvrière est la perte de son unité de classe, à travers mille affrontements fratricides, des sables du Golfe aux frontières de la Yougoslavie. C'est pour cela que la défense de cette unité est une question de vie ou de mort pour notre classe. Mais quelle espérance pourrait désormais avoir le prolétariat de maintenir cette unité, si son avant-garde consciente elle-même, renonçait à combattre pour son unification ? Qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un 'embrassons-nous tous', un 'escamotage opportuniste des divergences', un appel à une 'unité indifférenciée au mépris des principes'. Rappelons-nous que ce fut justement la participation aux discussions de Zimmerwald qui permit aux bolcheviks de réunir la Gauche de Zimmerwald, embryon de la future Internationale communiste et de la séparation définitive avec les sociaux-démocrates. »
L'appel poursuivait :
« Il ne s'agit pas de cacher les divergences pour rendre possible un 'mariage' entre groupes, mais de commencer à exposer et à discuter ouvertement des divergences qui sont à l'origine de l'existence des différents groupes.
Le point de départ, c'est de systématiser la critique réciproque des positions dans la presse. Cela peut paraître une banalité, mais il y a encore des groupes révolutionnaires qui, dans leur presse, font semblant d'être seuls au monde.
Un autre pas qui peut être fait immédiatement, c'est de systématiser la présence et l'intervention aux réunions publiques des autres groupes.
Un pas plus important est la confrontation des positions dans des réunions publiques, convoquées conjointement par plusieurs groupes, face à des événements d'une importance particulière, comme la guerre du Golfe. »
Des petits pas
Notre appel n'a rencontré aucune réponse explicitement favorable de la part des autres organisations prolétariennes. Et pourtant, quelques petits pas ont été réalisés ici et là :
- le groupe bordiguiste, qui publie Il comunista et Le prolétaire, a publié des polémiques ouvertes avec d'autres organisations bordiguistes et avec BC ;
- la Communist Workers Organisation (CWO) de Grande-Bretagne, à ouvert les pages de sa presse à d'autres groupes, a participé avec d'autres groupes à un cercle de discussion dans le nord de l'Angleterre, et a pris récemment l'initiative, peu fréquente, d'inviter le CCI à une réunion de lecteurs à Londres ;
- au cours des deux dernières années, le BIPR (Bureau international pour le parti révolutionnaire), formé par BC et la CWO, en 1984, a ouvert ses stands aux publications du CCI au cours de la fête annuelle du groupe Lutte ouvrière à Paris ([1] [44]) ;
- BC a publié BC Inform une publication restreinte destinée à l'information des groupes prolétariens internationalement ;
- plusieurs groupes prolétariens à Milan (y compris BC, Programma et le CCI) ont participé ensemble dans une action de dénonciation à l'occasion de la visite de Ligatchev (ancien membre du Polit-Bureau de 1’URSS) invité par des staliniens locaux. Même si de fortes critiques peuvent être faites à cette action, elle n'en traduisit pas moins une volonté de rompre l'isolement. Une volonté qui se concrétisa à nouveau peu de temps après par la participation des mêmes groupes à une journée d'exposition débat de la presse internationaliste.
Ces initiatives constituent sans aucun doute des pas dans la bonne direction. Mais ces derniers sont-ils suffisants pour nous permettre de penser que le milieu politique prolétarien est véritablement en train de se donner les moyens d'assumer ses responsabilités au niveau qu'exige la gravité de la situation ? Nous ne pensons pas que ce soit le cas.
En réalité, même si nous considérons bienvenue la nouvelle « ouverture » des groupes prolétariens, nous sommes forcés de constater qu'il s'agit plutôt d'une réponse empirique à la nouvelle situation mondiale que d'une véritable réévaluation fondée sur une analyse en profondeur.
La nécessité d'une méthode
Le regroupement des révolutionnaires ne peut se faire au hasard. Il exige une méthode consistante, fondée sur l'ouverture au débat, combinée avec une rigoureuse défense des principes.
Une telle méthode doit éviter deux dangers :
- d'une part, tomber dans le « débat pour le débat », dans des bavardages académiques où chacun dit ce qu'il veut sans se soucier de créer une dynamique vers des actions communes ;
- d'autre part, croire qu'il serait possible d'entreprendre un « travail commun » sur une base purement « technique », sans clarté préalable sur les principes, clarté qui ne peut être atteinte que par le débat ouvert.
Un manque de méthode peut être excusé chez de jeunes groupes qui manquent d'expérience du travail révolutionnaire. Ce n'est pas le cas pour des organisations qui se réclament de l'héritage de la Gauche italienne et de l'Internationale communiste. Or, lorsqu'on se penche sur l'histoire du BIPR on ne peut que constater, premièrement, qu'il n'y a aucune méthode solide de regroupement des révolutionnaires, deuxièmement, que le manque de méthode a stérilisé les efforts réalisés.
Si nous critiquons le BIPR, nous n'en tirons pour autant aucune satisfaction. Nous avons et avons eu nos propres difficultés, en particulier au cours des années 1980. Nous ne sommes que trop conscients de la terrible fragilité de l'ensemble du milieu révolutionnaire aujourd'hui, surtout si l'on compare cette faiblesse avec les énormes responsabilités qui sont aujourd'hui celles de la classe ouvrière et de ses organisations politiques. Si nous nous penchons sur les défauts du mouvement, par le passé et actuellement, c'est pour les dépasser et ainsi mieux nous préparer à affronter l'avenir. Les révolutionnaires n'étudient pas l'histoire de leur classe à la recherche de « recettes » ou de « formules magiques », mais pour tirer profit de cette expérience historique en vue d'affronter les problèmes du présent. Quelques fois ils peuvent oublier qu'ils font eux-mêmes partie de cette histoire. Après tout, Battaglia Comunista existe depuis au moins 1952, et le CCI constitue déjà l'organisation politique prolétarienne qui a vécu le plus longtemps en tant que corps internationalement organisé et centralisé, dans l'histoire de la classe ouvrière. Les Conférences internationales tenues à la fin des années 70 ont leur place dans l'histoire du prolétariat, tout comme celles de Zimmerwald ou de Kienthal. L'histoire du milieu prolétarien depuis ces Conférences n'est pas une question « d'intérêt archéologique » comme l'a affirmé BC (Workers'Voice, n° 62). Cette période a constitué en réalité un terrain d'expérimentation pratique des différentes conceptions de l'intervention et du regroupement qui se sont exprimées au cours de ces Conférences.
Le prolétariat a une tâche historique à accomplir : le renversement du capitalisme et la construction de la société communiste. Pour mener à bien cette tâche, il ne dispose que de deux armes : sa conscience et son unité. Il en découle pour les révolutionnaires une double responsabilité : intervenir dans la classe ouvrière pour défendre le programme communiste, et travailler en vue du regroupement des révolutionnaires comme une expression de l'unité de la classe.
Nous n'avons pas à hésiter sur l'objectif d'un tel regroupement : la formation du parti mondial communiste, la dernière internationale, sans laquelle la victoire d'une révolution communiste est impossible.
Le travail de regroupement a plusieurs facettes, liées entre elles mais distinctes :
- l'intégration d'individus militants au sein des organisations communistes, le principe de l'action prolétarienne étant celui de l'action collective et organisée sur la base d'un engagement commun à la cause communiste ;
- les organisations des pays au centre du capitalisme, où l'expérience historique du prolétariat est la plus importante, ont une responsabilité particulière vis-à-vis des groupes qui surgissent dans les pays de la périphérie dans les pires conditions de précarité et d'isolement politique ; ces groupes ne peuvent survivre et contribuer à l'unification mondiale de la classe ouvrière qu'en brisant leur isolement et en s'intégrant dans un mouvement plus large ;
-enfin, toutes les organisations communistes, et surtout celles qui ont une filiation historique avec les organisations de la classe ouvrière dans le passé, ont la responsabilité de montrer à leur classe qu'il y a une différence fondamentale, une frontière de classe, entre les groupes et organisations qui défendent fermement les principes internationalistes, d'une part, et les partis « socialistes » ou « communistes » dont la seule fonction est de renforcer l'emprise de la bourgeoisie sur les exploités, d'autre part. En d'autres termes, les communistes doivent clairement définir et défendre le milieu politique prolétarien.
Si nous voulons que les efforts encore hésitants faits aujourd'hui aboutissent à quelque chose, cela ne pourra être fait que sur la base d'un abandon du manque de méthode, des attitudes opportunistes et du sectarisme dont le BIPR a fait preuve depuis sa formation en 1984.
Les Conférences internationales de la Gauche communiste
On ne peut dans cet article reprendre l’histoire détaillée des Conférences internationales ([2] [45]). Mais nous devons en rappeler quelques éléments.
La première Conférence appelée par BC ([3] [46]) se tint à Milan, en mai 1977 ; la deuxième à Paris, en novembre 1978 ; la troisième également.à Paris, en mai 1980. Outre BC, la CWO et le CCI, y participèrent plusieurs groupes se situant sur le terrain de la Gauche communiste ([4] [47]).
Les critères pour participer aux Conférences, tels qu'ils furent définis, puis précisés, lors des deux premières Conférences, étaient les suivants :
«-Reconnaissance de la révolution d'Octobre comme révolution prolétarienne ;
-Reconnaissance de la rupture avec la social-démocratie effectuée par le premier et le deuxième congrès de l'IC ;
- Rejet sans réserve du capitalisme d'Etat et de l'autogestion ;
- Rejet de tous les partis communistes et socialistes en tant que partis bourgeois ;
- Orientation vers une organisation de révolutionnaires qui se réfère à la doctrine et à la méthodologie marxiste comme science du prolétariat ;
- Reconnaissance du refus de l'encadrement du prolétariat derrière, et sous une forme quelconque, les bannières de la bourgeoisie. » ([5] [48])
Le CCI soutenait l'idée des Conférences telles qu'elles avaient été proposées par la lettre initiale de BC:
« Dans une situation telle que celle que nous vivons, où la dynamique des choses progresse beaucoup plus vite que la dynamique du monde des hommes, la tâche des forces révolutionnaires est d'intervenir dans les événements par un retour à la volonté réalisatrice sur le terrain où elle a pris naissance et qui est propre aujourd'hui à l'accueillir. Mais la Gauche communiste faillirait à sa tâche si elle ne se donnait pas des armes efficaces du point de vue de la théorie et de la pratique politique, c'est-à-dire :
a) avant tout, sortir de l'état d'infériorité et d'impuissance où l'ont menée le provincialisme de querelles culturelles empreintes de dilettantisme, l'infatuation incohérente qui ont pris la place de la modestie révolutionnaire, et surtout l'affaiblissement du concept de militantisme compris comme sacrifice dur et désintéressé ;
b) établir une base programmatique historiquement valable, laquelle est, pour notre parti, l'expérience théorico-pratique qui s'est incarnée dans la révolution d'Octobre et, sur le plan international, l'acceptation critique des thèses du 2e congrès de l'IC ;
c) reconnaître que l'on ne parvient ni à une politique de classe, ni à la création du parti mondial de la révolution, ni d'autant moins à une stratégie révolutionnaire si l'on ne décide pas d'abord de faire fonctionner, dès à présent, un Centre international de liaison et d'information qui soit une anticipation et une synthèse de ce que sera la future Internationale, comme Zimmerwald, et plus encore Kienthal, furent l'ébauche de la 3e Internationale. » ([6] [49])
« La Conférence devra indiquer aussi comment et quand ouvrir un débat sur des problèmes par exemple tels que le syndicat, le parti et tant d'autres qui divisent actuellement la Gauche communiste internationale, ceci, si nous voulons qu'elle se conclue positivement et représente un premier pas vers des objectifs plus vastes et vers la formation d'un front international des groupes de la Gauche communiste qui soit le plus homogène possible, si nous voulons enfin sortir de la tour de Babel idéologique et politique et d'un ultérieur démembrement des groupes existants. » ([7] [50])
BC donnait à la Conférence des objectifs qui allaient encore plus loin : «... nous retenons que la gravité de la situation générale... impose des prises de position précises, responsables et surtout en accord avec une vision unitaire des différents courants au sein desquels se manifeste internationalement la Gauche communiste... » ([8] [51])
Cependant, au cours des Conférences, le moins qu'on puisse dire c'est que BC n'a pas brillé par sa cohérence. Loin de défendre la nécessité de «prises de position précises, responsables » BC a systématiquement refuse la moindre prise de position commune : « Nous sommes opposés, par principe, à des déclarations communes, car il n'y a pas d'accord politique. » (Intervention de BC à la 2e Conférence) ([9] [52]); «Ce n'est pas le plus ou moins grand nombre de groupes signant la résolution (sur la situation internationale, proposée par le CCI) qui donnera à celle-ci un plus ou moins grand poids dans la classe » (Intervention de BC à la 3e Conférence).
Il vaut la peine de rappeler que la 3e Conférence se tint peu de temps après l'invasion de l'Afghanistan par l’URSS, et que tous les groupes participants étaient d'accord sur la nature impérialiste de ce pays, l'inévitabilité de la guerre sous le capitalisme, et sur la responsabilité du prolétariat comme seule force capable de faire reculer la marche vers la guerre. Tous ces points d'accord étaient certainement suffisants pour marquer clairement la séparation entre la Gauche communiste et les trotskistes, les staliniens, les socialistes et les divers «démocrates» qui demandaient aux travailleurs d'appuyer un des deux camps dans la confrontation entre les blocs impérialistes des USA et de l'URSS en Afghanistan. ([10] [53])
Suite à l'échec des Conférences, BC pouvait écrire en 1983: «Les Conférences ont rempli leur tâche essentielle qui était de créer un climat de confrontation et de débat au niveau international au sein du camp prolétarien (...) nous les considérons comme des instruments de classification et de sélection politique au sein du camp révolutionnaire ». ([11] [54])
Mais qu'est-il advenu du «Centre international de liaison et d'information » ? Où est le «front international des groupes de la Gauche communiste » ?
Le Bureau international pour le parti révolutionnaire
Evidemment, tout le monde peut changer d'avis, même une «force de direction sérieuse », comme aime à se qualifier BC. Après avoir défini un « camp révolutionnaire » de groupes sérieux (en fait réduit à eux-mêmes), situé au sein d'un « camp prolétarien » (qui, entre autres, inclut le CCI, merci), BC et la CWO avaient décidé de convoquer une 4e Conférence internationale et de fonder le BIPR.
Au cours d'une de ses dernières interventions dans la 3e Conférence BC déclara :
« Nous voulons aller à une quatrième Conférence qui soit un lieu de travail et non de simple discussion... Travailler ensemble c'est reconnaître un terrain commun. Par exemple, un travail commun ne peut être entrepris qu'avec des groupes qui reconnaissent la nécessité de créer des groupes ouvriers d'avant-garde, s'organisant sur une plate-forme révolutionnaire. »
Dans Revolutionary Perspectives n° 18, la CWO a aussi annoncé son intention de «développer des discussions et un travail commun en vue du regroupement de la CWO avec le PCInt (BC). Ceci ne veut pas dire que nous soyons proches de la fin d'un tel processus, ni non plus que des questions seront mises de côté ou oubliées, mais notre récente coopération à la 3e Conférence nous rend optimistes quant à la réalisation d'une conclusion positive. » On proclama donc la nécessité d'une 4e Conférence internationale qui « ne reproduise pas les limitations de ses précédentes mais qui constitue la condition préliminaire pour rendre possible un travail politique commun à une échelle internationale. »
Peu de temps après fut constitué le BIPR. La quatrième Conférence s'était tenue et avait abouti a un fiasco total. ([12] [55]) Depuis lors l'expérience n'a pas été recommencée. Cependant, le premier numéro de la revue du BIPR, Communist Review, constatait que : « Dans les Conférences, les groupes et organisations appartenant au camp politique prolétarien se rencontrent, convergent et se confrontent ». La plat-forme du Bureau devait représenter « un moment dans la synthèse des plates-formes des groupes au niveau national ».
Quelle est la situation neuf ans plus tard ? Les Conférences internationales sont restées lettre morte. Il n'y pas eu de regroupement entre BC et la CWO. Qui plus est, et d'après ce qui ressort de leur presse, il n' y a même pas eu de discussion entre eux pour résoudre leurs divergences, par exemple sur la question syndicale ou parlementaire. Les camarades français du BIPR, qui en 1984 avaient « l'intention de jeter les bases d'une reconstruction organisationnelle du mouvement révolutionnaire sur les positions organiques mises en avant par le BIPR », ont disparu sans laisser de trace. Le seul autre groupe qui a rejoint le BIPR, Lai Pataka, en Inde, a sombré dans un fatras de diatribes anti-BIPR, et a, lui aussi, disparu.
Les treize années depuis la 3e Conférence ont violemment mis à l'épreuve le milieu prolétarien : beaucoup de forces militantes, dont la classe ouvrière a tant besoin, se sont évaporées. Il suffit de regarder ce que sont devenus la plupart des groupes participant aux Conférences (y compris ceux qui ne le firent qu'épistolairement) : Forbundet Arbetarmakt (Suède), l'Eveil internationaliste (France), l'Organisation communiste révolutionnaire internationaliste d'Algérie ont disparu. Le Groupe communiste internationaliste (GCI) s'est rapproché du gauchisme avec ses ambiguïtés sur l'appui à « Sentier lumineux ». Les Nuclei Comunisti Internazionalisti (NCI), à travers les diverses mutations qui les ont amenés à la constitution de l'OCI, se sont jetés dans le camp de la bourgeoisie pendant la guerre du Golfe en appuyant l'Irak. Le FOR, Ferment ouvrier révolutionnaire, se délite.
La disparition de certains de ces groupes traduisait certainement la nécessité d'une inévitable décantation. Et il ne saurait être question de refaire l'histoire avec des « si », il n'en demeure pas moins que l'échec des Conférences signait la disparition d'un lieu où la Gauche communiste pouvait se définir elle-même et affirmer sa nature révolutionnaire face aux multiples variétés de gauchisme. Pour les nouveaux groupes à la recherche d'une cohérence, ce fut la disparition d'un solide point de repère qui aurait été utile dans la tempête idéologique de la décomposition du capitalisme. Aujourd'hui, les groupes qui surgissent sans pouvoir s'identifier complètement avec les positions politiques des organisations existantes au sein de la Gauche communiste, sont condamnés à un isolement quasi-total, avec tout ce que cela entraîne, en termes de stagnation politique, de démoralisation et d'ouverture à l'infiltration de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise.
Le BIPR a été
incapable de fournir une alternative aux Conférences. Celles-ci sont restées
au niveau de projets. Il n'en est toujours rien du regroupement annoncé entre
la CWO et BC.
Le BIPR en Inde
Si l'on veut comprendre pourquoi le BIPR n'est pas parvenu à mener à bien un seul regroupement solide, il est utile de jeter un coup d'oeil à la tentative d'intégration du groupe indien Lai Pataka dans le BIPR.
Le BIPR s'est toujours fait des illusions sur la possibilité de regroupement avec des organisations ayant leurs origines dans le camp ennemi, et plus particulièrement dans le gauchisme. Ces illusions sont elles-mêmes liées à une attitude ambiguë, dont BC n'est jamais parvenue à se défaire, envers les mouvements de masses sur un terrain non-prolétarien. Au cours de la 2e Conférence, BC avait pu dire que la tâche des communistes est « d'être en tête des mouvements de libération nationale » et « de travailler dans le sens d'un clivage de classe au sein du mouvement, et non de le juger de l'extérieur ». Ces positions ont été reprises dans les thèses sur Les tâches des communistes dans la périphérie du capitalisme. La conclusion en est la suivante :
« Dans ces pays (de la périphérie), la domination du capital ne s'étend pas encore à toute la société, le capital n'a pas soumis l'ensemble de la collectivité aux lois de l'idéologie du capital comme il l'a fait dans les pays centraux. Dans les pays de la périphérie, l'intégration politique et idéologique des individus dans la société capitaliste ne constitue pas un phénomène de masse comme dans les pays centraux, parce que l'individu exploité, frappé par la misère et l'oppression, n'est pas encore l'individu citoyen des formations capitalistes d'origine. Cette différence avec les pays centraux rend possible l'existence d'organisations communistes de masse dans la périphérie. (...) Ces 'meilleures' conditions impliquent la possibilité d'organiser des masses de prolétaires autour du parti prolétarien. » ([13] [56])
Nous avons toujours dit que c'est une erreur fatale de croire que les communistes peuvent, d'une façon ou d'une autre, «prendre la tête » de mouvements de libération nationale, de luttes nationalistes révolutionnaires, ou quel que soit le nom que l'on donne à ces luttes de « nations ». De telles luttes sont, en fait, une attaque directe contre la conscience du prolétariat, parce qu'elles noient la seule classe révolutionnaire dans la masse du « peuple », un danger particulièrement important dans les pays périphériques, où le prolétariat est largement dépassé en nombre par la paysannerie et par les masses de pauvres sans terre et sans travail.
Nous savons cela, non seulement par la théorie, mais aussi par la pratique. La plus vieille section du CCI, au Venezuela, se forma en opposition directe aux idéologies guévaristes de « libération nationale » en vogue dans les années 1960 dans toute la gauche. Plus récemment, notre expérience de formation d'une section au Mexique a confirmé, si c'était encore nécessaire, qu'une solide présence communiste ne peut être établie que sur la base d'une confrontation directe avec toutes les variétés de gauchisme et par l'établissement d'une rigoureuse frontière de classe entre le gauchisme, aussi « radical » soit-il, et les positions prolétariennes.
De la «Quatrième Conférence internationale», tenue avec des défenseurs du PC iranien, jusqu'à la correspondance fraternelle avec le groupe « marxiste-léniniste » Revolutionnary Proletarian Platform (RPP) en Inde, le BIPR n'a jamais réussi à établir cette claire séparation. Aussi n'y a-t-il rien de surprenant à ce que des gauchistes soient eux-mêmes plus conscients des divisions qui les opposent aux communistes. Ainsi le RPP pouvait écrire au BIPR :
« ... sur la question de la participation dans des syndicats réactionnaires et dans les parlements bourgeois, il nous est difficile d'être d'accord avec vous ou avec tout courant qui rejette totalement une telle participation. Même si nous reconnaissons que votre position sur les syndicats (...) est beaucoup plus saine que celle du CCI (qui considère que les syndicats ont été intégrés dans l'Etat bourgeois et doivent comme tels être détruits), il nous semble que sur le fond, elle demeure une critique de l'approche bolchevique-léniniste, à partir d'un point de vue d'extrême gauche, car elle part des mêmes prémisses théoriques que le CCI et les courants similaires. » ([14] [57])
L'ironie veut que la CWO semble être parvenue maintenant à notre position sur l'impossibilité que des groupes (contrairement aux individus) puissent passer du camp bourgeois au camp prolétarien : « La politique de ces groupes (trotskistes) se situe sans aucun doute dans l'aile gauche du capital et ce serait une énorme erreur de s'imaginer que de telles organisations puissent revenir dans le camp du communisme internationaliste. »([15] [58])
Mais ni la CWO, ni BC, ni le BIPR n'ont été capables de comprendre cela dans leur attitude envers les partisans du PC Iranien en exil (SUCM) ou envers l'organisation maoïste indienne RPP (et il n'est pas inutile de rappeler que le maoïsme, contrairement au trotskisme, n'a jamais appartenu au camp prolétarien). Au contraire. Après l'exclusion du CCI de la 3e Conférence internationale, au lendemain du fiasco de la 4e, tenue avec comme seul « invité » le SUCM, le BIPR se réjouissait de mener avec le RPP en Inde « une bataille politique contre les partisans (du CCI) » ([16] [59]) et d'accepter que la section bengali du RPP et son journal se dirigent comme un tout vers « le camp du communisme internationaliste ».
Dans le n° 11 de la Communist Review, une « Prise de position sur Lai Pataka » fait remarquer que : « Quelques esprits cyniques peuvent penser que nous avons accepté ce camarade trop rapidement dans le BIPR ». Nous ne faisons pas partie de ces « esprits cyniques ». Le problème ne réside pas dans la « précipitation » du BIPR à « accepter » Lai Pataka, mais dans une faiblesse congénitale du BIPR lui-même. Comment le BIPR pourrait-il aider les autres à surmonter leurs confusions et à rompre avec l'idéologie bourgeoise, alors que lui-même entretient des ambiguïtés sur des questions telles que le syndicalisme, et s'avère incapable de tracer une nette démarcation entre communistes et gauchistes. Vue l'incapacité de BC et de la CWO à conduire leurs propres discussions jusqu'au regroupement, comment le BIPR pourrait-il fournir un solide point de référence pour ceux qui évoluent vers des positions communistes ?
Les flirts
opportunistes avec le gauchisme de la part du BIPR s'accompagnent logiquement
d'une attitude sectaire vis-à-vis de groupes qui ne sont pas dans sa «sphère d'influence ». Ainsi, le numéro
3 de la Communist Review qui traite
assez longuement des groupes en Inde, ne fait aucune mention du groupe qui
publiait Communist Internationaliste ni du groupe qui publiera plus tard
Kamunist Kranti, bien que ces deux groupes fussent connus, au moins de la CWO.
Puis vers 1991, Lai Pataka disparaît des pages de Workers Voice et se voit remplacé
par Kamunist Kranti : « Nous espérons
que, dans l'avenir, de fécondes relations pourront être établies entre le
Bureau international et Kamunist Kranti ». Deux ans plus tard, tout porte
à croire que ces rapports sont restés stériles, puisque le n° 11 de Communist Review dit : « c'est une tragédie que, malgré l'existence
d'éléments prometteurs, il n’existe pas encore un noyau solide de communistes
indiens ». Il n'y aurait que « des
étincelles de conscience au milieu du désordre ». Entre temps, le noyau de Communist Internationalist est devenu
partie intégrante du CCI. Le BIPR pourrait mieux contribuer au processus de
regroupement des révolutionnaires s'il commençait par reconnaître l'existence
d'autres groupes dans le mouvement.
Le BIPR dans l'ex-bloc de l'est
Après les échecs avec les iraniens du SUCM et les indiens du RPP, on aurait pu s'attendre à ce que le BIPR ait appris quelque chose à propos des frontières séparant les organisations bourgeoises et la classe ouvrière. Mais, le compte-rendu de l'intervention du BIPR avec le groupe autrichien Gruppe Internazionalistische Kommunisten (GDC), dans les pays de l'Est, nous en fait douter.
Nous ne pouvons que saluer l'effort du BIPR pour défendre des positions communistes dans la tourmente de l'ex-bloc de l'est (et n'était-ce pas là une situation exigeant un «front international de la Gauche communiste », pour employer les termes de BC ?). Mais comment ne pas être troublé par les illusions que semble développer BC sur la possibilité qu'il surgisse quelque chose de positif du sein des anciens PC ? « Nos camarades ont donc décidé d'aller voir les restes du parti 'communiste' tchécoslovaque. Il aurait pu être dangereux d'aller dire aux staliniens toute notre haine de leur régime de capitalisme d'Etat, exploiteur de notre classe, mais cela valait la peine si on devait y trouver quelque résidu de leur base de classe, désorienté et en présence des derniers souffles du parti. » Et, parlant d'une autre réunion : « les discussions n'ont pas manqué (y compris un échange d'idées avec des représentants étrangers de la IVe Internationale) » ([17] [60])
Comment peut-il y avoir un « échange d'idées » entre ceux qui se proposent de faire revivre le corps putride du stalinisme et la Gauche communiste, décidée à l'enterrer pour toujours ? Le rapport du GDC, dans Workers Voice n° 55, se fait l'écho de l'idée qu'il peut exister un «mélange» de marxisme prolétarien et d'idéologie bourgeoise à l’Est : «Il y existe une plus large connaissance des idées marxistes au sein de la population, certains éléments de l'analyse matérialiste marxiste ne sont pas inconnus, même s'ils subissent des distorsions bourgeoises et sont mêlés d'un contenu bourgeois ». Mais, du point de vue de la conscience de la classe ouvrière, quel sens a de choisir entre un travailleur de l'Europe de l'Ouest qui n'a jamais entendu parler de « l'internationalisme prolétarien », et un travailleur de l'Est pour qui ce terme veut dire invasion de la Tchécoslovaquie ou de l'Afghanistan par la Russie ? Le pire, c'est que le GIK semble préférer la pêche dans les eaux troubles des staliniens défroqués que l'intervention au sein de la classe elle même :
« Plus importante que notre intervention dans la rue fut notre intervention au sein du nouveau KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) qui s'est reformé en janvier 1990. Il n'y a pas de véritable homogénéité dans celui-ci et le point commun à tous ses fondateurs c'est qu'ils veulent maintenir des 'idéaux communistes' (...) Beaucoup, au sein du KPD (...) défendent la RDA caractérisée comme un 'système socialiste avec des erreurs'. D'autres sont divisés entre le stalinisme pur et ceux qui appuient les oppositions anti-staliniennes de gauche (trotskistes et Gauche communiste). » ([18] [61]) Une fois encore la distinction entre trotskisme et Gauche communiste est estompée, comme si les deux pouvaient appartenir à une sorte de front commun « anti-stalinien ». Ce n'est certainement pas avec ce genre d'intervention que l'on pourra contribuer à une rupture nette avec le stalinisme et ses défenseurs trotskistes.
Un nouveau début...ou encore un peu plus du même acabit ?
Pour autant que nous le sachions, au cours de ses neuf années d'existence, le BIPR n'est pas réellement parvenu à étendre sa présence ou à faire avancer le regroupement avec la CWO, annoncé en 1980. La «première sélection de forces » dont parlait BC au lendemain de la fin des Conférences internationales, s'est avérée... très sélective. A l'automne 1991, la CWO annonce: «L'alternative historique de notre époque est entre l'actuelle barbarie capitaliste qui aboutira à la destruction de toute vie humaine, et l'instauration du socialisme par le prolétariat (...) Participer à ce processus exige une plus grande concentration de forces que les nôtres (ou de celles que peut posséder tout autre groupe du camp politique prolétarien). C'est pourquoi nous nous attachons à trouver de nouveaux moyens, fondés sur des principes, pour entretenir un dialogue politique avec tous ceux qui considèrent qu'ils combattent pour les mêmes objectifs que nous. » Treize ans après que BC et CWO eurent assumé « la responsabilité qu'on est en droit d'attendre de la part d'une force dirigeante sérieuse », en interrompant les Conférences internationales, la boucle est bouclée. Mais, pour paraphraser Marx, si l'histoire se répète deux fois, la première c'est sous la forme d'une tragédie, la seconde sous forme de farce. Le « nouveau début » de la CWO n'a conduit pour le moment qu'à un demi-regroupement avec le Communist Bulletin Group (CBG). Mais le CBG n'est-il pas l'exemple même de groupe dont BC pouvait écrire, en avril 1992 : «L'importance politique d'une division, qui est parfois nécessaire pour être capable d'interprétations politiques précises et pour définir des stratégies, a ouvert la porte, dans un certain milieu politique et parmi certaines personnalités, à une exaspérante pratique de scissionner pour scissionner, à un rejet individuel de toute centralisation, de toute discipline organisationnelle, ou de toute responsabilité 'encombrante' dans le travail collectif départi. » ?
Comment la CWO, qui ne manque jamais une occasion de dénoncer « le spontanéisme » et « l'idéalisme » du CCI, peut-elle proposer une fusion avec le CBG qui, pour autant qu'il lui reste quelques principes, est supposé défendre la plate-forme du CCI? Avec un tel fatras sans principes, ce nouvel effort du BIPR ne peut aboutir qu'à un échec, comme les précédents. ([19] [62])
Quel chemin pour l'avenir ?
Vingt ans d'expérience, avec leurs succès et leurs échecs, dans la construction d'une organisation internationale présente sur trois continents et dans douze pays, nous ont appris au moins une chose : il n'y a pas de raccourcis dans le chemin du regroupement. Le manque de compréhension mutuelle, l'ignorance des positions des autres, la méfiance qui sont le legs des années écoulées depuis la fin des Conférences internationales, rien de cela ne disparaîtra du jour au lendemain. Pour reconstruire un tant soit peu d'unité dans le camp prolétarien, il nous faut avant tout revenir à un peu de « modestie révolutionnaire », pour reprendre un terme de BC, et entreprendre les pas, très limités, que le CCI propose dans son Appel : polémiques régulières, présence aux réunions publiques des autres groupes, organisation de réunions publiques en commun, etc. Et, lorsqu'un retour à l'esprit des Conférences internationales sera redevenu possible, il faudra avoir tiré les leçons du passé :
« Il y aura d'autres conférences. Nous y serons et nous espérons y retrouver, si le sectarisme ne les a pas tués d'ici là, les groupes qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris l'importance de ces Conférences que nous venons de vivre, elles profiteront de l'acquis de celles-ci :
- importance de ces Conférences pour le milieu révolutionnaire et pour l'ensemble de la classe ;
- nécessité d'avoir des critères ;
- nécessité de se prononcer ;
- rejet de toute précipitation ;
- nécessité de la discussion la plus approfondie sur les questions cruciales affrontées par le prolétariat.
Pour construire un corps sain, le futur parti mondial, il faut une méthode saine. Ces Conférences, à travers leurs points forts comme à travers leurs faiblesses, auront appris aux révolutionnaires qui "n'ont pas désappris d'apprendre", comme disait Rosa Luxembourg, en quoi consiste une telle méthode ».([20] [63])
Sven.
[1] [64] Lutte ouvrière, la principale organisation trotskiste en France, tient une kermesse annuelle près de Paris, quelque chose qui tient plus de la foire de campagne que d'un événement politique. Pour donner une image de tolérance politique, il y est autorisé à toute une série d'organisations «de gauche » d'y tenir des stands pour la vente de leur presse et d'organiser de courtes réunions publiques pour défendre leurs positions. Le CCI a toujours participé à ces «fêtes» afin de défendre des positions internationalistes et dénoncer la nature anti-ouvrière des trotskistes. Il y a trois ans il s'est produit un incident plus important que d'habitude : un camarade du CCI, au cours d'un forum de discussion, a démasqué les tentatives de LO de nier qu'elle avait appuyé la campagne électorale de Mitterrand en 1981 - de sorte que la duplicité de LO apparaissait sans équivoque. Depuis lors, le CCI a été interdit d'y tenir des stands ou des forums.
[2] [65] Les textes et les procès-verbaux de ces conférences peuvent être obtenus à nos adresses. Nous avons aussi traité à plusieurs reprises des principales questions soulevées par les Conférences dans différents numéros de la Revue internationale.
[3] [66] Ces conférences ont été formellement tenues à l'initiative de BC. Mais BC n'était pas seule à partager un souci de regroupement. Révolution internationale, qui allait devenir plus tard la section en France du CCI, avait déjà lancé un appel à BC pour que, en tant qu'un des groupes historiques au sein du prolétariat, elle engage un travail de regroupement des forces prolétariennes dispersées. En 1972, à l'initiative d'Internationalism (plus tard la section du CCI aux Etats-Unis) débuta un effort de conférences et de correspondance qui aboutit d'un côté à la formation de la CWO et de l'autre du CCI en 1975.
[4] [67] Si l'on inclut les groupes qui ont participé ne fut-ce que par correspondance et au moins à une conférence, on peut citer : le FOR, Ferment ouvrier révolutionnaire; Fôr Komunismen et Forbundet Arbetarmakt, de Suède; Nuclei Leninisti Internazionalisti et Il Leninista d'Italie; Organisation communiste révolutionnaire internationaliste d'Algérie; le Groupe communiste internationaliste et le Groupe communiste l'Eveil internationaliste, de France.
[5] [68] Bulletin préparatoire n° 1 de la 3e Conférence des groupes de la Gauche communiste (novembre 1979).
[6] [69] Aux groupes internationalistes de la Gauche communiste, Milan, avril 1976; in Textes et compte rendu de la Conférence internationale organisée par le PCInt (BC) à Milan les 30-4 et 1-5 1977.
[7] [70] Deuxième lettre circulaire du PCInt. (BC) aux groupes communistes au sujet d'une éventuelle rencontre internationales Milan, 15 juin 1976; in Textes et compte rendu de la Conférence internationale...
[8] [71] Première lettre-circulaire du PCInt, in Textes et compte rendu de la Conférence internationale...
[9] [72] Deuxième Conférence des groupes de la Gauche communiste : textes préparatoires, compte rendu, correspondance. Paris, novembre 1978.
[10] [73] Au lendemain de notre «exclusion» des conférences, dans une article intitulé : « Le sectarisme, un héritage de la contre-révolution à dépasser », nous écrivions à ce propos :
« Se taire, c'est pour des révolutionnaires, nier leur existence. Les communistes n'ont rien à cacher à leur classe. Face à elle, dont ils se veulent l’avant-garde, ils assument de façon responsable leurs actes et leurs convictions. Pour cela, les prochaines conférences devront rompre avec les habitudes "silencieuses" des trois conférences précédentes.
Elles devront savoir affirmer et assumer CLAIREMENT, explicitement, dans des textes et des résolutions courtes et précises, et non dans des centaines de pages de procès-verbaux, les résultats de leurs travaux, qu'il s'agisse de l'éclaircissement de DIVERGENCES, ou qu'il s'agisse de positions COMMUNES, partagées par l'ensemble des groupes.
L'incapacité des conférences passées à mettre noir sur blanc le contenu réel des divergences a été une manifestation de leur faiblesse. Le silence jaloux de la 3e Conférence sur la question de la guerre est une honte. Les prochaines conférences devront savoir assumer leurs responsabilités, si elles veulent être viables. » (...)
« "Mais, attention", nous disent les groupes partisans du silence. "C'est que nous, on ne signe pas avec n'importe qui ! Nous ne sommes pas des opportunistes !" Et nous leur répondons : l'opportunisme c'est trahir des principes à la première opportunité. Ce que nous proposions ce n'était pas de trahir un principe (l'internationalisme), mais de l'affirmer avec le maximum de nos forces. » Revue internationale, n° 22, 3e trimestre 1980.
[11] [74] Réponse de BC à l’Adresse aux groupes politiques prolétariens du CCI (1983).
[12] [75] Nous ne pouvons traiter ici de la triste histoire de la 4e Conférence. Nous renvoyons le lecteur aux n° 40 et 41 de la Revue internationale.
[13] [76] Communist Review, n° 3, (1985).
[14] [77] Workers Voice, n° 65.
[15] [78] Workers Voice, n° 65.
[16] [79] Communist Review, n° 3.
[17] [80] Workers Voice, n° 53, septembre 1990.
[18] [81] Workers Voice, n° 55; c'est nous qui soulignons.
[19] [82] Peut-être est-ce déjà le cas. Les derniers numéros de Workers Voice ne portent pas trace des « contributions régulières » du CBG annoncées.
[20] [83] Lettre du CCI au CE du PCInt, après la 3e Conférence; in 3e Conférence des groupes de la gauche communiste, mai 1980 -Procès verbal (janvier 1981).
Courants politiques:
- Gauche Communiste [84]
- TCI / BIPR [85]
Approfondir:
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [7e partie] II
- 4170 lectures
L'étude du capital et les fondements du communisme
2. Le renversement du fétichisme de la marchandise
Dans la première partie de ce chapitre ([1] [88]), nous avons commencé par examiner le contexte historique dans le cadre duquel Marx a traité de la société capitaliste comme étant la dernière de toute une série de systèmes d'exploitation et d'aliénation, en tant que forme d'organisation sociale non moins transitoire que ne le furent l'esclavage romain ou le féodalisme médiéval. Nous avons noté que, dans ce contexte, il fallait considérer le drame de l’histoire de 1’humanité à la lumière de la relation dialectique entre les liens sociaux originels de 1’humanité et la croissance des rapports marchands qui avaient à la fois dissous ces liens et préparé le terrain pour une forme plus avancée de communauté humaine. Dans la partie qui suit, nous nous centrerons sur l'analyse qu'a développée Marx dans sa maturité, du capital lui-même - de sa nature interne, de ses contradictions insolubles et de la société communiste destinée à le supplanter.
Démystifier la marchandise
Il est certainement impossible d'étudier Le capital de Marx, ses différents brouillons et annexes, depuis les Grundrisse jusqu'aux Théories de la Plus-Value, sans ressentir une vive agitation. Ce gigantesque travail intellectuel auquel «j'ai sacrifié ma santé, mon bonheur et ma famille » ([2] [89]) fouille, jusque dans les détails les plus extraordinaires, les origines historiques de la société bourgeoise, examine très concrètement le mode d'opération quotidien du capital, depuis le terrain de l'usine jusqu'au système du crédit, « descend » jusqu'aux questions les plus générales et les plus abstraites de I’histoire de 1’humanité et des caractéristiques de l'espèce humaine, pour « s'élever » ensuite vers le concret, à la réalité dure et nue de l'exploitation capitaliste. Mais tout en étant un travail qui requiert une concentration et un effort mental considérables de la part de ses lecteurs, ce n'est jamais un travail académique, ni une simple description, ni un exercice d'apprentissage scolaire constituant une fin en soi. Comme Marx l'a souvent répété, c'est à la fois une description et une critique de l'économie politique bourgeoise. Son but n'était pas de classer, d'établir des catégories ni de définir les caractéristiques du capital, mais de montrer le chemin de sa destruction révolutionnaire.
Comme le dit Marx dans son langage coloré, Le capital est « assurément la bombe la plus effrayante qui ait jamais été lancée à la tête de la bourgeoisie ». ([3] [90]).
Dans cet article, notre objectif n'est pas, et ne pourrait être, l'examen détaillé du Capital et des autres travaux sur l'économie politique. Il est simplement de faire ressortir ce qui nous semble constituer ses thèmes centraux afin de souligner leur contenu révolutionnaire et donc communiste. Nous commencerons, comme l'a fait Marx, par la marchandise.
Dans la première partie de cet article, nous avons rappelé que, du point de vue de Marx, I’histoire n'est pas simplement la chronique du développement de ses capacités productives, mais est aussi celle de son aliénation croissante, une aliénation qui atteint son apogée dans le capitalisme et le système du travail salarié. Dans Le capital, cette aliénation est traitée sous différents angles, mais son application la plus significative est sans doute contenue dans le concept du fétichisme de la marchandise ; et dans une large mesure, Le capital lui-même constitue une tentative de percer, dévoiler et renverser ce caractère fétiche.
Selon Marx dans le premier chapitre du Capital, la marchandise apparaît à 1’humanité comme « énigmatique » dès qu'on la considère comme quelque chose de plus qu'un simple article de consommation - c'est-à-dire quand on la considère non du point de vue de sa simple valeur d'usage, mais de celui de sa valeur d'échange. Plus la production d'objets matériels est subordonnée aux besoins du marché, de l'achat et de la vente, plus 1’humanité perd de vue les buts et les motifs réels de la production. La marchandise a jeté un sort aux producteurs, et jamais ce sort n'a été aussi puissant, jamais cet « univers ensorcelé et perverti » ([4] [91]) ne s'est autant développé que dans la production universelle de marchandises, dans le capitalisme - première société dans I’histoire où les rapports marchands ont pénétré jusqu'au cœur même du système productif, au point que la force de travail elle-même est devenue une marchandise. Voici comment Marx décrit le processus dans lequel les rapports marchands en sont arrivés à ensorceler l'esprit des producteurs « ... dans l'acte de vision, la lumière est réellement projetée d'un objet extérieur sur un autre objet, l’œil; c'est un rapport physique entre des choses physiques. Mais la forme valeur et le rapport de la valeur des produits du travail n'ont absolument rien à faire avec leur nature physique. C'est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d'un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie de ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là les produits du cerveau humain ont l'aspect d'êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu'ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production. » ([5] [92])
Pour Marx, découvrir et renverser le fétichisme de la marchandise était crucial à deux niveaux. D'abord, parce que la confusion que les rapports marchands semaient dans l'esprit humain, rendait le fonctionnement véritable de la société bourgeoise extrêmement difficile à saisir, même par les théoriciens les plus éduqués et les plus intelligents de la classe dominante. Et deuxièmement, parce qu'une société dominée par la marchandise était nécessairement condamnée à échapper au contrôle de ses producteurs ; pas seulement dans un sens abstrait et statique, mais également au sens où un tel ordre social allait en définitive mener l'ensemble de l'humanité à la catastrophe s'il n'était pas remplacé par une société qui ait banni la valeur d'échange en faveur de la production pour l'usage.
Le secret de la plus-value
Les économistes bourgeois avaient évidemment vu que le capitalisme était une société basée sur la production pour le profit ; certains d'entre eux avaient même reconnu l'existence d'antagonismes de classe et d'injustices sociales au sein de la société.
Mais aucun d'entre eux n'avait été capable de discerner les origines réelles du profit capitaliste dans l'exploitation du prolétariat. On retrouve à nouveau le fétichisme de la marchandise : contrairement au despotisme oriental, à l'esclavage classique, ou au féodalisme, il n'existe pas d'exploitation institutionnalisée dans le capitalisme, pas de corvée, pas de propriété légale d'un être humain par un autre, pas de jours fixes pour travailler la terre du seigneur. Dans la vision du simple bon sens de la pensée bourgeoise, le capitaliste achète le « travail » de l'ouvrier et lui donne, en échange, un « salaire équitable ». Si un profit surgit de cet échange, ou de la production capitaliste en général, il a simplement pour fonction de couvrir le coût et l'effort dépensés par le capitaliste, ce qui semble également équitable. Ce profit peut provenir du fait que le capitaliste achète « à bas prix » et vend « cher » - c'est-à-dire qu'il vient du marché - ou bien qu'il est le produit de l'« abstinence » du capitalisme lui-même, ou encore, comme dans la théorie de Senior, « de la dernière heure de travail ».
Mais ce que Marx a démontré à travers son analyse de la marchandise, c'est que l'origine du profit capitaliste réside dans une véritable forme d'esclavage, dans un temps de travail non payé à l'ouvrier. C'est pourquoi Marx commence Le Capital par l'analyse de l'origine de la valeur, en expliquant que la valeur d'une marchandise est déterminée par la quantité de temps de travail contenu dans sa production. Jusque là Marx était en continuité avec l'économie politique bourgeoise classique (même si des « experts » économiques modernes nous diraient aujourd'hui que la théorie de la valeur du travail n'est rien d'autre qu'une charmante vieillerie - ce qui exprime la dégénérescence ultérieure de la « science » économique bourgeoise). Mais il a été capable d'aller plus loin dans l'exploration de la marchandise particulière qu'est la force de travail (pas le travail dans l'abstrait comme l'a toujours vu la bourgeoisie, mais la capacité de travail de l'ouvrier, qui est ce que le capitaliste achète vraiment). Cette marchandise, comme toute autre, « vaut » la quantité de temps de travail nécessaire pour la reproduire - c'est-à-dire dans ce cas, répondre aux besoins fondamentaux de l'ouvrier comme la nourriture, l'habillement, le toit, etc. Mais la force de travail vivant, contrairement aux machines qu'elle fait tourner, comporte la caractéristique unique d'être capable de créer plus de valeur en un jour de travail que ce qu'il est nécessaire pour la reproduire. L'ouvrier, qui travaille 8 heures par jour, peut donc ne pas passer plus de 4 heures à travailler pour lui-même - le reste étant donné « gratuitement » au capitaliste. Cette plus-value, une fois qu'elle est réalisée sur le marché, constitue la véritable source du profit capitaliste. Le fait que la production capitaliste soit précisément l'extraction, la réalisation et l'accumulation de ce surtravail volé, en fait, par définition, par nature, un système d'exploitation de classe en totale continuité avec l'esclavage et le féodalisme. Il ne s'agit pas de parler de combien de temps travaille un ouvrier, 8, 10 ou 18 heures par jour, ni de savoir si son environnement est agréable ou infernal, ou son salaire haut ou bas. Ces facteurs influencent le taux d'exploitation, non le fait de l'exploitation. L'exploitation n'est pas un sous-produit accidentel de la société capitaliste, ni le produit de patrons particulièrement avides. C'est le mécanisme fondamental de la production capitaliste, et celle-ci ne peut se concevoir sans cette exploitation.
Les implications de cela sont immédiatement révolutionnaires. Dans le cadre marxiste, toutes les souffrances, matérielles et spirituelles, imposées à la classe ouvrière sont le produit logique et inévitable de ce système d'exploitation. Le capital est sans aucun doute un puissant acte d'accusation morale contre la misère et la dégradation que la société bourgeoise fait peser sur la grande majorité de ses membres. Le volume I, en particulier, montre dans le détail comment le capitalisme est né « suant le sang et la boue par tous les pores » ([6] [93]) ; comment dans sa phase d'accumulation primitive, le capital naissant a violemment exproprié les paysans et puni à coups de fouet et de hache les vagabonds qu'il avait lui-même créés ; comment - et dans la première période de la manufacture, la phase de la « domination formelle » du capital, et dans le système industriel proprement dit, la phase de la « domination réelle »- la soif de plus-value des « loups-garous » capitalistes avait mené, avec toute la puissance objective d'une machine en marche, à 1’horreur du travail des enfants, des journées de travail de 18 heures et tout le reste. Dans ce même travail, Marx dénonce l'appauvrissement interne, l'aliénation de l'ouvrier réduit à n'être qu'un simple rouage d'un vaste engrenage, à n'être qu'un simple fragment, du fait du caractère pénible et répétitif de son travail, de son réel potentiel humain. Mais il ne le fait pas dans le but d'en appeler à une forme plus humaine de capitalisme, mais en démontrant scientifiquement que le système lui-même du travail salarié doit mener à de tels excès » ; que le prolétariat ne peut atténuer ses souffrances en comptant sur la bonne volonté ou les pulsions charitables de ses exploiteurs, mais seulement en menant une résistance opiniâtre et organisée contre les effets quotidiens de l'exploitation ; que « la misère, l'oppression, l'esclavage, la dégradation, l'exploitation » inévitablement croissants ne peuvent être balayés que par « la résistance de la classe ouvrière, sans cesse grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et organisée par le mécanisme même de la production capitaliste. » ([7] [94]) Bref, la théorie de la plus-value prouve la nécessité, l'inévitabilité absolue de la lutte entre le capital et le travail, de classes aux intérêts objectivement irréconciliables. Tel est le fondement de granit de toute analyse de l'économie, la politique et la vie sociale capitalistes qui ne peuvent être compris clairement et lucidement que du point de vue de la classe exploitée, puisque seule cette dernière a un intérêt matériel à percer le voile de la mystification dont le capitalisme se recouvre.
Les contradictions insolubles du capital
Comme nous l'avons montré dans la première partie de cet article, le matérialisme historique, l'analyse marxiste de 1’histoire est synonyme de la vision selon laquelle toute société de classe a traversé des époques d'ascendance durant lesquelles ses rapports sociaux fournissent un cadre pour le développement progressif des forces productives, et des époques de décadence durant lesquelles ces mêmes rapports sont devenus une entrave croissante à un développement ultérieur, nécessitant l'émergence de nouveaux rapports de production. Dans la vision de Marx, le capitalisme ne fait pas exception à ces lois - au contraire, Le Capital, et toute l’œuvre de Marx, en fait, ne peuvent être conçus que comme la nécrologie du capital, l'étude des processus qui mènent à sa chute et à sa disparition. C'est pourquoi le crescendo du volume I est constitué par le passage dans lequel Marx prédit une époque où « le monopole du capital devient une entrave pour le mode de production qui a grandi et prospéré avec lui et sous ses auspices. La socialisation du travail et la centralisation de ses ressorts matériels arrivent à un point où elles ne peuvent plus tenir dans leur enveloppe capitaliste. Cette enveloppe se brise en éclats. L'heure de la propriété capitaliste a sonné. Les expropriateurs sont à leur tour expropriés ». ([8] [95])
Le premier volume du Capital est cependant principalement une étude critique du « procès de production capitaliste ». Son but principal est de mettre à nu la nature de l'exploitation capitaliste et se limite donc largement à l'analyse des rapports directs entre le prolétariat et la classe capitaliste, ayant recours à un modèle abstrait dans lequel les autres classes et formes de production n'ont pas d'importance. C'est dans les volumes suivants, en particulier dans le volume III et dans les Théories sur la plus-value (2e partie) ainsi que dans les Grundrisse que Marx lance la phase suivante de son attaque contre la société bourgeoise : la démonstration que la chute du capital sera le résultat des contradictions enracinées au cœur même du système, dans la production de la plus-value elle-même.
Déjà dans les années 1840, et en particulier dans le Manifeste communiste, Marx et Engels avaient identifié les crises périodiques de surproduction comme étant les signes avant-coureurs de la faillite définitive du capitalisme. Dans Le Capital et les Grundrisse, Marx consacre beaucoup de pages à la polémique contre les économistes politiques bourgeois qui tentent de montrer que le capitalisme est fondamentalement un système économique harmonieux dans lequel tout produit peut, si tout va bien, trouver un acheteur - c'est-à-dire que le marché capitaliste peut absorber toutes les marchandises fabriquées dans le processus de production capitaliste. Si des crises de surproduction ont bien lieu, selon les arguments de Say, Mill et Ricardo, elles sont le résultat d'un déséquilibre purement contingent entre l'offre et la demande, d'une « disproportion » malencontreuse entre un secteur et l'autre ; ou peut-être sont-elles tout simplement le résultat de salaires trop bas. Une surproduction partielle est possible, mais pas une surproduction généralisée. Et toute idée selon laquelle les crises de surproduction auraient trouvé leur source dans les contradictions insolubles inhérentes au système lui-même, ne pouvait être admise, parce que c'était admettre la nature limitée et transitoire du mode de production capitaliste :
« La phraséologie apologétique, utilisée pour nier l'existence de la crise, est importante en ce qu'elle prouve toujours le contraire de ce qu'elle veut prouver. Pour nier l'existence de la crise, elle affirme qu'il y a unité, là où existent opposition et contradiction. Elle est donc importante en ce qu'on peut dire: elle prouve que si, en fait, les contradictions qu'elle nie imaginairement n'existaient pas, les crises, elles non plus, n'existeraient pas. Mais, en fait, la crise existe, parce que ces contradictions existent. Chaque raison qu'elle avance contre la crise est une contradiction niée par l'imagination, donc une contradiction réelle, donc une raison de la crise. La volonté de nier par l'imagination les contradictions qui, selon un vœu pieux, ne doivent pas exister ». ([9] [96])
Et dans les paragraphes suivants, Marx montre que c'est dans son existence même que le système du travail salarié et de la plus-value contient les crises de surproduction:
« Ce que les ouvriers produisent en fait, c'est la plus-value. Aussi longtemps qu'ils en produisent, ils ont de quoi consommer. Mais dès que cela cesse, leur consommation cesse, parce que cesse leur production. Ce n'est nullement parce qu'ils produisent un équivalent pour leur consommation qu'ils ont de quoi consommer... Quand on réduit donc ce rapport à celui de consommateurs et de producteurs, on oublie que le travailleur salarié qui produit et le capitaliste qui produit sont des producteurs d'un genre tout à fait différent (abstraction faite des consommateurs qui ne produisent rien du tout). A nouveau on nie l'existence de cette opposition, en faisant abstraction d'une opposition qui existe réellement dans la production. Le simple rapport entre travailleur salarié et capitaliste implique :
1. Que la majeure partie des producteurs (les ouvriers) ne sont pas consommateurs (pas acheteurs) d'une très grande portion de leur produit: les moyens et la matière de travail ;
2. Que la majeure partie des producteurs, les ouvriers, ne peuvent consommer un équivalent pour leur produit, qu'aussi longtemps qu'ils produisent plus que cet équivalent - qu'ils produisent la plus-value ou le surproduit. Il leur faut constamment être des surproducteurs, produire au-delà de leurs besoins pour pouvoir être consommateurs ou acheteurs, à l'intérieur des limites de leurs besoins ». ([10] [97])
Bref, puisque le capitaliste extrait la plus-value de l'ouvrier, l'ouvrier produit toujours plus qu'il ne peut acheter. Evidemment, pour le capitaliste individuel, cela ne pose pas de problème puisqu'il peut toujours trouver un marché chez les ouvriers d'un autre capitaliste ; de même pour l'économiste politique bourgeois : ses oeillères de classe l'empêchent de voir les problèmes du point de vue du capital social dans son ensemble. Mais dès qu'on l'appréhende de ce point de vue (ce que seul peut faire un théoricien du prolétariat), alors apparaît l'aspect fondamental du problème. Marx l'explique dans les Grundrisse :
« En fait, nous n'avons pas encore à analyser ici le rapport d'un capitaliste vis-à-vis des ouvriers des autres capitalistes. Ce rapport nous révèle les illusions de tout capitaliste, mais ne change absolument rien au rapport entre le capital et le travail. Chacun des capitalistes sait que ses ouvriers ne lui font pas face comme consommateurs dans la production, et s'efforce de restreindre autant que possible leur consommation, c'est-à-dire leur capacité d'échange, leur salaire. Cela ne l'empêche pas, bien sûr, de souhaiter que les ouvriers des autres capitalistes fassent la plus grande consommation possible de ses marchandises. Quoiqu'il en soit, le rapport général fondamental entre le capital et le travail est celui de chacun des capitalistes avec ses ouvriers.
Mais l'illusion propre à chacun des capitalistes privés, en opposition à tous les autres, à savoir qu'en dehors de ses propres ouvriers, toute la classe ouvrière n'est faite que de consommateurs et d'échangistes, de dispensateurs d'argent, et non d'ouvriers, provient de ce que le capitaliste oublie ce qu'énonce Malthus : "L'existence même d'un profit réalisé sur une marchandise quelconque implique une demande autre que celle émanant du travailleur qui l'a produite", et par conséquent "la demande émanant du travailleur productif lui-même ne peut jamais suffire à toute la demande". Etant donné qu'une branche de production en active une autre et gagne ainsi des consommateurs parmi les ouvriers du capital étranger, chaque capitaliste croit à tort que la classe ouvrière, créée par la production elle-même, suffit à tout. Cette demande créée par la production elle-même incite à négliger la juste proportion de ce qu'il faut produire par rapport aux ouvriers: elle tend à dépasser largement leur demande, tandis que, par ailleurs, la demande des classes non ouvrières disparaît ou se réduit fortement, - c'est ainsi que se prépare l'effondrement ». ([11] [98])
Pas plus que la classe ouvrière, prise dans son ensemble, ne peut constituer un marché adéquat pour la production capitaliste, le problème ne peut être non plus résolu par la vente des produits entre capitalistes :
« Si l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger et consommer leurs marchandises entre eux, on perd de vue la nature foncière du système capitaliste et l'on oublie qu'il s ‘agit de faire fructifier le capital, et non de le consommer ». ([12] [99])
Puisque le but du capital est l'accroissement de la valeur, la reproduction de la valeur sur une échelle toujours plus vaste, il a besoin d'un marché toujours plus grand, « l'extension du champ extérieur de la production » ([13] [100]) ; c'est pourquoi, dans sa phase ascendante, le capitalisme a été poussé à conquérir le globe et à soumettre des parties de plus en plus importantes de celui-ci à ses lois. Mais Marx était tout à fait conscient du fait que ce processus d'expansion ne pourrait se poursuivre à l'infini : la production capitaliste allait se heurter aux limites du marché, dans un sens à la fois géographique et social ; alors, ce que Ricardo et d'autres refusaient d'admettre, deviendrait évident : « ...le mode de production bourgeois constitue une limite pour le libre développement des forces productives, limite qui se manifeste dans les crises et, entre autres, dans la surproduction - phénomène de base des crises ». ([14] [101])
Tout en étant contraints de nier la réalité de la surproduction, les économistes bourgeois n'en étaient pas moins troublés par une autre contradiction fondamentale contenue dans la production capitaliste : la tendance du taux de profit à chuter. Marx situait les origines de cette tendance dans la nécessité impérieuse pour les capitaux de se faire concurrence, de révolutionner constamment les moyens de production, c'est-à-dire d'accroître la composition organique du capital, le rapport entre le travail mort - incarné par les machines et qui ne produit pas de nouvelle valeur - et le travail vivant du prolétariat.
Les conséquences contradictoires d'un tel « progrès » sont ainsi résumées :
« ...il est de la nature du mode de production capitaliste que, au cours de son évolution, le taux moyen général de la plus-value se traduise nécessairement par une baisse du taux de profit général. La masse de travail vivant utilisé diminue continuellement par rapport à la masse de travail matérialisé qu'elle met en mouvement, c'est-à-dire par rapport aux moyens de production consommés de façon productive; il s'ensuit que la fraction non payée de ce travail vivant, matérialisée dans la plus-value, doit décroître sans cesse par rapport à la valeur du capital total investi. Or, ce rapport entre la masse de la plus-value et la valeur du capital total investi constitue le taux de profit; celui-ci doit donc baisser continuellement ». ([15] [102])
Ce qui, dans ce phénomène, inquiétait les économistes bourgeois les plus sérieux, tels que Ricardo, c'était sa nature inéluctable, le fait que « ...le taux de profit est le moteur de la production capitaliste » et que « sa baisse ... apparaît ainsi comme une menace pour le développement du processus de production capitaliste », parce que de nouveau ceci implique que « le mode de production capitaliste » n'est pas un absolu, mais qu'il « se crée lui-même une barrière ». « Et cette limite particulière démontre le caractère étroit, simplement historique et transitoire, du mode de production capitaliste ». ([16] [103])
Le travail inachevé de Marx
Le capital est nécessairement un travail inachevé. Non seulement parce que Marx n'a pas vécu assez longtemps pour le terminer, mais aussi parce qu'il a été écrit dans une période historique durant laquelle les rapports sociaux capitalistes n'étaient pas encore devenus une entrave définitive au développement des forces productives. Et ce n'est sûrement pas sans rapport avec le fait que lorsqu'il définit l'élément fondamental de la crise capitaliste, Marx insiste tantôt sur le problème de la surproduction, tantôt sur la baisse tendancielle du taux de profit, tout en n'établissant jamais de séparation mécanique et rigide entre les deux : par exemple, le chapitre du 3e volume, dédié aux conséquences de la baisse du taux de profit, contient également certains des passages les plus clairs sur le problème du marché. Néanmoins, cette brèche, ou cette contradiction apparente, dans la théorie de la crise de Marx, a amené, dans la période de déclin du capitalisme, à l'émergence, au sein du mouvement révolutionnaire, de théories différentes sur les origines de ce déclin. Il n'est pas surprenant de les retrouver sous deux rubriques principales : celle qui se base sur le travail de Rosa
Luxemburg, et insiste sur le problème de la réalisation de la plus-value, et celle qui découle des travaux de Grossman et Mattick, et met en évidence la baisse du taux de profit.
Ce n'est pas le lieu d'examiner ces théories de façon détaillée ; nous avons commencé à le faire ailleurs ([17] [104]). Nous nous contenterons ici de répéter pourquoi, selon nous, l'approche de Luxemburg est la plus cohérente.
D'un point de vue « négatif », c'est parce que la théorie de Grossman-Mattick, qui nie le caractère fondamental du problème de la réalisation, semble régresser vers les idées des économistes politiques bourgeois que Marx avait dénoncées parce qu'elles soutenaient que la production capitaliste créait un marché suffisant pour elle-même. En même temps, ceux qui adhèrent à la théorie de Grossman-Mattick ont souvent recours aux arguments d'économistes révisionnistes comme Otto Bauer que Luxemburg ridiculise dans son Anti-critique. Selon eux, les schémas mathématiques abstraits de Marx sur la reproduction élargie dans le 2e volume du Capital « résoudraient » le problème de la réalisation et toute l'approche de Rosa Luxemburg se résumerait à une simple incompréhension, à un non-problème.
D'un point de vue plus positif, l'approche de Luxemburg fournit une explication des conditions historiques concrètes qui déterminent l'ouverture de la crise permanente du système : plus le capitalisme intègre à lui-même les aires d'économie non-capitaliste restantes, plus il crée un monde à sa propre image, moins il peut étendre son marché de façon permanente et trouver de nouveaux débouchés pour la réalisation de cette partie de la plus-value qui ne peut être réalisée ni par les capitalistes, ni par le prolétariat. L'incapacité du système à continuer de s'étendre comme auparavant a ouvert la nouvelle époque de l'impérialisme et des guerres impérialistes qui ont constitué le signal de la fin de la mission historique progressiste du capitalisme, menaçant l'humanité de retourner dans la barbarie. Tout cela, comme nous l'avons vu, s'intègre pleinement au «problème » du marché tel que Marx le pose dans sa critique de l'économie politique.
En même temps, alors que l'approche de Grossman-Mattick, du moins sous sa forme pure, nie carrément cette question, la méthode de Luxemburg nous permet de voir comment le problème de la baisse du taux de profit devient de plus en plus aigu une fois que le marché mondial ne trouve plus de champ d'expansion : si le marché est saturé, il n'y a plus de possibilité de compenser la chute du taux de profit, c'est-à-dire la quantité décroissante de valeur contenue dans chaque marchandise, par une augmentation de la masse de profit, c'est-à-dire en produisant et en vendant plus de marchandises; au contraire, une telle tentative ne fait qu'exacerber le problème de la surproduction. Il devient ici évident que les deux contradictions essentielles mises à nu par Marx agissent l'une sur l'autre et s'aggravent l'une l'autre, approfondissant la crise et la rendant toujours plus explosive.
« Les crises du marché mondial doivent être comprises comme regroupant réellement et égalisant violemment toutes les contradictions de l'économie bourgeoise ». ([18] [105]) C'est certainement vrai du désastre économique qui a ravagé l'ordre capitaliste ces vingt-cinq dernières années. Malgré tous les mécanismes que le capitalisme a mis en place en vue de repousser la crise, pour tricher en fait avec les conséquences de ses propres lois (les montagnes de dettes, l'intervention de 1’Etat, la mise en place d'organismes de commerce et de taxations à l'échelle mondiale, etc), cette crise porte toutes les marques de la crise de surproduction, révélant comme jamais auparavant l'absurdité et l'irrationalité véritables du système économique de la bourgeoisie.
Dans cette crise, nous sommes confrontés, à un degré bien plus élevé que par le passé, au contraste insensé entre l'immense potentiel de richesses et de jouissance promis par le développement des forces productives, et la misère et les souffrances réelles induites par les rapports sociaux de production. Techniquement parlant, assez de nourriture et un logement adéquat pourraient être fournis au monde entier : au lieu de cela, des millions d'êtres humains meurent de faim pendant qu'on jette la nourriture dans les océans, que les fermiers sont payés pour ne pas produire et que d'inimaginables ressources financières et scientifiques sont dépensées dans les abîmes de la production militaire et de guerre ; des millions sont sans logis tandis que les ouvriers de la construction sont jetés au chômage ; des millions sont forcés de travailler de plus en plus dur, durant des journées de plus en plus longues, afin de répondre aux besoins de la concurrence capitaliste, alors que des millions supplémentaires sont rejetés du travail dans l'inactivité et la pauvreté du chômage. Et tout cela parce qu'il y a une folle épidémie de surproduction. Non pas, comme le souligne Marx, de surproduction par rapport aux besoins, mais de surproduction par rapport à la capacité de payer.
« Ce n'est pas qu'on produise trop de moyens de subsistance par rapport à la population existante ; bien au contraire, la production est insuffisante pour satisfaire de façon normale et humaine les besoins de la masse de la population... En revanche, trop de moyens de travail et de subsistance sont produits périodiquement pour qu'on puisse les faire fonctionner comme moyens d'exploitation des ouvriers à un certain taux de profit. Il est produit trop de marchandises pour qu'on puisse réaliser et reconvertir en capital nouveau la valeur et la plus-value qui s y trouvent contenues... dans les conditions de répartition et de consommation de la production capitaliste... Il n'est pas produit trop de richesse. Mais périodiquement, il est produit trop de richesse dans les formes antagonistes du capital ». ([19] [106])
Bref, la crise de surproduction qui ne peut plus être atténuée par une nouvelle expansion du marché, met à nu le fait que les forces productives ne sont plus compatibles avec leur « enveloppe » capitaliste et que cette enveloppe doit être «mise en pièces ». Le fétichisme de la marchandise, la tyrannie du marché doivent être dépassés par la classe ouvrière révolutionnaire, seule force sociale capable de prendre la direction des forces productives existantes et de les orienter vers la satisfaction des besoins humains.
Le communisme : une société sans échange
Les définitions du communisme dans les travaux théoriques de Marx « mûr » sont posées à deux niveaux qui sont en lien l'un avec l'autre. Le premier découle logiquement de la critique du fétichisme de la marchandise, d'une société dominée par des forces mystérieuses, non humaines et prise dans les terribles conséquences de ses contradictions internes. C'est en fait la tentative de Marx de concrétiser un projet qu'il avait déjà annoncé dans La question juive en 1843 : le fait que l'émancipation de 1’humanité nécessite que l'homme reconnaisse et organise ses propres pouvoirs sociaux au lieu d'être dominé par eux. Il expose donc à grands traits la solution aux insolubles contradictions de la société marchande : une forme fondamentalement simple d'organisation sociale où les divisions basées sur la propriété privée ont été dépassées, où la production est faite en fonction des besoins et non du profit et où le calcul du temps de travail à réaliser, au lieu d'être conçu comme une torture à chaque ouvrier individuel et à la classe ouvrière dans son ensemble, est seulement déterminé en fonction de la quantité de travail social qui doit être dépensé à la production de tel ou tel ordre de besoins :
« La vie sociale, dont la production matérielle et les rapports qu'elle implique forment la base, ne sera dégagée du nuage mystique qui en voile l'aspect, que le jour où s'y manifestera l’œuvre d'hommes librement associés, agissant consciemment et maîtres de leur propre mouvement social »
« Représentons-nous enfin une réunion d'hommes libres travaillant avec des moyens de production communs, et dépensant, d'après un plan concerté, leurs nombreuses forces individuelles comme une seule et même force de travail social. Tout ce que nous avons dit du travail de Robinson se reproduit ici, mais socialement et non individuellement. Tous les produits de Robinson étaient son produit personnel et exclusif et conséquemment objets d'utilité immédiate pour lui. Le produit total des travailleurs unis est un produit social. Une partie sert de nouveau comme moyen de production et reste sociale ; mais l'autre partie est consommée, et, par conséquent, doit se répartir entre tous. Le mode de répartition variera suivant l'organisme producteur de la société et le degré de développement historique des travailleurs. Supposons, pour mettre cet état de choses en parallèle avec la production marchande, que la part accordée à chaque travailleur soit en raison de son temps de travail. Le temps de travail jouerait ainsi un double rôle. D'un côté sa distribution dans la société règle le rapport exact des diverses fonctions aux divers besoins ; de l'autre, il mesure la part individuelle de chaque producteur dans le travail commun, et en même temps la portion qui lui revient dans la partie du produit commun réservée à la consommation. Les rapports sociaux des hommes dans leurs travaux et avec les objets utiles qui en proviennent restent ici simples et transparents dans la production aussi bien que dans la distribution ». ([20] [107])
Bien que toutes ces caractéristiques paraissent simples et transparentes, évidentes même, il a été à maintes reprises nécessaire que les marxistes insistent sur cette définition minimale d'une société communiste, contre tous les faux « socialismes » qui ont hanté si longtemps le mouvement ouvrier. Dans les Grundrisse, par exemple, il y a une longue polémique contre les fantaisies proudhoniennes sur un socialisme basé sur un échange égalitaire, un système où l'ouvrier serait payé totalement pour la valeur de son produit, et où la monnaie serait remplacée par une sorte de non-monnaie pour mesurer cet échange. Contre cela, Marx dit à la fois qu'il est impossible d'abolir la monnaie tant que la valeur d'échange demeure la forme sociale prise par les produits, et que, dans une véritable société communiste, « d'emblée le travail de l'individu y est posé comme travail social. Quelle que soit donc la forme matérielle et particulière du produit qu'il crée ou contribue à créer, ce qu'il achète avec son travail, ce n'est pas tel ou tel produit, mais une participation déterminée à la production collective. Il n'a donc pas à échanger ici de produit particulier : son produit n'est pas une valeur d'échange ». ([21] [108])
Quand Marx à son époque écrivait « qu'il est absolument faux de penser, comme le font certains socialistes, que nous avons besoin du capital et non des capitalistes » ([22] [109]), il se référait à des éléments confus du mouvement ouvrier. Mais dans la période de décadence du capitalisme, de telles idées ne sont pas simplement fausses ; elles sont devenues une partie de l'arsenal de la contre-révolution. L'une des caractéristiques distinctives de l'ensemble de la gauche .du capital, depuis les partis « socialistes » en passant par les staliniens jusqu'aux trostskystes les plus radicaux, c'est que tous identifient le socialisme à une société capitaliste sans capitalistes privés, un système où le capital a été nationalisé, le travail salarié étatisé et où la production de marchandises continue de régner, et si ce n'est au niveau de chaque unité nationale, alors au niveau mondial, en tant que rapport entre les différentes « nations socialistes ». Naturellement, comme nous l'avons vu avec le système stalinien du défunt bloc de 1`Est, un tel système n'évite en aucune façon les contradictions fondamentales du capital et est condamné à s'effondrer, au même titre que les variantes plus classiques de la société bourgeoise.
Le règne de la liberté
Jusqu'ici, Marx a décrit les soubassements matériels de la liberté communiste, ce qui lui est fondamentalement pré-requis :
« Dans ce domaine, la liberté ne peut consister qu'en ceci : les producteurs associés - l'homme socialisé - règlent de manière rationnelle leurs échanges organiques avec la nature et les soumettent à leur contrôle commun au lieu d'être dominés par la puissance aveugle de ces échanges; et ils les accomplissent en dépensant le moins d'énergie possible, dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. Mais l'empire de la nécessité n'en subsiste pas moins. C'est au-delà que commence l'épanouissement de la puissance humaine qui est sa propre fin, le véritable règne de la liberté qui, cependant, ne peut fleurir qu'en se fondant sur ce règne de la nécessité. » ([23] [110])
Le vrai but du communisme n'est donc pas une liberté négative par rapport à la domination de lois économiques arbitraires, mais la liberté positive de développer les potentialités humaines au maximum et pour elles-mêmes. Comme on l'a noté auparavant, ce projet d’une portée considérable était annoncé par Marx dès ses premiers écrits, en particulier dans les Manuscrits économiques et philosophiques, et il n'en a dévié à aucun moment de son travail ultérieur.
Le passage qu'on vient de citer, est précédé d'une prise de position qui dit que « le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité et les fins extérieures ; il se situe donc, par sa nature même, au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite » ([24] [111]). C'est vrai dans la mesure où l'énorme développement de la productivité du travail sous le capitalisme, l'automatisation de la production (que Marx entrevoit clairement dans de nombreux passages des Grundrisse) rendent possible de réduire au minimum la quantité de temps et d'énergie consacrée à des tâches répétitives et sans intérêt. Mais lorsque Marx commence vraiment à examiner le contenu de l'activité humaine caractéristique de l'humanité communiste, il reconnaît qu'une telle activité dépassera toute séparation rigide entre le temps libre et le temps de travail :
« Au demeurant, il tombe sous le sens que le temps de travail immédiat ne pourra pas toujours être opposé de manière abstraite au temps libre, comme c'est le cas dans le système économique bourgeois. Le travail ne peut pas devenir un jeu comme le veut Fourier, qui eut le grand mérite d'avoir proclamé comme fin ultime le dépassement, dans une forme supérieure, non point du mode de distribution mais de production. Le temps libre - qui est à la fois loisir et activité supérieure - aura naturellement transformé son possesseur en un sujet différent, et c'est en tant que sujet nouveau qu'il entrera dans le processus de la production immédiate. Par rapport à l'homme en formation, ce processus est d'abord discipline ; par rapport à l'homme formé, dont le cerveau est le réceptacle des connaissances socialement accumulées, il est exercice, science expérimentale, science matériellement créatrice et réalisatrice. Pour l'un et l'autre, il est en même temps effort, dans la mesure où, comme en agriculture, le travail exige la manipulation pratique et le libre mouvement ». ([25] [112])
Aussi, si Marx critique Fourier lorsque ce dernier pense que le travail peut devenir « une simple joie, un simple jeu » (une incompréhension reprise par les successeurs de Fourier, comme les situationnistes, qui abondent à la marge du mouvement révolutionnaire), il offre au contraire un but non pas plus gris ou plus banal, mais bien plus passionnant par sa portée, mettant en évidence que « le renversement de ces obstacles constitue en soi une affirmation de liberté (..) les fins extérieures perdent leur apparence de nécessité naturelle, posées et imposées comme elles sont par l'individu lui-même : (…c’est) la réalisation de soi, l’objectivisation du sujet, donc sa liberté concrète, qui s’actualise précisément dans le travail ». ([26] [113])
Et de nouveau : « Les travaux vraiment libres, la composition musicale par exemple, c'est diablement sérieux, cela exige même l'effort le plus intense ». ([27] [114])
Vision mondiale de la première classe travailleuse à être révolutionnaire et reconnaissant le travail comme la forme d'activité spécifiquement humaine, le marxisme ne peut envisager que les êtres humains trouvent une satisfaction réelle dans un simple « loisir » conçu dans une opposition abstraite vis-à-vis du travail ; il affirme donc que l'humanité se réalisera véritablement sous la forme de la création active, dans une fusion inspirée de travail, de science et d'art.
Dans la prochaine partie de cette série, nous suivrons le « retour » de Marx du monde abstrait des études économiques au monde pratique de la politique, dans la période qui a culminé dans la première révolution prolétarienne de l'histoire, la Commune de Paris. Ce faisant, nous retracerons le développement de la compréhension marxiste du problème politique par excellence : le problème de l'Etat et comment s'en débarrasser.
CDW.
[1] [115] Voir la Revue Internationale n°75.
[2] [116] Lettre à Meyer, 30 avril 1867
[3] [117] Lettre à Becker, 17 avril 1867.
[4] [118] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 7e section, « La formule trinitaire».
[5] [119] Livre I du Capital, chapitre I, Edition Garnier Flammarion.
[6] [120] Ibid., chapitre XXXII.
[7] [121] Ibid.
[8] [122] Ibid.
[9] [123] Théories sur la Plus-Value, chapitre XVII, Editions sociales, Tome II.
[10] [124] Ibid.
[11] [125] Grundrisse, «Chapitre du Capital », Edition 1018.
[12] [126] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 3e section, « Conclusions ».
[13] [127] Ibid.
[14] [128] Théories sur la Plus-Value, Chapitre XVII, Ed. sociales, Tome II.
[15] [129] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 3e section, « Définition de la loi».
[16] [130] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome 11, 3e section, «Conclusions ».
[17] [131] Voir en particulier l'article « Marxisme et théorie des crises» dans la Revue Internationale n°13
[18] [132] Théories sur la Plus- Value, Chapitre XVII, Ed. sociales, Tome II.
[19] [133] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, 3e section, « Les contradictions internes ».
[20] [134] Livre I du Capital, chapitre I, Ed. Garnier Flammarion. Nous reviendrons dans un autre article sur la question du temps de travail comme moyen de mesure de la consommation individuelle. Mais notons qu'ici, ce n'est plus le temps de travail qui domine le travailleur et la société ; la société l'utilise de façon consciente comme moyen de planifier la production et la distribution rationnelles des valeurs d'usage. Et, comme Marx le montre dans les Grundrisse, ce n'est certainement plus en termes de temps de travail qu'elle mesure sa richesse réelle, mais en termes de temps libre.
[21] [135] Grundrisse, « Chapitre de l'Argent », Ed. 10-18.
[22] [136] Principes d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, Tome II, Chapitre III, « Manufacture et capital ».
[23] [137] Livre III du Capital, Ed. La Pléiade, Tome II, Fragments, « En manière de conclusion».
[24] [138] Ibid.
[25] [139] Principes d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, Tome II, chapitre II, «Machinisme, science et loisir créateur »,.
[26] [140] Principes d'une critique de l'économie politique, Ed. La Pléiade, Tome II, Chapitre II, « Le travail comme sacrifice et le travail libre ».
[27] [141] Ibid.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [143]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 77 - 2e trimestre 1994
- 2731 lectures
Situation internationale : Les grandes puissances impérialistes sont les fauteurs de guerre
- 3244 lectures
Les grandes puissances impérialistes sont les fauteurs de guerre dans l'ex-Yougoslavie, tout comme dans le reste du monde
L'hiver, et particulièrement le mois de février 1994, a vu la guerre impérialiste en Yougoslavie passer à un stade supérieur, plus dramatique, aux enjeux plus élevés encore pour le monde capitaliste, avec le massacre du marché de Sarajevo et l'intervention militaire directe des Etats-Unis et de la Russie. Mais la folie guerrière et les conflits régionaux gagnent aussi toute la planète : les anciennes Républiques méridionales et orientales de l'ex-URSS, le Moyen-Orient, l'Afghanistan, le Cambodge, l'Afrique.
En même temps, la crise économique étend et aggrave ses ravages sur des milliards d'êtres humains. Là aussi, l'impasse, la catastrophe et la perspective d'une chute dramatique dans la misère gagnent toute la planète, ce qui ne pourra qu'alimenter encore plus les conflits et les guerres.
Le capitalisme mène le monde à la désolation et à la destruction. La guerre dans l'ex-Yougoslavie n'est pas une guerre d'un autre temps, du passé, ni d'une période transitoire, le prix à payer pour la fin du stalinisme, mais bel et bien une guerre impérialiste d'aujourd'hui, de la situation qui fait suite à la disparition du bloc de l'Est et de l'URSS. Une guerre de la phase de décomposition du capitalisme décadent. Une guerre qui est l'annonce du seul devenir que peut offrir le capitalisme à l'ensemble de l'humanité.
Au bas mot 200 000morts -combien de blessés, d'invalides ? - tel est le tribut payé par la population en Bosnie et dans l'ex-Yougoslavie aux nationalismes et aux intérêts impérialistes. Les vies déchirées, « la purification ethnique » massive, les familles chassées de chez elles et déportées dont les membres sont séparés - se reverront-ils un jour ? - voilà la réalité du capitalisme. Il faut dénoncer la terreur exercée par chaque camp, par des milices et une soldatesque ivres de sang, de viols, de tortures. Il faut dénoncer la terreur qu'exercent les Etats bosniaque, serbe et croate, sur les réfugiés dont on exige la mobilisation forcée dans les différentes armées, sous peine de mort en cas de désertion. Et bien sûr, dénoncer la misère et la faim, crier son horreur devant les vieillards réduits à la mendicité, assassinés par un « snipper » parce qu'ils ne courent pas assez vite, devant ces parents partis chercher du ravitaillement et déchiquetés par les obus qui tombent aveuglement, devant les enfants traumatisés à vie dans leur chair et dans leur coeur. Il faut dénoncer la barbarie du capitalisme. Il est responsable de ces tragédies.
Il faut dénoncer aussi, dans cette folie guerrière, dans cette barbarie dont la population ne voit pas la fin, les nouvelles « valeurs », les nouveaux « principes », qui émergent du « nouvel ordre mondial » que la bourgeoisie nous avait promis après la chute du mur de Berlin : le chaos et le chacun pour soi. Les retournements d'alliance, la trahison, sont la règle : à peine signés, les accords de cessez-le-feu sont systématiquement bafoués ; les Bosniaques, les Croates, et les Serbes, se sont tour à tour alliés avec l'un contre l'autre, pour ensuite se retourner contre l'allié de la veille. Les Croates et les Bosniaques se sont entre massacrés à Mostar sous l'oeil bienveillant des miliciens serbes alors qu'ils s'opposaient ensemble aux Serbes à Sarajevo. Jusqu'aux « Musulmans » de l'enclave de Bihac qui se sont entre-tués alors qu'ils étaient encerclés !
Une fois terminé le conflit actuel, s'il doit se terminer un jour, jamais la situation d'avant-guerre ne pourra revenir. Les Etats qui subsisteront seront dévastés et ne pourront se relever dans une situation de crise économique mondiale. Même si les bourgeoisies locales ne pouvaient y échapper, et n'y ont pas échappé, aveuglées par leur propre nationalisme, par les différents intérêts particuliers, par le « chacun pour soi », la guerre en Yougoslavie ne débouchera pas sur des Etats renforcés et viables. Tout au plus certains seigneurs de la guerre, certains roitelets locaux, vont pouvoir jouir de leur pouvoir et de leur racket, jusqu'à ce qu'un rival vienne les supplanter. C'est ce qui s'est passé au Liban, en Afghanistan, au Cambodge. C'est ce qui se passe en Géorgie, en Palestine, au Tadjikistan, et ailleurs. La Yougoslavie s'est « libanisée » à son tour.
L'INTERVENTION IMPERIALISTE DES GRANDES PUISSANCES EST RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DE LA GUERRE ET DE SON AGGRAVATION
Si l'explosion de la Yougoslavie tenait directement des effets de la décomposition, l'impérialisme a trouvé dans cette même décomposition généralisée, et en Yougoslavie même, un terrain fertile à son action funeste. A l'origine, c'est l'Allemagne qui a poussé les Slovènes et les Croates à l'indépendance. Et ce sont les Etats-Unis et la France, entres autres, qui ont appuyé, à l'époque, les Serbes pour qu'il réagissent et donnent une leçon à la Croatie, et à l'Allemagne.
« Il n'y pas de soutien désintéressé, dès que le problème de la Bosnie est devenu le problème des Balkans, il s'est transformé en un problème de rapport de forces politiques, et les intérêts des grandes puissances ont pris le pas sur la réalité du conflit. » ([1] [145])
Aujourd'hui, deux ans d'interventions directes, militaires et diplomatiques, des grandes puissances dans le conflit, sous couvert de l'ONU et de l'OTAN, et si besoin était encore, les derniers événements de février, la menace de frappes aériennes, l'envoi de casques bleus russes, les chasseurs F16 de l'OTAN abattant des avions serbes, révèlent clairement, sans ambiguïté, le caractère impérialiste du conflit où les grandes puissances défendent leurs intérêts les unes contre les autres : « Une politique internationale effective continue d'être contrecarrée par les intérêts rivaux des principales puissances européennes. Avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie protégeant effectivement les Serbes, et les Etats-Unis faisant ce qu'ils peuvent en faveur du gouvernement musulman, ceux-ci mettent maintenant la pression sur la troisième partie en lutte, les Croates, dont le protecteur traditionnel, l'Allemagne, trouve peu politique de se dresser contre les autres puissances. » ([2] [146])
Il y a longtemps que le masque de « l'humanitaire » est tombé. La presse bourgeoise internationale, on vient de le voir, ne l'évoque plus. Du coup apparaît au grand jour la nature et l'objectif des grandes proclamations des pacifistes et autres « humanistes » du monde bourgeois qui appelaient à sauver la Bosnie, à arrêter le massacre. Ils ont servi durant deux ans à essayer de mobiliser les populations, et particulièrement la classe ouvrière des grandes puissances industrialisées, derrière les interventions militaires, derrière l'impérialisme de leur propre bourgeoisie nationale. Une fois de plus, les grands pacifistes, qu'ils soient « philosophes », écrivains, artistes, curés, ou (h écologistes, se sont révélés, avec leur double langage, comme de dangereux va-t-en-guerre au service de l'impérialisme.
Les Etats-Unis a la contre-offensive
Depuis la guerre du Golfe où les Etats-Unis avaient fait la démonstration éclatante de leur leadership mondial, la bourgeoisie américaine a vécu de sérieuses déconvenues, un échec même, en Yougoslavie. D'abord incapables de s'opposer au démembrement de cette dernière, et donc à l'indépendance de la Croatie qui manifestait une ouverture et une avancée pour l'Allemagne, les Etats-Unis se sont appuyés sur la Bosnie pour avoir un point d'ancrage dans la région. Mais là, ils se sont révélés incapables de garantir l'intégrité et l'unité de ce nouvel Etat malgré leur puissance. Résultat : une Slovénie et une Croatie indépendantes sous influence allemande, une Serbie sous influence française d'abord, et aujourd'hui surtout russe, une Bosnie démantelée, un Etat-croupion sur lequel il était difficile de s'appuyer. Le bilan était négatif pour la première puissance impérialiste mondiale. Les Etats-Unis ne pouvaient rester sur un échec qui mettait en cause leur « crédibilité » et leur leadership et les affaiblissait aux yeux du monde. Les Etats-Unis ne pouvaient rester sur un échec qui allait encourager encore plus les grands rivaux impérialistes, européens et japonais, et les petits impérialismes des pays « secondaires », à s'affirmer et à remettre en cause le « nouvel ordre mondial » américain.
Impuissants dans les Balkans, leur contre-offensive s'est développée autour de deux axes au niveau mondial : leur intervention en Somalie et au Moyen-Orient avec l'ouverture - au prix de l'action militaire meurtrière d'Israël au Liban en juillet 1993 - des négociations de paix entre l'Etat Hébreu et l'OLP ([3] [147]). Ils faisaient la preuve de leur capacité militaire et diplomatique, de leur capacité à « régler des conflits » ce qui, parallèlement, mettait en évidence... l'incapacité des Européens à régler la guerre en Bosnie. D'autant que les Etats-Unis faisaient tout pour saboter les différents plans de partition au profit des Serbes, que mettaient en avant les Européens : en poussant le gouvernement bosniaque à l'intransigeance et en réarmant son armée. Ce qui a permis à celle-ci de reprendre l'offensive contre les Serbes et les Croates durant l'hiver.
Cependant, cela ne pouvait suffire à faire regagner le terrain perdu à la première puissance mondiale, à effacer l'impression d'affaiblissement. Certes, elle réussissait à bloquer l'action des Européens, les négociations de paix en particulier, mais sans pouvoir reprendre l'initiative. A force, la poursuite sanglante du conflit commençait à atteindre, par ricochet, encore plus la «crédibilité» des Etats-Unis eux-mêmes. Le massacre du marché de Sarajevo est venu à point pour relancer la donne du jeu impérialiste.
Alors que Clinton justifiait l'absence d'intervention militaire aérienne américaine par le refus des Français et des Britanniques, des voix de plus en plus nombreuses de l'appareil d'Etat américain poussaient à l'action : « Nous continuerons à avoir un problème de crédibilité si nous n'agissons pas » lui a répondu Tom Foley ([4] [148]), « Speaker » à la Chambre des Représentants. On le voit, Tom Foley est plus soucieux de la crédibilité militaire des Etats-Unis que des considérations « humanitaires » qui sont avancées au « prime time » des télévisions à l'usage des populations et de la classe ouvrière.
L'ultimatum de l'OTAN redonne l'initiative aux Etats-Unis
L'ultimatum de l'OTAN qui a fait suite au carnage du marché de Sarajevo, a sanctionné l'impuissance européenne, de la France et de la Grande-Bretagne en particulier, obligées d'approuver les frappes aériennes qu'elles avaient toujours refusées et sabotées depuis le début du conflit. Il manifestait la prépondérance de l'OTAN, dont les Etats-Unis sont les maîtres, sur l'ONU et les casques bleus sur place, où le poids de la France et de la Grande-Bretagne était plus grand. Le retrait des canons serbes, obtenu par la menace aérienne de l'OTAN a été un succès pour les Etats-Unis. L'ultimatum leur a permis de reprendre l'initiative, d'avoir un pied dans la place, tant au plan militaire que diplomatique. Néanmoins, ce succès restait encore limité. Il n'était qu'un premier pas. Il ne gommait pas le recul des mois précédents, en particulier la partition de la Bosnie.
« Les gouvernements européens ont joué un rôle cynique. (...) Les Européens voulaient utiliser le bombardement de Sarajevo et d'autres villes, pour faire pression sur le gouvernement bosniaque afin qu'il accepte un mauvais plan de partition qui leur dénie tout territoire vital et toutes routes de commerce. S'ils acceptent maintenant de souscrire aux frappes aériennes de l'OTAN contre les canons des assiégeants, ils attendent au moins en retour que Washington se joigne à leur manoeuvre diplomatique au moment même où le gouvernement bosniaque a commencé à retrouver une force militaire et à récupérer certaines de ses pertes initiales. » ([5] [149])
Par ailleurs, la démonstration de force américaine était amoindrie par un retrait des Serbes en traînant les pieds et la protection que leur a fournie l'arrivée de casques bleus russes. «L'alliance (l'OTAN) n'a pas fait ses preuves. Et l'on continuera à douter de sa volonté et de sa capacité. » ([6] [150]). L'aviation américaine allait essayer de corriger quelque peu cette mauvaise impression, en abattant quatre avions serbes qui survolaient le territoire bosniaque malgré l'interdiction qui leur en était faite, et alors que près de mille infractions avaient été relevées auparavant, sans provoquer de réaction de l'OTAN. La « crédibilité » des Etats-Unis leur imposait de saisir la bonne occasion au bon moment pour eux. Ils l'ont saisie.
Après l'ultimatum, les Etats-Unis mettent les Européens sur la touche
Le retour en force des Etats-Unis s'est concrétisé par la signature de l'accord croato-musulman. Dès le début du mois de février, la pression des Etats-Unis s'est faite sentir sur la Croatie: « Il est temps maintenant de faire payer la Croatie, économiquement et politiquement. » ([7] [151]), la menace avant le chantage. Ce que les Croates ont compris tout de suite, comme en témoigne le limogeage du chef croate de Bosnie ultra-nationaliste, Mate Boban, et son remplacement par quelqu'un de plus « raisonnable » et de plus contrôlable. Après la menace est venue le « deal », le marché, et la proposition : « Le seul moyen pour que la Croatie puisse obtenir un soutien international pour réclamer la Krajina est de reformer son alliance avec la Bosnie. » ([8] [152])
Est-il besoin de souligner que cette nouvelle alliance sous l'égide américaine qui promet à la Croatie la récupération de la Krajina occupée par les Serbes, est directement dirigée contre ceux-ci ? Un pas vers la « paix » qui est porteur d'une aggravation encore plus terrible de la guerre, tant au plan « quantitatif» - l'embrasement de toute l'ex-Yougoslavie-, qu'au plan «qualitatif» si l'on ose dire - une guerre « totale » entre les armées régulières de Serbie et de Croatie.
A l'heure où nous écrivons, l'accord entre Croates et Bosniaques n'a pas éteint les affrontements autour de Mostar en particulier. Mais pour sûr, c'est un succès pour les Etats-Unis dans la mesure où les pays européens, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui sont obligées de « saluer » l'initiative, la voient d'un très mauvais oeil. Exit les négociations de Genève sous l'égide de l'Union Européenne. L'accord vient confirmer et leur impuissance et leur mise sur la touche, au moins pour le moment. La signature de l'accord à Washington même, la photo de Warren Cristopher, le Secrétaire d'Etat américain, debout derrière les signataires, est une douce revanche pour la bourgeoisie américaine après plus de deux ans de pieds de nez européens: «L'Europe en tant que principal arbitre de la crise yougoslave a fait son temps. » ([9] [153])
l'agressivite imperialiste de la Russie
Le retour en force de la Russie « dans le concert des nations », sa ferme opposition à l'ultimatum de l'OTAN, puis le succès de sa diplomatie qui sauve la face des Serbes « en obtenant» le recul de leur artillerie des hauteurs de Sarajevo, l'envoi de casques bleus russes, sont une autre expression de la redistribution des cartes impérialistes depuis le massacre du marché de Sarajevo. Elle marque un réveil de « l'arrogance » impérialiste de la Russie. Cette aspiration à rejouer un rôle de premier plan sur la scène internationale s'était déjà clairement affirmée ces derniers mois.
Jusqu'à présent, l'attitude des Etats-Unis à l'égard de la Russie, était un soutien sans faille à Eltsine, tant sur le plan intérieur contre les fractions staliniennes conservatrices, que sur le plan extérieur. L'intervention russe dans son ancien empire s'est faite avec l'assentiment américain.
Que, dans les ex-républiques soviétiques, la Russie fasse pièce aux aspirations impérialistes de l'Iran « islamiste » et de la Turquie qui penche toujours plus vers l'Allemagne, que la Russie impose à une Ukraine, toujours troisième puissance nucléaire du monde, mais dont l'économie est en pleine déconfiture, ses conditions et donc l'abandon de son flirt avec l'Allemagne, qu'une Russie s alliée s'arroge une zone d'influence sur le territoire de l'ancienne URSS, voilà qui ne pouvait que convenir à la bourgeoisie nord-américaine.
Mais que la Russie ait des visées plus précises sur les pays de l'ex-Pacte de Varsovie, quand elle s'oppose à leur intégration à l'OTAN, voilà qui inquiète les bourgeoisies européennes, l'Allemagne au premier chef, et qui provoque des interrogations au sein même de la bourgeoisie américaine, même si Clinton cède à sa demande en repoussant l'adhésion. Que la Russie enfin accède militairement pour la première fois de toute son histoire dans les Balkans, même sous la forme symbolique - mais quel symbole ! - de quelques centaines de casques bleus, c'est-à-dire qu'elle ait franchi un pas important vers la réalisation de cet objectif historique vieux de plusieurs siècles, et jamais atteint, d'une ouverture sur la Méditerranée, voilà qui alerte la bourgeoisie américaine. Car point trop n'en faut. Cette vieille aspiration à la Méditerranée de la part de la Russie, tout comme la même aspiration de la part de l'Allemagne, ne peut être acceptée par les impérialismes américain, britannique et français qui, eux, y sont déjà présents, même avec un Eltsine et des « réformateurs » au pouvoir. « Nous n'avons pas affaire à du noir et du blanc, mais du gris. Il y aura forcément des choses que nous n'aimerons pas » a dit Clinton à propos de la Russie. ([10] [154])
Mais de plus, dans la situation incontrôlable et incontrôlée qui se développe chaque jour un peu plus en Russie, le chaos et l'anarchie qui s'approfondissent, les départs du gouvernement Eltsine des « réformateurs » proaméricains comme Gaïdar, au profit des fractions « conservatrices » de la bourgeoisie russe dont l'esprit ultra-nationaliste et revanchard s'incarne jusque dans les outrances de Jirinowski, ne peuvent qu'alarmer les puissances occidentales. Le risque est réel de voir une Russie incontrôlable, aux mains de néo-staliniens revanchards ou d'un Jirinowski.
Soyons clair, quelle que soit la fraction au pouvoir, ce retour de la Russie au premier plan dans les antagonismes impérialistes, ne signifie pas un retour à la situation de « stabilité » internationale qui avait prévalu de Yalta à la chute du mur de Berlin, et qui avait alimenté tous les conflits impérialistes de l'époque. Il ne signifie pas la réapparition de deux grandes puissances capables d'imposer à leurs protégés respectifs les limites à ne pas dépasser. Il n'y aura pas de retour à la reconstitution d'un bloc impérialiste de l'Est mené par la Russie opposé à un bloc de l'Ouest. Le retour de la Russie, alimenté et dangereusement exacerbé par la situation de chaos dans le pays et la fuite en avant de la bourgeoisie russe, est porteur d'aggravation terrible des tensions et des antagonismes impérialistes, porteur de chaos et de guerres encore plus accentués au plan international.
L'utilisation de l'OTAN (qui avait été créée en 1949 pour faire face à l'URSS) pour imposer aujourd'hui l'ultimatum à la Serbie, a constitué « une gifle magistrale ». Elle a signifié un avertissement à la Russie, à Eltsine bien sûr, mais aussi aux autres fractions de l'appareil d'Etat russe, aux revanchards et aux nostalgiques de la grandeur de l'URSS. «L'ultimatum de l'OTAN, en soi, était déjà suffisamment mortifiant » pour la Russie. ([11] [155]) Les Etats-Unis ont voulu adresser un message clair à leur «partenaire» russe (la presse américaine ne parle plus d'« allié ») : attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Au cas où le message n'aurait pas été bien entendu, l'attaque par l'aviation américaine des avions serbes est venue mettre les points sur les « i ». N’est-ce pas la première fois de son histoire que l'OTAN tire une seule balle en 45 ans d'existence ?
Tout comme cette intervention militaire directe des Etats-Unis en ex-Yougoslavie, l'intervention militaire russe, tout aussi directe, est un nouvel élément d'extrême importance dans la situation internationale. Les deux marquent un pas de plus dans la guerre, un pas de plus dans l'exacerbation ^des tensions impérialistes, un pas de plus dans le chaos et le « tous contre tous », tant dans les Balkans - pauvres populations qui ne sont pas au bout de leurs souffrances -que sur le reste de la scène internationale.
L’EUROPE IMPUISSANTE
Si la nouvelle donne de la situation internationale au plan des rivalités impérialistes s'illustre par le retour en force des impérialismes des Etats-Unis et de la Russie en exYougoslavie, elle est caractérisée aussi par son corollaire : l'impuissance et l'affaiblissement des puissances européennes, tout particulièrement de la France et de la Grande-Bretagne. Celles-ci, qui avaient réussi durant deux ans, à saboter les intentions d'intervention militaire américaine, à narguer ouvertement les Etats-Unis, et à occuper un rôle de premier plan sur les terrains militaire et diplomatique, ont dû ravaler leurs prétentions et se ranger finalement derrière ce qu'elles avaient systématiquement refusé : les frappes aériennes de l'OTAN sur les Serbes. De son côté, l'Allemagne n'a pu qu'assister impuissante à la contre-offensive américaine, qui signifiait certes une pression sur les Serbes dont elle ne pouvait qu'être satisfaite, mais aussi une pression sur la Croatie, son allié, ce dont au contraire, elle ne pouvait se réjouir.
L'avancée allemande est bloquée
En fait, avec les derniers événements, l'Allemagne voit se multiplier les obstacles à son affirmation comme puissance impérialiste « leader », comme pôle impérialiste alternatif aux Etats-Unis. La Russie, avec l'aval américain, tend à lui disputer l'Europe centrale et l'Ukraine. En Yougoslavie, où « l'Autriche, la Croatie et la Slovénie ne peuvent plus compter sur un "leadership" allemand clair» ([12] [156]), l'Allemagne voit les Etats-Unis lui disputer, chose impensable il y a encore deux mois, la Croatie. Incapable qu'elle est de lui offrir ce que les Etats-Unis lui promettent : la Krajina. Elle voit même l'impérialisme américain lui interdire tout rôle réel dans les négociations et dans l'alliance entre les Croates et les Musulmans. Absente sur le terrain, puisqu'elle n'a pas de troupes parmi les soldats de l'ONU, seule grande puissance avec le Japon à ne pas avoir de siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies sur lequel elle ne peut donc peser, et encore moins poser son veto, elle ne peut que jouer en sous-main -elle ne s'en prive pas bien sûr - et assister impuissante, pour l'instant, à la contre-offensive américaine.
Par ailleurs, la nouvelle « arrogance » fusse inquiète l'Allemagne. Car même si celle-ci peut essayer parfois de « flirter » avec la Russie, les deux ayant en commun l'objectif d'accéder à la Méditerranée, sur le long terme, au plan historique, les deux ont aussi des intérêts impérialistes opposés et contradictoires, particulièrement en Europe de l'Est et dans les Balkans. L'Allemagne est donc prise entre son aspiration à devenir une des premières puissances impérialistes, donc à s'affirmer contre les Etats-Unis tout particulièrement, et l'inquiétude d'une Russie chaotique, dont seuls les Etats-Unis peuvent la protéger militairement.
Incapable de suivre la mise américaine, l'impérialisme français est mis hors-jeu
La France, pour qui « le maintien de la coopération politique franco-allemande comme noyau de la Communauté Européenne continue d'être la priorité de la diplomatie française » ([13] [157]) au niveau général et historique, s'est opposée localement à l'avancée allemande en Croatie et vers la Méditerranée. En même temps, elle s'est opposée à toute ingérence américaine. Elle a donc essayé de jouer seule, avec la Grande-Bretagne, ce qui s'est révélé être au-dessus de ses forces.
Ayant perdu l'écoute de la partie Serbe, menacées par l'offensive militaire bosniaque, les négociations de paix sous leur égide paralysées, la France et la Grande-Bretagne étaient dans l'impasse. Situation inconfortable. La bourgeoisie française ayant épuisé ses atouts, en a tiré les conséquences en priant les Etats-Unis et l'OTAN d'intervenir. Incapable de relancer à hauteur de la mise américaine, elle a du se coucher pour pouvoir rester à la table du jeu impérialiste.
Comme lors de la guerre du Golfe. C'est ce que le Président Mitterrand appelle : « tenir son rang ». C'était ça ou être exclue de la table avec perte et fracas.
La Grande-Bretagne sous la pression américaine
Pour la Grande-Bretagne, la contradiction et l'échec ont été à peu près les mêmes. Lieutenant historique des Etats-Unis, leur plus fidèle allié dans les rivalités impérialistes, et hostile, elle aussi, à toute avancée de l'Allemagne dans les Balkans, la bourgeoisie britannique n'en a pas moins, signe des temps, signe du règne croissant du chaos et du chacun pour soi, voulu défendre ses intérêts spécifiques en Yougoslavie, et en particulier ne pas « partager » sa présence politique et militaire dans la région avec la bourgeoisie américaine. La redistribution des cartes qu’a occasionnée le bombardement du marché de Sarajevo et l'ultimatum de l'OTAN, auquel le gouvernement Major s'est déclaré hostile, se sont accompagnés d'une forte pression sur la Grande-Bretagne avant le voyage de son premier ministre à Washington. ([14] [158])
« L'approche à court terme dans le désastre bosniaque orchestré par la Grande-Bretagne, menace de déstabiliser une bonne partie de l'Europe. (...) John Major devrait repartir de Washington sans aucun doute sur le fait que sa politique bosniaque sera étudiée minutieusement et que tout opportunisme supplémentaire qui exacerberait la crise des Balkans, ne sera pas facilement oublié, ni pardonné. » ([15] [159])
Cette pression américaine et la situation difficile dans laquelle la Grande-Bretagne s'est retrouvée en Bosnie, ont imposé à la bourgeoisie britannique de rentrer dans le rang et d'approuver l'ultimatum de l'OTAN (d'autant qu'elle se retrouvait seule depuis l'approbation de la France). Comme le disait The Guardian, «Dans un discours aux Communes, le ministre des Affaires étrangères Douglas Hurd a trahi les motivations cachées de ce revirement. Il a souligné par trois fois la nécessité de rétablir la crédibilité et la solidarité au sein de l'OTAN, et en particulier le soutien des Etats-Unis à cette organisation. » ([16] [160])
Avec l'OTAN, les Etats-Unis imposent aux européens de rentrer dans le rang
Les Etats-Unis viennent avec éclat de réaffirmer à la face du monde leur leadership mondial. Ils ont finalement réussi à refaire le coup de la Guerre du Golfe : faire rentrer dans le giron américain -pour le moins en Yougoslavie et pour le moment en tout cas -les puissances européennes qui voulaient s’en dégager. Et particulièrement, l'Allemagne, la France surtout et des pays (l'Italie, l'Espagne, la Belgique par exemple) qui, bien qu'assumant un rôle secondaire, n'oublient pas de défendre leurs intérêts impérialistes et de jouer la carte européenne, et donc anti-américaine, derrière la France et l'Allemagne. De même, cette impuissance de l'Europe, obligée d'en appeler aux Etats-Unis, prend une signification pour l'ensemble des impérialismes de la planète qui sont poussés d'une manière ou d'une autre à s'élever contre les intérêts américains. C'est une victoire pour la bourgeoisie américaine, une victoire qui porte en elle l'exacerbation des antagonismes impérialistes et des guerres.
VERS L'AGGRAVATION DES TENSIONS IMPERIALISTES ET DU CHAOS
Le succès remporté par les Etats-Unis en ex-Yougoslavie n'est pas encore complet. Ils ne peuvent s'en contenter. L'alliance croato-musulmane qu'ils patronnent, si elle va jusqu'à son terme, va porter l'affrontement avec la Serbie à un niveau supérieur. Les puissances européennes qui viennent de prendre une gifle, ne vont pas manquer de jeter de l'huile sur le feu. Eltsine, poussé par les fractions les plus conservatrices et nationalistes, ne peut qu'accentuer la politique impérialiste de la Russie. Mais pire encore, tous les Etats étant impérialistes, la chaîne des conflits impérialistes entraîne tous les pays dans un processus irréversible et inextricable d'affrontements et d'antagonismes : dans les Balkans, la Grèce, la Macédoine, l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, et la Turquie ; en Asie ex-soviétique, la Turquie, la Russie et l'Iran ; en Afghanistan, la Turquie, l'Iran et le Pakistan ; au Cachemire, le Pakistan doté de l'arme atomique contre l’Inde, elle aussi, puissance nucléaire ; l’Inde contre la Chine au Tibet ; la Chine et le Japon contre la Russie pour des querelles de frontières et les îles Kouriles, etc. La guerre de tous contre tous. Et la liste est loin, très loin, d'être exhaustive.
La chaîne des conflits en cascade, les uns entraînant les autres, dans le désordre et le chaos, le chacun pour soi le plus complet, se tend de plus en plus. Elle entraîne le monde capitaliste dans la barbarie guerrière la plus noire. Se vérifie ainsi la position marxiste selon laquelle le capitalisme, c'est la guerre impérialiste, la « paix » ne faisant que préparer la guerre impérialiste. Se vérifie ainsi la thèse marxiste selon laquelle dans la période de décadence, tout Etat, petit ou grand, faible ou fort, est impérialiste. Se vérifie aussi la thèse marxiste selon laquelle la classe ouvrière, le prolétariat international, où qu'il se trouve, ne peut apporter son soutien au nationalisme, à sa bourgeoisie, une telle capitulation politique ne menant qu'à l'abandon de ses intérêts de classe, de ses luttes, ne menant qu'aux sacrifices matériels et physiques sur l'autel du nationalisme. Se vérifie l'affirmation marxiste que le capitalisme en décadence n'a plus rien de positif à apporter à l'humanité, que sa décomposition entraîne celle-ci vers le néant, vers sa perte. Se vérifie l'alternative que mettaient en avant les communistes du début du siècle : socialisme ou barbarie.
Au prix d'innombrables et incommensurables souffrances, de larmes et de sang, l'échéance historique décisive se rapproche. Détruire le capitalisme avant qu'il ne détruise l'humanité entière, tel est l'enjeu, dramatique et gigantesque, telle est la mission historique du prolétariat !
[1] [161] Libération, 22/2/94.
[2] [162] The New York Times repris par l'International Herald Tribune, 3/3/94.
[3] [163] Le massacre d'Hébron par un colon fanatique religieux juif que les soldats israéliens présents ont laissé faire de toute évidence, exprime la réalité de la «paix» que les Etats-Unis imposent au Moyen-Orient. Si le crime profite à l'Etat hébreu qui trouve ainsi une justification pour essayer de museler et de désarmer ses propres extrémistes, il aggrave encore plus la situation de chaos dans laquelle les territoires occupés et le territoire israélien lui-même sont en train de s'enfoncer. Si les négociations de paix et la constitution d'un Etat palestinien, en continuité avec la guerre du Golfe, sont, et seront, un succès des Etats-Unis, qui ont éliminé ainsi tout rival impérialiste de la région, la situation de désordre et d'anarchie, de décomposition, des deux Etats, et de la région, continuera à s'aggraver.
[4] [164] Le Monde, 8/2/94.
[5] [165] The New York Times, 9/2/94.
[6] [166] The Guardian, repris dans Courrier International du 24/2/94.
[7] [167] The New York Times repris par Y International Herald Tribune du 8/2/94.
[8] [168] The New York Times repris dans Y International Herald Tribune du 26/2/94.
[9] [169] The Guardian repris dans Courrier International du 24/2/94.
[10] [170] Le Monde, 27/2/94.
[11] [171] La Repubblica, repris dans Courrier International du 24/2/94.
[12] [172] International Herald Tribune, 14/2/94.
[13] [173] 1bid.
[14] [174] Le visa accordé par le gouvernement américain au leader de TIRA, Gerry Adams, et la publicité faite autour de sa visite aux Etats-Unis, son interview par Larry King, célèbre journaliste de CNN à une heure de grande écoute, ont été aussi une expression de la pression américaine sur le gouvernement Major.
[15] [175] International Herald Tribune, 26/2/94.
[16] [176] Repris dans Courrier International, 17/2/94.
Géographique:
- Europe [15]
Questions théoriques:
- Guerre [177]
- Impérialisme [178]
Crise économique mondiale : l'explosion du chômage
- 2971 lectures
L'année 1994 a commencé marquée par une réalité majeure : l'explosion du chômage
L'année 1994 a commencé marquée par une réalité majeure : l'explosion du chômage dans le monde. Les gouvernements des 7 premières puissances économiques occidentales ont pour l'occasion organisé, à grands renforts de propagande médiatique, une réunion exclusivement consacrée à cette question, qualifiée de « problème numéro un ». Le président américain devait solennellement y présenter «c un plan mondial contre le chômage », fondé sur la « réussite » des méthodes américaines. Au coeur de l'Europe, dans la première puissance du continent, le chômage bat des records inconnus depuis les années 1930. Le ministre allemand de l'économie, Gunter Rexold reconnaît : « Le fait que plus de quatre millions de citoyens n'aient pas trouvé de travail constitue pour l'Etat et la société l'un des plus grands défis depuis la fondation de la République Fédérale. » Un rapport de l'Organisation internationale du travail affirme qu'il y a aujourd'hui 30 % des travailleurs dans le monde qui sont chômeurs ou sous-employés. Cela fait 820 millions de personnes : 120 millions sont des chômeurs officiellement « enregistrés », 700 millions sont des « sous-employés ». Quelle est la signification de cette nouvelle aggravation du chômage ? Les méthodes du gouvernement américain sont elles un remède efficace contre la maladie ? Quelles perspectives pour la lutte de classe ?
Une situation sans précédent
Plus l'idéologie dominante, dans la foulée des campagnes sur « l'effondrement du communisme », présente le capitalisme comme la seule forme d'organisation sociale possible pour l'humanité moderne, plus les ravages occasionnés par la subsistance de ce système s'avèrent dévastateurs. Le chômage, source de misère, d'exclusion, de désespoir, ce fléau qui incarne au plus haut point l'impitoyable et absurde dictature du profit capitaliste sur les conditions d'existence de l'immense majorité de la société, constitue sans aucun doute la plus significative de ces calamités.
L'actuelle augmentation du chômage, expression de la nouvelle récession ouverte dans laquelle le capitalisme s'enfonce depuis maintenant quatre ans, ne s'abat pas sur une monde jouissant du « plein emploi ». Loin s'en faut. Cela fait maintenant plus d'un quart de siècle, depuis la récession de 1967, qui marqua la fin de la prospérité consécutive à la reconstruction d'après-guerre, que la lèpre du chômage se répand systématiquement sur la planète. La maladie s'est aggravée et répandue suivant le rythme des ralentissements de la « croissance » économique, avec des moments d'accélération et des périodes de piétinement relatif. Mais les périodes de soulagement ne sont jamais parvenues à annuler les effets de l'aggravation précédente, et à travers des fluctuations diverses, dans tous les pays, le nombre de chômeurs n'a cessé d'augmenter. ([1] [179]) Depuis le début des années 1970, le terme même de « plein emploi » a quasiment disparu du vocabulaire. Les adolescents de deux dernières décennies se sont toujours vu appeler « la génération du chômage ».
L'explosion du chômage qui marque le début des années 1990 ne crée donc pas un nouveau problème. Elle ne vient qu'empirer une situation déjà dramatique. Et elle le fait avec force.
L'Allemagne, première puissance économique européenne, a connu depuis 1991 une très forte augmentation du chômage. En janvier 1994, le chiffre officiel de demandeurs d'emploi a dépassé le cap des quatre millions. Si l'on ajoute à ce chiffre celui des chômeurs « en traitement social », on atteint les six millions. Il s'agit du niveau le plus élevé connu dans ce pays depuis la dépression des années 1930. Le taux de chômage officiel atteint 17 % dans l'ex-RDA, 8,8 % à l'ouest. Les perspectives pour l'avenir immédiat sont tout aussi catastrophiques : 450 000 chômeurs de plus annoncés par les « experts » d'ici la fm de l'année. Des licenciements massifs sont prévus dans les secteurs les plus compétitifs et puissants de l'économie allemande : 51 000 suppressions d'emplois chez Daimler-Benz, 30 000 dans la chimie, 16 000 dans l'aéronautique, 20 000 chez Volkswagen...
Les dépenses du capital allemand pour l'unification avaient momentanément constitué un marché qui a permis à l'Europe de retarder un tant soit peu son entrée dans la récession ouverte par rapport aux Etats-Unis ou la Grande Bretagne. La plongée de l'économie allemande en récession s'est accompagnée d'une explosion du chômage dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Ainsi en un peu moins de trois ans les taux de chômage (officiels) sont passés de 9 à plus de 12 % en France, de 1,5 à plus de 9 % en Suède, de 6,5 à près de 10 % aux Pays-Bas et en Belgique, de 16 à 23,5 % en Espagne.
On estime qu'il faudrait en Europe une croissance d'au minimum 2,5 % par an pour simplement empêcher la poursuite de l'accroissement du chômage. On en est loin. Même les plus optimistes conjoncturistes ne prévoient pas de diminution du chômage en Europe avant l'année 1995, voire 1996. Pour la seule année 1994, l'OCDE prévoit un million de chômeurs en plus sur le vieux continent.
A cet accroissement quantitatif, il faut ajouter une rapide détérioration qualitative, marquée par le développement du chômage dit « de longue durée » et du chômage des jeunes ([2] [180]), accompagnés de la diminution généralisée des allocations de chômage en temps et en valeur.
Le Japon, qui connaît sa plus forte récession depuis la 2e Guerre, voit aussi le chômage se développer. Même si le niveau absolu y reste encore bas en comparaison avec les autres puissances, le nombre de chômeurs « officiels » y est passé en trois ans de 1,3 millions à près de 2 millions. Ces chiffres ne donnent cependant qu'une idée très partielle de la réalité, le gouvernement japonais ayant suivi une politique qui consiste à préférer garder les chômeurs dans les usines, quitte à les payer moins et réduire le temps de travail, plutôt que de les mettre à la rue. Mais cette politique, qui accompagnait celle des « emplois à vie » dans les grands conglomérats industriels, cède le pas à la multiplication des licenciements et suppressions de postes. Toyota a clairement annoncé l'avenir en proclamant la fin de sa politique d'emploi garanti. ([3] [181])
Face à cette situation, le gouvernement des Etats-Unis et, à sa suite, ceux du Canada et du Royaume-Uni, se vantent d'avoir réussi depuis deux ans à créer de nouveaux emplois et à arrêter la croissance du chômage. Il est vrai que dans les puissances « anglo-saxonnes » les statistiques officielles constatent une réduction du chômage. Mais cette affirmation cache deux réalités majeures : la faiblesse quantitative de cette « reprise » de l'emploi et la mauvaise qualité des emplois créés.
Sur le plan purement quantitatif, l'actuelle « reprise » de l'emploi paraît insignifiante par rapport à celle qui suivit la récession de 1979-1982.
Ainsi, dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis, le nombre d'emplois n'a fait, au mieux, que se maintenir globalement depuis 3 ans, certains secteurs connaissant même des baisses importants. Les grandes entreprises industrielles continuent d'annoncer des licenciements massifs : dans le seul mois de novembre 1993, Boeing, ATT, NCR et Philip Morris ont annoncé 30 000 suppressions d'emplois pour les années à venir. Au cours de la reprise reagannienne des années 1980, l'emploi industriel avait augmenté de 9 %, alors qu'aujourd'hui cette augmentation ne dépasse pas 0,3 %. Dans le secteur tertiaire, l'administration Clinton se vante d'avoir augmenté de 3,8 % le nombre d'emplois, mais ce chiffre était de 8 % après 1982. Le budget présenté par Clinton pour 1995 est un des plus rigoureux depuis des années : « Il faut distinguer le luxe et la nécessité ». Il prévoit la suppression de 118 000 emplois dans les administrations publiques, une étape vers les 250 000 suppressions annoncées pour les cinq années à venir.
Pour ce qui est du Royaume-Uni et du Canada, la reprise de l'emploi s'y résume pour le moment à des mouvements marginaux, quasiment insignifiants.
Les faits sont simples : il y a aujourd'hui dans l'ensemble de ces trois pays 4 millions de chômeurs de plus qu'il y a 3 ans. ([4] [182])
Quant à la qualité des emplois, la réalité des Etats-Unis illustre dans toute sa profondeur l'ampleur du désastre économique. Les travailleurs y sont de plus en plus plongés dans une situation d'instabilité et d'insécurité permanente. On est chômeur pendant six mois, on travaille pendant trois. La fameuse « mobilité » de l'emploi se traduit dans les faits par une sorte de répartition du chômage. On est chômeur moins longtemps qu'en Europe, mais plus souvent. D'après un récent sondage, parmi les personnes qui ont un travail aux Etats-Unis, 40 % ont déclaré craindre le perdre dans l'année qui vient. Les emplois créés le sont, pour l'essentiel, dans le secteur tertiaire. Une grande partie est constituée par des « services » tels que garer des voitures dans les grands restaurants, promener des chiens, garder des enfants, emballer des paquets aux caisses des supermarchés, etc. A coup de « petits boulots », on transforme les chômeurs en valets à (très) bon marché... 30 millions de personnes, soit 25 % de la population active américaine, sont en-dehors du circuit normal de l'emploi, c'est-à-dire vivent directement sous la pression du chômage.
Quelles que soient les formes que prend la maladie, aux Etats-Unis ou en Europe, dans les pays industrialisés ou dans les pays sous-développés, le chômage est devenu effectivement « le problème numéro un » de notre époque.
Quelle est la portée de cette réalité ?
La signification du développement chronique et massif du chômage
Pour la classe ouvrière la signification négative du chômage est une évidence qu'elle vit quotidiennement. Pour le prolétaire qui ne trouve pas de travail, c'est l'expulsion de ce qui constitue la base des relations sociales : le processus de production. C'est, pendant quelque temps, lorsqu'il a la chance de recevoir des allocations, l'impression de vivre en « parasite » de la société, puis c'est l'exclusion, la misère totale. Pour celui qui travaille c'est l'obligation de supporter toujours plus les «abus» de la classe dominante, au nom du chantage : « si tu n'est pas content, il y a des milliers de chômeurs qui sont prêts à prendre ta place ». Pour les prolétaires, le chômage, en tant que réalité et en tant que menace, constitue une des plus efficaces formes de répression, une des pires aggravations de tout ce qui fait de la machine capitaliste un instrument d'exploitation et d'oppression.
La signification négative du chômage peut apparaître cependant moins évidente pour la classe capitaliste. D'une part, celle-ci subit le classique aveuglement des classes exploiteuses, incapables de percevoir véritablement les méfaits sociaux de leur domination ; d'autre part, elle a besoin de croire et de faire croire que l'irrésistible montée du chômage depuis plus d'un quart de siècle constitue, non pas une maladie propre à la sénilité historique de son système, mais un phénomène presque « naturel », une sorte de fatalité due au progrès technique et aux nécessités d'adaptation du système. « Il faut s'y faire, mes amis, les emplois d'hier ne reviendront pas, » déclarait le secrétaire américain au Travail, Robert Reich, pendant la réunion du G7 sur le chômage.
En fait, la propagande sur « la nouvelle reprise » essaie de théoriser la situation qui se développe dans certains pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada), où la production a recommencé de croître, sans que pour autant le chômage se soit significativement réduit.
Mais il n'y a rien de « naturel » ni de « sain » dans le développement massif du chômage. Même du point de vue de la santé du capitalisme lui-même, le développement chronique et massif du chômage est une manifestation in équivoque de décrépitude.
Pour la classe capitaliste, le chômage constitue une réalité qui, dans un premier temps du moins, par le chantage qu'il permet de pratiquer, renforce son pouvoir sur les exploités et lui permet de mieux les saigner, ne fut-ce que par la pression qu'il exerce à la baisse sur les salaires. C'est une des raisons pour lesquelles la classe dominante a toujours besoin d'un volant de chômage permanent.
Mais ce n'est là qu'un aspect des choses. Du point de vue du capital, au-delà d'un minimum, le développement du chômage constitue un facteur négatif, destructeur de capital, il est la manifestation d'une maladie. Le capital ne se nourrit que de chair prolétarienne. La substance du profit, c'est du travail vivant. Ce ne sont ni les machines, ni les matières premières qui lui fournissent le profit, mais le « sur-travail » des exploités. Lorsque le capital licencie de la force de travail, il se prive de la source véritable de son gain. S'il le fait, ce n'est pas parce qu'il aime ça, mais parce que les conditions du marché et les impératifs de rentabilité le lui imposent.
L'enfoncement chronique dans le chômage massif traduit dans la réalité deux contradictions fondamentales, mises en évidence par Marx, qui condamnent historiquement le capitalisme :
- l'incapacité de ce dernier à créer, par ses propres mécanismes, un marché solvable suffisant pour écouler toute la production qu'il est en mesure de réaliser ;
- la nécessité de « remplacer des homme par des machines» pour assurer sa compétitivité, ce qui se traduit par une tendance permanente à la baisse du taux de profit.
L'actuelle explosion du chômage, qui vient s'ajouter à la masse de chômeurs qui s'est accumulée pendant plus de vingt-cinq ans de 1967 à aujourd'hui, n'a rien à voir avec une « salutaire restructuration » due au « progrès ». Elle représente au contraire la preuve pratique de l'impuissance définitive du système capitaliste.
Les « solutions » capitalistes
La réunion du G7 consacrée au problème du chômage a été un événement typique de la manipulation spectaculaire avec laquelle gouverne la classe dominante. Le message médiatique de l'opération se résumait à ceci : « Vous qui vous demandez si vous allez perdre votre emploi ou si vous allez en trouver un ; vous qui vous inquiétez de voir vos enfants devenir chômeurs, sachez que les gouvernements des 7 principales puissances économiques occidentales s'en préoccupent et s'en occupent. »
Evidemment, il n'en est sorti aucune décision concrète, à part demander au secrétariat de l'OCDE de mieux comptabiliser les chômeurs ou l'engagement à tenir une nouvelle réunion du G7 en juillet, à Naples, pour parler à nouveau sur le problème.
Le « plan mondial contre le chômage » annoncé par Clinton s'est en fait résumé à l'affirmation de la part des Etats-Unis de leur ferme volonté d'intensifier leur agressivité dans la guerre commerciale qui les oppose au reste du monde. En demandant au capital japonais de mieux ouvrir son marché intérieur, en exigeant des européens qu'ils abaissent leurs taux d'intérêts pour relancer leur production (et donc leurs importations en provenance des Etats-Unis), le discours de Clinton ne faisait que confirmer l'avertissement lancé par son représentant au commerce, M. Kantor : « Personne ne doit avoir de doutes sur notre engagement à aller de l'avant, à ouvrir des marchés et à développer le commerce, comme nous l'avons fait depuis que le président Clinton a pris en charge ses fonctions. »
Le spectacle du G7 a au moins mis en évidence que les différents capitaux nationaux sont incapables effectivement de trouver une solution mondiale au chômage, que la seule chose qu'ils savent et peuvent faire, c'est le chacun pour soi et tous contre tous, l'exacerbation de la guerre commerciale.
Les grands principes qui ont été affirmés ne sont autres que les exigences de la compétitivité pour chaque capital national. Et, de ce point de vue, il est certain que le capital américain pouvait offrir sa récente politique économique comme modèle. Celle-ci a en effet mis en pratique toutes les recettes pour tenter de rentabiliser une économie défaillante en l'armant contre la concurrence :
Licencier la main d'oeuvre « excédentaire »
«Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, la restauration de la compétitivité industrielle est hostile à l'emploi. » C'est ainsi que s'exprimait lors du G7 un haut fonctionnaire de l'Union européenne, un des rédacteurs du Livre blanc présenté par Delors. Nous avons vu comment le capital américain a mis en pratique ce principe en développent la « mobilité de l'emploi. »
Augmenter la rentabilité et la productivité de la main d'oeuvre employée
Pour cela l'administration Clinton n'a fait qu'infliger avec vigueur la vieille méthode capitaliste : payer moins les exploités tout en les faisant travailler plus. Clinton l'a formulé en termes très concrets : « Une plus longue semaine de travail qu'il y a 20 ans, pour un salaire équivalent. » Et c'est la réalité : le temps de travail hebdomadaire dans les industries manufacturières aux Etats-Unis est aujourd'hui effectivement le plus élevé depuis 20 ans. Quant aux salaires, Clinton avait promis pendant sa campagne électorale de revaloriser le salaire minimum, et même de l'indexer sur l'inflation. Il n'en a rien été. Et, comme ce minimum est quasiment gelé depuis le début des années 1980, cela fait plus de dix ans que le salaire minimum réel ne cesse de baisser aux Etats-Unis. Pour ce qui est de la dite « protection sociale », c'est-à-dire cette partie du salaire que le capital verse sous forme de certains services et allocations publiques, l'administration démocrate présente son fameux plan pour établir un système de santé national comme un progrès. En réalité, il ne s'agit pas d'une dépense supplémentaire du capital américain en faveur des exploités, mais au contraire, d'une tentative pour rationaliser une réalité anarchique et absurde qui, en fin de compte, aboutit à ce que les frais de santé par travailleur soient, dans ce pays, parmi les plus élevés du monde.
Intensifier l'exploitation de la force de travail par la modernisation de l'appareil de production
Depuis deux ans les investissements pour l'équipement des entreprises a fortement augmenté aux Etats-Unis (+15% en 1993, un taux analogue est prévu pour 1994). Ces investissements, pour importants qu'ils soient dans certains secteurs, ne s'accompagnent pas pour autant d'une augmentation significative de l'emploi. Ainsi, par exemple, ATT, qui se prépare à investir d'énormes sommes pour la mise en place des « autoroutes de la communication », projet de grands travaux annoncés pour la décennie, vient en même temps d'annoncer 14 000 licenciements.
Les méthodes américaines ne sont en fait que les vieilles recettes de guerre économique du capital contre les concurrents et contre les exploités. Les autres capitaux nationaux n'en ont pas de différentes sur le fond. Les gouvernements de la vieille Europe, qui se vantent tant d'avoir un système exemplaire de protection sociale, mènent depuis des années un travail systématique de réduction des « dépenses sociales ». « Certaines mesures, telles que le volet social (annexé au traité de Maastricht) sont à ranger au musée auquel elles appartiennent », déclarait récemment Kenneth Clarke, Chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni. C'est le même discours et la même pratique qui ont été développés par tous les gouvernements, même si ce n'est pas partout présenté de façon aussi provocante.
Dans le meilleur des cas, ces politiques peuvent permettre de reporter les effets de la crise sur des capitaux concurrents ([5] [183]). En aucun cas, elles ne fournissent une solution générale.
L'accroissement de la rentabilité et de la productivité de la force de travail peut favoriser, dans un premier temps, le capital d'un pays aux dépens des autres, mais, du point de vue global, avec la généralisation de cet accroissement de productivité, cela ne fait que reposer de façon encore plus aigus le problème de l'insuffisance des marchés pour absorber la production réalisable. Moins de travailleurs employés avec des salaires moindres c'est autant de débouchés en moins. Plus de productivité c'est autant de marchés supplémentaires à trouver.
Chaque capital national ne peut combattre le problème à son échelle spécifique qu'en l'aggravant à l'échelle générale.
Enfin, last but not least, la reprise des investissements aux Etats-Unis a été financée, une fois de plus, par le crédit. La seule dette publique nette est passée en quatre ans de 30% à 39% du PIB. Un mouvement analogue s'est développé d'ailleurs dans les autres pays pour faire face à la récession. Cela ne fait que venir aggraver la situation financière mondiale, fragile et explosive, rongée par deux décennies de crédits et de spéculations en tous genres.
Pour encourager le recours au crédit, le gouvernement américain à imposé, depuis trois ans, des taux d'intérêt à court terme extrêmement bas. L'augmentation de ces taux est tout aussi inévitable que dangereuse pour l'équilibre financier mondial. Le faible coût de l'argent à court terme a permis la constitution d'énormes capitaux spéculatifs. La bourse de Wall Street, en particulier, en a été inondée ([6] [184]). Le relèvement du coût des crédits risque d'entraîner un véritable krach financier qui ruinerait rapidement les efforts réalisés pour tenter d'endiguer la montée du chômage.
Les « solutions » qu'offrent aujourd'hui les gouvernements pour affronter le problème du chômage, outre qu'elles constituent des attaques directes contre les conditions d'existence des exploités, ont cette particularité de reposer sur les sables mouvants de l'endettement à outrance et de la spéculation sans limites.
Quelles perspectives pour la lutte de classe ?
Même s'il venait à connaître un véritable effondrement économique, le capitalisme ne disparaîtra pas de lui-même pour autant. Sans l'action révolutionnaire du prolétariat, ce système continuera de pourrir sur pied entraînant l'humanité dans une barbarie sans fin.
Quel rôle joue et jouera le chômage dans le cours de la lutte de classe ?
La généralisation du chômage, pour la classe exploitée, c'est pratiquement pire que la présence d'un agent de la police dans chaque foyer, dans chaque lieu de travail. Par le chantage ignoble qu'il permet à la classe dominante sur les travailleurs, il rend plus difficile la lutte.
Cependant, à partir d'un certain degré, la révolte contre cette répression elle-même devient un puissant stimulant du combat de classe et de sa généralisation. A partir de quelle quantité, de quel pourcentage de chômeurs, cette transformation peut-elle se produire? La question est en elle-même sans réponse, car ce qui est en question ce n'est pas un rapport mécanique entre économie et lutte de classe, mais un processus global complexe où la conscience des prolétaires joue le premier rôle.
Nous savons cependant qu'il s'agit d'une situation totalement différente de celle de la grande dépression économique des années 1930.
Du point de vue économique la crise des années 1930 fut résolue par le développement de l'économie de guerre et les politiques keynésiennes (en Allemagne, à la veille de la guerre, le chômage avait presque totalement « disparu ») ; aujourd'hui la véritable efficacité de l'économie de guerre, ainsi que de toutes les politiques keynésiennes se trouve derrière nous. Celle-ci s'est usée jusqu'à conduire à la situation présente, laissant comme solde une bombe financière d'endettement.
Du point de vue politique, l'actuelle situation du prolétariat mondial n'a rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 1930. Il y a soixante ans, la classe ouvrière subissait tout le poids des défaites sanglantes et dramatiques qu'elle avait essuyées pendant la vague révolutionnaire de 1917-23, en particulier en Allemagne et en Russie. Idéologiquement et physiquement vaincue, elle se laissait embrigader, atomisée derrière les drapeaux des bourgeoisies nationales, pour marcher vers une deuxième boucherie mondiale.
Les générations de prolétaires d'aujourd'hui n'ont pas subi de défaites importantes. A partir des luttes de 1968 - premières réponses à l'ouverture de la crise économique - elles ont, à travers des hauts et des bas, des avancées et des reculs dans leur combativité et leur conscience, ouvert et confirmé un nouveau cours historique.
Les gouvernements ont raison de trembler devant ce qu'ils appellent « les troubles sociaux » que peut produire le développement du chômage.
Ils ont su, et ils savent utiliser les aspects du chômage qui rendent plus difficile la lutte prolétarienne : son aspect répressif, diviseur, atomisant, le fait qu'il rejette toujours plus une fraction de la classe révolutionnaire, en particulier les jeunes, de plus en plus interdits d' « entrer dans la vie active », dans une marginalisation décomposée et destructrice.
Mais, le chômage, par la violence de l'attaque qu'il représente contre les conditions d'existence de la classe révolutionnaire, par le fait même qu'il prend une ampleur universelle, frappant sans distinction tous les secteurs, dans tous les pays, met en évidence que, pour les exploités, l'issue ne dépend pas d'une question de gestion, de réforme ou de restructuration du capitalisme, mais de la destruction du système lui-même.
L'explosion du chômage révèle dans toute son ampleur l'impasse capitaliste et la responsabilité historique de la classe ouvrière mondiale.
RV.
[1] [185] En 1979, après la «reprise» qui suivit la récession de 1974-75 (dite du «premier choc pétrolier»), il y avait toujours 2 millions de chômeurs en plus qu'en 1973 aux Etats-Unis, 750 000 en Allemagne de l'Ouest. Entre 1973 et 1990, à la veille de l'actuelle récession, le nombre « officiel » de chômeurs dans la zone de l'OCDE (les 24 pays industrialisés d'Occident - y compris le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) - avait augmenté de 20 millions, passant de 11 à 31 millions. Il ne s'agit là que des pays les plus riches. Dans le « tiers-monde » ou dans l'ancien « bloc socialiste», l'ampleur de la catastrophe est incomparablement plus grave. Après la récession de 1980-82, nombreux sont les pays sous-développés qui ne se sont plus relevés et qui ont entamé un enfoncement sans fin dans la misère et le sous-emploi.
[2] [186] Début 1994, 50 % des chômeurs en Europe le sont depuis plus d'un an. Les « experts » prévoient que fin 1994 un quart des chômeurs y auront moins de 20 ans. {International Herald Tribune, 14 mars 1994).
[3] [187] Le Japon doit faire face à une très forte réduction de ses exportations, c'est-à-dire du principal moteur de sa croissance. Cette réalité se fait sentir dans tous les secteurs de son économie. Mais elle est particulièrement significative dans celui des produits électroniques de consommation, domaine où le Japon est très performant. Ainsi les exportations de ce secteur ont-elles chuté de près de 25 % en 1993 et ne représentent aujourd'hui que 50 % de ce qu'elles étaient en 1985. Pour la première fois le Japon a dû, en 1993, importer plus de postes de télévisions couleurs qu'il en a exportés.
Le paradoxe est que ces importations proviennent pour l'essentiel des entreprises japonaises implantées dans le Sud-est asiatique afin de profiter de coûts de main d'oeuvre inférieurs.
Le « boom » économique exceptionnel de certaines économies asiatiques trouve en réalité sa source dans la crise mondiale qui contraint les capitaux des principales puissances, soumis à la plus impitoyable guerre commerciale, à « délocaliser » certaines de leurs productions dans des pays à main d'œuvre bon-marché (...et disciplinée) afin de baisser leurs coûts.
[4] [188] 2,3 millions de plus aux Etats-Unis, 1,2 million au Royaume-Uni, 600 000 au Canada.
[5] [189] Ainsi, par exemple, une partie de la « reprise » américaine récente s'est faite directement aux dépens du capital japonais auquel elle a réussi à enlever certaines parts de marché.
[6] [190] Il en est ainsi des valeurs boursières dites « dérivatives »dont la caractéristique est de reposer non plus sur des critères économiques, liés à la santé desentreprises qu'elles sont supposées représenter, mais sur des équation mathématiques fondées sur des mécanismes purement spéculatifs. (Signe des temps, une grande partie des investissements informatiques des dernières années aux Etats-Unis ont été destinés à moderniser et élargir les capacités des entreprises qui spéculent avec ces systèmes ultramodernes.) Ces valeurs représentent une masse colossale d'argent: le portefeuille de Salomon Brothers en contient pour 600 milliards de dollars, celui de la Chemical Bank 2 500 milliards. A eux deux seuls cela fait 3 100 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB annuel de l'Allemagne, plus la France et le Danemark !
Récent et en cours:
- Crise économique [191]
Questions théoriques:
- Décadence [192]
Comment est organisée la bourgeoisie : Le mensonge de l'Etat « démocratique », II.
- 4074 lectures
L'exemple des rouages secrets de l'Etat italien
On pourrait croire, à écouter la propagande de la classe dominante, que celle-ci n'a qu'un souci : le bien de l'humanité. Le discours idéologique sur la « défense des libertés et de la démocratie», sur les «droits de l'homme » ou 1' « aide humanitaire » est en complète contradiction avec la réalité. Le battage qui accompagne ce discours est à la mesure du mensonge qu'il véhicule. Comme le disait déjà Goebbels, le maître de la propagande nazie : «r Plus le mensonge est gros, plus il a de chance d'être cru ». Cette « règle », l'ensemble de la bourgeoisie mondiale l'applique avec assiduité. L'Etat du capitalisme décadent a développé tout un appareil monstrueux de propagande, réécrivant l'histoire, couvrant d'un vacarme assourdissant les événements, pour masquer la nature barbare et criminelle du capitalisme, qui n'est plus porteur d'un quelconque progrès pour l'humanité. Cette propagande pèse lourdement sur la conscience de la classe ouvrière. Elle est d'ailleurs conçue pour cela.
Les deux articles qui suivent, «L'exemple des rouages secrets de l'Etat italien » et « La bourgeoisie mexicaine dans l'histoire de l'impérialisme», montrent tous deux comment, derrière les discours propagandistes de circonstance, la bourgeoisie du capitalisme décadent est une classe de gangsters, dont les multiples fractions sont prêtes à toutes les manoeuvres pour la défense de leurs intérêts dans l'affrontement qui les oppose dans l'arène capitaliste et impérialiste et dans le front qui les unit face au danger prolétarien.
Pour bien combattre l'ennemi, il faut le connaître. Ceci est particulièrement vrai pour le prolétariat dont la conscience, la clarté dont il doit faire preuve dans sa lutte, est l'arme principale. Sa capacité à mettre à nu les mensonges de la classe dominante, à voir derrière le paravent de la propagande, notamment « démocratique », la réalité de la barbarie du capitalisme et de la classe qui l'incarne, est déterminante pour sa capacité future à jouer son rôle historique : mettre fin par la révolution communiste à la période la plus sombre que l'humanité ait jamais connue.
Le mensonge de l'Etat « démocratique », II. L'exemple des rouages secrets de l'Etat italien
La première partie de cet article ([1] [193]) a abordé le cadre général qui permet de comprendre le développement totalitaire du fonctionnement de l'Etat dans le capitalisme décadent, y compris dans ses variantes démocratiques. Cette deuxième partie traite d'une illustration de ce fonctionnement, au travers du cas concret de l'Italie.
Depuis de nombreuses années, les scandales à répétition qui ont émaillé la vie politique de la classe dominante en Italie, notamment les affaires dites de la Loge P2 ([2] [194]), du réseau Gladio et des liens avec la Mafia, ont permis de soulever un coin du voile vertueux dont se pare l'Etat démocratique et d'avoir un aperçu de la réalité sordide et criminelle de son fonctionnement. La piste sanglante des multiples attentats terroristes et mafieux, des « suicides » sur fond de faillites financières trouve son origine au coeur même de l'Etat, dans ses manoeuvres tortueuses pour assurer son hégémonie. Une « affaire » chasse l'autre, et la classe dominante sait parfaitement utiliser la nouveauté apparente de chaque scandale pour faire oublier les précédents. Aujourd'hui, les autres grandes « démocraties » occidentales montrent du doigt la bourgeoisie italienne coupable de telles oeuvres, pour mieux faire croire qu'il s'agit là d'une situation particulière et spécifique. Machiavel et la Mafia, tout comme le Chianti et le Parmesan ne sont-ils pas des produits typiquement italiens? Pourtant, toute l'histoire scandaleuse de la bourgeoisie italienne, et les ramifications qu'elle met à jour, montre exactement le contraire. Ce qui est spécifique à l'Italie, c'est que les apparences démocratiques y sont plus fragiles que dans les autres démocraties historiques. Les scandales en Italie, lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, mettent pourtant en évidence que ce qu'ils dévoilent n'est pas propre à l’Italie, mais est au contraire l'expression de la tendance générale du capitalisme décadent au totalitarisme étatique et des antagonismes impérialistes mondiaux qui ont marqué le 20e siècle.
L'histoire de l’Italie depuis le début du siècle le démontre amplement.
LA MAFIA : au coeur de l'Etat et de la stratégie impérialiste
Depuis le milieu des années 1920, Mussolini a déclaré la guerre à la Mafia. «Je l'assécherai comme j'ai asséché les marais Pontin » déclare-t-il. Les troupes du préfet Mori sont chargées de cette besogne en Sicile. Mais avec les années qui passent Cosa Nostra résiste et, lorsque se profile la perspective de la 2e guerre mondiale, la Mafia, implantée de manière solide dans le sud de l'Italie et aux Etats-Unis, devient un enjeu stratégique important pour les futurs belligérants. En 1937, Mussolini, intéressé à renforcer son influence parmi les italo-américains afin de tenter d'installer ainsi une « cinquième colonne » en territoire ennemi, accueille à bras ouvert Vito Genovese, l'adjoint de Lucky Luciano, le boss de la Mafia américaine, en délicatesse avec la justice des Etats-Unis. Genovese devient un protégé du régime fasciste, invité plusieurs fois à la table du Duce à partager le spaghetti de l'amitié en compagnie, entre autres, de célébrités telles que le Comte Ciano, gendre de Mussolini et ministre des Affaires étrangères et d’Hermann Goering. Il recevra en 1943 la plus haute distinction du régime fasciste, le Duce en personne lui épinglera l'Ordre de Commandatore sur la poitrine. Genovese rend de menus service au régime fasciste, éliminant des mafieux qui ne comprennent pas les nouvelles règles du jeu, organisant l'assassinat, à New-York, d'un journaliste italo-américain, Carlo Tresca, responsable d'un journal antifasciste influent, Il Martello. Mais surtout, l'adjoint de Lucky Luciano, va mettre à profit sa situation privilégiée pour monter une structure de trafic en tous genres et développer son réseau d'influence : le préfet de Naples, Albini, devient son homme lige, et Genovese réussit à le faire nommer sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur en 1943. Ciano, qui s'adonne à la drogue, tombe aussi sous la coupe de Genovese dont il dépend pour son approvisionnement.
Pendant ce temps, aux Etats-Unis, avec l'entrée en guerre en 1941, l'importance stratégique de la Mafia est reconnue. Sur le plan intérieur, il s'agit d'éviter la création d'un front intérieur au sein de l'immigration d'origine italienne, et la Mafia qui contrôle, entre autre, les syndicats des dockers et des camionneurs, secteurs vitaux pour l'acheminement de l'approvisionnement des armées, devient dans ces conditions un interlocuteur incontournable de l'Etat américain. Pour renforcer sa crédibilité, la Mafia organise en février 1942, le sabotage, dans le port de New-York, du paquebot Normandie en cours de réaménagement pour le transport de troupes qui devient la proie des flammes. Peu après, une grève générale des dockers fomentée par le syndicat mafieux paralyse l'activité du port. Finalement, la Marine américaine demande à Washington l'autorisation de négocier avec la Mafia et son chef Luciano, alors en prison ; autorisation que Roosevelt s'empressera d'accorder. Bien que ce fait soit toujours nié par l'Etat américain et les détails de l'Opération Underworld (puisque tel fut son nom) toujours classifiés secrets, bien que Lucky Luciano ait toujours proclamé jusqu'à sa mort que tout cela n'était que «foutaises et galéjades à l'usage des cons » ([3] [195]), après des décennies de silence, le fait que l'Etat américain ait négocié une alliance avec la Mafia est aujourd'hui généralement reconnu. Conformément à la promesse qui sera faite, Luciano sera libéré au lendemain de la guerre et « exilé » en Italie. Pour justifier cette grâce, Thomas Dewey, celui qui, comme procureur, avait organisé l'arrestation et le jugement de Luciano dix ans plus tôt, et qui, grâce à cette publicité, était entre temps devenu le gouverneur de l'Etat de New-York, déclara dans une interview au New York Post : « Une enquête exhaustive a établi que l'aide apportée par Luciano à la Marine pendant la guerre a été considérable et précieuse. »
Des services, la Mafia en a effectivement rendus de très importants à l'Etat américain durant la guerre. Après avoir placé ses billes dans les deux camps, quand à la mi-1942 le rapport de forces bascule plus nettement en faveur des Alliés, la Mafia met ses forces à la disposition des Etats-Unis. Sur le plan intérieur, elle va engager ses syndicats dans l'effort de guerre, mais c'est surtout en Italie qu'elle va s'illustrer. Les troupes américaines durant le débarquement de 1943 en Sicile vont bénéficier du soutien efficace de la Mafia sur place. Débarqués le 10 juillet, les soldats américains font une véritable promenade de santé, rencontrent très peu d'opposition et sept jours plus tard seulement Palerme est sous leur contrôle. Pendant ce temps, la 8e armée britannique qui, elle, n'a probablement pas bénéficié du même soutien mafieux, dut se battre pendant cinq semaines et subir de nombreuses pertes pour atteindre partiellement ses objectifs. Cette alliance avec la Mafia aurait, selon certains historiens, sauvé la vie à 50 000 soldats américains. Le General Patton appellera, à partir de ce moment, le parrain sicilien Don Calogero Vizzini, l'organisateur de cette déroute italo-allemande, le « General Mafia ». En récompense celui-ci, qui avait passé des années en prison, sera élu maire de sa ville, Villalba, sous l'oeil bienveillant des Alliés. Une semaine après la chute de Palerme, le 25 juillet, Mussolini est éliminé par le Grand conseil fasciste et un mois après l'Italie capitule. Dans ce processus qui suit le débarquement en Sicile, le rôle du réseau d'influence constitué par Genovese sera très important. Ainsi, Ciano participe aux côtés de Badoglio à l'élimination de Mussolini. La structure de marché noir mise en place dans la région de Naples travaillera en complète harmonie avec les forces Alliées pour un profit mutuel. Vito Genovese deviendra l'homme de confiance de Charlie Poletti, gouverneur militaire américain de toute l'Italie occupée. Par la suite Genovese, de retour aux Etats-Unis, deviendra là-bas le principal boss mafieux de l'après-guerre.
L'alliance qui s'est nouée durant la guerre entre l'Etat américain et la Mafia ne va pourtant pas s'achever avec celle-ci, l’Honorata Societa est un partenaire qui s'est révélé trop efficace et trop utile pour risquer qu'elle serve d'autres intérêts, alors qu'avec la fin de la 2e guerre mondiale, l'Etat américain voit se profiler l'émergence d'un nouveau rival impérialiste : l'URSS.
LE RESEAU « GLADIO » : une structure de manipulation pour les intérêts stratégiques du bloc
En octobre 1990, le président du conseil Giulio Andreotti révèle l'existence d'une organisation clandestine, parallèle aux services secrets officiels, financée par la CIA, intégrée à l'OTAN et chargée de faire face à une éventuelle invasion russe et, par extension, à lutter contre l'influence communiste : le réseau Gladio. Ce faisant, il provoque un beau tollé. Pas seulement en Italie, mais internationalement dans la mesure où une telle structure a été constituée dans tous les pays du bloc occidental sous le contrôle des Etats-Unis.
«Officiellement», le réseau Gladio a été constitué en 1956, mais son origine réelle remonte à la fin de la guerre. Avant même que la deuxième guerre mondiale ne soit achevée, alors que le destin des forces de l'Axe est déjà scellé, le nouvel antagonisme qui se développe entre les Etats-Unis et l'URSS polarise l'activité des états-majors et des services secrets. Les crimes de guerre et les responsabilités sont oubliés au nom de la guerre qui commence à se mener contre l'influence du nouvel adversaire russe. Dans toute l'Europe les services Alliés, et notamment américains, opèrent un recrutement tous azimuts d'anciens fascistes et nazis, d'hommes de sac et de corde, d'aventuriers de tous poils, au nom de la sacro-sainte lutte contre le « communisme ». Les « vaincus » trouvent là une occasion de se refaire une virginité à bon compte.
En Italie, la situation est particulièrement délicate pour les intérêts occidentaux. Il y existe le Parti stalinien le plus fort d'Europe occidentale qui sort de la guerre auréolé de gloire pour son rôle déterminant dans la résistance face au fascisme. Alors que se préparent les élections pour 1948, conformément à la nouvelle constitution mise en place à la Libération, l'inquiétude grandit parmi les stratèges occidentaux, car nul ne peut être certain du résultat, et une victoire du PCI serait une catastrophe. En effet, alors que la Grèce est plongée dans la guerre civile et que le PC menace d'y prendre le pouvoir par la force, que la Yougoslavie est encore dans l'orbite russe, la chute de l'Italie sous l'influence de 1’URSS signifierait un désastre stratégique de première grandeur pour les intérêts occidentaux, avec le risque de perdre le contrôle de la Méditerranée et donc l'accès au Moyen-Orient.
Pour faire face à cette menace, les divisions de la guerre sont vite oubliées par la bourgeoisie italienne. En mars 1946, le Haut Commissariat pour les sanctions contre le fascisme, chargé d'épurer l'Etat des éléments qui s'étaient trop impliqués dans le soutien à Mussolini, est dissous. Les partisans sont démobilisés. Les autorités mises en place par les Comités de libération, notamment à la tête de la police, sont remplacées par des responsables naguère nommés par Mussolini. De 1944 à 1948, on estime que 90 % du personnel de l'appareil d'Etat du régime fasciste a réintégré ses fonctions.
La campagne électorale censée sanctifier la nouvelle république démocratique bat son plein. L'establishment financier et industriel, l'armée, la police, qui avaient été les principaux soutiens du régime fasciste, se mobilisent et, face au danger « communiste », embouchent la trompette de la défense de la démocratie occidentale, leur ancien ennemi. Le Vatican, fraction essentielle de la bourgeoisie italienne qui, après avoir soutenu le régime de Mussolini, avait joué double-jeu durant la guerre, comme à son habitude, se lance aussi dans la campagne électorale et le Pape devant 300 000 fidèles réunis sur la place Saint-Pierre déclare que « celui qui offrirait son aide à un parti qui ne reconnaît pas Dieu serait un traître et un déserteur ».
La Mafia dans le sud de l'Italie va s'employer activement dans la campagne électorale, finançant la Démocratie-chrétienne, donnant des consignes de vote à sa clientèle.
Tout cela sous l'oeil bienveillant et avec le soutien actif des Etats-Unis. En effet, l'Etat américain ne ménage pas ses efforts. Aux Etats-Unis, une campagne, « lettere à Italia » est mise en place pour que les italo-américains envoient à leur famille en Italie des lettres recommandant le « bon » vote. La radio Voice of America qui, durant la guerre, vilipendait les méfaits du régime fasciste, dénonce dorénavant à longueur de journée les dangers du «communisme». Deux semaines avant les élections, le Plan Marshall est approuvé, mais les Etats-Unis n'ont pas attendu cette échéance pour inonder le gouvernement italien de dollars. Quelques semaines avant, une aide de 227 millions de dollars avait été votée par le Congrès. Les partis et les organisations hostiles au PCI et au Front démocratique qu'il fédère reçoivent une aide sonnante et trébuchante : la presse américaine évalue alors les sommes dépensées dans ces circonstances à 20 millions de dollars.
Mais pour le cas où tout cela ne suffirait pas à faire échec au Front démocratique du PCI, les Etats-Unis vont mettre en place une stratégie secrète destinée à faire face à un éventuel gouvernement dominé par les staliniens. Les diverses cliques de la bourgeoisie italienne opposés au PCI -responsables de l'appareil d'Etat, armée, police, grands industriels et financiers, Vatican, parrains de la Mafia - sont contactés par les services secrets américains qui coordonnent leur action. Un réseau clandestin de résistance à une éventuelle mainmise «communiste» est structuré. Il recrute parmi les «anciens» fascistes, l'armée, la police, le milieu mafieux et, de manière générale, parmi tous les « anti-communistes » convaincus. La résurgence des groupes fascistes est encouragée au nom de la défense des « libertés ». Des armes sont distribuées clandestinement. L'éventualité d'un coup d'Etat militaire est envisagée et ce n'est pas un hasard si, quelques jours avant l'élection, 20 000 carabiniers sont engagés dans des manoeuvres avec du matériel blindé et si le ministre de l'Intérieur, Mario Scelba, déclare avoir organisé une structure capable de faire face à une insurrection armée. En cas de victoire du PCI la sécession de la Sicile est prévue. Les Etats-Unis peuvent compter pour cela sur la Cosa Nostra qui soutient dans cette intention la lutte « indépendantiste » de Salvatore Giuliano, tandis que l'état-major américain prévoit sérieusement une occupation de la Sicile et de la Sardaigne par ses forces armées.
Finalement, le 16 avril 1948, avec 48 % des voix, la Démocratie-chrétienne l'emporte avec 40 sièges de majorité. Le PCI est renvoyé dans l'opposition. Les intérêts occidentaux sont saufs. Mais les premières élections de la nouvelle république démocratique italienne issue de la Libération n'ont rien eu de démocratique. Elles sont le produit d'une gigantesque manipulation. Et de toute façon, si le résultat en avait été défavorable, les forces « démocratiques » de l'Occident étaient prêtes à organiser un coup d'Etat, à semer le désordre, à susciter une guerre civile pour restaurer leur contrôle de l'Italie. C'est sous ces auspices et dans ces conditions rien moins que « démocratiques » qu'est née la république italienne. Jusqu'à aujourd'hui elle en porte les stigmates.
Pour parvenir à ce résultat électoral, loin du cadre officiel du fonctionnement « démocratique », une structure clandestine, regroupant les secteurs de la bourgeoisie les plus favorables aux intérêts occidentaux et formant ainsi la clique dominante au sein de l'Etat italien, a été mise en place sous la houlette des Etats-Unis. Ce qui sera plus tard dénommé le réseau Gladio regroupe ainsi secrètement un cerveau politique : le sommet ; un corps économique : les différents clans intéressés qui en tirent profit tout en le finançant ; des bras armés : la piétaille aux ordres, recrutée par les services secrets de toutes sortes, et chargée des basses besognes. Cette structure a montré son efficacité et elle sera maintenue. En effet, avec le développement des antagonismes impérialistes de la période dite de la « guerre froide », avec la présence d'un PC très puissant en Italie, ce qui était valable du point de vue des intérêts stratégique occidentaux au lendemain de la guerre reste d'actualité.
Cependant, manipuler les résultats électoraux, au travers d'un contrôle serré des partis politiques, des principaux organes de l'Etat, des médias et du coeur de l'économie, ne suffisait pas. Le danger d'un retournement de situation au profit du PCI subsistait. Depuis la fin de la guerre, pour faire face à la « subversion communiste », l'organisation Gladio (ou son équivalent sous quelque nom que ce soit) a préparé l'éventualité d'un coup d'Etat militaire pour le compte du bloc occidental.
- En 1967, L'Expresso dénonce les préparatifs putschistes organisés trois ans plus tôt par les carabiniers et les services secrets. Par la suite, dans leur enquête, les juges vont se heurter au secret d'Etat, à la dissimulation des preuves par les services secrets, à l'obstruction des ministères et d'hommes politiques influents et à une série de décès mystérieux parmi les protagonistes de l'affaire.
- Dans la nuit du 7-8 décembre 1970, un commando d'extrême-droite occupe le ministère de l’Intérieur à Rome. Ce complot avorte et les quelques centaines d'hommes en armes qui se promènent dans la nuit romaine rentreront chez eux à l'aube. Aventurisme de quelques éléments fascistes ? A voir ! L'instruction, qui va durer sept ans, montrera que ce complot a été organisé par le prince Valerio Borghese, qu'il bénéficiait de complicités militaires au plus haut niveau, de complicités politiques au sein de la Démocratie-chrétienne et du Parti social-démocrate, et que l'attaché militaire de l'ambassade américaine était en liaison étroite avec les initiateurs du coup. Là encore, l'enquête sera peu à peu étouffée, même si l'Amiral Miceli, responsable des services secrets, est destitué en 1974 à la suite d'un mandat d'arrêt qui l'inculpe « d'avoir promu, constitué et organisé en concours avec d'autres personnes une association secrète de militaires et de civils destinée à provoquer une insurrection armée. »
- En 1973, un autre complot visant à fomenter un coup d'Etat est découvert par la police italienne, organisé par l'ancien ambassadeur d'Italie à Rangoon, Edgardo Sogno. Encore une fois, l'instruction est empêchée de mener son enquête au nom du « secret d'Etat ».
Cependant, à bien les considérer, ces complots, plus que de réelles tentatives de coup d'Etat qui auraient échoué, semblent au contraire correspondre à des préparatifs « au cas où » et à des manoeuvres pour entretenir une atmosphère politique. En effet, en 1969, Italie est secouée par une vague de grèves, 1'« automne chaud », qui marque le réveil de la lutte de classe et vient aviver, dans la tête des stratèges de l'OTAN, la peur d'une déstabilisation de la situation sociale en Italie. Au lendemain de 1969, une stratégie va être élaborée, destinée à rétablir l'ordre et à renforcer l'Etat : la « stratégie de la tension. »
LA « STRATEGIE DE LA TENSION » : la provocation comme méthode de gouvernement
En 1974, Roberto Caballero, un fonctionnaire du syndicat fasciste Cisnal, déclare dans une interview à L'Europeo : « Quand des troubles apparaissent dans le pays (désordres, tensions syndicales, violences), l'Organisation se met en action pour créer les conditions d'un rétablissement de l'ordre si les troubles ne se produisent pas, ils sont créés par l'organisation elle-même, par le truchement de tous ces groupes d'extrême-droite (quand il ne s'agit pas de groupes d'extrême-gauche) aujourd'hui impliqués dans les procès sur la subversion noire, » et il précise aussi que le groupe dirigeant de cette organisation « qui comprend des représentants des services secrets italiens et américains ainsi que de puissantes sociétés multinationales, a choisi une stratégie de désordre et de tensions qui justifie le rétablissement de l'ordre. »
En 1969, on dénombre 145 attentats commis. Le point culminant, cette année-là, sera atteint le 12 décembre avec des explosions meurtrières à Rome et Milan faisant 16 morts et une centaine de blessés. L'enquête sur ces attentats va s'égarer durant trois ans sur la piste anarchiste avant qu'elle ne s'oriente, malgré tous les obstacles mis sur son chemin, sur la piste noire, celle de l'extrême-droite et des services secrets. L'année 1974 est marquée par deux explosions meurtrières à Brescia (7 morts, 90 blessés) et dans un train, Italicus (12 morts, 48 blessés). Encore une fois, c'est la piste noire qui est mise en évidence. Cependant, à partir de cette année 1974, le terrorisme « noir » de l'extrême-droite laisse la place au terrorisme des Brigades rouges qui atteint son sommet avec l'enlèvement et l'assassinat du président du Conseil, Aldo Moro. Mais en 1980 l'extrême-droite refait son apparition violente avec le sanglant attentat de la gare de Bologne (90 morts) qui lui est finalement attribué. Une fois de plus, les services secrets sont mouillés par l'instruction et de nouveau des généraux responsables de ces services passeront en procès.
La « stratégie de la tension » a été mise en oeuvre avec cynisme et efficacité pour renforcer un climat de terreur et justifier ainsi le renforcement des moyens de répression et de contrôle de la société par l'Etat. Le lien entre le terrorisme d'extrême-droite et les services secrets a été clairement mis en évidence par les enquêtes qui ont été menées, même si celles-ci ont été globalement étouffées. Par contre, en ce qui concerne le terrorisme d'extrême-gauche, mené par des groupes comme les Brigades rouges et Prima Linea, ces liens n'ont pas été démontrés de manière claire par les enquêtes policières. Pourtant, là aussi, avec le recul du temps, les témoignages et les éléments s'accumulent qui tendent à démontrer que le terrorisme « rouge » a été encouragé, manipulé, utilisé, sinon parfois directement impulsé par l'Etat et ses services parallèles.
Il faut déjà constater que les attentats des Brigades rouges ont finalement le même résultat que celui des néo-fascistes : créer un climat d'insécurité propice aux campagnes idéologiques de l'Etat visant à justifier le renforcement de ses forces répressives. Dans la deuxième moitié des années 1970, ils tombent à point pour faire oublier ce que les enquêtes commençaient à mettre en évidence : à savoir que les attentats de 1969 à 1974 n'étaient pas l'oeuvre d'anarchistes, mais d'éléments fascistes utilisés par les services secrets. Justifiés par une phraséologie révolutionnaire, ces attentats « rouges » sont le meilleur moyen pour semer la confusion dans le processus de clarification de la conscience en train de s'opérer au sein de la classe ouvrière. Ils permettent de faire peser lourdement le poids de la répression sur les éléments les plus avancés du prolétariat et sur le milieu révolutionnaire, assimilés au terrorisme. Bref, du point de vue de l'Etat, il est bien plus utile que le terrorisme « noir ». C'est d'ailleurs pour cela que, dans un premier temps, les médias de la bourgeoisie au service de l'Etat attribuent les premiers attentats réalisés par l'extrême-droite à des anarchistes, tel était d'ailleurs le but de la manoeuvre : une provocation.
« Il peut arriver que face à la subversion communiste les gouvernements de pays Alliés fassent preuve de passivité ou d'indécision. L'espionnage militaire des Etats-Unis doit avoir le moyen de lancer des opérations spéciales capables de convaincre les gouvernements des pays Alliés et l'opinion publique de la réalité du danger d'insurrection. L'espionnage militaire des Etats-Unis devrait chercher à infiltrer les foyers d'insurrection au moyen d'agents en mission spéciale chargés déformer certains groupes d'action au sein des mouvements les plus radicaux. ». Cette citation est extraite du US Intelligence Field Manual, manuel de campagne des espions américains, dont les responsables de Washington prétendent qu'il est un faux. Mais il a été authentifié par le Colonel Oswald Le Winter ([4] [196]), ancien agent de la CIA et officier de liaison en Europe, dans un documentaire télévisé consacré à Gladio. Il lui donne aussi un contenu concret en déclarant dans cet interview: «Les Brigades rouges avaient été infiltrées de même que Baader-Meinhof et Action Directe. Plusieurs de ces organisations terroristes de gauche étaient infiltrées et sous contrôle », et précise que « des rapports et des documents émis par notre bureau de Rome attestaient que les Brigades rouges avaient été infiltrées et que leur noyau dirigeant recevait ses ordres de Santovito.». Le général Santovito était à l'époque le chef des services secrets italiens (SISMI). Source plus fiable, Federico Umberto d'Amato, ancien chef de la police politique et ministre de l'Intérieur de 1972 à 1974, raconte avec fierté : « Les Brigades rouges ont été infiltrées. Cela a été difficile parce qu'elles étaient dotées d'une structure très fermée et très efficace. Toutefois, elles ont été infiltrées de façon remarquable, avec des résultats optimaux. »
Plus que tout autre attentat commis par les Brigades rouges, l'enlèvement d'Aldo Moro, l'assassinat de son escorte, sa séquestration et son exécution finale en 1978 vont faire soupçonner une manoeuvre d'un clan dans l'Etat et des services secrets. On s'étonne que les Brigades rouges, composées de jeunes éléments révoltés, très motivés et convaincus, mais sans grande expérience de la guerre clandestine, aient pu mener à bien une opération d'une telle envergure. L'enquête met en lumière plusieurs faits troublants : présence d'un membre des services secrets sur le lieu de l'enlèvement, les balles qui ont été tirées ont subi un traitement spécial utilisé dans les services spéciaux, etc. Alors que le scandale suscité par la découverte de la main de l'Etat dans les attentats de 1969 à 1974, faussement attribués aux anarchistes, commençait à être oublié, le doute renaît dans l'opinion publique italienne sur une manipulation étatique derrière les attentats des Brigades rouges. En effet, Aldo Moro est enlevé à la veille de la signature du « Compromis historique » qui devait sceller une alliance de gouvernement entre la Démocratie-chrétienne et le PCI, et dont Moro était le maître d'oeuvre. Sa veuve déclare : « Je savais par mon mari, ou par une autre personne, qu'aux environs de 1975 on l'avait averti que ses tentatives d'amener toutes les forces politiques à gouverner ensemble pour le bien du pays déplaisaient à certains groupes et à certaines personnes. On lui avait dit que s'il persistait à vouloir mener à bien son projet politique, il risquait de payer son obstination très chère. » L'option du «Compromis historique » aurait eu pour résultat d'ouvrir les portes du gouvernement au PCI. Moro qui était au courant, en tant que président du Conseil, de l'existence de Gladio, pensait probablement que le travail d'infiltration mené depuis des années au sein de ce parti, afin de le soustraire à l'influence de l'Est, et que son éloignement grandissant des options politiques russes, le rendaient acceptable au yeux de ses alliés occidentaux. Mais la manière dont l'Etat le lâcha durant son enlèvement montre que ce n'était pas le cas. Finalement, le « Compromis historique » n'a pas été signé. La mort de Moro correspond donc parfaitement à la logique des intérêts défendus par Gladio. Et lorsque D'Amato parle de « résultats optimaux » obtenus dans l'infiltration des Brigades rouges, pense-t-il à l'assassinat de Moro ?
Les diverses enquêtes butaient toujours sur l'obstruction de certains secteurs de l'Etat, les manoeuvres administratives dilatoires et le sacro-saint secret d'Etat. Mais avec le dévoilement de la Loge P2 en 1981, les juges voient leurs soupçons confirmés quant à l'existence d'une structure parallèle, d'un gouvernement occulte qui tirait les ficelles dans l'ombre et organisait la « stratégie de la tension ».
LA LOGE P2 : le véritable pouvoir occulte de l'Etat
En 1981, la Garde des finances découvre la liste de 963 « frères » membres de la Loge P2. Sur cette liste figurent le Gotha de la bourgeoisie italienne : 6 ministres en exercice, 63 hauts fonctionnaires des ministères, 60 politiciens dont Andreotti et Cossiga, 18 juges et procureurs, 83 grands industriels dont Agnelli, Pirelli, Falk, Crespi, des banquiers tels Calvi et Sindona, des membres du Vatican tel le cardinal Casaroli, de grands noms du secteur de la communication comme Rizzoli propriétaire du Corriere de la Sera, ou Berlusconi propriétaire de nombreuses chaînes de télévision, quasiment tous les responsables des services secrets depuis des années dont les généraux Allavena, chef du SIFAR de juin 1965 à juin 1966, Miceli nommé à la tête des services secrets en 1970, l'Amiral Casardi qui lui succède, le Général Santovito alors patron du SISMI, 14 généraux de l'armée, 9 amiraux, 9 généraux des carabiniers, 4 généraux de l'aéronautique et 4 de la garde des finances, pour ne citer que les officiers les plus capes. Mais il faut aussi citer des universitaires, des syndicalistes, des responsables de groupes d'extrême-droite. A l'exclusion des radicaux, des gauchistes et du PCI, tout l'éventail politique italien est représenté. Cette liste n'est pourtant certainement pas complète. De nombreux autres noms au moment du scandale ont été cités sans qu'une preuve puisse être apportée. Des rumeurs invérifiables ont même couru sur la participation de membres influents du PCI à la P2.
Pourtant, on pourrait penser qu'il n'y a là rien que de très habituel. En effet, il est courant de retrouver au sein de la franc-maçonnerie de nombreux notables qui pratiquent ses rites et qui trouvent là un bon moyen de cultiver leurs relations et de remplir leur carnet d'adresses. La personnalité du Grand-Maître, Licio Gelli, est pourtant troublante.
A la tête de cette loge, Gelli est inconnu du grand public, mais le développement de l'enquête et les révélations qui se succèdent va montrer l'influence déterminante qu'il a exercée sur la politique italienne durant des années. Personnage à l'histoire édifiante, Gelli a commencé sa carrière comme membre du parti fasciste. A 18 ans il s'engage chez les Camicie nere, les « chemises noires » qui vont combattre en Espagne. Pendant la guerre il collabore activement avec les nazis auxquels il livre des dizaines de partisans et de déserteurs. A partir de 1943 il semble qu'il commence à faire double jeu en contactant la Résistance et les services secrets américains. Après la guerre il se réfugie en Argentine et revient sans problèmes en Italie en 1948. Au début des années 1960 il s'inscrit à la Franc-maçonnerie, participe à la loge Propaganda due, dont il devient rapidement le Grand Maître et où il est rejoint par les principaux responsables des services secrets. Sa puissance alors est confirmée par de nombreux témoignages. Lors du mariage d'un de ses enfants, d'éminentes personnalités tels le président du Conseil Amintore Fanfani et, semble-t-il, le pape Paul VI, envoient des cadeaux somptueux. Selon les enquêteurs, en signe d'amitié, Agnelli lui aurait offert un téléphone en or massif. Au début des années 1980, Gelli téléphone presque chaque jour au président du Conseil, au ministre du Commerce et de l'Industrie, à celui des Affaires étrangères, aux dirigeants des principaux partis politiques de la Péninsule (démocrate-chrétien, socialiste, social-démocrate, républicain, libéral et néofasciste). A sa résidence près de Florence et dans les salons privés du luxueux hôtel Excelsior où il reçoit, défile le Gotha de l'Establishment italien, notamment Andreotti, qui est en fait son représentant politique officiel, son âme damnée.
La conclusion de la commission d'enquête sur la Loge P2 ne manque pas d'intérêt. Elle estime que Gelli « appartient aux services secrets dont il est le chef; la Loge P2 et Gelli sont l'expression d'une influence exercée par la maçonnerie américaine et la CIA sur le Palazzo Giustiniani depuis sa réouverture après la guerre ; une influence qui témoigne de la dépendance économique à l'égard de la Maçonnerie américaine et de son chef Frank Gigliotti. » Gigliotti est lui-même un agent de la CIA. En 1990, un ex agent de la CIA, Richard Brenneke, dans une interview à la télévision qui fait scandale, déclare : « Le gouvernement des Etats-Unis finançait la P2 jusqu'à 10 millions de dollars par mois. » Voilà qui est clair. La P2 et Gladio ne font qu'un. L'acte d'accusation du 14 juin 1986 fait état de « l'existence en Italie d'une structure secrète composée de militaires et de civils qui, s'étant donnée comme finalité ultime le conditionnement des équilibres politiques existants à travers le contrôle de l'évolution démocratique du pays, a tenté de réaliser cet objectif en se servant des moyens les plus divers, parmi lesquels le recours direct aux attentats commis par des organisations néo-fascistes » et parle d' « une sorte de gouvernement invisible dans lequel la P2, des secteurs déviants des services secrets, le crime organisé et le terrorisme sont étroitement liés. »
Mais pourtant, ce constat lucide des juges ne va pas changer grand chose au fonctionnement de l'Etat italien. Soupçonné d'avoir commandité l'attentat de Bologne, Gelli s'exile à l'étranger. Arrêté dans une banque suisse le 13 septembre 1982, alors qu'il retirait 120 millions de dollars d'un compte numéroté, le vieil homme sera l'auteur d'une invraisemblable évasion de sa prison genevoise le 10 août 1983, et il s'évanouira dans la nature, jusqu'à ce que, quatre ans plus tard, il vienne se livrer aux autorités helvétiques. De Suisse Gelli sera extradé en Italie. Mais alors qu'en son absence il avait, en 1988, été condamné à 10 ans de prison, il sera rejugé en 1990 et finalement acquitté. Le scandale de la P2 est banalisé, oublié. La Loge P2 a disparu mais, n'en doutons pas, une autre structure occulte a du la remplacer, tout aussi efficace. En 1990, Cossiga, président de la République et ex-membre de la P2, pourra déclarer avec satisfaction à propos de Gladio, qu'il est « fier que le secret ait pu être gardé pendant 45 ans. » Oubliés les dizaines de morts victimes des attentats, oubliés les multiples assassinats. De nouveaux scandales viennent à point faire oublier les anciens.
QUELQUES LEÇONS
Tous ces événements, où la grande histoire de l'Italie voisine avec le crime et le fait divers, n'ont finalement eu que peu d'écho en dehors de la péninsule. Tout cela est apparu comme des « affaires italiennes », sans correspondance avec ce qui se passait dans les autres grandes démocraties occidentales. En Italie même, le rôle de la Mafia a été surtout présenté comme un produit régional du sud de l'Italie, la « stratégie de la tension » comme l'oeuvre de secteurs dévoyés des services secrets, et les scandales politiques comme un simple problème de corruption de certains politiciens. Bref, les véritables leçons ont été escamotées et, de scandales en révélations, de procès médiatisés en démissions de responsables étatiques, l'illusion d'une lutte de l'Etat contre ces atteintes à l'ordre démocratique a été maintenue. Pourtant, ce que met clairement en évidence ce bref historique des « affaires » qui ont ébranlé la république italienne depuis les années 1930 est tout autre.
- Les « affaires » ne sont pas un produit spécifiquement italien, mais le résultat de l'activité internationale de la bourgeoisie, dans un contexte de rivalités impérialistes exacerbées. Dans ces conditions, cela signifie que l'Italie, loin d'être une exception, est au contraire un exemple de ce qui existe partout.
- Elles ne sont pas l'expression d'une minorité dévoyée de la classe dominante, mais elles traduisent le fonctionnement totalitaire de l'Etat du capitalisme décadent, même si celui-ci se cache derrière le masque de la démocratie.
Aussi bien l'histoire de l'ascension de Cosa Nostra que les révélations de l'existence des réseaux Gladio et de la Loge P2, montre qu'il ne s'agit pas d'affaires italiennes, mais bien d'affaires internationales.
Cela est particulièrement évident avec l'affaire Gladio. Le réseau Gladio était, par définition, une structure secrète de l'OTAN, donc internationale. Elle était la courroie de transmission clandestine du contrôle des Etats-Unis sur les pays de leur bloc, destinée à s'opposer aux manoeuvres de l'impérialisme adverse et aux risques de déstabilisation sociale par tous les moyens, y compris les moins avouables. C'est pourquoi elle était secrète,. De la même manière qu'elle a existé et agi en Italie, elle a existé et agi dans les autres pays du bloc occidental. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement : aux mêmes causes, les mêmes effets.
Avec cet éclairage, on peut mieux comprendre les forces qui étaient à l'oeuvre derrière le coup d'Etat des colonels en Grèce en 1967, celui de Pinochet au Chili en 1973, ou encore tous ceux qui se sont succédés en Amérique latine durant les années 1970. De même, ce n'est pas seulement en Italie que, à partir de la fin des années 1960, des vagues d'attentats terroristes se sont développées, qui ont aidé l'Etat à mener des campagnes idéologiques intenses destinées à déboussoler la classe ouvrière qui reprenait le chemin de la lutte et à justifier le renforcement de son arsenal répressif En Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, au Japon, en Espagne, en Belgique, aux Etats-Unis, on peut, à la lumière de l'exemple italien, penser avec raison que, derrière les agissements terroristes de groupes d'extrême-droite, d'extrême-gauche, nationalistes, il y a la main de l'Etat et de ses services secrets, et l'expression d'une stratégie internationale organisée sous les auspices du bloc.
De même, l'exemple édifiant en Italie du rôle de la Mafia révèle que ce n'est pas là un fait très récent, ni un produit spécifiquement local. L'intégration de la Mafia au coeur de l'Etat italien n'est pas un phénomène nouveau : elle date de plus de cinquante ans. Elle n'est pas le produit d'une simple et lente gangrène affairiste qui affecterait seulement les politiciens les plus corrompus : elle est le résultat du bouleversement des alliances qui s'est opéré durant la seconde guerre mondiale. La Mafia, pour le compte des Alliés, a joué un rôle déterminant dans la chute du régime mussolinien et, pour paiement de ses services, a gagné une place centrale dans l'Etat. L'alliance qui est scellée avec la guerre ne va d'ailleurs pas cesser avec celle-ci. La Mafia restera, comme clique de la bourgeoisie italienne, le principal point d'appui des Etats-Unis. Le poids et le rôle important de la Mafia au sein de l'Etat italien est donc, avant tout, le résultat de la stratégie impérialiste américaine.
Alliance contre-nature entre le champion américain de la défense de la démocratie et le symbole du crime au nom des impératifs stratégiques mondiaux ? Alliance, oui, contre-nature, certainement pas. La réalité italienne ne fait que mettre en évidence un phénomène mondial du capitalisme décadent : au nom des sacro-saints impératifs de la raison d'Etat et des intérêts impérialistes, les grandes puissances qui, sur le devant de la scène médiatique, claironnent leurs convictions démocratiques, nouent, dans l'arrière-cour, des alliances qui montrent le mensonge de tous leurs discours officiels. C'est une banalité de constater que les multiples dictateurs qui sévissent à la périphérie sous-développée du capitalisme subsistent grâce au parrainage intéressé d'une puissance ou d'une autre. Il en est de même pour les clans mafieux dans le monde : leur activité peut se développer impunément parce qu'ils savent aussi rendre des services précieux aux divers impérialismes dominants qui se partagent la planète.
Ils sont même le plus souvent partie intégrante des fractions dominantes de la bourgeoisie des pays où ils sévissent. C'est évident pour toute une série de pays dont la production et l'exportation de drogue constituent l'activité économique essentielle, favorisant au sein de la classe dominante l'ascension des gangs qui contrôlent ce secteur de l'économie capitaliste qui prend de plus en plus d'importance. Mais cette réalité n'est pas l'apanage des pays sous-développés et l'exemple vient du haut de la hiérarchie du capitalisme mondial. Ainsi, l'alliance entre l'Etat américain et la Mafia italienne, pendant la deuxième guerre mondiale, trouve aussi son pendant au niveau interne aux Etats-Unis où, par la même occasion, la branche américaine de Cosa Nostra est en fait invitée à participer, avec ses moyens, aux affaires de l'Etat. De même, la situation au Japon n'est pas sans rappeler celle de l'Italie et les récents scandales qui y ont éclaté mettent en lumière l'omniprésence des liens entre les politiques et la Mafia locale. L'exemple italien est donc aussi valable pour les deux premières puissances économiques mondiales où ce qu'on appelle la Mafia a conquis une place de choix au sein de l'Etat. Ce n'est cependant pas seulement dû au poids économique considérable lié à la maîtrise de secteurs économiques extrêmement lucratifs -drogue, jeu, prostitution, racket, etc. - , mais aussi aux services « spécialisés » que ces cliques de gangsters peuvent rendre et qui correspondent parfaitement aux besoins de l'Etat du capitalisme décadent.
Il est vrai que la bourgeoisie la plus « respectable » a toujours su, lorsque cela était nécessaire, utiliser les services d'agents spéciaux, ou ceux de ses fractions les moins fréquentables pour des activités « non-officielles », c'est-à-dire illégales selon ses propres lois. Au 19e siècle, les exemples ne manquent pas : l'espionnage bien sûr, mais aussi l'embauche de gros bras du milieu pour casser des grèves ou l'utilisation de Mafias locales pour favoriser la pénétration coloniale. Mais à cette époque cet aspect de la vie du capitalisme était limité et circonstanciel. Depuis son entrée dans sa phase de décadence au début du siècle, le capitalisme est dans une situation de crise permanente. Il ne peut plus, pour assurer sa domination, s'appuyer sur la réalité du progrès qu'il apporte, car tel n'est plus le cas. Pour perpétuer son pouvoir, de plus en plus, il a du recourir au mensonge et à la manipulation. De plus, au cours du 20e siècle, marqué par deux guerres mondiales, l'exacerbation des tensions impérialistes est devenue un facteur prépondérant de la vie du capitalisme. Dans la foire d'empoigne qu'est devenue la planète, tous les coups, même les plus tordus, sont permis pour assurer la survie. Pour répondre à ces nécessités, le fonctionnement de l'Etat a dû s'adapter. Dans la mesure où la manipulation et le mensonge, que ce soit pour les besoins de la défense impérialiste ou ceux du contrôle social, sont devenus des aspects essentiels de sa survie, le secret et sa préservation sont devenus un aspect central de la vie de l'Etat capitaliste, le fonctionnement démocratique classique de la bourgeoisie et de son Etat, tels qu'il existait au 19e siècle, n'est plus possible. Il n'est perpétué que comme illusion destinée à masquer la réalité d'un fonctionnement étatique totalitaire, qui n'a plus rien de démocratique. La réalité du pouvoir et ses agissements, parce qu'ils devenaient inavouables, ont été occultés. Non seulement le pouvoir effectif s'est concentré au sein de l'exécutif, aux dépens du législatif, dont la représentation, le parlement, est devenu un simple paravent destiné à alimenter les campagnes médiatiques, mais de plus, au sein même de cet exécutif, le pouvoir est concentré entre les mains des spécialistes du secret et des manipulations en tous genres. Dans ces conditions, non seulement l'Etat a dû recruter une abondante main d'oeuvre spécialisée, créant une multitude de services spéciaux, tous plus secrets les uns que les autres, mais en son sein, l'ascension des cliques de la bourgeoisie les plus expérimentées dans le secret et l'activité « illégale » a été, comme conséquence, favorisée. Dans ce processus, l'Etat totalitaire a étendu son emprise sur l'ensemble de la société, y compris ses bas-fonds, aboutissant à une symbiose extraordinaire où il devient difficile de distinguer un représentant politique d'un homme d'affaires, d'un agent secret ou d'un gangster, et vice versa.
Telle est la raison de fond du rôle croissant des secteurs mafieux dans la vie du capital. Mais la Mafia n'est pas le seul exemple. L'affaire de la Loge P2 montre que la Maçonnerie est un instrument idéal, par son fonctionnement occulte et ses ramifications internationales, pour être utilisée comme réseau d'influence par les services secrets pour les besoins de la politique impérialiste. Cela fait d'ailleurs longtemps que les diverses obédiences maçonniques dans le monde ont été investies par le pouvoir d'Etat et mises au service des puissances impérialistes occidentales qui les utilisent selon leurs plans. C'est d'ailleurs probablement le cas de la majeure partie des sociétés secrètes d'une quelconque importance.
Mais la Loge P2 n'était pas seulement un outil de la politique impérialiste américaine. Elle était d'abord une partie du capital italien et elle montre, au-delà du verbiage démocratique, la réalité du fonctionnement de l'Etat et de son totalitarisme. Elle regroupait en son sein des clans de la bourgeoisie qui dominent de manière occulte l'Etat depuis des années. Cela ne veut pas dire qu'elle regroupait toute la bourgeoisie italienne. Déjà, à priori le PCI en était exclu, représentant une autre faction à l'orientation en politique étrangère tournée vers l'Est. Il est également probable que d'autres cliques existent au sein du capital italien, ce qui pourrait expliquer que le scandale ait éclaté. En son sein de la Loge P2 cohabitaient d'ailleurs plusieurs clans soudés par les intérêts convergents sous la houlette américaine face au danger commun représenté par l'impérialisme russe et le danger de subversion «communiste». La liste trouvée dans la résidence de Gelli permet d'identifier certains de ces clans : les grands industriels du nord, le Vatican, un secteur très important de l'appareil d'Etat, notamment les états-majors de l'armée et des services secrets, et de manière plus discrète, la Mafia. Le lien de cette dernière avec la Loge P2 apparaît avec la présence des banquiers Sindona et Calvi, le premier mort empoisonné en prison et le deuxième étrangement pendu sous un pont de Londres, qui tous deux ont été impliqués dans des scandales financiers quand ils géraient à la fois les fonds du Vatican et de la Mafia. Etranges alliances parfaitement significatives du capitalisme contemporain. La Loge P2 nous présente un cocktail sulfureux qui montre encore une fois que souvent la réalité dépasse la fiction la plus échevelée : sociétés occultes, services secrets, Vatican, partis politiques, milieux des affaires, de l'industrie et de la finance, Mafia, journalistes, syndicalistes, universitaires, etc.
En fait, avec la Loge P2 est dévoilé le véritable centre de décision occulte qui a présidé aux destinées du capitalisme italien depuis la guerre. Gelli se nommait lui-même, avec un humour cynique, le «grand marionnettiste », celui qui, derrière la scène, tirait les ficelles et dont les « marionnettes » étaient les hommes politiques. Le grand jeu démocratique de l'Etat italien n'était donc qu'une habile mise en scène. Les décisions les plus importantes étaient prises ailleurs que dans les structures officielles (assemblée nationale, ministères, présidence du Conseil, etc.) de l'Etat italien. Cette structure secrète de pouvoir s'est maintenue quel qu'ait été le résultat des multiples consultations électorales qui se sont déroulées durant toutes ces années. D'ailleurs, la Loge P2 avait toutes les cartes dans sa manche pour, comme en 1948, manipuler les élections et maintenir le PCI à l'écart. Quasiment tous les leaders des partis démocrates-chrétiens, républicains, socialistes, étaient à sa dévotion et le jeu « démocratique » de 1'« alternance » n'était qu'un trompe-l'oeil. La réalité du pouvoir, elle, ne changeait pas. En coulisse, Gelli et sa Loge P2 continuaient à contrôler l'Etat.
Là encore, il n'y a aucune raison pour qu'il s'agisse d'une spécificité italienne, même si ailleurs, le centre occulte de décision ne prend pas forcément l'aspect quelque peu folklorique d'une loge maçonnique. Depuis quelques années, l'aggravation brutale de la crise et le bouleversement des alignements impérialistes dû à la disparition du bloc de l'Est provoquent un chamboulement des alliances entre les cliques qui existent au sein de chaque capital national. Loin d'être l'expression d'une soudaine volonté de restaurer un fonctionnement démocratique, les campagnes qui se développent aujourd’hui dans de nombreux pays, au nom du nettoyage de l'Etat de ses éléments les plus pourris, ne sont que l'expression de règlements de compte entre diverses cliques pour le contrôle central de l'Etat. La manipulation des médias, l'usage à bon escient des dossiers compromettants, sont les armes de cette lutte qui peut aussi prendre d'autres formes plus sanglantes.
En fait, tout cela montre, avec le recul, que, loin d'être une exception, l'Italie, qui depuis des années voit se succéder les scandales politiques, était l'exemple édifiant et annonciateur de ce qui s'est aujourd'hui généralisé.
JJ.
Quelques références. Sur la Mafia : « Le syndicat du crime », J.-M. Charlier et J. Marcilly, Presses de la Cité, Paris 1980. Sur Gladio et la Loge P2 : « Intelligences secrètes », F. Calvi et O. Schmidt, Hachette, Paris 1988 ; « Gladio », EPO, Bruxelles 1991 ; ainsi que le documentaire télévisé en trois parties « Gladio », BBC 1992. Sur la « stratégie de la tension » en Italie : « Il partito del golpe », G. Flamini, Ferrara, Boloventa 1981.
Géographique:
- Italie [201]
Questions théoriques:
- Décadence [192]
- Impérialisme [178]
Comment est organisée la bourgeoisie : La bourgeoisie mexicaine dans l'histoire de l'impérialisme
- 3230 lectures
Différents facteurs, que ce soit le fait d'être une réserve de matières premières (minéraux, pétrole) ou surtout sa situation géographique -une longue frontière avec les Etats-Unis -, confèrent au Mexique une importance particulière au sein des relations impérialistes : il constitue une « priorité » pour la sécurité de la première puissance mondiale. Dans un article sur le Traité de libre commerce ([1] [202]), nous avons souligné que le traité a pour objectif fondamental de préserver la stabilité du Mexique (et au-delà, la stabilité de toute l'Amérique latine), parce que toute situation de conflits sociaux, chaos ou guerre, se répercuterait sur les Etats-Unis. En même temps, il s'agit pour les Etats-Unis, d'éviter qu'une bourgeoisie latino-américaine ne se rapproche d'une autre grande puissance, l'Allemagne ou le Japon par exemple. Mais, par-dessus tout, garantir la stabilité du gouvernement mexicain, sans qu'il y ait trop de désordres, un gouvernement qui soit de plus un allié inconditionnel au sud de sa frontière (et aussi au nord avec le Canada), est une priorité pour la bourgeoisie des Etats-Unis.
Il semble évident que la classe capitaliste du Mexique est alignée sur celle des Etats-Unis. Pourtant, en voyant la situation dans d'autres pays, y compris d'Amérique latine, où les gouvernements remettent en question, à plus ou moins grande échelle, leur fidélité aux Etats-Unis, où les bourgeoisies se tournent de plus en plus vers l'Allemagne (ou le Japon), ou se désintègrent, provoquant des crises politiques qui menacent l'unité de l'Etat capitaliste, nous devons nous poser la question : pourrions-nous voir au Mexique une situation de déstabilisation, ou même de remise en question de la domination américaine semblable à celle qui se produit dans d'autres pays, ou au contraire, le Mexique est-il pour les Etats-Unis, un terrain 100% acquis ?
L'ascension des Etats-Unis dans les dernières décennies du siècle dernier, a signifié une domination économique et politique de plus en plus totale sur les pays d'Amérique latine. Mais cette domination n'a pas été exempte de conflits et de difficultés. De fait, l'application de la dite « Doctrine Monroe », selon laquelle « l'Amérique appartient aux américains » (c'est-à-dire « l'Amérique latine appartient à la bourgeoisie des Etats-Unis »), a signifié, en premier lieu, la liquidation, au début du siècle, de l'influence des vieilles puissances qui avaient dominé l'Amérique latine tout au long du 19e siècle, celle de l'Angleterre en premier lieu. Ensuite, dans la première moitié du 20e siècle, elle a signifié la lutte contre ceux qui tentaient de s'approprier un morceau du gâteau américain, et surtout la lutte contre l'Allemagne. Enfin, après la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis ont dû combattre les tentatives de déstabilisation menées par 1’URSS. Tout au long de ce siècle, les crises politiques qui ont secoué les pays d'Amérique latine ont eu pour toile de fond - voire pour cause fondamentale- ces affrontements : changements violents de gouvernements, assassinats de responsables gouvernementaux, coups d'Etat ou guerres. L'attitude des bourgeoisies d'Amérique latine ne peut en aucun cas être qualifiée de passive. C'est plutôt que, cherchant à tirer le meilleur profit, elles ont pris le parti, appuyées plus d'une fois par les autres grandes puissances, de mettre en question plus ou moins sérieusement la suprématie américaine, sans jamais naturellement parvenir à se débarrasser d'elle. Le Mexique est une illustration parfaite de ce que nous avançons.
La soi-disant « Révolution mexicaine» ou d'où vient la «fidélité » de la bourgeoisie mexicaine ?
Une des conséquences les plus importantes -pour ne pas dire la plus importante de la guerre de 1910-1920, la soi-disant « révolution mexicaine », fut l'affaiblissement définitif de la bourgeoisie nationale qui avait grandi à l'ombre des vieilles puissances, et son remplacement par une « nouvelle bourgeoisie », alliée inconditionnelle et soumise des Etats-Unis. En effet, pendant la seconde moitié du 19e siècle, puis surtout pendant les trente années de l'ère Porfirio Diaz, s'était développé un capital national agressif et combatif (dans les mines, les chemins de fer, le pétrole, le textile, etc., ainsi que dans le commerce et les finances), sous la houlette de pays comme la France ou l'Angleterre. La bourgeoisie mexicaine de cette époque voyait comme une menace les avancées et les prétentions des Etats-Unis, une menace contre l'Amérique latine et le Mexique en particulier, et essayait de la contrecarrer en ouvrant ses portes à d'autres puissances, dans l'illusion qu'en multipliant les influences politiques en provenance d'Europe, aucune puissance ne pourrait prédominer.
Cependant, vers la fin du 19e siècle, la dictature féroce de Diaz commença à se lézarder. La forme de la dictature militaire de l'Etat capitaliste devenait trop étroite pour le stade de développement atteint par l'économie, et différents facteurs ont poussé à la modification de cette situation. Ceci s'est exprimé par le fractionnement de la classe capitaliste, par une lutte pour la succession du vieux Diaz ; en particulier, une fraction combative de capitalistes propriétaires-terriens du nord aspirait à occuper une place prédominante, en accord avec sa puissance économique, dans le gouvernement. En même temps, un profond mécontentement se développait dans les classes travailleuses de la campagne (peones des haciendas dans tout le pays, rancheros dans le nord, comuneros dans le sud) et dans le jeune prolétariat industriel, qui ne supportaient plus l'exploitation sans pitié qu'ils subissaient. La conjonction de ces facteurs a produit une commotion sociale qui a mené à 10 ans de guerre interne, sans que - contrairement à ce que dit l'histoire officielle- cela constitue pour autant une véritable révolution sociale.
En premier lieu, la guerre de 1910-1920 au Mexique ne fut pas une révolution prolétarienne. Le prolétariat industriel, jeune et dispersé, ne constituait pas, en ce temps-là, une force décisive. En fait, ses tentatives de rébellion les plus importantes, dans la vague de grèves du début du siècle, avaient été complètement écrasées à la veille des événements de 1910-1920. Si certains secteurs du prolétariat ont participé à la guerre, ils l'ont fait comme wagon de queue d'un train d'une des fractions bourgeoises. Quant au prolétariat agricole, privé du guide de son frère industriel et encore très attaché à la terre, il a été intégré à la guerre paysanne.
A son tour, la guerre paysanne n'a pas constitué non plus une révolution. La guerre du Mexique est venue démontrer pour la nième fois que le mouvement paysan se caractérise par l'absence de projet historique propre, et ne peut être que liquidé ou intégré dans le mouvement d'une des classes historiques (le prolétariat ou la bourgeoisie). Au Mexique, c'est dans le sud que le mouvement paysan a pris sa forme la plus « classique ». Les partisans paysans, qui conservaient encore leurs traditions communautaires, se sont lancés à l'assaut des haciendas « porfiristes » ([2] [203]), mais après avoir récupéré la terre, ils ont abandonné les armes, et n'ont jamais été capables de former une armée régulière, ni un gouvernement capable de contrôler pour un certain temps les villes qu'ils avaient prises. Ces partisans furent combattus aussi bien par l'ancien régime que par le nouveau (qualifié de «révolutionnaire»), qui avait surgi de la guerre. Finalement, ils furent complètement écrasés. La bataille des rancheros du nord connut le même destin : leur tactique de prise de villes avec des assauts de cavalerie, propre au siècle dernier, fut efficace face à l'armée fédérale « porfiriste », mais échoua avec fracas devant la guerre moderne des tranchées, des barbelés hérissés et des mitrailleuses, qui était celle de l'armée du nouveau régime. La défaite des paysans (comuneros du sud et rancheros du nord) se solda par la restitution des terres aux anciens propriétaires des haciendas, et la formation de nouvelles latifundia dans les premiers temps du nouveau régime.
Enfin, cette guerre ne saurait être considérée comme une révolution bourgeoise. Elle n'a pas donné lieu à la formation d'un Etat capitaliste, puisqu'il existait déjà; elle n'a fait que substituer une forme d'Etat à une autre. Son seul mérite fut d'avoir jeté les bases d'une adéquation des rapports capitalistes à la campagne, avec l'élimination du système des «tiendas de raya» qui attachait les peones aux haciendas et empêchait ainsi la libre circulation de la force de travail (mais en général, les rapports de production capitalistes existaient déjà pleinement; ils s'étaient développés de façon accélérée et étaient prédominants déjà avant la guerre).
La main des grandes puissances dans la guerre du Mexique
Mais la soi-disant « révolution mexicaine » n'a pas eu pour seul contenu le conflit social interne. Elle était inscrite, pleinement, dans les conflits impérialistes qui ont secoué le monde au début de ce siècle, qui ont conduit à la 1° guerre mondiale de 1914-18 et à un changement dans l'hégémonie des grandes puissances, changement qui mettait les Etats-Unis au premier rang des puissances impérialistes. En fait, la succession de gouvernements qui va de la chute de Diaz au gouvernement et à l'assassinat de Madero, puis au gouvernement et à l'expulsion de Huerta, et jusqu'au gouvernement et à l'assassinat de Carranza, que l'histoire officielle explique comme une succession de mésaventures d'hommes « bons » ou « méchants », « traîtres » ou « patriotes », peut s'expliquer beaucoup plus logiquement par les luttes pour la suprématie économique et politique au Mexique, au travers du contrôle de son gouvernement, et par le parti pris par les différents gouvernements, leurs virages - parfois à 180 degrés - vis-à-vis de ces luttes impérialistes. Plus concrètement, au-delà de ces bouleversements, nous pouvons voir les efforts des Etats-Unis pour établir au Mexique un gouvernement soumis à leurs intérêts ([3] [204]).
Ainsi la décomposition et la chute du gouvernement de Diaz fut activement impulsée par les Etats-Unis, qui appuyèrent les fractions de capitalistes propriétaires d'haciendas du nord (avec à leur tête Madero), dans le but d'obtenir des concessions économiques et politiques, et d'affaiblir l'influence des puissances européennes. Pourtant, Madero ne cherchait ni à détruire en faveur des Etats-Unis l'équilibre des forces entre les différentes puissances qu'avait toujours entretenu Diaz, ni à améliorer réellement la situation des classes exploitées. D'ailleurs Madero, à mesure que s'embrasait l'explosion des révoltes paysannes, devint un obstacle aux yeux des Etats-Unis, qui organisèrent alors la conspiration de Huerta pour l'assassiner et s'emparer du pouvoir.
Plus tard, Huerta essaiera vainement, d'utiliser les affrontements entre grandes puissances à son profit : il finit abandonné de tous. Parallèlement, le mouvement paysan atteignait son apogée et Huerta fût, lui aussi, renversé. Simultanément, la 1° guerre mondiale avait éclaté en Europe, et c'est là qu'ont commencé à influer sur la situation mexicaine d'autres intérêts : ceux de l'Allemagne.
L'Allemagne disputait aux autres puissances sa place dans l'arène impérialiste de la répartition du monde, dans laquelle elle était arrivée avec retard. Elle avait quelques intérêts économiques au Mexique, mais ce n'était pas le principal. L'Allemagne avait compris l'importance stratégique du Mexique et essayait de l'utiliser comme moyen de faire obstacle aux visées américaines. D'abord avec Huerta et ensuite, plus résolument encore, avec Carranza, les services diplomatiques et secrets allemands tentèrent de provoquer un conflit armé entre le Mexique et les États-Unis. L'Allemagne essayait par là de détourner les efforts de guerre des Etats-Unis qui déjà fournissaient en armes les puissances « alliées » et se préparaient à entrer en guerre. A l'extrême, la bourgeoisie allemande rêvait d'une alliance Japon-Mexique-Allemagne qui aurait pu se confronter aux Etats-Unis en Amérique, mais le Japon était plus préoccupé de s'établir en Chine et ne se sentait pas assez fort pour affronter les Etats-Unis. Finalement, les « alliés » parvinrent à renverser les conjurés appuyés par l'Allemagne. Enfin, comprenant l'imminence de la défaite, l'Allemagne amorça un virage dans sa politique, et, grâce à des accords économiques, tenta de se préserver une influence sur le Mexique, en espérant des jours meilleurs.
Au début des années 1920, après la fin de la 1° guerre mondiale et l'étouffement de la guerre interne, une nouvelle bourgeoisie vint au pouvoir, dont les capitaux d'« origine » provenaient directement des butins de la guerre. Malgré le pouvoir croissant des Etats-Unis sur l'ensemble du continent et le net recul des anciennes puissances, Angleterre et France, les conflits ne cessèrent pas totalement. L'Angleterre par exemple, disputa encore aux Etats-Unis pendant deux décennies le contrôle du pétrole. Et les gouvernements « issus de la révolution » postérieurs à celui de Carranza (qui lui aussi finit assassiné) ne remirent plus jamais en question la suprématie du voisin du nord.
Pourtant, l'ancienne bourgeoisie de l'époque « porfiriste », bien que très affaiblie, n'avait pas été complètement détruite. Et avant d'accepter de s'adapter à la nouvelle situation et de reconnaître qu'il n'y avait pas d'autre choix que de coexister et même de fusionner avec la nouvelle bourgeoisie, certains secteurs trouvèrent la force de remettre en question le nouveau gouvernement.
La guerre des « cristeros »
Les règlements de comptes non liquidés entre les deux fractions de la bourgeoisie nationale au lendemain de la guerre de 1910-1920 entraînèrent une nouvelle guerre sanglante de 1926 à 1929, qui dévasta les Etats du centre-ouest de la République (Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacan) dans lesquels, tout récemment, les paysans avaient déjà servi de chair à canon. Quant à l'influence que les grandes puissances exercèrent sur le Mexique, il est hautement intéressant de constater que l’ « ancienne » fraction avait reçu récemment un appui, plus ou moins voilé, de la part de certains secteurs du capital européen (d'Espagne, de France et d'Allemagne) au travers de... l'Eglise catholique romaine. Cette fraction avait pour mot d'ordre la « liberté religieuse » soi-disant menacée par le «régime révolutionnaire» (en réalité, ce dernier ne faisait qu'arracher des parts du pouvoir économique à l'« ancienne» fraction qui incluait l'église catholique). Et derrière ce mot d'ordre, se cachait l'idéologie de la « Synarchie ». Derrière le cri de « Vive le Christ-Roi » (de là leur vient le nom de «cristeros»), poussé par l'armée irrégulière de l'ancienne fraction bourgeoise, se cachait toute la conception d'une recherche d'un nouvel «ordre mondial » qui aurait à sa tête les anciennes puissances (France, Allemagne, Italie, Espagne), prémisse idéologique, comme on pourra le voir par la suite, du fascisme européen des années 1930. Ainsi, de nouveau, nous voyons derrière un conflit interne une tentative de déstabiliser le pays de la part du capital européen (ou tout du moins de certains secteurs) qui, des années plus tard, s'affrontera sur le terrain militaire aux Etats-Unis. Les « cristeros » furent battus, et il ne restait à 1'« ancienne » fraction du capital qu'à imiter la nouvelle, qu'à se fondre en elle et enterrer ses propres aspirations pro-«européennes». Les gouvernements des années 1930-40 se soumirent aux Etats-Unis, transformant le Mexique en fournisseur de matières premières durant la 2e guerre mondiale. Ce fut la position non seulement du gouvernement de Avila Camacho, qui en vint à « déclarer la guerre » aux puissances de l'Axe, mais aussi du gouvernement de son prédécesseur et électeur (au Mexique, la voix du président est décisive pour l'élection de son successeur), Lazaro Cardenas, général qui s'était distingué dans la guerre contre les «cristeros», dont la mythique «expropriation du pétrole», en 1938, conduisit en fait à l'expulsion définitive des compagnies pétrolières anglaises et à la conversion du Mexique en réserve énergétique à l'usage exclusif des Etats-Unis.
La parenthèse du bloc impérialiste stalinien
A la fin de la seconde guerre mondiale, en 1945, s'est ouverte ce que nous pourrions appeler une «parenthèse» historique dans la guerre que se menaient, depuis le début du siècle, les Etats-Unis et l'Allemagne pour le contrôle du monde. Pendant plus de 40 ans, l'impérialisme russe disputa la suprématie mondiale à l'impérialisme américain ([4] [205]). La formation d'un nouveau jeu de blocs plaça les ennemis d'hier du même côté, l'Allemagne aux côtés des Etats-Unis. Quant à l'Amérique latine, les Etats-Unis y renforcèrent leur domination économique et politique, malgré les tentatives d'intervention de 1’URSS dans la région (à travers quelques guérillas et le flirt avec des gouvernements « socialistes »). Ces tentatives ne furent d'ailleurs, à part à Cuba ([5] [206]), que des essais de déstabiliser la région, très semblables à ceux du passé, surtout à ceux de l'Allemagne.
Cette parenthèse a été refermée, au début de cette décennie, par l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, la dissolution du bloc de l'Ouest et le démantèlement de l'URSS. Mais au contraire de ce qu'affirme la propagande des médias, cet événement ne signifie pas la fin des affrontements entre les grandes puissances, la « fin de l'histoire », ou autres semblables mensonges.
Les relations impérialistes constituent aujourd'hui une source de déstabilisation, de guerres et de chaos qui affectent le monde tout entier. Aucun pays, grand ou petit, n'échappe au jeu sinistre des luttes impérialistes, et surtout à celles qui opposent les deux grandes puissances rivales tout au long de ce siècle : les Etats-Unis et l'Allemagne. Au milieu du « nouveau désordre mondial », se dessinent les tendances à la formation d'un nouveau partage entre blocs impérialistes, ayant comme axe ces deux puissances, autour desquelles se polarisent tous les autres pays, dans lequel les alliés d'hier deviennent ennemis, dans un tourbillon sans frein où le chaos ne fait qu'alimenter ces tendances, lesquelles à leur tour accroissent le chaos. Et le Mexique n'échappe en aucun cas à cette dynamique des relations capitalistes mondiales.
Le Mexique, « toujours fidèle » ?
Nous allons maintenant essayer de répondre à la question que nous avons posée au début de cet article, au sujet de la « fidélité » aux Etats-Unis de la classe capitaliste mexicaine. La bourgeoisie des Etats-Unis s'est assurée de la fidélité de la bourgeoisie mexicaine pendant six décennies, et elle continuera assurément à le faire, en général.
Il subsiste cependant, non une «fraction» (ce qui impliquerait une fissure profonde dans le capital, et ce n'est pas le cas), mais quelques secteurs du capital mexicain qui, traditionnellement, ont toujours résisté à la domination presque exclusive des Etats-Unis. Ces secteurs, bien que relativement minoritaires, ont été capables d'élever un des leurs au fauteuil présidentiel : ce fut le cas, dans les années 1960, du président Diaz Ordaz Claro, et ce ne fut possible que parce que les rivalités entre « pro-européens » et « pro-américains » étaient secondaires à l'époque, le premier plan étant occupé par « l'ennemi principal », le capitalisme russe, et parce qu'il existait une alliance entre l'Europe occidentale et les Etats-Unis. Ceci n'arrivera plus. Les Etats-Unis vont rechercher la garantie d'une fidélité absolue de la part de l'exécutif mexicain, ils vont chercher à éviter toute « erreur » qui pourrait amener au pouvoir un représentant des secteurs les plus favorables aux puissances du vieux continent.
Malgré cela, nous pouvons nous attendre à ce que ces secteurs minoritaires, illusionnés par l'essor de l'Allemagne, commencent à se manifester bruyamment, à s'agiter, à « protester », à « exiger », créant par là des problèmes supplémentaires au gouvernement pro-américain. Nous pouvons aussi prévoir que les rivaux des Etats-Unis vont soutenir ces secteurs, non pour s'emparer du Mexique, mais pour créer une instabilité sociale dans la « chasse gardée » des Etats-Unis, partant du principe que tout ce qui fait obstacle aux Etats-Unis et les oblige à détourner leurs efforts (économiques, politiques, militaires) est de nature à offrir des avantages. Nous pouvons déjà en observer des signes. Par exemple, dans la réactivation ces derniers mois des héritiers de la « synarchie » (le Parti démocrate mexicain, et d'autres groupements qui lui sont proches). A l'intérieur du Parti d'Action Nationale - le PAN, rien moins que la seconde force du pays -, une partie a décidé de s'allier au gouvernement de Salinas, alors que l'autre, dans laquelle sont restés les « leaders historiques», a décidé de former un autre parti, qui se rapproche idéologiquement des « synarchistes ». Significative elle aussi, la lutte à l'intérieur de l'Eglise catholique oppose ceux qui cherchent à concilier avec le gouvernement et ceux qui l'attaquent constamment du haut de leurs chaires. Et enfin, le ressurgissement de la revendication du « Christ-Roi », et des « cristeros », impulsée par le Vatican (dont certains indices font penser qu'il se rapproche de l'Allemagne), n'est pas le fruit du hasard : manifestation religieuse à Guanajuato, dans le lieu qui symbolise le mouvement des « cristeros », présidée par le gouverneur (membre du PAN); manifestation dans la ville de Mexico pour célébrer la béatification récente d'une trentaine de martyrs de la guerre des «cristeros», béatification prononcée par... le Pape.
Nous insistons : les secteurs minoritaires du capital mexicain, partisans d'une attitude « anti-américaine » et donc « pro-européenne » ne peuvent mettre en question la suprématie des Etats-Unis au Mexique, mais ils peuvent par contre créer des problèmes, de plus ou moins grande "ampleur. L'avenir nous le dira.
Le prolétariat doit-il prendre parti pour une des fractions bourgeoises ?
Il est vital pour la classe ouvrière de comprendre que ses intérêts n'ont rien à voir avec les luttes impérialistes. Elle n'a rien à gagner à appuyer une fraction bourgeoise contre l'autre, et tout à perdre. Deux guerres mondiales pour le partage du monde entre les différents bandits impérialistes n'ont apporté à la classe ouvrière que des dizaines de millions de morts. Au Mexique aussi, les guerres bourgeoises de 1910-1920 et de 1926-29 n'ont apporté aux classes travailleuses que des millions de morts et un renforcement des chaînes de l'oppression.
Le prolétariat doit être conscient qu'à travers les appels à défendre la « patrie » ou la « religion » se cache la volonté d'amener le prolétariat à défendre des intérêts qui ne sont pas les siens, voire à s'entre-tuer au nom des intérêts de ses propres exploiteurs. Ces appels vont sûrement s'amplifier, jusqu'à devenir assourdissants, au fur et à mesure que la bourgeoisie aura besoin de façon plus urgente de la chair à canon pour ses luttes internes et ses guerres. Le prolétariat doit rejeter ces appels, et au contraire s'opposer à la continuation des luttes impérialistes, en développant sa lutte de classe, seule voie qui mène à en terminer définitivement avec le système capitaliste, lequel n'a rien à offrir à l'humanité, sinon le chaos et les guerres.
Leonardo, Juillet 1993. Révolution Mundial n° 16.
[1] [207] Revolucion Mundial n° 12, « TLC : El gendarme del mundo asegura su traspatio ». Le TLC est en français aussi appelé ALENA, Accord de Libre-Echange Nord-Américain.
[2] [208] De Porfirio Diaz.
[3] [209] Le livre de F.Katz, La guerre secrète au Mexique, est une étude très complète et révélatrice du degré d'ingérence des grandes puissances dans la « révolution » mexicaine. C'est de ce livre que nous avons tiré une grande partie de nos informations.
[4] [210] Nous ne pouvons revenir ici sur notre conception du stalinisme. Nous recommandons à nos lecteurs le Manifeste du 9e Congrès du CCI et notre Revue Internationale
[5] [211] Sur Cuba, voir Revolucion Mundial n° 9 et 10.
Géographique:
- Mexique [212]
Questions théoriques:
- Décadence [192]
- Impérialisme [178]
Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre (1ère partie)
- 3181 lectures
Polémique avec Programme Communiste sur la guerre impérialiste
Dans les numéros 90, 91 et 92 de la revue Programme Communiste publiée par le Parti Communiste International (PCI), qui édite aussi les journaux Il Communista en langue italienne et Le Prolétaire en langue française) [1] [213], on trouve une longue étude sur « La guerre impérialiste dans le cycle bourgeois et dans l'analyse marxiste », qui fait le point des conceptions de cette organisation sur une question de première importance pour le mouvement ouvrier. Les positions politiques fondamentales qui y sont affirmées constituent une défense claire des principes prolétariens face à tous les mensonges véhiculés par les différents agents de la classe dominante. Cependant, certains des développements théoriques sur lesquels ces principes sont fondés, et les prévisions qui en découlent, ne sont pas toujours à la hauteur des affirmations principielles et risquent d'affaiblir ces dernières plutôt que de les renforcer. Cet article se propose de soumettre à la critique ces conceptions théoriques erronées afin de dégager les bases les plus solides possibles à la défense de l'internationalisme prolétarien.
Le CCI, contrairement à d'autres organisations qui se réclament comme lui de la Gauche communiste (notamment, les différents PCI appartenant au courant « bordiguiste »), a toujours établi une distinction claire entre les formations qui se trouvent dans le camp prolétarien et celles qui se trouvent dans le camp bourgeois (commes les différents représentants du courant trotskyste, par exemple). Avec ces dernières, il ne saurait être question d'un quelconque débat politique : la responsabilité des révolutionnaires est de les dénoncer comme des instruments de la classe dominante destinés, grâce à leur langage «ouvrier» ou « révolutionnaire», à dévoyer le prolétariat de son terrain de classe afin de le soumettre pieds et poings liés aux intérêts du capital. En revanche, entre les organisations du camp prolétarien, le débat politique n'est pas seulement une possibilité, mais un devoir. Ce débat n'a rien à voir avec un échange d'idées tel qu'on peut le rencontrer dans les séminaires universitaires, c'est un combat pour la défense de la clarté des positions communistes. En ce sens, il peut prendre les formes d'une vive polémique, justement parce que les questions concernées sont de la première importance pour le mouvement de la classe et que chaque communiste sait bien qu'une petite erreur théorique ou politique peut avoir des conséquences dramatiques pour le prolétariat. Cependant, même dans les polémiques, il est nécessaire de savoir reconnaître ce qui est correct dans les positions de l'organisation qu'on critique.
Une défense ferme des positions de classe
Le PCI (Il Communista) se revendique de la tradition de la Gauche communiste italienne, c'est-à-dire un des courants internationaux qui a maintenu des positions de classe lors de la dégénérescence de 1’Internationale communiste au cours des années 1920. Dans l'article publié par Programme communiste (PC) on peut constater que, sur toute une série de questions essentielles, cette organisation n'a pas perdu de vue les positions de ce courant. En particulier, cet article contient une réaffirmation claire de ce qui fonde la position des communistes face à la guerre impérialiste. La dénonciation de celle-ci n'a rien à voir avec celle des pacifistes ou des anarchistes :
« Le marxisme est complétement étranger aux formules vides et abstraites qui font de "l'anti-bellicisme" un principe supra-historique et qui voient de façon métaphysique dans les guerres le Mal absolu. Notre attitude se fonde sur une analyse historique et dialectique des crises guerrières en liaison avec la naissance, le développement et la mort des formes sociales.
Nous distinguons donc :
a) les guerres de progrés (ou de développe-ment) bourgeois dans l'aire européenne de 1792 à 1871
b) les guerres impérialistes, caractérisées par le choc réciproque entre nations au capitalisme ultra-développé...
c) les guerres révolutionnaires prolétariennes. » (PC n° 90, p. 19)
« L'orientation fondamentale est de prendre position pour les guerres qui poussent en avant le développement général de la société et contre les guerres qui y font obstacle ou qui le retardent. En conséquence, nous sommes pour le sabotage des guerres impérialistes, non parce qu'elles sont plus cruelles et plus épouvantables que les précédentes, mais parce qu'elles se mettent en travers du devenir historique de l'humanité ; parce que la bourgeoisie impérialiste et le capitalisme mondial ne jouent plus aucun rôle "progressiste", mais sont devenus au contraire un obstacle au développement général de la société... » (PC n° 90, p. 22)
Le CCI pourrait signer des deux mains ces phrases qui rejoignent ce que nous avons écrit à de multiples reprises dans notre presse territoriale et dans cette revue. [2] [214]
De même, la dénonciation du pacifisme que fait le PCI est particulièrement claire et percutante :
« ... le capitalisme n'est pas "victime" de la guerre provoquée par tel ou tel énerguméne, ou par des "esprits malins" reliquats d'époques barbares contre lesquels il faudrait périodiquement se défendre. (...) le pacifisme bourgeois doit nécessairement déboucher dans le bellicisme. Le rêve idyllique d'un capitalisme pacifique n'est en effet pas innocent. C'est un rêve tâché de sang. Si l'on admet que capitalisme et paix peuvent aller ensemble de façon non contingente et momentanée, mais de façon permanente, on est obligé, quand montent les cris de guerre, de reconnaître que quelque chose d'étranger à la civilisation menace le développement pacifique, humanitaire du capitalisme; et que celui-ci doit donc se défendre, y compris avec les armes si les autres moyens ne suffisent pas en regroupant autour de lui les hommes de bonne volonté et les "amoureux de la paix". Le pacifisme accomplit alors sa pirouette finale et se convertit en bellicisme, en facteur actif et agent direct de la mobilisation guerrière. Il s'agit donc d'un processus obligé, qui dérive de la dynamique interne du pacifisme. Celui-ci tend naturellement à se transformer en bellicisme... » (PC n° 90, p. 22)
De cette analyse du pacifisme, le PCI fait découler une orientation juste par rapport aux prétendus mouvements anti-guerre qu'on voir périodiquement fleurir à 1’heure actuelle. Avec le PCI, nous considérons évidemment qu'il peut exister un anti-militarisme de classe (comme celui qui s'est manifesté au cours de la première guerre mondiale et qui a abouti à la révolution en Russie et en Allemagne). Mais cet anti-militarisme ne peut se développer à partir des mobilisations orchestrées par toutes les bonnes âmes de la bourgeoisie :
« Par rapport aux "mouvements pour la paix" actuels, notre consigne 'positive' est celle d'une intervention de l'extérieur à caractére de propagande et de prosélytisme en direction des éléments prolétariens capturés par le pacifisme et englobés dans les mobilisations petites-bourgeoises afin de les arracher à ce genre d'encadrement et d'action politique. nous disons en particulier à ces éléments que ce n'est pas dans les parades pacifistes d'aujourd'hui que se prépare l'antimilitarisme de demain, mais dans la lutte intransigeante de défense des conditions de vie et de travail des prolétaires en rupture avec les intérêts de l'entreprise et de l'économie nationale. Comme la discipline du travail et la défense de l'économie nationale préparent la discipline des tranchées et la défense de la patrie, le refus aujourd'hui de défendre et respecter les intérêts de l'entreprise et de l'économie nationale préparent l'antimilitarisme et le défaitisme de demain. » (PC n° 92, p. 61) Comme nous le verrons plus loin, le défaitisme n'est plus un mot d'ordre adapté à la situation présente ou à venir. Cependant, nous tenons à souligner toute la validité de cette démarche.
Enfin, l'article de PC est très clair également en ce qui concerne le rôle de la démocratie bourgeoise dans la préparation et la conduite de la guerre impérialiste :
« ... dans "nos" Etats civilisés, le capitalisme règne grâce à la démocratie (..) lorsque le capitalisme pousse sur le devant de la scène canons et généraux, il le fait en s'appuyant sur la démocratie, ses mécanismes et ses rites hypnotiques » (PC n°91, p. 38) « L'existence d'un régime démocratique permet à l'Etat une plus grande efficacité militaire car il permet de potentialiser au maximum tant la préparation de la guerre que la capacité de résistance du pays en guerre. » (Ibid.)
« ... le fascisme ne peut faire appel pratiquement qu'au sentiment national, poussé jusqu'à l'hystérie raciste, pour cimenter "l'Union nationale" alors que la démocratie possède une ressource encore plus puissante pour souder l'ensemble de la population à la guerre impérialiste : le fait que la guerre émane directement de la volonté populaire librement exprimée lors des élections, et qu'elle apparaît ainsi, grâce à la mystification des consultations électorales, comme une guerre de défense des intérêts et des espérances des masses populaires et des classes laborieuses en particulier.» (PC n°91, p. 41)
Nous avons reproduit ces longues citations de Programme Communiste (et nous aurions pu en donner d'autres, notamment concernant les illustrations historiques des thèses présentées) parce qu'elles représentent exactement notre position sur les questions concernées. Plutôt que de réaffirmer avec nos propres mots nos principes concernant la guerre impérialiste, il nous a paru utile de mettre en évidence la profonde unité de vues qui existe sur cette question au sein de la Gauche communiste, unité de vues qui constitue notre patrimoine commun.
Cependant, autant il convient de souligner cette unité principielle, autant il est du devoir des révolutionnaires de mettre en évidence les inconséquences et incohérences théoriques du courant « bordiguiste » qui affaiblissent considérablement sa capacité de donner une boussole efficace au prolétariat. Et la première de ces inconséquences réside dans le refus de ce courant de reconnaître la décadence du mode de production capitaliste.
La « non-décadence » à la manière bordiguiste
La reconnaissance que, depuis le début du siécle, et particulièrement depuis la première guerre mondiale, la société capitaliste est entrée dans sa phase de décadence constitue une des pierres angulaires de la perspective du mouvement communiste. Au cours du premier holocauste impérialiste, des révolutionnaires comme Lénine, pour appuyer la nécessité pour le prolétariat de rejeter toute participation à celui-ci, de « transformer la guerre impérialiste en guerre civile », se basent sur une telle analyse (voir en particulier L'impérialisme, stade suprême du capitalisme). De même, l'entrée du capitalisme dans sa période de décadence est au cceur des positions politiques de 1`Internationale communiste lors de sa fondation en 1919. C'est justement parce que le capitalisme est devenu un système décadent qu'il ne saurait plus être question de lutter en son sein pour obtenir des réformes, comme le préconisaient les partis ouvriers de la 2e Internationale, mais que la seule tâche historique que puisse se donner le prolétariat est de réaliser la révolution mondiale. C'est en particulier sur cette base de granit que, par la suite, la Gauche communiste internationale et, notamment, sa fraction italienne, a pu élaborer l'ensemble de ses positions politiques. [3] [215]
Cependant, c'est « l'originalité » de Bordiga et du courant dont il a été l'inspirateur que de nier que le capitalisme soit entré dans sa période de décadence [4] [216]. Et pourtant, le courant bordiguiste, notamment le PCI (Il Comunista) est bien obligé de reconnaître que quelque chose a changé au début de ce siècle, tant dans la nature des crises économiques que dans celle de la guerre.
Sur la nature de la guerre, les citations de PC que nous avons reproduites plus haut parlent d'elles-mêmes: il existe effectivement une différence fondamentale entre les guerres que pouvaient mener les Etats capitalistes au siècle dernier et celles de ce siècle. Par exemple, 6 décennies séparent les guerres napoléoniennes contre la Prusse de la guerre franco-allemande de 1870, alors que cette dernière n'est distante que de 4 décennies de celle de 1914. Cependant, la guerre de 1914 entre la France et l'Allemagne est fondamentalement différente de toutes les précédentes entre ces deux nations: c'est pour cela que Marx pouvait appeler les ouvriers allemands à participer à la guerre de 1870 (voir le premier manifeste du Conseil Général de l’AIT sur la guerre franco-allemande) tout en se situant parfaitement sur un terrain de classe prolétarien, alors que les socio-démocrates allemands qui appelaient ces mêmes ouvriers à la « défense nationale » en 1914 se situaient résolument sur le terrain bourgeois. C'est exactement ce que les révolutionnaires comme Lénine et Rosa Luxemburg ont défendu bec et ongle à cette époque contre les socio-chauvins qui prétendaient s'inspirer de la position de Marx en 1870 : cette position n'avait plus cours parce que la guerre avait changé de nature, et ce changement résultait lui-même d'un changement fondamental dans la vie de l'ensemble du mode de production capitaliste.
Programme Communiste, d'ailleurs, ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme (comme on l'a vu plus haut) que les guerres impérialistes « se mettent en travers du devenir historique de l'humanité ; parce que la bourgeoisie impérialiste et le capitalisme mondial ne jouent plus aucun rôle 'progressiste'; mais sont devenus au contraire un obstacle au développement général de la société ». De même, reprenant une citation de Bordiga, il considére que «Les guerres impérialistes mondiales démontrent que la crise de désagrégation du capitalisme est inévitable en raison de l'ouverture de la période oú son expansion n'exalte plus l'augmentation des forces productives, mais en fait dépendre l'accumulation d'une destruction encore plus grande » (PC n°90, p.25). Cependant, enfermé dans les vieux dogmes bordiguistes, le PCI est incapable d'en tirer la conséquence logique du point de vue du matérialisme historique : le fait que le capitalisme mondial soit devenu un obstacle au développement général de la société signifie tout simplement que ce mode de production est entré dans sa période de décadence. Lorsque Lénine ou Rosa Luxemburg faisaient ce constat en 1914, ils ne tiraient pas une telle idée de leur chapeau : ils ne faisaient qu'appliquer scrupuleusement la théorie marxiste à la compréhension des faits historiques de leur époque. Le PCI, comme l'ensemble des autres « PCI » appartenant au courant « bordiguiste », se réclame du marxisme. C'est une très bonne chose : aujourd'hui, seules des organisations basant leurs positions programmatiques sur les enseignements du marxisme peuvent prétendre défendre la perspective révolutionnaire du prolétariat. Malheureusement, le PCI nous administre la preuve qu'il a du mal à comprendre cette méthode. En particulier, il aime employer abondamment le terme « dialectique », mais il nous prouve que, à l'image de l'ignorant qui veut donner le change en employant des mots savants, il ne sait pas de quoi il parle.
Par exemple, concernant la nature des crises, voici ce que l'on peut lire dans PC :
« Les crises décennales du jeune capitalisme n'eurent que des incidences tout à fait mineures ; elles avaient plus le caractére de crises du commerce international que de la machine industrielle. Elles n'entamaient pas les potentialités de la structure industrielle (...). C'était des crises de chômage, c'est-à-dire de fermeture, d'arrêt des industries. Les crises modernes sont des crises de désagrégation de tout le système, qui doit ensuite péniblement reconstruire ses différentes structures » (PC n° 90, p. 28). Suit toute une série de statistiques qui démontrent l'ampleur considérable des crises du 20e siècle, sans commune mesure avec celles du siècle dernier. Ici, en ne percevant pas que cette différence d'ampleur entre ces deux types de crises est révélateur non seulement d'une différence fondamentale entre elles, mais aussi dans le mode de vie du systéme qu'elles affectent, le PCI s'assoie royalement sur un des éléments de base de la dialectique marxiste : la transformation de la quantité en qualité. En effet, pour le PCI, la différence entre les deux types de crises reste du domaine du quantitatif et ne concerne pas les mécanismes fondamentaux. C'est ce qu'il révéle en écrivant : «Au siècle dernier on enregistra huit crises mondiales: 1836, 1848, 1856, 1883, 1886 et 1894. La durée moyenne du cycle selon les travaux de Marx était de 10 ans. A ce rythme 'juvénile" fait suite, dans la période qui va du début du siècle à l'éclatement du second conflit mondial, une succession plus rapide des crises: 1901, 1908, 1914, 1920, 1929. A un capitalisme démesurément accru correspond une augmentation de la composition organique (..) ce qui conduit à une croissance du taux d'accumulation : la durée moyenne du cycle se réduit pour cette raison à 7 ans. » (PC n° 90, p. 27). Cette arithmétique sur la durée des cycles fait la preuve que le PCI met sur le même plan les convulsions économiques du siècle dernier et celles de ce siècle, sans comprendre que la nature même de la notion de cycle a changé fondamentalement. Aveuglé par sa fidélité à la parole divine de Bordiga, le PCI ne voit pas que, suivant les mots de Trotsky, les crises du 19e siècle étaient les battements de coeur du capitalisme alors que celles du 20e siécle sont les râles de son agonie.
C'est le même aveuglement que manifeste le PCI lorsqu'il essaie de mettre en évidence le lien entre crise et guerre. De façon très argumentée et systématique, faute d'être rigoureuse (nous y reviendrons plus loin), PC tente d'établir que, dans la période actuelle, la crise capitaliste débouche nécessairement sur la guerre mondiale. C'est une préoccupation tout à fait louable puisqu'elle a le mérite de vouloir réfuter les discours illusoires et criminels du pacifisme. Cependant, il ne vient pas à l'idée de PC de se demander si le fait que les crises du 19e siècle ne débouchaient pas, pour leur part, sur la guerre mondiale, ou même sur des guerres localisées, ne provient pas d'une différence de fond avec celles du 20e siècle. Là encore, le PCI fait preuve d'un «marxisme» bien pauvre : il ne s'agit même plus d'une incompréhension de ce que veut dire le mot dialectique, il s'agit d'un refus, ou au moins d'une incapacité, d'examiner en profondeur, au-delà d'une fixation sur d'apparentes analogies pouvant exister entre des cycles économiques du passé et d'aujourd'hui, les phénomènes majeurs, déterminants, de la vie du mode de production capitaliste.
Ainsi, le PCI se montre incapable, à propos d'une question aussi essentielle que celle de la guerre impérialiste, d'appliquer de façon satisfaisante la théorie marxiste en comprenant la différence fondamentale qui existe entre la phase ascendante du capitalisme et sa phase de décadence. Et la concrétisation navrante de cette incapacité réside dans le fait que le PCI essaye d'attribuer aux guerres de la période actuelle une rationalité économique similaire à celle que pouvaient avoir les guerres au siècle dernier.
Rationalité et irrationalité de la guerre
Notre Revue internationale a déjà publié de nombreux articles sur la question de l'irrationalité de la guerre dans la période de décadence du capitalisme [5] [217]. Notre position n'a rien à voir avec une «découverte originale » de notre organisation. Elle est basée sur les acquis fondamentaux du marxisme depuis le début du 20e siècle, notamment exprimés par Lénine et Rosa Luxemburg. Ces acquis ont été formulés avec une très grande clarté en 1945 par la Gauche communiste de France contre la théorie révisionniste développée par Vercesi à la veille de la Seconde Guerre mondiale, théorie qui avait conduit son organisation, la Fraction italienne de la Gauche communiste, à une paralysie totale lors de l'éclatement du conflit impérialiste :
« A l'époque du capitalisme ascendant, les guerres (...) exprimèrent la marche ascendante de fermentation, d'élargissement et de l'expansion du système économique capitaliste. (...) Chaque guerre se justifiait et payait ses frais en ouvrant un nouveau champ d'une plus grande expansion, assurant le développement d'une plus grande production capitaliste. (...) La guerre fut le moyen indispensable au capitalisme lui ouvrant des possibilités de développement ultérieur, à l'époque ou ces possibilités existaient et ne pouvaient être ouvertes que par le moyen de la violence. De même le croulement du monde capitaliste ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de ce croulement, qui, sans ouvrir aucune possibilité de dévelopement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines. » (Rapport sur la situation internationale à la Conférence de juillet 1945 de la GCF; republié par la Revue Internationale n° 59.)
Cette distinction entre les guerres du siècle dernier et celles de ce siècle, PC la fait également, comme on l'a vu. Cependant, il n'en tire pas les conséquences et, après avoir fait un pas dans la bonne direction, il en fait deux en sens inverse en cherchant une rationalité économique aux guerres impérialistes qui dominent le 20e siècle.
Cette rationalité, « la démonstration des raisons économiques fondamentales qui poussent tous les Etats à la guerre » (PC n° 92, p. 54), PC essaye de la trouver dans des citations de Marx : « une destruction périodique de capital est devenue une condition nécessaire à l'existence d'un quelconque taux d'intérêt courant (...) Considéré de ce point de vue, ces horribles calamités que nous sommes habitués à attendre avec tant d'inquiétude et d'appréhension (...) ne sont probablement que le correctif naturel et nécessaire d'une opulence excessive et exagérée, la 'vis medicatrix' grâce à laquelle notre système social tel qu'il est actuellement configuré, a la possibilité de se libérer de temps à autre d'une pléthore toujours renaissante qui en menace l'existence, et de revenir à un état sain et solide » (Grundrisse). En réalité, la destruction de capital que Marx évoque ici est celle provoquée par les crises cycliques de son époque (et non par la guerre) à un moment, justement, où ces crises constituent les battements de coeur du système capitaliste (même si elles posent déjà en perspective les limitations historiques de ce système). En de nombreux endroits de son oeuvre, Marx démontre que la façon dont le capitalisme surmonte ses crises réside non seulement dans une destruction (ou plutôt une dévalorisation) du capital momentanément excédentaire mais aussi, et surtout, dans la conquête de nouveaux marchés, particulièrement à l'extérieur de la sphére des rapports de production capitalistes [6] [218]. Et puisque le marché mondial n'est pas extensible indéfiniment, puisque les secteurs extra-capitalistes ne peuvent que se rétrécir jusqu'à disparaître complètement à mesure que le capital soumet la planète à ses lois, le capitalisme est condamné à des convulsions de plus en plus catastrophiques.
C'est une idée qui sera développée de façon beaucoup plus systématique par Rosa Luxemburg dans L'accumulation du capital mais qu'elle n'a nullement inventée, comme le prétendent certains ignorants. Une telle idée apparaît d'ailleurs en filligrane dans certains passages du texte de PC mais, lorsque que celui-ci fait référence à Rosa Luxemburg, ce n'est pas pour s'appuyer sur ses remarquables développements théoriques qui expliquent avec la plus grande clarté les mécanismes des crises du capitalisme et particulièrement pourquoi les lois de ce système le condamnent historiquement, c'est pour reprendre à son compte la seule idée vraiment contestable qu'on puisse trouver dans L'accumulation du capital, la thèse suivant laquelle le militarisme pourrait constituer un « champ d'accumulation » soulageant partiellement le capitalisme de ses contradictions économiques (voir PC n° 91 pages 31 à 33). C'est malheureusement dans une telle idée que s'était justement fourvoyé Vercesi, à la fin des années 1930, ce qui l’a conduit à penser que le formidable développement de la production d'armements à partir de 1933, en permettant une relance de la production capitaliste, éloignait d'autant la perspective d'une guerre mondiale. En revanche, lorsque PC veut donner une explication systématique du mécanisme de la crise, afin de mettre en évidence le lien existant entre celle-ci et la guerre impérialiste, il adopte une vision unilatérale basée de façon prépondérante sur la thése de la baisse tendancielle du taux de profit:
« Depuis que le mode de production bourgeois est devenu dominant, la guerre est liée de façon déterministe à la loi établie par Marx de la baisse du taux de profit moyen, qui est la clé de la tendance du capitalisme à la catastrophe finale » (PC n° 90, p. 23). Suit un résumé, que PC emprunte à Bordiga (Dialogue avec Staline), de la thèse de Marx suivant laquelle l'élévation constante, dans la valeur des marchandises (du fait des progrès constants des techniques productives), de ce qui revient aux machines et aux matières premières par rapport à ce qui revient au travail des salariés, conduit à une tendance historique à la baisse du taux de profit, dans la mesure où seul le travail de l'ouvrier est en mesure de produire un profit (de produire plus de valeur qu'il ne coùte).
Il faut signaler que, dans son analyse, PC (et Bordiga qu'il cite abondamment) n'ignore pas la question des marchés et le fait que la guerre impérialiste est la conséquence de la concurrence entre Etats capitalistes :
« La progression géométrique de la production impose à chaque capitalisme national d'exporter, de conquérir sur les marchés extérieurs des débouchés adéquats pour leur production. Et comme chaque pôle national d'accumulation est soumis à la même règle, la guerre entre Etats capitalistes est inévitable. De la guerre économique et commerciale, des conflits financiers, des disputes pour les matières premières, des affrontements politiques et diplomatiques qui en découlent, on en arrive finalement à la guerre ouverte. Le conflit latent entre Etats éclate d'abord sous la forme de conflits militaires limités à certaines zones géographiques, de guerres localisées où les grandes puissances ne s'affrontent pas directement, mais par personnes interposées ; mais il débouche finalement sur une guerre généralisée, caractérisée par le choc direct des grands monstres étatiques de l'impérialisme, lancés les uns contre les autres par la violence de leurs contradictions internes. Et tous les Etats mineurs sont entraînés dans le conflit, dont le théatre s'étend nécessairement à toute la planète. Accumulation-Crises-Guerres locales-Guerre mondiale. » (PC n° 90, p. 24)
On ne peut que souscrire à cette analyse, qui recoupe en fait ce que les marxistes ont mis en avant depuis la première guerre mondiale. Cependant, là où le bât blesse, c'est que la recherche des marchés extérieurs ne soit vue par PC que comme conséquence de la baisse tendancielle du taux de profit, alors que, au-delà même de cet aspect des choses, le capitalisme comme un tout a un besoin permanent de marchés en dehors de sa propre sphére de domination, comme l'a magistralement démontré Rosa Luxemburg, pour pouvoir réaliser la part de plus-value destinée à être réinvestie dans un cycle ultérieur par le capital en vue de son accumulation. A partir de cette vision unilatérale, PC attribue à la guerre impérialiste mondiale une fonction économique précise, lui conférant une véritable rationalité dans le fonctionnement du capitalisme :
« La crise tire son origine de l'impossibilité de poursuivre l'accumulation, impossibilité qui se manifeste quand l'accroissement de la masse de production ne réussit plus à compenser la chute du taux de profit. La masse du surtravail total n'est plus à même d'assurer du profit au capital avancé, de reproduire les conditions de rentabilité des investissements. En détruisant du capital constant (travail mort) à grande échelle, la guerre joue alors un rôle économique fondamental: grâce aux épouvantables destructions de l'appareil productif, elle permet en effet une future expansion gigantesque de la production pour remplacer ce qui a été détruit, donc une expansion parallèle du profit, de la plus-value totale, c'est-à-dire du surtravail dont est friand le capital. Les conditions de reprise du processus d'accumulation sont rétablies. Le cycle économique repart. (...) Le système capitaliste mondial, entre vieux dans la guerre, mais y trouve un bain de jouvence dans le bain de sang qui lui donne une nouvelle jeunesse et il en ressort avec la vitalité d'un robuste nouveau-né. »(PC n' 90, p. 24)
La thèse de PC n'est pas nouvelle. Elle a été mise en avant et systématisée par Grossmann dans les années 1920 et reprise après lui par Mattick, un des théoriciens du mouvement conseilliste. Elle peut se résumer de façon trés simple dans les termes suivants : en détruisant du capital constant, la guerre fait baisser la composition organique du capital et permet, de ce fait, un redressement du taux de profit. Le hic, c'est qu'il n'a jamais été prouvé que lors des reprises qui ont suivi les guerres mondiales, la composition organique du capital ait été inférieure à ce qu'elle était à leur veille. C'est bien du contraire qu'il s'agit. Si l'on prend le cas de la seconde guerre mondiale, par exemple, il est clair que, dans les pays affectés par les destructions de la guerre, la productivité moyenne du travail et donc le rapport entre le capital constant et le capital variable a très rapidement rejoint, dès le début des années 1950, ce qu'ils étaient en 1939. En fait, le potentiel productif qui est reconstitué est considérablement plus moderne que celui qui avait été détruit. C'est d'ailleurs ce que PC constate lui-même pour en faire justement une des causes du boom d'après guerre (!) : «L'économie de guerre transmet en outre au capitalisme tant les progrès technologiques et scientifiques réalisés par les industries militaires que les implantations industrielles créées pour la production d'armements. Celles-ci ne furent en effet pas toutes détruites par les bombardements, ni - dans le cas allemand - par le démantèlement réalisé par les alliés. (...) La destruction à grande échelle d'équipements, d'intallations, de bâtiments, de moyens de transport, etc., et la réallocation des moyens de production à haute composition technologique venus de l'industrie de guerre... tout cela crée le miracle. » (PC n° 92, p. 38).
Quant aux Etats-Unis, en l'absence de destructions sur leur propre sol, la composition organique de leur capital était bien supérieure en 1945 à ce qu'elle était 6 ans auparavant. Pourtant, la période de « prospérité » qui accompagne la reconstruction se prolonge bien au-delà (en fait jusqu'au milieu des années 1960) du moment où le potentiel productif d'avant-guerre a été reconstitué, faisant retrouver à la composition organique sa valeur précédente. [7] [219]
Ayant déjà consacré de nombreux textes à la critique des conceptions de Grossmaan-Mattick auxquelles PC, à la suite de Bordiga, se rattache, nous ne la reprendrons pas ici. En revanche, il est important de signaler les aberrations théoriques (et aberrations tout court) auxquelles les conceptions de Bordiga, reprises par le PCI, conduisent.
Les aberrations de la vision du PCI
La préoccupation centrale du PCI est tout à fait correcte : démontrer le caractère inéluctable de la guerre. En particulier, il veut rejeter fermement la vision du « super impérialisme » développée notamment par Kautsky lors de la première guerre mondiale et destinée à « démontrer » que les grandes puissances pourraient se mettre d'accord entre elles afin d'établir une domination en commun et pacifique sur le monde. Une telle conception était évidemment un des fers de lance des mensonges pacifistes, voulant faire croire aux ouvriers qu'on pourrait mettre fin aux guerres sans avoir besoin de détruire le capitalisme. Pour répondre à une telle vision, PC donne l'argument suivant :
« Un super-impérialisme est impossible ; si par extraordinaire l'impérialisme réussissait à supprimer les conflits entre Etats, ses contradictions internes le contraindraient à se diviser de nouveau en pôles nationaux d'accumulation concurrents et donc en blocs étatiques en confit. La nécessité de détruire d'énormes masses de travail mort ne peut en effet être satisfaite par les seules catastrophes naturelles. » (PC n'90, p. 26)
En somme, la fonction fondamentale des blocs impérialistes, ou de la tendance vers leur constitution, est de créer les conditions permettant des destructions à grande échelle. Avec une telle vision, on ne voit pas pourquoi les Etats capitalistes ne pourraient pas justement s'entendre entre eux afin de provoquer, lorsque nécessaire, de telles destructions permettant une relance du taux de profit et de la production. Ils disposent de suffisamment de moyens pour opérer de telles destructions tout en gardant un contrôle sur elles afin qu'elles préservent aux mieux leurs intérêts respectifs. Ce que PC se refuse à prendre en considération, c'est que la division en blocs impérialistes est le résultat logique de la concurrence à mort que se livrent les différents secteurs nationaux du capitalisme, une concurrence qui fait partie de l'essence même de ce système et qui s'exacerbe lorsque la crise le frappe avec toute sa violence. En ce sens, la constitution de blocs impérialistes ne résulte nullement d'une sorte de tendance, encore inachevée, vers l'unification des Etats capitalistes mais, bien au contraire, de la nécessité où ils se trouvent de former des alliances militaires dans la mesure où aucun d'entre eux ne pourrait faire la guerre à tous les autres. Le plus important dans l'existence des blocs n'est pas la convergence d'intérêts pouvant exister entre les Etats alliés (convergence qui peut être remise en cause comme le démontrent tous les retournements d'alliance qu'on a vus au cours du 20e siécle), mais bien l'antagonisme fondamental entre les blocs, expression au plus haut niveau des rivalités insurmontables existant entre tous les secteurs nationaux du capital. C'est pour cela que l'idée d'un « super-impérialisme » est un non sens dans les termes.
Par l'utilisation d'arguments faibles ou contestables, le rejet par le PCI de l'idée du « super-impérialisme » perd considérablement de sa force, ce qui n'est pas le meilleur moyen de combattre les mensonges de la bourgeoisie. C'est particulièrement évident lorsque, à la suite du passage cité plus haut, il enchaîne ainsi : «Ce sont des volontés humaines, des masses humaines qui doivent faire les choses, des masses humaines dressées les unes contre les autres, des énergies et des intelligences tendues pour détruire ce que défendent d'autres énergies et d'autres intelligences ». Ici, on constate toute la faiblesse de la thèse du PCI : franchement, avec les moyens dont disposent aujourd'hui les Etats capitalistes, et particulièrement l'arme nucléaire, en quoi les « volontés humaines » et surtout « les masses humaines » sont-elles indispensables pour provoquer un degré suffisant de destruction, si telle est la fonction économique de la guerre impérialiste aux dires du PCI.
En fin de compte, le courant « bordiguiste » ne pouvait que payer par de graves dérives théoriques et politiques la faiblesse des analyses sur lesquelles il fonde sa position sur la guerre et les blocs impérialistes. C'est ainsi que, ayant expulsé par la porte la notion d'un super-impérialisme, il le laisse revenir par la fenêtre avec sa notion d'un « condominium russo-américain » sur le monde :
« La seconde guerre mondiale a donné naissance à un équilibre correctement décrit par la formule du "condominium russo-américain" (..) si la paix a régné jusqu'ici dans les métropoles impérialistes, c'est précisément en raison de cette domination des USA et de l'URSS... » (PC n° 91, p. 47)
« En réalité, la "guerre froide" des années cinquante exprimait l'insolente sûreté des deux vainqueurs du conflit et la stabilité des équilibres mondiaux sanctionnés à Yalta ; elle répondait dans ce cadre à des exigences de mobilisation idéologique et de maîtrise des tensions sociales existant à l'intérieur des blocs. La nouvelle "guerre froide" qui prend la place de la détente dans la deuxième moitié des années 70 répond à une exigence de maîtrise d'antagonismes non plus (ou pas encore) entre les classes, mais entre Etats qui ont de plus en plus de mal à supporter les vieux systèmes d'alliance. La réponse russe et américaine aux pressions grandissantes consiste à chercher à orienter en direction du camp opposé l'aggressivité impérialiste de leurs alliés. » (PC n° 92, p. 47)
En somme, la première « guerre froide» n'avait d'autre motivation qu'idéologique afin de « maîtriser les antagonismes entre les classes ». C'est vraiment le monde à l'envers: si au lendemain de la première guerre mondiale, nous avions assisté à un réel recul des antagonismes impérialistes et à un recul parallèle de l'économie de guerre, c'est que la bourgeoisie avait comme principale préoccupation de faire face à la vague révolutionnaire commencée en 1917 en Russie, d'établir un front commun contre la menace de l'ennemi commun et mortel de tous les secteurs de la bourgeoisie : le prolétariat mondial. Et si la seconde guerre mondiale a immédiatement débouché sur le développement des antagonismes impérialistes entre ses deux principaux vainqueurs, avec le maintien d'un degré très élevé de l'économie de guerre, c'est justement que la menace que pouvait encore représenter un prolétariat, déjà profondément affecté par la contre-révolution, avait été complétement éradiquée au cours même de la guerre et à son lendemain par une bourgeoisie instruite par sa propre expérience historique (cf. notamment « Les luttes ouvrières en Italie 1943 » dans la Revue Internationale n° 75). En fait, avec la vision de PC, la guerre de Corée, la guerre d'Indochine et plus tard celle du Vietnam, sans compter toutes celles du Moyen-Orient opposant un Etat d’Israël soutenu fermement par les Etats-Unis et des pays Arabes recevant une aide massive de l'URSS (et nous ne parlons pas de dizaines d'autres jusqu'à la guerre en Afghanistan qui s'est prolongée jusqu'à la fin des années 1980) n'avaient rien à voir avec un antagonisme fondamental entre les deux grand monstres impérialistes mais à une sorte de « bluff» correspondant, soit à de simples campagnes idéologiques contre le prolétariat, soit à la nécessité, pour chacun des super-grands, de maintenir l'ordre dans son pré-carré.
D'ailleurs, cette dernière idée est contredite par PC lui-même qui attribue à la « détente » entre les deux blocs, entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1970, la même fonction que la guerre froide : «En réalité, la détente ne fut que la réponse des deux superpuissances aux lignes de fracture qui apparaissent toujours plus nettement dans leurs sphères d'influence respectives. Ce qu'elle signifiait, c'était une pression accrue de Moscou et de Washington sur leurs alliés pour contenir leurs poussées centrifuges. » (PC n°92, p. 43)
Il est vrai que les communistes ne doivent jamais prendre pour argent comptant ce que disent la bourgeoisie, ses journalistes et ses historiens. Mais prétendre que derrière la plupart des guerres (plus d'une centaine) qui ont ravagé le monde, depuis 1945 jusqu'à la fin des années 1980, il n'y avait pas la main des grandes puissances, c'est tourner le dos à une réalité observable pour quiconque n'avait pas de crotte dans les yeux, c'est aussi remettre en cause ce que PC affirme lui-même avec beaucoup de justesse : « Le conflit latent entre Etats éclate d'abord sous la forme de conflits militaires limités à certaines zones géographiques, de guerres localisées oú les grandes puissances ne s'affrontent pas directement, mais par personnes interposées » (voir plus haut).
En fait, le PCI peut toujours expliquer par la « dialectique » la contradiction entre ce qu'il raconte et la réalité, ou bien entre ses différents arguments : il nous fait surtout la preuve que la rigueur n'est pas son fort et qu'il lui arrive de raconter n'importe quoi, ce qui n'est pas fait pour combattre efficacement les mensonges bourgeois et renforcer la conscience du prolétariat.
C'est bien de cela dont il est question, et jusqu'à la caricature, lorsque, pour combattre les mensonges du pacifisme, il s'appuie sur un article de Bordiga de 1950 qui fait de l'évolution de la production d'acier l'indice majeur, sinon un des facteurs de l'évolution du capitalisme lui-même: « La guerre à l'époque capitaliste, c'est-à-dire le plus féroce type de guerre, c'est la crise produite inévitablement par la nécessité de consommer l'acier produit, et de lutter pour le droit de monopole de la production supplémentaire d'acier » (« Sa majesté l'acier », Battaglia Comunista n° 18/1950)
Toujours préoccupé par sa volonté d'attribuer une « rationalité » à la guerre, PC en est conduit à laisser entendre que la guerre impérialiste n'est pas seulement une bonne chose pour le capitalisme mais aussi pour l'ensemble de l'humanité, et donc pour le prolétariat, lorsqu'il affirme que : « ... la prolongation de la paix bourgeoise au-delà des limites définies par un cycle économique qui réclame la guerre, même si elle était possible, ne pourrait déboucher que sur des situations pires encore que celle de la guerre ». Suit alors une citation de l'article de Bordiga qui vaut son pesant de cacahuètes (ou d'acier, si l'on veut !) :
« Arrêtons-nous à supposer... qu'au lieu des deux guerres [mondiales]... nous ayons eu la paix bourgeoise, la paix industrielle. En à peu près trente cinq années, la production avait augmenté de 20 fois ; elle serait devenue encore 20 fois plus grande que les 70 millions de 1915, arrivant aujourd'hui [1950-NDLR] à 1400 millions. Mais tout cet acier ne se mange pas, ne se consomme pas, ne se détruit pas sinon en massacrant les peuples. Les deux milliards d'hommes pèsent à peu prés 140 millions de tonnes ; ils produiraient en une seule année dix fois leur propre poids d'acier. Les dieux punirent Midas en le transformant en une masse d'or; le capital transformerait les hommes en une masse d'acier, la terre, l'eau et l'air dans lesquels ils vivent en une prison de métal. La paix bourgeoise a donc des perspectives plus bestiales que la guerre. »
Il s'agit là, bel et bien, d'un délire de Bordiga comme en était affecté malheureusement trop souvent ce révolutionnaire. Mais au lieu de prendre ses distances avec ces divagations, le PCI, au contraire surenchérit :
« Surtout si l'on considére que la terre, transformée en cercueil d'acier, ne serait qu'un lieu de putréfaction où marchandises et hommes en excès se décomposeraient pacifiquement. Voilà, Messieurs les pacifistes, quel pourrait être le fruit du "retour à la raison" des gouvernements, leur conversion à une "culture de paix" ! Mais c'est précisément pourquoi c'est non la Folie, mais la Raison - bien sûr la Raison de la société bourgeoise, qui pousse tous les gouvernements vers la guerre, vers la salutaire et hygiénique guerre. » (PC n° 92, p. 54)
Bordiga, en écrivant les lignes dont se revendique le PCI, tournait le dos à une des bases même de l'analyse marxiste: le capitalisme produit des marchandises, et qui dit marchandise dit possibilité de satisfaire un besoin, aussi perverti soit-il, comme le «besoin» d'instruments de mort et de destruction de la part des Etats capitalistes. S'il produit de l'acier en grandes quantités, c'est effectivement, en bonne partie, pour satisfaire la demande des Etats en armements lourds destinés à faire la guerre. Cependant, cette production ne peut aller bien au-delà de la demande de ces Etats : si les industriels de la sidérurgie n'arrivent plus à vendre leur acier aux militaires, parce que ces derniers en ont déjà consommé en quantité suffisante, ils ne vont pas poursuivre bien longtemps, sous peine de faillite de leur entreprise, une production qui n'arrive plus à se placer: ils ne sont pas fous. Par contre, Bordiga l'est quelque peu lorsqu'il imagine que la production d'acier pourrait se poursuivre indéfiniment sans autre limite que celle imposée par les destructions de la guerre impérialiste.
Il est heureux pour le PCI que le ridicule ne tue pas (et pour sa part, Bordiga n'est pas mort de cela non plus) : c'est avec un grand éclat de rire que les ouvriers risquent d'accueillir ses élucubrations et celles de son inspirateur. En revanche, c'est extrêmement regrettable pour la cause que le PCI s'efforce de défendre : en utilisant des arguments stupides et ridicules contre le pacifisme, il est conduit, involontairement, à faire le jeu de cet ennemi du prolétariat.
A quelque chose malheur est bon, toutefois : par ses arguments délirants pour justifier la « rationalité » de la guerre, le PCI démolit une telle idée. Et ce n'est pas une mauvaise chose lorsque cette idée le conduit à mettre en avant une perspective qui risque de démobiliser le prolétariat en lui faisant sous-estimer les dangers que le capitalisme fait peser sur 1’humanité. C'est une telle idée qui se trouve en particulier résumée dans cette affirmation :
« Il en découle aussi [de la guerre comme manifestation d'une rationalité économique] que la lutte inter-impérialiste et l'affrontement entre puissances rivales ne pourra jamais conduire à la destruction de la planéte, parce qu'il s'agit justement, non d'avidités excessives mais de la nécessité d'échapper à la surproduction. Quand l'excédent est détruit, la machine de guerre s'arrête, quel que soit le potentiel destructif des armes mises en jeu, car disparaissent du même coup les causes de la guerre. » (PC n° 92, p. SS)
Dans la seconde partie de cet article, nous reviendrons sur cette question de la sous-estimation dramatique de la menace de la guerre impérialiste à laquelle conduit l'analyse du PCI, et plus concrétement sur le facteur de démobilisation que représentent pour la classe ouvrière les mots d'ordre de cette organisation.
FM.
[1] [220] Il est nécessaire de faire cette précision car il existe á l’heure actuelle trois organisations qui se nomment « Parti Communiste International » : deux d'entre elles proviennent de l'ancienne organisation du même nom qui a éclaté en 1982 et qui publiait en italien Il Programma Comunista ; aujourd'hui, ces deux scissions publient respectivement ce même titre et Il Comunista. Le troisième PCI, qui s'est formé à la suite d'une scission plus ancienne, publie pour sa part, Il Partito Comunista.
[2] [221] Voir en particulier les articles publiés dans la Revue Internationale n° 52 et 53 « Guerre et militarisme dans la décadence ».
[3] [222] Sur cette question, voir plus particulièrement (parmi de nombeux textes consacrés à la défense de la notion de décadence du capitalisme) notre étude : « Comprendre la décadence du capitalisme » dans la Revue internationale n° 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56 et 58. La question du lien entre l'analyse de la décadence et les positions politiques est traitée dans le n° 49.
[4] [223] Voir « Comprendre la décadence du capitalisme ». La critiques des conceptions de Bordiga est abordée en particulier dans les n° 48, 54 et 55 de la Revue Internationale.
[5] [224] Voir notamment « La guerre dans le capitalisme » (n° 41) ainsi que «Guerre et militarisme dans la décadence » (n° 52 et 53)
[6] [225] Voir à ce sujet la brochure sur La décadence du capitalisme ainsi que de nombreux articles dans cette même Revue internationale, notamment dans le n°13 : « Marxisme et théorie des crises» et dans le n° 76 : « Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessité matérielle».
[7] [226] Sur l'étude des mécanismes économiques de la reconstruction, voir en particulier les parties V et VI de l'étude « Comprendre la décadence du capitalisme » (Revue internationale n° 55 et 56).
Courants politiques:
- Bordiguisme [227]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [192]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [8e partie]
- 4116 lectures
1871 : la première révolution prolétarienne
Le communisme : une société sans Etat
Selon la conception populaire erronée que tous les porte-parole de la bourgeoisie, de la presse aux professeurs d'université, reprennent et propagent systématiquement, le communisme serait une société où tout est dirigé par l'Etat. Toute l'identification entre le communisme et les régimes staliniens de l'Est est fondée sur cette présomption.
Et cependant, c'est une totale falsification, un renversement de la réalité. Pour Marx, pour Engels, pour tous les révolutionnaires qui ont suivi leur trace, le communisme signifie une société sans Etat, une société où les être humains dirigent leurs affaires sans qu'une puissance coercitive ne les domine, sans gouvernement, sans armée, sans prisons et sans frontières nationales.
Evidemment, la bourgeoisie du monde entier a une réponse à cette version-là du communisme : « oui, oui, mais ce n'est qu'une utopie, ça ne pourra jamais exister ; la société moderne est bien trop vaste, bien trop complexe ; les êtres humains sont trop peu dignes de confiance, trop violents, trop avides de pouvoir et de privilèges. » Les plus sophistiqués des professeurs (comme J.Talmon, par exemple, auteur du livre Les Origines de la Démocratie Totalitaire) nous expliquent même que la simple tentative de créer une société sans Etat ne peut que mener à la sorte d’Etat-Léviathan monstrueux qui a surgi, sous Staline, en Russie.
Mais voyons : si la vision d'un communisme sans Etat n'est rien de plus qu'une utopie, un vain rêve, pourquoi les maîtres de l'Etat actuel passent-ils tant de temps et d'énergie à répéter le mensonge selon lequel le communisme = le contrôle de l'Etat sur la société ? N'est-ce pas parce que la version authentique du communisme constitue véritablement un défi subversif contre l'ordre existant, et parce qu'elle correspond aux nécessités d'un mouvement réel qui est inévitablement contraint de s'affronter à l'Etat et à la société que celui-ci protège ?
Si le marxisme constitue le point de vue théorique et la méthode de ce mouvement, celui du prolétariat international, il est alors facile de voir pourquoi l'idéologie bourgeoise sous toutes ses formes, même celles qui s'accolent l'étiquette de «marxiste», a toujours cherché à enterrer la théorie marxiste de l'Etat sous l'immense dépotoir de poubelles intellectuelles. Quand il a écrit L'Etat et la Révolution en 1917, Lénine parlait d'«exhumer» la véritable position marxiste des décombres du réformisme. Aujourd'hui, dans le sillage de toutes les campagnes bourgeoises identifiant le capitalisme d'Etat stalinien au communisme, il faut continuer à exhumer. D'où cet article qui est centré sur l'événement considérable, la Commune de Paris,j première révolution prolétarienne de l'histoire, qui a légué à la classe ouvrière les leçons les plus précieuses précisément sur cette question.
La Première Internationale : de nouveau, la lutte politique
En 1864, Marx sortait de plus d'une décennie d'immersion dans un profond travail théorique d'investigation pour revenir au monde de la politique pratique. Dans la décennie qui suivit, il allait orienter l'essentiel de ses énergies sur deux questions politiques par excellence : la formation d'un parti international des travailleurs, et la conquête du pouvoir par le prolétariat.
Après le long reflux de la lutte de classe qui avait eu lieu, à la suite de la défaite des grands soulèvements sociaux de 1848, le prolétariat d'Europe commençait à montrer des signes de réveil de sa conscience et de sa combativité. Le développement de mouvements de grève sur des revendications à la fois économiques et politiques, la formation des syndicats et des coopératives ouvrières, la mobilisation des ouvriers sur des questions de politique « étrangère » telles que le soutien à l'indépendance de la Pologne ou aux forces anti-esclavagistes dans la guerre civile américaine, tout cela a convaincu Marx que la période de défaite touchait à sa fin. C'est pourquoi il apporta son soutien actif à l'initiative des syndicalistes anglais et français de former l'Association Internationale des Travailleurs ([1] [229]) en septembre 1864. Comme le dit Marx dans le Rapport du Conseil Général de l'Internationale au Congrès de Bruxelles en 1868 : cette Association « n'est fille ni d'une secte, ni d'une théorie. Elle est le produit spontané du mouvement prolétaire, engendré lui-même par les tendances naturelles et irrépressibles de la société moderne ». ([2] [230]) Ainsi, le fait que les raisons de beaucoup d'éléments qui formèrent l'Internationale, n'aient pas eu grand chose à voir avec les vues de Marx (par exemple, la principale préoccupation des syndicalistes anglais était d'utiliser l'Internationale pour empêcher l'importation de briseurs de grève étrangers), n'a pas empêché ce dernier d'y jouer un rôle prépondérant ; il a siégé au Conseil Général la plus grande partie de l'existence de celui-ci et a rédigé beaucoup de ses documents les plus importants. Comme l'Internationale était le produit d'un mouvement du prolétariat à une certaine étape de son développement historique, une étape où il était encore en train de se former en tant que force au sein de la société bourgeoise, il était à la fois possible et nécessaire pour la fraction marxiste de travailler dans l'Internationale à côté d'autres tendances de la classe ouvrière, de participer à leurs activités immédiates dans le combat quotidien des ouvriers, tout en essayant en même temps de libérer l'organisation des préjugés bourgeois et petit-bourgeois, et de l'imprégner autant que possible de la clarté théorique et politique requises pour agir comme avant-garde révolutionnaire d'une classe révolutionnaire.
Ce n'est pas le lieu ici de faire une histoire de toutes les luttes doctrinaires et pratiques qu'a menées la fraction marxiste dans l'Internationale. Il suffit de dire qu'elles étaient basées sur des principes qui avaient déjà été établis dans Le Manifeste Communiste et renforcés par l'expérience des révolutions de 1848, en particulier :
- « L'émancipation des travailleurs doit être l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes » ([3] [231]), d'où la nécessité d'une organisation « établie par les ouvriers eux-mêmes et pour eux-mêmes » ([4] [232]), et la rupture avec l'influence des libéraux et des réformistes bourgeois ; bref, travailler à une politique et une action de classe indépendantes pour le prolétariat, même dans une période où les alliances avec des fractions progressistes bourgeoises étaient encore à l'ordre du jour. Au sein de l'Internationale elle-même, la défense de ce principe devait mener à la rupture avec Mazzini et ses disciples nationalistes bourgeois.
- En conséquence, « la classe en ouvrière ne peut agir en tant que classe qu'en se constituant en parti politique, distinct et opposé à tous les partis formés par les classes propriétaires » et que « cette constitution de la classe ouvrière en parti politique est indispensable pour assurer le triomphe de la révolution sociale et son but ultime - l'abolition des classes » ([5] [233]). Cette défense d'un parti de classe, une organisation internationale et centralisée des prolétaires les plus avancés ([6] [234]), a été menée contre tous les éléments anarchistes, « anti-autoritaires », fédéralistes, en particulier les disciples de Proudhon et de Bakounine qui pensaient que toute forme de centralisation était par essence despotique et que, de toute façon, I l'Internationale n'avait rien à voir avec la politique, que ce soit dans les phases défensive ou révolutionnaire du mouvement prolétarien. L'Adresse Inaugurale de l'Internationale en 1864 insistait déjà sur le fait que « la conquête du pouvoir politique est donc devenue le premier devoir de la classe ouvrière. » ([7] [235]) La résolution de 1871 a donc constitué une répétition de ce principe fondamental contre tous ceux qui croyaient que les révolutions sociales pourraient réussir, sans que les ouvriers ne prennent la peine de former un parti politique et de se battre en tant que classe pour le pouvoir politique.
Dans la période qui va de 1864 à 1871, le débat sur l'engagement dans la « politique » était en grande partie lié à la question de savoir si la classe ouvrière devait participer à la sphère de la politique bourgeoise (l'appel au suffrage universel, la participation du parti des ouvriers au parlement, la lutte pour les droits démocratiques, etc.), comme moyen d'obtenir des réformes et de renforcer ses positions au sein de la société capitaliste. Les Bakouninistes et les Blanquistes ([8] [236]), champions de la toute-puissance de la volonté révolutionnaire, refusaient d'analyser les conditions matérielles objectives dans lesquelles agissait le mouvement ouvrier, et rejetaient de telles tactiques comme des diversions vis-à-vis de la révolution sociale. La fraction matérialiste de Marx, d'un autre côté, analysait que le capitalisme en tant que système global n'avait pas encore achevé sa mission historique, n'avait pas encore créé toutes les conditions de la transformation révolutionnaire de la société, et qu'en conséquence, il était encore nécessaire que la classe ouvrière lutte pour des réformes aux niveaux à la fois économique et politique. Ce faisant, non seulement elle améliorerait sa situation matérielle immédiate, mais elle se préparerait et s'organiserait pour l'épreuve y de force révolutionnaire qui se produirait inévitablement dans la trajectoire historique du capitalisme vers la crise et l'effondrement.
Ce débat devait se poursuivre dans le mouvement ouvrier dans les décennies suivantes, bien que dans des contextes différents et avec des protagonistes très différents. Mais en 1871, les événements considérables en Europe continentale devaient ajouter une toute autre dimension au débat sur l'action politique de la classe ouvrière. Car c'était l'année de la première révolution prolétarienne de l'histoire, la conquête réelle du pouvoir politique par la classe ouvrière l'année de la Commune de Paris.
La Commune et la conception matérialiste de l'histoire
« Tout pas du mouvement réel vaut mieux qu'une dizaine de programmes » ([9] [237]).
Le drame et la tragédie de la Commune de Paris sont brillamment analysés par Marx dans La guerre civile en France, publié durant l'été 1871 en tant qu'Adresse officielle de l'Internationale. Dans cette diatribe passionnée, Marx montre comment une guerre entre des nations, la France et la Prusse, s'est transformée en une guerre entre les classes : à la suite du désastreux effondrement militaire de la France, le gouvernement de Thiers, établi à Versailles, avait conclu une paix impopulaire et cherché à en imposer les termes à Paris ; cela ne pouvait être fait qu'en désarmant les ouvriers regroupés dans la Garde Nationale. Le 18 mars 1871, des troupes envoyées par Versailles cherchèrent à saisir les canons qui se trouvaient sous le contrôle de la Garde nationale ; ce devait être le prélude d’une répression massive contre la classe ouvrière et ses minorités révolutionnaires. Les ouvriers de Paris répondirent en descendant dans la rue et en fraternisant avec les troupes de Versailles. Les jours qui suivirent, ils proclamèrent la Commune.
Le nom de la Commune de 1871 était l'écho de la Commune révolutionnaire de 1793, organe des sans-culotte durant les phases les plus radicales de la révolution bourgeoise. Mais la seconde Commune avait une signification très différente ; elle n'était pas tournée vers le passé, mais vers le futur, celui de la révolution communiste de la classe ouvrière.
Bien que Marx, durant le siège de Paris, ait mis en garde contre un soulèvement dans des conditions de guerre qui serait une « folie désespérée » ([10] [238]), lorsque eut lieu le soulèvement, Marx et l'Internationale s'engagèrent et exprimèrent la solidarité la plus inébranlable avec les Communards - parmi lesquels les membres de l'Internationale jouèrent un rôle d'avant-garde, même si quasiment aucun n'était d'obédience «marxiste». Il ne pouvait y avoir d'autre réaction face aux viles calomnies que la bourgeoisie mondiale lança contre la Commune, et à l'horrible revanche que la classe dominante prit sur le prolétariat parisien pour avoir osé défier sa « civilisation » : après le massacre de milliers de combattants sur les barricades, d'autres milliers, hommes, femmes, et enfants, furent exécutés massivement, incarcérés dans les conditions les plus abjectes, déportés comme forçats dans les colonies. Jamais depuis les jours de la Rome antique n'avait été orchestrée une telle orgie sanglante par la classe dominante.
Mais au-delà de la question élémentaire de la solidarité prolétarienne, il y a une autre raison pour laquelle Marx a été amené à reconnaître la signification fondamentale de la Commune. Même si elle était historiquement « prématurée », dans le sens où les conditions matérielles d'une révolution prolétarienne mondiale n'étaient pas encore mûres, la Commune constituait néanmoins un événement d'une portée historique mondiale, une étape cruciale sur le chemin de cette révolution ; elle constituait un trésor de leçons pour le futur, pour la clarification du programme communiste. Avant la Commune, la fraction la plus avancée de la classe, les communistes, avait compris que la classe ouvrière devait prendre le pouvoir politique comme premier pas vers la construction d'une communauté humaine sans classe. Mais la façon précise dont le prolétariat établirait sa dictature, n'avait pas encore été clarifiée car une telle avancée théorique ne pouvait que se baser sur l'expérience vivante de la classe. La Commune de Paris a constitué une telle expérience, peut-être la preuve la plus vivace que le programme communiste n'est pas un dogme fixe et statique, mais qu'il évolue et se développe en lien l étroit avec la pratique de la classe ouvrière ; pas une utopie, mais une grande expérience scientifique dont le laboratoire est le mouvement réel de la société. Il est bien connu qu'Engels fit un point spécifique, dans son introduction ultérieure au Manifeste communiste de 1848, établissant que l'expérience de la Commune avait rendu obsolètes les formulations du texte qui exprimaient l'idée de s'emparer de l'appareil d'Etat existant. Les conclusions que Marx et Engels ont tirées de la Commune, sont, en d'autres termes, une démonstration et une justification de la méthode matérialiste historique. Comme le dit Lénine dans L'Etat et la révolution :
« Il n'y a pas un grain d'utopisme chez Marx ; il n'invente pas, il n'imagine pas de toutes pièces une société "nouvelle". Non, il étudie comme un processus d'histoire naturelle, la naissance de la nouvelle société à partir de l'ancienne, les formes de transition de celle-ci à celle-là. Il prend l'expérience concrète du mouvement prolétarien de masse et s'efforce d'en tirer les leçons pratiques. Il 'se met à l'école' de la Commune, de même que tous les grands penseurs révolutionnaires n'hésitèrent pas à se mettre à l'école des grands mouvements de la classe opprimée... » ([11] [239])
Notre but n'est pas de refaire l'histoire de la Commune, les principaux événements sont déjà décrits dans La guerre civile en France, ainsi que dans beaucoup d'autres travaux, y compris ceux de révolutionnaires comme Lissagaray qui s'est lui-même battu sur les Joarricades. Ce que nous essaierons de faire f ici, c'est d'examiner exactement ce que Marx ^ja appris de la Commune. Dans un autre article, nous étudierons comment il a défendu ces leçons contre toutes les confusions qui prévalaient dans le mouvement ouvrier de cette époque.
Marx contre l'adoration de l'Etat
« Ce ne fut donc pas une révolution contre telle ou telle forme de pouvoir d'Etat, légitimiste, constitutionnelle, républicaine ou impériale. Ce fut une révolution contre l'Etat lui-même, cet avorton surnaturel de la société ; ce fut la reprise par le peuple et pour le peuple de sa propre vie sociale. » ([12] [240])
Les conclusions qu'a tirées Marx de la Commune de Paris, n'étaient pas par ailleurs un produit automatique de l'expérience directe des ouvriers. Elles étaient une confirmation et un enrichissement d'un élément de la pensée de Marx qui avait été constant depuis qu'il avait rompu d'abord avec l’hégélianisme pour évoluer vers la cause prolétarienne.
Même avant de devenir clairement communiste, Marx avait déjà commencé à critiquer l'idéalisation hégélienne de l'Etat. Pour Hegel, dont la pensée était faite d'un mélange contradictoire de radicalisme dérivé de la poussée de la révolution bourgeoise et de conservatisme hérité de l'atmosphère étouffante de l'absolutisme prussien, l'Etat, et en cela l'Etat prussien existant, se définissait comme l'incarnation de l'Esprit Absolu, la forme parfaite de l'existence sociale. Dans sa critique de Hegel, Marx montre au contraire que loin d'être le produit supérieur et le plus noble de l'être humain, le sujet rationnel de l'existence sociale, l'Etat, et par dessus tout l'Etat prussien bureaucratique, était un aspect de l'aliénation de l'homme, de sa perte de contrôle sur ses propres pouvoirs sociaux. La pensée d'Hegel était sens dessus dessous : « Hegel part de l'Etat et conçoit l'homme comme Etat subjective ; la démocratie part de l'homme et conçoit l'Etat comme l'homme objectivé. » ([13] [241])
A ce moment-là, le point de vue de Marx était celui de la démocratie bourgeoise radicale (très radicale en fait puisque, comme nous l'avons déjà démontré, la véritable démocratie mènerait à la disparition de l'Etat), un point de vue qui voyait que l'émancipation de l'humanité relevait d'abord et avant tout de la sphère de la politique. Mais très rapidement, comme il commençait à envisager les choses du point de vue de la perspective prolétarienne, il fut capable de voir que si l'Etat devenait étranger à la société, c'est parce qu'il était le produit d'une société fondée sur la propriété privée et les privilèges de classe. Dans ses écrits sur La loi contre les voleurs de bois, par exemple, il avait commencé à adopter le point de vue selon lequel l'Etat est le gardien de l'inégalité sociale, d'étroits intérêts de classe ; dans La question juive, il avait commencé à reconnaître que la réelle émancipation humaine ne pouvait se restreindre à la dimension politique, mais requérait une forme de vie sociale différente. Ainsi, dès les débuts du communisme de Marx, celui-ci était très préoccupé de démystifier l'Etat et il n'en dévia jamais.
Comme on l'a vu dans les articles sur le Manifeste communiste et les révolutions de 1848 ([14] [242]), au fur et à mesure que le communisme émergeait en tant que courant avec une organisation et un programme politique définis, il poursuivait dans le même esprit. Le Manifeste communiste, rédigé à la veille des grands soulèvements sociaux de 1848, avait en perspective non seulement la prise du pouvoir politique par le prolétariat, mais l'extinction finale de l'Etat une fois que ses racines, une société divisée en classes, auraient été extirpées et supprimées. Et les expériences réelles des mouvements de 1848 permirent à la minorité révolutionnaire organisée dans la Ligue communiste de beaucoup faire la lumière sur le chemin du prolétariat vers le pouvoir, mettant en évidence la nécessité, dans tout soulèvement révolutionnaire, que la classe ouvrière conserve ses propres armes et ses propres organes de classe, et suggérant même (dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte) que la tâche du prolétariat révolutionnaire n'était pas de perfectionner l'appareil d'Etat bourgeois, mais de le détruire.
Aussi la fraction marxiste n'interpréta-t-elle pas l'expérience de la Commune sans patrimoine théorique : les leçons de l'histoire ne sont pas »spontanées« dans le sens où l'avant-garde communiste les développe sur la base d'un cadre d'idées déjà existant. Mais ces idées elles-mêmes doivent être constamment réexaminées et testées à la lumière de l'expérience de la classe ouvrière, et c'est à la gloire des ouvriers parisiens d'avoir offert une preuve convaincante que la classe ouvrière ne peut faire la révolution en s'emparant d'un appareil dont la structure et le mode de fonctionnement mêmes sont adaptés à la perpétuation de l'exploitation et de l'oppression. Si le premier pas de la révolution prolétarienne est la conquête du pouvoir politique, il ne peut avoir lieu sans la destruction violente de l'Etat bourgeois existant.
L'armement des ouvriers
Que la Commune ait surgi de la tentative du gouvernement de Versailles de désarmer les ouvriers est hautement symbolique : cela a démontré que la bourgeoisie ne peut tolérer un prolétariat en armes. A l'inverse, le prolétariat ne peut parvenir au pouvoir que les armes à la main. La classe dominante la plus violente et la plus impitoyable de l'histoire ne permettra jamais d'être évincée du pouvoir par un vote, elle ne peut qu'y être forcée, et la classe ouvrière ne peut défendre sa révolution contre toutes les tentatives de la renverser qu'en se dotant de sa propre force armée. En fait, deux des critiques les plus rigoureuses portées par Marx à la Commune, c'est que celle-ci n'avait pas suffisamment utilisé la force, ayant manifesté une « crainte superstitieuse » face à la Banque de France au lieu de l'occuper et de l'utiliser comme objet de marchandage, et qu'elle n'avait pas lancé d'offensive contre Versailles quand cette dernière manquait encore de ressources pour mener l'attaque contre-révolutionnaire du capital.
Mais, malgré les faiblesses sur ces aspects, la Commune fit une avancée historique décisive lorsque, dans l'un de ses premiers décrets, elle prononça la dissolution de l'armée existante et introduisit l'armement général de la population dans la Garde nationale qui fut effectivement transformée en milice populaire. Ce faisant, la Commune fit le premier pas vers le démantèlement de l'ancien appareil d'Etat, qui trouve son expression par excellence dans l'armée, dans une force armée qui surveille la population, n'obéit qu'aux échelons supérieurs de l'appareil d'Etat et n'est soumise à aucun contrôle d'en bas.
Le démantèlement de la bureaucratie par la démocratie ouvrière
A côté de l'armée, et en fait profondément interdépendante de celle-ci, l'institution qui concrétise le plus clairement l'Etat comme une « excroissance parasitaire » devenue étrangère à la société, est la bureaucratie, ce réseau byzantin de fonctionnaires permanents qui voient quasiment l'Etat comme leur propriété privée. Là aussi, la Commune prit des mesures immédiates pour se libérer de ce parasite. Engels résume ces mesures très succinctement dans son Introduction à La Guerre civile en France :
« Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs, de l'Etat et des organes de l'Etat, à l'origine serviteurs de la société en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places, de l'administration, de la justice et de l'enseignement au choix des intéressés par élection au suffrage universel, et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et, deuxièmement, elle ne rétribua tous les services, des plus bas aux plus élevés, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu'elle payât dans l'ensemble était de 6 000 francs. Ainsi on mettait le holà à la chasse aux places et à l'arrivisme, sans en appeler aux mandats impératifs des délégués aux corps représentatifs qui leur étaient encore adjoints par surcroît. » ([15] [243])
Marx a également souligné qu'en combinant les fonctions exécutives et législatives, la Commune était « un corps agissant », « non pas un organisme parlementaire ». ([16] [244]) En d'autres termes, elle était une forme supérieure de démocratie vis-à-vis du parlementarisme bourgeois : même dans les beaux jours de celui-ci, la division entre le législatif et l'exécutif faisait que ce dernier tendait à échapper au contrôle du premier et engendrait ainsi une bureaucratie croissante. Cette tendance s'est, bien entendu, pleinement confirmée dans l'époque de la décadence capitaliste au cours de laquelle les organes exécutifs de l'Etat ont fait du législatif une simple apparence, une façade.
Mais sans doute la preuve la plus parlante du fait que la démocratie prolétarienne incarnée par la Commune était plus avancée que tout ce qui pouvait exister sous la démocratie bourgeoise, est le principe des délégués révocables :
« Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait 'représenter' et fouler au pied le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en communes... » ([17] [245])
Les élections bourgeoises sont fondées sur le principe du citoyen atomisé dans l'isoloir électoral, avec un vote qui ne lui donne aucun contrôle réel sur ses « représentants ». La conception prolétarienne des délégués élus et révocables, au contraire, ne peut fonctionner que sur la base d'une mobilisation permanente et collective des ouvriers et des opprimés. Suivant la tradition des sections révolutionnaires d'où a surgi la Commune de 1793 (sans mentionner les « agitateurs » radicaux élus dans les rangs du Nouveau modèle d'armée de Cromwell, dans la révolution anglaise), les délégués au Conseil de la Commune étaient élus par des assemblées publiques tenues dans chaque arrondissement de Paris. Formellement parlant, ces assemblées électorales avaient le pouvoir de formuler les mandats de leurs délégués et de les révoquer si nécessaire. Dans la pratique, il devait apparaître que la plus grande partie du travail de supervision et de pression sur les délégués de la Commune était réalisé par les « Comités de Vigilance » et des clubs révolutionnaires qui surgirent dans les quartiers ouvriers et qui étaient le lieu où se concentrait une intense vie de débat politique, à la fois sur les questions générales et théoriques auxquelles était confronté le prolétariat, et à la fois sur les questions immédiates de survie, d'organisation et de défense. La déclaration de principe du Club communal qui se réunissait dans l'église de St Nicolas des Champs, dans le troisième arrondissement, nous donne un aperçu du niveau de conscience prolétarienne atteint par les prolétaires de Paris durant les deux mois enivrants de l'existence de la Commune :
« Les buts du Club Communal sont les suivants :
Combattre les ennemis de nos droits communs, de nos libertés et de la République. Défendre les droits du peuple, l'éduquer politiquement de sorte qu'il puisse gouverner lui-même.
Rappeler les principes à nos délégués s'ils devaient s'en éloigner, et les soutenir dans tous leurs efforts pour sauver la République. Mais par dessus tout, soutenir la souveraineté du peuple qui ne doit jamais renoncer à ses droits, à superviser les actions de ses délégués.
Peuple, gouverne toi-même directement, à travers des réunions politiques, à travers ta presse ; fais peser la pression sur ceux qui te représentent - ils ne peuvent aller trop loin dans la direction révolutionnaire... Longue vie à la Commune ! »
Du semi-Etat à la suppression de l'Etat
Fondée sur l'auto mobilisation permanente du prolétariat armé, la Commune comme le dit Engels, «n'était plus un Etat au sens propre » ([18] [246]). Lénine dans L'Etat et la révolution, cite cette phrase et la développe :
« La Commune cessait d'être un Etat dans la mesure où il lui fallait opprimer non plus la majorité de la population, mais une minorité (les exploiteurs) ; elle avait brisé la machine d'Etat bourgeoise ; au lieu d'un pouvoir spécial d'oppression, c'est la population elle-même qui entrait en scène. Autant de dérogations à ce qu'est l'Etat au sens propre du mot. Et si la Commune s'était affermie, les vestiges de l'Etat qui subsistaient en elle se seraient 'éteints' d'eux-mêmes ; elle n'aurait pas eu besoin d"abolir' ses institutions : celles-ci auraient cessé de fonctionner au fur et à mesure qu'elles n'auraient plus rien eu à faire. » ([19] [247])
Ainsi l'« anti-étatisme » de la classe ouvrière opère à deux niveaux, ou plutôt en deux étapes : d'abord, la destruction violente de l'Etat bourgeois ; ensuite son remplacement par une nouvelle sorte de pouvoir politique qui autant que possible évite les «pires aspects » de tous les Etats antérieurs, et qui, en fin de compte, rend possible que le prolétariat se débarrasse complètement de l'Etat, en le consignant, selon les termes évocateurs d'Engels, « au Musée des Antiquités à côté du rouet et de la hache. » ([20] [248])
De la Commune au communisme : la question de la transformation sociale
Le dépérissement de l'Etat est basé sur la transformation de l'infrastructure économique et sociale, sur l'élimination des rapports capitalistes de production et sur le mouvement vers une communauté humaine sans classe. Comme nous l'avons déjà noté, les conditions matérielles d'une telle transformation n'existaient pas à l'échelle mondiale en 1871. De plus, la Commune ne fut au pouvoir que deux mois, et seulement dans une seule ville assiégée, même si elle a inspiré d'autres tentatives révolutionnaires dans d'autres villes de France (Marseille, Lyon, Toulouse, Narbonne, etc.).
Quand les historiens bourgeois essaient de ridiculiser les proclamations de Marx sur la nature révolutionnaire de la Commune, ils mettent en évidence le fait que la plupart des mesures économiques et sociales qu'elle a prises, étaient à peine socialistes : la séparation de l'Eglise et de l'Etat, par exemple, est entièrement compatible avec le républicanisme bourgeois radical. Même les mesures ayant plus spécifiquement un impact sur le prolétariat, l'abolition du travail de nuit des boulangers, l'aide à la formation des syndicats, etc., se concevaient comme une défense des ouvriers contre l'exploitation plutôt que comme la suppression de l'exploitation elle-même. Tout cela a amené certains « experts » de la Commune à y voir plus le dernier souffle de la tradition jacobine que la première salve de la révolution prolétarienne. D'autres, comme l'a noté Marx, ont pris la Commune pour « un rappel à la vie des communes médiévales, qui d'abord précédèrent ce pouvoir d'Etat, et ensuite en devinrent le fondement. » ([21] [249])
Toutes ces interprétations se basent sur une totale incompréhension de la nature de la révolution prolétarienne. Les leçons de la Commune de Paris sont fondamentalement des leçons politiques, des leçons sur les formes et les fonctions du pouvoir prolétarien, pour la simple raison que la révolution prolétarienne ne peut commencer qu'en tant qu'acte politique. Manquant de toute assise économique au sein de l'ancienne société, le prolétariat ne peut s'engager dans un processus de transformation sociale tant qu'il n'a pas pris les rênes du pouvoir politique, et ceci à l'échelle mondiale. La révolution russe de 1917 a eu lieu à une époque historique où le communisme à l'échelle mondiale était une possibilité, et elle fut victorieuse à l'échelle d'un grand pays. Et pourtant là encore, l'héritage fondamental de la révolution russe est lié au problème du pouvoir politique de la classe ouvrière, comme on le verra plus tard dans un autre article. S'attendre à ce que la Commune ait introduit le communisme dans une seule ville, c'était attendre des miracles. Comme Marx le dit : « La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la Commune. Elle n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle de par sa structure économique même, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances et les hommes. Elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre. » ([22] [250])
Contre toutes les fausses interprétations de la Commune, Marx insistait sur le fait qu'elle était « essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail ». ([23] [251])
Dans ces passages, Marx reconnaît que la Commune fut d'abord et avant tout une forme politique, et qu'il n'était pas du tout question qu'en une nuit, sous sa domination, soient réalisées des utopies. Et cependant, en même temps, il reconnaît qu'une fois que le prolétariat a pris les choses en main, il doit et peut enclencher, ou plutôt « libérer », une dynamique qui mène à « la transformation économique du travail », malgré toutes les limites objectives placées face à cette dynamique. C'est pourquoi la Commune, tout comme la révolution russe, contient également des leçons valables pour la future transformation sociale.
Comme exemple de cette dynamique, de cette logique vers la transformation sociale, Marx a souligné l'expropriation des usines abandonnées par les capitalistes qui avaient fui la ville, et leur prise en charge par des coopératives ouvrières qui devaient être organisées dans une fédération unique. Pour lui, c'était une expression immédiate du but ultime de la Commune, l'expropriation générale des expropriateurs :
« Elle (la Commune) voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail, en simples instruments d'un travail libre et associé. Mais c'est du communisme, c'est’ l'impossible’ communisme ! Eh quoi, ceux des membres de la classe dominante qui sont assez intelligents pour comprendre l'impossibilité de perpétuer le système actuel, - et ils sont nombreux - sont devenus les apôtres importuns et bruyants de la production coopérative. Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et un piège; si elle doit évincer le système capitaliste ; si l'ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous leur propre direction et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inévitable de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très 'possible' communisme ? » ([24] [252])
La classe ouvrière en tant qu'avant-garde des opprimés
La Commune nous a aussi laissé d'importants éléments de compréhension des rapports entre la classe ouvrière une fois qu'elle a pris le pouvoir, et les autres couches non-exploiteuses de la société, dans ce cas, la petite-bourgeoisie urbaine et la paysannerie. En agissant comme avant-garde déterminée de l'ensemble de la population exploitée, la classe ouvrière a montré sa capacité à gagner la confiance de ces autres couches, qui sont moins capables d'agir en tant que force unifiée. Et pour maintenir ces couches aux côtés de la révolution, la Commune a introduit une série de mesures économiques qui allègent leurs charges matérielles : l'abolition de toutes les sortes de dettes et d'impôts, la transformation de l'incarnation immédiate de l'oppression paysanne, «ses sangsues actuelles, le notaire, l'avocat, l'huissier, et autres vampires judiciaires, en agents communaux salariés, élus par lui et devant lui responsables. » ([25] [253]) Dans le cas des paysans, ces mesures restaient largement hypothétiques puisque l'autorité de la Commune ne s'étendait pas aux districts ruraux. Mais les ouvriers de Paris gagnèrent vraiment, dans une large mesure, le soutien de la petite-bourgeoisie urbaine, en particulier à travers l'ajournement des obligations de la dette et l'annulation des intérêts.
L'Etat comme « mal nécessaire »
Les structures électorales de la Commune ont aussi permis aux autres couches non-exploiteuses de participer politiquement au processus révolutionnaire. C'était inévitable et nécessaire, et devait se répéter durant la révolution russe. Mais en même temps, rétrospectivement vu du 20e siècle, nous pouvons voir que l'une des principales indications du fait que la Commune était une expression « immature » de la dictature du prolétariat, qu'elle était une expression de la classe ouvrière n'ayant pas encore atteint son plein développement, réside dans le fait que les ouvriers n'avaient pas d'organisation spécifique indépendante en son sein, ni un poids prépondérant dans les mécanismes électoraux. La Commune était élue exclusivement sur la base d'unités territoriales (les arrondissements) qui, tout en étant dominées par le prolétariat, ne pouvaient permettre à la classe ouvrière de s'imposer comme une force clairement autonome (en particulier si la Commune s'était étendue pour embrasser la majorité paysanne en dehors de Paris). C'est pourquoi les conseils ouvriers de 1905 et de 1917-21, élus par les assemblées sur les lieux de travail et basés dans les principaux centres industriels, constituèrent une avancée comme forme de la dictature du prolétariat par rapport à la Commune. Nous pouvons aller jusqu'à dire que la forme de la Commune correspondait plus à l'Etat composé de tous les Soviets (d'ouvriers, de paysans, de citadins), qui surgit de la révolution russe, qu'à l'organisation des Conseils ouvriers.
L'expérience russe a rendu possible la clarification du rapport entre les organes spécifiques de la classe, les conseils ouvriers, et l'Etat soviétique dans son ensemble. En particulier, elle a montré que la classe ouvrière ne peut s'identifier directement avec ce dernier, mais qu'elle doit exercer une vigilance constante et un contrôle sur celui-ci à travers ses propres organisations de classe qui y participent sans y être englouties. Nous examinerons cette question plus tard, dans d'autres articles de cette série, bien que nous l'ayons déjà largement traitée dans nos publications. Mais ça vaut la peine de dire que Marx a lui-même entrevu le problème. Le premier brouillon de La guerre civile en France contient le passage suivant :
« ...la Commune n'est pas le mouvement social de la classe ouvrière, et, par suite, le mouvement régénérateur de toute l'humanité, mais seulement le moyen organique de son action. La Commune ne supprime pas les luttes de classes, par lesquelles la classe ouvrière s'efforce d'abolir toutes les classes, et par suite toute domination de classe... mais elle crée l'ambiance rationnelle dans laquelle cette lutte de classes peut passer par ses différentes phases de la façon la plus rationnelle et la plus humaine. » ([26] [254])
Ici, on voit une claire vision du fait que la dynamique réelle de la transformation communiste ne vient pas d'un Etat post-révolutionnaire puisque la fonction de ce dernier, comme pour tous les Etats, est de contenir les antagonismes de classe, de les empêcher de déchirer la société. D'où son aspect conservateur par rapport au mouvement social réel du prolétariat. Même dans la courte vie de la Commune, nous pouvons définir certaines tendances dans cette direction. L'histoire de la Commune de Paris de Lissagaray en particulier contient beaucoup de critiques des hésitations, confusions et, dans certains cas, des positions creuses de certains délégués au Conseil de la Commune dont beaucoup incarnaient, en fait, un radicalisme petit-bourgeois obsolète qui était fréquemment mis en question par les assemblées des quartiers plus prolétariens. Un des clubs révolutionnaires locaux au moins déclara qu'il fallait dissoudre la Commune parce qu'elle n'était pas assez révolutionnaire !
Dans un passage très célèbre, Engels plonge certainement dans le même problème quand il dit que l'Etat, le demi-Etat de la période de transition vers le communisme, « ...est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s'empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu'à ce qu'une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l'Etat. » ([27] [255]) Preuve supplémentaire que, selon le marxisme, la puissance de l'Etat est la mesure de l'asservissement de l'homme.
De la guerre nationale à la guerre de classe
Il y a une autre leçon vitale de la Commune qui n'est pas liée au problème de la dictature du prolétariat, mais à une question qui a été particulièrement épineuse dans l'histoire du mouvement ouvrier : la question nationale.
Comme nous l'avons déjà dit, Marx et sa tendance au sein de la Première Internationale reconnaissaient que le capitalisme n'avait pas encore atteint l'apogée de son développement. En fait, le capitalisme était encore limité par les vestiges de la société féodale et d'autres restes archaïques. Pour cette raison, Marx a soutenu certains mouvements nationaux dans la mesure où ils représentaient la démocratie bourgeoise contre l'absolutisme, qu'ils étaient pour l'unification nationale contre la fragmentation féodale. Le soutien que l'Internationale a apporté à l'indépendance de la Pologne contre le Tsarisme russe, à l'unification italienne et allemande, aux Nordistes en Amérique contre le Sud esclavagiste durant la Guerre Civile, se basait sur cette logique matérialiste. C'étaient aussi les causes qui mobilisaient la sympathie et la solidarité active de la classe ouvrière : en Grande-Bretagne par exemple, il y avait des meetings de soutien à l'indépendance polonaise, de grandes manifestations contre l'intervention britannique aux côtés des Sudistes en Amérique, même si le manque de coton résultant de la guerre apportait de réelles privations pour les ouvriers du textile en Grande-Bretagne.
Dans ce contexte où la bourgeoise n'avait pas encore complètement achevé ses tâches historiques progressistes, le problème des guerres de défense nationale était très réel et les révolutionnaires devaient considérer sérieusement chaque guerre entre Etats ; et le problème se posa avec une grande acuité quand la guerre franco-allemande éclata. La politique de l'Internationale envers cette guerre est résumée dans la Première Adresse du Conseil Général de l'AIT sur la guerre franco-allemande. Dans son essence, c'était une prise de position d'un internationalisme prolétarien fondamental contre les guerres « dynastiques » de la classe dominante. Elle citait un Manifeste produit par la section française de l'Internationale lors de l'éclatement de la guerre :
«Une fois de plus, sous prétexte d'équilibre européen et d'honneur national, des ambitions politiques menacent la paix du monde. Travailleurs français, allemands, espagnols, que nos voix s'unissent dans un cri de réprobation contre la guerre ! (...) La guerre pour une question de prépondérance ou de dynastie ne peut être, aux yeux des travailleurs, qu'une criminelle absurdité. » ([28] [256])
De tels sentiments ne se limitaient pas à une minorité socialiste : Marx rapporte, dans la première Adresse, comment les ouvriers internationalistes français pourchassaient les chauvins pro-guerre dans les rues de Paris.
En même temps, l'Internationale défendait que « du côté allemand, la guerre est une guerre de défense. » ([29] [257]) Mais cela ne voulait pas dire empoisonner les ouvriers avec le chauvinisme : en réponse à la prise de position de la section française, les allemands affiliés à l'Internationale, tout en acceptant tristement qu'une guerre défensive était un mal inévitable, déclaraient aussi: «...la guerre actuelle est exclusivement dynastique... Nous sommes heureux de saisir la main fraternelle que nous tendent les ouvriers de France. Attentifs au mot d'ordre de l'Association Internationale des Travailleurs : Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! Nous n'oublierons jamais que les ouvriers de tous les pays sont nos amis et les despotes de tous les pays, nos ennemis ! » ([30] [258])
La première Adresse mettait aussi en garde les ouvriers allemands contre le danger que la guerre ne se transformât en une guerre d'agression du côté allemand, et elle reconnaissait également la complicité de Bismarck dans la guerre, même si c'était avant les révélations sur le télégramme d’Ems qui a prouvé à quel point Bismarck avait en fait attiré Bonaparte et son « Second Empire » dans la guerre. De toute façon, avec l'effondrement de l'armée française à Sedan, la guerre est véritablement devenue une guerre de conquête pour la Prusse. Paris fut assiégé et la Commune elle-même surgit sur la question de la défense nationale. Le régime de Bonaparte fut remplacé par une République en 1870, parce que l'Empire s'était avéré incapable de défendre Paris ; maintenant la même République prouvait qu'elle préférait livrer la capitale à la Prusse plutôt qu'elle ne tombe dans les mains des ouvriers en armes.
Mais bien que, dans leur action initiale, les ouvriers de Paris aient encore pensé en termes d'une sorte de patriotisme défensif, de préservation de l'honneur national par la bourgeoisie elle-même, le soulèvement de la Commune marqua en fait un moment historique décisif. Face à la perspective d'une révolution ouvrière, les bourgeoisies prussienne et française unirent leurs rangs pour l'écraser : l'armée prussienne relâcha ses prisonniers de guerre pour gonfler les troupes contre-révolutionnaires françaises de Thiers, et permit à ces dernières de traverser ses lignes pour mener leur assaut final contre la Commune. De ces événements, Marx a tiré une conclusion de portée historique :
« Qu'après la plus terrible guerre des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat, cet événement inouï prouve, non pas comme Bismarck le pense, l'écrasement définitif d'une nouvelle société montante, mais la désagrégation complète de l'ancienne société bourgeoise. Le plus haut effort d'héroïsme dont la vieille société soit encore capable est une guerre nationale ; et il est maintenant prouvé qu'elle est une pure mystification des gouvernements, destinée à retarder la lutte des classes, et qui est jetée de côté, aussitôt que cette lutte de classe éclate en guerre civile. La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu'un contre le prolétariat ! »([31] [259])
Pour sa part, le prolétariat révolutionnaire de Paris avait déjà commencé à faire un certain nombre de pas au-delà de la phrase patriotique initiale : d'où le décret permettant aux étrangers de servir la Commune, «parce que le drapeau de la Commune est le drapeau de la république Universelle » ; la destruction publique de la colonne Vendôme, symbole de la gloire martiale de la France. La logique historique de la Commune de Paris était d'aller vers une Commune mondiale, même si ce n'était pas possible à cette époque. C'est pourquoi le soulèvement des ouvriers de Paris pendant la guerre franco-allemande, quelles que soient toutes les phrases patriotiques qui l'ont accompagnée, était en réalité le signe avant-coureur des insurrections de 1917-18 explicitement contre la guerre, et de la vague révolutionnaire qui les a suivies.
Les conclusions de Marx ouvrent aussi la perspective du futur. Il pouvait être prématuré de dire en 1871 que la société bourgeoise était réduite en poussière : cette année a pu marquer la fin de la question nationale en Europe, comme Lénine le note dans L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Mais elle continuait à se poser dans les colonies, alors que le capitalisme entrait dans la dernière phase de son expansion. Dans un sens plus profond, la dénonciation par Marx de l'imposture de la guerre nationale anticipait ce qui allait devenir une réalité générale une fois que le capitalisme serait entré dans sa phase de décadence : dorénavant, toutes les guerres seraient des guerres impérialistes, et, en ce qui concernait le prolétariat, il ne pourrait plus être question d'une quelconque défense nationale.
Les soulèvements de 1917-18 ont aussi confirmé ce qu'avait dit Marx de la capacité de la bourgeoisie à s'unifier contre la menace prolétarienne : face à la possibilité d'une révolution mondiale des ouvriers, les bourgeoisies d'Europe, qui s'étaient déchirées les unes les autres pendant quatre ans, découvrirent subitement qu'elles avaient toutes les raisons de faire la paix afin d'étouffer le défi prolétarien contre leur « ordre » dégoulinant de sang. Une fois de plus, les gouvernements du monde furent « un contre le prolétariat. »
Dans le prochain article, nous étudierons la lutte de Marx et de sa tendance contre les éléments du mouvement ouvrier qui n'ont pas compris, ou même ont cherché à minimiser, les leçons de la Commune, en particulier les sociaux-démocrates allemands et les anarchistes de Bakounine.
CDW.
[1] [260] Le nom Association Internationale des Travailleurs, en anglais en particulier, International Workingmen's Association, et non Workers, était évidemment le reflet de l'immaturité du mouvement de la classe, puisque le prolétariat n'a aucun intérêt à instituer dans ses propres rangs des divisions sexuelles. Comme dans les plus grands soulèvements sociaux, la Commune de Paris a vu une extraordinaire fermentation chez les femmes ouvrières qui non seulement ont bruyamment mis en question leur rôle « traditionnel », mais se sont souvent montrées les défenseuses les plus courageuses et les plus radicales de la Commune, dans les clubs révolutionnaires comme sur les barricades. Cette fermentation a aussi donné naissance à la formation de sections féminines de l'Internationale, ce qui, à l'époque, constituait une avancée, même si de telles formes n'ont plus de fonction dans le mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui.
2] [261] Quatrième Rapport annuel du Conseil Général de l'ATT, « Le Conseil Général de la Première Internationale », 1866-1868, Ed. de Moscou, p. 281.
[3] [262] Premières lignes des Statuts Provisoires de l'Association, « Le Conseil Général de la Première Internationale », 1864-1866, Ed. de Moscou, p. 243.
[4] [263] Discours au 7e anniversaire de l'Internationale à Londres, 1871.
[5] [264] Résolution de la Conférence de Londres de l'Internationale sur l'action politique de la classe ouvrière, septembre 1871, traduit de l'anglais par nous..
[6] [265] Le terme « constitution du prolétariat en parti » reflète certaines ambiguïtés sur le rôle du parti qui étaient aussi le produit des limites historiques de la période. L'Internationale contenait certaines caractéristiques d'une organisation unitaire, et pas seulement d'une organisation politique, de la classe. Durant tout le 19e siècle, la notion qu'un parti soit représentait la classe, soit était la classe sous sa forme organisée, était profondément enracinée dans le mouvement ouvrier. Ce n'est qu'au 20e siècle que de telles idées furent dépassées, et seulement après jde très douloureuses expériences que la nécessité de /(distinguer organisation unitaire et organisation ^politique devint claire. Néanmoins, il existait déjà une compréhension fondamentale du fait que le parti n'est pas l'organisation de l'ensemble de la classe, mais de ses éléments les plus avancés. Une telle définition est déjà mise en évidence dans Le Manifeste Communiste, et la Première Internationale se considérait elle-même également dans ces termes quand elle disait que le parti des ouvriers était (« la partie de la classe ouvrière qui est devenue consciente de son intérêt commun de classe ») (« La question militaire prussienne » et le Parti ouvrier allemand, écrit par Engels en 1865,).
[7] [266] « Le Conseil Général de la Première Internationale », 1864-66, Ed. de Moscou, p. 241.
[8] [267] Les Blanquistes partageaient avec les Bakouninistes le volontarisme et l'impatience, mais ils furent toujours clairs sur le fait que le prolétariat devait établir sa dictature afin de créer une société communiste. C'est pourquoi Marx, à certaines occasions importantes, a pu faire alliance avec les Blanquistes contre les Bakouninistes sur la question de l'action politique de la classe ouvrière.
[9] [268] Lettre de Marx à Bracke, 1875, traduit de l'anglais par nous.
[10] [269] Seconde Adresse du Conseil général de VAIT sur la guerre franco-allemande, Londres, 9 septembre 1870, Ed.sociales, p. 289.
[11] [270] Oeuvres choisies, Editions du Progrès, Moscou 1968, p. 324.
[12] [271] Marx, La guerre civile en France, Premier essai de rédaction, Ed. sociales, p. 212.
[13] [272] Critique de la doctrine de l'Etat de Hegel, 1843, traduit de l'anglais par nous.
[14] [273] Voir les Revue Internationale n° 72 et 73.
[15] [274] Ed.sociales, p. 301.
[16] [275] La guerre civile en France, Ed. sociales, p. 41.
[17] [276] Ibid ,p. 43.
[18] [277] Lettre à Bebel, 1875.
[19] [278] Oeuvres choisies, Tome 2, Editions du progrès, Moscou 1968, p. 338.
[20] [279] Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'Etat.
[21] [280] La guerre civile en France, Ed. sociales, p. 44.
[22] [281] Ibid, p. 46.
[23] [282] Ibid, p. 45.
[24] [283] Ibid, p. 46.
[25] [284] Ibid., p. 48.
[26] [285] La guerre civile en France, Premier essai de rédaction, Ed. sociales, p. 217.
[27] [286] Introduction à La guerre civile en France, Engels 1891, Ed. sociales, p. 301.
[28] [287] Manifeste « Aux travailleurs de tous les pays », Le Réveil, 12 juillet 1870, cité dans la Première Adresse du Conseil Général sur la guerre franco-allemande, 23 juillet 1870, Ed. sociales, p. 278.
[29] [288] Première Adresse du Conseil Général sur la guerre franco-allemande, Ed. sociales, p. 279.
[30] [289] Résolution adoptée à l'unanimité par un meeting de délégués, représentant 50 000 ouvriers saxons à Chemnitz, citée dans la Première Adresse..., ibid, p. 280.
[31] [290] La guerre civile en France. Ed. sociales, p.62.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [143]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 78 - 3e trimestre 1994
- 2777 lectures
Rwanda, Yémen, Bosnie, Corée : derrière les mensonges de « paix », la barbarie capitaliste
- 3013 lectures
Sous les auspices de « la paix », de « la civilisation » et de la « démocratie », les plus grandes puissances militaires du monde viennent de célébrer en grandes pompes l'anniversaire du débarquement Allié en Normandie. Les festivités organisées à cette occasion, le répugnant reality show mis en scène sur les lieux mêmes de la boucherie cinquantenaire, les phrases sonores à leur propre gloire que se sont échangés les chefs d'Etat les plus puissants de la planète, n'en finissant pas de se congratuler, ont donné lieu à un déballage médiatique phénoménal à l'échelle mondiale. Le message a été assené sur tous les tons : « Nous autres, grands Etats industrialisés et nos institutions démocratiques, sommes les héritiers des libérateurs qui chassèrent d'Europe l'incarnation du mal qu'était le régime nazi. Aujourd'hui comme hier, nous sommes les garants de la "civilisation", de la "paix" et de l'"humanitaire", contre l'oppression, la terreur, la barbarie et le chaos. »
Ces gens-là veulent nous faire croire, qu'aujourd'hui comme hier, la barbarie, c'est ... les autres. Le vieux mensonge selon lequel la boucherie de 1939-45, ses 50 millions de morts, son cortège d'atrocités et de souffrances, aurait eu pour seul responsable la folie barbare d'un Hitler et non le capitalisme comme un tout, et non les sordides intérêts impérialistes de tous les camps en présence. Cela fait un demi-siècle qu'on nous le rabâche, dans l'espoir qu'un mensonge mille fois répété devienne un vérité. Et s'ils nous le resservent aujourd'hui en mondovision, c'est encore pour disculper le capitalisme, et en particulier les grandes puissances « démocratiques », de la responsabilité des massacres, des guerres, des génocides et du chaos grandissant qui ravagent aujourd'hui la planète.
Un demi-million d'hommes impliqués dans l'opération, la plus gigantesque expédition militaire de tous les temps, une boucherie effroyable qui -en quelques heures - laissa sur le terrain des dizaines de milliers de cadavres. Voilà, ce que, « au nom de la paix », les têtes couronnées, galonnées, suffragées, de la « communauté internationale » célébraient en choeur le 6 juin 1994. En se recueillant hypocritement devant les champs de croix blanches à perte de vue où s'inscrivent l'âge de ces enfants qu'ils appellent des « héros » - 20 ans, 18 ans, 16 ans - la seule émotion vraie que ressentaient cette brochette de canailles, c'était bien le regret du « bon temps », celui d'il y a 50 ans, où la classe ouvrière était défaite et la chair à canon abondante et soumise. ([1] [291])
La « paix », tous, Clinton, Major, Mitterrand et les autres, n'ont eu que ce mot à la bouche. Ce même mot de "paix", dont ils se gargarisaient il y a 5 ans lors de la chute du mur de Berlin. Ce mot de "paix", au nom duquel cette même "communauté internationale" déchaîna, quelques mois plus tard, la "tempête du désert" en Irak avec ses centaines de milliers de victimes. De cette boucherie sans nom -ils nous l'avaient encore promis- un "nouvel ordre mondial" allait naître. Depuis lors, c'est encore en porte-parole de "la paix" et de la "civilisation" qu'ils se sont tous présentés, en Yougoslavie, en Afrique, dans les Etats de l'ex-URSS, au Moyen et en Extrême-Orient. Plus ces régions du monde étaient ravagées par la guerre, plus les grandes puissances s'y sont présentées en défenseurs de "la paix", et plus en réalité elles étaient présentes et actives sur tous les théâtres des conflits guerriers, pour y défendre la seule "juste cause" que connaissent tous les pays capitalistes : leurs intérêts impérialistes.
Il n'y a pas de paix possible dans le capitalisme. La fin de la seconde boucherie mondiale, si elle avait chassé la guerre d'Europe et des pays les plus développés, n'avait fait que la reporter vers la périphérie du capitalisme. Depuis 50 ans, les puissances impérialistes, grandes et petites, n'ont pas cessé de s'affronter militairement à travers les conflits locaux. Pendant des décennies, les guerres locales incessantes ont été autant de moments de l'affrontement entre les deux grands blocs impérialistes qui se disputaient le partage du monde. L'effondrement du bloc de l'Est et, par suite, l'éclatement de celui qui lui faisait face en Occident, loin de mettre fin à cette réalité guerrière et impérialiste du capitalisme a été le signal de son déchaînement tous azimuts et sans limites.
Dans un monde où le chacun pour soi règne désormais en maître, ce sont les anciens alliés d'hier qui se disputent aujourd'hui leurs zones d'influence impérialiste aux 4 coins de la planète. Les célébrations du « D day », où les plus puissants Etats se félicitaient mutuellement d'avoir ensemble chassé la guerre d'Europe il y a 50 ans, se sont déroulées alors même que la guerre est de retour sur ce continent et qu'elle y est activement nourrie, depuis trois ans en Yougoslavie, par les rivalités qui opposent ces mêmes Etats « civilisés ».
Non, le chaos guerrier qui ravage aujourd'hui la planète ne peut simplement s'expliquer par le soudain retour de "haines ancestrales" entre populations arriérées, comme le prétendent ceux qui veulent nous faire croire, encore une fois, que la barbarie, c'est les autres. Il est partout alimenté, attisé, entretenu, quand ce n'est pas carrément provoqué, par les rivalités et les ambitions impérialistes de ceux-là même qui nous abreuvent de discours sur leurs bonnes intentions "civilisatrices", "humanitaires", et "pacificatrices"
RWANDA : Les rivalités franco-américaines sont responsables de l'horreur
Un bain de sang effroyable. Des populations entières froidement assassinées, à coups de machettes et de gourdins à clous, les enfants égorgés dans leur berceaux, les familles pourchassées par des hordes de tueurs déchaînés jusque dans le moindre lieu où elles croient trouver refuge et mises à mort avec une sauvagerie inouïe. Le pays transformé en un immense charnier et dont l'effroyable évocation du lac Victoria charriant des milliers de cadavres putréfiés donne l'odieuse mesure. Le nombre des victimes ? Un demi-million au moins, sans doute plus encore. L'ampleur du génocide restera inconnu. Jamais dans l'histoire un tel exode de populations fuyant à l'aveugle les massacres ne s'était produit en si peu de temps.
L'évocation d'une telle horreur par les médias de la bourgeoisie « démocratique », qui se sont vautrées dans ces images d'holocauste, nous a renvoyé à l'envi le message : « regardez à quelles horreurs aboutissent les haines raciales ancestrales qui déchirent les populations arriérées de l'Afrique "sauvage" et face auxquelles les Etats civilisés sont impuissants. Et réjouissez vous de vivre dans nos contrées démocratiques à l'abri d'un tel chaos. Le quotidien de misère et de chômage que vous vivez ici est un paradis à côté des massacres que subissent ces populations. »
Le mensonge est cette fois d'autant plus énorme, que le prétendu conflit ethnique ancestral entre Hutus et Tutsis a été créé de toutes pièces par les puissances impérialistes à l'époque de la colonisation. Tutsis et Hutus correspondaient alors beaucoup moins à des critères « ethniques » qu'à des castes sociales. Les Tutsis désignaient la caste féodale au pouvoir sur laquelle se sont d'abord appuyées les puissances coloniales. Héritant de la colonie rwandaise lors du dépeçage de l'empire allemand entre les vainqueurs de la première guerre mondiale, c'est la Belgique qui introduit la mention ethnique sur la carte d'identité des Rwandais, attisant la haine entre les deux castes pour mieux s'appuyer sur la monarchie tutsi.
En 1959, changeant son fusil d'épaule, Bruxelles soutient la majorité hutu qui s'est emparée du pouvoir. La fameuse carte d'identité « ethnique » est maintenue et les discriminations entre tutsis et hutus dans les divers domaines de la vie sociale sont renforcées.
Plusieurs centaines de milliers de Tutsis fuient le pays pour s'installer au Burundi ou en Ouganda. Dans ce dernier pays, ils seront une base de recrutement pour la clique de l'actuel président ougandais Museveni qui prend le pouvoir avec leur soutien à Kampala en 1986. En retour, le nouveau régime ougandais favorise et arme la guérilla tutsie qui va se concrétiser par la création du Front patriotique rwandais (FPR) qui entre au Rwanda en octobre 1990.
Entre temps, le contrôle de l'impérialisme belge sur Kigali a laissé la place à la France qui apporte un soutien militaire et économique sans faille au régime hutu d'Habyarimana, lequel fait régner la terreur dans le pays en renforçant les ressentiments ethniques contre les Tutsis. C'est grâce au soutien de l'impérialisme français qui l'arme activement et qui envoie en renfort des militaires, que le régime repoussera l'avance du FPR, lequel est soutenu discrètement par les Etats-Unis, à travers l'Ouganda qui l'arme et l'entraîne.
A partir de là, la guerre civile s'emballe, les pogroms anti-Tutsis se multiplient en même temps que ceux menés par le FPR contre tous ceux qu'il soupçonne de « collaborer » avec le régime. Au nom de « protéger ses ressortissants », Paris renforce encore son corps expéditionnaire. En réalité l'État français ne fait que défendre sa chasse gardée face à l'offensive des Etats-Unis qui n'a de cesse, depuis l'effondrement du bloc de l'Est, de disputer à Paris ses zones d'influence en Afrique. La guérilla du FPR prend la forme d'une véritable offensive américaine visant à faire tomber le régime pro-français de Kigali.
Pour tenter de sauver le régime, la France finit par mettre sur pied en août 1993 un accord de «paix » qui prévoit une nouvelle constitution plus "démocratique", octroyant une partie du pouvoir à la minorité tutsi ainsi qu'aux diverses cliques d'opposition.
Cet accord va s'avérer irréalisable. Non pas parce que les "haines ancestrales" sont trop fortes, mais tout simplement parce que l'enjeu impérialiste et les calculs stratégiques des grandes puissances ne pouvaient pas s'en accommoder. L'assassinat le 6 avril 94, à la veille de la mise en place de la nouvelle constitution, des présidents rwandais et burundais fait capoter l'accord et met le feu au poudres, déclenchant le bain de sang que l'on sait. Les dernières révélations publiées par la presse belge (qui a des raisons d'en vouloir à son rival français en Afrique) mettant directement en cause des militaires français dans l'attentat du 6 avril suggèrent que Paris a très bien pu commanditer l'attentat dans l'espoir qu'en en faisant porter le chapeau aux rebelles du FPR, il obtiendrait toutes les justifications et la mobilisation nécessaires de la part de l'armée gouvernementale pour en finir avec la rébellion tutsi. Si tel est le cas la réalité a dépassé toutes ses espérances. Mais peu importe laquelle des deux cliques, gouvernementale ou FPR, et derrière elles qui, de la France ou des Etats-Unis, avait le plus intérêt à faire ainsi passer le conflit rwandais de la guérilla larvée à la guerre totale. La logique même du capitalisme le veut ainsi : la "paix" n'est qu'un mythe dans le capitalisme, au mieux une pause préparant les prochains affrontements, et en dernière instance la guerre reste son seul mode de vie, la seule manière de régler ses contradictions.
Aujourd'hui les apprentis sorciers font semblant de s'émouvoir devant l'ampleur prise par le brasier qu'ils ont eux-mêmes attisé. Pourtant, pendant des mois, tout ce beau monde à laissé faire le massacre se contentant de déplorer l'"impuissance de l'ONU". Le principe adopté à la mi-mai par le conseil de sécurité de l'ONU -plus d'un mois après le début de la guerre alors qu'on décomptait déjà 500 000 morts !- d'expédier 5 000 hommes dans le cadre de la MINUAR ne devrait pas voir un début de mise en oeuvre avant le mois de juillet ! Même si certains Etats africains de la région se sont dits prêts à fournir les troupes, du côté des grandes puissances, chargées d'assurer l'équipement et les moyens financiers, c'est la lenteur et l'apathie qui ont présidé, faisant s'indigner le responsable de la MINUAR : "c'est comme si nous étions devenus totalement insensibles, comme si cela nous était devenu indifférent." Ce à quoi rétorquaient les diplomates du conseil de sécurité : "de toutes façons le gros des massacres est passé, il faut attendre la suite." Les autres résolutions de l'ONU, censées mettre fin à l'alimentation de la guerre et aux livraisons d'armes à partir de l'Ouganda et du Zaïre, n'ont eu pas plus d'effet. Et pour cause, cette " impuissance", c'est la même qui règne dans la guerre en Bosnie. Elle ne fait que refléter les divergences d'intérêts impérialistes qui divisent ceux qui se font passer pour des forces de "maintien de la paix".
C'est de la bouche du gouvernement français que le sursaut militaro-humanitaire a refait surface en juin, après l'adoption d'un cessez-le-feu immédiatement violé. "On ne peut plus supporter ça" a clamé le ministre français des Affaires étrangères, et de proposer une intervention, "dans le cadre de l'ONU", mais à condition que l'opération soit menée sous le commandement direct de l'État français. L'initiative a évidemment provoqué une réaction immédiate des représentants du FPR s'indignant que « la France ne peut arrêter le génocide qu'elle a aidé à mettre en action. » Quant aux autres "grands" ils freinent des quatre fers, Etats-Unis en tête. D'une part parce qu'il ne fait pas de doute que si la France veut prendre la direction des opérations, c'est bien pour s'assurer la conservation de son rôle de puissance dominante dans le pays et dans le but de peser de tout son poids pour arrêter la progression du FPR. D'autre part, parce que les USA, de leur côté, non seulement s'appuient justement sur le dit FPR sur le terrain, mais tiennent plus généralement à faire entendre qu'il n'est pas question qu'une autre puissance qu'eux-mêmes prétende s'arroger le rôle du gendarme. Voilà les véritables ressorts de cette nouvelle vague de gesticulations " humanitaires", le sort des populations massacrées n'a rien à y voir.
YEMEN : Les calculs stratégiques des grandes puissances
Née de la réunification des deux Yémen il y a 4 ans - dans l'euphorie de l'effondrement du bloc de l'Est, qui laissa brutalement Aden et son parti unique dirigeant le PSY sans parrain - la toute nouvelle République yéménite unifiée n'aura pas fait long feu. La sécession du Sud et le conflit militaire qui opposent à nouveau les deux parties du pays n'est qu'un révélateur de plus de ce que vaut le « nouvel ordre mondial » promis : un monde d'instabilité et de chaos, des Etats qui se déchirent et éclatent sous la pression de la décomposition sociale. Mais comme au Rwanda, comme en Yougoslavie, ce chaos est nourri, alimenté par les puissances impérialistes de la région et au-delà, qui là encore sont bel et bien derrière dans le but d'essayer de tirer les marrons du feu pour leur propre compte.
Régionalement le conflit yéménite est ainsi nourri d'un côté par l'Arabie Saoudite qui reproche les trop grandes sympathies des factions islamistes du Nord avec son menaçant voisin l'Irak et avec le régime soudanais. C'est elle -et derrière elle son puissant allié américain- qui a ainsi attisé et soutenu la clique sécessionniste d'Aden dans le but d'affaiblir les factions yéménites pro irakiennes De l'autre, c'est aussi sa zone d'influence impérialiste régionale que défend Khartoum, en particulier contre son rival local l'Egypte, autre place-forte américaine, en appuyant l'offensive nordiste. Offensive dont l'enjeu n'est autre que le contrôle de la position éminemment stratégique que constitue le port d'Aden, en face de la place-forte française de Djibouti. Et que trouve-t-on derrière le régime militaro islamiste soudanais ? Comme par hasard l'appui discret de la France qui ne fait là qu'apporter la réponse du berger à la bergère, après que l'offensive des Etats-Unis en Somalie est venue menacer sa chasse gardée de Djibouti.
Le bras de fer qui se joue sur le continent africain et au Moyen-Orient entre les grandes puissances, en particulier entre les Etats-Unis et la France, aboutit à cette sordide réalité qui voit d'un côté l'Etat français dénoncer à cor et à cri l'obscurantisme islamiste, quand il sévit en Algérie et déstabilise ses propres zones d'influence avec la bénédiction des Etats-Unis qui soutiennent désormais sans se cacher le FIS. De l'autre côté, c'est Washington qui s'en va dénoncer ce même islamisme quand il contrarie ses prérogatives dans la péninsule arabique, tandis que la France, oubliant ses laïcs états d'âmes, le trouve plutôt à son goût quand il s'agit de défendre ses intérêts impérialistes à l'entrée de la Mer Rouge. Voilà encore une justification idéologique qui s'effondre devant la sordide réalité de l'impérialisme.
BOSNIE : Les missions « pacificatrices » attisent la guerre
C'est le même cynisme, la même duplicité des grandes puissances « civilisatrices » qui se révèlent dans l'enlisement de la guerre en Bosnie ([2] [292]). Les dernières évolutions de l'imbroglio diplomatico-militaire des principales puissances, tandis que les massacres continuent de plus belle, n'ont fait que confirmer le mensonge du caractère prétendument « humanitaire » de leurs prétentions et le sourd affrontement entre les « grands » qui se joue par populations serbes, croates et musulmanes interposées.
Le théâtre du conflit bosniaque, longtemps terrain privilégié de l'affirmation impérialiste des diverses puissances européennes est aujourd'hui devenue une des pierres angulaire de la contre-offensive américaine. Avec l'ultimatum de l'OTAN et la menace de frappes aériennes sur les forces serbes, Washington est parvenu à reprendre complètement l'initiative, à rabattre les nouvelles prétentions de la Russie à s'engouffrer dans le conflit et à sanctionner l'impuissance totale de la Grande-Bretagne et de la France, qui durent accepter une ingérence américaine qu'elles avaient jusque là refusée et sabotée par tous les moyens. Et ce sont encore les Etats-Unis qui ont marqué des points en parrainant la création d'une fédération croato-musulmane. Du coup les prétentions de l'Allemagne à s'appuyer sur la Croatie pour prendre pied sur les bords de la Méditerranée sont complètement mises sur la touche. Là encore, toutes ces grandes manoeuvres militaro-diplomatiques n'ont pas grand chose à voir avec le "retour de la paix".
Comme nous le disions dans notre précédent numéro : « l'alliance croato-musulmane qu'ils (les Etats-Unis) patronnent - si elle va jusqu'à son terme -va porter l'affrontement avec la Serbie à un niveau supérieur. Les puissances européennes qui viennent de prendre une gifle ne vont pas manquer de jeter de l'huile sur le feu. » Le vote par le Sénat américain, qui s'est prononcé pour la levée de l'embargo sur les armes en Bosnie - et qui a trouvé un appui inattendu de la part d'une poignée d'intellectuels français va-t-en-guerre de salon-, ne peut qu'encourager l'armée bosniaque, déjà réarmée par les bourgeoisie américaine à reprendre l'offensive militaire. Et ce n'est pas le plan européen de partition de la Bosnie, totalement inacceptable par les Musulmans et auquel la Maison blanche - en apparent désaccord avec son Congrès -fait semblant de se rallier qui risque de permettre l'arrêt des massacres. Son prévisible échec, tandis que l'appui de Washington au nouveau front anti-serbe croato-musulman rend inévitable un élargissement de la guerre, ne fait qu'annoncer de nouvelles tueries.
La boucherie qui ensanglante l'ex-Yougoslavie, depuis maintenant trois ans, n'est pas près de se terminer. Elle n'a fait que démontrer à quel point les conflits guerriers et le chaos nés de la décomposition du capitalisme se trouvent attisés par les menées des grands impérialismes. Et aussi, qu'au bout du compte, au nom du « devoir d'ingérence humanitaire », la seule alternative qu'ils aient, les uns et les autres, à proposer, c'est la suivante : soit bombarder les forces serbes, soit envoyer plus d'armes aux bosniaques. En d'autres termes, face au chaos guerrier que provoque la décomposition du système capitaliste, la seule réponse que celui-ci ait à donner, de la part des pays les plus puissants et les plus industrialisés, c'est d'y ajouter encore plus de guerre.
COREE : Vers de nouveaux déchaînements militaires
Tandis que les foyers de conflits se multiplient, un autre brasier couve avec la Corée du Nord, qui prétend se doter d'un embryon d'arsenal nucléaire. La réaction des Etats-Unis qui ont engagé le bras de fer avec Pyongyang menaçant celle-ci d'une escalade de sanctions, nous est encore une fois présentée comme l'attitude responsable de puissances « civilisées » soucieuses de combattre la course aux armements et de défendre la paix. En fait, cette « crise majeure », n'est pas sans rappeler le bras de fer engagé par ces mêmes Etats-Unis il y a quatre ans face à l'Irak et qui déboucha sur la boucherie de la guerre du Golfe. Et, comme à l'époque, les prétentions d'une Corée du Nord -qui est déjà un des pays les plus militarisés du monde, fort d'une armée d'un million d'hommes - à enrichir son énorme arsenal d'un « plus » nucléaire, ne sont fondamentalement qu'un prétexte.
Derrière la « crise coréenne » et l'intox médiatique sur les risques d'agression de Pyongyang sur son voisin du Sud, il y a fondamentalement la réaction américaine à la menace sur son hégémonie et son statut de gendarme du monde que fait peser l'alliance qui se noue entre les deux géants de la région : la Chine et le Japon. Les premiers visés dans cette affaire, à travers la détermination affichée par Washington à « aller jusqu'au bout s'il le faut », sont bien moins le régime de Pyongyang que ces deux derniers pays. Elle fait partie de la pression appuyée de la Maison blanche sur la Chine qui, tendant d'une main la carotte, avec le maintien de la « clause de la nation la plus favorisée » accordée à Pékin, brandit de l'autre le bâton, en s'attaquant à son petit protégé nord coréen.
L'objectif, en faisant volontairement monter la tension avec la Corée, est de contraindre la Chine et le Japon à se ranger derrière eux, d'obliger Pékin à se désolidariser de Pyongyang, et mettre à mal l'axe sino-japonais et toute velléité de politique indépendante de la part de ces deux pays. Exactement comme lors de la crise du Golfe, où les Etats-Unis avaient eux même provoqué la crise en encourageant les visées de Saddam Hussein sur le Koweït, dans le seul but de contraindre les puissances européennes à se ranger derrière eux et, contre leurs propres intérêts au Moyen Orient, à faire acte d'allégeance devant la toute puissance militaire américaine. L'opération avait parfaitement réussi alors. Les velléités d'affirmations impérialistes de ses rivaux européens avaient été un temps étouffées au prix d'une ignoble boucherie.
Que les Etats-Unis aillent jusqu'au bout cette fois-ci, que, rééditant leur « exploit » sanglant, ils mettent une fois de plus en branle leur énorme machinerie guerrière, dans le seul but de faire plier les puissances d'Asie à leurs diktats, n'est pas encore dit. En tout cas cette nouvelle crise montre l'avenir que prépare le capitalisme.
LE CAPITALISME C'EST LA GUERRE
Les cérémonies commémorant le « D day » avaient elles aussi pour but de rappeler à tous ceux qui seraient tentés de passer outre, que ce sont les Etats-Unis qui entendent faire la loi dans le monde en 1994, comme en 1944. Ainsi la gifle adressée à l'Allemagne, ostensiblement exclue des festivités, est venue sèchement lui rappeler sa position de vaincue de la seconde guerre mondiale et lui faire entendre qu'il serait mal venu de sa part de prétendre obtenir un autre statut dans le rapport de forces impérialiste actuel. L'absence encore plus remarquée de la Russie -qui n'a pas manqué de protester contre un tel oubli de sa participation à la victoire de 1945 et aux millions de prolétaires qu'elle avait sacrifiés sur l'autel de la boucherie mondiale- entendait bien aussi rabattre le caquet aux prétentions de Moscou à retrouver place au premier rang des puissances mondiales. Quant aux risettes hypocrites que se sont mutuellement adressés les invités de la fête, clamant leur volonté commune d'agir « pour la paix » elles cachaient décidément mal la sordide réalité des conflits qui les opposent aux quatre coins de la planète.
Il n'y aura pas de pause dans le rythme des foyers guerriers de par le monde. La guerre est inscrite depuis sa naissance dans l'histoire du capitalisme. Elle devient le mode de vie permanent de ce système à l'heure de sa décomposition. On veut nous faire croire qu'il s'agit d'une fatalité, qu'on est impuissant et que le mieux à faire encore est de s'en remettre à la bonne volonté des grandes puissances et de leurs efforts pour en limiter les effets les plus dévastateurs. Rien n'est plus faux. Comme on vient de le voir, ce sont elles les premiers fauteurs de guerre de part le monde. Et pour une raison bien simple : ce chaos guerrier et ce déchaînement du militarisme trouvent leurs fondements dans la faillite même de l'économie capitaliste.
LA REPONSE EST ENTRE LES MAINS DU PROLETARIAT
La barbarie guerrière, qui se répand dans les zones les plus sous-développées de la planète, a pour pendant la misère et le chômage massif, qui s'étendent désormais à l'autre pôle de la planète, dans les grands pays industrialisées. Guerre permanente et plongée catastrophique dans la crise économique sont, l'une et l'autre, des manifestations de la même faillite totale du système capitaliste. Oui, il est impuissant à résoudre ces fléaux. Tout au contraire, en continuant à pourrir sur pied, le capitalisme n'a d'autre chose à offrir que toujours plus de misère, de chômage et de guerres.
La réponse à l'avenir effroyable que nous promet le capitalisme existe. Elle est entre les mains de la classe ouvrière internationale et d'elle seule. Il appartient en particulier aux prolétaires des pays les plus industrialisés, qui subissent de plein fouet les conséquences dramatiques de la crise de ce système, d'y répondre par la lutte sur leur terrain de classe, de la manière la plus déterminée, la plus unie, la plus consciente.
Au sentiment d'impuissance face à la barbarie que veut lui inoculer la classe dominante, à ses tentatives de l'entraîner derrière elle dans ses aventures guerrières, la classe ouvrière doit répondre par le développement de sa riposte de classe aux attaques capitalistes. Cette riposte, et elle seule, est une réponse à la barbarie de ce système. Parce qu'elle seule porte en elle la possibilité de détruire le capitalisme avant que sa logique meurtrière n'aboutisse à la destruction de l'humanité. L'avenir de l'espèce humaine est entre les mains du prolétariat.
PE, 19/6/1994.
Questions théoriques:
- Décomposition [43]
- Guerre [177]
Crise économique mondiale : L'étude de l'OCDE sur l'emploi
- 3873 lectures
LE CYNISME DE LA BOURGEOISIE DECADENTE
La bourgeoisie a conscience qu'elle s'installe dans la crise. La faiblesse momentanée de la classe ouvrière internationale lui permet de tenir le langage cynique d'une classe historiquement moribonde qui sait qu'elle ne peut survivre qu'en intensifiant l'oppression et l'exploitation.
Les médecins ont parlé. Les économistes « experts » du Secrétariat de l'OCDE ([1] [295]), après deux ans de réflexion intense, déclarent avoir rempli « le mandat que leur ont confié les Ministres en mai 1992. » L'objet de l'examen : le chômage, hypocritement appelé « le problème de l'emploi ». Mais, quel est le diagnostic? Quels sont les remèdes proposés ?
L’Etude commence par tenter de mesurer les symptômes. « Il y a 35 millions des personnes au chômage dans les pays de l'OCDE. Quinze millions d'autres, peut-être, ont soit renoncé à chercher du travail, soit accepté faute de mieux un emploi à temps partiel. » La mesure de la maladie est déjà elle-même problématique : la définition du chômage est souvent différente suivant les pays et, dans tous les cas, elle sous-estime la réalité pour des raisons politiques évidentes. Mais, même avec ces déformations les chiffres sont sans précédent : 50 millions de personnes touchées directement par le problème du chômage, cela équivaut presque à la totalité de la population active de l'Allemagne et de la France ensemble !
Comment expliquent les médecins « experts » qu'on en soit arrivés là, eux pour qui le système capitaliste est éternel et est supposé connaître une nouvelle jeunesse depuis l'effondrement du stalinisme ?
« L'émergence d'un chômage à grande échelle en Europe, au Canada et en Australie et la prolifération d'emplois médiocres alliée à l'apparition du chômage aux Etats-Unis ont donc une seule et même cause profonde : l'incapacité de s'adapter de manière satisfaisante au changement. »
Quel changement ? « (...) Les technologies nouvelles, la globalisation et la concurrence intense qui s'exerce au niveau national et international. Les politiques et les systèmes en place ont rendu les économies rigides et paralysé la capacité, voire la volonté d'adaptation. »
En quoi consiste cette « inadaptation », cette « rigidité » ? Les naïfs qui croient encore que les économistes sont autre chose que des charlatans de mauvaise foi chargés de «justifier» le capitalisme, auraient pu s'attendre à ce qu'on parle de la rigidité de lois qui, par exemple, contraignent à payer les agriculteurs pour qu'ils ne cultivent pas la terre, ou à fermer des milliers d'usines en parfait état de marche alors que la misère ne cesse d'étendre sur la planète. Mais, pas du tout. Les rigidités dont parlent nos médecins sont au contraire celles qui peuvent gêner le libre et impitoyable jeu des lois capitalistes, ces lois qui plongent l'humanité dans un chaos croissant.
L’Etude illustre cyniquement ce point de vue par les remèdes, les « recommandations » qu'elle formule :
« ... Supprimer toute connotation négative, dans l'opinion publique, à l'égard des défaillances d'entreprises... Accroître la flexibilité du temps de travail...
Accroître la flexibilité des salaires, réduire les coûts de main-d'oeuvre non salariaux...
Réévaluer le rôle des salaires minimums légaux... en modulant suffisamment les taux de salaire en fonction de l'âge et des régions... Introduire des "clauses de renégociation " qui permettent de renégocier à un niveau inférieur des conventions collectives conclues à un niveau supérieur... Réduire les coûts de main d'oeuvre non-salariaux... en allégeant les prélèvements au titre du facteur travail (impôts payés par les patrons, NDLR) remplaçant ce type de prélèvements par d'autres impôts, notamment sur la consommation ou le revenu (impôts payés principalement par les travailleurs). Fixer les rémunérations offertes dans le cadre des programmes de création d'emplois à un niveau inférieur à celles que le participant pourrait obtenir sur le marché du travail afin de l'inciter à continuer de chercher un emploi régulier...
Les systèmes (d'assurance chômage) ont fini par constituer une garantie de revenu quasi permanente dans beaucoup de pays, ce qui n'incite pas à travailler...
Limiter la durée de versement des prestations de chômage dans les pays où elle est particulièrement longue... »
Rarement la bourgeoisie s'était permis de tenir un langage aussi brutal à une échelle aussi importante. Les conclusions de l'OCDE ne diffèrent pas sur le fond de celles formulées par les « experts » de l'Union européenne ou par le président américain lors du dernier G7 ([2] [296]). L’Etude devra servir de base aux travaux de la prochaine réunion du G7, consacrée une fois encore au problème du chômage.
La classe dominante connaît la puissance que lui donne le chantage au chômage sur la classe exploitée, elle connaît la difficulté à laquelle se heurte la classe ouvrière dans tous les pays pour retrouver le chemin de la lutte. Et cela lui permet d'élever le ton. De parler un langage sans fioritures.
En réalité, dans la pratique tous les gouvernements du monde, à des degrés divers, appliquent déjà de telles politiques. Ce qu'annonce ce document c'est simplement une aggravation de cette orientation.
Quelle efficacité peuvent avoir les « remèdes » proposés ?
Il n'y a pas d'adaptation saine du capitalisme aux changements que lui même provoque au niveau de la productivité technique du travail et de l'interdépendance de l'économie mondiale.
L'intensification de la concurrence entre capitalistes, exacerbée par la crise de surproduction et la rareté de marchés solvables, pousse ceux-ci à une modernisation à outrance des processus de production, remplaçant des hommes par des machines, dans une course effrénée à la «baisse des coûts». Cette même course les conduit à déplacer une partie de la production vers des pays où la main d'oeuvre est meilleur marché (Chine et Sud Est asiatique actuellement, par exemple).
Mais, ce faisant, les capitalistes ne résolvent pas le problème chronique du manque de débouchés qui frappe l'ensemble de l'économie mondiale. Tout au plus permet-il à certains de survivre aux dépens des autres, mais du point de vue global le problème ne s'en trouve qu'aggravé.
Là où il y a inadaptation ce n'est pas entre le capitalisme et la politique des gouvernements, qui ont tous depuis ^longtemps entrepris de s'attaquer progressivement au niveau de vie des exploités des pays les plus industrialisés. "L'inadaptation est entre la réalité des capacités techniques de la société : productivité du travail, explosion des communications, internationalisation de la vie économique, d'une part, et la subsistances des lois capitalistes, les lois de l'échange, du salariat, de la propriété privée individuelle ou étatique, d'autre part. C'est le capitalisme lui-même qui est devenu inadapté aux capacités et nécessités de l'humanité.
Comme le disait le Manifeste communiste : « Les institutions bourgeoises sont devenues trop étroites pour contenir la richesse qu'elles ont créée. »
Le seul intérêt du « nouveau » discours de la classe dominante c'est qu'il reconnaît que celle-ci est confrontée à une crise économique destinée à durer. Même si les bourgeois pensent toujours que leur système est éternel, même s'ils reparlent de nouvelle reprise de l'économie mondiale, ils admettent aujourd'hui que celui-ci est condamné, du
moins pour les prochaines années à vivre dans une situation où le chômage massif continuera d'être une constante, que le processus qui a vu le nombre de chômeurs sur la planète augmenter de façon continue depuis un quart de siècle est loin de pouvoir être arrêté.
L'Etude fait encore preuve d'une certaine lucidité lorsqu'elle envisage l'avenir social : « Certaines personnes ne seront pas capables de s'adapter aux impératifs d'une économie qui progresse... (Ils auraient du écrire : d'une économie dont la maladie mortelle progresse). Leur exclusion du grand courant des activités économiques risque de provoquer des tensions sociales qui pourraient être lourdes de conséquences sur les plans humain et économique ».
Ce que ne voient pas et ne peuvent voir ce « experts » c'est que ces « tensions sociales » sont porteuses de la seule issue pour l'humanité et que les « conséquences sur les plans humain et économique » peuvent être la révolution communiste mondiale.
18 juin 1994, RV
VERS UNE NOUVELLE TOURMENTE FINANCIERE
L'énorme effort d'endettement consenti par les Etats des principales puissances pour lutter contre la récession est en train d'ébranler le monstrueux et instable système financier international. L'anémique « reprise » annoncée, qui devait venir soulager l'aggravation des conditions d'existence des prolétaires s'en trouve, une fois encore, compromise.
La récession où s'enfonce le capitalisme mondial depuis le début des années 1990 fait connaître à la classe ouvrière la pire dégradation de ses conditions d'existence depuis la deuxième guerre mondiale. Les gouvernements annoncent cependant « la fin de la récession ». Ils prédisent des sacrifices supplémentaires pour les exploités, comme toujours, mais aussi, un renversement de la tendance dans le bon sens: le retour de la croissance, des emplois, la prospérité.
Est-ce vrai?
Il est vrai que les gouvernements ont fait des efforts pour limiter le désastre, freiner l'hémorragie d'emplois, faire reamarrer certains secteurs. Les résultats nt anémiques, là où ils ont eu le plus efficacité (Etats Unis, Canada, Grande
Bretagne) et à peine perceptibles en Europe ou au Japon.
Mais les remèdes employés par les gouvernements pour redonner un peu de tonus au corps défaillant de leur économie, en particulier l'accroissement de l'endettement public, sont en train de se transformer en un dangereux poison pour le système financier.
Depuis quatre ans, pour financer la lutte contre la récession, pour pallier au manque de débouchés solvables qui paralyse la croissance, les gouvernements des principales puissances ont eu recours à des augmentations massives de la dette publique. (Voir graphiques)
Le phénomène a pris une telle ampleur qu'il est devenu un des principaux facteurs de déstabilisation de l'appareil financier.
Les autorités monétaires ne cessent d'adresser des mises en garde aux Etats et aux organisations gouvernementales... « qui lèvent des fonds en nombre croissant et pour des montants toujours plus élevés. Le risque est grand que les autres candidats à l'emprunt soient évincés. Les gouvernements pourraient bien finir par occuper presque tout le terrain et donc pratiquement interdire l'accès du marché international à la plupart des entreprises industrielles et commerciales. » ([3] [297])
La demande de crédits à long terme se trouve ainsi violemment augmentée entraînant une hausse du coût de ces crédits, c'est-à-dire des taux d'intérêt à long terme.
Dette publique brute
(pourcentage du PIB)
Au début juin 1994 le journal Le monde pouvait constater: « Depuis la fin 1993 les taux d'intérêt à long terme allemands ont fortement progressé (de 5,54 à près de 7 %).La hausse a encore été plus forte en France (de 5,63 à 7,30 %) ou, pis encore au Royaume-Uni (de 6,18 à 8,30 %) » ([4] [298]) Aux Etats-Unis le rendement des bons du Trésor sur 30 ans, est passé de 6,4 au début de l'année à 7,3 % mi-juin.
Du coup on commence à parler de début de panique financière. Pourquoi ? A un premier niveau, celui de la spéculation boursière, parce que cela se traduit mécaniquement par une dévaluation correspondante d'une part énorme des placements financiers : les obligations. Cette dévaluation se répercute inévitablement tôt ou tard sur la valeur des actions elles-mêmes, ne fut-ce que parce de nombreux possesseurs d'obligations sont obligés de vendre des actions afin de couvrir leurs pertes. ([5] [299]) De façon générale, la spéculation se fait à crédit, et M toute hausse des taux d'intérêt, du coût || de l'argent pour spéculer, provoque des //secousses boursières.
Mais c'est au niveau de l'économie réelle que les conséquences de la hausse des taux d'intérêt à long terme sont les plus destructrices. Ces taux commandent aux investissements à long terme, c'est-à-dire aux investissements sur lesquels doit reposer une reprise économique : investissement d'équipement industriel, logements. Alors que les gouvernements s'efforcent d'encourager ce type d'investissements pour assurer la /relance de l'économie, la hausse des taux d'intérêt contrecarre frontalement [cette possibilité. Cet effet de frein est d'autant plus puissant que l'inflation étant généralement faible, les hausses des taux d'intérêt en termes réels sont d'autant plus lourdes.
L'inquiétude croissante des milieux financiers et gouvernementaux n'est pas feinte. La proposition formulée par Jacques Delors de constituer au niveau mondial une sorte de Conseil de sécurité économique, pour faire face à d'éventuelles crises financières mondiales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU fait face aux crises militaires internationales, en dit long sur le sujet.
Le monde financier n'est que la surface de la réalité économique. Mais c'est dans cette surface que se manifeste le capital sous sa forme la plus abstraite. C'est là qu'il trouve toute sa spécificité historique. C'est là que le capital s'oriente, s'investit et se ruine.
Les difficultés financières du capitalisme mondial ne sont que la manifestation des contradictions profondes qui déchirent le capitalisme lui-même. C'est ien trichant avec ses propres lois, en (particulier au niveau financier, que le (capitalisme est parvenu à survivre depuis un quart de siècle. Depuis l'effondrement du bloc de l'Est, cette tendance n'a fait que se développer. ([6] [300]) La spéculation a pris une ampleur sans précédent historique transformant une partie de la machine financière en un inextricable casino électronique que plus personne ne peut contrôler véritablement. La dette des Etats, la dette des agents supposés maintenir « l'ordre » est devenue le principal facteur de désordre.
Non. Le « retournement de tendance » que promettent les gouvernements aux exploités pour justifier les sacrifices imposés, est condamné à faire long feu. La tendance de fond de l'économie capitaliste mondiale vers le marasme et la misère ne fait que se confirmer annonçant de nouvelles convulsions à tous les niveaux.
RV.
[1] [301] Organisation de coopération et de développement économique. Elle regroupe les 24 pays les plus industrialisés de l'ex-bloc américain (tous les pays d'Europe occidentale, les Etats-Unis et le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Mexique est en cour d'intégration
[2] [302] Voir l'article «r L'explosion du chômage » dans le numéro précédent de cette revue.
[3] [303] Le monde, 29 mai 94.
[4] [304] Le monde, 12 juin 94.
[5] [305] La bourse de Paris, qui connaît une sorte de krach étalé dans le temps depuis quelques mois, a été particulièrement victime de ce mécanisme.
[6] [306] Même si c'est dans les grandes puissances occidentales que se concentre le jeu financier mondial, la situation financière n'est pas pour autant plus saine dans le reste du monde. L'évolution de la situation en Russie est à elle seule une bombe à retardement : « (...) sur l'ensemble de la Russie, les prêts à moins de trois mois représentent 96 % du total des crédits accordés. Les taux d'intérêt sont faramineux : 25 % par mois au minimum. Et les ratios de bilan deviennent fous : 513 milliards de roubles de capitaux propres, pour l'ensemble des banques commerciales... contre 16 000 milliards de crédits distribués. Soit une rapport de 1 à 31. Sur l'ensemble de la Russie les impayés se sont accrus de 559 % de janvier à septembre ; ils représentent aujourd'hui 21 % de l'encours de crédit distribué.
C'est ainsi, bien sûr, que s'annoncent les catastrophes financières. » Libération, 9 décembre 93.
Récent et en cours:
- Crise économique [191]
Questions théoriques:
- Décadence [192]
Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes (1e partie)
- 3574 lectures
Jamais la commémoration du débarquement du 6 juin 1944 n'aura connu une telle intensité. Jamais la victoire des impérialistes « Alliés » en Europe n'aura donné lieu à tant de bourrage de crâne médiatique. Un tel battage vise une nouvelle fois à masquer le caractère impérialiste du second holocauste mondial, tout comme le premier. Non contente d'agiter à nouveau l'épouvantail fasciste, la bourgeoisie se sert des miasmes de sa société en décomposition. A commencer par l'Allemagne, peu après l'effondrement du mur de Berlin, une publicité croissante allait mettre en vedette les partisans du retour de la « germanité » derrière les exactions de bandes de voyous au crâne rasé. Le meurtre et les incendies de foyers de la communauté turque ont servi de toile de fond pour diaboliser ces ennemis de la « démocratie » héritiers de la « peste brune », grossissant jusqu'à aujourd'hui ces bagarres de rues de voyous néonazis contre des prolétaires immigrés. Grossi à la loupe des médias cela devient de nouvelles « scènes de chasse aux étrangers » à Magdebourg..., sous-entendu comme les ennemis hitlériens de la démocratie dans les années 1930. Quand, en Italie, le démagogue Berlusconi associe cinq ministres d'extrême-droite et que peu après la municipalité de Vicence autorise un défilé d'une centaine de « néonazis » avec croix gammées, la classe politique bourgeoise crie son émotion devant cette nouvelle « marche sur Rome ». En fait de « marche sur Rome », la gauche de la bourgeoisie a réussi à entraîner, malgré la pluie, 300 000 personnes le 25 avril 1994 derrière le drapeau de l'anti-fascisme ! Les simplismes habituels de l'ordre dominant depuis 1945 se donnent libre cours.
En France les chefs des PS et PC brandissent la menace fasciste après de longues années où la gauche au pouvoir a agité l'épouvantail du politicien d'extrême-droite Le Pen. Pour parfaire le tableau de la menace du resurgissement de la « bête immonde », une visite souvenir d'une dizaine de vétérans de la Waffen SS sur les plages de Normandie vient figurer la montée en puissance des ennemis de la démocratie.
Près de 50 millions de morts tous pays confondus sont invoqués comme victimes exclusives de la « barbarie nazie ». De CNN au moindre journal régional, plus c'est gros mieux çà passe ! Dans la plupart des pays d'Europe, les moindres faits et gestes de ces groupuscules de voyous sont montés en mayonnaise. Hollywood fournit à point nommé un film qui s'appesantit sur le seul massacre des Juifs d'Europe et exalte le dévouement des braves GI's tombés par milliers sur les plages de Normandie au nom de la « liberté ».
Ces festivités militaristes esquivent soigneusement les crimes des grandes « démocraties victorieuses » qui, lorsqu'on les connaît ([1] [307]), placent incontestablement les chefs démocratiques sur la même stèle de barbarie que Hitler, Mussolini et Hirohito. Mais déjà dire cela est faire une concession au mensonge dominant sur la personnification des « crimes de guerre ». C'est une classe sociale, la bourgeoisie, qui est la principale criminelle de guerre. Les dictateurs ne sont que ses sous-fifres. Quand le sinistre Goebbels assurait qu'un mensonge répété à outrance finit par devenir une vérité, son vis-à-vis le cynique Churchill renchérissait : « En temps de guerre la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être préservée par un rempart de mensonges ». ([2] [308])
La victoire d'Hitler
Pourtant la plupart des combattants enrôlés dans les deux camps ne sont pas partis la fleur au fusil, encore tétanisés par la mort de leurs pères à peine 25 ans auparavant. L'exode massif en France, la terreur de l'Etat nazi encadrant la population allemande, les déportations massives de l'Etat capitaliste stalinien, rien de tout cela ne transpire des « actualités » nasillardes de l'époque qu'on nous ressert aujourd'hui. Un seul nom apparaît en lettres géantes dans tous les commentaires et filmographies « objectives » mais abjectes : HITLER. Au Moyen Age il y avait LA PESTE comme explication du fléau de Dieu. En plein milieu de l'ère capitaliste décadente, la bourgeoisie a trouvé l'équivalent pour le Dieu « Démocratie » : LA PESTE BRUNE. Les classes dominantes successives de l'histoire de l'humanité ont toujours eu recours à l'invocation d'un haut mal pour fabriquer un intérêt commun aux classes opprimées et à leurs exploiteurs. Un proverbe chinois résume fort bien la chose : « quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». La personnification des événements autour du nom des dictateurs ou des généraux Alliés est au demeurant très utile pour gommer l'idée qu'ils n'étaient que les porte-voix de leur bourgeoisie respective, et pour faire disparaître par la magie des noms, toute idée de classes au moment de la guerre ; tout le monde ne peut être qu'uni derrière la nouvelle croisade contre le MAL.
L'année de l'accession au pouvoir de l'élu bourgeois Hitler, 1933, est une année-clé, comme l'ont souligné les révolutionnaires qui publiaient la revue Bilan, non parce qu'elle signait « l'échec des démocraties », mais parce qu'elle signifiait la victoire décisive de la contre-révolution, en particulier dans le pays où le prolétariat est le plus important traditionnellement dans le mouvement ouvrier. Ce n'est pas simplement l'humiliant traité de Versailles de 1918, dont l'exigence de « réparations » mettait à genoux l'Allemagne, qui expliquait la venue au pouvoir d'Hitler, mais la disparition de la scène sociale du prolétariat comme menace pour la bourgeoisie.
En Russie, les massacres par l'Etat russe, des bolcheviks et ouvriers révolutionnaires, commençaient à prendre de l'ampleur, avec l'approbation muette des démocraties occidentales qui avaient tant fait pour armer les armées blanches. En Allemagne, c'est le régime social-démocrate de la République de Weimar qui avait passé tout naturellement le relais aux hitlériens, vainqueurs des élections républicaines. Les chefs « socialistes », massacreurs des ouvriers révolutionnaires allemands, les Scheidemann, Noske et tutti quanti, abandonnaient démocratiquement leurs postes ministériels ; ils ne furent jamais inquiétés personnellement pendant les cinq années du régime hitlérien.
Les luttes en France et en Espagne aux cours des années 1930 ne furent que des queues de grève face à l'ampleur de la défaite internationale de la classe ouvrière. La victoire électorale du fascisme en Italie et en Allemagne n'était pas la cause, mais le produit de la défaite du prolétariat sur son terrain social. La bourgeoisie en sécrétant le fascisme ne produisait pas un régime original, mais une forme capitaliste d'Etat dans la même lignée que le Welfare State de Roosevelt et du capitalisme stalinien. En période de guerre, les fractions bourgeoises s'unissent naturellement au niveau national puisqu'elles ont éliminé mondialement la menace du prolétariat, et cette unification peut prendre la forme du parti stalinien ou nazi.
En complicité avec la bourgeoisie russe et son Staline, la « montée des périls » est organisée par la plupart des PC inféodés au nouvel impérialisme russe, sous couvert de l'idéologie des Fronts Populaires qui permettent de maintenir les ouvriers désorientés derrière les programmes d'union nationale et de préparation à la guerre impérialiste.
Le PCF avait annoncé la couleur tricolore dès 1935 lors du pacte Laval-Staline, s'engageant à ce que les ouvriers aillent se faire massacrer : « Si Hitler, malgré tout, déclenchait la guerre, qu'il sache bien qu'il trouverait devant lui le peuple de France uni, les communistes au premier rang, pour défendre la sécurité du pays, la liberté et l'indépendance des peuples ». Ce sont les PC qui brisent les dernières grèves et qui confrontent et tirent sur les ouvriers en Espagne avec l'aide de la Guepeou, avant que les franquistes ne parachèvent la sale besogne. Puis les dirigeants staliniens se réfugient en France et en Russie, comme les De Gaulle et Thorez qui ne manqueront pas de suivre cet exemple, l'un à Londres, l'autre à Moscou.
La marche à la guerre imperialiste
De 1918 à 1935, les guerres n'avaient pas cessé dans le monde, mais il s'agissait de guerres limitées, éloignées de l'Europe, ou de guerres de « pacification » du type de celles du colonialisme français (Syrie, Maroc, Indochine). Pour les révolutionnaires qui publient Bilan, la première alerte grave est signifiée par la guerre d'Ethiopie qui met en présence l'impérialisme britannique et l'armée de Mussolini. Elle sert à une partie des alliés occidentaux à confondre fascisme et guerre. Le fascisme devient ainsi le principal fauteur de la prochaine guerre mondiale. L'épouvantail fasciste sera donc confirmé avec la victoire de l'armée franquiste en 1939. Le battage idéologique trouve sa concrétisation sanglante en exhibant les centaines de milliers de victimes du franquisme. Une période de statu quo va suivre, au nom de la recherche de la « paix », quand l'Allemagne annexe la Rhénanie, puis l'Autriche en 1938, puis la Bohème en 1939. Lorsque la Tchécoslovaquie est envahie le 27 septembre 1938 par l'armée allemande, les futurs Alliés ne bougent pas pour renchérir leur mensonge de « paix à tout prix ». Le 1er octobre se tient la conférence de Munich où la Tchécoslovaquie n'est pas invitée... De retour de cette sinistre parodie de conférence de la paix, le premier ministre français Daladier, chaleureusement accueilli par la foule, n'est pas dupe et sait que chaque camp en présence joue la montre. Les historiens officiels se contentent d'invoquer le retard de réarmement des Etats français et anglais alors qu'en fait, en sous-main, le jeu des alliances n'était pas encore véritablement tranché et que la bourgeoisie allemande caressait l'espoir de faire front commun avec la France et l'Angleterre. Pendant ce temps, les foules sont aussi abusées en Allemagne et en Angleterre qu'en France :
« (...) Les Allemands acclament follement Chamberlain en lequel ils voient, eux aussi, l'homme qui va les sauver de la guerre. Il y a plus de monde pour le saluer qu'il n'y en avait pour saluer Mussolini. (...) A Munich pavoisé de drapeaux anglais, c'est le délire. A l'aéroport d'Heston, on accueille également Chamberlain comme le messie. A Paris, on propose une souscription publique pour offrir un cadeau au premier ministre anglais ». ([3] [309])
En 1937 a commencé la guerre sino-japonaise qui menace l'hégémonie américaine dans le Pacifique. Le 24 août 1939 est le coup de tonnerre qui fait basculer dans l'abîme. Le pacte Hitler-Staline laisse les mains libres à l'Etat allemand pour foncer vers l'Europe de l'ouest. En attendant, la Pologne est envahie le 1er septembre par l'armée allemande, mais aussi pour partie par l'armée russe. Piteux, les Etats anglais et français déclarent la guerre en bonne et due forme à l'Allemagne, deux jours après. L'armée italienne s'est emparée de l'Albanie. Sans déclaration de guerre, l'armée de Staline envahit la Finlande le 30 novembre. Pendant ce temps l'armée allemande débarque en Norvège en avril 1940.
L'armée française commence son offensive dans la Sarre, bientôt bloquée au prix d'un millier de morts de part et d'autre. Ce qui permet à Staline de déclarer, démentant ses partisans chauvins selon lesquels son pacte avec la bourgeoisie allemande était un pacte avec le diable pour lui éviter de s'en prendre à l'Europe :
« Ce n'est pas l'Allemagne qui a attaqué la France et l'Angleterre, mais la France et l'Angleterre qui ont attaqué l'Allemagne (...) Après l'ouverture des hostilités, l'Allemagne a fait des propositions de paix à la France et à l'Angleterre, et l'Union Soviétique a ouvertement soutenu les propositions de paix de l'Allemagne. Les cercles dirigeants de France et d'Angleterre ont brutalement repoussé, tant les propositions de paix de l'Allemagne que les tentatives de l'Union Soviétique de mettre fin rapidement à la guerre ».
Personne ne veut endosser la tunique de fauteur de guerre face au prolétariat. Après la « Libération » il n'existera d'ailleurs plus de ministres « de la guerre » mais uniquement des ministres « de la défense ». Il est aussi frappant de constater ce fait, en Allemagne, que l'Etat nazi tient à apparaître lui aussi comme l'agressé. Le haut dignitaire nazi, Albert Speer, confie dans ses Mémoires une déclaration personnelle d'Hitler : « Nous ne commettrons pas une nouvelle fois l'erreur de 1914. Il s'agit maintenant de rejeter la faute sur l'adversaire ». A la veille de l'affrontement avec le Japon, Roosevelt ne dira pas antre chose : « Les démocraties ne doivent jamais apparaître comme l'agresseur ». Les neuf mois de confrontation l'arme au pied, nommés « drôle de guerre » confirment cette valse-hésitation de tous les belligérants. L'historien Pierre Miquel explique qu'Hitler avait remis l'ordre d'attaque à l'ouest pas moins de quatorze fois en raison de l'impréparation de l'armée allemande et des conditions météorologiques.
Le 22 juin 1941, l'Allemagne se retournera contre la Russie, surprenant totalement le « génial stratège » Staline. Le 8 décembre, après que l'impérialisme américain ait laissé massacrer ses propres soldats à Pearl Harbor (les services secrets savaient l'imminence de l'attaque japonaise), les Etats-Unis, « victimes » de la barbarie nippone, déclareront la guerre au Japon. Enfin l'Allemagne et l'Italie lanceront leur cri guerrier aux Etats-Unis le 11 décembre 1941.
Quelques observations s'imposent, après ce rapide survol de la marche diplomatique à la guerre mondiale dans une situation où le prolétariat mondial est muselé. Deux guerres locales (Ethiopie et Espagne) ont achevé de mettre en accusation le fascisme comme «fauteur de guerre », après des années d'excitation médiatique en Europe contre les exactions et parades hitlériennes et mussoliniennes, qui étaient certes plus ordonnées que les 14 juillet français ou les festivités nationalistes anglaises et américaines, mais non moins ridicules. Deux autres guerres locales au coeur de l'Europe (Tchécoslovaquie et Pologne) ont donné lieu à la défaite extrêmement rapide des deux pays « démocratiques » concernés. La « honteuse » non-intervention pour aider la Tchécoslovaquie (et l'Espagne) a rendu la « défense de la démocratie » et la conception de la liberté bourgeoise incontournables après l'invasion par les deux pays « totalitaires » de la Pologne. Les manoeuvres politico-diplomatiques peuvent traîner pendant des années, le conflit militaire, lui, tranche partiellement en quelques heures sur le terrain au prix d'un massacre inouï. La guerre ne devient mondiale véritablement qu'un an après la conquête de l'Europe par l'armée allemande. Pendant plus de quatre ans les Etats-Unis ne tenteront aucune opération décisive pour contrer les « envahisseurs », laissant la bourgeoisie allemande gendarmer l'Europe. Les Etats-Unis, éloignés du territoire européen, étaient initialement plus préoccupés par la menace japonaise dans le Pacifique. La guerre mondiale connaîtra donc une plus longue durée que les guerres locales, et cette durée ne s'explique pas seulement par la toute-puissance de l'armée allemande ni par les aléas des tractations impérialistes. Elle
est notoire, par exemple, la préférence d'une partie de la bourgeoisie américaine pour s'allier avec la bourgeoisie allemande plutôt qu'avec le «régime communiste » stalinien, tout comme la bourgeoisie allemande avait tenté et attendu en vain de s'allier avec la France et l'Angleterre contre les « Rouges ». En 1940 et en 1941, la bourgeoisie anglaise a été l'objet de propositions de paix par le gouvernement d'Hitler au moment des débuts de l'opération « Barbarossa » contre la Russie, et lors de la défaite de l'armée de Mussolini en Afrique du nord, et elle a hésité d'autant qu'elle pouvait laisser les deux puissances « totalitaires » se détruire mutuellement. En rester là cependant, serait raisonner comme si la principale classe ennemie de toutes les bourgeoisies, le prolétariat, avait disparu des soucis des chefs impérialistes en lice, du fait de la guerre « unificatrice » et... « Simplificatrice » !
De plus, les marxistes ne peuvent raisonner sur la guerre en soi, indépendamment des périodes historiques. La guerre, dans le capitalisme juvénile au 19e siècle fut un moyen indispensable permettant des possibilités de développement ultérieur, ouvrant à coups de canon des marchés. C'est ce que montrait en 1945, la Gauche communiste de France, un des rares groupes ayant maintenu l'étendard de l'internationalisme prolétarien pendant la seconde guerre mondiale, précisant que, par contre : « ...dans sa phase de décadence, le capitalisme ayant épuisé historiquement toutes les possibilités de développement, trouve dans la guerre moderne, la guerre impérialiste, l'expression de cette décadence qui, sans ouvrir aucune possibilité de développement ultérieur pour la production, ne fait qu'engouffrer dans l'abîme les forces productives et accumuler à un rythme accéléré ruines sur ruines. (...) Plus se rétrécit le marché, plus devient âpre la lutte pour la possession des sources de matières premières et la maîtrise du marché mondial. La lutte économique entre divers groupes capitalistes se concentre de plus en plus, prenant la forme la plus achevée des luttes entre Etats. La lutte économique exaspérée entre Etats ne peut finalement se résoudre que par la force militaire. La guerre devient le seul moyen par lequel chaque impérialisme national tend à se dégager des difficultés avec lesquelles il est aux prises, aux dépens des Etats impérialistes rivaux ». ([4] [310])
L'UNION NATIONALE PENDANT LA GUERRE
Les historiens bourgeois ne s'appesantissent pas sur ce fait : la défaite rapide de l'ancienne grande puissance continentale française. Ce ne sont pas simplement les conditions climatiques qui ont retardé l'attaque de l'armée allemande. L'appareil d'Etat allemand n'a pas choisi Hitler par erreur et n'est pas composé de crétins tout juste bons à marcher au pas de l'oie. La raison principale en est encore une fois le jeu des consultations diplomatiques secrètes. Même en pleine guerre des alliances peuvent être renversées. Au surplus, il existe toujours un souci chez la bourgeoisie allemande, en souvenir de l'insubordination des soldats allemands en 1918, que les soldats n'aient jamais faim... En 1938, la bourgeoisie allemande est l'héritière de la première République de Weimar qui a su écraser dans le sang la tentative de révolution prolétarienne en 1919 ; les bataillons SS sont constitués des anciens « corps francs » démocratiques qui ont massacré les ouvriers insurgés. Ni l'éruption de la Commune de Paris en 1870, ni la révolution d'octobre 1917, ni l'insurrection spartakiste de 1919 n'ont été oubliées. Même défaite politiquement, la classe ouvrière reste la classe dangereuse face à la guerre bourgeoise qui dure.
La rapide victoire de l'impérialisme allemand en Tchécoslovaquie avait été le résultat de la guerre des nerfs, du bluff, de manoeuvres raffinées, et surtout de la spéculation sur la crainte de tous les gouvernements des conséquences d'une guerre trop vite généralisée sans adhésion certaine du prolétariat. Plus avisé que les généraux français demeurés aux vieilles conceptions de la «guerre de position » de 1914, l'Etat-major allemand avait « modernisé » en faveur de la « Blitzkrieg » (guerre-éclair). Avancer lentement sans frapper férocement est, selon cette conception militariste (très prisée de nos jours, voir la guerre du Golfe), gage de défaite. Pire encore, d'autant que les bases d'adhésion des populations sont fragiles, traîner en longueur, laisser le temps aux combattants de s'interpeller par-dessus les tranchées, induit les risques de mutineries et d'explosion sociale. Au 20e siècle, la classe ouvrière devient inévitablement le premier bataillon contre la guerre impérialiste. Hitler, lui-même, confia un jour à son affidé Albert Speer : « l'industrie est un facteur favorable au développement du communisme ». Hitler déclarera même à ce confident, après la mise en vigueur du travail obligatoire en 1943 en France, que l'éventualité de voir surgir des troubles et des grèves qui freineraient la production, est un risque à courir en temps de guerre. La bourgeoisie allemande a donc un réflexe « bismarkien », tout comme Bismark fût confronté à l'insurrection des ouvriers parisiens contre leur propre bourgeoisie, ce qui avait bloqué l'action de l'envahisseur allemand et l'avait inquiété pour les risques de propagation d'une telle révolution parmi les soldats et ouvriers allemands, d'autant que ces mêmes ouvriers allemands avaient réagi de la même manière face à la guerre contre la Russie révolutionnaire, par la guerre civile contre leur propre bourgeoisie.
C'est pourtant une véritable guerre de lassitude qui est menée pendant près d'un an en France, après l'arrêt subit de la première offensive militaire allemande. L'Allemagne veut surtout s'ouvrir un « espace vital » à l'Est et préférerait encore s'allier avec les deux démocraties occidentales plutôt que de gâcher une partie de son potentiel militaire pour les envahir. L'Allemagne apportait son soutien au «parti de la guerre » de Laval et Doriot, anciens pacifistes qui s'étaient réclamés du socialisme. Ces fractions pro-fascistes qui militaient pour l'alliance franco-allemande restaient minoritaires. L'ensemble de la bourgeoisie se méfiait de la non-mobilisation du prolétariat français. Là, le prolétariat n'avait pas été vaincu frontalement à coups de baïonnettes et de lance-flammes en 1918 et 1923 le prolétariat allemand.
La bourgeoisie allemande se doit donc aussi, dans un second temps, d'avancer prudemment face à un pays qu'elle sait fragile pas tant militairement que socialement. En fait elle n'aura qu'à observer la lente décomposition de la bourgeoisie française entre ses lâches militaires et ses pacifistes futurs collaborateurs du régime d'occupation, qui maintiendront dans l'impuissance les ouvriers.
Les fronts populaires avaient contribué à un important effort de réarmement (tout en désarmant politiquement les ouvriers), mais n'avaient pas complètement réussi à réaliser l'union nationale. La police avait certes brisé beaucoup de grèves et interné des centaines de militants peu clairs eux-mêmes sur comment s'opposer à la guerre. La gauche de la bourgeoisie française avait calmé les ouvriers avec les boniments du Front populaire qui avait accordé les « congés payés » aux ouvriers, lesquels avaient été mobilisés pendant ces mêmes vacances. C'est le travail de sape des fractions pacifistes d'extrême-gauche qui permet d'achever toute alternative de classe. Complétant le travail de sabotage des staliniens, les anarchistes encore très influents dans les syndicats, publient le tract « Paix immédiate » en septembre 1939, signé par une brochette d'intellectuels : « (...) Pas de fleurs aux fusils, pas de chants héroïques, pas de bravos au départ des militaires. Et l'on nous assure qu'il en est ainsi chez tous les belligérants. La guerre est donc condamnée dés le premier jour, par la plupart des participants de l'avant et de l'arrière. Alors faisons vite la paix. »
La « paix » ne peut pas être l'alternative à la guerre dans le capitalisme décadent. De telles résolutions ne servent qu'à encourager le sauve-qui-peut, les solutions individuelles de départ à l'étranger pour les plus fortunés. Le désarroi des prolétaires est accru, leur inquiétude et leur impuissance s'articulent sur une débandade généralisée des partis et groupuscules de gauche qui les ont enfermés dans le « bon sens » antifasciste et qui ont prétendu défendre leurs intérêts.
Le délitement de la société française est tel que la « drôle de guerre » d'un côté, « komischer Krieg » de l'autre, n'aura été qu'un intermède permettant à l'armée allemande, peu après le premier grand bombardement meurtrier de Rotterdam (40 000 morts), d'enfoncer le 10 mai 1940 sans résistance la fragile ligne Maginot française. Les officiers de l'armée française fuient les premiers, laissant en plan leurs troupes. Les populations néerlandaise, belge, luxembourgeoise et du nord de la France, y inclus Paris et le Gouvernement, fuient de manière massive, irraisonnée et incontrôlable vers le centre et le sud de la France. Ainsi se produit un des plus gigantesques exodes modernes. Cette absence de « résistance » de la population lui sera d'ailleurs reprochée par les idéologues du « maquis » (dont beaucoup, comme Mitterrand et les chefs « socialistes » belges ou italiens n'ont tourné leur veste qu'à partir de 1942), et après la guerre, pour autoriser tous les chantages pour que la classe ouvrière se sacrifie à la reconstruction.
La Blitzkrieg n'en a pas moins causé 90 000 morts et 120 000 blessés côté français, 27 000 morts côté allemand. La débâcle aura drainé dix millions de personnes dans des conditions épouvantables. Un million et demi de prisonniers sont expédiés en Allemagne. Et c'est peu comparé aux 50 millions de morts de l'holocauste.
En Europe, la population civile subira les pertes les plus importantes que l'humanité ait jamais connue en période de guerre. Jamais autant de femmes et d'enfants n'auront rejoint dans la mort les soldats. Les victimes civiles seront pour la première fois de l'histoire mondiale plus nombreuses que les pertes militaires.
Avec son réflexe « bismarkien », la bourgeoisie allemande prendra soin de diviser en deux la France : une zone occupée, le nord avec la capitale, pour surveiller directement les côtes face à l'Angleterre ; et une zone libre, le sud, légitimée avec le gouvernement du général potiche de Verdun Pétain et l'ancien « socialiste » Laval pour l'honorabilité internationale ; cet Etat collaborateur soulagera un temps l'effort de guerre nazi jusqu'à ce que l'avancée des Alliés amène l'impérialisme allemand à le culbuter.
La crainte permanente d'une levée des ouvriers, même affaiblis, contre la guerre transparaît même chez ceux que la gauche présente comme « anti-sociaux ». Un journal collaborationniste, « L'Oeuvre », parle crûment la nécessité des syndicats - ce soi-disant acquis social du Front populaire- pour l'occupant, et dans les mêmes termes que n'importe quel parti de gauche ou trotskyste : « Les occupants ont le plus vif souci de ne pas dresser contre eux les éléments ouvriers, de ne pas perdre le contact, de les intégrer dans un mouvement social bien organisé (...). Les Allemands souhaitent que tous les ouvriers soient effectivement intégrés au corporatisme et, pour cela, il leur parait que les cadres sont nécessaires, qui aient effectivement la confiance des travailleurs (...) Pour obtenir des hommes qui aient autorité et qui soient effectivement suivis (...) ». ([5] [311]).
Dès 1941, une partie du gouvernement français collaborateur s'inquiète en effet du caractère provisoire de l'occupation et de la garantie d'ordre qui s'y rattachait. La bourgeoisie avec Pétain, tout autant que sa fraction émigrée, la « France libre » de De Gaulle, plus ou moins en contact discret, auront pour principal souci le maintien de l'ordre politique et social d'une époque à une autre. Sécrétée par sa fraction libérale planquée en Angleterre et par les staliniens français, l'idéologie des bandes armées de résistants -d'un impact très faible- aura tout d'abord de grandes difficultés à attirer les ouvriers dans l'Union nationale en vue de la « Libération ». La bourgeoisie allemande prêtera main-forte, malgré elle, avec « la relève » - l'obligation pour tout ouvrier d'aller travailler en Allemagne en échange du retour d'un prisonnier de guerre -, pour que subitement, en 1943, soient renforcés les rangs de l'action « terroriste » contre « l'occupant ». Mais, fondamentalement, ce sont les partis de gauche et d'extrême-gauche qui réussissent à rameuter les ouvriers en s'appuyant sur « la victoire de Stalingrad ».
Les revirements d'alliances impérialistes et les possibles réactions du prolétariat constituent les lignes d'orientation de la bourgeoisie en pleine guerre. Formellement, le tournant de la guerre contre l'Allemagne a lieu en 1942 avec l'arrêt de l'expansion du Japon et la victoire d'El Alamein qui libère les champs de pétrole. La même année débute la bataille de Stalingrad où l'Etat stalinien ne devra la victoire qu'à l'adjonction des fournitures militaires américaines (tanks et armes plus sophistiquées que la Russie ne pouvait en produire face à la moderne armée allemande). Au cours des négociations secrètes, l'Etat stalinien avait mis dans la balance son accord pour déclarer la guerre au Japon. La guerre aurait pu dès lors s'acheminer rapidement vers sa fin d'autant qu'il existait des velléités non déguisées d'une partie de la bourgeoisie allemande de se débarrasser d'Hitler, dont les tenants tenteront un attentat contre Hitler en juillet 1944, mais seront laissés isolés par les Alliés, et massacrés par l'Etat nazi (le plan Walkyrie avec l'amiral Canaris).
C'était sans compter avec le réveil du prolétariat italien. Il sera donc nécessaire de prolonger deux ans encore la guerre pour massacrer les forces vives du prolétariat et éviter une nouvelle paix précipitée comme en 1918, la révolution aux trousses.
1943 est un tournant dans la guerre, à la suite de l'éruption du prolétariat italien. Au niveau mondial, la bourgeoisie va se servir de l'isolement et de la défaite des ouvriers italiens pour développer la stratégie de la « résistance » dans les pays occupés, afin de faire adhérer les populations « de l'intérieur » à la future paix capitaliste. Alors que jusque là, la plupart des bandes de résistants étaient animées essentiellement par d'infimes minorités d'éléments des couches petites-bourgeoises nationalistes et aux méthodes terroristes, la bourgeoisie anglo-américaine va glorifier l'idéologie de la résistance plus pragmatiquement à la suite de la « victoire de Stalingrad » et des retournements pro-occidentaux des PC. Les ouvriers non prisonniers ne voyaient pas de différence entre l'exploitation par un patron allemand ou un patron français. Ils n'avaient pas eu envie de mourir au nom des alliances impérialistes anglo-françaises pour soutenir la Pologne, ils n'avaient fait aucun effort pour s'impliquer dans la guerre qui leur était restée étrangère. Pour les mobiliser en vue de la défense de la « démocratie » il fallait leur fixer une perspective qui leur parut valable du point de vue de classe. L'exhibition de la victoire de Stalingrad comme le tournant de la guerre, et donc la possibilité de mettre fin tout de même aux exactions militaires de l'occupant, de retrouver « la liberté » même avec les gendarmes autochtones, souleva l'espoir aux côtés du « communisme libérateur » représenté par Staline. Sans l'aide de ce mensonge (et l'opportune relève comme oppression supplémentaire), les ouvriers restaient hostiles aux bandes de résistants armés dont les exactions décuplaient la terreur nazie. Sans le renfort sur le terrain des staliniens et des trotskistes, la bourgeoisie de Londres et Washington n'avait aucune chance de ramener les ouvriers dans la guerre. Contrairement à 1914, il ne s'agit pas d'aligner en rang, au front, les ouvriers pour les envoyer à la boucherie, mais d'obtenir leur adhésion et de les encadrer sur le terrain civil dans les réseaux d'ordre résistant, derrière le culte de la glorieuse bataille de Stalingrad !
En effet, en Italie comme en France, beaucoup d'ouvriers rejoignent le maquis dès cette époque, encouragés dans l'illusion du combat de classe retrouvé, et le parti stalinien et les trotskistes leur resservent même l'exemple frauduleusement travesti de la Commune de Paris (les ouvriers ne se dressent-ils pas contre leur propre bourgeoisie menée par le nouveau Thiers, Pétain, alors que les allemands occupent la France?). Au milieu d'une population terrorisée et impuissante dans le déchaînement de la guerre, beaucoup d'ouvriers français et européens, embrigadés dans les bandes de résistants, vont désormais se faire tuer en croyant se battre pour la « libération socialiste » de la France ou de l'Italie, en somme dans une nouvelle « guerre civile contre sa propre bourgeoisie » ; tout comme on avait envoyé les prolétaires de chaque côté du front en 1914 au nom du fait que la France et l'Allemagne étaient les pays « exportateurs » du socialisme. Les bandes de résistants staliniens et trotskistes concentrent particulièrement leur chantage pour que les ouvriers soient « au premier rang pour la lutte pour l'indépendance des peuples », dans un secteur-clé pour paralyser l'économie, celui des cheminots.
Au même moment, la prééminence des fractions de droite pro-alliés dans les bandes armées, pour la restauration du même ordre capitaliste dans la paix, est l'objet d'un âpre combat, à l'insu des ouvriers. Des équipes d'agents secrets américains de l'AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories) sont envoyées sur le terrain en France et en Italie (c'est l'origine de la loge P2 en totale complicité avec la Mafia), pour veiller à ce que les staliniens n'accaparent pas tout le pouvoir qui leur aurait permis de se rattacher au giron de l'impérialisme russe. De bout en bout les staliniens sauront ainsi à quoi ils devaient s'en tenir, et en particulier dans leur domaine de prédilection, saboter la lutte ouvrière, désarmer les résistants utopistes illuminés, cogner sur les ouvriers hostiles aux exigences de la reconstruction. Dès la « Libération », et comme preuve de l'unité bourgeoise contre le prolétariat, la bourgeoisie occidentale - tout en condamnant pour la galerie une poignée de « criminels de guerre » - recrutera même un certain nombre d'anciens tortionnaires nazis et staliniens pour en faire des agents secrets efficaces dans la plupart des capitales européennes. Ces recrues retournées auront pour tâche en premier lieu évidemment de contrer les séides de l'impérialisme russe, mais surtout de lutter « contre le communisme », c'est-à-dire le but naturel de toute lutte autonome généralisée des ouvriers eux-mêmes, menaçant inévitablement après l'horreur de la guerre et avec la disette aux débuts de la paix capitaliste.
LA DESTRUCTION MASSIVE DU PROLETARIAT
Nous laissons les bourgeois débattre entre eux du nombre respectif de massacres selon les communautés ([6] [312]), mais il est incontestable qu'il faut commencer par en souligner le principal : les 20 millions de russes tués sur le front européen. Ce sont les grands oubliés des festivités du cinquantenaire du débarquement de juin 1944. Les historiens russes actuels continuent d'ailleurs à accuser les Etats-Unis d'avoir retardé le débarquement en Normandie à la seule fin de saigner davantage l'URSS, en prévision de la guerre froide : « Le débarquement a eu lieu alors que le sort de l'Allemagne était déjà scellé par les contre-offensives soviétiques du front de l'Est». ([7] [313])
Les bourgeois libéraux, à la fin des fastes de la reconstruction avec leur pape Soljetnitsyne, se sont mis tout à coup à épiloguer sur les millions de morts des Goulags sous Staline, faisant semblant d'oublier que le véritable parachèvement de la contre-révolution a été effectué avec la totale complicité de l'occident... dans la guerre. Nous savons comment la classe bourgeoise est impitoyable après une défaite du prolétariat (des dizaines de milliers de communards et de femmes et enfants ont été massacrés et déportés en 1871). Sa façon de mener la deuxième guerre mondiale lui permit de décupler le massacre de la classe qui lui avait flanqué la trouille en 1917. Les Russes ont supporté seuls le poids de quatre ans de guerre en Europe. Ce n'est qu'au tout début 1945 que les Américains prendront pied en Allemagne, économisant, si on peut dire, les victimes chez eux, et préservant leur paix sociale. Tragique « héroïsme » que celui des millions de victimes russes, puisque sans l'aide militaire américaine, le régime stalinien arriéré eût été défait à plate couture par l'Allemagne industrialisée.
Après un tel massacre et sur la paix des tombes, dans la Russie exsangue, le pouvoir d'Etat n'eut aucunement nécessité des subtilités démocratiques pour faire régner l'ordre. Les Alliés laissèrent de plus la soldatesque russe se venger sur des millions d'allemands, consacrant ainsi la Russie au rang de puissance « victorieuse », statut dont on sait que, comme en 1914, il est générateur de paix sociale et d'admiration de la bourgeoisie. De même qu'il a laissé massacrer le prolétariat de Varsovie, le gouvernement russe et son dictateur ont pour leur part clairement et impunément laissé massacrer et crever sans nourriture à Stalingrad et à Leningrad des centaines de milliers de civils, tout comme les staliniens se sont empressés, ainsi qu'en témoigne Souvarine, de mettre au compte des pertes dues à la guerre les millions de morts des Goulags.
Pour que les impérialismes victorieux soient repus (dépeçage des usines en Europe de l'est pour le régime stalinien et reconstruction à l'ouest au bénéfice des Etats-Unis), encore fallait-il que le prolétariat ne risque pas de voler sa « libération » à la bourgeoisie.
Un intense battage idéologique commun à l'occident et à la Russie « totalitaire » mit en exergue le génocide des Juifs, dont les Alliés étaient au courant depuis le début de la guerre. Comme les historiens les plus sérieux l'ont reconnu, le génocide des Juifs ne trouve pas son explication au... Moyen Age, mais dans le cadre de la guerre mondialisée. Le massacre prend une ampleur incroyable au moment du déclenchement de la guerre contre la Russie, pour « résoudre » plus rapidement le problème des masses énormes de réfugiés et de prisonniers parqués, en particulier en Pologne. Les préoccupations de l'Etat nazi sont encore une fois de nourrir avant tout ses propres soldats quitte à faire crever de façon expéditive une population qui pesait sur l'effort de guerre (il fallait économiser les balles pour le front russe, et simplifier le travail des bourreaux d'autant que la décimation par balles individu par individu s'était avérée démoralisante même pour les tueurs).
A la conférence des Alliés aux Bermudes en 1943, les Alliés avaient même décidé de ne rien faire pour les Juifs, préférant de fait cette extermination à l'immense exode qu'ils auraient eu à charge si les nazis avaient pu choisir l'expulsion. Plusieurs marchandages eurent lieu depuis la Roumanie et la Hongrie. Tous essuyèrent le refus poli de Roosevelt sous prétexte de ne pas fournir des subsides à l'ennemi. La proposition la plus connue, mais masquée aujourd'hui derrière l'action humaniste très limitée du seul Schindler, mit en présence des représentants des Alliés avec Eichmann pour l'échange de 100 000 Juifs contre 10 000 camions, échange que les Alliés refusèrent explicitement par la bouche de l'Etat britannique : « transporter tant de monde risquerait de nuire à l'effort de guerre ». ([8] [314])
Ce génocide des Juifs, «purification ethnique » des nazis, devait
trop bien excuser la « victoire » des Alliés dans la pire des barbaries.
L'ouverture des camps se fit avec énormément de publicité.
Ce rempart de mensonges diabolisant à outrance le camp vaincu, servit à faire taire les questionnements face aux bombardements de terreur des Alliés pour pacifier avant tout le prolétariat mondial. Les chiffres suffisent à dévoiler l'horreur :
-en juillet 1943, bombardement de Hambourg, 50 000 morts ;
-en 1944, à Darmstadt, Kônigsberg, Heilbronn, 24 000 victimes ;
- à Braunschweig, 23 000 victimes ;
- à Dresde, ville de réfugiés de tous les pays, les 13 et 14 février 1945 le bombardement intensif par les avions démocratiques cause 250 000 victimes, c'est l'un des plus grands crimes de cette guerre ;
- en 18 mois, 45 des 60 principales villes allemandes avaient été quasiment détruites et 650 000 personnes avaient péri;
-en mars 1945, le bombardement de Tokyo fait plus de 80 000 victimes ;
- en France, comme ailleurs, ce sont les quartiers ouvriers qui sont l'objet des bombardements des Alliés : au Havre, à Marseille, faisant apparemment sans distinction de nouveaux milliers de morts ; les populations civiles des lieux de débarquement comme Caen (et jusque dans le Pas-de-Calais) ont vécu avec terreur le massacre (plus de 20 000 victimes de part et d'autre) du débarquement, quand elles n'en ont pas été victimes également ;
- quatre mois après la reddition du Reich, alors que le Japon était pratiquement à genoux, au nom de la volonté de limiter les pertes américaines, l'aviation démocratique bombarde, avec l'arme la plus meurtrière et terrifiante de tous les temps, Hiroshima et Nagasaki ; le prolétariat doit en retenir désormais pour longtemps que la bourgeoisie est une classe toute puissante...
Dans un prochain article, nous reviendrons sur les réactions des ouvriers pendant la guerre, passées sous silence par les livres de l'histoire officielle, et sur l'action et les positions des minorités révolutionnaires de l'époque.
Damien.
[1] [315] Voir dans la Revue Internationale n° 66 : <r Les massacres et les crimes des "grandes démocraties " », 3e trimestre 1991.
[2] [316] La guerre secrète, A.C. Brown.
[3] [317] 34-39,L'avant-guerre,Michel Ragon, Ed. Denoêl, 1968.
[4] [318] Rapport sur la situation internationale, 14 juillet 1945.
[5] [319] L’œuvre, 29 août 1940.
[6] [320] Voir dans la Revue Internationale n° 66 : « Les massacres et les crimes des "grandes démocraties"», 3e trimestre 1991, ainsi que le Manifeste du 9e congrès du CCI : Révolution communiste ou destruction de l'humanité.
[7] [321] Le Figaro, 6 juin 1994.
[8] [322] Voir L'histoire de Joël Brand par Alex Weissberg.
Un demi-siècle plus tard le problème des réfugiés fait l'objet des mêmes restrictions capitalistes honteuses : « Pour des raisons économiques et politiques (chaque réfugié représentant une dépense de 7000 dollars), Washington ne veut pas que l'augmentation des réfugiés juifs se fasse au détriment d'autres exilés -d'Amérique Latine, d'Asie ou d'Afrique- qui ne disposent d'aucun soutien et sont peut-être plus persécutés » {Le Monde du 4 octobre 1989, « Les juifs soviétiques seraient les plus affectés par des restrictions à l'immigration »). L'Europe de Masstricht n'est pas en reste : « ...pour l'Europe, la majorité des demandeurs d'asile ne sont pas de "vrais" réfugiés, mais de quelconques migrants économiques. Intolérable sur un marché de l'emploi saturé » {Libération du 9 octobre 1989, « L'Europe veut trier les réfugiés ». Voilà où aboutit le capitalisme dans sa décadence. Comme il ne peut plus permettre le développement des forces productives, il préfère, en temps de guerre comme en temps de paix, laisser crever de mort lente la plus grande partie de l'humanité. L'impuissance hypocrite affichée face à la «r purification ethnique » de milliers d'hommes dans l'ex-Yougoslavie et au massacre de 500 000 êtres humains en quelques jours au Rwanda, du jamais vu, sont les dernières preuves de ce dont le capitalisme est capable AUJOURD'HUI. En laissant faire ces massacres, comme elles avaient laissé faire le génocide des Juifs, les démocraties occidentales prétendent être étrangères à l'horreur alors qu'elles en sont complices, et même plus directement partie-prenante qu'au temps des nazis.
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [323]
Questions théoriques:
- Impérialisme [178]
Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre (2e partie)
- 2924 lectures
Polémique avec Programme Communiste sur la guerre impérialiste (2e partie)
Le courant bordiguiste appartient incontestablement au camp du prolétariat. Sur un certain nombre de questions essentielles, il défend fermement les principes de la Gauche Communiste qui a mené le combat contre la dégénérescence de la 3e Internationale dans les années 1920 et qui, aprés son exclusion de celle-ci, a poursuivi la bataille, dans les conditions terribles de la contre-révolution, pour la défense des intérêts historiques de la classe ouvrière. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la question de la guerre impérialiste. Dans la première partie de cet article, nous avons mis ce fait en évidence pour ce qui concerne une organisation de ce courant : celle qui publie ll Comunista en Italie et la revue Programme Communiste (PC) en France. Nous avons cependant démontré, à travers les écrits de cette organisation, comment l'ignorance, par le courant bordiguiste, de la notion de décadence du capitalisme, pouvait conduire à des aberrations théoriques sur la question de la guerre impérialiste. Mais le plus grave, dans les erreurs théoriques des groupes « bordiguistes », c'est qu'ils conduisent à un désarmement politique de la classe ouvrière. C'est ce que nous allons mettre en évidence dans cette seconde partie.
A la fin de la première partie de cet article nous citions une phrase du PCI dans PC n° 92 particulièrement significative du danger que représente la vision de cette organisation : « Il en découle aussi [de la guerre comme mani-festation d'une rationalité économique] que la lutte inter-impérialiste et l'affrontement entre puissances rivales ne pourra jamais conduire à la destruction de la planéte, parce qu'il s'agit justement, non d'avidités excessives mais de la nécessité d'échapper à la surproduction. Quand l'excédent est détruit, la machine de guerre s'arrête, quel que soit le potentiel destructif des armes mi-=ses en jeu, car disparaissent du même coup les causes de la guerre. » Une telle vision, qui met sur le même plan les guerres du siécle dernier, qui avaient, effectivement, une rationalité économique, et celles de ce siècle qui ont perdu une telle rationalité, découle directement de l'incapacité de la part du courant bordiguiste de comprendre le fait que le capitalisme, conformément à ce que disait déjà l'Internationale com-=muniste, est entré dans sa période de décadence depuis la 1re guerre mondiale. Cependant, il est important de revenir sur une telle vision car, non seulement elle tourne le dos à l'histoire réelle des guerres mondiales, mais elle démobilise complétement la classe ouvrière.
Imagination bordiguiste et histoire réelle
Ce n'est pas vrai que les deux guerres mondiales ont pris fin du fait de la dis-parition des causes économiques qui les avaient engendrées. Il faut déjà s'enten-dre, évidemment, sur les causes éco-nomiques véritables de la guerre. Mais, même en se plaçant du point de vue du PCI : la guerre a pour objectif de dé-truire suffisamment de capital constant pour permettre de retrouver un taux de profit suffisant, on peut constater que l'histoire réelle est en contradiction avec la conception imaginaire qu'en donne cette organisation.
Si nous prenons le cas de la 2e guerre mondiale, affirmer une telle chose est une trahison honteuse du combat mené par Lénine et les internationalistes tout au long de celle-ci (à moins qu'il ne s'agisse que d'une ignorance crasse de ces faits historiques). En effet, conformément à la résolution adoptée au congrés de 1907 de la 2e internationale (Congrés de Stuttgart), qu'un amendement présenté par Lénine et Rosa Luxemburg avait rendue trés claire, et conformément au Manifeste adopté par le Congrés de Bâle, en 1912, Lénine a mené le combat, dés aoùt 1914, pour que les révolutionnaires : « utilisent de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches populaires -les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste. ». (Résolution du Congrés de Stuttgart) Il n'allait pas dire aux ouvriers : « De toutes façons, la guerre impérialiste prendra fin lorsque les causes économiques qui l'ont engendrée seront épuisées. » Au contraire, il mettait en évidence que le seul moyen de mettre fin à la guerre impérialiste, avant qu'elle ne conduise à une hécatombe catastrophique pour le prolétariat et pour l'ensemble de la civilisation, consistait dans la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Evidemment, PC reprend à son compte ce mot d'ordre, et il approuve la politique des internationalistes au cours de cette guerre. Mais en même temps, il n'est pas capable de comprendre que justement, le scénario qu'il présente de la fin de la guerre impérialiste généralisée ne s'est pas réalisé en 1917-18. Au contraire, la ler guerre mondiale a pris fin, et trés rapidement, en novembre 1918, parce que le prolétariat le plus puissant du monde, celui d'Allemagne, s'était soulevé contre elle et était en train de prendre le chemin de la révolution comme l'avait fait, un an auparavant, le prolétariat de Russie. Les faits sont éloquents : le 9 novembre 1918, aprés plusieurs mois de grèves ouvrières dans toute l'Allemagne, les marins de Kiel de la « Kriegsmarine » se mutinent contre leurs officiers, en même temps qu'une ambiance insurrectionnelle se développe au sein du prolétariat ; le 11 novembre, les autorités allemandes signent un armistice avec les pays de l'Entente. La bourgeoisie a trés bien compris la leçon de la Russie un an au-paravant oú, la décision du gouvernement provisoire, issu de la révolution de février 1917, de poursuivre la guerre avait constitué le principal facteur de mobilisation du prolétariat vers l'issue révolutionnaire d'Octobre et la prise du pouvoir par les soviets. Ainsi, l'histoire avait donné raison à la vision défendue par Lénine et les bolcheviks : c'est la lutte révolutionnaire du prolétariat qui a mis fin à la guerre impérialiste et non une quelconque destruction de l'excé-dent de marchandises.
La 2° guerre mondiale, contrairement à la première (et à l'attente de beaucoup de révolutionnaires) n'a pas ouvert le chemin d'une nouvelle vague révolutionnaire. Et ce n'est malheureusement pas faction du prolétariat qui y a mis fin. Cependant, cela ne veut pas dire qu'elle ait répondu au schéma abstrait de PC. Si on étudie sérieusement les faits historiques, et autrement qu'avec les lunettes déformantes des dogmes « invariants » du bordiguisme, on constate facilement que la fin de la guerre n'a eu rien a voir avec une quelconque « destruction suffisante de l'excédent ». En réalité, la guerre impéria-liste a pris fin avec la destruction com-pléte du potentiel militaire des vaincus et par l'occupation de leur territoire par les vainqueurs. Le cas le plus explicite a été celui de l'Allemagne, encore une fois. Si les Alliés ont pris la peine d'occuper chaque pouce du territoire allemand, en se le partageant en quatre, ce n'était pas pour des raisons économiques mais pour des raisons sociales : la bourgeoisie avait conservé le souvenir de la l'e guerre mondiale. Elle savait qu'elle ne pouvait compter sur un gouvernement vaincu pour garantir l'ordre social dans les énormes concentrations prolétariennes d'Allemagne. C'est d'ailleurs ce que dit lui-même PC (et encore une fois on peut constater son incohérence) :
« Au cours des 3 années 45-48, une grave crise économique frappe tous les pays européens touchés par la guerre [tiens ! pourtant c'est là qu'il y avait eu le plus de destruction de capital constant, NDLR] (..) On voit donc que le marasme d'aprés-guerre ne fait pas de différence entre vaincus et vainqueurs. Mais forte de l'expérience du premier aprés-guerre, la bourgeoisie mondiale a appris que ce marasme pouvait donner naissance à des flambées classistes et révolutionnaires. C'est la raison pour laquelle la période de dépression économique d'aprés-guerre sera aussi la période de l'occupation militaire massive de l'Europe. Cette occupation ne commencera à s'atténuer, dans le secteur occidental, qu'à partir de 1949, quand le spectre du "désordre social" se sera éloigné. » (PC n° 91, p. 43)
En réalité, au nom du « marxisme » et même de la « dialectique », PC nous donne une vision matérialiste vulgaire et mécaniste du processus de déclenchement et de fin de la guerre impérialiste mondiale.
Une vision schématique du déclenchement de la guerre impérialiste
Le marxisme établit qu'en dernière instance, ce sont les infrastructures économiques de la société qui déterminent ses superstructures. De même, l'ensemble des faits historiques, qu'ils affectent la scéne politique, militaire ou sociale, ont des racines économiques. Cependant, c'est encore une fois « en dernière instance » que s'exerce cette détermination économique, de façon dialectique et non mécanique. Il existe, notamment depuis le début du capitalisme, une origine économique aux guerres. Mais le lien entre les facteurs économiques et la guerre a toujours été médiatisé par une série de facteurs historiques, politiques. diplomatiques qui ont justement permis à la bourgeoisie de masquer aux yeux des prolétaires la véritable nature de la guerre. Cela est déjà valable au siécle dernier, lorsque la guerre présente une certaine rationalité économique pour le capital. Il en est ainsi, par exemple de la guerre franco-prussienne de 1870.
Du côté prussien, cette guerre n'a pas de but économique immédiat (même si, évidemment, le vainqueur se permet le luxe de faire verser au vaincu 6 milliards de francs-or en échange du départ de ses troupes d'occupation). Fondamentalement, la guerre de 1870 permet à la Prusse de réaliser autour d'elle l'unité allemande (aprés qu'elle ait vaincu son concurrent autrichien pour un tel rôle lors de la bataille de Sadowa, eu 1866). L'annexion de l'Alsace-Lorraine n'a pas d'intérêt économique décisif, mais elle constitue la corbeille du mariage entre les différentes entités politiques allemandes. Et c'est justement à partir de cette unité politique que peut se développer de façon impétueuse la nation capitaliste qui deviendra en peu de temps la première puissance économi-que d'Europe et qui l'est restée.
Du côté français, le choix fait par Napoléon III de se lancer dans la guerre est encore plus éloigné d'une détermination économique directe. Fondamentalement, comme le dénonce d'ailleurs Marx, il s'agit pour le monarque de mener une guerre « dynastique » permettant au second Empire, en cas de victoire, de s'enraciner de façon beaucoup plus solide à la tête de la bourgeoisie française (qui, dans sa grande majorité, qu'elle soit royaliste ou républicaine, ne porte pas « Badinguet » dans son cceur) et de permettre au fils de Napoléon de lui succéder. C'est pour cela, d'ailleurs, que Thiers, représentant le plus avisé de la classe capitaliste, était farouchement opposé à cette guerre.
Lorsqu'on examine les causes du déclenchement de la 2e guerre mondiale, on peut constater également à quel point le facteur économique, qui est évidemment fondamental, ne joue que de façon indirecte. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cet article, nous étendre sur l'ensemble des ambitions impérialistes des différents protagonistes de cette guerre (au début du siécle, les révolutionnaires ont consacré à cette question de nombreuses brochures). Il suffit de dire que l'enjeu fondamental pour les deux principaux pays de l'Entente, la Grande-Bretagne et la France, était de conserver leur empire colonial face aux ambitions de l'Allemagne, la puissance montante, dont le potentiel industriel ne disposait pratiquement pas de débouchés coloniaux. C'est pour cela, qu'en dernier ressort, la guerre se présente pour l'Allemagne, qui pousse le plus au conflit, comme une lutte pour un repartage des marchés au moment oú ces derniers sont déjà tous entre les mains des puissances plus anciennes. La crise économique qui commence à se développer à partir de 1913 constitue évidemment un facteur important d'exacerbation des rivalités impérialistes qui débouche sur le 4 aoùt 1914, mais il serait totalement faux de prétendre (et aucun marxiste ne l'a fait à l'époque) que la crise avait déjà pris une telle ampleur que le capital ne pouvait faire autre chose, afin de la surmonter, que de déchaîner la guerre mondiale avec ses immenses destructions.
En réalité, la guerre aurait trés bien pu éclater dés 1912, lors de la crise des Balkans. Mais justement, à ce moment précis, l'Internationale Socialiste avait su se mobiliser et mobiliser les masses ouvrières contre la menace de la guerre, notamment avec le Congrés de Bâle, pour que la bourgeoisie renonce à avancer plus sur le chemin de l'affrontement généralisé. En revanche, en 1914, la raison principale pour laquelle la bourgeoisie peut déclencher la guerre mondiale ne réside pas dans le niveau atteint par la crise de surproduction, qui était bien loin du niveau qu'elle a atteint aujourd'hui par exemple. Elle réside dans le fait que le prolétariat, endormi par l'idée que désormais la guerre ne menaçait plus, et plus généralement par l'idéologie réformiste (propagée par l'aile droite des partis socialistes qui dirigeait la plupart de ces partis), n'a opposé aucune mobilisation sérieuse face à la menace qui se profilait de plus en plus à partir de l'attentat de Sarajevo, le 20 juin 1914. Pendant un mois et demi, la bourgeoisie des principaux pays a eu tout loisir de vérifier qu'elle avait les mains libres pour déclencher les massacres. En particulier, tant en Allemagne qu'en France, les gouvernements ont pu contacter directement les chefs des partis socialistes qui les ont assurés de leur fidélité et de leur capacité à entraîner les ouvriers vers la boucherie. Nous n'inventons pas ces faits : ils ont été mis en évidence et dénoncés par les révolutionnaires de l'époque, comme Rosa Luxemburg et Lénine.
En ce qui concerne la 2° guerre mondiale, on peut évidemment mettre en évidence comment, à partir de la crise économique de 1929, se mettent en place tous les éléments qui vont aboutir au déclenchement de la guerre en septembre 1939 : arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, accession au gouvernement en 1936 des «fronts populaires » en France et en Espagne, guerre civile dans ce dernier pays, à partir de juillet de la même année. Le fait que la crise ouverte de l'économie capitaliste débouche finalement sur la guerre impérialiste est d'ailleurs perçu trés clairement par les dirigeants de la bourgeoisie. Ainsi, Cordell Hull, proche collaborateur du président américain Roosevelt, déclare : « Quand les marchandises circulent, les soldats n'avancent pas ». Pour sa part Hitler, à la veille de la guerre dit clairement à propos de l'Allemagne : « Ce pays doit exporter ou mourir ». Cependant, on ne peut rendre compte du moment oú se déclenche la guerre mondiale uniquement dans les termes oú le fait PC: «Aprés 29, on chercha à sur-monter la crise aux USA par une espéce de "nouveau modéle de développement ». L'Etat intervient de façon massive dans l'économie... et lance de gigantesques plans d'investissements pu-blics. On reconnaît aujourd'hui que tout cela n'eut que des effets secondaires sur l'économie qui, en 37-38 plongeait de nouveau vers la crise : seuls les crédits en 38 pour le réarmement purent amorcer une "vigoureuse" reprise et faire atteindre des maximums historiques de production. Mais l'endettement public et la production d'armements ne peuvent que freiner, mais pas éliminer la tendance aux crises. Constatons le fait qu'en 39 la guerre éclate pour éviter la chute dans une crise encore plus ruineuse... La crise d'avant la guerre dura 3 ans et elle fut suivie aprés 33 par une reprise qui conduisit directement à la guerre. » (PC n° 90, p. 29) Déjà il faut rejeter l'idée que la guerre serait moins ruineuse que la crise: quand on a vu dans quel état s'est retrouvée l'Europe aprés la 2° guerre mondiale, une telle affirmation n'est pas sérieuse. Cependant, l'explication donnée par PC des origines de la guerre n'est pas fausse en soi, mais elle le devient si on en fait la seule permettant de comprendre pourquoi la guerre a été déclenchée en 1939 et non pas dés le début des années 1930, lorsque le monde, et particulièrement l'Allemagne et les Etats-Unis, plongent dans la plus profonde récession de l'histoire.
Pour mettre en évidence le schématisme incroyable de l'analyse de PC, il suffit de citer le passage suivant : « C'est le cours de l'économie impérialiste qui, à un certain moment, 'fait" la guerre. Et, s'il est vrai que l'affrontement militaire résout provisoirement les problémes posés par la crise, il faut cependant souligner que l'affrontement militaire ne découle pas de la récession, mais de la reprise artificielle qui le suit. Droguée par l'intervention de l'Etat, financée par la dette publique (de l'industrie mili-taire pour une bonne partie), la production reprend de la hauteur ; mais la conséquence immédiate est l'engorgement d'un marché mondial déjà saturé, la reproduction sous une forme aiguë de l'affrontement inter-impérialiste, et donc la guerre. A ce moment les Etats se jettent les uns contre les autres, ils doivent se faire la guerre, et ils la feraient au besoin à coup de bulldozers, de rnoissonneuses-batteuses ou de toutes les machines pacifiques qu'on peut imaginer... Le pouvoir de déclencher la guerre n'appartient pas aux fusils mais aux masses de marchandises invendues. » (PC n° 91, p. 37)
Une telle vision fait complétement abstraction des conditions concrétes à travers lesquelles la crise économique débouche sur la guerre. Pour PC, les choses se réduisent au mécanisme : récession, reprise "droguée", guerre. Rien d'autre. On peut déjà noter que ce schéma ne s'applique nullement à la 1e guerre mondiale. Mais, concernant la 2e, il faut constater que PC ne se penche pas sur la forme que prend la reprise droguée en Allemagne à partir de 1933 : celle de la mise en ceuvre d'un effort d'armement colossal par le régime nazi, ni sur la signification de la venue au pouvoir de ce régime lui-même. De même, la signification de l'arrivée du Front populaire en France, par exemple, ne fait pas l'objet du moindre examen par PC. Enfin, des événements de la scéne internationale aussi importants que l'expédition italienne de 1935 con-tre l'Ethiopie, la guerre d'Espagne en 1936, la guerre entre le Japon et la Chine un an aprés sont ignorés.
En réalité, aucune guerre n'a jamais été menée avec des moissonneuses-batteuses. Quelle que soit la pression exercée par la crise, la guerre ne peut être déclenchée si ne sont pas mûres, si n'ont pas été préparées ses conditions militaires, diplomatiques, politiques et sociales. Et justement, l'histoire des années 1930 est celle de l'ensemble de ces préparatifs. Sans revenir ici longuement sur ce que nous avons déjà développé dans d'autres numéros de cette revue, on peut dire qu'une des fonctions du régime Nazi a été d'impulser l'effort de reconstitution à grande échelle et à « un rythme qui surprend même les gé-néraux »([1] [324]) du potentiel militaire de l'Allemagne, un potentiel que les clauses du traité de Versailles de 1919 avaient bridé jusque là. En France également, le Front Populaire a eu la responsabilité de relancer l'effort d'arme-ment à une échelle inconnue depuis la 1e guerre mondiale. De même, les guerres que nous avons évoquées plus haut s'inscrivaient dans les préparatifs militaires et diplomatiques de l'affrontement généralisé. Il faut mentionner particulièrement la guerre d'Espagne : c'est le terrain oú les deux puissances de l'Axe, Italie et Allemagne, non seulement testent de façon directe les armements pour la guerre à venir mais renforcent leur alliance en vue de celle-ci. Mais non seulement cela : la guerre d'Espagne constitue le parachévement de l'écrasement physique et politique du prolétariat mondial aprés la vague révolutionnaire qui avait commencé en 1917 en Russie et qui avait jeté ses derniers feux en Chine en 1927. Entre 1936 et 1939, ce n'est pas seulement le prolétariat d'Espagne qui est défait, d'abord par le Frente Popular, ensuite par Franco. La guerre d'Espagne a été un des moyens essentiels par lesquels la bourgeoisie des pays « démocratiques », particulièrement en Europe, a fait adhérer les ouvriers à l'idéologie anti-fasciste, l'idéologie qui a permis qu'ils soient utilisés une nouvelle fois comme « chair à canon » pour la 2° guerre mondiale. Ainsi, l'acceptation de la guerre impérialiste par les ouvriers que les régimes fasciste et nazi ont imposée par la terreur a été obtenue dans les autres pays au nom de la « défense de la Démocratie », avec la participation active, évidemment, des partis de gauche du capital, « socialistes » et « communistes ».
Le schéma du mécanisme qui conduit au déclenchement de la 2° guerre mondiale, tel que nous le propose PC, coincide avec la réalité. Mais s'il en est ainsi, c'est dans les conditions bien spécifiques de cette période, qu'on ne peut comprendre, loin de là, à partir de ce seul schéma. En particulier, en ce qui concerne l'Allemagne, notamment, mais aussi des pays comme la France et la Grande-Bretagne (avec un certain retard sur les autres pays, cependant) l'effort d'armement constitue un des aliments de la reprise aprés la dépression de 1929. Mais cela n'est possible que par le fait que les principaux Etats capitalistes avaient considérablement réduit leurs moyens militaires au lendemain de la 1e guerre mondiale dans la mesure où, à ce moment-là, la principale préoccupation de la bourgeoisie mondiale était de faire face à la vague révolutionnaire du prolétariat. De même, forte de son expérience de la l°guerre mondiale, la bourgeoisie sait pertinemment qu'elle ne peut se lancer dans la guerre impérialiste sans avoir au préalable soumis totalement le prolétariat afin de s'éviter un surgissement révolutionnaire de celui-ci au cours même de la guerre.
Ainsi, la « méthode » de PC consiste a établir comme loi historique, un schéma qui ne s'est appliqué qu'une seule fois dans l'histoire (puisqu'on a déjà vu qu'il ne s'était pas appliqué au premier avant-guerre non plus). Pour qu'il puisse être valable dans la période actuelle, il faudrait que les conditions historiques d'aujourd'hui soient fondamentalement les mêmes que celles des années 1930, ce qui est loin d'être le cas : jamais les armements n'ont été aussi développés et le prolétariat ne vient pas de subir une profonde défaite comme ce fut le cas dans les années 1920. Au contraire, il est sorti, depuis la fin des années 1960, de la profonde contre-révolution qui pesait sur lui depuis le début des années 1930.
Les conséquences de la vision schématique de Programme Communiste
La vision schématique de PC débouche sur une analyse particulièrement dangereuse de la période actuelle. C'est vrai que de temps en temps, dans son étude, PC semble retrouver une conception un peu plus marxiste du processus qui con-duit à la guerre mondiale. C'est le cas lorsqu'il écrit:
« Pour que de telles masses humaines puissent être efficacement envovées au massacre, il faut que les populations soient préparées à temps à la guerre ; et pour qu'elle puissent résister ait cours d'une guerre à outrance, il faut que ce travail de préparation soit suivi d'un travail de mobilisation constante des énergies et des consciences de la nation, de toute la nation, en faveur de la guerre. (..) Sans la cohésion de tout le corps social, sans la solidarité de toutes les classe envers une guerre pour laquelle on sacrifie ses propres existences et ses propres espoirs, même les troupes les mieux armées sont condamnées à se désagréger sous le coup des privations et des horreurs quotidiennes du conflit. » (PC n° 91, p. 41) Mais de telles affirmations, tout-à-fait justes, entrent en contradiction flagrante avec la démarche adoptée par PC lorsqu'il s'essaie à faire des prévisions sur les années à venir. En s'appuyant sur son schéma récession, reprise "droguée", guerre, PC se livre à de savants calculs (dont nous ferons ici grâce au lecteur) pour aboutir à la conclusion que : « Il nous faut maintenant réfuter la thése de l'imminence de la troisiéme guerre mondiale. » (PC n° 90, p. 27) « Il faudrait alors situer la date présumée de la maturité économique du conflit autour de la moitié de la première décennie du prochain millénaire (ou si l'on préfére, du prochain siécle). » (Ibidem., p. 29) Il faut noter que PC fonde une telle prévision sur le fait que : « Le processus de relance droguée typique de l'économie de guerre, qui suit la crise, ne se dessine pas encore, et ceci dans une situation économique, qui, de récession en récession, est encore loin d'avoir épuisé la tendance à la dépression inaugurée en 74-75. » (Ibidem.) Nous pourrions évidemment démontrer (voir toutes nos analyses sur les caractéristiques de la crise actuelle dans cette même Revue) en quoi, depuis plus d'une décennie déjà, les « reprises » de l'éco-nomie mondiale sont parfaitement « droguées». Mais c'est PC qui le dit lui-même quelques lignes plus haut : « Nous voulons seulement souligner que le systéme capitaliste mondial a utilisé pour prévenir la crise les mêmes moyens dont il s'était servi aprés le krach de 1929 pour s'en sortir. » La cohérence n'est vraiment pas le fort de PC et des bordiguistes : c'est peut-être leur conception de la « dialectique » eux qui se flattent d'être « rompus au maniement de la dialectique. » (PC n° 91, p. 56) ([2] [325])
Cela-dit, au-delà même des contradictions de PC, il importe de souligner le caractére parfaitement démobilisateur des prévisions qu'il s'amuse à faire sur la date du prochain conflit mondial. Depuis sa fondation, le CCI a mis en évidence que, dés lors que le capitalisme avait épuisé les effets de la reconstruction du second aprés guerre, dés lors que la crise historique du mode de production capitaliste se manifestait une nouvelle fois sous forme de crise ouverte (cela, dés la fin des années 1960, et non en 1974-75, comme le veulent les bordiguistes pour essayer de prouver la confirmation d'une vieille « prévision » de Bordiga) les conditions économiques d'une nouvelle guerre mondiale étaient données. II a également mis en évidence que les conditions militaires et diplomatiques d'une telle guerre étaient totalement mùres avec la constitution depuis plusieurs décennies des deux grands blocs impérialistes regroupés au sein de l'OTAN et du Pacte de Varsovie derrière les deux principales puissances militaires du monde. La raison pour laquelle l'impasse économique oú se trouvait le capitalisme mondial n'a pas dé-bouché sur une nouvelle boucherie généralisée se trouvait fondamentalement dans le fait que la bourgeoisie n'avait pas les mains libres sur le terrain social. En effet, dés les premières morsures de la crise, la classe ouvrière mondiale - en mai 1968 en France, à l'automne 1969 en Italie, et dans tous les pays développés par la suite - a redressé la tête et s'est dégagée de la profonde contre-révolution qu'elle avait subie pendant quatre décennies. En expliquant cela, en basant sa propagande sur cette idée, le CCI a participé (de façon trés modeste évidemment, compte-tenu de ses forces actuelles) à redonner confiance en elle même à la classe ouvrière face aux campagnes bourgeoises visant en permanence à saper cette confiance. Au contraire, en continuant à propager l'idée que le prolétariat était encore totalement absent de la scéne historique (comme lorsqu'il était « minuit dans le siécle »), le courant bordiguiste a apporté (involontairement, certes, mais cela ne change rien), sa petite contribution aux campagnes bourgeoises. Pire encore, en laissant croire que, de toutes façons, les conditions matérielles d'une 3e guerre mondiale n'étaient pas encore réunies, il a participé à démobiliser la classe ouvrière contre sa menace, jouant, à une petite échelle, le rôle qu'avaient tenus les réformistes à la veille de la le guerre mondiale lorsqu'ils avaient convaincu les ouvriers que la guerre n'était plus une menace. Ainsi, ce n'est pas seulement, comme on l'a vu dans la première partie de cet article, en affirmant qu'une 3e guerre mondiale ne risquait pas de détruire l'humanité que PC contribue à masquer les véritables enjeux du combat de classe aujourd'hui, c'est aussi en faisant croire que ce combat de classe n'est pour rien dans le fait que cette guerre mondiale n'ait pas eu lieu depuis le début des années 1970.
L'effondrement du bloc de l'Est, à la fin des années 1980, a momentanément fait disparaître les conditions militaires et diplomatiques d'une nouvelle guerre mondiale. Cependant, la vision erronée de PC continue d'affaiblir les capacités politiques du prolétariat. En effet, la disparition des blocs n'a pas mis fin aux conflits militaires, loin de là, des con-flits dans lesquels les grandes et moyen-nes puissances continuent de s'affronter par petits Etats, ou même par ethnies interposées. La raison pour laquelle ces puissances ne s'engagent pas plus directement sur le terrain, ou pour laquelle, lorsqu'elles le font effectivement (comme lors de la guerre du Golfe en 1991) elles n'envoient sur place que des soldats professionnels ou des volontaires, c'est la crainte que continue d'avoir la bourgeoisie que l'envoi du contingent, c'est à dire des prolétaires en uniforme, ne provoque des réactions et une mobilisation de la classe ouvrière. Ainsi, à l'heure actuelle, le fait que la bourgeoisie ne soit pas capable d'embrigader le prolétariat derrière ses objectifs guerriers constitue un facteur de premier plan limitant la portée des massacres impérialistes. Et plus la classe ouvrière sera capable de développer ses combats, plus la bourgeoisie sera entravée dans ses projets funestes. Voilà ce que les révolutionnaires doivent dire à leur classe pour lui permettre de prendre conscience et de ses réelles capacités et de ses responsabilités. Malheureusement, malgré sa dénonciation tout à fait valable des mensonges bourgeois sur la guerre impérialiste, et notamment du pacifisme, c'est ce que ne fait pas le courant bordiguiste, et notamment PC.
Pour conclure sur cette critique des analyses de PC sur la question de la guerre impérialiste, il nous faut relever les quelques « arguments » employés par cette revue lorsqu'elle tente de stigmatiser les positions du CCI. Pour PC, nous sommes des « sociaux pacifistes d'extrême gauche », au même rang que les trotskistes (PC n° 92, p. 61). Notre position serait « emblématique de l'impuissance du petit bourgeois en colére » (Ibidem., p. 57). Et pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que : « si l'éclatement de la guerre exclut définitivement la révolution, alors la paix, cette paix bourgeoise, devient malgré tout un "bien" que le prolétariat, tant qu'il n'a pas la force de faire la révolution, doit protéger comme la prunelle de ses yeux. Et voila que pointe à l'horizon la vieille "lutte pour la paix"... au nom de la révolution. L'axe fondamental de la pro-pagande du CCI lors de la dernière guerre du Golfe n'était-elle pas la dénonciation des "va-t-en guerre" de tout poil, et les lamentations sur le "chaos", le "sang" et les "horreurs" de la guerre ? Certes la guerre est horrible, mais la paix bourgeoise l'est tout autant et les "va-t-en paix" doivent être dénon-cés tout aussi sévérement que les "va-t-en guerre"; quant au "chaos" grandissant du monde bourgeois, il ne peut qu'être accueilli favorablement par les communistes véritables parce qu'il signifie que se rapproche l'heure oú la violence révolutionnaire devra être opposée à la violence bourgeoise. » (Ibidem.)
Sincérement, les « arguments » de PC sont un peu pauvres, et surtout, ils sont mensongers. Lorsque les révolutionnaires du début du siécle, les Luxemburg et les Lénine, à chaque congrés de l'Internationale Socialiste et dans leur propagande quotidienne, mettaient les ouvriers en garde contre la menace de la guerre impérialiste, qu'ils dénonçaient les préparatifs de celle-ci, ils ne faisaient pas la même chose que les pacifistes et il nous semble que PC se réclame encore de ces révolutionnaires. De même, lorsque, au cours de la guerre elle-même, ils stigmatisaient avec la dernière énergie tant la bestialité impérialiste que les « jusqu'au-boutistes » et autres « socio-chauvins », ce n'est pas pour cela qu'ils mêlaient leur voix à celle des pacifistes à la Romain Rolland. Et bien c'est exactement du même combat que celui de ces révolutionnaires dont se revendique le CCI, et sans la moindre concession aux discours pacifistes qu'il dénonce avec la même vigueur que les discours guerriers contrairement à ce que prétend PC (qui ferait bien de lire un peu mieux notre presse). En réalité, le fait que PC soit obligé de mentir sur ce que nous disons réell-ment ne fait que démontrer une seule chose : le manque de consistance de ses propres analyses.
Et pour clore, nous voudrions dire à ces camarades qu'il ne sert à rien de consacrer tant d'énergie à prévoir presque à l'année prés la date de la future guerre mondiale pour aboutir à une « prévision » pour la période qui vient qui ne comporte pas moins de quatre scénarios possibles (voir PC n° 92, p. 57 à 60). Le prolétariat, pour s'armer politiquement, attend des révolutionnaires des perspectives claires. Pour tracer de telles perspectives, il ne suffit pas à ces derniers de se contenter de la « stricte répétition de positions classiques »comme veut le faire le PCI (PC n° 92, p. 31). Si le marxisme ne peut s'appuyer que sur un strict respect des principes prolétariens, notamment par rapport à la guerre impérialiste, comme le considére autant le CCI que le PCI, il n'est pas une théorie morte, incapable de rendre compte des différentes circonstances historiques dans lesquelles la classe ouvrière développe son combat, tant pour la défense de ses intérêts immédiats que pour le communisme (les deux faisant d'ailleurs partie du même tout). II doit permettre, comme le disait Lénine, « l'analyse concréte d'une situation concréte ». Dans le cas contraire, mais ce n'est plus le marxisme, il ne sert à rien, sinon à semer encore plus de confusion dans les rangs de la classe ouvrière. C'est malheureusement ce qui arrive au « marxisme » tel que nous le sert le PCI.
FM.
[1] [326] « Histoire des relations internationales », Tome 8, page 142, par Pierre Renouvin, (Paris, 1972)
[2] [327] Dans le domaine des incohérences du PCI, on peut encore donner la citation suivante « si la paix a régné jusqu'ici dans les métropoles impérialistes, c'est précisément en raison de cette domination des USA et de l'URSS, et si la guerre est inévitable c'est pour la simple raison que quarante années de "paix" ont permis la maturation de forces qui tendent à remettre en question cet équilibre issu du dernier conflit mondial. » (PC n° 91, page 47) Il faudrait, une fois pour toutes, que le PCI se mette d'accord avec lui-même. Pourquoi la guerre n'a-elle pas eu lieu encore ? A cause, exclusivement, du fait que ses conditions économiques n'étaient pas encore mùres comme essaie de le démontrer PC à longueur de pages, ou bien du fait que ses préparatifs diplomatiques n'étaient pas encore réalisés. Comprenne qui pourra.
Courants politiques:
- Bordiguisme [227]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [192]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal mais une nécessite matérielle [9e partie]
- 3677 lectures
Le communisme contre le « socialisme d’Etat »
La conscience de classe est quelque chose de vivant. Le fait qu'une partie du mouvement prolétarien ait atteint un certain niveau de clarté, ne veut pas dire que l'ensemble du mouvement y ait aussi accédé, et même les fractions les plus claires peuvent, dans certaines circonstances, ne pas réussir à tirer toutes les implications de ce qu'elles ont appréhendé, et peuvent même régresser par rapport à un niveau de compréhension atteint auparavant.
Ceci est certainement vrai en ce qui concerne la question de l'Etat et les leçons que Marx et Engels ont tirées de la Commune de Paris, que nous avons analysées dans le précédent article de cette série ([1] [328]). Durant les décennies qui suivirent la défaite de la Commune, la montée du réformisme et de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier a mené, au tournant du siècle, à la situation absurde selon laquelle la position marxiste « orthodoxe », telle qu'elle était défendue par Kautsky et ses acolytes, était que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir au moyen des élections parlementaires, c'est-à-dire en s'emparant de l'Etat existant. Aussi quand Lénine, dans L'Etat et la révolution qu'il a rédigé pendant les événements révolutionnaires de 17, s'est attaché à « déterrer » le véritable héritage de Marx et Engels sur cette question, les « orthodoxes » l'accusèrent-ils de revenir à un anarchisme à la Bakounine !
En fait, la lutte pour faire connaître les leçons de la Commune de Paris, pour maintenir le mouvement prolétarien sur le chemin de la révolution communiste, avait déjà commencé au lendemain de l'insurrection des ouvriers français. Dans ce combat contre l'influence répugnante de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise sur le mouvement ouvrier, le marxisme a mené une bataille sur deux fronts : contre les « socialistes d'Etat » et les réformistes qui étaient particulièrement forts au sein du parti allemand, et contre la tendance anarchiste de Bakounine qui avait un forte présence dans les pays capitalistes moins développés.
Dans ce conflit à trois, beaucoup de questions étaient en débat, ou constituaient les germes de débats futurs. Dans le parti allemand, existait déjà la confusion entre la nécessaire lutte pour les réformes, et l'idéologie du réformisme qui oublie complètement les buts ultimes du mouvement. De l'autre côté, les Bakouninistes posaient aussi la question des réformes, mais dans le sens opposé : ils n'avaient que du mépris pour les luttes défensives immédiates de la classe et voulaient sauter par dessus, pour passer directement à la grande « liquidation sociale ». Avec ces derniers, devait également être posée de façon aiguë la question du rôle et du fonctionnement interne de l'Internationale, ce qui devait accélérer la chute de l'Internationale elle-même.
Dans les deux articles qui suivent, nous traiterons principalement de la façon dont ces conflits étaient reliés à la conception de la révolution et de la société future, bien qu'il y ait inévitablement de nombreux autres liens avec les questions mentionnées ci-dessus.
Le socialisme d'Etat est un capitalisme d'Etat
Au 20e siècle, l'identification entre le socialisme et le capitalisme d'Etat a constitué l'un des obstacles les plus tenaces au développement de la conscience de classe. Les régimes staliniens dans lesquels la brutalité de l'Etat totalitaire a violemment assuré le contrôle de la quasi-totalité de l'appareil économique, s'arrogeaient le nom de « socialistes », ce à quoi le reste de la bourgeoisie mondiale apportait obligeamment son accord. Et tous les cousins du stalinisme, des plus « démocratiques » aux plus « révolutionnaires », de la social-démocratie à sa droite au trotskisme à sa gauche, se sont attachés à répandre ce même mensonge fondamental.
Non moins pernicieuse que la version stalinienne est l'idée social-démocrate selon laquelle la classe ouvrière peut bénéficier de l'activité et de l'intervention de l'Etat, même dans les régimes qui sont explicitement identifiés comme « capitalistes » : selon ce point de vue, les conseils locaux, les gouvernements centraux contrôlés par les partis sociaux-démocrates, les institutions de l'Etat-providence, les industries nationalisées peuvent tous être utilisés pour le compte des ouvriers, et même constituer des étapes vers une société socialiste.
L'une des raisons pour lesquelles ces mystifications sont si profondément enracinées, c'est que les courants qui les défendent, ont appartenu dans le passé au mouvement ouvrier. Et beaucoup de pièges idéologiques qu'ils colportent aujourd'hui, trouvent leurs origines dans les confusions authentiques qui existaient dans une phase antérieure de ce mouvement. La vision marxiste du monde surgit d'un combat réel contre l'idéologie bourgeoise dans les rangs du mouvement prolétarien, et, pour cette raison même, est inévitablement confrontée à une lutte sans fin pour se libérer des subtiles influences de l'idéologie de la classe dominante. Dans le marxisme de la phase ascendante du capitalisme, nous pouvons donc voir une difficulté récurrente à abandonner l'illusion que l'étatisation du capital équivaut à la suppression de ce dernier.
Dans une large mesure, de telles illusions résultaient des conditions de l'époque dans lesquelles le capitalisme était encore perçu à travers la personnalité des capitalistes individuels, et où la concentration et la centralisation du capital était encore dans une phase précoce. Face à l'anarchie évidente créée par la pléthore d'entreprises individuelles concurrentes, il était assez facile d'aboutir à l'idée que la centralisation du capital entre les mains de l'Etat national constituerait un pas en avant. En fait beaucoup de mesures de contrôle par l'Etat mises en avant dans Le Manifeste Communiste (une banque d'Etat, la nationalisation de la terre, etc ([2] [329]) sont présentées dans le but explicite de développer la production capitaliste dans une période où elle avait encore un rôle progressif à jouer. Malgré cela, la question est restée obscure, même dans les travaux ultérieurs de Marx et Engels. Dans le précédent article de cette série, par exemple, nous avons cité l'un des commentaires de Marx sur les mesures économique de la Commune de Paris dans lequel il semble dire que si les coopératives ouvrières centralisaient et planifiaient la production à l'échelle nationale, ce serait alors du communisme. Ailleurs, Marx semble défendre comme une mesure transitoire vers le communisme, l'administration par l'Etat d'opérations typiquement capitalistes telles que le crédit ([3] [330]).
En soulignant ces erreurs, nous n'émettons aucun jugement moral sur nos ancêtres politiques. La clarification de ces questions ne pouvait être réalisée que par le mouvement révolutionnaire du 20e siècle, après des décennies d'expérience douloureuse : la contre-révolution stalinienne en Russie en particulier, et plus généralement, le rôle croissant de l'Etat en tant qu'agent organisateur de la vie économique à l'époque de la décadence capitaliste. La clarification qui s'est opérée aujourd'hui, est entièrement fondée sur la méthode d'analyse élaborée par les fondateurs du marxisme, et sur certains aperçus prophétiques sur le rôle que l'Etat aurait ou pourrait avoir dans l'évolution du capital.
Ce qui a permis aux générations ultérieures de marxistes de corriger certaines des erreurs « capitalistes d'Etat » précédentes, a été, par dessus tout, l’instance de Marx selon laquelle le capital est un rapport social, et ne peut défini d'une manière purement juridique. Tout l'objectif du travail de Marx est de définir le capitalisme comme un système d'exploitation fondé sur le travail salarié, l'extraction et la réalisation de la plus-value. De ce point de vue, cela n'a absolument aucun rapport de savoir si celui qui arrache la plus-value des ouvriers, qui réalise cette valeur sur le marché en vue d'accroître un profit et d'étendre son capital, est un bourgeois individuel, une corporation, ou un Etat national. Alors que le rôle l'économique de l'Etat s'accroissait peu à peu et nourrissait par conséquent les attentes illusoires de certaines parties du mouvement ouvrier, c'est cette rigueur théorique qui permit à Engels de formuler un passage souvent cité dans lequel il souligne que « ni la transformation en sociétés par actions, ni la transformation en propriété d'Etat ne supprime la qualité de capital des forces productives. Pour les sociétés par actions, cela est évident Et l'Etat moderne n'est à son tour que l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions extérieures générales du mode de production capitaliste contre des empiétements venant des ouvriers comme des capitalistes isolés. L'Etat moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble ». ([4] [331])
Parmi les apologues les plus sophistiqués du stalinisme, il y a des courants, habituellement les trotskystes et leur progéniture, qui ont défendu que si on ne pouvait traiter de socialiste le monstrueux cauchemar bureaucratique de l'ancienne URSS et d'autres régimes similaires, on ne pouvait pas non plus les appeler capitalistes car, lorsque existe la nationalisation totale de l'économie (bien qu'en réalité aucun régime stalinien n'ait atteint ce point-là), la production et la force de travail perdent leur caractère marchand. Tout au contraire, Marx était capable d'envisager théoriquement la possibilité d'un pays dans lequel tout le capital social se trouve entre les mains d'un seul agent sans que ce pays cesse d'être capitaliste : « Le capital pourra grossir ici par grandes masses en une seule main, parce que là il s'échappera d'un grand nombre. Dans une branche de production particulière, la centralisation n'aurait atteint sa dernière limite qu'au moment où tous les capitaux qui s'y trouvent engagés ne formeraient plus qu'un seul capital individuel. Dans une société donnée elle n'aurait atteint sa dernière limite qu'au moment où le capital national tout entier ne formerait plus qu'un seul capital entre les mains d'un seul capitaliste ou d'une seule compagnie de capitalistes. » ([5] [332])
Du point de vue du marché mondial, les « nations » ne sont, de toutes façons, rien de plus que des capitalistes ou des compagnies particuliers, et les rapports sociaux en leur sein sont entièrement dictés par les lois globales de l'accumulation capitaliste. Ca ne change pas grand chose si l'achat et la vente ont disparu à l'intérieur de telles ou telles frontières nationales : de tels pays ne sont pas plus des « îles de non capitalisme » dans l'économie capitaliste mondiale, que les kibboutz ne sont des îles de socialisme en Israël.
Ainsi la théorie marxiste contient-elle donc toutes les prémisses nécessaires au rejet de l'identification entre le capitalisme d'Etat et le socialisme. De surcroît, déjà à leur époque, Marx et Engels se sont trouvés confrontés à la nécessité de traiter cette déviation « socialiste d'Etat ».
« Le socialisme allemand »
L'Allemagne n'a jamais traversé de phase de capitalisme libéral : la faiblesse de la bourgeoisie allemande a fait que c'est un puissant Etat bureaucratique dominé par des éléments semi-féodaux qui a veillé sur le développement du capitalisme en Allemagne. Le résultat a été ce qu'Engels a appelé « cette vénération superstitieuse de l'Etat » ([6] [333]) qui était particulièrement forte en Allemagne et a énormément corrompu le mouvement ouvrier dans ce pays. Cette tendance était personnifiée par Ferdinand Lassalle dont la croyance dans la possibilité d'utiliser l'Etat existant par les ouvriers l'a même conduit à faire une alliance avec le régime de Bismarck « contre les capitalistes. » Mais le problème ne se réduisait pas au « socialisme d'Etat bismarckien » de Lassalle. Il y avait, dans le mouvement ouvrier allemand, un courant marxiste dirigé par Liebknecht et Bebel. Mais cette tendance est souvent tombée dans le genre de marxisme qui a amené Marx lui-même à déclarer qu'il n'était pas marxiste : une tendance mécaniste, schématique, et surtout, manquant d'audace révolutionnaire. Le fait même que ce courant s'appelait « social-démocrate », constituait en lui-même un pas en arrière : dans les années 1840, la social-démocratie avait été synonyme du « socialisme réformiste » de la petite-bourgeoisie, et Marx et Engels s'étaient délibérément définis comme communistes pour souligner le caractère prolétarien et révolutionnaire de la politique qu'ils défendaient.
Les faiblesses du courant Liebknecht-Bebel se révélèrent ouvertement en 1875, lorsqu'il fusionna avec le groupe de Lassalle pour former le Parti Ouvrier Social Démocrate (SDAP, plus tard SDP). Le document fondateur du nouveau parti, le Programme de Gotha faisait un certain nombre de concessions totalement inacceptables au Lassallisme. C'est ce qui amena Marx à rédiger la Critique du Programme de Gotha au cours de la même année.
Cette attaque cinglante contre les profondes confusions contenues dans le programme du nouveau parti resta un document « interne » jusqu'à 1891 : jusque là, Marx et Engels avaient eu peur que sa publication ne provoque une scission prématurée dans le SPD. On peut rétrospectivement se poser la question de la sagesse d'une telle décision, mais la logique qui y présidait est assez claire : avec toutes ses erreurs, le SPD était une réelle expression du mouvement prolétarien - il l'a montré en particulier dans la position internationaliste adoptée par Liebknecht et son courant -et même par beaucoup de Lassalliens -durant la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. Plus encore, le développement rapide du parti allemand avait déjà démontré l'importance croissante du mouvement en Allemagne pour l'ensemble de la classe ouvrière internationale. Marx et Engels ont vu la nécessité de mener un combat long et patient contre les erreurs idéologiques du SPD, et ils l'ont fait dans nombre de documents écrits après la Critique. Mais cette lutte était motivée par l'effort de instruire le parti, non de le détruire. C'est là la méthode qui a toujours fondé la lutte de la gauche marxiste contre la montée de l'opportunisme au sein du parti de classe : c'était une lutte pour le parti tant que celui-ci contenait une vie prolétarienne en son sein.
Dans la critique que font Marx et Engels du parti allemand, nous pouvons voir l'esquisse de bien des questions reprises plus tard par leurs successeurs, et qui devaient devenir des questions de vie ou de mort dans les grands événements historiques du début du 20e siècle. Et ce n'est absolument pas par hasard que celles-ci furent toutes centrées autour de la conception marxiste de la révolution prolétarienne, qui a toujours été la question clé qui différenciait les révolutionnaires des réformistes et des utopistes dans le mouvement ouvrier.
Réforme ou révolution
Dans la seconde moitié du 19e siècle, le capitalisme a connu sa plus grande accélération et un développement mondial. Dans ce contexte, la classe ouvrière a été capable d'arracher des concessions significatives à la bourgeoisie, améliorant considérablement les terribles conditions de travail et d'existence qui avaient présidé durant les phases antérieures de la vie du capitalisme (limitation du temps de travail, du travail des enfants, augmentation des salaires réels, etc.). Combiné à cela, il y eut des gains de nature plus politique - le droit de se réunir, de former des syndicats, de participer aux élections, etc. -qui permirent à la classe ouvrière de s'organiser et de s'exprimer dans la bataille pour l'amélioration de sa situation au sein de la société bourgeoise.
Marx et sa tendance ont toujours soutenu la nécessité de cette lutte pour des réformes, rejetant les arguments sectaires d'éléments tels que Proudhon, et, plus tard, Bakounine, qui voyaient ces luttes comme futiles ou comme une diversion par rapport à la voie vers la révolution. Contre de telles idées, Marx a affirmé qu'une classe incapable de défendre ses intérêts les plus immédiats, ne serait jamais capable d'organiser une nouvelle société.
Mais le succès même de la lutte pour des réformes a eu des conséquences négatives - la croissance de courants qui transformèrent cette lutte en une idéologie de réformisme, rejetant ouvertement le but communiste final en faveur de la lutte pour des acquis immédiats, ou bien amalgamant les deux en un mélange confus et déroutant. Marx et Engels peuvent ne pas avoir vu tous les dangers qu'impliquait la croissance de tels courants -c'est-à-dire qu'ils finiraient par attirer la majorité des organisations de la classe ouvrière au service de la bourgeoisie et de son Etat - mais le combat contre le réformisme en tant que type d'idéologie bourgeoise au sein du mouvement prolétarien, combat qui devait ultérieurement occuper les énergies de tant de révolutionnaires tels Lénine et Luxemburg, a certainement sérieusement commencé avec eux.
Ainsi, dans la Critique du Programme de Gotha, Marx souligne que non seulement les revendications immédiates que celui-ci contient (sur l'éducation, le travail des enfants) sont formulées de façon confuse ; mais pire que ça, le parti nouvellement formé ne parvient absolument pas à faire la distinction entre ces revendications immédiates et le but ultime. C'est particulièrement vrai dans l'appel à « des coopératives de production avec l'aide de l'Etat, sous le contrôle démocratique du peuple travailleur » qui serait sensé paver le chemin vers « l'organisation socialiste du travail ». Marx critique sans merci cette panacée du prophète Lassalle : « Au lieu de découler du processus de transformation révolutionnaire de la société, "l'organisation socialiste de l'ensemble du travail résulte" de "l'aide de l'Etat", aide que l'Etat fournit aux coopératives de production que lui-même (et non le travailleur) a "suscitées". Croire qu'on peut construire une société nouvelle au moyen de subventions de l'Etat aussi facilement qu'on construit un nouveau chemin de fer, voilà qui est bien digne de la présomption de Lassalle ! » ([7] [334]).
C'est un avertissement explicite vis-à-vis de ceux qui proclament que l'Etat capitaliste existant peut être d'une quelconque façon utilisé comme instrument de création du socialisme - même s'ils le présentent d'une façon plus sophistiquée qu'elle ne l'est dans le Programme de Gotha.
A la fin des années 1870, les défenseurs du réformisme dans le parti allemand sont devenus encore plus culottés, au point de mettre en question le fait que le parti se présente comme ...une organisation de la classe ouvrière. Dans leur « Circulaire à A. Bebel, W. Liebknecht, W.Bracke » rédigée en Septembre 1879, Marx et Engels portent ce qui constitue probablement l'attaque la plus lucide contre les éléments opportunistes qui infiltraient de plus en plus le mouvement :
« On joue aujourd'hui au social-démocrate, comme on jouait au démocrate bourgeois en 1848. Comme ces derniers considéraient la république démocratique comme quelque chose de très lointain, nos sociaux-démocrates d'aujourd'hui considèrent le renversement de l'ordre capitaliste comme un objectif lointain, et, par conséquent, comme quelque chose qui n'a absolument aucune incidence sur la pratique politique actuelle. On peut donc à coeur joie faire le philanthrope, l'intermédiaire, et couper la poire en deux. Et c'est ce que l'on fait aussi dans la lutte de classe entre prolétariat et bourgeoisie. On la reconnaît sur le papier - de toute façon, il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse d'exister -, mais dans la pratique on la camoufle, on la dilue et on l'édulcore. Le parti social-démocrate ne doit pas être un parti ouvrier ; il ne doit pas s'attirer la haine de la bourgeoisie, aucune autre ; c'est avant tout dans bourgeoisie qu'il faut faire une propagande énergique. Au lieu de s'appesantir sur des objectifs lointains qui, même s'ils ne peuvent être atteints par notre génération, effraient les bourgeois, le parti ferait mieux d'user toute son énergie à des réformes petites-bourgeoises de rafistolage qui vont consolider le vieil ordre social et peuvent éventuellement transformer la catastrophe finale en un processus de dissolution lent, fragmentaire, si possible pacifique. » ([8] [335])
Telles sont les grandes lignes de la critique marxiste envers toutes les variantes ultérieures de réformisme qui devaient avoir un effet désastreux dans les rangs de la classe ouvrière international.
La dictature du prolétariat contre l’« Etat du peuple »
L'incapacité du Programme de Gotha à définir le lien réel entre les phases défensive et offensive du mouvement prolétarien s'exprimait également dans sa totale confusion sur l'Etat. Marx démolit son appel à fonder un « Etat libre et une société socialiste » comme un non-sens, puisque l'Etat et la liberté sont deux principes opposés : « La liberté consiste à transformer l'Etat, organe supérieur de la société, en un organe entièrement subordonné à elle. » ([9] [336]). Dans une société pleinement développée, il n'y aura pas d'Etat. Mais plus important encore est la mise en évidence par Marx que cet appel à un « Etat du peuple » qui devrait se réaliser par l'attribution de réformes « démocratiques » que nombre de pays capitalistes avaient déjà concédées, constituait un moyen d'esquiver la question cruciale de la dictature du prolétariat. C'est dans ce contexte que Marx soulève la question : « Quelle transformation subira l'Etat dans une société communiste ? Autrement dit : quelles fonctions sociales s'y maintiendront-elles qui soient analogues aux fonctions actuelles de l'Etat ? Cette question ne peut avoir de réponse que par la science, et ce n'est pas en accouplant de mille manières le mot Peuple avec le mot Etat qu'on fera avancer le problème d'un saut de puce. Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire de la première en la seconde. A quoi correspond une période de transition politique où l'Etat ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat.
Le programme n'a pas à s'occuper, pour l’instant, de cette dernière, non plus que de la nature de l'Etat futur dans la société communiste » ([10] [337])
Comme nous l'avons vu dans le précédent article de cette série, cette notion de dictature du prolétariat était, en 1875, quelque chose de très réel pour Marx et sa tendance : la Commune de Paris, quatre ans seulement auparavant, avait été le premier épisode vivant de la classe ouvrière au pouvoir, et il avait montré qu'un tel bouleversement politique et social ne pouvait avoir lieu que si les ouvriers renversaient l'appareil d'Etat et le remplaçaient par leurs propres organes de pouvoir. Le Programme de Gotha a démontré que cette leçon n'avait pas été assimilée par le mouvement ouvrier dans son ensemble, et, au fur et à mesure que grandissait le courant réformiste dans le mouvement, elle devait être de plus en plus oubliée.
Dans l'intérêt de l'exactitude historique, il est nécessaire de souligner que Marx et Engels n'avaient pas eux-mêmes pleinement assimilé cette leçon. Dans un discours au Congrès de L'Internationale à La Haye, en septembre 1872, Marx pouvait encore développer que « Il faut tenir compte des institutions, des coutumes et des traditions des différents pays, et nous ne nions pas qu'il y a des pays, comme l'Amérique et l'Angleterre, et si je connaissais mieux ses institutions, la Hollande, où les ouvriers peuvent parvenir à leurs buts par des moyens pacifiques. Ceci étant dit, nous devons reconnaître que dans la plupart des pays du continent, il faudra forcer le levier de la révolution ; le recours à la force sera nécessaire un jour afin d'établir la domination du travail ».
Il faut dire que cette idée était une illusion de la part de Marx - la mesure du poids de l'idéologie démocratique, même sur les éléments les plus avancés du mouvement ouvrier. Dans les années qui suivirent, toutes sortes d'opportunistes devaient se saisir de telles illusions pour donner l'estampille d'approbation de Marx à leurs efforts pour abandonner toute idée de révolution violente et calmer la classe ouvrière avec la croyance qu'elle pourrait se débarrasser, pacifiquement et par des moyens légaux, du capitalisme, en utilisant les organes de la démocratie bourgeoise. Mais la tradition marxiste authentique n'est pas avec eux. Elle est avec les pairs de Pannekoek, Boukharine et Lénine qui ont pris les éléments les plus audacieux et révolutionnaires de la pensée de Marx sur la question, ce qui menait inexorablement à la conclusion que pour établir la domination du travail dans n'importe quel pays, la classe ouvrière devrait utiliser le levier de la force, et, d'abord et avant tout, contre l'appareil d'Etat existant, quelles que soient ses formes démocratiques. De plus, c'est la réalité, l'évolution réelle de l'Etat démocratique, qui leur ont permis de tirer cette conclusion, car, comme le dit Lénine dans L'Etat et la révolution :
«Aujourd'hui en 1917, à l'époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. L'Angleterre comme l'Amérique, les plus grands et les derniers représentants de la "liberté" anglo-saxonne dans le monde entier (absence de militarisme et de bureaucratisme) ont glissé entièrement dans le marais européen, fangeux et sanglant, des institutions militaires et bureaucratiques, qui se subordonnent tout et écrasent de tout leur poids. Maintenant en Angleterre comme en Amérique, la "condition première de toute révolution populaire réelle", c'est la démolition, la destruction de la "machine d'Etat toute prête". » ([11] [338])
La critique du substitutionisme
L'Association internationale des travailleurs (AIT) avait proclamé que « l'émancipation des travailleurs doit être l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ». Bien qu'il ne fût pas possible dans le mouvement ouvrier au 19e siècle de clarifier tous les aspects des rapports entre le prolétariat et sa minorité révolutionnaire, cette affirmation constitue une prémisse de base pour toute clarification ultérieure. Et, dans les polémiques au sein du mouvement après 1871, la fraction marxiste a eu de nombreuses occasions pour pousser la question plus loin que dans l'affirmation générale de l'AIT. En particulier dans le combat contre les véritables éléments réformistes qui infestaient le parti allemand, Marx et Engels étaient amenés à montrer que les visions élitistes et hiérarchiques des rapports entre le parti et la classe provenaient de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise, dont étaient porteurs, en particulier, les intellectuels des classes moyennes qui voyaient le mouvement ouvrier comme le véhicule de leurs propres schémas d'amélioration de la société.
La réponse des marxistes à ce danger n'était pas de se retirer dans l'ouvriérisme, dans l'idée qu'une organisation uniquement composée d'ouvriers industriels serait la meilleure garantie contre la pénétration des idées de la classe ennemie. « C'est un phénomène inévitable et inhérent au cours historique que des individus ayant appartenu jusqu'alors à la classe dominante se rallient au prolétariat en lutte et lui apportent des éléments de formation théorique. C'est ce que nous avons expliqué déjà dans le Manifeste Communiste, cependant, il convient défaire deux observations à ce sujet :
Premièrement : ces gens, pour être utiles au mouvement prolétarien, doivent vraiment lui apporter des éléments de formation d'une valeur réelle, or ce n'est pas du tout le cas de la grande majorité des bourgeois allemands convertis... Deuxièmement : lorsque ces individus venant d'autres classes se rallient au mouvement prolétarien, la première chose qu'il faut exiger d'eux, c'est de n'apporter avec eux aucun vestige de leurs préjugés bourgeois, petits-bourgeois, etc., mais de s'approprier sans réserve les conceptions prolétariennes. Or, ces messieurs ont démontré qu'ils sont enfoncés jusqu'au cou dans les idées bourgeoises et petites-bourgeoises... Nous ne pouvons donc marcher avec des gens qui expriment ouvertement que les ouvriers sont trop incultes pour s'émanciper eux-mêmes et qu'ils doivent donc être libérés d'abord par en haut, par les grands et philanthropes petits bourgeois. » ([12] [339])
L'idée que les ouvriers ne pourraient s'émanciper que grâce à l'action bénévole d'un Etat tout puissant va de pair avec celle d'un parti de « bienfaiteurs » descendus tout droit du ciel pour libérer ces pauvres ouvriers des ténèbres de leur ignorance et de leur servitude. Elles font toutes deux partie du même emballage réformiste socialiste d'Etat que Marx et son courant ont combattu avec tant d'énergie. Il faut dire, cependant, que l'illusion selon laquelle une petite élite pourrait agir au nom de la classe ouvrière ou à sa place, ne se limitait pas à ces éléments réformistes : elle pouvait être également défendue par des courants authentiquement prolétariens et révolutionnaires, et les Blanquistes en étaient l'exemple par excellence. La version blanquiste du substitutionisme était un vestige de la première phase du mouvement révolutionnaire ; dans son Introduction à La guerre civile en France, Engels montre comment l'expérience vivante de la Commune de Paris avait réfuté, dans la pratique, la conception blanquiste de la révolution :
« Elevés à l'école de la conspiration, liés par une stricte discipline qui lui est propre, (les blanquistes) partaient de cette idée qu'un nombre relativement petit d'hommes résolus et bien organisés était capable, le moment venu, non seulement de s'emparer du pouvoir, mais aussi, en déployant une grande énergie et de l'audace, de s'y maintenir assez longtemps pour réussir à entraîner la masse du peuple dans la révolution et à la rassembler autour de la petite troupe directrice. Pour cela, il fallait avant toute autre chose la plus stricte centralisation dictatoriale de tout le pouvoir entre les mains du nouveau gouvernement révolutionnaire. Et que fit la Commune qui, en majorité, se composait précisément de blanquistes ? Dans toutes ses proclamations aux Français de la province, elle les conviait à une libre fédération de toutes les communes françaises avec Paris, à une organisation nationale qui, pour la première fois, devait être effectivement créée par la nation elle-même. Quant à la force répressive du gouvernement naguère centralisé, l'armée, la police politique, la bureaucratie créées par Napoléon en 1798, reprises, depuis, avec reconnaissance par chaque nouveau gouvernement et utilisées par lui contre ses adversaires, c'est justement cette force qui devait partout être renversée, comme elle l'avait été déjà à Paris. » ([13] [340])
Que ce qu'il y avait de meilleur chez les blanquistes ait été obligé d'aller au-delà de leur propre idéologie s'est également confirmé dans les débats au sein de l'organe central de la Commune : lorsqu'un membre important du Conseil de la Commune a voulu suspendre les règles démocratiques de celle-ci et ériger un « Comité de Salut public » dictatorial sur le modèle de la révolution française bourgeoise, un nombre considérable de ceux qui s'y opposèrent étaient des blanquistes - preuve qu'un courant authentiquement prolétarien peut être influencé par le développement du mouvement réel de la classe, chose qui est rarement arrivé dans le cas des réformistes qui représentaient une tendance très matérielle de l'organisation de la classe à tomber entre les mains de son ennemi de classe.
Le contenu économique de la transformation communiste
Bien que le Programme de Gotha parle de « l'abolition du système salarié », sa vision sous-jacente de la société future était celle d'un « socialisme d'Etat ». Nous avons vu qu'il contenait la notion absurde d'un mouvement vers le socialisme au moyen de coopératives ouvrières assistées par l'Etat. Mais même lorsqu'il traite plus directement de la société socialiste future (dans laquelle existe toujours un «Etat libre »...), il est incapable d'aller au-delà de la perspective d'une société essentiellement capitaliste, dirigée par l'Etat au bénéfice de tous. Marx est capable de détecter cela sous le couvert des belles phrases du Programme, en particulier les parties qui parlent de la nécessité que « le travail collectif soit réglementé en communauté avec partage équitable du produit » et « d'abolir le système salarié avec la loi d'airain des salaires ». Ces expressions reflètent la contribution lassallienne à la théorie économique qui était, en fait, un abandon complet de la vision scientifique de Marx qui voit l'origine de la plus-value dans un temps de travail non payé, extrait des ouvriers. Les mots vides du Programme sur la «juste distribution » dissimulent le fait qu'il ne fait en réalité aucun projet pour se débarrasser des mécanismes fondamentaux de la production de valeur qui constitue la source infaillible de toute « injustice » dans la distribution des produits du travail.
Contre ces confusions, Marx affirme que : «Au sein de la société coopératrice, fondée sur la propriété commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits ; de même, le travail employé à des produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce qui se passe dans la société capitaliste, ce n'est plus par la voie d'un détour, mais directement, que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante du travail de la communauté. L'expression : "produit du travail", condamnable, même aujourd'hui, à cause de son ambiguïté, perd ainsi toute signification. » ([14] [341])
Mais plutôt que d'offrir une vision utopique de l'abolition immédiate de toutes les catégories de la production capitaliste, Marx souligne la nécessité de distinguer les phases inférieure et supérieure du communisme : « Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est à une société communiste non pas telle qu'elle s'est développée sur une base qui lui soit propre, mais telle qu'elle vient, au contraire, de sortir de la société capitaliste ; par conséquent, une société qui, sous tous les rapports, économique, moral, intellectuel, porte encore les marques matérielles de l'ancienne société du sein de laquelle elle sort. » ([15] [342])
Dans cette phase, existe encore la pénurie ainsi que tous les vestiges de la « normalité » capitaliste. Au niveau économique, l'ancien système salarié a été remplacé par un système de bons du travail : « le producteur reçoit donc individuellement... l'équivalent exact de ce qu'il a donné à la société. Ce qu'il lui a donné, c'est son quantum individuel de travail... Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni tant de travail (défalcation faite du travail effectué pour le fonds collectif) et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux une quantité d'objets de consommation correspondant à la valeur de son travail. » ([16] [343])
Comme Marx le souligne dans Le Capital, ces bons ne sont plus de l'argent au sens où ils ne peuvent ni circuler, ni être accumulés ; ils ne peuvent qu'« acheter » des articles de consommation individuels. D'une autre côté, ils ne sont pas complètement libérés des principes de l'échange de marchandises : « C'est évidemment ici le même principe que celui qui règle l'échange des marchandises pour autant qu'il est un échange de valeurs égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les conditions étant différentes, nul ne peut rien fournir d'autre que son travail £t que, par ailleurs, rien d'autre que des objets de consommation individuelle ne eut entrer dans la propriété de l'individu. Mais en ce qui concerne le partage de ces objets entre producteurs pris individuellement, le principe directeur est le même que pour l'échange de marchandises équivalentes : un même quantité de travail sous une forme s'échange contre une même quantité de travail sous une autre forme. Le droit égal est donc toujours ici, en principe, le droit bourgeois... » ([17] [344]) parce que, comme l'explique Marx, les ouvriers ont des besoins et des capacités très différents. C'est seulement dans la phase supérieure du communisme, quand « toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'étroit horizon du droit bourgeois pourra être complètement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !» ([18] [345])
Quelle est la cible exacte de cette polémique ? Ce qu'il y a derrière, c'est la conception classique du communisme non comme un « état » qui doit être imposé mais en tant que « mouvement réel qui abolit l'état de choses existant » comme l'a exprimé L'idéologie allemande trente ans auparavant. Marx élabore donc la vision de la dictature du prolétariat comme initiant un mouvement vers le communisme, d'une société communiste émergeant de l'effondrement du capitalisme et de la révolution prolétarienne. Contre la vision socialiste d'Etat selon laquelle la société capitaliste se transforme elle-même, en quelque sorte, en communisme à travers l'action de l'Etat opérant comme employeur unique et bénévole de la société, Marx envisage une dynamique vers le communisme fondée sur une base communiste.
L'idée des bons du travail doit être considérée à cette lumière. Dans le premier exemple, ils sont conçus comme une attaque contre la production de valeur, comme un moyen de se débarrasser de l'argent en tant que marchandise universelle, pour mettre halte à la dynamique de l'accumulation. Ils ne sont pas considérés comme un but, mais comme un moyen vers un but, moyen qui pourrait être immédiatement introduit par la dictature du prolétariat comme première étape d'une société d'abondance qui n'aura plus besoin de mesurer la consommation individuelle en fonction de la production individuelle.
Au sein du mouvement révolutionnaire, il y a eu et continue d'y avoir un débat pour savoir si ce système est le plus approprié pour réaliser ces buts. Pour un certain nombre de raisons, nous dirions qu'il ne l'est pas. Pour commencer, la socialisation « objective » de bien des aspects de la consommation (électricité, gaz, logement, transport, etc.) sera, dans le futur, rendue possible très rapidement par la fourniture gratuite de la plus grande part de ce genre de biens et de services, étant uniquement assujettis au contrôle de l'ensemble des réserves par les ouvriers ; de même, pour beaucoup d'articles de consommation individuels, un système de rationnement contrôlé par les conseils ouvriers aurait l'avantage d'être plus «collectif», moins dominé par les conventions de l'échange de valeur. Nous reviendrons là-dessus et sur d'autres problèmes dans un autre article. Notre préoccupation principale, ici, est de mettre à nu la méthode fondamentale de Marx : pour lui, le système des bons du travail avait une validité comme moyen d'attaquer les fondements du système de travail salarié et c'est par rapport à ce critère qu'il doit être jugé ; en même temps, il en reconnaissait clairement les limites, parce que le communisme intégral ne peut être réalisé en une nuit, mais seulement après « une période de transition plus ou moins longue ». En ce sens, Marx est lui-même le critique le plus sévère du système des bons du travail, insistant sur le fait qu'ils n'échappent pas à « l'étroit horizon du droit bourgeois » et qu'ils incarnent la persistance de la loi de la valeur. Ici, tout faux radicalisme est fatal (et, en fait, conservateur dans la pratique) parce qu'il amènerait le prolétariat à mélanger des moyens temporaires et contingents avec les buts réels. Ceci est, comme nous le verrons, une erreur dans laquelle beaucoup de révolutionnaires sont tombés durant la période de soi-disant communisme de guerre en Russie. Pour Marx, il fallait toujours garder en tête le but final du communisme, sinon le mouvement qui y conduit s'égarerait, et, finalement, serait pris une fois de plus dans l'orbite de la planète Capital.
Le prochain article de cette série examinera le combat de Marx contre la principale version du faux radicalisme à l'époque : le courant anarchiste autour de Bakounine.
CDW.
« Voila ce qui distingue les marxistes des anarchistes : les premiers tout en se proposant de supprimer complètement l'Etat, ne croient la chose réalisable qu'après la suppression des classes par la révolution socialiste, comme résultat de l'instauration du socialisme qui mène à la disparition de l'Etat; les seconds veulent la suppression complète de l'Etat du jour au lendemain, sans comprendre les conditions qui la rendent possible (...) » Lénine, L'Etat et la révolution
chap. 6, Oeuvres choisies II, Ed. Moscou.
[1] [346] Revue Internationale n° 77, 8e partie
[2] [347] Lire l'article de cette série dans la Revue Internationale n° 72
[3] [348] Cf. Le Capital, Volume 3, chapitre XXXVI.
[4] [349] Anti-Dühring, Chapitre 2 : « Notions théoriques », Editions sociales (3e édition), page 315. Engels continue plus loin : « En poussant de plus en plus à la transformation des grands moyens de production socialisés en propriété d'Etat, (le mode de production capitaliste) montre lui-même la voie à suivre pour accomplir ce bouleversement. Le prolétariat s'empare du pouvoir d'Etat et transforme les moyens de production d'abord en propriété d'Etat », ce dont il conclut que « le premier acte dans lequel l'Etat apparaît réellement comme représentant de toute la société, - la prise de possession des moyens de production au nom de la société -, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'Etat. » (ibid., pages 316 et 317). Engels se réfère ici sans aucun doute à l'Etat post-révolutionnaire qui se forme après la destruction du vieil Etat bourgeois. Cependant, l'expérience de la révolution russe a mené le mouvement révolutionnaire à mettre en question cette formulation même : la propriété des moyens de production même par « Etat-Commune » ne conduit pas à la disparition de l'Etat, et peut même contribuer à son renforcement et à sa perpétuation. Mais évidemment Engels ne bénéficiait pas d'une telle expérience.
[5] [350] Le Capital, Chapitre XXV, septième section, Editions La Pléiade, Tome I, page 1139. Bien que Marx utilise ici le terme « société », il ne peut que vouloir dire « pays » et non société capitaliste comme un seul tout : comme il le remarque ailleurs, un capital qui n'affronte pas d'autres capitaux, n'existe pas.
Le capitalisme ne peut exister sans la concurrence entre des unités capitalistes. De plus, l'histoire a montré que l'Etat-nation constitue le niveau le plus élevé d'unité effective que le capital puisse atteindre. Ceci a été confirmé récemment par la désintégration des blocs impérialistes formés en 1945 : une fois que la nation dominante n'est plus capable d'imposer l'unité du bloc, il éclate en différentes unités nationales qui le composent et sont concurrentes.
[6] [351] Introduction à La guerre civile en France, Ed. sociales, page 301.
[7] [352] Editions Spartacus, page 32.
[8] [353] « La social-démocratie allemande », Editions 10 18, page 146.
[9] [354] Critique du Programme de Gotha, Ed. Spartacus, page 33.
[10] [355] Ibid., page 34. Dans le précédent article de cette série, nous faisons référence à l'expérience de la révolution russe qui selon nous a montré la nécessité de faire une distinction entre l'Etat de la période de transition et la dictature du prolétariat, entre l'organe qui émane de la société transitoire et a la tâche de maintenir sa cohésion, et les instruments réels du pouvoir prolétarien (les conseils ouvriers, les comités d'usines, etc.) qui ont la tâche d'initier et de diriger le processus de transformation communiste. A certaines occasions, des groupes du milieu prolétarien ont utilisé ce passage de la Critique du Programme de Gotha (c'est-à-dire que l'Etat ne peut être que la dictature du prolétariat) pour argumenter contre cette distinction qui serait en contradiction avec Marx et le marxisme. En réponse, nous ne pouvons qu'affirmer que le mouvement réel de la classe a clarifié cette question dans la pratique ainsi qu'en théorie ; mais il est également important de comprendre le contexte historique de ce passage qui était une polémique contre ceux qui voulaient laisser l'Etat bourgeois existant tel quel et avaient peur de l'idée même de révolution.
[11] [356] Editions sociales, pages 57-58.
[12] [357] « Circulaire à A. Bebel », idem note 8, pages 147-148-149.
[13] [358] Idem note 6, pages 299-300.
[14] [359] Idem note 9, pages 21 -22.
[15] [360] Idem
[16] [361] Idem
[17] [362] Idem
[18] [363] Idem, page 24.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [143]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 79 - 4e trimestre 1994
- 2787 lectures
Editorial : les grandes puissances répandent le chaos
- 2432 lectures
Jeudi 8 septembre 1994, une semaine après le retrait définitif des troupes russes de la totalité du territoire de l’ex-RDA, le tour était venu aux trois alliés d'hier, Américains, Britanniques et Français d'évacuer Berlin. Quel symbole ! S'il est une ville qui, à elle seule, résume ces 45 années d'affrontements Est-Ouest, ce demi siècle de guerre dite froide, cynique euphémisme d'historien car il n'y a qu'à voir combien furent chauds et sanglants les bras de fer engagés en Corée et au Viêt-nam, c'est bien Berlin. La sinistre page d'histoire des rivalités impérialistes qui avait commencé à s'écrire dès la fin du second conflit mondial entre les Etats-Unis, la défunte URSS et leurs alliés respectifs, et dont l'Allemagne, à travers Berlin, avait constitué un des enjeux principaux, est donc tournée. Pourtant, force est de constater que la fin de cette époque, qui en réalité a débuté dès novembre 1989 avec la chute du mur de Berlin, ne correspond en rien à ce « nouvel ordre mondial » tant promis par tous les dirigeants des grands Etats capitalistes. Les dividendes de la paix se font décidément attendre.
En fait, jamais nous n'avons été aussi éloignés d'un monde fondé sur la concorde entre les Etats et sur la prospérité économique. En revanche, à l'exception peut-être des deux premiers conflits mondiaux, jamais l'humanité n'a eu autant à subir la barbarie, la sauvagerie d'un mode de production décadent, le capitalisme, qui partout se distingue à travers l'éternelle litanie des massacres, des épidémies, des exodes et des destructions.
Bombardements en Bosnie, attentats au Maghreb, massacres au Rwanda, tueries au Yémen, embuscades en Afghanistan, exode à Cuba, famine en Somalie... les contrées du globe épargnées par le chaos se font de plus en plus rares. C'est chaque jour désormais que sur tous les continents habités la liste des pays sombrant dans le désordre le plus total s'allonge.
Cela d'ailleurs, plus personne ne l'ignore. Il faut dire que quotidiennement les médias bourgeois et leurs zélés journalistes aux ordres ne manquent pas de nous montrer, de nous faire lire et entendre jusque dans les moindres détails la façon dont souffrent des millions d'êtres humains de part le monde. C'est, paraît-il, la déontologie de nos informateurs qui l'exige. Les citoyens des pays démocratiques peuvent et surtout doivent savoir. Nous vivons là, soi-disant, les temps modernes du triomphe de l'information objective. En vérité, si les renseignements bourgeois sont toujours bien à même de nous jeter à la figure le film de l'agonie de centaines de milliers d'individus comme au Rwanda, ils en masquent toujours les causes réelles. Constamment ils font passer pour vraies de fausses explications.
Le déchaînement du chaos porte la signature des grandes puissances
Pour ce qui est du dernier massacre en date, celui des populations ruandaises où près de 500 000 personnes ont péri, les interprétations fallacieuses de la bourgeoisie n'ont pas manqué. Tout, à peu près, a été dit au sujet des haines inexpiables qu'entretiennent entre eux les Tutsis et les Hutus et sur leurs différends remontant, paraît-il, à la nuit des temps. Rien n'est plus faux. Les vrais barbares se sont, entre autres, les officiels français, hauts fonctionnaires et diplomates aux discours onctueux, défenseurs acharnés des intérêts de l'impérialisme français dans la région. Car c'est bel et bien la bourgeoisie française qui, des années durant, a équipé militairement les troupes majoritairement hutues de feu le président Habyarimana, les sinistres FAR, responsables des premières tueries et des premiers exodes massifs de populations essentiellement tutsies. Cette orgie meurtrière, les autorités locales l'avaient planifiée ; ça, tous les grands journalistes et autres experts patentés se sont bien gardés de le dévoiler avant ou pendant les massacres. De même, très peu de choses ont filtré quant au soutien massif de la part des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne dont a bénéficié l'autre faction, tout aussi assassine, du FPR majoritairement tutsie. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la France n'ait pas vigoureusement dénoncé cet appui américain au FPR, sans quoi elle n'aurait pas pu se draper dans sa vertueuse défense des Droits de l'Homme dont elle est, à l'en croire, la patrie universellement garante. L'opération Turquoise n'a été que l'alibi humanitaire du criminel Etat français, la défense de ses sordides intérêts impérialistes, son mobile. Toutefois cette intervention n'a pu ni empêcher la poursuite des tueries, tel n'était pas son but, ni, par-dessus tout, empêcher la prise de Kigali par les pro-américains du FPR. Pour Paris, c'est nettement plus fâcheux. Mais qu'à cela ne tienne, les fameuses FAR, réfugiées au Zaïre et manipulées par la France, seront encouragées à harceler, voire à reprendre le pouvoir au FPR.
Ainsi, toute puissance démontre par-là qu'elle est toujours prompte à déchaîner le chaos dans le pré-carré de sa rivale. Afin donc de mieux déstabiliser une position française, les Etats-Unis et l'Angleterre ont sciemment, en aidant le FPR, joué la carte du désordre. Si elle le peut, la bourgeoisie française finira tôt ou tard par leur rendre la monnaie de leur pièce. Le calvaire qu'endure la population ruandaise est donc loin d'être achevé. La guerre, le choléra, la dysenterie ou la famine n'ont pas fini de faire de nouvelles victimes et au bout du compte, de tous ces fléaux, le Rwanda ne se relèvera pas.
A l'aune de cet exemple on comprend mieux la situation en Algérie. Les acteurs, les armes utilisées, les objectifs sont les mêmes. Ici aussi il s'agit pour l'impérialisme américain de déloger la France d'une de ses traditionnelles zones d'influence, le Maghreb. C'est délibérément que les Etats-Unis, par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite qui finance le FIS (Front Islamique du Salut), cherchent à chasser la France de la région. Ainsi, d'attentats en exécutions fomentés par un FIS sponsorisé par Washington, de répression en incarcérations pratiquées par des militaires parrainés par Paris, l'Algérie est en proie aux pires convulsions. Ici aussi on peut imaginer le chemin de croix que représente pour ces populations la prise en tenailles entre le FIS et les militaires. En outre, il y a fort à parier que bientôt toute l'Afrique du Nord connaîtra le même sort. Les enjeux étant de nature identique, comme le reconnaît le géopoliticien Y. Lacoste, dans une interview donnée à la revue L'Histoire n°180: «A la suite de l'Algérie, la Tunisie va sans doute basculer. Et même le Maroc... Aussi allons-nous au-devant d'une période très difficile pour la France. »
Plus proche encore des grandes métropoles industrialisées d'Europe que l'Algérie, il y a l'ex-Yougoslavie où, depuis plus de trois ans déjà, la guerre et l'anarchie règnent en maîtres. Régulièrement pourtant, on n'hésite pas à nous y annoncer l'imminence de la paix. Systématiquement cependant, la réalité se charge de tailler en pièces toutes les calembredaines pacifistes dont nous abreuve la bourgeoisie.
Souvenons-nous. L'hiver dernier, c'est Sarajevo qui était censée retrouver un peu de calme. Messes célébrées, concerts retransmis en mondovision, collectes organisées pour venir en aide aux enfants de cette ville martyre, rien n'avait manqué pour fêter solennellement l'arrêt des combats, consécutif aux bons offices des chancelleries des « grandes démocraties ». Qu'en reste-t-il à présent ? Les bombardements et les tirs des snipers ont repris sur la ville, à tel point que le Pape, Jean-Paul II lui-même, n'a pas pris le risque de vérifier si, en septembre, sa papamobile résisterait à l'épreuve du gros calibre. Il a préféré se rendre à Zagreb, en Croatie. C'est moins dangereux, pour le moment. Pour le moment seulement, car tous les agissements des grandes puissances participent à l'aggravation du conflit. Pour exemple, la récente initiative américaine de constitution d'une fédération croato-bosniaque qui vise à détacher la Croatie de son alliance avec l'Allemagne, risque de porter la confrontation à un niveau plus élevé encore. En effet, la politique de la Maison Blanche, en étant prête à épauler les Croates dans leur entreprise d'annexion de la Krajina, qui est une enclave serbe sur leur territoire, aura pour conséquence l'opposition, à grande échelle cette fois-ci, des Croato-bosniaques aux Serbes. Ici, mais sûrement plus qu'ailleurs étant donné l'importance stratégique des Balkans, comme en Somalie, en Afghanistan ou au Yémen, l'exacerbation des tensions entre les grandes puissances conduit et conduira à la désolation. Certes, encore s'agit-il là de pays sous-développés où le prolétariat, trop faible, ne peut empêcher le déchaînement de la barbarie. Néanmoins, ce qu'il faut constater, c'est qu'autant naguère le capitalisme avait encore les moyens de repousser à la périphérie ce chaos, autant à présent il ne peut empêcher le rapprochement des manifestations de celui-ci des grandes métropoles industrialisées. Les convulsions qui secouent l'Algérie et l'ex-Yougoslavie l'attestent.
De même, ce qui frappe actuellement c'est le nombre de zones géographiques totalement ravagées par la guerre et les fléaux. D'une certaine manière, jusque dans les années soixante-dix, grosso modo, un conflit chassait l'autre. Désormais, comme en Afghanistan, ils se poursuivent sous d'autres formes. Ce phénomène n'est pas un hasard. A l'instar d'un cancéreux parvenu au stade terminal et dans le corps duquel les métastases prolifèrent, le capitalisme de cette fin de siècle est dévoré par les cellules folles de la guerre qu'il ne peut stopper.
Le capitalisme se décompose : seul le prolétariat offre une perspective
Certains ne manqueront pas d'objecter qu'il est certaines régions de la planète où la paix des braves est possible. Il en serait apparemment ainsi en Irlande du Nord où l'IRA semble déposer les armes. Rien n'est plus trompeur. En forçant les extrémistes catholiques du Nord à négocier, les Etats-Unis cherchent à faire pression sur l'Angleterre afin que celle-ci n'ait plus de prétexte à son maintien en Ulster. Pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne n'est plus le docile allié d'hier.
Depuis l'effondrement de l'URSS les divergences d'intérêts impérialistes vont bon train des deux côtés de l'Atlantique, et ce tout particulièrement à propos de l'ex-Yougoslavie. La « pax capitalista » n'est jamais qu'un moment particulier dans le combat que se livrent les Etats. En fait, la décomposition capitaliste a plutôt tendance à affecter de plus en plus certains pays industrialisés. Bien sûr, le niveau des manifestations de celle-ci est encore infiniment moins catastrophique comparé aux pays précédemment cités. Mais tel est pourtant le cas en Italie et ce précisément à cause des rivalités impérialistes qui traversent cet Etat. Si historiquement l'Etat démocratique italien ne s'est jamais distingué par sa stabilité ([1] [364]), cette fragilité s'en trouve aujourd'hui aggravée, du fait des * rivalités qu'opposent en son sein différentes factions qui n'ont pas les mêmes options en matière d'alignements impérialistes. La clique de Berlusconi a plutôt choisi l'alliance américaine, tandis que l'autre, celle qui contrôle la magistrature, penche plutôt en faveur d'une alliance avec la France et l'Allemagne. Cet affrontement qui voit cette dernière faction n'avoir de cesse de dévoiler scandales sur scandales, conduit le pays à une situation de quasi paralysie. Bien évidemment, l'heure n'est pas venue d'un contexte à la ruandaise, où l'on verrait les bourgeois italiens régler leurs comptes à la machette. Non, pour le moment les coups de flingue et les pains de plastic suffisent. Le niveau de développement du pays n'est pas le même, l'histoire non plus, mais surtout et en premier lieu, la classe ouvrière italienne n'est pas prête à se ranger derrière tel ou tel clan bourgeois en présence.
Il en va d'ailleurs ainsi de l'ensemble du prolétariat des pays centraux. Cependant, ce non embrigadement de la seule classe capable d'apporter une perspective à l'humanité n'empêche pas pour autant le capitalisme de littéralement pourrir sur pied. Au contraire, c'est bien cette situation de blocage historique où ni le prolétariat ne peut imposer sa perspective historique immédiatement, c'est-à-dire le renversement du système, et où ni la bourgeoisie ne peut déclencher la guerre mondiale, qui est à l'origine de la phase de décomposition. Toutefois il est certain que si la classe ouvrière ne parvient pas au terme de sa mission historique, tous les scénarios les plus effroyables sont plausibles. De guerres en abominations de toute sortes, l'humanité finirait par être anéantie.
La classe bourgeoise n'a donc strictement rien à présenter face à la faillite de son organisation sociale. Elle ne nous propose que la résignation, l'acceptation de toute cette barbarie au nom de la fatalité, autant dire le suicide.
Car même en la reprise économique mondiale elle ne croit pas. Et pour cause. Elle sait que, même si elle parvient à relancer la production, en se livrant à une nouvelle fuite dans l'endettement (en particulier public), elle ne pourra plus résorber véritablement le chômage ni empêcher de violentes et destructrices explosions financières. La saturation du marché mondial et sa conséquence, à savoir la recherche de débouchés, cette autre guerre, commerciale cette fois, en obligeant tous les Etats et les entreprises à licencier, conduit les capitalistes à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Finalement, comme c'est écrit dans le dernier roman du français J. Attali ce « brillant penseur» bourgeois, ex-conseiller de Mitterrand, ex-président de la BERD et personnage probablement le plus diplômé de France, il n'y a pas d'avenir sinon pour un monde abominable fait de trafics d'organes et où les pères tuent leur fils. Cet ouvrage qui s'intitule « Il viendra », mais il est déjà là, n'est jamais qu'un triste résumé du monde actuel et du néant qu'il nous garantit si le prolétariat ne le renverse pas.
Arkady, 17 septembre 1994[1] [365] Voir à ce sujet dans la Revue internationale n° 76 et 77 la série « Comment est organisée la bourgeoisie ».
Questions théoriques:
- Décomposition [43]
- Guerre [177]
Les commémorations de 1944 : 50 ans de mensonges impérialistes (2e partie)
- 3486 lectures
Dans la première partie de cet article nous nous sommes efforcés de souligner l'ignominie des commémorations du débarquement de 1944, lequel n'a signifié aucune libération « sociale » pour le prolétariat mais un massacre inouï au cours de l'ultime année de la guerre, misère et terreur au cours des années de reconstruction. L'ensemble des camps capitalistes antagonistes a été responsable de la guerre qui s'est terminée par un repartage-dépeçage du monde entre grandes puissances. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises dans cette revue, le prolétariat n'est pas apparu au devant de la scène contrairement à la première guerre mondiale. Les ouvriers de tous les pays sont restés tétanisés par la terreur capitaliste. Mais si la classe ouvrière n'a pu se porter à la hauteur de sa capacité historique, à renverser la bourgeoisie, cela ne signifie pas qu'elle ait «disparu», ni qu'elle ait complètement abandonné sa combativité, ni que ses minorités révolutionnaires soient restées totalement paralysées.
La classe ouvrière est la seule force capable de s'opposer au déchaînement de la barbarie impérialiste comme elle l'a prouvé de manière incontestable au cours de la première guerre mondiale. Aussi, la bourgeoisie ne s'est-elle lancée dans la guerre qu'après avoir réuni les conditions pour l'embrigadement et l'impuissance du prolétariat international. La bourgeoisie démocratique actuelle peut pérorer sur sa libération. Ses prédécesseurs avaient pris avec vigilance toutes les précautions, avant, pendant et après-guerre pour éviter que le prolétariat n'ébranle à nouveau son édifice de barbarie comme en 1917 en Russie et 1918 en Allemagne. Cette expérience de la vague révolutionnaire surgie au cours et contre la guerre avait confirmé que la bourgeoisie n'est justement pas une classe toute-puissante. La lutte de masse du prolétariat qui débouche sur sa phase insurrectionnelle est une bombe sociale mille fois plus paralysante que la bombe atomique préparée par les nazis et achevée sous les auspices des chefs « démocratiques » et staliniens. Tout le déroulement de la seconde guerre mondiale, une fois qu'on cesse de se laisser abuser par le bourrage de crâne dithyrambique sur la chronologie des seules batailles militaires contre le mal hitlérien, révèle que le prolétariat est resté une des préoccupations centrales de la bourgeoisie dans les divers camps antagonistes. Cela ne signifie pas que le prolétariat était en mesure de menacer l'ordre existant comme deux décennies auparavant mais qu'il restait une préoccupation de premier plan de la bourgeoisie dans la mesure, notamment, où elle ne pouvait massacrer complètement cette classe qui produit l'essentiel de la richesse de la société. Il fallait détruire sa conscience. Il fallait faire perdre aux ouvriers l'idée même qu'ils existent comme corps social antagonique aux intérêts de la « nation », faire oublier aux ouvriers qu'unis massivement ils sont en mesure de changer le cours de l'histoire.
Comme nous le rappellerons brièvement ici, à chaque fois que le prolétariat a menacé de se redresser et tenté de s'affirmer comme classe, l'Union sacrée des impérialistes s'est rétablie par-delà les lignes de bataille. La bourgeoisie nazie, démocratique ou stalinienne, a réagi implicitement, sans concertation même souvent, pour préserver l'ordre social capitaliste. Les défenses immunitaires de l'ordre social réactionnaire surgissent naturellement. De cette longue défaite, de cette capacité de la bourgeoisie décadente à défendre son ordre de terreur, le prolétariat ne peut pas ne pas tirer les enseignements un demi-siècle plus tard.
1. L'avant-guerre
La guerre de 1939-45 n'a été possible que parce que le prolétariat, dans les années 1930, n'avait plus la force suffisante pour empêcher le conflit mondial, qu'il avait perdu la conscience de son identité de classe. C'était le résultat de trois étapes d'annihilation de la menace prolétarienne :
- l'épuisement de la grande vague révolutionnaire de l'après 1917, close avec le triomphe du stalinisme et de la théorie du « socialisme dans un seul pays » adoptée par l'Internationale communiste ;
- la liquidation des convulsions sociales dans le centre décisif où se jouait l'alternative capitalisme ou socialisme : en Allemagne, principalement sous la houlette de la Social-démocratie elle-même, le nazisme ne venant que parachever le travail pour imposer aux prolétaires une terreur sans précédent ;
- le dévoiement total du mouvement ouvrier dans les pays démocratiques sous le masque de la « liberté face au fascisme », avec l'idéologie des «fronts populaires » qui servit à paralyser plus subtilement les ouvriers des pays industrialisés que « l'union nationale » de 1914.
En Europe, cette formule des «fronts populaires » n'était que l'anticipation du Front National des PC et autres partis de gauche au cours de la guerre. Les prolétaires des pays développés étaient mis en condition pour ployer derrière l'antifascisme ou derrière le fascisme, idéologies symétriques les soumettant à la défense de « l'intérêt national », c'est-à-dire à l'impérialisme de leurs bourgeoisies respectives. Dans les années 1930, les ouvriers allemands n'étaient pas les « victimes du Traité de Versailles », comme leur clamaient leurs gouvernants, mais de la même crise qui frappait leurs frères de classe du monde entier. Les ouvriers d'Europe de l'ouest et des Etats-Unis n'étaient pas plus victimes d'Hitler, seul «fauteur de guerre » devant l'éternel, que de leur propre bourgeoisie « démocratique » soucieuse de la défense de ses sordides intérêts impérialistes. En 1936, les mystifications sur l'antifascisme et la « défense de la démocratie » se caractérisent par le bourrage de crâne pour pousser les ouvriers à prendre partie entre les fractions rivales de la bourgeoisie : fascisme/antifascisme, droite/gauche, Franco/République. Dans la plupart des pays européens, ce sont des gouvernements de gauche ou des partis de gauche « en opposition » et avec l'appui idéologique de la Russie stalinienne, qui génèrent l'idéologie des « Fronts Populaires », qui, comme leur nom l'indique, ont servi à convaincre les ouvriers d'accepter - à travers cette nouvelle version de l'alliance des classes ennemies - des sacrifices inimaginables.
La guerre d'Espagne a été la répétition générale de la guerre mondiale par la confrontation des différents impérialismes qui se sont logés derrière chacune des fractions de la bourgeoisie espagnole. Elle a surtout été le laboratoire de ces «fronts populaires » permettant la concrétisation et la désignation de « l'ennemi » contre qui on appelait les ouvriers d'Europe occidentale à se mobiliser derrière leur bourgeoisie : le fascisme. Les centaines de milliers d'ouvriers espagnols massacrés ont été une « preuve » de la nécessité de la « guerre démocratique », mieux que l'assassinat d'un archiduc à Sarajevo 20 ans auparavant.
La bourgeoisie n'a pu faire la guerre qu'en trompant les prolétaires, en leur faisant croire que c'était aussi leur guerre :
« C'est l'arrêt de la lutte de classe, ou plus exactement la destruction de la puissance de classe du prolétariat, la destruction de sa conscience, la déviation de ses luttes, que la bourgeoisie parvient à opérer par l'entremise de ses agents dans le prolétariat, en vidant ses luttes de leur contenu révolutionnaire et les engageant sur les rails du réformisme et du nationalisme, qui est la condition ultime et décisive de l'éclatement de la guerre impérialiste. » ([1] [366])
En fait, instruite par l'expérience de la vague révolutionnaire qui a débuté au cours même de la première guerre mondiale, la bourgeoisie, avant que de se lancer dans la seconde guerre mondiale, s'est assurée d'un écrasement complet du prolétariat, une soumission sans commune mesure avec celle qui avait permis le déclenchement de la « Grande Guerre ».
En particulier, il faut constater que, concernant l'avant-garde politique du prolétariat, plus nettement qu'en 1914, l'opportunisme a clairement triomphé dans les partis ouvriers plusieurs années avant le début du conflit, transformant ces derniers en des agences de l'Etat bourgeois. En 1914, dans la plupart des pays, il existe encore des courants révolutionnaires dans les partis de la 2e internationale. Par exemple les bolcheviks russes ou les spartakistes allemands étaient membres des partis social-démocrates et ont mené la lutte au sein de ces partis. Lorsque la guerre éclate, les partis social-démocrates ne sont pas en totalité aux ordres de la bourgeoisie. En leur sein continue à se manifester une vie prolétarienne qui va brandir le flambeau de l'internationalisme prolétarien, particulièrement aux conférences de Zimmerwald et Kienthal. En revanche, les partis se réclamant de la 3e Internationale ont fini dans le giron bourgeois au cours des années 1930, bien avant le début de la guerre mondiale pour laquelle ils vont servir de zélés sergents-recruteurs. Et ils pourront même bénéficier du renfort des organisations trotskistes qui passent à ce moment-là, avec armes et bagages, dans le camp de la bourgeoisie en embrassant la cause d'un des camps impérialiste contre l'autre (au nom de la défense de l'URSS, de l'anti-fascisme et autres thèmes crapuleux). Enfin, l'éclatement, l'extrême isolement des minorités révolutionnaires qui maintiennent, elles, les positions de principe contre la guerre confirment l'ampleur de la défaite subie par le prolétariat.
Atomisés, émiettés politiquement du fait de la trahison des partis qui parlaient en leur nom et de la quasi inexistence de leur avant-garde communiste, les prolétaires, ont donc réagi par la débandade généralisée au moment du déclenchement de la guerre.
2. Pendant la guerre
Comme lors du premier conflit mondial, il faut que s'écoulent au moins deux ou trois années avant que la classe ouvrière, assommée par l'entrée en guerre, ne puisse retrouver le chemin de ses combats. Malgré les conditions épouvantables de la guerre mondiale, et en particulier de la terreur qu'elle faisait régner, la classe ouvrière se montre toutefois capable de lutter sur son terrain. Cependant, du fait de la terrible défaite subie préalablement à la guerre, la plupart de ses combats n'auront pas une envergure susceptible de tracer à moyen terme la voie vers la révolution, ni pour inquiéter sérieusement les bourgeoisies en lice. La plupart des mouvements sont dispersés, coupés des leçons des luttes antérieures et surtout pas encore armés par une réelle réflexion sur les raisons de l'échec de la vague révolutionnaire internationale qui avait débuté en Russie, en 1917.
Dans les pires conditions donc, les ouvriers se montrent capables de relever la tête dans la plupart des pays belligérants, mais la censure et le matraquage des ondes sont omniprésents quand la presse n'a pas disparu. Dans les usines bombardées, dans les camps de prisonniers, dans les quartiers, les ouvriers tendent naturellement à retrouver leurs méthodes classiques de protestation. En France, par exemple, dès la seconde moitié de 1941 on compte des dizaines de grèves pour des revendications de salaires et de temps de travail. Il existe une propension des ouvriers à tourner le dos à toute participation à la guerre (bien que le pays soit à moitié occupé) : « le sentiment de classe restait plus fort que tout devoir national.» ([2] [367]) La grève des mineurs du Pas-de-Calais est significative à cet égard. Ils font porter aux seuls patrons français la responsabilité de l'aggravation des conditions de travail, n'obéissant pas encore aux mots d'ordre des staliniens en faveur de la « lutte patriotique ». La description de cette grève est saisissante :
« La grève du 7 de Dourges a éclaté comme éclatent les grèves dans toutes les fosses, depuis qu'elles existent. Le mécontentement règne. On en a assez. Pas plus en 1941 qu'en 1936 ou en 1902, les mineurs n'ont consulté le registre des lois. Ils ne se sont pas préoccupés s'il y avait des compagnies assistées de l'infanterie de ligne ou un gouvernement de Front populaire en puissance, ou des hitlériens prêts à les déporter. Au fond du puits, ils se sont consultés, ils se sont mis d'accord. Ils ont crié "Vive la grève" et ils ont chanté la gorge serrée, les larmes aux yeux, des larmes de joie, les larmes de la réussite. » ([3] [368]) Le mouvement s'étendra pendant plusieurs jours, laissant la soldatesque allemande impuissante, entraînant plus de 70 000 mineurs. Le mouvement sera sévèrement réprimé ([4] [369]).
L'année 1942 connaît d'autres luttes ouvrières, certaines avec des manifestations de rues. L'instauration de la « relève » (travail obligatoire en Allemagne), entraînera même des grèves avec occupation, avant que PCF et trotskistes ne dévient ce combat vers la lutte nationaliste. Il faut noter, cependant, que ces grèves et manifestations demeurent limitées au plan économique, face au rationnement de la nourriture et du ravitaillement. Le mois de janvier, dans le Borinage, en Belgique, a été marqué par toute une série de grèves et de mouvements de protestation dans les charbonnages. En juin, éclate une grève à la fabrique Nationale de Herstal et on voit des manifestations de ménagères devant l'Hôtel de Ville de Liège. Face à l'annonce de la déportation obligatoire de milliers de travailleurs à l'hiver 1942, 10 000 ouvriers se mettent en grève encore une fois à Liège, et le mouvement en entraînera 20 000 autres. A la même époque, grève de travailleurs italiens en Allemagne dans une grande fabrique d'avions. Début 1943, en Allemagne, à Essen, grève des ouvriers étrangers, français entre autres.
Le prolétariat n'est pas en mesure de s'élever dans une lutte frontale contre la guerre, c'est-à-dire contre sa propre bourgeoisie, au niveau des ouvriers russes de 1917. Restant à ce stade, la lutte revendicative qui ne se généralise pas peut être une protestation contre les patrons et les syndicats briseurs de grèves, mais tout en permettant la poursuite plus effective de la guerre par le gouvernement, lorsque les patrons accordent des hausses de salaires (aux USA et en Angleterre par exemple). Là réside le danger que vienne se greffer l'idéologie nationaliste de la Libération. Bien avant l'instauration en France du « travail obligatoire » (qui a été du pain béni pour l'Union Nationale en 1942-43), la bourgeoisie britannique disposa d'un fanatique partisan du travail obligatoire avec le PC britannique devenu hystérique après l'attaque de l'Allemagne contre la Russie au milieu de l'année 1941. Dès lors, de concert avec les trotskistes à travers les syndicats, il ne fut plus question de faire grève mais de développer la production visant à favoriser l'effort de guerre pour soutenir le bastion (l'impérialisme) russe. ([5] [370])
Malgré l'extrême faiblesse du prolétariat, la poursuite de la guerre mondiale joue néanmoins contre la bourgeoisie. Ainsi on peut mesurer la crue des journées de grève en Angleterre. Autant la période de déclaration de guerre montre un brutal freinage, autant dès 1941 le nombre de grèves va s'accroître jusqu'en 1944, puis décroître après la « Victoire».
Faisant le bilan de cette période de guerre, le groupe de la Gauche Communiste de France ne niera pas l'importance de ces grèves et les aura soutenues dans leurs objectifs immédiats, mais il ne « se leurre pas sur leur portée encore limitée et contingente. » ([6] [371]) Face à cet ensemble de grèves relativement dispersées et sans liaisons la plupart du temps, du fait du règne de la censure militariste, la bourgeoisie mondiale s'est toujours efforcée d'éviter leur radicalisation, faisant souvent des concessions économiques mineures, tant du côté allemand que du côté des alliés, et en ayant recours toujours au syndicalisme qui, sous ses diverses formes, était et reste un instrument de l'Etat bourgeois. Les relations sociales ne pouvaient rester longtemps pacifiques dans la guerre d'autant que l'inflation s'était aggravée.
La gravité terrible de la situation permet de comprendre pourquoi les minorités révolutionnaires espéraient la révolution plus qu'elle n'était contenue dans le véritable rapport de forces entre les classes. L'Europe entière vivait « au ras des rutabagas », seuls les travailleurs qui effectuaient de quinze à vingt heures supplémentaires par semaine étaient en mesure d'acheter des produits alimentaires dont le prix avait décuplé en trois ans. Dans une telle situation de priva tions et de haine doublée d'impuissance face aux internements et déportations, l'éclatement de la lutte massive de près de deux millions d'ouvriers italiens en mars 1943, d'une durée de plusieurs mois, plus encore que cette série des grèves qui se vérifie au niveau international, vient alerter la bourgeoisie mondiale, sonner l'heure de la préparation du mensonge de la Libération comme seule issue possible à la guerre.
Il ne s'agit pas de surestimer la portée de ce mouvement, mais de mesurer que face à cette action autonome du prolétariat italien sur son terrain de classe, la bourgeoisie italienne a pris immédiatement ses propres mesures, et a été aidée en cela par l'ensemble de la bourgeoisie mondiale, confirmant sa vigilance de l'avant-guerre.
Fin mars, 50 000 ouvriers de Turin se mettent en grève pour l'obtention d'une prime « de bombardement », pour l'augmentation des rations de vivres sans se soucier de ce qu'en pensera Mussolini. Leur rapide victoire encourage l'action de classe dans toute l'Italie du nord contre le travail de nuit dans les régions menacées de bombardements. Ce mouvement triomphe à son tour. Les concessions ne calment pas la classe ouvrière, de nouvelles grèves surgissent accompagnées de manifestations contre la guerre. La bourgeoisie italienne prend peur et tourne casaque en 24 heures. Mais la bourgeoisie alliée veille et occupe l'Italie du Sud à l'automne. Cette résurgence du prolétariat doit être contrée en replâtrant l'Union nationale sur une base royaliste et démocratique. Victor-Emmanuel sort de dessous la table pour faire arrêter Mussolini, avec la complicité des vieilles barbes fascistes Grandi et Ciano, soudainement converties à l'anti-fascisme. Malgré tout, les manifestations de masse continuent à se répandre à Turin, Milan, Bologne. Les cheminots organisent des grèves imposantes. Face à l'ampleur de ce mouvement, l'intérimaire gouvernemental Badoglio finit par s'enfuir en Sicile pour laisser Mussolini -libéré par Hitler -revenir assumer la répression avec les nazis et le consentement tacite de Churchill. La soldatesque allemande bombarde sauvagement les villes ouvrières. Churchill qui a déclaré qu'il faut « laisser les italiens mijoter dans leur jus », affirme ne vouloir traiter qu'avec un gouvernement de l'ordre. Il n'est pas question que la classe ouvrière apparaisse comme libératrice (d'autant qu'elle est capable d'aller plus loin pour son propre compte), les Alliés anglo-saxons veulent changer les pantins et tirer les ficelles eux-mêmes. Après la terrible répression et le gonflement concomitant des rangs de la résistance bourgeoise des partisans, les Alliés pourront avancer depuis le sud pour « libérer » le nord et réinstaller Badoglio ([7] [372]). Comme en France face au travail obligatoire, la bourgeoisie réussira à embrigader les ouvriers italiens battus sur leur terrain de classe dans l'idéologie de l'Union Nationale jusqu'à la dite Libération, sévèrement contrôlée par les milices staliniennes et la mafia.
Ce magnifique mouvement débuté en mars 1943 n'est pas un accident ou une rareté dans l'horreur de l'holocauste universel. Au cours de cette même année 1943, comme nous venons de le souligner, existait une timide vague de reprise des luttes au niveau international, sur laquelle nous ne disposons évidemment que de maigres informations. Quelques exemples : grève à l'usine Coqueril de Liège ; 3500 ouvriers en lutte à l'usine d'aviation de la Clyde et grève des mineurs près de Doncaster en Angleterre (mai 1943) ; grève des ouvriers étrangers à l'usine Messerschmidt en Allemagne ; grève à AEG, un importante usine près de Berlin où, pour protester contre une mauvaise cantine, des ouvriers hollandais entraînent des ouvriers belges, français mais aussi allemands dans la lutte ; grèves à Athènes et manifestations de ménagères ; 2000 ouvrières sont en grève en Ecosse en décembre 1943...
La grève massive des ouvriers italiens est restée cloisonnée en Italie, puis la résistance a dénaturé son sens. Cependant, le massacre est là aussi un aboutissement de l'échec ouvrier en pleine guerre : quand le prolétariat se laisse enfermer dans l'ornière nationaliste, il est férocement décimé. C'est une tactique constante de la bourgeoisie de faire régner la terreur après de telles tentatives. Et cette terreur est nécessaire à la bourgeoisie car elle n'a pas terminé la guerre et elle veut avoir les mains libres jusqu'à la fin de celle-ci, notamment sur d'autres théâtres d'opération qu'en Europe.
En Europe de l'Est, partout où risquaient de surgir des soulèvements ouvriers même sans perspective révolutionnaires, la bourgeoisie pratique la politique préventive de la terre brûlée.
A Varsovie, durant l'été 1944, les ouvriers sont restés contrôlés par le PS polonais depuis Londres. Ils participent à l'insurrection lancée par la« Résistance » lorsqu'ils apprennent que « l'Armée rouge » est entrée dans les faubourgs de la capitale, de l'autre côté de la Vistule. Et c'est avec le consentement tacite des Alliés, tout comme c'est avec la passivité évidente de l'Etat stalinien que l'Etat allemand a pu assurer son rôle de gendarme et de boucher, massacrant des dizaines de milliers d'ouvriers, rasant la ville. Huit jours plus tard Varsovie est un cimetière. Ensuite c'est au tour de Budapest où l'armée « rouge » laisse accomplir aussi le massacre puis fait son entrée comme une armée de fossoyeurs.
Pour sa part, la bourgeoisie « libératrice » d'occident ne veut pas de risques d'explosions sociales anti-guerres dans les pays vaincus. Pour ce faire, elle procède à des bombardements monstrueux sur les villes allemandes, des bombardements qui n'ont pas, la plupart du temps, d'intérêt militaire mais qui visent en priorité les quartiers ouvriers (à Dresde en février 1945, il y a près de 150 000 morts, plus du double qu'à Hiroshima). Il s'agit d'exterminer le plus possible de prolétaires et de terroriser les survivants pour qu'ils ne s'avisent pas de renouer avec leurs combats révolutionnaires de 1918 à 1923. De même, la bourgeoisie « démocratique » se donne les moyens d'occuper systématiquement les territoires d'où les nazis ont dû se replier. Il n'est pas question de laisser l'Allemagne vaincue se doter de son propre gouvernement succédant aux hitlériens. Toutes les offres de négociations ou d'Armistice par les opposants à Hitler ont été rejetées. Laisser se former un gouvernement allemand autochtone dans un pays « vaincu » aurait empêché de dormir les Churchill, Roosevelt et Staline, cela aurait constitué un risque majeur. Comme en 1918, un Etat allemand vaincu ne pouvait qu'être affaibli face à la classe ouvrière, révoltée par le meurtre massif et la misère noire, et aux soldats en débandade. Les armées alliées se chargeront de faire régner l'ordre elles-mêmes dans toute l'Allemagne pour une durée indéterminée (et restant sur place finalement jusqu'en 1994, mais pour d'autres raisons), en faisant peser pour longtemps un des plus grossiers mensonges du siècle : la «culpabilité collective» du peuple allemand.
3. Vers la « Libération »
Dans les tous derniers mois de Ma guerre, l'Allemagne est marquée par une série d'émeutes, de désertions, de grèves. Mais nul besoin de potiche démocratique à la Badoglio dans l'enfer des bombardements. Terrorisée, la classe ouvrière allemande est prise entre le marteau et l'enclume, entre les armées alliées et la soldatesque russe qui va déferler. Tout au long de la route de la débâcle de l'armée allemande les déserteurs sont pendus pour dissuader les autres. La situation aurait pu devenir inquiétante si la bourgeoisie n'avait pas continué à baliser le terrain de misère pour l'immédiat après-guerre. La répression féroce sera suffisante et la paix sociale préservée par l'occupation et la partition sans vergogne de l'Allemagne. Même s'ils pouvaient à juste titre se réjouir des réactions du prolétariat en Allemagne, nos camarades de cette époque surestimaient ce à quoi la bourgeoisie savait avoir affaire :
« Quand les soldats refusent de se battre, frisent en plusieurs endroits la guerre civile, quand les marins manifestent les armes à la main contre la guerre, quand les ménagères, la Volksturm, les réfugiés viennent augmenter la nervosité de la situation allemande, la plus formidable machine militaire et policière se casse et la révolte est en perspective immédiate. Von Rundstedt reprend la politique de Ebert en 1918, il espère par la paix éviter la guerre civile. Les alliés, eux, ont compris la menace révolutionnaire des événements italiens commencés en 1943. La paix maintenant c'est se trouver face à la crise qui sévit en Europe le plus intensément, sans armes, pour masquer les contradictions qui vont se solutionner par la guerre de classe. L’effort de guerre, la peste brune, la caserne, ne pourront plus servir de prétexte soit pour alimenter les industries hypertrophiées, soit pour continuer à tenir la classe ouvrière dans l'état d'esclavage et de famine actuels. Mais, fait encore plus grave, c'est la perspective du retour des soldats allemands dans leurs foyers détruits et de la répétition de la révolution de 1918 qui devient inévitable (...) Aux grands maux, des moyens héroïques : détruire, tuer, affamer, anéantir la classe ouvrière allemande. Nous sommes loin de la peste brune et de son châtiment, nous sommes très loin des promesses de paix des capitalistes. La démocratie a prouvé qu'elle était plus apte à défendre les intérêts bourgeois que la dictature fasciste. » ([8] [373])
En réalité, dans les pays vaincus, dont l'Allemagne, on assiste à la ruée des armées américaines et russes qui jamais ne laissent un no man's land dans les villes conquises et étouffent toute velléité de résistance prolétarienne. Dans les pays vainqueurs se déploie un chauvinisme incroyable, bien pire que lors de la première guerre mondiale. Comme le supputait la minorité révolutionnaire, craignant la contagion des soldats allemands démobilisés dont certains ne cachent pas leur joie, sourient sur les vieux films et jettent leurs casquettes en l'air, la bourgeoisie démocratique décide de les interner en France et en Angleterre. Une partie de l'armée allemande désintégrée est retenue à l'étranger; 400 000 soldats, maintenus prisonniers, sont amenés et internés en Angleterre plusieurs années après la fin de la guerre pour éviter que, comme leurs pères, ils ne fomentent une révolution une fois de retour au pays dans la misère européenne de l'immédiat après-guerre. ([9] [374])
La plupart des groupes révolutionnaires se sont enthousiasmés au vu de ces faits, plaquant le schéma de la révolution victorieuse en Russie par l'éruption du prolétariat contre la guerre. Or, de même qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, de même les conditions de 1917 ne pouvaient pas se reproduire parce que la bourgeoisie en avait tiré les leçons.
Après le formidable mouvement des ouvriers d'Italie, en 1943, il faudra près de deux ans à la minorité révolutionnaire la plus claire pour tirer les leçons de cet échec des ouvriers, au niveau international, pour mettre à profit une nouvelle fois des conditions drastiques de la guerre mondiale pour s'orienter vers la révolution : la bourgeoisie a su garder l'initiative et a profité de l'absence de partis révolutionnaires.
« Enrichi par l'expérience de la première guerre, incomparablement mieux préparé à l'éventualité de la menace révolutionnaire, le capitalisme international a réagi solidairement avec une extrême habileté et prudence contre un prolétariat décapité de son avant-garde. A partir de 1943, la guerre se transforme en guerre civile. En l'affirmant nous n'entendons pas dire que les antagonismes inter-impérialistes ont disparu, ou qu'ils ont cessé d'agir dans la poursuite de la guerre. Ces antagonismes subsistaient et ne faisaient que s'amplifier, mais dans une mesure moindre et acquérant un caractère secondaire, en comparaison de la gravité présentée pour le monde capitaliste par la menace d'une explosion révolutionnaire. La menace révolutionnaire sera le centre des soucis et des préoccupations du capitalisme dans les deux blocs : c'est elle qui déterminera en premier lieu le cours des opérations militaires, leur stratégie et le sens de leur déroulement. (...) A l'encontre de la première guerre impérialiste, où le prolétariat une fois engagé dans le cours de la révolution garde l'initiative et impose au capitalisme mondial l'arrêt de la guerre, dans cette guerre-ci, dès le premier signal de la révolution en Italie, en 1943, c'est le capitalisme qui se saisira de l'initiative et poursuivra implacablement une guerre civile contre le prolétariat, empêchera par la force toute concentration de forces prolétariennes, n'arrêtera pas la guerre, même quand, après la disparition du gouvernement d'Hitler, l'Allemagne demandera avec insistance l'Armistice, afin de s'assurer par un carnage monstre et un massacre préventif impitoyable, contre toute velléité de menace de révolution du prolétariat allemand (...) La révolte des ouvriers et des soldats, qui, dans certaines villes, se sont rendus maîtres des fascistes, a forcé les alliés à précipiter leur marche et à finir cette guerre d'extermination avant le plan prévu. » ([10] [375])
L'action des minorités révolutionnaires
La guerre n'a pu se produire, comme nous l'avons vu, que parce que le processus de dégénérescence de la 3e Internationale et de passage dans le camp bourgeois des partis communistes était achevé. Les minorités révolutionnaires qui ont combattu la montée du stalinisme et du fascisme du point de vue de classe ont toutes été vaincues, épuisées dans les pays démocratiques, éliminées et déportées en Russie et en Allemagne. De l'unité mondiale que représentent les Internationales à chaque époque, il ne reste plus que des bribes, des fractions, des minorités dispersées et souvent sans lien entre elles. Le mouvement de l'Opposition de gauche avec Trotsky qui a représenté un courant de combat contre la dégénérescence de la révolution en Russie s'est peu à peu enferré dans les positions opportunistes sur le Front Unique (possibilité d'alliance avec les partis de gauche de la bourgeoisie) et dans son successeur 1'« anti-fascisme ». Si Trotsky meurt, assassiné comme Jaurès (parce qu'il symbolise aux yeux de la bourgeoisie mondiale le danger prolétarien plus encore que le grand tribun de la 2e Internationale), au début du second holocauste mondial, ses partisans ne valent guère mieux que les sociaux-chauvins du début du siècle puisqu'ils prennent parti pour un camp impérialiste : celui de la Russie et celui de la Résistance.
La plupart des minorités, fragiles esquifs dans le désarroi du prolétariat, avaient éclaté au moment de la guerre. Seule la Fraction italienne autour de la revue Bilan annonçait depuis les années 1930 que le mouvement ouvrier était entré dans une période de défaites qui conduirait à la guerre. ([11] [376])
Le passage à la clandestinité entraîna tout d'abord l'éparpillement, la perte des précieux contacts bâtis pendant des années. En Italie, il ne subsiste aucun groupe organisé. En France, ce n'est qu'en 1942, en pleine guerre impérialiste, que se regroupent des militants ayant combattu dans la Fraction italienne réfugiée dans ce pays, et qui avaient délimité des positions politiques de classe face à l'opportunisme des organisations trotskistes. Il se dénomme Noyau français de la Gauche communiste. Ces courageux militants produisent une déclaration de principes qui rejette très nettement la « défense de l'URSS»:
« L'Etat soviétique, instrument de la bourgeoisie internationale, exerce une fonction contre-révolutionnaire. La défense de l'URSS au nom de ce qu'il reste des conquêtes d'Octobre doit donc être rejetée et faire place à la lutte sans compromis contre les agents staliniens de la bourgeoisie (...) La démocratie et le fascisme sont deux aspects de la dictature de la bourgeoisie qui correspondent aux besoins économiques et politiques de la bourgeoisie à des moments donnés. En conséquence la classe ouvrière qui doit instaurer sa propre dictature après avoir brisé l'Etat capitaliste, n'a pas à prendre parti pour l'une ou l'autre de ces formes. »
Des contacts sont rétablis avec les éléments du courant révolutionnaire en Belgique, en Hollande et avec des révolutionnaires autrichiens réfugiés en France. Dans les conditions très dangereuses de la clandestinité, à partir de Marseille, des débats très importants seront menés sur les raisons du nouvel échec du mouvement ouvrier, sur la nouvelle délimitation des «frontières de classe ». Cette minorité révolutionnaire ne cessera pas d'intervenir pour autant contre la guerre capitaliste, pour l'émancipation du prolétariat, en totale continuité avec le combat de la 3e Internationale à son origine. D'autres groupes émergeront plus ou moins clairement du giron trotskiste en refusant également la défense de l'URSS impérialiste et contre tous les chauvinismes : le groupe espagnol de Munis, les Revolutionare Kommunisten Deutschlands d'Autriche, et des groupes conseillistes hollandais. Les tracts de ces groupes contre la guerre, diffusés clandestinement, posés sur les banquettes de trains, sont vilipendés par la bourgeoisie « résistante », des staliniens aux démocrates, comme « hitléro-troskystes ». Ceux qui les diffusent risquent d'être fusillés sur place (voir les documents publiés ci-dessous et leur présentation).
En Italie, à la suite du puissant mouvement de lutte de 1943, les éléments de la Gauche dispersés se regroupent autour de Damen puis, ultérieurement autour de la figure mythique de Bordiga, personnalité de la gauche des 2e et 3e Internationale. Ils constituent, en juillet 1943, le Partito comunista internazionalista mais, croyant comme la plupart des révolutionnaires à une poussée insurrectionnelle de la classe ouvrière, ils subiront la Libération capitaliste et, malgré leur courage, éprouveront de grandes difficultés à défendre des positions claires face aux ouvriers entraînés derrière les sirènes bourgeoises ([12] [377]). Ils se montreront incapables de favoriser le regroupement des révolutionnaires au niveau international et se retrouveront à l'état d'infime minorité après guerre. En particulier, ils se refuseront à tout travail sérieux avec le noyau français qui se nomme désormais Gauche Communiste de France ([13] [378]).
En fait, malgré tout leur courage, les groupes révolutionnaires qui ont défendu des positions de classe, internationalistes, au cours de la seconde guerre mondiale, ne pouvaient pas influencer le cours des événements, compte tenu de la terrible défaite qu'avait subi le prolétariat et de la capacité de la bourgeoisie à prendre systématiquement les devants pour empêcher le développement de tout mouvement de classe vraiment menaçant. Mais leur contribution au combat historique du prolétariat, ne pouvait en rester là. Elle passait principalement par une réflexion permettant de tirer les enseignements des événements considérables qui venaient de se dérouler, une réflexion qu'il s'agit de poursuivre jusqu'à aujourd'hui.
Quels enseignements pour les révolutionnaires ?
C'est respecter la tradition marxiste portée par ces groupes du passé qu'être capable de continuer avec leur méthode critique, de passer au crible nous-mêmes leurs erreurs. C'est cela rester fidèle au combat qu'ils ont mené. Si la Gauche Communiste de France a su corriger son erreur d'appréciation sur la possibilité d'une inversion du cours de défaite au cours de la guerre mondiale, sans forcément tirer toutes les implications du fait que celle-ci ne favorise plus la révolution, les autres groupes, en Italie en particulier, ont maintenu la vision schématique du « défaitisme révolutionnaire ».
Constituant de manière volontariste et aventuriste un parti en Italie autour des personnalités de l'IC comme Bordiga et Damen, les révolutionnaires italiens ne se donnaient pas réellement les moyens de « restaurer les principes », encore moins de tirer les véritables enseignements de l'expérience passée. Ce Parti Communiste Internationaliste devait non seulement faillir - se retrouvant rapidement à l'état de secte - mais favoriser le rejet de la méthode d'analyse marxiste par un dogmatisme stérile qui ne fait que répéter les schémas du passé sur la question de la guerre en particulier. Le PCI persiste à la Libération à croire en l'ouverture d'un cycle révolutionnaire en parodiant Lénine : « La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile commence après la fin de la guerre » ([14] [379]). Reprendre l'analyse de Lénine selon lequel chaque prolétariat devait souhaiter « la défaite de sa propre bourgeoisie » tremplin pour la révolution -position déjà erronée à l'époque puisqu'elle induisait que les ouvriers des pays vainqueurs, eux, n'auraient pas disposé de ce même tremplin -, faire reposer la réussite de la révolution sur l'échec de sa propre bourgeoisie, relevaient d'un automatisme abstrait. En réalité, déjà dans la première vague révolutionnaire elle-même, la guerre, après avoir été un ferment de premier ordre dans la mobilisation du prolétariat, avait conduit à une division de celui-ci entre les ouvriers des pays vaincus, les plus combatifs et les plus lucides, et ceux des pays vainqueurs sur qui la bourgeoisie réussit à faire peser l'euphorie de la « victoire » pour paralyser leur combat et leur prise de conscience. En outre, l'expérience des années 1917-18, avait aussi fait la preuve que, face à un mouvement révolutionnaire qui se développe à partir de la guerre mondiale, la bourgeoisie dispose toujours d'une carte, qu'elle ne s'est pas privée déjouer en novembre 1918, alors que se développait la révolution en Allemagne : mettre un terme à la guerre, c'est-à-dire supprimer le principal aliment de l'action et de la prise de conscience du prolétariat.
En leur temps, nos camarades de la Gauche communiste s'étaient trompés lorsqu'ils avaient, en se basant sur le seul exemple de la révolution russe, sous-estimé les conséquences paralysantes de la guerre impérialiste mondiale pour le prolétariat. La seconde guerre mondiale se devait d'apporter les éléments pour une meilleure analyse de cette question cruciale. Aussi, répéter aujourd'hui les erreurs du passé, c'est entraver le véritable chemin vers les affrontements de classe : en s'avérant impuissant à enrichir la méthode marxiste, en s'interdisant d'être le guide dont le prolétariat a besoin comme le révèlent malheureusement ceux qui se prétendent les seuls héritiers de la Gauche Communiste Italienne. ([15] [380])
La question de la guerre a toujours été une question de premier plan dans le mouvement ouvrier. En même temps que l'exploitation et les attaques découlant de la crise économique, la guerre impérialiste moderne reste un facteur majeur de prise de conscience de la nécessité de la révolution. Il est évident que la permanence des guerres dans la phase de décadence du capitalisme doit être un précieux facteur de réflexion. Aujourd'hui que l'effondrement du diabolisé bloc de l'Est a momentanément repoussé la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale, cette réflexion ne doit pas s'arrêter. Les guerres que nous connaissons aux frontières de l'Europe sont là pour rappeler au prolétariat que « celui qui oublie la guerre la subira un jour » ([16] [381]). Il reste de la plus haute responsabilité du prolétariat de s'ériger contre cette société en décomposition. La perspective d'une autre société sous le contrôle du prolétariat passe nécessairement par la prise de conscience qu'il doit lutter sur son terrain social et y trouver sa puissance. La lutte du prolétariat croissante est une lutte antinomique à l'Etat, et donc antinomique aux objectifs militaires de la bourgeoisie.
Malgré les chants dithyrambiques sur le « nouvel ordre mondial » instaurés en 1989, la classe ouvrière des pays industrialisés ne doit se faire aucune illusion sur le répit qui lui est promis en attendant la prochaine destruction de l'humanité. Un sort que le capital, pour sa part, nous promet de façon inéluctable, qu'il découle d'une troisième guerre mondiale, au cas où se reconstituerait un nouveau système de blocs impérialistes, ou d'un total pourrissement de la société accompagné de famines, d'épidémies et d'une multiplication des conflits guerriers dans lesquels les armes nucléaires, qui aujourd'hui se propagent partout, reprendraient du service.
L'alternative reste bien ou révolution communiste ou destruction de l'humanité. Unis et déterminés les prolétaires peuvent désarmer la minorité qui tire les ficelles, et même les bombes atomiques seront frappées d'obsolescence. Ainsi, nous devons combattre fermement l'argument pacifiste bourgeois, qui n'a pas changé, selon lequel une telle technique moderne empêcherait désormais toute révolution prolétarienne. La technique est produite par les hommes, elle obéit à une politique déterminée. La conduite de la politique impérialiste reste étroitement déterminée, comme nous le démontre le déroulement de la deuxième guerre mondiale, par la soumission de la classe ouvrière. Or, désormais, depuis la reprise historique du prolétariat, à la fin des années 1960, les enjeux sont posés simultanément, même si le prolétariat mondial n'en tire pas encore toutes les leçons. Là où la guerre ne fait pas ses ravages, la crise économique s'appesantit, décuple la misère et révèle la faillite du capitalisme.
Les minorités révolutionnaires doivent ainsi passer au crible l'expérience antérieure. Il était « minuit dans le siècle » au coeur du plus grand crime que l'humanité ait connu, mais il serait plus criminel encore de croire que l'humanité en a fini avec ses risques de destruction totale. Dénoncer les guerres actuelles n'est pas suffisant, les minorités révolutionnaires doivent être capable d'analyser les arcanes de la politique impérialiste de la bourgeoisie mondiale, non pour prétendre pouvoir mettre le feu à la mèche là où le militarisme règne en maître, dans tous les foyers guerriers qui dévastent le monde aujourd'hui, mais pour indiquer au prolétariat que la lutte, beaucoup plus qu' « au front » se mène « à l'arrière ».
Combattre la guerre impérialiste omniprésente, lutter contre les attaques de la crise économique bourgeoise, signifie développer toute une série de luttes et d'expériences qui conduiront à l'étape de la guerre civile révolutionnaire, là où la bourgeoisie se croit en paix. Une longue période de combats de classe est encore nécessaire, rien ne sera facile.
Le prolétariat n'a pas le choix. Le capitalisme ne peut que mener à la destruction de l'humanité si le prolétariat s'avérait une nouvelle fois impuissant à le détruire.
Damien
[1] [382] Rapport sur la situation internationale de la conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France, Revue Internationale n° 59.
[2] [383] Grégoire Madjarian, « Conflits, pouvoirs et société à la Libération», et aussi intéressant, l'ouvrage de Stéphane Courtois «Le PCF dans la guerre».
[3] [384] Mémoires d'Auguste Lecoeur, ex-bras droit du chef stalinien français Thorez, exclu après-guerre, et donc plus libre d'exprimer la vérité de la lutte que lorsqu'il mentait avec les autres sur la primauté de la lutte nationaliste.
[4] [385] Par la force des choses, ce mouvement était prématuré et isolé, il ne pouvait avoir l'effet de résonance de la lutte massive des ouvriers italiens en 1943. Il faut noter cependant la différence entre l'occupation craintive de la soldatesque allemande (les officiers n'osent jamais descendre dans les fosses) et la dictature exercée par le PCF à la Libération sur les mineurs. Une émission de télévision de la 3e chaine française, au mois d'août, offrit des révélations stupéfiantes de la part de quelques mineurs survivants de la # bataille de la production ». Valets du pouvoir gaulliste, les ministres staliniens exigèrent un effort considérable au point que ce fut une véritable hécatombe... après-guerre. Des milliers de leurs compagnons, morts de silicose, du fait de la mécanisation et des cadences à outrance, furent donc les martyrs, non pas des <r boches » ni de la lutte <r anti-boche », mais des ordres du ministre stalinien Thorez. Pour le «r redressement du pays », Thorez n'avait pas hésité à vociférer : « Si des mineurs doivent mourir à la tâche, leurs femmes les remplaceront ». Il n'y a pas qu'en Russie totalitaire que l'espérance de vie était de très courte durée...
[5] [386] « Anti-Parliamentary communism, The movement for Workers'Councils, 1917-45 », Mark Shipway.
[6] [387] Rapport sur la situation internationale, juillet 1945.
[7] [388] Nous traitons de ce mouvement de 1943 en Italie dans la Revue Internationale n° 75.
[8] [389] « La Paix », L'Etincelle n° 5, organe de la Gauche Communiste de France, mai 1945.
[9] [390] « La rééducation des prisonniers allemands en Angleterre, de 1945 à 1948», Henry Faulk, ed Chatto & Windus, Londres 1977.
[10] [391] Extraits du Rapport sur la situation internationale, Gauche Communiste de France, juillet 1945, reproduit in Revue Internationale n° 59, 1989.
[11] [392] Nous n'avons pas la place\de
revenir en détail ici sur les débats dans la Fraction italienne ni sur les divergences
entre les différents groupes, mais nous tenons à la disposition de nos
lecteurs l'histoire de La Gauche Communiste d'Italie.
[12] [393] Voir les articles : « Les ambiguïtés de Battagîia Comunista sur la question des "partisans" », Revue internationale n°8, déc. 1976, « Le PCI à ses origines : tel qu'il prétend être, tel qu'il est », Revue internationale n° 32, 1er trim. 1983 et « A propos des origines du PCI », Revue internationale n° 34, 3e trim. 1983..
[13] [394] Sur l'histoire de ces groupes, consulter La Gauche communiste d'Italie, et la Revue internationale n° 34, 35, 38, 39, 64, 65, 66.
[14] [395] Cité dans Internationalisme n° 36, 1948, reprint m Revue Internationale n° 36, 1er trim. 1984.
[15] [396] Au moment de la guerre du Golfe nous avons démontré quel mauvais usage les courants qui se réclament de la Gauche italienne pouvaient encore faire du « défaitisme révolutionnaire » avec leur appel « à la fraternisation entre soldats irakiens et occidentaux » (voir notre article « Le milieu politique prolétarien face à la guerre du Golfe », Revue Internationale n° 64, 1er trim. 1991). Dans une zone et des conditions où le prolétariat est extrêmement faible lancer en l'air de tels mots d'ordre relève du volontarisme anarchiste ne pouvant au mieux que valoriser des désertions individuelles. Ces camarades devraient se demander pourquoi la bourgeoisie a les moyens de mener des guerres locales sans être inquiétée par le prolétariat et pourquoi elle n'a pas les moyens de les déclencher au coeur des métropoles industrialisées. Pire encore, ces mots d'ordre, repris en gros par toutes les sectes gauchistes, ne sont souvent que la feuille de vigne du soutien à l'impérialisme des petits pays opprimés par les gros. Ainsi, dernièrement, le n° 427 du Prolétaire titrait benoîtement avec pour mot d'ordre : « Impérialisme français hors d’Afrique et du Rwanda ! ». Que l'impérialisme français soit un boucher dans sa résistance au coup de pied au derrière que lui inflige l'impérialisme américain, portant même la plus lourde responsabilité dans le massacre de plus de 500 000 êtres humains au Rwanda, nous sommes les premiers à le dénoncer. Mais nous aurions honte de reprendre le mot d'ordre que s'approprie l'impérialisme américain ! Un tel mot d'ordre a certainement pour le PCI une consonance très « défaitiste » et alors ? L'impérialisme français est effectivement défait au Rwanda, en quoi cela a-t-il fait avancer d'un pas la conscience de classe des ouvriers en France ?
[16] [397] Albert Camus.
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [323]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [84]
Questions théoriques:
- Impérialisme [178]
Documents : la gauche communiste de France en 1944
- 3165 lectures
Présentation
Nous publions ci-après un tract de la Fraction française de la Gauche Communiste qui a été collé sur les murs de Paris en août 1944 pour s'opposer à l'ordre de mobilisation générale lancé par les F.F.I. le 18 août.
Nous publions également l'article paru en première page de L'Etincelle, journal du même groupe, paru en août 1944.
La Fraction française de la Gauche Communiste s'est créée à Marseille au début de cette même année.
C'est autour de la Fraction Italienne de la Gauche Communiste ([1] [398]) reconstituée à Marseille que s'est développé en 1942 un noyau d'une dizaine d'éléments français : certains venaient de rompre d'avec le trotskisme et d'autres, encore jeunes, se rapprochaient des positions politiques révolutionnaires.
Un peu d'histoire
La Gauche Communiste italienne (GCI) est bien connue de nos lecteurs. Cependant, en quelques lignes, il nous faut rappeler que la Gauche italienne a une longue tradition politique, théorique, et de lutte dans le mouvement ouvrier italien et international. Son existence remonte à quelques années avant la première guerre mondiale (au combat des jeunes du Parti Socialiste Italien (PSI) contre la guerre coloniale en Tripolitaine ([2] [399]), 1910-1912), la GCI est le principal acteur de la création à Livourne du Parti communiste italien en 1921. Dans le milieu des années 1920, elle maintient toujours des positions révolutionnaires contre l'Internationale communiste en dégénérescence et se bat en son sein jusqu'en 1928, date de son exclusion définitive, ainsi que de celle d'autres courants de Gauche comme l'Opposition de Gauche russe avec Trotsky lui-même. Enfin, à l'arrivée du fascisme en Italie, nombre de ses membres se trouvent en prison ou relégués dans les îles de la mer Tyrrhénienne. Dès lors, c'est dans l'émigration en France et en Belgique que la Gauche italienne continue son combat politique et internationaliste, d'abord dans l'Opposition de Gauche Internationale, qui n'est pas encore trotskiste, puis presque seule après son exclusion de cette dernière.
Dans les années 1930, la vague révolutionnaire est bien terminée, la révolution russe est restée isolée et définitivement vaincue, la classe ouvrière est battue ; et, plus les années passent, plus les révolutionnaires se retrouvent seuls et de plus en plus éloignés de leur classe : la classe ouvrière. « Il est minuit dans le siècle » selon les paroles de Victor Serge, mais la volonté communiste de la Gauche italienne ne faiblit pas ; elle maintiendra pendant toute cette période les principes communistes et internationalistes. C'est la seule organisation révolutionnaire qui comprend que le cours historique n'est plus favorable à la classe ouvrière et que le cours est ouvert à la guerre impérialiste mondiale. Cette compréhension de la situation politique lui permet de saisir que la guerre d'Espagne en 1936, comme la guerre d'Ethiopie ou en Mandchourie n’est que des préludes à la future guerre impérialiste généralisée. Elle défend alors l'idée que le prolétariat est battu et que la période n'est pas encore à la formation de nouveaux partis révolutionnaires. Dès lors son rôle, en tant que fraction d'un futur parti communiste, est de maintenir les « principes communistes » et de préparer « les cadres révolutionnaires » du futur parti qui naîtra avec le resurgissement du prolétariat dans une autre période historique.
Le début de la deuxième guerre a fini par avoir raison de la Gauche italienne et par disperser ses membres. Elle disparaît en août 1939 à la déclaration de guerre, le Bureau International de Bruxelles se dissout.
Mais des éléments rescapés de la « gauche italienne » se regroupent à Marseille et décident de continuer le combat pour l'internationalisme prolétarien ; ils dénoncent seuls et à contre-courant la guerre impérialiste. Ils appellent les prolétaires de tous les pays d'Europe à se battre contre tous les Etats capitalistes : démocratiques, fascistes, staliniens. ([3] [400])
Une surestimation de la période historique
Quand se développe de puissants mouvements de grèves en Italie en 1943, à Turin, Milan, etc. ([4] [401]), c'est enfin (!) une nouvelle perspective qui s'ouvre aux yeux de ces révolutionnaires. Ils estiment que le cours historique qui entraînait la classe ouvrière de défaites en défaites s'est enfin inversé. « Après 3 années de guerre, l'Allemagne et par là, l'Europe présente les premiers signes de faiblesses... On peut dire que les conditions objectives ouvrent l'ère de la révolution. » (Projet de résolution sur les perspectives et les tâches de la période transitoire, conférence de juillet 1943). ([5] [402])
Les événements insurrectionnels qui viennent de se produire en Italie sont très importants, mais la bourgeoisie veille ; elle ne fera pas les mêmes erreurs qu'elle a commises à la fin de la première guerre mondiale et qui ont conduit à la révolution en Russie et en Allemagne.
Les révolutionnaires eux commettent une double erreur :
- ils sous-estiment la bourgeoisie (cf. article ci dessus), ils estiment que de la guerre impérialiste sortira la révolution prolétarienne comme en 1871, 1905 et surtout 1917;
- ils sous-estiment la défaite subie par la classe ouvrière qui a été battue idéologiquement à la fin des années 1920, puis physiquement pour enfin être écrasée et assassinée dans la guerre impérialiste.
Les documents que nous reproduisons ci-dessous montrent cette surestimation : les slogans appellent les ouvriers à ne pas marcher derrière la Résistance, mais à organiser leurs « Comités d'action » pour suivre l'exemple des ouvriers italiens.
Après la trahison des partis communistes et des groupes trotskistes passés avec « armes et bagages » dans un camp impérialiste : celui des « démocraties » et du stalinisme, ils sont, et c'est leur immense mérite, l'expression de la classe ouvrière et la seule flamme révolutionnaire et internationaliste dans l'hystérie nationaliste, chauvine et revancharde de la « Libération ». C'est contre le courant et contre l'union nationale retrouvée : de la droite aux trotskistes en passant par les staliniens, que ces ouvriers et ces apatrides de la Gauche Communiste de France vont coller et diffuser leurs tracts et leurs journaux.
Il fallait un courage fou pour s'opposer à tous et appeler les ouvriers à déserter l'encadrement des « partisans », et passer entre les filets de la Gestapo, de la police de Vichy, des réseaux gaullistes et des « tueurs » staliniens.
RX.
TRACTS :
OUVRIERS!
Les troupes anglo-américaines viennent remplacer le GENDARME ALLEMAND dans l'oeuvre de répression de la classe ouvrière et de sa réintégration dans la guerre impérialiste.
La RESISTANCE vous pousse à l'insurrection, mais sous sa direction et pour des buts capitalistes.
Le PARTI COMMUNISTE abandonnant la cause du prolétariat a sombré dans le patriotisme funeste à la classe ouvrière.
- Ne répondez pas à l'insurrection qui se fera avec votre sang pour le plus grand bien du capitalisme international.
- Agissez en tant que prolétaires et non en tant que Français revanchards.
- Refusez d'être réintégrés dans la guerre impérialiste.
OUVRIERS!
- Organisez vos comités d'action et quand les conditions le permettront, vous suivrez l'exemple des ouvriers italiens.
Plus que jamais votre arme demeure LA LUTTE DE CLASSE sans considération de frontières et de nations.
Plus que jamais votre place n'est à côté, ni du fascisme, ni de la démocratie bourgeoise.
Plus que jamais le capitalisme ANGLO-AMERICAIN, RUSSE ET ALLEMAND SONT LES EXPLOITEURS DE LA CLASSE OUVRIERE.
La grève qui s'est déclenchée a été provoquée par LA BOURGEOISIE et pour SES INTERETS.
Demain pour lutter contre le chômage qu'elle ne peut résoudre, vous serez MOBILISES ET ENVOYES SUR LE FRONT IMPERIALISTE.
LE CAPITALISME INTERNATIONAL NE PEUT PLUS VIVRE QUE DANS LA GUERRE.
LES ARMEES ANGLO-AMERICAINES VOUS LE FERONT COMPRENDRE COMME VOUS L'A FAIT SENTIR L'ARMEE ALLEMANDE !
VOUS NE SORTIREZ DE LA GUERRE IMPERIALISTE QUE PAR LA GUERRE CI VILE !
PROLETARIAT CONTRE CAPITALISME !
GAUCHE COMMUNISTE FRANÇAISE
Août 1944
L'Etincelle
FRACTION FRANÇAISE GAUCHE COMMUNISTE
Août 1944.
« Le monde va changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tout ! »
Ouvriers,
Après 5 ans de guerre, avec sa longue suite de misère, de morts et de carnage, la bourgeoisie faiblit sous les coups d'une crise qui ouvre les portes de la guerre civile. L'Europe demain sera un vaste champ en éruption où les armées contre-révolutionnaires anglaises, américaines et russes, implacablement, essayeront d'étouffer les mouvements révolutionnaires de la classe ouvrière.
La tâche de répression entre les belligérants est déjà répartie. L'Italie, vaste champ d'expérience, a enseigné au capitalisme le danger de laisser subsister sur les chemins de la guerre des concentrations ouvrières susceptibles toujours de réapparaître comme classe indépendante, comme les ouvriers italiens l'ont prouvé.
Voilà pourquoi depuis deux ans l'Allemagne vous entrepose dans ses immenses usines où, côte à côte, les prolétaires européens s'échinent et se crèvent à fabriquer des armes pour la guerre impérialiste. Voilà pourquoi depuis deux ans les patriotards à la solde du capitalisme vous poussent vers le maquis pour vous faire perdre votre conscience de classe en vous transformant en revanchards. Tous les centres industriels importants de la France sont vides de plus en plus pour amoindrir les risques de la guerre civile et permettre la réduction des foyers révolutionnaires qui jailliront de cette guerre.
Le drainage de toutes les énergies ouvrières s'est fait dans l'esprit politique de vous affaiblir dans votre conscience et de vous parquer comme des animaux pour vous fouetter et vous abattre dès vos premiers murmures.
La guerre actuellement ne se joue pas entre les impérialistes belligérants, mais entre le capitalisme conscient de sa volonté de demeurer au pouvoir malgré l'impossibilité que l'Histoire lui impose et le prolétariat aveuglé par la démagogie qui jaillira spontanément des cadres du système bourgeois.
Les armes démagogiques et répressives du capitalisme sont déjà à pied d'oeuvre.
Au camp de concentration, au maquis, à l'exploitation forcenée de tous les ouvriers en Allemagne viennent s'ajouter les bombardements des villes, surtout là où des mouvements de grèves éclatent, comme à Milan, à Naples, à Marseille. Par radio, la tromperie bourgeoise emprunte une tenue et un langage qui s'auréole de la Révolution d'Octobre, et qui depuis 1933, date de la mort de l'Internationale Communiste, vous a conduit de défaites en défaites à la guerre impérialiste.
L'Armée Rouge, usurpatrice d'un nom qui s'est couvert de gloire parce qu'elle fut une armée ouvrière luttant révolutionnairement pour la dictature du prolétariat viendra continuer l'oeuvre de mort du fascisme, avec ses étiquettes de Soviets pour déguiser sous une unanimité à coups de crosse, l'exploitation capitaliste.
De Gaulle, « ce négrier », comme l'appelaient avant 1941 les staliniens dans une accolade anglo-américaine et russe vous étouffera sous l'habit kaki de votre nouvelle mobilisation.
L'Europe est mûre pour la guerre civile, le capitalisme est prêt à réagir pour vous conduire vers la guerre impérialiste.
Ouvriers, chaque arme du capitalisme contient en elle une arme dangereuse pour lui.
A la réduction des foyers révolutionnaires, la situation répond par une concentration plus dense de la classe ouvrière dans un point névralgique du capitalisme.
A la politique patriotarde, la solidarité prolétarienne s'est créée dans les usines allemandes et se fortifiera par la nécessité inéluctable pour les ouvriers de se défendre en tant qu'ouvriers dans une Europe livrée demain à la famine et au chômage.
La crise qui déferlera au lendemain de la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile n'épargnera pas les armées impérialistes des soubresauts sociaux de leurs arrières, ainsi que de la contamination révolutionnaire venant des insurrections du prolétariat européen qu'elles auront à mater. La cause du prolétariat français est irrémédiablement soudée à la cause du prolétariat européen après quatre années de centralisation et de concentration économique. Les ennemis les plus dangereux pour la classe ouvrière européenne et mondiale sont les capitalismes anglo-américain et russe qui n'entendent pas se laisser déposséder.
Ouvriers, quel que soit le nom que vous donnerez à vos organismes unitaires, l'exemple des Soviets russes de la Révolution d'Octobre 1917 doit vous enseigner le chemin, sans compromis ni opportunisme, du pouvoir.
Ni la démocratie, ni le stalinisme avec leur démagogie de « Pain, Paix et Liberté » ne pourront vous libérer de l'oppression et de la famine qui pointent, dans un monde où le capitalisme ne peut apporter que la guerre.
La société est dans une impasse infranchissable sans la Révolution prolétarienne.
Le premier pas à faire, c'est de briser d'avec la guerre impérialiste par une claire conscience de classe qui proclame avant tout la lutte de classe partout et toujours. La crise dans la bourgeoisie mondiale, qui s'est ouverte en Italie et en Allemagne, forge les conditions et les armes favorables à la guerre civile, début spontané de la Révolution.
Ouvriers ! Brisez d'avec toute anglofolie, americanofolie et russofolie,
Rejetez tout patriotisme dont le capitalisme lui même ne sait que faire,
Proclamez votre solidarité de classe et organisez la pour pouvoir résister victorieusement le jour de la Révolution,
Coupez court d'avec tous les partis traîtres à la cause ouvrière qui vous ont conduits à cette guerre impérialiste et qui tentent de vous y faire rester. Le gaullisme, la social-démocratie, le stalinisme, le trotskisme, voilà les paravents derrière lesquels l'ennemi de classe tentera de pénétrer dans vos rangs pour vous abattre.
Ouvriers ! Le salut ne peut venir que de vous parce que l'Histoire vous a donné toutes les possibilités de comprendre votre mission historique et les armes pour les accomplir.
En avant pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile !
Les ouvriers italiens vous ont montré la voie, à vous de répondre coup pour coup à la contre-révolution qui se camoufle dans vos rangs !
La F.F.G.C.
Evènements historiques:
- Deuxième guerre mondiale [323]
Courants politiques:
- Gauche Communiste [84]
Questions théoriques:
- Impérialisme [178]
Polémique avec Prometeo - Communist Review : la conception du B.I.P.R.de la decadence du capitalisme
- 4712 lectures
La guerre impérialiste est-elle une solution à la crise des cycles d'accumulation du capitalisme ?
Le futur Parti communiste mondial, la nouvelle Internationale, se construira sur des positions politiques qui dépasseront les erreurs, les insuffisances ou les questions non résolues, de l'ancien parti, l'Internationale communiste. Pour cette raison, il est vital de poursuivre le débat des organisations qui se réclament de la Gauche communiste. Parmi ces positions, nous considérons comme fondamentale la notion de la décadence du capitalisme. Nous avons montré, dans les numéros précédents de la Revue Internationale, comment l'ignorance de cette notion par le courant bordiguiste conduisait à des aberrations théoriques sur la question de la guerre impérialiste, et amenait à un désarmement politique de la classe ouvrière ([1] [408]).
Nous abordons dans cet article les positions du Partito Comunista Internazionalista et de la Communist Workers'Organisation, qui forment ensemble le Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR) ([2] [409]), organisations qui fondent quant à elles clairement la nécessité de la révolution communiste sur l'analyse que le capitalisme, depuis la 2e guerre mondiale, est entré dans sa phase de décadence.
Cependant, tout en se distinguant ainsi des groupes bordiguistes, aussi bien BC que la CWO défendent toute une série d'analyses qui impliquent, à notre avis, une relativisation ou même un rejet de la notion de décadence du capitalisme.
Dans cet article, nous examinerons une
série d'arguments que défendent ces organisations sur le rôle des guerres
mondiales et sur la nature de l'impérialisme, qui, selon nous, les empêchent de
défendre au fond et jusqu'au bout, dans toutes ses implications, la position
communiste sur la décadence du capitalisme.
La
nature de la guerre impérialiste
Le BIPR explique la guerre impérialiste généralisée, un phénoméne essentiel du capitalisme décadent de la manière suivante : « Et de la même façon qu'au 19e siécle les crises du capitalisme conduisaient à la dévaluation du capital existant (par le biais des faillites), ouvrant ainsi un nouveau cycle d'accumulation fondé sur la concentration et la fusion, au 20e siécle, les crises de l'impérialisme mondial ne peuvent plus se résoudre que par une dévaluation plus grande encore du capital existant, par la faillite économique de pays entiers. Telle est précisément la fonction économique de la guerre mondiale. Comme cela s'est produit en 1914 et en 1939, c'est la "solution" inexorable de l'impérialisme à la crise de l'économie mondiale. » ([3] [410]).
Cette vision de la «fonction économique de la guerre mondiale », «faillite économique de pays entiers », par analogie avec les faillites du siécle dernier, revient en fait à concevoir la guerre mondiale comme le moyen que trouve le capitalisme pour relancer un « nouveau cycle d'accumulation », ce qui signifie attribuer à la guerre mondiale une rationalité économique.
Les guerres du siècle passé avaient cette rationalité : elles permettaient, dans le cas des guerres nationales (comme les guerres italiennes ou la guerre franco-prussienne) de constituer de grandes unités nationales qui signifiaient une avancée réelle dans le développement du capitalisme, et, dans le cas des guerres coloniales, une extension des rapports de production capitalistes aux régions les plus éloignées du globe, contribuant à la formation du marché mondial.
Il ne se passe pas la même chose au 20e siécle, dans la période de décadence du capitalisme. La guerre impérialiste n'a pas une rationalité économique. Si la «fonction économique » de la guerre mondiale consistant en la destruction de capital peut sembler analogue à ce qui se passait au siécle dernier, ce n'est qu'une apparence. Comme le pressent confusément le BIPR en accolant des guillemets au mot « solution », la fonction de la guerre est radicalement différente au 20e siécle. Elle n'est précisément pas une solution face à une crise cyclique « ouvrant ainsi un nouveau cycle d'accumulation », mais elle est la manifestation la plus aigue de la crise permanente du capitalisme, elle exprime la tendance au chaos et à la désintégration qui s'est emparée du capitalisme mondial, et elle est de plus un accélérateur puissant de cette tendance.
Les
80 dernières années ont confirmé pleinement cette analyse. Les guerres impérialistes
sont l'expression la plus achevée de l'engrenage infernal du chaos et de la
désintégration dans lequel est enfermé le capitalisme dans sa période de décadence.
Il ne s'agit plus d'un cycle passant d'une phase d'expansion à une phase de
crise, de guerres nationales et coloniales, pour déboucher sur une nouvelle
expansion, manifestant le dé-veloppement global du mode de production
capitaliste, mais d'un cycle passant de la crise à la guerre impérialiste
généralisée pour le rapartage du marché mondial, puis de la reconstruction
d'aprés-guerre à une nouvelle crise plus large, comme ce fut le cas par deux
fois au cours de ce siécle.
La
nature de la reconstruction aprés la 2e guerre mondiale
Pour le BIPR « le capitalisme a vécu, bien sûr, les deux crises précédentes (il se référe à la 1e et à la 2e guerre mondiale) d'une manière dramatique, mais il avait encore devant lui des marges assez vastes pour espérer un développement ultérieur y inclus dans le cadre général de la décadence. » ([4] [411])
Le BIPR se rend compte de la gravité des destructions, des souffrances, que provoquent les guerres impérialistes et pour cela dit que c'est quelque chose de « dramatique ». Mais les guerres de la période ascendante étaient aussi « dramatiques » : elles provoquaient des destructions, la faim, des souffrances innombrables. Le capitalisme est né « dans la boue et le sang » comme le disait Marx.
Cependant, il y a une différence abyssale entre les guerres de la période ascendante et les guerres de la période décadente: dans les premières, « le capitalisme a des marges assez vastes de développement » pour reprendre les termes du BIPR, dans les secondes ces marges se sont dramatiquement réduites et n'offrent plus un champ suffisant pour l'accumulation du capital.
Là réside la différence essentielle entre les guerres de l'une et de l'autre période, entre ascendance et décadence du capitalisme. Aussi, penser qu'à travers la 1e et la 2e guerre mondiale, le capitalisme « avait encore devant lui des marges assez vastes pour espérer un développement ultérieur» , c'est jeter par dessus bord l'essentiel de la période de décadence du capitalisme.
Il est évident que cette analyse sur les « marges de développement » du capitalisme dans la décadence est trés liée aux explications du BIPR sur la crise fondées sur la seule théorie de la tendance à la baisse du taux de profit, sans tenir compte de la théorie développée par Rosa Luxemburg de la saturation du marché mondial, cependant, sans entrer dans cette discussion, un simple bilan de la reconstruction qui a suivi la 2e guerre mondiale dément ces prétendues « marges assez vastes de développement. »
Selon les apparences, aprés le cataclysme de la guerre, en 1945 l'économie mondiale non seulement « était revenue à la normale » mais avait de plus dépassé les niveaux de croissance précédents. Cependant; nous ne pouvons pas nous laisser aveugler par les chiffres mirifiques fournis par les statistiques. Si on laisse de côté le probléme de la manipulation de ces dernières par les gouvernements et les institutions économiques, phénoméne qui existe, mais qui est totalement secondaire dans le cas qui nous occupe, nous avons l'obligation d'analyser la nature et la composition de cette croissance.
Si nous procédons à cette analyse, nous voyons qu'une part importante de cette croissance est composée d'une part de la production d'armement et des dépenses de défense, et d'autre part de toute une série de dépenses (bureaucratie étatique, marketing et publicité, médias de « communication ») qui sont totalement improductives du point de vue de la production globale.
Commençons par la question de l'armement. A la différence de la période postérieure à la 1e guerre mondiale, en 1945 les armées ne sont pas complétement démobilisées et les dépenses d'armement augmentent de manière pratiquement ininterrompue jusqu'à la fin des années 1980.
Les dépenses militaires représentaient pour les Etats-Unis, avant l'effondrement de l'URSS, 10 % du Produit National Brut. En URSS elles représentaient 20-25 %, dans les pays de 1’Union européenne elle sont actuellement 3-4 %, dans les pays du « tiers-monde », elles atteignent dans beaucoup de cas 25 %.
La production d'armement augmente dans un premier temps le volume de la production, cependant, dans la mesure oú ces valeurs créées ne « retournent » pas dans le processus productif mais que leur aboutissement est ou bien la destruction ou bien de rouiller dans les casernes ou les silos nucléaires, elles représentent en fait la stérilisation, la destruction d'une partie de la production globale : avec la production d'armes et les dépenses militaires « une part chaque fois plus grande de cette production va à des produits qui n'apparaissent pas dans le cycle suivant. Le produit quitte la sphére de la production et ne retourne pas dans celle-ci. Un tracteur retourne à la production sous la forme de gerbes de blé, un tank non. » ([5] [412])
De la même manière, la période d'aprés-guerre a signifié un accroissement formidable des dépenses improductives: l’Etat a développé une immense bureaucratie, les entreprises ont suivi la même régle en augmentant de manière disproportionnée les systémes de contrôle et d'administration de la production, la commercialisation des produits, face aux difficultés de la vente sur le marché, a pris des proportions chaque fois plus grandes jusqu'à représenter prés de 50 % du prix des marchandises. Les statistiques capitalistes attribuent à cette masse formidable de dépenses un signe positif, en les comptabilisant comme « secteur tertiaire ». Cependant, cette masse croissante de dépenses improductives constitue plutôt une soustraction pour le capital global. « Lorsque les rapports de production capitalistes cessent d'être porteurs du développement des forces productives pour en devenir des entraves, tous les 'faux frais" qu'ils peuvent occasionner deviennent de simples gaspillages. Ce qu'il est important de noter, c'est que cette inflation de 'faux-frais" a été un phénopéne inévitable qui s'est imposé au capitalisme avec autant de violence que ses contradictions. L'histoire des nations capitalistes depuis un demi-siécle est rempli de "politiques d'austérité", d'essais, de retour en arrière, de luttes contre l'expansion incontrôlée des frais de l'Etat, des dépenses improductives en général. (..) Toutes ces tentatives aboutissent cependant systématiquement à des échecs. (..) Plus le capitalisme connaît de difficultés, plus il doit développer ses 'faux -frais". Ce cercle vicieux, cette gangréne qui ronge le systéme du salariat n'est qu'un des symptômes d'une même maladie : la décadence capitaliste. »([6] [413])
Une fois vue la nature de la croissance aprés la 2e boucherie impérialiste, voyons maintenant sa répartition dans les différentes aires du capitalisme mondial.
En commençant par l'ex-URSS et les pays qui ont constitué son bloc, une part non négligeable de la « reconstruction » en URSS s'est faite par le transfert d'usines entières de Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie, ex-RDA, Mandchourie, etc., sur le territoire de 1’URSS, ce qui ne signifie pas globalement une véritable croissance mais un simple changement de localisation géographique.
D'un autre côté, comme nous l'avons mis en évidence depuis des années ([7] [414]), l'économie des régimes staliniens produisait des marchandises d'une qualité plus que douteuse, de telle manière qu'une grande proportion était inutilisable. Sur le papier la production a pu croître à des niveaux «formidables », et le BIPR tombe dans le panneau à pieds joints ([8] [415]), mais en réalité la croissance a été en grande partie fictive.
En ce qui concerne les pays qui sont sortis des vagues successives de « décolonisation », dans l'article « Des nations mort-nées » ([9] [416]), nous avions mis en évidence le mensonge de ces « taux de croissance plus grands que ceux du monde industrialisé ». Aujourd’hui, nous pouvons voir qu'un grand nombre de ces pays est entré dans un processus accéléré de chaos et de décomposition, de faim, d’épidémies, de destructions et de guerres. Dans ces pays la guerre impérialiste comme mode de vie permanent du capitalisme décadent s'est imposée depuis le début comme une plaie dévastatrice constituant un terrain d’affrontement permanent entre les grandes puissances avec la complicité active des bourgeoisies locales.
Du point de vue strictement économique, l'immense majorité de ces pays est embourbée depuis des décennies dans une situation de marasme total. Et aujourd'hui par exemple les «fantastiques » taux de croissance des fameux « Quatre dragons asiatiques » ne doivent pas nous tromper. Ces pays se sont fait une petite place sur le marché mondial par la vente à des prix dérisoires de certains produits de consommation et de quelques composants auxiliaires de l'industrie électronique. Ces prix viennent d’une part de la surexploitation de la main d’oeuvre ([10] [417]) et, surtout, du recours systématique aux crédits d’Etat à l'exportation et au dumping (vente au-dessous de la valeur).
Ces pays ne peuvent pas échapper, comme les autres, à une loi implacable qui opére pour toutes les nations qui sont arrivées trop tard sur le marché mondial : « La loi de l'offre et de la demande joue contre tout développement de nouveaux pays. Dans un monde oú les marchés sont saturés, l'offre dépasse la demande et les prix sont déterminés par les coûts de production les plus bas. De ce fait, les pays ayant les coûts de production les plus élevés sont contraints de vendre leurs marchandises avec des profits réduits quand ce n'est pas à perte. Cela raméne leur taux d'accumulation à un niveau extrêmement bas et, même avec une main d'oeuvre trés bon marché, ils ne parviennent pas à réaliser les investissements nécessaires à l'acquisition massive d'une technologie moderne, ce qui a pour résultat de creuser encore plus le fossé qui sépare ces pays des grandes puissances industrielles. » ([11] [418])
Quant aux pays industriels, il est certain qu'entre 1945 et 1967, ils ont connu une réelle croissance économique (de laquelle il faut décompter le volume énorme des dépenses militaires et improductives).
Cependant, nous devons faire au moins deux précisions. En premier lieu : « Certains taux de croissance atteints depuis la deuxiéme guerre mondiale approchent - voire dépassent - ceux atteints au cours de la phase ascendante du capitalisme avant 1913. C'est le cas pour les pays comme la France et le Japon. C'est cependant loin d'être le cas pour la première puissance industrielle, les USA (50 % de la production mondiale au début des années 1950, 4,6 % de taux de crois-sance annuel moyen entre 1957 et 1965 contre 6,9% entre 1850 et 1880 »([12] [419]). De plus, la production mondiale entre 1913 et 1959 (y compris la fabrication d'armements) croît de 250 % , alors que si elle l'avait fait au même rythme moyen qu'entre 1880 et 1890, période d'apogée du capitalisme, elle aurait crù de 450 %. ([13] [420])
En deuxiéme lieu, la croissance de ces pays s'est faite au prix d'un appauvrissement croissant du reste du monde.Durant les années 70, le systéme de crédits massifs aux pays du « tiers-monde » de la part des grands pays industrialisés pour qu'il absorbent les énormes stocks de marchandises invendables, a donné l'apparence d'une « grande croissance » à toute l'économie mondiale. La crise de la dette qui a éclaté à partir de 1982, a dégonflé cette énorme bulle, mettant en évidence un probléme trés grave pour le capital: « pendant des années, une bonne partie de la production mondiale n'a pas été vendue mais tout simplement donnée. Cette production, qui peut correspondre à des biens réellement fabriqués, n'est donc pas une production de valeur, c'est à dire la seule chose qui intéresse le capitalisme. Elle n'a pas permis une réelle accumulation de capital. Le capital global s'est reproduit sur des bases de plus en plus étroites. Pris comme un tout, le capitalisme ne s'est donc pas enrichi. Au contraire, il s'est appauvri. » ([14] [421])
Il est significatif qu'aprés la crise de la dette dans le « tiers-monde » entre 1982 et 1985, la « solution » ait été l'endettement massif des Etats-Unis qui, entre 1982 et 1988, sont passés du statut de pays créditeur à celui de premier pays endetté du monde.
Cela montre l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme là oú il est le plus fort, dans les grandes métropoles industrialisées d'Occident.
De ce point de vue, l'explication que donne BC de la crise de la dette américaine, est erronée et représente une forte sous-estimation : « mais le véritable levier qui a été utilisé pour drainer les richesses de tous les coins de la terre vers les Etats-Unis fut la politique d'élévation des taux d'intérêt » BC caractérise cette politique comme « appropriation de la plus-value au travers du contrôle de la rente financière » en signalant que «du développement des profits au moyen du développement de la production industrielle, on est passé au développement des profits grâce au développement de la rente financière. » ([15] [422])
BC devrait se demander pourquoi on passe «du développement des profits au moyen du développement de la production industrielle » au « développement des profits grâce au développement de la rente financière. » Et la réponse est évidente : alors que dans les années 1960, un développement industriel était encore possible pour les grands pays capitalistes, alors que dans les années 1970, les crédits massifs aux pays du « tiers-monde » et de l’Est ont permis de maintenir à flot ce « développement », dans les années 1980, ces robinets se sont fermés définitivement et ce furent les Etats-Unis qui ont apporté une nouvelle fuite en avant avec leurs immenses dépenses en armements.
Voilà pourquoi BC se trompe en
considérant comme « lutte pour la rente
financière » le processus d'endettement massif des Etats-Unis et se rend
ainsi incapable de comprendre la situation des années 1990 oú les possibilités
d'un endettement des Etats-Unis dans les proportions des années 1980,
n'existent plus. Le capitalisme a le plus développé » s'est fermé une autre de
ses portes illusoires face à la crise ([16] [423]).
Le rapport entre la guerre impérialiste et la crise capitaliste
Pour BC, la guerre a devient à l'ordre du jour de l'histoire quand les contradictions du processus d'accumulation du capital se développent jusqu'à déterminer une surproduction de capital et une chute du taux de profit. » ([17] [424]) Historiquement, et historiquement seulement, cette position est juste. L'ére de l'impérialisme, la guerre impérialiste généralisée, naît de la situation d'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme dans sa phase de décadence, quand il ne peut plus poursuivre son accumulation à cause de la pénurie des nouveaux marchés qui lui permettaient jusque là d'étendre ses rapports de production.
BC s'essaie à démontrer, à partir d'une série d'éléments sur le chômage avant la 1e guerre mondiale, et sur le chômage et l'utili-sation de la capacité productive avant la 2e, que « les données (..) montrent sans équivoque le lien étroit qui existe entre le cours du cycle économique et les deux guerres mondiales. »([18] [425])
Outre le fait que les données sont limitées exclusivement aux Etats-Unis, nous renvoyons ici sans la reprendre à l'argumentation développée dans les articles déjà cités de la Revue Internationale n° 77 et 78 en réponse à Programme communiste qui énonce la même idée.
Le déchaînement de la guerre requiert, outre les conditions économiques, une condition décisive : l'enrôlement du prolétariat dans les grands pays industrialisés pour la guerre impérialiste. Sans cette condition, même si toutes les conditions u objectives u existent, la guerre ne peut être déchaînée. Nous ne revenons pas sur cette position fondamentale que BC rejette également ([19] [426]). Disons simplement que le lien mécanique entre guerre et crise économique que le BIPR prétend établir (coincidant sur cette position avec le bordiguisme qui rejette la notion de déca-dence), entraîne une sous-estimation du probléme de la guerre dans le capitalisme décadent.
Rosa Luxemburg dans L'accumulation du capital souligne que « plus s'accroît la violence avec laquelle à l'intérieur et à l'extérieur le capital anéantit les couches non-capitalistes et avilit les conditions d'existence de toutes les classes laborieuses, plus l'histoire quotidienne de l'accumulation dans le monde se transforme en une série de catastrophes et de convulsions, qui, se joignant aux crises économiques périodiques finiront par rendre impossible la continuation de l'accumulation et par dresser la classe ouvrière internationale contre la domination du capital avant même que celle-ci ait atteint économiquement les dernières limites objectives de son développement. » ([20] [427])
En général, la guerre et la crise économique ne sont pas des phénoménes liés dans un rapport mécanique. Dans le capitalisme ascendant, la guerre est au service de l'économie. Dans le capitalisme décadent, c'est l’inverse : surgissant de la crise historique du capitalisme, la guerre impérialiste acquiert sa propre dynamique et devient progressivement le mode de vie même du capitalisme. La guerre, le militarisme, la production d'armes, tendent à mettre à leur service l'activité économique, provoquant des déformations monstrueuses des propres lois de l'accumulation capitaliste et générant des convulsions supplémentaires dans la sphére économique.
C'est ce que pose avec lucidité le 2e congrés de 1`Internationale communiste :
« La guerre a fait subir au
capitalisme une évolution. (..) La guerre l'a accoutumé, comme aux actes les
plus ordinaires, à réduire par le blocus des pays entiers à la famine, à
bombarder et incendier des villes et villages pacifiques, à infecter les
sources et les rivières en y jetant des cultures du choléra, à transporter de
la dynamite dans des valises diplomatiques, à émettre des billets de banque
faux imitant ceux de l'ennemi, à employer la corruption, l'espionnage et la
contrebande dans des proportions jusque-là inouies. Les moyens d'action
appliqués à la guerre restérent en vigueur dans le monde commercial aprés la
conclusion de la paix. Les
opérations commerciales de quelque importance s'effectuent sous l'égide de 1’Etat.
Ce dernier est devenu semblable à une association de malfaiteurs armés jusqu
aux dents. » ([21] [428])
La nature des « cycles d'accumulation » dans la décadence capitaliste
Selon BC, « chaque fois que le systéme ne peut contrecarrer par une impulsion antagonique
les causes qui provoquent la chute du taux de profit, se posent alors deux
types de problémes : a) la destruction du capital en excés ; b) l'extension de
la domination impéréaliste sur le marché international. » ([22] [429]).
Avant tout, il faut préciser que BC a un siécle de retard: la question de « l'extension de la domination impérialiste sur le monde » a commencé à se poser chaque fois plus de manière aiguë dans la dernière décennie du siécle passé. Depuis 1914, cette question ne se pose plus pour la simple raison que tout le monde est pris, et bien pris, dans les filets sanglants de l'impérialisme. La question qui se répéte et s'aggrave depuis 1914 n'est pas l'extension de l'impérialisme mais le partage du monde entre les différents vautours impérialistes.
L'autre « mission » que BC assigne à la guerre impérialiste – « la destruction du ca-pital en excés » - tend à comparer les destructions de forces productives qui se produisaient au 19e siécle comme conséquences des crises cycliques du systéme, avec les destructions causées par les guerres impérialistes de ce siécle. Néammoins BC reconnaît la différence qualitative entre ces destruc-tions: « alors, il s'agissait du coût douloureux d'un développement "nécessaire" des forces productives, aujourd'hui nous sommes en présence d'une oeuvre de dévastation systématique projetée à échelle planétaire, aujourd'hui au sens économique, demain au sens physique, plongeant l'humanité dans l'abîme de la guerre. » ([23] [430]) Mais pas suffisamment, et BC a toujours persisté à relativiser cette différence pour insister bien plus sur une identité de fonctionnement du capitalisme dans sa phase ascendante et dans sa phase de décadence : « toute l'histoire du capitalisme est la course sans fin vers un équilibre impossible, seules les crises, c'est à dire famine, chômage, guerre et mort pour les travailleurs, sont les moments par lesquels les rapports de production créent de nouveau les conditions pour un cycle ultérieur d'accumulation qui aura comme ligne d'arrivée une autre crise encore plus profonde et plus vaste » ([24] [431]).
Il est certain qu'aussi bien dans le capitalisme ascendant que dans le capitalisme décadent, le systéme ne peut se libérer des crises périodiques qui l'aménent au blocage et à la paralysie. Cependant, constater cela nous laisse sur le terrain des économistes bourgeois qui nous confortent en répétant: « aprés une récession, vient une reprise et ainsi de suite. »
Certes, BC ne reprend pas ces chiméres et défend clairement la nécessité de détruire le capitalisme et de faire la révolution, mais il reste prisonnier du schéma du « cycle de l'accumulation. »
En fait :
- les crises cycliques de la période ascendante sont différentes des crises de la période décadente ; la racine de la guerre impérialiste ne se situe pas dans la crise de chaque cycle d'accumulation, ce n'est pas une sorte de dilemme qui se reproduit chaque fois qu'un cycle d'accumulation entre en crise, mais elle se situe dans une situation historique permanente qui domine toute la décadence capitaliste.
Alors que dans la période ascendante, les crises étaient de courte durée et survenaient de manière assez régulière chaque 7 ou 10 ans, depuis 1914, durant 80 ans, en nous limitant exclusivement aux grands pays industrialisés, nous avons eu :
- 10 ans de guerres impérialistes (1914-18 et 1939-45) avec plus de 80 millions de morts;
- 46 ans de crise ouverte : 1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-94 (nous ne prenons pas en compte les courts moments entre 1929-39 et 1967-94 de o reprise dopée u qui se sont intercalés entre ces années) ;
- 24 ans seulement (à peine le quart de la période) de reprise économique : 1922-29 et 1950-67.
Tout cela montre que le simple schéma de l'accumulation ne suffit pas à expliquer la réalité du capitalisme décadent et paralyse la compréhension de ses phénoménes.
Bien que BC reconnaisse le phénoméne du capitalisme fEtat, essentiel dans la décadence, il n'en tire pas toutes ses conséquences ([25] [432]). En effet, une caractéristiqüe essentielle de la décadence, qui affecte de manière décisive la manifestation des a crises cycliques », est l'intervention massive de lEtat (liée étroitement à la formation d'une économie de guerre), au moyen de toute une série de mécanismes que les économistes appellent a politique économique ». Cette intervention altére profondément la loi de la valeur provoquant des déformations monstrueuses dans l'ensemble de l'économie mondiale, qui aggravent et aiguisent systématiquement les contradictions du systéme, conduisant à des convulsions brutales non seulement dans l'appareil économique mais dans toutes les sphéres de la société.
Ainsi, le poids permanent de la guerre dans toute la vie sociale et, fautre part, le capitalisme dEtat, transforment radicalement la substance et la dynamique des cycles économiques : « Les conjonctures ne sont pas déterminées par le rapport entre la capacité de production et la taille du marché existant à un moment donné, mais par des causes essentiellement politiques. (..) Dans ce cadre, ce ne sont nullement des problémes d'amortissement du capital qui déterminent la durée des phases du développement économique mais en grande partie, l'ampleur des destructions subies au cours de la guerre précédente. (..) Contrairement au siécle dernier caractérisé par le "laisser faire", l'ampleur des destructions des récessions au 20e siécle est limitée par des mesures artificielles mises en place par les Etats et leurs institutions de recherche pour retarder la crise généralisée (..) [avec] tout un éventail de mesures politiques qui tendent à rompre avec le strict fonctionnement économique du capitalisme » ([26] [433]).
Le probléme de la guerre ne peut pas se situer dans la dynamique des « cycles d'accumulation » que, d'autre part, BC élargit à sa guise pour la période de décadence en l'identifiant avec les cycles « crise-guerre-reconstruction », alors que, comme nous l'avons vu, ces cycles n'ont pas une nature strictement économique.
Rosa Luxemburg précise: « Il est cependant trés important de constater de prime abord que cette succession périodique des conjonctures et la crise, si elles sont des éléments essentiels de la reproduction, ne constituent cependant pas le véritable probléme de la reproduction capitaliste. Successions périodiques de conjonctures et crise sont la forme spécifique du mouvement vers la production capitaliste, mais non pas ce mouvement lui-même. » ([27] [434])
Le probléme de la guerre dans le capitalisme décadent, doit être situé en-dehors des strictes oscillations du cycle économique, en-dehors des va-et-vient et des conjonctures du taux de profit.
« Dans cette ére non seulement la bourgeoisie ne peut plus développer les forces productives mais elle ne subsiste qu'à la condition de se livrer à leur destruction et d'anéantir les richesses accumulées, fruit du travail social des siécles passés. La guerre impérialiste généralisée est la manifestation principale de ce processus de décomposition et de destruction dans laquelle est entré la société capitaliste. » ([28] [435])
Le BIPR a les mains liées par ses théories sur les cycles d'accumulation selon la tendance à la chute du taux de profit et explique la guerre au travers du « déterminisme économique » des crises des cycles d'accumulation.
Comme marxistes, il est clair que nous savons trés bien que « l'infrastructure économique détermine toute la superstructure de la société ». Mais nous ne le comprenons pas d'une manière abstraite comme un calque qu'il faut appliquer mécaniquement à chaque situation, mais d'un point de vue historico-mondial. Et c'est pour cela que nous comprenons que le capitalisme décadent dont le marasme et le chaos ont une origine économique, a aggravé ceux-ci à tel point qu'on ne peut les comprendre limités à un strict économisme.
« L'autre aspect de l'accumulation capitaliste concerne les relations entre le capital et les modes de production non capitalistes, il a le monde entier pour théâtre. Ici les méthodes employées sont la politique coloniale, le systéme des emprunts internationaux, la politique des sphéres d'intérêts, la guerre. La violence, l'escroquerie, l'oppression, le pillage se déploient ouvertement, sans masque, et il est difficile de reconnaître les lois rigoureuses du processus économique dans l'enchevêtrement des violences et des brutalités politiques.
La théorie libérale bourgeoise n'envisage que l'aspect unique de la "concurrence pacifique", des merveilles de la technique et de l'échange pur de marchandises ; elle sépare le domaine économique du capital de l'autre aspect, celui des coups de force considérés comme des incidents plus ou moins fortuits de la politique extérieure. » ([29] [436]).
Le BIPR dénonce avec rigueur la barbarie du capitalisme, les conséquences catastrophiques de ses politiques, de ses guerres. Cependant, il n'arrive pas à avoir, comme il convient d'avoir avec une théorie conséquente de la décadence, une vision unitaire et globale de la guerre et de l'évolution économique. L'aveuglement et l'irresponsabilité qu'implique cette faiblesse, est manifeste dans cette formulation: « Dés les premières manifestations de la crise économique mondiale notre parti a soutenu que l'issue était obligatoire. L'alternative qui se pose est nette : ou dépassement bourgeois de la crise à travers la guerre mondiale vers un capitalisme monopoliste concentré ultérieurement dans les mains d'un petit numéro de groupes de puissances, ou la révolution prolétarienne. » ([30] [437])
Le BIPR n'est pas assez conscient de ce que signifierait une 3e guerre mondiale: purement et simplement l'anéantissement complet de la planéte. Même aujourd'hui oú la chute de 1’URSS et la disparition postérieure du bloc occidental rendent difficile la reconstitution de nouveaux blocs, les risques de destruction de l'humanité sous la forme d'une succession chaotique de guerres locales continuent à être trés graves.
Le degré de putréfaction du capitalisme, la gravité de ses contradictions ont atteint un tel niveau que dans ces conditions une 3e guerre mondiale conduirait à la destruction de l’humanité.
C'est une rêverie grossière, un jeu ridicule avec des schémas et des « théories » qui ne répondent pas à la réalité historique, que de supposer qu'aprés une 3e guerre mondiale puisse apparaître « un capitalisme monopo-liste concentré en un petit nombre de puissances ». C'est de la science-fiction... mais ancrée lamentablement dans des phénoménes de la fin du siécle dernier.
Le débat entre les révolutionnaires doit partir du niveau le plus élevé atteint par l'ancien parti, 1’Internationale communiste qui a dit trés clairement à la fin de la 1e Guerre mondiale: « Les contradictions du régime capitaliste se révélérent b l'humanité à la suite de la guerre, sous forme de souffrances physiques.- la faim, le froid, les maladies épidemiques et une recrudescence de barbarie. Ainsi est jugée sans appel la vieille que-relle académique des socialistes sur la théorie de la paupérisation et du passage progressif du capitalisme au socialisme. (..) Maintenant ce n'est pas seulement la paupérisation sociale, mais un appauvrissement physiologique, biologique, qui se présente à nous dans toute sa réalité hideuse. » ([31] [438])
La fin de la 2e guerre mondiale a confirmé, en allant beaucoup plus loin, cette analyse cruciale de l’IC. Depuis lors, la vie capitaliste, dans la « paix » comme dans la guerre, a aggravé les tendances que les révolutionnaires avaient prédites, à des niveaux qu'ils ne pouvaient imaginer à l'origine. A quoi bon jouer avec des hypothéses ridicules sur un « capitalisme monopoliste » aprés une 3e guerre mondiale ? L'alternative n'est pas « révolution prolétaienne ou guerre pour accoucher d'un capitalisme monopoliste », mais révolution prolétarienne ou destruction de 1’humanité.
Adalen, 1/9/94.
[1] [439] Voir Revue Internationale n° 77 et 78, « Le rejet de la notion de décadence », Polémique avec Programme communiste.
[2] [440] Le Partito Comunista Intemazionalista (PCInt) publie le journal Battaglia Comunista (BC) et la revue théorique Prometeo. La Communist Workers'Organisation (CWO) publie le journal Workers'Voice. La Communist Review est publiée conjointement par ces deux organisations et contient des articles du BIPR comme tel ainsi que des traductions d'articles de Prometeo.
[3] [441] Crise du capitalisme et perspectives du BIPR, dans la Communist Review n° 4, automne 1985.
[4] [442] Communist Review, n° 1, « Crise et impérialisme ».
[5] [443] Internationalisme n° 46, organe de la GCF, été 1952.
[6] [444] La décadence du capitalisme, brochure du CCI.
[7] [445] Voir « La crise en RDA », Revue Internationale n° 22, 3e trimestre 1980, « La crise dans les pays de 1’Est », n° 23.
[8] [446] En 1988, lorsque le chaos et la failite de l'économie soviétique étaient d'une évidence criante, le BIPR disait que « dans les années 1970 les taux de croissance de la Russie étaient encore le double de ceux de l'occident et égaux à ceux du Japon. Y compris dans la crise des débuts des années 1980 le taux de croissance russe était de 2-3 % plus important que celui de n'importe quelle puissance occidentale. Dans ces années, la Russie avait atteint largement la capacité militaire des Etats-Unis, avait dépassé sa technologie spatiale et pouvait engager les plus grands projets de construction depuis 1945. .v (Communist Review, n° 6)
[9] [447] Revue Internationale n° 69, 2e trimestre 1992, 3e partie de la série « Bilan de 70 années de 'libération nationale' ».
[10] [448] Il suffit de souligner l'importance qu'a en Chine le travail forcé pratiquement gratuit des prisonniers. Une étude d'Asian-Watch (organisation américaine de « défense des droits de l'homme ») a révélé l'existence de ces goulags chinois qui emploient 20 millions de travailleurs. Dans ces « camps de ré-éducation » sont effectués les travaux sous contrat pour les entreprises occidentales (françaises, américaines, etc.). Les défauts de qualité que détectent les contractants occidentaux sont immédiatement répercutés aux prisionnier responsable de l' « erreur » par des châtiments brutaux devant tous ses camarades.
[11] [449] Revue internationale n° 23, « La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme ».
[12] [450] La décadence du capitalisme, brochure du CCI.
[13] [451] Idem.
[14] [452] Revue Internationale n° 59, 4e trimestre 1989, « La situation internationale ».
[15] [453] Prometeo n° 6, « Les Etats-Unis et la domination du monde ».
[16] [454] BC, lancé dans la
spéculation de sa théorie de « la lutte pour le partage de la rente
financière », se met sur un terrain dangereux en affirmant que celle-ci « étant une forme d'appropriation parasitaire,
le contrôle de la rente exclut la possibilité de la redistribution de la
richesse entre les différentes catégories et classes sociales par la croissance
de la production et la circulation de marchandises. » Depuis quand la
croissance de la production et de la distribution de marchandises tend à
redistribuer la richesse sociale ? Comme marxistes, nous avions compris que la
croissance de la production capitaliste tend à « redistribuer » la
richesse au bénéfice des capitalistes et au détriment des ouvriers. Mais BC
découvre le contraire en tombant sur le terrain de la gauche du capital et des
syndicats qui demande des investissements « pour qu'il y ait du travail et du bien-être ». Face à une
telle « théorie », il faudrait rappeler ce que disait Marx au citoyen
Weston dans Salaire, prix et profit: « Ainsi le citoyen Weston oublie-t-il
que cette soupière, oú les travailleurs mangent, est emplie du produit tout
entier du travail national : que ce qui les empêche d’y puiser davantage, ce n'est
point l'étroitesse de la soupière, ce n'est point l'insuffisance de son
contenu, c'est seulement la petitesse de leurs cuillers ». (Chapitre 1,
« Salaire, prix et monnaie »,
La Pléiade).
[17] [455] Prometeo n° 6, décembre 1993, « Les Etats-Unis et la domination du monde ».
[18] [456] « Crise et impérialisme », Revue Communiste n° 1.
[19] [457] cf. Revue internationale n° 36, « La vision de BC sur le cours historique ».
[20] [458] Chap. 32.
[21] [459] Manifeste du 2° Congrés de l’Intemationale communiste.
[22] [460] Prometeo n° 6, décembre 1993, « Les Etats-Unis et la domination du monde ».
[23] [461] Battaglia comunista n° 10 (octobre 93).
[24] [462] 2e Conférence des groupes de la Gauche communiste, Textes préparatoires volume 1, « Sur la théorie des crises en général », contribution du PCInt-BC, voir la citation.
[25] [463] De manière explicite, les camarades identifient le capitalisme décadent avec le « capitalisme des monopoles » : « C'est précisément dans cette phase historique que le capitalisme entre dans sa phase décadente. La libre concurrence aiguisée par la chute du taux de profit, crée son contraire, le monopole, qui est la forme d'organisation que le capitalisme se donne pour contenir la menace d'une chute ultérieure du profit» (2e Conférence internationale, texte cité). Les monopoles survivent dans décadence mais n'en constituent pas, loin de là, l'essentiel. Cette vision est trés liée à la théorie de l'impérialisme et à l'insistance de BC sur le « partage de la rente financière ». II doit être clair que cette théorie rend difficile la compréhension à fond de la tendance universelle (pas seulement dans les pays staliniens) au capitalisme d'Etat.
[26] [464] « La lutte du prolétariat dans le capitalisme décadent », Revue internationale n° 23.
[27] [465] L'accumulation du capital, Chap. 1.
[28] [466] « Notre réponse » [à Vercesi], texte de la Gauche communiste de France, publié dans le Bulletin international de discussion, Fraction italienne de la Gauche communiste, n° 5, mai 1944.
[29] [467] L'accumulation du capital, Chap. 31.
[30] [468] Revue Communiste n°1, « Crise et impérialisme ».
[31] [469] « Manifeste de l’Internationale Communiste » 1° congrès de l’IC, mars 1919.
Courants politiques:
- TCI / BIPR [85]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Décadence [192]
Heritage de la Gauche Communiste:
Le communisme n'est pas un bel idéal, mais une nécessite matérielle [10e partie]
- 4471 lectures
Anarchisme ou communisme
Dans le dernier article de cette série, nous avons examiné le combat qu'a mené, dans l'Association internationale des travailleurs (AIT), la tendance marxiste contre les idéologies réformistes et «socialistes d'Etat» au sein du mouvement ouvrier, notamment dans le parti allemand. Pourtant, selon le courant anarchiste ou « antiautoritaire » de Mikhaïl Bakounine, Marx et Engels auraient incarné et inspiré la tendance socialiste d'Etat, et étaient les instigateurs les plus en vue de ce «socialisme allemand » qui avait pour but non pas de remplacer le capitalisme par une société libre et sans Etat, mais par une terrible tyrannie bureaucratique dont ils seraient eux-mêmes les gardiens. Jusqu'à aujourd'hui, les anarchistes de même que les libéraux présentent les critiques de Bakounine à Marx comme l'expression d'une profonde perspicacité sur la véritable nature du marxisme, comme une explication prophétique des raisons pour lesquelles les théories de Marx conduiraient inévitablement aux pratiques de Staline.
Mais, comme nous tenterons de le montrer dans cet article, la « critique radicale » du marxisme par Bakounine, comme toutes les critiques ultérieures, n'est radicale qu'en apparence. La réponse que Marx et son courant apportèrent à ce pseudo-radicalisme, allait nécessairement de pair avec la lutte contre le réformisme, car les deux idéologies représentaient la pénétration, dans les rangs du prolétariat, de points de |vue étrangers à la classe.
Le noyau petit-bourgeois de l'anarchisme
Le développement de l'anarchisme dans la seconde moitié du 19e siècle était le produit de la résistance des couches petites-bourgeoises -artisans, commerçants, petits paysans- à la marche triomphante du capital, résistance au processus de prolétarisation qui les privait de leur « indépendance » sociale passée. Plus fort dans les pays où le capital industriel s'est développé tardivement, à la périphérie orientale et méridionale de l'Europe, il exprimait à la fois la rébellion de ces couches contre le capitalisme, et leur incapacité à voir plus loin que celui-ci, vers le futur communiste ; au contraire, il énonçait leur désir de retour à un passé semi-mythique de communautés locales libres et de producteurs strictement indépendants, débarrassés de l'oppression du capital industriel et de l'Etat bourgeois centralisé.
Le «père» de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon, était l'incarnation classique de cette attitude, avec sa haine féroce non seulement envers l'Etat et les grands capitalistes, mais envers le collectivisme sous toutes ses formes, y compris envers les syndicats, les grèves et les expressions similaires de la collectivité de la classe ouvrière. A l'encontre de toutes les tendances profondes qui se développaient au sein de la société capitaliste, l'idéal de Proudhon était une société « mutualiste », fondée sur la production artisanale individuelle, liée par le libre-échange et le libre-crédit.
Marx avait déjà démoli les vues de Proudhon dans son livre Misère de la à Philosophie, publié en 1847, et l'évolution du capital lui-même, dans la seconde partie du siècle, avait fait la démonstration pratique de l'obsolescence des idées de Proudhon. Pour « l'ouvrier de masse» de l'industrie capitaliste, il était de plus en plus évident que, pour résister à l'exploitation capitaliste et l'abolir tout à la fois, seules une lutte collective et une appropriation collective des moyens de production pouvaient offrir un espoir.
Face à cela, le courant bakouniniste qui, à partir de 1860, a tenté de combiner « l'anti-autoritarisme » de Proudhon avec une approche collectiviste et même communiste des questions sociales, semble clairement constituer une avancée par rapport au Proudhonisme classique. Bakounine a même écrit à Marx pour exprimer son admiration vis-à-vis de son travail scientifique, déclarant être son disciple et lui offrant de traduire Le capital en russe. Et cependant, malgré son retard idéologique, le courant proudhonien avait, à certains moments, joué un rôle constructif dans la formation du mouvement ouvrier : Proudhon avait été un facteur de l'évolution de Marx vers le communisme dans les années 1840, et les proudhoniens avaient participé à la fondation de TAIT. L'histoire du Bakouninisme, au contraire, est quasiment entièrement une chronique du travail négatif et destructeur qu'il a mené contre l'Internationale. Même l'admiration que Bakounine professait envers Marx, faisait partie de ce syndrome : Bakounine confessait lui-même que « c'est également par tactique, par politique personnelle que j'ai tant honoré et loué Marx », son but ultime étant de briser la « phalange » marxiste qui dominait l'Internationale ([1] [470]).
La raison essentielle en est que, tandis que le Proudhonisme précédait le marxisme, et les groupes proudhoniens la 1ère Première Internationale, le bakouninisme s'est développé, dans une large mesure, en réaction au marxisme et contre le développement d'une organisation prolétarienne internationale centralisée.
Dans le morceau suivant Marx et Engels expliquent cette évolution en se référant au problème général des « sectes », mais ce sont surtout les bakouninistes qui sont visés, puisque le passage vient du texte « Les prétendues scissions dans l'Internationale » (1872) qui était une réponse du Conseil général aux intrigues de Bakounine contre l'AIT :
« La première phase dans la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie est marquée par le mouvement sectaire. Il a sa raison d'être à une époque où le prolétariat n'est pas encore assez développé pour agir comme classe. Des penseurs individuels font la critique des antagonismes sociaux, et en donnent des solutions fantastiques que la masse des ouvriers n'a qu'à accepter, à propager, et à mettre en pratique. Par leur nature même, les sectes formées par ces initiateurs sont abstentionnistes, étrangères à toute action réelle, à la politique, aux grèves, aux coalitions, en un mot à tout mouvement d'ensemble...Ces sectes, leviers du mouvement à leur origine, lui font obstacle dès qu'il les dépasse. » ([2] [471])
L'organisation prolétarienne contre les intrigues de la petite-bourgeoisie
Le principal enjeu de la lutte entre marxistes et bakouninistes était l'Internationale elle-même : rien ne démontre plus clairement l'essence petite-bourgeoise de l'anarchisme que son approche de la question organisationnelle, et ce n'est pas un hasard si la question qui a mené à la scission ouverte entre les deux courants, n'a pas été un débat abstrait sur la société future, mais a porté sur le fonctionnement de l'organisation prolétarienne, son mode d'opération interne. Mais, comme nous le verrons, ces différences organisationnelles étaient également liées à des visions différentes de la société future et des moyens de la créer.
A partir du moment où ils ont rejoint l'Internationale, à la fin des années 1860, mais surtout dans la période qui a suivi la défaite de la Commune, les bakouninistes ont crié haro sur le rôle du Conseil général, organe central de l'Internationale qui se trouvait à Londres et était donc fortement influencé par Marx et Engels. Pour Bakounine, le Conseil général n'était qu'une simple couverture pour Marx et « sa coterie » ; il se présenta donc comme le champion de la liberté et de l'autonomie des sections locales contre les prétentions tyranniques des « socialistes allemands ». Cette campagne fut liée à dessein à la question de la société future, puisque les bakouninistes défendaient que l'Internationale elle-même devait constituer l'embryon du nouveau monde, le précurseur de la fédération décentralisée des communes autonomes. Dans cette même perspective, la domination autoritaire des marxistes dans l'Internationale exprimait la vision qu'auraient ces derniers du futur : une nouvelle bureaucratie d'Etat traitant les ouvriers avec arrogance au nom du socialisme.
Il est parfaitement vrai que l'organisation prolétarienne, aussi bien pour ce qui est de son fonctionnement interne que pour sa fonction externe, est déterminée par la nature de la société communiste pour laquelle elle combat, ainsi que par la classe qui est porteuse de cette société. Mais contrairement à la vision anarchiste, le prolétariat n'a rien à craindre de la centralisation en soi : le communisme est effectivement la centralisation des capacités productives mondiales qui remplace l'anarchie de la concurrence capitaliste. Et afin d'atteindre cette étape, le prolétariat doit centraliser ses propres forces combattantes pour renverser un ennemi qui a souvent montré sa capacité à s'unir contre lui. C'est pourquoi les marxistes ont répondu aux sarcasmes de Bakounine en soulignant que son programme d'autonomie locale complète des sections signifiait la fin de l'Internationale en tant que corps uni. En tant qu'organisation de l'avant-garde prolétarienne, en tant qu' « organisation réelle et militante de la classe prolétaire dans tous les pays, unie dans la lutte commune contre les capitalistes, les propriétaires fonciers et leur pouvoir de classe organisé dans l'Etat » ([3] [472]), l'Internationale ne pouvait parler de 100 voix différentes : elle devait être capable de formuler les buts de la classe ouvrière de façon claire et sans ambiguïté. Et pour qu'elle puisse le faire, l'Internationale avait besoin d'organes centraux effectifs - pas de façade, dissimulant les ambitions de dictateurs et de carriéristes ; de corps élus et rendant des comptes, chargés de maintenir l'unité de l'organisation entre ses Congrès.
De leur côté, les bakouninistes voulaient réduire le Conseil général à « un simple bureau de correspondance et de statistique. Ses fonctions administratives cessant, ses correspondances se réduiraient nécessairement à la reproduction des renseignements déjà publiés dans les journaux de l'Association. Le bureau de correspondance serait donc éludé. Quant à la statistique, c'est un travail irréalisable sans une puissante organisation, et surtout, comme le disent expressément les statuts originaux, sans une direction commune. Or, comme tout cela sent fortement "l'autoritarisme", il y aura peut-être un bureau, mais certainement pas de statistique. En un mot, le Conseil général disparaît. La même logique frappe conseils fédéraux, comités locaux et autres centres "autoritaires". Restent seules les sections autonomes. » ([4] [473])
Plus loin dans le même texte, Marx et Engels argumentent que si l'anarchie voulait simplement dire le but ultime du mouvement de la classe - l'abolition des classes sociales et donc de l'Etat qui est le garant des divisions de classes - alors tous les socialistes étaient pour. Mais le courant de Bakounine y mettait autre chose dans sa pratique, puisqu'il proclamait « l'anarchie dans les rangs prolétaires comme le moyen le plus infaillible de briser la puissante concentration des forces sociales et politiques entre les mains des exploiteurs. Sous ce prétexte, elle demande à l'Internationale, au moment où le vieux monde cherche à l'écraser, de remplacer son organisation par l'anarchie. La police internationale ne demande rien de plus pour éterniser la république-Thiers, en la couvrant du manteau impérial ». ([5] [474])
Mais dans le projet de Bakounine, il y avait bien plus qu'une opposition abstraite à toute forme d'autorité et de centralisation. En fait, ce à quoi s'opposait Bakounine avant tout, c'était à « l'autorité » de Marx et de son courant ; et ses tirades contre leur soi-disant propension aux manoeuvres secrètes et au complot étaient fondamentalement une projection de sa propre conception profondément hiérarchique et élitiste de l'organisation. Sa bataille contre le Conseil général était motivée en réalité par sa détermination à établir un centre de pouvoir alternatif, caché.
Quand Marx et Engels évoquaient l'histoire des organisations « sectaires », ils ne se référaient pas seulement aux idées utopiques floues qui ont souvent caractérisé de tels groupes, mais également à leurs pratiques politiques et à leur fonctionnement, hérités des sociétés secrètes bourgeoises et petites-bourgeoises, avec leurs traditions clandestines, leurs serments et autres rituels occultes, parfois combinés à une propension au terrorisme et à l'assassinat. Comme on l’a vu dans un précédent article ce cette série ([6] [475]), la formation de la Ligue des Communistes en 1847 avait déjà marqué une rupture définitive avec ces traditions. Mais Bakounine était imprégné de ces pratiques et ne les a jamais abandonnées. Tout au long de sa carrière politique, il a toujours eu pour politique de former des groupes secrets directement sous son contrôle, plus fondés sur les « affinités » personnelles que sur tout autre critère politique, et il utilisait ces réseaux secrets d'influence pour gagner de l'hégémonie dans les organisations plus grandes.
N'ayant pas réussi à transformer la Ligue de la paix et de la liberté en sa propre version d'organisation socialiste, Bakounine forma l'Alliance de la démocratie socialiste en 1868. Elle avait des branches à Barcelone, Madrid, Lyon, Marseille, Naples et en Sicile ; la principale section se trouvait à Genève avec un Bureau central sous le contrôle personnel de Bakounine. L'aspect « socialiste » de l'Alliance était très vague et confus, définissant son but comme « l'égalisation sociale et économique des classes » (plutôt que leur abolition), et elle était fixée, de façon obsessionnelle, sur « l'abolition du droit d'héritage » comme clé du dépassement de la propriété privée.
Peu après sa formation, l'Alliance a posé sa candidature à l'Internationale. Le Conseil général a critiqué les confusions de son programme et insisté sur le fait qu'elle ne pouvait être admise dans l'Internationale comme organisation internationale parallèle ; elle devait se dissoudre et faire de chacune de ses sections, des sections de l'Internationale.
Bakounine était tout à fait d'accord avec ces termes pour la simple raison que l'Alliance n'était, pour lui, que la façade d'un dédale de plus en plus ésotérique de sociétés secrètes, certaines fictives et d'autres réelles ; d'une hiérarchie byzantine qui n'avait finalement à répondre que devant le « citoyen B. » lui-même. L'histoire complète des sociétés secrètes de Bakounine reste encore à découvrir, mais il est certain que, derrière l'Alliance (qui de toutes façons ne fut pas réellement dissoute lors de son entrée dans l'AIT), la « Fraternité Internationale » constituait un cercle interne qui avait déjà opéré dans la Ligue de la Paix et la Liberté. Il existait aussi une vague «Fraternité Nationale» à mi-chemin entre l'Alliance et la «Fraternité Internationale». Il peut y en avoir eu d'autres. La question est que de telles formations traduisent un mode de fonctionnement entièrement étranger au prolétariat. Là où les organisations prolétariennes fonctionnent à travers des organes centraux élus, rendant des comptes, la hiérarchie compliquée de Bakounine n'était redevable devant personne d'autre que lui-même. Là où les organisations prolétariennes, même lorsqu'elles doivent agir dans la clandestinité, sont fondamentalement ouvertes à leurs camarades, Bakounine traite les membres de niveau « moyen » de son organisation comme de simples fantassins qu'on manipule à volonté, et qui sont inconscients des buts qu'ils servent réellement.
Il n'est donc pas surprenant que cette conception élitiste des rapports au sein de l'organisation prolétarienne se trouve reproduite dans la vision de Bakounine de la fonction de l'organisation révolutionnaire dans l'ensemble de la classe. La polémique du Conseil général contre les bakouninistes, «L'Alliance de la Démocratie Socialiste et l'AIT », rédigée en 1873, met en évidence les perles suivantes dans les écrits de Bakounine :
« Il est nécessaire qu'au milieu de l'anarchie populaire qui constituera la vie même et toute l'énergie de la révolution, l'unité de la pensée et de l'action révolutionnaire se trouve un organe. Cet organe doit être l'association secrète et universelle des frères internationaux. » ([7] [476]) Admettant que les révolutions ne puissent être faites par des individus ou des sociétés secrètes, ces derniers ont la tâche d'organiser « non l'armée de la révolution - l'armée doit toujours être le peuple - mais un état-major révolutionnaire composé d'individus dévoués, énergiques, intelligents et surtout amis sincères et non ambitieux ni vaniteux, du peuple, capables de servir d'intermédiaires entre l'idée révolutionnaire et les instincts populaires. Le nombre de ces individus ne doit donc pas être immense. Pour l'organisation internationale dans toute l'Europe, cent révolutionnaires sérieusement et fortement alliés suffisent... » ([8] [477])
Marx et Engels qui ont écrit le texte en collaboration avec Paul Lafargue, font les commentaires suivants :
«Ainsi donc, tout se transforme. L'anarchie, la "vie populaire déchaînée, les mauvaises passions" et le reste ne suffisent plus. Pour assurer le succès de la révolution, il faut l'unité de la pensée et de l'action. Les Internationaux tâchent de créer cette unité par la propagande, par la discussion, et l'organisation publique du prolétariat, à Bakounine, il ne faut qu'une organisation secrète de cent hommes, représentants privilégiés de l'idée révolutionnaire, état-major en disponibilité de la révolution nommée par lui-même et commandée par le permanent "citoyen B.". L'unité de la pensée et de l'action ne veulent dire autre chose qu'orthodoxie et obéissance aveugle...Nous sommes en pleine Compagnie de Jésus. » ([9] [478])
La haine véritable de Bakounine envers l'exploitation et l'oppression capitalistes n'est pas en question. Mais les activités dans lesquelles il s'engageait, étaient profondément dangereuses pour le mouvement ouvrier. Incapable d'arracher le contrôle de l'Internationale, il était réduit à un travail de sabotage et de désorganisation, à provoquer des querelles internes interminables qui ne pouvaient qu'affaiblir l'Internationale. Son penchant pour la conspiration et la phraséologie assoiffée de sang a fait de lui le dupe spontané d'un élément ouvertement pathologique comme Netchaïev dont les actes criminels ont menacé de porter le discrédit sur l'Internationale tout entière.
Ces dangers furent amplifiés dans la période qui suivit la Commune, lorsque le mouvement prolétarien était en plein désarroi et que la bourgeoisie, convaincue que l'Internationale avait « créé » le soulèvement des ouvriers de Paris, persécutait partout ses membres et cherchait à détruire l'organisation. L'Internationale, dirigée par le Conseil général, devait réagir très fermement aux intrigues de Bakounine, affirmant le principe d'une organisation ouverte en opposition à celui du secret et de la conspiration : « Contre toutes ces intrigues, il n'y a qu'un seul moyen, mais il est d'une efficacité foudroyante ; c'est la plus complète publicité. Dévoiler ces menées dans leur ensemble, c'est les rendre impuissantes. » ([10] [479])
Le Conseil a aussi appelé et obtenu, au Congrès de La Haye en 1872, l'expulsion de Bakounine et de son associé Guillaume - non à cause des nombreuses différences idéologiques qui existaient sans aucun doute, mais à cause de leurs pratiques politiques qui mettaient en danger l'existence même de l'Internationale.
En fait, la lutte pour la préservation de l'Internationale avait, à ce moment-là, plus une signification historique qu'immédiate. Les forces de la contre-révolution donnaient le ton, et les intrigues de Bakounine ne faisaient qu'accélérer un processus de fragmentation qu'imposaient les conditions générales auxquelles la classe était confrontée. Dans la mesure où ils étaient conscients de ces conditions défavorables, les marxistes considéraient qu'il valait mieux que l'Internationale soit (au moins temporairement) démantelée que de tomber aux mains de courants politiques qui auraient sapé son but essentiel et fait tomber dans le discrédit jusqu'à son nom même. C'est pourquoi -toujours au Congrès de La Haye - Marx et Engels demandèrent que le Conseil général soit transféré à New York. C'était la fin effective de l'Internationale, mais lorsque le renouveau de la lutte de classe permit la formation de la deuxième Internationale, presque 20 ans après, ce devait être sur une base politique bien plus claire.
Le matérialisme historique contre l'idéalisme a-historique
De façon immédiate, la question organisationnelle était au coeur de la scission dans l'Internationale. Mais intimement liées aux divergences entre marxistes et anarchistes sur l'organisation, il existait toute une série de questions théoriques plus générales qui, elles aussi, révélaient les origines de classe différentes de ces deux points de vue.
Au niveau le plus «abstrait», Bakounine, malgré ses déclarations sur le matérialisme contre l'idéalisme, rejetait ouvertement la méthode matérialiste historique de Marx. Le point de départ était la question de l'Etat. Dans un texte rédigé en 1872, Bakounine établit tout à fait ouvertement les divergences :
« ...les sociologues de l'école de M. Marx, tels que M. Engels vivant, tels que feu Lassalle, par exemple, m'objecteront que l'Etat ne fut point la cause de cette misère, de cette dégradation et de cette servitude des masses ; que la situation misérable des masses, aussi bien que la puissance despotique de l'Etat, furent au contraire, l'une et l'autre, les effets d'une cause plus générale, les produits d'une phase inévitable dans le développement économique de la société, d'une phase qui, au point de vue de l'histoire, constitue un véritable progrès, un pas immense vers ce qu'ils appellent, eux, la révolution sociale. » ([11] [480])
De son côté, Bakounine défend non seulement la vision que l'Etat est la « cause » de la souffrance des masses, et son abolition immédiate la pré-condition de leur délivrance : il rejette aussi logiquement la vision matérialiste de l'histoire qui considère que le communisme n'est possible que comme résultat de toute une série de développements dans l'organisation sociale et les capacités productives de l'homme développements qui incluent la dissolution des communautés humaines originelles, ainsi que la montée et la chute d'une succession de sociétés de classe. En opposition à cette approche scientifique, Bakounine y substitue une approche morale :
« Matérialistes et déterministes, comme M. Marx lui-même, nous aussi nous reconnaissons l'enchaînement fatal des faits économiques et politiques dans l'histoire. Nous reconnaissons bien la nécessité, le caractère inévitable de tous les événements qui se passent, mais nous ne nous inclinons pas indifféremment devant eux, et surtout nous nous gardons bien de les louer et de les admirer lorsque, par leur nature, ils se montrent en opposition flagrante avec le but suprême de l'histoire, avec l'idéal foncièrement humain qu'on retrouve, sous des formes plus ou moins manifestes, dans les instincts, dans les aspirations populaires et sous les symboles religieux de toutes les époques, parce qu'il est inhérent à la race humaine, la plus sociable de toutes les races animales sur la terre. Ce but, cet idéal, aujourd'hui mieux conçus que jamais, peuvent se résumer en ces mots : c'est le triomphe de l'humanité, c'est la conquête et l'accomplissement de la pleine liberté et du plein développement matériel, intellectuel et moral de chacun, par l'organisation absolument spontanée et libre de la solidarité économique et sociale aussi complète que possible de tous les êtres humains vivant sur la terre. Maintenant, tout ce qui dans l'histoire se montre conforme à ce but, du point de vue humain - et nous ne pouvons pas en avoir d'autre - est bon ; tout ce qui lui est contraire est mauvais. » ([12] [481])
II est vrai, comme nous l'avons en fait montré dans cette série d'articles, que « l'idéal » du communisme est apparu dans les luttes des opprimés et des exploités tout au long de l'histoire, et que cette lutte correspond aux besoins les plus fondamentaux de l'homme. Mais le marxisme a démontré pourquoi, jusqu'à l'époque capitaliste, de telles aspirations étaient condamnées à rester un idéal ; pourquoi, par exemple, non seulement les rêves communistes de la révolte des esclaves de Spartacus, mais aussi la nouvelle forme féodale d'exploitation qui sortait la société de l'impasse de l'esclavage, constituaient des moments nécessaires de l'évolution des conditions qui font du communisme une possibilité réelle aujourd'hui. Pour Bakounine, cependant, alors que les premiers peuvent être considérés comme « bons », la seconde ne pouvait être considérée que comme « mauvaise », Aussi argumente-t-il, dans le texte qu'on vient de citer, que, tandis que la « liberté comparativement si hautement humaine » dans la Grèce antique était bonne, la conquête ultérieure de la Grèce par les romains plus barbares était mauvaise, et ainsi de suite à travers les siècles.
A partir de là, il devient impossible de juger si une formation sociale ou une classe sociale joue un rôle progressif ou régressif dans le processus historique ; à la place, tout est mesuré en fonction d'un idéal abstrait, d'un absolu moral qui reste inchangé tout au long de l'histoire.
Aux marges du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, il y a nombre de courants « modernistes » qui se sont spécialisés dans le rejet de la notion de décadence du capitalisme : les plus cohérents de ceux-ci (comme le Groupe Communiste Internationaliste, ou le groupe Wildcat au Royaume Uni) en sont arrivés à rejeter la conception marxiste de progrès, puisque argumenter qu'un système social est en déclin, signifie évidemment qu'il a été en ascendance à un moment. Ils concluent que le progrès est une notion complètement bourgeoise et que le communisme était possible à n'importe quel moment de l'histoire.
Il s'avère que ces modernistes ne sont pas si modernes après tout : ils sont de fidèles épigones de Bakounine qui a également été amené à rejeter l'idée de progrès et disait que la révolution sociale était possible à n'importe quel moment. Dans son travail de base, Etatisme et Anarchie (1873), Bakounine développe que les deux conditions essentielles d'une révolution sociale sont : la souffrance poussée à l'extrême, presqu'au point du désespoir, et l'inspiration d'un « idéal universel ». C'est pourquoi, dans le même passage, il affirme que l'Italie constitue le lieu le plus mûr pour une révolution sociale, en opposition aux pays industriellement plus développés où les ouvriers sont « relativement nombreux » et « si imprégnés de divers préjugés bourgeois qu'ils ne diffèrent pas de la bourgeoisie, sauf par le revenu ».
Mais le « prolétariat » révolutionnaire italien de Bakounine consiste en « deux ou trois millions d'ouvriers des villes, principalement dans les usines et les petits ateliers, et approximativement vingt millions de paysans totalement dépossédés ». En d'autres termes, le prolétariat de Bakounine est en fait un nouveau nom pour la notion bourgeoise de « peuple » - tous ceux qui souffrent, quelle que soit leur place dans les rapports de production, quelle que soit leur capacité à s'organiser, à devenir conscients d'eux-mêmes en tant que force sociale. En fait, Bakounine chante ailleurs les louanges du potentiel révolutionnaire des peuples slaves ou latins (en opposition aux allemands vis-à-vis desquels Bakounine a gardé une haine chauvine toute sa vie durant) ; il défend même, comme le note le Conseil général dans le texte « L'Alliance de la démocratie socialiste et l'AIT », que « le brigand, en Russie, est le véritable et l'unique révolutionnaire. »
Tout cela est totalement cohérent avec le rejet du matérialisme par Bakounine : si la révolution sociale est possible à tout moment, alors n'importe quelle force opprimée peut la réaliser, les brigands ou les paysans. En fait non seulement la classe ouvrière dans son sens marxiste n'a pas de rôle particulier à jouer dans ce processus, mais encore Bakounine se répand en injures contre les marxistes parce qu'ils affirment que la classe ouvrière doit exercer sa dictature sur la société :
« Si le prolétariat devient la classe dominante, qui, demandera-t-on, dominera-t-il ? C'est donc qu'il restera encore une classe soumise à cette nouvelle classe régnante, à cet Etat nouveau, ne fût-ce, par exemple, que la plèbe des campagnes qui, on le sait, n'est pas en faveur chez les marxistes et qui, située au plus bas degré de la civilisation, sera probablement dirigée par le prolétariat des villes et des fabriques. » ([13] [482])
Ce n'est pas le lieu ici de traiter la question des rapports entre la classe ouvrière et la paysannerie dans la révolution communiste. Il suffit de dire que la classe ouvrière n'a aucun intérêt à établir un nouveau système d'exploitation après avoir renversé la bourgeoisie. Mais, ce que les peurs de Bakounine révèlent, c'est précisément le fait qu'il n'aborde pas la question du point de vue du prolétariat, mais ce celui des « opprimés en général » - du point de vue de la petite-bourgeoise, pour être précis.
Incapable de saisir que le prolétariat est la classe révolutionnaire dans la société, non seulement parce qu'il souffre mais aussi parce qu'il contient en lui-même les germes d'une organisation sociale nouvelle et plus avancée, Bakounine n'est pas non plus capable d'envisager la révolution autrement que comme un «grand feu de joie », un épanchement de « mauvaises passions », un acte de destruction et non de création :
« Une insurrection populaire, par sa nature même, est instinctive, chaotique et destructrice... les masses sont toujours prêtes à se sacrifier, et ceci les transforme en une horde sauvage et brutale, capable de réaliser des exploits héroïques et apparemment impossibles...Cette passion négative, c'est vraie, est loin d'être suffisante pour atteindre le niveau élevé de la cause révolutionnaire ; mais sans elle, la révolution serait impossible. La révolution requiert une destruction étendue et générale, une destruction féconde et rénovatrice, car c'est par cette voie et uniquement par elle que naissent de nouveaux mondes ». ([14] [483])
De tels passages confirment non seulement que Bakounine a, de façon générale, une vision non prolétarienne ; mais ils nous permettent aussi de comprendre pourquoi il n'a jamais rompu avec une vision élitiste du rôle de l'organisation révolutionnaire. Tandis que, pour le marxisme, l'avant-garde révolutionnaire est le produit d'une classe devenant consciente d'elle-même, pour Bakounine les masses populaires ne peuvent jamais aller au-delà du niveau de la rébellion instinctive et chaotique : en conséquence, s'il faut réaliser plus que cela, cela nécessite le travail d'un « quartier général» qui agit derrière la scène. Bref, c'est la vieille notion idéaliste du Saint-Esprit qui descend sur quelque chose d'inconscient. Les anarchistes qui ne manquent jamais d'attaquer la mauvaise formulation de Lénine sur la conscience révolutionnaire introduite dans le prolétariat de l'extérieur, sont curieusement silencieux sur la version bakouniniste de la même notion...
La lutte politique contre l’indifférentisme politique
En lien étroit avec la question organisationnelle, l'autre grand point de dispute entre les marxistes et les anarchistes était la question de la « politique ». Le Congrès de La Haye fut un champ de bataille sur cette question : la victoire du courant marxiste (soutenu à cette occasion par les Blanquistes) a été formulée dans une résolution qui disait « le prolétariat ne peut agir en tant que classe qu'en se constituant en parti politique distinct, opposé à tous les vieux partis formés par les classes possédantes » et que « la conquête du pouvoir politique devient le grand devoir du prolétariat » dans la lutte pour son émancipation.
Cette discussion contenait deux dimensions. La première fait écho à la question de la nécessité matérielle. Puisque pour Bakounine, la révolution était possible à tout moment, toute lutte pour des réformes constituait fondamentalement une diversion par rapport à cette grande fin ; et si cette lutte allait au-delà de la sphère strictement économique (que les Bakouninistes acceptaient à contrecoeur sans jamais en comprendre vraiment la signification), sur le terrain de la politique bourgeoise -du parlement, des élections, des campagnes pour changer les lois - elle ne pouvait signifier autre chose qu'une capitulation face à la bourgeoisie. Aussi, selon Bakounine, « l'Alliance, prenant le programme de l'Internationale au sérieux, avait repoussé avec dédain toute transaction avec la politique bourgeoise, si radicale qu'elle se dise et si socialiste qu'elle se grime, recommandant au prolétariat comme la seule voie d'une émancipation réelle, comme la seule politique pour lui vraiment salutaire, la politique exclusivement négative de la démolition des institutions politiques, du pouvoir politique, du gouvernement en général, de l'Etat... » ([15] [484])
Derrière ces phrases hautement radicales, gît l'incapacité des anarchistes à saisir que la révolution prolétarienne, la lutte directe pour le communisme, n'était pas encore à l'ordre du jour parce que le système capitaliste n'avait pas encore épuisé sa mission historique, et que le prolétariat était face à la nécessité de se consolider comme classe, pour arracher toutes les réformes qu'il pouvait à la bourgeoisie afin, avant tout, de se renforcer pour la lutte révolutionnaire future. Dans une période où le parlement était une véritable arène de lutte entre fractions de la bourgeoisie, le prolétariat avait les moyens d'y entrer sans se subordonner à la classe dominante ; cette stratégie n'est devenue impossible qu'avec l'entrée du capitalisme dans sa phase décadente, totalitaire. Evidemment, la pré-condition en était que la classe ouvrière eût son propre parti politique, distinct et opposé à tous les partis de la classe dominante, comme le dit la résolution de l'Internationale, sinon, il agirait simplement comme un appendice des partis bourgeois plus progressifs au lieu de les soutenir de façon tactique à certains moments. Tout cela n'avait aucun sens pour les anarchistes. Mais leur opposition « puriste » à toute intervention dans le jeu politique bourgeois ne les armait pas pour défendre l'autonomie du prolétariat dans les situations réelles et concrètes : un exemple de premier ordre en est donné dans l'article d'Engels : « Les bakouninistes à l'oeuvre » écrit en 1873. Analysant les soulèvements d'Espagne qui ne pouvaient certainement pas avoir un caractère socialiste prolétarien étant donnée l'arriération du pays, Engels montre comment l'opposition des anarchistes à la revendication d'une république, leurs phrases sonnantes sur l'établissement immédiat de la Commune révolutionnaire, ne les avaient pas empêchés, dans la pratique, d'être à la queue de la bourgeoisie. Les commentaires acerbes d'Engels sont comme une prédiction de ce que les anarchistes allaient faire en Espagne 1936, quoique dans un contexte historique différent :
« Les bakouninistes furent forcés, dés qu'ils se trouvèrent en face d'une véritable situation révolutionnaire, de jeter par-dessus bord tout leur programme antérieur. Tout d'abord, ils ont sacrifié la théorie faisant un devoir de s'abstenir de toute activité politique, et notamment, de la participation aux élections. Puis ce fut l'anarchie, l'abolition de l'Etat ; au lieu d'abolir l'Etat, ils ont tenté plutôt de créer une multitude d'Etats nouveaux et petits. Ensuite ils ont laissé tomber le principe selon lequel les ouvriers ne doivent prendre part à aucune révolution qui n'ait pour but l'émancipation immédiate et complète du prolétariat, et ils prirent eux-mêmes part à un mouvement de toute notoriété purement bourgeois. Enfin, ils foulèrent aux pieds le principe qu'ils venaient eux-mêmes de proclamer: à savoir que l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire n'est qu'une nouvelle duperie et une nouvelle trahison à l'égard de la classe ouvrière, alors qu'ils figuraient fort tranquillement dans les comités gouvernementaux des diverses villes et cela presque partout comme une minorité impuissante dominée et politiquement exploitée par les bourgeois. » ([16] [485])
La seconde dimension de cette discussion sur l'action politique était la question du pouvoir. Nous avons déjà vu que, pour les marxistes, l'Etat constitue un produit de l'exploitation, non sa cause. Il est l'émanation inévitable d'une société divisée en classe et il ne peut disparaître qu'une fois que les classes auront cessé d'exister. Mais, contrairement à la vision des anarchistes, cela ne peut être le résultat d'une grande « liquidation sociale » faite en une nuit. Cela nécessite une période plus ou moins longue de transition durant laquelle le prolétariat doit d'abord prendre en mains le pouvoir politique, et utiliser ce pouvoir pour lancer la transformation économique et sociale.
En défendant, au nom de la liberté et de l'opposition à toute forme d'autorité, que la classe ouvrière devait s'abstenir de conquérir le pouvoir politique, les anarchistes empêchaient donc la classe ouvrière d'établir sa base première. C'était nécessairement un acte « autoritaire ». Selon les fameux termes d'Engels :
« Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs ? Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit ; c'est l'acte par lequel une partie de la population impose sa volonté à l'autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons, moyens autoritaires s'il en est ; et le parti victorieux s'il ne veut pas avoir combattu en vain, doit maintenir son pouvoir par la peur que ses armes inspireront aux réactionnaires. La Commune de Paris aurait-elle duré un seul jour, si elle ne s'était pas servie de cette autorité du peuple armé envers les bourgeois ? Ne peut-on, au contraire, lui reprocher de ne pas s'en être servi assez largement ? Donc, de deux choses l'une : ou les antiautoritaires ne savent pas ce qu'ils disent, et, dans ce cas, ils ne sèment que la confusion ; ou bien, ils le savent et, dans ce cas, ils trahissent le mouvement du prolétariat. Dans un cas comme dans l'autre, ils servent la réaction. » ([17] [486])
Ailleurs, Engels souligne que la revendication par Bakounine de l'abolition immédiate de l'Etat avait montré sa véritable valeur dans la farce de Lyon en 1870 (c'est-à-dire peu de temps avant le soulèvement véritable des ouvriers à Paris). Bakounine et une poignée de ses supporters s'étaient établis sur les marches de la Mairie de Lyon et avaient déclaré l'abolition de l'Etat et son remplacement par une fédération de communes ; malheureusement, « l'Etat, sous la forme et l'espèce de deux compagnies de gardes nationaux bourgeois, entra par la porte qu'on avait oublié de garder, balaya la salle, et fit reprendre à la hâte le chemin de Genève à Bakounine », son décret miraculeux en poche. ([18] [487])
Mais si les marxistes niaient que l'Etat puisse être supprimé par décret, cela ne voulait pas dire qu'ils voulaient établir une nouvelle dictature sur les masses : l'autorité qu'ils défendaient était celle du prolétariat en armes, non celle d'une faction ou d'une clique particulière. Et à la suite des écrits de Marx sur la Commune, c'était tout simplement une calomnie de proclamer, comme le faisait sans cesse Bakounine, que les marxistes voulaient prendre le contrôle de l'Etat existant, que, tout comme les Lassaliens, ils étaient pour un « Etat du peuple » - notion violemment critiquée par Marx dans sa Critique du Programme de Gotha ([19] [488]). La. Commune avait mis au clair que la première action de la classe ouvrière révolutionnaire était la destruction de l'Etat bourgeois et la création de nouveaux organes de pouvoir dont la forme correspondait aux besoins et aux buts de la révolution. C'est évidemment une légende anarchiste de proclamer que, dès le lendemain de la Commune, Marx aurait laissé tomber, de façon opportuniste, ses visions autoritaires et aurait adopté les positions de Bakounine, que l'expérience de la Commune aurait donné raison aux principes anarchistes et réfuté les principes marxistes. En fait, à lire les écrits de Bakounine sur la Commune (en particulier dans L'empire allemand du Knout et la révolution sociale), on ne peut qu'être marqué par le caractère abstrait de ses réflexions, par l'absence de tentatives d'assimiler et lier entre elles les leçons essentielles de cet événement, comment il se perd en divagations floues sur Dieu et la religion. On ne peut les comparer aux leçons concrètes que Marx a tirées de la Commune, leçons sur la forme réelle de la dictature prolétarienne (l'armement des ouvriers, les délégués révocables, la centralisation « par en bas » ([20] [489]). En fait, même après la Commune, Bakounine était tout à fait incapable de voir comment le prolétariat pouvait s'organiser comme force unie. Dans Etatisme et Anarchie, Bakounine argumente contre l'idée de la dictature du prolétariat par des questions naïves comme « Est-ce à dire que le prolétariat sera tout entier à la direction des affaires publiques ? », ce à quoi Marx répond, dans les notes qu'il a écrites sur le livre de Bakounine (rédigées en 1874-75, mais publiées seulement en 1926) : « Le comité exécutif d'un syndicat le compose-t-il à lui tout seul ? ». Ou quand Bakounine écrit « On compte environ quarante millions d'allemands. Se peut-il que ces quarante millions fassent partie du gouvernement ? », Marx répond « Certainement ! Car la chose commence par l'autonomie de la Commune » ([21] [490]). En d'autres termes, Bakounine n'a rien compris à la signification de la Commune en tant que nouvelle forme de pouvoir politique qui n'était pas basé sur le divorce entre une minorité de gouvernants et une majorité de gouvernés, mais permettait que la majorité exploitée exerce un pouvoir réel sur une minorité d'exploiteurs, participe au processus révolutionnaire et assure que les nouveaux organes de pouvoir n'échappent pas à son contrôle. Cette immense découverte pratique de la classe ouvrière fournissait une réponse réaliste à la question souvent posée sur les révolutions : comment empêcher un nouveau groupe de privilégiés d'usurper le pouvoir au nom de la révolution ? Les marxistes furent capables de tirer cette leçon, même si cela nécessitait de corriger leur position précédente sur la possibilité de s'emparer de l'Etat existant. Pour leur part, les anarchistes ne furent capables de voir dans la Commune qu'une confirmation de leur principe éternel, qui ne se différencie pas des préjugés bourgeois libéraux : tous les pouvoirs sont corrompus et le mieux est ne rien avoir à faire avec la conception indigne d'une classe qui a pour but de faire la révolution la plus radicale de tous les temps.
La société future : la vision artisanale de l'anarchisme
Ce serait une erreur de simplement ridiculiser les anarchistes ou de croire qu'ils ont toujours manqué de perspicacité. Si l'on se plonge dans les écrits de Bakounine ou d'un de ses proches associés comme James Guillaume, on peut certainement trouver des images d'une grande force avec des éclairs de sagesse sur la nature du processus révolutionnaire, en particulier à travers l'insistance permanente sur le fait que « la révolution ne doit pas être faite pour le peuple mais par le peuple et ne peut réussir si elle n'implique pas de façon enthousiaste toutes les masses du peuple » ([22] [491]). Nous pouvons même présumer que les idées des bakouninistes qui parlaient des Communes révolutionnaires basées sur « des mandats impératifs, responsables et révocables » dès 1869 (dans le «Programme de la Fraternité internationale » que Marx et Engels citent dans « l’Alliance de la démocratie socialiste et l'Internationale » eurent un impact direct, en particulier sur la Commune de Paris, puisque certains de ses dirigeants étaient des adeptes de Bakounine (Varlin, par exemple).
Mais comme on l’a dit à plusieurs occasions, les idées justes de l'anarchisme sont comparables à une horloge arrêtée qui donne l'heure juste deux fois par jour ; ce qui manque, c'est une méthode cohérente qui permette de saisir, du point de vue du prolétariat, une réalité mouvante. Nous avons déjà vu que c'est le cas lorsque l'anarchisme traite des questions d'organisation et de pouvoir politique. Ce n'est pas moins le cas quand il fait ses prescriptions pour la société future qui, dans certains textes (Le catéchisme révolutionnaire de Bakounine, 1866, ou La construction du nouvel ordre social de Guillaume, 1876) ressemblent à des « recettes de cuisine pour les marmites de l'avenir » telles que Marx a toujours refusé d'en écrire. Néanmoins, ces livres sont utiles pour démontrer que les « pères » de l'anarchisme n'ont jamais saisi les problèmes du communisme à la racine - et en premier lieu, la nécessité d'abolir le chaos des rapports marchands et de mettre les forces productives du monde dans les mains d'une communauté humaine unifiée. Dans la description du futur par les anarchistes, malgré toutes les références au collectivisme et au communisme, le point de vue de l'artisan n'est jamais dépassé. D'après le texte de Guillaume, par exemple, ce serait une bonne chose que la terre soit labourée en commun, mais la question cruciale c'est que les paysans gagnent leur indépendance ; qu'ils l'obtiennent par la propriété individuelle ou collective « est d'importance secondaire » ; de même, les ouvriers deviendront propriétaires des moyens de production à travers des corporations de commerce séparées, et la société dans son ensemble sera organisée à travers une fédération de communes autonomes. En d'autres termes, c'est un monde encore divisé en une multitude de propriétaires indépendants (individus ou corporations) qui ne peuvent avoir de lien qu'au moyen de l'échange, à travers des rapports marchands. Dans le texte de Guillaume, ceci est tout à fait explicite : les diverses associations de producteurs et les communes doivent être liées au moyen des bons offices d'une « Banque d'échange » qui organisera l'achat et la vente au nom de la société.
Guillaume défend l'idée que la société sera capable de produire des biens en abondance et que l'échange sera remplacé par la simple distribution. Mais n'ayant pas de véritable théorie du capital et de son mode d'opération, les anarchistes sont incapables de voir qu'une société d'abondance ne peut émerger qu'à travers une lutte incessante contre la production marchande et la loi de la valeur, puisque ces dernières sont précisément ce qui maintient les forces productives de l'humanité en esclavage. Un retour à un système de simple production marchande ne peut certainement pas conduire à une société d'abondance. En fait, un tel système ne peut exister sur une base stable, puisque la production simple de marchandises engendre inévitablement une production élargie de marchandises - et toute la dynamique de l'accumulation capitaliste. Aussi, tandis que le marxisme, parce qu'il exprime le point de vue de la seule classe de la société capitaliste qui ait un véritable avenir, voit la libération des forces productives comme le fondement d'un développement illimité du potentiel de l'homme, l'anarchisme, et son point de vue artisanal, est prisonnier dans la vision d'un ordre statique d'échange libre et égal. Ce n'est pas une véritable anticipation du futur, mais la nostalgie d'un passé qui n'a jamais été.
CDW.
[1] [492] Cité dans La vie de Marx, l'homme et le lutteur, B. Nicolaïevski, Ed. Gallimard, p. 332.
[2] [493] Marx/Bakounine, Socialisme autoritaire ou libertaire, Editions 10 18, Tome I, p. 279.
[3] [494] Ibid.
[4] [495] Ibid, p. 290.
[5] [496] Ibid, p. 300.
[6] [497] Revue Internationale, n° 71, 4e trim. 1992.
[7] [498] Marx/Bakounine, Socialisme autoritaire ou libertaire, Editions 10 18, Tome II, p. 148.
[8] [499] Ibid
[9] [500] Ibid,p. 149.
[10] [501] Ibid., p. 130
[11] [502] Ecrit contre Marx, ibid., Tome II, p. 49.
[12] [503] Ibid, pp. 50-51.
[13] [504] Etatisme et Anarchie cité dans la critique de Marx, ibid. Tome II, p. 375.
[14] [505] Etatisme et Anarchie.
[15] [506] Ecrit contre Marx, ibid., Tome II, p. 11.
[16] [507] Les bakouninistes au travail, IV, in Sur l'anarcho-syndicalisme. Ed. du Progrès, p. 159.
[17] [508] De l'autorité, ibid. Tome II, p. 120.
[18] [509] L'Alliance de la Démocratie Socialiste et l’AIT, ibid., Tome II, p. 159.
[19] [510] Voir l'article de la Revue Internationale, n° 78, 3etrim. 1994.
[20] [511] Voir l'article de la Revue Internationale, n° 77, 2e trim. 1994.
[21] [512] Ibid Marx/Bakounine, Tome II, p. 378.
[22] [513] Le catéchisme national, 1866.
Approfondir:
Questions théoriques:
- Communisme [143]