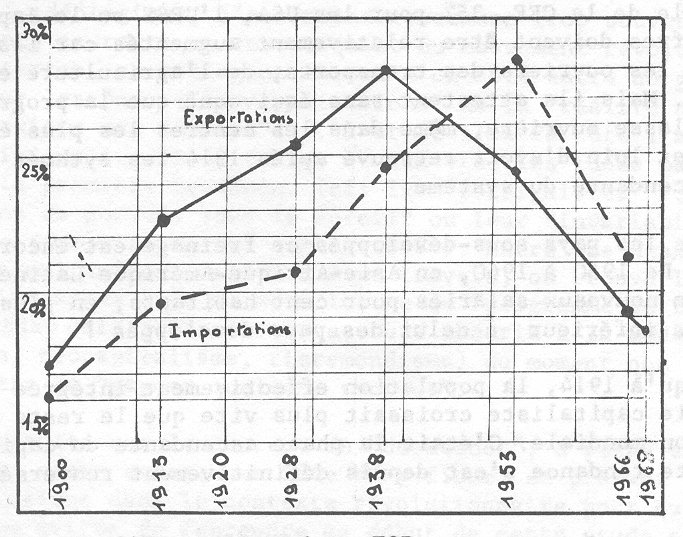Revue Internationale n° 141 - 2e trimestre 2010
- 2457 lectures
Face à la faillite de plus en plus évidente du capitalisme ... un seul avenir, la lutte de classe !
Jamais la faillite du système capitaliste n'aura été aussi évidente. Jamais, non plus, autant d’attaques aussi massives contre la classe ouvrière n'avaient été planifiées. Quels développements de la lutte de classe peut-on attendre dans cette situation ?
La gravité de la crise ne permet plus à la bourgeoisie d'en cacher la réalité
La crise des subprimes en 2008 a débouché sur une crise ouverte de dimension mondiale impliquant une chute de l'activité économique sans équivalent depuis 1929 :
- en quelques mois, de très nombreux établissements financiers ont été renversés comme une chaîne de dominos ;
- les fermetures d'usines se sont multipliées avec des centaines de milliers de licenciements partout dans le monde.
Les moyens mis en œuvre par la bourgeoisie pour éviter que l'effondrement ne soit encore plus brutal et profond n'ont pas été différents des politiques successives appliquées depuis le début des années 1970, à travers le recours au crédit. C'est ainsi qu'une nouvelle étape dans l'endettement mondial a été franchie, accompagnée d'un accroissement inégalé de la dette mondiale. Mais aujourd'hui, le montant de la dette mondiale est tel qu'il est devenu commun de parler de "crise de l'endettement" pour caractériser la phase actuelle de la crise économique.
La bourgeoisie a évité le pire, pour l'instant. Ceci dit, non seulement il n'y a pas eu de reprise, mais un certain nombre de pays présentent des risques sérieux d'insolvabilité, avec des taux d'endettement supérieurs à 100% du PIB. Parmi ceux-ci, non seulement la Grèce est en première ligne mais également le Portugal, l'Espagne (5e économie du l'UE), l'Irlande et l’Italie. La Grande-Bretagne, bien qu'elle n'ait pas atteint ces niveaux d'endettement, présente des signes que les spécialistes qualifient de très inquiétants.
Face au niveau de gravité atteint par la crise de surproduction, la bourgeoisie ne dispose que d'un seul recours : l’Etat. Mais celui–ci dévoile à son tour sa fragilité. La bourgeoisie ne fait que repousser les échéances tandis que tous les acteurs économiques n'ont d'autre issue que la fuite en avant qui devient de plus en plus difficilement praticable et risquée : s'endetter toujours davantage. Les fondements historiques de la crise tendent ainsi à devenir plus évidents. Contrairement au passé, la bourgeoisie ne peut plus camoufler la réalité de la crise et montre à visage découvert qu’il n’y a pas de solution possible au sein de son système.
Dans un tel contexte, l'insolvabilité d'un pays1 désormais incapable de rembourser les échéances de sa dette, peut provoquer une réaction en chaîne conduisant à l'insolvabilité de nombreux acteurs économiques (banques, entreprises, autres pays). Bien sûr, la bourgeoisie essaie encore de brouiller les pistes en polarisant l’attention sur la spéculation et les spéculateurs. Le phénomène de spéculation est réel mais ce mécanisme imprègne tout le système et pas seulement quelques "profiteurs" ou "patrons voyous". La finance folle, c'est-à-dire l'endettement sans limite et la spéculation à tout va, a été favorisée par le capitalisme comme un tout, comme un moyen de repousser les échéances de la récession. Tel est le mode de vie même du capitalisme aujourd'hui. Aussi c'est dans le capitalisme lui-même , incapable de survivre sans des injections nouvelles de crédits, de plus en plus massives, que réside le cœur du problème.
Quels remèdes la bourgeoisie concocte-t-elle à présent face à la crise de l'endettement ? La bourgeoisie est en train de tenter de faire passer un terrible plan d’austérité en Grèce. Un autre également est en préparation en Espagne. En France, de nouvelles attaques sur les pensions de retraites sont planifiées.
Les plans d'austérité peuvent-ils contribuer à relâcher l'étreinte de la crise ?
Les plans d'austérité constituent-ils un moyen pour une nouvelle reprise ? Permettront-ils de réhausser, au moins partiellement, le niveau de vie durement attaqué des prolétaires au cours de ces deux dernières années de crise ?
Certainement pas ! La bourgeoisie mondiale ne peut pas se permettre de laisser "couler" un pays comme la Grèce (malgré les déclarations tonitruantes et démagogiques d’Angela Merkel), sans courir le risque de conséquences analogues pour certains de ses créditeurs, mais la seule aide qu'elle puisse lui apporter, c'est de nouveaux crédits à un taux "acceptable" (cependant les prêts à 6% récemment imposés par l’UE à la Grèce sont déjà particulièrement élevés). En retour, des garanties de rigueur budgétaire sont exigées. L'assisté doit faire la preuve qu'il ne va pas constituer un puits sans fond engouffrant "l'aide internationale". Il est donc demandé à la Grèce de "réduire son train de vie" pour réduire le rythme de la croissance de ses déficits et de son endettement. Ainsi, à la condition que soient durement attaquées les conditions de vie de la classe ouvrière, le marché mondial des capitaux fera à nouveau confiance à la Grèce qui pourra attirer à elle les prêts et les investissements étrangers.
Ce n'est pas le moindre paradoxe de constater que la confiance à accorder à la Grèce dépend de sa capacité à réduire le rythme de l'accroissement de sa dette, et non pas de le stopper, ce qui serait d'ailleurs impossible. C'est-à-dire que la solvabilité de ce pays vis-à-vis du marché mondial des capitaux est suspendue à une augmentation de sa dette qui ne soit "pas trop importante". En d'autres termes, un pays déclaré insolvable à cause de son endettement peut devenir solvable même si cet endettement continue de croître. D’ailleurs, la Grèce elle-même a tout intérêt à faire planer la menace de son "insolvabilité" pour tenter de fléchir les taux d’intérêt de ses créanciers qui, s’ils n’étaient pas du tout remboursés, enregistreraient une perte sèche du montant de leurs créances et se trouveraient à leur tour rapidement "dans le rouge". Dans le monde actuel surendetté, la solvabilité est essentiellement basée non sur une réalité objective mais sur une confiance … pas réellement fondée.
Les capitalistes sont obligés d'adhérer à cette croyance, sinon ils doivent cesser de croire à la pérennité de leur système d'exploitation. Mais si les capitalistes sont obligés d'y croire, ce n'est pas le cas pour les ouvriers ! Les plans d’austérité permettent somme toute à la bourgeoisie de se rassurer mais ne résolvent en rien les contradictions du capitalisme et ne peuvent même pas enrayer la croissance de la dette.
Les plans d'austérité exigent une réduction drastique du coût de la force de travail, ce qui va être appliqué dans tous les pays puisque tous, à des degrés divers, sont confrontés à des problèmes énormes d'endettement et de déficit. Une telle politique qui, dans le cadre du capitalisme, ne connaît pas de réelle alternative, peut éviter un vent de panique, voire provoquer une mini-relance bâtie sur du sable, mais certainement pas assainir le système financier. Elle peut encore moins résoudre les contradictions du capitalisme qui le poussent à s'endetter toujours davantage sous peine d'être secoué par des dépressions de plus en plus brutales. Mais il faut aussi faire accepter ces plans d'austérité à la classe ouvrière. C'est pour la bourgeoisie un enjeu de taille et elle a aussi les yeux braqués sur la réponse des prolétaires à ces attaques.
Avec quel état d'esprit la classe ouvrière aborde-t-elle cette nouvelle vague d'attaques ?
Déjà, depuis le début des années 2000, le discours de la bourgeoisie "acceptez de vous serrer la ceinture pour que cela aille mieux demain" ne parvient généralement plus à illusionner la classe ouvrière, même s'il existe sur ce plan des différences d'un pays à l'autre. La récente aggravation de la crise ne s'est pas traduite jusqu'à présent par une amplification des mobilisations de la classe ouvrière au cours de ces deux ou trois dernières années. La tendance serait même plutôt inverse pour ce qui concerne l'année 2009. Les caractéristiques de certaines des attaques portées, notamment les licenciements massifs, ont en effet rendu la riposte de la classe ouvrière plus difficile puisque, face à ceux-ci :
- les patrons et les gouvernements se replient derrière un argument péremptoire : "Nous n’y sommes pour rien si le chômage augmente ou si vous êtes licenciés : c’est la faute de la crise."
- en cas de fermeture d’entreprise ou d’usine, l’arme de la grève devient inopérante, ce qui accentue le sentiment d’impuissance et le désarroi des travailleurs.
Néanmoins, même si ces difficultés pèsent encore lourdement sur la classe ouvrière, la situation n'est pas bloquée. C'est ce qu'illustre un changement d'état d'esprit au sein de la classe exploitée et se traduit par un frémissement de la lutte de classe.
L'exaspération et la colère des travailleurs sont nourries par une indignation profonde face à une situation de plus en plus scandaleuse et intolérable : la survie même du capitalisme a, entre autres, pour effet de faire apparaître plus crûment que jamais deux "mondes différents" au sein de la même société. Dans le premier, on trouve l'immense majorité de la population qui subit toutes les injustices et la misère et qui doit payer pour le second, le monde de la classe dominante, où il est fait un étalage indécent et arrogant de la puissance et de la richesse.
En lien plus direct avec la crise actuelle, l'idée répandue selon laquelle "ce sont les banques qui nous ont mis dans une mouise dont on ne peut pas sortir" (alors qu'on voit les Etats eux-mêmes approcher de la cessation de paiement) trompe de moins en moins et catalyse la colère contre le système. On voit ici les limites du discours de la bourgeoisie qui désignait les banques comme responsables de la crise actuelle pour tenter d'épargner son système comme un tout. Le "scandale des banques" éclabousse l'ensemble du capitalisme.
Même si la classe ouvrière à l’échelle internationale reste encore sonnée et désemparée face à l’avalanche des coups que lui portent tous les gouvernements de gauche comme de droite, elle n’est pas pour autant résignée ; elle n'est pas restée sans réaction au cours de ces derniers mois. En effet, les caractéristiques fondamentales de la lutte de classe qui avaient marqué certaines mobilisations ouvrières depuis 2003, refont leur apparition sous une forme plus explicite. C'est le cas, en particulier, de la solidarité ouvrière qui tend à nouveau à s'imposer comme un besoin fondamental de la lutte, après avoir été tant dénaturée et dépréciée dans les années 1990. A présent, elle se manifeste sous la forme d'initiatives, certes encore très minoritaires, mais porteuses d'avenir.
En Turquie, aux mois de décembre et janvier derniers, la lutte des ouvriers de Tekel a constitué un phare pour la lutte de classe. Elle a uni dans le même combat des ouvriers turcs et kurdes (alors qu'un conflit nationaliste divise ces populations depuis des années) comme elle a fait preuve d'une volonté farouche d'étendre la lutte à d'autres secteurs et s'est opposée de façon déterminée au sabotage des syndicats.
Au cœur même du capitalisme, alors que l'encadrement syndical, plus puissant et sophistiqué que dans les pays périphériques, permet encore d'empêcher l'explosion de luttes aussi importantes, on assiste aussi à un regain de la combativité de la classe ouvrière. Ainsi, les mêmes caractéristiques se sont vérifiées début février en Espagne, à Vigo. Là, les chômeurs sont allés trouver les travailleurs actifs des chantiers navals et ils ont manifesté ensemble, en rassemblant d’autres travailleurs jusqu’à obtenir l’arrêt du travail dans tout le secteur naval. Ce qui fut le plus remarquable dans cette action, c'est le fait que l'initiative avait été prise par les travailleurs licenciés des chantiers navals, lesquels avaient été remplacés par des travailleurs immigrés "qui dorment dans des parkings et qui mangent tout juste un sandwich par jour". Loin de susciter des réactions xénophobes de la part des ouvriers avec qui ils avaient été mis en concurrence par la bourgeoisie, ces derniers se sont solidarisés contre les conditions d'exploitation inhumaines réservées aux travailleurs immigrés. Ces manifestations de solidarité ouvrière s'étaient déjà produite également en Grande-Bretagne à la raffinerie de Lindsey de la part d'ouvriers du bâtiment en janvier et en juin 2009 de même qu'en Espagne dans les chantiers navals de Sestao en avril 2009 2.
Dans ces luttes, même si c'est de façon encore limitée et embryonnaire, la classe ouvrière a démontré non seulement sa combativité mais aussi sa capacité à contrer les campagnes idéologiques de la classe dominante pour la diviser, en exprimant sa solidarité prolétarienne, en unissant dans un même combat des ouvriers de différentes corporations, secteurs, ethnies ou nationalités. De même, la révolte des jeunes prolétaires, organisés en assemblées générales et qui avait attiré le soutien de la population, en décembre 2008 en Grèce, avait fait craindre à la classe dominante, la "contagion" de l’exemple grec aux autres pays européens, en particulier chez les jeunes générations scolarisées. Aujourd'hui, ce n’est pas un hasard si les yeux de la bourgeoisie sont à nouveau tournés vers les réactions des prolétaires en Grèce face au plan d’austérité imposé par le gouvernement et les autres Etats de l’Union européenne. Ces réactions ont valeur de test pour les autres Etats menacés par la faillite de leur économie nationale. D’ailleurs, l’annonce quasiment simultanée de plans similaires a également précipité dans la rue des dizaines de milliers de prolétaires qui ont manifesté en Espagne ou au Portugal. Ainsi, malgré les difficultés qui pèsent encore sur la lutte de classe, un changement d’état d’esprit est néanmoins en train de s’opérer dans la classe ouvrière. Partout dans le monde, l’exaspération et la colère s’approfondissent et se généralisent dans les rangs ouvriers.
Les réactions aux plans d’austérité et aux attaques
En Grèce...
En Grèce, le gouvernement a annoncé le 3 mars un nouveau plan d'austérité, le troisième en trois mois, impliquant une hausse des taxes à la consommation, la réduction de 30% du 13e mois et de 60% du 14e mois de salaire, primes touchées par les fonctionnaires (soit une diminution de 12% à 30% en moyenne de leur salaire) ainsi que le gel des pensions de retraites des fonctionnaires et des salariés du secteur privé. Mais ce plan passe très mal dans la population, notamment chez les ouvriers et les retraités.
En novembre-décembre 2008, le pays avait été secoué pendant plus d’un mois par une explosion sociale, menée principalement par la jeunesse prolétarienne, à la suite de l'assassinat d'un jeune par la police. Cette année, les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement socialiste menaçaient de déclencher une explosion non seulement parmi les étudiants et les chômeurs mais aussi parmi les bataillons principaux de la classe ouvrière.
Un mouvement de grève générale le 24 février 2010 contre le plan d’austérité a été largement suivi et une mobilisation des fonctionnaires du gouvernement a rassemblé autour de 40 000 manifestants. Un grand nombre de retraités et de fonctionnaires ont également manifesté le 3 mars dans le centre d'Athènes.
Les événements qui ont suivi ont montré encore plus clairement que le prolétariat était mobilisé : "Quelques heures seulement après l'annonce des nouvelles mesures, des travailleurs licenciés de l'Olympic Airways ont attaqué les brigades de la police anti-émeute gardant le siège de la compagnie et ont occupé le bâtiment, dans ce qu'ils appellent une occupation à durée indéterminée. L'action a conduit à la fermeture de la principale rue commerçante d'Athènes, pour de longues heures." (blog sur libcom.org)
Dans les jours précédant la grève générale du 11 mars, une série de grèves et d’occupations ont eu lieu : les travailleurs licenciés d’Olympic Airways ont occupé pendant 8 jours le siège de la Cour des Comptes tandis que les salariés de la compagnie d’électricité occupaient les agences pour l’emploi au nom du "droit des futurs chômeurs que nous sommes", selon l’un d’eux. Les ouvriers de l'Imprimerie nationale ont occupé leur lieu de travail et refusé d'imprimer les textes légaux des mesures d'économie en misant sur le fait que tant que la loi n'est pas imprimée, elle n'est pas valide... Les agents du fisc ont arrêté le travail pendant 48h, les salariés des auto-écoles dans le Nord du pays ont fait 3 jours de grève ; même les juges et autres officiers de justice ont stoppé toute activité pendant 4 heures chaque jour. Aucune poubelle n'a été vidée pendant plusieurs jours à Athènes, à Patras et à Thessalonique, les éboueurs ayant bloqué les grands dépôts de ces villes. Dans la ville de Komitini, les ouvriers de l’entreprise textile ENKLO ont mené une lutte avec marches de protestation et grèves : deux banques ont été occupées par les travailleurs.
Mais si la classe ouvrière en Grèce se trouve plus largement mobilisée qu'au cours des luttes de novembre-décembre 2008, les appareils d’encadrement de la bourgeoisie ont été mieux préparés et efficaces pour saboter la riposte ouvrière.
En effet, la bourgeoisie a pris les devants pour détourner la colère et la combativité des travailleurs vers des impasses politiques et idéologiques. Celles-ci sont parvenues à évacuer toutes les potentialités de prise en mains de la lutte et de la solidarité prolétariennes qui avaient commencé à prendre forme à travers le combat des jeunes générations ouvrières fin 2008.
L’exaltation du patriotisme et du nationalisme est largement utilisée pour diviser les ouvriers et les isoler de leurs frères de classe dans les autres pays : en Grèce, l’élément le plus mis en avant est le fait que la bourgeoisie allemande refuse d’aider l'économie grecque et le gouvernement du PASOK ne se prive pas d'exploiter les sentiments anti-allemands qui survivent encore de l'occupation nazie.
Le contrôle par les partis et les syndicats a permis d’isoler les ouvriers les uns des autres. Ainsi les salariés d’Olympic Airways n'ont permis à aucun étranger à la compagnie de pénétrer dans le bâtiment public qu’ils occupaient et les dirigeants syndicaux l'ont fait évacuer sans la moindre décision d’une AG. Quand d’autres ouvriers ont voulu se rendre dans les locaux du Trésor public, occupés par ceux de l’Imprimerie Nationale, ils furent sèchement refoulés sous prétexte "qu’ils n’appartenaient pas au ministère" !
La profonde colère des ouvriers en Grèce s’est exprimée contre le PASOK et les dirigeants syndicaux qui lui sont inféodés. Le 5 mars, le leader de la GSEE, centrale syndicale du secteur privé, a été malmené et frappé alors qu’il tentait de prendre la parole devant la foule et a dû être secouru par la police anti-émeute et se réfugier dans le bâtiment du Parlement, sous les huées de la foule l’invitant ironiquement à aller où il est à sa place : dans le nid des voleurs, des assassins et des menteurs.
Mais le PC grec (KKE) et son officine syndicale, le PAME, se présentent comme des alternatives "radicales" au PASOK alors qu'ils entretiennent une campagne pour focaliser la responsabilité de la crise sur les banquiers ou sur "les méfaits du libéralisme".
En novembre-décembre 2008, le mouvement avait été largement spontané et avaient tenu des assemblées générales ouvertes dans les écoles occupées et les universités. Le siège du Parti communiste (KKE), comme le siège de sa confédération syndicale du PAME, avait été lui-même occupé, ce qui était le signe d'une claire méfiance envers les appareils syndicaux et les staliniens, lesquels avaient dénoncé les jeunes manifestants à la fois comme des lumpen-prolétaires et des enfants gâtés de la bourgeoisie.
Mais cette fois-ci, le PC grec s'est ostensiblement mis à l’avant-garde des grèves, manifestations et occupations les plus radicales : "Le matin du 5 mars, les travailleurs du PAME syndicat affilié au Parti communiste occupait le ministère des finances (…) ainsi que la mairie du district de Trikala. Plus tard, le PAME a fait également occuper 4 émetteurs de TV dans la ville de Patras, et la station de télévision d’Etat de Thessalonique, obligeant les journalistes d'information à lire une déclaration contre les mesures gouvernementales" 3. Beaucoup de grèves ont également été déclenchées à l’initiative du PC qui avait appelé dès le 3 mars à une "grève générale" et à une manifestation pour le 5, et dès le 4 dans différentes villes. Le PAME a intensifié les actions spectaculaires, occupant tantôt le ministère des finances, tantôt investissant les locaux de la Bourse.
Le 11 mars, toute la Grèce a été paralysée à 90% pendant 24 heures par le mouvement de colère de la population suite au second appel en moins d’un mois des deux principaux syndicats à la grève générale. Au total, plus de 3 millions de personnes (sur une population totale de 11 millions) y ont pris part. La manifestation du 11 mars a été la plus massivement suivie à Athènes depuis 15 ans et elle a montré la détermination de la classe ouvrière à riposter à l’offensive capitaliste.
... et ailleurs
Dans toutes lés régions du monde, en Algérie, en Russie, au sein de la main-d’œuvre immigrée des Emirats, surexploitée et privée de toute protection sociale, chez les prolétaires anglais et parmi les étudiants réduits à une situation précaire dans l’ex-plus riche Etat de l’Amérique, la Californie, la situation actuelle témoigne d’une tendance de fond vers la reprise de la lutte de classe à l’échelle internationale.
La bourgeoisie est confrontée à une situation où, en plus des licenciements dans les entreprises en difficulté, les Etats doivent assumer frontalement les attaques contre la classe ouvrière pour lui faire supporter le coût de la dette. Le responsable direct des attaques, l'Etat en l'occurrence, est cette fois beaucoup plus facilement identifiable que dans le cas des licenciements face auxquels il peut même se présenter comme le "protecteur", même peu puissant, des salariés. Le fait que l'Etat apparaisse clairement pour ce qu'il est, le premier défenseur des intérêts de toute la classe capitaliste contre l'ensemble de la classe ouvrière, est un facteur qui favorise le développement de la lutte de classe, de son unité et de sa politisation.
Tous les éléments qui se développent dans la situation actuelle constituent les ingrédients pour l'explosion de luttes massives. Mais ce qui sera le détonateur de celles-ci est très certainement l'accumulation de l'exaspération, du ras le bol et de l'indignation. L'application par la bourgeoisie des différents plans d'austérité planifiés dans différents pays, va constituer autant d'occasions d'expériences de lutte et de leçons pour la classe ouvrière.
Les luttes massives, une étape future importante pour le développement de la lutte de classe … mais pas la dernière
L'effondrement du stalinisme et, surtout, son exploitation idéologique par la bourgeoisie fondée sur le plus grand mensonge du siècle identifiant les régimes staliniens au socialisme, ont laissé des traces présentes encore aujourd'hui dans la classe ouvrière.
Face aux "évidences" assénées par la bourgeoisie : "le communisme, ça ne marche pas ; la preuve, c’est qu’il a été abandonné au bénéfice du capitalisme par les populations concernées", les ouvriers ne pouvaient que se détourner du projet d’une société alternative au capitalisme.
La situation qui en a résulté est, de ce point de vue, très différente de celle qu'on a connue à la fin des années 1960. A cette époque, le caractère massif des combats ouvriers, notamment avec la grève de mai 1968 en France et "l’automne chaud" italien de 1969, avait mis en évidence que la classe ouvrière peut constituer une force de premier plan dans la vie de la société. L’idée qu’elle pourrait un jour renverser le capitalisme n’appartenait pas au domaine des rêves irréalisables, contrairement à aujourd'hui.
La difficulté à entrer massivement en lutte manifestée par le prolétariat depuis les années 1990 résulte d'un manque de confiance en lui-même, qui n'a pas été dissipé par le renouveau de la lutte de classe de l'année 2003.
Ce n'est que le développement des luttes massives qui permettra au prolétariat de récupérer la confiance en ses propres forces et de mettre à nouveau en avant sa perspective propre. C'est donc une étape fondamentale dans laquelle les révolutionnaires doivent favoriser la capacité de la classe ouvrière à comprendre les enjeux de ses combats dans leur dimension historique, à reconnaître ses ennemis et à prendre en main elle-même ses luttes.
Pour importante que soit cette étape future de la lutte de classe, elle ne signifiera pas pour autant la fin des hésitations du prolétariat à s'engager résolument dans la voie qui mène à la révolution.
Déjà en 1852, Marx, mettait en évidence le cours difficile et tortueux de la révolution prolétarienne, contrairement à celui des révolutions bourgeoises qui, "comme celles du 18e siècle, se précipitent rapidement de succès en succès" 4.
Cette différence, entre prolétariat et bourgeoisie, lorsqu'ils agissent comme classes révolutionnaires, résulte des différences existant entre les conditions de la révolution bourgeoise et celles de la révolution prolétarienne.
La prise du pouvoir politique par la classe capitaliste avait constitué le point d'arrivée de tout un processus de transformation économique au sein de la société féodale. Au cours de celui-ci, les anciens rapports de production féodaux, ont progressivement été supplantés par les rapports de production capitalistes. C'est sur ces nouveaux rapports économiques que la bourgeoisie s'est appuyée pour conquérir le pouvoir politique.
Tout différent est le processus de la révolution prolétarienne. Les rapports de production communistes, qui ne sont pas des rapports marchands, ne peuvent se développer au sein de la société capitaliste. Du fait qu'elle est la classe exploitée dans le capitalisme, privée par définition de la propriété des moyens de production, la classe ouvrière ne dispose pas, et ne peut disposer, de points d'appui économiques pour la conquête du pouvoir politique. Ses points d'appui sont sa conscience et son organisation dans la lutte. Contrairement à la bourgeoisie révolutionnaire, le premier acte de la transformation communiste des rapports sociaux doit consister en un acte conscient et délibéré : la prise du pouvoir politique à l'échelle mondiale par l'ensemble du prolétariat organisé en conseils ouvriers.
L'immensité de cette tâche est évidemment de nature à faire hésiter la classe ouvrière, à la faire douter de sa propre force. Mais c'est le seul chemin pour la survie de l'humanité : l'abolition du capitalisme, de l'exploitation et la création d'une nouvelle société.
FW (31 mars)
1. Bien entendu, la faillite d’un Etat n’a pas du tout les mêmes caractéristiques que celle d’une entreprise : s’il devenait incapable de rembourser ses dettes, il n’est pas question qu’un Etat mette la "clef sous la porte", puisse licencier tous ses fonctionnaires et dissoudre ses propres structures (police, armée, corps enseignant ou administratif…) même si, dans certains pays (notamment en Russie ou certains pays d’Afrique), les fonctionnaires ont pu, du fait de la crise, ne pas être payés pendant des mois…
2. Lire les articles suivants : "Grèves en Angleterre : Les ouvriers du bâtiment au centre de la lutte [2]" ; Sur la Turquie : "Solidarité avec la résistance des ouvriers de Tekel contre le gouvernement et les syndicats ! [3]" ; Sur l’Espagne : "A Vigo, l’action conjointe des chômeurs et des ouvriers des chantiers navals [4]"
3. D’après libcom.org [5]
4. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte.
Hommage à notre camarade Jerry Grevin
- 1868 lectures
Notre camarade Jerry Grevin, militant de longue date de la section américaine du CCI, est mort subitement d'une crise cardiaque le 11 février 2010. Sa mort prématurée est une perte énorme pour notre organisation et tous ceux qui le connaissaient : sa famille a perdu un mari, un père et un grand-père tendre et affectueux ; ses compagnons de travail à l'université où il enseignait ont perdu un collègue estimé ; les militants du CCI, dans sa section et dans le monde entier, ont perdu un camarade très aimé et totalement dévoué.
Jerry Grevin est né en 1946 à Brooklyn, dans une famille ouvrière de la deuxième génération d'immigrants juifs. Ses parents avaient un esprit critique qui les mena à entrer au Parti communiste des Etats-Unis, puis à le quitter. Le père de Jerry avait été profondément choqué par la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki à laquelle il avait assisté en tant que membre des forces américaines d'occupation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait jamais parlé de cette expérience et que son fils ne l'ait connue que bien plus tard, Jerry était convaincu qu'elle avait exacerbé l'état d'esprit anti-patriotique et anti-guerre qu'il avait hérité de ses parents.
L'une des grandes qualités de Jerry, et qui ne s'est jamais démentie, était son indignation brûlante et inébranlable contre toute forme d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Dès sa jeunesse; il a énergiquement pris part aux grandes causes sociales de l'époque. Il participa aux grandes manifestations contre la ségrégation et l'inégalité raciale organisées par le Congress of Racial Equality (CORE) dans le Sud des Etats-Unis. Cela nécessitait un courage certain puisque des militants et des manifestants subissaient quotidiennement de mauvais traitements, des bastonnades et étaient même assassinés ; et Jerry étant juif, non seulement il combattait les préjugés racistes, il en était lui-même l'objet. 1
Pour sa génération, aux Etats-Unis en particulier, l'autre question cruciale de l'époque était l'opposition à la Guerre du Vietnam. Exilé à Montréal au Canada, il fut l'animateur d'un des comités qui faisait partie du "Second Underground Railroad" 2 pour aider les déserteurs de l'armée américaine à fuir les Etats-Unis et à commencer une nouvelle vie à l'étranger. Il s'engagea dans cette activité non comme pacifiste mais avec la conviction que la résistance à l'ordre militaire pouvait et devait faire partie d'une lutte de classe plus large, contre le capitalisme, et il participa à la publication militante, de courte durée, Worker and Soldier. Plusieurs années après, Jerry eut la possibilité de consulter une partie –largement censurée- de son dossier au FBI: son épaisseur et les détails qu'il comportait –le dossier était régulièrement mis à jour dans la période où il militait dans le CCI- lui procurèrent une certaine satisfaction de constater que ses activités inquiétaient les défenseurs de l'ordre bourgeois et induisirent de sa part quelques commentaires caustiques envers ceux qui pensent que la police et les services de renseignements "ne s'occupent pas" des petits groupes insignifiants de militants aujourd'hui.
A son retour aux Etats-Unis dans les années 1970, Jerry travailla comme technicien des téléphones dans une des principales compagnies téléphoniques. C'était une période de bouillonnement de la lutte de classe avec la crise qui commençait à frapper et Jerry participa aux luttes à son travail, aux petites comme aux grandes, en même temps qu'il participait à un journal appelé Wildcat, prônant l'action directe et publié par un petit groupe du même nom. Bien qu'il ait été déçu par l'immédiatisme et l'absence d'une perspective plus large – c'est la recherche d'une telle perspective qui l'amena à rejoindre le CCI –cette expérience directe, à la base, couplée à ses grandes capacités d'observation et à une attitude humaine envers les travers et les préjugés de ses collègues de travail, lui apporta une vision profonde de la façon dont se développe concrètement la conscience dans la classe ouvrière. Comme militant du CCI, il illustrait souvent ses arguments politiques d'images vivantes tirées de son expérience.
Une de celles-ci décrivait un incident dans le Sud des États-Unis où son groupe de techniciens du téléphone de New York avait été envoyé travailler. Un ouvrier du groupe, un noir, était persécuté par la direction pour une prétendue faute , en fait totalement mineure; les New-Yorkais prirent sa défense, à la grande surprise de leurs collègues du Sud : "Pourquoi s'en faire ?" demandèrent-ils "ce n'est qu'un nègre". Ce à quoi un des New-Yorkais répondit vigoureusement que la couleur de la peau n'avait aucune importance, que les ouvriers étaient tous ouvriers ensemble et devaient se défendre mutuellement contre les patrons. "Mais le plus remarquable concluait Jerry, c'est que le type qui avait pris le plus fort la défense de l'ouvrier noir était connu du groupe pour être lui-même raciste et avoir déménagé à Long Island pour ne pas habiter dans un quartier noir. Et cela montre comment la lutte et la solidarité de classe constituent le seul véritable antidote au racisme".
Une autre histoire qu'il aimait raconter, concernait sa première rencontre avec le CCI. Pour citer l'hommage personnel d'un camarade : "Comme je l'ai entendu raconter un million de fois, c'est quand il rencontra pour la première fois un militant du CCI à une époque où il était, comme il le décrivait lui-même, "un jeune individualiste immédiatiste", écrivant et diffusant ses articles seul, qu'il se rendit compte que la passion révolutionnaire sans organisation ne pouvait qu'être une flamme passagère de jeunesse. C'est quand le militant du CCI lui dit: "OK, tu écris et tu es marxiste, mais que fais-tu pour la révolution?". Jerry racontait souvent cette histoire à la suite de quoi il ne dormit pas de toute la nuit. Mais ce fut une nuit blanche qui porta prodigieusement ses fruits". Beaucoup auraient pu se décourager face au commentaire abrupt du CCI, mais pas Jerry. Au contraire, cette histoire (qu'il racontait en s'amusant de son état d'esprit de l'époque) révèle une autre facette de Jerry: sa capacité à accepter la force d'un argument et à changer de point de vue s'il était convaincu par d'autres idées – une qualité précieuse dans le débat politique qui est l'âme d'une véritable organisation prolétarienne.
La contribution de Jerry au CCI est inestimable. Sa connaissance du mouvement ouvrier aux Etats-Unis était encyclopédique; sa plume alerte et son écriture colorée ont fait vivre cette histoire pour nos lecteurs dans les nombreux articles qu'il a écrits pour notre presse aux Etats-Unis (Internationalism) et pour la Revue internationale. Il avait aussi une maîtrise remarquable de la vie politique et de la lutte de classe aux Etats-Unis aujourd'hui et ses articles sur l'actualité, tant pour notre presse que pour nos bulletins internes, ont été des apports importants pour notre compréhension de la politique de la première puissance impérialiste mondiale.
Sa contribution à la vie interne et à l'intégrité organisationnelle du CCI a également été importante. Pendant des années, il a été un pilier de notre section américaine, un camarade sur qui on pouvait toujours compter pour être aux avant-postes quand des difficultés se présentaient. Pendant les difficiles années 1990, quand le monde entier –mais particulièrement peut-être les Etats-Unis- était inondé par la propagande sur "la victoire du capitalisme", Jerry ne perdit jamais la conviction de la nécessité et de la possibilité d'une révolution communiste, il ne cessa jamais de communiquer avec ceux qui l'entouraient et avec les rares nouveaux contacts de la section. Sa loyauté à l'organisation et à ses camarades était inébranlable, d'autant plus que, comme il le disait lui-même, c'était sa participation à la vie internationale du CCI qui lui donnait du courage et lui permettait de "recharger ses batteries".
Sur un plan plus personnel, Jerry était aussi extraordinairement drôle et doué pour raconter des histoires. Il pouvait –et cela arrivait souvent – faire rire pendant des heures une audience d'amis ou de camarades avec des histoires le plus souvent tirées de ses observations de la vie. Alors que ses histoires déployaient parfois des piques aux dépens des patrons ou de la classe dominante, elles n'étaient jamais cruelles ou méchantes. Au contraire, elles révélaient son affection et sa sympathie pour ses semblables, de même qu'une capacité bien trop rare à se moquer de ses propres faiblesses. Cette ouverture aux autres est sans doute ce qui a fait de Jerry un professeur efficace (et apprécié) – profession qu'il a embrassée tard, quand il était déjà dans la quarantaine.
Notre hommage à Jerry serait incomplet si nous ne mentionnions pas sa passion pour la musique Zydeco (un style de musique ayant pour origine les créoles de Louisiane et qui y est toujours jouée). Le danseur de Brooklyn était connu dans les festivals de Zydeco de l'arrière-pays de Louisiane, et Jerry était fier de pouvoir aider de jeunes groupes de Zydeco inconnus à trouver des lieux et une audience pour jouer à New York. C'était tout Jerry : enthousiaste et énergique dans tout ce qu'il entreprenait, ouvert et chaleureux avec les autres.
Nous ressentons d'autant plus vivement la perte de Jerry que ses dernières années ont été parmi les plus heureuses. Il était ravi de devenir le grand-père d'un petit-fils adoré. Politiquement, il y avait le développement d'une nouvelle génération de contacts autour de la section américaine du CCI et il s'était lancé dans le travail de correspondance et de discussion avec toute son énergie coutumière. Son dévouement avait porté ses fruits dans les Journées de Discussion tenues à New York quelques semaines seulement avant sa mort, qui avaient rassemblé de jeunes camarades de différentes parties des Etats-Unis, dont beaucoup se rencontraient pour la première fois. A la fin de la réunion, Jerry était ravi et il voyait celle-ci, et tout l'avenir qu'elle incarnait, comme l'un des couronnements de son activité militante. Il nous paraît donc juste de donner, pour terminer, la parole à deux jeunes camarades qui ont participé aux Journées de Discussion. Pour JK : "Jerry était un camarade de confiance et un ami chaleureux...Sa connaissance de l'histoire du mouvement ouvrier aux Etats-Unis ; la profondeur de son expérience personnelle dans les luttes des années 1970 et 1980 et son engagement à maintenir la flamme de la Gauche communiste aux Etats-Unis pendant la difficile période qui a suivi la prétendue "mort du communisme" étaient incomparables". Pour J : "Jerry a été une sorte de guide politique pour moi au cours des 18 derniers mois. Il était aussi un ami très cher (...) Il voulait toujours discuter et aider les camarades plus jeunes à apprendre comment intervenir et à comprendre les leçons historiques du mouvement ouvrier. Sa mémoire vivra dans chacun de nous, dans le CCI et à travers toute la lutte de classe."
CCI
1. En 1964, il y eut une affaire tristement célèbre où trois jeunes militants des droits civiques (James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner) furent assassinés par des officiers de police et des membres du Ku Klux Klan. Deux d'entre eux étaient des Juifs de New York.
2. Le nom "Underground Railroad" était une référence à un réseau, créé au 19e siècle avant la Guerre civile, de cachettes et de militants anti-esclavagistes qui aidaient les esclaves en fuite à gagner le Nord des États-Unis et le Canada.
Personnages:
- Jerry Grevin [6]
Qu'est-ce que les conseils ouvriers ? (II) : de février à juillet 1917 : resurgissement et crise
- 3827 lectures
Le but de cette série est de répondre à une question que se posent beaucoup de camarades (lecteurs et sympathisants), surtout parmi les plus jeunes : que sont les conseils ouvriers ? Dans le premier article de cette série 1, nous avons vu comment ils apparurent pour la première fois de l’histoire à la chaleur de la Révolution de 1905 en Russie et comment la défaite de cette dernière entraîna leur disparition. Dans ce deuxième article, nous allons voir comment ils réapparurent lors de la Révolution de Février 1917 et de quelle manière, sous la domination des anciens partis révolutionnaires mencheviques et socialistes-révolutionnaires (SR) qui avaient trahi la classe ouvrière, ils s’éloignèrent de la volonté et de la conscience croissante des masses ouvrières jusqu’à devenir, en juillet 1917, un point d’appui de la contre-révolution 2.
Pourquoi les soviets disparaissent-ils entre 1905 et 1917 ?
Oskar Anweiler, dans son ouvrage Les Soviets en Russie (3), souligne comment de nombreuses tentatives eurent lieu pour faire revivre les soviets à la suite de la défaite de la révolution en décembre 1905. Un Conseil de chômeurs vit ainsi le jour au printemps 1906 à Saint-Pétersbourg, qui envoya des délégués aux usines pour pousser à la renaissance du soviet. Une réunion qui regroupa 300 délégués en été 1906 ne donna rien à cause des difficultés à reprendre la lutte. Ce Conseil se décomposa peu à peu avec l’affaiblissement de la mobilisation, et disparut définitivement au printemps 1907. A Moscou, Kharkov, Kiev, Poltava, Ekaterinbourg, Bakou, Batoum, Rostoum et Kronstadt apparurent aussi des conseils de chômeurs plus ou moins éphémères tout au long de 1906.
Des soviets apparurent aussi sporadiquement en 1906-1907 dans certaines villes industrielles de l’Oural. C’est cependant à Moscou qu’eut lieu la tentative la plus sérieuse de constituer un soviet. Une grève éclata en juillet et s’étendit rapidement à de nombreuses concentrations ouvrières. Celles-ci mandatèrent rapidement quelques 150 délégués qui parvinrent à se réunir et à constituer un Comité exécutif, lançant des appels à l’extension de la lutte et à la formation de soviets de quartier. Les conditions n’étaient cependant pas celles de 1905 et le gouvernement, constatant le peu d’écho suscité par la mobilisation à Moscou, déchaîna une violente répression qui vint à bout de la grève et du tout nouveau soviet.
Puis les soviets disparurent de la scène sociale jusqu'en 1917. Cette disparition étonne bien des camarades qui se demandent comment il est possible que les mêmes ouvriers, qui avaient participé avec tant d’enthousiasme aux soviets en 1905, les aient condamnés à l’oubli ? Comment comprendre que la forme "conseil", qui avait démontré son efficacité et sa force en 1905, puisse disparaître comme par enchantement pendant une bonne douzaine d'années ?
Pour répondre à cette question, on ne peut partir du point de vue de la démocratie bourgeoise qui considère la société comme une somme d'individus, "libres et souverains", aussi "libres" de constituer des conseils que de participer à des élections. Si c'était le cas, comment comprendre alors que les millions de citoyens qui "avaient décidé" de se constituer en soviets en 1905 "choisirent" ensuite de délaisser cette forme d'organisation durant de longues années ?
Un tel point de vue ne peut parvenir à comprendre que la classe ouvrière n’est pas une somme d’individus "libres et autodéterminés", mais une classe qui ne parvient à s’exprimer, agir et s’organiser que lorsqu'elle s'affirme à travers son action collective dans la lutte. Cette dernière n’est pas alors la résultante de "décisions individuelles" mais bien le produit dynamique de la conjonction d’un ensemble de facteurs objectifs (la dégradation des conditions d’existence et l’évolution générale de la société), et de facteurs subjectifs (l'indignation, l’inquiétude sur l’avenir qui en découle, l'expérience de la lutte et le développement de la conscience de classe animés par l’intervention des révolutionnaires). L’action et l’organisation de la classe ouvrière sont un processus social, collectif et historique qui traduit une évolution du rapport de force entre les classes.
De plus, cette dynamique de la lutte de classe doit à son tour être replacée dans le contexte historique qui permet la naissance des soviets. Pendant la période historique d’ascendance du système capitaliste – et en particulier durant "l’âge d’or" entre 1873 et 1914 – le prolétariat avait pu constituer de grandes organisations permanentes de masse (en particulier, les syndicats) dont l’existence était une des conditions premières pour mener des luttes victorieuses. Dans la période historique qui s’ouvre au début du 20e siècle, celle de la décadence du capitalisme, marquée par l'éclatement de la Première Guerre mondiale, l’organisation générale de la classe ouvrière se construit dans et par la lutte, disparaissant avec elle si celle-ci ne peut aller jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au combat révolutionnaire pour détruire l’État bourgeois.
Dans de telles conditions, les acquis des luttes ne peuvent plus s’évaluer de façon comptable, en une somme de gains sonnants et trébuchants pouvant se consolider d’année en année, ni par une organisation de masse permanente. Ces acquis se concrétisent par des gains "abstraits" (évolution de la conscience, enrichissement du programme historique grâce aux leçons des luttes, perspectives pour l’avenir…) conquis dans les grands moments d’agitation puis qui disparaissent de l'appréhension immédiate des larges masses pour se replier dans le petit univers de minorités, donnant ainsi l’illusion de n’avoir jamais existé.
Février 1917 : les soviets surgissent dans le feu de la lutte
Entre 1905 et 1917, les soviets furent ainsi réduits à n’être plus qu’une "idée" orientant la réflexion mais aussi la lutte politique d’une poignée de militants. La méthode pragmatique qui n’accorde d’importance qu’à ce qui peut se voir et se toucher, ne permet pas de comprendre que l’idée même des soviets contenait une immense puissance matérielle. En 1917, Trotski écrivait : "il est hors de doute que le prochain, le nouvel assaut de la révolution sera suivi partout de l’institution de conseils ouvriers" 4. Les grands acteurs de la Révolution de Février furent effectivement les soviets.
Les minorités révolutionnaires, et plus particulièrement les bolcheviks après 1905, avaient défendu et propagé l’idée de constituer des soviets pour pousser la lutte en avant. Ces minorités gardèrent vivante dans la mémoire collective de la classe ouvrière la flamme des conseils ouvriers. C’est pour cela que, lors de l’éclatement des grèves de février qui prirent rapidement une grande ampleur, il y eut de nombreuses initiatives et appels pour la constitution de soviets. Anweiler souligne que "cette pensée surgit autant dans les usines paralysées que dans les cercles intellectuels révolutionnaires. Des témoignages directs affirmaient que dans certaines usines, dès le 24 février, on élisait des personnes de confiance pour un Soviet qui était en train de se construire" (traduit de l’édition en espagnol, p. 110). Autrement dit, l’idée des soviets qui, pendant longtemps, était restée cantonnée à quelques minorités, fut largement prise en charge par les masses en lutte.
En deuxième lieu, le Parti bolchevique contribua significativement au surgissement des soviets. Et il y contribua non pas en se basant sur un schéma organisationnel préalable ou en imposant une chaîne d’organisations intermédiaires qui au bout conduiraient à la formation des soviets, mais sa contribution fut quelque chose de bien différent, comme on va le voir, en lien avec un dur combat politique.
Pendant l’hiver de l’année 1915, lorsque quelques grèves ont commencé à surgir, surtout à Petersburg, la bourgeoisie libérale avait imaginé un plan pour embrigader les ouvriers dans la production de guerre, proposant que, dans les entreprises, soit élu un Groupe ouvrier au sein des Comités des industries de guerre. Les mencheviks se présentèrent et, ayant obtenu une large majorité, tentèrent d’utiliser le Groupe ouvrier pour présenter des revendications. Ils proposaient, de fait, à l’image des syndicats dans les autres pays européens, d’utiliser une "organisation ouvrière" vendue à l’effort de guerre.
Les bolcheviks s’opposèrent à cette proposition en octobre 1915 par la bouche de Lénine : "Nous sommes contre la participation aux Comités des industries de guerre, qui aident à mener la guerre impérialiste réactionnaire" 5. Les bolcheviks appelèrent à l’élection de comités de grève et le Comité du parti de Petersburg proposa que "les délégués des fabriques et ateliers, élus à la représentation proportionnelle, devront former le Soviet panrusse des députés ouvriers" 6.
Dans un premier temps, les mencheviks, avec leur politique électorale en faveur du Groupe ouvrier, contrôlèrent la situation d’une main de fer. Les grèves de l’hiver 1915 et celles, bien plus nombreuses, de la seconde moitié de 1916 restèrent sous la tutelle du Groupe ouvrier menchevique malgré que, ici où là, apparurent des comités de grève. Ce n'est qu'en février que le grain commença à germer.
La première tentative de constituer un soviet eut lieu lors d’une réunion improvisée qui se déroula au Palais de Tauride le 27 février. Ceux qui y participèrent n’étaient pas représentatifs ; il y avait des éléments du Parti menchevique et du Groupe ouvrier avec quelques représentants bolcheviques et d'autres éléments indépendants. Et là surgit un débat très significatif qui mit sur la table deux options totalement opposées : les mencheviks prétendaient que la réunion devait s’autoproclamer Comité provisoire du Soviet; le bolchevik Chliapnikov "s’[y] opposa, arguant que cela ne pouvait se faire en l’absence de représentants élus par les ouvriers. Il demanda leur convocation urgente et l’assemblée lui donna raison. Il fut décidé de finir la session et de lancer les convocations aux principales concentrations ouvrières et aux régiments insurgés" 7.
La proposition eut des effets foudroyants. La nuit même du 27, elle commença à se répandre dans de nombreux quartiers, les usines et les casernes. Des ouvriers et des soldats veillaient à suivre de près le développement des événements. Le lendemain, il y eut de nombreuses assemblées dans les usines et les casernes et, les unes après les autres, prirent la même décision : constituer un soviet et élire un délégué. Dans l’après-midi, le palais de Tauride était rempli de fond en comble de délégués d’ouvriers et de soldats. Sukhanov, dans ses Mémoires 8, décrit la réunion qui allait prendre la décision historique de constituer le soviet : "au moment de l’ouverture de la séance il y avait quelques 250 députés, mais de nouveaux groupes entraient sans cesse dans la salle" 9. Il raconte comment, au moment de voter l’ordre du jour, la session fut interrompue par des délégués de soldats qui voulaient transmettre les messages de leurs assemblées de régiment respectives. Et l’un d’eux fit le résumé suivant : "Les officiers ont disparu. Nous ne voulons plus servir contre le peuple, nous nous associerons avec nos frères ouvriers, tous unis pour défendre la cause du peuple. Nous donnerons nos vies pour cette cause. Notre assemblée générale nous a demandé de vous saluer". Sukhanov ajoute : "Et avec une voix étouffée par l’émotion, au milieu des ovations de l’assemblée frémissante, le délégué ajouta : Vive la Révolution !" 10.La réunion, constamment interrompue par l’arrivée de nouveaux délégués qui voulaient transmettre la position de ceux qu’ils représentaient, aborda au fur et à mesure les différentes questions : formation de milices dans les usines, protection contre les pillages et les agissements des forces tsaristes. Un délégué proposa la création d’une "commission littéraire" pour rédiger un appel adressé à tous le pays, ce qui fut approuvé à l'unanimité 11. L’arrivée d’un délégué du régiment Semionovski – réputé pour sa fidélité au Tsar et son rôle répressif en 1905 - entraîna une nouvelle interruption. Le délégué proclama : "Camarades et frères, je vous apporte les salutations de tous les hommes du régiment Semionovski. Tous jusqu’au dernier, nous avons décidé de nous joindre au peuple". Ceci provoqua "un courant d’enthousiasme qui parcourut toute l’assemblée" (Sukhanov). L’assemblée organisa un "état-major de l’insurrection" occupant tous les points stratégiques de Petersburg.
L’assemblée du Soviet n’avait pas lieu dans le vide. Les masses étaient mobilisées. Sukhanov souligne l’ambiance qui entourait la séance : "La foule était très compacte, des dizaines de milliers d’hommes s’y étaient rendus pour saluer la révolution. Les salons du palais ne pouvaient plus contenir autant de gens et, devant les portes, les cordons de la Commission militaire arrivaient tout juste à contenir une foule de plus en plus nombreuse" (idem, p. 56).
Mars 1917 : un gigantesque réseau de soviets s'étend sur toute la Russie
En 24 heures, le Soviet se rendit maître de la situation. Le triomphe de l’insurrection de Petersburg provoqua l’extension de la révolution à tout le pays. "Couvrant tout le territoire russe, le réseau des conseils locaux de députés ouvriers et soldats constituait en quelque sorte la charpente osseuse de la révolution" 12.
Comment a pu se produire une telle ramification gigantesque qui, en si peu de temps, s’est étendue sur tout le territoire russe ? Il y a des différences entre la formation des soviets en 1905 et en 1917. En 1905, la grève s’est déclenchée en janvier et les vagues successives de grève ne débouchèrent sur aucune organisation massive sauf quelques exceptions. Les soviets commencèrent à se constituer vraiment en octobre. Par contre, en 1917, c’est dès le début de la lutte que sont créés les soviets. Les appels du Soviet de Petersburg le 28 février tombèrent sur un sol fertile. La célérité impressionnante avec laquelle ce Soviet s’est constitué est, par elle-même, significative de la volonté de le faire surgir qui animait de larges couches d’ouvriers et de soldats.
Les assemblées étaient quotidiennes. Elles ne se limitaient pas à élire le délégué au Soviet. Il arrivait souvent que celui-ci soit massivement accompagné jusqu’au lieu de l’assemblée générale. Par ailleurs et parallèlement, des soviets de quartier se constituaient. Le Soviet lui-même avait fait un appel en ce sens et, le jour même, les ouvriers du quartier combatif de Vyborg, une agglomération prolétarienne de la banlieue de Petersburg, avaient pris les devants en constituant un Soviet de District et en lançant un appel très combatif pour que de tels soviets soient formés dans tout le pays. Les ouvriers de bien d’autres quartiers populaires suivirent leur exemple les jours suivants.
Et c’est de la même manière que les assemblées d’usine constituèrent des conseils d’usine. Ceux-ci, bien qu'étant nés pour répondre à des besoins revendicatifs et d’organisation interne du travail, ne se limitaient pas à cet aspect et devenaient de plus en plus politisés. Anweiler reconnaît que "Avec le temps, les Conseils d’Usine ont acquis une organisation solide à Petersburg, représentant, dans une certaine mesure, une concurrence par rapport au Conseil des Députés Ouvriers. Ils se sont associés aux conseils de rayon (quartier), et leurs représentants élisaient un conseil central avec, à sa tête, un comité exécutif. Etant donné qu’ils encadraient les travailleurs directement dans leur lieux de travail, leur rôle révolutionnaire a pris de plus en plus d’importance au fur et à mesure que le Soviet [de Petersburg] devenait une institution durable et commençait à perdre le contact étroit avec les masses" (p. 133, idem).
Ainsi, la formation de soviets s’est répandue dans toute la Russie, telle une traînée de poudre. A Moscou "le 1er mars eurent lieu les élections des délégués des usines et le Soviet tint sa première séance en élisant un Comité Exécutif de 30 membres. Le lendemain s’est constitué définitivement le Conseil ; on fixa des normes de représentativité, on élut les délégués pour le Soviet de Petersburg et on approuva la formation du nouveau gouvernement provisoire (…) La marche triomphale de la révolution qui depuis Petersburg s’est propagée à toute la Russie était accompagnée d’une vague révolutionnaire d’activité organisationnelle dans toutes les couches sociales qui a eu sa plus forte concrétisation dans la formation de soviets dans toutes les villes de l’Empire, depuis la Finlande jusqu’à l’océan Pacifique" 13
Même si les soviets s’occupaient d’affaires locales, leur préoccupation principale concernait les problèmes généraux : la guerre mondiale, le chaos économique, l’extension de la révolution à d’autres pays et ils prirent des mesures pour concrétiser ces préoccupations. Il est à souligner que l’effort pour centraliser les soviets est venu "d’en bas" et non d’en haut. Comme c'est dit ci-dessus, le Soviet de Moscou avait décidé d’envoyer des délégués au Soviet de Petersburg, le considérant tout naturellement comme le centre de tout le mouvement. Anweiler souligne que "les conseils d’ouvriers et de soldats des autres villes envoyaient leurs délégués à Petersburg ou gardaient des observateurs en permanence auprès du Soviet" (p. 129). Dès la mi-mars, des initiatives pour des congrès régionaux de soviets ont commencé à se faire jour. À Moscou une Conférence de cette nature eut lieu les 25-27 mars avec la participation de 70 conseils ouvriers et de 38 conseils de soldats. Dans le bassin du Donetz, il y eut une Conférence ayant les mêmes caractéristiques où se réunirent 48 soviets. Tout cet effort a culminé dans la tenue d’un Premier Congrès des soviets de toute la Russie qui eut lieu du 29 mars au 3 avril et regroupa des délégués de 480 soviets.
Le "virus organisationnel" se répandit aux soldats qui, écœurés par la guerre, désertaient les champs de bataille, se mutinaient, expulsaient les officiers et décidaient de rentrer chez eux. Contrairement à 1905 où ils n’existèrent pratiquement pas, les conseils de soldats se mirent à foisonner et à proliférer dans les régiments, les cuirassés, les bases navales, les arsenaux… L'armée regroupait un conglomérat de classes sociales, essentiellement des paysans, les ouvriers étant une minorité. Malgré cette hétérogénéité, la majorité de ces soviets s’unirent au prolétariat. Comme le signale l’historien et économiste bourgeois Tugan Baranovski, "ce n’est pas l’armée qui a déclenché l’insurrection, ce sont les ouvriers. Ce ne sont pas des généraux, mais des soldats qui se sont rendus à la Douma d’Empire 14. Et les soldats ont soutenu les ouvriers non point pour obtempérer docilement à des injonctions de leurs officiers, mais… parce qu’ils se sentaient apparentés par le sang aux ouvriers, en tant que classe de travailleurs, comme eux-mêmes" 15.
L’organisation soviétique gagna progressivement du terrain jusqu’à s’élargir fortement à partir de mai 1917, quand la formation de conseils de paysans commença à agiter des masses habituées depuis des siècles à être traitées comme du bétail. C’était là aussi une différence fondamentale avec 1905, qui n’avait connu que relativement peu de soulèvements paysans, totalement désorganisés.
Que toute la Russie se couvre d’un gigantesque réseau de conseils est un fait historique d’une immense portée. Comme le signale Trotski, "dans toutes les révolutions précédentes, sur les barricades se battaient des ouvriers, de petits artisans, un certain nombre d’étudiants ; des soldats prenaient leur parti ; ensuite, la bourgeoisie cossue, qui avait prudemment observé les combats des barricades par la fenêtre, recueillait le pouvoir" (16), mais il n’en fut pas ainsi cette fois. Les masses cessèrent de se battre "pour d’autres" et se préparèrent à se battre pour elles-mêmes à travers les conseils. Elles s’occupaient de toutes les affaires de la vie économique, politique, sociale et culturelle.
Les masses ouvrières étaient mobilisées. L’expression de cette mobilisation était les soviets et, autour d’eux, tout un gigantesque réseau d’organisations de type soviétique (conseils de quartier et conseils d’usine), réseau qui se nourrissait, et, à son tour, impulsait une quantité impressionnante d’assemblées, de réunions, de débats, d’activités culturelles qui se démultipliaient… Des ouvriers, des soldats, des femmes, des jeunes s’adonnaient à une activité fébrile. Ils vivaient dans une sorte d’assemblée permanente. On arrêtait le travail pour assister à l’assemblée de l’usine, au soviet de la ville ou du quartier, aux rassemblements, aux meetings, aux manifestations. Il est significatif qu’après la grève de février, il n’y ait eu pratiquement pas de grèves, excepté à des moments particuliers et dans des situations ponctuelles ou locales. Contrairement à une vision restrictive de la lutte, limitant celle-ci à la grève, l’absence de grèves ne voulait pas dire démobilisation. Les ouvriers étaient en lutte permanente, mais la lutte de classe, comme le disait Engels, constitue une unité formée par la lutte économique, la lutte politique et la lutte idéologique. Et les masses ouvrières étaient en train d'assumer simultanément ces trois dimensions de leur combat. Des actions massives, des manifestations, des rassemblements, des débats, la circulation de livres et de journaux…, les masses ouvrières russes, avaient pris leur propre destin en main et trouvaient en leur sein des réserves inépuisables de pensée, d’initiatives, de recherche, tout était abordé sans relâche dans des forums intensément collectifs.
Avril 1917 : le combat pour "tout le pouvoir aux soviets"
"Le soviet prit possession de tous les bureaux de postes et de télégraphes, de la radio, de toutes les gares, des imprimeries, de sorte que sans son autorisation il était impossible d’envoyer un télégramme, de sortir de Petersburg ou de publier un manifeste", reconnaît dans ses Mémoires un député du Parti Cadet 17. Et cependant, comme le signale Trotski, il existait un terrible paradoxe depuis février : le pouvoir des soviets avait été confié par la majorité (menchevique et socialiste-révolutionnaire) à la bourgeoisie, l’obligeant pratiquement à créer le Gouvernement provisoire 18, présidé par un prince tsariste et composé de riches industriels, de cadets et, pour faire bien, du "socialiste" Kérenski 19.
Le Gouvernement provisoire, à l’abri derrière les soviets, poursuivait sa politique guerrière et se souciait peu de trouver des solutions aux graves problèmes qui se posaient aux ouvriers et aux paysans. Cela menait les soviets à l’inefficacité et donc à la disparition, comme on peut le dégager de ces déclarations de dirigeants socialistes-révolutionnaires : "Les soviets n’aspirent nullement à rassembler l’Assemblée constituante où siègent les députés de toute la Russie […] Pas plus qu’ils ne sont un pouvoir parallèle à l’Assemblée nationale, pas plus, ils ne s’alignent sur le Gouvernement provisoire. Conseillers du peuple qui luttent pour ses intérêts […], ils ont conscience de ne représenter qu’une partie du pays et de ne jouir de la confiance que des seules masses populaires dans l’intérêt desquelles ils combattent. C’est pourquoi les soviets se sont toujours refusés à prendre en mains le pouvoir et à former un gouvernement" 20.
Au début du mois de mars, un secteur de la classe ouvrière commença cependant à prendre conscience du fait que les soviets tendaient à servir de paravent et d'instrument à la politique de la bourgeoisie. Il y eut alors des débats très animés dans quelques soviets, comités d’usine et conseils de quartiers sur la "question du pouvoir". L’avant-garde bolchevique était alors à la traîne, son Comité central 21 ayant précisément adopté une résolution de soutien critique au Gouvernement provisoire, malgré de fortes oppositions dans différentes sections du parti 22.
Le débat redoubla d’intensité en mars. "Le Comité de Vyborg rassembla dans un meeting des milliers d’ouvriers et de soldats qui, presqu’unanimement, adoptèrent une résolution sur la nécessité de la prise de pouvoir par le Soviet […] La résolution de Vyborg, en raison de son succès, fut imprimée et placardée au moyen d'affiches. Mais le Comité de Petrograd jeta son interdit formel sur cette résolution…" 23.
L’arrivée de Lénine en avril transforma radicalement la situation. Lénine, qui suivait avec inquiétude, depuis son exil en Suisse, les quelques informations qui arrivaient jusqu’à lui sur l’attitude honteuse du Comité central du Parti bolchevique, était parvenu aux mêmes conclusions que le Comité de Vyborg. Dans ses Thèses d’Avril, il le formula clairement : "Ce qu’il y a d’original dans l’actualité russe, c’est la transition de la première étape de la révolution, qui a donné le pouvoir à la bourgeoisie par suite du degré insuffisant de conscience et d’organisation du prolétariat, à sa deuxième étape, qui doit donner le pouvoir au prolétariat et aux couches pauvres de la paysannerie" 24.
Beaucoup d’auteurs ne voient pas dans cette intervention décisive de Lénine une expression du rôle d’avant-garde du parti révolutionnaire et de ses militants les plus remarquables mais, au contraire, la considèrent comme un acte d’opportunisme politique. Selon eux, Lénine aurait saisi au vol l’opportunité d’utiliser les soviets comme plate-forme pour conquérir le "pouvoir absolu", délaissant son habit de "jacobin rigoureux" pour prendre celui d’un anarchiste partisan du "pouvoir direct des masses". De fait, un ancien membre du parti décocha que : "Pendant de nombreuses années, la place de Bakounine dans la révolution russe est restée inoccupée ; maintenant, elle est prise par Lénine" 25.(Traduit pas nous)
Cette légende est radicalement fausse. La confiance de Lénine envers les soviets venait en fait de très loin, des leçons qu’il avait tirées de la Révolution de 1905. Dans un projet de résolution qu’il proposa en 1906 au IVe Congrès du Parti, il disait que "ces soviets étant des embryons du pouvoir révolutionnaire, leur force et leur importance dépendent entièrement de la force et du succès de l’insurrection", pour ajouter que "de telles institutions, si elles ne s’appuient pas sur une armée révolutionnaire et ne renversent pas les autorités gouvernementales (c’est-à-dire si elles ne se transforment pas en gouvernement révolutionnaire), seront inévitablement vouées à leur perte" 26. En 1915, il revint sur cette même idée : "Les conseils des députés ouvriers et autres institutions analogues doivent être considérés comme des organes insurrectionnels, des organes du pouvoir révolutionnaire. C’est seulement en liaison avec le développement de la grève de masse et avec l’insurrection […] que ces institutions peuvent être réellement utiles" 27.
Juin-juillet 1917 : la crise des soviets
Lénine était cependant conscient que le combat ne faisait que commencer : "Ce n’est qu’en luttant contre cette inconscience confiante des masses (lutte qui ne peut et ne doit se livrer qu’avec les armes idéologiques au moyen de la persuasion amicale, en se référant à l’expérience vivante) que nous pourrons vraiment nous débarrasser du déchaînement actuel de phrases révolutionnaires et réellement impulser tant la conscience du prolétariat que celle des masses, l’initiative locale, l' audace et la résolution". 28. (Traduit de l'espagnol pas nous)
Cela se vérifia amèrement lors du Premier Congrès des soviets de toutes les Russies. Convoqué pour unifier et centraliser le réseau des différents types de soviets éparpillés sur tout le territoire, ses résolutions allaient non seulement à l’encontre de la révolution mais débouchaient sur la destruction des soviets. Aux mois de juin et juillet est apparu au grand jour un problème politique grave : la crise des soviets, leur éloignement de la révolution et des masses.
La situation générale était marquée par un désordre total : hausse générale du chômage, paralysie des transports, perte des récoltes dans les campagnes, rationnement général. Les désertions se multipliaient dans l’armée ainsi que les tentatives de fraternisation avec l’ennemi sur le front. Le camp impérialiste de l’Entente (France, Grande-Bretagne et depuis peu États-Unis) faisait pression sur le Gouvernement provisoire pour qu’il lance une offensive générale contre le front allemand. Les délégués mencheviques et SR, complaisants face à cette demande, firent adopter une résolution au Congrès des soviets pour soutenir l’offensive militaire alors qu’une importante minorité, qui ne regroupait pas que les bolcheviks, était contre. Pour comble, le Congrès rejeta une proposition de limiter la journée de travail à huit heures et se désintéressa du problème agraire. De porte-voix des masses, il devint le porte-voix de ce qu’elles haïssaient par-dessus tout, la continuation de la guerre impérialiste.
La mise en circulation des résolutions du Congrès – et, en particulier, celles qui soutenaient l’offensive militaire – provoqua une profonde déception dans les masses. Celles-ci se rendirent compte que leur organisation leur glissait entre les doigts et commencèrent à réagir. Les soviets de quartier de Petersburg, le Soviet de la ville voisine de Kronstadt et divers conseils d’usine et les comités de plusieurs régiments proposèrent une grande manifestation le 10 juin dont l’objectif serait de faire pression sur le Congrès pour qu’il change de politique et s’oriente vers la prise de pouvoir, expulsant les ministres capitalistes.
La réponse du Congrès fut d’interdire temporairement les manifestations sous prétexte du "danger" d’un "complot monarchiste". Les délégués du Congrès furent mobilisés pour se déplacer dans les usines et les régiments pour "convaincre" les ouvriers et les soldats. Le témoignage d’un délégué menchevique est éloquent : "Toute la nuit durant, la majorité du Congrès, plus de cinq cents de ses membres, sans fermer l’œil, par équipes de dix, parcoururent les fabriques, les usines et les casernes de Petrograd, exhortant les hommes à s’abstenir de la manifestation. Le Congrès, dans un bon nombre de fabriques et d’usines et aussi dans une certaine partie de la garnison, ne jouissait d’aucune autorité… Les membres du Congrès furent accueillis très souvent d’une manière fort inamicale, parfois avec hostilité et, fréquemment, furent éconduits avec colère" 29.
Le front de la bourgeoisie avait compris la nécessité de sauver son principal atout – la séquestration des soviets – contre la première tentative sérieuse des masses pour les récupérer. Elle le fit avec son machiavélisme congénital, en utilisant les bolcheviks comme têtes de turcs, lançant une furieuse campagne contre eux. Au Congrès des cosaques qui se tenait en même temps que le Congrès des soviets, Milioukov proclama que "les bolcheviks étaient les pires ennemis de la Révolution russe… Il est temps d’en finir avec ces messieurs" 30. Le Congrès cosaque décida "de soutenir les soviets menacés. Nous autres, cosaques, ne nous querellerons jamais avec les soviets" 31. Comme le souligne Trotski, "contre les bolcheviks, les réactionnaires étaient prêts à marcher même avec le soviet pour l’étouffer d’autant plus tranquillement ensuite" 32. Le menchevik Liber montra clairement l’objectif en déclarant au Congrès des soviets : "Si vous voulez avoir pour vous la masse qui se dirige vers les bolcheviks, rompez avec le bolchevisme".
La violente contre-offensive bourgeoise contre les masses se faisait dans une situation où, dans leur ensemble, elles étaient encore politiquement faibles. Les bolcheviks le comprirent et proposèrent l’annulation de la manifestation du 10 juin, ce qui ne fut accepté qu'à contrecœur par quelques régiments et les usines les plus combatives.
Lorsque parvint cette nouvelle au Congrès des soviets, un délégué proposa que soit convoquée une manifestation "véritablement soviétique", le 18 juin. Milioukov analyse ainsi cette initiative : "Suite à des discours au ton libéral au Congrès des soviets, après avoir réussi à empêcher la manifestation armée du 10 juin… les ministres socialistes sentirent qu’ils étaient allés trop loin dans leur rapprochement avec nous, que le terrain fuyait sous leurs pieds. Effarés, ils se retournèrent brusquement vers les bolcheviks". Trotski le corrige avec justesse : "Il ne s'agissait pas, bien entendu, d'un virage vers les bolcheviks, mais de quelque chose de bien différent, une tentative de se tourner vers les masses, contre les bolcheviks" 33. (Traduit de l'espagnol par nous)
Ce fut un cuisant échec pour le Congrès des soviets dominé par la bourgeoisie. Les ouvriers et les soldats participèrent massivement à la manifestation du 18 juin, brandissant des banderoles réclamant tout le pouvoir aux soviets, la destitution des ministres capitalistes, la fin de la guerre, appelant à la solidarité internationale… Les manifestations reprenaient les orientations bolcheviques et exigeaient le contraire de ce que demandait le Congrès.
La situation empirait. Pressée par ses alliés de l’Entente, la bourgeoisie russe était dans une impasse. La fameuse offensive militaire s’était soldée par un fiasco, les ouvriers et les soldats voulaient un changement radical de politique des soviets. Mais la situation n’était pas si claire dans les provinces et dans les campagnes où, malgré une certaine radicalisation, la grande majorité restait fidèle aux SR et favorable au Gouvernement provisoire.
Le moment était venu pour la bourgeoisie de tendre une embuscade aux masses à Petersburg en provoquant un affrontement prématuré qui devait lui permettre d’asséner un rude coup à l’avant-garde du mouvement et d’ouvrir ainsi les portes à la contre-révolution.
Les forces de la bourgeoisie se réorganisaient. Des "soviets d’officiers" s’étaient constitués, dont la tâche était d’organiser des forces d’élite pour écraser militairement la révolution. Encouragées par les démocraties occidentales, les bandes noires tsaristes relevaient la tête. Selon les propres termes de Lénine, la vieille Douma fonctionnait comme un bureau contre-révolutionnaire sans que les leaders social-traîtres des soviets lui opposent le moindre obstacle.
Une série de provocations subtiles fut programmée pour pousser les ouvriers de Petersburg dans le piège d’une insurrection prématurée. Le Parti Cadet retira tout d’abord ses ministres du Gouvernement provisoire pour que celui-ci ne soit plus composé que de "socialistes". C’était une sorte d’invitation à ce que les ouvriers réclament la prise immédiate du pouvoir et se lancent à l’insurrection. L’Entente lança ensuite un véritable ultimatum au Gouvernement provisoire : il fallait choisir entre les soviets ou un gouvernement constitutionnel. Enfin, la plus violente provocation fut la menace de déplacer les régiments les plus combatifs de la capitale vers les régions frontalières.
Des masses importantes de travailleurs et de soldats de Petersburg mordirent à l’hameçon. A partir de nombreux soviets de quartiers, d'usines et de régiments, une manifestation armée fut appelée pour le 4 juillet. Son mot d'ordre était la prise du pouvoir par les soviets. Cette initiative montrait que les ouvriers avaient compris qu'il n'y avait pas d'issue en dehors de la révolution. Mais, en même temps, ils réclamaient que le pouvoir soit assumé par les soviets tels qu'ils étaient alors constitués, c'est-à-dire avec la majorité aux mains des mencheviks et des socialistes révolutionnaires dont la préoccupation était d'inféoder les soviets à la bourgeoisie. Cette scène, désormais célèbre, où un ouvrier s'adresse à un membre menchevique du Soviet, "pourquoi ne prends-tu pas le pouvoir une bonne fois pour toutes ?", est significative des illusions persistantes au sein de la classe ouvrière. C'était demander que le loup entre dans la bergerie ! Les bolcheviks mirent en garde contre le piège qui était tendu. Ils ne le firent pas avec suffisance, hissés sur un piédestal et disant aux masses à quel point elles se trompaient. Ils se mirent à la tête de la manifestation, coude à coude avec les ouvriers et les soldats, pour contribuer de toutes leurs forces à ce que la riposte soit massive mais ne dérape pas vers un affrontement décisif dont la défaite était écrite d’avance 34.
La manifestation s’acheva dans l’ordre et ne se lança pas à l’assaut révolutionnaire. Le massacre fut évité, ce qui fut une victoire des masses pour l’avenir. Mais la bourgeoisie ne pouvait pas reculer, elle devait poursuivre son offensive. Le Gouvernement provisoire, entièrement constitué de ministres "ouvriers", déchaîna alors une répression brutale particulièrement orientée contre les bolcheviks. Le Parti fut déclaré hors-la-loi, de nombreux militants furent emprisonnés, l’ensemble de la presse interdite, Lénine dut passer à la clandestinité.
Par un effort difficile mais héroïque, le Parti bolchevique avait contribué de façon décisive à éviter la défaite des masses, leur dispersion et la débandade qui les menaçait à travers leur désorganisation. Le Soviet de Petersburg, par contre, soutenu par le Comité exécutif élu lors du récent Congrès des soviets, touchait le fond de l’ignominie en avalisant le déchaînement d'une répression brutale et la réaction.
Comment la bourgeoisie a-t-elle pu dévoyer les soviets ?
L’organisation des masses en conseils ouvriers, dès février 1917, a signifié pour celles-ci la possibilité de développer leur force, leur organisation et leur conscience en vue de l’assaut final contre le pouvoir de la bourgeoisie. La période qui s’ensuivit, dite période de dualité de pouvoir entre prolétariat et bourgeoisie, a constitué une phase critique pour les deux classes antagoniques, pouvant aboutir, pour l’une et l‘autre, à une victoire politique et militaire sur la classe ennemie.
Pendant toute cette période, le niveau de conscience des masses, encore faible relativement aux nécessités d’une révolution prolétarienne, constituait une brèche au sein de laquelle la bourgeoisie devait tenter de s’engouffrer pour faire avorter le processus révolutionnaire en gestation. Elle disposait pour cela d’une arme d’autant plus dangereuse que pernicieuse, le sabotage de l'intérieur exercé par des forces bourgeoises agissant sous un masque "ouvrier" et "radical". Ce cheval de Troie de la contre-révolution fut constitué à l'époque, en Russie, par les partis "socialistes", mencheviks et SR.
Au début, beaucoup d'ouvriers entretenaient des illusions sur le Gouvernement provisoire et le voyaient comme une émanation des soviets, alors qu'en réalité il était leur pire ennemi. Quand aux mencheviks et socialistes-révolutionnaires, ils jouissaient d’une confiance importante parmi les grandes masses ouvrières qu’ils parvenaient à illusionner avec leurs discours radicaux, leur phraséologie révolutionnaire, ce qui leur permit de dominer politiquement la très grande majorité des soviets. C’est à partir de cette position de force qu’ils s’efforcèrent effectivement de vider ces organes de leur substance révolutionnaire pour les mettre au service de la bourgeoisie. S’ils n’y parvinrent finalement pas, c’est parce que les masses mobilisées en permanence, faisaient leur propre expérience les conduisant, avec l'appui du Parti bolchevique, à démasquer les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires à mesure que ceux-ci étaient amenés à assumer l’orientation du Gouvernement provisoire sur des questions aussi fondamentales que celles de la guerre et des conditions de vie.
Nous verrons dans un prochain article comment, dès la fin août 1917, les soviets parvinrent à se régénérer et à devenir réellement des plates-formes pour la prise du pouvoir, qui culmina dans la victoire de la Révolution d’Octobre.
C. Mir, 8 mars 2010
1 Cf. la Revue internationale no 140 [7].
2 Nous disposons aujourd’hui de beaucoup de matériel pour connaître en détails comment se développa la Révolution russe mais aussi pour voir le rôle décisif que joua le Parti bolchevique. En particulier l’Histoire de la Révolution russe de Trotski, Dix jours qui ébranlèrent le monde de John Reed, nos brochures sur la Révolution russe ainsi que de nombreux articles de notre Revue internationale, cf. les nos 71-72, 89 à 91 [8].
3 Cet auteur très antibolchevique narre cependant les faits de façon très fidèle et reconnaît avec impartialité les apports des bolcheviks, ce qui contraste d’ailleurs avec les jugements sectaires et dogmatiques qu’il assène de temps en temps.
4 Cité par Oskar Anweiler, op. cité.
5 Ídem
6 Ídem.
7 Gerald Walter, Vision d’ensemble de la Révolution russe.
8 Publiées en 1922 en 7 volumes, elles apportent le point de vue d’un socialiste indépendant, collaborateur de Gorki et des mencheviks internationalistes de Martov. Même s’il était en désaccord avec les bolcheviks, il soutint la Révolution d’Octobre. Cette citation et les suivantes sont extraites et traduites d’un résumé de ses Mémoires, publié en espagnol.
9 D’après Anweiler, il y avait autour de 1000 délégués à la fin de la session et, lors des suivantes, il y a eu jusqu’à 3000.
10 Œuvre citée, p. 54
11 Cette commission proposera l’édition permanente d’un journal du Soviet: Izvestia (Les Nouvelles) qui paraîtra régulièrement à partir de ce moment-là.
12 Anweiler, op. cité.
13 Anweiler, œuvre citée p. 121
14 Chambre des députés.
15 Cité par Trotski dans son Histoire de la Révolution russe, T. I.
16 Idem.
17 Parti constitutionnel démocratique (KD), de la grande bourgeoisie, formé précipitamment en 1905. Son dirigeant était Milioukov, éminence grise de la bourgeoisie russe de l’époque.
18 Trotski raconte comment la bourgeoisie était paralysée et comment les chefs mencheviques se servirent de leur influence dans les soviets pour lui remettre le pouvoir sans conditions, de sorte que Milioukov "ne se gênait pas pour afficher sa satisfaction et son agréable surprise » (Mémoires de Soukhanov, menchevik qui vécut de près les événements au sein du Gouvernement provisoire).
19 Cet avocat, très populaire dans les cercles ouvriers avant la révolution, finit par être nommé chef du Gouvernement provisoire et dirigea alors les différentes tentatives d’en finir avec les ouvriers. Ses intentions sont révélées par les mémoires de l’ambassadeur anglais de l’époque : "Kerenski m’exhorta à la patience en m’assurant que les soviets finiraient par mourir de mort naturelle. Ils céderaient bientôt leurs fonctions à des organes démocratiques d’administration autonome ».
20 Cité par Anweiler, op. cité.
21 En faisaient partie Staline, Kamenev et Molotov. Lénine était exilé en Suisse et n’avait pratiquement pas de moyens de contacter le parti.
22 Lors d’une réunion du Comité du Parti de Petrograd, célébrée le 5 mars, fut rejeté le projet de résolution présenté par Chliapnikov qui disait : "L’impératif de l’heure réside dans la formation d’un gouvernement révolutionnaire provisoire issu de l’unification des conseils locaux des députés ouvriers, paysans et soldats. Avant de passer à la conquête intégrale du pouvoir central, il est indispensable […] de consolider le pouvoir des conseils des députés ouvriers et soldats" (cité par Anweiler, op. cité).
23 Trotski, op. cité.
24 Nous ne pouvons aborder dans cet article le contenu de ces Thèses, extrêmement intéressantes au demeurant. Cf. la Revue internationale no 89, "Les Thèses d’avril, phare de la révolution prolétarienne [9]».
25 Cité par Trotski, op. cit.
26 Cité par Anweiler, op. cit.
27 Idem.
28 Lénine, Oeuvres choisies. Lenin Obras Escogidas tomo II página 50 edición española
29 Cité par Trotski, op. cité.
30 Que le chef de la bourgeoisie en Russie se permette de parler au nom de la Révolution russe révèle bien tout le cynisme typique de cette classe !
31 Régiments caractérisés par leur obéissance au tsar et à l’ordre établi. Ils furent les derniers à passer du côté de la révolution.
32 Trotski, op. cité.
33 Toutes ces citations sont extraites de Trotski, op. cité.
34 Voir notre article sur "Les journées de juillet et le rôle indispensable du parti [10]", Revue internationale no 90. Nous renvoyons nos lecteurs à cet article pour une analyse plus détaillée de cet événement.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [11]
Rubrique:
Décadence du capitalisme (VI) : La théorie du déclin du capitalisme et la lutte contre le révisionnisme
- 4310 lectures
Engels entrevoit l'arrivée de la crise historique du capitalisme
D'après un certain courant intellectuel, composé de marxologues, de conseillistes et d'anarchistes, la théorie marxiste est devenue stérile après la mort de Marx en 1883 ; selon eux, les partis sociaux-démocrates de la Deuxième Internationale auraient été dominés par la pensée d'Engels. Ce dernier ainsi que ses partisans auraient transformé la méthode d'investigation de Marx en un système de pensée à demi mécaniste qui assimilerait, à tort, la critique sociale radicale à la démarche des sciences de la nature. Ils accusent également la "pensée d'Engels" de revenir de façon quasi mystique aux dogmes hégéliens, en particulier lorsqu'il tente d'élaborer une "dialectique de la nature". Dans la conception de ce courant, ce qui est naturel n'est pas social, et ce qui est social n'est pas naturel. Si la dialectique existe, elle ne peut s'appliquer qu'à la sphère sociale.
Cette rupture dans la continuité entre Marx et Engels (qui, sous sa forme la plus extrême, rejette quasiment l'ensemble de la Deuxième Internationale considérée comme un instrument de l'intégration du mouvement ouvrier au service des besoins du capital) est souvent utilisée pour rejeter toute notion de continuité dans l'histoire politique de la classe ouvrière. De Marx - que peu de nos "anti-Engels" rejettent (au contraire, ils sont fréquemment devenus des "experts" de tous les détails du problème de la transformation de la valeur en prix ou d'autres aspects partiels de la critique faite par Marx à l'économie politique), on nous convie à sauter à pieds joints par dessus Engels, Kautsky, Lénine et par dessus les Deuxième et Troisième Internationales. Et tout en reconnaissant, à contre-cœur, que certaines parties de la Gauche communiste ont réalisé certains développements théoriques malgré leur parenté douteuse, on considère qu'après Marx, ce sont quelques intellectuels clairsemés... qui assurent la continuité véritable de sa théorie. Seuls ces brillants individus auraient vraiment compris Marx au cours des dernières décennies – il ne s'agit, en fait, personne d'autre que les partisans de la thèse "anti-Engels".
Nous ne pouvons ici répondre à l'ensemble de cette idéologie. Comme tous les mythes, elle se base sur certains éléments de la réalité qui sont distordus et amplifiés hors de toute proportion. Au cours de la période de la Deuxième Internationale, période au cours de laquelle le prolétariat se constituait comme classe en une force organisée au sein de la société capitaliste, il y a eu en effet une tendance à schématiser le marxisme et à en faire une sorte de déterminisme, en même temps que les idées réformistes exerçaient un poids réel sur le mouvement ouvrier ; et même les meilleurs marxistes, y compris Engels, n'y échappèrent pas 1. Mais même si Engels a commis des erreurs importantes au cours de cette période, écarter platement les travaux d'Engels après la mort de Marx en tant que négation et détournement de la pensée réelle de Marx est absurde étant donnée la coopération très étroite que les deux hommes ont entretenue du début à la fin de leurs relations. C'est Engels qui a assuré l'énorme tâche d'éditer et de publier Le Capital de Marx, dont les Volumes II et III cités par ceux qui dressent un mur entre Marx et Engels. Pense-t-on que cela aurait été possible si Engels avait été réellement été porteur des incompréhensions qui lui sont prêtées ?
L'un des tenants principaux de la ligne de pensée "anti-Engels" est le groupe Aufheben en Grande Bretagne, dont la série "Décadence : Théorie du déclin ou déclin de la théorie" 2, semble considérée par certains comme ayant porté le coup fatal à la notion moribonde de décadence du capitalisme, vu le nombre de fois où cette série est citée par tous ceux qui sont hostiles à cette notion. A son point de vue, la décadence du capitalisme est fondamentalement une invention de la Deuxième Internationale : "La théorie de la décadence du capitalisme est apparue pour la première fois dans la Deuxième Internationale. Le programme d'Erfurt soutenu par Engels établissait que la théorie du déclin et de l'effondrement du capitalisme était un point central du programme du parti" (Aufheben n°2, traduit par nous). Et ils citent les passages suivants :
"Ainsi la propriété privée des moyens de production change sa nature originelle en son contraire. (...) Jadis ce mode de propriété accélérait la marche de l'évolution sociale. La propriété privée est aujourd'hui la cause de la corruption, de la banqueroute de la société. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir si l’on veut ou non maintenir la propriété privée des moyens de production. Sa disparition est certaine. La question qui se pose est la suivante : la propriété privée des moyens de production doit-elle entraîner dans sa chute la société tout entière ; la société doit-elle, au contraire, se débarrasser du fardeau néfaste qui l'écrase, pour, devenue libre et en possession de nouvelles forces, continuer à suivre la voie que lui prescrivent les lois de l'évolution ? (p.110-111) Les forces productives qui se sont développées au sein de la société capitaliste ne sont plus compatibles avec le mode de propriété qui forme sa base. Vouloir maintenir cette forme de propriété, c'est rendre à l'avenir son progrès social impossible, c'est condamner la société à la stagnation et au déclin (...) (p.112) La société capitaliste est parvenue au terme de son chemin. Sa dissolution n'est plus qu'une affaire de temps. L'irrésistible évolution économique conduit nécessairement à la banqueroute du mode de production capitaliste. La constitution d'une nouvelle société, destinée à remplacer celle qui existe, n'est plus seulement souhaitable, elle est devenue inévitable. (p.141) En l'état actuel des choses, la civilisation capitaliste ne peut se maintenir. Il nous faut soit aller vers lesocialisme, soit retomber dans la barbarie. (p.142)"
Dans le résumé qui présente l'article suivant de la série, dans Aufheben n°3, l'argument selon lequel le concept de décadence trouve ses racines dans "le marxisme de la Deuxième Internationale" est encore plus explicite :
"Dans la première partie, nous avons examiné comment cette notion de déclin ou de décadence du capitalisme a ses racines dans le marxisme de la Deuxième Internationale et a été maintenue par deux courants qui se réclament être les vrais continuateurs de la "tradition marxiste classique" – le trostkysme-léninisme et le communisme de gauche ou de conseils." (notre traduction)
Bien que la citation qu'Aufheben présente comme faisant partie du Programme d'Erfurt, semble provenir plutôt des commentaires de Kautsky sur le Programme (Le programme socialiste 1892 3), le préambule au Programme contient effectivement une référence à la notion de déclin du capitalisme et affirme même que cette période est déjà ouverte :
"L'abîme qui sépare les possédants et les non-possédants est encore élargi par les crises qui ont leur principe dans l'essence du mode de production capitaliste, crises qui deviennent toujours plus étendues et plus dévastatrices, qui font de l'insécurité générale l'état normal de la société et fournissent la preuve que les forces productives de la société actuelle ont trop grandi pour cette société, que la propriété privée des moyens de production est devenue inconciliable avec un sage emploi et avec le plein développement de ces moyens de production." 4
En réalité, et bien que du point de vue d'Aufheben, le Programme d'Erfurt soit très dépendant de la théorie de la décadence, une lecture rapide de celui-ci donne plutôt l'impression qu'il n'y a aucun lien entre l'évaluation globale du système mentionnée plus haut et les revendications mises en avant dans le Programme, qui sont toutes des revendications minimales pour lesquelles il faut se battre au sein de la société capitaliste ; et même les nombreuses critiques détaillées portées par Engels et d'autres marxistes à ces revendications ne font quasiment aucune référence au contexte historique dans lequel celles-ci sont posées. 5
Ceci dit, il est vrai que dans les travaux d'Engels et d'autres marxistes de la fin du 19e siècle, on trouve de plus en plus de références à la notion d'entrée du capitalisme dans une crise de sénilité, une période de déclin.
Mais alors que pour Aufheben, cette notion s'éloignerait de Marx – qui, affirment-ils, a seulement dit que le capitalisme était un système "transitoire" et n'a jamais mis en avant l'idée d'un processus objectif de déclin ou d'effondrement du capitalisme comme fondement pour les luttes révolutionnaires du prolétariat contre le système – nous avons pour notre part cherché à montrer dans les précédents articles de cette série que le concept de décadence du capitalisme (comme des précédentes sociétés de classes) faisait partie intégrante de la pensée de Marx.
Il est vrai aussi que les écrits de Marx sur l'économie politique ont été produits au cours de la phase encore ascendante d'un capitalisme triomphant. Ses crises périodiques étaient des crises de jeunesse qui permettaient de propulser la marche impériale de ce mode de production dynamique sur toute la surface du globe. Mais Marx avait également vu, dans ces convulsions, les signes avant-coureurs de la chute finale du système et déjà commencé à entrevoir des manifestations de l'achèvement de la mission historique du capitalisme avec la conquête des régions les plus reculées de la planète, tandis que, dans le sillage des événements de la Commune de Paris, il affirmait que la phase des héroïques guerres nationales avait touché à sa fin dans "la vieille Europe".
De plus, au cours de la période qui a suivi la mort de Marx, les signes avant-coureurs d'une crise aux proportions historiques et pas seulement une répétition des anciennes crises cycliques, se manifestaient de plus en plus clairement.
Ainsi, par exemple, Engels a réfléchi sur la signification de la fin apparente du "cycle décennal" de crises et sur le début de ce qu'il appela une dépression chronique affectant la première nation capitaliste, la Grande-Bretagne. Et tandis que de nouvelles puissances capitalistes se frayaient leur chemin sur le marché mondial, l'Allemagne et les Etats-Unis avant tout, Engels vit que cela aboutirait inévitablement à une crise de surproduction encore plus profonde :
"L'Amérique va casser le monopole industriel de l'Angleterre – ou ce qui en reste – mais l'Amérique ne peut succéder à ce monopole. Et à moins qu'un pays ait le monopole des marchés mondiaux, au moins dans les branches décisives du commerce, les conditions – relativement favorables – qui existaient ici en Angleterre de 1848 à 1870 ne peuvent se reproduire nulle part, et même en Amérique, la condition de la classe ouvrière doit sombrer de plus en plus. Car s'il y a trois pays (disons l'Angleterre, l'Amérique et l'Allemagne) qui sont en concurrence sur un pied d'égalité pour la possession du Weltmarkt (marché mondial, en allemand dans le texte), il n'y a pas d'autre possibilité qu'une surproduction chronique, chacun des trois étant capable de produire la totalité de ce qui est requis." (Engels à Florence Kelley Wischnewetsky, 3 février 1886, traduit de l'anglais par nous)
En même temps, Engels voyait la tendance du capitalisme à engendrer sa propre ruine avec la conquête accélérée des régions non capitalistes qui entouraient les métropoles capitalistes :
"Car c'est l'un des corollaires nécessaires de la grande industrie qu'elle détruise son propre marché interne par le processus même par lequel elle le crée. Elle le crée en détruisant la base de l'industrie intérieure de la paysannerie. Mais sans industrie intérieure, les paysans ne peuvent vivre. Ils sont ruinés en tant que paysans ; leur pouvoir d'achat est réduit au minimum : et jusqu'à ce qu'en tant que prolétaires, ils se soient installés dans de nouvelles conditions d'existence, ils ne fourniront qu'un très pauvre marché aux nouvelles usines créées.
La production capitaliste étant une phase économique transitoire est pleine de contradictions internes qui se développent et deviennent évidentes en proportion de son développement. Cette tendance à détruire son propre marché interne en même temps qu'elle le crée, est l'une de ces contradictions. Une autre est la situation insoluble à laquelle cela mène et qui se développe plus vite dans un pays qui n'a pas de marché extérieur, comme la Russie, que dans les pays qui sont plus ou moins aptes à entrer en concurrence sur le marché mondial ouvert. Cette situation sans issue apparente trouve une sortie, pour ces derniers pays, dans des convulsions commerciales, dans l'ouverture violente de nouveaux marchés. Mais même alors, le cul de sac vous éclate à la figure. Regardez l'Angleterre. Le dernier nouveau marché qui pourrait apporter un renouveau de prospérité temporaire en s'ouvrant au commerce anglais est la Chine. Aussi le capital anglais insiste pour construire des chemins de fer chinois. Mais des chemins de fer en Chine signifient la destruction de la base de toute la petite agriculture chinoise et de l'industrie intérieure, et comme il n'existera même pas le contrepoids de la grande industrie chinoise, des centaines de millions de gens se trouveront dans l'impossibilité de vivre. La conséquence en sera une émigration énorme telle que le monde n'en a pas encore connue, l'Amérique, l'Asie, l'Europe submergées par les chinois qui sont haïs, une concurrence pour le travail avec les ouvriers d'Amérique, d'Australie et d'Europe sur la base du niveau de vie chinois, le plus bas de tous – et si le système de production n'a pas changé en Europe d'ici là, il devra alors changer.
La production capitaliste travaille à sa propre ruine et vous pouvez être sûr qu'elle le fera aussi en Russie." (Lettre à Nikolai Danielson, 22 septembre 1892, traduite de l'anglais par nous)
La croissance du militarisme et de l'impérialisme, visant avant tout à achever la conquête des aires non capitalistes de la planète, ont également permis à Engels de voir avec une extrême lucidité les dangers que cette évolution ferait courir en retour au centre du système – en Europe, menaçant d'entraîner la civilisation dans la barbarie tout en accélérant en même temps la maturation de la révolution.
"Aucune guerre n'est plus possible pour l'Allemagne prussienne sauf une guerre mondiale et une guerre mondiale d'une étendue et d'une violence inimaginables jusqu'ici. Huit à dix millions de soldats se massacreront et ce faisant dévoreront toute l'Europe jusqu'à la laisser plus anéantie qu'aucun nuage de sauterelles ne l'a jamais fait. La dévastation de la Guerre de Trente ans condensée en trois, quatre années et répandue sur le continent tout entier : la famine, les fléaux, la chute généralisée dans la barbarie, celle des armées comme celle des masses des populations ; une confusion sans espoir de notre système artificiel de commerce, d'industrie et de crédit aboutissant dans la banqueroute générale, l'effondrement des anciens Etats et de leur sagesse traditionnelle d'élite à un point tel que les couronnes vont tomber par douzaines et il n'y aura personne pour les ramasser ; l'impossibilité absolue de prévoir comment cela finira et qui sortira vainqueur ; un seul résultat est absolument certain : l'épuisement général et la création des conditions pour la victoire finale de la classe ouvrière." (15 décembre 1887, traduit de l'anglais par nous)
Au demeurant cependant, Engels ne voyait pas cette guerre comme un facteur de rapprochement inévitable de la perspective socialiste : il avait peur avec raison que le prolétariat ne soit aussi affecté par l'épuisement général et que cela le rende incapable d'accomplir sa révolution (d'où, pourrait-on ajouter, une certaine attraction pour des schémas quelque peu utopiques qui pourraient retarder la guerre, comme le remplacement des armées permanentes pas des milices populaires). Mais Engels avait des raisons d'espérer que la révolution éclaterait avant une guerre pan-européenne. Une lettre à Bebel (24-26 octobre 1891) exprime ce point de vue "optimiste" :
"... Selon les rapports, vous avez dit que j'avais prévu l'effondrement de la société bourgeoise en 1898. Il y a une légère erreur quelque part. Tout ce que j'ai dit, c'est que nous pourrions peut-être prendre le pouvoir d'ici 1898. Si cela n'arrive pas, la vieille société bourgeoise pourrait encore végéter un moment, pourvu qu'une poussée de l'extérieur ne fasse pas s'effondrer toute la vieille bâtisse pourrie. Un vieil emballage moisi comme ça peut survivre à sa mort intérieure fondamentale encore quelques décennies si l'atmosphère n'est pas troublée." (traduit de l'anglais par nous)
Dans ce passage, on trouve à la fois les illusions du mouvement de l'époque et sa force théorique sous-jacente. Les acquis durables du parti social-démocrate, surtout dans le domaine électoral et en Allemagne, donnèrent naissance à des espoirs excessifs sur la possibilité d'une progression inexorable vers la révolution (et la révolution elle-même allait jusqu'à être considérée en termes semi-parlementaires, malgré les mises en garde répétées contre le crétinisme parlementaire qui constituait un aspect central du bourgeonnement rapide de l'idéologie réformiste). En même temps, les conséquences de l'incapacité du prolétariat à prendre le pouvoir sont clairement établies : la survie du capitalisme pendant plusieurs décennies comme un "vieil emballage moisi" – bien qu'Engels comme la plupart des révolutionnaires de l'époque n'avait sûrement jamais imaginé que le système pourrait survivre dans sa phase de déclin encore un siècle ou plus. Mais le soubassement théorique permettant d'anticiper une telle situation est clairement établi dans ce passage.
Luxemburg mène la bataille contre le révisionnisme.
Pourtant, précisément parce que l'expansion impérialiste des dernières décennies du 19e siècle a permis au capitalisme de connaître des taux de croissance énormes, on se rappelle cette période comme celle d'une prospérité et d'un progrès sans précédent, d'une augmentation constante du niveau de vie de la classe ouvrière, non seulement grâce aux conditions objectives favorables mais aussi du fait de l'influence croissante du mouvement ouvrier organisé en syndicats et dans les partis sociaux-démocrates. C'était le cas, en particulier, en Allemagne et c'est dans ce pays que le mouvement ouvrier fut confronté à un défi majeur : la montée du révisionnisme.
Précédés par les écrits d'Edouard Bernstein à la fin des années 1890, les révisionnistes défendaient que la social-démocratie devait reconnaître que l'évolution du capitalisme avait invalidé certains éléments fondamentaux de l'analyse de Marx – surtout la prévision de crises toujours plus grandes et l'appauvrissement du prolétariat qui devait s'ensuivre. Le capitalisme avait montré qu'en utilisant le mécanisme du crédit et en s'organisant en trusts et en cartels gigantesques, il pouvait surmonter sa tendance à l'anarchie et à la crise et, sous l'impulsion d'un mouvement ouvrier bien organisé, faire des concessions de plus en plus grandes à la classe ouvrière. Le but "ultime", la révolution, incarné dans le programme du parti social-démocrate, devenait donc superflu et le parti devait se reconnaître pour ce qu'il était vraiment : un parti social-démocrate réformiste, avançant vers une transformation graduelle et pacifique, la transformation du capitalisme en socialisme.
Un certain nombre de figures de la gauche de la social-démocratie répliquèrent à ces arguments. En Russie, Lénine polémiqua contre les économistes qui voulaient réduire le mouvement ouvrier à une question de pain ; en Hollande, Gorter et Pannekoek menèrent la polémique contre l'influence croissante du réformisme dans les domaines syndical et parlementaire. Aux Etats-Unis, Louis Boudin rédigea un livre important, The Theoretical System of Karl Marx (1907), en réponse aux arguments des révisionnistes – nous y reviendrons plus loin. Mais c'est surtout Rosa Luxemburg en Allemagne qui est associée à la lutte contre le révisionnisme dont le cœur était la réaffirmation de la notion marxiste de déclin et d'effondrement catastrophique du capitalisme.
Quand on lit la polémique de Luxemburg contre Bernstein, Réforme sociale ou Révolution, on est frappé du point auquel les arguments mis en avant par ce dernier ont été répétés depuis, quasiment à chaque fois que le capitalisme a donné l'impression –quoique superficielle – de surmonter ses crises.
"D’après Bernstein, un effondrement total du capitalisme est de plus en plus improbable parce que, d’une part, le système capitaliste fait preuve d’une capacité d’adaptation de plus en plus grande et que, d’autre part, la production est de plus en plus différenciée. D’après Bernstein, la capacité d’adaptation du capitalisme se manifeste dans le fait qu’il n’y a plus de crise générale ; ceci, on le doit au développement du crédit, des organisations patronales, des communications, et des services d’information ; dans la survie tenace des classes moyennes, résultat de la différenciation croissante des branches de la production et de l’élévation de larges couches du prolétariat au niveau des classes moyennes ; enfin, dans l’amélioration de la situation économique et politique du prolétariat, grâce à l’action syndicale." (chapitre 1, "La méthode opportuniste") 6
Combien de fois en effet n'avons pas entendu que les crises appartiennent au passé et cela, pas seulement de la part des idéologues officiels de la bourgeoisie mais aussi de ceux qui proclament défendre une idéologie bien plus radicale, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme est organisé à l'échelle nationale ou même internationale, parce qu'il a la possibilité infinie de recourir au crédit et à d'autres manipulations financières ; combien de fois nous a-t-on dit que la classe ouvrière avait cessé d'être une force révolutionnaire parce qu'elle n'était plus dans la misère absolue que décrit Engels dans son livre sur les conditions de la classe ouvrière à Manchester en 1844, ou parce qu'elle se distinguerait de moins en moins des classes moyennes ? C'était notamment le grand refrain des sociologues des années 1950 et 1960, auquel les adeptes de Marcuse et de Castoriadis ont apporté un vernis radical ; et on a ressorti la rengaine du placard une nouvelle fois dans les années 1990, après l'effondrement du bloc de l'Est et avec le boom financé par le crédit dont le vernis factice ne s'est révélé que très récemment.
Contre ces arguments, Luxemburg a souligné que l' "organisation" du capital en cartels et au moyen du crédit était une réponse aux contradictions du système et tendait à exacerber ces contradictions à un degré supérieur et plus dévastateur.
Luxemburg considérait le crédit essentiellement comme un moyen de faciliter l'extension du marché tout en concentrant le capital dans un nombre de mains de plus en plus limité. A ce moment de l'histoire, c'était certainement le cas – il existait une véritable possibilité pour le capitalisme de s'étendre et le crédit accélérait cette expansion. Mais, en même temps, Rosa Luxemburg saisissait l'aspect destructeur du crédit du fait que cette expansion du marché constituait aussi la prémisse du futur conflit avec la masse des forces productives mises en mouvement :
"Ainsi le crédit, loin de contribuer à abolir ou même à atténuer les crises, en est au contraire un agent puissant. Il ne peut d’ailleurs en être autrement. La fonction spécifique du crédit consiste - très généralement parlant - à corriger tout ce que le système capitaliste peut avoir de rigidité en y introduisant toute l’élasticité possible, à rendre toutes les forces capitalistes extensibles, relatives et sensibles. Il ne fait évidemment ainsi que faciliter et qu’exaspérer les crises, celles-ci étant définies comme le heurt périodique entre les forces contradictoires de l’économie capitaliste." (chapitre 2, "L'adaptation du capitalisme", ibid.)
Le crédit n'était pas encore ce qu'il est en grande partie devenu aujourd'hui – pas tant un moyen d'accélérer l'expansion du marché réel, mais un marché artificiel en lui-même, dont le capitalisme est de plus en plus dépendant. Mais sa fonction comme remède qui aggrave le mal est devenue ainsi plus évidente à notre époque, et avant tout depuis ce qui est appelé le "credit crunch" en 2008.
De même, Luxemburg considérait la tendance du capitalisme et des capitalistes à s'organiser au niveau national et même international non comme une solution aux antagonismes du système mais comme une force potentielle qui les exacerbe à un niveau supérieur et plus destructeur :
" (...) ils aggravent la contradiction entre le caractère international de l’économie capitaliste mondiale et le caractère national de l’Etat capitaliste, parce qu’ils s’accompagnent toujours d’une guerre douanière générale ; ils exaspèrent ainsi les antagonismes entre les différents Etats capitalistes. À cela il faut ajouter l’influence révolutionnaire exercée par les cartels sur la concentration de la production, son perfectionnement technique, etc.
Ainsi, quant à l’action exercée sur l’économie capitaliste, les cartels et les trusts n’apparaissent pas comme un "facteur d’adaptation" propre à en atténuer les contradictions, mais bien plutôt comme l’un des moyens qu’elle invente elle-même pour aggraver sa propre anarchie, développer ses contradictions internes, accélérer sa propre ruine." (idem)
Ces prévisions, surtout quand l'organisation du capital est passée de la phase des cartels à celle des "trusts d'Etat national" qui s'affrontaient pour le contrôle du marché mondial en 1914 –allaient se trouver pleinement validées au cours du 20e siècle.
Luxemburg répondit aussi aux arguments de Bernstein selon lesquels le prolétariat n'avait pas besoin de faire la révolution puisqu'il jouissait d'une augmentation de son niveau de vie grâce à son organisation efficace en syndicats et à l'activité de ses représentants au parlement. Elle montrait que les activités syndicales comportaient des limites internes, les décrivant comme un "travail de Sisyphe", nécessaire mais constamment limité dans ses efforts d'accroître la part des ouvriers dans les produits de leur travail du fait de l'accroissement inévitable du taux d'exploitation apporté par le développement de la productivité. L'évolution ultérieure du syndicalisme dans la vie du capitalisme allait mettre encore mieux en évidence ses limites historiques, mais même à une époque où l'activité syndicale (ainsi que dans les domaines d'action parallèles du parlement et des coopératives) avait encore une validité pour la classe ouvrière, les révisionnistes altéraient déjà la réalité en défendant l'idée que ces activités pouvaient assurer à la classe ouvrière une amélioration constante et infinie de ses conditions de vie.
Et alors que Bernstein voyait une tendance à l'atténuation des rapports de classe à travers la prolifération d'entreprises à petite échelle et donc la croissance de la classe moyenne, Luxemburg affirmait l'existence de la tendance qui allait devenir prédominante dans le siècle suivant : l'évolution du capitalisme vers des formes de concentration et de centralisation gigantesques, tant au niveau des entreprises "privées" que de l'Etat et des alliances impérialistes. D'autres membres de la gauche révolutionnaire comme Boudin répondaient à l'idée selon laquelle la classe ouvrière allait devenir une classe moyenne en défendant que beaucoup de "cols blancs" et de techniciens qui étaient supposés engloutir le prolétariat étaient eux-mêmes, en réalité, un produit du processus de prolétarisation – là encore une tendance qui allait être très marquées au cours des dernières décennies. Les paroles de Boudin en 1907 retentissent de façon très moderne de même que les arguments spécieux qu'elles combattent :
"Une très grande proportion de ce qu'on appelle la nouvelle classe moyenne et qui apparaît comme telle dans les statistiques sur les revenus, constitue en réalité une partie du prolétariat ordinaire, et la nouvelle classe moyenne, quelle qu'elle soit, est bien plus petite que ce qui apparaît dans les tableaux des revenus. Cette confusion provient, d'une part, du vieux préjugé profondément ancré selon lequel Marx aurait attribué uniquement au travail manuel la propriété de créer de la valeur et, d'autre part, de la séparation de la fonction de gérant d'avec celle de propriétaire – effectuée par les corporations, comme on l'a noté auparavant. Dans ces circonstances, de larges parties du prolétariat sont comptées comme faisant partie de la classe moyenne, c'est-à-dire la couche inférieure de la classe capitaliste. C'est le cas pour ces activités, nombreuses et croissantes, dont la rémunération est appelée "salary" au lieu de "wage". Toutes ces personnes salariées, quel que soit leur salaire, qui constituent la majeure partie, et certainement une grande portion, de la "nouvelle" classe moyenne, font tout autant partie du prolétariat que le simple ouvrier journalier." (The Theoretical System of Karl Marx, 1907, traduit de l'anglais par nous)
En route vers la débâcle de la civilisation bourgeoise
La crise économique ouverte d'aujourd'hui a lieu dans un stade très avancé du déclin du capitalisme. Luxemburg répondait à Bernstein dans une période qu'elle caractérisait, avec une remarquable lucidité une fois encore, comme une période qui n'était pas encore celle du déclin mais dont l'approche devenait de plus en plus évidente. Ce passage est écrit en réponse à la question empirique (et empiriste) de Bernstein : pourquoi n'avons-nous pas assisté à l'ancien cycle décennal depuis le début des années 1870 ? Luxemburg insiste dans sa réponse sur le fait que ce cycle est en réalité l'expression de la phase de jeunesse du capitalisme ; maintenant le marché mondial se trouvait dans une "période de transition" entre sa période de croissance maximum et l'ouverture d'une époque de déclin :
"Le marché mondial se développe toujours. L'Allemagne et l'Autriche ne sont entrées dans la phase de véritable production industrielle à grande échelle que dans les années 1870 ; la Russie seulement dans les années 1880 ; la France est encore en grande partie à un stade de petite production ; les Etats balkaniques, pour la plus grande partie, ne se sont pas encore débarrassés des chaînes de l'économie naturelle ; et ce n'est que dans les années 1880 que l'Amérique, l'Australie et l'Afrique sont entrés dans un commerce étendu et régulier de biens avec l'Europe. Aussi, d'une part, nous avons maintenant derrière nous une ouverture soudaine et vaste de nouvelles aires d'économie capitaliste comme c'est arrivé périodiquement jusqu'aux années 1870 ; et nous avons derrière nous, pour ainsi dire, des crises de jeunesse qui ont suivi ces développements périodiques. D'autre part, nous ne sommes pas encore arrivés au degré de développement et d'épuisement du marché mondial qui produira la collision périodique, fatale entre les forces productives et les limites du marché, qui constitue la véritable crise de vieillesse du capitalisme. Nous sommes dans une phase où les crises n'accompagnent plus la montée du capitalisme et pas encore son déclin." (chapitre 2, traduit de l'anglais par nous)
Il est intéressant de noter que dans la deuxième édition de sa brochure, publiée en 1908, Luxemburg a omis ce passage et le paragraphe suivant, et mentionne la crise de 1907-1908, qui avait précisément pour centre les nations industrielles les plus puissantes : évidemment, pour Luxemburg, "la période de transition" touchait déjà à sa fin.
De plus elle fait aussi allusion au fait que l'attente précédente d'une nouvelle période qui s'ouvrirait pas "une grande crise commerciale" pourrait s'avérer une erreur – déjà dans Réforme sociale ou Révolution, elle souligne la croissance du militarisme, une évolution qui allait la préoccuper de plus en plus. C'est sûrement la possibilité que l'ouverture de la nouvelle période soit marquée par la guerre et non par une crise économique ouverte qui se trouve probablement derrière l'observation suivante :
"Dans la thèse socialiste affirmant que le point de départ de la révolution socialiste serait une crise générale et catastrophique, il faut à notre avis distinguer deux choses : l’idée fondamentale qu’elle contient et sa forme extérieure.
L’idée est celle-ci : on suppose que le régime capitaliste fera naître de lui-même, à partir de ses propres contradictions internes, le moment où son équilibre sera rompu et où il deviendra proprement impossible. Que l’on ait imaginé ce moment sous la forme d’une crise commerciale générale et catastrophique, on avait de bonnes raisons de le faire, mais c’est finalement un détail accessoire pour l’idée fondamentale elle-même." (Ch.1)
Mais quelle que soit la forme prise par "la crise de sénilité" du capitalisme, Rosa Luxemburg insistait sur le fait que sans cette vision de la chute catastrophique du capitalisme, le socialisme devenait une simple utopie :
"Pour le socialisme scientifique la nécessité historique de la révolution socialiste est surtout démontrée par l’anarchie croissante du système capitaliste qui enferme celui-ci dans une impasse. Mais si l’on admet l’hypothèse de Bernstein : l’évolution du capitalisme ne s’oriente pas dans le sens de l’effondrement - alors le socialisme cesse d’être une nécessité objective. (...) La théorie révisionniste est confrontée à une alternative : ou bien la transformation socialiste de la société est la conséquence, comme auparavant, des contradictions internes du système capitaliste, et alors l’évolution du système inclut aussi le développement de ses contradictions, aboutissant nécessairement un jour ou l’autre à un effondrement sous une forme ou sous une autre ; en ce cas, même les "facteurs d’adaptation" sont inefficaces, et la théorie de la catastrophe est juste. Ou bien les " facteurs d’adaptation " sont capables de prévenir réellement l’effondrement du système capitaliste et d’en assurer la survie, donc d’abolir ces contradictions, en ce cas, le socialisme cesse d’être une nécessité historique ; il est alors tout ce que l’on veut sauf le résultat du développement matériel de la société. Ce dilemme en engendre un autre : ou bien le révisionnisme a raison quant au sens de l’évolution du capitalisme - en ce cas la transformation socialiste de la société est une utopie ; ou bien le socialisme n’est pas une utopie, et en ce cas la théorie des " facteurs d’adaptation" ne tient pas. That is the question : c’est là toute la question." (idem)
Dans ce passage, Luxemburg fait ressortir avec totale clarté le rapport intime entre le point de vue révisionniste et le rejet de la vision marxiste du déclin du capitalisme et, inversement, la nécessité de cette théorie comme pierre de touche d'une conception cohérente de la révolution.
Dans le prochain article de cette série nous examinerons comment Luxemburg et d'autres ont cherché à situer les origines de la crise qui s'approchait dans le processus sous-jacent de l'accumulation capitaliste.
Gerrard
1 Voir par exemple l'article : "1895-1905 : la perspective révolutionnaire obscurcie par les illusions parlementaires [12]", Revue internationale n°88
2 Aufheben n° 2 et 3 https://libcom.org/article/aufheben [13]
3 Edition française Les bons caractères, 2004.
4 https://www.marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm [14]
5 https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/00/18910000.htm [15]
6 https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1898/r_ou_r1_1.html [16]
Questions théoriques:
- Décadence [17]
Rubrique:
La surproduction chronique, une entrave incontournable à l’accumulation capitaliste (débat interne au CCI (V))
- 5444 lectures
La dette mondiale atteint des sommets faramineux ne permettant plus comme avant de "relancer l’économie", au moyen d’un nouvel accroissement de l'endettement, sans mettre à mal la crédibilité financière des Etats et la valeur des monnaies. Face à cette situation, il est de la responsabilité des révolutionnaires d'analyser en profondeur les moyens par lesquels le capitalisme est parvenu jusqu'à présent à prolonger artificiellement la vie de son système à travers tout un ensemble de "tricheries" vis-à-vis de ses propres lois. C'est la seule méthode fournissant la clé d'une évaluation pertinente de l'impasse à laquelle se trouve actuellement confrontée la bourgeoisie mondiale.
L'étude de la période dite des Trente Glorieuses, tant louée et regrettée par la bourgeoisie, ne doit pas faire exception à cette attention de la part des révolutionnaires à qui il revient, bien sûr, de prendre en charge la nécessaire réfutation des interprétations qu’en donnent les défenseurs du capitalisme, en particulier lorsqu’ils veulent nous convaincre qu’il peut être réformé 1, mais également de participer à la confrontation fraternelle des différentes points de vue existant sur ce sujet au sein du camp prolétarien. C'est l'objet du débat que notre organisation a ouvert il y a maintenant bientôt deux ans dans les colonnes de la Revue internationale 2.
La vision développée par notre brochure La décadence du capitalisme selon laquelle les destructions opérées durant la Seconde Guerre mondiale auraient été, à travers le marché de la reconstruction, à l'origine du boom des années 1950 et 1960, a fait l’objet d'une critique dans le CCI, notamment de la part de la thèse que nous défendons dite des marchés extra-capitalistes et de l'endettement. Comme son nom l'indique, cette thèse considère que c'est la vente aux marchés extra-capitalistes et la vente à crédit qui ont été, durant les années 1950 et 1960, le moteur de l'accumulation capitaliste et non pas les mesures keynésiennes, comme le soutien une autre thèse dite du keynésiano-fordisme 3. Dans la Revue internationale n° 138 est parue une contribution signée Salome et Ferdinand défendant ce dernier point de vue et qui, en avançant un ensemble d'arguments non encore discutés publiquement, est venue ainsi relancer le débat. Tout en répondant aux arguments de ces deux camarades, cet article se fixe les objectifs suivants : rappeler les fondements de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement ; présenter des éléments statistiques qui, selon nous, illustrent sa validité ; examiner ses implications sur le cadre global d’analyse du CCI de la période de décadence du capitalisme 4.
Les principaux arguments théoriques en présence
L'analyse défendue dans la Décadence du capitalisme prêtait une certaine rationalité économique à la guerre (la guerre vue comme ayant des retombées économiques positives). En ce sens, elle était contradictoire avec de textes plus anciens de notre organisation qui mettaient quant à eux en évidence que "toutes ces guerres, comme les deux guerres mondiales (…), contrairement à celles du siècle dernier, (…) n'ont permis un quelconque progrès dans le développement des forces productives, mais n'ont eu d'autre résultat que des destructions massives laissant complètement exsangues les pays où elles se sont déroulées (sans compter les horribles massacres qu'elles ont provoqués)." 5
L’erreur de notre brochure résulte, selon nous, d’une application hâtive et erronée du passage suivant du Manifeste communiste : "Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens." En effet, le sens de ces lignes n'est pas d’attribuer à la destruction des moyens de production la vertu d’ouvrir un nouveau marché solvable à même de relancer la machine économique. En conformité avec l’ensemble des écrits économiques de Marx, il convient d’interpréter les effets de la destruction de capital (ou plutôt de la dévalorisation de celui-ci) comme participant à désengorger le marché et à freiner la tendance à la baisse du taux de profit 6.
La thèse dite du Capitalisme d'Etat keynésiano-fordiste offre une interprétation de la "prospérité" des années 1950 et 1960 différente à la fois de celle défendue par la Décadence du capitalisme et de celle défendue par la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement : "L’accroissement assuré des profits, des dépenses de l’État et l’augmentation des salaires réels, ont pu garantir la demande finale si indispensable au succès du bouclage de l’accumulation capitaliste" 7. Face à cette idée, les deux arguments suivants ont déjà été avancés :
a) Augmenter les salaires au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail constitue purement et simplement, du point de vue capitaliste, un gaspillage de plus-value qui n'est en aucune manière capable de participer au processus de l'accumulation. De plus, s'il est vrai que l’augmentation de la consommation ouvrière (au moyen d'augmentations de salaires) et des dépenses de l'État permettent d'écouler une production accrue, cela a pour conséquence une stérilisation de la richesse produite qui ne trouve pas à s'employer utilement pour valoriser le capital.8
b) Parmi les ventes effectuées par le capitalisme, la partie qui peut être dédiée à l'accumulation du capital, et qui participe ainsi à l'enrichissement réel de celui-ci, correspond aux ventes réalisées dans le commerce avec des marchés extra-capitalistes (intérieurs ou externes). C'est effectivement le seul moyen permettant au capitalisme de ne pas se trouver dans cette situation décrite par Marx où "des capitalistes s'échangent entre eux et consomment leur production", ce qui "ne permet en rien une valorisation du capital" 9.
Dans leur article de la Revue internationale n° 138, les camarades Salome et Ferdinand reviennent sur le sujet. A cette occasion, ils précisent, de façon tout à fait appropriée à notre avis, ce qu'ils considèrent être le cadre de ce débat : "Il peut être répondu (…) qu'un tel accroissement du marché est insuffisant pour réaliser toute la partie de la plus-value nécessaire à l'accumulation. Cela est vrai d'un point de vue général et à long terme. Nous, défenseurs de la thèse du capitalisme d'État keynesiano-fordiste, ne pensons pas avoir trouvé une solution aux contradictions inhérentes du capitalisme, une solution qui puisse se répéter à volonté."
Ils illustrent au moyen d’un schéma (basé sur ceux que Marx utilise dans le second volume du Capital, pour présenter le problème de la reproduction élargie) comment l’accumulation peut se poursuivre malgré le fait qu’une partie de la plus-value soit délibérément reversée aux ouvriers sous forme d'augmentations de salaire. De leur point de vue, la même logique sous-jacente explique également le caractère non indispensable d'un marché extra-capitaliste au développement du capitalisme : "Si les conditions sont celles que les schémas présupposent et si nous en acceptons les conséquences (conditions et conséquences qui peuvent être analysées séparément), par exemple un gouvernement qui contrôle toute l'économie peut théoriquement l'organiser de telle sorte que l'accumulation fonctionne selon le schéma ."
Pour les camarades, le bilan pour le capitalisme de cette redistribution de plus-value, bien qu’elle ralentisse l'accumulation, est néanmoins positif, en permettant un élargissement du marché intérieur : "Si ce profit est suffisamment élevé, les capitalistes peuvent augmenter les salaires sans perdre tout l'accroissement de la plus-value extraite" (…) "Une augmentation générale des salaires signifie également un accroissement de ces marchés" (…) "Le seul effet "nuisible" de ce "gaspillage de plus-value" réside dans le fait que l'augmentation de la composition organique du capital est plus lente que le rythme frénétique qu'elle aurait sinon".
Nous sommes d’accord avec le constat que font les camarades concernant les effets de ce "gaspillage de plus-value". Mais, à propos de celui-ci, ils disent également : "on ne peut pas affirmer que ce "gaspillage de plus-value" ne prenne en aucune manière part au processus d'accumulation. Au contraire, cette distribution des profits obtenus par l'augmentation de la productivité participe pleinement de l'accumulation". Il est clair, comme les camarades le reconnaissent eux-mêmes, que le gaspillage en question ne participe pas au processus de l’accumulation à travers l’injection de capital dans le procès de production. En effet, il détourne, de sa finalité capitaliste que représente l’accumulation, du capital pouvant être accumulé. Qu’il ait une utilité momentanée pour la bourgeoisie, sans aucun doute, puisqu’il permet de maintenir artificiellement, voire d’augmenter, un certain niveau d’activité économique. Il diffère ainsi dans le temps les problèmes d’insuffisance de débouchés pour la production capitaliste. C’est bien là le propre des mesures keynésiennes mais, encore une fois, cela n’est pas participer au processus d’accumulation. C’est participer au processus productif dans les conditions de la décadence du capitalisme où ce système, de plus en plus entravé dans son fonctionnement "normal", doit multiplier les dépenses improductives pour maintenir l'activité économique. En effet, ce gaspillage s’ajoute à celui déjà énorme constitué par les dépenses militaires ou d’encadrement de la société, etc. Motivé par la nécessité de créer un marché intérieur artificiel, il est une dépense tout aussi irrationnelle et improductive que ces dépenses là.
Si les mesures keynésiennes ont favorisé la croissance très importante des PIB (Produits Intérieurs Bruts) des principaux pays industrialisés dans les années 1950-60, donnant ainsi l'illusion d'un retour durable à la prospérité de la phase d'ascendance du capitalisme, la richesse réellement créée durant cette période s’est accrue à un rythme nécessairement beaucoup plus modeste puisqu’une partie significative de l’accroissement du PIB était faite de dépenses improductives 10.
Pour en terminer avec cette partie, nous examinerons une autre implication du raisonnement des camarades qui permettrait que, "À ce niveau, il n'y a aucune nécessité de marchés extra-capitalistes". Contrairement à ce que les camarades annoncent, nous n'avons pas trouvé le moindre argument nouveau qui mette en question la nécessité d’un acheteur extérieur aux relations de production capitalistes. Le schéma qu’ils proposent met effectivement en évidence que "un gouvernement qui contrôle toute l'économie peut théoriquement l'organiser" de telle sorte que soit réalisé l’élargissement de la production (par l’augmentation tant des moyens de production que celle des moyens de consommation), sans recourir à un acheteur extérieur et en versant aux ouvriers plus que ce qui est nécessaire au coût social de la reproduction de leur force de travail. Très bien, mais ceci ne représente pas l’accumulation élargie telle qu'elle est pratiquée sous le capitalisme. Plus précisément, l’accumulation élargie ne pourrait pas être pratiquée de la sorte sous le capitalisme quel que soit le niveau de contrôle de l’Etat sur la société, et cela qu’un sursalaire soit versé ou non aux ouvriers.
L’explication que donne Rosa Luxemburg de cette impossibilité lorsqu’elle décrit la boucle sans fin des schémas de l’accumulation élargie (élaborés par Marx dans le livre II du Capital) se réfère aux conditions concrètes de la production capitaliste : "D'après le schéma de Marx, le mouvement [de l'accumulation] part de la section I, de la production des moyens de production. Qui a besoin de ces moyens de production accrus ? A cela, le schéma répond : c'est la section II qui en a besoin, pour pouvoir fabriquer plus de moyens de consommation. Mais qui a besoin de ces moyens de consommation accrus ? Le schéma répond : précisément la section I, parce qu'elle occupe maintenant plus d'ouvriers. Nous tournons manifestement dans un cercle. Produire plus de moyens de consommation, pour pouvoir entretenir plus d'ouvriers, et produire plus de moyens de production, pour pouvoir occuper ce surplus d'ouvriers, est du point de vue capitaliste une absurdité" (L'accumulation du Capital ; paragraphe Analyse du schéma de la reproduction élargie de Marx);
Il est, à ce stade de la réflexion, tout à fait opportun d'examiner une remarque des camarades : "S'il n'y avait pas de crédit et s'il était nécessaire de réaliser en argent toute la production annuelle d’un seul coup sur le marché, alors, oui, il devrait exister un acheteur externe à la production capitaliste. Mais ce n'est pas le cas." Nous sommes d’accord avec les camarades pour dire qu’il n'est pas nécessaire qu'à chaque cycle de la production intervienne un acheteur externe, d’autant plus qu'il existe le crédit. Ceci dit, cela n'élimine pas le problème mais ne fait simplement que l'étaler et le différer dans le temps, en permettant qu'il se pose moins souvent mais à chaque fois de façon plus importante 11. Dés lors qu’un acheteur extérieur est présent au bout, par exemple, de 10 cycles d'accumulation ayant impliqué la coopération des secteurs I et II, et qu'il achète alors autant de moyens de production ou de consommation qu'il en est nécessaire pour rembourser les dettes contractées au cours de ces 10 cycles d'accumulation, alors tout va bien pour le capitalisme. Mais s’il n’y a pas au bout du compte un acheteur extérieur, les dettes accumulées ne peuvent jamais être remboursées ou alors seulement au moyen de nouveaux emprunts. La dette enfle alors inévitablement et démesurément jusqu’à l’éclatement d’une crise qui n'a pour effet que d'impulser un nouvel endettement. C’est exactement ce processus que nous voyons se répéter sous nos yeux, de façon de plus en plus grave, depuis la fin des années 1960.
Redistribuer une partie de la plus-value extraite sous forme d’augmentations de salaire ne revient, en fin de compte, qu'à augmenter le coût de la force de travail. Mais cela n’élimine en rien le problème de "la boucle sans fin" mise en évidence par Rosa Luxemburg. Dans un monde constitué uniquement de capitalistes et d'ouvriers, il n’existe pas de réponse à la question que Marx ne cesse de se poser dans le Capital (Livre II) "mais d'où vient l'argent nécessaire au financement de l’augmentation tant des moyens de production que de consommation" ? Dans un autre passage de L'accumulation du Capital Rosa Luxemburg reprend à con compte cette problématique en l’explicitant très simplement : "Une partie de la plus-value, la classe capitaliste la consomme elle-même sous forme de moyens de consommation et conserve dans sa poche l'argent échangé contre eux. Mais qui lui achète les produits où est incorporée l'autre partie, la partie capitalisée, de la plus-value ? Le schéma répond : en partie les capitalistes eux-mêmes, en fabriquant de nouveaux moyens de production, au moyen de l'élargissement de la production ; en partie de nouveaux ouvriers, qui sont nécessaires pour utiliser ces nouveaux moyens de production. Mais pour pouvoir faire travailler de nouveaux ouvriers avec de nouveaux moyens de production, il faut - du point de vue capitaliste - avoir auparavant un but pour l'élargissement de la production, une nouvelle demande de produits à fabriquer (…) D'où vient l'argent pour la réalisation de la plus-value dans les conditions de l'accumulation, c'est-à-dire de la non consommation, de la capitalisation d'une partie de la plus-value ?" (Paragraphe Analyse du schéma de la reproduction élargie de Marx) En fait, Marx lui-même fournira une réponse à cette question en désignant les "marchés étrangers" 12.
Faire intervenir un acheteur extérieur aux relations de production capitalistes résout, selon Rosa Luxemburg, le problème de la possibilité de l’accumulation. Cela résout également cette autre contradiction des schémas de Marx résultant du rythme différent de l'évolution de la composition organique du Capital dans les deux sections (celle des moyens de production et celle des moyens de consommation) 13. Les deux camarades reviennent dans leur texte sur cette contradiction mise en évidence par Rosa Luxemburg : "cette distribution des profits obtenus par l'augmentation de la productivité" (…) "atténue précisément le problème identifié par R. Luxemburg dans le chapitre 25 de L’accumulation du capital, où elle fait valoir fermement qu'avec la tendance vers une composition organique du capital toujours plus grande, un échange entre les deux secteurs principaux de la production capitaliste (production de moyens de production d'une part, de moyens de consommation de l'autre) est impossible à long terme". A ce propos les camarades font le commentaire suivant : "F. Sternberg considère ce point de réflexion de R. Luxemburg comme le plus important de "tous ceux qui ont soigneusement été évités par ceux qui critiquent Rosa Luxemburg" (Fritz Sternberg, El imperialismo ; Siglo XXI editores, p 70)." Sur ce point également nous ne partageons pas la position des camarades ni celle de Sternberg, laquelle ne correspond pas réellement à la manière dont Rosa Luxemburg a posé le problème.
En effet, pour Rosa Luxemburg elle-même, cette "contradiction" se résout dans la société par le placement d' "une portion toujours plus grande de la plus-value accumulable dans la section des moyens de production au lieu de la section des moyens de consommation. Comme les deux sections de la production ne sont que deux branches de la même production sociale totale ou si l'on veut deux succursales appartenant au même "capitaliste total", on ne peut rien objecter à l'hypothèse d'un transfert constant d'une partie de la plus-value accumulée d'une section à l'autre, selon les besoins techniques ; cette hypothèse correspond en fait à la pratique courante du capital. Cependant cette supposition n'est valable que tant que nous envisageons la plus-value capitalisable en termes de valeur." (L'accumulation du capital ; chapitre Les contradictions du schéma de la reproduction élargie - souligné par nous). Cette dernière supposition impliquant l'existence "d’acheteurs extérieurs" intervenant régulièrement dans la succession des cycles d'accumulation.
En fait, si une telle "contradiction" présente le risque d'aboutir à l’impossibilité de l’échange entre les deux sections de la production, c’est essentiellement dans le monde abstrait des schémas de la reproduction élargie dés lors qu’on ne fait pas intervenir un "acheteur extérieur". En effet, "le progrès technique doit se traduire, d'après Marx lui-même, par l'accroissement relatif du capital constant par rapport au capital variable ; par conséquent il y a nécessairement une modification constante dans la répartition de la plus-value capitaliste entre c et v". Or "Les capitalistes du schéma ne sont pas en mesure d'effectuer à leur gré cette modification car la capitalisation dépend a priori de la forme matérielle de leur plus-value [Ndlr : moyens de production ou moyens de consommation]. Puisque d'après l'hypothèse de Marx, l'élargissement de la production ne peut se faire qu'avec les moyens de production et de consommation produits dans le monde capitaliste" (Rosa Luxemburg ; L'accumulation du capital ; chapitre Les contradictions du schéma de la reproduction élargie).
Nous concevons tout à fait que les camarades n'aient jamais été convaincus par les démonstrations de Rosa Luxemburg quant à la nécessité d'un acheteur extérieur pour permettre l'accumulation capitaliste (ou, à défaut, d’un recours au crédit mais qui sera alors "non remboursable"). Par contre, nous n'avons pas identifié en quoi les objections qu'ils formulent en s'appuyant notamment sur Sternberg, dont nous avons de bonnes raisons de penser qu'il n'avait pas réellement assimilé le fond de la théorie de l'accumulation de Rosa Luxemburg 14, sont à même de remettre en cause des positions cardinales de cette théorie.
Comme nous l’avons déjà souligné dans des contributions antérieures, le fait que les sursalaires versés aux ouvriers ne servent à augmenter ni le capital constant ni le capital variable est déjà suffisant pour conclure au gaspillage total (du point de vue de la rationalité capitaliste) que représentent ces dépenses. Du point de vue strictement économique, le même effet aurait été produit par l’augmentation des dépenses personnelles des capitalistes. Mais il n’était pas nécessaire, pour parvenir à cette conclusion, de recourir à Rosa Luxemburg 15. Ceci étant dit, si nous avons jugé nécessaire de répondre aux objections faites par ces camarades à la théorie de l'accumulation du capital défendue par Rosa Luxemburg, c'est par ce que nous estimons que le débat sur cette question contribue à donner une assise plus large et profonde à la compréhension non seulement du phénomène des Trente Glorieuses mais également au problème de la surproduction dont on peut difficilement nier qu'il se trouve au cœur des problèmes actuels du capitalisme.
La part des marchés extra-capitalistes et de l’endettement dans l’accumulation des années 1950 et 1960
Deux facteurs sont à l’origine de l’augmentation des PIB durant cette période :
-
l’augmentation de la richesse réelle de la société à travers le processus d’accumulation du capital ;
-
toute une série de dépenses improductives en augmentation comme conséquence du développement du capitalisme d’Etat et plus particulièrement des politiques keynésiennes alors mises en place.
Nous nous intéressons, dans cette partie, à la manière dont l’accumulation s’est effectuée. C’est l’ouverture et l’exploitation accélérée des marchés extra-capitalistes qui avaient été à l’origine de la phase de très forte expansion du capitalisme débutée au sein de la deuxième moitié du 19e siècle et à laquelle la Guerre de 1914 avait mis un terme. La phase de décadence du capitalisme étant caractérisée globalement par l’insuffisance relative de tels marchés en regard des besoins toujours plus importants d’écoulement des marchandises, doit on en déduire que les marchés extra-capitalistes n’ont plus joué qu’un rôle marginal dans l’accumulation durant cette période de la vie du capitalisme ouverte par la guerre en 1914 ? Si c’est le cas, alors ces marchés ne peuvent pas expliquer, même en partie, l’accumulation réalisée dans les années 1950 et 1960. C’est la réponse que donnent les camarades dans leur contribution : "Pour nous, le mystère des Trente Glorieuses ne peut s’expliquer par des restes de marchés extra-capitalistes, alors que ceux-ci sont insuffisants depuis la Première Guerre mondiale en regard des nécessités de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme". Pour notre part, nous pensons au contraire que les marchés extra-capitalistes ont joué un rôle important dans l’accumulation, en particulier au début des années 1950, lequel a décru ensuite progressivement jusqu’à la fin des années 1960. A mesure qu’ils devenaient insuffisants, c’est l’endettement qui prenait le relais, en jouant le rôle de l’acheteur extérieur au capitalisme, mais évidemment il s’agissait d’un endettement d’une "qualité nouvelle", ayant cette caractéristique de ne plus pouvoir être réduit. En fait, c’est à cette période qu’il faut remonter pour trouver l’origine du phénomène d’explosion de la dette mondiale telle qu’on la connaît aujourd’hui, même si bien évidemment la contribution en valeur des décennies 1950 et 1960 à la dette mondiale actuelle est dérisoire.
Les marchés extra-capitalistes
Statistiquement, c’est en 1953 que culmine la part des exportations des pays développés en direction des pays coloniaux, évaluée en pourcentage des exportations mondiales (voire figure 1, la courbe des importations des pays coloniaux étant supposée la même que celle des exportations des pays développés en direction des pays coloniaux). Le taux de 29% alors atteint donne une indication de l’ordre de grandeur de l’importance des exportations en direction des marchés extra-capitalistes des pays coloniaux puisque, à l’époque, les marchés coloniaux sont encore très majoritairement extra-capitalistes. Par la suite, ce pourcentage diminuera pour se situer à 22% des exportations en 1966. Dans la réalité, la décroissance de ce pourcentage, relativement cette fois aux PIB et non plus aux exportations, est plus rapide encore puisque, durant cette période, les PIB augmentent plus rapidement que les exportations.
Figure 1. Importations des marchés coloniaux en pourcentage des importations mondiales (Schéma repris de BNP Guide statistique 1972 ; Sources : P. Bairoch op. cit. – Communiqué OCDE, novembre 1970)
Aux exportations en direction des marchés extra-capitalistes des colonies, il convient d’ajouter les ventes qui sont effectuées, au sein de pays capitalistes comme la France, le Japon, l’Espagne, etc., à des secteurs qui, comme le secteur agricole, ne sont encore que peu intégrés dans les relations de production capitaliste. De même, en Europe orientale il subsiste encore un marché extra capitaliste, alors que l’issue de la Première Guerre mondiale avait condamné l’expansion capitaliste dans ces pays à la stagnation 16.
Ainsi donc, si l’on considère l’ensemble des ventes effectuées par les régions dominées par des relations de production capitaliste en direction de celles produisant encore selon des relations précapitalistes, qu’il s’agisse des marchés extérieurs ou intérieurs, on s’aperçoit que celles-ci ont pu soutenir une partie importante de la croissance réelle des Trente Glorieuses, tout au moins au début des années 1950. Nous reviendrons dans la dernière partie de cet article sur l'appréciation du niveau de saturation des marché au moment de l’entrée du capitalisme dans sa phase de décadence, afin d’en faire une caractérisation plus fine.
L’endettement
Au tout début de notre débat interne, les tenants de la thèse du keynésiano-fordisme opposaient à notre hypothèse accordant un rôle à l’endettement dans les années 1950 et 1960 pour soutenir la demande le fait que "la dette totale n’augmente pratiquement pas pendant la période 1945-1980, ce n’est que comme réponse à la crise qu’elle explose. L’endettement ne peut donc expliquer la vigoureuse croissance d’après-guerre". Toute la question est de savoir ce que recouvre ce "pratiquement pas" et si, malgré tout, cela ne serait pas suffisant pour permettre le bouclage de l’accumulation, en complément des marchés extra-capitalistes.
Il est assez difficile de trouver des données statistiques concernant l'évolution de la dette mondiale durant les années 1950-60 pour la plupart des pays, sauf pour les Etats-Unis.
Nous disposons de l’évolution de la dette totale et du PNB américains, année par année, entre 1950 et 1969. L’étude de ces données (Figure 2) doit nous permettre de répondre à la question suivante : est-il possible que, chaque année, l’accroissement de la dette ait été suffisant pour assumer cette partie de l’augmentation du PIB qui ne correspond pas à des ventes effectuées en direction des marchés extra-capitalistes ? Comme on l’a déjà dit, dès lors que ceux-ci font défaut, c’est à l’endettement qu’il revient de jouer le rôle d’acheteur extérieur aux rapports de production capitalistes 17.
|
Année |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
|
GDP |
257 |
285 |
328 |
346 |
365 |
365 |
398 |
419 |
441 |
447 |
484 |
504 |
520 |
560 |
591 |
632 |
685 |
750 |
794 |
866 |
932 |
|
Dette |
446 |
486 |
519 |
550 |
582 |
606 |
666 |
698 |
728 |
770 |
833 |
874 |
930 |
996 |
1071 |
1152 |
1244 |
1341 |
1435 |
1567 |
1699 |
|
%annuel Dette/GDP |
|
171 |
158 |
159 |
160 |
166 |
167 |
167 |
165 |
172 |
172 |
174 |
179 |
178 |
181 |
182 |
182 |
179 |
181 |
181 |
182 |
|
%sur la période ΔDette /ΔGDP |
185% |
||||||||||||||||||||
|
Δannuel GDP |
|
28 |
44 |
17 |
19 |
0 |
33 |
21 |
22 |
6 |
36 |
20 |
16 |
40 |
30 |
42 |
53 |
65 |
44 |
72 |
67 |
|
Δannuel Dette |
|
40 |
33 |
31 |
31 |
24 |
60 |
33 |
30 |
41 |
63 |
41 |
56 |
66 |
75 |
81 |
93 |
97 |
94 |
132 |
132 |
|
(Δannuel Dette- |
|
12 |
-11 |
14 |
12 |
24 |
27 |
11 |
8 |
35 |
27 |
21 |
40 |
26 |
45 |
39 |
40 |
32 |
50 |
60 |
65 |
Figure 2. Evolution comparée du PIB (GDP) et de la dette aux Etats-Unis entre 1950 et 1960 18
Source (GDP et Dette): Federal Reserve Archival System for Economic research
https://fraser.stlouisfed.org/publications/scb/page/6870 [19]
https://fraser.stlouisfed.org/publications/scb/page/6870/1615/download/6... [20]
|
Année |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
|
%annuel Dette/GDP |
22 |
39 |
47 |
67 |
75 |
Figure 3.Evolution de la dette en RDA entre 1950 et 1970. Sources : Survey of Current Business (07/1975) - Monthly review (vol. 22, n°4, 09/1970, p.6)
L’augmentation de la valeur de la dette en pourcentage de l’augmentation de la valeur du PIB est, sur la période concernée, de 185%. En d'autres termes, l'augmentation en valeur de la dette est presque le double, en 20 ans, de l'augmentation du PIB. En fait, ce résultat démontre que l'évolution de l'endettement aux Etats-Unis est tel qu'il aurait largement pu, globalement durant la période considérée, assurer à lui seul la croissance du PIB de ce pays (et même participer à celle de certains autres d'autres pays) sans qu'il ait été nécessaire d'avoir recours à la vente aux marchés extra-capitalistes. Par ailleurs, on observe que chaque année, à l’exception de 1951, l’augmentation de la dette est supérieure à celle du PIB (c’est seulement en 1951 que la différence entre l’augmentation de la dette et l’augmentation du PIB est négative). Ce qui signifie que, pour chacune de ces années sauf une, c’est l’endettement qui aurait pu avoir assumé l’augmentation du PIB, ce qui est plus que nécessaire étant donné la contribution des marchés extra-capitalistes à la même époque.
La conclusion de cette réflexion concernant les Etats-Unis est la suivante : l’analyse théorique selon laquelle le recours au crédit avait pris le relais de la vente aux marchés extra-capitalistes pour permettre l’accumulation n’est pas démentie par la réalité même de l'évolution de l’endettement dans ce pays. Et, si une telle conclusion ne peut pas être généralisée de façon automatique à l'ensemble des pays industrialisés, le fait qu'elle concerne le plus grosse puissance économique mondiale, lui confère une certaine universalité que confirme par ailleurs le cas de la RDA. En effet, concernant ce pays, nous disposons de statistiques relatives à l’évolution de la dette en fonction du GNP (Figure 3) qui illustrent la même tendance.
Quelles implications pour notre analyse de la décadence ?
Quel niveau de saturation des marchés en 1914 ?
La Première Guerre mondiale éclate au faîte de la prospérité de l'économie capitaliste mondiale. Elle n'est précédée d'aucune crise se manifestant ouvertement sur le plan économique mais, néanmoins, c'est bien l'inadéquation croissante entre le développement des forces productives et les rapports de production qui se trouve à l'origine du conflit mondial et, avec lui, de l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Le développement de ce système étant conditionné par la conquête de marchés extra-capitalistes, la fin de la conquête coloniale et économique du monde par les métropoles capitalistes conduit celles-ci à s'affronter entre elles pour se disputer leurs marchés respectifs.
Contrairement à l'interprétation des camarades Salome et Ferdinand, une telle situation ne signifie pas que "les marchés extra-capitalistes (…) sont insuffisants depuis la Première Guerre mondiale en regard des nécessités de l'accumulation élargie atteinte par le capitalisme". En effet, si tel avait été le cas, la crise se serait manifestée au niveau purement économique avant 1914.
Ce sont ces caractéristiques de la période (rivalités impérialistes autour des territoires non capitalistes encore libres) que traduit précisément la citation suivante de Rosa Luxemburg : "L'impérialisme est l'expression politique du processus de l'accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. Géographiquement, ce milieu représente aujourd'hui encore la plus grande partie du globe." (L'accumulation du capital - Le protectionnisme et l'accumulation ; souligné par nous). A plusieurs reprise Rosa Luxemburg reviendra sur la description de l'état du monde à cette époque : "A côté des vieux pays capitalistes il existe, même en Europe, des pays où la production paysanne et artisanale domine encore aujourd'hui de loin l'économie, par exemple la Russie, les pays balkaniques, la Scandinavie, l'Espagne. Enfin, à côté de l'Europe capitaliste et de l'Amérique du Nord, il existe d'immenses continents où la production capitaliste ne s'est installée qu'en certains points peu nombreux et isolés, tandis que par ailleurs les territoires de ces continents présentent toutes les structures économiques possibles, depuis le communisme primitif jusqu'à la société féodale, paysanne et artisanale." (La critique des critiques. Souligné par nous)"
En fait, "la guerre mondiale, tout en étant un produit en dernière instance des contradictions économiques du système, a éclaté avant que ces contradictions aient pu se manifester au niveau "purement" économique. La crise de 1929 a donc été la première crise économique mondiale de la période de décadence." (Résolution sur la situation internationale du 16e congrès du CCI)
Si 1929 constitue la première manifestation significative, pendant la décadence, de l'insuffisance des marchés extra-capitalistes, cela signifie-t-il que, après cette date, il n'est pas possible que ces derniers aient joué un rôle significatif dans la prospérité capitaliste ?
Les vastes zones précapitalistes présentes de par le monde en 1914 n'ont pas pu "être asséchées" durant les 10 ans qui ont précédé 1929, période qui n'a pas été marquée par une intense activité économique mondiale. De même, durant les années 1930 et une bonne partie des années 1940, l’économie fonctionne au ralenti. C'est la raison pour laquelle, la crise de 1929, si elle illustre les limites des marchés extra-capitalistes atteintes à cette époque, ne marque pas pour autant la fin de toute possibilité que ceux-ci jouent un rôle significatif dans l’accumulation du capital.
L'exploitation d'un marché extra-capitaliste vierge, ou la meilleure exploitation d'un ancien marché extra-capitaliste, dépend en grande partie de facteurs tels que la productivité du travail dans les métropoles capitalistes dont résulte la compétitivité des marchandises produites ; les moyens de transport dont dispose le capital pour assurer la circulation des marchandises. Ces facteurs ont constitué le moteur de l'expansion du capitalisme à travers le monde, comme le mettait déjà en évidence Le Manifeste communiste 19. De plus, le mouvement de décolonisation a pu, en soulageant les échanges du poids considérable de l'entretien de l'appareil de domination coloniale, favoriser la rentabilité de certains marchés extra-capitalistes.
Le cycle "crise – guerre – reconstruction – nouvelle crise" en question
Le CCI avait très tôt corrigé une interprétation fausse de la réalité selon laquelle la Première Guerre mondiale aurait été la conséquence d’une crise économique ouverte. Comme nous l’avons vu à propos de cette période, la relation de cause à effet "crise – guerre" n’acquiert un sens universel (excluant toutefois le facteur lutte de classe) dés lors seulement que le terme crise est considéré au sens large, en tant que crise des rapports de production.
Quant à la séquence "guerre – reconstruction – nouvelle crise", nous avons également vu qu’elle ne permettait pas de rendre compte de la prospérité des années 1950 et 60 qui, en aucune manière, ne peut être mise sur le compte de la reconstruction consécutive à la Seconde Guerre mondiale. Il en va d’ailleurs de même concernant la reprise consécutive à la Première Guerre mondiale, durant laquelle le capitalisme renoue avec la dynamique antérieure à la guerre, basée sur l’exploitation des marchés extra-capitalistes, mais selon un rythme bien moindre qui porte la marque de l’état de guerre et des destructions occasionnées par celle-ci. Il y a effectivement eu reconstruction mais, loin de favoriser l’accumulation, celle-ci a plutôt signifié des faux frais nécessaires au redémarrage de l’économie.
Et depuis 1967, date à laquelle le capitalisme entre à nouveau dans une période de turbulences économiques, les crises se sont succédées, le capitalisme a ravagé la planète en multipliant les conflits impérialistes sans pour autant créer les conditions d’une reconstruction synonyme de retour même momentané et limité à la prospérité.
Ainsi que le CCI l’a toujours mis en évidence, l’entrée en décadence n’a pas signifié la fin de l’accumulation comme le traduit la poursuite de la croissance après 1914 et jusqu’à nos jours, quoique globalement à un rythme inférieur à celui de la période faste de l’ascendance du capitalisme (la majeure partie de la seconde moitié du 19e siècle jusqu’à 1914). Celle-ci s’est poursuivie sur la base de l’exploitation des marchés extra-capitalistes jusqu’au moment où ils furent totalement épuisés. C’est alors l’endettement non remboursable qui a dû prendre le relais en accumulant également des contradictions de plus en plus insurmontables.
Ainsi donc, et contrairement à ce qu'induit la représentation "crise – guerre – reconstruction – nouvelle crise", le mécanisme destruction / reconstruction n’a pas constitué un moyen permettant à la bourgeoisie de prolonger les jours du capitalisme, pas plus suite à la Première Guerre mondiale que suite à la Seconde. Les instruments privilégiés d'une telle entreprise, le keynésianisme et surtout l'endettement, s’ils ont pu avoir des effets immédiats allant dans le sens de repousser l’échéance des conséquences ultimes de la surproduction, n'ont pas été à coup nuls et encore moins miraculeux. L'abandon des mesures keynésiennes dans les années 1980 et surtout l’impasse actuelle de l’endettement généralisé et abyssal en constituent les preuves éclatantes.
Sílvio
1 Face à la crise, il ne manque pas de voix "à gauche" (et même aujourd’hui dans une grande partie de la droite) pour préconiser un retour aux mesures keynésienne comme l’illustre le passage suivant extrait d’un document de travail de Jacques Gouverneur, enseignant à l’Université Catholique de Louvin (Belgique). Comme le lecteur pourra s’en apercevoir, la solution qu’il préconise repose sur la mise à profit de l’augmentation de la productivité pour mettre en place de mesures keynésiennes et des politiques alternatives, … du type de celles qui, face à l’aggravation de la situation économique, ont été mises en avant par la gauche du capital depuis la fin des années 1960 afin de mystifier la classe ouvrière quant à la possibilité de réformer ce système : "Pour sortir de la crise et résoudre le problème du chômage, faut-il réduire – ou faudrait-il au contraire augmenter – les salaires, les prestations de sécurité sociale (allocations de chômage, pensions, remboursements de soins de santé, allocations familiales), les dépenses publiques (enseignement, culture, travaux publics, …) ? En d’autres termes : faut-il continuer à mettre en œuvre des politiques restrictives d’inspiration néolibérale (comme on le fait depuis le début des années 1980) ou faut-il au contraire préconiser un retour à des politiques expansives d’inspiration keynésienne (appliquées pendant la période de croissance 1945-1975) ? (…) En d’autres termes : les entreprises peuvent-elles augmenter simultanément leurs profits et leurs débouchés ? Il faut pour cela que deux conditions soient remplies. La première condition consiste en une augmentation de la productivité générale, en ce sens qu’avec un même nombre de travailleurs (ou d’habitants), l’économie produit un volume plus grand de biens et services. De manière imagée, une augmentation de la productivité sur une période donnée (…) élargit la taille du "gâteau" produit, augmente le nombre de "parts de gâteau" à répartir Dans une période où la productivité augmente, la mise en œuvre de politiques keynésiennes constitue la deuxième condition pour que les entreprises disposent simultanément de profits plus élevés et de débouchés élargis. (…) La perpétuation des politiques néolibérales multiplie les drames sociaux et débouche sur une contradiction économique majeure : elle accentue le divorce entre la croissance des profits globaux et celle des débouchés globaux. Mais elle favorise les entreprises et les groupes dominants : ceux-ci continuent donc à exercer une pression efficace sur les pouvoirs publics (nationaux et supranationaux) en vue de prolonger ces politiques globalement néfastes. Le retour à des politiques keynésiennes supposerait un changement dans le rapport de forces actuellement en vigueur ; il ne suffirait cependant pas pour résoudre les problèmes économiques et sociaux mis en évidence par la crise structurelle du système capitaliste. La solution à ces problèmes passe par la mise en œuvre de politiques alternatives : augmentation des prélèvements publics (essentiellement sur les profits) pour financer des productions socialement utiles, réductions du temps de travail pour développer l’emploi et le temps libre, glissement dans la composition des salaires pour promouvoir la solidarité." www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/FR_JG_Quelles_politiques_ [21]économiques_contre_la_crise_et_le_chômage_1.pdf (souligné par nous).
2 La présentation du débat ainsi que celle des trois principales positions en présence a été effectuée au sein de l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale, dans la Revue internationale n° 133. Par la suite ont été publiés successivement les articles suivants : Origine, dynamique, et limites du capitalisme d’Etat keynésiano-fordiste (Revue internationale n° 135) ; Les bases de l'accumulation capitaliste et Économie de guerre et capitalisme d’État (Revue internationale n° 136) ; En défense de la thèse ‘Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste’ (Revue internationale n° 138).
3 En défense de la thèse Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste (Réponse à Silvio et à Jens), Revue internationale n° 138.
4 Si la présente contribution ne revient pas sur des réponses de Salome et Ferdinand à la thèse L’économie de guerre et le capitalisme d’Etat, c'est parce que nous avons estimé moins prioritaire (même si nécessaire) la discussion des questions soulevées par cette dernière thèse et sur lesquelles nous aurons l'occasion de nous pencher. En effet, celles-ci ne sont pas déterminées d'abord et avant tout par une conception particulière des ressorts de l'accumulation mais plutôt par les conditions géopolitiques qui influent sur sa réalisation.
5 Cité dans l’article d’ouverture du débat dans le Revue internationale n° 133 : extrait du Rapport sur le Cours historique adopté au 3e congrès du CCI, citant lui-même le Rapport adopté à la Conférence de juillet 1945 de la Gauche Communiste de France et provenant de l'article Guerre, militarisme et blocs impérialistes dans la décadence du capitalisme publié en 1988, dans la Revue internationale n° 52.
6 Lire à ce sujet l’article de la série La décadence du capitalisme, Les contradictions mortelles de la société bourgeoise (Revue internationale n° 139).
7 Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste (Revue Internationale n° 135)
8 Voir l’article Les bases de l’accumulation capitaliste (Revue internationale n° 136)
9 Voir la thèse Les marchés extra-capitalistes et l’endettement dans l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (Revue internationale n° 133). La référence à l'œuvre de Marx est la suivante : Le capital, Livre III, section III : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, Chapitre X : Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation.
10 Voir sur cette question la présentation de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l’endettement dans l’article Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (Revue internationale n° 133)
11 Il est indéniable que le crédit joue un rôle régulateur et permet d’atténuer l'exigence de marchés extra-capitalistes à chaque cycle tout en la maintenant de façon globale. Mais cela ne change rien au problème de fond qui peut se ramener, comme le fait Rosa Luxemburg, à l'étude d'un cycle abstrait qui est la résultante des cycles élémentaires des divers capitaux : "Un élément de la reproduction élargie du capital social est, tout comme pour la reproduction simple que nous avons supposée plus haut, la reproduction du capital individuel. Car la production, qu'elle soit simple ou élargie, ne se poursuit en fait que sous la forme d'innombrables mouvements de reproduction indépendants de capitaux individuels" (L’accumulation du capital ; souligné par nous). De même, il est évident que seulement certains de ces cycles sont amenés à faire intervenir l’acheteur extérieur.
12 Cette réponse se trouve (entre autres) dans le livre III du capital "Comment est-il possible que parfois des objets manquant incontestablement à la masse du peuple ne fassent l'objet d'aucune demande du marché, et comment se fait-il qu'il faille en même temps chercher des commandes au loin, s'adresser aux marchés étrangers pour pouvoir payer aux ouvriers du pays la moyenne des moyens d'existence indispensables ? Uniquement parce qu'en régime capitaliste le produit en excès revêt une forme telle que celui qui le possède ne peut le mettre à la disposition du consommateur que lorsqu'il se reconvertit pour lui en capital. Enfin, lorsque l'on dit que les capitalistes n'ont qu'à échanger entre eux et consommer eux-mêmes leurs marchandises, on perd de vue le caractère essentiel de la production capitaliste, dont le but est la mise en valeur du capital et non la consommation" (Section III : la loi tendancielle de la baisse du taux de profit, Chapitre X : Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation)
13 L'élévation de la composition organique (c'est-à-dire la croissance plus rapide du capital constant par rapport au capital variable) dans la section des moyens de production est en moyenne plus rapide que dans celle des moyens de consommation, du fait des caractéristiques techniques propres à l’une et à l’autre de ces deux sections.
14 Malgré les excellentes illustrations et interprétations du développement du capitalisme mondial qu'il a réalisées, en s'appuyant sur la théorie de Rosa Luxemburg, en particulier dans Le conflit du siècle, on peut néanmoins s'interroger sur son assimilation en profondeur de cette théorie. En effet, Sternberg analyse dans ce même ouvrage la crise des années 1930 comme ayant résulté de l'incapacité du capitalisme a avoir su, à cette époque, synchroniser l'augmentation de la production avec celle de la consommation : "Le test qui consistait à synchroniser, sur la base de l'économie de profit capitaliste et sans expansion extérieure majeure, d'une part l'accroissement de la production et de la productivité, et, d'autre part, l'augmentation de la consommation, se solda donc par un échec. La crise fut le résultat de cet échec" (p 344). Laisser entendre qu'une telle synchronisation est possible sous le capitalisme, est le début de l’abandon de la rigueur et de la cohérence de la théorie de Rosa Luxemburg. C’est d’ailleurs ce que confirme l’étude la période post-Seconde Guerre mondiale faite par Sternberg où celui-ci développe sa conception selon laquelle il existe la possibilité d'une transformation de la société notamment à travers les nationalisations prises en charge par l'Etat et l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. La citation suivante en donne un aperçu : " …, la réalisation intégrale du programme travailliste de 1945 aurait constitué un grand pas vers la socialisation complète de l'économie anglaise, palier à partir duquel d'autres étapes sur la même voie auraient sans doute été franchies plus aisément (…) Au cours des premières années d'après-guerre, le gouvernement travailliste s'employa à exécuter le mandat que le peuple lui avait ainsi confié. S'en tenant strictement aux moyens et méthodes de la démocratie traditionnelle, il fit subir des modifications radicales à l'Etat, à la société et à l'économie capitalistes." (Chapitre Le monde d'aujourd'hui ; p 629). Le but n'est pas ici de faire la critique radicale du réformisme de Sternberg. Il s'agit seulement de mettre en évidence en quoi sa démarche réformiste incluait nécessairement une sous-estimation considérable des contradictions économiques qui assaillent la société capitaliste, sous-estimation peu compatible avec la théorie de Rosa Luxemburg telle qu'elle est exposée dans L'accumulation du Capital.
15 Comme l’illustre cette partie de notre critique effectuée dans Les bases de l'accumulation du capital (Revue internationale n° 136) qui s’appuie sur les écrits de Paul Mattick. En effet, pour ce dernier, contrairement à Rosa Luxemburg, il n’est pas nécessaire de faire intervenir un acheteur extérieur aux relations de production capitaliste pour que l’accumulation soit possible.
16 Fritz Sternberg, Le conflit du Siècle. III - La stagnation du capitalisme ; l'arrêt de l'expansion capitaliste ; l'arrêt de l'expansion extérieure du capitalisme ; p. 254.
17 Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la fonction de l’endettement n’est pas limitée à la création d’un marché artificiel.
18 %annuel Dette/GDP = (Dette/GDP)*100 ; %sur la période ΔDette/ΔGDP = ((Dette en 1969 - Dette en 1949) / (GDP en 1969 - GDP en 1949))*100 ; Δ annuel GDP = GDP en (n) - GDP en (n-1) ; Δ annuel Dette de l’année (n) = Dette l’année n - Dette de l’année (n-1) ;
19 "Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l'amélioration infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers." (souligné par nous).
Questions théoriques:
- L'économie [22]
L'Union Libre des Syndicats Allemands en marche vers le syndicalisme révolutionnaire
- 2918 lectures
Dans la première partie de cet article 1, nous avons rendu compte de la controverse au sein du mouvement syndical allemand et du SPD qui a mené à la création de l'Union Libre des Syndicats Allemands (Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, FVDG), l’organisation qui sera le précurseur du syndicalisme révolutionnaire allemand. Cet aperçu embrassait une période allant des années 1870 à1903. La FVDG, fondée en 1897, se présentait alors explicitement, et ce jusqu’en 1903, comme une partie combative du mouvement syndical social-démocrate. Elle n’avait aucun lien avec le syndicalisme révolutionnaire ou l’anarchisme, qui étaient très présents dans d’autres pays comme la France ou l’Espagne. La FVDG a défendu de façon très conséquente, au niveau théorique, la nécessité que les ouvriers organisés au sein des syndicats s’occupent non seulement des questions économiques mais également des questions politiques.
En raison du contexte d’éparpillement lors de sa naissance sous les lois antisocialistes et des démêlés avec la Confédération générale syndicale, la FVDG n’est toutefois pas parvenue à développer en son sein une coordination suffisante pour mener la lutte collective. L’organisation clairement syndicaliste révolutionnaire qui existe déjà dans les IWW aux États-Unis est, sur la question de la centralisation de l’activité, très en avance sur la FVDG. Le penchant permanent à la dispersion fédéraliste, même si celle-ci n’est pas encore théorisée au sein de la FVDG, demeure une faiblesse constante de cette organisation. Face à la grève de masse qui s’annonce, la répugnance envers la centralisation du combat va constituer de plus en plus clairement une entrave à l'activité politique de la FVDG.
La discussion autour des nouvelles formes de lutte apparues avec la grève de masse de la classe ouvrière au début du 20e siècle constitue pour la FVDG un grand défi et a pour conséquence que cette dernière commence à évoluer vers le syndicalisme révolutionnaire. Une évolution qui ne fait que se renforcer jusqu’à l’éclatement de la Première Guerre mondiale, comme nous allons l'illustrer dans cet article.
La grève de masse repousse dans l’ombre le vieil esprit syndicaliste1
Au niveau international, le tournant du 20e siècle voit de plus de plus se faire jour les prémisses de la grève de masse en tant que nouvelle forme de la lutte de classe. Par sa dynamique tendant spontanément à l’extension, propice au dépassement du cadre de la branche professionnelle, et par sa prise en compte de revendications politiques, la grève de masse se différencie des anciens schémas des combats de classe syndicaux du 19e siècle, entièrement organisés par les appareils syndicaux, limités à la corporation et à des revendications économiques. Dans les grèves de masse qui éclosent partout dans le monde se manifeste aussi une vitalité de la classe ouvrière qui tend à rendre caduques les grèves longuement préparées et complètement dépendantes de l’état des caisses de grèves syndicales.
Déjà en 1891avait eu lieu en Belgique une grève de 125 000 ouvriers puis en 1893 une autre de 250 000 travailleurs. En 1896 et 1897 se produisit la grève générale des ouvriers du textile de Saint-Pétersbourg en Russie. En 1900 ce fut le tour des mineurs de l’État américain de Pennsylvanie puis, en 1902 et 1903, de ceux d’Autriche et de France. En 1902 une nouvelle grève de masse eut lieu en Belgique pour le suffrage universel et, en 1903, ce fut le tour des cheminots aux Pays-Bas. En septembre 1904 eut lieu un mouvement national de grève en Italie. En 1903 et 1904 de grandes grèves ébranlèrent tout le Sud de la Russie.
L’Allemagne, malgré ses puissants syndicats forts de leurs traditions et sa classe ouvrière concentrée et organisée, n’a pas été à ce moment là l’épicentre de ces nouveaux épisodes de lutte de classes qui s’étendaient tels de violents raz-de-marée. La question de la grève de masse en fut d’autant plus passionnément discutée dans les rangs de la classe ouvrière en Allemagne. Le vieux schéma syndical de la "lutte de classe contrôlée", qui ne devait pas perturber le sacro-saint "ordre public", entrait en conflit avec l’énergie du prolétariat et la solidarité qui se déployait dans les nouvelles luttes de masse. Arnold Roller écrivit ainsi en 1905, au cours d’une lutte des mineurs de la Ruhr à laquelle 200 000 ouvriers prirent part : "On (les syndicats) s’est cantonné à conférer à la grève le caractère d’une sorte de démonstration paisible, attentiste, afin peut-être d’obtenir de la sorte des concessions par reconnaissance de cette "conduite raisonnable". Les mineurs des autres bassins organisés dans un esprit semblable, comme en Saxe, en Bavière, etc. témoignent leur solidarité en soutenant la grève et paradoxalement en faisant des heures supplémentaires pour produire des milliers de tonnes de charbon en plus – qui seront expédiées et utilisées par l’industrie au service du Capital pendant la grève (…) Pendant que les travailleurs dans la Ruhr souffrent de la faim, leurs représentants au Parlement négocient et obtiennent quelques promesses d’améliorations – légales – mais seulement pour après la reprise du travail. Bien entendu, la direction syndicale allemande a refusé l’idée d’exercer une pression réellement forte sur le patronat par l’extension de la grève à l’ensemble du secteur charbonnier. " 2
L’un des éléments déclencheurs les plus importants du célèbre "débat sur la grève de masse" en 1905/1906 au sein du SPD et des syndicats allemands fut sans aucun doute la puissante grève de masse de 1905 en Russie qui dépassait alors par sa dimension et sa dynamique politique tout ce qui s’était vu jusque-là 3.
Pour les syndicats, les grèves de masse signifiaient une remise en cause directe de leur existence et de leur fonction historique. Leur rôle d’organisation de défense économique permanente de la classe ouvrière n’était-il pas dépassé ? La grève de masse de 1905 en Russie, réaction directe à l’effrayante misère engendrée dans la classe ouvrière et la paysannerie par la guerre russo-japonaise, avait précisément montré que les questions politiques comme la guerre et, en fin de compte, la révolution se trouvaient maintenant au centre du combat ouvrier. Ces questions dépassaient de très loin le carcan de la pensée syndicale traditionnelle. Ainsi que l’écrivait très clairement Anton Pannekoek : "Tout ceci concorde fort bien avec le véritable caractère du syndicalisme, dont les revendications ne vont jamais au-delà du capitalisme. Le but du syndicalisme n'est pas de remplacer le système capitaliste par un autre mode de production, mais d'améliorer les conditions de vie à l'intérieur même du capitalisme. L'essence du syndicalisme n'est pas révolutionnaire mais conservatrice" 4
Reprocher aux dirigeants des syndicats puissamment enracinés en Allemagne leur manque de flexibilité parce qu’ils ne sympathisaient pas avec la forme de lutte de la grève de masse politique ne nous donne pas le fin mot de l’histoire. Leur attitude défensive vis-à-vis de la grève de masse résultait simplement de la nature et de la conception des organisations syndicales qu’ils représentaient, et qui ne pouvaient assumer les nouvelles exigences de la lutte de classe.
Il est évident que les organisations politiques et les partis de la classe ouvrière ont alors été obligés de comprendre la nature du combat engagé par les ouvriers eux-mêmes au moyen de la grève de masse. Cependant, "pour l’écrasante majorité des dirigeants sociaux-démocrates, il n’y avait qu’un axiome : la grève générale, c’est la folie générale!" 5. Ne voulant pas admettre la réalité, ils croyaient voir dans le déclenchement de la grève de masse uniquement et très schématiquement la "grève générale" qui était mise en avant par les anarchistes et les partisans de l’ancien co-fondateur de la social-démocratie hollandaise, Domela Nieuwenhuis. Quelques décennies auparavant, dans son texte Les Bakouninistes à l’œuvre daté de 1873, Engels avait, de façon tout à fait fondée, taxé de complète stupidité la vision d’une grève générale préparée dans les coulisses comme un scénario d’insurrection écrit d’avance. Cette ancienne vision de la "grève générale" consistait en ceci que grâce à un arrêt du travail simultané et général mené par les syndicats, le pouvoir de la classe dominante serait affaibli et mis à bas en quelques heures. En ce sens, les directions du SPD et des syndicats justifiaient leurs réticences et utilisaient les mots d’Engels comme une sentence pour rejeter en bloc et ignorer toute amorce de débat sur les grèves de masse réclamé par la Gauche autour de Rosa Luxemburg au sein du SPD.
L’examen plus précis de la fausse opposition entre "la grève générale anarchiste" et "le solide travail syndical" montre cependant clairement que le vieux rêve anarchiste de la grandiose grève générale économique et la conception des grandes centrales syndicales sont en fait très proches. Pour ces deux conceptions, ce qui comptait était exclusivement le nombre de combattants et elles balayaient la nécessité de prendre en charge les questions politiques désormais contenues, au moins potentiellement, dans les luttes massives.
La FVDG qui, jusqu’ici, avait toujours mis en avant l’activité politique des ouvriers était-elle en mesure d’apporter une réponse ?
La position de la FVDG sur la grève de masse
Motivé par les expériences de mouvements massifs en Europe à la fin du 19e siècle et au début du 20e, le débat sur la grève de masse s’est ouvert au sein de la FVDG en 1904 en vue du Congrès socialiste d’Amsterdam, congrès qui approchait et où cette question était à l’ordre du jour. Dans les rangs de la FVDG où l’on cherchait d’abord à comprendre le phénomène de la grève de masse, ce débat se heurtait à une certaine conception du travail syndical. Dans sa conception générale d’un travail syndical bien mené, la FVDG ne se distinguait sur le fond aucunement des grandes centrales syndicales sociales-démocrates. Cependant, sa faible influence ne la mettant pas en situation de pouvoir contrôler la lutte de classe, la question de la grève de masse y était bien plus ouverte que dans les grandes organisations syndicales.
Gustav Kessler, co-fondateur du courant "Localiste" et autorité politique au sein de la FVDG, est mort en juin 1904. C'est lui qui, au sein de la direction de la FVDG, avait représenté le plus fortement l’orientation vers la Social-démocratie. Le caractère très hétérogène de la FVDG, union des fédérations de métiers, a toujours laissé se constituer des tendances anarchistes minoritaires, comme celle autour d’Andreas Kleinlein Platz. La mort de Kessler et l’élection de Fritz Kater à la tête de la commission exécutive de la FVDG à l’été 1904 ouvrirent précisément une période de plus grande ouverture vis-à-vis des idées syndicalistes révolutionnaires.
C’était avant tout le syndicalisme révolutionnaire français de la CGT, avec son concept de "grève générale", qui semblait pouvoir apporter une réponse à une partie de la FVDG. Sous l’influence de Kessler, la FVDG avait, jusqu’au début de 1904, refusé de faire officiellement de la propagande en faveur de la grève générale. De façon agacée, la FVDG se posa alors la question de savoir si les différentes expressions récentes de la grève de masse de par le monde étaient ou non une confirmation historique de l'ancienne et théâtrale vision de la grève générale.
Deux documents expriment la meilleure compréhension de la grève de masse par la FVDG : la brochure éditée par Raphael Friedeberg en 1904, Parlementarisme et grève générale, ainsi qu’une résolution votée en août de la même année par la FVDG. Le point de vue de Friedeberg (il est resté membre du SPD jusqu’en 1907) a été très influant au sein du syndicat et a nourri ensuite toute sa réflexion. 6.
La brochure de Friedeberg se consacre essentiellement à une critique correcte et finement formulée de l’influence destructrice et abrutissante du parlementarisme tel qu’il était alors pratiqué par la direction social-démocrate : "La tactique parlementaire, la surestimation du parlementarisme, sont trop enracinées dans les masses du prolétariat allemand. Elles sont également trop confortables ; tout doit résulter de la législation, tous les changements dans les rapports sociaux ; tout ce qu'il suffit de faire à chacun, c’est de déposer tous les deux ans son bulletin socialiste dans l’urne. (…) Voilà un bien mauvais moyen d’éducation du prolétariat. (…) Je veux bien concéder que le parlementarisme a eu une tâche historique à remplir dans le développement historique du prolétariat, et qu’il l’aura encore." Comme on le voit, cet anti-parlementarisme n’avait pas le caractère d’un refus de principe, mais correspondait à un stade historique alors atteint au sein duquel ce moyen de propagande pour le prolétariat était devenu totalement inefficace.
De la même façon que Rosa Luxemburg, il a souligné le caractère émancipateur du grand mouvement de grève de masse pour le prolétariat : "À travers la grève, les ouvriers s’éduquent. Elle leur donne une force morale, leur apporte un sentiment de solidarité, une façon de penser et une sensibilité prolétariennes. L’idée de la grève générale offre aux syndicats un horizon tout aussi large que le lui a donné jusqu’ici l’idée du pouvoir politique du mouvement." Il a également écrit sur l’aspect éthique du combat de la classe ouvrière : "Si les ouvriers veulent renverser l’État de classe, s’ils veulent ériger un nouvel ordre mondial, ils doivent être meilleurs que les couches qu’ils combattent, celles qu’ils veulent écarter. C’est pourquoi ils doivent apprendre à repousser tout ce qui est bas et vil en elles, tout ce qui n’est pas éthique. C’est là le caractère principal de l’idée de grève générale, d’être un moyen de lutte éthique."
Ce qui est caractéristique du texte de Friedeberg, c’est l’utilisation du terme "grève générale" même lorsqu’il parle de la grève de masse politique concrète de l’année écoulée.
Même si le ressort de la brochure de Friedeberg est une réelle indignation contre l’esprit conservateur qui règne dans les grandes centrales syndicales, indignation qu’il partage avec Luxemburg, il en arrive à de tout autres conclusions :
- Il rejette clairement la tendance qui existait dans la FVDG à s’intéresser à des questions politiques : "nous ne menons aucun combat politique et, par conséquent, nous n’avons besoin d’aucune forme de combat politique. Notre combat est économique et psychologique." C’est là une nette rupture avec la position qu’avait auparavant la FVDG. En traçant, de façon superficielle, un trait d'égalité entre "parlementarisme" et "combat politique", il rejette la dynamique politique que la grève de masse avait exprimée.
- De plus, Friedeberg élabore une vision (certes très minoritaire au sein même de la FVDG) non matérialiste du combat de classe, basée sur une conception psychologique et sur la stratégie du "refus de la personnalité" - qu’il appelait "psychisme historique". On voit précisément ici qu’il suit certaines conceptions clairement anarchistes selon lesquelles c’est l’esprit de rébellion individuelle qui est l’élément moteur de la lutte de classe et pas le développement collectif de la conscience de classe.
- Bien que Friedeberg ait très correctement cloué au pilori l’idée réformiste social-démocrate de la prise graduelle du pouvoir d’État par le prolétariat, il tendait à adopter une conception gradualiste du même type, mais avec une touche syndicaliste : "Rien que ces dernières années, les syndicats ont accru leurs effectifs de 21% et sont parvenus à dépasser le million d’adhérents. Étant donné que de telles choses se conforment en quelque sorte à des lois, nous pouvons affirmer que, dans trois ou quatre ans nous aurons deux millions de syndiqués, et dans dix ans entre trois et quatre millions. Et lorsque l’idée de la grève générale aura pénétré plus profondément dans le prolétariat […] elle poussera entre quatre et cinq millions d’ouvriers à cesser le travail et ainsi à éliminer l’État de classe." En réalité, l’enrôlement toujours plus important de la classe ouvrière dans les syndicats n’offrait aucunement de meilleures conditions pour la révolution prolétarienne mais, au contraire, constituait un obstacle pour celle-ci.
Derrière la propagande autour d’un "moyen de lutte sans violence pure", on voit aussi chez Friedeberg une énorme sous-estimation de la classe dominante et de la brutale répression qu’elle sait déchaîner dans une situation révolutionnaire : "la caractéristique principale de l’idée de grève générale, c’est d’être un moyen de lutte éthique. […] Ce qui se produira après, lorsque nos adversaires voudront nous réprimer, lorsque nous serons en état de légitime défense, on ne peut pas aujourd’hui le déterminer."
Pour l’essentiel, Friedeberg a vu dans la grève de masse la confirmation de la vieille idée anarchiste de la grève générale. Sa plus grande faiblesse résidait dans le fait de ne pas avoir reconnu que la grève de masse qui venait ne pouvait se développer qu’en tant qu’acte politique de la classe ouvrière. En rupture avec la tradition de la FVDG, qui jusqu’alors avait constamment mis en garde contre toute lutte purement économique, il réduisait la perspective de la grève de masse à ce seul aspect. La base de la FVDG n'était pas unie derrière la conception de Friedeberg qui était le représentant d’une aile minoritaire évoluant vers l’anarchisme et entraînant la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. Cependant les positions de Friedeberg furent pour une courte période l’étendard de la FVDG. Friedeberg lui-même se retira de la FVDG en 1907 pour retourner dans une communauté anarchiste à Ascona.
La FVDG ne pouvait pas comprendre la grève de masse en suivant les théories de Friedeberg. L’esprit révolutionnaire qui se développait et qui se manifestait dans cette nouvelle forme de combat de la classe ouvrière posait la question de la fusion entre les questions politiques et économiques. La question de la grève générale qui se retrouvait maintenant sur le devant de la scène à la FVDG, représentait par rapport à la grève de masse un pas en arrière, une fuite vis-à-vis des questions politiques.
Cependant, malgré toutes ces confusions qui remontaient ainsi à la surface à travers les écrits de Friedeberg, le débat au sein de la FVDG a permis de remuer le mouvement ouvrier allemand. Il lui revient le mérite, bien avant la rédaction de brochures lumineuses et célèbres sur la grève de masse de 1905 (comme celles de Luxemburg ou de Trotsky) d’avoir soulevé cette question au sein du SPD.
Il n’est guère étonnant que la conception de la révolution de la FVDG (qui était elle-même l’union de différents syndicats) à cette époque ait continué à mettre en avant les syndicats en tant qu’organes révolutionnaires. Un pas en avant de la part de la FVDG aurait été qu’elle mette elle-même en question sa propre forme d’organisation. D’un autre côté, même Rosa Luxemburg comptait encore beaucoup sur les syndicats qu’elle décrivait dans beaucoup de pays comme un produit direct et en droite ligne de la grève de masse (par exemple en Russie). Il fallut attendre encore presque cinq ans avant que le livre de Trotsky, 1905, qui racontait l’expérience des conseils ouvriers en tant qu’organes révolutionnaires en lieu et place des syndicats, ne soit publié 7. Ce qui resta constant dans la FVDG et les organisations qui lui ont succédé, ce fut leur cécité vis-à-vis des conseils ouvriers et leur attachement viscéral au syndicat en tant qu’organe de la révolution. Une faiblesse qui devait s'avérer fatale lors du soulèvement révolutionnaire après la guerre en Allemagne.
Négociations secrètes pour contrecarrer la grève de masse et le débat à Mannheim en 1906
Au sein du SPD, un combat en règle s’engagea sur la question de savoir s’il fallait discuter de la grève de masse au Congrès du Parti en 1906. La direction du Parti chercha fébrilement à estampiller les manifestations les plus importantes de la lutte de classe comme dépourvues d’intérêt pour la discussion. Le Congrès du SPD de 1905 à Iéna ne s’était prononcé que pour la forme, dans une résolution qui proclamait que la grève de masse était "éventuellement une mesure à propager". La grève de masse était réduite à n'être qu'un ultime moyen de défense contre un éventuel retrait du droit de vote. Les leçons tirées de la grève de masse en Russie par Rosa Luxemburg furent caractérisées de "romantisme révolutionnaire" par la majorité de la direction du SPD et elles furent déclarées n'avoir aucune application possible à l’Allemagne.
Il n’est pas surprenant que juste après le Congrès d’Iéna, en février 1906, la direction du SPD et la commission générale des principaux syndicats se soient mis d’accord dans des pourparlers secrets pour œuvrer ensemble à empêcher des grèves de masse. Cet arrangement fut quand même démasqué. La FVDG publia dans son journal Die Einigkeit (L’Unité) des parties du procès-verbal de cette réunion qui lui était tombé dans les mains. Entre autres, on y lisait : "Le comité directeur du Parti n’a pas l’intention de propager la grève générale politique, mais cherchera, dans la mesure de son possible, à l’empêcher". Cette publication souleva au sein de la direction du SPD, "l’indignation de ceux qui étaient pris la main dans le sac" et rendit bon gré mal gré indispensable la remise à l’ordre du jour du débat sur la grève de masse au Congrès du Parti des 22 et 23 septembre 1906.
Les premiers mots de Bebel, dans son discours inaugural au Congrès de Mannheim, reflétaient la lâcheté et l'ignorance de la direction du Parti, qui se voyait fort incommodée par l’obligation de se confronter à une question qu’elle avait dans les faits espéré éviter : "Lorsque nous nous sommes séparés l’an dernier après le Congrès d’Iéna, personne n’a pressenti que nous aurions à nouveau cette année à discuter de la grève de masse. […] Du fait de la grosse indiscrétion de l’Einigkeit à Berlin, nous voilà face à un grand débat." 8. Afin de se sortir de l’embarras des discussions secrètes, mises en lumière par l’Einigkeit, Bebel tourna purement et simplement en dérision la FVDG et la contribution de Friedeberg : "Comment, en présence d’un tel développement et de la puissance de la classe des patrons vis-à-vis de la classe ouvrière, il est possible d’obtenir quelque chose avec des syndicats organisés localement, comprenne qui le pourra. De toute façon, la direction du Parti et le Parti lui-même dans sa grande majorité pensent que ces syndicats locaux sont totalement impuissants à assumer les devoirs de la classe ouvrière 9." Qui fut, huit ans plus tard, face au vote des crédits de guerre, "totalement impuissant à assumer les devoirs de la classe ouvrière" ? Précisément cette même direction du SPD ! La FVDG au contraire fut, en 1914, face à la question de la guerre, capable de prendre une position prolétarienne.
Au cours des très indigents débats sur la grève de masse qui eurent lieu lors du Congrès, au lieu d’arguments politiques, on s’échangea surtout des récriminations et justifications bureaucratiques, comme si les militants du Parti devaient s’en tenir à la résolution sur la grève de masse prise l’année précédente au Congrès d’Iéna, ou à celle du Congrès des syndicats de mai 1906, laquelle avait clairement rejeté la grève de masse. Le débat tourna pour l’essentiel autour de la proposition de Bebel et Legien de lancer un ultimatum aux membres du Parti organisés au sein de la FVDG afin qu’ils retournent dans la grande centrale syndicale, sous peine de se faire exclure immédiatement du Parti en cas de refus.
Au lieu de se pencher sur les leçons politiques à tirer des grèves de masse victorieuses, ou d’aborder les conclusions de la brochure de Rosa Luxemburg parue une semaine auparavant, le débat était réduit à une lamentable querelle juridico-politicienne !
Alors que le délégué invité de la FVDG, rédacteur de l’Einigkeit de Berlin, était tourné en ridicule, Rosa Luxemburg s’éleva de façon véhémente contre la machination destinée à mettre sous le boisseau le débat politique central sur la grève de masse à l’aide de moyens formels et purement disciplinaires : "En outre je trouve irresponsable que le Parti soit de quelque manière utilisé comme férule contre un groupe de syndicalistes déterminé, et que nous devions endosser la querelle et la discorde au sein du Parti. Il ne fait quand même aucun doute, que dans les organisations localistes se trouvent vraiment beaucoup de bons camarades, et il serait irresponsable si, pour servir directement les syndicats dans cette question, nous introduisions la brouille dans nos rangs. Nous respectons l'avis que les localistes ne doivent pas pousser le litige dans les syndicats au point d’entraver l'organisation syndicale ; mais au nom de la sacro-sainte égalité des droits, on doit reconnaître quand même au moins la même chose pour ce qui concerne le Parti. Si nous excluons directement les anarcho-socialistes du Parti, comme le comité directeur du Parti le propose, nous donnerons un bien triste exemple : nous ne serons capables de détermination et d’énergie que dès lors qu’il s’agit de délimiter notre Parti sur sa gauche, alors que nous laisserons avant comme après les portes très largement ouvertes sur sa droite.
Von Elm nous a rapporté, en illustration de ce qu’il appelle l’absurdité anarchiste, que dans l’Einigkeit ou dans une conférence des organisations locales, il se serait dit : "La grève générale est le seul moyen de lutte de classe réellement révolutionnaire à prendre en compte". Bien entendu, c’est une absurdité et rien d’autre. Cependant, chers amis, cela n’est pas plus éloigné de la tactique sociale-démocrate et de nos principes que les propos de David nous expliquant que le seul moyen de lutte de la social-démocratie est la tactique légale parlementaire. On nous dit que les localistes, les anarcho-socialistes, sapent peu à peu les principes sociaux-démocrates par leur agitation. Mais lorsqu’un membre des comités centraux comme Bringmann se prononce par principe contre la lutte de classe comme il l’a fait lors de votre conférence en février, c’est tout autant un travail de sape des principes de base de la social-démocratie." 10
Comme lors du Congrès du Parti de 1900, lors du débat sur les syndicats à Hambourg, Luxemburg s’oppose à la tentative d’utiliser les faiblesses de la FVDG comme un prétexte facile pour étouffer les questions centrales. Elle voyait que le grand péril ne provenait pas d’une minorité syndicale comme la FVDG, évoluant vers le syndicalisme révolutionnaire et dont les militants au sein du SPD se situaient souvent du côté de son aile gauche, mais bien plutôt du centre et de la droite du Parti.
La scission de la FVDG et la rupture définitive avec le SPD en 1908
La FVDG n'a nullement représenté pour la direction réformiste du SPD et la confédération syndicale centrale le même danger que l'aile révolutionnaire de la social-démocratie autour de Liebknecht et de Luxemburg. Cependant, l'aile révolutionnaire ne pouvait pas ne pas tenir compte de la FVDG uniquement en raison du fait que cette dernière constituait une petite minorité et qu’elle ne reconnaissait pas vraiment les enseignements des grèves de masse. L'émergence internationale de mouvements syndicalistes révolutionnaires puissants à partir de 1905, comme les IWW aux États-Unis, faisait des tendances syndicalistes révolutionnaires un danger potentiel pour le réformisme.
La stratégie, inaugurée en 1906 au Congrès du Parti à Mannheim, de faire pression sur les membres de la FVDG pour qu’ils entrent dans les syndicats centraux, s'est poursuivie pendant des mois. D'une part, on a offert à des membres connus et combatifs des syndicats locaux des postes rémunérateurs dans les bureaucraties des syndicats sociaux-démocrates. D'autre part, pour le Congrès du SPD à Nuremberg qui devait avoir lieu en 1908, est parue à nouveau une motion sur l'incompatibilité de la double affiliation SPD et FVDG.
Mais la FVDG échoua surtout à cause de ses ambiguïtés et des différences d’orientations au sein de ses associations professionnelles. À l’époque où il s’agissait de comprendre la grève de masse politique et l'émergence des conseils ouvriers, elle se déchira dans un affrontement interne sur la question de rejoindre les centrales syndicales ou de s’engager dans une voie syndicaliste révolutionnaire subordonnant les questions politiques aux questions économiques. À son Congrès extraordinaire de janvier 1908, la FVDG examina une motion des syndicats de maçons demandant de dissoudre la FVDG pour adhérer aux syndicats centraux. Bien que cette motion ait été rejetée, cela signifiait la scission de la FVDG et donc la fin de la longue histoire d'une immense opposition syndicale qui s'était appuyée sur la tradition prolétarienne de la social-démocratie. Plus d’un tiers de ses membres quitta immédiatement la FVDG pour rejoindre les grands syndicats. Le nombre d’adhérents tomba de 20 000 à moins de 7000 en 1910.
Il était alors facile à la direction de la social-démocratie de sceller, en septembre 1908, la scission avec la FVDG au Congrès du Parti par l'interdiction définitive de la double affiliation FVDG et SPD. Dès lors, les vestiges de la FVDG ne constituaient plus un danger sérieux pour les Legien et consorts.
Dans l'histoire de la naissance du syndicalisme révolutionnaire en Allemagne, l'année 1908 marque ainsi le début d'une nouvelle étape, celle d’un revirement d’orientation déclaré en faveur du syndicalisme révolutionnaire, et cela de la part d'un peu moins de la moitié des membres de la FVDG.
Vers le syndicalisme révolutionnaire
Vu que la FVDG dans sa genèse était apparue comme mouvement d'opposition syndicale solidement lié à la social-démocratie, donc à une organisation politique du mouvement ouvrier, elle ne s'était jamais caractérisée, avant 1908, comme syndicaliste révolutionnaire. En effet, le syndicalisme révolutionnaire ne signifie pas seulement un engagement tout feu tout flamme exclusivement dans les activités syndicales, mais aussi l’adoption d’une conception qui considère le syndicat comme la seule et unique forme d'organisation pour le dépassement du capitalisme - un rôle que celui-ci, de par sa nature d’organe de lutte pour des réformes, n’a jamais pu et ne pourra jamais jouer.
Le nouveau programme de 1911, "Que veulent les Localistes ? Programme, buts et moyens de la FVDG", significatif de la voie qu’elle empruntait, exprimait désormais ce point de vue de la façon suivante : "La lutte émancipatrice des travailleurs est principalement une lutte économique que le syndicat, conformément à sa nature en tant qu'organisation des producteurs, doit conduire sur tous les plans. (…) Le syndicat (et non le parti politique) est seul en mesure de permettre de façon requise l’épanouissement du pouvoir économique des travailleurs…" 11
Les années précédentes, les grandes grèves de masse avaient témoigné de la dynamique spontanée de la lutte des classes et avaient vu l’abandon par les Bolcheviks en 1903 du concept de "parti de masse", clarifiant dans le même temps la nécessité des organisations de minorités politiques révolutionnaires. Toutefois, le nouveau programme de la FVDG, certes avec bonne volonté et tout en combattant le vieux "dualisme", partait sur des conclusions fausses : "C’est pourquoi nous rejetons le dualisme nuisible (bipartition), tel qu’il est pratiqué par la social-démocratie et les syndicats centraux qui s’y rattachent. Nous entendons par là la division absurde des organisations ouvrières entre une branche politique et une branche syndicale. (…) Puisque nous rejetons la lutte parlementaire et l’avons remplacée par la lutte politique directe par des moyens syndicaux et non pas pour le pouvoir politique, mais pour l’émancipation sociale, tout parti politique ouvrier tel que la social-démocratie perd toute raison d’être." 12
Ce nouveau programme exprimait une complète cécité par rapport à l'émergence historique et au caractère révolutionnaire des conseils ouvriers et se réfugiait dans la théorisation pleine d'espoir d'un nouveau type de syndicat :
- alternative au parti de masse (de fait) périmé,
- alternative aux grands syndicats bureaucratisés,
- organe de la révolution,
- et, finalement, architecte de la nouvelle société.
Quelle tâche considérable !
À la façon caractéristique du syndicalisme révolutionnaire, la FVDG défendait à cette époque un clair rejet de l'État bourgeois et du parlementarisme débridé. Elle soulignait correctement la nécessité de la lutte de la classe ouvrière contre la guerre et le militarisme.
Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, la FVDG ne s'est pas rapprochée de l’anarchisme. Les théories de Friedeberg l'ayant mené de la social-démocratie vers l’anarchisme dans les années 1904-07, bien qu'elles aient servi d'emblème, n'ont pas pour autant signifié un basculement de l’ensemble de l'organisation dans l’anarchisme. Au contraire, les forces fortement orientées vers le syndicalisme révolutionnaire réunies autour de Fritz Kater craignaient également une "tutelle" de la part des anarchistes, du type de celle exercée par le SPD sur les syndicats. Dans l’Einigkeit d'août 1912, Kater caractérisait encore l'anarchisme comme "tout aussi superflu que tout autre parti politique" 13. Il serait faux de partir du principe que ce serait la présence en son sein d'anarchistes avérés qui aurait conduit la FVDG vers le syndicalisme révolutionnaire. L’hostilité envers les partis politiques, née des dures controverses avec le SPD, s’étendait dans les années d’avant-guerre également aux organisations anarchistes. Ce n'est en aucune manière non plus l'influence du charismatique anarchiste Rudolf Rocker à partir de 1919 qui aurait introduit cette hostilité envers les partis politiques dans l'organisation qui a succédé à la FVDG, la FAUD. Une telle évolution avait en effet déjà clairement eu lieu avant. R. Rocker ne fit que théoriser, dans les années 1920, beaucoup plus nettement que cela n’avait été le cas avant la guerre, cette hostilité du syndicalisme révolutionnaire allemand envers les partis politiques.
Les années précédant l’éclatement de la guerre en 1914 ont été marquées pour la FVDG par un repli sur elle-même. Les grands débats avec les organisations mères étaient terminés. La scission avec la Confédération syndicale centrale avait eu lieu en 1897. La rupture avec le SPD dix bonnes années plus tard, en 1908.
Il se produisit alors une situation curieuse révélant le paradoxe qui ressurgit constamment avec le syndicalisme révolutionnaire : se définissant en tant que syndicat voulant s’ancrer parmi un maximum de travailleurs, la FVDG a toutefois été réduite à un minimum de membres. Parmi ses 7000 adhérents environ, seule une faible partie était vraiment active. Elle n'était plus un syndicat ! Les vestiges de la FVDG formaient plutôt des cercles de propagande en faveur des idées syndicalistes révolutionnaires, et avaient plutôt un caractère de groupe politique. Mais ils ne voulaient pas être une organisation politique !
Les vestiges de la FVDG sont restés - et c'est pour la classe ouvrière une question absolument centrale - sur un terrain internationaliste et se sont opposés, malgré toutes leurs faiblesses, aux efforts de la bourgeoisie en faveur du militarisme et de la guerre. La FVDG et sa presse ont été interdites en août 1914, immédiatement après la déclaration de la guerre, et beaucoup de ses membres encore actifs ont été emprisonnés.
Dans un prochain article, nous examinerons le rôle des syndicalistes révolutionnaires en Allemagne jusqu’en 1923, période qui couvre la Première Guerre mondiale, la révolution allemande et la vague révolutionnaire mondiale.
Mario, 6.11.2009
1 "La naissance du syndicalisme révolutionnaire dans le mouvement ouvrier allemand [23]", Revue Internationale n° 137
2. Arnold Roller (Siegfried Nacht) : Die direkte Aktion ("L’action directe"), 1912. (notre traduction) Roller incarnait au sein de la FVDG l’aile anarchiste jusque-là très minoritaire.
3. Voir les Revue Internationale n° 120 [24], 122 [25], 123 [26], 125 [27] en anglais, espagnol et français.
4. Anton Pannekoek, Le Syndicalisme, International Council Correspondance, n° 2 - Janvier1936., Rédigé en anglais sous le pseudonyme de John Harper. (Notre traduction)
5. Paul Frölich, Rosa Luxemburg, sa vie et son œuvre, chapitre : "La grève politique de masse". Ed. L’Harmattan, p.168
6. Friedeberg lui-même ne venait pas de l’anarchisme mais était élu local du SPD et membre de la direction berlinoise du Parti social-démocrate.
7. Trotsky écrivit d’abord en 1907 Notre révolution. Quelques chapitres servirent de base à 1905, lequel fut écrit en 1908/1909.
8 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Mannheim, 23. bis 29. September 1906 (Procès-verbal des débats du Congrès du Parti Social-démocrate allemand, Mannheim, 1906), page 227.(Notre traduction)
9. Ibidem, page 295. .(Notre traduction)
10. Ibidem, , page 315 (ou dans les Œuvres complètes de Rosa Luxemburg, Tome 2 page 174).
11. Notre traduction
12. Notre traduction
13. Voir Dirk H. Müller, Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte vor 1918, p.191-198.