Revue Internationale n° 136 - 1er trimestre 2009
- 2670 lectures
Les révoltes de la jeunesse en Grèce confirment le développement de la lutte de classe
- 2909 lectures
A la fin de l'année 2008, plusieurs pays d'Europe ont été touchés simultanément par des mouvements massifs de la jeunesse scolarisée (étudiants et lycéens). En Grèce, les assemblées générales massives d'étudiants ont même évoqué un nouveau "Mai 68". En effet, ce ne sont pas seulement des jeunes qui se sont mobilisés contre les attaques du gouvernement et contre la répression de l'État policier, mais aussi plusieurs secteurs de la classe ouvrière en solidarité avec les jeunes générations. L'aggravation de la crise économique mondiale révèle de plus en plus la faillite d'un système qui n'a plus d'avenir à offrir aux enfants de la classe ouvrière. Mais ces mouvements sociaux ne sont pas seulement des mouvements de la jeunesse. Ils s'intègrent dans les luttes ouvrières qui se développent à l'échelle mondiale. La dynamique actuelle de la lutte de classe internationale, marquée par l'entrée des jeunes générations sur la scène sociale, confirme que l'avenir est bien entre les mains de la classe ouvrière. Face au chômage, à la précarité, à la misère et à l'exploitation, le vieux slogan du mouvement ouvrier "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous" est plus que jamais d'actualité.
L’explosion de colère et la révolte des jeunes générations prolétarisées en Grèce n’ont rien d’un phénomène isolé ou particulier. Elles plongent leurs racines dans la crise mondiale du capitalisme et leur confrontation à la répression violente met à nu la vraie nature de la bourgeoisie et de sa terreur d’État. Elles se situent dans la lignée directe de la mobilisation des jeunes générations sur un terrain de classe en France contre le CPE (Contrat Première Embauche) de 2006 et la LRU (Loi sur la Réforme de l’Université) de 2007 où les étudiants et les lycéens se reconnaissent avant tout comme des prolétaires révoltés contre leurs futures conditions d’exploitation. L’ensemble de la bourgeoisie des principaux pays européens l’a d’ailleurs bien compris en avouant ses craintes de contagion d’explosions sociales similaires face à l’aggravation de la crise. Ainsi, de façon significative, la bourgeoisie en France a fini par reculer en suspendant précipitamment son programme de réforme des lycées. D’ailleurs, le caractère international de la contestation et de la combativité étudiante et surtout lycéenne s’exprime déjà fortement.
En Italie, deux mois de mobilisation étudiante ont été ponctués par des manifestations massives qui se sont déroulées le 25 octobre et le 14 novembre derrière le slogan "Nous ne voulons pas payer pour la crise" contre le décret Gelmini contesté à cause des coupes budgétaires dans l’Éducation nationale et ses conséquences : notamment le non-renouvellement des contrats de 87 000 enseignants précaires et de 45 000 travailleurs de l’ABA (personnel technique employé par l’Éducation nationale) ainsi que face à la réduction des fonds publics pour l’université 1.
En Allemagne, le 12 novembre, 120 000 lycéens sont descendus dans les rues des principales villes du pays (avec des slogans tels que : "Le capitalisme, c’est la crise" comme à Berlin ou en assiégeant le parlement provincial comme à Hanovre).
En Espagne, le 13 novembre, des centaines de milliers d’étudiants ont manifesté dans plus de 70 villes du pays contre les nouvelles directives à l’échelle européenne (directives de Bologne) de la réforme de l’enseignement supérieur et universitaire généralisant la privatisation des facultés et multipliant les stages dans les entreprises.
La révolte notamment des jeunes générations de prolétaires face à la crise et à la détérioration de leur niveau de vie s’étend à d’autres pays : rien qu’en janvier 2009, Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie) et Sofia (Bulgarie) ont connu des mouvements d’émeutes durement réprimées par la police. Au Sénégal, en décembre 2008 des affrontements violents contre la misère croissante alors que les manifestants réclamaient une quote-part des fonds miniers exploités par Arcelor Mittal ont fait deux morts à Kégoudou, à 700 km au Sud-Est de Dakar. Au Maroc, 4000 étudiants de Marrakech s’étaient déjà révoltés début mai 2008 face à une intoxication alimentaire touchant 22 d’entre eux dans un restaurant universitaire. Suite à la répression violente du mouvement, arrestations, lourdes peines de prison et tortures se sont multipliées depuis lors.
Beaucoup d’entre eux se sont reconnus dans le combat des étudiants en Grèce.
L’ampleur de cette mobilisation face aux mêmes mesures de l’État n’a rien d’étonnant. La réforme du système éducatif entreprise à l’échelle européenne est à la base d’un conditionnement des jeunes générations ouvrières à un avenir bouché et à la généralisation de la précarité et du chômage.
Le refus et la révolte des nouvelles générations de prolétaires scolarisés face à ce mur du chômage et à cet océan de précarité que leur réserve le système capitaliste en crise suscitent également partout la sympathie des prolétaires, toutes générations confondues.
Violence minoritaire ou lutte massive contre l’exploitation et la terreur d’État ?
Les médias aux ordres de la propagande mensongère du capital n’ont pas cessé de chercher à déformer la réalité de ce qui s’est passé en Grèce depuis le meurtre par balle, le 6 décembre dernier, du jeune Alexis Andreas Grigoropoulos âgé de 15 ans. Ils ont présenté les affrontements avec la police comme le fait soit d’une poignée d’autonomes anarchistes et d’étudiants d'ultra-gauche issus de milieux aisés, soit de casseurs marginalisés. Ils n'ont cessé de diffuser en boucle à la télé des images d’affrontements violents avec la police et mettant surtout en scène des images d’émeutes de jeunes cagoulés faisant brûler des voitures, faisant voler en éclats des vitrines de boutiques ou de banques, voire des scènes de pillage de magasins.
C’est exactement la même méthode de falsification de la réalité que celle qu'on avait vue lors de la mobilisation anti-CPE de 2006 en France assimilée aux émeutes dans les banlieues de l’année précédente. C'est encore cette grossière méthode à laquelle on avait assisté lorsque les étudiants en lutte contre la LRU en 2007 en France avaient été assimilés à des "terroristes" et même à des "khmers rouges" !
Mais si le cœur des troubles a eu lieu dans le quartier universitaire grec, Exarchia, il est difficile aujourd'hui de faire avaler une telle pilule : comment ces mouvements de révolte seraient-ils seulement l’œuvre de bandes de casseurs ou d’activistes anarchistes alors qu’ils se sont étendus très rapidement comme une traînée de poudre à l’ensemble des principales villes du pays et jusque dans les îles (Chios, Samos) et les villes les plus touristiques comme Corfou ou en Crète comme à Héraklion ?
En fait, les révoltes se sont étendues à 42 préfectures de Grèce, même dans des villes où il n’y avait jamais eu de manifestation auparavant. Plus de 700 lycées et une centaine d’universités ont été occupés.
Les raisons de la colère
Toutes les conditions étaient réunies pour que le ras-le-bol d’une large partie des jeunes générations ouvrières prises d’angoisse et privées d’avenir éclate en Grèce qui est un concentré de l’impasse que le capitalisme réserve aux jeunes générations ouvrières : quand ceux qui sont appelés "la génération 600 euros" entrent dans la vie active, ils ont l’impression de se faire arnaquer. La plupart des étudiants doivent cumuler deux emplois par jour pour survivre et pouvoir poursuivre leurs études : ils en sont réduits à de petits boulots non déclarés et sous-payés, même en cas d’emplois davantage rémunérés ; une partie de leur salaire n’est pas déclarée, ce qui ampute ainsi leurs droits sociaux ; ils se retrouvent notamment privés de sécurité sociale ; leurs heures supplémentaires ne sont pas payées et ils sont incapables de quitter le domicile parental avant parfois l'âge de 35 ans faute de revenus suffisants pour pouvoir se payer un toit. 23 % des chômeurs en Grèce sont des jeunes (le taux de sans-emploi chez les 15-24 ans est officiellement de 25,2 %). Comme l’indique un article de presse en France 2: "Ces étudiants ne se sentent plus protégés par rien : la police les flingue, l’éducation les piège, l’emploi les lâche, le gouvernement leur ment". Le chômage des jeunes et leurs difficultés à entrer dans le monde du travail a ainsi créé et diffusé un climat d’inquiétude, de colère et d’insécurité généralisé. La crise mondiale est en train d’entraîner de nouvelles vagues de licenciements massifs. En 2009, est prévue une nouvelle perte de 100 000 emplois en Grèce, ce qui correspond à 5% de chômage supplémentaire. En même temps, 40% des travailleurs gagnent moins de 1100 euros brut et la Grèce connaît le taux le plus élevé de travailleurs pauvres des 27 États de l’UE : 14%.
Il n’y a d’ailleurs pas que les jeunes qui sont descendus dans la rue, mais aussi les enseignants mal payés et beaucoup de salariés, en proie aux mêmes problèmes, à la même misère et animés par le même sentiment de révolte. La brutale répression du mouvement, dont le meurtre de cet adolescent de 15 ans a été l’épisode le plus dramatique, n’a fait qu’amplifier cette solidarité où se mêle un mécontentement social généralisé. Comme le rapporte un étudiant, beaucoup de parents d’élèves ont été également profondément choqués et révoltés : "Nos parents ont découvert que leurs enfants peuvent mourir comme ça dans la rue, sous les balles d’un flic" 3 et ont pris conscience du pourrissement d’une société où leurs enfants n’auront pas le même niveau de vie qu’eux. Lors de maintes manifestations, ils ont été témoins des tabassages violents, des arrestations musclées, des tirs à balle réelle et à bras tendu des policiers antiémeutes (les MAT) avec leur arme de service.
Si les occupants de l’École Polytechnique, haut lieu de la contestation étudiante, ont dénoncé la terreur d’État, on retrouve cette colère contre la brutalité de la répression dans toutes les manifestations avec des slogans tels que : "Des balles pour les jeunes, de l’argent pour les banques." Plus clairement encore, un participant du mouvement a déclaré : "On n’a pas de job, pas d’argent, un État en faillite avec la crise, et tout ce qu’il y a comme réponse, c’est de donner des armes aux policiers." 4
Cette colère n’est pas nouvelle : les étudiants grecs s’étaient déjà largement mobilisés en juin 2006 contre la réforme des universités dont la privatisation entraînait l’exclusion des étudiants des milieux les plus modestes. La population avait aussi manifesté sa colère contre l’incurie du gouvernement lors des incendies de l’été 2007 qui avaient fait 67 morts, gouvernement qui n’a toujours pas indemnisé les nombreuses victimes qui avaient perdu leurs maisons ou leurs biens. Mais ce sont surtout les salariés qui s’étaient massivement mobilisés contre la réforme du régime des retraites début 2008 avec deux journées de grève générale très suivies en deux mois, avec des manifestations rassemblant chaque fois plus d’un million de personnes contre la suppression de la retraite anticipée pour les professions les plus pénibles et la remise en cause du droit des ouvrières de prétendre à la retraite dès 50 ans.
Face à la colère des travailleurs, la grève générale du 10 décembre encadrée par les syndicats a servi de son côté de contre-feu pour chercher à dévoyer le mouvement, PS et PC en tête, réclamant la démission du gouvernement actuel et des élections législatives anticipées. Cela n’est pas parvenu à canaliser la colère et à faire cesser le mouvement, malgré les multiples manœuvres des partis de gauche et des syndicats pour tenter d’enrayer la dynamique d’extension de la lutte et les efforts de toute la bourgeoisie et de ses médias pour isoler les jeunes des autres générations et de l’ensemble de la classe ouvrière en les poussant dans des affrontements stériles avec la police. Tout au long de ces journées et de ces nuits, les affrontements ont été incessants : les violentes charges policières à coups de matraques et de grenades lacrymogènes se sont traduites par des arrestations et des tabassages par dizaines.
Les jeunes générations d’ouvriers sont celles qui expriment le plus clairement le sentiment de désillusion et d’écœurement par rapport à un appareil politique ultra-corrompu. Depuis l’après-guerre, trois familles se partagent le pouvoir et depuis plus de trente ans, les dynasties des Caramanlis (à droite) et des Papandreou (à gauche) règnent sans partage en alternance sur le pays avec force pots-de-vin et scandales. Les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2004 après une période d’hyper-magouilles des socialistes dans les années 2000. Beaucoup rejettent l’encadrement d’un appareil politique et syndical totalement discrédité : "Le fétichisme de l’argent s’est emparé de la société. Alors les jeunes veulent une rupture avec cette société sans âme et sans vision." 5 Aujourd’hui, avec le développement de la crise, cette génération de prolétaires n’a pas seulement développé sa conscience d’une exploitation capitaliste qu’elle vit dans sa chair, elle exprime aussi sa conscience de la nécessité d’un combat collectif en mettant spontanément en avant des méthodes et une solidarité DE CLASSE. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle tire sa confiance en elle de son assurance d’être porteuse d’un autre avenir et déploie toute son énergie à s'insurger contre la pourriture de la société qui les entoure. Les manifestants revendiquent ainsi fièrement leur mouvement : "Nous sommes une image du futur face à une image très sombre du passé."
Si la situation n’est pas sans rappeler mai 68, la conscience des enjeux va bien au-delà.
La radicalisation du mouvement
Le 16 décembre, les étudiants investissent pendant quelques minutes la station de télévision gouvernementale NET et déploient sous les écrans une banderole proclamant : "Arrêtez de regarder la télé. Tout le monde dans les rues !" et lancent cet appel : "L’État tue. Votre silence les arme. Occupation de tous les édifices publics !". Le siège de la police antiémeutes d’Athènes est attaqué et un fourgon de cette police est incendié. Ces actions sont aussitôt dénoncées par le gouvernement comme une "tentative de renversement de la démocratie", et également condamnées par le PC grec (KKE). A Thessalonique, les branches locales du syndicat GSEE et de l’ADEDY, la Fédération des fonctionnaires, tentèrent de confiner les grévistes dans un rassemblement en face de la Bourse du travail. Les lycéens et les étudiants se montrèrent alors déterminés à emmener les grévistes en manifestation et ils y réussirent. 4000 étudiants et travailleurs défilèrent dans les rues de la ville. Déjà le 11 décembre, des militants de l’organisation étudiante du Parti communiste (PKS) tentèrent de bloquer les assemblées afin d’empêcher les occupations (Université du Panthéon, École de philosophie de l’Université d’Athènes). Leurs tentatives échouèrent alors que les occupations se développaient dans Athènes et le reste de la Grèce. Dans le quartier d’Ayios Dimitrios, la mairie est occupée avec une assemblée générale à laquelle ont participé plus de 300 personnes de toutes générations. Le 17, l’immeuble qui est le siège du principal syndicat du pays, la Confédération Générale des Travailleurs en Grèce (GSEE) à Athènes, est occupé par des travailleurs qui se proclament insurgés et invitent tous les prolétaires à venir faire de ce site un lieu d’assemblées générales ouvert à tous les salariés, aux étudiants et aux chômeurs.
Un scénario identique, avec occupation et AG ouvertes à tous, a également eu lieu à l’Université d’Économie d’Athènes et à l’École Polytechnique.
Nous publions la déclaration de ces travailleurs en lutte pour contribuer à rompre le "cordon sanitaire" médiatique mensonger qui encercle ces luttes et qui les présente comme de simples émeutes violentes animées par quelques jeunes casseurs anarchistes qui terroriseraient la population. Ce texte montre au contraire clairement la force du sentiment de solidarité ouvrière qui anime ce mouvement et fait le lien entre les différentes générations de prolétaires !
"Nous déterminerons notre histoire nous mêmes ou nous la laisserons être déterminée sans nous. Nous, travailleurs manuels, employés, chômeurs, intérimaires et précaires, locaux ou migrants, ne sommes pas des téléspectateurs passifs. Depuis le meurtre d’Alexandros Grigoropoulos le samedi 6 au soir, nous participons aux manifestations, aux affrontements avec la police, aux occupations du centre ville comme des alentours. Nous avons dû maintes et maintes fois quitter le travail et nos obligations quotidiennes pour descendre dans la rue avec les lycéens, les étudiants et les autres prolétaires en lutte.
NOUS AVONS DÉCIDÉ D’OCCUPER LE BÂTIMENT DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS EN GRÈCE (GSEE)
Pour le transformer en un espace de libre expression et un point de rendez-vous pour les travailleurs.
Pour dissiper les mythes encouragés par les médias sur l’absence des travailleurs dans les affrontements, sur la rage de ces derniers jours qui ne serait l’œuvre que de quelques 500 “cagoulés”, “hooligans”, ou autres histoires farfelues, sur la présentation des travailleurs par les journaux télévisés comme des victimes de ces affrontements, et alors que la crise capitaliste en Grèce et dans le monde mène à des licenciements innombrables que les médias et leurs dirigeants considèrent comme un “phénomène naturel”.
Pour démasquer le rôle honteux de la bureaucratie syndicale dans le travail de sape contre l’insurrection, mais aussi d’une manière générale. La Confédération générale des travailleurs en Grèce (GSEE), et toute l’intégralité de la machinerie syndicale qui le soutient depuis des dizaines et des dizaines d’années, sape les luttes, négocie notre force de travail contre des miettes, perpétue le système d’exploitation et d’esclavage salarié. L’attitude de la GSEE mercredi dernier parle d’elle-même : la GSEE a annulé la manifestation des grévistes pourtant programmée, se rabattant précipitamment sur un bref rassemblement sur la place Syntagma, tout en s’assurant simultanément que les participants se disperseraient très vite, de peur qu’ils ne soient infectés par le virus de l’insurrection.
Pour ouvrir cet espace pour la première fois, comme une continuation de l’ouverture sociale créée par l’insurrection elle-même, espace qui a été construit avec notre contribution mais dont nous avons été jusqu’ici exclus. Pendant toutes ces années, nous avons confié notre destin à des sauveurs de toute nature, et nous avons fini par perdre notre dignité. Comme travailleurs, nous devons commencer à assumer nos responsabilités, et cesser de faire reposer nos espoirs dans des leaders “sages” ou des représentants “compétents”. Nous devons commencer à parler de notre propre voix, nous rencontrer, discuter, décider et agir par nous-mêmes. Contre les attaques généralisées que nous endurons. La création de collectifs de résistance "de base" est la seule solution.
Pour propager l’idée de l’auto-organisation et de la solidarité sur les lieux de travail, de la méthode des comités de luttes et des collectifs de base, abolir les bureaucraties syndicales.
Pendant toutes ces années, nous avons gobé la misère, la résignation, la violence au travail. Nous nous sommes habitués à compter nos blessés et nos morts - les soi-disant “accidents du travail”. Nous nous sommes habitués à ignorer que les immigrants, nos frères de classe, étaient tués. Nous sommes fatigués de vivre avec l’anxiété de devoir assurer notre salaire, de pouvoir payer nos impôts et de se garantir une retraite qui maintenant ressemble à un rêve lointain.
De même que nous luttons pour ne pas abandonner nos vies dans les mains des patrons et des représentants syndicaux, de même nous n’abandonnerons pas les insurgés arrêtés dans les mains de l’Etat et des mécanismes juridiques !
LIBÉRATION IMMÉDIATE DES DÉTENUS !
RETRAIT DES CHARGES CONTRE LES INTERPELLÉS !
AUTO-ORGANISATION DES TRAVAILLEURS !
GRÈVE GÉNÉRALE !
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DANS LES BATIMENTS LIBÉRÉS DE LA GSEE" 6
Dans la soirée du 17 décembre, une cinquantaine de bonzes et de gros bras syndicaux tentent de réinvestir les locaux mais ils s’enfuient devant les renforts d’étudiants, en majorité anarchistes, de l’Université d’Économie, elle aussi occupée et transformée en lieu de réunion et de discussion ouverte à tous les ouvriers venant à la rescousse des occupants en chantant à tue-tête "Solidarité !".
L’association des immigrés albanais diffuse, entre autres, pour proclamer sa solidarité avec le mouvement, un texte intitulé "Ces jours-là sont les nôtres, aussi !"
De façon significative, une petite minorité de ces occupants diffusait le message suivant : "Panagopoulos, le secrétaire général de la GSEE, a déclaré que nous ne sommes pas des travailleurs, car les travailleurs sont au travail. Ceci, parmi d’autres choses, révèle bien ce qu’est en réalité le “job” de Panagopoulos. Son “job” est de s’assurer que les travailleurs sont bien au travail, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les travailleurs vont au travail.
Mais depuis une dizaine de jours, les travailleurs ne sont pas seulement au travail, ils sont aussi dehors, dans les rues. Et ceci est une réalité que aucun Panagopoulos du monde ne peut cacher (…) Nous sommes des gens qui travaillons, nous sommes aussi des chômeurs (payant par des licenciement nos participations dans des grèves appelées par la GSEE quand eux, les syndicalistes, sont récompensés par des promotions, nous travaillons sous contrat précaire de petit boulot en petit boulot, nous travaillons sans sécurité de façon formelle ou informelle dans des programmes de stages ou dans des emplois subventionnés pour diminuer le taux de chômage. Nous sommes une partie de ce monde et nous sommes ici.
Nous sommes des travailleurs insurgés, point barre.
Chacune de nos fiches de paye est payée avec notre sang, notre sueur, la violence au travail, les têtes, genoux, poignets, mains, pieds cassés [par les accidents du travail]
Le monde entier est fabriqué par nous, les travailleurs. (…)
Des prolétaires du bâtiment libéré de la GSEE"
Des appels à une grève générale à durée indéterminée à partir du 18 se multiplient. Les syndicats sont contraints d’appeler à une grève de trois heures dans les services publics pour ce jour-là.
Dans la matinée du 18, un autre lycéen de 16 ans participant à un sit-in près de son école dans une banlieue d’Athènes est blessé par balle. Le même jour, plusieurs sièges de radio ou de télévision sont occupés par des manifestants, notamment à Tripoli, Chania et Thessalonique. L’immeuble de la chambre de commerce a été occupé à Patras où de nouveaux affrontements avec la police se produisent. La gigantesque manifestation à Athènes a été très violemment réprimée : pour la première fois, de nouveaux types d’armes sont utilisés par les forces antiémeutes : des gaz paralysants et des grenades assourdissantes. Un tract dirigé contre la "terreur de l’État" est signé "des filles en révolte" et circule à partir de l’Université d’Économie.
Le mouvement perçoit confusément ses propres limites géographiques : c’est pourquoi il accueille avec enthousiasme les manifestations de solidarité internationale, notamment à Berlin, à Rome, à Moscou, à Montréal ou à New York et s’en fait l’écho : "ce soutien est très important pour nous". Les occupants de l’École Polytechnique appellent à "une journée internationale de mobilisation contre les meurtres d’État" pour le 20 décembre mais pour vaincre l’isolement de ce mouvement prolétarien en Grèce, la seule voie, la seule perspective est le développement de la solidarité et de la lutte de classe à l’échelle internationale qui s’exprime de plus en plus clairement face à la crise mondiale.
Une maturation porteuse d’avenir
A partir du 20 décembre, des combats de rue violents ont lieu et l’étau se resserre, en particulier autour de l’École Polytechnique assiégée par les forces de police qui menacent d’y donner l’assaut. Le bâtiment occupé du syndicat GSEE a été remis au GSEE le 21/12, à la suite d’une décision du comité d’occupation et votée en Assemblée Générale. Le comité d’occupation de l’École Polytechnique d’Athènes publiait le 22 décembre un communiqué déclarant notamment : "Nous sommes pour l’émancipation, la dignité humaine et la liberté. Pas besoin de nous envoyer vos gaz lacrymogènes, nous pleurons suffisamment par nous-mêmes."
Avec beaucoup de maturité, conformément à la décision prise lors de l’assemblée générale à l’université des Sciences économiques, les occupants de cette université utilisent l’appel à la manifestation du 24 contre la répression policière et en solidarité avec les emprisonnés comme moment propice pour évacuer l’immeuble en masse et en sécurité : "il semble y avoir un consensus sur la nécessité de quitter les universités et de semer l’esprit de la révolte dans la société en général." Cet exemple sera suivi dans les heures suivantes par les AG des autres universités occupées, en déjouant le piège de l’enfermement et d’un affrontement direct avec la police. Le bain de sang et une répression plus violente sont évités. De même, les AG ont clairement dénoncé des coups de feu dirigés contre un car de police et revendiqué par une soi-disant "Action populaire", comme un acte de provocation policière.
Le comité d’occupation de Polytechnique évacuait le dernier bastion d’Athènes symboliquement le 24 décembre à minuit. "L’assemblée générale et l’assemblée seule décidera si (et quand) nous quitterons l’université (…) La décision de l’occupation de l’Assemblée est politiquement sur place : le point crucial est ici que c’est aux personnes occupant l’immeuble, et non pas à la police, de décider du moment de quitter les lieux."
Auparavant, le comité d’occupation publiait une déclaration : "En mettant fin à l’occupation de l’École Polytechnique après 18 jours, nous envoyons notre plus chaleureuse solidarité à toutes les personnes qui ont fait partie de cette révolte de différentes manières, non seulement en Grèce mais aussi dans de nombreux pays d’Europe, des Amériques, en Asie et en Océanie. Pour tous ceux que nous avons rencontrés et avec qui nous allons rester, combattant pour la libération des prisonniers de cette révolte, mais aussi son prolongement jusqu’à la libération sociale mondiale."
Dans certains quartiers, les habitants se sont emparés de la sono installée par la municipalité pour jouer des chants de Noël, pour lire au micro des communiqués demandant, entre autres, la mise en liberté immédiate des détenus, le désarmement de la police, la dissolution des brigades antiémeutes et l’abolition des lois antiterroristes. A Volos, la station de radio municipale et les bureaux du journal local ont été occupés pour parler des événements et de leurs exigences. A Lesvos, des manifestants ont installé une sono dans le centre de la ville et ont transmis des messages. A Ptolemaida ou à Ioannina, un arbre de Noël a été décoré avec des photos du jeune lycéen tué et des manifestations, et avec les revendications du mouvement.
Le sentiment de solidarité s’est exprimé à nouveau spontanément et avec force le 23 décembre, après l’agression d’une employée par une entreprise de nettoyage Oikomet, sous-traitante de la compagnie de métro d’Athènes (Athens Piraeus Electric Railway –ISAP-), qui a reçu de l’acide sulfurique au visage alors qu’elle revenait du travail. Des manifestations de solidarité se sont déroulées et le siège du métro d’Athènes a été occupé le 27 décembre 2008 alors qu’à Thessalonique, c’est le siège de la GSEE qui était occupé à son tour. Les deux occupations ont organisé une série de manifestations, de concerts de solidarité et d’actions de "contre-information" (en occupant, par exemple, le système des haut-parleurs de la station de métro pour lire des communiqués).
L’assemblée à Athènes déclarait dans son texte :
"Quand ils attaquent l’une d’entre nous, c’est nous tous qu’ils attaquent !
Aujourd’hui, nous occupons les bureaux centraux de ISAP (métro d’Athènes) comme une première réponse à l’attaque meurtrière au vitriol sur le visage de Constantina Kouneva le 23 décembre, quand elle revenait du travail. Constantina est aux soins intensifs à l’hôpital. La semaine dernière, elle s’est disputée avec la compagnie revendiquant toute la prime de Noël pour elle et ses collègues, en dénonçant les actes illégaux des patrons. Avant cela, sa mère a été virée par la même compagnie. Elle-même a été déplacée loin de son premier poste de travail. Ce sont des pratiques très répandues dans le secteur des compagnies de nettoyage qui embauchent des travailleurs précaires. (...) Oikomet (…) a pour propriétaire un membre du PASOK (le parti socialiste grec). Elle emploie officiellement 800 travailleurs (les travailleurs parlent du double, tandis que les trois dernières années plus de 3000 y ont travaillé), où le comportement mafieux illégal des patrons est un phénomène quotidien. Par exemple, les travailleurs y sont obligés de signer des contrats blancs (les conditions sont écrites par les patrons ultérieurement) qu’ils n’ont jamais l’occasion de revoir. Ils travaillent 6 heures et ne sont payés que pour 4,5 (salaire brut) pour ne pas dépasser les 30 heures (sinon ils devaient être inscrits dans la catégorie de travailleurs à haut risque). Les patrons les terrorisent, les déplacent, les licencient et les menacent avec des démissions forcées. Constantina est l’une d’entre nous. La lutte pour la DIGNITÉ et la SOLIDARITÉ est NOTRE lutte."
Parallèlement, l’assemblée d’occupation du GSEE de Thessalonique publiait un texte dont nous reproduisons des extraits : "Nous occupons aujourd’hui le siège des Syndicats de Thessalonique pour nous opposer à l’oppression qui se manifeste par des meurtres et le terrorisme contre les travailleurs ; (…) nous faisons appel à tous les travailleurs pour rejoindre cette lutte commune. (…) L’assemblée ouverte de ceux qui occupent la centrale syndicale qui sont de milieux politiques différents, des syndicalistes, étudiants, immigrés et des camarades de l’étranger ont adopté cette décision commune :
- Continuer l’occupation ;
- Organiser un rassemblement en solidarité avec K. Kuneva ; (…)
- Organiser des actions d’informations et de prise de conscience dans les environs de la ville ;
- Organiser un concert dans le Centre pour récolter de l’argent pour Konstantina."
Par ailleurs, cette assemblée déclarait :
"Nulle part dans la plate-forme [des syndicats], il n’est fait référence aux causes de l’inégalité et de la misère et des structures de hiérarchie dans la société. (…) Les Confédérations Générales et les Centres de Syndicats en Grèce sont intrinsèquement partie prenante dans le régime au pouvoir ; leurs membres de base et les ouvriers doivent leur tourner le dos, et (…) choisir la création d’un pôle autonome de lutte dirigée par eux (…) Si les travailleurs prennent en charge leurs luttes et cassent la logique de leur représentation par les complices des patrons, ils retrouveront leur confiance et des milliers d’entre eux rempliront les rues dans les prochaines grèves. L’État et ses gros bras assassinent des gens.
Auto-organisation ! Luttes d’auto-défense sociale ! Solidarité avec les travailleurs immigrés et Konstantina Kuneva !"
Début janvier 2009, des manifestations ont encore lieu à travers tout le pays en solidarité avec les prisonniers. 246 personnes ont été arrêtés dont 66 sont toujours en prison préventive. A Athènes, 50 immigrants ont été arrêtés dans les trois premiers jours du mouvement de révolte, avec des peines allant jusqu’à 18 mois de prison dans des jugements sans interprètes, et se retrouvent menacés d’expulsion.
Le 9 janvier, jeunes et policiers se sont à nouveau affrontés à Athènes, à l’issue d’un défilé dans le centre ville de près de 3000 enseignants, étudiants et élèves. Sur leurs banderoles, figuraient des slogans tels que : "L’argent pour l’éducation et pas pour les banquiers“, “A bas le gouvernement des assassins et de la pauvreté". D’importantes forces antiémeutes ont chargé à plusieurs reprises pour les disperser, effectuant de nombreuses nouvelles interpellations.
Partout, comme en Grèce, avec la précarité, les licenciements, le chômage, les salaires de misère qu’impose sa crise mondiale, l’État capitaliste ne peut apporter que davantage de police et de répression. Seul, le développement international de la lutte et de la solidarité de classe entre ouvriers, employés, lycéens, étudiants, chômeurs, travailleurs précaires, retraités, toutes générations confondues, peut ouvrir la voie à une perspective d’avenir pour abolir ce système d’exploitation.
W. (18 janvier)
1. Voir notre article [1] sur la mobilisation massive contre la réforme de l'enseignement en Italie ;
2. Marianne n° 608 daté du 13 décembre : "Grèce : les leçons d’une émeute "
3. Libération du 12/12/2008
4. Le Monde du 10/12/2008
5. Marianne du 13 décembre
6. La plupart des textes reproduits ou les informations de presse locale ont été traduits par des sites anarchistes : tels que indymedia, cnt-ait.info, dndf.org, emeutes.wordpress.com en français ou sur libcom.org en anglais
Géographique:
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
La plus grave crise économique de l'histoire du capitalisme
- 6404 lectures
La bourgeoisie s'est payé une belle frayeur. D'août à octobre, un véritable vent de panique a soufflé sur l'économie mondiale. Les déclarations fracassantes des politiciens et économistes en attestent : "Au bord du gouffre", "Un Pearl Harbor économique", "Un tsunami qui approche", "Un 11-Septembre de la finance" 1,... seule l'allusion au Titanic manqua à l'appel !
Il faut dire que les plus grandes banques de la planète étaient en train de faire faillite les unes après les autres et que les Bourses plongeaient, perdant 32 000 milliards de dollars depuis janvier 2008, soit l'équivalent de deux années de la production totale des États-Unis. La Bourse islandaise s'est effondrée de 94 % et celle de Moscou de 71 % !
Finalement, la bourgeoisie, de plan de "sauvetage" en plan de "relance", est parvenue à éviter la paralysie totale de l’économie. Est-ce à dire que le pire est derrière nous ? Certainement pas ! La récession dans laquelle nous venons tout juste d'entrer s’annonce comme la plus dévastatrice depuis la Grande Dépression de 1929.
Les économistes l’avouent clairement : la "conjoncture" actuelle est "la plus difficile depuis plusieurs décennies" a annoncé HSBC, la "plus grande banque du monde", le 4 août 2. "Nous sommes confrontés à l'un des environnements économiques et de politique monétaire les plus difficiles jamais vus" a surenchéri le président de la Réserve fédérale américaine (la FED), le 22 août 3.
La presse internationale ne s’y est d’ailleurs pas trompée, elle qui n’a cessé de comparer la période actuelle au marasme économique des années 1930, telle cette Une de Time annonçant "The New Hard Times" sur une photo d’ouvriers allant à la "free soup" (la soupe populaire) en 1929. Et effectivement, de telles scènes se reproduisent bel et bien à nouveau : les associations caritatives distribuant des repas sont toutes débordées alors qu'en de nombreux pays, des files d’attente de plusieurs centaines de travailleurs désœuvrés se forment chaque jour devant les bureaux d’embauche.
Et que dire de l’allocution télévisée du 24 septembre 2008 de George W. Bush, Président des États-Unis : "Nous sommes au milieu d'une crise financière grave (...) toute notre économie est en danger. (...) Des secteurs clés du système financier des États-Unis risquent de s'effondrer. (...) l'Amérique pourrait sombrer dans la panique financière, et nous assisterions à un scénario désolant. De nouvelles banques feraient faillite (…) Le marché boursier s'effondrerait encore plus, ce qui réduirait la valeur de votre compte de retraite. La valeur de votre maison chuterait. Les saisies se multiplieraient. (...) De nombreuses entreprises devraient mettre la clé sous la porte, et des millions d'Américains perdraient leur emploi. (…) Au bout du compte, notre pays pourrait sombrer dans une longue et douloureuse récession".
Eh bien, ce "scénario désolant" d’une "longue et douloureuse récession" est en train de se réaliser, touchant non pas seulement "le peuple américain" mais les ouvriers du monde entier !
Une récession brutale…
Depuis la désormais célèbre "crise des subprimes" de l’été 2007, les mauvaises nouvelles économiques ne cessent de tomber, jour après jour.
L’hécatombe du secteur bancaire pour la seule année 2008 est impressionnante. Ont dû être rachetés par un concurrent, renfloués par une banque centrale ou tout simplement nationalisés : Northern Rock (la huitième banque anglaise), Bear Stearns (la cinquième banque de Wall Street), Freddie Mac et Fannie Mae (deux organismes de refinancement hypothécaire américains pesant près de 850 milliards de dollars), Merrill Lynch (autre fleuron américain), HBOS (deuxième banque d'Écosse), AIG (American International Group, l'un des plus grands assureurs mondiaux) et Dexia (organisme financier luxembourgeois, belge et français). Des faillites retentissantes et historiques ont aussi marqué cette année de crise. En juillet, Indymac, l'un des plus gros prêteurs hypothécaires américains, était placé sous tutelle des autorités fédérales. Il était alors le plus important établissement bancaire à faire faillite aux États-Unis depuis vingt-quatre ans ! Mais son record ne tiendra pas longtemps. Quelques jours plus tard, Lehman Brothers, la quatrième banque américaine, se déclare elle aussi en faillite. Le total de ses dettes s'élève alors à 613 milliards de dollars. Record battu ! La plus grosse faillite d'une banque américaine à ce jour, celle de Continental Illinois en 1984, mettait en jeu une somme seize fois plus modeste (soit 40 milliards de dollars). Deux semaines après seulement, nouveau record ! C'est au tour de Washington Mutual (WaMu), la plus importante caisse d'épargne aux États-Unis, de mettre la clef sous la porte.
Après cette sorte d’infarctus de ce qui constitue le cœur même du capitalisme, le secteur bancaire, c’est aujourd’hui la santé de l’ensemble du corps qui vacille et décline ; "l’économie réelle" est à son tour brutalement touchée. D’après le Bureau national de la recherche économique (NBER), les États-Unis sont officiellement en récession depuis décembre 2007. Nouriel Roubini, l'économiste le plus respecté aujourd'hui à Wall Street, pense même qu’une contraction de l'activité de l’économie américaine de l'ordre de 5 % en 2009 et de 5 % de nouveau en 2010 est probable 4 ! Nous ne pouvons savoir si tel sera le cas, mais le simple fait que l'un des économistes les plus réputés de la planète puisse envisager un tel scénario catastrophe révèle l'inquiétude réelle de la bourgeoisie. L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) s'attend à ce que toute l'Union Européenne soit en récession en 2009. Pour l’Allemagne, la Deutsche Bank prévoit un recul du PIB pouvant aller jusqu'à 4 % 5 ! Pour avoir un ordre d’idée de l’ampleur d’une telle récession, il faut savoir que la pire année depuis la Seconde Guerre mondiale avait été jusqu'ici 1975, quand le PIB allemand avait diminué de "seulement" 0,9 %. Aucun continent n’est épargné. Le Japon est déjà en récession et même la Chine, cet "Eldorado capitaliste", n'échappe pas à ce ralentissement brutal. Résultat : la demande s'est effondrée à un tel point que tous les prix, y compris le pétrole, sont à la baisse. Bref, l’économie mondiale va très mal.
… et une vague de paupérisation sans précédent depuis les années 1930
La première victime de cette crise est évidemment le prolétariat. Aux États-Unis, la dégradation des conditions de vie est ainsi particulièrement spectaculaire. 2,8 millions de travailleurs, incapables de faire face aux remboursements de leurs crédits, se sont retrouvés à la rue depuis l'été 2007. D’après l'Association des banquiers hypothécaires MBA, près d’un emprunteur immobilier américain sur dix est aujourd’hui potentiellement menacé d'expulsion. Et ce phénomène commence à toucher l'Europe, en particulier l'Espagne et la Grande-Bretagne.
Les licenciements aussi se multiplient. Au Japon, Sony a annoncé un plan sans précédent de 16 000 suppressions de postes, dont 8 000 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Ce groupe emblématique de l'industrie nippone n’avait jamais licencié d’employés en CDI. Le secteur du bâtiment, avec la crise de l’immobilier, tourne au ralenti. Le BTP espagnol s’attend à perdre 900 000 emplois d'ici à 2010 ! Pour les banques, c’est un véritable jeu de massacre. Citigroup, l'une des plus grandes banques du monde, va supprimer 50 000 emplois alors qu'elle en a déjà détruit 23 000 depuis début 2008 ! En 2008, pour ce seul secteur, 260 000 emplois ont été supprimés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Or, un emploi dans la finance génère en moyenne quatre emplois directs. L'effondrement des organismes financiers signifie donc le chômage pour des centaines de milliers de familles ouvrières. Autre secteur particulièrement touché, celui de l'automobile. Les ventes de véhicules se sont effondrées partout cet automne de plus de 30%. Renault, premier constructeur français, a pratiquement arrêté sa production depuis la mi-novembre ; plus aucune voiture ne sort de ses ateliers et cela alors que ses chaînes tournent déjà depuis des mois à 54 % de leurs capacités. Toyota va supprimer 3000 emplois temporaires sur 6000 (soit 50 % !) dans ses usines au Japon. Mais, c'est une nouvelle fois des États-Unis que parviennent les nouvelles les plus alarmantes : les fameux Big Three de Detroit (General Motors, Ford et Chrysler) sont au bord de la faillite. L’enveloppe de 15 milliards de dollars versée par l’État américain ne suffira pas à les sortir durablement d’affaire 6 (les Big Three demandaient d’ailleurs au minimum 34 milliards). Des restructurations massives vont avoir nécessairement lieu dans les mois à venir. Entre 2,3 et 3 millions d'emplois sont menacés. Et ici, les ouvriers licenciés vont aussi perdre, avec leur emploi, leur assurance maladie et leur retraite !
La conséquence inexorable de cette destruction massive d’emplois est évidemment l’explosion du chômage. En Irlande, le "modèle économique de la dernière décennie", le nombre de chômeurs a plus que doublé en un an, ce qui représente la plus forte hausse jamais enregistrée ! L'Espagne termine l'année avec 3,13 millions de chômeurs, soit près d'1 million de plus qu'en 2007 7. Aux États-Unis, 2,6 millions d’emplois ont été détruits en 2008, du jamais vu depuis 1945 8. La fin d’année a été particulièrement désastreuse avec plus de 1,1 millions de postes perdus sur novembre et décembre. A ce rythme, il pourrait y avoir encore 3 ou 4 millions de chômeurs supplémentaires d’ici le début de l’été 2009.
Et pour les rescapés, ceux qui voient leurs collègues être licenciés, l’avenir est au "travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup moins" 9. Ainsi, selon le dernier rapport du Bureau international du Travail (BIT) intitulé "Rapport mondial sur les salaires 2008/09", "Pour les 1,5 milliard de salariés dans le monde, des temps difficiles sont à venir", "la crise économique mondiale devrait déboucher sur de douloureuses coupes dans les salaires".
Inévitablement, le résultat attendu de toutes ces attaques est une hausse considérable de la misère. De l'Europe aux États-Unis, toutes les associations caritatives ont constaté ces derniers mois une augmentation d'au moins 10 % de l’affluence à la soupe populaire. Cette vague de paupérisation signifie que se loger, se soigner et se nourrir va devenir de plus en plus difficile. Cela signifie aussi pour les jeunes d'aujourd'hui que ce monde capitaliste n'a plus d'avenir à leur offrir !
Comment la bourgeoisie explique cette crise
Les mécanismes économiques qui ont engendré la récession actuelle commencent à être relativement connus. La télévision nous a abreuvé de reportages nous révélant, soi-disant, tous les dessous de l’affaire. Pour faire simple, durant des années, la consommation des "ménages américains" (autrement dit, des familles ouvrières) a été soutenue artificiellement par toutes sortes de crédits, en particulier, un crédit au succès foudroyant : les prêts hypothécaires à risque ou "subprimes". Les banques, les institutions financières, les fonds de pension… tous prêtaient sans se soucier de la capacité réelle de ces ouvriers à rembourser (d’où "à risque") pourvu qu’ils aient un bien immobilier (d’où "hypothécaire"). Au pire, croyaient-ils, ils seraient dédommagés par la vente des maisons gagées des débiteurs ne parvenant pas à rembourser leur dette. Il y eut alors un effet boule de neige : plus les ouvriers empruntaient – notamment pour acheter leur maison – et plus l’immobilier montait ; plus l’immobilier montait et plus les ouvriers pouvaient emprunter. Tous les spéculateurs de la planète sont alors entrés dans la danse : ils se sont mis à acheter eux aussi des maisons pour les revendre ensuite plus chers et, surtout, ils se sont vendus les uns les autres ces fameux subprimes par le biais de la "titrisation" (c'est-à-dire de la transformation des créances en valeurs mobilières échangeables sur le marché mondial comme les autres actions et obligations). En une décennie, la bulle spéculative est devenue énorme ; toutes les institutions financières de la planète ont réalisé ce type d’opération à hauteur de milliers de milliards de dollars. Autrement dit, des ménages que l’on savait insolvables sont devenus la poule aux œufs d’or de l’économie mondiale.
Evidemment, l’économie réelle a fini par rappeler tout ce beau monde à sa dure réalité. Dans la "vraie vie", tous ces ouvriers surendettés ont connu aussi la hausse du coût de la vie et le gel des salaires, les licenciements, la baisse des allocations chômage… En un mot, ils se sont appauvris considérablement si bien qu’une part de plus en plus grande d’entre eux fut effectivement incapable de faire face aux échéances de leur emprunt. Les capitalistes ont alors expulsé manu militari les mauvais payeurs pour revendre les biens immobiliers… mais les maisons mises ainsi en vente furent tellement nombreuses 10 que les prix ont commencé à baisser et… patatras… sous le soleil de l'été 2007, la belle grosse boule de neige a fondu d’un coup ! Les banques se sont retrouvées avec des centaines de milliers de débiteurs insolvables et autant de maisons ne valant plus rien sur les bras. Ce fut la faillite, le krach.
Résumé ainsi, tout cela peut sembler absurde. Prêter à des gens qui n’ont pas les moyens de rembourser va à l’encontre du bon sens capitaliste. Et pourtant, l’économie mondiale a basé l’essentiel de sa croissance de la dernière décennie sur une telle fumisterie. La question est donc pourquoi ? Pourquoi une telle folie ? La réponse apportée par les journalistes, les politiciens, les économistes est simple et unanime : C'est la faute aux spéculateurs ! C'est la faute à la cupidité des "patrons voyous" ! C'est la faute aux "banquiers irresponsables" ! Aujourd’hui, tous reprennent en chœur la ritournelle traditionnelle de la gauche et de l’extrême-gauche sur les méfaits de la "dérégulation" et du "néo-libéralisme" (sorte de libéralisme débridé), et appellent de leurs vœux un retour de l’État… ce qui révèle d’ailleurs la vraie nature des propositions "anti-capitalistes" de la gauche et de l’extrême-gauche. Ainsi, Sarkozy proclame que "le capitalisme doit se refondre sur des bases éthiques". Madame Merkel insulte les spéculateurs. Zapatero pointe un doigt accusateur sur les "fondamentalistes du marché". Et Chavez, l'illustre paladin du "socialisme du 21e siècle", commente les mesures de nationalisations d’urgence prises par Bush en lançant : "Le camarade Bush est en train de prendre certaines mesures propres au camarade Lénine" 11. Tous nous disent que l'espoir se tourne aujourd'hui vers un "autre capitalisme", plus humain, plus moral,… plus étatique !
Mensonges ! Dans la bouche de tous ces politiciens, tout est faux, à commencer par leur prétendue explication de la récession.
La catastrophe économique actuelle est le fruit de cent ans de décadence
En réalité, c’est l’État lui-même qui, le premier, a organisé cet endettement généralisé des ménages. Pour soutenir artificiellement l’économie, les État ont ouvert toutes grandes les vannes du crédit en diminuant les taux directeurs des banques centrales. Ces banques d’État en prêtant à bas-coût, à moins de 1% parfois, ont permis à l’argent de couler à flots. L’endettement mondial fut donc le résultat d’un choix délibéré de la bourgeoisie et non d’une quelconque "dérégulation". Comment comprendre autrement la déclaration de Bush au lendemain du 11 septembre 2001 qui, face à un début de récession, a lancé aux ouvriers : "Soyez de bons patriotes, consommez !". Le Président américain donnait ici un message clair à toute la sphère financière : multipliez les crédits à la consommation sinon l’économie nationale s’écroulera ! 12
En vérité, cela fait des décennies que le capitalisme survit ainsi, à crédit. Le graphique de la figure 1 13, qui présente l’évolution de la dette totale américaine (c’est-à-dire la dette de l’État, des entreprises et des ménages) depuis 1920, parle de lui-même. Pour comprendre l'origine de ce phénomène et aller au-delà de l'explication aussi simpliste que frauduleuse de la "folie des banquiers, des spéculateurs et des patrons", il faut percer "le grand secret de la société moderne": "la fabrication de plus-value" 14, selon les propres termes de Marx.
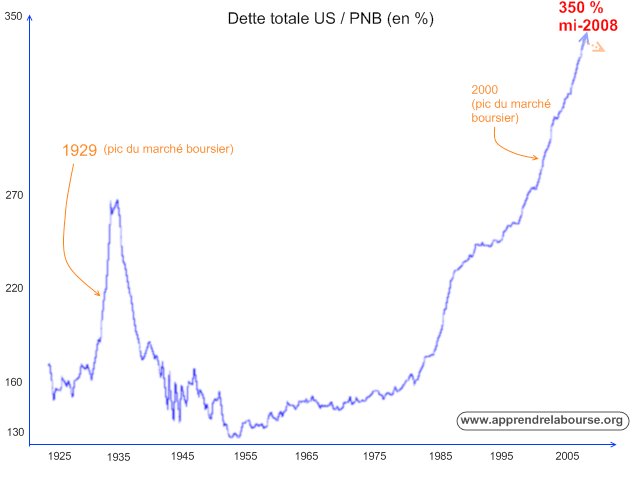
Figure 1 : Evolution de la dette totale américaine depuis 1920
Le capitalisme porte en lui, depuis toujours, une sorte de maladie congénitale : il produit une toxine en abondance que son organisme n’arrive pas à éliminer, la "surproduction". En effet, il fabrique plus de marchandises que son marché ne peut en assimiler. Pourquoi ? Prenons un exemple totalement théorique : un ouvrier travaillant sur une chaîne de montage ou derrière un micro-ordinateur et qui, à la fin du mois, est payé 800 euros. En fait, il a produit non pas pour l'équivalent de 800 euros, ce qu'il reçoit, mais pour la valeur de 1200 euros. Il a effectué un travail non payé ou, autrement dit, une plus-value. Que fait le capitaliste des 400 euros qu'il a volés à l'ouvrier (à condition qu'il soit parvenu à vendre la marchandise) ? Il en met une partie dans sa poche, admettons 150 euros, et les 250 euros restant, il les réinvestit dans le capital de son entreprise, le plus souvent sous forme de l'achat de machines plus modernes, etc. Mais pourquoi le capitaliste procède-t-il ainsi ? Parce qu'il n'a pas le choix. Le capitalisme est un système concurrentiel, il faut vendre les produits moins cher que le voisin qui fabrique le même type de produits. En conséquence, le patron est contraint non seulement de baisser ses coûts de production, c'est-à-dire les salaires 15, mais encore d'utiliser une part croissante du travail non payé dégagé pour le réinvestir prioritairement dans des machines plus performantes 16, afin d'augmenter la productivité. S'il ne le fait pas, il ne peut pas se moderniser, et, tôt ou tard, son concurrent, qui, lui, le fera, vendra moins cher et remportera le marché. Le système capitaliste est ainsi affecté par un phénomène contradictoire : en ne rétribuant pas les ouvriers par l'équivalent de ce qu'ils ont effectivement fourni comme travail et en contraignant les patrons à renoncer à consommer une grande part du profit ainsi extorqué, le système produit plus de valeur qu'il n'en distribue. Jamais ni les ouvriers ni les capitalistes réunis ne pourront donc à eux seuls absorber toutes les marchandises produites. Ce surplus de marchandises, qui va le consommer ? Pour ce faire, ce système doit forcément trouver de nouveaux débouchés en dehors du cadre de la production capitaliste ; c'est ce qu'on appelle les marchés extra-capitalistes (au sens d'en dehors du capitalisme, qui ne fonctionne pas de manière capitaliste).
C’est pourquoi au 18e siècle et surtout au 19e siècle, le capitalisme partit à la conquête du monde : il devait trouver en permanence de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, pour faire du profit en vendant ses marchandises en surplus, sous peine de voir son économie être paralysée. Et régulièrement d’ailleurs, c’est ce qui advenait quand il ne parvenait pas assez rapidement à obtenir de nouvelles conquêtes. Le Manifeste communiste de 1848 fait une description magistrale de ce type de crise : "Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat sur la société, l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce". A cette époque néanmoins, parce que le capitalisme était en pleine croissance, qu’il pouvait justement conquérir de nouveaux territoires, chaque crise laissait ensuite la place à une nouvelle période de prospérité. "Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe. Partout elle doit s'incruster, partout il lui faut bâtir, partout elle établit des relations... Le bas prix de ses marchandises est la grosse artillerie avec laquelle elle démolit toutes les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, d'adopter le mode de production bourgeois ; elle les contraint dimporter chez elles ce qui s'appelle la civilisation, autrement dit : elle fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image..." (Le Manifeste). Mais déjà à ce moment-là, Marx percevait dans ces crises périodiques quelque chose de plus qu'un simple cycle éternel qui déboucherait toujours sur la prospérité. Il y voyait l'expression des contradictions profondes qui minent le capitalisme. En "s'emparant de marchés nouveaux", la bourgeoisie "prépare des crises plus générales et plus profondes, tout en réduisant les moyens de les prévenir." (idem) ou encore, dans Travail Salarié et Capital, "C'est que la masse des produits et donc le besoin de débouchés s'accroît, alors que le marché mondial se rétrécit ; c'est que chaque crise soumet au monde commercial un marché non encore conquis ou peu exploité et restreint ainsi les débouchés.".
Tout au long du 18e et du 19e siècle, les principales puissances capitalistes se livrent à une véritable course à la conquête du monde ; elles se partagent progressivement la planète en colonies et forment de véritables empires. De temps à autre, elles se retrouvent face à face à lorgner sur un même territoire, une guerre courte éclate alors, et le vaincu part vite trouver un autre coin de terre à conquérir. Mais au début du 20e siècle, les grandes puissances s'étant partagées la domination du monde, il ne s’agit plus pour elles de faire la course en Afrique, en Asie ou en Amérique, mais de se livrer une guerre impitoyable pour défendre leurs aires d’influence et s’emparer, à la force des canons, de celles de leurs concurrents impérialistes. Il s’agit ici d’une véritable question de survie pour les nations capitalistes, il leur faut impérativement pouvoir déverser suffisamment leur surproduction sur les marchés non-capitalistes. Ce n’est donc pas un hasard si c’est l’Allemagne qui, n’ayant que très peu de colonies et étant dépendante du bon vouloir de l’Empire britannique pour commercer sur ses terres (dépendance insoutenable pour une bourgeoisie nationale), se montre la plus agressive et déclenche, en 1914, la Première Guerre mondiale. Cette boucherie fit plus de 11 millions de morts, causa des souffrances horribles et provoqua un traumatisme moral et psychologique à des générations entières. Cette horreur annonce l’entrée dans une nouvelle époque, l’époque la plus barbare de l’Histoire. Dès lors, le capitalisme a atteint son apogée, il entre dans sa période de décadence. Le krach de 1929 en sera une confirmation éclatante.
Et pourtant, après plus de cent années de lente agonie, ce système est toujours debout, titubant, mal en point, mais debout. Comment fait-il pour survivre ? Pourquoi son organisme n’est-il pas encore totalement paralysé par la toxine de la surproduction ? C’est ici que le recours à l’endettement entre en jeu. L'économie mondiale est parvenue à éviter un effondrement fracassant en y recourant de plus en plus massivement.
Comme le montre la figure 1, dès le début du 20e siècle, la dette totale américaine s'affole pour littéralement exploser dans les années 1920. Les ménages, les entreprises et les banques croulent sous les dettes. Et la chute brutale de la courbe de l’endettement dans les années 1930 et 1940 est en réalité trompeuse. En effet, la Grande Dépression des années 1930 représente la première grande crise économique de la décadence. La bourgeoisie n’était pas encore préparée à un tel choc. Tout d’abord, elle ne réagit pas ou mal. En fermant ses frontières (le protectionnisme), elle accentua la surproduction, la toxine fit des ravages. Entre 1929 et 1933, la production industrielle américaine s’effondra de moitié 17 ; le chômage frappa 13 millions d’ouvriers et une misère sans nom se développa, deux millions d’Américains se retrouvèrent sans-abri 18. Dans un premier temps, le gouvernement ne vint pas au secours du secteur financier : des 29 000 banques recensées en 1921, il n’en restera plus que 12 000 à la fin du mois de mars 1933 ; et cette hécatombe se poursuivra encore jusqu’en 1939 19. Toutes ces faillites sont synonymes d’une disparition pure et simple de montagnes de dettes 20. Par contre, ce qui n’apparaît pas sur ce graphique, c’est la croissance de l’endettement public. Après quatre années d’attentisme, l’État américain prit enfin des mesures : ce fut le New Deal de Roosevelt. Et en quoi consista ce plan dont on reparle tant aujourd’hui ? Il s’agit d’une politique de grands travaux basée sur… un recours massif et inédit à l’endettement étatique (de 17 milliards en 1929, la dette publique passa à 40 milliards en 1939 21).
Par la suite, la bourgeoise a tiré les leçons de cette mésaventure. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, elle organisa au niveau international des instances monétaires et financières (via la conférence Bretton Woods) et, surtout, elle systématisa le recours au crédit. Ainsi, après avoir touché un plancher en 1953-1954 et malgré la courte accalmie des années 1950 et 1960 22, la dette totale américaine recommence lentement mais sûrement à augmenter dès le milieu des années 1950. Et quand la crise fit son grand retour en 1967, la classe dominante n’attendit pas cette fois-ci quatre années pour réagir. Immédiatement, elle recourut aux crédits. Ces quarante dernières années peuvent en effet se résumer en une succession de crises et une montée exponentielle de la dette mondiale. Aux États-Unis, il y a eu officiellement des récessions en 1969, 1973, 1980, 1981, 1990 et 2001 23. La solution utilisée par la bourgeoisie américaine pour faire face chaque fois à ces difficultés est là aussi visible sur le graphique : la pente de l’endettement s’incline fortement à partir de 1973 et démesurément à partir des années 1990. Toutes les bourgeoisies du monde ont agit de la même façon.
Mais l'endettement n'est pas une solution magique. La Figure 2 24 montre que, depuis 1966, l’endettement est de moins en moins efficace pour engendrer de la croissance 25. Il s’agit là d’un cercle vicieux : les capitalistes produisent plus de marchandises que le marché ne peut normalement en absorber ; puis, le crédit crée un marché artificiel ; les capitalistes vendent donc leurs marchandises et réinvestissent ainsi leur profit dans la production et donc… re-belote, il faut de nouveaux crédits pour vendre les nouvelles marchandises. Non seulement ici les dettes s’accumulent mais, à chaque nouveau cycle, les nouvelles dettes doivent être de plus en plus importantes pour maintenir un taux de croissance identique (puisque la production s’est élargie). De plus, une part de plus en plus grande des crédits n’est jamais injectée dans le circuit de la production mais disparaît aussitôt, engloutie dans le gouffre des déficits. En effet, les ménages surendettés contractent souvent un nouvel emprunt afin de rembourser leurs dettes les plus anciennes. Les Etats, les entreprises et les banques fonctionnent de la même façon. Enfin, lors de ces vingt dernières années, l’"économie réelle" étant perpétuellement en crise, une partie croissante de l’argent créé est allé alimenter les bulles spéculatives (la bulle Internet, celles des Télécoms, de l’immobilier…) 26. Il était en effet plus rentable et finalement moins risqué de spéculer en Bourse que d'investir dans la production de marchandises qui ont toutes les peines du monde à être vendues. Il y a aujourd'hui cinquante fois plus d'argent qui circule dans les Bourses que dans la production 27.
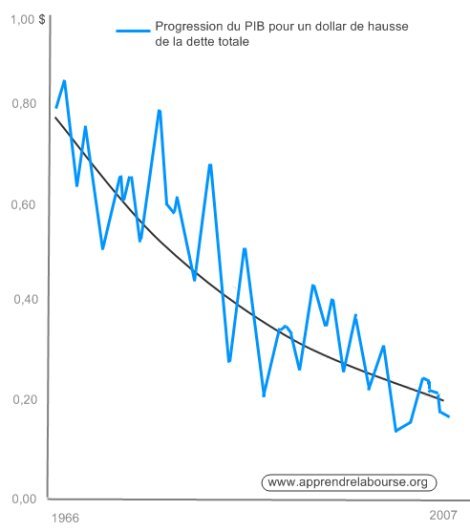
Figure 2 : Répercussion toujours plus faible de l'augmentation de la dette sur celle du PIB
Mais cette fuite en avant dans l’endettement n’est pas simplement de moins en moins efficace, elle débouche surtout inexorablement et systématiquement sur une crise économique dévastatrice. Le capital ne peut pas indéfiniment sortir de l'argent de son chapeau. C'est le b-a-ba du commerce : toute dette doit un jour être remboursée sous peine d'engendrer, pour le prêteur, de sérieuses difficultés pouvant aller jusqu'à la faillite. Nous revenons donc en quelque sorte à la case départ, le capital n'a fait que gagner du temps face à sa crise historique. Pire ! En reportant ainsi les effets de sa crise au lendemain, il a préparé en réalité chaque fois des convulsions économiques plus violentes encore. Voilà exactement ce qui arrive au capitalisme aujourd’hui !
L'État peut-il sauver l'économie capitaliste ?
Quand un particulier fait faillite, il perd tout et il est jeté à la rue. L'entreprise, elle, met la clef sous la porte. Mais un État ? Un État peut-il faire faillite ? Après tout, nous n'avons jamais vu d'État "fermer boutique". Pas exactement en effet. Mais être en cessation de paiement, oui !
En 1982, quatorze pays africains surendettés ont été contraints de se déclarer officiellement en cessation de paiement. Dans les années 1990, des pays d'Amérique du Sud et la Russie ont fait eux aussi défaut. Plus récemment, en 2001, l'Argentine s'est à son tour écroulée. Concrètement, ces États n'ont pas cessé d'exister, l'économie nationale ne s'est pas arrêtée non plus. Par contre, chaque fois, il y eut une sorte de séisme économique : la valeur de la monnaie nationale a chuté, les préteurs (en général d'autres États) ont perdu tout ou partie de leur investissement et, surtout, l'État a réduit drastiquement ses dépenses en licenciant une bonne partie des fonctionnaires et en cessant de payer pour un temps ceux qui restaient.
Aujourd'hui, de nombreux pays sont au bord d'un tel gouffre : l'Equateur, l'Islande, l'Ukraine, la Serbie, l'Estonie… Mais qu'en est-il des grandes puissances ? Le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a déclaré fin décembre que son État se trouvait en "état d'urgence fiscale". Ainsi, le plus riche des Etats américains, le "Golden State", s'apprête à licencier une bonne partie de ses 235 000 fonctionnaires (ceux qui resteront vont devoir prendre deux jours de congé non payés par mois à partir du 1er février 2009) ! En présentant ce nouveau budget, l'ex-star d'Hollywood a averti que "chacun devra consentir des sacrifices". C'est ici un symbole fort des difficultés économiques profondes de la première puissance mondiale. Nous sommes encore loin d'une cessation de paiement de l'État américain mais cet exemple montre clairement que les marges de manœuvres financières sont actuellement très limitées pour l'ensemble des grandes puissances. L'endettement mondial semble arriver à saturation (il était de 60 000 milliards de dollars en 2007 et a encore gonflé de plusieurs milliers de milliards depuis) ; contrainte de poursuivre dans cette voie, la bourgeoisie va donc provoquer des secousses économiques dévastatrices. La FED a abaissé ses taux directeurs pour l’année 2009 à 0,25% pour la première fois depuis sa création en 1913 ! L’État américain prête donc de l’argent presque gratuitement (et même en y perdant si l’on prend en compte l’inflation). Tous les économistes de la planète en appellent à un "new New Deal", rêvant de voir en Obama le nouveau Roosevelt, capable de relancer l'économie, comme en 1933, par un immense plan de grands travaux publics financé… à crédit 28. Des plans d’endettement étatique équivalents au New Deal, la bourgeoisie en lance régulièrement depuis 1967, sans véritable succès. Et le problème est qu'une telle politique de fuite en avant peut entraîner l’effondrement du dollar. Nombreux sont les pays aujourd'hui à effectivement douter des capacités des États-Unis à rembourser un jour leurs emprunts et à être tentés de retirer tous leurs investissements. Il en va ainsi de la Chine qui, fin 2008, a menacé, en langage diplomatique, l'Oncle Sam d'arrêter de soutenir l'économie américaine à travers l'achat de ses bons du Trésor : "Toute erreur sur la gravité de la crise causerait des difficultés aux emprunteurs comme aux créditeurs. L’appétit apparemment grandissant du pays pour les bons du Trésor américain n’implique pas qu’ils resteront un investissement rentable sur le long terme ou que le gouvernement américain continuera de dépendre des capitaux étrangers". Et voilà comment, en une phrase, la Chine menace l'État américain de couper la pompe à dollars chinoise qui alimente l’économie états-unienne depuis plusieurs années ! Si La Chine mettait sa menace à exécution 29, le désordre monétaire international qui s’ensuivrait serait alors apocalyptique et les ravages sur les conditions de vie de la classe ouvrière seraient gigantesques. Mais il n'y a pas que l'Empire du Milieu qui commence à douter : le mercredi 10 décembre, pour la première fois de son histoire, l'État américain a eu toutes les peines du monde à trouver des acquéreurs pour un emprunt de 28 milliards de dollars. Et, comme quoi toutes les grandes puissances ont les caisses vides, des ardoises de dettes interminables et une économie en piètre santé, le même jour, la même mésaventure a frappé l'État allemand : lui aussi, pour la première fois depuis les années 1920, a eu les pires difficultés à trouver des acheteurs pour un emprunt de 7 milliards d'euros.
Décidément, l'endettement, qu'il soit des ménages, des entreprises ou des États, n'est bien qu'un palliatif, il ne guérit pas le capitalisme de la maladie de la surproduction ; il permet tout au plus de sortir momentanément l'économie de l’ornière mais en préparant toujours des crises à venir plus violentes. Et pourtant, la bourgeoisie va poursuivre cette politique désespérée car elle n'a pas d'autre choix comme le montre, une énième fois, la déclaration du 8 novembre 2008 d’Angela Merkel à la Conférence Internationale de Paris : "Il n’existe aucune autre possibilité de lutter contre la crise que d’accumuler des montagnes de dettes" ou encore la dernière intervention du chef économiste du FMI, Olivier Blanchard : "Nous sommes en présence d’une crise d’une amplitude exceptionnelle, dont la principale composante est un effondrement de la demande […] Il est impératif de relancer […] la demande privée, si l’on veut éviter que la récession ne se transforme en Grande Dépression". Comment ? "par l’augmentation des dépenses publiques".
Mais, si ce n’est à travers ses plans de relance, l’État peut-il tout de même être LE sauveur en nationalisant une grande partie de l’économie, en particulier les banques et le secteur automobile ? Eh bien non, encore raté ! D’abord, et contrairement aux mensonges traditionnels de la gauche et de l’extrême gauche, les nationalisations n’ont jamais été une bonne nouvelle pour la classe ouvrière. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’importante vague de nationalisations avait pour objectif de remettre sur pied l'appareil productif détruit en augmentant les cadences de travail. Il ne faut pas oublier les paroles de Thorez, secrétaire général du Parti Communiste Français et alors vice-président du gouvernement dirigé par De Gaulle, qui lança à la face de la classe ouvrière en France, et tout particulièrement aux ouvriers des entreprises publiques : "Si des mineurs doivent mourir à la tâche, leurs femmes les remplaceront.", ou "Retroussez vos manches pour la reconstruction nationale !" ou encore "la grève est l’arme des trusts". Bienvenu dans le monde merveilleux des entreprises nationalisées ! Il n’y a ici rien d’étonnant. Les révolutionnaires communistes ont toujours mis en évidence, depuis l’expérience de la Commune de Paris de 1871, le rôle viscéralement anti-prolétarien de l’État. "L'État moderne, quelle qu'en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l'État des capitalistes, le capitaliste collectif idéal. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble." (F. Engels en 1878) 30
La nouvelle vague de nationalisations n’apportera donc rien de bon à la classe ouvrière. Et elle ne permettra pas non plus à la bourgeoisie de renouer avec une véritable croissance durable. Au contraire ! Ces nationalisations annoncent des bourrasques économiques à venir encore plus violentes. En effet, en 1929, les banques américaines qui ont fait faillite ont sombré avec les dépôts d'une grande partie de la population américaine, plongeant dans la misère des millions d'ouvriers. Dès lors, pour éviter qu'une telle débâcle ne se reproduise, le système bancaire avait été séparé en deux : d'un coté les banques d'affaires qui financent les entreprises et qui travaillent sur les opérations financières en tout genre, d'un autre coté les banques de dépôt qui reçoivent l'argent des déposants et qui s'en servent pour des placements relativement sécurisés. Or, emportées par la vague de faillites de l’année 2008, ces banques d'affaires américaines n'existent plus. Le système financier américain s'est recomposé tel qu'il était avant le 24 octobre 1929 ! A la prochaine bourrasque, toutes les banques "rescapées" grâce aux nationalisations partielles ou totales, risquent à leur tour de disparaître mais en emportant cette fois-ci les maigres économies et les salaires des familles ouvrières. Aujourd’hui, si la bourgeoise nationalise, ce n’est donc pas pour suivre un quelconque nouveau plan de relance économique mais pour éviter l'insolvabilité immédiate des mastodontes de la finance ou de l'industrie. Il s’agit d’éviter le pire, de sauver les meubles 31.
La montagne de dettes accumulées durant quatre décennies s'est transformée en véritable Everest et rien ne peut aujourd’hui empêcher le capital d’en dévaler la pente. L'état de l'économie est réellement désastreux. Cela dit, il ne faut pas croire que le capitalisme va sombrer d’un coup. La bourgeoisie ne laissera pas SON monde disparaître sans réagir ; elle tentera désespérément et par tous les moyens de prolonger l'agonie de son système, sans se soucier des maux infligés à l'humanité. Sa folle fuite en avant vers toujours plus d'endettement va se poursuivre et il y aura probablement à l’avenir, de-ci de-là, des courts moments de retour à la croissance. Mais ce qui est certain, c’est que la crise historique du capitalisme vient de changer de rythme. Après quarante années d'une lente descente aux enfers, l’avenir est aux soubresauts violents, aux spasmes économiques récurrents balayant non plus les seuls pays du Tiers-monde mais aussi les États-Unis, l’Europe, l’Asie… 32
La devise de l'Internationale communiste de 1919 "Pour que l'humanité puisse survivre, le capitalisme doit périr !" est plus que jamais d'actualité.
Mehdi (10 janvier 2009)
1. Respectivement : Paul Krugman (dernier prix Nobel d'économie), Warren Buffet (investisseur américain, surnommé "l'oracle d'Omaha" tant l'opinion du milliardaire de la petite ville américaine du Nebraska est respectée par le monde financier), Jacques Attali (économiste et conseiller des présidents français Mitterrand et Sarkozy) et Laurence Parisot (présidente de l'association des patrons français).
2. Libération du 4.08.08
3. Le Monde du 22.08.08.
4. Source : www.contreinfo.info [6]
5. Les Echos du 05.12.08
6. Cet argent a été trouvé dans les caisses du plan Paulson, pourtant déjà insuffisant pour le secteur bancaire. La bourgeoisie américaine est obligée "de déshabiller Paul pour habiller Jack", ce qui révèle là aussi l’état désastreux des finances de la première puissance mondiale.
7. Les Echos du 08.01.09
8. D’après le rapport publié le 9 janvier par le département du Travail américain (Les Echos du 09.01.09)
9. En France, le président Nicolas Sarkozy avait mené campagne en 2007 avec pour slogan principal "Travailler plus pour gagner plus" (sic !).
10. En 2007, près de trois millions de foyers américains sont en situation de défaut de paiement (in Subprime Mortgage Foreclosures by the Numbers - https://www.americanprogress.org/issues/2007/03/foreclosures_numbers.html [7]).
11. Pour une fois, nous sommes d'accord avec Chavez. Bush est effectivement son camarade. Même s'ils sont opposés par la lutte acharnée de leurs deux nations impérialistes respectives, ils n'en sont pas moins camarades dans la défense du capitalisme et des privilèges de leur classe… la bourgeoisie.
12. Aujourd’hui, Alan Greenspan, l’ex-président de la FED et le chef d’orchestre de cette économie à crédit, est lynché par tous les économistes et autres docteurs es-science. Tout ce beau monde a la mémoire bien courte et oublie un peu vite qu’il y a peu encore, il le portait aux nues, le surnommant même le "gourou de la finance" !
13. Source : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
14. Le Capital, Livre 1, p725, La Pléiade.
15. ou, autrement dit, le capital variable.
16. Le capital fixe.
17. A. Kaspi, Franklin Roosevelt, Paris, Fayard, 1988, p.20
18. Ces chiffres sont d’autant plus importants que la population américaine n’est à l’époque que de 120 millions. Source : Lester V. Chandler, America’s Greatest Depression 1929-1941, New York, Harper and Row, 1970, p.24. et sq.
19. D’après Frédéric Valloire, in Valeurs Actuelles du 15.02.2008.
20. Pour être complet, cette chute de la dette totale s’explique aussi par un mécanisme économique complexe : la création monétaire. En effet, le New Deal n'a pas été financé intégralement par la dette mais aussi par de la pure création monétaire. Ainsi le 12 mai 1933, on autorise le Président à faire augmenter les crédits des banques fédérales de 3 milliards de $ et la création de billets sans contrepartie or également de 3 milliards de $. Le 22 octobre de la même année, il y a dévaluation de 50 % du $ par rapport à l'or. Tout ceci explique la relative modération des ratios d'endettement.
22. De 1950 à 1967, le capitalisme connaît une phase de croissance importante, appelée "Trente Glorieuses" ou "Age d'or". Le but de cet article n'est pas d'analyser les causes de cette sorte de parenthèse dans le marasme économique du 20e siècle. Un débat se déroule aujourd’hui dans le CCI pour mieux comprendre les ressorts de cette période faste, débat que nous avons commencé à publier dans notre presse (lire "Débat interne au CCI : Les causes de la période de prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale" [9] in Revue internationale n° 133, 2e trimestre 2008). Nous encourageons vivement tous nos lecteurs à participer à cette discussion lors de nos réunions (permanences, réunions publiques) par courrier [10]ou par mail [11] .
23. Source : www.nber.org/research/business-cycle-dating [12].
24. Source : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
25. En 1966, un dollar d'endettement supplémentaire produisait 0,80 dollar de production de richesse en plus alors qu’en 2007, ce même dollar n’engendre plus que 0,20 dollar de PIB en plus.
26. Les actifs et l’immobilier ne sont pas comptabilisés dans le PIB.
27. Ainsi, contrairement à tous ce que nous disent les économistes, journalistes et autres bonimenteurs, cette "folie spéculative" est donc le produit de la crise et non l'inverse !
28. Alors que la rédaction de cet article est terminée, Obama vient d’annoncer son plan de relance tant attendu qui est, aux dires mêmes des économistes, "bien décevant" : 775 milliards vont être débloqués pour à la fois permettre un "cadeau fiscal" de 1000 dollars aux foyers américains (95% de ces foyers sont concernés) afin de les inciter à "se remettre à dépenser" et lancer un programme de grands travaux dans le domaine de l’énergie, des infrastructures et de l’école. Ce plan devrait, promet Obama, créer trois millions d’emplois "au cours des prochaines années". L’économie américaine détruisant en ce moment plus de 500 000 emplois par mois, ce nouveau New Deal (même s’il fonctionne au mieux des prévisions ce qui est très peu probable) est donc encore vraiment loin du compte.
29. Cette menace révèle, en elle-même, l'impasse et les contradictions dans lesquelles est l'économie mondiale. En effet, vendre massivement ses dollars reviendrait pour la Chine à scier la branche sur laquelle elle est assise puisque les Etats-Unis constituent le principal débouché de ses marchandises. C'est pourquoi elle a jusqu'à présent continué de soutenir en grande partie l'économie américaine. Mais d'un autre côté, elle a conscience que cette branche est pourrie, totalement vermoulue, et elle n'a aucune envie d'être encore assise dessus quand elle va craquer.
30. In L'Anti-Duhring, Ed.Sociales 1963, p.318.
31. Ce faisant, elle crée un terrain plus propice au développement des luttes. En effet, en devenant leur patron officiel, les ouvriers auront tous face à eux dans leur lutte directement l’Etat. Dans les années 1980, la vague importante de privatisation des grandes entreprises (sous Thatcher en Angleterre, par exemple) avait constitué une difficulté supplémentaire pour dévoyer la lutte de classe. Non seulement les ouvriers étaient appelés par les syndicats à se battre pour sauver les entreprises publiques ou, autrement dit, pour être exploités par un patron (l'Etat) plutôt qu'un autre (privé), mais en plus ils se confrontaient non plus au même patron (l'Etat) mais à une série de patrons privés différents. Leurs luttes étaient souvent éparpillées et donc impuissantes. A l'avenir, au contraire, le terreau sera plus fertile aux luttes d’ouvriers unis contre l’Etat.
32. Le terrain économique est particulièrement miné, il est donc difficile de savoir quelle sera la prochaine bombe à éclater. Mais dans les pages des revues économiques, un nom revient souvent sous la plume angoissée des spécialistes et autres docteurs es-science : les CDS. Un CDS (credit default swap) est une sorte d’assurance par laquelle un établissement financier se protège du risque de défaut de paiement d’un crédit en payant une prime. Le total du marché des CDS était estimé à 60 000 milliards de dollars en 2008. C’est dire si une crise des CDS sur le modèle de la crise des subprimes serait terriblement ravageuse. Elle emporterait en particulier tous les fonds de pensions américains et donc les retraites ouvrières.
Récent et en cours:
- Crise économique [13]
Questions théoriques:
- L'économie [14]
Il y a 90 ans, la révolution allemande : la guerre civile en Allemagne (1918-1919)
- 5951 lectures
Dans les trois premières parties de cette série sur la révolution allemande de 1918-1919 1, nous avons montré comment, après l’effondrement de l’Internationale socialiste face à la Première Guerre mondiale, le cours s’est inversé en faveur du prolétariat et a culminé dans la révolution de novembre 1918. Tout comme la révolution d’Octobre en Russie l’année précédente, novembre 1918 en Allemagne constituait l'aboutissement d'un processus de lutte et de révolte contre la guerre impérialiste. Alors qu’Octobre avait représenté le premier coup puissant porté par la classe ouvrière contre la "Grande Guerre", ce fut l’action du prolétariat allemand qui parvint, finalement, à y mettre fin.
Selon les livres d’histoire de la classe dominante, le parallèle entre les mouvements en Russie et en Allemagne s’arrête là. Pour ces livres, le mouvement révolutionnaire en Allemagne se limite aux événements de 1918, contre la guerre. Et, contrairement à la Russie, il n’y eut jamais en Allemagne de mouvement socialiste de masse contre le système capitaliste lui-même. D’après eux, les "extrémistes" qui se battaient pour qu’une révolution "bolchevique" ait lieu en Allemagne, allaient payer de leur vie le fait de ne pas l’avoir compris. C’est ce qu’on proclame.
Pourtant, la classe dominante de l’époque ne partageait pas la légèreté des historiens d’aujourd’hui sur le caractère indestructible de la domination capitaliste. Son programme du moment, c’était la Guerre civile !
Le "double pouvoir" et le système des conseils
L’existence d’une situation de double pouvoir, qui résultait de la révolution de novembre, motivait cet ordre du jour. Le résultat principal de la révolution de novembre fut la fin de la guerre impérialiste ; son principal produit fut la création d’un système de conseils d’ouvriers et de soldats qui, comme en Russie et en Autriche-Hongrie, s’étendait à tout le pays.
La bourgeoisie allemande, en particulier la social-démocratie, tirant rapidement les leçons de ce qui s’était passé en Russie, intervint immédiatement pour faire de ces organes des coquilles vides. Dans bien des cas, elle imposa l’élection de délégués sur la base de listes de partis, à savoir le parti social-démocrate (le SPD) et l’USPD hésitant et conciliateur, excluant ainsi de fait les révolutionnaires de ces organes. Lors du Premier Congrès des Conseils d’ouvriers et de soldats à Berlin, l’aile gauche du capital empêcha Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg d’intervenir. Et, surtout, elle fit adopter une motion déclarant que tout le pouvoir serait remis aux mains du futur gouvernement parlementaire.
Ces succès de la bourgeoisie sont toujours aujourd’hui à la base du mythe selon lequel les conseils en Allemagne, contrairement à ceux de Russie, n’étaient pas révolutionnaires. Mais cela ignore le fait qu’en Russie aussi, au début de la révolution, les conseils ne suivaient pas une orientation révolutionnaire, que la plupart des délégués élus au départ n’étaient pas révolutionnaires et que, là aussi, on avait poussé les "soviets" à abandonner le pouvoir rapidement.
Après la révolution de novembre, la bourgeoisie allemande ne se faisait aucune illusion sur le caractère prétendument inoffensif du système des conseils. Tout en revendiquant le pouvoir pour eux-mêmes, ces conseils continuaient à permettre à l’appareil d’Etat bourgeois de coexister à côté d’eux. Mais, d’un autre côté, le système des conseils, par sa nature dynamique et flexible, par sa composition, par son attitude, par son mode d’action, était capable de s’adapter à tous les tournants et de se radicaliser. Les Spartakistes, qui l’avaient immédiatement compris, avaient commencé une agitation incessante pour que les délégués soient réélus, ce qui se concrétiserait par un fort tournant à gauche de l’ensemble du mouvement.
Personne ne comprenait mieux le danger de cette situation de "double pouvoir" que la direction militaire allemande. Le général Groener, désigné pour mener les opérations de riposte, activa immédiatement la connexion téléphonique secrète 998 avec le nouveau chancelier, le social-démocrate Ebert. Et tout comme le légendaire sénateur Caton, deux mille ans plus tôt, avait conclu tous ses discours par les mots "Carthage (l’ennemi mortel de Rome) doit être détruit", Groener ne pensait qu’à détruire les conseils ouvriers et surtout de soldats Bien que pendant et après la révolution de novembre, les conseils de soldats aient en partie incarné un poids mort conservateur qui tirait les ouvriers en arrière, Groener savait que la radicalisation de la révolution renverserait cette tendance et que les ouvriers commenceraient à entraîner les soldats derrière eux. Et, par dessus tout, l’ambition des conseils de soldats était d’imposer leur commandement propre et de briser la domination des officiers sur les forces armées. Cela équivalait, rien de moins, qu’à armer la révolution. Aucune classe dominante n’a jamais accepté volontairement la contestation de son monopole sur les forces armées. En ce sens, l’existence même du système de conseils mettait la guerre civile à l’ordre du jour.
Plus encore, la bourgeoisie comprit qu’à la suite de la révolution de novembre, le temps ne jouait plus en sa faveur. La tendance spontanée contenue dans l'ensemble de la situation était à la radicalisation de la classe ouvrière, à la perte de ses illusions sur la social-démocratie et la "démocratie" et au développement de sa confiance en elle-même. C’est sans la moindre hésitation que la bourgeoisie allemande se lança dans la politique consistant à provoquer systématiquement des affrontements militaires. Elle voulait imposer des confrontations décisives à son ennemi de classe avant qu’une situation révolutionnaire ne puisse mûrir ; concrètement, "décapiter" le prolétariat au moyen d’une défaite sanglante des ouvriers dans la capitale, Berlin, centre politique du mouvement ouvrier allemand, avant que les luttes dans les provinces ne puissent atteindre une phase "critique ".
Une situation de lutte ouverte entre deux classes, chacune déterminée à imposer son propre pouvoir, chacune ayant ses propres organisations de domination de classe, ne peut qu’être temporaire, instable. Une telle situation de "double pouvoir" débouche nécessairement dans la guerre civile.
Les forces de la contre-révolution
Contrairement à la situation en Russie de 1917, la révolution allemande faisait face aux forces hostiles de l’ensemble de la bourgeoisie mondiale. La classe dominante n’était plus divisée par la guerre impérialiste en deux camps rivaux. De ce fait, la révolution devait affronter non seulement la bourgeoisie allemande mais aussi les forces de l’Entente qui étaient rassemblées sur la rive occidentale du Rhin, prêtes à intervenir si le gouvernement allemand perdait le contrôle de la situation sociale. Les États-Unis, qui étaient dans une certaine mesure un nouveau venu sur la scène politique mondiale, jouaient la carte de la "démocratie" et du "droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", se présentant comme la seule garantie de paix et de prospérité. Comme tels, ils cherchaient à formuler une alternative politique à la Russie révolutionnaire. La bourgeoisie française, pour sa part, obsédée par sa soif de revanche chauvine, brûlait de pénétrer plus avant dans le territoire allemand et, en cours de route, de noyer la révolution dans le sang. Ce fut la Grande-Bretagne, puissance dominante de l’époque, qui assuma la direction de l’alliance contre-révolutionnaire. Au lieu de lever l’embargo imposé à l’Allemagne au cours de la guerre, elle le maintint et même le renforça partiellement. Londres était déterminée à affamer la population allemande tant que ne serait pas installé dans le pays un régime politique approuvé par le gouvernement de sa majesté.
En Allemagne même, l’axe central de la contre-révolution était l’alliance de deux forces majeures : la social-démocratie et l’armée. La social-démocratie était le cheval de Troie de la terreur blanche ; elle opérait derrière les lignes de la classe ennemie, sabotant la révolution de l’intérieur, usant de l'autorité qui lui restait en tant qu’ancien parti ouvrier (avec les syndicats) pour créer un maximum de confusion et de démoralisation. Les militaires fournissaient les forces armées, mais aussi la cruauté, l’audace et la capacité stratégique qui les caractérisent.
Que représentait le groupe de socialistes russes, hésitants et peu enthousiastes, regroupés autour de Kerensky en 1917, en comparaison du sang-froid des contre-révolutionnaires du SPD allemand ! Qu’était la foule inorganisée des officiers russes comparée à l’efficacité sinistre de l’élite militaire prussienne ! 2
Au cours des jours et des semaines qui suivirent la révolution de novembre, cette alliance sinistre se prépara à résoudre deux problèmes majeurs. Face à la dissolution des armées impériales, elle devait souder en un noyau dur une nouvelle force, une armée blanche de la terreur. Elle en tira la matière brute à deux sources : de l’ancien corps des officiers et des sycophantes déracinés, rendus fous par la guerre et qui ne pouvaient plus être réintégrés dans la vie "civile ". Eux-mêmes victimes de l’impérialisme mais des victimes brisées, ces anciens soldats étaient à la recherche d’un exutoire à leur haine aveugle et d’un paiement pour ce service. C’est parmi ces desperados que les officiers de l’aristocratie – soutenus politiquement et couverts par le SPD – recrutèrent et entraînèrent ce qui allait devenir les Freikorps (les Corps francs), les mercenaires de la contre-révolution, le noyau de ce qui devint le mouvement nazi.
Ces forces armées étaient complétées par toute une série de réseaux d’espions et d’agents provocateurs coordonnés par le SPD et l’état-major de l’armée.
Le second problème était comment justifier aux yeux des ouvriers l’emploi de la terreur blanche. C’est la social-démocratie qui le résolut. Pendant quatre ans, elle avait défendu la guerre impérialiste au nom de la paix. Maintenant, elle prêchait la guerre civile pour… empêcher la guerre civile. Il n’y a personne qui veuille un bain de sang, déclarait-elle – sauf Spartakus ! La Grande Guerre a répandu bien trop de sang des ouvriers – mais Spartakus en veut plus !
Les médias de l’époque répandirent ces mensonges infâmes : Spartakus assassine, pille, recrute les soldats pour la contre-révolution et collabore avec l’Entente, reçoit de l’argent des capitalistes et prépare une dictature. Le SPD accusait Spartakus de ce qu’il était en train de faire lui-même !
La première grande chasse à l’homme du 20e siècle dans l’une des nations industrielles hautement "civilisées" d’Europe occidentale fut dirigée contre Spartakus. Et tandis que les capitalistes et les militaires de haut rang, offrant d’énormes récompenses pour la liquidation des chefs de Spartakus, préféraient garder l’anonymat, le SPD appela ouvertement à l’assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg dans la presse du parti. Contrairement à leurs nouveaux amis bourgeois, dans cette campagne, le SPD était animé non seulement par l’instinct de classe (bourgeois) et par des considérations stratégiques, mais également par une haine aussi éperdue que celle des Corps francs.
La bourgeoisie ne se laissa pas tromper par l’impression superficielle et fugitive du moment : Spartakus apparaissait comme un petit groupe, marginal. Elle savait que là battait le cœur du prolétariat et elle se prépara à porter son coup mortel.
Décembre 1918 : les premières victoires du prolétariat
L’offensive contre-révolutionnaire commença le 6 décembre à Berlin : une attaque dans trois directions. Un raid eut lieu sur le quartier général de la Rote Fahne ("Le drapeau rouge ") , le journal du Spartakusbund. Un autre groupe de soldats tenta d’arrêter les chefs de l’organe exécutif des conseils ouvriers qui étaient réunis en session. L’intention d’éliminer les conseils en tant que tels était claire. Au coin de la rue, un autre groupe de soldats appelait complaisamment Ebert à interdire le Conseil exécutif. Et une embuscade fut tendue à une manifestation de Spartakus près du centre ville, à Chausseestrasse : 18 morts, 30 blessés. Le courage et l’ingéniosité du prolétariat permit d’éviter le pire. Tandis que les chefs de l’exécutif des conseils parvinrent à discuter longuement avec les soldats impliqués dans cette action, un groupe de prisonniers de guerre russes, arrivant par derrière le long de Friedrichstrasse, surprit et maîtrisa les mitrailleurs à mains nues. 3
Le jour suivant, Karl Liebknecht échappa à une tentative de kidnapping et d’assassinat dans les locaux de la Rote Fahne. C’est son sang-froid qui lui permit de sauver sa vie à cette occasion.
Ces actes provoquèrent les premières gigantesques manifestations du prolétariat berlinois de solidarité avec Spartakus. A partir de ce moment là, toutes les manifestations du Spartakusbund étaient armées, menées par des camions portant des batteries de mitrailleuses. Au même moment, la gigantesque vague de grèves qui avait éclaté fin novembre dans les régions d’industrie lourde de Haute Silésie et de la Ruhr, s’intensifia face à ces provocations.
La cible suivante de la contre-révolution était la Volksmarinedivision (Division de la Marine du peuple) composée de marins armés qui avait marché depuis les ports de la côte sur la capitale pour répandre la révolution. Pour les autorités, sa présence même était une provocation, d’autant plus que, depuis lors, elle occupait le Palais des vénérés rois de Prusse. 4
Cette fois-ci, le SPD prépara le terrain plus soigneusement. Il attendit les résultats du Congrès national des conseils qui se prononça pour remettre le pouvoir au gouvernement social-démocrate et pour la convocation d’une assemblée nationale. Une campagne médiatique accusa les marins de maraude et de pillage. C’étaient des criminels, des spartakistes !
Au matin du 24 décembre, à la veille de Noël, le gouvernement présenta un ultimatum aux 28 marins qui tenaient le palais et aux 80 autres qui se trouvaient dans le Marstall (l’arsenal) 5 : reddition sans condition. La garnison mal armée jura de se battre jusqu’au dernier. Dix minutes plus tard exactement (il n’y eut même pas le temps d’évacuer des bâtiments les femmes et les enfants), le grondement de l’artillerie commença, réveillant la ville.
"Malgré toute la ténacité des marins, ce ne pouvait être qu’une bataille perdue puisqu’ils étaient très mal armés – où que la bataille ait pris place. Mais elle eut lieu au centre de Berlin. Il est bien connu que, dans les batailles, les rivières, les collines, les difficultés topographiques jouent un rôle important. A Berlin, les difficultés topographiques étaient les êtres humains.
Quand les canons se mirent à gronder, fièrement et très fort, les civils sortirent de leur sommeil et ils comprirent immédiatement ce que les canons disaient." 6
Contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France, l’Allemagne n’était pas une monarchie depuis longtemps centralisée. Contrairement à Londres ou à Paris, Berlin n’était pas devenue une métropole mondiale développée sous la conduite d’un plan gouvernemental. Comme la vallée de la Ruhr, Berlin avait poussé comme un cancer. Il en résultait que les quartiers gouvernementaux finirent par être encerclés sur trois côtés par une "ceinture rouge ", de gigantesques quartiers ouvriers. 7 Les ouvriers armés se précipitèrent sur les lieux pour défendre les marins. Les femmes et les enfants de la classe ouvrière se mirent entre les mitrailleuses et leurs cibles, uniquement armés de leur courage, de leur humour et de leur capacité de persuasion. Les soldats jetèrent leurs armes et désarmèrent les officiers.
Le jour suivant, la manifestation la plus massive dans la capitale depuis le 9 novembre prit possession du centre ville – cette fois-ci contre le SPD pour défendre la révolution. Le même jour, des groupes d’ouvriers occupèrent les bureaux du Vorwärts, le quotidien du SPD. Il ne fait pas de doute que cette action fût le résultat spontané de la profonde indignation du prolétariat. Pendant des décennies, le Vorwärts avait été le porte-parole de la classe ouvrière – jusqu’a ce que la direction du SPD l’en dépossède pendant la guerre mondiale. Il était maintenant devenu l’organe le plus honteux et le plus malhonnête de la contre-révolution.
Le SPD vit immédiatement la possibilité d’exploiter cette situation par une nouvelle provocation, en commençant par une campagne contre une prétendue "attaque contre la liberté de la presse ". Mais les délégués révolutionnaires, les Öbleute, se ruèrent au quartier général du Vorwärts pour persuader ceux qui l’occupaient qu’il était tactiquement plus sage de se retirer temporairement afin d’éviter une confrontation prématurée. (voir note 26)
L’année se termina donc par une autre manifestation de détermination révolutionnaire : l’enterrement des 11 marins tués dans la bataille du Marstall. Le même jour, la gauche de l’USPD quitta la coalition gouvernementale avec le SPD. Et, tandis que le gouvernement de Ebert envisageait de fuir la capitale, le Congrès de fondation du KPD commençait.
L’affaire Eichhorn et la deuxième occupation du Vorwärts
Les événements de décembre 1918 révélaient que la révolution commençait à s’affermir en profondeur. La classe ouvrière gagna les premières confrontations de la nouvelle phase tant par l’audace de ses réactions que par la sagesse de ses retraits tactiques. Le SPD avait finalement commencé à dévoiler sa nature contre-révolutionnaire aux yeux de l’ensemble de la classe. Il s’avéra vite que la stratégie bourgeoise de provocation était difficile à réaliser et même dangereuse.
Le dos au mur, la classe dominante tira les leçons de ces premières escarmouches avec une lucidité remarquable. Elle prit conscience que cibler directement et massivement les symboles et les figures auxquels s’identifiait la révolution – Spartakus, la direction des conseils ouvriers ou la division des marins – pouvait s’avérer contre-productif en provoquant la solidarité de l’ensemble de la classe ouvrière. Il valait mieux s’en prendre à des figures de second ordre qui susciteraient le soutien d’une partie de la classe seulement, ce qui permettrait ainsi de diviser les ouvriers de la capitale et de les isoler du reste du pays. Emil Eichhorn constituait une telle figure ; il appartenait à l’aile gauche de l’USPD. Un caprice du destin, paradoxe tel qu’en produit toute grande révolution, avait fait de lui le président de la police de Berlin. Dans cette fonction, il avait commencé à distribuer des armes aux milices ouvrières. C’était une provocation pour la classe dominante. Cibler cet homme aiderait à galvaniser les forces de la contre-révolution qui titubaient encore de ces premiers revers. En même temps, la défense d’un chef de la police constituait une cause ambiguë pour mobiliser les forces révolutionnaires ! Mais la contre-révolution avait une deuxième provocation dans sa manche, non moins ambiguë et comportant tout autant de potentiel pour diviser la classe ouvrière et la faire hésiter. La direction du SPD avait bien vu que la brève occupation des bureaux du Vorwärts avait choqué les ouvriers sociaux-démocrates. La plupart de ces ouvriers étaient honteux du contenu de ce journal mais ils étaient préoccupés par autre chose : le spectre d’un conflit militaire entre ouvriers sociaux-démocrates et ouvriers communistes – menace agitée en couleurs criardes par le SPD – qui pourrait résulter de ce genre d’actions d’occupation. Cette inquiétude pesait d’autant plus lourd – la direction du SPD le savait – qu’elle avait pour motif une réelle préoccupation prolétarienne de défendre l’unité de la classe.
Toute la machine de la provocation se mit à nouveau en marche.
Un torrent de mensonges : Eichhorn est corrompu, c’est un criminel payé par les Russes qui prépare un putsch contre-révolutionnaire !
Un ultimatum : Eichhorn doit démissionner immédiatement ou être forcé à le faire !
L’étalage de la force brute : Cette fois-ci, 10 000 hommes de troupe furent postées au centre de la ville, 80 000 autres rassemblés dans le voisinage. Ce dispositif militaire comprenait les divisions d’élite hautement disciplinées du général Maercker, des troupes d’infanterie, une "brigade de fer" postée sur la côte, des milices des quartiers bourgeois et les premiers Corps francs. Mais elles comprenaient aussi la "Garde républicaine ", milice armée du SPD, et d’importantes troupes du contingent qui sympathisaient avec la social-démocratie.
Le piège était prêt à se refermer.
Le piège fatal de janvier 1919
Comme la bourgeoisie s’y attendait, l’attaque contre Eichhorn ne mobilisa pas les troupes de la capitale qui sympathisaient avec la révolution. Elle ne mobilisa pas non plus les ouvriers des provinces où le nom de Eichhorn n’était pas connu. 8
Mais, dans la nouvelle situation, il existait une composante qui prit tout le monde par surprise. Ce fut la massivité et l’intensité de la réaction du prolétariat de Berlin. Le dimanche 5 janvier, 150 000 personnes répondirent à l’appel des Öbleute à manifester face à la police sur Alexanderplatz. Le lendemain, plus d’un demi million d’ouvriers posèrent leurs outils et prirent possession du centre ville. Ils étaient prêts à se battre et à mourir. Ils avaient immédiatement compris que la vraie question n’était pas Eichhorn mais la défense de la révolution.
Bien que déconcertée par la puissance de cette réponse, la contre-révolution eut assez de sang-froid pour poursuivre ses plans. Les locaux du Vorwärts furent de nouveau occupés mais aussi d’autres bureaux de presse de la ville. Cette fois, c’étaient les agents provocateurs de la police qui en avaient pris l’initiative. 9
Le jeune KPD lança immédiatement un avertissement à la jeune classe ouvrière. Dans un tract et dans les articles de première page de la Rote Fahne, il appelait le prolétariat à élire de nouveaux délégués à ses conseils et à s’armer mais, aussi, à prendre conscience que le moment de l’insurrection armée n’était pas encore venu. Une telle insurrection requérait une direction centralisée au niveau de tout le pays. Seuls des conseils ouvriers où les révolutionnaires domineraient, pourraient la fournir.
Le matin du 5 janvier, les chefs révolutionnaires se réunirent dans le quartier général de Eichhorn pour se consulter. Environ 70 Öbleute étaient présents dont, en gros, 80% soutenaient la gauche de l’USPD, les autres le KPD. Les membres du comité central de l’organisation berlinoise de l’USPD étaient venus ainsi que deux membres du comité central du KPD : Karl Liebknecht et Wilhelm Pieck.
Au départ, les délégués des organisations ouvrières n’étaient pas sûrs de la façon dont il fallait riposter. Puis l’atmosphère changea, électrisée par les rapports qui arrivaient. Ceux-ci concernaient les occupations armées dans le quartier de la presse et la prétendue préparation des différentes garnisons à se joindre à l’insurrection armée. Liebknecht déclara alors que, dans ces circonstances, il était nécessaire non seulement de repousser l’attaque contre Eichhorn mais de lancer l’insurrection armée.
Les témoins oculaires de cette réunion dramatique indiquent que l’intervention de Liebknecht constitua le tournant fatal. Durant toute la guerre, il avait représenté la boussole et la conscience morale du prolétariat allemand et même mondial. Maintenant, à ce moment crucial de la révolution, il perdit la tête et ses repères. Par dessus tout, il prépara la voie aux Unabhängigen, les indépendants, qui étaient toujours la principale force à ce moment. Manquant de principes politiques clairement définis, d’une perspective claire et à long terme et d’une confiance profonde dans la cause du prolétariat, ce courant "indépendant" était condamné à vaciller constamment sous la pression de la situation immédiate et donc à concilier avec la classe dominante. Mais le revers de ce "centrisme" était le besoin fortement ressenti de participer à n’importe quelle "action" peu claire à l’ordre du jour, ne serait-ce que pour montrer sa propre détermination révolutionnaire.
"Le parti indépendant n’avait pas de programme politique clair ; mais il n‘avait aucune intention de renverser le gouvernement Ebert-Scheidemann. A cette conférence, les décisions étaient aux mains des indépendants. Et à ce moment-là il apparut clairement que les figures hésitantes qui siégeaient au comité du parti de Berlin et n’aimaient pas en temps normal prendre des risques mais voulaient en même temps participer à tout, s’avérèrent les plus grands brailleurs, se présentant de la façon la plus "révolutionnaire" possible". 10
Selon Richard Müller, il y eut une sorte de surenchère entre les chefs de l’USPD et la délégation du KPD. "A présent les indépendants voulaient montrer leur courage et leur sérieux en surenchérissant sur les objectifs proposés par Liebknecht. Liebknecht pouvait-il se retenir, face au "feu révolutionnaire" de ces "éléments vacillants et hésitants" ? Ce n’était pas dans sa nature." (Ibid.)
On n’écouta pas les avertissements des délégués de soldats qui exprimèrent des doutes sur la préparation des troupes à la lutte.
"Richard Müller s’exprima de la façon la plus tranchante contre l’objectif proposé, le renversement du gouvernement. Il souligna qu’il n’existait ni les conditions politiques ni les conditions militaires. Le mouvement grandissait jour après jour dans le pays, aussi très rapidement les conditions politiques, militaires et psychologiques seraient atteintes. Une action prématurée et isolée à Berlin pourrait remettre en cause cette évolution ultérieure. Ce n’est qu’avec difficulté qu’il put exprimer ce rejet face à des objections venant de toutes parts.
Pieck, en tant que représentant du comité central du KPD, s’exprima fortement contre Richard Müller et demanda, en termes très précis, un vote immédiat et que la lutte soit engagée." 11
Trois décisions majeures furent mises au vote et adoptées. L’appel à la grève générale fut adopté à l’unanimité. Les deux autres décisions, l’appel à renverser le gouvernement et à poursuivre l’occupation des bureaux de presse, furent adoptées par une large majorité mais avec six voix contre. 12
Un "comité provisoire d’action révolutionnaire" fut alors constitué comportant 53 membres et trois présidents : Liebknecht, Ledebour et Scholze.
Maintenant, le prolétariat était pris au piège.
La semaine dite de Spartakus
Il allait s’ensuivre ce qui devait devenir "la semaine sanglante" à Berlin. La bourgeoisie l’appela "la semaine Spartakus" : un "putsch communiste" a été déjoué par les "héros de la liberté et de la démocratie ". Le destin de la révolution mondiale se joua en bonne partie cette semaine là, du 5 au 12 janvier 1919.
Le matin qui suivit la constitution du comité révolutionnaire, la grève était quasiment totale dans la ville. Un nombre d’ouvriers encore plus grand que la veille se répandit au centre ville, beaucoup d’entre eux étaient armés. Mais à midi, tous les espoirs d’un soutien actif des garnisons s’étaient évaporés. Même la division des marins, légende vivante, se déclara neutre et alla même jusqu’à arrêter son propre délégué, Dorrenbach, pour ce qu’elle considérait être sa participation irresponsable à l’appel à l’insurrection. Le même après-midi, la même Volksmarinedivision fit sortir le comité révolutionnaire du Marstall où il avait cherché refuge. De même, les mesures concrètes pour déloger le gouvernement furent contrecarrées ou même ignorées, puisque visiblement aucune puissance armée ne les soutenait ! 13
Toute la journée, les masses furent dans la rue, attendant des instructions de leurs dirigeants. Mais celles-ci ne venaient pas. L’art de réussir des actions de masse consiste dans la concentration et l’orientation de l’énergie vers un but qui dépasse le point de départ, qui fait avancer le mouvement général, qui donne à ses participants le sentiment d’un succès et d’une force collectifs. Dans la situation d'alors, la simple répétition de la grève et des manifestations de masse des jours précédents ne suffisait pas. Un pas en avant aurait été, par exemple, l’encerclement des casernes et l’agitation envers elles afin de gagner les soldats à la nouvelle étape de la révolution, à désarmer les officiers, à commencer un armement plus large des ouvriers eux-mêmes. 14 Mais le comité révolutionnaire auto-proclamé ne proposa pas ces mesures, entre autres du fait qu’il avait déjà mis en avant un ensemble d’actions plus radicales mais malheureusement irréalistes. Après avoir appelé à rien moins que l’insurrection armée, des mesures plus concrètes mais bien moins spectaculaires seraient apparues comme une déconvenue, une attente déçue, un recul. Le comité, et le prolétariat avec lui, étaient prisonniers d’un radicalisme erroné et vide.
La direction du KPD fut horrifiée quand elle reçut les nouvelles de la proposition d’insurrection. Rosa Luxemburg et Leo Jogiches en particulier accusèrent Liebknecht et Pieck d’avoir abandonné non seulement les décisions du Congrès du parti mais le programme du parti lui-même. 15
Mais on ne pouvait défaire ces erreurs et, comme telles, elles n’étaient pas (encore) la question de l’heure. Le cours des événements plaça le parti face à un terrible dilemme : comment sortir le prolétariat du piège où il était déjà pris ?
Cette tâche était bien plus difficile que celle qu’avaient accomplie les Bolcheviks au cours des célèbres "journées de juillet" de 1917 en Russie, quand le parti était parvenu à aider la classe ouvrière à éviter le piège d’une confrontation militaire prématurée.
La réponse étonnante, paradoxale que trouva le parti, sous l’impulsion de Rosa Luxemburg, fut la suivante. Le KPD, opposant le plus déterminé à une révolution armée jusqu’ici, devait devenir son protagoniste le plus fervent. Pour une simple raison. Prendre le pouvoir à Berlin était le seul moyen d’empêcher le massacre sanglant devenu maintenant imminent, d’empêcher la décapitation du prolétariat allemand. Une fois ce problème réglé, le prolétariat de Berlin pourrait s’attaquer à celui de tenir ou de reculer en bon ordre jusqu’à ce que la révolution soit mûre dans l’ensemble du pays.
Karl Radek, émissaire du parti russe, caché à Berlin, proposa une orientation alternative : retrait immédiat tout en gardant les armes mais, si nécessaire, en les rendant. Mais la classe dans son ensemble n’avait pas encore d’armes. Le problème était que l’apparition d’un "putsch" communiste "non démocratique" fournissait au gouvernement le prétexte dont il avait besoin pour imposer un bain de sang. Aucun recul des combattants ne pouvait défaire cela.
Le cours de l’action qu’avait proposé Rosa Luxemburg, était basé sur l’analyse que le rapport de forces militaire dans la capitale n’était pas défavorable au prolétariat. Et, en réalité, si le 6 janvier détruisit les espoirs que mettait le comité révolutionnaire dans "ses" troupes, il fut rapidement clair que la contre-révolution aussi avait mal calculé. La Garde républicaine et les troupes qui sympathisaient avec le SPD refusaient maintenant d’utiliser la force contre les ouvriers révolutionnaires. Dans leurs comptes-rendus des événements, le révolutionnaire Richard Müller et le contre-révolutionnaire Gustav Noske confirmèrent tous deux ultérieurement la justesse de l’analyse de Rosa Luxemburg : du point de vue militaire, le rapport de force au début de la semaine était en faveur du prolétariat.
Mais la question décisive n’était pas le rapport de force militaire mais le rapport de force politique. Et celui-ci pesait contre le prolétariat pour la simple raison que la direction du mouvement était toujours aux mains des "centristes ", des éléments hésitants et pas encore à celles des révolutionnaires conséquents. Selon "l’art de l’insurrection" marxiste, l’insurrection armée est la dernière étape du processus de renforcement de la révolution et elle balaie simplement les derniers postes de résistance.
Prenant conscience du piège dans lequel il s’était mis lui-même, le comité provisoire, au lieu d’armer le prolétariat, commença à négocier avec le gouvernement qu’il venait de déclarer déchu et sans même savoir ce qu’il voulait négocier. Face à cette attitude du comité, le KPD obligea Liebknecht et Pieck d’en démissionner le 10 janvier. Mais le mal était fait. La politique de conciliation paralysa le prolétariat, faisant remonter à la surface tous ses doutes et ses hésitations. Les ouvriers de toute une série d’usines importantes sortirent avec des déclarations qui condamnaient le SPD mais également Liebknecht et les "Spartakistes ", appelant à la réconciliation des "partis socialistes ".
A ce moment où la contre-révolution titubait, le social-démocrate Noske vint à la rescousse. "Il faut que quelqu’un joue le rôle du chien sanglant. Je n’ai pas peur de la responsabilité ", déclara-t-il. Tout en prétendant "négocier" pour gagner du temps, le SPD convoqua ouvertement les officiers, les étudiants, les milices bourgeoises pour noyer la résistance ouvrière dans le sang. Avec le prolétariat divisé et démoralisé, la voie était maintenant ouverte à la terreur blanche la plus sauvage. Les atrocités comportèrent le bombardement des bâtiments par l’artillerie, le meurtre des prisonniers et même des délégués venus négocier, le lynchage des ouvriers mais aussi des soldats ayant serré la main aux révolutionnaires, la persécution des femmes et des enfants dans les quartiers ouvriers, la profanation des cadavres mais aussi la chasse systématique et le meurtre de révolutionnaires comme Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Nous reviendrons sur la nature et la signification de cette terreur dans le dernier article de cette série.
La grève de masse révolutionnaire, janvier - mars 1919
Dans un célèbre article publié dans la Rote Fahne le 27 novembre 1918, "L’Achéron s’est mis en mouvement ", Rosa Luxemburg annonçait le début d’une nouvelle phase de la révolution : celle de la grève de masse. Cela allait se confirmer rapidement de façon éclatante. La situation matérielle de la population ne s’était pas améliorée avec la fin de la guerre, au contraire. L’inflation, les licenciements, le chômage massif, le travail précaire et la chute des salaires réels créèrent une nouvelle misère pour des millions d’ouvriers, de fonctionnaires mais aussi pour de larges couches des classes moyennes. De plus en plus, la misère matérielle mais aussi la déception amère vis-à-vis des résultats de la révolution de novembre poussaient les masses à se défendre. Les estomacs vides constituaient un puissant argument contre les prétendus bénéfices de la nouvelle démocratie bourgeoise. Des vagues de grèves successives parcoururent le pays, surtout pendant le premier trimestre 1919. Bien loin des centres traditionnels du mouvement socialiste organisé comme Berlin, les ports côtiers ou les secteurs du génie civil et de la haute technologie 16, des parties du prolétariat politiquement moins expérimentées furent entraînées dans le processus révolutionnaire. Elles comprenaient ceux que Rosa Luxemburg, dans sa brochure sur la grève de masse, appelait "la masse des Ilotes". C’étaient des secteurs particulièrement opprimés de la classe ouvrière qui n’avaient bénéficié d’aucune éducation socialiste et qui, de ce fait, étaient souvent regardés de haut par les fonctionnaires de la social-démocratie et des syndicats avant la guerre. Rosa Luxemburg avait prédit qu’ils joueraient un rôle majeur dans la lutte future pour le socialisme.
Et maintenant, ils étaient là. Par exemple, des millions de mineurs, de sidérurgistes, d’ouvriers du textile des régions industrielles du Bas-Rhin et de Westphalie. 17 Là, les luttes ouvrières défensives s’affrontèrent immédiatement à l’alliance brutale des patrons et des gardes armés de leurs usines, des syndicats et des Corps francs. A partir de ces premières confrontations se cristallisèrent deux principales revendications du mouvement de grève, formulées à la conférence des délégués de toute la région début février à Essen : tout le pouvoir aux conseils d’ouvriers et de soldats ! Socialisation des usines et des mines ! La situation s’exacerba lorsque les militaires tentèrent de désarmer et de démanteler les conseils de soldats et envoyèrent 30 000 membres des Corps francs occuper la Ruhr. Le 14 février, les conseils d’ouvriers et de soldats appelèrent à la grève générale et à la résistance armée. La détermination et la mobilisation des ouvriers étaient si grandes que l’armée blanche mercenaire n’osa même pas attaquer. L’indignation contre le SPD qui soutenait ouvertement les militaires et dénonçait la grève, fut indescriptible. A tel point que le 25 février, les conseils - soutenus par les délégués communistes – décidèrent de mettre fin à la grève. Les dirigeants avaient peur que les ouvriers inondent les mines ou attaquent les ouvriers sociaux-démocrates. 18 En fait, les ouvriers montrèrent un haut degré de discipline et une large minorité respecta l’appel à la reprise du travail – même si elle n’était pas d’accord avec cette décision. Malheureusement c’était le moment où la grève commençait en Allemagne centrale !
Une deuxième grève de masse gigantesque éclata vers la fin mars et dura plusieurs semaines malgré la répression des Corps francs.
"Très vite il apparut clairement que le Parti social-démocrate et les dirigeants syndicaux avaient perdu de leur influence sur les masses. La puissance du mouvement révolutionnaire des mois de février et mars ne résidait pas dans la possession ni dans l’utilisation des armes, mais dans la possibilité de retirer au gouvernement socialiste bourgeois son fondement économique en paralysant les aires de production les plus importantes. (…) L’énorme mobilisation militaire, l’armement de la bourgeoisie, la brutalité de la soldatesque ne purent briser cette puissance, ne purent forcer les ouvriers en grève à rentrer au travail." 19
Le second grand centre de la grève de masse était la région connue sous le nom d’Allemagne centrale (Mitteldeutschland). 20 Là le mouvement de grève explosa à la mi-février, pas seulement en réponse à la paupérisation et à la répression, mais aussi en solidarité avec les victimes de la répression à Berlin et avec les grèves du Rhin et de la Ruhr. Comme dans la région précédente, le mouvement tira sa force de sa direction par les conseils d’ouvriers et de soldats au sein desquels les sociaux-démocrates perdaient rapidement leur influence.
Mais, alors que dans la région de la Ruhr, les ouvriers de l’industrie lourde formaient l'essentiel des troupes, ici le mouvement incorpora non seulement les mineurs, mais quasiment toutes les professions et les branches d’industrie. Pour la première fois depuis le début de la révolution, les cheminots se joignirent au mouvement. Cela revêtait une importance particulière. L’une des premières mesures du gouvernement Ebert à la fin de la guerre avait été d’augmenter les salaires des cheminots de façon substantielle. La bourgeoisie avait besoin de "neutraliser" ce secteur pour pouvoir transporter ses brigades contre-révolutionnaires d’un bout à l’autre de l’Allemagne. Maintenant, pour la première fois, cette possibilité était mise en question.
Tout aussi significatif était le fait que les soldats des garnisons sortirent pour soutenir les grévistes. L’Assemblée nationale qui avait fui les ouvriers de Berlin, se déplaça à Weimar pour y tenir sa session parlementaire constitutive. Elle arriva en plein milieu d’une lutte de classe aiguë et de soldats hostiles, et dut se réunir derrière un rempart protecteur de pièces d’artillerie et de mitrailleuses. 21
L’occupation sélective des villes par les Corps francs provoqua des batailles de rue à Halle, Merseburg et Zeitz, des explosions des masses "enragées jusqu’à la folie" comme l’écrit Richard Müller. Comme dans la Ruhr, ces actions militaires ne parvinrent pas à briser le mouvement de grèves.
L’appel des délégués d’usines à la grève générale le 24 février devait révéler un autre développement extrêmement significatif. Les délégués soutinrent cet appel à l’unanimité, y compris ceux du SPD. En d’autres termes, la social-démocratie perdait de son contrôle même parmi ses membres.
"Dès le départ, la grève s’étendit au maximum. Il n’y avait pas d’intensification possible sinon par l’insurrection armée que les grévistes rejetaient et qui semblait injustifiée. Le seul moyen de rendre la grève plus efficace passait par les ouvriers de Berlin." 22
C’est ainsi que les ouvriers appelèrent le prolétariat de Berlin à rejoindre, à diriger en fait, le mouvement qui embrasait le centre de l’Allemagne, le Rhin et la Ruhr.
Et les ouvriers de Berlin répondirent du mieux qu’ils purent malgré la défaite qu’ils venaient de subir. Là, le centre de gravité était passé de la rue aux assemblées massives. Les débats qui eurent lieu dans les usines, les bureaux et les casernes avaient pour effet d’affaiblir continuellement l’influence du SPD et le nombre de ses délégués dans les conseils ouvriers. Les tentatives du parti de Noske de désarmer les soldats et de liquider leurs organisations ne firent qu’accélérer ce processus. Une assemblée générale des conseils ouvriers à Berlin le 28 février appela tout le prolétariat à défendre ses organisations et à se préparer à la lutte. La tentative du SPD d’empêcher cette résolution fut déjouée par ses propres délégués.
L’assemblée réélut son comité d’action. Le SPD perdit sa majorité. Lors de l’élection suivante du comité, le KPD avait presque autant de délégués que le SPD ; dans les conseils à Berlin, le cours s’orientait en faveur de la révolution. 23
Prenant conscience que le prolétariat ne pourrait vaincre que s’il était dirigé par une organisation unie et centralisée, l’agitation de masse pour la réélection des conseils d’ouvriers et de soldats dans tout le pays et pour la tenue d’un nouveau congrès national des conseils commença. Malgré l’opposition hystérique du gouvernement et du SPD à cette proposition, les conseils de soldats commencèrent à se déclarer en faveur de cette dernière. Les sociaux-démocrates misèrent sur le temps, pleinement conscients des difficultés pratiques pour mettre en œuvre ces projets.
Mais le mouvement à Berlin était confronté à une autre question très pressante : l’appel à soutenir les ouvriers d’Allemagne centrale. L’assemblée générale des conseils ouvriers de Berlin se réunit le 3 mars pour décider de cette question. Le SPD, sachant que le cauchemar de la semaine sanglante de janvier hantait toujours le prolétariat de la capitale, était déterminé à empêcher une grève générale. Et en fait, au départ, les ouvriers hésitèrent. Par leur agitation pour apporter la solidarité à l’Allemagne centrale, les révolutionnaires renversèrent peu à peu le cours. Des délégations de toutes les principales usines de la ville furent envoyées à l’assemblée des conseils pour l’informer que les assemblées sur les lieux de travail avaient déjà décidé d’arrêter le travail. Il devint clair que les communistes et les indépendants de gauche avaient la majorité des ouvriers derrière eux.
A Berlin aussi, la grève était quasiment totale. Le travail ne continua que dans les usines désignées par les conseils ouvriers pour le faire (les pompiers, les fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz, la santé, la production alimentaire). Le SPD - et son porte-parole le Vorwärts - dénonça immédiatement la grève, appelant les délégués membres du parti à faire de même. Ces délégués prirent alors position contre celle de leur propre parti. De plus, les imprimeurs qui étaient sous forte influence social-démocrate, avaient été parmi les rares professions à ne pas rejoindre le front des grévistes ; maintenant ils le faisaient pour protester contre l’attitude du SPD. De cette façon, la campagne de haine fut en grande partie réduite au silence.
Malgré tous ces signes de maturation, le traumatisme de janvier s’avéra fatal. La grève générale à Berlin arriva trop tard, au moment même où elle prenait fin en Allemagne centrale. Pire même. Les communistes, traumatisés en fait par la défaite de janvier, refusèrent de participer à la direction de la grève aux côtés des sociaux-démocrates. L’unité du front de la grève commença à s’effriter. La division et la démoralisation se répandirent.
C’était le moment pour les Corps francs d’envahir Berlin. Tirant les leçons des événements de janvier, les ouvriers se réunirent dans les usines et pas dans la rue. Mais au lieu d’attaquer immédiatement les ouvriers, les Corps francs marchèrent d’abord sur les garnisons et les conseils de soldats, d’abord contre les régiments qui avaient participé à réprimer les ouvriers en janvier ; ceux qui jouissaient le moins de la sympathie des travailleurs. Ce n’est qu’après qu’ils se tournèrent contre le prolétariat. Comme en janvier, il y eut des exécutions sommaires dans les rues, des révolutionnaires furent assassinés (parmi lesquels Leo Jogiches) ; les cadavres étaient jetés dans la Spree. Cette fois, la terreur blanche fut encore plus féroce qu’en janvier et monta à bien plus que 1000 morts. Le quartier ouvrier de Lichtenberg, à l’Est du centre ville, fut bombardé par l’aviation.
Sur les luttes de janvier - mars, Richard Müller écrit : "Ce fut le soulèvement le plus gigantesque du prolétariat allemand, des ouvriers, des employés, des fonctionnaires et même des parties des classes moyennes petites bourgeoises, à une échelle jamais vue auparavant et atteinte une seule fois par la suite pendant le putsch de Kapp. Les masses populaires étaient en grève générale non seulement dans les régions d’Allemagne sur lesquelles on s’est centré, mais en Saxe, en Bade, en Bavière ; partout les vagues de la révolution socialiste battaient les murs de la production capitaliste et de la propriété. Les masses ouvrières avançaient à grands pas sur la route poursuivant la transformation politique de novembre 1918." 24
Cependant, "le cours pris par les événements de janvier pesait toujours sur le mouvement révolutionnaire. Son début absurde et ses conséquences tragiques avaient brisé les ouvriers de Berlin et il fallut des semaines de travail opiniâtre pour les rendre capables d’entrer à nouveau en lutte. Si le putsch de janvier n’avait pas eu lieu, le prolétariat de Berlin aurait pu porter assistance à temps aux combattants du Rhin, de Westphalie et d’Allemagne centrale. La révolution se serait poursuivie et la nouvelle Allemagne aurait montré une face économique et politique tout à fait différente." 25
La révolution aurait-elle pu triompher ?
L’incapacité du prolétariat mondial à empêcher la Première Guerre mondiale créa des conditions difficiles pour la victoire de la révolution. En comparaison avec une révolution répondant avant tout à une crise économique, une révolution contre la guerre mondiale comporte des inconvénients considérables. D’abord, la guerre avait tué ou blessé des millions de travailleurs ; beaucoup d’entre eux étaient des socialistes expérimentés ayant une conscience de classe. Deuxièmement, contrairement à la crise économique, la bourgeoisie peut mettre fin à la guerre si elle voit que sa poursuite menace son système. C’est ce qui est arrivé en 1918. Cela a créé des divisions entre les ouvriers de chaque pays, entre ceux qui se contentaient de la fin des hostilités et ceux pour qui seul le socialisme pouvait résoudre le problème. Troisièmement, le prolétariat international était divisé, d’abord par la guerre elle-même, ensuite entre les ouvriers des pays "vaincus" et ceux des pays "vainqueurs ". Ce n’est pas par hasard si une situation révolutionnaire s’est développée dans les pays où la guerre était perdue (la Russie, l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne) et non dans les pays de l’Entente (la Grande-Bretagne, la France, les Etats-Unis).
Mais cela veut-il dire qu’une révolution prolétarienne victorieuse, dans ces circonstances, était impossible dès le départ ? Rappelons que c’était l’un des principaux arguments avancés par la social-démocratie pour justifier son rôle contre-révolutionnaire. Mais en réalité, c’était loin d’être le cas.
D’abord, bien que la "Grande Guerre" ait décimé physiquement et affaibli psychologiquement le prolétariat, cela n’empêcha pas la classe ouvrière de lancer un assaut puissant contre le capitalisme. Le carnage imposé était immense, mais moins que celui infligé par la suite par la Seconde Guerre mondiale ; et il n’y a pas de comparaison possible avec ce qu’une troisième guerre mondiale avec des armes thermonucléaires signifierait.
Deuxièmement, bien que la bourgeoisie ait pu mettre fin à la guerre, cela ne veut pas dire qu’elle pouvait en éliminer les conséquences matérielles et politiques. Parmi ces conséquences, il y avait l’épuisement de l’appareil productif, la désorganisation de l’économie et la surexploitation de la classe ouvrière en Europe. Dans les pays vaincus en particulier, la fin de la guerre ne mena pas à une restauration rapide du niveau de vie d’avant-guerre pour les masses de la population. Au contraire. Bien que la revendication de la "socialisation de l’industrie" ait contenu le danger de dévoyer la classe ouvrière de la lutte pour le pouvoir vers une sorte de projet autogestionnaire ayant la faveur de l’anarchisme et de l’anarcho-syndicalisme, en 1919 en Allemagne, la force principale derrière cette revendication était la préoccupation de la survie physique du prolétariat. Les ouvriers, de plus en plus convaincus de l’incapacité du capitalisme à produire assez de biens alimentaires, de charbon, etc. à des prix abordables pour que la population puisse passer l’hiver, commencèrent à se rendre compte qu’une force de travail sous-alimentée et épuisée, menacée d’épidémies et d’infection, devait prendre cette question en main, avant qu’il ne soit trop tard.
En ce sens, les luttes qui s'étaient développées contre la guerre ne se terminèrent pas avec la guerre elle-même. De plus, l’impact de la guerre sur la conscience de classe était profond. Il ôtait à la guerre moderne son image d’héroïsme.
Troisièmement, la brèche entre les ouvriers des pays "vainqueurs" et "vaincus" n’était pas insurmontable. En Grande-Bretagne en particulier, il y eut de puissants mouvements de classe à la fois pendant et à la fin de la guerre. L’aspect le plus frappant de 1919, "année de la révolution" en Europe centrale, était l’absence relative de la scène du prolétariat français. Où était cette partie de la classe qui, de 1848 à la Commune de Paris de 1871, avait été l’avant-garde de l’insurrection prolétarienne ? Dans une certaine mesure, il avait été contaminé par la frénésie chauvine de la bourgeoisie qui promettait à "ses" ouvriers une nouvelle ère de prospérité sur la base des réparations qu’elle allait imposer à l’Allemagne. N’y avait-il pas d’antidote à ce poison nationaliste ? Oui, il y en avait un. La victoire du prolétariat allemand aurait constitué cet antidote.
En 1919, l’Allemagne constituait la charnière indispensable entre la révolution à l’Est et la conscience de classe en sommeil à l’Ouest. La classe ouvrière européenne de 1919 avait été éduquée dans le socialisme. Sa conviction sur la nécessité et la possibilité du socialisme n’avait pas encore été minée par la contre-révolution stalinienne. La victoire de la révolution en Allemagne aurait sapé les illusions sur la possibilité d’un retour à la "stabilité" apparente du monde d’avant-guerre. La reprise par le prolétariat allemand de son rôle dirigeant dans la lutte de classe aurait énormément renforcé la confiance dans l’avenir du socialisme.
Mais la victoire de la révolution en Allemagne même était-elle une possibilité réaliste ? La révolution de novembre révéla la puissance et l’héroïsme de la classe mais, aussi, ses énormes illusions, ses confusions et ses hésitations. Pourtant, c’était tout autant le cas en février 1917 en Russie. Dans les mois qui suivirent février, le cours de la révolution russe a révélé la maturation progressive d’un immense potentiel qui a mené à la victoire d’Octobre. En Allemagne, à partir de novembre 1918 – malgré la fin de la guerre – on voit une maturation très similaire. Au cours du premier trimestre de 1919, nous avons vu le développement de la grève de masse, l’entrée de toute la classe ouvrière dans la lutte, le rôle croissant des conseils ouvriers et des révolutionnaires en leur sein, le début des efforts pour créer une organisation et une direction centralisées du mouvement, la mise à jour progressive du rôle contre-révolutionnaire du SPD et des syndicats ainsi que les limites de l’efficacité de la répression étatique.
Au cours de 1919, des soulèvements locaux et des "républiques des conseils" dans des villes côtières, en Bavière et ailleurs furent liquidés. Ces épisodes sont remplis d’exemples de l’héroïsme du prolétariat et d’amères leçons pour l’avenir. Pour l’issue de la révolution en Allemagne, ils ne furent pas décisifs. Les centres déterminants se trouvaient ailleurs. D’abord, dans l’énorme concentration industrielle de ce qui est, aujourd’hui, la province du Rhin-Westphalie. Aux yeux de la bourgeoisie, cette région était peuplée par une espèce sinistre vivant dans une sorte de sous-monde, qui ne voyait jamais la lumière du jour, qui vivait au-delà des frontières de la civilisation. La bourgeoisie fut horrifiée lorsqu’elle vit cette immense armée grise de villes tentaculaires, où le soleil ne brillait quasiment jamais et où la neige tombait noire, sortir des mines et des hauts fourneaux. Horrifiée, encore plus horrifiée même quand elle connut l’intelligence, la chaleur humaine, le sens de la discipline et de la solidarité de cette armée qui n’était plus, désormais, la chair à canon des guerres impérialistes mais le protagoniste de sa propre guerre de classe.
Ni en 1919, ni en 1920, la brutalité combinée des militaires et des Corps francs ne fut capable d’écraser cet ennemi sur son propre terrain. Il ne fut vaincu que lorsque, après avoir repoussé le putsch de Kapp en 1920, ces ouvriers commirent l’erreur d’envoyer leur "armée rouge de la Ruhr" hors des villes et des terrils mener une bataille conventionnelle. Ensuite, en Allemagne centrale avec sa classe ouvrière très ancienne et hautement qualifiée, baignée par la tradition socialiste. 26 Avant et pendant la guerre, des industries extrêmement modernes comme la chimie, l’aviation, y furent établies, attirant des dizaines de milliers de jeunes ouvriers inexpérimentés mais radicaux, combatifs, ayant un grand sens de la solidarité. Ce secteur aussi allait s’engager dans des luttes massives en 1920 (Kapp) et 1921 (l’Action de mars).
Mais si le Rhin, la Ruhr et l’Allemagne centrale étaient les poumons, le cœur et le tube digestif de la révolution, Berlin en était le cerveau. Troisième ville du monde par sa taille (après New York et Londres), Berlin était la "Silicon Valley" de l’Europe à l’époque. La base de son développement économique était l’ingéniosité de la force de travail, hautement qualifiée. Celle-ci avait une éducation socialiste de longue date et se trouvait au cœur du processus de formation du parti de classe.
La prise du pouvoir n’était pas encore à l’ordre du jour le premier trimestre 1919. La tâche de l’heure était de gagner du temps pour que la révolution mûrisse dans l’ensemble de la classe tout en évitant une défaite décisive. Le temps, à ce moment crucial, jouait en faveur du prolétariat. La conscience de classe s’approfondissait. Le prolétariat luttait pour constituer les organes nécessaires à sa victoire – le parti, les conseils. Les principaux bataillons de la classe rejoignaient la lutte.
Mais avec la défaite de janvier 1919 à Berlin, le facteur temps changea de camp, passant du côté de la bourgeoisie. La défaite de Berlin vint en deux temps : janvier et mars-avril 1919. Mais janvier fut déterminant car ce n’était pas seulement une défaite physique mais une défaite morale. L’unification des secteurs décisifs de la classe dans la grève de masse constituait la force capable de déjouer la stratégie de la contre-révolution et d’ouvrir la voie vers l’insurrection. Mais ce processus d’unification – similaire à ce qui eut lieu en Russie à la fin de l’été 1917 face au putsch de Kornilov – dépendait avant tout de deux facteurs : le parti de classe et les ouvriers de la capitale. La stratégie de la bourgeoisie consistant à infliger préventivement des blessures sérieuses à ces éléments décisifs, réussit. L’échec de la révolution en Allemagne face à ses propres "journées de Kornilov" fut avant tout le résultat de son échec face à la version allemande des "journées de juillet" 27.
La différence la plus frappante avec la Russie est l’absence d’un parti révolutionnaire capable de formuler et de défendre une politique lucide et cohérente face aux tempêtes inévitables de la révolution et aux divergences dans ses rangs. Comme nous l’avons écrit dans l’article précédent, la révolution pouvait triompher en Russie sans la constitution d’un parti de classe mondial, mais pas en Allemagne.
C’est pourquoi nous avons consacré un article entier de cette série au Congrès de fondation du KPD. Ce Congrès comprit beaucoup de questions, mais pas les questions brûlantes de l’heure. Bien qu'il ait formellement adopté l’analyse de la situation présentée par Rosa Luxemburg, en réalité trop de délégués sous-estimaient l’ennemi de classe. Tout en insistant énormément sur le rôle des masses, leur vision de la révolution était toujours influencée par les exemples des révolutions bourgeoises passées. Pour la bourgeoisie, la prise du pouvoir constituait le dernier acte de sa montée au pouvoir, préparée depuis longtemps par la montée de sa puissance économique. Comme le prolétariat en tant que classe exploitée, sans propriété, ne peut accumuler aucune richesse, il doit préparer sa victoire par d’autres moyens. Il doit accumuler la conscience, l’expérience, l’organisation. Il doit devenir actif et apprendre à prendre son destin en main. 28.
Le déroulement d’une révolution
Le mode de production capitaliste détermine la nature de la révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne révèle le secret du mode de production capitaliste. Etant passé par les étapes de la coopération, de la manufacture et de l’industrialisation, le capitalisme développe les forces productives qui sont la condition nécessaire à l’instauration d’une société sans classe. Elle le fait par l’établissement du travail associé. Le “travailleur collectif”, créateur de la richesse, est asservi aux rapports de propriété capitalistes par l’appropriation privée, compétitive et anarchique des fruits du travail associé. La révolution prolétarienne abolit la propriété privée, permettant au nouveau mode d’appropriation d’être conforme au caractère associé de la production. Sous la domination du capital, le prolétariat a depuis son origine créé les conditions de sa propre libération. Mais les fossoyeurs de la société capitaliste ne peuvent remplir leur mission historique que si la révolution prolétarienne est elle-même le produit du "travailleur collectif ", des ouvriers du monde agissant pour ainsi dire comme une seule personne. Le caractère collectif du travail salarié doit devenir l’association collective consciente de lutte.
Réunir dans la lutte à la fois l’ensemble de la classe et ses minorités révolutionnaires prend du temps. En Russie, cela prit une douzaine d’années, depuis la lutte pour "un nouveau type de parti de classe" en 1903, en passant par la grève de masse de 1905-1906 et la veille de la Première Guerre mondiale jusqu’aux exaltantes journées de 1917. En Allemagne et dans l’ensemble des pays occidentaux, le contexte de la guerre mondiale et de la brutale accélération de l’histoire qu’elle incarne, a accordé peu de temps à cette nécessaire maturation. L’intelligence et la détermination de la bourgeoisie après l’armistice de 1918 ont encore réduit le temps disponible pour celle-ci.
Nous avons plusieurs fois parlé, dans cette série d’articles, de l’ébranlement de la confiance en soi de la classe ouvrière et de son avant-garde révolutionnaire avec l’effondrement de l’Internationale socialiste face à l’éclatement de la guerre. Que voulions-nous dire ?
La société bourgeoise conçoit la question de la confiance en soi du point de vue de l’individu et de ses capacités. Cette conception oublie que l’humanité, plus que tout autre espèce connue, dépend de la société pour survivre et se développer. C’est encore plus vrai pour le prolétariat, le travail associé, qui produit et lutte non pas individuellement mais collectivement, qui produit non des individus révolutionnaires mais des organisations révolutionnaires. L’impuissance de l’ouvrier individuel – qui est bien plus extrême que celle du capitaliste ou même du petit propriétaire individuel – se révèle dans la lutte comme la force cachée de cette classe. Sa dépendance vis-à-vis du collectif préfigure la nature de la future société communiste dans laquelle l’affirmation conscience de la communauté permettra pour la première fois le plein développement de l’individualité. La confiance en soi de l’individu présuppose la confiance des parties dans le tout, la confiance mutuelle des membres de la communauté de lutte.
En d’autres termes, ce n’est qu’en forgeant une unité dans la lutte que la classe peut développer le courage et la confiance nécessaires à sa victoire. Ses outils théoriques et d’analyse ne peuvent être suffisamment aiguisés que de façon collective. Les erreurs des délégués du KPD au moment décisif à Berlin étaient en réalité le produit d’une maturité encore insuffisante de cette force collective du jeune parti de classe dans son ensemble.
Notre insistance sur la nature collective de la lutte prolétarienne ne dénie en aucune façon un rôle à l’individu dans l’histoire. Trotsky dans l’Histoire de la révolution russe, a écrit que sans Lénine, les Bolcheviks, en octobre 1917, auraient pu reconnaître trop tard que le moment de l’insurrection était venu. Le parti a failli rater "le rendez-vous de l’histoire ". Si le KPD avait envoyé Rosa Luxemburg et Leo Jogishes – ces analystes à la vision claire - au lieu de Karl Liebknecht et Wilhelm Pieck à la réunion dans le quartier général d’Emil Eichhorn le soir du 5 janvier, l’issue historique aurait pu être différente.
Nous ne nions pas l’importance de Lénine ou de Rosa Luxemburg dans les luttes révolutionnaires de l’époque. Ce que nous rejetons, c’est l’idée que leur rôle ait été avant tout le fait de leur génie personnel. Leur importance venait par dessus tout de leur capacité à être collectifs, à concentrer et renvoyer comme un prisme toute la lumière irradiée par la classe et le parti dans leur ensemble. Le rôle tragique de Rosa Luxemburg dans la révolution allemande, l’insuffisance de son influence sur le parti au moment décisif vient du fait qu’elle incarnait l’expérience vivante du mouvement international à un moment où le mouvement en Allemagne souffrait toujours de son isolement du reste du prolétariat mondial.
Nous voulons insister sur le fait que l’histoire est un processus ouvert et que la défaite de la première vague révolutionnaire n’était pas une conclusion inévitable. Nous n’avons pas l’intention de raconter l’histoire de "ce qui aurait pu être ". Il n’y a pas de retour en arrière dans l’histoire, seulement une marche en avant. Avec le recul, le cours suivi par l’histoire est toujours "inévitable ". Mais là nous oublions que la détermination – ou le manque de détermination – du prolétariat, sa capacité à tirer les leçons – ou l’absence de cette capacité – font partie de l’équation. En d’autres termes, ce qui devient "inévitable" dépend également de nous. Nos efforts actifs vers un but conscient constituent une composante active de l’équation de l’histoire.
Dans le prochain et dernier article de cette série, nous examinerons les immenses conséquences de la défaite de la révolution allemande et la validité de ces événements pour aujourd’hui et pour demain.
Steinklopfer
1 Pour lire ces articles, suivre ces liens : première partie [15], deuxième partie [16] et troisième partie [17].
2. Cette alliance entre les forces armées et le SPD qui s’avéra décisive pour la victoire de la contre-révolution, n’aurait pas été possible sans le soutien de la bourgeoisie britannique. Anéantir la puissance de la caste militaire prussienne était l’un des buts de guerre de Londres. Cet objectif fut abandonné afin de ne pas affaiblir les forces de la réaction. En ce sens, il n’est pas exagéré de parler de l’alliance entre la bourgeoisie allemande et la bourgeoisie britannique comme du pilier de la contre-révolution internationale de l’époque. Nous reviendrons sur cette question dans la dernière partie de la série.
3. Des milliers de prisonniers, russes et autres, étaient toujours détenus par la bourgeoisie allemande et condamnés au travail forcé, malgré la fin de la guerre. Ils participèrent activement à la révolution aux côtés de leurs frères de classe allemands.
4. Cet édifice baroque monumental, qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, fut détruit par la République démocratique allemande et remplacé par le "Palais de la République " stalinien. Auparavant, le portail devant lequel Karl Liebknecht avait proclamé la République socialiste le jour de la révolution de novembre, fut retiré et intégré à la façade adjacente du "Conseil d’Etat de la RDA ". Ainsi, le lieu d’où Liebknecht appela à la révolution mondiale fut transformé en symbole nationaliste du "socialisme en un seul pays ".
5. Ce bâtiment situé derrière le palais, existe toujours.
6. C’est ainsi que l’auteur Alfred Döblin le formule dans son livre Karl & Rosa, dans la dernière partie de son roman en 4 volumes : Novembre 1918. En tant que sympathisant de l’aile gauche de l’USPD, il fut le témoin oculaire de la révolution à Berlin. Son récit monumental fut écrit dans les années 1930 et est marqué par la confusion et le désespoir engendré par la contre-révolution triomphante.
7. Au cours de la reconstruction du centre ville après la chute du mur de Berlin, des tunnels d’évasion réalisés par les différents gouvernements du 20e siècle ont été mis à jour, qui n’étaient indiqués sur aucune carte officielle, monuments à la peur de la classe dominante. On ne sait pas si de nouveaux tunnels ont été construits.
8. Il y eut des grèves de sympathie et des occupations dans un certain nombre de villes dont Stuttgart, Hambourg et Düsseldorf.
9. Cette question, largement documentée par Richard Müller dans son histoire de la révolution allemande écrite dans les années 1920, est aujourd’hui un fait accepté par les historiens.
10. Volume III de l’Histoire de la révolution allemande : la guerre civile en Allemagne.
11. Müller, ibid. Richard Müller était l’un des chefs les plus talentueux et les plus expérimentés du mouvement. On peut faire un certain parallèle entre le rôle joué par Müller en Allemagne et celui de Trotsky en Russie en 1917. Tous deux furent présidents du comité d’action des conseils ouvriers dans une ville centrale. Tous deux allaient devenir historiens de la révolution à laquelle ils avaient directement participé. Il est pénible de voir la façon sommaire avec laquelle Wilhelm Pieck écarta les avertissements d’un dirigeant aussi responsable et expérimenté.
12. Les six opposants étaient Müller, Däuming, Eckert, Malzahn, Neuendorf et Rusch.
13. Le cas de Lemmgen, un marin révolutionnaire, fait partie de la légende mais est malheureusement vrai. Après l’échec de ses tentatives répétées de confisquer la banque d’Etat (un fonctionnaire appelé Hamburger contesta la validité des signatures de cet ordre), le pauvre Lemmgen était si démoralisé qu’il rentra chez lui et alla furtivement se coucher.
14. C’est précisément cette proposition d’action qui fut présentée publiquement par le KPD dans son organe de presse la Rote Fahne.
15. En particulier le passage du programme qui déclare que le parti assumerait le pouvoir uniquement avec le soutien des grandes masses du prolétariat.
16. Comme la Thuringe, la région de Stuttgart ou la vallée du Rhin, bastions du mouvement marxiste de longue date.
17. Centrés autour des rivières Ruhr et Wupper .
18. Le 22 février, les ouvriers communistes de Mülheim dans la Ruhr attaquèrent une réunion publique du SPD avec des pistolets.
19. R. Müller, Op.cit., Vol. III
20. Les provinces de Saxe, de Thuringe et de Saxe-Anhalt. Le centre de gravité était la ville de Halle et, à proximité, la ceinture d’industries chimiques autour de l’usine géante de Leuna.
21. Le terme "République de Weimar " qui couvre la période de l’histoire allemande qui va de 1919 à 1933 , a pour origine cet épisode.
22. Müller, ibid.
23. Durant les premiers jours de la révolution, l’USPD et Spartakus ensemble n’avaient qu’un quart de tous les délégués derrière eux. Le SPD dominait massivement. Les délégués membres des partis début 1919 se répartissaient ainsi :
le 28 février : 305 USPD, 271 SPD, 99 KPD, 95 Démocrates.
Le 19 avril : 312 USPD, 164 SPD, 103 KPD, 73 Démocrates.
Il faut noter que, durant cette période, le KPD ne pouvait agir que dans la clandestinité et qu’un nombre considérable de délégués nommés comme membres de l’USPD sympathisaient, en réalité, avec les communistes et allaient rapidement rejoindre leurs rangs.
24. Müller, ibid.
25. Müller, ibid.
26. Ce n’est pas par hasard si l’enfance du mouvement marxiste en Allemagne est associée aux noms de villes de Thuringe : Eisenach, Gotha, Erfurt.
27. Les journées de juillet 1917 constituent un des moments les plus importants non seulement de la révolution russe mais de toute l'histoire du mouvement ouvrier. Le 4 juillet, une manifestation armée d'un demi million de participants fait le siège de la direction du soviet de Petrograd, l'appelant à prendre le pouvoir, mais se disperse pacifiquement dans la soirée répondant en cela à l'appel des Bolcheviks. Le 5 juillet, les troupes contre-révolutionnaires reprennent la capitale de la Russie, lancent une chasse aux Bolcheviks et répriment les ouvriers les plus combatifs. Cependant, en évitant une lutte prématurée pour le pouvoir alors que l'ensemble de la classe ouvrière n'est pas encore prête, celle-ci va maintenir ses forces révolutionnaires intactes. C'est ce qui permettra à la classe ouvrière de tirer des leçons essentielles de ces événements, en particulier la compréhension du caractère contre-révolutionnaire de la démocratie bourgeoise et de la nouvelle gauche du capital : les Mencheviks et les Socialistes-révolutionnaires qui ont trahi la cause des travailleurs et des paysans pauvres et sont passés dans le camp ennemi. A aucun autre moment de la révolution russe, le danger d'une défaite décisive du prolétariat et de la liquidation du parti bolchevique n'a été aussi aigu que pendant ces 72 heures dramatiques. A aucun autre moment la confiance profonde des bataillons les plus avancés du prolétariat dans leur parti de classe, dans l'avant-garde communiste, n'a eu une aussi grande importance.
Avec la défaite de juillet, la bourgeoisie croit pouvoir en finir avec ce cauchemar. Pour cela, partageant la besogne entre le bloc "démocratique" de Kerenski et le bloc ouvertement réactionnaire de Kornilov, chef des armées, elle prépare le coup d'Etat de ce dernier pour la fin août et rassemble des régiments de Cosaques, de Caucasiens, etc., qui semblent encore fidèles au pouvoir bourgeois, et tente de les lancer contre les soviets. Mais la tentative échoue lamentablement. La réaction massive des ouvriers et des soldats, leur ferme organisation dans le Comité de défense de la révolution - qui, sous le contrôle du soviet de Pétrograd, se transformera plus tard en Comité militaire révolutionnaire, organe de l'insurrection d'Octobre - font que les troupes de Kornilov, ou bien restent immobilisées et se rendent, ou bien désertent pour rejoindre les ouvriers et les soldats - ce qui arrive dans la plupart des cas.
28. Contrairement à Luxemburg, Jogiches et Marchlewski qui étaient en Pologne (qui faisait partie de l’empire russe à l'époque) pendant la révolution de 1905-06, la majorité des fondateurs du KPD n’avaient pas d’expérience directe de la grève de masse et avaient du mal à comprendre qu’elle était indispensable à la victoire de la révolution.
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Allemande [18]
Débat interne au CCI : les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (III)
- 4069 lectures
Nous poursuivons dans ce numéro de la Revue Internationale la publication de notre débat interne relatif à l'explication de la période de prospérité des années 1950 et 60. Pour mémoire, ce débat avait initialement été motivé par des critiques à notre brochure La décadence du capitalisme concernant son analyse des destructions opérées durant la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières étaient en effet considérées comme étant à l'origine du marché de la reconstruction constituant un débouché à la production capitaliste. Une position (dénommée L’économie de guerre et le capitalisme d’État) s'était exprimée dès le début "en défense du point de vue défendu par notre brochure", selon lequel "le dynamisme économique en question avait été fondamentalement déterminé par les suites de la Guerre marquées par un renforcement extraordinaire des États-Unis sur le plan économique et impérialiste, et par l’économie de guerre permanente caractéristique du capitalisme décadent". Deux autres positions, qui partageaient alors la critique à l'analyse de la reconstruction exprimée dans La décadence du capitalisme, s'opposaient cependant par ailleurs sur l'analyse des mécanismes à l'œuvre permettant d'expliquer la prospérité des années 1950 et 60 : mécanismes keynésiens pour l'une (dénommée Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste) ; exploitation des derniers marchés extra-capitalistes et début de fuite en avant dans l'endettement pour l'autre (dénommée Les marchés extra-capitalistes et l'endettement).
Dans la Revue Internationale n° 133 [9] ont été publiées la présentation du cadre du débat ainsi que trois contributions exposant de façon synthétique les trois principales positions en présence. Dans le numéro 135 [19] de notre Revue, a été publié un article, Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, développant de façon plus exhaustive la thèse du Capitalisme d'État keynésiano-fordiste.
Dans ce numéro, nous laissons la parole aux deux autres positions avec les textes suivants "Les bases de l’accumulation capitaliste" et "Économie de guerre et capitalisme d’État" (en défense respectivement des positions Les marchés extra-capitalistes et l'endettement et L’économie de guerre et le capitalisme d’État). Nous tenons toutefois à faire précéder cette exposition de considérations relatives, d'une part à l'évolution des positions en présence et, d'autre part, à la rigueur du débat.
L'évolution des positions en présence
Pendant toute une période du débat, les différents points de vue exprimés se revendiquaient tous du cadre d'analyse du CCI1, celui-ci servant d'ailleurs souvent de référence aux critiques faites par telle ou telle position à telle ou telle autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et depuis un certain temps déjà. Une telle évolution fait partie des possibilités inhérentes à tout débat : des différences qui apparaissent comme mineures au départ peuvent s'avérer, après discussion, plus profondes qu'il n'y paraissait, jusqu'à remettre en cause le cadre théorique initial de la discussion. C'est ce qui s'est passé au sein de notre débat, notamment avec la thèse appelée Le Capitalisme d'État keynésiano-fordiste. Ainsi que cela ressort de la lecture de l'article Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste.(Revue internationale n° 135), cette thèse assume à présent ouvertement la remise en cause de différentes positions du CCI. Dans la mesure où des telles remises en question devront être prises en charge par le débat lui-même, nous nous limiterons ici à en signaler l'existence, laissant le soin à des contributions ultérieures de revenir dessus. Ainsi, pour cette thèse :
"Le capitalisme génère en permanence la demande sociale qui est à la base du développement de son propre marché" alors que, pour le CCI, "contrairement à ce que prétendent les adorateurs du capital, la production capitaliste ne crée pas automatiquement et à volonté les marchés nécessaires à sa croissance" (Plate-forme du CCI [20] )
L'apogée du capitalisme correspond à un certain stade de "l’extension du salariat et sa domination par le biais de la constitution du marché mondial". Pour le CCI, par contre, cette apogée intervient lorsque les principales puissances économiques se sont partagé le monde et que le marché atteint "un degré critique de saturation des mêmes débouchés qui lui avaient permis sa formidable expansion du 19ème siècle." (Plate-forme du CCI [20] )
L’évolution du taux de profit et la grandeur des marchés sont totalement indépendantes, alors que, pour le CCI, "la difficulté croissante pour le capital de trouver des marchés où réaliser sa plus-value, accentue la pression à la baisse qu’exerce, sur son taux de profit, l’accroissement constant de la proportion entre la valeur des moyens de production et celle de la force de travail qui les met en œuvre." (ibid. [20] )
Pousser la clarification systématique et méthodique des divergences jusqu'à leur racine, sans craindre les remises en cause qui pourraient en résulter, est le propre d'un débat prolétarien apte à réellement renforcer les bases théoriques des organisations qui se réclament du prolétariat. Les exigences de clarté d'un tel débat imposent, de ce fait, la plus grande rigueur militante et scientifique notamment dans la référence aux textes du mouvement ouvriers, dans leur utilisation en vue de telle ou telle démonstration ou polémique. Or justement l'article Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, de la Revue n° 135, n'est pas sans poser des problèmes sur ce plan.
Des exigences de rigueur du débat parfois mal assumées
L'article en question débute par une citation empruntée au n° 46 d'Internationalisme (Organe de la Gauche communiste de France): "En 1952, nos ancêtres de la Gauche communiste de France décidaient d'arrêter leur activité de groupe parce que : "La disparition des marchés extra-capitalistes entraîne une crise permanente du capitalisme (...) il ne peut plus élargir sa production. On verra là l'éclatante confirmation de la théorie de Rosa Luxemburg : le rétrécissement des marchés extra-capitalistes entraîne une saturation du marché proprement capitaliste. (...) En fait, les colonies ont cessé de représenter un marché extra-capitaliste pour la métropole, elles sont devenues de nouveaux pays capitalistes. Elles perdent donc leur caractère de débouchés. (...) la perspective de guerre... tombe à échéance. Nous vivons dans un état de guerre imminente...". Le paradoxe veut que cette erreur de perspective ait été énoncée à la veille des Trente glorieuses !"
De la lecture du passage cité, il ressort les deux idées suivantes :
En 1952 (date à laquelle l'article d'Internationalisme a été écrit), les marchés extra-capitalistes ont disparu, d'où la situation de "crise permanente du capitalisme".
La prévision par le groupe Internationalisme de l'échéance inéluctable de la guerre imminente découle de son analyse de l'épuisement des marchés extra-capitalistes.
Or, ceci n'est pas la réalité de la pensée d'Internationalisme mais sa transcription déformée à travers une citation (celle reproduite ci-dessus) empruntant respectivement et successivement au texte original des passages des pages 9, 11, 17 et 1 de la revue Internationalisme.
Le premier passage cité, "La disparition des marchés extra-capitalistes entraîne une crise permanente du capitalisme", est immédiatement suivi, dans Internationalisme, de la phrase suivante, non citée : "Rosa Luxemburg démontre par ailleurs que le point d’ouverture de cette crise s’amorce bien avant que cette disparition soit devenue absolue". En d'autres termes, pour Rosa Luxemburg comme pour Internationalisme, la situation de crise qui prévaut au moment de l'écriture de cet article n'implique en rien l'épuisement des marchés extra-capitalistes, "la crise s'amorçant bien avant cette échéance". Cette première altération de la pensée d'Internationalisme n'est pas sans conséquence sur le débat puisqu'elle alimente l'idée (défendue par la thèse du Capitalisme d'État keynésiano-fordiste) que les marché extra-capitalistes interviennent pour quantité négligeable dans la prospérité des années 1950 et 60.
La seconde idée attribuée à Internationalisme, "l'échéance de l'inéluctabilité de la guerre imminente qui découlerait de l'épuisement des marchés extra-capitalistes", n'est en fait pas une idée du groupe Internationalisme en tant que tel mais de certains camarades en son sein vis-à-vis desquels la discussion est engagée. C'est ce que montre le passage suivant d'Internationalisme, utilisé également dans la citation mais avec des amputations importantes et significatives (amputations en gras dans le texte qui suit) : "Pour certains de nos camarades, en effet, la perspective de guerre, qu’ils ne cessèrent jamais de considérer comme imminente, tombe à échéance. Nous vivons dans un état de guerre imminente et la question qui se pose à l’analyse n’est pas d’étudier les facteurs qui pousseraient à la conflagration mondiale –ces facteurs sont donnés et agissent déjà- mais, bien au contraire, d’examiner pourquoi la guerre mondiale n’a pas encore éclaté à l’échelle mondiale". Cette seconde altération de la pensée d'Internationalisme tend à discréditer la position défendue par Rosa Luxemburg et Internationalisme, puisque la Troisième Guerre mondiale, qui aurait dû être la conséquence de la saturation du marché mondial, n'a comme on le sait jamais eu lieu.
Le but de cette mise au point n'est pas la discussion de l'analyse d'Internationalisme, laquelle contient effectivement des erreurs, mais de relever une interprétation tendancieuse qui en a été faite, dans les colonnes de notre Revue Internationale. Il n'est pas davantage de porter préjudice au fond de l'analyse de l'article Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, qui doit absolument être différencié des arguments litigieux qui viennent d'être critiqués. Ces clarifications nécessaires étant à présent réalisées, il reste à poursuivre sereinement la discussion des questions en divergence au sein de notre organisation.
1. Comme nous le mettons en évidence dans la présentation [9] du cadre du débat (Revue Internationale n ° 133)
Questions théoriques:
- L'économie [14]
- Décadence [21]
Heritage de la Gauche Communiste:
Les bases de l'accumulation capitaliste
- 3670 lectures
La thèse dite des marchés extra-capitalistes et de l'endettement, comme son nom l'indique, considère que c'est la vente aux marchés extra-capitalistes et la vente à crédit qui ont constitué les débouchés permettant la réalisation de la plus-value nécessaire à l'accumulation du capitalisme durant les années 1950 et 60. Pendant cette période, l'endettement prend progressivement le relais des marchés extra-capitalistes subsistant encore dans le monde lorsque ces derniers deviennent insuffisants pour écouler les marchandises produites.
Deux questions se posent à propos de cette thèse :
- Sa validité peut-elle être vérifiée par l'analyse des échanges entre différentes zones économiques, présentant des niveaux différents d'intégration aux rapports de production capitalistes ? Peut-elle l'être également par l'analyse de l'endettement à cette époque ? Une prochaine contribution se penchera sur ce problème.
- En quoi se différencie-t-elle des deux autres thèses principales en présence ? En quoi est-elle compatible ou non avec celles-ci ? L'objet de la présente contribution est justement d'effectuer une analyse critique de la thèse dite du capitalisme d’État keynésiano-fordiste. Une autre viendra ultérieurement en commentaire de la thèse de L'économie de guerre et le capitalisme d'État.
Comme nous l'avons avancé dans le texte de présentation de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement paru dans la Revue Internationale n° 133 [9] , pas plus l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe ouvrière que celle des commandes étatiques - dont une grande partie est improductive, comme l'illustre le cas de l'industrie d'armement - ne peuvent en rien participer à l'enrichissement du capital global. Nous dédions l'essentiel du présent article à cette question qui, selon nous, fait l'objet d'une ambiguïté importante au sein de la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, en particulier du fait des vertus qu'elle attribue, pour l'économie capitaliste, à l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe ouvrière.
Pour cette dernière, "Ce système a donc momentanément pu garantir la quadrature du cercle consistant à faire croître la production de profit et les marchés en parallèle dans un monde désormais largement dominé par la demande salariale" 1. Que signifie faire croître la production de profit ? Produire des marchandises et les vendre, mais alors pour satisfaire quelle demande ? Celle émanant des ouvriers ? La phrase suivante de l'article en question est tout aussi ambiguë et ne nous renseigne pas davantage : "L’accroissement assuré des profits, des dépenses de l’État et l’augmentation des salaires réels, ont pu garantir la demande finale si indispensable au succès du bouclage de l’accumulation capitaliste" 2. Si l'accroissement des profits est assuré, l'accumulation capitaliste l'est aussi et, dans ce cas, il devient tout à fait inutile d'invoquer l'augmentation des salaires et des dépenses de l'État pour expliquer "le bouclage" de l'accumulation !
Ce flou dans la formulation du cœur du problème ne nous laisse pas d'autre possibilité que d'interpréter, au risque de nous tromper. Veut-on dire que les dépenses de l’État et l’augmentation des salaires réels garantissent la demande finale, permettant ainsi l'accroissement des profits, à la base de l'accumulation capitaliste ? Est-ce bien cela la bonne interprétation, comme pourrait le suggérer l'ensemble du texte. Si oui, alors il y a réellement un problème avec cette thèse qui, selon nous, remet en cause les fondements mêmes de l'analyse marxiste de l'accumulation capitaliste, comme nous allons le voir. Si, par contre, ce n'est pas la bonne interprétation, il faut nous dire quelle demande garantit la réalisation de profit à travers la vente des marchandises produites.
Ce qui est accumulé par les capitalistes, c'est ce qui reste de la plus-value extraite de l'exploitation des ouvriers, une fois payées toutes les dépenses improductives. Une augmentation des salaires réels ne pouvant se faire qu'au détriment de la plus-value totale, elle se fait donc nécessairement aussi au détriment de cette partie de la plus-value destinée à l'accumulation. En fait, une augmentation de salaire revient, dans la pratique, à reverser aux ouvriers une partie de la plus-value résultant de leur exploitation. Le problème avec cette partie de la plus-value reversée aux ouvriers est que, n'étant pas destinée à la reproduction de la force de travail (laquelle est déjà assurée par le salaire "non augmenté"), elle ne peut pas non plus participer à la reproduction élargie. En effet, qu'elle serve à l'alimentation, au logement ou aux loisirs des ouvriers, elle ne pourra plus jamais être utilisée pour participer à augmenter les moyens de production (machines, salaires pour de nouveaux ouvriers, etc.). C'est pourquoi, augmenter les salaires au-delà de ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail constitue purement et simplement, du point de vue capitaliste, un gaspillage de plus-value qui n'est en aucune manière capable de participer au processus de l'accumulation.
Il est vrai que les statistiques de la bourgeoisie occultent cette réalité. En effet, le calcul du PIB (Produit Intérieur Brut) intègre allègrement tout ce qui est relatif à l'activité économique improductive, qu'il s'agisse des dépenses militaires ou publicitaires, du revenu des curés ou des policiers, de la consommation de la classe exploiteuse ou des augmentations de salaires versées à la classe ouvrière. Tout comme les statistiques bourgeoises, la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste confond "accroissement de la production", mesurée par l'accroissement du PIB et "enrichissement du capitalisme", ces deux termes étant loin d'être équivalents puisque "l'enrichissement du capitalisme" a pour base l'augmentation de la plus-value réellement accumulée, à l'exclusion de la plus-value stérilisée dans les dépenses improductives. Or cette différence n'est pas minime en particulier dans la période considérée qui se caractérise par l'envol des dépenses improductives : "La création par le keynésianisme d'un marché intérieur capable de donner une solution immédiate à l'écoulement d'une production industrielle massive a pu donner l'illusion d'un retour durable à la prospérité de la phase d'ascendance du capitalisme. Mais, ce marché étant totalement déconnecté des besoins de valorisation du capital, il a eu pour corollaire la stérilisation d'une portion significative de capital." 3
L'idée selon laquelle l'augmentation des salaires de la classe ouvrière pourrait constituer, en certaines circonstances, un facteur favorable à l'accumulation capitaliste est totalement contradictoire avec cette position de base du marxisme (et pas seulement d'ailleurs !) pour qui "le caractère essentiel de la production capitaliste (…) est la mise en valeur du capital et non la consommation" 4.
Pourtant, rétorqueront les camarades qui défendent la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, celle-ci s'appuie elle-même sur Marx. L'explication que fournit cette thèse concernant le succès des mesures de capitalisme d'État visant à éviter la surproduction se base en effet sur cette idée de Marx selon laquelle "la masse du peuple ne peut jamais consommer davantage que la quantité moyenne des biens de première nécessité, (…) sa consommation n’augmente donc pas au rythme de l’augmentation de la productivité du travail" (Marx, Théories sur la plus-value, livre IV, Éditions sociales, tome 2 : 559-560). A travers cette formulation de Marx, la thèse en question entrevoit la solution au dépassement d'une contradiction de l'économie capitaliste : pourvu qu'il existe des gains de productivité suffisamment élevés permettant que la consommation augmente au rythme de l’augmentation de la productivité du travail, le problème de la surproduction est réglé sans empêcher l'accumulation puisque, par ailleurs, les profits, également en augmentation, sont suffisants pour assurer l'accumulation. Marx, de son vivant, n'avait jamais constaté une augmentation des salaires au rythme de la productivité du travail, et pensait même que cela ne pouvait pas se produire. Cela s'est pourtant produit à certains moments de la vie même du capitalisme, mais ce fait ne saurait en rien autoriser à en déduire que le problème fondamental de la surproduction, tel que Marx le met en évidence, s'en serait pour autant trouvé résolu, même momentanément. En effet, le marxisme ne réduit pas cette contradiction que constitue la surproduction à une question de proportion entre augmentation des salaires et celle de la productivité. Que le keynésianisme ait vu à travers un tel mécanisme de répartition de la richesse le moyen de maintenir momentanément un certain niveau d'activité économique dans un contexte de forte augmentation de la productivité du travail, est une chose. Que les "débouchés" ainsi créés aient effectivement permis un développement du capitalisme est une autre chose, illusoire celle-là. Il nous faut ici examiner de plus près comment une telle manière de "régler" la question de la surproduction par la consommation ouvrière se répercute sur les rouages de l'économie capitaliste. Il est vrai que la consommation ouvrière et les dépenses de l'État permettent d'écouler une production accrue mais avec pour conséquence, nous l'avons vu, une stérilisation de la richesse produite qui ne trouve pas à s'employer utilement pour valoriser le capital. La bourgeoise a d'ailleurs expérimenté d'autres expédients du même type visant à contenir la surproduction : la destruction des excédents agricoles, en particulier dans les années 1970 (alors que la famine sévissait déjà dans le monde), le contingentement à l'échelle européenne voire mondiale de la production d'acier, de pétrole, etc. En fait, quels que soient les moyens utilisés par la bourgeoisie afin d'absorber ou de faire disparaître la surproduction, ceux-ci se résument en bout de course à une stérilisation de capital.
Paul Mattick5, qui est cité par la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste 6, fait lui aussi le constat, concernant la période qui nous intéresse, d'une augmentation des salaires au rythme des gains de productivité : "Il est indéniable qu’à l’époque moderne les salaires réels ont augmenté. Mais seulement dans le cadre de l’expansion du capital, laquelle suppose que le rapport des salaires aux profits demeure constant en général. La productivité du travail devait alors s’élever avec une rapidité permettant à la fois d’accumuler du capital et d’accroître le niveau de vie des ouvriers" (7).
Mais il est dommage que la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste ne soit pas allée plus avant dans l'utilisation des travaux de Mattick. En effet, pour ce dernier comme pour nous, "la prospérité a pour base l'élargissement de plus-value destinée à l'expansion du capital." 8 En d'autres termes, elle ne s'accroît pas par des ventes à des marchés résultant d'augmentations des salaires ou des dépenses improductives de l'État : "Tout le problème se réduit en fin de compte à ce fait d'évidence qu'on ne peut accumuler ce qui est consommé, de sorte que la "consommation publique" ne saurait inverser le mouvement qui conduit le taux d'accumulation à stagner, voire à se contracter" 9. Or, cette particularité de la prospérité des années 1950 et 60 est demeurée inaperçue de l'économie bourgeoisie officielle et de la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste : "Les économistes ne font pas la distinction entre économie tout court et économie capitaliste, ils n'arrivent pas à voir que la productivité et ce qui est "productif pour le capital" sont deux choses différentes, que les dépenses, et publiques et privées, ne sont productives que dans la mesure où elles sont génératrices de plus-value, et non simplement de biens matériels et autres agréments de la vie" 10. Si bien que "Le surcroît de production que le déficit budgétaire a permis de financer se présente comme une demande additionnelle, mais d'une espèce particulière ; certes, elle prend son origine dans une production accrue, mais il s'agit d'un produit total accru sans augmentation corrélative du profit global." 11
De ce qui précède, il découle que la prospérité réelle des décennies 1950 et 60 n'a pas été aussi importante que veut bien le présenter la bourgeoisie, lorsqu'elle exhibe fièrement les PIB des principaux pays industrialisés de cette époque. Le constat que fait Mattick à ce propos est totalement valide : "En Amérique toutefois, il fallut maintenir la stabilité du niveau de production au moyen de la dépense publique, ce qui eut pour effet de gonfler, lentement mais sûrement, la dette publique. En outre, à la base de tout cela, on trouvait aussi la politique impérialiste des États-Unis — notamment, plus tard, la guerre du Vietnam. Or, comme le chômage ne tomba pas au-dessous de 4 % de la population active et que les capacités de production ne furent pas utilisées à plein, il est plus que vraisemblable que, sans la "consommation publique" d'armements et de vies humaines, le nombre de chômeurs aurait été infiniment supérieur à ce qu'il fut en réalité. Et comme à peu près la moitié de la production mondiale était d'origine américaine, on ne pouvait parler sérieusement, malgré l'essor du Japon et de l'Europe de l'Ouest, d'élimination complète de la crise mondiale, et bien moins encore si l'on faisait entrer les pays sous-développés en ligne de compte. Pour animée que fût la conjoncture, elle ne concernait que certaines fractions du capital mondial sans parvenir à créer un essor économique généralisé à la terre entière" 12. La thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste sous-estime cette réalité.
Pour nous, la source réelle de l'accumulation ne se trouve nullement dans les mesures keynésiennes mises en oeuvre à cette époque 13, mais dans la réalisation de la plus-value à travers la vente aux marchés extra-capitalistes et dans la vente à crédit. La thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste, si nous l'avons bien interprétée, commet une erreur théorique sur ce plan qui ouvre la voie à l'idée de la possibilité, pour le capitalisme, de surmonter sa crise pourvu que celui-ci parvienne de façon continue à augmenter la productivité du travail et à augmenter dans la même proportion les salaires des ouvriers.
Alors que la thèse du capitalisme d’État keynésiano-fordiste se revendiquait, au début de notre débat, de la continuité avec le cadre théorique développé par Marx et enrichi par Rosa Luxemburg sur les contradictions économiques du mode de production capitaliste, cela n'est plus aujourd'hui le cas concernant Rosa Luxemburg. Cependant, de notre point de vue, que cette thèse reprenne à son compte la théorie de Rosa Luxemburg ou la rejette, ne change strictement rien à son incapacité à rendre compte des contradictions qui minaient la société capitaliste pendant la période dite des Trente Glorieuses. En effet, comme on l'a vu à travers les différentes citations de Paul Mattick sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour critiquer la thèse en question, le débat avec cette dernière thèse ne renvoie en rien à celui, plus classique, opposant la nécessité de marchés extra-capitalistes pour le développement du capitalisme (comme la défend Rosa Luxemburg) et l'analyse des défenseurs de la baisse du taux de profit comme explication exclusive de la crise du capitalisme (comme la défend Paul Mattick).
Quant à cette autre question de savoir si la vente à crédit peut constituer de façon durable le moyen d'une réelle accumulation, elle renvoie bien au débat entre baisse du taux de profit et saturation des marchés extra-capitalistes. La réponse à cette question se trouve dans la capacité qu'a, ou n'a pas, le capitalisme de rembourser ses dettes. Or, l'accroissement continu de la dette, y inclus depuis fin des années 1950, est un signe que la crise ouverte actuelle de l'endettement plonge ses racines jusques et y compris dans la période de "prospérité" des années 1950 et 60. Mais ceci est un autre débat sur lequel nous reviendrons au moment de la vérification dans la réalité de la thèse des marchés extra-capitalistes et de l'endettement.
Silvio
1. In "Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste", Revue Internationale n° 135 [19].
2. Ibid
3. "Les causes de la prospérité consécutive à la Seconde Guerre mondiale (I) ; "Les marchés extra-capitalistes et l'endettement" ", Revue Internationale n° 133 [9].
4. Le Capital, Livre III, section III : "La loi tendancielle de la baisse du taux de profit", Chapitre X : "Le développement des contradictions immanentes de la loi, Pléthore de capital et surpopulation"
5. Membre de la Gauche communiste ayant milité dans le KAPD au moment de la révolution allemande. Emigré aux États-Unis en 1926, il militera dans les IWW et produira de nombreux écrits politiques y compris sur les questions économiques. A ce sujet, signalons deux ouvrages connus Marx et Keynes – Les limites de l'économie mixte, paru en 1969, et Crise et théorie des crises paru en 1974. Paul Mattick fait fondamentalement découler la crise du capitalisme de la contradiction mise en évidence par Marx, la baisse tendancielle du taux de profit. En ce sens, il diverge de l'interprétation luxemburgiste des crises qui, sans nier la baisse du taux de profit, met essentiellement l'accent sur la nécessité de débouchés extérieurs aux rapports de production capitalistes pour permettre au capitalisme de se développer. Il faut signaler la capacité de Mattick à résumer magistralement dans Crise et théorie des crises les contributions à la théorie des crises des épigones de Marx, de Rosa Luxemburg à Grossmann en passant par Tougan Baranowsky, sans oublier Pannekoek. Ses désaccords avec Rosa Luxemburg ne l'empêchent nullement de rendre compte de façon tout à fait objective et intelligible des travaux économique de la grande révolutionnaire.
6. Cette citation n'est pas présente dans la version de cet article publiée sur notre site. Elle l'est seulement dans la version imprimée de la Revue Internationale n° 135.
7. Paul Mattick, Intégration capitaliste et rupture ouvrière, EDI : 151. Cité dans l'article de la Revue n° 135 [19], "Origine, dynamique et limites du capitalisme d’État keynésiano-fordiste".
8. In Crise et théorie des crises, Paul Mattick. Souligné par nous.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid
13. Comme le note encore Mattick, conçu à l'origine comme moyen de s'affranchir de la crise, le keynésianisme ne constitue dans le fond qu'un facteur de son aggravation : "Ainsi la production compensatrice induite par l'État, à l'origine moyen d'atténuer la crise, contribue maintenant à l'aggraver, étant donné qu'elle fait perdre à une fraction toujours plus large de la production sociale son caractère capitaliste, autrement dit, sa faculté de créer du capital additionnel." (Ibid).
Questions théoriques:
- L'économie [14]
- Décadence [21]
Heritage de la Gauche Communiste:
Économie de guerre et capitalisme d'État
- 4849 lectures
Le but principal de cet article est de développer quelques bases pour l’analyse de la période du boom économique d’après-guerre, qui ont été esquissées dans la Revue internationale n° 133 [9] sous le titre Capitalisme d’Etat et économie de guerre. 1 Ce faisant, il semble également utile d’examiner brièvement certaines des objections à cette analyse soulevées par d’autres participants au débat.
Comme le soulignent très justement les remarques introductives dans la Revue internationale n°133, l’importance de ce débat va bien au-delà de l’analyse du boom d’après-guerre lui-même, mais touche des aspects plus fondamentaux de la critique marxiste de l’économie politique. Il doit en particulier contribuer à une meilleure compréhension des principales forces qui gouvernent la société capitaliste. Ces forces déterminent à la fois le dynamisme extraordinaire de la période d’ascendance du capitalisme qui l’ont fait progresser, depuis ses débuts dans les cités-États d’Italie et de Flandres jusqu’à la création de la première société planétaire, et le caractère immensément destructeur de la période décadente du capitalisme au cours de laquelle l’humanité a subi deux guerres mondiales dont la barbarie aurait fait pâlir Gengis Khan et qui menace aujourd’hui l’existence même de notre espèce.
Qu’est-ce qui sous-tend l’expansionnisme dynamique de l’économie capitaliste ?
La clé du dynamisme du capitalisme réside au cœur même des rapports sociaux capitalistes :
- l’exploitation de la classe productrice par la classe dominante prend la forme de l’achat de la force de travail comme marchandise ;
- le produit du travail de la classe exploitée doit nécessairement prendre la forme de marchandises ce qui, à son tour, signifie que l’expropriation du surtravail par la classe dominante implique nécessairement la vente de ces marchandises sur le marché. 2
Pour exprimer cela plus simplement à travers un exemple : le seigneur féodal s’emparait du surplus produit par ses serfs et l’utilisait directement pour entretenir son train de vie. Le capitaliste extrait la plus-value des ouvriers sous la forme de marchandises qui ne lui sont pas utiles comme telles, mais qui doivent être vendues sur le marché afin d’être transformées en capital monétaire.
Ceci crée inévitablement un problème pour le capitaliste : qui va acheter les marchandises qui représentent la plus-value créée par le travail des ouvriers ? Très schématiquement, historiquement deux réponses ont été apportées à cette question dans le mouvement ouvrier :
- selon certaines théories, le problème n’existe pas : le processus d’accumulation du capital et les opérations normales de crédit permettent aux capitalistes d’investir dans un nouveau cycle de production qui, se déroulant à une échelle plus large, absorbe la plus-value produite au cours du cycle précédent et l’ensemble du processus ne fait que recommencer. 3
- pour le CCI dans sa majorité, cette explication est inadéquate. 4 Après tout, si le capitalisme peut s’étendre à l’infini sur ses propres bases sans aucun problème, pourquoi la classe capitaliste a-t-elle la manie de la conquête extérieure ? Pourquoi la bourgeoisie ne reste-t-elle pas tranquillement chez elle et ne continue-t-elle pas à étendre son capital sans se lancer dans l’entreprise risquée, coûteuse et violente d’étendre constamment son accession à de nouveaux marchés ? Luxemburg répond ainsi à cette question dans l’Anti-critique : "Il doit s'agir d'acheteurs qui se procurent des moyens de paiement grâce à un système d'échange de marchandises, donc sur la base d'une production de marchandises, et cette production doit nécessairement se trouver à l'extérieur du système capitaliste de production ; les moyens de production de ces producteurs ne doivent pas entrer en ligne de compte comme capital, eux-mêmes n'entreront pas dans l'une des deux catégories de capitalistes ou d'ouvriers, et cependant ils ont besoin de marchandises capitalistes." 5
Jusqu’à la publication de son article dans la dernière Revue internationale n°135, il semblait raisonnable de penser que le camarade C.Mcl partageait cette vision de l’expansion du capitalisme dans sa phase ascendante.6 Dans cet article intitulé "Origine, dynamique, et limites du capitalisme d'État keynésiano-fordiste", le camarade semble avoir changé d'avis à ce sujet. Cela montre à tout le moins que les idées changent au cours des débats ; cependant, il nous semble nécessaire de nous arrêter un moment pour examiner certaines des idées nouvelles qu'il met en avant.
Il faut dire que ces idées ne sont pas très claires à première vue. D'une part, C.Mcl nous dit, et nous sommes d'accord, que l'environnement extra-capitaliste a "fourni [au capitalisme] toute une série d'opportunités" pour, entre autres, vendre les marchandises en excès. 7 Cependant C.Mcl nous dit, d’autre part, que non seulement ces "opportunités externes" n’étaient pas nécessaires puisque le capitalisme est parfaitement capable de développer sa propre "régulation interne", mais que l’expansion extérieure du capitalisme freine en fait son développement ; si nous comprenons bien le camarade C.Mcl, c’est parce que les marchandises vendues sur les marchés extra-capitalistes cessent de fonctionner comme capital et ne contribuent donc pas à l’accumulation, tandis que les marchandises vendues au sein du capitalisme permettent à la fois la réalisation de la plus-value (par la conversion du capital sous forme de marchandises en capital sous forme d’argent) et fonctionnent également comme éléments de l’accumulation, que ce soit sous forme de machines (moyens de production, capital constant) ou de biens de consommation (moyens de consommation pour la classe ouvrière, capital variable). Pour valider cette idée, le camarade C.Mcl nous apprend que les pays capitalistes qui n’avaient pas de colonies, ont connu au 19e siècle des taux de croissance supérieurs à ceux des puissances coloniales. 8 Ce point de vue nous semble tout à fait erroné tant d’un point de vue empirique que théorique. Il exprime une vision fondamentalement statique dans laquelle le marché extra-capitaliste ne constitue rien d’autre qu’une sorte de trop-plein pour le marché capitaliste lorsque celui-ci déborde.
Les capitalistes ne font pas que vendre sur le marché extra-capitaliste, ils y achètent également. Les navires qui transportaient des marchandises bon marché sur les marchés de l’Inde et de la Chine 9, ne rentraient pas à vide : ils revenaient chargés de thé, d’épices, de coton et d’autres matières premières. Jusqu’aux années 1860, le principal fournisseur de coton pour l’industrie textile anglaise était l’économie esclavagiste des États du Sud des Etats-Unis. Pendant la "crise du coton" causée par la Guerre civile, l’Inde et l’Égypte devinrent les nouveaux fournisseurs.
En réalité, "... dans le processus de circulation où le capital industriel fonctionne soit comme argent, soit comme marchandise, son circuit s'entrecroise – comme capital-argent ou comme capital-marchandise – avec la circulation marchande des modes sociaux de production les plus divers, dans la mesure où celle-ci est en même temps production marchande. Il importe peu que les marchandises soient le fruit d'une production fondée sur l'esclavage, ou le produits de paysans (Chinois, ryots des Indes), de communes rurales (Indes hollandaises), d'entreprises d'État (comme on les rencontre aux époques anciennes de l'histoire russe, sur la base du servage) ou de peuples chasseurs demi-sauvages, etc. : comme marchandises et argent, elles affrontent l'argent et les marchandises qui représentent le capital industriel ; elles entrent dans le circuit du capital industriel tout autant que dans le circuit de la plus-value véhiculée par le capital-marchandise et dépensée comme revenu (...). Le caractère du processus de production dont elles émanent est immatériel. Elles fonctionnent comme marchandises sur le marché et, en tant que marchandises, elles entrent dans le circuit du capital industriel comme dans le circuit de la plus-value qui y est incorporé." 10
Qu’en est-il de l’argument selon lequel l’expansion coloniale freine le développement du capitalisme ? A notre avis, on commet deux erreurs ici :
- comme le CCI (à la suite de Marx et de Luxemburg) l’a souligné à de nombreuses reprises, le problème du marché extra-capitaliste se pose à un niveau global et non au niveau du capital individuel ni même national 11 ;
- la colonisation ne constitue pas la seule forme que prend l’expansion capitaliste sur les marchés extra-capitalistes.
L’histoire des États-Unis fournit une illustration particulièrement claire – et d’autant plus importante du fait du rôle croissant de l’économie américaine au cours du 19e siècle – de ce point.
D’abord, l’inexistence d’un empire colonial américain au cours du 19e siècle n’était pas due à une "indépendance" quelconque de l’économie des États-Unis vis-à-vis d’un environnement extra-capitaliste mais au fait qu'elle trouvait ce dernier au sein des frontières américaines elles-mêmes. 12 Nous avons déjà mentionné l’économie esclavagiste des États du Sud. Après la destruction de celle-ci par la Guerre civile (1861-1865), le capitalisme s’est étendu au cours des 30 années suivantes vers l’Ouest américain selon un processus continu qu’on peut décrire ainsi : massacre et nettoyage ethnique de la population indigène ; établissement d’une économie extra-capitaliste à travers la vente et la concession de territoires nouvellement annexés par le gouvernement à des colons et de petits éleveurs 13 ; extermination de cette économie extra-capitaliste par la dette, la fraude et la violence, et extension de l’économie capitaliste. 14 En 1890, le Bureau américain du Recensement déclara "la Frontière" interne fermée. 15 En 1893, les États-Unis connurent une dépression sévère et au cours des années 1890, la bourgeoisie américaine était de plus en plus préoccupée par la nécessité d’étendre ses frontières nationales. 16 En 1898, un document du Département d’Etat américain expliquait : "Il semble y avoir un accord général sur le fait que nous allons chaque année nous trouver avec un surplus grandissant de produits manufacturés destinés aux marchés étrangers si l'on veut maintenir l'emploi des ouvriers et des artisans américains. L'élargissement de la consommation à l'étranger des produits de nos usines et de nos ateliers devient ainsi un problème sérieux non seulement commercial mais politique." 17. Suivit alors une rapide expansion impérialiste : Cuba (1898), Hawaï (1898 également), Philippines (1899) 18, la zone du canal de Panama (1903). En 1900, Albert Beveridge (un des principaux partisans de la politique impérialiste américaine) déclarait au Sénat : "Les Philippines sont à nous pour toujours (...). Et derrière les Philippines, il y a les marchés illimités de Chine (...). Le Pacifique est notre océan (...) Où trouver des consommateurs pour nos surplus ? La géographie apporte la réponse. La Chine est notre client naturel." 19
La décadence et la guerre
Les Européens pensent souvent à la frénésie impérialiste de la fin du 19e siècle comme une "Ruée vers l’Afrique". Sous beaucoup de rapports cependant, la conquête américaine des Philippines était d’une importance plus grande dans la mesure où elle symbolisait le moment où l’expansion impérialiste européenne vers l’Est s’affrontait à l’expansion américaine vers l’Ouest. La première guerre de cette nouvelle époque impérialiste fut menée par des puissances asiatiques, la Russie et le Japon, pour le contrôle de la Corée et l’accès aux marchés chinois. Cette guerre fut un facteur clé dans le premier soulèvement révolutionnaire du 20e siècle, en Russie, en 1905.
Qu’est-ce que cette nouvelle «époque de guerres et de révolutions" (comme l’Internationale communiste l’a décrite) impliquait pour l’organisation de l’économie capitaliste ?
De façon très schématique, elle implique l’inversion du rapport entre l’économie et la guerre : alors que dans la période ascendante du capitalisme, la guerre est une fonction de l’expansion économique, dans la décadence au contraire, l’économie est au service de la guerre impérialiste. L’économie capitaliste dans la décadence est une économie de guerre permanente. 20 C’est le problème fondamental qui sous-tend l’ensemble du développement de l’économie capitaliste depuis 1914 et en particulier de l’économie du boom d’après-guerre qui a suivi 1945.
Avant de poursuivre par l’examen du boom d’après-guerre de ce point de vue, il semble nécessaire de revenir brièvement sur certaines des autres positions présentes dans le débat.
1) Le rôle des marchés extra-capitalistes après 1945
Cela vaut la peine de rappeler que la brochure du CCI, La décadence du capitalisme, attribue déjà un rôle à la destruction continue des marchés extra-capitalistes au cours de cette période 21 et il est possible que nous ayons sous-estimé leur rôle dans le boom d'après-guerre ; en fait la destruction de ces marchés (dans le sens classique décrit par Luxemburg) continue encore aujourd'hui sous des formes les plus dramatiques, comme on peut le voir avec les dizaines de milliers de suicides chez les paysans indiens incapables de rembourser les dettes qu'ils ont contractées pour acheter des semences et des engrais à Monsanto et à d'autres. 22
Néanmoins, il est difficile de voir comment ces marchés auraient pu contribuer de façon décisive au boom d'après-guerre si l'on prend en compte :
- l'énorme destruction qu'a connue la petite économie paysanne dans beaucoup de pays entre 1914 et 1945 comme résultat de la guerre et de la catastrophe économique ; 23
- le fait que toutes les économies européennes subventionnaient massivement l'agriculture pendant la période d'après-guerre : l'économie paysanne constituait un coût pour ces économies plutôt qu'un marché.
2) La montée de la dette
Sur le plan des données, cet argument est beaucoup plus solide. Il est vrai que par rapport aux niveaux astronomiques atteints aujourd'hui, après plus de trente années de crise, l'accroissement de la dette pendant le boom d'après-guerre peut sembler à première vue trivial. Cependant comparé à ce qui se passait auparavant, sa montée fut spectaculaire. Aux États-Unis, la dette fédérale brute à elle seule passa de 48,2 milliards de dollars en 1938 à 483,9 milliards de dollars en 1973, c'est à dire dix fois plus. 24
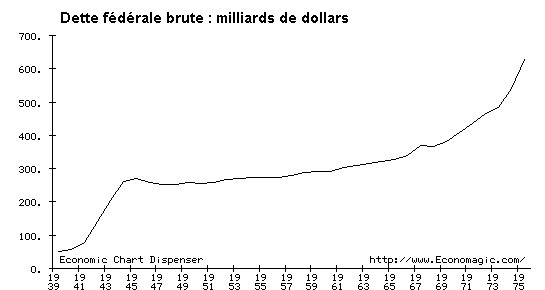
Le crédit à la consommation aux Etats-Unis passa de 4% du PIB en 1948 à plus de 12% au début des années 1970.
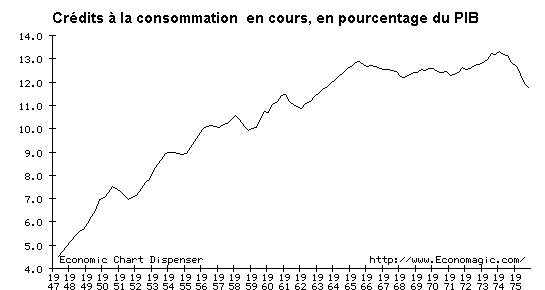
Les prêts immobiliers passèrent également de 7 milliards de dollars en 1947 à 70,5 milliards en 1970 – c'est-à-dire dix fois plus à cause du niveau important de crédits accordés, à bas taux et d'accès facile, par le gouvernement : en 1955, la Federal Housing Administration et la Veterans Administration détenaient à eux deux 41% de toutes les hypothèques. 25

3) L'augmentation des salaires
Pour le camarade C.Mcl, la prospérité du boom d'après-guerre était en grande partie due au fait que les salaires ont augmenté en même temps que la productivité grâce à une politique keynésienne délibérée ayant pour but d'absorber la production excédentaire et de permettre la poursuite de l'expansion du marché.
Il est vrai, comme Marx l'a souligné dans Le Capital, que les salaires peuvent augmenter sans menacer les profits tant que la productivité augmente aussi. Il est également vrai que la production de masse de biens de consommation est impossible sans la consommation massive de la classe ouvrière. Et il est tout aussi vrai qu'il y a eu une politique délibérée d'augmenter les salaires et le niveau de vie des ouvriers après la Seconde Guerre mondiale afin de se prémunir contre les révoltes sociales. Cependant, rien de tout cela ne résout le problème de base, identifié par Marx et Luxemburg, selon lequel la classe ouvrière ne peut absorber toute la valeur de ce qu'elle produit.
De plus, l'hypothèse de C.Mcl se fonde sur deux suppositions majeures qui ne sont pas justifiées empiriquement à notre avis :
- La première est que l'augmentation des salaires était garantie par l'indexation de ceux-ci à la productivité ; mais nous ne trouvons pas que cette politique soit attestée comme politique générale, sauf dans des cas mineurs comme en Belgique. 26 Pour prendre deux contre-exemples, l'échelle mobile introduite en Italie en 1945 liait les salaires à l'inflation (ce qui est évidemment une autre chose) et le "Contrat social" introduit par le gouvernement travailliste de Wilson en Grande-Bretagne à la fin du boom constituait une tentative désespérée de réduire les salaires dans une période de forte inflation en les indexant à la productivité.
-
La seconde est que le capital occidental n'aurait pas cherché une main d'œuvre bon marché jusqu'au début de la période de "mondialisation" dans les années 1980.C'est tout simplement faux : aux États-Unis, la migration des campagnes vers les villes a réduit la population rurale de 24,4 millions en 1945 à 9,7 millions en 1970. 27 En Europe, le même phénomène fut encore plus spectaculaire : environ 40 millions de personnes émigrèrent des campagnes et de pays hors d'Europe vers les grandes zones industrielles. 28
Les fruits de la guerre
La Seconde Guerre mondiale - encore plus que la Première – a démontré l'irrationalité fondamentale de la guerre impérialiste dans la décadence. Loin d'être payante par la conquête de nouveaux marchés, la guerre ruina les pays vainqueurs comme les pays vaincus. A une seule exception : les États-Unis, seul pays belligérant qui n'a subi aucune destruction sur son territoire. Cette exception jeta les bases d'un boom après guerre tout aussi exceptionnel et ne pouvant, de ce fait, se répéter.
L'un des principaux défauts des autres positions dans ce débat est que a) elles tendent à poser le problème en termes purement économiques, et b) elles ne considèrent que le boom d'après-guerre en lui-même et ne parviennent pas, de ce fait, à comprendre que ce boom a été déterminé par la situation créée par la guerre.
Quelle était donc cette situation ?
Entre 1939 et 1945, la taille de l'économie américaine doubla 29. Les industries existantes (comme la construction navale) appliquèrent les techniques de production de masse. De nouvelles industries entières furent créées : production à la chaîne d'avions, électronique, informatique (les premiers ordinateurs ont été utilisés pour calculer les trajectoires balistiques), produits pharmaceutiques (avec la découverte de la pénicilline), plastiques – la liste est sans fin. Et bien que la dette gouvernementale ait atteint un pic pendant la guerre, pour les Etats-unis, la plus grande partie de ce développement constituait de la pure accumulation de capital puisqu'ils saignaient à blanc les empires britannique et français en s'emparant de leur richesse accumulée contre des commandes d'armements.
Malgré cette supériorité écrasante, les États-Unis connurent, pour le moins, des problèmes à la fin de la guerre. Nous pouvons les résumer comme suit :
- Où trouver des débouchés pour la production industrielle américaine qui avait doublé pendant la guerre ? 30
- Comment défendre les intérêts nationaux américains – situés pour la première fois à une échelle vraiment mondiale – contre la menace d'expansion soviétique ?
- Comment éviter des soulèvements importants et la menace potentielle constituée par la classe ouvrière – aucune fraction de la bourgeoisie mondiale n'avait oublié Octobre 1917 – en Europe en particulier ?
Comprendre comment les Etats-Unis ont cherché à résoudre ces problèmes constitue la clé de la compréhension du boom d'après-guerre – et de sa fin dans les années 1970. Nous y reviendrons dans un prochain article ; cependant cela vaut la peine de souligner que Rosa Luxemburg écrivant avant le plein développement de l'économie capitaliste d'État pendant la Première et, surtout, la Seconde Guerre mondiale, avait déjà donné quelques indications sur les effets économiques de la militarisation de l'économie : "La multiplicité et l'éparpillement des demandes minimes de diverses catégories de marchandises, qui ne coïncident pas dans le temps et peuvent être satisfaites par la production marchande simple, qui n'intéressent donc pas l'accumulation capitaliste, font place à une demande concentrée et homogène de l'État. La satisfaction d'une telle demande implique l'existence d'une grande industrie développée à un très haut niveau, donc des conditions très favorables à la production de la plus-value et à l'accumulation. De plus, le pouvoir d'achat des énormes masses de consommateurs, concentré sous la forme de commandes de matériel de guerre faites par l'État, sera soustrait à l'arbitraire, aux oscillations subjectives de la consommation individuelle ; l'industrie des armements sera douée d'une régularité presque automatique, d'une croissance rythmique. C'est le capital lui-même qui contrôle ce mouvement automatique et rythmique de la production pour le militarisme, grâce à l'appareil de la législation parlementaire et à la presse, qui a pour tâche de faire l'opinion publique. C'est pourquoi ce champ spécifique de l'accumulation capitaliste semble au premier abord être doué d'une capacité d'expansion illimitée. Tandis que toute extension des débouchés et des bases d'opération du capital est liée dans une large mesure à des facteurs historiques, sociaux et politiques indépendants de la volonté du capital, la production pour le militarisme constitue un domaine dont l'élargissement régulier et par bonds paraît dépendre en première ligne de la volonté du capital lui-même." 31
Moins de 50 ans après la rédaction de ce livre, la réalité du militarisme impérialiste était décrite ainsi : "La conjonction d'un immense appareil militaire et d'une grande industrie d'armements est une expérience nouvelle pour les États-Unis. Chaque ville, chaque gouvernement d'État, chaque bureau du gouvernement fédéral ressent toute son influence –économique, politique et même spirituelle (...) nous devons en comprendre les graves implications. Notre travail, nos ressources, nos moyens d'existence, tout est impliqué ; de même la structure même de notre société.
Dans les conseils gouvernementaux, nous devons mettre en garde contre l'acquisition d'une influence injustifiée – recherchée ou non – du complexe militaro-industriel. Il existe et il persistera la possibilité d'une montée désastreuse de puissance incontrôlée.
(...) Dans le même ordre de choses et en grande partie responsable du changement radical de notre position militaro-industrielle, il y a la révolution technologique des dernières décennies.
Dans cette révolution, la recherche est devenue centrale ; elle est aussi devenue plus officielle, plus complexe et plus coûteuse. Une part qui s'accroît de façon régulière a lieu pour le gouvernement fédéral, par celui-ci et sous sa direction." Ces mots ont été prononcée en 1961, non pas par un quelconque intellectuel de gauche mais par le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower.
Jens, 10 décembre 2008.
1.. Pour des raisons de place, il est impossible de rendre compte de toute la période de 1945 à 1970. Nous nous proposons donc de n’aller pas plus loin qu’introduire une analyse des fondements du boom d’après-guerre que nous espérons traiter plus en détails plus tard.
2.. Ce n’est pas par hasard si le premier chapitre du Capital s’intitule "La marchandise ".
3.. Nous laissons de côté pour le moment la question des crises cycliques à travers lesquelles ce processus évolue historiquement.
4.. Nous ne répétons pas ici ce que le CCI a déjà écrit à maintes occasions pour défendre la vision que pour Marx et Engels - et pour Rosa Luxemburg en particulier parmi les marxistes de la génération suivante - le problème de l’inadéquation du marché capitaliste constitue une difficulté fondamentale sur la voie du processus d’accumulation élargie du capital.
6.. Voir en particulier l’article écrit par le camarade dans la Revue internationale n°127 [24] dans lequel, sous l’intertitre "Marx et Rosa Luxemburg : une analyse identique des contradictions économiques du capitalisme", il démontre de façon claire et très documentée la continuité entre l’analyse de Marx et celle de Luxemburg.
7.. "Cet environnement lui a cependant encore fourni toute une série d'opportunités tout au long de sa phase ascendante (1825-1914) comme source de profits, exutoire pour la vente de ses marchandises et appoint complémentaire de main d'œuvre."
8.. "Au 19e siècle, là où les marchés coloniaux interviennent le plus, TOUS les pays capitalistes NON coloniaux ont connu des croissances nettement plus rapides que les puissances coloniales (71% plus rapide en moyenne). Ce constat est valable pour toute l'histoire du capitalisme. En effet, la vente à l'extérieur du capitalisme pur permet bien aux capitalistes individuels de réaliser leurs marchandises, mais elle freine l'accumulation globale du capitalisme car, tout comme pour l'armement, elle correspond à une sortie de moyens matériels du circuit de l'accumulation".
9.. Notamment en ce qui concerne l’opium dans le cas de la Chine, la très "vertueuse" bourgeoisie britannique a mené deux guerres afin de forcer le gouvernement chinois à continuer de permettre à la population de s’empoisonner avec l’opium britannique.
10.. Le Capital, Livre II, première partie, chapitre II en français, Ed. La Pléiade. Les dernières phrases sont traduites de la version anglaise du Capital par nous.
11.. Schématiquement si l’industrie d’Allemagne (qui ne comportait pas de colonies) a pris le pas sur le marché mondial sur celle de Grande Bretagne (qui avait des colonies) et a connu un taux de profit supérieur, elle profitait aussi des marchés extra-capitalistes conquis par l’impérialisme britannique.
12.. Lorsque les Etats-Unis ont, par la force et la tromperie, dépouillé le Mexique du Texas (1836-1845) et de la Californie (1845-1847), ces nouveaux états ne furent pas intégrés à un "empire" mais au territoire national des Etats-Unis.
13.. Par exemple, le "Oklahoma Land Rush" (la "ruée vers le territoire de l’Oklahoma") en 1889. La ruée commença le 22 avril 1889 à midi avec environ 50 000 personnes sur la ligne de départ pour acquérir une part des 2 millions d’acres (8 000km2) disponibles.
14.. L’histoire du développement capitaliste aux États-Unis mériterait une série d’articles à elle seule et nous n’avons pas la place ici pour développer cette question. Par ailleurs, cela vaut la peine de souligner que ces mécanismes de l’expansion capitaliste ne se limitaient pas aux États-Unis mais qu’on les rencontre également –comme on peut le lire dans l’Introduction à l’économie politique de Rosa Luxemburg – dans l’expansion de la Russie vers l’Est et dans l’incorporation à l’économie capitaliste de la Chine, de l’Égypte et de la Turquie – pays qui n’ont jamais été des colonies.
15. Dans la société américaine, l'expression la Frontière (the Frontier) a un sens spécifique qui se réfère à son histoire. Il s'agit, tout au long du 19e siècle, un des aspects les plus importants du développement des États-Unis par l’extension du capitalisme industriel vers l’Ouest, qui s'est traduite par le peuplement de ces régions par des populations essentiellement composées de gens de souche européenne ou africaine.
16.. Cette préoccupation avait déjà trouvé une expression dans la "Doctrine Monroe" adoptée en 1823 qui établissait clairement que les États-Unis considéraient tout le continent américain, du Nord et du Sud, comme sa sphère d’intérêts exclusive – et la Doctrine Monroe fut imposée au moyen d’interventions militaires américaines répétées en Amérique latine.
17.. Cité dans Howard Zinn, History of American People. Traduit par nous
18.. La conquête des Philippines où les États-Unis commencèrent par évincer la puissance coloniale espagnole, puis menèrent une guerre féroce contre les insurrectos philippins, constitue un exemple particulièrement révoltant de l’hypocrisie et de la barbarie capitalistes.
19.. Howard Zinn, op.cit.
20.. Nous illustrerons cela par un exemple. En 1805, la révolution industrielle était déjà bien avancée en Grande-Bretagne : l'utilisation de la machine à vapeur et la production mécanisée des textiles s'étaient rapidement développées depuis les années 1770. Pourtant, lorsque cette année-là, les Britanniques détruisirent les flottes française et espagnole à la bataille de Trafalgar, le navire amiral de Nelson, HMS Victory, avait déjà près de 50 ans (ses plans en avaient été établis en 1756 et le navire finalement lancé en 1765). Il suffit de comparer cela à la situation actuelle où les technologies les plus avancées dépendent de l'industrie d'armement.
21.. La brochure La décadence du capitalisme – de façon juste à notre avis – associe ce phénomène au militarisme croissant des économies du "Tiers-Monde".
22.. On pourrait aussi parler de l'élimination des petits commerçants dans les pays développés avec l'expansion des supermarchés et de la commercialisation de masse des produits ménagers les plus ordinaires (y compris la nourriture évidemment), phénomènes qui ont clairement commencé dans les années 1950 et 1960.
23.. Le programme de collectivisation forcée de Staline en URSS pendant les années 1930, les guerres entre seigneurs et la guerre civile en Chine dans l'entre-deux guerres, la conversion de l'économie paysanne en économie de marché de pays comme la Roumanie, la Norvège ou la Corée pour répondre au besoin de l'impérialisme allemand et japonais d'être autonome pour leur approvisionnement alimentaire, les effets désastreux de la Grande Dépression sur les petits fermiers américains (Oklahoma Dust Bowl, - tempêtes de poussière en Oklahoma -), etc.
24.. Sauf mention contraire, les chiffres et les graphiques sont tirés des statistiques gouvernementales américaines disponibles sur https://www.economagic.com [25]. Nous nous concentrons, dans cet article, sur l'économie américaine en partie parce que les statistiques du gouvernement sont plus facilement disponibles mais, surtout, à cause du poids écrasant de l'économie américaine sur l'économie mondiale durant cette période.
25.. James T. Patterson, Grand expectations.
26.. En fait, selon une étude (cedar.barnard.columbia.edu/-econhist/papers/Hanes_sscaled4.pdf), des accords d'échelle mobile des salaires avaient déjà existé dans certaines industries américaines et britanniques dès le milieu du 19e siècle jusqu'aux années 1930 pour n'être abandonnés qu'après la guerre.
27.. Patterson (op. cit). Ce fut "l'un des changements les plus dramatiques de l'histoire américaine moderne".
28.. "En Italie, entre 1955 et 1971, environ 9 millions de personnes changèrent de régions. (...) 7 millions d'Italiens quittèrent le pays entre 1945 et 1970. Dans les années 1950-70, un quart de la force de travail grecque partit chercher du travail à l'étranger. (...) On estime qu'entre 1961 et 1974, un million et demi d'ouvriers portugais trouvèrent du travail à l'étranger – mouvement de population le plus important de toute l'histoire du Portugal, et qui laissa derrière lui une force de travail de 3,1 millions de personnes seulement. (...) En 1973, rien qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait près d'un demi-million d'Italiens, 535 000 Yougoslaves et 605 000 Turcs." (Tony Judt, Postwar: A History of Europe since 1945).
29.. Les Etats-Unis représentaient environ 40% de la production industrielle mondiale ; à eux seuls, ils produisaient en 1945 la moitié de la production mondiale de charbon, deux-tiers du pétrole, et la moitié de l'électricité. De plus, ils détenaient plus de 80% des réserves mondiales d'or.
30.. Howard Zinn (op.cit.) cite un membre du Département d'État en 1944 : "Comme vous le savez, nous devons prévoir une énorme augmentation de la production dans ce pays après la guerre, et le marché intérieur américain ne peut absorber indéfiniment toute cette production. La nécessité d'augmenter énormément les marchés étrangers ne fait aucun doute."
31.. L'accumulation du capital, écrit en 1913, chapitre : "Le militarisme, champ d'action du capital" (souligné par nous).
Questions théoriques:
- Décadence [21]
- L'économie [14]
