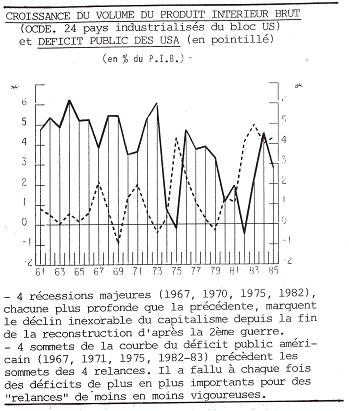Revue Internationale no 47 - 4e trimestre 1986
- 2532 lectures
Les attaques frontales annoncent l'unification des luttes ouvrières
- 2433 lectures
Les formidables combats de classe qui se sont déroulés en Belgique en avril-mai dernier -les plus importants depuis ceux de Pologne 80, depuis la fin des années 60 en Europe occidentale sont venus démontrer de façon éclatante toute la vanité des discours bourgeois sur le "réalisme de la classe ouvrière face à la crise", sa "compréhension de la nécessité de faire des sacrifices" et autres sornettes destinées à démoraliser les ouvriers, à les empêcher de voir la force qu'ils représentent face au capitalisme lorsqu'ils luttent et s'unissent. Ces combats ont mis en évidence que la bourgeoisie n'a pas les mains libres pour asséner aux ouvriers les coups de plus en plus brutaux que lui dicte 1'effondre ment croissant de son économie. Et cela non seulement en Belgique, mais dans l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui se trouvent d'ores et déjà -ou ne tarderont pas à se trouver- dans une situation similaire à celle de ce pays. Mais ce mouvement a démontré plus encore. De même que celui du secteur public en septembre 1983 dans cette même Belgique avait donné le signal d'un renouveau magistral des luttes ouvrières dans les principales métropoles capitalistes - après le recul général qui avait accompagné la défaite de 1981 du prolétariat en Pologne- les combats du printemps 86 font la preuve que la lutte du prolétariat mondial est entrée dans une nouvelle phase de son développement. Alors qu'en 1985 la bourgeoisie des pays centraux avait réussi à émietter les manifestations de combativité, qu'avec une politique de découpage dans le temps et dans l'espace de ses attaques, elle était parvenue à disperser les ripostes ouvrières, les luttes massives du prolétariat en Belgique ont mis en évidence les limites d'une telle politique. En effet, l'approche d'une nouvelle récession bien plus considérable encore que celle de 1982-83 (voir 1'article "L'impasse" dans ce numéro de la Revue) oblige la bourgeoisie à renoncer de plus en plus à des attaques dispersées et la contraint à des attaques massives et frontales. Face à celles-ci, les luttes ouvrières, à l'image de celles de Belgique, en avril-mai 86, prendront à leur tour de façon croissante un caractère massif et tendront à l'unification par delà les divisions catégorielles et régionales.
Voilà ce qui constitue l'axe de l'analyse développée déjà dans l'article "De la dispersion, vers l'unification" dans le précédent n° de notre Revue ainsi que de la résolution adoptée par notre organisation en juin 86 et que nous publions dans ce n°. Depuis que cette résolution a été adoptée, la situation est venue clairement confirmer cette analyse. Si la période des vacances a été peu propice au déploiement de grands mouvements de la classe ouvrière, par contre, elle a été l'occasion pour la bourgeoisie d'un grand nombre de pays de déchaîner des attaques anti-ouvrières d'une brutalité et d'une ampleur sans précédent. Qu'on en juge...
DES ATTAQUES SANS PRECEDENT
C'est dans un pays réputé pour son haut niveau de vie et de "protection" sociale -les Pays-Bas- qu'on été portées les attaques les plus spectaculaires durant cet été. Avec quelques mois de décalage par rapport à la Belgique voisine, la bourgeoisie a décidé des mesures tout à fait comparables à celles qui, dans ce dernier pays, étaient à l'origine des grands mouvements du printemps. Dès sa mise en place, le 14 juillet, le gouvernement de centre droit issu des élections du 21 mai, a annoncé la nécessité de réduire de façon drastique les dépenses budgétaires pour l'année 87 : ce sont au moins 12 milliards de florins qui devront être économisés (l'équivalent de 360 dollars par habitant !). Le gouvernement a annoncé que si l'année 87 serait "dure", cela irait mieux par la suite et que le niveau des revenus de 90 retrouverait celui de 86. On sait ce que valent ce genre de promesses. En attendant, les mesures prévues se passent de commentaires :
- suppression de 40 000 emplois dans les services publics de l'Etat (sur un total de 170 000) et plus de 100 000 parmi les fonctionnaires régionaux et municipaux ;
- instauration d'une "auto-contribution" pour les soins de santé (par exemple, la 1ère journée d'un séjour à l'hôpital ne sera pas remboursée) ;
- augmentation de 5% de la contribution à la sécurité sociale, ce qui correspond à une baisse de 2% des salaires ;
- réduction de 25% de la masse totale des subventions pour le logement social (ce qui affecte en priorité les chômeurs et les ouvriers les plus pauvres) ;
- réduction de 41 000 à 30 000 par an du nombre des logements construits par l'Etat (dans un pays qui souffre d'une crise du logement permanente) : cette mesure, avec la précédente, aboutira à la suppression de 30 000 emplois dans le bâtiment ;
- réduction massive des allocations chômage (alors qu'il était versé 85% du salaire pendant 6 mois, 70% pendant 18 mois et 60% par la suite, l'indemnité passera à 60% dès le début) ;
- mise au travail obligatoire pour un salaire de misère des chômeurs de moins de 25 ans (un bon moyen de faire baisser à bon compte les chiffres du chômage) ;
- dans le secteur privé, limitation à 1,3% des hausses de salaires alors que l'inflation était de 2,5% en 85 et qu'elle va encore s'accélérer ;
- dans ce même secteur, réduction à 37 heures et demi de la semaine de travail sans aucune compensation salariale.
Au total, ces mesures représentent une baisse des revenus de 10% pour la classe ouvrière et une augmentation de 15% du nombre des chômeurs. Ce sont tous les secteurs de la classe ouvrière (secteur privé, secteur public, chômeurs), toutes les composantes du revenu ouvrier (salaire nominal, salaire "social") qui, à l'image de la Belgique, sont brutalement attaqués.
Bien que sous une forme moins spectaculaire, ce type de mesures a déferlé ces derniers mois sur les ouvriers de nombreux autres pays :
- réduction des effectifs de la fonction publique en Espagne et en France (30 000 pour 87 dans ce pays) ;
- suppression massive d'emplois dans les entreprises publiques (50 000 dans l'INI en Espagne, 20 000 à la régie Renault et 9000 dans les chemins de fer en France) ;
- poursuite et intensification des fermetures d'usines et des licenciements dans les secteurs "faibles" tels que la sidérurgie (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, 3000 en France, fermeture des aciéries de USX dans 7 Etats aux USA), la construction navale (10 000 suppressions d'emplois en RFA, 5000 en Espagne, fermeture de 3 sites de la Normed en France, soit 6000 emplois), les charbonnages (8000 suppressions d'emplois dans la Ruhr en RFA, par exemple) ;
- blocage ou baisse des salaires (gel des traitements de la fonction publique et des pensions vieillesse en France, nombreuses baisses de salaires aux USA, etc.) ;
- accroissement des charges sociales (amputation de 0,7% des salaires pour les cotisations vieillesse et prélèvement de 0,4% sur tous les revenus en France, mesures similaires en Espagne, etc.) ;
- démantèlement de la "couverture sociale" (nouvelle réduction de la liste des médicaments remboursés et suppression du remboursement à 100% des dépenses de santé par les mutuelles en France, mesures du même type encore plus brutales dans la plupart des entreprises aux USA) ;
- réductions de l'indemnisation du chômage (par exemple, suppression des primes particulières pour la nourriture, les vêtements et le logement en Grande-Bretagne).
La liste pourrait s'allonger beaucoup plus sans pour cela rendre compte de façon complète de la terrible attaque subie à l'heure actuelle par la classe ouvrière dans tous les pays. Et ce n'est pas fini : si de telles attaques peuvent permettre à chaque bourgeoisie nationale de ne pas être étouffée par ses concurrentes dans la guerre commerciale que toutes se livrent, elles ne peuvent en aucune façon empêcher l'effondrement global de l'économie mondiale et elles seront nécessairement suivies de nouvelles attaques encore plus brutales, massives et frontales : le pire est encore devant nous.
LA LUTTE DE CLASSE
Annoncées pour la plupart durant la période des vacances, ces mesures anti-ouvrières n'ont pas encore provoqué de réponses significatives dans les grandes concentrations d'Europe occidentale. Mais il ne faut pas s'y tromper : le mécontentement est partout explosif et il l'est d'autant plus que la sournoiserie de ces attaques portées dans le dos des ouvriers au moment où ils ne pouvaient se défendre n'a fait qu'accroître leur colère. D'ailleurs, la bourgeoisie sait à quoi s'en tenir : partout, elle a confié à sa gauche et à ses syndicats le soin de miner le terrain. Dans tous les pays on assiste à un même phénomène : les syndicats adoptent un langage de plus en plus "radical", "extrémiste" même. En Suède, par exemple, la centrale LO, pourtant contrôlée par le parti social-démocrate actuellement au gouvernement, surprend par le ton de ses discours d'une "combativité" et d'une "intransigeance" jamais vues. En France, c'est la CGT, contrôlée par le PC,qui aujourd'hui tient un langage, organise des actions qu'elle aurait dénoncés comme "gauchistes" et "irresponsables" il y a peu de temps encore : elle claironne que "seule la lutte paie"; elle appelle "partout à des ripostes massives et unitaires" contre les "mauvais coups" du gouvernement ; elle dénonce avec vigueur la politique du précédent gouvernement (qu'elle a pourtant soutenu pendant 3 ans) ; elle ne craint pas d'organisé des actions illégales (comme le blocage des trains et des autoroutes) ou violentes (affrontements contre la police). Si partout les syndicats durcissent ainsi le ton c'est ([1] [1]) pour une raison très simple : il faut qu'ils prennent les devants afin de ne pas être débordés par les mouvements qui se préparent et d'être capables de les saboter, de les diviser.
Mais si, en Europe occidentale, c'est essentiellement à travers les manoeuvres bourgeoises qu'on peut juger des potentialités de lutte, dans la première puissance mondiale -les USA- c'est la classe elle-même qui est venu faire la preuve de sa combativité et de sa prise de conscience du besoin d'unité. En effet, dans un pays où le battage sur les "succès" économiques du libéralisme reaganien, sur la "reprise" etc. a été assourdissant, il n'y a pas eu de vacances pour la lutte de classe :
- dans le secteur du téléphone, grève de 155 000 ouvriers à ATT en juin durant 26 jours, de 66 000 ouvriers d'autres compagnies en août ;
- dans la sidérurgie, grève à la LTV (2ème producteur US) en juillet, 22 000 ouvriers en grève à USX le 1er août (premier mouvement depuis 1959) ;
- plusieurs autres mouvements dans les transports aériens, dans les usines de papier (7 500 ouvriers), dans l'industrie alimentaire (usines Hormel dans le Minnesota, Watsonville en Californie) ;
- dans le secteur public, en juillet-août, grève de 32 000 employés communaux à Philadelphie et Détroit (deux très grandes métropoles industrielles de l'Est) notamment dans les secteurs des transports, de la santé et chez les éboueurs.
Dans ces deux dernières grèves, les actes de solidarité se multiplient parmi les ouvriers et déjouent en partie les manoeuvres de division organisées de concert par la direction et les syndicats (signature d'accords séparés pour chaque catégorie d'ouvriers). Et si à Philadelphie, les menaces de licenciements proférées par les tribunaux viennent finalement à bout, après 3 semaines de grève, de la combativité et de la solidarité, celles-ci sont suffisamment fortes dès le début à Détroit pour empêcher la bourgeoisie de recourir à de telles menaces et pour l'obliger à renoncer à un de ses objectifs majeurs : faire dépendre les augmentations de salaires pour les 3 prochaines années de la "santé financière" de la municipalité.
Dans un pays où la bourgeoisie s'est toujours distinguée par la brutalité et le cynisme de son attitude face à la classe ouvrière (qu'on se souvienne du licenciement de 12 000 aiguilleurs du ciel en août 81, par exemple) son recul face aux grévistes de Détroit constitue une nouvelle illustration de la résolution publiée plus bas :
"(Les luttes) "paient" et ... elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire... plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer et reporter les attaques qu'elle se propose de mener"..
Ce que démontrent en fin de compte les luttes ouvrières aux USA, de même que l'extrême tension existant en Europe occidentale, c'est que l'heure n'est pas aux lamentations sur "la passivité de la classe ouvrière", son "embrigadement derrière les syndicats", lamentations dans lesquelles se complaisent encore nombre de groupes révolutionnaires. Dans la période qui vient, le prolétariat va livrer des combats d'une importance considérable ce qui va placer de plus en plus les organisations révolutionnaires devant leurs responsabilités : soit elles seront partie prenante de ces combats afin de les impulser, ce qui suppose qu'elles soient conscientes de leur enjeu et du rôle qu'elles doivent y jouer, soit elles seront balayées impitoyablement par l'histoire.
FM. 7 septembre 86
[1] [2] Cette affirmation ne saurait être contredite par le fait, qu'après un recul temporaire face aux grèves du printemps, le gouvernement belge a finalement décidé de maintenir 1'intégralité des coupes budgétaires projetées : ce qui est ici démontré c'est 1 'habileté de la bourgeoisie dont le gouvernement a annoncé les mesures peu de temps avant les, vacances9afin de pouvoir les confirmer durant cette période après la retombée de la mobilisation ouvrière, c'est la capacité que conservent les syndicats à saboter l'unité ouvrière, c'est la nécessité, par suite, pour les ouvriers, non seulement de les huer comme ce fut le cas en Belgique mais aussi de se confronter à eux, de ne pas leur laisser l'initiative, de pousser toujours plus avant la recherche de l'unification et, ce faisant, de prendre eux-mêmes en main leur lutte par leur auto-organisation.
Géographique:
- Europe [3]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [4]
Résolution sur la situation internationale 1986
- 2599 lectures
1) La résolution sur la situation internationale du 6ème Congrès du CCI (Revue Internationale n°44) en novembre 85, était placée sous le signe de la dénonciation de toute une série de mensonges mis en avant par la bourgeoisie pour tenter de masquer les enjeux véritables de cette situation :
- "mythe d'une amélioration de la situation du capitalisme mondial dont les 'succès' de l'économie américaine en 1983 et 84, seraient l'incarnation','
- prétendue "atténuation des tensions impérialistes avec la modification en 1984 des discours reaganiens et la 'main tendue' aux négociations avec 1’URSS qui trouvent leur pendant avec 1'offensive de séduction diplomatique du nouveau venu Gorbatchev",
- battage sur "l'idée que le prolétariat ne lutte pas, qu'il a renoncé à défendre ses intérêts de classe, qu'il n'est plus un acteur de la scène politique internationale."
Si, à l'époque, ces mensonges pouvaient s'appuyer sur un semblant de réalité, huit mois après, cette même réalité s'est chargée de démentir ouvertement toutes les campagnes précédentes, confirmant une nouvelle fois que les années 80 sont bien celles où la faillite historique du capitalisme, sa nature décadente et barbare sont appelées à se révéler dans toute leur nudité, où se précisent de plus en plus ouvertement les véritables enjeux de toute la période historique que nous vivons. De plus, la rapidité avec laquelle les événements sont venus battre en brèche les mensonges de 85 illustre une autre caractéristique fondamentale de ces années de vérité : l'accélération croissante de l'histoire.
Ainsi, la présente résolution ne se propose pas de redémontrer, après celle de novembre 85, toute la vanité des discours bourgeois. Elle prend appui sur cette dernière résolution, dont elle constitue le complément, pour mettre en évidence en quoi les huit mois écoulés ont confirmé ses orientations, pour souligner cette accélération de l'histoire, de même qu'elle se propose de signaler les premiers enseignements des expériences de la classe ouvrière au cours de cette dernière période.
L'ACCELERATION DE L'EFFONDREMENT ECONOMIQUE
2) La résolution du 6ème Congrès du CCI indiquait les limites de la "reprise" aux USA de même que de la capacité de ce pays de servir de "locomotive" pour les économies des autres pays de son bloc :
"C'est principalement le formidable endettement du tiers-monde dans la seconde moitié des années 70... qui a permis pour un temps aux puissances industrielles de redresser leurs ventes et de relancer leur production.
Après 82, c'est... 1'endettement encore plus considérable des USA, tant extérieur... qu'intérieur...
qui a permis à ce pays de connaître ses taux de croissance records en 1984 de même que ce sont ses énormes déficits commerciaux qui ont bénéficié momentanément aux exportations de quelques autres pays (telle la RFA) et donc au niveau de leur production.
En fin de compte, de même que l'endettement astronomique des pays du tiers-monde n'avait pu aboutir qu'à un choc en retour catastrophique, en forme d'une austérité et d'une récession sans précédent, l'endettement encore plus considérable de l'économie américaine ne peut, sous peine d'une explosion dé son système financier... que déboucher sur une nouvelle récession tant de cette économie que des autres économies dont les marchés extérieurs vont se réduire comme peau de chagrin."
L'évolution de la situation ces derniers mois constitue une illustration concrète de ces limites :
- le déficit du budget fédéral des USA, qui avait permis la création d'une demande artificielle pour les entreprises de ce pays (380 milliards de $ pour 83 et 84), sera impérativement réduit (le Congrès US a adopté une loi (Gramm-Rudman) instaurant des coupes automatiques des budgets en cas de déficit),
- plus encore, la baisse du dollar de 30 % en quelques mois (baisse voulue et organisée par les autorités) signifie que les USA sont déterminés à réduire drastiquement leur déficit commercial devenu astronomique (et qui a placé ce pays dans le peloton de tête des pays les plus endettés du monde) et donc à repartir à la reconquête de leurs marchés tant intérieurs qu'extérieurs.
Ce dernier fait signifie donc une intensification de la guerre commerciale avec les concurrents (qui sont aussi les alliés) des USA (Japon et Europe occidentale), lesquels verront leurs propres marchés s'effondrer (sans que cela signifie d'ailleurs un regain de santé de l'économie US du fait du rétrécissement général du marché mondial). De même, cette baisse du dollar signifie que ces mêmes pays se voient rembourser leurs prêts 30 % moins cher que leur valeur initiale.
3) De même, cette baisse du dollar ne signifiera nul répit pour les pays du tiers-monde. Si, d'un côté, leur endettement de 1.000 milliards de dollars (la plupart du temps libellé en cette monnaie) sera partiellement réduit, les revenus de leurs exportations servant à son remboursement seront amputés d'autant (puisque exprimés également en dollars). De plus, leur situation ne pourra que s'aggraver avec la baisse souvent considérable des prix des matières premières qui, sous la pression de la surproduction généralisée, caractérise la période actuelle, dans la mesure où celles-ci constituent leur poste principal (sinon exclusif) d'exportation. Cette situation est particulièrement spectaculaire et dramatique en ce qui concerne la principale des matières premières, le pétrole (dont l'effondrement des prix démontre le caractère uniquement spéculatif, et nullement basé sur une quelconque "pénurie", des flambées de 1973 et 1979). Des pays comme le Mexique ou le Venezuela, déjà incapables de faire face à leurs dettes phénoménales lorsqu'ils vendaient leur baril à 30 dollars, sont plongés avec le baril à 15 dollars, dans une banqueroute totale. Ainsi s'amplifie encore cette barbarie sans nom, cet enfer permanent dans le tiers-monde, que la résolution de novembre 85 présentait comme un des indices les plus éloquents de l'effondrement de l'économie mondiale.
De même aussi, les pays du bloc russe, à commencer par l'URSS elle-même, dont les matières premières constituent (à l'image des pays sous-développés) la principale exportation, verront-ils encore s'aggraver une situation économique déjà déplorable et devront-ils renoncer encore plus à acheter en occident les équipements industriels modernes qui leur font tant défaut (ce qui viendra encore réduire les débouchés de leurs fournisseurs occidentaux).
4) Pour ce qui concerne l'Europe occidentale, dont la résolution de novembre 85 soulignait la gravité de la situation économique, la baisse des matières premières et notamment du pétrole, ne permet d'espérer aucune amélioration sensible. Contrairement aux déclarations satisfaites présentant ces baisses (cumulées avec celle du dollar) comme un "ballon d'oxygène" du fait de la réduction de l'inflation et des déficits commerciaux qu'elles sont censées provoquer, c'est une nouvelle aggravation de la situation qu'il faut en attendre à terme. D'une part des pays comme la Grande-Bretagne et la Norvège ou les Pays-Bas sont directement victimes de la baisse du pétrole (et du gaz naturel dont le prix est lié à celui du pétrole). D'autre part, et surtout, l'ensemble des pays d'Europe occidentale qui exportent une part importante de leur production vers les pays du tiers-monde et notamment les pays producteurs de pétrole, verront de plus en plus se fermer le marché de ces pays en même temps que s'épuiseront leurs sources de devises. En fait d'"oxygène"c'est du gaz asphyxiant que contient ce "ballon" tant vanté de la baisse des matières premières et du pétrole. D'ailleurs, derrière cette euphorie de façade, la bourgeoisie des pays d'Europe occidentale est consciente de l'extrême noirceur des perspectives économiques résultant du cumul de la fermeture croissante du marché des USA (du fait de la baisse du dollar et des mesures protectionnistes prises par ce pays), de 1'anémie du marché du COMECON et de l'épuisement des contrats mirifiques des pays de l'OPEP, alors que dès maintenant c'est plus de 11 % (en chiffres officiels, donc sous-estimés) de la force de travail qu'elle ne peut employer. C'est justement parce qu'elle ne se fait pas d'illusions que, dans tous les pays, cette bourgeoisie multiplie les mesures brutales d'austérité (comme celles du gouvernement Martens en Belgique) afin de préserver du mieux possible sa compétitivité déjà faible en prévision de la terrible guerre commerciale que va déchaîner la récession qui s'annonce.
Dans ces centres vitaux du capitalisme, où se trouvent les plus grandes et anciennes concentrations industrielles, et donc ouvrières, c'est donc une nouvelle et considérable détérioration de la situation économique - avec les terribles attaques antiouvrières qu'elle comporte - qui constitue la seule perspective, à court terme, détérioration qui ne pourra que se répercuter, en fin de compte, sur les pays (USA et Japon) jusqu'à présent les mieux lotis.
L'INTENSIFICATION DES CONFLITS IMPERIALISTES
5) Comme le CCI, avec tous les marxistes, l'a toujours souligné (et rappelé dans la résolution de novembre 85), 1'effondrement de 1'infrastructure économique de la société capitaliste ne peut déboucher que sur une fuite en avant vers un affrontement impérialiste généralisé. A peine 6 mois après le grand "show" au sommet de Genève, les embrassades des duettistes Reagan et Gorbatchev sont complètement oubliées (comme l'annonçait cette résolution). Avec autant de promptitude qu'il les avait abandonnées lors de sa campagne électorale, Reagan a repris ses diatribes contre "l'empire du mal" dénonçant avec une vigueur renouvelée les "violations des droits de l'homme" et les "intentions belliqueuses" de l'URSS de même que l'hypocrisie de ses propositions de réduction des armements, ce qui s'est notamment concrétisé tout récemment par la dénonciation, de la part de la Maison Blanche, des accords SALT II. Ainsi se confirme avec éclat l'offensive du bloc occidental en vue de "parachever l'encerclement de l'URSS, de dépouiller ce pays de toutes les positions qu'il a pu conserver hors de son glacis direct" (Résolution du 6ème Congrès du CCI). En ce domaine est particulièrement significatif de l'accélération générale dé l'histoire imprimée par l'effondrement économique du capitalisme, le bombardement par l'aviation américaine des deux plus grandes villes de Libye ainsi que des principales bases militaires de ce pays. C'est une nouvelle illustration du fait qu'une "des caractéristiques majeures de cette offensive est l'emploi de plus en plus massif par le bloc de sa puissance militaire" (Ibid.).
6) Si le raid américain d'avril 86 n'était pas directement dirigé contre l'URSS ou une de ses positions stratégiques, dans la mesure où la Libye n'a jamais été un membre du bloc de l'Est, c'est bien l'offensive d'ensemble contre ce bloc qui constitue l'arrière-plan de cette action d'éclat. En effet, celle-ci visait à :
- confirmer avec force et de façon spectaculaire que la Méditerranée est désormais un "mare nostrum" américain (à la veille des bombardements, l'URSS éloigne prudemment ses navires des côtes libyennes ce qui illustre bien qu'elle a renoncé à contester l'hégémonie totale des USA dans cette région du monde) ;
- envoyer un avertissement à tous les pays (et pas seulement à la Libye) qui, sans appartenir au bloc de l'Est, manifestent au gré des USA une trop grande indépendance à leur égard ou une soumission insuffisante.
En particulier, il était signifié à la Syrie qu'elle se devait d'exécuter avec plus d'efficacité le contrat passé avec elle en échange du départ des corps expéditionnaires occidentaux du Liban en 84 et consistant à faire, en compagnie d'Israël, "le gendarme" dans ce pays (notamment par la mise au pas des groupements pro-iraniens). Mais le principal destinataire du message porté par les Fil américains, c'est une nouvelle fois l'Iran dont la réinsertion dans le bloc US continue de constituer l'objectif majeur de l'étape présente de l'offensive occidentale. Et il semble bien que le message ait été reçu par ce pays : son récent rapprochement diplomatique avec la France (qui a fait "un geste" en "poussant" Massoud Radjavi hors de ses frontières tout en maintenant son plein soutien militaire à l'Irak) indique que le régime de Téhéran commence à comprendre "où se trouve son intérêt".
Cependant, la fonction du raid américain ne se limitait pas à des questions de stratégie impérialiste. Avec tout le battage médiatique qui l'a accompagné, notamment autour de la "dénonciation du terrorisme", cette opération se voulait également une contribution à toutes les campagnes idéologiques visant à détourner la classe ouvrière des luttes qui ne peuvent manquer de se déployer face à 1'intensification des attaques économiques qui se développent à l'heure actuelle. Car pour la bourgeoisie de tous les pays, plus important encore que le problème des antagonismes commerciaux entre nations, des affrontements impérialistes entre blocs, est le problème que lui pose l'énorme potentiel de combativité existant au sein du prolétariat, notamment celui des pays centraux du capitalisme, et qui constitue la clé de voûte de toute la situation mondiale présente, l'élément déterminant le cours historique actuel.
L'ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DES COMBATS DE CLASSE
7) S'il est un domaine où l'accélération de l'histoire se manifeste de façon particulièrement nette, c'est bien celui du développement de la lutte de la classe ouvrière. Cela "se traduit en particulier par le fait que les moments de recul de la lutte (comme celui de 1981-83) sont de plus en plus brefs, alors que le point culminant de chaque vague de combats se situe à un niveau plus élevé que le précédent" (Ibid.). De même, au sein de chacune de ces vagues, les "moments inévitables de répit, de maturation, de réflexion" (ibid.) sont eux-mêmes d'une durée de plus en plus courte. Ainsi toute la campagne récente sur la "passivité" de la classe ouvrière, basée sur une baisse apparente de la combativité en 1985, a fait aujourd'hui long feu avec les formidables combats de classe qui viennent de se dérouler en avril et mai en Belgique."Ces combats qui viennent après des mouvements de très grande ampleur en Scandinavie et surtout en Norvège (et qui, compte tenu du faible niveau des luttes ouvrières dans cette région auparavant, sont significatifs de la profondeur de la vague actuelle des combats de classe), constituent une confirmation éclatante de ce qu'affirmait la résolution du 6ème Congrès du CCI :
"...les actuels moments de répit... que peut s'accorder aujourd'hui la classe restent limités dans le temps comme dans l'espace, et bien que la bourgeoisie fasse tout pour transformer cet effort de réflexion qui s'opère dans la classe en expectative et en passivité, la situation reste caractérisée par une accumulation de mécontentement et de combativité potentielle prête à exploser d'un moment à l'autre."
Mais ce que traduit principalement le mouvement des ouvriers en Belgique c'est l'étroitesse des limites de la politique bourgeoise qui avait permis en 1985, non une extinction des manifestations de combativité, mais une dispersion de ces manifestations en une série de luttes isolées, menées par un nombre bien plus limité d'ouvriers que dans la première phase (83-84) de la troisième vague de luttes depuis la reprise historique de 1968 et qui avait débuté par les combats massifs du secteur public en septembre 83 dans ce même pays.
8) Cette politique de dispersion des luttes, la bourgeoisie l'avait basée essentiellement sur une dispersion des attaques économiques elles-mêmes, sur une planification et un étalement dans le temps et l'espace de celles-ci. Cela lui était permis par la petite marge de manoeuvre que lui laissaient les retombées de la "reprise" américaine de 83-84, ce qui d'emblée posait les limites objectives de cette politique du fait même que, pour l'économie capitaliste, ce répit ne pouvait être que de courte durée. De plus, cette politique contenait toute une série d'autres limites :
- dans la mesure où, dans les pays les plus avancés, une part non négligeable du prix de la force de travail est versée sous forme de prestations sociales de toutes sortes (sécurité sociale, allocations familiales, etc.) toute réduction de cette part de salaire ne peut se faire que de façon globale, au détriment de toutes les ouvriers et non de ceux de tel ou tel secteur;
- du fait que, dans ces mêmes pays, une énorme proportion (souvent la majorité) des ouvriers dépendent d'un "patron" unique, l'Etat, soit parce qu'ils travaillent dans le secteur public, soit parce que sans emploi, ils ne survivent que de ses subsides, le champ d'application de cette politique se limite essentiellement à un secteur particulier de la classe, celui qui travaille dans le secteur privé (ce qui explique en grande partie tous les efforts de beaucoup de gouvernements en vue de "reprivatiser" le plus possible l'économie).
Ce qui vient de se passer en Belgique confirme que 1'ensemble dé ces limites commence à être atteint, que c'est de façon de plus en plus massive et surtout frontale que la bourgeoisie est obligée de porter ses attaques, que la tendance générale des luttes n'est plus au maintien dans la dispersion mais au dépassement de cette dispersion. C'est particulièrement clair lorsqu'on constate que les mesures qui ont provoqué cette formidable réponse de la classe :
- sont dictées à la bourgeoisie par l'absence presque totale de marge de manoeuvre économique, par l'urgence d'"assainir" et d'adapter l'économie du pays notamment face à la perspective de 1'intensification sans précédent de la guerre commerciale que va provoquer la récession qui vient, urgence qui ne lui permet plus d'étaler ou de reporter ses attaques,
- concernent tous les secteurs de la classe ouvrière (privé, public et chômeurs) et mettent en cause toutes les composantes du salaire (salaire nominal et salaire "social").
C'est encore plus clair lorsqu'on voit pratiquement tous les secteurs de la classe ouvrière participer massivement au mouvement, non seulement d'une simple façon simultanée, mais avec des tentatives de plus en plus déterminées de rechercher la solidarité et l'unification des luttes d'un secteur à l'autre.
9) De même que la grève du secteur public en Belgique en 83 annonçait l'entrée de la classe ouvrière mondiale, et tout particulièrement en Europe occidentale, dans la première phase de la troisième vague de luttes, celle qui fut marquée par des luttes massives et d'une très grande simultanéité .internationale, les récentes grèves dans ce même pays, annoncent 1'entrée de cette même classe ouvrière dans une troisième phase de cette vague, celle qui après la deuxième phase marquée par la dispersion des luttes, va manifester des tendances de plus en plus nettes vers 1'unification de celles-ci. Le fait que dans les deux cas ce soit la classe ouvrière du même pays qui se soit retrouvée aux avant-postes n'est pas sans signification. En effet, malgré la petite taille de ce pays, la situation de la Belgique constitue un résumé des caractéristiques fondamentales de l'ensemble des pays d'Europe occidentale :
- situation catastrophique d'une économie nationale développée, par ailleurs extrêmement dépendante du marché mondial (70% de la production de ce pays est exportée)
- taux très élevé du chômage
- très forte concentration industrielle sur une surface réduite
- ancienneté tant de la bourgeoisie que du prolétariat
- vieille et forte expérience pour ces deux classes de leurs affrontements communs.
De ce fait, les combats qui viennent de se dérouler dans ce pays ne sauraient être considérés comme un feu de paille, un événement non significatif à l'échelle européenne et mondiale. Au contraire, ils ne font qu'augurer de ce qui attend les autres pays d'Europe occidentale, et plus généralement les principaux pays avancés, dans la période qui vient. Et cela notamment du point de vue de leurs principales caractéristiques dont la plupart avaient déjà été identifiées dès le début de la troisième vague de luttes :
1."tendance à des mouvements de grande ampleur impliquant un nombre élevé d'ouvriers, touchant des secteurs entiers ou plusieurs secteurs simultanément dans un même pays, posant ainsi les bases de l'extension géographique des luttes;
2. tendance au surgissement de mouvements spontanés manifestant, en particulier à leurs débuts, un certain débordement des syndicats;
3. développement progressif au sein de l'ensemble du prolétariat de sa confiance en soi, de la conscience de sa force, de sa capacité à s'opposer comme classe aux attaques capitalistes"(Ibid.);
4. recherche de la solidarité active et de l'unification par delà les usines, les catégories ou les régions, notamment sous forme de manifestations de rue et en particulier de délégations massives d'un centre ouvrier à l'autre, mouvement qui se fera en confrontation croissante avec tous les obstacles placés par le syndicalisme et au cours duquel "s'imposera de plus en plus aux ouvriers des grandes métropoles capitalistes, notamment ceux d'Europe occidentale, la nécessité de l'auto-organisation de leur combat" (Ibid.)
10) Cette nécessité de l'auto-organisation et cette tendance à la recherche active de l'unification, au-delà de la simple extension des luttes, constituent le trait majeur de la 3ème phase de la 3ème vague de luttes. Ce trait (qui n'avait pas encore été identifié lors du 6ème Congrès du CCI) découlait de la politique bourgeoise d ' éparpillement des luttes basée sur 1'éparpillement des attaques économiques (mise en évidence, par contre, au début de l'année 86 dans l'éditorial de la Revue Internationale n°45).
Du fait même qu'il fait suite à une offensive bourgeoise tendant à briser l'élan de la 3ème vague de luttes, et qu'il s'inscrit en dépassement des difficultés engendrées par cette offensive, ce trait introduit dans cette 3ème vague de luttes une dimension générale de la plus haute importance, d'une portée comparable à cette autre caractéristique mise en évidence dès son début : "la simultanéité croissante des luttes au niveau international, jetant les jalons pour la future généralisation mondiale des luttes." (Revue Internationale n°37, 1er trimestre 84). Cependant malgré leur importance comparable, ces deux caractéristiques n'ont pas la même signification du point de vue du développement concret des luttes ouvrières, et partant, de 1'intervention des révolutionnaires en leur sein. La simultanéité internationale, malgré toute sa dimension historique en tant que préfiguration de la future généralisation, est bien plus, à l'heure actuelle, un état de fait découlant notamment de la simultanéité des attaques bourgeoises dans tous les pays que d'une démarche délibérée, prise en charge de façon consciente par les ouvriers de ces pays, et cela notamment du fait de la politique systématique de black-out menée par la bourgeoisie. Par contre la tendance à l'unification des luttes, tout en ayant une portée historique comparable, en tant que jalon vers la grève de masse, et partant vers la révolution, constitue également une donnée immédiate au sein des combats prolétariens actuels, une composante de ces combats que les ouvriers doivent nécessairement prendre en charge de façon consciente. En ce sens, si la simultanéité internationale des luttes pose les jalons, le cadre historique de leur généralisation mondiale future, le chemin concret qui y conduit, dans la mesure où cette généralisation ne pourra être qu'un acte conscient, passe nécessairement par le développement des tendances à 1'unification qui s'expriment dès maintenant. C'est pour cela qu'il revient aux révolutionnaires de souligner dans leur intervention toute 1'importance de cette marche vers l'unification. Et cela d'autant plus que c'est dans cette marche que la classe sera contraint de développer de façon croissante son auto organisation face aux confrontations répétées contre les obstacles syndicaux.
11) Une des composantes de ce mouvement vers l'auto organisation, et qui s'était déjà manifestée dans les luttes récentes, s'est exprimée de façon très claire lors des derniers combats en Belgique : la tendance au surgissement spontané des luttes, en dehors de toute consigne syndicale, tendance déjà mise en évidence dès le début de la 3ème vague. A propos de cette tendance, il importe de souligner les points suivants :
11-1. Elle participe d'une composante générale de la lutte de classe dans la période de décadence déjà identifiée depuis longtemps par les révolutionnaires : "Un tel type de luttes, propre à la période de décadence, ne peut se préparer d'avance sur le plan organisationnel. Les luttes explosent spontanément et tendent à se généraliser...ce sont là des caractéristiques qui préfigurent l'affrontement révolutionnaire."(Revue Internationale N°23, "Le prolétariat dans le capitalisme décadent").
11-2. Cependant les mouvements spontanés ne traduisent pas nécessairement un niveau de conscience plus élevé que les mouvements se développant à l'appel des syndicats :
- d'une part, de nombreuses luttes surgies spontanément ont été et sont encore reprises en main facilement par les syndicats,
- d'autre part, l'occupation systématique du terrain social par la gauche dans l'opposition conduit souvent les syndicats à prendre les devants de combats porteurs d'un fort potentiel de prise de conscience,
- enfin, dans certaines circonstances historiques, notamment celles où la gauche est au gouvernement, comme ce fut le cas fréquemment au cours des années 60-70, des grèves spontanées ou même sauvages, peuvent n'être que la simple traduction pratique de 1'opposition déclarée des syndicats à toute lutte sans pour cela exprimer un niveau élevé de la conscience dans la classe.
11-3. Toutefois, le fait que la tendance à la multiplication des luttes spontanées se développe alors que la bourgeoisie a placé ses forces de gauche dans l'opposition, que celles-ci radicalisent de façon très importante leur langage, confère aux luttes spontanées d'aujourd'hui une signification toute différente de celle des luttes évoquées plus haut. Ce fait révèle notamment un discrédit croissant des syndicats aux yeux des ouvriers, discrédit qui, résultant de manoeuvres où les syndicats se présentent en permanence comme "l'avant-garde" des combats, et même s'il ne débouche pas mécaniquement sur une prise de conscience de fond de la véritable nature du syndicalisme et de la nécessité de l'auto-organisation, crée les conditions de cette prise de conscience.
11-4. Une des causes importantes de cette tendance aux surgissements spontanés réside dans l'accumulation d'un énorme mécontentement qui explose bien souvent de façon inattendue. Mais là encore, une des raisons de cette accumulation de mécontentement est constituée par le fait que le discrédit qui pèse sur les syndicats les empêche aujourd'hui d'organiser des "actions" destinées à servir de soupape de sécurité à ce mécontentement.
Ainsi, en exprimant globalement une maturation de la combativité et de la conscience, notamment du point de vue de la compréhension croissante du rôle du syndicalisme et des nécessités de la lutte, le développement actuel des mouvements spontanés de la classe s'inscrit pleinement dans le long processus historique qui conduit aux affrontements révolutionnaires.
12) Ce discrédit des syndicats, dont l'accroissement est une condition, certes insuffisante, mais indispensable au développement de la conscience dans la classe, est appelé à s'amplifier de façon significative dans la phase actuelle de la lutte de classe. En effet, si la mise à contribution depuis de nombreuses années,du syndicalisme et de la gauche en général comme élément central de la politique bourgeoise de division de la classe, de sabotage, dévoiement et épuisement des luttes, permet d'expliquer le degré de méfiance d'ores et déjà atteint par les ouvriers à 1'égard des syndicats, si le début de la 3ème vague correspondait déjà à une certaine usure de la gauche dans l'opposition après que cette carte jouée à partir de 78-79 ait été grandement responsable de l'épuisement prématuré de la 2ème vague et du désarroi qui accompagne la défaite en Pologne de 1981, la période pendant laquelle la bourgeoisie a été capable de mener sa politique de dispersion des attaques a permis à celle-ci, dans la plupart des pays, de s'épargner un emploi trop voyant de ses forces de gauche et de ses syndicats. En effet, durant cette période, ce sont les secteurs de droite et le patronat privé qui se sont trouvés aux avant-postes dans la mise en oeuvre de la stratégie de division des luttes ouvrières dans la mesure où celle-ci se basait avant tout, non sur les manoeuvres de la gauche, mais sur la façon dont les attaques directes étaient elles-mêmes conduites, les syndicats ne faisant qu'accentuer le caractère dispersé des luttes découlant de la forme même des attaques 'auxquelles ces luttes ripostaient.
Mais dès lors que par l'épuisement de sa marge de manoeuvre économique, la bourgeoisie est contrainte de renoncer à la dispersion des attaques, qu'elle est obligée de les mener de façon frontale, elle ne dispose plus pour poursuivre sa politique de division des ouvriers (politique qu'elle maintiendra jusqu'à la révolution) que de la gauche et des syndicats, lesquels sont beaucoup plus ouvertement mis à contribution et sont amenés, de ce fait, à dévoiler bien plus leur véritable fonction. La multitude de manoeuvres entreprises par les syndicats lors des récentes luttes en Belgique (notamment le saucissonnage des journées d'action par secteur) en vue de casser en morceaux la riposte ouvrière aux mesures gouvernementales, la prise de conscience constatée chez les ouvriers du rôle de diviseurs joué par les syndicats, constituent une première concrétisation probante de cette tendance générale à l'accentuation du discrédit de la gauche et des syndicats qui est propre à la phase actuelle du développement des combats de classe.
13) La méfiance croissante des ouvriers à l'égard de la gauche et des syndicats est riche, comme on l'a vu, de potentialités de surgissements massifs de la lutte du prolétariat, du développement de l'auto-organisation et de la conscience de celui-ci. En particulier, la période qui vient verra se manifester de plus en plus nettement une tendance à la formation au sein de la classe de groupements plus ou moins formels d'ouvriers cherchant à se défaire des nasses paralysantes du syndicalisme, à réfléchir sur les perspectives plus générales de leur combat.
C'est bien pour ces raisons que la bourgeoisie mettra de plus en plus en avant l'arme du"Syndicalisme "de base" ou "de combat" - comme cela s'est illustré clairement dans les luttes en Belgique - destiné, avec son langage "radical", à ramener à l'intérieur du carcan syndical (des syndicats existants ou du syndicalisme) les ouvriers qui tentent de briser ce carcan. Dans cette situation, il importe de pouvoir distinguer ce qui témoigne de la vitalité de la classe (l'apparition de groupes ou comités d'ouvriers combatifs engagés dans une démarche de rupture avec la gauche ou le syndicalisme) de ce qui relève d'une politique bourgeoise destinée notamment à entraver cette démarche (le développement du syndicalisme de base), d'autant qu'au début d'un tel processus, les éléments de la classe qui se sont engagés dans cet effort de rupture peuvent adopter des positions apparemment en retrait par rapport à celles du syndicalisme de base et des gauchistes, spécialistes de la phrase "radicale". Il appartient par conséquent aux révolutionnaires de ne pas juger de façon statique les phénomènes de ces deux types qui apparaîtront au cours du développement des luttes, mais d'avoir en vue, sur la base d'un examen attentif, la dynamique de chaque phénomène particulier afin de pouvoir combattre avec la plus grande vigueur toute manoeuvre "radicale" de la bourgeoisie mais aussi de savoir encourager et impulser les efforts encore embryonnaires de la classe en direction d'une prise de conscience et non les stériliser en les confondant avec ces manoeuvres bourgeoises.
14) Un des autres enseignements des récents combats en Belgique, qui vient confirmer ce que les marxistes ont toujours affirmé contre les proudhoniens et les lassaliens, et plus récemment contre les modernistes, c'est que la classe ouvrière, non seulement peut et doit lutter pour la défense de ses intérêts immédiats en préparation de sa lutte comme classe révolutionnaire, mais peut aussi sur ce terrain faire reculer la bourgeoisie. Si la décadence du capitalisme interdit à cette dernière d'accorder de réelles réformes à la classe ouvrière, si la phase de crise aiguë - comme celle où nous sommes entrés - ne lui offre d'autre possibilité que d'attaquer les ouvriers de plus en plus brutalement, cela ne signifie nullement que la classe ouvrière n'ait d'autre choix qu'entre faire (ou préparer) immédiatement la révolution et subir passivement ces attaques sans espoir de les limiter. Même lorsque la situation d'un capital national apparaît comme désespérée, comme c'est le cas de la Belgique aujourd'hui, que les attaques impliquées par cette situation ne semblent pas pouvoir être différées ou atténuées, la bourgeoisie conserve encore une petite marge de manoeuvre lui permettant de renoncer momentanément - et même au prix de difficultés futures bien pires encore - à certaines de ses attaques si elle se confronte à un niveau significatif de résistance de la part du prolétariat. C'est ce qu'on a pu également constater en Belgique avec le "réexamen" des mesures touchant les mines du Limbourg et les chantiers navals, de même qu'avec le report du plan d'austérité du gouvernement Martens.
Il en est en fin de compte du degré d'urgence et de gravité des attaques capitalistes comme du de gré de saturation des marchés qui les dicte : de même que, si elle tend à devenir de plus en plus totale, cette saturation n'atteint jamais un point absolu, la marge de manoeuvre économique de chaque capital national, tout en s'approchant toujours plus de zéro, n'atteint jamais une telle limite. Il importe donc que les révolutionnaires, s'ils doivent mettre en évidence la perspective d'effondrement de plus en plus total du capitalisme et donc la nécessité de le remplacer par la société communiste, soient également capables, en vue d'impulser les luttes immédiates, de montrer que celles-ci "paient" et qu'elles "paient" d'autant plus qu'elles sont menées à une grande échelle, de façon unie et solidaire, que plus la bourgeoisie s'affrontera à une classe ouvrière forte et plus elle sera contrainte d'atténuer, et reporter les attaques qu'elle se proposé de mener.
15) Une des autres confirmations qu'apportent les événements d'avril-mai 86 en Belgique, c'est l'importance croissante de la lutte des chômeurs, la capacité de ce secteur de la classe ouvrière de s'intégrer de plus en plus dans les combats généraux de la classe, même si ce phénomène n'a été constaté que sous une forme encore embryonnaire au cours de cette période. Avec cet autre phénomène constitué par l'apparition et le développement ces dernières années de nombreux comités de chômeurs dans les principaux pays d ' Europe occidentale, c'est bien une confirmation de l'analyse selon laquelle :
- le chômage deviendra "un élément essentiel du développement des luttes ouvrières jusque-là la période révolutionnaire...
- les ouvriers au chômage tendront de plus en plus à se retrouver aux avant-postes des combats de classe."(Résolution du 6ème Congrès du CCI).
Une autre confirmation apportée par la dernière période concerne l'organisation des chômeurs : ce qu'a montré une nouvelle fois 1'expérience de la Conférence de Gottingen en RFA (en 1985) de même que de plusieurs comités de chômeurs comme celui de Toulouse en France, c'est que, fondamentalement, l'organisation des chômeurs est à l'image de celle de l'ensemble de la classe : elle surgit et se centralise dans la lutte et pour les besoins de la lutte. Même si les comités de chômeurs peuvent exister de façon plus durable que les comités de grève, toute tentative pour maintenir en vie de tels organes, de les doter d'une structure centralisée en dehors de tels besoins, ne peut que les conduire à devenir tout autre chose que des organisations unitaires de lutte : au meilleur des cas, des groupes ouvriers de discussion, au pire de nouveaux syndicats.
16) Les luttes en Belgique apportent enfin une autre confirmation de ce que les révolutionnaires ont mis en évidence depuis le surgissement historique du prolétariat à la fin des années 60 et plus particulièrement avec 1'accélération considérable de l'histoire qui marque les années 80 : du fait que la crise laisse de moins en moins de répit à la bourgeoisie et que celle-ci est amenée à en laisser de moins en moins à la classe ouvrière,, cette dernière est conduite, au cours d'une même génération, à accumuler les expériences de lutte contre le capital et "cette accumulation d'expériences de lutte du prolétariat, comme la proximité de plus en plus grande entre chacune d'elles, constitue un élément essentiel de prise de conscience par l'ensemble de la classe (des conditions et des véritables enjeux de son combat."(Ibid.)
Ainsi, il est clair qu'en Belgique, les ouvriers ont été capables de donner une telle ampleur à leurs combats du printemps 86 parce qu'ils avaient tiré et conservé de nombreux enseignements des luttes menées trois ans auparavant. C'est là un phénomène qui tendra à se généraliser et s'intensifier dans tous les pays centraux du capitalisme, ce qui donne la mesure des potentialités de lutte considérables, d'une ampleur inconnue jusque-là présent, qui existent dans ces pays et que ne doivent pas sous-estimer les révolutionnaires. Et cela d'autant plus que, contrairement à ce qui s'était déroulé dans le passé où la récession de 74-75 avait frappé une classe ouvrière en recul momentané, où celle de 81-82 est intervenue alors que le prolétariat subissait encore le poids de la défaite de 81 en Pologne, la récession qui s'annonce va rencontrer et impulser des luttes ouvrières en plein essor.
Toutefois il serait faux et dangereux de s'imaginer que, d'ores et déjà, est ouvert un chemin rectiligne vers la période révolutionnaire, La classe ouvrière est encore loin d'une telle période. Pour y parvenir elle doit opérer en son sein toute une transformation qui fera de la classe exploitée qu'elle est au sein du capitalisme - et à travers ses luttes comme classe exploitée - la classe révolutionnaire capable de prendre en charge l'avenir de l'humanité. C'est dire toute la dimension et la difficulté du chemin qu'il lui reste à parcourir, notamment pour se défaire de toute la pression de 1’idéologie dominante qui pèse sur elle et tout particulièrement pour venir à bout, à travers des confrontations répétées et de plus en plus conscientes, des multiples mystifications et pièges que la bourgeoisie, sa gauche et ses syndicats, opposent et continueront d'opposer à ses luttes et à sa prise de conscience. Même condamnée historiquement, et telle un fauve blessé à mort, la bourgeoisie continuera à se défendre bec et ongles jusqu'au bout, et l'expérience montre à quel point elle est capable d'inventer en permanence de nouveaux pièges visant à défaire le prolétariat, ou au moins à ralentir sa progression.
C'est pourquoi il importe de souligner le caractère heurté du combat de la classe ouvrière, d'avoir en mémoire les enseignements déjà tirés par Rosa Luxemburg lors des combats de 1905 dans l'Empire russe, le fait notamment que la grève de masse, qui marque l'entrée dans une période révolutionnaire, est un "océan de phénomènes" aux apparences contradictoires, de multiples formes de lutte, d'avancées puis de reculs au cours desquels il semble que se soit éteint le feu de la lutte, mais qui ne font que préparer des combats encore plus vastes.
Malgré leurs limites et bien qu'elles fussent encore bien loin de la grève de masse (laquelle constitue une perspective à long terme dans les pays avancés) les récentes luttes en Belgique, avec leurs divers rebondissements, nous confirment la nécessité de prendre en compte cette démarche heurtée, de ne pas enterrer un mouvement dès ses premiers revers, de garder confiance dans toutes les potentialités qu'il peut receler et qui ne s'expriment pas immédiatement.
S'il appartient aux révolutionnaires de souligner aux yeux de leur classe toute l'importance et toutes les potentialités de ses luttes actuelles, il leur appartient aussi de lui montrer la longueur et la difficulté du chemin à parcourir et cela, non pour la démoraliser, mais au contraire pour lutter contre la démoralisation qui menace après chaque revers. C'est le propre des révolutionnaires que d'exprimer au plus haut point ces qualités de la classe porteuse du futur de l'humanité : la patience, la conscience de l'ampleur immense de la tâche à accomplir, une confiance sereine mais indestructible en l'avenir.
25/6/86
Vie du CCI:
Conscience et organisation:
Où en est la crise économique ? : l’impasse
- 2895 lectures
LA CRISE S'APPROFONDIT LA GUERRE COMMERCIALE S'EXACERBE
LES ATTAQUES CONTRE LA CLASSE OUVRIERE S'INTENSIFIENT
Devant une population de travailleurs sceptiques, fatigués de voir le chômage s'accroître inexorablement depuis 15 ans et d'entendre tout aussi régulièrement que "la fin des difficultés de l'économie est proche", les gouvernements ont crié, au début 86, sur tous les toits, que cette fois-ci on commençait à voir le bout du tunnel -à condition, évidemment, que les travailleurs acceptent encore quelques sacrifices. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole s'effondraient sur le marché mondial et que le cours du dollar baissaient. La presse parlait de "contre-choc pétrolier", de la "manne pétrolière" qui allait tout résoudre. Le cauchemar tendrait à sa fin.
Six mois plus tard les faits sont là : les capitaux des pays industrialisés ont bien réalisé des économies sur la facture, pétrolière évaluées à 60 milliards de dollars, mais le chômage non seulement ne diminue pas mais ne fait que s'accroître et les annonces de nouveaux licenciements dans tous les secteurs se multiplient dans tous les pays.
Quant aux plans d'austérité, tous les gouvernements ne font quel es renforcer.
L'économie américaine ne cesse de ralentir sa croissance pour connaître au 2ème trimestre 86 son taux de croissance le plus faible depuis "l'année noire" de 1982 (+1,1%).
Le Japon, dont la production dépend plus que jamais directement de ses exportations vis-à-vis des USA, connaît pour la première fois depuis 1975 des taux de croissance négatifs (-0,5% du PNB au premier trimestre) et le spectre d'une récession imminente. L'Europe subit, tout carme le Japon, les effets de l'essoufflement de l'économie US et les prévisions de croissance sont toutes successivement révisées à la baisse.
OU EST PASSEE LA "MANNE PETROLIERE" ?
La chute du prix du pétrole et du dollar s'est bien traduite depuis la fin 85 par d'importantes économies en particulier pour les capitaux des pays industrialisés importateurs de pétrole (on parle de 60 milliards de dollars, soit l'équivalent de la production annuelle totale d'un pays comme l'Autriche ou le Danemark). Mais qu'ont fait jusqu'à présent les capitalistes avec cet argent ? Dans les pays sous-développés importateurs de pétrole il n'aura servi qu'à tenter d'éponger un peu de l'énorme endettement extérieur. Dans les pays industrialisés, il n'a fait pour le moment qu'alimenter les spéculations de toutes sortes (métaux précieux, taux de change des monnaies...) et en particulier celle effrénée qui enflamme depuis un an les principales places boursières d'occident.
Confrontés à la tâche quasi impossible de réaliser de véritables investissements productifs (ouverture de nouvelles usines, embauche de nouvelle main d'oeuvre) les capitaux se réfugient dans des manoeuvres spéculatives. Les capitaux affluent, entre autre, aux bourses et les actions des entreprises montent à des vitesses foudroyantes sans que pour autant celles-ci se préparent significativement à investir ou produire plus. C'est ainsi qu'on assiste à ce phénomène aussi absurde que lourd de menaces d'effondrements financiers où l'en voit en un an, entre mai 85 et mai 86, le cours des actions littéralement exploser : +25% en Grande-Bretagne, +30% aux USA et au Japon, +38% en France, +45% en Allemagne, +206% en Italie ! Alors que les indices de la production industrielle stagnent ou reculent carrément : -0,8% en Grande-Bretagne, +0,6% aux USA, -1,7% au Japon (du jamais vu depuis 75), -1,8% en France, +1% en Allemagne, +1,2% en Italie.
La spéculation en de telles proportions est toujours un signe majeur de crise : elle traduit l'impuissance de la machine productive et le déclin du capital' réel au profit de ce que Marx appelait le capital fictif. Pour l'avenir, c'est l'accumulation d'une bombe financière car les profits ainsi contenus sont tout aussi fictifs.
Les économies provoquées par la chute du prix du pétrole ne se transforment pas en facteur de croissance dans les pays industrialisés importateurs car le problème de fond du capitalisme n'est pas un manque de ressources financières mais le manque de débouchés, de marchés solvables pour ses marchandises. Par contre, cette chute a des effets catastrophiques pour les pays exportateurs qui voient se réduire d'autant leur principale source de revenus. Au premier plan de ces victimes, l'URSS, et à travers elle, les pays de l'Est.
LA CHUTE DE PETROLE ET DU DOLLAR : DES MANIFESTATIONS D'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DE LA CRISE ECONOMIQUE
Le pétrole n'est pas une matière première tout à fait comme les autres du fait de son importance militaire et économique et du fait que sa distribution et son traitement dans le monde dépendent pour l'essentiel des grandes "multinationales" pétrolières américaines... donc du Pentagone. Mais il n'en demeure pas moins une marchandise soumise à la pression des lois du marché. L'effondrement de son cours nominal n'est pas un phénomène isolé. Il s'intègre entièrement dans le phénomène global de l'actuelle baisse des cours des matières premières (entre 1983 et 85, le prix des matières premières agricoles exportées par les pays en voie de développement ont chuté de 13%, celui des minéraux, minerais et métaux de 8% ; indice CNUCED). C'est là encore un symptôme typique de crise économique, capitaliste. Il y a surproduction de matières premières non pas parce que leur production a particulièrement augmenté, au contraire, mais parce que les industries manufacturières qui les consomment, sont elles-mêmes de plus en plus confrontées à la surproduction. La baisse de leur prix est le signe d'une insuffisance croissante du marché mondial, de la surproduction généralisée de toutes les marchandises.
Quant à la chute du dollar elle a une signification immédiate qui traduit la situation catastrophique de la première puissance mondiale. Pour sortir de l'effondrement de la récession de 1982 le capital américain a dû recourir à une nouvelle fuite en avant dans l'endettement, en particulier par une foudroyante augmentation de son déficit public (cf. graphique). Entre 82 et 85 celui-ci a presque doublé, passant de 128 à 224 milliards de dollars (et on estime qu'il ne sera pas inférieur à 230 milliards en 86), ce qui équivaut à peu près à la production annuelle de l'Espagne et de la Belgique réunis, ou à l'endettement total du Mexique, Brésil et Venezuela réunis ! Quant à sa balance commerciale -la différence entre la valeur des exportations et des importations- son déficit est passé de 34 milliards de dollars en 82 à 124 en 85, soit une augmentation de 265% en 3 ans. De ce fait, on est arrivé à cette situation particulièrement significative de l'état de santé du capitalisme mondial que la première puissance économique est devenue l'Etat le plus endetté du monde.
La chute du cours du dollar est la manifestation de cet état de fait. Le capital américain est contraint de laisser tomber le cours de sa monnaie car d'une part il y trouve le principal moyen de réduire le montant de sa dette astronomique (libellée en dollars), d'autre part parce qu'il n'a pas d'autre moyen pour améliorer la compétitivité de ses marchandises sur le marché mondial.
20 ANS APRES, LES PROBLEMES DES MARCHES POSES PAR LA FIN DE LA RECONSTRUCTION D'APRES-GUERRE REAPPARAISSENT AU GRAND JOUR AVEC UNE FORCE DECUPLEE
Mais au-delà de la signification immédiate de la baisse du dollar au niveau de l'économie américaine, on assiste à la manifestation de l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme mondial depuis la fin des années 60.
Pendant les années 50 et 60 (les "années dorées" disent aujourd'hui avec nostalgie les économistes bourgeois) l'économie mondiale a connu un développement basé essentiellement sur la dynamique de la reconstruction des puissances détruites pendant la 2è guerre mondiale. Les USA "exportaient massivement vers l'Europe et le Japon qui absorbaient tout aussi massivement les produits "made in USA" et le monde entier honorait le roi dollar comme de l'or. Cependant, dans la deuxième moitié des années 60, la reconstruction s'achève ([1] [7]) : l'Europe et le Japon sont devenus des puissances qui, non seulement sont capables d'exporter plus qu'elles n'importent, mais qui en outre ne peuvent plus vivre sans exporter de plus en plus. Dès 1967 un puissant ralentissement de la croissance en Allemagne occidentale déclenche une première récession mondiale. Eh 15 ans celle-ci sera suivie de trois autres récessions chacune plus profonde et étendue que la précédente : 1970, 1975, 1982.
Le capitalisme occidental a jusqu'à présent surmonté ces récessions, en un premier temps -au début des années 70- en "trichant" sur ses propres lois, en abandonnant certains des aspects les plus contraignants de ses propres mécanismes, un peu comme un navire qui, commençant à faire eau de toutes parts, jette à l'eau une partie de son intérieur pour ralentir sa perte. Mais il y est parvenu partout en ayant recours de façon de plus en plus massive au crédit sous toutes ses formes, c'est-à-dire en repoussant à plus tard les échéances... et sans pour autant résoudre le problème de fond : son incapacité intrinsèque à créer lui-même de réels débouchés solvables suffisants pour absorber sa production.
Crédits massifs à certains pays sous-développés, aux, pays du bloc de l'Est, aux pays producteurs de pétrole, enfin crédits au gouvernement de la première puissance mondiale pour financer son armement.
C'est ainsi qu'on voit au cours des années 70 "le miracle brésilien", la modernisation industrielle de certains pays de l'Est (Pologne) avec des prêts occidentaux, le boom des pays pétroliers.
Mais au début des années 80 l'ensemble de ces crédits arrive à échéance : il ne suffit pas de construire des usines et de les faire tourner encore faut-il pouvoir vendre ce qu'elles produisent. Les pays qui ont acquis quelques nouvelles capacités industrielles, incapables de se faire une place dans un marché mondial sursaturé et dominé par les vieilles puissances, se déclarent les uns après les autres incapables de rembourser leurs dettes, et donc à posteriori incapables de continuer à acheter : on connaît la banqueroute du capital polonais en 1980.Celles des autres pays périphériques se succèdent les unes après les autres. Les importations des pays sous-développés non producteurs de pétrole qui croissaient encore en 1980 au rythme de 11% par an, chutent a -5% l’an en 1982. La croissance de celles des pays pétroliers de la périphérie passent de 21% en 1980 à 2% en 82 et -3% en 83.
La récession de 1982, la plus profonde et étendue depuis la 2de guerre mondiale fut la manifestation éclatante de la faillite de cette fuite en avant.
La "relance américaine" de 83-84, faite au prix des déficits que l'on cannait, empêchera que le système bancaire mondial, et donc le système économique lui-même, ne s'effondre totalement. Cependant, malgré les gigantesques moyens mis en oeuvre par le capital américain, la relance n'en sera pas une réellement : elle ne réussit pas à relancer l'économie des pays périphériques qui s'effondre, l'Europe elle-même ne parvenant qu'à stagner. Dès la mi-85 la "locomotive" donne tous les signes de l'essoufflement.
L'actuelle baisse du dollar, le développement vertigineux du protectionnisme américain, les mesures prises par le gouvernement US pour réduire son déficit public, sont la manifestation de la fin de cette quatrième tentative de "relance" d'un capitalisme mondial décadent qui, depuis près de 20 ans, s'enfonce dans des convulsions- toujours plus profondes et tragiques pour l'humanité, incapable de dépasser ses propres contradictions.
LES PERSPECTIVES
Contraction du marché mondial par la banqueroute des pays sous-développés - producteurs de pétrole ou non -, par celle de l'économie des pays de l'Est, par 1'incessibilité pour les grandes puissances de poursuivre la fuite en avant dans l'endettement, menaces d'effondrement bancaires et financiers, même les économistes bourgeois les plus optimistes ne se risquent plus à parler sérieusement de véritable relance.
L'avenir des différents capitaux du monde est celui de la plongée dans la récession et d'une exacerbation sans précédent d'une guerre commerciale sans quartiers pour les parts de marché entre les capitaux "survivants".
Plus le marché mondial se rétrécit et plus cette guerre devient et deviendra aiguë. Or l'arme principale dans cette concurrence pour les marchés, c'est la réduction des prix de vente et donc des coûts de production, celui de la force de travail en premier lieu.
Licenciements de la main d'oeuvre dans les secteurs considérés peu compétitifs, 'flexibilité" de la force de travail, généralisation du travail temporaire et précaire, réduction des salaires versés sous forme monétaire, réduction des salaires versés sous forme de prestations sociales - de la sécurité sociale aux allocations familiales en passant par les retraites, l'enseignement, la santé, etc.
De l'Australie à la Norvège, du Japon à la Belgique, de l'Argentine aux Etats-Unis, tous les gouvernements appliquent des plans dits "d'austérité" destinés à réduire les coûts de main d'oeuvre, à attaquer brutalement les conditions d'existence de la classe ouvrière, pour permettre au capital de survivre.
Plus que jamais la logique de l'exploitation capitaliste apparaît pour ce qu'elle est : la négation antagonique des intérêts les plus élémentaires des travailleurs.
La décomposition de ce système barbare et décadent se fait et se fera en réduisant les classes exploitées à une misère intenable. Mais, ce faisant, elle développe les conditions qui permettent au prolétariat mondial, à travers sa lutte de résistance, de réaliser enfin son unité internationale et de s'affronter à sa tâche historique : la destruction du capitalisme et la construction du communisme.
R.V.
[1] [8] Voir notre brochure "La décadence du capitalisme" sur 1'analyse de l'évolution du capitalisme depuis la seconde guerre mondiale
Récent et en cours:
- Crise économique [9]
1936 : la gauche mène le prolétariat à la boucherie impérialiste
- 4591 lectures
Il y a 50 ans, en 1936, au printemps, explosait en
France une vague de grèves ouvrières spontanéescontre l'aggravation de
l'exploitation provoquée par la crise économique et le développement de l'économie
de guerre. En juillet, en Espagne, face soulèvement militaire de Franco,
l'ensemble de la classe ouvrière partait aussi en grève pour répondre à
l'attaque. Trotski crut voir le début d'une nouvelle vague
révolutionnaire internationale.
Cependant, en quelques mois, l'appareil politique de la gauche du capital, sachant se mettre à la tête de ces mouvements, parviendra à les saboter de l'intérieur, participera à leur répression et enfin, enfermant les ouvriers dans la fausse alternative fascisme/anti-fascisme, remplira le rôle de sergent-recruteur idéologique pour la préparation de ce qui allait être la 2ème boucherie inter-impérialiste mondiale.
Si nous consacrons, à l'occasion de cet anniversaire, deux articles sur ces événements, c'est parce qu'il est aujourd'hui indispensable :
- de dénoncer le mensonge colporté par "la gauche" du capital selon lequel celle-ci aurait été pendant ces événements 1'incarnation-des intérêts de la classe ouvrière, en montrant au contraire comment elle en fut le bourreau ;
- de rappeler les leçons tragiques de ces expériences, en particulier le piège fatal que constitue pour la classe ouvrière d'abandonner le terrain de la défense intransigeante de ses intérêts spécifiques, pour se soumettre aux nécessités d'un camp bourgeois contre un autre ;
- de mettre en évidence ce qui distingue les années 30 - marquées par la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le triomphe de la contre-révolution - de l'actuelle période historique Ou de nouvelles générations de prolétaires cherchent à se dégager des idéologies contre-révolutionnaires à travers une confrontation permanente et croissante contre le capital et cette même gauche ; une confrontation que le prolétariat ne pourra mener jusqu'à son terme, les révolution communiste, qu'en se réappropriant les leçons, si chèrement payées, de son expérience passée.
GUERRE D'ESPAGNE, répétition de la guerre mondiale
1986 marque le cinquantième anniversaire des événements de 1936 en Espagne. La bourgeoisie commémore cette date par des campagnes de falsification des faits, lançant le pernicieux message que les événements de 1936 auraient été une "révolution prolétarienne", alors qu'aujourd'hui, par contre, nous serions dans une situation de "recul et de défaites", de "crise de la classe ouvrière", de soumission toujours plus forte aux diktats du capitalisme.
Il est bien évident que cette leçon, que la bourgeoisie veut que nous tirions de ces événements passés, fait partie de toute sa tactique de dispersion, d'isolement, de division contre le développement des luttes ouvrières. Il s'agit de les noyer dans un soi-disant climat d'apathie et de démobilisation pour s'opposer à leur extension et leur unification.
Face à ces manoeuvres, notre position militante défend les potentialités immenses des luttes actuel les du prolétariat avec la même force qu'elle rejette le mensonge d'une "révolution sociale" en 1936. Nous nous réclamons du courage et de la lucidité de BILAN qui dénonçait, contre le courant, la tuerie impérialiste perpétrée en Espagne, et qui nous fournit la méthode qui nous permet d'affirmer aujourd'hui les potentialités de la lutte de classe dans les années 80 et d'assumer une intervention déterminée en son sein.
GUERRE IMPERIALISTE OU REVOLUTION PROLETARIENNE ?
Comment caractériser les événements qui se sont déroulés en Espagne à partir de 1931 et qui se sont accélérés à partir de 1936?
Notre méthode ne peut se fonder exclusivement sur la violence et la radicalité des heurts entre les classes qui secouèrent l'Espagne de l'époque, mais sur l'analyse du rapport de forces entre les classes à échelle capitaliste internationale et sur toute une époque historique
Cette analyse du cours historique nous permet de déterminer si les différents conflits et situations s'inscrivent dans un processus de défaites du prolétariat dans la perspective de la guerre impérialiste généralisée ou, par contre, dans un processus de montée de la lutte de classes s'orientant vers des affrontements de classe révolutionnaires.
Pour savoir dans quel cours s'inscrivent les événements de 1936, il faut répondre à une série de questions :
- quel était le rapport de forces mondial entre les classes ? Evoluait-il en faveur du prolétariat ou de la bourgeoisie ?
- quelle était l'orientation des organisations politiques du prolétariat ? Vers la dégénérescence opportuniste, la désagrégation et l'intégration dans le camp capitaliste ou, au contraire, vers la clarté et le développement de leur influence ? Plus concrètement : le prolétariat disposait-il d'un parti capable d'orienter ses combats vers la prise du pouvoir ?
- les conseils ouvriers se sont-ils développés et affirmés comme alternative du pouvoir ?
- les luttes prolétariennes ont-elles attaqué l'Etat capitaliste sous toutes ses formes et institutions ?
Face à ces questions notre méthode est celle de BILAN et des autres communistes de gauche (par exemple la minorité de la Ligue des Communistes Internationaux de Belgique à la tête de laquelle se trouvait Mitchell) : ils partent d'une analyse historique et mondiale du rapport de forces dans laquelle inscrivent les événements d'Espagne; ils constatent non seulement l'inexistence d'un parti de classe, mais la débandade et le passage dans le camp de la bourgeoisie de la grande majorité des organisations ouvrières; ils dénoncent la récupération rapide des organismes ouvriers embryonnaires du 19 juillet 1936 par l'Etat capitaliste et, surtout, ils élèvent leur voix contre le piège criminel d'une soi-disant "destruction" de l'Etat capitaliste républicain qui "disparaît" sous la couverture d'un "gouvernement ouvrier" détruisant le terrain de classe des ouvriers et les mène à la tuerie impérialiste de la guerre contre Franco.
Quel était le rapport de forces après les terribles défaites des années 20 ? De quelle manière la mort de l'Internationale communiste ainsi que la dégénérescence accélérée des partis communistes conditionnaient-elles la situation des ouvriers espagnols ? Que restait-il, en définitive, dans les années 30 ? Un cours vers l'affrontement entre les classes ?
Répondre à ces questions était vital pour déterminer s'il y avait ou non révolution en Espagne et, surtout, pour se prononcer sur la nature du violent conflit militaire établi entre les forces franquistes et les forces républicaines, pour voir leur rapport avec l'aggravation des conflits impérialistes qui frappent le monde à cette époque.
L'ABANDON DU TERRAIN DE CLASSE
Le 19 juillet 1936, les ouvriers déclarent la grève contre le soulèvement de Franco et vont massivement aux casernes pour désarmer cette tentative, sans demander la permission au Front Populaire ni au Gouvernement Républicain qui leur font autant de croche-pieds que possible. Unissant la lutte revendicative à la lutte politique, les ouvriers dans cette action arrêtent la main meurtrière de Franco. Mais une autre main meurtrière les paralyse en faisant semblant de leur serrer la main : c'est le Gouvernement Républicain, le Front Populaire, Companys, qui, avec l'aide de la CNT et du POUM, réussissent à faire que les ouvriers abandonnent le terrain de classe de la bataille sociale, économique et politique contre Franco et la République, et se déplacent sur le terrain capitaliste d'une bataille exclusivement militaire dans les tranchées et la guerre de positions, exclusivement contre Franco. Devant la riposte ouvrière du 19 juillet l'Etat républicain "disparaît", la bourgeoisie "n'existe plus", tous se cachent derrière le Front Populaire et les organismes "plus à gauche" tels que le Comité Central de Milices Antifascistes ou le Conseil Central de l'Economie. Au nom de ce "changement révolutionnaire" si facilement conquis, la bourgeoisie demande et obtient des ouvriers l'Union Sacrée autour du seul et unique objectif de battre Franco. Les sanglants massacres qui ont lieu par la suite en Aragon, à Oviedo, à Madrid, sont le résultat criminel de la manoeuvre idéologique de la bourgeoisie républicaine qui fait avorter les germes classistes du 19 juillet 1936.
Ayant quitté son terrain de classe, le prolétariat non seulement devra subir l’égorgement guerrier mais, en conséquence, il lui sera imposé toujours plus de sacrifices au nom de la production pour la guerre "de libération" : réduction des salaires, inflation, rationnements, journées de travail épuisantes... Désarmé politiquement et physiquement, le prolétariat de Barcelone se soulèvera de désespoir en mai 1937 et sera vilement massacré par ceux qui l'avaient bassement trompé : "Le 19 juillet 1936, les prolétaires de Barcelone, AVEC LEURS POINGS NUS, écrasèrent l'attaque de bataillons de Franco, ARMES JUSQU'AUX DENTS. Le 4 mai 1937, ces mêmes prolétaires, MUNIS D'ARMES, laissent sur le pavé bien plus de victimes qu'en juillet lorsqu'il doivent repousser Franco et c'est le gouvernement antifasciste -comprenant jusqu'aux anarchistes et dont le POUM est indirectement solidaire- qui déchaîne la racaille des forces répressives contre les ouvriers." (BILAN "Plomb, mitraille, prison : ainsi répond le front populaire aux ouvriers de Barcelone osant résister à l'attaque capitaliste") "Les fronts militaires : une nécessité imposée par les situations ? Non ! Une nécessité pour le capitalisme afin d'encercler et d'écraser les ouvriers ! Le 4 mai 1937 apporte la preuve éclatante qu'après le 19 juillet, le prolétariat avait à combattre Companys, Giral, tout autant que Franco. Les fronts militaires ne pouvaient que creuser la tombe des ouvriers parce qu'ils représentaient les fronts de la guerre du capitalisme contre le prolétariat. A cette guerre, les prolétaires espagnols -à 1 'exemple de leurs frères russes de 1917- ne pouvaient riposter qu'en développant le défaitisme révolutionnaire dans les deux camps de la bourgeoisie : le républicain comme le "fasciste", et en transformant la guerre capitaliste en guerre civile en vue de la 'destruction totale de l'Etat bourgeois. (BILAN, idem)
L'argument" selon lequel en Espagne 1936, il y a eu une "révolution" est d'une incroyable légèreté et implique une totale ignorance des conditions d'une réelle révolution prolétarienne.
Le contexte international était à la défaite et la désagrégation ouvrières :-"Si le critère internationaliste veut dire quelque chose, il faut affirmer que sous le signe d'une croissance de la contre-révolution au niveau mondial, 1'orientation politique de l'Espagne, entre 1931 et 1936, ne pouvait que poursuivre une direction parallèle et non le cours inverse, d'un développement révolutionnaire. La révolution ne peut atteindre son plein développement que comme produit d'une situation révolutionnaire à échelle internationale. Ce n'est que sur cette base que nous pouvons expliquer les défaites de la Commune de Paris et de la Commune russe de 1905, ainsi que la victoire du prolétariat russe en octobre 1917" (Mitchell : "La guerre en Espagne", janvier 1937).
Les organisations politiques prolétariennes souffraient, dans leur immense majorité, une terrible débandade : les PC s'intégraient définitivement à leurs capitaux nationaux respectifs, le trotskysme se perdait dramatiquement dans l'opportunisme, les rares organisations fidèles au prolétariat ("Bilan", etc.) souffraient d'un terrible isolement : "Notre isolement n'est pas fortuit : il est la conséouence d'une profonde victoire du capitalisme mondial qui est parvenu à gangrener jusqu'aux groupes de la gauche communiste dont le porte-parole a été jusqu'à ce jour Trotsky." (BILAN "L'isolement de notre fraction devant les événements d'Espagne"). "S'il restait le moindre doute sur le rôle fondamental du parti dans la révolution, l'expérience espagnole depuis juillet 1936 aurait suffi pour l'effacer définitivement. Même si on assimile l'attaque de Franco à l'aventure de Kornilov en août 1917(ce qui est faux historiquement et politiquement le contraste entre les deux évolutions est impressionnant L'une, en Espagne détermine la collaboration progressive entr les classes jusqu'à l'union sacrée de toutes les forces politiques ; l'autre, en Russie se dirige vers une élévation de la lutte de classes qui culmine dans 1'insurrection victorieuse, sous le contrôle vigilant du parti bolchevique, trempé, tout au long de quinze années de lutte, par la critique et la lutte armée".(Mitchell : "La guerre en Espagne", janvier 1937).
Il ne peut y avoir une débandade opportuniste vers la bourgeoisie de toutes les forces révolutionnaires en même temps que les masses ouvrières vont de victoire en victoire. C'est tout le contraire : la montée de la lutte de classes est le résultat, en même temps qu'elle l'impulse, d'un mouvement de clarification et de regroupement des révolutionnaires et le fait que ceux-ci se trouvent réduits à leur plus simple expression traduit, en même temps qu'il le renforce, un cours de défaites de la classe ouvrière.
LA SOUMISSION A L'ETAT BOURGEOIS
Malgré la propagande qui a été faite sur la "valeur révolutionnaire" des Comités d'Usine, les collectivités, etc. , il n'a pas existé non plus de conseils ouvriers en 1936 : "Immédiatement étouffés, les comités d'usine, les comités de contrôle des entreprises où l'expropriation ne fut pas réalisée (en considération du capital étranger ou pour d'autres considérations) se transformèrent en organes devant activer la production et, par là, furent déformés dans leur signification de classe. Il ne s'agissait pas d'organismes créés pendant une grève insurrectionnelle pour renverser l'Etat, mais d'organismes orientés vers 1'organisation de la guerre, condition essentielle pour permettre la survivance et le renforcement de cet Etat'.' (BILAN "La leçon des événements d'Espagne")
Pour entraîner les ouvriers dans la boucherie inter capitaliste, tous, de Companys au POUM, d'Azana à la CNT "cèdent le pouvoir" aux organismes ouvriers :
"En face d'un incendie de classe, le capitalisme ne peut même pas songer à recourir aux méthodes classiques de la légalité. Ce qui le menace, c'est 1'INDEPENDANCE de la lutte prolétarienne conditionnant l'autre étape révolutionnaire vers l'abolition de la domination bourgeoise. Le capitalisme doit donc renouer les fils de son contrôle sur les exploités. Ces fils, qui. étaient précédemment la magistrature, la police, les prisons, deviennent dans la situation extrême de Barcelone, les Comités des Milices, les industries socialisées, les syndicats ouvriers gérant les secteurs essentiels de l'économie, les patrouilles de vigilance, etc." (BILAN "Plomb, mitraille, prison : ainsi répond le front populaire aux ouvriers de Barcelone osant résister à l'attaque capitaliste")
En fin de comptes, le pire des mensonges a été le mirage criminel de la soi-disant "destruction" ou "disparition" de l'Etat républicain. Laissons la voix marxiste de BILAN et la minorité de la Ligue des Communistes dénoncer ce mensonge :
1) "En ce qui concerne 1'Espagne, on a souvent évoqué la révolution prolétarienne en marche, on a parlé de la dualité de pouvoirs, le pouvoir "effectif" des ouvriers, la gestion 'socialiste', la 'collectivisation' des usines et de la terre, mais à aucun moment n'ont été posés sur des bases marxistes le problème de l'Etat ni celui du parti." (Mitchell :"La guerre d'Espagne")
2) "Ce problème fondamental (il se réfère à la question de l'Etat) a été remplacé par celui de la destruction des 'bandes fascistes' et l'Etat bourgeois est resté debout en adoptant une apparence 'prolétarienne'. On a permis que ce qui domine soit l'équivoque criminelle sur sa destruction partielle et on a juxtaposé à l'existence d'un 'pouvoir ouvrier réel' le 'pouvoir de façade' de la bourgeoisie, qui se concrétisera en Catalogne dans deux organismes 'prolétariens' : le Comité Central des Milices Antifascistes et le Conseil d'Economie." (Mitchell, idem)
3) "Le Comité Central des milices représente l'arme inspirée par le capitalisme pour entraîner, par l'organisation des milices, les prolétaires en dehors des villes et de leurs localités, vers les fronts territoriaux où ils se feront massacrer impitoyablement. Il représente l'organe qui rétablit l'ordre en Catalogne, non avec les ouvriers, mais contre ceux-ci, qui seront dispersés sur les fronts. Certes l'armée régulière est pratiquement dissoute, mais elle est reconstituée graduellement avec les colonnes de miliciens dont 1'Etat-Major reste nettement bourgeois, avec les Sandino, les Villalba et consorts. Les colonnes sont volontaires et elles peuvent le rester jusqu'au moment où finiront la griserie et 1 'illusion de la révolution et réapparaîtra la réalité capitaliste. Alors on marchera à grands pas vers le rétablissement officiel de l'armée régulière et vers le service obligatoire." (BILAN "La leçon des événements d'Espagne")
4) "Les ressorts essentiels de l'Etat bourgeois sont restés intacts :
- l'armée a pris d'autres formes - en devenant des milices- mais elle a conservé son contenu bourgeois en défendant les intérêts capitalistes de la guerre antifasciste ;
-la police, formée par les gardes d'assaut et les gardes civils, n'a pas été dissoute mais s'est cachée pendant un temps dans les casernes pour reparaître au moment opportun ;
- la bureaucratie du pouvoir central a continué à fonctionner et a étendu ses ramifications à l'intérieur des milices et du Conseil de 1'Economie dont elle n'a pas du tout été un agent exécutif, mais au contraire à qui elle a inspiré des directives en accord avec les intérêts capitalistes." (Mitchell, idem)
5) "Les tribunaux ont été rétablis rapidement dans leur fonctionnement avec l'aide de 1'ancienne magistrature, plus la participation des organisations "antifascistes". Les Tribunaux populaires de Catalogne partent toujours de la collaboration entre les magistrats professionnels et des représentants de tous les partis. [...] Les banques et la Banque d'Espagne sont restées intactes et partout des mesures de précaution furent prises pour empêcher (même par la force des armes) la mainmise des masses." (BILAN, op. cit.)
ANNEES 30 - ANNEES 80
Nous avons déjà vu que, comme Marx l'a dit, l'idéologie bourgeoise nous présente la réalité cul par dessus tête : les années 30 seraient ainsi des années "révolutionnaires" tandis qu'aujourd'hui nous serions dans une époque "contre-révolutionnaire".
Si la bourgeoisie insiste tellement sur cette réalité renversée c'est précisément à cause de la profonde crainte qu'elle ressent devant les potentialités de la lutte ouvrière à notre époque et parce que, en même temps, elle regrette ces années 30 où elle a pu enrôler le prolétariat pour la boucherie impérialiste et lui présenter chacune de ses défaites comme de "grandes victoires".
A L'EPOQUE, en 1936, les mystifications sur l’anti-fascisme, la "défense de la démocratie", faire prendre parti entre fractions opposées du capital (fascisme/anti-fascisme, droite/gauche, Franco/République), polarisent de manière croissante le prolétariat mondial, augmentant sa démoralisation et son adhésion aux plans de guerre de la bourgeoisie, culminant dans la terrible boucherie de 1939-45.
AUJOURD'HUI les mystifications de l’anti-fascisme, la défense nationale, le soutien à la Russie "patrie du socialisme", convainquent de moins en moins les ouvriers qui montrent une hostilité et une méfiance croissantes devant de tels mensongers. Cela ne s'est certes pas traduit, pour le moment, en une compréhension massive de la nécessité d'opposer une alternative révolutionnaire à la débâcle du capitalisme, laissant prévaloir trop souvent encore une attitude de scepticisme et d'expectative. Mais cette attitude peut et doit se transformer, avec le développement des luttes ouvrières contre les attaques toujours plus brutales et massives du capital en crise, et avec l'intervention des révolutionnaires en leur sein.
A L'EPOQUE, les gouvernements de gauche, les Fronts Populaires, ont suscité une ample adhésion de la part de la classe ouvrière, au point que ce sont eux qui, dans beaucoup de pays (France, Suède, Espagne) ont assumé la tâche de convaincre les ouvriers d'accepter "pour le bien de la Patrie", tous les sacrifices imaginables.
AUJOURD'HUI, la classe ouvrière s'oppose, en défense de ses besoins en tant que classe, à tout gouvernement, fût-il de droite ou de gauche, au point d'"appliquer dans la pratique" la consigne que BILAN défendait sans succès dans les années 30 : "Ne pas faire le jeu de la gauche quand on lutte contre la droite et ne pas avantager la droite quand, on lutte contre la gauche". Une démonstration concluante en est que les gouvernements "socialistes" en France, en Grèce, en Espagne, en Suède, etc. ont eu affaire à des ripostes massives et acharnées des travailleurs qui ne se sont pas laissés tromper par le chantage selon lequel ils seraient en train de s'opposer à "leur" gouvernement.
A L'EPOQUE, les partis prolétariens, créés lors de la formation de la 3ème Internationale, les partis communistes, menaient à terme un processus tragique de dégénérescence opportuniste en s'intégrant définitivement au camp capitaliste et en utilisant leur passé ouvrier -qui était indiscutable- pour cautionner une politique de défense de l'Etat bourgeois. Quant aux fractions communistes qui s'en étaient dégagées et poursuivaient le travail de défense intransigeante des positions de classe, elles étaient de plus en plus réduites à l'isolement et se heurtaient à l'incompréhension croissante des ouvriers.
AUJOURD'HUI les organisations qui ont su rester fidèles à la continuité historique des positions communistes élargissent leur écho dans la classe, en même temps que surgissent, un peu partout, des noyaux, des groupes, des éléments, qui n'ont aucune illusion sur les forces de gauche du capital et recherchent véritablement une cohérence communiste. Tout cela, bien qu'à ses débuts et encore entravé par les doutes et les hésitations, constitue la base d'un processus de décantation politique qui conduit à la constitution du Parti Communiste Mondial, d'une nouvelle Internationale du prolétariat.
En d'autres termes, alors que les luttes ouvrières de 1936, en particulier en Espagne, s'inscrivaient dans le cours ouvert par la défaite de la vague révolutionnaire de 1917-23, et le triomphe de la contre-révolution en Allemagne, Italie, Europe centrale, Russie, les combats ouvriers de notre époque s'inscrivent dans un processus de reconstitution de l'unité du prolétariat mondial qui se dégage de l'emprise de l'idéologie de la classe dominante pour livrer de nouvelles batailles décisives contre le capital.
LES MANOEUVRES DE LA GAUCHE : UNE EXPERIENCE A NE PAS OUBLIER
La comparaison des deux époques nous conduit à une autre leçon fondamentale : la continuité qui existe dans le travail anti-ouvrier des partis de gauche et des syndicats, à l'époque et aujourd'hui. Leurs tactiques ne sont pas les mêmes car, comme nous venons de le voir, les différences dans le rapport de forces entre les classes et dans l'état de la conscience ouvrière sont évidentes, mais ce qui n'a pas changé est leur fonction anti-ouvrière en tant que bastion fondamental de l'Etat capitaliste contre les luttes ouvrières.
Malgré les conditions historiques différentes, un examen des virages, des manoeuvres des partis de gauche, des syndicats -particulièrement de la CNT- dans l'Espagne de 1936, peut nous offrir des leçons pour combattre leurs manoeuvres et pièges dans les luttes actuelles.
En 1931, le PSOE, qui avait déjà montré son intégration au capital espagnol avec sa collaboration ouverte avec la dictature de Primo de Rivera (Largo Caballero a été conseiller d'Etat du dictateur et l'UGT faisait office d'indicateur dans les usines) a fait alliance avec les républicains et, jusqu'en 1933, a participé à la féroce répression des luttes ouvrières et paysannes,
Mais, comme nous l'avons indiqué "La gauche n'accomplit pas [sa fonction capitaliste] uniquement et même pas généralement au pouvoir. La plupart du temps, elle 1'accomplit plutôt en étant dans 1'opposition parce qu'il est généralement plus facile de l'accomplir en étant dans l'opposition qu'au pouvoir. (...) Leur présence au gouvernement les rend plus vulnérables, leur usure au pouvoir plus grande et leur crédibilité se trouve plus rapide ment mise en- question. Dans une situation d'instabilité, cette tendance est encore accélérée. Or, la baisse de leur crédibilité les rend inaptes pour assurer leur fonction d'immobilisation de la classe ouvrière" (Revue Internationale n°18, p.25, 26 : "Dans l'opposition comme au gouvernement, la "gauche" contre la classe ouvrière").
Pour ces raisons, le PSOE qui, en janvier 1933, se tachait les mains de sang ouvrier à Casasviejas, quittait le gouvernement en mars et, suivi par l'UGT, "radicalisait" son langage au point que Largo Caballero, ancien conseiller d'Etat de Primo de Rivera et ministre du Travail de 1931 à 1933, devenait le "Lénine espagnol" !
Dans l'opposition, le PSOE promettait aux ouvriers la "révolution" et parlait partout d'"immenses dépôts d'armes prêts pour quand viendrait le moment opportun de réaliser l'insurrection". Avec cette "musique céleste", il s'opposait aux luttes revendicatives des ouvriers qui, soi-disant, "portaient préjudice aux plans d'insurrection" et tout ce qu'il visait était, de même que son compère en Autriche à la même époque, d'amener les ouvriers à un affrontement suicide avec l'Etat bourgeois pour les saigner cruellement.
En octobre 1934 les ouvriers des Asturies sont tombés dans ce piège. Leur héroïque insurrection dans les zones minières et dans la ceinture industrielle d'Oviedo et de Gijon s'est trouvée complètement isolée par le PSOE qui a empêché par tous les moyens que dans le reste de l'Espagne, particulièrement à Madrid, les ouvriers ne secondent le mouvement. Tout au plus a-t-il toléré des grèves "pacifiques", incapables d'étendre le front ouvert par les mineurs des Asturies.
Cette manoeuvre criminelle du PSOE et de l'UGT a permis au gouvernement républicain d'écraser la révolte ouvrière par une répression sauvage. A la tête des troupes du massacre se trouvait Franco, qualifié par les partis de l'époque de général "professionnel, loyal à la République".
Mais le massacre des Asturies a ouvert une répression féroce dans tout le pays : tout militant ouvrier remarqué était mis en prison sans que le "Lénine espagnol", Largo Caballero, ne bougeât le petit doigt.
Le doigt que le PSOE a bougé, en concordance avec une tactique générale mise en pratique dans d'autres pays européens, a été le fameux "Front Populaire". Ensemble avec le PSOE, l'UGT et les partis républicains (Azana et Cie) se sont ligués le PCE (illustrant par là son passage définitif dans la défense de l'Etat bourgeois), la CNT et le POUM, deux organismes qui avaient jusqu'alors été ouvriers, qui l'ont appuyé "de manière critique".
Le "Front Populaire" prétendait ouvertement remplacer la lutte ouvrière par la farce électorale, la lutte en tant que classe contre toutes les fractions du capital par la lutte sur le terrain de ce dernier contre sa fraction "fasciste" au bénéfice de son aile "antifasciste". A la lutte revendicative d'ouvriers et de paysans pauvres, il opposait un illusoire et ridicule "programme de réformes" qui ne serait jamais appliqué. A la seule perspective possible pour le prolétariat (sa révolution communiste) il opposait une fantasmagorique "révolution démocratique".
Il s'agissait là d'un crime de démobilisation des ouvriers, de dévoiement de leur combat sur le terrain de la bourgeoisie, c'était une manière concrète de les désarmer, de briser leur unité et leur conscience, de les livrer, pieds et poings liés, aux militaires qui, depuis le jour même du triomphe du Front Populaire (février 1936), préparaient tranquillement un bain de sang parmi les ouvriers avec l'assentiment tacite du gouvernement "populaire".
Quand enfin Franco s'est soulevé le 18 juillet, le Front Populaire, montrant son vrai visage, n'a pas seulement essayé de calmer les ouvriers et de les renvoyer chez eux, mais a refusé catégoriquement de répartir les armes. Dans une fameuse déclaration, le Front Populaire appelait au calme et lançait sa devise "LE GOUVERNEMENT COMMANDE, LE FRONT POPULAIRE OBEIT", ce qui revenait concrètement à demander aux ouvriers de rester passifs et obéissants afin de se laisser massacrer par les militaires. C'est ce qui est arrivé à Séville, où les ouvriers ont suivi les consignes de calme et d'attente "des ordres du gouvernement", données par le très "antifasciste" PCE, ce qui a permis au général Queipo del Llano de prendre facilement le contrôle et d'organiser un terrible bain de sang.
Ce ne fut, comme nous l'avons vu plus haut, que le soulèvement pour leur propre compte des ouvriers à Barcelone et dans d'autres centres industriels, sur leur propre terrain de classe, unissant la lutte revendicative à la lutte politique, qui a paralysé pour un moment le bourreau Franco.
Mais les forces de gauche du capital, les PSOE-PCE et compagnie, ont su réagir à temps et ont déployé une manoeuvre qui allait devenir décisive. Rapidement, en 24 heures, ils se sont mis à la tête du soulèvement ouvrier et ont essayé de l'acheminer -avec succès- vers l'affrontement exclusivement contre Franco -laissant ainsi le chemin libre à la République et au Front Populaire- et exclusivement sur un terrain militaire, hors du terrain social, revendicatif et politique, hors des grandes concentrations industrielles et urbaines.
En vingt-quatre heures le gouvernement de Martinez Barrio -formé pour négocier avec tes militaires rebelles et organiser avec eux le massacre des ouvriers- a été remplacé par le gouvernement de Giral, plus "intransigeant" et "antifasciste".
Mais l'essentiel a été de s'assurer l'appui inconditionnel de la CNT, qui regroupait le gros des ouvriers en Espagne et qui, rapidement, a déconvoqué la grève et a orienté les organismes ouvriers créés spontanément dans les usines et quartiers ouvriers -les Comités, les Milices, les Patrouilles de Contrôle- vers la collaboration "antifasciste" avec les autorités républicaines (les Companys, Azana, Front Populaire, etc.) et vers leur transformation en agences de recrutement d'ouvriers pour la boucherie sur le front.
Avec ce pas culminait la dégénérescence de la CNT qui s'intégrait définitivement à l'Etat capitaliste. La présence de ministres cénétistes au gouvernement catalan d'abord et au gouvernement central ensuite, présidé par l'inévitable Largo Caballero, ne faisait que sceller cette trajectoire. Tous les organismes dirigeants de la CNT déclarèrent une guerre féroce contre les rares courants qui, même dans une terrible confusion, luttaient pour défendre une position révolutionnaire. Ce fut le cas, par exemple, des groupes autour de la revue "Les Amis du Peuple". Ils se sont trouvés isolés, expulsés, envoyés aux positions les plus dangereuses du front, dénoncés indirectement à la police républicaine, etc., par toute la bande des Garcia Oliver, Montseny , Abad de Santillan, et Cie.
La manoeuvre du Front Populaire de la "guerre antifasciste, a été définitive et a conduit les ouvriers espagnols à une tuerie aux proportions monstrueuses : plus d'un million de morts. Mais la tuerie s'est pro longée par des souffrances incroyables à l'arrière pas seulement franquiste mais aussi républicaine. Là, au nom de la guerre "antifasciste", les quelques conquêtes ouvrières concédées pour calmer le soulèvement ouvrier du 19 juillet 1936, ont été immédiatement annulées, la CNT ayant été la première à le demander. Les salaires de misère, les journées épuisantes, les rationnements, la militarisation du travail, ont scellé une exploitation sauvage et totale des ouvriers.
Le PCE fut alors le principal parti de l'exploitation, du sacrifice pour la guerre et la répression anti-ouvrière.
Le parti stalinien avait comme mot d’ordre "Non aux grèves dans l'Espagne démocratique", et cela était plus qu'un mot d’ordre, c'était le drapeau pour empêcher, au moyen de la police -qu'il contrôlait en majorité- toute lutte, toute revendication dans les usines. C'est la succursale catalane du PCE, le PSUC, qui a organisé, en janvier 1937, une manifestation "populaire" contre les Comités d'Usine trop réticents aux impératifs de la militarisation.
Le PCE est devenu, dans l'Espagne républicaine, le parti de l'ordre. C'est comme ça qu'il a acquis l'estime de nombreux militaires, propriétaires agricoles et industriels, fonctionnaires de la police, et de nombreux et qualifiés "senontos" d'extrême-droite qui y ont adhéré ou l'ont appuyé. Avec cet aval, il a rapidement contrôlé les appareils répressifs de l'Etat républicain, vidant les prisons des fascistes et patrons et les remplissant d'ouvriers combatifs.
Le point culminant de ces bons et loyaux services rendus au capitalisme a été la tuerie de mai 1937. Les ouvriers de Barcelone, en ayant assez de tant de souffrances et d'exploitation, se sont soulevés devant la provocation de la police face aux travailleurs du téléphone. Le PCE a immédiatement organisé une répression féroce, déplaçant des troupes de Valence et du front d'Aragon. La CNT et le POUM, faisant des appels au "calme", à la "réconciliation entre frères", etc., ont collaboré en immobilisant les ouvriers. Franco a arrêté momentanément les hostilités pour faciliter aux bourreaux staliniens l'écrasement des ouvriers.
La guerre d'Espagne se prolongea jusqu'en 1939. Elle se conclut par la victoire de Franco et l'établissement du régime politique que l'on sait. L'effroyable répression qui s'en suivit sur les prolétaires qui a/aient participé à la guerre dans le camp républicain. acheva la saignée que la bourgeoisie venait d'effectuer sur un des secteurs les plus combatifs du prolétariat à cette époque. Les horreurs de la dictature obscurantiste firent en partie oublier celles de la "dictature-démocratique" de la République du début des années 30 et tout le travail de sabotage et répression des luttes ouvrières par les forces "de gauche" du capital (PCE, PSOE, CNT) pendant les années de la guerre civile. Cinquante ans après, les prolétaires espagnols subissent le pouvoir et l'exploitation capitaliste à nouveau sous la forme de la démocratie bourgeoise, franquistes et républicains réconciliés derrière une même armée et une même police pour préserver et gérer l'ordre social existant.
Cinquante ans après, alors que la résistance ouvrière contre les effets de la crise économique capitaliste fait de nouveau se reconstituer, aux quatre coins de la planète, l'armée des prolétaires de tous les pays, les avertissements de BILAN de 1936, les leçons de la tragédie espagnole, doivent être clairement assimilés : les prolétaires ne peuvent se défendre efficacement qu'en comptant uniquement sur leurs propres forces, imposant l'autonomie de leur classe. Tout abandon du terrain tracé par la défense intransigeante de leurs intérêts de classe au profit d'une quelconque alliance avec quelque fraction que ce soit de la classe dominante, se fait à leurs dépens et conduit aux pires défaites.
Adalen
LE "FRONT POPULAIRE" EN FRANCE, du dévoiement des grèves à l'union nationale (extraits de Bilan)
"Le Front Populaire s'est avéré être le processus réel de la dissolution de la conscience de classe des prolétaires, l'arme destinée à maintenir .dans toutes les circonstances de leur vie sociale et politique les ouvriers sur le terrain du maintien de la société bourgeoise." BILAN N° 31 - Mai-juin 1936
En ce début des années 30, 1 'anarchie de la production capitaliste est totale. La crise mondiale jette sur le pavé des millions de prolétaires. Seule 1'économie de guerre, pas seulement la production massive d'armement mais aussi toute 1'infrastructure nécessaire à cette production, se développe puissamment. Autour d'elle 1'industrie s'organise ; elle impose les nouvelles organisations du travail dont le "taylorisme" sera un des plus beaux rejetons.
Sur le front social, malgré la puissante contre-révolution "venue de l'intérieur" en Russie, malgré l'écrasement du prolétariat le plus puissant du monde, la classe ouvrière d'Allemagne, le monde vacille, semble encore hésiter à la croisée des chemins entre une nouvelle guerre mondiale ou un nouveau souffle révolutionnaire, seul capable d'endiguer la terrible perspective et d'ouvrir les portes d'un nouvel avenir. L'écrasement du mouvement ouvrier en Italie, les fronts populaires ([1] [10]) de France et d'Espagne, les idéologies d'union nationale, alimenté par la plus colossale duperie et escroquerie idéologique de ce siècle -1'"antifascisme"- auront finalement raison de ces dernières hésitations. En 1939 le monde basculera dans la boucherie, il est minuit dans le siècle. L'avenir n'a plus d'avenir, il est tout entier absorbé et détruit dans le présent de la haine, du meurtre et de la destruction massive.
Le mérite de ce grand service rendu au capitalisme d'avoir vaincu les dernières poches de résistance ouvrières en emprisonnant le prolétariat dans une idéologie nationaliste, démocratique, en lui faisant abandonner le terrain de la lutte contre les conséquences de la crise historique du capitalisme, revient à ceux qui aujourd'hui fêtent ce sinistre anniversaire : la gauche capitaliste et ses garde-chiourme syndicaux.
Fêter 1'anniversaire du Front Populaire, c'est fêter l'anniversaire de la guerre, de la victoire finale sur le prolétariat international de 1'idéologie nationaliste et de la collaboration de classes qui allait amener trois ans après les ouvriers de toutes les nations dans le colossal fratricide de la seconde guerre mondiale.
L'histoire du Front Populaire a été élevée au rang de mythe et la vérité, tant de ce qui l'a amené, de son contenu réel et surtout de ses conséquences, est bien loin de ce qu'en disent ceux qui se revendiquent de ce passé glorieux et qui 1'évoquent aujourd'hui avec nostalgie.
Pour faire parler la vérité sur ces années noires où la conscience de la classe ouvrière sabordée par ceux qui s'en réclamaient sombra dans la pire des servitudes, le nationalisme, nous avons choisi de laisser la parole à ceux qui, contemporains de cette bien triste époque, peut-être la plus triste de toute l'histoire du mouvement ouvrier, surent, à l'écart des grandes hystéries idéologiques, maintenir haut le drapeau de 1'émancipation ouvrière, à commencer par l'internationalisme. Nous laisserons donc la parole à la revue BILAN sur le contenu, le déroulement et 1'attitude de la gauche officielle dans les luttes ouvrières ainsi que sur les "acquis' ouvriers" du front populaire.
De tous les mythes sur l'histoire du Front Populaire, les acquis ouvriers, et parmi ceux-ci les "congés payés", sont de loin les plus répandus.
LES ACQUIS DU FRONT POPULAIRE : UNE LARGE FUMISTERIE
La lecture des longues citations de BILAN nous apprendra, si l'on ne le sait déjà, que la période du Front Populaire ne fut en rien idyllique en ce qui concerne la condition ouvrière, les longues et dures grèves qui ponctuent toute son histoire en sont déjà le meilleure indication. Quant aux congés payés, pour ne prendre qu'un exemple, il nous faut tout d'abord dire que les luttes qui les obtinrent furent toujours le fait spontané des ouvriers en butte à la militarisation du travail :
"Ce n'est pas par hasard que ces grandes grèves se déclenchent dans l'industrie métallurgique en débutant par les usines d'avions. C'est qu'il s'agit de secteurs qui travaillent aujourd'hui à plein rendement, du fait même de la politique de réarmement suivie dans tous les pays. Ce fait ressenti par les ouvriers fait qu'ils ont dû déclencher leurs mouvements pour diminuer le rythme abrutissant de la chaîne : améliorer leurs salaires : obtenir un contrat collectif de travail et la reconnaissance des syndicats par le patronat ; des vacances payées, sur la base d'une intensification du travail en métallurgie qui se fait en l'onction de la guerre. C'est donc là un paradoxe douloureux dont les ouvriers ne sont pas responsables mais qui revient aux forces du capitalisme qui ont réduit les travailleurs à cette situation." (BILAN n° 31, mai-juin 1936, p. 1013)
Si face à la tension de la force de travail dans le cadre du renforcement de 1'économie de guerre et aux nouvelles organisations du travail que celles-ci induisaient, les ouvriers furent acculés à la lutte pour, entre autres, obtenir une pause annuelle, dans les mains des syndicats cette victoire pour laquelle ceux-ci n'avaient d'ailleurs aucun mérite, devint un but final, une institution qui devait permettre 1'intégration de la classe ouvrière à 1'économie de guerre dans le cadre de la militarisation du travail.
A LA VEILLE DU FRONT POPULAIRE : LE POISON NATIONALISTE
Les articles de BILAN donnent de la période qui s'étend de juillet 1934 jusqu'au printemps 1937 un autre éclairage que le conte de fées traditionnellement raconté par la gauche. Sur quelles bases s'est constitué le Front Populaire ?
SOUS LE SIGNE DU 14 JUILLET
C'est' sous le signe d'imposantes manifestations de masses que le prolétariat français se dissout au sein du régime capitaliste. Malgré les milliers et les milliers d'ouvriers défilant dans les rues de Paris, on peut affirmer que pas plus en France qu'en Allemagne ne subsiste une classe prolétarienne luttant pour ses objectifs historiques propres. A ce sujet, le 14 juillet marque un moment décisif dans le processus de désagrégation du prolétariat et dans la reconstitution de l'unité sacro-sainte de la Nation capitaliste. Ce fut vraiment une fête nationale, une réconciliation officielle des classes antagonistes des exploiteurs et des exploités ; ce fut le triomphe du républicanisme intégral que la bourgeoisie, loin d'entraver par des services d'ordre vexatoires, laissa se dérouler en apothéose. Les ouvriers ont donc toléré le drapeau tricolore de leur impérialisme, chanté la "Marseillaise" et même applaudi les Daladier, Cot et autres ministres capitalistes qui avec Blum, Cachin, ont solennellement juré "de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde" ou, en d'autres termes, du plomb, des casernes et la guerre impérialiste pour tous.
Il n'y a pas à dire, les événements vont vite. Depuis la déclaration de Staline, la situation s'est rapidement clarifiée. Les ouvriers ont désormais une patrie à défendre, ils ont reconquis leur place dans la Nation et, désormais, ils admettent que toutes les proclamations révolutionnaires concernant l'incompatibilité entre l'Internationale et la "Marseillaise", la révolution communiste et la Nation capitaliste, ne sont que des phrases que la révolution d'Octobre a lancées vainement, puisque Staline en a montré l'insuffisance [...].
Le 14 juillet vint donc une apothéose finale du dévouement prolétarien à la république démocratique. C'est l'exemple des militants communistes et socialistes qui détermina les ouvriers -hésitant à juste titre- d'entonner la Marseillaise. Quel spectacle inoubliable, écrira le "Populaire" ; quel triomphe, ajoutera l'"Humanité". Et les uns comme les autres feront intervenir le "vieil ouvrier" classique qui, "en pleurant", exprimera sa joie de voir l'hymne de ses exploiteurs, des bourreaux de juin, des assassins des communards, des civilisateurs du Maroc et de la guerre de 1914, redevenir prolétarien. Duclos, dans son discours, dira qu'en saluant le drapeau tricolore, les ouvriers saluent le passé "révolutionnaire" de la France, mais que leur drapeau rouge représente le futur. Mais ce passé se continue dans le présent, c'est-à-dire dans l'exploitation féroce des ouvriers, dans les guerres de rapine du capitalisme jetant au massacre des générations entières de prolétaires. En 1848 également, la bourgeoisie essaya de ressusciter le passé, les traditions de 93, les principes de Liberté, Egalité, Fraternité, pour voiler les contrastes présents des classes : la tuerie de juin fut la conséquence des illusions prolétariennes.[...]
Et après cette imposante manifestation de défaite de la classe appelée à renverser la société bourgeoise, à instaurer une société communiste, l'on se demande si, vraiment, une menace fasciste pourrait se poser en France. Jusqu'ici, il semble bien que les Croix de Feu aient plus été un moyen de chantage, un épouvantail pour accélérer la désagrégation des masses prolétariennes au travers du front commun qu'un danger réel. Mais on érigea l'antifascisme en loi suprême justifiant les pires capitulations, les compromissions les plus basses pour arriver par là à concentrer les ouvriers loin de leurs revendications immédiates, loin de leurs organisations de résistance, sur un front d'antifascisme comportant même Herriot. Ce n'est pas un hasard si les arrêtés-lois vinrent immédiatement après le 14 juillet et s'ils trouvèrent le prolétariat dans un état d'incapacité manifeste bien que des milliers d'ouvriers aient défilé en clamant "les Soviets" quelques jours auparavant. [...] (BILAN, juillet-août 1933)
FACE AUX LUTTES REVENDICATIVES
La préparation du Front Populaire annonçait donc déjà son futur déroulement, en particulier face aux luttes revendicatives des ouvriers. Comment s'est déroulée la fameuse année 1936 sur le front social ?
LA RECONCILIATION DES FRANÇAIS ET L'UNITE SYNDICALE
Un souffle d'air frais a traversé la France le 6 décembre dernier ; le parlement a vécu une "journée historique" lorsque Blum, Thorez, Ybarnegaray ont scellé la "réconciliation des Français". Désormais, plus de luttes meurtrières ne doivent ensanglanter la France républicaine et démocratique. T out le monde va fraternellement désarmer. Le fascisme est vaincu. Le Front Populaire a sauvé les institutions républicaines. Si ces événements n'entraînaient à leur suite des millions d'ouvriers français, s'ils ne contenaient tellement de faits répugnants, l'on serait tenté de rire aux éclats devant les bouffonneries qu'ils contiennent. Personne ne menaçait la République bourgeoise et tous la voulaient menacée. La droite accusait la gauche et vice-versa. Le Front Populaire proclamait son civisme républicain alors que La Roque et ses Croix de Feu répétaient la même litanie. Les formations Croix de Feu -certes plus puissantes et infiniment mieux armées que les ouvriers- ne menaçaient pas plus la République que les formations de combat ou d'auto-défense du Front Populaire, puisque les uns et les autres se mettaient à son service pour renforcer la domination capitaliste qui est d'autant plus républicaine qu'elle y trouve largement son compte.
Au point de vue de la situation immédiate, les dupes de la journée historique du 6 décembre .sont incontestablement les ouvriers. Déjà, après leur résistance de Brest et de Toulon, ils furent qualifiés de "provocateurs" par les chiens déchaînés du Front Populaire. Après la "réconciliation", le prolétaire qui tentera de résister par la violence à la violence capitaliste sera assommé, injurié et remis par les adeptes du front populaire entre les mains des agents de police. Contre les spartakistes, disait Rosa Luxemburg, les social-patriotes mobilisèrent ciel et terre, déchaînèrent le fer et le feu : Spartakus devait être massacré ! En France, le Front populaire, fidèle à la tradition des traîtres, ne manquera de provoquer au meurtre contre ceux qui ne se plieront pas devant le "désarmement des Français " et qui, comme à Brest et à Toulon, déclencheront des grèves revendicatives, des batailles de classe contre le capitalisme et en dehors de l'emprise des piliers du Front Populaire. (BILAN n°26, décembre-janvier 1936)
Cette attitude en ce début de l'année 1936 n'est que le prélude au fantastique travail de sape de la gauche et des syndicats lors du mouvement du printemps.
Les conditions qui accompagnent le triomphe du Front Populaire sont donc celles qui voient l'anéantissement de la conscience de classe des ouvriers. Le triomphe du gouvernement du Front Populaire consacre la disparition de toute résistance prolétarienne au régime bourgeois, du moins de toute résistance organisée du prolétariat. Des centristes ([2] [11]) aux socialistes, tous s'efforcent de bien faire ressortir que le gouvernement Blum ne sera pas un gouvernement révolutionnaire, qu'il ne touchera pas à la propriété bourgeoise, qu'il ne faut pas que les possédants prennent trop au sérieux la formule centriste : faire payer les riches. Le programme du Front Populaire porte comme premier point l'amnistie et non la révolution ; l'épuration des administrations ; la dissolution des Ligues et puis des mesures économiques de grands travaux que l'on exécutera, comme en Belgique M. de Man en exécute pour résorber le chômage. Les centristes seront satisfaits des dernières décisions du parti radical, déclarant participer au gouvernement Blum et exigeant l'unité de vote de ses élus au gouvernement. Deux bonnes décisions dira l'"Humanité" qui s'empressera de crier que le Front Populaire représente enfin la revanche des Communards sur Versailles. Toute la presse bourgeoise louera la modération des socialistes et des centristes et l'on ne prendra pas trop au sérieux les accusations de l'extrême droite criant que le PC prépare l'avènement des Soviets avec ses comités de Front Populaire. Mais dans cette atmosphère idyllique une seule note discordante : les menaces de conflits de salaires de prolétaires lassés des promesses "d'humanisation" des décrets-lois. A grande peine la CGT avait liquidé la menace d'une grève générale des mineurs du Pas-de-Calais, menace qui pouvait tomber comme un pavé dans une mare entre les deux tours électoraux. Après la victoire du Front Populaire des mouvements se déterminent progressivement jusqu'à embrasser ces derniers temps l'ensemble de la région parisienne. Un journaliste belge a fait remarquer très justement que les mouvements en France se sont déclenchés un peu sur le type des grèves de mai 1936 en Belgique : en dehors et contre les syndicats, en somme comme des mouvements "sauvages". [...]
A partir du 14 mai, le mouvement atteint la région parisienne. C'est à Courbevoie, où les ouvriers font la grève dans l'usine et arrachent 0,25 F d'augmentation et un contrat collectif de six mois. C'est à Villacoublay où les ouvriers obtiennent des vacances payées, puis à Issy-les-Moulineaux, à Neuilly, à Gennevilliers. Partout les mouvements se déclenchent en dehors de toute intervention des syndicats, spontanément, et acquièrent tous le même caractère : des grèves au sein de l'usine.
Le jeudi 28 mai, c'est enfin la grève chez Renault, où 32.000 ouvriers se mettent en branle. Le vendredi et samedi les entreprises métallurgiques de la Seine entrent dans le mouvement. [...] Dans l'"Humanité" et dans le "Populaire" on fit un particulier effort pour bien prouver que le Front Populaire n'était pour rien dans ces mouvements et surtout dans leurs formes. Il fallait à tout prix tranquilliser la bourgeoisie qui, comme le prouve l'article de Gallus dans l'"Intransigeant", n'était pas le moins du monde effrayée. Le capitalisme comprenait parfaitement qu'il ne pouvait être question d'une véritable occupation des usines, mais d'une lutte ouvrière prenant pour champ de combat l'intérieur de l'usine où l'intrusion des partis du Front Populaire, de la CGT est moins à craindre. En Belgique aussi les grèves des mineurs en mai 1935 eurent ce caractère et l'exprimèrent clairement en refusant de recevoir dans la mine des délégués officiels des syndicats socialistes du POB ou du PC.
De pareils mouvements sont symptomatiques et gros de dangers pour le capitalisme et ses agents. Les ouvriers sentent que leurs organisations de classe sont dissoutes dans le Front Populaire et que leur terrain d'action spécifique devient leur lieu de travail où ils sont unis par les chaînes de leur exploitation. Dans de pareilles circonstances une fausse manoeuvre du capitalisme peut déterminer des heurts, des chocs qui peuvent ouvrir les yeux aux travailleurs et les éloigner du Front Populaire. Mais Sarraut comprit encore une fois la situation. Il laissa faire. Pas de gardes mobiles, pas de brutale expulsion des travailleurs des usines. Des marchandages, et puis laisser faire socialistes et centristes.
Le 30 mai, Cachin tente de lier ces mouvements de classe en opposition au Front Populaire à ce dernier. Il écrit : "Le drapeau tricolore fraternise sur l'usine avec le drapeau rouge. Les ouvriers sont unanimes à soutenir les revendications générales : Croix de Feu, Russes blancs, étrangers, socialistes communistes, tous sont fraternellement unis pour la défense du pain et le respect de la loi". Mais le "Populaire" du même jour n'est pas complètement d'accord avec cette appréciation, car après avoir chanté victoire au sujet de la rentrée chez Renault, il écrit : "C'est fini. C'est la victoire. Seuls dans l'Ile Seguin, quelques exaltés -il y a des sincères, mais aussi des provocateurs Croix de Feu- semblent en douter". Il est probable que la "victoire chez Renault n'ait pas été approuvée par de nombreux ouvriers qui n'ont pas voulu faire preuve de 'cet esprit conciliant' dont Frachon parle dans l'"Humanité" et qui les détermina très souvent à reprendre le travail 'avec une partie seulement de ce qu'ils réclament'". Ceux-là seront les "provocateurs", les "Croix de Feu".
Ces messieurs du Front Populaire ont bien mis en évidence non seulement pour la bourgeoisie, mais aussi pour les ouvriers eux-mêmes, qu'il ne s'agissait pas d'événements révolutionnaires. Cela "une occupation révolutionnaire, écrit le "Populaire", allons donc ! Partout : joie, ordre, discipline". Et l'on montre des photos d'ouvriers dansant dans les cours des usines ; on parle de parties de plaisir : "les ouvriers se baignent, ou jouent à la belote ou flirtent." (BILAN n° 31, mai-juin 1936)
DU SABOTAGE A LA REPRESSION DIRECTE ET IMPITOYABLE
Ainsi, avant, pendant son règne, le Front Populaire ne fut jamais le front ouvrier contre le capitalisme mais le front de la bourgeoisie contre la classe ouvrière. C'est en tant que tel qu'il signa son oeuvre contre-révolutionnaire avec le sang des ouvriers parisiens. C'est ce que nous montre la répression du printemps37.
LA FRANCE "LIBRE, FORTE ET HEUREUSE" ASSASSINE LES PROLETAIRES
Les sifflements des balles ont arraché le masque du Front Populaire. Les cadavres ouvriers ont expliqué la "pause" du gouvernement Blum. Dans les rues de Clichy, le programme du Front Populaire s'est manifesté au travers des fusils des gardes mobiles et rien ne pouvait mieux l'illustrer.
Ah ! Les défenseurs de l'ordre républicain, les bourreaux de la démocratie bourgeoise peuvent pousser leurs cris d'allégresse. L'émeute est matée et le vieux cri traditionnel : "l'ordre règne, dans Varsovie" peut retentir à nouveau car les cosaques de Max Dormoy veillent.
Mais le sang ouvrier n'a pas rougi impunément les pavés de Paris, ce Pans où l'on s'apprêtait à commémorer les Communards de 1871. Désormais l'Union Sacrée acquiert une signification de sang et les ouvriers pourront retirer de cette tragique expérience un précieux enseignement de classe. Ils sauront notamment que l'on ne peut "réconcilier les Français" par la capitulation volontaire du mouvement ouvrier. La garde mobile sera présente pour l'imposer avec ses fusillades. Ils sauront aussi que la démocratie bourgeoise, "la France libre, forte et heureuse" et le fameux mot d'ordre du "Front Populaire", "le Pain, la Paix, la Liberté" signifie : le surarbitre pour les revendications ouvrières, l'emprunt de la défense nationale et les fusils des gardes mobiles, pour les manifestations prolétariennes dépassant le cadre tracé par les socialo-centnstes. [...]
Voilà dix mois que les ouvriers sont aux prises avec le Front Populaire et la chanson commence à s'user. Pourquoi Blum ne réprime-t-il pas ce danger fasciste que l'on dit si imminent ? Pourquoi reprend-on aux ouvriers tout ce qu'ils avaient cru gagner avec leurs mouvements de grèves ? Pourquoi les traite-t-on de "provocateurs" lorsqu'ils passent à l'attaque malgré l'arbitrage ? Blum fait la "pause" uniquement pour les ouvriers qui doivent continuer à faire des sacrifices.
Tout cela a créé un état d'irritation parmi les ouvriers qui se manifeste particulièrement dans la région parisienne où les bonzes réformistes-centristes sont acculés dans les assemblées syndicales. Déjà, devant cet état de tension, ils avaient décidé d'organiser deux manifestations aux environs de Paris : l'une pour les chômeurs et l'autre pour les ouvriers. Enfin, en métallurgie l'on se trouvait devant des demandes d'ouvriers, de grève générale, afin de protester contre les décisions du surarbitre
C'est dans cette situation tendue que les socialo-centristes ont donné le dernier carré de l'antifascisme pour maintenir les ouvriers dans le chemin de l'Union Sacrée, consentie "volontairement" par les travailleurs. La contre-manifestation de Clichy devait être imposante : on allait montrer à de La Roque que "la Nation française" vit et lutte pour la démocratie bourgeoise dont Messieurs Daladier-Herriot sont d'authentiques représentants. La bourgeoisie aussi se préparait, car connaissant la situation parmi les ouvriers, elle se méfiait un peu des chefs socialo-centnstes pouvant être débordés par leurs troupes. Les gardes mobiles furent armés sérieusement comme s'ils partaient en guerre. Parmi les dirigeants des forces répressives existait la conviction que "la pause" de Blum était aussi la pause des mouvements ouvriers. La directive était donc de réprimer férocement ces derniers et l'ambiance nécessaire fut certainement créée parmi les gardes mobiles. Il n'y avait pas, et il ne pouvait y avoir de contradiction entre les chefs "fascistes" de la police et le gouvernement du Front Populaire. Celui-ci parlait de la "pause" en expliquait la nécessité aux ouvriers alors que les premiers ne faisaient que l'appliquer avec la mentalité bornée du policier qui applique brutalement ses instructions sans s'occuper des conséquences. [...]
Deux forces se sont heurtées à Clichy : le prolétariat et la bourgeoisie. Les travailleurs concentrés en masse pour des buts antifascistes ont trouvé dans leur nombre imposant la force d'exalter leur colère et d'exprimer la tension imprimée dans leurs chairs de prolétaires éternellement dupés : la bourgeoisie est passée à la répression là où le Front Populaire ne pouvait plus maintenir les ouvriers sur le front des intérêts capitalistes. [...]
Rien n'a pu dénaturer la bataille de Clichy, comme rien n'a pu dénaturer les massacres de la Tunisie et ceux qui se déroulent ces derniers temps en Algérie, en Indochine. C'est le Front Populaire, qui en voulant rester au pouvoir pendant "la pause" doit passer au massacre des prolétaires de la métropole et des colonies où l'accumulation des reculs imposés aux ouvriers par Blum, pousse à des batailles de plus en plus violentes. Le programme démagogique du Front Populaire arrive au bout de son rouleau et le nouveau programme passe par le massacre des ouvriers. Et que l'on ne cherche pas les "provocations" ailleurs que dans la situation qui est faite aux ouvriers. La vérité se dégage ici avec une clarté qui se passe de commentaires : les ouvriers en exigeant la grève la faisaient contre l'Etat capitaliste qui les avait mitraillés et où se trouvait le Front Populaire. Les socialo-centnstes conscients de cette^ situation (qui pourrait déterminer la bourgeoisie à employer un autre matériel que celui de Blum pour maintenir sa domination) essayait d'en faire une vulgaire manifestation antifasciste. C'est pourquoi il fallait en limiter strictement la durée (jusqu'à midi) ; bien marquer qu'il ne s'agissait pas de réaliser des ordres du jour demandant la grève générale pour défendre les revendications ouvrières (communiqué de la CGT et de l'Union des Syndicats parisiens).
Et enfin, il s'agissait non de lutter contre le gouvernement du Front Populaire mais de le consolider. (BILAN n° 40, avril-mai 1937)
Prénat
GLOSSAIRE :
Front Populaire : coalition électorale, puis ensuite gouvernementale (1936-37), de la gauche capitaliste, regroupant Parti Socialiste (SFIO), Parti Radical (ou "Radicaux"), Parti Communiste Français.
Croix de Feu : organisation d'"Anciens combattants", d'extrême-droite. Fondée en 1927, elle sera dissoute en 1936.
QUELQUES-UNS DES HOMMES POLITIQUES :
Duclos, Cachin : dirigeants du PCF.
Thorez : Secrétaire général du PCF.
Daladier : dirigeant du Parti Radical.
Blum : dirigeant du Parti Socialiste SFIO, mènera la coalition gouvernementale du Front Populaire.
Herriot : Président de la Chambre des députés de 1936 à 1940, dirigeant du Parti Radical Socialiste.
La Roque : dirigeant des Croix de Feu.
JOURNAUX :
L'Intransigeant : journal de droite, classique.
L'Humanité : organe quotidien du PCF.
Le Populaire : journal du Parti socialiste.
[1] [12] Un bref glossaire donnant les principaux partis et mouvements, hommes politiques, journaux, est disponible en fin d'article.
[2] [13] La Gauche communiste et Bilan considéraient comme « centristes » les staliniens et les partis communistes affiliés à l'Internationale. Sur « centrisme et opportunisme » voir la Revue Internationale n°44.
Géographique:
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [16]
Approfondir:
- Espagne 1936 [17]
Heritage de la Gauche Communiste:
Polémique avec le P.C.Int.-Battaglia Comunista : La période de transition
- 2834 lectures
Le débat sur la période de transition a toujours été l'objet de polémiques acharnées entre groupes révolutionnaires. Avec le développement de la lutte de classe, les révolutionnaires sont obligés de porter leur attention sur des questions plus immédiates des luttes ouvrières, en particulier les questions de l'intervention et de l'organisation. Mais en jouant son rôle de force de propositions concrètes dans les luttes ouvrières, l'organisation révolutionnaire, parce qu'elle s'appuie sur ce qui est "général", ce qui concerne tous les ouvriers, l'ensemble de la classe, ne peut pas se permettre de négliger le problème des buts historiques de la lutte : la destruction révolutionnaire de l'Etat capitaliste, la dictature du prolétariat, la transformation communiste de la vie sociale.
En consacrant cet article aux positions du Parti Communiste Internationaliste-Battaglia Comunista (PCInt.) sur la période de transition, telles qu'elles ont été exprimées dans le document de son 5ème Congrès (Prometeo n°7), notre but est d'aider à la réanimation de cette importante discussion au sein du mouvement révolutionnaire.
Pour notre part, nous n'avons aucun doute sur le fait que le PCInt. partage avec nous une base commune importante d'acquis historiques du marxisme, en particulier :
- contre les théories idéalistes typiques de l'historiographie bourgeoise, il localise les origines de l'Etat dans l'évolution historique réelle et matérielle de la société de classes ;
- contre l'utopie anarchiste, il affirme la nécessité de la dictature du prolétariat et d'un Etat pendant la période de transition, qui sera encore marquée par des divisions de classes ;
- contre le réformisme, qui est maintenant une idéologie contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, il affirme les leçons de La Commune de Paris sur la nécessité de détruire l'Etat bourgeois et de le remplacer par un Etat d'un nouveau type, un semi-Etat destiné à disparaître avec le dépassement des antagonismes de classe ;
- en accord avec L'Etat et la Révolution de Lénine, il affirme que le semi-Etat doit être basé sur la forme Soviet découverte par la classe ouvrière en 1905 et 1917 ;
- et enfin, dans la ligne de la contribution de la Fraction italienne de la Gauche communiste dans les années 30, il tire un certain nombre de leçons critiques de l'expérience russe :
.les causes du déclin de la révolution russe et la transformation de l'Etat des Soviets et du parti bolchevik en machine capitaliste contre-révolutionnaire, réside d'abord et surtout dans l'échec de la révolution à s'étendre au niveau international;
.au sein du cadre objectif de l'isolement de la révolution et des conditions d'arriération et de famine auxquelles s'est confrontée la révolution russe, certaines erreurs du parti bolchevik ont agi comme "accélérateur" du processus de dégénérescence ;
.la première de ces erreurs résidait dans une identification entre le parti et la dictature du prolétariat, aboutissant à la confusion entre parti et Etat, à la faille grandissante entre le parti et la classe, et l'incapacité croissante du parti à jouer son rôle réel d'avant-garde politique ; il y a aussi un écho - même si, comme nous le verrons plus loin, il est faible et inconsistant - de la position développée par la Fraction et plus élaborée par la Gauche Communiste de France(GCF) ([1] [19]) et le CCI selon laquelle non seulement le parti ne doit pas être identifié à l'Etat, mais aussi que l'Etat transitoire et la dictature du prolétariat ne sont pas identiques.
L ' importance de ces points communs ne doit pas être sous-estimée parce que ceux-ci constituent des frontières de classe sur le problème de l'Etat, le "point de départ" essentiel pour une compréhension marxiste de la question, l'exception ici étant la question de la non-identification de l'Etat avec la dictature du prolétariat qui, comme nous 1'avons toujours défendu est une "question ouverte" qui ne peut pas être définitivement tranchée avant la prochaine expérience révolutionnaire majeure.
Ayant brièvement défini ce que nous considérons être des zones d'accord, nous pouvons maintenant développer nos critiques aux inconséquences et insuffisances du PCInt. qui diminuent sa capacité à défendre et développer la position marxiste sur ces questions.
Une assimilation incomplète du travail de la GAUCHE ITALIENNE
Le PCInt. proclame que :
"Les positions politiques mentionnées ici, représentent le bagage théorique et la tradition de lutte de la Gauche Italienne, dont la présence historique a été assurée par la fondation du Parti Communiste d'Italie, et les acquis successifs de la Fraction et du PCInt. constitué au cours de la seconde guerre mondiale."
Comme nous l'avons dit, le texte reflète indubitablement le travail de la Fraction. Mais si le PCInt ne balaie pas purement et simplement ce travail comme le font les bordiguistes. On ne peut pas dire non plus qu'il a pleinement assimilé ce travail et surtout la méthode qui a permis à la Fraction d'entamer une critique fondamentale des positions de 1'Internationale Communiste (IC). Dans un certain nombre de cas, le PCInt. revient à l'orthodoxie "léniniste" que la Fraction avait osé mettre en doute. Ceci est particulièrement clair sur la question des relations entre le prolétariat et 1'Etat transitoire.
D'après le PCInt., le CCI régresse du marxisme à l'opportunisme quand il défend l'idée qu'une leçon cruciale de la révolution russe est que l'Etat transitoire, émanant d'un ordre social qui est encore divisé en classes, aura un caractère conservateur plutôt que dynamique, codifiant et administrant, au mieux, la poussée vers le communisme venant de la classe révolutionnaire, et au pire, s'y opposant et devenant le foyer de la contre-révolution renaissante ; et que, en conséquence, le prolétariat ne doit pas identifier son autorité de classe avec la machine d'Etat, mais doit subordonner rigoureusement celle-ci au contrôle de ses propres organes de classe.
Le PCInt. veut être très "orthodoxe" sur cette question et revient donc à la position de Marx selon laquelle dans la période de transition, "l'Etat ne peut être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat." (Marx s'attaquait ici aux déviations réformistes sur l'Etat). Pour le PCInt. -'l'Etat est un 'Etat ouvrier', et même un 'Etat socialiste (dans le sens où il permet la réalisation du socialisme)"; c'est la même chose que les Soviets : "L'erreur est de voir les Soviets (qui auront tout le pouvoir) comme étant différents de l'Etat ; mais l'Etat prolétarien n'est rien d'autre que la synthèse centralisée du réseau des Soviets."
En fait, le PCInt. ne peut rester très "orthodoxe" sur cette question qu'en ignorant certaines des questions fondamentales posées par la Fraction et les continuateurs de sa méthode. Le texte a, en fait, quelques lueurs des développements de la Fraction à ce propos, en ce sens que certains passages impliquent que l'Etat et la dictature du prolétariat ne sont pas identiques. Par exemple, le texte commence en disant :
"Parler de la période de transition, c'est parler de l'Etat ouvrier et de ses caractéristiques politiques et économiques, et des relations qui doivent s'établir entre celui-ci et la forme spécifique de la dictature du prolétariat : les Soviets"
Mais cette perspicacité est alors contredite par l'insistance du PCInt. à se définir contre les positions du CCI. Et ce faisant, il se définit inévitablement contre le travail de la Fraction. Les pages de Bilan contiennent beaucoup d'études profondes sur la question de l'Etat. Ses origines historiques, les différentes formes de l'Etat dans la société capitaliste, etc., sont analysées dans ... la série d'articles "Parti-Internationale-Etat". Les questions politiques et économiques posées par la période de transition sont examinées surtout dans la série d'articles de Mitchell "Problèmes de la Période de Transition" (que le CCI se propose de republier).A la lumière de l'expérience russe, où les Soviets ont été transformés en un monstrueux appareil bourgeois, Mitchell revient à certaines mises en garde de Marx et Engels à propos de l'Etat transitoire qui est un "mal nécessaire", un "fléau" que le prolétariat est contraint d'utiliser, et Mitchell conclut que les bolcheviks avaient fait une erreur fondamentale en identifiant la dictature du prolétariat avec l'Etat transitoire :
"Bien que Marx, Engels et surtout Lénine eussent maintes fois souligné la nécessité d'opposer à l'Etat son antidote prolétarien, capable d'empêcher sa dégénérescence, la Révolution russe, loin d'assurer le maintien et la vitalité des organisations de classe du prolétariat, les stérilisa en les incorporant à l'appareil étatique et ainsi dévora sa propre substance. Même dans la pensée de Lénine, la notion de "Dictature de l'Etat" devint prédominante : c'est ainsi qu'à la fin de 1918, dans sa polémique avec Kautsky ("La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky") il ne parvient pas à dissocier les deux notions opposées : Etat et Dictature du Prolétariat." (Bilan n°31, p.1038) Ou encore,
"La sauvegarde de la Révolution russe et son maintien sur les rails de la Révolution mondiale n'étaient donc pas conditionnés par l'absence de l'ivraie bureaucratique - excroissance accompagnant inévitablement la période transitoire - mais par la présence vigilante d'organismes prolétariens où pût s'exercer l'activité éducatrice du Parti conservant au travers de l'Internationale la vision de ses tâches internationalistes. Ce problème capital, les Bolcheviks ne purent le résoudre par suite d'une série de circonstances historiques et par ce qu'ils ne disposaient pas encore du capital expérimental et théorique indispensable. L'écrasante pression des événements contingents leur fit perdre de vue l'importance que pouvait représenter la conservation des Soviets et Syndicats en tant qu'organisations se juxtaposant à l'Etat et le contrôlant, mais ne s'y incorporant pas."(Id.p.1040).
Le lien entre cette position et celle du CCI est clair. Les organes de classe du prolétariat ne doivent pas être confondus avec l'Etat. Aussi, le PCInt. devrait se référer à BILAN sur cette question.
Bien sûr, la position du CCI n'est pas simplement une répétition de celle de BILAN. En assimilant le travail de la GCF il a rendu plus clairs un certain nombre de points :
- Sur la question du parti : BILAN a vu la nécessité de distinguer le prolétariat et son parti d'avec l'Etat, mais tendait à identifier le parti avec la dictature du prolétariat. Pour le CCI, le parti n'est pas un instrument pour exercer le pou voir politique. C'est là la tâche des "conseils ouvriers" et des autres organes unitaires de la classe ouvrière. La fonction du parti est de mener un combat politique au sein des conseils et de la classe dans son ensemble contre toutes les vacillations et l'influence bourgeoise, et pour la réalisation du programme communiste ;
- sur la question syndicale : le prolétariat dans la période de transition aura encore besoin de défendre ses intérêts immédiats contre les exigences de l'Etat, mais il n'y aura plus de syndicats, hérités des organisations par métier du siècle dernier dans la lutte pour des réformes et qui ont prouvé être antithétiques aux besoins de la lutte de classe' et sont passés dans le camp capitaliste à l'époque de la révolution sociale. Il y aura les conseils ouvriers et les comités d'usines, de quartier, milices, etc., qui en émanent (cf. infra).
- sur la question de l'Etat lui-même : la GCF et le CCI faisant des recherches plus approfondies sur les origines de l'Etat dans l'histoire et dans la période de transition ([2] [20]) ont rejeté la formulation "Etat prolétarien" qui apparaît encore dans le travail de BILAN.
Dans le passage de son document traitant des origines historiques de l'Etat, le PCInt. résume correctement les écrits d'Engels sur le sujet en disant que :
1) l'Etat est le produit de la société divisée en classes ;
2) l'Etat est l'instrument de domination de la classe économiquement dominante.
" Pourtant, il n'en tire pas toutes les conclusions appropriées, en particulier le fait que l'Etat n'émerge pas comme une simple création, ex-nihilo, de la classe dominante, mais il émerge "spontanément" des contradictions internes d'un ordre social divisé en classes. L'Etat est d'abord et avant tout un instrument de préservation de l'ordre social. Cette compréhension permet d'expliquer comment, dans le phénomène du "capitalisme d'Etat", l'Etat peut se "substituer" à la classe dominante traditionnelle, l'exemple le plus poussé étant l'Etat russe où cette classe dominante "traditionnelle"avait été renversée par le prolétariat. Cette compréhension du fait que l'Etat émerge d'une situation sociale divisée en classes permet de voir que l'Etat transitoire n'émane pas du prolétariat mais des exigences de la société transitoire elle-même. La destruction de l'Etat bourgeois représente une rupture dans une continuité millénaire, qui nous conduit, à un niveau supérieur, à la situation qui existait avant l'émergence des premières formes étatiques. L'Etat transitoire découle des "désordres" hérités de la destruction de l'Etat bourgeois. Mais, contrairement à tous les Etats antérieurs, cet Etat ne deviendra pas "automatiquement" l'expression organique, la prolongation d'une classe économiquement dominante, exploiteuse, parce qu'une telle classe n'existera plus. Le prolétariat devra mener une lutte politique constante pour s'assurer que l'Etat reste sous son contrôle ; aucun développement automatique des lois économiques n'assurera cela. Au contraire, la période de transition sera la champ de bataille entre la volonté humaine consciente et les automatismes économiques de toutes sortes, et ainsi entre le prolétariat communiste et l'Etat qui tendra à refléter la pression continue des lois économiques dans une société encore marquée par la pénurie et la division en classes.
Pour être plus précis, l'émergence de l'Etat dans la société transitoire signifie que celui-ci sera basé sur des organismes -les soviets territoriaux- qui regroupent l'ensemble de la population non-exploiteuse. Bien qu'ils contiennent des prolétaires, ces organes ne sont pas prolétariens en eux-mêmes et le prolétariat doit toujours maintenir une stricte indépendance politique, à travers ses organes de classe spécifiques, les conseils ouvriers, qui exerceront un contrôle rigoureux sur les soviets territoriaux et sur tous les organes administratifs ou répressifs qui émergeront de leur centralisation.
Il est frappant de voir que le texte du PCInt. évacue presque entièrement le problème de l'organisation des couches non-prolétariennes, non exploiteuses dans l'Etat transitoire, en particulier au vu de la "sensibilité" autoproclamée du PCInt vis-à-vis des problèmes que rencontrent ces couches à la périphérie du capitalisme, où elles dépassent largement en nombre la classe ouvrière et posent donc un problème central pour la révolution. En conséquence, quand le PCInt. est obligé d'aborder ce problème, il tombe dans deux erreurs symétriques :
- l'erreur "ouvriériste" (qui a été, dans le passé, particulièrement nette dans la Communist Workers'Organisation (CWO) consistant à nier que ces couches auront un rôle particulier quelconque dans l'Etat transitoire. Ainsi ils écrivent : "Les soviets seront élus exclusivement par les ouvriers, privant de tout droit électoral ceux qui profitent du travail salarié ou qui, d'une façon ou d'une autre, exploitent économiquement le travail du prolétariat."
L'exclusion des exploiteurs de toute participation aux soviets est une chose, et nous sommes d'accord avec cela. Mais ce passage ne nous dit rien de ce qu'il faut faire de toutes les vastes masses humaines -paysans, artisans, éléments marginalisés, etc.- qui n'appartiennent ni à la classe ouvrière ni à la bourgeoisie. Essayer d'exclure ces masses du système des soviets aurait été impensable aux Bolcheviks en 1917, et il devrait en être de même pour les communistes aujourd'hui. Pour entraîner ces couches derrière et dans la révolution ouvrière et non contre elle, pour élever leur conscience des buts et des méthodes de la transformation communiste, pour pousser en avant leur intégration dans le prolétariat, ces couches doivent être intégrées dans le système des soviets, à travers un réseau de Soviets élus sur la base d'assemblées de quartiers ou de village (au contraire des conseils ouvriers, qui seront élus sur les lieux de travail) ;
- l'erreur inter-classiste, qui consiste à faire , fusionner, ou à submerger les organes de classe du prolétariat dans des organes regroupant toute la population non-exploiteuse : le PCInt. parle ainsi de l'Etat transitoire comme "l'Etat de tous les exploités,. dirigés politiquement par une classe ouvrière organisée sur une base internationale."De nouveau, la formulation n'est pas totalement incorrecte ; la confusion provient de ce qui n'est pas dit. Qui sont "tous les exploités" ? La classe ouvrière seule, ou bien, comme le passage semble l'impliquer dans la phrase "dirigés politiquement par une classe ouvrière", les autres couches non-exploiteuses aussi ? Et si l'Etat doit être celui de toutes les couches non-exploiteuses, comment sera-t-il "dirigé politiquement" par la classe ouvrière si la classe ouvrière n'est pas organisée de façon indépendante ?
Ces deux erreurs se renforcent réciproquement, dans la mesure où elles viennent de la même source : une incapacité à analyser les conditions sociales réelles donnant naissance à l'Etat dans la période de transition.
LA QUESTION SYNDICALE
Sur la question syndicale, il est normal d'attendre des groupes révolutionnaires d'aujourd'hui une plus grande clarté que la Gauche italienne, dans la mesure où la faiblesse des luttes de classe autonomes dans les années 30 ne donnait pas à celle-ci tous les éléments pour résoudre cette question. Comme nous l'avons dit, à la fois Bilan, et à ses débuts la GCF considéraient que la nécessaire défense des intérêts immédiats du prolétariat contre les exigences de l'Etat transitoire, serait assurée par les syndicats. Ce qui est étrange, en tout cas, c'est de lire que le PCInt. - qui dit que les syndicats ne sont plus des organes prolétariens, et devront être détruits pendant la révolution - défend l'idée, dans son document sur la période de transition, écrit en 1983, selon laquelle :
"Les Soviets sont réellement des organes révolutionnaires et politiques. Ils ne doivent donc pas être confondus avec les syndicats qui, après la révolution, auront encore la fonction de défense des intérêts immédiats du prolétariat et d'organisation des luttes contre la bourgeoisie pendant le difficile processus 'd'expropriation des expropriateurs’. Ils ne doivent pas non plus être confondus avec les Conseils d’usine qui auront la tâche d'assurer le contrôle ouvrier sur la production."
Nous avons souvent dit que le PCInt. et la CWO gardent certaines confusions à propos des syndicats, vus comme organisations "intermédiaires" ou même "ouvrières" à notre époque, et cela le confirme tout à fait. Ils semblent incapables de comprendre pourquoi la forme syndicale ne correspond plus aux besoins de la lutte de classe de notre époque, époque de la décadence capitaliste et de la révolution prolétarienne. Les caractéristiques essentielles de la lutte de classe à cette époque - son caractère massif, la nécessité de rompre toutes les barrières sectorielles - ne changeront pas après la prise du pouvoir par les ouvriers. Nous avons déjà dit que nous reconnaissons la nécessité continué pour les ouvriers de pouvoir défendre leurs intérêts immédiats et spécifiques contre les exigences de l'Etat transitoire, mais pour cela il faut des organes qui regroupent les prolétaires sans tenir compte des branches ou secteurs : les comités d'usine et les Conseils ouvriers eux-mêmes. Dans la vision des choses du PCInt., où les Conseils ouvriers "sont" l'Etat, on nous présente le scénario bizarre dans lequel les ouvriers utilisent les syndicats pour se défendre... contre les Conseils ouvriers !
EN CONCLUSION
Cet article ne prétend en aucune façon être une étude exhaustive sur la question de la période de transition, ni même de la vision du PCInt. sur la question. Son but était plutôt de donner une nouvelle impulsion à la discussion sur là période de transition, de définir certains points de base, et de critiquer quelques une des confusions, contradictions ou concessions à l'idéologie bourgeoise contenues dans les positions d'une autre organisation révolutionnaire. Les positions du PCInt.,bien que se situant sur une base marxiste, montrent,sur certaines questions cruciales - les relations entre classe et Etat, Parti et Etat, la question syndicale - une difficulté à avancer à partir de cette base vers des conclusions plus cohérentes. Il reste à mi-chemin entre les positions les plus avancées de la Gauche communiste et les thèses dépassées de l'Internationale Communiste sous Lénine. Mais comme même la bourgeoisie révolutionnaire l'avait compris, on ne peut pas faire une révolution à moitié. Toutes les confusions et contradictions à propos du processus révolutionnaire seront mises à nu par la révolution elle-même. Et c'est précisément pour cela que le débat sur la période de transition ne peut pas être ignoré aujourd'hui : quand nous serons lancés dans l'océan de la révolution communiste, nous devrons être équipés de la boussole la plus précise possible que nous permet l'évolution présente de la théorie marxiste.
M.U.
Courants politiques:
- Bordiguisme [23]
- Battaglia Comunista [24]
Heritage de la Gauche Communiste:
La gauche hollandaise (1900-1914) : Le mouvement "Tribuniste" 3eme partie
- 4189 lectures
Cet article est la dernière partie de l'étude sur l'histoire de la Gauche hollandaise entre 1900 et 1914. Après avoir traité des difficultés du surgissement du courant marxiste dans les conditions de la Hollande du début du siècle et des débuts de ce qui allait devenir la "Gauche hollandaise" (Revue Internationale n°45), puis de la fragilité des organisations politiques du prolétariat confrontées à la pression permanente de l'idéologie bourgeoise en leurs rangs (Revue Internationale n°46), l'étude traite dans cette partie de la naissance du mouvement "tribuniste" jusqu'à l'exclusion de ce courant de la social-démocratie (SDAP) par l'aile opportuniste.
C'est en octobre 1907 que les radicaux marxistes commencèrent à publier leur propre "hebdomadaire social-démocrate". A la tête de "De Tribune" on trouvait les futurs chefs de l'organisation tribuniste : Wijnkoop, Ceton et van Ravesteyn, qui disposaient du soutien inconditionnel du 3ème rayon d'Amsterdam, le plus révolutionnaire du parti. Pannekoek et Gorter y contribuèrent régulièrement, donnant des textes théoriques et polémiques parmi les plus importants. Tous étaient animés par l'espérance d'une future révolution ; la période était plus favorable que jamais historiquement avec le début d'une crise économique, qu'ils n'analysaient pas encore comme la crise générale du capitalisme.
L'orientation était déjà antiparlementaire; il s'agissait de rattacher la lutte des ouvriers à la lutte internationale en les libérant des illusions parlementaire et nationale. Le but était en effet "1° démasquer la signification réelle des manoeuvres trompeuses de la démocratie bourgeoise en matière de droit de vote et de transformations sociales, et 2° donner une'' idée aux ouvriers de la signification des relations internationales et de la lutte de classe à l'étranger." Il est remarquable de constater que cette ligne politique se rapproche considérablement de celle du futur courant de Bordiga, par la proclamation de la lutte politique et théorique contre la démocratie bourgeoise et l'affirmation de l'internationalisme. Il est certain que les "Tribunistes" ne pouvaient guère avoir une activité organisée, en dehors des sections comme celle d'Amsterdam où ils étaient majoritaires. Chassés par les révisionnistes des organes centraux, ils concevaient leur lutte essentiellement sous l'aspect théorique.
Mais le combat politique - avec la publication de "De Tribune" qui était sans concessions dans sa lutte contre le révisionnisme - allait vite se durcir et poser rapidement la question de la scission dans le parti. Une chasse aux "sorcières" marxistes était enclenchée. A Rotterdam, les chefs révisionnistes firent destituer la rédaction marxiste de l'organe local ; et cela juste après le Congrès d'Arnhem (1908) qui avait rejeté la proposition de Troelstra d'interdire "De Tribune". Par la suite, c'est le même processus d'interdiction des autres organes locaux d'inspiration marxiste qui se généralise.
La crise du parti était ouverte ; elle allait se précipiter avec les interventions publiques de Troeistra contre les positions marxistes en plein parlement, face aux partis politiques bourgeois.
a) La question de la période et de la crise
L'affrontement avec les "tribunistes" allait se produire à l'automne 1908. à l'occasion d'une prise de position de Troelstra au parlement. Celui-ci niait publiquement la nécessité pour les ouvriers d'appréhender le devenir du capitalisme de façon théorique, dans le cadre du marxisme ; il soutenait qu'il n'y avait "pas de besoin de théorie logique abstraite" dans la lutte de classe. Finalement - sans la nécessité d'une révolution, et donc de façon pacifique et "automatique" - "le capitalisme conduit de lui-même au socialisme" (Id.). Autant dire que le socialisme n'était plus déterminé par l'existence des conditions objectives de la crise et la maturation de la conscience du prolétariat ; il devenait une simple croyance religieuse. A ces affirmations, "De Tribune" réagit très violemment et de façon mordante contre la personne de Troelstra, symbole du révisionnisme dans le parti :
"Un politicien pratique de la social-démocratie doit aussi comprendre la théorie ; il doit la connaître et pouvoir la défendre. C'est peut-être pour un 'bourgeois' une lourde tâche, mais la classe ouvrière ne s'accorde pas moins avec son chef. Ce savoir, cette science socialiste est certes souvent plus facile à atteindre que pour un homme qui est issu de la bourgeoisie. L'ouvrier peut savoir immédiatement à partir de sa propre vie ce que le socialiste issu de la bourgeoisie doit auparavant apprendre de la théorie ; par exemple, ce qui pour Troelstra n'est pas encore certain : que le fossé économique entre les deux classes devient toujours plus profond... Si la possibilité existe que le fossé entre les classes ne devienne pas plus profond, alors notre socialisme sombre dans une croyance ; la certitude devient une attente. Avec la croyance et l'espoir les ouvriers sont suffisamment floués. Pour cela ils n'ont pas besoin de socialisme. L'Eglise aussi leur apporte la croyance que cela ira mieux dans l'au-delà et les braves libéraux et démocrates espèrent que cela ira mieux bientôt." Mais le plus important dans la dénonciation du révisionnisme par les Tribunistes était l'affirmation théorique du cours historique du capitalisme vers une crise mondiale.' En cela, la Gauche hollandaise - sauf Pannekoek plus tard (cf.infra) - rejoignait la position de Rosa Luxemburg qu'elle devait exposer en 1913 : "La prétendue 'prophétie' de Marx est aussi pleinement réalisée dans le sens que les périodes de développement capitaliste moderne deviennent toujours plus courtes, que. en général les 'crises' comme force transitoire d'une production forte à une production faible doivent toujours encore persister et que avec le développement du capitalisme elles s'élargissent, deviennent plus longues, les maux limités localement devenant toujours plus des calamités mondiales."
Ces attaques portées contre les théories révisionnistes de Troelstra furent considérées par une majorité du SDAP comme de simples attaques personnelles. Fait extrêmement grave dans l'histoire du mouvement ouvrier, en contradiction avec la liberté de critique dans un parti ouvrier, les révisionnistes interdirent le colportage de "De Tribune" lors d'une réunion publique où parlait Troelstra. C'était le début du processus -d'exclusion des positions marxistes, processus qui allait brutalement s'accélérer à la veille de l'année 1909.
b) Gorter contre Troelstra sur la "morale" prolétarienne
"De Tribune" avait sorti en feuilleton au cours de l'année 1908 l'une des contributions majeures de Gorter à la vulgarisation du marxisme : "Le matérialisme historique expliqué aux ouvriers". Prenant à titre d'exemple la grève de 1903, Gorter montrait que la lutte de classe faisait surgir une authentique morale de classe qui entrait en contradiction avec la morale "générale" commune défendue par les tenants de l'ordre existant. La conception matérialiste, défendue par Gorter, qui sapait les fondements de toute morale religieuse, fut violemment attaquée au Parlement par le député chrétien Savornin Lohman les 19 et 20 novembre. Celui-ci, en défendant l'unité de la nation, accusa la social-démocratie de vouloir susciter la guerre entre les classes et d'intoxiquer ainsi la classe ouvrière avec le marxisme.
Au heu de faire bloc avec Gorter face aux attaques d'un représentant de la conception bourgeoise,Troelstra se lança dans une diatribe contre Gorter,qu'il présenta comme non représentatif du parti et une simple caricature du marxisme. Pour lui, la morale n'était pas déterminée par les rapports sociaux ; elle était valable 'pour les prolétaires comme pour les bourgeois. Il s'appuyait pour cela sur les concepts ambigus qu'avait utilisés Marx dans les statuts de l'AIT, ceux de droits, de devoirs et de justice. - Mais Troelstra, en confondant à dessein les valeurs communes à l'espèce humaine et la morale officielle qu'il présentait comme universelle transformait la morale de la lutte ouvrière - guidée par des intérêts communs et une action tendue vers la victoire - en une monstruosité. Le matérialisme de Gorter serait un pur appel au meurtre et aboutirait à une vision de barbarie. Selon lui, Gorter, par exemple, serait contre le fait qu'"un ouvrier sauve un fils de capitaliste en train de se noyer". La démagogie de Troelstra dans l'argumentation était dans ce cas identique à celle de Lohman, à laquelle il se ralliait.
Gorter répliqua fougueusement, selon son habitude, aussi bien à Lohman qu'à Troelstra, par une brochure vite écrite et publiée pour les nécessités du combat. Après une période d'isolement politique, il se lançait totalement dans la lutte de parti. Il concentra la pointe acérée de la critique sur la personne de Troelstra qui "en réalité, au plus profond de ses paroles, a choisi le camp de la bourgeoisie". Il montrait d'autre part que Troelstra trahissait la pensée profonde de Marx en utilisant les termes ambigus des Statuts de l'AIT. La correspondance de Marx et Engels, publiée quelques années plus tard, devait permettre à Gorter de justifier triomphalement son argumentation. En effet, dans une lettre du 4 novembre 1864, Marx expliquait qu'il avait du faire quelques concessions face aux proudhoniens: "j'ai été obligé d'accueillir dans le préambule des Statut deux phrases contenant les mots 'devoir' (duty) et 'droit' (right) de même que les mots vérité, morale et justice' (truth, morality and justice), mais je les ai placés de telle sorte qu'ils ne causent pas de dommage."
D'autre part, Gorter répliquait vigoureusement à l'accusation que la morale du prolétariat visait à s'attaquer aux individus capitalistes, au mépris de tout sentiment d'humanité. La morale du prolétariat est essentiellement une morale de combat qui vise à la défense de ses intérêts contre la classe bourgeoise, comme catégorie économique, et non comme somme d'individus. Elle est une morale qui vise à s'abolir dans la société sans classes, laissant la place à une véritable morale, celle de l'humanité tout entière émancipée de la société de classes.
Suite à cette polémique, la scission devint inévitable. Elle était souhaitée par Troelstra, qui tenait à éliminer du parti toute tendance critique marxiste. Dans une lettre à Vliegen du 3 décembre, il avouait :
"Le schisme est là; la seule ressource ne peut être qu'une scission."
LA SCISSION DU CONGRES DE DEVENTER (13-14 février 1909)
Pour éliminer les Tribunistes et leur revue, les chefs révisionnistes proposèrent un référendum pour examiner la question de la suppression de la revue "De Tribune" lors d'un congrès extraordinaire. Le comité du parti était hésitant et même contre de telles mesures extraordinaires. Troelstra passa par dessus le comité et par référendum obtint des 2/3 du parti la convocation du congrès. Il se manifestait ainsi que la très grande majorité du SDAP était gangrenée par le révisionnisme; elle était même à la base plus révisionniste que le "sommet", que ses organes directeurs.
D'autre part, les- éléments marxistes issus du "Nieuwe Tijd" et collaborateurs de "De Tribune" capitulèrent devant Troelstra. Au cours d'une conférence tenue le 31janvier, sans même que soient invités les principaux rédacteurs tribunistes, Roland-Holst et Wibaut se déclarèrent prêts à quitter la rédaction de la revue pour diriger un futur supplément hebdomadaire ("Het Weekblad") de "Het Volk" le quotidien du SDAP débarrassé de toute critique marxiste contre le révisionnisme. Au lieu de se solidariser avec leurs camarades de combat, ils firent un serment d'allégeance à Troelstra en se déclarant pour "un travail commun de loyale camaraderie de parti". Ceux-ci se proclamèrent; "marxistes de paix", essayant de se réfugier dans une attitude centriste de conciliation entre la droite et la gauche marxiste. Dans le mouvement marxiste en Hollande, Roland-Holst conserva constamment cette attitude (cf. infra).
Les Tribunistes ne manquèrent pas de reprocher à Roland-Holst sa capitulation : son attitude ne faisait que rendre plus certaine la scission souhaitée par les révisionnistes.
Il est vrai que, de leur côté, la minorité marxiste j était loin d'être homogène pour mener jusqu'au bout le combat à l'intérieur du SDAP. Wijnkoop, Van Raveysten et Ceton, qui constituaient la véritable tête organisatrice de la minorité, s'étaient déjà résolus à la scission avant le congrès, pour maintenir en vie "De Tribune". Par contre, Gorter - qui n'était pas formellement dans la rédaction - restait beaucoup plus réservé. Il se méfiait de la fougue de cette triade et ne voulait en aucun cas précipiter la scission. Il souhaitait que Wijnkoop se modère et que les Tribunistes restent dans le parti, au prix même de l'acceptation j de la suppression de "De Tribune" en cas d'échec au congrès de Deventer :
"J'ai 'continuellement dit contre la rédaction de 'Tribune' : nous devons tout faire pour attirer les autres vers nous, mais si cela échoue après que nous nous soyons battus jusqu'au bout et que tous nos efforts aient échoué, alors nous devons céder." (Lettre à Kautsky, 16 février 1909)
De fait, lors du congrès extraordinaire de Deventer, les Tribunistes se battirent pendant deux jours avec acharnement et dans des conditions extrêmement difficiles. Souvent interrompus par Troelstra qui usait systématiquement d'une démagogie anti-"intellectuels" ironisant sur les "professeurs de "De Tribune" -, affrontant le plus souvent les rires d'incompréhension de la majorité du congrès, ils restèrent offensifs. Ils se battirent pour maintenir l'essence révolutionnaire du parti, "le sel du parti", selon la formule lancée par Gorter. Sans la liberté de critique marxiste contre l'opportunisme, liberté exercée dans les grands partis comme le parti allemand -, on supprimait la possibilité "d'éveiller la conscience révolutionnaire". Plus qu'aucun autre, Gorter sut exprimer lors du congrès la conviction révolutionnaire des Tribunistes ; une période décisive de guerre menaçante ,et de révolution future en Allemagne s'ouvrait, qui entraînerait la Hollande dans la tourmente :
"Internationalement, la période est très importante. Une guerre internationale menace. Alors le prolétariat allemand entrera en insurrection.
Alors la Hollande doit choisir sa couleur ; alors le parti doit se réjouir qu'il y ait eu des hommes qui mettaient au premier plan le côté révolutionnaire de notre lutte."
Conscient finalement du naufrage du SDAP, Gorter concluait à la fin du congrès par un vibrant appel au regroupement des révolutionnaires autour de "Tribune": "Venez vous joindre à nous autour de 'Tribune' ; ne laissez pas le navire couler !". Cet appel n'était cependant pas une invitation à la scission et à l'édification du nouveau parti. Gorter était encore convaincu de la nécessité de rester dans le parti, faute de quoi les Tribunistes perdraient toute possibilité de se développer : "Notre force dans le parti peut grandir; notre force en dehors du parti ne pourra jamais croître."
Mais ce combat pour rester à l'intérieur du parti échoua. Le processus de scission était irréversible avec les décisions prises majoritairement par le congrès.
Le congrès décida de façon écrasante - par 209 mandats contre 88 et 13 blancs la suppression de "De Tribune", remplacé par un hebdomadaire dirigé principalement par Roland-Holst. Mais, surtout, il excluait du parti les trois rédacteurs de "Tribune" : Wijnkoop Van Raveysten et Ceton. Dans l'esprit des révisionnistes, il s'agissait de décapiter la "tête" organisative, de séparer les "chefs" de la masse des sympathisants tribunistes dans le parti.
Cette manoeuvre échoua. Après le choc de l'exclusion des porte-parole du tribunisme, dans les sections les militants se ressaisirent et se solidarisèrent avec les trois rédacteurs. Rapidement, ce qui était jusque là une tendance informelle se transforma en groupe organisé. Aussitôt après le congrès - preuve que les Tribunistes avaient envisagé cette possibilité avant la scission - une commission permanente d'organisation fut formée pour regrouper la tendance "tribuniste". Des membres du groupe "Nieuwe Tijd", dont Gorter, finirent par rejoindre la commission. Gorter, après six semaines d'hésitations et de doute sur son attitude unitaire, finit par se résoudre à s'engager à fond dans un travail avec les Tribunistes exclus. Gorter mettait en garde, cependant, contre la fondation d'un second parti qui serait purement volontariste.
C'est en fait la publication le 13 mars par le SDAP du référendum dans le parti, pour approuver les décisions de Deventer, qui poussa les exclus à former un second parti. Par 3712 voix contre 1340, le SDAP avalisait l'exclusion du parti de toute la rédaction de "Tribune".
Or, entre-temps, avant que l'annonce d'exclusion définitive fut connue, Gorter et Winjkoop se rendirent à Bruxelles le 10 mars. Trois membres du Bureau socialiste international - Huysmans, Vandervelde et Anseele tous connus pour leur appartenance à la droite - dont le siège était dans la capitale belge, les attendaient pour résoudre la "question hollandaise". Contrairement à leurs craintes, Gorter et Wijnkoop trouvèrent une grande compréhension dans le BSI, lequel s'indigna de l'exclusion décidée à Deventer, et tenta d'obtenir la réintégration des exclus comme la libre expression du marxisme dans le SDAP. Pour jouer les médiateurs, Huysmans, le secrétaire en titre du BSI, se rendit en Hollande pour obtenir des instances du SDAP les décisions suivantes :
- l'annulation de la décision d'exclusion de Deventer ;
- l'acceptation d'un des rédacteurs exclus dans le nouvel hebdomadaire dirigé par Roland-Holst ;
- la reconnaissance du droit d'expression pour la minorité marxiste.
Sur tous ces points, les instances dirigeantes du SDAP semblèrent ébranlées par les avis de Huysmans suggérés le 15 mars. Mais, la veille, le 14 mars, s'était tenu à Amsterdam le congrès de fondation du parti tribuniste qui prit le nom de SDP (Parti social-démocrate). Sa fondation avait donc été décidée par ses membres sans même attendre les résultats des négociations du BSI avec le SDAP. Ce dernier, pourtant au courant des discussions menées depuis le 10 mars, avait fait avaliser l'exclusion le 13 mars.
C'est donc dans une situation d'extrême confusion que naquit le SDP. Il s'agissait d'un petit parti de 419 membres divisé en 9 sections. Son programme était celui de l'ancien parti d'avant 1906, avant les modifications révisionnistes.
Wijnkoop était nommé par le congrès président du parti, en raison de ses capacités d'organisateur.Gorter devenait membre de la direction du SDP. Mais son poids organisationnel était trop faible pour contrecarrer la politique personnelle, voire ambitieuse de Wijnkoop, prêt à sacrifier toute possibilité d'unité sur l'autel de "son" groupe. Une telle politique n'était pas sans arranger la majorité révisionniste du SDAP qui souhaitait la scission définitive d'avec le courant marxiste.
Pour toutes ces raisons, les tentatives faites par le BSI pour mettre fin à la scission échouèrent. Un congrès extraordinaire convoqué d'urgence pour le 21 mars, une semaine après celui de fondation, rejeta majoritairement les propositions faites par Huysmans de retourner dans le SDAP. Gorter était, avec quelques-uns qui appartenaient à la vieille garde du SDAP pour. Il jugeait particulièrement irresponsable l'attitude de Wijnkoop dont il dénonçait en privé "l'opiniâtreté sans limites". Il était à ce point démoralisé qu'il songea même un moment à quitter le SPD. Le rejet par le BSI et le SDAP des conditions de réintégration des militants tribunistes le décida cependant à s'engager complètement dans l'activité du nouveau parti.
En effet, le congrès du 21 mars, en dépit de l'attitude peu claire de Wijnkoop, avait laissé la porte ouverte à une réintégration dans l'ancien parti. Une résolution du congrès montrait le souhait de la majorité de maintenir aux Pays-Bas un seul parti ; pour cela le congrès posait des conditions qui permettraient aux Tribunistes de continuer leur travail de critique et d'activité marxistes dans le SDAP, si elles étaient acceptées :
"(le congrès) souhaite qu'en Hollande il y ait un seul parti social-démocrate et charge le comité du Parti, dans l'intérêt de l'unité, de lui donner pleins pouvoirs pour dissoudre le SDP, dès que :
- le SDAP, par référendum, lève 1'exclusion des trois rédacteurs;
- le SDAP reconnaît dans une résolution clairement formulée la liberté de tous ses membres ou de tout groupe de membres, ouvertement, sous toute forme, écrite et orale, de proclamer les principes consignés dans le programme et d'exercer leur critique"
Le rejet de ces conditions qui apparurent comme un ultimatum, par le BSI et le SDAP, créait une situation nouvelle dans l'Internationale : il y avait dans un pays comme les Pays-Bas deux partis socialistes se réclamant tous deux de la 2ème Internationale. Cette situation était - dans la 2ème Internationale - exceptionnelle. Même en Russie, après la scission entre les bolcheviks et les mencheviks, les deux fractions restaient adhérentes du même parti : le POSDR (Parti ouvrier social-démocrate russe). Mais aux Pays-Bas, il s'était révélé à travers la scission l'impossibilité politique - et aussi la non-volonté autant de la majorité révisionniste que de la minorité tribuniste - de demeurer membres du même parti.
Il était cependant très clair pour les militants marxistes du SDP que leur parti était un parti de l'Internationale. La scission était une scission locale et non une scission d'avec la 2ème Internationale.
Il était évident pour eux que la 2ème Internationale restait un corps vivant pour le prolétariat international et qu'elle n'avait nullement encore fait faillite. La faillite du SDAP de Troelstra n'était nullement celle de l'Internationale. Pour le SDP, le "modèle" de parti .restait encore, comme pour les bolcheviks, la social-démocratie allemande, avec laquelle il avait des liens étroits. Gorter, comme membre de la direction du SDP, restait en correspondance régulière avec Kautsky, du moins jusqu'en 1911, date de la rupture de la Gauche avec le Centre kautskyste. Pannekoek, qui s’était installé en Allemagne depuis 1906 et était depuis la scission membre du SDP, était membre de la section de Brème du SPD, après avoir enseigné dans l'école du Parti.
Pour devenir section de l'Internationale, le SDP entre prit promptement des démarches auprès du Bureau socialiste international. Gorter et Wijnkoop furent mandatés pour exposer au BSI les motifs de la scission en s'appuyant sur les rapports spécialement rédigés à l'adresse de l'Internationale. La demande d'acceptation du nouveau parti comme section à part entière fut en fait l'objet d'un conflit entre une gauche représentée par Singer (SPD) et Vaillant et une droite, dont l'autrichien Adler était le porte-parole. C'est à une faible majorité que l'acceptation du SDP dans l'Internationale fut rejetée : fa résolution Adler recueillait 16 voix, contre l'acceptation ; celle de Singer 11 voix, pour. Ainsi, le 7 novembre 1909, par ce vote, le SDP était de fait exclu du mouvement ouvrier international, par une majorité du BSI qui prenait fait et cause pour le révisionnisme.
Le SDP trouva néanmoins un appui inconditionnel dans la gauche bolchevique. Lénine -qui avait pris contact avec Gorter avant le BSI condamna avec indignation la décision du Bureau socialiste international de Bruxelles. Pour lui, il ne faisait aucun doute que les révisionnistes étaient responsables de la scission :
"[Le BSI] adopta une position formaliste et, prenant nettement parti pour les opportunistes, rendit les marxistes responsables de la scission."-
Il approuvait sans réserves les tribunistes qui n'avaient pas accepté la suspension de "De Tribune". Comme eux, il condamnait le centrisme de Roland-Holst "qui fit malheureusement preuve d'un désolant esprit de conciliation"
Ainsi débutait entre le SDP et les bolcheviks une communauté d'action qui allait devenir de plus en plus étroite. En partie grâce à la Gauche russe, le SDP finit par être accepté en 1910 comme section, de plein droit de l'Internationale. Disposant d'un mandat contre 7 au SDAP, il put participer aux travaux des congrès internationaux, à Copenhague en 1910 et à Bâle en 1912.
Ainsi, malgré les manoeuvres des révisionnistes, le SDP s'intégrait pleinement dans le mouvement ouvrier international. Son combat allait se mener conjointement avec la Gauche internationale, particulièrement avec la Gauche allemande, pour la défense des principes révolutionnaires.
JUSQU’A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Jusqu'à la première guerre mondiale, pendant laquelle il allait connaître une audience croissante dans le prolétariat, le SDP connut une "traversée du désert". Il resta un petit parti, sans grande influence dans le prolétariat néerlandais : quelques centaines de militants contre plusieurs milliers au SDAP de Troelstra. Sa croissance numérique fut très lente et limitée, en dépit de son esprit militant : au moment de la scission, le SDP comptait 408 militants ; en 1914,' 525. Le nombre d'abonnés à "De Tribune" fut limité et fluctuant : 900 lors du congrès de Deventer ; 1400 en mai 1909 et 1266 en 1914. A cause de sa faible audience le SDP ne fut jamais un parti parlementaire le devint à la fin de la guerre ; sa participation aux élections fut toujours une débâcle. Lors des élections de juin 1909, il obtint 1,5 % des voix par district. Même Gorter, qui était réputé être le meilleur orateur du parti, le seul capable de susciter l'enthousiasme des ouvriers connut un échec retentissant : poussé à être candidat aux élections de 1913 à Amsterdam et dans la ville industrielle d'Enschede, il obtint 196 voix pour le SDP contre 5325 pour le SDAP, dans cette dernière ville. Mais, même s'il participait aux élections, le terrain du- SDP n'était pas les élections, terrain où s'était enlisé le SDAP.
Réduit à une petite cohorte, le SDP -par suite de mauvaises conditions dans lesquelles s'était accomplie la scission de Deventer- ne peut rallier l'organisation des jeunesses, qui traditionnellement se tenait à la pointe de la lutte contre le capitalisme et la guerre, de façon active et radicale. L'organisation de jeunesse, "De Zaaier" ("Le Semeur"), qui avait été créée en 1901, voulut rester autonome : ses sections étaient libres de se rattacher à l'un ou à l'autre des deux partis. Lorsque, en 1911, le SDAP créa sa propre organisation de jeunesse, essentiellement pour contrer l'activité antimilitariste du "Zaaier", celui-ci éclata. Les quelques militants restants (100 environ) refusèrent néanmoins de suivre le SDP, malgré l'orientation commune.
Le risque était grand, malgré la solidité théorique du parti, que le SDP s'enfonce dans le sectarisme. Les attaches du parti avec le prolétariat d'industrie étaient distendues depuis la scission. Moins de la moitié des militants travaillait dans les usines ou les ateliers ; une grosse partie était composée d'employés et d'instituteurs. Le sommet du parti -jusqu'en 1911 du moins était composé d'intellectuels, solides théoriciens, mais -sauf Gorter- souvent sectaires et doctrinaires. Cette direction d'enseignants était portée à transformer le parti en secte.
La lutte contre le sectarisme au sein du SDP se posa dès le départ. En mai 1909, Mannoury -un des chefs du parti et futur dirigeant stalinien- déclara que le SDP était le seul et unique parti socialiste, le SDAP étant devenu un parti bourgeois. Gorter, d'abord minoritaire, se battit avec acharnement contre cette conception, lui qui avait mené la bataille contre Troelstra avec le plus d'acharnement ; il montra que -bien que le révisionnisme " menât au camp bourgeois- le SDAP était avant tout un parti opportuniste au sein du camp prolétarien. Cette position avait des implications directes au niveau des activités d'agitation et de propagande dans la classe. Il était en effet possible de se battre avec le SDAP, chaque fois que celui-ci défendait encore un point de vue de classe, sans la moindre concession théorique.
"Secte ou parti", telle était la question que Gorter posa très clairement devant l'ensemble du parti en novembre 1910. Il s'agissait de savoir si le SDP s'associerait à une pétition lancée par le SDAP pour le suffrage universel. Le SDP, comme tous les partis socialistes de l'époque, se battait pour le suffrage universel. La question centrale était donc l'analyse de classe du SDAP, mais aussi la lutte contre l'inaction sectaire lors des luttes politiques. Au départ, seule une petite minorité, menée par Gorter, soutint l'idée de la pétition et de l'agitation sur le suffrage universel. Il fallut tout le poids de Gorter pour qu'enfin une faible majorité se dessinât en faveur d'une activité commune avec le SDAP. Gorter montra le danger d'une tactique de non-participation, qui risquait de pousser le parti à un isolement total. Face au SDAP, qui n'était certes "pas un vrai parti", mais "un rassemblement, une masse attroupée pour une troupe de démagogues", la tactique devait être celle du "frelon" aiguillonnant dans le bon sens. Cette attitude fut finalement. Celle du parti jusqu'à la guerre, moment où le SDAP franchit le Rubicon en votant les crédits de guerre.
L'évolution du SDAP confirmait en effet la validité du combat mené dès le début par les tnbunistes contre le révisionnisme. Celui-ci, progressivement, était happé par l'idéologie et l'appareil d'Etat bourgeois. En 1913, le SDAP se prononça pour la mobilisation militaire en cas de guerre, et Troelstra proclamait ouvertement l'adhésion du révisionnisme au nationalisme et au militarisme :"Nous devons accomplir notre devoir", écrivait-il dans le quotidien du SDAP.
Fort de ses succès électoraux en 1913, le SDAP qui avait obtenu 18 sièges, se déclarait prêt à prendre des portefeuilles ministériels dans le nouveau gouvernement libéral. La participation à un gouvernement bourgeois aurait signifié l'abandon total du reste de principes prolétariens du parti de Troelstra ; celui-ci devenait ainsi un parti bourgeois intégré dans l'appa reil d'Etat. Il y eut cependant un faible et dernier sursaut prolétarien dans ce parti : lors de son congrès tenu à Zwolle, contre l'avis de Troelstra, une faible majorité se dégagea (375 voix contre 320) finalement contre la participation ministérielle Il est vrai que l'agitation faite par le SDP sous la forme d'une lettre ouverte écrite par Gorter et adressée au con grès qui n'en eut même pas connaissance- contre la participation ne fut pas étrangère à ce dernier sur saut.
L'activité du SDP ne se limita pas à critiquer le SDAP. Elle se déploya essentiellement dans la lutte de classe, dans les luttes économiques et dans l'action contre la guerre :
- La reprise de la lutte de classe internationale au début des années 1910 favorisa l'activité du parti qui y puisa enthousiasme et confiance. Ses militants participèrent avec ceux du NAS aux luttes des maçons d'Amsterdam en 1909 et 1910, qui se défiaient du SDAP, jugé "parti d'Etat". En 1910, le parti formait avec le NAS un "comité d'agitation contre la vie chère". Ainsi débutait une longue activité commune avec les syndicalistes-révolutionnaires, qui ne fut pas sans développer l'influence du SDP avant et pendant la guerre, au sein du prolétariat néerlandais. Cette activité commune eut pour conséquence de réduire progressivement le poids des éléments anarchistes au sein du petit syndicat et de développer une réceptivité aux positions marxistes révolutionnaires,
La lutte politique contre la guerre menaçante fut une constante du SDP. Celui-ci participa très activement au congrès de Bâle en 1912, congrès centré sur la menace de guerre. Le SDP, comme d'autres partis, proposa un amendement pour la grève de protestation en cas d'éclatement d'un conflit mondial. Cet amendement, qui fut rejeté, prenait soin de se démarquer de l'idée de "grève générale" lancée par les anarchistes. Malheureusement, suite' à l'interdiction des débats dans le congrès, le discours qu'avait préparé Gorter et orienté contre le pacifisme, ne put être lu. La voix révolutionnaire du SDP ne put retentir dans l'Internationale, couverte par les discours de tribun du pacifiste Jaurès.
A la veille de la guerre, le SDP -après une crise d'isolement sectaire- avait incontestablement développé une activité dans le prolétariat néerlandais qui ne fut pas sans porter ses fruits. L'évolution du SDAP vers le- "ministérialisme" -c'est-à-dire la participation au gouvernement bourgeois-, son acceptation de la "défense nationale" avaient incontestablement confirmé les analyses du courant marxiste. Celui-ci, compte tenu des conditions très défavorables de la scission de Deventer, restait néanmoins faible .numériquement : le courant révolutionnaire était recouvert par le courant révisionniste, en pleine expansion numérique et électorale.
Dans un si petit parti, l'orientation politique restait en partie déterminée par le poids des personnalités. La clarté théorique d'un Gorter et son soutien actif étaient décisifs^ face aux ambitions organisationnelles et au manque de principes d'un Wijnkoop et d'un Revesteyn. Cette opposition était lourde d'une nouvelle scission.
Cependant, l'audience du courant marxiste hollandais et sa force dépassaient le cadre étroit de la petite Hollande. C'est dans l'Internationale et avec la Gauche allemande que le marxisme hollandais contribua de façon décisive à la naissance de la Gauche communiste. Cette contribution fut moins organisationnelle que théorique, et déterminée par l'activité de Pannekoek en Allemagne. C'était à la fois une force et une faiblesse du "tnbunisme" hollandais.
Chardin
Géographique:
- Hollande [26]
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [28]