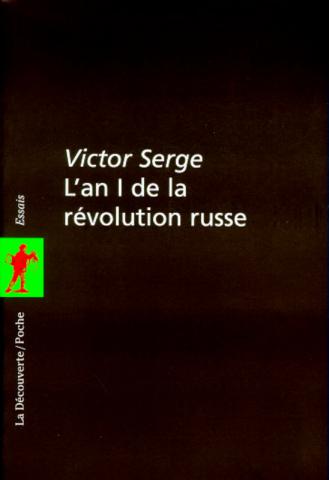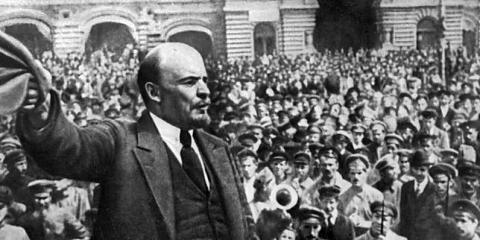Révolution Internationale n°464 - mai juin 2017
- 989 reads
Présidentielle en France : c’est toujours la bourgeoisie qui gagne les élections
- 1071 reads
Le nouveau président de la République est enfin élu, cet homme prétendument “nouveau” et “hors système” : Emmanuel Macron.
Celui-ci promet de “changer” la France et de “réunir tous les Français” dans une nouvelle concorde nationale et fraternelle. Il promet de relancer l’économie française et se veut l’homme du renouveau européen, d’une zone euro plus démocratique et économiquement dynamique. Autant d’enjeux de nature exclusivement bourgeoise. C’est sans conteste la classe bourgeoise qui seule peut se réjouir des résultats et ce sont toujours ses propres représentants qui gagnent les élections. Il n’y a là rien de nouveau. La démocratie est l’idéologie derrière laquelle se cache la dictature du capitalisme, son État totalitaire et sa domination sur la société. Depuis plus d’un siècle, le terrain électoral est un piège mystificateur puissant contre le prolétariat. Les élections bourgeoises sont en effet un des moments privilégiés pour la classe dominante afin de se donner des gouvernements conformes à la défense de ses intérêts, tout en développant de manière intensive et concentrée l’idéologie démocratique servant à masquer sa cupidité et la dictature du système capitaliste. À travers celles-ci, elle tente de faire croire que c’est la majorité de la population qui gouverne et décide. Ceci est l’exact contraire de la réalité. La démocratie est bien la dictature la plus idéologiquement sophistiquée permettant à la minorité exploiteuse de dominer la majorité de la population et, au premier rang de celle-ci, le prolétariat. Elle efface les antagonismes d’intérêts de classes pourtant irréconciliables. Elle transforme le prolétariat révolutionnaire en une somme d’individus, de “citoyens-électeurs” isolés, atomisés et impuissants 1.
Des élections marquées par le danger du populisme
C’est un fait évident, la bourgeoisie française dans ses secteurs les plus responsables du point de vue de ses intérêts objectifs était très inquiète de la possibilité de l’arrivée du FN au pouvoir, ce parti bourgeois et défenseur lui-aussi de l’intérêt national mais totalement irrationnel et irresponsable. À ce niveau, Angela Merkel, la chancelière allemande, et son tristement célèbre ministre de l’Économie, le sieur Schlaube, étaient également très préoccupés. Ils n’ont donc pas ménagé leur soutien très actif à la candidature Macron. Merkel ne déclarait-elle pas pendant l’entre deux tours du scrutin français : “Je n’ai aucun doute sur le fait qu’Emmanuel Macron, s’il est élu, ce que je souhaite, sera un président fort” ? Sans oublier l’ancien président américain Obama et la Commission européenne qui n’ont pas arrêté de mener campagne pour soutenir eux-aussi cette candidature. De fait, la bourgeoisie française misait sur deux candidats jugés les plus aptes à gérer au mieux les affaires du capitalisme national, tout en pouvant faire face au FN : messieurs Juppé et Macron. Cependant, la candidature Juppé était dès le départ fort compromise. Celui-ci, ancien Premier ministre, membre d’un parti rejeté par la majorité des français (Les Républicains) et au lourd passé d’homme d’appareil, représentait un fort risque d’échec. Ce que les primaires de la droite ont amplement confirmé avec la victoire surprise de François Fillon. En réalité, des secteurs croissants de la bourgeoisie travaillaient déjà de plus en plus ouvertement à la réussite de “l’homme nouveau” Macron. Le soutien actif du Président sortant, François Hollande, est rapidement devenu un secret de polichinelle. Il en allait de même pour un certain nombre de ténors au sein du Parti socialiste en pleine déconfiture. Ce phénomène était aussi présent au sein de la droite elle aussi en pleine crise. Soutenue par de nombreux milieux d’affaires (financiers et industriels), relayée par les médias, BFM en tête, la campagne était outrancière, mais efficace ! Il fallait promouvoir Macron à tout prix ! Pourquoi une telle volonté, une telle détermination de la part des partis les plus responsables de la bourgeoisie occidentale et française ? Sûrement pas pour défendre l’intérêt du prolétariat ! En vérité, toute cette partie de la classe dominante avait peur de voir le FN accéder au pouvoir et il lui fallait absolument donner l’illusion d’un “renouvellement”.
La bourgeoisie est la classe la plus machiavélique de l’histoire
La bourgeoisie est sans contestation possible la classe exploiteuse la plus intelligente de l’histoire. En tant que classe, elle ne peut jamais perdre totalement de vue où sont ses intérêts et comment les défendre. L’histoire du capitalisme est là pour le démontrer, que ce soit face au prolétariat révolutionnaire ou dans la défense de ses propres intérêts économiques et impérialistes. À ce titre, la montée du populisme dans la plupart des pays occidentaux ne pouvait que l’alarmer et l’inquiéter. Cette grande inquiétude, s’est transformée en préoccupation permanente et prioritaire avec la victoire du Brexit en Grande-Bretagne et celle de Trump aux Etats-Unis. Il ne s’agissait pas là de phénomènes ayant eu lieu dans de petits pays, faibles et secondaires. Deux des bourgeoisies les plus puissantes du monde avaient été incapables d’empêcher la victoire électorale du populisme. L’alarme était non seulement déclenchée mais elle sonnait maintenant en permanence et de manière stridente, d’autant qu’elle menaçait de faire voler en éclats l’Union européenne. Cela ne devait pas se reproduire en France, lieu d’existence d’une puissante formation populiste alors que ce populisme sape les fondements idéologiques mystificateurs avec lesquels la bourgeoisie maintient encore une certaine cohésion sociale (les “Droits de l’homme”, le progrès universel, etc.). Ce parti bourgeois (le FN), rétrograde et irrationnel, est incapable d’encadrer idéologiquement la société en procédant par “exclusion”, en proclamant ouvertement que le monde est en train de sombrer et qu’il faut sauver sa nation et ses ressortissants de souche au détriment du reste de la planète.
Ce qui inquiète en premier lieu les fractions de la bourgeoisie les plus lucides, c’est l’inaptitude de ces partis populistes à défendre de manière efficace et cohérente les intérêts généraux du capital national. La proposition d’un référendum de Marine Le Pen pour sortir de l’Union européenne ou se défaire de l’euro en est une expression très claire. Les partis populistes se caractérisent par une incapacité à savoir quelle politique ils doivent mener, un jour proposant une chose et le lendemain son contraire ; et cela est vrai tant en matière économique, qu’impérialiste. Empêcher le FN d’arriver au pouvoir en France était d’autant prioritaire qu’il était également nécessaire de montrer à la face du monde que la victoire du Brexit et de Trump n’étaient pas les produits d’un phénomène irréversible. Le résultat des élections en France vient de le démontrer de même que le soulagement de bon nombre de grandes chancelleries. C’est en ce sens que ces élections, malgré la fragilité historique de la bourgeoisie, sont une réussite pour celle-ci non seulement en France mais également sur un plan international et particulièrement en Europe.
Les causes profondes de cette nécessaire réaction
La nécessité d’une réaction de la bourgeoisie face à la montée du populisme trouve ses causes premières dans le lent processus d’affaiblissement historique qu’elle subit, y compris dans les principaux pays occidentaux. À la racine de ce processus historiquement irréversible se trouve l’approfondissement de la décomposition du système capitaliste. Cela se traduit notamment par une difficulté croissante à développer une politique sur le long terme, à garantir la cohésion suffisante pour la défense des intérêts nationaux au-delà des intérêts de cliques, de coteries ou de rivalités personnelles. Cette dynamique affecte en premier lieu les partis traditionnels qui sont à la tête des États bourgeois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, ce sont les partis de la droite traditionnelle et le PS qui sont particulièrement touchés, au point d’être en situation de marginalisation. Une très grande majorité de la population ne veut plus de ces partis. À la tête de la France depuis des décennies, ils n’ont fait que, chacun leur tour, développer une austérité et une précarité croissante sans offrir aucune perspective d’avenir un tant soit peu crédible. Gangrenés par les affaires, les pires bagarres de clans et rivalités d’ego, ils ont suscité dégoût et rejet massif. Ils ont fait le lit d’un populisme toujours plus présent et renforcé. Cet affaiblissement des partis les plus responsables et les plus expérimentés de la bourgeoisie nationale est une réalité qui s’impose ainsi à toute la classe bourgeoise et qui peut avoir de graves conséquences, comme nous le voyons aujourd’hui aux Etats-Unis. Or, de nouvelles attaques de la classe ouvrière doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Face à ces enjeux, à la gravité et à l’urgence, les partis traditionnels complètement discrédités ne pouvaient plus assumer aussi facilement leurs tâches. Ils n’auraient été qu’un facteur accélérateur du processus d’affaiblissement historique de la bourgeoisie. Même si rien n’assure encore que les élections législatives du mois de juin prochain donneront une majorité solide à Macron, avec l’immense campagne de sympathie pro-Macron, c’est à la poursuite de cette réaction politique que s’est attelée maintenant une grande partie de la bourgeoisie française et allemande, au-delà de leur concurrence économique et impérialiste bien réelles.
D’énormes attaques en perspective contre les conditions de vie
La bourgeoisie met en place au mieux de ses possibilités actuelles les moyens les plus opérants possibles pour mener une attaque sans précèdent des conditions de vie et de travail. C’est ce que Macron vient de répéter à la face de l’Europe toute entière dans sa récente conférence de presse à Berlin : “Je suis là pour réformer profondément et rapidement la France. Je tiendrai mes promesses de campagne”. Le prolétariat est une nouvelle fois prévenu. Macron va agir, légiférer frontalement et sans retenue. Il propose ainsi de prendre sans tarder une série de mesures dont les prolétaires en tête vont payer les frais, et cela dès cet été, pendant qu’une partie des ouvriers ne sont pas sur leur lieu de travail aux côtés de leurs frères de classe.
Le maître-mot en la matière est flexibilité généralisée, l’objectif étant de pousser beaucoup plus loin encore la loi El Khomri : imposer, sur chaque lieu de travail, le niveau de salaire, de temps de travail réel et de conditions de licenciements au nom de la compétitivité. C’est le renforcement féroce de l’exploitation que prépare ainsi Macron. Mais cela n’est pas suffisant. L’assurance-chômage va également en prendre un sale coup. La hausse de la CSG et le flicage renforcé des chômeurs sont au programme. Quant aux retraites, “les sommes cotisées individuellement détermineront le niveau de pension de chacun”. Ceci est très clair : il faudra travailler plus longtemps pour des retraites encore plus misérables, avec disparition des quelques garanties encore existantes. Et Macron se propose également de supprimer les régimes spéciaux. C’est sa politique pour “réduire”, comme il le dit en paraphrasant l’ancien président Chirac, la “fracture sociale” ! Précarisation et appauvrissement généralisés pour ceux qui travaillent, les chômeurs, les jeunes et les retraités. C’est toute la classe ouvrière qui va ainsi très violemment être attaquée par l’État capitaliste français.
Il n’y a pas d’autre solution que de développer la lutte de classe
Il est clair que les élections ne sont qu’une arme entre les mains de la bourgeoisie. Hier, Hollande et Sarkozy, aujourd’hui, Macron… Mais pour le prolétariat, il n’y a là aucune autre perspective que davantage d’exploitation et de dégradation de ses conditions de vie. La bourgeoisie n’accorde aucune dignité au prolétariat, pas plus qu’à la vie humaine. Seuls comptent sa domination et son profit. Pour cela, Macron peut compter sur d’autres fractions de la bourgeoisie nationale. Mélenchon et son mouvement ont déjà participé activement à renforcer l’idéologie démocratique et républicaine. Dans le futur, ils auront probablement un rôle encore plus important à jouer contre la lutte du prolétariat. Mélenchon, ce vieux routier de l’appareil d’État bourgeois le sait pertinemment ! Comme le savent également les gauchistes et les syndicats, CGT et FO en tête, puisqu’ils préparent déjà ce qu’ils appellent un “troisième tour social”, c’est-à-dire rejouer pleinement leur rôle d’encadrement des luttes pour les saboter et les dévoyer hors du terrain de classe.
Pour une partie de la classe ouvrière, une erreur grave serait de penser pouvoir contester l’ordre capitaliste et remettre en cause ce déferlement prévu d’attaques en tombant dans les bras d’une révolte réactionnaire et populiste, dressant les ouvriers les uns contre les autres. Tout aussi dangereux serait le soutien aux “forces démocratiques” de l’anti-populisme. Des jeunes peu nombreux dans la rue criaient au lendemain du premier tour : “Ni Marine, ni Macron, ni patrie, ni patron !” Aussi confus que puisse être ce slogan et malgré la grande difficulté dans laquelle se trouve le prolétariat aujourd’hui du point de vue de sa combativité et de sa conscience, un tel slogan, porté par quelques jeunes, exprime en germe l’idée de la lutte de classe et la nécessité d’affirmer la perspective d’une autre société. La révolution communiste reste la seule possibilité réaliste pour construire enfin une société réellement humaine, sans classes sociales et sans exploitation. Pour cela, il faudra s’affronter de manière consciente à la bourgeoise, son État et sa démocratie.
Philippe, 19 mai 2017
1 Voir “Élections et démocratie : l’avenir de l’humanité ne passe pas par les urnes”, Révolution internationale, no 463.
Géographique:
- France [2]
Situations territoriales:
Personnages:
- Emmanuel Macron [4]
Récent et en cours:
- Elections 2017 [5]
Rubrique:
Brexit: le capitalisme britannique se bat pour limiter les dégâts
- 1001 reads
Après avoir remplacé David Cameron comme Premier ministre britannique, Theresa May a déclaré : “Brexit veut dire Brexit”. Elle a répété ce mantra sous plusieurs formes, pendant les mois qui ont suivi. Cela n’a pas aidé à comprendre dans quelle direction la politique gouvernementale britannique allait s’orienter mais a plutôt contribué à entretenir les incertitudes.
La classe dominante britannique ne s’attendait pas à la victoire du “oui” au Brexit. Dans les mois qui ont suivi, il est devenu évident qu’il n’y avait pas de plan en vue de cette éventualité. Le gouvernement Cameron n’avait pris aucune disposition en ce sens. Ceux qui ont fait campagne pour quitter l’Union européenne sont revenus avec des slogans tels que “350 millions de livres de plus par semaine pour la NHS” mais n’ont pas proposé de mesures concrètes. La bourgeoisie britannique a en partie perdu le contrôle de son appareil politique et a cherché des stratégies pour limiter les dégâts sur l’économie, pour stabiliser une situation qui entraîne, surtout depuis l’arrivée du président Trump aux États-Unis, le développement rapide de perturbations et d’incertitudes.
“L’avenir radieux” de Theresa May
Le Livre blanc de février 2017 du gouvernement utilise près de 25 000 mots pour essayer de résoudre un torrent de contradictions. Dans un discours de janvier, Theresa May a déclaré : “le peuple britannique (…) a voté pour façonner un avenir meilleur.” Le but du Livre blanc est de préparer la voie pour une “sortie de l’UE douce et bénéfique pour les deux parties” et “éviter une rupture traumatisante”. Il reste à voir dans quelle mesure cet avenir sera effectivement “radieux”.
On peut y lire que “nous ne chercherons pas à être des membres du Marché unique, mais nous poursuivrons au contraire un nouveau partenariat stratégique avec l’UE, incluant un accord de libre-échange et un nouvel accord douanier.” Ainsi, le Royaume-Uni va quitter le Marché unique et trouver un compromis avec les 27 pays restants. Pour quitter l’UE, l’accord de seulement 20 pays sur 28 est requis, alors qu’un accord commercial nécessite l’accord des 27 États de l’UE. En ce qui concerne le commerce, le gouvernement pense qu’ “un système basé sur des règles internationales est fondamental pour soutenir le libre-échange et prévenir le protectionnisme”. Néanmoins, pour la Grande-Bretagne, pour qui les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation, la présidence de Trump n’est pas, dans le cadre de rapport d’État à État, une perspective réjouissante, car ce pays semble aller dans une direction protectionniste en mettant en avant “L’Amérique d’abord” et en renégociant les accords commerciaux. Dans le même sens, l’Institut des études fiscales a suggéré que la perte de marchés aurait un énorme impact sur l’économie britannique bien que les contributions au budget européen vont cesser.
Theresa May propose une alternative au Marché unique : “si nous étions exclus du Marché unique, nous serions libres de changer les bases du modèle économique britannique.” Le chancelier de l’Échiquier, Philip Hammond, s’adressant à Welt am Sonntag du 15 janvier 2017, a déclaré : “Si nous n’avons pas l’accès au Marché européen, si nous en sommes exclus, si la Grande-Bretagne doit quitter l’Union sans accord sur l’accès aux marchés, nous pourrions subir des dommages économiques au moins sur le court terme. Dans ce cas, nous pourrions être obligés de changer notre modèle pour retrouver de la compétitivité. Et vous pouvez être sûrs que nous ferons tout ce que nous avons à faire.” La proposition de “faire quelque chose de différent” a été accueillie avec beaucoup de réserve. Est-ce que le Royaume-Uni va devenir un paradis fiscal ? Va-t-il s’enferrer dans une guerre commerciale et tarifaire ? Il y a vraiment beaucoup de possibilités, dont la moindre n’est pas de susciter au Royaume-Uni un renouveau de la production manufacturière, en dépit de vagues promesses en ce sens.
Une des raisons pour lesquelles l’accès du Royaume-Uni au Marché unique paraît impossible à beaucoup de commentateurs est qu’il impliquerait une liberté de circulation pour les citoyens de l’UE. Theresa May a déclaré : “Nous voulons garantir les droits des citoyens européens qui vivent déjà en Grand-Bretagne” ; mais, en même temps, son gouvernement se prépare à utiliser ces trois millions de personnes comme monnaie d’échange. Liam Fox a présenté les émigrés européens en Grande-Bretagne comme “les cartes maîtresses” dans les négociations sur le Brexit. Un document issu d’une fuite du Comité pour les affaires légales du Parlement européen révèle qu’il pourrait y avoir un retour de boomerang de la part de l’UE.
Les contradictions dans la position du gouvernement reflètent la situation inconfortable dans laquelle se trouve le capitalisme britannique. “Nous allons reprendre le contrôle de nos lois”, clame Theresa May, mais, en même temps, “alors que nous adoptons le corps de la loi européenne dans nos règles internes, nous nous assurerons que les droits des travailleurs seront pleinement respectés.” Le but est de prendre tout ce qui est “bénéfique” dans l’UE tout en gardant les avantages de l’indépendance. La bourgeoisie britannique utilisera toutes les manœuvres possibles et rendra l’Europe responsable des éventuelles difficultés. Mais elle ne part pas en position de force.
L’adaptation à la crise
La bourgeoisie britannique s’est historiquement fait remarquer par la capacité de son appareil politique à défendre les intérêts du capital national. Le résultat du referendum a montré une perte de cohésion croissante au sein de la classe dominante, mais il a également montré sa capacité à s’adapter aux difficultés. La démonstration en a été faite après le referendum, avec le “choix” évident de Theresa May comme chef du Parti conservateur pour résoudre une crise gouvernementale temporaire. De même, les batailles légales et parlementaires ultérieures et le rôle des media doivent être appréhendés dans ce contexte. Le procès intenté contre le gouvernement, pour l’empêcher d’agir seul et conserver un rôle pour le Parlement, a provoqué une vague de colère chez les media populistes contre les juges de la cour d’appel : le Daily Mail les a présentés comme “ennemis du peuple”, alors que les media libéraux défendaient “l’indépendance du pouvoir judiciaire”.
Mais ce que l’on considérait comme une “crise constitutionnelle” s’est rapidement estompé. Lorsque l’appel du gouvernement à la Cour suprême a également été rejeté, il y a eu beaucoup moins d’hystérie. La Chambre des communes a fait son travail en entérinant les propositions de l’exécutif, malgré le fait que la majorité des membres du Parlement aurait préféré rester dans l’UE. Le Parti travailliste a été particulièrement utile. Jérémy Corbyn a imposé aux membres du Parlement l’obligation absolue de soutenir les étapes de la législation pour le Brexit. Corbyn a été loyalement soutenu par les trotskistes du Socialist Worker du 9 février 2017 : “Il a avec raison insisté pour que les députés travaillistes votent en faveur d’un projet de loi ouvrant le processus de sortie de l’UE”.
Ailleurs au Parlement, une source gouvernementale a déclaré : “Si les lords ne veulent pas affronter un appel public appelant à leur abolition, ils doivent se soumettre et protéger la démocratie, et accepter ce projet de loi.” Le secrétaire au Brexit, David Davis a appelé ses pairs à “faire leur devoir patriotique”. Les menaces à l’encontre de la Chambre des lords, de la part du Parti conservateur, sont la preuve des divisions qui existent au sein de la bourgeoisie, même si, à un niveau plus profond, elle est unie en tant que partie d’une classe capitaliste d’État.
Les options impérialistes de la bourgeoisie britannique se rétrécissent
Malgré toutes les déclarations de “liberté pour le Royaume-Uni”, en janvier 2017, la visite de Theresa May aux États-Unis et en Turquie a montré la réalité de la position de l’impérialisme britannique. Elle a tendu la main à Donald Trump et essayé de grappiller tout ce qui était possible. La prétendue “relation spéciale” entre les États-Unis et la Grande-Bretagne a toujours été en réalité au bénéfice des premiers et il semble peu probable que ce déséquilibre soit corrigé dans un avenir proche. En Turquie, Theresa May a “adressé un sévère avertissement au président turc Recep Tayyip Erdogan concernant le respect des droits de l’Homme hier, alors qu’elle s’apprêtait à signer un contrat de 100 millions de livres pour un marché d’avions de combat dont le 10 Downing Street espère qu’il permettra à la Grande-Bretagne de devenir le principal partenaire de défense Turque” (The Guardian du 28 /01 /17).
Voilà le visage international que montre actuellement la bourgeoisie anglaise. Les perspectives en dehors de l’UE sont incertaines, elle tente désespérément de recevoir des miettes de l’impérialisme américain, les perspectives pour son secteur financier ne sont pas assurées, mais, au moins, elle peut compter sur la vente d’armes à un pays en conflit. Un document gouvernemental divulgué a donné la liste des industries prioritaires pour les pourparlers sur le Brexit. Parmi les hautes priorités figurent l’aérospatiale, le transport aérien, les services financiers, les transports terrestres (transport ferroviaire exclu), les assurances et les infrastructures bancaires et commerciales. Les priorités inférieures comprennent l’acier, le pétrole et le gaz, les télécommunications, les services postaux et environnementaux, l’eau, les services médicaux et l’éducation. Dans les coulisses se prennent les décisions concernant quels secteurs peuvent survivre ou être sacrifiés et quels secteurs ont besoin d’un soutien plus conséquent.
Dans le Telegraph du 11 février 2017, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne sous-estime pas la capacité de la bourgeoisie anglaise à intriguer et conspirer : “les Anglais vont tenter sans trop d’effort de diviser les 27 États-membres restants.” Et le gouvernement anglais est en position de repli, car comme le dit May : “pour la Grande-Bretagne, pas d’accord du tout vaut mieux qu’un mauvais accord.” Telle est la position d’un “Brexit dur” auquel la bourgeoisie anglaise semble se rallier. L’impitoyable détermination de la bourgeoisie anglaise ne faiblit pas mais sa capacité à fonctionner de façon cohérente dans une période de décomposition croissante s’est abaissée.
Les problèmes auxquels la classe ouvrière doit faire face en Grande-Bretagne font écho à ceux qu’elle rencontre internationalement. En 1989, les transitions dans les régimes d’Europe de l’Est se sont faites sous les yeux d’une classe ouvrière spectatrice, qui n’a joué aucun rôle indépendant. Au cours des deux dernières années, nous avons assisté au développement du terrorisme aux portes de l’Europe de l’Ouest, au referendum sur l’Europe, à l’élection de Donald Trump et à la résurgence du Front national de Marine Le Pen. Là non plus, la classe ouvrière n’a pas été un facteur actif dans cette situation, malgré les changements énormes et le mécontentement de la population contre les élites. La bourgeoisie va tenter d’utiliser la décomposition de son système contre la classe ouvrière, que ce soit par la promotion de l’option populiste ou par des campagnes et des confrontations anti-populistes. Mais, alors que la bourgeoisie défend une société en déclin, la classe ouvrière, elle, a la capacité de créer de nouvelles relations sociales basées sur la solidarité et non sur l’exploitation et le nihilisme.
Car, 15 février 2015
(D’après World Revolution, organe de presse du CCI au Royaume-Uni)
Géographique:
- Grande-Bretagne [6]
Récent et en cours:
- Brexit [7]
Rubrique:
Grève générale en Guyane: l’interclassisme est une impasse !
- 793 reads
La manifestation du 28 mars dernier en Guyane a rassemblé plus de 10 000 personnes dans les deux principales villes, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni (40 000 selon les organisateurs), sur une population de 250 000 habitants à l’appel des 37 syndicats qui composent l’Union guyanaise des travailleurs (UGT). C’est la mobilisation la plus massive de l’histoire de ce territoire, au lendemain du déclenchement d’une grève générale illimitée appelée par ces mêmes syndicats. Quel sens donner à cette grève ? Quelles sont les perspectives de ce mouvement ?
Ce mouvement traduit un énorme ras-le-bol, un sentiment d’être méprisé dans un contexte où la grande majorité de la population guyanaise s’enfonce dans une misère et une pauvreté effroyables. Il existe un contraste effarant entre la haute technologie développée au centre spatial de Kourou et le sort des villages voisins totalement privés d’éclairage public et même d’eau potable : “la fusée décolle mais, nous, on n’a pas de lumière” proclamait un habitant de la région. Il témoigne aussi d’un écart énorme entre la métropole de la cinquième puissance mondiale et ce département où 50 % de la population a moins de 25 ans mais où 40 % des jeunes quittent le système scolaire sans aucun diplôme, où sévit aussi le chômage (dont le taux officiel est de 22 %), où le taux de suicide est entre dix et vingt fois supérieur à celui de l’hexagone (en particulier au sein de la population d’origine amérindienne), la vie chère (avec des prix en moyenne 40 % plus élevés qu’en métropole), la terrible pénurie sanitaire (délabrement des structures hospitalières et médicales) et l’insécurité face à la criminalité (42 meurtres en un an), la délinquance, et la présence de gangs mafieux (comme dans toute l’Amérique latine) qui traduisent le niveau saisissant de la décomposition de la situation sociale.
Depuis près de 50 ans, les exaspérations et les frustrations se sont accumulées face aux promesses non tenues des “politiques” (seulement en “visite” lors de tournées électorales) et des élus locaux qui ont débouché sur cette explosion générale de mécontentement ; mais cette explosion ne doit pas masquer le caractère fondamentalement interclassiste du mouvement où les réelles revendications ouvrières (réclamant de nouveaux établissements pour l’éducation et la santé, des transports scolaires gratuits, un accès au soin pour tous, etc.) sont noyées ou dévoyées sur un terrain totalement nationaliste au nom de “la défense des intérêts du peuple guyanais” (1). Pourquoi ce mouvement est-il si fortement médiatisé ?
D’une part, justement parce qu’il est embarqué sur le terrain idéologiquement pourri de la mobilisation citoyenne et “populaire” à travers des collectifs “Pou Lagwiyann dékolé” (Pour le décollage de la Guyane) qui ont mené, à la place des élus “qui ont perdu leur légitimité”, les négociations avec les ministres représentants du gouvernement (dont la ministre des Outremers, Ercika Bareigts, qui s’est publiquement excusée devant “le peuple guyanais” et les “500 frères contre la délinquance”. Le mouvement des “500 frères” est d’ailleurs très actif dans les collectifs et n’est autre qu’une milice encagoulée composée en bonne partie de policiers et de personnel de sociétés de sécurité appuyée par le MEDEF (syndicat patronal) local. Ils ont imposé leurs méthodes musclées de commandos et d’actions “coups de poing” obligeant les commerçants à fermer leurs rideaux, le blocage des routes et de l’approvisionnement des stations-services, l’occupation du centre spatial de Kourou, etc. Les “500 frères” et d’autres collectifs similaires, des “Toukans” au “Trop Violans”, mettent constamment en avant les revendications en faveurs de plus de forces de police et de tribunaux mais réclament aussi des mesures franchement xénophobes tels que le démantèlement des squats et l’expulsion des détenus étrangers vers leurs pays d’origine, ou carrément le renvoi de la main-d’œuvre immigrée venant du Brésil, du Surinam ou de Haïti, peuplant de nombreux bidonvilles et assimilée à des délinquants.
Ce battage médiatique a plusieurs buts :
– mettre en avant le dialogue démocratique “à visage découvert”, avec la présence des médias dans les négociations pour donner du crédit à “la pression du peuple guyanais” afin de réclamer… la “protection de l’État français” 2 ;
– faire apparaître le “soutien populaire” de “collectifs citoyens” qui n’ont d’autre objectif que d’empêcher le mouvement de s’exprimer sur un terrain de classe ;
– mettre en avant ses méthodes de lutte en les présentant comme les seuls moyens possibles (l’action déterminée d’une minorité) de “faire bouger les choses” ou déjà “de se faire entendre”, méthodes qui n’ont rien à voir avec celles de la classe ouvrière dans ses luttes 3 ;
– renforcer cet interclassisme à travers le caractère identitaire et nationaliste de la “lutte du peuple guyanais” au nom des “droits démocratiques” en soulignant ses “propres” revendications éducatives, culturelles, “droits” des peuples autochtones (intégrer l’histoire du territoire ou les langues maternelles dans l’éducation, par exemple). Il faut rappeler les impasses des mouvements précédents dans les territoires d’outremer où l’aspect nationaliste et indépendantiste avait pris le dessus à travers l’encadrement syndical du LKP en Guadeloupe en 2009, les divisions interethniques en Martinique en 2010 ou encore à Mayotte en 2011 ;
– servir de repoussoir pour renvoyer une image et un sentiment d’impuissance qui ne peut que renforcer le déboussolement général actuel de la classe ouvrière et ses difficultés à s’affirmer sur son terrain autonome de classe.
À aucun moment, les prolétaires guyanais n’ont été capables d’affirmer la nécessité ni de dégager le besoin d’une telle autonomie et de se battre sur un terrain d’intérêts de classe. Ils n’ont pas su tirer les leçons des mouvements similaires des travailleurs d’outremer des années passées et inscrire leur lutte dans un cadre global et internationaliste. Ce faisant, malgré toute leur colère et leur détermination affichée, ils se condamnent à tomber dans tous les pièges et les illusions (lutte “citoyenne” et “démocratique” des collectifs, “lutte du peuple” enfermé dans le carcan du nationalisme) tendus par la bourgeoisie qui ne peut les conduire que dans une impasse. Cette incapacité reflète toute la faiblesse et les difficultés actuelles de l’ensemble de la classe ouvrière à retrouver et affirmer son identité de classe.
Wim, 13 avril 2017
1) Le caractère interclassiste ressort clairement du cahier de revendications (de 400 pages) du collectif “Pour que la Guyane décolle” (voir le site Internet du collectif sur nougonkasa.fr) qui, à côté de revendications à caractère “social” (volets éducation et formation, santé…) glisse pêle-mêle des propositions réclamant davantage de moyens répressifs face au problème de l’insécurité (plus de police et de tribunaux) ou une plus grande libéralisation en faveur du patronat local, lui permettant notamment de légaliser de juteux trafics de drogue et d’or avec le Brésil voisin, sans oublier le thème particulier des “peuples autochtones”.
2) Alors que le gouvernement à l’issue des négociations n’a accepté qu’un déblocage d’un peu plus d’un milliard d’euros sur les quelque 3 milliards réclamés par les collectifs (en accordant une large part aux demandes de crédits “sécuritaires” ou patronales), ceux-ci ont alors décidé de poursuite le mouvement déjà engagé dans une impasse mais “lâché” par le patronat, en large partie satisfait des “concessions” du gouvernement métropolitain.
3) À la rescousse de ce fourvoiement, les gauchistes apportent leur petite pierre, en vantant comme un “modèle de lutte à suivre” sa prétendue “radicalité” et “combativité” qui vont de “Vive la lutte des travailleurs guyanais !” (LO) au “Soutien au peuple guyanais !” du NPA de Poutou, en passant par “La Guyane au bord de la révolution sociale” (Voix des Travailleurs).
Géographique:
- France [2]
Situations territoriales:
Famine en Afrique de l’Est: silence, le capitalisme tue !
- 1347 reads
Depuis fin 2016, une grande partie de la population de l’Afrique de l’Est est touchée par une grave famine qui s’abat impitoyablement sur des millions de personnes. Au Soudan du Sud, ce nouvel État qui a proclamé son indépendance en 2011 et n’a connu depuis que la guerre civile, pas moins de 4,9 millions de personnes (soit 42 % de la population !) a besoin d’une aide alimentaire urgente. Selon l’ONG Action contre la faim, 4,4 millions de personnes sont également directement menacées au Nigeria, tout comme la moitié de la population en Somalie (6,2 millions de personnes). Pour compléter ce tableau (loin d’être exhaustif), au Moyen-Orient, plus de 14 millions de Yéménites sont actuellement en situation “d’insécurité alimentaire”. Concrètement, la vie de ces millions d’êtres humains, sur qui la faim s’abat sans discernement d’âge ou de sexe, se résume à l’épouvantable et permanente angoisse de ne pouvoir trouver ni eau (rarement potable) ni nourriture.
La faible médiatisation de ce drame gigantesque a de quoi surprendre 1). Cette fois, on est bien loin des images du ministre Kouchner débarquant sur une plage somalienne, pieds nus et sac de riz sur l’épaule, caméras de télé braquées sur lui. Aucun appel à la mobilisation générale comme lorsqu’un tsunami dévasta l’Asie du Sud-est en 2004. Cette fois, comme la plupart du temps, les populations peuvent crever dans leur coin, en silence et loin des caméras.
En fait, contrairement aux exemples qui suivent, les États n’ont nullement besoin d’un alibi humanitaire pour couvrir une opération militaire imminente ou la conquête de juteux marchés en Afrique de l’Est :
• En 1914, l’invasion de la Belgique par les troupes allemandes préfigurait déjà une longue liste d’instrumentalisation de la détresse des populations civiles. Sur la base d’un rapport-bidon commissionné par la Grande-Bretagne (le Rapport Bryce), artistes et organisations humanitaires (la Croix-Rouge, notamment) véhiculèrent une série de fables sur les atrocités de l’armée allemande : le Boche était ainsi accusé de viols de masse, de tortures et de mutilations. Les troupes commirent évidemment des exactions. Mais, à l’époque, les prétendues révélations sur les comportements des soldats n’étaient fondées sur aucun témoignage : elles furent inventées de toutes pièces et largement exagérées.
• Mais le cynisme humanitaire de la bourgeoisie prit une toute autre dimension après la Seconde Guerre mondiale. La guerre du Biafra entre 1967 et 1970 représente à ce titre un véritable tournant dans cette instrumentalisation. La presse déploya des moyens exceptionnels pour médiatiser la famine qui frappait le pays et dénoncer les atrocités, réelles ou inventées, de l’armée nigériane. Voici ce que déclarait Jacques Foccart, l’homme de la Françafrique, à ce propos : “Les journalistes ont découvert la grande misère des Biafrais. C’est un bon sujet. L’opinion s’émeut et le public en demande plus. Nous facilitions bien sûr le transport des reporters et des équipes de télévision par des avions militaires jusqu’à Libreville et, de là, par les réseaux qui desservent le Biafra” 2. Les images insoutenables d’enfants au ventre ballonné par la dénutrition et de réfugiés affamés déclenchèrent une vague de solidarité internationale que l’État français canalisa sur le terrain de l’aide humanitaire en évacuant sans scrupules sa responsabilité majeure dans le conflit. C’est à cette occasion qu’émergèrent le concept insidieux de “droit d’ingérence” et ses panégyristes, Kouchner en tête. En dénonçant le prétendu génocide perpétré par le pouvoir nigérian, le fondateur de Médecins sans frontières apporta son soutien aux sécessionnistes alors appuyés par la France dans une guerre civile qui allait provoquer plus d’un million de morts. Un pont aérien transportant officiellement des vivres fut mis en place. Mais ce pont humanitaire servait surtout à dissimuler l’envoi d’armes et de mercenaires au gouvernement du Biafra..., ce qui aggrava davantage la situation.
• En novembre 1992, la mise en scène, déjà évoquée plus haut, assurée par l’ineffable Kouchner en Somalie avait été précédée par une intense campagne médiatique allant jusqu’à mobiliser massivement les enfants et les enseignants dans les 74 000 écoles françaises pour que chaque élève apporte en classe un kilo de riz. Cela allait permettre à l’ONU d’officialiser le fameux “droit d’ingérence” et surtout de préparer directement l’envoi des troupes dans le cadre de l’opération militaire Restore Hope, supervisée par les Etats-Unis.
• En 1984-1985, l’instrumentalisation de l’humanitarisme prit d’ailleurs un tour industriel écœurant. L’Éthiopie était alors touchée par une famine qui fit plusieurs centaines de milliers de victimes. En déclenchant partout dans le monde d’immenses campagnes caritatives, les grandes puissances purent se livrer à une rivalité sans merci pour la défense de leurs sordides intérêts impérialistes. Mais de plus, alors même que les concerts et les succès musicaux, comme We Are The World aux États-Unis, passaient en boucle à la radio ou à la télévision, l’aide alimentaire était, avec la complicité des États donateurs, détournée pour financer l’achat d’armes de guerre ! Et pendant ce temps, au Lesotho, la population mourait de faim dans l’indifférence...
• Entre avril 1991 et fin 1996, au lendemain de la guerre du Golfe, “l’aide humanitaire” servit encore de puissante arme de propagande guerrière et fut le prétexte tout trouvé pour couvrir les opérations militaires d’envergure Provide Comfort I et II des Etats-Unis et de leurs alliés au nord de l’Irak, sous prétexte “d’aider” et “protéger” les populations kurdes contre l’armée irakienne.
Nous pourrions multiplier les exemples tant de l’instrumentalisation des crises humanitaires que de l’indifférence coupable, voire complice, dont fait preuve la bourgeoisie. Mentionnons néanmoins un exemple récent particulièrement significatif. En 2010, un séisme frappait Haïti, causant 230 000 morts, et dévastant une partie du pays, dont la capitale, Port-au-Prince. Un déferlement impérialiste s’abattit aussitôt sur l’île. Sous couvert d’urgence humanitaire qu’une énorme campagne médiatique avait préparée 3, chaque État, rangé en ordre de bataille derrière ses 10 000 ONG ( !) et ses milliers de soldats, essaya d’y arracher des occasions d’affaires et une influence politique accrue. Comme pour chaque catastrophe, beaucoup d’États avaient promis une aide financière afin de faciliter leurs ambitions. Mais les différentes bourgeoisies nationales utilisèrent en réalité les 12 milliards promis comme monnaie d’échange pour défendre leurs intérêts particuliers. Une infime fraction des sommes annoncées, qui servit essentiellement à “arroser” la bourgeoisie locale, fut effectivement injectée dans le pays dont la population subit encore aujourd’hui les conséquences du séisme 4.
Aujourd’hui les rares reportages consacrés à la famine au Sud Soudan sont destinés à susciter un sentiment de fatalité et d’impuissance, soit en invoquant simplement la sécheresse ou le dérèglement climatique (comme au Sahel), soit la terreur que font régner les affrontements entre bandes armées locales (comme au Darfour ou en Somalie) en masquant l’intérêt impérialiste à géométrie variable des grandes puissances dans leur aide humanitaire. Que l’on assiste à l’enfoncement des populations dans une détresse oubliée ou à l’exploitation de cette situation par des lamentations tapageuses et cyniques, en réalité, l’objectif idéologique reste celui de détourner de la prise de conscience que la responsabilité majeure de cette situation incombe aux lois du système capitaliste basées sur les rapines et le profit, celles d’un système miné par ses contradictions insurmontables qui plonge l’humanité dans un engrenage de plus en plus dramatique et meurtrier dans sa phase de décomposition.
La seule classe en mesure de faire vivre une authentique solidarité désintéressée, c’est le prolétariat. Tant que les lois du profit et de la concurrence capitaliste domineront ce monde, tant que la classe ouvrière n’y opposera pas son unité et sa solidarité, le chaos, la famine et la barbarie engendrés par le système capitaliste ne cesseront de s’étendre.
Marius, 11 mai 2017
1 En dehors de quelques articles ou reportages publiés en février et mars 2017, et de quelques autres exclusivement sur le Yémen, la presse ne dit presque plus un mot sur ces situations de famine.
2 Foccart parle, T. 1, p. 346, cité par François-Xavier Verschave dans : La Françafrique, le plus long scandale de la République.
3 La classe ouvrière donna sans compter aux ONG qui se constituèrent alors un gigantesque pactole... qui n’arriva jamais aux victimes.
4 Les soldats de l’ONU apportèrent par ailleurs dans leur bagages le choléra qui, comme au Yémen actuellement, se répandit comme une traînée de poudre au milieu des camps de réfugiés et des décombres.
Rubrique:
Polémique avec le PCI: Daech, un avatar décomposé de la lutte de libération nationale !
- 1190 reads
Dans son numéro no 519 (mars-avril-mai 2016), Le Prolétaire, organe de presse du Parti communiste international (PCI) a fait la critique de notre article : “Attentats à Paris, à bas le terrorisme ! À bas la guerre ! À bas le capitalisme !” (1) Le PCI considérant que nous sommes “superficiels” et “impressionnistes”, ironise sur le fait que le “CCI est choqué” par les attentats, d’où le titre de l’article emprunté à la romancière Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements. En fait, Le Prolétaire confond ici l’indignation prolétarienne face à la barbarie avec ce qu’il imagine être de la sensiblerie petite-bourgeoise ou du pacifisme. Avant de répondre à ces critiques et indépendamment des désaccords que nous pouvons avoir avec cette organisation, nous tenons d’abord à soutenir son initiative polémique. Les polémiques au sein du milieu révolutionnaire ont toujours été la sève vivifiante du combat révolutionnaire. Trop peu fréquentes aujourd’hui, elles sont d’autant plus précieuses, notamment entre les organisations qui défendent les principes de la Gauche communiste. De telles entreprises sont indispensables à la clarification. Elles doivent permettre une confrontation des positions politiques pour alimenter la réflexion en faveur de l’indispensable élaboration théorique nécessaire à l’orientation du prolétariat et de ses minorités en recherche de cohérence des positions révolutionnaires.
Nation ou classe ?
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre ici à toutes les questions soulevées dans ce texte. Selon nous, un point apparaît prioritaire, du fait notamment qu’il est en débat chez des éléments proches du PCI : la question nationale 2. En effet, à la lecture de l’article du Prolétaire, il apparaît qu’au sein même du milieu de sympathisants qui gravitent autour des positions “bordiguistes” existe un questionnement mettant en jeux la question de la nation et de l’internationalisme. Nous apprenons ainsi qu’un participant à une réunion du PCI, et d’autres éléments par ailleurs, se sont sérieusement posés la question de savoir s’il fallait ou non “condamner” Daech, en vertu du “principe de la lutte anti-impérialiste” ! Cette problématique est reformulée ainsi par Le Prolétaire : “Faudrait-il en conclure que l’EI représenterait une force bourgeoise anti-impérialiste, une force qui, en secouant le statu quo, travaillerait sans le vouloir en faveur de la future révolution prolétarienne par l’accentuation du chaos et l’affaiblissement de l’impérialisme dans la région ? Une force qu’il faudrait donc plus ou moins soutenir en dépit de sa brutalité et de ses sinistres traits réactionnaires ?” La réponse du Prolétaire à propos d’un tel soutien (ou, comme le PCI l’écrit, ce “plus ou moins soutien”) est négative. Elle montre que les camarades du PCI se placent du point de vue de la classe ouvrière. On peut, par ailleurs, observer que leur approche sur la question nationale n’est plus tout à fait appliquée de la même manière que durant les années 1980, lorsqu’ils mettaient en avant la possibilité “d’une lutte de libération du peuple palestinien”.
Mais quelle est l’argumentation du Prolétaire aujourd’hui ? Voici une première affirmation : “En raison de l’absence de toute force prolétarienne, l’EI, ainsi que les autres formations armées, “modérées” ou radicales, ont été la réponse contre-révolutionnaire bourgeoise –et non moyenâgeuse ou tribale– à l’ébranlement des équilibres nationaux et régional. L’EI ne lutte pas pour étendre le chaos et affaiblir l’ordre bourgeois, mais pour restaurer à son profit ce dernier (...)”. Les camarades du PCI parlent à juste titre de “l’absence de toute force prolétarienne”. Mais dans le passage d’un autre article du même numéro, en réponse à ces mêmes sympathisants, Le Prolétaire ajoute ceci : “Daech est un ennemi des prolétaires, d’abord des prolétaires de Syrie et d’Irak, puis des prolétaires des pays impérialistes (souligné par nous). Avant de faire des attentats en Europe, il avait fait des attentats en Irak et ailleurs. Avant de faire des attentats en Irak et ailleurs, il avait réprimé les prolétaires dans les régions qu’il contrôle (cas des prolétaires de la voirie à Mossoul qui avaient fait une action de revendication sur leurs conditions de travail et qui pour cette raison ont été exécutés par Daech)”. Un problème majeur réside selon nous dans la formulation évoquant les prolétaires “des pays impérialistes”. Les camarades présupposent, en effet, que certains pays ne seraient pas impérialistes aujourd’hui. Nous ne partageons absolument pas ce point de vue. Le PCI poursuit dans le même extrait en affirmant ceci : “Les prolétaires doivent lutter contre toutes les oppressions nationales, pour l’autodétermination et la liberté de séparation de tous les peuples opprimés ou colonisés (souligné par nous) ; non pas parce que leur idéal est la création d’États bourgeois, mais parce que, pour que puissent s’unir les prolétaires des pays dominants et les prolétaires des pays dominés, les premiers doivent démontrer dans les faits qu’ils ne sont pas solidaires de l’oppression qu’exerce “leur” bourgeoisie et “leur” État, mais qu’ils la combattent au contraire non seulement en paroles mais si possible en pratique. C’est le seul moyen pour que la proposition qu’ils font aux prolétaires des pays dominés, de s’unir sur des bases de classe anti-bourgeoises, puisse être comprise”. Cette position du Prolétaire, qui diffère des élucubrations nationalistes des gauchistes, n’en demeure pas moins dangereuse et très ambiguë depuis ses prémisses. Elle sépare initialement les prolétaires des pays “dominants” de ceux des pays “dominés” et reste enfermée dans la problématique des “oppressions nationales”. Mais, pourrait-on nous rétorquer, cette position du Prolétaire, n’était-elle pas héritée de la tradition du mouvement ouvrier du passé ?
La position de Rosa Luxemburg confirmée par les faits
Ce fût en effet le cas jusqu’à ce que les conditions historiques changent radicalement et que l’expérience de luttes nouvelles ne remettent en cause les pratiques devenues inappropriées pour le combat ouvrier. Lors de son Premier congrès en mars 1919, l’Internationale communiste (IC) reconnaissait que le capitalisme était dans sa phase de déclin et faisait ainsi référence au besoin d’une lutte internationale du prolétariat. Le Manifeste de l’Internationale aux prolétaires du monde entier, commençait par reconnaître que “l’État national, après avoir donné une impulsion vigoureuse au développement capitaliste, est devenu trop étroit pour l’expansion des forces productives” (3. Dans la même logique, il était souligné que “seule la révolution prolétarienne peut garantir aux petits peuples une existence libre, car elle libérera les forces productives de tous les pays des tenailles serrées par les États nationaux”. Le prolétariat ne pouvait donc s’affranchir que dans le cadre d’une lutte mondiale, dans un même mouvement d’ensemble, unitaire, comprenant les bastions des grandes métropoles. Comme le disait Lénine, “les faits sont têtus”. La tactique qui avait été adoptée par les bolcheviks, pensant pouvoir malgré tout réaliser l’extension de la révolution mondiale en s’appuyant sur le vieux principe de la libération nationale fut un terrible fiasco, précipitant le prolétariat vers l’écrasement et la défaite. Les exemples sont nombreux. En Finlande, la bourgeoisie locale “libérée” profita du “cadeau” des bolcheviks pour écraser l’insurrection ouvrière en janvier 1918. Dans les pays baltes, la même année, la “libération nationale” permettait à la bourgeoisie britannique d’écraser tranquillement la révolution sous les tirs des canons de la marine !
Les apports critiques les plus fertiles sur la question nationale furent élaborés très tôt et avec beaucoup de lucidité par Rosa Luxemburg : “Les bolcheviks eux-mêmes ont aggravé les difficultés objectives de la situation par le mot d’ordre dont ils ont fait le fer de lance de leur politique, le droit des nations à l’autodétermination ou, plus exactement, par ce qui se cache, en fait, derrière cette phraséologie : la ruine de la Russie en tant qu’État... défenseur de l’indépendance nationale même jusqu’au séparatisme, Lénine et ses amis pensaient manifestement faire ainsi de la Finlande, de l’Ukraine (...) autant de fidèles alliés de la Révolution russe. Mais nous avons assisté au spectacle inverse : l’un après l’autre, ces “nations” ont utilisé la liberté qu’on venait de leur offrir pour s’allier en ennemies mortelles de la révolution russe à l’impérialisme allemand et pour transporter sous sa protection même le drapeau de la contre-révolution” (4.
Malgré quelques éléments de clarté sur le sujet au moment du premier congrès de l’Internationale communiste, les défaites ouvrières successives et la montée de l’opportunisme allaient engloutir les efforts fragiles et favoriser la régression théorique. La lucide critique de Rosa Luxemburg ne sera reprise que de façon très minoritaire par une partie de la Gauche italienne, notamment Bilan, une position dont Internationalisme a hérité et que défend aujourd’hui le CCI. Depuis l’épisode de la vague révolutionnaire des années 1920 et la défaite qui a conduit à la terrible période de contre-révolution stalinienne, aucune prétendue lutte de libération nationale n’a pu produire autre chose que des massacres et des embrigadements derrière les nations et puissances impérialistes rivales. Ce qui s’était révélé à l’époque de Lénine comme une erreur tragique s’est confirmé par la suite de manière éclatante par des crimes sanglants. Depuis la Première Guerre mondiale et avec le déclin historique du système capitaliste, toutes les nations, grandes ou petites, sont devenues en réalité des maillons d’une chaîne impérialiste plongeant le monde dans une guerre permanente. À chaque fois, les manœuvres impérialistes sont à l’œuvre, quelle que soit la nation considérée et le prolétariat n’est alors que l’otage de la prétendue “libération” contre une autre fraction bourgeoise, opposé à ses frères de classe sacrifiés. Ce fut le cas par exemple au Soudan qui, après son indépendance en 1956, allait connaître une terrible guerre civile instrumentalisée par les blocs impérialistes de l’Est comme de l’Ouest faisant au moins deux millions de morts. En Angola, après les premiers soulèvements à Luanda en 1961 et l’indépendance en 1975, des années de guerres opposaient les forces du MPLA au pouvoir (Mouvement populaire de libération de l’Angola, soutenu par l’URSS) et les rebelles de l’UNITA (soutenus par l’Afrique du Sud et les États-Unis). Le bilan de cette “lutte de libération” était proche d’un million de morts. La décolonisation et le contexte de Guerre froide ne feront qu’illustrer cela de manière systématique, les prolétaires n’étant que de la chair à canon derrière les drapeaux nationaux.
Des confusions dangereuses
Si Le Prolétaire ne soutient pas Daech, s’il a pu évoluer sur la question nationale, il n’en conserve pas moins certaines confusions qui l’avaient conduit par le passé à abandonner ponctuellement la position de l’internationalisme prolétarien en soutenant, même si ce fut de manière critique, les forces capitalistes de l’Organisation de libération de la Palestine. C’est ce que montre ce passage rédigé à l’époque : “Par son impact dans les masses arabes, la lutte contre Israël constitue un formidable levier dans la lutte sociale et révolutionnaire” (5. Le cadre de la lutte de libération nationale, qui ne pouvait que l’amener au fiasco politique, était ainsi théorisé par Le Prolétaire : “Le marxisme intransigeant, lui, reconnaît, même là où l’intervention autonome du prolétariat n’a pu ou ne peut encore se produire, même si ces révolutions n’ont pu dépasser un horizon national et démocratique, la valeur authentiquement révolutionnaire de bouleversements aussi gigantesques que ceux qui se sont produits en Orient au cours des 60 dernières années, et qu’il serait vain d’ignorer sous prétexte qu’ils n’ont pas conduit au socialisme” (6. L’abandon ponctuel de la position de classe internationaliste à propos du conflit israélo-palestinien allait provoquer une grave crise au sein du PCI conduisant à sa dislocation avec El Oumami sur la base d’un positionnement ouvertement nationaliste arabe que nous dénoncions justement à l’époque : “Pour El Oumami, 1’“union sacrée juive” fait disparaître les antagonismes de classe à l’intérieur d’Israël. Inutile donc de faire des appels au prolétariat d’Israël. C’est exactement le “peuple allemand, peuple maudit” des staliniens pendant la Seconde guerre mondiale. Et quand, au cours d’une manifestation OLP-Solidarité, aux cris de “Sabra et Chatila, vengeance !”, El Oumami se vante d’avoir “capturé un sioniste qui a reçu une terrible raclée”, on est au niveau de “à chacun son boche” du PCF à la fin de la Seconde guerre. El Oumami se joint aux rangs de la bourgeoisie au niveau du chauvinisme le plus abject” (7. La prise de position opportuniste du Prolétaire sur le conflit israélo-palestinien dans les années 1980 est une concession ouverte à l’idéologie gauchiste nationaliste. En soutenant de façon critique la lutte des Palestiniens face à Israël, en les coupant ainsi de leurs frères de classe israéliens sous prétexte de leur allégeance à la bourgeoisie israélienne, Le Prolétaire participait à entériner la division et abandonnait tout principe de solidarité de classe.
Aujourd’hui, Le Prolétaire n’utilise pas la même argumentation que par le passé mais semble évoluer davantage par empirisme. Si le PCI ne sombre pas dans la catastrophe en refusant très nettement tout soutien à Daech, il n’en reste pas moins prisonnier de conceptions encore dangereuses et confuses pour la classe ouvrière, en particulier dans un contexte où le nationalisme reprend quelques couleurs du fait de la propagande étatique et des puissantes campagnes populistes en cours. Les raisons qui se trouvent à la racine du maintien de telles confusions sont liées au terrible fardeau de la contre-révolution stalinienne. Le capitalisme d’État en URSS avait ainsi dénaturé l’expérience de la vague révolutionnaire des années 1920 en exploitant ses pires erreurs pour écraser le prolétariat. Au nom de “l’autodétermination”, du “droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, de la “libération nationale des peuples opprimés”, l’État stalinien avait su profiter des erreurs de Lénine pour les pervertir et en faire un dogme éternel qui allait malheureusement conduire certains révolutionnaires, comme ceux du PCI, à tirer de leur côté de fausses leçons en reprenant à leur compte d’anciennes erreurs perçues comme des “vérités révolutionnaires”.
Le PCI sous-estime la réalité du chaos impérialiste
Or, les faits plus récents, depuis les boucheries impérialistes de la Guerre froide, n’ont fait que confirmer encore les positions de Rosa Luxemburg. Maintenir les confusions concernant “l’autodétermination des peuples” est, à notre avis, largement responsable des positions aberrantes qui persistent encore aujourd’hui et qui poussent certains éléments à poser la question aberrante de savoir si Daech doit être appuyé et soutenu par les révolutionnaires dans une lutte soi-disant “anti-impérialiste”. Depuis la disparition du bloc de l’Est, les prétendues luttes de libération nationale n’ont fait qu’alimenter le chaos mondial. C’est ce dont témoigne la naissance des mini-États nés de la dislocation de l’ex-empire stalinien, générant des avortons qui ne savent faire autre chose que propager les miasmes du nationalisme. C’est ce que nous avons pu voir avec l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et la guerre qui s’en est suivie entre les nouvelles nations “libérées”, ce que nous avons pu voir aussi lors du conflit en Tchétchénie (où la ville de Grozny avait été réduite en cendres) ainsi que lors du conflit dans l’enclave ethnique du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan faisant de nombreuses victimes et des milliers de réfugiés au début des années 1990. Une telle logique s’étend également à toutes les fractions bourgeoises sans possession de territoire, les seigneurs de guerre ou autres terroristes qui incarnent l’idéologie nationaliste et la barbarie capitaliste.
Dans son article, le PCI critique également une formule utilisée par notre article, celle de l’idée d’un “pas qualitatif avec les attentats de Paris”. Il faut reconnaître que cette formulation a été critiquée en notre sein et elle peut faire l’objet d’un débat. Mais pas pour les raisons qu’en donne Le Prolétaire qui évoque nos “oublis” des “années de plomb en Italie dans les années soixante-dix”, celle des événements “contre les manifestants algériens tués par la police en 1961”, “les hécatombes dans les pays de l’Est”, etc. En fait, notre formulation, certes critiquable, voulait simplement signifier que ces attentats traduisent une aggravation de la situation chaotique au niveau mondial, ce qui est très différent de l’idée d’une “perte de mémoire” de notre part. En revanche, critiquer nos prétendus “oublis” révèle que, pour les camarades du Prolétaire, ces attentats sont à mettre sur le même plan que ceux perpétrés dans les années 1970 et que les événements du temps de la Guerre froide. En quelque sorte, il n’y aurait rien de nouveau sous le soleil. Cette tendance du Prolétaire à ne pas voir la dynamique réelle de l’impérialisme est liée à une vision figée de l’histoire, persistant à nier la réalité d’une phase de décadence du système capitaliste et de son évolution. En défendant le même principe de “libération nationale” alors que des décennies d’expérience, et les défaites ouvrières qui l’accompagnent, ont démontré sa dangerosité, Le Prolétaire persiste et s’avère difficilement capable de prendre en compte la réalité historique dans le cadre d’une démarche vivante et dialectique. Il ne fait qu’interpréter les événements selon le même dogme immuable, une conception nettement sclérosée, fossilisée de l’histoire et des leçons à tirer pour l’avenir du mouvement ouvrier, qui font que ses positions et analyses se trouvent parfois en décalage avec la réalité et même en opposition avec les besoins de la lutte de classe.
Qu’une organisation de la Gauche communiste soit amenée, ne serait-ce qu’à formuler la question d’un soutien éventuel à Daech vis-à-vis de ses sympathisants ou contacts, ne peut en effet que provoquer “stupeurs et tremblements”. Une telle confusion politique signifie la perte de vue de ce qui fait la vraie force du prolétariat : sa solidarité, son unité internationale et sa conscience de classe.
Contrairement à ce que prétend Le Prolétaire, la classe ouvrière, quelles que soient les conditions, ne doit pas se défendre dans un cadre “national”. Et c’est d’autant plus valable et évident pour celui issue de l’idée fumeuse et archaïque d’un prétendu “grand califat”. Ne possédant que sa force de travail et privé de toute forme de propriété, le prolétariat n’a pas d’intérêts spécifiques autre que son projet révolutionnaire, par-delà les frontières nationales. Son intérêt commun est celui de son organisation et celui du développement de sa conscience. Et parce qu’ils possèdent cela en commun, les prolétaires du monde entier peuvent s’unir grâce à un ciment puissant : celui de la solidarité. Cette solidarité n’est pas une sorte d’idéal ou d’utopie, elle est une force matérielle grâce à laquelle le prolétariat international peut défendre ses intérêts de classe et donc son projet révolutionnaire universel.
RI, mars 2017
1) “Le CCI et les attentats : stupeurs et tremblements”, Le Prolétaire no 519.
2) Parmi d’autres questions importantes (comme notre prétendu pacifisme, le rapport de force entre les classes, etc.) que nous ne pouvons traiter dans le cadre de cet article, on pourra noter celle de la phase de décomposition, situation inédite de la vie du système capitaliste et cadre d’analyse de la période historique, aujourd’hui essentiel pour orienter les activités des révolutionnaires.
3) Manifestes, thèses et résolutions des Quatre premiers congrès mondiaux de l'Internationale Communiste – 1919-1923, fac-similé François Maspéro.
4) Rosa Luxemburg, La Révolution russe.
5) Le Prolétaire no 370 (mars-avril 1983).
6) Le Prolétaire no 164 (7 au 27 janvier 1974).
7) Revue Internationale no 32, “Le Parti communiste international (Programme Communiste) à ses origines, tel qu’il prétend être, tel qu’il est [10]”.
Vie du CCI:
Récent et en cours:
- Terrorisme [12]
Témoignage: l’An I de la Révolution russe
- 1208 reads
Les quelques lignes extraites de cet ouvrage d’un témoin de la révolution, Victor Serge, constituent un cinglant démenti à l’idéologie en vogue martelée ad nauseam cent ans après par tous les médias selon laquelle Octobre 1917 n’aurait été qu’un vulgaire « coup d’État » perpétré par Lénine et une poignée de bolcheviks.
On était au 6 octobre. La Conférence démocratique, succédané d’un parlement de la révolution, montée par les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, s’était ouverte à Moscou à la mi-septembre. Les grèves l’en avaient chassée, les garçons d’hôtel et de restaurant refusant de servir ses membres. Elle s’était transférée à Petrograd. Elle délibérait maintenant sous la protection de marins choisis parmi les plus sûrs. Et les baïonnettes de ses gardes frémissaient au passage d’un tribun bolchevik : “Quand nous en servirons-nous enfin ?”
Cet état d’esprit était général dans la flotte. Quinze jours avant le 25 octobre, les marins de l’escadre de la Baltique, alors en rade de Helsingfors, exigeaient que l’on ne perdît plus de temps et que l’insurrection “sanctifiât la destruction, qui nous semblait inévitable, de la flotte par les Allemands”. Ils consentaient à périr : mais pour la révolution. Le Soviet de Cronstadt refusait, depuis le 15 mai, de reconnaître le gouvernement provisoire. Après les événements de juillet, les commissaires chargés par Kérenski de procéder à bord des vaisseaux à l’arrestation des “meneurs bolcheviks” n’y avaient obtenu que cette réponse laconique : “Des meneurs, nous en sommes tous !” C’était vrai. La masse avait alors d’innombrables meneurs.
Des délégués des tranchées venaient tenir au Soviet de Petrograd un langage comminatoire : “Jusques à quand durera cette situation intenable ? Les soldats nous ont mandatés pour vous l’annoncer : si des démarches énergiques ne sont pas tentées d’ici au 1er novembre, les tranchées se videront, l’armée tout entière rentrera. Vous nous oubliez ! Si vous ne trouvez pas d’issue à la situation, nous viendrons chasser nous-mêmes nos ennemis, à coups de baïonnette – mais vous vous en irez avec eux !” Telle était, relate Trotski, la voix du front.
Au début d’octobre, l’insurrection naissait partout, spontanément ; les troubles agraires s’étendaient au pays entier. “Les provinces de Toula, Tambov, Riazan, Kalouga se sont soulevées. Les paysans, qui attendaient de la révolution la paix et la terre, déçus, s’insurgent, saisissent les récoltes des propriétaires fonciers, brûlent leurs résidences. Le gouvernement Kérensky réprime lorsqu’il en a la force. Heureusement, ses forces sont restreintes.” “Écraser l’insurrection paysanne, l’avertit Lénine, ce serait tuer la révolution.” Dans les Soviets des villes et les armées, les bolcheviks, naguère encore en minorité, deviennent majorité. Aux élections des doumas (municipalités) de Moscou, ils obtiennent 199 337 suffrages sur 387 262 votants. Il y a sur 710 élus, 350 bolcheviks, 184 cadets, 104 socialistes-révolutionnaires, 31 mencheviks et 41 divers. En cette veille de guerre civile, les partis modérés, moyens, s’effondrent, les partis extrêmes grandissent. Tandis que les mencheviks perdent toute influence réelle et que le Parti socialiste-révolutionnaire, parti gouvernemental, qui paraissait peu de temps auparavant disposer d’une immense influence, passe au troisième plan, les constitutionnels démocrates, cadets, partis de la bourgeoisie, viennent s’aligner, renforcés, en face des révolutionnaires. Aux élections précédentes, en juin, socialistes-révolutionnaires et mencheviks avaient obtenu 70 % des suffrages exprimés ; ils tombent à 18 %. Sur 17 000 soldats consultés, 14 000 votent pour les bolcheviks.
Les soviets se transforment. Citadelles des mencheviks et des socialistes-révolutionnaires, ils se bolchevisent. De nouvelles majorités s’y forment. Le 31 août à Petrograd et le 6 septembre à Moscou, les motions bolchevistes présentées aux soviets obtiennent pour la première fois des majorités. Le 8 septembre, les bureaux menchevistes socialistes-révolutionnaires des deux soviets démissionnent. Le 25 septembre, Trotski est élu président du Soviet de Petrograd. Noguine est porté à la présidence du Soviet de Moscou. Le 20 septembre, le Soviet de Tachkent prend officiellement le pouvoir. Les troupes du gouvernement provisoire le lui reprennent. Le 27 septembre, le Soviet de Reval décide en principe la transmission de tous les pouvoirs aux soviets. Peu de jours avant la révolution d’Octobre, l’artil1erie démocratique de Kérensky tire sur le Soviet insurgé de Kalouga.
Soulignons ici un fait peu connu. À Kazan, l’insurrection d’Octobre triompha avant même d’avoir été déclenchée à Petrograd. Un des acteurs des événements de Kazan a relaté ce dialogue entre militants : “– Mais qu’eussiez-vous fait si les soviets n’avaient pas pris le pouvoir à Petrograd ? – Il nous était impossible de renoncer au pouvoir ; la garnison ne l’eût pas toléré. – Mais Moscou vous eût écrasés ! – Non. Vous avez tort de le croire. Moscou n’aurait pu venir à bout des 40 000 soldats de Kazan.”
Dans l’immense pays, les masses tout entières des classes laborieuses, paysans, ouvriers, soldats vont à la révolution. Montée élémentaire, irrésistible, d’une puissance comparable à celle de l’océan. (...)
Les masses ont des millions de visages ; elles ne sont point homogènes ; elles sont dominées par des intérêts de classe, divers et contradictoires ; elles ne parviennent à la conscience véritable (sans laquelle aucune action féconde n’est possible) que par l’organisation. Les masses soulevées de la Russie de 1917 s’élèvent à la nette conscience de l’action nécessaire, des moyens, des objectifs à atteindre, par l’organe du Parti bolchevique. Ce n’est pas une théorie, c’est l’énoncé d’un fait. Les rapports entre le Parti, la classe ouvrière, les masses laborieuses nous apparaissent ici avec un relief admirable. Ce que veulent confusément les marins de Cronstadt, les soldats de Kazan, les ouvriers de Petrograd, d’Ivanovo-Voznessensk, de Moscou, de partout, les paysans saccageant les demeures seigneuriales, ce qu’ils veulent tous, sans avoir la possibilité d’exprimer nettement leurs aspirations, de les confronter avec les possibilités économiques et politiques, de s’assigner les fins les plus rationnelles, de choisir les moyens les plus propres de les atteindre, de choisir le moment le plus favorable à l’action, de s’entendre d’un bout à l’autre du pays, de s’informer les uns les autres, de se discipliner, de coordonner leur effort innombrable, de constituer, en un mot, une force uniquement intelligente, instruite, volontaire, prodigieuse, ce qu’ils veulent tous, le Parti l’exprime en termes clairs, et le fait. Le Parti leur révèle ce qu’ils pensent. Le Parti est le lien qui les unit entre eux, d’un bout à l’autre du pays. Le Parti est leur conscience, leur intelligence, leur organisation.
Quand les artilleurs des cuirassés de la Baltique, anxieux du danger suspendu sur la révolution, cherchent une voie, l’agitateur bolchevik est là qui la leur montre. Il n’en est pas d’autre, c’est l’évidence. Quand des soldats dans la tranchée veulent exprimer leur volonté d’en finir avec la tuerie, ils élisent au comité du bataillon les candidats du Parti bolchevique. Quand des paysans, las des atermoiements de “leur Parti” socialiste-révolutionnaire, se demandent s’il n’est pas temps d’agir enfin eux-mêmes, la voix de Lénine leur parvient : “Prends la terre, paysan !” Quand les ouvriers sentent 1’intrigue contre-révolutionnaire les environner de toutes parts, la Pravda leur apporte les mots d’ordre qu’ils pressentaient et qui sont aussi ceux de la nécessité révolutionnaire. Devant le placard bolchevique, les passants de la rue miséreuse, attroupés, s’exclament : “Mais c’est ça !” C’est ça. Cette voix est la leur.
C’est pourquoi la marche des masses à la révolution se traduit par un grand fait politique : les bolcheviks, petite minorité révolutionnaire en mars, deviennent en septembre-octobre le parti de la majorité. Distinguer entre les masses et le Parti devient impossible. Ce n’est qu’un flot. Sans doute y a-t-il bien, parmi les foules, d’autres révolutionnaires épars, socialistes-révolutionnaires de gauche (les plus nombreux), anarchistes, maximalistes, qui veulent aussi la révolution : poignée d’hommes emportés par les événements. Meneurs menés. Combien leur conscience des réalités est confuse, nous le verrons par maints traits. Les bolcheviks, eux, grâce à leur juste intelligence théorique du dynamisme des événements, s’identifient à la fois aux masses laborieuses et à la nécessité historique. “Les communistes n’ont pas d’intérêts distincts de ceux du prolétariat tout entier”, est-il écrit dans le Manifeste de Marx et d’Engels. Combien cette phrase écrite en 1847 nous apparaît maintenant juste !
Depuis les émeutes de juillet, le Parti, qui vient de traverser une période d’illégalité et de persécution, n’est que toléré. Il se forme en colonne d’assaut. À ses membres, il demande de l’abnégation, de la passion et de la discipline : il ne leur procure en revanche que la satisfaction de servir le prolétariat. Voyez pourtant grandir ses effectifs. Il comptait, en avril, 72 organisations, fortes de 80 000 membres. Fin juillet, ses effectifs atteignent 200 000 affiliés, groupés dans 162 organisations.
Victor Serge, 1930
Personnages:
- Victor Serge [14]
Rubrique:
Campagne médiatique contre Lénine et la Révolution russe: la révolution “démocratique” de février 1917 utilisée pour falsifier la Révolution d’octobre
- 1487 reads
Pour le centenaire de la Révolution russe, de nouvelles publications et émissions s’emparent de ce sujet sensible. Tout un flot de propagande se déverse donc à nouveau (1 pour dénaturer les heures héroïques de cet événement grandiose qui fut un des plus importants du xxe siècle, du moins un des plus riches d’enseignements pour le prolétariat mondial. Parmi le foisonnement de l’offre, l’émission TV de la chaîne Arte proposait un titre alléchant : “Lénine, une autre histoire de la Révolution russe” (2. Selon les journalistes du journal Le Monde, “cette évocation est une formidable relecture de l’année 1917 déprise des fables qui l’ont maquillée au fil du temps et au gré des idéologies”. La propagande bourgeoise a toujours véhiculée une “autre histoire de la Révolution” pour mieux enterrer sa véritable histoire, en faisant parler les images à travers des commentaires mensongers plaqués sur des documents d’archives et des films muets. Arte, la chaîne “culturelle” était aussi au rendez-vous de la campagne antibolchevique et anti-léniniste.
Avec de nombreux documents d’archives que nous avons peu l’habitude de voir, l’émission nous plonge dans une sorte de cours d’histoire a priori revisité. Le ton professoral des commentaires cherche d’entrée à instaurer l’autorité des “spécialistes”, maniant l’anaphore (“Ça ne s’est pas passé comme ça...”) et parfois l’ironie feutrée. Par exemple, au moment de prononcer le titre du journal des bolcheviks, la Pravda (la Vérité), on perçoit nettement cette antiphrase ou le téléspectateur est amené à entendre que la Pravda, dans l’esprit du “spécialiste”, n’est que mensonges.
Lénine calomnié et défiguré
L’émission, centrée sur la personnalité de Lénine procède régulièrement et très habilement par oppositions d’images, par antithèses “pédagogiques” dans l’intention de salir une nouvelle fois le combattant qu’était Lénine. Ainsi, d’un côté, on évoque l’exilé en Suisse, totalement “absent” de la scène, avec un plan fixe de la ville de Zurich paisible, le tout accompagné de commentaires et d’une petite musique légère où, en fin de compte, rien ne se passe. Lénine est présenté comme une sorte de planqué totalement à côté de l’histoire. Loin de toute réalité, l’exil est schématiquement réduit aux seuls privilèges des “intellectuels” (sous-entendu déconnectés des masses) et aux “gens aisés”. Cette insistance sociologique qui se base sur une part de réalité n’a d’autre objectif que de souligner le fait que les “masses” sont totalement étrangères aux révolutionnaires. La dimension politique et combative est à peine suggérée, le caractère militant, la dimension réelle du combat de Lénine est occultée, ses polémiques sont totalement passées sous silence. Par net contraste, les plans sur la situation en Russie exposent les événements du terrain, accompagnés d’un montage d’images plus dynamiques. Cette opposition volontairement construite de façon antithétique cherche de manière évidente à disqualifier d’entrée le combat de Lénine qui très rapidement apparaît sous les traits d’un imposteur. Et d’ailleurs, le retour sur sa famille et son enfance, l’évocation de ses anciens combats et, surtout, l’exécution de son frère après sa participation à un attentat contre le tsar, serviront de support à une explication unilatérale consistant à affirmer que Lénine avait comme motivation exclusive pour son engagement révolutionnaire une “soif de vengeance” contre l’aristocratie. N’a-t-il pas dit, comme le rappelle le commentateur de ce documentaire : “ils me le paieront” ?
Dans ce cadre, le marxisme n’est qu’un simple adjuvant devant permettre d’assurer son “pouvoir personnel”. La réalité est aux antipodes de telles calomnies. La démarche désintéressée et solidaire de Lénine, son sens du combat révolutionnaire pour la cause du socialisme ont été la matrice reconnue par tous ses camarades de lutte, par les ouvriers eux-mêmes et, au-delà des polémiques, par toutes les grandes figures du mouvement ouvrier de l’époque et confirmée par la réalité des faits. L’émission, pourtant très documentée, n’a évidemment aucun témoignage disponible dans ce sens. Pourtant, dans sa Révolution russe, Rosa Luxemburg n’hésite pas à affirmer : “Tout ce qu’un parti peut apporter, en un moment historique, en fait de courage, d’énergie, de compréhension révolutionnaire et de conséquence, les Lénine, Trotski et leurs camarades l’ont réalisé pleinement. L’honneur et la capacité d’action révolutionnaire, qui ont fait à tel point défaut à la social-démocratie, c’est chez eux qu’on les a trouvés. En ce sens, leur insurrection d’Octobre n’a pas sauvé seulement la Révolution russe, mais aussi l’honneur du socialisme international.”
Construite de manière chronologique, l’émission évoque 1905, puis les grands événements qui jalonnent les journées de février 1917 pour souligner que les bolcheviks sont politiquement en dehors du coup et ne comprennent absolument rien à la situation. Partant d’une réalité ou les bolcheviks étaient effectivement minoritaires au départ, la plupart en prison, le parti pris est de souligner que Lénine est non seulement souvent “absent”, mais qu’il “navigue à vue” et se retrouve en permanence “ballotté par les événements”. La seule qualité de ce grand révolutionnaire se résumerait uniquement à l’art de la manipulation.
Face à cela, Trotski rétablit la réalité de la démarche de Lénine : “La principale force de Lénine consistait en ceci qu’il comprenait la logique interne du mouvement et réglait d’après elle sa politique. Il n’imposait pas son plan aux masses. Il aidait les masses à concevoir et à réaliser leurs propres plans” (3.
Un plaidoyer mensonger en faveur de la démocratie bourgeoise
Le procédé de l’antithèse, cher à l’émission d’Arte, se poursuit avec le portrait croisé de Lénine et de Kerenski. Là encore, le seul personnage “digne de l’histoire” est Kerenski, véritablement encensé sans pudeur. Kerenski est présenté comme l’incarnation du mouvement des masses aux aspirations prétendument démocratiques. On insiste sur l’accueil qu’il fait aux ouvriers “crasseux” et “sentant la sueur”, les soldats excédés qui l’acclament, sa soi-disant légitimité. Kerenski est présenté comme le grand démocrate qui fait le trait d’union entre le conseil ouvrier, le palais Tauride et la Douma. La réalité, c’est qu’il œuvre pour la réaction, comme le montre sa démarche vis-à-vis de l’ambassadeur américain : “Nous ferons en sorte que les soviets meurent de mort naturelle. Le centre de gravité de la vie politique se déplacera progressivement des soviets vers les nouveaux organes démocratiques de représentation autonome” (4. Tout est dit.
Le commentaire qui occulte tout cela peut ainsi se permettre de présenter le quartier industriel de Vyborg et les 400 000 prolétaires comme spontanément animés d’une même aspiration démocratique et non d’un combat historique révolutionnaire contre le système capitaliste. Les initiatives ouvrières sont bien évoquées, comme par exemple l’extraordinaire traversée de la Neva gelée, à la barbe des troupes réactionnaires, des flics et des autorités postées sur le pont Alexandre II. Mais elles apparaissent comme purement contingentes, sous couvert du simple chaos lié au gré des événements, sans considération aucune pour la dimension consciente et politique des masses ouvrières. De la même manière, le Conseil ouvrier de Petrograd est frauduleusement assimilé à une sorte de parlement populaire et non à ce qu’il représente réellement : un organe de lutte ou se mène le véritable combat politique du prolétariat. Sous prétexte d’une “pluralité” de courants politiques et d’influences bourgeoises et petites bourgeoises durant cette période, le commentateur s’autorise à réduire le soviet à une simple représentation démocratique 5.
Les journées de février sont présentées frauduleusement comme le point culminant de la révolution, alors qu’il n’existait en réalité qu’un double pouvoir : d’un côté celui des conseils, de l’autre celui du gouvernement provisoire, sans issue décisive. La suite des événements, jusqu’à octobre, apparaît comme une sorte de dépossession des conseils par les bolcheviks. En réalité, c’est l’inverse. Ils luttaient contre la réaction qui œuvrait derrière le masque pseudo-révolutionnaire de la gauche démocratique pour tenter d’abuser et de tromper les conseils : “Là où un ministre bourgeois n’aurait pu se présenter pour assurer la défense du gouvernement, devant les ouvriers révolutionnaires ou dans les soviets, on voyait paraître (ou plutôt la bourgeoisie y envoyait) un ministre “socialiste” (Skobélev, Tsérétéli, Tchernov ou d’autres encore) qui œuvrait en conscience au profit de la bourgeoise, suait sang et eau pour défendre le ministère, blanchissait les capitalistes, bernait le peuple en répétant des promesses, des promesses et des promesses, et en lui recommandant d’attendre, d’attendre, d’attendre et d’attendre” (6.
Les événements de février 1917, tout comme ceux de 1905, sont naturellement évoqués en lien avec la lutte du prolétariat contre la guerre. Mais tout le contexte international de la lutte de classe durant l’année 1917 est soigneusement occulté, comme si “l’irruption des masses” en Russie n’était qu’un simple accident lié au particularisme d’un “pays arriéré”. Rien sur la réalité des mutineries et des mouvements de fraternisation des soldats sur tous les fronts, rien sur les grèves un peu partout et la fermentation à l’arrière, sur le fait que débute en réalité une véritable vague révolutionnaire internationale du prolétariat.
L’opposition radicale entre la bourgeoisie, le gouvernement provisoire désirant poursuivre la guerre à tout prix, et les révolutionnaires bolcheviks, Lénine en tête, refusant la boucherie impérialiste, est relayé au second plan et noyé sous le flot des commentaires falsificateurs. Les autres grands faits marquants de la Révolution restent soumis à la même intoxication idéologique : disqualifier les bolcheviks et surtout Lénine. La rigueur même de Lénine et son respect rigoureux des décisions prises au cours des congrès, (comme par exemple en 1903 face à ceux qui refusaient de se soumettre aux décisions votées et à la fronde des Menchéviks7 est calomniée, les commentaires présentant Lénine comme dogmatique et dictateur. Rien n’est plus mensonger ! Pire, Lénine aurait été, selon le commentateur, quelqu’un qui “aura passé toute sa vie à exclure et à diviser”. Ce commentaire arrive à l’occasion du testament de Lénine lorsque ce dernier, sur son lit de mort, demande à ses camarades du Parti bolchevik d’écarter Staline du Comité central du fait de sa cruauté. Comme par enchantement, le commentateur ne dit pas un mot du testament de Lénine, tout simplement parce qu’il contient la preuve qu’il n’y avait aucune “continuité” entre Lénine et Staline. Le mensonge par omission fait partie intégrante du procédé de toutes les campagnes d’intoxication idéologique contre Lénine et la révolution russe. Lénine a toujours été l’artisan patient d’un combat unitaire, défendant “l’esprit de parti” contre tous les opportunistes, contre les “cercles” qui tendaient à refuser l’unité des révolutionnaires en fragmentant d’autant les énergies, affaiblissant les efforts en faveur de la lutte prolétarienne internationale. Ce fut tout le sens de son combat et l’apport de ses Thèses d’Avril. Face à tous les sycophantes et à ceux qui cherchaient à collaborer et à s’accommoder de la classe dominante, des miasmes conservateurs de la démocratie bourgeoise, face à tous les opportunistes, Lénine, en effet, ne courbait pas l’échine et se montrait intransigeant. Il se refusait très justement à toute concession face à l’ennemi de classe, face aux exploiteurs et donc, n’acceptait pas le capitalisme. Bien entendu, le reflux de la vague révolutionnaire et l’encerclement par les troupes de l’Entente, le poids de visions erronées héritées du passé social-démocrate allaient conduire à une situation absolument tragique 8.
En réalité, ce qui dérange les réalisateurs de cette émission, c’est avant tout le fait que Lénine ne soit pas un patriote et qu’il refuse l’union sacrée en souhaitant même, suprême transgression, “la défaite de son propre pays” ! Refuser “l’union sacrée” provoque en effet des “divisions” au sein de la “nation” et une opposition de classe : cela, nous ne le nions pas. À toutes les étapes fondamentales du récit des événements, le commentaire maintient la même ligne officielle faisant passer la moindre erreur pour une trahison !
Durant les journées de juillet, la terrible contre-offensive réactionnaire, la chasse aux bolcheviks ou les masses sont “exposées aux coups” (Trotski), sont l’occasion de souligner que Lénine est “absent”, ou “bafouille” autour de bolcheviks en “panique”. La réalité est que le Parti bolchevik a bien au contraire compris les pièges de la réaction et a pris position contre l’insurrection et la prise du pouvoir qui était prématurée en juillet (les soldats n’étant pas suffisamment solidaires des ouvriers et la situation de la province en retard politiquement sur Petrograd). Dans d’autres circonstances, comme dans une de ses interventions au soviet, Lénine est tellement incompris que son prétendu “délire politique” inquiète sa propre compagne Kroupskaïa “craignant pour sa santé mentale”. Ignoble ! Ainsi, le stress liés à la situation tendue, le surmenage, se transforment aux yeux de nos “experts” en une véritable pathologie mentale. La prétendue “compétition” de Lénine entre les soviets et les bolcheviks, sa volonté de faire main basse sur les conseils et “le pouvoir qui lui monte à la tête”... tout cela relève des mêmes interprétations mensongères. Si les bolcheviks parviennent à déjouer le putsch du général Kornilov au mois d’août, regroupés et retranchés autour du conseil ouvrier à Smolny, c’est finalement pour nous suggérer quasi explicitement que Lénine est in fine lui-même une sorte de “Kornilov” qui a fini par réussir son coup en octobre. Cela, après avoir quitté “sa cabane” à Helsinki et avoir mis en œuvre le sabotage de la démocratie. Le IIe Congrès des soviets devient un simple enjeux démocratique et Lénine un “obsédé de l’insurrection” cherchant de façon insatiable à assouvir à tous prix, encore une fois, son “appétit du pouvoir”. L’argument massue étant que Lénine n’a pas attendu le IIe Congrès des soviets avant d’appeler à la prise du pouvoir, et donc que la révolution aurait été confisquée aux masses prolétariennes. Ce qui est faux : ce n’est pas le dictateur Lénine, ni le Comité central du Parti bolchevik, mais le Comité militaire révolutionnaire (CMR) élu par le soviet de Petrograd qui a appelé à l’insurrection d’Octobre. Et nos “historiens” bourgeois le savent très bien !
Octobre : une insurrection en faveur de la Révolution mondiale et non un “putsch”
Toute la question de la prise du pouvoir d’Octobre, de la décision même de l’insurrection, sont présentés de façon classique par la propagande officielle comme un vulgaire “coup d’État” mené par le CMR totalement contrôlé en sous-main par une poignée de bolcheviks et l’ineffable dictateur Lénine. Ce qu’oublie de dire l’émission, c’est que le CMR est réellement sous le contrôle du soviet de Petrograd. Il s’agirait, aux dire même du commentateur, d’une simple “opération de police” opposée à l’image qu’en donne le film du célèbre cinéaste Eisenstein. Et là encore, l’émission pourtant très bien documentée, s’inspirant de témoignages et sources diverses, se garde bien d’évoquer le point de vue de Trotski qui clarifie les choses : “II n’y eut presque point de manifestations, de combats de rue, de barricades de tout ce que l’on entend d’ordinaire par “insurrection”. La révolution n’avait pas besoin de résoudre un problème déjà résolu. La saisie de l’appareil gouvernemental pouvait être effectuée d’après un plan, avec l’aide de détachements armés relativement peu nombreux, partant d’un centre unique (...) Le calme dans les rues, en octobre, l’absence de foules, l’inexistence de combats donnaient aux adversaires des motifs de parler de la conspiration d’une minorité insignifiante, de l’aventure d’une poignée de bolcheviks. (...) En réalité, les bolcheviks pouvaient ramener au dernier moment la lutte pour le pouvoir à un “complot”, non point parce qu’ils étaient une petite minorité, mais au contraire parce qu’ils avaient derrière eux, dans les quartiers ouvriers et les casernes, une écrasante majorité, fortement groupée, organisée, disciplinée” (9.
De même, le témoignage vivant du journaliste américain John Reed, qui a assisté aux “dix jours qui ébranlèrent le monde”, est totalement occulté : “C’est ainsi, dans le fracas de l’artillerie, dans l’obscurité, au milieu des haines, de la peur et de l’audace la plus téméraire, que naquit la nouvelle Russie (…). Pareils à un fleuve noir emplissant toute la rue, sans chants ni rires, nous passions sous l’Arche Rouge (…). De l’autre côté de l’Arche, nous priment le pas de course, nous baissant et nous faisant aussi petits que possible, puis, nous rassemblant derrière le piédestal de la colonne d’Alexandre (…). Après être restés quelques minutes massée derrière la colonne, la troupe, qui se composait de quelques centaines d’hommes, retrouva son calme et, sans nouveaux ordres, d’elle-même, repartit en avant. Grâce à la lumière qui tombait des fenêtres du Palais d’hiver, j’avais réussi à distinguer que les deux ou trois cents premiers étaient des gardes rouges, parmi lesquels étaient disséminés seulement quelques soldats (…). Un soldat et un garde rouge apparurent dans la porte, écartant la foule : ils étaient suivis d’autres gardes, baïonnette au canon, escortant une demi-douzaine de civils qui avançaient l’un derrière l’autre. C’était les membres du Gouvernement provisoire (…). Nous sortîmes dans la nuit glacée, toute frémissante et bruissante de troupes invisibles, sillonnées de patrouilles (…). Sous nos pieds, le trottoir était jonché de débris de stuc de la corniche du Palais qui avait reçu deux obus du croiseur Aurora. C’était les seuls dégâts causés par le bombardement. Il était trois heures du matin. Sur la Nevski, tous les becs de gaz étaient de nouveau allumés ; le canon de trois Apouces avait été enlevé et seuls les gardes rouges et les soldats accroupis autour des feux rappelaient encore la guerre (…). À Smolny, des bureaux du Comité militaire révolutionnaire semblaient jaillir des éclairs, comme d’une dynamo travaillant à trop grande puissance” (10.
Selon l’émission d’Arte, le soviet à Smolny n’est que pure forme dans la mesure ou le pouvoir est “confisqué” par le “parti unique” et le méchant Lénine. Une sorte de fracture se serait consolidée après la mise en place des commissaires du peuple.
Par un tour de passe-passe dont les médias aux ordres de la classe bourgeoise ont le secret, l’émission d’Arte se termine par des commentaires sur le chaos sanglant engendré par la Révolution d’octobre et qui aurait provoqué l’effondrement définitif du “communisme” en 1989. La matraquage idéologique est encore utilisé à outrance mais, aujourd’hui, avec un objectif particulièrement pernicieux : Oui, il y a bien eu une révolution prolétarienne en Russie mais ce que voulaient ces masses prolétariennes, c’était la démocratie, une démocratie parlementaire comme dans les pays occidentaux, avec sa mystification du “pouvoir du peuple” par le suffrage universel.
Mensonge ! Ce que voulaient les masses prolétariennes, c’était la fin de la guerre de 1914-18. Et seul Lénine et le Parti bolchevik avait ce “programme” révolutionnaire et permettait au prolétariat de prendre en main sa destinée. C’est grâce à Octobre que la Révolution russe et le “bolchevisme” ont mis fin à la boucherie mondiale. Cette vérité historique, nos commentateurs, professeurs d’“histoire” et autres chantres de la démocratie bourgeoise, se gardent bien de la mentionner. Comme le disait Goebbels, chef de la propagande nazie en Allemagne : “Un mensonge énorme porte avec lui une force qui éloigne le doute”. Et dans l’art de la propagande et de la falsification de l’histoire, les idéologues patentés de l’État démocratique n’ont pas grand chose à envier aux “lavages de cerveaux” des régimes nazi ou stalinien.
WH, 13 février 2017
1) Si la propagande est permanente et prend des formes différentes, elle a connu des pics fiévreux, comme au moment de la prise du pouvoir par les bolcheviks, parfois durant la guerre froide, mais aussi et surtout au moment et après l’effondrement de l’URSS durant les années 1990. Voir notre brochure : Octobre 1917 début de la révolution mondiale : les masses ouvrières prennent leur destin en main [16].
2) Émission du vendredi 3 mars, avec la participation de l’historien Marc Ferro, spécialiste de la Russie et de l’URSS. Ce véritable porte-parole de l’histoire officielle n’a cessé d’entretenir et de colporter doctement le plus grand mensonge de l’histoire assimilant le stalinisme au communisme.
3) Trotski, Histoire de la Révolution russe, Tome I, chapitre “Le réarmement du Parti”.
4) John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde.
5) Le fait d’insister sur La Marseillaise reprise par les manifestants, sans en préciser les raisons ni l’état d’esprit réel des masses, le fait de souligner l’obtention du droit de vote des femmes sous le gouvernement provisoire, tout laisse croire, en fin de compte a une simple révolution bourgeoise et purement démocratique.
6) Lénine : Les enseignements de la révolution, point VI.
7) Lire la brochure de Lénine, Un pas en avant deux pas en arrière.
8) Nous n’avons jamais nié les erreurs commises par le Parti bolchevik, ni sa dégénérescence et sa transformation en colonne vertébrale de l’odieuse dictature stalinienne. Le rôle du Parti bolchevik ainsi que la critique implacable de ses erreurs et sa dégénérescence ont été analysés dans différents articles de notre Revue internationale :
–“La dégénérescence de la Révolution russe” et “Les leçons de Kronstadt” (no 3) ;
• “La défense du caractère prolétarien de la Révolution d’Octobre” (nos 12 et 13).
La raison essentielle de la dégénérescence des partis et organisations politiques du prolétariat résidait dans le poids de l’idéologie bourgeoise dans leurs rangs, qui créait constamment des tendances à l’opportunisme et au centrisme (voir “Résolution sur le centrisme et l’opportunisme”, Revue internationale no 44).
9) Trotski, op. cit.
10) John Reed, op. cit.
Géographique:
- Russie [17]
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [18]
Personnages:
- Lénine [19]