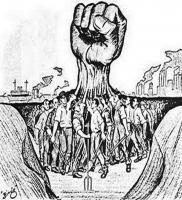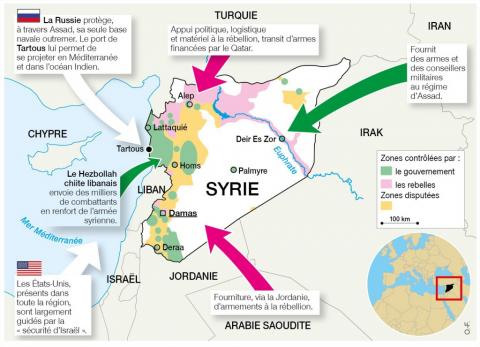ICConline - 2013
- 1846 reads
ICConline - janvier 2013
- 1118 reads
Espagne: les mesures du gouvernement contre les expulsions ne sont pas une solution mais une escroquerie !
- 1454 reads
 Nous publions ci-dessous de larges extraits d’un article d’Acción Proletaria, section du CCI en Espagne, au sujet de l’agitation hypocrite du gouvernement espagnol qui ne résout rien des situations dramatiques consécutives aux expulsions massives. La version originale du texte est disponible sur notre site en langue espagnole.
Nous publions ci-dessous de larges extraits d’un article d’Acción Proletaria, section du CCI en Espagne, au sujet de l’agitation hypocrite du gouvernement espagnol qui ne résout rien des situations dramatiques consécutives aux expulsions massives. La version originale du texte est disponible sur notre site en langue espagnole.
Le 9 novembre dernier, à Baracaldo, près de Bilbao, une femme s’est suicidée en se jetant dans la rue depuis le balcon de sa maison, pendant que la police pénétrait dans son logement pour l’expulser. Quelques semaines auparavant, des faits similaires s’étaient déroulés, faisant deux autres victimes à Burjassot (dans la région de Valence) et à Grenade. Combien de cas semblables existent-ils en réalité ? Il est impossible de se prononcer parce que, dans bien des situations, les causes des suicides apparaissent confuses, attribuées à la dépression, à des conflits familiaux, etc.
Face à “l’émotion sociale” et, surtout, aux réactions de rage immédiates et spontanées des voisins des victimes et de beaucoup de personnes qui ont exprimé leur solidarité, plusieurs représentants de l’appareil d’État garantissant “l’ordre” capitaliste ont inondé les bulletins d’informations de leurs jérémiades et de leurs condoléances, en promettant des mesures pour “empêcher les pertes en vies humaines”, et autres bla-bla-bla, démontrant ainsi pour la énième fois que la répugnante hypocrisie de nos exploiteurs ne connaît plus de limites.
Un cynisme révoltant
Ainsi, nous avons vu défiler dans les médias les banquiers des victimes, arborant leur mine la plus compassée, pour se justifier, racontant qu’ils avaient “le moins possible” fait procéder à des expulsions et, qu’en tous cas, ils l’avaient fait, nous ont-ils dit, pour sauvegarder les intérêts des autres clients de la banque. On sait cependant que la banque nationalisée a accéléré la procédure d’une authentique avalanche de demandes de mesures d’expulsion pour nettoyer sa balance de paiements de créances douteuses qui la faisaient passer pour une “mauvaise banque”. Nous avons aussi entendu des juges qui, depuis 2008, ont prononcé des arrêtés d’expulsion pour près de 400 000 familles en Espagne, et mis en cause “les politiques” parce qu’ils sont les seuls à détenir le pouvoir de changer les lois. Nous avons écouté des policiers qui ont sorti par la force les expulsés de leur maison et qui ont rossé tous ceux qui se rassemblaient pour s’y opposer, racontant “qu’ils pleuraient aussi” (sic!) même s’ils devaient “accomplir leur devoir en obéissant aux juges”. Nous avons lu les déclarations très suivies dans les médias de “communiqués”, demandant aux politiques qu’ils se mettent d’accord entre eux pour limiter les ravages de la crise parmi les populations les plus défavorisées ; même si, c’est évident pour eux, il fallait tenir compte des véritables limites de ce qui serait “déjà la fragile stabilité du système financier”, la “crédibilité de l’Espagne face aux investisseurs étrangers” (…). Nous avons vu le Parti Populaire (parti de droite actuellement au pouvoir) se vanter du fait qu’à la différence de l’inutile Zapatero, ils avaient, eux, pris des mesures pour protéger les plus défavorisés, bien que ces mesures aient été impulsées par la banque elle-même, qui en avait annoncé les grandes lignes dix jours avant le pompeux décret de Rajoy, et qui a reçu les bénédictions de la “troïka” elle-même. (1) Mais le pompon du cynisme doit revenir surtout au PSOE, le parti qui a gouverné le plus longtemps l’Espagne post-franquiste et qui n’a jamais modifié la loi hypothécaire de 1946, adoptée par le même régime dictatorial tellement honni par le PSOE. Le “parti qui a créé 5 millions de chômeurs” est aussi celui qui a fait procéder à 300 000 expulsions entre 2007 et 2011. Et c’est ce parti là qui se plaint aujourd’hui de l’impact limité des mesures de Rajoy, qui a aussi applaudi à tout rompre le dénommé “Code de bonne conduite des banques” approuvé en mars de cette année et qui a pu être appliqué en tout et pour tout à 130 familles dans tout le pays. Le même Rubalcaba (2), qui a envoyé la police contre les rassemblements qui sont organisés depuis le 15 mai pour s’opposer aux expulsions, demande à l’heure actuelle que la police municipale des mairies “socialistes” ne collabore pas à leur exécution. Il y a quelques jours, Maria Antonia Trujillo, ex-ministre du logement de Zapatero, déclarait de manière provocatrice : “Celui qui contracte des dettes doit les payer. Sinon, il ne devait pas s’endetter.” Et celui qui est aujourd’hui le bras droit de Rubalcaba lui a répliqué : “Où as-tu balancé ton âme socialiste ?”. Si l’arrogance de la première est répugnante (…), le cynisme du second est proprement révoltant.
Avec cette nauséabonde campagne de fausse solidarité, le crocodile capitaliste exhibe de fausses larmes pour que nous, ses victimes, ayons confiance en sa “bonne volonté”. Il veut que nous croyions que son goût du lucre, son appât du gain cesse quand il se heurte aux droits humains les plus élémentaires. Comme si ne figurait pas déjà dans la Constitution le droit de vivre dignement et celui au travail ! (…) Si la Troïka et le gouvernement ont accordé un moratoire de deux ans pour des familles aux revenus inférieurs à 19 000 euros annuels, dont plus de la moitié sont couverts de dettes hypothécaires et qui, en plus, sont au chômage sans toucher la moindre allocation, ce n’est nullement parce que leur “bonté d’âme” s’est finalement imposée à leur nature capitaliste. Mais c’est parce que l’immense majorité des familles dans cette situation sont insolvables, et que les jeter à la rue ne permettra aucun bénéfice. Bien au contraire : cela ne ferrait que grossir le stock de logements que la banque et le gouvernement ne parviennent pas à écouler. En échange du “droit” de rester deux années de plus dans leur maison, les familles “bénéficiaires” verront d’ailleurs augmenter leur dette d’un “raisonnable” 30 % supplémentaire. Et si au cours de ce moratoire, un “bénéficiaire” décroche un contrat de travail ou recueille le moindre petit ballon d’oxygène pour sa survie, il devra reprendre le paiement de ses traites ou accepter l’expulsion définitive.
Le vrai visage du capitalisme et la véritable lutte contre les expulsions
Le président de l’Association espagnole des Banques a déclaré récemment que la “solution” aux expulsions était de “construire plus de logements, d’accepter davantage de crédits et d’hypothèques”, comme si le capitalisme agissait pour satisfaire les besoins humains. Mais c’est complètement faux ! Le capitalisme vit pour transformer les besoins humains, comme tous les aspects de la vie qui vont de la santé aux loisirs en passant par le logement, en marchandises qui s’échangent contre d’autres marchandises, comme la force de travail qui s’échange contre un salaire dans n’importe quelle circonstance. Le capitalisme ne sacrifie jamais cette valeur d’échange au profit de la valeur d’usage que peuvent avoir ces “marchandises” pour les travailleurs qui les ont créées. C’est pour cela qu’il existe aujourd’hui en Espagne un million de logements vides, pendant que les familles s’entassent dans les maisons des grands-parents (3), ou que les jeunes ne peuvent pas s’émanciper avant l’âge de trente ans en moyenne ! Comme nous l’avons signalé dans un autre article d’Acción Proletaria (“Débat sur la question du logement”), la crise actuelle du logement est, sur ce plan, le problème le plus représentatif des maux capitalistes infligés à l’humanité : c’est une crise de surproduction, dont les lois du marché sont établies pour des acheteurs solvables et sans aucun égard pour les besoins humains.
C’est une illusion de croire que le capitalisme peut résoudre le problème du logement, comme tant d’autres, en partant des besoins humains ou en fonction d’une justice égalitaire pour les prêteurs et les emprunteurs. C’est une funeste mystification. Une de nos principales critiques à des plateformes revendicatives comme celle des « Victimes de la Loi Hypothécaire » (PAH) ou celle de « Halte aux Expulsions » ! (Stop Desahucios) est la suivante : si ces plateformes ont bien organisé des assemblées, qui ont effectivement donné lieu à un authentique mouvement de solidarité envers les victimes des expulsions, elles tombent dans une analyse et des propositions venant d’un stérile réformisme “radical” (…).
En dernière instance, l’avalanche d’expulsions est inséparable de l’appauvrissement toujours plus brutal et très rapide de la classe ouvrière. Pour les prolétaires, cela implique de ne jamais séparer la lutte contre les expulsions de la lutte contre les licenciements, contre les coupes claires dans le système de santé, ou contre les coups de hache sur les salaires. C’est une lutte des exploités contre la survie de ce système d’exploitation.
Les psychologues qui assistent aux assemblées qui regroupent les expulsés disent qu’ils les voient chaque fois arriver plus démoralisés, et qu’une partie très importante de ceux qui ont des tendances suicidaires se présentent à eux avec le sentiment qui accompagne les expulsions de vivre cela comme “un échec personnel”. Nous avons déjà vu la même chose chez les chômeurs, ou les cas de suicides au travail (4) qui ont explosé, par exemple, en France ces dernières années. C’est l’autre visage de la supposée “liberté” de l’individu dans la société capitaliste : convertir en échec personnel ce qui, en réalité, est l’incapacité du mode de production d’assurer, derrière ses valeurs d’équilibre budgétaire, ses marchandises, son profit et son accumulation, la satisfaction des besoins humains les plus élémentaires. Pour que l’humanité puisse survivre, il faut que le capitalisme soit balayé de la surface de la terre.
Dámaso, (20 novembre 2012)
(1) La Troïka désigne les experts représentant la Commission Européenne, la Banque Centrale Européenne et le FMI, chargés d'auditer la situation économique des pays européens en difficulté, comme la Grèce ou l’Espagne, et notamment l'état de leurs finances publiques dans le cadre de l'accord de refinancement négocié de leur dette en mai 2010 (NdT).
(2) Alfredo Perez Rubalcaba, déjà membre du gouvernement de Felipe Gonzalez dans les années 1990, a été, entre autres, ministre de l’intérieur de 2006 à 2010, puis vice-premier ministre et porte-parole du gouvernement “socialiste” entre 2010 et 2012. Nommé secrétaire général du PSOE depuis février 2012, il se présente aujourd’hui comme le “chef de file de l’opposition” (NdT).
(3) On estime qu’aujourd’hui, en Espagne, 600 000 familles vivent sur la pension des anciens dont le logement déjà payé se transforme en refuge auquel ont recours les expulsés ou les familles qui ne peuvent payer leur loyer.
(4) Voir pour le premier cas, notre article sur : es.internationalism.org/book/export/html/2407. Et pour le second : fr.internationalism.org/ap/2000s/2010s/2010/213_suicides
Géographique:
- Espagne [1]
Rubrique:
Le grand absent du film «Après Mai»: l’expérience ouvrière
- 1811 reads
Eeuku4vzPkg [2]
Au mois de novembre 2012 est sorti le film Après Mai du réalisateur Olivier Assayas. En grande partie autobiographique, Olivier Assayas retrace la vie d’un groupe de jeunes pris dans l'effervescence politique de l’après-Mai 68. Le réalisateur fait ainsi revivre son expérience politique de l’époque : les manifestations, les collages d’affiches, les distributions de tracts, les divisions entre trotskistes, maoïstes et anarchistes... Par petites touches, le film montre les impasses dans lesquelles ces organisations gauchistes vont entraîner cette jeunesse de l’après-Mai. Le féminisme est ainsi montré à travers le refus de la soumission d’une personne vis-à-vis de son compagnon. Le film met en exergue les luttes de libération nationale, notamment à travers une réunion sur une place publique en Italie où un film est projeté par des éléments qui semblent appartenir au mouvement maoïste et où on glorifie la « lutte d’un peuple » (difficile de savoir lequel) qui a « chassé l’impérialisme américain » tant honni. L’anti-fascisme est également très présent à travers la confrontation entre des jeunes et des individus qu’ils stigmatisent comme « fascistes ». La question de l’autogestion, à travers une discussion dans un chalet, est également explorée sans oublier la question du pacifisme, que l’on voit à travers des réunions festives, où le peace and love s'affirme dans le sillage du mouvement étudiant qui avait surgi aux États-Unis « contre la guerre » et pour «la paix au Vietnam ». Le besoin de se réaliser individuellement, de « jouir sans entraves », notamment à travers l’expression artistique, sont soulignés par l'image. Un des jeunes, qui semble être le réalisateur du film, lit en effet le manifeste de l’Internationale situationniste1. Tout ceci constitue un bon tableau de ce qu’a été « l’après-Mai ».
Par contre, est complètement absent dans ce film ce qui a fait peur à la bourgeoisie à l'époque : la lutte massive de la classe ouvrière ! Pas une seule fois dans les discussions qu’ont entre eux les protagonistes du film n’est abordée ce qui fut la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier : neuf millions de grévistes ! Pas une réflexion pour comprendre la signification historique de cette grève ! Certainement que ce manque a du frustrer certains (es) qui sont allés voir ce film, ou en étonner d’autres. Mais doit-t-on être surpris par ce manque ? En réalité, pas vraiment, car les organisations gauchistes faisaient tout pour que la réflexion n’ait pas lieu. S’appuyant sur l’illusion très présente à l’époque au sein de la jeunesse que la révolution était « au coin de la rue », ils arrivaient à entraîner celle-ci dans des impasses, dans l’activisme qui allait mener à la démoralisation, voire au suicide, comme le montre un autre film de Romain Goupil : Mourir à trente ans.
Est-ce pour cela que dans une interview donnée au journal l’humanité datée du 14 novembre Olivier Assayas déclarait : « L’obsession de la politique était partout… Et c’est vrai qu’après un tel événement, elle formait une espèce de surmoi qui pouvait être étouffant. Il y a quelque chose de violent et de triste dans le gauchisme… »
Face à un « oubli » de taille, ce film doit être l’occasion de revenir sur l’après-Mai 68 mais du point de vue des révolutionnaires. Comme dit plus haut, Mai 68 fut la plus grande grève de l’histoire du mouvement ouvrier. Cette reprise de la lutte ouvrière n’a pas eu lieu qu’en France. Cette dernière était partie intégrante d’un mouvement international en réaction aux premiers effets de la crise économique ouverte : "Dans tous les pays industriels, en Europe et aux Etats-Unis, le chômage se développe et les perspectives économiques s'assombrissent. L'Angleterre, malgré une multiplication de mesures pour sauvegarder l'équilibre, est finalement réduite fin 1967 à une dévaluation de la Livre Sterling, entraînant derrière elle des dévaluations dans toute une série de pays. Le gouvernement Wilson proclame un programme d'austérité exceptionnel : réduction massive des dépenses publiques..., blocage des salaires, réduction de la consommation interne et des importations, effort pour augmenter les exportations. Le premier janvier 1968, c'est au tour de Johnson [Président des États-Unis] de pousser un cri d'alarme et d'annoncer des mesures sévères indispensables pour sauvegarder l'équilibre économique. En mars, éclate la crise financière du dollar. La presse économique chaque jour plus pessimiste, évoque de plus en plus le spectre de la crise de 1929 (...) Mai 1968 apparaît dans toute sa signification pour avoir été une des premières et une des plus importantes réactions de la masse des travailleurs contre une situation économique mondiale allant en se détériorant" (Révolution Internationale, ancienne série n° 2, printemps 1969).
C’est ainsi qu’il y aura des luttes en Argentine et en Italie en 1969, en Allemagne et en Pologne en 1970, en Espagne en 1974, en Angleterre dans les années 1970, etc. Ce resurgissement des luttes à l’échelle internationale signifiait la fin de la contre-révolution faisant suite à l'échec de la Révolution en Russie dans les années 1920 et à l’ouverture d’une perspective vers des affrontements de classes qui allaient progressivement tendre à se généraliser.
Dans le même temps, ces premières luttes allaient voir timidement renaître les forces révolutionnaires à l’échelle internationale. Le mouvement massif de la classe ouvrière a remis à l’ordre du jour l’idée de la révolution communiste dans de nombreux pays. Le mensonge du stalinisme qui se présentait comme « communiste » et « révolutionnaire » a commencé à se lézarder. Comme le montre le film, cela allait profiter dans un premier temps aux groupes maoïstes et trotskistes. Et le développement des luttes suivi de l'effondrement du bloc de l'Est, les débuts de la remise en cause de l'emprise des syndicats, de la fonction de la farce électorale et démocratique comme instruments de la domination bourgeoise, allaient amener une petite minorité à se tourner vers les courants politiques qui, par le passé, avaient dénoncé le plus clairement le rôle contre-révolutionnaire des syndicats et la mystification parlementaire. Vers ceux qui avaient le mieux incarné la lutte contre le stalinisme : les groupes issus de la Gauche Communiste. C’est ainsi que va réapparaître sur les étals des librairies politisées qui ouvraient à l’époque, les écrits de Pannekoek, Görter, Rosa Luxembourg… De nouveaux groupes vont apparaître qui vont se pencher sur cette expérience de la Gauche Communiste et ses courants divers : les conseillistes, la Gauche italienne ou allemande... La notion de Parti faisant trop penser au stalinisme, ce sont davantage les positions conseillistes qui auront dans un premier temps un relatif succès. Cette effervescence politique allait voir surgir des groupes conseillistes en plus de ceux déjà présents, avec un certain succès en Europe : par exemple ICO en France, Solidarity en Grande-Bretagne. Une conférence internationale sera même organisée en Scandinavie en septembre 1977. Ce renouveau des positions de la Gauche Communiste allait se manifester aussi par la naissance et le développement de notre organisation, le Courant Communiste International2.
Dans l’interview citée plus haut, Olivier Assayas poursuivait en disant : « Mais, en même temps, la jeunesse avait foi dans le futur, dans la transformation possible de la société. Est-ce dépassé aujourd’hui ? Aux jeunes de se poser la question, de confronter leur jeunesse à la nôtre ».
Vis-à-vis des questions que pose Assayas, la réalité a montré ces dernières années que la jeunesse ne baissait pas les bras, qu’elle ne courbait pas l’échine vis-à-vis des attaques que lui imposait la bourgeoisie. On l’a vu, par exemple, lors de la lutte contre le CPE en 20063. Dernièrement, on a vu encore cette nouvelle génération très présente dans le mouvement des « Indignés », en Tunisie, Egypte, Israël, Etats-Unis, Espagne, Grèce, etc. Outre le fait de résister aux attaques liées à la crise historique du capitalisme, ces luttes ont fait surgir tout un tas de questionnements nourris par l’indignation face au capitalisme. Ceci s’est traduit par des discussions voulant comprendre le pourquoi de cette crise, comprendre qui pouvait changer la société et comment, pour quel futur. Ces questions ne sont pas nouvelles ! On peut les retrouver parmi la jeunesse de mai et de l'après- Mai 68. Mais, aujourd’hui, elles se posent avec encore plus d’acuité dans le contexte de no future que le capitalisme impose à l’ensemble de l’humanité. Se poser ces questions, comme la nouvelle génération se les pose (et pas seulement la nouvelle génération), c’est déjà les prémices permettant de dire qu’une transformation de la société est possible. Il ne s’agit pas, comme le dit Assayas, de confronter une jeunesse à une autre qui a fait mieux que l’autre ou pas.
« Le développement du chômage et des attaques contre toutes les conditions de vie de la classe ouvrière, de même que le déchaînement de la barbarie guerrière dans les pays de la périphérie, ne peuvent que continuer à balayer le mythe d’un capitalisme ‘à visage humain’ et les dernières illusions sur la possibilité de reformer ce système décadent. C’est aux nouvelles générations de la classe ouvrière qu’il revient de reprendre le flambeau des combats menés par leurs aînés en sachant en tirer les principaux enseignements pour que la future vague révolutionnaire mondiale soit victorieuse et permettre l’édification d’une nouvelle société sans classe, sans guerre et sans exploitation : la société communiste mondiale. Ce sont les nouvelles générations qui doivent faire vivre dans la pratique de leurs combats massifs et solidaires le vieux mot d’ordre du mouvement ouvrier : prolétaires de tous les pays, unissez- vous ! » (Citation de la brochure Mai 68 et la perspective révolutionnaire)4.
Anselme (15 janvier)
1 fr.internationalism.org/rinte80/debord.htm
2 fr.internationalism.org/rinte80/20ans.htm et fr.internationalism.org/rint/123_30ans
3 fr.internationalism.org/ri368/cpe.htm
4 fr.internationalism.org/files/fr/mai_68.pdf
Rubrique:
Manifestations du 1er décembre à Mexico: derrière le triomphe de Peña Nieto, la provocation et la répression
- 1385 reads
Le jour même de l’investiture du nouveau président du Mexique et alors que se déroulaient des manifestations contre lui, de violents affrontements avec la police ont eu lieu en plein centre de Mexico, quadrillé par un service d’ordre impressionnant, sous l’impulsion de provocateurs infiltrés dans des groupes de jeunes manifestants, et notamment en excitant de petits groupes anarchistes. Les charges policières très violentes se sont soldées par un mort, plusieurs dizaines de blessés et près d’une centaine d’arrestations arbitraires. Aujourd’hui, encore une quinzaine d’inculpés victimes de cette répression restent en prison dans l’attente de leur procès. Notre section au Mexique a rapidement publié un article que nous reprenons ici pour tenter de tirer les principales leçons de ces événements pour notre classe.
Le 1er décembre, alors que Peña Nieto était investi comme nouveau président du Mexique1, des manifestations hostiles à son arrivée au pouvoir se déroulaient dans les rues. La pesante campagne électorale de la bourgeoisie avait réussi à ce que de larges masses d’exploités nourrissent l’espoir de voir les partis de la bourgeoisie, la démocratie et les élections, comme des instruments encore utiles pour s’opposer aux malheurs qu’impose le capitalisme. Cette confusion, qui empêche de voir le fond du problème et de désigner le capitalisme comme le véritable ennemi, a en même temps engendré un sentiment d’impuissance. Ce dernier se transforme parfois en bouillon de culture et se traduit par des actes de désespoir ouvrant ainsi la porte à toutes sortes de provocations.
Il est certain que le mécontentement et le ras-le-bol face à l’action des gouvernements se poursuivent et continuent à croître. Mais ceci, d’une manière qui ne favorise pas (du moins dans l’immédiat) une prise de conscience et une dynamique d’unité. D’un côté existe l’idée permanente qu’une force sociale alternative pourrait émerger sous la forme d’un “mouvement citoyen”, de l’autre, celle consistant à orienter cette rage exclusivement à travers des actions aveugles et désespérées. Ces dernières, même si elles se prétendent radicales, n’expriment rien d’autre qu’un volontarisme propre aux classes sans perspective historique. Ni l’une ni l’autre de ces deux formes d’expression ne conduisent à stimuler l’unité de la lutte. Au contraire, ces phénomènes sont les produits d'une perte d’identité politique et de l’infiltration d’idéologies étrangères au prolétariat, renforçant la confusion, l’impuissance et la division. C’est pour cela que le capital lui-même assure en maintes occasions la promotion de ces deux formes de manifestations.
Confusion et division, une ambiance propice à la provocation
Dans ce contexte, les manifestations du 1er décembre expriment un véritable mécontentement et un rejet ouvert de la politique qui prépare des coups plus forts contre les conditions de vie des exploités, mais ne trouvent pas les chemins qu’il faudrait emprunter pour y répondre. La bourgeoisie a donc su profiter de cette confusion de manière à ce que les forces de police du nouveau gouvernement fédéral, en lien avec celles du gouvernement de gauche de la capitale, se partagent les tâches pour monter une véritable provocation. Ils ont travaillé de manière coordonnée : d’abord, une de ces forces policières a préparé un scénario d’intimidation une semaine auparavant, en dressant des barrières métalliques pour fermer les avenues et les stations de métro. Après, les deux corps de police sont intervenus, profitant des actions confuses des manifestants, pour donner en réponse un assaut plus violent utilisant massivement des gaz éternuant et des balles en caoutchouc, causant des blessés, suscitant aussi l’indignation et la peur. Ils ont ensuite profité de la situation pour encercler et emprisonner de façon arbitraire les manifestants (y compris de simples passants). Parmi tout ce désordre, on notait la présence importante de groupes d’agents provocateurs en civil armés de chaînes (comme l’ont mis en évidence les photos diffusées par les réseaux d’Internet), qui se sont consacrés non seulement à repérer et ficher les manifestants mais de plus à les exciter à casser des vitres.
Ce qui s’est passé le 1er décembre a donc été un piège très bien planifié par la bourgeoisie. Il a été rendu possible par la confusion et le désespoir engendrés par la campagne électorale. Le stratagème cherchait non seulement à discréditer les protestations de jeunes qui continuent à rejeter le président élu (même si ces protestations restent très confuses) mais, surtout, à envoyer un avertissement intimidant à tous les travailleurs. L’intention est de les prévenir qu’au moment des attaques plus brutales envers leurs conditions de vie et de travail en général, les mobilisations ne seront pas tolérées. Elles devront s’attendre à être très mal reçues par un appareil répressif qui a déjà sorti ostensiblement les crocs ; appareil répressif provenant à la fois du gouvernement fédéral et du gouverneur de la capitale2, montrant une fois de plus que les partis se différencient seulement par la couleur qu’ils arborent et le verbiage qu’ils utilisent, mais se retrouvent unis dans leur chair pour défendre les intérêts du capital. Effectivement, le PRI ne doit pas revenir au pouvoir sans que tous les partis, comme toujours, n’activent leur union sacrée pour protéger la gouvernance qui convient à leurs petites affaires capitalistes.
Les affrontements et les dégâts qui se sont déroulés comme réponse au retour du PRI au gouvernement, ont pu faire les titres de première page des quotidiens, capter l’attention des porte-paroles officiels et mettre sans doute en évidence l’attitude bestiale de ceux qui nous gouvernent, que ce soit le PRI ou le PRD. En quoi ces moyens ont-ils permis de faire avancer la prise de conscience ? Quel rôle peuvent jouer les exploités et en particulier la classe ouvrière dans ce type d’expressions ? Quelle différence existe t-il entre les appels à suivre un genre de messie comme López Obrador et suivre une minorité jetant des pierres et des cocktails Molotov ?
Le mécontentement qui se nourrit de la misère qu’impose le capital et la colère face à l’action prédatrice des gouvernements, réclament des ripostes massives et conscientes dans lesquelles les exploités et les opprimés ne seraient pas de simples pions aveugles ou des victimes de la répression, mais des sujets actifs, capables de prendre en mains leur propre combat et définir leurs buts.
Comment peuvent lutter les exploités
La seule classe qui puisse transformer le monde que le capital est en train de détruire à toute vitesse, maintenant dans l’exploitation et la misère des millions de personnes, c’est le prolétariat. Mais cette classe se voit soumise à un bombardement idéologique incessant qui cherche à éviter que ne se consolident les armes principales sur lesquelles elle peut compter, à savoir : sa conscience et son organisation. La bourgeoisie tente donc de la domestiquer, de la réduire à la condition de citoyenneté, à lui faire espérer tout du vote et du cadre institutionnel comme elle le fait avec les autres classes, telles que la petite-bourgeoise, elle aussi opprimée par la classe dominante mais qui n’a pas de perspective d’avenir. C'est pour cela qu’elle la fait cohabiter dans son schématisme social avec le prolétariat, pour essayer de le contaminer de son désespoir, de son manque de confiance et ainsi encourager des ripostes aveugles et désespérées. Non seulement ces dernières n’aident en rien le processus de prise de conscience et le renforcement de la lutte contre le capital, mais se retournent en terrain propice pour que se glissent les provocations.
C’est pourquoi l’infiltration de l’idéologie bourgeoise ou petite-bourgeoise dans les rangs des prolétaires est un problème avec lequel on doit se confronter, c’est un danger qui nécessite qu’on le prenne en considération et que l’on y réfléchisse de manière ouverte.
Le résultat des charges policières du 1er décembre a eu pour conséquence la capture d’un peu moins d’une centaine de personnes qui se sont vues intenter des procès, qui ont subi des tortures et des vexations. Cela a permis en plus de lancer une campagne contre les anarchistes et contre quiconque ne se laisse pas encadrer dans les normes de leur démocratie, enfonçant davantage le clou de la confusion.
Face aux agressions contre les conditions de vie des travailleurs, comme celle de la “réforme du travail” menaçant d’augmenter les impôts, les prix et la répression, l’unique voie dont disposent les exploités est la lutte. Mais cela, sans tomber ni dans les illusions derrière les partis de gauche de la bourgeoisie (y compris le PRD, le PT, le Morena…)3, ni en menant des actions désespérées prônées par des groupes contaminés par l’idéologie petite-bourgeoise. Le véritable combat prolétarien nécessite des expressions massives et conscientes qui permettent le débat et la réflexion collective ouverte.
Nous ne prétendons défendre ni le pacifisme ni le légalisme. Le marxisme, dans son analyse matérialiste de l’histoire, peut comprendre que le prolétariat est l‘unique classe révolutionnaire capable de détruire le système capitaliste. Pour réussir cela, il devra recourir à la violence, mais pas de manière aveugle et comme produit du désespoir. C’est une violence consciente qui sera utilisée par les masses4. Cette conscience prolétarienne n'émerge pas comme imitation ou produit d’actions individualistes, même si elles se prétendent "héroïques" mais provient de la réflexion et de la compréhension de la condition d’exploité. De cette compréhension, elle tire sa force, son organisation, son unité, sa conscience. Elle possède ses propres méthodes de lutte, tout à fait contraires aux actions stériles que nous avons pu identifier dans les mouvements récents de protestation.
Revolution Mundial (5 décembre 2012)
1 L’investiture d’Enrique Peña Nieto au Mexique signe le retour au pouvoir du PRI- dénommé Parti Révolutionnaire Institutionnel (sic !) depuis 1946, ex-PNR (parti national révolutionnaire) puis PRM (parti de la révolution mexicaine) qui se réclame de l’héritage de la révolution nationale mexicaine de 1910 et a exercé la fonction gouvernementale de façon quasiment ininterrompue depuis 1928, à l’exception de la période entre 2000 et 2012 où c’est le PAN, parti de “droite” plus marqué par une politique d’alliance avec son puissant voisin, les Etats-Unis, qui a pris les rênes du pouvoir sous Fox entre 2000 et 2006 puis Calderon entre 2006 et 2012(NdT).
2 La municipalité de Mexico est, elle, dirigée par le PRD (Parti de la Révolution Démocratique), parti “de gauche” qui provient d’une scission du PRI depuis 1989. Il est d’ailleurs significatif de noter que, lors de l’investiture de Peña Nieto, les trois partis, le PRI, le PAN et le PRD viennent de cosigner un “Pacte social” qui consacre leur volonté de travailler ensemble “pour le bien de la Patrie”, c’est-à-dire pour mener des attaques plus féroces contre les travailleurs… (NdT)
3 Le PT (Parti du Travail) est une des composantes de la gauche de tendance “gauchiste”. Quant au MORENA (Mouvement de Régénération Nationale), animé par l’ex-candidat du PRD, López Obrador, il fait désormais figure de gauche parlementaire plus radicale dans son opposition au gouvernement, à l’instar de Die Linke en Allemagne ou du Front de Gauche de Mélenchon en France (NdT).
4 Voir notre article “Terreur, terrorisme et violence de classe”, in Revue Internationale numéro 14, 3e trim. 1978 et le texte de notre résolution sur le même sujet publié dans le numéro 15 de notre Revue.
Géographique:
- Mexique [3]
Rubrique:
ICConline - février 2013
- 1150 reads
Derrière le «défi alimentaire», la barbarie du capitalisme décadent!
- 2252 reads

Un milliard d'êtres humains sont victimes de sous-nutrition ! (1) A cela, il faut ajouter la misère croissante d'une masse paupérisée largement majoritaire dans la population mondiale. Malgré les progrès techniques et des capacités de produire sans précédent, une grande partie du monde crève encore de faim !
Comment expliquer un tel paradoxe ? La classe dominante a ses réponses. Ce phénomène monstrueux serait lié à un « épuisement des ressources » (2) et à la « croissance démographique » (3).
En réalité, la pénurie chronique qui enfle comme la peste n'est que le produit du système capitaliste, de la loi du profit. Et c'est cette loi qui aboutit à une absurdité au regard du marché même et des hommes, la surproduction de marchandises. Cette dernière induit un phénomène totalement irrationnel et scandaleux, que la bourgeoisie passe largement sous silence : le gaspillage.
Un article du Monde rend compte d'une étude récente et révèle que « 30 à 40% des 4 milliards de tonnes d'aliments produites chaque année sur la planète ne finissent jamais dans une assiette »(4). Si l'étude ne peut mettre en évidence les causes profondes du gaspillage sans remettre en cause le capitalisme, soulignant qu'en Europe et aux États-Unis les consommateurs eux-mêmes jettent la nourriture à la poubelle, elle reste à la surface des choses en expliquant que de tels gestes sont simplement liés au conditionnement des produits et au marketing (avec ses « promotions ‘deux pour le prix d'un’ »). L'étude n'ose révéler que le gaspillage est surtout généré par la surproduction et la recherche du profit à court terme, conduisant les industriels à multiplier « des infrastructures inadaptées et des lieux de stockage peu performants » avec des « défaillances les plus marquées (...) en aval de la chaine de production ». Cette étude oublie de dire qu'une marchandise de moins en moins bonne qualité, pléthorique, qui ne peut être vendue faute de client, s'entasse dans ces lieux volontairement négligés du fait qu'ils s'avèrent trop coûteux ! Pour faire des économies et du profit, les capitalistes spéculent et en arrivent souvent à détruire délibérément des marchandises, notamment des denrées alimentaires. Pour les mêmes motifs, « jusqu'à 30% des cultures de légumes au Royaume-Uni ne sont jamais récoltées ! » Les productions sont donc souvent détruites afin de ne pas faire chuter le cours des marchandises. Par exemple, certains producteurs qui ne peuvent pas vendre leurs fruits ou légumes, même à perte, les aspergent de gasoil pour maintenir artificiellement les cours.
Dans les pays dits « en voie de développement », le même phénomène existe, amplifié et même aggravé dès le début de la chaine de production, « entre le champ et le marché, du fait de transports locaux inadéquats », aboutissant à des pertes colossales. Les « déficiences » peuvent être telles que « dans le Sud-Est asiatique (…) les pertes de riz oscillent entre 37 et 80% de la production totale en fonction du stade de développement du pays, la Chine se situant par exemple à 45% et le Vietnam à 80% ».
Le rapport souligne aussi une sombre réalité : « Cette perte nette ne se limite pas aux déchets générés par les aliments non consommés. Le gâchis est visible à tous les niveaux de la chaîne de production alimentaire, dans l'utilisation des terres, de l'eau, de l'énergie. Environ 550 milliards de mètres cubes d'eau sont ainsi perdus pour faire pousser des récoltes qui n’atteindront jamais les consommateurs. »
Selon les ingénieurs de cette étude, une simple exploitation rationnelle des ressources existantes permettrait « d'offrir 60 à 100% de nourriture en plus sans augmenter la production tout en libérant du terrain et en diminuant la consommation d’énergie ». Nous l'affirmons ici tout net : cette perspective « de bon sens » est impossible à réaliser dans le système capitaliste ! Le problème ne réside pas du fait d'un manque de compétences ou de volonté : il réside avant tout dans les contradictions d'un système économique qui ne produit pas pour satisfaire les besoins humains, dont il se soucie comme d'une guigne, mais pour le marché, pour réaliser un profit. De là découlent les pires absurdités, l'anarchie et l'irrationalité la plus totale.
On peut prendre, parmi des milliers d’exemples, un des plus scandaleux : au moment où des enfants d'Afrique sub-saharienne criaient le plus famine, alors qu'étaient imposés des quotas laitiers et un gel des terres en Europe, des associations caritatives et des ONG quémandaient des fonds à coups de campagnes publicitaires coûteuses et culpabilisantes, pour financer des stocks de lait en poudre destinés à ces enfants affamés, qui manquaient également... d'eau ! Si l'affaire n'avait pas été aussi triste et tragique, on aurait presque pu en faire un mauvais gag.
Le système capitalisme est un mode de production obsolète qui devient une force destructrice dressée contre la civilisation. Il génère et active toutes les pulsions mortifères. Ses contradictions, face aux tragédies croissantes qu'il engendre, exacerbent les comportements les plus irrationnels et antisociaux. La famine et le gaspillage, la pauvreté et le chômage, comme les guerres, sont ses enfants naturels. Mais en son sein, il cultive aussi sa négation et son propre fossoyeur, la classe ouvrière, celle des exploités tournés vers le futur. Eux seuls pourront mettre fin à ce système putride. Plus que jamais, l'alternative reste bien « socialisme ou barbarie » !
WH (1er janvier)
(1) Cela signifie une nourriture journalière inférieure à la quantité répondant aux besoins de l’organisme d'une personne (2500 calories par jour).
(2) Tout mensonge a un fond de vérité. Il n'y a pas, en soi, un manque de ressources. Par contre, le système capitaliste génère des situations qui conduisent à la destruction massive de ces dernières.
(3) Nous serons théoriquement autour de 9 milliards en 2050.
(4) Rapport Global Food Waste Not, Want not, publié le jeudi 10 janvier 2013 par l'Institution of Mechanical Engineers (IME), organisation britannique des ingénieurs en génie mécanique. (Source : https://écologie.blog.lemonde.fr [4])
Récent et en cours:
- Crise économique [5]
Rubrique:
Massacre de Newtown aux États-Unis: la descente du capitalisme dans la barbarie.
- 1390 reads
Nous publions, ci dessous, la traduction de larges extraits d'un article publié par notre section aux États-Unis suite à la tuerie dans la ville de Newtown aux États-Unis.
Comme lors des drames précédents, l'horreur de ce massacre sans mobile de 27 enfants et adultes par une seule personne nous a tous glacé le sang, or, c'est le treizième événement de ce genre dans ce pays pour la seule année 2012. Et les États-Unis ne sont pas le seul pays à connaître de telles abominations : En Chine, par exemple, le jour même du massacre de Newtown, un homme a blessé avec un couteau 22 enfants dans une école.
Il existe de plus en plus d'individus, qui se sentent tellement écrasés, isolés, incompris, rejetés que les tentatives de suicide des jeunes s'accroissent de plus en plus ; et le fait même du développement de cette tendance montre que face à la difficulté qu'ils ont de vivre, ils ne voient aucune perspective de changement qui leur permettrait d'espérer une évolution positive de leurs conditions de vie.
Cela provoque de telles souffrances et de tels troubles chez certains qu'ils en rendent responsables l'ensemble de la société et en particulier l'école qui doit normalement ouvrir sur la possibilité de trouver un emploi et qui n'ouvre souvent que sur le chômage et qui est devenu le lieu où se créent de multiples frustrations et où s'ouvrent bien des blessures ; le meurtre aveugle – suivi par leur suicide –, leur apparaît alors le seul moyen de montrer leur existence et leur souffrance.
Les différents aspects de la décomposition, et notamment l'horrible massacre de Newtown, constituent un levier dont la bourgeoisie se sert contre toute recherche d'une alternative au système de mort dans lequel nous vivons. Derrière la campagne sur le fait de poster des policiers à la porte des écoles, l'idée qui est instillée est celle de la méfiance à l'égard de tout le monde, ce qui vise à empêcher ou détruire tout sentiment de solidarité au sein de la classe ouvrière. D'un autre côté, cela signifie que l'on ne peut avoir confiance que dans l’État et dans la répression qu'il mène alors qu'il est le gardien du système capitaliste qui est la cause des horreurs que nous sommes en train de vivre.
Le massacre de vies innocentes à l’école élémentaire de Sandy Hook à Newtown (Connecticut) est un rappel horrible de la nécessité d’une transformation révolutionnaire complète de la société. La propagation et la profondeur de la décomposition du capitalisme ne peuvent qu’engendrer d’autres actes aussi barbares, insensés et violents. Il n’y a absolument rien dans le système capitaliste qui puisse fournir une explication rationnelle à un tel acte et encore moins rassurer sur le futur d'une telle société (...).
Au lendemain de la tuerie dans l’école du Connecticut, et comme cela a également été le cas pour d’autres actes violents que nous avons en mémoire, tous les partis de la classe dirigeante ont suscité un questionnement : comment est-il possible qu'à Newtown, réputée pour être la ville « la plus sûre d'Amérique », un individu dérangé ait trouvé le moyen de déchaîner tant d’horreurs et de terreurs ? Quelles que soient les réponses proposées, la première préoccupation des médias est de protéger la classe dirigeante et de dissimuler son propre mode de vie meurtrier.
La justice bourgeoise réduit le massacre à un problème strictement individuel, suggérant en effet que le geste d’Adam Lanza s’explique par ses choix, sa volonté personnelle de faire le mal, penchant inhérent à la nature humaine. Elle prétend que rien de psychologique, ni de comportemental explique l’action du tireur. Nancy J. Herman, professeur agrégée de sociologie à l’Université de Central Michigan explique même qu' « aujourd’hui, la médicalisation du comportement déviant ne nous permet pas d’accepter la notion de ‘Mal’. La disparition de l’imagerie religieuse du péché, la montée en puissance des théories déterministes du comportement humain et la doctrine de la relativité culturelle nous ont amené à exclure la notion de mal de nos discours. » En conséquence, la justice avance comme solution le renouveau de la foi religieuse et la prière collective !
De cette façon, la justice nie tous les progrès réalisés depuis de nombreuses décennies par les études scientifiques sur le comportement humain qui, pourtant, permettent de mieux comprendre l’interaction complexe entre l’individu et la société (...). C’est également ainsi que la justice justifie sa proposition d’emprisonner tous ceux qui relèvent d’un comportement déviant, en réduisant leurs crimes à un acte immoral. (…)
La nature de la violence ne peut pas être comprise si on la dissocie du contexte social et historique où elle s’exprime. Les maladies mentales existent depuis longtemps, mais il semble que leur expression ait atteint leur paroxysme dans une société en état de siège, dominée par le « chacun pour soi », par la disparition de la solidarité sociale et de l’empathie. Les gens pensent qu’ils doivent se protéger contre… contre qui, d'ailleurs ? Tout le monde est un ennemi potentiel et c’est une image, une croyance renforcée par le nationalisme, le militarisme et l’impérialisme de la société capitaliste.
Pourtant la classe dirigeante se présente comme le garant de la « rationalité » et contourne soigneusement la question de sa propre responsabilité dans la propagation des comportements anti-sociaux. Ceci est encore plus flagrant lors des jugements par la cour martiale de l’armée américaine des soldats ayant commis des actes atroces, comme dans le cas de Robert Bales qui a massacré et tué 16 civils en Afghanistan dont 9 enfants. Pas un mot, naturellement, sur sa consommation d’alcool, de stéroïdes et de somnifères pour calmer ses douleurs physiques et émotionnelles, ni sur le fait qu’il a été envoyé sur l’un des champs de bataille les plus violents d'Afghanistan pour la quatrième fois !
Si les médias, les films et les jeux violents enseignent et renforcent l'idée que la rixe et le meurtre sont des moyens acceptables pour résoudre un conflit, ils ne sont cependant pas à l’origine des comportements anti-sociaux, comme le proclament les politiciens de gauche. C’est à la fois la concurrence au cœur du fonctionnement du mode capitaliste et ses expressions militaristes qui alimentent les médias et le contenu des jeux vidéo.
Lorsque les enfants grandissent dans une culture qui célèbre la violence comme un moyen acceptable de « gagner » et quand la société enseigne qu’il faut « gagner » à tout prix, ils sont parfaitement susceptibles d’acquérir ces « valeurs ». Sous le capitalisme, ces « valeurs » sont omniprésentes et ce que nous voyons dans les médias et les jeux vidéo n’en est que le reflet.
(…) La société développe une dangereuse culture de la suspicion et de la peur des autres en préconisant le « chacun pour soi. » Beaucoup de personnes finissent par privilégier le meurtre plutôt que la solidarité humaine comme solution aux différents, aux conflits et aux problèmes personnels.
Tout ceci est à l’origine de l’obsession de la mère d’Adam Lanza pour les armes à feu et de son habitude d’emmener ses enfants, y compris son fils, sur les stands de tir. Nancy Lanza est une « survivaliste ». L’idéologie du « survivalisme » est fondée sur le « chacun pour soi » dans un monde pré et post-apocalyptique. Elle prône l’autonomie, ou plutôt la survie individuelle, en faisant des armes un moyen de protection permettant de mettre la main sur les rares ressources vitales. En prévision de l’effondrement de l’économie américaine, qui est sur le point de survenir selon les survivalistes, ces derniers stockent des armes, des munitions, de la nourriture et s'enseignent des moyens de survivre à l’état sauvage. (...) Est-ce si étrange qu’Adam Lanza ait pu être envahi par ce sentiment de « no future » ? Ou peut-être a-t-il vu dans ces enfants pleins de vie des concurrents futurs à éliminer ? Quel que soit le véritable état mental attribué à Adam Lanza, il est certain qu’il ne disposait pas d’un esprit serein, lucide et rationnel.
(…) N’écoutant que ses intérêts politiques répugnants, la faction de la classe dirigeante au pouvoir n’hésite pas à se servir de l’horreur suscitée par le massacre de l’école du Connecticut pour affaiblir la partie adverse (...). Pour sa part, la droite propose de renforcer l’appareil répressif afin que tout individu potentiellement dangereux puisse être enfermé. Dans leurs délires, ils voient les écoles comme des prisons où les professeurs deviendraient des policiers, transformant un lieu comme l’école en univers carcéral.
Il est naturel d’éprouver de l’horreur et une très grande émotion face au massacre d’innocentes victimes. Il est naturel de chercher des explications à un comportement complètement irrationnel. Cela traduit un besoin profond d’être rassuré, d’avoir la maîtrise de son destin et de sortir l’humanité d’une spirale sans fin d’extrême violence. Mais la classe dirigeante profite des émotions de la population et utilise son besoin de confiance pour l’amener à accepter une idéologie où seul l’État serait capable de résoudre les problèmes de la société.
Les révolutionnaires doivent affirmer clairement que c’est le maintien de la société divisée en classes et l’exploitation du capitalisme qui sont les seuls responsables du développement de comportements irrationnels qu’ils sont incapables d'éliminer ou seulement maîtriser.
Ana, (21 décembre 2012)
Géographique:
- Etats-Unis [6]
Rubrique:
«Crimes de guerre» au nord-Mali: le crime, c'est la guerre !
- 1406 reads
Les soupçons d'exactions commises par les troupes maliennes contre les « peaux claires » (personnes d'origine arabe et Touarègue) se multiplient au fur et à mesure que la guérilla islamiste recule dans la guerre qui se déroule en ce moment au nord-Mali.
Les « observateurs », qui à chaque conflit sont toujours presqu’aussi nombreux que les belligérants, se divisent : les uns invitent à la prudence et, à l'image de Saint-Thomas qui ne croit que ce qu’il voit, veulent croire à une guerre « propre » tant que le premier charnier n'a pas été découvert ; tandis que les autres lèvent les bras au ciel en criant « C'est exactement ce qu'on craignait, on ne pourra pas dire qu'on n'avait pas prévenu. »
Ces derniers ne prennent pas un risque énorme en pointant le danger de débordements guerriers sur les populations civiles. Il serait en revanche nettement plus acrobatique de chercher dans l'histoire une guerre qui se serait déroulée sans ses chapelets d'exécutions sommaires, de viols, de mutilations, de déportations arbitraires et d’humiliations de tous ordres. Ne serait-ce que pour la décennie écoulée, un rapide échantillonnage nous fait approcher le million de victimes, tandis que les guerres du 20e siècle ont tué plus de 231 millions de personnes.1
Lors de la Première Guerre mondiale, les troupes allemandes envahissaient la Belgique et le Nord et l'Est de la France en août 1914 : 5 000 civils wallons et une bonne centaine de français en feront les frais.
La guerre d'Espagne se déroule elle aussi dans un climat revanchard et pogromiste : la « terreur blanche » aura fait entre 80 000 (officiellement) et 200 000 (estimations d'historiens) victimes. La « terreur rouge » de son côté dépassera les 75 000 victimes, dont une bonne partie dans le clergé catholique.
La Seconde Guerre mondiale mettra la barre nettement plus haut. Les pogroms en Allemagne et en Pologne sont connus, les hauts faits de l'armée allemande ont été suffisamment documentés pour qu'on ne s'étale pas sur la question : dans le sud de la France, les SS ravageront des dizaines de villages en 1944 et dans le même temps, Oradour-sur-Glane verra 642 de ses habitants exécutés en une journée. Peu avant, l'Armée Rouge pénétrera en Allemagne et pendant deux ans, les habitants seront terrorisés, tués, violés, déportés... les historiens établissent un bilan de 600 000 victimes. Côté Pacifique, le Japon laissera une trace sanglante indélébile. On se limitera à citer le massacre de Manille en 1945 et ses 100 000 victimes.
Plus récemment, l'ex-Yougoslavie s'est illustrée avec de nombreux massacres dont celui de Srebrenica durant l'été 1995 reste le plus connu (8 000 morts), tout comme le conflit au Kosovo en 1999 avec ses 800 000 déportés.
En Afrique, enfin, les 800 000 morts au Rwanda en 1994, et la terreur permanente installée en République Démocratique du Congo depuis 1993, ne sont que deux exemples du climat de mort qui flotte sur le continent noir.
Il n'y a pas de guerre « propre », il n'y a pas de conflit armé qui ne s'accompagne pas de massacres de civils et de leur déportation. Cela n'est tout simplement pas possible car toute guerre s'accompagne d'un discours idéologique rempli de haine et de stigmatisation, construit pour entraîner l'adhésion de ceux qui vont devoir risquer leur vie sous l'uniforme, de ceux qui vont devoir trimer dix fois plus pour soutenir « l'effort de guerre »... Ce discours c'est celui du nationalisme qui fait porter à « l'étranger », celui d'en face, la responsabilité de tous les maux. Cette division nationaliste distille la haine sur des bases d'appartenance nationale, religieuse, ethnique... peu importe, finalement, tant qu'elle cache correctement les fondements impérialistes du conflit et la responsabilité des bourgeoisies nationales, et d'elles seules !
On a suffisamment répété aux Maliens que toute leur misère est de la faute des « Arabes ». Quand le rapport de force s'inverse, la conséquence est immédiate et inévitable : tout comme les Kosovars incarnaient tous le mal, tout comme les Allemands étaient « tous nazis », les « Arabes » sont tous fondamentalistes, et ils doivent payer : femmes, enfants, vieillards, ils sont tous responsables. La haine est aveugle !
Cela fait plus de vingt ans que le Mali est traversé par cette haine. Les exactions contre les « peaux claires » ne sont pas nouvelles : 50 morts à Léré en 1991 ; 60 morts à Gossi et Foïta en 1992, entraînant la fuite de dizaines de milliers de Touaregs de l'autre côté des frontières algérienne et mauritanienne ; plusieurs exécutions en 1994 autour de Ménaka, puis plusieurs dizaines à Tombouctou...
Le risque était donc important que le développement actuel du conflit conduise à des massacres toujours plus nombreux. Ce sera toujours le cas dans tous les conflits impérialistes et ce ne sont pas les quelques procès retentissants de grands « criminels de guerre » des années, voire des dizaines d'année après, qui viendront retenir le bras vengeur des combattants nourris de haine depuis toujours.
GD (31 janvier)
1 Milton Leitenberg, Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century (2006).
Rubrique:
ICConline - mars 2013
- 1047 reads
Grèce: soigner l’économie tue le malade
- 1354 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d'un article rédigé par notre section en Grande-Bretagne, World revolution, sur l'effondrement du système de soins en Grèce.
En décembre 2012, le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung rendait compte d’une visite en Grèce :
"En octobre 2012, le traumatologue Georg Pier rapportait les observations suivantes sur la Grèce : Des femmes sur le point d’accoucher se hâtaient désespérément d’un hôpital à l’autre ; mais comme elles n’avaient pas d’assurance-maladie ou suffisamment d’argent, personne ne voulait les aider à mettre leur enfant au monde.
Des gens, qui jusqu’à présent faisaient partie des classes moyennes, cherchaient des restes de fruits et de légumes dans les poubelles. (…)
Un vieil homme disait à un journaliste qu’il n’avait plus les moyens d’acheter les médicaments nécessaires pour soigner son problème cardiaque : sa pension avait été diminuée de 50% comme celle de beaucoup d’autres retraités. Il a travaillé pendant plus de quarante ans, pensant avoir fait les choses correctement ; maintenant, il ne comprend plus le monde.
Lorsque tu es admis dans un hôpital, tu dois apporter tes propres draps et ta propre nourriture. Comme le personnel d’entretien a été mis à la porte, les médecins et les infirmiers, qui n’ont pas reçu de salaire depuis des mois, ont commencé à nettoyer les toilettes. Il y a une pénurie de gants et de cathéters jetables. Devant les conditions hygiéniques déplorables dans plusieurs établissements, l’Union Européenne avertit du danger de propagation de virus infectieux."
Les mêmes conclusions étaient tirées par Marc Sprenger, chef du Centre Européen pour la Prévention et le Contrôle des Maladies (ECDC). Le 6 décembre, il alerta [les autorités] sur l’effondrement du système de santé et des mesures d’hygiène en Grèce, ajoutant que cela pouvait aboutir à une pandémie dans toute l’Europe. Il y a une pénurie de gants à usage unique, de blouses et de serviettes de désinfection, de boules de coton, de cathéters, de rouleaux de papier pour couvrir les tables d’examen médical. Les patients ayant des maladies infectieuses, comme la tuberculose, ne reçoivent pas le traitement nécessaire, ce qui entraîne l’augmentation du risque de propagation de virus résistants en Europe.
Un contraste frappant entre ce qui est techniquement possible et la réalité du capitalisme
Au 19e siècle, beaucoup de patients (jusqu’à un tiers parfois) mouraient à cause d’un manque d’hygiène à l’hôpital, en particulier les femmes pendant l’accouchement. Ces drames pouvaient s’expliquer en grande partie par l’ignorance, parce que beaucoup de docteurs ne se lavaient pas les mains avant un traitement ou une opération et, souvent, ils allaient avec des blouses sales d’un patient à l’autre.
Les découvertes en hygiène, de Semmelweis ou Lister par exemple, permirent une réelle amélioration. Les nouvelles mesures d’hygiène et les découvertes sur la transmission des germes permirent une forte réduction des maladies nosocomiales.
Aujourd’hui, l’utilisation des gants et des instruments chirurgicaux à usage unique est une pratique courante dans la médecine moderne. Mais, tandis que l’ignorance du 19e siècle est une explication plausible de la mortalité importante dans les hôpitaux, les dangers qui deviennent évidents dans les hôpitaux en Grèce ne sont pas une manifestation de l’ignorance mais une expression de la menace qui pèse sur l’humanité ; cette menace provient de la faillite d’un système de production totalement obsolète.
Si, aujourd’hui, la santé des habitants du cœur de la civilisation antique est menacée par le manque de fonds des hôpitaux ou par leur insolvabilité (ils ne peuvent plus acheter de gants à usage unique), si les femmes enceintes qui cherchent une prise en charge dans les hôpitaux sont renvoyées parce qu’elles n’ont pas d’argent ou pas d’assurance médicale, si les gens qui ont des maladies de cœur ne peuvent plus payer leurs médicaments…, cela devient une attaque contre la vie-même. Si, dans un hôpital, le personnel d’entretien, qui est indispensable dans la chaîne de l’hygiène, est licencié, si les docteurs et les infirmiers, qui n’ont pas reçu leur salaire depuis longtemps, doivent prendre en charge les tâches de nettoyage, cela apporte une lumière crue sur la "régénération" de l’économie. C’est le terme utilisé par la classe dominante pour justifier ses attaques brutales contre nous : la "régénération" se retourne en menace sur nos vies.
Après 1989, en Russie, l’espérance de vie a baissé de cinq ans à cause de l’effondrement du système de santé d’une part, mais aussi à cause de l’augmentation de la consommation d’alcool et de drogue. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement en Grèce que le système de santé est démantelé petit à petit pour s’effondrer simplement. Dans un autre pays en faillite, l’Espagne, le système de santé est également en train d’être démoli. Dans le vieux centre industriel qu’est Barcelone, de même que dans d’autres grandes villes, les services des urgences ne sont parfois ouverts que quelques heures, pour faire des économies budgétaires. En Espagne, au Portugal et en Grèce, beaucoup de pharmacies ne reçoivent plus de médicaments vitaux. Le laboratoire pharmaceutique allemand Merck ne fournit plus le médicament anti-cancéreux Erbitux aux hôpitaux grecs ; Biotest, un laboratoire qui vend du plasma sanguin pour le traitement de l’hémophilie et du tétanos, a arrêté de fournir ses produits à cause du non-paiement des factures depuis juin dernier.
Jusqu’à présent, ces conditions médicales désastreuses étaient connues principalement dans les pays africains ou dans les régions dévastées par la guerre ; mais maintenant, la crise dans les pays anciennement industrialisés a conduit à une situation telle que des domaines vitaux comme les soins de santé sont de plus en plus sacrifiés sur l’autel du profit. Ainsi, l’obtention d’un traitement médical n’est plus basé sur ce qui est techniquement possible : on ne reçoit le traitement que si on est solvable.1
Cette évolution montre que l’écart entre ce qui est techniquement possible et la réalité de ce système s’agrandit. Plus l’hygiène est menacée et plus nous risquons de voir apparaître des épidémies incontrôlables. Nous devons rappeler l’épidémie de grippe espagnole, qui s’est répandue à travers l’Europe après la fin de la Première Guerre mondiale, entraînant la mort de plus de vingt millions de personnes. La guerre, avec son cortège de famines et de privations, avait préparé les conditions de cette épidémie. La crise économique joue le même rôle dans l’Europe d’aujourd’hui. En Grèce, le taux de chômage frôlait les 25% au dernier trimestre de 2012 ; le chômage des jeunes de moins de 25 ans atteignait 57%, 65% des jeunes femmes sont sans emploi. Les prévisions indiquent toutes une augmentation plus rapide, jusqu’à 40% en 2015. La paupérisation accompagnant le chômage a déjà conduit à ce que "des zones résidentielles et des immeubles d’appartements ont été privés de fourniture de fuel pour défaut de paiement. Pour éviter d’avoir trop froid l'hiver chez eux, beaucoup de gens ont commencé à utiliser des poêles à bois ; les gens coupent le bois illégalement dans les forêts proches. Au printemps 2012, un vieil homme s’est donné la mort devant le parlement d’Athènes ; juste avant de mourir, il aurait crié : je ne veux pas laisser de dettes à mes enfants. Le taux de suicide a doublé en Grèce depuis ces trois dernières années."2
Après l’Espagne avec le détroit de Gibraltar, l’Italie avec Lampedusa et la Sicile, la Grèce est le point principal d’entrée pour les réfugiés qui fuient les zones dévastées par la guerre et les espaces paupérisés d’Afrique et du Moyen Orient. Le gouvernement a installé une gigantesque clôture le long de la frontière turque. Il a monté d’immenses camps de réfugiés dans lesquels plus de 55 000 clandestins étaient internés en 2011. Les partis politiques de l’aile droite essayent de susciter une atmosphère de pogrom contre ces réfugiés, leur reprochant d’importer des "maladies de l’étranger" et de s’emparer des ressources qui reviennent de droit aux "Grecs d’origine". Mais la misère qui conduit ces millions de gens à fuir leur pays natal et qui se répand inexorablement dans les hôpitaux et les rues de l’Europe provient de la même source : un système social qui est devenu un obstacle à tout progrès humain.
Dionis (04 janvier)
1Dans les pays "émergents" comme l’Inde, de nouveaux hôpitaux privés voient sans arrêt le jour. Ils sont accessibles uniquement aux riches patients et encore plus aux patients solvables qui viennent de l’étranger. Ils offrent des traitements qui sont beaucoup trop chers pour la majorité des Indiens et beaucoup de patients étrangers qui viennent en tant que "touristes médicaux" dans les cliniques privées indiennes n’ont pas les moyens de s’offrir leur traitement médical chez eux.
2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, décembre 2012.
Rubrique:
Ateliers de débats à Alicante (Espagne) : rien de plus pratique qu’une bonne théorie !
- 2342 reads
Le CCI a été invité à participer aux « Ateliers pour travailleurs indignés » organisés par « Asamblearios-TIA »[1] et nous avons décidé d’y participer activement.
Nous pensons que ces Ateliers répondent à un authentique intérêt pour l’éclaircissement des questions essentielles sur la compréhension politique du capitalisme et des alternatives qui peuvent nous en sortir. À partir des luttes immédiates et concrètes, ces camarades sont arrivés à la conclusion que la compréhension profonde de la réalité est nécessaire pour élaborer une théorie révolutionnaire. Nous soutenons avec enthousiasme leur initiative parce qu’elle ouvre un espace de débat nous permettant de nous faire collectivement une idée plus précise de la réalité qui nous étouffe et des moyens pour la combattre.
Ceci dit, nous devons reconnaître que nous ne disposons d’aucune recette ni de la moindre formule magique pour résoudre les questions posées par ces camarades. Ce dont nous sommes en revanche convaincus, c’est que lors de l’intervention dans les luttes, pour ne pas tomber dans les pièges de l’ennemi, ou tout simplement dans la démoralisation et la frustration, la meilleure et la plus profonde compréhension d’ensemble est nécessaire.
Ce qui différencie la plus parfaite des toiles d’araignée de l’œuvre d’un architecte, c’est le fait que l’homme, avant de réaliser son « œuvre », la représente dans sa tête et la réalise à partir d’un plan. Cette capacité à agir collectivement selon un objectif ou une volonté résultant de notre compréhension du réel s’appelle « théorie » et elle a contribué de manière essentielle au développement de l’humanité. Sans la capacité à analyser, à élaborer des conclusions et à agir en accord avec nos besoins et nos objectifs, nous serions toujours, sans doute, dans des sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs.
La théorie n’est pas du tout, du point de vue des travailleurs, le résultat d’un processus abstrait de pensée éloigné de la pratique ou des besoins immédiats. Bien au contraire, la théorie fait partie de la pratique même des révolutionnaires. Sans théorie, il ne peut pas y avoir de pratique révolutionnaire.
Le capitalisme est la société de la généralisation de la marchandise où la « valeur d’échange » est devenu la « devise » dans les relations humaines, y compris dans la sphère des émotions et des sentiments, de sorte que la production sociale répond aux besoins de la marchandise et non pas aux besoins des hommes. Cette réalité matérielle de la production détermine une idéologie dominante qu’on considère comme « le sens commun ». N’importe quelle mise en cause de la société du capital exige un examen critique de ce « sens commun » dominant qui n’est pas autre chose que la tentative des classes dominantes pour imposer une manière de penser apparaissant comme « naturelle » et par conséquent comme la seule possible et valable. Sans une réflexion approfondie, la mise en cause du capital est impossible.
Par ailleurs, la « théorie » n’est ni le produit ni l’apanage de génies illuminés ou de catéchismes dogmatiques. Au contraire, la théorie révolutionnaire ne saurait être que le produit collectif et historique d’une classe exploitée porteuse d’une société future libérée des rapports d’exploitation. Cette élaboration théorique ne saurait être que le résultat d’une culture collective de réflexion et de débat capable de mettre en question le « sens commun » de la classe dominante et d’élaborer la théorie qui nous permette de finir avec l’exploitation de tous par quelques-uns.
Le « mouvement du 15 mai » a été un mouvement spontané qui, en Espagne, exprimait le malaise et l'indignation des exploités, et il a également exprimé le besoin renaissant de beaucoup de gens de lutter. A la suite du « 15 mai », et de bien d’autres mouvements similaires partout dans le monde[2], des regroupements ont surgi qui ont ressenti le besoin de mener à bien des réflexions en profondeur : la pratique a démontré que quand l’effort théorique manque, on peut tomber très facilement dans les pièges de l’État et de ses instruments, et finir par lutter pour les intérêts de l’ennemi au nom des prétendus intérêts de tous. Ces groupes minoritaires sont conscients du fait que le combat révolutionnaire requiert une « dimension théorique » et c’est pour cela que des espaces de débats et de réflexion surgissent et affrontent les questions telles que « comment lutter ? » et « pourquoi lutter ? ». Poser ces questions est une « nécessité » de la pratique révolutionnaire.
Comme le groupe Asamblearios-TIA l’affirme, l’auto-organisation des travailleurs est le seul moyen pour les travailleurs de devenir maîtres de leurs vies et de leur destinée. La systématisation du débat où nous pouvons clarifier collectivement les questions politiques de la lutte est la forme d’auto-organisation nécessaire en cette période de « pause » dans les luttes.
La crise du capitalisme montre comment, d’une part, on se dirige vers plus de misère, de barbarie et de destruction de la planète, et, d’autre part, combien il est difficile de proposer une alternative à la société qui implique le dépassement des contradictions du système capitaliste. Le défi est énorme. « Hic Rhodus, hic salta ! »[3]. C’est pour cela qu’il est indispensable de donner au combat une perspective historique, une dimension internationale et une profonde compréhension de ses moyens et de ses objectifs. La création d’authentiques espaces de débats et de réflexion est la tâche du moment pour les combats à venir. Comme les camarades d’Alicante l’ont proposé, nous encourageons les minorités qui surgissent dans le monde à créer ce genre d’espace de débats et de réflexion, à s’armer de la théorie révolutionnaire qui pourra nous permettre de détruire le capitalisme et de construire une nouvelle société.
Nous publions ci-dessous le texte traduit de l’appel de ces camarades et, à la suite, nous ajoutons une proposition de textes pour la discussion.
Notre souhait : que les débats les plus fructueux puissent se faire jour !
CCI, 27 décembre 2012
ATELIERS POUR TRAVAILLEURS INDIGNÉS[4]
Tout ce dont vous avez toujours voulu débattre sur la lutte prolétarienne et dont vous n’aviez pas osé discuter.
ALACANT 2013
Qui sommes-nous ?
Nous sommes des travailleurs, des chômeurs, des étudiants,… comme toi ! Des personnes qui subissent ce système d’exploitation. Nous nous sommes organisés par nous-mêmes en un regroupement avec lequel nous voulons agir mais aussi débattre. Notre groupe s’appelle Asamblearios–TIA (Travailleurs indignés et auto-organisés)[5]
Que sont ces ateliers ?
Avec les ateliers qu’on va réaliser, on voudrait créer un espace de réflexion et de rencontres où l’on puisse partager des connaissances. Dans notre présent si convulsif où nous réagissons avec inertie à cause de l’agression permanente du capital, nous considérons qu’il est nécessaire de créer ce type de lieu de réflexion qui nous servira à prendre le meilleur chemin pour mener à bien nos propositions.
Quels en sont les objectifs ?
Nous avons toujours eu au sein de notre regroupement le souci d’approfondir nos analyses et de mettre en rapport la réalité que nous vivons avec l’histoire du mouvement des exploité(e)s. Nous pensons que la théorie et l’histoire sont des armes pour changer le monde, des armes qu’on nous a volées et qu’on a remises aux mains de « l’ennemi ». Ces ateliers se veulent être une contribution dans ce sens. Leur contenu et aussi leur forme, tournent autour du MOUVEMENT de ceux « d’en bas », ils en font partie et prennent parti pour ce « parti ». Il ne s’agit pas de cours magistraux que viendrait nous faire un illustre professeur, il s’agit de reconstruire entre nous tous une histoire et une théorie pour essayer de tout changer. Ni plus ni moins.
Les contenus et la méthode que nous mettons en avant est celle de rassembler tous les efforts pour comprendre ; nous voulons encourager l’action à partir de la réflexion ; et nous voulons récupérer notre histoire et notre parole. Nous sommes ambitieux et nous le sommes parce que, même en étant si peu nombreux arithmétiquement, nous savons que nous ne sommes pas seuls, parce que nous sommes nombreux au sein de cette « immense majorité qui représente une majorité immense. »
Comment va-t-on procéder ?
Les ateliers que nous proposons auront une périodicité mensuelle durant l’année 2013, juillet et août exceptés. La méthode proposée pour ces ateliers requiert la participation active des présents, ce qui est la garantie pour que tous les points de vue soient pris en compte. La meilleure façon de participer, ce serait d’envoyer par avance à l’atelier (ceux qui voudront et pourront le faire) un texte de réflexion sur le sujet du mois. Nous nous engageons à présenter une introduction sur le sujet, en prenant en compte les textes présentés. Par la suite, on passera au débat.
Le débat nous amènera à découvrir un vocabulaire et des expressions avec lesquels nous établirons un glossaire participatif. Ce glossaire participatif consistera à définir tous les termes qui nous auront paru importants, en y intégrant toutes les acceptions possibles.
De quoi va-t-on parler et quand ? (voir les sujets détaillés plus loin)
· 11 janvier : Présentation des ateliers
· 25 janvier : Qu’est-ce qu’une crise et comment la combattre ?
· 15 février : Lutte de classe
· 15 mars : Auto-organisation et autonomie ouvrière
· 12 avril : Internationalisme
· 17 mai : Révolution sociale
· 14 juin : Qu’entendons-nous par nationalisme ?
· 20 septembre : Démocratie et libération
· 18 octobre : Autogestion
· 15 novembre : Syndicalisme
· 13 décembre : Parlementarisme
Comment peut-on s’inscrire et où ces ateliers vont-ils se dérouler ?
Pour s’inscrire, on peut nous contacter sur [email protected] [9]
Envoie-nous ton nom, le nom des ateliers auxquels tu veux participer (un, plusieurs, tous) et une adresse e-mail pour te contacter.
Avec toutes les personnes intéressées, nous ferons une réunion de présentation des ateliers pour nous organiser et nous connaitre, le 11 janvier dans le local d’ASIA. Tous les ateliers auront lieu dans le local d’Asia (Calle Barón de Finestrat nº 52, 1er étage, près de la place « de las Palomas », Alicante) entre 19h et 21h.
Faut-il payer quelque chose ?
Eh bien oui ! Car il faut payer le local d’ASIA (et les activités qui s’y réalisent) ! On établira une cotisation de 5 euros par atelier qui sera payée lors de l’atelier introductif du 11 janvier. Pour être plus précis, l’argent sera intégralement reversé à une caisse pour l’autogestion d’ASIA (Apoyo Salud Integral Autogestionada, Soutien à une santé intégrale autogérée)
Nous t’attendons, salut !
Pour toute question, contacte-nous : [email protected] [9]
Ébauche des ateliers
11 janvier « Présentation des ateliers »
On réexaminera ensemble les ateliers qu’on va partager, la méthode et le contenu, on rassemblera les suggestions et les possibles changements.
On débattra aussi sur les raisons qui ont fait que ces sujets ont été choisis et les termes même du titre de ces ateliers.
25 janvier « Que sont les crises et que peut-on faire face à elles »
Qu’est qu’une crise ? Est-ce que les crises sont inhérentes au capitalisme ? Les théories sur les crises…
Voilà un mot répété jusqu'à la satiété et qui justifie tout. Le capitalisme parait être en crise. Est-ce une crise de décadence ? Si c’était le cas, cela nous oblige à mettre en avant un changement révolutionnaire comme seule issue pour l’humanité.
15 février « Lutte de classes »
Qu’est-ce que la lutte de classes ? Est-elle toujours d’actualité ? Est-ce une lutte « centrale » ? Qui est la Classe ouvrière et pourquoi nous proposons de l’écrire avec majuscule ? Faut-il porter un bleu de travail pour faire partie de la Classe ouvrière ?
Face à la prétendue modernité du “citoyen” comme acteur social, nous redonnons la priorité au sujet historique par excellence : la Classe ouvrière, le prolétariat, les exploités, les travailleurs.
15 mars « Auto-organisation et autonomie ouvrière »
Qu’est-ce que l’auto-organisation ? Pourquoi nous est-elle si nécessaire ? Comment la rechercher et l’atteindre ?
Nous insistons sur l’auto-organisation des assemblées, sur l’autonomie prolétarienne. Nous constatons que, dans l’histoire de notre Classe, cette autonomie a été un facteur fondamental pour le développement du mouvement ouvrier. La libération des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou ne sera pas.
12 avril « Internationalisme »
Qu’est-ce l’internationalisme ? Peut-il exister un internationalisme qui ne soit pas prolétarien ? Pourquoi est-il fondamental pour le mouvement prolétarien ? Comment s’est-il développé dans l’histoire ?
L’internationalisme est fondamental pour le développement d’un véritable mouvement des exploités. L’émancipation des travailleurs sera mondiale ou ne sera pas.
17 mai « Révolution Sociale »
Qu’est-ce une révolution ? Qu’est-ce qu’une révolution pour la Classe ouvrière ? La révolution est-elle possible ? Est-elle inévitable ? Quelle société voulons-nous construire ?
Ce système nous paraît à tous insoutenable et beaucoup d’entre nous réfléchissent sur comment nous pourrions le changer pour vivre dans une société qui donne satisfaction aux besoins de l’humanité.
14 juin « Qu’entendons-nous par nationalisme »
Qu’est-ce le nationalisme ? À quelle classe appartient l’idéologie nationaliste ? Est-ce qu’il y a un rapport entre nationalisme et internationalisme ?
De plus en plus (comme lors d’autres périodes de « crise »), les conflits nationalistes s’exacerbent. Il est essentiel que nous prenions une position claire en tant que classe face à un tel sujet dans une situation qui excite les conflits impérialistes.
20 septembre « Démocratie et libération »
C’est quoi la démocratie ? Est-ce que le démocratisme est, ou a été, un mouvement libérateur pour l’humanité ? Pourquoi utilise-t-on le terme démocratique à tout bout de champ et pour tout ?
Démocratie réelle, démocratie participative, démocratie directe,… : face aux usages tous azimuts de la « démocratie », il est nécessaire de clarifier ce qu’est la démocratie et qui elle sert. De quoi veut-on parler quand on parle de démocratie et pourquoi nous ne l’appelons pas ainsi ?
18 octobre « Autogestion »
Qu’est-ce que l’autogestion ? Pourquoi lui donne-t-on des définitions si différentes ? L’autogestion et l’auto-organisation, est-ce la même chose ? L’autogestion est-elle une arme révolutionnaire pour les travailleurs ?
L’autogestion est autant « à la mode » que la démocratie ; pour certains, c’est définitivement une panacée, pour d’autres un mirage qui entrave la lutte de la Classe ouvrière.
15 novembre « Syndicalisme »
Qu’est-ce le syndicalisme ? Comment la Classe ouvrière l’a-t-il développé ? Est-il toujours utile pour la Classe ouvrière ? Et s’il ne l’est pas, pourquoi ? Quelle est la différence entre auto-organisation/autonomie ouvrière et syndicalisme ?
Très critiqués d’une manière intuitive par les travailleurs, les syndicats ont toujours un poids énorme au sein de la Classe. Mais les syndicats ne nous servent pas, ils nous amènent à la défaite. Pourquoi ?
13 décembre « Parlementarisme »
Qu’est-ce le parlementarisme ? Sert-il aujourd’hui à quelque chose ? Que décide-t-on au parlement ? Peut-on réformer le parlement ?
De même que pour le syndicalisme, les politiciens et les élections sont sérieusement mis en question par la population. Cette mise en question populaire a un sens profond qu’on doit pouvoir expliquer
Ateliers pour travailleurs indignés
APPORTS DU CCI AUX DIFFÉRENTS SUJETS :
Il s’agit d’une contribution ouverte : au fur et à mesure que le débat se développera, nous proposerons d’autres textes.[6]
25 janvier « Que sont les crises et que peut-on faire face à elles ? »
La compréhension de la crise actuelle, de ses mécanismes d’évolution, de son rythme et ses conséquences est une question compliquée qui demande un débat patient.
Par rapport à la question posée dans l’ébauche des Ateliers « S’agit-il d’une crise de décadence ? Notre réponse est affirmative. Et à partir de là, nous sommes aussi convaincus que cela nous oblige « à mettre en avant un changement révolutionnaire comme seule issue pour l’humanité. »[7]
Pour une contribution à la discussion nous avons sélectionné trois textes :
- un article récent [10] de notre Revue Internationale nº148 (janvier 2012) qui analyse la situation actuelle de la crise, ses conséquences économiques et politiques et son évolution :
- un article plus ancien [11] paru dans notre Revue Internationale nº 96 (janvier 1999) qui avait été conçu comme une réponse à la convulsion économique mondiale de 1997-98, celle que l’on nommait, à l’époque, la crise « des tigres asiatiques ». Dans cet article, on montrait que le capitalisme, à travers l’intervention massive de l’État (capitalisme d’État), a accompagné la crise en la ralentissant, en la dosant dans le temps et en la canalisant sur des secteurs économiques particuliers, afin d’éviter un effondrement brutal mais en prolongeant indéfiniment ses effets. Depuis 2007, la crise du capitalisme subit une forte accélération, la plus grave de ces quarante dernières années. Pour s’en faire une idée : nous sommes sortis de la crise de 1997-98 grâce à des prêts et des injections de crédit de quelque 120 milliards de dollars. Pour la crise actuelle, entre 2007 et 2011, quelque 7000 milliards de dollars ont été injectés ! Surtout, il y a quelque chose qui différencie la phase actuelle de la situation dominante des trente années précédentes : avant, les attaques contre les conditions de vie des travailleurs étaient graduelles et progressives, aujourd’hui nous assistons à une attaque généralisée. D’un appauvrissement lent nous sommes passés à un appauvrissement rapide et généralisé.
- Nous complétons les contributions précédentes avec un article qui s’interroge sur les « pays émergents » (Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, les BRICS) et leur capacités à constituer la base d’un « nouveau capitalisme. [12] »
15 février « Lutte de classes »
Nous apportons à la discussion l’article en deux parties de notre Revue Internationale : "Qui peut changer le monde ?", parties 1 [13] et 2 [14] (1993).
15 mars « Auto-organisation et autonomie ouvrière »
Comme le dit si bien l’Ébauche, la libération des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ou ne sera pas. Quelle est la forme concrète que prend cette auto-organisation des travailleurs ? L’expérience qui se reproduit depuis 1905 a montré que cette forme est celle des Assemblées ouvrières massives, générales et ouvertes, et l’élection par celles-ci de Comités élus et révocables. Et ces comités, lorsque les ouvriers arrivent à posséder une force révolutionnaire suffisante, prennent la forme organisationnelle des Conseils Ouvriers.
Pour contribution à la discussion, nous proposons le premier article d’une série intitulée « Qu'est-ce que les conseils ouvriers ? [15]», publiée aussi dans notre Revue internationale. [8]
12 avril « Internationalisme »
Le sujet est très vaste, de sorte que nous proposons un seul aspect : quelle serait la réponse internationaliste à la crise ? Ceci pour répondre aux solutions nationalistes avec lesquelles on nous matraque : une “issue nationale” à la crise, s’opposer à la « domination allemande », etc. : « Face à la crise du capitalisme, quelle réaction : nationalisme ou internationalisme ? [16] » [9]
17 mai « Révolution Sociale »
Notre contribution à la discussion se concrétise dans deux textes que nous avons écrits en tant que réponse à des débats surgis en Amérique du Sud : « Cinq questions sur le communisme [17]», « Qu’est-ce le socialisme ? [18] »[10]
14 juin « Qu’entendons-nous par nationalisme ?»
Pour matériel de réflexion, nous incluons un texte qui est le fruit d’un débat qui a eu lieu au Brésil : « Entre internacionalismo y nacionalismo-patriotismo no existe afinidad alguna ¡hay que elegir ! [19]»[11]
20 septembre « Démocratie et libération »
Pour aborder ce sujet, nous proposons un texte historique adopté lors du Premier congrès de l’Internationale Communiste célébré en mars 1919 : les « Thèses sur la Démocratie et sur la dictature du prolétariat », republié par nous dans « La démocratie bourgeoise, c’est la dictature du capital [20] », Revue Internationale nº100.
18 octobre « Autogestion »
Pour ce sujet, nous présentons un débat que nous avons eu avec des camarades d’Argentine, le groupe Nouveau Projet Historique [21]
15 novembre « Syndicalisme »
Là aussi, nous voudrions contribuer à la discussion avec des comptes-rendus de débat :
- avec des camarades de Séville où nous essayons de voir comment les syndicats sont devenus historiquement des organes intégrés dans l’Etat capitaliste et des collaborateurs étroits avec le patronat : « Apuntes sobre la cuestión sindical [22]. »
- avec des camarades de Ferrol où nous essayons de répondre à la question : Pourquoi les syndicats trahissent-ils toujours les ouvriers ? [23]
- avec des camarades de Barcelone qui pestent contre les CO et l’UGT mais pensent qu’il pourrait exister un syndicalisme radical qui, lui, défendrait les ouvriers : « ¿Es posible otro sindicalismo? [24]» (Un autre syndicalisme est-il possible ?).
13 décembre « Parlementarisme »
On peut consulter l’ensemble des textes publiés sous la rubrique « El Engaño del Parlamentarismo [25] »
[1] « La TIA (Travailleurs indignés et auto-organisés) est un collectif qui est né d’un regroupement spontané de camarades du milieu ‘pro-assemblées’ et autonome d’Alicante lors des assemblées massives de mai 2011. » Ils se définissent eux-mêmes comme « des ouvrier(e)s, des chômeurs, des étudiant(e)s,… comme toi. Nous sommes des personnes qui subissons ce système d’exploitation. Nous nous sommes organisés en regroupement et nous voulons agir mais aussi débattre. »
[2] Voir, pour un bilan des mouvements en 2011, notre tract international : 2011 : de l'indignation à l'espoir, (1er Mai 2012), https://fr.internationalism.org/isme354/2011_de_l_indignation_a_l_espoir... [26]
[3] Hic Rhodus, hic salta ! (Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter). Paroles tirées de la traduction latine d'une fable d'Esope parlant d'un vantard qui affirmait, en faisant appel à des témoins, qu'il avait fait à Rhodes un saut magnifique. On lui répondait : « A quoi bon les témoins ? Voici Rhodes, c'est ici qu'il faut sauter ! ». Ce qui signifie au sens figuré : « C'est maintenant qu’il s’agit de montrer ce dont tu es capable ! » La phrase fut utilisée par Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, (Voir : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1851/12/brum.htm [27], dont cette noté est extraite)
[4] TRAVAILLEURS, CHÔMEURS, ÉTUDIANTS, RETRAITÉS… et PROLÉTAIRES en général.
[5] La TIA est un collectif né du regroupement spontané des camarades du milieu « pro-assemblées » et autonome à Alicante autour des assemblées massives de mai 2011. Dans ce contexte, ces camarades se chargeront de la « structure organisationnelle » du mouvement, auxquels se joindront d’autres camarades partageant des points de vue communs, sur les assemblées générales, l’anticapitalisme et l’internationalisme prolétarien. Les différences politiques avec d’autres collectifs qui se revendiquaient aussi du mouvement du 15 mai, les ont amenés à se séparer formellement d’autres organisations qui continuent à utiliser ce nom et à fonctionner indépendamment de ces projets. L’incorporation à ce regroupement d’autres camarades venant des Assemblées Ouvertes des Travailleurs a fait que le regroupement s’appelle dorénavant : Asamblearios – TIA
[6] Pour cette traduction, les références sont tirées, si elles existent, de nos textes en français. Pour les textes en espagnol, voir : https://es.internationalism.org/ [28]
[7] Pour des lectures plus approfondies, on peut consulter sur notre site, dans notre rubrique « Approfondir » (pour l’espagnol, cliquez « Textos por Temas »), la série La Decadencia del Capitalismo. https://es.internationalism.org/go_deeper [29]; https://fr.internationalism.org/approfondir [30]
[8] Le reste des articles de cette série peuvent être lus dans les numéros suivants : 141, 142, 143 et 145.
[9] Pour des lectures plus approfondies, surtout sur la réponse internationaliste à la guerre, voir sur notre site : « La question nationale » dans la rubrique « Approfondir ». (https://fr.internationalism.org/series/208 [31])
[10] Ces textes sont en espagnol. Toujours dans la rubrique « Approfondir », on peut consulter les thèmes « Qu'est-ce que le communisme? » et « Vive la révolution ! ».
[11] « Entre l’internationalisme et le nationalisme-patriotisme, il n’existe pas la moindre affinité : il faut choisir ! » Pour une étude plus exhaustive, voir notre brochure Nation ou Classe, (https://fr.internationalism.org/brochure/nation [32])
Géographique:
- Espagne [1]
Rubrique:
ICConline - avril 2013
- 1336 reads
Lutte isolée, lutte défaite !
- 1961 reads
Nous publions, ci-dessous, la traduction d’un tract de notre section en Espagne, Acción Proletaria, qui fait le bilan de la vague de luttes qui a touché ce pays ces derniers mois. Les questions auxquelles sont confrontés les ouvriers espagnols sont identiques à celles rencontrées dans de nombreux pays. Partout, l’Etat et ses chiens de garde syndicaux cherchent à isoler les ouvriers sur un terrain corporatiste ou nationaliste, voire à nous opposer les uns aux autres.
Au cours de ces derniers mois, les luttes ouvrières se sont multipliées en Espagne, au Portugal, en Afrique du Sud, en Egypte, en Turquie, en Chine…
Ces luttes sont la riposte au déluge d’attaques qui nous tombe dessus : licenciements, coupes budgétaires, expulsions de domicile, réductions drastiques de salaires, salaires payés avec retard… Elles expriment la tentative de faire face à la catastrophe humanitaire que sont le chômage, les expulsions, les queues devant les institutions caritatives, les gens qui vivent dans la rue, les suicides…
Cette barbarie n’a pas surgi d’un coup ! Nous n’y sommes pas parvenus après des années de prétendue opulence et de consommation. En vérité, la descente aux enfers (pour ne donner que l’exemple de l’Espagne) dure depuis quarante ans :
Il y a vingt ans que le contrat de travail « normal » a laissé sa place au contrat précaire ;
Les licenciements massifs se succèdent depuis le début des années 80 ;
les pensions sont rognées depuis 1985 ;
le pouvoir d’achat des salariés a diminué depuis trente ans de façon graduelle ;
dans le secteur public, les postes fixes à vie ont été remplacés par des contrats à durée déterminée et par des contrats d’intérim.
Si pendant les quarante dernières années la chute fut plus ou moins graduelle, ces cinq dernières années, l’accélération est brutale. Cette accélération montre qu’une guerre a été déclarée contre nos conditions de vie, contre notre futur et celui de l’humanité tout entière.
L’isolement est le socle de notre défaite.
Dans de nombreuses villes d’Espagne, nous voyons comment les éboueurs et les employés de la voirie font grève et manifestent, comment les grèves se sont multipliées dans les transports en commun (métro de Madrid et de Valence, bus de Madrid et d’ailleurs), ainsi que dans beaucoup d’autres secteurs : la métallurgie, le textile, la chimie, la santé, les banques, les services sociaux...
Mais chaque secteur lutte de son côté, enfermé sur lui-même, complétement isolé. Voilà le grand problème des luttes actuelles. Elles n’ont pas réussi à se rejoindre dans des manifestations conjointes et unitaires, avec des assemblées ouvertes que d’autres secteurs peuvent rejoindre, en particulier ceux qui sont très isolés et dispersés : chômeurs, retraités, précaires, étudiants…
Unifier les luttes, s’organiser pour riposter ensemble :
Ceci est plus justifié que jamais, parce que nous sommes touchés par des problèmes aux noms universels : coupes budgétaires, licenciements, plans sociaux, chômage, misère, absence de futur…
Ceci est plus nécessaire que jamais, parce que le Capital et son Etat, avec la vieille tactique de « diviser pour mieux régner », nous pousse dans une chute sans fin qui conduit au chômage et à la paupérisation absolue.
Ceci est la seule réponse pour le futur.
Le capitalisme n’a plus rien à offrir. Son calcul consiste en ce que nous nous épuisions, que nous tombions dans la résignation pour finir dans le désespoir. En cela, l’isolement des luttes joue un rôle de premier plan car il imprime dans nos têtes l’idée que nous ne pouvons rien faire, que l’union est impossible… et cela finit avec des conclusions du style : « l’homme est mauvais par nature » ou « nous sommes condamnés d’avance ».
En Grèce aujourd’hui, après seize grèves générales et des luttes isolées innombrables, les ouvriers se sentent fatigués, apathiques, désorientés ; il y a même des secteurs, déçus de tout et de tous, qui se laissent emporter par des idéologies populistes, autant de gauche que de droite, qui les appellent à rejoindre et à défendre la Patrie et à haïr les étrangers.
Nous avons besoin d'une réflexion en profondeur sur les causes de l’isolement des luttes.
Grève générale et luttes isolées : les deux faces du piège syndical.
En réfléchissant sur les causes de l’isolement, il n’est pas difficile de s’apercevoir qu’une grande responsabilité incombe aux syndicats : les CO1 et l’UGT2 nous ont tendu un piège lorsque, à chaque ERE3, et pour chaque coupe, ils ont proposé une riposte isolée, enfermée dans « notre » entreprise et « notre » secteur, limitée à une pression particulière centrée sur les responsables du secteur ou de la corporation concernés ; et lorsque nous voulons lutter, ils sortent alors de leur chapeau la « grève générale » ! C’est ainsi que les syndicats ont appelé à deux grèves générales en 2012 : le 29 mars et le 14 novembre.
Lutte isolée et grève générale sont les deux faces du piège syndical. La grève générale n’engendre pas de l’unité mais de la division, n’incite pas à la mobilisation mais ne fait que démobiliser. C’est unir pour diviser, rassembler pour démobiliser. La grève générale consiste à réserver pour un jour « J » l’exercice de l’unité et de la combativité, revenant pour le reste des jours de l’année à l’atomisation, à la passivité, au « chacun à ses affaires ». La grève générale est une institution de plus du capitalisme, du même genre que Noël ou la Saint-Valentin. À Noël, il faut être gentil et ouvert vis-à-vis de nos semblables, pour, une fois la fête finie, revenir aux affrontements quotidiens, au « sauve-qui-peut », au « malheur aux vaincus ». À la Saint-Valentin, les couples déclarent leur amour éternel et le lendemain, c’est le retour du quotidien : les jalousies, les méfiances, les disputes habituelles…
Le danger de l’idéologie syndicale.
Les CO et l’UGT sont des institutions de l’Etat, du même ordre que le Gouvernement, l’Opposition, le Patronat, l’Eglise, le Pouvoir Judiciaire, l’Armée, la Police… Le Roi les reçoit, ils ont une ligne directe avec la Moncloa4 et avec les chefs du patronat, ils participent à une multitude d’organismes, ils constituent un pouvoir de fait dans des entreprises, des hôpitaux, dans des administrations publiques, des banques et Caisses d’épargne…
Ils ont deux rôles, qui ne sont pas opposés mais complémentaires : un rôle institutionnel et un rôle combatif d'opposition. Ces rôles sont comme les deux mains, la droite et la gauche :
De la main droite. ils signent tout ce que le gouvernement ou le patronat leur mettent sur la table, ils assènent les pires coups de poignards dans le dos des travailleurs, tiennent le même langage que les patrons, le gouvernement et les politiciens : investissement, productivité, croissance… ;
Avec la main gauche, ils ôtent le costard-cravate, et en chemise ils sortent dans la rue. Là, ils hurlent contre Rajoy5 et contre la CEOE6, là ils appellent « à la lutte » et sont capables de pousser les mots d’ordre les plus radicaux.
Tout cela n’a qu’un but : nous amener à adopter l’approche des problèmes et les méthodes de lutte que nous pouvons qualifier d’idéologie syndicale7.
Aux côtés des CO et de l’UGT, il existe une gamme variée de syndicats radicaux. Ceux-ci n’ont pas un grand rôle institutionnel, sauf quelques exceptions isolées et ponctuelles ; leur rôle est celui de la lutte combative. Mais le problème, c’est qu’ils défendent et véhiculent l’idéologie syndicale de manière encore plus radicale et extrême. Dans ce sens (et au-delà de l’honnêteté de beaucoup de leurs militants), ils complètent et sont les auxiliaires du tandem CO-UGT.
La CGT et la CNT critiquent le tandem CO-UGT, mais leur façon de lutter, c’est juste un peu plus de vin du même tonneau : ils ont proposé « une autre grève générale » le 26 septembre 2012, en soutenant celle qui avait été convoquée par les syndicats nationalistes galiciens et basques, et ont fini par se joindre à celle du 14 novembre, appelée par CO-UGT.
Ils critiquent les appels de CO-UGT parce que ceux-ci respectent le service minimum ou se bornent à appeler à des arrêts partiels, mais ils proposent des grèves illimitées tout autant enfermées dans leur secteur, avec lesquelles nous ne sortons toujours pas du piège de l’isolement.
Le syndicalisme radical n’est pas une alternative à CO-UGT pour la simple raison qu’il agit à l’intérieur du même piège : l’idéologie syndicale.
La critique et le débat de fond sur cette idéologie sont nécessaires.
L’idéologie syndicale est un obstacle à l’action directe menée par les travailleurs eux-mêmes. La méthode du « manuel » du syndicalisme consiste à mettre en avant qu'« il faut faire bouger les travailleurs par l’appel et l’activisme d’une minorité » : il faut d’abord les « indigner » avec des dénonciations et des agitations préalables. Il faut passer ensuite aux « actions d’échauffement », pour enfin déboucher sur un appel à la lutte le jour « J ». Le résultat bien connu de ce « processus », c’est que les travailleurs arrivent au jour « J » confus, divisés, désorganisés, passifs…
Ces méthodes vont à l’encontre totale de l’expérience mille fois répétée. La lutte ouvrière ne suit pas ces chemins préétablis sur commande, mais elle surgit au moment le plus inattendu, souvent pour un motif apparemment secondaire qui exprime le fait que la coupe de l’indignation est pleine. Les ouvriers tendent alors à s’organiser en assemblées générales improvisées. L’enthousiasme et l’intérêt se propagent comme une tache d’huile. Ils cherchent la communication directe et les rencontres avec d’autres travailleurs pour ainsi arriver à sortir de l’entreprise ou du secteur. Les uns appellent les autres à la lutte, à ce qu’ils y joignent leurs propres revendications, à ce qu’il organisent des assemblées générales ouvertes où tout le monde puisse s’exprimer, où l’on aborde autant les forces que les faiblesses, exprimant non seulement ce qui est positif mais aussi les peurs, les doutes, les sentiments négatifs.
Tout cela n’est pas une découverte alternative à la recette syndicale mais ce que l’expérience historique de la lutte ouvrière nous montre comme étant possible et nécessaire. C’est de cette manière que le mouvement du 15-M (expression de la revendication d’une jeunesse en situation précaire ou au chômage) a surgi. Quelques années auparavant, la grève massive à Vigo, en 2006, a montré les mêmes tendances8. Et c’est de cette manière que les luttes ouvrières s’expriment depuis 19059.
Beaucoup de camarades voudraient être « pratiques » et laisser tomber les « idéalismes ». Cependant, ils ne font que reprendre encore et toujours la même recette syndicale, qui a démontré encore et toujours sa nocivité. Ils se refusent à étudier les expériences du mouvement ouvrier qui montrent ce qu’est vraiment la lutte ouvrière, comment elle s’est manifestée historiquement. Ne se rendent-ils pas compte que c’est eux qui tombent dans un idéalisme réactionnaire ?
L’idéologie syndicale est enchaînée à l’entreprise, à la corporation et à la nation.
Le syndicalisme surgit au XIXe siècle. Son objectif n’est pas de détruire le capitalisme, mais d’obtenir, à l’intérieur de ces rapports de production, les meilleures conditions possibles pour les ouvriers.
À l’époque (XIXe siècle et début du XXe) où le capitalisme ne s’était pas implanté dans tous les pays et dans tous les milieux économiques, le syndicalisme pouvait jouer un rôle favorable aux travailleurs. Mais avec l’entrée du capitalisme dans sa décadence, le syndicat ne peut obtenir que des miettes et encore très ponctuelles, tombant dans les filets de l’État et de la défense du capitalisme.
Le syndicalisme ne peut pas mettre en question les structures de reproduction de l’économie capitaliste, c'est-à-dire, l’entreprise, le secteur et la nation. Au contraire (et ceci en toute connivence avec les partis de gauche du capital), il s’érige comme l’un de ses défenseurs le plus conséquent. Selon les syndicats, le développement de la nation serait le cadre où l’on pourrait fabriquer un gâteau plus grand, bon pour tout le monde. Marx, dans Salaire, prix et profit, combattait déjà ces illusions syndicalistes présentes dans les Trade Unions britanniques, donnant l’exemple d’une soupière : les syndicalistes disaient que si la soupière était plus grande, il y aurait davantage de soupe à distribuer, ce que Marx réfutait en disant que le problème n’était pas la taille de la soupière mais celle de la cuillère avec laquelle les ouvriers mangeaient, celle-ci tendant, historiquement, à devenir de plus en plus petite.
Les syndicats nous mystifient en disant, par exemple, que si le patron investissait dans la production, au lieu d’emporter ses millions en Suisse, les licenciements ne seraient pas nécessaires. Avec des balivernes pareilles, ils nous mystifient doublement : d’abord en occultant le fait que le capitalisme requiert des licenciements et l’appauvrissement des ouvriers en tant que condition de sa propre survie ; et, deuxièmement, en nous ligotant à la défense de l’entreprise, du secteur et de la nation, au lieu de lutter pour nos besoins en tant qu’êtres humains : ceux de vivre et d’avoir un futur.
En nous ligotant à la défense de ce trio funeste, le syndicalisme propose, nécessairement et fatalement, une lutte isolée. Si une lutte se conçoit en tant que défense de tel ou tel secteur ou de telle ou telle entreprise, en quoi les autres travailleurs vont-ils se sentir concernés ? En rien !
Lors de la récente grève du métro de Madrid, un syndicat très radical, Solidaridad Obrera10, dont les membres défendent avec beaucoup de force et de sincérité que tout se fasse en assemblées, a été incapable de briser ce carcan. La seule chose qu’il a su proposer en faveur de l’unité a été de faire coïncider une des journées de grève du métro avec la grève de la régie des autobus (EMT)11. Alors que les gens montraient leur compréhension envers les grévistes du métro, alors qu’il y avait des conditions pour transformer cette sympathie passive en action, dans la mesure où, à ce moment-là, en plus de l’EMT, les travailleurs de la santé étaient aussi en lutte, pourquoi n’a-t-on pas proposé de mener ensemble toutes les luttes ? Pourquoi n’a-t-on pas appelé à la création d’assemblées ouvertes et des manifestations conjointes pour frapper avec un seul poing le Capital et son Etat ?
Les choses se sont passées de la même manière lorsque les mineurs sont arrivés à Madrid en juillet 2012. Beaucoup de travailleurs se sont rendus à leurs manifestations, on y a vécu des moments d’union et de joie. Qu'ont fait les syndicats ? Mettre au plus vite les mineurs dans leurs bus pour qu’ils rentrent dans la solitude de leurs puits ! Et qu'ont fait les syndicats radicaux ? Ils n’ont pas ouvert la bouche.
Par rapport aux besoins des luttes, les syndicats marchent toujours à contretemps. Quand il y a une possibilité d’étendre et de radicaliser la lutte, ils s’y opposent de toutes leurs forces. Et quand les ouvriers sont passifs, alors ils proclament avec grandiloquence leur radicalisme dans le vide. Et, en plus, ils ont le culot de reprocher aux ouvriers leur passivité !
Nous devons opposer l’unité et la solidarité de la lutte ouvrière à la concurrence et au « tous contre tous » du capitalisme.
Le capitalisme a bouleversé de fond en comble les conditions dominant les systèmes précédents, basés sur le conservatisme et l’enchaînerement à la religion, aux seigneurs, aux « hiérarchies naturelles ». En créant le marché mondial, il a apporté un énorme progrès historique et, surtout, une productivité très élevée du travail sur la base du travail associé propre au prolétariat.
Cependant, le capitalisme, derrière cette face éblouissante, avait une face plus sombre. La contrepartie était la concurrence féroce, l’atomisation la plus extrême, le cynisme et l’absence de scrupules des plus méprisables dans l’obtention du plus grand profit dans un minimum de temps possible. Cela a donné à la vie quotidienne un caractère très destructeur, qui est devenu insupportable dans la décadence du capitalisme et encore pire dans des moments de crise ouverte, comme c’est le cas aujourd’hui.
Les liens sociaux se déchirent, chacun est obligé de se livrer à une course folle pour survivre isolé et en concurrence avec les autres ; la vie est subie avec la souffrance de l’anxiété, car l’insécurité est totale avec le sentiment que quand nous nous y attendons le moins, nous nous retrouvons sur le bas-côté, invisible pour les autres. Elles sont innombrables les personnes qui finissent dans la dépression, dans le suicide et dans la drogue.
La société capitaliste est celle de la formule « l’homme est un loup pour l’homme », celle de la « guerre de tous contre tous », comme le disait Hobbes, un philosophe anglais du XVIIe siècle, qui discerna, à l’aube du système capitaliste, la barbarie morale qu’il enfermait dans ses fibres les plus cachées.
Les conditions actuelles rendent très difficile la lutte ouvrière, une lutte dont les bases sont tout le contraire de la normalité quotidienne du capitalisme : unité face à la division, solidarité face à la concurrence, confiance face au soupçon, empathie face au « chacun pour soi ».
La lutte ouvrière ne surgit pas uniquement pour des motifs économiques, même si ceux-ci sont leur fil conducteur. La lutte prolétarienne exige un effort moral, un changement de mentalité de la part des ouvriers, même si ce changement n’est pas un préalable et qu'il s’inscrit dans un processus. Et c’est justement là où l’approche syndicale (en concordance avec les autres forces du capital) provoque un grand dommage parce que la vision qu’elle induit des ouvriers est celle qui fait de ceux-ci des citoyens aux intérêts particuliers, corporatistes et égoïstes, dans le cadre de la Nation, laquelle serait l’expression d'un prétendu « intérêt général ». Il est vital de rompre avec cette idéologie syndicale pour que la lutte ouvrière puisse se développer.
Acción Proletaria, (7 février)
1 Les Commissions ouvrières, syndicat lié au Parti communiste d’Espagne. [NdT]
2 Union générale des travailleurs, syndicat lié au Partie socialiste ouvrier espagnole, équivalent du PS français. [NdT]
3 Expediente de Regulación de Empleo, c’est-à-dire : plan social [NdT]
4 Siège du chef du gouvernement espagnol. [NdT]
5 Chef du gouvernement espagnol depuis fin 2011(droite). [NdT]
6 Confederación Española de Organizaciones Empresariales, principale organisation patronale en Espagne. [NdT]
7 Lire notre brochure : Les syndicats contre la classe ouvrière. (https://fr.internationalism.org/brochures/syndicats [34])
8 Nous avons publié plusieurs articles sur ces luttes de 2006. Lire, par exemple : Grève de la métallurgie à Vigo en Espagne, une avancée dans la lutte prolétarienne. (https://fr.internationalism.org/isme/326/vigo [35])
9 Cf. Grève de masse, parti et syndicats, de Rosa Luxemburg, où, sur la base de l’expérience de la révolution de 1905 en Russie, sont exposés les nouveaux questionnements et les nouvelles méthodes de la lutte prolétarienne alors que s’ouvrait la période de décadence du capitalisme. De même, un collectif de camarades d’Alicante, en Espagne, dénonce la grève générale et défend comme méthode de lutte la grève de masse. Lire, sur notre site : Déclaration des travailleurs d’Alicante (Espagne) sur la grève générale.
10 Solidarité ouvrière, scission de la CNT, qui a repris le nom de la publication historique du syndicat anarchiste.
11 Lire, sur le site de Solidaridad Obrera : LA ASAMBLEA GENERAL EMPIEZA A GOLPEAR CON CONTUNDENCIA (https://www.solidaridadobrera.org/index.php?option=com_content&view=arti... [36])
Rubrique:
Venezuela: avec ou sans Chavez, de plus en plus d’attaques contre les travailleurs
- 1378 reads
L'immense culte de la personnalité autour de la dépouille du leader du "socialisme du XXIe siècle", Hugo Chavez, vient couronner un long et patient matraquage idéologique au Venezuela et ailleurs, au point où il a été question, comme l'ont fait les staliniens en leur temps avec la dépouille de Lénine, d'embaumer le corps de Chavez1.
Écrit en février peu avant son décès, l'article suivant, rédigé par nos camarades du Venezuela, permet de faire le point sur la dynamique économique et sociale de la "République bolivarienne", dans un cadre intéressant pour la préparation des luttes futures du prolétariat. Même si le contexte a changé, nous publions cette traduction qui met bien en avant la situation de l’après-Chavez et les problèmes que doit affronter la bourgeoisie. Depuis plusieurs mois, malgré les pirouettes des dirigeants concernant la santé de Chavez, tous savaient que ses jours étaient comptés. "L’émotion" suscitée chez "le peuple" à la suite du décès sera d’ailleurs exploitée jusqu’à la nausée pour permettre à la fraction "bolivarienne" (la boli-bourgeoisie, comme on dit avec humour dans le pays) de remporter les élections, mais les problèmes n’ont fait que s’aggraver.
Les fractions de la bourgeoisie vénézuélienne, tels des vautours, aiguisent leurs griffes dans la dispute pour le contrôle de l’État face au retrait imminent d’Hugo Chavez de la présidence, quel que soit l’évolution de la maladie dont il souffre. Ce strident personnage folklorique qui a maintenu intact le capitalisme en le déguisant sous l’appellation du "socialisme du XXIe siècle", a tenu bien ficelés les intérêts divergents des capitalistes pour mieux tromper la classe ouvrière, notamment en administrant la rente pétrolière pour réaliser quelques actions en faveur des pauvres afin de donner le change. Les récentes élections dans ce pays sud-américain ont été, pour la classe ouvrière, en plus de tout le flot de fantaisies et d’illusions exaltant la démocratie bourgeoise, l’occasion d’assister au summum de la vulgarité de la vie politique et de la répugnante "éthique" de ses gouvernants. L’exploitation de l’image d’un Chavez terrassé par la maladie, a mis à nu le cynisme des belligérants de tout bord dans cette lutte électorale. C’est ainsi que les uns et les autres ont tout fait pour attendrir les cœurs des vénézuéliens et amoindrir la colère que les effets de la crise font surgir chez eux, en même temps qu’est encensée, comme le fait la gauche latino-américaine, "la si saine démocratie bolivarienne".
L’absence de Chavez a fait surgir des bagarres intestines et a ouvert une vague d’incertitude au sein de la population : d’un côté, ceux de la fraction soutenant le président malade et inaudible, ont besoin de sa figure pour contrôler les appétits de ceux qui poussent des coudes pour la relève, pendant que la droite n’arrive pas à tirer profit de la situation, tout en se présentant comme la rénovation nécessaire pour le système ; les deux se repaissent du chagrin et vendent de la compassion une bible à la main.
Le chavisme contrôle pratiquement tous les pouvoirs publics et les institutions, ce qui aurait facilité l’élection du candidat, mais il existe un contexte politique, économique et social qui rend difficile pour la majorité chaviste la convocation d’élections de suite. Sur le plan politique, même si l’un des plus visibles continuateurs de la politique du pouvoir chaviste, le vice-président Maduro, s’est vu adoubé par Chavez lors de son départ pour se faire soigner à Cuba, pendant l’absence de celui-ci on a vu comment les militaires, parmi lesquels Chavez s’est formé politiquement, ont mis en avant Diosdado Cabello, président de l’Assemblée Nationale, pour prendre la tête de la "Révolution bolivarienne" sans Chavez. Indépendamment de celui qui sera mis au sommet, après toutes les escarmouches de rigueur, la fraction bourgeoise au pouvoir finira par trouver un accord pour continuer à administrer et à gérer pour que la crise économique mondiale n’entame pas trop leurs profits et qu’elle retombe, évidemment et comme toujours, sur le dos de la classe ouvrière.
Dans leur situation d’orphelins, même si leurs prochains pères sont bien identifiés, les cohortes chavistes durcissent leur politique vis-à-vis des autres fractions bourgeoises avec la volonté de garder leur hégémonie. Et en même temps, ils envoient des messages aux travailleurs pour qu’ils rejoignent les rangs du PSUV (Parti Socialiste Uni de Venezuela) et ses satellites. Par ailleurs, ceux qui se lanceraient dans une mobilisation au milieu de la situation confuse actuelle subiraient la répression immédiate. Le combat parlementaire a pris des allures grotesques et ridicules avec des mises en scène où l’on défend la glorieuse constitution et où l’on évoque la sainteté des hommes illustres vivants ou morts. On menace également, à coup d’investigations pour corruption, d’anciens gouverneurs de l’opposition en accentuant encore plus la décomposition sociale galopante.
La crise à son apogée
Mais le problème le plus grave que la bourgeoisie doit affronter avec ou sans le régime chaviste, comme n’importe quel autre dans le monde, c’est la situation économique. Le chavisme prétend convaincre tout le monde de la viabilité de son projet politique en contournant la crise économique mondiale au moyen de la rente pétrolière comme si c’était un jet continu de dollars inépuisable à la disposition de l’Etat. À cheval sur un populisme effréné, le chavisme s’est lancé bride abattue à la sauvegarde des pauvres et des déclassés, à la conquête d’une clientèle politique dans les immenses bidonvilles qu’il n’a contribué qu’à agrandir, en criant, en braillant là où on veut bien l’entendre, qu’avec la manne pétrolière et avec une nouvelle constitution approuvée par un vote obligatoirement enthousiaste, il édifierait un socialisme aux contours incertains. Voilà un exemple de sa logorrhée attrape-couillons. Ainsi, avec un tel aplomb mystificateur, et l’incommensurable contribution des syndicats, le chavisme essaye de bloquer toute amélioration des conditions de vie du prolétariat vénézuélien. Sur ce terrain, le chavisme, sa suite ou la très hypothétique alternance de droite, sont très jaloux à l’heure de sauvegarder le taux de profit des capitalistes. Depuis 1998, l’année où Chavez a pris la tête de l’État, jusqu’en 2010, le salaire réel dans le secteur privé s’est dévalué de 31%. Et aujourd’hui le tableau économique est très grave. En 2012, on a dépassé tous les records avec des chiffres qui mettent en évidence que l’économie du Venezuela est aussi malade, sinon plus, que son président : haut déficit fiscal (18% du PIB), dû aux dépenses publiques démesurés (51% du PIB) ; importations les plus élevés des seize dernières années (59% par rapport aux exportations) ; 22% d’inflation, la plus élevée de la région... Les dépenses de l’Etat ont été couvertes, en plus de la rente pétrolière, par l’augmentation de la dette ; celle-ci a atteint 50% du PIB alors qu’elle était de 35% en 1998 ; on couvre aussi cette dette en faisant tourner la planche à billets, un argent qui n’est soutenu par la moindre richesse, ce qui a entraîné les niveaux d’inflation les plus élevés de la région ces dernières années.
À cause de la méfiance généralisée dans les Etats, incapables de solder leurs dettes souveraines, la Chine, qui a octroyé des prêts importants à l’Etat vénézuélien ces dernières années, ne veut plus désormais en octroyer d’autres à une économie qui ressemble à un puits sans fond ; les doutes sur la santé, pas seulement celle de Chavez, mais de l’économie vénézuélienne rendent plus difficile et coûteux le placement des obligations d’Etat sur le marché dont la prime de risque a atteint 13,6%. Cela préoccupe autant la majorité chaviste au pouvoir que les opposants. La bourgeoisie de la région est préoccupée par le Venezuela dont elle espère que la situation politique se stabilise, surtout les dirigeants des pays de l’ALBA2 et ceux qui sont bénéficiaires de rabais sur la facture pétrolière. Évidemment les représentants de "l’Empire" (les États-Unis), néanmoins client principal des exportations pétrolières, demandent que l’on respecte la constitution et la démocratie ; le Brésil (pays avec lequel le Venezuela est pas mal endetté) et la Colombie attendent de leur côté une issue stable. Tous seraient affectés par une situation prolongée de l’incertitude qui règne au Venezuela.
Seule la lutte prolétarienne a de l’avenir
Sans la force médiatique braillarde de son président "socialiste", la bourgeoisie craint les conséquences des mesures draconiennes que l’aggravation de la crise économique mondiale lui exige de prendre pour essayer d’éviter la possible banqueroute des finances publiques, tout en évitant la colère des travailleurs qui pourra s’exprimer dans des mobilisations qui ne pourront que déstabiliser une situation sociale déjà bien fragile. Les dénommées "Missions", fers de lance de la politique chaviste pour pallier aux conditions dramatiques de pauvreté dans lesquelles vivent de larges couches de la population et qui sont une des bases électorales du chavisme, vont réduire leurs moyens en mettant ainsi à nu le grand mensonge des soi-disant réussites du "socialisme du XXIe siècle". Et ce sont les travailleurs qui subiront le plus les attaques de la bourgeoisie. Ce sont les ouvriers, véritables otages captifs pour les impôts, qui ont sur leur dos les lourdes charges de l’appareil d’État vénézuélien, avec les programmes "anticrise". Et loin d’être bénéficiaires des dépenses sociales de santé, d’éducation et de logement, ils ont surtout eu des réductions progressives de leurs salaires à tel point que 60% des ouvriers sont payés avec le salaire minimum mensuel (autour de 321 dollars-US, qui se réduisent à 100 si l’on considère le taux de change non officiel). Dans ces conditions, les travailleurs ont devant eux la nécessité de retrouver leurs liens d’unité et de solidarité qui leur permettront de récupérer leur identité de classe en entreprenant des luttes pour une amélioration de leurs conditions de vie. Au milieu du tintamarre sentimental et de la mystification du projet chaviste, la classe ouvrière commence déjà à faire montre de sa combativité et de sa confiance en ses propres forces pour combattre son ennemi, quel que soit le camouflage avec lequel il se présente dans ce pays caribéen. Les syndicats de tout poil montrent bien, par réaction, le changement : ils commencent à préparer leurs manœuvres les plus sophistiquées pour essayer d’encadrer la révolte sociale émergeante pour la canaliser vers la défense d’une prétendue révolution qui n’a bénéficié qu’à la bourgeoisie et qui n’a fortifié que le capitalisme.
Les minorités les plus conscientes de la classe prolétarienne ont la responsabilité de montrer à cette classe à laquelle elles appartiennent qu’autant le "socialisme bolivarien" de la gauche que la "démocratie sociale" de la droite, sont les deux faces d’un même monstre décadent qui doivent être affrontés théoriquement et politiquement pour ouvrir la voie vers l’émancipation de la classe ouvrière et le communisme.
Pedro/Cadinov (25 février)
1 En fait, ce projet aurait pu se réaliser si le corps n’avait pas été trop abîmé quand cela s’est décidé.
2 Alliance bolivarienne pour les Amériques. Il s’agit d’une organisation politique et économique, fondée par Hugo Chavez et Fidel Castro en 2005, visant à servir les intérêts impérialistes de plusieurs pays plus ou moins en opposition avec les Etats-Unis. L’Iran et la Russie, notamment, ont un statut de membres de l’ALBA. [NdT]
Rubrique:
ICConline - juin 2013
- 1200 reads
Effondrement d’un atelier au Bangladesh: l’industrie du meurtre
- 1215 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article paru dans World Revolution, organe de presse du CCI en Grande-Bretagne.
Le 24 avril, plus de mille personnes, en grande partie des femmes, ont perdu la vie lors de l’effondrement de l’usine Place Rana à Dhaka, au Bangladesh. Huit autres personnes ont été tuées dans l’incendie du quartier Mirpur dans la même ville. Le nombre de morts aurait certainement été plus important si le feu s’était déclaré pendant la journée, comme cela s’est passé en novembre dernier à l’usine textile Tazreen où cent douze ouvriers sont morts.
Ces "accidents" sont l’expression du meurtre industriel. Il ne faut pas cacher le fait qu’il existe un terrible désintérêt pour la sécurité des ouvriers du textile au Bangladesh, qui triment dans des conditions épouvantables pour des salaires très bas. Mais il ne s’agit pas d’un excès regrettable que l’on pourrait imputer à quelques patrons sans scrupule. Cette situation est inscrite dans la structure profonde de l’économie mondiale. Diminuer les coûts de la force de travail profite non seulement aux gredins locaux à qui appartiennent les usines, mais aussi aux grandes entreprises internationales du vêtement : les belles marques de prestige comme Primark ont gonflé leurs profits grâce aux prix cassés du travail qu’on peut imposer dans le Tiers-Monde.
De plus, malgré les réformes effectuées et les progrès dans la production industrielle à l’Ouest, le capital fait partout le maximum de profit aux dépens de la vie humaine. Presque en même temps, avait lieu l’attaque terroriste contre la foule assistant au marathon de Boston et l’explosion d’une usine d’engrais à West, près de Wako au Texas, qui causa quatorze morts, deux cents blessés et souffla deux pâtés de maisons. Sur le moment, cela passa pour un accident. Plus récemment, un auxiliaire médical présent sur la scène fut accusé d’avoir provoqué l’explosion. Mais quelle que soit la vérité, l’explosion de West révèle la profonde irresponsabilité de la production capitaliste, dans la mesure où l’usine contenant des matériaux hautement volatiles était située près d’un établissement de soins, une école et un certain nombre d’immeubles résidentiels. Cela fait penser à l’explosion de l’usine chimique d’engrais de Toulouse, en France, au début des années 2000, où vingt-huit ouvriers furent tués plus un enfant. Dix mille cinq cents personnes furent blessées, un quart d’entre elles gravement. Finalement, le directeur de l’usine a été exonéré de toute responsabilité lors du procès qui a suivi. Nous pourrions également parler de l’installation de la centrale nucléaire de Fukushima dans un lieu hautement vulnérable aux séismes et aux tsunamis, qui est également situé tout près d’une zone résidentielle.
Dégoûté par les dernières nouvelles du Bangladesh, un sympathisant de notre organisation a envoyé ces observations sur notre forum de discussion1. Nous pouvons seulement dire que cette colère est amplement justifiée : "La situation au Bangladesh est en train d’atteindre des proportions grotesques, avec des désastres horribles –le meurtre industriel– qui surviennent avec une régularité écœurante. Pourquoi chacun s’embête–t-il encore à aller au travail au Bangladesh, à la fin ? Dieu sait qu’ils sont à peine payés, de plus ! Alors, pourquoi y aller ? La réponse, bien sûr, est que, sous le capitalisme, nous avons tous besoin même de la plus infime somme d’argent que la bourgeoisie peut nous donner –le salaire : ‘un salaire, juste pour un jour de travail’ ou quelque ordure de ce genre – contente-toi de survivre au jour le jour. Nous subsistons avec des salaires de misère pris aux capitalistes dans des circonstances qui mettent souvent nos vies en péril. Et les risques ne sont pas seulement physiques (incendies et effondrement d’immeubles ou environnements pollués par du poison), ils peuvent aussi être psychologiques, générant des détresses consternantes et du chagrin. Oh ! Comme nous devrions être reconnaissants à la bourgeoisie ; sa générosité et son humanité ; son engagement infini pour la planète et le règne de la paix à travers le monde ! Où serions-nous sans elle ? Comment pourrions-nous nous débrouiller sans elle, valorisant son mode de vie rapace sur notre existence, afin de lui permettre de réaliser son profit ? Et combattre dans ses guerres violentes ! Si l’on ne se fait pas écraser dans l’effondrement d‘une usine, ou carboniser à l’intérieur d’une usine fermée à clé, on a toujours la possibilité d’une mort lente dans un tsunami radioactif, un anéantissement soudain par des bombardements venus de loin de missiles ou de drones, ou une élimination pénible et angoissante par les armes chimiques, ou une disparition instantanée à cause d’un tireur d’élite d’un camp ou d’un autre des groupes perpétuellement en conflit : officiel ou autre. La bourgeoisie n’a pas seulement inventé le ‘monstre industriel’, elle a également transformé le meurtre de masse en industrie. C’est la seule chose qu’elle sache faire bien maintenant."
Amos (11 mai)
1 Nous profitons de cette occasion pour encourager tous nos lecteurs à venir débattre sur nos forums en français, anglais et espagnol.
Géographique:
- Asie [37]
Rubrique:
Le legs de Chavez à la bourgeoisie: un programme de défense du capital, une grande mystification pour les masses appauvries
- 1768 reads
Nous publions ci-dessous de larges extraits d’un article écrit par notre section au Venezuela suite au décès d’Hugo Chavez. La version intégrale est disponible sur notre site en langue espagnole.
Il n’y a pas que les hiérarques de l’Etat vénézuélien qui pleurent la mort de Chavez, mais aussi de nombreux gouvernants d’Amérique latine et du monde. Certains d’entre eux sont même venus "faire leurs adieux" au leader de la "révolution bolivarienne". Beaucoup sont venus à cause de leurs engagements politiques et commerciaux (c’est le cas des pays membres de l’ALBA1 et des pays bénéficiaires d’accords pétroliers avec le Venezuela), mais tous ont entonné à l’unisson un concert de lamentations sur la disparition de ce chef d’État. Au nom de "la lutte contre la pauvreté" et "la justice sociale", Chavez a réussi à imposer un projet de gouvernement qui, pendant 14 ans, a permis à une large partie de la bourgeoisie d’attaquer les conditions de vie et la conscience du prolétariat (…).
Le prolétariat doit s’appuyer sur son expérience historique pour rejeter et démasquer ce déluge de sentimentalisme et d’hypocrisie de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoise. Chavez est un mythe créé par le capitalisme, alimenté et renforcé par la bourgeoisie nationale comme mondiale, à l’aide de la mystification du "socialisme du XXIe siècle". La bourgeoisie mondiale, surtout ses tendances de gauche, a besoin de maintenir vivant ce mythe. Et le prolétariat, de son côté, a besoin de développer ses propres armes pour combattre l’idéologie du chavisme et ainsi montrer aux couches sociales les plus appauvries le véritable chemin vers le socialisme.
L’émergence du chavisme : un projet bourgeois, nationaliste de gauche
L’émergence de Chavez dans l’arène politique date de sa tentative de coup d’État à la tête d’un groupe de militaires contre le social-démocrate Carlos Andrés Pérez en 1992. Depuis, sa popularité n’a jamais cessé de grandir de manière vertigineuse jusqu’à son arrivée à la présidence de la république au début de l’année 1999. Durant cette période, il a réussi à engranger les fruits du mécontentement et de la méfiance de larges secteurs de la population vis-à-vis des partis social-démocrate (gauche) et social-chrétien (droite) qui faisaient l’alternance au pouvoir depuis la chute de la dictature militaire en 1958, surtout auprès des masses les plus paupérisées du Venezuela touchées par la crise économique des années 1980 et qui furent les protagonistes des révoltes de 1989. Ces deux partis étaient entrés dans un processus de décomposition caractérisé par une corruption généralisée et l’abandon des tâches de gouvernement, ce qui n’était que l’expression de la décomposition qui embrassait l’ensemble de la société, surtout au sein des classes dominantes, au point que celles-ci ont été incapables de donner un minimum de cohésion à leurs forces pour garantir la paix sociale.
Chavez, grâce à son charisme et à son ascendant auprès des masses les plus paupérisées, qui ont vu en lui l’avènement enfin possible d’un État protecteur, reçut le soutien de plusieurs secteurs du capital national, notamment des forces armées, ainsi que des partis de gauche et des gauchistes des années 1960 et 1970, lesquels ont ressuscité leur vieux programme politique basé sur les luttes de "libération nationale" remis au goût du jour : toujours contre "l’impérialisme yankee" et pour le surgissement d’une authentique bourgeoisie nationaliste et bolivarienne, favorable à la création de la "grande patrie sud-américaine" et appuyant ses objectifs sur les revenus très juteux des exportations pétrolières (…). Donc, dès le départ, le projet chaviste fut conçu comme un projet bourgeois de gauche, capitaliste d’État et nationaliste, basé sur une union entre les civils et les militaires, et prenant comme référence les régimes les plus despotiques d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient, beaucoup d’entre eux étant d’anciens alliés du bloc impérialiste russe disparu.
Tout au long de ses 14 ans de gouvernement, Chavez a permis à son projet de gouvernement de prendre corps. Celui-ci sera plus tard nommé "socialisme du XXIe siècle" et se nourrira de l’exclusion et de la confrontation avec les secteurs du capital national au pouvoir jusqu’en 1998 et des secteurs du capital privé opposés à Chavez, ainsi que d’une géopolitique régionale et mondiale agressive renforcée par un anti-américanisme radical.
Son grand "secret", célébré par une partie importante de la bourgeoisie mondiale, consiste en ce qu’il a su renouveler les illusions et les espoirs de la grande masse de pauvres laissés pour compte au Venezuela, en les sortant de "l’invisibilité", en leur faisant croire qu’un jour ils pourraient sortir de leur situation de misère, alors que ce que le chavisme a fait en réalité, c’est appauvrir l’ensemble de la population, les travailleurs surtout, en appliquant la formule maitresse de la gauche du capital : le "nivellement par le bas". Et c’est ainsi que le chavisme a réussi à contenir le malaise social de cette masse de pauvres que le capitalisme décadent a accumulé tout le long du XXe siècle, une masse qui n’a cessé d’augmenter parce qu’il est impossible pour le capital de l’intégrer au travail productif. Mais il a également atteint un autre objectif qui fait l’envie des autres bourgeoisies : il peut compter sur une masse électorale qui a permis aux nouvelles élites civiles et militaires de la classe dominante de se maintenir au pouvoir par les voies démocratiques. Ce n’est pas un hasard si les forces chavistes, pendant ces 14 années au pouvoir, ont emporté 13 des 15 élections nationales qu’elles ont organisées.
Chavez : un indéniable produit de la décomposition de la société capitaliste
Le surgissement du chavisme ne doit pas être envisagé uniquement comme le résultat de l’échec des gouvernements qui l’ont précédé, encore moins comme le résultat du seul charisme de Chavez, tel que la bourgeoisie voit les choses, c'est-à-dire les grands personnages comme seul moteur de l’histoire. Le chavisme est l’expression de la décomposition du système capitaliste dans son ensemble. L’effondrement du bloc russe à la fin des années 1980 fut le signal le plus visible de l’entrée du capitalisme dans la nouvelle phase de sa décadence, celle de sa décomposition2. Cet événement, qui bouleversa le système des blocs impérialistes existant jusqu’alors, a eu deux conséquences principales : l’affaiblissement progressif de l’impérialiste américain au niveau mondial et une attaque en règle contre la conscience de classe du prolétariat, avec un battage incessant identifiant l’effondrement du bloc stalinien avec la "mort du communisme". Les secteurs du capital, pour pouvoir survivre dans leur tâche d’embrigadement de la classe ouvrière, devaient fabriquer de "nouvelles" idéologies ; et c’est ainsi que, au cours des années 1990, surgit la "troisième voie" avec des mouvements de gauche et gauchistes dans les pays de la périphérie mais, aussi d’Europe. C’est dans ce bouillon de culture, produit de la décomposition du système capitaliste, que Chavez émerge et consolide son projet, en compagnie d’autres leaders et d’autres mouvements sociaux de gauche dans plusieurs pays d’Amérique latine : Lula avec le soutien du PT, du MST et des Forums Sociaux au Brésil ; Evo Morales en Bolivie avec le mouvement indigéniste ; ou le zapatisme au Mexique et son soutien au mouvement indigène et paysan, etc. (…).
Le régime chaviste n’a pas pu stopper l’avancée imparable de la décomposition sociale au Venezuela ; c’est plutôt le contraire : il en a été un facteur d’accélération tant sur le plan intérieur que régional. En chassant les hauts bureaucrates des entreprises et des institutions de l’Etat, le chavisme les a remplacé par de nouveaux bureaucrates civils et militaires qui sont parvenus à amasser de grandes fortunes et des propriétés à l’intérieur et à l’extérieur du pays au moyen d’une corruption dépassant largement celle des gouvernements précédents. Le chavisme a ainsi su acheter la fidélité à son projet "révolutionnaire" en distribuant sans compter les revenus du pétrole (…)
L’hégémonie des fractions chavistes de la bourgeoisie au pouvoir est basée sur un renforcement de l’Etat sur tous les plans et un affrontement permanent avec des secteurs du capital national opposés au régime, surtout contre quelques représentants du capital privé, soumis à des expropriations et des contrôles ; c’est la manière avec laquelle ce régime justifie devant ses supporters qu’il lutte contre "la bourgeoisie", alors que beaucoup de chavistes sont devenus de dignes représentants du capital privé. C’est ainsi que l’affrontement politique entre les fractions du capital national a été le trait dominant du régime chaviste ; une lutte où chaque fraction du capital tire de son côté et essaye d’imposer ses intérêts particuliers, y entraînant l’ensemble de la société et en ayant des répercussions sur tous les plans de la vie sociale.
Sur le plan économique, la crise générale du système a mis à nu le caractère insoutenable des prétentions du chavisme à élever le Venezuela au rang de puissance économique régionale, ce qui se concrétise, entre autres choses, par l’abandon de l’infrastructure industrielle du pays (qui affecte même "la poule aux œufs d’or", l’industrie pétrolière), les infrastructures routières et le service de l’électrification (pourtant l’un des meilleurs d’Amérique latine il n’y a pas plus de deux décennies) qui sont fortement délabrés. Au niveau des télécommunications, le Venezuela souffre d’un retard considérable par rapport aux autres pays de la région.
Mais c’est au niveau social que se produit le pire des drames : la détérioration des services de santé et de l’éducation (que le chavisme vend comme l’une des plus grandes réussites de "la révolution") est plus forte qu’il y a une décennie ; et la sécurité publique a été pratiquement abandonnée (mais ce n’est, en revanche, pas le cas quand il s’agit de réprimer les manifestations des travailleurs et de la population) : en 14 années de gouvernement "socialiste", plus de 150 000 personnes ont été assassinées, ce qui a placé le Venezuela (et surtout sa capitale, Caracas) au rang des pays où la criminalité est la plus élevée au monde, dépassant les chiffres du Mexique et de la Colombie3.
Lors du décès du grand leader de la "révolution bolivarienne", le pays berceau du "socialisme du XXIe siècle" se retrouve enfoncé dans une crise économique grave. En 2012, les indicateurs économiques ont battu tous les records et mettent en évidence que l’économie est aussi malade que l’était son ancien président : déficit fiscal élevé (autour de 18% du PIB, le plus élevé de la région), à cause d’une dépense publique pharamineuse (51% du PIB) ; les importations ont été les plus élevées depuis 16 ans, autour de 56 milliards de dollars, et elles équivalent à 59% des exportations ; il y a eu 22% d’inflation, la plus élevée de la région (…). Et pour aggraver la situation, la Chine, qui a fait d’importants crédits à l’État vénézuélien ces dernières années, refuse d’en octroyer d’autres à une économie qui ressemble à un puits sans fond. Par ailleurs, les doutes sur la santé de l’économie vénézuélienne rendent plus difficile et coûteux le placement des bons d’Etats sur le marché, pour lesquels il faut payer une prime de 13,6%.
Le projet chaviste du "socialisme du XXIe siècle" est un énième échec de la bourgeoisie, une version du capitalisme d’État au XXIe siècle qui enfonce les travailleurs et la société dans la pauvreté alors que la classe bourgeoise, et surtout la nouvelle élite chaviste, s’enrichit. Voilà un exemple qui montre que la droite, la gauche et les gauchistes n’ont aucune solution contre la misère et la barbarie auxquelles le capitalisme nous soumet.
Le mythe de la réduction de la pauvreté
Depuis la mort de Chavez, tant les chefs d’État que les hauts représentants d’institutions comme l’ONU, l’OEA ou la Banque Mondiale (BM) ont insisté sur sa politique en faveur des plus pauvres qui, d’après ces pontes, aurait permis de réduire la misère au Venezuela. Les représentants des partis de gauche, des groupes gauchistes ou des mouvements sociaux se sont également fait l’écho des statistiques manipulées par le pouvoir, prenant le relais d’une propagande orchestrée par le chavisme pour montrer au monde que celui-ci aurait réduit la pauvreté en "redistribuant les richesses", en mettant les ressources de l’État au profit des plans d’alimentation, de santé, d’éducation, etc., pour les secteurs qui en ont le plus besoin.
D’après les chiffres de l’INE, l’organisme chargé des statistiques au Venezuela, ces chiffres montreraient les "réussites de la révolution" de Chavez : les foyers pauvres seraient passés de 49% de la population à 27,4% entre 1998 et 2011 (quelque 4 millions), rejoignant les 37 millions de personnes qui, d’après la BM, auraient cessé d’être pauvres dans la dernière décennie en Amérique latine. La bourgeoisie mondiale a visiblement besoin de mettre en avant des pays qui, sous le régime capitaliste, seraient en voie de "d’éradiquer la pauvreté" et proches de tenir les échéances des "Objectifs du millénaire" que l’ONU avait mis en avant.
La réalité est bien différente car le régime de Chavez n’a fait que massifier la pauvreté, en maintenant les pauvres dans leur misère, en réduisant le niveau de vie des travailleurs sous contrat et des secteurs les plus pauvres des couches moyennes (…)
Le régime se vante d’avoir créé des emplois (autour d’un million dans le secteur public), en opposant cette affirmation au fait (vrai, par ailleurs) qu’en Europe et aux Etats-Unis, c’est le chômage qui augmente. Il est vrai que l’emploi a augmenté au Venezuela de même que dans plusieurs pays de la région, mais il s’agit d’emplois précaires, sans contrat, à durée ni déterminée ni indéterminée, violant même les lois du travail, sans le moindre salaire social de base (santé, aide à l’éducation des travailleurs eux-mêmes et de leurs enfants, etc.) (…). Grâce à cette nouvelle machine de guerre sociale, le chavisme a opéré une véritable saignée parmi les travailleurs des secteurs productifs, en écrasant les salaires autour du salaire minimum (300 $-US au taux de change officiel et 100 $, au marché noir) (…).
Le renforcement de l’État
Chavez avait su "rafraîchir" la mystification démocratique en appliquant la formule de la "démocratie participative". Il a noyauté et mis sous contrôle de l’État les couches les plus pauvres de la population et les mouvements sociaux, à travers des organisations comme les Cercles Bolivariens et, plus récemment, les Conseils communaux, le tout agrémenté de nouveaux plans d’assistance clientélistes appelés "Missions". C’est ainsi que le chavisme a réussi à concrétiser la formule maitresse de l’égalitarisme promue par la gauche, celle du "nivellement par le bas", autrement dit, élargir la paupérisation à l’ensemble de la population, surtout au sein de la classe ouvrière. Le régime de Chavez a réussi à renforcer la puissance de l’État contre la société, ce qui est dans la droite ligne de la vision défendue par la gauche selon laquelle "socialisme" veut dire plus d’État.
De cette manière, l’État ne s’est pas seulement renforcé sur le plan économique en expropriant les secteurs du capital privé opposés au régime, il a aussi renforcé un totalitarisme étatique omniprésent à tous les niveaux de la société. Avec Chavez, la société s’est militarisée et le caractère policier de l’État s’est approfondi pour contrôler et réprimer la population, surtout les travailleurs.
Au niveau interne et externe, le chavisme, à l’instar de ce que font la bourgeoisie cubaine et d’autres bourgeoisies de la région, utilisent "l’impérialisme américain" pour expliquer tous les maux et, surtout pour justifier leur propre politique impérialiste.
Historiquement la bourgeoisie vénézuélienne n’a jamais caché sa volonté de devenir une grande puissance régionale, une orientation que le chavisme a exacerbée grâce au déclin de la puissance américaine dans le monde, notamment dans leur arrière-cour latino-américaine. Grâce à la formule constamment rabâchée de "la menace impérialiste", le régime chaviste justifie l’augmentation des achats d’armement, au point que, selon le Rapport de 2012 du Stockholm International Peace Research Institute sur les ventes d’armes, le Venezuela est devenu le premier importateur d’armes conventionnelles d’Amérique du Sud et le treizième du monde, en augmentant de plus de 500 % l’achat d’armement entre 2002 et 2006, la Russie étant l’un de ses principaux fournisseurs. C’est ainsi que le gouvernement vénézuélien, qui n’arrête pas de parler de paix et d’union régionale, se joint à la course aux armements à laquelle participent les bourgeoisies de la région, en contribuant avec ardeur à la déstabilisation de celles-ci (…).
Le régime chaviste mène une géopolitique plus agressive que les gouvernements qui l’ont précédé. Avec l’objectif de construire "la grande patrie de Bolivar", et en utilisant les ressources pétrolières comme arme de pénétration, il a réussi à devenir un facteur de déstabilisation à cause de la concurrence plus ou moins feutrée avec d’autres aspirants régionaux, surtout le Brésil et la Colombie. Ce régime a créé un ensemble avec Cuba, l’ALBA, qui regroupe les pays acheteurs de la franchise "socialisme du XXIe siècle", ainsi que "PétroCaraïbe"4, pour pénétrer la région des Caraïbes, et d’autres accords avec les pays du Mercosur, l’Argentine notamment. Ces pays ont droit à des avantages sur leurs importations pétrolières et à des "aides" diverses de l’État vénézuélien. C’est ainsi que le chavisme achète des « loyautés » au niveau régional, en investissant une bonne partie de la rente pétrolière et en dégradant les conditions de vie du prolétariat vénézuélien.
Une banalisation du socialisme et une attaque contre l’identité de classe
Après une décennie de campagne orchestrée par la bourgeoisie mondiale autour de la "mort du communisme" à la suite de l’effondrement du bloc stalinien en 1989, avec pour objectif d’affaiblir la conscience et la lutte du prolétariat pour une nouvelle société, le chavisme est venu renforcer ladite campagne, en banalisant et en dénaturant le socialisme, en lui arrachant sa réelle essence prolétarienne. Les secteurs bourgeois et petits-bourgeois opposants apportent aussi leur contribution à cette campagne, en qualifiant le régime de "communiste" ou de "castro-communiste". Ceci est l’un des apports le plus importants de la bourgeoisie chaviste, son obole à l’ensemble de la bourgeoisie, puisque cet amalgame est une attaque en règle contre la conscience de classe du prolétariat, non seulement au Venezuela, mais aussi au niveau régional et mondial.5
Prétendre qu’une "révolution" est en marche, que le socialisme serait en train de s’installer dans un pays grâce à une poignée de militaires et de gauchistes aventuriers qui ont pris le contrôle et renforcé l’État capitaliste, où le sujet révolutionnaire serait le "peuple", où la pauvreté serait prétendument dépassée avec des plans d’assistance, et où l’on serait contre le capitalisme et l’impérialisme parce qu’on lance des diatribes contre les Etats-Unis, c’est prétendre répéter au XXIe siècle la tragédie de ce qui a été au siècle passé la soi-disant "révolution cubaine" contre le développement de la conscience de classe du prolétariat cubain, de celui de l’Amérique latine et du monde entier (…).
La prétendue "révolution bolivarienne" n’a rien à voir avec le socialisme. Il s’agit d’un mouvement chauvin et nationaliste, alors que, comme on le sait, le Manifeste Communiste, premier programme politique du prolétariat, met en avant depuis 1848 le mot d’ordre : "Les prolétaires n’ont pas de patrie ni d’intérêts nationaux à défendre". La "révolution" chaviste est un mouvement aux références hors du temps, parce qu’il prétend nous faire remonter à l’indigénisme précolombien et à la tradition bolivarienne, une idéologie en lien avec la bourgeoisie révolutionnaire de son temps (début du XIXe siècle) en lutte contre la domination espagnole au profit de l’oligarchie créole, une pensée aujourd’hui totalement réactionnaire. Le chavisme est un projet bourgeois qui ne part pas du tout d’un mouvement de luttes du prolétariat, mais des secteurs de la petite bourgeoisie gauchiste civile et militaire, aigrie parce qu’exclue du pouvoir à la suite du renversement de la dictature en 19586. Il s’appuie sur les masses paupérisées et sur les secteurs les plus faibles du prolétariat, que la bourgeoisie vénézuélienne a habitués pendant des décennies à l’assistance et au clientélisme politique, parce que ces secteurs sont plus vulnérables et plus enclins à se laisser berner par la moindre miette que l’État distribue. C’est dans ce but que ce régime organise les Cercles Bolivariens ou Conseils Communaux et mobilise pour précariser les conditions de vie de la classe ouvrière active (qu’il qualifie d’aristocratie ouvrière) allant même jusqu’à l’affronter avec ses bandes armées. Dans ce sens, le projet chaviste s’inscrit dans l’ensemble des "mouvements sociaux" promus par la gauche et le gauchisme dont l’objectif consiste en ce que les masses paupérisées s’habituent à vivre dans la misère et la précarité et que leurs luttes ne rejoignent pas celles du prolétariat, de la classe sociale qui produit de manière associée, qui utilise la grève comme mécanisme de confrontation contre le capital et qui peut prendre conscience de la force sociale qu’elle représente et lutter pour dépasser la misère à laquelle le capitalisme la soumet (…).
La riposte du prolétariat
La mort de Chavez ne signifie pas mort du chavisme. Chavez n’a pas été ni ne sera pas le dernier dirigeant populiste d’un pays latino-américain : le XXe siècle a accouché de plusieurs chefs d’État avec des profils plus ou moins semblables qu’on considérait comme une espèce en voie d’extinction. La bourgeoisie a besoin de ses Chavez pour contrôler et essayer de leurrer les masses les plus pauvres qui, en partie, appartiennent aux secteurs les plus faibles et les plus atomisés du prolétariat, des secteurs qui, inévitablement, continueront à s’accroitre tant que le système capitaliste, qui ne fait que s’enfoncer dans sa décadence et sa décomposition, perdurera.
Cette situation dramatique met le prolétariat au défi historique de développer ses luttes et de devenir la référence pour ces masses miséreuses qui mettent aujourd’hui leurs espoirs dans l’État et dans ce genre de messies que, tel Chavez, le capitalisme crée. Le prolétariat au Venezuela lutte, malgré le harcèlement idéologique et répressif de l’État, malgré la polarisation politique excitée par les factions du capital. Des travailleurs du secteur industriel et du secteur public, utilisent l’arme de la grève et de la manifestation pour affronter l’État ; même si certains ont des sympathies vis-à-vis du chavisme, ils montrent, par contre, une méfiance vis-à-vis de l’État-patron. Les attaques permanentes de l’État "socialiste" les poussent à résister ; ils n’ont pas d’autre chemin7 (…).
Face à l’idéologie gauchiste du chavisme, face aux idéologies que la bourgeoisie génère et continuera à générer pour la sauvegarde de son système, le prolétariat au Venezuela et au niveau mondial a besoin de développer sa lutte contre le capital en allant plus loin que ses revendications immédiates, en développant sa conscience politique, en s’organisant en tant que classe autonome. La classe ouvrière ne connaît pas de frontières dans sa lutte, et doit prendre conscience que ce n’est qu’en luttant de façon autonome contre toutes les idéologies démoralisantes, dans tous les pays, mais avec des formes différentes, et en luttant sur le terrain de la défense de ses propres intérêts, pas ceux d’un Etat, quel qu’il soit, qu’elle pourra imposer la construction d’une autre société ouverte à la libération de toute l’humanité : celle du communisme (…).
Internacionalismo (24/03/13)
1 Alternative Bolivarienne pour les Amériques dont font partie l’Equateur, le Nicaragua, la Bolivie, Cuba et quelques autres pays (NdT).
2 Cf. "La décomposition, phase ultime de la décadence capitaliste [39]" (NdT).
3 Voir l’article en espagnol : Incremento de la violencia delictiva en Venezuela: Expresión du drama de la descomposición du capitalismo [40], (juin 2012).
4 PétroCaraïbe est un accord entre le Venezuela est plusieurs pays des Caraïbes permettant à ces derniers d’acheter du pétrole vénézuélien à des prix préférentiels (NdT).
5 On peut constater comment cette mystification idéologique s’est transposée en France avec, d’un côté, Mélenchon et son Parti de Gauche qui sont devenus les défenseurs inconditionnels du chavisme. Et, de l’autre côté, le reste de la bourgeoisie, en particulier les journalistes qui font la fine bouche et se pincent le nez devant un régime "socialiste" "si peu démocrate" tout en "faisant justice" au chavisme pour avoir prétendument "réduit la pauvreté" [NdT].
6 Il s’agit de la dictature droitière et pro-américaine du général Pérez Jiménez. Après sa chute et jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Chavez en 1999, il y a eu une succession de gouvernements tantôt à droite (démocratie chrétienne) tantôt à gauche (social-démocratie) mais aussi corrompus les uns que les autres. Pendant ces années, le Venezuela a connu des mouvements et des guérillas pro-castristes [NdT].
7 Voir les articles : Guayana est une poudrière : le prolétariat à la recherche de son identité de classe à travers la lutte (mars 2010), (https://fr.internationalism.org/icconline/2010/guayana_est_une_poudriere_le_proletariat_a_la_recherche_de_son_identite_de_classe_a_travers_la_lutte.html [41]) et Les ouvriers de Guayana (Venezuela) luttent contre le chavisme. (juillet 2011), (https://fr.internationalism.org/icconline/2011/les_ouvriers_de_guayana_luttent_contre_le_chavisme.html [42])
Personnages:
- Hugo Chavez [43]
Rubrique:
Manifestations contre l'augmentation du prix des transports au Brésil: la répression policière provoque la colère de la jeunesse
- 1713 reads
Nous publions ci-dessous la traduction d’un article de Revolução Internacional, organe de presse du CCI au Brésil.
Une vague de protestations contre l’augmentation du prix des transports collectifs se déroule actuellement dans les grandes villes du Brésil, particulièrement dans la ville de São Paulo mais aussi à Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Aracaju et Natal. Cette mobilisation rassemble des jeunes, étudiants et lycéens et dans une moindre mesure, cependant non négligeable, des travailleurs salariés et autonomes (prestataires de services individuels).
La bourgeoisie brésilienne, avec à sa tête le PT (Parti du Travail) et ses alliés, a insisté pour réaffirmer que tout allait bien. Et cela alors que la réalité perceptible montre qu’il existe de grosses difficultés pour contenir l’inflation au moment où sont adoptées des mesures de soutien à la consommation des ménages afin d’éviter que l’économie n’entre en récession. Sans aucune marge de manœuvre, la seule alternative sur laquelle elle peut s’appuyer pour contenir l’inflation consiste d’une part à augmenter les taux d’intérêt et de l’autre à réduire les dépenses des services publics (éducation, santé et aide sociale).
Ces dernières années, beaucoup de grèves ont éclaté contre la baisse des salaires et la précarisation des conditions de travail, de l’éducation et du système de soins. Cependant, dans la majorité des cas, les grèves ont été isolées par le cordon sanitaire des syndicats liés au gouvernement "pétiste" (dominé par le PT) et le mécontentement a été contenu afin qu’il ne remette pas en question la "paix sociale" au bénéfice de l’économie nationale. C’est dans ce contexte qu’intervient l’augmentation du prix des transports à São Paulo et dans le reste du Brésil : toujours plus de sacrifices pour les travailleurs afin de soutenir l’économie nationale, c’est-à-dire le capital national.
Sans aucun doute, les exemples de mouvements qui ont explosé de par le monde ces dernières années, avec la participation de la jeunesse, mettent en évidence que le capitalisme n’a pas d’autre alternative à offrir pour le futur de l’humanité que l’inhumanité. C’est pour cela que la récente mobilisation en Turquie a eu un écho aussi fort dans les protestations contre le coût des transports au Brésil. La jeunesse brésilienne a montré qu’elle ne veut pas accepter la logique des sacrifices imposée par la bourgeoisie et s’inscrit dans les luttes qui ont secoué le monde ces dernières années comme la lutte des enfants de la classe ouvrière en France (lutte contre le CPE en 2006), de la jeunesse et des travailleurs en Grèce, Egypte et Afrique du Nord, des Indignés en Espagne, des "Occupy" aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Une semaine de protestations et la réaction brutale de la bourgeoisie
Encouragées par le succès des manifestations dans les villes de Porto Alegre et de Goiânia, qui ont dû faire face à une forte répression et qui, malgré celle-ci, ont réussi à obtenir la suspension de l’augmentation du prix des transports, les manifestations à São Paulo ont commencé le 6 juin. Elles furent appelées par le Mouvement pour le libre accès aux transports (MPL, Movimento Passe Livre), groupe constitué majoritairement par des jeunes étudiants influencés par les positions de gauche, et aussi anarchistes, qui a vu une augmentation surprenante de ses adhérents pour atteindre entre 2000 à 5000 personnes. D’autres mobilisations intervinrent ensuite les 7, 11 et 13 juin. Dès le début, la répression fut brutale et s’est soldée par de nombreuses arrestations et de nombreux jeunes blessés. Il faut ici souligner le courage et la combativité des manifestants et la sympathie qu’ils ont suscitée rapidement dans la population, dès le début, à un point tel que cela a surpris les organisateurs.
Face aux manifestations, la bourgeoisie a déchaîné un niveau de violence peu commun dans l’histoire de mouvements de ce type, parfaitement pris en charge par les médias qui se sont empressés de qualifier les manifestants de vandales et d’irresponsables. Une personne haut placée dans la hiérarchie étatique, le procureur de justice Rogério Zagallo, s’est illustré publiquement en conseillant à la police de bastonner et tuer : "Cela fait deux heures que j’essaie de regagner mon domicile mais il y a une bande de singes révoltés qui bloquent les stations Faria Lima et Marginal Pinheiros. Quelqu’un pourrait-il informer la Troupe de Choc (Tropa de Choque : unité d’élite de la police militaire) que cette zone fait partie de ma juridiction et que s’ils tuent, ces fils de putes, c’est moi qui instruirai l’enquête policière (…). Comment ne pas avoir la nostalgie de l’époque où ce genre de choses se résolvait avec une balle en caoutchouc dans le dos de ces merdes".
En plus de cela, on a vu une succession de discours d’hommes politiques appartenant à des partis adversaires entre eux, comme le gouverneur d’État Geraldo Alckmin, du PSDB (parti de la social-démocratie brésilienne) et le maire de São Paulo, du PT, tous deux vociférant en défense de la répression policière et condamnant le mouvement. Une telle syntonie n’est pas commune, vu que le jeu politique de la bourgeoisie consiste typiquement à attribuer la responsabilité des problèmes qui se posent à la fraction de la bourgeoisie qui se trouve momentanément au pouvoir.
En réponse à la répression croissante et au rideau de fumée des principaux journaux, chaînes de télévision et radio, davantage de participants se sont réunis à chaque mobilisation, jusqu’à 20 000 personnes jeudi dernier, le 13 juin. La répression fut encore plus féroce et cela se traduisit par 232 arrestations et de nombreux blessés.
Il vaut la peine de souligner l’apparition d’une nouvelle génération de journalistes. Quoiqu’encore minoritaires, à travers une claire manifestation de solidarité, ils ont rendu compte des violences policières et, en même temps, en ont été les victimes. Conscients des manipulations toujours présentes dans les éditoriaux des grands médias, ces journalistes sont parvenus, d’une certaine manière, à faire percevoir que les actes de violence des jeunes sont une réaction d’autodéfense et que, certaines fois, les déprédations effectuées essentiellement contre des cabinets gouvernementaux et de la justice sont des manifestations non contenues d’indignation contre l’État. En plus de cela, des actes émanant de provocateurs, ceux que la police utilise habituellement dans les manifestations, ont également été rapportés.
La mise en évidence d’une série de manipulations qui constituait un démenti aux versions de source étatique officielle, des médias et de la police tentant de falsifier les faits, de démoraliser et criminaliser un mouvement légitime, eut pour effet de multiplier la participation des manifestants et d’augmenter le soutien de la population. En ce sens, il est important de souligner la grande contribution qu’a eue l’action sur les réseaux sociaux d’éléments actifs dans le mouvement ou sympathisant avec lui. Par peur que la situation devienne incontrôlable, certains secteurs de la bourgeoisie commencent à changer de discours. Les grandes entreprises de communication, dans leurs journaux et télévisions, après une semaine de silence sur la répression policière ont finalement fait état des "excès" de l’action policière. Certains hommes politiques, de la même manière, ont critiqué les "excès" sur lesquels ils promettent d’enquêter.
La violence de la bourgeoisie à travers son État, quel que soit son visage, démocratique ou "radical", a comme fondement la terreur totalitaire contre les classes qu’elle exploite ou opprime. Si avec l’État démocratique, cette violence n’est pas aussi ouverte que dans les dictatures et est plus cachée, de manière à ce que les exploités acceptent leurs conditions d’exploités et s’identifient à elles, cela ne signifie pas que l’État renonce aux méthodes de répression physique les plus variées et modernes lorsque la situation l’exige. Ce n’est donc pas une surprise si la police déchaîne une telle violence contre le mouvement. Cependant, comme dans l’histoire de l’arroseur arrosé, on a vu que l’accroissement de la répression n’a fait que provoquer une solidarité croissante au Brésil et même dans le monde, encore que de façon très minoritaire. Des mobilisations en solidarité sont déjà prévues en dehors du Brésil, principalement à l’initiative de Brésiliens vivant à l’étranger. Il faut dire clairement que la violence policière est dans la propre nature de l’État et que ce n'est pas un cas isolé ou un "excès" de démonstration de force par la police comme voudraient le faire croire les médias bourgeois et les autorités liées au système. En ce sens, il ne s’agit pas d’un échec des "dirigeants" et cela n’avance à rien de "demander justice" ou encore demander un comportement plus courtois de la police car, pour faire face à la répression et imposer un rapport de force, il n’existe pas d’autre moyen que l’extension du mouvement vers de larges couches de travailleurs. Pour cela, nous ne pouvons pas nous adresser à l’État et lui demander l’aumône. La dénonciation de la répression et de l’augmentation du prix des transports doit être prise en charge par l’ensemble de la classe ouvrière, en l’appelant à venir grossir les actions de protestation dans une lutte commune contre la précarisation et la répression.
Les manifestations, qui sont loin d’être terminées, se sont étendues à tout le Brésil et les protestations ont été présentes au début de la Coupe des Confédérations de football de 2013 qui fut marquée par les huées adressées à la présidente Dilma Rousseff, ainsi qu’au président de la FIFA, Joseph Blatter, avant le match d’ouverture du tournoi entre le Brésil et le Japon1. Tous deux n’ont pu dissimuler à quel point ils furent incommodés par ces marques d’hostilité et ont abrégé leur discours afin de limiter la confusion. Autour du stade s’est aussi déroulée une grande manifestation à laquelle participèrent environ 1200 personnes en solidarité avec le mouvement contre l’augmentation du coût des transports. Elles aussi furent fortement réprimés par la police qui blessa 27 personnes et en mit 16 en détention. Afin de renforcer encore la répression, l’État déclara que toute manifestation à proximité des stades durant la coupe des Confédérations serait interdite, sous le prétexte de ne pas porter préjudice à cet événement, à la circulation des personnes et véhicules, ainsi qu’au fonctionnement des services publics.
Les limites du mouvement pour la gratuité des transports et quelques propositions
Comme on le sait, ce mouvement s’est développé à l’échelle nationale grâce à sa propre dynamique et à la capacité de mobilisation des jeunes étudiants et lycéens contre l’augmentation des prix des transports. Cependant, il est important de prendre en compte qu’il a comme objectif, à moyen et long terme, de négocier l’existence d’un transport public gratuit pour toute la population et mis à disposition par l’État.
Et c’est exactement là que se situe la limite de sa principale revendication, vu qu’un transport universel et gratuit, cela ne peut exister dans la société capitaliste. Pour arriver à cela, la bourgeoisie et son État devraient accentuer plus encore le degré d’exploitation de la classe ouvrière et autres travailleurs, à travers une augmentation des impôts sur les salaires. Ainsi, il faut prendre en compte que la lutte ne doit pas être placée dans la perspective d’une réforme impossible, mais toujours dans celle de faire que l’État révoque ses décrets.
Actuellement, les perspectives du mouvement semblent dépasser les simples revendications contre l’augmentation des tarifs des transports. Déjà des manifestations sont prévues la semaine prochaine dans des dizaines de villes grandes et moyennes.
Le mouvement doit être vigilant vis-à-vis de la gauche du capital, spécialisée dans la récupération des manifestations pour les diriger vers des impasses, comme par exemple demander que les tribunaux de justice résolvent les problèmes et que les manifestants rentrent à la maison.
Pour que ce mouvement se développe, il est nécessaire de créer des lieux pour écouter et discuter collectivement les différents points de vue à propos de la lutte. Et cela n’est possible qu’au moyen d’assemblées générales avec la participation de tous, où est garanti indistinctement le droit de parole à tout manifestant. En plus de cela, il faut appeler les travailleurs salariés, les convier à des assemblées et à des actions de protestation car eux et leurs familles sont concernés par l’augmentation du prix des transports.
Le mouvement de protestation qui s’est développé au Brésil constitue un démenti cinglant à la campagne de la bourgeoisie brésilienne, soutenue en cela par la bourgeoisie mondiale, selon laquelle le Brésil est un "pays émergent" en voie de dépasser la pauvreté et de mettre en route son propre développement. Une telle campagne a été particulièrement promue par Lula qui est mondialement connu pour avoir prétendument tiré de la misère des millions de Brésiliens alors qu’en réalité sa grande réalisation pour le capital est d’avoir réparti des miettes parmi les masses les plus pauvres afin de les maintenir dans l’illusion et accentuer la précarité du prolétariat brésilien en général.
Face à l’aggravation de la crise mondiale et de ses attaques contre les conditions de vie du prolétariat, il n’y a pas d’autre issue que la lutte contre le capitalisme.
Revolução Internacional (Corrente Comunista Internacional), 16 juin
1 Les dépenses somptuaires de l’État et du gouvernement entreprises pour la préparation de la Coupe du Monde de football en 2014 et les JO de 2016 prévus au Brésil alimentent aussi la colère d’une grande partie de la population ainsi davantage pressurée (NdT).
Récent et en cours:
- Luttes de classe [45]
Rubrique:
Mouvements sociaux, guerres impérialistes… une seule alternative: Socialisme ou barbarie
- 1236 reads
D’un côté, la montée des tensions impérialistes et guerrières qui s’expriment en Syrie et dans une moindre mesure au Sahel. De l’autre, une montée de la colère sociale qui a éclaté quasi-simultanément en Turquie et au Brésil, deux pays pourtant sous des régimes prétendument si différents. L’alternative posée par le capitalisme ne pourrait s’exprimer plus clairement : guerre impérialiste ou lutte de classe, désolation ou solidarité,… barbarie ou socialisme !
En Syrie, par exemple, la guerre et les massacres auxquels sont exposées les populations (plus de 100 000 morts en quinze mois) illustrent toute l’horreur et la barbarie d’un système agonisant. Ils traduisent la situation dramatique où sont plongés des millions de prolétaires, englués dans le déchaînement des affrontements entre cliques bourgeoises entretenues par toutes les grandes puissances. Pris en otage, ils ne peuvent constituer une force suffisante pour pouvoir jouer le moindre rôle particulier et à plus forte raison dégager leur propre perspective. Malheureusement, le corollaire de cette situation est que, comme dans une partie croissante du Moyen-Orient ou d’Afrique, la jeunesse exploitée, se retrouvant massivement enrôlée dans l’un ou l’autre des camps opposés, y est réduite à de la chair à canon.
A l’inverse, en Turquie comme au Brésil, des centaines de milliers de prolétaires, qui souffrent aussi fortement, tentent cette fois de s’organiser et de lutter. Ils sont capables de susciter un immense élan de solidarité et de protestation. En première ligne de ce combat, les jeunes générations se réclament et s’inspirent fortement de l’exemple des mouvements des Indignés en Espagne, tout en faisant face à une même répression féroce : qu’elle vienne d’un gouvernement islamiste rétrograde ou d’un pouvoir détenu par la gauche. Une gauche soi-disant la plus "radicale" et "progressiste", variante du fameux "socialisme du XXIe siècle", en vogue en Amérique latine et qui prétendait faire du Brésil un modèle de pays émergent tirant la majorité de la population de son immense pauvreté. Même si au Brésil, le refus de la hausse des prix des transports publics a servi de détonateur/unificateur du mouvement, celui-ci ne se réduit pas à des revendications strictement économiques. Malgré le recul spectaculaire du gouvernement contraint sous la pression de renoncer à cette attaque, comme le gouvernement français qui cherchait à imposer le CPE (Contrat première embauche) avait déjà dû faire machine arrière devant la mobilisation des jeunes prolétaires en 2006, la reculade n’a pas suffi à endiguer la mobilisation car elle est l’expression d’un ras-le-bol beaucoup plus profond. L’exemple de la Turquie est encore plus édifiant. On y trouve, outre une continuité avec la lutte des ouvriers de Tekel en 2008 qui avait déjà démontré, de manière encore embryonnaire, tout un potentiel de combativité et de solidarité au-delà même des divisions inter-ethniques alimentées par la bourgeoisie, le rejet, notamment parmi les nouvelles générations de prolétaires à l’avant-garde du mouvement, d’un carcan et d’une oppression culturelle et idéologique insupportable. Les valeurs morales obscurantistes et autoritaires incarnées par le gouvernement pro-islamique d’Erdogan, ses attitudes provocatrices entraînant radicalisation et extension du mouvement face à la répression, renforcent la puissante aspiration à la dignité. En dépit du poids de la violence et de la décomposition sociale, plus que vers le Printemps arabe facilement récupéré par les religieux, la protestation des jeunes prolétaires en Turquie, imprégnée ces derniers mois par un contexte de luttes ouvrières importantes dans les grands centres industriels du pays et influencée par son expérience laïc depuis Mustapha Kemal Atatürk, s’inscrit, malgré toutes les faiblesses qu’elle exprime, dans une dynamique profonde et dans la lignée du mouvement des Indignés, des Occupy et de Mai 1968. Elle y puise ses ressources les plus vives, face à un monde de misère, d’oppression idéologique et d’exploitation, tout comme d’ailleurs le mouvement social au Brésil qui s’est également nettement démarquée de la religion d’État et d’union sacrée nationale autour du "Dieu football" (prenant ainsi pour cible les dépenses exorbitantes de l’État pour les préparatifs de la Coupe du Monde). Cette agitation intense, ce grondement frémissant venu des entrailles de la société pourrissante traduit une même aspiration, un même espoir. Il est porté par des jeunes générations combatives, les enfants de prolétaires moins marqués que leurs aînés par le poids des défaites, du stalinisme et de la contre-révolution en général. Ils réagissent et appellent ainsi à des rassemblements massifs ou à des mobilisations à partir de portables et des réseaux sociaux, comme Twitter. Depuis les tréfonds des favelas au nord de Rio aux gigantesques manifestations dans toutes les grandes villes brésiliennes, jusqu’à la place Taksim et aux assemblées ouvertes au débat public dans les parcs d’Istanbul ou chez les étudiants chiliens, ils aspirent à un autre type de rapports sociaux, où ils ne seraient plus méprisés ni traités comme des bêtes de somme.
Ces mouvements expriment l’annonce d’une nouvelle période pour le futur, celle d’un ébranlement en profondeur, qui résonne comme un moyen et une promesse d’échapper à la résignation et à la logique de concurrence propre au capitalisme. Exactement sur le même terrain que dans les pays du cœur historique du capitalisme où, si la même dégradation des conditions d’existence est présente aussi, la classe ouvrière ne parvient pas encore à prendre le chemin de luttes massives, en grande partie parce qu’elle trouve face à elle une bourgeoisie très expérimentée et organisée. Mais c’est d’ores et déjà vers cette classe ouvrière des pays centraux, en particulier d’Europe, que se portent les regards des mobilisations actuelles, car elle est la partie du prolétariat mondial la plus concentrée, la plus expérimentée et la plus rompue aux pièges et mystifications les plus sophistiqués tendus en permanence par l’ennemi, tel que la démocratie ou la liberté syndical. Les méthodes de lutte qu’elle est donc potentiellement capable d’établir, comme les assemblées générales massives et autonomes, sont de véritables armes pour l'ensemble du prolétariat international. De sa mise en mouvement dépendra ainsi l’avenir de l’humanité entière.
Wim (26 juin)
ICConline - juillet 2013
- 1071 reads
ICConline - septembre 2013
- 928 reads
Appel à la solidarité pour la rénovation de la Librairie Autonome Gondolkodó à Budapest
- 1123 reads
Nous publions ci-dessous un appel lancé par la librairie Hongroise Gondolkodó Autonom Antikvárium afin de les soutenir et de diffuser leur message.
Le CCI connaît et apprécie la librairie depuis plus de quinze ans. Notre presse est disponible à cette adresse ainsi que de nombreuses autres publications internationalistes de différents pays. Nous avons également pris part à différentes discussions organisées à Budapest par la librairie[1] [46].En fait, il s'agit de l’une des rares librairies à défendre un point de vue prolétarien (et non de la gauche bourgeoise) dans la région du Centre-Est Européen, même si nous ne savons pas si c’est la seule qui ait fonctionné sans interruption depuis plusieurs années comme les camarades l’écrivent dans leur appel.
Une librairie peut être un lieu où l’on diffuse les positions révolutionnaires et, encore plus important, un lieu de discussions sur ces positions dans la recherche d’une clarification et d’une cohérence théoriques. Les camarades de la Librairie Autonome Gondolkodó et le CCI sont d’accord sur la question de la nécessité de venir à bout du mode de production capitaliste et des états nationaux, même si nous avons des divergences concernant d’autres problèmes, notamment sur le rôle des révolutionnaires et les questions d’organisation. Cependant, ces divergences ne nous empêchent pas de diffuser cet appel à la solidarité et sont une stimulation pour les débats futurs à Budapest ou ailleurs, par Internet ou dans des réunions publiques.
CCI
La Librairie Autonome Gondolkodó est le seul endroit où l’on distribue la presse du mouvement ouvrier, le seul lieu de rencontre dans la région du Centre-Est Européen (à savoir en Hongrie) qui fonctionne de manière continue depuis plus de vingt ans. Aujourd’hui, cet endroit doit être réhabilité car les murs sont humides et poreux, le plâtre tombe, les rayonnages des livres sont bancals, les canalisations sanitaires souvent bouchées. L’état de la librairie s’est dégradé petit-à-petit et la distribution des publications est devenue plus difficile dans ces conditions.
Parce que nous ne pouvons pas payer le coût de la rénovation générale, nous lançons un appel à votre aide financière, afin que cette rénovation puisse se faire pendant l’été. S’il vous plaît, soutenez notre projet selon vos possibilités (si vous pouvez envoyer dix euros, c’est déjà bien, mais si vous avez plus d’argent, vous pouvez envoyer une plus grosse somme).
Camarades, militants et sympathisants, s’il vous plaît, diffusez cet appel à la solidarité et soutenez-nous !
Merci pour votre aide au nom de la solidarité prolétarienne internationale !
GONDOLKODÓ AUTONOMOUS BOOKSHOP (17 septembre 2013)
Virements bancaires à :
Raiffeisen Bank
Nom : Tütö Lázló
Iban : HU 3912 0101 5401 3152 1900 2000 06
Swift code : UBRTHUHB
[1] [47] Voir par exemple notre compte-rendu de la réunion publique qui s’est tenue en 2010 à Budapest sur le thème de la situation économique mondiale et les perspectives pour la lutte de classes.
ICConline - octobre 2013
- 1050 reads
Le pacifisme des Verts au service de l'impérialisme
- 1143 reads
"La non-violence comme mode de résolution des crises internationales représente une valeur constitutive de l’écologie politique". Voilà ce que le projet politique d'Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV) disait en 2012.
Le mouvement écologiste, toutes chapelles et appellations confondues, s’est en effet toujours rangé dans le camp du "pacifisme", une doctrine aussi vieille que la guerre et qui depuis deux siècles a pris une ampleur à la hauteur du déchaînement guerrier que le capitalisme a offert à l’humanité.
Pour le pacifisme, la résolution des conflits et oppositions ne peut se faire par la guerre. Tout, soi-disant, doit être fait pour que cette issue fatale ne soit pas mise en œuvre. Un retour même superficiel sur l'histoire contemporaine permet de constater la grande efficacité de cette ligne de conduite…
Dans une vision plus radicale, c’est la violence même, sous toutes ses formes, qui doit être exclue des rapports humains et sociaux. C’est dans cette acception que se rangent manifestement les écologistes français en faisant de la non-violence un pilier de leur doctrine politique.
Dès lors, on est en droit de se demander comment ils pensent pouvoir mener une action militaire non-violente en Syrie ou au Mali. C’est sans doute que la non-violence est à géométrie variable selon que les intérêts du pays sont en jeu ou pas !
Après avoir soutenu l’intervention française au Mali, les écologistes vont maintenant plus loin en se plaçant à l’initiative de pressions sur le gouvernement pour une intervention (non-violente, forcément) face à Bachar El-Assad. Fin août, David Durand, secrétaire national du parti Vert français déclarait dans un communiqué de presse : "pour EELV, une intervention, y compris militaire, nonobstant l’utilisation de la Russie et de la Chine de leur droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, est à ce stade inéluctable". Fin août toujours, Daniel Cohn-Bendit fulmine à la radio sur un possible veto au conseil de sécurité de l’ONU : "Il faut abolir le droit de veto et donc je demande une initiative de l’Europe donc de la France".
Peut-être que leur sensibilité écologiste leur fera mettre une fleur à leur fusil, mais quoiqu’il en soit, les Verts sont bien décidés à prendre les armes. Pourquoi un tel "revirement" ? Pourquoi une telle "trahison" de leur "non-violence" viscérale ?
La réponse tient dans la nature même du pacifisme. Avant chaque conflit impérialiste, le discours pacifiste sort de son hibernation, avec toujours le même résultat : anesthésier les esprits ! Le pacifisme n’est pas une forme de résistance à la guerre, il en est au contraire le préparateur.
La bourgeoisie ne peut pas faire la guerre sans enrôler le prolétariat sous ses uniformes. Même si la guerre est de plus en plus technologique et robotisée, d’une part, elle ne l’est pas complètement, des soldats s’entretuent toujours sur les champs de bataille, et d’autre part, un conflit militaire implique un "effort de guerre" des puissances engagées, un effort tous azimuts justifié par la nécessité de se sacrifier pour une prétendue "paix" et "liberté".
C’est pour cela que le prolétariat constitue toujours un obstacle potentiel aux ambitions guerrières de la bourgeoisie : il lui faut d’abord s’assurer que la classe ouvrière sera suffisamment faible pour ne pas réagir avant même d’envisager de s’engager dans un conflit.
La bourgeoisie doit compter sur tous les moyens pour bâillonner le prolétariat et parmi l’arsenal dont elle dispose, il y a le nationalisme, bien sûr, qui fait vibrer la corde patriotique et la peur de l’étranger, du dictateur, du "barbare". Le nationalisme cherche à faire adhérer le prolétariat à la doctrine impérialiste de la bourgeoisie par la diabolisation d'une autre ou d’autres nations rivales.
Pour ceux qui n’adhèrent pas, il y a alors le pacifisme. Le pacifisme permet d’encadrer théoriquement le réflexe prolétarien de refus de la guerre. Avant même qu’une réflexion ne s’engage dans la classe sur la nature de la guerre et sur les intérêts qu’elle défend, la bourgeoisie oriente ce refus vers le "refus de la violence" en soi, le "refus de la guerre" en soi.
Le pacifisme symbolise l’impuissance absolue. Il théorise la guerre comme étant un moyen facultatif de régler des crises alors même que dans le capitalisme, la guerre est un fléau inéluctable. De ce fait, le pacifisme contribue à masquer la nature du capitalisme et de l’impérialisme, en stérilisant la réflexion pour museler la réaction ouvrière à la guerre. En cela, ils sont d'excellents auxiliaires qui contribuent réellement à préparer la guerre.
Les écologistes continuent ainsi à se construire une réputation de parti bourgeois, de gouvernement, fiable et loyal. Leur contribution à la boucherie impérialiste est bien réelle et peu importe que la guerre soit un fléau environnemental en plus d’être un désastre humain. Se faire une place en tant que parti bourgeois dans l'échiquier politique en est le prix.
La bourgeoisie française sait qu'elle peut compter sur la participation des Verts et sur leur loyauté au capital. Elle trouve en eux de fidèles serviteurs de ses intérêts de classe et il est vrai qu'ils ne ratent jamais une occasion de le démontrer ouvertement.
Il ne faut se faire aucune illusion sur "l’alternative écologiste" ! Les écologistes sont des défenseurs du capitalisme et sont en ce sens des ennemis de la classe ouvrière.
GD (19 septembre)
Rubrique:
Les mouvements sociaux au Brésil de juin 2013: la crise du capital et l’austérité déchaînent l'indignation des masses
- 1814 reads
Un "spectre hante le monde" : le spectre de l'indignation. Un peu plus de deux ans après le "Printemps arabe" qui a ébranlé par surprise les régimes de différents pays d'Afrique du Nord et dont les effets se font encore sentir, deux ans après le mouvement des Indignés en Espagne et des Occupy aux États-Unis, des mouvements ont secoué la Turquie tandis que le Brésil connaissait une vague de manifestations, cette dernière parvenant à mobiliser des millions de personnes dans plus de cent villes, avec des caractéristiques inédites pour ce pays.
Ces différents mouvements se sont produits dans des pays très différents et très éloignés géographiquement, mais partagent pourtant des caractéristiques communes : leur spontanéité, une répression brutale de l'État, leur massivité, une participation majoritaire de jeunes, notamment à travers les réseaux sociaux... Mais le dénominateur commun qui les caractérise est une grande indignation face à la détérioration des conditions de vie provoquée par la profondeur d'une crise qui ébranle les fondements du système capitaliste et a connu une accélération importante depuis 2007. Cette détérioration s'exprime par une précarisation accélérée du niveau de vie des masses ouvrières et une grande incertitude face à l'avenir parmi la jeunesse prolétarisée ou en voie de prolétarisation. Ce n'est pas un hasard si le mouvement en Espagne a pris le nom d’Indignados, et qu'au sein de cette vague de mouvements sociaux massifs, il est celui qui est allé le plus loin dans la remise en cause du système capitalisme comme dans ses formes d'organisation à travers des assemblées générales massives.
Ces mouvements, comme on l'a vu, peuvent surgir dans n'importe quelle partie du monde et chaque fois pour des motifs apparemment insignifiants. Ils sont révélateurs du fait que les luttes sociales tendent à s'imposer au premier plan sur la scène mondiale. Par leurs revendications et leurs méthodes de lutte, ils s'opposent à l'État bourgeois et aux partis qui le représentant, qu'ils soient de droite ou de gauche, et s'inscrivent dans la perspective de la lutte du prolétariat mondial pour la destruction du mode de production capitaliste qui se montre incapable de garantir le développement de l'humanité, sans compter la menace potentielle que représente ce système pour sa survie. Nous sommes ainsi en présence des premiers signes de l'évolution souterraine de cette "vieille taupe" à laquelle se référait Marx et qui commence à saper les fondements de l'ordre capitaliste et essaie de sortir à la surface.
Un mouvement prolétarien
Les mouvements sociaux de juin dernier au Brésil que nous avons salué et dans lesquels nous avons pu intervenir dans la mesure de nos moyens, revêtent une signification très importante à la fois pour le prolétariat brésilien, d'Amérique latine et celui du reste du monde, qui permet de dépasser dans une grande mesure le cadre régionaliste traditionnel de ce pays.
Ces mouvements massifs se distinguent radicalement des "mouvements sociaux" sous le contrôle de l'État, du Parti des Travailleurs (PT) et des autres partis politiques, tel que le Mouvement des Travailleurs ruraux sans terre (MST). De même, ils se différencient de mouvements qui ont surgi dans différents pays de la région dans les dernières décennies, comme celui en l'Argentine au début du siècle, des mouvements indigénistes en Bolivie et en Équateur, du mouvement zapatiste au Mexique ou du chavisme au Venezuela, qui ont été le résultat de confrontations entre fractions bourgeoises et petites-bourgeoises entre elles, se disputant le contrôle de l'État et la défense du capital national.
En ce sens, les mobilisations de juin au Brésil représentent la plus importante mobilisation spontanée de masses dans ce pays et en Amérique latine de ces 30 dernières années. C'est pour cela qu'il est fondamental de tirer les leçons de ces événements d'un point de vue de classe.
Il est indéniable que ce mouvement a surpris la bourgeoisie brésilienne et mondiale, tout comme les organisations révolutionnaires aussi bien à l'intérieur qu'en dehors du Brésil, ainsi que les groupes et organisations qui l'avaient initialement favorisé. La lutte contre la hausse du prix des transports publics (qui font chaque année l'objet d'un accord entre les patrons d'entreprises de transport et l'État) ne fut que le détonateur du mouvement. Celui-ci a cristallisé toute l'indignation qui a fait son nid depuis quelque temps dans la société brésilienne et qui s'est manifestée notamment en 2012 avec les luttes dans la fonction publique comme dans les universités, principalement à São Paulo et dans les chantiers de grands travaux du programme d'accélération de la croissance (PAC) ; avec également de nombreuses grèves dans le pays contre la baisse des salaires et la précarisation des conditions de travail, de l'éducation et de la santé au cours de ces dernières années.
À la différence des mouvements sociaux massifs qui se sont succédés dans différents pays depuis 2011, celui du Brésil a été engendré et s'est unifié autour d'une revendication concrète qui a permis la mobilisation spontanée de larges secteurs du prolétariat : contre la hausse de tarif des transports publics. Le mouvement a pris un caractère massif au niveau national dès le 13 juin, quand les manifestations de protestation contre la hausse appelées par le Movimento Passe Livre (MPL : mouvement pour le libre accès aux transports) à São Paulo, ont été violemment réprimées par la police. Cependant, pendant cinq semaines, outre de grandes mobilisations à São Paulo, se sont déroulées différentes manifestations autour de la même revendication dans différentes villes du pays, à tel point que, par exemple, à Puerto Alegre, Goiânia et d'autres villes, cette pression a contraint les gouvernements locaux à céder sur la hausse des tarifs de transports, après de dures luttes fortement réprimées par l'État.
Cela s'exprime clairement à travers le mouvement social de Goiânia le 19 juin : "À Goiânia, après cinq semaines de manifestations et un jour avant le sixième grand rassemblement, qui confirmait la présence dans la rue de dizaines de milliers de personnes, la préfecture dirigée par Paulo Gracia (du PT) et le gouverneur Marconi Perillo (du Parti Social-démocrate brésilien, PSDB –centre droit) ont tenu une réunion commune et ont décidé d'un commun accord la révocation définitive de l'augmentation du tarif des transports publics. Nous savons que cette révocation est le produit de la pression de plus d'un mois de mobilisation et de la crainte de la possibilité que les choses échappent totalement au contrôle de ce gouvernement provincial et aux entreprises contractuelles."
Le mouvement s'est d'emblée clairement inscrit sur le terrain prolétarien. Ces éléments se sont exprimés à un degré plus ou moins grand par l'extension et l'ampleur du mouvement et, bien que de façon minoritaire, à l´écart de mots d'ordre clairement nationalistes. En premier lieu, il faut souligner que la majorité des manifestants appartiennent à la classe ouvrière, principalement des jeunes ouvriers et des étudiants, en majorité issus de familles prolétariennes ou en voie de prolétarisation. La presse bourgeoise a présenté le mouvement comme une expression des "classes moyennes", avec la claire intention de créer une division entre les travailleurs. En réalité, la majorité de ceux catalogués comme classe moyenne sont des ouvriers qui reçoivent des salaires souvent moins importants que ceux des ouvriers qualifiés des zones industrielles du pays. Cela explique le succès et les sympathies qu'a éveillés cette mobilisation contre la hausse de prix des tickets de bus urbains, qui représentait une attaque directe contre les revenus des familles prolétariennes. Cela explique aussi pourquoi cette revendication initiale s'est transformée rapidement en une remise en cause dirigée contre l'État à cause du délabrement de secteurs tels que la santé, l'éducation et l'aide sociale et de plus en protestations contre les colossales sommes d'argent public investies à l'occasion de l'organisation de la coupe du monde de football de l'an prochain et pour les Jeux olympiques de 2016. Pour les besoins de ces événements, la bourgeoisie n'a pas hésité à recourir, par différents moyens, à l'expulsion forcée des habitants proches des stades : à la Aldeia Maracanã à Rio au premier semestre de cette année ; dans des zones convoitées par les promoteurs immobiliers de São Paulo en mettant le feu aux favelas gênant leurs projets. C'est cette situation qu'exprimait clairement le Bloco de Lutas Pelo Transporte 100% Público de Porto Alegre le 20 juin : "La lutte n'est pas seulement pour quelques centimes et ne concerne pas non plus que Porto Alegre, car la mobilisation prend une dimension nationale et va au-delà de la revendication sur les transports publics. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de dix villes qui ont annoncé la réduction du tarif des transports. Maintenant nous sommes des centaines de milliers de personnes à descendre dans la rue au Brésil, en lutte pour nos droits. Le thème de la coupe [du monde de football] est déjà présent dans les manifestations. La même masse populaire qui remet en question le système de transports met en question également les investissements publics par millions dans les stades, les déplacements de familles [du fait des aménagements urbains pour les besoins de la coupe du monde], le pouvoir de la FIFA et l'État d'urgence qui va restreindre les droits de la population."
Il était très significatif que le mouvement se soit organisé pour réaliser des manifestations autour des stades des villes où se déroulaient les matches de foot de la Coupe des Confédérations, en vue d'obtenir une forte médiatisation et autour du rejet du spectacle préparé au bénéfice de la bourgeoisie brésilienne ; et aussi autour de la brutale répression de l'État contre les manifestants autour des stades, responsable de la mort de plusieurs manifestants. Dans un pays où le football est le sport national, que la bourgeoisie a évidemment su utiliser comme un défouloir nécessaire au contrôle de la société, les manifestations des prolétaires brésiliens constituent une leçon pour le prolétariat mondial. La population brésilienne est réputée pour aimer le football, mais cela ne l'a pas empêchée de refuser l'austérité pour financer les dépenses somptuaires que représente l'organisation des événements sportifs que prépare la bourgeoisie pour montrer au monde entier qu'elle est capable de jouer dans la cour "des grands de ce monde". Pour leur quotidien, les manifestants exigeaient une qualité de services publics du "type FIFA". Les mouvements de juin ont gâché la fête que voulait préparer la bourgeoisie brésilienne.
Du côté de ces revendications, le mouvement a montré son indignation envers les hauts niveaux de décomposition qu'affiche la bourgeoisie brésilienne, en s'en prenant aux institutions les plus représentatives de la gabegie, de la corruption, de l'oisiveté et de l'arrogance de l'État brésilien : à Brasilia, la capitale, ils se sont emparés des installations du Congrès et ont essayé d'entrer dans le palais d'Itamaraty, symbole de la politique extérieure de l'État ; à Rio de Janeiro, ils ont essayé de pénétrer dans l'Assemblée législative d'État, et plusieurs habitants des favelas, parmi lesquels ceux de Rocinha, ont protesté devant la résidence du gouverneur de Rio ; à São Paulo, ils ont essayé de pénétrer dans la préfecture et dans l'Assemblée législative provinciale ; à Curitiba, ils ont tenté de rentrer au siège du gouvernement provincial. Fait également très significatif, il y a eu un rejet massif des partis politiques (surtout du PT) et des organisations syndicales ou étudiantes soutenant le pouvoir : à São Paulo, plusieurs de leur membres ont été expulsés des manifestations parce qu'ils arboraient des bannières ou des signes d'appartenance au PT ou à la CUT comme à d'autres organisations et partis de gauche, électoraux ou pas, comme le PSTU, le PSOL, le PC du Brésil, le PCB et à des syndicats.
D'autres expressions du caractère de classe du mouvement se sont manifestées bien que de manière minoritaire. Dans le feu du mouvement se sont tenues plusieurs assemblées, bien qu'elles n'aient pas les mêmes caractéristiques de celles des Indignés en Espagne. Par exemple, celles de Rio de Janeiro et de Belo Horizonte, qui se sont nommées "Assemblées populaires et égalitaires", se proposaient de créer un "nouvel espace spontané, ouvert et égalitaire de débat” au sein desquelles il est arrivé que participent plus de 1000 personnes.
Ces assemblées, bien qu'elles aient démontré la vitalité du mouvement et la nécessité d'auto-organisation des masses pour imposer leurs revendications, ont présenté plusieurs faiblesses :
même si plusieurs autres groupes et collectifs ont participé à leur organisation, elles ont été animées par les forces de gauche et gauchistes du capital qui ont principalement enfermé leur activité dans la périphérie des villes ;
leur objectif principal était d'être des moyens de pression et des organes de négociation avec l'État, pour des revendications particulières d'amélioration propres à telle ou telle communauté ou ville. Elles tendent par la même occasion à s'affirmer comme des organes permanents ;
elles prétendaient être indépendantes de l'État et des partis ; mais elles ont bel et bien été noyautées par les partis et les organisations pro-gouvernementales ou gauchistes qui y ont anéanti toute expression spontanée ;
elles ont mis en avant une vision localiste ou nationale, luttant contre les effets et non contre les causes des problèmes, sans remettre en cause le capitalisme.
Dans le mouvement, plusieurs références explicites aux mouvements sociaux d'autres pays se sont également exprimées, principalement celui de Turquie, lequel s'est référé aussi à celui du Brésil. Malgré le caractère minoritaire de ces expressions, elles n'en constituent pas moins un révélateur de ce qui est ressenti comme commun aux deux mouvements.
Dans différentes manifestations, on a pu voir ainsi déployées des banderoles proclamant : "Nous sommes Grecs, Turcs, Mexicains, nous sommes sans patrie, nous sommes des révolutionnaires" ou des pancartes portant l'inscription : "Ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas la Grèce ; c'est le Brésil qui sort de l'inertie."
À Goiânia, le Frente de Luta Contra o Aumento (Front de Lutte Contre l'Augmentation) qui regroupe différentes organisations de base soulignait la nécessaire solidarité et le débat entre les différentes composantes du mouvement : "NOUS NE DEVONS PAS CONTRIBUER À LA CRIMINALISATION ET À LA PACIFICATION DU MOUVEMENT ! NOUS DEVONS RESTER FERMES ET UNIS ! Malgré les désaccords, nous devons maintenir notre solidarité, notre résistance, notre combativité et approfondir notre organisation et nos discussions. De la même manière qu'en Turquie, pacifiques et combatifs peuvent coexister et lutter ensemble, nous devons suivre cet exemple."
La grande indignation qui a animé le prolétariat brésilien peut se concrétiser dans la réflexion suivante de la Rede Extremo Sul, réseau des mouvements sociaux de la périphérie de São Paulo : "Pour que ces possibilités deviennent réalité, nous ne pouvons pas laisser canaliser sur des objectifs nationalistes, conservateurs et moralistes, l'indignation qui s'exprime dans les rues ; nous ne pouvons pas permettre que les luttes soient capturées par l'État et par les élites en vue de les vider de leur contenu politique. La lutte contre l'augmentation du prix des transports publics et contre l'état déplorable de l’entretien de ce service est directement liée à la lutte contre l'État et les grandes corporations économiques, contre l'exploitation et l'humiliation des travailleurs, et contre cette forme de vie où l'argent est tout et les personnes ne sont rien."
Les mobilisations au Brésil viennent de loin…
La bourgeoisie brésilienne, comme chaque bourgeoisie nationale y aspire, a œuvré depuis des décennies pour faire du Brésil une grande puissance continentale et mondiale. Pour arriver à ses fins, il ne suffisait pas de disposer d'un immense territoire qui occupe quasiment la moitié de l'Amérique du Sud, ni de compter sur d'importantes ressources naturelles ; il était nécessaire de créer les conditions pour maintenir l'ordre social, surtout le contrôle sur les travailleurs, moins par un joug militaire qu’à travers les mécanismes plus sophistiqués de la démocratie. Dans ce but, elle a préparé une transition relativement "douce" dans les années 80 d'un régime de dictature militaire vers une démocratie républicaine ; cet objectif a été atteint sur le plan politique avec la formation de deux pôles : l'un regroupant les forces de droite formées par deux partis constitués dans les années 80, comme le PSDB (composé par des intellectuels de la bourgeoisie et de la petite- bourgeoisie) et des partis de droite liés aux représentants de la dictature (PMDB, DEM, etc.) ; l'autre de centre-gauche que s'est structuré autour du PT, avec une assise importante au niveau populaire, mais principalement au niveau des ouvriers et des paysans. De cette manière s'est établie une sorte d'alternance de gouvernements de droite et de centre-gauche, reposant sur des élections "libres et démocratiques", indispensable pour pouvoir fortifier le capital brésilien sur l'arène mondiale.
La bourgeoisie brésilienne est parvenue ainsi à renforcer son appareil productif et à affronter le plus dur de la crise économique des années 90, pendant que, sur le plan politique, elle a réussi à créer une force politique autour du PT, qui, en raison de sa jeunesse, a réussi à intégrer des organisations et des dirigeants syndicaux, des membres de l'église catholiques adeptes de la "théologie de la libération", des trotskistes qui considéraient le PT comme un parti révolutionnaire de masses, d'intellectuels, d'artistes et d'éléments démocrates. Le PT représentait la réponse de la bourgeoisie de gauche brésilienne après l'effondrement du bloc russe en 1989 qui avait affaibli les composantes de la gauche du capital au niveau mondial ; de cette manière elle a réussi ce que lui enviaient les autres bourgeoisies de la région : créer une force politique qui lui a permis de contrôler les masses paupérisées mais surtout de maintenir "la paix sociale". Cette situation s'est consolidée avec l'accession du PT au pouvoir en 2002 en utilisant le charisme et l'image ouvriériste de Lula.
C'est ainsi qu'au cours de la première décennie du nouveau siècle, l'économie brésilienne est parvenue à se hisser au septième rang mondial selon la Banque mondiale, à tel point qu'à l'heure actuelle, elle fait partie de la "crème" du prétendu "groupe des pays émergents" dits BRICS ; de plus, la bourgeoisie mondiale salue le "miracle brésilien" réussi sous la présidence de Lula, qui, selon ses dires, est censé avoir permis de sortir de la pauvreté des millions de Brésiliens et de faire accéder d'autres millions dans cette fameuse "classe moyenne". Ce que personne n'a jamais mentionné, ni le PT, ni Lula, ni le reste de la bourgeoisie, c'est que cette "grande réussite" s'est effectuée en utilisant une partie de la plus-value pour la distribuer sous forme de miettes aux couches les plus paupérisées, alors que dans le même temps la précarisation des masses travailleuses s'accentuait.
La crise en toile de fond
Quand l'accélération de la crise économique s'est manifesté en 2007, dont les effets affectent encore l'économie mondiale 6 ans plus tard, Lula, comme d'autres dirigeants de la région, a déclaré que l'économie brésilienne était "blindée". Pendant que les principales puissances économiques chancelaient, l'économie brésilienne restait satisfaite d'elle-même. Même si le Brésil ne se trouvait pas dans l'œil du cyclone de la crise, il est indéniable que dans le cadre de l'interdépendance de l'économie mondiale, aucun pays ne peut échapper à ses effets, encore moins le Brésil qui dépend fortement de l'exportation de ses matières premières et de ses services. Nous en avons la preuve avec la Chine, le grand partenaire du Brésil dans le groupe des BRICS, dont l'économie est fortement affectée par la crise mondiale.
La crise demeure néanmoins la toile de fond de la situation au Brésil. Pour en atténuer les effets, la bourgeoisie brésilienne a développé une relance du marché intérieur avec une politique de grands travaux, provoquant un boom de la construction au niveau public comme privé, qui s'étend à des rénovations et des constructions d'infrastructures sportives pour les compétitions sportives de 2014 et 2016 ; tout en favorisant le crédit et l'endettement des familles pour relancer la consommation intérieure, du logement aux appareils électroménagers, politique qui a provoqué une augmentation des dépenses publiques et une hausse des impôts.
Les limites sont déjà tangibles au niveau des indicateurs économiques : déficit de la balance des paiements évaluée à 3 milliards de dollars américains au premier semestre de cette année, le plus mauvais résultat depuis 1995 et ralentissement de la croissance (prévision annuelle de 6,7% en 2013), mais surtout à travers la détérioration du pouvoir d'achat et des conditions de vie de la classe ouvrière en raison de l'augmentation du prix des produits de consommation et des services (dont les transports). De même, il y a une tendance très sensible dans la population à la diminution des emplois et à une croissance du chômage.
Ainsi, le mouvement de protestations au Brésil ne sort pas de nulle part. Il y a un ensemble de causes qui l'ont fait surgir, et qui non seulement se maintiennent mais qui s'aggravent avec l'approfondissement de la crise économique. A cause de le vague de protestations, l'État s'est vu forcé d'augmenter les dépenses sociales, mais en réalité la crise économique l'oblige à prendre des mesures pour réduire de telles dépenses. C'est pour cela que la présidente de la république Dilma Rouseff a déclaré qu'elle devait réduire les dépenses publiques.
Les pièges de la bourgeoisie
Comme on pouvait s'y attendre, la bourgeoisie brésilienne n'est pas restée les bras croisés dans sa confrontation à la crise sociale, qui, même apaisée, reste latente. Le seul résultat concret qui a été obtenu sous la pression des masses, a été la suspension de la hausse terriblement élevée des transports publics que l'Etat parviendra à compenser par d'autres moyens pour aider financièrement les entreprises de transports.
Au début de la vague de protestations, pour calmer les esprits, pendant que le gouvernement préparait une stratégie pour tenter de contrôler le mouvement, la présidente Dilma Rousseff déclarait, par l'intermédiaire d'une de ses porte-paroles, qu'elle considérait comme "légitimes et compatible avec la démocratie" la protestation de la population ; de son côté Lula, "critiquait" les "excès" de la police. Mais la répression de l'État n'a pas cessé, et les protestations de la rue non plus.
Un des pièges les plus élaborés contre le mouvement a été la propagation du mythe d'un "coup d'État" de la droite, rumeur propagée non seulement par le PT et le parti stalinien, mais aussi par les trotskistes du PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) et du PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados) : il s'agissait d'une tentative de dévoyer le mouvement en le transformant en un appui au gouvernement de Dilma Rousseff, fortement affaibli et discrédité. Alors que la réalité des faits montrait précisément que la répression féroce contre les protestations de juin exercée par le gouvernement de gauche du PT ont été tout aussi, voire plus brutales que celle des régimes militaires, la gauche et l'extrême gauche du capital brésilien œuvraient à obscurcir cette réalité en identifiant le fascisme avec la répression ou les régimes de droite.
Vint également le rideau de fumée du projet d'une "réforme politique", mis en avant par Dilma Rousseff, avec pour objectif de combattre la corruption dans les partis politiques et d'enfermer la population sur le terrain démocratique en l'appelant à voter sur les réformes proposées.
Pour tenter de regagner une influence auprès des mobilisations sociales dans la rue, les partis politiques de la gauche du capital et les syndicats ont lancé plusieurs semaines à l'avance un appel à une "Journée nationale de lutte" le 11 juillet, présentée comme un moyen de protester contre l'échec des accords de conventions collectives de travail. Dans ce simulacre de mobilisation, toutes les organisations syndicales, aussi bien proches du gouvernement que de l'opposition, se sont donné la main.
De même, Lula, faisant étalage de sa grande expérience anti-ouvrière, a convoqué le 25 juin une réunion avec les dirigeants des mouvements contrôlés par le PT et le parti stalinien, y compris les organisations alliées du gouvernement chez les jeunes et les étudiants, dans le but explicite de neutraliser la contestation dans la rue.
Les forces et les faiblesses du mouvement
La grande force du mouvement a été que, depuis le début, il s'est affirmé comme un mouvement contre l'État, non seulement à travers la revendication centrale contre la hausse des tarifs des transports publics ; mais aussi avec sa mobilisation contre l'état d'abandon des services publics et contre l'orientation des dépenses en direction des spectacles sportifs. De même, l'ampleur et la détermination de la contestation ont contraint la bourgeoisie à faire marche arrière en retirant cette hausse dans plusieurs villes.
La cristallisation du mouvement autour d'une revendication concrète, si elle a constitué une force du mouvement, en a également constitué la limite, dès lors que celui-ci ne parvenait pas à aller au-delà. Il a marqué le pas lorsqu'il a réussi à imposer que soit annulée la décision de hausse de tarif des transports. Mais, de plus, il ne s'est pas compris comme un mouvement remettant en cause l'ordre capitaliste, aspect qui a été présent par exemple dans le mouvement des Indignés en Espagne.
La méfiance envers les principaux moyens de contrôle social de la bourgeoisie s'est traduite par le rejet des partis politiques et des syndicats, qui représente une faille sur le plan idéologique pour la bourgeoisie, marquée par l'épuisement des stratégies politiques qui ont émergé depuis la dictature et le discrédit des équipes successivement en place à la tête de l'Etat, aggravé par la corruption notoire en leur sein. Cependant, derrière un rejet indifférencié de la politique, réside le danger du rejet de toute politique, de l'apolitisme, qui constitue une faiblesse importante du mouvement. En effet, sans débat politique, il n'y a aucune possibilité d'avancée réelle de la lutte dont le sol nourricier est justement celui de la discussion pour comprendre la racine des problèmes contre lesquels on se bat, et qui ne peut se soustraire à une critique des fondements du système capitaliste.
Ce n'est donc pas un hasard si une faiblesse du mouvement a été l'absence d'assemblées de rues ouvertes à tous les participants où puissent se discuter les problèmes de société, les actions à mener, l'organisation du mouvement, son bilan et ses objectifs. Les réseaux sociaux ont constitué un moyen important pour la mobilisation et pour rompre l'atomisation. Mais ils ne pourront jamais remplacer le débat vivant et ouvert des assemblées.
Le poison du nationalisme n'a pas épargné le mouvement comme en ont témoigné la présence, dans les mobilisations, de nombreux drapeaux brésiliens et des mots d'ordre nationalistes, comme il n'était pas rare d'entendre l'hymne national dans les cortèges. Cela n'avait pas été le cas dans le mouvement des Indignés en Espagne. En ce sens, le mouvement de juin au Brésil a présenté les mêmes faiblesses que les mobilisations en Grèce ou dans les pays arabes, où la bourgeoisie a réussi à noyer la grande vitalité des mouvements dans un projet national de réforme ou de sauvegarde de l'Etat. Dans ce contexte, la protestation contre la corruption a bénéficié en dernière analyse à la bourgeoisie et à ses partis politiques, surtout ceux de l'opposition, qui, par ce moyen, espèrent retrouver un certain crédit politique dans la perspective des prochaines élections. Le nationalisme est une voie sans issue pour les luttes du prolétariat qui viole la solidarité internationale des mouvements de classe.
Malgré une participation majoritaire des prolétaires au mouvement, ceux-ci s'y sont impliqués de manière atomisée. Le mouvement n'est pas parvenu à mobiliser les travailleurs des centres industriels qui ont un poids important, surtout dans la région de São Paulo ; il ne l'a même pas proposé. La classe ouvrière, qui sans aucun doute a accueilli le mouvement avec sympathie et s'est même identifié à lui, parce qu'il luttait pour une revendication où elle reconnaissait ses intérêts, n'est pas parvenue à se mobiliser comme telle. Cette question de l'identité de classe n'est pas seulement une faiblesse au niveau de la classe ouvrière au Brésil, mais au niveau mondial. Ce comportement est en fait une caractéristique de la période où la classe ouvrière a du mal à affirmer son identité de classe, aggravée au Brésil par des décennies d'immobilité résultant de l'action des partis politiques et des syndicats, principalement le PT et la CUT.
Cette situation explique d'une certaine manière l'émergence de mouvements sociaux avec les caractéristiques de ceux qui ont surgi au Brésil, en Turquie, en Espagne, aux États-Unis, en Égypte, etc., où ce sont les nouvelles générations de prolétaires, beaucoup d'entre eux se trouvant sans emploi, qui se révoltent en comprenant que le capitalisme leur ferme toute possibilité d'avoir une vie décente et ressentent dans leur chair les souffrances de la précarisation de leur vie familiale.
En ce sens, les mobilisations au Brésil sont une source d'inspiration et laissent une grande leçon pour l'union du prolétariat brésilien et mondial : il n'y a pas de solution possible à nos problèmes dans le capitalisme ; cela dépend de la capacité du prolétariat a assumer sa responsabilité historique de lutter contre le capital, dans la recherche de son identité de classe à travers la solidarité non seulement du prolétariat au Brésil, mais au niveau mondial. C'est de cette manière que leur lutte convergera avec celle des jeunes prolétaires qui aujourd'hui se mobilisent contre le capital, et ce sera une référence pour eux.
Revolução Internacional, organe de presse du CCI au Brésil (09 août 2013)
Récent et en cours:
- Luttes de classe [45]
Rubrique:
Syrie: Derrière l'agitation diplomatique, l'impasse d'un système meurtrier
- 1589 reads
Le spectacle hideux et l’exhibition des cadavres d'enfants agonisants, suite à l'attaque aux armes chimiques du 21 août dernier près de Damas, ne sauraient émouvoir les dignitaires de ce monde, dont les réactions hypocrites n'étaient dictées que par des intérêts et des considérations impérialistes. Comme en témoignent les massacres aux gaz dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, l'utilisation d'armes chimiques destructrices au Vietnam et les bombardements atomiques au Japon, les grandes démocraties n'ont jamais hésité à utiliser les armes les plus meurtrières. Aujourd'hui, les déclarations affligées des chancelleries apparaissent d'autant plus hypocrites que les bombardements et les massacres de populations otages faisant plus d'une centaine de milliers de morts depuis l’éclatement de la guerre en Syrie, la politique sanglante de terreur et les millions de réfugiés fuyant la barbarie n'ont, jusqu'à présent, aucunement constitué une "ligne rouge" infranchissable pour la bourgeoisie.
Une aggravation des tensions et de la barbarie
Si l'usage des armes chimiques relevait probablement d'une provocation russo-syrienne (Bachar el Assad ayant été averti par Obama à plusieurs reprises en 2012 de ne pas franchir la "ligne rouge"), pour d'autres puissances rivales, dont les États-Unis et la France, cette "ligne rouge" ne constituait qu'un prétexte médiatisé à outrance et exploité politiquement pour préparer "l'opinion" à une éventuelle intervention militaire. Face à la tragédie en cours, les avertissements précipités, suivis de réactions contrastées des États, les rodomontades et tergiversations des chancelleries montrent la réalité d'un sordide bras de fer impérialiste dans lequel les populations ont moins de valeur qu'une guigne. Et ce sont précisément ces rapports entre les puissances belligérantes qui expliquent la durée du conflit et les souffrances atroces des populations. Car, en comparaison, sans ce degré de confrontation au sein de l'arène mondiale, les régimes balayés dans les pays du "Printemps arabe", comme la Libye, n'avaient pas fait long feu.
Au coup diplomatique de la Russie proposant de "placer sous contrôle international l'arsenal chimique de la Syrie" a répondu l'hypocrite "exploration des voies diplomatiques" des adversaires, dont l'impuissance politique semble désormais dicter presque exclusivement la conduite. Indépendamment de l'issue de cette nouvelle crise et des décisions que prendront les chancelleries, intervention militaire imminente ou pas, nous assistons à une spectaculaire montée en puissance des tensions guerrières dans cette poudrière, sur fond de chaos croissant où l'usage des armes apparaît de plus en plus nécessaire pour la classe dominante, comme un puissant engrenage devenu incontrôlable. La banalisation de l'usage d'armes chimiques, l'extension du conflit au Liban, la présence de vautours plus agressifs dans la région, comme le Qatar et l’Arabie Saoudite, mais aussi des puissances régionales comme la Turquie et l'Iran dont l'implication dans le conflit est une source particulière d'inquiétude pour Israël, sont autant de preuves que le conflit va bien au-delà des frontières de la Syrie. Ils illustrent la gradation inquiétante de la voracité des appétits.
Mais plus encore, la présence des grands requins impérialistes aux prises indique le niveau atteint par les tensions depuis la fin de la guerre froide. Ainsi, pour la première fois depuis 1989, nous nous trouvons devant un affrontement politique majeur entre les anciens leaders de blocs que sont les États-Unis et la Russie. Bien qu'affaiblie par la désintégration du bloc de l'Est et de l'URSS, cette dernière s'est ragaillardie après avoir mené une politique de terre brûlée, comme en Tchétchénie, en Géorgie et dans le Caucase durant les années 1990. La Russie s'accroche désormais à son point d'ancrage en Syrie pour tenter de maintenir à tout prix sa présence et sa liaison stratégique avec l'Iran, et limiter l'influence des Républiques sunnites rivales sur ses frontières méridionales, tout en maintenant un port en Méditerranée.
Cette aggravation des tensions se mesure également par le fait que la Chine s'oppose plus ouvertement aux États-Unis que par le passé. Alors que la puissance chinoise s'était éloignée de la Russie durant la période des blocs, neutralisée par le camp américain suite aux tractations et au voyage du président Nixon en 1972, elle redevient aujourd'hui un ennemi majeur qui inquiète particulièrement les États-Unis. Depuis l'effondrement de l'URSS et la relative montée en puissance de la Chine, la donne est en train de changer. Encouragée par ses avancées en Afrique, la Chine confirme sa volonté de renforcer ses appuis impérialistes, notamment en Iran et au Proche-Orient, pour assurer les voies de son approvisionnement énergétique. Son rôle de trouble-fête déstabilise encore plus fortement les rapports impérialistes.
C'est surtout l'affaiblissement et l'isolement de plus en plus évident des États-Unis, dont les tentatives pour jouer le rôle de gendarme du monde ont rencontré un échec cuisant en Afghanistan et en Irak, qui a permis le renforcement des puissances russe et chinoise. La seule comparaison de leur actuelle "intervention" en Syrie avec le rôle joué par les Etats-Unis lors de la première guerre du Golfe, en 1991, donne une idée de la profondeur de leurs difficultés. Utilisant l'invasion du Koweït par Saddam Hussein comme un prétexte pour exhiber leur supériorité militaire, ils avaient alors réussi à mettre sur pied une "coalition" impliquant non seulement un certain nombre de pays arabes, mais aussi les principaux membres de l'ancien bloc occidental qui avaient pourtant tenté de se libérer de l'emprise américaine suite à la désintégration du bloc de l'Est. L'Allemagne et le Japon, ne participant pas militairement à l'opération, soutenaient l'aventure, tandis que la Grande-Bretagne et la France étaient directement "appelées" pour les combats. Malade et agonisante, l'URSS en lambeaux de Gorbatchev n'avait rien pu faire pour barrer la route militaire de l'Amérique. Un peu plus d'une décennie plus tard, avec la seconde invasion de l'Irak, l'Amérique devait faire face à une opposition diplomatique plus active de l'Allemagne, de la France et la Russie. Ceci étant, lors des invasions de l'Afghanistan en 2001 et de l'Irak en 2003, les Etats-Unis pouvaient encore compter sur le soutien fidèle, diplomatique et militaire, de la Grande-Bretagne. La défection de cette dernière pour l'intervention envisagée en Syrie a contraint l'administration Obama à annuler les opérations et à se plier à l'option diplomatique mise en avant par Moscou. Le vote à la Chambre des Communes contre la proposition de Cameron soutenant une intervention militaire est un témoignage des profondes divisions qui existent au sein de la bourgeoisie britannique, résultant de la participation du pays aux bourbiers afghan et irakien. Mais surtout, il s'agit d'un indicateur sérieux montrant l'affaiblissement de l'influence américaine dans le monde. La découverte soudaine que la France, qui a soutenu et poussé à l'intervention, est "la plus vieille alliée" de l'Amérique, ne doit pas donner l'illusion que cette dernière va occuper le rôle de fidèle lieutenant que la Grande-Bretagne (nonobstant ses propres ambitions à rechercher un rôle plus indépendant) a joué dans la plupart des entreprises impérialistes des États-Unis depuis la fin de la guerre froide. L'alliance entre les Etats-Unis et la France est avant tout circonstancielle et donc peu fiable. À cela, nous pouvons ajouter les positions discrètement discordantes venant d'Allemagne, dont le rapprochement insidieux avec la Russie est une autre préoccupation pour Washington.
Comme on peut le voir, le "nouvel ordre mondial" que promettait la bourgeoisie au moment de la première guerre du Golfe, en 1990, n'a débouché que sur un panier de crabes où la loi de la jungle est la seule reconnue.
L’importance stratégique de la Syrie
Dans le cadre de ce nouveau bras de fer, la Syrie reste un enjeu stratégique très important. Historiquement, c'est assez tôt au XXe siècle que la Syrie moderne émerge en se libérant du joug ottoman. Durant la Première Guerre mondiale, mobilisant ses troupes, la Grande-Bretagne avait fait la promesse de lui accorder l'indépendance en cas de victoire, afin de mieux contrôler la région. Mais, dès 1916, suite aux accords secrets de Sykes/Picot[1] [46], la Syrie était cédée à la France par la Grande-Bretagne. Il s'agissait en fait de priver l'Allemagne de ses ambitions, elle qui avait déjà envisagé de construire une ligne de chemin de fer reliant Bagdad dans le but de "mettre les points stratégiques principaux de l'Empire turc en Asie mineure en communication immédiate avec la Syrie et les provinces arrosées par l’Euphrate et le Tigre".[2] [50] Aujourd'hui, du fait de l'insécurité croissante des voies maritimes traditionnelles passant par le Golfe persique, la Syrie redevient une des routes terrestres pour les hydrocarbures tant convoités. Ouverte par un couloir sur la côte méditerranéenne du Levant (où des armes venant de Russie sont acheminées aujourd'hui) et à l'Est vers les pays producteurs de pétrole, l'intérêt qu'elle suscite ne fait que croître.
Les tensions qui se développent sont donc en grande partie liées à cette place historiquement centrale de la Syrie dans la région. Elles sont aussi alimentées par l'opposition d’Israël[3] [51], dont les menaces sur la Syrie et surtout l’Iran se sont transformées en véritable ultimatum ne cessant d'inquiéter les grands parrains impérialistes. De plus, tandis que des puissances comme le Qatar et l'Arabie Saoudite fournissent des armes aux rebelles, la Turquie frontalière cherche à défendre ses intérêts en jouant sur la présence d'une minorité kurde au Nord du pays.
Et derrière ces forces se profile surtout la polarisation majeure autour de l'axe chiite, dont la place stratégique liée au détroit d'Ormuz, et donc à la route maritime du pétrole, conduit à une véritable course aux armements et à la présence accrue en mer de bâtiments de guerre, notamment issus de la flotte américaine. Ceci explique la volonté du gouvernement iranien de relancer son programme nucléaire (que Poutine soutient en proposant, par provocation, une "aide pour la construction d'une centrale nucléaire").
Vers un accroissement sans précédent du chaos
Jusqu'ici, le régime musclé et sanguinaire de Bachar el Assad signifiait pour l'ensemble des puissances impérialistes, États-Unis compris, une relative "stabilité" et une certaine "prévisibilité", appréciés par défaut de concurrents sérieux. Aujourd'hui, si l'opposition syrienne arrivait finalement à prendre le dessus, il est certain qu'une réaction en chaine entrainerait un chaos incroyable et totalement imprévisible. En effet, l'Armée syrienne de Libération (ALS) est aujourd’hui elle-même un véritable patchwork, et il n'existe pas d'opposition véritablement unie. Cet agrégat politiquement affaibli, malgré l'appui discret de forces pro-américaines et pro-européennes, vers lequel la circulation des armes se fait sans l'assurance d'un contrôle véritable, se trouve infiltré, ou tout au moins environné de groupes djihadistes terroristes, principaux pourvoyeurs d'armes aux rebelles dont bon nombre sont venus de l'extérieur de la Syrie, agissant bien souvent pour leur propre compte à la manière des seigneurs de guerre qui sévissent en Afrique. Ainsi, la possibilité pour des puissances occidentales de s’appuyer sur une véritable opposition alternative au régime en place est proche du zéro absolu.
Nous sommes là confrontés à un phénomène beaucoup plus large, que nous pouvons observer dans tous les autres pays arabes qui ont été confrontés à des événements similaires lors du "Printemps arabe" : aucune véritable opposition n'a pu surgir et aucune fraction bourgeoisie n'a pu prendre le relais politique afin d'offrir une véritable "alternative démocratique" et une stabilité. Tous ces régimes n'ont pu survivre que grâce à la force de l'armée tentant d'enserrer du mieux possible les différents clans de la classe dominante et couches sociales afin d'éviter que la société ne vole en éclats. On a pu le voir en Libye et plus récemment en Égypte, suite au coup d'état militaire contre le président Morsi et les Frères musulmans. Tout ceci montre la réalité d'une véritable impasse, typique de la décadence capitaliste et de sa phase ultime de décomposition, où la seule chose à offrir en temps de crise économique n'est autre que la misère, la force brutale de l'armée, la répression et les effusions de sang.
Et cette situation est d’autant plus préoccupante qu'elle nourrit les fractures religieuses et communautaires qui sont parmi les plus concentrées au monde, entre chrétiens, musulmans chiites et sunnites, juifs, druzes, etc. Sans être directement à l'origine des conflits, ces fractures vives viennent approfondir les divisions et les haines d'une société sans avenir. Cette région a d'ailleurs été marquée dans le passé par de nombreux génocides comme en Arménie, des déplacements de populations et des massacres perpétrés par les puissances coloniales qui ont entretenu ces haines ravivées aujourd'hui et qui ne peuvent déboucher que sur de nouveaux pogroms. Le régime syrien a dans le collimateur les communautés chrétiennes. Il se trouve au cœur des divisions qui se cristallisent en Syrie (entre alaouites et sunnites[4] [52], musulmans et chrétiens, etc.). Et sous le couvert de la guerre, d'innombrables cas de pogroms contre telle ou telle communauté sont souvent organisés, avec l'afflux de djihadistes fanatiques, certains soutenu par l'Arabie Saoudite, rendant la situation pire que jamais.
La catastrophe est d'autant plus grande que les États-Unis, puissance va-t'en guerre sur le déclin, ont été les fers de lance de ce chaos. En jouant aux gendarmes du monde, ils se sont transformés en pompiers pyromanes et n'ont fait eux-mêmes qu'accélérer le chaos existant, se retrouvant affaiblis comme jamais auparavant. En 2008, Obama a triomphé de son adversaire G.W. Bush grâce à son image d'anti-Bush, fauteur de guerres et initiateur de fiascos à répétitions. Mais aujourd'hui, le "prix Nobel de la paix" Obama s'avère lui-même un va-t'en guerre de la pire espèce, de moins en moins crédible, étalant toujours plus ouvertement son impuissance, malgré des talents de politicien que ne possédait pas son prédécesseur. Aujourd'hui donc, non seulement Obama doit faire face à une opinion publique de plus en plus hostile à la guerre, échaudée par les mensonges et les échecs successifs, mais il ne peut évoquer le fait de déployer des troupes sans marcher sur des œufs et se heurter à une hostilité ravivant les échecs et en arrière-plan le syndrome du Vietnam.
À cela, il faut ajouter la réalité d'une crise économique insupportable, où les dépenses supplémentaires pour les croisades militaires sont de moins en moins bien tolérées. Pour l’instant, le recul des États-Unis en Syrie s’explique par un contexte géopolitique difficile, ce qui amène Washington à de nouvelles contorsions où apparaissent maintenant des distinctions hypocrites et ridicules entre les "armes chimiques" et les "armes n'utilisant que des composants chimiques". Nuance !
Avec la multiplication des bourbiers, les mystifications qui avaient servi d'alibis depuis les années 1990 dans les diverses croisades impérialistes autour de la "guerre propre", de l'engagement "humanitaire" pour la "sécurité" ont perdu de leur superbe. Et les États-Unis se trouvent devant un véritable dilemme qui touche à leur crédibilité par rapport à leurs alliés, notamment Israël, de plus en plus critiques et inquiets : soit ils ne font rien, et cela ne peut qu'encourager l’offensive et l'escalade des revendications et provocations des rivaux ; soit ils frappent du poing et alimentent encore plus la contestation et le chaos. Ce qui est certain, c'est que comme toutes les autres puissances impérialistes, ils ne peuvent échapper à la logique du militarisme. Tôt ou tard, ils ne pourront s'abstenir d'une nouvelle campagne militaire et de l'usage des armes.
Une seule alternative: socialisme ou barbarie
L'engrenage infernal de ce chaos et des tensions guerrières vient du coup une nouvelle fois mettre en exergue la responsabilité du prolétariat international : s'il n'est pas en mesure de peser immédiatement de façon décisive face à la barbarie guerrière qui se déchaine, lui seul constitue la force historique capable de mettre fin à cette barbarie par sa lutte révolutionnaire. Depuis le début des événements, et a fortiori au moment où le conflit ouvert menace de s’embraser, les faiblesses qui pèsent sur le prolétariat ne peuvent permettre d'entrevoir une quelconque dynamique de luttes massives en Syrie. Comme nous l'avons déjà signalé : "le fait que les manifestants du Printemps arabe en Syrie aient abouti, non sur la moindre conquête pour les masses exploitées et opprimées, mais sur une guerre qui a fait plus de 100 000 morts constitue une sinistre illustration de la faiblesse dans ce pays de la classe ouvrière, la seule force qui puisse mettre un frein à la barbarie guerrière. Et c'est une situation qui vaut aussi, même si sous des formes moins tragiques, pour les autres pays arabes où la chute des anciens dictateurs a abouti à la prise du pouvoir par les secteurs les plus rétrogrades de la bourgeoisie représentés par les islamistes, comme en Égypte ou en Tunisie, ou par un chaos sans nom comme en Libye".[5] [53]
Aujourd'hui, le cours des événements confirme pleinement l’analyse du CCI basée sur ce qu'avait écrit en 1916 Rosa Luxembourg, citant Engels dans la Brochure de Junius : "la société bourgeoisie est placée devant un dilemme : ou bien passage au socialisme ou rechute dans la barbarie. Mais que signifie donc une rechute dans la barbarie au degré de civilisation que nous connaissons en Europe aujourd'hui ? Jusqu’ici nous avons lu ces paroles sans y réfléchir et nous les avons répétées sans en pressentir la terrible gravité. Jetons un œil autour de nous en ce moment même, et nous comprendrons ce que signifie une rechute de la société bourgeoisie dans la barbarie. Le triomphe de l'impérialisme abouti à l’anéantissement de la civilisation, sporadiquement pendant le durée d'une guerre moderne et définitivement si la période de guerres mondiales qui débute maintenant devait se poursuivre sans entraves jusque dans ses dernières conséquences. (…) Nous sommes placés aujourd'hui devant ce choix : ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, avec pour conséquence, comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière ; ou bien victoire du socialisme, c'est-à-dire la lutte consciente du prolétariat international contre l'impérialisme et contre sa méthode d'action : la Guerre. C'est là un dilemme de l'histoire du monde, un 'ou bien', 'ou bien' encore indécis dont les plateaux balancent devant la décision du prolétariat conscient. Le prolétariat doit jeter résolument dans la balance le glaive du combat révolutionnaire ; l'avenir de la civilisation et de l'humanité en dépendent".
WH (12 septembre 2013)
[1] [47] Comment l'Empire ottoman fut dépecé, de Henry Laurens dans Le Monde Diplomatique (avril 2003).
[2] [54] Rohrbach, cité par Rosa Luxembourg dans la Brochure de Junius.
[3] [55] Notons qu'il existe toujours un contentieux entre Israël et la Syrie à propos du plateau du Golan. A cela, nous pouvons ajouter que la relance du programme nucléaire iranien envenime fortement les rapports entre toutes ces puissances.
[4] [56] La dynastie des el-Assad est issue de la minorité alaouite dans un pays majoritairement sunnite, ce qui a permis d'embrigader de nombreux sunnites "spoliés" par une minorité religieuse.
[5] [57] Extrait de la Résolution sur la situation internationale du XXe congrès du CCI.
Rubrique:
ICConline - novembre 2013
- 1056 reads
Nicaragua: le gouvernement sandiniste réprime les ouvriers
- 1890 reads
Au début de l’été, certains média internationaux publièrent, en catimini, l’information concernant la lutte des retraités au Nicaragua pour leurs pensions et la répression qu’ils ont subie de la part du gouvernement sandiniste1. Les titres affirmaient: “le gouvernement sandiniste réprime les petits vieux”2. Le gouvernement d’Ortega s’en est évidemment défendu. Nous publions ci-dessous à ce sujet l'article envoyé par le Noyau de Discussion Internationaliste du Costa Rica (groupe proche du CCI). L'article dénonce le piège dans lequel la bourgeoisie a essayé d'enfermer la lutte des retraités pour la faire passer pour une simple campagne politique de l’opposition, la transformant en étendard de la lutte entre fractions bourgeoises. Cet article défend en même temps la nature spontanée et prolétarienne de ce conflit qui a eu droit à la brutalité de la répression officielle, celle des « corps francs » du sandinisme. Dans le camps adverse, le cynisme instrumentalise cette lutte pour déloger les sandinistes du gouvernement et occuper leur place. Le texte compare cette lutte aux manifestations du Brésil et de Turquie en remarquant que dans ces deux pays il s’agissait surtout d'une réaction des jeunes alors qu'au Nicaragua ce sont plutôt les anciens qui se sont exprimés. Mais dans tous les cas, il s’agit d’une même lutte ouvrière. Nous sommes d’accord avec cette insistance, au-delà des particularités soulignées : la massivité, en premier lieu. Les explosions des Indignés ou les luttes qui se sont déroulées au Brésil à cause des prix des transports, ou celle de Turquie, ont mobilisé en effet davantage, des centaines de milliers de personnes. La classe ouvrière, en second lieu, a participé plus nettement à la lutte avec d’autres secteurs de la population dans ces pays. Même si ses initiatives et ses traditions de luttes ont imprégné ces mouvements, particulièrement les assemblées en Espagne et la solidarité en Turquie et au Brésil, la classe ouvrière n’a pas acquis la confiance suffisante pour prendre la direction de la lutte, pour mettre en avant ses revendications propres en tant que classe, pour mettre en avant sa perspective de lutte, etc.
La lutte des “petits vieux” a été vraiment très loin d’être aussi massive que celle de ces pays. Elle a été cependant une expression véritable de la classe ouvrière, d’un bout à l’autre, malgré des faiblesses indéniables.
Le gouvernement sandiniste réprime les travailleurs qui manifestent contre des pensions de misère
Comme partout ailleurs dans le monde, le capitalisme et sa crise attaquent toujours davantage la classe ouvrière. La misère ne fait qu’augmenter avec une répression brutale face à n’importe quelle volonté de lutter. Le sandinisme, qui historiquement a été « vendu » comme une alternative « socialiste », montre encore une fois son vrai visage, comme partie de la bourgeoisie mondiale et réprimant la classe ouvrière. C’est dans ce contexte qu’on comprend la manifestation des retraités du Nicaragua, dans le cadre des luttes qui se développent ici ou là dans le monde, avec une classe ouvrière qui se refuse à perdre le peu qu’elle a sur l’autel de l’enrichissement de quelques capitalistes et qui ne supporte plus le poids de le crise d’un système depuis longtemps pourri et décadent. Le gouvernement sandiniste n’est pas en reste pour faire payer sa crise aux exploités. Même si les manifestations n’atteignent pas l’ampleur des luttes les plus récentes en Turquie et, par la suite, au Brésil, elles font partie de la même lutte de la classe ouvrière du monde entier. La lutte de ces personnes âgées ne concerne pas qu’elles seules mais aussi les jeunes et la classe toute entière, parce qu’on attaque les retraites de la même manière qu’on attaque les conditions de vie de l’ensemble des travailleurs et des autres exploités.
Une attaque coordonnée entre police et sympathisants sandinistes
Un groupe de personnes âgées a occupé en juin dernier pendant quelques jours les bureaux de la Sécurité Sociale du Nicaragua (INSS) pour exiger une pension minimum pour les travailleurs qui n’ont pas pu accéder au minimum de 750 parts de cotisations. Ce qu’ils demandent c’est qu’on leur octroie une pension sur la base d’un salaire minimum de 140 $ et quelques possibilités de soins médicaux. Seulement 8 000 sur les 54 000 travailleurs qui se trouvent dans ces conditions reçoivent un "ticket solidaire" de 50 $, une quantité avec laquelle on peut à peine survivre. Le reste ne reçoit rien du tout !
Selon les données de l’INSS, 71 658 personnes, dont 54 872 toujours en vie, ont cotisé entre 250 et 750 points. La réponse des responsables de l’INSS a été la suivante : « il n’y a pas d’argent ! », « c’est Anastasio Somoza qui a tout emporté en 1979 ! »3.
La répression est tombée sur les « viejitos » de deux côtés : les milices sandinistes et la police. Durant l’occupation, la police a barré l’accès aux familles et aux amis qui portaient du ravitaillement aux occupants, dont certains ont affirmé qu’on les avait empêchés d’aller chercher à boire. Quelques jours après, de jeunes sympathisants se sont joints aux protestations. Le Gouvernement, de son côté, a mis en branle des milices de choc qu’il a déguisé en « organisation spontanée populaire » que la police a laissé passer pour qu’elles puissent s’adonner à une répression en règle bien plus agressive que celle de la police elle-même. Cela, d’autant plus que personne ne pouvait porter une quelconque plainte puisque personne n’avait rien vu et qu'aucun agresseur n’avait été arrêté. À la fin, les forces de l'ordre ont procédé à un délogement musclé sous prétexte « d’amener les gens âgés à une visite médicale préventive », alors que c’est la police elle-même qui avait empêché l’entrée de nourriture et boisson mettant ainsi en danger la santé de ces personnes ! En plus, les occupants ont été accusés d’avoir « causé des ravages » aux installations.
Quelques jours après, les autorités ont appelé à une « contre-manifestation » pour montrer la « solidarité avec le gouvernement ». Et comme il arrive lors des mobilisations parrainées par le gouvernement sandiniste, celui-ci a mis en branle tous les moyens logistiques dont il disposait pour garantir le succès d’un tel appel.
Le discours de l’opposition au gouvernement et de la bourgeoisie internationale reste toujours le même : « Le gouvernement de gauche du Nicaragua réprime les vieux », alors que, de l’autre côté, le gouvernement sandiniste affirme que « La droite veut manipuler nos petits vieux ». C'est ce qu’on peut lire sur les média de la bourgeoisie internationale et sur ceux des sandinistes. Voilà un jeu destiné à tromper notre classe et donner l’impression qu’il y a une différence entre les uns et les autres alors qu’ils font tous partie de la même classe exploiteuse.
Il est juste que ces personnes âgées veuillent lutter pour leurs pensions de retraite et nous devons les défendre. Nous devons dénoncer la répression du gouvernement sur la classe ouvrière dont une de ses fractions se retrouve dans la misère, comme c’est le cas des travailleurs ayant cumulé peu de cotisations. Le fait de ne pas avoir les cotisations suffisantes est surtout dû au travail précaire effectué par ces personnes, sans compter tous ces travailleurs qui sont partis au Costa Rica et qui en sont revenus sans la moindre cotisation à cause de leur situation de travail illégal.
Le discours du gouvernement d’Ortega appelle à un patriotisme pseudo-socialiste qui divise la classe ouvrière. Ils disent que c’est « la droite » qui est derrière les luttes, et, au niveau international, on accuse « la gauche » d’être à l’origine de ces mesures contre « les petits vieux ». Quelle que soit l’excuse qu’ils mettent en avant : « il n’y a pas d’argent par la faute de Somoza », pour les uns, ou « c’est bien la gauche qui réprime les retraités » pour les autres, on voit très bien que la gauche et la droite font la même chose. Tous leurs discours ne servent qu’à occulter le fait qu’ils font une même politique : opprimer la classe ouvrière par le capital quel que soit sa forme.
Il est important de démasquer ce faux dualisme qui ne sert qu’à diviser la classe ouvrière. Il faut dévoiler ce qui se cache derrière la gauche du capital avec son soi-disant "socialisme du XXIème siècle" qui n’est que le même capitalisme et la même exploitation que partout ailleurs.
Un horizon est possible
Le chemin politique des Indignés en Turquie et au Brésil, où l’on commence à mettre en avant une lutte plus générale contre le capitalisme, montre que la seule alternative pour la classe ouvrière c’est de lutter unis, ce qui requiert une confrontation avec les syndicats qui ne cherchent qu'à diviser pour finir par la défaite dans des luttes isolées, de secteur ou de corporation. C’est cette vision de l’unité qui a permis que dans des luttes très concrètes la conscience évolue et que puisse être mis en avant la lutte en tant que classe, défendant des intérêts communs, en proposant un futur. Le capitalisme dans la crise actuelle montre de façon de plus en plus évidente ce qu’est sa réalité historique et comment seule une société nouvelle pourra sortir l’humanité de l’abîme dans lequel elle est en train de sombrer. Il n’y a pas d’autre issue à la crise que la destruction du capitalisme, que la défaite de tous ses gouvernements y inclus ceux qui se font appeler « socialistes ». Il n’y a que la classe ouvrière unie qui puisse assurer un avenir à l’humanité et freiner la destruction de la planète.
Núcleo [Noyau] de Discusión Internacionalista en Costa Rica (Juillet 2013)
Managua, juin 2013
1 Ce que le CCI a écrit en français sur le sandinisme au Nicaragua se retrouve éparpillé dans différents articles, mais peut se résumer dans cette citation : « Même s’ils veulent établir un “gouvernement de type socialiste-révolutionnaire”, ce n’est, concrètement dans la réalité des faits, que le même scénario que celui écrit par le sandinisme au Nicaragua : la défense pure et simple du régime bourgeois et de l’économie nationale », article faisant référence au Nicaragua en parlant des élections dans le pays voisin El Salvador.[« Elections au Salvador : le FMLN, de la guérilla stalinienne au gouvernement »]. En espagnol on peut lire : « À la suite des élections en 2006, ces mêmes sandinistes sont revenus au pouvoir » (Revolución mundial nº 96 (2007), “Nicaragua: regresan los sandinistas al gobierno para dar continuidad a la explotación y opresión”). [NdT]
2 « viejito », « petit vieux », ce diminutif n’est ni méprisant ni condescendant dans l’espagnol des Amériques, mais affectueux pour désigner les personnes âgées. [NdT]
3 Cet A. Somoza faisait partie d’une famille de dictateurs qui depuis les années 1930 tenait le pouvoir au Nicaragua avec les méthodes les plus brutales, soutenu par les Etats-Unis, pays pour lequel ce type de gouvernants devait être la garantie contre toute avancée du bloc adverse (l’URSS) dans les pays latino-américains, surtout à la suite de la victoire castriste à Cuba. Fondé dans les années 60, un groupe guérillero, le Front Sandiniste, soutenu par ce bloc adverse, a fini par renverser Somoza. Les Sandinistes gouvernent actuellement le Nicaragua avec le soutien du chavisme vénézuélien, mais surtout, étant une économie très endetté et très pauvre, par divers organismes internationaux : tout cela enveloppé d’un verbiage du type socialiste-national avec des concessions au catholicisme et agrémenté d’anti-américanisme.[NdT].
Géographique:
Rubrique:
ICConline - décembre 2013
- 1209 reads
Mali, Centrafrique… derrière l’alibi démocratique, la guerre impérialiste
- 1592 reads
La « paix » ne règne pas au Mali ! Bien au contraire, l’impérialisme français s’enfonce de plus en plus dans le chaos malien. Pourtant, au même moment, la France a décidé de faire le coup de feu en Centrafrique, un autre pays du Sahel, pour soi-disant « protéger » les populations et « rétablir l’ordre et permettre une amélioration de la situation humanitaire ». En effet, les médias exposent en ce moment des images en provenance de la Centrafrique sur les massacres et le Département d’Etat américain évoque une situation « pré-génocidaire ». Bref, l’horreur est omniprésente au cœur du continent africain. Mais aucune presse ne mentionne la responsabilité de la France dans l’explosion de cette barbarie alors que l’Etat français est l’acteur ou le témoin principal des crimes, passés et présents, commis dans son ex-pré carré colonial.
En ce qui concerne le Mali, contrairement aux allégations mensongères de François Hollande, sa fameuse « victoire sur les groupes terroristes » ne se confirme toujours pas ! Le pouvoir français a beau obliger les cliques maliennes à organiser des « élections libres » et « démocratiques » (présidentielles en août et législatives en ce mois de novembre) en vue de « restaurer l’Etat malien et assurer la paix », cette propagande mensongère est en totale contradiction avec les faits eux-mêmes.
Silence radio sur la nouvelle guerre du Mali
« …pourquoi avoir engagé 1 500 militaires dans cette « nouvelle reconquête » du Nord Mali ? Avec, comme supplétifs, quelques éléments de l’armée malienne et de la force africaine de l’ONU dont les officiers français déplorent « le manque de combativité et leurs équipements médiocres ». Enfin, quelle bizarre idée d’avoir baptisé « opération Hydre » ce nouvel engagement français, en référence à ce serpent dont les sept têtes repoussent après avoir été tranchées… En réalité, des avions de combat interviennent régulièrement, et, parfois les combats sont rudes, près de Gao et de la frontière du Niger. (…) A Bamako, l’amiral Guillaud (patron des armées françaises) a parlé métier. Au général Marc Fourcaud, commandant du corps expéditionnaire français, et, à ses officiers, il s’est bien gardé de fixer une date pour la fin de leur intervention : ‘Il faut redoubler d’adaptation, d’imagination et de vigilance face à un adversaire qui se montre jusqu’au-boutiste ‘. Façon de dire qu’il ne s’agit pas d’ « une simple action de contre-terroriste » comme le prétend Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. » (Le Canard enchaîné du 30/10/13)
« Malgré la présence de milliers de soldats français et africains dans le septentrion malien pour les traquer, les éléments de ces groupes terroristes ont pu perpétrer, depuis septembre 2013, trois attaques meurtrières. Particulièrement élaboré, le raid mené le 23 octobre dernier à Tessalit, dans le nord-est du Mali, contre des soldats tchadiens de la Mission intégrée des Nations-unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) nous apprend beaucoup sur la capacité de résistance d’Aqmi et du Mujao ». (Courrier international 7-13/11/13)
A cela s’ajoute une série d’accrochages meurtriers entre l’armée malienne et les forces nationalistes du NMLA en vue de contrôler la ville de Kidal, sans compter les sanglantes prises d’otages et autres explosions de kamikazes dont les civils font régulièrement les frais.
Tout ceci confirme qu’au Mali la guerre est toujours aussi sanglante entre barbares islamistes et gangs agissant au nom de la défense de l’ordre et de la démocratie, tous également avides de sang et de gains économiques, tous semant la mort et la désolation parmi les populations sahéliennes sans le moindre état d’âme.
Hollande et l’impérialisme français plongent dans le chaos centrafricain
Depuis mars 2013, la Centrafrique est plongée dans un chaos sanglant, suite à un coup d’Etat militaire piloté par une coalition de rebelles se nommant la « Séléka » qui a chassé du pouvoir l’ex-président (putschiste) François Bozizé en mettant à sa tête un élément de la rébellion Michel Djotodia. Une fois au pouvoir, les groupes armés se livrent quotidiennement aux assassinats, au pillage des ressources (or, diamant, etc.), au racket, à la rafle des jeunes dans les quartiers, aux viols... Pour échapper à ce monstrueux carnage, des centaines de milliers d’habitants ont dû quitter leur domicile en allant se réfugier tantôt dans la forêt tantôt dans les pays voisins. Mais, de fait, il n’y a pas que les ex-rebelles au pouvoir qui sèment la terreur, il y a aussi leurs opposants. Par exemple, les partisans de l’ancien président renversé se comportent eux aussi en bourreaux, tout cela sous les yeux indifférents des centaines de soldats français qui se contentent odieusement de « compter les points » et les morts. Sans doute hanté par « l’expérience rwandaise » où il fut accusé de complicité dans le génocide, l’impérialisme français se lance dans une nouvelle intervention en Centrafrique.
« Ce n’est plus qu’une question de jours, la France va lancer une opération militaire en République centrafricaine (RCA). ‘Une opération coup de poing, limitée dans le temps, pour rétablir l’ordre et permette une amélioration de la situation humanitaire », indique une source au ministère de la défense’ ». (Le Monde, 23/11/13)
Au moment où nous rédigeons ces lignes, le gouvernement français annonce l’envoi en Centrafrique d’un millier de soldats allant renforcer les 400 sur place en permanence.
Les responsabilités criminelles de la France en Centrafrique
« Pour le meilleur comme pour le pire, c’est un pays que Paris connaît bien. Ce fut même une caricature de ce que l’on appelait jadis la « Françafrique ». Un Etat où la France faisait et défaisait les régimes. Remplaçant des dictateurs en cours d’émancipation par d’autres qui lui étaient redevables. On a bien noté les visites mystérieuses ces derniers mois à Bangui de Claude Guéant et de Jean-Christophe Mitterrand, deux figures d’une « Françafrique » moribonde ». (Le Monde, 28/11/13)
En effet, le gendarme français retrouve le chemin de Bangui pour y rétablir son ordre néo-colonial, mais contrairement au gros mensonge du gouvernement Hollande, ce n’est pas pour « permettre une amélioration de la situation humanitaire » ou à cause des « exactions extraordinaires » qui s’y déroulent. Car cela fait bientôt un an que les autorités françaises ferment les yeux sur les « actes abominables » se déroulant en Centrafrique et pire encore le silence était de mise jusqu’aujourd’hui à tous les étages du pouvoir français, grands médias compris. Et pour cause. Le gouvernement français se sentait bien mal à l'aise pour dénoncer les massacres et mutilations que subissent les populations centrafricaines. D’abord, rappelons que le général François Bozizé (arrivé au pouvoir en 2003 par un coup d’Etat téléguidé par Paris) a été renversé fin mars 2012 par une coalition de groupes armés (la « Séléka ») soutenue en sous main par la France. En réalité, l’impérialisme français s’est servi de ces bandes armées pour se débarrasser de l’ancien « dictateur » qui échappait à son contrôle : « Jacob Zuma n’a pas hésité une seconde à voler au secours du président centrafricain François Bozizé lors que ce dernier, menacé par une rébellion armée, a fait appel à lui en décembre 2012. Le fait que Bozizé ait été lâché par la France et soutenu de façon quelque peu ambiguë par ses voisins francophones- considérés à Pretoria comme autant des néo-colonies- a encore accru la détermination sud-africaine à intervenir. En une semaine, 400 soldats de la force de défense nationale d’Afrique du Sud (SANDF) ont été transportés à Bangui. Installé dans les locaux de l’école de la police du kilomètre 9, mais aussi à Bossembélé et à Bossangoa à l’intérieur du pays, ils n’ont aucun contact, ni avec les forces africaines multinationales présentes sur place, ni avec l’ONU, ni bien sûr avec le contingent français. Jakob Zuma n’a de comptes à rendre à personne. Et ce ne sont pas les sociétés chinoises qui, dans le plus grand secret, opèrent depuis 3 ans dans le nord-est de la Centrafrique, où des gisements de pétrole sont désormais avérés, qui s’en plaindront. Elles n’attendent qu’une protection sud-africaine pour démarrer les premiers forages ». (Jeune Afrique, 10/03/13).
On voit là la vraie raison du « lâchage » de l’ex-président Bozizé : la « trahison » de son maître français en allant « coucher » avec l’Afrique du Sud, rivale déclarée de la France derrière laquelle se cache à peine la Chine, l’autre redoutable concurrent en train de s’emparer des ressources pétrolières de ce pays. Pourtant, en fonction des « accords de défense » existant entre les deux pays (permettant, entre autres, la présence militaire française permanente en Centrafrique), Hollande aurait dû soutenir Bozizé qui avait fait appel à lui. Au lieu de cela, le président français a décidé de « punir » son « ex- ami dictateur » par tous les moyens y compris en facilitant l’avancée des bandes sanguinaires de la Seléka jusqu’au palais présidentiel entouré par ailleurs de centaines de militaires français.
Cela permet de comprendre la dose de cynisme de la part de François Hollande quand on l’entend déclarer aujourd’hui : « Il se produit en Centrafrique des actes abominables. Un chaos, des exactions extraordinairement graves. Nous devons agir. (sic !) ».
Voila une hypocrisie de langage qui tente de camoufler et de justifier les abominables crimes que l’ex-puissance coloniale s’apprête à commettre en Centrafrique comme elle cherche à masquer sa complicité avec les diverses cliques sanguinaires concurrentes en présence et sa part majeure de responsabilité dans les horribles massacres en cours dans ces pays.
En clair, le gouvernement Hollande se fiche totalement du sort des populations centrafricaines, maliennes et autres, de leurs souffrances multiples. Il s’agit pour lui, de façon inavouée, simplement de défendre les intérêts du capital national par tous les moyens, dans un des derniers bastions de l’impérialisme français, le Sahel, région hautement stratégique et bourrée de matières premières, face aux autres requins impérialistes qui lui disputent son influence.
Amina (29 novembre)
Géographique:
- Afrique [59]