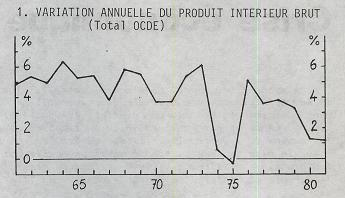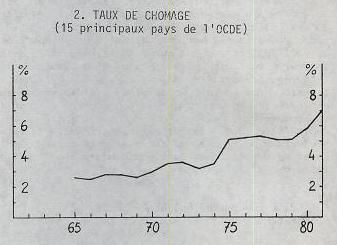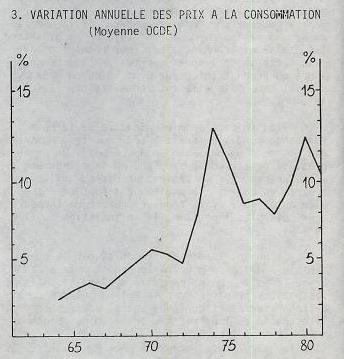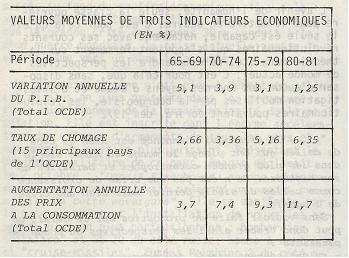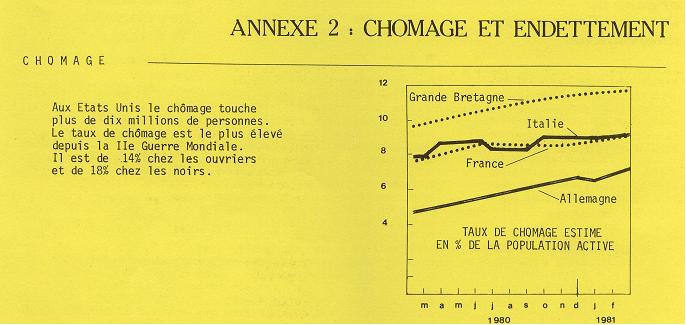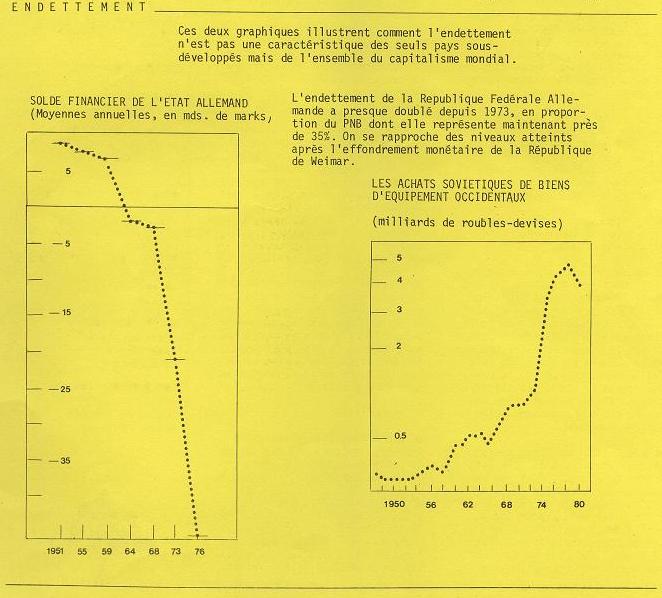Revue Int. 1982 - 28 à 31
- 3912 reads
Revue Internationale no 28 - 1e trimestre 1982
- 2541 reads
Situation internationale : Crise économique et lutte de classe
- 3408 reads
Nous avons fréquemment, dans notre presse, analysé le années 1980 comme les "années de vérité" (cf. la Revue Internationale n°20 et 26 notamment). Les deux premières années de cette décennie ont pleinement confirmé cette? analyse. En effet, 1980 et 1981 auront été le théâtre d'événements de la plus haute importance et particulièrement significatifs de l'enjeu qui, pour une bonne part, va se jouer dans les années 80 : guerre impérialiste généralisée ou révolution prolétarienne mondiale.
Sur le plan de la situation économique, celle qui détermine l'ensemble de la vie sociale, ce fut une fin brutale aux illusions : 1980 et 1981 se présentent comme les années d'une nouvelle récession de 1'économie mondiale, d'une poussée massive de 1'inflation et d'un développement sans précédent du chômage.
La réponse bourgeoise à cette crise : l'aggravation des tensions inter-impérialistes et des préparatifs de guerre n'a pas manqué, pour sa part, de se porter à la hauteur des causes qui l'engendrent. L'année 80 avait débuté avec 1'invasion de 1'Afghanistan, l'année 1981 se termine par l'annonce d'un formidable renforcement des armements partout dans le monde et par l'ouverture, à Genève, de nouvelles négociations entre l'URSS et les USA sur le "désarmement" : on connaît leur rôle d'écran de fumée destiné à masquer la course vertigineuse aux moyens d'holocauste.
La réponse ouvrière, elle aussi, a été à la hauteur de l'aggravation de l'enjeu : durant l'été 1980, prenait corps en Pologne le plus formidable mouvement de masse du prolétariat mondial depuis plus d'un demi-siècle. Mouvement que la bourgeoisie de tous les pays s'est employée à étouffer et dont elle n'est pas encore venue à bout. Mouvement qui a mis en évidence tant la solidarité que sait se donner la classe capitaliste face à la lutte prolétarienne, que la nécessité d'une extension mondiale de cette lutte.
C'est un point sur ces trois aspects indissociables et fondamentaux pour le destin de l'humanité la crise du capitalisme, la réponse bourgeoise à celle-ci et la réponse prolétarienne) que se propose de faire cet article.
UNE CRISE ECONOMIQUE QUI CESSE DE S'AGGRAVER
En 1959, le dirigeant de la première puissance mondiale déclarait triomphant : "Nous avons enfin appris à gérer une économie moderne de façon à assurer son expansion continue" ([1] [1]). Un an plus tard, les Etats-Unis connaissaient leur récession la plus sérieuse de l'après-guerre : - 0,1% de croissance du Produit Intérieur Brut (bien en deçà évidemment ce qu'ils allaient connaître par la suite).
En 1975, Chirac, premier ministre de la 5ème puissance mondiale jouait à son tour les "Nostradamus" : "Nous voyons le bout du tunnel". Un an après, il devait céder sa place au "meilleur économiste de France", le professeur Barre, qui, à son départ, en mai 81, laissait une situation encore pire qu'il ne l'avait trouvée (nombre de chômeurs deux fois plus important, 14 d'inflation au lieu de 117).
Il y a un an, Reagan était choisi par la bourgeoisie américaine pour régler son compte à la crise (c'est du moins ce qu'il déclarait). Mais les potions préparées par le Prix Nobel d'Economie Milton Friedman et quelques autres adeptes de "l'économie de l'offre" n'y ont rien pu. L'économie américaine replonge dans la récession, le chômage approche des 10 millions (chiffre record dans 1'après-guerre) et le directeur du Budget, David Stockman, reconnaît lui-même qu'il ne croyait pas tellement au succès de la politique économique dont, il était le principal animateur.
Aussi régulièrement que l'automne succède à l'été et l'hiver à l'automne, les dirigeants de ce monde se sont trompés et ont trompé leur auditoire en annonçant "la sortie du tunnel". Comme dans un film surréaliste, cette sortie a semblé s'éloigner au fur et à mesure qu'avançait le train jusqu'à n'être plus qu'un petit point de lumière qui sera bientôt invisible.
Mais les dirigeants de l'Ouest n'ont pas le monopole des prédictions hasardeuses.
En septembre 80, Gierek était remplacé par Kania à la tête du POUP pour avoir mené l'économie polonaise à la catastrophe. Avec Kania, ça allait changer ! Et effectivement, ça a changé. La situation économique de l'été 80 prend, avec le recul des airs de prospérité à côté de celle d'aujourd'hui. Une chute de la production de 15% a suivi une chute de 4%. Réélu triomphalement à la tête de son parti en juillet, Kania est descendu aux oubliettes en octobre de la même année.
Quant aux pronostics de Brejnev régulièrement démentis, ils ont au moins aussi nombreux que les cessions plénières du Comité Central du PCUS. Dans un sursaut de lucidité et avec un certain humour, probablement involontaire, Brejnev a fini récemment par constater en substance que lorsque trois années de suite, la production agricole est mauvaise à cause des intempéries, il convient de réviser les analyses sur le climat de 1'URSS.
L'ensemble des pays du COMECON s'est distingué ces dernières années par une incapacité chronique à réaliser les objectifs du plan de 1976-80. Si le plus "sérieux", la RDA a réussi à réaliser 80% de l'augmentation prévue du revenu national, ce chiffre tombe à 50% pour la Hongrie. Quant à la Pologne, sa croissance par rapport à 76 se réduit à 0, ce qui revient à dire qu'elle ne produit aujourd'hui que 70% de ce que les planificateurs avaient prévu. Et vive le "formidable acquis ouvrier" que, d'après les trotskystes, représente la planification !
L'autre "acquis ouvrier majeur", selon les trotskystes, le monopole étatique du commerce extérieur, a lui aussi fait la preuve de sa redoutable efficacité : les pays du Comecon sont aujourd'hui parmi les plus endettés du monde. Quant au mythe de l'absence d'inflation dans ces pays, il a fait long feu depuis qu'on assiste régulièrement à des augmentations massives des prix "officiels" pouvant aller jusqu'à 200% (plus de 170% sur le prix du pain en Pologne).
En 1936, Trotski voyait dans les progrès économiques de l'URSS la supériorité du socialisme sur le capitalisme : "Il n'y a plus lieu de discuter avec MM. les économistes bourgeois : le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pages du Capital, mais dans une arène économique qui couvre le sixième de la surface du globe; non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de 1'électricité". ([2] [2]).
Avec la même logique il faudrait aujourd’hui arriver à la conclusion opposée : le capitalisme est supérieur au socialisme tant est évidente la faiblesse et la fragilité de l’économie des pays dits "socialistes"! C'est d'ailleurs le cheval de bataille que chevauchent les économistes occidentaux pour justifier leur défense irréductible du mode de production capitaliste. En fait, la crise qui frappe les pays de l'Est est une nouvelle illustration de ce ont que les révolutionnaires dit depuis toujours, l'URSS et ses satellites n'ont rien de socialiste. Ce sont des économies capitalistes, et qui plus est, relativement sous développées.
Mais les cris de satisfaction que poussent les tenants du capitalisme privé en montrant du doigt les pays de l'Est ne réussissent pas, bien que ce soit là leur fonction, à masquer la gravité de la crise au cœur même des citadelles du capitalisme mondial.
Les graphiques qui suivent, donnent une image de l'évolution de trois indicateurs majeurs de l'économie de l'ensemble des pays de l'OCDE (c'est à dire, les pays les plus développés d'Occident) le taux d'inflation, la variation annuelle du Produit Intérieur Brut et le taux de chômage.
Plus que les valeurs annuelles, elles-mêmes déjà significatives, il est intéressant d'examiner les valeurs moyennes sur des périodes de plusieurs années (61-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-81). On constate une détérioration constante de la situation du capitalisme occidental sur les trois plans considérés.
Evidemment, pour certains, ce n'est pas encore la "vraie" crise puisqu'on n'assiste pas sur une longue période, à un recul massif de la production comme ce fut le cas dans les années 30 : pour le moment, les taux de croissance moyens restent encore positifs. A cet argument, on peut apporter deux réponses :
1) Comme nous l'avons déjà mis en évidence dans d'autres articles, si la bourgeoisie n'a "pas appris" (et pour cause ! à surmonter une crise insoluble, elle a par contre appris, depuis 1929, à en ralentir le rythme, notamment par l'emploi massif de mesures de capitalisme d'Etat et par la prise en charge par les pays leaders de chaque bloc de la conduite des affaires des divers pays qui composent ces blocs (à travers le Comecon, pour le bloc de l'Est, via notamment l'OCDE et le FMI pour le bloc de l'Ouest). Il est d'ailleurs à noter, que, malgré les antagonismes inter-impérialistes, le bloc le plus riche, peut à l'occasion, venir en aide à l'économie en détresse d'un pays du bloc adverse, notamment lorsque ce pays est menacé d'explosions sociales. L'aide de l'occident à la Pologne et l'adhésion de ce pays ainsi que de la Hongrie au FMI l'illustrent bien.
2) Il n'y a pas qu'un recul de la production qui puisse indiquer l'existence d'une réelle situation de crise. Le simple recul continu des taux moyens de croissance, tel qu'il apparaît clairement sur le graphique, montre que quelque chose se dérègle, et de façon définitive, dans le fonctionnement de l'économie mondiale. De plus aujourd’hui, avec la mise en œuvre massive des techniques d'automation, le taux annuel d'augmentation le la productivité du travail est tel que, bon an mal an, même si un nombre important d'entreprises ferment leurs portes, le volume total de ce qui est produit peut se maintenir à un niveau supérieur à celui de l'année précédente, sans que cela n'indique une quelconque santé de l'économie ([3] [3]).
En fait, parmi les indices de 1'aggravation de la crise il faut retenir l'augmentation du chômage. Ce phénomène est une expression directe de l'incapacité du capitalisme à intégrer de nouveaux travailleurs dans son appareil productif. Pire, c'est une expression du fait qu’il a commencé à les rejeter massivement de celui-ci. Et cela, non seulement dans les pays du tiers-monde, comme c'était le cas durant la période de reconstruction du 2ème après-guerre, mais dans les métropoles même du capitalisme : les pays avancés. C'est là un signe flagrant de la faillite historique d'un mode de production qui avait pour vocation d'étendre au monde entier les rapports de production sur lesquels il est basé, l’exploitation du travail salarié, et qui aujourd’hui n'est même plus capable de maintenir l’étendue de celle-ci dans ses bastions mêmes (sans parler de la situation dans le Tiers-Monde où le chômage sévit de façon tragique depuis des décennies).
L'évolution du taux d'inflation est un autre indicateur très significatif de la dégradation constante du fonctionnement du capitalisme. L'inflation est une expression directe de la fuite en avant forcenée qui est devenue le mode de survie du capitalisme. Incapable de trouver des débouchés solvables pour sa production, ce système tire des traites sur l'avenir en s'endettant de façon massive et continue. Ce sont les Etats qui montrent le chemin dans ce domaine. Par des déficits budgétaires en croissance constante, par l'utilisation intensive de la planche à billets, ils tentent de créer des marchés artificiels pour remplacer ceux qui se dérobent à la production nationale. De plus en plus, les monnaies deviennent des monnaies de singe, des reconnaissances de dettes émises par des Etats qui ne sont plus solvables eux-mêmes. Et cette monnaie de singe ne peut que perdre de sa valeur de façon croissante d'où l'augmentation de l'inflation.
Quand elles tentent de limiter ce phénomène les politiques économiques n'aboutissent en fin de compte qu'à entraîner la récession : en essayant d’hypothéquer un peu moins l'avenir, on comprimait encore plus le présent. On connaît le résultat du "traitement de choc" de Mme Thatcher qui a fait augmenter le chômage de 68% en 1 an jusqu’à dépasser les 3 millions (chiffre plus élevé que dans les années 30) La potion Reagan aussi a fait merveille : 9 millions de chômeurs, 8,4 de la population active en novembre 81 (Reagan s'était engagé à ne pas dépasser les 8%). Quant à l'élixir Schmidt il a également fait ses preuves : augmentation du chômage de 54% en un an.
En réalité, la bourgeoisie de tous les pays se trouve de plus en plus coincée entre les deux lames d'une paire de ciseaux : la récession et l'inflation. Et chaque tentative de se dégager d'un des fléaux aboutit à se heurter à l'autre sans qu'on ait réussi pour autant à échapper au premier. Ainsi, Reagan avait-il, parmi ses nombreuses promesses, annoncé une réduction à 42,5 milliards de dollars du déficit budgétaire pour l'exercice 1981-82 : on envisage maintenant un chiffre de l'ordre de 100 milliards pour cet exercice, 125 milliards et 145 milliards pour les deux suivants.
On pourrait ainsi multiplier les chiffres qui, tous, aboutiraient à mettre en évidence l'impasse dans laquelle se trouve le capitalisme. En fait, le simple bon sens suffit à constater qu'il n'y a pas de solution à la crise de ce système : si les conditions qui existaient aux cours des années 65-69 ont abouti aux conditions dégradées des années 70-74 (voir tableau n°4), si ces dernières ont abouti aux conditions encore plus mauvaises des années 75-79, on ne voit pas comment, ni par quel miracle, les choses pourraient d'un seul coup s'améliorer.
Déjà en 1974, dans un accès de lucidité, le président français d'alors, Giscard-d'Estaing, déclarait-il : "Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que, s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe" (24-10-74).
Plus récemment, l'OCDE, dans ses "Perspectives économiques" de juillet 1981, donnait un exemple touchant de cette angoisse qui étreint la bourgeoisie quand elle regarde son futur. Echaudé par des années de prévision qui s'étaient révélées trop optimistes, se refusant à sonder avec lucidité l'avenir économique du monde par peur de "découvrir qu'il va à la catastrophe", cet organisme, sérieux s'il en est, écrivait :
"Dans la plupart des pays, les perspectives immédiates sont complexes et difficiles... Les prévisions ne peuvent jamais être tenues pour sûres. Même les comportements, dont la régularité, base même de toutes les prévisions, paraît bien établie, peuvent se modifier, quelquefois très brutalement. .. Si, comme cela arrive souvent, les nombreuses hypothèses sur lesquelles les prévisions sont fondées ne se réalisent pas, 1'avenir peut se présenter de façon très différente..."
En clair, l'OCDE avouait qu'elle ne servait plus à rien ... Cette incapacité de la bourgeoisie de prévoir son avenir est la traduction du fait que c'est une classe qui n'a plus aucun avenir à proposer à l'humanité sinon, celui d'un holocauste généralisé.
L'avenir de l'humanité, seule la classe ouvrière peut le mettre en œuvre. C'est pour cela qu'elle seule est capable, notamment avec ses courants révolutionnaires qui s'appuient fermement sur la théorie marxiste, de comprendre les perspectives du monde actuel. C'est pour cela que, sans disposer d'aucun des énormes moyens d'étude et d'investigation mobilisés par la bourgeoisie, les révolutionnaires pouvaient écrire, dès 1972 :
"(...) la crise qui s'annonce est bien du type de celles qui ont plongé le monde du XXème siècle dans les plus grandes catastrophes et barbaries de son histoire. Ce n'est pas une crise de croissance comme celles du siècle dernier mais bien une crise de 1 'agonie.
Sans vouloir faire de pronostics sur le délai, on peut donc tracer ainsi les perspectives du monde capitaliste :
- ralentissement massif des échanges internationaux
- guerres commerciales entre les différents pays
- mise en place de mesures protectionnistes, et éclatement des unions douanières (CEE, etc..)
- retour à l'autarcie
- chute de la production
- augmentation massive du chômage
- baisse des salaires réels des travailleurs".
("Révolution Internationale" Ancienne Série n°7, mars-avril 72)
C'est pour les mêmes raisons que, dès 1968, alors que personne ne parlait encore de crise, les révolutionnaires écrivaient déjà :
"L'année 67 nous a laissé la chute de la Livre Sterling et 68 nous apporte les mesures de Johnson, la lutte inter-capitaliste s 'aiguise rendant chaque jour plus réelle la menace de guerre mondiale, voici que se dévoile la décomposition du système capitaliste, qui, durant quelques années, était restée cachée derrière 1'ivresse du "progrès" qui avait succédé à la Seconde Guerre Mondiale (...) Nous ne sommes pas des prophètes, et nous ne prétendons pas deviner quand et de quelle façon vont se dérouler les événements futurs. Mais ce dont nous sommes effectivement conscients et sûrs, concernant le processus dans lequel est plongé actuellement le capitalisme, c'est qu'il n'est pas possible de 1'arrêter avec des réformes, des dévaluations ni aucun autre type de mesures économiques capitalistes et qu'il mène directement à la crise".
("Internacionalismo", janvier 1968. Publication du CCI au Venezuela)
LA REPONSE BOURGEOISE A LA CRISE
De plus en plus, la bourgeoisie tire des traites sur l'avenir. Elle le fait par un endettement vertigineux, par l'inflation. Mais sa fuite en avant ne se limite pas au plan économique. Comme par le passé, au fond du gouffre économique, il y a la guerre impérialiste généralisée. Aussi sûrement, que la grande crise des années 30 a conduit à la 2ème guerre mondiale, la crise actuelle pousse le capitalisme vers un 3ème holocauste.
La menace de guerre n'est plus à démontrer, elle est de plus en plus présente dans les préoccupations quotidiennes de la grande majorité de la population. Elle est inscrite dans l'énorme accélération des efforts d'armements de tous les pays et notamment du pays le plus puissant. Présentant le programme militaire de ce pays, Reagan déclarait le 2 octobre : "Depuis Eisenhower, aucune administration américaine n'avait présenté un projet nucléaire de cette envergure". Elle se manifeste par la mise au point et l'installation de nouvelles armes de plus en plus perfectionnées : bombardier "Backfire" et SS 20 du côté russe; bombe à neutrons et "cruise-missiles", fusées Pershing 2 du côté américain. Elle est révélée par le fait que, de plus en plus, c'est l'Europe, c'est à dire le théâtre central des deux guerres mondiales précédentes qui devient le terrain privilégié des préparatifs militaires : la controverse actuelle ainsi que les négociations russo-américaines de Genève sur les "Euromissiles" l'illustrent bien. De même que la crise a d'abord frappé avec violence les pays de la périphérie du capitalisme avant de déferler sur ses métropoles, la guerre, qui pendant longtemps a réservé ses ravages aux pays du Tiers-Monde (extrême Orient, Moyen-Orient, Afrique) étend maintenant sa menace vers ces métropoles.
Mais les préparatifs pour un troisième holocauste ne se situent pas uniquement sur le plan de l'accumulation d'armements. Ils passent aussi par un resserrement des rangs des différents pays autour des leaders de leurs blocs respectifs. C'est particulièrement net du côté occidental où, malgré toutes les déclarations et campagnes des différents partis, les gouvernements sont amenés à s'aligner sur les positions américaines. Par exemple, Schmidt semblait agir en franc-tireur et désobéir aux consignes américaines. En réalité, sa rencontre avec Brejnev du 22 novembre n'a pas été une occasion de faire des infidélités à son bloc de tutelle. Bien au contraire : les positions qu'il a prises lors de cette rencontre lui ont même valu les félicitations de l'opposition de droite au Bundestag.
Mitterrand, pour sa part, s'est donné des grands airs d’indépendance par rapport aux USA en ce qui concerne le Tiers-Monde. Au sommet Nord-Sud de Cancun, il a fait, contre les positions de Reagan, son numéro en faveur de "négociations globales" entre les pays développés et les pays sous-développés pour que les premiers viennent en aide aux seconds. Deux jours avant, à Mexico, il avait prononcé un grand discours emphatique, préparé par son conseiller Régis Debray (ex-admirateur de "Che" Guevara), dans lequel il s'adressait à "ceux qui prennent le les armes pour défendre les libertés", "à tous les combattants de la liberté", pour leur dire "Courage, la liberté vaincra"!
Ces déclarations, de même que la reconnaissance des mouvements de guérilla du Salvador, apparaissaient comme des pavés dans la mare de la politique américaine. En réalité, il s'agissait d'un simple partage des tâches au sein du bloc occidental entre ceux qui parlent fort et utilisent le langage de l'intimidation (et c'est celui qui aujourd'hui prime à l'égard du Tiers-Monde et ceux qui ont pour tâche spécifique de permettre au bloc occidental de contrôler les mouvements d'opposition et de guérilla, et d'empêcher qu'ils ne basculent du côté russe.
Depuis longtemps déjà, le bloc américain a délégué à 1'impérialisme français la responsabilité du maintien de l'ordre Sans certaines zones du Tiers-Monde. Mitterrand a repris de Giscard la tâche d'être le gendarme de l'Afrique (comme on a pu le voir récemment avec le Tchad). Compte-tenu de son profil "humaniste" et "socialiste", il a reçu en plus mandat, en compagnie de son acolyte mexicain, Lopez Portillo, d'être le "public-relations" de ce bloc à l'égard des mouvements bourgeois qui luttent contre les régimes militaires d'Amérique Latine.
Mais la véritable nature des liens qui unissent l'impérialisme français au bloc américain ne s'exprime pas dans ces déclarations "déviantes". Elle se révèle bien plus dans d'autres déclarations de Mitterrand, à la suite de la rencontre avec Reagan à Yorktown, le 18 octobre :
"Il s'agissait de bonnes conversations. Entre amis, le dialogue est facile. Nous avons la franchise de vieux amis qui peuvent tout se dire sans rien détruire" et Mitterrand a souligné "la bonne santé de 1'amitié franco-américaine, qui n'est pas menacée par les divergences".
La thèse souvent agitée dans les médias bourgeois d'une montée du neutralisme (et qui trouve son pendant avec la thèse chère au groupe du PIC et de Volonté Communiste de "l'effritement des blocs") n'est fondamentalement qu'un argument de propagande destiné à permettre la poursuite du raffermissement des liens au sein du bloc occidental face à la tension impérialiste avec le bloc russe.
Une dernière illustration de cette tendance au renforcement du bloc occidental a été donnée par l'assassinat de Sadate dans lequel on a voulu voir, propagande oblige, "la main de Moscou". En réalité, la mort de Sadate a arrangé les affaires du bloc occidental. D'une part, elle a permis le remplacement d'un dirigeant de plus en plus impopulaire qui affrontait un mécontentement social croissant et dont le maintien risquait d'aboutir à une situation à l'iranienne. D'autre part, elle a ouvert la voie, comme l'a déclaré crument Cheysson, ministre français des relations extérieures, à un rapprochement entre les pays arabes, et notamment entre les deux plus puissants, l'Egypte et l'Arabie Saoudite. Et cette reconstitution de l'unité arabe, défaite depuis les accords de Camp David, et qui ne peut se réaliser que sous l'égide américaine, constitue bien un des fers de lance de l'impérialisme occidental dans cette région du monde face à l'instabilité iranienne et la percée russe en Afghanistan. S'il y a "la main de quelqu'un" derrière les extrémistes religieux qui ont commis l'attentat, ce n'est certainement pas celle du KGB mais bien celle de la CIA qui avait, par ailleurs, la responsabilité du dispositif de sécurité de Sadate.
L'assassinat de Sadate a été présenté comme une "atteinte à la paix". En un sens, c'est vrai, mais pour des raisons totalement opposées à celles que présente la propagande occidentale. Si cet événement participe à la marche vers la guerre, ce n'est pas parce que Sadate était "l'homme de la paix": il ne l'a jamais été, ni en 73 quand il a pris l'initiative de la guerre contre Israël, ni à Camp David, dans le cadre d'une "Pax Americana" destinée à renforcer les positions politiques et militaires de l'occident au Moyen-Orient. La mort de Sadate s'inscrit dans les préparatifs de guerre en ce sens qu'elle ouvre la voie à l'établissement d'une paix au Moyen-Orient. Et comme toujours par le passé, dans le capitalisme décadent, la paix en un endroit du monde n'est pas autre chose que le moyen de préparer ailleurs une guerre encore plus étendue et plus meurtrière.
C'est là une cruelle réalité du monde actuel, la paix et les paroles de paix n'ont d'autres fonctions que de préparer la guerre. C'est ce qui se manifeste en ce moment même avec les énormes campagnes pacifistes qui se déchaînent en Europe occidentale.
L'histoire nous enseigne que les guerres mondiales ont toujours été préparées par des campagnes pacifistes. Déjà avant 1914, l'aile réformiste de la Social-démocratie, notamment sous la conduite de Jaurès, avait fait tout un battage pacifiste : ce fut pour mieux appeler les ouvriers à la guerre en août 1914 au nom de "la défense de la civilisation", cette "civilisation" qu'on se proposait de préserver auparavant en manifestant pour la paix. Si Jaurès, assassiné à la veille de la guerre, n'a pas eu l'occasion de faire ce dernier pas de sa démarche, par contre Léon Jouhaux, dirigeant de la CGT, qui avait été en première ligne pour les campagnes pacifistes, s'est retrouvé, pour sa part, au gouvernement d'Union Nationale. Dès avant 1914, le pacifisme, promu par les réformistes, fut donc un des moyens employés par le capitalisme pour jeter le prolétariat pieds et poings liés dans la boucherie impérialiste.
De même en 1934, sous l'égide des partis staliniens et de leurs "compagnons de route", avec la participation des socialistes et l'adhésion enthousiaste des trotskystes (et même des anarchistes), le mouvement Amsterdam-Pleyel (du nom du lieu où s'étaient tenues les deux conférences qui avaient préparé l'action) s'était donné comme objectif la lutte pour la paix. Ce mouvement aboutira aux "Fronts Populaires" contre le fascisme (considéré comme le principal fauteur de guerre) et aura été un des moyens de mobilisation du prolétariat pour la 2ème guerre mondiale.
La même manœuvre sera rééditée au début des années 50, lorsque la "guerre froide" apparaît comme la prémisse à une 3ème guerre mondiale. A la suite de "l'appel de Stockholm" contre l'armement atomique, les partis staliniens développent une énorme campagne de signatures "pour la paix" qui obtient un succès non négligeable (à tel point que les prostituées surprises en train de racoler des clients se défendent en affirmant qu'elles leur proposaient de signer la pétition pacifiste !). Si cette fois là, les tensions n'avaient pas abouti à une nouvelle guerre mondiale, les méthodes pour la préparer avaient, de nouveau, été mises en œuvre.
Pourquoi les campagnes pacifistes précèdent-elles toujours les guerres ?
En premier lieu, en se proposant de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils "sauvegardent la paix", ou "renoncent aux armements", elles accréditent l'idée que ces gouvernements ont le choix entre plusieurs politiques, que la guerre impérialiste n'est pas un mal inévitable que porte le capitalisme décadent, mais résulte d'une politique "belliciste" de tel ou tel secteur de la bourgeoisie, A partir d'une telle idée, quand elle est bien ancrée dans la tête des prolétaires, on peut ensuite les convaincre que c'est la bourgeoisie de "l'autre pays" qui est "belliciste", qui "veut la guerre", et que, par conséquent, il faut faire 1' "union sacrée" pour la combattre et l'empêcher de sévir. C'est comme cela qu'en 1914, les socialistes français ont appelé à la lutte contre le "militarisme prussien", les socialistes allemands au combat contre "le tsarisme et ses alliés". C'est comme cela que staliniens et sociaux-démocrates ont préparé la croisade "antifasciste" de la 2ème guerre mondiale.
En second lieu, les campagnes pacifistes, en ce sens qu'elles rassemblent tous les citoyens qui sont "contre la guerre", tendant à nier les différences et les antagonismes de classe. Ce faisant, elles canalisent et diluent la combativité prolétarienne dans un magma interclassiste, où se retrouvent tous les "hommes de bonne volonté" mais où le prolétariat perd de vue ses intérêts de classe. Elles sont donc un barrage redoutable contre la lutte de classe qui constitue le seul obstacle réel qui puisse entraver la marche vers l'issue bourgeoise aux contradictions du capitalisme : la guerre impéria1iste généralisée.
C'est pour ces raisons qu'avant et pendant la première guerre mondiale (notamment sous la conduite de Lénine) les révolutionnaires ont combattu le pacifisme, ont opposé aux mots d'ordre réformistes le mot d'ordre révolutionnaire de "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" et ont expliqué que le fléau de la guerre ne pourrait disparaître qu'avec le capitalisme lui-même. De même, entre les deux guerres et pendant la seconde guerre mondiale, seuls sont restés sur un terrain de classe les groupes et fractions qui ont maintenu cette position contre les pacifistes d'alors.
Les campagnes pacifistes d'aujourd'hui ont exactement la même fonction que celles du passé. Elles prennent la suite des campagnes précédentes de "défense des droits de l'homme" promues par Carter et de "défense du monde libre" promues par Reagan. Mais alors que les précédentes avaient en grande partie échoué, les campagnes pacifistes rencontrent un succès bien plus grand car elles s'appuient sur une inquiétude réelle qui a saisi les populations notamment en Europe occidentale. Pour l'heure, elles ne sont pas directement dirigées contre l'URSS comme l'étaient les précédentes. En certains endroits, elles bénéficient même de l'appui du bloc de l'Est via les partis staliniens. Mais même si, pour le moment, elles se donnent pour cible principale la politique militaire du bloc de l'Ouest (notamment les fusées Pershing, les Cruise missiles et la bombe à neutrons), c'est d'une importance secondaire car elles ne sont qu'une première étape dans l'opération de mobilisation du prolétariat d'occident derrière son bloc. Le moment venu, il sera temps de mettre en évidence que le véritable danger pour la paix c'est "l'autre", le bloc de l'Est. Pour l'heure, ce qu'il s'agit surtout d'obtenir, c'est que le prolétariat cesse d'apparaitre comme une force autonome dans la société comme il a recommencé à le faire, notamment depuis les grèves de Pologne.
Ce qui importe le plus à la bourgeoisie, c'est que les ouvriers soient incapables de comprendre le lien qui existe entre les luttes qu'ils sont conduits à mener contre l'austérité et la lutte contre la menace de guerre. Rien n'inquiète plus la classe capitaliste qu'une prise de conscience par le prolétariat du véritable enjeu de ses combats, du fait que ceux-ci n'ont pas seulement de sens par rapport aux revendications économiques qui les motivent, mais sont un réel obstacle aux préparatifs bourgeois pour la guerre impérialiste, constituent des préparatifs de la classe en vue du renversement du capitalisme.
Les campagnes pacifistes sont donc un rideau de fumée destiné à dévoyer la classe ouvrière, à l'entrainer sur un terrain qui n'est pas le sien, à enfermer ses luttes sur le strict terrain économique. Elles visent à désamorcer le resurgissement de la lutte de classe et, de ce fait, à détruire le seul véritable obstacle que rencontre le capitalisme sur le chemin de la guerre impérialiste généralisée.
Le rôle des révolutionnaires est de les dénoncer comme telles.
QUELLES PERSPECTIVES POUR LA CLASSE OUVRIERE
Parce qu'elle menace les fondements mêmes de la société d'exploitation, et non tel ou tel secteur de celle-ci, parce qu'elle oblige de ce fait la bourgeoisie mondiale à resserrer les rangs, la lutte de la classe ouvrière constitue la seule force dans la société capable d'enrayer l'engrenage de la guerre impérialiste. C'est ce qu'on a pu constater une nouvelle fois au cours de l'année .1980. La première partie de cette année a été dominée, suite à l'invasion de l'Afghanistan, par une aggravation sans précédents des tensions entre blocs. Par contre, dès que surgissent les grèves de masse en Pologne, le panorama de la situation se transforme.
L'escalade de la propagande belliciste s'interrompt pour un temps, et avant même son investiture, Reagan envoie, en novembre 80 son ambassadeur personnel, Percy, reprendre avec le gouvernement russe un contact interrompu depuis la fin 1979. Si les diatribes américaines se poursuivent néanmoins à propos de la Pologne, elles ont une toute autre signification que celles qui avaient suivi l'invasion de l'Afghanistan. Certes, et c'est toujours bon à prendre, on continue à présenter auprès de l'opinion occidentale l'URSS comme le "méchant", celui qui en veut à "l'indépendance du peuple polonais". Mais la fonction essentielle des mises en garde américaines à l'URSS contre toute velléité d'intervention en Pologne est justement de rendre crédible cette menace auprès des ouvriers polonais et de les inciter à la "modération".
Face au prolétariat de Pologne, on a assisté à la constitution d'une Sainte Alliance de toute la bourgeoisie mondiale qui s'est répartie les tâches tant à l'extérieur (bloc de l'Ouest et bloc de l'Est) qu'à l'intérieur (POUP et "Solidarité") afin d'isoler le prolétariat et de venir à bout de sa lutte ([4] [4]). C'est pour cela que la question de la généralisation mondiale des combats prolétariens est devenue si fondamentale comme nous l'avons souligné souvent dans ces colonnes ([5] [5]).
Faute d'une telle généralisation, on peut constater aujourd'hui comment, progressivement, la bourgeoisie reprend le terrain qu'elle avait du céder au mois d'août 80. En décidant le 2 décembre d'employer la force contre les élèves pompiers en grève (6000 policiers des forces antiémeutes contre 300 étudiants), les autorités polonaises ont marqué un nouveau point contre la classe ouvrière. Le processus de reprise en main remonte à février 81 avec la nomination du général Jaruzelski à la tête du gouvernement. Il se déploie en mars avec l'affaire des violences policières de Bydgoszcz où c'est de façon délibérée que les autorités provoquent la classe ouvrière (même si Walesa se plait à présenter ces violences comme un "complot contre Jaruzelski")afin de pouvoir lui infliger la première gifle qui doit inaugurer la mise au pas. Cette gifle, ce n'est d'ailleurs pas tant le gouvernement qui l'assène mais "Solidarité" qui, après tout un battage sur la grève d'avertissement de 4 heures et la préparation d'une grève générale illimitée, signe avec le gouvernement un compromis en forme de capitulation et le fait avaler aux travailleurs.
Cette reprise en main s'est poursuivie par la nomination en octobre de Jaruzelski au poste de 1er secrétaire du POUP. Désormais ce général cumule trois postes clé : la direction du parti, du gouvernement et de l'armée. Et comme après sa nomination de février, celle d'octobre est suivie (cette fois sous sa responsabilité explicite) d'une nouvelle apparition brutale et bien plus massive de la police.
Aujourd'hui encore, il revient à "Solidarité" de dévoyer, par un langage radical s'il le faut, le mécontentement ouvrier qui s'accumule tant contre la contre-offensive gouvernementale que contre des conditions d'existence qui n'ont jamais été aussi catastrophiques. Ainsi, le 7 décembre, le gouvernement se paye le luxe de diffuser de façon répétée des propos radicaux tenus par Walesa lors de la réunion des dirigeants de Solidarité du 3 décembre, à la suite de l'intervention de la police :
"Je n'ai plus d'illusions, les choses sont allées si loin qu'il faut tout dire aux gens, leur dire quel est l'enjeu, que ce n'est rien de moins que de changer la réalité. Aucun changement de système ne peut se faire sans casse. L'essentiel est d'être vainqueur. "
Le but de la manœuvre gouvernementale est évident : intimider la population en laissant planer la menace de graves répercussions à de tels propos. L'autre but de cette opération est de redorer le blason de Walesa auprès des ouvriers les plus combatifs, car le gouvernement aura encore besoin de lui pour les calmer le moment venu.
La stratégie de la bourgeoisie est claire. Elle consiste à acculer le prolétariat à l'alternative : capituler ou engager une épreuve de force frontale qu'il sait perdue compte-tenu de son isolement présent.
C'est pour cela que la généralisation des combats de classe apparaît chaque jour plus comme une nécessité impérieuse.
Pour l'heure, cette généralisation tarde à venir. En Europe de l'Est, on a pu constater une montée de la combativité là où la crise frappe le plus violemment les ouvriers: La Roumanie (dont le gouvernement reprend à son compte la campagne pacifiste d'occident!). Cette combativité ne pourra s'exprimer pleinement dans tous les pays, tant à l'Ouest qu'à l'Est, que lorsque la pression économique sera devenue intolérable pour les masses ouvrières. Partout, avec l'aggravation de la crise, cette pression se développe. Mais dans un premier temps, elle a tendance à provoquer une plus grande passivité du prolétariat (bien que la signification de tels chiffres soit toujours à examiner avec précaution, les statistiques mettent en évidence pour 1980 et le début 81 une baisse presque générale en Europe occidentale et aux USA du nombre des conflits sociaux et des jours perdus pour faits de grève). Ce n'est pas là un signe que le prolétariat aurait déjà perdu la partie (quoique si cette passivité se prolonge une telle issue deviendrait menaçante). C'est plutôt la manifestation d'une prise de conscience diffuse au sein de la classe de l'importance de l'enjeu de ses prochaines luttes, de l'ampleur des tâches qui l'attendent.
Si aujourd'hui le prolétariat hésite encore, c'est qu'il est en train de se rendre compte qu'il est entré dans les "années de vérité".
F.M. 8-12-81
[1] [6] Richard Nixon, discours prononcé à son "inauguration" en janvier1969).
[2] [7] "La révolution trahie", chapitre 1er, section 1ère.
[3] [8] Le développement de nouvelles techniques dans le domaine de 1'automation n'empêche pas cependant certains pays comme les USA de connaître un ralentissement dans les gains de productivité et même, à certains moments, un recul de celle-ci. Il ne faut pas voir là "un échec de la technique", mais un effet de la crise elle-même qui vient amoindrir les taux d'utilisation du potentiel industriel et ralentir l'investissement productif (par manque de débouchés solvables). C'est ce que constate 1'OCDE dans son langage aseptisé ".un des objectifs essentiels des politiques gouvernementales doit être de créer un environnement dans lequel les stimulants du marché incitent les firmes à améliorer leur capacité d'innovation et leurs performances bien évidemment, le renouvellement technologique que l'on préconise ne peut avoir lieu qu'en présence de conditions économiques favorables. Or les perspectives actuelles n'encouragent pas à faire le saut de l'innovation. Il y a donc un grand risque que les entreprises n'innovent pas à un rythme suffisant, préférant attendre que le climat des affaires se stabilise. "
(Les Enjeux des transferts de technologie Nord-Sud. OCDE. Paris 1981) Ainsi, en s'aggravant, la crise vient saper les bases de ce qui avait permis au capitalisme d'en masquer pour un temps la profondeur.
[4] [9] voir nos différents articles dans les Revues Internationales n°23, 24, 25
[5] [10] voir notamment les textes du 4ème Congrès du CCI dans la Revue Internationale n°26
Récent et en cours:
- Crise économique [11]
Questions théoriques:
- Décadence [12]
Lutte de classe en Europe de l'est (1970-1980)
- 3928 reads
La première partie de cet article est parue dans la REVUE INTERNATIONALE n°27. Cette deuxième partie reprend 1'évolution de la lutte de classes dans les pays de 1'Est à partir de la reprise mondiale de la fin des années 1960, et jusqu'aux événements de la fin des années 1970, notamment les événements de 1976 en Pologne. La dernière partie, qui paraîtra dans le prochain n° de cette revue traitera de la reprise mondiale de la lutte inaugurée par les événements de Pologne de 1980.
L'importance de la vague révolutionnaire de 1917-23, et même de la vague de lutte de classe qui a parcouru l'Europe de l'Est en 1953-56, a montré le potentiel qui existait pour l'internationalisation de la lutte prolétarienne, pour la constitution véritable de la classe ouvrière en force révolutionnaire unique, unifiée à l'échelle mondiale. Mais comme nous l'avons vu dans la première partie de cet article (voir Revue Internationale n° 27), ce potentiel n'a pas pu se réaliser à cette époque. Ces mouvements de classe de millions d'ouvriers ont été brisés par leur isolement à l'échelle mondiale. Comme nous l'avons vu, l'histoire des grands soulèvements de l'Europe de l'Est et du centre, des années 1920 aux années 50, est avant tout l'histoire de leur isolement du reste du prolétariat. Ce fut le résultat, en plus des obstacles permanents que le capitalisme impose à la classe ouvrière (usines, branches d'industrie, nations, etc.) d'un changement global du rapport de forces entre les classes en faveur de la bourgeoisie, qui a déterminé l'ensemble du développement de la lutte de classe durant six décennies. Le moment décisif de ce processus fut l'incapacité du prolétariat à empêcher l'explosion de la première guerre mondiale. Le résultat de cette défaite sans précédent que fut août 1914, fut de laisser le champ libre à la barbarie du capitalisme décadent, à la guerre impérialiste qui divisa le prolétariat en plein milieu. La tendance du capitalisme dans cette période de déclin n'est pas seulement de renforcer l'unité de chaque capital national autour de l'Etat, mais aussi de diviser le monde en deux grands camps guerriers impérialistes. Le résultat, pour le prolétariat, qui ne fut pas assez fort pour affronter et détruire ce système avant que celui-ci ne s'effondre dans la barbarie, fut que les organisations, les leçons politiques, les traditions de lutte de la classe ouvrière furent noyées dans un océan de sang et de misère.
Comme nous l'avons vu dans la première partie, la vague révolutionnaire fut principalement limitée aux pays défaits de la première guerre mondiale, tandis que les luttes des années 50 émergeant du massacre de 1939-45 restèrent au sein du bloc russe, qui dut concentrer brutalement ses forces et attaquer frontalement le prolétariat pour tenter de maintenir la paix avec le bloc américain, et ainsi bénéficier péniblement du boom de la reconstruction d'après-guerre, Les conséquences de cet isolement international de parties combatives du prolétariat, imposé par les divisions mêmes de l'impérialisme, sont extrêmement graves :
- il devient impossible pour le prolétariat comme un tout de simplement commencer à s'attaquer aux racines du système d'exploitation contre lequel il combat, car ceci ne peut se faire qu'à 1'échelle mondiale ;
- la puissance de la bourgeoisie mondiale reste intacte, elle est dirigée contre le prolétariat de façon unifiée et coordonnée ;
- la classe ouvrière est entravée dans sa pleine compréhension des tâches de la période, car une conscience révolutionnaire est précisément basée sur la compréhension que les expériences quotidiennes de lutte (les défaites organisées par les syndicats, la réalité brutale derrière le masque de la démocratie, etc...), font partie des mêmes conditions des ouvriers, partout, son indissolublement liées et convergent vers la nécessité de détruire le système à l'échelle mondiale. Cette perspective profonde ne peut être le produit que des luttes des ouvriers à l'échelle mondiale, qui se trouvent dans les mêmes conditions, avec les mêmes tâches, et le même ennemi partout. C'est au creuset de la généralisation mondiale des luttes que l'unité internationale du prolétariat se forgera.
Dans cette deuxième partie de cet article, nous examinerons le développement de la lutte prolétarienne dans les années 70 jusqu'aux années 80. C'est la fin de la contre-révolution, le commencement d'un resurgissement international du combat prolétarien. C'est la fin de l'isolement des ouvriers de l'Est. C'est la période du redressement du rapport de forces global entre les classes, qui depuis plus d'un demi-siècle, était resté en faveur du capitalisme. Pour la première fois, la période qui s'ouvre est une période de généralisation simultanée de la crise économique, et de la résistance prolétarienne dans toute la planète. La réponse internationale du prolétariat a forcé la bourgeoisie mondiale à unifier ses forces, à se préparer à affronter et à défaire les ouvriers pour ouvrir la voie à sa propre "solution" à la crise, la guerre mondiale. Dans ce sens, en bloquant la voie à la guerre impérialiste, en faisant surgir le spectre de la révolution prolétarienne, la classe ouvrière a progressivement repoussé et résorbé la division dans ses rangs, imposée par deux guerres impérialistes. La dernière décade a montré que les conditions de la lutte des ouvriers, et la réponse de la bourgeoisie, s'unifient de plus en plus. C'est un monde qui se dirige, non vers la guerre, mais vers la guerre de classe mondiale.
LES CONDITIONS DE LA CLASSE OUVRIERE DANS LES "PARADIS SOCIALISTES"
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la vie quotidienne pour les ouvriers en Europe de l'Est ressemble à un monde en état de guerre permanente. La croyance naïve de la classe ouvrière d'Europe de l'Est dans la possibilité d'une vie meilleure sous le capitalisme est un bon exemple du fait que, â l'époque du capitalisme mondial, les conditions qui prévalent au niveau global, sont plus importantes pour déterminer l'état de conscience de la classe dans n'importe quelle région du globe que ne le sont les conditions spécifiques prévalant dans la région. Il n'y avait rien dans la vie quotidienne des ouvriers de l’Est pour nourrir des illusions sur la nature progressiste de "leur" régime. Ils devaient souffrir de faim pour qu'on puisse construire des tanks. Ils devaient faire la queue des heures durant pour les choses les plus élémentaires. Toute protestation, toute résistance de classe, était considérée comme une mutinerie et traitée comme telle. Dans un monde encore dominé par l'antagonisme entre blocs impérialistes rivaux, et non par la bataille entre classes, les illusions des ouvriers -particulièrement à l'Est- portaient par dessus tout sur les conditions dans 1'AUTRE bloc. Les illusions à l'Ouest dans la nature progressiste de l'Est "socialiste" et les illusions à l'Est sur la nature paradisiaque et permanente de la reconstruction occidentale d'après-guerre, avec l'espoir pour les ouvriers que "leur" bourgeoisie y arriverait tôt ou tard, étaient les deux faces d'une même pièce. C'était une période où les conditions de lutte dans les deux blocs étaient radicalement différentes, ce qui accréditait le mythe que deux systèmes sociaux opposés étaient à l'œuvre à l'Est et à l'Ouest. A l'Ouest, on déclarait que la lutte de classe était dépassée. A l'Est, où elle était supposée ne plus exister non plus, c'était plus difficile à cacher. Les luttes y étaient explosives mais isolées, et pouvaient être présentées aux ouvriers à l'Ouest comme des mouvements de libération nationale ou comme des réactions aux imperfections d'un socialisme authentique. Pour l'Est comme pour l'Ouest, la crise du bloc russe était devenue si lourde et si permanente qu'il était possible pour la bourgeoisie mondiale de déclarer : "Ce n'est pas la crise, c'est le socialisme" !
L'AUTARCIE ET L'ECONOMIE DE GUERRE
C'est seulement par une sévère autarcie que les pays du bloc russe ont pu empêcher de tomber eux-mêmes sous le contrôle du bloc américain. Ce contrôle direct et illimité de l'économie et du commerce extérieur exercé par l'Etat dans ces pays, les restrictions dans l'investissement direct de capital de l'Ouest, dans le commerce Est-Ouest, dans le mouvement de main-d’œuvre, etc. ne sont pas du tout des preuves de la nature non-capitaliste du COMECON, comme le prétendent les trotskysmes. Elles servent exclusivement à la préservation du bloc russe contre la domination occidentale.
En étant contraints de s'isoler eux-mêmes des principaux centres du capitalisme mondial, les capitaux nationaux de l'Est, déjà non compétitifs, ont accentué leur retard technologique par rapport à l'Ouest. Leur perte progressive de compétitivité signifie qu'ils ne peuvent réaliser qu'une partie de leur capital investi sur le "marché mondial". La plus grande partie des marchandises produites par la COMECON est vendue à l'intérieur de ses frontières. Comme pour tout capitaliste individuel qui doit acheter ses propres produits parce qu'il ne trouve personne d'autre pour les prendre, les lois du capitalisme dictent au bloc russe d'entrer tôt ou tard sur le marché. Au niveau du capital national et des blocs impérialistes, le verdict de faillite ne tombe qu'avec le surgissement de la guerre mondiale impérialiste.
Pour éviter ce verdict de l'histoire, la bourgeoisie d'Europe de l'Est doit essayer de faire face à l'Ouest sur le niveau MILITAIRE. Pour ce faire, elle doit investir une beaucoup plus forte proportion de sa richesse dans le secteur militaire que la bourgeoisie de l'Ouest. En se basant pendant des années sur l'autarcie derrière les lignes tracées à Yalta et Potsdam, les "pays socialistes" ont été capables de réaliser des taux de croissance spectaculaires pendant les années 1950 et 1960. Mais à part dans le domaine militaire, il n'y a eu que peu de croissance réelle, juste une pléthore de biens industriels souvent inutilisables qui à l'Ouest ne trouveraient un marché qu'au rebut.
Dans les années 1970, le COMECON a commencé à s'ouvrir un peu plus vers l'Ouest. Ce ne fut pas, comme le disent les trotskystes, pour élever le niveau de vie des ouvriers. Ce ne fut pas non plus, comme beaucoup de politiciens occidentaux l'ont cru à l'époque, une capitulation du Kremlin face à l'argent occidental. L'ouverture était sensée bannir le danger d'une guerre mondiale, et ouvrir une nouvelle ère d'expansion économique. Pour les ouvriers de l'Est, cette modernisation signifia un accroissement temporaire de la fourniture de biens de consommation, et augmenta les possibilités de visiter ou même de travailler à l'Ouest. La Pologne, qui possédait et qui possède encore de grandes réserves de charbon, une ouverture maritime non prise par les glaces et de larges réserves de force de travail bon marché sous-employées dans l'agriculture, fut spécialement choisie par le Kremlin pour devenir la force motrice de cette modernisation. C'est pourquoi la Pologne devint le point central de la contradiction entre les fausses illusions nourries par, d'un côté, la modernisation, et, d'un autre côté, l'accélération de l'économie de guerre. Elle devint ainsi le centre le plus important du développement de la lutte de classe pendant plus d'une décade.
Les années 1970 ont vu apparaître les premières brèches dans les illusions concernant l'Ouest, à cause de l'accroissement de la crise et de la lutte de classe. Néanmoins, cette décade a été caractérisée avant tout par la chute des conditions de vie des ouvriers accompagnée d'un renforcement des illusions sur un futur de paix et de prospérité. Cette contradiction explosive entre illusion et réalité surgit à la surface après le tournant de l'économie mondiale de la fin des années 1970. Les premiers fruits dans les années 80, les années de vérité, ont été les grèves de masse en Pologne et l'écho mondial que ces luttes ont rencontré.
LES "ACQUIS D'OCTOBRE"
Que ce soit à l'Est comme à l'Ouest, il ne manque pas de défenseurs des "acquis de la révolution d'Octobre" dont sont supposés jouir les ouvriers du bloc russe. Nous examinerons quelques uns de ces "acquis". Par exemple, la soi-disant élévation des salaires réels et baisse des heures de travail. En se basant sur les chiffres officiels et sur des sources telles que les propres mémoires de Nikita Kroutchev, Schwendtke et Ksikarlieff, qui viennent de cercles dissidents russes, calculent ceci :
"En un mot, que ce soit selon l'URSS ou l'information étrangère, le revenu moyen des ouvriers industriels en Russie avant la 1ère guerre mondiale peut être établi à 60 - 70 roubles par mois. Ceci signifie que les gains actuels, correspondant à la valeur nominale en roubles, sont deux fois plus hauts qu'avant la révolution, et ceci face aux prix qui sont 5 à 6 fois supérieurs, et donc, qu'aujourd'hui les ouvriers en URSS vivent deux fois et demie à trois fois moins bien qu'avant la révolution. Le nombre de jours de travail dans l'année, malgré l'introduction de la semaine de cinq jours, est plus fort qu'avant la révolution, et résulte des nombreuses fêtes religieuses qui étaient observées dans l'ancienne période. Alors qu'aujourd'hui, il y a huit jours fériés par an et que le nombre total de jours travaillés est de 252, l'année de travail avant la révolution n'était que de 237 jours, ce qui revient en fait à une semaine de travail moyenne de 4 jours 1/2... Si nous divisons le revenu mensuel -150 roubles soviétiques contre 70 roubles tsaristes- par le nombre de jours travaillés dans le mois (21 jours en URSS, 19,75 en Russie), nous obtenons un revenu quotidien de 7,14 roubles pour l'URSS et 3,54 pour la Russie. Voici maintenant les prix des plus importantes denrées alimentaires :
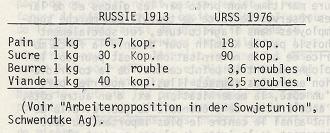
"Un guide des statistique du travail de l'URSS de 1967 montrait que plus de 20 % des ouvriers employés dans le secteur le mieux payé, l'industrie de la construction, se trouvaient au-dessous du seuil de pauvreté, et que plus de 60 % de ceux des industries les moins payées des industries textile et alimentaire se trouvaient au-dessous de ce seuil de pauvreté" ("The Soviet Working Class, Discontent and Opposition" Holubenko dans Critique).
Dans le bloc russe, les femmes travaillent presque toutes. L'Allemagne de l'Est par exemple a le plus haut taux de femmes employées dans l'industrie dans le monde. Elles jouent un rôle semblable à celui des ouvriers immigrés à l'Ouest,
en percevant en moyenne la moitié d'un salaire d'homme. Elles sont employées non seulement dans les usines, mais aussi sur les chantiers, dans la construction des routes et des chemins de fer, par exemple en Sibérie, etc. "Récemment, la route de Revda à Sverdlovsk a été élargie par la construction d'une deuxième voie. Ce travail physique extrêmement dur a été fourni à 90 % par des femmes. Elles ont travaillé à la pioche, à la pelle et à la barre à mine. En fait, les femmes des minorités nationales prédominent (Mordva, Tachunaschi, Marejer). Si à l'Ouest il est parfois possible de prendre un jeune homme pour une fille, à cause des vêtements et du style de coiffure, en Russie c'est le contraire, du fait des vêtements de travail sales, des mains, de la manière de marcher, de courir et de boire" (Schwendtke, P.62).
A notre avis, ces rapports sur la misère des conditions des ouvriers dans les "pays socialistes" tendent malgré tout à SOUS-ESTIMER la situation. Par exemple, les données de la journée de travail ci-dessus ignorent l'accroissement constant des heures supplémentaires -souvent NON PAYEES- obligatoires. En 1970, les ouvriers des docks Warskin à Stettin disaient avoir à effectuer plus de 80 heures supplémentaires par mois (voir "Rote Fahne liber Polen"). Et même si le niveau de vie est beaucoup plus bas en URSS, particulièrement dans les régions asiatiques, qu'en Europe de l'Est, les conséquences de l'austérité permanente n'ont pas épargné les ouvriers des pays satellites non plus :
"Une étude de la révolution et de ses causes publiée clandestinement en Hongrie au début de 1957 sous le pseudonyme de Hungaricus, montre à partir des statistiques hongroises officielles que le niveau des salaires réels est tombé de 20 % pendant les années de la construction socialiste de 1949 à 1953. Le salaire mensuel moyen était inférieur au prix d'un costume neuf, et la paye journalière d'un travailleur de ferme d'Etat était insuffisante pour acheter un kilo de viande. Bien sûr, la brochure d'Hungaricus ne prend en compte que 15 % des familles hongroises, qui vivaient sous le régime déclaré "niveau de vie minimum", avec 30 % qui l'atteignaient et 55 % qui vivaient au-dessous de ce niveau. Ceci signifiait que parmi les 15 % de familles de la classe ouvrière, tous les membres n'avaient pas de couverture pour dormir et 20 % des ouvriers n'avaient même pas de manteau d'hiver. Ce furent ces sans-manteaux, suggère Hungaricus, qui fournirent le gros des troupes qui affrontèrent les tanks russes en octobre 1956" (Comax, "The working class in the Hungarian Révolution of 1956). Il n'y a pas à chercher plus loin la cause principale de la vague de lutte de classe de 1953-56 !
Si on considère la fameuse "disparition du chômage" dans le bloc russe, on peut citer l'oppositionnel "Osteuropa" n°4, "Unterbeschafbigung un Arbeitslosigkeit in der Sowjetunion" :
"Avec le début des plans quinquennaux staliniens, les échanges de main d'œuvre furent terminés. Ceux qui voulaient travailler étaient envoyés dans les chantiers de construction socialiste dans les régions les plus éloignées... En déclarant le chômage aboli, et en arrêtant le paiement d'indemnités de chômage, le gouvernement condamna des mil liions de gens à la misère et à la faim. Staline utilisa aussi les camps de concentration dans sa "lutte contre le chômage", ce qui fit disparaître la force de travail en surplus dans les régions les plus peuplées. Selon le calcul de l'expert de la BBC, Pospelowski, 2 % à 3 % de la population laborieuse était inemployée en 1960, ce qui veut dire 3 à 4 millions de gens. Dans ce calcul ne sont pas inclus ceux qui sortent de l'école, les gens qui pour des raisons technologiques sont inutilisés et en attente de travail, les saisonniers, les paysans kolkhoziens et ouvriers des sovkhozes. Si on les compte pour 1 % de la population, le calcul se monte à plus de chômage que durant la récession de 1967-69 en Allemagne de l'Ouest et en chiffres absolus à plus de chômeurs que dans les années d'après-guerre aux USA. Pospelowski ajoute que c'est le tableau général du chômage complet selon les chiffres de 1957. Il considère que, si on inclut le chômage partiel, on atteint un chiffre de 5 % de la population laborieuse sans emploi... avec un nombre de chômeurs complets qui s'est considérablement accru."
C'est une manifestation claire de l'anarchie du mode de production capitaliste que le chômage soit un problème pour des pays où la bourgeoisie doit compenser une faible composition organique du capital et un faible niveau technologique par une utilisation accrue de main-d’œuvre, et qui fait que le chômage s'accroît en même temps que s'accroît la pénurie de main-d’œuvre.
Depuis 1967, les bureaux de chômage ont rouvert dans toutes les grandes villes de Russie. Ils envoient les chômeurs dans le grand nord et en Extrême-Orient. Le résultat des "rationalisations" de l'économie russe pendant le plan quinquennal de 1971-75, a été que 20 millions d'ouvriers ont perdu leur travail. En plus, il faut compter plus de 10 millions de travailleurs saisonniers. Depuis le début des années 70, les camps de travail et les "colonies de pionniers" de Sibérie sont devenus une fois de plus une soupape pour l'explosion du chômage et pour l'exode rural.
Malgré le silence discret de la gauche prorusse à l'Ouest, l'existence du chômage à l'Est est connue depuis des années. Nous mentionnerons comme exemple une lettre de lecteur au journal des enseignants russes "Utschiteskaja Gazeta", du 18 janvier 1965 :
"Comment peut-on se réconcilier avec de telles circonstances honteuses, quand dans une ville de taille moyenne il y a encore des jeunes gens qui n'ont jamais travaillé et qui ne vont plus à l'école depuis des années. Livrés à eux-mêmes, ils traînent dans les rues pendant des années, font les pickpocket, vendent des objets, et se saoulent à la gare" (Schwendtke p. 75). En plus du chômage direct -le gouvernement polonais menace actuellement de licencier 2 millions d'ouvriers- l'industrie est affaiblie par les arrêts dus au manque d'approvisionnement en pétrole, en pièces de rechange, matières premières ou services d'entretien.
En 1979, le KOR déclarait que près d'un tiers de l'industrie polonaise était inutilisée à un moment donné pour ces mêmes raisons, ce qui doit être encore plus vrai aujourd'hui. Pour les ouvriers qui travaillent à la pièce, cela signifie une chute encore plus brutale de leur paye. L'industrie est aussi affaiblie par des taux astronomiques de rotation de main-d’œuvre, car les ouvriers affamés cherchent désespérément de meilleurs contacts. Aujourd’hui, la bourgeoisie russe est obligée de permettre aux ouvriers de changer de travail deux fois par an, pour éviter des explosions sociales. "La rotation de la main-d’œuvre est la principale plaie du système économique soviétique. La perte d'heures de travail due à la rotation en URSS est beaucoup plus grande que la perte due aux grèves aux USA. Par exemple, dans une usine où j'ai travaillé, avec une équipe de 560 personnes, plus de 500 employés quittèrent pendant l'année 1973 (Nikolaï Dragosch, fondateur d'"Unification démocratique de l'URSS" "Wir mussen die Angst uberwinden").
Face à l'impérieuse nécessité de survivre, les ouvriers vivent du pillage des usines dans lesquelles ils travaillent. Ces actions sont une expression de 1'atomisation extrême de la classe ouvrière en dehors des périodes de lutte, mais elles révèlent aussi l'absence de toute identification avec les profits de "leur" compagnie ou avec les objectifs du plan quinquennal.
"L'usine d'automobiles de Gorki maintient à ses frais un secteur criminel de la milice d'environ 40 personnes, qui confisquent aux ouvriers au cours de contrôles quotidiens l'équivalent de 20 000 roubles en outils et pièces détachées. Le désespoir chez les ouvriers va si loin qu'ils coupent des carrosseries de Volga en plusieurs morceaux au chalumeau, les jettent par dessus les murs, les ressoudent et les vendent". (Cité de Lomax, p. 32)
Face aux réalités crues de la crise économique permanente, le contrôle policier et la répression ouverte ont été longtemps les principaux moyens de tenir en échec le prolétariat. Nous allons voir comment une petite terreur d'Etat a réussi à paralyser un prolétariat conduit à se révolter face à la détérioration de la situation, une rareté croissante des biens de consommation, des prix élevés, particulièrement sur le marché noir, l'accroissement des cadences dans les usines, l'effondrement des services sociaux, la plus forte suppression de logements depuis 1954, l'humiliation constante de la part de la police et de l'administration. Les ouvriers ont commencé à se poser des questions sur tous les aspects du contrôle capitaliste, des syndicats à la police jusqu'à la bouteille de vodka.
LE SURGISSEMENT DE LA LUTTE DE CLASSE EN URSS
"Les journalistes estiment que jusqu'au milieu des années 70, des actions spontanées des ouvriers, pas plus de 10 % ont été connues publiquement ou par les gens à l'Ouest (Schwendtke, p.148). Holubenko commente dans le même sens :
"... le samizdat n'a fait connaître que très peu sur la question de l'opposition de la classe ouvrière; le samizdat dont aujourd'hui 1 000 documents par an parviennent à l'Ouest, est écrit principalement par l'aile libérale ou de droite de l'intelligentsia, et reflète les préoccupations de cette intelligentsia" ( Holubenko, ibid, p. 5).
Mais le problème va plus loin que çà. Les services d'espionnage occidentaux sont extrêmement bien informés de ce que fait la classe ouvrière dans le bloc russe, tout comme les services de radio qui transmettent vers l'Est (Radio Liberty, BBC, Deutscher Welle, etc.) qui collaborent étroitement avec ceux-ci. Ce que nous avons ici, c'est un black-out massif sur les nouvelles de la lutte de classe de la part du "monde libre". Cette censure concerne d'abord l'information fournie aux ouvriers de l'Est, pour enrayer le danger de généralisation. Un des exemples les plus connus est la décision de Radio Free Europe de Munich de refuser de transmettre une série de lettres envoyées par les mineurs roumains en grève pour informer les autres roumains et les ouvriers d'Europe de l'Est de leurs actions. Ensuite, ceci concerne l'information qu'on laisse passer vers les ouvriers à l'Ouest. Par exemple, les grèves russes de Kaliningrad, Wor et d'autres villes en Biélorussie qui éclatèrent en solidarité avec le soulèvement polonais de 1970, sont bien connues en Pologne, mais n'ont été apportées à l'Ouest qu'en 1974, et encore, à travers le service de presse Hsinhua de Pékin (9.1.1974).
La bourgeoisie occidentale a de bonnes raisons de collaborer avec sa contrepartie russe en cachant les activités des ouvriers particulièrement en Russie par le silence. Les ouvriers à l'Ouest doivent continuer à croire que "les Russes" sont sur le point de "nous" envahir plutôt que de savoir que le prolétariat russe est engagé dans une lutte presque permanente avec sa propre bourgeoisie. D'un autre côté, cela donnerait au prolétariat mondial un plus grand sentiment de force et d'unité de savoir qu'un des plus forts de ses détachements a repris le chemin de la guerre de classe. Dans la première partie de cet article, nous avons traité de la reprise de la lutte de classe en URSS dans les années 1950 et 60. Dans cette première partie, écrite en novembre 1980, et traitant de la vague de grèves du début des années 60, avec son point culminant à Novocherkask en 1962, nous disions -à tort, il semble- qu'il y avait eu une absence de comités de grève et autres moyens d'organiser et de coordonner la lutte après les premières explosions. Un reportage dit comment : "Les insurgés de la région du Donbass considéraient les manifestations de Novotcherkask comme un échec parce qu'ils s'étaient rebellés là-bas sans l'assentiment des bureaux d'organisation de grève de Rostov, Urgansk, Tagourog et d'autres villes. Ceci confirmerait les rumeurs et les rapports concernant un quartier général d'une opposition organisée dans le Donbass" (Cornelia Gersten-maïer, "Voices of the Silent").
La vague de grèves de 1962 fut provoquée par l'annonce de l'augmentation du prix de la viande et des produits quotidiens. "Grèves sur le tas, manifestations de masse de protestation dans les usines, manifestations de rue, et dans beaucoup de parties de l'URSS, des émeutes de grande échelle se produisirent. De source sure, on parle de tels événements à Grosny, Krasnovar, Donetsk, Yaroslav, Idanov, Gorki et même à Moscou où il semble qu'un meeting de masse ait eu lieu à l'usine d'automobiles Morkvitch" (Holubenko, p.12). Holubenko, en se basant sur les reportages d'un stalinien canadien nommé Kolasky, qui passa deux ans en URSS, mentionne aussi une grève des ouvriers du port d'Odessa contre le rationnement de nourriture, et une grève dans une usine de motos à Kiev. Le texte de Chanvier ("La classe ouvrière et les syndicats dans les compagnies soviétiques") parle d'une grève à Vladivostok contre le rationnement de nourriture, qui déboucha sur un soulèvement sanglant. Jusqu'en 1969, un calme relatif est revenu sur le front des grèves. La nouvelle direction Brejnev-Kossyguine a commencé par faire plus de compromis sur les salaires. Depuis 1969 cependant, les salaires ont fortement baissé en dessous même de ceux de l'ère Kroutchev. Déjà alerté par les grandes grèves du bassin du Donetz et à Kharkov en 1967, les forces de répression ont été renforcées.
Depuis 1965, et particulièrement depuis 1967, beaucoup de nouvelles organisations ont été établies pou renforcer les secteurs de la police et des agents spéciaux. Le pouvoir de la police s'est élargi, le nombre de policiers et d'officiers de sécurité professionnels s'est beaucoup accru, des postes de police de nuit et des unités de police motorisées ont été mises en place. De plus, une série de nouvelles lois a été établie pour "renforcer l'ordre social dans tous les domaines de la loi". Des ordonnances, des décrets et des lois tels que la loi votée en 1969 qui insistait sur la suppression des opposants politiques dangereux, des émeutes de masse, des meurtres de policiers, révèlent une nouvelle insistance- sur la "loi et l'ordre". Il y a aussi la promotion sans précédent de chefs du KGB à des postes dans les bureaux politiques centraux". (Holubenko, p.18).
La vague de grèves de 1969-73 en URSS fut une des plus importante, quoique moins bien connue, de la reprise internationale du prolétariat mondial en réponse à la rentrée du système capitaliste dans une crise internationale ouverte. Partout, les ouvriers de l'Union soviétique commencèrent à protester contre le rationnement de nourriture, la hausse des prix et les mauvaises conditions de logement. Quelques grèves de 1969 que nous connaissons :
- "Mi-mai 1969, des ouvriers de l'usine hydro-électrique de Kiev dans le village de Beujozka se rencontrèrent pour discuter du problème du logement. Beaucoup d'entre eux étaient encore logés dans des baraques préfabriquées et des wagons de chemin de fer malgré les promesses des autorités de fournir des logements. Les ouvriers déclarèrent qu'ils ne croyaient plus les autorités locales, et décidèrent d'écrire au Comité central du parti communiste. Après leur meeting, les ouvriers manifestèrent avec des banderoles telles que "tout le pouvoir aux soviets"" (Reddaway,"Uncensored Russia") Le reportage provient d'un journal clandestin oppositionnel "chronique des événements récents".
- Un mouvement de grève éclata à Sverdlovsk contre une chute de 25 % des salaires avec l'introduction de la semaine de 5 jours et de nouvelles normes de salaires. Concentration autour d'une grosse usine de caoutchouc, la grève, selon Schwendtke, prit des formes semi-insurrectionnelles. La milice de guerre civile ("B0M" et "MWD") dut être retirée et les revendications des ouvriers accordées.
- A Krasnovar, Kuban, les ouvriers refusèrent d'aller à l'usine jusqu'à ce que l'approvisionnement en nourriture soit correct dans les magasins.
- A Gorki, les femmes travaillant dans une usine d'armements lourds "quittèrent le travail en déclarant qu'elles allaient acheter de la viande et qu'elles ne reprendraient pas le travail tant qu'elles n'en auraient pas assez acheté" (Holubenko, p.16).
- En 1970, un mouvement de grève éclata dans plusieurs usines à Wladimir.
- En 1971, dans la plus grande usine d'équipements d'URSS, l'usine de Kirov à Kopeyske, la grève se termina par l'arrestation des militants de la grève par le KGB.
''Les plus importants désordres dans cette période eurent lieu à Dniepropetrovsk et Dniprozerzkinsk dans une région d'industrie lourde du sud de l'Ukraine. En septembre 1972, à Dniepropetrovsk, des milliers d'ouvriers partirent en grève, réclamant des salaires plus hauts et une amélioration générale du niveau de vie. Les grèves englobèrent plus d'une usine et furent réprimées au prix de nombreux morts et blessés. Cependant, un mois plus tard, en octobre 1972, des émeutes éclatèrent à nouveau dans la même ville. Les revendications: un meilleur approvisionnement, une amélioration des conditions de vie, le droit de choisir un travail au lieu qu'il soit imposé... Par chance, à cause de l'existence d'un document récent du Samizdat, on a plus d'informations sur les émeutes qui se produisirent à Dnipropetrovsk, ville de 270 000 habitants, à plusieurs kilomètres de Dniepropetrovsk. En particulier, la milice arrêta un petit nombre de gens saouls à un mariage, les emmena dans la voiture de police qui explosa. La foule assemblée marcha en colère sur l'immeuble de la milice centrale de "la ville et le mit à sac, brûlant les fichiers de police et causant d'autres dégâts. La foule marcha ensuite sur le quartier général du Parti où la personne de service ordonna à la foule, avec des menaces, de se disperser, et où deux bataillons de la milice ouvrirent le feu. Il y eut dix morts, dont deux miliciens tués par la foule. L'émeute est un exemple de la tension des rapports sociaux en Union Soviétique -un exemple de comment un petit incident apparemment peut être l'étincelle d'un événement qui dépasse de loin l'importance de l'incident lui-même (Holubenko, la source du Samizdat est Ukrain'ska Slovo) (Le Douban ukrainien a été depuis longtemps un centre de résistance prolétarienne et participa déjà à la vague de grèves de 1956 qui secoua l'Europe de l'Est. La vague de 1956 dans le Douban est mentionné par Holubenko aussi bien que par 1'"Opposition Socialiste tchèque" dans sa publication en Allemagne de l'Ouest "Listy Blàtter", septembre 1976. "Listy" mentionne aussi "des manifestations de masse du prolétariat à Krasnodar, Naltschy, Krivyj Rik" et le soulèvement populaire de Tachkent en 1968).
Pour 1'année 1973, le point final de la deuxième vague de grèves de l'après-guerre en URSS, nous pouvons mentionner les actions importantes suivantes :
- Une grève dans la plus grande usine de Kytebsk, contre une chute de 20 % des salaires. Le KGB essaya sans succès de traquer les "meneurs".
-"En mai 1973, des milliers d'ouvriers de l'usine de construction de machines du Brest-Litovsk Chausee à Kiev partirent en grève à 11 heures en demandant des augmentations de salaires. Le directeur téléphona immédiatement au comité central du PC d'Ukraine. A 15 heures, les ouvriers étaient informés que leurs salaires seraient augmentés et la plupart des grands administrateurs de l'usine furent démis. Il est important de noter que, selon cette information, la population locale attribua le succès de cette grève au fait qu'elle avait un caractère organisé et que le régime avait peur que la grève ne s'étende au "Stettin ukrainien" (Holubenko, source "Sucharnist", Munich).
- Le soulèvement populaire de Karina en Lituanie en 1973 qui déboucha sur des combats de rue et la construction de barricades, et qui fut réprimé de façon sanglante (mentionné par "Listy"). Cette explosion de rage populaire, provoquée par la détérioration de la situation économique et par l'accroissement de la répression policière, eut une lourde résonnance nationaliste. Une révolte similaire eut lieu à Tiflis en Géorgie le 1er mai 1974, qui se développa hors de la manifestation officielle du 1er mai.
- Finalement, au cours de l'hiver 1973, la vague de grève atteignit les métropoles occidentales de Moscou et Leningrad avec des records d'arrêts de travail sur les chantiers de construction qui ont été rapportés.
L'INTERLUDE POLONAIS 1970-76
La réapparition du combat prolétarien dans les années 70 a été internationale dans ses dimensions. Mais elle n'a cependant pas été généralisée. En URSS, les luttes ont été nombreuses et violentes, mais elles sont restées isolées et souvent inorganisées. Elles eurent lieu principalement en dehors des centres industriels de la Russie même. Ceci ne signifie pas que ce ne fut pas de grandes masses d'ouvriers qui s'y trouvèrent engagées. Il y a des concentrations énormes du prolétariat, particulièrement dans des endroits de l'Ukraine et de la Sibérie occidentale. Mais ces ouvriers sont plus isolés les uns des autres ainsi que des principales concentrations industrielles du prolétariat mondial. Plus important encore, ces luttes peuvent être limitées au travers de l'utilisation des mystifications nationale, régionale et linguistique (le "soviet" du prolétariat parle plus de 100 langues) qui présente le combat comme étant contre les "russes". En assurant des approvisionnements plus favorables en denrées alimentaires et en biens de consommation d'un côté, et un formidable déploiement des forces de répression de l'autre, l'Etat a été capable de maintenir son contrôle social à Moscou et à Leningrad, là où le prolétariat a été le plus décimé par la défaite de la vague révolutionnaire des années 20, et par la guerre et la terreur d'Etat qui s'en suivirent, que dans n'importe quel autre endroit du monde. Ce contrôle sur la Russie soviétique est décisif.
Dans les années 70, la Pologne est devenue le principal centre dans le bloc russe, de la reprise mondiale de la lutte de classe.
Le prolétariat en Hongrie et en Allemagne de l'Est était encore sous le coup de la double défaite des années 20 et 50, les ouvriers tchécoslovaques avaient, de plus, à se remettre du coup de la défaite de 1968-69. Ce sont précisément les principaux pays du bloc dans la perspective de l'extension de la révolution mondiale, hautement industrialisés, avec des concentrations significatives d'ouvriers riches en tradition de lutte, proches d'autres cœurs industriels, ceux de l'Europe de l'ouest, dont le plus important, l'Allemagne de l'ouest.
Comme pour la Pologne qui a appartenu autrefois à la "ceinture agricole" avec la Roumanie et la Bulgarie, mais qui entreprit une industrialisation importante après la guerre, son rôle historique consiste à devenir une courroie de transmission révolutionnaire entre le front des pays industrialisés du bloc à l'Ouest, et l'URSS à l'Est. Parce que les ouvriers de l'Europe de l'Est et du centre doivent porter le plus lourd fardeau de la contre-révolution des années 20 aux années 50, la réponse du prolétariat à la réapparition de la crise mondiale ouverte du système capitaliste, y a été PLUS HESITANTE ET INEGALE qu'à l'Ouest. Comme résultat, la courroie de transmission polonaise est apparue bien AVANT l'extension des grèves de masse à l'Est ou à l'Ouest qu'elle pourrait relier les unes aux autres. C'est la véritable base de toutes les illusions sur la Pologne-Exception -ou la notion que la Pologne est le centre du monde- qui continue à attacher les ouvriers aux "solutions" nationales, au capital national polonais, quelle que soit par ailleurs la haine que ceux-ci portent au capitalisme et à son Etat, jusqu'à ce que les grèves de masse explosent ailleurs. Les ouvriers polonais n'étaient pas seuls dans cette période que ce soit au niveau mondial ou à l'Est. Nous avons déjà mentionné la grève-solidarité en URSS avec la révolte polonaise de 1970. Cette explosion était précédée d'une importante grève de mineurs roumains et par la grande vague de grèves en URSS qui avait commencé 18 mois plus tôt. La bourgeoisie de l'ensemble du bloc fut surprise par ce Soulèvement. "Partout les plans quinquennaux étaient corrigés en faveur de 1'approvisionnement en biens de consommation et en nourriture. En Bulgarie, les augmentations de prix qui étaient prévues pour le 1/1/71 furent supprimées, en URSS en mars, on fit grand cas de 1'effondrement de certains prix. En RDA, les événements en Pologne accélérèrent 1'explosion d'une crise politique latente qui fut marquée par le remplacement de Walter Ulbricht par Honecker. Le SED baissa les prix des textiles et autres produits industriels, après qu'il y eut des troubles sur les hausses de prix cachées, et l'augmentation des pensions" (Koenen, Kuhn, "Freiheit, Unabhàugigkeit und Brot").
En novembre 1972, après un gel des prix pendant deux ans en Pologne imposé à Gierek par les ouvriers de Lodz en février 1971 et qui doit se terminer, les dockers de Gdansk et Stettin se mettent en grève, juste au moment où le Congrès des Syndicats réuni à Varsovie devait voir comment se prononcer contre la prolongation du gel des prix. Gierek se rendit à Gdansk pour calmer les ouvriers. En son absence, les ouvriers du textile de Lodz et les mineurs de Katowice partirent en grève. Le président Jaroszewicz dut passer à la télévision pour annoncer la poursuite du blocage des prix (voir Green dans "Die Internationale", n°13, p.26). Les ouvriers défendirent leur niveau de vie sans hésitation. Dans les chantiers navals de la Baltique en 1974, par exemple, une nouvelle norme de productivité provoqua une grève de protestation massive. Des récits d'incidents similaires viennent de beaucoup d'endroits du pays. En mars 1975, il n'y avait plus de viande dans les magasins. Pour empêcher une explosion prolétarienne, les réserves de viande du l'armée furent envoyées rapidement dans les ports de la Baltique et dans les mines de Silésie. Immédiatement, des ouvriers du textile de Lodz se mirent en grève. Il y eut des émeutes de la faim à Varsovie. A Radom, les ouvriers des Cartoucheries imposèrent la libération de 150 femmes qui avaient été arrêtées après une grève (rapporté dans "Der Spiegel, 15 mars 1975).
En juin 1976, une tentative fut faite d'augmenter le prix de la nourriture de 60%. La réaction fut immédiate. A Radom, une manifestation des ouvriers des Cartoucheries appela tous les ouvriers de la ville à sortir. Le Quartier général du parti fut incendié et 7 ouvriers furent tués en combattant sur les barricades. Une vague de répression s'ensuivit : 2 000 ouvriers furent arrêtés. Au même moment, dans l'immense usine de tracteurs d'Ursus près de Varsovie, 15 000 ouvriers lâchèrent les outils et coupèrent les lignes de chemin de fer Paris-Moscou, prenant en otage le train. La police arrêta 600 ouvriers, et mille autres furent renvoyés immédiatement. A Plock, les ouvriers marchèrent sur le siège du parti, en chantant l'Inter nationale, et sur les casernes pour fraterniser avec les soldats. Là encore, 100 ouvriers furent arrêtés. Cet usage de la répression massive dans des centres industriels secondaires n'a pas pu arrêter le mouvement, parce que les dockers de la Baltique, les ouvriers de l'automobile de Varsovie, les ouvriers de Lodz, Poznan, etc., débrayèrent. Il semble que ce fut qu'une question d'heures qu'ils ne soient rejoints par les mineurs de Silésie. Gierek fut contraint d'annuler immédiatement les hausses de prix. Mais cette concession fut suivie d'une vague d'arrestations massives, de tortures, d'atrocités policières Les augmentations de prix furent faites plus lentement, moins ouvertement, mais sûrement. Face à cette contre-attaque féroce de la bourgeoisie, et du fait que le niveau de vie se détériorait encore malgré les grèves même les plus résolues, le prolétariat en Pologne entra dans une période de repli et de réflexion.
La période de 1976-80 a été un calme relatif sur le front des grèves en Pologne. Pour ceux qui ne voient que la surface des événements, ça a pu paraître une période de défaite. Mais l'approfondissement de la lutte de classe internationalement, la maturation lente mais sûre de la seconde vague mondiale de résistance prolétarienne depuis 1968, qui a déjà dans cette période de 1976-81 atteint un niveau qualitativement supérieur, va révéler le mûrissement des conditions d'une future VAGUE REVOLUTIONNAIRE qui court sous la surface.
Krespel
Géographique:
- Europe [13]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [14]
Heritage de la Gauche Communiste:
Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire
- 3125 reads
Depuis quelques mois, le milieu révolutionnaire vit une série de convulsions politiques, Certaines organisations disparaissent ou se disloquent:
- le PIC (Pour l'Intervention Communiste -France-) vient de se dissoudre; seule une fraction de celle-ci, le "Groupe Volonté Communiste", continue une existence politique (cf. RI mensuel n° 88)
- le FOR-Alarma (Ferment Ouvrier Révolutionnaire) a dissous sa section en Espagne et se sépare de ses camarades aux USA.
D'autres vivent des départs importants de militants :
- le PCI (Programme communiste) vient d'exclure les sections du sud de la France et des sections en Italie dont celle de Turin ;
- au CCI également il y a eu des départs et des exclusions de militants. Il y a encore d'autres groupes qui subissent un recul politique profond :
- le NCI (Nuclei -Italie- à l'origine une scission du PCI et donc du milieu révolutionnaire) vient de publier un projet d'unification politique avec le groupe crypto-trotskyste, "Combat Communiste" en France ou des déboussolements momentané :
- le CWO (Communist Workers'Organisation -Grande Bretagne- après avoir défendu contre vents et marées la nécessité d'une "insurrection" en Pologne, fait une volte-face dans son appréciation de la situation. (dans le n°4 de Workers'Voice le CWO appelait à la "Révolution tout de suite" en Pologne. Dans le numéro suivant le CWO critique honnêtement son erreur d'analyse qu'il considère maintenant "un appel aventuriste" Le CWO est un des rares groupes dans le milieu révolutionnaire capable de corriger ouvertement et publiquement ses erreurs).
Pourquoi tous ces bouleversements? Pourquoi l'infime minorité de la classe ouvrière qui constitue son milieu politique se réduit-il encore davantage et que faut-il en conclure? Pourquoi ces échecs et désorientations politiques?
C'est d'autant plus difficile de répondre à ces questions que le "milieu politique révolutionnaire" n'est qu'une juxtaposition de groupes politiques, chacun gardant jalousement ses secrets, ses crises et sa vie dans le silence, en pensant qu'il suffirait de jubiler sur les problèmes des autres pour être à la hauteur de la situation générale. Le milieu politique avec ses divergences politiques et ses différentes organisations n'a pas de cadre pour débattre ses problèmes, pour confronter et clarifier les positions politiques s'il ne s'assume ni par rapport à lui-même ni face à la classe.
Il est donc difficile de dire avec certitude quelles sont les raisons politiques précises qui ont provoqué ces convulsions. Mais il faut tout de même tenter de faire un premier bilan de la situation actuelle, quitte à le développer ou le corriger ensuite. Fous pensons que le milieu politique révolutionnaire actuel :
- paie le prix des immaturités politiques et organisationnelles qui existent depuis longtemps dans le milieu ravagé par le sectarisme.
- subit des convulsions politiques dues à une inadéquation de ses positions politiques et de sa pratique face à la nouvelle situation ouverte par la grève de masse en Pologne.
Les problèmes du CCI s'inscrivent, comme ceux des autres groupes, dans ce contexte : comment contribuer à la prise de conscience de la classe ouvrière dans ces "années de vérité".
L'ECHEC DES CONFERENCES INTERNATIONALES
Les immaturités politiques du milieu qui se paient aujourd'hui et qui se paieront encore demain, se sont déjà clairement révélées dans l'échec des Conférences Internationales de 1977 à 1980, l'échec d'un milieu politique tel qu'il est sorti de la première vague de la lutte de classe en 1968, tel qu'il a subi le reflux des années 70.
Le cycle des Conférences Internationales proposé par Battaglia Comunista et appuyé à fond par le CCI ([1] [16]) marquait la première tentative sérieuse depuis 1968 de briser l'isolement des groupes révolutionnaires.
Depuis le début des Conférences, le PCI (Programme Communiste), dans son isolement dédaigneux, a refusé toute participation, convaincu que le Parti historique formel, indivisible et invariant, existe déjà dans son propre programme et organisation. Croyant vivre seul au monde, le PCI refusait de prendre sa place dans une discussion politique internationale, préférant attribuer aux autres sa propre vision des Conférences : c'est à dire un lieu pour "la pêche à la ligne", du recrutement qui soi-disant ne l'intéressait pas.
Le FOR, après avoir donné son accord de principe à la 1ère Conférence et être venu à la 1ère séance de la 2ème Conférence, s'est retiré dans un coup de théâtre qui cachait mal son incapacité de défendre ses positions, surtout celle qui nie la signification de la crise économique du système en faveur d'une vague théorie d'une "crise de civilisation''.
Le PIC, après avoir communiqué son accord par correspondance, a brusquement changé d'avis. Il a refusé de participer à la discussion en la stigmatisant d'avance comme "dialogue de sourds"...Mais c'est le PIC qui était sourd et le résultat, c'est qu'il ne risque pas d'entendre, puisqu'aujourd'hui il est mort.
Mais le sectarisme ne s'arrêtait pas aux portes de la Conférence; l'esprit de chapelle et le refus d'assumer une discussion jusqu'au bout entravaient tous les travaux de la Conférence.
Il est vrai que les Conférences ont aidé à démanteler le mur de suspicions et de malentendus qui existaient entre les groupes. Elles ont débattu des questions essentielles pour le milieu révolutionnaire : où en est la crise du capitalisme; quelle est l'évolution de la lutte de classe et le rôle des syndicats; le nationalisme et la "libération nationale" ; le rôle des organisations révolutionnaires. Ces débats ont été publiés dans des brochures et diffusés publiquement en trois langues. Dans ce sens, les Conférences constituent un acquis important pour l'avenir.
Mais elles n'ont jamais réellement compris pourquoi elles existaient, ni la gravité de l'enjeu. La sclérose politique, la peur d'aller jusqu'au bout dans la confrontation des analyses et des positions politiques ont fait des débats plus des "matchs" entre groupes "rivaux" qu'une recherche réelle de compréhension et de confrontation fructueuses. Les Conférences, en tant que telles, ont toujours refusé de se prononcer sur des résumés de débats définissant de façon claire les points d'accord et de désaccord pour cerner les divergences. Plus grave encore : sous prétexte que les organisations révolutionnaires n'étaient pas d'accord sur tout, Battaglia Comunista, le CWO et l'Eveil ont refusé d'affirmer en commun avec le CCI et le NCI les principes révolutionnaires de base contre le danger de guerre impérialiste dans le monde actuel! La Conférence est restée "muette" par rapport à ses responsabilités politiques, face à la classe ouvrière. L'idée qu'un groupe révolutionnaire est issu de la classe ouvrière et doit rendre des comptes historiques de sa fonction, qu'il n'est pas un cercle qui peut se permettre de bavarder ou faire la girouette, cette idée n'a pas encore même aujourd'hui pénétré l'esprit de tout le milieu politique,
A la 3ème Conférence, voulant faire une sélection politique a priori, B.C. et le CWO proposaient comme nouveau critère pour la participation aux prochaines Conférences une résolution sur le Parti de classe qui le mettrait, disait-il, à l'abri des "spontanéistes du CCI". Sans discussion réelle, le CCI s'est trouvé ainsi exclu d'emblée des Conférences à venir par une manœuvre sordide.
Des groupes parlaient beaucoup à l'époque du besoin d'une "sélection stricte" parmi les groupes révolutionnaires. Ils voulaient déjà limiter la discussion sur le Parti et sur d'autres questions pour ne pas avoir à confronter les "trouble-fêtes" du CCI. 'Au lieu d'encourager la poursuite d'une confrontation de positions politiques, cette "sélection" par manœuvre qui a préféré attribuer au CCI des positions fantaisistes issues de leur propre imagination que d'entendre celles que le CCI défendait réellement sur le Parti, a étouffé les débats et les Conférences ; il n'y a jamais eu depuis d'autres Conférences. Croyant pouvoir précipiter un "regroupement" prématuré, -séduit par des flirts de B.C.- le milieu politique est passé à côté de la possibilité de créer un cadre responsable pour la discussion politique internationale indispensable.
"La sélection, c'est la pratique de la classe qui 1a fait et non quelques conciliabules entre organisations. C’est pourquoi il ne faut pas surestimer la capacité "de auto-sélection". La vraie sélection, on en parlera en temps voulu".([2] [17])
Et c'est en effet la réalité objective d'aujourd'hui qui se charge d'une décantation dans le milieu politique. Mais nous n'avons plus de cadre organisé pour débattre les difficultés actuelles ; nous n'avons que des convulsions violentes qui se déroulent surtout dans la confusion et la dispersion.
LES ANNEES DE VERITE
Les Conférences Internationales se sont disloquées en mai 1980, trois mois avant l'éclatement de la grève de masse en Pologne.
Cette grève de masse est le signe le plus significatif de la montée internationale d'une nouvelle vague de la lutte de classe. Elle marque le début d'une phase décisive au cours de laquelle commenceront des affrontements de classe d'une envergure sans précédent et qui, à terme, décideront du sort de l'humanité : guerre capitaliste ou révolution prolétarienne.
C'est la réalité de cette nouvelle période qui jette un défi aux groupes révolutionnaires dispersés : sont-ils suffisamment armés politiquement pour comprendre et faire face à la nouvelle situation?
Pour comprendre les exigences nouvelles il faut saisir l'essentiel de l'accélération du processus historique depuis deux ans :
- L'accentuation grave de la crise économique qui atteint tous les pays du globe y inclus et d'une façon brutale les pays de l'Est mais aussi les géants du bloc occidental : l'Allemagne et le Japon. Aujourd'hui la crise, le chômage, ne parviennent plus à se limiter aux catégories particulières de la société mais touchent au noyau central de la classe ouvrière occidentale; le rationnement et la pénurie à l'Est annoncent l'avenir que la société réserve aux ouvriers partout dans le monde.
- L'effort de repousser la crise vers les pays périphériques ,1e "Tiers-Monde", n'amortit plus le choc économique pour les grandes puissances ; quant aux pays sous-développés il n'amène qu'un génocide sans espoir, chaque jour plus difficile à cacher.
- L'aggravation des conflits inter-impérialistes et surtout des tensions entre les deux blocs. La crise contient déjà les prémisses de la guerre, et son déroulement actuel se double d'une préparation accélérée à la guerre. Le danger de guerre existe parce que le capitalisme existe toujours, mais aujourd'hui le chemin vers la guerre généralisée est barré par la combativité du prolétariat.
- L'accentuation des effets de la crise a provoqué le début d'une nouvelle montée des luttes de classe internationale ; la grève de masse en Pologne en août 1980 annonce les affrontements de classe décisifs des années à venir. Tous les éléments de la situation actuelle convergent dans les leçons de la Pologne et la nécessité de l’internationalisation des luttes ouvrières.
- La bourgeoisie à l'échelle internationale reconnaît le danger mortel pour son système contenu dans la combativité ouvrière. Par-dessus les frontières nationales et même celles du bloc, la classe capitaliste collabore pour faire face au danger de la grève de masse. Dans les affrontements décisifs de cette période le prolétariat n'aura pas devant lui une bourgeoisie surprise et déconcertée comme dans la période de la 1ère vague de 1968 ; il affrontera une bourgeoisie avertie, préparée à utiliser au maximum ses capacités de mystification, de dévoiement et de répression.
- La stratégie bourgeoise contre le prolétariat s'appuie essentiellement sur la Gauche et atteint le maximum de son efficacité quand la Gauche est en "opposition" aux partis gouvernementaux cachant ainsi la convergence de tous les partis bourgeois et syndicats englobés dans le capitalisme d'Etat, l'Etat totalitaire de la décadence du système. Le clivage principal de la société, entre la bourgeoisie sénile réfugiée et transmutée dans l'Etat capitaliste hypertrophié et la classe ouvrière, est ainsi caché par la façade du "jeu démocratique" destiné à travers les syndicats et les campagnes idéologiques de la Gauche à désarmer la résistance de la classe ouvrière pour que la répression puisse s'abattre le moment venu. La clé du cours de l'histoire se joue dans la capacité de la classe ouvrière à résister à l'embrigadement derrière la Gauche.
Ces grands traits de la situation actuelle, le prolétariat des principaux centres industriels ne les saisit que partiellement pour le moment. Mais le mûrissement de la conscience de classe face à l'aggravation de la situation objective qui s'est manifesté dans la grève de masse en Pologne n'est pas un phénomène "polonais", mais l'annonce de tout un processus pénible, long et tortueux à l'échelle internationale qui ne se voit pas toujours à la surface jusqu'au jour du débordement. C'est l'annonce d'un processus d'unification de la classe par dessus les barrières capitalistes et ses frontières nationales.
Mais pour les minorités révolutionnaires, celles qui doivent contribuer au processus de prise de conscience de leur classe, les années de vérité posent un défi immédiatement plus tangible dans la mesure où les organisations révolutionnaires opèrent au niveau conscient ou pas du tout. Seront-elles le simple reflet des hésitations et confusions de la classe ouvrière, le reflet de 1'éparpillement du passé ou seront-elles à la hauteur de la grève de masse pour y devenir un facteur actif dans le processus historique? L'histoire ne pardonne pas et si les organisations révolutionnaires d'aujourd'hui ne sont pas capables de répondre aux exigences de l'évolution de la situation, elles seront balayées sans recours.
LES EXIGENCES DE LA PERIODE ACTUELLE
Il est inévitable que les exigences de cette nouvelle période d'accélération des événements secouent un milieu politique composé essentiellement des groupes constitués pendant les années de reflux et sur la lancée de ce qui restait de -1968. Mais 1968 et la première vague des luttes ouvrières contre la crise n'ont pas laissé suffisamment d'acquis en profondeur pour assurer une stabilité politique aujourd’hui. Par ailleurs, les groupes comme le PCI ou B.C. qui viennent directement des fractions politiques constituées dans la période de contre-révolution d'avant 1968, s'ils assurent une stabilité politique à un certain niveau important, sont atteints d'un processus de sclérose des positions politiques et de la vie de l'organisation qui les expose autant que les autres aux bouleversements de la période actuelle.
De plus, et de façon générale, la pression de la terreur de l'Etat bourgeois s'accroit et détermine en elle-même une décantation en nos rangs de ceux qui n'ont pas encore compris l'enjeu de l'engagement politique.
Nous pouvons très globalement définir les exigences de cette époque de la façon suivante :
- la nécessité d'un cadre programmatique cohérent, synthétisant les acquis du marxisme à la lumière d'une critique principielle des positions de la 3ème Internationale.
- la capacité d'appliquer ce cadre à une analyse de la situation actuelle des rapports de force entre les classes,
- une compréhension de la question de l'organisation des révolutionnaires comme une question politique à part entière, la nécessité de créer un cadre international et centralisé pour cette organisation, de définir clairement son rôle et sa pratique dans le processus d'unification de la classe ouvrière vers le regroupement des révolutionnaires.
En examinant la trajectoire actuelle de certains groupes politiques y inclus le CCI, nous verrons que ces trois aspects sont liés mais demandent tout de même une attention particulière pour chacun.
1) En ce qui concerne le cadre programmatique des principes de l'histoire du mouvement ouvrier, ne pas se baser sur les acquis du marxisme, c'est se condamner à l'échec sans recours. Des groupes comme le PIC qui dans sa phase finale jetait par-dessus bord les acquis de la 1ère, 2ème et 3ème Internationale en les considérant toutes dégénérées et contre-révolutionnaires, quittent le terrain historique du marxisme pour aller tout droit à la disparition pure et simple. Sans la dimension historique et réelle du marxisme, tout soi-disant "principe" devient une pure abstraction.
Mais il est aussi vrai que nous ne pouvons pas réduire le marxisme à une bible à laquelle on s'accrocherait à la lettre. C'est aussi la voie de la facilité bien que, dans une certaine mesure, moins immédiatement catastrophique pour un groupe. Encore faut-il dire que l'idéologie bourgeoise utilise toujours les erreurs du mouvement ouvrier du passé comme véhicule pour une pénétration en milieu ouvrier et sa trahison.
Un cadre programmatique adéquat aujourd'hui implique forcément un réexamen critique des erreurs de la 3ème Internationale. Les continuateurs directs de la Gauche italienne aujourd'hui se sont arrêtés à mi-chemin du bilan critique des positions de TIC. C'est pour cela qu'un groupe issu de la Gauche italienne et qui s'en revendique, le NCI, peut aujourd'hui penser s'unir à une variante du trotskysme : sur la question syndicale, sur la "libération nationale" et même sur le parlementarisme. Il n'y avait qu'un pas à franchir pour trouver un terrain "d'entente" avec le trotskysme. Ce que le NCI fait dans la réalité reste un danger implicite -le glissement vers le gauchisme- pour tous ceux qui se réclament "intégralement" des positions du 2ème Congrès de l'IC après 60 ans d'expérience syndicale, nationale et parlementaire. Nous l'avons vu avec les "groupes syndicaux" et le "Front unique à la base" de B.C. et les scissions qui ont suivi en 1980. Nous voyons ce danger aujourd'hui dans le PCI (Programme) avec sa "tactique" de Front contre la répression qui semble être un des éléments qui a provoqué la scission récente.
De plus, l'aveuglement de la plupart de ces groupes par rapport aux contributions positives de la Gauche allemande des années 1917-21 les laisse sans cadre pour comprendre réellement la grève de masse en Pologne et sa signification politique. (Pour une analyse de la grève de masse aujourd'hui, voir la Rint n°27 "Notes sur la grève de masse, hier et aujourd’hui")
La grève de masse en Pologne soulève concrètement pour la première fois depuis 1917,1a question du rôle des Conseils ouvriers ce que mai 68 en France n'a posé que confusément en paroles à travers les "comités d'action" où se mélangeaient la contestation étudiante et le début d'un réveil du prolétariat. Pour ceux de la Gauche italienne, ou ceux qui subissent son influence comme le CWO, le schéma d'une classe ouvrière et ses conseils comme simple masse de manœuvre pour le Parti qui, lui, prendrait le pouvoir, colle de moins en moins à la réalité de notre époque parce que c'est une erreur théorique pour laquelle la classe ouvrière a déjà payé très cher. (Pour les implications de la Pologne au niveau de la question du Parti, voir la Rint n°24 "A la lumière des événements en Pologne, le rôle des révolutionnaires"). De plus, pour le PCI (Programme) par exemple, les syndicats, les comités de grève, les conseils ouvriers sont tous au même niveau des manifestations de "1'associationnisme ouvrier" à subordonner au Parti ; de cette façon non seulement ce groupe ne saisit pas la dynamique même de la grève de masse mais les événements de la Pologne révèlent leur ambiguïté de principes sur la question syndicale. Les confusions sur le rôle des syndicats aujourd'hui et les illusions sur un travail "syndical" soi-disant "à la base" ou "radical" aboutissent à faire le jeu de Solidarnosc et, qu'on le veuille ou non,. contribuent à enchainer le prolétariat à l'Etat.
L'éclatement de la grève de masse a mis en évidence les insuffisances programmatiques de beaucoup d'organisations. Des groupes n'ayant pas un cadre théorique leur permettant de reconnaitre une grève de masse quand ils en voient une, n'ayant pas un cadre d'analyse qui leur permet de comprendre la période actuelle et de pouvoir réagir rapidement aux surgissements brusques de la classe ouvrière, tombent facilement dans des prises de positions superficielles et erronées. Quand on ne comprend pas que la prise de conscience du prolétariat est un processus, on devient facilement blasé sur les efforts des ouvriers, en ne voyant que les faiblesses, en ignorant les enseignements positifs et les potentialités. De plus, les tendances activistes des groupes les poussent à une vision localise : ce qui se passe "chez soi" semble avoir plus d'importance que des grèves "lointaines" en Pologne dans lesquelles il est difficile d'avoir une présence "physique" (locale) directe. Ainsi la signification politique la plus importante de la Pologne n'a pas été comprise la nécessité pour les organisations politiques de généraliser les leçons de la Pologne au prolétariat international.
Si dans un premier temps, des groupes ont eu tendance à sous-estimer l'importance historique de cette expérience, certains sont ensuite tombés dans l'excès contraire : ils appelaient à une "insurrection" dans la seule Pologne. Ce genre d'appel, de toute façon aventuriste dans le contexte actuel soulève une question de fond sur le mûrissement des conditions de la révolution. Nous avons commencé une discussion sur 1' internationalisation dans la Rint n°26 "Les conditions historiques de la généralisation de la lutte de la classe ouvrière", sans beaucoup d'écho dans le milieu.
Les incompréhensions et faiblesses politiques ont toujours des répercussions au niveau de la vie organisationnelle des groupes. Le PIC par exemple a sérieusement sous-estimé l'envergure de la grève de masse. Deux exemples. A la suite des événements d'août 1980 le PIC n'avait d'yeux que pour les "curés" et le syndicalisme. Cette prise de position erronée a donné lieu à une discussion au sein du groupe qui aboutissait à une rectification de sa position dans sa revue la 'Jeune Taupe'! Mais des divergences ont sans doute subsisté se rapportant au niveau d'une discussion sur le rôle des organisations révolutionnaires. Trois idées sur l'organisation sont sorties de ce débat donnant lieu à trois tendances, les trois, plus floues les unes que les autres. Ceux qui défendaient l'idée la moins floue sont partis pour former "Volonté Communiste" à Paris laissant ainsi le PIC se dissoudre. En effet c'était l'aboutissement logique quand on ne sait pas pourquoi on existe.
Le FOR de son côté est aussi passé à côté de la signification profonde de la Pologne. Ce groupe, qui n'a jamais fait d'analyse des conditions objectives menant à une prise de conscience révolutionnaire, croit que la révolution est "toujours possible", et n'est qu'une question de "volonté". C'est pour cela qu'il a pu écrire : "Le mouvement (en Pologne) montre plus d'insuffisances du point de vue révolutionnaire que d'aspects positifs" (Alarme fin 80) et en même temps il appelait à la formation des conseils ouvriers et à la révolution communiste. C'est comme son tract enflammé à l'époque de la grève Longwy-Denain en France qui appelait à la prise du pouvoir! Une divergence sur l'appréciation des événements en Pologne semble être une des raisons du départ (ou exclusion?) des camarades du FOR (groupe Focus) aux USA.
C'est tout de même grave que des organisations politiques de la classe ouvrière puissent se tromper si lourdement face à des événements d'une telle portée historique. De plus, des appels aventuristes peuvent, dans un contexte de demain, avoir des répercussions d'une gravité désastreuse. Si le milieu politique actuel n'arrive pas à être à la hauteur de sa tâche au niveau des principes il sera voué à la décomposition.
2) Au niveau de la concrétisation des principes pour dégager des analyses et des orientations politiques ponctuelles," l'accélération des événements a aussi inévitablement posé des problèmes aux groupes. Le PIC avec sa théorie de "l'effritement des blocs" (tandis qu'en réalité les deux grands blocs s'affrontent de plus en plus nettement) s'est perdu à ce niveau parce qu'il ne savait pas distinguer entre les intérêts économiques particuliers de certains pays (le Japon et 1'Allemagne) et le besoin militaire, stratégique et économique beaucoup plus puissant et global qui pousse à l'intégration dans un bloc au risque de périr. La nature profonde du capitalisme d'Etat et la tendance totalitaire de la bourgeoisie en décadence échappaient au PIC comme d'ailleurs au FOR.
BC voyait la contre-révolution jusqu'en 1980 mais prévoyait la "social-démocratisation des partis staliniens"(en prenant pour argent comptant "1'Eurocommunisme") tandis qu'en réalité le jeu de 1'"opposition" les pousse vers le contraire. Le CCI avait du mal à concrétiser les aspects de la nouvelle période dans l'analyse de la gauche dans l'opposition et s'est livré à des pronostics électoraux locaux qui se sont avérés erronés clans la réalité. Aujourd'hui nous voyons plus clairement comment approfondir ce cadre d'analyse mais cet effort a causé des secousses dans l'organisation.
C'est inévitable que la situation actuelle où l'on voit un surgissement lent et douloureux de la conscience de classe en réponse à une CRISE ECONOMIQUE DU SYSTEME, déroute un peu les organisations révolutionnaires. Dans l'histoire de 1871, de 1905 et de 1917 c'était la guerre impérialiste qui a directement et brusquement fait surgir l'insurrection. Pour tous les groupes (surtout ceux comme le PCI qui refusent de voir la révolution venant d'autre chose qu'une guerre même aujourd'hui) cette situation pose de nouvelles questions qui n'ont pas de parallèle directe avec les luttes ouvrières face aux crises~~cycliques du capitalisme ascendant. La capacité de s'orienter clairement dans la pratique dépend surtout de la solidité et du bien-fondé des principes. C'est la clarté théorique et programmatique qui seule peut nous orienter tous et qui décidera de notre sort en tant que groupes politiques.
Ce qu'il ne faut pas faire dans cette période de montée des luttes, c'est se paniquer de ne pas rencontre^ un écho immédiat dans la classe et glisser à travers des tendances activistes vers le gauchisme. On a vu où cela mène le NCI. On a vu l'activisme du PIC se résoudre dans le néant. On croit voir ceux qui prônent la tactique du "front anti répression" exclure les non-convaincus du PCI ; nous voyons le contraire dans le CCI : ce sont entre autres, les tendances activistes et gauchistes qui nous quittent. On a vu aussi l'impatience de "l'insurrection", on a vu miroiter des projets pour des "comités ouvriers" dans les usines à tout bout de champ - mais on n'a rien vu encore. La lutte de classe risque de nous secouer encore plus durement si nous ne savons pas développer notre intervention SANS TOMBER DANS L'ACTIVISME. Et surtout si la question principielle du rôle de l'organisation des révolutionnaires n'est pas claire.
3) La question d'organisation est généralement celle qui cristallise toutes les autres dans un moment de bouleversement. Des aspects à souligner ici se résument essentiellement à la nécessité de répondre aux exigences de l'époque actuelle par un cadre organisationnel international. Seule une organisation internationale peut faire face aux besoins du prolétariat et son unification comme classe à travers l'internationalisation des luttes. La dislocation de l'effort international du FOR montre ce que nous disons depuis longtemps : ce n'est pas si facile de créer une organisation internationale dans laquelle existe une vie politique intense mais unie. On ne l'improvise pas et surtout pas sans une vision cohérente de l'activité et d'analyse révolutionnaires. Le CCI a aussi subi une crise récemment qui tournait essentiellement autour de la question : centralisme ou fédéralisme ; l'unité de l'organisation ou agitation individuelle. Ces difficultés nous amènent à réexaminer profondément si toute notre organisation a bien assimilé les principes de la centralisation et nos statuts du fonctionnement. Nous allons développer ce point plus loin.
Les scissions, 1'éparpillement des organisations révolutionnaires vont évidemment à rencontre de la tendance générale de cette période historique de montée des luttes : La tendance vers l'unification de la classe et de ses expressions politiques. ([3] [18]) Nous avons toujours dit que l'attitude du PIC qui avait scissionné du CCI pour une histoire d'un tract sur les événements au Chili (tract que d'ailleurs le CCI a sorti quatre jours après) était un acte irresponsable. On ne rentre et on ne sort pas d'un groupe politique comme d'un magasin. Il est possible et même probable que des actes irresponsables de ce genre cachent des divergences de fond mais ce comportement interdit la discussion : on ne sait pas quels sont alors réellement les points de désaccords, ni si leur gravité exigerait un départ. En agissant ainsi on n'aide en rien le développement du milieu politique.
De la même façon, plusieurs groupes ayant abouti à la même plateforme de base du CCI (dont le CWO et l'ancien Workers Voice) refusaient en 1975 de s'associer à la formation du CCI, une attitude que nous avons également considérée irresponsable. Un groupe se définit par sa plateforme ; on ne fait que discréditer l'idée même du rôle des révolutionnaires en maintenant une existence séparée pour des raisons secondaires ou localistes. Par la suite les groupes de cette époque, dans la mesure où ils ont survécu, ont trouvé bien des "raisons" et de nouvelles positions pour justifier une vie séparée sans réellement vouloir confronter le problème du sectarisme.
Mais si nous pensons que le processus d'unification doit s'entamer à la lumière de la lutte de classe, nous ne considérons pas la décantation actuelle comme une chose entièrement négative. Nous ne regrettons pas qu'un groupe confus comme le PIC disparaisse et élimine ainsi un écran de fumée des yeux de la classe ouvrière. Nous ne regrettons pas non plus que des éléments qui virent vers le gauchisme ou la démoralisation nous lâchent la main.
Si le milieu politique doit payer ses immaturités, que cela se fasse le plus complètement possible. On s'est souvent demandé comment allait se forger l'unité de demain :par un processus graduel d'élargissement du milieu des années 70 ? Maintenant nous avons en partie la réponse : ce ne sera pas à travers un élargissement progressif mais à travers des convulsions, des heurts, des crises qui balaieront les débris qui ne servent pas à l'avenir, à travers des épreuves pour tester la validité politique et organisationnelle du cadre existant. Le vent de la destruction n'a pas fini de souffler mais quand la lutte de classe aura éprouvé ce milieu d'aujourd'hui il y aura alors des bases plus claires pour un nouveau point de départ.
LES DEBATS DANS LE CCI nos activités et de nos réflexions.
Les exigences de la nouvelle période ont aussi provoqué un certain bouleversement dans le CCI. L'origine de ces difficultés se trouve, comme toujours, dans des faiblesses au niveau politique et organisationnel.
Au 3ème Congrès du CCI en 1979 nous avons décidé de répondre à l'ouverture de la nouvelle période de montée des luttes ouvrières par une accélération et un élargissement de notre intervention. Cette orientation était juste et nécessaire, mais elle était souvent mal interprétée au sein de l'organisation.
L'intervention du CCI dans la grève des dockers à Rotterdam, à Longwy-Denain ([4] [19]) ou à la Sonacotra en France, dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne par exemple, révélait certaines: incompréhensions politiques. Est-ce qu'une organisation révolutionnaire intervient au niveau des collectes d'argent, principalement en tant que "porteurs d'eau" aux ouvriers en lutte ou est ce qu'elle doit intervenir au niveau politique dans les assemblées générales? Que dire quand les ouvriers sont embrigadés dans des "comités de grève" syndicaux destinés à étouffer la lutte.
Il est normal que de telles questions et bien d'autres surgissent quand une organisation commence à être "testée" par la lutte. Nous avons répondu au niveau global par une étude approfondie des conditions générales de la lutte ouvrière dans la période de décadence en insistant sur les différences entre aujourd'hui et le l9ème siècle et sur l'impossibilité et le danger d'employer les mêmes tactiques du passé sans réexamen profond et critique. (Voir la Revue Internationale n°23 "La lutte du prolétariat dans la décadence du capitalisme"). Mais nous avons eu du mal à concrétiser cette appréciation synthétique et l'organisation a eu tendance à rester à la surface de la discussion, ce qui ne permettait pas une réelle assimilation de ces nouvelles données.
De plus, nous avons eu à réagir contre une tendance à glisser sur les principes surtout dans la grève de la sidérurgie en Grande-Bretagne. Bien que l'organisation en tant que telle se soit prononcée clairement sur la nature syndicale de ces "comités de grève" qui étouffaient l'énorme combativité ouvrière, certains camarades par activisme ou par démoralisation commençaient à mettre en question la base même de notre position sur les syndicats aujourd’hui, en voulant voir dans les émanations syndicales une forme "hybride" permettant "un pas en avant". Cette discussion rejoignait celle sur les dangers du "syndicalisme de base" ou "radical", sur le danger d'un glissement vers le gauchisme et des pratiques gauchistes.
De façon générale l'élargissement de notre intervention était trop souvent compris comme un feu vert aux tendances immédiatistes ou localistes au détriment d'une intervention politique à long terme, au détriment de notre unité internationale. On avait tendance à surestimer les possibilités d'un écho immédiat dans la classe, â surestimer des luttes qui n'étaient que des préludes aux affrontements plus décisifs. La fixation d'une partie de l'organisation sur la grève de l'acier en G.B. a failli les aveugler aux événements de la Pologne. Mais en fait, c'était la grève de masse en Pologne qui nous a aidés à rectifier le tir à ce niveau de
Le CCI, qui s'est formé pendant la période de reflux momentané en 1975 a trop souvent pensé que lorsqu'une montée de luttes commencerait de nouveau, tous nos problèmes allaient s'évanouir dans l'enthousiasme général. Maintenant on comprend que ce n'est pas le cas et que c'est une vision bien infantile de l'épreuve de l'histoire. Si au niveau de nos analyses de la lutte de classe nous avons pu arriver assez rapidement à clarifier le débat, l'organisation avait tendance à vouloir voir seulement du côté du prolétariat et non pas un rapport de force entre les classes. Bien que nous avons développé le débat sur le Cours historique au niveau théorique, au niveau quotidien immédiat il y avait une résistance à analyser la réponse de la bourgeoisie comme un tout, sa stratégie globale contre la lutte ouvrière. Des camarades croyaient qu'on allait se transformer en "chercheurs bourgeois" à force de tant discuter sur la stratégie de la bourgeoisie! On avait du mal à saisir le fait qu'il est de la plus grande importance de comprendre le jeu de son ennemi de classe.
Au début de la période de montée des luttes en 1978-79 nous avons écrit sur les "années de vérité sur le potentiel de la situation qui allait s'ouvrir et l'effort de l'Etat bourgeois de se protéger en utilisant à fond le syndicalisme de base et la "gauche dans l'opposition". Quand on commence à énoncer une nouvelle analyse, elle apparait forcément limitée à des grandes lignes, donnant l'impression d'un schématisme. Par exemple, notre courant politique en parlant de la crise du capitalisme en 1967-68 a passé pour "fou" du fait que superficiellement il y avait beaucoup de données qui semblaient contredire cette thèse. Pourtant, elle était juste. De la même façon, l'analyse de la période actuelle et de la "gauche dans l'opposition" nécessitait un approfondissement surtout qu'apparemment et "formellement" il semblait que nous nous soyons trompés en voulant l'appliquer à des pronostics électoraux locaux à un niveau trop ponctuel sans tenir compte des dérapages toujours possibles. Néanmoins nous continuons la recherche et la rectification dans le cadre général « qui reste pour nous toujours fondamental. Il y avait cependant des camardes qui, à la suite des élections en France ont voulu abandonner toute référence à un cadre, jetant l'enfant avec l'eau sale. Nous avons ouvert ce débat publiquement. dans notre presse (cf. la revue n°26; RI n°87; World Révolution août 1981) et nous le continuerons s'il le faut. Nous publierons dans un prochain numéro une étude, fruit de notre discussion interne, sur la bourgeoisie en période de décadence, liée au développement du capitalisme d'Etat. Pour nous, ce n'est pas l'existence de divergences qui représente la faiblesse la plus dangereuse en notre sein mais des réactions impulsives quand on oublie la nécessité des analyses cohérentes ou quand on nie tout besoin de cadre théorique. C'est se résigner à un déboussolement total. Sur le fond et dans ce cadre nous continuerons la discussion sur la gauche dans l'opposition et ses implications.
Sans vouloir se laisser aller à une autosatisfaction dangereuse, il faut dire que malgré des faiblesses politiques conjoncturelles, le CCI dispose d'un cadre de principes cohérents qui lui a permis de répondre aux événements et de continuer son travail en rectifiant s'il le faut ses erreurs. Contrairement aux groupes politiques qui ne sont pas armés pour faire face à la période actuelle et à venir, le CCI, s'il reste dans la rigueur de l'application de sa méthode et de ses principes, est capable de tenir le coup et de contribuer beaucoup au combat du prolétariat C'est là toute la différence entre une appréciation conjoncturelle erronée sur des élections en France et une incapacité de comprendre une grève de masse ou le Cours historique.
LES DIFFICULTES ORGANISATIONNELLES
Comme nous l'avons dit, des faiblesses politiques traduisent au niveau organisationnel, en l’occurrence pour le CCI, un manque de rigueur dans les analyses immédiates, conjoncturelles et les activités qui ont donné lieu à toute une série de discussions sur le fonctionnement interne :
- Sommes-nous des "individus" face à la classe ouvrière (le mythe du révolutionnaire "franc-tireur") ou est-ce-que la classe ouvrière secrète des organisations politiques qui assument une responsabilité collective devant la classe?
- Sur le droit des minorités par rapport à l'unité de l'organisation. Nous pensons qu'une minorité, tant qu'elle n'a pas convaincu l'organisation de la validité de ses positions, doit se tenir au seul mode de fonctionnement que nous connaissons, l'exécution des décisions collectives prises majoritairement. Ces décisions ne sont pas obligatoirement justes (l'histoire a souvent montré le contraire) mais tant que l'organisation n'a pas changé d'avis, elle parle avec une seule voix, celle de son unité internationale. Cela ne veut pas dire que nous gardons nos divergences "secrètes"- au contraire nous pensons qu'il est nécessaire d'ouvrir publiquement nos discussions internes.
Mais aucune minorité ne peut se livrer à saboter le travail global. Certes, il est difficile de vivre avec des désaccords sur des questions d'analyse, il est difficile de faire vivre une organisation non monolithique mais nous sommes convaincus que c'est le seul moyen principiel de faire en sorte que la vie politique du prolétariat traverse réellement une organisation révolutionnaire.
- Le centralisme contre le fédéralisme. Des tendances localistes peuvent toujours surgir dans une organisation internationale mais ce serait notre mort que d'y céder ([5] [20]). Nous avons aussi assisté à des débats qui parfois dégénéraient vers la calomnie sur le fonctionnement interne que certains stigmatisaient comme "bureaucratique" pour la seule raison que notre règle de prise de décision est conçue de façon centralisée.
Nous ne prétendons pas exposer ici tous les aspects de ces débats. Nous y reviendrons. Mais si toutes les critiques n'étaient pas entièrement sans fondement, il y avait surtout des problèmes à revoir et des erreurs à corriger concernant une assimilation incomplète de nos positions de fond sur l'organisation, une tendance à accepter des adhésions à la va-vite, un manque de rigueur de notre pratique organisationnelle, etc.
Ce qu'il faut surtout retenir est que les grandes lignes de cette discussion recouvraient des divergences de fond. L'histoire du mouvement ouvrier nous montre qu'une question d'organisation a souvent été un critère de discrimination d'une gravité profonde ; on n'a qu'à se rappeler des débats dans l’AIT sur le centralisme et le fédéralisme entre Marx et Bakounine, ou le débat sur les critères d'adhésion au 2ème Congrès du parti social-démocratie russe qui a déterminé la scission entre bolcheviks et menchéviks. Aujourd'hui la question de l'unité internationale d'une organisation politique prolétarienne est un point capital, de même la question de l'engagement militant et la responsabilité collective d'un groupe. Le mouvement d'aujourd'hui souffre encore de la hantise des pratiques staliniennes inqualifiables et cette hantise continue à entraver un véritable travail organisationnel. Le mouvement souffre soit d'un étouffement des débats et des minorités, comme dans le PCI, soit des minorités ne reconnaissant ni leurs devoirs envers l'organisation ni l’acquis précieux pour le prolétariat que représente une organisation révolutionnaire comme cela s'est manifesté parfois dans le CCI.
Après notre 4ème Congrès où nous avons tous constaté des incompréhensions organisationnelles, nous avons décidé d'engager une période de discussion à fond sur les questions organisationnelles devant aboutir à une Conférence extraordinaire du CCI. Cette Conférence devrait nous permettre de tirer un bilan sur l'expérience organisationnelle du CCI depuis ses débuts et d'améliorer son fonctionnement.
Nous prenons la responsabilité collective pour les incompréhensions qui avaient surgi en notre sein. Ce n'est pas notre intention, ni à l'intérieur de notre organisation, ni à l'extérieur, de faire de ceux qui sont partis du CCI les boucs-émissaires de nos erreurs. Les faiblesses de notre organisation sont un produit de l'ensemble et c'est souvent des raisons secondaires, même accidentelles qui font que certains individus cristallisent plus que d'autres (d'autres qui souvent partagent leurs idées à un moment donné) les difficultés de l'ensemble.
Mais les événements dans le CCI se sont précipités cet été. Alors que nous commencions la discussion dans les bulletins internes, une "tendance" s'est déclarée précipitamment, sans document précisant ses positions, faisant circuler "clandestinement" et en dehors de l'organisation toute une série d'écrits la dénigrant. Trois jours après que l'organisation ait enfin reçu officiellement un document collectif annonçant la formation de la tendance/ certains de ses membres avaient préféré à la discussion un départ précipité et chemin faisant, de voler le matériel et de retenir l'argent de l'organisation en leur possession. Sans autre clarification des divergences, sans attendre la Conférence, d'autres sont partis, plus simplement, par démora1isation.
LES RECENTS EVENEMENTS
Pourquoi ces discussions ont tourné si brusquement au pire et si mal? Pourquoi s'accompagnaient-elles d'une campagne de calomnies sans précédent de la part de ces ex-camarades contre le CCI? En partie sans doute parce que nous avons mis trop de temps à réagir politiquement. Mais la raison principale est que derrière cette précipitation se trouve la manipulation d'un élément particulièrement dangereux, le nommé Chénier. Nous disposons actuellement de documents montrant l'existence de tout un complot secret et sordide, planifié minutieusement de sang froid faisant circuler des ragots et toutes sortes de "projets" et des instructions, de la part de Chénier sur comment torpiller l'organisation, de se débarrasser des tâches organisationnelles, du comment jouer sur les cordes sentimentales, et de multiplier des intrigues par un réseau clandestin personnel, du comment "noyer" les organes centraux et faire un travail de sape et "sans scrupules". On peut regretter qu'un certain nombre de camarades se soient laissés entraîner par lui dans une fièvre de contestation et dans une correspondance et des réunions clandestines créant une organisation clandestine surprenante au sein de l'organisation. La trajectoire de Chénier dans le milieu politique montre qu'il a agi pareillement dans tous les groupes où il est passé aboutissant' chaque fois à leur désorganisation.
Quand le CCI a publié dans sa presse "l'avertissement" contre les agissements de ce Chénier, il n'a fait que son devoir envers le milieu politique. Certains ont cru lire et interpréter dans ce que nous avons publié une dénonciation plus précise ; ils sont dans Terreur. Nous n'avons pas de preuves formelles de son appartenance à une agence de l'Etat ou quelque chose de similaire et nous ne l'avons jamais prétendu. Nous avons dit par contre que c'est un élément dont le comportement trouble est dangereux pour les organisations politiques et de cela nous sommes profondément convaincus. Quiconque voudrait ignorer cet avertissement doit savoir qu'il le ferait à ses propres dépens comme le CCI l'a appris par expérience. Tout groupe politique peut s'informer de sa trajectoire auprès des uns et des autres. Ce que l'on peut affirmer, c'est que ceux qui travaillent délibérément à la destruction des organisations révolutionnaires pour le compte de l'Etat ou d'autres appendices n'agissent pas autrement que ne l'a fait Chénier.
La réponse du milieu politique à cet avertissement montre ses faiblesses. C'est comme si une telle éventualité n'avait jamais traversé l'esprit de certains groupes. Croit-on réellement que le problème de la sécurité ne se pose pas? De toute façon le sectarisme de certains, comme le GCI, fait qu'il utilise notre effort simplement pour mieux dénigrer le CCI. Il croit que "cet avertissement ne sert qu'à jeter le discrédit sur un militant en rupture et l'ensemble de sa tendance", (lettre du 17/11/81 au CCI). Le CCI a vu bien des départs de camarades (y inclus le GCI) et il n'a jamais "utilisé" autre chose que la discussion politique pour répondre aux questions politiques. Dans les 13 ans d'existence de notre courant politique nous n'avons jamais exclu ([6] [21]) des militants pour divergences politiques, et encore moins descendu au niveau d'inventer des histoires sur le plan de la sécurité. Si nous avions voulu faire des "manœuvres", nous aurions agi comme Chénier : dans le secret, dans le complot, en ne disant rien à personne. Mais notre but n'est pas de nous "débarrasser" des personnes énonçant des désaccords politiques, au contraire, c'est le départ précipité et éhonté de certains membres de cette "tendance" manipulés par Chénier qui a fermé la porte à la clarification des désaccords avec eux. Et pour cause - un manipulateur craint toujours la discussion ; la discussion ouverte lui coupe les moyens de tirer les ficelles qui lui permettent de travailler les individus. C'est pour éviter la discussion que Chénier a précipité les départs et nous le dénoncions pour son travail de destruction.
Il est normal que des groupes politiques sérieux nous posent des questions ; on peut, dans une certaine mesure, se méfier des accusations. Nous regrettons que le milieu politique n'a pas aujourd'hui le moindre cadre pour s'entendre et régler des problèmes de cette nature en même temps qu'il poursuit la confrontation des positions politiques, parce que nous aurions tout de suite ouvert cette question à la collectivité. Cette collectivité n'existant pas, nous avons pris nos responsabilités et nous avertissons les autres, même ceux qui préfèrent utiliser ces avertissements pour alimenter leurs mesquins sentiments "anti-CCI". Aujourd'hui que nous avons récupéré la plupart du matériel volé, nous considérons l'affaire Chénier close. Maintenant que Chénier est arrivé au terme de son travail de destruction, profitant d'un moment de faiblesse du CCI, il peut se retirer de la politique.
En volant l'organisation, les autres ex-camarades (Chénier mis à part) ne réalisaient pas , sans doute, la gravité de leur acte. Surtout quand on vient du milieu gauchiste c'est une pratique courante. En réagissant par rapport à cet acte révoltant, le CCI a défendu non seulement son organisation mais une POLITIQUE GENERALE PAR RAPPORT AUX MOEURS DANS LE MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE.
Voler les ressources collectives d'une organisation révolutionnaire, c'est la réduire au silence. C'est un acte politique d'une signification grave. Nous avons averti par" écrit tous les éléments concernés que nous condamnons cet acte et que nous allions réagir. Ils ont répondu en disant que le CCI est une bande de "propriétaires outragés" en nous disant que le matériel volé est "une compensation pour leurs cotisations" versées antérieurement! Ainsi un trésorier, en décidant de partir pourrait enlever la caisse. Une organisation révolutionnaire serait-elle une entreprise d'investissements – et quand on en a marre, on retire "ses" actions avec intérêts si possible? ;
Le CCI n'est pas un groupe de pacifistes. Nous avons, récupéré notre matériel. Devant notre effort légitime et tout à fait contrôlé de récupération, nos ex- j camarades ont, à plusieurs reprises, menacé de faire appel ...à la police. Tout cela sans doute en raison de leur lâcheté autant que de leurs confusions politiques.
La non violence au sein du milieu révolutionnaire, l'interdiction de régler les désaccords par le vol et la violence est un principe qu'il est absolument indispensable de défendre et sans lequel toute activité révolutionnaire est impossible. Nous l'avons défendu non seulement pour le CCI mais pour le milieu révolutionnaire dans son ensemble. Peut-on, en quittant un groupe révolutionnaire tenter de le détruire? A-t-on le droit, parce que "cela vous arrange" de décider du jour au lendemain qu'un groupe est "dégénéré", "mort", "inutile" ou "bureaucratique", pour mieux lui nuire par le vol de ses moyens d'intervention? Ce sont des mœurs du marasme gauchiste et si des groupes révolutionnaires ne prennent pas clairement et publiquement position là-dessus, le mi' lieu révolutionnaire n'existe pas. Si les organisations révolutionnaires ne réagissent pas contre le sectarisme qui fait que le groupe révolutionnaire voisin devient l'ennemi n°1, il ne restera plus rien du milieu politique dans la période à venir. Par cette porte entrera toute la pression de l'Etat bourgeois pour détruire les organisations révolutionnaires. La question de la non violence au sein des organisations révolutionnaires et entre elles n'est qu'un petit aspect d'une question beaucoup plus profonde et fondamentale : celle de la non violence au sein de la classe ouvrière. Cette question, nous l'avons soulevée et développée et il serait temps que les autres groupes qui se disent révolutionnaires se prononcent clairement là-dessus.
Le CCI continue ses préparations pour la Conférence extraordinaire et cela même en l'absence des individus directement concernés nous continuerons à débattre leurs positions politiques pour mieux définir notre orientation.
Pour l'ensemble du milieu politique, comme pour le CCI, ou on saura être à la hauteur des années de vérité ou on sera amené à disparaitre.
J.A.
[1] [22] Les participants aux Conférences Internationales étaient Battaglia Comunista (Italie), le NCI (Italie),le CCI, le CWO (Angleterre), Internationell Révolution (Suède- aujourd’hui une section du CCI) et à la 3ème Conférence, également l’Eveil internationaliste (France).
Le GCI (Gauche Communiste Internationaliste- Belgique) une scission du CCI en 1978 est venu comme observateur à la 3ème Conférence. Leur "participation" consistait à dénoncer la Conférence et à saboter l'ordre du jour. Pour les critères politiques sur lesquels on jugeait la participation à ces Conférences de discussion, voir les trois Bulletins des Conférences.
[2] [23] "Le Sectarisme, un héritage de la contre-révolution à dépasser" Rint n°22 sur le bilan de la 3ème Conférence internationale.
[3] [24] Bien que cette tendance vers le regroupement des révolutionnaires soit la meilleure expression des besoins de classe, nous ne la considérons pas comme un absolu. Cette tendance ne s’achève pas toujours dans la création d’un seul parti de classe avant la révolution. Nous rejetons la conception bordiguiste qui n1admet, par principe, qu'une seule expression politique du prolétariat.
[4] [25] cf. la Rint n°20 "Réponse à Nos Censeurs".
[5] [26] Les ex-camarades qui forment aujourd'hui le groupe News of War and Révolution ont quitté le CCI en juin et expriment un aspect de cette faiblesse localiste et fédéraliste. Pour eux, seule une organisation petite et locale peut être réellement démocratique. Pour eux comme pour nos ex membres à Manchester, l'effort de former le CCI "était prématuré". Nos ex-membres à Manchester pensent travailler avec des éléments venant du milieu "libertaire" en décomposition de Solidarity se dédiant aussi à un travail local, aussi bien en théorie qu'en pratique, (cf. WR nov. 1981) L'Ouvrier Internationaliste à Lille semble s'arrêter après 2 numéros, après avoir fait du "porte à porte" (dans la pure tradition de L.O.) pour "intervenir" et "vendre'.'
[6] [27] Le CCI a exclu les camarades qui ont volé l'organisation pour "comportement indigne de militants communistes". Contrairement aux bruits qui circulent (notamment dans la lettre du GCI) les 2ex-membres du CCI en Angleterre qui forment News of War and révolution n'ont rien à voir ni avec le vol, ni avec la récupération, ni avec les exclusions. Leurs prises de positions profondément erronées dans cette affaire et que nous critiquons par ailleurs, ne sont pas à mettre au même niveau.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (3ème partie)
- 3053 reads
Cette critique de "Lénine philosophe" de Harper (Pannekoek) d'INTERNATIONALISME (1948) est la suite des articles parus dans les n°25 et 27 de la REVUE INTERNATIONALE (Se reporter à 1'introduction du n°25).
"... LA REVOLUTION RESERVE UNE CHAIRE D'HISTOIRE ANCIENNE A KAUTSKY..." ET DE PHILOSOPHIE A HARPER
Après les quelques critiques que nous avons pu adresser à la philosophie de Harper, nous voulons maintenant montrer comment le point de vue politique qu'il en dégage s'éloigne dans les faits des positions des révolutionnaires, (Nous n'avons pas voulu, d'ailleurs, approfondir, mais simplement bien montrer que toutes les critiques de Harper faites d'un matérialisme soi-disant mécaniste, partaient d'une exposition assez juste, quoique par trop schématique, du problème de la connaissance humaine et de la praxis marxiste et révolutionnaire, et aboutissaient dans leur application politique pratique, à un point de vue mécaniste et vulgaire.)
Pour Harper :
1) La Révolution russe, dans ses manifestations philosophiques, (critique de l'idéalisme), était uniquement une manifestation de pensée matérialiste bourgeoise...typiquement empreinte du milieu et des nécessités russes.
2) La Russie du point de vue économique, colonisée par le capital étranger, éprouve le besoin de s'allier avec la révolution du prolétariat, "et même", dit-il :
"...Lénine a été obligé de s'appuyer sur la classe ouvrière et comme la lutte qu'il menait devait être poussée à l'extrême, sans ménagement, IL A AUSSI adopté la doctrine la plus radicalisée du prolétariat occidental ([1] [31]) en lutte contre le capital mondial, le marxisme".
Mais, ajoute-t-il :
"Comme la révolution russe présentait un mélange des deux caractères du développement occidental : la révolution bourgeoise quant à sa tâche et la prolétarienne quant à sa force active, aussi la théorie bolchevique qui l'accompagnait était un mélange du matérialisme bourgeois quant à ses conceptions fondamentales et du matérialisme prolétarien quant à la doctrine de la lutte de classe..."
Et là Harper de nommer les conceptions de Lénine et de ses amis de marxisme typiquement russe seul, dit-il, Plekhanov est peut- être le marxiste le plus occidental, quoique encore pas dégagé complètement du matérialisme bourgeois.
Si il est effectivement possible qu'un mouvement bourgeois puisse s'appuyer sur "un mouvement révolutionnaire du prolétariat en 1utte contre le capitalisme mondial" (Harper), et que le résultat de cette lutte soit 1'établissement d'une bureaucratie comme classe dominante qui a volé les fruits de la révolution prolétarienne internationale, alors la porte est ouverte à la conclusion de James Burnham, conclusion selon laquelle la technobureaucratie établit son pouvoir dans une lutte contre l'ancienne forme capitaliste de la société, en s'appuyant sur un mouvement ouvrier, et selon laquelle le socialisme est une utopie
Ce n'est pas par hasard que le point de vue de Harper rejoint celui de Burnham. La seule différence est que Harper "croit" au socialisme et que Burnham "croit" que le socialisme est une utopie ([2] [32]). Mais où ils se rejoignent c'est dans la méthode critique qui est tout à fait étrangère d'avec une méthode révolutionnaire et à la fois objective.
Harper qui a adhéré à la 3ème Internationale, qui a formé le parti communiste hollandais, qui a participé à l'I.C. pendant les années cruciales de la révolution, qui a participé à entraîner le prolétariat de l'Europe à la participation de cet "Etat russe contre-révolutionnaire", Harper s'explique là dessus en disant :
"...si on l'avait connu à ce moment là...", (Matérialisme et Empiriocriticisme de Lénine),"...on aurait pu prédire..."(le sort de la dégénérescence de la révolution russe et du bolchévisme en un capitalisme d'Etat appuyé sur les ouvriers).
On peut répondre à Harper que des marxistes "éclairés" avaient prédit, et étaient arrivés aux mêmes conclusions que Harper sur la révolution russe, et cela bien avant lui, nous voulons citer Karl Kautsky.
La position de Kautsky au sujet de la Révolution russe a été suffisamment rendue publique par le large débat qui eut lieu entre lui Lénine et Rosa, Luxembourg, pour qu'il soit besoin d’insister là dessus, (Lénine, "Contre le courant" "Le Socialisme et la guerre" "L'impérialisme, stade suprême du capitalisme", "L'Etat et la Révolution"; Kautsky, "La dictature du prolétariat" ; Rosa Luxemburg, "La révolution russe", Kautsky, "Rosa Luxemburg et le Bolchévisme").
Dans la suite d'articles de Kautsky, Rosa Luxembourg et le Bolchévisme" (Kampf de Vienne), publiés en brochure, en français, en Belgique, en 1922,on peut, très largement montrer comment, en plus d'un point, les conclusions de Harper peuvent lui être comparées.
"...Et cela ("La Révolution russe" de Rosa Luxembourg) nous (Kautsky) met dans cette posture paradoxale, d'avoir ici ou là, à défendre les bolcheviks contre plus d'une accusation de Rosa Luxembourg..." (Kautsky "Rosa Luxembourg et le Bolchévisme".)
Cela de la part de Kautsky, pour défendre les "erreurs" des bolcheviks (que Rosa critique dans sa brochure), comme des conséquences logiques de la révolution bourgeoise en Russie, et de bien montrer que les bolcheviks ne pouvaient pas faire autre chose que ce à quoi le milieu russe était destiné, à savoir, la révolution bourgeoise.
Pour citer quelques exemples, disons que Rosa critique l'attitude des bolcheviks dans le mot d'ordre et dans la pratique de la prise individuelle de possession dans le partage des terres par les petits paysans, ce qui amènerait, pensait-elle, des difficultés inouïes ensuite à cause du morcellement de la propriété foncière ; elle préconisait au contraire la collectivisation immédiate des terres. Lénine avait déjà répondu à ces arguments que Kautsky avait, d'un autre point de vue (chapitre "Servilité à l'égard de la bourgeoisie sous prétexte d'analyse économique", "La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky"), déjà avancé.
Kautsky: "...Pas de doute que cela (la propriété parcellaire) ait suscité un obstacle puissant pour le progrès du socialisme en Russie. Mais c'est une marche des choses qu'il était impossible d'empêcher : elle aurait pu seulement cire mise en train plus rationnellement que cela ne fut fait par les bolcheviks. Preuve justement que la Russie se trouve essentiellement au stade de la révolution bourgeoise. C'est pourquoi la réforme agraire bourgeoise du bolchévisme lui survivra, tandis que ses mesures socialistes ont été déjà reconnues par lui-même incapables de durer et préjudiciables. . ."
On sait que la "puissante" vue de Kautsky a été totalement infirmée par cet autre "socialiste" Staline qui a collectivisé les terres et "socialisé" l'industrie alors que la révolution était déjà totalement étouffée.
Et voici un long échantillon de Kautsky sur le développement du marxisme en Russie qui se rapproche étrangement de la dialectique de Harper (voir "Lénin als philosophe" -La Révolution russe-);
"Comme il était arrivé chez les français, les révolutionnaires parmi les russes reçurent des réactionnaires cette croyance à l'importance exemplaire de leur nation sur les autres nations .Lorsque le marxisme vint de l'Occident pourri en Russie, il dut combattre très énergiquement cette illusion et démontrer que la révolution sociale ne pouvait sortir que d'un capitalisme supérieurement développé. La révolution à laquelle marchait la Russie serait forcément d'abord une révolution bourgeoise sur le modèle de celle qui s'était produite en Occident. Mais à la longue, cette conception parut vraiment aux plus impatients des éléments marxistes trop restrictive et trop paralysante, surtout à partir de 1905, de la première révolution où le prolétariat russe avait combattu si victorieusement, remplissant d'enthousiasme le prolétariat de toute l'Europe.
Chez les plus radicaux des marxistes russes se forma dès lors une nuance particulière de marxisme. La partie de la doctrine qui fait dépendre le socialisme des conditions économiques du haut développement du capitalisme industriel, alla désormais pâlissant de plus en plus à leurs yeux. En revanche, la théorie de la lutte de classe revêtit des couleurs de plus en plus fortes. Elle fut toujours davantage considérée comme la seule lutte pour le pouvoir politique par tous les moyens, détaché de sa base matérielle. Dans cette manière de concevoir les choses, on arrivera finalement à voir dans le prolétariat russe un être extraordinaire, le modèle de tout le prolétariat du monde. Et les prolétaires des autres pays commencèrent à le croire et à saluer dans le prolétariat russe le guide de l'ensemble du prolétariat international vers le socialisme. Il n'est pas difficile de se l'expliquer. L'Occident avait ses révolutions bourgeoises derrière lui et devant lui les révolutions prolétariennes. Mais celles-ci exigeaient une force qu'il n'avait encore atteinte nulle part. C'est ainsi qu'en Occident, nous nous trouvions dans un stade intermédiaire entre deux époques révolutionnaires, ce qui mettait dans ces pays la patience des éléments avancés à une dure épreuve. La Russie, elle, au contraire, était si en retard qu'elle avait encore devant elle la révolution bourgeoise, la chute de 1'absolutisme. Cette besogne n'exigeait pas un prolétariat aussi fort que la conquête de la domination exclusive par la classe ouvrière en Occident. La Révolution russe se produisit donc plus tôt que celle de l'Occident. Elle était essentiellement une révolution bourgeoise, mais cela put un certain temps ne pas éclater aux yeux par le fait que les classes bourgeoises sont aujourd'hui en Russie bien plus faibles encore qu'elles n'étaient en France à la fin du 18ème siècle. Si l'on négligeait le fond économique, à ne considérer que la lutte de classe et la force relative du prolétariat, il pouvait, durant un temps réellement semblé que le prolétariat russe fut supérieur au prolétariat de 'Europe occidentale et destiné à lui servir de guide."
("Rosa Luxemburg et le Bolchévisme", Kautsky).
Harper reprend un à un, philosophiquement, les arguments de Kautsky :
Kautsky oppose deux conceptions du socialisme :
1) la première selon laquelle le socialisme n'est réalisable qu'à partir de bases capitalistes avancées... (La sienne et celle des menchéviks, valable pour la critique de la révolution russe pour des sociaux-démocrates allemands parmi lesquels s'est trouvé un Noske...conception qui conduisait réellement à faire la politique capitaliste d'Etat en s'appuyant sur "une partie de la masse populaire" contre le prolétariat révolutionnaire).
2) Une autre conception, selon laquelle la lutte pour le pouvoir politique "...par tous les moyens, détachée de sa base matérielle..." permettait "même en Russie" de construire le socialisme... (ce qui aurait été, déformée à souhait, la position des bolcheviks).
En réalité, Lénine et Trotski disaient : la révolution bourgeoise en Russie ne peut être faite QUE par l'insurrection du prolétariat -l'insurrection du prolétariat ayant une tendance objective à se développer sur une échelle internationale-,il nous est permis d'espérer, de par le degré de développement des forces productrices MONDIALES, que cette insurrection russe provoque un mouvement général.
La révolution russe poussant à la révolution bourgeoise du point de vue du développement des forces productives en Russie, la réalisation du socialisme est très possible à condition d'un déclenchement mondial de la révolution. Lénine et Trotski, de même que Rosa Luxembourg, pensaient que le niveau de développement des forces productives dans le monde entier, non seulement rendait le socialisme possible, mais encore le rendait nécessaire, ce niveau ayant atteint un stade qu'ils qualifiaient en commun accord "l'Ere des guerres (mondiales) et des révolutions", en désaccord seulement sur les facteurs économiques de cette situation. Il fallait pour que le socialisme fût possible que la révolution russe ne restât pas isolée.
Kautsky répond, avec les menchéviks, que Lénine et Trotski ne voyaient dans la révolution qu'un seul facteur "volontariste" de prise de pouvoir par un "putsch" bolchevik allant même jusqu'à comparer le bolchévisme au blanquisme.
Tous ces marxistes et socialistes "éclairés" étaient justement ceux que Harper semble citer en exemple, ceux qui avaient "...multiplié les avertissements...", qui étaient contre "...la direction du mouvement ouvrier international par les Russes...", comme Kautsky :
"Mais que Lénine n'avait pas compris le marxisme en tant que théorie de la révolution prolétarienne, qu'il n'avait pas compris la nature profonde du capitalisme, de la bourgeoisie, du prolétariat dans l'ultime phase de leur développement, on en a la preuve immédiatement après 1917, quand le prolétariat international devait être conduit à la révolution prolétarienne par la III° Internationale sur les ordres de la Russie et quand les avertissements des marxistes occidentaux restèrent sans écho..."
Comparé à toute la distinction savante de Kautsky entre Russie retardataire et Occident, entre "marxistes russes" et occidentaux, on retrouve ici toutes les critiques des marxistes "centristes" apparentés à Kautsky.
Ils reprochaient tous, Kautsky en tête, de ne pas avoir considéré le fait de l'état arriéré de l'économie russe, alors que Trotski avait depuis longtemps, et le premier dès 1905, répondu d'une façon magistrale à tous ces "honnêtes pères de famille" (Lénine), comment l'état avancé de la concentration industrielle en Russie, d'une part, et d'autre part, sa situation retardataire du point de vue social (retard de la révolution bourgeoise) en faisant un pays prédisposé à un état révolutionnaire constant et ou la révolution NE POUVAIT - QU'ETRE PROLETARIENNE OU NE PAS ETRE.
Pour Harper bâtissant sa théorie et sa critique philosophique sur la théorie et la critique historico-économique de Kautsky, il dit que, du fait de la situation arriérée de l'économie russe, et du fait de 1'inéluctabilité de la révolution bourgeoise en Russie, du point de vue économique, la philosophie de la révolution russe était obligée de prendre le marxisme première manière, c'est à dire révolutionnaire-démocrate-bourgeoise-feuerbachien, "...la religion est l'opium du peuple..." (critique de la religion), et que c'est normal que Lénine et ses amis n'aient pas pris le marxisme deuxième manière, dialectique-révolutionnaire-prolétarien : "...L'existence sociale conditionne la conscience..." ; (il oublie seulement de dire qu’il est impossible que Harper ne sache pas cela- que la lutte essentielle des bolcheviks était axée contre tous les courants à leur droite dans la social-démocratie, gouvernementaux et centristes -avant I918-et cela très largement, à travers toute la presse européenne et des brochures en toutes les langues, alors que "Matérialisme et Empiriocriticisme" n'a été connu que très tard par un large public russe, traduit encore plus tard en allemand et encore plus tard en français et presque pas lu en dehors de la Russie, on est en droit de se demander si l'esprit de "Matérialisme et Empiriocriticisme" était contenu dans ces articles et brochures, choses que Harper n'a même pas tenté de démontrer, et pour cause !) ; -et il conclut de là, comme Kautsky, que "malgré" la conception volontariste de la lutte de classe de Lénine et Trotski, qui voulaient "...faire du prolétariat russe le chef d'orchestre de la révolution mondiale...",1a révolution était fatalement vouée à être bourgeoise, philosophiquement, du fait que Lénine et ses amis avaient émis un mode de pensée philosophique-matérialiste-bourgeois-feuerbachien-(Marx première manière).
Ce fait, fait rejoindre dans leur critique de la révolution russe, Kautsky et Harper quant au fond du problème, mais aussi quant à la forme qu'ils donnent à leur pensée et à leur critique des bolcheviks où ceux-ci sont accusés d'avoir voulu diriger la révolution mondiale du Kremlin,
Mais il y a mieux, Harper démontre dans son exposé philosophique qu'Engels n'était pas un matérialiste dialecticien, mais encore profondément attaché, quant à ses .conceptions dans le domaine de la connaissance aux sciences de la nature et au matérialisme bourgeois. Cette théorie pour être vérifié demanderait une exégèse que Harper n'a pas fournie au passif d'Engels, alors que Mondolfo, dans un ouvrage important sur le matérialisme dialectique, semble vouloir démontrer le contraire ; ce qui prouve que cette querelle n'existe pas d'aujourd'hui ; quoi qu'il en soit, je crois que des jeunes générations pourront voir dans les générations qui les ont précédées ce que nous pouvons constater chez Lénine ou chez Engels qui faisaient une critique des philosophies de leur temps en partant d'un même niveau de connaissance scientifique et parfois par trop schématisé, alors qu'on doit surtout étudier leur attitude générale non en tant que philosophes, mais d'abord vérifier s'ils se situent sur le terrain de la praxis, des thèses de Marx sur Feuerbach dans leur comportement général.
Dans ce sens, on admettra comme se rapprochant beaucoup plus de la réalité, ce que Sydney Hook dit de l'œuvre de Lénine dans "Pour comprendre Marx" :
"….Ce qui est bien étrange, c'est que Lénine néglige l'incompatibilité entre son activisme politique et sa philosophie dynamique d'action réciproque exprimée dans "QUE FAIRE" d'un côté, et la théorie de la connaissance selon une correspondance absolument mécanique, défendue si violemment par ' lui dans son "Matérialisme et Empiriocriticisme" de l'autre. Ici il suit mot pour mot Engels dans son affirmation que les "sensations sont les copies, les photographies, les images, les reflets de miroir des choses", et que l'esprit n'est pas actif dans la connaissance. Il semble croire que si l'on soutient la participation de l'esprit comme un facteur actif à la connaissance, conditionné par le système nerveux et toute l'histoire du passé, il s'en suit que l'esprit crée tout ce qui existe, y compris son propre cerveau. Cela serait de l'idéalisme le plus caractérisé, et idéalisme signifie religion et croyance en Dieu.
Mais le passage de la première à la seconde proposition est le NON SEQUITUR (elle ne suit pas) le plus manifeste que l'on puisse imaginer. En réalité dans l'intérêt de sa conception du marxisme comme théorie et pratique de la révolution sociale, Lénine dut admettre que la connaissance est une affaire active, un processus dans lequel matière, culture et esprit réagissent réciproquement les uns sur les autres, et que les sensations ne constituent pas la connaissance mais une partie des matériaux travaillés par la, connaissance.
C'est la position prise par Marx dans ses "Thèses sur Feuerbach" et dans l'"Idéologie allemande". Quiconque considère les sensations comme les copies exactes du monde extérieur amenant elles-mêmes à la connaissance, ne peut éviter le fatalisme et le mécanisme. Dans les écrits politiques et non techniques de Lénine, on ne trouve aucune trace de cette épistémologie dualiste lockéenne ; son "QUE FAIRE", ainsi que nous l'avons déjà vu, contient une acceptation franche du rôle actif de la connaissance de classe dans le processus social. C’est dans ses écrits pratiques s'occupant des problèmes concrets d'agitation, révolution et reconstruction que l'on trouve la vraie philosophie de Lénine.. " ("Pour comprendre Marx"- Sydney Hook- p.57-58) ([3] [33])
Le témoignage vivant et l'expression la plus vraie de ce que dit Sydney Hook et qui rejette Harper du côté des Plekhanov-Kautsky est cette illustration de Trotski (Ma Vie) :
Parlant de Plekhanov il dit : " Ce qui le démolissait c'était précisément ce qui donnait des forces à Lénine : l'approche de la révolution. Plekhanov fut le propagandiste et le polémiste du marxisme, mais non pas le politique révolutionnaire du prolétariat. Elus la révolution devenait imminente, plus il entait le sol lui glisser sous les pieds. .. "
On voit donc que n'est pas tant la thèse philosophique de Harper -qui est originale (elle est au contraire une mise au point après tant d'autres), mais surtout la conclusion qu'il en tire.
Cette conclusion et une conclusion fataliste du genre de celle de Kautsky. Kautsky, dans sa brochure « R. Luxemburg et le Bolchévisme", cite une phrase que Engels lui aurait écrite dans une lettre personnelle :
« …les fins véritables et non les fins illusoires d’une révolution sont toujours réalisées par suite de cette révolution…»
C'est ce que Kautsky veut démontrer dans sa brochure, c'est ce que Harper arrive à démontrer (pour ceux qui veulent le suivre dans sa conclusion) dans "Lénin als philosophe", et après avoir combattu le matérialisme bourgeois chez Lénine et chez Engels, il en arrive à une conclusion mécaniste des plus vulgaires de la révolution russe, ".produit fatal" ".fin véritable et non illusoire..." "...la révolution russe a produit ce qu'elle devait produire, c'était écrit dans Empiriocriticisme et dans les conditions de développement économiques russes..." ".le prolétariat mondial devait simplement lui servir de couverture idéologique marxiste..."; "..la nouvelle classe au pouvoir s'emparant tout naturellement de cette forme de penser du Léninisme, matérialiste bourgeoise, pour s 'emparer du pouvoir et lutter contre les ouches de la bourgeoisie capitaliste établie, qui sont philosophiquement retombées vers le crétinise religieux, le mysticisme et l'idéalisme, en même temps qu'ils sont devenus conservateurs et réactionnaires ; ce vent frais, cette nouvelle philosophie, cette nouvelle classe capitaliste d'Etat, d'intellectuels et de techniciens, trouve sa raison d'être dans Empiriocriticisme et dans le Stalinisme et elle "monte" dans tous les pays, etc. .etc. "
Donc en quelque sorte :
Marx première manière = Lénine Empiriocriticisme =Staline !!!
C’est ce que Burnham a très bien compris, sans connaître Harper, c'est ce que de nombreux anarchistes se plaisent à répéter sans en rien comprendre. Il est- bien évident que Harper ne dit pas cela avec autant de brutalité, mais le fait qu'il ouvre la porte à toutes les conclusions des apologistes bourgeois et anarchistes de Burnham, suffisent à démontrer la tare constitutive de son « Lénin als philosophe »
Ensuite quand il est amené à tirer les enseignements « prolétariens purs » de la révolution russe (je fais remarquer qu'on dit toujours dans le langage Harper-Kautsky "la révolution russe" et rarement « la révolution d'octobre" » distinction qui doit leur écorcher la plume) quand il tire cet enseignement « prolétarien pur », en séparant l'action de la classe ouvrière russe, et « l'influence bourgeoise des bolcheviks » , il en arrive à dire que c'est surtout dans ses grèves généralisées, et dans les soviets (ou conseils) "en soi", qu'a produits la révolution russe, qu'elle est un enseignement positif pour le prolétariat :
1) le prolétariat doit se détacher idéologique « homme par homme » de l'influence bourgeoise.
2) Il doit apprendre progressivement à gérer seul les usines et a organiser la production.
3) Les grèves généralisées et les Conseils sont les armes exclusives du prolétariat.
Et il s'avère que cette conclusion est un type achevé de réformisme, et que de plus c'est totalement anti-"dialectique".
Le détachement "homme par homme" de l'idéologie bourgeoise, en plus que si elle était réalisable remettrait le devenir du socialisme à la fin des siècles, et ferait apparaître la doctrine de Marx comme une belle légende qu'on raconte aux enfants des prolétaires pour leur donner du courage à envisager la vie, de plus nous sommes dans une société bourgeoise dont le caractère social primordial est que chaque homme, pris homme par homme, dans le prolétariat lui-même , ne se détache pas homme par homme, mais pas du tout de l'idéologie dominante ce qui fait de cette idée une "idée" qui garde éternellement sa qualité d'idée. Au contraire la classe ouvrière, dans son ensemble, parvient à s'en détacher dans certaines conditions historiques où elle entre plus violemment en heurt avec le vieux système que dans d'autres. Il n'y a pas de socialisme réalisable "homme par homme" à la manière des vieux réformistes qui croyaient qu'il fallait "réformer d'abord l'homme avant de réformer la société", alors que les deux ne sont pas séparables. La société change quand l'humanité entre en mouvement pour la faire changer, et le prolétariat entre en mouvement, non "homme par homme", mais "comme un seul homme" quand il se trouve placé dans des conditions historiques spéciales.
Le fait que Harper répète sous une forme apparemment nouvelle les vieilles sornettes réformistes, lui permet, sous un verbiage philosophico-dialectique, d'escamoter les problèmes, principaux axes, de la révolution russe, et de les reléguer dans les oubliettes des "raisons d'Etat russes" qui ont tout de même un peu bon dos en ce moment. Il s'agit de la position de Lénine contre la guerre et de la théorie de Trotski de la révolution permanente.
Eh bien oui! Messieurs Kautsky-Harper, on peut toucher des points justes dans une critique purement négative des théories philosophiques ou économiques de Lénine et de Trotski, mais cela ne veut pas dire que vous ayez acquis pour cela une position révolutionnaire, et dans leurs positions politiques, au cours de la révolution russe dans la phase cruciale de 1'insurrection, c’étaient Lénine et Trotski qui étaient vraiment des révolutionnaires marxistes...
Il ne suffit pas, philosophiquement, 20 après la bataille, et après y avoir participé soi-même parmi les chefs de file, de s'apercevoir que tout cela n'a eu pour résultat que l'Etat stalinien et de dire que ceci est le produit de cela. Il faut aussi se demander COMMENT Lénine et Trotski pouvaient s'appuyer sur le mouvement ouvrier international, et POURQUOI, et nous dire franchement si c'est le stalinisme qui est le produit fatal de ce mouvement.
Cela, Harper est comme Kautsky, incapable de nous le dire, parce que dans leurs positions politiques, face à. la bourgeoisie, dans la guerre impérialiste, ou dans une période révolutionnaire montante, ils n'ont pas de conceptions qui leur permettent seulement d'aborder ces problèmes, ils ne les connaissent pas. Ils connaissent ainsi Lénine "en tant que philosophe" ou en tant que "chef d'Etat", mais ils ne connaissent pas Lénine en tant que marxiste révolutionnaire, le vrai visage de Lénine, face à la guerre impérialiste, et celui de Trotski face à la conception mécaniste du développement capitaliste "fatal" de la Russie. Ils ne connaissent pas le vrai visage d'Octobre qui n'est pas celui des grèves de masses et pas non plus uniquement celui des soviets, soviets auxquels Lénine n'était pas attaché d'une manière absolue (comme Harper), parce qu'il jugeait lui que les formes du pouvoir du prolétariat sortaient spontanément de sa lutte en même temps qu'elle. Et en cela je crois que Lénine était aussi plus marxiste, parce qu'il n'était pas attaché aux soviets ni au syndicat, ni au parlementarisme (même s'il se trompait) d'une manière définitive, mais d'une manière appropriée à un moment de la lutte de classe créée par et pour elle.
Tandis que l'attachement quasi théologique de Harper à ses conseils le fait aujourd'hui, de ce côté également, prendre une forme de cogestion des ouvriers dans le régime capitaliste, comme un apprentissage du socialisme. Ce n'est pas le rôle des révolutionnaires de perpétrer un apprentissage de ce genre. Avec celui de l'apprentissage "homme par homme" de la théorie du socialisme» l'humanité est condamnée à être l'esclave éternelle et éternellement aliénée, avec ou sans conseils avec ou sans "raden communisten" et leurs méthodes d'apprentissage du socialisme en régime capitaliste, vulgaire réformisme, l'envers de la médaille kautskiste.
Quant à la lutte de classe "propre", "par les moyens appropriés" la grève etc.. On en a vu les résultats, elle rejoint la théorie de la gréviculture trotskiste, des trotskistes actuels et des anarchistes, qui perpétuent actuellement la vieille tradition des "trade-unionistes" et des "économistes " et que dès "Que faire" Lénine critiquait si violemment. Ce qui fait que la position antisyndicale des "Raden-Kommunisten", pour être juste pour nous du point de vue purement négatif, n'en est pas moins fausse "en elle même" parce que les syndicats sont remplacés par des petits frères, les soviets, et jouent le même rôle. On croit qu'il faut remplacer le nom pour changer le contenu. On n'appelle plus le Parti, parti, les Syndicats, syndicat, mais on les remplace par les mêmes organisations qui ont les mêmes fonctions et qui portent un autre nom. Qu'on appelle un chat "Raminagrobis", il aura pour nous la même anatomie et le même rôle sur la terre, sauf pour certains pour qui il sera devenu un mythe, et c'est curieux que des philosophes, des matérialistes "dialecticiens" aient l'esprit aussi borné et les vues aussi étroites pour tenter de nous faire avaler comme un monde nouveau le monde de leurs constructions mythologiques, de "Raminagrobis" par rapport au monde des chats.
C'est dans le fond assez normal, dans l'ancien monde un Kautsky était un vulgaire réformiste, dans le monde nouveau, trotskistes, anarchistes et raden-communistes sont des "Révolutionnaires authentiques"; alors qu'ils sont beaucoup plus grossièrement réformistes que le fin théoricien du réformisme, Kautsky.
Le fait que Harper reprenne des arguments classiques du réformisme bourgeois, menchéviks et kautskistes, (et plus récemment la rencontre de ce point de vue et de celui de Burnham), contre la révolution russe ne peut pas tellement étonner. Au lieu de chercher dans cette époque révolutionnaire à tirer des enseignements en marxiste, (tels que Marx et Engels ont, par exemple, tiré des enseignements de la Commune de Paris), Harper veut condamner "en bloc" la révolution russe et le bolchévisme qui y est attaché (tout autant que blanquisme et proudhonnisme étaient attachés à la Commune de Paris).
Harper se rapproche très près de la réalité, et si au lieu de chercher à condamner les bolcheviks appropriés au milieu russe", il s'était demandé quel était le niveau de pensée de cette gauche de la social-démocratie, dont tous étaient issus, il aurait pu tirer de toutes autres conclusions de son livre parce qu'il aurait vu que ce niveau (même chez les plus développés du point de vue de la dialectique) ne permettait pas de résoudre certains problèmes auxquels se heurtait la révolution russe (dont le problème du Parti et de l'Etat), problèmes sur lesquels à la veille de la révolution russe aucun marxiste n'avait des idées précises (et pour cause).
Dans l'ensemble du niveau des connaissances, philosophiques, économiques et politiques, nous l'affirmons et nous allons tenter de le démontrer, ce sont les bolcheviks qui étaient, en 1917, parmi les plus avancés des révolutionnaires du monde entier, et cela en grande partie grâce à la présence de Lénine et de Trotski.
Si les événements sont venus apparemment les contredire, ce n'est pas à cause de leur développement intellectuel approprié au "milieu russe, mais cela est dû au niveau général du mouvement ouvrier international, ce qui également pose des problèmes philosophiques que Harper n'a même pas voulu aborder.
Philippe
[1] [34] Voir plus loin les citations de Kautsky sur "la doctrine du prolétariat occidental".
[2] [35] Dans un prochain n°, nous verrons comment un des disciples de Harper, Cannemeyer va aboutir quoiqu'avec regret et tristesse, au même constat que Burnham sur le "socialisme comme utopie". Fondamentalement, avec beaucoup de bavardage en plus, ce sera 1'aboutissement du groupe Socialisme ou Barbarie et de son mentor Chaulieu.
[3] [36] Et ceci pour le "milieu spécifiquement russe" de Harper-Kautsky : ".la doctrine matérialiste - écrit Marx- affirmant que les hommes sont les produits de leur milieu et de leur éducation, et que les hommes différents sont les produits de milieux et d'éducations différents, oublie que le milieu lui-même a été transformé par 1'homme et que l'éducateur doit à son tour être éduqué. C'est pourquoi elle sépare la société en deux parties dont l'une est élevée au-dessus de 1'ensemble. La simultanéité des changements parallèles dans le milieu et dans l'activité humaine ne peut être rationnellement comprise qu'en tant que pratique révolutionnaire..." (D'après Marx-Engels "Thèses sur Feuerbach", S.Hook, op.ci
Courants politiques:
- Le Conseillisme [37]
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 29 - 2e trimestre 1982
- 2607 reads
Après la répression en Pologne : perspectives des luttes de classe mondiales
- 2794 reads
Le coup de force du 13 décembre 1981 en Pologne a mis fin à l'épisode le plus important depuis un demi-siècle du long combat entre classe ouvrière mondiale et capital. Depuis le resurgissement historique de la lutte prolétarienne à la fin des années 60, jamais la classe ouvrière n'était allée, en effet, aussi loin dans la combativité, la solidarité et 1'auto organisation. Jamais elle n'avait employé avec autant d'ampleur cette arme essentielle de sa lutte dans la période de décadence du capitalisme : la grève de masse. Jamais elle n'avait infligé à la bourgeoisie de telles craintes, ne l'avait contrainte à déployer autant de moyens de défense ([1] [39]). Aujourd'hui, le prolétariat est muselé en Pologne. Une nouvelle fois, il a versé son sang et, contrairement à ce qui s'était passé en 70 et en 76, c'est pour subir une exploitation décuplée, une misère accrue proche de la famine, une terreur déchaînée. C'est donc par une défaite pour la classe ouvrière que se clôt cet épisode. Mais au moment où la coalition de toutes les forces bourgeoises et la force des armes l'obligent à quitter la scène en Pologne, il importe que le prolétariat mondial tire un maximum de leçons de l'expérience qu'il vient de vivre. Il importe qu'il puisse répondre, et avec lui son avant-garde communiste, à la question : Où en sommes-nous? Quelle perspective pour la lutte de classe?
POLOGNE 1980-81 : LE DEBUT DES"ANNEES DE VERITE"
Depuis plusieurs années le CCI a présenté les années 80 comme les "années de vérité", celles où "la réalité du monde actuel (se) révélera dans toute sa nudité", où se "décidera pour une bonne part l'avenir de l'humanité" (Revue Internationale n°20). Cette analyse ne tombait pas du ciel. Elle s'appuyait sur un examen sérieux de l'évolution de la situation économique du système capitaliste concrétisé notamment dans la résolution sur la situation internationale du 3ème Congrès du CCI en juin 1979:
"Après plus d'une décennie de dégradation lente mais inéluctable de son économie et d'échec de tous les "plans de sauvetage" mis en œuvre, le capitalisme a administré la preuve de ce que les marxistes n'ont cessé d'affirmer depuis longtemps : ce système est entré dans sa phase de déclin historique et il est absolument incapable de surmonter les contradictions économiques qui 1'assaillent aujourd’hui. Dans la période qui vient, nous allons assister à un nouvel approfondissement de la crise mondiale du capitalisme, sous forme, notamment, d'une nouvelle flambée d'inflation et d'un ralentissement sensible de la production qui risque de faire oublier celui de 1974-75 et provoquera une aggravation brutale du chômage."(Revue Internationale n°18, p.28)
La caractérisation des années 80 comme "années de vérité" s'appuyait également sur le fait :
"Qu’après une période de relatif recul des luttes couvrant le milieu des années 70, la classe ouvrière tend à renouer aujourd'hui avec une combativité qui s'était manifestée de façon généralisée et souvent spectaculaire à partir de 1968."
Par la détérioration inéluctable qu'elle continuera à provoquer sur les conditions de vie des ouvriers, la crise obligera même les plus hésitants à reprendre le chemin de la lutte" (Revue Internationale n°18, p.29) .
Les luttes ouvrières de Pologne qui se développent au cours de l'été 80 et qui, pendant près d'un an et demi, vont occuper une place de premier ordre sur la scène internationale, constituent à ce jour la manifestation la plus important de cette tendance à la reprise des luttes.
Elles ont fait suite à des mouvements sociaux qui ont touché à partir de 1978 un nombre important de pays industriels comme les USA (grève des mineurs des Appalaches), l'Allemagne (sidérurgie), les Pays-Bas (dockers), la France (explosions de Longwy et Dënain) et surtout la Grande-Bretagne qui connait en 1979 le nombre le plus élevé de journées de grève depuis 1926 (29 millions). Mais seules les luttes du prolétariat en Pologne illustrent la tendance "de la nouvelle vague de luttes à redémarrer au niveau qualitatif le plus élevé atteint par la vague précédente." (Idem)
Le fait que ce soit en Pologne qu'aient pris place les premiers grands combats des "années de vérité" résulte de la faiblesse de la bourgeoisie dans les pays dits "socialistes". Faiblesse qui s'exprime tant sur le plan économique que sur le plan politique. En effet, l'explosion ouvrière de l'été 80 provenait directement de la catastrophe économique qui accable le capital polonais, un des maillons les plus faibles de cet ensemble de pays faiblement développés et particulièrement vulnérables à la crise que constitue le bloc de l'Est.
Mais cette explosion a pu avoir lieu parce que, sur place, la bourgeoisie ne disposait pas d'une des armes essentielles qu'elle utilise aujourd'hui contre le prolétariat : une gauche chargée, grâce à son langage "ouvrier" et sa place dans l'opposition, de saboter de l'intérieur, de dévoyer et d'épuiser les luttes ouvrières.
Dans les grandes concentrations ouvrières d'Occident, frappées elles aussi, ces dernières années, d'une manière cruelle par la crise, comme en témoigne entre autres le niveau de chômage (presque 30 millions de chômeurs pour l'OCDE), c'est de façon préventive que la bourgeoisie a fait face à la tendance à la reprise des combats prolétariens.
Elle s'est appuyée fondamentalement sur les manœuvres de la gauche, partis "ouvriers" et syndicats, à qui il revenait la tâche essentielle d'immobiliser la classe ouvrière, de lui lier les mains pendant que les équipes gouvernementales se chargeaient de mettre en œuvre une austérité accrue. L'exemple le plus clair nous en a été donné par la Grande-Bretagne où, dès 1978, face aux luttes ouvrières, les travaillistes et les trade-unions passaient dans l'opposition, renonçaient au "contrat social" chargé de faire adhérer les travailleurs aux objectifs gouvernementaux et radicalisaient de façon notable leur langage contre la politique de Thatcher. C'est grâce à cette "gauche dans l'opposition" que la bourgeoisie anglaise, une des plus aguerries du monde, a réussi à venir à bout des luttes de 78-79, et en 80-81 à faire taire en bonne partie le prolétariat au moment où celui-ci subissait une des attaques les plus violentes de son histoire.
En Europe de l'Est, les régimes en place, directement issus de la contre-révolution, basant leur pouvoir essentiellement sur la terreur policière, n'ont pas la même souplesse. En 1980, en Pologne, face à l'ampleur du mouvement de grèves et dans un contexte international de reprise des luttes, la bourgeoisie ne peut pas employer comme en 70 et en 76 la répression sanglante. En août, elle est débordée par la situation et c'est dans la brèche ouverte dans ses lignes de défense que s'est engouffré le prolétariat pour mener les combats les plus importants depuis un demi-siècle.
Ainsi, ce n'est pas seulement à cause de la gravité de la crise et de l'attaque contre le niveau de vie des travailleurs que les luttes en Pologne ont pris une telle ampleur. L'incapacité de la bourgeoisie locale à utiliser les armes politiques qui ont fait leurs preuves en Occident est un facteur au moins aussi important pour expliquer ce phénomène.
Ce n'est qu'à chaud" avec la création du syndicat "Solidarité", que la classe dominante a pu se doter d'une telle arme efficace contre le prolétariat. Et c'est à l'échelle internationale que la bourgeoisie a mené sa contre-offensive. En août 80, elle a compris à son tour de façon claire que nous étions entrés dans les années "dé vérité" et elle a accéléré ses préparatifs pour les affronter.
LE DEPLOIEMENT DES FORCES DE LA BOURGEOISIE
Ayant compris la dimension mondiale de son combat contre le prolétariat, c'est donc bien à l'échelle du monde entier que la bourgeoisie a développé son dispositif. Pour cela, elle a su faire passer au second plan ses antagonismes inter-impérialistes quitte à employer ses divisions réelles comme moyen d'un partage des tâches.
Dans ce partage, il est revenu aux gouvernements du bloc de l'Est le soin d'intimider les ouvriers de cette région par des menaces d'intervention et de répression violente de la part du "grand frère". Ces gouvernements avaient également la tâche de déconsidérer à leurs yeux les luttes ouvrières de Pologne au moyen de campagnes nationalistes sur le mode : "les polonais sont des paresseux et des énergumènes", "c'est pour cela que leur économie s'effondre", "leur agitation est responsable de nos propres difficultés économiques". ..
Mais l'essentiel du travail est revenu aux grandes puissances occidentales qui ont accompli de front toute une série de tâches :
-sauvetage économique du capital polonais en faillite, notamment à travers un rééchelonnement de sa dette,
-crédibilisation des campagnes d'intimidation développées par Moscou au moyen notamment de "mises en garde contre toute intervention extérieure en Pologne", amplement répercutées dans ce pays par les médias du type "Radio Free Europe" et BBC,
-campagnes en direction des prolétaires d'Occident sur le thème : "les problèmes affrontés par les ouvriers en Pologne sont spécifiques à ce pays ou à ce bloc" (gravité de la crise économique, pénurie, misère, "totalitarisme")
-prise en charge, tant matérielle que politique, par la gauche et les syndicats de l'Ouest, de la mise en place de l'appareil de "Solidarnosc" (envois de fonds, de matériels d'impression, de délégations chargées d'enseigner au nouveau-né les diverses techniques de sabotage des luttes...)
-sabotage systématique des luttes ouvrières dans les pays de l'Ouest par ces mêmes organisations qui ont employé tout l'arsenal classique ("journées d'action", "grèves" bidon, divisions de la classe en secteurs professionnels ou géographiques) mais auquel elles ont ajouté ces derniers mois d'énormes campagnes pacifistes destinées à détourner vers une impasse démobilisatrice l'inquiétude réelle et justifiée des travailleurs face à la menace de guerre (cf. article "crise et lutte de classe" dans la Revue Internationale n°28). Il est remarquable que, pour faciliter leur travail de sabotage de la combativité ouvrière, les syndicats d1 Occident -juste retour des choses- se soient servis, pour redorer leur blason, de la popularité de "Solidarité" auprès des ouvriers qu'ils ont pour tâche d'encadrer : le cynisme et la duplicité de la bourgeoisie, surtout celle de gauche, n'ont pas de limites!
En Pologne même, cette offensive bourgeoise d'affaiblissement de la classe ouvrière mondiale a eu pour résultat :
-le développement du "syndicat indépendant" au détriment de la plus grande conquête d'août 80 : la grève de masse, l'auto-organisation de la lutte.
-le développement des illusions nationalistes, démocratiques, et autogestionnaires promues par ce syndicat et qui trouvaient un des leur principaux aliments dans la passivité du prolétariat des autres pays.
Contrairement aux inepties débitées par ceux qui pensaient qu'en Pologne le prolétariat radicalisait sa lutte et s'apprêtait à livrer au capitalisme un combat décisif (voire même la révolution!), il est important donc de comprendre comment s'est produit, entre août 80 et décembre 81, cet affaiblissement progressif, malgré les énormes réserves de combativité de la classe ouvrière en Pologne; de comprendre et de mettre en évidence pourquoi, entre ces deux dates, la bourgeoisie a attendu presque un an et demi pour déchainer sa répression. Il s'agit de faire apparaître clairement que cette répression n'est pas intervenue parce que la bourgeoisie et son agent au sein du prolétariat "Solidarité" auraient été débordés, mais bien, au contraire, parce que, face à leur offensive, le prolétariat s'est retrouvé en POSITION DE FAIBLESSE. Et cette faiblesse, C'EST AU NIVEAU MONDIAL QU'ELLE S'EST REVELEE.
LA DEFAITE OUVRIERE.
Avec l'instauration de l'état de guerre en Pologne, le prolétariat a subi une défaite ; il serait illusoire et même dangereux de se le cacher. Seuls des aveugles ou des inconscients peuvent prétendre le contraire.
C'est une défaite parce que, dans ce pays, les ouvriers sont aujourd'hui emprisonnés, déportés, terrorisés, astreints de travailler le fusil dans le dos pour des salaires encore plus misérables qu'avant. Leur résistance de plusieurs semaines face au coup de force, pour courageuse et déterminée qu'elle fut, était vouée à l'échec.
Les différentes formes de résistance passive elles-mêmes seront vaincues à la longue, car elles ne sont plus le fait de larges mouvements de masse, d'une action collective et organisée de la classe, mais d'une somme d'ouvriers dont la répression et la terreur ont rétabli 1'atomisation.
C'est une défaite parce qu'en Pologne, le prolétariat s'est laissé tromper et démobiliser par les mystifications mises en avant par la bourgeoisie et que, du fait que son ennemi le plus pernicieux, "Solidarité" ,ne s'est pas clairement démasqué et de plus, jouit maintenant de l'auréole du martyr, la répression qu'il subit aujourd'hui ne lui donne pas réellement les moyens de tirer pleinement les leçons de son expérience, de prendre clairement conscience des enjeux de sa lutte.
C'est enfin et fondamentalement une défaite parce que ce coup de force atteint le prolétariat de tous les pays sous forme de démoralisation et surtout d'une réelle désorientation, d'un déboussole-ment certain face aux campagnes déchaînées par la bourgeoisie depuis le 13 décembre 81 et prenant le relais de celles d'avant cette date.
Cette défaite, le prolétariat mondial l'a subie dès lors que le capitalisme, d'une façon concertée, est parvenu à isoler le prolétariat de Pologne du reste du prolétariat mondial, à l'enfermer idéologiquement dans le cadre de ses frontières de bloc (pays "socialistes" de l'Est) et nationales ("la Pologne est une affaire de polonais"); dès lors qu'il est parvenu, grâce à tous les moyens dont il dispose, à faire des ouvriers des autres pays des SPECTATEURS, inquiets, certes, mais PASSIFS, à les détourner de la seule forme que peut avoir la solidarité de classe : la généralisation de leurs luttes dans tous les pays, en mettant en avant une caricature hideuse de solidarité : les manifestations sentimentales, les pétitions humanistes et la charité chrétienne avec ses envois de colis pour Noël.
LA NON GENERALISATION DE LA LUTTE OUVRIERE EST EN SOI UNE DEFAITE. C'est la première et la plus essentielle des leçons des événements de Pologne.
Le coup du 13 décembre, sa préparation et ses suites sont une victoire de la bourgeoisie. Ce sont des exemples douloureux pour le prolétariat de l'efficacité de la stratégie mondiale du capital de "gauche dans l'opposition". Cet exemple illustre une fois de plus que, dans la décadence du capitalisme, la bourgeoisie n'affronte pas le prolétariat de la même façon qu'au siècle dernier. A cette époque les défaites infligées au prolétariat, les répressions sanglantes, ne lui laissaient pas d'ambiguïté sur qui étaient ses amis et ses ennemis : ce fut notamment le cas lors de la Commune de Paris et même de la révolution de 1905 qui, tout en annonçant déjà les combats de ce siècle (la grève de masse et les conseils ouvriers) comportait encore des caractéristiques propres au siècle dernier (notamment quant aux méthodes de la bourgeoisie). Aujourd'hui par contre, la bourgeoisie ne déchaîne la répression ouverte qu'à la suite de toute une préparation idéologique, dans laquelle la gauche et les syndicats jouent un rôle décisif, et qui est destiné tant à affaiblir les capacités de défense du prolétariat qu'à l'empêcher de tirer tous les enseignements nécessaires de la répression.
Le capitalisme n'a pas renoncé et ne renoncera jamais à l'emploi de la répression ouverte et brutale contre le prolétariat. C'est son arme de prédilection dans les pays arriérés, là où le prolétariat est le moins concentré. Mais son champ d'action ne se limite pas à ces régions. Partout, c'est une arme destinée à parachever une défaite du prolétariat, à le dissuader le plus longtemps possible de reprendre le combat, à "faire un exemple" à l'égard de l'ensemble de la classe ouvrière, à la démoraliser. C'est en cela que consistait la fonction du coup de force du 13 décembre 81 en Pologne.
Cependant, dans les grandes concentrations ouvrières, l'arme essentielle de la bourgeoisie est l'arme idéologique. C'est pour cela que le prolétariat doit se garder d'une accumulation de défaites idéologiques comme celle d'aujourd'hui, qui viendrait saper le potentiel de combativité de ses bataillons décisifs et l'empêcherait d'engager le combat frontal contre le capitalisme.
QUELLES PERSPECTIVES ?
Premier assaut d'envergure des "années de vérité" contre la forteresse capitaliste, les luttes ouvrières de l'été 80 en Pologne constituaient, même si leurs protagonistes n'en n'étaient pas conscients, un appel au prolétariat mondial.
Brouillé par tous les bruits de la propagande bourgeoise, cet appel à la généralisation du combat n'a pas été entendu. Bien au contraire.
Si on se réfère par exemple aux statistiques du nombre de jours de grèves (qui sans être un critère absolu, indiquent quand même une tendance), les années 80 et 81 comptent parmi celles depuis 1968 où la combativité ouvrière s'est manifestée le moins. A l'heure présente, dans des grandes puissances capitalistes comme les USA et l'Allemagne, la bourgeoisie est capable de faire accepter aux ouvriers, sans réaction de leur part, des baisses importantes de leur niveau de vie (cf. accords dans l'automobile aux USA, dans la métallurgie en RFA). Le "cordon sanitaire" mis en place par la bourgeoisie mondiale autour du prolétariat "pestiféré" de Pologne a été efficace. Relativement désarçonnée en août 80, la bourgeoisie a finalement remporté, et de manière nette, ce premier affrontement.
Est-ce à dire que le prolétariat est d'ores et déjà battu, que dès à présent la bourgeoisie a les mains libres pour apporter à la crise de son système sa propre réponse : l'holocauste impérialiste?
Ce n'est pas le cas. Pour cruelle qu'elle soit, la défaite subie par le prolétariat à la suite de ses combats en Pologne n'est que partielle. Pour les mêmes raisons qui ont fait que le premier engagement des "années de vérité" a eu lieu dans ce pays (faiblesse de son économie et de son régime), qui ont permis à la bourgeoisie d'isoler aussi facilement les combats qui s'y sont déroulés (pays de second ordre, relativement excentré par rapport aux grandes concentrations industrielles et prolétariennes), pour ces mêmes raisons, les combats de Pologne n'étaient pas décisifs. La défaite est partielle parce que l'affrontement n'était que partiel C'est un bataillon détaché du prolétariat mondial parti en éclaireur qui a engagé le combat. Par contre, le gros des troupes, celui qui est basé dans les énormes concentrations industrielles d'Occident, et notamment en Allemagne, n'est pas encore entré dans la bataille. Et c'est pour tenter de l'en empêcher que s'est développée la campagne actuelle de la bourgeoisie d'Occident sous la conduite du chef d'orchestre Reagan (ce n'est pas un hasard si on a parlé du "Reagan show").
Cette campagne est la continuation de celle qui avait été mise en place bien avant le coup de force du 13 décembre 81 et qui l'avait rendu possible.
La seule différence consiste dans le fait qu'avant cette date, la campagne visait simultanément les ouvriers d'Occident et ceux de Pologne dans la mesure où ceux-ci restaient en première ligne des affrontements de classe, alors que maintenant la bourgeoisie occidentale vise primordialement le prolétariat de son bloc. Après avoir fait taire le détachement le plus combatif du prolétariat mondial, il revient au capital de concentrer l'attaque idéologique en direction des bataillons les plus importants : ceux dont dépendra l'issue du combat.
C'est en ce sens qu'on ne doit pas considérer ces campagnes comme des préparatifs idéologiques directs en vue de la guerre impérialiste. Certes, chacun des blocs ne perd aucune occasion de marquer des points dans ce domaine dans la mesure où les conflits entre blocs ne disparaissent jamais. De même il est clair que l'aboutissement d'une éventuelle défaite générale du prolétariat serait un nouvel holocauste impérialiste. Cependant, il est important de souligner que l'objectif prioritaire de la présente campagne est de prévenir les surgissements prolétariens dans les principales métropoles du capitalisme en tentant de faire coller les ouvriers de ces pays au char de l'Etat "démocratique". L'utilisation du repoussoir du "totalitarisme du bloc de l'Est" n'a pas pour fonction immédiate l'embrigadement guerrier contre l'autre bloc, mais la DEMOBILISATION DES LUTTES OUVRIERES qui est la condition PREALABLE à cet embrigadement.
De la même façon que dans les campagnes pacifistes, la peur de la guerre est exploitée pour détourner le prolétariat de son terrain de classe, dans le "Reagan Show" actuel, la division entre blocs et entre pays est utilisée pour briser la combativité du prolétariat et son front de lutte. Face à lui, on assiste, non pas à une division entre secteurs de la bourgeoisie, mais à une division du travail entre ces secteurs.
Quelles sont les chances de réussite de cette campagne de la bourgeoisie?
Même si cette classe n'a pas encore aujourd'hui les mains libres pour apporter sa propre réponse guerrière à la crise, ne faut-il pas craindre qu'elle réussisse à maintenir sa chape de plomb idéologique jusqu'à étouffer complètement et définitivement la combativité prolétarienne?
Ce danger existe et nous l'avons signalé plus haut. Mais il est important de mettre en évidence les atouts dont dispose aujourd'hui le prolétariat et qui distinguent la situation présente de celles qui existaient à la veille de 1914 ou dans les années 30 à des moments où le rapport de forces global penchait en faveur de la bourgeoisie. Dans ces deux cas, le prolétariat avait été directement battu dans les grandes métropoles (en particulier, dans celles d'Europe occidentale : Allemagne, France, Grande-Bretagne), soit sur un plan uniquement idéologique (à la veille de 1914 grâce au poids du réformisme et à la trahison des partis socialistes) soit sur les deux plans physique et idéologique (après la terrible défaite des années 20).
Tel n'est pas le cas aujourd'hui ([2] [40]), où les générations ouvrières dans les grands centres industriels n'ont pas subi de défaite physique, où les mystifications démocratiques ou antifascistes n'ont plus le même impact que par le passé, où le mythe de la "patrie socialiste" est moribond, où les anciens partis ouvriers passés à l'ennemi capitaliste, le PC et le PS, ont un pouvoir d'embrigadement du prolétariat bien moindre qu'au moment de leur trahison.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que les réserves de combativité du prolétariat sont encore pratiquement intactes et, comme on l'a vu avec la Pologne, énormes.
Cette combativité, la bourgeoisie ne pourra pas la contenir indéfiniment, malgré toutes les campagnes, manœuvres, mystifications qu'elle déploie à l'échelle internationale. Toute mystification, pour être efficace, a besoin de s'appuyer sur une apparence de vérité.
Or les mystifications grâce auxquelles la bourgeoisie réussit encore à empêcher la classe ouvrière mondiale d'engager un combat massif sont destinées à être directement attaquées par l'aggravation de la crise :
-le mythe des "Etats socialistes" qui, en son temps, fut une des armes majeures de l'embrigadement de la classe ouvrière par le capitalisme, vit aujourd'hui ses dernières heures face à la déroute économique de ces Etats, à la misère croissante qui s'abat sur la classe ouvrière qui y vit et aux explosions sociales qui en résultent;
-l'idée qu'il existe des "spécificités nationales" ou de bloc, qui a permis l'isolement du prolétariat en Pologne, sera de plus en plus battue en brèche par le nivellement par le bas de la situation économique de tous les pays ainsi que des conditions de vie de tous les travailleurs;
-l'illusion qu'en acceptant des sacrifices on pourra s'éviter une situation bien pire (illusion qui a pesé sur les ouvriers américains ou allemands lorsqu'ils ont consenti à des baisses de salaires en échange d'une hypothétique garantie de l'emploi) ne pourra pas résister indéfiniment à l'aggravation inexorable de cette situation;
-la croyance dans les vertus de telle ou telle potion miracle ("économie de l'offre", nationalisations, autogestion, etc.), capable, sinon de rétablir (on n'en n'est plus là], mais d'empêcher l'aggravation de la situation économique, se heurte de plus en plus durement à la réalité des faits.
Plus généralement, c'est l'ensemble des piliers idéologiques du système actuel qui subira l'assaut de son effondrement économique :
-toutes les grandes phrases des politiciens sur "la civilisation", la "démocratie", les "Droits de l'homme", la "solidarité nationale", la "fraternité humaine", la "sécurité", "l'avenir de la société", etc. apparaîtront de plus en plus pour ce qu'elles sont : de vulgaires rodomontades, des mensonges cyniques;
-à des masses croissantes de prolétaires, y compris ceux des pays jusqu'à présent les plus "prospères", le système actuel dévoilera sa véritable nature et deviendra synonyme pour eux de barbarie, de terreur étatique, d'égoïsme, d'insécurité et de désespoir.
Malgré et à cause des terribles épreuves que l'aggravation de la crise impose au prolétariat, celle-ci constitue donc un atout pour lui. C'est un atout d'autant plus important que le développement de la crise présente est bien plus apte à lui ouvrir les yeux que celui de la crise de 1929. En effet, après la violente chute du début des années 30, le capitalisme avait donné pendant quelques années l'illusion d'un rétablissement grâce aux interventions étatiques massives et notamment le développement d'une économie de guerre. Ce rétablissement momentané qui s'est achevé en 1938 a permis cependant de finir de démobiliser le prolétariat, déjà considérablement affaibli par les défaites des années 20, et de le jeter, pieds et mains liés, dans la seconde boucherie mondiale.
Aujourd'hui, par contre, la bourgeoisie a épuisé toutes les ressources des politiques néo-keynésiennes et a depuis des décennies déjà développé pleinement son économie de guerre. Elle ne peut plus offrir à la société aucune illusion de rétablissement : le caractère absolument inexorable de la crise s'impose à tous avec d'autant plus de force. Et cela, au point même que même les plus fervents défenseurs universitaires du capitalisme, les économistes, avouent leur totale impuissance » Après que le prix Nobel "néo-keynésien", Paul Samuelson ait constaté amèrement en 1977, "la crise de la science économique", c'est son rival, le prix Nobel "monétariste" Milton Friedman, qui avoue en septembre 1977 : "Je ne comprends pas ce qui se passe" (Newsweek).
Si la récession de 1971 avait été suivie jusqu'en 73 d'une reprise euphorique, celle de 1974-75 n'avait laissé la place qu'à une reprise languissante et celle qui commence en 1980 n'en finit pas de traîner et de démentir les prévisions sur une "nouvelle reprise". C'en est bien fini de toutes les potions administrées au long des années 70 pour retarder les échéances et qui deviennent aujourd’hui un facteur d'aggravation du mal. Confrontées à la surproduction de marchandises, les grandes puissances capitalistes ont tenté de vendre celles-ci en usant et abusant du crédit. Le résultat est remarquable rentre 71 et 81, la dette totale du Tiers-Monde est passée de 86,6 à 524 milliards de dollars avec une augmentation de 118 milliards pour 1981. La plupart de ces pays sont maintenant en cessation de paiement : au pays du "miracle", le Brésil, champion du monde de l'endettement, sur 100 dollars empruntés il n'y en a aujourd'hui que 13 qui soient investis productivement; les 87 autres sont destinés à payer les intérêts et les amortissements des dettes antérieures. Mais cet endettement du Tiers-Monde n'est qu'une partie de l'endettement total, qui dépasse de loin les 1000 milliards de dollars et grâce auquel le capitalisme a tenté d'esquiver la crise au cours des années 70. La banqueroute du Tiers-Monde signe celle de toute l'économie mondiale.
Alors que la crise trouve son origine au centre du capitalisme, les pays où il est le plus développé, ceux-ci ont tenté pendant une décennie d'y résister en repoussant les effets les plus brutaux vers la périphérie. Mais telles les ondes à la surface d'un bassin qui reviennent vers le centre après avoir atteint ses bords, les convulsions les plus violentes de la crise reviennent, avec une force accrue, frapper les métropoles du capital y compris cette "Allemagne modèle" qui faisait tant d'envieux et qui connait aujourd'hui une des progressions du chômage les plus fortes d'Europe.
C'est maintenant le prolétariat de ces métropoles qui est frappé de plein fouet par la crise et qui sera contraint, malgré toutes les manœuvres de la gauche dans l'opposition qui ne pourront à la longue que s'user, de reprendre le combat, comme a commencé à le faire celui des pays périphériques (Brésil 78-79, Pologne 80-81 par exemples). Ce prolétariat, la bourgeoisie ne pourra pas l'isoler aussi facilement qu'elle l'a fait avec celui de Pologne.
Alors seront données les conditions d'une réelle généralisation mondiale des luttes prolétariennes, comme les combats de Pologne en ont mis en évidence la nécessité ([3] [41]). Cette généralisation n'est pas une étape simplement quantitative du développement de la lutte de classe. C'est un pas réellement QUALITATIF qu'accomplira le prolétariat en la réalisant :
-elle seule permettra de surmonter les illusions nationalistes, syndicalistes, démocratiques, véhiculées notamment par la gauche, qui pèsent sur le prolétariat,
-elle seule permettra de mettre en échec la solidarité et la coopération réalisée par la bourgeoisie face à la lutte de classe,
-elle seule créera les conditions où pourra se poser le problème du renversement de l'Etat capitaliste, de la prise du pouvoir par le prolétariat (contrairement à ce que pensent certains, dont le GCI, qui posaient déjà comme tâche aux ouvriers de Pologne de prendre les armes.
-elle seule donnera les moyens au prolétariat de prendre conscience de sa force, et du fait que sa lutte représente le seul espoir de toute l'humanité, que la véritable signification de ses multiples combats est de constituer autant de préparatifs pour la révolution communiste, dont Vidée lui deviendra de nouveau familière après plus d'un demi-siècle d'éclipsé."
C'est donc parce que la crise frappe maintenant de plein fouet les grandes métropoles capitalistes que cette généralisation devient possible. Son chemin en sera long et heurté et comportera encore d'autres défaites, partielles mais douloureuses. L'essentiel de ces combats est devant nous; pendant longtemps encore, le prolétariat se heurtera aux sabotages de la gauche et en particulier de ses fractions "radicales" comme le "syndicalisme de base". Ce n'est qu'après avoir débusqué ses multiples pièges et avoir engagé le combat contre elle qu'il pourra s'attaquer frontalement à l'Etat capitaliste en vue de le détruire.
C'EST UNE LONGUE ET DIFFICILE BATAILLE QUI S'ANNONCE, MAIS RIEN N'INDIQUE QU'AVEC POUR ALLIE L'EFFONDREMENT IRREVERSIBLE DE L'ECONOMIE CAPITALISTE, LE PROLETARIAT NE SOIT PAS EN MESURE DE LA REMPORTER.
F.M. 12-3-82
[1] [42] Sur la portée des luttes ouvrières en Pologne, la grève de masse, les moyens déployés par la bourgeoisie mondiale contre le prolétariat, le lecteur pourra se reporter aux articles parus dans la Revue Internationale n°23,24,25,26,27 et 28 ainsi que dans la brochure à paraitre prochainement.
[2] [43] Voir à ce sujet le Rapport sur le cours historique au 3° congrès du C.C.I. dans la Revue Internationale n°18
[3] [44] Voir le texte sur "La généralisation mondiale des luttes" dans la Revue Internationale n°26
Géographique:
- Pologne [45]
Récent et en cours:
- Mouvement étudiant [46]
Heritage de la Gauche Communiste:
Lutte de classes en Europe de l’est (1970 -1980)
- 3093 reads
L'unification internationale du prolétariat dans le processus de la révolution mondiale est la condition matérielle la plus décisive du communisme. Après avoir mis en relief la puissance des luttes ouvrières dans les pays de l'Est de l920 à 1970 et les limites que leur a imposé leur isolement international (Revue Internationale n° 27 et 28), la fin de cette étude montre comment les luttes des années 80 ouvrent la perspective de la fin de cet isolement.
LA VAGUE DE LUTTES DES ANNEES 70 A L’EST
En septembre 1976, les oppositionnels tchèques faisaient état dans le journal "Listy Blâtter" du développement d'une nouvelle vague de résistance en URSS :
"Le 8 novembre de 1'année dernière, soixante marins russes, Lettoniens et Estoniens de la flotte du Drapeau Rouge, se mutinèrent à bord du destroyer "Storoschewoi". Le bateau après avoir quitté le port de Riga fut attaqué en haute mer par des hélicoptères et des sous-marins. La bataille passe pour avoir été très sanglante, la majorité des marins ayant été tués et les survivants passés en cour martiale ou exécutés. La cause de la rébellion : des conditions sociales insupportables et des traitements inhumains, similaires à ceux du vaisseau tsariste "Potemkine" en 1905 à Odessa. Il y a également 1'agitation continuelle dans la métropole géorgienne 'Tiflis' qui fut rapportée en avril par 1'organe du parti "Sarja Wostoka". Manifestations de rue de lycéens et d'étudiants, assassinats de fonctionnaires du parti russe et de leurs collaborateurs, des manifestations spontanées pour la liberté d'ouvriers et de femmes, et même des affrontements de rues, barricades et attentats à la bombe contre les palaces du parti. L'agitation a pris un caractère de masse, et ne peut être complètement contenue par la police secrète.
En dernier lieu, nous devons mentionner la vague de grèves récentes provoquée par le rationnement alimentaire, concentrée ici encore, dans les centres industriels des régions en dehors de la Russie (Baltique, Ukraine). Le ravitaillement échauffe 1'atmosphère de pré-révolution; des arrêts de travail spontanés, des rassemblements de masse, des marches, des meetings de protestations ont été rapportés, venant des villes de Rostov sur le Don, Lvov, Kiev, Dniepropetrovsk, Riga et Dnieprodzeijinsk Dans la métropole ukrainienne de Kiev, des affrontements sanglants eurent lieu entre des femmes ouvrières et la milice en face des magasins d'alimentation vides. Les rationnements les plus importants concernent 1'approvisionnement en aliments de première nécessité -viande, pain, produits laitiers. Dans les entreprises de machine-outil Tscheljabinsk et d'industrie chimique Schtschokino, des grèves ont éclaté en réaction aux lock-out".
Mis à part le caractère aberrant de l'expression "une atmosphère prérévolutionnaire", il ne peut y avoir aucun doute sur l'étendue des troubles sociaux qui ont saisi de larges régions d'URSS vers la fin des années 1970. Un rapport raconte à quelle vitesse Brejnev fut obligé de se rendre à Toula en 1977 à cause d'un mouvement de grève oui s'y était déclenché. Les ouvriers, là, avaient refusé d'aller chercher leurs salaires durant deux mois, parce qu'ils ne pouvaient rien acheter avec. Brejnev décida -33 ans après la fin de la dernière guerre- de proclamer Toula "ville héroïque" pour son rôle dans la victoire contre Hitler. Ce statut impliqua un meilleur approvisionnement en nourriture (rapporté dans "Osteuropakomitee, Info 32" Socialist review, été 80).
Au mois de décembre de la même année eut lieu une violente grève dans la grande usine de caoutchouc de Kaunas en Lituanie et peu après, une grève perlée dans l'industrie mécanique (Poutilov) à Leningrad, celle qui fut au cœur de la révolution d'octobre, en protestation contre le mauvais traitement des prisonniers travaillant dans l'usine (rapporté dans "Listy").
En 1973, des grèves de protestations éclatèrent dans les mines de Roumanie. Comme en 70, elles furent violentes mais elles restèrent sporadiques et isolées (rapporté dans "Der Spiegel, 12.12.77). En 1977, les mineurs, le cœur militant de la classe ouvrière en Roumanie, reprenaient le flambeau de la lutte. La grève éclata à Lupeni et s'étendit immédiatement à toutes les vallées minières voisines. En tout, 90.000 personnes se mirent en grève, dont 35.000, retranchées dans Lupeni pour prévenir le danger d'une répression. Le second jour, plusieurs des membres d'une délégation du sommet du parti, envoyés pour "négocier" furent fait prisonniers, et d'autres eurent le visage barbouillé de l'infâme nourriture que l'on donne à manger aux ouvriers. Ceausescu vint alors en personne et eut beaucoup de chance de s'en tirer vivant. Les ouvriers tentèrent de le lyncher. Il s'enfuit immédiatement au Kremlin pour s'entretenir avec Brejnev. Un détachement de l'Armée Rouge envoyé pour disperser les ouvriers changea d'avis quand il rencontra leur résistance. Puis, alors que la grève commençait à s'étendre au delà des bassins miniers de la vallée de Jiul -aux chemins de fer, à une usine textile de Brasov, à une usine de machinerie lourde de Bucarest- Ceausescu revint pour satisfaire les revendications ouvrières. Deux semaines durant, la situation de l'approvisionnement s'aggrava gravement. L'armée revint alors : 2000 hommes appartenant aux troupes de choc furent envoyés à Lupeni. Ils attaquèrent les ouvriers, et en battirent un grand nombre jusqu'à les rendre infirmes à vie. Puis ils déportèrent 16.000 mineurs avec leurs familles dans différentes parties du pays. Beaucoup furent envoyés travailler dans les mines d'uranium où ils perdirent leurs cheveux en quelques semaines; le cancer se répandit parmi eux en quelques mois. Le slogan principal des mineurs de Lupeni était "à bas la bourgeoisie prolétarienne". Dans leur cinquième lettre à "Radio free Europe", les ouvriers écrivirent :
"De tout notre cœur, nous vous demandons de lire cette lettre au micro; n'ayez pas peur qu'il soit connu qu'il y a des grève dans un Etat socialiste. Il y en aura encore plus car nous n'avons pas d'autre solution que de rendre la justice nous-mêmes avec nos manches de pioches".
En septembre, l'agence allemande d'informations DPA parla de nouvelles grèves dans la région. A partir du 1er janvier 1978, la vallée de Jiul fut déclarée "zone interdite", isolée de tout contact extérieur.
Les problèmes de l'isolement des ouvriers de Roumanie sont semblables à ceux rencontrés en URSS. Ceci explique la nature pernicieuse du régime de Ceausescu, tant exalté à l'ouest pour son "indépendance" vis à vis de Moscou et son soi-disant "engagement à la paix". Le gouvernement de Ceausescu est en fait le plus haï de tous ceux du bloc de l'Est, à l'exception du régime de Honecker en RDA.
Vers la fin des années 70, le mécontentement de la classe ouvrière a commencé à se manifester dans la partie ouest du bloc. Déjà en 1971, une série de grèves ont eu lieu à Budapest selon certains rapports. En 1975, "Der Spiegel" rapporte ce qui suit sur la situation en Tchécoslovaquie :
"Des tracts distribués dans de nombreuses usines parlent d'actions de protestations qui montrent un mécontentement des ouvriers dirigé contre le régime : dans le complexe industriel de Prague, dans des entreprises sidérurgiques de 1'est de la Slovaquie, parmi les cheminots". (Der Spiegel n°18).
Des rapports sur des comités de grève de protestation sont parvenus de Tchécoslovaquie de manière fréquente depuis lors, par exemple, dans l'usine CKD de construction de machines à Pragueen lutte contre la hausse des prix (rapporté dans "Intercontinental Press" n°49. 1978).
La paix sociale fragile qui a régné en Allemagne de l'Est depuis 1953, en raison de la hausse dissimulée des prix prit fin à l'automne 1977. En octobre de cette année là, un mouvement de grève éclata à Karl-Marx Stadt qui fut violemment écrasé par des troupes de choc et par la police politique. 50 ouvriers furent arrêtés. Les chefs de l'administration locale furent décorés de la "médaille Karl Marx" en récompense pour le rôle qu'ils ont joué dans l'écrasement de la révolte. Le 7 octobre, une foule de jeunes gens se battirent contre la police dans le centre de Berlin-Est alors qu'elle tentait de disperser un concert de rock. Plusieurs personnes furent tuées dont deux policiers. La population dans les quartiers ouvriers voisins du lieu ("Prenz lauerberg") protégèrent les jeunes gens en les cachant dans leurs maisons et en jetant de l'huile bouillante sur les policiers qui les poursuivaient. Quelques jours après, les ouvriers des ateliers de Narva à Berlin-Est entrèrent en grève, demandant qu'un tiers de leur salaire soit payé en devises occidentales. La Stasi (police politique) dut se rendre chez les ouvriers chaque jour, les forcer à travailler, et les ramener chez eux le soir (rapporté par R. Havemann dans une interview avec "Le Monde" du 21/1/78).
Une série de grèves eurent lieu aussi à Dresde où la même revendication fut soulevée. Au cours du même mois, les ouvriers du bâtiment se mirent en grève ("Der Spiegel". 17/10/77). Une nouvelle loi fut promulguée le 1/1/78 prévoyant des amendes d'un demi-million de marks pour les ouvriers en grève! De telles mesures n'ont pas réussi à intimider les ouvriers. En mai 1978, dans les villes de Witten-berge et d'Erfurt, des affrontements violents avec la police furent signalés. Dans la seconde moitié de 1979 jusqu'en 1980, des rapports sur des grèves et des actions de protestations furent connus à l'ouest; par exemple, une grève des dockers de Rostock qui retinrent du matériel de guerre en partance pour le Vietnam ainsi qu'une grande grève à Walterhausen qui se termina par une série d'arrestations.
LES EFFETS DE LA CRISE
La progression quantitative et qualitative de la lutte de classe dans les pays de l'Est ne peut être comprise que dans le contexte d'une aggravation de la crise de l'économie mondiale qui a éliminé les dernières illusions sur le fait que les pays de l'est pourraient offrir un débouché à la surproduction du bloc occidental. L'exacerbation de la crise et donc de la concurrence sur le marché mondial rend de plus en plus difficile pour le C0MEC0M de vendre ses produits à l'étranger et donc d'obtenir des devises, nécessaires au remboursement de ses dettes aux pays du bloc de l'Ouest Plus la crise mondiale se développe, plus s'exacerbe la concurrence sur les marchés et plus les pays membres du C0MEC0N tendent à chancelier vers la faillite.
Par ailleurs la crise exacerbe les conflits in-ter-impérialistes entre les deux blocs et force la bourgeoisie de chaque bloc à attaquer le prolétariat plus âprement afin de fournir un effort militaire grandissant. La solution bourgeoise à la crise, c'est la guerre. Si la crise a provoqué une chute rapide du niveau de vie de la classe ouvrière (hausse des prix et rationnement de plus en plus fort dans tous les pays du COMECON), elle a rendu aussi nécessaire en 1979 l'invasion de l'Afghanistan. Et ce tournant dans l'accélération de la militarisation appelle à des attaques encore plus dures contre la classe ouvrière.
La rivalité entre les blocs et la lutte entre classes sont les deux pôles autour desquels tourne le capitalisme décadent. De ces deux pôles, celui de la lutte de classe est fondamental. En 1'ABSENCE de guerre de classe, la rivalité entre les blocs devient dominante. Quand nous parlons de guerre de classe, nous voulons parler du combat prolétarien car l'attaque de la bourgeoisie contre la classe ouvrière est, elle, permanente. Depuis la fin des années 60, la guerre de classe a été le facteur dominant dans le monde pour la première fois depuis presque un demi-siècle. L'invasion russe en Afghanistan n'est pas venue altérer ce fait. Celle-ci a exprimé une tension grandissante entre les blocs, mais cette tension reste secondaire si, en retour, elle provoque de la part des ouvriers une réponse à un niveau qualitativement plus élevé. Les deux pôles dominant dans le capitalisme décadent, la rivalité entre les blocs et la guerre de classe sont déterminés par leur objectif respectif : guerre ou révolution. Ceux-ci sont diamétralement opposés l'un à l'autre, mais étant donné que la pleine participation du prolétariat est essentielle pour les deux, la trajectoire de la société dépend de la réponse ouvrière à la crise.
Les luttes des années 50 ont nécessité une collaboration temporaire de la bourgeoisie mondiale. Mais du fait de la restriction de ces luttes à un bloc (en opposition avec la période révolutionnaire de 1917-23 où les deux fronts de guerre étaient touchés par la lutte de classe spécialement sur le front de l'est), elle ne remettait pas en question la domination des rivalités inter-impérialistes sur la société. En face du prolétariat, la bourgeoisie a installé des gouvernements populaires (Gomulka, Naqy, Kroutchev même) soutenus par de nombreuses oppositions de gauche, qui ont essayé d'attacher les ouvriers à ces gouvernements. Le régime de Dubcek en Tchécoslovaquie fut la dernière tentative réussie de contrôler les ouvriers par un gouvernement "populaire". De même, la terreur de masse de l'époque stalinienne touchait à sa fin. Elle était remplacée par une terreur sélective qui avait pour fonction d'aligner immédiatement contre les murs les militants ouvriers dans les usines, mais qui laissait tout de même assez de place aux oppositionnels bourgeois pour mieux manœuvrer contre la classe ouvrière. Ce changement de climat ne correspondait pas encore à une altération dans l'équilibre des forces entre les deux classes antagoniques. Les oppositionnels étaient là pour faire du battage sur l'image démocratique des régimes comme ceux de l'URSS où les "plaintes" du "Samizdat" circulaient sous les yeux du KGB .Et ce dans le même temps où il y avait au moins un million de prisonniers politiques détenus, la plupart prolétaires !
Ces oppositions étaient présentées comme une garantie au fait que le régime pourrait accorder une pleine démocratie aux ouvriers, si ceux-ci étaient prêts à se battre pour la mère-patrie de Kroutchev. Elles étaient "antistaliniennes" et mettaient en garde contre un "retour aux méthodes de Staline". Même quand elles se sont déclarées "marxiste-léniniste", considérant l'URSS comme un Etat capitaliste, (concession évidente à une opinion couramment répandue chez un grand nombre d'ouvriers !), ces oppositions déclaraient habituellement leur loyauté à la constitution (de Staline !), au parti communiste contre "la restauration de la bourgeoisie" (sic) etc. A cette époque, ceux qui étaient pro-occidentaux étaient immédiatement réprimés ou déportés. La principale thèse des "Démocrates" de Russie, d'Ukraine et de la Baltique par exemple (mouvement prétendant avoir 20.000 militants et 180.000 sympathisants) consistait à dire que c'était dans l'intérêt même des gouvernements de se réformer.
UNE NOUVELLE PERIODE DE LUITES
Le resurgissement international de la lutte de classe dans les années 70 a change" l'équilibre des forces entre classes et a laissé la bourgeoisie, y compris ses fractions oppositionnelles dans le désarroi.
En Pologne, les ouvriers ont fini de croire qu'il était possible de "régénérer" une quelconque partie de l'appareil stalinien; ainsi les oppositionnels issus de la crise de 1956 et du mouvement étudiant des années 1960 (comme Kuron) n'eurent que cela comme objectif de propagande et se sont trouvés complètement isolés de la classe. Cela a créé un dangereux vide politique dans lequel la lutte de classe a pu se développer. Après les mouvements de grève de 1970/71, des ouvriers combatifs de Szczecin et d'autres centres ont essayé de résister à la dissolution des comités de grève en les transformant en noyau d'un syndicat oppositionnel. Les oppositionnels, à l'intérieur et à l'extérieur du parti communiste purent ainsi canaliser les illusions des ouvriers dans le syndicalisme à l'aide d'un projet de transformation des syndicats existants en des organes "indépendants du gouvernement". Le projet de contrôler les ouvriers de cette manière échoua misérablement parce que les ouvriers avaient perdu toute confiance dans les syndicats existants, et d'autre part, parce que la bourgeoisie était préparée à organiser une façade démocratique pour les syndicats mais ne pouvait leur permettre d'organiser des qrèves et des actions revendicatives, a l'Ouest, les syndicats maintiennent leur pression sur les ouvriers en organisant des actions mort-nées afin de les empêcher de prendre leur destinée en main . A l'Est, les staliniens se sont traditionnellement reposés sur la police pour maintenir l'ordre dans la mesure où chaque arrêt de la production, même organisé par les syndicats, entraîne un retard considérable des pays de l'Est dans la course aux armements avec les pays de l'Ouest.
Les années 70 ont connu d'importants changements dans l'atmosphère sociale au sein du bloc de 1'Est» spécialement en URSS. La nouvelle génération d'ouvriers qui n'ont pas vécu sous la période de contre-révolution stalinienne sont beaucoup plus décidés et moins dominés par la peur. Sur les places des marchés de Tachkent ou dans le métro de Moscou, ils critiquent ouvertement le régime. Mais ils ont encore beaucoup d'illusions sur les régimes à l'Ouest, particulièrement sur les "syndicats libres" et la démocratie occidentale. En URSS, les grèves sont devenues des faits journaliers habituels dans les petites et moyennes entreprises où, de toute façon, la production est très faible. Les ouvriers sont sous-alimentés, souvent affamés et la productivité est plus que médiocre.
Dans les grandes usines produisant pour l'économie de guerre en Silésie, la police surveille les ouvriers, armée de mitraillettes, pour les garder au travail. Dans ces usines, il ne peut y avoir de grèves. La seule alternative est : production ou guerre civile. Là généralisation de la lutte de classe en URSS et dans les autres pays du monde peut seule permettre que ces ouvriers se révoltent aussi; ceci n'est qu'une question de temps. La vague de grèves des années 70 a rendu ce fait très clair à la bourgeoisie. Elle est assise sur un baril de poudre.
L'invasion de l'Afghanistan a exacerbé encore plus la tension sociale. Il devient très clair que le motif des sacrifices des ouvriers n'est pas un avenir meilleur, le "communisme" mais celui de la guerre mondiale. Cette perspective a renforcé la détermination du prolétariat de ne faire aucun sacrifice pour assurer la défense du système. Les désertions massives en Afghanistan de l'armée russe ne sont qu'un symptôme de cette vérité première.
De manière très significative en Russie, la dernière identification avec la mère-Patrie qui pouvait subsister de la seconde guerre mondiale est morte avec l'Afghanistan. La contradiction absolue entre les intérêts du prolétariat et ceux de la mère-Russie est en train de devenir particulièrement claire.
LA NECESSITE DE LA GAUCHE DANS L'OPPOSITION
Avec l'entrée en lutte des ouvriers à l'Est contre leurs propres gouvernements, lutte freinée uniquement par l'étendue de l'appareil de répression, le développement d'une "opposition" forte et crédible est devenu un souci majeur de la bourgeoisie mondiale!
Il est nécessaire de rappeler ici, qu'étant donné l'absence d'une presse développée par les groupes oppositionnels dans les pays de l'est (le KOR à la fin des années 70 ne distribuait que 30.000 exemplaires de "Robotnik" à chaque numéro), leurs analyses politiques sont transmises à des millions d'ouvriers nuit et jour par l'intermédiaire des émissions des radios occidentales .Ce sont ces organes de propagande que les ouvriers écoutent, et non "La Pravda" ou "Neues Deutschland".
Le nationalisme est une arme primordiale pour contrôler les ouvriers et les attacher à la défense du système capitaliste. Dans les années 50 et 60, les gouvernements des pays de l'Est avaient la possibilité de l'utiliser pour renforcer leur contrôle sur la classe ouvrière (Gomulka, par exemple). En URSS, la réforme de décentralisation de Kroutchev tentait de donner aux PC d'Ukraine, de Géorgie, etc. plus de liberté de mouvement afin de dévier le mécontentement contre "les russes". De plus, elle opposait les différentes nationalités les unes aux autres. En 1978, par exemple, une vague de grève déferla sur la province autonome d'Abkhazie appartenant à la Géorgie, saisit la capitale Soukhoumi et les districts miniers, gagnant également un soutien actif des ouvriers agricoles et des paysans. Ce mouvement social intense resta complètement isolé parce qu'il fut dévié vers une lutte de libération nationale contre les "géorgiens". "L'Abkhazien" vend sa production industrielle et agricole à la Géorgie à un prix fixé et Tbilissi est libre d'en revendre une partie à la Russie avec profit. Dans de telles circonstances, il ne fut pas difficile aux oppositionnels de mener le mouvement ouvrier dans une impasse bourgeoise engageant les ouvriers dans une "guerre des douanes" à la frontière (rapporté par "Schwendtke).
Au début des années 70, la capacité des partis communistes au pouvoir à renforcer la mystification nationaliste en Europe de l'Est ou dans la partie non russe de l'URSS était en train de disparaître. Plus personne ne croyait ce qu'ils disaient; d'autre part, le seul nationalisme convaincant dans le bloc de l'Est devait être fatalement si antirusse qu'aucune équipe gouvernementale ne, pouvait et ne peut toujours se le permettre. Pour éviter cela, le Kremlin décida de laisser cette tâche à l'opposition. La position officielle du gouvernement contre le nationalisme antirusse, sous n'importe quelle manière ou forme ne pouvait que renforcer la crédibilité de l'opposition. C'est ce raisonnement qui est présent derrière les "doctrines" de Brejnev:
- après l'invasion de Prague, la soi-disant "souveraineté" limitée des Etats socialistes;
- en décembre 1972, la proclamation de la "solution" de la question nationale en URSS avec la création d'un "unique grand peuple soviétique".
Comme en Pologne et en Tchécoslovaquie, les réformistes du parti et les oppositionnels favorables aux "Droits de l'homme" et aux occidentaux en URSS, entrèrent en crise avec le resurgissement de la lutte de classe. L'avenir appartenait alors clairement à ceux qui avaient la capacité de se radicaliser et d'avoir une présence à l'intérieur du prolétariat.
En Ukraine et dans d'autres régions d'URSS où la lutte de classe est devenue particulièrement puissante, les oppositionnels sont radicaux, et depuis longtemps, se sont attachés à gagner de l'influence parmi les ouvriers. Parmi de tels groupes, on pouvait compter: "Tout le pouvoir aux Soviets" (Moldavie, 1964), "Les Jeunes 0uvriers"(Alma-Ata,, 1977), "Les Groupes de La Commune", "Les Ouvriers de l'Oural" (Sverdlovsk 1970), "Pour la réalisation des idées de Lénine" (Vorochilovgrad 1970) (Voir Die Politische Opposition in der Ukraine dans Sozialistisches Osteuropakomitee, Info 32). Nous ne possédons pas suffisamment de documentation pour juger si quelques-uns de ces groupes ont ou non représenté une quelconque expression du prolétariat. Ce qui est certain, pour la majorité de ces groupes, malgré tout leur radicalisme verbal, c'est qu'ils ont représenté des programmes de "démocratisation" du capitalisme russe, afin d'éviter les explosions sociales. Le fait que ces groupes aient été obligés, dans nombre de cas, de parler d'un "capitalisme soviétique" et d'une "nouvelle bourgeoisie" en URSS afin d'avoir un impact sur les ouvriers, reflète certainement l'attitude répandue parmi les militants ouvriers vis-à-vis de la "patrie socialiste". Les radicaux ont été divisés entre différentes lignes nationalistes dures, travaillant dans la clandestinité la plus stricte, faisant de la propagande pour la lutte armée, et même s'y entraînant ; tandis que d'autres courants plus orientés vers la classe ouvrière, mélangeaient le poison nationaliste avec des revendications pour les "syndicats 1ibres". Pendant les années 70, en Ukraine par exemple, de tels gauchistes ont développé une activité dans les usines. Il y a des centaines d'organisations de ce genre dans toute l'URSS.
De plus, vers la fin des années 1970, une série de tentatives ont été faites pour installer de larges syndicats oppositionnels républicains, le plus connu et récent étant le SMOT, avec des sections dans une douzaine de villes. Alors que les ouvriers qui font grève dans les usines d'importance stratégique vitale sont purement et simplement exécutés, les oppositionnels, ces robustes défenseurs de l'Etat capitaliste, ne connaissent que tracasseries et arrestations par le KGB. Si la police les laissait absolument tranquilles, les ouvriers pourraient difficilement avoir confiance en eux.
La formation du KOR en Pologne en 1976, qui eut comme effet immédiat de canaliser la réponse ouvrière à la répression de 76 vers une impasse légaliste et démocratique, cette formation est un bon exemple de développement d'un courant oppositionnel et radical, qui se proclame le défenseur des ouvriers contre le gouvernement, afin de décapiter la montée de la lutte de classe.
Le KOR abandonna la revendication portant sur la réforme du stalinisme pour appeler les ouvriers à s'organiser "en dehors et contre l'Etat capitaliste') mais de toute façon en organes étatiques, en syndicats qui entretiennent l'illusion chez les ouvriers de pouvoir, de manière permanente, se défendre, sans maintenir leur lutte et leur organisation dans cette lutte. Ce travail de propagande (des membres du KOR ont été par exemple milité et travailler aux chantiers "Lénine" avant l'été 1980), a aidé à former les bases sur lesquelles allait se former Solidarnosc, aujourd'hui la force numéro 1 travaillant pour la loi et l'ordre en Pologne.
Nous n'avons pas l'intention ici de revenir en détails sur tous les aspects de la grève de masse en Pologne, et ses répercussions internationales. Nous renvoyons nos lecteurs aux articles parus dans notre presse territoriale et dans les Revues Internationales parues depuis août80.
Le tournant à gauche de l'opposition et la volonté de l'Etat de tolérer leur activité furent des facteurs clés de la stratégie bourgeoise contre la classe ouvrière, après l'Afghanistan et surtout après l'éruption en 1980 en Pologne. Comprenant l'impossibilité d'empêcher l'éclatement de la grève de masse, la bourgeoisie s'affaire à restreindre à un seul Etat national toute la portée de ce mouvement. La menace d'une invasion en Pologne qui était plutôt dirigée vers les ouvriers des autres pays d'Europe de l'Est pour les tenir en échec, fut renforcée et complétée par la mise en avant dans le mouvement, de buts bourgeois (par l'opposition fraîchement radicalisée) qui mena à un enfermement du mouvement et un renforcement de l'Etat à travers la consolidation de l'aile oppositionnelle de son appareil avec les nouveaux syndicats.
L'idéologie de la démocratie et du syndicalisme libre n'a pas seulement réussi -après un an de lutte- à stopper la grève de masse. Elle a aussi permis à la bourgeoisie mondiale- en Europe de l'Est par l'intermédiaire des oppositionnels-de présenter des leçons fausses d'une lutte en Pologne qui captait l'attention des ouvriers de toute la surface du globe. Si les ouvriers d' Europe de l'Est ne se sont pas joints au mouvement de masse, ce n'est pas seulement du fait qu'en Allemagne de l'Est, et en Hongrie par exemple, l'approvisionnement soit moins précaire qu'en Pologne, ou du fait de l'omniprésence de l'armée russe dans ces pays, ou encore parce que les gouvernements auraient pu persuader leurs populations que le mouvement de grève détruisait l'économie polonaise, mais c'est avant tout parce que l'opposition dans ces pays disait à la classe que les ouvriers de Pologne avaient réussi à opposer une telle résistance massive parce qu'ils s'étaient d'abord organisés en syndicats libres. Ainsi la tâche du prolétariat d'Europe de l'Est ne serait pas de se joindre au combat, suivant ainsi leurs camarades dans les luttes de masse, organisés dans les assemblées ouvrières, et les comités de grèves élus et révocables, pour s'affronter à l'Etat. Il s'agirait plutôt d'attendre et de construire des syndicats libres, chacun dans son propre pays, chaque fraction ouvrière démocratisant "son propre" Etat terroriste: Cette capacité de stopper la grève de masse en Pologne qui menaçait d'extension au-delà des frontières, fut un tournant crucial ; celui de la persuasion des ouvriers qu'il n'y aurait d'autre perspective à la lutte qu'une perspective nationale. Et ceci est le message du Congrès de Solidarité à Gdansk avec son fameux appel à la formation de "syndicats libres et indépendants" dans les autres pays du bloc de l'Est.
Cette internationalisation falsifiée se résume à dire "Pour vous également, il n'y a que des solutions nationales". La vague de grève de 1980-1981 ne fut pas "nationale", cela nous est montré par le fait que cet événement était la continuation du vaste mouvement de grèves de la fin des années 1970 qui toucha l'Allemagne à l'Est et à l'Ouest, la Grande-Bretagne, la France, le Brésil, l'URSS, la Corée du Sud etc. Elle fut immédiatement précédée par un court mais massif mouvement de grèves en URSS. Au début de mai 1980,
170 000 ouvriers de l'usine automobile de Togliattigrad se mettent en grève en solidarité avec les conducteurs d'autobus ; leurs revendications aboutissent deux jours après. Aussitôt, 200 000 travailleurs de l'usine automobile de Gorki cessent le travail pour protester contre les rationnements. La grève fut précédée par une distribution massive de tracts. C'est le plus grand débrayage de l'histoire de l'URSS. Selon certains rapports, il y aurait eu ensuite, une nouvelle grève dans l'usine de camions de Kama. En août et septembre, alors que le mouvement polonais atteignait son point culminant, une série de protestations et de troubles sont signalés dans les régions minières de Roumanie, puis en Hongrie (Budapest) et en Tchécoslovaquie. Le chef du Parti tchèque, Husak, fut contraint de se précipiter aux mines d'Ostrava, afin de mettre un terme à cette situation. Dans cette région, de nombreuses mines s'étendent au-delà de la frontière avec la Pologne, rendant particulièrement intense le contact avec les mineurs silésiens. Prague réagit en verrouillant pratiquement la frontière avec la Pologne. Pour les européens de l'Est, les frontières séparant Pologne, Allemagne de l'Est et URSS devinrent pratiquement infranchissables. Tous les trains entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne furent momentanément annulés. En même temps, les armées du Pacte de Varsovie se massaient aux frontières de la Pologne, et d'interminables manœuvres commencèrent jusqu'à l'intérieur même du pays. On rapporte également qu'au début du mois d'octobre, des manifestations de rue et des affrontements eurent lieu dans la capitale d'Estonie, Tallin, événements qui ont débordé vers d'autres centres importants des républiques baltes de l'URSS. Des grèves éclatèrent à Kaunas, et Vilnius en Lituanie villes où de nombreuses personnes parlent polonais.
Comme la situation se développait, les ouvriers en Pologne, reprenant l'exemple des chantiers navals à Gdansk, commencèrent à démystifier le bluff de la menace d'invasion russe, conscients que jamais les ouvriers des pays voisins ne laisseraient faire une telle chose. Cette conviction fut renforcée par les nombreux discours diffusés par les médias de l'ouest dans lesquels étaient affirmé ceci par exemple : "Les autorités soviétiques craignent qu'une intervention de l'armée de 1'Allemagne de 1'est en Pologne ne provoque un mouvement généralisé de grèves en RDA. Déjà les mouvements sociaux ont progressé dans le pays depuis trois mois maintenant, mouvements que les autorités ont réussi à cacher."("Lettre de 1'Expansion" du 22.12.80). Dans ces mouvements, il faut inclure le mouvement de grève autour de Magdebourg en novembre, et les grèves de solidarité dans les villes proches de la frontière polonaise telles que Gorlitz et Francfort sur Oder.
Le second exemple, tiré du "Financial Times" (13/12/81) concerne les tentatives de mobilisation des réservistes d'Ukraine pour envahir la Pologne :
"Selon les rapports, 1'appel aux réservistes des Trans-Carpates en août a donné lieu à des scènes approchant du chaos. Les habitants de la région étaient recrutés dans les rues, les voitures réquisitionnées sur les routes et les réservistes désertaient les points de rassemblement en masse. Les désertions des réservistes qui, pour la plupart quittaient régulièrement les points de rassemblement pour aller dormir dans leur famille, furent interprétées comme le reflet du moral très bas qui affectaient les gens de cette région, bien informés des événements en Pologne et sympathisant fortement avec les ouvriers polonais."
L'année 1981 se poursuivit avec d'importantes luttes ouvrières dont les plus importantes furent celles de Roumanie en novembre, luttes où les mineurs furent rejoints par les sidérurgistes et d'autres ouvriers dans une série de grèves, d'affrontements avec la police, d'attaques contre des bâtiments de l'Etat, et qui firent plusieurs morts.
"L'hélicoptère qui devait transporter sur place le président Ceausescu pour un dialogue avec les mécontents dans les régions minières fut lapidé".
Ce même rapport parle d'un accroissement de l'activité des oppositionnels dans les Républiques de la Baltique et dans d'autres parties de l'URSS, de la formation de syndicats "indépendants", et, par exemple, de la distribution de tracts en Estonie, appelant à une grève pour le début décembre en protestation à la montée des prix du 1er août. Des appels similaires ont été rapportés de Lithuanien et de Lettonie. Ce qui est assez significatif pour une région où les mystifications nationalistes et séparatistes sont très persistantes; le rapport explique que c'est la détérioration de la situation économique qui anime les ouvriers.
En même temps que la lutte du prolétariat, on a pu voir d'importantes explosions sociales dans des régions où le séparatisme et le nationalisme jouent un rôle important, mais où, maintenant plus que jamais, l'appauvrissement des ouvriers et des autres secteurs tend à devenir l'aspect dominant de la situation sociale. Ce qui se manifeste, par exemple, dans les violents affrontements qui ont eu lieu en Géorgie et dans le Kosovo(Yougoslavie) pendant le printemps 81.
Aujourd'hui, nous pouvons dire que le potentiel de généralisation de la lutte de classe en Europe de l'Est est de manière évidente plus élevé que jamais depuis les années 20, mais que l'accalmie relative de la lutte sur le front occidental en Europe (qui n'est que le calme avant la tempête !) ainsi que l'enfermement de la grève de masse en Europe de l'Est dans les limites de la frontière nationale par les oppositionnels, ont empêché le baril de poudre d'exploser. La perspective de luttes majeures dans les métropoles occidentales dans la période à venir et l'accélération de la crise qui se produit maintenant également en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, montrent que le potentiel pour la généralisation des luttes au niveau mondial s'accroit, en dépit de la grande contre-offensive de la bourgeoisie au niveau mondial dans le sillage de la Pologne.
VERS L'UNIFICATION DU PROLETARIAT MONDIAL
Du point de vue marxiste, la réalisation la plus révolutionnaire du capitalisme est d'avoir créé son propre fossoyeur : le prolétariat international, et d'avoir développé les forces productives à une échelle mondiale avec lesquelles le prolétariat pourra abolir la société de classe. Pour ce "service", nous serons éternellement reconnaissant à nos impitoyables exploiteurs et leur système barbare. Le capitalisme a créé les conditions matérielles préalables au communisme, mais seulement à une échelle mondiale. Le capitalisme a conquis le globe, non d'une manière planifiée, mais à travers des siècles de compétition qui ont créé la division du travail, l'interdépendance de chaque partie de l'économie mondiale. VOILA POURQUOI L'UNIFICATION INTERNATIONALE DU PROLETARIAT DANS LE PROCESSUS DE LA REVOLUTION MONDIALE EST LA CONDITION MATERIELLE PREALABLE LA PLUS DECISIVE POUR LE COMMUNISME.
Aujourd'hui, chaque lutte du prolétariat est une lutte contre le capitalisme comme un tout, parce que le système affronte les ouvriers, telle une seule et unique masse réactionnaire dont chaque partie est également pourrie. C'est pour cette raison que les ouvriers ne peuvent plus s'organiser de manière corporative ou nationale. Le secret de l'existence des conseils ouvriers dans les luttes de masse dans le capitalisme décadent est la poussée permanente, souterraine -mais visible à la surface- d'une tendance à l'unification de la classe ouvrière.
"Le prolétariat produit une nouvelle forme d'organisation qui englobe la classe ouvrière dans sa 'totalité sans distinction de profession, ni de maturité politique, un appareil élastique qui est capable de renouvellement, d'extension et d'intégration de nouveaux secteurs de manière constante".
Manifeste de l'Internationale Communiste.1919.
Les conseils ouvriers sont apparus dans le contexte de la grève de masse, de la généralisation autonome du combat prolétarien qui menace toujours de déborder les barrières érigées par le capitalisme. De plus, comme le résultat de l'immaturité des conditions subjectives pour la révolution mondiale, les conseils ouvriers ont également, de manière paradoxale, toujours reflété l'hétérogénéité du prolétariat mondial. Les conseils ouvriers de 1905 en Russie ont annoncé la fin de la période ascendante du capitalisme à une échelle mondiale. Mais ils ont mis aussi en évidence le rôle d'avant-garde du jeune prolétariat russe qui, autour d'un pôle de regroupement, le parti bolchevique, a poussé à la formation en 1919 de l'Internationale Communiste. De la même manière, durant la vague révolutionnaire de 17/23, les conseils ouvriers ont joué un rôle important dans les pays vaincus pendant la guerre. Les conseils ouvriers ont exprimé, pas seulement la lutte pour l'unité de la classe, mais également ses propres divisions dues aux conséquences de la guerre. De même, l'apparition des conseils ouvriers en Hongrie 1956 ne signifiait pas un signe de maturation de la classe ouvrière internationale, mais une continuité avec la vague révolutionnaire de 1917-23 qui touchait à sa fin. Les défaites des années 50 représentent la cassure définitive d'avec cette continuité. Les ouvriers en Hongrie se souviennent encore de l'expérience des conseils en 1919, mais comme cela a été exprimé dans un appel aux conseils :
"Non au gouvernement de Nagy ou de Kadar, oui a celui de Bêla Kun".
Aujourd'hui, les ouvriers en Pologne se sont confrontés à la résistance unifiée de la bourgeoisie mondiale, unie autour d'une stratégie de renforcement de ses fractions oppositionnelles de gauche comme Solidarnosc, organe de l'Etat bourgeois implanté parmi la classe ouvrière pour contrôler ses réactions. Du fait de cette unité de la bourgeoisie mondiale, il ne peut y avoir "de maillon faible de l'impérialisme" comme en Russie 1917. C'est pourquoi, il n'y a pas eu de conseils ouvriers en Pologne pendant le mouvement de 1980-81, non pas du fait de la faiblesse du secteur polonais de la classe, mais parce que la grève de masse qui a surgi a été l'expression la plus développée d'UNE MATURATION INTERNATIONALE, D'UNE REELLE HOMOGENEISATION DU PROLETARIAT MONDIAL. En de telles circonstances, les conseils ouvriers et le parti de classe futur apparaîtront directement au niveau international; ils naîtront comme produit d'une prise de conscience grandissante de la nécessité de combattre et de détruire le capitalisme mondial.
Dans la perspective de la révolution mondiale, l'Europe devient la clef du futur, le centre du prolétariat mondial et des rivalités entre les blocs. Le prolétariat de l'Europe de l'Ouest jouera le rôle le plus crucial,
-du fait de sa concentration, de son niveau d'industrialisation et de culture; -du fait d'une grande expérience de la démocratie bourgeoise et des "syndicats libres", les armes les plus redoutables de la classe ennemie; -parce que les économies nationales de cette région du monde sont si intimement liées qu'une lutte limitée au cadre national devient vite une absurdité;
-parce que les ouvriers en Allemagne de 1'ouest ou en France parlent de cinq à dix langues, non dans différentes régions, mais dans une seule et même partie du pays, et ceci permet d'avoir une vision beaucoup plus globale des tâches de la classe ouvrière mondiale; -parce qu'une grève de masse peut se produire en Pologne et être tranquillement massacrée en Sibérie, tandis que si elle éclatait dans un pays majeur de l'ouest, elle paralyserait une grande partie de l'économie mondiale et ainsi forcerait les ouvriers, partout, à en tenir compte; -enfin, les ouvriers de l'ouest, se sont vus épargnés l'écrasement du double échec de la lutte de classe dans les années 20 et 50. C'est pourquoi, ils devront jouer le premier rôle dans la préparation de la REPUBLIQUE INTERNATIONALE DES CONSEILS et du parti communiste mondial futur.
La dernière vague révolutionnaire des années 20 s'est pratiquement terminée avec la suppression quasi totale du prolétariat révolutionnaire de Russie et d'Allemagne. Demain, la classe ouvrière d'URSS, plus grande, plus concentrée, plus puissante que jamais, prendra sa place au côté du combat révolutionnaire mondial de ses frères de classe. Et le prolétariat en Allemagne devra prendre en charge le rôle clé de charnière entre l'Est et l'Ouest, faisant voler en éclat le mur de Berlin, ce symbole d'un prolétariat mondial déchiré par deux guerres mondiales. L'isolement des ouvriers à l'Est touche à sa fin. Voilà la leçon de la lutte de classe du début des années 80.
Krespel. novembre 1981
Géographique:
- Europe [13]
- Russie, Caucase, Asie Centrale [47]
Récent et en cours:
- Luttes de classe [14]
Heritage de la Gauche Communiste:
Théories des crises : le véritable dépassement du capitalisme, c’est l'élimination du salariat
- 4053 reads
(à propos de la critique des thèses de Rosa Luxembourg par Nicolas Boukharine)
Le communisme est un vieux rêve de l'humanité. Un rêve aussi vieux que la société divisée en classes. Depuis que les hommes se sont vus contraints, pour subsister matériellement dans la nature de diviser leur communauté en classes antagoniques, ils rêvent plus ou moins d'une société humaine, réunifiée, d'une société communiste.
Ce rêve tend à apparaitre avec plus de force lorsque la société de classes entre en crise. Aujourd'hui, ce projet a plus de réalité que jamais. Il existe une classe qui peut le concrétiser : la classe ouvrière. Mais c'est en comprenant DE QUELLE CRISE souffre la société que l'on peut à la fois comprendre POURQUOI cette classe est révolutionnaire, historiquement, et DANS QUEL SENS elle doit agir. C'est pour cela que le marxisme reste indispensable à la conscience de la révolution. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir sur les débats qui ont eu lieu dans le mouvement ouvrier sur la conception de la crise du capitalisme et sur les conséquences de ces conceptions.
COMPRENDRE LES CRISES, C'EST COMPRENDRE COMMENT DEPASSER LE CAPITALISME.
"En tant qu'idéal d'un ordre social reposant sur l'égalité et la fraternité entre les hommes, en tant qu'idéal d'une société communiste, le socialisme datait de milliers d'années. Chez les premiers apôtres du christianisme, chez diverses sectes religieuses du Moyen-âge, lors de la guerre des paysans, l'idée socialiste n'a cessé de jaillir comme expression la plus radicale de la révolte contre l'ordre existant. Mais justement comme idéal recommandable en tout temps et en tout lieu historique, le socialisme n'était que le beau rêve de quelques exaltés, un songe doré hors d'atteinte, comme l'arc en ciel dans les nuages.
(...) Un homme a tiré les dernières conséquences de la théorie du mode de production capitaliste, en se situant dès l'abord du point de vue du prolétariat révolutionnaire: Karl Marx. Pour la première fois, le socialisme et le mouvement ouvrier moderne se placèrent sur le terrain inébranlable de la connaissance scientifique." (Rosa Luxembourg, "Introduction à l'économie politique, Ch.1, partie5).
Les avenues emplies de voitures brillant aux éclairs des néons ont fait croire pendant des années qu'il n'y aurait plus jamais de crise économique. On avait rangé les photos jaunies des chômeurs des années 30 à côté des images de batailles napoléoniennes et des famines du Moyen Age. Les révolutionnaires marxistes qui, comme toujours depuis déjà près d'un siècle passaient leur temps à annoncer l'inévitabilité de la crise du capitalisme, étaient classés plus ou moins dans la même catégorie que les témoins de Jéhovah et leurs litanies sur :"la fin du monde est proche". Bourgeois, bureaucrates, spécialistes des "affaires sociales" proclamaient la "retentissante faillite du marxisme".
Aujourd'hui, la une des journaux du monde entier est régulièrement consacrée à l'aggravation d'une crise économique dont personne n'ose plus prédire la date de la fin... et dont personne ne prévoyait l'ampleur.
Belle revanche pour ceux qui depuis le milieu du siècle dernier s'efforcent de définir une vision du monde débarrassée des lunettes idéologiques de ceux qui profitent du système: une vision qui rejette l'idée suivant laquelle le capitalisme serait un système de production éternel ; une vision qui sache concevoir en permanence le capitalisme dans sa dimension historique, c'est à dire comme un système appelé à disparaitre tout comme l'esclavagisme et le servage féodal.
Le marxisme est essentiellement l'effort théorique de percevoir le monde du point de vue de la classe exploitée directement par le capitalisme, le prolétariat, dans le but d'un bouleversement révolutionnaire. Il est l'effort de comprendre SUR QUELLES BASES OBJECTIVES S'APPUIENT AUJOURD'HUI LA NECESSITE ET LA POSSIBILITE D'UNE ACTION REVOLUTIONNAIRE DE CETTE CLASSE.
Pour le marxisme, la révolution communiste n'est possible et nécessaire que dans la mesure où le capitalisme s'avère incapable de remplir la fonction historique pour laquelle surgit tout système économique dans l'histoire : permettre aux hommes de subvenir à leurs nécessités matérielles. L'incapacité de continuer à remplir cette fonction se traduit dans les faits par la crise économique qui paralyse l'appareil de production.
Il n'y a jamais eu de lutte prolétarienne importante en dehors des périodes de crise économique. Il ne peut y avoir de révolution ouvrière sans crise économique. Seul cet effondrement de l'économie peut avoir la force de déstabiliser l'ordre social au point de permettre aux forces vives de la société, le prolétariat mondial, et avec lui à l'ensemble des exploités du monde de bâtir un nouveau monde conçu par eux, adapté aux techniques et aux possibilités d'une humanité unifiée par la volonté des producteurs eux-mêmes.
Les lignes de force de l'existence du capitalisme, l'évolution de ses formes de vie, trouvent aussi une explication dans la lutte permanente du système contre ses propres contradictions, pour éviter ses crises économiques. Les gérants du capital mondial ne sont pas passifs face au développement des contradictions internes de leur système et aux crises de plus en plus dévastatrices que l'exacerbation de ces contradictions provoque. L'impérialisme, les guerres, la tendance à l'étatisation de la société, par exemple, sont incompréhensibles si on ne sait ce qui contraint le capitalisme à y recourir de façon de plus en plus systématique. Pour comprendre les palliatifs que le capitalisme tente d'appliquer à sa maladie, il faut comprendre la nature et les causes mêmes de cette maladie, donc de ces crises.
Dans l'article "Les théories des crises, de Marx à l'Internationale Communiste" (paru dans la Revue Internationale n°22), nous avions insisté sur le lien qui existe entre les débats théoriques sur l'analyse des crises du capitalisme et des problèmes aussi cruciaux pour le mouvement ouvrier que l'alternative REFORME OU REVOLUTION, ou la participation du prolétariat aux GUERRES IMPERIALISTES.
A travers la critique formulée par Boukharine aux analyses des crises de Rosa Luxembourg, c'est surtout la question du CONTENU du communisme, la définition de la nouvelle société qui se trouve posée.
Pour être viable historiquement, la nouvelle société qui succédera au capitalisme devra avoir la capacité d'empêcher que ne se reproduise ce qui bloque actuellement la société. La seule certitude que nous pouvons avoir, c'est que le communisme s'il existe sera tel qu'il aura dépassé les contradictions actuelles du capitalisme.
Le féodalisme s'est imposé à l'esclavagisme parce qu'il permettait à une population de subsister par elle-même sans dépendre du pillage d'autres populations; le capitalisme s'est à son tour imposé historiquement devant l'effondrement du féodalisme par sa capacité à permettre la concentration de forces productives matérielles et humaines que l'émiettement de la société en fiefs autonomes et jalousement isolés les uns des autres rendait impossible.
Si l'on veut savoir ce que sera le communisme, il faut commencer par savoir qu'est ce qui ne va pas dans la société présente ; où est ce que se bloque la machine ; qu'est ce qui dans les rapports de production capitalistes a fini par empêcher les hommes de produire à leur faim ; si nous parvenons à déterminer où se trouve le cœur de la maladie capitaliste, nous pouvons en déduire ce que devront être les caractéristiques HISTORIQUEMENT VITALES de la société future.
Comprendre les causes des crises du capitalisme, c'est donc comprendre en quoi et pourquoi le socialisme est une nécessité et une possibilité historique. C'est aussi comprendre COMMENT le capitalisme peut être dépassé, ce qu'il faut détruire et quelles sont les bases d'une communauté réelle de l'humanité.
Derrière les différences théoriques qui opposent les analyses des crises de Rosa Luxembourg et celles de Boukharine, se dessinent deux conceptions radicalement différentes de ce que sont les fondements économiques de la société à construire sur les ruines de l'ancienne.
Rosa Luxembourg place au centre des contradictions du capitalisme la limite imposée à son développement par la généralisation du salariat. De ce point de vue, la question cruciale dans la construction d'une société communiste, c'est donc L'ELIMINATION DU SALARIAT, l'abolition du travail salarié.
Pour Boukharine, l'incapacité fondamentale du capitalisme est celle de dépasser ses divisions internes et de maitriser "L'ANARCHIE" de sa production. En conséquence, la CENTRALISATION DES MOYENS DE PRODUCTION aux mains de l'Etat et la PLANIFICATION apparaissent en elles-mêmes comme un dépassement du capitalisme. Ainsi, se référant à l'Union Soviétique, où étatisation et planification de la production ont été développées mais où subsiste le salariat, Boukharine parle, en 1924, de "la contradiction entre le monde capitaliste et le NOUVEAU système économique de l'Union Soviétique".
C'est en ayant en vue cet aspect qu'il est le plus important de répondre à la brochure écrite par Boukharine en 1924 pour critiquer l'analyse de Rosa Luxembourg : "L'impérialisme et l'accumulation du capital."
L'ANALYSE DES CRISES DE SURPRODUCTION PAR ROSA LUXEMBOURG.
Les crises du capitalisme prennent la forme de crises de surproduction. Les usines ferment, noyées dans des stocks de marchandises qui n'ont pas trouvé d'acheteurs alors qu'en même temps on jette à la rue des chômeurs et réduit le salaire de ceux qui restent au travail. Le capitalisme a détruit le pouvoir d'achat de la population non intégrée au capitalisme en détruisant son mode de production. Les mieux lotis parmi cette population se sont intégrés comme esclaves dans le système capitaliste. Les autres, plus nombreux, sont réduits à la famine (2/3 de l'humanité).
Il y a "surproduction" non pas vis à vis des besoins "absolus" de la société, mais vis à vis des besoins "solvables", c'est à dire de la capacité d'achat de la société dominée par le capital.
L'originalité des thèses de R.L. ne consiste pas dans l'analyse de la cause fondamentale, "ultime" des crises économiques du capitalisme. Au niveau de la "cause" elle ne fait que reprendre l'analyse de Marx:
"La raison ultime de toutes les crises réelles, c'est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses, face à la tendance de l'économie capitaliste à développer les forces productives comme si elles n 'avaient pour limites que le pouvoir de consommation absolu de la société" ([1] [48]).
Tout comme pour Marx, pour Luxembourg, la contradiction qui condamne le capitalisme aux crises économiques est celle, d'une part entre sa nécessité de développer en permanence sa capacité de production, sous la pression de la concurrence, et d'autre part l'impossibilité de créer lui-même des débouchés suffisants pour absorber cette masse toujours croissante de marchandises. Le capital est simultanément contraint de jeter sur le marché une masse toujours croissante de produits à vendre, et de limiter par ailleurs la capacité d'achats des masses salariées.
"La surproduction, écrit Marx, a spécialement pour condition la loi générale de la production du capital : produire à la mesure des forces productives (c'est à dire selon la possibilité qu'on a d'exploiter la plus grande masse possible de travail avec une masse donnée de capital) sans tenir compte des limites existantes du marché ou des besoins solvables, et en y procédant par un élargissement constant de la production et de l'accumulation donc par une reconversion constante du revenu en capital, tandis que d'autre part, la masse des producteurs demeure et doit nécessairement demeurer limitée à un niveau moyen de besoins de par la nature de la production capitaliste." ([2] [49]) (souligné par nous)
Rosa Luxembourg reprend à son compte la même analyse de la cause essentielle des crises capitalistes. Son apport se situe à un niveau plus concret et historique. La question à laquelle elle répond est la suivante : à partir de quand cette contradiction transforme-t-elle les rapports de production capitalistes en une lourde entrave au développement des forces productives de l'humanité?
R.L. répond : à partir du moment où le capitalisme a étendu sa domination au monde entier.
"Le mode de production capitaliste pourrait avoir une puissante extension s'il devait refouler partout les formes arriérées de production. L'évolution va dans ce sens. Cependant, cette évolution enferme le capitalisme dans la contradiction fondamentale : plus la production capitaliste remplace les modes de production plus arriérés, plus deviennent étroites les limites du marché créé par la recherche du profit, par rapport aux besoin d'expansion des entreprises capitalistes existantes" (R.Luxembourg : Introduction à l'Economie Politique -dernier chapitre)
Pour Rosa Luxembourq, les marchés supplémentai-dont le capital a besoin pour se développer, il les trouve dans les secteurs "non-capitalistes"; l'expansion coloniale du capitalisme, qui atteint son apogée au début de ce siècle, traduit la recherche par les premières puissances capitalistes de ces nouveaux débouchés. (Rosa Luxembourg ne fait d'ailleurs que développer l'idée du Manifeste
Communiste en 1848 : "Poussée par le besoin de débouchés toujours plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit toute la surface du globe").
Au 19ème siècle, du vivant de Marx, le capitalisme connait une série de crises économiques.
"La bourgeoisie, nous dit le Manifeste, les surmonte, d'une part en imposant la destruction d'une masse de forces productives; d'autre part en s'emparant de marchés nouveaux et en exploitant mieux les anciens."
Pour Rosa Luxembourg, un changement qualitatif se produit dans la vie du capitalisme mondial à partir du moment où les "nouveaux débouchés" deviennent de plus en plus rares et insuffisants en égard du développement des puissances capitalistes. L'arrivée de nouvelles puissances, telles que l'Allemagne et le Japon sur le marché mondial au début du siècle conduit ainsi à de nouvelles crises. Mais contrairement à celles du 19ème siècle, celles-ci ne pourront pour ainsi dire plus être surmontées par la conquête de "marchés nouveaux". Des "solutions" indiquées par Marx et Engels dans le Manifeste, celles qui vont passer au premier plan, c'est la meilleure exploitation des anciens marchés, et SURTOUT LA DESTRUCTION DE FORCES PRODUCTIVES. La première guerre mondiale avec ses 24 millions de morts, la guerre totale et à outrance entrainant la destruction systématique de l'appareil productif des capitaux concurrents afin de s'emparer de leurs anciens marchés, traduit dans toute son horreur barbare la fin de l'époque florissante du capitalisme.
La contribution de Rosa Luxembourg à la théorie marxiste consista donc essentiellement dans l'explication de comment la contradiction entre production et consommation qui caractérise le capitalisme depuis sa naissance, conduit celui-ci -à partir du moment où il a étendu sa domination à la planète entière- à l'IMPERIALISME et à l'autodestruction de l'humanité, mettant définitivement à l'ordre du jour de l'histoire son dépassement par une société basée sur des rapports de production nouveaux.
Si les usines ferment par manque de débouchés solvables alors que la misère matérielle de l'humanité se développe, il n'y a d'autre issue historique que l'élimination de la planète des lois du marché, et plus particulièrement DU SALARIAT.
En généralisant le salariat, le capitalisme a généralisé le marché comme médiation entre l'activité des hommes en tant que producteurs, et leur activité en tant que consommateurs. Dépasser le capitalisme, c'est de ce point de vue, détruire cette médiation et rétablir le lien direct entre la production et la consommation. Du point de vue de l'analyse de R.Luxembourg, la marche révolutionnaire s'identifie avec le combat contre le salariat (c'est à dire contre l'utilisation de la force de travail comme marchandise); son objectif immédiat ne peut être autre que celui de soumettre la production à la consommation, d'orienter la production directement en fonction des nécessités matérielles des hommes. Autrement, c'est l'impasse.
REPONSE AUX CRITIQUES DE BOUKHARINE A ROSA LUXEMBOURG
Au delà de son objectif théorique immédiat : l'analyse des crises du capitalisme, le travail de Boukharine s'inscrivait dans le cadre de la "bolchévisation" des partis de l'Internationale Communiste ([3] [50]). Boukharine se donne pour tâche de "détruire" l'analyse de R.Luxembourg et pour cela il fait flèche de tout bois. Il critique tout ce qui lui passe sous les yeux sans chercher toujours à voir quelle peut être la cohérence générale de ce qu'il analyse et sans crainte d'aboutir à des contradictions. Cependant, on trouve dans sa brochure la formulation des principales critiques qui ont été reprises soit l'une, soit l'autre aussi bien par les staliniens et les trotskystes que par les bordiguistes ou des ex-trotskystes comme Raya Dunayevskaya.
L'essentiel de cette critique peut être formulée de la façon suivante :
Luxembourg se trompe lorsqu'elle affirme que le capital ne peut pas créer ses propres débouchés pour assurer son développement; le problème posé par R.Luxembourg -"pour qui produire"- est un faux problème; les ouvriers peuvent constituer un débouché suffisant pour assurer cette expansion; enfin, Luxembourg ignore ou néglige dans son explication des crises, les principales contradictions mises en lumière par Marx -et en particulier "l'anarchie de la production capitaliste".
LE CAPITAL PEUT-IL CREER SES PROPRES DEBOUCHES ?
Voici comment Rosa Luxembourg pose le problème :
"Ce qu'il faut expliquer, ce sont les grands actes d'échanges sociaux, qui sont provoqués par des besoins économiques réels. (...) Ce qu'il nous faut trouver, c'est la demande économique du surproduit ...".("L'accumulation du capital". Chapitre 9).
Pour R.Luxembourg, suivant les théories de Marx, le développement du capital, son accumulation se traduit par un accroissement de la capacité de production et donc, du produit de l'exploitation des ouvriers: le surproduit. Etudier les conditions de ce développement, c'est donc déterminer entre autre, qui achète ce surplus de production, qui achète la part de la production sociale qui reste une fois que les prolétaires ont dépensé leur salaire et que les capitalistes ont d'une part remplacé les matières premières et l'usure des outils de production, et d'autre part prélevé leur part de profit pour leur consommation personnelle. En d'autres termes, qui achète la part du profit destinée à être transformée en nouveau capital, en nouveaux moyens d'exploitation du travail !
La production capitaliste crée elle-même un marché, un "besoin économique réel" pour la plus grande partie de la production : la masse des salaires versés (capital variable), les dépenses pour restaurer l'usure de l'appareil productif et les matières premières consommées (capital constant) et enfin, les dépenses des capitalistes pour leur consommation personnelle (part de la plus-value non réinvestie), tout cela constitue un besoin "économique réel", "une demande solvable" du point de vue du capital. Tout cela constitue la partie de la production que le capitalisme peut "s'acheter à lui-même". Mais il reste une part de la production à vendre : la part du surtravail que les capitalistes -contrairement à ce que faisaient les seigneurs féodaux et les maîtres d'esclaves de l'antiquité qui consommaient personnellement tout leur profit- ne consomment pas afin de pouvoir accroître leur capital, afin de pouvoir le reproduire non plus "simplement", tel qu'il était au départ du cycle de production, mais de façon "élargie". Cette part de la production est très petite en comparaison avec la masse totale produite. Mais, de sa "réalisation", c'est-à-dire de sa vente, dépend que le capitalisme puisse ou non continuer son accumulation, son élargissement. R.Luxembourg affirme que cette partie de la plus-value ne peut, dans les conditions capitalistes, être vendue, ni aux ouvriers, ni aux capitalistes, Elle ne peut être employée, ni à l'accroissement de la consommation de la classe dominante -comme dans les systèmes passés- ni à la consommation des ouvriers.
"... La consommation croissante de la classe capitaliste ne saurait en tout cas être considérée comme le but final de l'accumulation; au contraire pour autant que cette consommation s'effectue et s'accroit, il ne peut y avoir d'accumulation; la consommation personnelle des capitalistes entre dans la catégorie de la reproduction simple. Il s 'agit au contraire de savoir pour qui les capitalistes produisent lorsqu'ils "pratiquent l'abstinence" au lieu de consommer eux-mêmes leur plus-value, c'est à dire, lorsqu’ils accumulent. A plus forte raison, le but de 1'accumulation ne saurait être du point de vue capitaliste, l'entretien d'une armée d'ouvriers toujours plus nombreuse. La consommation des ouvriers est une conséquence de l'accumulation, elle n'en est jamais ni le but ni la condition, à moins que les bases de la production capitaliste ne soient bouleversées. D'ailleurs les ouvriers ne peuvent jamais consommer que la partie du produit correspondant au capital variable, et pas un sou de plus. Qui donc réalise la plus-value toujours croissante ? " ("L'accumulation du capital". Chapitre 25).
Et R. Luxemburg répond : les secteurs non-capitalistes. Le capital ne peut pas constituer un marché pour toute sa production.
Pour qui produisent les capitalistes ?
Boukharine reproduit ce morceau dans sa brochure et pour y répondre commence par mettre en question la façon même de poser le problème.
"Avant tout, peut-on poser la question du point de vue du BUT subjectif (même subjectif de classe) ? Que signifie soudainement une telle TELEOLOGIE (étude de la finalité) dans les sciences sociales ? Il est clair que la problématique même est incorrecte méthodologiquement, pour autant qu'il s'agit là d'une formulation sérieuse et non d'une tournure métaphorique. En effet, prenons par exemple une loi économique reconnue par la camarade R. Luxembourg elle-même, par exemple la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. "Pour qui", c'est à dire, dans l'intérêt de qui cette baisse se produit-elle ? La question est évidemment absurde, il n'est pas permis de la poser, car la notion de but est exclue ici, à priori. Chaque capitaliste (Souligné par nous) cherche à obtenir un profit différentiel (et y réussit parfois); d'autres le rattrapent, et comme résultat nous avons un fait SOCIAL : la baisse du taux de profit. De la sorte, la camarade Luxembourg abandonne la voix de la méthodologie marxiste en renonçant à la rigueur conceptuelle de l'analyse de Marx." (Boukharine."L'impérialisme et l'accumulation du capital". Chapitre 1).
Boukharine a raison de dire qu'il est absurde de poser la question "POUR QUI baisse le taux de profit". La baisse du taux de profit est une tendance concernant la mesure d'une proportion économique (profit sur capital engagé). C'est une tendance qui n'a pas "de destinataire". Elle n'est pas créée par quelqu'un en vue de la fournir à quelqu'un d'autre. La question "pour qui" n'a aucun sens. Mais il en est tout autrement de la question "Pourquoi les capitalistes décident-ils d'augmenter leur production ?".
Le capitaliste produit pour vendre et réaliser un profit. Il n'augmente sa production que s'il sait qu'il aura un débouché, des acheteurs capables de réaliser le travail qu'il a extirpé à ses ouvriers en argent comptant. Le capitaliste ne développe sa production que s'il sait A QUI VENDRE, ce qui est la traduction capitaliste de la question plus générale : POUR QUI PRODUIRE ? Et cette question est pour lui tellement cruciale que s'il ne sait y répondre, il est condamné à la faillite.
Boukharine accepte finalement de répondre à la question mais à condition, dit-il, de la poser d'un point de vue OBJECTIF. Voilà comment il commence donc sa réponse : "...sa question... ne devient significative que sous une forme objective, à savoir : tout système social croissant quelle que soit son enveloppe historico-économique, quelques contradictions qu'il développe, quelques soient les motifs qui guident ses agents dans leur activité économique, suppose un lien absolument objectif (même s'il est INDIRECT) entre la production et la consommation. En outre, L'ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION, comme résultat de L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION, comme autre côté de cet accroissement, est la CONDITION FONDAMENTALE DE LA CROISSANCE DE TOUT SYSTEME SOCIAL." (p.29. souligné par Boukharine).
En d'autres termes, la production crée elle-même son propre débouché. Plus on produit, et plus on consomme. Si on applique le raisonnement de Boukharine aux situations de crise capitaliste, on aboutit à l'absurdité suivante : que doivent faire les capitalistes lorsqu'ils sont confrontés à une crise généralisée de surproduction et qu'ils n'arrivent pas. à écouler des stocks de marchandises invendues ? Le docteur Boukharine leur répond : produisez encore plus ! Ne vous en faites pas, OBJECTIVEMENT, l'accroissement de la consommation n'est que le RESULTAT, "L'AUTRE COTE" de l'accroissement de la production !
C'est peut-être une raisonnement logique, qui satisfait l'esprit théorique de Boukharine, mais il n'arrange pas beaucoup les affaires du capitaliste qui ne sait plus où entreposer ses marchandises produites, mais invendues.
Répondant à l'économiste français J.B. Say et à sa fameuse loi selon laquelle la production créé automatiquement son marché, Marx écrivait dans "La critique de l'économie politique" :
"L'équilibre métaphysique des achats et des ventes se ramène à ceci : chaque achat est une vente et chaque vente, un achat. Cela n'a rien de bien consolant pour les détenteurs de marchandises qui n'arrivent pas à les vendre, ni donc à acheter". (Partie sur "La métamorphose des marchandises")
On appelle "sophisme" un raisonnement qui est conforme aux règles de la logique mais aboutit à des conclusions fausses, c'est à dire contredites par la réalité qu'elles prétendent cerner. C'est le cas du raisonnement de Boukharine.
Boukharine dit une vérité : quel que soit le type de société qu'on envisage, il y a un lien "objectif" entre la production et la consommation. Pour produire, il faut consommer, ne fut-ce que des aliments pour ceux qui produisent. Pour consommer, il faut produire de quoi consommer. C'est une vérité, mais elle n'est ni très originale, ni très utile ici. De l'âge de pierre au capitalisme, il y a toujours un lien "absolument objectif" entre production et consommation. Mais CE LIEN n'est pas le même dans tous les systèmes de production qui se sont succédés dans l'histoire.
Dans le capitalisme en particulier, CE LIEN "ABSOLUMENT OBJECTIF" se trouve totalement bouleversé par la généralisation du salariat. Le capitalisme fait connaître à l'humanité un phénomène qu'elle ne pouvait même imaginer pendant les millénaires précédents : les crises de surproduction. Pour la première fois dans l'histoire, il peut y avoir accroissement de la production de biens aptes à la consommation, sans que cela s'ensuive d'une augmentation de la consommation. Qui plus est, pendant les crises de surproduction, la consommation baisse, du fait des licenciements et des baisses de salaire, et les ouvriers qui restent au travail doivent travailler plus dur que jamais sous la menace du chômage. En ce sens, la platitude de Boukharine sur le lien "absolument objectif" qui existe entre production et consommation "dans tout système social croissant" ne fait pas avancer la question d'un iota. Au contraire, en noyant le capitalisme dans la nuit des temps des systèmes précédents, on ne fait qu'embrouiller le problème, voire le rendre insoluble.
Cependant, Boukharine persiste et signe. "L'ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION, -dit-il- comme résultat de L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION, est LA CONDITION FONDAMENTALE DE LA CROISSANCE DE TOUT SYSTEME SOCIAL".
Ce faisant, il nous dit :
1)une trivialité
2) une stupidité qui fut le cheval de bataille de la plupart des économistes bourgeois au 19ème siècle.
Une trivialité : l'accroissement de la consommation présuppose un accroissement de la production. Il est assez évident que pour consommer plus, il faut d'abord qu'il y ait plus de biens à consommer, donc plus de biens de consommation produits. On peut difficilement consommer ce qui n'existe pas. Une stupidité : l'accroissement de la consommation est un résultat de l'accroissement de la production. Dans le capitalisme, on peut produire plus sans que pour autant il y ait augmentation de la consommation. Il n'y a que dans le capitalisme qu'une telle chose est possible -la surproduction-mais c'est justement du capitalisme et de ses crises qu'il est question ici, et non des systèmes précapitalistes.
L'accroissement de la consommation n'est systématiquement un produit de l'accroissement de la production que dans des systèmes sociaux où la production est orientée vers la consommation immédiate des producteurs.
Dans les sociétés sans classes du "communisme primitif", les hommes se répartissaient plus ou moins égalitairement le résultat de leur production. Lorsque le produit de la chasse, de l'élevage ou de l'agriculture augmentait, la consommation augmentait automatiquement d'autant.
Dans les sociétés du type de l'esclavagisme antique ou du féodalisme, la classe dominante s'emparait du surproduit du travail des exploités et elle le consommait. Lorsque la production se développait, cela se traduisait d'une part, par une éventuelle augmentation de la consommation des travailleurs, (cela dépendait en partie du bon vouloir des maîtres), et, de la consommation de la classe dominante. Sous une forme ou sous une autre, un accroissement de la production avait systématiquement pour résultat une augmentation de la consommation.
Dans le capitalisme, ce lien systématique est rompu. Le lien entre le producteur et le consommateur est devenu contradictoire. Le capital ne se développe qu'en réduisant la part de la consommation.
"Le mode de production capitaliste a cette particularité que la consommation humaine qui, dans toutes les économies antérieures, était le but, n'est plus qu'un moyen au service du but proprement dit : l'accumulation capitaliste. La croissance du capital apparaît comme le commencement et la fin, la fin en soi et le sens de toute la production. L'absurdité de tels rapports n'apparaît que dans la mesure où la production capitaliste devient mondiale. Ici, à l'échelle mondiale, l'absurdité de l'économie capitaliste atteint son expression dans le tableau d'une humanité entière gémissant sous le joug terrible d'une puissance sociale aveugle qu'elle a elle-même créée inconsciemment : le capital. Le but fondamental de toute forme sociale de production : l'entretien de la société par le travail, la satisfaction des besoins apparaît ici complètement renversé et mis la tête en bas puisque la production pour le profit est non plus pour l'homme devient la loi sur toute la terre et que la sous-consommation, l'insécurité permanente de la consommation et par moments la non-consommation de l'énorme majorité de l'humanité deviennent la règle." (R. Luxembourg, "Introduction à l'Economie politique". Ch. sur "Les tendances de l'économie capitaliste".)
Tout comme les économistes bourgeois qui croient que les lois de production capitaliste ont existé de tout temps car elles sont "naturelles", Boukharine ne parvient pas à cerner ce qui distingue fondamentalement le capitalisme des autres types de sociétés dans l'histoire. Cela le conduit aussi bien à imaginer un capitalisme avec des caractéristiques du communisme qu'à concevoir un communisme ou du moins la rupture avec le capitalisme comme du capitalisme d'Etat -ce qui est beaucoup plus lourd de conséquences politiques .
LES OUVRIERS PEUVENT-ILS CONSTITUER LA DEMANDE SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE AU DEVELOPPEMENT DU CAPITAL ?
Pour argumenter contre l'analyse de R.Luxembourg, Boukharine prétend que l'accroissement de la consommation des ouvriers peut constituer le débouché nécessaire à la réalisation du profit capitaliste et donc à l'expansion de l'accumulation du capital.
"La production de la force de travail est indiscutablement la condition préalable de la production des valeurs matérielles, de la plus-value du capital. La production de la force de travail SUPPLEMENTAIRE est indubitablement la condition préalable de l'accroissement de l'accumulation." "(...) En réalité, le fait est que les capitalistes embauchent des OUVRIERS SUPPLEMENTAIRES, qui représentent ensuite précisément une demande supplémentaire". (Boukharine, Idem, Ch.1)
"Indubitablement" Boukharine évolue dans un monde théorique étranger à la réalité du capitalisme et de ses crises. théorique d'un capitalisme planifié et centralisé, qui, suivant ses directives se débarrasserait des crises :
"Représentons-nous (...) un régime CAPITALISTE COLLECTIF (capitalisme d'Etat) où la classe capitaliste est unie en un trust unique, et où, par conséquent, nous avons, une économie organisée, mais en même temps antagoniste du point de vue de classes (...) l'accumulation est-elle possible en ce cas ? Certes oui. Il n'y a pas de crise car, LES DEMANDES RECIPROQUES DE LA PART DE CHAQUE BRANCHE DE LA PRODUCTION A L'EGARD DE CHAQUE AUTRE BRANCHE AUSSI BIEN QUE LA DEMANDE DE CONSOMMATION, tant de la part des capitalistes que de la part des ouvriers sont données d'avance (il n'y a pas "d'anarchie de la production", il y a un plan rationnel du point de vue du capital). En cas de "mécompte" dans les moyens de production, 1'excédent est stocké, et, la rectification correspondante est effectuée au cours de la période de production suivante. D'autre part, en cas "d'erreur de calcul " pour les moyens de consommation des ouvriers ON DONNE CE SUPPLEMENT COMME "FOURRAGE" AU MOYEN D'UNE DISTRIBUTION GRATUITE, OU BIEN ON A-NEANTIT LA PORTION CORRESPONDANTE DU PRODUIT (souligné par nous). En cas de mécompte dans la production de produits e luxe,"l'issue" est également claire. Par conséquent, il ne peut y avoir dans ce cas de crise de surproduction". (Boukharine, idem, fin du Ch.3)
Boukharine prétend résoudre théoriquement le problème en l'éliminant. Le problème des crises de surproduction du capitalisme ., c'est la difficulté à vendre". Boukharine nous dit : on n'a qu'à procéder à "UNE DISTRIBUTION GRATUITE" ! Si le capitalisme avait la possibilité de distribuer gratuitement ce qu'il produit, il ne connaitrait effectivement jamais de crise majeure. Sa principale contradiction étant de ce fait résolue. Mais un tel capitalisme ne peut exister que dans la tête d'un Boukharine en mal d'arguments. La distribution "gratuite" de la production, c'est-à-dire l'organisation de la société de sorte que les hommes produisent directement pour eux-mêmes, cela constitue effectivement la seule solution pour l'humanité. Seulement, cette solution, ce n'est pas un capitalisme "organisé" mais le communisme.
Dans la réalité, une nation capitaliste qui s'amuserait à distribuer gratuitement sa production aux producteurs perdrait toute compétitivité économique face aux nations concurrentes par l'élévation de ses "coûts" de main d'œuvre. Dans la jungle du marché mondial, les capitaux qui survivent sont ceux qui vendent à meilleur prix, donc ceux qui font produire leurs exploités avec les coûts les plus bas. La consommation ouvrière est un coût, une charge pour le capital -non un but. Marx avait déjà répondu à ce genre d'élucubrations théoriques :
"Dans des régimes où les hommes produisent pour eux-mêmes, il n'y a pas de crise, mais il n'y a pas de production capitaliste non plus. (...) Dans le capitalisme, (...) un homme qui a produit n'a pas le choix entre vouloir vendre et ne le vouloir pas. Il lui faut vendre"
"Il ne faut jamais oublier que dans la production capitaliste, il ne s'agit pas de valeur d'usage, mais de valeur d'échange, et spécialement de l'augmentation de la plus-value. C'est là le moteur de la production capitaliste et c'est vouloir embellir les faits que de faire abstraction de sa base même dans le seul but d'évacuer les contradictions de la production capitaliste et d'en faire une production qui est orientée par la consommation immédiate des producteurs". Marx. ([4] [51])
Un des arguments les plus fréquemment employés contre l'analyse de Rosa Luxembourg, Boukharine le formule de la façon suivante :
"Rosa Luxembourg se rend l'analyse trop aisée. Elle privilégie une contradiction, à savoir, celle entre les conditions de la production de la plus-value et les conditions de la réalisation, la contradiction entre la production et la consommation dans les conditions du capitalisme. (...
R. Luxembourg négligerait des contradictions, telle celle entre "les différentes branches de production, la contradiction entre l'industrie et l'agriculture limitée par la rente foncière, l'anarchie du marché et la concurrence, la guerre en tant que moyen de cette concurrence, etc." (Boukharine, idem. Ch. 5)
Nous traiterons de cette question dans la suite de cet article. (à suivre )
R.V
{C}{C}{C}{C}{C}{C}[1]{C}{C}{C}{C}{C}{C} [52] K.Marx. « Le Capital », livre 3, 5° section III ;
{C}{C}{C}{C}{C}{C}[2]{C}{C}{C}{C}{C}{C} [53] K.Marx « Théories sur la plus-value ». Fin du 17° chapitre ;
{C}{C}{C}{C}{C}{C}[3]{C}{C}{C}{C}{C}{C} [54] "Un certain nombre de camarades du parti communiste d'Allemagne étaient, et pour une part sont encore d'avis, qu'on ne saurait baser un programme révolutionnaire que sur la théorie de l'accumulation de la camarade R. Luxemburg. L'auteur du présent ouvrage, qui est d'un avis différent, dut nécessairement se "charger d'un travail analysant d'un point de vue critique l'Accumulation du capital. CELA FUT D'AUTANT PLUS NECESSAIRE QUE, PAR SUITE DU MOT D'ORDRE DE BOLCHEVISATION des partis membres de l'Internationale Communiste, on commença à discuter de questions telles que la question nationale, agraire et coloniale, sur lesquelles la camarade R. Luxembourg avait adopté une attitude différente de l'attitude orthodoxe du bolchévisme. Il fallait donc examiner si il n'y avait pas de rapport entre les erreurs qu'elle avait commise dans ces questions et les erreurs théoriques de son Accumulation du capital.". (Boukharine, Préface de 1925 à "L'Impérialisme et l'accumulation du capital")
{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[4] [55] K.MARX, « Théories sur le plus-value ».
Questions théoriques:
- Décadence [12]
Heritage de la Gauche Communiste:
Rapport sur la fonction de l'organisation révolutionnaire
- 3967 reads
L'accélération des évènements et les enjeux des "années de vérité" obligent les révolutionnaires à approfondir leurs conceptions de l'organisation de l'avant-garde du prolétariat, sur la nature et la fonction de l'organisation, sur la structure et le fonctionnement.
Ce rapport sur la nature et la fonction de l'organisation a été adopté par la Conférence Internationale du CCI de janvier 82. Dans un prochain numéro, nous publierons le second rapport, sur la structure et le fonctionnement de l'organisation.
1) Depuis qu'il s'est créé, le CCI a toujours souligné l'importance décisive d'une organisation internationale des révolutionnaires dans le surgissement d'un nouveau cours de luttes de classe à l'échelle mondiale. Par son intervention dans la lutte, même à une échelle encore modeste; par ses tentatives persévérantes d'oeuvrer à la création d'un lieu véritable de discussions entre groupes révolutionnaires, il a montré dans la pratique que son existence n'était ni superflue, ni imaginaire. Convaincu que sa fonction répondait à un profond besoin de la classe, il a autant combattu le dilettantisme que la mégalomanie d'un milieu révolutionnaire, marqué encore par les stigmates de l'irresponsabilité et de l'immaturité. Cette conviction s'appuie, non sur une croyance religieuse mais sur une méthode d'analyse : la théorie marxiste. Les raisons du surgissement de l'organisation révolutionnaire ne sauraient se comprendre en dehors de cette théorie, sans laquelle il ne saurait y avoir de véritable mouvement révolutionnaire.
2) Les récentes scissions que vient de subir le CCI ne sauraient être comprises comme une crise fatale. Elles traduisent essentiellement une incompréhension sur les conditions et la marche du mouvement de classe qui secrète l'organisation révolutionnaire :
- que le cours vers la révolution est un phénomène mondial, et non local;
- que l'ampleur de la crise et des luttes n’ouvre pas mécaniquement une période immédiatement révolutionnaire;
- que la nécessité de l'organisation n'est ni contingente, ni épisodique mais couvre toute une période historique jusqu'au triomphe du communisme mondial;
- qu'en conséquence, le travail de l'organisation doit être compris à long terme, et se préserver de tous les raccourcis artificiels sécrétés par l'impatience immédiatiste, et qui mettraient en danger l'organisation.
3) L'incompréhension de la fonction de l'organisation des révolutionnaires a toujours conduit à la négation de sa nécessité :
- dans la vision anarchiste et conseilliste, l'organisation est considérée comme un viol de la personne de chaque ouvrier, et se réduit à un conglomérat d'individus, dont le rassemblement est purement fortuit;
- le bordiguisme classique, qui identifie parti et classe, rejette indirectement cette nécessité en confondant la fonction de l'organisation des révolutionnaires et la fonction de l'organisation générale de la classe.
4) Hier, comme aujourd'hui, cette nécessité d'une organisation de révolutionnaires demeure, et ne saurait se prévaloir ni de la contre-révolution, comme repoussoir, ni de l'ampleur de la lutte de classe (comme en Pologne où n'existait pas de fraction révolutionnaire organisée) :
- depuis la constitution du prolétariat en classe au 19ème siècle, le regroupement des révolutionnaires a été et reste un besoin vital. Toute classe historique porteuse du bouleversement social se donne une vision claire du but et des moyens de la lutte qui la mènera au triomphe de ses buts historiques;
- la finalité communiste du prolétariat engendre une organisation politique qui, théoriquement (programme) et pratiquement (activité), défend les buts généraux de l'ensemble du prolétariat;
- sécrétée en permanence par la classe, l'organisation révolutionnaire dépasse et donc nie toute division naturelle (géographique et historique) et artificielle (catégories professionnelles, lieux de production). Elle traduit la tendance permanente au surgissement d'une conscience unitaire de classe, s'affirmant en s'opposant à toute division immédiate;
- face au travail systématique de la bourgeoisie de dévoyer et briser la conscience du prolétariat, l'organisation révolutionnaire est une arme décisive pour combattre les effets pernicieux de l'idéologie bourgeoise. Sa théorie (le programme communiste) et son action militante dans la classe sont un puissant contrepoison aux miasmes de la propagande capitaliste.
5) Le programme communiste dont découle le principe d'action militante est le fondement de toute organisation révolutionnaire digne de ce nom. Sans théorie révolutionnaire, il ne saurait y avoir de fonction révolutionnaire, c'est à dire organisation pour la réalisation de ce programme. De ce fait, le marxisme a toujours rejeté toute déviation immédiatiste et économiste, visant à dénaturer et à nier le rôle historique de l'organisation communiste.
6) L'organisation révolutionnaire est un organe de la classe. Qui dit organe, dit membre vivant d'un corps vivant. Sans cet organe, la vie de la classe se trouverait privée d'une de ses fonctions vitales, et momentanément diminuée et mutilée. C'est pourquoi, de façon constante, cette fonction renaît, croit, s'épanouit en créant nécessairement l'organe dont elle a besoin.
7) Cet organe n'est pas un simple appendice physiologique de la classe, se contentant d'obéir à ses impulsions immédiates. L'organisation révolutionnaire est une partie de la classe. Elle n'est ni séparée, ni confondue (identique) avec la classe. Elle n'est ni une médiation entre l'être et la conscience de classe. Elle en est une forme particulière, la partie la plus consciente. Elle regroupe donc, non la totalité de la classe, mais sa fraction la plus consciente et la plus active. Pas plus que le parti n'est la classe, la classe n'est le parti.
8) Partie de la classe, l'organisation des révolutionnaires n'est pas la somme de ses parties (les militants), ni une association de couches sociologiques (ouvriers, employés, intellectuels). Elle se développe comme une totalité vivante dont les différentes cellules n'ont d'autre fonction que d'assurer son meilleur fonctionnement. Elle ne privilégie, ni des individus, ni des catégories particulières. A l'image de la classe, l'organisation surgit comme un corps collectif.
9) Les conditions du plein épanouissement de l'organisation révolutionnaire sont les mêmes que celles qui ont permis l'essor de la classe prolétarienne :
- sa dimension internationale; à l'image du prolétariat, l'organisation naît et vit en brisant le cadre national imposé par la bourgeoisie, en opposant au nationalisme du capital l'internationalisation de la lutte de classe dans tous les pays;
- sa dimension historique; l'organisation, comme fraction de la classe la plus avancée porte une responsabilité historique devant la classe. Mémoire de l'expérience irremplaçable du mouvement ouvrier passé, elle est l'expression la plus consciente des buts généraux et historiques du prolétariat mondial.
Ce sont ces conditions qui donnent à la classe comme à son organisation politique sa forme unitaire.
10) L'activité de l'organisation des révolutionnaires ne peut être comprise que comme un ensemble unitaire, dont les composants ne sont pas séparés mais interdépendants :
- son activité théorique, dont l'élaboration est un effort constant, et le résultat ni figé, ni achevé une fois pour toute. Elle est aussi nécessaire qu'irremplaçable;
- activité d'intervention dans les luttes économiques et politiques de la classe. Elle est la pratique par excellence de l'organisation où la théorie se transforme en arme de combat par la propagande et l'agitation;
- activité organisationnelle oeuvrant au développement, au renforcement de ses organes, à la préservation des acquis organisationnels, sans lesquels le développement quantitatif (adhésions) ne saurait se changer en développement qualitatif.
11) Bien des incompréhensions politiques et organisationnelles qui se sont manifestées dans notre Courant sont nées de l'oubli du cadre théorique dont le CCI s'est doté dès sa naissance. Elles ont pour origine une mauvaise assimilation de la théorie de la décadence du capitalisme, et des implications pratiques de cette théorie dans notre intervention.
12) Si, dans son essence, l'organisation des révolutionnaires n'a pas changé de nature, les attributs de sa fonction se sont qualitativement modifiés entre la phase d'ascendance et la phase de décadence du capitalisme. Les bouleversements révolutionnaires du premier après-guerre ont rendu caduques certaines formes d'existence de l'organisation révolutionnaire, et en ont développées d'autres qui au 19ème siècle encore n'apparaissaient que de façon embryonnaire.
13) Le cycle ascendant du capitalisme a donné une forme singulière et donc transitoire aux organisations politiques révolutionnaires :
- une forme hybride : aussi bien les coopératives, les syndicats que les partis pouvaient coexister dans une même organisation. Malgré les efforts de Marx, la fonction politique de l'organisation s'est retrouvée reléguée au second plan, la lutte syndicale passant au premier plan;
- la formation d'organisations de masse regroupant des fractions significatives de groupes sociaux particuliers (jeunes, femmes, coopérateurs), voire la majorité de la classe ouvrière de certains pays, a doté l'organisation socialiste d'une forme lâche, amenant un amoindrissement de sa fonction originaire d'organisation révolutionnaire.
La possibilité de réformes immédiates, tant économiques que politiques, déplaçait le champ d'action de l'organisation socialiste. La lutte immédiate, gradualiste primait sur la vaste perspective du communisme, affirmée dans le Manifeste Communiste.
14) L'immaturité des conditions objectives de la révolution a entraîné une spécialisation des tâches organiquement liées, une atomisation de la fonction de l'organisation :
- tâches théoriques réservées à des spécialistes (écoles de marxisme, théoriciens professionnels);
- tâches de propagande et d'agitation menées par des permanents ("révolutionnaires professionnels") syndicaux et parlementaires;
- tâches organisationnels, exercées par des fonctionnaires rétribués par le parti.
15) L'immaturité du prolétariat dont les grandes masses sortaient des campagnes ou des ateliers d'artisans, le développement du capitalisme dans le cadre de nations à peine formées, ont obscurci la fonction réelle de l'organisation des révolutionnaires :
- la croissance énorme de masses prolétarisées, sans tradition politique et organisationnelle, soumises aux mystifications religieuses, et prisonnières encore de la nostalgie de leur ancien état de producteurs indépendants, a donné une place démesurée au travail d'organisation et d'éducation du prolétariat. La fonction de l'organisation était conçue comme une injection de conscience et de "science" au sein d'une classe encore inculte et à peine sortie des illusions de la prime enfance;
- la croissance du prolétariat dans le cadre des nations industrialisées, a obscurci la nature internationale du socialisme (on parle plus de "socialisme allemand", de "socialisme anglais" que de socialisme international). La 1ère et 2ème Internationale se présentaient comme une fédération de sections nationales plus que comme une même organisation mondiale centralisée;
- la fonction de l'organisation était comprise comme une fonction nationale: édification du socialisme dans chaque pays, couronnée par une fédération associée d'Etats "socialistes" (Kautsky);
- l'organisation était considérée comme celle du peuple "démocrate", amené à se rallier peu à peu par les élections, au programme socialiste.
16) Ces caractéristiques passagères de cette période historique faussèrent les rapports entre parti et classe :
- le rôle des révolutionnaires apparaissait comme dirigiste (formation d'un Etat-major). De la classe étaient exigées des vertus de discipline militaire, de soumission à ses chefs. Comme toute armée, elle ne pouvait exister sans "chefs", à qui elle s'en remettait dans l'accomplissement de ses buts substitutionnisme, et même de ses moyens (syndicalisme)
- le parti était le parti du "peuple tout entier" gagné à la "démocratie socialiste". La fonction classiste du parti disparaissait dans le marécage du démocratisme.
C'est contre cette dégénérescence de la fonction du parti, que luttèrent et la Gauche de la 2ème Internationale et la 3ème Internationale à ses débuts. Que l'Internationale Communiste ait repris certaines conceptions de l'ancienne Internationale faillie (partis de masse, frontisme, substitutionnisme, etc.) est une réalité qui ne saurait avoir vertu d'exemple pour les révolutionnaires aujourd'hui. La rupture avec les déformations de la fonction de l'organisation est une nécessité vitale qui s'est imposée avec l'ère historique de la décadence.
16 bis) La période révolutionnaire surgie de la guerre a signifié un changement profond, irréversible, de la fonction des révolutionnaires :
- l'organisation, qu'elle soit encore réduite en dimension, ou parti développé, ne prépare plus ni n'organise la classe, et à fortiori la révolution secrétée par le prolétariat tout entier;
- elle n'est ni l'éducatrice, ni l'état-major, préparant et dirigeant les militants de la classe. La classe s'éduque dans la lutte révolutionnaire et les "éducateurs" eux-mêmes ont besoin d'être "éduqués" par elle;
- elle ne reconnaît plus des groupes particuliers (jeunes, femmes, coopérateurs, retraités, etc...)
17) L'organisation révolutionnaire est donc immédiatement unitaire, bien qu'elle ne soit pas l'organisation unitaire de la classe, représentée par les conseils ouvriers. Elle est une unité d'une unité plus vaste : le prolétariat mondial qui l'a engendrée .
- elle ne surgit plus nationalement, mais mondialement, comme une totalité secrétant ses différentes branches "nationales";
- son programme est identique (unicité) dans tous les pays, à l'Est comme à l'Ouest, dans le monde capitaliste développé comme dans les pays sous-développés. S'il subsiste encore aujourd'hui des "spécificités" nationales, produit d'une inégalité du développement capitaliste et de persistance d'anachronismes précapitalistes, celles-ci ne sauraient en aucun cas amener au rejet de l'unicité du programme. Celui-ci est mondial ou n'est rien.
18) La maturation des conditions objectives de la révolution (concentration du prolétariat, plus grande homogénéisation de la conscience d'une classe plus unifiée, plus qualifiée, d'un niveau intellectuel et d'une maturité supérieure à ceux du siècle dernier) a profondément modifié et la forme et la démarche de l'organisation des révolutionnaires:
a) par sa forme :
- elle est une minorité plus restreinte que par le passé, mais plus consciente, sélectionnée par son programme et son activité politique;
- elle est plus impersonnelle qu'au 19ème siècle, et cesse d'apparaître comme une organisation de chefs dirigeant la masse des militants. La période des chefs illustres et des grands théoriciens est révolue. L'élaboration théorique devient une tâche véritablement collective. A l'image des millions de combattants prolétariens "anonymes", la conscience de l'organisation se développe par l'intégration et le dépassement des consciences individuelles dans une même conscience collective;
- elle est plus centralisée dans son mode de fonctionnement, contrairement aux 1ère et 2ème Internationales, qui restèrent en grande partie une juxtaposition de sections nationales. Dans l'ère historique où la révolution ne saurait être que mondiale, elle est l'expression d'une tendance mondiale au regroupement des révolutionnaires. Cette centralisation, à la différence des conceptions dégénérescentes de l'Internationale Communiste après 1921 n'est pas une absorption de l'activité mondiale des révolutionnaires par un parti national particulier. Elle est l'autorégulation des activités d'un même corps existant dans plusieurs pays, sans qu'une partie puisse prédominer sur les autres parties. Cette primauté du tout sur les parties conditionne la vie même de celles-ci.
b) par sa démarche :
- dans la phase historique des guerres et des révolutions, elle retrouve sa véritable finalité: lutter pour le communisme, non plus par la simple propagande pour un but lointain, mais par son insertion directe dans le grand combat pour la révolution mondiale;
- comme l'a démontrée la révolution russe, les révolutionnaires surgissent et n'existent que dans et par la classe, de laquelle ils n'ont ni droits ni privilèges à exiger. Ils ne se substituent pas à la classe, de laquelle ils n'ont ni procuration de pouvoir, ni pouvoir étatique à recevoir;
- leur rôle consiste essentiellement à intervenir dans toutes les luttes de la classe, et à remplir pleinement leur fonction irremplaçable jusqu'après la révolution;
- de catalyser le processus de maturation de la conscience prolétarienne.
19) Le triomphe de la contre-révolution, la domination totalitaire de l'Etat, ont rendu plus difficile l'existence même de l'organisation révolutionnaire et réduit l'étendue même de son intervention. Dans cette période de profond recul, sa fonction théorique a prévalu sur sa fonction d'intervention et s'est révélée vitale pour la conservation des principes révolutionnaires. La période de contre-révolution a montré:
- que, petits cercles, noyaux, minorités insignifiantes isolées de la classe, les organisations révolutionnaires ne peuvent se développer qu'après l'ouverture d'un nouveau cours historique vers la révolution;
- que "recruter" à tout prix se traduit par la perte de leur fonction, en sacrifiant les principes pour le mirage du nombre. Toute adhésion est volontaire : elle est une adhésion consciente à un programme;
- que l'existence de l'organisation se perpétue par le maintien ferme et rigoureux de son cadre théorique marxiste. Ce qu'elle perd en quantité, elle le gagne en qualité, par une sévère sélection théorique, politique et militante;
- que -plus que par le passé- elle est le lieu privilégié de la résistance des faibles forces prolétariennes à la pression gigantesque du capitalisme, fort de 50 années de domination contre-révolutionnaire.
C'est pourquoi, même si l'organisation n'existe pas pour elle-même, il lui est vital de conserver de façon résolue l'organe que lui a confié la classe, en le renforçant, en oeuvrant au regroupement des révolutionnaires à l'échelle mondiale.
20) La fin de la période de contre-révolution a modifié les conditions d'existence des groupes révolutionnaires. Une nouvelle période s'est ouverte, favorable au développement du regroupement des révolutionnaires. Cependant, cette période nouvelle floraison reste encore une période charnière, les conditions nécessaires pour le surgissement du parti ne se sont pas transformées -par un véritable saut qualitatif- en conditions suffisantes. C'est pourquoi, pendant tout un laps de temps, se développeront des groupes révolutionnaires qui, par la confrontation, voire des actions communes, et finalement par leur fusion, manifesteront la tendance vers la constitution d'un parti mondial.
La réalisation de cette tendance dépend et de l'ouverture du cours vers la révolution et de la conscience même des révolutionnaires.
Si certaines étapes ont été franchies depuis 1968, si une sélection s'est opérée dans le milieu révolutionnaire, il doit être clair que le surgissement du parti n'est ni automatique ni volontariste, compte tenu du développement lent de la lutte de classe et du caractère immature et souvent irresponsable du milieu révolutionnaire.
21a) En effet, après le resurgissement historique du prolétariat en 1968, le milieu révolutionnaire s'est retrouvé trop faible et trop immature pour affronter la nouvelle période. La disparition ou la sclérose des anciennes Gauches Communistes -qui avaient lutté contre le courant pendant toute la période de contre-révolution- a été un facteur négatif dans le mûrissement des organisations révolutionnaires. Plus que les acquis théoriques des Gauches -redécouverts peu à peu et lentement réassimilés- ce sont les acquis organisationnels (la continuité organique) qui ont fait défaut, acquis sans lesquels la théorie reste une langue morte.
La fonction de l'organisation, sa nécessité même ont été le plus souvent incomprises, quand elles n'ont pas été tournées en dérision.
21b) Faute de cette continuité organique, les éléments surgis de l'après 68 ont subi la pression écrasante du mouvement étudiant et contestataire:
- adhésion à la théorie individualiste de la vie quotidienne et de l'auto-réalisation de soi,
- l'académisme de cercles, où la théorie marxiste est comprise soit comme une "science", soit comme une éthique personnelle,
- activisme-immédiatisme, où l'ouvrièrisme cachait mal un abandon total à la pression du gauchisme.
La décomposition du mouvement étudiant, le désabusement devant la lenteur et la sinuosité de la lutte de classe ont été théorisés sous la forme du modernisme. Mais le véritable milieu révolutionnaire s'est épuré de ces éléments les moins fermes, les moins sérieux, pour lesquels le militantisme était soit une occupation dominicale, soit le stade suprême de l'aliénation.
22) Malgré la confirmation éclatante, surtout depuis la grève de masse en Pologne, que la crise ouvrait un cours vers des explosions de classe de plus en plus généralisées, les organisations révolutionnaires -dont le CCI- ne se sont pas libérées d'un autre danger, non moins pernicieux que l'académisme et le modernisme : l'immédiatisme ; dont les frères jumeaux sont l'individualisme et le dilettantisme. C'est à ces fléaux que l'organisation des révolutionnaires doit aujourd'hui résister, si elle veut conserver son existence.
23) Le CCI, ces dernières années, a subi les effets désastreux de l'immédiatisme, forme typique de l'impatience petite bourgeoise, et ultime avatar de l'esprit confus de mai 68. Les formes les plus éclatantes de cet immédiatisme ont été :
a) l'activisme, apparu dans l'intervention et théorisé sous la forme de la conception volontariste du "recrutement". Il a été oublié que l'organisation ne se développe pas artificiellement, mais organiquement, par une sélection rigoureuse sur la base d'une plate-forme. Le développement "numérique" n'est pas un simple fait de volonté, mais le fruit d'une maturation de la classe et des éléments qu'elle sécrète.
b) le localisme s'est manifesté dans des interventions ponctuelles. On a vu certains éléments du CCI présenter "leur" section locale comme une propriété personnelle, une entité autonome, alors qu'elle ne peut être qu'une partie du Tout. La nécessité de l'organisation internationale a été même niée, voire ridiculisée, en ne voulant y voir qu'un "bluff" ou mieux qu'un "lien" formel entre sections.
c) l'économisme -déjà combattu par Lénine- s'est traduit par un esprit gréviculteur, chaque grève étant considérée en soi et non replacée et intégrée dans le cadre mondial de la lutte de classe. Souvent, la fonction politique de notre Courant a été reléguée au second plan. En se considérant parfois comme des "porteurs d'eau" ou des "techniciens" de la lutte au service des ouvriers, on a préconisé la préparation matérielle de la lutte future.
d) le suivisme (ou "queuisme"), ultime avatar de ces incompréhensions du rôle et de la fonction de l'organisation, s'est concrétisé par une tendance à suivre les grèves, en dissimulant son drapeau. Des hésitations sont apparues dans la dénonciation claire et intransigeante de toute forme nouvelle de syndicalisme. Les principes étaient mis de côté pour mieux "coller" au mouvement, et trouver un écho plus immédiat -être "reconnus" à tout prix par la classe.
e) l'ouvriérisme a été finalement la synthèse achevée de ces aberrations. Comme chez les gauchistes, certains éléments ont cultivé la démagogie la plus grossière en opposant "ouvriers" et "intellectuels", "base et sommet" au sein de l'organisation.
Le départ d'un certain nombre de camarades montre que l'immédiatisme est une maladie qui laisse des séquelles très graves, et qu'il débouche inévitablement sur la négation de la fonction politique de l'organisation, comme corps théorique et programmatique.
24) Toutes ces déviations, de type gauchiste, ne sont pas le fruit d'une insuffisance théorique de la plate-forme de l'organisation. Elles traduisent une inassimilation du cadre théorique, et en particulier de la théorie de la décadence du capitalisme, qui modifie profondément les formes d'activité et d'intervention de l'organisation des révolutionnaires.
25) C'est pourquoi le CCI doit combattre vigoureusement tout abandon du cadre programmatique, abandon qui mène fatalement à l'immédiatisme dans l'analyse politique. Il doit lutter résolument:
- contre l'empirisme, où la fixation sur l'événementiel, le phénomène contingent, mène fatalement à la vieille conception des "cas particuliers", éternelle matrice de tout opportunisme,
- contre toute tendance à la superficialité, qui se manifeste par un esprit de routine, voire une paresse intellectuelle,
- contre une certaine méfiance ou hésitation devant le travail théorique. Aux « couleurs roses »-de l'intervention, ne s'oppose pas la "grisaille" de la théorie. Celle-ci ne saurait être comprise comme un domaine réservé à des spécialistes en marxisme. Elle est le produit d'une réflexion collective et de la participation de tous à cette réflexion.
26) Pour préserver les acquis théoriques et organisationnels, il est nécessaire de liquider les séquelles du dilettantisme, forme infantile de l'individualisme :
- travail par à coups, sans méthode, à court terme,
- travail individuel, expression du "dilettantisme artisanal",
- irresponsabilité politique dans la constitution de tendances prématurées ou artificielles,
- démission ou fuite devant ses responsabilités. L'organisation n'est pas au service des militants dans leur vie quotidienne; au contraire, les militants luttent quotidiennement pour s'insérer dans le vaste travail de l'organisation.
27) La compréhension claire de la fonction de l'organisation en période de décadence est la condition nécessaire pour notre propre essor dans la période décisive des années 80.
Si la révolution n'est pas une question d'organisation, elle a des questions d'organisation à résoudre, des incompréhensions à surmonter, pour que la minorité des révolutionnaires puisse exister comme organisme de classe.
28) L'existence du CCI est garantie par une réappropriation de la méthode marxiste qui est sa boussole la plus sûre dans la compréhension des évènements et dans son intervention. Tout travail d'organisation ne saurait être compris et développé qu'à long terme. Sans méthode, sans esprit collectif, sans effort permanent de l'ensemble des militants, sans esprit persévérant excluant toute impatience immédiatiste, il ne saurait y avoir de véritable organisation révolutionnaire. Le prolétariat mondial a confié au CCI un organe dont l'existence est un facteur nécessaire dans les combats futurs.
29) Contrairement au siècle passé, la tâche de l'organisation révolutionnaire est plus difficile. Elle exige plus de chacun; elle subit encore les derniers effets de la contre-révolution, et les contrecoups d'une lutte de classe marquée encore par des avancées et des reculs, un cours en dents de scie.
Si elle ne subit plus l'atmosphère étouffante et destructive de la longue nuit de la contre-révolution triomphante, si aujourd'hui, elle déploie son activité dans une période favorable à l'éclosion de la lutte de classe et à l'ouverture d'un cours vers des explosions généralisées au niveau mondial, l'organisation doit savoir -une fois la lutte retombée- reculer en bon ordre, quand la classe momentanément recule.
C'est pourquoi, jusqu'à la révolution, l'organisation révolutionnaire devra savoir résolument lutter contre le courant ambiant d'incertitudes, voire de démoralisation dans la classe. La défense de l'intégrité de l'organisation dans ses principes et sa fonction est primordiale. Savoir résister, sans faiblesses ni repliement sur soi, c'est pour les révolutionnaires préparer les conditions de la victoire future. Pour cela, la lutte théorique la plus acharnée contre les déviations immédiatistes est vitale pour que la théorie révolutionnaire puisse s'emparer des masses.
En se libérant des séquelles de l'immédiatisme, en se réappropriant la tradition vivante du marxisme, préservé et enrichi par les Gauches Communistes, l'organisation démontrera dans la pratique qu'elle est bien l'instrument irremplaçable que le prolétariat a sécrété pour qu'elle puisse être à la hauteur de ses tâches historiques.
additif
C'est dans les périodes de luttes généralisées et de mouvements révolutionnaires que l'activité des révolutionnaires aura un impact direct, décisif même, car :
- la classe ouvrière se trouve alors face à une confrontation décisive avec son ennemi mortel: imposer la perspective prolétarienne ou céder aux mystifications, aux provocations et se laisser écraser par la bourgeoisie,
- elle subit en son propre sein, jusque dans ses assemblées et conseils, le travail de sabotage et de sape des agents bourgeois qui utilisent tous les moyens pour ralentir et dévoyer la lutte.
La présence des révolutionnaires en vue d'avancer des orientations politiques claires au mouvement et d’accélérer le processus d’homogénéisation de la conscience de classe, est alors, comme l’ont démontré les expériences de la révolution en Russie et en Allemagne, un facteur déterminant pouvant faire pencher la balance dans l’un ou l'autre sens. En particulier, on ne peut manquer de rappeler le rôle capital joué par les révolutionnaires tel que Lénine le définit dans ses "Thèses d'avril" :
Reconnaître que notre parti est en minorité, et ne constitue, pour le moment, qu'une faible minorité dans la plupart des Soviets de députés ouvriers, en face du bloc de tous les éléments opportunistes petits-bourgeois tombés sous l'influence de la bourgeoisie et qui étendent cette influence sur le prolétariat (...) Expliquer aux masses que les Soviets des députés ouvriers sont la seule forme possible de gouvernement révolutionnaire, et que, par conséquent, notre tâche, tant que ce gouvernement se laisse influencer par la bourgeoisie, ne peut être que d'expliquer patiemment, systématiquement, opiniâtrement aux masses les erreurs de leur tactique, en partant essentiellement de leurs besoins pratiques,' (Thèse 4)
Dès aujourd'hui, l'existence du CCI et la réalisation de ses tâches présentes représentent un travail de préparation indispensable pour être â la hauteur des tâches futures. La capacité des révolutionnaires a remplir leur rôle dans les périodes de lutte généralisée est conditionnée par leur activité actuelle.
1) Cette capacité ne naît pas spontanément mais est développée à travers tout un processus d'apprentissage politique et organisationnel. Des positions cohérentes et clairement formulées, tout comme les capacités organisationnelles pour les défendre, les diffuser et les approfondir ne tombent pas du ciel mais exigent une préparation, dès aujourd'hui. Ainsi, l'histoire nous montre comment la capacité des bolcheviks à développer leurs positions en tenant compte de l'expérience de la classe (1905 - la guerre) et à renforcer leur organisation, leur a permis, contrairement, par exemple, aux révolutionnaires en Allemagne, à jouer un rôle décisif dans les combats révolutionnaires de la classe.
Dans ce cadre, un des objectifs essentiels pour un groupe communiste doit être de dépasser le niveau artisanal de ses activités et de son organisation qui, en général, marque ses premiers pas dans la lutte politique. Le développement, la systématisation, l'accomplissement régulier et sans à-coups de ses tâches d'intervention, de publication, de diffusion, de discussion et de correspondance avec des éléments proches doit figurer au centre de ses préoccupations. Cela suppose un développement de l'organisation à travers des règles de fonctionnement et d'organes spécifiques lui permettant d'agir non comme une somme de cellules dispersées mais comme un corps unique doté d’un métabolisme equilibre.
2) Dès aujourd'hui, l'organisation des révolutionnaires représente également un pôle de regroupement politique international cohérent face aux groupes politiques, aux cercles de discussion et aux groupes ouvriers épars qui surgissent et surgiront un peu partout dans le monde avec le développement des luttes. L'existence d'une organisation internationale communiste avec une presse et une intervention crée la possibilité pour ces groupes, à travers une confrontation des positions et des expériences de se situer, de développer la cohérence révolutionnaire de leurs positions, et le cas échéant, de rejoindre l'organisation communiste internationale. En cas d'absence d'un tel pôle, les possibilités de disparition, de découragement, de dégénérescence (à travers par exemple l'activisme, le localisme, le corporatisme) de tels groupes sont d'autant plus grandes. Avec le développement des luttes et l'approche de la période de confrontation révolutionnaire, ce rôle gagnera encore en importance par rapport aux éléments sortant directement de la classe en lutte.
De plus en plus, la classe ouvrière est amenée à heurter son ennemi mortel de plein fouet. Même si le renversement du pouvoir de la bourgeoisie n'est pas immédiatement réalisable, le choc sera violent et risque d'être décisif pour la poursuite de la lutte de classe. C'est pourquoi les révolutionnaires se doivent d'intervenir dès maintenant, dans la mesure de leurs moyens, au sein de la lutte de classe:
- pour pousser les luttes ouvrières aussi loin que possible pour que toutes les potentialités qu'elles contiennent soient réalisées,
- pour réaliser qu'un maximum de problèmes soient posés, qu'un maximum de leçons puissent être tirées dans le cadre des perspectives politiques générales.
Conscience et organisation:
Courants politiques:
- Gauche Communiste [29]
Heritage de la Gauche Communiste:
Correspondance internationale : Russie 1917 et Espagne 1936 - Focus (usa)
- 3071 reads
"Les ouvriers espagnols sont allés beaucoup plus loin que les ouvriers russes de 1917. La Russie en 1917 était une lutte entre le féodalisme et la bourgeoisie, cette dernière manipulant les ouvriers, l'Espagne 1936 était strictement une réponse des ouvriers au capital." FOCUS ([1] [57])
Internationalism répond : "En Russie en 1917, à la différence de l'Espagne 1936, l'appareil d'Etat capitaliste a été balayé par les organes de masse du prolétariat. (...) L'insurrection désespérée des ouvriers à Barcelone en mai 1937 était le dernier sursaut du prolétariat, un effort vain pour renverser l'appareil d'Etat capitaliste?
REMARQUES INTRODUCTIVES
Depuis quelques temps, dans la presse de la tendance politique qui se dit le Courant Communiste International (CCI), ont paru des polémiques avec le groupe politique international auquel nous appartenons, Fomento Obrero Revolucionario (FOR). Ces polémiques ont couvert beaucoup de questions, et on peut constater que le CCI défend certaines positions fondamentales proches de celles du FOR : principalement l'opposition aux syndicats et aux "guerres de libération nationale". Cependant, ces points d'accord.de fait, aussi importants qu'ils soient dans le monde actuel, n'impliquent aucune identité de vue ou accord fondamental entre le CCI et le FOR.
Les axes pour interpréter ces positions, les voies de l'intervention, les méthodes de recherche, et les analyses historiques du CCI et du FOR sont complètement et totalement différentes.
Par exemple, bien que les deux tendances attaquent les syndicats, la base théorique pour le faire est entièrement opposée. Le CCI commence par une reconnaissance subjective, honnête et nécessaire de la fonction anti-ouvrière des syndicats. Puis, en utilisant quelques instruments théoriques limités, il tente de projeter en remontant l'histoire une théorie rétrospective du syndicalisme, basée sur le concept que les syndicats étaient progressistes au siècle dernier, lorsque le capitalisme était ascendant et pouvait satisfaire les besoins de base des ouvriers, alors qu'aujourd'hui, le capitalisme est décadent et doit utiliser les syndicats pour aider à réduire la consommation. Cette analyse ignore le rôle quotidien des syndicats dans la vente de la force de travail, et donc comme un secteur organique du capital. Pour nous du FOR, ce qui ne va pas dans les syndicats, ce n'est pas qu'ils fournissent ou ne fournissent pas des salaires plus élevés, mats c'est que dans la négociation des salaires, ou du prix du travail, ils fortifient le système dans lequel le travail est acheté et vendu comme marchandise. Les fonctions ouvertement répressives des syndicats ne dérivent pas non plus du besoin épisodique de la bourgeoisie d'avoir un "tampon" entre elle et les ouvriers, aspect du problème qui dans sa logique peut détourner les ouvriers en suggérant que de "nouveaux" syndicats, ou des syndicats "de lutte de classe", sont la réponse à la corruption des bureaucrates syndicaux. La véritable origine des syndicats est dans 1'inévitabilité, étant donné la vente de la force de travail comme marchandise, de la concurrence entre le vendeur (l'ouvrier) et l'acheteur (l'employeur) sur le prix.
Les ouvriers aujourd'hui tendent à s'opposer aux syndicats à cause de leur rôle dans la classe ouvrière comme police et régulateur de la production, aspect inchangé de leur rôle économique, et non produit des caprices d'une quelconque médiation politique, réelle ou imaginaire. La propagande du CCI sur les syndicats, bien qu'excellente par sa vigueur, reste néanmoins trop incorrectement sur-"théorisée" pour contribuer directement au développement d'un mouvement ouvrier antisyndical. Un attachement à la "théorie" en amateur et un aveuglement à l'expérience, dont la question syndicale n'est qu'un exemple, caractérise l'ensemble de l'activité polémique et politique du CCI. Ceci est particulièrement évident dans la plus récente communication du CCI avec le FOR, le texte "Les confusions du FOR sur Russie 1917 et Espagne 1936" dans la Revue Internationale n°25, 1981 (cité dans la suite de cet article sous le nom "1917-1936"). Le but du présent texte est de fournir une base pour une réponse complète aux points soulevés par le CCI dans "1917-1936".
Avant de passer à ce texte, quelques clarifications sont nécessaires. Bien que l'auteur de ces lignes soit membre du FOR, ce travail n'est pas et ne doit pas être considéré comme un texte "officiel" du FOR sur la Russie 1917 et l'Espagne 1936. Il est de l'avis de l'auteur que l'activité dans une organisation politique, tout en supposant l'accord sur le programme et sur les principales questions politiques de l'heure, ne peut pas et ne devrait pas automatiquement requérir l'accord sur tous les points de l'analyse du passé. Les raisons de ceci sont d'abord la nécessité pour les militants de développer des habitudes de recherche indépendante, et en second lieu, la futilité et l'infantilisme de rechercher des réponses simples et absolues dans l'analyse des événements historiques. Les positions de l'auteur sur l'Espagne 1936 ne diffèrent pas de celles du FOR en général et de ses principaux porte-paroles, G.Munis en particulier. Ce n'est pas le cas sur la Russie 1917, sur laquelle l'auteur est arrivé plus tard à être en désaccord avec les principaux points de l'analyse mise en avant par Munis. Nous disons plus tard, car notre position actuelle sur la Russie, comme nous le verrons, diffère beaucoup de celle développée par l'auteur dans une lettre sur Trotski publiée dans "Marxist Worker" n°2, 1980. La lettre de "Marxist Worker" développait une position défendue jusqu'à cette année.
Nous examinerons les positions du CCI sur l'Espagne et la Russie. Puis nous aborderons la position de Munis sur la Russie. Enfin, nous présenterons notre propre vision sur la Russie. (Ces deux derniers points ne sont pas publiés dans cette Revue, note de la rédaction).
Nous devons ajouter une dernière remarque. Notre critique du CCI est extrêmement dure, dans la lignée du texte "La fausse trajectoire de Révolution Internationale" qui sera bientôt publié dans notre bulletin "The Alarm". Ceci n'exclut pas une perspective de travail politique commun avec le CCI. Le FOR et le CCI sont aujourd'hui les seuls groupes qui ont une position de classe combative sur la contre-révolution de la "libération nationale", la question la plus urgente du moment. Dans nos attaques contre la "gauche" Salvadorienne, nous sommes seuls. Même si nos traditions et nos méthodes diffèrent radicalement empêchant un plein accord, ceci n'a pas d'effet sur des projets spécifiques pour des actions politiques conjointes. Sur ce point, l'auteur de ces lignes est pleinement soutenu par les autres membres de FOCUS.
1. LE CCI ET LE FOR SUR L'ESPAGNE 1936
Nous ne pouvons cacher notre inquiétude dans ce que nous voyons comme les défauts majeurs du système théorique et polémique du CCI qui ne se sont jamais aussi bien exprimés que dans leur position sur l'Espagne 1936. Pour commencer, dans "1917-1936" le CCI emploie des méthodes critiques contre Munis qui se situent dans les pires traditions de la fausse "gauche". Plutôt que d'étudier et analyser sans illusions les vues de Munis, le CCI fabrique puis démolit adroitement un homme de paille, en présentant comme les positions de Munis ce qu'il espère faire croire à ceux qui ne connaissent pas le travail de Munis. "1917-1936" tente d'étiqueter l'insistance de Munis (et notre insistance) sur la phase espagnole plus que russe dans les convulsions révolutionnaires mondiales de 1917 à 1937 comme "erreur fondamentale", puis attaque les "origines de l'erreur" en les réduisant à une prétendue "insistance sur les mesures sociales plus que politiques" dans les écrits de Munis. L'un "découle" évidemment de l'autre, car la dialectique doit être respectée. Le CCI est entraîné dans une sorte de chasse aux sorcières sur l'Espagne, non pas comme conséquence d'une recherche sur l'histoire politique Ibérique entre 1930 et 1939, mais par un désir de protéger et justifier à tout prix le "pacte" qu'il a passé avec les Bordiguistes, qui nient qu'une révolution ait eu lieu en Espagne parce qu'aucun parti "Bolchevik" n'a surgi. Le CCI n'affirme pas ceci aussi crûment : il parle d'une "organisation ouvrière de la gauche communiste", qui est ce qu'il décrit comme le parti Bolchevik dans sa position sur la Russie. Nous verrons où cela les conduit. Ce qui nous frappe dans ce "principe" du Bordiguisme et du CCI, c'est qu'il a un arrière-goût d'Hégélianisme. Mais l'Espagne est un événement d'histoire : nous ne sommes ni préparés ni désireux d'avoir une discussion de philosophie. Ce que nous avons dit sur cette position lorsque les Bordiguistes l'ont défendue au départ, est que leur point de référence, Bilan, était extrêmement ferme sur l'événement, puisqu'il appelait les ouvriers espagnols à "aller de l'avant" vers une révolution sociale sur la base d'une ... répétition du 19 juillet 1936, reconnaissant ainsi la signification pleinement révolutionnaire et communiste de cet événement majeur de la Révolution Espagnole.
L'article "1917-1936" du CCI n'est hélas pas organisé pour faciliter le débat sur l'Espagne, puis qu’il procède par la méthode d'aborder un sujet puis de glisser soudain et sans transition à un autre dès qu'on arrive en terrain solide. En somme, le CCI fait un peu plus que de répéter les arguments Bordiguistes : "Munis dit qu'il a eu révolution sociale en Espagne mais pas en Russie; mais ceci est évidemment faux, parce que... Munis fait aussi l'éloge des collectivités économiques espagnoles, et qu'elles n'étaient pas authentiquement communistes". Mais le caractère de la Révolution Espagnole n'est pas déterminé par celui des collectivités. Se concentrer sur celles-ci, c'est improviser. On peut pardonner une improvisation brillante et utile, comme celle de Rosa Luxemburg sur la Révolution Russe, mais il est évident que le CCI essaie simplement de justifier une contre-vérité à laquelle il adhère religieusement. Sur les collectivités, un point doit être fait immédiatement : les aspects positifs de leur travail cités par Munis n'ont pas été inventés par lui. Ils existaient, ni plus ni moins que les espoirs des ouvriers du monde dans la malheureuse "expérience Russe" existaient. "Harceler" les collectivités espagnoles aujourd'hui n'apporte pas plus de crédit au CCI que ce ne fut le cas pour les Bordiguistes de Programme Communiste il y a dix ans (voir "Alarma" n°25, 1973, en réponse au Prolétaire). En analysant la soi-disant "insistance sur les mesures sociales plus que politiques" en citant le "contenu social" des collectivités comme preuve qu'il n'y a pas eu de Révolution en Espagne, le CCI pratique lui-même ce qu'il attaque. En général le discours du CCI est caractérisé par un genre d'improvisation qui tend à rejeter ce qu'on attaque hors de la tradition communiste. C'est une des raisons pour lesquelles le FOR et Munis tendent soit à ignorer le CCI, soit à lui répondre avec un "excès de vitriol ".
Dans le FOR, nous admettons certainement que l'Espagne est la question la plus cruciale. Mais nous ne réduisons pas notre analyse des révolutions au critère qui se base sur l'activité du Parti ou les mesures étatiques. Ce qui décide de l'ampleur d'une lutte politique, c'est 1'étendue de 1'action autonome des ouvriers, par une quelconque "mesure'' particulière. Aussi, la supériorité de l'Espagne sur la Russie consiste en certains aspects-clés de l'Espagne 1936-39 qui sont absents de l'expérience russe :
La destruction de l'Etat, de la police et de l'armée par les ouvriers et non par un seul parti ou groupe, le 19 juillet 1936 ;
La prise en mains des principales industries par les ouvriers, suivie par la collectivisation de l'économie, dans laquelle le rôle de l'Etat et même, dans une certaine mesure, des syndicats, a été au départ secondaire par rapport à l'élan de masse non-institutionnel. Par exemple, en Russie 1917, les comités de ravitaillement ouvriers des villes étaient organisés pour prendre le blé aux koulaks; mais, en tant que mesures économiques, ce type d'action était remplacé rapidement par les nationalisations. A Barcelone en 1936, tous les marchés et les industries alimentaires ont été collectivisés par les travailleurs eux-mêmes. Ce qui s'est produit en Russie était une confiscation "révolutionnaire", une arme temporaire contre la famine. Ce qui s'est produit en Espagne était une explosion de classe contre le capital et le système du salariat.
3 mai 1937 à Barcelone : soulèvement ouvrier armé victorieux contre le stalinisme, défait par les seuls soins de la trahison des chefs de l'anarcho-syndicaliste CNT.
Plus important, ces événements eurent lieu après plusieurs années de confrontations de classe massives et de préparations ouvertes de la classe ouvrière pour la révolution, symbolisées surtout par la Commune des Asturies de 1934.
C'est tout à l'honneur de Trotski, malgré ses nombreuses erreurs, d'avoir reconnu que dans la période 1936-37 les ouvriers espagnols sont allés beaucoup plus loin que les ouvriers russes en 1917. La Russie en 1917 était une lutte entre le féodalisme et la bourgeoisie, cette dernière manipulant les ouvriers. L'Espagne 1936 était strictement une réponse des ouvriers au capital.
A ceci, le CCI ne répond qu'une chose: l'Espagne n'était pas autre chose qu'une répétition de la seconde guerre mondiale et un précurseur du Vietnam; une guerre entre puissances impérialistes antagonistes. Dans sa vision des liens entre l'Espagne et la Seconde Guerre Mondiale, il exagère quelque chose de juste, mais qui est pour les révolutionnaires une vérité secondaire, exactement à la manière des commentateurs politiques bourgeois et des historiens staliniens de la guerre d'Espagne, qui voient aussi dans l'Espagne une "guerre antifasciste", et rien d'autre. Ce qu'ils veulent tous ignorer, c'est que bien que la Révolution Espagnole se soit transformée d'une guerre civile en une guerre impérialiste (une revanche éloquente de l'histoire sur la formulation fameuse de Lénine, mais vide de sens, sur la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile), elle a d'abord été une révolution sociale, et les masses ont résisté à sa transformation en guerre impérialiste, en proportion directe de la violence et des mensonges utilisés par les Staliniens en 1936-39 qui se comparent aux Sociaux-démocrates dans la période 1914-23. Si les ouvriers espagnols n'avaient pas résisté à la campagne de guerre de la bourgeoisie, la réaction stalinienne n'aurait pas été aussi nécessaire.
La résistance des ouvriers espagnols au bellicisme de la bourgeoisie internationale et aux staliniens les distingue beaucoup en comparaison des ouvriers en France et en Allemagne en 1914 - la première guerre mondiale n'a certainement pas été précédée directement d'un 19 juillet ou d'un 3 mai -et aussi des ouvriers d'Europe de l'Est depuis 1945, où ni un 19 juillet ni un 3 mai ne se sont produits. Ce sont là les principaux points à discuter sur l'Espagne, bien que le CCI choisisse de les ignorer.
2. LE CCI SUR LA RUSSIE 1917
Comme pour l'Espagne, le CCI traite la Russie avec une approche de bluff. Examinons un peu quelques-uns des points importants de la question russe tels qu'ils apparaissent dans "1917-1936", qui ne révèlent pas seulement une caricature des positions de Munis, mais aussi une caricature du marxisme qui tend à discréditer fortement le CCI. Un point formel est à remarquer : le CCI, en polémiquant contre Munis sur la Russie, choisit d'ignorer son principal travail sur le sujet, le livre "Parti-Etat, Stalinisme, Révolution" publié par Spartacus en 1975, Paris. Mais nous traiterons de cela plus loin. Ce qui saute aux yeux dans "1917-1936", c'est la présence de perles telles que l'affirmation que le "parti des ouvriers (c'est-à-dire Bolchevik, note de l'auteur) exerçait encore (pendant la période du "communisme de guerre", note de l'auteur) un certain contrôle politique sur l'Etat qui a surgi de la Révolution Russe. Nous disons 'certain' parce que ce contrôle était relatif". La réaction de n'importe qui, même connaissant superficiellement l'histoire du bolchevisme, à cette affirmation doit être la surprise pour ne pas dire la stupeur. Qui n'a jamais sérieusement suggéré que le contrôle bolchevik sur l'Etat ait "diminué" de quelque manière que ce soit après 1917 ? Faire une telle proclamation, c'est suggérer que Staline n'était pas un bolchevik par exemple. Dire que le régime stalinien ne représentait pas les intentions révolutionnaires des Léninistes est une chose ; mais proclamer que le Parti-Etat ne s'est pas développé à partir de la dictature du parti Bolchevik, c'est s'engager à fabriquer une histoire qui ne trouve pire que celle des faux "Spartacistes" de Robertson, sinon celle des staliniens eux-mêmes. Le fait que le parti Bolchevik ait continué à dominer pendant la période "révolutionnaire" et "contre-révolutionnaire" de l'histoire russe d'après 1917, c'est précisément ce qui doit être analysé. Une habitude scolaire de jouer avec les concepts, visible dans cette remarque ridicule sur une "diminution" du contrôle étatique Bolchevik, montre à quel point d'excès le CCI est conduit par sa sollicitude envers les Bolcheviks, attitude malheureusement partagée par Munis, bien que Munis soit allé plus loin que tout autre "loyaliste à Lénine" par une démystification d'octobre 1917. Cette "loyauté à Lénine" mène aussi le CCI à traiter de manière apologétique et hésitante des aspects du bolchévisme même s'il ne peut les tolérer. Par exemple, dans "1917-1936", il dit : "ce qu'ils (les Bolcheviks) ont fait au niveau économique et social était le plus qui pouvait être fait". Ce que les Bolcheviks ont fait, c'est de mettre en place le capitalisme d'Etat ! Est-ce réellement tout ce qui pouvait être fait ? Plus loin, le CCI affirme que "la trahison du Bolchévisme doit être ajoutée comme une cause fondamentale interne" de la contre-révolution, comme si cette "trahison" n'était qu'une note de plus en bas de page ! Le CCI ne fait et n'a fait aucune tentative pour analyser les racines de cette "trahison" au-delà de cette remarque éculée que "l'erreur fondamentale interne de la Révolution Russe était d'avoir identifié la dictature du parti avec la dictature du prolétariat, la dictature des Conseils Ouvriers. Ce fut l'erreur subsistutionniste fatale des Bolcheviks". Une fois encore, cette position est partagée par Munis et par ceux qui au sein du FOR sont d'accord avec lui. Sur ce point, l'auteur de ces lignes est en désaccord total avec le CCI et Munis. D'abord, ce qui n'allait pas dans la dictature des bolcheviks, ce n'était pas le fait qu'elle se "substituait" aux masses. L'argument contre le"substitutionnisme" est un argument démocratique bourgeois contre la dictature en général. Toutes les dictatures sans exception sont substitutionnistes. Une dictature des Conseils Ouvriers se substituera elle-même aux ouvriers pas moins qu'une dictature d'un parti. Une dictature du prolétariat doit se subsister à coup sûr au reste de la société. En fait, la "substitution aux masses" est absolument nécessaire dans certaines situations. Le rejet du "substitutionnisme" du CCI est, ironiquement, exactement l'erreur faite par la FAI anarchiste en Espagne 1936, erreur reconnue, à leur crédit, par les anarchistes réellement révolutionnaires du groupe des Amis de Durutti, qui ont combattu avec les prédécesseurs du FOR, avec les masses à Barcelone en mai 1937. La question n'est pas dictature, mais dictature de qui? Le problème avec la dictature Bolchevik, comme nous allons essayer de le démontrer plus loin, est que c'était la dictature d'un parti non prolétarien.
Une critique complète du CCI, comme nous l'avons dit, devrait laisser de côté le domaine de la politique pour celui de la philosophie, puisque les réminiscences hégéliennes subsistent, par exemple dans la remarque que " toute altération du niveau politique (dans une révolution, note de l'auteur) implique un retour au capitalisme". Pour nous, c'est plus la persistance du capitalisme qui détermine toute altération de la forme politique. Le reste de 1'"arsenal" théorique du CCI est de la même piètre qualité. Parler de l'isolement de la Russie après la révolution comme facteur déterminant dans l'histoire de l'Etat bolchevik est bien et juste, mais après prés de 60 ans de répétitions, ce point a été au moins partiellement transformé en prétexte. Après tout, le pays "isolé" était le "sixième du monde". Et bien que nous rejetions les théories de Vollmar ou Staline sur le "Socialisme en un seul pays", il reste 1'"acceptation" curieuse de l'isolement russe de Zinoviev et d'autres "vieux bolcheviks"" en 1923, 1926 et 1927, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et en Chine; un aspect de l'histoire bolchevik suffisamment expliqué par les analyses psychologiques de Trotski.
Sur la question des "révolutions isolées", le CCI se laisse aller à quelque chose qui frise la calomnie dans la polémique avec Munis, alors que Munis a toujours insisté sur le fait que la victoire de la révolution espagnole, et de toute autre révolution, dépend avant tout de la destruction des frontières nationales et de l'extension de la révolution à d'autres pays. Finalement, que prouverait le pays révolutionnaire "isolé" en question, si au lieu d'être la Bolivie, comme c'est suggéré par le CCI, c'était les USA, la Russie, l'Allemagne de l'Ouest ou le Japon? Ou même la France ou l'Italie, la Chine ou le Brésil? Est-ce qu'un tel événement ne tendrait pas à contribuer à une révolution mondiale "simultanée", possibilité que le CCI choisit d'écarter? On peut nous railler, le FOR, pour fonder toute une perspective et un Second Manifeste Communiste sur cette possibilité, mais c'était précisément la perspective de Marx et Engels, qui fondaient leurs espoirs sur l'Angleterre et la France, les Etats-Unis et la Russie de leur époque, également capables d'emmener le monde entier avec elles, "simultanément".
FOCUS- 1981-
Réponse du CCI
Avant de discuter de la nature de classe des événements de Russie 1917 et d'Espagne 1936, qui sont les questions centrales dans le texte de Focus, quelques commentaires sont nécessaires. Sur la nature des syndicats, Focus écarte l'analyse du CCI selon laquelle le rôle des syndicats a différé dans les phases ascendantes et décadentes du capitalisme et offre à la place l'argument suivant: les syndicats ont toujours été contre 1a classe ouvrière parce que "en négociant les salaires ou le prix du travail ils fortifiaient le système dans lequel le travail est acheté et vendu comme une marchandise."
Ici, Focus présente une vue moraliste et a-historique de la nature du syndicalisme et un manque de compréhension de la différence qualitative entre les phases ascendante et décadente du capitalisme c'est-à-dire des conditions différentes dans lesquelles le prolétariat lutte.
Dans le capitalisme ascendant, quand il était encore historiquement un système progressiste, développant les forces productives, créant le marché mondial et établissant les bases matérielles pour la révolution communiste, la révolution prolétarienne n'était pas encore à l'ordre du jour. Ce qui était à l'ordre du jour pour la classe ouvrière, c'était un combat pour se constituer elle-même en tant que classe défendant ses intérêts de classe, participant à la lutte pour renverser le féodalisme où cela n'avait pas encore été accompli et pour arracher des réformes et des concessions à la bourgeoisie, afin de faire progresser son niveau de vie qui, réellement, incluait une lutte pour l'amélioration des conditions de la vente de la force de travail. Les syndicats ne furent jamais révolutionnaires, mais ils ont réellement offert les moyens pour le prolétariat, il y a un siècle, de lutter pour ses intérêts de classe propres, et pour développer les capacités politiques et organisationnelles requises dans la confrontation avec l'Etat capitaliste. C'est pourquoi les révolutionnaires à cette époque, Marx et Engels compris, avaient raison dans leur vision selon laquelle les syndicats étaient des écoles pour le socialisme. Cependant, quand le capitalisme entre dans sa phase décadente, ce qu'annonce de manière sanglante l'éclatement de la première guerre inter-impérialiste (1914), quand la possibilité de gagner des réformes durables arrive à son terme et que le capitalisme devient un frein au développement ultérieur des forces productives, la révolution prolétarienne est alors à l'ordre du jour et elle seule, peut constituer un progrès pour l'espèce humaine. La base matérielle pour l'existence du syndicat comme organe de la classe a été détruite par la crise historique du mode de production capitaliste, et les syndicats sont désormais, définitivement incorporés dans l'appareil d'Etat capitaliste.
Focus veut insister sur le fait que les syndicats ont toujours été contre la classe ouvrière par nature, parce qu'ils ont seulement lutté pour -des améliorations de conditions de vie de la classe ouvrière. Ce n'est pas le CCI qu'il doit attaquer, mais la conception en elle-même qui est la base du marxisme : le capitalisme dans sa phase ascendante constitue un pas nécessaire et progressiste pour l'humanité et le prolétariat doit défendre ses intérêts de classe directement opposés à ceux de la bourgeoisie, à travers une lutte politique et économique. Le capitalisme a créé les conditions humaines et matérielles de sa propre destruction.
MESURES POLITIQUES CONTRE MESURES ECONOMIQUES
Pour commencer, plusieurs choses doivent être clarifiées en rapport avec l'article "Russie 1917 et Espagne 1936, critique de Munis et du FOR" qui est publié dans la Revue Internationale n° 25.
Cet article souligne le point crucial : le renversement de l'Etat capitaliste et la prise du pouvoir par la classe ouvrière est le premier pas décisif dans la révolution prolétarienne. Ce sont la destruction révolutionnaire de l'Etat capitaliste et l'établissement d'une dictature prolétarienne à travers les conseils ouvriers qui sont les conditions préalables indispensables pour la transformation des relations économiques. Les mesures économiques entreprises par la révolution ouvrière quand elle triomphe dans n'importe quel pays, ne sont pas sans conséquence ou secondaires. Des mesures économiques correctes peuvent accélérer le processus de la révolution, contribuer à l'internationalisation de la révolution et à l'oblitération la plus rapide de la persistance de la loi de la valeur. Des mesures politiques incorrectes peuvent certainement retarder ce processus mais le point crucial est que, les mesures économiques doivent être observées dans leur contexte politique. Le pouvoir politique est la base de la révolution.
Le CCI ne pense pas que "ce qu'ont fait (les Bolcheviks) sur le plan social et économique était le maximum que l'on puisse faire". Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, les bolcheviks ont fait des erreurs de politique dont certaines étaient même de nature bourgeoise, mais nous insistons sur le fait que, aussi longtemps que le prolétariat exerce son pouvoir politique, de telles erreurs peuvent être corrigées (cf. Revue Int.85)
La plus claire et la plus radicale des politiques économiques entreprises par le prolétariat quand il prend le pouvoir dans quelque pays que ce soit, ne pourrait en elle-même opérer une transition au communisme. C'est seulement l'extension de la révolution à travers la guerre civile internationale entre le prolétariat et le capital et le renversement de l'appareil d'Etat capitaliste dans chaque pays qui peuvent rendre possible la transition au communisme nécessitant l'abolition de la production de marchandises, du travail salarié et de la loi de la valeur. Les erreurs, économiques et même politiques qui sont objectivement des concessions aux rapports sociaux capitalistes, peuvent être corrigées, mais seulement si le pouvoir politique prolétarien ,1a dictature de classe est intact. Et de la même manière, toute défaillance dans l'extension de la lutte de classe à un double pouvoir, à un assaut direct et à une destruction de l'Etat capitaliste, a pour conséquence de rendre toute tentative de transformation économique sans signification et de toute façon sans contenu révolutionnaire. L'article de la Revue Internationale 25 souligne que ce pouvoir politique du prolétariat, cette condition préalable à la transformation qui amène au communisme, était complètement absente dans l'Espagne de 1936.
L'ESPAGNE DE 1936-1937
Le FOR et FOCUS proclament que l'Etat bourgeois a été détruit par les ouvriers en Espagne 1936, mais cela est totalement faux. Il y eut sans aucun doute une insurrection ouvrière qui empêcha le coup d'Etat de Franco de triompher, mais en l'espace bref de quelques semaines, les anarchistes, staliniens, trotskystes furent tous intégrés dans le même Etat bourgeois avec les bourgeois républicains,
L'insurrection ouvrière fut rapidement transformée en une guerre entre fractions capitalistes rivales -chaque fraction étant armée et soutenue par un bloc impérialiste en compétition avec l'autre - grâce au travail de ces organisations capitalistes: absence d'organes unitaires de masse du prolétariat avec des comités élus et révocables pour coordonner la lutte (conseils ouvriers), contrôle des milices armées par ces organisations (Staliniens, sociaux-démocrates, CNT anarchiste), arrêt de la grève générale dans des villes-clefs telles que Barcelone, dispersion par celles-ci des ouvriers armés sur le front, pour gagner du terrain sur l'armée de Franco (au lieu de combattre sur le front de la lutte de classe et de renverser l'Etat capitaliste à son moment de faiblesse). C'est ce travail qui sanctionne la véritable intégration de ces organisations dans le gouvernement de l'Etat capitaliste espagnol. De tout ceci, devait découler une guerre dans laquelle le prolétariat allait être massacré pour la sauvegarde du capitalisme.
Le fait que l'Etat n'ait pas été détruit, que le prolétariat n'ait pas exercé sa dictature de classe, signifie que les collectivisations exaltées par Focus étaient vides de toute signification révolutionnaire. Elles ont été en fait utilisées contre les ouvriers pour empêcher les grèves dans l'industrie de guerre, pour augmenter le taux d'exploitation, pour allonger la journée de travail, etc. Aussi longtemps que l'appareil d'Etat bourgeois existe, de tels actes économiques "révolutionnaires" deviennent des obstacles à la tâche révolutionnaire primordiale : la destruction de l'Etat capitaliste. Tout comme le récent battage de la bourgeoisie sur l'autogestion en Pologne (et comme le démontre pleinement l'évolution vers l'autogestion des entreprises américaines en perdition), les illusions sur les pas économiques que les ouvriers peuvent faire sans détruire l'Etat capitaliste, ne peuvent que conduire à l'auto-exploitation sous le capitalisme.
Si l'Etat bourgeois fut détruit en 1936, comme le prétend Focus, de quelle manière la classe ouvrière a-t-elle exercé sa dictature de classe ? Mais même Focus trouve bien difficile de croire que la classe ouvrière a réellement pris le pouvoir politique en Espagne, et ils sont ainsi forcés de se contredire comme ils le font quand ils écrivent : "il y a eu une insurrection victorieuse d'ouvriers armés contre le stalinisme qui ne devait être vaincue que par la faute de la trahison des leaders de la CNT anarcho-syndicaliste le 3 mai 1937 à Barcelone". Pourquoi les ouvriers devraient-ils faire une révolution contre quelque chose qu'ils auraient déjà détruit ? Et que sommes-nous susceptibles de comprendre par la curieuse formulation : "une insurrection victorieuse... vaincue... " ?
L'insurrection désespérée des ouvriers à Barcelone en mai 1937 était le dernier sursaut du prolétariat, un effort vain pour renverser l'appareil d'Etat capitaliste, qui, mortellement blessé un an plus tôt, a été sauvé par les forces combinées de la social-démocratie, du stalinisme, de l'anarchisme et du trotskysme.
L'insurrection ne fut pas écrasée par la faute de la trahison de quelques leaders anarchistes comme voudrait nous le faire croire Focus, mais par l'armée, que ces organisations capitalistes -et pas seulement ses leaders- ont elles-mêmes précisément créée, et par l'influence idéologique permanente qu'ont eue ces mêmes organes de l'Etat capitaliste sur la classe ouvrière.
RUSSIE 1917
Quant il parle de la Révolution Russe, Focus montre une confusion et une inconsistance extrêmes. Le texte conclut sur le fait que, en Russie, en 1917, ce n'est pas une révolution prolétarienne mais une révolution bourgeoise contre le féodalisme qui a eu lieu. Cela implique que ces camarades, soit ne comprennent pas que le capitalisme, comme système global, est entré dans sa phase décadente au début de ce siècle et que la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour, soit qu'ils ne parviennent pas à saisir le capitalisme dans sa globalité de système mondial et croient que la phase décadente du capitalisme est commencée dans certains pays et pas dans d'autres. Ces deux visions sont erronées.
Si réellement la révolution bourgeoise était à l'ordre du jour en 1917 nous ne comprenons vraiment pas l'hostilité de Focus à l'égard de ce qu'ils appellent à tort une tendance bourgeoise radicale (les Bolcheviks), dans la mesure où les marxistes soutiennent la bourgeoisie progressiste dans son dépassement des résidus du féodalisme qui bloquent le développement des forces productives, dans la phase ascendante du capitalisme. Mais en fait le capitalisme en 1917 était un système mondial, dominant tout le marché mondial, miné par des contradictions insurmontables. Cela en fit un obstacle au développement des forces productives, au niveau mondial, et en ce sens la révolution prolétarienne était à l'ordre du jour en Russie comme partout ailleurs.
En Russie en 1917, à la différence de l'Espagne en 1936, l'appareil d'Etat capitaliste a été balayé car les organes de masse du prolétariat -les Soviets-, et cet événement monumental a été clairement saisi comme n'étant que le premier pas de la révolution mondiale de la classe ouvrière. Ni le renversement de l'Etat capitaliste, ni la reconnaissance de la nécessité vitale de la révolution mondiale, n'auraient été possibles sans le rôle décisif de la minorité révolutionnaire de la classe, le Parti Bolchevik... Et ce, malgré d'un côté toutes les erreurs et même les conceptions carrément capitalistes de son programme (le Parti se substituant à la classe, etc.) et de l'autre, le rôle non moins décisif que ce Parti a joué dans la contre-révolution qui a écrasé la classe ouvrière.
Nous ne pouvons qu'être d'accord avec G.Munis, qui parle au nom du FOR (quoique pas à celui de FOCUS) quand il écrit : "Une analyse révolutionnaire de la contre-révolution doit rejeter 1'une après 1'autre toutes les idioties sur la soi-disant nature bourgeoise des Bolcheviks, aussi bien que les commentaires teintés de ragots sur leur cruauté et leur avidité de pouvoir. De tels arguments conduisent à un reniement de la révolution russe et de la révolution en général ; Ils sont le produit des sceptiques, et pas seulement d'eux, mais surtout, et de plus en plus, de staliniens défroqués. "
Après avoir rejeté la nature de classe prolétarienne de la Révolution de 1917, Focus est incapable de tirer une quelconque leçon pour le futur de cet événement essentiel. Au lieu de cela, il opte pour un exercice littéraire de déformation, comparant la révolution russe à la révolution française, ce qui est permis par le point de vue erroné de Focus, selon lequel la Révolution en Russie en 1917 était (comme la révolution française), une révolution bourgeoise. Pour le prolétariat, les leçons tirées de sa révolution à propos du besoin d'internationalisation de la révolution, de la dictature des conseils ouvriers et du rejet du substitutionnisme, sont par conséquent complètement ignorées par Focus.
En fait, quand il rejette "les clichés à propos du substitutionnisme bolchevik" FOCUS voit dans toutes les dictatures, sans exception, le substitutionnisme :
"Une dictature des conseils ouvriers se substituerait aux ouvriers autant qu'un Parti. La dictature du prolétariat se substituerait encore plus au reste de la société. En fait, "le substitutionnisme des masses" est absolument nécessaire dans certaines situations".
Parce qu'il rejette la nature ouvrière de la révolution russe, il ne peut voir que la révolution russe montre que ce substitutionnisme sonne le glas de la mort de la révolution ouvrière. Ce substitutionnisme a été un puissant facteur de la contre-révolution en Russie qui a contribué à la destruction du pouvoir de la classe ouvrière organisée dans les conseils ouvriers, et a amené au capitalisme d'Etat. Quand Focus parle des conseils se substituant à la classe ouvrière, il ne comprend pas la relation dynamique entre la classe ouvrière et les conseils ouvriers; que les conseils ouvriers ne peuvent pas se permettre d'être une institution au-dessus de la classe ouvrière, mais doivent être conservés comme des organes unitaires pour la classe ouvrière dans lesquels la plus large démocratie ouvrière est maintenue.
Si le substitutionnisme est inévitable et nécessaire, comme le prétend Focus, on peut se demander si ce groupe a une quelconque conception ou engagement vis à vis de la démocratie ouvrière !
J.G. & M.I. Internationalism (Section du CCI. aux U.S.A.)
[1] [58] Nous publions deux parties de cette lettre. Dans le numéro précédent de la Revue International, nous parlons de la rupture de FOCUS avec le FOR, cette lettre a été écrite lorsque FOCUS faisait partie du FOR
Histoire du mouvement ouvrier:
- Révolution Russe [59]
Evènements historiques:
- Espagne 1936 [60]
Courants politiques:
Revue Internationale no 30 - 3e trimestre 1982
- 2706 reads
Guerre des malouines : manoeuvres militaires, manoeuvres idéologiques, un piège pour le prolétariat
- 4786 reads
La guerre des îles Malouines vient alimenter une propagande intensive de la bourgeoisie. Le spectre d'une 3ème guerre mondiale vient hanter la conscience des prolétaires. Pourtant, la préoccupation essentielle de la bourgeoisie, ce n'est pas la guerre, c'est la perspective des affrontements de classe dans les centres du capitalisme. Le cours historique est à la révolution. C'est ce cours que la bourgeoisie essaie de renverser pour ouvrir le chemin vers la guerre mondiale. Sur son chemin, elle doit s'affronter au prolétariat qui n'est pas embrigadé. Les campagnes incessantes n'ont pas d'autre but que d'affaiblir le prolétariat avant cet affrontement.
La lutte de classe en Pologne est venue montrer que le prolétariat n'est pas vaincu, que son potentiel de combativité est énorme. La crise est là qui frappe toujours plus fort et pousse le prolétariat vers la révolution. Le conflit des îles Malouines est utilisé par la bourgeoisie pour "distraire" le prolétariat de cette perspective, pour lui faire oublier qu'il ne peut être mis fin à la guerre sans d'abord mettre fin au capital.
L'enjeu du conflit n'est pas aux îles Malouines, il est au coeur du prolétariat mondial, là où se dessine 1'avenir de 1'humanité.
LES CAUSES DE LA GUERRE
Depuis le début des hostilités, le 2 avril 1982, le conflit des îles Malouines a fait des centaines de morts et de blessés. Déclenchée par le débarquement des troupes argentines, entamée au rythme lent de la mise en place du blocus naval par la marine britannique, la guerre a été brutalement débarrassée de ses oripeaux folkloriques sous les coups des armes les plus sophistiquées de la marine et de 1'aviation.
Toute l'histoire de la bourgeoisie et de ses guerres nous montre que les alibis humanistes ne sont que des mensonges. Ce conflit ne fait pas exception à la règle : le régime des tortionnaires de Buenos-Aires se fait le chantre de 1'anti-colonialisme, de 1'anti-yankee, lui qui a toujours survécu grâce au soutien politique, militaire et économique des Etats-Unis ; la bourgeoisie anglaise se pose comme le défenseur intransigeant des valeurs démocratiques, elle dont l'histoire est jalonnée de massacres coloniaux, de guerres impérialistes, elle qui aujourd'hui s'est faite la spécialiste de la répression en Irlande du Nord. Tout cela n'est que de la propagande. Mais où sont donc les intérêts en jeu qui peuvent justifier un tel conflit ?
QUELS INTERETS ECONOMIQUES ?
Quasiment inconnues il y a encore quelques mois, les îles Malouines se retrouvent propulsées aujourd'hui au centre de l'actualité mondiale. 1800 habitants, dont la richesse ne reposait que sur 300 000 moutons et sur la pêche se retrouvent aujourd'hui prisonniers sous un déluge de bombes. Ce ne sont pas ces pauvres activités économiques qui peuvent réellement susciter des convoitises et une guerre de cette envergure. Alors, les Malouines recèlent-elles des ressources cachées ? La presse a pu parler à loisir des richesses cachées des océans : pétrole, krill, nodules poly-métalliques, etc. pour essayer d'expliquer le conflit. Pourtant, à l'heure de la crise de surproduction généralisée, qui va investir dans l'Atlantique Sud, surtout dans la région des Malouines, près du cercle polaire, aux conditions climatiques terribles? L'Atlantique Sud n'est pas la mer du Nord, entourée de pays industrialisés qui ont permis l'exploitation pétrolière dans des conditions climatiques comparables et on sait avec quelles difficultés.
Il n'y a pas d'enjeux économiques majeurs aux Malouines. Ces rochers perdus au milieu de l'océan, balayés par des vents glacés, sont-ils des enjeux stratégiques ?
QUELS ENJEUX STRATEGIQUES ?
Les îles Malouines étaient jusqu'à présent éloignées des préoccupations militaires. Les vieilles revendications territoriales des argentins semblaient faire partie du folklore latino-américain, tandis que la présence militaire de la Grande-Bretagne était symboliquement constituée avant le débarquement des troupes argentines par une poignée de soldats. Ces îles ne constituent un enjeu stratégique ni pour la Grande-Bretagne, ni pour 1'Argentine
Pour l'ensemble du bloc occidental qui voit deux de ses piliers s'affronter, les îles Malouines ne représentaient pas plus un enjeu stratégique crucial. Le bloc adverse, contrôlé par l'URSS, est bien incapable d'intervenir militairement dans cette région du globe. L'Amérique du Sud est la chasse gardée des Etats-Unis. A mille kilomètres des côtes du continent sud-américain, les îles Malouines sont à des milliers de kilomètres des bastions militaires pro-russes les plus proches, Cuba et l'Angola. Quant aux mythiques bases russes de l'Antarctique, elles se trouvent de l'autre côté du pôle sud. La plus importante présence militaire de l'URSS dans cette région, c'est encore l'oeil de ses satellites.
Le danger"russe"viendrait-il alors de l'Argentine elle-même ? On peut en effet difficilement soupçonner la Grande-Bretagne de sympathie prorusse. Le principal argument à l'appui de cette thèse réside dans le commerce argentin avec l'URSS, et notamment les exportations de blé à destination du bloc de l'Est. L'Argentine ne s'est-elle pas opposée ainsi à l'embargo sur le blé qu'avait décidé le président des Etats-Unis, Carter, après l'invasion de l'Afghanistan. Cet argument tombe à l'eau de lui-même, lorsqu'on sait que les exportations de céréales des Etats-Unis vers l'URSS sont bien supérieures à celles de l'Argentine. Ce serait quoi qu'il en soit7faire bien peu de cas du contrôle exercé par les Etats-Unis sur l'Argentine, dont le gouvernement et l'armée vivent au rythme des conseillers américains ([1] [62]). Un tel conflit n'a pu se déclencher sans que ceux-ci soient au courant.
Malgré la prétendue surprise affichée à Londres et Washington devant le débarquement des troupes argentines, celui-ci n'a pu se préparer et s'effectuer sans que les principales puissances occidentales ne soient au courant.
Dans ces conditions, s'il n'y a pas d'enjeux économiques et militaires qui justifieraient un tel déploiement de forces, pourquoi cette guerre, pourquoi ces morts ?
En voyant ce que le conflit des Malouines n'est pas, nous devinons ce qu'il cache : un gigantesque mensonge, son but est double : tester les armes navales modernes, et surtout nourrir une campagne intense de propagande qui vise à annihiler la prise de conscience du prolétariat mondial et notamment immobiliser les gros bataillions du prolétariat des pays industrialisés d’Europe.
DES GRANDES MANOEUVRES MEURTRIERES
Le bloc occidental contrôlé par les Etats-Unis trouve là l'occasion dans des conditions réelles de tester ses armes les plus sophistiquées. Tout cela loin de toute possibilité d'ingérence de l'URSS, en toute "tranquillité" vis-à-vis du grand rival impérialiste : le bloc de l'Est.
Cette guerre, qui met aux prises deux alliés fidèles et importants des Etats-Unis, n'est pas un affaiblissement pour le bloc occidental, bien au contraire. Elle lui sert à organiser pour l'avenir sa stratégie aéronavale et à orienter les milliards de dollars d'investissement nécessaires à la modernisation de son armement.
La Guerre des Six-Jours entre Israël et l'Egypte avait bouleversé les conceptions des stratégies de la mort moderne sur les batailles de blindés. Des centaines de chars détruits en quelques heures avaient montré l'importance des missiles et de l'électronique dans la guerre moderne sur terre. Le conflit des îles Malouines vient clarifier dans le même sens les conceptions actuelles de la bataille navale.
Au milieu de la tempête, dans des eaux glacées qui tuent en quelques minutes ceux qui tombent dedans, avec des nuits qui durent 15 heures, la bourgeoisie fait manoeuvrer ses troupes, expérimente ses armements les plus sophistiqués avec tout le mépris de la vie humaine que cela implique. Sous-marins atomiques, destroyers ultra-modernes aux noms ronflants, avions et missiles aux noms "innocents", transports de troupes dans le "luxe" des grands paquebots transatlantiques, bombardiers à long rayon d'action : la bourgeoisie nous demande de nous extasier devant la sophistication technologique et la perfection mortelle de sa panoplie guerrière, comme autrefois la presse alliée avait salué le bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki comme un "grand progrès scientifique" !
La bourgeoisie française trahit l'hypocrisie de toute la bourgeoisie lorsqu'elle s'extasie et se frotte les mains devant 1'efficacité des avions Mirage et Super-Etendard et des missiles Exocet qui sont pourtant employés contre son allié britannique.
Un capitaine de vaisseau britannique trahit les préoccupations militaires réelles de la bourgeoisie occidentale lorsqu'il déclare que, si le missile Exocet a coulé le destroyer Sheffield, c'est parce que ce dernier n'avait pas de défense contre ce système d'arme, mais que de toute façon, les russes n'ont pas d'armes équivalentes à l'Exocet. Derrière le conflit des îles Malouines, la bourgeoisie occidentale prépare le réarmement des forces aéronavales de l'OTAN face à l'URSS.
Mais là n'est pas encore l'essentiel. Dans ce conflit, la bourgeoisie vise un autre but, autrement important dans la période actuelle : la propagande pour égarer, déboussoler et museler le prolétariat.
LA CAMPAGNE IDEOLOGIQUE
Depuis le 2 avril 82, le spectacle de la guerre entre l'Argentine et la Grande-Bretagne fait la une et mobilise les médias du monde entier. La guerre entre l'Irak et l'Iran qui a fait plus de 100 000 morts et qui continue, n'a jamais eu un tel "succès". Ce ne sont certainement pas des motifs humanistes ou simplement la volonté de l'information qui animent une telle campagne, lancée à l'échelle internationale.
Dans la période de décadence du capitalisme, la bourgeoisie maintient sa domination sur la société par la terreur et le mensonge. Jamais l'humanité n'avait vécu une telle barbarie. Ce siècle a fait plus de 100 millions de morts dans les guerres ; des milliards d'hommes croupissent dans la famine et la misère les plus extrêmes. Chaque jour, dans ses usines, la bourgeoisie assassine plus d'ouvriers soumis à des conditions de travail désastreuses, qu'en deux mois de conflit aux îles Malouines. Chaque jour, les conditions de vie désespérantes qu'impose le capital, poussent des milliers de nouvelles victimes vers le suicide. C'est cette réalité de la barbarie du capitalisme en faillite que la bourgeoisie veut toujours faire oublier par sa propagande.
La campagne sur la guerre des îles Malouines ne fait pas exception à la règle. Déjà, la manière dont la bourgeoisie argentine se lance dans le conflit, utilisant celui-ci comme dévoiement du mécontentement social grandissant, la manière dont la bourgeoisie britannique réagit en développant un matraquage chauvin, nous montrent de façon caricaturale le poison idéologique que veut semer la bourgeoisie : accentuer la division du prolétariat mondial par le nationalisme. De ce processus, seule la bourgeoisie sort renforcée, aussi bien l'union nationale ([2] [63]) que la fausse opposition entre "pacifistes" et "bellicistes" sont autant de thèmes dont le seul but est d'empêcher la classe ouvrière de se concevoir de façon autonome par rapport à ses exploiteurs, et de l'entraîner derrière la bourgeoisie.
Mais si cette campagne trouve son expression la plus claire en Argentine et en Grande-Bretagne, les deux pays directement engagés dans la guerre, l'essentiel, même si cela peut paraître moins évident, c'est sa dimension internationale, à l'échelle du bloc de l'Ouest. C'est tout le prolétariat du bloc impérialiste contrôlé par les Etats-Unis qui est visé.
Pourquoi une telle campagne idéologique de la part de la bourgeoisie ? D'abord pour semer la confusion au sein du prolétariat. La crise pousse toujours plus la bourgeoisie vers la faillite économique ; elle est de plus en plus obligée d'attaquer le prolétariat, d'amputer son niveau de vie, de le réduire à des conditions de misère toujours pires. Après celui des pays sous-développés, c'est au tour du prolétariat des pays développés à être soumis à une paupérisation accélérée.
Dans les années 70, face à une attaque limitée de la bourgeoisie, le prolétariat a montré dans les métropoles du capitalisme qu'il n'était pas vaincu. La crise est là qui vient balayer les dernières illusions. Les grèves en Pologne sont venues montrer que le potentiel de combativité est intact. Au coeur historique, au centre de gravité du prolétariat mondial, en Europe, les conditions s'accumulent qui poussent vers une situation explosive, qui poussent le prolétariat vers la prise de conscience de la nécessité et de la possibilité de la révolution prolétarienne. C'est cette prise de conscience que la bourgeoisie veut entraver, dévoyer, affaiblir au travers d'incessantes campagnes menées depuis deux ans : sur l'Iran, sur l'Afghanistan, sur le Salvador, sur la Pologne, sur le pacifisme, etc...([3] [64]). La campagne sur la guerre des îles Malouines se situe dans cette continuité ; c'est dans ce cadre qu'elle prend tout son sens.
La propagande de la bourgeoisie sert d'abord un but : faire oublier au prolétariat le terrain de la lutte de classe. Avec la guerre locale des îles Malouines, après l’Afghanistan, l'Iran, le Salvador, la bourgeoisie occupe la tête des prolétaires et tente de faire oublier l'essentiel. Elle cherche à habituer à l'idée de la guerre, à en faire le centre des préoccupations de la classe ouvrière, et ainsi la déboussoler. La propagande bourgeoise cherche à hypnotiser le prolétariat, comme le serpent qui paralyse ainsi sa proie avant de la tuer et de la dévorer.
Le corollaire des campagnes bellicistes, c'est la pacifisme. Enfermer le prolétariat dans le faux choix "guerre ou paix" ne vise qu'un but : faire accepter au prolétariat la "paix" capitaliste, c'est-à-dire la misère. La "paix" capitaliste n'est qu'un leurre, ce n'est que la préparation de la guerre impérialiste dans un système qui, depuis des dizaines d'années, ne survit que par et pour la guerre.
Tant que le sang n'avait pas coulé, l'aspect folklorique du conflit ne permettait pas un plein développement de la campagne à partir du conflit des îles Malouines. La bourgeoisie a tué ce qu'il fallait (des centaines de soldats) pour crédibiliser aux yeux du prolétariat mondial le danger de guerre. Faire peur avec la guerre, afin d'amener le prolétariat à oublier la perspective révolutionnaire qui se dessine, seule alternative réelle à la crise de l'économie capitaliste. Créer au sein de la classe ouvrière le réflexe de l'autruche afin que le prolétariat plonge la tête dans les sables mouvants du nationalisme.
La bourgeoisie n'avait pas procédé autrement lors des campagnes anti-terroristes : créer un sentiment d'insécurité en alimentant les campagnes à coup de bombes sanglantes, de statistiques et faits divers sur la délinquance, afin de justifier le renforcement de l'appareil policier, de diviser le prolétariat et renforcer son atomisation au nom de l'ordre social.
L'impact de la campagne sur les îles Malouines ne se mesure pas tant dans un embrigadement du prolétariat en Argentine ou en Grande-Bretagne derrière l'étendard national (ce qui reste on ne peut plus hypothétique et de toute façon provisoire), mais dans la peur de la guerre mondiale et les réflexes isolationnistes induits, derrière lesquels rode le nationalisme ([4] [65]).
La campagne sur ia guerre des îles Malouines rejoint les campagnes qui l'ont précédée dans la tentative d'utiliser la peur de la guerre comme moyen de paralyser le prolétariat en lui faisant croire que toute instabilité sociale accélère le danger de guerre mondiale. Ce fut le thème véhiculé lors des grèves en Pologne : prétendre que la lutte des ouvriers polonais serait un facteur d'accroissement des tensions inter-impérialistes. C'est exactement l'inverse : la grève de masse en Pologne a constitué un frein aux tendances bellicistes de l'ensemble de la bourgeoisie mondiale. Le dispositif militaire du Pacte de Varsovie a été paralysé en même temps que l'économie polonaise ; les bourgeoisies des pays occidentaux, inquiètes des risques de généralisation de la lutte de classe en Europe, ont du également mettre leurs préoccupations militaires vis-à-vis du bloc adverse au second plan.
Pour isoler le prolétariat dans chaque pays, pour l'affaiblir, le nationalisme est une arme essentielle. C'est un réflexe isolationniste et nationaliste que la bourgeoisie s'évertue à recréer derrière le pacifisme, le neutralisme, le bellicisme, 1'anti-américanisme, 1'anti-totalitarisme, etc. Derrière le conflit des îles Malouines, la stratégie de la bourgeoisie se prof4-le : diviser le prolétariat pour mieux l'affronter.
Ce conflit truqué permet à la bourgeoisie au travers des "divisions" entre camps belligérants d'essayer d'opposer des fractions du prolétariat mondial à d'autres.
- Le déchaînement d'une violente campagne anti-USA en Amérique Latine a pour but, après la campagne sur le Salvador d'exacerber les sentiments anti-gringos, anti-yankee très vivaces en Amérique latine et ainsi d'opposer le prolétariat d'Amérique du Sud à celui d'Amérique du Nord. De la même manière les thèmes anti-coloniaux de la propagande argentine face à l'Alliance des pays développés, USA et Marché Commun visent à opposer le prolétariat des pays sous-développés à celui des pays développés. Dans les pays d'Europe de l'Ouest le prolétariat est appelé à soutenir l'effort de guerre de sa bourgeoisie au nom des valeurs occidentales, de la démocratie face au militarisme et au totalitarisme, les mêmes thèmes de propagande utilisés contre le bloc adverse, des forces du pacte de Varsovie.
Les grandes campagnes internationales de la bourgeoisie ont pour but essentiel dans la période actuelle, quelque en soit le prétexte, de développer les divisions au sein du prolétariat mondial, d'isoler chaque fraction de la classe ouvrière par rapport aux autres. Diviser pour régner, c'est toujours la même vieille recette éprouvée de la domination des exploiteurs.
La victoire que la bourgeoisie de tous les pays attend de la guerre des Malouines, ce n'est pas celle des armes, c'est celle de la propagande, du mensonge. Son but, ce n'est pas la domination sur un archipel de rochers, mais la domination sur le prolétariat.
GUERRE OU REVOLUTION
Avec le conflit des îles Malouines, ce qui se profile ce n'est pas immédiatement le spectre d'une troisième guerre mondiale, contrairement à ce que veut faire croire la classe dominante, c'est d'abord la préparation d'une attaque du prolétariat sur le plan économique, idéologique et militaire que la bourgeoisie met en place. C'est de cet ennemi-là que la bourgeoisie a peur.
Tous les palliatifs de la classe capitaliste pour faire face à la crise se révèlent impuissants. Les centres industriels sont touchés de plein fouet et le pire est à venir. L'affaissement du système économique mondial en son centre créé les conditions d'une explosion sociale au cœur du prolétariat mondial, là d'où le capital s'est élancé à la conquête du monde, là où se trouve l'enjeu des guerres mondiales, là où, au début du siècle, a été concrètement posée la question de la révolution prolétarienne : l'Europe.
La Pologne a été un avertissement pour la bourgeoisie mondiale. La dégradation accélérée de ses conditions de vie pousse la classe ouvrière vers un nouveau saut qualitatif de sa lutte et de sa conscience, au niveau international.
Les campagnes de division de la bourgeoisie ont pour but d'entraver ce processus qui mène vers la révolution communiste parce que c'est lui qui est à 1'ordre du jour.
Le chemin vers la guerre mondiale est barré par la dynamique de la lutte de classe prolétarienne. Le cours historique est vers des affrontements révolutionnaires et la bourgeoisie ne parvient pas^à embrigader le prolétariat mondial pour l'entraîner vers une guerre mondiale. La nature même du conflit des Malouines montre paradoxalement que la guerre mondiale n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. L'importance des moyens mis en œuvre pour cette campagne est à la hauteur des appréhensions de la bourgeoisie.
Pourtant s'il n'est pas immédiat au niveau mondial, le danger de guerre,est toujours présent. Le capitalisme ne peut vivre sans guerre; d'une certaine manière le conflit des Malouines vient encore le démontrer. Le prolétariat, s'il ne veut pas être entraîné dans la guerre capitaliste, doit détruire le capital. Les armes qui sont expérimentées dans l'Atlantique Sud donnent un avant-goût de ce que prépare la bourgeoisie. Si le prolétariat ne réagit pas, elle n'en restera pas là.
Mettre fin à la guerre, c'est mettre fin au capital car les deux sont indissolublement liés. C'est ce que la bourgeoisie veut nous faire oublier. Plus que jamais, l'alternative reste la division du prolétariat et la guerre ou l'union de la classe ouvrière et la révolution.
J.J.
"Mais les "faucons ", comme les "colombes ", commencent à s'interroger 1 'effort militaire en temps de paix est-il la meilleure façon de sortir de la crise économique? Jusqu'où l'austérité peut-elle être imposée sans menacer les équilibres internes? " ("Le monde diplomatique", avril 82)
"Le problème de la défense européenne est sérieux, mais il est avant tout d'ordre politique et économique. Le risque en Europe n'est pas 1 ' invasion peu probable par l'URSS mais l'échec moral économique et politique qui pourrait faire le jeu de ce pays."(Citation du co-directeur de l’Institut des Sciences politiques de Washington idem)
Le problème numéro un que confronte la bourgeoisie aujourd'hui, c'est le danger d'affrontement avec la classe ouvrière. La presse et les théoriciens de la bourgeoisie eux-mêmes l'expriment de plus en plus clairement.
[1] [66] Par ailleurs, 1'affrontement met face à face 1 'Argentine et la Grande-Bretagne, qui{, culturellement (150 000 argentins d'origine britannique), économiquement (la City de Londres a d'énormes investissements en Argentine) et militairement (la Grande-Bretagne fournit une part notable des armes qui massacrent ses propres soldats), sont des pays étroitement liés. Le Japon de son côté, aide 1'Argentine à faire face à ses dépenses de guerre en acceptant le report du paiement des dettes de celle-ci. Tous ces éléments ne peuvent que faire douter de la réalité des antagonismes
[2] [67] En Argentine les tortionnaires sont soutenus par leurs anciennes victimes, les torturés de l'opposition. Le nationalisme efface tout. Là est le rêve de la bourgeoisie que les victimes acceptent leurs bourreaux et que les exploités vénèrent leurs exploiteurs.
[3] [68] Sur la Pologne, voir Revue Internationale, N°27, 28 et 29. Sur le Salvador, voir le N° 25. Sur 1'Iran, voir Revue Internationale N°20 et 22.
[4] [69] La bourgeoisie est friande de sondages, instruments d'intoxication sur le thème de "1 'opinion publique" et qui lui servent aussi d'indications sur l'impact de ses campagnes idéologiques. L'Institut Gallup a ainsi fait un sondage international sur le thème de "la défense de la patrie". En France, à un sondage IFRES-Wickert, 47 % des personnes interrogées pensent que 1 'affaire des Malouines peut déboucher sur un conflit mondial, tandis que 87 % des allemands de l'Ouest estiment que les risques d'une guerre mondiale a augmenté à cause de ce conflit. Corollairement, face à cette peur, le vieux réflexe nationaliste joue au travers de la volonté saine mais détournée de rester en dehors du conflit : 61 % de gens en France s 'opposent au soutien à la Grande-Bretagne si cela devait impliquer un engagement ; 75 % des allemands réclament une stricte neutralité. En partie, ces chiffres montrent un manque d'adhésion à la guerre.
Géographique:
- Argentine [70]
- Grande-Bretagne [71]
Questions théoriques:
- Guerre [72]
Pourquoi l'alternative guerre ou révolution : La guerre est-elle une condition favorable pour la révolution communiste ?
- 4759 reads
De 1845 à 1847, le monde, particulièrement l'Europe, par suite de mauvaises récoltes agricoles, va connaître une grave crise économique : le prix du blé double en France, éclatent alors des émeutes de la faim. Les paysans ruinés ne peuvent plus acheter aux industriels, la construction de chemins de fer s'arrête, le chômage se généralise, les salaires baissent, les faillites se multiplient. La classe ouvrière engage une lutte pour des réformes : pour la limitation de la durée de travail pour un salaire minimum, pour l'obtention de travail, pour un droit de coalition et de grève, pour l'égalité civique et la suppression des privilèges, etc. Consécutivement : les journées explosives de février 1848 en France, si bien condensées dans le fameux opuscule de Marx "Les luttes de classe en France", devaient léguer comme leçon majeure à la postérité la nécessité pour la classe ouvrière de se démarquer désormais de la classe bourgeoise, de préserver une indépendance de classe. On oubli un aspect essentiel de cette révolution, pourtant : elle n'avait pas été provoquée par une guerre. Les causes en étaient oubliées, l'attention se concentrait sur l'écrasement de l'insurrection de juin 48 et la question d'un meilleur armement des ouvriers, de combats de rue mieux organisés, à l'encontre des leçons tirées par Marx et Engels sur la période historique et la nature de la lutte de classe.
Plus tard, si le désastre de Sedan entraîna l'effondrement de l'Empire en septembre 1870 puis la constitution d'un "gouvernement de Défense Nationale" avec le bourgeois Thiers à sa tête - qui allait échouer à désarmer la population parisienne et entraîner en réaction l'érection de la Commune au mois de mars - ce fût certes la première insurrection prolétarienne victorieuse de l'histoire, ce fut malgré tout un "accident" comme le reconnut Marx en cette période encore ascendante du capitalisme. Une nouvelle fois la bourgeoisie triomphait du prolétariat en train de se constituer. L'invocation de la Commune de Paris réitérée en oubliant son caractère accidentel conforta bien des confusions sur les possibilités pour une révolution prolétarienne de sortir victorieuse à long terme d'une guerre. Certes comme le notait Engels dans une introduction à "La Guerre Civile en France" : "... dès le 18 mars, le mouvement parisien avait un caractère de classe jusqu'alors dissimulé par la lutte contre l'invasion étrangère". Mais les conditions objectives n'étant pas réunies les communards étant en avance sur la marche de l'histoire, deux facteurs contribuèrent à la défaite : l'isolement (une ville assiégée) et le terrain militaire propre à la bourgeoisie ("la guerre contre l'armée versaillaise, sans cesse renforcée, absorba toutes les énergies" Engels), sans oublier le poids de l'entier soutien des forces prussiennes à la bourgeoisie française. Incroyable "ironie" de l'histoire, la Commune, tout en montrant concrètement la possibilité et la nécessité de la dictature du prolétariat, laissait accroire que toute révolution pouvait désormais émerger d'une guerre, et par vacuité théorique entraîna de fausses théorisations dans le mouvement ouvrier ; par exemple Franz Mehring et Jules Guesde théorisèrent la guerre "révolutionnaire" ; cette thèse confinera chez Guesde avec la thèse nationaliste de soumission à sa propre bourgeoisie. Or, surtout avec la fin du siècle consacrant l'entrée en décadence du capitalisme, il n'y avait plus de guerre "révolutionnaire", il n'y en avait d'ailleurs jamais eu pour le prolétariat. Nous verrons tout au long de ce texte pourquoi la guerre n'est pas en soi un "mal nécessaire" à la révolution.
Evidemment, comme toute expérience originale, la Commune -bien qu'à l'origine réaction ultime de "Défense Nationale"- confrontait pour la première fois en temps de guerre une bourgeoisie surprise et inexpérimentée face à la menace prolétarienne et révélait qu'une guerre est inévitablement stoppée par l'éruption du prolétariat ou en tout cas qu'elle ne peut pas être menée n'importe comment s'il subsiste le moindre îlot de résistance prolétarienne. L'arrêt de la guerre dans de telles conditions permet un repli des forces bourgeoises, la fin temporaire de leurs antagonismes guerriers et impérialistes afin de contourner puis étrangler conjointement le prolétariat.
En dépit de ce type de situation plus favorable à la bourgeoisie, pendant des décennies on accepta comme un axiome dans le mouvement ouvrier que les guerres créaient ou pouvaient créer les conditions les plus favorables à la généralisation des luttes et ainsi à l'explosion révolutionnaire. On s'abstint de considérer le handicap presque insurmontable créé par les situations de guerre mondiale qui limite ou réduit à néant une réelle extension victorieuse de la révolution. C'est véritablement à l'orée de la période décadente du capitalisme que l'enjeu va apparaître plus clairement dans le cours vers la 1ère guerre mondiale à travers la question : Guerre OU Révolution, et non pas Guerre ET Révolution.
La lutte de classe dans les conditions de guerre
Les révolutions de 1905 et 1917 dans le cours vers la guerre mondiale
N'en déplaise aux glorificateurs d'un passe considéré comme sans failles, les minorités révolutionnaires russes et allemandes à l'intérieur de la IIème Internationale n'ont pas considéré suffisamment les conditions imposées par le changement de période du capitalisme. Même s'il est vrai qu'il était terriblement difficile de s'extraire du processus d'involution de la IIème Internationale, les futurs fondateurs de l'Internationale Communiste furent surpris par l'entrée en guerre et ne se sont pas consacrés à tout le travail de préparation nécessaire pour le prolétariat.
Depuis quelques années, le CCI est parvenu à dégager l'importance de la notion de cours historique et le poids défavorable des conditions de guerre par le passé pour les révolutions (il est utile de se reporter à l'article "Le cours historique" Revue Internationale n°26). Rétrospectivement, on peut considérer qu'il revient à l'audacieux et lucide Trotsky avec sa fraction au début du siècle, non seulement d'avoir compris dès avant 1914 mieux que la majorité des bolcheviks qu'il n'y avait plus de révolution bourgeoise à l’ordre du jour en Russie, mais d'avoir aussi commencer à déblayer le terrain des fausses théorisations en délimitant les conditions aggravantes de cette révolution de 1905 en Russie "attardée" et "ratée" selon ses propres termes :
"La guerre, incontestablement, a joué un rôle énorme dans le développement de notre révolution, elle a désorganisé matériellement l'absolutisme : elle a disloqué l'armée, elle a donné de l'audace à la masse des habitants. Mais heureusement elle n'a pas créé la révolution et c'est une chance parce que la révolution née de la guerre est impuissante : elle est le produit de circonstances extraordinaires, repose sur une force extérieure et en définitive se montre incapable de conserver les positions conquises". (Notre révolution) La minorité autour de Trotsky, publiant "Naché Slovo" (Notre parole), produit et cristallisation d'une forte poussée de la classe au début du siècle en Russie, sera une des plus aptes à tirer des leçons cruciales sur la spontanéité historique du prolétariat se dotant de Conseils ouvriers, mais aussi mettra en lumière une raison essentielle à l'échec de 1905 : la situation de guerre. Dans son article "Catastrophe militaire et perspectives politiques" (Naché Slovo, avril-sept 1915), Trotsky, au nom de sa fraction, se refuse à spéculer sur la guerre en soi, non par motifs d'ordre humanitaires, mais pour des conceptions internationalistes. Il met en évidence le clivage insurmontable introduit par le processus de guerre : si la défaite ébranle le gouvernement vaincu et peut par conséquent favoriser sa décomposition, il n'en est rien pour le gouvernement victorieux qui est au contraire renforcé. De surcroît, dans le pays défait, rien n'est joué s'il n'existe pas un prolétariat fortement développé et apte à déstabiliser complètement son gouvernement vaincu militairement par homologue ennemi. Les contradictions entraînées par la guerre constituent un facteur très douteux d'impulsion historique du prolétariat dans la voie du succès ; constatation qui ne peut être infirmée à posteriori par aucun des échecs révolutionnaires, y compris la courte vague de bouleversements sociaux ouverte par l'année 1917.
La guerre n'est pas un tremplin assuré pour la révolution, elle est un phénomène dont le prolétariat ne peut avoir un parfait contrôle ou en disposer de son plein gré pour la faire disparaître alors qu'elle sévit mondialement. Trotsky au cours de ces années d'apprentissage, conçoit ainsi parfaitement l'impuissance d'une révolution basée uniquement sur des "circonstances extraordinaires". Les circonstances défavorables d'une révolution issue d'une défaite militaire dans un pays, sont, outre d'être circonscrite à ce seul pays, de trouver en héritage : "Une vie économique détruite, des finances exsangues et des relations internationales peu favorables" (Naché Slovo). Par conséquent, la situation de guerre ne peut conduire qu'à une réalisation plus difficile, voire impossible, des objectifs d'une révolution. Sans nier qu'une situation de défaitisme puisse préfigurer la catastrophe militaire et politique d'un Etat bourgeois et doive être utilisée par les révolutionnaires, Trotsky répète que ceux-ci ne font pas à leur guise les circonstances historiques mais représentent une des forces du processus historique. D'ailleurs ces révolutionnaires n'avaient-ils pas été induits en erreur en 1903 croyant à l'imminence d'une révolution avec un développement massif des grèves en Russie, qui devaient être paralysées dans un premier temps par la guerre russo-japonaise, puis, malgré le sursaut de 1905, défaites avec l'arrêt de cette même guerre ? Trotsky peut tracer une analogie historique avec les importantes grèves de 1912-1913 qui tiraient profit, à un niveau plus élevé pourtant des expériences précédentes, pour être en fin de compte bloquées à nouveau par la préparation de la guerre mondiale cette fois-ci. La défaite russe dans ces nouvelles circonstances ne dit rien qui vaille à Trotsky, d'autant plus que les sociaux- patriotes Lloyd George, Vandervelde et Hervé envisagent favorablement cette défaite comme propre à éveiller "le bon sens gouvernemental des classes dirigeantes", autrement dit spéculent en vulgaires défaitistes sur "la force automatique du krach militaire, sans intervention directe des classes révolutionnaires". Cette méfiance se justifiait d'autant plus que la défaite militaire en soi n'est pas la voie royale à la victoire révolutionnaire ; il faut, dit encore Trotsky insister sur l'importance de l'agitation des révolutionnaires dans cette période de bouleversements qui s'ouvre bien que défavorablement compte tenu de l'expérience historique antérieure.
La catastrophe militaire en épuisant les moyens de domination économique et politique de l'autocratie capitaliste ne risque-t-elle pas de ne provoquer mécontentement et protestations que dans une certaine limite ? Le risque ne demeure-t-il pas que l'épuisement des masses consécutif à la guerre ne les conduise à l'apathie ou au désespoir ? Le poids de la guerre est colossal, il n'y a pas d'automatisme vers une explosion révolutionnaire. Les dégâts prolongés de la guerre peuvent couper l'herbe sous le pied à toute alternative révolutionnaire. Malheureusement Trotsky se trompe sur un point, il croit que l'accumulation de défaites guerrières ne favoriserait pas la révolution, tout le contraire est vrai, c'est justement pour éviter cela que la bourgeoisie mondiale, prévoyante et inspirée par son passé, arrêtera la guerre en 1918. D'autre part, il utilise encore le mot d'ordre de "lutte pour la paix" au lieu de défaitisme révolutionnaire plus conséquent et défendu fermement par Lénine. Cependant, et déjà dans les circonstances tragiques et défavorables à long terme de la 1ère guerre mondiale, Trotsky détermine clairement le saut qualitatif nécessaire par rapport à 1905 : le mouvement révolutionnaire ne peut plus être "national" mais "de classe" à l’encontre des pleurnicheries des sociaux-patriotes mencheviks et libéraux alignés derrière le slogan capitaliste de "victoire", c'est à dire de prolongation de la guerre. Le prolétariat en Russie est confronté à toutes les fractions bourgeoises qui veulent l'isoler et l'empêcher de réagir sur son terrain de classe ; contrairement à 1905, il ne peut plus bénéficier de la "neutralité bienveillante" de la bourgeoisie. En 1905, il était faible car sans aide externe, isolé des masses prolétariennes d'Europe, quand au contraire le tsarisme bénéficiait de l'appui des Etats européens. En 1915, se posent deux questions : faut-il recommencer une révolution nationale où le prolétariat serait de nouveau dépendant de la bourgeoisie, ou bien faut-il faire dépendre la révolution russe de la révolution internationale ? Trotsky répond par l'affirmative à la deuxième question. Plus nettement qu'en 1905, le mot d'ordre "A bas la guerre !" doit se transformer en "A bas le pouvoir !". En conclusion : "seule la révolution internationale peut créer les forces grâce auxquelles le combat du prolétariat en Russie peut être mené jusqu'au bout". Ce long résumé de l'intéressant article de Trotsky nous fournit, par sa pertinence dans l'analyse des circonstances défavorables au prolétariat en période de guerre impérialiste, des éléments pour pourfendre les idéologies gauchistes et trotskistes de nos jours qui veulent nous faire avaler que les luttes de classe auraient toujours pris leur véritable essor révolutionnaire dans le cadre du nationalisme et de la guerre ; ainsi ces idéologues ne font que révéler que leur camp d'appartenance est celui de la bourgeoisie.
L’explosion d'octobre 17 contraignit le monde capitaliste à faire cesser la guerre, mais, bien que compte tenu de la faiblesse et maladresse de la bourgeoisie russe, le capitalisme mondial ait été pris de vitesse par le prolétariat des centres industriels de Russie, il saura se ressaisir pour stopper la vague révolutionnaire soulevée par ce premier succès. L'écrasement du mouvement révolutionnaire en Allemagne portera un coup décisif à l'internationalisation de la révolution. Ce ressaisissement de la bourgeoisie mondiale condamnera le prolétariat en Russie à l'isolement et par conséquent à une longue mais inéluctable dégénérescence fatale pour toute cette période à l'ensemble du prolétariat mondial. Cette première gigantesque apparition du prolétariat sur la scène du XXème siècle aura été brièvement victorieuse, la bourgeoisie le lui fera payer très cher par une contre-révolution dont le prolétariat international ne devait pas se relever de sitôt, même au cours de la IIème guerre mondiale.
L'absence de réaction du proletariat pendant et après la deuxième guerre mondiale
Au milieu de ce demi-siècle de contre-révolution triomphante, la IIème guerre mondiale ne fera que parachever la défaite dans l'isolement des années 20, On ne verra pas surgir de mouvements révolutionnaires un tant soit peu comparables à ceux de 1905 ou 1917-19. On peut citer bien sûr la dite Commune de Varsovie social-démocrate de 1944- réaction désespérée d'une population martyrisée et décimée sous la botte militaire- qui tint 63 jours puis fut exterminée par les hitlériens avec le consentement de Staline. On peut aussi citer les grèves de 1943-44 en Italie réprimées avec l'aval des "Alliés" anglais. Aucun de ces cas n'est probant pour estimer qu'il y aurait eu amorce d'un resurgissement du prolétariat à l'échelle mondiale menaçant la continuation de la guerre impérialiste.
Dans l'ensemble ce fut le coma le plus intense, le plus tragique du mouvement ouvrier dont les meilleures forces avaient été décimées par la contre-révolution stalinienne et achevées par le déchaînement terrible des belligérants capitalistes démocrates et hitlériens avec leurs blocs de résistance et leurs bombardements aveugles. Ce deuxième carnage impérialiste mondial montait un degré plus haut dans l'horreur que le précédent. Une révolution allait-elle mettre fin, surgir dans ou après cette tuerie planétaire ? Des révolutionnaires isolés et dispersés ont pu l'espérer vainement, quand les contre-révolutionnaires des maquis de "libération nationale" l'ont fait croire impunément dans le cadre de leurs idéologies chauvines, avec pour toute perspective une "libération" dans l’ordre, par étape, avec les démocrates briseurs de grève, les Churchill, De Gaulle et Eisenhower aux côtés de leur"camarade" Staline. La guerre cessa enfin, non sous une nouvelle menace prolétarienne, mais parce que les limites de la destruction totale avaient été atteintes, parce que plusieurs capitalistes "alliés" étaient venus à bout de la volonté d'hégémonie mondiale de l'un d'entre eux. Aucun nouvel Octobre 17 n'avait vu le jour. Le capitalisme retrouvant des airs de jeunesse, comme les herbes qui poussent sur les charniers humains, amorçait une période de reconstruction sur des ruines. Période de reconstruction temporaire qui ne devait pas l'empêcher de retomber un peu plus de deux décennies plus tard dans le marasme économique, poursuivant implacablement le développement de son économie de guerre en préparation...d'une 3ème guerre mondiale. Les quelques révoltes ouvrières dans le monde qui se produisirent les années suivantes restèrent fragmentées et isolées, que ce soit en France, en Pologne ou dans le tiers-monde, elles furent canalisées et étouffées dans l'ornière de la reconstruction capitaliste ou dans les dites libérations des colonies planifiées par les deux "Grands". Fondamentalement le cours de l'histoire était encore défavorable au prolétariat, il devait mettre longtemps à se remettre de l'échec physique et idéologique des années 20. Il faut se rendre compte de la profondeur d'une telle défaite pour comprendre comment la guerre mondiale a pu se reproduire inéluctablement dans les années 40.
Les limites du processus révolutionnaire dans les conditions de guerre
La guerre mondiale est le plus haut moment de la crise du capitalisme décadent, elle ne favorise pas en soi les conditions de la généralisation de la révolution. Prendre conscience de cela est mettre en évidence la responsabilité historique du prolétariat contre une possible 3ème guerre mondiale. En examinant la période de la 1ère guerre mondiale, nous pouvons considérer que, après avoir été battu idéologiquement et bien que ressurgissant en Russie, en Allemagne et en Europe centrale, le prolètariat resta cloisonné dans chaque nation. La bourgeoisie stoppant la guerre pour mieux faire face à l'attaque prolétarienne renforçait les barrières nationales. Bien que produites par la situation d‘aggravation économique et reprise des fortes luttes du début des années 1910, ces actions combatives du prolétariat ne pourront pas dépasser l'illusion véhiculée par la IIème Internationale traître selon laquelle la révolution devait se produire graduellement pays par pays et malgré la fondation justifiée d'une 3ème Internationale réellement communiste, la boucle du nationalisme étant refermée par le social-chauvinisme. En outre, avec cet arrêt de la guerre, l'inégalité des retombées économiques dans les pays vaincus et vainqueurs maintiendra et favorisera une division illusoire dans le prolétariat international. En avançant l'idée de "paix" la bourgeoisie mondiale était consciente des dangers du défaitisme révolutionnaire et des risques de contagion malgré tout des pays vaincus aux pays vainqueurs. Seul l'armistice entre les différents belligérants capitalistes pouvait leur permettre de souder leurs rangs pour rétablir la "paix sociale". Ainsi Clemenceau pût venir prêter main forte à Hindenbourg et Noske contre le prolétariat en Allemagne. Le prolétariat isolé sera ainsi acculé à des insurrections rapides et défavorables. Les conditions de l'échec sont réunies contre le prolétariat par cet arrêt de la guerre en Allemagne, la réussite est isolée en Russie dans des conditions exceptionnelles de "maillon faible" c'est à dire ne frappant pas de façon décisive au coeur géographique du capitalisme: l'Europe. Dans ce premier affrontement historique déterminant et inévitable entre la bourgeoisie réactionnaire et la classe révolutionnaire, la bourgeoisie restait maîtresse du terrain. Nous pouvons donc considérer que toute la période de la 1ère guerre mondiale n'a pas sécrété les meilleures conditions pour favoriser la révolution prolétarienne. Répétition sanglante de la barbarie capitaliste, la 2ème guerre mondiale était issue directement des clauses de l’"Armistice" de 1918, une paix provisoire et hypocrite pour justifier un nouveau partage capitaliste du monde. Cette répétition était d’autant plus possible qu'après la défaite physique du prolétariat au début des années 20, triomphaient les idéologies contre-révolutionnaires du stalinisme, du fascisme et de 1'anti-fascisme. Si le prolétariat a pu entraver sérieusement le processus de la 1ère guerre mondiale c'est bien sûr parce qu'il n'avait pas été écrasé physiquement et frontalement auparavant, c'est parce que en se battant sur son terrain de classe il avait été amené inévitablement à s'opposer à la guerre, c'est aussi parce que le type de guerre de tranchées favorisait, par la proximité des combattants la contagion révolutionnaire. Ce dernier facteur n'existait déjà plus au cours de la seconde avec l'utilisation des bombardiers et des sous-marins. Le capitalisme en perfectionnant les capacités de destruction à longue portée de ces engins de mort, et en mettant au point ses premières armes nucléaires -"testées" à Hiroshima par la très "démocratique" bourgeoisie américaine - faisait déjà des préparatifs en 1945 pour "aller plus loin" dans une 3ème guerre mondiale, pour empêcher toute possibilité de révolte interne en pouvant détruire des villes entières, en instaurant la menace de guerre sur n'importe quel recoin de la planète. Faire état de ce danger de gradation dans la destruction de la part du capitalisme n'a rien de mystique, mais rehausse la responsabilité du prolétariat qui a pour tâche historique de s'opposer à cette marche à la destruction généralisée avec les armes de la lutte de classe avec une vigueur au moins comparable à celle de la vague révolutionnaire du début du siècle. Pouvons nous croire une 3ème guerre mondiale inévitable pourtant ? Ces dernières années peuvent incliner à établir des comparaisons avec les périodes qui ont précédé les deux guerres mondiales : "paix armée", détérioration des relations internationales capitalistes, guerres locales, accroissement illimité du militarisme, social-pacifisme, bourrage de crânes tout azimut. La comparaison est facile et les arguments ne sont pas solides face à la réalité sociale. Il ne s'agit pas de prendre ses désirs pour des réalités mais de prendre la réalité des années 80 à bras le corps.
QUATRE CONDITIONS POUR LA REVOLUTION A NOTRE EPOQUE
Si nous restions obnubilés en surface par les phénomènes et les conséquences des deux plus grands carnages impérialistes de l'histoire de l'humanité, nous pourrions dire avec dépit : "jamais deux sans trois !", comme le philistin superstitieux du bistrot à côté. Mais, en utilisant la méthode marxiste,
nous répétons que "les grands événements de l'histoire se répètent pour ainsi dire deux fois : la première fois comme tragédie la seconde fois comme farce"! Mais que le communisme ne soit pas inéluctable si le prolétariat ne se hausse pas à la hauteur de sa responsabilité historique, nous le savons bien, mais la 3ème guerre mondiale n'est pas fatale non plus si sont comprises les potentialités immenses du prolétariat à notre époque. Plus que jamais, il revient aux révolutionnaires qui ont tiré le bilan des défaites passées de montrer à la racine la voie laissée ouverte par les générations mortes.
Il faut constater cependant, aujourd'hui encore, que les masses prolétariennes dans leur grande majorité ne sont pas encore pleinement conscientes de 1'enjeu, ni prêtes â engager les batailles décisives ; elles sont malgré tout amenées de plus en plus à poser de sérieux jalons de préparation. Nous ne prouverions rien en parlant vaguement des mécontentements sociaux ou en décomptant des millions d'heures de grèves dans tous les pays depuis 20 ans. Les courbes de ces grèves ont été plutôt décroissantes, et la plupart des luttes échouent régulièrement. La bourgeoisie réussit même à organiser de fausses grèves, des simulacres de luttes et à illusionner des ouvriers pour l'autogestion de leurs usines en faillite. Mais, malgré le tableau peu reluisant et à signification limitée des statistiques et données journalistiques, un certain nombre d'événements et d'explosions de luttes ouvrières se sont produits depuis près de deux décennies aux quatre coins du globe du Brésil à la Pologne, accumulant toute une série d'expériences internationales. Cette série de jalons, bien qu’irrégulière, révèle par contre-coup des conditions essentielles pour la révolution mondiale.
Le marasme économique mondial
La première véritable condition favorable pour la révolution réside dans le marasme économique mondial qui a endeuillé définitivement toutes les espérances bourgeoises en un monde capitaliste en perpétuel développement. Cette crise économique mondiale imparable et inguérissable est venue mieux que tout discours révolutionnaire déchirer la mystification du progressisme vers une humanité capitaliste heureuse (reléguant l'avenir de la classe ouvrière au 19ème siècle).
Bien supérieure en longueur et en intensité aux crises économiques cycliques du 19ème siècle ou à la période charnière du début de ce siècle, cette crise atteint indifféremment tous les recoins de la planète, pas un seul capitaliste n'en réchappe, pas un seul pays, pas un seul bloc. Ses effets concernent, mutilent, aggravent la situation de l'ensemble de la classe ouvrière mondiale. L'infrastructure économique s'effondre lentement révélant les vices de forme du système. Ce n'est plus la faute à l'ennemi de l'autre côté du Rhin ou des Pyrénées, c'est "partout pareil". Malgré les diverses censures, déformations ou désinformations à l'Est comme à l'Ouest, "ils" ne peuvent plus gouverner comme avant. Dans sa décadence avérée ce système capitaliste dévoile sa nature rétrograde et doit renouveler incessamment ses panoplies de mystifications. En tant que force étatique de contrainte, "ils" ce n'est plus seulement les patrons de droit divin mais surtout une superstructure d'encadrement social : gouvernements, syndicats, partis de gauche et de droite au langage commun d'austérité. L'effritement de l'infrastructure économique n'est pas sans ébranler la superstructure politique bourgeoise mais celle-ci tente de freiner et d'empêcher l'entière prise de conscience par le prolétariat des causes du marasme économique. Trouver des dérivatifs aux responsabilités du capitalisme n'est pas tâche aisée car ce système en crise fondamentale dans ses soubassements -ne disposant plus de débouchés réels comme dans sa phase ascendante du 19ème siècle- peut difficilement cacher à l'humanité que sa seule perspective n'est que la destruction, le gaspillage et la paupérisation, culminant dans une nouvelle guerre mondiale.
La perspective de guerre mondiale
Cette unique perspective de guerre mondiale dans l'optique capitaliste, particulièrement invoquée partout depuis deux ans, devient ainsi la deuxième condition impliquant la nécessaire émergence de l'alternative prolétarienne. Ce n'est pas paradoxal. Deux guerres mondiales laissent encore des traces indélébiles malgré la vanité capitaliste des "libérateurs". Au départ, la bourgeoisie à travers toutes ses composantes, avait toujours préparé et présenté ces deux guerres mondiales comme : - permettant la résolution des difficultés économiques ("exporter ou périr")
- inévitables, indépendamment des bonnes volontés conciliatrices ("la faute aux autres", "on ne peut faire autrement" ).
L'exacerbation de la compétition impérialiste et la paupérisation consécutives à ces deux guerres, de même que la gigantesque crise économique mondiale aujourd'hui, révèlent l'inanité du premier argument. La barbarie de deux guerres mondiales n'a pu se produire qu'en fonction d'une bourgeoisie impuissante à résoudre les aberrations de son système, et même si une fraction de celle-ci -le stalinisme- a pu se parer outrageusement du terme, entraver et retarder d'autant plus la marche vers le "communisme".
Quant à l'idée d'inévitabilité de guerre au futur, elle est d'autant plus mensongère que les capitalistes n'en sont pas persuadés eux-mêmes tant que le prolétariat et l'immense population de la planète n'en sont pas convaincus. Guerre inévitable s'il fallait s'en tenir simplement à l'argument militaire, mais en réalité la bourgeoisie n'est pas simplement son appareil militaire, même si celui-ci est aux rênes de commande pendant la guerre ou aux premiers rangs pour la répression physique. La bourgeoisie ne pourrait pas faire fonctionner sa société avec les seuls militaires ; elle n'a jamais pu entraîner à la guerre et réprimer le prolétariat simplement autour de cartes d’Etat-major qui ne recouvrent pas la réalité sociale. Un raisonnement d'Etat major militaire ne peut pas permettre de comprendre pourquoi le prolétariat ne se laisse pas soumettre par la bourgeoisie, il n'y a pas de troupes dans un camp donné avec des uniformes distincts, des généraux, des munitions, face à un camp adverse. La menace provient de l'intérieur même de tous les pays capitalistes amis ou ennemis, elle a pour nom conscience et unité prolétarienne. L'hypothèse à court terme d'une 3ème guerre mondiale supposerait une parfaite imbécillité, folie suicidaire ou tout au moins une incapacité à vouloir en contrôler le déclenchement et le déroulement de la part de la bourgeoisie. Il ne faut jamais oublier que les capitalistes et leurs généraux ne peuvent faire une guerre sans troupes. Les guerres mondiales précédentes n'ont pas été des conflits d'armées de métier ou de seuls mercenaires.
Il ne s'agit pas de croire que les capitalistes voudraient préparer de nouvelles guerres de tranchées ou d'arquebuses dépassées, mais de comprendre qu'en regard du monde entier, ils ne peuvent apparaître comme des assassins de l'humanité ; il y a toujours un Hitler ou un vaincu pour être gratifié de cette réputation. Le capitalisme en tant que tel doit être exempté de cette responsabilité pour être perpétué. Jamais ni Foch, ni Clemenceau, ni Churchill, ni Wilson, ni Staline, ni Eisenhower n'ont avoué organiser la guerre pour les mesquins intérêts de rapine capitaliste, ils invoquaient la "liberté", le "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", le "socialisme". Chacun se parait d'une mystification pour entraîner ses troupes au massacre et tous se retrouvèrent en fin de compte pour parader devant les catafalques de ceux qu'ils y avaient expédiés au nom de "la patrie ou la mort". Aujourd'hui 1'administration Reagan peut-elle invoquer les intérêts de l'humanité sans honte, l'administration Brejnev ou Mitterrand le socialisme sans faire vomir ? Seule la révolution prolétarienne peut permettre de rejeter à jamais les guerres locales et mondiales dans les ordures du passé capitaliste.
LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA CLASSE V OUVRIERE
Troisième condition fondamentale pour l'affaiblissement de la perspective de guerre, mais surtout en faveur de la révolution, qui transparaît dans les deux premières, c'est le sursaut conscient organisé et centralisé de la seule force révolutionnaire :1e prolétariat en action depuis la fin des années 60.
Il n'était pas resté endormi après la fin de la 2ème guerre mondiale, mais pendant les années de reconstruction ses réactions furent des coups de butoir isolés et la prospérité relative retrouvée par le capitalisme avait permis des concessions économiques. Tournant capital, l'année 1968 fût marquée par la grève massive de mai en France, mais surtout par le fait que des luttes ouvrières se produisaient en plusieurs endroits du monde simultanément. Le début des années 70 fut marqué par une succession de luttes importantes dans plusieurs pays européens; mais avec le sabotage réussi de la gauche bourgeoise déviant plus spécialement dans cette zone le mécontentement sur le terrain électoral, on pouvait croire jusqu'à la fin des années 70 que le prolétariat avait été calmé. D'ailleurs la bourgeoisie avec sa ribambelle de larbins sociologiques à la Marcuse, Bahro ou Gorz semblait vouloir faire croire à sa nouvelle disparition (et énième), quand les prolétaires en Pologne se sont chargés de la ramener sur terre. Tant pis pour les idéologues, aujourd'hui comme en 1918 le prolétariat est la seule classe apte dans les faits à stopper la perspective de guerre et à présenter à l'humanité l'alternative communiste. Contre tous ceux qui encouragent d'une façon ou d'une autre la survie du capitalisme le prolétariat doit opposer le cri "Guerre OU Révolution". Ce cri on ne l'a pas entendu monter de la Pologne, mais une affirmation de la lutte de classe comme celle d'août 80, cela revient au même. Alors que depuis deux ans on nous rebattait les oreilles en occident avec l'invasion de l'Afghanistan "confirmant" la "menace russe", qu'on renchérissait sur le soi-disant retard du potentiel militaire américain comparé à celui du pacte de Varsovie, tout à coup le spectre prolétarien est revenu hanter l'Europe et l'ensemble des capitalistes et, confirmer, malgré des luttes inégales dans le temps, le sursaut de la classe ouvrière depuis la fin des années 60.
Ce sursaut du prolétariat s'il prend racine dans la lutte contre l'austérité capitaliste, mûrit également grâce aux contradictions du capitalisme décadent.
L'essentiel, la conscience de classe, se développe à partir de l'usure d'un certain nombre de mystifications bourgeoises. Au 19ème siècle déjà Marx pouvait considérer dans le "Manifeste communiste' que la bourgeoisie produisait ses propres fossoyeurs, de même aujourd'hui nous pouvons considérer que "la bourgeoisie fournit aux prolétaires les éléments de sa propre éducation, c'est à dire des armes contre elle-même" (Le Manifeste p. 45). Au tournant du siècle, certains pouvaient douter encore de la proximité de la révolution en fonction d'une classe ouvrière sortie peu à peu de l'artisanat ou émergeant des campagnes, en fonction des résidus du féodalisme, de l'analphabétisme. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hésitations possibles, dans les principaux pays industrialisés, le prolétariat est vraiment constitué en classe, de même dans beaucoup de pays du tiers-monde, il existe comme une force contrainte historiquement de dépasser les faiblesses et les échecs de son passé. Aujourd'hui les leçons de toute l'histoire du mouvement ouvrier peuvent être réappropriées beaucoup plus vite dans les fanges du capitalisme, il n'y a pas nécessité d'une "éducation socialiste" ni d'écoles de cadres du parti. En combattant les lois économiques du Capital, le prolétariat introduit du même coup le chambardement dans la superstructure idéologique de domination bourgeoise. Ceci à travers deux facteurs, avec les réserves d'usage : l'éducation dispensée par la société bourgeoise et les moyens de communication moderne,
Il ne s'agit pas ici de faire l'éloge de l'éducation bourgeoise qui a pour but de reproduire les inégalités sociales, ni d'exalter le savoir qui n'est pas un gage de conscience de classe. D'ailleurs cette éducation dispensée et fabriquée par le capitalisme est pour une grande part un moyen de manipulation considérable qui, en un sens, vulnérabilise les individus, les discipline socialement, remplace l'obscurantisme religieux féodal. Mais il s'agit de comprendre que, à un certain degré de dégénérescence de toute société, même les meilleurs pare-feux peuvent provoquer un retour de flamme. L'analphabétisme n'existe pratiquement plus dans les principaux pays industrialisés, de nombreux prolétaires ont suivi des études secondaires et pratiquent une autre langue que la leur. En soi ce "progrès" et cette "éducation" ne sont pas "révoltants" ; s'ils favorisent la révolte c'est uniquement parce qu'ils sont synonymes de DEQUALIFICATION et de chômage car la bourgeoisie a développé anarchiquement la formation scolaire et universitaire. Nombreux sont les ouvriers ou les employés bacheliers, nombreux les chômeurs diplômés d'université, donc sans qualification "productive". Après avoir été bercé tout au long de ses études par la promesse de pouvoir échapper à la condition ouvrière, l'ancien élève ou étudiant confronte durement la réalité capitaliste s'il ne l'a pas sérieusement appréhendée auparavant, un ouvrier analphabète pouvait avaler des discours de maître d'école, croire à l'inégalité d'intelligence à la naissance, s’en remettre à ceux qui "savaient", s'en laisser compter sur "1'ennemi" ; est-ce comparable aujourd'hui? Les moyens de communication électronique modernes sont également une arme à double tranchant. Si au premier abord l'émission radio et TV, avec son caractère veule et son usage du mensonge par omission atteint jusqu'à la moindre cellule d'immeuble, jusqu'au moindre prolétaire atomisé même s'il ne veut pas lire un journal, et tente d'endormir la conscience de classe, en revanche ces émissions de propagande sophistiquée de la bourgeoisie -il faut bien les appeler par leur nom- ne peuvent plus à un certain moment prétendre jouer un rôle de "directeur de conscience" quand les conditions de vie sont aggravées ou que l'huissier frappe à la porte, elles ne peuvent même pas cacher l'horreur du capitalisme en décomposition. . Cette crise générale des valeurs idéologiques bourgeoises d'abrutissement est d'autant plus avérée par la simple comparaison avec le 19ème siècle. De 1’ouvrier analphabète, recevant tardivement les nouvelles du monde, gavé de patriotisme, le système en est venu à procréer un ouvrier constamment insatisfait et pénétré d'un doute tout aussi constant quant aux promesses des diverses idéologies. De démoralisants en soi en l'absence de lutte de classe ces facteurs d'aliénation de la société contemporaine se retournent contre la bourgeoisie avec le développement de cette même lutte de classe, et hâtent la remise en cause de son système d'oppression.
L'internationalisation des luttes proletariennes
L'internationalisation des luttes prolétariennes est ce quatrième facteur qui va non seulement favoriser, mais être l'étape décisive vers la révolution mondiale. Au 19ème siècle encore, le développement des luttes pouvait être perçu au sein des nations, et, comme l'exprimait Marx : "Les nations ne peuvent constituer le contenu de l'action révolutionnaire. Elles ne sont que des formes à l'intérieur desquelles fonctionne le seul moteur de l'histoire : la lutte des classes". Dans la 1ère et 2 ième Internationale, on conçut ainsi l'idée de la réalisation du socialisme mondial : des luttes s'additionneraient d'abord entreprises par entreprises (nationalisations), puis elles deviendraient des révolutions pays par pays, ceux-ci se "fédérant" ensuite entre eux ; c'est encore la vision de l'aile bordiguiste du mouvement révolutionnaire. Cependant, si les conditions du changement de période historique du capitalisme déclinant ont brisé cette vision, l'idée de Marx n'est pas remise en cause, elle est prolongée : la forme à l'intérieur de laquelle fonctionne la lutte de classe est l'ensemble du monde capitaliste, par delà ses barrières nationales ou de blocs. La bourgeoisie mondiale exploite tout prolétaire en n'importe quel pays, le tourneur italien, le maçon russe comme l'électricien américain. L'ouvrier sud-américain employé dans une filiale de Renault sait que son principal patron réside en France, le métallurgiste polonais qu'il dépend d'un commanditaire en Russie. Si tout ceci explique concrètement, à la racine, l'intérêt de tous les capitalistes à serrer les coudes contre toute grève ou lutte de masse, par contre l'appartenance corporative à une même branche industrielle n'a jamais permis réellement à la solidarité ouvrière de franchir les clivages nationaux. La nature de la classe ouvrière ne passe pas par la définition corporatiste mais indépendamment des diverses professions. Les aiguilleurs du ciel américain ont fait récemment la tragique expérience de l'absence de solidarité internationale de corporation, l'idéologie de gauche du capitalisme laissant croire à cette illusion. Dans une concurrence capitaliste débridée, les métallurgistes anglais en grève ont pu voir un acier "étranger" préféré au "leur" et à meilleur coût, les mineurs français voir livrer du charbon "polonais" ou "allemand". Le terrain de la défense ou de l'exaltation du produit d'une corporation est celui où le capital règne en maître, en particulier par l'entremise des syndicats, c'est un lieu où le chauvinisme peut encore être entretenu. Espérer l'extension de la lutte à la même branche ou filiale c'est placer les prolétaires sur le même terrain concurrentiel que les diverses firmes qui fabriquent un même produit, c'est sous-estimer le patriotisme d'entreprise lié à la production d'une marchandise donnée quand les capitalistes font accroire que le produit de leur travail appartiendrait aux ouvriers ; ainsi les prolétaires sont limités et déterminés aux bornes de l'entreprise, au mode de fabrication déviés de la remise en cause de l'ensemble du mode de production capitaliste.
Le prolétariat dans son entier produit toutes les richesses, la production capitaliste parcellisée et mercantile lui est étrangère, et il n'a pas droit de regard sur son utilisation en bout de chaîne. Dans ces conditions un prolétaire se définit avant tout comme être salarié, sujet exploité dans un système social marchand qui lui est hostile. Lorsque les prolétaires luttent, ils ne luttent pas au premier abord pour un meilleur charbon français ou un meilleur acier anglais, ils luttent -quelles que soient leurs professions- contre les condition d'exploitation et de soumission, et en prolongement au niveau plus élevé du développement de leurs luttes- s'ils ne se laissent pas entraver par les barrages syndicalistes- remettent en cause l'Etat capitaliste. La généralisation des luttes au niveau international ne peut donc provenir d'une extension corporative. La grève massive de mai 68 en France et les grèves dans le monde au même moment, ou la grève de masse d'août 80 en Pologne ne se sont pas produites par une addition de corporations en lutte, par la même branche puis les unes aux côtés des autres. C'est en dépassant la vision d'une somme de corporations que les prolétaires en Pologne ont trouvé le réel chemin de la lutte contre l'Etat, en posant les mêmes objectifs des usines vers la rue ; leur révolte contre les conditions d'exploitation devint lutte contre l'ordre capitaliste et non pas meilleure gestion ou production de marchandises. La réaction de l'Etat polonais témoigna de la solidarité des divers Etats capitalistes contre la lutte ouvrière, derrière lui se tenaient à la fois l'Etat russe et les Etats occidentaux. Cette coalition de la bourgeoisie est une leçon de choses en ce qui concerne le manque d'unité internationale du prolétariat. A charge de revanche cette coalition bourgeoise montre la nécessité d'une unité de combat de l'ensemble du prolétariat contre la force capitaliste qui sait faire cesser momentanément ses divisions intrinsèques pour parer à la lutte de classe. Si toutes les fractions de la bourgeoisie mondiale se sont jetées comme un seul homme sur l'incendie polonais, cela prouve que, malgré ses difficultés économiques insurmontables, cette classe rétrograde veille à empêcher à tout prix sa destruction par le prolétariat ; cela prouve qu'elle a la hantise de 1'imitation et de la contagion. La répression organisée de longue main internationalement pour apparaître comme un "règlement de compte" entre "polonais", ne peut cacher que derrière la milice et l'armée polonaise se tenait toute la bourgeoisie mondiale (il était plus lucide d'avoir recours à la mystification nationaliste de "charbonnier maître chez soi"). L'utilisation renouvelée des barrières nationales est encore un trait dominant de la politique bourgeoise et rend plus difficile à envisager une simultanéité absolue d'explosions de luttes de classe dans plusieurs pays à la fois où les prolétaires, hors des corporations, se tendraient la main par-dessus les frontières. Mais l'approfondissement de la crise économique brise ces barrières dans la conscience d'un nombre grandissant de prolétaires à travers les faits qui montrent qu'il s'agit d'une MEME lutte de classe. Il faut tirer les leçons du fait que les principales luttes de ces dernières années se soient succédées étalées dans le temps, sans liens de classe directs d'un pays à l'autre. En effet, d'autant plus que la crise économique ne frappe pas un pays puis un autre, le premier remontant la pente quand l'autre la redescend, comme dans la période de reconstruction suivant la 2ème guerre mondiale, elle tend à frapper en même temps l'ensemble des pays et surtout les plus industrialisés et têtes de pont capitalistes florissants jusque là. Ainsi le tourbillon du marasme économique, s'il procède avec lenteur, tend à rapprocher le moment où comme pendant l’année 68 et avec une accélération soudaine, les luttes ouvrières se produiront dans plusieurs pays à la fois sur les mêmes bases : lutte contre l'austérité capitaliste, contre la menace du chômage et implicitement contre la menace de guerre. Beaucoup plus qu'à travers ces luttes qui se sont succédées ces dernières années, c'est à travers une simultanéité dans la mesure du possible de nouvelles luttes en plusieurs pays que se posera le problème de la jonction par delà les barrières nationales et de blocs impérialistes, contraignant la bourgeoisie mondiale à une réaction dispersée, encourageant la prise de conscience que 1'ennemi capitaliste est le même partout. Qu'il le veuille ou non, c'est la prochaine étape qualitative nécessaire pour le prolétariat, possible dans la conjoncture mondiale, obligatoire pour son renforcement. Dans une telle situation un mouvement de masse comparable à celui de la Pologne en 1980 ne restera pas isolé mais trouvera la solidarité par le développement d'autres mouvements de masse.
En ces années 80 le prolétariat devra frapper au coeur des principales métropoles capitalistes s'il veut donner un solide élan à son combat international. C'est particulièrement au vieux coeur du capitalisme, l'Europe, que les échanges entre zones de lutte ne devront plus être une caricature de bons offices syndicaux. La concrétisation d'échanges internationaux sera là exemplaire pour le monde entier. Cela sera décisif pour la révolution internationale. Le problème de la destruction des Etats bourgeois sera posé plus abruptement mais ne sera pas résolu pour autant.
Gieller
"La guerre, incontestablement, a joué un rôle énorme dans le développement de notre révolution, elle a désorganisé matériellement l'absolutisme : elle a disloqué 1'armée, elle a donné de 1'audace à la masse des habitants. Mais heureusement, elle n'a pas créé la révolution, et c'est une chance parce que la révolution née de la guerre est impuissante : elle est le produit de circonstances extraordinaires, repose sur une force extérieure et en définitive se montre incapable de conserver les positions conquises. "(Trotsky, "Notre Révolution").
Cette juste conception que Trotsky développe après le mouvement de 1905 en Russie, sera contredite par les théories que Trotsky développera après la révolution de 1917, elle aussi déclenchée à la suite d'une guerre.
Pourtant, l'échec de la révolution russe après son isolement fut une vérification supplémentaire du caractère défavorable que constituent les conditions que crée la guerre.
Courants politiques:
- Gauche Communiste [29]
Approfondir:
Questions théoriques:
- Le cours historique [74]
Heritage de la Gauche Communiste:
Théories des crises : le véritable dépassement du capitalisme c’est l'élimination du salariat
- 3087 reads
(à propos de la critique des thèses de Rosa Luxembourg par Nicolas Boukharine)
"Si on veut savoir ce que sera le communisme, il faut commencer par savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la société présente". Dans l'article précédent ([1] [76]), nous avons montré comment d'un point de vue marxiste, l'idée que l'on se fait du socialisme dépend de l'analyse que l'on partage des contradictions internes du capitalisme. Derrière les critiques que formule en 1924 Nicolas Boukharine, bolchevik, "théoricien" de l'Internationale Communiste, aux analyses des contradictions capitalistes par Rosa Luxemburg ([2] [77]), se dessinent les bases de la théorie de la possibilité du socialisme en un seul pays et de l'identification du capitalisme d'Etat avec le socialisme. Pour démontrer cela, nous avions commencé par rejeter certaines des principales objections avancées par Boukharine. Nous avons ainsi répondu à l'argument suivant lequel le problème de base posé par Rosa Luxemburg -l'incapacité du capitalisme de créer en permanence ses propres débouchés- n'existerait pas. Nous avons rappelé en quoi et pourquoi les crises de SURPRODUCTION étaient et restent une donnée essentielle et inévitable du capitalisme, et montré la vacuité de l'argument suivant lequel les ouvriers, leur consommation, pourraient constituer un débouché suffisant pour absorber la surproduction capitaliste.
Nous nous attacherons dans cette 2ème partie à répondre à un des arguments les plus fréquemment employés contre l'analyse de Rosa Luxemburg. Boukharine le formule ainsi : "Rosa Luxemburg se rend l'analyse trop aisée. Elle privilégie une contradiction, à savoir, celle entre les conditions de la production de la plus-value et les conditions de la réalisation, la contradiction entre la production et la consommation dans les conditions du capitalisme". (L'impérialisme et l'accumulation du capital. Chap.5).
Y-A-T-IL DANS LE CAPITALISME UNE CONTRADICTION PLUS DETERMINANTE QUE LES AUTRES ?
Comme tout ce qui est vivant, le système de production capitaliste est et a toujours été traversé de multiples contradictions, c'est-à-dire de nécessités s'excluant et s'opposant les unes aux autres. Sa vie, son développement, sa marche impétueuse dans l'histoire, bouleversant en quelques siècles des millénaires d'histoire et modelant un monde à son image, furent le résultat non pas d'une volonté idéaliste de domination en soi, mais le produit de sa lutte permanente pour dépasser ses contradictions internes.
Ce fut l'essentiel de l'oeuvre de Marx que de montrer comment et pourquoi ces contradictions devaient conduire un jour le capitalisme, tout comme les sociétés passées (esclavagisme antique, féodalisme) à connaître une phase de décomposition, de décadence, mettant à l'ordre du jour l'instauration de nouveaux rapports sociaux, l'avènement d'une nouvelle société qui devrait être le communisme.
Marx a mis en lumière un grand nombre de ces contradictions. Boukharine en reprochant à Rosa Luxemburg de "privilégier une contradiction" en cite quelques-unes que Rosa Luxemburg néglige selon lui : "La contradiction entre les branches de production; la contradiction entre 1'industrie et 1'agriculture limitée par la rente foncière ; 1'anarchie du marché et la concurrence ; la guerre en tant que moyen de cette concurrence ; etc." (Id.)
Il faudrait ajouter, parmi les plus importantes:
la contradiction entre d'une part le caractère de plus en plus social de la production (techniquement parlant, le monde tend à produire comme une seule usine, chaque produit contenant du travail des quatre coins de la planète) et d'autre part le caractère parcellarisé, limité, privé de l'appropriation de cette production ;
la contradiction entre le fait que le capital ne peut tirer de profit que de l'exploitation du travail vivant (le capitaliste ne peut pas "exploiter" la machine) alors que dans le processus de production, la part du travail vivant par rapport à celle du travail mort (les machines) tend à se restreindre au fur et à mesure du progrès technique (contradiction qui s'exprime dans la "baisse tendancielle du taux de profit");
enfin, et surtout, la contradiction vivante que constitue l'exploitation elle-même, l'antagonisme de plus en plus aigu entre les producteurs et le capital.
C'est l'ensemble de toutes ces contradictions qui -après avoir été pendant des siècles un stimulant à l'expansion- conduit dans sa décadence le capitalisme, à l'étouffement, à la paralysie et à la banqueroute historique.
L'objet du débat n'est pas de reconnaître ou non l'existence de ces contradictions. Mais d'abord de savoir pourquoi,à un moment donné de leur développement, ces contradictions internes, de stimulants, d'aiguillons du développement se transforment en entraves ?
Rosa Luxemburg y répond effectivement en "privilégiant" une contradiction : celle entre les conditions de la production de la plus-value et celles de sa réalisation sur le marché mondial; cette contradiction est elle-même un produit de celle entre valeur d'usage et valeur d'échange au sein de la marchandise capitaliste.
LA CONTRADICTION ENTRE LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION ET CELLES DE LA REALISATION DE LA PLUS-VALUE COMMANDE A TOUTES LES AUTRES CONTRADICTIONS DU CAPITALISME.
Pour Rosa Luxemburg, c'est lorsque le capitalisme ne parvient plus à élargir ses marchés "par rapport aux besoins d'expansion des entreprises capitalistes existantes", que toutes ses contradictions internes tendent à éclater dans leur plus grande évidence. La contradiction découverte par Marx entre les conditions de production de la plus-value, (le profit) et les conditions de la réalisation de cette plus-value (la réalisation sous forme argent, la vente du sur-travail extirpé), cette contradiction commande à toutes les autres. Si la contradiction entre la nécessité de produire à une échelle toujours plus large et celle de réduire la part de la production qui revient à la masse des salariés est dépassée, surmontée, toutes les autres contradictions se trouvent atténuées, voire transformées en simples stimulants. Tant que le capitalisme trouve des marchés, des débouchés à la taille des nécessités de son expansion, toutes ses difficultés internes sont aplanies.
C'est ainsi que les crises éclatent lorsque les marchés sont devenus trop restreints, et elles sont dépassées lorsque de nouveaux débouchés sont ouverts. C'est au niveau du marché mondial et de ses crises que toutes les contradictions internes au mode de production éclatent ou sont aplanies. C'est ce qu'exprime Marx lorsqu'il écrit :
- "Les crises du marché mondial doivent être vues comme la synthèse réelle et l'applanissèment violent de toutes les contradictions de cette économie, dont chaque sphère manifeste les divers aspects réunis dans ces crises". ("Matériaux pour l'économie". Ed. La Pléiade. T.II p. 476)
Le caractère déterminant de cette contradiction sur les autres contradictions apparaît clairement lorsqu'on analyse les conditions concrètes dans lesquelles d'autres contradictions importantes se trouvent exacerbées ou atténuées. Considérons le cas des deux contradictions les plus fréquemment mises en avant par les critiques de Rosa Luxemburg : la concurrence entre capitalistes, la baisse tendancielle du taux de profit.
LA CONCURRENCE EST UN STIMULANT LORSQUE LES MARCHES SONT SUFFISANTS.
Tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ont cherché à théoriser l'idée de l'existence d'un système de production "non capitaliste" en URSS ont toujours -tel Boukharine- accordé une place prépondérante à la concurrence entre capitalistes parmi les contradictions internes du capitalisme.
L'URSS ne serait pas capitaliste parce qu'elle serait parvenue à éliminer la concurrence et donc l'anarchie dans la production. Et pourtant, il suffit d'analyser quelle est la réalité de cette concurrence pour comprendre qu'il s'agit d'une contradiction dont l'ampleur et la nature dépendent étroitement de l'abondance des débouchés solvables existants.
L'objet de la concurrence entre capitalistes, ce sont les marchés.
L'objet des luttes entre tribus primitives anthropophages, c'était les corps humains à dévorer; les cités esclavagistes se battaient pour piller les richesses d'autres populations et pour des esclaves; les seigneurs féodaux pour des terres, des serfs, des animaux. Les capitalistes, eux, se battent pour quelque chose de beaucoup plus abstrait et universel : des marchés. Certes, ils ne se privent pas de piller lorsqu'ils le peuvent, à la façon de leurs ancêtres, mais ce qui leur est plus spécifique, c'est de s'affronter sans pitié et par tous les moyens pour le contrôle des marchés.
De ce fait, 1'exacerbation de la concurrence entre capitalistes et l'intensité de ses effets dépendent étroitement de l'ampleur des marchés qui sont l'objet de cette concurrence. Dans les périodes où le capitalisme dispose de débouchés solvables suffisants pour l'élargissement de la production, la concurrence joue un rôle de stimulant pour la compétition. Sans limite de marchés, la "libre concurrence" pourrait apparaître comme un simple affrontement sportif entre capitalistes. Mais dès que ces débouchés se restreignent, les capitalistes s'entre-déchirent dans des affrontements meurtriers, les survivants se nourrissant des cadavres des victimes du manque de débouchés. La concurrence se transforme alors en une entrave au développement du capital et des forces productives de la société en général. Ainsi, depuis plus d'un demi-siècle, la concurrence capitaliste, non seulement conduit la société à des guerres mondiales de plus en plus destructrices, mais en outre, en temps de "paix", elle provoque des frais de plus en plus lourds, destinés non pas à entretenir ou accroître la production, mais à"faire face à la concurrence" : développement de la bureaucratie d'Etat, des dépenses militaires, des dépenses en "marketing" ou publicité.
Ce n'est pas la concurrence qui engendre la pénurie des marchés, c'est la pénurie des marchés qui exacerbe et rend destructrice la concurrence.
C'est de la capacité du capitalisme à faire reculer les limites du marché mondial que dépend le degré d'exacerbation et de "nocivité" de la concurrence capitaliste.
LA BAISSE TENDANCIELLE DU TAUX DE PROFIT DEVIENT EFFECTIVE EN PRESENCE D'UNE INSUFFISANCE DES MARCHES.
Il en est de même de la tendance permanente à la baisse du taux de profit. Cette tendance, mise en lumière pour la première fois par Marx, est une tendance provoquée par :
{C}{C}{C}{C}1) {C}{C}{C}{C}la nécessité pour le capitalisme de "moderniser" en permanence sa production, introduisant dans le processus de production une part toujours plus grande de machines par rapport au travail vivant;
{C}{C}{C}{C}2) {C}{C}{C}{C}l'impossibilité pour les capitalistes d'extraire du surtravail d'autre source que de l'exploitation du travail vivant lui-même.
Mais, si cette loi est dite "tendancielle", c'est justement parce qu'elle est constamment contrecarrée, freinée, ou compensée par d'autres tendances au sein du système. Marx a aussi clairement mis en évidence les facteurs qui la contrecarrent et ceux qui en compensent les effets.
La tendance à la baisse elle-même est freinée principalement par la baisse des coûts réels de" production (salaires, machines, matières premières) que provoque l'accroissement de la productivité du travail. Il faut moins de temps de travail pour produire les biens nécessaires à l'entretien d'un ouvrier, une machine ou telle matière première.
Les effets de cette baisse du taux de profit lui-même, tendent à être compenses par l'accroissement de la masse de profit. Un taux de 20% de profit est plus faible qu'un taux de 22%, mais un profit de 20% sur 2 millions de dollars investis, c’est beaucoup plus que 22% sur un million. Mais pour le capitaliste la capacité d’augmenter sa productivité comme celle d’accroître la masse de son profit, sont étroitement dépendantes de sa capacité à élargir l’échelle de sa production et donc de sa capacité de « vendre plus » (cette question est plus longuement développée dans l’article « les théories des crises de Marx à l’Internationale Communiste » déjà cité).
La baisse du taux de profit, de TANDANCIELLE devient EFFECTIVE et DESTRUCTRICE de capital, lorsque que les forces qui la contrecarrent et la compensent « en temps normal » s’affaiblissent, ce qui se produit essentiellement lorsque l’élargissement de la production est devenu impossible par l’insuffisance des marchés solvables où réaliser la plus-value. Tout comme pour la concurrence, la baisse tendancielle du taux de profit, est une contradiction qui DEPEND elle-même de celle qui existe au niveau des conditions de réalisation de la plus-value.
Rosa Luxemburg ne privilégie pas une contradiction au hasard parmi d'autres. Elle souligne celle où se concentrent toutes les autres, celle qui traduit la pression et les tensions de l'ensemble des contradictions internes au capitalisme. Et cela permet de déterminer à quel moment l'ensemble des contradictions du capitalisme se transforme en entrave.
Boukharine, après avoir affirmé qu'il ne faut privilégier aucune contradiction du capitalisme pour comprendre ses crises, se trouve cependant confronté à la question : à quel moment ces contradictions deviennent des limites définitives ? Et la seule réponse qu'il peut donner, c'est :
- "Des limites sont données par un degré déterminé de tensions des contradictions capitalistes".(Idem. p.134).
"Un degré déterminé" ? Mais quel degré ? Quel est le degré de "concurrence" à atteindre ? Quel est le taux de profit minimum ? Ce sont des questions auxquelles Boukharine ne répond pas, parce qu'il n'y a pas de réponse à ces questions sans se référer spécifiquement à la capacité du capitalisme à trouver des débouchés.
L'analyse de Luxemburg permet par contre de déterminer comment ces limites sont celles du marché mondial, et en son sein, plus particulièrement «les marchés extra-capitalistes.
LA CONTRADICTION MISE EN AVANT PAR ROSA LUXEMBURG EST-ELLE "EXTERIEURE" AU PROCESSUS DE PRODUCTION CAPITALISTE?
Comment -d'après Rosa Luxemburg- le capitalisme a-t-il pu surmonter la contradiction entre sa nécessité d'élargir toujours plus ses débouchés et la nécessité de réduire toujours plus la part de production revenant aux exploités? En trouvant des acheteurs en dehors du processus de production capitaliste. Pour l'entreprise capitaliste mondiale, vendre et racheter elle-même ses propres produits n’a aucun sens. Il lui faut des "clients" extérieurs à son entreprise auxquels vendre ce surplus, cette part de la plus value que ne peuvent acquérir ni l’ouvrier, ni le capitaliste. Ces clients, ces « tierces personnes » -explique Rosa Luxembourg– le capitaliste les a trouvé dans les premiers temps du capitalisme, principalement dans les seigneurs féodaux.
Dans la période de la révolution industrielle, il la trouve surtout dans les secteurs agricoles et artisanaux demeurés en dehors de son contrôle, en particulier dans les territoires coloniaux que les puissances finirent par se disputer dans deux guerres mondiales.
Dans sa phase de décadence, c’est dans la reconstruction des centres industriels détruits pendant les guerres que le capitalisme trouvera une compensation momentanée à son manque de débouchés extérieurs. Et depuis la fin des années soixante, depuis la fin de la reconstruction consécutive à la seconde guerre mondiale, le capitalisme a eu recours à une fuite en avant par des crédits de plus en plus massifs aussi bien aux pays moins développés qu'aux capitaux des métropoles.
L'introduction dans l'analyse des contradictions du capital de cet élément que constituent les secteurs extra-capitalistes, l'élargissement du cadre de l'analyse au niveau de sa réalité la plus globale, celle du marché mondial, est considérée par les critiques de Luxemburg comme une "hérésie" par rapport à Marx, et comme une recherche des contradictions du capitalisme en dehors du processus de production capitaliste. Ainsi, pour Boukharine par exemple, le manque de clients n'appartenant pas aux entreprises capitalistes, de "tierces personnes" est une contradiction qui ne serait pas "interne". "Le capitalisme -oppose-t-il à Luxemburg- développe ses contradictions internes. Ce sont elles et non le manque de "tierces personnes" qui la fait finalement périr". (Idem. p. 140).
En d'autres termes, pour comprendre les contradictions du capitalisme, il faudrait s'en tenir à la réalité du capitalisme dans 1'usine et ignorer ce qui se passe sur le marché mondial ; le marché mondial serait en quelque sorte "extérieur" à la réalité profonde du capitalisme!
Cette critique de Luxemburg est formulée de façon particulièrement nette par Raya Dunayevskaya (ancienne collaboratrice de Trotsky) dans un article écrit à la fin de la seconde guerre mondiale sur les analyses "de l'Accumulation du Capital" :
"Pour Marx, le conflit fondamental dans une société capitaliste, c'est celui entre le capital et le travail ; tout autre élément lui est subordonné. S'il en est ainsi dans la vie, la première nécessité dans la théorie, beaucoup plus même que dans la société, c'est de poser le problème comme un problème entre le capitaliste et 1'ouvrier, purement et simplement. D'où l'exclusion des "tierces personnes" et, comme il le dit lui-même à plusieurs reprises, 1'exclusion du marché mondial comme n'ayant rien à voir avec le conflit entre ouvriers et capitalistes". (Raya Dunayevskaya "Analysis of R.Luxemburg's Accumulation of capital". Publié en 1967 en appendice de la brochure "State Capitalism and Marx's Humanism").
Il est vrai que pour expliquer comment le capitaliste extirpe du surtravail à l'ouvrier, il n'est pas nécessaire de faire intervenir le marché mondial et plus particulièrement les secteurs extra-capitalistes. Mais si l'on veut comprendre les conditions pour que cette exploitation puisse se prolonger et se développer, ou être bloquée dans le temps, il est indispensable d'avoir en vue le processus global de reproduction et d'accumulation du capital. Cela ne peut être fait qu'à l'échelle d'existence réelle du capital : celle du marché mondial
En lui-même, le marché constitué par les secteurs extra-capitalistes n'est pas le produit de l'exploitation de l'ouvrier par le capital, mais sans lui, l'exploitation ne peut se reproduire à une échelle élargie.
Si le capital a un besoin vital de ce type de marchés pour survivre, c'est parce que le rapport entre ouvrier et capital est tel que, ni l'ouvrier, ni le capitaliste ne peuvent constituer une demande solvable pour réaliser la part du profit destiné à être réinvesti. Sans la consommation des masses limitée par le salaire, sans l'exploitation de l'ouvrier par le capitaliste, si les ouvriers pouvaient consommer directement ou indirectement tout ce qu'ils produisent, bref, si le salaire n'existait pas, le problème des marchés extérieurs ne se poserait pas; mais ce ne serait plus du capita1isme.
L'extension du marché mondial n'est pour le capitalisme une limite que dans la mesure où il est indispensable à l'existence de la reproduction du capitalisme dans des conditions contradictoires.
En ce sens, il n'y a pas une opposition entre ce que seraient "les contradictions internes" du capitalisme et la nécessité de ces débouchés extra-capitalistes. Aussi bien la nécessité de ces débouchés, que l'incapacité du capitalisme de les élargir indéfiniment jusqu'à intégrer l'ensemble de l'humanité directement au sein du processus de production capitaliste, ne sont pas des phénomènes déterminés par des forces ou des lois extérieures au capitalisme, mais par le caractère contradictoire de ses lois internes.
Pour mieux éclairer cet aspect de la question, considérons le cas des convulsions de la fin du mode de production féodal.
Pour beaucoup d'historiens bourgeois, les catastrophes qui caractérisent la société féodale, en particulier au cours du XIVème siècle, trouvent leur explication dans le manque de terres défrichables. Les famines, les épidémies, les guerres, la stagnation ou le recul général qui couvraient l'Europe au XIVème siècle, auraient ainsi traduit une limite en quelque sorte "naturelle".
Il est vrai que le féodalisme s'est heurté -entre autre- à la difficulté d'étendre les surfaces cultivables dans sa période de déclin. Mais s'il en était ainsi, ce n'était pas du fait d'une mauvaise volonté de la "mère nature" mais parce que les rapports sociaux de production ne permettaient pas la mise en place des moyens techniques et humains indispensables pour entreprendre des défrichements plus difficiles.
L'économie féodale était trop cloisonnée en millions de fiefs, de corporations, de privilèges pour permettre la concentration des forces productives qu'exigeait la situation. Ce n'est pas "la nature" qui explique l'effondrement historique du féodalisme, mais les incapacités propres, les contradictions internes de celui-ci.
La nature par elle-même n'est ici, ni une contradiction "externe", ni une contradiction "interne". Elle n'est que le mi1ieu dans lequel et face auquel les contradictions du système s'exacerbent.
Il est un peu de même avec le capitalisme et sa pénurie de marchés extra-capitalistes. La vie même du capitalisme, son expansion, est synonyme de transformation de nouveaux hommes en prolétaires et le remplacement d'anciennes formes de production en rapports de production capitalistes. Une entreprise capitaliste qui se développe est une entreprise qui embauche plus de prolétaires. Une entreprise particulière peut prendre des ouvriers à une autre.
Mais l'ensemble constitué par tout le capitalisme mondial ne peut embaucher que des travailleurs non-capitalistes. Le capital, doit, pour vivre, absorber le monde non-capitaliste (artisans, petits commerçants, paysans) comme sa nourriture. Mais ce n'est pas uniquement pour se procurer de la main d'oeuvre que la capital vit aux dépens du secteur non-capitaliste. Comme on l'a vu, c'est surtout parce qu'il y trouve des clients, une demande solvable pour la part du surproduit qu'il ne peut acheter lui-même.
Malheureusement pour lui, le capital ne peut faire du commerce avec des clients non-capitalistes sans les ruiner. Qu'il vende des biens de consommation ou des moyens de production, il détruit automatiquement l'équilibre précaire de toute économie pré-capitaliste (donc moins productive que lui). Introduire des habits bon marchés, implanter un chemin de fer, installer une usine suffisent à détruire toute organisation économique pré-capitaliste.
Le capital aime ses clients pré-capitalistes comme l'ogre aime les enfants : en les dévorant.
Le travailleur des économies pré-capitalistes qui a eu "le malheur de toucher au commerce avec les capitalistes" sait que tôt ou tard, il finira, dans le meilleur des cas, prolétarisé par le capital, dans le pire -et c'est chaque jour le plus fréquent depuis que le capitalisme s'enfonce dans la décadence- dans la misère et l'indigence, au milieu de champs stérilisés, ou marginalisés, dans les bidonvilles d'une agglomération.
Le capital est ainsi confronté à la situation suivante : d'une part, il a besoin de plus en plus de clients non-capitalistes pour écouler une partie de sa production; d'autre part, au fur et à mesure qu'il commerce avec eux, il les ruine. L'impérialisme, la décadence du capitalisme, la vie suivant le cycle crise-guerre-reconstruction- sont la manifestation du fait que, depuis plus d'un demi-siècle, les débouchés non-capitalistes sont devenus insuffisants en égard aux nécessités d'expansion du capital mondial.
Mais, tout comme la nature par rapport aux rapports de production féodaux, les secteurs non-capitalistes ne sont ni une contradiction "interne" ni un élément "externe" aux rapports capitalistes. Ils font partie du milieu dans lequel et face auquel le capital existe.
En formulant sa critique à Rosa Luxemburg : ce sont les contradictions internes du capitalisme et non le manque de "tierces personnes" qui font finalement périr le capitalisme, Boukharine bataille contre des hommes de paille. Rosa Luxemburg n'a pas plus prétendu que c'étaient les économies pré-capitalistes qui "faisaient périr" le capitalisme qu'el le n'a affirmé que c'était les cailloux des terres européennes qui ont fait périr le féodalisme.
Ce qu'elle a fait, c'est replacer les contradictions internes du capitalisme, découvertes non par elle, mais par Marx, dans leur milieu vivant : le marché mondial.
LE MILIEU DU CAPITAL, C'EST LE MARCHE MONDIAL
Boukharine comme Raya Dunayevskya prétendent pouvoir comprendre les mécanismes les plus fondamentaux du capitalisme, ceux qui le conduisent à la crise, sans se soucier du milieu dans lequel vit le système. Autant vouloir comprendre le fonctionnement d'un poisson sans tenir compte du fait qu'il vit dans l'eau ou d'un oiseau, sans intégrer dans l'analyse ses rapports avec l'air. Ne pas comprendre l'importance du marché mondial pour l'analyse des crises du capitalisme, c'est en fait ne pas comprendre la nature même du capitalisme.
C'est oublier qu'avant d'être producteur, le capitaliste est d'abord et avant tout UN MARCHAND, UN COMMERÇANT.
Dans la mythologie bourgeoise, le capitaliste est toujours présenté comme un petit producteur qui, grâce à son travail, est devenu un grand producteur. Ce serait le petit artisan du Moyen-Âge devenu le grand industriel ou l'Etat patron de nos jours. La réalité historique est autre.
Dans le féodalisme en décomposition, ce ne sont pas tant les artisans des villes qui se dégagent comme la classe capitaliste, c'est plutôt les marchands. Qui plus est, les premiers prolétaires n'ont souvent été autres que les artisans soumis à la "domination formelle".
Le capitaliste est un marchand dont le commerce principal est celui de la force de travail. Il achète du travail sous la forme de marchandises de force de travail et il le revend sous la forme de produits ou services. Son profit, la plus-value, c'est la différence entre le prix de la marchandise force de travail et celui des marchandises que celle-ci produit. Le capitaliste est contraint de s'occuper du processus de production dont il est le maître mais il n'en reste pas moins ainsi un marchand. Le monde d'un marchand, c'est le marché et dans le cas du capitaliste : le marché mondial.
Les secteurs non-capitalistes font partie du marché mondial.
Ceux qui rejettent l'analyse de Rosa Luxemburg ont généralement du marché mondial -lorsqu'ils finissent par en admettre l'existence- une vision totalement fausse. Celui-ci est considéré que comme l'ensemble des capitalistes et des salariés des capitalistes. Ce faisant, ils nient les conditions pour comprendre la réalité des crises capitalistes et pourquoi elles prennent la forme de crise du marché mondial.
L'ensemble des capitalistes et leurs salariés constituent le marché de la plus grande partie de la production capitaliste; c'est le marché "intérieur" du capitalisme; mais il y a aussi tous les secteurs non-capitalistes : le marché "extérieur". Voici comment Rosa Luxemburg définit ces deux parties du marché mondial :
- "Le marché intérieur et le marché extérieur tiennent certes une place importante et très différente l'une de l'autre dans la poursuite du développaient capitaliste; mais ce sont des notions non pas de géographie, mais d'économie sociale. Le marché intérieur du point de vue de la production capitaliste est le marché capitaliste, il est cette production elle-même dans le sens où elle achète ses propres produits et où elle fournit ses propres éléments de production. Le marché extérieur pour le capital est le milieu social non-capitaliste qui l'entoure, qui absorbe ses produits et lui fournit des éléments de production et des forces de travail."
Le marché mondial c'est tout cet ensemble et c'est comme tel qu'il doit être intégré dans toute analyse de ses crises.
L'ANALYSE DE ROSA LUXEMBURG PERMET DE MIEUX COMPRENDRE POURQUOI A LA BASE DE TOUTES LES CONTRADICTIONS DU CAPITALISME, IL Y A LA MARCHANDISE ET DONC LE SALARIAT.
Dans les travaux du "Capital", Marx a très souvent fait abstraction du marché mondial, car il s'attachait, dans cette partie de ses travaux essentiellement à analyser les rapports internes du fonctionnement du système. Certains épigones y ont vu un argument contre les analyses de Rosa Luxemburg. En intégrant cette analyse dans son cadre plus général, et plus concret du marché mondial, Rosa Luxemburg n'a fait que développer les travaux inachevés de Marx, poursuivant le cheminement que celui-ci s'était méthodologiquement fixé :
- "S'élever de l'abstrait au concret"
Qu'on la privilégie ou pas, la contradiction entre les conditions de production de la plus-value et celle de sa réalisation, cet antagonisme "interne" découvert par Marx, ne peut être réellement compris si on ne connaît pas toutes les "conditions de sa réalisation". Or la réalisation de la plus-value induit la vente d'une part de celle-ci à des clients autres que les capitalistes ou leurs salariés, c'est à dire à des secteurs non-capitalistes. En introduisant ces derniers dans l'analyse des contradictions du capitalisme, Rosa Luxemburg ne nie pas les contradictions internes au mode de production capitaliste ; au contraire, elle donne les moyens de les comprendre dans toute leur réalité concrète et historique.
Mais en privilégiant la contradiction entre production et réalisation de la plus-value, elle "privilégie" la contradiction de base du capitalisme : celle entre la valeur d'usage et la valeur d'échange de la marchandise en général, et de la principale marchandise en particulier : la force de travail et son prix en argent : le salaire. C'est l'existence même du salariat qui apparaît à la base de l'impasse capitaliste.
La réalisation de la plus-value, la métamorphose en argent des marchandises produites par le surtravail des ouvriers, est contradictoire parce que le salariat limite inévitablement la consommation des ouvriers eux-mêmes.
Dans les théories sur la plus-value, Marx écrivait :
"... C'est la métamorphose de la marchandise elle-même qui renferme, en tant que mouvement développé, la contradiction -impliquée dans l'unité de la marchandise- entre valeur d'échange et valeur d'usage, puis entre argent et marchandise. "
La contradiction entre la valeur d'usage de la force de travail et sa valeur d'échange, le salaire, n'est autre que celle de l'exploitation du prolétaire par le capital.
Aussi est-ce seulement dans le cadre de l'analyse de Rosa Luxemburg que l'élimination du salariat apparaît de façon cohérente comme la caractéristique PREMIERE du dépassement du capitalisme.
La question prend toute son importance politique lorsqu'il s'agit d'un problème comme l'évaluation de la nature de classe de l'URSS: "socialiste" ou "en marche vers le socialisme" selon les partis "socialistes ou "communistes" et l'ensemble des partis de centre et de droite ; "Etat ouvrier dégénéré" selon Trotsky et les trotskystes; il revient à la "gauche allemande" des années 20 d'avoir la première analysé d'un point de vue marxiste l'URSS comme du capitalisme d'Etat ; ce n'est pas un hasard si c'était un des seuls courants dans le mouvement ouvrier à connaître et partager l'analyse des crises de Rosa Luxemburg.
Dans sa brochure de critique à l'"Accumulation du Capital", Boukharine affirme nettement la nature non capitaliste de l'URSS :
"A toutes les contradictions du système capitaliste mondial s'ajoute encore une autre contradiction cardinale: la contradiction entre le monde capitaliste et le nouveau système économique de l'Union Soviétique."(Idem p.136)
Ce n'est pas non plus un hasard. Lorsque, dans l'analyse des crises du capitalisme, on "privilégie" des contradictions telles que "la concurrence et l'anarchie capitaliste", on tend inévitablement à voir dans les nationalisations d'entreprises, dans le développement 'du pouvoir d'Etat, dans la planification, des preuves de rupture réelle avec le capitalisme. Lorsqu'on ignore la réalité du marché mondial et son importance dans la vie du capitalisme, on laisse la porte ouverte à l'idée de la possibilité du socialisme en un seul pays.
A travers la critique théorique de l'analyse de Rosa Luxemburg, Boukharine jetait les bases des théories qui sous le stalinisme serviront à présenter avec un verbiage marxiste un régime d'exploitation capitaliste, comme du socialisme.
La compréhension des problèmes économiques de la période de transition du capitalisme au communisme est étroitement dépendante de l'analyse des crises du capitalisme. Il faudra demain avoir tiré toutes les leçons de l'expérience pratique de la révolution russe dans ce domaine. Cela comporte aussi d'avoir dépassé toutes les aberrations théoriques que la dégénérescence de la révolution a engendrées.
R.V.
Sont déjà parus sur les théories des crises dans la Revue Internationale, les articles suivants :
Marxisme et théories des crises - n° 13
Théories économiques et lutte pour le socialisme - n°16
Sur l'impérialisme (théories de Marx, Lénine, Boukharine, R.Luxemburg) - n°19.
Les théories des crises, de Marx à l'Internationale Communiste - n°22.
{C}{C}{C}{C}
{C}{C}{C}{C}[1]{C}{C}{C}{C} [78] Revue Internationale N°29. Voir aussi "Lesthéories des crises,de Marx à l'Internationale Communiste" dans la Revue Internationale N°22, 3ème trimestre 80).
{C}{C}{C}{C}[2]{C}{C}{C}{C} [79] Nicolas Boukharine. "L'impérialisme et l'accumulation du capital". Ed.EDI.
Questions théoriques:
- Décadence [12]
Heritage de la Gauche Communiste:
Critique de «LÉNINE PHILOSOPHE» de Pannekoek (Internationalisme, 1948) (4ème partie)
- 2753 reads
LES CONCLUSIONS DE HARPER SUR LA REVOLUTION RUSSE ET L'ASPECT DE LA DIALECTIQUE MARXISTE QU'IL A CRU BON DE LAISSER DANS L'OMBRE...
Il y a trois façons de considérer la révolution russe :
a) La première est celle des "socialistes" de tout poil, droite, centre et gauche, révolutionnaires et Cie (en Russie), indépendants et tutti quanti, ailleurs.
Avant la révolution, leur perspective était : la révolution russe sera une révolution bourgeoise démocratique, au sein de laquelle, -démocratie bourgeoise,- la classe ouvrière pourra lutter "démocratiquement" pour "ses droits et libertés".
Tous ces messieurs étaient, en plus de "révolutionnaires démocrates sincères", de fervents défenseurs du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", et arrivaient à la défense de la nation par le détour d'un internationalisme à sens unique partant du pacifisme et aboutissant à la lutte contre les agresseurs et les oppresseurs. Ces gens là étaient des"moralistes" dans le plus pur sens du terme, défendant le "droit" et la "liberté", avec un grand D et un grand L des pauvres et des opprimés.
Bien entendu, quand la première révolution, celle de février éclata, ce fut un torrent de larmes de joie et d'allégresse, la confirmation de la sainte perspective, enfin, la sainte révolution tant attendue.
Ils avaient seulement oublié que le coup de pouce donné par l'insurrection générale de février ne faisait qu'ouvrir les portes à la vraie lutte de classe des classes en présence.
Le tzar tombé, la révolution bourgeoise en voie d'accomplissement au sein même de la vieille autocratie, signifiait le pourrissement de cet appareil, et la nécessité de son remplacement : février ouvre la porte à la lutte pour le pouvoir.
Au sein de la Russie même, quatre forces se révèlent en présence :
- l'autocratie, bureaucratie féodale gouvernant un pays où le grand capital est en train de s'installer,
- la bourgeoisie et petite bourgeoisie, grand capital, directeurs d'industrie et élite intellectuelle, moyenne propriété foncière, etc...
- la grande masse de la paysannerie pauvre à peine sortie du servage.
- les intellectuels et petite bourgeoisie prolétarisés par la crise du régime et du pays, et le grand prolétariat industriel.
Les éléments "réactionnaires" (les soutiens du régime tsariste), s'étaient convaincus de l'inéluctabilité et de la nécessité de l'introduction du grand capitalisme industriel en Russie, et ils n'aspiraient pas à autre chose qu'à être les gérants et les gendarmes du grand capital financier étranger, au prix d'un conservatisme social à eux favorable, le maintien du système bureaucratique impérial, la "libération" du servage, nécessaire à fournir une main- d'oeuvre à l'industrie, tout en maintenant le haut contrôle de la bureaucratie et de la noblesse sur la moyenne paysannerie, considérée comme une classe de métayers.
Ceci était, évidemment, déjà, la "révolution bourgeoise". Mais les forces sociales qui entraient sur l'arène de l'histoire ne tenaient pas compte des desideratas de la bureaucratie. Le capital introduit en Russie, cela signifiait, d'un côté le prolétariat, de l'autre la classe capitaliste, qui ne se compose pas que des possesseurs de capitaux, mais de toute la classe sociale qui dirige effectivement l'industrie et administre la circulation des capitaux.
L'importation du capital eut pour conséquence de révéler aux classes dirigeantes russes, dans le sens le plus large du terme, toutes les possibilités énormes de développement que pouvait fournir le capitalisme à la Russie.
Se créaient donc,au sein de ces classes, deux tendances ambivalentes : la première, nécessité de se servir du capital financier étranger pour le développement capitaliste en Russie ; la deuxième, une tendance à l'indépendance nationale, et donc, à se libérer de l'emprise de ce capital.
Dès l'ouverture du cours révolutionnaire, les pays qui avaient investi des capitaux en Russie, tels la France et l'Angleterre et bien d'autres encore, comprirent surtout le danger du point de vue des intérêts de "leurs" capitaux. Or, on sait que la mentalité du possédant, en général, est la pleutrerie, la peur,et, par réaction le déchaînement et l'explosion de la force dont il peut disposer.
Ces pays savaient très bien qu'un gouvernement démocratique sauvegarderait leurs intérêts, mais comme tout capitaliste, ils voyaient dans l'installation d'un quelconque putsch réactionnaire, la possibilité de dicter leur politique et celle d'avoir effectivement la mainmise sur un territoire extrêmement riche. Les pays étrangers misaient donc sur tous les tableaux, soutenaient tout le monde, Kerinsky et Dénikine, les bandes réactionnaires et le gouvernement provisoire, etc.. Les uns recevaient de l'argent, des armes et des conseillers techniques militaires, les autres recevaient les "conseils désintéressés" de la part d'ambassadeurs ou autres consuls. De plus, à travers cette grande bagarre pour le pouvoir, se faisaient jour avec d'autant plus d'acuité les luttes pour la prépondérance d'influence, les rivalités d'impérialismes, unis pour un jour, se tirant dans le dos et complotant par derrière contre l'allié, etc..
Le terme le plus adéquat pour caractériser la géographie politique de la période qui va de la première révolution (février) à la seconde, (octobre), c'est le marasme, le chaos, où l'histoire contemporaine n'a pu mettre son nez que très peu de temps grâce aux publications, par le gouvernement bolchevik,de tous les accords secrets officiels.
b) La guerre impérialiste elle-même était dans une impasse, les cadavres pourrissaient dans les "no man's land" séparant les tranchées d'un front couvrant tout l'est de l'Allemagne et de l'Empire Austro-Hongrois, et le sud de ces mêmes pays, sans que la guerre, ne sembla être en passe de trouver une issue.
Dans ce chaos général, un petit groupe politique qui avait représenté l'internationalisme révolutionnaire aux conférences de Zimmerwald et de Kienthal, et qui avait posé comme principe premier de la renaissance d'un mouvement ouvrier révolutionnaire sur le cadavre de la IIème Internationale :
Le prolétariat devra AVANT TOUT proclamer son internationalisme en entrant en lutte, QUOI QU'IL ARRIVE contre sa propre bourgeoisie, ayant bien en vue que ce mouvement n'est qu'un mouvement international du prolétariat qui doit, pour permettre de réaliser le socialisme, s'étendre aux principales puissances bourgeoises.
La seule divergence qui existait entre sociaux-démocrates et le noyau de la future Internationale Communiste était ce point fondamental :les sociaux-démocrates pensaient réaliser le socialisme par des"progrès dans l'élargissement de la démocratie intérieure" du pays, et de plus ils pensaient que la guerre était un "accident" dans le mouvement de l'histoire, et que pendant la guerre, plus de luttes de classe, qui devaient être mises à la naphtaline, en attendant la victoire sur le méchant ennemi qui venait empêcher cette "lutte" de s'opérer "pacifiquement".
(Il faudrait avoir plus de place et montrer les manifestes des différents partis, S.D, S.R etc.. de l'époque de la guerre de 1914 à 1917-et des extraits d'articles de journaux de ces partis destinés aux troupes russes en France, et où le "socialisme" y était défendu avec une ardeur., vraiment héroïque).
La gauche qui commença à se regrouper après les deux conférences de Suisse, avait ses assises politiques les plus solides autour de la personnalité de Lénine, à l'époque presque totalement isolé, de ses propres ex-partisans du parti bolchevik et même dans la gauche de la social-démocratie, considéré comme un illuminé, Lénine proclamait en substance :
"... Prêcher la collaboration des classes, renier la révolution sociale et les méthodes révolutionnaires, s1adapter au nationalisme bourgeois 3 oublier le caractère changeant des frontières nationales et des patries, ériger en fétiche la légalité bourgeoise, renier l'idée de classe et la lutte de classe par crainte d1éloigner la "masse de la population" (lisez : la petite bourgeoisie) voilà, sans nul doute la base théorique de l’opportunisme .."
"...La bourgeoisie abuse les peuples en jetant sur le brigandage impérialiste le voile de l’ancienne idéologie de la "guerre nationale". Le prolétariat démasque le mensonge en proclamant la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. C'est le mot d'ordre indiqué par les résolutions de Stuttgart de Baie, qui prévoyaient, non la guerre en général, mais bien cette guerre-ci, et qui parlaient non pas de la "défense de la patrie", mais "d'accélérer la faillite du capitalisme" et d'exploiter à cet effet la crise produite par la guerre, en donnant l'exemple de la Commune. La Commune a été la transformation de la guerre nationale en guerre civile.
Cette transformation n'est pas facile à faire et ne s'opère pas au gré de tel ou tel parti. Et c'est précisément ce qui correspond à l'état objectif du capitalisme en général, et de sa phase terminale en particulier. C'est dans cette direction et dans cette direction seulement, que doivent travailler les socialistes. Ne pas voter les. crédits de guerre, ne pas approuver le "chauvinisme" de SON pays et des pays alliés, mais au contraire, combattre avant tout autre le chauvinisme de SA bourgeoisie, et ne pas se cantonner dans les moyens légaux lorsque la crise est ouverte et que la bourgeoisie elle-même a annulé la légalité créée par elle, voilà la LIGNE DE CONDUITE qui MENE à la guerre civile et qui amènera fatalement à un moment ou à un autre de l'incendie qui embrase l'Europe. .. "
"... La guerre n'est pas un accident, un "péché" comme pensent les curés (qui prêchent le patriotisme, l'humanité et la paix, au moins aussi bien que les opportunistes), mais une phase inévitable du capitalisme, une forme de 'la vie capitaliste aussi légitime que la paix. La guerre actuelle est une guerre des peuples. De cette vérité il ne résulte pas qu'il faille suivre le courant "populaire" du chauvinisme, mais que pendant la guerre, à la guerre, et sous des aspects guerriers, continuent à exister et continueront à sa manifester les antagonismes sociaux qui déchirent les peuples... "
"... A bas les niaiseries sentimentales et les soupirs imbéciles après "la paix à tout prix"! L'impérialisme a mis en jeu le sort de la civilisation européenne. Si cette guerre n'est pas suivie d'une série de révolutions victorieuses, elle sera suivie à bref délai d'autres guerres. La fable de la "dernière guerre" est un conte creux et nuisible, un "mythe" petit bourgeois (selon l'expression très juste du Golos).
Aujourd'hui ou demain, pendant cette guerre ou après elle, actuellement ou bien lors de la prochaine guerre, l'étendard prolétarien de la guerre civile ralliera non seulement des centaines de milliers d'ouvriers conscients, mais des millions de semi-prolétaires et des petits bourgeois abêtis actuellement de chauvinisme et que les horreurs de la guerre pourront effrayer et déprimer, mais surtout instruiront,éclaireront, éveilleront, organiseront, tremperont et prépareront à la guerre contre la bourgeoisie, celle de "leur" pays et celle des pays "étrangers"...."
".. La IIème Internationale est morte, vaincue par l’opportunisme. A bas l'opportunisme et vive l'Internationale épurée non pas seulement des "transfuges" (comme le désire le Golos) mais aussi de l'opportunisme, la IIIème Internationale !
La IIème Internationale a accompli sa part de travail utile. (…)
A la IIIème Internationale appartient l'organisation des forces prolétariennes pour l'offensive révolutionnaire contre les gouvernements capitalistes, pour la guerre civile contre la bourgeoisie de tous les pays, pour la conquête du pouvoir, pour la victoire du socialisme..."
En comparant cela à Marx, on voit combien, contrairement à ce qu'Harper veut bien nous faire croire, Lénine a compris le marxisme et a su Rappliquer au moment adéquat :
".,. Il va absolument de soi que, pour pouvoir lutter d'une façon générale, la classe ouvrière doit s'organiser chez elle EN TANT QUE CLASSE et que l'intérieur du pays est le théâtre immédiat de sa lutte. C'est en cela que sa lutte de classe est nationale, non pas quant à son contenu, mais comme le dit le Manifeste Communiste, "quant à sa forme". Mais le "cadre de l'Etat national actuel", c'est à dire de l'Empire allemand, entre lui-même à son tour, économiquement, "dans le cadre" du système des Etats. Le premier marchand venu sait que le commerce extérieur et la grandeur de Mr Bismarck réside précisément dans une sorte de politique internationale.
Et à quoi le Parti Ouvrier allemand réduit-il son internationalisme ? A la conscience que le résultat de son effort "sera la fraternité internationale des peuples" phrase empruntée à la bourgeoise Ligue de la liberté et de la paix, et qu'on fait passer comme un équivalent de la fraternité internationale des classes ouvrières dans la lutte commune contre les classes dominantes et leurs gouvernements. " (Critique du Programme de Gotha) (1-5)
Ce qui distinguait donc cette gauche de la S.D de l'ensemble du mouvement ouvrier, c'était ses positions politiques :
1- SUR LA NOTION DE LA PRISE DU POUVOIR (la querelle démocratie bourgeoise et démocratie ouvrière intégrale par la dictature du prolétariat)
2- sur la nature de la guerre et la position des révolutionnaires dans cette guerre.
Sur tout le reste, notamment sur l'organisation "économique" du socialisme, on en était encore aux mots d'ordre des nationalisations de la terre et de l'industrie, comme beaucoup gardaient en politique le mot d'ordre de la "grève générale insurrectionnelle". Quoi qu'il en soit, il est bon de rappeler que très peu nombreux étaient les militants socialistes, même dans la gauche, qui avaient compris les positions de Lénine au cours de la guerre, et qui se rallieront APRES COUP à la Révolution Russe, quand la théorie se sera trouvée réalisée dans les faits.
Ceci est tellement vrai, que dans la querelle de Kautsky-Lénine, il n'est pas soufflé mot de la part de Kautsky, de ce côté du problème et pourtant, Lénine le fait remarquer, Kautsky avait pris position antérieurement, au Congrès de Baie, pour des positions analogues et très avancées sur le pouvoir ouvrier et sur l'internationalisme. Cependant il ne suffit pas de signer des résolutions, faut-il encore savoir les appliquer pratiquement. C'est là, est quand on trouve transposé du plan théorique au plan pratique qu'on voit le vrai marxiste. Toute la valeur d'un Plékhanov et d'un Kautsky, des hommes considérables dans le mouvement ouvrier socialiste de la fin du 19ème siècle, s'effondre comme statue de sel à côté de ce petit groupe de bolcheviks qui a du transposer sur le plan pratique leurs théories, d'abord pour la prise du pouvoir, ensuite devant la guerre, face aux S.R de gauche et à la fraction bolchevique qui était pour la "guerre révolutionnaire" à Brest-Litovsk, et devant l'offensive allemande, et devant la guerre civile intérieure qui se poursuivait.
En attendant que la révolution gagne internationalement, on ne pouvait faire en Russie qu'une organisation bourgeoise de l'économie, mais sur le modèle du capitalisme le plus avancé : le capitalisme d'Etat.
Seul le règlement ultérieur de la révolution internationale, (QUI AVAIT EU SON POINT DE DEPART INTERNATIONALEMENT, sur les positions et devant L'EXEMPLE DES BOLCHEVIKS), permettrait la possibilité d'une évolution et d'une transformation de la société vers le socialisme. En dehors de cela, on pourrait citer cent exemples de fausses positions, avant et après la révolution, de ce même Lénine.
En 1905, Trotsky lui donne une sévère leçon dans "Nos différents"et c'est sur la synthèse de la position de Trotsky dans "Nos différents" et de Lénine dans "Que faire ?" que s'est opérée la prise de position dans la guerre. Après la prise du pouvoir, une somme formidable d'erreurs ont été commises de part et d'autres à l'intérieur du parti, chez Lénine, Trotsky etc.. Il ne s'agit pas ici de se voiler les yeux sur toutes ces erreurs, nous y reviendrons par la suite en d'autres endroits, où il s'agira surtout des "léninistes purs". Mais les enseignements qu'on peut tirer après 30 ans de recul, alors que les conditions économiques ont changé, que les caractères se sont accentués, cette méthode est différente de celle qui consiste à faire face aux événements qui se présentent d'une façon anarchique et imprévue. Aujourd'hui on peut dire quelles furent les erreurs des bolcheviks, on peut étudier la révolution russe comme un événement historique, on peut voir quels étaient les groupes politiques en présence, analyser et étudier leurs documents, leur action etc..
Mais, pour hier, avec toutes leurs positions retardataires, les bolcheviks, Lénine et Trotsky en tête, étaient-ils engagés dans un mouvement qui avait pour fin immédiate d'être un mouvement vers le socialisme ? Les chemins pris par les bolcheviks y conduisaient-ils ? Ou bien ceux pris par Kautsky, ou ceux pris par X, Y, ou Z ?
Nous répondons, il n'y avait qu'une seule base de départ pour que le mouvement s'engage dans la voie de la révolution socialiste, et cette base, seuls les bolcheviks, -en Russie-, (et encore pas tous, loin de là), l'avaient mis en avant et l'avaient appliquée. C'est cette base qui faisait que leur action était engagée dans une lutte de classe où le but était le renversement du capitalisme à l'échelle internationale et où les positions politiques générales conduisaient réellement à ce renversement.
Sorti de là, de ces bases qui ont présidé dans les grandes lignes à l'éclosion du mouvement bolchevik octobriste, il y aurait bien des choses à dire, et la discussion, loin d'être close là dessus, ne fait au contraire que commencer, mais elle ne peut avoir lieu et ne peut avoir pour bases que au minimum, le programme révolutionnaire d'octobre et bien entendu, au travers de ce programme, valable pour une époque et toute l'expérience du mouvement ouvrier de ces 30 dernières années.
Le mouvement révolutionnaire qui s'est engagé en 1917 en Russie A PROUVE qu'il était international, de par les répercussions qu'il a eues en Allemagne l'année d'après.
Au début du mois de novembre 1918, les marins allemands se révoltent, les soviets se propagent dans toute l'Allemagne.
Mais quelques jours après, l'armistice était signé, quelques mois après, Noske avait fait son travail de répression, enfin en 1919,,.quand le 1er Congrès de l'I.C s'est tenu, -et quoique le grand mouvement provoqué par la révolution russe-allemande ait secoué le prolétariat encore pendant de longues années,- le point culminant de la révolution était déjà dépassé, la bourgeoisie s'était ressaisie, la paix retrouvée émoussait la lutte de classe peu à peu, le prolétariat refluait idéologiquement au fur et à mesure que la révolution allemande était brisée par morceaux. L'échec de la révolution allemande avait laissé la Russie isolée, devant poursuivre son organisation économique et attendre une nouvelle vague révolutionnaire.
Mais l'histoire est ainsi faite qu'un mouvement ouvrier ne peut être victorieux par étapes. La Révolution russe n'étant qu'une victoire partielle, le résultat final du mouvement qu'elle a déchaîné ayant été une défaite à l'échelle internationale, la "soi-disant" construction du "socialisme" en Russie devait surtout être l'image de cette défaite du mouvement ouvrier international.
L'I.C tenant ses congrès à Moscou montrait déjà que la révolution était stoppée, le reflet de cette défaite se traduit, dans l'étude des congrès, qui marquent à chaque nouveau congrès, un nouveau recul du mouvement ouvrier international, sur le plan théorique à Moscou, physiquement à Berlin.
De nouveau, les révolutionnaires se trouvaient mis en minorité puis exclus. L'Internationale Communiste, après la IIème et la 1ère, les partis communistes après tant d'autres partis "socialistes", "ouvriers" et autres, voyaient leur idéologie embourgeoisée peu à peu.
Mais à côté de ce recul du mouvement ouvrier, deux phénomènes marquant se produisent, un parti ouvrier dégénéré gardait le pouvoir d'un Etat pour lui seul et le capitalisme dans une nouvelle ère, se trouvait entré en 1914 et, par la suite replongé, au fur et à mesure du recul du mouvement ouvrier, dans des crises internes à un degré bien plus élevé qu'auparavant.
C'est pensons nous, l'analyse de ces deux phénomènes que seule la Fraction Italienne de la G.C (en publiant "Bilan", dont le nom seul est tout un programme, de 1933 à 1938), a su dégager d'une façon claire, et qui aurait du permettre de donner naissance à un nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire.
c) Devant cette dégénérescence du mouvement ouvrier, devant l'évolution du capitalisme moderne, devant l'Etat stalinien russe, devant les problèmes qui se sont posés aux insurrections de soviets, il y a une troisième position qui consiste à ne pas se fatiguer dans une recherche trop approfondie des pourquoi et des comment HISTORIQUES ET POLITIQUES de ces 30 dernières années, et à tout mettre sur le dos d'une "tête de turc". Les uns choisissent comme "tête de turc" Staline, et font de 1'antistalinisme qui les conduit à la participation à la guerre dans le camp américain "démocratique" ; d'autres choisissent un "dada" quelconque. Le "dada" varie selon les besoins de la mode politique. En 1938-42, la mode était de mettre sur le dos du fascisme la guerre et la dégénérescence de la société dues au maintien du système capitaliste dans son ensemble. Aujourd'hui c'est le stalinisme qui sert de "tête de turc". Alors les théories et les théoriciens fleurissent : Burnham, contre la bureaucratie, Bettelheim pour, etc.. Sartre et la "liberté" et toute la clique des écrivains salariés des partis politiques de la bourgeoisie et du journalisme moderne pourri d'arrivistes. Dans le tableau, l'accusation de Harper contre le "léninisme", dont le "stalinisme serait le produit fatal", n'est qu'une pièce à conviction de plus et une surenchère.
Dans une heure ou le "marxisme" subit sa plus grande crise (espérons seulement que c'est une crise de croissance), Harper ne fait que mettre un peu plus de confusion là où il y en a déjà de trop.
Quand Harper affirme :
".., Mais non, on ne trouve rien chez Lénine qui indiquerait que les idées sont déterminées par la classe. Les divergences théoriques chez lui planent dans l'air. Bien entendu,une opinion théorique ne peut être critiquée qu'à l'aide d'arguments théoriques. Mais quand les conséquences sociales sont mises au premier plan avec une telle violence, on ne devrait pas laisser dans l'ombre l'origine sociale des conceptions théoriques. Ce coté essentiel du marxisme, visiblement, n'existe pas chez Lénine. . "
("Lénine als philosophe" -Harper La science de la nature -Lénine-)
Il va ici plus loin que la simple confusion, plus loin que ne pourrait l'être, entraîné par la polémique, un excès de langage. Harper est un de ces nombreux marxistes qui ont vu dans le marxisme l'affirmation plus d'une méthode philosophique et scientifique en théorie, mais qui restent dans le ciel astronomique de la théorie sans jamais l'appliquer à la pratique historique du mouvement ouvrier. Pour ces "marxistes" la "praxis" est encore un objet de philosophie, pas encore un sujet agissant.
N'y a-t-il pas une philosophie à tirer de cette période révolutionnaire ?
Si certainement. Je dirai même que pour un marxiste, on ne peut tirer de philosophie que d'un mouvement de l'histoire, pour en tirer les leçons pour la suite du mouvement historique. Or, que fait Harper ? il philosophe sur la philosophie de Lénine en l’enlevant de son contexte historique. S’il n’y avait que cela, il aurait été amené seulement à exprimer une demi-vérité. Mais voilà qu’il veut appliquer cette conclusion, cette demi-vérité, à un contexte historique qu’il ne s’est même pas donné la peine d’examiner. Là il nous fournit la preuve qu’il n’a pas fait mieux, sinon pire que Lénine dans « Matérialisme et Empiriocriticisme ». Il a parlé du marxisme, et la montré dans sa position par rapport au problème de la connaissance. Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce que Harper a dit ; il y a surtout à dire que l’aspect principal de la position du problème de la PRAXIS et de la connaissance, pour un marxisme, ne se fait pas en dehors de l’aspect politique immédiat que revêt la « praxis » véritable révolutionnaire, c'est-à-dire le développement du mouvement de la pensée et de l’action révolutionnaire !!! Or Harper répète comme une litanie : « Lénine n’était pas un marxiste !!! Il n’a rien compris à la lutte de classe !!! », et il s’avère que, point par point Lénine suit les enseignements de Marx, dans le développement de sa pensée politique révolutionnaire pratique.
La preuve que Lénine a compris et appliqué à la révolution russe les enseignements du marxisme, est contenue dans la « préface » de Lénine au « lettres de Marx à Kugelmann », où il a puisé l’enseignement que Marx a tiré de la commune de Paris ; on trouve encore une curieuse analogie entre les texte de Lénine que nous avons cité et ce passage de Marx, critique du programme de Gotha « I-5 ».
Lénine et Trotski sont en plein dans la ligne du marxisme révolutionnaire. Ils ont suivi ses enseignements pas à pas. La théorie de « Révolution permanente » de Trotski n’est autre que la leçon du Manifeste Communiste et du marxisme en général, son aspect non dégénéré : la révolution russe en reproduit d’ailleurs fidèlement les schémas et obéit à ce marxisme. On a oublié une seule chose, chez Harper comme chez tant d’autres marxiste : la perspective valable pour les révolutions du 19° siècle, pendant la période ascendante du capitalisme, et sur laquelle encore se trouve à cheval la révolution russe, est-elle valable pour la période dégénérescente de cette société ?
Lénine avait bien dégagé la nouvelle perspective en parlant d’une nouvelle période dite « des guerres et des révolutions » ; Rosa avait bien dégagé l’idée que le capitalisme entré dans une époque de dégénérescence, cela n’a pas empêché l’I.C. et à sa suite tout le mouvement ouvrier trotskiste et autre opposition de gauche de resté sur l’ancienne perspective, ou d’y revenir, comme Lénine le fit après l’échec de la révolution allemande. Harper pense bien qu’il y a une nouvelle perspective, mais il prouve par son analyse de Lénine et à travers lui de la révolution russe, qu’il n’a pas su après tant d’autres l’a dégager et qu’il s’est perdu dans des tas de considérations vague ou fausses comme tant d’autres avant lui.
Et ce n’est pas un hasard que se soient les héritiers d’une partie du bagage idéologique de « Bilan » qui lui répondent, comme ils répondent d’ailleurs au « léninistes » pure.
Les « pro » et les « anti » Lénine oublient seulement une chose c’est que si les problèmes d’aujourd’hui ne se comprennent qu’à la lueur de ceux d’hier ils sont cependant différent.
Philippe
Heritage de la Gauche Communiste:
Revue Internationale no 31 - 4e trimestre 1982
- 2702 reads
Moyen-Orient : la barbarie des impérialismes
- 2557 reads
Le battage sur la tuerie dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth ouest, tuerie et battage menés par la bourgeoisie occidentale, constitue un rappel de plus, s'il en était besoin que la survie des lois du système capitaliste mène le monde à la barbarie. Ce déluge de fer et de sang (subi pendant trois jours par hommes, femmes et enfants), complaisamment étalé pour des besoins de propagande, est un massacre de plus marquant l'agonie d'un système qui fournit quotidiennement son lot de victimes, des accidents du travail aux catastrophes "naturelles", des répressions aux guerres.
Le Moyen-Orient n'a jamais cessé, depuis le début de ce siècle, d'être un champ de bataille des grandes puissances, un terrain privilégié de guerre pour le capitalisme. C'est la guerre que se livrent les deux grands blocs impérialistes qui s'y est poursuivie depuis la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, le bloc occidental, en repoussant son adversaire, le bloc de l'est, accentue sa mainmise sur la région. Il vise à la transformer en un bastion militaire face au bloc russe. La "pax americana" parachève une étape de sa stratégie d'élimination de toute présence significative de l'URSS, consolidant sa position, en partie pour compenser et contrer la déstabilisation de l'Iran et répondre à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. L'invasion du Liban par Israël au cours de l'été 1982 et l'installation de troupes américaines, françaises et italiennes s'inscrivent dans cette stratégie où ce sont les populations qui paient le prix de ce jeu sanglant.
Pourquoi la bourgeoisie occidentale a t-elle monté un battage sur ce massacre des camps de palestiniens ?
Au Liban même, ce genre d'opération s'est déjà souvent produit et ceci d'un côté comme de l'autre. Beaucoup de combats meurtriers ou de vagues d'assassinats de ce genre qui se déroulent dans le monde ne bénéficient pas d'autant de "faveur". Ce battage revêt en fait essentiellement un double aspect : d'une part, signifier clairement l'impossibilité de tout appel à l'aide du bloc adverse et consacrer la victoire occidentale, et d'autre part, poursuivre les campagnes idéologiques de la bourgeoisie sur les thèmes véhiculant un sentiment d'impuissance et de terreur (comme le pacifisme, l'anti-terrorisme, l'agitation du danger de guerre) et présentant les interventions militaires comme les seules chances d'assurer la paix. La guerre des Iles Malouines était montée de toute pièce principalement dans le but de tester l'impact idéologique d'une expédition militaire d'un grand pays capitaliste ([1] [81]). Avec l'expédition de troupes au Liban, c'est en utilisant un événement dont les racines sont profondément différentes, l'affrontement entre blocs impérialistes, que la propagande bourgeoise poursuit ce même but.
Aux prises avec la crise ouverte qui offre des perspectives de plus en plus catastrophiques, la bourgeoisie n'a d'autre possibilité que de pousser vers sa "solution", la guerre impérialiste généralisée. Mais cette voie est barrée par la classe ouvrière qui n'a pas subi de défaite décisive Malgré l'annihilation relative des luttes surtout après les mouvements de 1980-81 en Pologne, la classe ouvrière n'adhère massivement à aucun des idéaux de la bourgeoisie. C'est ce qui impose à cette dernière la répétition constante de campagnes idéologiques pour occuper tout le terrain, tenter d'enrayer la reprise entamée dans les grands pays à la fin des années 70, empêcher qu'elle ne débouche sur une lutte massive et internationale de la classe ouvrière, la seule force capable d'offrir une alternative à la barbarie du système capitaliste.
La barbarie du capitalisme
Toute l'histoire de l'humanité est jalonnée de massacres, de guerres et de génocides. Le capitalisme, dernière société d'exploitation de l'homme par l'homme, en subsistant depuis plus de 60 ans, après la défaite de la vague révolutionnaire des années 1917-23 et le triomphe de la contre-révolution, a poussé cette barbarie jusqu'à faire peser sur l'humanité la menace de sa disparition définitive dans une troisième guerre mondiale général isée.
De toutes les guerres de l'histoire, de l'Antiquité à la guerre de 100 ans, des guerres féodales aux guerres napoléoniennes, celles du 20ème siècle ont laissé des millions de victimes : 20 millions de morts pendant la guerre de 1914-18, 50 millions dans celle de 1939-45, plusieurs dizaines de millions depuis. Et la classe dominante dispose dans ses arsenaux de quoi faire sauter plusieurs fois la planète.
De même, des millions de morts sont tombes sous les coups d'opérations de répression et dans la contre-révolution qui s'est abattue sur la classe ouvrière : en Allemagne en 1917-23 et sous le nazisme, en Russie après l'échec de la révolution de 1917 et sous le stalinisme, en Chine en 1927, en Espagne dans la "guerre civile" de 1936-39, etc. Le nombre de victimes est tel que tous les massacres additionnés depuis la révolte des esclaves de Spartacus jusqu'à la répression des Communards de 1871 ne représentent qu'une faible partie des saignées qu'a du subir l'humanité dans son évolution.
Le capitalisme, en faisant faire un bond gigantesque à l'humanité, a aussi développé jusqu'à un degré jamais égalé l'exploitation. Il a surgi en jetant dans la misère des populations entières, en les dépossédant de leurs anciens moyens de subsistance pour les transformer en prolétaires, ne disposant plus que de leur force de travail. Dans la période ascendante du capitalisme, cette situation constituait un lourd tribut payé à un développement véritable des forces productives. Dans la période de décadence, elle est la conséquence que le capitalisme est devenu incapable de se développer dans le sens d'un accroissement de la satisfaction des besoins humains. Il n'a survécu au contraire que par la destruction.
Les tueries du capitalisme sont la partie visible de l'iceberg. La partie immergée est constituée par la barbarie et l'absurdité quotidiennes de l'exploitation et de l'oppression.Lorsque la bourgeoisie fait campagne sur un massacre, elle le monte en épingle pour s'en servir de paravent ou d'alibi ([2] [82]) pour d'autres massacres, pour justifier un système qui vit dans un cycle infernal de crise-guerre-reconstruction-crise. Ce cycle qui s'est déjà reproduit deux fois au 20ème siècle ne peut aller qu'en s'amplifiant vers la destruction totale de l'humanité si le prolétariat ne détruit pas de fond en comble le capitalisme mondial.
La liste est longue des hauts faits de la terreur du capitalisme. La mise en avant à un moment ou à un autre par la bourgeoisie d'un épisode de cette série noire n'est que l'arbre qui cache la forêt.
Au Liban, la bourgeoisie a tenté un coup double : parachever le"nettoyage" en semant la terreur, feindre l'indignation à des fins de propagande. Avec l'imbroglio impérialiste du Liban, après plusieurs mois de pilonnages et de bombardements intensifs, les lamentations sont de l'hypocrisie. C'est la bourgeoisie mondiale, de l'Ouest à l'Est, en particulier celle des pays "démocratiques", qui porte le sang sur ses mains.
Ce sont tous les Etats capitalistes -et tous les Etats du monde sont capitalistes, y compris les Etats "potentiels" comme celui de l'OLP- avec leurs organismes, leurs partis et leurs syndicats qui sont les garants de l'ordre bourgeois et de la défense de la patrie, qui sont les responsables des massacres. Au Liban, Reagan, Castro, Thatcher, Mitterrand et Brejnev, tous y sont allés de leur larme sur une tuerie commise en un lieu où près de onze armées d'occupation sont présentes. Le thème de "personne n'a rien pu faire" est destiné à prêcher la passivité et à introduire l'idée que "la seule chose à faire " est de ramener en beauté les armées des Etats-Unis, de la France et de l'Italie, "pour la sécurité". Et tel était effectivement le but de l'opération,
Conflits inter-impérialistes et campagne idéologiques
De par sa situation géographique, voie de passage entre Europe, Asie et Afrique, et ses ressources pétrolières, le Moyen-Orient a toujours été un des enjeux stratégiques au coeur des guerres du 20ème siècle, un "théâtre d'opération" comme le disent les stratèges de la bourgeoisie. C'est le capitalisme mondial qui a façonné le Moyen-Orient en une constellation d'Etats, par les traités internationaux et les armées des grands Etats capitalistes.
Après la domination turque au début de ce siècle, la domination franco-anglaise entre les deux guerres, et la domination anglo-américaine à la fin de la 2ème guerre (Conférence de Téhéran et Traité de Yalta), le Moyen-Orient est en voie de repasser aujourd'hui tout entier sous l'hégémonie occidentale, après avoir été disputé par le bloc russe pendant plus de vingt ans.
Depuis une dizaine d'années, on assiste à un renversement systématique des positions que l'URSS avait péniblement acquise dans les années 50. C'est d'abord le retour de l'Egypte dans le camp américain après la guerre Israélo-égyptienne de 1973. Des 1974, le retrait américain du Viêt-Nam, outre qu'il correspondait à un marchandage avec la Chine, marquait aussi une accentuation de l'offensive diplomatique et militaire américaine au Moyen-Orient. C'était la stratégie des "petits pas" de Kissinger, qui avait ouvert des pourparlers avec toutes les parties en présence, et dont un des aboutissements devait être les accords de Camp David entre Israël et l'Egypte. Une fois le front égyptien neutralisé sous contrôle américain, avec le retrait d'Israël du Sinaï, c'est vers le nord (Syrie, Irak, Liban) que l'offensive s'est poursuivie :
- mise au pas de l'Irak ;
- immobilisation de la Syrie par les manipulations sur le plan intérieur, en particulier des "Frères Musulmans", l'intimidation militaire et l'aide financière considérable de l'Arabie ([3] [83]) ;
- jusqu'à la neutralisation de toute influence prorusse au sein de l'OLP, avec le ralliement de celle-ci aux plans occidentaux, et la dispersion de son appareil militaire dans différents pays.
Cette dernière évolution se dessinait aussi depuis plusieurs années déjà, avec le discours d'Arafat à l'ONU en 1976 qui marquait officieusement le début du passage de l'OLP sous le contrôle de la diplomatie occidentale qui est effectif aujourd'hui. Israël a été l'exécuteur sur le terrain, de ce "nettoyage".
Aujourd'hui, la phase qui s'engage du terrain militaire vers le terrain plus "diplomatique" risque de faire perdre à Israël son rôle d'allié privilégié et de place forte militaire unique, et ne se passe pas sans frictions. Il est possible même qu'Israël ait quelque peu outrepassé les objectifs qui lui étaient fixés par l'administration Reagan, ou que cette dernière ait laissé faire. Quoi qu'il en soit, cela n'enlève rien pour autant à la responsabilité américaine dans les massacres. •Au contraire. Dans cette hypothèse, cela ne fait que montrer la perfidie qui consiste à liquider les exécuteurs des basses oeuvres une fois leur tâche accomplie, à fabriquer un bouc émissaire pour se blanchir de son forfait; cela ne fait que révéler quelles sont les méthodes de gangsters de la bourgeoisie dans la défense de ses intérêts.
La bourgeoisie israélienne est de toute façon, contrainte de se plier. Sa force militaire et son pouvoir économique, elle ne les détient que par les bonnes grâces de ses puissants alliés. Comme tous les Etats de la région, l'Etat d'Israël est un pion dans la guerre impérialiste, et sa population comme toutes celles de la région, une victime exploitée, militarisée et embrigadée pour des intérêts qui ne sont pas les siens.
Feindre la réprobation et l'indignation envers l'Etat d'Israël vise plusieurs objectifs pour l'impérialisme américain :
- mener à bien son plan stratégique en reprenant à Israël des privilèges militaires et territoriaux ;
- passer à la phase d'une opération de"nettoyage" à celle de la diplomatie repoussant le front impérialiste vers l'Iran et l'Afghanistan ;
- tenter de blanchir ses responsabilités dans les massacres et aider à ce que la mystification de la défense de la "cause palestinienne" ne perde pas toute crédibilité aux yeux des populations du Moyen-Orient avec le retournement de veste de l'OLP.
C'est la "cause palestinienne" qui a été la justification idéologique de l'embrigadement dans le camp prorusse, faisant miroiter le "retour au pays" aux milliers de réfugiés qui ont servis pendant 40 ans de masse de manoeuvre et de chair à canon; tout comme"l'holocauste des juifs" a servi de "grand alibi" ([4] [84]) à l'idéologie de guerre de l'anti-fascisme puis à l'embrigadement au Moyen-Orient.
La "guerre civile" au Liban n'a rien d’une guerre d'opprimés contre des oppresseur, ou d’une guerre de libération contre l'impérialisme, plus qu'aucune des guerres de ce siècle. Contrairement à ce que proclame la gauche du capital et jusqu'aux bordiguistes, les prolétaires n’ont aucun camp à soutenir ou à rejoindre dans la guerre au Moyen-Orient. La population est encadrée par de multiples milices de tous bords armées par tous les marchands de canons de la planète.
Plus encore que l'Iran où surgirent des luttes ouvrières, qu'Israël où des mouvements contre la hausse des prix et les blocages des salaires se sont produits, que l'Egypte où les ouvriers manifestèrent à plusieurs reprises contre la faim, le Liban où le prolétariat est très faible, constitue, avec cette "guerre civile", un concentré de l'absurdité de la guerre impérialiste. Dans ce sens, si ces événements marquent une victoire du bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est, un renforcement du premier par une collaboration plus étroite en son sein, ils marquent aussi une victoire de la bourgeoisie sur le prolétariat qui nulle part n'a réagi,
La clé se trouve dans les pays développés
La situation ne dépend pas de ce qui se passe au niveau local, mais de ce qui se passe dans les métropoles capitalistes. Le rapport de force ne peut s'établir en faveur du prolétariat qu'au niveau mondial. Si le prolétariat, là où il est le plus fort et le plus concentré reste paralysé et subit les attaques de la bourgeoisie sans réagir, alors la voie sera ouverte pour la poursuite et la poussée à un niveau supérieur de la guerre capitaliste.
Après plus de dix années de crise ouverte du capitalisme, ce qui a fait que la guerre ne s'est pas généralisée, c'est la reprise de la lutte de classe depuis la fin des années 60 dans les pays développés et dans le monde entier. La nouvelle poussée des luttes de la fin des années 70, après une période de reflux, a également ressurgi dans les principaux pays développés (USA, Allemagne, France, Grande-Bretagne). Elle a culminé en Pologne où la classe ouvrière mondiale s'est engagée dans la grève de masse et a posé la question de l'internationalisation des luttes ouvrières ([5] [85]), et mis en évidence l'importance décisive du développement de la lutte de classe dans les pays industrialisés et en Europe de l'Ouest en particulier ([6] [86]).
L'obstacle que constitue la classe ouvrière à la perpétuation de son système, la bourgeoisie l'a ressenti. Elle s'est unifiée au niveau mondial pour faire face au mouvement de Pologne. Toute sa propagande est plus destinée à abasourdir le prolétariat qu'à trouver des alibis aujourd'hui introuvables à un embrigadement dans la guerre face au bloc russe, bloc impérialiste historiquement plus faible, encore affaibli par la crise économique et menacé par la combativité prolétarienne.
"Le renforcement des blocs, qui constitue une pré condition pour la guerre contre le bloc rival, est aujourd'hui également une préparation immédiate et directe pour affronter le prolétariat où qu'il soit, s'il met en cause la domination du capital" ([7] [87]).
Avec les événements du Liban, la propagande s'est déchaînée pour imposer un sentiment de terreur et de fatalité d'une part, pour renforcer le mensonge du capitalisme "démocratique", "humain" "pacificateur". Le but est pour l'impérialisme de tirer profit d’une de ses victoires militaires en 1'utilisant contre le prolétariat, en le perdant dans le dédale de la recherche du coupable", alors que le seul coupable c'est le capital et tous ses agents.
C'est au prolétariat mondial qu'il appartient, en engageant la lutte internationalement, de répondre à l'offensive de la bourgeoisie. Seule la classe ouvrière est la force capable, en mettant fin au capitalisme, d'en terminer à jamais avec toutes les formes de la barbarie.
MG.
[1] [88] Voir la Revue Internationale n° 30 : "La guerre des Malouines [89]".
[2] [90] Lire sur cette question "Auschwitz ou le grand alibi" (PCI) sur la justification de l’"antifascisme".
[3] [91] Lors des combats aériens, la Syrie a perdu 86 de ses avions contre 0 à Israël.
[4] [92] Lire sur cette question "Auschwitz ou le grand alibi" (PCI) sur la justification de l’"antifascisme".
[5] [93] Voir les n° 23 à 29 [94] de la Revue Internationale sur les enseignements de la lutte de classe en Pologne.
[6] [95] Lire dans ce n° l'article p.5.
[7] [96] "Rapport sur la crise et les conflits inter-impérialistes [97]" au 4ème Congrès du CCI, Revue Internationale n° 26.
Géographique:
- Moyen Orient [98]
Récent et en cours:
- Guerre en Irak [99]
Machiavélisme, conscience et unité de la bourgeoisie
- 3505 reads
Les deux articles qui suivent sont le produit de discussions qui ont animé le CCI ; ils visent notamment à resituer le niveau de conscience et la capacité de manœuvre de la bourgeoisie dans la période de décadence. Ce débat est lié à un autre, sur le machiavélisme de la bourgeoisie, sur lequel s'est cristallisée entre autre la "tendance" qui s'est formée et a quitté le CCI durant l'hiver 1981[1] [100].Cette tendance plutôt informelle a éclaté en plusieurs groupes en quittant le CCI : "L'ouvrier internationaliste" en France qui a disparu depuis, "News of war and révolution" et "The bulletin" en Grande-Bretagne qui portent tous la même critique au CCI ; celui-ci aurait une vision machiavélique de la bourgeoisie et policière de l'histoire. De même, dans le milieu politique des groupes tels que "Volonté communiste" ou "Guerre de classe"[2] [101] en France accusent le CCI de surestimer la conscience de la bourgeoisie.
Mais cette discussion ne pose pas seulement la question concrète de comment la bourgeoisie manœuvre dans la période de décadence ; elle pose la question plus générale de ce qu'EST la bourgeoisie, et de ce que cela IMPLIQUE pour le prolétariat.
Pourquoi la bourgeoisie est machiavélique
Voyons d'abord qui était Machiavel ; cela permettra de comprendre ce qu'est le machiavélisme, de voir de quoi il est effectivement question.
Il ne s'agit pas ici de faire une analyse exhaustive de l'œuvre de Machiavel et de son temps, mais de comprendre ce qu'il apporte du point de vue de l'idéologie bourgeoise en construction.
Machiavel est un homme d'Etat florentin, de l'époque de la Renaissance, essentiellement connu pour son oeuvre principale Le Prince. Bien sûr, Machiavel comme tout homme est borné par les limites de son temps, et sa compréhension est conditionnée par les rapports de production de son époque, marquée par la décadence du féodalisme. Mais précisément, son temps est aussi celui d'une nouvelle classe qui vient postuler pour le pouvoir : la bourgeoisie qui commence à assurer sa domination sur l'économie, classe révolutionnaire de l'époque qui aspire à la domination politique de la société. Le Prince de Machiavel n'est pas seulement une peinture fidèle du temps où il a été écrit, un reflet de la perversité et de la duplicité des gouvernements du XVI/XVII° siècle. Machiavel a d'abord compris la "vérité effective" de la politique des Etats de son époque : peu importent les moyens ; l'essentiel est le but, conquérir et conserver le pouvoir. Son souci est avant tout d'enseigner aux princes de son époque comment conserver le domaine conquis, comment ne pas s'en trouver dépossédé par quiconque. Machiavel est le premier à séparer la morale de la politique, c'est à dire la religion de la politique. Il se place du point de vue "technique". En effet, le prince ne gouverne pas son cheval pour le bien de ce dernier. Mais durant la féodalité, le prince n'a pas bien compris la raison d'Etat, et c'est ce que Machiavel se propose de lui enseigner. Machiavel ne nous révèle rien en disant que les princes doivent mentir pour gagner, et aussi lorsqu'il constate qu'ils tiennent rarement parole en politique : tout ceci, on le sait déjà depuis Socrate. La vie des princes, leur cynisme et leur peu de foi conditionnent le pouvoir grossier qu'ils détiennent déjà. Ayant assimilé le cynisme, il ne reste à Machiavel qu'à remettre en cause la foi, et c'est ce qu'il fait en remettant en cause la morale et son support : la religion. Peu importent les moyens pour la raison d'Etat. Ainsi, en rejetant tout préjugé d'ordre moral pour l'exercice du pouvoir, Machiavel justifie l'emploi de la coercition et opère le rejet de la religion pour la domination d'une minorité d'hommes sur une majorité de leurs semblables.
C'est pour cela qu'il est le premier idéologue politique de la bourgeoisie ; il émancipe la politique de la religion. Pour lui, comme pour la classe montante, le mode de domination peut être athée tout en se servant de la religion. Si l'histoire antérieure du Moyen Age ne connaissait pas d'autre forme idéologique que la religion, la bourgeoisie va cristalliser peu à peu son idéologie propre en se débarrassant de la religion, tout en la conservant accessoirement. En détruisant le lien entre politique et morale, entre politique et religion, Machiavel détruit l'idée féodale du pouvoir de droit divin ; il fait le lit de la bourgeoisie.
En fait, les princes à qui Machiavel enseigne, ce sont les "princes de la bourgeoisie", future classe dominante, car les princes féodaux ne peuvent entendre son message sans détruire du même coup les bases de domination du système féodal. Machiavel exprime le point de vue révolutionnaire à l'époque, de sa classe : la bourgeoisie.
Même dans ses limites, la pensée de Machiavel n'exprime pas seulement les limites de son époque, mais les limites de sa classe. Lorsqu'il pose la "vérité effective" comme une vérité éternelle, ce n'est pas tant l'illusion de son époque qu'il exprime que l'illusion de la bourgeoisie qui, comme toutes les classes dominantes qui l'ont précédée dans l'histoire, est aussi une classe exploiteuse. Machiavel pose explicitement ce qui a été implicite pour toutes les classes dominantes et exploiteuses dans l'histoire. Le mensonge, la terreur, la coercition, le chantage, la corruption, le complot et l'assassinat politiques ne sont pas des moyens de gouvernement nouveaux ; toute l'histoire de l'antiquité comme celle de la féodalité le démontrent abondamment. Comme les patriciens de la Rome antique, comme l'aristocratie féodale, la bourgeoisie, elle aussi classe exploiteuse ne fait pas exception à la règle si ce n'est que patriciens et aristocrates "faisaient du machiavélisme sans le savoir" alors que la bourgeoisie est machiavélique et le sait. Elle en fait aussi une "vérité éternelle" parce qu'elle se vit comme éternelle, parce qu'elle suppose l'exploitation comme éternelle.
Comme toutes les classes exploiteuses, la bourgeoisie est aussi une classe aliénée. Parce que son chemin historique la mène vers le néant, elle ne peut en avoir conscience, elle ne peut admettre consciemment ses limites historiques.
Contrairement au prolétariat qui, comme classe exploitée et classe révolutionnaire dans la période présente est poussée vers l'objectivité révolutionnaire, la bourgeoisie est prisonnière de sa subjectivité de classe exploiteuse. La différence entre la conscience de classe révolutionnaire du prolétariat et la "conscience" de classe exploiteuse de la bourgeoisie n'est donc pas seulement une question de degré, de quantité, c'est une différence qualitative.
La vision du monde de la bourgeoisie porte inévitablement les stigmates de sa situation de classe exploiteuse et de classe dominante, qui de plus aujourd'hui, n'exprime plus rien de révolutionnaire, de progressiste pour l'ensemble de l'humanité depuis l'entrée du capitalisme dans sa phase de décadence. Elle exprime obligatoirement au niveau de son idéologie, la réalité du mode de production capitaliste, basé sur la recherche effrénée du profit, sur la concurrence de plus en plus exacerbée, sur une exploitation effrénée.
Comme toute classe exploiteuse, la bourgeoisie ne peut, malgré toutes ses prétentions, que trahir dans la pratique son mépris absolu pour la vie humaine. La bourgeoisie a d'abord été une classe de commerçants pour qui "les affaires sont les affaires", pour qui "l'argent n'a pas d'odeur". Machiavel ne fait rien d'autre que de traduire dans la séparation entre "politique" et "morale", la séparation que la bourgeoisie fait entre "affaires" et "morale". Dans ces conditions, pour la bourgeoisie, la vie humaine n'a d'importance qu'en tant que marchandise, que valeur d'échange.
Cette réalité, la bourgeoisie ne l'exprime pas seulement dans son rapport global aux classes exploitées et notamment à la principale, la classe ouvrière, mais en son sein même, dans son être, dans sa manière d'exister. Expression d'un mode de production basé sur la concurrence, toute sa vision ne peut être que celle d'une rivalité qui va se traduire par la rivalité de tous les individus entre eux, c'est à dire au sein même de la bourgeoisie. Parce qu'elle est une classe exploiteuse, elle ne peut qu'avoir une vision hiérarchique. Dans sa division, la bourgeoisie ne fait qu'exprimer la réalité d'un monde divisé en classes, c'est à dire où l'exploitation existe.
Depuis qu'elle est classe dominante, la bourgeoisie a toujours appuyé son pouvoir par le mensonge de l'idéologie. La devise de la République française triomphante de 1789 : "Liberté, égalité, fraternité" en est la plus parfaite illustration. Les premiers Etats démocratiques du monde qui s'imposent contre la féodalité en Angleterre, en France, aux Etats Unis n'ont pas hésité, lorsqu'il s'agissait d'étendre leurs conquêtes territoriales et coloniales, à employer sans vergogne les moyens les plus répugnants, et pour augmenter leurs profits, à imposer à la classe ouvrière l'exploitation la plus terrible, la répression la plus féroce.
Cependant, si jusqu'au début du XXè siècle, le pouvoir de la bourgeoisie repose essentiellement sur le pouvoir de son économie triomphante, sur l'expansion tumultueuse des forces productives, sur le fait que réellement par sa lutte, la classe ouvrière peut parvenir à arracher une amélioration de sa situation matérielle, depuis l'entrée du monde capitaliste dans sa période de décadence caractérisée par la tendance à l'écroulement de l'économie, la bourgeoisie voit la base matérielle de sa domination sapée par la crise de son économie. Dans ces conditions, les aspects idéologiques et répressifs de sa domination de classe vont devenir essentiels. Le mensonge et la terreur vont devenir les moyens du gouvernement de la bourgeoisie.
Le machiavélisme de la bourgeoisie n'est pas l'expression d'un anachronisme ou une perversion de l'idéal bourgeois de "démocratie", il est conforme à son être, à son existence réelle. Ce n'est pas une "nouveauté" dans l'histoire, c'est une de ses plus sinistres banalités. Si toutes les classes exploiteuses l'ont exprimé à différents niveaux, la bourgeoisie va le porter à un seuil qualitatif jamais atteint auparavant. En faisant éclater le cadre idéologique de la domination féodale : la religion, la bourgeoisie émancipe la politique de la religion, ainsi qu'elle le fait du juridique, des sciences et de l'art. Elle en fait un instrument conscient de sa domination. C'est sur ce plan que résident à la fois l'avancée et les limites de la bourgeoisie.
Ce n'est pas le CCI qui a une vision machiavélique de la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie qui, par définition, est machiavélique. Ce n'est pas le CCI qui a une vision conspirative et policière de l'histoire, c'est la bourgeoisie. Cette vision, elle n'arrête pas de l'étaler à toutes les pages de ses livres d'histoire, exaltant les individus, s'étalant sur les complots, sur les aspects superficiels des rivalités de cliques sans réellement voir les déterminations profondes, déterminantes dont ces épi phénomènes ne sont que l'écume de la vague.
Finalement, pour les révolutionnaires, constater que la bourgeoisie est machiavélique est relativement secondaire et banal. Ce qui est l'essentiel est d'en tirer les implications pour la lutte du prolétariat.
Toute l'histoire de la bourgeoisie montre son intelligence manoeuvrière et particulièrement la période de décadence, martelée par deux guerres mondiales où la bourgeoisie a montré qu'elle ne reculait devant aucune barbarie, aucun mensonge[3] [102].
Croire qu'aujourd'hui la bourgeoisie n'est pas capable de développer la même habileté manoeuvrière et le même manque de scrupule qu'elle manifeste dans ses rivalités internes face à son ennemi de classe historique, le prolétariat, conduit à une profonde sous-estimation de l’ennemi que la classe ouvrière doit affronter.
Les exemples historiques de la Commune de Paris et de la Révolution Russe montrent déjà que face au prolétariat, la bourgeoisie peut mettre ses antagonismes les plus forts, ceux qui la poussent à la guerre, sous le boisseau pour s'unir face à la classe capable de la détruire.
Mais surtout, la classe ouvrière qui pour la première fois dans l'histoire est à la fois classe révolutionnaire et classe exploitée, ne peut s'appuyer sur aucune force économique pour réaliser sa révolution politique. Sa conscience est sa force essentielle. Cela, la bourgeoisie l'a bien compris : "Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser" disait déjà Machiavel ; cela est on ne peut plus vrai aujourd'hui.
Parce que la terreur ne peut seule suffire, toute la propagande bourgeoise n'a pas d'autre rôle que de maintenir le prolétariat dans les chaînes de l'exploitation, de l'embrigader pour des intérêts qui lui sont étrangers, d'entraver le développement de sa conscience de la nécessité et de la possibilité de la révolution communiste.
Si la bourgeoisie aujourd'hui entretient à grands frais tout un appareil politique d'encadrement et de mystifications du prolétariat (parlement, partis, syndicats, associations diverses, etc.), instaure un contrôle absolu sur tous les médias (presse, radio, T.V.), c'est bien parce que la propagande -le mensonge- est une arme essentielle de la bourgeoisie. Pour alimenter cette propagande, la bourgeoisie n'hésite pas à provoquer l'évènement au besoin.
Ne pas voir cela revient à rejoindre le camp des idéologues que Marx raillait en écrivant : "Tandis que, dans la vie quotidienne, tout shopkeeper, tout boutiquier sait fort bien distinguer entre ce qu 'un individu prétend être et ce qu 'il est en réalité, notre historiographie n 'est pas encore parvenue à ce savoir banal. Elle croit sur parole tout ce que chaque époque affirme et s 'imagine à son propre sujet". Cela revient à ne pas voir la bourgeoisie parce qu'on n'est pas à même de comprendre ses manoeuvres et leur ampleur, parce qu'on n'en croit pas la bourgeoisie capable.
Pour ne citer que deux exemples, particulièrement illustratifs, prenons :
- les campagnes anti-terroristes internationales dont le but est de créer un climat d'insécurité afin de polariser l'attention du prolétariat et de lui imposer un contrôle policier renforcé et toujours plus sévère. La bourgeoisie n'a pas seulement utilisé les actes désespérés d'une petite-bourgeoisie égarée, mais devant l'intérêt de telles campagnes, n'a pas hésité à provoquer l'évènement, a fomenter et organiser des attentats terroristes meurtriers afin d'alimenter sa propagande. Depuis longtemps, la bourgeoisie a compris le rôle essentiel de la gauche pour contrôler les ouvriers. Faire croire que les PC, les PS, les gauchistes, les syndicats défendent les intérêts de la classe ouvrière est une des tâches essentielles de la propagande capitaliste. C'est le mensonge qui pèse le plus lourdement sur la conscience du prolétariat.
Là est le machiavélisme de la bourgeoisie face au prolétariat. C'est simplement la manière d'être et d'agir de la bourgeoisie, rien de nouveau en soi dans tout cela. Dénoncer la bourgeoisie, c'est avant tout dénoncer ses manœuvres, ses mensonges, c'est le rôle des révolutionnaires.
La question de l'efficacité de la bourgeoisie dans ses manœuvres et sa propagande face au prolétariat est une autre question. La bourgeoisie, dans les secrets de ses ministères, peut préparer les complots, les manœuvres les plus habiles, leur réussite dépend de facteurs autres et notamment de la conscience du prolétariat. Le meilleur moyen de renforcer cette conscience est pour la classe ouvrière de rompre avec toutes les illusions qu'elle peut avoir sur ses ennemis de classe et sur leurs manœuvres.
Le prolétariat a devant lui une classe de gangsters sans scrupules qui ne recule et ne reculera devant aucune manœuvre pour le maintien dans les fers de l'exploitation capitaliste. Cela, il doit le savoir.
J. J.[1] [103] Lire "Crise du milieu révolutionnaire", Revue Internationale n°28.
[2] [104] News of War and Révolution", 70 High Street, Leicester, Grande-Bretagne.
"The Bulletin", Ingram, 580 George St. Aberdeen, Scotland, Grande-Bretaqne.
"Révolution Sociale", BP 30316 75767 Paris Cedex 16, France.
"Guerre de Classe" c/o Parallèles 47 rue St Honoré 75001 Paris, France.
[3] [105] Les scandales épisodiques qui remontent à la surface comme les gaz nauséeux du marais, viennent montrer le répugnant état de décomposition de cette classe machiavélique qu'est la bourgeoisie. Affaire Lockheed qui montre la corruption réelle du commerce international ; affaire de la Loge P2 en Italie qui illustre à souhait le fonctionnement occulte de la bourgeoisie au sein de l'Etat, loin de tout principe "démocratique" ; affaire De Broglie où un ancien ministre influent apparaît tout d'un coup à la croisée de trafic de fausse monnaie, d'armes, et d'escroquerie financière internationale ; affaire Matesa en Espagne, la liste serait longue qui trahit le manque de scrupules de cette classe de gangsters qu'est la bourgeoisie. La scène de la politique internationale de la bourgeoisie est riche d'assassinats politiques, de Sadate à Béchir Gemayel, de complots, de coups d'Etat fomentés à l'aide des services secrets d'une des fractions dominantes de la bourgeoisie mondiale.
Questions théoriques:
- Aliénation [106]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [107]
Notes sur la conscience de la bourgeoisie décadente
- 3825 reads
1. Le prolétariat est la première classe révolutionnaire dans l'histoire qui n'a pas de pouvoir économique au sein de l'ancienne société, le prolétariat n'est pas une classe exploiteuse. Sa conscience, la conscience de soi, est donc d'une importance cruciale pour le succès de sa révolution, alors que pour les précédentes classes révolutionnaires, la conscience était un facteur secondaire, ou même négligeable pour la construction d'un pouvoir économique antérieur à la prise du pouvoir politique.
Pour la bourgeoisie, dernière classe exploiteuse dans l'histoire, la tendance vers un développement d'une conscience de classe a été poussée beaucoup plus loin que pour les classes qui l'ont précédée, car elle avait besoin d'une victoire théorique et idéologique pour cimenter son triomphe sur l'ancien ordre social. La conscience de la bourgeoisie a été poussée par deux facteurs-clés :
- par le bouleversement constant des forces productives, le système capitaliste est toujours plus étendu et en créant le marché mondial, il a porté le monde à un niveau jamais atteint d'interrelations ;
- dès les premiers jours du système capitaliste, la bourgeoisie a eu à faire face à la menace de la classe destinée à être son fossoyeur : le prolétariat.
Le premier facteur a poussé la bourgeoisie et ses théoriciens à développer une vision du monde alors que son système socio-économique était dans une phase d'ascendance, c'est à dire alors qu'il était encore basé sur un mode de production progressiste. Le second facteur a constamment rappelé à la bourgeoisie que, comme classe, quels que soient les conflits d'intérêts entre ses membres, elle devait s'unifier pour la défense de son ordre social contre les luttes du prolétariat. Quelle que soit l'avance dans la conscience qu'a représentée la bourgeoisie par rapport aux classes dominantes qui l'ont précédée, la vision du monde de celle-ci était inévitablement tronquée par le fait que sa position de classe exploiteuse dans la société lui masquait la nature transitoire de son système.
2. L'unité fondamentale de l'organisation sociale au sein du capitalisme a été l'Etat-nation. Et dans les limites de l'Etat-nation, la bourgeoisie a organisé sa vie politique d'une façon compatible avec sa vie économique. Classiquement, la vie politique était organisée à travers des partis qui s'affrontaient les uns, les autres dans l'arène parlementaire.
Ces partis politiques, reflétaient au premier chef les conflits d'intérêts entre différentes branches du capital au sein de l'Etat-nation. Dès la confrontation des partis dans cette arène, les moyens de gouvernement étaient créés pour contrôler et diriger l'appareil d'Etat qui orientait alors la société vers les buts décidés par la bourgeoisie. Dans ce mode de fonctionnement, on pouvait voir la capacité de la bourgeoisie à déléguer son pouvoir politique à une minorité d'elle-même. (On peut remarquer que cette organisation "classique" de la vie politique bourgeoise, selon le schéma parlementaire n'était pas un schéma d'application universelle, mais une tendance pendant la période ascendante du capitalisme. Les formes réelles variaient selon les différents pays en fonction de facteurs tels que : la rapidité du développement capitaliste; la capacité à résoudre les conflits avec l'ancien ordre social dominant; l'organisation concrète de l'appareil d'Etat; les pressions imposées par la lutte du prolétariat, etc..).
3. Le passage du système capitaliste dans sa période de décadence a été rapide, car le développement accéléré de la production capitaliste s'est violemment heurté à la capacité du monde à l'absorber. En d'autres termes, les rapports de production ont imposé de manière brutale leurs entraves sur les forces productives. Les conséquences apparurent très rapidement dans les événements mondiaux de la deuxième décade de ce siècle : en 1914, lorsque la bourgeoisie a démontré ce que signifiait l'époque de l'impérialisme; en 1917, lorsque le prolétariat a montré qu'il pouvait avancer sa solution historique pour l'humanité.
La leçon de 1917 n'a pas été perdue par la bourgeoisie. A l'échelle mondiale, la classe dominante a su comprendre que sa première priorité dans cette période est de défendre son système social contre le soulèvement du prolétariat. Elle tend donc à s'unir face à cette menace.
4. La décadence est l'époque de la crise historique du système capitaliste. De manière permanente, la bourgeoisie doit faire face aux principales caractéristiques de la période: le cycle de crise-guerre-reconstruction, et la menace contre l'ordre social que constitue le prolétariat. En réponse, trois développements profonds se sont produits dans l'organisation du système capitaliste:
- le capitalisme d'Etat;
- le totalitarisme ;
- la constitution de blocs impérialistes.
5. Le développement du capitalisme d'Etat constitue le mécanisme par lequel la bourgeoisie a organisé son économie au sein de chaque nation pour affronter une crise qui s'approfondit sans cesse pendant la période de décadence. Mais si le capitalisme d'Etat est en premier lieu la réponse à la crise au niveau de la production, ce processus d'étatisation ne s'arrête pas là. De plus en plus, d'autres institutions ont été absorbées par la voracité de la machine étatique pour en devenir des instruments, et là où elles n'existaient pas, elles ont été créées. L'appareil d'Etat s'est aussi immiscé dans tous les aspects de la vie sociale. Dans ce contexte, l'intégration des syndicats dans l'Etat a été de la plus grande nécessité et a acquis la plus haute signification. Non seulement, ils existent dans la période décadente pour faire en sorte que la production continue, mais encore, en tant qu'encadreurs du prolétariat, ils sont devenus des agents importants de la militarisation de la société.
Les différences et les antagonismes au sein de la bourgeoisie ne disparaissent pas dans chaque capital national pendant la période de décadence, mais ils sont l'objet d'une mutation considérable à cause du pouvoir de l'Etat. En somme, les antagonismes au sein de la bourgeoisie à l'échelle nationale ne se sont atténués que pour réapparaître dans une concurrence encore plus acharnée entre les nations à l'échelle internationale.
6. L'une des conséquences du capitalisme d'Etat est que le pouvoir dans la société bourgeoise tend à passer des mains du législatif à l'appareil exécutif de l'Etat. Ceci a une profonde conséquence sur la vie politique de la bourgeoisie puisque cette vie a lieu dans le cadre de l'Etat. Dans la période de décadence, la tendance dominante dans la vie politique bourgeoise est au totalitarisme, tout comme elle est à l'étatisation dans sa vie économique.
Les partis politiques ne sont plus l'émanation des divers groupes d'intérêts comme ils l'étaient au 19ème siècle. Ils deviennent des expressions du capital d'Etat envers des secteurs spécifiques de la société. En un sens, on peut dire que les partis politiques de la bourgeoisie dans n'importe quel pays, ne sont que des fractions du parti totalitaire étatique. Dans certains pays, l'existence d'un parti unique étatique se voit très clairement comme en URSS. Cependant, dans les "démocraties", ce n'est qu'à certains moments qu'on peut voir exister clairement un seul parti étatique. Par exemple :
- le pouvoir de Roosevelt et du Parti Démocrate aux USA à la fin des années 30 et pendant la seconde guerre mondiale ;
- "l'état d'exception" en Grande-Bretagne pendant la seconde guerre mondiale et la création du Cabinet de Guerre.
7. Dans le contexte du capitalisme d'Etat, les différences qui séparent les partis bourgeois ne sont rien en comparaison de ce qu'ils ont en commun. Tous partent d'une prémisse générale selon laquelle les intérêts du capital national sont supérieurs à tous les autres. Cette prémisse fait que les différentes fractions du capital national sont capables de travailler très étroitement ensemble, surtout derrière les portes fermées des commissions parlementaires et aux plus hauts échelons de l'appareil d'Etat. En réalité, ce n'est qu'un petit bout des débats de la bourgeoisie qui se montre au parlement. Et les membres du parlement, sont en fait, devenus des fonctionnaires d'Etat.
8. Néanmoins, dans toutes les nations, il existe des divergences au sein de la bourgeoisie. Mais il est très important de distinguer parmi elles :
- celles qui constituent des divergences d'orientation réelles: ces différentes fractions du capital national peuvent à un moment donné ne pas voir un des aspects de l'intérêt national, comme par exemple ce qui divisa le Parti Conservateur et Travailliste dans les années 40 et 50 sur ce qu'il fallait faire de l'Empire britannique. La question de l'appartenance à un bloc impérialiste est également une divergence possible, comme on le voit très souvent dans les pays du Tiers-Monde dans les guerres localisées. A de tels moments, de grands schismes peuvent se développer dans l'Etat, et même des blocages importants de son fonctionnement ;
- les divergences qui viennent des pressions sur les différentes parties selon la position et la fonction qu'elles occupent dans la société : il peut ainsi y avoir un accord général sur des orientations, mais un désaccord sur la façon de les mettre à l'oeuvre. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en Grande-Bretagne à propos des efforts de renforcement de l'emprise syndicale sur la classe ouvrière à la fin des années 60 et au début des années 70 ;
- les divergences qui ne sont que des "salades" pour détourner l'attention et mystifier les populations : par exemple, tout le "débat" sur les accords Salt et leur ratification par le Congrès américain au cours de l'été 79 était une opération idéologique qui couvrait le fait que la bourgeoisie avait pris d'importantes décisions concernant les préparatifs d'une troisième guerre mondiale et la stratégie qu'elle voulait mettre en place pour continuer d'aller vers la guerre.
Il y a souvent des aspects de chacune de ces divergences dans les désaccords de la bourgeoisie, surtout au moment des élections.
9. Comme les antagonismes entre les Etats se sont aiguisés tout au long de cette période de la vie du capitalisme, le capital mondial a tendu à pousser les caractéristiques du capitalisme d'Etat à l'échelle internationale, à travers la formation de blocs. Et si la formation des blocs a permis une certaine atténuation des antagonismes entre les Etats membres de chaque bloc, elle n'a fait que porter la rivalité à un niveau supérieur, entre les blocs, clivage final du système capitaliste mondial où toutes les contradictions économiques se trouvent concentrées.
Avec la formation des blocs, les anciennes alliances entre groupes d'Etats capitalistes (d'importance plus ou moins égale) ont été remplacées par deux groupements au sein desquels les capitaux plus faibles sont subordonnés à un capital dominant. Et de même que dans le développement du capitalisme d'Etat, l'appareil d'Etat s'immisce dans tous les aspects de la vie économique et sociale, de même l'organisation du bloc pénètre tout Etat qui en est membre. Deux exemples :
- la création de moyens de régulation de toute l'économie mondiale depuis la dernière guerre mondiale (les accords de Bretton Woods, la Banque Mondiale, le FMI, etc.) ;
- la création d'une structure de commandement militaire dans chaque bloc (OTAN, Pacte de Varsovie).
10. Marx a dit que c'est seulement en temps de crise que la bourgeoisie devient intelligente. C'est vrai, mais comme beaucoup de visions de Marx, il faut le considérer dans le contexte de la nouvelle période historique. La vision d'ensemble de la bourgeoisie s'est considérablement rétrécie avec sa transformation de classe révolutionnaire en classe réactionnaire dans la société. Aujourd'hui, la bourgeoisie n'a plus la vision du monde qu'elle avait au siècle précédent et en ce sens, elle est beaucoup moins intelligente. Mais au niveau de sa propre organisation pour survivre, pour se défendre, la bourgeoisie a montré une capacité immense de développement des techniques de contrôle économique et social bien au delà des rêves de la classe dominante du 19ème siècle. En ce sens, la bourgeoisie est devenue "intelligente" face à la crise historique de son système socio-économique.
Malgré ce que nous venons de mentionner sur les trois évolutions significatives de la vie bourgeoise dans la décadence, il faut réaffirmer les contraintes qui pèsent au départ sur la conscience de la bourgeoisie, son incapacité à avoir une conscience unie ou à comprendre pleinement la nature de son système.
Mais si le développement du capitalisme d'Etat et d'une organisation à l'échelle du bloc n'ont pas pu réaliser l'impossible, ils ont procuré à la bourgeoisie des mécanismes hautement développés qui lui permettent d'agir de manière concertée : la capacité de la bourgeoisie à organiser le fonctionnement de toute l'économie mondiale depuis la seconde guerre mondiale, ce qui lui a permis de prolonger la période de reconstruction et de repousser la réapparition d'une crise ouverte et qui fait que des types de krach comme celui de 1929 n'ont pas recommencé, en est un témoignage. Ces actions étaient toutes basées sur le développement d'une théorie sur les mécanismes et les "imperfections" (comme la bourgeoisie aime les appeler) du mode de production. En d'autres termes, c'est consciemment que la bourgeoisie l'a fait.
La capacité de la bourgeoisie à agir de façon concertée au niveau diplomatique et militaire s'est également manifestée plusieurs fois : les actions, et non des moindres, qui ont eu lieu plusieurs fois au Moyen-Orient depuis 30 ans par exemple.
Cependant, si la bourgeoisie a relativement les mains libres pour agir au niveau purement économique et militaire, là où elle n'a affaire qu'à elle-même, le fonctionnement de l'Etat est plus complexe là où il faut s'occuper des questions sociales car celles-ci comprennent les mouvements des autres classes, en particulier du prolétariat.
11. Par rapport au prolétariat, l'Etat peut utiliser différentes branches de son appareil dans une division du travail cohérente : même dans une seule grève, les ouvriers peuvent avoir à faire face à une combinaison des syndicats, de la propagande et des campagnes de presse et de télévision avec leurs différentes nuances et de celles des différents partis politiques, de la police, des services sociaux, et parfois de l'armée. Comprendre que ces différentes parties de l'Etat agissent de façon concertée ne veut pas dire que chacune d'entre elles est consciente de tout le cadre général au sein duquel elle accomplit ses tâches et sa fonction.
La bourgeoisie n'a pas besoin que toutes ses parties comprennent ce qui se passe. La bourgeoisie peut déléguer ses pouvoirs à une minorité de ses membres. C'est pour cela que l'Etat n'est pas entravé d'une façon significative par le fait que l'ensemble de la classe dominante ne se rende pas compte de tous les aspects de la situation. Il est donc possible de parler de "plans" de la bourgeoisie même si ce n'est qu'une partie de celle-ci qui les fait.
Ceci ne peut fonctionner que par la façon dont les différentes armes se complètent. Les différentes armes de l'Etat ont différentes fonctions, et comme elles sont aux prises avec la partie de la société à laquelle elles correspondent, elles transmettent également aux plus hauts niveaux de l'organisation de l'Etat, les pressions qu'elles subissent, et participent donc à ce qu'il décide et détermine ce qui est possible ou pas.
Au plus haut niveau de l'appareil d'Etat, il est possible, pour ceux qui commandent, d'avoir une sorte de tableau global de la situation et des options qu'il faut prendre de façon réaliste pour y faire face. Tout en disant cela, il est cependant important de noter :
- que ce tableau n'est pas l'expression claire, non mystifiée (une conscience du type de celle que peut avoir le prolétariat) de la situation, mais une approche pragmatique de celle-ci ;
- que celle-ci n'est pas unitaire, mais divisée, c'est à dire que les différentes fractions de la bourgeoisie peuvent ne pas la "partager" ;
- que les inévitables contradictions de la bourgeoisie créent des discordances considérables.
Dans l'appréciation du fonctionnement de tout appareil étatique, il est important de reconnaître les points suivants :
- il faut faire une distinction entre une conscience qui ouvre à la compréhension du système social capitaliste (celle du prolétariat) et celle qui ne se développe que pour défendre ce système (la conscience de la bourgeoisie]; c'est ainsi que l'armée "d'analystes sociaux" qu'utilise l'Etat peut aider à défendre le système social, mais jamais à le comprendre ;
- l'activité de la bourgeoisie n'est pas dominée par les caprices subjectifs des individus ou de parties de la classe dominante mais en réponse aux forces fondamentales qui agissent dans la société à un moment donné.
12. En conséquence, les manœuvres de la bourgeoisie, que cette dernière en soit consciente ou non, sont déterminées, structurées et limitées par et dans le cadre :
- de la période historique (décadence) ;
- de la crise conjoncturelle (ouverte ou non) ;
- du cours historique (vers la guerre ou vers la révolution) ;
- du poids momentané de la lutte de classe (avancée/reflux).
En fonction de l'évolution de la situation, l'importance relative de secteurs-clés de la bourgeoisie se renforce au sein de l'appareil d'Etat, selon que leur rôle et leur orientation deviennent plus clairs. Dans la plupart des pays du monde, ce processus mène automatiquement au gouvernement l'équipe choisie, comme résultat de l'existence du seul parti unique.
Cependant, dans les "démocraties" en général dans les pays les plus forts, le processus de renforcement de certaines fractions de l'appareil d'Etat et le processus de choix des équipes gouvernementales ne sont pas les mêmes. Par exemple, on a vu pendant plusieurs années en Grande-Bretagne se renforcer la gauche dans les syndicats au niveau local de l'appareil d'Etat, alors que le Parti Travailliste perdait le pouvoir politique. La dictature totalitaire de la bourgeoise reste, et par un tour de prestidigitation adroit: la population choisit "librement" ce que les conjurés ont déjà choisi pour elle. Le plus souvent, la ruse marche et les "démocraties" ne maintiennent le mécanisme électoral que parce qu'elles ont appris à le manipuler.
Le "libre choix" de l'équipe dirigeante par l'électorat est conditionné par :
- les programmes que ces partis choisissent de défendre ;
- la propagande de la presse et la télévision ;
- le soutien (ou autre) apporté par des institutions d'importance comme les syndicats et les organismes patronaux, à un parti ou à un autre ;
- l'existence de partis tiers qui agissent comme alternateurs ou comme ciment ;
- la réorientation de certaines parties des programmes électoraux selon les effets sur l'électorat comme le montrent les sondages d'opinion ;
- après les élections, les manoeuvres des différentes composantes de la bourgeoisie pour obtenir ce que les nécessités imposent.
Sans entrer dans les détails, les exemples suivants illustrent des utilisations récentes de ces mécanismes :
- peu avant l'élection présidentielle américaine de 1976, il devint clair qu'une victoire de Carter était en jeu. Ce n'est qu'à ce moment là que l'AFL-CIO décida de soutenir Carter et mobiliser les ouvriers pour voter. Le succès de Carter ne fut assuré que pendant la dernière quinzaine de la campagne ;
- en 1980, l'élection présidentielle de Reagan a été assurée par deux stratagèmes : Kennedy a permis que la nomination de Carter par le Parti Démocrate ne bénéficie pas d'un soutien clair. Anderson a été présenté comme un troisième candidat "sérieux" afin de prendre des votes à Carter tout en lui permettant de trouver les fonds pour faire sa campagne ;
- l'adaptation minutieuse des plateformes électorales en réponse aux résultats des sondages est ouvertement explicitée aux USA par les médias ;
- en Grande-Bretagne, le Lib-Lab Pact (Pacte entre les Libéraux et les Travaillistes) a rendu possible à une minorité travailliste de rester au gouvernement malgré les crises parlementaires;
- grâce au soutien de partis minoritaires aux Conservateurs par un vote de non-confiance aux Travaillistes, il fut possible aux Travaillistes de regagner l'opposition face aux luttes qui surgissent en 1979 ;
- en février 1974, Heath a appelé aux élections en vue d'obtenir un soutien pour briser la grève des mineurs. Cela lui a permis de former un gouvernement avec l'appui des Libéraux. Cependant, tout en reconnaissant le besoin pour le Parti Travailliste d'aller au pouvoir pour contrôler la lutte des ouvriers, les Libéraux ont refusé et ouvert la voie à Wilson et à la période du "Contrat Social".
Ces quelques exemples illustrent les mécanismes dont dispose la bourgeoisie et le fait qu'elle sait les utiliser. Cependant, selon les pays, la bourgeoisie a un appareil plus ou moins flexible. A cet égard, les USA et la Grande-Bretagne disposent probablement de la machine la plus efficace des "démocraties". On peut voir en France, par contre, un exemple d'un appareil relativement moins souple, et dans les élections présidentielles de 1981, les défaillances de la bourgeoisie.
13. On a déjà mentionné le cadre imposé par la période aux manoeuvres de la bourgeoisie. Dans les périodes où la lutte de classe est relativement faible, la bourgeoisie choisit ses équipes dirigeantes en fonction de critères avant tout économique et de politique étrangère. Dans de tels cas, on voit relativement clairement les objectifs que poursuit la bourgeoisie dans ce que fait le gouvernement. Ainsi, dans les années 50, le gouvernement anglais -la fraction Eden du Parti Conservateur- répondait à la nécessité pour la bourgeoisie de défendre l'Empire Britannique contre les assauts américains. Cet effort fut anéanti avec l'affaire de Suez en 1956. L'économie britannique pouvait cependant fonctionner sous l'égide du Parti Conservateur (durant la période de la fraction Macmillan, le Parti Conservateur a mis en oeuvre la plupart des orientations des Travaillistes), et elle le fit jusqu'en 1964. Il n'y a pas nécessairement de critère absolu pour juger si un gouvernement donné est le meilleur ou non pour la bourgeoisie.
Ce n'est pas le cas dans les périodes de surgissement de la lutte de classe, comme celle ouverte depuis 1968. Au fur et à mesure que la crise elle-même et la lutte de classe s'intensifient, le cadre imposé à la bourgeoisie devient plus défini et plus contraignant et les conséquences d'une erreur par rapport à ce cadre deviennent plus dangereuses pour elle.
Dans les années 70, la bourgeoisie a cherché en même temps à résoudre sa crise économique, de pallier à la lutte de classe et de se préparer à la guerre. Dans les années 80, elle n'essaie plus de résoudre la crise économique; il est devenu généralement clair que c'est impossible. Le cadre qui est imposé à la bourgeoisie est déterminé par la lutte de classe et les préparatifs de guerre; il est devenu clair que ces derniers dépendent de sa capacité à répondre à la première. Dans une telle situation, la façon dont la bourgeoisie présente à la classe ouvrière sa politique, est cruciale, car en l'absence de solutions réelles, les mystifications prennent de plus en plus d'importance.
La bourgeoisie doit s'affronter au problème de la lutte de classe aujourd'hui alors que :
- ses palliatifs économiques sont arrivés à leur fin ;
- la classe ouvrière a déjà eu droit à toute la période de "contrat social" ou autre et ne peut plus être mobilisée sur ce terrain ;
- la bourgeoisie doit imposer des niveaux plus forts d'austérité à une classe ouvrière non battue;
La bourgeoisie est confrontée à la nécessité immédiate d'écraser la classe ouvrière. C'est ce qui rend le cadre de la gauche dans l'opposition un facteur fondamental de la situation actuelle pour la bourgeoisie. Cela devient un critère d'évaluation des préparatifs de la bourgeoisie pour faire face à la classe.
14. On a déjà montré que face au prolétariat, la bourgeoisie tend à s'unir et que sa conscience tend à devenir plus "intelligente". On a vu de claires expressions de ce processus depuis 10 ans et plus :
- lors des événements de 1968 et leur suite immédiate, chaque capital national a tâché de traiter avec "son" prolétariat. Là, on peut voir une bourgeoisie unie derrière l'Etat confrontant une classe ouvrière montante pour la première fois ;
- comme la lutte de classe a continué à se développer, la bourgeoisie s'est vue forcée de faire face au prolétariat au niveau du bloc. On l'a vu pour la première fois au Portugal en 1974 et en Italie, où ce n'est que grâce au soutien d'autres pays du bloc, qu'on a trouvé des ressources et des mystifications face à la lutte ouvrière ;
- avec la Pologne en 1980-81, où la bourgeoisie a dû pour la première fois s'organiser entre blocs face au prolétariat. En cela, nous pouvons voir les débuts d'un processus où la bourgeoisie doit mettre de côté ses rivalités impérialistes afin de faire face au prolétariat, phénomène jamais vu depuis 1918.
Nous sommes donc dans une période où la bourgeoisie commence à s'organiser à l'échelle mondiale pour faire face au prolétariat, utilisant des mécanismes créés en grande partie pour répondre à d'autres nécessités.
15. Comme le prolétariat entre dans une période de confrontation de classe décisive, il devient impératif de mesurer la force et les ressources de l'ennemi de classe. Les sous-estimer reviendrait à désarmer le prolétariat qui a besoin de clarté et de conscience, et qui doit se débarrasser des illusions pour faire face à l'enjeu historique.
Comme ce texte a tenté de le montrer, l'appareil d'Etat de la bourgeoisie se renforce dans le monde entier pour faire face au prolétariat. Nous pouvons nous attendre à ce que ce processus se poursuive, que l'Etat devienne plus sophistiqué et que la conscience de la bourgeoisie devienne plus alerte et un facteur plus actif dans la situation. Cependant, cela ne veut pas dire que l'ennemi du prolétariat devient de plus en plus fort. Au contraire, le renforcement de l'Etat a lieu sur des fondements qui s'effondrent. Les contradictions de l'ordre bourgeois sont la cause du fait que la société fait "craquer ses habits". Car même si l'Etat se renforce, il ne sera pas capable de redresser le déclin du système que déterminent des facteurs historiques. L'Etat peut être fort, mais sa force est fragile.
Parce que le système social se désintègre, le prolétariat sera capable d'affronter l'Etat au niveau social en attaquant ses fondements, en élargissant la brèche provoquée par les contradictions sociales. Le succès du mouvement du prolétariat tendant encore à élargir cette brèche dépendra de la confrontation avec la première ligne de défense de l'Etat bourgeois : les syndicats.
Marlowe
Questions théoriques:
- Aliénation [106]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Conscience de classe [107]
Les conditions de la révolution crise de surproduction, capitalisme d'état et économie de guerre
- 5686 reads
(EXTRAIT DU RAPPORT SUR LA SITUATION INTERNATIONALE, 5ème Congrès de RI)
La compréhension de la critique de la "théorie des maillons faibles" ne doit pas nous faire oublier ce qu'ont fait les ouvriers polonais. En effet, cette lutte a montré au prolétariat international ce qu'était un mouvement de masse, a posé la question de l'internationalisation même si elle ne pouvait y répondre, et donc du contenu révolutionnaire de la lutte ouvrière à notre époque qui ne peut être indépendant de l'internationalisation. Le CCI a largement traité la question de l'internationalisation et de la lutte de classe en Pologne ([1] [108]). Par contre nous avons insuffisamment posé la question du contenu révolutionnaire de la lutte auquel s'était heurté sans pouvoir le comprendre les ouvriers polonais. Pourtant cette question s'est posée, et en particulier à propos de la question"économique" quand, pour la première fois, les ouvriers ont commencé à critiquer Solidarité"de façon ouverte et directe: lorsque au nom de l'économie nationale" et de l"autogestion" il s'est opposé directement aux grèves qui se sont développées durant l'été 81. Durant ces grèves, pour employer leurs propres termes, les ouvriers étaient prêts "à mettre au placard" les dirigeants de "Solidarité" les plus populaires, Walesa et Cie, et à continuer les grèves "jusqu'à la Noël et même plus s'il le fallait". La seule chose qui les ait arrêtés, c'est la question des perspectives. Dans la situation de pénurie généralisée qui domine dans les pays de l'Est, les ouvriers polonais livrés à eux-mêmes ne pouvaient pas les mettre en avant. Cette situation ne manquera pas de se reposer, mais dans les pays développés, l'existence tout à la fois d'une surproduction généralisée et d'une technicité productive ultradéveloppée pourra permettre aux ouvriers de mettre en avant leur propre perspective révolutionnaire et internationaliste.
Le développement actuel de la lutte de classe et des conditions objectives, la crise du capitalisme qui la détermine, signent la faillite des conceptions idéalistes qui niaient le caractère fondamental de la "crise catastrophique" du capitalisme, comme base objective de la Révolution Communiste Mondiale.
Cette faillite est la faillite de toute une conception de la révolution dont le moteur serait "idéologique", conception qui n'est en fait que le rejet de la théorie marxiste où les rapports de production déterminent l'ensemble des rapports sociaux. C'est la faillite des théories de" l'Internationale Situationniste" qui déclarait en 1969 contre l'analyse de la crise que faisait Révolution Internationale que la "crise économique était la présence eucharistique qui soutendait toute une religion". C'est la faillite des pauvres conceptions du FOR selon lesquelles seule la"volonté" est le moteur de la révolution. C'est, enfin, la faillite des théories issues de Socialisme ou Barbarie selon lesquelles le capitalisme d'Etat et le militarisme sont une troisième voie, une solution historique aux contradictions du capitalisme.
Affirmer que la catastrophe historique est la base objective et nécessaire de la révolution communiste ne suffit pas. Il faut encore montrer, et cela est aujourd'hui vital, pourquoi et comment elle l'est. C'est l'objet de cette étude.
Il n'est pas étonnant que les groupes cités ci-dessus aient tous de la transformation révolutionnaire de la société une conception"autogestionnaire". La situation historique ne signe pas seulement la faillite des conceptions idéalistes déjà citées. Mais aussi la faillite des conceptions populistes, misérabilistes et tiers-mondistes, animées en particulier par les théories des "maillons faibles" et de "l'aristocratie ouvrière", défendues particulièrement par le courant bordiguiste.
Nous devons montrer non seulement que la crise est nécessaire parce qu'elle paupérise de façon absolue la classe ouvrière et la pousse à la révolte, mais surtout comment elle mène à la révolution parce qu'elle est la crise d'un mode de production, la crise d'un rapport social où la nature de la crise, la surproduction, pose à la fois la nécessité de la révolution, et sa possibilité, où cette nature de la crise désigne d'un même mouvement, le sujet et l'objet de la révolution, la classe exploitée et la fin des sociétés d'exploitation et de pénurie.
Dans un premier temps, il faut cerner le mieux possible la nature du bond qualitatif que franchit la crise économique en plongeant les métropoles industrialisées dans la récession et la surproduction généralisée. La période de décadence du capitalisme n'est pas un moment figé, une éternelle répétition mais possède son histoire, son évolution. Pour comprendre les bases objectives de la lutte de classe aujourd'hui, nous devons donc situer l'évolution de la surproduction, du capitalisme d'Etat et de leur rapport réciproque. C'est ainsi que nous pourrons mieux cerner la nature et le contenu de ce qu'on appelle "le pas qualitatif de la crise économique11 et de ses conséquences pour la lutte de classe.
En montrant que sous ses différents aspects, surproduction, capitalisme d'Etat, militarisme, ce pas qualitatif de la crise du capitalisme ne s'effectue pas seulement par rapport aux années70 mais aussi et surtout par un pas qualitatif par rapport à toute l'évolution de la décadence du capitalisme. En montrant que la crise actuelle est aussi la crise des moyens dont la bourgeoisie a usé pour faire face à la crise de son système et de toute l'importance historique que revêt cette situation.
"L’anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe" disait Marx, c'est à dire que la forme supérieure de développement d'une espèce révèle dans sa forme achevée quelles étaient les tendances et les voies de développement des formes embryonnaires dans les espèces inférieures. Il en est de même de la situation historique actuelle qui "révèle" dans la plus haute expression de décadence, toute la réalité et la vérité de l'époque qui va de la première guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
SURPRODUCTION ET CAPITALISME D'ETAT
Le capitalisme d'Etat n'a jamais été l'expression de la santé, de la vigueur du capitalisme, l'expression d'un nouveau développement historique et organique du capitalisme, mais seulement:
- l'expression de sa décadence;
- l'expression de sa capacité à réagir vis-à-vis de cette décadence.
C'est pour cela que nous devons essayer d'analyser dans la situation actuelle, les rapports qu'entretiennent la crise du capitalisme et le capitalisme d'Etat, sous leurs divers aspects : social, économique et militaire.
Nous commencerons par ce dernier.
1-1. SURPRODUCTION ET ARMEMENT
La crise de surproduction n'est pas seulement la production d'un excédent sans débouchés, mais aussi la destruction de cet excédent.
"Dans ces crises, une grande partie, non seulement des produits déjà créés, mais encore des forces productives existantes est livrée à la destruction. Une épidémie sociale éclate qui, à toute autre époque eut semblé absurde : l'épidémie de la surproduction." (Le Manifeste Communiste).
Ainsi, la surproduction implique un procès d'auto-dévalorisation du capital, un procès d'auto-destruction. La valeur du surproduit non-accumulable n'est pas figée ou stockée, mais doit être détruite.
Cette nature de la crise de surproduction s'exprime de façon nette et sans ambiguïté dans les rapports qu'entretiennent à l'heure actuelle, la crise et l'économie de guerre.
Toute la période de décadence montre que la crise de surproduction implique un déplacement de la production vers l'économie de guerre. Considérer cela comme "une solution économique" même momentanée, serait commettre une grave erreur, ayant à la racine justement l'incompréhension que la crise de surproduction est un procès d’autodestruction. C'est ce procès d'autodestruction issu de la révolte des forces productives contre les rapports de production, qui s'exprime dans le militarisme.
Ce déplacement de "l'économique" vers le "militaire" a pu cacher un temps la surproduction générale. Dans les années 30 et après-guerre, le militarisme a pu faire illusion. Aujourd'hui, la situation de l'économie de guerre dans la crise générale du capitalisme révèle toute la vérité.
Ainsi, nous assistons aujourd'hui à un développement extrêmement important de l'armement comme par exemple aux USA où :
"Le Sénat a battu un record historique, le 4 décembre, en votant 208 milliards de dollars pour le budget de la défense pour 1932. Jamais une loi financière américaine n'avait atteint un tel montant. Ce chiffre est supérieur de 8 milliards aux exigences du Président Reagan". (Le Monde du 9.11.81).
Mais dans la situation globale du capitalisme mondial actuellement et en l'état dans lequel se présente la situation financière des différents Etats du monde, il faut être conscient qu'une telle politique de dépenses d'armement est un facteur extrêmement grave d'approfondissement de la crise économique, de la récession, comme de l'inflation.
Dans la situation actuelle, de tels budgets pour l'armement, et cela non seulement aux USA mais dans tout le bloc (en particulier en RFA et au Japon) n'ont aucun effet, même immédiat, comme dans les années 30 ou après-guerre, de soutien d'un certain niveau de la production industrielle mais au contraire, accélère très rapidement la baisse de cette production.
Contrairement aux années 30, la politique actuelle de l'armement ne créera pas d'emplois, sinon en infime partie par rapport à ceux qu'elle supprime. Situation encore renforcée par le fait que le développement de l'armement ne s'accompagne pas d'une politique de déficit social ou de politique des "grands travaux" comme dans les années 30, mais aujourd'hui se réalise en opposition directe à ces politiques. De plus, les emplois créés par le développement actuel de l'armement ne concernent qu'une petite partie des ouvriers, ceux très qualifiés, ou des techniciens de formation scientifique à cause du haut degré de technicité de l'armement moderne.
Ainsi, aujourd'hui, le développement de l'armement ne peut plus masquer la crise générale de surproduction et, de plus, l'inflation que provoque l'investissement dans l'armement est à son tour un facteur accélérateur de la crise économique du capitalisme.
"Le gouvernement de M. Reagan ne pourra se permettre des dépenses militaires qu'en imposant une politique monétaire plus restrictive encore, associée également à une politique fiscale restrictive et à une limitation des dépenses publiques non militaires et de l'emploi public. Tous ces efforts aboutiront à une augmentation du chômage. Ce qui s'annonce au delà du keynésianisme militaire, c'est la première dépression militaire du vingtième siècle" ("Un nouvel ordre militaire" - Le Monde Diplomatique - Avril 82).
Dans cette situation, le poids de l'armement existant et son développement présent sont vécus par la population et en particulier par la classe ouvrière, comme une cause directe de la paupérisation générale et du chômage, en plus des menaces de guerre apocalyptique qu'il fait planer sur toute la planète. C'est pour cela que la révolte contre la guerre est contenue dans la révolte générale du prolétariat même si la guerre n'est pas une menace immédiate.
Il serait simpliste de considérer que la planification de la production d'un armement ultra-moderne est la caractéristique de l'administration "Reagan". Une telle préparation industrielle et conceptuelle ne se réalise pas du jour au lendemain ni en plusieurs mois. La vérité, c'est que l'armement qui voit le jour aujourd'hui a été longuement préparé dans les années 70 sous la responsabilité des démocrates, mais ceux-ci ne pouvaient pas en prendre la responsabilité politique sans laisser complètement dégarni le front social.
Ce n'est pas pour rien si, dans une telle situation historique et pour la première fois dans toute l'histoire de la décadence, c'est la droite, les républicains aux USA, qui sont les animateurs d'une politique de surarmement.
"L'économie d'expansion militaire est résolument non républicaine aux USA. Les booms militaires des cinquante dernières années -l'expansion de 1938, la seconde guerre mondiale, le réarmement de la guerre de Corée et de la guerre froide en 1950-1952, le boom de l'espace et des missiles de 1961-1962, la guerre du Viêt-Nam ont tous été inspirés par des gouvernements démocrates." (Idem.)
Ce n'est pas un hasard non plus qu’aujourd’hui le pacifisme soit un des thèmes préféré de l'opposition. Il serait faux de ne considérer le pacifisme, ou les campagnes à propos du Salvador comme- seulement une préparation à long terme. A court terme et dans l'immédiat, elles ont bien largement contribué à isoler la lutte des ouvriers polonais mais aussi à faire passer les budgets dits "d'austérité" au profit en particulier de 1'armement.
"Nous devons donc faire aujourd'hui une distinction entre les campagnes pacifistes d'aujourd'hui et celles qui ont précédé la seconde guerre mondiale. Les campagnes pacifistes d'avant la seconde guerre mondiale préparaient directement l'embrigadement dans la guerre d'une classe ouvrière déjà embrigadée dans l'idéologie anti-fasciste."
"Aujourd'hui ces campagnes pacifistes ont bien sur pour tâche de préparer la démobilisation vis-à-vis de la guerre, mais ce n'est pas leur tâche directe, immédiate, qui est de contrer la lutte de la classe et d'empêcher que n'éclatent des mouvements de masse dans lés pays développés. Le pacifisme joue aujourd'hui le rôle de l’anti-fascisme d'hier.
" Pour la bourgeoisie il est vital que l'unité entre la lutte contre la guerre et la crise ne se fasse pas, que l'alternative "guerre ou révolution" ne se pose pas"
"En cela le pacifisme est une arme particulièrement efficace car tout en répondant à une véritable anxiété dans les populations, il sépare la question de la guerre et de la crise, pose une fausse alternative "guerre ou paix" et tente de faire renaître les sentiments nationalistes au travers d'un pseudo-neutralisme".
"Face à la question de la guerre la fausse alternative "guerre ou paix" vient compléter face aux questions de la crise économique l'autre alternative "prospérité ou austérité"."
Ainsi avec la lutte "contre l'austérité" d'un coté et la lutte "pour la paix" d'un autre, la bourgeoisie occupe tout le terrain de la révolte sociale. C'est la meilleure illustration de ce qu'on appelle la "gauche dans l'opposition".
1.2. SURPRODUCTION ET KEYNESIANISME
De même que le militarisme n'a jamais été un champs d'accumulation pour le capital, le capitalisme d'Etat sous ses aspects économiques n'a jamais été l'expression d'un développement organique et supérieur du capitalisme, le produit de sa concentration et de sa centralisation, mais au contraire l'expression des difficultés rencontrées dans son processus d'accumulation, de centralisation, et de concentration ([2] [109]). Tout comme le militarisme, le capitalisme d'Etat, en particulier sous ses formes keynésiennes, a pu faire illusion avant et après-guerre ainsi que dans les années 70 Aujourd'hui, la réalité balaie le mythe.
Nous avons souvent mis en lumière l'endettement, gigantesque auquel étalent parvenus les pays sous-développés sans que cela leur ait jamais permis un véritable "décollage" économique. Bien au contraire, ils sont arrivés à une situation où les 3/4 des crédits qu'ils contractent vis-à-vis des puissances occidentales ne servent qu'à rembourser les dettes passées. Mais cet endettement n'est pas le privilège des pays sous-développés. Ce qui est remarquable ici, c'est que l'endettement est une des caractéristiques de l'ensemble du capitalisme, à l'Est comme à l'Ouest ([3] [110]), et le fait qu'il prenne des formes plus multiples dans les pays développés ne change rien à l'affaire. Pour ce qui est du .capitalisme d'Etat comme gouvernail de l'économie, c'est finalement cette politique d'endettement et de déficit qui a pris le dessus, qui s'est imposée massivement, bien plus que "l'orientation" de l'économie elle-même. C'est l'économie qui a imposé ses lois à la bourgeoisie, et non pas la bourgeoisie qui a "orienté" l'économie. (Cf. RINT N° 26).
"Les USA sont devenus "la locomotive" de l'économie mondiale en créant un marché artificiel pour le reste de son bloc au moyen d'énormes déficits commerciaux. Entre 1976 et 1980, les USA ont acheté des marchandises à l'étranger pour 100 milliards de dollars, plus qu'ils n'en ont vendus. Seuls les USA -parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale- pouvaient mettre en œuvre une telle politique sans qu'il soit nécessaire de dévaluer massivement sa monnaie. Ensuite, les USA ont inondé le monde de dollars sous forme de prêts aux pays sous-développés et au bloc russe. Cette masse de papier-monnaie a temporairement créé une demande effective qui a permis au commerce mondial de continuer", (RINT N026, P. 4.)
Nous pouvons prendre ici l'exemple de la seconde puissance économique mondiale, la RFA, pour illustrer un autre aspect de la relance par l'endettement et les déficits d'Etat :
"L'Allemagne s'est mise à jouer à la "locomotive", cédant à la pression, il faut le reconnaître, des autres pays (...). L'augmentation des dépenses publiques a en gros doublé, croissant 1,7 fois comme le produit national, A tel point que la moitié de celui-ci est dorénavant canalisé par les pouvoirs publics (...) Ainsi, la croissance de l'endettement public a-t-elle été explosive. Stable autour de 18% du PNB au début des années 70, cet endettement est passé brusquement à 25% en 1975, puis à 35% cette année; sa part a donc doublé en dix ans. Elle atteint un niveau inconnu depuis les années de banqueroute de l'entre-deux guerre (...). Les allemands qui n'ont pas la mémoire courte, voient ressurgir le spectre des brouettes remplies de billets de la République de Weimar!" ([4] [111]) (L'Expansion, 5.11.81)
Et un peu comme dans les pays sous-développés, l'endettement est tellement fort que "le service de la dette absorbe plus de 50% des crédits nouveaux".
Voilà la face cachée de la "reprise" de la fin des années 70, le "secret révélé" de remèdes qui se sont avérés pire que le mal.
Au 4ème Congrès International du CCI ainsi qu'à l'occasion d'autres rapports et articles publiés depuis, nous avons largement montré que cette politique économique des années 70 était parvenue à sa fin. Les différents Etats du monde en ont tellement usé que s'ils la poursuivaient, ils iraient très vite à la catastrophe financière et à l'écroulement économique immédiat. La crise du dollar en 79 a été le premier signe de cette catastrophe, elle a été le signal le plus net d'une nécessité de changement de politique économique, la fin des "locomotives" et de l'endettement ([5] [112]).
A la lumière du développement de la situation économique, nous pouvons déjà faire un premier bilan des résultats de la "nouvelle politique économique" dite "d'austérité". Ici aussi, les USA peuvent nous servir de référence. Les plus en avant dans la politique d'endettement, ils ont été aussi les plus en avant dans la politique "monétariste". Le résultat n'est pas brillant; ils ont certes évité jusqu'à aujourd'hui l'effondrement, mais à quel prix...
Dans tous les domaines de la production sauf l'armement, la production a chuté de manière incroyable et d'ores et déjà, 15% de la classe ouvrière se trouve au chômage... Pourtant, ces derniers mois nous pouvons assister à une baisse de l'inflation dans tous les pays développés... sauf en France. Mais ici aussi cette baisse de l'inflation est essentiellement due à la baisse fantastique de la production:
" La Maison Blanche n'a pas manqué de célébrer ce succès. En réalité, pour le moment, c'est plus la récession qui explique la considérable décélération de l'inflation que celle-ci n'annonce la possibilité d'une reprise". (Le Monde de l'Economie, 6.4.82)
De toutes façons, dans les mois qui viennent, la question "du financement de la crise" va se poser de manière encore plus forte pour l'ensemble du capitalisme mondial car :
1- La baisse de la production entraîne une baisse proportionnelle des rentrées pour l'Etat, baisse encore renforcée par les allégements fiscaux que sont obliges d'établir les différents Etats pour maintenir un minimum de production;
2- L'augmentation des budgets militaires est une ponction considérable, pour l'ensemble des budgets ;
3- L'augmentation du chômage est elle-même une cause de déficit du au système d'allocations.
De tous ces budgets, il n'y a guère que les systèmes d'allocations qui puissent être remis en cause ainsi que tous les autres budgets dits "sociaux"; la baisse de la production entraîne... la baisse de la production.
"S'étant présenté comme le champion de l'équilibre pendant sa campagne, M.Reagan est en train de battre tous les records : on prévoit un déficit d'une centaine de milliards en l982 et plus l'année suivante" (Le Monde, 3.4.82),
En fait le capitalisme est "coincé": pour faire face à l'effondrement et à la catastrophe financière, il provoque l'effondrement de la production avec le seul avantage, et encore ce n'est pas certain, de pouvoir le contrôler, l'accompagner.
Quand les économistes interprètent les politiques de Reagan ou de Thatcher comme "moins étatistes", c'est une absurdité. Ce n'est pas parce que la politique économique de l'Etat change d'orientation qu'elle n'est plus d'Etat, au contraire. Si avec le jeu keynésien, c'est tout un aspect du capitalisme d'Etat qui a changé, cela ne veut pas dire que le capitalisme d'Etat est mort, et que le système économique est abandonné à son sort. Ne pouvant plus repousser l'effondrement dans une fuite en avant, l'Etat n'abandonne pas pour autant la partie. Il se résout à la seule politique économique qui lui reste : accompagner, ralentir, homogénéiser à l'ensemble de la planète l'effondrement du capitalisme.
Ainsi, les différents Etats du monde organisent-ils la descente dans la récession généralisée, et cela de façon mondiale. Nous pouvons tirer quelques implications d'une telle situation historique.
1- Avec la fin du keynésianisme qui soutenait le capital à un niveau d'activité artificiel, c'est aussi sa capacité à polariser la "richesse" à un pôle de nations et la "pauvreté" à un autre gui s'épuise. La situation en Belgique offre à une petite échelle peut-être, mais caricaturalement, une illustration frappante de ce processus :
La Belgique est devenue l'homme malade de l'Europe. Sa prospérité au lendemain de la guerre que ses voisins qualifiaient "d'insolente" s'est progressivement dégradée au point qu'aujourd'hui, sa situation est devenue au sens littéral du terme, catastrophique. Un déficit budgétaire quintuple de celui de la France, une balance des paiements de plus en plus déséquilibrée, un endettement intérieur et extérieur extraordinairement élevé, un chômage touchant 12% de la population active, et surtout, une désindustrialisation croissante, risquent de faire de cette nation, autrefois plaque tournante de l'Europe, un pays sous-développé. Une chose est certaine et de nature à inquiéter tous les européens : pour la Belgique, mais aussi pour les Dix, l'heure de la vérité a sonné". (Le Monde, 23.2.82)
2- Durant les années 70, les déficits de l'Etat et l'endettement ont été une des armes les plus efficaces pour enrayer la "lutte de classe dans les pays développés et illusionner les ouvriers des pays de l'Est. La fin de cette situation et la mise en place dans les pays développés d'un"Etat forteresse", d'un Etat policier et militariste à outrance Nui accompagne le capitalisme dans sa chute en faisant directement payer la crise aux ouvriers parce qu'il ne peut plus faire autre chose, pose d'autres conditions objectives.
Nous assistons donc aujourd'hui à un changement qualitatif dans les conditions objectives par rapport aux années 70. Mais ce n'est pas seulement par rapport aux années 70 que la situation actuelle implique un changement qualitatif, mais aussi par rapport à toute la période de décadence. Par rapport aux années 30, la bourgeoisie ne possède pas les moyens économiques d'un encadrement de la classe ouvrière. Les années 30 étaient la période de"grande envolée" du capitalisme d'Etat, en particulier sous ses aspects keynésiens. Si l'on prend l'exemple des USA dans les années 30, on constate que :
" L'écart qui séparait à ce moment la production de la consommation fut attaqué de 3 côtés à la fois :
1°. Contractant une masse de dettes sans cesse accrue, l'Etat exécuta une série de vastes travaux publics (...)
2°. L'Etat augmenta le pouvoir d'achat des masses laborieuses :
a) En introduisant le principe d'accords collectifs garantissant des salaires minimum et édictant des limitations de la durée du travail, tout en renforçant la position générale des organisations ouvrières et notamment du syndicalisme
b) en créant un système d'assurance contre le chômage et par d'autres mesures sociales destinées à empêcher une nouvelle réduction du niveau de vie des masses.
3°. De plus l'Etat tenta, par une série de mesures telles que des limitations imposées à la production agricole et des subventions destinées à soutenir les prix agricoles, d'augmenter le revenu de la population rurale de façon à permettre à la majorité des exploitants de rejoindre le niveau de vie des classes moyennes urbaines". (Le Conflit du Siècle, Sternberg.p.389).
Dans les années 30, les mesures du"New-Deal" .furent prises après le plus fort de la crise économique. Aujourd'hui non seulement le "New-Deal" des années 70 est derrière nous alors que le plus fort de la crise est devant nous sans possibilité d'issue dans la guerre, mais encore nous n'avons pas assisté dans les pays développés à cette vague de syndicalisation et d'embrigadement idéologique qui a aussi caractérisé les années 30. Au contraire, dés le milieu des années 70, on assiste à une désyndicalisation générale, contrairement aux années 30 ou comme le rapporte Sternberg dans Le Conflit du siècle :
" Du fait des modifications décisives qui s'étaient opérées sous l'égide du New-Deal dans la structure sociale américaine, la situation du syndicalisme changea du tout au tout. Le New-Deal encouragea en effet le mouvement syndical par tous les moyens (...). Au cours d'un bref espace de temps qui va de 1933 à 1939, le nombre de syndiqués a fait plus que tripler. A la veille de la deuxième guerre mondiale, il y a plus de deux fois plus de cotisants qu'aux meilleurs moments d'avant la crise, bien plus "qu'à aucun moment de l'histoire syndicale américaine". (Ibid, p. 395)
3-. La situation historique actuelle est une réfutation totale de la théorie du capitalisme d'Etat comme "solution" aux contradictions du capitalisme. Le keynésianisme a été le principal écran qui cachait la réalité du capitalisme décadent. Avec sa faillite et du fait que les Etats ne peuvent plus que se résoudre à accompagner le capitalisme dans son effondrement, le capitalisme d'Etat apparaît clairement pour ce qu'il a toujours été : une expression nette de la décadence du capitalisme.
Ce constat ne revêt pas seulement un intérêt théorique et polémique, à l'encontre de ceux qui se représentaient le capitalisme d'Etat comme une "troisième voie". Il est devenu d'une extrême importance du point de vue des conditions objectives et de leur lien avec les conditions subjectives de la lutte de classe par rapport à la question de l'Etat.
Considérer que le capitalisme d'Etat a été une expression de la décadence du capitalisme ne suffit pas. Le capitalisme n'a pu "s'installer" pour des décennies dans la décadence qu'après avoir cassé les reins du prolétariat révolutionnaire, et dans cette tâche, le capitalisme d'Etat a été à la fois un des plus grands résultats et un des plus puissants moyens de la contre-révolution. Pas seulement du point de vue militaire, mais surtout du point de vue idéologique.
Dans la vague révolutionnaire du début du siècle, dans les années 30 ou durant la reconstruction, la question de l'Etat est toujours au centre de l'illusion politique du prolétariat et de la mystification idéologique de la bourgeoisie. Que ce soit l'illusion que l'Etat, même transitoire est l'outil de la transformation de la société, le représentant de l'unité et de la collectivité prolétarienne comme dans la révolution russe; que ce soit le mythe de la défense de l'Etat "démocratique" contre11!'Etat fasciste" dans les années 30 et la guerre; que ce soit encore l'Etat "social" de la reconstruction ou enfin l'Etat "sauveur" de la gauche au pouvoir des années 70, toujours le prolétariat est amené à penser que tout se joue dans la "forme" de l'Etat, qu'il ne peut s'exprimer qu'au travers d'une forme particulière de l'Etat. Toujours, la bourgeoisie entretient dans la classe ouvrière un esprit de délégation de pouvoir à un représentant ou à un organe de l'Etat et également un esprit et une attitude "d'assisté". Ce sont ces mythes largement diffusés par la pensée dominante et ces illusions constamment entretenues dans la classe ouvrière que Marx combattait déjà en déclarant :
"Parce que (le prolétariat) pense dans la forme de la politique, il aperçoit la raison de tous les abus dans la volonté, tous les moyens d'y remédier dans la violence et dans le renversement d'une forme d'Etat déterminée", (souligné dans le texte. Gloses critiques marginales à l'article : "Le roi de Prusse et la réforme sociale par un prussien", Marx 1844, "Ed, Spartacus, p. 87).
Durant toutes les dernières décennies, la classe ouvrière a vécu toutes les formes possibles et inimaginables de la dernière forme de l'Etat bourgeois, le capitalisme d'Etat -"stalinien, fasciste, démocratique" et "keynésien". Des Etats fascistes ou keynésien, il ne reste pas grand chose comme mystification; le peu d'illusions qui restait sur l'Etat stalinien a été balayé par la lutte des ouvriers polonais. Par contre, l'Etat "démocratique et keynésien" a maintenu les illusions finalement les plus fortes sur le prolétariat.
La fin de l'Etat keynésien dans les pays développés donc clés, ne veut pas dire que la question de l'Etat est réglée. Au contraire, elle commence à se poser réellement avec la mise en place du combat ouvert, celui qui rejette la gauche dans l'opposition et s'apprête à affronter la classe ouvrière. Mais dans ce combat, le prolétariat aura eu l'expérience des diverses formes d'Etat que pouvait revêtir le capitalisme décadent et des diverses façons dont il s'est fait happer dans ses diverses formes.
Dans l'unité des conditions objectives où le capitalisme d'Etat n'apparaît pas comme une forme supérieure mais comme une forme décadente et dans les conditions subjectives constituées par l'expérience du prolétariat, c'est la question de la destruction de l'Etat par le prolétariat qui est posée.
Dans ce combat, notre tâche est, premièrement de rappeler au prolétariat son expérience passée, deuxièmement, de le mettre en garde contre toute prétendue facilité à mener le combat, en montrant justement à travers 1'expérience que si le capitalisme d'Etat est une expression décadente, il est en même temps l'expression de la capacité de la bourgeoisie à s'adapter, à réagir et à ne pas lâcher le morceau facilement.
1.3. L'ETAT FORTERESSE
Si l'on doit tirer une première conclusion des rapports entre la crise économique, le militarisme et le capitalisme d'Etat avec toutes les implications tant objectives que subjectives que nous avons tenté de tracer sur chacun de ces points, nous devons mettre en avant :
1°. L'Etat de la bourgeoisie; n'abandonne, pas la partie; il se transforme en Etat-forteresse, policier et militarisé à outrance.
2°. Ne pouvant plus jouer sur les aspects économiques et sociaux du capitalisme d'Etat pour repousser et reporter les échéances de la crise, 1'Etat-forteresse n'attend pas non plus les bras croisés que le prolétariat lui livre l'assaut en se cantonnant purement dans sa"forteresse ". Au contraire, il prend l'initiative du combat en dehors de sa forteresse, sur le terrain où tout se joue : le terrain social. Telle est la profonde signification de ce qu'on appelle aujourd'hui la "gauche dans l'opposition", mouvement que l'on peut voir aujourd'hui de façon évidente dans les principales métropoles industrialisées.
3°. Ne pouvant plus jouer sur les aspects économiques et sociaux pour repousser et reporter les échéances de la lutte de classe, et en plus de la gauche dans l'opposition qui prépare le terrain, l'Etat développe deux aspects essentiels de sa politique :
- la répression et le quadrillage policier;
- de vastes campagnes idéologiques de plus en plus spectaculaires -véritable terrorisme idéologique- sur toutes les questions que pose la situation mondiale : guerre, crise et lutte de classe.
Telle est la profonde signification des campagnes "pacifistes", de "solidarité" avec la Pologne, des campagnes sur le Salvador, du conflit des Iles des Malouines et des incessantes campagnes anti-terroristes.
4°. La question de l'Etat, de ses rapports avec la lutte de classe et de sa destruction ne peut-être véritablement posée que dans les pays développés, là où l'Etat est le plus fort tant du point de vue matériel qu'idéologique.
Même si l'anachronisme des structures étatiques dans les pays développés ou encore dans les pays de l'Est, formes issues de la contre-révolution, est peu adapté pour faire face à la lutte de classe, l'expérience nous a montré comment en Pologne la bourgeoisie pouvait retourner cet anachronisme, cette faiblesse, en moyens de mystification contre la lutte tant que les ouvriers des pays développés ne rentraient pas eux-mêmes dans le combat. La lutte pour la "démocratie en Pologne" en est la meilleure illustration.
De toutes façons, la faiblesse ou l'inadaptation des pays peu développés est largement compensée par l'unité de la bourgeoisie mondiale et de ses différents Etats face à la classe ouvrière.
Dans le même sens, il serait dangereux et erroné de croire que les Etats des pays développés sont affaiblis devant la lutte de classe à cause de la profonde unité qu'a manifestée la bourgeoisie de ces pays, contrairement à des pays moins développés où la bourgeoisie peut jouer sur ses divisions pour dévoyer les ouvriers.
Face aux enjeux de la situation mondiale et de la lutte de classe, ce n'est pas tant les divisions "régionales" par exemple qui seront l'axe du travail de la bourgeoisie contre le prolétariat. L'axe essentiel du travail de sape de la bourgeoisie ne peut être qu'une fausse division de classe entre droite et gauche, et cette capacité de mettre en place cette fausse vision dépend justement de la force de la bourgeoisie, de la force de son unité.
1-4. SURPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT TECHNIQUE
Nous avons essayé de montrer dans les premières parties de ce rapport comment la surproduction était aussi destruction, gaspillage, et impliquait pour le prolétariat 1'intensification de 1'exploitation et un rabaissement de ses conditions d'existence. Cet aspect de la critique de l'économie est extrêmement important, premièrement pour comprendre bien sûr l'évolution de la crise, et deuxièmement pour notre propagande. En effet, la bourgeoisie n'a pas manqué (déjà en Pologne)et ne manquera pas de mettre en avant que la lutte des ouvriers aggrave la crise économique et se fait donc "au détriment de tous". A ce point, nous devons déjà rétorquer : tant mieux si le prolétariat accélère la crise économique et l'effondrement du capitalisme sans laisser le temps à la bourgeoisie et à la crise de détruire une grande partie des moyens de consommation et de production, parce que justement, la crise de surproduction est aussi une destruction.
Mais en montrant comment la crise de surproduction est destruction, nous n'avons montré qu'un aspect de la crise historique et catastrophique du capitalisme. En effet, la crise de surproduction ne détermine pas seulement une destruction mais aussi un développement technique important (nous verrons plus tard que ce n'est nullement contradictoire, au contraire). Ce que nous montre le développement de la crise de surproduction, c'est que la surproduction ne s'accompagne pas seulement d'une destruction ou "gel" des marchandises et des forces productives, mais que le capital, pour compenser la surproduction générale et la baisse du taux de profit dans une situation de concurrence acharnée, tend à développer la productivité du capital. Ainsi, ces dernières années, à côté de la désindustrialisation de vieux secteurs comme la sidérurgie, le textile, la construction navale, etc., nous avons vu se développer d'autres secteurs de pointe déjà mentionnés plus haut, le tout accompagné par une centralisation des capitaux.
Ainsi, de la même manière que toutes les mesures prises pour faire face à la crise de surproduction, en particulier le keynésianisme, n'ont fait que provoquer une crise de surproduction encore plus gigantesque, le développement technique n'a fait, lui, que pousser à son extrême la contradiction entre les rapports de production et le développement des forces productives.
En effet, durant cette dernière décennie, en particulier, nous avons pu voir un développement assez fantastique des moyens techniques sur tous les "fronts" :
1°. - développement et application à la production des automatismes, de la robotique, de la biologie;
- développement et application de l'informatique à la gestion et à l'organisation;
- développement des moyens de communication : transports (aéronautique en particulier), communication audio-visuelle, télématique et télétraitement.
2°. Et pour animer l'ensemble de ces forces, des moyens d'énergie ("à la hauteur", en particulier le nucléaire).
Pour la bourgeoisie, dans son idéologie c'est une troisième "révolution industrielle" qui est à l'ordre du jour. Mais pour elle, cette troisième "révolution industrielle", premièrement ne peut pas ne pas provoquer des bouleversements sociaux importants, et deuxièmement ne peut se réaliser sans guerre mondiale, sans un "nettoyage" gigantesque et un repartage du monde. Les politiques économiques et militaires du monde capitaliste actuel sont mises-en place en fonction de cette perspective et pas seulement pour taire face aux données" immédiates de la crise économique
De façon immédiate, la bourgeoisie mondiale s'efforce de maintenir un tant soit peu la production et d'éviter un effondrement économique brutal. Mais ici, que ce soit dans les domaines sociaux, économiques ou militaires, nous devons comprendre que la bourgeoisie n'agit pas au coup par coup, qu'elle s'est donnée une perspective, et nous aurions tort de ne pas en tenir compte. Nous aurions tort et paierions cher le fait de crier victoire simplement parce que le taux de chômage a augmenté de façon incroyable et de nous contenter de dire : "Ah ! que les économistes sont bêtes." Nous aurions tort de ne pas tenir compte et accorder toute son importance à ces phénomènes et idéologies actuelles. Cela non seulement pour critiquer la bourgeoisie par rapport à la Question de ce qu'elle appelle la Restructuration" -et qui est en fait le chômage- mais encore pour renverser son argumentation quant à l'avenir de cette "troisième révolution industrielle" et qui est notre propre vision de ce qui est en jeu dans l'époque actuelle de 1'histoire humaine.
Le développement de certaines techniques de productivité du travail dans les secteurs qui survivent n’est en rien contradictoire avec le développement de la crise économique. "Car le développement technique s'est investi essentiellement dans les secteurs improductifs :
1°. Premièrement militaire : la "guerre des Falklands" et les moyens techniques ultramodernes (satellites électroniques, etc..) mis en oeuvre nous ont donné une petite idée de cette fameuse "troisième révolution industrielle";
2°. Deuxièmement, dans les secteurs des "services" : bureaux, banques, etc..
Ainsi, le développement de la productivité (qui n'est en fait, pour l'essentiel que potentiel) s'accompagne d'une désindustrialisation générale et ne compense pas, loin s'en faut, la chute vertigineuse de la production. C'est le cas de la principale puissance mondiale qui assure, à elle seule, un tiers de la production mondiale, les USA :
"Divisant l'ensemble de la force de travail en deux catégories -celles qui produisent des biens de consommation ou d'équipement et celles qui produisent des services-, l'hebdomadaire "Business Week" montre que les emplois diminuent dans la première catégorie au profit de la seconde : 43,4% en 1945 ... 33,3% en 1970... 28,4% en 1980... 26,2% en prévision pour 1990 et augmentent en proportion inverse dans le second secteur : respectivement, 56% en 1945, 66,7% en 1970, 71,6% en 1980, 73,8% en prévision pour 1990 (...). Le grand patronat américain s'est engagé depuis quelques années dans une sorte de grève de l'investissement productif". (Le Monde Diplomatique, mars 1982).
D'autre part, le développement de la productivité quand il s'effectue dans la production, provoque premièrement un chômage gigantesque et, deuxièmement, développe pour les ouvriers qui conservent du travail une déqualification du travail, et des conditions de travail très pénibles et très policières . Seule une infime minorité de techniciens très qualifiés y trouvent "son compte".
Quant à la question de la "révolution industrielle" elle-même, la bourgeoisie est consciente parce qu'elle y est directement confrontée, que le marché mondial, tel qu'il est aujourd'hui, déjà sursaturé par l'ancien état de la production, ne peut offrir le tremplin pour son développement.
Dans son idéologie, seule une guerre mondiale "pourrait préparer le terrain" pour un développement et une application sur une large échelle, des techniques de production moderne. De toute façon, elle n'a pas le choix.
C'est pour cela que l'essentiel de la préparation de cette "fameuse révolution industrielle" s'effectue sur le terrain militaire, c'est là que s'est développé et appliqué tout ce que l'humanité a produit de meilleur du point de vue scientifique.
Il en va donc de même pour le développement de la productivité et de la surproduction : toutes deux sont dans le cadre du système bourgeois pure destruction. C'est ce que nous devons dire à la classe ouvrière. Non seulement cela, mais aussi, qu'au travers du développement des moyens techniques actuelles et de la surproduction, le capitalisme a poussé à ses extrêmes limites l'antagonisme entre les forces productives et les rapports de production.
"A l'époque où l'homme avait besoin d'un an pour confectionner une hache en pierre, de plusieurs mois pour fabriquer un arc, ou faisait un feu en frottant pendant des heures deux morceaux de bois l'un contre l'autre, 1'entrepeneur le plus rusé et le plus dénué de scrupules n'aurait pu extorquer d'un homme le moindre surtravail. Un certain niveau de productivité du travail est nécessaire pour que l'homme puisse fournir du surtravail". (Rosa Luxemburg. Introduction à l'économie politique, p.255).
En effet, pour qu'un rapport d'exploitation puisse s'implanter et diviser la société en classes, un certain niveau de productivité était nécessaire. Il fallait qu'à côté du travail nécessaire pour assurer la subsistance des producteurs puisse se développer un surtravail assurant la subsistance des exploiteurs et permettant l'accumulation des forces productives.
Toute l'histoire de l'humanité depuis la dissolution de la communauté primitive jusqu'à nos jours est l'histoire de l'évolution du rapport entre travail nécessaire et surtravail -rapport déterminé lui-même par le niveau de productivité du travail- déterminant telle ou telle société de classe, tel ou tel rapport d'exploitation entre producteurs et exploiteurs.
Notre époque historique qui commence au début du siècle a totalement renversé ce rapport entre travail nécessaire et surtravail. Avec le développement technique, la partie du travail constitué par le travail nécessaire est devenue infime par rapport au surtravail.
Ainsi, si l'apparition du surtravail a pu permettre dans certaines conditions l'apparition de la société de classes, son développement historique par rapport au travail nécessaire a complètement renversé la problématique des sociétés d'exploitation et pose la nécessité et la possibilité de la révolution communiste, la possibilité de la société d'abondance, sans classes et sans exploitation.
La crise historique du capitalisme, la crise de surproduction déterminée par le manque de marchés solvables a poussé cette situation jusqu'à son extrême. Pour faire face à la surproduction, la bourgeoisie a développé la productivité du travail qui, à son tour, a aggravé la crise de surproduction et cela de manière d'autant plus forte que la guerre mondiale n'était pas possible.
Aujourd'hui, cette révolte des forces productives contre les rapports de production bourgeois, s'exprimant dans la surproduction, la productivité du travail et leurs rapports réciproques, a atteint un point culminant et éclate au grand jour.
LES CONDITIONS DE LA LUTTE DE CLASSE DANS LES PAYS DEVELOPPES
"Tant que le prolétariat n’est pas encore assez développé pour se constituer en classe, que, par conséquent, la lutte même du prolétariat avec la bourgeoisie n'a pas encore un caractère politique, et que les forces productives en se sont pas encore assez développées dans le sein de la bourgeoisie elle-même pour laisser entrevoir les conditions matérielles nécessaires à l'affranchissement du prolétariat et à la formation d'une société nouvelle, ses théoriciens ne sont que des utopistes (...) et ils ne voient dans la misère que la misère, sans y voir le coté subversif qui renversera la société ancienne". (Misère de la Philosophie, Marx).
C'est à partir de la situation que nous venons de décrire dans les points précédents que nous pouvons comprendre que la crise économique n'est pas seulement nécessaire pour la révolution parce qu'elle exacerbe la misère de la classe ouvrière, mais aussi et surtout parce qu'elle pose tout autant la nécessité de la révolution qu'elle en révèle la possibilité. C'est pour toutes ces raisons que la crise économique du capitalisme n'est pas une simple "crise économique" au sens strict du terme, mais la crise d'un rapport social d'exploitation qui contient la nécessité et la possibilité de l'abolition de toute exploitation : elle est dans ce sens la crise de l'économie tout court.
De ce point de vue, ce n'est que dans les pays développés que sont posées les conditions objectives et subjectives de l'initiative révolutionnaire, de la possibilité de la généralisation internationale de la lutte de classe et c'est de ces pays que dépend fondamentalement toute la dynamique révolutionnaire. Cela n'est rien d'autre que ce que les révolutionnaires ont toujours pensé ;
" Quand Marx et les socialistes imaginaient la révolution à venir, ils pensaient toujours qu'elle surviendrait dans le coeur industriel du monde capitaliste, d'où elle communiquerait à la périphérie. C'est ainsi que s'exprime encore F. Engels dans une lettre à Kautsky du 12 novembre 1882, où il traite des différentes étapes d'une transformation ainsi que du problème posé par la pensée socialiste par les colonies, des puissances impérialistes : du moment que l'Europe sera réorganisée, ainsi que l'Amérique du Nord, ces ensembles posséderont une puissance si colossale et donneront un tel exemple que les pays semi civilisés ne pourront que se laisser entraîner par eux, ne fût-ce que sous la pression de leurs besoins économiques". (Le Conflit du Siècle. Steinberg, P. 242).
Le processus de la révolution communiste n'est pas autre chose que le processus de l'unification de la lutte du prolétariat à l'échelle mondiale. La lutte des ouvriers des pays moins développés, en particulier la lutte des ouvriers des pays de l'Est, fait partie intégrante de ce processus. Mais du point de vue des conditions subjectives et objectives, ce n'est que des pays développés que peut être impulsée la dynamique révolutionnaire de ce processus. Cette compréhension est vitale pour l'unité de la classe ouvrière mondiale, elle ne remet pas en question cette unité, au contraire. L'être de la classe ouvrière a toujours été révolutionnaire, même quand les conditions objectives ne l'étaient pas. C'est cette situation qui a déterminée la grande tragédie du mouvement ouvrier. Mais jamais les grandes luttes révolutionnaires n'ont été vaines, sans conséquences historiques. Les luttes des ouvriers de 1848 ont montré la nécessité de l'autonomie du prolétariat; les luttes de la Commune de 1871, la nécessité de détruire de fond en comble l'Etat bourgeois. Quant à la révolution russe et la vague révolutionnaire des années 1917-23, qui se sont déroulées dans des conditions historiques mûres mais défavorables (la guerre), elles sont une source inépuisable d'enseignements pour le prolétariat. La reprise de la lutte ouvrière au coeur du capitalisme dans la fin de la contre-révolution a déjà commencé à confirmer quelle sera la dynamique révolutionnaire de notre époque dans des conditions de crise économique généralisée.
ANNEXE 1 : SURPRODUCTION ET CRISE AGRICOLE
La crise agricole est une question que nous avons rarement traitée; pourtant aujourd'hui le développement de la crise générale du capitalisme implique aussi un développement de la crise agricole qui ne pourra pas ne pas avoir de conséquences importantes sur la condition de vie ouvrière. De plus, au travers de la crise agricole, on peut voir une illustration frappante des deux aspects de la crise historique du capitalisme, premièrement son caractère généralisé, deuxièmement, sa nature de surproduction.
Sur l'aspect généralisé de la crise agraire, F. Sternberg écrit dans "Le conflit du siècle" :
"La crise de 1929 se caractérise ... de plus par sa nature à la fois industrielle et agraire... C'est là un autre phénomène spécifique de la crise de 1929 qui ne s'était jamais produit au cours des crises du 19ème siècle... La catastrophe de 1929 frappe les USA aussi violemment que l'Europe et l'ensemble des pays coloniaux. De plus, elle n'est pas seulement une crise céréalière, mais ses effets touchent à toute la production agricole... Celle-ci, dans ces conditions, ne peut qu'aggraver encore la crise industrielle", (p. 334-335)
Et sur l'illustration de la nature de la crise générale qu'apporte la crise agricole, on ne saurait être plus clair que l'auteur déjà cité :
"Nulle part en effet, le caractère particulier de la crise capitaliste n'éclate aussi nettement que dans la crise agricole. Sous le règne des formes d'organisation sociale qui précédèrent le capitalisme, les crises avaient été marquées par un déficit de la production et, étant donné le rôle prépondérant tenu alors par la production agricole, par un déficit de la production des denrées alimentaires. (...) Mais pendant la crise de 1929, on produisait trop de denrées alimentaires et les fermiers, menacés par centaines de milliers d'être chassés de leurs fermes ... tandis que les gens des villes ne parvenaient pas, dans bien des cas, à acheter les denrées indispensables", (p.336).
Nous aurions tort de sous-estimer la question de la crise et de la surproduction agricole tant dans nos analyses que dans nos interventions et notre propagande.
Dans nos analyses de la crise, parce que la crise en se développant va devenir une donnée de plus en plus importante dans la condition ouvrière. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à dire durant les années 70, la surproduction agricole a pu être masquée et épongée par les aides, et les subventions des différents Etats qui maintenaient ainsi les prix et donc la production agricole. A l'heure actuelle, cette politique de soutien, tout comme la production industrielle touche à sa fin, et ou du moins, est considérablement réduite. Il suffit de considérer la situation de la surproduction agricole en Europe et tous les remous qu'elle a provoqués ces derniers mois pour s'en convaincre. Cela vaut pour l'Europe mais aussi pour les USA qui sont un des premiers producteurs agricoles du monde, ainsi :
"Les agriculteurs américains s'arrachent les cheveux. 1982 sera, disent-ils, leur pire année depuis la grande dépression... La crise est due essentiellement à la surproduction comme si les progrès techniques dont le Middle West avaient tant profité, commençaient à se retourner contre lui... En 1980, ils assuraient à eux seuls 24,3% des ventes mondiales de riz, 44,9% du blé, 70,1% du mais et 77,8% des arachides. Actuellement, un hectare cultivé sur trois "travaille" pour l'exportation. Les américains sont donc très sensibles au rétrécissement des marchés extérieurs provoqué par les difficultés de l'économie mondiale". (Le Monde).
Du point de vue de notre propagande, une telle situation de surproduction dans le domaine de l'alimentation illustre on ne peut mieux l'anachronisme total de la perpétuation du capitalisme et ce que l'humanité serait capable de réaliser, débarrassée du système marchand et du secteur d'armement, des secteurs improductifs;!'humanité se trouve dans une situation inconnue jusqu'à aujourd'hui où :
"La production actuelle de céréales à elle seule' pourrait fournir à chaque homme, femme et enfant, plus de 3 000 calories et 65 g de protéines par jour, ce qui est bien supérieur aux besoins, même calculés largement. Pour éliminer la malnutrition, il suffirait de réorienter réellement 2% de la production céréalière mondiale vers ceux qui ont besoin".(Banque Mondiale : "Rapport sur le développement dans le monde").
[1] [113] Voir Revue Internationale n°23 et n°27.
[2] [114] Il est intéressant de noter ici le parallèle que fait Keynes lui même entre le militarisme et les mesures de capitalisme d'Etat qu'il préconisait:
"Il est semble-t-il politiquement impossible pour une démocratie capitaliste d'organiser les dépenses à l'échelle nécessaire pour réaliser les expériences grandioses qui confirmeraient ma démonstration - sauf dans des conditions de guerre". (Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie).
[3] [115] Voir Annexe II.
[4] [116] Voir Annexe II, (graphiques sur l'endettement).
[5] [117] Cette réalité vaut autant pour les pays de l'Est que pour ceux de l'Ouest. Mais il est intéressant de noter que la limitation des crédits de la part du bloc occidental qui fait partie de la politique générale dite d'"austérité" ait été présentée comme une mesure de "solidarité" vis-à-vis des "polonais".
Vie du CCI:
- Résolutions de Congrès [118]
Questions théoriques:
- Guerre [72]
- L'économie [119]
Heritage de la Gauche Communiste:
- Capitalisme d'Etat [80]